
Le face à face russo-chinois : le « vide » sibérien face « au trop plein » chinois
par Marc ROUSSET
La Russie coopère avec la Chine dans le cadre de l’Organisation de coopération de Shanghaï (O.C.S.) qui vise à empêcher toute incursion de l’O.T.A.N. (ou des États-Unis seuls) en Asie centrale. Mais parallèlement, Moscou est très préoccupée de la montée en puissance de la Chine avec qui elle partage 4 300 km de frontières communes. La Russie ne peut oublier que les seules invasions du territoire russe qui aient réussi venaient toujours de l’Est. Moscou est donc de facto très ouvert à toute coopération européenne qui lui permet d’accroître l’encadrement international de la puissance chinoise émergente et également de renforcer sa capacité à défendre les richesses et le potentiel économique de la Sibérie, l’enjeu du XXIe siècle entre la Grande Europe de Brest à Vladivostok et la Chine.
J’ai à maintes reprises demandé aux puissances occidentales de ne pas identifier le communisme soviétique à la Russie et l’histoire de la Russie » a pu dire Alexandre Soljenitsyne. La Russie est en fait la sentinelle de l’Europe face à la Chine et à l’Asie centrale. L’Europe doit se considérer comme l’« Hinterland » de la Russie et voir dans la Sibérie le « Far East » de la Grande Europe. L’Europe ne va pas de Washington à Bruxelles, mais de Brest à Vladivostok. En Sibérie, en Asie centrale, l’Européen, c’est le Russe ! Ces thèmes ont été abordés dans mon ouvrage La Nouvelle Europe Paris-Berlin-Moscou. Il est donc intéressant de s’interroger sur ce que certains ont appelé le « péril jaune » pour le monde européen, suite au déséquilibre structurel démographique entre la Chine et la Russie et au « vide sibérien » face au « trop plein » chinois.
La démographie chinoise
La population de la République populaire de Chine s’élevait fin 2010 à 1 341 000 000 d’habitants. Si l’on y rajoute Hong Kong, Macao et Taïwan, la population de la Chine est la plus grande du monde et s’élève à 1 370 000 000 d’habitants, soit plus du cinquième de l’humanité.
La baisse rapide de la mortalité et le retard du contrôle des naissances sous Mao Tsé-Toung, encourageant un temps les Chinois à procréer une armée de « petits soldats » ont contribué à une forte croissance démographique. En 1953, la Chine totalisait seulement 582 000 000 habitants.
Toutefois, selon les dernières projections démographiques de l’O.N.U. (2008), la population chinoise pourrait ne jamais atteindre 1 500 000 d’habitants, plafonnant à 1 460 000 000 en 2035 avant d’amorcer une décroissance. La politique de l’enfant unique pratiquée par la Chine depuis 1979 sur la décision de Deng Xiao-Ping a porté ses fruits : quatre cents millions de naissances auraient été évitées en vingt-cinq ans. Le taux de fécondité a atteint une moyenne de 1,77 enfant par femme entre 2005 et 2010 quand il était de 4,77 entre 1970 et 1975 et déjà de 2,93 enfants par femme en moyenne les cinq années suivantes.
Il faut bien mesurer les limites de la politique de l’enfant unique. Dès sa mise en place, la loi obligeant tous les Chinois mariés à n’avoir qu’un seul enfant a été battue en brèche par deux exceptions de taille : les couples de paysans avaient droit à deux enfants si le premier s’avérait être une fille, et les ethnies non Han n’étaient pas soumises à la loi car menacées puisque minoritaires. D’autre part, seules les zones urbaines et les six provinces relevant du pouvoir central ont été soumises à la loi de l’enfant unique. Cet ensemble constitue 35 % seulement de la population chinoise totale. La totalité de la Chine a donc, en réalité, 1,47 enfant par couple.
En 2002, une loi autorisait un couple à avoir plusieurs enfants moyennant une taxe de six cents euros par enfant supplémentaire. Depuis juillet 2007, le gouvernement central autorise les couples composés de deux enfants uniques à avoir, eux-mêmes, deux enfants. Une ville comme Shanghaï, dont le niveau de vieillissement de la population est l’un des plus élevé du pays, est allée plus loin en 2009. Elle encourage les couples à avoir deux enfants en supprimant notamment les aides sociales allouées jusque là aux couples sans enfants.
Le gouvernement chinois aurait ainsi tendance à assouplir la politique de l’enfant unique. La Chine est tiraillée entre deux maux, surpopulation et déséquilibre entre les sexes, vieillissement de la population provoqué par un faible taux de la natalité. Les plus de 65 ans étaient cent millions en 2008; ils seront trois cent quarante millions en 2050, soit près de 25 % de la population. La réalité compliquée de la question démographique chinoise ne préjuge pas de ce que décidera finalement le gouvernement chinois. Un fait structurel et objectif demeure : il y aura toujours plus d’un milliard de Chinois au Sud de la Sibérie. Le déséquilibre structurel démographique de l’ordre de 1 à 10 avec la Russie est d’autant plus préoccupant que, comme le disait Aristote, « la nature a horreur du vide ».
Évolution et perspectives de la démographie russe
Le début du déclin démographique russe coïncide avec l’arrivée de Gorbatchev au pouvoir (1985 – 1991), c’est-à-dire avec la mise en place de la Perestroïka suivie de l’effondrement du système soviétique. En 1990, la Russie comprenait cent quarante-neuf millions d’habitants, cent quarante-cinq millions d’habitants en 2001 et cent quarante-deux millions en 2007, soit sept millions d’habitants en moins de vingt ans, un rythme de croisière de disparition du peuple russe de 400 000 citoyens de moins chaque année. En fait, le rythme de disparition était d’environ 800 000 habitants par an car, depuis la fin de l’U.R.S.S., 400 000 Russes ont quitté chaque année les ex-républiques soviétiques pour la mère patrie.
Au début des années 2000, selon Boris Revitch du Centre de démographie russe, l’espérance de vie était de 59 ans pour un homme à la naissance, soit vingt ans de moins qu’en Europe occidentale, pour plusieurs raisons : l’alcoolisme (34 500 morts par an), le tabagisme (500 000 morts par an), les maladies cardio-vasculaires (1 300 000 de morts par an), le cancer (300 000 morts par an), le S.I.D.A., les accidents de la route (39 000 morts par an), les meurtres (36 000 morts par an), les suicides (46 000 décès par an), la déficience du système de santé qui faisait la fierté de l’U.R.S.S. et qui était devenue une catastrophe sanitaire avec, par exemple, une mortalité infantile (11 pour 1000), deux fois plus élevée que dans l’U.E.
Tandis que de plus en plus de Russes mouraient, de moins en moins naissaient. À la fin des années 1990, il y avait au minimum trois millions d’I.V.G. par an en Russie, pour un million de naissances, avec un taux de fécondité tombé au plus bas en 1999 à 1,16 enfants par femme. L’habitat trop exigu dans les grands immeubles du système soviétique contribuait à la nouvelle habitude de l’enfant unique.
Dans son discours au Conseil de la Fédération en mai 2006, le président Poutine a confirmé la mise en place d’une politique nataliste par son bras droit Dimitri Medvedev, en aidant les jeunes couples à faire un second, voire un troisième enfant. Une batterie de mesures a été prise pour aider à la natalité. Les plus importantes sont des primes financières de l’État, des avantages fiscaux, mais aussi des aides au crédit et au logement. Les résultats du plan Medvedev couplés avec une politique migratoire de Russes de l’ex-U.R.S.S. et de nombreux Ukrainiens ont été fulgurants. La population a décru de 760 000 habitants en 2005, 520 000 habitants en 2006, 238 000 en 2007, 116 000 en 2008. En 2009 avec 1 760 000 naissances, 1 950 000 décès, 100 000 émigrants et 330 000 naturalisations, la population russe a augmenté pour la première fois depuis quinze ans de quelque 50 000 habitants. Le taux de fécondité de 1,9 enfant par femme en 1990, tombé à 1,1 enfant par femme en 2000 était remonté à 1,56 enfants par femme en 2009, soit un taux similaire à celui de l’Union européenne de 1,57 enfants par femme. Bien que le nombre d’avortements ait diminué, on recensait encore en 2008 1 234 000 avortements pour 1 714 000 naissances.
D’ici à 2050, la démographie russe va donc être soumise à deux forces contradictoires : d’une part, la politique nataliste gouvernementale, l’opinion publique hostile à l’immigration non russe, la construction en plein essor, les améliorations en matière d’éducation, d’agriculture et de santé (les quatre « projets nationaux »), le retour aux valeurs traditionnelles, à la religion orthodoxe et d’autre part l’effet d’hystérésis, suite à la chute de l’U.R.S.S., qui correspond à un rétrécissement structurel de la strate de population en âge de procréer (1), les influences néfastes de l’Occident et de sa « culture de mort » (libéralisation de la contraception, de l’avortement, de l’homosexualité, féminisme et travail des femmes, regroupement des populations dans les métropoles, destruction des petits agriculteurs, allocations familiales attribuées de plus en plus aux populations immigrées)
Trois prévisions démographiques majeures ont été envisagées pour l’année 2030 en 2010 par le Ministère russe de la Santé.
Selon une prévision estimée mauvaise, la population devrait continuer à baisser pour atteindre 139 630 000 en 2016 et 128 000 000 d’habitants en 2030. Le taux d’immigration resterait « faible » autour de 200 000 par an pour les vingt prochaines années.
Selon une prévision estimée moyenne, la population devrait atteindre 139 372 000 habitants en 2030. Le taux d’immigration serait contenu à 350 000 nouveaux entrants par an.
Selon une prévision haute, la population devrait augmenter à près de 144 000 000 habitants en 2016 et continuer à augmenter jusqu’à 148 000 000 en 2030. Le taux d’immigration serait plus élevé dans cette variante, soutenant la hausse de la population et avoisinerait les 475 000 nouveaux entrants par an. Sur vingt ans, on arriverait à une « immigration » équivalente à 8 % de la population du pays. Celle-ci serait principalement du Caucase et de la C.E.I., soit des populations post-soviétiques, russophones dont des communautés sont déjà présentes en Russie, et donc pas foncièrement déstabilisantes.
Pour l’année 2050, il nous paraît bien difficile pour ne pas dire impossible de se prononcer. Il semble donc plus raisonnable de retenir pour l’année 2050 dans les prévisions 2006 de l’O.N.U. (2), le point haut de 130 millions d’habitants, la prévision de l’O.N.U. étant de 107 800 000 habitants avec un point bas de 88 000 000 habitants.
L’enjeu de la Sibérie
Sibérie tient son nom de la petite ville de Sibir. L’étymologie du mot est incertaine, mais le terme pourrait provenir du turco-mongol sibir désignant un peuplement très dispersé. La Sibérie est la partie asiatique de la Fédération de Russie : une immense région d’une surface de 13 100 000 km2 (environ vingt-quatre fois la surface de la France) très peu peuplée (39 000 000 habitants soit environ 3 habitants au km2). Cette partie Nord de l’Asie représente 77 % de la surface de la Russie, elle-même deux fois plus grande que les États-Unis, mais seulement 27 % de sa population.
La Sibérie a les plus grandes forêts de la planète. L’intérêt économique majeur réside dans les richesses de son sous-sol, de pétrole et de gaz qui pourraient aller jusqu’au pôle Nord où la Russie a planté son drapeau par plus de 4 000 m de fond en juillet 2007. La Sibérie fournit de l’hydro-électricité et du charbon avec de riches bassins tels que celui du Kouzbass. Grâce à la Sibérie, avec cinq cents années de réserve, la Russie est le deuxième producteur mondial de charbon derrière les États-Unis. La Sibérie possède des gisements d’argent, d’or, d’uranium, de cuivre, de titane, de plomb, de zinc, d’étain, de manganèse, de bauxite, molybdène, de nickel… Un diamant sur quatre extrait dans le monde provient de Sibérie. Le réchauffement climatique ouvre la perspective d’exploitation d’autres immenses ressources en hydrocarbures. Moscou va être un acteur de premier plan dans la pièce qui va se jouer pour les ressources naturelles, la science et le transit maritime du XXIe siècle dans le Grand Nord.
La Sibérie d’aujourd’hui : un avant-poste des Européens face à la Chine
La Moscovie s’est construite contre les vagues déferlantes tartares et s’est toujours représentée comme une forteresse érigée au cœur d’un océan de plaines immenses et sans bornes. Les Russes ont colonisé la Sibérie, le Caucase et l’Asie centrale parce qu’ils étaient obligés de le faire. La Russie a connu pendant deux siècles le joug tartaro-mongol. La colonisation russe correspondait à des impératifs vitaux pour sa survie, à l’obligation géopolitique de trouver des frontières naturelles dont elle était dépourvue et qui était indispensable à sa protection. L’expansionnisme russe, contrairement à celui de l’Europe occidentale, était défensif et structurel.
Si les savants ont déclaré solennellement le paisible Oural au paysage ondulé, dont la pente ne devient raide que dans le nord, loin de la toundra, comme une ligne de démarcation entre l’Asie et l’Europe, les autochtones, eux, le considèrent comme une ligne de partage des eaux couverte de forêt, et rien de plus.
Les Russes se souviennent de Yermak comme d’un aventurier cosaque aussi remarquable que Magellan, d’un conquistador aussi intrépide que Cortez, car ce fut Yermak qui conduisit la première mission réussie dans la mystérieuse Sibérie, et qui inspira aux Russes l’idée de repousser leurs frontières de 6 200 km plus à l’Est, jusqu’à la côte asiatique du Pacifique. Trois fois dans l’histoire, la Sibérie fut traversée par des conquérants : par les hordes de cavaliers d’Attila et de Gengis Khan puis, en sens inverse, par le millier d’hommes de Yermak. C’est en 1558 qu’Ivan IV le Terrible accorde des privilèges d’exploitation des territoires situés à l’Est de l’Oural aux Stroganov, équivalents des Fugger, à la recherche de fourrures. Un mouvement est lancé qui conduira les cosaques sur les rives du Pacifique en 1639 (et même plus tard en Alaska). Tandis que Français et Allemands se disputaient quelques lambeaux de territoire en Italie et aux Pays-Bas, une poignée de cavaliers navigateurs explorateurs parcourait une étendue vaste comme vingt fois la France ou l’Allemagne, plusieurs centaines de fois l’Alsace, la Flandre ou le Milanais. À la fin du XVIIIe siècle, la Russie a conquis la Sibérie. Ce territoire reste aujourd’hui vide même si l’une des principales retombées du Transsibérien fut l’augmentation substantielle de la migration vers l’Est de l’Empire russe. 3 800 000 personnes émigrèrent vers la Sibérie entre 1861 et 1914 et contribuèrent à la russification des populations indigènes de Sibérie. Sans le Transsibérien, ces populations auraient émigré vers l’Amérique. La Sibérie ne comptait que 1 500 000 habitants en 1815, dix millions en 1914 et vingt-trois millions en 1960.
La nécessité de l’espace : une vérité qui n’est plus reconnue
Que depuis toujours la politique soit une lutte pour l’espace, pour acquérir une base, une place, que l’espace constitue l’alpha et l’oméga de toute vie, que la politique, la science, le commerce ne sont rien d’autre que l’acquisition de cet espace, voilà une vérité qui n’est plus reconnue.
Un avantage évident revient à qui, outre sa technicité, dispose aussi des matières premières nécessaires. Qui n’a que sa technique à offrir et doit importer les matières premières est désavantagé. C’est l’indépendance à long terme que de pouvoir se nourrir des produits de sa terre, que d’exploiter ses propres matières premières indispensables à la vie et à la protection, que de pouvoir se défendre avec des armes conçues et fabriquées chez soi. La certitude de pareils avantages, c’est un espace suffisamment grand qui la confère, si l’on s’en tient à l’exemple américain. A contrario, le Japon redeviendra à terme le vassal de la Chine simplement en raison du manque d’espace et donc de sa plus faible population par rapport à son futur suzerain.
L’espace contient tout ce dont nous avons besoin, même l’air que nous respirons et l’eau qui nous désaltère. Il constitue donc le bien suprême. Plus d’espace, c’est plus d’oxygène, plus de pain, plus de rivières et de forêts, plus de terrain pour bâtir sa maison, plus de terre pour les jardins, plus de possibilités de repos, plus de distance d’homme à homme, une sphère privée élargie pour chacun, plus d’occasions de fuir les bruits et l’intoxication des villes, plus de calme pour penser, élaborer des projets, travailler, rêver, réfléchir. C’est accroître tout ce qui rend la vie digne d’être vécue et qui, hélas, se fait de plus en plus rare. Renoncer à l’espace, c’est renoncer à la vie.
L’Eurasie, du Pacifique à la Baltique, peut contenir plus d’hommes que le territoire de l’Europe occidentale. Un droit à l’occupation doit donc être reconnu aux peuples européens sur l’espace allant du Sud du Portugal au détroit de Behring, en incluant le Nord-Caucase et la totalité de l’espace sibérien. Sur cet espace, cinq cents millions d’Européens et cent cinquante millions de Russes devraient pouvoir prolonger jusqu’à Vladivostok les frontières humaines et culturelles de l’Europe. Le grand défi de la Sibérie est son trop faible peuplement par trente-neuf millions de Russes avec le risque d’une colonisation rampante par la Chine. La Sibérie restera-t-elle russe et donc sous le contrôle civilisationnel européen ou deviendra-t-elle chinoise et asiatique ?
Les traités inégaux et l’actuelle frontière entre la Chine et la Russie
En 1689, suite à cinquante ans de confrontations armées inégales numériquement entre les cosaques et les Mandchous, les empires chinois et russe signent le traité de Nertchinsk : la Russie renonce à l’intégralité du bassin de l’Amour. L’empire Qing n’avait jamais occupé ces terres du nord, mais il ne souhaitait pas voir les Russes s’y installer. À partir du XVIIIe siècle, la Russie cherche cependant à devenir une puissance navale dans l’océan Pacifique; elle encouragea les Russes à venir s’y établir et développe une présence militaire dans la région. La Chine n’avait jamais gouverné réellement la région et les avancées russes passèrent inaperçues. Les habitants de ces territoires n’étaient pour la plupart pas des Hans, mais des Mandchous, des Tibétains ou des Turcs. Au milieu du XIXe siècle, le bassin de l’Amour restait ainsi une terre sauvage où sur un million de km2 ne vivaient pas plus de trente mille personnes.
Mais dans les années 1850, la donne géopolitique a changé, l’Empire chinois est affaibli. En 1842, la Chine, suite à la Guerre de l’Opium, avait cédé Hong Kong par le traité de Nankin. Une nouvelle expédition russe a lieu pour explorer la région du fleuve Amour. En 1858, la Chine doit signer le traité d’Aïgoun, considéré comme un des nombreux traités inégaux avec les puissances occidentales. La Russie prend le contrôle de la rive gauche de l’Amour, de l’Argoun à la mer. « La Russie a réussi à arracher à la Chine un territoire grand comme la France et l’Allemagne réunis et un fleuve long comme le Danube », commentait Engels dans un article. Deux ans plus tard, en même temps que le sac du Palais d’Été par la coalition franco-anglaise, la Russie confirme et amplifie ses gains par la convention de Pékin. Elle obtient la cession de la région de Vladivostok et Khabarovsk sur les rives droites de l’Amour et de l’Oussouri. Vladivostok qui était un village chinois du nom de Haichengwei « Baie des concombres de la mer » est fondée officiellement en 1860 et signifie « Seigneur de l’Orient ».
La Russie cherche plus tard à contrôler la Mandchourie pour protéger la Sibérie et élargir son ouverture sur l’océan Pacifique. Elle obtient la cession de Port-Arthur (Lüshunkou en chinois). La défaite face au Japon en 1905 ruine cette politique. La Russie renonce à la Mandchourie et doit céder Port-Arthur. Ce dernier retrouvera temporairement la souveraineté soviétique entre 1945 et 1955.
Dans les années 1960, les relations entre la Chine et l’U.R.S.S. se dégradent fortement et MaoTsé-Toung remet en cause les traités signés au XIXe siècle entre les empires russe et mandchou. À partir de 1963, les incidents frontaliers se multiplient. Dès 1964, le président Mao, dans un discours aux parlementaires japonais, fait allusion aux territoires perdus. Ces tensions aboutissent en 1969 à un affrontement armé pour le contrôle de l’île Damanski sur la rivière Oussouri qui fait des centaines de morts, en majorité chinois, mais n’aboutit pas à un nouveau tracé. L’U.R.S.S. envisage même de détruire préventivement les installations nucléaires chinoises. Dans les années qui suivent, la situation reste très tendue et n’évolue guère jusqu’aux années 1980.
À partir de 1988, à l’instigation de Mikhaïl Gorbatchev, les relations entre l’U.R.S.S. et la Chine se détendent et les négociations reprennent. Le 16 mai 1991, la Russie et la Chine signent un traité sur les frontières, qui laisse toutefois en suspens le sort de certains petits territoires disputés. Ces derniers points sont réglés par différents accords signés dans un contexte diplomatique nettement plus détendu. Le dernier traité est signé en 2004. À l’issue de ces règlements, la Chine a réalisé quelques gains territoriaux très mineurs par rapport aux traités antérieurs.
Le résultat final, c’est qu’aujourd’hui la frontière sino-russe est constituée de deux morceaux de longueurs très inégales situés de part et d’autre de la Mongolie. Elle est définie dans son intégralité depuis 2004. Le tronçon de l’Ouest ne mesure que 50 km. Le tronçon de l’Est mesure 4 195 km. C’est la sixième plus longue frontière internationale du monde. L’intégration des territoires frontaliers par les deux empires russe et chinois a été tout à fait différente. Les plaines du Nord-Est de la Chine ont été rapidement peuplées et mises en valeur par des colons chinois dès le début du XIXe siècle. Par contre, le peuplement de l’Extrême-Orient russe par des colons venus de Russie d’Europe a été moins important et beaucoup plus long (3). La différence entre les deux peuplements a donné naissance à une ligne de discontinuité de part et d’autre du fleuve Amour et de la rivière Oussouri : d’un côté, sept millions de Russes, de l’autre, plus de soixante millions de Chinois vivant dans les provinces frontalières du Jilin et du Heilongjiang. Les manuels d’histoire chinois apprennent aux écoliers que l’Extrême- Orient russe a été pris par la force à La Chine qui a signé les traités sous la menace.
Le danger chinois démographique et économique à court terme en Extrême-Orient et en Sibérie russe
En Russie, l’opinion publique est hostile à l’immigration. Contrairement aux affabulations de l’Occident, même si le « péril jaune » est très réel à terme, plus particulièrement en Sibérie et en Extrême-Orient, il y a à ce jour en Russie, un maximum de 400 000 Chinois, selon Zhanna Zayonchkouskaya, chef de Laboratoire de migration des populations de l’Institut national de prévision économique de l’Académie des Sciences de Russie, et non pas plusieurs millions comme cela a pu être annoncé. Les Russes ont veillé au grain et ont pris des mesures très sévères pour éviter une possible invasion. La seule immigration qui a été favorisée est le rapatriement de Russes établis dans les anciennes républiques soviétiques (Kirghizistan, Kazakhstan, Pays baltes, Turkménistan. ). Des villes comme Vladivostok, Irkoutsk, Khabarovsk, Irkoutsk Krasnoïarsk… et même Blagovetchensk, à la frontière chinoise, sont des villes européennes avec seulement quelques commerçants ou immigrés chinois en nombre très limité. Une invasion aurait pu avoir lieu en Extrême-Orient dans les années 1990, tant la situation s’était dégradée. Il est à remarquer que les migrants chinois de l’époque ont profité du laxisme et de l’anarchie ambiante pour filer à l’Ouest de la Russie. Être clandestin n’est pas aisé aujourd’hui en Extrême-Orient et en Sibérie : la frontière est relativement imperméable; le risque est grand; les hôtels sont sous contrôle étroit; le chaos qui suivit l’éclatement de l’U.R.S.S. est déjà loin.
Il n’en reste pas moins vrai qu’un climat d’hostilité, voire de peur, s’est développé envers les Chinois chez les Russes d’Extrême-Orient qui a été largement utilisé dans le débat russe sur les orientations de politique étrangère (3). En 2001, le XVe congrès du Parti communiste chinois avait décidé d’une stratégie de consolidation de la présence chinoise à l’étranger, en encourageant la population à émigrer. Pékin avait fait savoir à Moscou qu’il n’appuierait sa candidature à l’O.M.C. que contre la promesse de ne pas réglementer l’entrée de la main-d’œuvre chinoise sur le marché du travail russe. Le ministre russe de la Défense, Pavel Grachev, avait pu déclarer : « Les Chinois sont en train de conquérir pacifiquement les confins orientaux de la Russie ». Et, selon un haut responsable russe des questions d’immigration, « nous devons résister à l’expansionnisme chinois ». Le problème est d’autant plus grave, au-delà du taux de la natalité, que la région se vide et que de nombreux Russes repartent en Russie de l’Ouest. Ces dernières années, la région de Magadan a été délaissée par 57 % de sa population, la péninsule du Kamtchaka par 20 % et l’île Sakhaline par 18 %. La densité moyenne en Extrême-Orient est de 1,2 habitant au kilomètre carré contre une moyenne nationale de 8,5. Bref, selon les prévisions les plus pessimistes, l’Extrême-Orient russe peuplé de 6 460 000 personnes au 1er janvier 2010 pourrait ne compter que 4 500 000 habitants en 2015, contre 7 580 000 au plus haut.
Sur le plan économique, en 2002, selon l’analyste Andreï PIontkovsky, 10 % seulement des échanges de l’Extrême-Orient russe se faisaient avec les autres régions de Russie. 90 % des achats extra-provinciaux venaient de Chine, Corée du sud ou Japon à cause du coût prohibitif du fret aérien ou ferroviaire avec l’Ouest de la Russie. À Vladivostok, Khabarovsk, et à Irkoutsk en Sibérie, la plupart des voitures avaient le volant à droite parce qu’elles venaient directement du Japon où l’on conduit à gauche. Des mesures ont été prises tout récemment par les autorités, non sans difficultés, pour favoriser l’achat de voitures russes et abaisser le coût du fret.
La structure des échanges commerciaux bilatéraux avec la Chine s’est renversée depuis la fin de la guerre froide. La Russie devient le « junior partner » de la Chine. Dans les exportations russes vers la Chine, les matières premières dominent : produits minéraux (56,4 %) en 2008, principalement pétrole et dérivés; bois et dérivés (15,5 %); produits de la chimie (13,9 %); métaux et dérivés (5,3 %); seulement 4,4 % pour les machines, l’équipement et les moyens de transport. Les exportations chinoises vers la Russie sont, pour l’essentiel, constituées de ces derniers articles(53,9 %), ainsi que de métaux(8,4 %), de produits chimiques (6,8 %) et de textiles (15,1 %). Les autorités russes ne se satisfont visiblement pas de cet état de fait. Le Kremlin n’accepte pas que la Russie devienne un réservoir de matières premières pour la Chine et insiste constamment sur la nécessité de corriger la structure des exportations russes.
La Russie s’efforce aussi d’orienter les investissements chinois de façon à endiguer la désindustrialisation de l’Extrême-Orient russe. Plus globalement, le Kremlin est convaincu que fermer l’Extrême-Orient et la Sibérie à la Chine et à d’autres partenaires étrangers (Corée, Japon, pays d’Asie du Sud-Est ) reviendrait à les condamner à terme, voire à les perdre en les rendant plus vulnérables aux appétits territoriaux d’autres pays de la région, la Chine en premier lieu. En revanche, mettre en concurrence plusieurs pays étrangers dans cette région permet d’espérer qu’aucun d’entre eux « ne parviendra à atteindre l’hégémonie »; de plus, si les relations avec la Chine devaient se détériorer, la Russie aurait acquis la possibilité de défendre plus efficacement ses zones frontalières puisqu’elle les aura mieux développées. Moscou, on le voit, n’écarte pas complètement la perspective d’une réouverture des problèmes territoriaux avec la Chine, malgré le règlement du litige frontalier en 2008 et l’engagement des deux pays, dans leur traité d’amitié et de bon voisinage, à s’abstenir de toute revendication territoriale mutuelle.
Ce souci russe en Asie orientale apparaît encore plus nettement en Asie centrale. Dans cette région, Moscou ne se sent plus aussi sûr que par le passé de la force de ses moyens d’influence (minorités russes, liens historiques et économiques…). La Chine a considérablement étoffé sa présence économique dans cette zone depuis le début des années 2000 et semble en passe de supplanter la Russie comme premier partenaire commercial des États centre-asiatiques. Face à la force de frappe financière et économique de la Chine, la Russie va-t-elle longtemps pouvoir faire le poids ? Au sein de l’O.C.S., à l’heure de la crise économique globale, c’est Pékin qui a occupé le terrain en consentant aux membres de l’Organisation des prêts d’un montant de dix milliards de dollars. La situation est encore plus grave, aux yeux de Moscou, dans le domaine énergétique : la politique de Pékin va directement à l’encontre de la stratégie du Kremlin, déterminé à contrôler le plus possible les hydrocarbures de la zone Caspienne/Asie centrale afin de conforter ses positions face aux clients européens. Le lancement, fin 2009, du gazoduc Turkménistan – Ouzbékistan – Kazakhstan – Chine qui s’ajoute à l’oléoduc kazakho-chinois ne réjouit pas plus la Russie que les tubes Caspienne – Turquie contournant son territoire promus dans les années 1990 par les États-Unis. Au point que certains experts russes estiment que Moscou pourrait être tenté de fomenter des troubles dans le Turkestan oriental pour faire dérailler les accords énergétiques Chine – Asie centrale.
Les visées chinoises inéluctables à moyen terme sur la Mongolie extérieure et à très long terme sur la Sibérie
Le temps n’est plus où la Russie débordait de forces vives, jusqu’à pouvoir sacrifier vingt millions d’hommes dans la lutte contre le nazisme. On comprend mieux pourquoi les responsables russes continuent de refuser pour le moment de vendre certains matériels de portée stratégique tels que les chasseurs bombardiers de type TU 22 ou TU 95, ou encore des sous-marins de quatrième génération de la classe « Amour » ou « Koursk ». Selon le chancelier Bismarck, « l’important, ce n’est pas l’intention, mais le potentiel » et comme chacun sait, l’histoire n’est pas irréaliste (Irrealpolitik) et droit-de-l’hommiste, mais réaliste (Realpolitik) et imprévisible.
La montée en puissance de la Chine ne se traduira pas seulement par le remplacement progressif de l’anglo-américain par le mandarin en Asie, mais aussi par des visées territoriales.
L’expansionnisme nationaliste chinois se traduit d’une façon forte et brutale pour mater dans l’œuf et empêcher toute velléité de résistance, aussi bien au Tibet qu’au Xinjiang. Le chemin de fer à 6 200 000 dollars qui relie Pékin à Lhassa renforce l’emprise de la Chine sur le Tibet et sa capacité de déploiement militaire rapide contre l’Inde. Il est probable qu’après avoir maintenant récupéré Hong Kong et Macao de façon pacifique et selon les traités, la Chine a déjà et aura comme première préoccupation de rétablir sa souveraineté sur l’île de Taïwan. Avec ses 1 400 missiles pointés vers « l’île rebelle », Pékin a menacé d’écraser sous le feu ses « frères » taïwanais, s’ils devaient proclamer leur indépendance. Dans les faits, la réunification avec Taïwan est bel et bien en marche. Le mandarin est la langue officielle à Taïwan. Les vols aériens et les communications ont été progressivement rétablis avec le continent. La symbiose est de plus en plus étroite entre les deux économies
Une fois Taïwan sous sa coupe, la Chine cherchera tout naturellement à récupérer la Mongolie extérieure cédée par la Chine à la Russie en 1912 et devenue ensuite une république populaire, puis un État indépendant lors du démantèlement de l’U.R.S.S. « La Chine va d’abord s’occuper de Taïwan, puis ce sera notre tour » a pu dire B. Boldsaikhan, chef politique en Mongolie extérieure du mouvement Dayar Mongol. État de 1 535 000 km2, sous-peuplée avec seulement 2 800 000 habitants, dotée de très riches gisements aurifères et d’uranium, la Mongolie extérieure, pendant de la Mongolie intérieure autonome chinoise, est déjà contrôlée économiquement par les Chinois, quelque 100 000 Russes ayant fait très rapidement leurs valises en 1990. La Mongolie extérieure sera un jour inéluctablement envahie comme le Tibet et, au-delà de quelques protestations américaines, la Chine rétablira en fait une souveraineté légitime historique sur l’ensemble de la Mongolie qui date de la soumission de la Mongolie aux Mandchous en 1635. Gengis Khan est considéré en Chine comme un héros de la nation chinoise; un mausolée lui a été construit à Ejin Horo, dans la province chinoise de Mongolie intérieure, pour le huit centième anniversaire de sa naissance.
Puis ce sera le tour de l’Extrême-Orient russe. Selon Andreï Piontkovsky, directeur du Centre d’études stratégiques de Moscou, c’est la Chine de l’Orient et non pas l’Occident qui représente la menace stratégique la plus sérieuse pour la Russie. Ces revendications s’inscrivent dans le droit fil du concept stratégique « d’espace vital » d’une grande puissance qui, selon les théoriciens chinois, s’étend bien au-delà de ses frontières.
La Russie et la Chine occupent ensemble un espace géographiquement continu entre la mer Baltique et la Mer de Chine de 26 600 000 km2, habités par 1 400 000 000 personnes. Des similitudes apparaissent lors de l’analyse de l’histoire de ces deux grands et complexes blocs géopolitiques. Tous deux s’étaient constitués au détriment de l’empire nomade des Mongols, dont la Mongolie enclavée entre la Chine et la Russie, constitue le dernier vestige, avec la Mongolie intérieure, rattachée à la Chine, et la Bouriatie faisant partie de la Russie. Tous deux possèdent une zone périphérique, peu peuplée et sous-exploitée (la Sibérie et l’Extrême-Orient pour la Russie, le Tibet et le Xinjiang pour la Chine). Cependant, la Chine est plus peuplée que la Russie. Son poids démographique constitue en même temps un atout (le marché le plus grand de la planète) et un handicap majeur (le pays est surpeuplé et proche de la saturation). Certains spécialistes estiment que le seuil de l’auto-suffisance chinoise se trouve à 1 500 000 000 habitants. En Sibérie et en Extrême-Orient, il y a tout ce qui manque à la Chine : les hydrocarbures, les matières premières et l’espace pour développer l’agriculture. Un paradoxe se dessine, car la Russie est un géant géographique et la Chine manque d’espace. Ces deux ensembles géopolitiques sont donc condamnés soit à collaborer, soit à s’affronter. On se rappellera que le projet communiste a réuni ces deux géants géopolitiques pendant onze ans. La perspective d’un tel rapprochement était devenue le pire des cauchemars pour les responsables occidentaux et américains.
Le retour de la Russie sur le Pacifique était logique et inévitable. Cependant, avec un déclin démographique, la Russie est-elle capable de mettre seule en valeur la Sibérie ? Il n’est pas suffisant d’avoir une volonté politique, il faut également disposer de moyens. C’est pourquoi l’affrontement paraît à long terme inéluctable. Il est clair que l’O.C.S. n’est qu’une parenthèse tactique pour les deux futurs adversaires afin de mieux pouvoir contrer l’Amérique en Asie centrale. La puissance balistique de la Russie avec ses 2 200 têtes nucléaires est dans un horizon prévisible la seule garantie de non invasion de la Sibérie par la Chine.
Une leçon à méditer…
Selon Hélène Carrère d’Encausse, la Sibérie est « un espace vide aux abords d’une Chine surpeuplée » (4). Si l’Europe se considère à terme comme l’Hinterland de la Russie et ne se laisse pas envahir par l’immigration extra-européenne en préservant sa civilisation, elle peut constituer avec la Russie la Grande Europe qui serait une forteresse inexpugnable face à la Chine, l’Islam et l’Asie centrale. Dans ce cas, la Sibérie pourrait rester sous contrôle civilisationnel russe et donc européen.
Le schéma alternatif, c’est que les cent quarante millions descendants des Scythes soient envahis par un milliard et demi de Chinois qui brûlent de passer l’Amour tandis que l’Europe, déversoir naturel de l’Afrique, comme l’a d’ailleurs explicité le Libyen Kadhafi, est tout aussi menacée !
Pour ceux qui trouveront ces propos bien pessimistes, je souhaiterais leur rappeler cette magnifique exposition du musée Guimet : « Kazakhstan : Hommes, bêtes et dieux de la steppe ». Il fut un temps, dès le deuxième millénaire avant notre ère, où le Kazakhstan et l’Ouzbékistan étaient le domaine non des Asiates, mais des Aryens : les Scythes. D’origine et de langue indo-européennes, décrits par Aristote citant Hérodote comme ayant des « cheveux blonds et blanchâtres », les Scythes nomadisaient de l’Ukraine à l’Altaï. Leur civilisation était très riche et d’une rare finesse (art funéraire, maîtrise des métaux précieux, travail des objets utilitaires…). Comment une civilisation aussi brillante dont les chefs entreprenants et guerriers ne craignaient rien tant que mourir dans leur lit, ont-ils disparu ? Sans doute ont-ils été victimes de ce que les Slaves appellent « la peste blanche », la dénatalité. Et son inéluctable corollaire, la submersion par des ethnies à la natalité galopante et l’inévitable métissage. Dans leur match démographique contre la déferlante asiatique, les Scythes ne pesèrent pas lourd. Les hordes tartares les avalèrent et le génie de la race se tarit.
Une leçon à méditer pour les Européens de l’Ouest face à l’Afrique et pour les Russes en Sibérie face au trop plein chinois.
Marc Rousset
Notes
1 : Hélène Carrère d’Encausse, La Russie entre deux mondes, Fayard, 2009, p. 65.
2 : cf. le rapport de l’O.N.U., World Population Prospects : the 2006 revision.
3 : Sébastien Colin, « Le développement des relations frontalières entre la Chine et la Russie », dans les Études du C.E.R.I., n° 96, juillet 2003.
4 : Hélène Carrère d’Encausse, op. cit., p. 172.
Article printed from Europe Maxima: http://www.europemaxima.com
URL to article: http://www.europemaxima.com/?p=1982




 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg




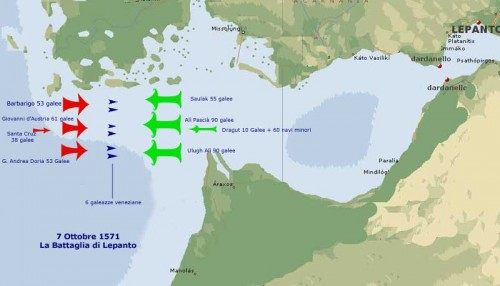

 China hat die Vereinigten Staaten offiziell wissen lassen, dass ein von Washington geplanter Angriff auf Pakistan als Akt der Aggression gegen Peking ausgelegt werden wird. Diese unverblümte Warnung ist das erste seit 50 Jahren – den sowjetischen Warnungen während der Berlin-Krise von 1958 bis 1961 – bekannt gewordene strategische Ultimatum, das den Vereinigten Staaten gestellt wird. Es ist ein Anzeichen dafür, dass sich die Konfrontation zwischen den USA und Pakistan zu einem allgemeinen Krieg auszuweiten droht.
China hat die Vereinigten Staaten offiziell wissen lassen, dass ein von Washington geplanter Angriff auf Pakistan als Akt der Aggression gegen Peking ausgelegt werden wird. Diese unverblümte Warnung ist das erste seit 50 Jahren – den sowjetischen Warnungen während der Berlin-Krise von 1958 bis 1961 – bekannt gewordene strategische Ultimatum, das den Vereinigten Staaten gestellt wird. Es ist ein Anzeichen dafür, dass sich die Konfrontation zwischen den USA und Pakistan zu einem allgemeinen Krieg auszuweiten droht. Ce n'est pas parce que l'on se tient, comme nous le faisons nous autres, totalement aux côtés des peuples palestinien et irakien actuellement menacés de génocide par la "conspiration mondialiste" des Etats-Unis et de ce que se tient derrière celle-ci, que l'on ne doit pas moins totalement être, en même temps, contre les grands desseins subversifs de l'Islam fondamentaliste en action. Et on ne peut quand même pas nier le fait que, de tous les chefs d'Etat européens actuellement en fonction, Silvio Berlusconi soit le seul qui, au nom de l'Italie, ait dit de l'Islam fondamentaliste tout ce qu'il fallait dire, ni qu'en chaque occasion il ait ouvertement pris le parti de rappeler et de soutenir la nécessité incontournable de l'intégration de la nouvelle Russie de Vladimir Poutine à part entière —politique, militaire, économique et culturelle— dans l'Union Européenne.
Ce n'est pas parce que l'on se tient, comme nous le faisons nous autres, totalement aux côtés des peuples palestinien et irakien actuellement menacés de génocide par la "conspiration mondialiste" des Etats-Unis et de ce que se tient derrière celle-ci, que l'on ne doit pas moins totalement être, en même temps, contre les grands desseins subversifs de l'Islam fondamentaliste en action. Et on ne peut quand même pas nier le fait que, de tous les chefs d'Etat européens actuellement en fonction, Silvio Berlusconi soit le seul qui, au nom de l'Italie, ait dit de l'Islam fondamentaliste tout ce qu'il fallait dire, ni qu'en chaque occasion il ait ouvertement pris le parti de rappeler et de soutenir la nécessité incontournable de l'intégration de la nouvelle Russie de Vladimir Poutine à part entière —politique, militaire, économique et culturelle— dans l'Union Européenne. 




 To paraphrase Harold Macmillan, a “wind of change” is blowing through Africa. But, unlike 1960, when the former British Prime Minister made his famous remark, the wind today is not that of a growing national consciousness in the mud huts and shanty-towns, but instead the stiff breeze of a new kind of Neocolonialism.
To paraphrase Harold Macmillan, a “wind of change” is blowing through Africa. But, unlike 1960, when the former British Prime Minister made his famous remark, the wind today is not that of a growing national consciousness in the mud huts and shanty-towns, but instead the stiff breeze of a new kind of Neocolonialism.
 The PR men for Global-colonialism would claim that, after decades of civil war and millions of deaths, partition is the only way to “save human lives” and achieve a “lasting peace.” But this ignores the fact that both the states created by this division will still be ethnic patchworks. A more likely explanation is that, in addition to wishing to humiliate Khartoum, the Global-colonialists are simply removing an overly polarizing division that serves to unite the diverse groups on either side of the divide. With the non-Muslims in the South out of the way, the simmering divisions between the Muslim Furs, Nubians, Bejas, and various Arab-speaking groups in the North will move to the fore; while, in the same way, in the new state of South Sudan ethnic divisions long suppressed by the need to fight Islamic oppression will also bubble to the surface. This, in effect, creates much better conditions for the profitable exploitation of the oil fields in the region.
The PR men for Global-colonialism would claim that, after decades of civil war and millions of deaths, partition is the only way to “save human lives” and achieve a “lasting peace.” But this ignores the fact that both the states created by this division will still be ethnic patchworks. A more likely explanation is that, in addition to wishing to humiliate Khartoum, the Global-colonialists are simply removing an overly polarizing division that serves to unite the diverse groups on either side of the divide. With the non-Muslims in the South out of the way, the simmering divisions between the Muslim Furs, Nubians, Bejas, and various Arab-speaking groups in the North will move to the fore; while, in the same way, in the new state of South Sudan ethnic divisions long suppressed by the need to fight Islamic oppression will also bubble to the surface. This, in effect, creates much better conditions for the profitable exploitation of the oil fields in the region.








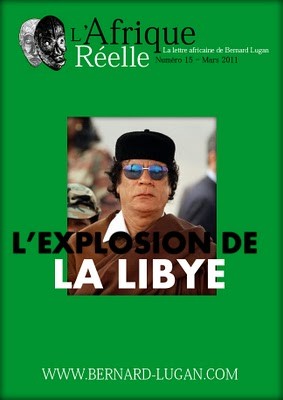 La France a son Lampedusa, mais un Lampedusa à la puissance 10. Pour la seule année 2010, 26 405 clandestins en furent expulsés, ce qui donne une idée du chiffre réel du nombre des arrivants...
La France a son Lampedusa, mais un Lampedusa à la puissance 10. Pour la seule année 2010, 26 405 clandestins en furent expulsés, ce qui donne une idée du chiffre réel du nombre des arrivants... 