By Gwendolyn Taunton
Ex: https://manticorepress.net
This article was originally published in The Radical Tradition (out of print).
The issue of political identity is not often connected with spiritual sources in the eyes of the average citizen; however on an imperceptible, inextricable level, the two are combined in a myriad of ways which escape the notice of many. Indeed, the application of spiritual and/or mythical elements being deployed as part of a political agenda is nothing new, for it can found in a diverse range of historical epochs from the time of the Roman Empire to contemporary politics. The parallel I wish to draw is between the concept of the Primordial Tradition (standing as a sui generis argument) to the theory of primordialism in political science, with the specific intent of identifying and providing a new definition of cultural identity that is intended to bypass both the political left/right dichotomy and approach identity from a ‘top-down’ perspective, as opposed to a flat, unilateral model of left/right duality. The need for a new theory of national identity is becoming one of paramount importance in the increasingly isolated world of mass ‘individualism’ which has come to predominate the modern world. In the process of cross-comparison between Traditions and primordialism, a clear narrative of interaction will be extrapolated to reveal a blue print for the construction of a new form of political theory that seeks to redefine the common elements in national identities. To begin the discourse, a brief introduction to the twin theories of the Primordial Tradition and primordialism is required.
The Primordial Tradition is rightly defined as being a sui generis argument meaning that it is self-generating – a concept which originated with Durkheim. Essentially a sui generis argument is classified as self-perpetuating because it originates from a concept which is deemed to be existent from the beginning. In the sociology of Émile Durkheim, a sui generis is used to illustrate his theory on social existence. Durkheim states that the main object of sociology is to study social facts. These social facts can only be explained by other social facts. They have a meaning of their own and cannot be reduced to psychological or biological factors. Social facts have a meaning of their own, and are ‘sui generis’. Durkheim also states that when one takes an organization and replaces some individuals with others, the essence of the organization does not necessarily change. It can happen, for example, that over the course of a few decades, the entire staff of an organization is replaced, while the organization still retains its distinctive character. Durkheim does not limit this thought to organizations, but extends it to the whole society: he maintains that society, as it was there before any particular living individual was born, is independent of all individuals. His sui generis (its closest English meaning in this sense being ‘independent’) society will furthermore continue its existence after the individual ceases to interact with it. Society and culture, are therefore naturally arising phenomena.
Sui generis is a Latin expression, literally meaning “of its own kind/genus”, or unique in its characteristics. In this circumstance spirituality and Tradition are deemed to be archetypal concepts which are inherent in the psyche of humans from the beginning of the evolution of consciousness itself. Like, society, they are naturally occurring. This implies a relationship with Jungian thought and links it to Jung’s theory of the subconscious and archetypes as symbols, which whilst are not possessed of a corporeal existence, act as what he called ‘psychoids’. These psychoids are not themselves alive but possess an abstract existence which influences the nature of human thought despite the fact that they themselves are not sentient. This idea is similar to that which was expressed by Plato when he discussed the realm of Ideals in which abstract concepts take on an existence in a theoretical plane of reality. This idea of a Primordial Tradition which serves as an ideological substratum for all of the world’s Traditions to draw upon, in best thought of a repository of universal archetypes which are translated into the various Traditions of the world, each one being shaped by the geographic and cultural phenomena present in the respective Traditions. The language of Tradition is ethno-symbolist in origin; symbols and patterns of belief shape the cultures of the world around them. When minor discrepancies can be found in the archetypes (if examined in a cross-cultural comparison), they are easily explained as being a different translation of the same archetype or symbol, for it is imperative to remember that not all cultural groups in the world share the same set of psychological processes; each culture has been shaped by unique historical, geographical, natural and social forces. Thus the God of an indigenous shamanic population may appear radically different to the God of the Jews or Christians, though all are in fact speaking of the same entity. The foundational premise of the symbol is the same as that of an archetypal phenomena; however the translation itself is parsed through each environment differently.
If we are to accept spirituality as a self-generating phenomena set apart from the world of the mundane by its inherent qualities of the sacred and transcendent, how can we relate this process to the construction of a national identity? The answer to this question arises from an older theory which has fallen out of grace with contemporary political critique – primordialism. Not only is there a great similarity between the titles of the two theories, there is also a significant overlap between the two concepts, for both are self-generating and self-perpetuating without the need for any artificial intervention – in sum, both are organic, living forms of belief and awareness which are to be found in all peoples for they are universal values. Though at first the concept of an organic mode of national identity (and hence also an organic model for political identity) may appear like a radical transition, it is in fact not. The term primordialism (sometimes also known as perennialism) in political theory is the argument which contends that nations are ancient, natural phenomena, and thus shape themselves when constructing an identity. This stands in radical contrast to the inorganic modernist view of nationality, which is shaped and guided by external forces. Alan Bairner explains the distinction between primordialism and modernism (or instrumentalism) below:
It is relatively standard practice in sociological and political studies of nations and nationalisms to differentiate between primordialist (or ethno-symbolist) and modernist perspectives […] Central to the former is the belief that primordial attachments or relations are a matter of the significance attributed to criteria that are perceived to be objective language, ethnicity, geography, religion and which are almost certain to predate the emergence of the modern nation state and of nationalism as a modern political ideology. […] The modernist perspective, on the other hand, focuses on nations and nationalisms as modern inventions which emerge in response to new social and economic challenges.[1]
As the above extract hints, the key to understanding this dyad of political polarity, is that primordialism approaches the nation as a living, organic entity, formed from naturally occurring social bonds, whereas modernism adopts the approach that the nation is in fact an artificial construct. The first mentions of primordialism in this context arise from German Romanticism, and are found in the works of Johann Gottlieb Fichte and Johann Gottfried Herder. Herder’s theories revolved around the use of language in cultural groupings, and for Herder, the concept of the nation was synonymous with its linguistic group, which he also held to be a reflection of the group’s thoughts processes – thus each linguistic grouping would have not only different languages, but a different thought process. This is highly indicative of linguistic groupings being one of the primary sources from which national identities are formed.
Another important element which plays a key role in the assertion of national identities (under the broader context of primordialism) is the landscape itself. As Anthony D. Smith suggests territorial ‘homeland’ components of nations in primordialism indicate that ‘the landscapes of the nation define and characterise the identity of its people’.[2] Land and geographical features will always be a universal within any cultural grouping, for they generate images to which the populace at large can relate to.
Landscape is itself a representation, ‘a medium . . . embedded in a tradition of cultural signification and communication, a body of symbolic forms capable of being invoked and reshaped to express meaning and values’ (Mitchell 1994: 14). The interpretation of landscapes is hence a politically loaded activity: the meaning attributed to them results from an ideologically coded interpretation of society and nation (Nogue´ and Vicente 2004). Landscapes function in nation-building discourses as symbols of national authenticity. For this purpose, nature can be nationalised, but by associating nationhood with a landscape the nation can itself be naturalised (Kaufmann and Zimmer 1998; Smith 1986: 183–90).[3]

The notion of sacred land is also found in almost all indigenous cultures, particularly in locations where natural phenomenon were unusual; thus not only did land shape the evolution of society, it is also intrinsically wed to spirituality. These sites often become associated with myth, pilgrimage, and ritual. Furthermore, the appeal of the landscape in defining cultural identity is not limited to inhabitants of localised regions; it is also significantly embodied in constructing the identity of diasporic groups. In this respect, the fact that nations are defined territorially (although in relation to diasporic nationals they can also transcend spatial boundaries) is an important factor in their emotional appeal, especially when one considers the importance of the landscape for any territorial entity.[4] An obvious example of the use of the land as a construct of national identity amongst diasporic peoples would the implementation of modern Israel being established as the mythical homeland of the Jews.
It seems a matter of logic to assume that any group of people cohabiting a particular geographic region for a period of time would form the necessary social bonds which would act as a precursor to the formation of a rudimentary community, and that this community would in turn associate the land upon which they lived as part of their national identity. This however, is only a small portion of the factors which compose the totality of primordialism. Clifford Geertz elaborated further on primordialism, and is usually credited in literature as the author who introduced the concept of the primordial attachments and sentiments of an individual to the world.[5]
In Geertz’s theory the factors which constitute primordialism are in fact the assumed normative functions present in human social groupings. In Geertz’s theory one is bound to one’s kinsman, one’s neighbour, one’s fellow believer, ipso facto, as the result not only of personal affection, practical necessity, common interest, or obligation, but in great part by virtue of some absolute importance attributed to the very tie itself.[6] The nature of the attachments themselves are not constants, and vary between individuals and communities.
According to C. Geertz (1963), primordial attachments are also created at the social level when a community shares ideas of (also assumed) blood ties, the same race, speech, territory, religion, customs, and traditions. Many cultures regard primordial communities as universal and eternal. The lineage on both the mother’s and the father’s sides of the family, the history of the religious, ethnic group or nation can be traced back many centuries. History and ancestors are very important in the primordial community (Baèová, V., 1966). The primordial community as a historically developed givenness shows a tendency to dominate individuals. Membership of a primordial community is assigned to an individual and is considered to be hereditary (e.g. a caste but also a religion).[7]
Obviously this definition of primordialism encounters a problem in the modern era, in that immigration renders the above definition of primordialism both unfeasible and inappropriate. It is for this reason, that modernism/instrumentalism has gained prominence in academic circles, with primordialism being regarded as an out moded theory which is now only demonstrated amongst tribal communities. The crux of the argument in regards to the success of primordialism rests on the ethnicity of the actors involved; instrumentalism holds ethnicity as impermanent and an intangible aspect which can be changed. In instrumentalism, ethnic identity is not given to an individual in advance and forever, it is not primordial, but is constructed during one’s development and can undergo changes during one’s life.[8] By contrast, primordialism is defined below:
According to the primordial approach, ethnic identity is given to the individual just like the primordial membership of a community into which he/she was born (i.e. forever). As one cannot change the country, where one was born, or one’s native language, one cannot change one’s identity, which is deeply rooted in him or her. According to P.R. Brass (1991), it is common to all primordial views that ethnicity is based on descent.[9]
Therefore, the reason why primordialism is no longer deemed to a credible theory for national identity is not because it has inherently been proven wrong, but rather because it no longer suits the requirements of the modern state construct which is composed of people from a number of different ethnic backgrounds. The difference between primordialism and instrumentalism is further elaborated below.
The concern about multiculturalism has surfaced also in studies on nationalism which analyse the future of the nation. The two different positions that come here to the fore or ethno-symbolic and modernist can be best exemplified by the works of Anthony D. Smith and Mary Kaldor respectively. According to Smith (2002), while nationalism can certainly be regarded as a modern phenomenon, nations are not. In different forms (clans, tribes, city-states or ethnic communities), ‘nations’ have always existed (Smith, 2002, p. 14). National identities are somewhat perennial, pervasive, and ‘authentic’; while other types of identity gender, class, religion, etc. are situational, i.e. context-dependent (Smith, 2000, pp. 133134). As nations pre-date the rise of the modern state, it is possible that they will also survive its demise. The opposite view is held by modernists, who maintain that nations are not ‘primordial’, but ‘historical’ products, inextricably linked to the rise of the modern state. According to Kaldor (2004), it is therefore likely to expect that as nations came into existence, one day they will disappear.[10]
In the modern era, basing primordialism upon the ethnicity of the actors is not possible. In order to redefine primordialism, other aspects of organic communities must be examined to determine what the actual bonds of primordial attachments are in the modern era of mass relocation. Obviously, a number of factors occur in combination which ensure the normal social bonding processes take place within the community – language, culture, and group psychology will all occur within the formative process. All of this is quite reminiscent of Victor Turner’s theory of communitas. As one of the leading anthropologists, the idea of communitas put forward by Turner revolves around the interplay of spiritual Traditions to form bonds within social groupings – this intangible bond by which people identify their sense of ‘belonging’ is what Turner refers to as communitas. In terms of relevance in assisting us on our quest to redefine primordialism and national identity in terms which are relevant to the circumstances of the current nation/state, it is vital for us to understand what creates the sentiment of communitas which serves to form the primordial attachments and all national identities in terms of group psychology. This concept is what I refer to as the pathos, which is the impetus behind all arts, spiritual/philosophical beliefs and politics. I have chosen to implement the term pathos as being representative of an emotional state which is deliberately evoked as a response to a particular aesthetic. Thus, it is the unseen bond which binds the object of art to its observer though the will and intent of its creator. By using this, the artist attempts to evoke his emotional state in the observer by means of replication. Pathos is the emotional response of the observer to any particular art form, and any piece of successful art will cause pathos to manifest in the observer. Moreover, pathos is not limited entirely to art and it is capable of manifesting in other culture spheres, notably spirituality and politics. Art and spirituality are siblings which are primarily evoked to appeal to the subconscious. In spirituality the need for a successful pathos reaction is required in the participant, not the observer and is a core component of prayer and ritual. The ritual specialist also replaces the artist to elicit the pathos response from the audience. Obviously in spirituality the emotions evoked will be different to those which are often evoked by art, and tend to relate more to abstract mental states and the higher processes of cognition i.e. devotion, bliss, ecstasy, peacefulness. In politics the way in which pathos is evoked is again different, and it is best illustrated in the writings of Gustav Le Bon, whose works dwelt upon irrational impulses in the masses and generating emotional responses from the crowds. For Le Bon ‘crowds were characterised by illogical spirit, instinctive character, and a propensity to be governed by feelings.’[11] Le Bon advised the leader to know the “art of impressing the imagination of crowds,” because that knowledge would enable him to govern them.[12] Thus here the principle of raising a pathos response is the same in art, spirituality and politics, for all three rely on the ability of one person to create an emotional response in many individuals in order for their respective endeavours to be successful. It is undeniable that politics utilises the principle of pathos, and that in the writings of Le Bon on crowd psychology, politics became a mysterious new art form.
Le Bon encouraged leaders to play on the power of representation and to adopt theatrical modes. He equally directed attention to the use of words and language in combination with images. In the same way that representations, “if handled by art.” can turn magic, so words and formulas could become “supernatural powers”. No matter what their meaning, the power of words was relevant, Le Bon claimed. “Words whose sense is the most ill-defined are sometimes those that possess the most influence.” Words had a “truly magical power.” […] By emphasising magic in the leader’s relation to crowds, Le Bon instituted a doctrine of mystification. Since he believed he had scientifically proven the crowd’s irrational nature, Le Bon in effect advised the orators to appeal to their “sentiments, and never to their reason.” He suggested that in order to convince the crowd, it was necessary to know more than the feeling that animated it. One also needed to “pretend to share those sentiments” and possibly to divine from instant to instant the sentiments to which one’s discourse is giving birth.”[13]
 There is very little room for doubt that Le Bon’s theory was directed as using politics as an art form, in which an active leader sought to evoke pathos reactions in a passive crowd, and we can see it enacted in Italian history by Mussolini, who was profoundly influenced by the works of Le Bon. Not only did Mussolini use the works of Le Bon to draw pathos reactions from the people of Italy, he saw politics as an art form, which links it strongly to the need to provoke emotional states in the otherwise passive observers, with the ‘performance’ serving as the medium by which to connect the ‘artist’ (in this example, Mussolini) with the observer (the Italian public). Mussolini describes politics as an art below:
There is very little room for doubt that Le Bon’s theory was directed as using politics as an art form, in which an active leader sought to evoke pathos reactions in a passive crowd, and we can see it enacted in Italian history by Mussolini, who was profoundly influenced by the works of Le Bon. Not only did Mussolini use the works of Le Bon to draw pathos reactions from the people of Italy, he saw politics as an art form, which links it strongly to the need to provoke emotional states in the otherwise passive observers, with the ‘performance’ serving as the medium by which to connect the ‘artist’ (in this example, Mussolini) with the observer (the Italian public). Mussolini describes politics as an art below:
That politics is an art there is no doubt. Certainly it is not a science, nor is it empiricism. It is thus art. Also because in politics there is a lot of intuition. “Political” like artistic creation is a slow elaboration and a sudden divination. At a certain moment the artist creates with inspiration, the politician with decision. Both work the material and the spirit…In order to give wise laws to a people it is also necessary to be something of an artist.[14]
As an art, politics is governed by the same rule as other arts; that it operates by generating an appeal to the irrational, emotive states. By means of generating pathos, the speaker or leader creates a bond betwixt themselves and the crowd. This was by no means limited to Mussolini and is a widely utilised political technique. A political scientist, Walter Connor, analysed the speeches of great leaders of nations, as well as national revivalists and noted a conspicuous uniformity of phraseology that was observable in a number of these speeches.
Phrases and pictures of family, blood, brothers, sisters, mothers, ancestors, home were almost universal. The speeches and phrases were able to mobilize masses and many individuals also believed them in private. W. Connor justifies the force of these appeals to primordial attachments by their emotional strength through which they have affected and continue to affect the human mind.[15]
Connor’s analysis paints a very clear picture of the political uses of not only primordial attachments, but also the effects of the successful raising of pathos in the respective audiences. Furthermore, the fact that these elements were also present in Mao’s speeches suggests that the use of emotive language was not limited to the Right Wing – indeed, as a universal element in the culture spheres, the use of pathos in politics is independent of all political parties and regimes for it is a technique or component and thus could be utilised by any and all political persuasions. A quick examination of speeches from the former American president George W. Bush reveals a highly targeted usage of key words and phrases such as ‘freedom’ and the ‘axis of evil’. Though Bush’s use of pathos in politics pales in comparison to others, attempts to raise pathos in his politic speeches are present, and this is demonstrated by excessive repetition of phrases and carefully selected words which were targeted to rouse the American public. Thus, appeals to the emotions in politics are not limited to the far right or nationalism; the power of words and pathos is merely a tool which could be utilised by any political current.
Pathos, when coupled with the primordial attachments, is a driving force in the construction of national identities both in the world of theory and the application of real politic. In a smaller community, these primordial attachments tend to be stronger, but theorists are still at a loss to explain how they translate into nationalism, where the attachments are weaker. I would tend to argue that this in itself is no great mystery; there is merely a need to generate more pathos to enhance the existing feelings of communitas to a point where primordial attachments manifest at a level wherein they are made to appear even in inorganic constructs such as the ‘nation’. Baèová cites this point, saying that ‘According to some authors, the success of nationalism can today be explained by the fact that it made an efficient use of the strength of human primordial attachments and extended them to a macrocommunity, i.e. to the nation state.’[16]In the context of social theory, these attachments can be rendered in a variety of different forms.
Social categorization theory and research have taught us that there is personality-based identity (‘personal’ identity), and categorical/inscriptive or ‘group’ identity. Likewise, there are two kinds of attraction (Hogg 1992) : personal attraction (caused by the personality of another), and social attraction (caused by the group-membership of another, through the prototyped stereotype attached to such membership). However, this theory takes the (contextless) process of categorization itself to be decisive (Turner et al. 1987) , and proposes no theory about the different kinds of ‘groups’ with which people can identify. There are many kinds of group identities: ethnic, kinship, political, religious, gender, class, racial, regional. Each creates an in-group (where ego is member) and an out-group, and therefore a social boundary, by stipulating certain conditions that members must satisfy in order to be such. But psychologists have in general treated all group identities and in-group/out-group cleavages as resulting from the same, general, stereotype-formation process (for example, Bar-Tal et al. 1989; Leyens/Yzerbyt/Schadron 1994). However, we are probably equipped with specialized psychologies (plural) to process the different kinds of social boundaries that recur in the social world. Group identities are probably ‘domain-specific’, like most other aspects of human cognition (Symons, 1992; Tooby & Cosmides 1992). If so, membership conditions in one domain (political groups) may well be different from those in another (ethnic groups).[17]
The interesting implication which arises here, is that in such a community where pathos is strong enough to forge primordial attachments and enhance the feeling of communitas, is that it would create a friendlier, more caring community – this would stand in a marked contrast to the isolation of a community of ‘individuals’, which is today the hallmark of the majority of nations today. In discussing primordialism and pathos in nationalism, Heam argues that ‘to understand better the importance of human sentiments in the formation of nationalism, what is needed is detailed case and comparative studies that look at the actual interface of primordial discourses of kinship, territory and language, and primary groups in specific social structures, and the workings of national discourses in those contexts, whether playing upon primordialist themes or not’.[18]
Steve Bruce argues that religion is greatly underestimated as a force in contemporary Western society both in terms of literal belief and in terms of symbolic and metaphorical meaning.[19] Furthermore, as structural-functionalism has declined in the social sciences as a theoretical tool of analysis, so too have the functional aspects and relevance of religion been overlooked.[20] Certainly, due to the current climate religion is more misunderstood in the Occident than it was two hundred years ago – with every step taken towards scientific progress, research in the humanities has taken about twenty steps backward. We must not ignore the impact of different spiritual Traditions on national identity either, whether they have had positive or adverse effects, for spirituality, has, and continues to be, a driving force in human culture. As Durkheim concluded, ‘If religion has given birth to all that is essential in society, it is because the idea of society is the soul of religion’.[21] Thus in the eyes of Durkheim, society and religion are linked in a fundamental manner. Indeed, a cursory glance at the etymological origins of both religion and society reveals just how deep the connection betwixt the two is. The word ‘religion’ comes from the Latin religio, meaning bonds of social relations; ‘society’ comes from the Latin socio, meaning bonds of compassion and community.[22]The true role of spirituality is thus one of social relationships, which serve to define a network or community; a definition which would exclude all forms of political religion which define an individual’s role in relationship to the state instead.
Religion thus implies the idea of networks and relations superior to the individual that perform life-enhancing, even life-creating functions that create a sense of community and compassion because its members share relationships, thus was Durkheim able to identify God and religion as society. The relationships one enters into also help form one’s consciousness and culture and thus one’s identity, sense of place and belonging. Relationships convey knowledge and information, ways of interpreting the world and understanding one’s place in it – skills vital to maintaining one’s life in terms of social interaction, economic cooperation, material survival and physical (military) preservation.[23]
Therefore, if used correctly, spirituality should serve to bring a community together – only when spirituality falls into the hands of politics does it become misused for other agendas. Here, on a side note, I would also advocate, in light of the fact that spirituality has replaced religion as the common term for metaphysical beliefs, that both be substituted by the word Tradition when we speak of belief systems that are rooted in cultural and/or ancestral heritage. Having seen how Tradition can be warped by political agendas, it behoves us to explain what the appropriate role of Tradition should be in national identities. Otto says that “if there be any single domain of human experience that presents us with something unmistakably specific and unique peculiar to itself assuredly that is it is that of the religious life.” The individual nature of Tradition ties an individual to culture and community more strongly than ties of ethnicity and in terms of asserting or prescribing national identities it is more effective, particularly in the modern era where cultural groups are composed of mixed ethnicities. Moreover, the acceptance of the same Tradition equates to a similar cultural and ethical viewpoint which creates a more harmonious society, whereas geographical or ethnic primordial attachments create weaker bonds and the principle of communitas is lessened. Thus, I would argue that the principle primordial attachment in the theory of primordialism, is not ethnicity but Tradition. It has previously been asserted by Brass that ethnicity is the prime condition for primordialism, as it cited here.
According to P.R. Brass, it is common to all primordial views that ethnicity is based on descent. The primordial understanding of one’s ethnic membership explains the non-rational behaviour of people, which is against their other (even existential) interests when defending their ethnicity, their willingness to suffer persecution or to die for their nation.[24]
Whilst this may explain the rise of nations in the pre-colonial world, this view is longer feasible for primordialism as it is not sufficient to explain the mixed cultural groupings of the modern era. Not only are there now large communities of mixed ethnicity, there are also the newly emerging micro-communities to consider, which although currently limited to social networking, do exhibit the same patterns as newly emerging nations, in the regard that the social bonds are naturally arising from primordial attachments, usually cultural or lifestyle based. In the current era, any political theory or ideology which holds ethnicity to be the main primordial attachment is ultimately doomed to failure. The previous definition of primordialism is no longer appropriate as it does not allow variance in geography and ties ethnic groups to territorial locations. Thus, the theory needs to be revised to accurately reflect national identity in the modern era. In its current format it also fails to explain newly emergent forms of supra-nationalism such as the EU which will be addressed later in this article. A more feasible stance is advocated by Ernest Gellner.
According to him, nationalism means a transfer of the focus of People’s identity into a culture that is disseminated through literacy and the formal system of education. It is not the mother tongue (i.e. primordial attachment) that is important any more, but the language of alma mater (as an instrumental means of communication). This is a consequence, in Gellner’s opinion, of industrialization and the demands for a standardized system of education, which brought the community (polity) and culture closer together. In these psychological terms nationalism extended the cultural and civilization repertoire of the sources of an individual’s identity. However, nationalism assumes and relies on the efficiency of primordial sentiments.[25]
 Thus the culmination of national identity, fostered by the primordial attachments, passes through the contemporary education system, and it is this way that all current modes of national identity are disseminated. Language is also reinforced as a prime focus for creating primordial bonds, and is perhaps the most important element in constructing national identity, for without a common linguistic group, there can be no opportunities for bonding within the community. Translated into education via the medium of language, the culture and community prescribe the value of the nation to an individual.[26]
Thus the culmination of national identity, fostered by the primordial attachments, passes through the contemporary education system, and it is this way that all current modes of national identity are disseminated. Language is also reinforced as a prime focus for creating primordial bonds, and is perhaps the most important element in constructing national identity, for without a common linguistic group, there can be no opportunities for bonding within the community. Translated into education via the medium of language, the culture and community prescribe the value of the nation to an individual.[26]
To integrate into a modern society (nation) everyone needs to share a single underlying culture. To integrate into a pre-modern society (ethnic group) one needs to acquire its very specific culture. The difference is that a modern culture has a universality to it that encourages differences, but only if they can effectively exchange and form relations of reciprocity, which requires uniformity and a single truth or system for defining truth. A pre-modern culture requires quite overt conformity to local conditions and so is non-universal, it is in fact very conformist, although the wide variety of different local styles of conformity seems to indicate a greater variety and non-conformity.[27]
So, then in the context of modernity, and accepting the given that this can no longer be based on ethnic descent, how can cultural and national identity be constructed in the modern era? With Brenner we see a new definition emerging providing arguments on both a supra and sub-national basis. Thus the traditional model of the nation-state can be unified at the macro-level and divided at the micro level, making the model not only top-heavy but providing weak foundations on which to build any bonds of communitas. However, the inverse model can also be constructed, with smaller micro-communities at the bottom, which serve to de-stabilise the top strata of the supra-national level by threatening to split the structure from the base, if we think of the macro/micro community to be pyramid shaped in structure. Thus, by disrupting the bottom of the pyramid it is possible to topple the larger macro-nation community structures by dividing communities at the micro level. Whilst the topic has been analysed numerous times, and the process itself has been widely acknowledged, little has been said of how this affects the nation, national identity, and how to rectify the situation, as Antonisch cites below:
All the above-mentioned studies affirm, more or less explicitly, that in the present epoch the nation-state, if not in crisis, is at least experiencing a transformation. Many of these studies, however, limit the analysis of this transformation to only one of the two dimensions of the ‘nation-state’. The focus is almost exclusively on the transformation of the structure and powers of the state. How this transformation affects the nation is somewhat passed under silence.[28]
In regards to supra-national constructs, many have predicted a decline in national identity, which would have an obvious and expected conclusion, given that merging small cultural systems into a larger one should consume the smaller, or least cause it diminish in size and strength. Curiously however, evidence actually points in the opposite direction. National pride has actually increased within the EU, with the exception of Northern Ireland. Whilst other factors could easily have been the cause of this, as opposed to it merely being the result of policy implementation at the supra-national level, the fact remains that it has increased. Whilst supra-nationalism obviously delivers nationalist identity in a few form which has not been utilised before, it is still a nationalist construct – one which remains unscathed by the negative imagery affiliated with nationalism in the post WWII era. Thus, unrecognisable to most as a supra-nationalist construct, it does not trigger the usual ‘knee-jerk’ reaction the public experiences in the presence of nationalist rhetoric. This means the impact of supra-nationalism, contrary to being an impediment to the cultural identity of member states, is actually creating nationalist sentiments, which even if they are not enough to provide a true sense of communitas betwixt inhabitants, is nonetheless generating nationalism, albeit from a macro level. The results of the surveys conducted by Eurobarometer are listed below.
Eurobarometer – The survey question about national pride (‘Would you say that you are very proud, quite proud, not very proud, or not at all proud to be [nationality]?’) was first asked in 1982, but unfortunately it was not included every year in Eurobarometer standard surveys, with a significant gap between 1989 and 1993. Looking at data at the European level, we notice that overall from 1982 to 2005, national identities among the EU-15 countries have not declined. On the contrary, at the European level, national identity has increased by ten percentage points. The countries which mainly account for this increase are Belgium, East Germany, and Italy. Northern Ireland is the only territory which has experienced a major downturn.[29]
This may in fact be an example of Manuel Castells study on identities in the age of the network society. According to Castells, religious fundamentalisms, ethno-nationalisms, regionalist movements, and local communes are today the new identity expressions of the ‘space of places’ which complement the de-territorialised, globalized identity of a technocratic-financial-managerial elite who lives in the ‘space of flows’.[30] Thus, it would be nationalism, but of the kind which is not confined to the ‘space of places’ but rather an example of the new modernist identities created by the ‘space of flows’. In regards to modernist constructs, we are dealing with a new form of nationalism which is not tied to any given community, nor is based on the organic model of Tradition.
In conclusion, the current modern shift towards a social structure based on modernism/instrumentalism, whilst obviously intended to construct cultural and/or national identity in the modern area, is likely to prove a top-heavy and unwieldy model which fails to provide a fundamental solid building base for the creation of communitas. The bonds it seeks to establish between citizens are insubstantial compared to the genuine ties generated by communitas and primordial attachments, both of which rely on the generation of pathos in order to create these bonds. Pathos can be raised through the arts, spirituality, or even charisma itself – the crucial element for success is not the mode, but the reaction itself, which serves to act as a catalyst for forging the primordial attachments that are required to cultivate a healthy society. The failure to generate this essential component makes modernism/instrumentalism incapable of rendering the appropriate amount of pathos required to create an emotional attachment or primordial bond to the inorganic nation/state impossible, which as a consequence also renders the failure of any movement based on national identity. With the inadequacy of modernism/instrumentalism and its failure to deliver any meaningful cultural significance, we are left with its opposite pole in the dyad, primordialism. As an old theory however, primordialism also is lacking in the modern era, due to the impetus it used to place on ethnicity as the defining point of identity – a solution which is at best tenuous in modern society. It is therefore imperative to revise the definition of primordialism so that it no longer bases its philosophy on the ethnicity of actors within the nation. The defining point of cultural identity needs to less rigid than that of fixed biology, and based on common viewpoints – for example a community whom shares the same philosophy is likely to be much more harmonious than one whose identity is based purely on physical characteristics. I therefore propose that the term primordialism be redefined to place greater emphasis of Tradition, spirit and culture – all the integral building blocks of society which render organic and naturally arising communities possible. It is only by creating a new cultural paradigm that is relevant to the modern era that any true spiritual or political reformation can begin.
[1] Bairner, A., National Sports and National Landscapes: In defence of Primordialism, in National Identities, Vol. 11, No. 3, (UK: Loughborough University, 2009), 223.
[2] Ibid., 224.
[3]Huysseune, M., Landscapes as a Symbol of Nationhood: the Alps in the Rhetoric of the Lega Nord in Nations and Nationalism, Issue 16 Vol.2, 2010, 355.
[4] Bairner, A., National Sports and National Landscapes: In Defence of Primordialism, in National Identities, 225.
[5] Baèová, V., The Construction of National Identity – on Primordialism and Instrumentalism, in Human Affairs, Issue 8 (Institute of Social Sciences, Slovak Academy of Sciences, 1998), 4.
[6] Ibid., 31.
[7] Ibid., 32.
[8] Ibid., 36.
[9] Ibid., 36.
[10]Antonsicha, M., National Identities in the Age of Globalisation: The Case of Western Europe, in National Identities, Vol. 11, No. 3 (UK: University of Birmingham, 2009), 28.
[11] Falasca-Zamponi, S., Fascist Spectacle: The Aesthetics of Power in Mussolini’s Italy (USA: University of California Press, 1997), 18.
[12]Ibid., 20.
[13] Ibid., 20.
[14] Ibid., 15.
[15]Baèová, V., The Construction of National Identity – on Primordialism and Instrumentalism, in Human Affairs, 41.
[16] Ibid., 38.
[17] Gill-White, F. J., How Thick is Blood? The Plot Thickens…if Ethnic Actors are Primordialists, what Remains of the Circumstantialist/Primordialist Controversy in Ethnic and Racial Studies, Volume 22 Number 5 (USA: Taylor & Francis Ltd, 1999), 800.
[18] Bairner, A., National Sports and National Landscapes: In Defence of Primordialism, in National Identities, 225.
[19] Dingleya, J., Religion, Truth, National Identity and Social Meaning: The Example of Northern Ireland, in National Identities Vol. 11, No. 4, December 2009, 367.
[20] Ibid. 368.
[21] Gates, D.K. & Steane, P., Political Religion – the Influence of Ideological and Identity Orientation in Totalitarian Movements and Political Religions, Vol. 10, Nos. 3–4, Taylor & Francis 2009, 305.
[22] James Dingleya, Religion, Truth, National Identity and Social Meaning: The Example of Northern Ireland, in National Identities, 369.
[23] Ibid., 369.
[24] Baèová, V., The Construction of National Identity – on Primordialism and Instrumentalism, in Human Affairs, 38.
[25] Ibid., 38-39.
[26] Ibid., 39.
[27]Dingleya, J., Religion, Truth, National Identity and Social Meaning: The Example of Northern Ireland, in National Identities, 380.
[28]Antonsicha, M., National Identities in the Age of Globalisation: The Case of Western Europe in National Identities, Vol. 11, No. 3, UK, 2009, 282.
[29] Ibid., 285.
[30] Ibid., 283.
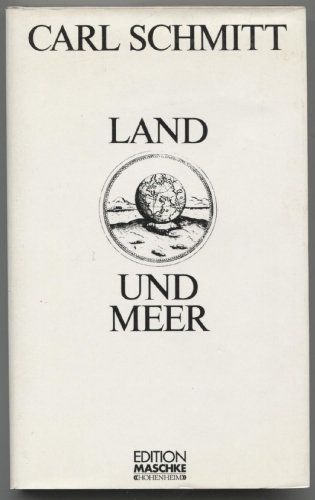 Toute notre existence d’ici-bas, notre bonheur, nos malheurs, nos joies et nos peines, sont pour nous la vie « terrestre », c’est-à-dire, selon les sujets, un paradis ou une vallée de larmes. On comprend donc que dans nombre de mythes et de légendes qui expriment les souvenirs et les épreuves les plus lointains et les plus intimes des peuples, la terre apparaisse comme la mère primitive des hommes. Les livres sacrés nous racontent que l’homme, issu de la terre, retournera à la terre. […] Parmi les quatre éléments (la terre, l’eau, l’air et le feu), c’est la terre qui est vouée à l’homme et qui le marque le plus fortement. L’idée qu’il pourrait être marqué aussi fortement par un autre de ces quatre éléments apparaît, de prime abord, chimérique : l’homme n’est ni un poisson ni un oiseau et encore moins un être-du-feu, à supposer que celui-ci puisse exister. » (p.17-18)
Toute notre existence d’ici-bas, notre bonheur, nos malheurs, nos joies et nos peines, sont pour nous la vie « terrestre », c’est-à-dire, selon les sujets, un paradis ou une vallée de larmes. On comprend donc que dans nombre de mythes et de légendes qui expriment les souvenirs et les épreuves les plus lointains et les plus intimes des peuples, la terre apparaisse comme la mère primitive des hommes. Les livres sacrés nous racontent que l’homme, issu de la terre, retournera à la terre. […] Parmi les quatre éléments (la terre, l’eau, l’air et le feu), c’est la terre qui est vouée à l’homme et qui le marque le plus fortement. L’idée qu’il pourrait être marqué aussi fortement par un autre de ces quatre éléments apparaît, de prime abord, chimérique : l’homme n’est ni un poisson ni un oiseau et encore moins un être-du-feu, à supposer que celui-ci puisse exister. » (p.17-18) « Tous les peuples du centre et de l’Ouest de l’Europe participent à la grande épopée de la découverte des terres nouvelles, qui soumit le monde à la domination européenne. […] De grands astronomes et d’éminents géographes allemands contribuent à l’éclosion d’un nouveau regard sur le monde […] Sous son génial ministre de la marine, Colbert, la France du XVIIème siècle surclassa, pour plusieurs décennies, l’Angleterre dans la construction de navires de guerre. » (p.39)
« Tous les peuples du centre et de l’Ouest de l’Europe participent à la grande épopée de la découverte des terres nouvelles, qui soumit le monde à la domination européenne. […] De grands astronomes et d’éminents géographes allemands contribuent à l’éclosion d’un nouveau regard sur le monde […] Sous son génial ministre de la marine, Colbert, la France du XVIIème siècle surclassa, pour plusieurs décennies, l’Angleterre dans la construction de navires de guerre. » (p.39)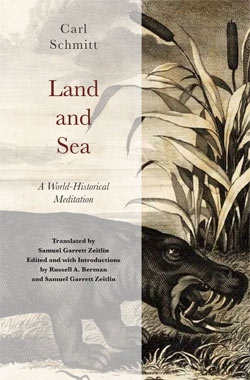 « L’apparition de l’avion marqua la conquête d’une troisième dimension après celle de la terre et de la mer. L’homme s’élevait au-dessus de la surface de la terre et des flots et se dotait en même temps d’un moyen de communication entièrement nouveau –et d’une arme non moins nouvelle. Ce fut un nouveau bouleversement des échelles de référence et des critères, et les possibilités de domination humaine sur la nature et les autres hommes devinrent incalculables. » (p.87)
« L’apparition de l’avion marqua la conquête d’une troisième dimension après celle de la terre et de la mer. L’homme s’élevait au-dessus de la surface de la terre et des flots et se dotait en même temps d’un moyen de communication entièrement nouveau –et d’une arme non moins nouvelle. Ce fut un nouveau bouleversement des échelles de référence et des critères, et les possibilités de domination humaine sur la nature et les autres hommes devinrent incalculables. » (p.87)




 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg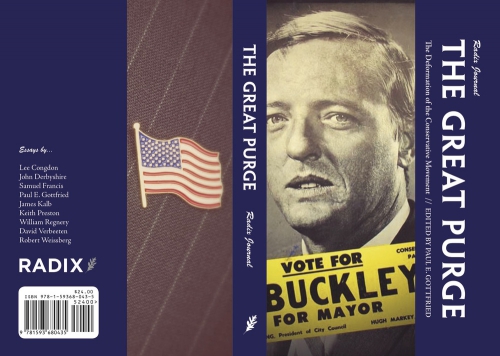




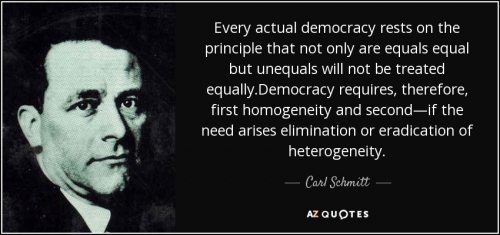



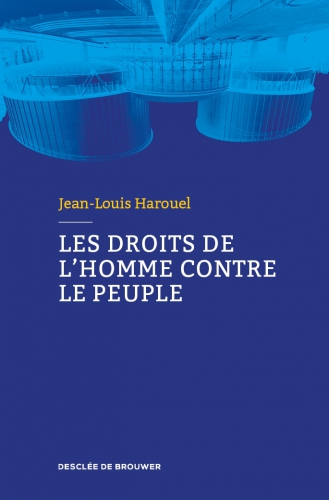

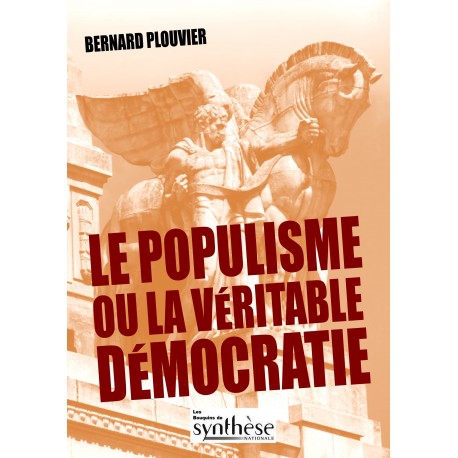 Q. Dans ce livre, vous présentez ce que les bien-pensants et bien-disants interpréteraient comme un non-sens : l’assimilation du populisme à la démocratie. Est-ce une provocation à but commercial ou l’expression d’une intime conviction ?
Q. Dans ce livre, vous présentez ce que les bien-pensants et bien-disants interpréteraient comme un non-sens : l’assimilation du populisme à la démocratie. Est-ce une provocation à but commercial ou l’expression d’une intime conviction ?
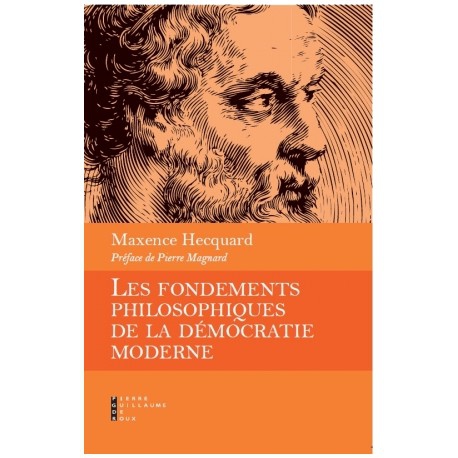




 There is very little room for doubt that Le Bon’s theory was directed as using politics as an art form, in which an active leader sought to evoke pathos reactions in a passive crowd, and we can see it enacted in Italian history by Mussolini, who was profoundly influenced by the works of Le Bon. Not only did Mussolini use the works of Le Bon to draw pathos reactions from the people of Italy, he saw politics as an art form, which links it strongly to the need to provoke emotional states in the otherwise passive observers, with the ‘performance’ serving as the medium by which to connect the ‘artist’ (in this example, Mussolini) with the observer (the Italian public). Mussolini describes politics as an art below:
There is very little room for doubt that Le Bon’s theory was directed as using politics as an art form, in which an active leader sought to evoke pathos reactions in a passive crowd, and we can see it enacted in Italian history by Mussolini, who was profoundly influenced by the works of Le Bon. Not only did Mussolini use the works of Le Bon to draw pathos reactions from the people of Italy, he saw politics as an art form, which links it strongly to the need to provoke emotional states in the otherwise passive observers, with the ‘performance’ serving as the medium by which to connect the ‘artist’ (in this example, Mussolini) with the observer (the Italian public). Mussolini describes politics as an art below: Thus the culmination of national identity, fostered by the primordial attachments, passes through the contemporary education system, and it is this way that all current modes of national identity are disseminated. Language is also reinforced as a prime focus for creating primordial bonds, and is perhaps the most important element in constructing national identity, for without a common linguistic group, there can be no opportunities for bonding within the community. Translated into education via the medium of language, the culture and community prescribe the value of the nation to an individual.[26]
Thus the culmination of national identity, fostered by the primordial attachments, passes through the contemporary education system, and it is this way that all current modes of national identity are disseminated. Language is also reinforced as a prime focus for creating primordial bonds, and is perhaps the most important element in constructing national identity, for without a common linguistic group, there can be no opportunities for bonding within the community. Translated into education via the medium of language, the culture and community prescribe the value of the nation to an individual.[26]



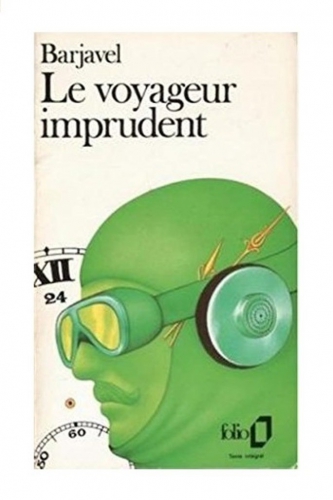 Autre auteur, même système que les castes spécistes, Barjavel et son œuvre Le Voyageur Imprudent. Il est ici question d’un voyageur temporel qui part dans le futur lointain ou après une catastrophe identifiée comme la disparition de l’électricité, l’humanité a évolué dans sa
Autre auteur, même système que les castes spécistes, Barjavel et son œuvre Le Voyageur Imprudent. Il est ici question d’un voyageur temporel qui part dans le futur lointain ou après une catastrophe identifiée comme la disparition de l’électricité, l’humanité a évolué dans sa

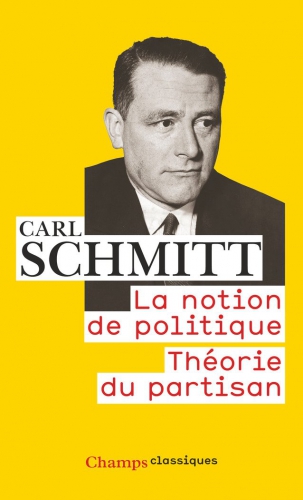 Cette citation brille par son actualité. Face à l’invasion migratoire et à la place de plus en plus
Cette citation brille par son actualité. Face à l’invasion migratoire et à la place de plus en plus
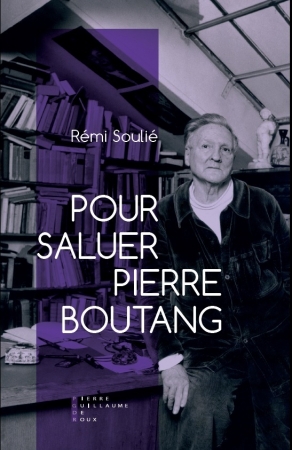 « Le 20 septembre 2016, Boutang aurait eu cent ans (p. 14). » Jeune étudiant toulousain, Rémi Soulié le découvre en 1987 par l’intermédiaire de ses entretiens télévisés avec George Steiner. Séduit, il lui écrivit. S’en suivit ensuite une décennie de correspondances épistolaires, de visites fréquentes et d’appels téléphoniques nombreux jusqu’à la mort de Pierre Boutang, le 27 juin 1998.
« Le 20 septembre 2016, Boutang aurait eu cent ans (p. 14). » Jeune étudiant toulousain, Rémi Soulié le découvre en 1987 par l’intermédiaire de ses entretiens télévisés avec George Steiner. Séduit, il lui écrivit. S’en suivit ensuite une décennie de correspondances épistolaires, de visites fréquentes et d’appels téléphoniques nombreux jusqu’à la mort de Pierre Boutang, le 27 juin 1998.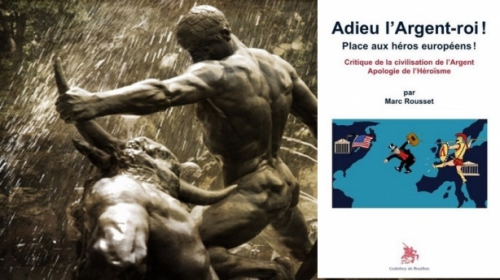

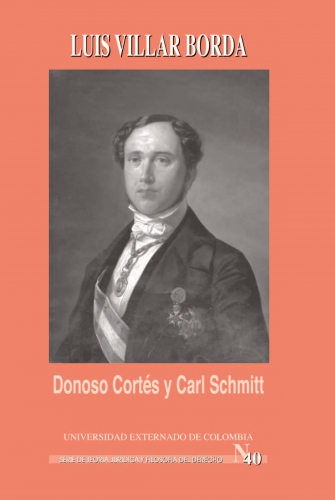 De nos jours, la « discussion » est devenue une marchandise, le produit vendable des nouvelles par câble et des revues d’opinion; il n’y a plus même le prétexte d’une « recherche de la vérité ».
De nos jours, la « discussion » est devenue une marchandise, le produit vendable des nouvelles par câble et des revues d’opinion; il n’y a plus même le prétexte d’une « recherche de la vérité ». Nous voyons, cependant, que la négociation ne bouge que dans une seule direction. Par exemple, supposons que j’offre 50 $ pour un produit et que le vendeur demande 100 $. Nous négocions pour 75 $. Le vendeur connaît alors ma limite. Donc la prochaine fois que nous négocions, nous commençons à 75 $ et il exige 125 $. Si, par indécision, ou si je manque de volonté pour tenir ferme, vous pouvez voir que le prix va continuer à augmenter. Ainsi, les conflits sociaux continuent d’être résolus dans un seul sens, malgré les intentions des conservateurs de maintenir le statu quo, et, en tout cas, continue à « évoluer » dans la même direction.
Nous voyons, cependant, que la négociation ne bouge que dans une seule direction. Par exemple, supposons que j’offre 50 $ pour un produit et que le vendeur demande 100 $. Nous négocions pour 75 $. Le vendeur connaît alors ma limite. Donc la prochaine fois que nous négocions, nous commençons à 75 $ et il exige 125 $. Si, par indécision, ou si je manque de volonté pour tenir ferme, vous pouvez voir que le prix va continuer à augmenter. Ainsi, les conflits sociaux continuent d’être résolus dans un seul sens, malgré les intentions des conservateurs de maintenir le statu quo, et, en tout cas, continue à « évoluer » dans la même direction.
 Mais en 1983, c'était un acte contre-révolutionnaire, dans la mesure où le platonisme était considéré par les déconstructeurs comme le modèle à abattre. Ni Baptiste Rappin, ni son postfacier Pierre Magnard, ni même le préfacier Jean-Jacques Wunenburger ne le signalent (à moins qu'une note m'ait échappé ?) : une annexe du livre de Gilles Deleuze, Logique du sens (éditions de Minuit, 1969) s'intitulait Platon et les simulacres. Il s'agissait de la reprise d'un article au titre original nettement plus virulent, Renverser le platonisme (les simulacres), paru en 1966 dans la Revue de Métaphysique et de Morale. C'est pourtant, de toute évidence, au titre de cette annexe que fait allusion le titre de la thèse de doctorat de Mattéi qui substituait au titre de Deleuze un «Étranger» à la place de Platon : cet Étranger fait bien sûr allusion à celui du Sophiste de Platon, un des dialogues métaphysiques les plus techniques et élevés de Platon. C'est peut-être aussi, et cela Rappin le signale à juste titre, une allusion au roman d'Albert Camus avec qui Mattéi éprouvait une affinité spirituelle en raison de leur communauté d'origine et de formation.
Mais en 1983, c'était un acte contre-révolutionnaire, dans la mesure où le platonisme était considéré par les déconstructeurs comme le modèle à abattre. Ni Baptiste Rappin, ni son postfacier Pierre Magnard, ni même le préfacier Jean-Jacques Wunenburger ne le signalent (à moins qu'une note m'ait échappé ?) : une annexe du livre de Gilles Deleuze, Logique du sens (éditions de Minuit, 1969) s'intitulait Platon et les simulacres. Il s'agissait de la reprise d'un article au titre original nettement plus virulent, Renverser le platonisme (les simulacres), paru en 1966 dans la Revue de Métaphysique et de Morale. C'est pourtant, de toute évidence, au titre de cette annexe que fait allusion le titre de la thèse de doctorat de Mattéi qui substituait au titre de Deleuze un «Étranger» à la place de Platon : cet Étranger fait bien sûr allusion à celui du Sophiste de Platon, un des dialogues métaphysiques les plus techniques et élevés de Platon. C'est peut-être aussi, et cela Rappin le signale à juste titre, une allusion au roman d'Albert Camus avec qui Mattéi éprouvait une affinité spirituelle en raison de leur communauté d'origine et de formation. 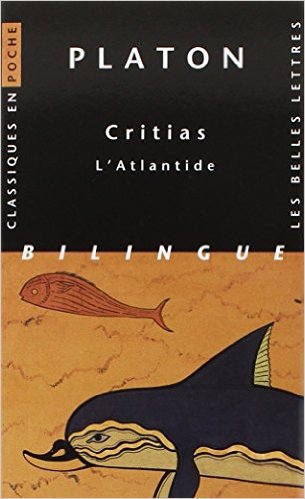 En politique, Mattéi pensa sur le mode platonicien pur et dur, de la fin du XXe siècle à sa mort : il combat dans La Barbarie intérieure – essai sur l'immonde moderne (1999), la subversion sophistique de la contre-culture, de l'art moderne qui nie le rapport au sens ou qui se veut non-sens, du rejet de l'autorité à l'école comme dans la société. Son pythagorisme le pousse même à critiquer sévèrement la musique dodécaphonique : elle est parfois très belle, pourtant, et Platon l'aurait peut-être appréciée... qui sait ? Baptiste Rappin rappelle que Mattéi fut hostile à certaines tendances contemporaines telles que le management ou le transhumanisme. Autant le premier me semble fondamentalement antipathique (3), autant le second me semble intéressant. Ces réserves sont destinées à montrer que la dernière période de la production de Mattéi, bien que cohérente avec sa période purement métaphysique antérieure, s'avère, en fin de compte, aussi peu originale qu'elle. Mais l'originalité étant un concept qui n'appartenait pas à la pensée antique, Mattéi aurait sans doute apprécié, in fine, d'être tenu pour un transmetteur fidèle, poursuivant un combat qu'il n'avait pas initié.
En politique, Mattéi pensa sur le mode platonicien pur et dur, de la fin du XXe siècle à sa mort : il combat dans La Barbarie intérieure – essai sur l'immonde moderne (1999), la subversion sophistique de la contre-culture, de l'art moderne qui nie le rapport au sens ou qui se veut non-sens, du rejet de l'autorité à l'école comme dans la société. Son pythagorisme le pousse même à critiquer sévèrement la musique dodécaphonique : elle est parfois très belle, pourtant, et Platon l'aurait peut-être appréciée... qui sait ? Baptiste Rappin rappelle que Mattéi fut hostile à certaines tendances contemporaines telles que le management ou le transhumanisme. Autant le premier me semble fondamentalement antipathique (3), autant le second me semble intéressant. Ces réserves sont destinées à montrer que la dernière période de la production de Mattéi, bien que cohérente avec sa période purement métaphysique antérieure, s'avère, en fin de compte, aussi peu originale qu'elle. Mais l'originalité étant un concept qui n'appartenait pas à la pensée antique, Mattéi aurait sans doute apprécié, in fine, d'être tenu pour un transmetteur fidèle, poursuivant un combat qu'il n'avait pas initié.
 De Particratie (Aspekt 2016) is een werk van de aanstormende intellectueel Arnout Maat. Vanuit zijn achtergrond in geschiedenis, politicologie en politieke communicatie presenteert hij een relaas over het huidige politieke bestel. De essentie is dat politieke partijen al een eeuw lang een véél grotere rol spelen in de representatieve democratie dan ooit door onze grondwet is bedoeld. “De particratie van binnenuit omvormen to een democratie, zoals D66 ooit poogde te doen, is onmogelijk: alsof men een rijdende auto probeert te repareren”, zo vat Maat zijn relaas op de achterflap samen.
De Particratie (Aspekt 2016) is een werk van de aanstormende intellectueel Arnout Maat. Vanuit zijn achtergrond in geschiedenis, politicologie en politieke communicatie presenteert hij een relaas over het huidige politieke bestel. De essentie is dat politieke partijen al een eeuw lang een véél grotere rol spelen in de representatieve democratie dan ooit door onze grondwet is bedoeld. “De particratie van binnenuit omvormen to een democratie, zoals D66 ooit poogde te doen, is onmogelijk: alsof men een rijdende auto probeert te repareren”, zo vat Maat zijn relaas op de achterflap samen.

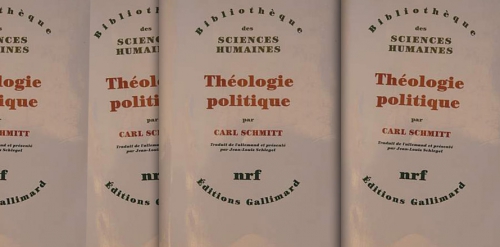
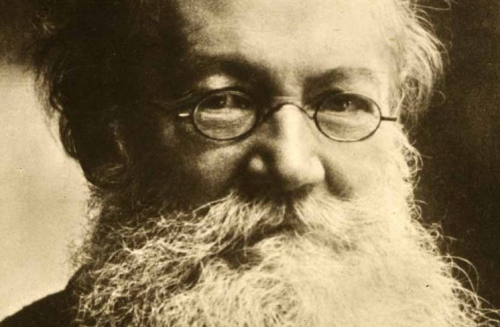

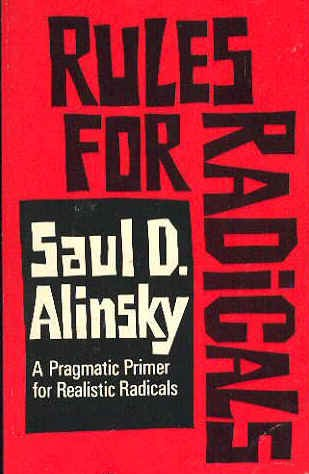
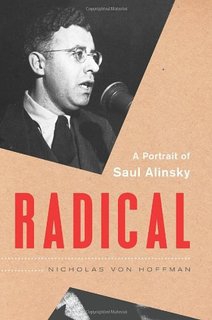 Thus, (((the long march through the institutions))) has a road-map that will take it up the mountain, while pseudo-reactionary Republican stonewalling of issues—for as long as is politically required by their constituents until leftward change is a done deal—leads to nothing. There is a reason why some of Bill Clinton’s campaign speeches from 1996 sound like Donald Trump’s in 2016, and it’s because the left has succeeded into converting many Goldwater-Reagan era Republicans into 1990s’ Democrats. Homosexual marriage will soon be a conservative issue when faced with transgenderism. And the latter will in time be accepted as well on the Beltway right. (((Alinsky’s))) methods move the Overton window; cuckservatives merely follow Overton movements.
Thus, (((the long march through the institutions))) has a road-map that will take it up the mountain, while pseudo-reactionary Republican stonewalling of issues—for as long as is politically required by their constituents until leftward change is a done deal—leads to nothing. There is a reason why some of Bill Clinton’s campaign speeches from 1996 sound like Donald Trump’s in 2016, and it’s because the left has succeeded into converting many Goldwater-Reagan era Republicans into 1990s’ Democrats. Homosexual marriage will soon be a conservative issue when faced with transgenderism. And the latter will in time be accepted as well on the Beltway right. (((Alinsky’s))) methods move the Overton window; cuckservatives merely follow Overton movements.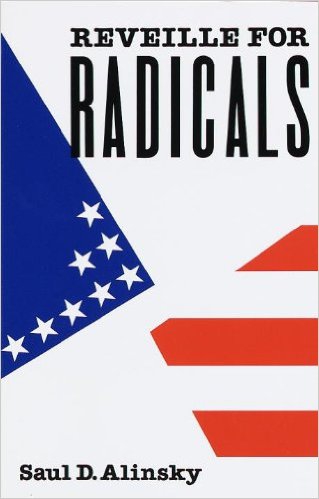 (((Alinsky))) tactics work and continue to work for the left. Whether it’s
(((Alinsky))) tactics work and continue to work for the left. Whether it’s
Was kann eine Revolution entzünden? Um hierauf eine Antwort zu finden, schildert Manuel Ionas das Leben und die Gedankenwelt des russischen Anarchisten Peter Kropotkin.
Das revolutionärste Buch der Bibel ist ihr letztes, die Apokalypse des Johannes. In einer ekstatischen Schau wird der Seher Johannes Zeuge kommender, gigantischer Umstürze, welche die Autorität Gottes gegen alle anderen Autoritäten, allen voran Babylons, der Großen, durchsetzen. Alles Gute kommt von oben, und das Heil arbeitet sich durch ein monumentales Zerstörungswerk an allem Mächtigen und Festgefügten voran.
Bei Peter Kropotkin (1842-1921) und anderen namhaften Anarchisten kommt alles Gute von unten. Kein Gott kümmert sich um die Unterdrückten, kein Herr der Herren oder König der Könige auf Wolken wird es richten, sondern sie, die bis dahin passiv Hinnehmenden tun es selbst. Wollte man die anarchistische Bewegung als kirchliches Mysterienspiel persiflieren, so wäre der berserkernde Wander-Revolutionär Michael Bakunin (1814-1876) Johannes der Täufer, der wohlerzogene Peter Kropotkin wäre Paulus. Und der Heiland?
Der Welterlöser wäre die Revolution. Keine Gestalt, nicht einmal eine Lehre oder ein Dogma, sondern einzig und allein ein Ereignis wurde zum Hoffnungsträger hochstilisiert und messianisch erwartet. Man hat die anarchistische Bewegung gern als religiöses Phänomen gedeutet und (ab)gewertet. Sie galt strengen Kommunisten marxistisch-leninistischer Prägung gleichsam als die pubertäre Phase des Sozialismus. Noch der letzte große, marxistisch orientierte Geschichtsschreiber Eric Hobsbawm bewegte sich ganz in dieser Tradition. Schwer taten sich die Bescheid-Wisser der bolschewistischen Kaderpartei mit dem unbedingten Freiheitsdrang, der vermeintlichen Fortschrittsfeindlichkeit sowie vor allem der konsequenten Anti-Staatlichkeit der sozialistischen Stiefbrüder.
Was aber gerade der Anarchismus, der nie eine einheitliche, geschlossene Bewegung gewesen ist, uns Heutigen in puncto Revolution bzw. Revolutionserwartung zu sagen hat, soll im Fortgang dieses Artikels am Beispiel eines scharfsinnigen Pamphlets Kropotkins aus dem Jahr 1880 vor Augen geführt werden.
Freiwillig in Sibirien: Lehrjahre eines russischen Aristokraten
Der oben gewagte Vergleich Kropotkins mit dem Völkerapostel Paulus erklärt sich aus dem radikalen Bruch mit dem Herkunftsmilieu, den beide vollzogen haben, um allein ihrer Mission gegenüber loyal zu sein. Peter Kropotkin war Spross eines Zweigs der altrussischen Herrscherdynastie der Rurikiden und behielt trotz Bekehrung zum Anarchismus stets die feinen Manieren seiner Klasse bei.
In seiner Haftzeit in der berühmten Peter und Paul Festung erhielt er einmal hohen Besuch vom Bruder Zar Alexander II., Großfürst Nikolai, der mit eigenen Augen sehen wollte, dass ein Mitglied der Aristokratie und ehemaliger Page de Chambre des Zaren tatsächlich als Staatsfeind einsaß. Seine Abstammung sorgte anfangs auch für anhaltendes Misstrauen im sozialrevolutionären Tschaikowski Kreis in St. Petersburg, in den der 30-Jährige 1872 um Aufnahme gebeten hatte. In einem Brief von 1878 wird ihm übellaunig das Fehlen jeder Führungs- und Organisationsfähigkeit attestiert. Ein Fanatiker der Ideen sei er, so lautet das Verdikt eines Kampfgenossen über den ersten umfassenden Theoretiker anarchistischer Ideen.
Doch war Peter Kropotkin keineswegs ein Stubenhocker, der vor der Anschauung in die heile Welt der Theorie floh. Schon in jungen Jahren vollzog er einen Schritt der Emanzipation, der allenthalben für Kopfschütteln gesorgt hatte: 1862 ersuchte er um eine Versetzung in den Stab des Militärgouverneurs von Ost-Sibirien. Es war eine Flucht vor einer Karriere am Hofe des Zaren, zu dem er zuvor noch als Page aufgeblickt hatte, da Alexander II. als Befreier der Bauern galt. Es war aber auch eine Flucht vor dem allmächtigen Vater, der auf seinen Ländereien wie ein Kasernenkommandant regierte, obwohl er nicht einmal zu den grausamsten seiner Klasse gehörte. Bei den Bauern seines Vaters hatte der sensible Junge schon früh den Zusammenhalt und die menschliche Wärme einer unterdrückten Gruppe kennengelernt.
Diese Eindrücke vergaß er nie und nahm sie mit in die Amur-Region. Dort, entrückt von Zivilisation und Hofglanz, vollzog sich seine Bekehrung zu anarchistischen Grundideen. Später wird Kropotkin, der sich in dieser Zeit intensiv mit Geographie und Biologie beschäftigte, immer wieder auf soziale Phänomene in sibirischen Stammesgesellschaften wie auch in der Tierwelt zu sprechen kommen.
Bei den Tschuktschen im fernen Osten formten sich die Eckpfeiler seiner Überzeugungen, wie sie von Anarchisten vertreten wurden. Zu ihnen gehören: Tradition statt Zivilisation, Gemeinschaft statt Staat und Freiheit statt Autorität. Angeleitet vom ähnlich empfindenden Gouverneur, einem Sympathisanten Bakunins, und ergänzt durch Lektüre westlicher Philosophen vollzog sich in Peter Kropotkin die Wandlung zum libertären Revolutionär.
Rechts vor Links oder: Das Volk zuerst
Dass rechts auch da ist, wo der Daumen links ist, trifft bisweilen sogar auf dem Feld des ideologischen Kampfes zu, oftmals zur Überraschung der beteiligten Protagonisten. Nicht erst seit Karl Radeks Schlageter-Rede aus dem Jahr 1923, in welcher der originelle Bolschewik die national empfindenden Massen Deutschlands im Lager der Arbeit und nicht im Lager des Kapitals verortete, kann man bei antistaatlichen Revolutionären Schnittmengen ausmachen.
Und so nimmt es nicht Wunder, dass sich seit dem 19. Jahrhundert in den Chor sozialistisch-libertärer Stimmen auch Rufe nach nationaler Unabhängigkeit mischten. Kein Geringerer als Michael Bakunin war von den Slawophilen beeinflusst und sah, vereint mit allen russischen Revolutionären jeder Couleur, in Preußen-Deutschland das Symbol allen Übels, dessen ein Staat fähig war und dies, obwohl die Prägung durch den deutschen Idealismus auch bei ihm nicht wegzudenken ist.
Peter Kropotkin, dessen ideelle und geographische Wanderschaft ihn Anfang 1872 zur Jura-Föderation der Ersten Internationalen geführt hatte, zu der sich die anti-marxistischen Sozialisten zusammengeschlossen hatten, konnte dem nationalen Aufbegehren ebenfalls Positives abgewinnen.
Im Einklang mit seinen Überzeugungen von notwendiger Abschüttelung aller Autoritäten konnte er etwa 1897 zur angespannten Lage der Balkanvölker schreiben, dass der Befreiungskampf gegen eine auswärtige Tyrannei als Auftakt zur Befreiung von sozialen Tyranneien angesehen werden müsse. Dem Internationalismus erteilte er in einem anderen Schreiben eine Absage, solange nicht jede Nation wirklich unabhängig wäre. Freiheit galt für Individuen, Gruppen sowie für ganze Nationen. Nach anarchistischer Ansicht dürfte nicht einmal der Seele eine Herrschaft über den Körper (und umgekehrt) zugestanden werden. Einem vorauseilenden Kosmopolitismus wurde ebenso eine Absage erteilt, wie dem Imperialismus.
1880 erschien in der Genfer Zeitschrift Le Révolté ein Artikel Kropotkins, der später als Pamphlet in französischer Sprache herauskommen sollte. In ihm wird eine konzise Diagnose einer revolutionären Situation erstellt, die in vielem an unsere aktuelle Befindlichkeit erinnert. Dem naturwissenschaftlich interessierten und bewanderten Autor erscheinen Revolutionen wie Naturgewalten, die periodisch auftreten, alles mit sich reißen und ein neues Gleichgewicht herstellen. Ähnlich einer Krankheit geht ihnen eine Inkubationszeit voraus. In letzterer kommt es nach Kropotkin zu einer Art Umwertung aller bisher gültigen und anerkannten Werte.
Was früher Recht war, stellt sich nun als schreiendes Unrecht heraus. Die Untätigkeit der Regierenden beschleunigt diesen Prozess. Die Spannungen nehmen überall in der Gesellschaft zu und reichen bis in das Innere der Familien. Die soziale Zersplitterung schreitet voran und wird durch eine Ökonomie der fieberhaften Profitmaximierung gesteigert. Die Regierung ist schnell überfordert und wird von den Problemen überholt. Sie funktioniert allenfalls mechanisch und ist nicht einmal mehr in der Lage, offensiv reaktionär zu agieren.
Eine einzige missglückte Unterdrückungsmaßnahme
Jedes Entgegenkommen seitens der Herrschenden ist nun zu spät und stachelt das revolutionäre Fieber eher noch an. Die Massen beginnen, sich ihrer Stärke bewusst zu werden. Die Revolution bricht aus. Zwar glaubt Kropotkin, anders als der Psychologe Gustave Le Bon, dass auch in dieser Phase die meisten Menschen den Stimmen der Mäßigung zugeneigt sind, doch dauert dieses retardierende Moment des Aufruhrs nicht allzu lang. Die warnenden Stimmen nämlich haben seit je her die kleine mutige Elite diskreditiert, die auf dieses Ereignis hingearbeitet hat, ohne dass jemand ernsthaft Notiz nahm.
Nach seiner Meinung genügt in dieser Situation nur eine einzige verunglückte Unterdrückungsmaßnahme seitens der Regierung, um den Revolutionären die Sympathien der Massen zu garantieren. Der Stachel der Revolution bohrt sich nun unaufhaltsam bis in die herrschenden Klassen hinein, deren Einheit nun zerbröckelt. Peter Kropotkin ist davon überzeugt, dass diejenige Partei in einer Revolution Gehör findet, die am meisten und am härtesten für sie gearbeitet hat. Aus ihren Reihen kommen die wenigen Mutigen, die eine Masse von bis dahin Ängstlichen mitreißen können, denn, so sein Credo „Mut, Hingabe und Opferbereitschaft sind ebenso ansteckend, wie die Feigheit“ (Peter Kropotkin „The spirit of revolt“).