

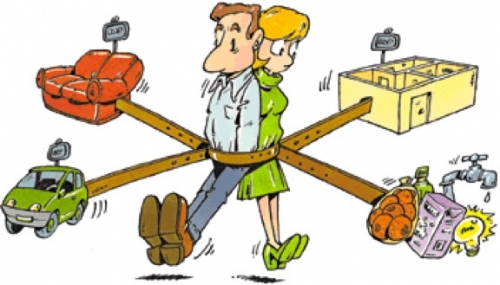
La société occidentale a développé des modèles ou des voies qui conduisent l’homme à s’éloigner des limites imposées par la nature, de la loi divine… ce sont ce que le Pape Jean-Paul II appelait des structures de péché.






En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.



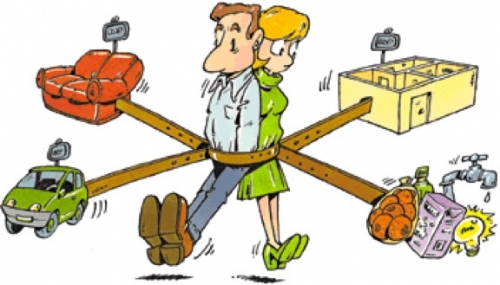






09:34 Publié dans Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : définitions, philosophie, philosophie politique, christianisme, chrétienté, catholicisme, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Guerra, política y partido
“La revolución proletaria no puede triunfar sin un partido, por fuera de un partido, contra un partido o con un sustituto para un partido. Esa es la principal enseñanza de los diez últimos años” (León Trotsky, Lecciones de Octubre).
El desborde ocurrido en las jornadas del 14 y 18 de diciembre ha puesto sobre la mesa la discusión sobre las relaciones entre guerra y política. A pesar de su campaña contra los “violentos”, el único violento fue el gobierno: reprimiendo una concentración de masas sobre el fondo del repudio masivo a la ley antijubilatoria, era inevitable que su acción represiva desatara una dura respuesta de los sectores movilizados.
La “gimnasia” del enfrentamiento a la represión dejó un sinnúmero de enseñanzas. Entre ellas, una central: las relaciones entre lucha política y lucha física: el pasaje de la lucha política a la acción directa.
Esta problemática ha sido abordada por el marxismo sobre todo a partir de la Revolución Rusa. Si bien con antecedentes en los estudios de Marx y Engels, y también los debates en la socialdemocracia alemana (que tuvo como gran protagonista a Rosa Luxemburgo), fueron Lenin y Trotsky los que le dieron vuelo a las investigaciones sobre las relaciones entre ambos órdenes sociales[1].
La fuente básica de los marxistas ha sido siempre Karl von Clausewitz, oficial del ejército prusiano, que a comienzos del siglo XIX y resumiendo la experiencia de los ejércitos napoleónicos, escribió su clásico tratado De la Guerra que hasta hoy expresa uno de los abordajes más profundos de dicho evento.
Clausewitz iniciaba su estudio con una sentencia que rompía con el sentido común de la época, cuando señalaba que la guerra no es una esfera social autónoma sino “la continuidad de la política bajo otras formas”, formas violentas.
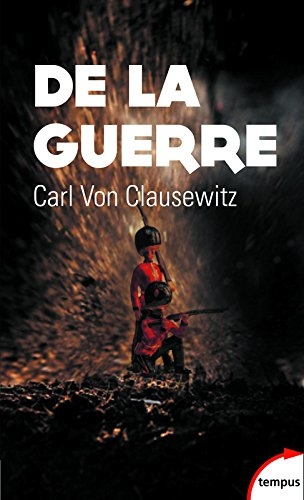 Lenin y Trotsky recuperarían sus definiciones dándoles terrenalidad en la experiencia misma de la revolución: en el evento por antonomasia del pasaje de la política a la lucha física: la ciencia y arte de la insurrección: el momento en que se rompe el continuum de la historia con la intervención de las masas comandadas por el partido revolucionario, que se hacen del poder y cambian la historia.
Lenin y Trotsky recuperarían sus definiciones dándoles terrenalidad en la experiencia misma de la revolución: en el evento por antonomasia del pasaje de la política a la lucha física: la ciencia y arte de la insurrección: el momento en que se rompe el continuum de la historia con la intervención de las masas comandadas por el partido revolucionario, que se hacen del poder y cambian la historia.
Si, en definitiva, la lucha política es una lucha de partidos, la insurrección como evento máximo de traducción de la política al enfrentamiento físico, no tiene otra alternativa que ser comandado por un partido. Volveremos sobre esto.
A la insurrección de Octubre le seguiría la experiencia de Trotsky al frente del Ejército Rojo durante la guerra civil; las enseñanzas desprendidas de dicho evento.
A partir de la experiencia, y de la elaboración teórica desprendida de la misma, se fue forjando un corpus de conceptos, donde un lugar no menor lo ocupan las categorías de estrategia y táctica; la estrategia, que tiene que ver con el conjunto total de los enfrentamientos que llevan al triunfo en la confrontación; la táctica, relacionada con los momentos parciales de dicho enfrentamiento: los momentos específicos donde se pone a prueba la estrategia misma; estrategia que, como decía Clausewitz, debe entrar en el combate con el ejército y corregirse a la luz de sus desarrollos.
De ahí que esta elaboración tenga que ver con el pasaje de la política a la guerra: con aquel momento donde los enfrentamientos se sustancian en el lenguaje de la lucha física; lucha física que, de todas maneras, siempre está comandada por la política: “Bajo el influjo de Sharnhorst, Clausewitz se interesó por la visión histórica de la guerra (…) y llega a la temprana conclusión de que la política es el ‘alma’ de la guerra” (José Fernández Vega, Carl von Clausewitz. Guerra, política y filosofía).
La guerra como continuidad de la política
Desde Clausewitz guerra y política son esferas estrechamente relacionadas. Lenin y Trotsky retomaron esta definición del gran estratega militar alemán de comienzos del siglo XIX. Se apoyaron en Engels, que ya a mediados del siglo XIX le había comentado a Marx el “agudo sentido común” de los escritos de Clausewitz. También Franz Mehring, historiador de la socialdemocracia alemana y uno de los aliados de Rosa Luxemburgo, se había interesado por la historia militar y reivindicaba a Clausewitz.
Por otra parte, hacia finales de la II Guerra Mundial, en el pináculo de su prestigio, Stalin rechazó a Clausewitz con el argumento de que la opinión favorable que tenía Lenin acerca de éste se debía a que “no era especialista en temas militares”…
Pierre Naville señalaría que el Frente Oriental y el triunfo militar del Ejército Rojo sobre la Wehrmacht, había confirmado la tesis contraria: la validez de Clausewitz y lo central de sus intuiciones militares; entre otras, la importancia de las estrategias defensivas en la guerra.
Según su famosa definición, para Clausewitz “la guerra es la continuación de la política por otros medios”. Quedaba así establecida una relación entre guerra y política que el marxismo hizo suya. La guerra es una forma de las relaciones sociales cuya lógica está inscripta en las relaciones entre los Estados, pero que el marxismo ubicó, por carácter transitivo, en la formación de clase de la sociedad. La guerra, decía Clausewitz, debe ser contemplada “como parte de un todo”, y ese todo es la política, cuyo contenido, para el marxismo, es la lucha de clases.

Con agudeza, el teórico militar alemán sostenía que la guerra debía ser vista como un “elemento de la contextura social”, que es otra forma de designar un conflicto de intereses solucionado de manera sangrienta, a diferencia de los demás conflictos.
Esto no quiere decir que la guerra no tenga sus propias especificidades, sus propias leyes, que requieren de un análisis científico de sus determinaciones y características. Desde la Revolución Francesa, pasando por las dos guerras mundiales y las revoluciones del siglo XX, la ciencia y el arte de la guerra se enriquecieron enormemente. Tenemos presentes las guerras bajo el capitalismo industrializado y las sociedades pos-capitalistas como la ex URSS, y el constante revolucionamiento de la ciencia y la técnica guerrera.
Las relaciones entre técnica y guerra son de gran importancia; ya Marx había señalado que muchos desarrollos de las fuerzas productivas ocurren primero en el terreno de la guerra y se generalizan después a la economía civil.
Las dos guerras mundiales fueron subproducto del capitalismo industrial contemporáneo: la puesta en marcha de medios de destrucción masivos, el involucramiento de las grandes masas, la aplicación de los últimos desarrollos de la ciencia y la técnica a la producción industrial y a las estrategias de combate (Traverso).
Esto dio lugar a toda la variedad imaginable en materia de guerra de posiciones y de maniobra: con cambios de frente permanentes y de magnitud, con la aparición de la aviación, los medios acorazados, los submarinos, la guerra química y nuclear y un largo etcétera[2].
Como conclusión, cabe volver a recordar lo señalado por Trotsky a partir de su experiencia en la guerra civil: no hay que atarse rígidamente a ninguna de las formas de la lucha: la ofensiva y la defensa son características que dependen de las circunstancias. Y, en su generalidad, la experiencia de la guerra ha consagrado la vigencia de las enseñanzas de Clausewitz, que merecen un estudio profundo por parte de la nueva generación militante.
La política como “guerra de clases”
Ahora bien, si la guerra es la continuidad de la política por otros medios, a esta fórmula le cabe cierta reversibilidad: “Si la guerra puede ser definida como la continuidad de la política por otros medios, [la política] deviene, recíprocamente, la continuidad de la guerra fuera de sus límites por sus propios medios. Ella también es un arte del tiempo quebrado, de la coyuntura, del momento propicio para arribar a tiempo ‘al centro de la ocasión” (Bensaïd, La política como arte estratégico).
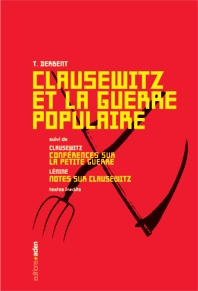 De ahí que muchos de los conceptos de la guerra se vean aplicados a la política, ya que ésta es, como la guerra, un campo para hacer valer determinadas relaciones de fuerza. Sin duda, las relaciones de fuerza políticas se hacen valer mediante un complejo de relaciones mayor y más rico que el de la violencia desnuda, pero en el fondo en el terreno político también se trata de vencer la resistencia del oponente.
De ahí que muchos de los conceptos de la guerra se vean aplicados a la política, ya que ésta es, como la guerra, un campo para hacer valer determinadas relaciones de fuerza. Sin duda, las relaciones de fuerza políticas se hacen valer mediante un complejo de relaciones mayor y más rico que el de la violencia desnuda, pero en el fondo en el terreno político también se trata de vencer la resistencia del oponente.
En todo caso, la política como arte ofrece más pliegues, sutilezas y complejidades que la guerra, como señalaría Trotsky, que agregaba que la guerra (y ni hablar cuando se trata de la guerra civil, su forma más cruenta), debe ser peleada ajustándose a sus propias leyes, so pena de sucumbir: “Clausewitz se opone a las concepciones absolutistas de la guerra [que la veían como una suerte de ceremonia y de juego] y enfatiza el ‘elemento brutal’ que toda guerra contiene” (Vega, ídem).
De allí que se pueda definir a la política (metafóricamente) como continuidad de la “guerra” que cotidianamente se sustancia entre las clases sociales explotada y explotadora. Así, la política es una manifestación de la guerra de clases que recorre la realidad social bajo la explotación capitalista. Esta figura puede ayudar a apreciar la densidad de lo que está en juego, superando la mirada a veces ingenua de las nuevas generaciones.
Nada de esto significa que tengamos una concepción militarista de las cosas. Todo lo contrario: el militarismo es una concepción reduccionista que pierde de vista el espesor de la política revolucionaria, y que deja de lado a las grandes masas, reemplazadas por la técnica y el herramental de guerra, a la hora de los eventos históricos.
Es característico del militarismo hacer primar la guerra sobre la política, algo común tanto a las políticas de las potencias imperialistas como a las formaciones guerrilleras pequeño-burguesas de los años 70: perdían de vista a las grandes masas como actores y protagonistas de la historia.
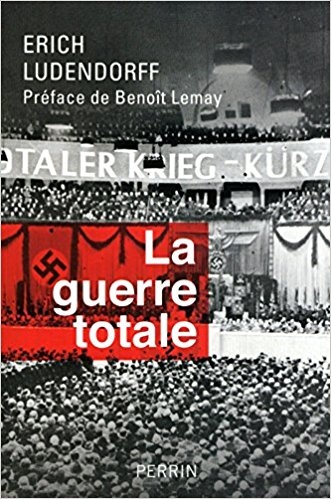 Tal era la posición del general alemán de la I Guerra Mundial, Erich von Ludendorff, autor de la obra La guerra total (1935), donde criticaba a Clausewitz desde una posición reduccionista que ponía en el centro de las determinaciones a la categoría de “guerra total”, a la que independizaba de la política negando el concepto clausewitziano de “guerra absoluta”, que necesariamente se ve limitado por las determinaciones políticas.
Tal era la posición del general alemán de la I Guerra Mundial, Erich von Ludendorff, autor de la obra La guerra total (1935), donde criticaba a Clausewitz desde una posición reduccionista que ponía en el centro de las determinaciones a la categoría de “guerra total”, a la que independizaba de la política negando el concepto clausewitziano de “guerra absoluta”, que necesariamente se ve limitado por las determinaciones políticas.
A su modo de ver De la guerra era “el resultado de una evolución histórica hoy anacrónica y desde todo punto de vista sobrepasada” (Darío de Benedetti, ídem).
Para Ludendorff y los teóricos del nazismo, lo “originario” era el “estado de guerra permanente”; la política, solamente uno de sus instrumentos. De ahí que se considerara la paz simplemente como “un momento transitorio entre dos guerras”.
En esa apelación a la “guerra total” las masas, el Volk, eran vistas como un instrumento pasivo: pura carne de cañón en la contienda: “Ludendorff olvida el factor humano, las fuerzas morales según Clausewitz, como factor decisivo de toda movilización (…) [apela a] un verdadero proceso de cosificación, que permite una total disposición de medios para su alcance” (de Benedetti, ídem).
Pero lo cierto es lo contrario: si la guerra no es más que la continuidad de la política por medios violentos, es la segunda la que fija los objetivos de la primera: “En el siglo XVIII aún predominaba la concepción primitiva según la cual la guerra es algo independiente, sin vinculación alguna con la política, e, inclusive, se concebía la guerra como lo primario, considerando la política más bien como un medio de la guerra; tal es el caso de un estadista y jefe de campo como fue el rey Federico II de Prusia. Y en lo que se refiere a los epígonos del militarismo alemán, los Ludendorff y Hitler, con su concepción de la ‘guerra total’, simplemente invirtieron la teoría de Clausewitz en su contrario antagónico” (AAVV, Clausewitz en el pensamiento marxista).
Con esta suerte de “analogía” entre la política y la guerra lo que buscamos es dar cuenta de la íntima conflictividad de la acción política; superar toda visión ingenua o parlamentarista de la misma. La política es un terreno de disputa excluyente donde se afirman los intereses de la burguesía o de la clase obrera. No hay conciliación posible entre las clases en sentido último; esto le confiere todos los rasgos de guerra implacable a la lucha política.
La política revolucionaria, no la reformista u electoralista, tiene esa base material: la oposición irreconciliable entre las clases, como destacara Lenin. Lo que no obsta para que los revolucionarios tengamos la obligación de utilizar la palestra parlamentaria, hacer concesiones y pactar compromisos.
Pero la utilización del parlamento, o el uso de las maniobras, debe estar presidida por una concepción clara acerca de ese carácter irreconciliable de los intereses de clase, so pena de una visión edulcorada de la política, emparentada no con las experiencias de las grandes revoluciones históricas, sino con los tiempos posmodernos y “destilados” de la democracia burguesa y el “fin de la historia” que, como señalara Bensaïd, pretenden reducir a cero la idea misma de estrategia.

Crítica del militarismo
El criterio principista de tipo estratégico que preside al marxismo revolucionario es que todas las tácticas y estrategias deben estar al servicio de la autodeterminación revolucionaria de la clase obrera, de su emancipación. Sobre la base de las lecciones del siglo XX, debe ser condenado el sustituismo social de la clase obrera como estrategia y método para lograr los objetivos emancipatorios del proletariado.
El sustituismo como estrategia, simplemente, no es admisible para los socialistas revolucionarios. Toda la experiencia del siglo XX atestigua que si no está presente la clase obrera, su vanguardia, sus organismos de lucha y poder, sus programas y partidos, si no es la clase obrera con sus organizaciones la que toma el poder, la revolución no puede progresar de manera socialista: queda congelada en el estadio de la estatización de los medios de producción, lo que, a la postre, no sirve a los objetivos de la acumulación socialista sino de la burocracia.
Un ejemplo vivido por los bolcheviques a comienzos de 1920 fue la respuesta al ataque desde Polonia decidida por el dictador Pilsudsky en el marco de la guerra civil, ataque que desató una contraofensiva del Ejército Rojo que atravesó la frontera rusa y llegó hasta Varsovia. Durante unas semanas dominó el entusiasmo que “desde arriba”, militarmente, se podía extender la revolución. Uno de los principales actores de este empuje fue el talentoso y joven general Tujachevsky (asesinado por Stalin en las purgas de los años 30[3]).
Esta acción fue explotada por la dictadura polaca de Pilsudsky como “un avasallamiento de los derechos nacionales polacos”, y no logró ganar el favor de las masas obreras y mucho menos campesinas, por lo que terminó en un redondo fracaso.

Trotsky, que con buen tino se había opuesto a la misma[4], sacó la conclusión que una intervención militar en un país extranjero desde un Estado obrero, puede ser un punto de apoyo secundario y/o auxiliar en un proceso revolucionario, nunca la herramienta fundamental: “En la gran guerra de clases actual la intervención militar desde afuera puede cumplir un papel concomitante, cooperativo, secundario. La intervención militar puede acelerar el desenlace y hacer más fácil la victoria, pero sólo cuando las condiciones sociales y la conciencia política están maduras para la revolución. La intervención militar tiene el mismo efecto que los fórceps de un médico; si se usan en el momento indicado, pueden acortar los dolores del parto, pero si se usan en forma prematura, simplemente provocarán un aborto” (en E. Wollenberg, El Ejército Rojo, p. 103).
De ahí que toda la política, la estrategia y las tácticas de los revolucionarios deban estar al servicio de la organización, politización y elevación de la clase obrera a clase dominante; que no sea admisible su sustitución a la hora de la revolución social por otras capas explotadas y oprimidas aparatos políticos y/o militares ajenos a la clase obrera misma (otra cosa son las alianzas de clases explotadas y oprimidas imprescindibles para tal empresa).
El criterio de la autodeterminación y centralidad de la clase obrera en la revolución social, es un principio innegociable. Y no sólo es un principio: hace a la estrategia misma de los socialistas revolucionarios en su acción.
Otra cosa es que las relaciones entre masas, partidos y vanguardia sean complejas, no admitan mecanicismos. Habitualmente los factores activos son la amplia vanguardia y las corrientes políticas, mientras que las grandes masas se mantienen pasivas y sólo entran en liza cuando se producen grandes conmociones, algo que, como decía Trotsky, era signo inequívoco de toda verdadera revolución.
Ocurre una inevitable dialéctica de sectores adelantados y atrasados en el seno de la clase obrera a la hora de la acción política; no se debe buscar el “mínimo común denominador” adaptándose a los sectores atrasados sino, por el contrario, ganar la confianza de los sectores más avanzados para empujar juntos a los más atrasados.
Incluso más: puede haber circunstancias de descenso en las luchas del proletariado y el partido -más aún si está en el poder- verse obligado a ser una suerte de nexo o “puente” entre el momento actual de pasividad y un eventual resurgimiento de las luchas en un período próximo. No tendrá otra alternativa que “sustituir”, transitoriamente, la acción de la clase obrera en defensa de sus intereses inmediatos e históricos.

Algo de esto afirmaba Trotsky que le había ocurrido al bolchevismo a comienzos de los años 20, luego de que la clase obrera y las masas quedaran exhaustas a la salida de la guerra civil[5]. Pero el criterio es que aun “sustituyéndola”, se deben defender los intereses inmediatos e históricos de la clase obrera. Y esta “sustitución” sólo puede ser una situación transitoria impuesta por las circunstancias, so pena de transformarse en otra cosa[6].
Ya la teorización del sustituismo social de la clase obrera en la revolución socialista pone las cosas en otro plano: es una justificación de la acción de una dirección burocrática y/o pequeñoburguesa que, si bien puede terminar yendo más lejos de lo que ella preveía en el camino del anticapitalismo, nunca podrá sustituir a la clase obrera al frente del poder. Porque esto amenaza que se terminen imponiendo los intereses de una burocracia y no los de la clase obrera (como ocurrió en el siglo XX).
Quebrar el movimiento inercial
De lo anterior se desprende otra cuestión: la apelación a los métodos de lucha de la clase obrera en contra del terrorismo individual o de las minorías que empuñan las armas en “representación” del conjunto de los explotados y oprimidos.
En el siglo pasado han habido muchas experiencias: el caso de las formaciones guerrilleras latinoamericanas, y del propio Che Guevara, que excluían por definición los métodos de lucha de masas en beneficio de los “cojones”: una “herramienta central” de la revolución, porque la clase obrera estaba, supuestamente, “aburguesada”…
Un caso similar fue el del PCCh bajo Mao. La pelea contra el sustituismo social de la clase obrera tiene que ver con que los revolucionarios no “inventamos nada”: no creamos artificialmente los métodos de pelea y los organismos de lucha y poder. Más bien ocurre lo contrario: buscamos hacer consciente su acción, generalizar esas experiencias e incorporarlas al acervo de enseñanzas de la clase obrera.
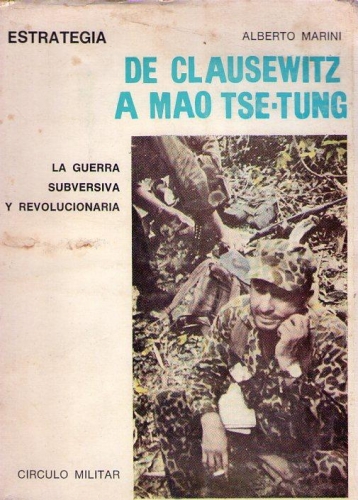 Esta era una preocupación característica de Rosa Luxemburgo, que insistía en la necesidad de aprender de la experiencia real de la clase obrera, contra el conservadurismo pedante y de aparato de la vieja socialdemocracia.
Esta era una preocupación característica de Rosa Luxemburgo, que insistía en la necesidad de aprender de la experiencia real de la clase obrera, contra el conservadurismo pedante y de aparato de la vieja socialdemocracia.
Vale destacar también la ubicación de Lenin frente al surgimiento de los soviets en 1905. Los “bolcheviques de comité”, demasiado habituados a prácticas sectarias y conservadoras, se negaban a entrar en el Soviet de Petrogrado porque éste “no se declaraba bolchevique”… Lenin insistía que la orientación debía ser “Soviets y partido”, no contraponer de manera pedante y ultimatista, unos y otros.
Sobre la cuestión del armamento popular rechazamos las formaciones militares que actúan en sustitución de la clase obrera, así como el terrorismo individual, y por las mismas razones. Pero debemos dejar a salvo no sólo la formación de ejércitos revolucionarios como el Ejército Rojo, evidentemente, también experiencias como la formación de milicias obreras y populares o las dependientes de las organizaciones revolucionarias.
Este último fue el caso del POUM y los anarquistas en la Guerra Civil española, más allá del centrismo u oportunismo de su política. Y podrían darse circunstancias similares en el futuro que puedan ser englobadas bajo la orientación del armamento popular.
Agreguemos algo más vinculado a la guerra de guerrillas. En Latinoamérica, en la década del 70, las formaciones foquistas o guerrilleras, rurales o urbanas, reemplazaban con sus “acciones” la lucha política revolucionaria (las acciones de masas y la construcción de partidos de la clase obrera).
Sin embargo, este rechazo a la guerra de guerrillas como estrategia política, no significa descartarla como táctica militar. Si es verdad que se trata de un método de lucha habitualmente vinculado a sectores provenientes del campesinado (o de sectores más o menos “desclasados”), bajo condiciones extremas de ocupación militar del país por fuerzas imperialistas, no se debe descartar la eventualidad de poner en pie formaciones de este tipo íntimamente vinculadas a la clase trabajadora. Esto con un carácter de fuerza auxiliar similar a una suerte de milicia obrera, y siempre subordinada al método de lucha principal, que es la lucha de masas[7].
Pasemos ahora a las alianzas de clases y la hegemonía que debe alcanzar la clase obrera a la hora de la revolución. Si la centralidad social en la revolución corresponde a la clase obrera, ésta debe tender puentes hacia el resto de los sectores explotados y oprimidos.
Para que la revolución triunfe, debe transformarse en una abrumadora mayoría social. Y esto se logra cuando la clase obrera logra elevarse a los intereses generales y a tomar en sus manos las necesidades de los demás sectores explotados y oprimidos.
Es aquí donde el concepto de alianza de clases explotadas y oprimidas se transforma en uno análogo: hegemonía. La hegemonía de la clase obrera a la hora de la revolución socialista corresponde al convencimiento de los sectores más atrasados, de las capas medias, del campesinado, de que la salida a la crisis de la sociedad ya no puede provenir de la mano de la burguesía, sino solamente del proletariado.
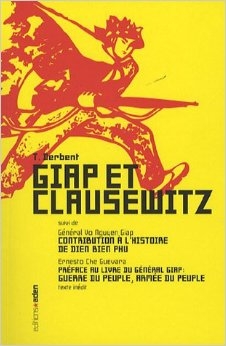 Este problema es clásico a toda gran revolución. Si la Revolución Francesa de 1789 logró triunfar es porque desde su centro excluyente, París, logró arrastrar tras de sí al resto del país. Algo que no consiguió la Comuna de París cien años después, lo que determinó su derrota. El mismo déficit tuvo el levantamiento espartaquista de enero de 1919 en Alemania, derrotado a sangre y fuego porque el interior campesino y pequeño-burgués no logró ser arrastrado. Multitudinarias movilizaciones ocurrían en Berlín enfervorizando a sus dirigentes (sobre todo a Karl Liebknecht; Rosa era consciente de que se iba al desastre), mientras que en el interior el ejército alemán se iba reforzando y fortaleciendo con el apoyo del campesinado y demás sectores conservadores.
Este problema es clásico a toda gran revolución. Si la Revolución Francesa de 1789 logró triunfar es porque desde su centro excluyente, París, logró arrastrar tras de sí al resto del país. Algo que no consiguió la Comuna de París cien años después, lo que determinó su derrota. El mismo déficit tuvo el levantamiento espartaquista de enero de 1919 en Alemania, derrotado a sangre y fuego porque el interior campesino y pequeño-burgués no logró ser arrastrado. Multitudinarias movilizaciones ocurrían en Berlín enfervorizando a sus dirigentes (sobre todo a Karl Liebknecht; Rosa era consciente de que se iba al desastre), mientras que en el interior el ejército alemán se iba reforzando y fortaleciendo con el apoyo del campesinado y demás sectores conservadores.
Precisamente en esa apreciación fundaba Lenin la ciencia y el arte de la insurrección: en una previsión que debía responder a un análisis lo más científico posible, pero también a elementos intuitivos, acerca de qué pasaría una vez que el proletariado se levantase en las ciudades.
El proletariado se pone de pie y toma el poder en la ciudad capital. Pero la clave de la insurrección, y la revolución misma, reside en si logra arrastrar activamente o, al menos, logra un apoyo pasivo, tácito, o incluso la “neutralidad amistosa” (Trotsky), de las otras clases explotadas y oprimidas en el interior.
De ahí que alianza de clases, hegemonía y ciencia y arte de la insurrección tengan un punto de encuentro en el logro de la mayoría social de la clase obrera a la hora de la toma del poder.
Una apreciación que requerirá de todas las capacidades de la organización revolucionaria en el momento decisivo, y que es la mayor prueba a la que se puede ver sometido un partido digno de tal nombre: “Todas estas cartas [se refiere a las cartas de Lenin a finales de septiembre y comienzos de octubre de 1917], donde cada frase estaba forjada sobre el yunque de la revolución, presentan un interés excepcional para caracterizar a Lenin y apreciar el momento. Las inspira el sentimiento de indignación contra la actitud fatalista, expectante, socialdemócrata, menchevique hacia la revolución, que era considerada como una especie de película sin fin. Si en general el tiempo es un factor importante de la política, su importancia se centuplica en la época de guerra y de revolución. No es seguro que se pueda hacer mañana lo que puede hacerse hoy (…).
“Pero tomar el poder supone modificar el curso de la historia. ¿Es posible que tamaño acontecimiento deba depender de un intervalo de veinticuatro horas? Claro que sí. Cuando se trata de la insurrección armada, los acontecimientos no se miden por el kilómetro de la política, sino por el metro de la guerra. Dejar pasar algunas semanas, algunos días; a veces un solo día sin más, equivale, en ciertas condiciones, a la rendición de la revolución, a la capitulación (…).
“Desde el momento en que el partido empuja a los trabajadores por la vía de la insurrección, debe extraer de su acto todas las consecuencias necesarias. À la guerre comme à la guerre [en la guerra como en la guerra]. Bajo sus condiciones, más que en ninguna otra parte, no se pueden tolerar las vacilaciones y las demoras. Todos los plazos son cortos. Al perder tiempo, aunque no sea más que por unas horas, se le devuelve a las clases dirigentes algo de confianza en sí mismas y se les quita a los insurrectos una parte de su seguridad, pues esta confianza, esta seguridad, determina la correlación de fuerzas que decide el resultado de la insurrección” (Trotsky, Lecciones de Octubre).
El partido como factor decisivo de las relaciones de fuerzas
Veremos someramente ahora el problema del partido como factor organizador permanente y como factor esencial de la insurrección.
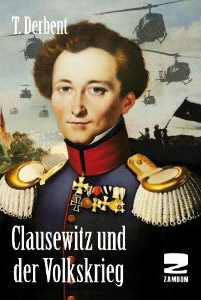 El partido no agrupa a los trabajadores por su condición de tales sino solamente aquéllos que han avanzado a la comprensión de que la solución a los problemas pasa por la revolución socialista: el partido agrupa a los revolucionarios y no a los trabajadores en general (cuya abrumadora mayoría es de ideología burguesa, reformista y no revolucionaria).
El partido no agrupa a los trabajadores por su condición de tales sino solamente aquéllos que han avanzado a la comprensión de que la solución a los problemas pasa por la revolución socialista: el partido agrupa a los revolucionarios y no a los trabajadores en general (cuya abrumadora mayoría es de ideología burguesa, reformista y no revolucionaria).
Quienes se agrupan bajo un mismo programa constituyen un partido. Pero si sus militantes no construyen el partido, no lo construye nadie: el partido es lo menos objetivo y espontáneo que hay respecto de las formas de la organización obrera: requiere de un esfuerzo consciente y adicional, con leyes propias.
Un problema muy importante es el de la combinación de los intereses del movimiento en general y los del partido en particular a la hora de la intervención política. Un error habitual es sacrificar unos en el altar de los otros.
En el caso de las tendencias más burocráticas, lo que se sacrifica son los intereses generales de los trabajadores en función de los del propio aparato. Ya Marx sostenía que los comunistas sólo se caracterizaban por ser los que, en cada caso, hacían valer los intereses generales del movimiento.
Pero es también una concepción falsa creer que los intereses del partido nunca valen; que sólo vale el interés “general”, sacrificando ingenuamente los intereses del propio partido.
Así se hace imposible construir el partido, cuya mecánica de construcción es la menos “natural”. Precisamente por esto hay que aprender a sostener ambos intereses: las condiciones generales de la lucha y la construcción del partido a partir de ellas. Además, hay que saber evaluar qué interés es el que está en juego en cada caso. Nunca se puede correr detrás de toda lucha, de todo acontecimiento; no hay partido que lo pueda hacer.
Pero cuando se trata de organizaciones de vanguardia, hay que elegir. Hay que jerarquizar considerando el peso del hecho objetivo, y también las posibilidades del partido de responder y construirse en esa experiencia.
Esto significa que no siempre la agenda partidaria se ordena alrededor de la agenda “objetiva” de la realidad. Hay que considerar la agenda de la propia organización a la hora de construirse, sus propias iniciativas: “La observación más importante que se puede hacer a propósito de todo análisis concreto de la correlación de fuerzas es que estos análisis no pueden ni deben ser análisis en sí mismos (a menos que se escriba un capítulo de historia del pasado), sino que sólo adquieren significado si sirven para justificar una actividad práctica, una iniciativa de voluntad. Muestran cuáles son los puntos de menor resistencia donde puede aplicarse con mayor fruto la fuerza de la voluntad; sugieren las operaciones tácticas inmediatas; indican cómo se puede plantear mejor una campaña de agitación política, qué lenguaje entenderán mejor las multitudes, etc. El elemento decisivo de toda situación es la fuerza permanentemente organizada y dispuesta desde hace tiempo, que se puede hacer avanzar cuando se considera que una situación es favorable (y sólo es favorable en la medida en que esta fuerza existe y está llena de ardor combativo); por esto, la tarea esencial es la de procurar sistemática y pacientemente formar, desarrollar, hacer cada vez más homogénea, más compacta y más consciente de sí misma esta fuerza [es decir, el partido]” (Gramsci, La política y el Estado moderno, pp. 116-7).
En síntesis: el análisis de la correlación de fuerzas sería “muerto”, pedante, pasivo, si no tomara en consideración que el partido es, debe ser, un factor fundamental en dicha correlación de fuerzas; el factor que puede terminar inclinando la balanza; el que munido de una política correcta, y apoyándose en un determinado “paralelogramo de fuerzas”, puede mover montañas.
La figura del “paralelogramo de fuerzas” nos fue sugerida por la carta de Engels a José Bloch (1890). Engels colocaba dicho paralelogramo como subproducto de determinaciones puramente “objetivas”. Sin embargo, a la cabeza de dicho “paralelogramo” se puede y debe colocar el partido para irrumpir en la historia: romper la inercia con el plus “subjetivo” que añade el partido: “(…) la historia se hace de tal modo, que el resultado final siempre deriva de los conflictos entre muchas voluntades individuales, cada una de las cuales, a su vez, es lo que es por efecto de una multitud de condiciones especiales de vida; son, pues, innumerables fuerzas que se entrecruzan las unas con las otras, un grupo infinito de paralelogramos de fuerzas, de las que surge una resultante -el acontecimiento histórico- (…)”.
El partido que sepa colocarse a la cabeza de dicho “paralelogramo”, que haya logrado construirse, que sepa hacer pesar fuerzas materiales en dicho punto decisivo, podrá mover montañas: romper el círculo infernal del “eterno retorno de lo mismo” abriendo una nueva historia.
Bibliografía
AAVV, Clausewitz en el pensamiento marxista, Pasado y Presente.
Darío de Benedetti, La teoría militar entre la Kriegsideologie y el Modernismo Reaccionario, Cuadernos de Marte, mayo 2010.
Daniel Bensaïd, La politique comme art stratégique, Archives personnelles, Âout 2007, npa2009.org.
Antonio Gramsci, La política y el Estado moderno, Planeta-Agostini, Barcelona, 1985.
León Trotsky, Lecciones de Octubre, Kislovodsk, 15 de septiembre de 1924, Marxist Internet Archive.
José Fernández Vega, Carl von Clausewitz. Guerra, política y filosofía, Editorial Almagesto, Buenos Aires, 1993.
[1] De Lenin se conoce un cuaderno de comentarios sobre De la Guerra; Trotsky “mechó” muchas de sus reflexiones estratégicas con referencias al teórico alemán, amén de tener sus propios Escritos militares.
[2] Ver nuestro texto Causas y consecuencias del triunfo de la URSS sobre el nazismo, en www.socialismo-o-barbarie.org.
[3] Tujachevsky estaba enrolado en la fallida “teoría de la ofensiva”. Trotsky estaba en contra de la misma: la condenaba por rígida, militarista y ultraizquierdista. Ver las Antinomias de Antonio Gramsci (un valioso texto del marxista inglés Perry Anderson de los años 70).
[4] En este caso se dio una sorprendente “inversión” (en relación a los errores) bajo el poder bolchevique: en general, fue Lenin el que dio en la tecla en las disputas con Trotsky. Pero en este caso las cosas se dieron invertidas: mientras Lenin se arremolinaba entusiasta sobre los mapas siguiendo la ofensiva, Trotsky manifestaba sus reservas.
[5] Ver al respecto nuestros textos sobre el bolchevismo en el poder.
[6] Ver al respecto El último combate de Lenin de Moshe Lewin.
[7] En todo caso, el siglo XX ha dado lugar a un sinnúmero de ricas experiencias militares en el terreno de la revolución, las que requieren de un estudio ulterior.
00:23 Publié dans Histoire, Militaria, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marxisme, marxisme révolutionnaire, clausewitz, guerre, guerre révolutionnaire, allemagne, prusse, histoire, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
15:08 Publié dans Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : utilitarisme, philosophie politique, philosophie, théorie politique, yvan blot, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
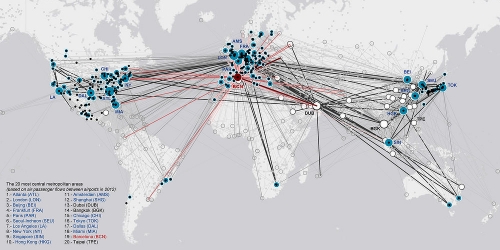
Multipolarity and polycentricity
Ex: https://www.geopolitica.ru
The very term “multipolarity” is of American (Anglo-Saxon) origin, and in the third chapter we examined similar concepts that have been developed in other countries. As various scholars have indicated, varying interpretations of multipolarity have provoked certain conceptual dilemmas. For instance, a report on long-term global trends prepared by the Zurich Center for Security Studies in 2012 noted that:
The advantage of ‘multipolarity’ is that it accounts for the ongoing diffusion of power that extends beyond uni-, bi-, or- tripolarity. But the problem with the term is that it suggests a degree of autonomy and separateness of each ‘pole’ that fails to do justice to the interconnections and complexities of a globalised world. The term also conceals that rising powers are still willing to work within the Westernshaped world economic system, at least to some extent. This is why the current state of play may be better described as ‘polycentric’. Unlike ‘multipolarity’, the notion of ‘polycentricism’ says nothing about how the different centres of power relate to each other. Just as importantly, it does not elicit connotations with the famous but ill-fated multipolar system in Europe prior to 1914 that initially provided for regular great power consultation, but eventually ended in all-out war. The prospects for stable order and effective global governance are not good today. Yet, military confrontation between the great powers is not a likely scenario either, as the emerging polycentric system is tied together in ways that render a degree of international cooperation all but indispensable.
The Swiss scholars involved in this summation approached the issue from the standpoint of reviewing security issues in a globalized world and tried to find an adequate expression for contemporary trends. However, there also exist purely technical approaches and ideological theories which employ the term “polycentric”.
The concept of “polycentricity” had been used before to describe the functioning of complex economic subjects. Accordingly, if management theories are springboards for geopolitical practice, then this model’s basic elaborations already exist. In a literal sense, the term “polycentric” suggests some kind of spatial unit with several centers. However, the term does not specify what kind of centers are in question, hence the obvious need to review various concepts and starting points before discussing polycentrism.
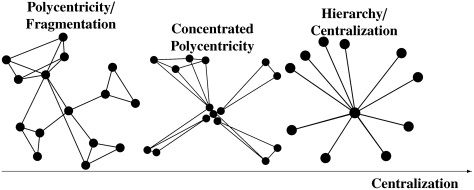
Four levels of this concept can be discussed in the context of political-administrative approaches. The analytical-descriptive level is needed for describing, measuring, and characterizing the current state of a spatial object by means of precisely determining how long a country or capital can be “polycentric.” Secondly, this concept can be understood in a normative sense which might help, for example, in reorganizing the spatial configuration of an object, i.e., either to promote/create polycentrism or support/utilize an existing polycentric structure. Thirdly, when it comes to spatial entities, it is necessary to specify their spatial scale, i.e., at the city level, city-region, mega-regional level, or even on the national or transnational levels. Upon closer examination, the concept of polycentrism concept thus challenges our understanding of centers in urban areas, since such can concern either their roles and functional ties (relations) or their concrete morphological forms (the structure of urban fabric). This differentiation between the functional and morphological understandings of polycentrism constitutes the fourth dimension.
In the contemporary situation which features the presence of city-states and megalopoli that can easily compete with some states in the classical understanding in the most varied criteria (number of residents and their ethnic identity, length of external borders, domestic GDP, taxes, industry, transport hubs, etc.), such an approach seems wholly appropriate for more articulated geopolitical analysis. Moreover, in the framework of federal models of state governance, polycentrism serves as a marker of complex relations between all administrative centers. Regional cooperation also fits into this model since it allows subjects to “escape” mandatory compliance with a single regulator, such as in the face of a political capital, and cooperate with other subjects (including foreign ones) within a certain space.
To some extent, the idea of polycentrism is reflected in offshore zones as well. While offshores can act as “black holes” for the economies of sovereign states, on the other hand, they can also be free economic zones removing various trade barriers clearly within the framework of the operator’s economic sovereignty.
It should also be noted that the theory of polycentrism is also well known in the form of the ideological contribution of the Italian community Palmiro Togliatti as an understanding of the relative characteristics of the working conditions facing communist parties in different countries following the de-Stalinization process in the Soviet Union in 1956. What if one were to apply such an analysis to other parties and movements? For example, in comparing Eurosceptics in the EU and the conglomerate of movements in African and Asian countries associated with Islam? Another fruitful endeavor from this perspective could be evaluating illiberal democracies and populist regimes in various parties of the world as well as monarchical regimes, a great variety of which still exist ranging from the United Kingdom’s constitutional monarchy to the hereditary autocracy of Saudi Arabia which appeared relatively recently compared to other dynastic forms of rule. Let us also note that since Togliatti the term “polycentrism” has become popular in political science, urban planning, logistics, sociology, and as an expression for unity in diversity.

In 1969, international relations and globalization expert Howard V. Perlmutter proposed the conceptual model of EPG, or Ethnocentrism-Polycentrism-Geocentrism, which he subsequently expanded with his colleague David A Heenan to include Regionalism. This model, famously known by the acronym EPRG, remains essential in international management and human resources. This theory posits that polycentrism, unlike ethnocentrism, regionalism, and geocentrism, is based on political orientation, albeit through the prism of controlling commodity-monetary flows, human resources, and labor. In this case, polycentrism can be defined as a host country’s orientation reflecting goals and objectives in relation to various management strategies and planning procedures in international operations. In this approach, polycentrism is in one way or another connected to issues of management and control.
However, insofar as forms of political control can differ, this inevitably leads to the understanding of a multiplicity of political systems and automatically rejects the monopoly of liberal parliamentarism imposed by the West as the only acceptable political system. Extending this approach, we can see that the notion of polycentrism, in addition to connoting management, is contiguous to theories of law, state governance, and administration. Canada for instance has included polycentricity in its administrative law and specifically refers to a “polycentric issue” as “one which involves a large number of interlocking and interacting interests and considerations.” For example, one of Canada’s official documents reads: “While judicial procedure is premised on a bipolar opposition of parties, interests, and factual discovery, some problems require the consideration of numerous interests simultaneously, and the promulgation of solutions which concurrently balance benefits and costs for many different parties. Where an administrative structure more closely resembles this model, courts will exercise restraint.”
Polycentric law became world-famous thanks to Professor Tom Bell who, as a student at the University of Chicago’s law faculty, wrote a book entitled Polycentric Law in which he noted that other authors use phrases such as “de-monopolized law” to describe polycentric alternatives.
Bell outlined traditional customary law (also known as consolamentum law) before the establishment of states and in accordance with the works of Friedrich A. Hayek, Bruce L. Benson, and David D. Friedman. Bell mentioned the customary law of the Anglo-Saxons, ecclesiastical law, guild law, and trade law as examples of polycentric law. On this note, he suggests that customary and statutory law have co-existed throughout history, an example being Roman law being applied to Romans throughout the Roman Empire at the same time as indigenous peoples’ legal systems remained permitted for non-Romans.

Polycentric theory has also attracted the interest of market researchers, especially public economists. Rather paradoxically, it is from none other than ideas of a polycentric market that a number of Western scholars came to the conclusion that “Polycentricity can be utilized as a conceptual framework for drawing inspiration not only from the market but also from democracy or any other complex system incorporating the simultaneous functioning of multiple centers of governance and decision making with different interests, perspectives, and values.” In our opinion, it is very important that namely these three categories - interests, perspectives, and values - were distinguished. “Interests” as a concept is related to the realist school and paradigm in international relations, while “perspectives” suggests some kind of teleology, i.e., a goal-setting actor, and “values” are associated with the core of strategic culture or what has commonly been called the “national idea,” “cultural-historical traditions”, or irrational motives in the collective behavior of a people. For a complex society inhabited by several ethnic groups and where citizens identify with several religious confessions, or where social class differences have been preserved (to some extent they continue to exist in all types of societies, including in both the US and North Korea, but are often portrayed as between professional specialization or peculiarities of local stratification), a polycentric system appears to be a natural necessity for genuinely democratic procedures. In this context, the ability of groups to resolve their own problems on the basis of options institutionally included in the mode of self-government is fundamental to the notion of polycentrism.
Only relatively recently has polycentrism come to be used as an anti-liberal or anti-capitalist platform. In 2006, following the summit of the World Social Forum in Caracas, Michael Blanding from The Nation illustrated a confrontation between “unicentrism” characterized by imperial, neo-liberal, and neo-conservative economic and political theories and institutions, and people searching for an alternative, or adherents of “polycentrism.” As a point of interest, the World Social Forum itself was held in a genuinely polycentric format as it was held not only in Venezuela, but in parallel also in Mali and Pakistan. Although the forum mainly involved left socialists, including a large Trotskyist lobby (which is characteristic of the anti-globalist movement as a whole), the overall critique of neoliberalism and transnational corporations voiced at the forum also relied on rhetoric on the rights of peoples, social responsibility, and the search for a political alternative. At the time, this was manifested in Latin America in the Bolivarian Revolution with its emphasis on indigenism, solidarity, and anti-Americanism.
It should be noted that Russia’s political establishment also not uncommonly uses the word “polycentricity” - sometimes as a synonym for multipolarity, but also as a special, more “peace-loving” trend in global politics insofar as “polarity presumes the confrontation of poles and their binary opposition.” Meanwhile, Russian scholars recognize that comparing the emerging polycentric world order to historical examples of polycentricity is difficult. Besides the aspect of deep interdependence, the polycentricity of the early 21st century possesses a number of different, important peculiarities. These differences include global asymmetry insofar as the US still boasts overwhelming superiority in a number of fields, and a multi-level character in which there exist: (1) a military-diplomatic dimension of global politics with the evolution of quickly developing giant states; (2) an economic dimension with the growing role of transnational actors; (3) global demographic shifts; (4) a specific space representing a domain of symbols, ideals, and cultural codes and their deconstructions; and (5) a geopolitical and geo-economic level.
Here it is necessary to note that the very term “polycentricity” in itself harbors some interesting connotations. Despite being translated to mean “many”, the first part (“poly-“) etymologically refers to both “pole” and “polis” (all three words are of Ancient Greek origin), and the second part presupposes the existence of centers in the context of international politics, i.e., states or a group of states which can influence the dynamic of international relations.
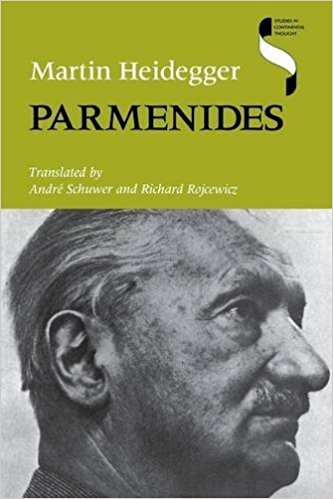 In his Parmenides, Martin Heidegger contributed an interesting remark in regards to the Greek term “polis”, which once again confirms the importance and necessity of serious etymological analysis. By virtue of its profundity, we shall reproduce this quote in full:
In his Parmenides, Martin Heidegger contributed an interesting remark in regards to the Greek term “polis”, which once again confirms the importance and necessity of serious etymological analysis. By virtue of its profundity, we shall reproduce this quote in full:
Πόλις is the πόλоς, the pole, the place around which everything appearing to the Greeks as a being turns in a peculiar way. The pole is the place around which all beings turn and precisely in such a way that in the domain of this place beings show their turning and their conditions. The pole, as this place, lets beings appear in their Being and show the totality of their condition. The pole does not produce and does not create beings in their Being, but as pole it is the abode of the unconsciousness of beings as a whole. The πόλις is the essence of the place [Ort], or, as we say, it is the settlement (Ort-schaft) of the historical dwelling of Greek humanity. Because the πόλις lets the totality of beings come in this or that way into the unconcealedness of its condition, the πόλις is therefore essentially related to the Being of beings. Between πόλις and “Being” there is a primordial relation.
Heidegger thus concludes that “polis” is not a city, state, nor a combination of the two, but the place of the history of the Greeks, the focus of their essence, and that there is a direct link between πόλις and ἀλήθεια (this Greek word is usually translated into Russian as “truth”) Thus, in order to capture polycentricity, one needs to search for the foci and distribution areas of the essence of the numerous peoples of our planet. Here we can once again mention strategic cultures and their cores.
Translated from Russian by Jafe Arnold.
Multipolarity is the best future for Europe
Iranian view on Multipolarity in the New World
South America In The Emerging Multipolar World Order
Prisoners of Friedman and Brzezinski: Neoliberal America vs. Multipolarity
18:44 Publié dans Définitions, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : leonid savin, polycentricité, multipolarité, géopolitique, philosophie, philosophie politique, théorie politique, sciences politiques, politologie, définition |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Ex: http://www.theoccidentalobserver.net
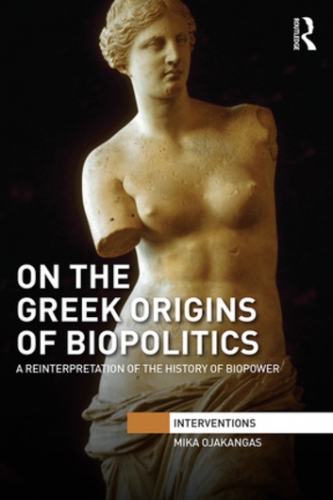 Mika Ojakangas, On the Origins of Greek Biopolitics: A Reinterpretation of the History of Biopower
Mika Ojakangas, On the Origins of Greek Biopolitics: A Reinterpretation of the History of Biopower
London and New York: Routledge, 2016
Mika Ojakangas is a professor of political theory, teaching at the University of Jyväskylä in Finland. He has written a succinct and fairly comprehensive overview of ancient Greek thought on population policies and eugenics, or what he terms “biopolitics.” Ojakangas says:
In their books on politics, Plato and Aristotle do not only deal with all the central topics of biopolitics (sexual intercourse, marriage, pregnancy, childbirth, childcare, public health, education, birthrate, migration, immigration, economy, and so forth) from the political point of view, but for them these topics are the very keystone of politics and the art of government. At issue is not only a politics for which “the idea of governing people” is the leading idea but also a politics for which the question how “to organize life” (tou zên paraskeuên) (Plato, Statesman, 307e) is the most important question. (6)
The idea of regulating and cultivating human life, just as one would animal and plant life, is then not a Darwinian, eugenic, or Nazi modern innovation, but, as I have argued concerning Plato’s Republic, can be found in a highly developed form at the dawn of Western civilization. As Ojakangas says:
The idea of politics as control and regulation of the living in the name of the security, well-being and happiness of the state and its inhabitants is as old as Western political thought itself, originating in classical Greece. Greek political thought, as I will demonstrate in this book, is biopolitical to the bone. (1)
Greek thought had nothing to do with the modern obsessions with supposed “human rights” or “social contracts,” but took the good to mean the flourishing of the community, and of individuals as part of that community, as an actualization of the species’ potential: “In this biopolitical power-knowledge focusing on the living, to repeat, the point of departure is neither law, nor free will, nor a contract, or even a natural law, meaning an immutable moral rule. The point of departure is the natural life (phusis) of individuals and populations” (6). Okajangas notes: “for Plato and Aristotle politics was essentially biopolitics” (141).
In Ojakangas’ telling, Western biopolitical thought gradually declined in the ancient and medieval period. Whereas Aristotle and perhaps Plato had thought of natural law and the good as pertaining to a particular organism, the Stoics, Christians, and liberals posited a kind of a disembodied natural law:
This history is marked by several ruptures understood as obstacles preventing the adoption and diffusion of the Platonic-Aristotelian biopolitical model of politics – despite the influence these philosophers have otherwise had on Roman and Christian thought. Among these ruptures, we may include: the legalization of politics in the Roman Republic and the privatization of everyday life in the Roman Empire, but particularly the end of birth control, hostility towards the body, the sanctification of law, and the emergence of an entirely new kind of attitude to politics and earthly government in early Christianity. (7)
 Ojakangas’ book has served to confirm my impression that, from an evolutionary point of view, the most relevant Western thinkers are found among the ancient Greeks, with a long sleep during the Roman Empire and the Middle Ages, a slow revival during the Renaissance and the Enlightenment, and a great climax heralded by Darwin, before being shut down again in 1945. The periods in which Western thought was eminently biopolitical — the fifth and fourth centuries B.C. and 1865 to 1945 — are perhaps surprisingly short in the grand scheme of things, having been swept away by pious Europeans’ recurring penchant for egalitarian and cosmopolitan ideologies. Okajangas also admirably puts ancient biopolitics in the wider context of Western thought, citing Spinoza, Nietzsche, Carl Schmitt, Heidegger, and others, as well as recent academic literature.
Ojakangas’ book has served to confirm my impression that, from an evolutionary point of view, the most relevant Western thinkers are found among the ancient Greeks, with a long sleep during the Roman Empire and the Middle Ages, a slow revival during the Renaissance and the Enlightenment, and a great climax heralded by Darwin, before being shut down again in 1945. The periods in which Western thought was eminently biopolitical — the fifth and fourth centuries B.C. and 1865 to 1945 — are perhaps surprisingly short in the grand scheme of things, having been swept away by pious Europeans’ recurring penchant for egalitarian and cosmopolitan ideologies. Okajangas also admirably puts ancient biopolitics in the wider context of Western thought, citing Spinoza, Nietzsche, Carl Schmitt, Heidegger, and others, as well as recent academic literature.
At the core of the work is a critique of Michel Foucault’s claim that biopolitics is a strictly modern phenomenon growing out of “Christian pastoral power.” Ojakangas, while sympathetic to Foucault, says the latter’s argument is “vague” (33) and unsubstantiated. Indeed, historically at least, Catholic countries with strong pastoral power tended precisely to be those in which eugenics was less popular, in contrast with Protestant ones.
It must be said that postmodernist pioneer Foucault is a strange starting point on the topic of biopolitics. As Ojakangas suggests, Foucault’s 1979 and 1980 lecture courses The Birth of Biopolitics and On the Government of the Living do not deal mainly with biopolitics at all, despite their titles (34–35). Indeed, Foucault actually lost rapidly lost interest in the topic.
Okajangas also criticizes Hannah Arendt for claiming that Aristotle posited a separation between the familial/natural life of the household (oikos) and that of the polis. In fact: “The Greek city-state was, to use Carl Schmitt’s infamous formulation, a total state — a state that intervenes, if it so wishes, in all possible matters, in economy and in all the other spheres of human existence” (17). Okajangas goes into some detail citing, contra Arendt and Foucault, ancient Greek uses of household-management and shepherding as analogies for political rule.

Aristotle appears as a genuine forerunner of modern scientific biopolitics in Ojakangas’ account. Aristotle’s politics was at once highly conventional, really reflecting more widespread Greek assumptions, and his truly groundbreaking work as an empirical scientist, notably in the field of biology. For Aristotle “the aim of politics and state administration is to produce good life by developing the immanent potentialities of natural life and to bring these potentialities to fruition” (17, cf. 107). Ojakangas goes on:
Aristotle was not a legal positivist in the modern sense of the word but rather a representative of sociological naturalism, as for Aristotle there is no fundamental distinction between the natural and the social world: they are both governed by the same principles discovered by empirical research on the nature of things and living beings. (55–56)
And: “although justice is based on nature, at stake in this nature is not an immutable and eternal cosmic nature expressing itself in the law written on the hearts of men and women but nature as it unfolds in a being” (109).
This entailed a notion of justice as synonymous with natural hierarchy. Okajangas notes: “for Plato justice means inequality. Justice takes place when an individual fulfills that function or work (ergon) that is assigned to him by nature in the socio-political hierarchy of the state — and to the extent that everybody does so, the whole city-state is just” (111). Biopolitical justice is when each member of the community is fulfilling the particular role to which he is best suited to enable the species to flourish: “For Plato and Aristotle, in sum, natural justice entails hierarchy, not equality, subordination, not autonomy” (113). Both Plato and Aristotle adhered to a “geometrical” conception of equality between humans, namely, that human beings were not equal, but should be treated in accordance with their worth or merit.
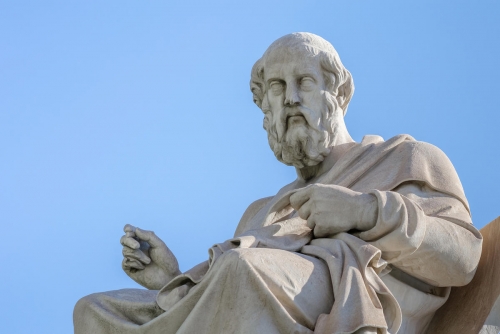
Plato used the concepts of reason and nature not to comfort convention but to make radical proposals for the biological, cultural, and spiritual perfection of humanity. Okajangas rightly calls the Republic a “bio-meritocratic” utopia (19) and notes that “Platonic biopolitico-pastoral power” was highly innovative (134). I was personally also extremely struck in Plato by his unique and emphatic joining together of the biological and the spiritual. Okajangas says that National Socialist racial theoriar Hans F. K. Günther in his Plato as Protector of Life (1928) had argued that “a dualistic reading of Plato goes astray: the soul and the body are not separate entities, let alone enemies, for the spiritual purification in the Platonic state takes place only when accompanied with biological selection” (13).[1]
Okajangas succinctly summarizes the decline of biopolitics in the ancient world. Politically this was related to the decline of the intimate and “total” city-state:
It indeed seems that the decline of the classical city-state also entailed a crisis of biopolitical vision of politics. . . . Just like modern biopolitics, which is closely linked to the rise of the modern nation-state, it is quite likely that the decline of biopolitics and biopolitical vision of politics in the classical era is related to the fall of the ethnically homogeneous political organization characteristic of the classical city-states. (118)
The rise of Hellenistic and Roman empires as universal, cultural states naturally entailed a withdrawal of citizens from politics and a decline in self-conscious ethnopolitics.
 While Rome had also been founded as “a biopolitical regime” and had some policies to promote fertility and eugenics (120), this was far less central to Roman than to Greek thought, and gradually declined with the Empire. Political ideology seems to have followed political realities. The Stoics and Cicero posited a “natural law” not deriving from a particular organism, but as a kind of cosmic, disembodied moral imperative, and tended to emphasize the basic commonality of human beings (e.g. Cicero, Laws, 1.30).
While Rome had also been founded as “a biopolitical regime” and had some policies to promote fertility and eugenics (120), this was far less central to Roman than to Greek thought, and gradually declined with the Empire. Political ideology seems to have followed political realities. The Stoics and Cicero posited a “natural law” not deriving from a particular organism, but as a kind of cosmic, disembodied moral imperative, and tended to emphasize the basic commonality of human beings (e.g. Cicero, Laws, 1.30).
I believe that the apparently unchanging quality of the world and the apparent biological stability of the species led many ancient thinkers to posit an eternal and unchanging disembodied moral law. They did not have our insights on the evolutionary origins of our species and of its potential for upward change in the future. Furthermore, the relative commonality of human beings in the ancient Mediterranean — where the vast majority were Aryan or Semitic Caucasians, with some clinal variation — could lead one to think that biological differences between humans were minor (an impression which Europeans abandoned in the colonial era, when they encountered Sub-Saharan Africans, Amerindians, and East Asians). Missing, in those days before modern science and as White advocate William Pierce has observed, was a progressive vision of human history as an evolutionary process towards ever-greater consciousness and self-actualization.[2]
Many assumptions of late Hellenistic (notably Stoic) philosophy were reflected and sacralized in Christianity, which also posited a universal and timeless moral law deriving from God, rather than the state or the community. As it is said in the Book of Acts (5:29): “We must obey God rather than men.” With Christianity’s emphasis on the dignity of each soul and respect for the will of God, the idea of manipulating reproductive processes through contraception, abortion, or infanticide in order to promote the public good became “taboo” (121). Furthermore: “virginity and celibacy were as a rule regarded as more sacred states than marriage and family life . . . . The dying ascetic replaced the muscular athlete as a role model” (121). These attitudes gradually became reflected in imperial policies:
All the marriage laws of Augustus (including the system of legal rewards for married parents with children and penalties for the unwed and childless) passed from 18 BC onwards were replaced under Constantine and the later Christian emperors — and even those that were not fell into disuse. . . . To this effect, Christian emperors not only made permanent the removal of sanctions on celibates, but began to honor and reward those Christian priests who followed the rule of celibacy: instead of granting privileges to those who contracted a second marriage, Justinian granted privileges to those who did not (125)
The notion of moral imperatives deriving from a disembodied natural law and the equality of souls gradually led to the modern obsession with natural rights, free will, and social contracts. Contrast Plato and Aristotle’s eudaimonic (i.e., focusing on self-actualization) politics of aristocracy and community to that of seventeenth-century philosopher Thomas Hobbes:
I know that in the first book of the Politics Aristotle asserts as a foundation of all political knowledge that some men have been made by nature worthy to rule, others to serve, as if Master and slave were distinguished not by agreement among men, but by natural aptitude, i.e. by their knowledge or ignorance. This basic postulate is not only against reason, but contrary to experience. For hardly anyone is so naturally stupid that he does not think it better to rule himself than to let others rule him. … If then men are equal by nature, we must recognize their equality; if they are unequal, since they will struggle for power, the pursuit of peace requires that they are regarded as equal. And therefore the eighth precept of natural law is: everyone should be considered equal to everyone. Contrary to this law is PRIDE. (De Cive, 3.13)
It does seem that, from an evolutionary point of view, the long era of medieval and early modern thought represents an enormous regression as compared with the Ancients, particularly the Greeks. As Ojakangas puts it: “there is an essential rupture in the history of Western political discourse since the decline of the Greek city-states” (134).
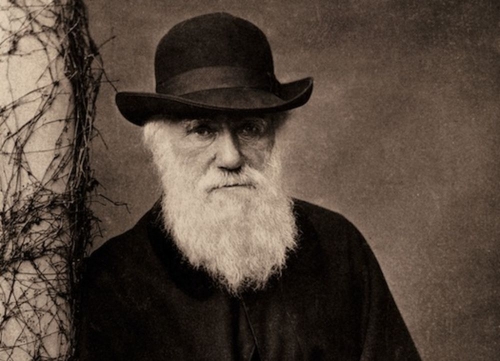
Western biopolitics gradually returned in the modern era and especially with Darwin, who himself had said in The Descent of Man: “The weak members of civilized societies propagate their kind. No one who has attended to the breeding of domestic animals will doubt that this must be highly injurious to the race of man.”[3] And: “Man scans with scrupulous care the character and pedigree of his horses, cattle, and dogs before he matches them; but when he comes to his own marriage he rarely, or never, takes any such care.”[4] Okajangas argues that “the Platonic Aristotelian art of government [was] more biopolitical than the modern one,” as they did not have to compromise with other traditions, namely “Roman and Judeo-Christian concepts and assumptions” (137).
Okajangas’ book is useful in seeing the outline of the long tradition of Western biopolitical thinking, despite the relative eclipse of the Middle Ages. He says:
Baruch Spinoza was probably the first modern metaphysician of biopolitics. While Kant’s moral and political thought is still centered on concepts such as law, free will, duty, and obligation, in Spinoza we encounter an entirely different mode of thinking: there are no other laws but causal ones, the human will is absolutely determined by these laws, freedom and happiness consist of adjusting oneself to them, and what is perhaps most essential, the law of nature is the law of a self-expressing body striving to preserve itself (conatus) by affirming itself, this affirmation, this immanent power of life, being nothing less than justice. In the thought of Friedrich Nietzsche, this metaphysics of biopolitics is brought to its logical conclusion. The law of life is nothing but life’s will to power, but now this power, still identical with justice, is understood as a process in which the sick and the weak are eradicated by the vital forces of life.
I note in passing that William Pierce had a similar assessment of Spinoza’s pantheism as basically valid, despite the latter’s Jewishness.[5]
The 1930s witnessed the zenith of modern Western biopolitical thinking. The French Nobel Prize winner and biologist Alexis Carrel had argued in his best-selling Man the Unknown for the need for eugenics and the need for “philosophical systems and sentimental prejudices must give way before such a necessity.” Yet, as Okajangas points out, “if we take a look at the very root of all ‘philosophical systems,’ we find a philosophy (albeit perhaps not a system) perfectly in agreement with Carrel’s message: the political philosophy of Plato” (97).
Okajangas furthermore argues that Aristotle’s biocentric naturalist ethics were taken up in 1930s Germany:
Instead of ius naturale, at stake was rather what the modern human sciences since the nineteenth century have called biological, economical, and sociological laws of life and society — or what the early twentieth-century völkisch German philosophers, theologians, jurists, and Hellenists called Lebensgesetz, the law of life expressing the unity of spirit and race immanent to life itself. From this perspective, it is not surprising that the “crown jurist” of the Third Reich, Carl Schmitt, attacked the Roman lex [law] in the name of the Greek nomos [custom/law] — whose “original” meaning, although it had started to deteriorate already in the post-Solonian democracy, can in Schmitt’s view still be detected in Aristotle’s Politics. Cicero had translated nomos as lex, but on Schmitt’s account he did not recognize that unlike the Roman lex, nomos does not denote an enacted statute (positive law) but a “concrete order of life” (eine konkrete Lebensordnung) of the Greek polis — not something that ‘ought to be’ but something that “is”. (56)
Western biopolitical thought was devastated by the outcome of the World War II and has yet to recover, although perhaps we can begin to see glimmers of renewal.

Okajangas reserves some critical comments for Foucault in his conclusion, arguing that with his erudition he could not have been ignorant of classical philosophy’s biopolitical character. He speculates on Foucault’s motivations for lying: “Was it a tactical move related to certain political ends? Was it even an attempt to blame Christianity and traditional Christian anti-Semitism for the Holocaust?” (142). I am in no position to pronounce on this, other than to point out that Foucault, apparently a gentile, was a life-long leftist, a Communist Party member in the 1950s, a homosexual who eventually died of AIDS, and a man who — from what I can make of his oeuvre — dedicated his life to “problematizing” the state’s policing and regulation of abnormality.
Okajangas’ work is scrupulously neutral in his presentation of ancient biopolitics. He keeps his cards close to his chest. I identified only two rather telling comments:
The latter’s odd phrasing strikes me as presenting an ostensibly left-wing point to actually make a taboo right-wing point (a technique Slavoj Žižek seems to specialize in).
In any event, I take Ojakangas’ work as a confirmation of the utmost relevance of ancient political philosophy for refounding European civilization on a sound biopolitical basis. The Greek philosophers, I believe, produced the highest biopolitical thought because they could combine the “barbaric” pagan-Aryan values which Greek society took for granted with the logical rigor of Socratic rationalism. The old pagan-Aryan culture, expressed above all in the Homeric poems, extolled the values of kinship, aristocracy, competitiveness, community, and manliness, this having been a culture which was produced by a long, evolutionary struggle for survival among wandering and conquering tribes in the Eurasian steppe. This highly adaptive traditional culture was then, by a uniquely Western contact with rationalist philosophy, rationalized and radicalized by the philosophers, untainted by the sentimentality of later times. Plato and Aristotle are remarkably un-contrived and straightforward in their political methods and goals: the human community must be perfected biologically and culturally; individual and sectoral interests must give way to those of the common good; and these ought to be enforced through pragmatic means, in accord with wisdom, with law where possible, and with ruthlessness when necessary.
[1]Furthermore, on a decidedly spiritual note: “ rather than being a Darwinist of sorts, in Günther’s view it is Plato’s idealism that renders him a predecessor of Nazi ideology, because race is not merely about the body but, as Plato taught, a combination of the mortal body and the immortal soul.” (13)
[2] William Pierce:
The medieval view of the world was that it is a finished creation. Since Darwin, we have come to see the world as undergoing a continuous and unfinished process of creation, of evolution. This evolutionary view of the world is only about 100 years old in terms of being generally accepted. . . . The pantheists, at least most of them, lacked an understanding of the universe as an evolving entity and so their understanding was incomplete. Their static view of the world made it much more difficult for them to arrive at the Cosmotheist truth.
William Pierce, “Cosmotheism: Wave of the Future,” speech delivered in Arlington, Virginia 1977.
[3] Charles Darwin, The Descent of Man and Selection in Relation to Sex (New York: Appleton and Company, 1882), 134.
[4]Ibid., 617. Interestingly, Okajangas points out that Benjamin Isaac, a Jewish scholar writing on Greco-Roman “racism,” believed Plato (Republic 459a-b) had inspired Darwin on this point. Benjamin Isaac, The Invention of Racism in Classical Antiquity (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2004), 128.
[5]Pierce, “Cosmotheism.”
00:05 Publié dans Livre, Livre, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eugénisme, darwinisme, grèce antique, antiquité grecque, biopolitique, philosophie politique, théorie politique, cité grecque, sciences politiques, politologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

par Juan Asensio
Ex: http://www.juanasensio.com
«En effet, même si elle n’est ni nécessité, ni caprice, l’histoire, pour le réactionnaire, n’est pourtant pas une dialectique de la volonté immanente, mais une aventure temporelle entre l’homme et ce qui le transcende. Ses œuvres sont des vestiges, sur le sable labouré par la lutte, du corps de l’homme et du corps de l’ange. L’histoire selon le réactionnaire est un haillon, déchiré par la liberté de l’homme, et qui flotte au vent du destin.»
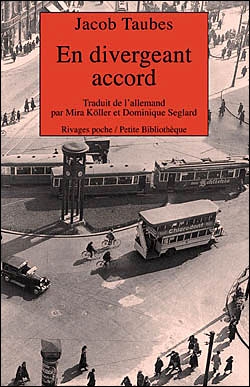 Acheter En divergent accord : à propos de Carl Schmitt sur Amazon.
Acheter En divergent accord : à propos de Carl Schmitt sur Amazon. Évidemment, tout, absolument tout étant lié, surtout lorsqu'il s'agit des affinités électives existant entre les grands esprits qui appréhendent le monde en établissant des arches, parfois fragiles mais stupéfiantes de hardiesse, entre des réalités qu'en apparence rien ne relie (cf. p. 38), je ne pouvais, poursuivant la lecture de cet excellent petit livre qui m'a fait découvrir le fulgurant (et, apparemment, horripilant) Jacob Taubes, que finalement tomber sur le nom qui, selon ce dernier, reliait Maritain à Schmitt, qualifié de «profond penseur catholique» : Léon Bloy, autrement dit le porteur, le garnt ou, pourquoi pas, le «signe secret» (p. 96) lui-même. Après Kafka saluant le génie de l'imprécation bloyenne, c'est au tour du surprenant Taubes, au détour de quelques mots laissés sans la moindre explication, comme l'une de ces saillies propres aux interventions orales, qui stupéfièrent ou scandalisèrent et pourquoi pas stupéfièrent et scandalisèrent) celles et ceux qui, dans le public, écoutèrent ces maîtres de la parole que furent Taubes et Kojève (cf. p. 47). Il n'aura évidemment échappé à personne que l'un et l'autre, Kafka et le grand commentateur de la Lettre aux Romains de l'apôtre Paul, sont juifs, Jacob Taubes se déclarant même «Erzjude» «archijuif», traduction préférable à celle de «juif au plus profond» (p. 67) que donne notre petit livre : «l'ombre de l'antisémitisme actif se profilait sur notre relation, fragile comme toujours» (p. 47), écrit ainsi l'auteur en évoquant la figure de Carl Schmitt qui, comme Martin Heidegger mais aussi Adolf Hitler, est un «catholique éventé» dont le «génie du ressentiment» lui a permis de lire «les sources à neuf» (p. 112).
Évidemment, tout, absolument tout étant lié, surtout lorsqu'il s'agit des affinités électives existant entre les grands esprits qui appréhendent le monde en établissant des arches, parfois fragiles mais stupéfiantes de hardiesse, entre des réalités qu'en apparence rien ne relie (cf. p. 38), je ne pouvais, poursuivant la lecture de cet excellent petit livre qui m'a fait découvrir le fulgurant (et, apparemment, horripilant) Jacob Taubes, que finalement tomber sur le nom qui, selon ce dernier, reliait Maritain à Schmitt, qualifié de «profond penseur catholique» : Léon Bloy, autrement dit le porteur, le garnt ou, pourquoi pas, le «signe secret» (p. 96) lui-même. Après Kafka saluant le génie de l'imprécation bloyenne, c'est au tour du surprenant Taubes, au détour de quelques mots laissés sans la moindre explication, comme l'une de ces saillies propres aux interventions orales, qui stupéfièrent ou scandalisèrent et pourquoi pas stupéfièrent et scandalisèrent) celles et ceux qui, dans le public, écoutèrent ces maîtres de la parole que furent Taubes et Kojève (cf. p. 47). Il n'aura évidemment échappé à personne que l'un et l'autre, Kafka et le grand commentateur de la Lettre aux Romains de l'apôtre Paul, sont juifs, Jacob Taubes se déclarant même «Erzjude» «archijuif», traduction préférable à celle de «juif au plus profond» (p. 67) que donne notre petit livre : «l'ombre de l'antisémitisme actif se profilait sur notre relation, fragile comme toujours» (p. 47), écrit ainsi l'auteur en évoquant la figure de Carl Schmitt qui, comme Martin Heidegger mais aussi Adolf Hitler, est un «catholique éventé» dont le «génie du ressentiment» lui a permis de lire «les sources à neuf» (p. 112).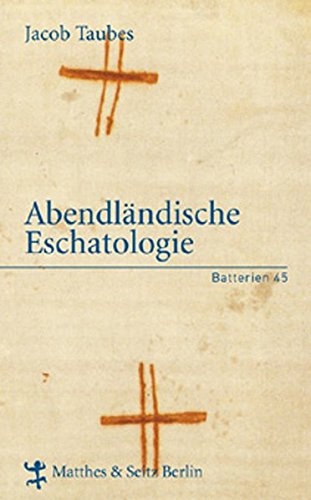 C'est l'importance, capitale, de cette thématique que Jacob Taubes évoque lorsqu'il affirme que les écailles lui sont tombées des yeux quand il a lu «la courbe tracée par Löwith de Hegel à Nietzsche en passant par Marx et Kierkegaard» (p. 27), auteurs (Hegel, Marx et Kierkegaard) qu'il ne manquera pas d'évoquer dans son Eschatologie occidentale (Nietzsche l'étant dans sa Théologie politique de Paul) en expliquant leur philosophie par l'apocalyptique souterraine qui n'a à vrai dire jamais cessé d'irriguer le monde (4) dans ses multiples transformations, et paraît même s'être orientée, avec le régime nazi, vers une furie de destruction du peuple juif, soit ce peuple élu jalousé par le catholiques (et même les chrétiens) conséquents. Lisons l'explication de Taubes, qui pourra paraître une réduction aux yeux de ses adversaires ou une fulgurance dans l'esprit de ses admirateurs : «Carl Schmitt était membre du Reich allemand avec ses prétentions au Salut», tandis que lui, Taubes, était «fils du peuple véritablement élu par Dieu, suscitant donc l'envie des nations apocalyptiques, une envie qui donne naissance à des fantasmagories et conteste le droit de vivre au peuple réellement élu» (pp. 48-9, le passage plus haut cité suit immédiatement ces lignes).
C'est l'importance, capitale, de cette thématique que Jacob Taubes évoque lorsqu'il affirme que les écailles lui sont tombées des yeux quand il a lu «la courbe tracée par Löwith de Hegel à Nietzsche en passant par Marx et Kierkegaard» (p. 27), auteurs (Hegel, Marx et Kierkegaard) qu'il ne manquera pas d'évoquer dans son Eschatologie occidentale (Nietzsche l'étant dans sa Théologie politique de Paul) en expliquant leur philosophie par l'apocalyptique souterraine qui n'a à vrai dire jamais cessé d'irriguer le monde (4) dans ses multiples transformations, et paraît même s'être orientée, avec le régime nazi, vers une furie de destruction du peuple juif, soit ce peuple élu jalousé par le catholiques (et même les chrétiens) conséquents. Lisons l'explication de Taubes, qui pourra paraître une réduction aux yeux de ses adversaires ou une fulgurance dans l'esprit de ses admirateurs : «Carl Schmitt était membre du Reich allemand avec ses prétentions au Salut», tandis que lui, Taubes, était «fils du peuple véritablement élu par Dieu, suscitant donc l'envie des nations apocalyptiques, une envie qui donne naissance à des fantasmagories et conteste le droit de vivre au peuple réellement élu» (pp. 48-9, le passage plus haut cité suit immédiatement ces lignes). 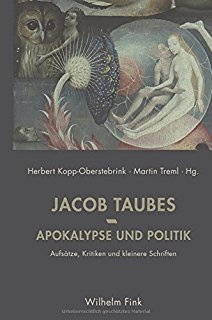 Cette complexité se retrouve dans le jugement de Jacob Taubes sur Carl Schmitt qui, ce point au moins est évident, avait une réelle importance intellectuelle à ses yeux, était peut-être même l'un des seuls contemporains pour lequel il témoigna de l'estime, au-delà même du fossé qui les séparait : «On vous fait réciter un alphabet démocratique, et tout privat-docent en politologie est évidemment obligé, dans sa leçon inaugurale, de flanquer un coup de pied au cul à Carl Schmitt en disant que la catégorie ami / ennemi n'est pas la bonne. Toute une science s'est édifiée là pour étouffer le problème» (p. 115), problème qui seul compte, et qui, toujours selon Jacob Taubes, a été correctement posé par le seul Carl Schmitt, problème qui n'est autre que l'existence d'une «guerre civile en cours à l'échelle mondiale» (p. 109). Dans sa belle préface, Elettra Stimilli a du reste parfaitement raison de rapprocher, de façon intime, les pensées de Schmitt et de Taubes, écrivant : «Révolution et contre-révolution ont toujours évolué sur le plan linéaire du temps, l'une du point de vue du progrès, l'autre de celui de la tradition. Toutes deux sont liées par l'idée d'un commencement qui, depuis l'époque romaine, est essentiellement une «fondation». Si du côté de la tradition cela ne peut qu'être évident, étant donné que déjà le noyau central de la politique romaine est la foi dans la sacralité de la fondation, entendue comme ce qui maintient un lien entre toutes les générations futures et doit pour cette raison être transmise, par ailleurs, nous ne parviendrons pas à comprendre les révolutions de l'Occident moderne dans leur grandeur et leur tragédie si, comme le dit Hannah Arendt, nous ne le concevons pas comme «autant d'efforts titanesques accomplis pour reconstruire les bases, renouer le fil interrompu de la tradition et restaurer, avec la fondation de nouveaux systèmes politiques, ce qui pendant tant de siècles a conféré dignité et grandeur aux affaires humaines» (pp. 15-6).
Cette complexité se retrouve dans le jugement de Jacob Taubes sur Carl Schmitt qui, ce point au moins est évident, avait une réelle importance intellectuelle à ses yeux, était peut-être même l'un des seuls contemporains pour lequel il témoigna de l'estime, au-delà même du fossé qui les séparait : «On vous fait réciter un alphabet démocratique, et tout privat-docent en politologie est évidemment obligé, dans sa leçon inaugurale, de flanquer un coup de pied au cul à Carl Schmitt en disant que la catégorie ami / ennemi n'est pas la bonne. Toute une science s'est édifiée là pour étouffer le problème» (p. 115), problème qui seul compte, et qui, toujours selon Jacob Taubes, a été correctement posé par le seul Carl Schmitt, problème qui n'est autre que l'existence d'une «guerre civile en cours à l'échelle mondiale» (p. 109). Dans sa belle préface, Elettra Stimilli a du reste parfaitement raison de rapprocher, de façon intime, les pensées de Schmitt et de Taubes, écrivant : «Révolution et contre-révolution ont toujours évolué sur le plan linéaire du temps, l'une du point de vue du progrès, l'autre de celui de la tradition. Toutes deux sont liées par l'idée d'un commencement qui, depuis l'époque romaine, est essentiellement une «fondation». Si du côté de la tradition cela ne peut qu'être évident, étant donné que déjà le noyau central de la politique romaine est la foi dans la sacralité de la fondation, entendue comme ce qui maintient un lien entre toutes les générations futures et doit pour cette raison être transmise, par ailleurs, nous ne parviendrons pas à comprendre les révolutions de l'Occident moderne dans leur grandeur et leur tragédie si, comme le dit Hannah Arendt, nous ne le concevons pas comme «autant d'efforts titanesques accomplis pour reconstruire les bases, renouer le fil interrompu de la tradition et restaurer, avec la fondation de nouveaux systèmes politiques, ce qui pendant tant de siècles a conféré dignité et grandeur aux affaires humaines» (pp. 15-6).
10:25 Publié dans Judaica, Livre, Livre, Philosophie, Révolution conservatrice, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théologie, théologie politique, philosophie, philosophie politique, révoltuion conservatrice, judaica, judaïsme, jacob taubes, carl schmitt, théorie politique, eschatologie politique, politologie, sciences politiques, allemagne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
11:18 Publié dans Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sid lukkassen, eric c. hendriks, marxisme culturel, leo strauss, philosophie, philosophie politique, politologie, sciences politiques, théorie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Les valeurs populistes comme résistance au narcissisme
par Renaud Garcia
Ex: http://www.oragesdacier.info
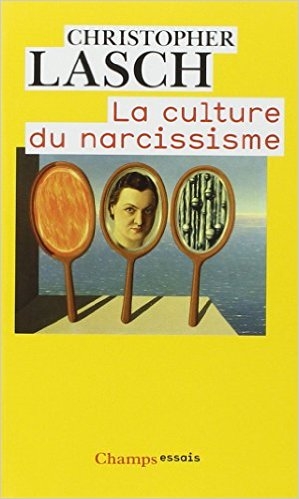 Dans une enquête de grande ampleur, qui évoque notamment le radicalisme chrétien d’Orestes Brownson (1803-1876), le transcendantalisme de Ralph Waldo Emerson (1803-1882), le mouvement de résistance non violente de Martin Luther King (1929-1968), en passant par le socialisme de guilde de George Douglas Howard Cole (1889-1959), Lasch met en évidence tout un gisement de valeurs relatives à l’humanisme civique, dont les Etats-Unis et plus largement le monde anglo-saxon ont été porteurs en résistance à l’idéologie libérale du progrès. Il retrouve, par-delà les divergences entre ces œuvres, certains constances : l’habitude de la responsabilité associée à la possession de la propriété ; l’oubli volontaire de soi dans un travail astreignant ; l’idéal de la vie bonne, enracinée dans une communauté d’appartenance, face à la promesse de l’abondance matérielle ; l’idée que le bonheur réside avant tout dans la reconnaissance que les hommes ne sont pas faits pour le bonheur. Le regard historique de Lasch, en revenant vers cette tradition, n’incite pas à la nostalgie passéiste pour un temps révolu. A la nostalgie, Lasch va ainsi opposer la mémoire. La nostalgie n’est que l’autre face de l’idéologie progressiste, vers laquelle on se tourne lorsque cette dernière n’assure plus ses promesses. La mémoire quant à elle vivifie le lien entre le passé et le présent en préparant à faire face avec courage à ce qui arrive. Au terme du parcours qu’il raconte dans Le Seul et Vrai Paradis, le lecteur garde donc en mémoire le fait historique suivant : il a existé un courant radical très fortement opposé à l’aliénation capitaliste, au délabrement des conditions de travail, ainsi qu’à l’idée selon laquelle la productivité doit augmenter à la mesure des désirs potentiellement illimités de la nature humaine, mais pourtant tout aussi méfiant à l’égard de la conception marxiste du progrès historique. Volontiers raillée par la doxa marxiste pour sa défense « petite bourgeoise » de la petite propriété, tenue pour un bastion de l’indépendance et du contrôle sur le travail et les conditions de vie, la pensée populiste visait surtout l’idole commune des libéraux et des marxistes, révélant par là même l’obsolescence du clivage droite/gauche : le progrès technique et économique, ainsi que l’optimisme historique qu’il recommande. Selon Lasch qui, dans le débat entre Marx et Proudhon, opte pour les analyses du second, l’éthique populiste des petits producteurs était « anticapitaliste, mais ni socialiste, ni social-démocrate, à la fois radicale, révolutionnaire même, et profondément conservatrice ».
Dans une enquête de grande ampleur, qui évoque notamment le radicalisme chrétien d’Orestes Brownson (1803-1876), le transcendantalisme de Ralph Waldo Emerson (1803-1882), le mouvement de résistance non violente de Martin Luther King (1929-1968), en passant par le socialisme de guilde de George Douglas Howard Cole (1889-1959), Lasch met en évidence tout un gisement de valeurs relatives à l’humanisme civique, dont les Etats-Unis et plus largement le monde anglo-saxon ont été porteurs en résistance à l’idéologie libérale du progrès. Il retrouve, par-delà les divergences entre ces œuvres, certains constances : l’habitude de la responsabilité associée à la possession de la propriété ; l’oubli volontaire de soi dans un travail astreignant ; l’idéal de la vie bonne, enracinée dans une communauté d’appartenance, face à la promesse de l’abondance matérielle ; l’idée que le bonheur réside avant tout dans la reconnaissance que les hommes ne sont pas faits pour le bonheur. Le regard historique de Lasch, en revenant vers cette tradition, n’incite pas à la nostalgie passéiste pour un temps révolu. A la nostalgie, Lasch va ainsi opposer la mémoire. La nostalgie n’est que l’autre face de l’idéologie progressiste, vers laquelle on se tourne lorsque cette dernière n’assure plus ses promesses. La mémoire quant à elle vivifie le lien entre le passé et le présent en préparant à faire face avec courage à ce qui arrive. Au terme du parcours qu’il raconte dans Le Seul et Vrai Paradis, le lecteur garde donc en mémoire le fait historique suivant : il a existé un courant radical très fortement opposé à l’aliénation capitaliste, au délabrement des conditions de travail, ainsi qu’à l’idée selon laquelle la productivité doit augmenter à la mesure des désirs potentiellement illimités de la nature humaine, mais pourtant tout aussi méfiant à l’égard de la conception marxiste du progrès historique. Volontiers raillée par la doxa marxiste pour sa défense « petite bourgeoise » de la petite propriété, tenue pour un bastion de l’indépendance et du contrôle sur le travail et les conditions de vie, la pensée populiste visait surtout l’idole commune des libéraux et des marxistes, révélant par là même l’obsolescence du clivage droite/gauche : le progrès technique et économique, ainsi que l’optimisme historique qu’il recommande. Selon Lasch qui, dans le débat entre Marx et Proudhon, opte pour les analyses du second, l’éthique populiste des petits producteurs était « anticapitaliste, mais ni socialiste, ni social-démocrate, à la fois radicale, révolutionnaire même, et profondément conservatrice ».
15:24 Publié dans Philosophie, Sociologie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, polpulisme, narcissisme, christopher lasch, sociologie, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Du dextrisme et de la révolution conservatrice
12:04 Publié dans Actualité, Définitions, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dextrisme, actualité, définition, common decency, théorie politique, politologie, sciences politique, philosophie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Ex: http://www.counter-currents.com
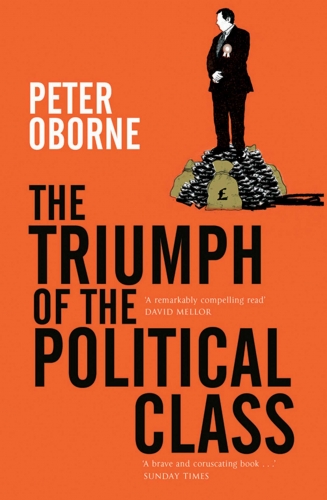 Review:
Review:
Peter Oborne
The Triumph of the Political Class
London: Simon & Schuster, 2007
Some books are born again. Every book with a political theme aims to be prophetic, and only time can reveal their success or otherwise. Orwell’s 1984, Bloom’s The Closing of the American Mind, Huntington’s The Clash of Civilizations, Faye’s Convergence of Catastrophes are all books whose time has arrived. It is difficult to believe that one such book is a little over a decade old, but Peter Oborne’s The Triumph of the Political Class (TPC) has never been as relevant as it is today.
The book concerns itself solely with the United Kingdom, although its main thesis is relevant to the USA, as well as to the gauleiters of Europe. Oborne is a well-respected British journalist. As what is termed in Britain a lobby correspondent, he has access to the innermost workings of the ‘mother of all parliaments’, as politician John Bright described England’s governmental locus in 1865. TPC, as dazzling as it is, naturally made Oborne enemies within the very elite whose rise and victory he describes in the book. For Oborne gave the game away, like the heckler in the audience who sees and tells his fellow spectators how the magician on the stage is working his wonders, or little Toto pulling back the curtain to reveal that the Wizard of Oz is just an eccentric old man with a set of cogs and levers.
Oborne’s essential theme is that “the real divide in British public life is no longer between the main political parties, but between the Political Class and the rest.’ (p. xvii).
This class, he writes, replaced the old establishment and its standards of governance. Instead of public servants entering parliament from many walks of life, politicians in the UK are now unlikely to have worked outside of journalism, PR, advertising, or the legal profession. Very few have experience outside the world of politics, and the established route is from one of the top universities, Oxford or Cambridge, usually studying Politics, Philosophy and Economics, famously known as PPE. The next step is an internship, working for an established politician. Some may become specials advisers, or SpAds as they are known, to a working politician. This tier of government has largely replaced the function of Britain’s long-established Civil Service, and is illegitimately funded by the British taxpayer. It is also wholly politically orthodox. As Oborne emphasises, any opinions or ideological beliefs outside the accepted protocols will disable a political career before it has even begun.
This incubation of political agency has serious consequences. Politics ceases to be an active, deeply social and communitarian practice and becomes instead occupied by a technocratic cabal convinced that they are best equipped to improve the lot of others. The results of this in the UK is a country well on the way to ruination. Increasingly Sovietised, Britain – and particularly England – is being run by malevolent arch-bureaucrats, a managerial class more concerned with appearance than reality. As Orwell famously wrote, in The Lion and the Unicorn, England is a family with the wrong members in control.
Oborne credits 19th-century Italian lawyer and social theorist Gaetano Mosca with the coinage of what he called the classe politica. Mosca’s major work, Elementi de Scienzi Politica, is now seen by the new establishment as a precursor to Italian fascism under Mussolini, and this is a clear example of the ‘fascist’ or ‘far Right’ tag being applied by the Political Class and their provisional wing in the media to anyone who gives the game away.

Peter Oborne
Oborne updates Mosca’s 1896 insight, and describes how the modern Political Class – I will follow Oborne’s practice of capitalising the words in this phrase – has devoted itself to the destruction and replacement of the Establishment. Speech, vocabulary, dress, lifestyle; all of these elements serve to identify the new regime, and have been standardized to produce a homogenous tier of operatives who now serve themselves only, and their shadowy backers in the business world.
Oborne stresses that the political class is the result of a toxic amalgam of 1960s student agitation, technocracy and, in particular, Communism. Ostensibly defeated with the fall of the Berlin Wall, Communism in fact merely hibernated and emerged in a different guise. Oborne relegates his comments on Communism to a footnote, but it should not elude us. “Although Communism has enjoyed barely any electoral success in Britain during the last 100 years,” he writes, “its influence has been exceptionally strong among the governing elite…” (p. 47).
Communism, the spectre haunting Europe with which Marx famously opened the Communist Manifesto, is now a revenant. The EU is notoriously staffed, in its upper echelons at the very least, by ex-Communist sympathisers and even members. Angela Merkel’s Communist past is well known. The Red Menace never went anywhere, it just changed its livery. This lingering of Communism explains Oborne’s observation that ‘the Political Class has at all times resented and sought to destroy the free-standing status of British institutions.’ (p. 49).
And it is the destruction or infiltration of the great British institutions that Oborne delineates, as each one is shown to have fallen to this triumphal Political Class, making as it has a long march of its own of which Mao or Gramsci would have been proud. This factional overthrow serves but one purpose, that “the instinctive priority of the Political Class has been to expand the role and powers of the executive and its proxies, sacrificing civil liberties if necessary.” (p. 183).
The inevitable attacks on the British monarchy are highlighted, seen as it is by the new rulers as an archaic irrelevance whose popularity with ordinary people they despise.
Parliament, and its essential function in what was a democratic Britain, has been undermined as a direct result of the journalistic backgrounds not just of MPs, but of advisers to government. “All important announcements”, writes Oborne, “are now made through the media, and only as an afterthought through the [House of] Commons.” (p. 201).
In addition to this sidelining of an ancient democratic process, Oborne shows the way in which the Parliamentary Commissioner for Standards had had his or her role watered down and weakened. The Political Class does not wish for scrutiny, at least not of itself. The people, of course, are another matter. Great Britain has around a quarter of the CCTV cameras in the world, far more per capita than Russia or North Korea.
The section of TPC dealing with the Political Class’s capture of the British media is exemplary of how democracy in Great Britain has been subverted. Oborne writes that the Political Class has “sought to give an almost constitutional role to the British media by building it up as an alternative to existing state institutions.” (p. 234).

In short, the British government and Her Majesty’s Opposition now use the media as a glorified advertising agency. ‘Client journalists’ now do the work Parliament used to do. This pact is compounded by a sleight of hand which effects to produce the myth of a ‘hostile media’, that is, a fourth estate which still fulfils its original role in speaking truth to power in any meaningful way. It does no such thing, of course, and any journalist who dissents from this arrangement will soon find themselves filing their copy in the backwaters of a provincial newspaper.
The role of the media in the Iraq War is focused on briefly in the book, and as an exemplar of the way in which the UK Political Class now uses the media. This war is still the most disgraceful chapter of Tony Blair’s tenure as Prime Minister, and Oborne lays out clinically the way that the British press, and the BBC, conspired to paint a flattering, Dorian Gray-like picture of Blair as war hero, when in fact it was the lies told by him and his jumped-up press secretary Alastair Campbell – very much a villain of Oborne’s book – that initiated that wholly spurious and ruinous conflict.
The great losers in this Caesarean and triumphalist rise to power are, of course, the British people. They are now treated as a set of consumerist statistics to be manipulated and triangulated. Indeed, as Oborne writes, “Members of the Political Class… regard civil society as a threat because it represents a giant area of the public domain which stands outside its control” (p. 329).
With serious calls from the likes of Tony Blair to have a second and even third Brexit referendum, the contempt that the Political Class has for the ordinary people they are supposed to represent is clear. The EU’s disdain for its citizens is even more apparent, and entire countries have already been made to vote more than once for continued membership of this corrupt bloc, the elites simply recasting the vote until it goes their way.
With British politics currently rudderless, and becoming more impotent by the week, it is tempting to herald the unravelling of Oborne’s Political Class, in the UK at least, and my only disappointment with TPC is that Oborne spends little time on technocracy, the fallacious idea that government is best suited to improve the lot of its citizens by virtue of its collective expertise. Having myself worked and clashed with management companies for the past ten years, I can see the parallels between management and government, and the willful blindness of those who believe they are the experts.
Oborne’s book is eerily prophetic, and shows what he calls the architecture of the Political Class. Any tremor which threatens to shake the whole is to be feared and attacked. In the same way that the average Republican is aghast at the victory of Donald Trump, so too the British political class would resist any attempt to alter its fundamental structure and aims, even if its own putative party were in power. Brexit is, of course, the most obvious example of resistance and, in the same way that the deep state is confounding Trump’s attempts to govern, so too the EU, in collusion with Britain’s own deep state, will not allow Brexit to happen without fighting to the last redoubt.
Towards the end of TPC, Oborne writes a paragraph that is a distant echo of Orwell’s famous statement, in his most famous book, that the only hope lies with the proles. It is profoundly to be wished for that these two great visionaries are right.
[It] is almost certain… that the next great political movement will come from outside the Political Class. Just as the Political Class has emerged from the wreckage of the party system, so it is certain to produce its own antithesis. At some stage a British politician may well discover a new language of public discourse and methodology of political engagement which communicates simply and plainly to voters. (p. 331).
Should this language and methodology ever be discovered, Peter Oborne’s prescient book will serve well both as its dictionary and instruction manual.
00:13 Publié dans Actualité, Livre, Livre, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : classe politique, grande-bretagne, royaume-uni, peter oborne, livre, théorie politique, politologie, sciences politiques, élites, fausses élites |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Avondland en Rijksgedachte
door Jonathan Van Tongeren
Ex: https://www.novini.nl
Er wordt veel gesproken over Europa of het Avondland. Maar wat is Europa? Velen hebben al gewezen op de betekenis van het Romeinse recht en het Griekse denken en sommigen noemen de Europese cultuur daarom zelfs excentrisch. Zij zien echter iets cruciaals over het hoofd. Kenmerkend voor het Avondland is de spanning tussen universaliteit en particulariteit. Dit laat zich het beste illustreren aan de hand van de Rijksgedachte.
Enerzijds is Europa voor een klein continent zeer rijk aan volken en naties, kent het een grote diversiteit aan regionale culturen en levenswijzen, anderzijds leeft nergens het universele denken sterker dan in Europa. Dat universele denken heeft bijvoorbeeld betrekking op het denken in termen van Europa of Avonland; ondanks de niet geringe culturele onderscheiden tussen de volken en regio’s van Europa, bestaat er toch een besef dat de Europeanen iets gemeen hebben, in zekere zin bij elkaar horen. Verder heeft het universele denken ook betrekking op de hele mensheid. Nergens wordt er zo sterk in termen van de gehele mensheid gedacht als in de Europese cultuurkring.
Aanvankelijk was Europa vooral een term die betrekking had op de klassieke beschaving ten westen van de oostkust van de Middellandse Zee. Het Romeinse Rijk breidde zich echter uit naar Gallië, Iberië en Germanië en incorporeerde Galliërs, Germanen en anderen in het Romeinse Rijk, ging ze op enig moment als Romeinse burgers beschouwen. Zo werden deze Germanen en anderen vanuit hun particulariteit opgenomen in de universaliteit van de Pax Romana. Hier werd een belangrijk fundament gelegd voor wat Europa later zou worden.
In de nadagen van het Romeinse Rijk organiseerde zich buiten het bereik van Rome, aan de andere kant van Rijn en Donau een confederatie van Germaanse stammen. Zij noemden zich de Franken, dat wil zeggen de vrijen, vrij van Romeinse overheersing. Deze Franken zouden later net als de Alemannen en anderen het Romeinse Rijk binnenvallen, zich vermengen met de lokale Gallo-Romeinse bevolking en er eigen koninkrijken vormen.
Nog later zou echter juist een Frankische koning de draad van het gevallen West-Romeinse Rijk weer opnemen: Karel de Grote. Dit is het eerste rijk, hier begint de Rijksgedachte. Het Rijk van Karel de Grote stond natuurlijk niet alleen in de universele traditie van het Romeinse Rijk, de Franken namen ook hun particulariteit mee. Hier zien we de typische spanning die kenmerkend is voor Europa. De Franken waren de dragende natie van het nieuwe Rijk, maar voor andere volken was zeer beslist plaats daarbinnen.
Zo hebben we gezien hoe het Romeinse en het Germaanse een rol speelde in de totstandkoming van het Europese. Ook het christendom speelde echter een belangrijke rol, het faciliteerde het samengaan van het Romeinse universele en het Germaanse particuliere. Het christendom kon de samenvloeiing van het Romeinse en het Germaanse faciliteren, doordat het zelf al de spanning tussen het universele en het particuliere in zich draagt. Dit zien we bijvoorbeeld als de apostel Paulus vanuit Klein-Azië naar Europa is gekomen en op de Areopagus in Athene met de mensen spreekt. We lezen hierover in Handelingen 17:15-34. In vers 26 zegt de apostel dan: “Hij [God] heeft uit één enkele [mens]het gehele menselijke geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte van de aarde te wonen en Hij heeft de hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald.” Enerzijds is de hele mensheid dus verwant, anderzijds wil God dat de mensen zich verspreiden op de aarde en volken zich ergens vestigen om eigen particuliere tradities vormen.

We zien in de geschiedenis ook terug dat dit denken heeft postgevat bij de gekerstende Germanen. Zonder Clovis die zich liet dopen, was er geen Karel de Grote geweest die bij Byzantium erkenning zocht van zijn rijk als opvolger van het West-Romeinse Rijk. Waar het Romeinse Rijk nog uitging van het opnemen van Galliërs en Germanen in het Romeinse Rijk door assimilatie, is deze neiging nauwelijks aanwezig in het Rijk van Karel de Grote. Waar Rome zijn particulariteit expandeerde tot universele proporties, neemt de universaliteit van het Frankische Rijk andere particulariteiten in zich op zonder die op te heffen.
De Rijksgedachte leeft later voort in het Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie. De Duitse natie is daarin dragend, maar andere naties hebben een plaats binnen het rijk dat zich uitstrekt naar Bohemen en Italië. Nog later zien we nog het meeste van de Rijksgedachte terug in de Oostenrijks-Hongaarse Dubbelmonarchie. Dat rijk wordt na de Eerste Wereldoorlog echter onder het mom van Wilsons idee van nationale zelfbeschikking aan stukken gereten. Deze schending van de Rijksgedachte zal grote gevolgen hebben voor Europa. “Dat is nu eenmaal”, zoals Schiller dicht, “de vloek van de euvele daad, dat ze, zich voortplantend, steeds nieuw kwaad baart.”
Hieruit komt dan ook de geperverteerde Rijksgedachte van een door de afloop van de Eerste Wereldoorlog gefrustreerde Oostenrijkse korporaal in Duitse dienst voort. Zijn zogenaamde Derde Rijk heeft niets uit te staan met de oude Rijksgedachte, het gaat hem om Lebensraum voor de Duitse natie en andere volken moeten daarvoor wijken of zelfs uitgeroeid worden. Om deze demonische pervertering van de Rijksgedachte uit te bannen moest alles uit de kast getrokken worden.
Maar na het uitbannen van deze geest, is Europa niet teruggekeerd naar de Rijksgedachte. Zo zitten we nu met een ten diepste on-Europese ‘ever closer union’. De vraag is of een terugkeer naar de Rijksgedachte om die onder de nieuwe omstandigheden opnieuw vorm te geven nog mogelijk is. Een appreciatie van het Europese erfgoed lijkt daarvoor niet toereikend. De Britse Conservatieve politicus, wijlen sir Fred Catherwood bracht het treffend onder woorden: “We have swept our European house clean of fascism and of communism. We now have democracy and freedom of speech from the Atlantic to the Urals. But we also now have a Europe emptier than before of the Christian faith. In the words of Christ’s parable, Europe is a house swept clean, ready for seven devils worse than the first to come in.”
00:54 Publié dans Affaires européennes, Histoire, Synergies européennes, Théorie politique, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : empire, saint empire, allemagne, occident, idée impériale, europe, affaires européennes, histoire, théorie politique, politologie, sciences politiques, philosophie politique, tradition, traditionalisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Een wereldorde gewrocht op wereldzeeën
door Jonathan Van Tongeren
Ex: http://www.novini.nl
In zijn boek Land en zee schetst de Duitse staatsrechtsgeleerde Carl Schmitt (1888-1985) de geopolitieke bronnen van het internationale recht en de Anglo-Amerikaanse wereldhegemonie, hij lokaliseert die in de overgang van de Britten van een eilandnatie naar een echte zeemacht.
In de eerste hoofdstukken van zijn boek schetst Schmitt de ontwikkelingen in de scheepvaart, de verkenning en de uiteindelijke beheersing van de zeeën. Hij gebruikt daar ettelijke hoofdstukken voor, waarmee hij ook het punt van de grote geleidelijkheid van deze ontwikkelingen overbrengt. Eerst was er wel zeevaart, maar waren er nog geen echte zeemachten, de zee begon als kustvaart en later beperkten handelsmachten als Genua en Venetië zich aanvankelijk tot binnenzeeën als de Middellandse Zee en de Zwarte Zee. Pas in de loop van de vijftiende eeuw gaat men de kust van Afrika verkennen, rondt men uiteindelijk de Kaap en trekken ontdekkingsreizigers als Vasco da Gama en Magellaan er op uit. En Columbus niet te vergeten.
 Maar het zijn protestanten in Noordwest-Europa die zich tot echte zeemachten ontwikkelen, doordat watergeuzen en piraten een primaire afhankelijkheid van de zee ontwikkelen. Het zullen uiteindelijk dan ook de Engelsen (en zij die als de Engelsen denken) zijn die de vrijgemaakte maritieme energieën beërven en het idee propageren dat de zee vrij is, dat de zee niemand toebehoort.Dat idee lijkt eerlijk genoeg, de zee is vrij dus van iedereen, niet waar? Maar als de open zee niemand toebehoort, geldt er uiteindelijk het recht van de sterkste. “De landoorlog heeft de tendens naar een open veldslag die beslissend is”, schrijft Schmitt. “In de zeeoorlog kan het natuurlijk ook tot een zeeslag komen, maar zijn kenmerkende middelen en methoden zijn beschieting en blokkade van vijandelijke kusten en confiscatie van vijandige en neutrale handelsschepen [..]. Het ligt in de aard van deze typerende middelen van de zeeoorlog, dat zij zich zowel tegen vechtenden als niet-vechtenden richten.”
Maar het zijn protestanten in Noordwest-Europa die zich tot echte zeemachten ontwikkelen, doordat watergeuzen en piraten een primaire afhankelijkheid van de zee ontwikkelen. Het zullen uiteindelijk dan ook de Engelsen (en zij die als de Engelsen denken) zijn die de vrijgemaakte maritieme energieën beërven en het idee propageren dat de zee vrij is, dat de zee niemand toebehoort.Dat idee lijkt eerlijk genoeg, de zee is vrij dus van iedereen, niet waar? Maar als de open zee niemand toebehoort, geldt er uiteindelijk het recht van de sterkste. “De landoorlog heeft de tendens naar een open veldslag die beslissend is”, schrijft Schmitt. “In de zeeoorlog kan het natuurlijk ook tot een zeeslag komen, maar zijn kenmerkende middelen en methoden zijn beschieting en blokkade van vijandelijke kusten en confiscatie van vijandige en neutrale handelsschepen [..]. Het ligt in de aard van deze typerende middelen van de zeeoorlog, dat zij zich zowel tegen vechtenden als niet-vechtenden richten.”
En dan maakt Schmitt een cruciaal punt: “[S]inds de Britse inbezitname van de zee raakten de Engelsen en de volkeren die in de ban van Engelse ideeën staan, eraan gewend. De voorstelling dat een landrijk een wereldomspannende macht zou kunnen uitoefenen zou volgens hun wereldbeeld ongehoord en onverdraaglijk zijn.”
Het Britse eilandrijk groeide uit tot een wereldomspannende macht, doordat het voor de zee koos. “Nadat de scheiding van land en zee en de tweespalt der beide elementen eenmaal tot constitutie van de planeet was geworden” ontwikkelde men een hele manier van denken en een internationaal rechtssysteem “waarmee de mensen voor zichzelf de wijsheid en redelijkheid van deze situatie verklaarden, zonder het oerfeit daarvan in het oog te houden: de Britse keuze voor de zee en de tijdsgebondenheid daarvan.” Zodoende kunnen we ons geen ander mondiaal economisch systeem en geen ander internationaal recht meer voorstellen. Daaruit blijkt “dat de grote Leviathan ook macht over de geest en de ziel van de mens heeft”.
Land en zee is rijk aan waardevolle gedachten, maar tegelijk een zeer compact boek, zodat de lezer vooral de tijd moet nemen om de sterk geconcentreerde ideeën die het bevat op zich in te laten werken. Recent is er een Nederlandse vertaling verschenen bij Uitgeverij De Blauwe Tijger, die dit klassieke werk mooi uitgevoerd heeft in een tweetalige editie met op de rechterpagina’s de vertaling en links het originele Duits. Een kleinood voor iedereen die iets wil begrijpen van de wereld waarin wij leven!
N.a.v. Carl Schmitt, Land en zee. Een wereldhistorische beschouwing (Uitgeverij De Blauwe Tijger: Groningen, 2017), vertaling: Henry van Sanderburg, paperback met stofomslag.
00:33 Publié dans Géopolitique, Livre, Livre, Révolution conservatrice, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : carl schmitt, géopolitique, thalassocratie, puissance maritime, révolution conservatrice, théorie politique, philosophie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Ex: https://www.geopolica.ru
Extrait de The Conservative Revolution (Moscou, Arktogaïa, 1994), The Russian Thing Vol. 1 (2001), et de The Philosophy of War (2004). – Article écrit en 1991, publié pour la première fois dans le journal Nash Sovremennik en 1992.
Le fameux juriste allemand Carl Schmitt est considéré comme un classique du droit moderne. Certains l’appellent le « Machiavel moderne » à cause de son absence de moralisme sentimental et de rhétorique humaniste dans son analyse de la réalité politique. Carl Schmitt pensait que, pour déterminer les questions juridiques, il faut avant tout donner une description claire et réaliste des processus politiques et sociaux et s’abstenir d’utopisme, de vœux pieux, et d’impératifs et de dogmes a priori. Aujourd’hui, l’héritage intellectuel et légal de Carl Schmitt est un élément nécessaire de l’enseignement juridique dans les universités occidentales. Pour la Russie aussi, la créativité de Schmitt est d’un intérêt et d’une importance particuliers parce qu’il s’intéressait aux situations critiques de la vie politique moderne. Indubitablement, son analyse de la loi et du contexte politique de la légalité peut nous aider à comprendre plus clairement et plus profondément ce qui se passe exactement dans notre société et en Russie.
Leçon #1 : la politique au-dessus de tout
Le principe majeur de la philosophie schmittienne de la loi était l’idée de la primauté inconditionnelle des principes politiques sur les critères de l’existence sociale. C’est la politique qui organisait et prédéterminait la stratégie des facteurs économiques internes et leur pression croissante dans le monde moderne. Schmitt explique cela de la manière suivante : « Le fait que les contradictions économiques sont maintenant devenues des contradictions politiques … ne fait que montrer que, comme toute autre activité humaine, l’économie parcourt une voie qui mène inévitablement à une expression politique » [1]. La signification de cette allégation employée par Schmitt, comprise comme un solide argument historique et sociologique, revient en fin de compte à ce qu’on pourrait définir comme une théorie de l’« idéalisme historique collectif ». Dans cette théorie, le sujet n’est pas l’individu ni les lois économiques développant la substance, mais un peuple concret, historiquement et socialement défini qui maintient, avec sa volonté dynamique particulière – dotée de sa propre loi – son existence socioéconomique, son unité qualitative, et la continuité organique et spirituelle de ses traditions sous des formes différentes et à des époques différentes. D’après Schmitt, le domaine politique représente l’incarnation de la volonté du peuple exprimée sous diverses formes reliées aux niveaux juridique, économique et sociopolitique.
Une telle définition de la politique est en opposition avec les modèles mécanistes et universalistes de la structure sociétale qui ont dominé la jurisprudence et la philosophie juridique occidentales depuis l’époque des Lumières. Le domaine politique de Schmitt est directement associé à deux facteurs que les doctrines mécanistes ont tendance à ignorer : les spécificités historiques d’un peuple doté d’une qualité particulière de volonté, et la particularité historique d’une société, d’un Etat, d’une tradition et d’un passé particuliers qui, d’après Schmitt, se concentrent dans leur manifestation politique. Ainsi, l’affirmation par Schmitt de la primauté de la politique introduisait dans la philosophie juridique et la science politique des caractéristiques qualitatives et organiques qui ne sont manifestement pas incluses dans les schémas unidimensionnels des « progressistes », qu’ils soient du genre libéral-capitaliste ou du genre marxiste-socialiste.
La théorie de Schmitt considérait donc la politique comme un phénomène « organique » enraciné dans le « sol ».
La Russie et le peuple russe ont besoin d’une telle compréhension de la politique pour bien gouverner leur propre destinée et éviter de devenir une fois de plus, comme il y a sept décennies, les otages d’une idéologie réductionniste antinationale ignorant la volonté du peuple, son passé, son unité qualitative, et la signification spirituelle de sa voie historique.
Leçon #2 : qu’il y ait toujours des ennemis ; qu’il y ait toujours des amis
Dans son livre Le concept du Politique, Carl Schmitt exprime une vérité extraordinairement importante : « Un peuple existe politiquement seulement s’il forme une communauté politique indépendante et s’oppose à d’autres communautés politiques pour préserver sa propre compréhension de sa communauté spécifique ». Bien que ce point de vue soit en désaccord complet avec la démagogie humaniste caractéristique des théories marxiste et libérale-démocratique, toute l’histoire du monde, incluant l’histoire réelle (pas l’histoire officielle) des Etats marxistes et libéraux-démocratiques, montre que ce fait se vérifie dans la pratique, même si la conscience utopique post-Lumières est incapable de le reconnaître. En réalité, la division politique entre « nous » et « eux » existe dans tous les régimes politiques et dans toutes les nations. Sans cette distinction, pas un seul Etat, pas un seul peuple et pas une seule nation ne pourraient préserver leur propre identité, suivre leur propre voie et avoir leur propre histoire.
Analysant sobrement l’affirmation démagogique de l’antihumanisme, de l’« inhumanité » d’une telle opposition, et de la division entre « nous » et « eux », Carl Schmitt note : « Si on commence à agir au nom de toute l’humanité, au nom de l’humanisme abstrait, en pratique cela signifie que cet acteur refuse toute qualité humaine à tous les adversaires possibles, se déclarant ainsi comme étant au-delà de l’humanité et au-delà de la loi, et donc menace potentiellement d’une guerre qui serait menée jusqu’aux limites les plus terrifiantes et les plus inhumaines ». D’une manière frappante, ces lignes furent écrites en 1934, longtemps avant l’invasion terroriste du Panama ou le bombardement de l’Irak par les Américains. De plus, le Goulag et ses victimes n’étaient pas encore très connus en Occident. Vu sous cet angle, ce n’est pas la reconnaissance réaliste des spécificités qualitatives de l’existence politique d’un peuple, présupposant toujours une division entre « nous » et « eux », qui conduit aux conséquences les plus terrifiantes, mais plutôt l’effort vers une universalisation totale et pour faire entrer les nations et les Etats dans les cellules des idées utopiques d’une « humanité unie et uniforme » dépourvue de toutes différences organiques ou historiques.
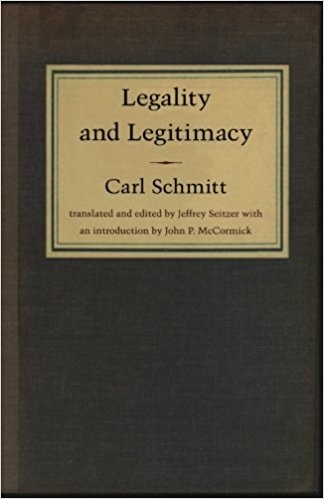 Commençant par ces conditions préalables, Carl Schmitt développa la théorie de la « guerre totale » et de la « guerre limitée » dénommée « guerre de forme », où la guerre totale est la conséquence de l’idéologie universaliste utopique qui nie les différences culturelles, historiques, étatiques et nationales naturelles entre les peuples. Une telle guerre représente en fait une menace de destruction pour toute l’humanité. Selon Carl Schmitt, l’humanisme extrémiste est la voie directe vers une telle guerre qui entraînerait l’implication non seulement des militaires mais aussi des populations civiles dans un conflit. Ceci est en fin de compte le danger le plus terrible. D’un autre coté, les « guerres de forme » sont inévitables du fait des différences entre les peuples et entre leurs cultures indestructibles. Les « guerres de forme » impliquent la participation de soldats professionnels, et peuvent être régulées par les règles légales définies de l’Europe qui portaient jadis le nom de Jus Publicum Europeum (Loi Commune Européenne). Par conséquent, de telles guerres représentent un moindre mal dont la reconnaissance théorique de leur inévitabilité peut protéger les peuples à l’avance contre un conflit « totalisé » et une « guerre totale ». A ce sujet, on peut citer le fameux paradoxe établi par Chigalev dans Les Possédés de Dostoïevski, qui dit : « En partant de la liberté absolue, j’arrive à l’esclavage absolu ». En paraphrasant cette vérité et en l’appliquant aux idées de Carl Schmitt, on peut dire que les partisans de l’humanisme radical « partent de la paix totale et arrivent à la guerre totale ». Après mûre réflexion, nous pouvons voir l’application de la remarque de Chigalev dans toute l’histoire soviétique. Si les avertissements de Carl Schmitt ne sont pas pris en compte, il sera beaucoup plus difficile de comprendre leur véracité, parce qu’il ne restera plus personne pour attester qu’il avait raison – il ne restera plus rien de l’humanité.
Commençant par ces conditions préalables, Carl Schmitt développa la théorie de la « guerre totale » et de la « guerre limitée » dénommée « guerre de forme », où la guerre totale est la conséquence de l’idéologie universaliste utopique qui nie les différences culturelles, historiques, étatiques et nationales naturelles entre les peuples. Une telle guerre représente en fait une menace de destruction pour toute l’humanité. Selon Carl Schmitt, l’humanisme extrémiste est la voie directe vers une telle guerre qui entraînerait l’implication non seulement des militaires mais aussi des populations civiles dans un conflit. Ceci est en fin de compte le danger le plus terrible. D’un autre coté, les « guerres de forme » sont inévitables du fait des différences entre les peuples et entre leurs cultures indestructibles. Les « guerres de forme » impliquent la participation de soldats professionnels, et peuvent être régulées par les règles légales définies de l’Europe qui portaient jadis le nom de Jus Publicum Europeum (Loi Commune Européenne). Par conséquent, de telles guerres représentent un moindre mal dont la reconnaissance théorique de leur inévitabilité peut protéger les peuples à l’avance contre un conflit « totalisé » et une « guerre totale ». A ce sujet, on peut citer le fameux paradoxe établi par Chigalev dans Les Possédés de Dostoïevski, qui dit : « En partant de la liberté absolue, j’arrive à l’esclavage absolu ». En paraphrasant cette vérité et en l’appliquant aux idées de Carl Schmitt, on peut dire que les partisans de l’humanisme radical « partent de la paix totale et arrivent à la guerre totale ». Après mûre réflexion, nous pouvons voir l’application de la remarque de Chigalev dans toute l’histoire soviétique. Si les avertissements de Carl Schmitt ne sont pas pris en compte, il sera beaucoup plus difficile de comprendre leur véracité, parce qu’il ne restera plus personne pour attester qu’il avait raison – il ne restera plus rien de l’humanité.
Passons maintenant au stade final de la distinction entre « nous » et « eux », celui des « ennemis » et des « amis ». Schmitt pensait que la centralité de cette paire est valable pour l’existence politique d’une nation, puisque c’est par ce choix que se décide un profond problème existentiel. Julien Freud, un disciple de Schmitt, formula cette thèse de la manière suivante : « La dualité ennemi-ami donne à la politique une dimension existentielle puisque la possibilité théoriquement impliquée de la guerre soulève le problème et le choix de la vie et de la mort dans ce cadre » [2].
Le juriste et le politicien, jugeant en termes d’« ennemi » et d’« ami » avec une claire conscience de la signification de ce choix, opèrent ainsi avec les mêmes catégories existentielles qui donnent aux décisions, aux actions et aux déclarations les qualités de réalité, de responsabilité et de sérieux dont manquent toutes les abstractions humanistes, transformant ainsi le drame de la vie et de la mort en une guerre dans un décor chimérique à une seule dimension. Une terrible illustration de cette guerre fut la couverture du conflit irakien par les médias occidentaux. Les Américains suivirent la mort des femmes, des enfants et des vieillards irakiens à la télévision comme s’ils regardaient des jeux vidéo du genre Guerre des Etoiles. Les idées du Nouvel Ordre Mondial, dont les fondements furent posés durant cette guerre, sont les manifestations suprêmes de la nature terrible et dramatique des événements lorsqu’ils sont privés de tout contenu existentiel.
La paire « ennemi »/« ami » est une nécessité à la fois externe et interne pour l’existence d’une société politiquement complète, et devrait être froidement acceptée et consciente. Sinon, tout le monde peut devenir un « ennemi » et personne n’est un « ami ». Tel est l’impératif politique de l’histoire.
Leçon #3 : La politique des «circonstances exceptionnelles» et la Décision
L’un des plus brillants aspects des idées de Carl Schmitt était le principe des « circonstances exceptionnelles » (Ernstfall en allemand, littéralement « cas d’urgence ») élevé au rang d’une catégorie politico-juridique. D’après Schmitt, les normes juridiques décrivent seulement une réalité sociopolitique normale s’écoulant uniformément et continuellement, sans interruptions. C’est seulement dans de telles situations purement normales que le concept de la « loi » telle qu’elle est comprise par les juristes s’applique pleinement. Il existe bien sûr des règlementations pour les « situations exceptionnelles », mais ces réglementations sont le plus souvent déterminées sur la base de critères dérivés d’une situation politique normale. La jurisprudence, d’après Schmitt, tend à absolutiser les critères d’une situation normale lorsqu’on considère l’histoire de la société comme un processus uniforme légalement constitué. L’expression la plus complète de ce point de vue est la « pure théorie de la loi » de Kelsen. Carl Schmitt, cependant, voit cette absolutisation d’une « approche légale » et du « règne de la loi » [= « Etat de droit »] comme un mécanisme tout aussi utopique et comme un universalisme naïf produit par les Lumières avec ses mythes rationalistes. Derrière l’absolutisation de la loi se dissimule une tentative de « mettre fin à l’histoire » et de la priver de son motif passionné créatif, de son contenu politique, et de ses peuples historiques. Sur la base de cette analyse, Carl Schmitt postule une théorie particulière des « circonstances exceptionnelles » ou Ernstfall.
L’Ernstfall est le moment où une décision politique est prise dans une situation qui ne peut plus être régulée par des normes légales conventionnelles. La prise de décision dans des circonstances exceptionnelles implique la convergence d’un certain nombre de facteurs organiques divers reliés à la tradition, au passé historique, aux constantes culturelles, ainsi qu’aux expressions spontanées, aux efforts héroïques, aux impulsions passionnées, et à la manifestation soudaine des énergies existentielles profondes. La Vraie Décision (le terme même de « décision » était un concept clé de la doctrine légale de Schmitt) est prise précisément dans une circonstance où les normes légales et sociales sont « interrompues » et où celles qui décrivent le cours naturel des processus politiques et qui commencent à agir dans le cas d’une « situation d’urgence » ou d’une « catastrophe sociopolitique » ne sont plus applicables. « Circonstances exceptionnelles » ne signifie pas seulement une catastrophe, mais le positionnement d’un peuple et de son organisme politique devant un problème, faisant appel à l’essence historique d’un peuple, à son noyau, et à sa nature secrète qui fait de ce peuple ce qu’il est. Par conséquent, la Décision politiquement prise dans une telle situation est une expression spontanée de la volonté profonde du peuple répondant à un défi global, existentiel ou historique (ici on peut comparer les vues de Schmitt à celles de Spengler, Toynbee et d’autres révolutionnaires-conservateurs avec lesquels Carl Schmitt avait des liens personnels).
Dans l’école juridique française, les adeptes de Carl Schmitt ont développé le terme spécial de « décisionnisme », à partir du mot français décision (allemand Entscheidung). Le décisionnisme met l’accent sur les « circonstances exceptionnelles », puisque c’est dans ce cas que la nation ou le peuple actualise son passé et détermine son avenir dans une dramatique concentration du moment présent où trois caractéristiques qualitatives du temps fusionnent, à savoir le pouvoir de la source d’où est issu ce peuple dans l’histoire, la volonté du peuple de faire face à l’avenir et d’affirmer le moment précis où le « Moi » éternel est révélé et où le peuple prend entièrement la responsabilité dans ses mains, et l’identité elle-même.
En développant sa théorie de l’Ernstfall et de l’Entscheidung, Carl Schmitt montra aussi que l’affirmation de toutes les normes juridiques et sociales survient précisément durant de telles périodes de « circonstances exceptionnelles » et qu’elle est primordialement basée sur une décision à la fois spontanée et prédéterminée. Le moment intermittent de l’expression singulière de la volonté porte plus tard sur la base des normes constantes qui existent jusqu’à l’émergence de nouvelles « circonstances exceptionnelles ». Cela illustre en fait parfaitement la contradiction inhérente aux idées des partisans radicaux du « règne de la loi » : ils ignorent consciemment ou inconsciemment le fait que l’appel à la nécessité d’établir le « règne de la loi » est lui-même une décision basée précisément sur la volonté politique d’un groupe donné. En un sens, cet impératif est avancé arbitrairement et pas comme une sorte de nécessité fatale et inévitable. Par conséquent, l’acceptation ou le refus du « règne de la loi » et en général l’acceptation ou le refus de tel ou tel modèle légal doit coïncider avec la volonté du peuple ou de l’Etat particulier auquel est adressée la proposition ou l’expression de volonté. Les partisans du « règne de la loi » tentent implicitement de créer ou d’utiliser les « circonstances exceptionnelles » pour mettre en œuvre leur concept, mais le caractère insidieux d’une telle approche et l’hypocrisie et l’incohérence de cette méthode peuvent tout naturellement provoquer une réaction populaire, dont le résultat pourrait très bien apparaître comme une autre décision alternative. De plus, il est d’autant plus probable que cette décision conduirait à l’établissement d’une réalité légale différente de celle recherchée par les universalistes.
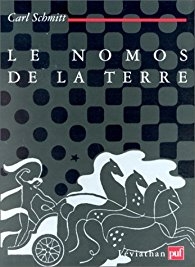 Le concept de la Décision au sens supra-légal ainsi que la nature même de la Décision elle-même s’accordent avec la théorie du « pouvoir direct » et du « pouvoir indirect » (potestas directa et potestas indirecta). Dans le contexte spécifique de Schmitt, la Décision est prise non seulement dans les instances du « pouvoir direct » (le pouvoir des rois, des empereurs, des présidents, etc.) mais aussi dans les conditions du « pouvoir indirect », dont des exemples peuvent être les organisations religieuses, culturelles ou idéologiques qui influencent l’histoire d’un peuple et d’un Etat, certes pas aussi clairement que les décisions des gouvernants mais qui opèrent néanmoins d’une manière beaucoup plus profonde et formidable. Schmitt pense donc que le « pouvoir indirect » n’est pas toujours négatif, mais d’un autre coté il ne fait qu’une allusion implicite au fait qu’une décision contraire à la volonté du peuple est le plus souvent adoptée et mise en œuvre par de tels moyens de « pouvoir indirect ». Dans son livre Théologie politique et dans sa suite Théologie politique II, il examine la logique du fonctionnement de ces deux types d’autorité dans les Etats et les nations.
Le concept de la Décision au sens supra-légal ainsi que la nature même de la Décision elle-même s’accordent avec la théorie du « pouvoir direct » et du « pouvoir indirect » (potestas directa et potestas indirecta). Dans le contexte spécifique de Schmitt, la Décision est prise non seulement dans les instances du « pouvoir direct » (le pouvoir des rois, des empereurs, des présidents, etc.) mais aussi dans les conditions du « pouvoir indirect », dont des exemples peuvent être les organisations religieuses, culturelles ou idéologiques qui influencent l’histoire d’un peuple et d’un Etat, certes pas aussi clairement que les décisions des gouvernants mais qui opèrent néanmoins d’une manière beaucoup plus profonde et formidable. Schmitt pense donc que le « pouvoir indirect » n’est pas toujours négatif, mais d’un autre coté il ne fait qu’une allusion implicite au fait qu’une décision contraire à la volonté du peuple est le plus souvent adoptée et mise en œuvre par de tels moyens de « pouvoir indirect ». Dans son livre Théologie politique et dans sa suite Théologie politique II, il examine la logique du fonctionnement de ces deux types d’autorité dans les Etats et les nations.
La théorie des « circonstances exceptionnelles » et le thème de la Décision (Entscheidung) associé à cette théorie sont d’une importance capitale pour nous aujourd’hui, puisque c’est précisément à un tel moment dans l’histoire de notre peuple et de notre Etat que nous nous trouvons, et les « circonstances exceptionnelles » sont devenues l’état naturel de la nation – et non seulement l’avenir politique de notre peuple mais aussi la compréhension et la confirmation essentielle de notre passé dépendent maintenant de la Décision. Si la volonté du peuple s’affirme et que le choix national du peuple dans ce moment dramatique peut clairement définir qui est « nous » et « eux », identifier les amis et les ennemis, et arracher une auto-affirmation politique à l’histoire, alors la Décision de l’Etat russe et du peuple russe sera sa propre décision existentielle historique qui placera un sceau de loyauté sur des millénaires de « construction du peuple » et de « construction de l’empire ». Cela signifie que notre avenir sera russe. Si d’autres prennent la décision, à savoir les partisans de l’« approche humaine commune », de l’« universalisme » et de l’« égalitarisme », qui depuis la mort du marxisme représentent les seuls héritiers directs de l’idéologie utopique et mécaniste des Lumières, alors non seulement le futur ne sera pas russe mais il sera « seulement humain » et donc il n’y aura « pas de futur » (du point de vue de l’être du peuple, de l’Etat et de la nation). Notre passé perdra tout son sens et les drames de la grande histoire russe se transformeront en une farce stupide sur la voie du mondialisme et du nivellement culturel complet au profit d’une « humanité universelle », c’est-à-dire l’« enfer de la réalité légale absolue ».
Leçon #4 : Les impératifs d’un Grand Espace
Carl Schmitt s’intéressa aussi à l’aspect géopolitique des questions sociales. La plus importante de ses idées dans ce domaine est la notion de « Grand Espace » (Grossraum) qui attira plus tard l’attention de nombreux économistes, juristes, géopoliticiens et stratèges européens. La signification conceptuelle du « Grand Espace » dans la perspective analytique de Carl Schmitt se trouve dans la délimitation des régions géographiques à l’intérieur desquelles les variantes de la manifestation politique des peuples et des Etats spécifiques inclus dans cette région peuvent être conjointes pour accomplir une généralisation harmonieuse et cohérente exprimée dans une « Grande Union Géopolitique ». Le point de départ de Schmitt était la question de la Doctrine Monroe américaine impliquant l’intégration économique et stratégique des puissances américaines dans les limites naturelles du Nouveau Monde. Etant donné que l’Eurasie représente un conglomérat beaucoup plus divers d’ethnies, d’Etats et de cultures, Schmitt postulait qu’il fallait donc parler non tant de l’intégration continentale totale que de l’établissement de plusieurs grandes entités géopolitiques, chacune devant être gouvernée par un super-Etat flexible. Ceci est assez analogue au Jus Publicum Europeaum ou à la Sainte Alliance proposée à l’Europe par l’empereur russe Alexandre 1er.
D’après Carl Schmitt, un « Grand Espace » organisé en une structure politique flexible de type impérial et fédéral équilibrerait les diverses volontés nationales, ethniques et étatiques et jouerait le rôle d’une sorte d’arbitre impartial ou de régulateur des conflits locaux possibles, les « guerres de forme ». Schmitt soulignait que les « Grands Espaces », pour pouvoir être des formations organiques et naturelles, doivent nécessairement représenter des territoires terrestres, c’est-à-dire des entités tellurocratiques, des masses continentales. Dans son fameux livre Le Nomos de la Terre, il traça l’histoire de macro-entités politiques continentales, la voie de leur intégration, et la logique de leur établissement graduel en tant qu’empires. Carl Schmitt remarquait que parallèlement à l’existence de constantes spirituelles dans le destin d’un peuple, c’est-à-dire des constantes incarnant l’essence spirituelle d’un peuple, il existait aussi des constantes géopolitiques des « Grands Espaces » qui gravitent vers une nouvelle restauration avec des intervalles de plusieurs siècles ou même de millénaires. Dans ce sens, les macro-entités géopolitiques sont stables quand leur principe intégrateur n’est pas rigide ni recréé abstraitement, mais flexible, organique, et en accord avec la Décision des peuples, avec leur volonté, et avec leur énergie passionnée capable de les impliquer dans un bloc tellurocratique unifié avec leurs voisins culturels, géopolitiques ou étatiques.
La doctrine des « Grands Espaces » (Grossraum) fut établie par Carl Schmitt non seulement comme une analyse des tendances historiques dans l’histoire du continent, mais aussi comme un projet pour l’unification future que Schmitt considérait non seulement comme possible, mais désirable et même nécessaire en un certain sens. Julien Freund résuma les idées de Schmitt sur le futur Grossraum dans les termes suivants : « L’organisation de ce nouvel espace ne requerra aucune compétence scientifique, ni de préparation culturelle ou technique dans la mesure où elle surgira en résultat d’une volonté politique, dont l’ethos transforme l’apparence de la loi internationale. Dès que ce ‘Grand Espace’ sera unifié, la chose la plus importante sera la force de son ‘rayonnement’ » [3].
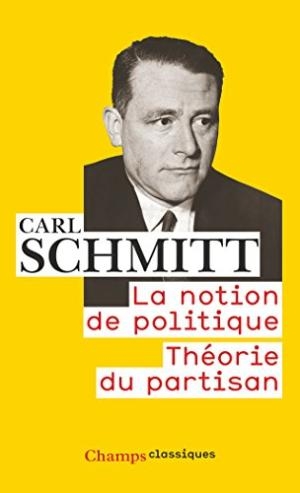 Ainsi, l’idée schmittienne du « Grand Espace » possède aussi une dimension spontanée, existentielle et volitionnelle, tout comme le sujet fondamental de l’histoire selon lui, c’est-à-dire le peuple en tant qu’unité politique. Tout comme les géopoliticiens Mackinder et Kjellen, Schmitt opposait les empires thalassocratiques (la Phénicie, l’Angleterre, les Etats-Unis, etc.) aux empires tellurocratiques (l’empire romain, l’empire austro-hongrois, l’empire russe, etc.). Dans cette perspective, l’organisation harmonieuse et organique d’un espace n’est possible que pour les empires tellurocratiques, et la Loi Continentale ne peut être appliquée qu’à eux. La thalassocratie, sortant des limites de son Ile et initiant une expansion navale, entre en conflit avec les tellurocraties et, en accord avec la logique géopolitique, commence à miner diplomatiquement, économiquement et militairement les fondements des « Grands Espaces » continentaux. Ainsi, dans la perspective des « Grands Espaces » continentaux, Schmitt revient une fois de plus aux concepts des paires ennemis/amis et nous/eux, mais cette fois-ci à un niveau planétaire. La volonté des empires continentaux, les « Grands Espaces », se révèle dans la confrontation entre les macro-intérêts continentaux et les macro-intérêts maritimes. La « Mer » défie ainsi la « Terre », et en répondant à ce défi, la « Terre » revient le plus souvent à sa conscience de soi continentale profonde.
Ainsi, l’idée schmittienne du « Grand Espace » possède aussi une dimension spontanée, existentielle et volitionnelle, tout comme le sujet fondamental de l’histoire selon lui, c’est-à-dire le peuple en tant qu’unité politique. Tout comme les géopoliticiens Mackinder et Kjellen, Schmitt opposait les empires thalassocratiques (la Phénicie, l’Angleterre, les Etats-Unis, etc.) aux empires tellurocratiques (l’empire romain, l’empire austro-hongrois, l’empire russe, etc.). Dans cette perspective, l’organisation harmonieuse et organique d’un espace n’est possible que pour les empires tellurocratiques, et la Loi Continentale ne peut être appliquée qu’à eux. La thalassocratie, sortant des limites de son Ile et initiant une expansion navale, entre en conflit avec les tellurocraties et, en accord avec la logique géopolitique, commence à miner diplomatiquement, économiquement et militairement les fondements des « Grands Espaces » continentaux. Ainsi, dans la perspective des « Grands Espaces » continentaux, Schmitt revient une fois de plus aux concepts des paires ennemis/amis et nous/eux, mais cette fois-ci à un niveau planétaire. La volonté des empires continentaux, les « Grands Espaces », se révèle dans la confrontation entre les macro-intérêts continentaux et les macro-intérêts maritimes. La « Mer » défie ainsi la « Terre », et en répondant à ce défi, la « Terre » revient le plus souvent à sa conscience de soi continentale profonde.
Comme remarque additionnelle, nous illustrerons la théorie du Grossraum avec deux exemples. A la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe, le territoire américain était divisé entre plusieurs pays du Vieux Monde. Le Far West, la Louisiane appartenaient aux Espagnols et plus tard aux Français ; le Sud appartenait au Mexique ; le Nord à l’Angleterre, etc. Dans cette situation, l’Europe représentait une puissance tellurocratique pour les Américains, empêchant l’unification géopolitique et stratégique du Nouveau Monde sur les plans militaire, économique et diplomatique. Après que les Américains aient obtenu l’indépendance, ils commencèrent graduellement à imposer de plus en plus agressivement leur volonté géopolitique au Vieux Monde, ce qui conduisit logiquement à l’affaiblissement de l’unité continentale du « Grand Espace » européen. Par conséquent, dans l’histoire géopolitique des « Grands Espaces », il n’y a pas de puissances absolument tellurocratiques ou absolument thalassocratiques. Les rôles peuvent changer, mais la logique continentale demeure constante.
En résumant la théorie schmittienne des « Grands Espaces » et en l’appliquant à la situation de la Russie d’aujourd’hui, nous pouvons dire que la séparation et la désintégration du « Grand Espace » autrefois nommé URSS contredit la logique continentale de l’Eurasie, puisque les peuples habitant nos terres ont perdu l’opportunité de faire appel à l’arbitrage de la superpuissance [soviétique] capable de réguler ou d’empêcher les conflits potentiels et réels. Mais d’un autre coté, le rejet de la démagogie marxiste excessivement rigide et inflexible au niveau de l’idéologie d’Etat peut conduire et conduira à une restauration spontanée et passionnée du Bloc Eurasien Oriental, puisqu’une telle reconstruction est en accord avec toutes les ethnies indigènes organiques de l’espace impérial russe. De plus, il est très probable que la restauration d’un Empire Fédéral, d’un « Grand Espace » englobant la partie orientale du continent, entraînerait au moyen de son « rayonnement de puissance » l’adhésion de ces territoires additionnels qui sont en train de perdre rapidement leur identité ethnique et étatique dans la situation géopolitique critique et artificielle prévalant depuis l’effondrement de l’URSS. D’autre part, la pensée continentale du génial juriste allemand nous permet de distinguer entre « nous » et « eux » au niveau continental.
La conscience de la confrontation naturelle et dans une certaine mesure inévitable entre les puissances tellurocratiques et thalassocratiques offre aux partisans et aux créateurs d’un nouveau Grand Espace une compréhension claire de l’« ennemi » auquel font face l’Europe, la Russie et l’Asie, c’est-à-dire les Etats-Unis d’Amérique avec leur alliée insulaire thalassocratique, l’Angleterre. En quittant le macro-niveau planétaire et en revenant au niveau de la structure sociale de l’Etat russe, il s’ensuit donc que la question devrait être posée : un lobby thalassocratique caché ne se trouve-t-il pas derrière le désir d’influencer la Décision russe des problèmes dans un sens « universaliste » qui peut exercer son influence par un pouvoir à la fois « direct » et « indirect » ?
Leçon #5 : La « paix militante » et la téléologie du Partisan
A la fin de sa vie (il mourut le 7 avril 1985), Carl Schmitt accorda une attention particulière à la possibilité d’une issue négative de l’histoire. Cette issue négative de l’histoire est en effet tout à fait possible si les doctrines irréalistes des humanistes radicaux, des universalistes, des utopistes et des partisans des « valeurs communes universelles », centrées sur le gigantesque potentiel symbolique de la puissance thalassocratique que sont les USA, parviennent à une domination globale et deviennent le fondement idéologique d’une nouvelle dictature mondiale – la dictature d’une « utopie mécaniste ». Schmitt pensait que le cours de l’histoire moderne se dirigeait inévitablement vers ce qu’il nommait la « guerre totale ».
Selon Schmitt, la logique de la « totalisation » des relations planétaires au niveau stratégique, militaire et diplomatique se base sur les points-clés suivants. A partir d’un certain moment de l’histoire, ou plus précisément à l'époque de la Révolution française et de l’Indépendance des Etats-Unis d’Amérique, commença un éloignement fatal vis-à-vis des constantes historiques, juridiques, nationales et géopolitiques qui garantissaient auparavant l'harmonie organique sur la planète et qui servaient le « Nomos de la Terre ».
Sur le plan juridique, un concept quantitatif artificiel et atomique, celui des « droits individuels » (qui devint plus tard la fameuse théorie des « droits de l'homme »), commença à se développer et remplaça le concept organique des « droits des peuples », des « droits de l’Etat », etc. Selon Schmitt, l’élévation de l’individu et du facteur individuel isolé de sa nation, de sa tradition, de sa culture, de sa profession, de sa famille, etc., au niveau d’une catégorie juridique autonome signifie le début du « déclin de la loi » et sa transformation en une chimère égalitaire utopique, s’opposant aux lois organiques de l’histoire des peuples et des Etats, des régimes, des territoires et des unions.
Au niveau national, les principes organiques impériaux et fédéraux ont fini par être remplacés par deux conceptions opposées mais tout aussi artificielles : l’idée jacobine de l’« Etat-nation » et la théorie communiste de la disparition complète de l’Etat et du début de l'internationalisme total. Les empires qui avaient préservé des vestiges de structures organiques traditionnelles, comme l’Autriche-Hongrie, l’empire ottoman, l’empire russe, etc., furent rapidement détruits sous l’influence de facteurs externes aussi bien qu’internes. Enfin, au niveau géopolitique, le facteur thalassocratique s’intensifia à un tel degré qu’une profonde déstabilisation des relations juridiques entre les « Grands Espaces » eut lieu. Notons que Schmitt considérait la « Mer » comme un espace beaucoup plus difficile à délimiter et à ordonner juridiquement que celui de la « Terre ».
La diffusion mondiale de la dysharmonie juridique et géopolitique fut accompagnée par la déviation progressive des conceptions politico-idéologiques dominantes vis-à-vis de la réalité, et par le fait qu’elles devinrent de plus en plus chimériques, illusoires et en fin de compte hypocrites. Plus on parlait de « monde universel », plus les guerres et les conflits devenaient terribles. Plus les slogans devenaient « humains », plus la réalité sociale devenait inhumaine. C’est ce processus que Carl Schmitt nomma le début de la « paix militante », c’est-à-dire un état où il n’y a plus ni guerre ni paix au sens traditionnel. Aujourd’hui la « totalisation » menaçante contre laquelle Carl Schmitt nous avait mis en garde a fini par prendre le nom de « mondialisme ». La « paix militante » a reçu son expression complète dans la théorie du Nouvel Ordre Mondial américain qui dans son mouvement vers la « paix totale » conduit clairement la planète vers une nouvelle « guerre totale ».
Carl Schmitt pensait que la conquête de l’espace était le plus important événement géopolitique symbolisant un degré supplémentaire d’éloignement vis-à-vis de la mise en ordre légitime de l’espace, puisque le cosmos est encore plus difficilement « organisable » que l’espace maritime. Schmitt pensait que le développement de l’aviation était aussi un pas de plus vers la « totalisation » de la guerre, l’exploration spatiale étant le début du processus de la « totalisation » illégitime finale.
Parallèlement à l’évolution fatale de la planète vers une telle monstruosité maritime, aérienne et même spatiale, Carl Schmitt, qui s’intéressait toujours à des catégories plus globales (dont la plus petite était « l’unité politique du peuple »), en vint à être attiré par une nouvelle figure dans l’histoire, la figure du « Partisan ». Carl Schmitt y consacra son dernier livre, La théorie du Partisan. Schmitt vit dans ce petit combattant contre des forces bien plus puissantes une sorte de symbole de la dernière résistance de la tellurocratie et de ses derniers défenseurs.
Le partisan est indubitablement une figure moderne. Comme d’autres types politiques modernes, il est séparé de la tradition et il vit en-dehors du Jus Publicum. Dans son combat, le Partisan brise toutes les règles de la guerre. Il n’est pas un soldat, mais un civil utilisant des méthodes terroristes qui, en-dehors du temps de guerre, seraient assimilées à des actes criminels gravissimes apparentés au terrorisme. Cependant, d’après Schmitt, c’est le Partisan qui incarne la « fidélité à la Terre ». Le Partisan est, pour le dire simplement, une réponse légitime au défi illégitime masqué de la « loi » moderne.

Le caractère extraordinaire de la situation et l’intensification constante de la « paix militante » (ou « guerre pacifiste », ce qui revient au même) inspirent le petit défenseur du sol, de l’histoire, du peuple et de la nation, et constituent la source de sa justification paradoxale. L’efficacité stratégique du Partisan et de ses méthodes est, d’après Schmitt, la compensation paradoxale du début de la « guerre totale » contre un « ennemi total ». C’est peut-être cette leçon de Carl Schmitt, qui s’inspirait lui-même beaucoup de l’histoire russe, de la stratégie militaire russe, et de la doctrine politique russe, incluant des analyses des œuvres de Lénine et Staline, qui est la plus intimement compréhensible pour les Russes. Le Partisan est un personnage intégral de l’histoire russe, qui apparaît toujours quand la volonté du pouvoir russe et la volonté profonde du peuple russe lui-même prennent des directions divergentes.
Dans l’histoire russe, les troubles et la guerre de partisans ont toujours eu un caractère compensatoire purement politique, visant à corriger le cours de l’histoire nationale quand le pouvoir politique se sépare du peuple. En Russie, les partisans gagnèrent les guerres que le gouvernement perdait, renversèrent les systèmes économiques étrangers à la tradition russe, et corrigèrent les erreurs géopolitiques de ses dirigeants. Les Russes ont toujours su déceler le moment où l’illégitimité ou l’injustice organique s’incarne dans une doctrine s’exprimant à travers tel ou tel personnage. En un sens, la Russie est un gigantesque Empire Partisan, agissant en-dehors de la loi et conduit par la grande intuition de la Terre, du Continent, ce « Grand, très Grand Espace » qui est le territoire historique de notre peuple.
Et à présent, alors que le gouffre entre la volonté de la nation et la volonté de l’establishment en Russie (qui représente exclusivement « le règne de la loi » en accord avec le modèle universaliste) s’élargit dangereusement et que le vent de la thalassocratie impose de plus en plus la « paix militante » dans le pays et devient graduellement une forme de « guerre totale », c’est peut être cette figure du Partisan russe qui nous montrera la voie de l’Avenir Russe au moyen d’une forme extrême de résistance, par la transgression des limites artificielles et des normes légales qui ne sont pas en accord avec les canons véritables de la Loi Russe.
Une assimilation plus complète de la cinquième leçon de Carl Schmitt signifie l’application de la Pratique Sacrée de la défense de la Terre.
Remarques finales
Enfin, la sixième leçon non formulée de Carl Schmitt pourrait être un exemple de ce que la figure de la Nouvelle Droite européenne, Alain de Benoist, nommait l’« imagination politique » ou la « créativité idéologique ». Le génie du juriste allemand réside dans le fait que non seulement il sentit les « lignes de force » de l’histoire mais aussi qu’il entendit la voix mystérieuse du monde des essences, même si celui-ci est souvent caché sous les phénomènes vides et fades du monde moderne complexe et dynamique. Nous les Russes devrions prendre exemple sur la rigueur germanique et transformer nos institutions lourdaudes et surévaluées en formules intellectuelles claires, en projets idéologiques clairs, et en théories convaincantes et impérieuses.
Aujourd’hui, c’est d’autant plus nécessaire que nous vivons dans des « circonstances exceptionnelles », au seuil d’une Décision si importante que notre nation n’en a peut-être jamais connue de telle auparavant. La vraie élite nationale n’a pas le droit de laisser son peuple sans une idéologie qui doit exprimer non seulement ce qu’il ressent et pense, mais aussi ce qu’il ne ressent pas et ne pense pas, et même ce qu’il a nourri secrètement en lui-même et pieusement vénéré pendant des millénaires.
Si nous n’armons pas idéologiquement l’Etat, un Etat que nos adversaires pourraient temporairement nous arracher, alors nous devons forcément et sans faille armer idéologiquement le Partisan Russe qui se réveille aujourd’hui pour accomplir sa mission continentale dans ce que sont maintenant les Riga et Vilnius en cours d’« anglicisation », le Caucase en train de s’« obscurcir », l’Asie Centrale en train de « jaunir », l’Ukraine en train de se « poloniser », et la Tatarie « aux yeux noirs ».
La Russie est un Grand Espace dont la Grande Idée est portée par son peuple sur son gigantesque sol eurasien continental. Si un génie allemand sert notre Réveil, alors les Teutons auront mérité une place privilégiée parmi les « amis de la Grande Russie » et deviendront « les nôtres », ils deviendront des « Asiates », des « Huns » et des « Scythes » comme nous, des autochtones de la Grande Forêt et des Grandes Steppes.
Notes
[1] Carl Schmitt, Der Begriff des Politischen, p. 127
[2] Julien Freund, « Les lignes de force de la pensée politique de Carl Schmitt », Nouvelle Ecole No. 44.
[3] Ibid.
09:56 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Eurasisme, Géopolitique, Révolution conservatrice, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, russie, alexandre douguine, europe, affaires européennes, carl schmitt, révolution conservatrice, eurasisme, nouvelle droite russe, nouvelle droite, théorie politique, politique internationale, philosophie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Sur le quatrième monde, ou le retour de la politique
Par Hervé Juvin
Deuxième colloque de Chișinău (15-16 décembre 2017)
Ex: http://lesakerfrancophone.fr
Quel est le monde dans lequel nous entrons ? Quel est le monde dans lequel nous nous engageons à vivre ?
Les organisateurs de ce colloque ont eu raison lorsqu’ils ont choisi ce sujet : la quatrième économie. Mais je ne suis pas sûr qu’ils aient raison s’ils veulent que nous limitions notre champ d’application aux seuls problèmes économiques actuels.
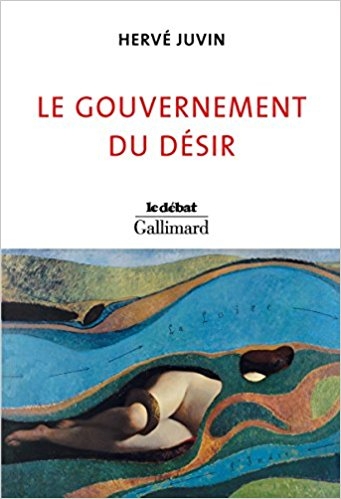 Ma réponse sera : le monde conduit par l’économie est le vieux monde. Nous ne regardons pas seulement l’échec misérable des institutions de Bretton Woods et de l’ordre libéral de l’Occident. Non seulement nous assistons à l’effondrement de la finance globalisée et des marchés interconnectés, mais aussi à celui d’un système dirigé par les Américains. Nous sommes les témoins de la fin de l’économie telle que nous la connaissions. Vous dites : économie ? Dites politique, idiot ! 1
Ma réponse sera : le monde conduit par l’économie est le vieux monde. Nous ne regardons pas seulement l’échec misérable des institutions de Bretton Woods et de l’ordre libéral de l’Occident. Non seulement nous assistons à l’effondrement de la finance globalisée et des marchés interconnectés, mais aussi à celui d’un système dirigé par les Américains. Nous sommes les témoins de la fin de l’économie telle que nous la connaissions. Vous dites : économie ? Dites politique, idiot ! 1
Pour le dire franchement ; la quatrième économie ne concerne pas l’économie, elle concerne surtout la politique, « nous, les gens » contre « l’ego, moi, moi-même » et il s’agit aussi de spiritualité. La lettre encyclique du Pape François, « Laudato si » est peut-être le texte politique le plus important de la décennie. Il s’agit principalement de ce que nous appelons « l’écologie humaine ». Et il s’agit aussi d’économie. Parce qu’il s’agit de survie.
Nous avons quitté l’économie agraire quelque part au siècle dernier, à un moment où l’ère industrielle était à son apogée. Ensuite, nous sommes doucement passés à une économie financière et de l’information dans laquelle nous sommes plus ou moins intégrés. Permettez-moi de prendre un exemple. J’ai commencé mon activité professionnelle à une époque où les compagnies aériennes comparaient le nombre de vols qu’elles effectuaient et le nombre de clients qu’elle servaient par an ; où deux constructeurs automobiles comparaient la taille de leurs usines, le nombre de leurs employés et les voitures qu’ils produisaient. De nos jours, ils ne font que comparer leur Ebitda et le ROE ; leurs travaux ne concernent plus les clients ou les produits, mais seulement l’argent. Gagner de l’argent, à tout prix. Est-ce qu’ils savent même ce qu’ils produisent ?
Quelle est la prochaine grande chose ? Ne rêvez pas des biotechnologies, des nanotechnologies, de l’intelligence artificielle, etc. Tout cela est bon pour les gars de Davos et pour ceux qui ont développé une telle foi qu’ils croient que la technologie peut résoudre tous les problèmes que la technologie a créés et crée encore à grande échelle. Et il y en a beaucoup à venir ! Attendez-vous simplement à un cauchemar avec l’impact des inégalités croissantes ; non seulement la pauvreté, mais l’expulsion de la nature d’un nombre croissant de personnes, passant la plus grande partie de leur temps devant un écran, obsédés par Internet, et n’ayant aucun accès à la nature à aucun prix – dunes de sable, forêts, rivières, et le chant des oiseaux, tout cela devenant le privilège des très riches, les seuls à garder un accès direct et illimité à la nature.
Notre condition actuelle est façonnée par deux tendances puissantes ; une extinction massive de la diversité, à la fois naturelle et culturelle ; et le surgissement de l’économie comme vraie nature des êtres humains – le totalitarisme de l’ego.
Nous sommes proches d’une compréhension très précise que les deux constituent la plus grande menace contre la survie humaine, et que les deux appellent donc à une course à la vie. Le fait est que cette menace vient directement de ce qu’on nous dit de célébrer le plus : développement ; croissance ; technologie ; libre échange… Nous chérissons profondément la cause même de notre disparition, nous aimons ce qui nous amène au bord de l’extinction…
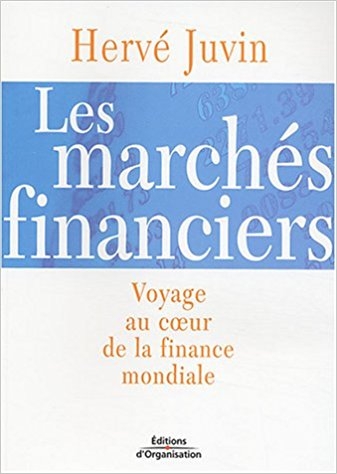 Laissez-moi dire quelques mots sur chaque question.
Laissez-moi dire quelques mots sur chaque question.
Vous lisez beaucoup de choses sur l’extinction massive des insectes, des grands mammifères, etc. En fait, il y a plus d’une centaine d’espèces différentes de poulets dans la nature ; 97% des fermes industrialisées n’élèvent que trois espèces de poulets. Selon la FAO, plus de dix mille espèces de légumes étaient consommées il y a un siècle. L’agro-industrie a réduit cette diversité à moins de 60% pour 90% de ses produits commerciaux. Et la superficie occupée par l’agro-industrie est trois fois plus élevée qu’il y a vingt ans, mais un tiers du sol fertile est surexploité et proche de la désertification, selon un rapport de la FAO récemment publié à Ordos, en Chine. Mais c’est encore plus inquiétant côté humain. Il y a quarante ans, plus de 8000 langues différentes avaient encore une communauté de locuteurs dans le monde. De nos jours, 7000 n’ont pas plus d’un ou deux locuteurs, et elles vont bientôt disparaître avec eux. Le nombre de langues humaines a été divisé par près de dix fois en un demi-siècle, et chaque langue perdue est une bibliothèque qui brûle ! Du logement à l’agro-industrie, des modèles sociaux aux cultures autochtones, de la gastronomie locale aux aliments transformés, le trésor vivant de la diversité humaine est sur le point de s’effondrer ; nous devons savoir que la diversité entre les espèces ainsi qu’entre les communautés humaines est le facteur clé de la survie. Et cet atout crucial est en jeu.
La puissante tendance derrière l’effondrement de la diversité naturelle et humaine est le surgissement de l’économie en tant que véritable nature humaine et en tant que foi religieuse. Ce que nous appelons économie est l’association explosive entre une économie extractive et une économie de la cupidité au nom des droits individuels de l’homme. Cela repose presque entièrement sur deux hypothèses.
Premièrement, les ressources naturelles sont en quantité illimitée. Et elles sont gratuites. Le prix des ressources naturelles n’est que le prix de leur extraction, de leur transport et de leur emballage. Le marketing compte aussi. Juste pour mettre dans les rêves de milliards de personnes des marques et des produits dont ils n’ont jamais rêvé et dont ils n’ont absolument pas besoin. Ces hypothèses visaient à donner à l’homme la puissance de Dieu ; un pouvoir illimité, inégalé et sans égal sur n’importe quelle créature, et aussi sur la planète. Pour cet être humain libéré de ses chaînes, il n’y a plus de contraintes, ni de nature, ni de Dieu ; il est son propre créateur, et quand et où il y a des limites, il y a juste des problèmes à résoudre. Pour l’individu souverain, comme nouvelle religion des droits de l’homme, la foi religieuse elle-même n’est qu’un problème à résoudre. Mais cette supposition est fausse, et nous le savons. Nous payons déjà pour des ressources que personne n’a jamais rêvé de payer ; quel est le marché de l’émission de carbone, si ce n’est le marché de l’air pur ? Nous craignons déjà des maladies dans l’eau, dans la terre, et dans trop de formes de vie. Et le roi de la peur joue en coulisse, la peur du changement climatique, la peur des maladies, la peur d’une espérance de vie plus courte et, de plus, la peur de la vie elle-même − la peur du monde extérieur. L’Ouest ne le comprend pas et considère qu’il s’agit juste d’un autre problème à résoudre. Si vous ne voulez pas être un américain comme tout le monde veut l’être, vous avez un problème. Un gros problème, oui.
 La deuxième hypothèse est que toute société humaine dans le monde entier est à la recherche de développement. C’est aussi un mensonge. En fait, la plupart des communautés indigènes et des confessions religieuses sont organisées contre le développement ; elles n’ont pas de place pour une telle chose dans leur communauté. Près de chez moi, sur la côte ouest de Madagascar, ils brûlent la maison de quiconque devient riche, pour le garder dans la communauté. Ils comprennent très bien que l’argent est le grand fossé entre les êtres humains, et l’économie de marché, la fin des communs. Le fait n’est pas qu’ils sont incapables de se développer eux-mêmes ; la vérité est que, en tant que communauté, ils refusent l’individualisme lié au développement économique. Ils préfèrent leur communauté au droit illimité de rompre avec elle et avec la nature elle-même. La phrase qu’ils préfèrent est « Mieux vaux une touche de fihavanana (le bien-être collectif) qu’une tonne d’or ». Pour le bien de la croissance, ce que nous appelons le développement, c’est la rupture de ces communautés contre leur volonté et la fin de leur bien-être collectif pour les fausses promesses d’un accomplissement individuel. Sous le faux drapeau de la liberté, pour le commerce et l’argent, les Occidentaux l’ont fait à plusieurs reprises, de la rupture du Japon par le commodore Perry, aux misérables guerres de l’Opium contre la Chine, à la guerre criminelle contre les gouvernements nationalistes des Philippines ou d’Amérique du Sud. Les opérations criminelles de la Fondation Gates introduisant des OGM dans les pays pauvres d’Afrique, réduisant le paysan en esclavage. Il y a aussi le grand projet d’électrification de l’Afrique ouvrant la porte à la nouvelle colonisation des terres, des cultures, des forêts et des richesses de sa biodiversité, par les grandes entreprises. Et ce qui importe le plus, c’est la destruction des symboles de leurs traditions [« Rest » en anglais, NdT], de leurs choses sacrées et, finalement, de leur foi – l’usine du dénuement moral ; les rendant honteux de qui ils sont. De l’Afrique à l’Amérique du Sud ou de l’Asie du Sud-Est à la Russie, les populations autochtones savent très bien que tout n’est pas à vendre ; vous ne pouvez pas échanger quelques acres de forêt tropicale contre quelques acres de toundra. Vous ne pouvez pas échanger le dernier rhinocéros blanc contre des actions dans des parcs animaliers. Et ils craignent que l’avidité illimitée provoque des guerres pour les ressources ; qu’est-ce que l’invasion de l’Irak, sinon une guerre pour le pétrole, la guerre civile en Syrie, sinon une guerre pour l’eau, qu’est-ce que le meurtre de Saddam Hussein, de Mouammar Kadhafi, le bombardement d’une usine de produits pharmaceutiques au Soudan ? Et tant de nombreuses attaques terroristes similaires, à l’exception d’une tentative désespérée de contrôler les ressources naturelles, la vie elle-même, et de maintenir la capacité des États-Unis à ne jamais faire face à leur dette insoutenable ?
La deuxième hypothèse est que toute société humaine dans le monde entier est à la recherche de développement. C’est aussi un mensonge. En fait, la plupart des communautés indigènes et des confessions religieuses sont organisées contre le développement ; elles n’ont pas de place pour une telle chose dans leur communauté. Près de chez moi, sur la côte ouest de Madagascar, ils brûlent la maison de quiconque devient riche, pour le garder dans la communauté. Ils comprennent très bien que l’argent est le grand fossé entre les êtres humains, et l’économie de marché, la fin des communs. Le fait n’est pas qu’ils sont incapables de se développer eux-mêmes ; la vérité est que, en tant que communauté, ils refusent l’individualisme lié au développement économique. Ils préfèrent leur communauté au droit illimité de rompre avec elle et avec la nature elle-même. La phrase qu’ils préfèrent est « Mieux vaux une touche de fihavanana (le bien-être collectif) qu’une tonne d’or ». Pour le bien de la croissance, ce que nous appelons le développement, c’est la rupture de ces communautés contre leur volonté et la fin de leur bien-être collectif pour les fausses promesses d’un accomplissement individuel. Sous le faux drapeau de la liberté, pour le commerce et l’argent, les Occidentaux l’ont fait à plusieurs reprises, de la rupture du Japon par le commodore Perry, aux misérables guerres de l’Opium contre la Chine, à la guerre criminelle contre les gouvernements nationalistes des Philippines ou d’Amérique du Sud. Les opérations criminelles de la Fondation Gates introduisant des OGM dans les pays pauvres d’Afrique, réduisant le paysan en esclavage. Il y a aussi le grand projet d’électrification de l’Afrique ouvrant la porte à la nouvelle colonisation des terres, des cultures, des forêts et des richesses de sa biodiversité, par les grandes entreprises. Et ce qui importe le plus, c’est la destruction des symboles de leurs traditions [« Rest » en anglais, NdT], de leurs choses sacrées et, finalement, de leur foi – l’usine du dénuement moral ; les rendant honteux de qui ils sont. De l’Afrique à l’Amérique du Sud ou de l’Asie du Sud-Est à la Russie, les populations autochtones savent très bien que tout n’est pas à vendre ; vous ne pouvez pas échanger quelques acres de forêt tropicale contre quelques acres de toundra. Vous ne pouvez pas échanger le dernier rhinocéros blanc contre des actions dans des parcs animaliers. Et ils craignent que l’avidité illimitée provoque des guerres pour les ressources ; qu’est-ce que l’invasion de l’Irak, sinon une guerre pour le pétrole, la guerre civile en Syrie, sinon une guerre pour l’eau, qu’est-ce que le meurtre de Saddam Hussein, de Mouammar Kadhafi, le bombardement d’une usine de produits pharmaceutiques au Soudan ? Et tant de nombreuses attaques terroristes similaires, à l’exception d’une tentative désespérée de contrôler les ressources naturelles, la vie elle-même, et de maintenir la capacité des États-Unis à ne jamais faire face à leur dette insoutenable ?
Nous avons beaucoup à apprendre des communautés autochtones. Nous, les peuples des Nations européennes, sommes aussi des peuples autochtones, sur nos terres, dans nos pays, avec nos traditions, notre foi, nos biens communs pour lesquels nous avons combattu tant de fois, et nous sommes toujours capables de nous battre. Mais nous n’avons plus beaucoup de temps pour le faire.
La situation actuelle a de grandes conséquences sur l’économie elle-même mais elle concerne principalement ce que nous appelons la politique. Nous devons réinventer la signification même de celle-ci ; la liberté collective des sociétés humaines de façonner leur destin. Et nous devons réinventer la façon dont la politique régit l’économie ; la façon dont l’économie est un outil de nos sociétés, pas l’inverse. Karl Polanyi a écrit des choses définitives à ce sujet.
Le système post-démocratique de la grande entreprise en charge de nos rêves, de nos emplois et de nos vies repose principalement sur la libre poursuite de la cupidité illimitée par l’ego – l’individu souverain. L’idée de base est que l’homme n’est que la liberté illimitée qu’il se crée, et qu’il a droit à une utilisation illimitée du monde. Ne faites pas d’erreur ! Ce système n’est pas faible, malgré toutes les apparences. Ce système est très puissant, mais sous deux conditions : dans la mesure où la grande majorité des citoyens pensent être de véritables initiés, qu’ils sont des gagnants du système, et aussi, dans la mesure où les ressources naturelles lui permettent de promettre une croissance illimitée. C’est le gouvernement de l’homo œconomicus par ses désirs illimités ; le gouvernement pour le big business sous le visage souriant de la démocratie.
Ce système a colonisé nos esprits, nos rêves, nos imaginaires ; sa principale réalisation est de nous avoir coupé du monde extérieur. Nous sommes en fait aveugles à l’altérité, l’Occident ignore la tradition [« Rest »en anglais, NdT]. Et connaissez-vous le premier symptôme d’une dépendance à Internet ? L’incapacité de reconnaître les visages humains entre amis et membres de la famille !
 En disant cela, nous sommes proches du grand secret caché derrière la scène ; nous sommes confrontés à la fin des systèmes libéraux tels que nous les connaissions.
En disant cela, nous sommes proches du grand secret caché derrière la scène ; nous sommes confrontés à la fin des systèmes libéraux tels que nous les connaissions.
Ces systèmes libéraux ne s’appuient pas tellement sur la foi collective dans la Constitution, la Nation ou même le parti au pouvoir. Ils ne comptent que sur la cupidité libre et illimitée accordée à chaque individu. Non seulement c’est autorisé mais c’est même prescrit. Tous les systèmes religieux, sociaux et politiques avant nous, ont fait très attention à limiter, à refréner le désir du plaisir, de la richesse, des biens, ou à leur substituer des biens spirituels ; nous vivons dans le premier système politique et social basé sur la libération absolue et complète de la cupidité. Jetez un œil à nos écoles commerciales et sur les MBA ; nous en avons fait un modèle d’école de cynisme et de cécité morale ! Et ne vous trompez pas, ce système est incroyablement puissant ! Le système de la cupidité individuelle a gagné contre le totalitarisme. Il a gagné contre les grandes religions, les traditions et même les nationalismes. Le lien invisible créé entre les individus sur rien de plus que la promesse d’une quête illimitée d’argent, de biens et de plaisir est bien plus fort que les liens extérieurs, les autorités supérieures, Dieu, l’Empereur, le Roi ou la révolution politique ; ceux là venaient d’en haut. La révolution individuelle vient de l’intérieur. La cupidité de l’intérieur, c’est le puissant moteur du libéralisme individuel ! En fait, la révolution de l’individu est le principal moteur politique du siècle dernier. Et est le gagnant contre le fascisme, le nazisme, et finalement l’Union soviétique elle-même.
Le secret à partager entre nous est que le jeu est terminé. Les seules et uniques conditions de la viabilité du système de la cupidité étaient l’offre illimitée de ressources naturelles et le renouvellement des systèmes vivants d’un côté ; et le partage des avantages entre tous les citoyens de l’autre côté. L’économie du carbone a en fait façonné la démocratie. L’offre illimitée de ressources naturelles a façonné les droits de l’homme en tant que droits de l’individu souverain. Les droits illimités appellent un approvisionnement illimité. Nous savons que ce système est près de s’effondrer. L’effondrement viendra non seulement de l’extension de la pauvreté, mais du fait que la grande majorité des citoyens occidentaux seront de plus en plus exclus de toute forme de bénéfices venant du système. Depuis la fin de la grande peur du communisme et la fin de l’Union soviétique, voici la fin du capitalisme de partage. Le capitalisme ne repose plus sur de bons salaires qui augmentent régulièrement ; il s’appuie de plus en plus sur les prisons et la police. Et l’effondrement viendra non seulement du changement climatique, mais aussi des terribles conséquences des produits chimiques, des pesticides et de la pharmacie dans les sols, la viande et, finalement, la richesse humaine. Il viendra non seulement de l’empoisonnement de l’eau douce, de la nourriture transformée et de l’atmosphère urbaine, mais aussi des événements extrêmes menaçant toutes ces villes au bord de la mer, et aussi des quantités de réfugiés jamais vues auparavant − par dizaines de millions venant d’Asie et d’Afrique.
Le facteur de la peur suit de près la tromperie. Et les deux sont politiquement des armes de destruction massive pour l’Occident.
Cela définit le moment politique que nous vivons maintenant dans les pays occidentaux. Le passage d’individus unifiés par leur désir de richesse à des communautés unies par la lutte pour la survie est un moment à la fois de grandes attentes et de grands risques. C’est la dimension cachée derrière le Brexit, derrière la victoire de Donald Trump, pas si surprenante après tout, et derrière tant de booms politiques et d’explosions à venir ! Et ce pourrait être le meilleur des temps, ainsi que le pire des moments. Qui sait, à un moment où la Chine annonce que la venue de la civilisation écologique devrait avoir lieu au cœur du rêve chinois ?
L’économie va bien sûr refléter ce grand tableau. En fait, c’est déjà dans les faits et les chiffres. Le moment logistique que nous vivons est l’augmentation spectaculaire des coûts de transport, et le nouveau localisme qu’il exige. Le moment entrepreneurial que nous vivons est l’effondrement de l’entreprise mondialisée, et la recherche illimitée d’énergie qu’elle a demandée ; les PME sont les seules à créer des emplois et à s’impliquer réellement dans la communauté par des achats locaux, une embauche locale, l’intégration culturelle et l’engagement local. Et le moment industriel que nous vivons est le passage du travail humain à la production robotique, ce qui signifie que partout dans le monde, les coûts de production sont sur le point de s’égaliser ; ce qui signifie que la main-d’œuvre bon marché ou l’esclavage perdront leur pouvoir de fixation des prix. En passant, l’entreprise mondiale perdra son avantage concurrentiel. Le localisme et les PME sont les nouvelles grandes choses dans les pays où les robots vont payer des impôts ! Mais le moment où nous vivons est aussi principalement le moment où la terre n’est plus si amicale avec les êtres humains. Après deux siècles d’agressions industrielles et chimiques, la nature est éveillée. Personne ne survivra seul à l’effondrement à venir. Et ne rêvez pas ; vous ne pouvez pas mettre de l’argent dans le réservoir de votre voiture, pas plus que manger votre or.
C’est pourquoi nous sommes à la fin de l’individu souverain et de la société de marché. C’est la fin de l’ego, du moi, moi-même, mon seul ami. Nous sommes déjà au début d’une nouvelle ère politique, l’ère de la survie.
Le deuxième enjeu est le retour des communs. La deuxième partie du grand Chapitre de la Liberté, provenant de l’Angleterre du XIVe siècle, le Chapitre des Forêts, est entièrement consacré à assurer la sécurité des communs, en tant que droit fondamental des communautés. Les communs aident les pauvres à satisfaire leurs besoins fondamentaux, bien mieux que n’importe quelle aide publique ou charité privée. Les communs donnent à tout membre de la communauté qui les protège, un libre accès à leur utilisation pour des besoins personnels, mais aucun accès pour un usage commercial ou industriel. C’est un chemin pour la dignité et l’engagement.
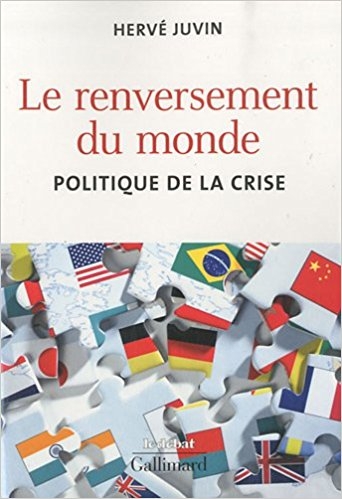 Les biens communs, ou les communs, ne cadrent pas bien avec le libre-échange, la libre circulation des capitaux, les privatisations de masse et l’hypothèse de base que tout est à vendre ; la terre, l’eau douce, l’air et les êtres humains. En fait, le libre-échange et les marchés mondiaux sont les pires ennemis des communs. La grande ouverture des dernières communautés vivant sur elles-mêmes est une condamnation à mort. Bienvenue à la réinvention de l’esclavage par ces apôtres des migrations de masse et des frontières ouvertes ! Je n’ai aucun doute à ce sujet ; une grande partie de ce que nous appelons « développement » et « aide internationale » sera bientôt considérée comme un crime contre l’humanité – l’effondrement des biens communs pour le bénéfice des entreprises mondialisées et des intérêts privés. Et le mouvement des « no borders » sera également considéré comme une manière subtile d’utiliser le travail forcé et embaucher des esclaves avec un double avantage : premièrement, faire le bien avec le sentiment d’être d’une qualité morale supérieure, deuxièmement, faire du bien à la rentabilité du capital.
Les biens communs, ou les communs, ne cadrent pas bien avec le libre-échange, la libre circulation des capitaux, les privatisations de masse et l’hypothèse de base que tout est à vendre ; la terre, l’eau douce, l’air et les êtres humains. En fait, le libre-échange et les marchés mondiaux sont les pires ennemis des communs. La grande ouverture des dernières communautés vivant sur elles-mêmes est une condamnation à mort. Bienvenue à la réinvention de l’esclavage par ces apôtres des migrations de masse et des frontières ouvertes ! Je n’ai aucun doute à ce sujet ; une grande partie de ce que nous appelons « développement » et « aide internationale » sera bientôt considérée comme un crime contre l’humanité – l’effondrement des biens communs pour le bénéfice des entreprises mondialisées et des intérêts privés. Et le mouvement des « no borders » sera également considéré comme une manière subtile d’utiliser le travail forcé et embaucher des esclaves avec un double avantage : premièrement, faire le bien avec le sentiment d’être d’une qualité morale supérieure, deuxièmement, faire du bien à la rentabilité du capital.
La société globale basée sur l’économie comme notre nature humaine, détruit les communs à un rythme incroyable. Non seulement parce qu’elle détruit les frontières qui les protégeaient ; parce que cela place le libre-échange au-dessus des communautés, des religions et des choses sacrées. Et le modèle du marché global où tout est à vendre substitue effectivement l’expulsion des communs générant pauvreté pour une partie croissante de la population mondiale. L’accès libre à la nature sera bientôt refusé à la majorité des gens ; des légumes ou de la viande qu’ils mangent, au jeu qu’ils jouent ou aux loisirs qu’ils partagent, des graines sur lesquelles ils comptent, sur les enfants qu’ils veulent. Tout sera calibré, tout passera sous la coupe de la loi de la meilleure rentabilité pour le capital – et à la fin du processus, la vie humaine elle-même finira par être un produit de l’industrie.
Les communautés indigènes, des tribus d’Amérique du Sud aux associations environnementales en France ou en Allemagne, sont aussi les seules à vouloir protéger leurs communs, et se battent parfois avec ferveur pour les sauver contre des projets industriels ou des investissements massifs. Elles devront lutter contre ces soi-disant « accords commerciaux » dont le seul but est de protéger, non pas l’investissement lui-même, mais le retour attendu des bénéfices ! Toute analyse approfondie du conflit entre les compagnies minières aurifères équatoriennes et canadiennes, ou entre le Guatemala et la Bolivie et les entreprises industrielles américaines, révèle cette situation confuse ; l’explosion actuelle du capital, mieux connue sous le nom de « quantitative easing », crée une pression croissante sur les ressources naturelles. Le système monétaire émet des chèques en nombres illimités, et c’est à la nature de payer la facture ! C’est pourquoi la prochaine étape est l’accaparement final de la nature pour le bénéfice du système de la dette ; pas un morceau de terre, ou une gorgée d’eau, pas un poisson dans l’océan profond ou un arbre dans la forêt tropicale ne va échapper à l’industrie – leur destruction pour de l’argent.
Le retour des communs est l’une des conditions principales et uniques de notre survie.
Qu’est-ce que ça veut dire ? La plupart d’entre nous en Europe sont des autochtones. Nous savons d’où nous venons, et nous savons à quoi nous appartenons. Ce qui nous importe le plus, c’est de dire « nous » avec confiance, avec foi, avec amitié. Les communs sont l’endroit où tout le monde dit « nous ». C’est l’endroit où il n’y a pas de place pour le « moi ». Et les bases sont solides pour le futur proche. Ce sont les ressources qui ne sont pas à vendre, les ressources partagées par la communauté, pas pour le commerce ou l’industrie à tout prix, des ressources hors de portée des commerçants ou des banquiers. Pas de libre-échange, pas de marché, pas de pouvoir de prix sur les communs. Les graines, le sol, l’eau douce, l’air, la naissance humaine et les vies humaines ne sont pas non plus à vendre. Elles ne sont pas le moyen de maximiser le rendement du capital ! La nature elle-même prendra soin de nos biens communs, et nous donnera beaucoup plus que n’importe quel fonds d’investissement, seulement si nous la respectons, seulement si nous la laissons jouer, seulement si nous la laissons faire. C’est la plus grande leçon de l’écologie, de l’agroforesterie et de l’agriculture biotech. Nous avons juste à appartenir. Nous avons juste à partager une identité ; il suffit d’accepter des limites. Voici la venue de la politique identitaire. Voici la disparition de l’économie telle que nous la connaissons. Toutes ces questions sont profondément politiques, et elles appellent à un retour au pouvoir de toute la communauté politique dans son ensemble – pas la disparition de la communauté pour mon bénéfice, moi l’individu souverain !
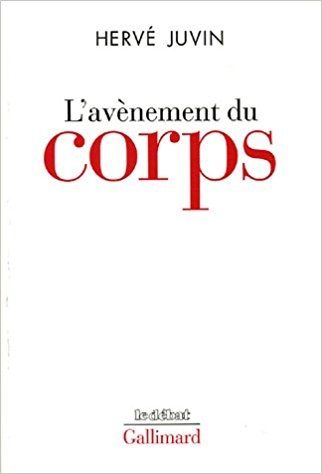 Quelle est la prochaine étape ?
Quelle est la prochaine étape ?Nous sommes à la fin de l’économie libérale telle que nous la connaissons et, à ce moment-là, nous serrons à la fin de la cupidité individuelle en tant qu’outil puissant de l’ordre politique. Qu’est-ce qui va arriver ? Et que devons-nous faire ?
Après l’effondrement de l’économie en tant que foi, et l’effondrement du marché mondial en tant que sorcellerie, le premier besoin est spirituel. Je ne dis pas religieux. Mais nous devons reconnaître la dimension sacrée de la vie, de toutes les formes de vie. Nous devons partager les symboles de notre destin commun et de notre volonté collective, et nous avons besoin d’une renaissance de la communauté comme étant bien plus que la somme des individus – la magie du « Nous, les gens » est encore à réinventer. Cela pourrait être le cadeau le plus utile de l’Union Européenne au monde extérieur ; vous ne pouvez pas construire une communauté politique sur le marché, l’argent, la croissance ou les droits individuels. Nous avons besoin de plus que cela, de quelque chose de différent, quelque chose proche de la foi, des symboles et de la fraternité, quelque chose comme cette chose sacrée que nous perdons, et qu’ils nous prennent.
La condition même de la réévaluation des biens communs est la reconnaissance générale que tout n’est pas à vendre, parce qu’il y a des choses à vendre, il y a des choses à transmettre, et il y a des choses à donner ou à partager. Et il y a des choses sacrées dans lesquelles la communauté met sa confiance et par lesquelles elle exprime sa différence. Bien sûr, ces choses sont sacrées. Bien sûr, ces choses n’ont pas de substitut sous forme monétaire. Elles ne sont ni négociables ni vendables. C’est la définition même de la sacralité, et nous partageons un besoin urgent de redéfinir ce qui dans la nature, dans nos pays, sociétés et chez nous, n’est pas à vendre, parce que c’est la partie principale de notre être humain.
Ce n’est pas le moment d’élaborer des propositions pour résoudre nos problèmes. Je vais juste souligner trois choses principales à faire, et à faire maintenant.
Nous devons élaborer un nouveau système de comptabilité. Le système actuel compte comme une valeur ajoutée la destruction des espèces et des ressources rares. C’est une menace contre notre survie. Le seul système durable tiendra compte du respect de la loi par les entreprises, des contraintes fiscales et sociales et du respect des cultures et modes de vie locaux par les entreprises privées et les organismes étrangers.
Nous devons prendre en compte la fin de l’économie du carbone, le retour de la géographie et le besoin de localisme et d’activités auto-orientées. Ce n’est pas un problème mineur ; ce pourrait être la fin de la démocratie telle que nous la connaissons, basée sur un approvisionnement énergétique illimité pour le commerce et les communications. Le coût du transport presque nul est le plus grand mensonge du système économique actuel, l’appel efficace à la globalisation. La distance aura de l’importance, la géographie aura de l’importance et son coût reste encore à intégrer.
Beaucoup plus important, nous devons travailler autour du droit à la diversité, la condition la plus importante de notre survie. C’est peut-être le plus grand apprentissage de l’écologie et de la biologie ; la diversité est collective, et cette diversité est la clé de la survie.
Nous ne survivrons pas à l’alignement de la planète sur la cupidité illimitée pour les ressources. Personne ne réclame la démocratie mondiale, l’uniformisation du monde par l’économie dite libérale. Personne ne sait plus qui sont Milton Friedman ou Friedrich von Hayek – ce ne sont que des personnages de musées. Mais personne ne pense plus que le problème concernera le socialisme, ou l’économie contrôlée par l’État, ou quelque chose entre les deux. La vraie reconnaissance de la liberté humaine comme liberté collective et de la diversité culturelle et politique comme trésor de l’humanité, don de la nature et condition même de notre survie, droit fondamental au-dessus de tout autre droit économique ou individuel politique, est la clé d’un avenir de paix, de compréhension mutuelle et de coexistence respectueuse.
À Chisinau, ce 17 décembre 2017, je lance un appel collectif pour renouveler l’accord conclu lors de la Conférence de La Havane, en 1948-1949, lorsque les Nations Unies ont prévu de subordonner le libre-échange et les marchés libres au bien-être, au progrès social et à la sécurité environnementale des populations.
J’appelle à un engagement collectif pour reconstruire un forum des pays non alignés, le même qui a eu lieu à Bandung, en 1955, un forum de ceux qui ne veulent pas être relocalisés, être déportés ou être privés de leur identité par des intérêts étrangers, un forum de personnes qui partagent profondément le sentiment que le trésor le plus important de l’humanité est au-delà de tout ce qui se vend, le trésor de la diversité culturelle et de la générosité de la nature.
Et j’appelle à renouveler la Déclaration de Coyococ, en 1974, sur les droits collectifs des peuples autochtones, contre les colons et les envahisseurs, les droits à la sécurité collective sociale, culturelle et environnementale. Ce sont les véritables fondements des droits de l’homme ; les droits individuels ne servent à rien s’il n’y a pas de société organisée pour les prendre pour acquis.
Il y a plusieurs siècles, le Chapitre des Forêts donnait un sens précis et efficace aux droits de l’homme ; le droit de vivre selon la nature et de vivre de la richesse des ressources naturelles et des écosystèmes vivants. L’échec d’une approche juridique des droits de l’homme est avéré ; plus il y en a, moins ils prouvent une quelconque efficacité. Beaucoup de mots, et si peu de réalité !
Le chemin était ouvert il y a longtemps. Il est temps maintenant de compléter et de garantir les droits humains par une déclaration des droits collectifs – id est, les droits des sociétés humaines à ne pas être détruites par l’extérieur, le droit à leur sécurité morale, religieuse, politique et environnementale, le droit de tous peuples autochtones de se protéger ou d’être protégés contre les colons et les envahisseurs, à tout prix et par quelque moyen que ce soit. C’est la vraie condition de notre survie. Nous ne survivrons pas à travers ce siècle sans la générosité de la nature, la beauté des cultures et la liberté naturelle de l’esprit humain.
Écrivain, Essayiste, Économiste
Président, NATPOL DRS (DRS comme diversité, résilience et sécurité)
Conférence sur le Cercle Aristote
Traduit par Hervé relu par Catherine pour le Saker Francophone
Note:
01:08 Publié dans Actualité, anthropologie, Ecologie, Economie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hervé juvin, anthropologie, écologie, économie, décroissance, croissance, colloque de chisinau, chisinau, moldavie, philosophie, philosophie politique, politologie, théorie politique, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

par Nicolas Bonnal
Ex: http://www.dedefensa.org
Nous sommes dominés par le monde anglo-américain depuis deux siècles, et sommes à la veille de la troisième guerre mondiale voulue par ses élites folles. Alors une petite synthèse.
J’ai glané ces citations sur archive.org, dans les dix-sept volumes de Bonald (1754-1838), cet unique défenseur de la Tradition (j’allais écrire bon guénonien : hyperboréenne) française. Je les distribue à mes lecteurs au petit bonheur.
A l’époque de Macron et de l’oligarchie mondialiste, ce rappel :
« Ceci nous ramène à la constitution de l'Angleterre, où il n'y a pas de corps de noblesse destinée à servir le pouvoir, mais un patriciat destiné à l'exercer. »
J’ai souvent cité ce surprenant passage des Mémoires d’Outre-tombe de Chateaubriand (3 L32 Chapitre 2) :
« Ainsi ces Anglais qui vivent à l'abri dans leur île, vont porter les révolutions chez les autres ; vous les trouvez mêlés dans les quatre parties du monde à des querelles qui ne les regardent pas : pour vendre une pièce de calicot, peu leur importe de plonger une nation dans toutes les calamités. »
On comprend enfin que le commerce américain ne prépare pas la paix mais la guerre. Bonald se montre ici d’accord avec les marxistes (comme souvent) en rappelant que l’Angleterre est toujours en guerre :
« L'Angleterre est en système habituel, je dirais presque naturel de guerre, ou du moins d'opposition, avec tous les peuples du monde, et le repos ne peut être pour elle qu'un état forcé et accidentel. Cet état d'opposition est totalement indépendant des dispositions personnelles et du caractère particulier de ceux qui la gouvernent : il tient à sa position insulaire, à sa constitution populaire, qui donne à sa politique un caractère inquiet et agresseur, et qui la place constamment dans le système d'accroissement, et jamais dans celui de repos et de stabilité; en sorte que, comme elle est continuellement agitée au dedans, on peut dire qu'elle entretient au dehors et dans le monde politique le mouvement perpétuel. »

Sur le même inquiétant sujet Bonald ajoute, non sans quelque réminiscence de Thucydide (voyez livre premier, CXL et suivantes):
« Cette disposition à toujours s'étendre, et cette facilité à attaquer partout, ont, dans tous les temps, donné aux peuples dominateurs des mers, comme l'observe Montesquieu, un tour particulier d'esprit impérieux et arrogant, dont les Anglais ne sont pas exempts; en sorte que le caractère particulier de l'Anglais est la soif démesurée d'acquérir et la fureur de la cupidité, parce que le système politique de l'Angleterre est une tendance sans mesure à l'accroissement. »
Sanctions économiques et commerciales ? L’Angleterre les applique déjà :
« L'Angleterre n'attaque pas le territoire de tous les peuples; mais elle en attaque le commerce ou par la force ou par la ruse…
Au reste, les peuples commerçants ont tous plus ou moins de cet esprit envahisseur, comme tous les hommes qui font le commerce ont tous le désir de s'enrichir les uns aux dépens des autres. »
Bonald offre une belle comparaison psychologique entre les peuples agricoles qui ont disparu et les commerçants :
« Et il est peut-être vrai de dire que le commerce, qui peuple les cités, rapproche les hommes sans les réunir, et que l'agriculture, qui les isole dans les campagnes, les réunit sans les rapprocher. »
Et de conclure cruellement sur le destin colonial anglo-saxon :
« Ainsi le vol et l'intempérance, vices particuliers aux sauvages, sont très-communs chez les Anglais. Le peuple y est féroce jusque dans ses jeux; les voyageurs l'accusent d'un penchant extrême à la superstition, autres caractères des peuples sauvages… »
Si « le credo a été remplacé par le crédit » (Marx toujours), la superstition aujourd’hui c’est le fanatisme médiatique (voyez Macluhan encore et la galaxie Gutenberg). Ces peuples soi-disant libres sont toujours les plus conditionnés par la presse et leurs médias. « L’ineptie qui se fait respecter partout, il n’est plus permis d’en rire », écrit un Guy Debord toujours hautement inspiré.

L’Angleterre, rappelle Bonald est aussi philosophe (« quelle race peu philosophique que ces Anglais », écrira Nietzsche dans Jenseits, §252), et sa philosophie a créé le bourgeois moderne, « le dernier homme », comme l’a bien vu Fukuyama (The end of history, chapter XVII) :
« On pourrait, avec plus de raison, représenter l'Angleterre exportant dans les autres États le philosophisme, dissolvant universel qu'elle nous a envoyé un peu brut à la vérité, mais que nous avons raffiné en France avec un si déplorable succès. »
Hélas, l’Angleterre est une puissance mimétique, disait René Girard, et Bonald avant lui :
« Les autres nations, et particulièrement la France, n'ont pas fait assez d'attention à cet engouement général que les Anglais ont eu l'art d'inspirer pour leurs mœurs, leurs usages, leur littérature, leur constitution. »
Bonald voit poindre le continent américain, qui sauvera les miséreux de Dickens d’une organisation sociale scandaleuse (combien de famines, de pendaisons, de déportations ?) :
« Dans l’état où se trouvent aujourd'hui les deux mondes, il en faudrait un troisième où pussent se réfugier tous les malheureux et tous les mécontents. L'Amérique, dans l'autre siècle, sauva peut-être l'Angleterre d'un bouleversement total. »
Bonald explique même l’excentricité britannique :
« Après les changements religieux et politiques arrivés en Angleterre sous Henri VIII, on remarqua dans cette île une prodigieuse quantité de fous, et il y a encore plus d'hommes singuliers que partout ailleurs. »
Les individus et même le pays peuvent rester sympathiques (William Morris, Chesterton, Tolkien, mes témoins de mariage…) :
« Heureusement pour l'Angleterre, elle a conservé de vieux sentiments, avec ou plutôt malgré ses institutions. »
Surtout, l’Angleterre ne défend que l’argent :
« Dans ce gouvernement, il est, dans les temps ordinaires, plus aisé au particulier de constituer en prison son débiteur, qu'au roi de faire arrêter un séditieux, et il est moins dangereux pour sa liberté personnelle d'ourdir une conspiration que d'endosser une lettre de change; c'est ce qu'on appelle la liberté publique. »

Il faut dire que le roi là-bas n’est pas un monarque.
Le modèle social (Bonald écrit avant Dickens, il est contemporain du grand penseur incompris Godwin) reste ignominieux et humainement destructeur :
« Les fabriques et les manufactures qui entassent dans des lieux chauds et humides des enfants des deux sexes, altèrent les formes du corps et dépravent les âmes. La famille y gagne de l'argent, des infirmités et des vices ; et l'État une population qui vit dans les cabarets et meurt dans les hôpitaux. »
Le commerce n’enrichit pas forcément les nations, rappelle notre grand esprit :
« Le commerce fait la prospérité des États; on le dit : mais avant tout il veut la sienne; et toutes les usurpations y trouvent des fournisseurs, la contrebande des assureurs, et les finances des agioteurs, qui font hausser ou baisser les fonds publics dans leur intérêt, et jamais dans celui de l'État. »
La dépravation sociale, morale, mentale, y est totale (relisez Defoe, l’affreux de Quincey ou découvrez Hogarth sous un autre angle –le rake’s progress) :
« Dans les petites villes, les spectacles et les cafés, prodigieusement multipliés, et les cabarets dans les campagnes, dépravent et ruinent toutes les classes de la société, et troublent la paix et le bonheur des familles. Les tavernes et les liqueurs fortes sont, en Angleterre, une cause féconde de mendicité. »
Déficit commercial ? Perversion de modèle économique ? Dépendance aux importations ? Lisez Bonald sur l’Angleterre :
« Telle nation qu'on regarde comme la plus riche, l'Angleterre, par exemple, est, comme nation, réellement plus pauvre que bien d'autres, parce qu'elle est, comme nation, moins indépendante, et qu'elle a, plus que les nations continentales, besoin des autres peuples et du commerce qu'elle fait avec eux, sur eux, ou contre eux, pour subsister telle qu'elle est. »

Surtout pas de blocus, pas d’autarcie alors :
« De là vient que la guerre la plus dangereuse qu'on lui ait faite, est la mesure qui l'excluait des ports de toute l'Europe. »
Bonald ne parle pas de la dette publique qui émerveille Marx (Capital, I, sixième partie) et atteint 200% du PNB pendant les guerres napoléoniennes !
Le bilan du miracle industriel célébré par tous les imbéciles depuis deux siècles ou plus :
« Qu'est-il résulté en Angleterre de l'extension prodigieuse donnée à l'industrie et au système manufacturier ? une population excessive, une immense quantité de prolétaires, une taxe des pauvres qui accable les propriétaires, une guerre interminable entre agriculture , qui veut vendre ses denrées à un haut prix pour atteindre le haut prix des frais de culture, et les fabricants qui voudraient les acheter à bon marché pour pouvoir baisser le prix de leurs salaires et soutenir la concurrence dans les marchés étrangers ; l'impossibilité à une famille distinguée de vivre à Londres conformément à son rang, même avec cent mille livres de rente ; tous les extrêmes de l'opulence et de la misère, et les malheurs dont ils menacent tous les Etats. »
Et c’est ce modèle qui a triomphé dans le monde ; il n’aurait plus manqué que cela…
01:05 Publié dans Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis de bonald, 19ème siècle, réaction, conservatisme, philosophie, philosophie politique, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

ex: https://madmonarchist.blogspot.com
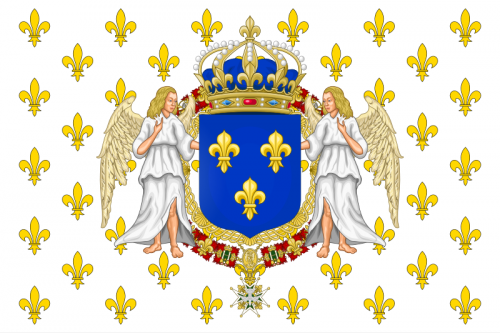
15:25 Publié dans Histoire, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, france, régicide, louis xvi, 18ème siècle, révolution française, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

 Effets
Effets
02:04 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yvan blot, démocratie directe, démocratie, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Les Français ne sont pas stupides et comprennent parfaitement que ce sont les politiques menées par les gouvernements successifs depuis 50 ans qui ont accentué leurs problèmes, qui ont mené le pays à la ruine et qui sont à l’origine du déferlement migratoire les submergeant. Pour résoudre le conflit cognitif entre la vision d’un Etat républicain que l’on préjuge par nature au service de la France et des Français et le constat objectif d’un Etat républicain agissant contre l’intérêt national, les Français sont amenés à postuler que cette distorsion est purement accidentelle. Si la République mène le peuple français au tombeau, par le Grand Remplacement notamment, c’est que le personnel politique à sa tête est corrompu, apatride, ou tout simplement incompétent. Il suffit donc d’en changer. Cette illusion sert les intérêts de l’opposition du moment, d’où l’alternance gauche-droite que l’on observe depuis des décennies. Elle entretient aussi la mythologie démocratique. Même les partis « populistes » veulent en tirer bénéfice en proclamant pouvoir nettoyer ces écuries d’Augias. Est-ce pour autant exact ?
 Rien n’est moins sûr. Depuis des décennies, des politiciens de tous bords se succèdent au pouvoir sans que le pays ralentisse sa course vers le précipice. Tous n’étaient pas corrompus, apatrides ou incompétents. Marie-France Garaud, Jean-Pierre Chevènement, Philippe Séguin, Philippe de Villiers, Nicolas Dupont-Aignan, Philippe Buisson, Henri Guaino, pour n’en citer que quelques uns, ont côtoyé de très près le sommet de l’Etat. Ils ont parfois montré une certaine lucidité quant au chemin sans issue qu’empruntait le pays. Ils n’ont pourtant pas réussi à l’en détourner. En fait, on le voit avec Trump aux Etats-Unis, même un président doit situer son action politique à l’intérieur du cadre idéologique fixé par le régime en place. Car ce qui compte n’est pas la personnalité qui gouverne mais la latitude que lui laisse le système politique, à savoir, pour ce qui nous concerne, la République. Permettez-moi une comparaison :
Rien n’est moins sûr. Depuis des décennies, des politiciens de tous bords se succèdent au pouvoir sans que le pays ralentisse sa course vers le précipice. Tous n’étaient pas corrompus, apatrides ou incompétents. Marie-France Garaud, Jean-Pierre Chevènement, Philippe Séguin, Philippe de Villiers, Nicolas Dupont-Aignan, Philippe Buisson, Henri Guaino, pour n’en citer que quelques uns, ont côtoyé de très près le sommet de l’Etat. Ils ont parfois montré une certaine lucidité quant au chemin sans issue qu’empruntait le pays. Ils n’ont pourtant pas réussi à l’en détourner. En fait, on le voit avec Trump aux Etats-Unis, même un président doit situer son action politique à l’intérieur du cadre idéologique fixé par le régime en place. Car ce qui compte n’est pas la personnalité qui gouverne mais la latitude que lui laisse le système politique, à savoir, pour ce qui nous concerne, la République. Permettez-moi une comparaison :
Imaginez que vous jouiez à un jeu vidéo, une course automobile par exemple. Vous pouvez faire accélérer votre voiture, la faire ralentir, la faire s’arrêter, vous pouvez doubler d’autres voitures, aller à gauche ou à droite de la chaussée, rester au centre de celle-ci. Ce que vous ne pouvez pas faire, c’est sortir du circuit. Ce n’est pas une question d’incompétence : même le meilleur joueur du monde n’y parviendrait pas. Le programme n’a pas été conçu pour ça : il ne le permet pas. Si vraiment vous voulez pouvoir sortir du circuit, il n’y a donc qu’un seul moyen : changer de jeu !
La République, quant à elle, est un système politique qui possède ses propres données et instructions de fonctionnement : son propre logiciel ! Le politicien qui joue en République est comme dans un circuit : il peut aller à gauche, à droite ou au centre du jeu politique. Il peut accélérer les réformes ou bien les ralentir. Il peut même les stopper un temps. Ce qu’il ne peut pas faire, c’est sortir du circuit : sortir du programme républicain ! Là aussi, ce n’est pas une question d’incompétence : le logiciel républicain ne le permet tout simplement pas. Pour sortir de ce circuit il n’y a qu’un seul moyen : refuser le système politique et en changer… ce qui est formellement interdit par la Constitution et le Code Pénal !
La ruine de notre pays, l’effacement de notre nation ou le Grand Remplacement ne sont donc pas le résultat de l’incompétence d’une classe politique qui aurait commis en toute innocence une succession d’erreurs malencontreuses. Sauf à sortir du cadre, c’est-à-dire à se mettre hors la loi, ceux qui ont choisi la carrière politicienne ne peuvent, Front National compris, que respecter les « valeurs » et les « principes » du régime en place, ce qui, traduit informatiquement, signifie une complète subordination aux codes, aux instructions et aux procédures dictées par un programme. Ceci explique largement la continuité et la ressemblance des politiques suivies depuis 50 ans, et même depuis 1789. Qu’elles soient à « gauche » de la chaussée ou à sa « droite », ces politiques restent sur la même route républicaine. Une route qui conduit inexorablement à une République universelle.
Si les politiciens sont responsables d’avoir « voulu jouer » avec un système qu’ils savaient par essence antinational (pour les plus cultivés d’entre eux), la République est quant à elle coupable d’avoir fixé des règles du jeu qui supposaient à terme la disparition de la nation, c’est-à-dire de la France et du peuple français de souche européenne.
Montrer que la République est, par son ADN idéologique, ses « valeurs » et ses « principes », une entité politique qui ne pouvait qu’entraîner la dilution du peuple autochtone dans l’universel est une démarche véritablement révolutionnaire. Car dès lors, le « changement » à l’intérieur du régime apparaît comme un leurre et le renversement du régime apparaît comme l’unique possibilité d’assurer un destin à notre peuple.

Il faut passer ce cap psychologique, fruit d’une manipulation mentale opérée dès l’école, pour considérer la République pour ce qu’elle est : un régime étranger qui a colonisé le peuple autochtone et le vampirise depuis deux siècles. C’est avec le sang autochtone que la République a répandu sa doctrine dans le monde entier. C’est sans souci des souffrances autochtones que la République construit aujourd’hui son modèle de société métissée.
Transcendantale, la République ne peut être nationale. Se voulant universelle, elle ne peut se dire spécifique. N’étant pas spécifique, elle n’est pas « française », ou tout au moins pas plus française qu’algérienne ou malgache.
L’universel républicain prétend construire un modèle de société acceptable et accepté par tous les hommes quelles que soit leur origine, leur religion ou leur culture. Rappelons que la francité n’est ni acceptable, ni acceptée par tous les hommes : tous les hommes n’accepteraient pas de faire leur l’histoire des Français, de manger du lard ou de fêter Noël ! La République n’a donc rien à voir avec la France incarnée par le peuple autochtone de ce pays. C’est même une anti-France puisque son modèle de société postule la faisabilité du « vivre-ensemble » et légitime par contrecoup les politiques d’immigration, politiques qui sont à l’origine du Grand Remplacement, donc de l’effacement de la France comme nation enracinée dans une histoire et une identité.
La République est un système « génétiquement » hostile à notre nation comme à toute nation. Le travail d’un Réfractaire consiste essentiellement à supprimer les résistances psychologiques qui empêchent de le comprendre.
Antonin Campana
01:17 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, europe, affaires européennes, théorie politique, politologie, sciences politiques, république |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

01:06 Publié dans Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guerre, thucydide, grèce antique, antiquité grecque, hellénisme, philologie classique, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Par Dominique Philos.
Un article de Témoignage fiscal
Ex: https://www.contrepoints.org
Les quelques réflexions qui suivent m’ont été inspirées par l’attitude de Thierry Solère, député Les Républicains, par ailleurs visé par une enquête fiscale, qui a changé « d’écurie » pour passer à LREM et qui s’est accroché à ses fonctions de questeur pour des raisons financières (doublement de l’indemnité de base de 5.600 € par mois) mais aussi de pouvoir ; et qui a dû s’incliner… de très mauvaise grâce tout en risquant finalement d’être exclu de LREM pour des petits arrangements entre amis avec Urvoas, ancien ministre socialiste de la Justice.
Le politicien professionnel fait de la politique son activité exclusive mais reste marginal par rapport au nombre total d’élus, qui sont majoritairement des non professionnels. Or, il peut apparaître singulier de vouloir faire carrière dans un secteur qui relève en principe du seul mandat électif périodique ; lequel rend nécessairement aléatoire, en fonction du résultat des élections, toute projection de carrière.
On connaît pourtant des politiciens professionnels qui ont eu quarante ans ou plus d’activité exclusivement politique ; ce qui justifie que l’on s’intéresse un peu à eux.
Nul besoin de diplôme pour se lancer en politique ; il suffit d’avoir de l’audace, de l’ambition, pas trop de scrupules, une élocution aisée, une aptitude à mentir et à dissimuler.
Le politicien professionnel cultive l’amitié politique et les réseaux essentiellement à des fins de Cursus Honorum et de pouvoir. Son ambition est d’arriver aux fonctions les plus prestigieuses et il va tout faire, une fois arrivé à la position convoitée, pour s’y maintenir.
Le discours du politicien tourne toujours autour du même sujet et utilise toujours les mêmes arguments : Votez pour moi, je vais assurer votre bonheur et, évidemment, la population ne demande bien souvent qu’à croire aux belles promesses du politicien qui n’hésitera jamais à caresser l’électeur dans le sens du poil !
La réalité qui se cache derrière ce discours est un peu plus nuancée… réalité qui révèle souvent une distorsion entre l’éthique affichée et des petits accommodements personnels.
Le cadre d’action du politicien professionnel, spécialement en France, est l’État car c’est lui qui lui donne sa légitimité et ses moyens d’action tout en exploitant le besoin de protection et d’assistanat d’une partie notable de la population qui ne demande pas mieux que d’être prise en charge par un État présenté comme protecteur, de la naissance à la mort, avec un travail, une sécurité sociale, des vacances, des colonies de vacances, une retraite et un logement fournis par ce même État.
Seulement, pas besoin de creuser bien longtemps pour s’apercevoir de la vacuité du discours car :
Quand il promet qu’il va verser des aides sociales, il oublie juste de vous dire que ce n’est pas son argent qu’il va distribuer mais celui extorqué à d’autres, voire même, comble de l’ironie et du cynisme, à vous-même, mais le tout est de vous convaincre.
Quand il promet des services publics gratuits, l’illusion trompeuse de la gratuité laisse à penser que le politicien œuvre pour le bien public, or si les services publics sont gratuits pour certains c’est qu’ils sont payés par d’autres ; les fonctionnaires ne sont pas des bénévoles.
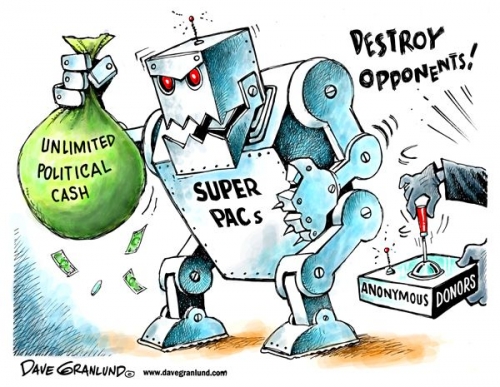
Quand il prévoit de financer des investissements (« ici l’État investit pour votre avenir»), il oublie juste de vous dire que ce sont vos impôts qui sont investis et que le politicien sait surtout dépenser avec prodigalité l’argent des autres ! Par ailleurs, les miracles accomplis par les politiciens se résument bien souvent à une illusion provoquée par l’escamotage des coûts réels des dépenses financées par l’impôt.
Quand il promet la création d’emplois, en fait, il ne crée pas d’emplois, au mieux il peut seulement recruter des fonctionnaires qui ne sont pas des emplois productifs mais uniquement des emplois payés par les impôts des autres. Il peut aussi distribuer vos impôts par le biais de subventions pour attirer des entreprises susceptibles de créer ces emplois.
Finalement, la constante est que le politicien professionnel promet beaucoup en dépensant votre argent !
Contrairement à ce qu’il tente de faire croire, le politicien professionnel ne veut pas votre bonheur, il veut essentiellement le sien et fera toujours passer ses intérêts avant ceux de ses électeurs. Le politicien a, avant tout, pour but le pouvoir et l’argent (et le sexe en prime, parfois) mais il préfère faire croire à son engagement altruiste ; c’est à la fois plus glorieux et plus valorisant pour son ego… souvent largement dimensionné. On a quelquefois parlé d’hubris à propos de certains.
En outre, il n’hésitera pas à sacrifier les intérêts de ses électeurs aux siens propres notamment lorsqu’il obéit à des directives d’appareil ; même si celles-ci sont contraires à l’intérêt de ses concitoyens. Car il est avant tout dans le calcul politicien.
Ayant accès aux fonds publics, il va utiliser, en tant qu’élu, votre argent à son bénéfice personnel d’une part pour s’assurer un train de vie tout à fait confortable (on se souvient de la gauche caviar) et d’autre part pour assurer sa réélection c’est-à -dire son maintien en place.
Pour cela, il faut qu’il soit populaire et surtout qu’on le voit et qu’on ne l’oublie pas. Il va donc sur les plateaux télé et participe à tous les évènements médiatiques (y compris à l’enterrement d’un chanteur populaire) pour y être vu ou pour discourir de sujets dont parfois il ignore tout. Il va aussi tenter de contrôler son image et notamment acheter la presse, avec vos impôts, pour qu’elle parle de lui favorablement ; car quoi de mieux qu’une presse subventionnée et complaisante et d’autant plus complaisante qu’elle dépend du politique pour sa survie.

Il n’a échappé à personne que les politiciens professionnels exploitent tous les ressorts psychologiques, et quelquefois les plus vils, des électeurs pour arriver à leurs fins (cupidité, jalousie, victimisation …). En fait, le politicien professionnel se crée une clientèle c’est-à-dire qu’il va prêcher dans le sens des idées de la fraction de la population visée afin de recevoir son assentiment ; l’électorat n’étant finalement perçu que comme un marché à conquérir (le marketing politique n’est pas un vain mot).
La désignation de boucs émissaires et de la responsabilité des autres est aussi bien une technique classique pour attirer un électorat que pour détourner l’attention et éluder ses propres responsabilités car, vous l’aurez peut-être remarqué, mais le politicien professionnel n’a jamais tort et ne se trompe jamais ! On l’a compris : la lâcheté ou, à tout au moins, le manque de courage est aussi un de ses traits de comportement.
Il cherchera et trouvera, au moyen d’explications simplistes, des responsables à la situation et à l’insatisfaction de sa clientèle, et, de ce fait, il n’hésitera pas à s’attaquer aux étrangers, à l’Europe, aux riches, aux banques, aux juifs fraudeurs fiscaux qui « ruinent le pays » en n’acceptant pas la spoliation, à des profiteurs hypothétiques étant entendu que les profiteurs sont toujours les autres … tout en exploitant la crédulité, les sentiments xénophobes et la peur de la population.
La promesse de faire payer les autres, surtout les autres, ne peut d’ailleurs que recevoir l’assentiment d’une population qui rêve du « grand soir » et qui a tendance à se victimiser.
De ce fait, il n’aura aucun scrupule à manipuler l’opinion et à mentir pour parvenir aux fonctions qu’il convoite et utilisera à cet effet toutes les ressources de la démagogie et du clientélisme (il peut même défendre des idées auxquelles il ne croit pas) ; le cynisme étant d’ailleurs un mode ordinaire de gestion du politicien qui reste, quoiqu’il arrive, un opportuniste.
L’électeur n’apparaît finalement être, dans ce schéma, qu’un instrument, un moyen pour permettre au politicien professionnel d’arriver à ses fins car le tout c’est d’être élu !
Le rêve du politicien est en fait de contrôler la population qui devient soumise et obéit ; ce qui est facile dans les régimes autoritaires de type URSS ou Allemagne nazie mais est évidemment plus compliqué dans les démocraties où il est nécessaire de recueillir l’assentiment, au moins passif, des populations.
Le politicien n’a alors que deux solutions : acheter les électeurs avec l’argent… des autres en organisant des transferts autoritaires de richesse au profit de sa clientèle ou leur faire peur afin de les rendre plus réceptifs, plus malléables à son discours. L’écologie, je devrais plutôt dire l’hystérie réchauffiste, (on nous parle désormais d’urgence climatique) est l’archétype du sujet qui permet de conditionner la population pour lui faire accepter une vérité officielle et la contraindre à accepter des contraintes et des impôts qu’elle n’accepterait pas autrement.
C’est juste une version actualisée de la carotte et du bâton.
L’envers du décor est que le jour où il faudra solder les dettes de l’État et sa dette colossale (pour l’instant arrêtée à 2.200 mds €), ces mêmes politiciens sauront vous expliquer qu’il faut payer, mais de responsable… vous n’en trouverez pas ; car, et c’est le défaut de notre démocratie, le politicien peut faire à peu près n’importe quoi sans encourir de sanction (à part électorale), à la grande différence d’un mandataire social (gérant ou PDG de société) qui, s’il gère mal, sera révoqué très rapidement et fera probablement un séjour en prison.
En outre, volontiers moralisateurs, les politiciens professionnels font preuve d’une bonne dose de vénalité et d’absence de scrupules. En témoigne la liste, arrêtée en 2013, de 160 politiciens de tous bords condamnés (ici).
Rapporté au nombre total d’élus (5 ou 600.000), ce nombre est certes dérisoire mais si on le rapporte aux 577 députés et 348 sénateurs, la proportion devient alors beaucoup plus significative parce que, on omet en général de vous le dire, les politiciens condamnés sont la plupart du temps des politiciens professionnels.

Les politiciens ont su organiser le système de telle façon qu’on ne peut plus se passer d’eux et le système électoral fait qu’il suffit de recueillir l’assentiment de la plus forte minorité pour arriver au pouvoir (puisque la démocratie moderne n’est pas le gouvernement par la majorité mais bien celui de la plus forte minorité) bien aidé en cela par un système électoral à deux tours calculé pour éliminer les concurrents, éviter la dilution des votes et canaliser l’électorat !
De plus, il est nécessairement en faveur de l’accroissement du rôle de l’État, et si vous y prêtez un peu attention vous observerez que les politiciens professionnels évoquent souvent le rôle, l’importance et les missions de l’État pour la raison qu’il va en résulter pour eux une augmentation parallèle de leur pouvoir sur la société ; lequel va leur permettre, en s’ingérant et en légiférant sur tous les aspects de notre vie, de devenir des intermédiaires ou des arbitres indispensables.
En fait, si l’on y regarde bien, l’utilité du politicien est tout à fait marginale et on connaît des cas où des États ont pu fonctionner sans gouvernement et sans dommage pendant de longues périodes (en Belgique notamment pendant 18 mois).
Opportunisme, clientélisme, ambition démesurée, veulerie et vacuité sont les traits de comportement habituels du politicien professionnel et vous pouvez lire l’article de Nathalie MP sur son site (ici). Il vous éclairera sur la réalité de la politique française et « l’engagement » de politiciens sans conviction mais opportunistes.
Vous me direz : On ne demande pas aux politiciens d’être gentils mais d’être efficaces et compétents.
Seulement, le problème est qu’ils sont très rarement compétents et donc, a contrario, le plus souvent sont totalement incompétents et s’en remettent aux spécialistes c’est à dire …. à l’administration.
En fait, le politicien professionnel est le plus souvent un individu ordinaire, sans talent, sans compétence, vénal et sans scrupule qui exploite la naïveté de ses électeurs et n’hésitera pas à mentir pour justifier ses propres actions (on se rappelle la déclaration de celui-là selon laquelle « il ne pouvait pas dire la vérité aux français car ils ne comprendraient pas »).
Finalement, bien qu’omniprésents, il ne faut surtout ne pas se faire d’illusion quant à leurs convictions et leur rôle dans la société. Le politicien professionnel est sans doute un mal nécessaire de la démocratie mais ce n’est ni un gentil ni un altruiste.
Je ne sais pas si cela peut vous rassurer mais c’était déjà le cas sous la République Romaine du temps de Jules César. Nous n’avons visiblement pas fait beaucoup de progrès depuis.
09:13 Publié dans Actualité, Sociologie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique professionnel, sociologie, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

El proceso separatista catalán, con su punto álgido en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, provocó una reacción patriótica inesperada no solo en Cataluña, traducida en movilizaciones populares en defensa de la Cataluña Hispánica y la unidad de España.
Una reacción inesperada además, por las décadas en las que el mismo régimen del 78 y su clase política, llenos de complejos y de una concepción ajena y beligerante contra todo planteamiento identitario – asociándolo erróneamente con el separatismo - han utilizado el denominado patriotismo constitucional como la respuesta del denominado “bloque constitucionalista” frente al secesionismo.
Ciertamente el régimen del 78 se encuentra ante un fenómeno que se le puede ir de las manos, por lo que empezó - a través de los partidos constitucionalistas (PP. Ciudadanos y PSOE) y movimientos cívicos afines a éstos- la canalización de la reacción patriótica hacia un constitucionalismo, responsable por acción u omisión de la actual problemática territorial con los separatismos que no se circunscribe solo a Cataluña o País Vasco.
Y es que, la influencia alemana en el régimen del 78, no solo viene aplicada a la Ley fundamental de Bonn de 1949 o al asumir como propia la idea del “Estado social y democrático de derecho”, los partidos que se llevan turnando en el poder durante la Segunda Restauración, han asumido en sus idearios el concepto de patriotismo constitucional.
En el caso del PSOE era previsible por la matriz izquierdista y socialdemócrata de este concepto, pero en el caso del PP, fue asumido en una ponencia aprobada en su congreso nacional de Enero de 2002, evidenciando una vez más los complejos de la derecha española.
El constitucionalismo, entonces, tiene como base ideológica al patriotismo constitucional, un concepto surgido del “Institut für Socialforschung” (Instituto de Investigación Social), también conocido como Escuela de Frankfurt, en cual se agrupaban seguidores de Marx, Hegel y Freud.
El más conocido de sus teóricos, Jürgen Habermas, en su obra “Identidades nacionales y postnacionales” define al patriotismo constitucional de la siguiente manera:
“En este caso las identificaciones con las formas de vida y tradiciones propias quedan recubiertas por un patriotismo que se ha vuelto más abstracto, que no se refiere ya al todo concreto de una nación, sino a procedimientos y a principios abstractos.”
(…) “En el proceso público de la tradición se decide acerca de cuáles de nuestras tradiciones queremos proseguir y cuáles no.”
Si nos atenemos a las palabras de Habermas, podemos comprender que la consecuencia de la crisis de la conciencia nacional en España, se debe precisamente a un proceso de deconstrucción de ésta que el mismo Régimen del 78 ha ido realizando, como continuación de todos aquellos que desde el siglo XVIII impusieron la extranjerización y el rechazo a nuestra identidad cultural e histórica, considerada como algo arcaico y oscurantista que debía ser sustituido por unos valores ilustrados que como aportación negativa, traían la ruptura del individuo con “su circunstancia”, esto es, tradición, identidad, cultura, Historia o etnia; para ser sustituido por un individuo desarraigado que pueda ser manejable por intereses ajenos a la nación de la que forma parte.
Y es que para que exista una conciencia nacional, ésta solo tiene sentido con la fidelidad a nuestras señas de identidad y asumiendo un relato histórico nacional que va desde la Roma Imperial hasta nuestros días, pasando por la reafirmación de España con la Reconquista.
Un patriotismo identitario, popular y soberanista que no suponga la adhesión a regímenes concretos, sino que éstos sirvan a los intereses de España y los españoles por encima de todo.
09:10 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Droit / Constitutions, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique international, droit constitutionnel, constitution, droit, europe, affaires européennes, multiculturalisme, philosophie politique, espagne, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

EUROPA - Volume I, II & III
(10 janvier 2018)
I : VALEURS ET RACINES PROFONDES DE L'EUROPE
Les valeurs qui nous déterminent ou devraient encore et toujours nous déterminer sont nées aux périodes axiales de l’histoire, nous expliquait Karl Jaspers. Pour l’Europe et pour les peuples de souche européenne, Jaspers situait cette émergence de valeurs dans l’antiquité, aux époques de Zoroastre ou de Socrate.
Pour la Grèce, nous situerions cette émergence à l’ère homérique. D’autres filons philosophiques voient la naissance de valeurs fondatrices en Europe à d’autres époques, portée par d’autres figures individuelles ou collectives : Marc-Aurèle, Maître Eckhart, Sohrawârdî, Nietzsche…
Il s’agit désormais, à une époque de nihilisme profond, de vide, de ressusciter ces valeurs fondamentales et traditionnelles par un combat métapolitique permanent et vigilant, créant tout à la fois une rétivité sociale, politique et militante, dirigée contre les vecteurs du nihilisme délétère, et, chez chacun des combattants politiques ou métapolitiques, du plus humble au plus prestigieux, une force intérieure tranquille, inaccessible aux séductions perverses de la modernité dévoyée.
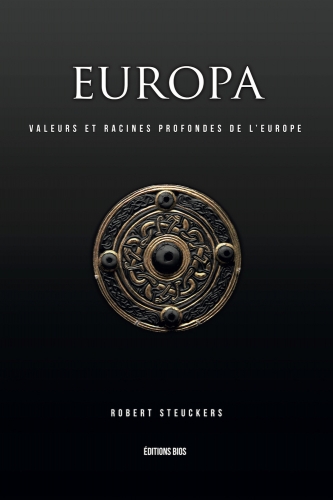
II : DE L'EURASIE AUX PÉRIPHÉRIES, UNE GÉOPOLITIQUE CONTINENTALE
Les deux guerres mondiales du XXème siècle nous ont appris que seuls comptaient sur l’échiquier planétaire les grands espaces, théorisés par les écoles géopolitiques et par le juriste Carl Schmitt.
Pour l’Europe, il s’agit de s’insérer dans un espace eurasien qui englobe la Sibérie russe, comme au temps de l’alliance tacite entre Louis XVI, Marie-Thérèse et Catherine II ou comme au temps, trop bref, de la Sainte-Alliance post-napoléonienne.
Cette convergence eurasienne implique un regard bienveillant sur les espaces perse, indien ou chinois (confucéen), de façon à créer un monde multipolaire où le politique repose sur des assises éthiques traditionnelles et solides, sur les longues mémoires, sur la plus grande profondeur temporelle possible.
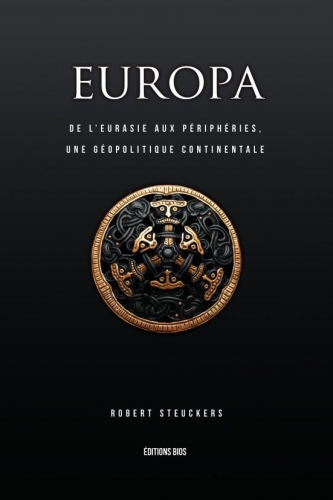
III : L'EUROPE, UN BALCON SUR LE MONDE
L’Europe, c’est d’abord une identité anthropologique. Mais c’est aussi une réalité géographique : une presqu’île à l’ouest d’une masse continentale eurasienne, perpétuellement assiégée, depuis les Huns, les Avars ou les Ottomans jusqu’aux faux réfugiés économiques arrivant aujourd’hui à Lampedusa ou à Lesbos.
Une Europe réveillée doit connaître son passé tragique, son passé de sous-continent et d’humanité assiégée, doit se remémorer la volonté de combattre de ses générations antérieures et les ressorts religieux et idéologiques de ses voisins, amis ou ennemis. Il n’y a pas de politique cohérente possible, pas d’avenir stable, sans longue mémoire.
Ce livre entend surtout, et de manière didactique, fournir les éléments de cette mémoire qu’il faudra impérativement, impérialement, retrouver, sous peine de mort, de disparition dans la honte et la misère.

Editions BIOS
Directeur: Laurent Hocq
Retrouvez nous sur :
http://www.facebook.com/editionsbios.fr/ …
+33 7 70 27 00 46
laurent.hocq@editionsbios.fr
Janvier 2018
Trois volumes d'un total de 996 pages
ISBN : 979-10-94233-01-6
75.00 €
16:31 Publié dans Eurasisme, Géopolitique, Livre, Livre, Nouvelle Droite, Révolution conservatrice, Synergies européennes, Terres d'Europe, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : actualité, europe, affaires européennes, politique internationale, histoire, révolution conservatrice, synergies européennes, robert steuckers, nouvelle droite, nouvelle droite européenne, new right, neue rechte |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

15:09 Publié dans Philosophie, Sociologie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, philosophie politique, théorie politique, politologie, sciences politiques, pitirim sorokin, conservatisme, sociologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

La saison des étrennes est passée. C’est dommage, car Aristide Leucate, rédacteur à L’Action Française 2000 et à Réfléchir & Agir, par ailleurs chroniqueur à l’émission hebdomadaire « Synthèse » à Radio Libertés, aurait volontiers offert à Yves-Charles Zarka le « Qui suis-je ? » qu’il vient de consacrer à Carl Schmitt. Dénonciateur en chef d’une clique pseudo-universitaire sclérosée qui traque l’infime « détail nazi » dans l’œuvre schmittienne, Zarka aurait sûrement apprécié ce magnifique cadeau…
Il faut reconnaître qu’à rebours de nombreux ouvrages publiés dans cette collection, Aristide Leucate ne retrace pas la vie de Carl Schmitt de sa naissance, le 11 juillet 1888 à Plettenberg, à son décès, le 7 avril 1985 dans la même ville. Certes, il en parle, mais ce sont les repères biographiques de neuf pages quand même placés en annexes qui fournissent l’essentiel. Félicitons-nous aussi de l’absence des trois pages habituelles de bio-astrologie qui n’apportaient rien aux précédentes études.
 Aristide Leucate propose surtout la biographie intellectuelle d’un des plus grands penseurs du XXe siècle. Juriste de formation, universitaire de haut vol, Carl Schmitt est un Prussien de l’Ouest en référence à ces terres rhénanes remises à la Prusse par le traité de Vienne en 1814 – 1815. Francophone et latiniste, ce catholique intransigeant admira toujours l’Espagne et tout particulièrement son Âge d’Or. Il n’est pas fortuit si sa fille unique, Amina, épousa en 1957 un professeur de droit de nationalité espagnole, ancien membre de la Phalange, Alfonso Otero Varela. Ses quatre petits-enfants sont donc des citoyens espagnols.
Aristide Leucate propose surtout la biographie intellectuelle d’un des plus grands penseurs du XXe siècle. Juriste de formation, universitaire de haut vol, Carl Schmitt est un Prussien de l’Ouest en référence à ces terres rhénanes remises à la Prusse par le traité de Vienne en 1814 – 1815. Francophone et latiniste, ce catholique intransigeant admira toujours l’Espagne et tout particulièrement son Âge d’Or. Il n’est pas fortuit si sa fille unique, Amina, épousa en 1957 un professeur de droit de nationalité espagnole, ancien membre de la Phalange, Alfonso Otero Varela. Ses quatre petits-enfants sont donc des citoyens espagnols.
Carl Schmitt est remarquable dans son hostilité à l’État de droit bourgeois et aux thèses libérales. « Le libéralisme juridique, selon Schmitt, peut être défini comme une excroissance du droit et des libertés individuelles dans le champ du politique, au point de subsumer celui-ci sous l’empire de ceux-là (p. 34) ». Il s’attache au contraire à considérer « le droit comme unité d’ordre concret (p. 39) », à rebours des chimères juridiques positivistes. Aristide Leucate aurait pu mentionner les confrontations qu’avait Schmitt avec les cercles libéraux dont certains comme Röpke assimileront quelques-uns de ses commentaires dans la formulation de l’ordo-libéralisme ou des théories défendues par l’École néo-libérale autrichienne. N’oublions pas que Carl Schmitt et Friedrich A. Hayek font partie des références du Carrefour de l’Horloge.
L’auteur de cette biographie s’attarde longtemps sur la brève adhésion de Schmitt au NSDAP entre 1933 et 1936. Il rappelle que le pseudo-tribunal de Nuremberg l’acquitta bien que les occupants alliés eussent confisqué toute sa bibliothèque et que Schmitt fût révoqué et mis d’office à la retraite à titre disciplinaire sans toutefois bénéficier de la moindre pension. Jusqu’en 1952, il bénéficiera de la « générosité de quelques admirateurs (élèves, amis, collègues) qui, par l’intermédiaire de l’Academia Moralis fondée en 1947, subvinrent à ses besoins (p. 85) ».
Retournant vivre dans sa maison natale qu’il nomme « San Casciano » en référence au lieu d’exil de Machiavel, Carl Schmitt continue à observer la marche du monde d’un point de vue à la fois juridique et philosophique de l’histoire. En 1950 paraît son célèbre Nomos de la Terre. Penseur du politique qui se structure autour de la distinction « ami – ennemi », du décisionnisme, de la nouvelle figure du partisan/terroriste et de la neutralisation des institutions politiques, il théorise le « grand espace » géopolitique. Il « craignait l’avènement d’un État mondial qui signifierait, du même coup, l’anéantissement du politique par neutralisation des antagonismes seuls à même de lui conférer sa substance vitale. La “ dépolitisation ” devait donc être conjurée par la recherche d’un espace politique concret où s’arrimerait la décision du souverain. Ce nouvel ordre international, théorisée, dès 1939 […] inspiré de la doctrine de Monroe (formulée en 1823 par ce président américain), devait prendre acte de l’effacement progressif de l’État en tant que sujet central, sinon architectonique, de l’ancien jus publicum europaeum, et privilégier l’avènement de nouvelles prises et distributions de terres organisées autour d’un Volk (pp. 103 – 104) ». Ce « grand espace » qui peut correspondre à la politogénèse européenne pourrait exercer la fonction vitale de Ketachon, soit de rempart aux ravages de l’entropie politique.
« À l’heure où, dans le monde, il se publie sur Carl Schmitt une étude (livre, monographie ou article) tous les dix jours (p. 10) » et que les États-Unis, l’Amérique latine et la Chine discutent de plus en plus de ses écrits, l’opuscule d’Aristide Leucate constitue une excellente introduction à l’œuvre magistrale de ce très grand maître à réfléchir.
Georges Feltin-Tracol
• Aristide Leucate, Carl Schmitt, Pardès, coll. « Qui suis-je ? », 2017, 124 p., 12 €.
09:47 Publié dans Livre, Livre, Révolution conservatrice, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : carl schmitt, aristide leucate, livre, révolution conservatrice, allemagne, théorie politique, politologie, sciences politiques, philosophie, philosophie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
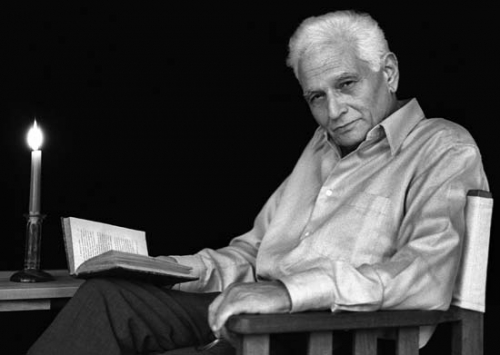
Ex: http://www.dedefensa.org
31 décembre 2017 – Nous avons consacré hier 30 décembre 2017 un F&C à partir d’un texte de James Edward Kunstler sur la situation crisique extraordinaire où est emportée l’Amérique. Kunstler parle d’une situation d’“irréalité” (terme qui rencontre certains de nos concepts) et cite deux “opérationnalisation de [cette] irréalité” qui, à notre avis, se complètent pour donner toute sa puissance à l’épisode crisique fondamental et décisif actuel aux USA. Nous nous attachons ici à l'explication de la deuxième “opérationnalisation de l’irréalité”, celle qui a est développée par le progressisme-sociétal. Nous citons le passage décrivant cet évènement
« ... La seconde est ainsi synthétisée par Kunstler, à propos des différentes facettes du progressisme-sociétal tel qu’il s’est développé à une vitesse extraordinaire depuis 2014-2015 et essentiellement à l’occasion de la campagne puis de l’élection de Donald Trump :
» “ L’idée nouvelle et fausse que quelque chose étiqueté ‘discours de hain’ – étiqueté par qui ? –équivaut à la violence qu’il décrit flottait autour des établissements d’enseignement des cycles supérieurs en un nuage toxique d'hystérie intellectuelle concocté dans le laboratoire de la philosophie dite “post-structuraliste”, où gisaient des parties des corps de Michel Foucault, Jacques Derrida, Judith Butler et Gilles Deleuze, qui seraient surmonté d’un cerveau fait d’un tiers de Thomas Hobbes, d'un tiers de Saul Alinsky et d'un tiers de Tupac Shakur, le tout donnant un parfait Frankenstein accouchant d’une monstrueuse pensée... ”
» Ce passage est d’une extrême importance pour nous, dans la mesure essentiellement où Kunstler mentionne quelques noms de “déconstructivistes” dont la pensée pèse sur notre époque, – non pour l’aider à reconstruire quelque chose sur ce qui aurait été détruit mais pour la pousser, pour l’entraîner, pour l’emprisonner dans une irrésistible pulsion de destruction, quel que soit l’objet à détruire. (“Destruction” plutôt que “mort” parce que ces déconstructivistes pensent finalement que la destruction n’est pas la mort, – et c’est en cela que cette pensée est singulièrement diabolique.)... »
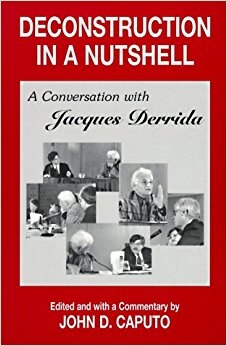 L’on voit l’importance déterminante que Kunstler attribue à un courant philosophique bien connu, celui que l’on connaît sous divers noms dont celui de “déconstruction”. Le nom de Jacques Derrida y figure en bonne place et il nous a semblé ainsi particulièrement opportun de revenir sur un texte F&C (du 27 avril 2015), sur une intervention de Derrida particulièrement révélatrice à notre sens, et en en orientant notre commentaire vers une hypothèse offrant une explication de l’évolution de la politique mondiale avec l’intervention catastrophique de la politiqueSystème conçue d’une façon complètement incontestable comme un phénomène imposé par le Système, lui-même opérationnalisation du “déchaînement de la Matière” ; et, depuis, cet ensemble complété d’une façon encore plus significative par l’accélération extraordinaire du phénomène de dissolution du progressisme-sociétal, avec la grande crise de l’américanisme et du pouvoir de Washington D.C. ouverte à l’été 2015 et qui ne cesse pas de s’aggraver.
L’on voit l’importance déterminante que Kunstler attribue à un courant philosophique bien connu, celui que l’on connaît sous divers noms dont celui de “déconstruction”. Le nom de Jacques Derrida y figure en bonne place et il nous a semblé ainsi particulièrement opportun de revenir sur un texte F&C (du 27 avril 2015), sur une intervention de Derrida particulièrement révélatrice à notre sens, et en en orientant notre commentaire vers une hypothèse offrant une explication de l’évolution de la politique mondiale avec l’intervention catastrophique de la politiqueSystème conçue d’une façon complètement incontestable comme un phénomène imposé par le Système, lui-même opérationnalisation du “déchaînement de la Matière” ; et, depuis, cet ensemble complété d’une façon encore plus significative par l’accélération extraordinaire du phénomène de dissolution du progressisme-sociétal, avec la grande crise de l’américanisme et du pouvoir de Washington D.C. ouverte à l’été 2015 et qui ne cesse pas de s’aggraver.
La “confession” involontaire, ou semi-involontaire du philosophe Derrida, à partir de sa propre expérience d’écrivain et de penseur de la déconstruction, nous suggère une hypothèse opérationnelle et contradictoire implique selon laquelle la déconstruction produite par le déconstructeur alimente la déconstruction de ce même déconstructeur. D’une certaine façon, cette observation n’est nullement contradictoire avec nos conceptions générales car l’on retrouve dans ce cas de “la déconstruction produite par le déconstructeur [alimentant] la déconstruction du déconstructeur” rien de moins qu’une variante de la formule surpuissance-autodestruction. On comprend, au travers des liens de Derrida avec l’évolution de la pensée progressiste-sociétale et de la psychologie de l’américanisme, le lien extrêmement fort et révélateur que nous offre cet incident (la “confession” de Derrida) avec la situation présente.
Le texte du 27 avril 2015 repris ci-dessous a été évidemment relu et modifié en fonction des plus récents événements de ces deux dernières années. Néanmoins, pour l’essentiel, il nous paraît être tout à fait pertinent.

27 avril 2015 (relu et actualisé au 31 décembre 2017) – La genèse de ce texte est chronologiquement complexe à établir. Qu’il nous suffise de dire qu’un proche, qui suivait nos travaux concernant notamment le processus-Système de “néantisation” sous la formule dd&e (déstructuration-dissolution-entropisation), nous signala la présence sur YuTube d’une intervention du philosophe “déconstructeur” Jacques Derrida, sous doute datant de 2002, sous le titre (anglais) de Derrida’s Terror. C’est sur ce document que nous appuyons notre texte qui développe une hypothèse ambitieuse.
(Nous sollicitons ici le terme “néantisation” pour désigner en une forme plus définitive le processus dd&e, et bien qu’on puisse arguer que “néantisation” pourrait équivaloir à “entropisation” ; mais le premier néologisme [de Heidegger], d’origine philosophique et métaphysique, semble apte à embrasser la processus général dd&e, plus que le terme “entropisation”, de facture fortement scientifique, et de plus qui fait partie de la formule [dd&e], donc dans une position qu’on pourrait juger inopportunément “juge et partie”. Une hypothèse serait que, dans notre esprit, “entropisation” constituât l’opérationnalisation de la “néantisation” tandis que la “néantisation” engloberait l’ensemble du processus dd&e. C’est à voir et l’on verra. En attendant, on notera ce que Gorge Steiner dit, dans Grammaires de la création [NRF essais/Gallimard, 2001], du terme “néantisation” : « Mais c’est Heidegger qui va le plus loin dans le repliement des contours du langage ordinaire et de la syntaxe rationnelle. Dans le contexte historique qui est déterminant pour cette étude, à l’époque de la longue éclipse des espoirs humains et de la dislocation du temps futur, Heidegger fait du “néant” un verbe : Nichten, “néantir”. Le néologisme va beaucoup plus loin que vernichten, qui signifie “détruire”, “anéantir”. Il laisse pressentir comme à travers un voile, – la notion d’“ombre” est ici cruciale, – l’anéantissement de ce qui existe. »)
Le document Derrida’s Terror, mis sur YuTube le 24 novembre 2008 par un incertain Xenosophia, est manifestement une interview faite par un (des) intervieweur(s) de langue anglaise, ou anglo-américaine sans nul doute (Derrida, décédé en 2004, enseignait régulièrement aux USA, comme on va le voir évidemment). La présentation écrite est en anglais, il y a des sous-titres anglais et, à un moment, Derrida dit une phrase en anglais alors que le reste de son intervention est en français. D’après les indications que nous avons recueillies, il s’agirait d’un document réalisé par deux des anciennes élèves de Derrida, de Kirby Dick & Amy Ziering Kofman (voir ce lien). Le texte de présentation dit ceci (le souligné en caractère gras est de nous : il marque combien l’acte de la déconstruction est irrémédiablement un acte d’une extraordinaire agressivité parce qu’il est une attaque impitoyable contre tout ce qui est, activement ou potentiellement, et même relativement, ordre, harmonie et équilibre) : « Jacques Derrida speaks about the aggressivity that is inevitable in the act of deconstruction, and the fear and anxiety that he experiences as he finds himself “aggressing” other texts, persons, or institutions. » Il y avait 5.591 visions le 25 avril 2015 alors qu’il y en avait eu 1.285 lorsque nous le visionnâmes pour la première fois, le 12 août 2012. Nous l’avons consulté à nouveau, près de deux ans et demi plus tard, et nous enregistrons 6.809 visions. La durée de l’interview est de 3 minutes 48 secondes. Voici sa transcription (Nous avons mis quelques mots en gras, pour souligner ceux qui sont les plus importants pour notre propos ; le mot “i-na-dmi-ssible” “tronçonné” en tirets retranscrit l’intonation de martèlement que Derrida déclame...)
« …Chaque fois que j’écris quelque chose … Que j’avance dans des espaces où je ne m’étais pas aventuré, ce qui implique des actes qui peuvent sembler agressifs à l’égard de penseurs, ou de collègues… C’est déjà arrivé… Je ne suis pas “polémiqueur” [sic] mais il est vrai que les gestes de type déconstructif ont souvent l’apparence de gestes qui vont déstabiliser, ou angoisser les autres, ou même blesser les autres quelquefois…
» Alors, chaque fois que j’ai fait ce geste là, il y a y eu des moments de peur… Pas au moment où j’écris, parce qu’au moment où j’écris, il y a une espèce de nécessité, une espèce de force, plus forte que moi, qui fait que ce que je dois écrire, je l’écris, quelles que soient les conséquences … Je n’ai jamais renoncé à écrire quoi que ce soit parce que les conséquences me faisaient peur. Rien ne m’intimide quand j’écris. Je dis ce que je pense qui doit être dit. Bon…

» Cela dit, quand je n’écris pas, quand je ne suis pas en train d’écrire, et à un moment très particulier qui est le moment où je m’endors… When I have a nap and I fall asleep … A ce moment-là, dans un demi-sommeil, je suis effrayé par ce que je suis en train de faire, et je me dis “mais tu es fou, tu es fou d’écrire ça, tu es fou de t’attaquer à ça, tu es fou de critiquer telle ou telle personne, tu es fou de contester telle ou telle autorité, que ce soit une autorité textuelle, une autorité institutionnelle, une autorité personnelle”... Et il y a une sorte de panique, dans un subconscient, comme ça, une sorte de panique, comme si … comme si, à quoi est-ce que je peux comparer ça ? Imaginez un enfant qui fait une chose honteuse, il a fait une chose honteuse, bon… Il y a les rêves d’enfant de Freud, où l’enfant se promène nu, vous savez les rêves où l’on se promène tout nu, et puis l’on est effrayé parce que tout le monde voit que vous êtes nu … Bon… Dans ce demi-sommeil, j’ai l’impression que j’ai fait une chose criminelle, honteuse, inavouable, quelque chose que je n’aurais jamais dû faire… Et quelqu’un est en train de me dire : “Mais tu es fou de faire ça !” … Et c’est l’évidence même, je le crois dans mon demi-sommeil, je le crois… Et donc, l’ordre qui est évident dans cela, c’est “Arrête tout, retire ça, brûle tes papiers… Ce que tu viens de faire est i-na-dmi-ssible !” Mais dès que je me réveille, c’est fini.
» Ca veut dire que… Je l’interprète comme ça, ça veut dire que quand je suis éveillé, conscient, au travail, etc., je suis d’une certaine manière plus inconscient que dans un demi-sommeil… Dans un demi-sommeil, je, je… il y a une certaine vigilance qui me dit la vérité, à savoir que ce que je fais c’est très grave, d’une certaine manière … Mais quand je suis éveillé et au travail, cette vigilance-là est en sommeil. Elle n’est pas la plus forte, et donc je fais ce qui doit être fait… »
Il faut regarder et écouter Derrida, l’esprit dégagé au moins pour cet instant de tout parti pris, voire même de ses propres positions fondamentales, le regarder et l’écouter disons d’humain à humain. Il dit une vérité profonde de son être, de lui-même, qui le tourmente horriblement et dont on sent qu’il ne parviendra jamais à la maîtriser (il mourra deux années après cette intervention), comme s’il en était prisonnier ; et cela, n’est-ce pas, dont on devine qu’il le sait, ou qu’il le devine “comme semi-inconsciemment”, comme lorsqu’il est dans cet état de demi-sommeil qu’il mentionne, où il juge qu’alors une vigilance fondamentale contre des forces extérieures maléfiques reprend sa place et qu’il entend la condamnation de ses écrits comme une vérité qui le remplit de honte.
(En quelque sorte, c’est quand il est conscient, c’est quand il est “libre” qu’il est prisonnier, car alors le venin des idées idéologisées reprend le dessus.)
Il est difficile de ne pas ressentir le sentiment d’une grande compassion, presque un élan de solidarité pour ce qu’il nous dit de la tragédie humaine, et comme nous-mêmes à sa place, nécessairement, nous l’aurions expérimenté dans son intensité quoique chacun à sa manière et selon l’orientation de son esprit. La tragédie intérieure de cet homme se trouve dans cette interrogation : comment surmonter une telle contradiction ? Entre cette “vigilance” qui lui “dit la vérité”, savoir que ce qu’il fait est “i-na-dmi-ssible” et devrait être brûlé, et lui-même, écrivant contre cette vigilance qu’il a écartée, estimant qu’il “fait ce qui doit être fait” ? Entre ceci qui est sa “vigilance” lui disant que ce qu’il fait est “i-na-dmi-ssible” et cela qui lui dit “ce qui doit être fait” qui est ce que sa “vigilance” dénonce ?... Il faut que l’enjeu soit, pour cet esprit, – mais aussi pour la théorie qu’il représente et l’influence qu’eut et qu’a cette théorie, – d’une importance vitale et, surtout, imposé par une force irrésistible et d’une surpuissance exceptionnelle.
(Il faut insister là-dessus, dans ce moment de vérité : Derrida s’explique à lui-même de ses actes comme s’il existait effectivement quelque chose d’extérieur à lui, qui le guide et le force, et la contraint...)
Maintenant, laissons de côté l’aspect humain pour lequel nous disons notre plus grand respect, et venons-en à l’aspect disons plus social et symbolique de définition de la philosophie que représentent Derrida et quelques-uns des philosophes de la même école que lui et qui connurent la même aventure disons pédagogique. Derrida le dit lui-même, – le “geste de type déconstructif” définit le mouvement philosophique qui se développe à partir des références du structuralisme et du poststructuralisme ; on pourrait donc désigner ce mouvement comme celui de “la déconstruction” alors que nous serions conduit, pour notre part, à voir dans ce même mot, en partie l’équivalent de notre “déstructuration-dissolution”. Derrida exprime sa “peur” à propos de l’activation, dont il est lui-même l’ordonnateur, des “gestes de type déconstructif”. Il ne peut prétendre parler, disons comme pourrait le faire un isolé, un non-conformiste, un “poète maudit” ou un philosophe rebelle, un homme dressé contre les conventions et l’ordre établi (effectivement, des positions qui plaisent tant aux “intellectuels” qui se jugent nécessairement “en avance”, là où l’on peut se sentir isolé, angoissé, exposé à la vindicte du conformisme, etc., puisqu’effectivement “en avance” sur tout cela). Bien au contraire. Derrida fut, en son temps, avec ses confrères du post-structuralisme, un véritable maître, et reconnu et encensé comme tel, de la future pensée dominante en train de s’élaborer, – mais nous devrions dire plutôt “psychologie dominante”, car peu nous importe le contenu extraordinairement complexe jusqu’à la micro-conceptualisation, de cette “pensée”. Pour nous, cette “future psychologie dominante” fut absolument la matrice implacable de la “pensée dominante” (pour le coup, le terme “pensée” a sa place), là où cela comptait, comme elle l’est absolument aujourd’hui de la déferlante progressiste-sociétale perçue comme une dynamique de la pensée dont le cours déconstructurationniste est tracé et absolument inarrêtable.
Le livre French Theory, de François Cusset (La Découverte, 2003), nous instruit à propos du formidable succès de ces philosophes français aux USA dans les années 1970. Le “quatrième de couverture” nous suffit à cet égard pour avoir une idée du cheminement de l'influence de cette French Theory, et parce que c’est de psychologie et non de pensée que nous parlons, – et cette psychologie étant parfaitement celle de la “déconstruction”, ou “déstructuration-dissolution”, – ou, si l’on veut employer un néologisme d’une famille de grand style qu’on a déjà suggérée, la “déconstructuration”...
« Sait-on que la science-fiction américaine, du roman “cyberpunk” à la saga “Matrix”, se nourrit largement de Jean Baudrillard ? Que Gilles Deleuze et Félix Guattari inspirent aux États-Unis les pionniers de l’internet et de la musique électronique ? Que Michel Foucault y est une référence majeure des luttes communautaires tandis que Jacques Derrida est une star sans égale dans l’université ? [...] C’est cette histoire, mal connue, de la ‘French Theory’ que François Cusset retrace ici. Il retrace le succès de cette étrange ‘théorie française’, – la déconstruction, le biopouvoir, les micropolitiques ou la simulation [le simulacre], – jusque dans les tréfonds de la sous-culture américaine. Il restitue l’atmosphère particulière des années 1970 et raconte la formidable aventure américaine, et bientôt mondiale, d’intellectuels français marginalisés dans l’Hexagone ...»
Que voilà donc des flons-flons triomphants (où, tout de même, Baudrillard est mis dans le même sac que Foucault, Deleuze, Derrida & Cie, ce qui est pousser le bouchon un peu loin) ... Ils ont l’avantage, ces flons-flons, de nous confirmer contrairement à ce qu'il prétend nous dire, que ces “intellectuels français” ne furent jamais vraiment marginalisés “dans l’Hexagone”... Finalement, c’est cette marginalisation qui a manqué à Derrida et ce manque fait comprendre les arcanes de son drame, parce qu'il s'agit d'une époque où la célébrité fait de vous une victime désignée et vulnérable d’un système maléfique d’une puissance inoiuïe.
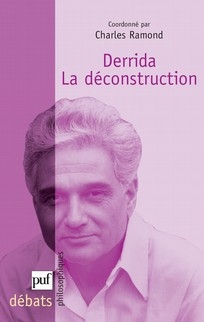 Ainsi revenons-nous au drame de Derrida que restituent les quelques minutes de confidences qu’on a écoutées. Ayant écarté les occurrences sociales et autres qui figurent au début des confidences, nous revenons au plus profond du secret de l’être, pour considérer enfin ce qu’il nous dit en vérité, selon notre interprétation. Dans ces moments de semi-conscience que lui-même (Derrida) qualifie de la plus grande “vigilance”, c’est-à-dire de la lucidité qui dit “la vérité” en écartant l’espèce d’opium de la pure spéculation intellectuelle, l’esprit qui fait “ce qui doit être fait” est confronté à ce jugement terrible : « Ce que tu viens de faire est i-na-dmi-ssible »... Non pas “selon ta fonction, ta position sociale, ton respect de la hiérarchie”, mais parce qu’il s’agit de quelque chose d’“i-na-dmi-ssible” en soi, – et cela ne peut être alors que le fait de céder à la tentation épouvantable, de succomber à l’influence du Mal, d’accepter le simulacre qu’il impose.
Ainsi revenons-nous au drame de Derrida que restituent les quelques minutes de confidences qu’on a écoutées. Ayant écarté les occurrences sociales et autres qui figurent au début des confidences, nous revenons au plus profond du secret de l’être, pour considérer enfin ce qu’il nous dit en vérité, selon notre interprétation. Dans ces moments de semi-conscience que lui-même (Derrida) qualifie de la plus grande “vigilance”, c’est-à-dire de la lucidité qui dit “la vérité” en écartant l’espèce d’opium de la pure spéculation intellectuelle, l’esprit qui fait “ce qui doit être fait” est confronté à ce jugement terrible : « Ce que tu viens de faire est i-na-dmi-ssible »... Non pas “selon ta fonction, ta position sociale, ton respect de la hiérarchie”, mais parce qu’il s’agit de quelque chose d’“i-na-dmi-ssible” en soi, – et cela ne peut être alors que le fait de céder à la tentation épouvantable, de succomber à l’influence du Mal, d’accepter le simulacre qu’il impose.
Si nous disons cela, c’est conduit par la logique autant qu’influencé grandement par l’intuition, laquelle nous a proposé comme évidence que le Mal se manifeste essentiellement par ce processus dd&e, ou pour retrouver notre trouvaille de circonstance, par le processus de “déconstructuration”... Et l’état de semi-conscience où la “vigilance” retrouve sa place naturelle, c’est celui où la psychologie, débarrassée des chaînes des idées auxquelles l’esprit s’est attaché, est capable de percevoir toute la puissance de la vérité et de se faire elle-même messagère de la vérité pour admonester le philosophe. Ainsi Derrida se trouverait-il confronté à la vision affreuse que les idées qu’il développe constitueraient effectivement une transcription socio-intellectuelle de l’influence du Mal (ou du Système pour notre compte, pris dans son sens le plus large d’opérationnalisation du “déchaînement de la Matière”).
Encore une fois, il ne nous viendrait pas à l’esprit de développer cette idée misérable et infondée de faire un procès à Derrida. D’ailleurs, sa “confession” quasi-psychanalytique parle pour lui-même : il représente ce cas qu’on a déjà envisagé d’une intelligence brillante, d’un exceptionnel brio intellectuel, trahis par une psychologie trop faible ou affaiblie (elle n’est capable de transmettre les messages essentiels venus d’un en-dehors ou d’un au-delà que lorsque l’esprit est dans un état de conscience très amoindrie). Il représente cette défaite permanente des psychologies, depuis le XVIIIème siècle (siècle du “persiflage” bien entendu), confrontées aux pressions des salons, de l’université, des milieux intellectuels dominants, bref de tout ce qui fait la modernité dans son activité d’influence par le système de la communication.
(Il ne nous viendrait certes pas à l’esprit, non plus, d’écarter l’idée qu’un intellectuel, un écrivain, un penseur, un essayiste, un philosophe, ne connaît pas de terribles faiblesses dans son travail sans nécessairement avoir sa psychologie affaiblie. S’il fallait identifier la principale, ce serait l’angoisse avec ses différents effets [paralysie de la création, panique, etc.], et l’angoisse à cause du doute, mais non la peur, comme le confie Derrida. [L’angoisse concerne l’inconnu, qui peut être dangereux ou amical, faussaire ou vrai ; la peur, elle, concerne ce qui est connu et dont on sait le danger que cette chose représente, c’est-à-dire la cause de la peur identifiée comme mauvaise ou ennemie ; l’angoisse réclame la vérité de l’énigme qu’on affronte pour pouvoir être surmontée, la peur marque la démarche dont on a identifié le danger.] Outre cette différence entre l’angoisse et la peur, il y a ce fait que l’angoisse ne vient pas dans les états de semi-conscience, sous le coup d’une “vigilance” qui soudain joue son rôle ; elle marque en toute lucidité le travail de la pensée consciente, procédant par à-coups d’incertitudes angoissantes suivies de soudaines certitudes sublimes, suivies à nouveau d’incertitudes angoissantes, etc., –une bataille sans fin pour la vérité, et non pas une avancée sans douter mais transie de peur, pour “faire ce qui doit être fait”, “une espèce de nécessité, une espèce de force, plus forte que moi, qui fait que ce que je dois écrire je l’écris, quelles que soient les conséquences”, – cela dont la “vérité” vous dit par instant que c’est “i-na-dmi-ssible”. Nous n’écartons pas un instant l’idée que l’écrit est l’outil principal de transmission de forces invisibles [voir notamment le 16 avril 2015] et qu’il entraîne l’écrivain considéré alors comme un “messager” bien plus qu’il n’est conduit par lui, mais rien n’assure bien évidemment que dans ces forces ne s’en glissent pas certaines qui représentent une influence maléfique. C'est à la vigilance d'exercer son office.)

A partir de notre raisonnement intuitif concernant ce cas tel que nous l’identifions, à l’audition de ce remarquable document de la “confession” de Jacques Derrida, et à la lumière de ce qu’on sait de l’extraordinaire succès de la French Theory aux USA, il nous semble qu’une hypothèse opérationnelle historique peut être développée. Il s’agirait de présenter une explication hypothétique pour mieux comprendre notre époque depuis la fin de la Guerre froide et surtout depuis l’attaque du 11 septembre 2001, et essentiellement la politique de l’américanisme qui est apparue finalement comme étant elle-même l’opérationnalisation de la “politiqueSystème” dans spn sens le plus large et dont on sait qu’elle peut, qu’elle doit complètement et parfaitement s’identifier à elle.
(Le concept de “politiqueSystème“ doit être pris ici dans son sens quasiment absolu, c’est-à-dire embrassant politiques extérieures et situations intérieures. Cela va évidemment et nécessairement, ô combien, jusqu’à comprendre l’irruption depuis 1974-1975 de la grande crise intérieure du pouvoir de l’américanisme et du déchaînement du progressisme-sociétal, ou marxisme-culturel comme l’identifient nombre d’intellectuels conservateurs.)
Ce que nous observons, d’abord depuis la fin de la Guerre froide jusqu’à l’attaque 9/11, puis à partir de 9/11, c’est une évolution psychologique US caractérisée par une alternance maniaco-dépressive, d’abord d’un épisode dépressif puis d’un épisode maniaque (à partir de l’été 1996), transcendé ensuite avec 9/11 en une sorte d’épisode hypomaniaque qu’on peut aisément aligner avec un concept tel que l’“idéal de puissance”. Quant à la politique extérieure suivie à partir de 9/11, identifiée comme “politiqueSystème” (dans son épisode “hégémonisme-chaotique”), elle ne présente aucun caractère de cohérence lorsqu’elle est observée sur le terme de la quinzaine d’années nous séparant du 11 septembre 2001. Bien entendu, cette politique a un caractère de surpuissance évident qui est systématiquement interprété comme une politique de conquête hégémonique des USA, — en général d’une façon avantageuse pour les USA, à notre sens en complète contradiction avec la vérité-de-situation à cet égard. Sur ce terme de 2001-2015 on observe que cette conquête hégémonique tourne en rond sur des territoires d’ores et déjà conquis (ou sous l’influence US), si bien qu’on finit par s’interroger sur la cohérence de la chose : combien de fois les USA ne se sont-ils pas lancés à l’assaut de l’Irak depuis 1991 ? Pourquoi les USA n’ont-ils pas aménagé leur écrasante supériorité sur la Russie dans les années 1990, en pratiquant une politique un peu plus habile avec un pays qui leur était quasiment acquis (même Poutine, à ses débuts, ne demandaient qu’à coopérer avec les USA) ? Pourquoi dans ces conditions ouvertes à la coopération, éventuellement à l’intégration-domination de la Russie dans l’OTAN, lancer dès 2002 le programme de missiles antimissiles qui n’a jusqu’ici servi qu’à s’aliéner la Russie et à pousser Poutine vers une réaffirmation de la souveraineté russe, et à un réarmement de son pays ? Etc... Chacune de ses questions sans réponse accentue le jugement d’une politique de complet désordre qui n’est conduite que par l'effet qu'elle produit de la déstructuration et de la dissolution.
Certes, les théories et les complots ne manquent pas, mais eux aussi tournent en rond et ne produisent rien. Il y a les neocons affirmant vouloir refaire les cartes du monde en s’appuyant sur Leo Strauss et proclamant l’ère du “chaos créateur”, il y a l’hypercapitalisme et sa référence à Friedrich von Hayek et la thèse de l’“ordre spontané” aussi vieille que l’Empire du Milieu. Mais rien ne sort de tout ce verbiage de communication dont Strauss et Hayek ne réclameraient certainement pas la paternité. On passe d’une Libye qu’on conquiert pour son pétrole et qui est récupérée par l’anarchie comme l’avaient prévu les adversaires de cette expédition, à une Syrie qu’on ne parvient même pas à attaquer, à une Ukraine qui nous conduit au bord d’un conflit aux proportions inimaginables sans se ménager la moindre issue de secours avant de sombrer dans la paralysie d’un trou noir de gaspillage, de corruption et de désordre, tout cela et dans le même temps en lançant au Moyen-Orient la constitution d’un pseudo-“État Islamique” qu’on finance et qu’on arme tout en le combattant avec fureur, ou en soutenant l’attaque du Yémen par une maison Saoud dont la sénilité a produit soudain un vertige interventionniste, sans très bien savoir contre qui et dans quel but, et qui se trouve soudain à découvert, face aux plus grandes menaces pour sa propre survivance.

Bien entendu, à partir de 2015 s’est ajouté le volet intérieur, la crise interne du système de l’américanisme sous la poussée du progressisme-sociétal, avatar intérieur et effectivement sociétal de la même politiqueSystme. Là aussu, les psychologies sont touchées en priorité et la pente suivie est, d’une façon aveuglante à force d’être évidente, celle de la “déconstructuration”.
Le résultat est toujours et encore un immense désordre qui ne cesse de grandir et de s’amplifier selon un élan à la fois exponentiel et d’orientation entropique, et se caractérisant par une poussée constante, déstructurante et dissolvante, ou bien “déconstructurante” après tout ... L’impression, souvent émise, est que les intelligences qui mènent cette politique sont, à l’image de la déstructuration-dissolution du pouvoir en divers centres, complètement déstructurées ou déconstruites, donc elles-mêmes transformant la perception du monde qu’elles reçoivent en désordre en restituant évidemment des politiques qui alimentent ce désordre et l’accroissent partout où c’est possible ; il n’y a qu’un pas à faire, et nous le faisons plus souvent qu’à notre tour, pour avancer l’hypothèse que les psychologies qui sont au service de ces intelligences sont elles-mêmes déstructurées et livrent une perception qui l’est nécessairement. C’est bien évidemment à ce point que nous retrouvons Derrida, sa confession extraordinaire et la French Theory.
Notre thèse est que la French Theory, dont on a mesuré le triomphe aux USA par les extraits cités plus haut, et qui toucha tous les domaines, constitua un phénomène psychologique d’une profondeur considérable (il est question des “tréfonds de la sous-culture américaine”). Ce succès concerna certes bien des idées pour ces milieux des élites devenues élites-Système qui entretiennent leur vanité intellectuelle s’il le faut au prix de la destruction du monde, mais il eut surtout un impact fondamental sur les psychologies de ces élites, d’ailleurs à partir de conceptions de déstructuration et de déconstruction correspondant parfaitement à l’esprit de l’américanisme tel qu’on peut le percevoir, notamment dans le flux du “déchaînement de la Matière”.
(On sait combien nous apprécions les États-Unis d’Amérique comme une construction a-historique, “en-dehors de l’Histoire”, donc naturellement productrice d’une politique de déconstruction de l’Histoire allant jusqu’à l’annonce triomphale quoiqu’un peu hasardeuse de la “fin de l’Histoire”, au moment où la French Theory donne tous ses effets sur la psychologie américaniste en accentuant décisivement ses caractères naturels.)
Cette hypothèse donnant un tel effet au constat de l’influence de la French Theory aux USA est largement concevable tant on perçoit avec quelle force l’un des messagers de la “déconstructuration” lui-même, Derrida, est touché au niveau de sa psychologie. La philosophie de la déconstruction et de la déstructuration (“déconstructuration”) touche la psychologie autant que l’esprit, et elle a sur la psychologie un effet déconstructeur et déstructurant qui agit de toutes les façons sur l’esprit, sans même qu’il soit nécessaire d’assimiler les idées portées par la philosophie elle-même.
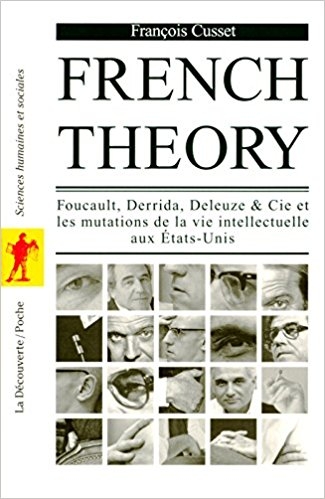 Les philosophes de la French Theory eurent un peu le même effet que celui qu’amena Sigmund Freud en le pressentant largement, lors de son premier voyage aux USA en 1909, lorsqu’il s’exclama que ce pays-continent était la terre rêvée pour la psychanalyse tant il était producteur fondamental de la névrose caractéristique de la modernité, désignée en 1879 par le Dr. Beard comme “le mal américain”. Simplement, à un peu moins d’un siècle de distance, ils ont décisivement prolongé Freud pour porter la psychologie de l’américanisme à son point de fusion, lorsqu’elle devint le parfait serviteur du Système en se déstructurant. La French Theory servait sur un plateau de fer et de tonnerre le destin des USA d’après la Guerre froide : une psychologie à la fois absolument déstructurée et absolument déstructurante, ou absolument “déconstructurante” si l’on veut, avec des idées plus ou moins précisées à mesure, qu’on peut de temps en temps saupoudrer de neocon ou de von Hayek, sans oublier la “démocratie” dont l’idée portée vers des lieux impréparés pour cela enfante elle aussi le désordre par “déconstructuration”.
Les philosophes de la French Theory eurent un peu le même effet que celui qu’amena Sigmund Freud en le pressentant largement, lors de son premier voyage aux USA en 1909, lorsqu’il s’exclama que ce pays-continent était la terre rêvée pour la psychanalyse tant il était producteur fondamental de la névrose caractéristique de la modernité, désignée en 1879 par le Dr. Beard comme “le mal américain”. Simplement, à un peu moins d’un siècle de distance, ils ont décisivement prolongé Freud pour porter la psychologie de l’américanisme à son point de fusion, lorsqu’elle devint le parfait serviteur du Système en se déstructurant. La French Theory servait sur un plateau de fer et de tonnerre le destin des USA d’après la Guerre froide : une psychologie à la fois absolument déstructurée et absolument déstructurante, ou absolument “déconstructurante” si l’on veut, avec des idées plus ou moins précisées à mesure, qu’on peut de temps en temps saupoudrer de neocon ou de von Hayek, sans oublier la “démocratie” dont l’idée portée vers des lieux impréparés pour cela enfante elle aussi le désordre par “déconstructuration”.
Drôle d’hypothèse ou drôle de théorie finalement, que de proposer un tel rôle à la French Theory, matrice de la postmodernité et dont la position épouse parfaitement l’invasion universelle du “marché” et de l’effet de déconstruction et de déstructuration qu’il exige pour être quitte de toutes les règles et de tous les principes. On retrouve le même mouvement dans le monde de l’art, avec la déconstruction complète de la notion d’“art” qu’implique l’“Art Contemporain” (l’AC), lui aussi entièrement créature créée par le “marché”, le Corporate Power et l’hypercapitalisme, – et tous ces bouleversements pesant affreusement sur les psychologies de leurs principaux acteurs, toujours dans le même sens “déconstructurant”...
On observerait alors plusieurs enchaînement à la fois contradictoires et logiques ... Les USA qui purent se constituer grâce à la France et son intervention lors de leur guerre de l’indépendance, lancés à la conquête du monde par l’américanisation (vieux projet évident dès la fin du XIXème siècle) dans un sens qui trahissait évidemment les conceptions françaises engagées lors de l’aide aux insurgents de 1776 (voir la Deuxième Partie du Tome-I de La Grâce de l’Histoire) ; recevant en retour, deux siècles plus tard, de la France, productrice tout au long de son histoire du pire et du meilleur de l’esprit dans un affrontement métahistorique colossal, la French Theory qui pourrait bien être la recette pour accomplir le destin annoncé par Lincoln-1838 (« En tant que nation d’hommes libres, nous devons éternellement survivre, ou mourir en nous suicidant ») ... Le problème, sans nul doute, est que nous sommes du voyage, et il faut espérer qu’il y a plus d’embarcations de sauvetage qu’il n’y en avait sur le Titanic.
Au reste, on conviendra que ce rangement ne contredit en rien celui, plus général, que nous proposons avec la thèse du “déchaînement de la Matière”. Il s’y insère parfaitement, avec cette proximité jusqu’à l’intimité de la volonté de déstructuration (et la dissolution des esprits et des formes), de déstructuration-dissolution, de “déconstructuration”, qui s’ensuit, qui est le caractère même de la modernité, aussi bien que des phénomènes que nous observons, en constante progression depuis plus de deux siècles et entrés dans une phase d’accélération foudroyante depuis un quart de siècle et particulièrement depuis 2001. Il faut dire que les trois minutes 48 secondes de la “confession” de Derrida, celle-ci avec son caractère tragique et sa résonnance pathétique, nous suggèrent effectivement que l’on se trouve là devant un phénomène dont la description et la signification touchent aux choses les plus hautes et à l’inversion la plus basses de ces choses les plus hautes. Comme si s’ouvrait soudain, devant nous, une porte d’un pan essentiel pour notre contre-civilisation du Grand Mystère...
09:46 Publié dans Actualité, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, jacques derrida, déconstruction, déconstructivisme, philosophie, philosophie politique, french theory, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook