SYNERGIES EUROPÉENNES - NOVEMBRE 1988
Discours pour l'Europe
(Paris, 9 novembre 1988)
par Robert STEUCKERS
Mesdames, Messieurs,Chers amis et camarades,Chers partisans de la lucidité donc de la "troisième voie",
Les partis politiques du système veulent faire une Europe. Une Europe qu'ils annoncent pour 1992-93. Mais cette Europe n'est évidemment pas notre Europe. C'est une Europe qui traîne quelques soli-des boulets: notamment celui d'être la concrétisation d'un vieux projet américain. Professeur à Rome, Rosaria Quartararo a exploré les archives améri-cai-nes de Washington et d'ailleurs et elle y a découvert que la CEE, telle que nous la connaissons aujour-d'hui, avait déjà soigneusement été esquissée dans le fameux Plan Marshall et dans le cadre de la Eu-ro-pean Recovery Policy. Autrement dit, l'intégration envisagée s'est faite sous le signe de la vassalité à l'égard des Etats-Unis. Alors que les plans nés en Eu-rope, chez un Briand ou un Quisling, chez un Drieu La Rochelle ou chez un Henri De Man, pré-voyaient la liberté pour tous les peuples et le respect de toutes les identités, sans qu'il n'y ait de dépen-dance à l'endroit d'une puissance extra-continentale, les Etats-Unis, dont les stratégies diplomatiques et militaires ont toujours visé à deux choses:
- soit affaiblir notre continent en favorisant ses divisions internes;
- soit favoriser une intégration, de façon à faciliter la pénétration de nos marchés par les firmes et les ex-por-tateurs américains. De l'Allemagne de Weimar, li-vrée pieds et poings liés à la partitocratie des sous-capables, les circuits financiers américains disaient: It's a penetrated system, c'est un système "péné-tré". Cette qualité de "pénétré", eh bien, nous la re-fusons ici haut et fort.
En théorie, l'Europe intégrée est gérée par la Com-mission de Bruxelles. Mais en réalité, cet organe de dé-cision, qui devrait agir dans le sens de l'indépen-dance de notre continent, agit en fait pour favoriser et faciliter la "pénétration" de notre économie par les systèmes japonais et américains; la Commission se positionne ainsi comme un facteur de liquéfaction de notre tissu industriel, exactement comme HIV liqué-fie les stratégies du corps contre l'intrusion des virus de toutes sortes.
Par le fait que la Commission ne joue pas son rôle d'instance décisionnaire, les adversaires du Grand Es-pace européen obtiennent pleine satisfaction: celle d'avoir en face d'eux un processus d'intégration non dangereux, qui ne bénéficie qu'aux seules multina-tio-nales "pénétrantes", et d'avoir affaire à un organe soi-disant décisionnaire qui ne prend pas de vérita-bles décisions et qui se soumet aux parlements na-tionaux, dont l'horizon n'est pas européen mais é-troi-tement électoraliste, local, concussionnaire.
On en arrive au paradoxe suivant: les Européens sin-cères —et nous, nous voulons être de ceux-là— sont obligés de constater que l'Europe se défait par l'action délétère des institutions qui sont censées la ren-dre forte et que les seuls espaces de résistance aux pénétrations américaines et japonaises sont par-fois certains politiciens régionaux ou nationaux, qui ne sont pas encore trop gâtés par les turpitudes par-lementaires!
L'Europe des forces identitaires, que nous appelons de nos vœux, doit dès lors se donner pour mission de réduire cette logique perverse en miettes. Dans cette Europe-là, qui est nôtre, la Commission doit pou-voir décider et fortifier notre indépendance; elle doit suivre la logique impériale de l'auto-centrage,
- en refusant l'éparpillement tous azimuts des capi-taux;
- en favorisant les fusions économiques intra-euro-péennes et les investissements dans la modernisation de nos outils industriels;
- en dérivant les plus-values globales dans les cir-cuits de sécurité sociale et de politique familiale nataliste.
La Commission, dans son état actuel, a accru dange-reusement cette tare affligeante qu'est le nanisme po-li-tique volontaire; en suivant cette voie, elle a mené nos peuples dans une impasse: en effet, nos peuples sont des peuples de travailleurs, de créateurs, de pro-ducteurs et ont su faire de nos pays des géants éco-nomiques. Un géant économique ne peut jamais ê-tre un nain politique. Par conséquent, notre tâche est simple: c'est de combler rapidement le fossé qui sépare, d'un côté, la formidable et puissante réalité économique que nous représentons virtuellement dans le monde, et, d'un autre côté, notre marasme po-litique, notre indécision calamiteuse et notre éco-no-mie "pénétrée". D'ailleurs, soyons clairs et so-yons francs, une situation aussi paradoxale ne peut te-nir à long terme. A notre grandeur économique, doit correspondre une grandeur politique, garantie par une Commission décisionnaire qui obéit à d'au-tres logiques et d'autres principes que ceux de ce libéralisme qui véhicule la pénétration étrangère et dé-bilite notre corps politique.
Nous ne sommes donc pas hostiles à un chapeautage des gouvernements nationaux véreux, corrompus et anachroniques par une Commission qui serait ani-mée par la stratégie de l'auto-centrage et par l'idée de puissance. Par une Commission qui allierait l'idée d'Empire à celle du Zollverein (union douanière). Mais à la Commission libérale, molle, vassalisée et châ-trée par la valetaille partitocratique, nous préfé-re-rons toujours le gouvernement national dirigiste et so-cialiste, qui offrira un espace de résistance et sous-traiera ses administrés aux catastrophes provo-quées par le mondialisme des écervelés libéraux, com-me en Suède où le taux de chômage n'est que de 2,8%.
Evidemment, on pourrait nous poser une question em-barrassante: votre préférence —fort nuancée, nous en convenons— pour l'Etat national non mondialiste et non libéral ne vous aligne-t-elle pas d'em-blée sur les positions de Madame Thatcher qui vient de prononcer à Bruges un vibrant réquisitoire contre l'intégration européenne?
Notre réflexe identitaire est aux antipodes du réflexe insulaire de Madame Thatcher, tout comme notre va-lo-risation du rôle potentiel de la Commission est dia-métralement opposée au rôle réel qu'elle joue aujour-d'hui, dans une Europe qui se désindustrialise, se clo-chardise et se quart-mondise.
Margaret Thatcher a saboté l'autonomie alimentaire eu-ropéenne en torpillant la politique agricole com-mu-ne; par fétichisme idéologique, par son admiration fanatique pour les thèses fumeuses du néo-li-bé-ralisme, pour les grimoires de Hayek et de Milton Friedman, des anarcho-capitalistes et de la "Nou-vel-le Droite" américaine de la "majorité morale" (Moral Majority), par ses engouements idéologiques, Mar-ga-ret Thatcher a démantelé l'outil industriel britan-nique, déconstruit avec un acharnement déplorable les barrières protectionnistes existantes, tant en Grande-Bretagne qu'en Europe. Cette politique qu'elle veut imposer à la Commission, au détriment de bon nombre de secteurs industriels continentaux, français, belges, italiens ou allemands, favorise la concurrence américaine et japonaise et décourage les investissements auto-centrés; qui pis est, elle assas-sine le capital concret, ruine notre tissu industriel, déconsidère le fruit du Travail des producteurs au profit des magouilles des spéculateurs de tous poils; elle privilégie le capital vagabond et financier au dé-triment du capital créatif des machines et du capital humain des mains façonnantes de nos ouvriers et de la matière grise de nos chercheurs! Cette logique est une logique de l'artifice, de l'abstraction; elle est un défi aux forces de nos cerveaux, de nos mains, de notre sang!
En Ecosse, Madame Thatcher a confié des zones fran-ches à la firme Hitachi, abandonnant du même coup des lambeaux du sol et de la souveraineté britanniques à une instance privée étrangère. Dans ces zones franches, sacrifiées à l'anarchie capitaliste, son gouvernement promet de ne pas appliquer les lois de protection sociales: Hitachi pourra ainsi li-cencier des ouvriers écossais, embaucher de pauvres hères venus des quatre coins de la planète, ne devra payer aucune cotisation sociale, aucune indemnité de licenciement, aucune pension d'invalidité! Pour une Dame de Fer qui frappe du poing à Bruges, devant De-lors et Martens médusés, et réclame le droit à la souveraineté nationale, c'est un comble... Mais alors, au fait, qu'est-ce que la souveraineté nationale pour Madame Thatcher? Est-ce le droit de vendre des sujets britanniques comme esclaves à des né-griers japonais? Le droit de solder le territoire écos-sais à l'encan?
Chers camarades, en criant notre volonté politique, nous devons être vigilants et ne pas tomber dans les pièges du vocabulaire. Nous vivons en effet dans un monde orwellien, où chaque chose en est venue à si-gnifier son contraire:
- La Commission est, théoriquement, une instance dé-cisionnaire mais elle ne décide pas;
- Les Etats nationaux sont des anachronismes, après les charniers de Verdun, de la Somme, de Capo-ret-to, de Stalingrad ou de Poméranie, mais, ce sont parfois des leaders nationaux ou de vieux pays indé-pendants comme la Suisse ou la Suède qui créent et maintiennent de la souveraineté en notre continent;
Madame Thatcher hurle son nationalisme, mais ce na-tionalisme galvaude la souveraineté du pays et dé-pouille ses nationaux de tous droits, les mue en es-claves-numéros pour fabricants de gadgets japonais.
L'Europe des partisans de l'identité, notre Europe, sait au moins quelles sont les recettes de la souveraineté et de l'indépendance! Nous savons quelles doc-trines nous solliciterons: celles de List et de Schmol-ler, celles de Delaisi et de Perroux, celles de Zischka et de Messine. Nous savons quelles sont les grandes lignes qu'il faudra suivre pour bâtir un "grand espace protégé", pour assurer la liberté de tout un continent par un dirigisme économique sai-nement conçu!
Il est faux et trop facile de dire que nous n'avons pas de doctrine économique. Nous n'avons tout simple-ment pas eu les fonds nécessaires pour la diffuser, nous n'avons pas bénéficier de la complicité des mé-dias!
Et chez les autres, existe-t-il des doctrines écono-miques cohérentes? Que dire du RPR qui a fait cam-pagne pour un libéralisme reaganien, en même temps qu'il proclamait sa fidélité au gaullisme qui, lui, était pourtant dirigiste? Que dire de l'UDF qui se réclame de Keynes, sans vouloir se débarrasser du libre-échangisme libéral? Qui, avec Raymond Barre, se réclame de ce Keynes, lequel manifestait sa joie devant les réalisations économiques du IIIème Reich (j'oublie sans doute que Mr. Barre est un anti-facho officiel, comme mr. tout-le-monde...)? Que dire du PS qui se réclame de Schumpeter, pour qui les in-novations des inventeurs et des patrons sont les mo-teurs de l'économie et du progrès? Que dire donc de ce PS qui, malgré cet engouement pour Schumpeter, n'abandonne pas ses marottes égalitaristes? Que pen-ser ensuite des capitulations successives de la "IIème gauche", de la "IIIème gauche" et des sé-ductions du capitalisme libertaire, prôné par d'ex-PSU?
Face à l'incohérence et au désorientement, à l'échec patent et à l'enlisement tragi-comique des partis du système, nous sommes désormais en mesure de fai-re valoir notre droit à la parole et de propulser notre cohérence doctrinale sur la scène politique, de faire irruption dans le débat sans plus rougir de notre im-préparation. Je m'adresse surtout aux étudiants qui sont dans nos rangs: qu'ils se préparent pour ce que j'appelerais "la bataille de l'économie"; qu'ils étof-fent et fourbissent leurs argumentaires. Nos divers mouvements rénovateurs, qu'ils soient politiques ou métapolitiques, ont désormais l'impérieux devoir de se consacrer corps et âme aux doctrines écono-mi-ques, d'arraisonner enfin le social, même si cela im-plique le léger sacrifice d'être moins littéraires, voire moins nostalgiques.
Le modèle américain, reaganien, a fait faillite. Seul de-meure le modèle japonais. Le MITI nippon, c'est l'instance centrale qui régule (mot significatif!) l'é-conomie de l'Empire du Soleil Levant et c'est l'exem-ple que devrait suivre la Commission de Bru-xelles: les Japonais ont investi dans des machines-outils robotisées, en se passant allègrement d'im-mi-grés et en conservant ipso facto une homogénéité so-cio-culturelle. Ces deux options japonaises des an-nées cinquante portent aujourd'hui leurs fruits. Les "eurocrates" ont choisi la politique du chien crevé au fil de l'eau: ils n'ont pas investi à temps dans la ro-botisation et ils ont importé de la main-d'œuvre du Maghreb ou de la Turquie. Conséquence: nous a-vons un taux de chômage massif et nous ne sommes pas compétitifs.
Contrairement à ce qu'affirme une brochette de vilains petits cloportes, qui pissent leurs articulets mal torchés dans des revues soi-disant anti-fascistes, nous n'allons pas chercher nos modèles auprès des totalitarismes d'antan. Nous souhaitons plus simplement une synthèse efficace des stratégies suédoises ou japonaises et une application des théories véritablement socialistes que les sociaux-démocrates, pusillanimes et indécis, n'ont jamais osé s'approprier.
Mais il est temps de conclure:
Nous voulons des robots comme les Japonais, pas des esclaves immigrés;
Nous voulons des hommes et des peuples libres, pas des masses hallucinées par le déracinement;
Nous voulons le progrès technologique, pas l'avilis-sement des peuples nord-africains et sud-sahariens; parce que nous sommes de vrais humanistes —et non des humanistes de carnaval— parce que la di-gnité est un principe cardinal dans notre éthique, nous voulons des "potes" qui travaillent à reverdir le Sahara, nous voulons des "potes" qui travaillent dans les fermes modèles du désert de Libye; nous ne voulons pas des "potes" manipulés, devenus "schi-zo" dans de sordides HLM de banlieue;
Nous voulons le succès économique, pas le chôma-ge ni la désindustrialisation ni la quart-mondisation ou la tiers-mondisation de nos classes ouvrières;
Nous sommes des futuristes et des bâtisseurs, pas des collectionneurs de bric-à-brac.
Donc, il n'y a qu'un seul mot d'ordre qui tienne: au travail!



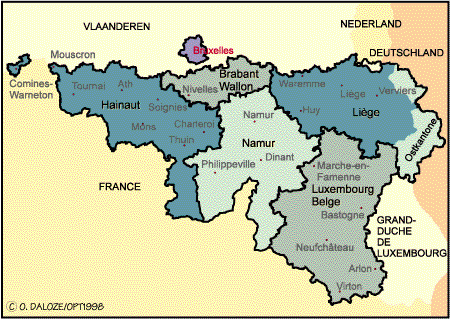

 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg


 Im agitatorischen Stil kommt der unter Herausgeberschaft von Hartmut Plaas’ 1928 erschienene Sammelband: „Wir klagen an! Nationalisten in den Kerkern der Bourgeoisie“ daher. Als einen der ersten Faksimiles druckte der Uwe-Berg-Verlag die Schrift in seiner Reihe „Quellentexte zur Konservativen Revolution“ unter der Kategorie „Die Nationalrevolutionäre“ ab. Was der Einband nicht verrät: der Herausgeber wurde 1944 im Zuge des Stauffenberg-Attentats hingerichtet.
Im agitatorischen Stil kommt der unter Herausgeberschaft von Hartmut Plaas’ 1928 erschienene Sammelband: „Wir klagen an! Nationalisten in den Kerkern der Bourgeoisie“ daher. Als einen der ersten Faksimiles druckte der Uwe-Berg-Verlag die Schrift in seiner Reihe „Quellentexte zur Konservativen Revolution“ unter der Kategorie „Die Nationalrevolutionäre“ ab. Was der Einband nicht verrät: der Herausgeber wurde 1944 im Zuge des Stauffenberg-Attentats hingerichtet. mit ihr! Ihr führet Krieg und heulet derweil um Frieden! Wir klagen euch an.“ Die Zeilen lesen sich oftmals als prägende Leidensgeschichten aus den Gefängnissen der Weimarer Republik. Aber auch eine gewisse Zynik spricht aus vielen Zeilen. So etwa hier bei Roderich Zoeller: „Und ich verließ nach sechsmonatigem Nachdenken hinter Gitterfenstern das Gefängnis natürlich als sittlich gebesserter Mensch.“
mit ihr! Ihr führet Krieg und heulet derweil um Frieden! Wir klagen euch an.“ Die Zeilen lesen sich oftmals als prägende Leidensgeschichten aus den Gefängnissen der Weimarer Republik. Aber auch eine gewisse Zynik spricht aus vielen Zeilen. So etwa hier bei Roderich Zoeller: „Und ich verließ nach sechsmonatigem Nachdenken hinter Gitterfenstern das Gefängnis natürlich als sittlich gebesserter Mensch.“





 DI F. WILLIAM ENGDAHL - Ex:
DI F. WILLIAM ENGDAHL - Ex:





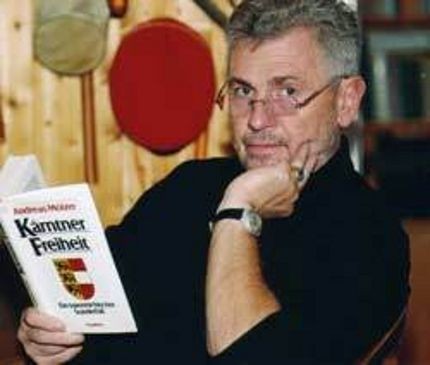
 Voici l'analyse des résultats des élections européennes que nous a adressé notre ami Coclés :
Voici l'analyse des résultats des élections européennes que nous a adressé notre ami Coclés :



 C’est Jean-Luc Mélenchon qui a le mieux commenté les résultats de cette élection européenne : les Français ne veulent pas de cette Europe-là. Cette Europe en question, c’est celle, technocratique, de Bruxelles ou de Strasbourg sur laquelle les Européens n’ont aucune prise. C’est une Europe du fric aux mains des lobbies, une Europe qui se gausse des peuples et de la personnalité de chacun d’entre eux. C’est une Europe sans conscience politique, sans vision géopolitique et sous influence. Les députés européens sont des guignols impuissants et les eurodéputés français largement débordés par les Anglais ou les Allemands, qui ont formé depuis longtemps le personnel ad hoc. La France ne s’impose à Bruxelles – et encore, voir la crise du lait – qu’en situation de rupture et quand le pouvoir politique s’en mêle pour régler en général un problème de politique intérieure. De ce point de vue, nous ne sommes pas les seuls à dénoncer cette Europe-là. Ce reproche est d’ailleurs général sur le continent.
C’est Jean-Luc Mélenchon qui a le mieux commenté les résultats de cette élection européenne : les Français ne veulent pas de cette Europe-là. Cette Europe en question, c’est celle, technocratique, de Bruxelles ou de Strasbourg sur laquelle les Européens n’ont aucune prise. C’est une Europe du fric aux mains des lobbies, une Europe qui se gausse des peuples et de la personnalité de chacun d’entre eux. C’est une Europe sans conscience politique, sans vision géopolitique et sous influence. Les députés européens sont des guignols impuissants et les eurodéputés français largement débordés par les Anglais ou les Allemands, qui ont formé depuis longtemps le personnel ad hoc. La France ne s’impose à Bruxelles – et encore, voir la crise du lait – qu’en situation de rupture et quand le pouvoir politique s’en mêle pour régler en général un problème de politique intérieure. De ce point de vue, nous ne sommes pas les seuls à dénoncer cette Europe-là. Ce reproche est d’ailleurs général sur le continent. Lo spettro dell’euroscetticismo si aggira per l’Europa. In realtà, è sempre così a ogni turno di elezioni Europee: un po’ perché, di voto in voto, l’assoluta mancanza di poteri del Parlamento Europeo si fa più manifesta, proprio in raffronto al modo in cui da quando c’è l’Euro l’Europa è diventata invece più importante nella vita dell’europeo della strada; un po’, perché proprio perché questa consultazione conta pochissimo può essere un modo eccellente per sfogare la propria voglia di protestare, senza esporre il proprio Paese a troppi rischi. Infatti, è tradizionale il fenomeno di quei partiti anti-Europa che prendono voti solo alle elezioni Europee: dal quel Movimento Popolare anti-Cee che nel 1979 e 1984 fu la lista più votata alle Europee danesi, anche se nel 2004 si era ridotta a un solo eletto; a quel Partito per l’Indipendenza del Regno Unito (Ukip) che apparso senza risultati nel 1994 ebbe tre eletti nel 1999 e addirittura 12 nel 2004, rivelandosi il terzo partito. Stando ai sondaggi l’Ukip dovrebbe crescere ancora: dal 16,1 al 19%, che potrebbe portarlo addirittura al secondo posto, davanti allo stesso partito di governo laburista. Il dato è tanto più significativo se si pensa che nel contempo è accreditato un 7% al Partito Nazionale Britannico (Bnp): un partito di destra dura, non solo anti-europea, che potrebbe valere un paio di seggi. Nel 2004 aveva ottenuto un 4,9, che per un’incollatura lo aveva lasciato sotto la soglia si sbarramento.
Lo spettro dell’euroscetticismo si aggira per l’Europa. In realtà, è sempre così a ogni turno di elezioni Europee: un po’ perché, di voto in voto, l’assoluta mancanza di poteri del Parlamento Europeo si fa più manifesta, proprio in raffronto al modo in cui da quando c’è l’Euro l’Europa è diventata invece più importante nella vita dell’europeo della strada; un po’, perché proprio perché questa consultazione conta pochissimo può essere un modo eccellente per sfogare la propria voglia di protestare, senza esporre il proprio Paese a troppi rischi. Infatti, è tradizionale il fenomeno di quei partiti anti-Europa che prendono voti solo alle elezioni Europee: dal quel Movimento Popolare anti-Cee che nel 1979 e 1984 fu la lista più votata alle Europee danesi, anche se nel 2004 si era ridotta a un solo eletto; a quel Partito per l’Indipendenza del Regno Unito (Ukip) che apparso senza risultati nel 1994 ebbe tre eletti nel 1999 e addirittura 12 nel 2004, rivelandosi il terzo partito. Stando ai sondaggi l’Ukip dovrebbe crescere ancora: dal 16,1 al 19%, che potrebbe portarlo addirittura al secondo posto, davanti allo stesso partito di governo laburista. Il dato è tanto più significativo se si pensa che nel contempo è accreditato un 7% al Partito Nazionale Britannico (Bnp): un partito di destra dura, non solo anti-europea, che potrebbe valere un paio di seggi. Nel 2004 aveva ottenuto un 4,9, che per un’incollatura lo aveva lasciato sotto la soglia si sbarramento.

