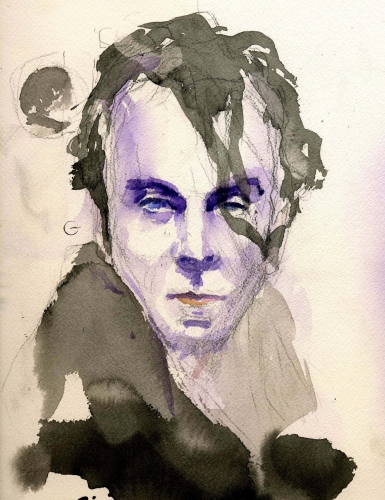
Parution du n°444 du Bulletin célinien
Sommaire :
 Céline à Rennes, en 1923
Céline à Rennes, en 1923
De Rosembly à Thibaudat
Chronologie 1944
L’Église vue par Thibaudat
Schopenhauer, la musique et Céline
Pierre-Marie Miroux nous écrit.
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

L'Europe s'éloigne de l'OTAN
Pascual Serrano
Ex: http://www.elespiadigital.com/index.php/noticias/defensa/35663-europa-se-aleja-de-la-otan
L'humiliation subie suite au retrait américain d'Afghanistan, sans compter sur les partenaires européens de l'OTAN, et suite à l'accord militaire AUKUS entre l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis, accord qui tourne le dos à l'Europe et suspend même les contrats d'armement avec la France, a ouvert un débat dans l'UE sur la nécessité d'une armée européenne propre, organisée en dehors de l'OTAN.
Le 22 août, le haut représentant de l'UE, Josep Borrell, a exprimé la nécessité pour l'Union européenne de disposer de sa propre force militaire indépendante. Le président français Emmanuel Macron est allé jusqu'à dire que l'OTAN était "en état de mort cérébrale" et Mme Merkel a parlé d'une perte de confiance avec les alliés, faisant clairement référence à Washington.
Toutes ces affirmations ont fait suite à la décision américaine de retirer ses troupes d'Afghanistan le 31 août et à la prise de Kaboul qui s'en est suivie, ainsi qu'au contrôle total du pays par les talibans, laissant les partenaires européens comme simples témoins de la fin d'une intervention dans laquelle ils ont été entraînés par les États-Unis et que ceux-ci laissent désormais sans aucun pouvoir de décision.
Annulation d'un contrat de 56 milliards de dollars
Puis vint l'AUKUS, un acronyme pour Australie, Royaume-Uni, États-Unis. Un accord militaire entre ces trois pays pour assurer la sécurité dans la zone indo-pacifique. Un accord porté secrètement devant les partenaires européens des États-Unis et qui, parmi de nombreuses autres conséquences, a conduit à l'annulation d'un contrat signé entre la France et l'Australie en 2016, d'un montant de 56 milliards d'euros, pour la construction française de huit sous-marins à propulsion nucléaire de dernière génération. Cela a provoqué l'ire du gouvernement français et le rappel de ses ambassadeurs à Washington et à Canberra pour des consultations.
Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a déclaré qu'il s'agissait d'un "coup de poignard dans le dos" et que Canberra avait trahi la confiance de Paris. Le Drian a ensuite comparé l'administration Biden à celle de Donald Trump, qui a tissé une relation exécrable avec les alliés européens de l'Amérique.
"Ce qui m'inquiète dans tout ça, c'est aussi le comportement des Américains. Cette décision unilatérale, brutale et imprévisible est très similaire à ce que faisait M. Trump. Ce n'est pas comme ça, entre alliés, qu'il faut faire", a déploré M. Le Drian.
Le diplomate en chef de l'UE, Josep Borrell, a tenu les mêmes propos. "Je regrette de ne pas avoir été informé, de ne pas avoir participé à ces discussions", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.
"Des missions où l'OTAN n'est pas présente mais où l'UE l'est"
L'onde de choc de l'humiliation des Européens en Afghanistan, où ils sont allés lorsque les États-Unis leur ont dit d'y aller et où ils sont également partis lorsqu'ils en ont reçu l'ordre, a atteint tous les pays et institutions européens. Dans un discours au Parlement européen, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré :
"Ce dont nous avons besoin, c'est de l'Union européenne de défense. L'Europe peut - et doit clairement - être capable et désireuse d'en faire plus pour elle-même". Mme von der Leyen, qui a été ministre de la défense dans son propre pays et qui a une connaissance approfondie des questions militaires et de leurs lacunes au niveau de l'UE, a annoncé qu'elle convoquerait un sommet sur la défense l'année prochaine.

C'est précisément l'année où la France assurera la présidence de l'UE. "Il y aura des missions où l'OTAN ou l'ONU ne seront pas présentes", a déclaré M. von der Leyen, "mais où l'UE devrait être présente".
L'une des premières questions concrètes de défense européenne à être discutée au lendemain du désastre afghan est l'idée, déjà ancienne, d'un bataillon européen de réaction rapide de 5000 hommes. M. Borrell a soulevé la question lors d'une réunion informelle des ministres de la défense de l'UE à Kranj (Slovénie), début septembre.
Selon le quotidien El País, "cette initiative, à laquelle pensaient les dirigeants de Bruxelles avant même que l'OTAN ne débarque en Afghanistan, a déjà été reprise ce printemps par 14 États membres, dont la France, l'Allemagne et l'Espagne".
"Même les atlantistes changent de position"
Selon le journal, la proposition a reçu un accueil inhabituellement réceptif de la part d'une majorité de pays lors du Conseil informel où M. Borrell l'a évoquée. "C'est incroyable. Personnellement, je ne l'ai jamais vu auparavant. Même les atlantistes sont en train de changer de position", a déclaré une source présente à la réunion au quotidien espagnol.
Même la ministre allemande de la défense, Annegret Kramp-Karrenbauer, a proposé d'explorer la possibilité qu'un éventuel déploiement soit décidé par l'UE, tandis que les troupes ne seraient fournies que par une coalition de volontaires. La possibilité de pouvoir activer la force rapide par une majorité qualifiée du Conseil, sans avoir besoin de l'unanimité, a même été discutée.
Groupements tactiques de l'UE
L'idée d'une sorte de petite armée propre a commencé à prendre forme en 1999 - lorsque la création d'une force de réaction rapide de 60.000 hommes a été discutée et soutenue par le ministre espagnol de la défense en 2000. L'UE dispose d'une force de réaction rapide depuis 2007, mais peu de gens la connaissent car elle n'a jamais été utilisée. Il s'agit des "groupements tactiques de l'UE", deux bataillons d'urgence d'environ 1500 soldats chacun, dont l'un est toujours actif pour répondre à toute crise ou menace.

Les bataillons sont multinationaux et effectuent une rotation tous les six mois. L'Espagne sera à la tête du contingent au second semestre 2022. Avec ces bataillons, l'UE peut effectuer deux déploiements de réaction rapide d'une durée minimale de 30 jours, pouvant être prolongée jusqu'à 120 jours grâce aux réserves et au réapprovisionnement.
La nouvelle force de réaction rapide serait en fait une nouvelle variante, "plus opérationnelle et prête à être activée", de ce qui existe déjà, selon les termes de M. Borrell. Depuis 2017, l'UE dispose d'un projet de coopération militaire accrue entre les États membres, la "coopération structurée permanente" (PESCO), qui n'a pas été suffisamment développé.
Treize pays européens ont déjà signé un accord militaire
Il ne s'agit pas de la seule initiative européenne de développement militaire en dehors de l'OTAN. Le 25 juin 2018, les ministres de la défense de neuf pays de la région ont signé à Luxembourg une lettre d'intention sur le développement de la nouvelle initiative européenne d'intervention (EII ou E2I). La ministre française des Armées, Florence Parly, a clairement indiqué que l'IIE serait un "processus rapide et opérationnel" permettant de réunir des forces de différents pays européens chaque fois que nécessaire.
Ces neuf pays sont désormais au nombre de treize, qui se sont engagés à accroître leur coopération militaire et leur indépendance vis-à-vis des États-Unis, comme l'a rapporté Euronews en septembre.
La ministre française de la Défense, Florence Parly, a expliqué à l'issue de la réunion : "La chute de Kaboul et le retrait mal préparé des troupes d'Afghanistan ont été un moment très difficile. Nous avons constaté un manque de coordination entre nous, entre les alliés de l'OTAN et les membres de l'UE également. Et je voudrais mentionner le partenariat AUKUS annoncé sans aucune consultation préalable le même jour que le lancement de la stratégie indo-pacifique de l'UE. Ces développements nous montrent quelque chose que nous savons déjà. L'Europe doit parler pour elle-même, l'Europe doit être capable d'agir pour elle-même - pour la sécurité de nos citoyens.
La "boussole stratégique" de l'UE est née
Les confrontations successives en matière de défense entre l'UE et Donald Trump ont déjà incité l'Allemagne à présenter à ses partenaires européens, en 2019, une proposition de réflexion stratégique en matière de défense, appelée la boussole stratégique. Ce que Reuters a décrit comme "le plus proche que le bloc européen puisse se rapprocher d'une doctrine militaire commune similaire au concept stratégique de l'OTAN, qui définit les objectifs de l'alliance, est la dernière étape en date dans l'accélération des efforts visant à approfondir leur coopération en matière de défense".
Il s'agit d'une proposition qui a été soumise aux conclusions du Conseil de sécurité et de défense du 17 juin 2020 et qui a été diffusée et analysée dans la publication espagnole Política Exterior, qui compte neuf anciens ministres des affaires étrangères dans son conseil consultatif. L'objectif est de présenter le document final de la "boussole stratégique" pour examen par le Conseil européen en 2022.
Plus d'autonomie militaire européenne d'ici 2024
Entre-temps, lors du sommet européen de février, ainsi qu'à Bruxelles en mai, l'UE a convenu de renforcer son autonomie en matière de défense. Dans les documents approuvés à l'unanimité par les 27, l'UE s'est engagée à mettre en œuvre son programme de défense jusqu'en 2024, à mener "une action plus stratégique" et à "accroître la capacité de l'UE à agir de manière autonome".
De même, comme le rapporte Europa Press, "l'importance de renforcer les initiatives militaires conjointes au sein de l'UE, telles que PESCO ou le Plan industriel européen de défense, qui génère des synergies entre les industries civiles, militaires et spatiales de l'Union, tout en assurant la cohérence dans l'utilisation des différents équipements de défense" a également été soulignée.
Un élément à garder à l'esprit est que l'UE n'a plus le poids du Royaume-Uni, le pays le plus réticent à évoluer vers un système de défense européen plus indépendant de l'OTAN et des États-Unis.
Le commerce des armes
Ce qui est indiscutable, c'est que derrière le discours sur la souveraineté en matière de défense se cache plus qu'autre chose un commerce d'armes et de guerre. Comme nous l'avons vu, le dernier accès de souverainisme de Macron est dû au fait qu'il a été évincé de la vente d'armes qu'il comptait faire à l'Australie ; et derrière un éloignement militaire entre l'UE et les États-Unis, les intérêts des entreprises militaires des deux côtés de l'Atlantique pèseront davantage. Selon qu'ils concluent qu'ils préfèrent s'entendre sur le partage du marché ou se battre séparément pour s'accaparer le marché.

Dans l'Union européenne, l'organe politique le plus étroitement lié à la défense est l'Agence européenne de défense (AED), créée en 2004, qui "aide ses 26 États membres (tous les pays de l'UE sauf le Danemark) à développer leurs ressources militaires". Pour les organisations de paix, cette agence est utilisée comme un lobby par l'industrie de l'armement, comme dans de nombreux autres domaines, les dépenses impopulaires des pays sont présentées comme un impératif de l'Union et les gouvernements évitent le coût politique pour le public.
D'autre part, il y a quelques mois, le Parlement européen a approuvé 7953 millions d'euros pour le Fonds européen de défense pour la période 2021-2027.
En d'autres termes, en plus d'être un important vendeur d'armes, l'UE est également un important client. Ainsi, la véritable guerre ne consiste pas à tirer des armes, mais à les vendre et à les acheter.
Enquêtes européennes sur une armée nationale
Un autre élément à prendre en compte est l'opinion des Européens sur le fait d'avoir leur propre armée en dehors de l'OTAN. L'enquête européenne Eurobaromètre de 2017 a montré qu'une majorité d'Européens (55 %) étaient d'accord avec la création d'une armée européenne.
En France, un sondage réalisé par le magazine Le Point en 2019 a révélé un soutien de 81 %. En Espagne, un sondage réalisé par la société Sociométrica pour le journal El Español a montré que jusqu'à 71,3 % des Espagnols seraient favorables à la création d'une armée européenne dans laquelle les militaires seraient intégrés à leurs forces armées. De même, un sondage en ligne réalisé par le journal 20minutos indique que 88,35 % de ses lecteurs sont favorables à une telle armée européenne.
L'OTAN n'est certainement pas la plus populaire, non seulement elle n'a pas résolu la paix dans les endroits où elle est intervenue, comme l'Afghanistan, l'Irak, la Syrie et la Libye, mais elle crée également des conflits dans les zones de paix. L'expulsion, le 6 octobre, de huit diplomates de la représentation russe auprès de l'OTAN a incité le ministère russe des Affaires étrangères à annoncer la fermeture de sa représentation auprès de l'Alliance atlantique à Bruxelles et le retrait des visas pour le personnel de la mission de l'OTAN à Moscou.
Ce que dit le traité de l'UE
Mais une armée est-elle viable en vertu du droit européen ? L'article 42 du traité sur l'Union européenne fait référence à la défense dans les termes suivants : " La politique de sécurité et de défense commune fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune. Il fournit à l'Union une capacité opérationnelle faisant appel à des moyens civils et militaires.
L'Union peut avoir recours à ces ressources lors de missions en dehors de l'Union pour le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale, conformément aux principes de la Charte des Nations unies. La mise en œuvre de ces tâches est soutenue par les capacités fournies par les États membres".
Toutefois, les décisions en matière de défense doivent être prises "à l'unanimité" au sein du Conseil européen, et les obligations découlant de l'appartenance de certains États à l'OTAN doivent être respectées.
28 sur 30 sont européens
La réalité est que sur les 30 pays qui composent une OTAN avec un leadership et une domination clairs des États-Unis, 28 se trouvent en Europe. Un départ de plus en plus prévisible des Européens serait un coup mortel pour une organisation qui ne compte que les États-Unis et le Canada en dehors du continent européen.
Il serait curieux que, comme le Pacte de Varsovie, qui a disparu parce que ses membres sont partis et non parce qu'il a été militairement vaincu par un ennemi extérieur, l'OTAN soit également dissoute parce que ses membres sont partis.
10:29 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Défense, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, union européenne, défense européenne, affaires européennes, politique internationale, otan, géopolitique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Paix de Westphalie
Alexander Dugin
https://www.geopolitica.ru/article/vestfalskiy-mir
Quiconque a étudié, même superficiellement, les relations internationales sait que l'ordre mondial dans lequel l'humanité vit encore sur la base des clauses de la paix de Westphalie. Cette expression est aujourd'hui courante, mais il convient de rappeler ce que fut cette paix, conclue le 24 octobre 1648.
Ce jour-là, un accord a été conclu à Münster et Osnabrück entre les principales puissances européennes pour mettre fin à la guerre de Trente Ans. Dans l'histoire européenne, la guerre de Trente Ans est considérée comme la limite entre l'ordre médiéval et le plein avènement de l'ère moderne. C'était la dernière guerre menée sous les bannières de la religion. Les pays catholiques se sont battus contre les pays protestants. La principale question qui se posait était la suivante: qui allait gagner - la Réforme ou la Contre-Réforme ?

Le modèle de politique et d'idéologie médiévale dans cette guerre était représenté par les puissances du Sud de l'Europe combattant sous la bannière du catholicisme et de l'Empire autrichien.
Les pays protestants - en particulier l'Angleterre et les États scandinaves, mais aussi les partisans de Luther dans d'autres régions d'Europe - s'opposent à la suprématie des papes et au pouvoir de l'empire. En raison de sa haine traditionnelle des Habsbourg, la France, officiellement catholique mais déjà profondément modernisée, se bat aux côtés des protestants.
La guerre a fait périr jusqu'à un tiers de la population européenne et certaines régions ont perdu plus de 70 % de leur population. Il s'agit d'une véritable guerre mondiale, car elle touche non seulement le territoire de la vieille Europe, mais aussi les colonies.
Les forces en présence étaient presque égales, et aucun des camps, malgré leurs énormes pertes, n'a réussi à obtenir un avantage décisif. La paix de Westphalie a assuré cet équilibre des forces en reconnaissant les droits des deux camps belligérants.

Bien que le sud catholique parvienne à se maintenir face à l'avancée protestante et que l'Empire des Habsbourg conserve sa position et son influence, bien que sous une forme réduite, c'est le nord protestant qui a le dessus. Les pays protestants ont insisté dès le début pour qu'il n'y ait pas d'autorité dans la politique européenne qui soit au-dessus de la souveraineté nationale - ni l'autorité de l'Église romaine ni celle de l'Empire autrichien.
C'est alors que le principe de l'État-nation, de l'État-nation et de la souveraineté nationale a enfin été reconnu par tous. Bien que le catholicisme et l'Empire aient subsisté, ils ne sont plus reconnus comme des entités supranationales, mais comme des États européens distincts au même titre que tous les autres. L'Empire est relégué au rang d'État européen, et le statut du pape est maintenu exclusivement dans la zone des pays catholiques, et uniquement en tant qu'autorité purement religieuse. En d'autres termes, bien que les protestants (et les Français qui les ont rejoints, qui ont été en grande partie les initiateurs) n'aient pas conquis définitivement leurs adversaires, ils ont réussi à imposer leur idée de la politique normative à l'Europe dans son ensemble.
C'est cet ordre que l'on appelle l'ordre westphalien : il est fondé sur le principe de la souveraineté nationale, au-dessus de laquelle aucune autorité ou pouvoir - religieux ou impérial - n'est reconnu. Désormais, les questions de religion, de structure politique et d'ordre social deviennent l'affaire de chaque État-nation et personne ne peut les influencer au nom d'une quelconque structure supranationale.


Dessins de Pierre Courcelle: le Comte 't Serclaes de Tilly, commandant des armées impériales et des troupes des Pays-Bas royaux; à l'arrière-plan, cuirassier des Bandes d'Ordonnance des Pays-Bas.
La paix de Westphalie coïncide avec la montée de la bourgeoisie, qui mène à l'époque des batailles acharnées contre l'ordre médiéval, où l'aristocratie sacerdotale et militaire dirige la société. La bourgeoisie européenne s'attaque au sacerdoce, représenté par les Papes, et à la caste de l'aristocratie militaire, représentée par l'Empire autrichien. Oui, ce n'est pas encore une démocratie bourgeoise à part entière, car tous les pays protestants restent des monarchies. Mais il s'agissait d'un nouveau type de monarchie - une sorte de monarchie bourgeoise.
Et bien que le catholicisme romain et les Habsbourg aient tenté de préserver l'ancien ordre européen sur leurs territoires, ils ont été contraints d'accepter les règles du jeu westphaliennes. Dans ces règles, c'est l'État-nation qui devient normatif, qui par son idéologie favorisait déjà la croissance de la bourgeoisie et la sortie du Moyen Âge. Non seulement dans les pays protestants, mais aussi dans les pays catholiques.
Il est révélateur qu'en Angleterre même, un an après la paix de Westphalie, le roi Charles Ier ait été exécuté suite à la guerre civile qui avait commencé encore plus tôt. La France, en revanche, suivra le même chemin conduisant au régicide et à la prise du pouvoir par les représentants de l'oligarchie bourgeoise au cours du XVIIIe siècle suivant. Les pays catholiques, en revanche, sont restés plus longtemps que les autres attachés aux anciennes méthodes, et la bourgeoisie n'y a finalement triomphé qu'au vingtième siècle.
Ainsi, la paix de Westphalie marque la victoire historique de la bourgeoisie laïque sur l'ordre impérial chrétien de succession. C'est aussi le moment où le nationalisme apparaît comme l'outil le plus important de la bourgeoisie européenne dans la bataille contre l'ordre médiéval sacré. La paix de Westphalie a donné naissance aux États-nations.
Plus tard, la bourgeoisie s'est alourdie de nationalisme et a parallèlement rejeté les États-nations - l'Union européenne moderne en est un exemple. Ainsi, progressivement, la paix de Westphalie a commencé à être démantelée par les forces mêmes qui l'avaient construite. Mais c'est la prochaine page de l'histoire des idéologies politiques et des relations internationales. Comparé au mondialisme contemporain, l'État-nation est encore loin, mais déjà à ses origines, il est quelque chose de douteux et d'anti-traditionnel, comme quelque chose de bourgeois. Tout aussi douteux et contenant des contradictions insolubles est le nationalisme, qui doit être dépassé.
Pas une nation, mais un empire. Pas le monde bourgeois westphalien, mais l'ordre sacré de la grande étendue.
10:51 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, traité de westphalie, paix de westphalie, ordre westphalien, europe, affaires européennes, alexandre douguine |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Irak: la victoire électorale de Sadr n'est que le début d'un grand voyage
Damir Nazarov
Source: https://www.geopolitica.ru/article/pobeda-sadra-na-vyborah-lish-nachalo-velikogo-puti
Lors des élections irakiennes qui viennent d'avoir lieu, les partisans de Muqtada Sadr ont remporté la victoire. Malgré un faible taux de participation, les sadristes l'ont emporté avec une solide marge sur les coalitions de l'État de droit et du Fatah (Alliance de la victoire).
Les opposants aux sadristes invoquent un grand nombre d'irrégularités, mais il n'en reste pas moins que Sadr est plus que populaire parmi les Irakiens. Il fallait s'y attendre et s'y préparer. Cependant, les principaux adversaires de Sadr au parlement, Maliki et Ameri, semblent avoir tout simplement sous-estimé l'influence de Muqtada. S'appuyant sur un taux de participation élevé combiné à un énorme mécontentement populaire à l'égard du premier ministre Kadhimi, la "branche politique de Hashad al-Shaabi" et le parti islamique DAWA ont en quelque sorte décidé que cela suffisait à les convaincre. Oui, le Fatah avait beaucoup de choses positives dans son programme politique, l'expulsion de l'occupation, la mise en œuvre d'accords avec la Chine, la défense légale de la Force de mobilisation populaire, la lutte contre la dictature du dollar, mais même cela n'était pas suffisant. Le décompte des voix a montré que le Fatah a perdu de manière significative par rapport à 2018.
Encore une fois, les élections qui ont eu lieu ne doivent pas être considérées comme une réalité 100% irakienne, car le taux de participation se situait entre 30 et 40 %. La dure réalité du pays ne doit pas être oubliée, le tandem de la dictature de Sistani et du système de quotas imposé par les Américains, parasite toujours le corps de l'Irak, ce qui signifie que les forces islamiques devront jouer selon les règles de l'Occident. Au moins à la surface de l'arène politique.
En supposant que nous ayons assisté à une sorte de jeu électoral, nous pouvons alors supposer que le même Fatah pourrait simplement "prétendre" son "effondrement" et en fait dégager la voie pour Muqtada Sadr, c'est l'opinion à laquelle je suis arrivé après un post de Salim al-Hasani (membre de DAWA) où il a souligné une sorte de collusion* entre Ameri et Sadr. Rappelez-vous également l'histoire avant l'élection lorsque Sadr a refusé de se rendre aux urnes. Mais il s'est passé quelque chose et les sadristes ont fini par remporter une victoire écrasante (même s'il y a eu un accord entre les poids lourds des blocs chiites, il n'avait pour but que d'embrouiller les Américains).
 Malgré les plaintes incessantes de l'aile politique de la Mobilisation populaire concernant l'équité des élections, la première chose que Sadr a faite après sa victoire a été de prendre contact avec Hadi al-Ameri pour convenir d'un candidat au poste de premier ministre du pays. Le leader sadriste a ainsi montré son ouverture au dialogue et sa reconnaissance du Fatah et de ses alliés (en particulier le parti DAWA) comme les principaux partis politiques du pays, aux côtés du vainqueur de l'élection. A l'attention des membres de l'opposition radicale de l'Alliance de la Victoire, le chef sadriste a publié une déclaration appelant à la "retenue" et au respect de la paix civile dans le pays.
Malgré les plaintes incessantes de l'aile politique de la Mobilisation populaire concernant l'équité des élections, la première chose que Sadr a faite après sa victoire a été de prendre contact avec Hadi al-Ameri pour convenir d'un candidat au poste de premier ministre du pays. Le leader sadriste a ainsi montré son ouverture au dialogue et sa reconnaissance du Fatah et de ses alliés (en particulier le parti DAWA) comme les principaux partis politiques du pays, aux côtés du vainqueur de l'élection. A l'attention des membres de l'opposition radicale de l'Alliance de la Victoire, le chef sadriste a publié une déclaration appelant à la "retenue" et au respect de la paix civile dans le pays.
Pourquoi l'ultra-populaire Sadr a-t-il gagné maintenant? Je pose une telle question étant donné la certitude de fraude dans les élections qui ont eu lieu et en gardant à l'esprit les tactiques de la République islamique voisine.
1 - Sadr devra imposer une lutte idéologique aux partisans de Sistani, les deux étant des exemples pour le public nationaliste irakien, mais en même temps des adversaires idéologiques majeurs. Muqtada est un partisan des énormes changements dans le système islamique de la théologie "traditionnelle" de Najaf, Sistani un ardent rempart de l'ahbarisme moderne. La tâche de Sadr est d'affaiblir l'électorat de Marjah et le cercle des "maîtres" de Najaf en général.
2 - Le retrait des représentants du Hashad al-Shaabi de l'opposition atténuera l'impasse qui se dessine entre les régimes du Golfe (encadrés par Washington) et la République islamique. Maintenant, les régimes du Golfe vont refroidir légèrement leurs ardeurs, pour une telle manœuvre (pour convaincre les régimes du Golfe de leur nationalisme et de leur distance par rapport à l'Iran) Sadr a même pris l'avion pour rendre visite aux Saoudiens en 2017. Le cheikh Khazali a mis en garde contre l'ingérence des Émirats arabes unis dans les élections irakiennes il y a six mois. L'objectif des Émirats était de manipuler et ils ont obtenu ce qu'ils voulaient (le Fatah a "perdu" des voix). La question est de savoir en faveur de qui Abu Dhabi a faussé les résultats. Comme le soulignent à juste titre les journaux iraniens associés aux "conservateurs", "les partis chiites ont à nouveau gagné lors des dernières élections, ce qui constitue une grande victoire pour l'Irak".
3 - le démocratisme non alternatif. La plupart des personnalités politiques irakiennes n'offrant pas, à ce stade, d'alternative au système de quotas en vigueur, les règles imposées par l'Occident d'une république parlementaire imposent un jeu de démocratie électorale. Et dans ces conditions, il y aura presque toujours un rapport de force entre les opposants, la création de blocs politiques temporaires et le changement obligatoire de gouvernement. Les Irakiens continuent de jouer le jeu de la démocratie, mais cela tient davantage à une cause interne qu'à la domination occidentale. Cette affirmation sur le fait de "jouer le pouvoir du peuple" est facile à prouver, puisque la "démocratie" n'empêche pas chaque force influente en Irak d'avoir son "État dans l'État" (RASD, Résistance islamique, Sadriddistes, Nadjaf, BAAS, mafia du pétrole, tribalisme).
En règle générale, le populisme est une solution temporaire pour gérer une société en crise, la rhétorique nationaliste permettant d'ouvrir un couloir pour la domination politique. L'Irak a été témoin du schéma susmentionné. L'actuel Sadr est l'incarnation du nationalisme modéré, dans le bon sens du terme. Il est juste de souligner que jusqu'à présent, seul (*1) Muqtada Sadr, de toutes les grandes figures chiites, offre un projet plus réaliste de réforme de l'ordre politique du pays.
Brève conclusion
Sadr joue un rôle et le fait avec succès, l'objectif principal de Muqtada n'est pas le parlement, il sait que le système des quotas ne lui permettra pas de mettre en œuvre toutes les réformes. Le fils du légendaire révolutionnaire a une tâche plus importante à accomplir : le contrôle total de Najaf. Ce n'est pas pour rien que Muqtada a souligné ses origines et la continuation de la politique de la noble famille Sadr. Ainsi, le chef sadriste s'est distancé des "processus politiques désordonnés" en gardant à l'esprit le domaine de la théologie. A mon avis, nous assistons à une sorte de "ruse", Muqtada contrôlera le parlement sans se présenter à un poste particulier, ce qui lui permettra de conserver son statut de "pur clerc" non entaché de jeux politiques. Ce statut permettra à Muqtada de défier la "vieille garde" de Najaf à l'avenir.
C'est lorsque Sadr aura réussi à réaliser le rêve de son père et de son oncle de réformer l'une des principales institutions chiites de l'Oumma que l'Irak et l'ensemble du monde islamique pourront s'attendre à un changement révolutionnaire.
Notes:
* - après un certain temps, certains membres des sadriddistes ont déclaré qu'il n'y aurait pas de consensus sur la question.
*1 - il existe de petits partis islamiques, tels que le Parti de la vertu, le Harakat Hizbullah et le tout nouveau Mouvement pour la droite. Chacun a ses propres projets, mais en raison de leur faible popularité, de la barrière de la dictature de Najaf et du système de gouvernement pro-occidental du pays, ces partis ne sont pas en mesure de réaliser leurs idées.
10:30 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, irak, élections irakiennes, muqrada sadr, politique internationale, monde arabe, monde arabo-musulman |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
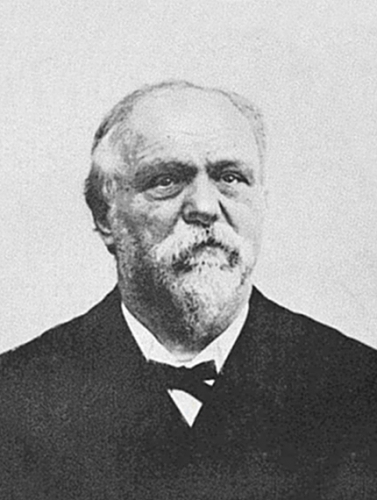
Georges Sorel, notre maître. Le livre de Pierre Andreu
par Gennaro Malgieri
Ex: https://www.destra.it/home/georges-sorel-il-nostro-maestro-il-libro-di-pierre-andreu/
Pierre Andreu est l'une des grandes figures oubliées de la culture politique du vingtième siècle. On lui doit pourtant d'importantes études sur Max Jacob, Drieu La Rochelle et surtout Georges Sorel. Ce manque de mémoire est dû aux préjugés dont il a fait l'objet, animés principalement par les intellectuels de la gauche française de l'après-guerre qui ne lui pardonnaient pas son amitié avec le philosophe catholique Emmanuel Mounier et l'ancien ministre de Vichy Paul Marion. Mais c'est surtout sa "révision" de la pensée de Sorel, qu'il appelait "Notre maître" dans l'essai que nous recensons ici, qui a alimenté le ressentiment de la gauche à son égard.
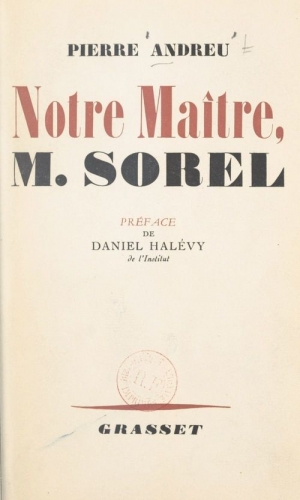
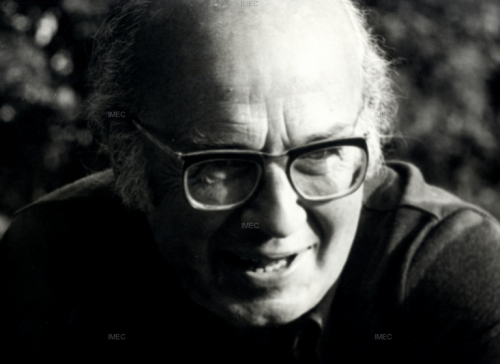
Sorel était sans aucun doute un grand maître à penser : en témoigne le travail qu'il a mené avec passion pour démonter la théorie marxiste, fournissant ainsi au syndicalisme révolutionnaire naissant les armes pour s'opposer à l'exploitation du prolétariat dans le cadre plus large de la crise de civilisation dans laquelle il était inévitablement impliqué, comme la bourgeoisie d'ailleurs. Des classes sociales victimes du progrès, responsables de la décadence morale et sociale que Sorel a dénoncée dans un ouvrage aussi mince qu'efficace et passionnant : Les Illusions du progrès.
Journaliste, essayiste, biographe et poète, Pierre Andreu est né le 12 juillet 1909 à Carcassonne, dans le département de l'Aude en Occitanie. En tant qu'étudiant, il est fasciné par les œuvres de Charles Péguy, Pierre-Joseph Proudhon et Georges Sorel, avec lesquels il se lie d'amitié, malgré l'énorme différence d'âge. Et ce n'est pas par hasard, mais par véritable gratitude, que ce livre, dédié à son ami et maître, s'ouvre sur ces mots: "J'ai rencontré Sorel dans l'atelier de Péguy. À cinquante ans, avec sa barbe blanche, il avait l'air d'un vieillard dans cet endroit qui mesurait à peine douze mètres carrés et où personne ne touchait aux trente ans". Une intense entente s'établit entre le vieil homme et le jeune homme, qui se traduira par les livres que l'élève consacrera des années plus tard au penseur, ainsi que par les choix intellectuels et politiques ultérieurs qui le conduiront, de manière apparemment contradictoire, près de Mounier et de sa revue catholique Esprit et de l'anarcho-fasciste Drieu La Rochelle. À la fin des années 1930, Andreu se définit comme un fasciste. Et malgré ce choix difficile, il reste proche de Max Jacob, dont il admire la poésie et la peinture, ainsi que la rectitude morale: anti-nazi, il est mort dans un camp.
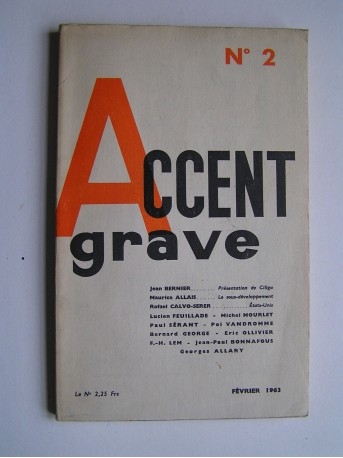
Andreu connaît un meilleur sort à la fin de la guerre: il est fait prisonnier et, après avoir purgé sa peine, il met en place de nombreuses activités culturelles et éditoriales, dont l'Accent grave (revue de l'Occident), lancé en 1963 avec Paul Sérant, Michel Déon, Roland Laudenbach et Philippe Héduy, quelques-uns des meilleurs représentants de la pensée conservatrice française de l'époque. Le magazine s'inspire des idées de Charles Maurras et se concentre sur la crise de la civilisation occidentale. Andreu est ensuite directeur du bureau de l'ORTF à Beyrouth de 1966 à 1970, où il entre en contact avec des intellectuels arabes et palestiniens et devient ensuite directeur de la chaîne de radio France Culture.
En 1982, il a reçu le prix de l'essai de l'Académie française pour son ouvrage Vie et mort de Max Jacob. Dans les dernières années de sa vie, Andreu a soutenu François Mitterrand, sans oublier son ancien maître, au point de reprendre la rédaction des Cahiers Georges Sorel.
Pierre Andreu est mort le 25 mars 1987 à l'âge de 77 ans, écologiste et pacifiste, témoignant jusqu'au bout de son étonnante irrégularité intellectuelle malgré la cohérence d'une pensée inspirée par la lutte contre la décadence.
Parmi ses ouvrages les plus importants, citons Drieu, témoin et visionnaire, préfacé par Daniel Halévy ; Histoire des prêtres ouvriers ; l'essai sur Max Jacob déjà cité ; Les Réfugiés arabes de Palestine ; Le Rouge et le Blanc : 1928-1944 (mémoires) ; avec Frédéric Grover (1979), Drieu La Rochelle ; Georges Sorel entre le noir et le rouge ; Poèmes ; Révoltes de l'esprit : les revues des années 30.
Sorel, notre maître, est déterminant dans l'interprétation des idées de l'idéologue français. Il est si décisif qu'Andreu en fait une sorte de "prophète" du déclin en reconstruisant sa critique profonde des conséquences des Lumières, des résultats de la Révolution française et donc du produit plus mûr des deux événements, intellectuel et politique, qui ont changé l'histoire de la pensée européenne : le marxisme. C'est entre 1897 et 1898 que Sorel prend conscience de l'inanité du socialisme marxiste pour changer le destin des classes populaires et forger en même temps une nouvelle société.
Lorsque la crise du parti socialiste éclate, grâce aux critiques impitoyables de Bernstein et Lagardelle, Sorel se range sans hésiter du côté des réformateurs et attaque le marxisme en affirmant qu'il n'est "pas une religion révélée". Andreu ajoute qu'à la même époque, le Maître a fait la grande découverte de sa vie : le syndicalisme dans lequel il voyait l'avenir du socialisme. Le syndicalisme consiste, essentiellement, en une action autonome des travailleurs. Ainsi, ce ne sont plus les partis, les associations affiliées aux cliques politiques, le parlementarisme comme élément d'acquisition de pouvoirs indus qui auraient pu faire bouger un monde embaumé par la Grande Révolution. Rien de tout ça. Ce sont les travailleurs qui doivent, peut-être violemment, prendre possession de leur destin, qui coïncide avec celui de la nation.
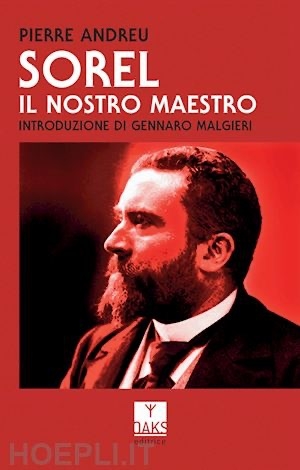
Sorel, tout en restant paradoxalement marxiste, estime, écrit Andreu, que la remise en cause du marxisme exigée par les révisionnistes au début du XXe siècle pour sauver tout ce que le marxisme avait apporté en philosophie et en recherche économique, a été réalisée par les syndicalistes révolutionnaires dans la pratique de l'action ouvrière.
C'est à Benedetto Croce que nous devons l'introduction de la pensée et de l'œuvre de Sorel en Italie. Bien qu'éloigné de l'idéologue français en termes de théorie et de pratique politique, le philosophe italien a saisi sa "proximité" tant au niveau de sa critique du marxisme que de sa rectitude morale illustrée par une vie concentrée sur l'étude et la compréhension de la modernité - nous dirions aujourd'hui - sans se laisser emporter par les modes et les utopies en vogue à l'époque. C'est ainsi que l'œuvre majeure de Sorel, Réflexions sur la violence (1906), a pu paraître en Italie grâce à Croce et influencer de manière décisive les intolérants au marxisme scolastique, à commencer par les syndicalistes révolutionnaires dont elle est devenue le "mythe" absolu, tandis que Lénine et Mussolini s'abreuvaient également à sa doctrine.
Sorel a reconnu que si pour Marx le socialisme était "une philosophie de l'histoire des institutions contemporaines", il lui apparaissait comme "une philosophie morale" et "une métaphysique des mœurs", mais aussi "une œuvre grave, redoutable, héroïque, le plus haut idéal moral que l'homme ait jamais conçu, une cause qui s'identifie à la régénération du monde". Les socialistes n'auraient donc pas à formuler des théories, à construire des utopies plus ou moins séduisantes, puisque "leur seule fonction consiste à s'occuper du prolétariat pour lui expliquer la grandeur de l'action révolutionnaire qui lui est due".
"Le socialisme est devenu une préparation pour les masses employées dans la grande industrie, qui veulent supprimer l'État et la propriété; on ne cherche plus comment les hommes s'adapteront au bonheur nouveau et futur: tout se réduit à l'école révolutionnaire du prolétariat, tempérée par ses expériences douloureuses et caustiques". Le marxisme n'est donc pour Marx qu'une "philosophie des armes", tandis que son destin "tend de plus en plus à prendre la forme d'une théorie du syndicalisme révolutionnaire - ou plutôt d'une philosophie de l'histoire moderne dans la mesure où celle-ci est fascinée par le syndicalisme. Il ressort de ces données indiscutables que, pour raisonner sérieusement sur le socialisme, il faut d'abord se préoccuper de définir l'action qui relève de la violence dans les rapports sociaux actuels".
Ici: c'est la suggestion d'un théoricien de l'histoire moderne qui rapproche Croce de Sorel, à qui il reconnaît qu'"à cause du flou de la pensée de Marx sur l'organisation du prolétariat, les idées de gouvernement et d'opportunité se sont glissées dans le marxisme, et ces dernières années, une véritable trahison de l'esprit lui-même a eu lieu, remplaçant ses principes authentiques par "un mélange d'idées lassalliennes et d'appétits démocratiques...". Les conseils de Sorel aux travailleurs sont résumés en trois chapitres, à savoir: en ce qui concerne la démocratie, ne pas courir après l'acquisition de nombreux sièges législatifs, qui peuvent être obtenus en faisant cause commune avec les mécontents de toutes sortes; ne jamais se présenter comme le parti des pauvres, mais comme celui des travailleurs; ne pas mélanger le prolétariat ouvrier avec les employés des administrations publiques, et ne pas viser à étendre la propriété de l'État; - en ce qui concerne le capitalisme, rejeter toute mesure qui semble favorable aux travailleurs, si elle conduit à un affaiblissement de l'activité sociale; en ce qui concerne le conciliarisme et la philanthropie, rejeter toute institution qui tend à réduire la lutte des classes à une rivalité d'intérêts matériels; rejeter la participation des délégués ouvriers aux institutions créées par l'Etat et la bourgeoisie; s'enfermer dans les syndicats, ou plutôt dans les Chambres de Travail, et rassembler autour d'eux toute la vie ouvrière".
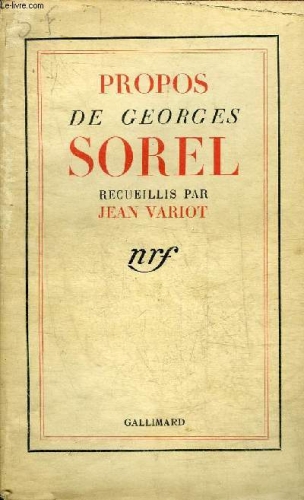
La morale révolutionnaire - qui allait au-delà du marxisme - était toute là, comme le résume Croce dans Conversations critiques. Sorel a nourri et manifesté de grandes ambitions qu'il aurait transfusées dans son enseignement doctrinaire : combattre l'indifférence en matière de morale et de droit, lutter contre l'utilitarisme, initier le peuple à la vie héroïque. Nous serions heureux, écrit-il en 1907 dans les Procés de Socrate, si nous pouvions parvenir à allumer dans quelques âmes le feu sacré des études philosophiques et à convaincre certains des dangers que court notre civilisation par l'indifférence en matière de morale et de droit.
En bref, seul un mouvement ouvrier héroïque et pur, selon Sorel, pourrait empêcher le monde de glisser vers la décadence, comme l'a observé Andreu, "en bannissant toute influence démocratique et bourgeoise (parlementaires, fonctionnaires, avocats, journalistes, riches bienveillants), en rejetant toute idée de compromis avec les patrons et en assurant une autonomie d'action complète".
Sorel était devenu un conservateur. Le spectacle français et européen l'a déprimé. Il ne voyait plus personne. Il y avait peu d'amis avec qui il échangeait des lettres et à qui il confiait son amertume. Les nouveaux révolutionnaires n'étaient pas dignes de sa leçon, même si, du moins en Italie, ils continuaient à le vénérer. Il a écrit à quelques personnes: Benedetto Croce et Mario Missiroli qui a accompagné "le dernier Sorel" vers la fin. Missiroli (photo, ci-dessous) avait l'habitude de publier ses articles dans le Resto del Carlino (il les a ensuite réunis en deux volumes: L'Europa sotto la tormenta et Da Proudhon a Lenin). Seul, malade et pauvre, il meurt le 27 août 1922. Sa chambre funéraire, raconte Daniel Halévy, était nue, le cercueil recouvert d'un tissu noir, sans croix, reposant sur un simple trépied, personne ne veillait sur lui, une flamme s'éteignait lentement.

L'homme qui avait mis le feu à l'Europe n'avait même pas les condoléances de ceux qui lui devaient tout. Et il a laissé derrière lui l'une de ses œuvres les plus impressionnantes, des Réflexions sur la violence aux Illusions du progrès et aux Ruines du monde antique : un héritage dans lequel nous ne cesserons jamais de puiser à la recherche des raisons de la décadence d'un monde et des déceptions de révolutions qui ont produit des monstruosités infinies.
Pierre Andreu, Sorel il nostro maestro, éditions Oaks, 2021, pp. 295, € 25,00.
10:17 Publié dans Livre, Livre, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, pierre andreu, georges sorel, philosophie, philosophie politique, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

La revue de presse de CD
24 octobre 2021
ARMÉNIE/AZERBAÏDJAN
Karabagh, un an après la guerre quelle situation ? Entretien avec Rahman Mustafayef, ambassadeur d’Azerbaïdjan en France. Entretien avec Hasmik Tolmajian, ambassadrice d’Arménie en France.
Un an après la fin de la guerre au Karabagh, Conflits revient vers cette région pour analyser la situation présente. Guerre militaire de haute intensité, qui a mobilisé les pays de la région, c’est aussi un conflit symbolique à forte charge émotionnelle pour les deux parties, Arménie et Azerbaïdjan. Conflits a donc interrogé les deux parties prenantes, afin de présenter à ses lecteurs les deux visions politiques portées par les belligérants
Conflits
https://www.revueconflits.com/hasmik-tolmajian-ambassade-...
https://www.revueconflits.com/haut-karabagh-un-an-apres-l...
GAFAM
Linkedin, un réseau professionnel nocif
On évoque souvent les GAFAM (google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) et leurs capacités de nuisance tant au niveau psychologique que sociétale… Pourtant parmi ces « réseaux » il en est un qui est beaucoup moins cité, et pourtant il a une capacité d’influence notoire. Il s’agit du réseau LinkedIn (rappelons ici que le groupe a été racheté par Microsoft en 2016), réseau réservé « aux professionnels », un réseau de travail qui compte près de 775 millions de membres à travers le monde est plus de 10 millions d’inscrits en France.
Breizh-info
https://www.breizh-info.com/2021/10/22/172929/gafa-linked...
Facebook et l’Alliance de la presse d’information générale trouvent un accord sur le droit voisin
C’est signé ! Un accord a été conclu le 21 octobre entre Facebook et l’Alliance de la presse d’information générale, représentant 284 éditeurs français, pour l’application du droit voisin. Cette loi permet aux éditeurs et agences d’être rémunérés lorsque leurs contenus sont diffusés sur les plateformes numériques.
Siècle digital
https://siecledigital.fr/2021/10/21/facebook-et-lalliance...
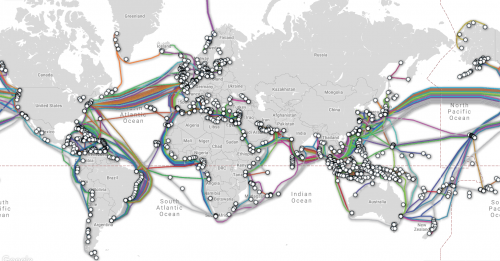
Internet ne tient qu'à 420 câbles : l'Europe est-elle prête à les protéger ?
Oubliez les constellations de satellites, les centaines de lancements de SpaceX et les notions de «cloud» ou de sans-fil: tout cela tend à nous faire croire que nos smartphones, ordinateurs et autres machines sont liés les uns aux autres via l'espace. Or il n'en est rien. Les satellites représentent à peine 1% des échanges de données.
Slate
http://www.slate.fr/story/217824/cables-sous-marins-inter...
LECTURE
Nouvelles complètes, I – 1947-1953 et II – 1954-1981, de Philip K. Dick. Coffret de de tomes de 1275 et 1176 pages. Quarto Gallimard.55 €.
Présentation : « Rédigées à partir de 1947, parfois à un rythme frénétique, les nouvelles jouent un rôle essentiel dans la construction dickienne : Véritable laboratoire d’idées, de formats, réservoir de personnages et de néologismes, elles constituent à la fois les soubassements et la pierre angulaire d’une œuvre foisonnante (120 nouvelles et 45 romans) ». (Extrait de la 4e de couverture). On y trouve d’innombrables prémonitions foudroyantes sur notre monde d’aujourd’hui ; beaucoup d’humour, du pessimisme, des « territoires occupés », des dupliquants, des dictatures sanitaires, de la pensée unique, des désinformations médiatiques, des monde « woke »… Bref, une quintessence de science-fiction qui n’est qu’une réalité actuelle. Beaucoup d’annexes, une biographie détaillée et un remarquable travail éditorial.
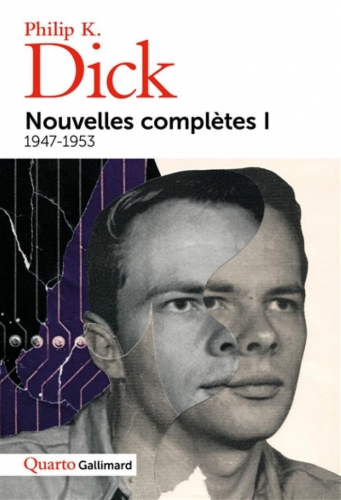
Auteur : L’auteur américain de chefs-d’œuvre tels que Ubik, Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? (mis en scène par Ridley Scott sous le titre Blade Runner) (et de Le Maître du Haut Château notamment est l’un des plus grands écrivains de science-fiction (1928-1982). Sa fragilité psychologique, le souvenir traumatique de la mort de sa sœur jumelle, Jane, après cinq semaines de vie (voir la photo bouleversante de leur tombe commune page 124 du tome I) lui ont permis de voir la face sombre de notre civilisation et de composer une œuvre toujours plus actuelle. A noter que ces nouvelles ont paru au fur et à mesure dans des magazines populaires tirés à plus d’un million d’exemplaire alors qu’aujourd’hui Philip K. Dick est considéré comme un auteur pour public averti !
Extraits (tous sont le début d’une nouvelle) :
« L’homme sortit sur le perron et examina le temps qu’il faisait. Clair et froid – de la rosée sur le gazon. Il boutonna son manteau et enfonça ses mains dans ses poches. Tandis qu’il commençait à descendre les marches du perron, les deux chenilles qui attendaient auprès de la boîte aux lettres frémirent de curiosité.
« Le voilà qui part, dit la première. Va faire ton rapport. »
Comme l’autre commençait à agiter ses pattes, l’homme s’arrêta et se retourna rapidement. « Je vous ai entendues », dit-il.
Il fit tomber les chenilles du mur en grattant celui-ci du pied, les poussa sur le ciment et les écrasa. »
« Malgré l’heure tardive, les lumières continuaient à briller dans le grand immeuble communautaire Abraham Lincoln, car c’était le soir de la Toussaint : conformément aux statuts, les six cents résidents devaient être présents dans la salle commune souterraine. Ils y entraient un par un, sans perdre de temps, hommes, femmes et enfants ; à la porte, manipulant le nouveau lecteur d’identité – un appareil plutôt onéreux -, Bruce Corley s’assurait qu’aucun individu en provenance d’un autre immeuble communautaire n’essayait de se faufiler. Ls résidents se soumettaient sans rechigner et tout allait très vite. »
« Le capitaine Edgar Lightfoot, agent de la CIA, s’exclama : « Bon sang ! Voilà que les Fnouls sont de retour, mon commandant. Ils se sont emparés de Provo, en Utah. » Le commandant Hank grogna et fit signe à sa secrétaire de lui apporter le dossier Fnoul, qui était tenu sous clé. « Quelle forme ont-ils adoptée, cette fois ? demanda-t-il vivement.
La dernière fois, songea Hank, c’étaient des pompistes »…
« Walter, qui jouait au roi de la montagne, reconnut tout de suite le camion blanc visible derrière le bouquet de cyprès. Le camion abortif, pensa-t-il. Venu chercher un enfant pour une intervention postnatale à la clinique d’avortement. Et ce sont peut-être mes parents qui l’ont appelé, se dit-il encore. Pour moi. »
« Bob Blbleman avait l’impression que les robots ne regardaient jamais les gens en fac. En outre, quand il y en avait un dans les parages, un certain nombre de petits objets de valeur disparaissaient. Leur conception de l’ordre, c’était de tout ranger en une seule pile. Mais il était bien obligé de s’adresser à eux pour commander un déjeuner puisque ce genre de travail était situé trop bas dans l’échelle des salaires pour intéresser des humains. »
MÉDIAS
Il faut se débarrasser des médias traditionnels
Les médias traditionnels ne sont plus que des filtres et des biais entre les citoyens qui s’en débarrassent progressivement.
Contrepoints
https://www.contrepoints.org/2021/10/22/408991-il-faut-se...
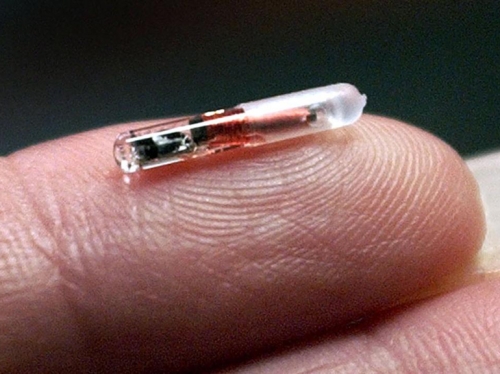
REFLEXION
La puce dans le vaccin
Le QR code des vaccinés n’est pas encore sous-cutané. Mais bien des gérants de bars et leurs clients trouveraient plus pratique d’éviter de sortir le smartphone pour boire un coup. Une puce bien placée ne ferait pas une grande différence, maintenant qu’on est habitués à être scannés comme des colis. Comme dit ce client en terrasse interrogé par la radio : « Au début c’est un peu gênant, mais on finit par s’habituer à tout ».
Pièces et Main-d’Oeuvre
https://www.piecesetmaindoeuvre.com/IMG/pdf/la_puce_dans_...
SANTÉ
Le pass-sanitaire temporaire, faites-moi rire !
Certains sont surpris de la prolongation du pass sanitaire. En fait, le projet industriel derrière est trop coûteux pour être arrêté si tôt !
Contrepoints
https://www.contrepoints.org/2021/10/20/408986-le-pass-sa...
Ivermectine en traitement précoce en Australie
Le médecin et chercheur Thomas Borody, relate une expérience de traitement par une trithérapie par Ivermectine-Doxycycline-Zinc, en ambulatoire et portant sur 600 patients, avec groupe témoin non traité, volontaires et non tirés au sort (randomisés).
Covid-factuel
https://www.covid-factuel.fr/2021/10/21/ivermectine-en-tr...
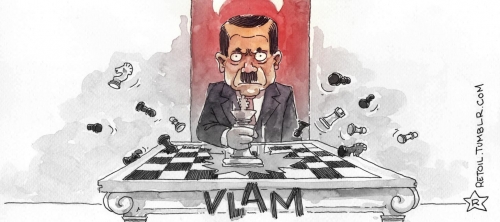
TURQUIE
La Turquie en Syrie : le jeu d’échec d’Erdogan
La Turquie unifie régulièrement ses groupes armés contrôlés de l’Armée nationale syrienne dans le but de les exempter de la responsabilité de multiples crimes commis contre l’humanité.
Contrepoints
https://www.contrepoints.org/2021/10/22/409097-la-turquie...
UNION EUROPÉENNE
Crise de l’énergie au sein de l’UE : ces 4 points qui divisent les Etats membres
L’augmentation des prix du gaz et de l’électricité affecte les États membres différemment. Et comme souvent, les 27 peinent à parler d’une seule voix et s’opposent même sur les solutions concernant la Russie, les objectifs climatiques, et la classification de certaines énergies comme vertes. Une fracture qui s’est observée lors du Sommet européen de jeudi 21 octobre.
Businessam.be
https://fr.businessam.be/crise-de-lenergie-au-sein-de-lue...
09:53 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, journaux, médias, france, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Poutine croque le bloc occidental à la moulinette
Ex: https://www.dedefensa.org/article/poutine-croque-le-bloc-bao-a-la-moulinette
22 octobre 2021 – Poutine a fait une longue apparition de trois heures devant le public de la session plénière de l’édition 2021 du “Davos russe”, ou de “l’anti-Davos” si l’on veut, – le “Valdaï Discussion Club”. Son intervention s’est faite dans le style de ses fameuses et très longues conférences de presse, avec questions du modérateur et du public, qu’il s’agisse de celui qui était présent physiquement ou par liaison vidéo.
On comprend ainsi qu’il y a eu de très nombreux sujets abordés, notamment les habituels sujets de politique extérieure avec les critiques russes concernant l’OTAN, l’Ukraine ou la façon dont les Occidentaux, américanistes en particulier, ont terminé leur piteuse aventure afghane. Poutine juge que « les problèmes mondiaux s’accumulent et deviennent de plus en plus explosifs ». Il fait le bilan de la période qui vit la domination absolue de l’Occident, puis l’effritement sinon l’effondrement de cette domination, avec cette remarque renvoyant évidemment à l’Irak et à l’Afghanistan :
« Auparavant, une guerre perdue par un pays signifiait une victoire de l’un sur l'autre, – et c’était le premier qui assumait la responsabilité pour ce qui survenait. […] Aujourd'hui, tout est différent. Peu importe qui gagne, la guerre ne finit pas, elle ne fait que changer de forme. Un vainqueur hypothétique ne veut pas s’occuper d’assurer l’ordre pacifique et il ne fait qu’aggraver le chaos et amplifier le vide dangereux pour le monde… »
Ce qui nous intéresse surtout, c’est la façon appuyée avec laquelle Poutine s’est attaché à l’observation et à l’interprétation des crises culturelles qui touchent l’Occident, sous le nom générique de wokenisme, comprenant aussi bien le phénomène de l’“antiracisme” que celui des LGTBQ. Bien entendu, le président russe est extrêmement critique d’une part, d’autre part absolument épouvanté et effaré par ces phénomènes.
Il est tout à fait remarquable et sans doute significatif pour nos mémoires encalminées, qu’il compare certains aspects de nos folies wokenistes avec la période culturelle très particulière en URSS, après la guerre civile de 1918-1921 (au moment de la NEP dans l’économie) jusqu’au tout-début du stalinisme (1928-29 et la “dékoulakisation”). La culture développa des avant-gardisme aussi bien culturels (disons “les futuristes” avec le flamboyant Maïakovski) que sociétaux dans les mœurs sociaux, tentant des approches ultra-modernistes plus tard symbolisées par des références à l’homo sovieticus, – tout cela débouchant d’une façon bien décourageante et pleine d’enseignement sur le stalinisme pur-jus, avec développement d’un goulag déjà bien affirmé et les purges permanentes sur le modèle 1936-1939 de la ‘Grande Purge’ du NKVD de Iéjov (la ‘Iéjovtchina’).
Regards étonnés de l’ancien colonel du KGB purgé, lui, de toutes les pratiques du NKVD, sur l’étrange évolution de l’Occident, du style “tout ça pour ça”...
• Monstrueux ‘NewSpeak’ en Occident... « “La discussion sur les droits des hommes et des femmes [en Occident] s’est transformée en une fantasmagorie totale dans un certain nombre de pays occidentaux. Ceux qui se risquent à dire que les hommes et les femmes existent encore, et que c'est un fait biologique, sont pratiquement ostracisés” en Occident, a déclaré Poutine, qualifiant cette situation de “fantasmagorie totale”.
» “Sans parler de choses tout simplement monstrueuses”, a-t-il ajouté, “comme lorsqu'on enseigne aux enfants, dès leur plus jeune âge, qu'un garçon peut facilement devenir une fille et vice versa. En fait, on les endoctrine dans les prétendus choix qui sont soi-disant disponibles pour tout le monde, – en supprimant les parents de l'équation et en forçant l'enfant à prendre des décisions qui peuvent ruiner sa vie.”
» C’est à la limite du crime contre l'humanité, – le tout sous couvert de ‘progrès’”.
» Il ajoute que la situation lui rappelle le “NewSpeak” inventé par les “guerriers de la culture soviétiques” dans les années 1920, dans l'espoir de redéfinir les valeurs des gens et de créer un nouveau sens de la conscience. »
• ‘Cancel Culture’ et racisme inversé... « Une autre pratique occidentale qui rappelle à Poutine les débuts de l'ère soviétique est la poussée vers la “justice sociale” par le biais de la discrimination positive et de la culture de l'annulation.
» “La lutte contre le racisme est une cause nécessaire et noble, mais dans la ‘culture de l'annulation’ moderne, elle se transforme en discrimination inverse, en racisme inversé”, a déclaré Poutine. “C'est avec une grande perplexité que nous voyons aujourd'hui à l'Ouest, dans des pays qui ont pris l'habitude de se considérer comme des fleurons du progrès, des pratiques que la Russie a laissées dans un passé lointain”. »
Poutine conservateur ? Poutine prudent, certes, qui observe tous ces troubles et ce chaos avec circonspection sinon horreur et qui ne peut faire que procéder avec la plus extrême prudence... D’où la définition de son conservatisme hérité de Berdiaev et son observation de l’inéluctable crise du capitalisme entré dans une voie sans issue conduisant dans une impasse posée contre un mur comme en rêve Donald Trump.
• Le conservatisme de Berdiaev... « A la question de savoir si ces vues [sur les pratiques sociétales dans le bloc-BAO/le bloc occidental] font de lui un conservateur, Poutine a cité le philosophe russe Nikolaï Berdiaev [expulsé d’URSS en 1922] qui disait que “le conservatisme n’est pas quelque chose qui vous empêche de monter et d’avancer, mais quelque chose qui vous empêche de reculer et de tomber dans le chaos.”
• Crise du capitalisme... « Selon Poutine, il y a une “inégalité croissante des avantages matériels et des opportunités au sein de la société” dans certains des pays les plus riches du monde.
» “Tout le monde voit bien que le modèle de capitalisme existant, qui constitue aujourd’hui la base de l’ordre social dans la grande majorité des pays, est à bout de souffle”, a déclaré Poutine. “Il n'y a plus d'issue à l’enchevêtrement de contradictions de plus en plus déroutantes”. »
En un sens, on comprendra qu’il n’y a rien pour nous surprendre dans les réactions et les jugements de Poutine. Son attention pour les questions sociétales et culturelles, voire spirituelles, est largement connue depuis de nombreuses années, une fois l’homme débarrassé des tombereaux d’insanités imbéciles dont le bloc-BAO (= le bloc occidental) ne cesse de l’accabler, comme on encense un fantasme de bouc-émissaire.
On doit donc se rendre à l’évidence : à rendre compte de sa lucidité et de la façon dont il saisit bien les fils et les effets de la crise, de la façon dont il situe les responsabilités et identifie les folies, on comprend après tout cet acharnement américaniste et occidentaliste contre lui.
“Cet homme est dangereux”, se dit le Système... Et de faire les yeux doux au premier Navalny venu : c’est dire où il en est, le Système !
Quels que soient ses travers et ses vilenies, Poutine est insupportable à cette époque à cause de sa lucidité et de la façon dont il l’exprime, et de son refus opiniâtre de notre habituel simulacre civilisationnel, cette irrésistible tendance à laquelle nous force notre déterminisme-narrativiste, de prendre des vessies pleines de vides en simulacre pour des lanternes pleines de vertus rassurantes dans leur bouffitude de moraline. S’il est corrompu, Poutine, comme disent nos docteurs en cette même moraline de Soros aux parlementaires européens, alors il l’est à l’image de Talleyrand, c’est-à-dire qu’il est également aussi brillant et clairvoyant que lui.
(Talleyrand superbement grimé en évêque, – qu’il était d’ailleurs, – et élégamment poudré en révolutionnaire pour figurer dans la célébration de la Fête de la Fédération en 1790, sur la scène, devant la foule pieusement rassemblée sur le Champ de Mars avec les parlementaires de la Convention Nationale aussi sérieux qu’autant de papes, acceptant le serment à la Patrie de La Fayette et lui chuchotant: « Ne me faites pas rire ».)
12:28 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : vladimir poutine, russie, occident, occidentisme, occidentalisme, bloc occidental, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Folies apocalyptiques - Ne confondons pas protection de l'environnement et terrorisme climatique
par Umberto Masoero
Ex: https://www.destra.it/home/follie-apocalittiche-non-confondiamo-la-difesa-dellambiente-con-il-terrorismo-climatico/
Si le problème de la natalité en Italie est déjà préoccupant - l'équivalent de la population d'une ville de taille moyenne disparaît chaque année - le terrorisme climatique promet maintenant de nous pousser encore plus vers l'abîme avant de nous "sauver", comme l'espèrent les militants. S'il s'agissait d'opinions isolées de quelques têtes brûlées anonymes qui font de la désinformation pour le bénéfice de leurs guerres saintes du dimanche, nous pourrions nous en tirer avec un haussement d'épaules, mais si nous incluons également des personnalités importantes du show-business et de la politique, et que les victimes potentielles sont jeunes et très jeunes, il est immédiatement évident que la situation est vraiment grave.
 Miley Cyrus (ci-contre) a déclaré il y a quelques jours à peine qu'elle avait "juré de ne pas avoir de bébé sur cette planète de merde". Nous parlons d'une pop star avec plus de 147 millions de followers sur Instagram, principalement des enfants. Je vous laisse imaginer l'effet toxique que de telles déclarations peuvent avoir sur ceux qui sont encore en train de se forger leur propre vision du monde. Mais ce n'est pas suffisant. Alexandra Ocasio-Cortez, une éminente représentante des démocrates d'Amérique, dans une récente story Instagram, a demandé à son large public "s'il est encore éthique d'avoir des enfants dans le monde dans lequel nous vivons". Il n'est donc pas surprenant que Morgan Stanley ait indiqué dans une note aux investisseurs, il y a deux mois, que "le mouvement en faveur du choix de ne pas avoir d'enfants par crainte du changement climatique se développe et a un impact sur la fécondité plus rapide que toute autre tendance antérieure dans un contexte de baisse de la fécondité". Cette tendance a également été quantifiée par des enquêtes récentes, dont un article paru dans The Atlantic le 20 septembre: au moins un tiers de la population américaine de moins de 45 ans choisit désormais de ne pas avoir d'enfants ou d'en avoir moins en raison des préoccupations liées au changement climatique.
Miley Cyrus (ci-contre) a déclaré il y a quelques jours à peine qu'elle avait "juré de ne pas avoir de bébé sur cette planète de merde". Nous parlons d'une pop star avec plus de 147 millions de followers sur Instagram, principalement des enfants. Je vous laisse imaginer l'effet toxique que de telles déclarations peuvent avoir sur ceux qui sont encore en train de se forger leur propre vision du monde. Mais ce n'est pas suffisant. Alexandra Ocasio-Cortez, une éminente représentante des démocrates d'Amérique, dans une récente story Instagram, a demandé à son large public "s'il est encore éthique d'avoir des enfants dans le monde dans lequel nous vivons". Il n'est donc pas surprenant que Morgan Stanley ait indiqué dans une note aux investisseurs, il y a deux mois, que "le mouvement en faveur du choix de ne pas avoir d'enfants par crainte du changement climatique se développe et a un impact sur la fécondité plus rapide que toute autre tendance antérieure dans un contexte de baisse de la fécondité". Cette tendance a également été quantifiée par des enquêtes récentes, dont un article paru dans The Atlantic le 20 septembre: au moins un tiers de la population américaine de moins de 45 ans choisit désormais de ne pas avoir d'enfants ou d'en avoir moins en raison des préoccupations liées au changement climatique.
Même si l'on accepte le scénario le plus catastrophique comme absolument réel - même s'il est principalement le résultat de la désinformation causée par le fameux "cherry picking" typique des divers magazines qui spéculent sur le terrorisme climatique - la conclusion logique serait de tout miser sur les nouvelles générations. Ce sont eux qui pourront faire avancer le développement technologique qui nous permettra, dans plusieurs décennies, d'avoir un impact beaucoup plus important que celui que nous pouvons avoir aujourd'hui sur la durabilité des modes d'obtention de l'énergie et, en général, de ce dont nous avons besoin pour vivre de l'écosystème dont nous faisons partie.

Nous n'avons pas besoin d'une génération de dépressifs chroniques, bien nourris mais à l'esprit obscurci par des idéaux pessimistes, voire anti-humains. Au contraire, nous avons désespérément besoin de jeunes gens courageux qui veulent s'engager et qui sont prêts à tout miser sur l'avenir. À l'heure où nous avons l'espérance de vie la plus élevée depuis le début de l'histoire et les niveaux de prospérité les plus élevés jamais atteints, le choix de renoncer à la relation potentiellement la plus intense et la plus significative avec un être humain - celle avec son propre enfant - est exactement ce qu'il semble être : un acte inhumain, lâche et irrationnel, et une grave insulte à la mémoire des hommes et des femmes qui, avant nous, n'ont pas eu peur d'essayer de donner à leurs enfants un avenir meilleur, en les mettant au monde même pendant les guerres et les pestes.
Avant de nous lever de nos confortables fauteuils et d'aller cracher notre fureur sur des générations entières sur les médias sociaux, il serait peut-être bon de nous rappeler que nous sommes également assis sur le dur labeur, la souffrance et surtout l'espoir des générations qui nous ont précédés, auxquelles nous devrions peut-être accorder un peu plus de respect, et dont nous devrions certainement prendre exemple pour affronter les défis de notre présent la tête haute et le dos droit.
12:19 Publié dans Actualité, Ecologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, écologie, terrorisme climatique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
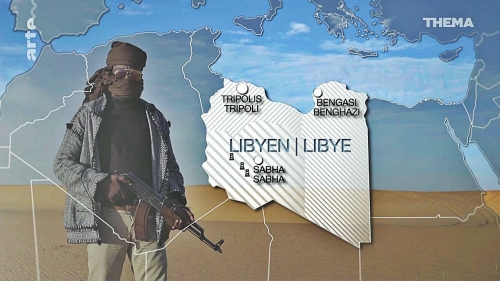
Une Libye disparue et divisée
par Alberto Negri
Source : Il quotidiano del sud & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/una-libia-sparita-e-spartita
La Libye a disparu et elle a été divisée. En ce dixième anniversaire de l'assassinat de Kadhafi à Syrte, la Libye n'a plus guère d'importance. Si ce n'est pour lancer des appels plus ou moins crédibles à la "stabilité", dont il a également été question hier lors de la conférence internationale de Tripoli.
Dans le vide politique qui a résulté de l'attaque occidentale en 2011, la Libye a disparu et elle a été divisée. En ce dixième anniversaire de l'assassinat de Kadhafi à Syrte, la Libye importe peu désormais. Si ce n'est pour lancer des appels plus ou moins crédibles à la "stabilité", dont il a également été question hier lors de la conférence internationale de Tripoli, la première du genre organisée en Libye, seule note positive de l'événement. La stabilité et la sécurité en Libye ne signifient en fait pas grand-chose pour nous: d'abord l'arrêt des vagues migratoires, le reste vient plus tard, des élections au retrait des troupes mercenaires dont la présence a été qualifiée hier d'"inquiétante" par le Premier ministre Dabaiba. Mais aucune conclusion n'a été tirée à Tripoli, ni sur les soldats et mercenaires turcs et russes, ni sur les élections présidentielles et législatives.
Pas un mot n'a été gaspillé sur les milliers d'êtres humains réduits en esclavage dans les camps libyens. Pourtant, les juges d'Agrigente qui ont porté plainte contre le navire de l'ONG Mediterranea - qui a refusé de remettre les migrants aux Libyens - ont été explicites: non seulement il est juste de ne pas communiquer avec les "garde-côtes libyens", mais une contradiction flagrante se dégage des conclusions de la justice. Quiconque finance et forme les "garde-côtes libyens", c'est-à-dire l'Italie, viole le droit international et se rend complice d'un comportement criminel.
La stabilité de la Libye n'a jamais vraiment été souhaitée par quiconque au cours de cette décennie, depuis le lynchage et l'assassinat de Mouhammar Kadhafi le 20 octobre à Syrte. Avec l'intervention aérienne de mars 2011, après la chute des raïs Ben Ali et Moubarak, la France et la Grande-Bretagne, avec le soutien des États-Unis, n'avaient pas l'intention d'exporter la démocratie mais de remplacer le régime de Tripoli par un gouvernement plus malléable et proche des intérêts de Paris et de Londres. M. Sarkozy, qui avait reçu de l'argent libyen pour sa campagne électorale de 2007, en voulait amèrement à M. Kadhafi, qui avait refusé d'acheter ses centrales nucléaires, tandis que le raïs libyen poursuivait ses accords énergétiques avec l'Italie et ENI.

La Grande-Bretagne et la France n'ont pas toléré le retour de la Libye, quoique d'une manière totalement différente de son passé colonial, dans la Quatrième Banque italienne, un événement sanctionné par le défilé pompeux du rais libyen à Rome le 30 août 2010. Des accords avaient été mis sur la table pour 55 milliards d'euros: plus du double de la loi budgétaire actuelle de Draghi.
 Ces éléments apparaissent également dans l'intéressant documentaire de la RAI intitulé "Il était une fois Kadhafi" (qui sera diffusé dans quelques semaines) où le général des services Roberto Jucci (tableau, ci-contre) témoigne abondamment de la manière dont il a bloqué les ordres d'Aldo Moro de renverser Kadhafi par un coup d'État en 1971. Le documentaire raconte également comment Jucci, inspiré par Andreotti, a répondu aux demandes de fournitures militaires de Kadhafi. Comme on le sait, ce sont Craxi et Andreotti qui ont sauvé le colonel libyen des sanctions américaines, y compris les raids aériens de 1986 ordonnés par Reagan.
Ces éléments apparaissent également dans l'intéressant documentaire de la RAI intitulé "Il était une fois Kadhafi" (qui sera diffusé dans quelques semaines) où le général des services Roberto Jucci (tableau, ci-contre) témoigne abondamment de la manière dont il a bloqué les ordres d'Aldo Moro de renverser Kadhafi par un coup d'État en 1971. Le documentaire raconte également comment Jucci, inspiré par Andreotti, a répondu aux demandes de fournitures militaires de Kadhafi. Comme on le sait, ce sont Craxi et Andreotti qui ont sauvé le colonel libyen des sanctions américaines, y compris les raids aériens de 1986 ordonnés par Reagan.
C'est pourquoi la décision de l'Italie de se joindre aux raids de l'OTAN contre Kadhafi n'a pas été prise pour des raisons humanitaires mais simplement parce que les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France nous faisaient du chantage et menaçaient même de bombarder les usines ENI. L'Italie subit alors sa plus grande défaite depuis la Seconde Guerre mondiale et perd toute crédibilité résiduelle sur la rive sud. La décennie qui vient de s'écouler depuis l'explosion du printemps arabe n'a pas été suffisante pour retrouver un rôle en Méditerranée, un rôle qu'Aldo Moro avait déjà fortement défendu dans les années 1960 et 1970. L'Italie ne peut qu'espérer que les puissances se battent entre elles et se heurtent dans les espaces restants. C'est ce qui se passe, par exemple, dans le cas de la Turquie: après l'accord militaire du 30 septembre entre la France et la Grèce, Rome cherche le soutien d'Ankara dans l'exploration offshore des zones économiques spéciales qui coupent désormais la Méditerranée en tranches.
Nous gardons un profil bas dans le jeu libyen, sous la pression de Paris et face à la tentative française de convoquer une autre conférence libyenne le 12 novembre. Et espérer un candidat présidentiel proche des intérêts italiens. Aux noms controversés de Seif Islam Gaddafi et Khalifa Haftar, on peut préférer l'actuel premier ministre Dabaiba, qui a rencontré Di Maio hier.
Mais le plus déconcertant en ce dixième anniversaire de la mort de Kadhafi, c'est la réévaluation historique larvée de ce dernier par les mêmes médias et journaux qui ont applaudi les raids occidentaux qui ont plongé le pays dans le chaos. En Libye, les Américains ont vu l'assassinat d'un ambassadeur envoyé pour traiter avec la guérilla islamique à Benghazi par Hillary Clinton et sa "stratégie du chaos" démentielle (11 septembre 2012). La France a imprudemment manœuvré avec Haftar contre le gouvernement Sarraj, soutenue par l'Italie et l'ONU, la Grande-Bretagne a systématiquement saboté les tentatives de stabilisation, avec pour résultat qu'aujourd'hui nous avons la Turquie en Tripolitaine et des mercenaires et pilotes russes en Cyrénaïque. Et la liste des erreurs tragiques commises en Libye, que nous dressons ici, est suffisante pour aujourd'hui.
11:51 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : libye, afrique du nord, afrique, affaires africaines, méditerranée, italie, monde arabe, monde arabo-musulman, géopolitique, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Jihad Inc.: de l'opération Gulmarg à la chute de Kaboul
Sergio Restelli
Ex: https://it.insideover.com/terrorismo/jihad-inc-dalloperazione-gulmarg-alla-caduta-di-kabul.html
Le 22 octobre 1947 reste dans les mémoires comme le moment de la naissance du "Jihad Inc", au cours duquel le Pakistan a commencé à utiliser la religion pour mener à bien des génocides contre des populations locales et leurs cultures, un modus operandi qui a également été mis en œuvre au Pakistan oriental (l'actuel Bangladesh) qui, bien qu'il ait réussi à se libérer en 1972, a eu des conséquences traumatisantes qui ont marqué de nombreuses autres générations à venir.
Le modus operandi du "Jihad inc" est le même que celui utilisé en Afghanistan encore aujourd'hui, où des groupes issus des tribus talibanes sont entraînés et armés par l'armée pakistanaise, avec des soldats pakistanais en civil, ont contribué à la prise de Kaboul et à l'assaut du Panjshir. Il est donc nécessaire de faire un retour en arrière afin de clarifier, d'éclairer et de raconter les événements réels qui se sont déroulés au Cachemire.
Immédiatement après son indépendance, l'Inde a choisi de rester une nation démocratique laïque et de protéger constitutionnellement ses minorités, mais ce n'était pas le cas du Pakistan, qui s'est au contraire déclaré "nation islamique et théocratique" sans aucun respect pour sa diversité ethnique et a décidé de persécuter non seulement ses minorités, mais aussi les musulmans d'Inde qui avaient émigré vers la république islamique nouvellement établie. C'est précisément le début du djihad qui est la raison d'être du Pakistan, de ses forces armées et de sa politique.
Le 22 octobre 1947, le Pakistan a mené son premier djihad au Cachemire. L'effet fut si dévastateur qu'aujourd'hui encore, 74 ans plus tard, les gens se souviennent de ces jours d'horreur comme du "Jour noir". L'ampleur de l'horreur et de la destruction était inimaginable et le chaos de ces jours-là, la trahison du Pakistan, les viols et les meurtres commis par la milice tribale armée libérée par l'armée pakistanaise, restent gravés dans la psyché de chaque Cachemiri, même aujourd'hui.

Quelques mois après la partition, les Pakistanais sont entrés au Cachemire en violation de toutes les règles et de tous les accords conclus précédemment et ont lancé une attaque armée contre l'État de Jammu-et-Cachemire avec l'aide de tribus, venues de la région actuelle des zones tribales sous administration fédérale (FATA). Les milices tribales ont été entraînées, approvisionnées en munitions et dirigées par l'armée pakistanaise. Ils ont pillé, violé et tué des centaines d'innocents dans la vallée, quelle que soit leur religion. Les trésors du Cachemire ont été pillés. Certains parents ont empoisonné leurs filles, préférant qu'elles meurent dans la dignité. Des milliers d'hommes ont été convertis de force à l'islam. Des enfants innocents ont été massacrés. Des centaines de milliers d'hommes se sont retrouvés sans abri. Il était impossible d'estimer le nombre d'orphelins.
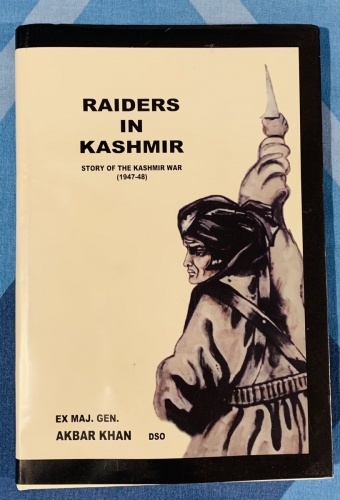
Le major général Akbar Khan de l'armée pakistanaise, qui a organisé l'attaque et l'a appelée "Opération Gulmarg", a eu l'occasion de raconter son succès dans le livre "Raiders in Kashmir", dans lequel il révèle le premier des nombreux cas de perfidie du Pakistan.
Le modus operandi du Pakistan consistait à créer une guerre au nom de l'Islam dans le seul but de massacrer des innocents. C'est précisément la raison pour laquelle le 22 octobre est devenu un rappel de l'objectif du Pakistan d'anéantir le Cachemire et sa culture.
Une stratégie très similaire, initialement conçue pour capturer et soumettre le Cachemire, a été utilisée par le Pakistan en Afghanistan. Un groupe sunnite wahhabite, qui n'a rien en commun avec la culture millénaire de l'Afghanistan, impose son éthique religieuse et sociale, faisant disparaître le peuple afghan et son identité, au nom de la religion, avec le soutien appuyé de l'armée et des services de renseignement pakistanais (ISI).
Baramulla, creuset des cultures cachemirie, pendjabi et britannique, reste l'exemple le plus effroyable de violations des droits de l'homme. Des femmes ont été enlevées en 1947 et vendues comme esclaves sur les marchés de Rawalpindi et Peshawar ou envoyées dans des territoires tribaux éloignés. En leur honneur, de nombreux hommes se sont jetés dans la rivière Jhelum ou dans des puits fermés. Ceux qui ont résisté ont été mutilés ou tués sans pitié et leurs corps ont été jetés dans la rivière Jhelum. Selon certains témoins oculaires, l'eau de la rivière a changé de couleur à cause de la grande quantité de sang.
Le cas le plus horrible s'est produit au collège, couvent et hôpital de Saint-Joseph, le lieu le plus médiatisé de tout le raid. Les religieuses, les prêtres, la congrégation et les patients de l'hôpital ont été violés et massacrés. Parmi eux se trouvaient un certain nombre d'Européens, dont le lieutenant-colonel Dykes et son épouse, une Britannique qui avait accouché quelques jours plus tôt ; Mère Teresalina, une jeune religieuse espagnole ; Mère Aldertrude, la mère supérieure adjointe ; et M. Jose Barretto, un Anglo-Indien qui fut tué dans le jardin avant que les religieuses chrétiennes ne s'alignent devant un peloton d'exécution. Ces hommes sont décrits comme des "montagnards sauvages aussi agiles que des chats sauvages" qui "ont pillé la chapelle du couvent jusqu'à la dernière poignée en laiton".
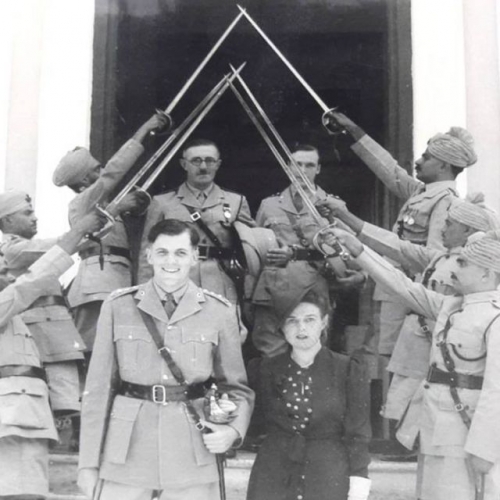
Ironiquement, le colonel Dykes du régiment sikh, qui a été envoyé en Inde au milieu des années 1930 pour aider au transfert de pouvoir, était diplômé de Sandhurst où l'un de ses camarades de promotion, Akbar Khan, a plus tard planifié l'invasion du Cachemire le 22 octobre, où Dykes a été assassiné (ci-dessus, le Lt-Colonel Dykes et son épouse).
Le Pakistan n'a jamais présenté d'excuses pour les violations des droits de l'homme commises par son armée, même s'il en revendique souvent la paternité. Il est profondément attristant de voir comment la Commission des droits de l'homme des Nations unies et Amnesty International ont choisi d'ignorer ce massacre. L'attaque de la mission St Joseph, située dans les paisibles contreforts de l'Himalaya, a marqué le début d'un djihad visant à reconquérir le Cachemire, le "Paradis sur Terre".
Depuis ce jour de 1947, où plus de 35.000 Cachemiris ont perdu la vie, le Cachemire est devenu la région la plus militarisée du monde. Les Cachemiris vivent dans une terre brisée et le Pakistan est responsable de décennies de violence. Cette stratégie, qui a débuté avec l'opération Gulmarg, a été ensuite suivie par l'armée pakistanaise au Pakistan oriental (aujourd'hui Bangladesh). Le nettoyage ethnique et le génocide, ainsi que l'imposition de normes socio-culturelles, n'ont abouti qu'à la balkanisation du Pakistan en un nouveau pays, le Bangladesh, en 1971. Le Pakistan a laissé derrière lui des décennies de traumatisme, de mort et de destruction. Avec la chute de Kaboul aux mains des talibans le 15 août, ce 22 octobre prend une signification plus grande, sans jamais oublier comment et où tout a commencé. Il faut espérer que la communauté internationale, au moins maintenant, prêtera attention à cette menace de portée mondiale.

11:23 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cachemire, pakistan, inde, histoire, asie, affaires asiatiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
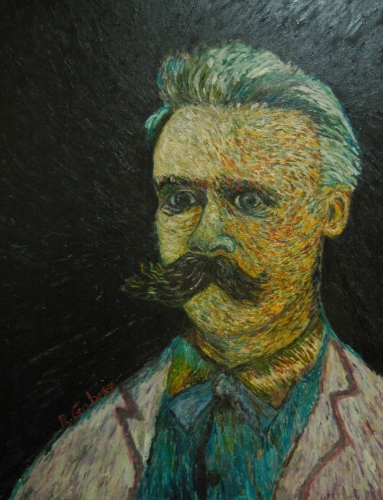
Le mysticisme de Nietzsche
Un classique du philosophe Gustave Thibon ("Nietzsche ou le déclin de l'esprit") sur le philosophe allemand a été republié chez Iduna.
par Giovanni Sessa
Ex: https://www.barbadillo.it/101348-la-mistica-di-nietzsche/
Gustave Thibon, Nietzsche ou le déclin de l'esprit
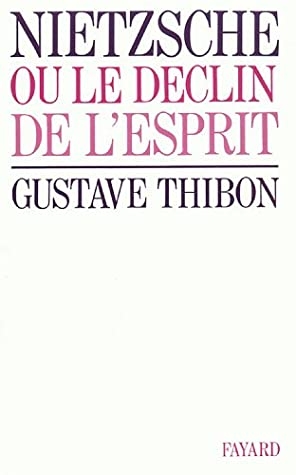 Certains livres, ceux qui éclairent des problèmes théoriques et des besoins existentiels déjà présents en nous, peuvent être lus d'une traite. Nous sortons, nous, d'une telle lecture, qui ne nous a pas peu fascinés. Nous faisons référence à un texte capital du philosophe français Gustave Thibon, Nietzsche ou le déclin de l'esprit, qui est paru dans le catalogue d'Iduna editrice (pour les commandes : associazione.iduna@gmail.com, pp. 299, €25.00). Le texte est accompagné d'une préface de Massimo Maraviglia, visant à contextualiser la figure de l'auteur dans le panorama culturel du vingtième siècle et à clarifier le rapport paradoxal qui liait ce dernier au penseur de l'Au-delà de l'homme. En premier lieu, il nous semble que le volume montre comment les choix intellectuels divergents des uns et des autres n'ont pas du tout pesé sur l'exégèse faite par le penseur français. Le catholique Thibon trouve chez le philosophe allemand un trait mystique, totalement négligé par les interprètes proches des perspectives nietzschéennes.
Certains livres, ceux qui éclairent des problèmes théoriques et des besoins existentiels déjà présents en nous, peuvent être lus d'une traite. Nous sortons, nous, d'une telle lecture, qui ne nous a pas peu fascinés. Nous faisons référence à un texte capital du philosophe français Gustave Thibon, Nietzsche ou le déclin de l'esprit, qui est paru dans le catalogue d'Iduna editrice (pour les commandes : associazione.iduna@gmail.com, pp. 299, €25.00). Le texte est accompagné d'une préface de Massimo Maraviglia, visant à contextualiser la figure de l'auteur dans le panorama culturel du vingtième siècle et à clarifier le rapport paradoxal qui liait ce dernier au penseur de l'Au-delà de l'homme. En premier lieu, il nous semble que le volume montre comment les choix intellectuels divergents des uns et des autres n'ont pas du tout pesé sur l'exégèse faite par le penseur français. Le catholique Thibon trouve chez le philosophe allemand un trait mystique, totalement négligé par les interprètes proches des perspectives nietzschéennes.
Naturellement, comme on le verra, nous faisons référence à une sorte de mysticisme négatif qui aurait agi comme un pôle d'attraction sur le théoricien de l'éternel retour. Pour entrer dans le cœur vital du nietzschéisme, Thibon présente le drame intime vécu par l'homme Nietzsche, dans la mesure où, à la manière fichtienne, il est conscient que derrière toute philosophie il y a un homme, avec ses propres idiosyncrasies, ses passions et un trait de caractère donné. En effet, il avoue explicitement "Nous pensons [...] que chez Nietzsche la doctrine est toujours déterminée par les passions et les réactions de l'homme" (p. 9). Et si Nietzsche n'avait pas soutenu que: "il n'y a pas de vérités, sauf les vérités individuelles"? (p. 9). En raison de l'accent mis sur l'homme, sur son esprit convulsivement tendu vers l'infini, le volume que nous présentons ici va au-delà de la "lettre" du penseur de Röcken, mais en retrace la substance. Cette méthode herméneutique est une conséquence des choix existentiels faits par Thibon. Fils de paysans, lorsque la Première Guerre mondiale éclate, il est contraint de prendre la place de son père parti au front et de travailler dans les champs.
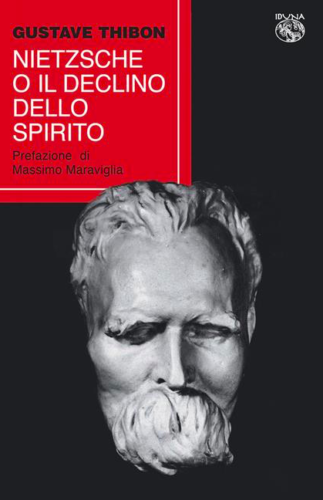 La nature est devenue son premier professeur de sagesse. Il a observé et apprécié sa dimension cyclique, montrant à l'homme le chemin de l'éternité. De la vie rurale qu'il a menée dans son manoir ancestral de Saint-Marcel-d'Ardèche, à laquelle il s'est consacré définitivement après une période d'errance et de voyages, il a tiré l'idée que la limite est le caractère distinctif et insurmontable de la vie. L'étude et la lecture occupaient ses journées, ainsi que les travaux des champs. D'où l'épithète, qui l'a accompagné jusqu'à ses derniers jours, de paysan-philosophe. Ami du premier Maritain, il a accueilli en 1941 Simone Weil, de qui il a appris, comme le rappelle la préface, que: "L'homme désire toujours quelque chose au-delà de l'existence" (p. III). Autodidacte exceptionnel, il est profondément influencé par l'enseignement de Léon Bloy, qui fait de lui un "chrétien extrême": "Je suis un extrémiste à cause de mon attirance pour la théologie négative, la mystique de la nuit, le "Dieu sans base ni appui" qui était celui de saint Jean de la Croix et qui est le mien aujourd'hui" (p. II). Cette tendance spirituelle le met également en contact avec Gabriel Marcel: ce dernier avait compris le caractère énigmatique de l'existence, car il était conscient de "la différence fondamentale entre la pensée scientifique objectivante [...] et une ontologie consciente qui voit (dans la vie) essentiellement le mystère " (p. III).
La nature est devenue son premier professeur de sagesse. Il a observé et apprécié sa dimension cyclique, montrant à l'homme le chemin de l'éternité. De la vie rurale qu'il a menée dans son manoir ancestral de Saint-Marcel-d'Ardèche, à laquelle il s'est consacré définitivement après une période d'errance et de voyages, il a tiré l'idée que la limite est le caractère distinctif et insurmontable de la vie. L'étude et la lecture occupaient ses journées, ainsi que les travaux des champs. D'où l'épithète, qui l'a accompagné jusqu'à ses derniers jours, de paysan-philosophe. Ami du premier Maritain, il a accueilli en 1941 Simone Weil, de qui il a appris, comme le rappelle la préface, que: "L'homme désire toujours quelque chose au-delà de l'existence" (p. III). Autodidacte exceptionnel, il est profondément influencé par l'enseignement de Léon Bloy, qui fait de lui un "chrétien extrême": "Je suis un extrémiste à cause de mon attirance pour la théologie négative, la mystique de la nuit, le "Dieu sans base ni appui" qui était celui de saint Jean de la Croix et qui est le mien aujourd'hui" (p. II). Cette tendance spirituelle le met également en contact avec Gabriel Marcel: ce dernier avait compris le caractère énigmatique de l'existence, car il était conscient de "la différence fondamentale entre la pensée scientifique objectivante [...] et une ontologie consciente qui voit (dans la vie) essentiellement le mystère " (p. III).
La critique de la modernité par Thibon s'appuie sur un constat qui, à ses yeux, semblait aller de soi. A l'époque actuelle, "le ciel est fermé et l'égout est grand ouvert" (p. III). La société contemporaine a un trait catagogique, dans la mesure où en elle la vie a été privée de son essence, de sa raison d'être. Thibon, tout comme Nietzsche, voulait redonner un sens au monde. Les deux ont suivi des chemins différents: le chemin chrétien pour le premier, le chemin du retour à Hellas pour le second. Pourtant, ils partageaient tous deux une donnée existentielle commune: le désir de dépasser la simple existence, sensible à l'appel de l'infini et de l'éternel.
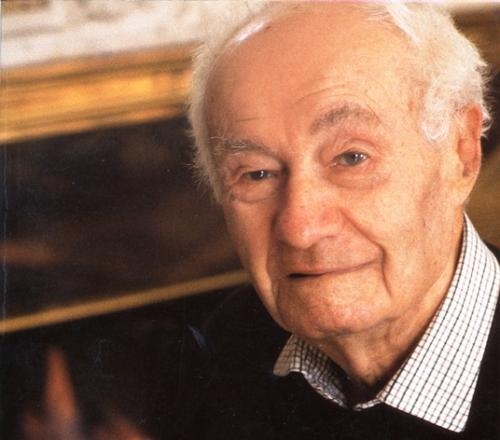
Le Français est, en effet, fasciné par la soif d'absolu qui se dégage des pages de l'Allemand. En eux, il semble percevoir un "pressentiment" du divin, qui disparaîtra bientôt chez Nietzsche, en raison de la montée orgueilleuse de l'ego. Pour Thibon, le "oui à la Terre" du penseur de l'Au-delà de l'homme finit par rencontrer le Néant, il ne s'ouvre pas à la Fondation: "Le monde du devenir, totalement imprégné de Néant, Nietzsche ne le veut plus comme un pont jeté vers la rive divine, mais comme le but fascinant de toute destinée" (p. 277).
En tout cas, pour Thibon, l'antichristianisme de Nietzsche est compensé par sa fascination pour Dieu. De manière appropriée, Maraviglia rappelle le jugement de Karl Löwith sur Nietzsche. Le disciple de Heidegger interprète la "volonté de puissance" comme la volonté d'avenir, la dernière manifestation de la théologie de l'histoire chrétienne, désormais définitivement immanentisée. Au contraire, la civilisation antique, notamment hellénique, avait en son centre la physis, la nature, avec ses cycles éternels, la montée et la chute des entités, d'où le primat de la volonté était totalement absent. La critique acerbe du moralisme, c'est-à-dire la pédagogie de l'anti-morale de Nietzsche, la tabula rasa des pseudo-valeurs du monde bourgeois, aurait pu induire chez le penseur allemand cette dénudation de l'ego, opérée par les mystiques chrétiens, en particulier par saint Jean de la Croix, auquel Thibon dédie la troisième partie du volume. Nietzsche et Jean de la Croix "avaient l'âme de l'adorateur ardent" (p. 225), et s'efforçaient de chasser d'eux-mêmes toute impureté "humaine, trop humaine".
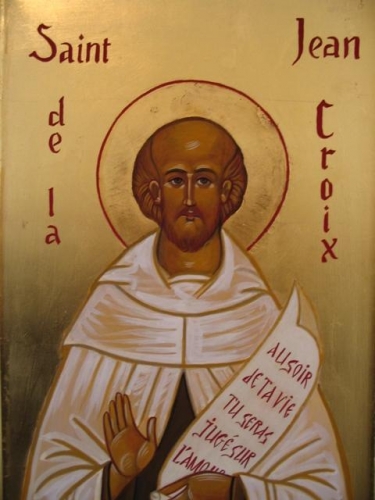
De Nietzsche jaillit "un torrent furieux de négation" (p. 228) des faux idéaux de la modernité. Thibon relie la négation des nouvelles idoles à Dieu, à l'immuable. Le philosophe français attribue la catastrophe existentielle de l'Allemand au fait qu'il soit resté fidèle au devenir. En réalité, à notre avis, si l'on doit parler d'échec nietzschéen, il faut l'attribuer au résidu chrétien qui a fait de l'éternel retour une énième philosophie de l'histoire, incapable, pour cette raison, de rencontrer réellement la physis grecque. Ce n'est que face à cela que l'homme se dépense stoïquement, comme le répétait Löwith: "Il n'espère pas, il ne désespère pas", pour une vie persuadée.
L'option de la foi nous sépare de Thibon. Néanmoins, nous considérons que ce livre est d'une grande pertinence exégétique. Il saisit ce qui est "caché" chez Nietzsche et le transmet au lecteur d'une manière passionnée et engageante.
18:42 Publié dans Livre, Livre, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, philosophie, nietzsche, friedrich nietzsche, gustave thibon, mysticisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

L'Asie centrale après le retrait américain
Par Amedeo Maddaluno
Ex: https://www.eurasia-rivista.com/lasia-centrale-dopo-il-ritiro-di-washington/
Quelques mois après le retrait américain de Kaboul, où va l'Asie centrale? Quels sont les pays qui gagnent en influence sur la région en général et sur l'Afghanistan en particulier? Les puissances asiatiques sont désormais les seules qui semblent vouloir prendre en charge le pays (même si elles restent très prudentes quant à la possibilité de leur implication directe). De ce point de vue, Washington a atteint son objectif, en pouvant se consacrer en toute liberté à l'Indo-Pacifique.
L'Afghanistan vu par ses voisins
Essayons, méthodologiquement, de raisonner en termes géographiques, en construisant une série de cercles concentriques autour de l'Afghanistan. Le premier cercle, celui des pays immédiatement impliqués dans les nouveaux scénarios qui se sont ouverts en Afghanistan après le retrait américain, est celui des pays voisins: Pakistan, Iran, Turkménistan, Ouzbékistan et Tadjikistan. Ces pays ont un certain nombre de problèmes en commun: ils ont eu tendance à être affaiblis par une série de problèmes économiques. L'Iran en raison des sanctions imposées par les États-Unis, le Turkménistan et l'Ouzbékistan en raison de leur économie caractérisée par la monoculture de matières premières, le Tadjikistan en raison de l'absence de matières premières (si l'on exclut l'eau et l'énergie hydroélectrique) et d'une véritable structure économique autonome, le Pakistan en raison de sa pauvreté congénitale, de son instabilité, du manque d'infrastructures et d'investissements, de sa dette publique élevée et de ses faibles réserves monétaires. Tous ces pays partagent également certaines caractéristiques de politique étrangère: un certain degré de méfiance à l'égard de Washington - de la méfiance silencieuse de Tachkent à la méfiance active d'Islamabad en passant par la méfiance conflictuelle de Téhéran - et une certaine ouverture conséquente au dialogue avec Moscou et Pékin: de l'alliance de facto du Pakistan avec la Chine ou de l'alliance du Tadjikistan avec la Russie, à l'activisme de troisième ordre de plus en plus faible de Téhéran, qui s'ouvre progressivement à une amitié stable avec les deux grandes capitales [1].
Il existe un troisième facteur que ces acteurs ont en commun: l'hostilité à l'égard de l'extrémisme fondamentaliste et sectaire (et la méfiance qui en découle à l'égard du nouveau gouvernement taliban), allant de la recherche d'un modus vivendi vigilant, comme dans le cas de l'Iran, du Turkménistan ou de l'Ouzbékistan, au rejet pur et simple, du moins officiellement, de tout dialogue avec Kaboul, comme dans le cas du Tadjikistan. Un cas particulier est celui du Pakistan, un pays exportant l'extrémisme qui peut être utilisé contre son rival indien, contre l'adversaire soviétique, contre les encombrants pseudo des américains. Le Pakistan a créé les talibans, les a soutenus par tous les moyens et continue de les soutenir. Dépourvu de toute profondeur géographique, le Pakistan aurait son arrière-cour idéale dans un Afghanistan ami en cas de conflit avec l'Inde. Tous ces facteurs ont donné lieu à une phase fébrile de dialogues bilatéraux, dans laquelle se distinguent l'activisme de Téhéran, la réouverture par l'Ouzbékistan de canaux avec ses voisins, et l'ambiguïté énigmatique du Pakistan, difficile à décrypter.
Aucun de ces pays n'a la force économique ou les capacités militaires pour intervenir directement en Afghanistan. Tant que les talibans peuvent faire en sorte que le radicalisme sunnite ne mette pas trop le pied hors des montagnes afghanes - et que les États-Unis n'y remettent pas les pieds - personne n'a intérêt à intervenir. Cela ne signifie pas, bien sûr, que chacun ne cherche pas à cultiver des interlocuteurs privilégiés sur les pentes de l'Hindukush, qu'il s'agisse des Tadjiks pour Douchanbé, des Hazaras chiites pour Téhéran ou des Talibans pour Islamabad ; mais ces mois ont montré que l'objectif des États de la ceinture péri-afghane est de maintenir le statu quo, aussi stable que possible. Un effet secondaire intéressant du récent changement de régime à Kaboul a été l'intensification de la coopération et du dialogue entre les pays péri-afghans [2], qui jusqu'à récemment n'étaient pas à l'abri de rivalités et de tensions frontalières.
L'Afghanistan vu de Moscou, Pékin, New Delhi et Ankara: une stabilité maximale avec une implication directe minimale.

Les acteurs les plus riches, les plus puissants et les plus aptes militairement n'ont pas de frontière directe avec l'Afghanistan (aucun, à l'exception de la République populaire de Chine, qui partage une très courte frontière avec Kaboul dans la région instable du Sinkiang). Les intérêts de Moscou et de Pékin sont les mêmes que ceux des pays de la ceinture péri-afghane: une stabilité maximale avec une implication directe minimale.
Les médias occidentaux ont émis l'hypothèse que la République populaire de Chine et la Fédération de Russie étaient prêtes à entrer en Afghanistan une minute après le retrait des États-Unis, chaque pays utilisant les moyens qui lui convenaient le mieux: les baïonnettes pour Moscou, les investissements et le commerce pour Pékin. En dehors des contacts diplomatiques avec les Talibans [3] qui dirigent actuellement le pays, à notre connaissance, pas une seule baïonnette russe n'a franchi la frontière tadjike, pas un seul dollar n'est parvenu à Kaboul depuis Pékin. Aucun des deux pays n'a de ressources à gaspiller. Depuis des mois, Moscou est trop occupé à former les troupes kazakhes, tadjikes, ouzbèkes, indiennes et pakistanaises - et même mongoles - aux opérations de lutte contre le terrorisme et à maintenir, voire à étendre, ses bases en Asie centrale. Pékin est bien trop occupé à défendre le corridor sino-pakistanais contre les insurgés baloutches [4] et les islamistes [5], qui sont probablement considérés d'un œil bienveillant par son rival indien et les États-Unis, pour aller créer de toutes pièces de coûteux tronçons de la route de la soie dans un pays dépourvu d'infrastructures.
L'Afghanistan est peut-être riche en matières premières, mais la Chine peut déjà les obtenir en toute sécurité et à moindre coût ailleurs. Depuis des mois, les commentateurs des coulisses imaginent une intervention militaire d'Ankara en Afghanistan, mais même Erdogan semble avoir compris jusqu'à présent qu'il n'a aucune raison d'intervenir dans la dynamique afghane. Ce n'est pas que la Turquie, comme d'habitude de connivence avec le Qatar, ne tente pas d'inclure les Talibans dans le circuit de la famille bigarrée des mouvements apparentés aux Frères musulmans. Ils l'ont fait, ils le font et ils le feront avec des contacts diplomatiques et des offres économiques, afin de gagner de l'influence au cœur de l'Asie - une influence à rejouer avec Pékin et Moscou; mais aucun soldat turc ne se bat en Afghanistan, contre Isis ou contre qui que ce soit. La tendance générale qui s'applique à la Russie s'applique également à la Turquie: elle s'insère dans les espaces laissés vacants par l'Occident, mais uniquement là où cela l'arrange.

Le seul facteur qui a une chance de rompre l'équilibre de l'équation est le "facteur Inde", ou plutôt le facteur "rivalité Inde-Pakistan". Le Pakistan est le seul pays de la ceinture péri-afghane qui a des intérêts vitaux à Kaboul. L'Inde considère le Pakistan comme son ennemi existentiel, et a tout intérêt à le chasser de Kaboul, ainsi qu'à contrarier la Chine en contribuant à l'instabilité aux frontières de cette dernière. C'est donc la rivalité indo-pakistanaise et indo-chinoise qui constitue l'événement potentiel de rupture de l'équilibre afghan, et les événements de ces derniers mois semblent aller exactement dans ce sens: s'il y a eu des interventions étrangères en Afghanistan après le retrait américain, elles ont été le fait des deux puissances nucléaires du sous-continent indien. L'Inde semble avoir armé la brève insurrection tadjike du Panshir avec le soutien de Douchanbé, le Pakistan semble être intervenu avec des drones et des renseignements pour aider les talibans à la dompter. Encore une fois, "verum est factum" et "hypotheses non fingo" : les puissances qui interviennent en Afghanistan sont celles qui, selon le manuel de géopolitique, perçoivent que des menaces existentielles - ou des ressources vitales - viennent de là. Ceci est tout à fait indépendant des spéculations sur les initiatives diplomatiques individuelles, telles que le maintien de l'ambassade russe à Kaboul ou la visite chinoise à la base aérienne de Bagram [6], épisodes de l'administration diplomatique normale (Un déploiement chinois limité à une tête de pont afghane pourrait difficilement bouleverser le tableau stratégique que nous esquissons). Même si les Chinois ouvraient une base de soutien aérien en Afghanistan, rien ne changerait dans le fond de leur politique: maintenir une stabilité maximale avec un engagement minimal. Aujourd'hui, ce n'est pas la ceinture péri-afghane, ni seulement les grandes capitales asiatiques ou eurasiennes qu'il faut scruter pour comprendre l'avenir de la zone. Comme le suggère la rivalité entre le Pakistan et l'Inde et entre la Chine et l'Inde, pour saisir toute la complexité, nous devons élargir le cadre et inclure la zone "indo-pacifique".
M. Brzezinski, au revoir, bienvenue à M. Spykman?
La puissance des empires est faite, pour une part non négligeable, d'image et de narration: en un mot, de prestige, le prestige étant l'une des composantes de ce que Nye a défini comme le "soft power". Le prestige, l'image et le discours des États-Unis en tant que "policier" et "divinité tutélaire" de l'ordre mondial sont indéniablement compromis par le retrait d'Afghanistan. Il est toutefois trop tôt pour déterminer la gravité de ces dommages et l'influence qu'ils auront sur le poids géopolitique réel des États-Unis. Pour paraphraser Mark Twain, les rapports annonçant la mort des États-Unis semblent grossièrement exagérés. Les États-Unis ont déjà réalisé deux choses. Tout d'abord, ils ont obligé les puissances régionales à s'occuper de l'Afghanistan à leur place. Il est possible (et souhaitable pour l'avenir du peuple afghan tourmenté) qu'ils réussissent mieux que les Américains eux-mêmes ; en tout état de cause, il risque d'être coûteux, en termes de temps, d'efforts politiques, de risques et de ressources, ne serait-ce que d'entourer l'Afghanistan d'un cordon sanitaire adéquat pour empêcher les terroristes et les opiacés de sortir. Les États-Unis ont alors libéré leurs ressources militaires, politiques et économiques pour se consacrer au théâtre qui les intéresse vraiment: le théâtre dit "indo-pacifique".
C'est sur les mers - et sur les terres insulaires et péninsulaires - de l'Indo-Pacifique que le véritable endiguement de la République populaire de Chine prendra forme. Les États-Unis ont compris que la marche vers le cœur de l'Asie est coûteuse et exigeante. Le fait de défier l'URSS et ses alliés dans le "Grand Moyen-Orient", de frapper les Soviétiques avec le "djihad" afghan, de s'opposer aux gouvernements nationaux arabes et de contenir la République islamique d'Iran, a émoussé les capacités de projection mondiale de ces puissances, mais n'a pas empêché la Russie de renaître de ses cendres et l'Iran de résister. Elle a moins empêché la République populaire de Chine de devenir une puissance économique mondiale. Les Américains doivent changer de stratégie et revenir à un endiguement de l'Asie à partir de ses côtes: en un mot, à partir du "Rimland". Revenons sur la définition même de l'"Indo-Pacifique", qui désigne le théâtre géopolitique des deux océans. Cela indique clairement que les États-Unis considèrent la mer d'Asie - et non "les mers" - comme un théâtre unique sur lequel activer l'endiguement anti-chinois impliquant l'Inde, l'Australie [7], le Japon et la Grande-Bretagne: les quatre pays qui, à part Taïwan bien sûr, sont les plus sensibles aux appels de Washington contre Pékin.
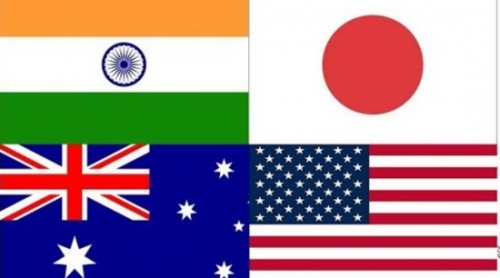
De ce point de vue, l'Asie centrale est une pure diversion, un piège tendu aux Chinois, aux Russes et aux Iraniens. Pourquoi contenir la Chine sur les mers? Parce que les mers sont le point faible de la Chine et le point fort des États-Unis. C'est des mers que la République populaire reçoit des ressources et c'est par les mers qu'elle exporte des produits manufacturés. Par ressources reçues, nous ne faisons bien sûr pas seulement référence aux matières premières, mais aussi aux flux financiers vers les ports de Hong Kong et de Shanghai. C'est sur les mers que la Chine montre qu'elle n'est pas encore une puissance militaire, pas même à l'échelle régionale. La forteresse anti-chinoise de Taïwan empêche la Chine d'avoir le contrôle total de ses mers voisines, dont sa flotte de haute mer - récemment construite mais pas encore d'un niveau technologique adéquat et avec une expérience de combat insuffisante - peine à sortir. La République populaire est contrainte de recourir à la construction d'îles artificielles comme bases avancées en dehors de la "première chaîne d'îles", la zone maritime contrôlée par le Japon de Tsushima aux Ryukyu et Senkaku, puis à Taïwan et enfin au Vietnam.
La décision de la Chine de se tourner vers des infrastructures terrestres, dont la construction est extrêmement coûteuse dans l'immensité de l'Asie, aujourd'hui gelée, aujourd'hui déserte, aujourd'hui montagneuse et isolée, et en proie au séparatisme et au radicalisme, n'est pas plus sûre. La République populaire de Chine connaît une crise démographique sans précédent [8], qui pourrait la conduire à devenir vieille avant d'être riche. La Chine est assiégée principalement par la mer - du Sud et de l'Est - mais le théâtre terrestre - de l'Ouest - n'est pas un théâtre dans lequel elle peut se sentir à l'aise.
Spykman, le géopoliticien qui a théorisé l'endiguement de l'Eurasie par la mer, n'a pas pris une revanche définitive sur Brzezinski, le géopoliticien qui a théorisé l'assaut du cœur de l'Eurasie: c'est simplement que les Etats-Unis se servent des enseignements de l'un et de l'autre (et cela vaut pour ceux qui imaginent encore la géopolitique comme une discipline rigide et déterministe). Une fois encore, la ressource que les acteurs eurasiens doivent déployer pour résister au siège est une alliance toujours plus étroite, une collaboration toujours plus grande [9].
NOTES:
[1] Spécialement depuis l'adhésion officielle de la République islamique à "l'Organisation de Shanghai pour la coopération"; voir Giuseppe Gagliano, SCO. l’Iran sarà tra i membri: un’operazione per contenere gli USA www.notiziegeopolitiche.net, 21 Settembre 2021
[2] Giuliano Bifolchi, How Afghanistan is influencing the Turkmenistan-Uzbekistan cooperation, www.specialeurasia.com, 6 Ottobre 2021
[3] Du reste, si les Etats-Unis ont dialogué et négocié avec les talibans au plus haut niveau, on ne comprend pas pourquoi les pays bien plus proches de l'Afghanistan ne devraient ou ne pourraient pas le faire.
[4] Michel Rubin, Could Washington Support Balochistan Independence? nationalinterest.org, 12 Settembre 2021
[5] Giorgio Cuscito, Karachi per la Cina, rubrique Il mondo oggi, www.limesonline.com, 6 Ottobre 2021
[6] Gianandrea Gaiani, La corsa alle basi in Afghanistan e dintorni, www.analisidifesa.it, 5 Ottobre 2021
[7] L'accord nommé AUKUS entre les Etats-Unis et leurs satellites, le Royaume-Uni et l'Australie, n'est pas survenu au hasard mais, justement, au lendemain du retrait américain de Kaboul. Cet accord sert à signaler aux pays de la région indo-pacifique que les Etats-Unis sont prêts à cautionner sérieusement la politique de l'endiguement antichinois, y compris en partageant des technologies nucléaires sophistiquées et en acceptant le risque de faire monter la tension sur ce théâtre précis, contribuant de la sorte à une course aux armements.
[8] Mario Seminerio, Contrordine, cinesi: moltiplicatevi, phastidio.net, 5 Ottobre 2021
[9] Bradley Jardine, Edward Lemon, In post-American central Asia, Russia and China are tightening their grip, warontherocks.com, 7 Ottobre 2021
18:18 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, géopolitique, politique internationale, afghanistan, asie centrale, asie, affaires asiatiques, région indo-pacifique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Anecdotes afghanes dysgenrées
par Georges FELTIN-TRACOL
Dans sa « Chronique d’une fin du monde sans importance » intitulée « Rencontre du troisième type » qu’on lit dans le numéro 192 d’Éléments d’octobre – novembre 2021, Xavier Eman dépeint avec le talent qu’on lui connaît l’accueil d’un interprète afghan exfiltré par une famille de Bo-bo véganes et climatophiles des beaux quartiers de Paris, de Lyon, de Bordeaux ou de Rennes. Le sympathique « rapatrié » (sic !) ne termine pas le repas de ses hôtes et les quitte après l’entrée dans la pièce de l’adolescent du couple en pleine transition genrée. Dans la réalité, il est probable que cette scène n’aurait pas eu lieu. L’invité se serait seulement demandé à haute voix: « Tiens ! Vous aussi, vous avez votre batcha ? »

L’Afghanistan, le Pakistan et l’Asie centrale pratiquent une coutume ancestrale nommée le batcha bazi, ce qui signifie « jouer avec les garçons ». Des garçons pré-pubères ou adolescents sont offerts aux chefs de tribu ou à de riches dignitaires qui les travestissent en filles pour les grandes occasions. Les batchas dansent devant les invités masculins lors des mariages ou à la fin des réunions entre les différents responsables tribaux. L’ONU considère le batcha bazi comme une forme d’esclavage sexuel pédophile, car bien des batchas sont violés par leurs maîtres. Cela ne les empêche pas d’être respectés et salués avec maints égards quand ils circulent dans les rues du bazar.
La majorité des batchas sont des Hazaras. Descendants des Mongols dont ils ont souvent gardé les traits caractéristiques, les Hazaras vivent au centre de l’Afghanistan. Sous le premier émirat islamique des talibans avant 2001, ils étaient persécutés, car ils pratiquent le chiisme dans un pays majoritairement sunnite. L’Iran voisine accueille depuis un quart de siècle de centaines de milliers de réfugiés de cette ethnie dont bien des jeunes gens s’enrôlent dans les milices chiites en Irak et en Syrie contre l’État islamique.

Dans certaines régions d’Afghanistan et du Pakistan existe une autre coutume étonnante pour des sociétés jugées patriarcales : le batcha poch qui veut dire « habillée comme un garçon ». Certaines familles qui n’ont pas d’héritier mâle décident d’élever l’une de leurs filles (ou leur fille unique) en garçon. La fille porte un prénom masculin, s’habille avec des vêtements masculins et peut se déplacer dans l’espace public sans aucune restriction. Elle peut même servir de chaperon mâle à sa mère ou à ses jeunes sœurs quand ces dernières doivent quitter la maison familiale. Ce statut original cesse autour de la puberté avec tous les désagréments imaginables. En effet, l’adolescente élevée en garçon a été dispensée de cuisine, de tâches ménagères quotidiennes et de broderie. Elle est plus difficile par conséquent à marier.
Le batcha poch pourrait vivement intéresser Machine Rousseau dont le compagnon serait, selon ses dires, un « homme déconstruit », l’élue parisienne Alice Coffin et la misandre pathétique Pauline Harmange. Ces trois-là devraient séjourner de longs semestres dans les coins finalement si inclusifs de l’Afghanistan…
Dès l’invasion occidentale de ce pays, la population locale a pu bénéficier de cours de formation rééducative en faveur des droits LGTBQAXY+++ avec un succès fort aléatoire. Pourquoi ? Pour des motifs surprenants. Il y a cinq ans, l’auteur de la présente chronique discutait dans le Sud de la France avec un contractor. Cet ancien militaire des forces spéciales françaises exerçait en Afghanistan. Au cours de cette conversation passionnante, il lui donna trois anecdotes révélatrices des mœurs afghanes.
Pour quelles raisons autant de jeunes Afghans fuient-ils leur patrie ? Non par peur des talibans, ni pour éviter la guerre ! Pour ne pas servir dans l’armée officielle qui a montré en août dernier son immense valeur guerrière. Chaque unité combattante possède son giton. Exempté de toute corvée et déchargé des tours de garde, un gars de la section consent, le soir venu, à servir de réconfort sexuel à ses compagnons d’arme. En cas d’attaque, ceux-ci font tout pour le protéger au péril de leur propre vie. On a ici une transposition adulte du batcha bazi qui coïncide aussi avec les thèses homo-érotiques des communautés martiales masculines chères à l’un des penseurs folcistes de la Révolution conservatrice allemande, Hans Blüher.

Au début de l’occupation en 2001 - 2002, les officiers occidentaux veulent s’attirer les bonnes grâces et l’appui des chefs de tribu. Comment les soudoyer ? Pas par des armes qu’ils ont déjà à profusion, ni non plus en leur versant des sommes d’argent ou en leur offrant de somptueuses voitures dans des contrées reculées très pauvres aux sentiers défoncés impraticables. Le viagra résout le problème. Après une rapide visite médicale, militaires et contractors occidentaux expliquent au chef du village l’intérêt d’avaler la petite pilule bleue. Ainsi un notable presque septuagénaire depuis longtemps impuissant peut-il honorer toute la nuit et les nuits suivantes sa nouvelle épouse à peine post-adolescente. Quelques mois plus tard, la jeune épouse tombait enceinte pour la plus grande fierté de son mari qui décéda ensuite d’un usage excessif de cet adjuvant…
L’OTAN donne à trois douaniers installés dans un poste montagneux isolé des tablettes numériques et deux ânes. Le contractor français assiste à cette remise hétéroclite de biens quelque peu incongrus. Il retrouve les douaniers trois - quatre mois plus tard. Ils lui montrent, tout fiers, l’enregistrement d’une scène banale. Le premier filme avec la tablette. Le deuxième tient l’âne tandis que le troisième, le pantalon sur les chevilles, prend du bon temps avec l’animal, en fait une ânesse.
L’Occidental du début du XXIe siècle verrait dans ces quelques exemples des témoignages d’une pesante misère sexuelle. Or ce point de vue est faux. Le contractor indique que l’absence de toute présence féminine non maternelle stimule une libido prête à s’assouvir à la première occasion venue. La vue de femmes-soldats occidentales déclencha d’ailleurs dans les premières années de l’occupation des scènes osées qui auraient valu à leurs auteurs d’être dénoncés par MeToo. Pendant ces vingt dernières années, on n’a pourtant guère entendu les associations féministes hystériques critiquer ce pays. Ne serait-ce pas au fond une bonne raison ?
16:57 Publié dans Actualité, anthropologie, Ethnologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : afghanistan, sexualité, ethnologie, anthropologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Aleksandr Douguine et la politique gnostique
Cristian Barros
Qu'est-ce que le gnosticisme? La question est certainement aussi ancienne que le mouvement spirituel et intellectuel auquel elle fait allusion. Historiquement, le gnosticisme semble être la pénombre ésotérique, marginale, voire élitiste de la plupart des religions abrahamiques, et en tant que tel, il coule comme un courant sous-jacent dans les piétiés exotériques et officielles. Ses sources sont opaques et fragmentaires, et son portrait dépend largement des critiques hostiles, principalement chrétiennes, qui ont contribué à sa ruine. Les gnostiques ont vraisemblablement délibéré avec une grande véhémence sur l'origine du mal, dont découlerait une théogonie fondée sur l'aliénation de l'homme au cosmos. Leur métaphysique est dualiste: le mal et le bien coexistent, le premier étant identifié à la matière et le second à l'esprit. La relation entre les deux dimensions est hautement dramatique, et repose sur un acte de trahison ou d'usurpation. Ainsi, des gnostiques comme Marcion affirment que la fable de la Chute est en réalité une inversion profane du véritable secret du monde: le Serpent est le dispensateur de la lumière et le Dieu biblique une entité asservissante et jalouse.
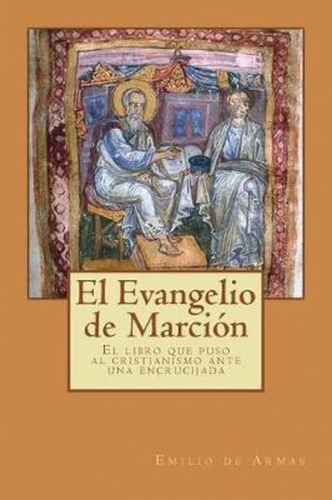
Certains récits gnostiques soutiennent que la lutte entre le mal et le bien sera résolue dans un dénouement climatique, d'où les diverses apocalypses découvertes à Nag Hammadi (1). D'autres versions, en revanche, se désintéressent froidement du sort du monde actuel. Ce pessimisme radical accepte que le mal soit le tissu même de la réalité, échappant à toute rédemption.
Il est clair que nous avons affaire à une hétérodoxie qui est elle-même une tradition complexe offrant de multiples interprétations. Mais son caractère marginal, proprement initiatique, se prête assez mal à la constitution d'un horizon politique, surtout à l'ère de la politique de masse. Néanmoins, il convient de rappeler que nombre des mouvements politiques de la Modernité sont nés dans des contextes sectaires, voire conspirationnistes, des francs-maçons de 1789 aux ligues d'artisans de 1848. Pour paraphraser Carl Schmitt, on peut dire que les catégories de la politique moderne résultent de la sécularisation des motifs religieux. En effet, l'évidement même du sacré en Occident a déplacé les aspirations prophétiques de l'autel vers la tribune parlementaire et les bureaux bureaucratiques. De manière symptomatique, le bourgeois Bentham et le révolutionnaire Lénine reposent aujourd'hui encore momifiés dans leurs sanctuaires murés de cristal respectifs.

Le XXe siècle a vu réapparaître, cette fois plus que comme une simple curiosité de cabinet, l'ancienne gnose héritée d'Alexandrie et du Levant hellénistique. Je pense ici en particulier aux études d'Adolph von Harnack, un savant prussien qui a réhabilité la figure de l'hérésiarque Marcion dans son livre éponyme, Marcion : Le testament d'un Dieu étrange. Rétrospectivement, le texte de Harnack peut être considéré comme le renouvellement philologique des études gnostiques, celles-ci étant tacitement impliquées dans la polémique protestante. Harnack semble avoir fait de Marcion un véhicule pour sa critique du légalisme religieux sclérosé qui perdure dans le christianisme, une rigidité que Harnack impute finalement au judaïsme.
En effet, en tant que religion purement intérieure, une forme d'intériorité mystique, le gnosticisme était proche du piétisme luthérien, mais se distançait de ce dernier dans la mesure où le gnosticisme primitif promettait à l'initié un processus de déification intérieure ou théosis. En tout cas, la redécouverte du gnosticisme dans le romantisme allemand avait un aspect politique évident, concernant l'épuration des éléments orientaux ou pharisiens d'un nouveau credo d'authenticité autochtone. Marcion lui-même s'attaquait à la tendance pétrinienne et philosémite du christianisme du deuxième siècle, et visait ainsi à créer un Évangile purifié, idéalement exempt des stigmates du tribalisme et du ritualisme mosaïques.
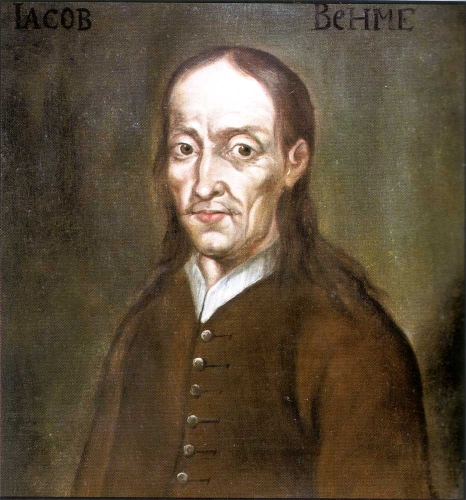
Bien sûr, la théosophie romantique peut être retracée jusqu'au visionnaire baroque autodidacte Jacob Boehme, qui influencera finalement Hegel, comme l'atteste solidement le livre notoire de F. C. Baur. D'ailleurs, le romantisme lui-même, en tant que rébellion contre la rationalité extérieure, antagoniste du légalisme universel jacobin, peut être comparé à une explosion instinctive des motifs antinomiens, ataviques, de la gnose : aliénation et authenticité, pessimisme métaphysique et héroïsme existentiel.
En ce sens, Hegel est un acteur majeur de ce que nous pouvons appeler la nébuleuse du gnosticisme moderne. Hegel a adapté les anciennes figures de l'histoire sacrée en langage académique, sécularisant la théorie même de la Trinité chrétienne dans sa dialectique, tout en masquant l'historicisme providentiel de Joachim de Fiore derrière sa téléologie idéaliste. D'une manière ou d'une autre, nous dit-on, Hegel a contribué au programme des futures religions politiques ou laïques et de leurs régimes subséquents, comme des chercheurs à l'esprit libéral comme Raymond Aron, Karl Popper et Eric Voegelin ont surnommé les expériences totalitaires du 20e siècle. En conséquence, nous pouvons considérer le siège de Stalingrad comme le choc apocalyptique des deux ailes opposées de la chimère hégélienne: l'universalisme marxiste et le particularisme nazi. Avec le temps, cependant, le camp triomphant allait connaître sa propre Némésis : la chute du mur de Berlin en 1989. Depuis lors, le pragmatisme libéral, dans son incarnation la plus nihiliste, récupère tout le butin du monde.
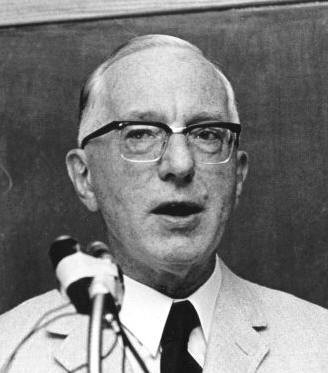
Il est révélateur que le professeur émigré de l'entre-deux-guerres Eric Voegelin ait inventé la thèse tant vantée de "l'immanentisation de l'Eschaton" afin d'anathématiser, plutôt que d'analyser sérieusement, l'émergence d'agendas totalisants ou révolutionnaires en politique. Voegelin se réfère ici à l'Eschaton comme à la consommation surnaturelle de l'histoire, déplorant la perversion démagogique qui transforme "la fin du temps sacré" en "le début d'une nouvelle ère profane". En vérité,
Voegelin tente d'exorciser l'infiltration de l'espérance chiliastique dans le statu quo bourgeois. Un effort similaire a également été déployé par un autre exilé libéral, Karl Popper, qui a rédigé le volumineux manifeste de la nouvelle foi antitotalitaire, La société ouverte et ses ennemis (1945), condamnant Platon et Hegel en tant que rêveurs d'une utopie spartiate, verticale et introvertie : la société fermée, un paradis du même.
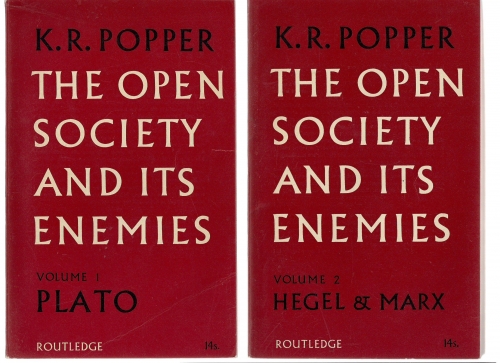
En réalité, tous ces polémistes libéraux ont lutté contre l'intégration des masses, et donc de l'irrationnel, dans la politique moderne. Contrairement à eux, les essayistes antilibéraux comme Georges Bataille et Carl Schmitt voyaient les choses avec une sorte d'optimisme cryptique. Bataille, pornographe obscur, primitiviste bohème et saint manqué, a également été un brillant interprète de la nouvelle politique de masse tout au long des années trente. À cette époque, Bataille était profondément immergé dans l'hermétisme, au point de fonder le "Collège de sociologie sacrée", un cénacle cultuel visant à restaurer les rites sacrificiels dans les bois parisiens, une affaire sans doute extravagante. Pourtant, l'article en question, La structure psychologique du fascisme (1933), présente encore de puissantes intuitions nietzschéennes. En résumé, le texte considère le fascisme comme une résurgence de l'"hétérogène", l'étiquette de Bataille pour l'irrationnel et le refoulé: un magma qui monte du monde souterrain animal de la psyché humaine.
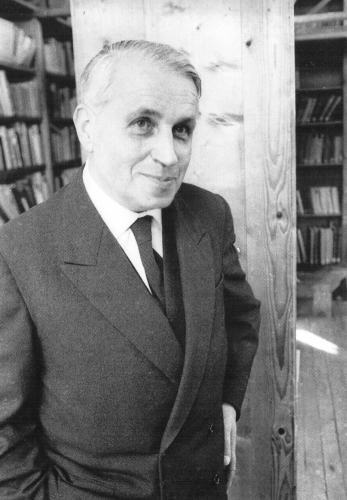
Bien que formellement communiste, le projet anthropologique de Bataille était créativement antimoderne, puisqu'il prétendait racheter l'aliénation de l'homme au moyen de liens sacrés comme le sexe et le jeu. De manière anecdotique, l'historien marxiste Richard Wolin considère Bataille comme un énergumène totalitaire, situé quelque part sur le spectre du national-bolchevisme. Notre point de vue est peut-être moins indulgent, puisque nous accusons Georges Bataille d'être un sombre gnostique, qui n'a fait que flirter avec le communisme et le fascisme en tant que stratégies terre-à-terre pour finalement inaugurer l'Eschaton.
Presque en chœur, maintenant sur l'autre rive du Rhin, le juriste Carl Schmitt a écrit son essai Staat, Bewegung, Volk, un sinistre chant du cygne pour le régime constitutionnel et parlementaire de Weimar, dont Schmitt ne pleure pas du tout l'agonie. En fait, Schmitt postule ici une identification dynamique entre masses et appareil d'État, voire le dépassement même de la technocratie par le peuple en armes. Également catholique ex-ultramontain comme Bataille lui-même, Schmitt fustige le marxisme universaliste tout en menaçant les capitalistes d'un futur État ouvrier populiste et plébiscitaire. Il va sans dire que la dénonciation de Marx par Schmitt concerne son libéralisme voilé, son universalisme abstrait, et non son élan prolétarien.
Par parenthèse, Schmitt était également un lecteur avide de l'hermétiste français René Guénon, une figure dont la gravitation était également très palpable dans le milieu de Bataille. De manière intrigante, une autre présence commune hantant le champ intellectuel de Schmitt et de Bataille est celle de Joseph de Maistre, l'ennemi juré de 1789, et pourtant son garant providentiel. La théorie du sacrifice de Maistre, qui remonte à Origène, peut-être le seul gnostique parmi les Pères de l'Église, résonne étrangement avec l'œuvre de Bataille et de Schmitt. D'une manière ou d'une autre, on pense naturellement à ces deux auteurs, ces deux maudits, mi-chanteaux mi-icônes de la contre-culture, lorsque Popper invoque les "ennemis" de la société ouverte...

Jusqu'à présent, un avatar récent de ce que nous pourrions appeler la politique gnostique est le polygraphe russe Alexandre Douguine, dépeint pendant ses années juvéniles par un romancier français contemporain comme un "ours dansant avec un sac à dos rempli de livres". Au-delà des digressions, Douguine a suffisamment mûri pour devenir un intellectuel antilibéral lucide et un prosélyte des blocs civilisationnels au-delà de l'esprit de clocher des petits États-nations. Souvent diabolisé comme un impérialiste russe, Douguine prône plutôt la création d'œcumènes ou de "grands espaces" en fonction des strates culturelles et religieuses. En conséquence, il pourrait être plus justement caractérisé comme un zélateur agissant contre l'impérialisme unipolaire, à savoir l'hégémonie atlantiste, que comme un simple bigot nostalgique du passé russe.
Bien au contraire. Douguine est un activiste acharné, un terroriste de l'esprit, et non un rat de bibliothèque mélancolique de la variété slave.
Tout bien considéré, Dugin est un penseur géostratégique et aussi un théoricien politique, mais ces appellations transcendent l'étiquette académique. Il ressemble à la fois à Bataille et à Schmitt dans la mesure où l'écriture exotérique masque un noyau ésotérique et anagogique plus profond. Encore une fois, il est plus un mystagogue qu'un érudit formel, bien qu'il accomplisse ce rôle de façon impeccable. Quant à Douguine, nous pouvons ajouter que la Tradition et la Révolution sont des pôles voués à être réconciliés dans un futur apogée, ce qui est une entreprise à laquelle il tient beaucoup.
Ainsi, son évolution du dissident soviétique au national-bolchevisme et à l'eurasianisme n'enlève rien à son noyau intérieur, qui est certainement gnostique et apocalyptique. En ce qui concerne sa première description, le "complexe national-bolchevisme" a toujours eu une dimension territoriale, visant à réaliser une entente continentale entre l'Allemagne et la Russie - comme un rempart contre l'étouffoir capitaliste atlantiste. Dès lors, l'eurasianisme de Douguine devient cohérent, un déploiement naturel. En outre, son "socialisme populiste" n'est pas abstrait mais historiquement enraciné, il n'est pas technophile mais plutôt tellurique, il s'appuie donc sur le développement organique des communautés établies. Quant à son eurasianisme, Douguine emprunte de manière transparente aux travaux de terrain de Lev Gumilev sur la symbiose entre agriculteurs et pasteurs dans les steppes, auxquels Gumilev attribuait un "zeste cyclique" (passionarnost) pour conquérir puis être à son tour assimilé à des structures sédentaires: des barbares revitalisant l'horizon agraire.
Une précision s'impose donc.

Certes, l'esprit grec faisait la distinction entre topos et chôra. Selon le Timée de Platon, par exemple, il y avait une véritable différence entre un point d'une extension abstraite, à savoir un crux cartographique, et le "lieu existentiel". Ainsi, la chôra était un espace d'enracinement, une réalité ancrée. Platon, quant à lui, considérait évidemment l'Attique, et plus particulièrement Athènes, comme son véritable lieu d'appartenance. C'est pourquoi l'exil politique, l'éviction de sa propre ville, était considéré comme pire que la mort, condition illustrée par le procès de Socrate. En revanche, le topos que l'on retrouve plus tard chez Aristote représente l'espace pur, le continuum quantitatif - qui se transformera finalement en res extensa de Descartes, le tableau physique et géométrique.
Il est révélateur que les Grecs classiques n'aient renoncé au patriotisme et embrassé le cosmopolitisme qu'une fois les cités hellénistiques vaincues par les légions romaines. Les besoins pratiques d'accommodement et de survie ont dicté un nouveau compromis, dès que la Grèce a été réduite au statut de colonie. Les philosophes s'adaptent progressivement à la domination impériale et, finalement, se divisent en deux écoles, l'une cynique et l'autre stoïcienne. Apparemment, Diogène le Cynique ("qui vivait comme un chien") fut le premier à inventer le terme kosmopolitês ("citoyen du monde"). Cette innovation subtile impliquait un changement radical par rapport au mythe traditionnel athénien de l'autochtonie, la croyance ancestrale partagée de descendre du sol même de la Grèce. Mais alors que les cyniques étaient plutôt des universalistes individualistes, les stoïciens étaient des organicistes cosmiques. En temps voulu, le stoïcisme est devenu la philosophie de l'oligarchie romaine, avec tout son fatalisme patricien et son sens du devoir déguisé en alibi pour la conquête.
L'espace en tant que quantité est finalement une aberration de la conscience, un phantasme-phénomène mathématique exacerbé plus tard par le commerce et la science moderne. Heureusement, l'écologie, en tant que "science holistique", est apparue dans les années 1900 comme un antidote opportun contre cette vision positiviste, technocentrique et réductionniste. De même, on pourrait citer ici les résultats de l'éthologie et de la géographie humaine de Jacob von Uexküll à Auguste Berque, et même des "écologistes culturels" comme Leo Frobenius, qui ont respectivement abordé l'interaction environnementale en utilisant des notions empathiques et contextuelles comme Umwelt, oecumène et Paideuma.
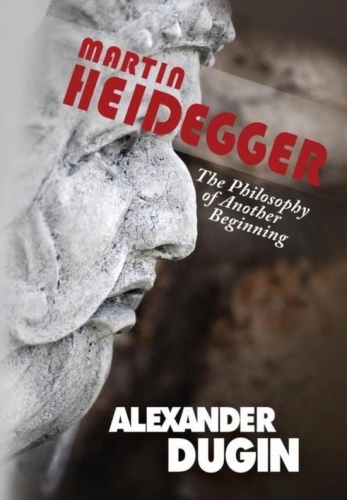
Douguine lui-même défend la notion de Heidegger du Dasein en tant que lieu d'être organique, enraciné et historiquement significatif. Heidegger célèbre la surface plutôt que la profondeur, l'impression quotidienne plutôt que la théorie incarnée, la routine inconsciente plutôt que l'effort délibéré, et il crée ainsi une sorte de populisme existentiel: "Être, c'est habiter". En conséquence, l'appropriation par Douguine de ce motif heideggérien lui permet de construire un projet géopolitique totalisant, qui repose à la fois sur le localisme et le pluralisme.
Cependant, la vision finale du monde de Douguine concerne les polities géostratégiques ou les "blocs civilisationnels". Plus encore, Dugin postule qu'un esprit transcendant ou un "ange" surplombe chaque civilisation, ce qui essentialise fortement sa théorie des relations internationales. Néanmoins, l'angélologie politique de Douguine permet une lecture métaphorique fructueuse - un exercice également proposé par Giorgio Agamben, un schmittien de gauche. Maintenant, pour récapituler, je souligne l'endroit même où Douguine affirme sa singularité, en habitant un paysage posthistorique - pour ainsi dire, une arène eschatologique.

En tant que gnostique, Douguine est un dualiste métaphysique et comprend que la lutte finale, en tant que point culminant d'une série d'escarmouches mineures, est exclusivement binaire, littéralement manichéenne. À ce stade, la fin du temps terrestre devient donc le début du temps sacré. De même, l'espace du conflit devient lui aussi sacralisé, c'est-à-dire orienté vers le sacrifice et la mort. Les anges de la fin s'incarnent dans les puissances de la Mer et de la Terre, thalassocratie contre tellurocratie, Léviathan contre Béhémoth... En d'autres termes, il s'agit de cultures mobiles contre des cultures axiales, ces dernières étant amalgamées dans la masse eurasienne, appelée Heartland.
16:41 Publié dans Nouvelle Droite, Philosophie, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre douguine, nouvelle droite, nouvelle droite russe, philosophie, philosophie politique, théologie politique, gnosticisme, tradition, traditionalisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

L'artifice de la pandémie pour les banques centrales
Markku Siira
Ex: https://markkusiira.com/
Pour le professeur Fabio Vighi, la crise de la pandémie n'est au fond qu'un symptôme du capitalisme financier déréglé. Plus largement, c'est le symptôme d'un monde qui n'est plus capable de croître en générant du profit à partir du travail humain et qui s'appuie donc sur la "logique compensatoire du dopage monétaire constant".
"Alors que la contraction structurelle de l'économie basée sur le travail gonfle le secteur financier, l'instabilité de ce dernier ne peut être contenue que par les urgences mondiales, la propagande de masse et la tyrannie de la biosécurité", conclut le chercheur italien.
Pour survivre par ses propres moyens, la cabale des banques centrales est prête à "sacrifier la liberté humaine et à adopter un système soutenu par la science et la technologie des entreprises, la propagande des médias et les histoires de catastrophes, accompagné d'un philanthro-capitalisme pseudo-humanitaire des plus dégoûtants".
L'introduction des passeports numériques de santé (qui, il y a seulement un an, était qualifiée de "théorie du complot" par les réchauffistes) marque un tournant décisif. Ce "marquage" est crucial si l'élite veut persuader les gens d'accepter la structure de pouvoir de plus en plus centralisée qui est présentée comme une condition préalable à la libération des restrictions imposées lors de la pandémie.
Après l'introduction de la carte d'identité numérique, l'oppression des citoyens - le principe "l'ébouillantement lent de la grenouille" - se poursuivra de manière régulière et progressive. Les plafonds de taux d'intérêt actuels sont conçus pour conditionner les masses à utiliser des portefeuilles électroniques pour contrôler non seulement l'accès aux services publics, mais aussi les dépenses des citoyens.
Le système financier mondial est une gigantesque arnaque de Ponzi: Vighi enterre les jeux du monde financier. Si ceux qui la dirigent devaient perdre le contrôle de la création de liquidités, une explosion s'ensuivrait, détruisant l'ensemble du tissu socio-économique sous-jacent. Dans le même temps, une récession écrasante priverait les politiciens des derniers vestiges de crédibilité.
Par conséquent, le seul plan viable pour l'élite semble être un effondrement économique contrôlé. Il s'agit notamment de l'affaiblissement des chaînes d'approvisionnement, qui entraînera une "pénurie de tout", et de la création d'une infrastructure numérique pour un coup d'État technocratique.
L'analyste financier Mauro Bottarelli a résumé la logique d'une économie pandémique comme suit : "Une urgence sanitaire semi-permanente vaut mieux qu'un effondrement brutal du marché, par rapport auquel le souvenir de 2008 [la crise financière] est comme une promenade tranquille dans le parc".
La fausse pandémie est donc un outil de sauvetage, essentiellement un "événement de politique monétaire conçu pour prolonger la vie d'un mode de production moribond et axé sur la finance". Avec l'aide du virus, le capitalisme cherche à se renouveler en invoquant la menace globale, mais au détriment de la vie quotidienne, du niveau de vie et de la santé (mentale) de la population.
Si et quand la bulle des taux d'intérêt éclatera enfin, que fera l'élite ? En termes plus clairs, quel nouveau spectacle les sauvera, sans que les masses humiliées ne montent aux barricades dans des conditions révolutionnaires ?
Vighi spécule sur les options : "Aliens ? Une cyber-attaque sur le système bancaire ? Un tsunami dans l'Atlantique ? Des jeux de guerre en Asie du Sud-Est ? Une nouvelle guerre contre le terrorisme ?" L'arsenal des mondialistes ne manque pas de choix, sans parler de la manipulation des masses par les médias.
Peut-on éviter une récession dévastatrice ? La réponse politique d'aujourd'hui semble s'inspirer de la sagesse séculaire selon laquelle "les situations extrêmes appellent des mesures extrêmes". Pour Vighi, cela signifie qu'"aucun crime contre l'humanité ne peut être exclu en s'obstinant à nier l'effondrement du système".
En réduisant au silence le débat public sur le sujet par la censure et l'intimidation, nous sommes conduits "vers une dystopie biotechnologique et capitaliste, dont la nature infernale sera probablement pleinement révélée lors de la prochaine crise mondiale".
L'actuelle "ségrégation de la population sur la base du statut vaccinal" est, selon M. Vighi, "une réalisation typique mais révolutionnaire des régimes totalitaires de notre époque". Si la résistance est vaincue, une carte d'identité numérique obligatoire sera introduite pour enregistrer la "vertu" du comportement des citoyens et réglementer leur participation à la société. Le coronavirus était le cheval de Troie idéal pour cette percée.
L'Alliance ID2020, soutenue par des géants tels qu'Accenture, Microsoft, la Fondation Rockefeller, MasterCard, IBM, Facebook et l'omniprésente "alliance pour les vaccins" Gavi de Bill Gates, prévoit depuis longtemps un système d'identification numérique basé sur la technologie blockchain.
L'argent numérique, lié à l'identité numérique, pose les bases d'un néo-féodalisme qui s'étendra d'abord aux chômeurs demandeurs d'emploi et éventuellement à la majorité des gens. Lorsque Larry Fink, PDG du géant de l'investissement BlackRock, déclare que "les marchés préfèrent les gouvernements totalitaires aux démocraties", il est peut-être préférable de le croire.
Les monnaies numériques permettraient aux gouverneurs des banques centrales non seulement de surveiller chaque transfert d'argent, mais aussi de bloquer l'accès à l'argent ou son utilisation pour toute raison jugée légitime. Le projet de numérisation de la vie comprendrait également un "passeport internet" qui, après des contrôles réguliers, exclurait les contenus inappropriés du web. Les interdictions de médias sociaux et les suppressions de comptes sont déjà un avant-goût des choses à venir.
Si les scores de crédit social tombent en dessous d'un certain niveau, la recherche d'un emploi, les voyages ou l'obtention d'un prêt dépendront de la volonté de la personne de participer à des "programmes de réhabilitation". On peut supposer qu'un "marché noir" des exclus de la société ne tarderait pas à apparaître (de faux certificats de vaccination sont déjà vendus en ligne).
Il semble donc bien que nous soyons entrés dans le "biofascisme" sous la direction des banquiers centraux. La pierre angulaire du fascisme historique était l'industrie contrôlée par l'État, qui restait néanmoins aux mains de particuliers. M. Vighi trouve "assez étonnant que, malgré les preuves accablantes de l'existence de portes tournantes systématiques entre les secteurs public et privé, la plupart des intellectuels n'aient pas encore compris que c'est la direction que nous prenons".
L'écrivain et réalisateur italien Ennio Flaiano a dit un jour que le mouvement fasciste était composé de deux groupes : les fascistes et les antifascistes. "Aujourd'hui, alors que la plupart de ceux qui se disent antifascistes soutiennent tacitement ou avec enthousiasme le virage autoritaire dicté par la médecine, ce paradoxe est plus pertinent que jamais", observe Vighi.
L'élite économique et ses sbires politiques ont également détourné la "science", que les citoyens effrayés sont "invités à suivre". La "science" déformée par l'élite est donc un obstacle à la prise de conscience de l'effondrement de l'ancien monde. La vraie science, qui continue d'opérer derrière un épais voile de censure, n'imposerait jamais des mandats dictatoriaux tels que ceux en vigueur aujourd'hui dans les pays qui se disent "démocratiques".
La foi aveugle dans la "science du corona" révèle donc un désir désespéré de s'accrocher au pouvoir capitaliste, même dans sa variante autoritaire. Même si l'ancien système a cessé de fonctionner, "l'illusion du corona permet au capitalisme de suspendre une fois de plus toute enquête sérieuse sur sa maladie structurelle et sur la transformation en cours".
Cette "dictature douce" est déjà monnaie courante. Ce qu'il faut, c'est une prise de conscience autocritique, une désobéissance civile courageuse et un réveil collectif, mais cela ne semble pas se produire à une échelle suffisante. Le jeu de rôle mondial de la crise pandémique, avec ses blocages et ses ouvertures sociales, va se poursuivre. Les maîtres chanteurs de l'urgence seront-ils un jour tenus responsables de leurs actes?
19:07 Publié dans Actualité, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, économie, finances |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Trois commentaires (amers) sur les dernières élections italiennes
La défaite du centre-droit en Italie: personne ne démissionne et personn ne change les équipes d'incompétents
Augusto Grandi
SOURCE : https://electomagazine.it/la-disfatta-del-centrodestra-ma-nessuno-si-dimette-e-nessuno-cambia-squadre-di-incapaci/
Pendant la campagne électorale, lorsque Electomagazine a prédit une défaite générale du centre-droit dans les cinq premières villes (Rome, Milan, Naples, Turin et Bologne), un lecteur a protesté, affirmant que les comptes ne sont faits qu'à la fin. Nous sommes arrivés à la fin et le centre-droit a perdu dans les cinq villes. Il est difficile de faire pire, notamment parce qu'il a très mal perdu. Avec de nets écarts à Rome et Turin après avoir perdu au premier tour dans les autres villes.
Et il est très difficile de renverser la réalité en prétendant que perdre Rome mais tenir bon à Trieste signifie 1:1, que perdre Turin mais gagner à Beinasco et Carmagnola signifie un triomphe. Même à Latina, le centre-droit a réussi à perdre au scrutin après avoir eu l'illusion d'avoir gagné au premier tour.
S'il y avait des hommes politiques cohérents à la tête des partis de centre-droit, l'ensemble de la classe dirigeante aurait démissionné immédiatement. Car il ne suffit pas d'aller à la télévision et d'admettre que, oui, peut-être, les candidats choisis n'étaient pas les meilleurs. Trop commode, et même pas vrai dans certains cas. Paolo Damilano, à Turin, n'était pas un mauvais candidat. La coalition qui a échoué à présenter un projet pour la ville s'est complètement trompée.
Ce qui n'allait pas partout, c'était la stratégie consistant à viser le centre, ces modérés que Berlusconi aime mais qui n'aiment pas Berlusconi. D'autre part, cette course au centre a fait perdre les voix des banlieues. Ils ne se sentent pas représentés par les majordomes de la Confindustria, qui ne se reconnaissent pas dans une politique en faveur de ceux qui font monter les prix pour profiter de la reprise fantôme.
Trois partis, plus divers autres pièges, qui ont abandonné leurs âmes pour partir à la recherche d'un électeur qui n'existe que dans les rêves nocturnes de ceux qui en ont mangé beaucoup. Même l'âme plastifiée de Forza Italia a été mise de côté pour poursuivre le politiquement correct, la sexualité fluide, la culture du cachet, toutes les bêtises imposées par les opposants et véhiculées par les " copines " du sultan. La Ligue a renoncé au fédéralisme, Meloni a coupé les racines mais sans réfléchir à la manière de nourrir l'arbre.
Tous trois - Salvini, Meloni et Berlusconi - sont convaincus que les solistes suffisent à faire gagner leurs partis respectifs et à gouverner l'Italie. Une énorme erreur. Nous avons besoin de grands chefs d'orchestre qui savent réunir d'excellents musiciens, éventuellement les meilleurs pour chaque instrument. Mais pour y parvenir, il faut renverser tout ce qui a été fait ces dernières années. Sans culture, sans préparation, sans étude, vous n'avez pas d'excellents musiciens. Et un chef d'orchestre, aussi bon soit-il, ne transformera pas un groupe d'amis d'amis qui ne savent pas jouer et ne veulent pas apprendre en un grand orchestre.
Augusto Grandi
Sans vision, sans idéologie, sans classe dirigeante, le centre-droit se réunit pour ne rien changer
par Augusto Grandi
SOURCE : https://electomagazine.it/senza-visione-senza-ideologia-senza-classe-dirigente-il-centrodestra-si-incontra-per-non-cambiare/
Le centre-droit italien se réunit pour faire le point sur la situation. En réalité, s'il y avait une once d'honnêteté intellectuelle, cela ne prendrait que le temps d'un café. Parce que l'analyse de la défaite est extrêmement simple. Avant le vote, amis et adversaires, anciens compagnons de voyage et ceux qui aimeraient encore voyager ensemble, l'avaient déjà fait. Tous sont d'accord sur un point : la classe dirigeante des trois partis concernés est désastreuse, irrémédiablement désastreuse. Chacun des analystes pouvait avoir des visions différentes sur la direction à prendre, mais il y avait unanimité sur le bas niveau des classes dirigeantes, quelle que soit leur position politique.
Mais comme c'est cette même classe dirigeante qui fera le point sur la situation, il semble peu probable que cela conduise à un suicide collectif. Dans le meilleur des cas, mais ce sera de toute façon difficile, il sera peut-être possible d'arriver à une toute petite autocritique. Déplacer la responsabilité des défaites sur les candidats et non sur ceux qui les avaient promus. Il sera beaucoup plus difficile d'avoir le courage de remettre en question la bonté des stratégies. Et il est impossible de critiquer les idéologies, pour la simple raison qu'elles n'existent dans aucun des trois partis.
Mais ils sont tous confiants de remporter les élections en 2023. Les sondages sont rassurants, comme ils l'ont été pour ce cycle électoral. Mais les électeurs en ont eu assez d'être menés en bateau et n'ont pas voté. Récompensant, de cette manière, une gauche obtuse mais constamment obtuse. A droite, en revanche, la cohérence est inconnue.
Mais 2023, c'est loin, et il devient compliqué de continuer à esquiver pour éviter de clarifier ses positions. Il n'est pas possible de concilier les slogans de la droite sociale avec les apparitions du majordome de la Confindustria qui demande moins de financement pour les personnes en difficulté et le donne aux grandes entreprises. Il est ridicule d'insister sur la souveraineté et de refuser ensuite d'accepter le fait qu'il existe des mesures pour frapper les entreprises qui délocalisent (ce qui est très différent d'une internationalisation qui ne supprime pas d'emplois en Italie). Il est stupide de demander l'annulation du revenu de citoyenneté en l'absence d'une réelle proposition de création de nouveaux emplois décemment rémunérés.
La gauche, par une opération culturelle et idéologique, a offert à sa base une vision du monde. Discutable, dangereuse, mais appréciée par la base et qui a suscité le vote. À droite, les selfies de Salvini, les bêtises du tribunal d'Arcore sur le sexe et les restrictions à la liberté de pensée, la servilité de Lollobrigida envers les patrons, ont convaincu les anciens électeurs de rester à la maison.
Mais alors, à quoi bon faire le point sur la situation ? Berlusconi s'obstine à ne pas vouloir d'un dauphin décent, le cercle de Garbatella reste retranché dans le grand périphérique de Rome, Salvini est un leader diminué de moitié qui attend de comprendre ce que Giorgetti et Zaia veulent faire quand ils seront grands. Il n'est pas question de "vision du monde". Tout ce que nous pouvons espérer, c'est un nouveau slogan banal et perdant.
Augusto Grandi
Une droite atteinte du Syndrome de Stockholm subira sans cesse des attaques dans les prochains mois
Enrico Toselli
SOURCE : https://electomagazine.it/una-destra-con-la-sindrome-di-stoccolma-sara-sotto-attacco-anche-nei-prossimi-mesi/
La droite italienne est liée aux SS. Le dogue antifasciste peut donc être déchaînée. Avant de comprendre que SS signifie Syndrome de Stockholm. Un article paraît dans Repubblica dans lequel, tout en réaffirmant la fascisterie de Fdi, il n'incite même pas à pendre tous les électeurs de droite. Non représentable, avec un parti à dissoudre mais en évitant de les exterminer. "Comme tu es bon", aurait commenté Fantozzi. Exactement comme ils l'ont commenté à droite.
Mais c'est le même syndrome de Stockholm qui émerge lorsque, dans une élection quelconque, la droite gagne. Et ils se sentent coupables envers leurs adversaires qui, jusqu'à la veille, étaient occupés à cracher sur les nouveaux vainqueurs. Ainsi, pour éviter tout sentiment de culpabilité, les rôles fondamentaux en politique sont confiés à la gauche. Dans l'espoir de s'attirer ses faveurs, d'éviter les protestations et les controverses. Qui, au contraire, sont immédiatement déclenchées.
Quand, au contraire, c'est la gauche qui gagne, elle place tous ses loyalistes à des postes clés. Comme il se doit. Mais le syndrome de Stockholm n'est pas perdu pour la droite vaincue. Il évite ainsi toute opposition sérieuse et crédible. En réalité, il s'agit d'un alibi banal. On ne s'oppose pas, non pas par respect ou par peur de ses adversaires, mais parce que ce serait fatigant. Étudier les dossiers, parcourir les villes pour vérifier les vrais problèmes, mettre en place un dispositif de contre-information. Non, trop compliqué.
Il vaudrait mieux se contenter d'attendre une protestation citoyenne spontanée et tenter ensuite de s'en sortir. Sans même vérifier si la protestation est motivée, si elle est basée sur des faits réels.
Aujourd'hui, nous votons alors que la gauche a déjà remporté trois grandes villes au premier tour. Personne n'a remarqué une intervention pour construire une véritable opposition à Milan, Naples, Bologne. Il est vrai que la campagne électorale de la gauche a été aussi sordide et partisane qu'on puisse l'imaginer, mais l'incapacité de la droite à réagir a été embarrassante.
Et si le modèle d'agression s'avère avoir fonctionné à Rome et à Turin, il est logique qu'il soit répété dans les mois à venir. Sans que la droite ait la moindre idée de comment réagir.
Enrico Toselli
18:40 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : italie, actualité, europe, affaires européennes, élections italiennes, politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
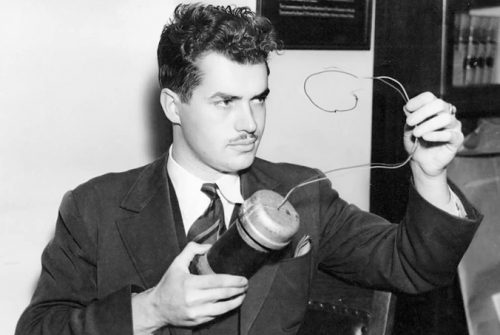
Jack Parsons : Ordre et chaos dans le libéralisme 1.0
Michael Krumpmann
Ex: https://katehon.com/de/article/jack-parsons-ordnung-und-chaos-im-liberalismus-10?fbclid=IwAR3IyAATZfrz-VglYavSts6nE_mVwsQJdC2MrLY24U9KH3uWJaQXvm3juew
Dans un article précédent, j'ai présenté quelques figures du "libéralisme 1.0" dont les idées peuvent constituer une amorce de coopération et/ou d'intégration avec la quatrième théorie politique.
L'essentiel de ses représentants, notamment Hans-Hermann Hoppe et Janusz Korwin-Mikke, peut être résumé sous le terme occulte de "chemin de la main droite". Cela signifie : la construction et le maintien d'un héritage familial commun, une moralité stricte avec une forme d'éthique guerrière, un sens de la famille, de la discipline, et la condamnation de la perversion et de la débauche. Son objectif est de construire et de maintenir l'ordre et d'éviter le chaos. Cela correspond également au caractère de nombreux libertaires, qui désirent en fait une vie tranquille et retirée qu'ils peuvent passer en tant qu'"homme au-dessus du temps" et vivre ainsi "loin de la décadence culturelle ainsi que de la destruction". C'est pourquoi des cas comme celui des Lykov (une famille de vieux croyants en Russie qui a fui à la suite de la révolution et s'est retirée dans les terres désolées de Sibérie et n'a été redécouverte par l'État que dans les années 1990) sont si fascinants pour les libertaires, car ils incarnent leur désir primitif.
Mais cela ne représente qu'un aspect du libertarianisme, ou "libéralisme 1.0", car au-delà, il y avait aussi des libertaires intéressants pour les traditionalistes en ce que leur philosophie représente la "voie de la main gauche", en principe destructrice, y compris la remise en question des "sophismes" sociétaux. L'un de leurs plus célèbres représentants était Jack Parsons, qui dirigeait le Jet Propulsion Lab, lequel a constitué le noyau de l'agence spatiale NASA. La plupart des gens ne connaissent de Parsons que le fait qu'il a essayé de paterner une déesse de la lune dans un rituel occulte et le considèrent donc comme fou. Mais dans ce cas, les apparences sont trompeuses.
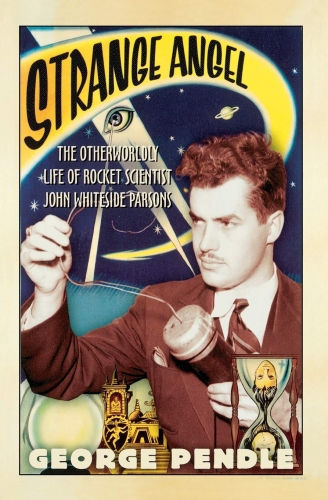
Parsons était non seulement un spécialiste des fusées, un ufologue et un philosophe, mais aussi un adepte de l'occultiste Aleister Crowley. En outre, il était un passeur de frontières entre les théories politiques et était à l'origine un socialiste. Cependant, désillusionné par la nature autoritaire de l'URSS, il passe dans le camp libertaire. Selon Parsons, les idées des pères fondateurs des États-Unis étaient l'expression parfaite de la "vraie volonté" théologique.
Cependant, il ne croyait pas en un "Empire américain", mais était d'avis que les États-Unis actuels trahiraient les principes du libéralisme 1.0. Il partait du principe que les États-Unis allaient lentement se transformer en un État totalitaire et impérialiste qui n'avait de libéral que le nom. À ses yeux, le libéralisme avait le potentiel de devenir un totalitarisme encore pire que les deux autres théories politiques de la modernité (communisme et fascisme), le libéralisme 2.0 de notre époque.
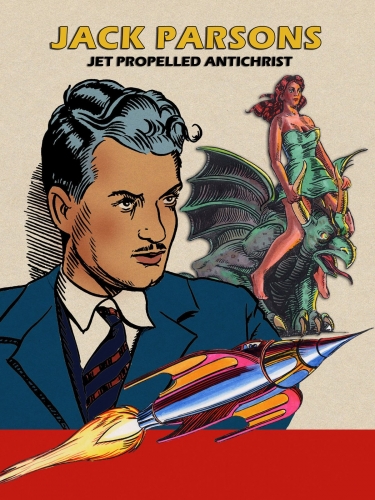
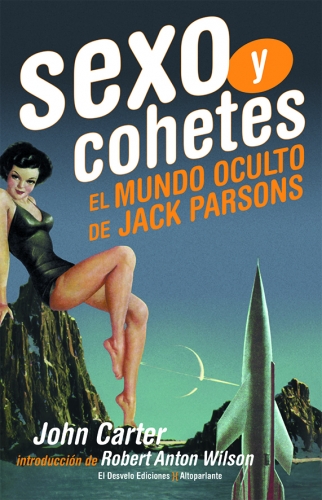
C'est précisément en raison de la descente dans le totalitarisme que l'appareil d'État des États-Unis dégénérerait en une "république bananière" inefficace. La police ne ferait que prétendre assurer la sécurité, mais en réalité, elle ne pourrait rien faire contre les grands criminels. Au lieu de cela, les personnes socialement marginalisées et la population noire seraient harcelées avec toute la sévérité requise afin de prétendre qu'ils se soucient de la sécurité de la population.
Comme la plupart des autres représentants du "libéralisme 1.0" et des existentialistes, il croyait que la paix venait avec la responsabilité. Toutefois, contrairement à la plupart de ses "collègues", il était d'avis que la responsabilité n'inclut pas seulement la responsabilité personnelle, mais aussi la responsabilité envers la communauté. Si les gens n'en tenaient pas compte, la stabilité politique ne serait possible que par l'élimination de l'individu et la mise en place d'un appareil de contrôle global, qu'il fallait bien sûr empêcher.
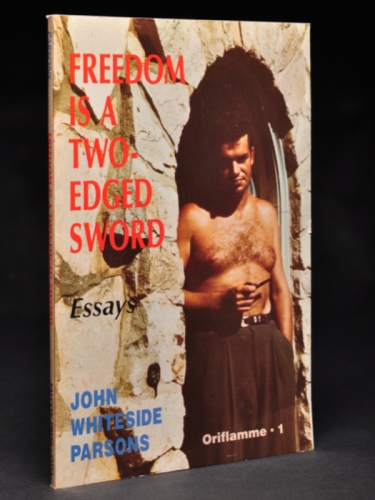
Bien que la première partie de son ouvrage Freedom is a Two Edged Sword (1990) ressemble par endroits à une défense typique de l'État minimal lockéen, il n'était pas partisan d'un tel système étatique. Au contraire, il pensait que même un État minimal ne pouvait pas protéger la liberté humaine. Au contraire, il croyait, par analogie avec Stirner et Nietzsche, qu'un homme qui veut être libre ne doit pas attendre que les autres lui donnent la liberté. Au lieu de cela, il doit se battre lui-même pour sa liberté contre vents et marées. Celui qui attend éternellement que l'État lui donne la liberté restera éternellement un esclave.
La deuxième partie de son œuvre principale porte sur la libération de la féminité. Mais il ne parle pas d'une autre variété du féminisme libéral. Au contraire, il s'agit de la complémentation mutuelle de la masculinité et de la féminité. Il y décrit la femme comme l'incarnation du principe de Shakti avec des termes comme "feu" et "épée flamboyante". En résumé, sa vision du genre se résume au fait que les hommes et les femmes doivent s'entraider pour développer leur potentiel. Parsons a décrit les relations entre les sexes avec la parabole "l'homme est le guerrier et le héros, la femme est sa grande prêtresse".
Ce que Parsons avait à l'esprit comme relations entre les sexes était donc le contraire de la bataille féministe des sexes, de la compétition pour les carrières et de la paranoïa sur la "masculinité toxique", la "culture du viol", etc. Parsons voyait l'homme et la femme comme des compléments qui avaient besoin l'un de l'autre, s'entraidaient et se poussaient mutuellement vers de nouveaux sommets, et non comme des monstres dangereux qu'il fallait protéger l'un de l'autre. Et les deux sexes devraient pouvoir vivre des vies caractérisées par la "passion ardente", l'émotion et la confiance mutuelle, et non des vies mornes de femmes de carrière émancipées et d'esclaves salariées dans les usines sans âme de la bourgeoisie.
Jack Parsons était également un adepte de la "sexualité sacrée" telle qu'elle est pratiquée, entre autres, dans le tantra indien. Et à l'instar de cet enseignement et de philosophes de gauche comme Wilhelm Reich et Georges Bataille, Jack Parsons s'attache également à surmonter les conflits intérieurs, les inhibitions, les blocages et les limitations à l'aide de l'extase. Selon lui, cela constitue également la base d'une plus grande liberté.
Il faut toutefois préciser ici que ces rêves ne se sont pas réalisés dans la soi-disant "révolution sexuelle" de la génération 68, mais que les gens ont même développé une sexualité beaucoup plus névrosée et perturbée à travers le féminisme libéral et ses doctrines qu'à l'époque des puritains. A ce stade, on peut se demander comment cela a pu se produire. L'une des raisons en est certainement que la vision féministe actuelle de l'amour et de la sexualité est façonnée par la doctrine libérale de l'individu indépendant et que, par conséquent, ces "désirs" sont essentiellement considérés comme une menace potentielle pour la liberté individuelle. C'est probablement à cause de la doctrine de l'individu indépendant que la pornographie est également en plein essor, car elle représente une forme de sexualité dans laquelle l'individu n'a pas besoin de partenaire et est donc complètement indépendant.
La pensée de Parsons montre également des traces d'un vitalisme anti-chrétien clairement influencé par Nietzsche, comme le montre également une grande partie de la Nouvelle Gauche. Mais cette action négative envers le christianisme est-elle vraiment encore justifiée ? Car la perte de pouvoir des églises chrétiennes depuis 1945 n'a fait que conduire à la désintégration de la société, à plus de matérialisme, et à des idéologies politiques telles que le libéralisme 2.0 prenant la place du christianisme comme religion de substitution, incluant la morale d'esclave et la mentalité de victime critiquées par Nietzsche. Les chrétiens n'ont jamais eu à l'esprit une transformation culturelle et sociale aussi extrême que celle que prépare le libéralisme 2.0. Au contraire, ils avaient consciemment essayé de suivre la tradition gréco-romaine.
Jack Parsons, contrairement à la plupart des libéraux, n'était en aucun cas un partisan des Lumières et de sa "raison instrumentale" totalitaire. Au contraire, il pensait qu'une trop grande confiance dans la raison entraînerait un évitement de l'inconnu et de l'inexplicable.
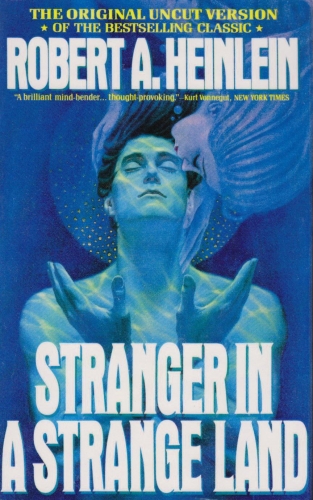
Les idées et la vie de Parsons ont influencé le roman "A Stranger in a Strange World" écrit par son ami Robert Heinlein en 1961. Dans ce livre, un astronaute proclame une nouvelle religion sexo-magique et devient ensuite le sauveur de l'humanité. Ce roman a eu une influence considérable sur la culture hippie. De même, le 15ème chapitre du livre d'Eduard Limonov "L'autre Russie", publié en 2006, présente d'étonnants parallèles avec les idées de Heinlein et semble par endroits être une combinaison de l'œuvre de Heinlein avec les premières idées socialistes de Charles Fourier.
10:29 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jack parsons, futurologie, sexualité, littérature, littérature américaine, lettres, lettres américaines |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

"Explorateurs du continent" par Claudio Mutti: l'Eurasie et le sens de l'unité
par Riccardo Rosati
Ex: https://www.barbadillo.it/79739-cultura-esploratori-del-continente-di-claudio-mutti-eurasia-e-il-senso-dellunita/?fbclid=IwAR2XY0hh1OQi0QZgCHkNXKZrhjUqwKdUlH5AGNymaV1eb-O2HhiW2_v_O6Q
La géopolitique et les outils d'interprétation nécessaires
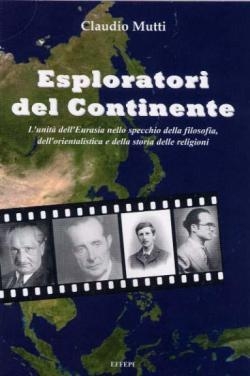 De nos jours, on parle beaucoup de géopolitique, malheureusement souvent sans posséder les instruments d'interprétation nécessaires, faute de lectures essentielles. Cela signifie que cette discipline très complexe est le plus souvent confondue avec le concept de "globalisme", qui analyse tout de manière simpliste comme une série de rapports de force économiques et militaires. La "victime" choisie de cette perspective erronée est le mot Eurasie. Il suffirait honnêtement de peu de choses pour ne pas confondre géopolitique et mondialisation, il suffirait de se référer aux lectures évoquées plus haut, soit les livres de Halford John Mackinder à ceux de Karl Haushofer, sans oublier Jean Thiriart; pour ne citer que l'école européenne, car la géopolitique a des bases très solides chez de nombreux chercheurs russes. Un outil utile pour commencer à mieux comprendre les fondements du raisonnement géopolitique se trouve dans le livre de Claudio Mutti: Esploratori del Continente. L'unité de l'Eurasie au miroir de la philosophie, de l'orientalisme et de l'histoire des religions.
De nos jours, on parle beaucoup de géopolitique, malheureusement souvent sans posséder les instruments d'interprétation nécessaires, faute de lectures essentielles. Cela signifie que cette discipline très complexe est le plus souvent confondue avec le concept de "globalisme", qui analyse tout de manière simpliste comme une série de rapports de force économiques et militaires. La "victime" choisie de cette perspective erronée est le mot Eurasie. Il suffirait honnêtement de peu de choses pour ne pas confondre géopolitique et mondialisation, il suffirait de se référer aux lectures évoquées plus haut, soit les livres de Halford John Mackinder à ceux de Karl Haushofer, sans oublier Jean Thiriart; pour ne citer que l'école européenne, car la géopolitique a des bases très solides chez de nombreux chercheurs russes. Un outil utile pour commencer à mieux comprendre les fondements du raisonnement géopolitique se trouve dans le livre de Claudio Mutti: Esploratori del Continente. L'unité de l'Eurasie au miroir de la philosophie, de l'orientalisme et de l'histoire des religions.
Bien qu'il ait été publié il y a quelques années, il traite dans un langage simple de questions qui sont toujours d'une brûlante actualité. En effet, il ne faut pas se laisser abuser par le caractère essentiel des écrits de ce volume, dû à la volonté de clarifier et non d'embrouiller les idées du lecteur sur un sujet d'une énorme complexité. Ce n'est pas pour rien que chaque chapitre est accompagné d'un certain nombre de notes qui donnent une bonne idée de la grande qualité de cet ouvrage. Cela ne devrait pas surprendre, si l'on considère que l'auteur est également le fondateur de la revue Eurasia, qui tente depuis des années de proposer une interprétation différente de cette discipline, en s'opposant courageusement à l'occidentalo-centrisme des publications les plus populaires et qui sont, malheureusement, accréditées dans les cercles de l'élite comme possédant des compétences spécifiques que, bien au contraire, elles n'ont pas, déclinant continuellement la géopolitique à travers la lentille déformée de l'économie et d'un Droit International qui loue obstinément le Global Power.
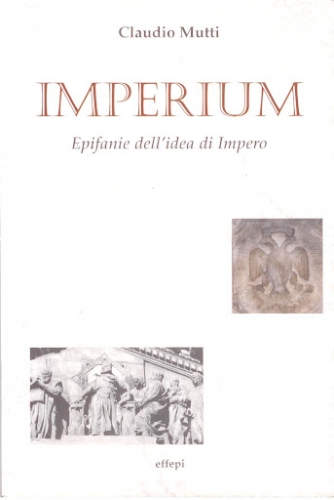
L'élément géographique et le facteur continental
Dans son introduction à l'ouvrage, Tiberio Graziani souligne combien le raisonnement de ce livre, bien qu'il porte sur des figures d'un passé plus ou moins récent, reste le raisonnement essentiel du débat géopolitique actuel: "La dimension continentale, ou largement régionale, semble constituer, en fait, l'entité géopolitique la plus sensible aux besoins historiques actuels de la population mondiale" (7). Il s'agit de préciser d'emblée comment l'approche "continentaliste", précisément parce qu'elle se fonde sur cet élément géographique si cher à Haushofer en particulier, reconnaît et valorise non seulement l'articulation géographique, mais aussi l'aspect géoculturel, donc l'identité, tant d'un point de vue ethnique que spirituel, relevant pleinement de la sphère des études dites traditionnelles. En ce qui concerne le continent eurasien, qui représente la portion la plus riche de la planète en termes de civilisation, il n'existe actuellement aucun texte en italien qui analyse pleinement son organicité géoculturelle. Le recueil d'essais de Claudio Mutti présenté ici contribue à combler cette lacune.
En examinant les travaux d'importants philosophes, orientalistes et historiens des religions des XIXe et XXe siècles, l'auteur nous permet de prendre conscience d'une convergence entre les nombreuses entités culturelles de l'Eurasie, qui ne doivent pas être comprises, comme on l'a dit, comme de simples facteurs économico-géographiques, mais plutôt comme de multiples éléments culturels, apparemment très différents, mais qui, si on les examine avec une approche traditionnelle - et c'est ce que fait Mutti - se révèlent unis par un lien profond. Certains des noms mentionnés dans ce livre sont connus, au moins par ouï-dire, du public qui lit (Friedrich Nietzsche, Giuseppe Tucci, Mircea Eliade, Martin Heidegger), d'autres moins (Italo Pizzi, Ananda K. Coomaraswamy, Franz Altheim, Henry Corbin), et c'est précisément en retraçant le rapport de ces derniers avec l'Asie que Mutti ouvre des perspectives en partie nouvelles. En effet, ces derniers temps, dans des milieux qui se présentent comme "dissidents" et aux attitudes abusivement juvéniles, on a régulièrement tendance à dire ce qui a déjà été dit, en s'attardant sur les auteurs habituels: Evola, Jünger, Spengler, pour se retrouver à colporter des raisonnements palustres comme s'ils étaient novateurs ou, pire encore, à pousser le désir d'être original jusqu'à l'inexactitude. Tout cela n'appartient pas du tout à la manière de faire de la recherche de Mutti, comme le démontre également ce travail, puisqu'il vient d'une formation "ancienne", et donc sérieuse, qui ne considère pas le présentisme culturel comme synonyme de compétence.
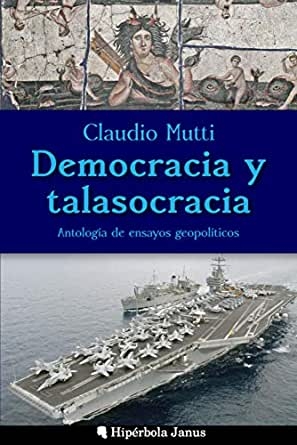
Pendant longtemps, les analystes désemparés qui circulent tant à droite qu'à gauche n'ont pas été en mesure de nous fournir les outils appropriés pour comprendre pleinement la valeur cruciale de la dimension continentale. Néanmoins, la reconstruction d'entités géopolitiques plus conformes aux besoins historiques actuels de la population mondiale est le seul remède pour arrêter la dégénérescence de la politique internationale.
Quand on fait ne serait-ce qu'une allusion au fameux plan Kalergi, on est immédiatement accusé de conspiration. Cependant, les objectifs fixés au début des années 1920 par Richard Coudenhove-Kalergi (1894 - 1972) ont presque tous été atteints. Et c'est précisément en examinant l'état actuel du continent européen, mais vu sous l'angle de quelques éminents savants et penseurs du passé, que Mutti met indirectement à nu la crise d'identité des peuples occidentaux, et ce en citant des sources faisant autorité, des personnes qui se sont penchées avec une sophistication intellectuelle sur ce problème.
Par exemple, dans les toutes premières pages du livre, on rappelle les paroles de Nietzsche qui, réitérant sa haine tenace du nationalisme, réussit à résumer parfaitement la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, ayant également anticipé cette société apatride tant encouragée par le Global Power: "[...] ces circonstances amènent nécessairement avec elles un affaiblissement et à la fin une destruction des nations, au moins de celles qui sont européennes ; de sorte que d'elles toutes, par suite d'un métissage constant, devra naître une race mixte, celle de l'homme européen" (13). En ce qui concerne Nietzsche, il semble clair que son intérêt pour la spiritualité indienne était violemment anti-chrétien. Cela nous permet de mettre en évidence deux éléments qui caractérisent l'écriture de Mutti. C'est-à-dire que les personnalités qu'il considère se répartissent en deux catégories: les spécialistes de l'Orient, souvent aussi explorateurs de ces terres lointaines d'une part; les grands intellectuels fascinés par les cultures asiatiques d'autre part. Dans le cas de Nietzsche, et nous le disons avec le plus grand respect pour ce philosophe nodal, il est clair pour l'orientaliste qu'il jugeait plutôt qu'il ne voyageait ! C'est un Orient "exploité" pour parler, et mal, de l'Occident. A notre avis, cela affaiblit partiellement sa réflexion sur la relation entre ces deux continents.
Des érudits à redécouvrir
À l'ère des livres qui ne servent pas ou peu à enrichir sa culture, découvrir quelque chose de nouveau est une grande source de réconfort; n'est-ce pas à cela que sert la non-fiction? S'il s'agit d'un autre savant italien oublié par la modernité, la joie est double. Mutti nous parle d'Italo Pizzi (1849-1920) (photo, ci-dessous), un iraniste et un homme de grande culture.

En 1969, l'éminent arabisant Francesco Gabrieli dénonçait comme suit l'effacement de la mémoire de Pizzi dans notre Académie, coupable d'être toujours distraite: "l'oubli presque total dans lequel est tombé aujourd'hui ce laborieux vulgarisateur de la culture exotique" (29); des mots qui, il y a quelques années déjà, révélaient les maux de l'orientalisme italien, c'est-à-dire l'occultation, même dans les bibliographies, de tous ces noms qui, dans le passé, ont fait la grandeur des études italiennes sur l'Asie, en leur préférant ponctuellement des spécialistes anglo-saxons, ou des chercheurs contemporains qui, dans nos universités, se sont révélés peu à la hauteur de cette somptueuse tradition intellectuelle. Quant aux réflexions de Pizzi sur l'Orient, il souligne la grande pertinence de la littérature persane pour la littérature occidentale: "Or, ce qu'un poète persan a pu faire, on voit mal pourquoi un poète grec, dans des conditions peut-être pas si différentes, ne pourrait pas le faire" (33). Bien que Mutti souligne certaines analyses peut-être trop simplistes de la part de cet important orientaliste, il loue néanmoins sa capacité à avoir identifié dans le monde proto-musulman moyen-oriental, et dans le monde islamique en général, une ressource qui peut et doit encore être une source d'intérêt pour nous. L'histoire de la recherche italienne dans ce secteur est également glorieuse, grâce à de nombreux islamistes (pensons à Carlo Alfonso Nallino, auquel un prestigieux centre d'études est dédié à Rome, et qui fut un étudiant de Pizzi) et iranistes de grande importance, dont Pizzi est un digne membre. S'il y avait plus de livres, comme celui-ci, qui nous fassent redécouvrir de nombreux noms oubliés de la connaissance, l'orientalisme italien vivrait une saison différente de la présente.
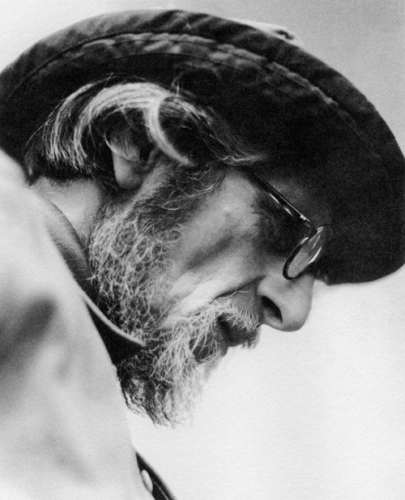
Ananda K. Coomaraswamy (1877 - 1947) est l'un des plus grands représentants de la Pensée traditionnelle, même s'il est connu presque exclusivement par ceux qui s'occupent de ce courant philosophique particulier. L'érudit d'origine cinghalaise est souvent présent dans les écrits que Mutti a adressés au fil des ans à une vision traditionnelle de l'art, compris comme une expression de la spiritualité humaine et non, comme c'est le cas depuis des décennies, comme un simple fait historico-technique. Dans le chapitre qui lui est consacré, il est expliqué comment Coomaraswamy voyait une convergence entre l'Occident et l'Orient dans l'art, mais uniquement dans l'art traditionnel, tout en critiquant la décadence intrinsèque de l'art moderne: "qui n'a pas d'autre fin que lui-même" (46).
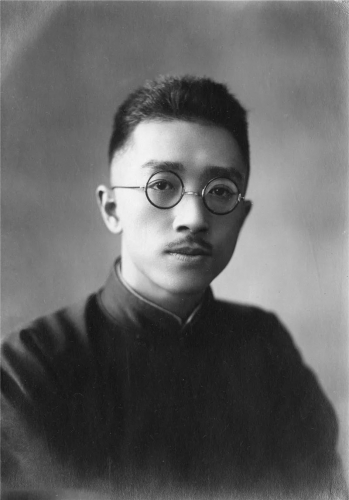
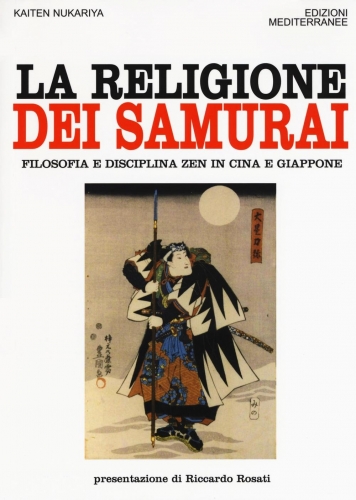
Coomaraswamy a servi de pont entre l'art occidental et l'art oriental, étant parfaitement versé dans les deux, parlant ainsi en vertu d'une compétence scientifique complète. En cela, il nous rappelle ce que le Japonais Kaiten Nukariya (1867-1934) a fait dans le domaine religieux, en essayant de raconter le bouddhisme zen aux Occidentaux d'une manière compréhensible pour nous, et avec des références également au christianisme, dans son livre, que nous avons introduit et édité : La religione dei samurai. Filosofia e disciplina zen in Cina e Giappone (Roma, Edizioni Mediterranee, 2016). En outre, le livre de Mutti a pour principal objectif de reconstruire un lien continental entre l'Orient et l'Occident, en retraçant les œuvres et les pensées des personnalités qui ont traité de cette question au fil du temps. Il va sans dire, compte tenu du thème du livre et de son auteur, qu'un chapitre sur Mircea Eliade ne pouvait manquer. Il y aurait trop de choses à dire sur ce que le chercheur roumain a fait pour l'histoire des religions, principalement sur la culture chamanique, qui est l'une des âmes profondes des peuples eurasiens. Néanmoins, il convient de s'attarder sur ce qui était le concept clé d'Eliade concernant l'Eurasie. C'est-à-dire un vaste espace géographique et spirituel qui, pour lui, trouve son centre en Roumanie, qu'il considère comme le "cœur" de l'Eurasie (66).
La théorie de Mutti selon laquelle le continent eurasien nous concerne de près, puisqu'il s'étend jusqu'à l'Europe, est à notre avis convaincante et bien documentée. La seule remarque que nous pouvons faire est qu'il s'agit d'une perspective géopolitique purement européenne. En fait, pour les géopoliticiens russes, que l'on pourrait définir comme appartenant à un eurasisme intégral, l'Eurasie est une entité géographique qui n'est certainement pas en conflit avec l'entité européenne, mais encore autre, presque alternative.
Inversez le cours !
Au terme de notre analyse, il est utile de rappeler les mots de la présentation de Graziani, qui expliquent parfaitement l'objectif du livre de Claudio Mutti, à savoir se proposer comme une invitation puissante et rigoureuse : "[...] redécouvrir l'unité intime des différentes manifestations culturelles de l'Eurasie" (8), afin d'inverser le cours indiqué par cette incapacité à comprendre l'Orient de la part de ceux que nous avons appelés pendant des années les bienfaiteurs du progrès. La position de Mutti est en ligne avec celle exprimée il y a des années par le plus grand orientaliste de l'ère moderne, Giuseppe Tucci (auquel un chapitre spécial est consacré), qui était clair sur l'importance de tracer d'abord et de reconstruire ensuite une unité spirituelle eurasienne. En effet, les intérêts de recherche variés et sophistiqués de Tucci comprennent également l'eurasisme ; d'ailleurs, son IsMEO (Institut italien pour le Moyen-Orient et l'Extrême-Orient) a été fondé précisément pour jouer un rôle d'acteur culturel et politique dans plusieurs des pays qui font partie de l'unité continentale susmentionnée. Cette dernière a été presque une obsession pour Tucci (photo, ci-dessous) jusqu'à la fin de sa vie, comme le rappelle Mutti, citant ce qui fut probablement le dernier discours public du grand savant italien, dans une interview accordée au quotidien La Stampa le 20 octobre 1983 : "Je ne parle jamais d'Europe et d'Asie, mais d'Eurasie. Il n'y a pas un événement qui se déroule en Chine ou en Inde qui ne nous influence pas, ou vice versa, et il en a toujours été ainsi" (55).

Dans son invitation à redécouvrir les réflexions sur l'Asie de quelques-uns des grands esprits de l'Occident, Mutti ne cache pas que l'"inquisition néo-lumières" qui a caractérisé le savoir en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale a sensiblement fait reculer la pensée, élisant la notion simple et stérile, disjointe du raisonnement, à une sorte de valeur de caste chez les professeurs et assimilés. Pour cette raison, nous ne pouvons qu'être d'accord avec Mutti lorsqu'il parle de "[...] l'insuffisance de l'érudition académique face aux doctrines spirituelles" (37). En effet, si l'on a l'illusion de pouvoir comprendre le Moyen-Orient et l'Extrême-Orient en apprenant des choses par cœur - quand cela se passe bien - en considérant le développement d'une perception de ce que ces peuples ressentent réellement comme superflu, alors il ne faut pas s'étonner du tout que ces personnes bavardent systématiquement sur la "civilisation".
* Nous tenons à remercier Annarita Mavelli, spécialiste de l'eurasianisme intégral, qui nous a aidés à aborder les questions traitées dans ce volume.
*Explorateurs du Continent. L'unité de l'Eurasie dans le contexte de la filosofia, de l'orientalisme et de l'histoire des religions par Claudio Mutti (Genova, Effepi, 2011).
10:10 Publié dans Eurasisme, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cvlaudio mutti, livre, eurasie, asie, eurasisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Mémoire historique: mai 68 n'était pas ce qu'on vous a dit
Ernesto Milà
Ex: http://info-krisis.blogspot.com/2021/10/la-memoria-historica-de-anteayer.html
Mai 2021 sera le 53ème anniversaire de la "révolution de mai". Bien que le rôle protagoniste incontestable de ses événements ait été joué par l'extrême gauche, les groupes néofascistes français ont joué un rôle important dans le déclenchement des événements en ces jours tendus. Dans l'article suivant, nous examinerons le rôle de ces groupes dans les événements traumatisants du "Mai français".
La blessure algérienne
En février 1963, le colonel Argoud, alors chef de l'OAS, Organisation de l'Armée Secrète, qui avait lutté contre l'abandon de l'Algérie, est enlevé à Munich. De Gaulle était revenu au pouvoir en 1958 avec un programme qui, au départ, indiquait clairement que la France n'accorderait pas l'indépendance à l'Algérie, même sous la pression du terrorisme du Front de libération nationale. Quelques années plus tard, cependant, il ne restait rien de ces intentions initiales et le cri gaulliste de "l'Algérie française" fut ignominieusement remplacé par la signature des Accords d'Évian qui inaugurèrent l'indépendance de l'Algérie, avec pour conséquence l'expulsion de 1,5 million de colons français et la fuite prudente de 150.000 harkis (Algériens d'origine ayant collaboré à la colonisation française).

Une grande partie de l'armée refuse d'accepter la signature des accords d'Évian et la rétrocession de l'Algérie, mais elle retient sa protestation et décide d'adopter une position critique mais silencieuse et de se conformer de manière disciplinée aux ordres de de Gaulle d'abandonner l'Algérie; une autre partie de l'armée, minoritaire, opte pour la voie du coup d'État et, lorsque celui-ci échoue, elle opte pour la résistance armée et le terrorisme avec des groupes d'activistes civils (voir la dernière partie de l'article sur Jeune Nation dans RHF-V).
Les auteurs du coup d'État et les membres de l'OAS ont dû purger de lourdes peines de prison, tandis que de nombreux autres sont restés en exil forcé. Leurs camarades restés fidèles à de Gaulle, moins par conviction que par discipline, n'oublient pas complètement ceux qui ont fait ce qu'ils n'ont pas osé faire. En 1968, ces soldats occupent les plus hautes fonctions de l'armée française et commandent les unités offensives les plus puissantes stationnées en Allemagne. Grâce à ces unités, De Gaulle a pu rester au pouvoir pendant la révolte de mai 1968, mais ce n'était pas pour rien: la contrepartie était l'amnistie pour les membres de l'OAS et pour les soldats emprisonnés pour avoir participé à la lutte pour l'"Algérie française". Si Mai 68 a servi à quelque chose, c'est, paradoxalement, à panser les blessures entre les deux factions militaires. Mais il y avait autre chose.
De l'OAS au Front Uni de Soutien au Sud-Vietnam
Après la fin du terrorisme de l'OAS et l'arrestation de ses derniers noyaux militants, l'extrême droite française tente de se regrouper mais ne peut éviter de se polariser en deux branches: dont celle d'Europe-Action, fondée par Dominique Venner, qui fut, à la fin de sa vie, directeur de la Nouvelle Revue d'Histoire; il avait développé une théorie du travail politique pendant son séjour en prison et l'avait couchée sur le papier dans le pamphlet Pour une critique positive. En janvier 1963, paraît le premier numéro de la revue Europe-Action, tirée à 10.000 exemplaires, entièrement réalisée par des jeunes ayant participé soit à l'OAS, soit à la guerre d'Algérie, soit à d'autres groupes militants. Le magazine sera l'organe de la Fédération des Etudiants Nationalistes (voir l'article de RHF-V sur Jeune Nation mentionné ci-dessus). Ce groupe soutient la candidature de Tixier-Vignancour à la présidence de la République en 1965 et devient en juin 1968 - quinze jours à peine après la fin officielle des émeutes de mai - la revue Nouvelle Ecole, noyau de diffusion des idées de la "nouvelle droite", dont l'activité se poursuit encore aujourd'hui.
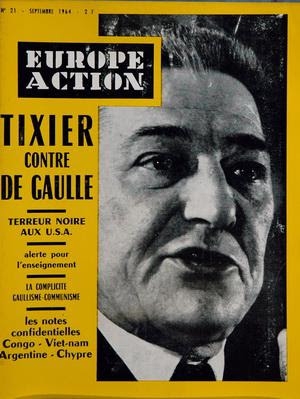
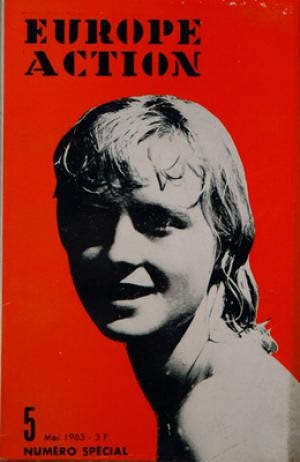
Au sein de la FEN, et précisément pour protester contre la candidature de Tixier-Vignancour, une dissidence s'est formée qui a d'abord tenté de contacter le Belge Jean Thiriart, directeur du mouvement Jeune Europe, avec lequel ils n'ont pas réussi à s'entendre, puis Pierre Sidos, le fondateur de Jeune Nation, qui avait été l'un des piliers de la résistance contre la capitulation de l'Algérie, organisation dissoute après le coup d'État des généraux contre De Gaulle. Sidos postule la fondation d'un nouveau mouvement pour lequel il propose le nom d'Occident, qui avait déjà été utilisé par l'ancienne revue soutenant le camp de Franco pendant la guerre civile espagnole et avait une certaine tradition parmi l'extrême droite française. Fin avril 1964, la nouvelle formation, le Mouvement Occidental, est officiellement fondée et affiche d'emblée sa vocation de mouvement militant déterminé à combattre les gauchistes dans la rue, comme s'il s'agissait d'une réédition de Jeune Nation.

Peu après sa création, Sidos avait déjà exprimé sa volonté d'empêcher, avec ses 70 militants, le rassemblement anticolonialiste que les étudiants africains vivant à Paris allaient organiser le 1er mai de cette même année. C'était dit et fait. Les 400 personnes qui participaient à la réunion ont été brutalement dispersées et les locaux de la Mutualité où devait se tenir la réunion ont été fortement endommagés. Tout au long des mois de mai et juin, les affrontements avec les étudiants communistes se sont multipliés presque sans interruption. Le 12 juin, 60 militants d'Occident ont pris d'assaut le cinéma Le Savoir où la CGT (syndicat communiste) et l'UNEF (syndicat étudiant communiste) organisaient un spectacle pacifiste. A cette occasion, les 2000 spectateurs ont dû se disperser devant la virulence de l'agression.
Tous ces incidents ont conduit à quelques arrestations et Sidos a conseillé à ses partisans de se calmer. Puis, en 1965, ont lieu les élections présidentielles auxquelles Occident ne participe pas et qui éclipsent toute autre activité politique. La première crise interne du nouveau mouvement se produit lorsque les militants les plus activistes expulsent Sidos en février 1966 alors qu'il tente de conclure un pacte avec Venner pour fusionner avec la FEN dans ce qui aurait été une reconstruction de l'ancien mouvement Jeune Nation. L'expulsion de Sidos fait échouer l'opération et peu après, il forme L'Oeuvre Française, dont le nom est presque une réponse à l'Action Française et indique le degré de parenté et de familiarité entre les thèses nationalistes de Sidos et le maurrassisme. Sans la retenue de Sidos, Occident participe à toutes les opérations provocatrices et violentes que sa petite armée lui permet de mener. L'échec de la candidature de Tixier-Vignancour aux élections présidentielles cette année-là, candidature qui avait été soutenue par la FEN et Europe Action, conduit à la transformation de ce groupe en ce qui deviendra plus tard la Nouvelle Ecole et la nouvelle droite, s'éloignant de l'action politique. Le champ est ainsi dégagé pour Occident.
"Le Vietnam va gagner, Vietcongs meurtriers"
D'on ne sait où, l'un des leaders d'Occident, Philippe Asselin, obtient de l'argent avec lequel il loue des locaux fortifiés et publie une revue destinée aux étudiants universitaires. François Duprat, qui vient de rentrer du Congo, rejoint le groupe. C'est Duprat et un autre militant d'Occident qui publient le premier commentaire de l'œuvre d'Herbert Marcuse, l'un des gourous de la contestation, diffusé en français en mars 1965. Un an plus tard, cependant, le mouvement s'est lancé dans l'activisme le plus frénétique.
Le 15 mars, un groupe de militants d'Occident a mené une opération de représailles à l'université de la Sorbonne, où cinq militants d'un autre groupe d'extrême-droite avaient été attaqués quelques jours auparavant. À l'époque, Occident a largué des tracts dont le texte reproduisait simplement une phrase du général indonésien Suharto, célèbre à l'époque: "Tuez tous les communistes où qu'ils se trouvent". Occident jouait manifestement la carte de la provocation. Dès lors, toute l'opinion publique française, et notamment les étudiants de gauche, savent qui est Occident. Le 26 mars suivant, ils se sont heurtés à la police lorsque celle-ci a tenté d'empêcher un rassemblement de la Ligue de la jeunesse communiste dans le Quartier latin. Presque sans interruption, en pleine frénésie militante, ils ont boycotté une pièce de Jean Genet, Les Paravents, qui aurait insulté l'armée française. En octobre 1966, ils ouvrent une salle au cœur du quartier latin, rue Serpente. Suivront, au cours du dernier trimestre de cette année, des manifestations à l'occasion du dixième anniversaire de l'invasion de la Hongrie par l'armée soviétique et des luttes répétées pour expulser les gauchistes de leur fief à l'université de Nanterre. Certains militants d'Occident se sont inscrits à la faculté de philosophie et lettres de Nanterre et sont bien représentés au conseil de l'université. Leurs camarades de classe sont Daniel Cohn-Bendit, les frères Castro, Brumberg et Caruso, leaders d'une extrême gauche encore mal définie, mais exceptionnellement active et violente. Nous approchions rapidement du scénario politique qui déclencherait le "mai français".
Le 17 octobre 1966, sept militants d'Occident prennent d'assaut la cafétéria de l'université de Nanterre et expulsent soixante-dix gauchistes qui doivent se tourner vers les étudiants du PCF pour obtenir de l'aide. Le lendemain, les incidents se sont répétés, mais ils n'étaient pas seulement sept mais trente, et ils ont été confrontés à 150 gauchistes. L'affrontement a fait des dizaines de blessés et a contribué au climat de violence qui allait réapparaître continuellement à partir de ce moment-là. Début décembre 1967, Paris Match publie des photos des incidents qui ont eu lieu quelques jours plus tôt à Nanterre. Les images, dans lesquelles on pouvait voir des militants d'Occident, ont choqué l'opinion publique par leur brutalité.
L'année suivante sera encore plus dure. Des groupes pro-chinois et trotskystes sont apparus, travaillant principalement dans les universités et diffusant des slogans contre la guerre du Vietnam et en soutien au Vietcong. Cela a incité Occident à créer une contrepartie, le Front Uni de Soutien au Sud Vietnam. Le 7 février 1968, ce Front tente de tenir sa première réunion dans la grande salle de la Mutualité à Paris, mais l'extrême gauche appelle à la mobilisation générale: "Le nazisme ne passera pas". La réunion, assiégée par 3000 maoïstes, s'est terminée suite à bon nombre d'incidents majeurs. Les les militants d'Occident ont ensuite manifesté sur le boulevard Saint Michel aux cris de "Viêtcongs assassins" et "Occident vaincra". Le résultat final est favorable à Occident et le Front a pu envoyer 4000 francs collectés lors du rassemblement pour la construction d'un hôpital au Sud-Vietnam. Et comme cette journée a été jugée comme un succès, deux autres journées ont été convoquées pour les 30 et 31 mars 1968. Le 30, 2000 manifestants défilent derrière des drapeaux sud-vietnamiens sur l'avenue Wagram. Le gouvernement sud-vietnamien fera un usage intensif des photos prises à cette occasion. En l'espace de quelques semaines, le Front, soutenu par Occident, a rassemblé 1500 sympathisants et acquis une notoriété médiatique.
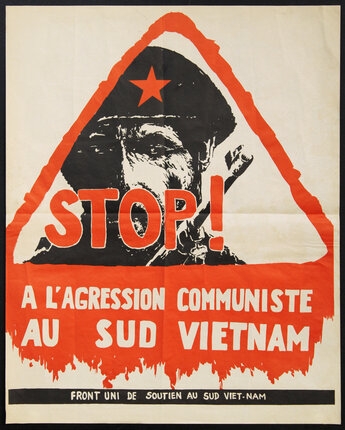
Dans un contexte de violence croissante, on assiste à des tentatives de lynchage de membres d'Occident et à la fameuse réplique de Cohn-Bendit au ministre de l'éducation François Missoffe, prélude à la crise qui occupera une grande partie des médias. Occident ordonne à ses militants de "marcher sur Nanterre". Mais les maoïstes sont allés de l'avant et ont mené une attaque éclair le 29 avril contre l'exposition du Front dans la rue de Rennes. Deux cent cinquante maoïstes de l'UJC-ML avec leur "direction militaire" à la tête ont pris d'assaut l'exposition alors qu'elle était à peine défendue par 10 militants qui ont été littéralement massacrés. Suite à cette attaque, les dirigeants d'Occident ont appelé à un rassemblement... qui se tiendra à l'université de Nanterre le 2 mai.
L'UJC-ML (Union de la jeunesse communiste marxiste-léniniste, formation maoïste) cède à sa "direction militaire" et, avec les membres du Mouvement du 22 mars de Cohn-Bendit (anarcho-situationnistes), se barricade dans la faculté en stockant des cocktails Molotov, des barres de fer, des bâtons et des manches en bois. Une assemblée d'extrême gauche confie la direction de la défense de Nanterre à Xavier Langlade, chef de la JCR (Jeunesse communiste révolutionnaire, d'obédience trotskiste). A l'entrée de la faculté, ils ont installé une banderole: "Fascistes échappés de Dien Bien Fu, vous n'échapperez pas à Nanterre"... Cependant, les prisonniers barricadés ne sont pas aussi optimistes que leurs banderoles le laissent croire. Ils craignaient à tout moment l'assaut de 250 militants d'Occident capables d'une violence sans précédent que la gauche n'avait que trop bien connue à son propre détriment. Finalement, le ministère de l'éducation a ordonné la fermeture de la faculté. Ainsi, ce qui ne pouvait avoir lieu à Nanterre, loin du centre de Paris, aurait lieu dans le Quartier latin, à la faculté de La Sorbonne, au cœur de Paris.
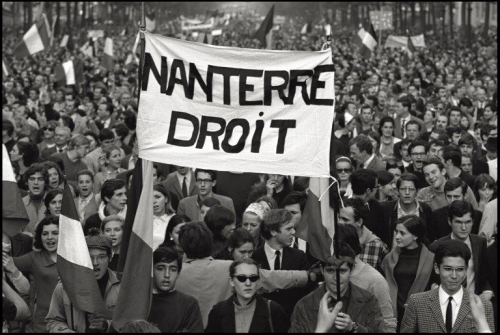
Les surprises du mois de mai
Puis vint un étrange attentat que personne n'a revendiqué et que, quarante ans plus tard, personne n'a réussi à élucider. Le matin du 3 mai 1968, une bombe a explosé à la Sorbonne, sur le point de détruire complètement la faculté. Les conduites de gaz avaient été sabotées. Tous les groupes d'extrême droite et d'extrême gauche se sont attaqués les uns aux autres et se sont mutuellement accusés d'avoir provoqué l'explosion. L'attentat a amené les gauchistes à se barricader dans la Sorbonne et les militants d'Occident dans "leur" faculté de droit de la rue d'Assas; à 14 heures, 200 d'entre eux ont tenté de manifester devant la Sorbonne. Ils notent que, malgré la tension, le cordon de police a disparu. À cette occasion, ils n'ont pas emporté leurs instruments de combat avec eux, mais dans trois camionnettes qui suivaient de près les manifestants. En chemin, ils ont décidé de se retirer. Il y a une chose qu'ils ne comprennent pas et qui leur échappe: qui a donné l'ordre aux policiers de se retirer? Ils décident donc de manifester sur le boulevard Saint Michel, à l'endroit même où les gauchistes de la FER (Fédération des étudiants révolutionnaires, autre groupe trotzkyste à tendance "lambertiste") et les maoïstes de l'UJC-ML tentent de se regrouper. À ce moment-là, les trois fourgons qui suivaient les membres d'Occident distribuent leur cargaison. Parmi les objets contondants, le premier cocktail Molotov de Mai 68 sera lancé par un étudiant d'Occident sur l'un des véhicules de police. La "Révolution de Mai" venait d'exploser...
L'armée française face aux émeutes de mai
Le "coup d'Alger" (soulèvement du 1er Régiment de parachutistes) avait échoué par manque de préparation et de solidarité de la part de la plupart des militaires et la répression à laquelle il a donné lieu, d'abord l'exécution du lieutenant-colonel Bastien-Thiry et, enfin, l'assassinat par les "barbouzes" (forces mercenaires, véritables tueurs à gages du Service d'action gaulliste) de dizaines de partisans de l'"Algérie française", dont de nombreux militaires, et l'enlèvement de dizaines de "Français d'Algérie". Bien que la majorité des forces armées françaises soient suffisamment disciplinées pour se conformer à l'autorité du général de Gaulle, très peu le soutiennent activement et tous veulent panser les blessures que la crise algérienne et l'OAS ont infligées aux forces armées. Beaucoup ont gardé l'occasion de faire amende honorable. Les événements du mois de mai leur ont donné l'occasion de le faire. Et ils l'ont saisi.
Six mois plus tôt seulement, en décembre 1967, des informations étaient parvenues à la deuxième section de l'état-major de l'armée sur les activités des cellules de l'UJC-ML dans certaines unités, à savoir le 9ème régiment de hussards, le 43ème régiment d'infanterie et le 151ème régiment de chars. Les activités de ces cellules consistaient à diffuser les magazines et le matériel de l'organisation et à gagner des sympathisants et des membres pour l'organisation. La sécurité militaire a retrouvé les militants, les a dispersés dans différentes unités et les a placés sous surveillance.
Toutefois, cet épisode a amené les services de renseignement militaires à s'inquiéter de l'émergence de ces groupes et, comme les services de sécurité civils de l'État ne leur fournissaient pas d'informations efficaces sur la situation, ils ont dû créer leur propre réseau d'informateurs et constituer leurs propres dossiers sur ces petites formations de jeunes extrémistes.
C'est la première fois depuis la guerre d'Algérie que l'armée française s'intéresse aux groupes politiques. Et ce qu'elle a vu l'a plongée dans la confusion. Les rapports produits avant le mois de mai, qui tentaient de dresser un portrait de l'extrême gauche, étaient inexacts, confus, pleins d'erreurs et pratiquement inutiles. Ils n'ont pu que décrire les organisations de jeunesse du vieux parti communiste pro-soviétique, le seul qui, jusqu'à la percée de l'UCJ-ML dans les casernes, les avait concernés. Le problème est que ces informations sont anciennes et donc inutiles. Lorsque les premiers incidents éclatent au Quartier latin le 3 mai, l'armée française est pratiquement hors circuit et ignore tout de l'activité et des caractéristiques des groupes.
Le 11 mai, le ministre de la Défense, Pierre Messmer, après avoir fait ses adieux au Premier ministre afghan qui était resté en France en visite officielle, s'est empressé de rencontrer quelques conseillers et de prendre quelques mesures de précaution contre ce qui pourrait arriver. Il faut rappeler qu'à cette époque, dans la nuit du 10 au 11 mai, a lieu la fameuse " nuit des barricades " dans la rue Gay-Lussac, sur laquelle nous reviendrons un peu plus loin, mais qui marque en tout cas le paroxysme des émeutes.
A ce moment, la 11ème Brigade blindée en garnison au Camp des Loges (Saint Germain en Laye), qui était en manœuvre à Mailly, est mise en alerte. Trois régiments de cette unité (le 501ème Chars, stationné à Rambouillet), la Marche du Tchad (à Pontoise) et la 1ère unité d'Artillerie (basée à Melun), tous situés dans les environs de Paris, sont immédiatement prêts à intervenir. La 9ème Brigade, en manœuvre à Courtine, est également mobilisée et les centres d'instruction des recrues, le 1er Train et le 151ème Montflery sont prêts au cas où il serait nécessaire de renforcer les unités de police, de gendarmerie et de CRS. D'autres unités situées dans la banlieue parisienne - les 9ème et 11ème hussards et le 5ème régiment d'infanterie - ont également été placées en état d'alerte, les congés annulés et toutes leurs troupes prêtes à intervenir au pied levé. Dans l'Ouest parisien, les différents bataillons et régiments de la 11ème division légère d'intervention restent dans le même état d'alerte jusqu'à la fin des incidents.
Ils ne sont pas intervenus, mais la situation ne s'est pas améliorée. Le 13 mai, lorsque les syndicats déclarent une grève générale, l'armée s'alarme véritablement. Le vendredi 24 mai, De Gaulle apparaît devant les médias pour appeler à l'ordre, mais son discours ne calme pas les choses et est complètement ignoré par les syndicats et les émeutiers du Quartier latin. Les incidents se multiplient et l'armée rappelle les enseignements sur la "guerre révolutionnaire" dispensés dix ans plus tôt à l'École de guerre psychologique de Philipeville, en Algérie. Les spécialistes de ces techniques avaient pris des positions sans équivoque en faveur de l'Algérie française et certains même de l'OAS. Ils se sont donc tournés vers eux. C'est à ce moment-là que le fossé qui s'était creusé au sein des forces armées après la guerre d'Algérie a commencé à se refermer. L'anticommunisme partagé par les deux factions militaires a eu cet effet. Mais à l'époque - le 24 mai - les positions n'étaient pas unanimes. Si tous étaient d'accord pour barrer violemment la route à un coup d'État de gauche, tous n'étaient pas prêts à agir si les organisations de gauche arrivaient au pouvoir par des moyens légaux. Dans les milieux militaires, on pensait que l'arrivée au pouvoir du PC était possible et, entre autres, le gouverneur militaire de Paris n'était pas prêt à agir dans ce cas. D'autres militaires, en revanche, l'étaient.
Les militaires en contact avec l'extrême droite
Au vu de la situation du 25 mai, certains officiers en garnison autour de Paris prennent contact avec les membres de l'extrême droite la plus militante pour savoir s'ils peuvent compter sur leurs troupes au cas où ils seraient obligés d'intervenir.

Ces dirigeants - avec certains desquels nous avons échangé des vues sur cette question - ont répondu par l'affirmative, mais même eux n'étaient pas sûrs des positions que prendraient leurs militants de base. Dans la nuit du 10 au 11 mai, lors des combats de la rue Gay-Lussac, quelques militants d'extrême droite avaient été aperçus parmi les barricades, affrontant la police. Et, d'autre part, beaucoup détestaient les communistes et les gauchistes pour leurs affrontements constants avec eux, mais ils ne détestaient pas moins l'armée et De Gaulle qui avaient permis l'abandon de l'Algérie et les forces de l'ordre qui les avaient emprisonnés et jetés dans les cellules de la Santé et de Fresnes. Beaucoup n'avaient pas oublié Bastien-Thiry, Boby-Dovecar, Claude Piegs, Roger Degueldre et d'autres torturés et tués par De Gaulle et ses "barbouzes". Certes, ils étaient anticommunistes, mais beaucoup détestaient le gaullisme bien plus que les gauchistes. En outre, les militants d'extrême-droite ont un mauvais souvenir: pendant les jours du coup d'État d'Alger, ils ont été littéralement abandonnés par les militaires qui leur avaient promis leur soutien et ne sont pas disposés à faire un nouveau pari six ans plus tard avec ceux qui les avaient trahis. L'organisation particulière qui avait été contactée par les militaires était, naturellement, Occident, qui avait fait preuve d'une très grande capacité de violence.
Lorsque, le 17 mai, les gauchistes ont expulsé l'extrême-droite de la faculté de droit d'Assas, le Mouvement Occident a été contacté par des ex-militaires et des mercenaires qui avaient travaillé avec Bob Denard au Congo, proposant leur collaboration pour un assaut contre cette faculté. Les dirigeants d'Occident ont rejeté cette option, même si leurs trois principaux dirigeants - oublions leurs noms - ont accepté la proposition. Les autres ont voté contre, préférant une victoire des gauchistes à un accord avec les gaullistes. Ainsi, Occident a quitté le terrain de la lutte pendant les journées de mai.
L'autre groupe polarisé autour de Tixier-Vignancour, qui opère à l'époque sous le nom de Front National Anti-Communiste, appelle à une manifestation le 22 mai avec une participation minime (à peine 1000 personnes), dont 200 militants d'Occident. La manifestation devait se terminer par la prise d'assaut de la rédaction du journal communiste L'Humanité, mais cette action ne s'est pas concrétisée en raison des jets de billes de fer et d'objets par les assiégés. Les membres les plus activistes se sont ensuite rendus au Lycée Condorcet, occupé par des gauchistes, et ont réussi à les en déloger et à arracher leurs drapeaux rouges et noirs. Ils ont ensuite manifesté devant la gare Saint-Lazare, occupée par les grévistes.
Si l'opinion d'Occident n'était pas unanime parmi ses dirigeants, il en était de même pour le parti de Tixier-Vignancour. Son adjoint, Raymond Le Bourre, est opposé à une participation aux événements aux côtés des gaullistes, mais Tixier est d'avis que des améliorations peuvent être apportées à la situation des prisonniers de l'OAS et au retour des exilés.
Les médias d'extrême droite, l'hebdomadaire Minute et l'hebdomadaire Rivarol, étaient contre un pacte pour sauver le gaullisme.
Toutefois, un accord a été conclu à la hâte dans la nuit du 24 mai. Discrètement, les dirigeants d'extrême-droite signataires de l'accord devaient mobiliser leurs troupes; en cas d'insurrection communiste, elles devaient se concentrer au camp de Satory, et si elles ne pouvaient l'atteindre par leurs propres moyens, on donnait un certain nombre de points où elles devaient être prises en charge par des camions de l'armée; les militaires refusaient de délivrer des armes à ces troupes et proposaient de les placer dans des unités militaires spéciales, soumises à la discipline militaire et qui exécuteraient les ordres de la direction militaire. En cas d'insurrection communiste, ces groupes seraient inclus dans des unités de choc qui seraient préalablement purgées des éléments suspects.
Le 26 mai, une nouvelle réunion a eu lieu entre des représentants des forces armées et des représentants des différentes directions d'extrême-droite. La réunion a eu lieu dans un appartement du Quartier latin, à quelques dizaines de mètres des barricades. Les militaires ont proposé la création d'une milice civique commandée par eux et composée de l'extrême-droite et de ses sympathisants en cas de coup d'État de gauche.
La direction d'extrême-droite exige que ces milices soient totalement indépendantes des Comités de défense civique gaullistes avec lesquels aucun accord ne serait possible. Les militaires ont accepté à condition qu'ils soient encadrés et disciplinés par eux, afin d'éviter les excès que pourraient commettre certains extrémistes. À partir de ce moment et au cours des jours suivants, les dirigeants des différents groupes d'extrême-droite ont commencé à mobiliser leurs troupes par le bouche à oreille. A partir de ce moment, les militaires eux-mêmes ont changé de position par rapport à l'extrême-droite. Ils ont fourni des lieux de rencontre.

Le voyage de De Gaulle aux garnisons françaises en Allemagne
À partir du 24 mai, lorsqu'il devient évident que la proposition de de Gaulle de convoquer un référendum n'a pas calmé la situation, l'activité militaire se concentre sur le sondage des unités "sûres" au cas où l'insurrection de gauche aurait lieu. Les unités contactées autour de Paris sont celles du 11ème régiment de hussards, dont l'état-major, selon Duprat, est le plus fervent partisan de l'intervention. La 11ème Brigade et la 11ème Division légère sont également des unités favorables à une intervention musclée. Les chars de la 8ème division avaient été concentrés au nord de Paris et les troupes "sûres" de Metz et Nancy avaient campé près de la capitale.
Le déploiement de toutes ces unités avait été conseillé parce que la "gendarmerie mobile" n'était pas très sûre (contrairement aux CRS) et qu'elle était connue pour échouer dans les missions pour lesquelles elle avait été envoyée. Comme dans tous les processus révolutionnaires, la crise des forces de police a été le premier signe indubitable de la crise de l'État.
En outre, d'autres unités militaires proches de la capitale ne sont pas disposées à intervenir en cas d'insurrection communiste (le 9ème hussards, le 2ème régiment de marine). Les autres unités n'étaient pas opérationnelles ou ne se prêtaient pas à une telle intervention.
Dès le 24 mai, 10.000 réservistes sont appelés et le 25, les unités "sécurisées" autour de Paris sont renforcées. Samedi 25 mai, à 8h30, une colonne militaire a été repérée sur l'autoroute Paris-Lille en direction de la capitale. Les militaires ont commencé à montrer leurs unités dans la banlieue de Paris, en guise d'avertissement.
Au cours des trois jours suivants, des "bruits de sabre" commencent à être entendus dans les garnisons de l'est de la France et dans les bases françaises en Allemagne. S'il est vrai que les commandants de ces unités sont des gaullistes avoués, il n'en va pas de même pour leurs états-majors. Beaucoup s'en étaient mordu les lèvres six ans plus tôt lors de l'insurrection du 1er régiment de parachutistes à Alger et se remettaient à douter et à maudire de Gaulle. Certains d'entre eux avaient parfois collaboré avec l'OAS, couvert ses militants ou même travaillé dans ses activités.
Après le discours du 24, De Gaulle, surpris par l'effet inverse de celui recherché, tombe dans le silence et la confusion. Le régime était au bord de l'effondrement. Alors que le silence s'éternise, les militaires sont de plus en plus favorables à une action efficace contre les émeutiers. Le bruit court que certaines unités sont maintenant prêtes à intervenir, non pas pour sauver de Gaulle, mais pour écraser la gauche.
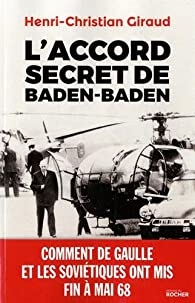 Le 29, de Gaulle se rend à Baden-Baden pour rencontrer le général Massu, commandant en chef des forces françaises en Allemagne, dont les unités s'avèreraient les plus efficaces en cas de conflit. De Gaulle parvient à persuader les militaires qu'il est "le seul capable de sauver la France du communisme" et même qu'il est prêt à en payer le prix. En réalité, ils ont été persuadés. L'important, c'est ce qu'ils ont exigé en échange du déplacement des unités d'intervention au-delà de la frontière: une amnistie générale pour les membres de l'OAS emprisonnés et exilés. De Gaulle ne proteste pas. Il allait soit mourir dans le fauteuil de l'Elysée, soit s'exiler.
Le 29, de Gaulle se rend à Baden-Baden pour rencontrer le général Massu, commandant en chef des forces françaises en Allemagne, dont les unités s'avèreraient les plus efficaces en cas de conflit. De Gaulle parvient à persuader les militaires qu'il est "le seul capable de sauver la France du communisme" et même qu'il est prêt à en payer le prix. En réalité, ils ont été persuadés. L'important, c'est ce qu'ils ont exigé en échange du déplacement des unités d'intervention au-delà de la frontière: une amnistie générale pour les membres de l'OAS emprisonnés et exilés. De Gaulle ne proteste pas. Il allait soit mourir dans le fauteuil de l'Elysée, soit s'exiler.
Le lendemain, De Gaulle s'adresse à nouveau aux Français, avec une attitude totalement différente. Peu avant, la 11ème Brigade blindée avait effectué une marche ostentatoire vers Paris, tandis que le 1er Régiment de parachutistes de marine, cantonné à Bayonne, recevait 10 avions Nord Atlas de Pau et 20 de Toulouse, se préparant à sauter sur Paris. Une colonne de véhicules blindés en provenance d'Allemagne a franchi la frontière, cherchant à attirer le plus d'attention possible sous prétexte de manœuvres. D'autres mouvements similaires ont été effectués simplement pour attirer l'attention.
De la mort politique à la résurrection de de Gaulle
A partir de ce moment, le récepteur du message a parfaitement compris la situation. Le PCF, à l'époque, est partagé entre l'insurrection et le retour aux quartiers d'hiver. En réalité, le PCF n'a jamais pris l'initiative de la situation, mais il ne voulait pas non plus se dissocier complètement d'une révolte qui risquait d'amputer son influence sur les masses.
Le 30 mai, le gaullisme est relancé. Les Comités de défense de la République assurent la présence des éléments les plus actifs de la droite et de l'extrême droite, dont la grande majorité sont d'anciens partisans de l'Algérie française. Les spécialistes de l'armée en matière d'opérations psychologiques ont parfaitement coordonné le discours de De Gaulle ce jour-là et la mobilisation qui a suivi sur les Champs Elysées le soir même. Entre 700.000 et 800.000 personnes ont défilé sur les Champs entre la place de la Concorde et la place de l'Etoile.

Le fondateur et chef de l'OAS, Raoul Salan, est spectaculairement libéré le 15 juin 1968, au moment où la révolte de mai prend officiellement fin. Le Quartier latin est de moins en moins animé: les "révolutionnaires" sont partis en vacances.
Georges Bidault, président du Conseil national de la Résistance, ainsi que les généraux et cadres de l'OAS qui étaient en exil depuis 1963, ont également pu rentrer en France à cette date. Peu après, Bidault a fondé le parti Justice et Liberté, qui était l'un des partis qui ont ensuite fait partie du Front national dirigé par Jean Marie Le Pen.
Alicante et Tarragone, pleines de pieds-noires exilés, ont vu ces communautés diminuer en nombre. Ils ont tous été amnistiés. Certains ne sont jamais revenus en France. L'un d'entre eux m'a dit : "La France est comme une femme que tu as beaucoup aimée et qui, soudain, te trompe. Tu lui donnes un coup de pied et tu ne veux plus jamais entendre parler d'elle".
Que s'est-il réellement passé ?
Apparemment, tout était clair :
- Un processus subversif déclenché par des éléments d'extrême-gauche avait réussi à entraîner la CGT et le PCF, soucieux de ne pas perdre leur influence sur les masses.
- Pendant quelques jours, la France a vécu au bord de la guerre civile et d'un coup d'État.
- Le général de Gaulle, cherchant un soutien pour rester au pouvoir, demande l'aide des forces armées.
- L'armée lui son concours en échange d'une amnistie générale pour ses camarades emprisonnés et du retour des exilés.
- Ces mesures sont entrées en vigueur le 15 juin, date à laquelle la révolte, qui avait commencé un mois et demi plus tôt, a officiellement pris fin.
Donc l'affaire était close, le dossier fermé... ou l'était-il ?
Pas du tout.
À la fin de la révolte, certains services de renseignement, probablement français, ont divulgué divers dossiers aux médias, imputant les incidents aux services spéciaux de la République démocratique allemande (RDA). Nombre de ces dossiers ont été diffusés par la presse de droite et d'extrême droite, qui les croyait les croyant authentiques.
Il a été rapporté que plusieurs grenades à main offensives fabriquées en Allemagne de l'Est ont été trouvées sur les barricades de la rue Gay-Lussac pendant la célèbre "nuit des barricades" du 10 au 11 mai. Ces grenades étaient de type RG42, considérées comme "très meurtrières". Dans la zone où ils ont été découverts, on a vu de jeunes Allemands appartenant au Sozialistiche Deutsche Studenten (SDS), l'un des groupes contestataires allemands qui, à l'époque, faisaient l'objet d'une enquête pour leurs liens avec le HVA (Hauptverteidigungsamt, le service de renseignement est-allemand) qui, selon ces rapports, était responsable des opérations de déstabilisation en Europe occidentale depuis 1965.....
Évidemment, toutes ces informations n'étaient que pure intoxication. À l'époque, nous nous en doutions. Maintenant, nous en sommes sûrs. Il est vrai qu'il y avait un marionnettiste qui tirait les ficelles de la subversion, mais ce n'était certainement pas l'HVA. Si c'était lui, tous les détails de l'opération seraient parfaitement connus aujourd'hui: le HVA a été dissout et ses archives ont été rendues publiques depuis l'unification allemande en 1989. Non, le HVA n'était pas le "bon indice", elle n'était que l'excuse, la manœuvre de diversion. Les grenades plantées à côté d'une voiture dans la rue Gay-Lussac n'étaient qu'une intoxication.
Et, bien sûr, en 1965, le HVA n'a déclenché aucune opération, mais la même année, c'est précisément la CIA, comme nous le savons aujourd'hui, qui a déclenché l'opération CHAOS, ordonnée et commandée par James Jessus Angleton. Cette opération, qui visait initialement à affaiblir les partis communistes pro-soviétiques, a été utilisée à d'autres fins tout aussi fallacieuses: la déstabilisation du gouvernement du général de Gaulle.
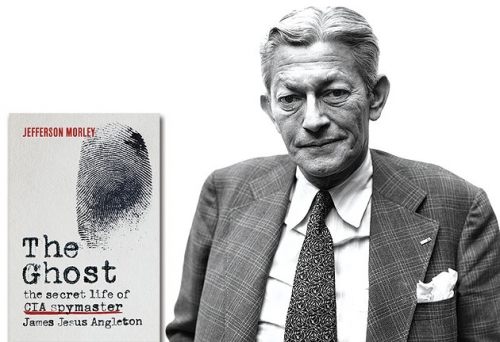
De Gaulle avait séparé les forces armées françaises de l'appareil militaire de l'OTAN en 1967, tout en restant dans la structure de l'Alliance atlantique. Les Américains ne lui pardonnent pas cette rebuffade, ni celle qui va suivre lorsque, lors de son voyage au Canada, il proclame devant les caméras de télévision du monde entier: "Vive le Québec libre". Le démembrement du Canada aurait signifié la perte de l'influence américaine dans la partie francophone du pays et la montée de l'influence française dans une zone que les théoriciens de la "destinée manifeste" avaient déjà baptisée "sphère d'influence américaine".
C'était le sens ultime du Mai français et tout le reste n'était que chorégraphie et accessoires pour une "opération spéciale". Le fait que les maoïstes aient été artificiellement gonflés au cours de l'opération CHAOS, le fait que le premier cocktail Molotov des émeutes ait été lancé - comme nous l'avons vu - par un militant d'Occident sur une voiture de police et le fait que ce mouvement, dès son origine, a pratiqué une attitude militante totalement provocatrice et visant à crisper les situations, le fait même que les membres de l'extrême-droite aient eu le cœur déchiré entre les barricades de la rue Gay-Lussac et l'adhésion aux milices civiques anticommunistes et, enfin, le fait que la "révolution de mai" se soit soldée immédiatement par la chute de De Gaulle - il a perdu le référendum qu'il avait lui-même convoqué - et le pardon général des militants de l'OAS... tout cela, ce sont les vrais fruits de Mai, bien plus, en tout cas, que Cohn-Bendit et les autres "ex-combattants", quarante ans plus tard, colportant leurs fantasmes et leurs fictions... Mai 68 avait différents marionnettistes, Cohn-Bendit était une des marionnettes. Nous répétons : "Mai 68 a eu différents marionnettistes". La CIA en était une, mais il y en avait d'autres dans le système interne de la France. Qui a dit qu'une opération planifiée par des services spéciaux ne peut pas être exploitée pour d'autres objectifs ?
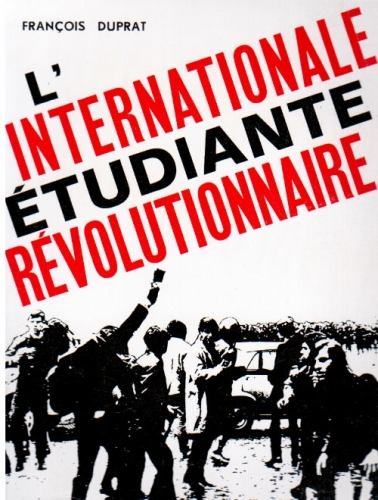
Note : plusieurs ouvrages de François Duprat ont été pris en compte pour cet article : L'Internationale Etudiante Révolutionnaire et Les journées du Mai 68, Editions NEL, La comédie de la révolution et Les journées du Mai, publiés par Défense de l'Occident et L'extrême-droite en France 1944-1972, Editions Albatros.
15:53 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : france, histoire, mai 68, de gaulle, extrême-gauche, extrême-droite |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
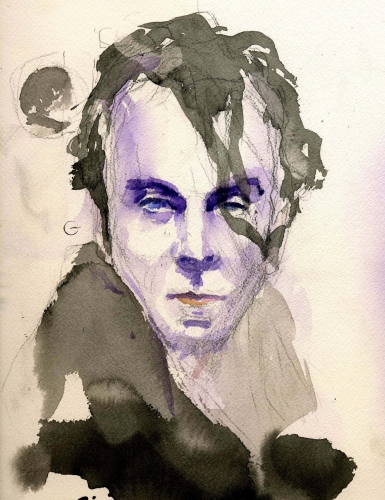
Parution du n°444 du Bulletin célinien
Sommaire :
 Céline à Rennes, en 1923
Céline à Rennes, en 1923
De Rosembly à Thibaudat
Chronologie 1944
L’Église vue par Thibaudat
Schopenhauer, la musique et Céline
Pierre-Marie Miroux nous écrit.
Calendrier Editorial
Plusieurs éditeurs avaient sollicité les ayants droit de Céline afin d’éditer ses manuscrits inédits. Comme c’était prévisible, c’est l’éditeur « historique » de l’écrivain qui publiera ce corpus. Si le contrat n’a pas encore été signé, un calendrier éditorial se précise.
Le mois passé, François Gibault et Véronique Chovin ont rencontré Antoine Gallimard pour esquisser les étapes de publication des différents textes. Celui-ci a souligné qu’ils sont tous les trois animés par « le même souci de restituer ces textes de manière intégrale. »¹ Et de rappeler qu’il avait signé avec Lucette un accord lui donnant un droit d’option pour les éventuels inédits à venir. Pour l’édition, il n’y aura pas de travail d’équipe à proprement parler mais, vu le temps à rattraper, d’une attribution lot par lot aux célinistes compétents. Le professeur Henri Godard concentrera son travail sur Casse-pipe dont il a déjà assuré l’édition (partielle) pour la Pléiade. Il s’agit donc de numériser sans délai les manuscrits mis en sécurité dans une banque. Seuls quelques céliniens privilégiés, comme Émile Brami et David Alliot, ont eu jusqu’à présent la chance de les voir. Dans un premier temps, deux ouvrages vont être publiés : le manuscrit intitulé « Guerre », vraisemblablement écrit après Voyage au bout de la nuit, et la version considérablement augmentée de Casse-pipe, soit plus de 400 feuillets inédits qui viendront compléter ceux déjà publiés en 1949². Ces deux manuscrits devraient voir le jour dans la collection “Blanche” à l’automne prochain. Ultérieurement une nouvelle édition du troisième volume de la Pléiade (qui comprend Casse-pipe et Guignol’s band) sera édité. Le directeur de cette collection, Hugues Pradier, assistait d’ailleurs à cette réunion. Quant aux autres manuscrits, Antoine Gallimard assure que tout le travail éditorial sera mené de telle sorte qu’il aboutisse avant 2031, échéance à laquelle l’œuvre de Céline tombera dans le domaine public. Dans dix ans exactement. Nul doute qu’il faudra moins de temps à Henri Godard (1937) pour achever ce travail. Alors qu’il avait annoncé avoir définitivement mis un terme à ses travaux sur Céline³, il est donc appelé à se remettre au travail. Tout se présente au mieux et il s’est naturellement déclaré ravi de cette réapparition de manuscrits. Tout en marquant son étonnement de l’avoir appris par la presse. Sans doute estime-t-il à juste titre que les ayants droit eussent pu songer que cette découverte le concernait au premier chef. Il s’agit maintenant d’établir un planning et de répartir le travail. Sans doute ne faudra-t-il pas compter sur les transcriptions effectuées par le receleur dont les éditeurs peuvent, par ailleurs, très bien se passer.
13:52 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis-ferdinand céline, revue, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
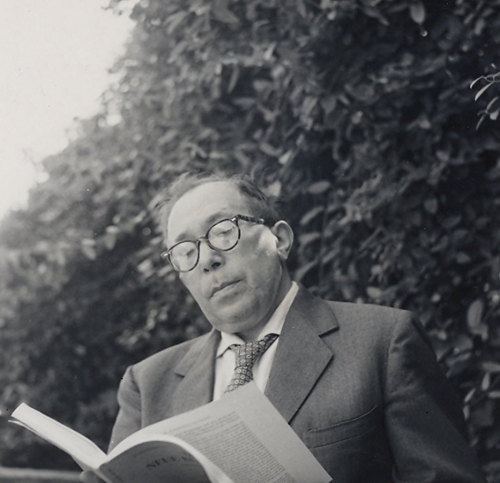
Leo Strauss : Libéralisme 1.0 et révolution conservatrice
Michael Kumpmann
Source : https://www.geopolitica.ru/de/article/leo-strauss-liberalismus-10-und-konservativer-revolution?fbclid=IwAR3d5AbHFVJqQgS8zD8k8vQwtVIkzL7xsgrAYr4QgpcfS0zFB6x0lyNhRdo
Dans mes derniers textes, j'ai abordé les idées du Prof. Douguine sur le conflit entre le libéralisme 1.0 et le libéralisme 2.0. Dans ce contexte, je me suis jusqu'à présent beaucoup concentré sur le courant de l'école autrichienne d'économie nationale et sur les prolongements "libertariens" de cette école de pensée, de Rothbard à Hoppe. Mais il ne s'agit bien sûr que d'une petite partie d'une école de pensée dans laquelle il y a aussi d'autres idées intéressantes à "découvrir".
En Europe, le concept d'absolutisme éclairé a émergé. Parmi ses représentants, il y avait Hegel, qui, bien qu'il ait aimé certains des concepts des Lumières et du libéralisme, voulait apprivoiser la révolution culturelle "jacobine" et préserver ainsi autant que possible la tradition antérieure.
L'un des représentants les plus intéressants de ce mode de pensée européen est le disciple de Carl Schmitt, Leo Strauss. Strauss se réfère à Schmitt, Nietzsche et Heidegger, entre autres, dont les idées lui permettent de trouver un moyen de surmonter les problèmes de la modernité et de se rattacher à la tradition d'"Athènes" et de "Jérusalem". Ce faisant, bien qu'il soit extrêmement critique à l'égard du libéralisme, il se considère néanmoins comme un libéral et veut créer un "meilleur libéralisme".
C'est précisément en raison de cette combinaison de "révolution conservatrice" et de pensée libérale que Strauss présente un grand intérêt pour un lien entre le "libéralisme 1.0" et la quatrième théorie politique.
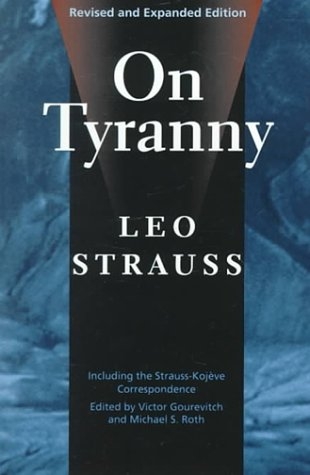
Strauss a acquis la mauvaise réputation d'avoir été l'ancêtre des néoconservateurs, mais il existe des démarcations claires entre lui et les néoconservateurs. Pendant ce temps, aux États-Unis, les gens de droite opposés au mondialisme et au bellicisme des néoconservateurs ont également découvert Strauss. L'associé de Trump, "Michael Anton", est un de leurs représentants. Pendant ce temps, dans les universités américaines influencées par la pensée de Strauss, comme Claremont, nous pouvons voir une dispute entre partisans néoconservateurs et partisans trumpistes des idées de Strauss.
Mais si Strauss a incontestablement une mauvaise réputation, il a également proclamé de nombreuses vérités, comme l'observation que Karl Popper était un penseur peu sophistiqué et carrément primaire.
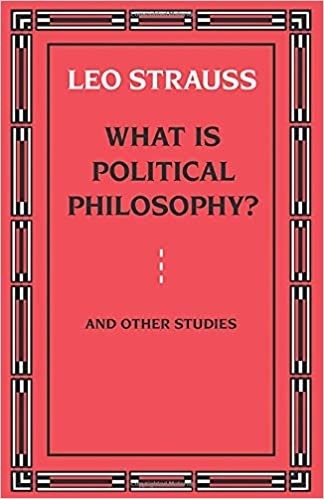
Bien que Leo Strauss se soit senti libéral, surtout au crépuscule de sa vie, il a vivement critiqué de nombreux aspects du libéralisme. Parmi ses critiques, on trouve la volonté des libéraux de tout soumettre à la logique de l'économie, ainsi qu'à la philosophie, jusqu'à ce que l'économie devienne le centre de la vie. Dans la lignée de Platon, Strauss considérait la démocratie plus comme un mal que comme "la meilleure de toutes les formes de gouvernement", décourageant ainsi sa glorification mais insistant pour la tolérer.
Il n'est donc pas surprenant que Leo Strauss, comme beaucoup de vieux libéraux 1.0 du XIXe siècle, ait été un partisan de la souveraineté nationale et un opposant à l'idée d'un État mondial globaliste.
Un point important de la pensée de Strauss est son idée de l'opposition entre "révélation et raison". Au début, Strauss voit deux voies d'accès à la connaissance se faire face, voies apparemment en conflit l'une avec l'autre. D'un côté, la révélation, par laquelle il entend la religion (qu'il associe à Jérusalem). L'autre pôle représente la raison, qu'il voit incarnée dans la philosophie et la science, et sous la forme de l'Athènes antique. Il pense que même si les deux parties veulent remplacer l'autre, elles ne peuvent pas, mais ont besoin l'une de l'autre. Strauss part maintenant du principe que les philosophes des Lumières ont commis une erreur et se sont rangés du côté de la raison pure, contre la religion et la révélation.
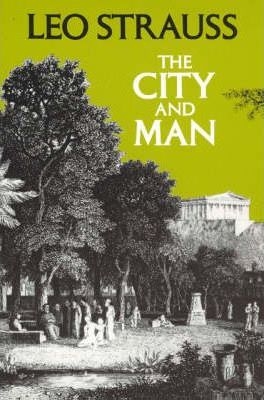 Cette accusation n'est pas nouvelle et a été formulée tant par le philosophe allemand Hegel dans sa Phénoménologie de l'esprit que par Isaac Newton dans ses écrits alchimiques. Et c'est vrai, bien sûr.
Cette accusation n'est pas nouvelle et a été formulée tant par le philosophe allemand Hegel dans sa Phénoménologie de l'esprit que par Isaac Newton dans ses écrits alchimiques. Et c'est vrai, bien sûr.
Mais il est important de noter que Leo Strauss est l'un des rares auteurs libéraux à l'avoir constaté. De très nombreux autres auteurs libéraux, en fait, ont pensé tout à fait différemment. Ayn Rand a dénigré les personnes religieuses et les philosophes comme Friedrich Nietzsche en les qualifiant de "mystiques stupides". Ayn Rand est ensuite devenue l'un des auteurs favoris d'Anton LaVey, le fondateur de l'"Église de Satan". Et on la retrouve surtout parmi les critiques de l'Islam, etc., on trouve beaucoup de gens qui ont une haine pure et simple de la religion et qui vivent selon l'idée de Dostoïevski que si Dieu n'existe pas, ils peuvent faire ce qu'ils veulent car personne ne peut les arrêter. Et même si ce n'est pas aussi extrême.
Dans de nombreux partis "libéraux-conservateurs" comme la CDU, nombreux sont ceux qui demandent que la religion soit subordonnée à l'idéologie libérale. Et le résultat de ce sécularisme est alors que, par exemple, l'Église protestante en Allemagne se transforme lentement en aile religieuse de l'idéologie du genre.
Mais il faut aussi dire que la religion et la philosophie n'étaient pas vraiment si séparées l'une de l'autre dans l'Antiquité. Confucius a également enseigné des idées religieuses en Chine et ses disciples ont entretenu des échanges animés avec le bouddhisme et le taoïsme. En Grèce, il y avait les hermétiques, ainsi que Pythagore. Et même Platon ne peut être compris correctement que dans le contexte de la religion. L'idéal d'Aristote de la "vie de philosophe" se résume également à une vie de moine érémitique plutôt que de professeur séculier dans une université. Une philosophie "laïque" n'a pas réellement existé dans le monde antique. Même les francs-maçons, qui ont eu une influence sur la modernité, se considèrent comme une institution religieuse et n'acceptent normalement pas les anti-religieux et les athées.
Ce qui est intéressant dans la comparaison avec Hegel, qui a fait une critique similaire du libéralisme et des Lumières dans ce domaine, c'est qu'il est naturellement associé à l'absolutisme éclairé, à Napoléon, à la Prusse et à l'Empire allemand (et puisqu'ils y ont adopté beaucoup de Prussien, aussi indirectement au Japon). Il faut dire ici que si ces pays et ces idéologies ont été influencés par le libéralisme, ils ont également restreint le libéralisme autant que possible, et n'ont pas essayé d'abolir les institutions traditionnelles telles que la monarchie, mais de les préserver et de les compléter. De nombreux pays comme l'Allemagne et le Japon ont pu protéger temporairement des traditions comme la famille, même avec le capitalisme (voir les entreprises familiales japonaises Zaibatsu telles que Mitsubishi, qui ont même été en grande partie construites par des samouraïs, et où la structure et la tradition familiales féodales se sont perpétuées sans heurts, mais sous une forme différente). Ces développements montrent que Strauss et Hegel avaient raison, et qu'il ne faut jamais opposer la science à la religion, mais chercher une synthèse.
Pourquoi la séparation entre la raison et la révélation a-t-elle des conséquences aussi négatives, comme on le voit dans la Révolution française, l'hostilité libérale à la tradition, etc.
La raison principale est que la religion retourne le dicton bien connu de Dostoïevski: "Si Dieu existe, tout n'est pas permis". Dieu, en tant qu'être omnipotent, est la limite ultime. S'il y a un Dieu, alors la science et la philosophie ne peuvent aller à son encontre. La volonté de Dieu se réalise, que cela convienne ou non à l'homme. Le sage ne peut que découvrir la vérité sur le monde. Il ne peut pas recréer la vérité du monde.
Si Dieu n'existait pas, il n'y aurait personne pour arrêter l'homme. Chaque structure du monde serait capable d'être modifiée et recombinée à volonté. Que ce soit par des méthodes biologiques comme l'eugénisme ou le génie génétique, ou par des méthodes culturelles comme la psychologie, la déconstruction postmoderne, l'éducation, etc.
Tout, qu'il s'agisse du sexe, de la volonté, des désirs personnels d'une personne, de son espèce, etc. serait modifiable.
Et c'est également là que se cache la croyance erronée de nombreux conservateurs libéraux. De nombreux conservateurs libéraux tels que Thilo Sarrazin, le mouvement américain pour la biodiversité humaine, etc. pensent qu'en se référant simplement à la biologie, on peut vaincre les postmodernistes tels que Judith Butler, etc. Mais c'est complètement faux. La référence à la biologie conduirait plutôt à une volonté de dépasser le genre non pas par la déconstruction mais par le génie génétique. Seule la croyance en un ordre divin dans un cosmos peut mettre un terme à cette évolution.
C'est un point essentiel de la pensée de Strauss : la tradition constitue la véritable limite de la raison. La religion montre que l'on ne peut pas remodeler le monde à volonté, et qu'il vaut mieux ne pas essayer. Les modes de vie traditionnels ont un sens et ne peuvent être modifiés arbitrairement au nom du "progrès".
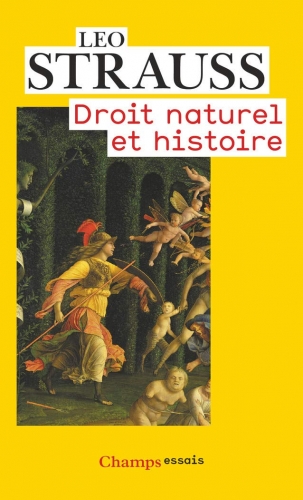
Après tout, les religions nous enseignent aussi le "memento mori", à savoir que la décadence et la finitude font partie de ce monde et que la raison ne peut rien y changer. Vous pouvez vivre aussi rationnellement et raisonnablement que vous le souhaitez et éviter tous les dangers, mais à un moment donné, la mort vous rattrapera. Seulement, il vaut mieux mourir en ayant construit une famille, un amour et un héritage que de mourir seul et sans tout cela. Un excès de bon sens et d'évitement du danger ne garantit pas que vous ne mourrez pas, mais que vous êtes victime d'une mort insensée.
De nombreuses valeurs traditionnelles, comme le sens de la famille, mais aussi la recherche occidentale de l'excellence, de la vertu et du thymos, qui tenait particulièrement à cœur à Leo Strauss, sont un moyen pour l'être humain de faire face à sa finitude. Les Grecs de l'Antiquité cherchaient également à mener une vie aussi bonne que possible et à devenir la meilleure version possible d'eux-mêmes, car ils savaient que la vie se termine à un moment donné et qu'il ne faut donc pas la gâcher.
Mais comme Strauss lui-même l'a noté, la raison pure ne peut généralement pas produire de buts et de valeurs autres que la simple survie nue le plus longtemps possible (ou la satisfaction des intérêts personnels, comme dans l'utilitarisme). Cependant, il y a ici le danger de glisser vers un hédonisme insignifiant et animal et de mourir finalement d'une mort misérable et insignifiante.
Après cette escarmouche préliminaire sur Leo Strauss et son opinion selon laquelle on a besoin à la fois de la religion et de la raison, la partie suivante de mes réflexions politico-philosophiques portera davantage sur le cœur de la pensée de Strauss et sur son opinion sur le libéralisme.
11:00 Publié dans Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : leo strauss, philosophie, philosophie politique, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
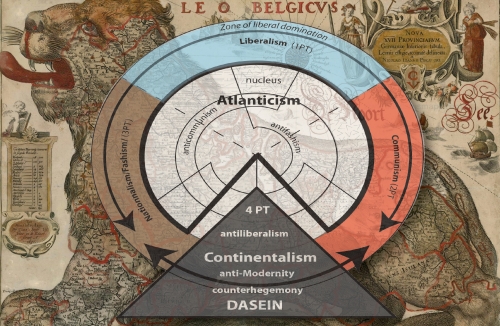
Le libéralisme 1.0 et la quatrième théorie politique: alliés dans la lutte contre la grande réinitialisation
Michael Krumpmann
Source: https://katehon.com/de/article/liberalismus-10-und-die-vierte-politische-theorie-verbuendete-im-kampf-gegen-den-great-reset?fbclid=IwAR113oSt4JaQUejFILXpmrv2blo5XzdGhalarDefDUzoUCUp-S_7Cs3azSg
Dans son texte "Libéralisme 2.0", Alexandre Douguine a proposé une invitation informelle aux libertariens à rejoindre la quatrième théorie politique et la lutte contre le libéralisme de gauche et le Great Reset. Avant de devenir moi-même un partisan de Douguine, je fréquentais les cercles libertariens et j'étais, tout particulièrement, un partisan enthousiaste de Ron Paul. Je pense donc que je devrais réfléchir à la manière dont les autres libéraux/libertariens peuvent trouver leur chemin vers la "quatrième position". Parce que je fus l'un des premiers à avoir accepté cette invitation de Douguine.
Il y a quelques questions et points essentiels que ces libéraux devraient prendre en considération - à commencer par l'individu: bien sûr, l'individu en tant que sujet de la première théorie politique doit être remis en question. C'est là que le dilemme du hérisson de Schopenhauer entre en jeu. En gros, cela signifie que lorsque les gens se rapprochent les uns des autres, ils peuvent se faire du mal. La position des droits de l'homme chez les "liberals" actuels est maintenant que l'on doit veiller à ce que les gens ne se rapprochent pas trop les uns des autres de manière non intentionnelle. Les droits de l'homme sont désormais perçus comme des barrières imaginaires entre les gens.
Ce à quoi mène cette pensée est visible en Occident depuis 2020: les éléments clés dans la situation nouvelle sont les masques obligatoires et la distanciation sociale obligatoire, mais aussi des problèmes tels que la pornographie ou certaines idées anti-familiales du féminisme.
Au cours des dernières décennies, la technologie numérique a également fait un travail terrible en isolant les individus de leurs semblables. Le philosophe américain Curtis Guy Yarvin (photo), alias Mencius Moldbug, a imaginé que la pire des punitions serait d'enfermer une personne seule dans une capsule et de la faire vivre dans un monde virtuel imaginaire. Pour un nombre effrayant de personnes, cependant, c'est déjà la réalité de la vie aujourd'hui. Le Great Reset de Klaus Schwab semble intensifier massivement ces problèmes.
Il est donc dangereux de définir l'individu uniquement comme un sujet qui a besoin d'être protégé de ses semblables.

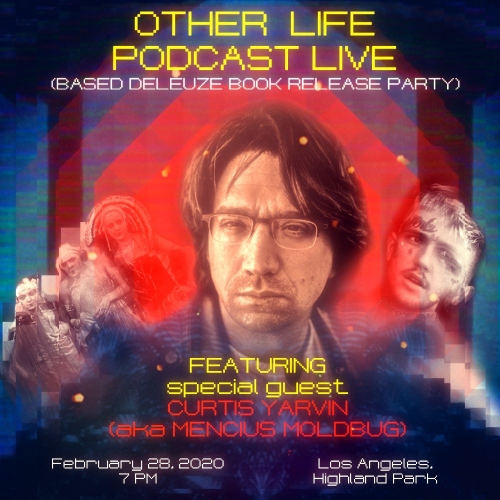
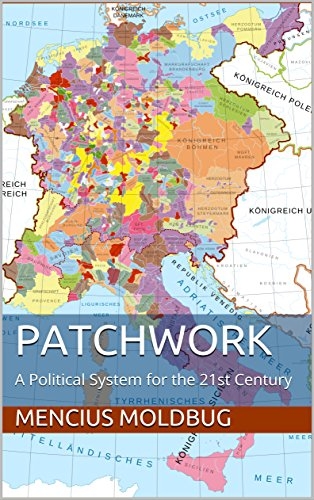
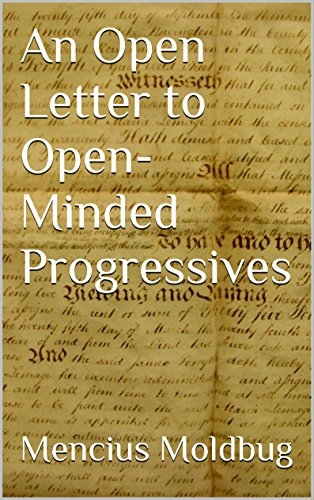
Pour résoudre ce problème, il faut accorder plus d'attention à l'autre facette du dilemme du hérisson: l'homme ne peut pas vivre sans les autres. De nombreux philosophes ont également affirmé que l'être humain individuel ne peut se définir et être perçu que s'il vit avec d'autres êtres humains. Heidegger a dit : "Être, c'est être avec" (Mitsein) et Martin Buber a dit: "Le Je ne devient le Je que par le Tu". Les églises chrétiennes ont longtemps prêché exactement cette position, à savoir que l'individu a une dignité à laquelle il a droit, mais qu'il ne peut la vivre pleinement qu'en communauté avec d'autres personnes. La pensée compétitive ne mène nulle part à long terme.
Et un point très important pour les libéraux et libertariens est également que tout affaiblissement de la communauté naturelle, et tout plan visant à libérer l'individu de ses semblables, ne mène en fin de compte qu'à un renforcement du gouvernement et à une privation progressive des droits de l'individu. C'est pourquoi la communauté est nécessaire, également pour préserver la liberté.
La famille et les voisins sont plus à même d'aider l'individu dans son besoin que l'État-père.
La première théorie politique est une manifestation de la modernité et fait donc partie de la décadence.
Cependant, Douguine a très bien montré dans ses travaux précédents que dans les deuxième et troisième théories politiques, outre les courants dominants anti-traditionnels, il y avait aussi des gens comme Ustryalov (Oustrialov), Evola, Herman Wirth, etc. qui aspiraient à préserver ou à revenir à la tradition.
Il en va de même pour le libéralisme. Douguine a déjà fait référence à la célèbre description de Hayek sur l'importance de préserver les traditions. Son disciple et futur chancelier Ludwig Erhard, avec son appréciation de la famille traditionnelle et de la classe moyenne, peut être vu sous un jour similaire. Mais il existe d'autres exemples : Hans Hermann Hoppe et Janusz Korwin-Mikke avec leur opinion qu'une société libre n'est possible qu'en restaurant les institutions traditionnelles, comme la monarchie. Également Robert Heinlein, dont les œuvres décrivent l'importance du code du guerrier, ainsi que des idées sexuelles rappelant fortement des religions telles que le tantrisme. Il ne faut pas oublier que les dernières principautés d'Europe, notamment Monaco et le Liechtenstein, font également partie des "pays préférés" de nombreux libéraux/libertariens.
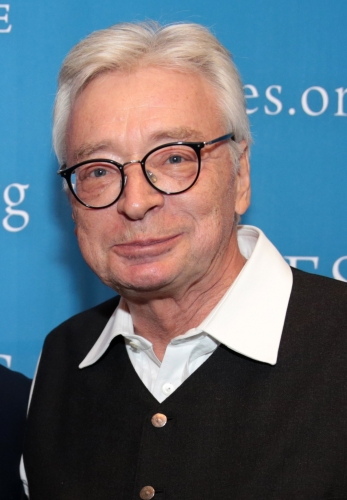
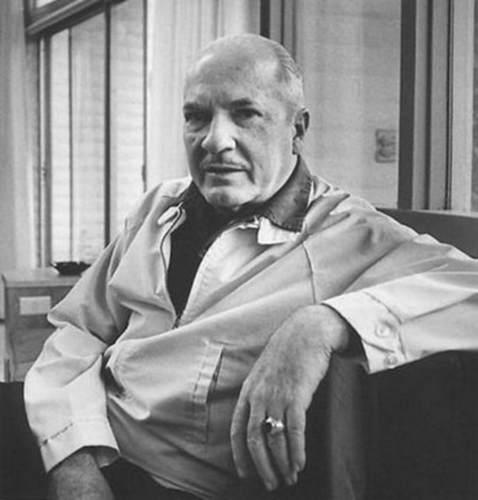
Hans Hermann Hoppe, Janusz Korwin-Mikke et Robert Heinlein
En tant que libéral qui veut arriver à la quatrième position politique, on devrait trouver et promouvoir de tels éléments pro-traditionalistes de son propre camp, permettant ainsi une "révolte contre le monde moderne (libéral)".
Il faut ensuite que le libéral, ou le libertarien, se rende compte que le libéralisme n'est pas la "seule chose qui rende heureux" et qu'il peut y avoir d'autres voies vers la liberté, qui peuvent peut-être être combinées à la sienne. Par exemple, les idées de Limonov et de Charles Fourier sur les petites communautés villageoises indépendantes qui peuvent déterminer leurs propres affaires et commercer entre elles seraient beaucoup plus tolérables pour un vrai libéral (ou un vrai libertarien) que le (pseudo) capitalisme d'État occidental d'aujourd'hui. Les existentialistes comme Nietzsche, Heidegger et Kierkegaard montrent bien que la liberté exige une attitude intérieure et que l'"homme de masse stupide" ne peut pas vivre librement même dans un État libre, car la liberté doit aussi inclure la liberté de ne pas être capitaliste. La liberté doit aussi inclure, par exemple, le fait de rejoindre un ordre monastique et de ne plus vouloir rien savoir de l'argent.
Par conséquent, le projet occidental de bombarder la démocratie dans d'autres pays doit également être combattu et rejeté du point de vue de la liberté. Mais il y a aussi des voix dans la première théorie politique qui sont contre cet "Empire américain". Un très grand nombre d'entre elles ont été bien présentées par Murray N. Rothbard dans son livre The Betrayal of the American Right. Ron Paul, bien sûr, est également connu pour une position similaire. Korwin Mikke a même plaidé pour une alliance anti-américaine entre la Pologne et la Russie.

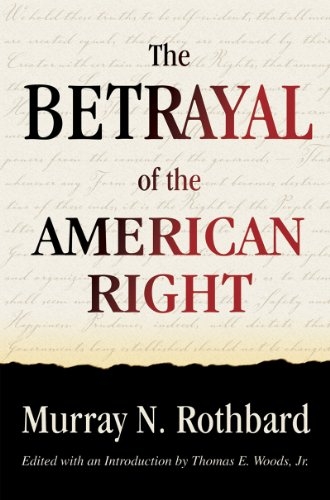
Dans "Constitution européenne", Jean Thiriart décrit une économie largement libre, quoique sous la primauté de l'armée, ce qui serait également acceptable pour les libéraux.
Dans "L'horizon de l'empire idéal" et "Le nouveau monarque de Thaïlande", Douguine lui-même a écrit sur l'idéal traditionnel d'un roi qui "gouverne sans gouverner", et qu'un bon roi doit idéalement faire si peu que la plupart des citoyens ne remarquent même pas son existence. Un tel dirigeant serait en fait beaucoup plus agréable pour les libéraux qu'une démocratie comme l'actuelle RFA.
Outre la question de savoir si l'homme peut également devenir libre par des moyens non libéraux, les libéraux/libertariens devraient également se demander quels aspects de leur propre position empêchent la liberté au lieu de la promouvoir.
Enfin, il convient de mentionner que l'écrivain américain d'extrême droite et parfois secrétaire de Joseph McCarthy, Francis Parker Yockey, a rédigé une critique détaillée de la pensée libérale. Il a écrit que la pensée libérale était fondée sur l'idée que l'homme est si rationnel qu'il peut décider lui-même de son existence et n'a pas besoin du paternalisme de l'État. Mais les libéraux ont fait l'erreur de ramener l'État par le biais du minarchisme. Selon lui, un libéral conséquent devrait être un anarchiste.
On peut certes avancer l'argument selon lequel les adeptes du libéralisme 2.0 n'ont pu acquérir autant d'influence que parce qu'ils ont mis sous leur contrôle des appareils d'État tels que la télévision publique, l'éducation, le système judiciaire, etc. et que, volontairement, personne n'aurait eu l'idée qu'il existe 36.000 genres. Il existe, bien sûr, des arguments de poids en faveur d'un État fort et d'un État en général. Il faut seulement se demander si un "Great Reset" aurait pu émerger du libéralisme si les libéraux n'avaient pas écouté John Locke et Adam Smith, mais des gens comme Bakounine, Kropotkine ou Proudhon.
Les points positifs que l'on peut obtenir et apprendre du libéralisme sont, outre l'idée de liberté, surtout l'idée de décentralisation. Julius Evola a bien décrit le fait que les sociétés traditionnelles n'étaient pas des États centraux où un seul gouvernement gérait tout pour l'empire, mais des principautés et des provinces dotées d'un haut degré d'autonomie. Les libéraux sont également de grands partisans de l'idée de décentralisation.
10:39 Publié dans Définitions, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : libéralisme, libertariens, alexandre douguine, quatrième théorie politique, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Qui soutient le terrorisme ? Un groupe terroriste anti-chinois exclu de la liste: "Il ressuscite d'entre les morts"!
Brian Berletic*
Ex: http://www.elespiadigital.com/index.php/noticias/seguridad/35540-2021-10-09-12-14-26
Des soupçons sont apparus lorsque, fin 2020, les États-Unis ont retiré de la liste des organisations terroristes le Mouvement islamique du Turkestan oriental (ETIM), parfois appelé Parti islamique du Turkestan (TIP).
En effet, les États-Unis ont affirmé que l'ETIM / TIP n'était pas active depuis plus de dix ans, alors qu'ils ont eux-mêmes admis avoir frappé des cibles de l'ETIM / TIP en Afghanistan pas plus tard qu'en 2018, soit deux ans seulement avant sa radiation de la liste.
Un article du Guardian de 2020 intitulé "Les États-Unis retirent un groupe fantôme de la liste des terroristes accusés d'avoir commis des attentats en Chine", par exemple, porterait à le croire:
"Dans un avis publié dans le Federal Register, qui publie les nouvelles lois et réglementations américaines, le secrétaire d'État, Mike Pompeo, a déclaré vendredi qu'il allait révoquer la désignation du Mouvement islamique du Turkestan oriental (ETIM) comme "organisation terroriste".
"L'ETIM a été retiré de la liste parce que, depuis plus d'une décennie, il n'y a aucune preuve crédible que l'ETIM continue d'exister", a déclaré un porte-parole du département d'État.
L'affirmation du porte-parole du département d'État américain n'a pas été contestée par le Guardian, bien que le journal ait lui-même écrit un article en 2013, il y a tout juste 7 ans, sur le retrait de la liste où il est indiqué:
Le Parti islamique du Turkestan (PIT) est le premier groupe à revendiquer l'attentat du 28 octobre, au cours duquel un véhicule tout-terrain a traversé un groupe de piétons près de la place emblématique du centre de Pékin, s'est écrasé sur un pont de pierre et a pris feu, tuant cinq personnes et en blessant des dizaines d'autres. Les autorités chinoises ont rapidement identifié le conducteur comme étant un Ouïgour, soit un ressortissant d'une minorité ethnique musulmane du Xinjiang, une région rétive et peu peuplée de l'extrême nord-ouest du pays.

L'article indique non seulement que le département d'État américain a menti en affirmant que l'organisation terroriste était en sommeil depuis plus de dix ans, mais il illustre également la menace terroriste très réelle à laquelle la Chine est confrontée dans tout le pays de la part des organisations terroristes basées au Xinjiang.
Le gouvernement américain et les médias occidentaux en général qualifient depuis des années de "génocide" les politiques de sécurité menées par Pékin pour contrer cette menace.
ETIM / TIP : "Back from the dead"
Dans ces conditions, il n'est pas surprenant que le magazine américain Newsweek ait publié en septembre de cette année un article intitulé "Exclusif : Malgré la pression de la Chine sur les talibans, les séparatistes ouïgours voient des opportunités en Afghanistan", dans lequel le porte-parole de l'ETIM / TIP, "inexistant", était interviewé par les médias américains.
Cet article s'inscrit dans le sillage du retrait américain d'Afghanistan, une décision qui a clairement ouvert la voie à une transition entre l'occupation militaire américaine de ce pays d'Asie centrale et un rôle plus secret de soutien à des groupes militants qui sèment le chaos non seulement à l'intérieur des frontières de l'Afghanistan, mais aussi bien au-delà, y compris dans la Chine voisine.
L'article de Newsweek rapporte :
"Les États-Unis sont un pays fort, ils ont leur propre stratégie, et aujourd'hui, nous voyons le retrait du gouvernement américain de cette guerre en Afghanistan, qui entraîne d'énormes pertes économiques, comme un moyen d'affronter la Chine, qui est l'ennemi de toute l'humanité et de toutes les religions à la surface de la Terre", a déclaré à Newsweek un porte-parole du bureau politique du Parti islamique du Turkestan, communément appelé Mouvement islamique du Turkestan oriental (ETIM).
Dans ce qui semble être les premiers commentaires du groupe secret à un média international depuis qu'il a été retiré de la liste américaine des organisations terroristes l'année dernière, le porte-parole du Parti islamique du Turkestan a déclaré qu'il espérait que le retrait de l'armée américaine le mois dernier serait suivi d'une pression accrue contre la Chine.
"Nous pensons que l'opposition des États-Unis à la Chine profitera non seulement au Parti islamique du Turkestan et au peuple du Turkestan, a déclaré le porte-parole, mais aussi à l'ensemble de l'humanité."
Newsweek mentionnerait également les frappes américaines sur les cibles de l'ETIM / TIP en 2018, notant :
Pendant de nombreuses années, les États-Unis ont inclus l'ETIM dans leur liste de terroristes, dans le cadre des mesures du Patriot Act mises en place après les attentats du 11 septembre 2001. Le Pentagone a même ciblé le groupe par des frappes aériennes en Afghanistan jusqu'en 2018 au moins.

Le public est censé croire que la radiation de l'ETIM/TIP de la liste américaine des organisations terroristes est fondée sur de prétendues preuves que l'organisation n'existe plus, alors qu'elle continue manifestement d'exister et de commettre des actes de terrorisme, et qu'elle s'aligne désormais ouvertement sur la politique étrangère des États-Unis à l'encontre de la Chine après sa "résurgence".
De même, les États-Unis ont retiré de la liste des organisations terroristes qu'ils cherchaient à utiliser comme mandataires armés dans des conflits contre des nations ciblées. Cela inclut le Groupe islamique combattant libyen (GICL) que les États-Unis ont utilisé dans leur guerre par procuration non seulement en Libye même en 2011, mais plus tard en transférant des combattants et des armes de l'Afrique du Nord au Moyen-Orient contre la Syrie, également à partir de 2011.
Les États-Unis ont également retiré de la liste les Mujahedin-e-Khalq (MEK), une organisation terroriste utilisée par les États-Unis et leurs alliés pour mener des opérations terroristes contre le gouvernement et le peuple iraniens.
Ce n'est un secret pour personne que les États-Unis soutiennent le séparatisme au Xinjiang, en Chine.
L'article de Newsweek consacre une grande partie de son espace à tenter de dépeindre l'ETIM / TIP comme s'engageant dans une bataille héroïque pour l'indépendance contre une occupation chinoise "oppressive". L'article précise :
"Le Turkestan oriental est la terre des Ouïghours", a déclaré le porte-parole du Parti islamique du Turkestan. "Après que le gouvernement chinois a occupé notre patrie par la force, il nous a obligés à quitter notre patrie en raison de l'oppression qu'il exerce sur nous. Tout le monde sait que le Turkestan oriental a toujours été la terre des Ouïghours".
Ce n'est qu'au milieu de l'article que Newsweek finit par l'admettre :
Outre la Chine et les Nations unies, un certain nombre de nations et d'organisations internationales telles que l'Union européenne, le Kirghizstan, le Kazakhstan, la Malaisie, le Pakistan, la Russie, la Turquie, les Émirats arabes unis et le Royaume-Uni considèrent l'ETIM comme une organisation terroriste.
En fait, les Nations unies considèrent l'ETIM / TIP comme un groupe terroriste et Newsweek cite cette organisation qui "représente une menace immédiate pour la sécurité de la Chine et de son peuple".
Le Conseil de sécurité de l'ONU, sur le site officiel de l'ONU, dans une déclaration intitulée "Eastern Turkestan Islamic Movement", note explicitement :
"Le Mouvement islamique du Turkestan oriental (ETIM) est une organisation qui a eu recours à la violence pour atteindre son objectif d'établir un soi-disant "Turkestan oriental" indépendant au sein de la Chine".
La déclaration du CSNU est très claire sur deux points. Premièrement, les Nations unies, et par extension la majorité de la communauté internationale, ne reconnaissent pas le terme "Turkestan oriental" et reconnaissent plutôt le territoire comme le Xinjinang et comme faisant partie de la Chine.
Deuxièmement, le Conseil de sécurité des Nations unies désigne explicitement l'ETIM / TIP comme une organisation terroriste qui a utilisé la violence pour servir ses ambitions séparatistes.
Le terme "Turkestan oriental" est utilisé uniquement par les séparatistes, en contradiction avec le droit international et le statut de la région internationalement reconnue du Xinjiang, en Chine.
Il est donc particulièrement révélateur de voir sur le site officiel du National Endowment for Democracy du gouvernement américain que ses programmes au Xinjiang sont énumérés sur une page intitulée "Xinjiang / Turkestan oriental (Chine)".
Les organisations citées, dont le Projet des droits de l'homme ouïghour (UHRP) et le Congrès mondial ouïghour (WUC), font explicitement référence au Xinjiang, en Chine, comme au "Turkestan oriental", qu'elles considèrent comme "occupé" par la Chine.
L'UHRP se décrit sur son site Internet en déclarant (c'est nous qui soulignons) :
"Le Projet des droits de l'homme des Ouïghours promeut les droits des Ouïghours et des autres peuples turcs musulmans du Turkestan oriental, que le gouvernement chinois appelle la région autonome ouïghoure du Xinjiang...".
Le site web du WUC indique que l'organisation se déclare "mouvement d'opposition à l'occupation chinoise du Turkestan oriental".
Les deux organisations sont financées par le gouvernement américain, et l'UHRP est basée à Washington DC.
Le Congrès mondial ouïghour, financé par le gouvernement américain, est l'organisation à l'origine du prétendu "Tribunal ouïghour". Le site officiel du Tribunal ouïghour admet même (c'est nous qui soulignons):
"En juin 2020, Dolkun Isa, président du Congrès mondial ouïghour, a officiellement demandé à Sir Geoffrey Nice QC d'établir et de présider un tribunal populaire indépendant chargé d'enquêter sur les "atrocités en cours et le possible génocide" contre les Ouïghours, les Kazakhs et d'autres populations musulmanes turques".

Ainsi, non seulement les États-Unis encouragent clairement le séparatisme au Xinjiang, en Chine, en finançant directement des organisations qui promeuvent le séparatisme, mais ils n'ont pas seulement retiré l'ETIM/TIP de la liste américaine, alors qu'il est une organisation terroriste active, ce qui lui permet d'allouer plus facilement des fonds et de voyager dans le monde entier, mais aussi de tirer parti de son contrôle considérable sur les médias mondiaux et les institutions internationales pour qualifier de "génocide" la réponse de la Chine à cette campagne concertée de séparatisme et de terrorisme dirigée contre son territoire et son peuple.
En d'autres termes, les États-Unis sont, d'une part, armés d'une épée - les terroristes "résurgents" de l'ETIM / TIP désireux de se joindre à l'encerclement et à l'endiguement de la Chine par les États-Unis - et, d'autre part, les États-Unis disposent du bouclier de la "défense des droits de l'homme" pour se protéger des tentatives de la Chine de faire face à cette menace.
C'est une ironie perpétuelle que les États-Unis s'arrogent le leadership d'un "ordre international fondé sur des règles" qui, selon eux, garantit la paix et la stabilité dans le monde, alors que, dans le même temps, ils constituent la plus grande menace pour ces deux éléments.
* Chercheur et écrivain en géopolitique basé à Bangkok.
15:37 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, géopolitique, terrorisme, turkestan chinois, xinjiang, ouïghours, asie, asie centrale, affaires asiatiques, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
10:01 Publié dans Actualité, Entretiens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pollueurs, actualité, nicolas bonnal |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Les troubles partiels comme étapes nécessaires
Ernesto Milà
Ex: https://info-krisis.blogspot.com/2021/04/cronicas-desde-mi-retrete-los.html?m=1
Ceux d'entre nous qui entrent maintenant dans leurs "années avancées" sont peut-être ceux qui sont les plus conscients des changements accélérés qui se sont produits depuis notre enfance jusqu'à aujourd'hui. Je pense que je suis privilégié d'être né dans les années 1950, d'être encore en vie et de pouvoir dire que je n'ai pas manqué le train de la modernité, même si les changements que j'ai vus depuis que je me souviens sont presque de la science-fiction. Et celles qui nous attendent dans les dix prochaines années le seront encore plus.
La première année où je suis allé à l'école, nous allions en classe même le samedi, nous n'avions de vacances que le dimanche et le jeudi après-midi. C'était en 1957. L'année suivante, le jeudi a été remplacé par le samedi. Nous sommes rentrés à la maison. Il n'y avait pas de télévision, et il n'y en a eu qu'un an plus tard, juste quelques heures par jour, de 14h00 à 16h00 et de 19h00 à 24h00. Et un seul canal. Mon père a acheté le téléviseur avant l'installation de l'antenne relais de Tibidabo. C'était une boîte Philips avec des portes, presque comme une armoire, mais avec un écran pas plus grand que 40 cm, en noir et blanc. Rien à voir avec le plasma panoramique que l'on pouvait contrôler par la voix et même auquel on pouvait parler (si on était assez fou pour le faire), ni avec les 40 chaînes et la demi-douzaine de streamings... Dans les années 50, l'objet culte des foyers était la radio et c'était sa période d'or, avec les "serials", avec les "cabinets de consultation sentimentale", avec les programmes musicaux. À quoi ressemblera la télévision du futur ? Jusqu'où peut-elle aller alors que nous avons déjà atteint une intégration parfaite entre la télévision classique, le streaming, les jeux vidéo, l'Internet et la téléphonie mobile ?


Mais le pire n'est pas la vitesse à laquelle tout change, ni même les doutes sur ce que l'avenir nous réserve, mais la certitude absolue, pleine et entière que, dans son ensemble, la civilisation, la culture, les valeurs, l'environnement politico-économique, se dégradent à une vitesse qui n'est que le reflet inversé de la courbe ascendante des nouvelles technologies. Une société, ce n'est pas seulement une télévision, un téléphone portable ou une puce. Une société est, avant tout, un modèle de coexistence, d'organisation et de valeurs.
C'est tout cela qui se dégrade à vue d'œil. Il ne s'agit pas d'en discuter, ni de le prouver. Ceux qui ne le perçoivent pas auront adopté les valeurs "progressistes" qui impliquent l'acceptation du dogme selon lequel l'histoire progresse toujours vers des états supérieurs de coexistence et de civilisation. Ceux qui le perçoivent et qui désespèrent sont les conservateurs qui se rendent compte qu'il y a de moins en moins d'éléments à préserver et que toutes les valeurs qui les nourrissaient autrefois (patrie, religion, monarchie, ordre) se diluent à vue d'œil.
Entre ceux qui voient le verre comme complètement plein et ceux qui le voient comme sec, il y a une troisième option : le teetotaler. Laissez-nous vous expliquer.
Si le progrès ne peut pas toujours être considéré comme positif, mais que l'on peut même voir dans certains de ses traits avant-gardistes, voire sinistres (les propositions de sexualité de Unidas Podemos et de la gauche le sont, ainsi que l'accent mis sur tout ce qui est négatif et destructeur : avortement, euthanasie, légalisation des drogues), le conservatisme n'a aujourd'hui aucun sens, alors que toutes les institutions et les valeurs sur lesquelles il était fondé tombent les unes après les autres (aristocratie, religion, patrie). Ni l'optimisme ni le désespoir ne sont des attitudes valables dans notre époque troublée.
Même dans les moments les plus difficiles de ma vie, deux idées m'ont toujours fait avancer, gravées au plus profond de mon âme. La première m'a été inculquée par Julius Evola: "Si vous ne pouvez rien faire contre la modernité, faites en sorte que la modernité ne puisse rien faire contre vous". Je suis conscient des derniers développements de la modernité et je m'intéresse à son évolution future, mais je pourrais vivre sans eux. Je suis présent sur certains réseaux sociaux, mais ce n'est pas devenu le centre de ma vie. Je réponds aux messages sur mon téléphone portable, mais je ne les zappe pas. Je suis dans le monde moderne, je vis dans le monde moderne, mais je ne m'identifie pas à lui et je pourrais m'en passer.

La seconde idée est présente dans les travaux de René Guénon: "Les troubles partiels ne sont qu'une partie de l'ordre général". Guénon part de l'"histoire cyclique" soutenue dans les diverses traditions de l'Orient et de l'Occident, selon laquelle, "au commencement", il n'y avait pas une humanité ignorante, bestiale et primitive, issue de singes anthropoïdes, mais un âge d'or où l'humain se confondait avec la pure spiritualité. A partir de cet Eden originel, l'humanité serait entrée dans un processus de décadence, dont nous vivons aujourd'hui l'extrême limite. La fin du cycle précède le début d'un autre. Par conséquent, tout ce que nous pouvons voir aujourd'hui comme étant catastrophique, chaotique, sinistre et exaspérant, n'est rien d'autre que des "désordres partiels", qui, comme le tonnerre et les vents d'ouragan, accompagnent chaque tempête tropicale, mais après lesquels, le Soleil brille à nouveau invinciblement en haut, c'est-à-dire que l'Ordre - avec une majuscule - est rétabli.
Notre génération (et sûrement celle de nos enfants et petits-enfants) continuera à vivre dans cet environnement de crise en constante mutation. Nous pouvons penser à ce que sera l'Espagne dans les 50 prochaines années, un pays qui n'aura pas réussi à décoller, qui se sera désintégré intérieurement, dans lequel on chantera encore les gloires de la transition, on se souviendra de Suárez, Felipe et Aznar comme des "grands de la démocratie", nous aurons subi une nouvelle crise économique, nous serons toujours à la périphérie de l'Europe qui, à son tour, sera devenue la périphérie du monde technologique et globalisé. Nous vivrons de subventions, nous consommerons de la malbouffe, de la junk-culture, la religion traditionnelle aura été remplacée par le monde des sectes, la criminalité multiethnique se sera cristallisée en mafias qui rivaliseront avec les partis politiques en termes d'influence, à l'exception d'une petite élite de privilégiés et de bénéficiaires de la mondialisation, le reste de la population vivra, soit sur le fil du rasoir subventionné par les impôts d'un autre groupe plus petit, avec un travail stable et craignant la possibilité de le perdre. L'"éducation" et la "santé" seront les deux grands perdants. La sauvagerie, la toxicomanie et les maladies psychologiques et chroniques ou les pandémies seront les compagnons inséparables avec les nouveaux "gadgets intelligents" ... La politique? Des gens qui se battent pour profiter des deniers publics, rien de plus. Des alternatives? Elles ne sont ni là ni à attendre.
Désespérant? Pas du tout: "tout désordre partiel fait partie d'un ordre plus général". C'est dans les moments de plus grande crise et de désintégration que les meilleurs esprits choisissent de se retirer des feux de la rampe, de s'entraîner, de se préparer par tous les moyens, de créer des réseaux, en un mot, de préparer l'alternative pour "le moment venu". Car ce moment, n'en doutez pas, viendra. Le vieux dicton nous rappelle qu'"il vaut mieux allumer une bougie que de maudire l'obscurité".
Cela explique aussi pourquoi, après des situations de crise extrême, apparaissent les figures des grands souverains de l'histoire, ceux qui ont résisté, qui sont remontés à la surface dès qu'ils ont eu suffisamment de force intérieure, après avoir tenu bon en temps de crise. Et n'ayez aucun doute sur le fait que la génération de résistants qui émergera dans la seconde moitié du siècle sera plus forte que toute autre parce qu'elle aura enduré plus que toute autre dans l'histoire les désintégrations de la dernière étape de cet âge sombre. L'acier le plus dur est celui qui a été le plus martelé.
09:56 Publié dans Actualité, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, kali yuga, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Les quatre phases de la révolution conservatrice
par Ernesto Milà
Ex: https://info-krisis.blogspot.com/2019/01/365-quejios-244-las-cuatro-fases-de-la.html?m=1&fbclid=IwAR3y8SlxZ43hF2XxTr391kJY8GD2nJ03la56M7H4Wk1MTtcA9pHzb_sbcVU
Je lisais des articles de Julius Evola, écrits entre 1934 et 1943 sur l'État. Evola présente un double danger pour ceux qui prennent son œuvre de manière dogmatique : l'"escapisme" (utiliser ses textes pour fuir la réalité: "si nous sommes dans le Kali-Yuga, on ne peut rien faire d'autre qu'attendre") et la "casuistique" (trouver à chaque instant la phrase d'Evola qui convient le mieux pour soutenir ses propres positions, en oubliant que son œuvre couvre soixante ans et des situations très différentes). Je vais donner un exemple relativement courant chez certains "évoliens argentins": étant donné qu'Evola analyse l'islam et a une opinion positive de cette religion, ils comprennent cela comme une acceptation de tout ce qui vient de l'islam... y compris le djihadisme, qui ne serait rien d'autre que le tribut que l'Occident devrait payer pour s'être séparé de sa tradition. Evola, évidemment, se moquerait de ces positions et lui-même n'a pas hésité à varier ses positions à différents moments de sa vie. Cependant, dans la collection de textes écrits pour les revues Lo Stato, La Vita Italiana, Il Regime Fascista et Il Corriere Padano, on peut voir certaines idées - qu'il a confrontées à Carl Schmitt - sur la "reconstruction de l'idée de l'État véritable" et la manière d'y parvenir. Il convient de rappeler certaines des idées qu'il a avancées et qui peuvent être considérées comme la "stratégie de la révolution conservatrice".
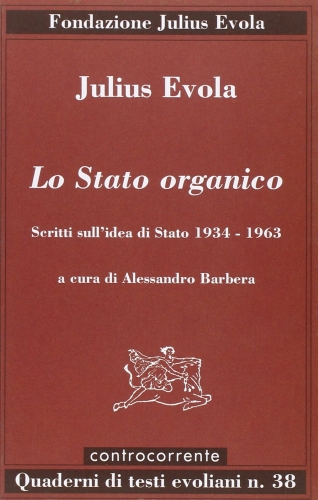
En effet, Evola, comme on le sait, était parfaitement conscient que le temps jouait contre les principes traditionalistes qu'il défendait et qui ont connu un moment de rupture au moment même de la Révolution française. La crise s'est aggravée avec la révolution russe. Il était donc impossible de penser en termes de "tout ou rien": il était clair qu'une "révolution traditionnelle" (c'est-à-dire une ré-révolution menant au modèle idéal des origines) était impossible. Il a donc décomposé le processus de la "révolution conservatrice" en quatre phases qui, comme les barreaux d'une échelle, devaient être gravis de manière ordonnée, l'un après l'autre, dans une succession inexorable vers le but final. Les thèmes qui devaient présider à chacune de ces phases étaient les suivants:
- Lutte contre le marxisme et ses différentes variétés, toutes reconnaissables par le culte des masses.
- Lutte contre les conceptions bourgeoises.
- Lutte pour la formation d'une "nouvelle aristocratie", et
- Lutte pour la réinstallation au centre de l'État d'une idée supérieure de caractère spirituel.
Je crois d'ailleurs qu'il s'agit d'une idée, apparue entre 1934 et 1940, qu'il n'a jamais écartée et dans laquelle il s'est toujours réaffirmé. Il est important de souligner que cette succession de phases devait être couronnée, selon les termes d'Evola, non pas par une affirmation du "totalitarisme", mais de l'État traditionnel. Il ne faut pas oublier qu'Evola n'a jamais adhéré au fascisme et que, tout au plus, ce qu'il proposait était de considérer le fascisme comme un "état de fait" qui pouvait être rectifié, mais qui comportait quelques éléments problématiques, dont le culte des masses. Dans son Fascisme vu de droite, Evola aborde point par point les différences entre le fascisme et l'État traditionnel. Mais ce n'est pas cet extrême qui nous intéresse maintenant, mais la gradation par étapes. Pourquoi en est-il ainsi ?
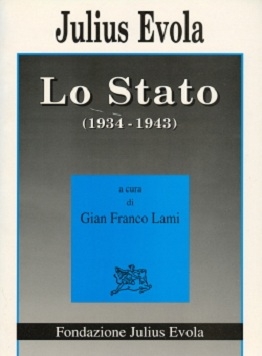 La première étape - la lutte contre le marxisme et ses avatars ultérieurs - semble évidente: Evola, au vu de ce qui s'était passé en URSS et dans les pays où le communisme avait triomphé, avant et après la guerre mondiale, enregistrait une sorte de monstrueuse régression finale, une absence absolue de libertés, la destruction de tout résidu d'organisation "traditionnelle", à commencer par la famille, et une égalité absolue qui équivalait à une dépersonnalisation totale. Il n'est donc pas surprenant que certains des articles d'Evola d'après-guerre aient défendu l'alignement de l'Italie sur les États-Unis ou sur l'OTAN elle-même. En substance, la politique du Mouvement social italien s'inspirait des idées d'Evola et celle-ci en faisait partie (que ses partisans s'en souviennent aujourd'hui ou non: elle ne figure pas dans ses grandes œuvres de pensée, mais elle figure dans les articles qu'il écrivait pour le Secolo d'Italia ou pour le quotidien Roma). Sans oublier, bien sûr, que la lutte contre le marxisme mobilise des membres de différents groupes sociaux qui "réagissent" à la possibilité que l'État tombe entre leurs mains. Jusqu'à présent, cette position n'est rien de plus que celle du centre-droit, et si elle devait s'arrêter là, la proposition d'Evola ne serait pas très différente de celles faites chaque matin par Jiménez Losantos sur ses ondes de la radio. Mais Evola a énoncé une deuxième étape.
La première étape - la lutte contre le marxisme et ses avatars ultérieurs - semble évidente: Evola, au vu de ce qui s'était passé en URSS et dans les pays où le communisme avait triomphé, avant et après la guerre mondiale, enregistrait une sorte de monstrueuse régression finale, une absence absolue de libertés, la destruction de tout résidu d'organisation "traditionnelle", à commencer par la famille, et une égalité absolue qui équivalait à une dépersonnalisation totale. Il n'est donc pas surprenant que certains des articles d'Evola d'après-guerre aient défendu l'alignement de l'Italie sur les États-Unis ou sur l'OTAN elle-même. En substance, la politique du Mouvement social italien s'inspirait des idées d'Evola et celle-ci en faisait partie (que ses partisans s'en souviennent aujourd'hui ou non: elle ne figure pas dans ses grandes œuvres de pensée, mais elle figure dans les articles qu'il écrivait pour le Secolo d'Italia ou pour le quotidien Roma). Sans oublier, bien sûr, que la lutte contre le marxisme mobilise des membres de différents groupes sociaux qui "réagissent" à la possibilité que l'État tombe entre leurs mains. Jusqu'à présent, cette position n'est rien de plus que celle du centre-droit, et si elle devait s'arrêter là, la proposition d'Evola ne serait pas très différente de celles faites chaque matin par Jiménez Losantos sur ses ondes de la radio. Mais Evola a énoncé une deuxième étape.
L'anti-bourgeoisie était la deuxième revendication à brandir au moment où le "danger communiste" était éradiqué. Car il ne s'agissait pas d'accepter l'établissement des valeurs et des conceptions bourgeoises qui, historiquement, avaient accompagné la naissance de la bourgeoisie, du libéralisme et des révolutions qu'elle avait menées depuis la Révolution américaine et la Révolution française à la fin du XVIIIe siècle. C'est là qu'apparaît la rupture entre le centre-droit libéral et les courants traditionalistes: dans l'acceptation ou la non-acceptation de l'économie de marché et de ses principes. De même, la doctrine de la bourgeoisie est liée à la "parti(to)cratie" et au républicanisme en politique et dans les habitudes sociales au conformisme, à la vie confortable, au sentimentalisme et aux valeurs du romantisme. Une telle attitude ne peut être adoptée à l'étape précédente: si l'on reconnaît que le danger le plus extrême est le bolchevisme, il s'agit d'unir les forces pour l'éradiquer, mais une fois cet objectif atteint, il s'agit de se rappeler que ce n'était pas l'objectif final, mais le premier objectif intermédiaire: le suivant est la lutte contre cet élément qui a rendu possible l'existence du bolchevisme, la bourgeoisie industrielle et son faisceau d'idées.
On peut dire que le fascisme a réalisé ces deux objectifs et même qu'il a établi des conceptions militantes et anti-bourgeoises, mais il n'est pas allé beaucoup plus loin, sauf dans certains secteurs de la "révolution allemande", fortement influencés par les idées des "jeunes conservateurs" (Jungkonservativen). Ces secteurs prônent la création d'une nouvelle aristocratie pour reprendre les rênes de l'État. Cette "nouvelle aristocratie" devait prendre la forme et avoir l'éthique d'une "aristocratie guerrière", non pas tant parce qu'elle était belliciste que parce qu'elle assumait et incarnait les valeurs militaires. Evola, à un moment donné dans les années 30 et surtout lors de ses tournées en Allemagne et dans ses conférences au Herrenklub, soutenait - et en cela sa position était la même que celle défendue en Espagne par la revue Acción Española - que l'aristocratie du sang devait à nouveau assumer ses responsabilités et se configurer comme la nouvelle élite de la nation. Evola le résume dans un article publié dans Lo Stato (février 1943): "C'est une nouvelle époque aristocratique qui doit s'affirmer au-delà de la décadence bourgeoise de la civilisation occidentale". Pour Evola, ce sont les valeurs enseignées dans les académies militaires et restées recluses dans les hauts murs de l'armée qui doivent former une "élite" entre les mains de laquelle seront tenues les rênes du nouvel État. Ici, la position d'Evola s'éloigne du tronc central des fascismes qui, au fond, étaient des mouvements de masse, anti-démocratiques, anti-bourgeois, anti-bolcheviques, mais totalitaires et sans que l'idée d'"élite" soit présente dans leur noyau doctrinal central.
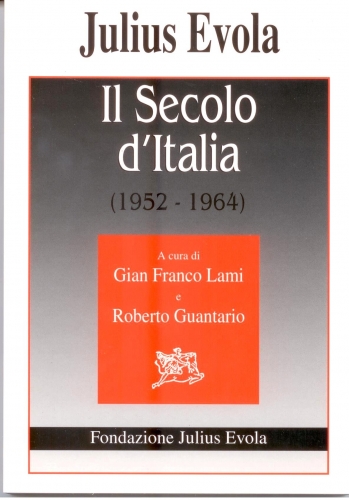
Enfin, nous en arrivons au dernier point: l'objectif d'un État traditionnel est la construction d'un empire, compris comme l'acquisition d'un "pouvoir" qui répond à une supériorité de nature spirituelle. C'est peut-être le grand problème du traditionalisme: jusqu'aux années 1960, il était clair que lorsque les Européens parlaient d'une Tradition spirituelle vivante, ils faisaient référence au catholicisme. Après Vatican II, il n'est plus aussi clair si une telle référence existe ou non, et si la ligne de l'Eglise la place comme une autre force de la modernité, ou même si elle est en mesure de faire en sorte que ses valeurs servent à forger une élite. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, beaucoup nourrissent des espoirs quant au magistère de l'Église sur les questions politiques et pas seulement politiques. Ce qu'Evola soutient, c'est qu'un État doit être fondé sur un "principe supérieur" et que ce principe, en tant que "supérieur", ne peut venir des masses (car, métaphysiquement, le supérieur ne peut venir de l'inférieur).
Si un "doute raisonnable" subsiste sur ce dernier point, c'est que nous nous trouvons dans une période de transition caractérisée par une confusion des idées, typique des temps de crise, et par la persistance des braises des anciennes traditions. Le temps et le vent - comme dans la chanson de Bob Dylan - apporteront certaines réponses et seul le temps nous dira à quoi ressembleront les synthèses du futur qui remplaceront les valeurs spirituelles et les institutions actuellement périmées: tout comme le paganisme dans son déclin a été remplacé par le christianisme, dans le déclin du christianisme apparaîtra une autre formule qui pourra être prise comme référence pour couronner le "Nouvel État" avec un principe supérieur digne de ce nom.
09:40 Publié dans Philosophie, Révolution conservatrice, Théorie politique, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julius evola, philosophie politique, révolution conservatrice, théorie politique, politologie, sciences politiques, tradition, traditionalisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook