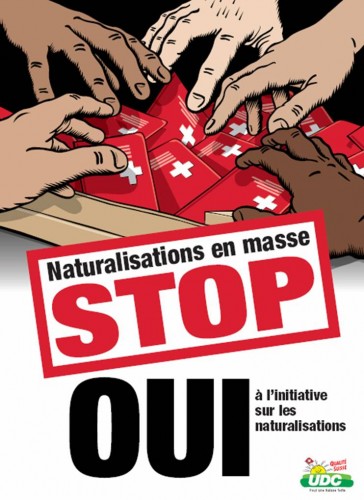War is Peace, Freedom is Slavery, Ignorance is Strength, and Debt is Recovery
In light of the ever-present and unyieldingly persistent exclamations of ‘an end’ to the recession, a ‘solution’ to the crisis, and a ‘recovery’ of the economy; we must remember that we are being told this by the very same people and institutions which told us, in years past, that there was ‘nothing to worry about,’ that ‘the fundamentals are fine,’ and that there was ‘no danger’ of an economic crisis.
Why do we continue to believe the same people that have, in both statements and choices, been nothing but wrong? Who should we believe and turn to for more accurate information and analysis? Perhaps a useful source would be those at the epicenter of the crisis, in the heart of the shadowy world of central banking, at the global banking regulator, and the “most prestigious financial institution in the world,” which accurately predicted the crisis thus far: The Bank for International Settlements (BIS). This would be a good place to start.
The economic crisis is anything but over, the “solutions” have been akin to putting a band-aid on an amputated arm. The Bank for International Settlements (BIS), the central bank to the world’s central banks, has warned and continues to warn against such misplaced hopes.
What is the Bank for International Settlements (BIS)?
The BIS emerged from the Young Committee set up in 1929, which was created to handle the settlements of German reparations payments outlined in the Versailles Treaty of 1919. The Committee was headed by Owen D. Young, President and CEO of General Electric, co-author of the 1924 Dawes Plan, member of the Board of Trustees of the Rockefeller Foundation and was Deputy Chairman of the Federal Reserve Bank of New York. As the main American delegate to the conference on German reparations, he was also accompanied by J.P. Morgan, Jr.[1] What emerged was the Young Plan for German reparations payments.
The Plan went into effect in 1930, following the stock market crash. Part of the Plan entailed the creation of an international settlement organization, which was formed in 1930, and known as the Bank for International Settlements (BIS). It was purportedly designed to facilitate and coordinate the reparations payments of Weimar Germany to the Allied powers. However, its secondary function, which is much more secretive, and much more important, was to act as “a coordinator of the operations of central banks around the world.” Described as “a bank for central banks,” the BIS “is a private institution with shareholders but it does operations for public agencies. Such operations are kept strictly confidential so that the public is usually unaware of most of the BIS operations.”[2]
The BIS was founded by “the central banks of Belgium, France, Germany, Italy, the Netherlands, Japan, and the United Kingdom along with three leading commercial banks from the United States, including J.P. Morgan & Company, First National Bank of New York, and First National Bank of Chicago. Each central bank subscribed to 16,000 shares and the three U.S. banks also subscribed to this same number of shares.” However, “Only central banks have voting power.”[3]
Central bank members have bi-monthly meetings at the BIS where they discuss a variety of issues. It should be noted that most “of the transactions carried out by the BIS on behalf of central banks require the utmost secrecy,”[4] which is likely why most people have not even heard of it. The BIS can offer central banks “confidentiality and secrecy which is higher than a triple-A rated bank.”[5]
The BIS was established “to remedy the decline of London as the world’s financial center by providing a mechanism by which a world with three chief financial centers in London, New York, and Paris could still operate as one.”[6] As Carroll Quigley explained:
[T]he powers of financial capitalism had another far-reaching aim, nothing less than to create a world system of financial control in private hands able to dominate the political system of each country and the economy of the world as a whole. This system was to be controlled in a feudalist fashion by the central banks of the world acting in concert, by secret agreements arrived at in frequent private meetings and conferences. The apex of the system was to be the Bank for International Settlements in Basle, Switzerland, a private bank owned and controlled by the world’s central banks which were themselves private corporations.[7]
The BIS, is, without a doubt, the most important, powerful, and secretive financial institution in the world. It’s warnings should not be taken lightly, as it would be the one institution in the world that would be privy to such information more than any other.
Derivatives Crisis Ahead
In September of 2009, the BIS reported that, “The global market for derivatives rebounded to $426 trillion in the second quarter as risk appetite returned, but the system remains unstable and prone to crises.” The BIS quarterly report said that derivatives rose 16% “mostly due to a surge in futures and options contracts on three-month interest rates.” The Chief Economist of the BIS warned that the derivatives market poses “major systemic risks” in the international financial sector, and that, “The danger is that regulators will again fail to see that big institutions have taken far more exposure than they can handle in shock conditions.” The economist added that, “The use of derivatives by hedge funds and the like can create large, hidden exposures.”[8]
The day after the report by the BIS was published, the former Chief Economist of the BIS, William White, warned that, “The world has not tackled the problems at the heart of the economic downturn and is likely to slip back into recession,” and he further “warned that government actions to help the economy in the short run may be sowing the seeds for future crises.” He was quoted as warning of entering a double-dip recession, “Are we going into a W[-shaped recession]? Almost certainly. Are we going into an L? I would not be in the slightest bit surprised.” He added, “The only thing that would really surprise me is a rapid and sustainable recovery from the position we’re in.”
An article in the Financial Times explained that White’s comments are not to be taken lightly, as apart from heading the economic department at the BIS from 1995 to 2008, he had, “repeatedly warned of dangerous imbalances in the global financial system as far back as 2003 and – breaking a great taboo in central banking circles at the time – he dared to challenge Alan Greenspan, then chairman of the Federal Reserve, over his policy of persistent cheap money.”
The Financial Times continued:
Worldwide, central banks have pumped thousands of billions of dollars of new money into the financial system over the past two years in an effort to prevent a depression. Meanwhile, governments have gone to similar extremes, taking on vast sums of debt to prop up industries from banking to car making.
White warned that, “These measures may already be inflating a bubble in asset prices, from equities to commodities,” and that, “there was a small risk that inflation would get out of control over the medium term.” In a speech given in Hong Kong, White explained that, “the underlying problems in the global economy, such as unsustainable trade imbalances between the US, Europe and Asia, had not been resolved.”[9]
On September 20, 2009, the Financial Times reported that the BIS, “the head of the body that oversees global banking regulation,” while at the G20 meeting, “issued a stern warning that the world cannot afford to slip into a ‘complacent’ assumption that the financial sector has rebounded for good,” and that, “Jaime Caruana, general manager of the Bank for International Settlements and a former governor of Spain’s central bank, said the market rebound should not be misinterpreted.”[10]
This follows warnings from the BIS over the summer of 2009, regarding misplaced hope over the stimulus packages organized by various governments around the world. In late June, the BIS warned that, “fiscal stimulus packages may provide no more than a temporary boost to growth, and be followed by an extended period of economic stagnation.”
An article in the Australian reported that, “The only international body to correctly predict the financial crisis ... has warned the biggest risk is that governments might be forced by world bond investors to abandon their stimulus packages, and instead slash spending while lifting taxes and interest rates,” as the annual report of the BIS “has for the past three years been warning of the dangers of a repeat of the depression.” Further, “Its latest annual report warned that countries such as Australia faced the possibility of a run on the currency, which would force interest rates to rise.” The BIS warned that, “a temporary respite may make it more difficult for authorities to take the actions that are necessary, if unpopular, to restore the health of the financial system, and may thus ultimately prolong the period of slow growth.”
Further, “At the same time, government guarantees and asset insurance have exposed taxpayers to potentially large losses,” and explaining how fiscal packages posed significant risks, it said that, “There is a danger that fiscal policy-makers will exhaust their debt capacity before finishing the costly job of repairing the financial system,” and that, “There is the definite possibility that stimulus programs will drive up real interest rates and inflation expectations.” Inflation “would intensify as the downturn abated,” and the BIS “expressed doubt about the bank rescue package adopted in the US.”[11]
The BIS further warned of inflation, saying that, “The big and justifiable worry is that, before it can be reversed, the dramatic easing in monetary policy will translate into growth in the broader monetary and credit aggregates.” That will “lead to inflation that feeds inflation expectations or it may fuel yet another asset-price bubble, sowing the seeds of the next financial boom-bust cycle.”[12] With the latest report on the derivatives bubble being created, it has become painfully clear that this is exactly what has happened: the creation of another asset-price bubble. The problem with bubbles is that they burst.
The Financial Times reported that William White, former Chief Economist at the BIS, also “argued that after two years of government support for the financial system, we now have a set of banks that are even bigger - and more dangerous - than ever before,” which also, “has been argued by Simon Johnson, former chief economist at the International Monetary Fund,” who “says that the finance industry has in effect captured the US government,” and pointedly stated: “recovery will fail unless we break the financial oligarchy that is blocking essential reform.”[13] [Emphasis added].
At the beginning of September 2009, central bankers met at the BIS, and it was reported that, “they had agreed on a package of measures to strengthen the regulation and supervision of the banking industry in the wake of the financial crisis,” and the chief of the European Central Bank was quoted as saying, “The agreements reached today among 27 major countries of the world are essential as they set the new standards for banking regulation and supervision at the global level.”[14]
Among the agreed measures, “lenders should raise the quality of their capital by including more stock,” and “Banks will also have to raise the amount and quality of the assets they keep in reserve and curb leverage.” One of the key decisions made at the Basel conference, which is named after the Basel Committee on Banking Supervision, set up under the BIS, was that, “banks will need to raise the quality of their so-called Tier 1 capital base, which measures a bank’s ability to absorb sudden losses,” meaning that, “The majority of such reserves should be common shares and retained earnings and the holdings will be fully disclosed.”[15]
In mid-September, the BIS said that, “Central banks must coordinate global supervision of derivatives clearinghouses and consider offering them access to emergency funds to limit systemic risk.” In other words, “Regulators are pushing for much of the $592 trillion market in over-the-counter derivatives trades to be moved to clearinghouses which act as the buyer to every seller and seller to every buyer, reducing the risk to the financial system from defaults.” The report released by the BIS asked if clearing houses “should have access to central bank credit facilities and, if so, when?”[16]
A Coming Crisis
The derivatives market represents a massive threat to the stability of the global economy. However, it is one among many threats, all of which are related and intertwined; one will set off another. The big elephant in the room is the major financial bubble created from the bailouts and “stimulus” packages worldwide. This money has been used by major banks to consolidate the economy; buying up smaller banks and absorbing the real economy; productive industry. The money has also gone into speculation, feeding the derivatives bubble and leading to a rise in stock markets, a completely illusory and manufactured occurrence. The bailouts have, in effect, fed the derivatives bubble to dangerous new levels as well as inflating the stock market to an unsustainable position.
However, a massive threat looms in the cost of the bailouts and so-called “stimulus” packages. The economic crisis was created as a result of low interest rates and easy money: high-risk loans were being made, money was invested in anything and everything, the housing market inflated, the commercial real estate market inflated, derivatives trade soared to the hundreds of trillions per year, speculation ran rampant and dominated the global financial system. Hedge funds were the willing facilitators of the derivatives trade, and the large banks were the major participants and holders.
At the same time, governments spent money loosely, specifically the United States, paying for multi-trillion dollar wars and defense budgets, printing money out of thin air, courtesy of the global central banking system. All the money that was produced, in turn, produced debt. By 2007, the total debt – domestic, commercial and consumer debt – of the United States stood at a shocking $51 trillion.[17]
As if this debt burden was not enough, considering it would be impossible to ever pay back, the past two years has seen the most expansive and rapid debt expansion ever seen in world history – in the form of stimulus and bailout packages around the world. In July of 2009, it was reported that, “U.S. taxpayers may be on the hook for as much as $23.7 trillion to bolster the economy and bail out financial companies, said Neil Barofsky, special inspector general for the Treasury’s Troubled Asset Relief Program.”[18]
Bilderberg Plan in Action?
In May of 2009, I wrote an article covering the Bilderberg meeting of 2009, a highly secretive meeting of major elites from Europe and North America, who meet once a year behind closed doors. Bilderberg acts as an informal international think tank, and they do not release any information, so reports from the meetings are leaked and the sources cannot be verified. However, the information provided by Bilderberg trackers and journalists Daniel Estulin and Jim Tucker have proven surprisingly accurate in the past.
In May, the information that leaked from the meetings regarded the main topic of conversation being, unsurprisingly, the economic crisis. The big question was to undertake “Either a prolonged, agonizing depression that dooms the world to decades of stagnation, decline and poverty ... or an intense-but-shorter depression that paves the way for a new sustainable economic world order, with less sovereignty but more efficiency.”
Important to note, was that one major point on the agenda was to “continue to deceive millions of savers and investors who believe the hype about the supposed up-turn in the economy. They are about to be set up for massive losses and searing financial pain in the months ahead.”
Estulin reported on a leaked report he claimed to have received following the meeting, which reported that there were large disagreements among the participants, as “The hardliners are for dramatic decline and a severe, short-term depression, but there are those who think that things have gone too far and that the fallout from the global economic cataclysm cannot be accurately calculated.” However, the consensus view was that the recession would get worse, and that recovery would be “relatively slow and protracted,” and to look for these terms in the press over the next weeks and months. Sure enough, these terms have appeared ad infinitum in the global media.
Estulin further reported, “that some leading European bankers faced with the specter of their own financial mortality are extremely concerned, calling this high wire act ‘unsustainable,’ and saying that US budget and trade deficits could result in the demise of the dollar.” One Bilderberger said that, “the banks themselves don't know the answer to when (the bottom will be hit).” Everyone appeared to agree, “that the level of capital needed for the American banks may be considerably higher than the US government suggested through their recent stress tests.” Further, “someone from the IMF pointed out that its own study on historical recessions suggests that the US is only a third of the way through this current one; therefore economies expecting to recover with resurgence in demand from the US will have a long wait.” One attendee stated that, “Equity losses in 2008 were worse than those of 1929,” and that, “The next phase of the economic decline will also be worse than the '30s, mostly because the US economy carries about $20 trillion of excess debt. Until that debt is eliminated, the idea of a healthy boom is a mirage.”[19]
Could the general perception of an economy in recovery be the manifestation of the Bilderberg plan in action? Well, to provide insight into attempting to answer that question, we must review who some of the key participants at the conference were.
Central Bankers
Many central bankers were present, as per usual. Among them, were the Governor of the National Bank of Greece, Governor of the Bank of Italy, President of the European Investment Bank; James Wolfensohn, former President of the World Bank; Nout Wellink, President of the Central Bank of the Netherlands and is on the board of the Bank for International Settlements (BIS); Jean-Claude Trichet, the President of the European Central Bank was also present; the Vice Governor of the National Bank of Belgium; and a member of the Board of the Executive Directors of the Central Bank of Austria.
Finance Ministers and Media
Finance Ministers and officials also attended from many different countries. Among the countries with representatives present from the financial department were Finland, France, Great Britain, Italy, Greece, Portugal, and Spain. There were also many representatives present from major media enterprises around the world. These include the publisher and editor of Der Standard in Austria; the Chairman and CEO of the Washington Post Company; the Editor-in-Chief of the Economist; the Deputy Editor of Die Zeit in Germany; the CEO and Editor-in-Chief of Le Nouvel Observateur in France; the Associate Editor and Chief Economics Commentator of the Financial Times; as well as the Business Correspondent and the Business Editor of the Economist. So, these are some of the major financial publications in the world present at this meeting. Naturally, they have a large influence on public perceptions of the economy.
Bankers
Also of importance to note is the attendance of private bankers at the meeting, for it is the major international banks that own the shares of the world’s central banks, which in turn, control the shares of the Bank for International Settlements (BIS). Among the banks and financial companies represented at the meeting were Deutsche Bank AG, ING, Lazard Freres & Co., Morgan Stanley International, Goldman Sachs, Royal Bank of Scotland, and of importance to note is David Rockefeller,[20] former Chairman and CEO of Chase Manhattan (now J.P. Morgan Chase), who can arguably be referred to as the current reigning ‘King of Capitalism.’
The Obama Administration
Heavy representation at the Bilderberg meeting also came from members of the Obama administration who are tasked with resolving the economic crisis. Among them were Timothy Geithner, the US Treasury Secretary and former President of the Federal Reserve Bank of New York; Lawrence Summers, Director of the White House's National Economic Council, former Treasury Secretary in the Clinton administration, former President of Harvard University, and former Chief Economist of the World Bank; Paul Volcker, former Governor of the Federal Reserve System and Chair of Obama’s Economic Recovery Advisory Board; Robert Zoellick, former Chairman of Goldman Sachs and current President of the World Bank.[21]
Unconfirmed were reports of the Fed Chairman, Ben Bernanke being present. However, if the history and precedent of Bilderberg meetings is anything to go by, both the Chairman of the Federal Reserve and the President of the Federal Reserve Bank of New York are always present, so it would indeed be surprising if they were not present at the 2009 meeting. I contacted the New York Fed to ask if the President attended any organization or group meetings in Greece over the scheduled dates that Bilderberg met, and the response told me to ask the particular organization for a list of attendees. While not confirming his presence, they also did not deny it. However, it is still unverified.
Naturally, all of these key players to wield enough influence to alter public opinion and perception of the economic crisis. They also have the most to gain from it. However, whatever image they construct, it remains just that; an image. The illusion will tear apart soon enough, and the world will come to realize that the crisis we have gone through thus far is merely the introductory chapter to the economic crisis as it will be written in history books.
Conclusion
The warnings from the Bank for International Settlements (BIS) and its former Chief Economist, William White, must not be taken lightly. Both the warnings of the BIS and William White in the past have gone unheralded and have been proven accurate with time. Do not allow the media-driven hope of ‘economic recovery’ sideline the ‘economic reality.’ Though it can be depressing to acknowledge; it is a far greater thing to be aware of the ground on which you tread, even if it is strewn with dangers; than to be ignorant and run recklessly through a minefield. Ignorance is not bliss; ignorance is delayed catastrophe.
A doctor must first properly identify and diagnose the problem before he can offer any sort of prescription as a solution. If the diagnosis is inaccurate, the prescription won’t work, and could in fact, make things worse. The global economy has a large cancer in it: it has been properly diagnosed by some, yet the prescription it was given was to cure a cough. The economic tumor has been identified; the question is: do we accept this and try to address it, or do we pretend that the cough prescription will cure it? What do you think gives a stronger chance of survival? Now try accepting the idea that ‘ignorance is bliss.’
As Gandhi said, “There is no god higher than truth.”
For an overview of the coming financial crises, see: "Entering the Greatest Depression in History: More Bubbles Waiting to Burst," Global Research, August 7, 2009.
Endnotes
[1] Time, HEROES: Man-of-the-Year. Time Magazine: Jan 6, 1930: http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,738364-1,00.html
[2] James Calvin Baker, The Bank for International Settlements: evolution and evaluation. Greenwood Publishing Group, 2002: page 2
[3] James Calvin Baker, The Bank for International Settlements: evolution and evaluation. Greenwood Publishing Group, 2002: page 6
[4] James Calvin Baker, The Bank for International Settlements: evolution and evaluation. Greenwood Publishing Group, 2002: page 148
[5] James Calvin Baker, The Bank for International Settlements: evolution and evaluation. Greenwood Publishing Group, 2002: page 149
[6] Carroll Quigley, Tragedy and Hope: A History of the World in Our Time (New York: Macmillan Company, 1966), 324-325
[7] Carroll Quigley, Tragedy and Hope: A History of the World in Our Time (New York: Macmillan Company, 1966), 324
[8] Ambrose Evans-Pritchard, Derivatives still pose huge risk, says BIS. The Telegraph: September 13, 2009: http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/banksandfinance/6184496/Derivatives-still-pose-huge-risk-says-BIS.html
[9] Robert Cookson and Sundeep Tucker, Economist warns of double-dip recession. The Financial Times: September 14, 2009: http://www.ft.com/cms/s/0/e6dd31f0-a133-11de-a88d-00144feabdc0.html
[10] Patrick Jenkins, BIS head worried by complacency. The Financial Times: September 20, 2009: http://www.ft.com/cms/s/0/a7a04972-a60c-11de-8c92-00144feabdc0.html
[11] David Uren. Bank for International Settlements warning over stimulus benefits. The Australian: June 30, 2009:
http://www.theaustralian.news.com.au/story/0,,25710566-601,00.html
[12] Simone Meier, BIS Sees Risk Central Banks Will Raise Interest Rates Too Late. Bloomberg: June 29, 2009:
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601068&sid=aOnSy9jXFKaY
[13] Robert Cookson and Victor Mallet, Societal soul-searching casts shadow over big banks. The Financial Times: September 18, 2009: http://www.ft.com/cms/s/0/7721033c-a3ea-11de-9fed-00144feabdc0.html
[14] AFP, Top central banks agree to tougher bank regulation: BIS. AFP: September 6, 2009: http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5h8G0ShkY-AdH3TNzKJEetGuScPiQ
[15] Simon Kennedy, Basel Group Agrees on Bank Standards to Avoid Repeat of Crisis. Bloomberg: September 7, 2009: http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=aETt8NZiLP38
[16] Abigail Moses, Central Banks Must Agree Global Clearing Supervision, BIS Says. Bloomberg: September 14, 2009: http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=a5C6ARW_tSW0
[17] FIABIC, US home prices the most vital indicator for turnaround. FIABIC Asia Pacific: January 19, 2009: http://www.fiabci-asiapacific.com/index.php?option=com_content&task=view&id=133&Itemid=41
Alexander Green, The National Debt: The Biggest Threat to Your Financial Future. Investment U: August 25, 2008: http://www.investmentu.com/IUEL/2008/August/the-national-debt.html
John Bellamy Foster and Fred Magdoff, Financial Implosion and Stagnation. Global Research: May 20, 2009: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=13692
[18] Dawn Kopecki and Catherine Dodge, U.S. Rescue May Reach $23.7 Trillion, Barofsky Says (Update3). Bloomberg: July 20, 2009: http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=aY0tX8UysIaM
[19] Andrew Gavin Marshall, The Bilderberg Plan for 2009: Remaking the Global Political Economy. Global Research: May 26, 2009: http://www.globalresearch.ca/index.php?aid=13738&context=va
[20] Maja Banck-Polderman, Official List of Participants for the 2009 Bilderberg Meeting. Public Intelligence: July 26, 2009: http://www.publicintelligence.net/official-list-of-participants-for-the-2009-bilderberg-meeting/
[21] Andrew Gavin Marshall, The Bilderberg Plan for 2009: Remaking the Global Political Economy. Global Research: May 26, 2009: http://www.globalresearch.ca/index.php?aid=13738&context=va
Andrew Gavin Marshall is a Research Associate with the Centre for Research on Globalization (CRG). He is currently studying Political Economy and History at Simon Fraser University.






 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg
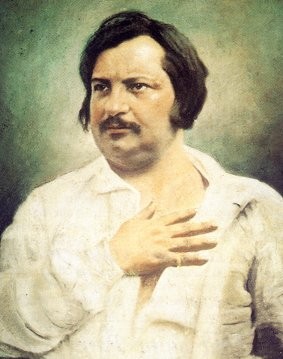





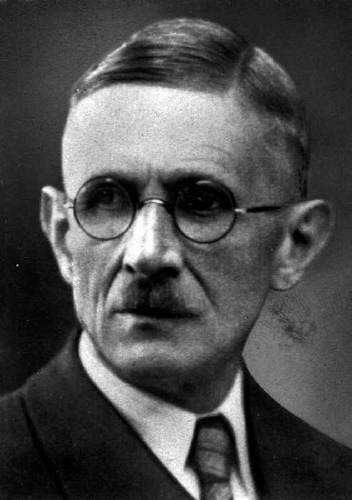 Hans-Georg MEIER-STEIN:
Hans-Georg MEIER-STEIN: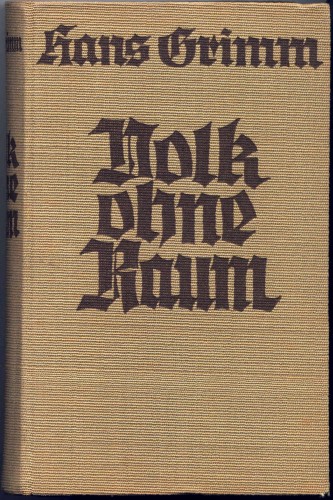
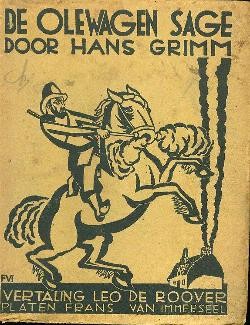
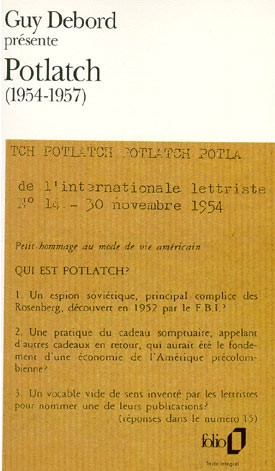
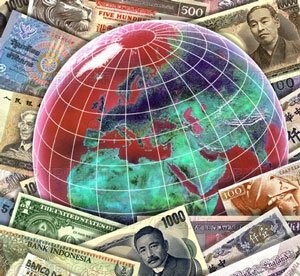

 Il ne faudrait quand même pas que les antiracistes riches, qui énervent prodigieusement ceux qui sont dans des situations difficiles, donnent sans cesse des leçons de morale aux pauvres ! Les pauvres en ont marre d’être sans cesse accusés de racisme… Nous avons perdu contact avec la réalité. Je crois qu’il faut prendre les problèmes avec humilité. Nous retrouverons le sens de la réalité le jour où la nécessité s’imposera de vraiment combattre le racisme au lieu d’y voir le moyen, pour la gauche la plus compromise dans la modernité médiatique, de préserver son identité et de s’embellir à ses propres yeux. […]
Il ne faudrait quand même pas que les antiracistes riches, qui énervent prodigieusement ceux qui sont dans des situations difficiles, donnent sans cesse des leçons de morale aux pauvres ! Les pauvres en ont marre d’être sans cesse accusés de racisme… Nous avons perdu contact avec la réalité. Je crois qu’il faut prendre les problèmes avec humilité. Nous retrouverons le sens de la réalité le jour où la nécessité s’imposera de vraiment combattre le racisme au lieu d’y voir le moyen, pour la gauche la plus compromise dans la modernité médiatique, de préserver son identité et de s’embellir à ses propres yeux. […]
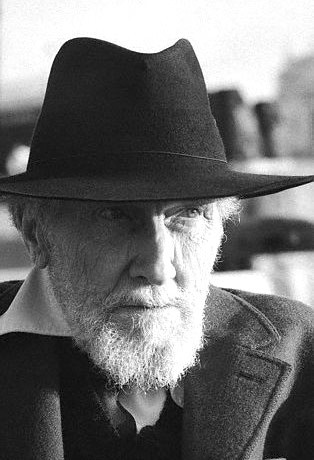 ARCHIVES DE SYNERGIES EUROPEENNES - 1997
ARCHIVES DE SYNERGIES EUROPEENNES - 1997


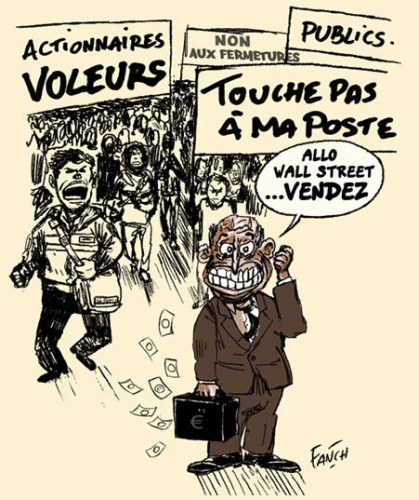
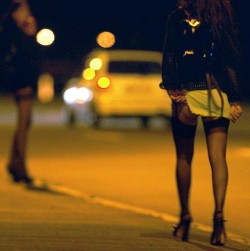
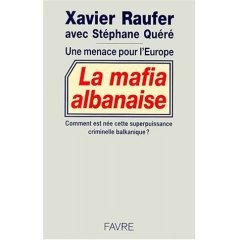
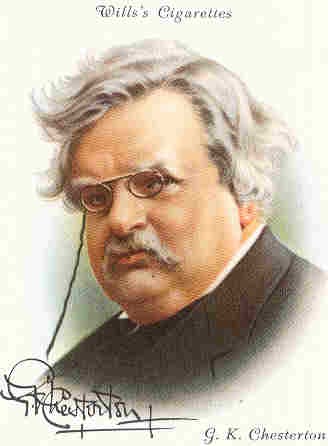

 Warmonger Wins Peace Prize
Warmonger Wins Peace Prize Rusia espera conocer los detalles del nuevo escudo antimisil de EEUU (DAM) en Europa en las consultas bilaterales previstas para el próximo 12 de octubre en Moscú, informó hoy el ministerio ruso de Asuntos Exteriores.
Rusia espera conocer los detalles del nuevo escudo antimisil de EEUU (DAM) en Europa en las consultas bilaterales previstas para el próximo 12 de octubre en Moscú, informó hoy el ministerio ruso de Asuntos Exteriores.