vendredi, 23 octobre 2009
Polonia y Estados Unidos analizan nueva estrategia militar
Polonia y Estados Unidos analizan nueva estrategia militar

El plan norteamericano pretende situar en el viejo continente sistemas de misiles móviles, en sustitución del proyecto inicial de escudo balístico propuesto por el ex presidente George Bush, y que el mes pasado la actual administración de Barack Obama desechó.
En declaraciones a la radio pública polaca, el viceministro de Defensa de ese país, Stanislaw Komorowski, dijo que hoy tendrán la oportunidad de solicitar toda la información necesaria sobre la nueva propuesta, pues todavía hay muchas preguntas.
La decisión de Obama de cancelar el polémico plan de Bush, no fue bien vista por las autoridades polacas y sí por las rusas, quienes en más de una ocasión denunciaron que este escudo balístico constituía una amenaza directa a su seguridad.
A cambio de aceptar ser la sede de las baterías de misiles, Bush prometió a Polonia la entrega de cohetes tipo Patriot, una demanda reiterada del ejército polaco por considerar necesario este tipo de armamento para repeler posibles ataques de países vecinos.
Pese a su decisión, Obama no descartó la posibilidad de buscar variantes que protegieran mejor al pueblo estadounidense, a sus tropas y a sus aliados en Europa por lo que anunció una “propuesta gradual y adaptable” a la defensa antimisiles en el continente.
Según declaraciones de funcionarios estadounidenses, la administración Obama optará mejor por misiles Patriot y SM-3 recién desarrollados y capaces de interceptar lanzamientos enemigos antes de que un misil ofensivo de largo alcance enfrente una supuesta amenaza iraní.
El sistema será desplegado inicialmente en embarcaciones estadounidenses en el Mediterráneo y no en la considerada área de influencia de Rusia en Europa Oriental.
A pesar del rechazo de la nueva administración norteamericana de seguir adelante con el escudo antimisiles, todo apunta a que el sistema Patriot se instalará finalmente en los próximos meses en Polonia, bajo el control inicial de una dotación de militares estadounidenses para asegurar su funcionamiento.
Extraído de Prensa Latina.
00:25 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europe, affaires européennes, politique internationale, politique, otan, pologne, etats-unis, atlantisme, occidentalisme, défense, actualité |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Riposte à l'encerclement médiatique et guerre idéologique
 « Riposte à l'encerclement médiatique et guerre idéologique »
« Riposte à l'encerclement médiatique et guerre idéologique »
Par Jean-Yves Clouzet
Comment sortir de l’encerclement médiatique?, s’interroge Polémia après avoir examiné avec brio La tyrannie médiatique (*). Afin de répondre à cette interrogation si actuelle, il convient de se référer à un ouvrage magistral sorti en 2002 aux Éditions Sicre, une maison d’édition royaliste légitimiste : Riposte à l’encerclement médiatique et guerre idéologique de Jean-Yves Clouzet. Il met dans ce véritable manuel de techniques de « contournement » médiatique tout son talent de conférencier, de journaliste, de soutien actif aux dissidents soviétiques et de militant solidariste. S’appuyant sur ses expériences passées, il offre à l’ensemble des réprouvés de l’Occident les moyens de se défaire de cette oppression.
Une véritable chape de plomb écrase la population
L’ouvrage commence d’abord par étudier le terrain et à disséquer le fonctionnement du Médiacosme. Sans cette approche préalable, toute menée postérieure serait vaine, car « par leur simple existence colossale et technologiquement inaccessible au commun, les mass media disposent des moyens d’une domination graduellement universelle. En quelques semaines d’effort, par un verbiage benoît, ils sont en mesure de ruiner des concepts vitaux d’une civilisation, pour y substituer des préjugés de leur fantaisie : puérils, exquis, dangereux ou pervers » (p. 20). Une véritable chape de plomb écrase la population. La cohésion même du peuple en est menacée puisque « au service de l’idéologie dominante, la classe médiatique exerce sur lui un pouvoir inouï, fait d’illusions, de persuasion et de divertissement. N’est-elle pas devenue son pédagogue sournois, intraitable et fascinante ? » (p. 17). La « pédagogie » du Système médiatique passe par les canaux de la « communication idéologique » que sont la publicité, la presse périodique, la radio-télévision, la censure molle et douce, leurs valets zélés… Les médias sont des armes de guerre culturelle, des vecteurs du « despotisme médiatique » et fourrier de la « société du spectacle » au sens debordien du terme. L’entreprise d’avilissement est totale ! « En suscitant massivement des penchants en faveur de la drogue, de la pornographie, de la violence, en faisant de l’avortement, de l’euthanasie, de l’hypersexualisme, des comportements banals et même privilégiés, en glorifiant la prééminence du criminel sur la victime, le monde médiatique prépare les génocides futurs. Par le saccage de la langue, de l’histoire, de l’art et de la foi des peuples, ils les conditionnent pour consentir à leur propre disparition. En élargissement la sphère marchande à la totalité de la vie individuelle et collective, ils mettent en place les conditions d’un esclavage comparable à ce que le monde à connu et déjà combattu » (p. 46).
Toutefois, l’« entité médiatique » ne présente aucune homogénéité interne. « Vers l’extérieur, le bloc médiatique agit comme une arme de guerre. À l’intérieur, en revanche, c’est un champ clos où s’affrontent des forces consensuelles mais rivales. […] La lutte mondiale entre les grands groupes de presse signifie la recherche acharnée des bénéfices, mais aussi de la puissance » (p. 48). Ces contentieux internes deviennent de réels atouts pour ses contempteurs.
Quelques pistes pour ébranler et démanteler le cercle idéologique
Les deuxième et troisième parties donnent aux lecteurs la possibilité d’« ébranler l’encerclement et [de la] démanteler ». S’inspirant Des falaises de marbre d’Ernst Jünger et de L’Archipel du Goulag de Soljénitsyne, Jean-Yves Clouzet en appelle - entre autres - au « bond offensif », car ce bréviaire de guérilla médiatique fourmille d’actions aisées à mener. « Dans la guerre idéologique, le bond offensif s’exprime par une série d’actes inattendus et visibles, qui répondent à un signe populaire, parfois implicite. La nature du but visé, les résultats obtenus et les moyens disponibles donnent des limites à ces actions, menées suivant des règles et dans une perspective définie. Elles sont organisées en faveur de la population, dans ses malheurs principaux et pour ses souhaits les plus justifiés par les faits et par la doctrine. En vue d’obtenir un soulagement pour cette population, un développement du mouvement et une diffusion doctrinale, cette initiative offensive s’exprime par la rencontre directe du peuple jusqu’à la symbiose et par le détournement à son service de forces intellectuelles, médiatiques et politiques jusqu’alors inertes ou adverses » (p. 140). Par « bond offensif », Jean-Yves Clouzet entend la conjonction d’« une sorte de trinité unifiée entre le peuple, l’élite et la doctrine, qui s’informent mutuellement, en permanence. Car, s’il y a un peuple, il y a une élite. […] Et, si existent le peuple et l’élite, existe la doctrine [qui] exprime un fruit de l’incarnation divine en l’humanité, spécialement dans le peuple considéré et en son histoire » (p. 139).
Suggestions et recettes de combat
Très pragmatique et fort lucide, l’auteur en appelle non point à une impossible fusion entre les branches variées et buissonnantes de la dissidence, mais à leur alliance, ou pour le moins à leur entente, leur coopération, voire leur coordination. « Prenons l’exemple des courants monarchistes, avance-t-il. Les deux royalistes, le bonapartiste et leurs variantes peuvent se reconnaître un foyer commun : le principe monarchique, avec la succession héréditaire et la personne sacrée du souverain qui assure la continuité de l’État. Ce seul point autorise un travail commun, dont la force rejaillit pour chacun. Des colloques, des études et des publications centrés sur ce thème, sans trop déborder sur ce qui divise, fortifient cette plate-forme doctrinale et son originalité idéologique » (p. 245).
En lisant Riposte à l’encerclement médiatique et guerre idéologique, on se demande si les présentes dissidences n’appliquent pas déjà quelques-uns de ses conseils. Qu’on pense donc à Radio-Courtoisie avec la réinformation, à Solidarité des Français ou Action populaire sociale avec leurs soupes hivernales et l’aide apportée aux plus démunis, à Contribuables associés avec des audits thématiques et précis, à S.O.S. Éducation pour le relèvement du niveau scolaire, à Novopress, car « une agence de presse permet de diffuser des informations auprès des media, mais aussi de fournir une référence » (p. 296). Ce livre regorge de suggestions faisables !
Internet, un « biotope » propice à toutes les pensées réfractaires au politiquement correct.
Le seul point quelque peu dépassé de l’ensemble porte sur l’appréciation du rôle d’Internet. Depuis la parution du livre, le réseau informatique planétaire a pris une dimension considérable et constitue aujourd’hui un nouvel espace. Internet devient désormais un « biotope » propice à toutes les pensées réfractaires au politiquement correct. Leur appropriation de l’univers cybernétique peut se comprendre comme l’établissement de « bases de départ » alternatives de la Reconquête.
On sait que Carl Schmitt rédigea en 1963 une Théorie du partisan qu’il voyait complémentaire à sa Notion du politique. Certes, son partisan bénéficiait d’une assise terrienne, tellurique même, et s’apparentait au Rebelle jüngerien. Comme lui, il recourt aux forêts. Par ailleurs, si les conditions historiques sont favorables au partisan, il peut obtenir des appuis populaires comme le montra fort bien la tactique militaire maoïste. Or, en ces temps de liquidité maximale et de phénomènes erratiques incessants, sa Figure prend maintenant une tournure internautique.
La « Réacosphère » a investi assez tôt la Toile. Cependant, du fait du caractère essentiellement mouvant du monde d’Internet, il serait plus juste de désigner le partisan en ligne sous les termes de « pirate », de « corsaire » ou de « flibustier », d’autant que les règles d’engagement et de fonctionnement du réseau mondial relèvent plus des codes de la guerre sur mer au temps de la marine à voile que des pratiques de la guerre de masse industrialisée. Sur cette gigantesque « île de la Tortue » virtuelle se côtoient hackers et trollers, diffuseurs (volontaires ou non) de désinformation et « guerriers virtuels ». Ils y commettent des blogues, des commentaires, des articles et/ou des vidéos. Le Système a bien compris la menace puisqu’il cherche à y renforcer en prétextant la lutte contre le « terrorisme », la « pédophilie » et le « racisme ».
Pourtant, le danger existe. Il réside pour les véritables Travailleurs postmodernes dans le risque non négligeable d’une déconnexion complète préjudiciable à terme pour leur cause. Il paraît dès lors indispensable que s’établissent des liens réels entre militants de rue et combattants en ligne. En dehors de la répercussion des actions militantes sur la Toile et de leur amplification, il devient enfin urgent que les amis, compétents en informatique, ouvrent des hébergements pour sites et acceptent d’être des fournisseurs d’accès Internet (F.A.I.). Outre que cet objectif assurerait aux nôtres un travail décent et exprimerait une entraide effective, pareille entreprise développerait - en dépit des inévitables divergences - un esprit de corps, bref, un sentiment d’appartenance communautaire. D’un point de vue pratique, avoir avec soi des F.A.I. éviterait les rétorsions qu’ont subi quelques blogues patriotes ces derniers temps.
Alors, aux armes citoyens ? Non, à vos claviers cyberdissidents !
Georges Feltin-Tracol
Le partisan sur la Toile
pour Polémia
17/10/2009
Les intertitres sont de la rédaction
•
Jean-Yves Clouzet, Riposte à l’encerclement médiatique et guerre idéologique, Sicre Éditions, Paris, 2002, 372 p.
(*) La tyrannie médiatique, ed. Polémia.com, septembre 2008, 80 p.
http://www.polemia.com/article.php?id=1729
Image: Couverture de Riposte à l’encerclement médiatique et guerre idéologique
Georges Feltin-Tracol
00:20 Publié dans Manipulations médiatiques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : médias, political correctness, guerre idéologique, métapolitique, manipulation |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Gabriele d'Annunzio: "Entre la lumière d'Homère et l'ombre de Dante"
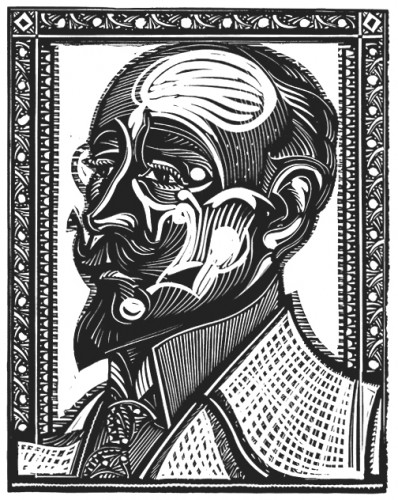 Gabriele D’Annunzio :« Entre la lumière d’Homère et l’ombre de Dante »
Gabriele D’Annunzio :« Entre la lumière d’Homère et l’ombre de Dante »
« En quelque sorte, un dialogue d'esprit, une provocation, un appel... »
Friedrich Nietzsche
Ex: http://scorpionwind.hautetfort.com/
Né en 1863, à Pescara, sur les rivages de l'Adriatique, D'Annunzio sera le plus glorieux des jeunes poètes de son temps. Son premier recueil paraît en 1878, inspiré des Odes Barbares de Carducci. Dans L'Enfant de volupté, son premier roman, qu'il publie à l'âge de vingt-quatre ans, l'audace immoraliste affirme le principe d'une guerre sans merci à la médiocrité. Chantre des ardeurs des sens et de l'Intellect, D'Annunzio entre dans la voie royale de l'Art dont l'ambition est de fonder une civilisation neuve et infiniment ancienne.
Le paradoxe n'est qu'apparent. Ce qui échappe à la logique aristotélicienne rejoint une logique nietzschéenne, toute flamboyante du heurt des contraires. Si l'on discerne les influences de Huysmans, de Baudelaire, de Gautier, de Flaubert ou de Maeterlinck, il n'en faut pas moins lire les romans, tels que Triomphe de la Mort ou Le Feu, comme de vibrants hommages au pressentiment nietzschéen du Surhomme.
Il n'est point rare que les toutes premières influences d'un auteur témoignent d'une compréhension plus profonde que les savants travaux qui s'ensuivent. Le premier livre consacré à Nietzsche (celui de Daniel Halévy publié en 1909 ) est aussi celui qui d'emblée évite les mésinterprétations où s'embrouilleront des générations de commentateurs. L'écrivain D'Annunzio, à l'instar d'Oscar Wilde ou de Hugues Rebell, demeurera plus proche de la pensée de Nietzsche,- alors même qu'il ignore certains aspects de l'œuvre,- que beaucoup de spécialistes, précisément car il inscrit l'œuvre dans sa propre destinée poétique au lieu d'en faire un objet d'études méthodiques.
On mesure mal à quel point la rigueur méthodique nuit à l'exactitude de la pensée. Le rigorisme du système explicatif dont usent les universitaires obscurcit leur entendement aux nuances plus subtiles, aux éclats brefs, aux beaux silences. « Les grandes idées viennent sur des pattes de colombe » écrivait Nietzsche qui recommandait aussi à son ami Peter Gast un art de lire bien oublié des adeptes des « méthodes critiques »: « Lorsque l'exemplaire d'Aurores vous arrivera en mains, allez avec celui-ci au Lido, lisez le comme un tout et essayez de vous en faire un tout, c'est-à-dire un état passionnel ».
L'influence de Nietzsche sur D'Annunzio, pour n'être pas d'ordre scolaire ou scolastique, n'en est pas pour autant superficielle. D'Annunzio ne cherche point à conformer son point de vue à celui de Nietzsche sur telle ou telle question d'historiographie philosophique, il s'exalte, plus simplement, d'une rencontre. D'Annunzio est « nietzschéen » comme le sera plus tard Zorba le Grec. Par les amours glorieuses, les combats, les défis de toutes sortes, D'annunzio poursuit le Songe ensoleillé d'une invitation au voyage victorieuse de la mélancolie baudelairienne.
L'enlèvement de la jeune duchesse de Gallese, que D'Annunzio épouse en 1883 est du même excellent aloi que les pièces de l'Intermezzo di Rime, qui font scandale auprès des bien-pensants. L'œuvre entière de D'Annunzio, si vaste, si généreuse, sera d'ailleurs frappée d'un interdit épiscopal dont la moderne suspicion, laïque et progressiste est l'exacte continuatrice. Peu importe qu'ils puisent leurs prétextes dans le Dogme ou dans le « Sens de l'Histoire », les clercs demeurent inépuisablement moralisateurs.
Au-delà des polémiques de circonstance, nous lisons aujourd'hui l'œuvre de D'Annunzio comme un rituel magique, d'inspiration présocratique, destiné à éveiller de son immobilité dormante cette âme odysséenne, principe de la spiritualité européenne en ses aventures et créations. La vie et l'œuvre, disions-nous, obéissent à la même logique nietzschéenne,- au sens ou la logique, désentravée de ses applications subalternes, redevient épreuve du Logos, conquête d'une souveraineté intérieure et non plus soumission au rationalisme. Par l'alternance des formes brèves et de l'ampleur musicale du chant, Nietzsche déjouait l'emprise que la pensée systématique tend à exercer sur l'Intellect.
De même, D'Annunzio, en alternant formes théâtrales, romanesques et poétiques, en multipliant les modes de réalisation d'une poésie qui est , selon le mot de Rimbaud, « en avant de l'action » va déjouer les complots de l'appesantissement et du consentement aux formes inférieures du destin, que l'on nomme habitude ou résignation.
Ce que D'Annunzio refuse dans la pensée systématique, ce n'est point tant la volonté de puissance qu'elle manifeste que le déterminisme auquel elle nous soumet. Alors qu'une certaine morale « chrétienne » - ou prétendue telle - n'en finit plus de donner des lettres de noblesse à ce qui, en nous, consent à la pesanteur, la morale d’annunzienne incite aux ruptures, aux arrachements, aux audaces qui nous sauveront de la déréliction et de l'oubli. Le déterminisme est un nihilisme. La « liberté » qu'il nous confère est, selon le mot de Bloy « celle du chien mort coulant au fil du fleuve ».
Cette façon d’annunzienne de faire sienne la démarche de Nietzsche par une méditation sur le dépassement du nihilisme apparaît rétrospectivement comme infiniment plus féconde que l'étude, à laquelle les universitaires français nous ont habitués, de « l'anti-platonisme » nietzschéen,- lequel se réduit, en l'occurrence, à n'être que le faire valoir théorique d'une sorte de matérialisme darwiniste, comble de cette superstition « scientifique » que l'œuvre de Nietzsche précisément récuse: « Ce qui me surprend le plus lorsque je passe en revue les grandes destinées de l'humanité, c'est d'avoir toujours sous les yeux le contraire de ce que voient ou veulent voir aujourd'hui Darwin et son école. Eux constatent la sélection en faveur des êtres plus forts et mieux venus, le progrès de l'espèce. Mais c'est précisément le contraire qui saute aux yeux: la suppression des cas heureux, l'inutilité des types mieux venus, la domination inévitable des types moyens et même de ceux qui sont au-dessous de la moyenne... Les plus forts et les plus heureux sont faibles lorsqu'ils ont contre eux les instincts de troupeaux organisés, la pusallinimité des faibles et le grand nombre. »
Le Surhomme que D'Annunzio exalte n'est pas davantage l'aboutissement d'une évolution que le fruit ultime d'un déterminisme heureux. Il est l'exception magnifique à la loi de l'espèce. Les héros du Triomphe de la Mort ou du Feu sont des exceptions magnifiques. Hommes différenciés, selon le mot d'Evola, la vie leur est plus difficile, plus intense et plus inquiétante qu'elle ne l'est au médiocre. Le héros et le poète luttent contre ce qui est, par nature, plus fort qu'eux. Leur art instaure une légitimité nouvelle contre les prodigieuses forces adverses de l'état de fait. Le héros est celui qui comprend l'état de fait sans y consentir. Son bonheur est dans son dessein. Cette puissance créatrice,- qui est une ivresse,- s'oppose aux instincts du troupeau, à la morale de l'homme bénin et utile.
Les livres de D'Annunzio sont l'éloge des hautes flammes des ivresses. D'Annunzio s'enivre de désir, de vitesse, de musique et de courage car l'ivresse est la seule arme dont nous disposions contre le nihilisme. Le mouvement tournoyant de la phrase évoque la solennité, les lumières de Venise la nuit, l'échange d'un regard ou la vitesse physique du pilote d'une machine (encore parée, alors, des prestiges mythologiques de la nouveauté). Ce qui, aux natures bénignes, paraît outrance devient juste accord si l'on se hausse à ces autres états de conscience qui furent de tous temps la principale source d'inspiration des poètes. Filles de Zeus et de Mnémosyne, c'est-à-dire du Feu et de la Mémoire, les Muses Héliconiennes, amies d'Hésiode, éveillent en nous le ressouvenir de la race d'or dont les pensées s'approfondissent dans les transparences pures de l'Ether !
« Veut-on, écrit Nietzsche, la preuve la plus éclatante qui démontre jusqu'où va la force transfiguratrice de l'ivresse ?- L'amour fournit cette preuve, ce qu'on appelle l'amour dans tous les langages, dans tous les silences du monde. L'ivresse s'accommode de la réalité à tel point que dans la conscience de celui qui aime la cause est effacée et que quelque chose d'autre semble se trouver à la place de celle-ci,- un scintillement et un éclat de tous les miroirs magiques de Circé... »
Cette persistante mémoire du monde grec, à travers les œuvres de Nietzsche et de D'Annunzio nous donne l'idée de cette connaissance enivrée que fut, peut-être, la toute première herméneutique homérique dont les œuvres hélas disparurent avec la bibliothèque d'Alexandrie. L'Ame est tout ce qui nous importe. Mais est-elle l'otage de quelque réglementation morale édictée par des envieux ou bien le pressentiment d'un accord profond avec l'Ame du monde ? « Il s'entend, écrit Nietzsche, que seuls les hommes les plus rares et les mieux venus arrivent aux joies humaines les plus hautes et les plus altières, alors que l'existence célèbre sa propre transfiguration: et cela aussi seulement après que leurs ancêtres ont mené une longue vie préparatoire en vue de ce but qu'ils ignoraient même. Alors une richesse débordante de forces multiples, et la puissance la plus agile d'une volonté libre et d'un crédit souverains habitent affectueusement chez un même homme; l'esprit se sent alors à l'aise et chez lui dans les sens, tout aussi bien que les sens sont à l'aise et chez eux dans l'esprit. » Que nous importerait une Ame qui ne serait point le principe du bonheur le plus grand, le plus intense et le plus profond ? Evoquant Goethe, Nietzsche précise : « Il est probable que chez de pareils hommes parfaits, et bien venus, les jeux les plus sensuels sont transfigurés par une ivresse des symboles propres à l'intellectualité la plus haute. »
La connaissance heureuse, enivrée, telle est la voie élue de l'âme odysséenne. Nous donnons ce nom d'âme odysséenne, et nous y reviendrons, à ce dessein secret qui est le cœur lucide et immémorial des œuvres qui nous guident, et dont, à notre tour, nous ferons des romans et des poèmes. Cette Ame est l'aurore boréale de notre mémoire. Un hommage à Nietzsche et à D'Annunzio a pour nous le sens d'une fidélité à cette tradition qui fait de nous à la fois des héritiers et des hommes libres. Maurras souligne avec pertinence que « le vrai caractère de toute civilisation consiste dans un fait et un seul fait, très frappant et très général. L'individu qui vient au monde dans une civilisation trouve incomparablement davantage qu'il n'apporte. »
Ecrivain français, je dois tout à cet immémorial privilège de la franchise, qui n'est lui-même que la conquête d'autres individus, également libres. Toute véritable civilisation accomplit ce mouvement circulaire de renouvellement où l'individu ni la communauté ne sont les finalités du Politique. Un échange s'établit, qui est sans fin, car en perpétuel recommencement, à l'exemple du cycle des saisons.
La philosophie et la philologie nous enseignent qu'il n'est point de mouvement, ni de renouvellement sans âme. L'Ame elle-même n'a point de fin, car elle n'a point de limites, étant le principe, l'élan, la légèreté du don, le rire des dieux. Un monde sans âme est un monde où les individus ne savent plus recevoir ni donner. L'individualisme radical est absurde car l'individu qui ne veut plus être responsable de rien se réduit lui-même à n'être qu'une unité quantitative,- cela même à quoi tendrait à le contraindre un collectivisme excessif. Or, l'âme odysséenne est ce qui nous anime dans l'œuvre plus vaste d'une civilisation. Si cette Ame fait défaut, ou plutôt si nous faisons défaut à cette âme, la tradition ne se renouvelle plus: ce qui nous laisse comprendre pourquoi nos temps profanés sont à la fois si individualistes et si uniformisateurs. La liberté nietzschéenne qu'exigent les héros des romans de D’annunzio n'est autre que la liberté supérieure de servir magnifiquement la Tradition. Ce pourquoi, surtout en des époques cléricales et bourgeoises, il importe de bousculer quelque peu les morales et les moralisateurs.
L'âme odysséenne nomme cette quête d'une connaissance qui refuse de se heurter à des finalités sommaires. Odysséenne est l'Ame de l'interprétation infinie,- que nulle explication « totale » ne saurait jamais satisfaire car la finalité du « tout » est toujours un crime contre l'esprit d'aventure, ainsi que nous incite à le croire le Laus Vitae:
« Entre la lumière d'Homèreet l'ombre de Dante
semblaient vivre et rêver
en discordante concorde
ces jeunes héros de la pensée
balancés entre le certitude
et le mystère, entre l'acte présent
et l'acte futur... »
Victorieuse de la lassitude qui veut nous soumettre aux convictions unilatérales, l'âme odysséenne, dont vivent et rêvent les « jeunes héros de la pensée », nous requiert comme un appel divin, une fulgurance de l'Intellect pur, à la lisière des choses connues ou inconnues.
Luc-Olivier d'Algange
source: Le cygne noir numéro 1 >> Intentions 5
00:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, littérature italienne, lettres italiennes, italie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Les Académies de la Renaissance
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1996
 Les académies de la Renaissance
Les académies de la Renaissance
Grande historienne de la Renaissance, Frances A. Yates (1899-1981) est connue en France pour les remarquables livres que sont L'art de la mémoire (Gallimard), Giordano Bruno et la tradition hermétique (Dervy), La philosophie occulte (Dervy) et Astrée (Belin). Les PUF publient son troisième ouvrage paru en 1947 en Grande-Bretagne, Les Académies en France au XVIième siècle. J. B. Trapp écrit dans son avant-propos: «Partant de Pontus de Tyard, F. Yates remonta jusqu'à la source du mouvement académique de la Renaissance, l'Académie platonicienne de Florence patronnée par les Médicis. De là, elle parvint aux académies fondées en France par les rejetons de la branche féminine des Médicis, Charles IX et Henri III. Semblables académies, devait-elle constater, faisaient mentir la connotation d'inutilité et d'inefficacité traditionnellement associée aux travaux académiques. Le néo-platonisme florentin, qui visait à réconcilier entre elles, non seulement la religion et la philosophie, mais également les factions religieuses et les religions elles-mêmes, avait été introduit en France par des médiateurs comme Jacques Lefèvre d'Etaples, Symphorien Champier, Maurice Scève et Marguerite de Navarre. Cette influence devait marquer profondément la pensée irénique française, par l'intermédiaire des membres de la Pléiade et à travers l'Académie de poésie et de musique de Baif. Une telle philosophie était à la fois profonde et riche de potentialités. Mais la tragédie —ainsi le perçut très vivement Frances Yates— fut que l'Europe, une fois de plus, devait se trahir elle-même. La science, la pensée, les préoccupations diverses des académies, cette réunion en un tout harmonieux de toutes les activités humaines, tout ceci eût pu servir à l'instauration de la paix et de la tolérance. Mais cette chance fut réduite à néant par les politiciens et par les zélotes des guerres de religion. L'idéal académique survécut cependant. Il persista pendant la prolifération des académies partielles au XVIIième siècle; on le retrouve chez les philosophes du XVIIIième siècle, désireux d'opérer la libération des esprits et d'instaurer la tolérance religieuse par le moyen de la propagation du savoir encyclopédique; et finalement, au XIXième siècle, la création de l'Institut de France devait rassembler de nouveau les arts et les sciences. Les académies en France au XVIième siècle apparaît, sur plus d'un point, comme l'ouvrage le plus important et le plus stimulant de Frances Yates» (J. de BUSSAC)
Frances A. YATES, Les académies en France au XVIième siècle, PUF 1996, 512 pages, 338 F.
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, 16ème siècle, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 22 octobre 2009
Serie televisiva turca provoca fuerte tension entre Turquia e Israel
Serie televisiva turca provoca fuerte tensión entre Turquía e Israel

La primera cadena de la televisión pública turca TRT 1 difundió el martes, a una hora de gran audiencia, un episodio de una serie que desató la ira del ministro de Relaciones Exteriores israelí, Avigdor Lieberman, y malestar en el primer ministro Benjamin Netanyahu. Lieberman decidió al día siguiente convocar al encargado de negocios turco en Tel Aviv, en ausencia del nuevo embajador, que aún no ha asumido sus funciones.
“Israel no puede aceptar incitaciones al odio contra su Estado y sus soldados. Incitaciones que pueden desembocar en atentados contra los numerosos turistas judíos e israelíes que viajan a Turquía”, declaró el jueves, tras esta audiencia, un responsable del ministerio de Relaciones Exteriores israelí, Naor Gilaon.
Por su parte, Netanyahu declaró a los periodistas: “Nos sentimos también molestos, es lo menos que se puede decir, por lo que hemos visto estos últimos tiempos de parte de Turquía”. “Esto plantea la pregunta: ¿qué dirección toma la política de Turquía, esperamos que sea hacia la consolidación de la paz, no de los extremismos”, añadió.
En el episodio de la serie se ve a niños palestinos que tiran piedras contra soldados israelíes, que responden con tiros, matando a varios de ellos, entre ellos cuales una niñita que sonríe antes de su último suspiro. También muestra a soldados israelíes cuando matan a un recién nacido en los brazos de su padre, poco después de su nacimiento en un edificio en ruinas, debido a que la pareja no pudo trasladarse a un hospital.
La audiencia de la serie es por el momento marginal: ocupa el puesto 97º en el ránking de programas.
El periodista islamista Hakan Albayrak, consejero de los productores de la serie, defendió su contenido. “¿Por qué las escenas de matanzas serían exageradas? ¿No se puede hablar de un Estado que cometió matanzas?”, preguntó Albayrak.
Este incidente diplomático se suma a otro ocurrido la semana pasada en el ámbito militar. De forma inesperada, Turquía anuló las maniobras aéreas que debía llevar a cabo con la aviación israelí, a pesar del acuerdo de cooperación militar firmado con Israel en 1996. Una decisión que fue condenada por Israel y Estados Unidos.
Las relaciones entre los dos países comenzaron a degradarse en el invierno pasado, cuando el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, criticó a Israel por su comportamiento durante la ofensiva militar contra la Franja de Gaza.
Turquía “no recibe instrucciones” de Israel, declaró el jueves Erdogan, que dirige desde 2002 un gobierno islamista conservador.
El miércoles, Erdogan, había declarado a una televisión árabe que las maniobras con Israel habían sido anuladas para respetar la voluntad del pueblo turco, “que no quiere más cosas de ese estilo”.
La diplomacia de ambos países se esfuerza por calmar los ánimos. “Hay un efecto bola de nieve, en las declaraciones de unos y otros. Pero los dirigentes de ambos países saben que la estructura de las relaciones bilaterales es fuerte”, señaló a la AFP un diplomático turco de alto rango. “Incluso entre amigos muy cercanos pueden aparecer diferencias”, dijo por su parte Gaby Levy, embajador de Israel en Ankara.
Burak Akinci
Extraído de AFP.
00:24 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : turquie, israël, proche orient, moyen orient, méditerranée |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
"Ballade au Pays de Scarlett": le nouveau livre de Jean-Claude Rolinat
 “ Ballade au pays de Scarlett ”,
“ Ballade au pays de Scarlett ”,
le nouveau livre de Jean-Caude Rolinat…
Cinq questions à Jean-Claude Rolinat :
Jean-Claude Rolinat vient de publier « Ballade au pays de Scarlett» aux Editions Fol’fer, dans lequel il évoque ce Deep South conservateur qui refusa la normalisation voulue par Washington et s’engagea dans une guerre dite de sécession. Conçu comme un abécédaire tout à la fois historique et touristique, le pays de Scarlett a trouvé en Rolinat un de ses meilleurs portraitistes. L’auteur n’a pas seulement saisi le cliché de ce Sud profond, il en a capté l’âme.
Catherine Robinson
Quelle est l’ambition de cette “ Ballade au pays de Scarlett ” ?
Au risque de paraître prétentieux, j’écris les livres que j’aurais aimé lire… D’autre part, s’agissant de celui-ci, j’ai dû aller onze ou douze fois aux Etats-Unis, plus particulièrement dans le Sud, et, à chaque voyage, je sentais monter en moi l’irrésistible envie de “ témoigner ”, d’inciter les gens à venir admirer des paysages autres que les merveilleux mais classiques décors de l’Ouest, sentir la geste, l’épopée d’un peuple qui résista de 1861à 1865 à l’énorme machine de guerre nordiste… De plus, dans nos milieux, il est de bon ton de confondre l’Amérique avec son gouvernement, de faire de sa pseudo intelligentsia le reflet frelaté du pays réel. Si le monde devait juger la France à travers les chansonnettes de Carla Bruni… au secours ! Il ne faut donc pas confondre le gouvernement fédéral de cette puissante thalassocratie forcément impérialiste qui, au passage, ne se nourrit que de nos faiblesses, avec le peuple de l’Amérique profonde, rurale, conservatrice, où les gens sont attachés, tout comme nous, aux simples valeurs traditionnelles. Et puis, “ les forts en gueule ” de l’anti-américanisme primaire, sans discernement, sont souvent les mêmes qui, jadis, étaient pétrifiés de trouille face aux chars soviétiques, bien contents alors d’avoir les GI’s de l’Oncle Sam présents en Europe. Cela étant dit, les temps ont changé, j’en suis bien conscient.
J’espère que l’achat de ce livre poussera plus d’un lecteur à boucler sa valise et à atterrir à Atlanta, à la Nouvelle Orléans, à Memphis ou à Nashville car, tout en étant un petit ouvrage historico-politique, c’est aussi surtout, et avant tout, un guide touristique.
L’Amérique telle que vous nous la décrivez est loin de ressembler aux modèles des séries télé américaines et encore plus loin de ce prétendu vide culturel comme d’un certain mode de vie envahissant (Pop Art, fast food…). Qu’en est-il réellement ?
L’Amérique est à elle seule un condensé du monde entier : toutes les ethnies de la terre s’y côtoient. Toutefois, les Etats du Sud font entendre leur petite musique particulière. Sans doute parce que c’est là que la vieille Europe et sa civilisation survécurent le plus longtemps. Et puis la nature, je ne vous dis que ça ! Des chênes d’où pend comme des guirlandes de Noël la mousse espagnole, la vigne vierge qui part à l’assaut des fils électriques, des torrents bondissants et des chutes d’eau spectaculaires (c’est là qu’ont été tournés par exemple des films tels que Le Dernier des Mohicans ou Délivrance), des magnolias fleuris, des marais aux eaux noires comme la stout irlandaise où les alligators ne dorment que d’un œil… Les paysages et l’histoire, ainsi que les peuples qui les habitent et qui la font, sont étroitement imbriqués, indissociables, mêlant à chaque instant, à chaque coin de rue passé et présent. Malgré la malédiction de l’esclavage ou à cause de lui, Noirs et Blancs qui, comme l’huile et l’eau, ne se mélangent guère, sont toutefois parties prenantes de ces Etats américains à part entière et entièrement à part, inséparables, comme les bandes zébrées du célèbre mammifère africain. Quant au “ vide culturel ” que vous évoquez, il suffit de franchir les portes de n’importe quel musée des villes du Sud pour tordre le cou à cette rumeur…
Parmi les multiples sujets historiques, vous traitez de Napoléon III et des Sudistes. Pourriez-vous nous en dire quelques mots ?
L’empereur Napoléon III, qui vérifiait ce que Tocqueville avait pressenti une ou deux décennies avant lui, voulait contenir sinon contrecarrer cette puissance émergente. Ce qui explique qu’il souhaita jouer un rôle d’arbitre dans le conflit entre les Etats qui, quelque part, l’arrangeait bien dans sa tentative de mettre un prince européen sur le trône du Mexique. Il informa le représentant de la Confédération, Sidell, qu’il espérait obtenir une suspension des hostilités. Une façon pour lui d’afficher ses préférences sudistes. Mais l’Angleterre ne suivit pas la France, la Russie non plus. Alors, il abandonna. Le gouvernement de l’Union s’en souviendra, en soutenant ouvertement Juarez contre Maximilien que Napoléon III avait imposé comme Empereur aux Mexicains. On connaît la suite…
Question guide touristique, vous nous indiquez, parmi les perles du Sud, une petite ville du nom de Madison à voir impérativement. Quelle est sa particularité ?
À elle seule, la petite cité de Madison en Géorgie, située sur l’Interstate 20 à l’est d’Atlanta, même si elle n’a pas l’ampleur de la somptueuse Savannah ou de la nonchalante et élégante Charleston, est la quintessence des villes du Sud : maisons antebellum de style victorien, antiquaires et végétation rafraîchissante. Et puis, c’est une des rares agglomérations qui échappa à la fureur de ce pyromane de général Sherman dans sa marche vers la mer…
S’il n’y avait qu’un livre d’écrivain du Sud à citer – hormis Margaret Mitchell –, quel est celui que vous choisiriez ?
Disons deux ou trois… Puiser au hasard dans l’œuvre de Faulkner bien sûr, avec son récurrent et mythique comté de Yoknapatawpha qui pourrait bien être celui d’Oxford où il vivait dans le Mississippi, sans oublier non plus Vladimir Volkoff avec ses Nouvelles américaines ainsi que Dominique Venner avec Le Blanc Soleil des Vaincus car, après tout, the South gonna rise again !
Propos recueillis par Catherine Robinson
Publié dans le quotidien Présent
Jean-Claude Rolinat, Ballade au pays de Scarlett, Atelier Fol’Fer, BP 20047, 28260 Anet. Tél : 06 74 68 24 40. Fax : 09 58 28 28 66. Prix : 26 euros franco.
NDLR : Jean-Claude Rolinat participera à la 3ème journée nationale et identitaire organisée par Synthèse nationale, mercredi 11 novembre prochain au Forum de Grenelle (5, rue de la Croix Nivert 75015 Paris). Il dédicacera ses livres.
Source : Synthèse Nationale [1]
Article printed from :: Novopress Québec: http://qc.novopress.info
URL to article: http://qc.novopress.info/6688/%e2%80%9c-ballade-au-pays-de-scarlett-%e2%80%9d-le-nouveau-livre-de-jean-caude-rolinat/
URLs in this post:
[1] Synthèse Nationale: http://synthesenationale.hautetfort.com/archive/2009/10/15/ballade-au-pays-de-scarlett-le-nouveau-livre-de-jean-caude.html
00:18 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, histoire, etats-unis, sudistes, confédération |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
10ème Congrès de l'ADSAV
00:15 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bretagne, celticité, celtitude, mouvement breton, celtes, régionalisme, autonomisme, régions d'europe, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
R. Steuckers: entretien pour le journal Hrvatsko Slovo
 Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998
Robert Steuckers :
Entretien pour le journal
Hrvatsko Slovo
Propos recueillis par Tomislav Sunic
1. Quelle est votre carte d'identité?
Je suis né en 1956 à Uccle près de Bruxelles. J'ai été à l'école de 1961 à 1974 et à l'Université et à l'école de traducteurs-interprètes de 1974 à 1980. Dans ma jeunesse, j'ai été fasciné par le roman historique anglais, par la dimension épique de l'Ivanhoe de Walter Scott, de la légende de Robin des Bois, par l'aventure de Quentin Durward, par les thématiques de la Table Ronde. Le cadre médiéval et la profondeur mythique ont très tôt constitué chez moi des référentiels importants, que j'ai complété avec notre propre héritage littéraire épique flamand, avec le Lion des Flandres de Hendrik Conscience, et par les thèmes bretons, découverts dans Le Loup Blanc de Paul Féval. Certes, j'ai lu à l'époque de nombreuses éditions vulgarisées, parfois imagées, de ces thématiques, mais elles n'ont cessé de me fasciner. Des films comme Excalibur ou Braveheart prouvent que ce filon reste malgré tout bien ancré dans l'imaginaire européen. En dépit des progrès techniques, du désenchantement comme résultat de plusieurs décennies de rationalisme bureaucratique, les peuples ont un besoin vital de cette veine épique, il est donc nécessaire que la trame de ces légendes ou que ces figures héroïsées demeurent des réferentiels impassables. Sur le plan philosophique, avant l'université, dans l'adolescence de 12 à 18 ans qui reste la période où s'acquièrent les bases éthiques et philosophiques essentielles du futur adulte, j'ai abordé Nietzsche, mais surtout Spengler parce qu'il met l'histoire en perspective. Pour un adolescent, Spengler est difficile à digérer, c'est évident et on n'en retient qu'une caricature quand on est un trop jeune lecteur de cet Allemand à la culture immense, qui nous a légué une vision synoptique de l'histoire mondiale. Toutefois, j'ai retenu de cette lecture, jusqu'à aujourd'hui, la volonté de mettre l'histoire en perspective, de ne jamais soustraire la pensée du drame planétaire qui se joue chaque jour et partout. Juste avant d'entrer à l'université, pendant la dernière année de l'école secondaire, j'ai découvert Toynbee, A Study of History, sa classification des civilisations, son étude des ressorts de celles-ci, sa dynamique de “challenge-and-response”; ensuite, pour la Noël 1973, il y avait pour moi dans la hotte des cadeaux Révolte contre le monde moderne de Julius Evola et une anthologie de textes de Gottfried Benn, où celui-ci insistait sur la notion de “forme”. J'avais également lu mes premiers ouvrages d'Ernst Jünger. A l'école, j'avais lu notamment le Testament espagnol de Koestler et La puissance et la gloire de Graham Greene, éveillant en moi un intérêt durable pour la littérature carcérale et surtout, avec le prêtre alcoolique admirablement mis en scène par Greene, les notions de péché, de perfectibilité, etc. que transcende malgré tout l'homme tel qu'il est, imparfait mais sublime en dépit de cette imperfection. Dès la première année à l'Université, je découvre la veine faustienne à partir de Goethe, les deux chefs-d'œuvre d'Orwell (La ferme des animaux et 1984), Darkness at Noon de Koestler (autre merveille de la littérature carcérale!). Immédiatement dans la foulée, je me suis plongé dans son ouvrage philosophique The Ghost in the Machine, qui m'a fait découvrir le combat philosophique, à mon avis central, contre le réductionnisme qui a ruiné le continent européen et la pensée occidentale en ce siècle et dont nous tentons péniblement de sortir aujourd'hui. Depuis ma sortie de l'université, j'ai évidemment travaillé comme traducteur, mais j'ai aussi fondé mes revues Orientations (1982-1992), Vouloir (depuis 1983), et co-édité avec mes amis suisses et français, le bulletin Nouvelles de Synergies Européennes (depuis 1994). Entre 1990 et 1992, j'ai travaillé avec le Prof. Jean-François Mattéi à l'Encyclopédie des Œuvres philosophiques des Presses Universitaires de France.
2. Dans les milieux politico-littéraires, on vous colle souvent l'étiquette de “droitier”. Etes-vous de droite ou de gauche. Qu'est-ce que cela signifie aujourd'hui?
Dans l'espace linguistique francophone, cela a été une véritable manie de coller à tout constestataire l'étiquette de “droite”, parce que la droite, depuis le libéralisme le plus modéré jusqu'à l'affirmation nationaliste la plus intransigeante, en passant par toutes les variantes non progressistes du catholicisme, ont été rejetées sans ménagement dans la géhenne des pensées interdites, considérées arbitrairement comme droitières voire comme crypto-fascistes ou carrément fascistes. Cette manie de juger toutes les pensées à l'aune d'un schéma binaire provient en droite ligne de la propagande communiste française, très puissante dans les médias et le monde des lettres à Paris, qui tentait d'assimiler tous les adversaires du PCF et de ses satellites au fascisme et à l'occupant allemand de 1940-44. Or, au-delà de cette polémique —que je ne reprendrai pas parce que je suis né après la guerre— je constate, comme doivent le constater tous les observateurs lucides, que les cultures dans le monde, que les filons culturels au sein de chaque culture, sont l'expression d'une pluralité inépuisable, où tout se compose, se décompose et se recompose à l'infini. Dans ce grouillement fécond, il est impossible d'opérer un tri au départ d'un schéma simplement binaire! La démarche binaire est toujours mutilante. Ceci dit, je vois essentiellement trois pistes pour échapper au schéma binaire gauche/droite.
- La première vient de la définition que donnait le grand économiste français François Perroux du rôle de l'homme dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire de la communauté où il est né par le hasard des circonstances. L'homme selon Perroux est une personne qui joue un rôle pour le bénéfice de sa communauté et non pas un individu qui s'isole du reste du monde et ne donne rien ni aux siens ni aux autres. En jouant ce rôle, l'homme tente au mieux d'incarner les valeurs impassables de sa communauté nationale ou religieuse. Cette définition a été classé à droite, précisément parce qu'elle insistait sur le caractère impassable des grandes valeurs traditionnelles, mais bon nombre d'hommes de gauche, qu'ils soient chrétiens, musulmans, agnostiques ou athées, en reconnaîtront la pertinence.
- La deuxième piste, très actuelle, est celle que nous indique le communautarisme américain, avec des auteurs comme Sandel, Taylor, McIntyre, Martha Nussbaum, Bellah, Barber,Walzer, etc. Au cours du XXième siècle, les grandes idéologies politiques dominantes ont tenté de mettre les valeurs entre parenthèses, de procéder à une neutralisation des valeurs, au bénéfice d'une approche purement technocratique des hommes et des choses. Dans les années 50 et 60, l'idéologie dominante de l'Occident, aux Etats-Unis et en Europe de l'Ouest, a été ce technocratisme, partagé par le libéralisme, la sociale-démocratie et un conservatisme qui se dégageait des valeurs traditionnelles du catholicisme ou du protestantisme (en Allemagne: de l'éthique prussienne du service à l'Etat). Les questions soulevées par les valeurs, dans l'optique d'une certaine philosophie empirique, néo-logique, étaient des questions vides de sens. Ce refus occidental des valeurs a généré un hyper-individualisme, une anomie générale qui se traduit par un incivisme global et une criminalité débridée en croissance continue. Le questionnement soulevé aujourd'hui par l'école communautarienne américaine est une réponse à l'anomie occidentale (dont on n'est pas toujours fort conscient dans les pays européens qui ont connu le communisme) et cette réponse transcende évidemment le clivage gauche/droite.
- La troisième piste est celle des populismes. Sous le titre significatif de Beyond Left and Right. Insurgency and the Establishment, une figure de proue de la gauche radicale américaine, David A. Horowitz, a publié récemment un ouvrage qui fait sensation aux Etats-Unis depuis quelques mois. Horowitz recence toutes les révoltes populaires américaines contre l'établissement au pouvoir à Washington, depuis 1880 à nos jours. Délibérément, Horowitz choisit à gauche comme à droite ses multiples exemples de révoltes du peuple contre ces oligarchies qui ne répondent plus aux nécessités cruelles qui frappent la population dans sa vie quotidienne. Horowitz brise un tabou tenace aux Etats-Unis, notamment en s'attaquant au caractère quelque peu coercitif des gauches, depuis le New Deal de Roosevelt jusqu'à nos jours. Une coercition subtile, bien camouflée derrière des paroles moralisantes... C'est à dessein que j'ai choisis ici des exemples américains, car les idéologèmes américains sont indépendants, finalement, des clivages européens nés de la seconde guerre mondiale. Même des propagandistes chevronnés ne pourront accuser de “fascisme” des filons idéologiques nés en plein centre ou en marge des traditions “républicaines” ou “démocrates”. Ce qui importe, c'est de défendre un continuum dans lequel on s'inscrit avec sa lignée.
3. Dans vos écrits sur la géopolitique, on perçoit une très nette influence des grands géopolitologues comme Kjellén, Mackinder, Haushofer et Jordis von Lohausen; vous semblez aussi vous intéresser aux travaux du Croate Radovan Pavic. De votre point de vue d'Européen du Nord-Ouest, comment percevez-vous la Mitteleuropa, plus particulièrement la Croatie?
C'est certain, j'ai été fasciné par les travaux des classiques de la géopolitique. J'ai rédigé des notes sur les géopolitologues dans l'Encyclopédie des Œuvres philosophiques, éditée par le Prof. Jean-François Mattéi (Paris, 1992). Le dernier numéro de ma revue Vouloir (n°9/1997) est consacré à ces pionniers de la pensée géopolitique. En ce qui concerne votre compatriote Pavic, c'est, avec le Français Michel Foucher (Lyon), le meilleur dessinateur de cartes expressives, parlantes, suggestives en Europe aujourd'hui. L'art de la géopolitique, c'est avant tout l'art de savoir dessiner des cartes qui résument à elles seules, en un seul coup d'oeil, toute une problématique historique et géographique complexe. Pavic et Klemencic (avec son atlas de l'Europe, paru cette année à Zagreb) perpétuent une méthode, lancée par la géopolitique allemande au début de ce siècle, mais dont les racines remontent à ce pionnier de la géographie et de la cartographie que fut Carl Ritter (1779-1859). Quant à ma vision de la Mitteleuropa, elle est quelque peu différente de celle qu'avait envisagée Friedrich Naumann en 1916. Au beau milieu de la première guerre mondiale, Naumann percevait sa Mitteleuropa comme l'alliance du Reich allemand avec l'Autriche-Hongrie, flanquée éventuellement d'une nouvelle confédération balkanique faisant fonction d'Ergänzungsraum pour la machine industrielle allemande, autrichienne et tchèque. Cette alliance articulée en trois volets aurait eu son prolongement semi-colonial dans l'empire ottoman, jusqu'aux côtes de la Mer Rouge, du Golfe Persique et de l'Océan Indien. Aujourd'hui, un élément nouveau s'est ajouté et son importance est capitale: le Rhin et le Main sont désormais reliés au Danube par un canal à gros gabarit, assurant un transit direct entre la Mer du Nord et l'espace pontique (Fleuves ukrainiens, Crimée, Mer Noire, Caucase, Anatolie, Caspienne). Cette liaison est un événment extraordinaire, une nouvelle donne importante dans l'Europe en voie de formation. La vision du géopolitologue Artur Dix, malheureusement tombé dans l'oubli aujourd'hui, peut se réaliser. Dix, dans son ouvrage principal (Politische Geographie. Weltpolitisches Handbuch, 1923), a publié une carte montrant quelles dynamiques seraient possibles dès le creusement définitif du canal Main/Danube, un projet qu'avait déjà envisagé Charlemagne, il y a plus de mille ans! Aujourd'hui le Rhin est lié à la Meuse et pourrait être lié au Rhône (si les gauches françaises et les nationalistes étriqués de ce pays ne faisaient pas le jeu des adversaires extra-européens de l'unité de l'Europe et du rayonnement de sa culture). Les trafics sur route sont saturés en Europe et le transport de marchandises par camions s'avèrent trop cher. L'avenir appartient aux péniches, aux barges et aux gros-pousseurs fluviaux. Ainsi qu'aux oléoducs transcaucasiens. Fin décembre 1997, l'armée belge en poste en Slavonie orientale a plié bagages et a acheminé tout son charroi et ses blindés par pousseurs jusqu'à Liège, prouvant de la sorte l'importance militaire et stratégique du système fluvial intérieur de la Mitteleuropa. La mise en valeur de ce réseau diminue ipso facto l'importance de la Méditerranée, contrôlée par les flottes américaine et britannique, appuyées par leur allié turc. Les Etats d'Europe centrale peuvent contrôler aisément, par leurs propres forces terrestres la principale voie de passage à travers le continent. La liaison Rotterdam/Constantza devient l'épine dorsale de l'Europe. Quant à la Croatie, elle est une pièce importante dans cette dynamique, puisqu'elle est à la fois riveraine du Danube en Slavonie et de l'Adriatique, partie de la Méditerranée qui s'enfonce le plus profondément à l'intérieur du continent européen et qui revêt dès lors une importance stratégique considérable. Au cours de l'histoire, quand la Croatie appartenait à la double monarchie austro-hongroise et était liée au Saint-Empire, dont le territoire belge d'aujourd'hui faisait partie intégrante, elle offrait à cet ensemble complexe mais mal unifié une façade méditerranéenne, que l'empire ottoman et la France ont toujours voulu confisquer à l'Autriche, l'Allemagne et la Hongrie pour les asphyxier, les enclaver, leur couper la route du large. Rappelons tout de même que la misère de l'Europe, que la ruine de la civilisation européenne en ce siècle, vient essentiellement de l'alliance perverse et pluriséculaire de la France monarchique et de la Turquie ottomane, où la France reniait la civilisation européenne, mobilisait ses forces pour la détruire. La Mitteleuropa a été prise en tenaille et ravagée par cette alliance: en 1526, le Roi de France François Ier marche sur Milan qu'il veut arracher au Saint-Empire; il est battu à Pavie et pris prisonnier. Ses alliés ottomans profitent de sa trahison et de sa diversion et s'emparent de votre pays pendant longtemps en le ravageant totalement. Au XVIIième siècle, la collusion franco-ottomane fonctionne à nouveau, le Saint-Empire est attaqué à l'Ouest, le Palatinat est ravagé, la Franche-Comté est annexée par la France, la Lorraine impériale est envahie, l'Alsace est elle aussi définitivement arrachée à l'Empire: cette guerre inique a été menée pour soulager les Turcs pendant la grande guerre de 1684 à 1699, où la Sainte-Alliance des puissances européennes (Autriche-Hongrie, Pologne, Russie) conjugue ses efforts pour libérer les Balkans. En 1695, Louis XIV ravage les Pays-Bas et incendie Bruxelles en inaugurant le bombardement de pure terreur, tandis que les Ottomans reprennent pied en Serbie et en Roumanie. En 1699, le Prince Eugène, adversaire tenace de Louis XIV et brillant serviteur de l'Empire, impose aux Turcs le Traité de Carlowitz: la Sublime Porte doit céder 400.000 km2 de territoires à la Sainte-Alliance, mais au prix de tous les glacis de l'Ouest (Lorraine, Alsace, Franche-Comté, Bresse). La République sera tout aussi rénégate à l'égard de l'Europe que la monarchie française, tout en introduisant le fanatisme idéologique dans les guerres entre Etats, ruinant ainsi les principes civilisateurs du jus publicum europæum: en 1791, alors qu'Autrichiens, Hongrois et Russes s'apprêtaient à lancer une offensive définitive dans les Balkans, la France, fidèle à son anti-européisme foncier, oblige les troupes impériales à se porter à l'Ouest car elle lance les hordes révolutionnaires, récrutées dans les bas-fonds de Paris, contre les Pays-Bas et la Lorraine. Le premier souci de Napoléon a été de fabriquer des “départements illyriens” pour couper la côte dalmate de son “hinterland mitteleuropäisch” et pour priver ce dernier de toute façade méditerranéenne. L'indépendance de la Croatie met un terme à cette logique de l'asphyxie, redonne à la Mitteleuropa une façade adriatique/méditerranéenne.
4. A votre avis, quelles seront les forces géopolitiques qui auront un impact sur le destin croate dans l'avenir?
Le destin croate est lié au processus d'unification européenne et à la rentabilisation du nouvel axe central de l'Europe, la liaison par fleuves et canaux entre la Mer du Nord et la Mer Noire. Mais il reste à savoir si la “diagonale verte”, le verrou d'Etats plus ou moins liés à la Turquie et s'étendant de l'Albanie à la Macédoine, prendra forme ou non, ou si une zone de turbulences durables y empêchera l'émergence de dynamiques fécondes. Ensuite, l'affrontement croato-serbe en Slavonie pour la maîtrise d'une fenêtre sur le Danube pose une question de principe à Belgrade: la Serbie se souvient-elle du temps de la Sainte-Alliance où Austro-Hongrois catholiques et Russes orthodoxes joignaient fraternellement leurs efforts pour libérer les Balkans? Se faire l'allié inconditionnel de la France, comme en 1914, n'est-ce pas jouer le rôle dévolu par la monarchie et la république françaises à l'Empire ottoman de 1526 à 1792? Ce rôle d'ersatz de l'empire ottoman moribond est-il compatible avec le rôle qu'entendent se donner certains nationalistes serbes: celui de bouclier européen contre tout nouveau déferlement turc? La nouvelle Serbie déyougoslavisée a intérêt à participer à la dynamique danubienne et à trouver une liaison fluviale avec la Russie. Toute autre politique serait de l'aberration. Et serait contraire au principe de la Sainte-Alliance de 1684-1699, qu'il s'agit de restaurer après la chute du Rideau de fer et des régimes communistes. Par ailleurs, l'intérêt de la France (ou du moins de la population française) serait de joindre à la dynamique Rhin/Danube le complexe fluvial Saône/Rhône débouchant sur le bassin occidental de la Méditerranée, zone hautement stratégique pour l'ensemble européen, dont Mackinder, dans son livre Democratic Ideals and Reality (1919), avait bien montré l'importance, de César aux Vandales et aux Byzantins, et de ceux-ci aux Sarrazins et à Nelson.
5. En vue de la proximité balkanique, quelles seront les synergies convergentes?
Favoriser le transit inter-continental Rotterdam/Mer Noire et faire de la région pontique le tremplin vers les matières premières caucasiennes, caspiennes et centre-asiatiques, est une nécessité économique vitale pour tous les riverains de ce grand axe fluvial et de cette mer intérieure. D'office, dans un tel contexte, une symphonie adviendra inéluctablement, si les peuples ont la force de se dégager des influences étrangères qui veulent freiner ce processus. Les adversaires d'un consensus harmonieux en Europe, de tout retour au jus publicum europæum (dont l'OSCE est un embryon), placent leurs espoirs dans la ligne de fracture qui sépare l'Europe catholique et protestante d'une part, de l'Europe orthodoxe-byzantine d'autre part. Ils spéculent sur la classification récente des civilisations du globe par l'Américain Samuel Huntington, où la sphère occidentale euro-américaine (“The West”) serait séparée de la sphère orthodoxe par un fossé trop profond, à hauteur de Belgrade ou de Vukovar, soit exactement au milieu de la ligne Rotterdam/Constantza. Cette césure rendrait inopérante la nouvelle dynamique potentielle, couperait l'Europe industrielle des pétroles et des gaz caucasiens et l'Europe orientale, plus rurale, des produits industriels allemands. De même, la coupure sur le Danube à Belgrade a son équivalent au Nord du Caucase, avec la coupure tchétchène sur le parcours de l'oléoduc transcaucasien, qui aboutit à Novorossisk en Russie, sur les rives de la Mer Noire. La guerre tchétchène profite aux oléoducs turcs qui aboutissent en Méditerranée orientale contrôlée par les Etats-Unis, tout comme le blocage du transit danubien profite aux armateurs qui assurent le transport transméditerranéen et non pas aux peuples européens qui ont intérêt à raccourcir les voies de communication et à les contrôler directement. La raison d'être du nouvel Etat croate, aux yeux des Européens du Nord-Ouest et des Allemands, du moins s'ils sont conscients du destin du continent, se lit spontanément sur la carte: la configuration géographique de la Croatie, en forme de fer à cheval, donne à l'Ouest et au Centre de l'Europe une fenêtre adriatique et une fenêtre danubienne. La fenêtre adriatique donne un accès direct à la Méditerranée orientale (comme jadis la République de Venise), à condition que l'Adriatique ne soit pas bloquée à hauteur de l'Albanie et de l'Epire par une éventuelle barrière d'Etats satellites de la Turquie, qui verrouilleraient le cas échéant le Détroit d'Otrante ou y géneraient le transit. La fenêtre danubienne donne accès à la Mer Noire et au Caucase, à condition qu'elle ne soit pas bloquée par une entité serbe ou néo-yougoslave qui jouerait le même rôle de verrou que l'Empire ottoman jadis et oublierait la Sainte-Alliance de 1684 à 1699, prélude d'une symphonie efficace des forces en présence dans les Balkans et en Mer Noire. L'Europe comme puissance ne peut naître que d'une telle symphonie où le nouvel Etat croate à un rôle-clé à jouer, notamment en reprenant partiellement à son compte les anciennes dynamiques déployées par la République de Venise, dont Raguse/Dubrovnik était un superbe fleuron.
6. Vous semblez être assez critique à l'égard de l'Etat pluri-ethnique belge? Quel sera son rôle?
L'Etat et le peuple belges sont des victimes de la logique partitocratique. Les peuples de l'Ostmitteleuropa savent ce qu'est une logique partisane absolue, parce qu'ils ont vécu le communisme. A l'Ouest la logique partisane existe également: certes, dans la sphère privée, on peut dire ou proclamer ce que l'on veut, mais dans un Etat comme la Belgique, où les postes sont répartis entre trois formations politiques au pro rata des voix obtenues, on est obligé de s'aligner sur la politique et sur l'idéologie étriquée de l'un de ces trois partis (démocrates-chrétiens, socialistes, libéraux), sinon on est marginalisé ou exclu: la libre parole dérange, la volonté d'aller de l'avant est considérée comme “impie”. On m'objectera que la démocratie de modèle occidental permet l'alternance politique par le jeu des élections: or cette possibilité d'alternance a été éliminée en Belgique par le prolongement et la succession ad infinitum de “grandes coalitions” entre démocrates-chrétiens et socialistes. A l'exception de quelques années dans les “Eighties”, où les libéraux ont participé aux affaires. Ce type de “grandes coalitions” ne porte au pouvoir que l'aile gauche de la démocratie-chrétienne, dont l'arme principale est une démagogie dangereuse sur le long terme et dont la caractéristique majeure est l'absence de principes politiques. Cette absence de principes conduit à des bricolages politiques abracadabrants que les Belges appellent ironiquement de la “plomberie”. L'aile plus conservatrice de cette démocratie-chrétienne a été progressivement marginalisée en Flandre, pour faire place à des politiciens prêts à toutes les combines pour gouverner avec les socialistes. Or, les socialistes sont relativement minoritaires en Flandre mais majoritaires en Wallonie. Dans cette partie du pays, qui est francophone, ils ont mis le patrimoine régional en coupe réglée et ils y règnent comme la mafia en Sicile, avec des méthodes et des pratiques qui rappellent les grands réseaux italiens de criminalité. Les scandales qui n'ont cessé d'émailler la chronique quotidienne en Belgique viennent essentiellement de ce parti socialiste wallon. La Belgique fonctionne donc avec l'alliance de socialistes wallons majoritaires dans leur région, de socialistes flamands minoritaires dans leur région, de démocrates-chrétiens wallons minoritaires et de démocrates-chrétiens flamands majoritaires, mais dont la majorité est aujourd'hui contestée par les libéraux néo-thatchériens et les ultra-nationalistes. Une très forte minorité flamande conservatrice (mais divisée en plusieurs pôles antagonistes) est hors jeu, de même que les classes moyennes et les entrepreneurs dynamiques en Wallonie, qui font face à un socialisme archaïque, vindicatif, corrompu et inefficace. La solution réside dans une fédéralisation toujours plus poussée, de façon à ce que les Flamands plus conservateurs n'aient pas à subir le mafia-socialisme wallon et les Wallons socialistes n'aient pas à abandonner leurs acquis sociaux sous la pression de néo-thatchériens flamands. Mais la pire tare de la Belgique actuelle reste la nomination politique des magistrats, également au pro rata des voix obtenues par les partis. Cette pratique scandaleuse élimine l'indépendance de la magistrature et ruine le principe de la séparation des pouvoirs, dont l'Occident est pourtant si fier. Ce principe est lettre morte en Belgique et la cassure entre la population et les institutions judiciaires est désormais préoccupant et gros de complications. L'avenir de la Belgique s'avère précaire dans de telles conditions, d'autant plus que la France essaie d'avancer ses pions partout dans l'économie du pays, de le coloniser financièrement, avec l'accord tacite de Kohl —il faut bien le dire— qui achète de la sorte l'acceptation par la France de la réunification allemande. Le pays implosera si son personnel politique continue à ne pas avoir de vision géopolitique cohérente, s'il ne reprend pas conscience de son destin et de sa mission mitteleuropäisch, qui le conduiront de surcroît à retrouver les intérêts considérables qu'il avait dans la Mer Noire avant 1914, surtout les entreprises wallonnes! Non seulement l'Etat belge implosera s'il ne retrouve pas une vision géopolitique cohérente, mais chacune de ses composantes imploseront à leur tour, entraînant une catastrophe sans précédent pour la population et créant un vide au Nord-Ouest de l'Europe, dans une région hautement stratégique: le delta du Rhin, de la Meuse et de l'Escaut, avec tous les canaux qui les relient (Canal Albert, Canal Juliana, Canal Wilhelmina, Willemsvaart, etc.).
7. Le peuple flamand en Belgique a joué un rôle non négligeable lors de la guerre en ex-Yougoslavie, en apportant son aide au peuple croate. Qu'est-ce qui les unit?
Les nationalistes flamands s'identifient toujours aux peuples qui veulent s'affranchir ou se détacher de structures étatiques jugées oppressantes ou obsolètes. En Flandre, il existe un véritable engouement pour les Basques, les Bretons et les Corses: c'est dû partiellement à un ressentiment atavique à l'égard de la France et de l'Espagne. La Croatie a bénéficié elle aussi de ce sentiment de solidarité pour les peuples concrets contre les Etats abstraits. Pour la Croatie, il y a encore d'autres motifs de sympathie: il y a au fond de la culture flamande des éléments baroques comme en Autriche et en Bavière, mais marqués d'une truculence et d'une jovialité que l'on retrouve surtout dans la peinture de Rubens et de Jordaens. Ensuite, il y a évidemment le catholicisme, partagé par les Flamands et les Croates, et un Kulturnationalismus hérité de Herder qui est commun aux revendications nationalistes de nos deux peuples. Mais ce Kulturnationalismus n'est pas pur repli sur soi: il est toujours accompagné du sentiment d'appartenir à une entité plus grande que l'Etat contesté —l'Etat belge ici, l'Etat yougoslave chez vous— et cette entité est l'Europe comme espace de civilisation ou la Mitteleuropa comme communauté de destin historique. Certes, dans la partie flamande de la Belgique, le souvenir de l'Autriche habsbourgeoise est plus ancien, plus diffus et plus estompé. Mais il n'a pas laissé de mauvais souvenirs et l'Impératrice Marie-Thérèse, par exemple, demeure une personnalité historique respectée.
00:05 Publié dans Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : entretiens, belgique, flandre, wallonie, mitteleuropa, europe centrale, europe, affaires européennes, croatie, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 21 octobre 2009
Israël deviendra-t-il un Etat normal?
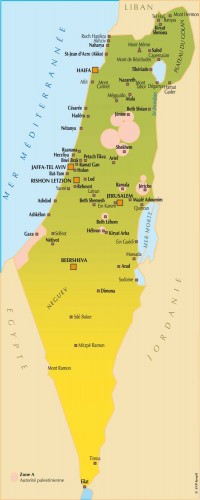 Israël deviendra-t-il un Etat “normal”?
Israël deviendra-t-il un Etat “normal”?
Intéressante contribution de Roger Cohen dans les colonnes de l’International Herald Tribune du vendredi 16 octobre 2009. Question initiale de Cohen: “Israël est-il un Etat parmi les autres Etats?”. Dans un sens, oui, car il en possède la plupart des attributions. Dans un autre, non, car soixante ans après sa création, Israël n’a toujours pas de frontières stables, de constitution bien établie, de paix durable. Israël, écrit Cohen, vit dans un état d’exception permanente et fait de cette exception son fétiche. Pour Cohen, Israël devrait pouvoir affronter le monde tel qu’il est, même s’il est décevant, et ne pas s’appesantir sur le monde d’hier. Roger Cohen: “L’holocauste représentait la quintessence du mal. Mais il s’est déroulé il y a soixante-cinq ans. Ceux qui l’ont perpétré sont morts ou vont très bientôt mourir. Le prisme holocaustique pourrait être bien déformant... L’histoire éclaire mais elle aveugle aussi”.
Roger Cohen émet ces réflexions un peu amères après le discours tenu par Benjamin Netanyahou à la tribune des Nations Unies en septembre dernier. Ce discours était truffé de références déclamatoires portant sur l’Allemagne nazie, l’Iran actuel et Al Qaïda (sans qu’il n’ait fait la distinction qui s’impose pourtant à tout observateur sérieux: Al Qaïda représente un extrémisme sunnite, ennemi mortel, en bon nombre de circonstances, de l’Iran chiite, tout amalgame relevant de la propagande à bon marché sinon de la farce pure et simple). Devant tous ces croquemitaines, passés et présents, Israël était posé comme un courageux petit résistant solitaire qui, selon les propos mêmes de Netanyahou, représentait “la civilisation contre la barbarie, le 21ème siècle contre le 9ème siècle, ceux qui sanctifient la vie contre ceux qui glorifient la mort”. Du pur lyrisme, effectivement, avec un condiment d’apocalypse.
Pour Roger Cohen, ce type de discours est “facile, tonitruant et inutile”: “Il y a diverses civilisations présentes au Moyen Orient, dont les attitudes face à la religion et à la modernité varient mais toutes sont à la recherche d’un accord entre elles”. Face à cette volonté générale, bien qu’assez diffuse, Israël se cramponne à son statut d’exception. La stratégie d’Obama, pourtant, vise à masquer le sentiment américain qui veut que les Etats-Unis, eux aussi, sont “exceptionnels” dans le monde car cette idée d’une “grande mission civilisatrice” des Etats-Unis ne fait plus du tout l’unanimité et provoque de plus en plus souvent une levée de boucliers ailleurs dans le monde. Cohen: “Obama tente d’infléchir Israël pour qu’il se donne une image de soi plus prosaïque et plus réaliste”.
Reste la question nucléaire: Obama cherche à faire adhérer Israël au traité de non-prolifération. Car, en effet, comment concilier l’intransigeance américaine face au programme nucléaire iranien et l’indifférence face à l’arsenal nucléaire israélien, non déclaré? Le monde risque d’accuser les Etats-Unis de pratiquer un double langage, d’opter pour une politique de deux poids deux mesures. Obama aurait ce type d’ambiguïté en horreur. Le secrétaire américain à la défense, Robert Gates, quant à lui, dit que la meilleure façon d’avoir à terme un Iran sans armes nucléaires est de lui montrer qu’il n’est plus menacé par personne dans la région. Israël doit dès lors abandonner partiellement les mythes qui lui ont conféré cette d’idée d’exception, exprimée encore récemment par Netanyahu à la tribune des Nations Unies. Bref, Israël doit se débarrasser de sa mentalité obsidionale. Cohen: “Le Moyen Orient a changé. Israël doit changer aussi. Dire ‘plus jamais’ est certes une nécessité mais le dire est simultanément une manière inadéquate de faire face au monde moderne”.
Si Israël doit se débarrasser de sa mentalité obsidionale, et partant, des mythes qui la fondent et la consolident, l’Europe, elle aussi, ne devrait-elle pas se débarrasser de mythes incapacitants, remontant à l’époque de l’holocauste et qui paralysent encore et toujours son processus d’unification? Roger Cohen demande cet effort à Israël, dans le cadre réduit de l’Etat hébreu, mais sa requête pourrait aisément déborder ce cadre réduit et s’adresser à tout le sous-continent européen.
(source: Roger COHEN, “An ordinary Israel”, in : “International Herald Tribune”, Oct. 16., 2009).
00:25 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : israel, proche orient, moyen orient, palestine, judaica, judaïsme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Le nouveau rôle de la Turquie
 Le nouveau rôle de la Turquie
Le nouveau rôle de la Turquie
Commentant les récentes négociations turco-arméniennes, menées sous l’oeil vigilant d’Hillary Clinton, le journaliste Stephen Kinzer écrit dans les colonnes de l’”International Herald Tribune”: “Depuis près de 86 ans qu’elle existe telle quelle en tant qu’Etat, la Turquie avait gardé un profil bas dans le monde. Ces jours-là sont finis. Maintenant, la Turquie cherche à jouer un rôle régional très ambitieux en tant que puissance conciliatrice, s’efforçant d’établir partout la paix. Lorsque les officiels turcs débarquent dans des pays cruellement divisés comme le Liban, l’Afghanistan ou le Pakistan, chaque faction cherche fébrilement à engager un dialogue avec eux. Il n’y a pas un pays au monde dont les diplomates sont autant les bienvenus, que ce soit à Téhéran ou à Jérusalem, à Moscou ou à Tbilissi, à Damas ou au Caire. En tant que pays musulman intimement lié à la région qui l’entoure , la Turquie peut se présenter partout, amorcer des partenariats et conclure des accords que ne peuvent conclure les Etats-Unis”.
Plus sceptique dans la suite de son article, Kinzer rappelle tout de même les défauts à la cuirasse turque: Chypre, le problème kurde, les persécutions larvées de toutes les minorités religieuses, chrétiennes ou non sunnites.
Kinzer: “Dans d’autres circonstances, l’Egypte, le Pakistan ou l’Iran auraient pu émerger en tant que leaders du monde islamique. Leurs sociétés, toutefois, sont faibles, fragmentées voire en voie de décomposition. L’Indonésie ferait un candidat hegemon plus plausible mais elle n’a aucune tradition historique en matière de leadership et est très éloignée du centre de la zone de crise du monde musulman. Reste donc la Turquie. Elle essaie de prendre ce rôle d’hegemon”.
Kinzer parle très certainement le langage de Washington, qui a un besoin urgent de “proxy”, de mandataire, dans la région. Les accords turco-arméniens vont dans le sens des intérêts pétroliers américains. La Turquie a donc bien joué son rôle dans le Caucase-Sud. Et pour qu’elle continue à bien pouvoir le jouer, il faut créer artificiellement des diversions, des faux conflits où le “politiquement correct” est apparemment écorné, où l’idéologie officielle de l’Occident est bafouée. D’où les incidents avec Israël à propos des manoeuvres aériennes et d’une série télévisée turque présentant Tsahal sous un jour fort glauque. Ces artifices servent, avec le néo-islamisme/néo-ottomanisme d’Erdogan et de Davutoglu, de leurres pour appâter les Arabes.
‘Source: Stephen KINZER, “A new role for Turkey”, in: “International Herald Tribune”, Oct. 16, 2009).
00:20 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : turquie, affaires européennes, europe, proche orient, mer noire, méditerranée, monde islamique, islam, moyen orient |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Revoluçao Conservadora, forma catolica e "ordo aeternus" romano
 Revolução Conservadora, forma católica e “ordo aeternus” romano
Revolução Conservadora, forma católica e “ordo aeternus” romano
A Revolução Conservadora não é somente uma continuação da «Deutsche Ideologie» romântica ou uma reactualização das tomadas de posição anti-cristãs e helenistas de Hegel (anos 1790-99) ou uma extensão do prussianismo laico e militar, mas tem também o seu lado católico romano. Nos círculos católicos, num Carl Schmitt por exemplo, como nos seus discípulos flamengos, liderados pela personalidade de Victor Leemans, uma variante da Revolução Conservadora incrusta-se no pensamento católico, como sublinha justamente um católico de esquerda, original e verdadeiramente inconformista, o Prof. Richard Faber de Berlim. Para Faber, as variantes católicas da RC renovam não com um Hegel helenista ou um prussianismo militar, mas com o ideal de Novalis, exprimido em Europa oder die Christenheit: este ideal é aquele do organon medieval, onde, pensam os católicos, se estabeleceu uma verdadeira ecúmena europeia, formando uma comunidade orgânica, solidificada pela religião.Der Glanz, die Macht ist dahin» [«Estamos no fim, a Áustria está morta. O Esplendor e o Poder desapareceram»].
Depois do retrocesso e da desaparição progressiva deste organon vivemos um apocalipse, que se vai acelerando, depois da Reforma, a Revolução francesa e a catástrofe europeia de 1914. Desde a revolução bolchevique de 1917, a Europa, dizem estes católicos conservadores alemães, austríacos e flamengos, vive uma Dauerkatastrophe. A vitória francesa é uma vitória da franco-maçonaria, repetem. 1917 significa a destruição do último reduto conservador eslavo, no qual haviam apostado todos os conservadores europeus desde Donoso Cortés (que era por vezes muito pessimista, sobretudo quando lia Bakunine). Os prussianos haviam sempre confiado na aliança russa. Os católicos alemães e austríacos também, mas com a esperança de converter os russos à fé romana. Enfim, o abatimento definitivo dos “estados” sociais, inspirados na época medieval e na idade barroca (instalados ou reinstalados pela Contra-Reforma) mergulha os conservadores católicos no desespero. Helena von Nostitz, amiga de Hugo von Hoffmannstahl, escreve «Wir sind am Ende, Österreich ist tot.
Num tal contexto, o fascismo italiano, contudo saído da extrema-esquerda intervencionista italiana, dos meios socialistas hostis à Áustria conservadora e católica, figura como uma reacção musculada da romanidade católica contra o desafio que lança o comunismo a leste. O fascismo de Mussolini, sobretudo depois dos acordos de Latrão, recapitula, aos olhos destes católicos austríacos, os valores latinos, virgilianos, católicos e romanos, mas adaptando-os aos imperativos da modernidade.
É aqui que as referências católicas ao discurso de Donoso Cortés aparecem em toda a sua ambiguidade: para o polemista espanhol a Rússia arriscava converter-se ao socialismo para varrer pela violência o liberalismo decadente, como teria conseguido se tivesse mantido a sua opção conservadora. Esta evocação da socialização da Rússia por Donoso Cortés permite a certos conservadores prussianos, como Moeller van den Bruck, simpatizar com o exército vermelho, para parar a Oeste os exércitos ao serviço do liberalismo maçónico ou da finança anglo-saxónica, ainda mais porque depois do tratado de Rapallo (1922), a Reichswehr e o novo exército vermelho cooperam. O reduto russo permanece intacto, mesmo se mudou de etiqueta ideológica.
Hugo von Hoffmannstahl, em Das Schriftum als geistiger Raum der Nation [As cartas como espaço espiritual da Nação] utiliza pela primeira vez na Alemanha o termo “Revolução Conservadora”, tomando assim o legado dos russos que o haviam precedido, Dostoievski e Yuri Samarine.
Para ele a RC é um contra-movimento que se opõe a todas as convulsões espirituais desde o século XVI. Para Othmar Spann, a RC é uma Contra-Renascença. Quanto a Eugen Rosenstock( que é protestante), escreve: «Um vorwärts zu leben, müssen wir hinter die Glaubensspaltung zurückgreifen» [Para continuar a viver, seguindo em frente, devemos recorrer ao que havia antes da ruptura religiosa]. Para Leopold Ziegler (igualmente protestante) e Edgard Julius Jung (protestante), era preciso uma restitutio in integrum, um regresso à integralidade ecuménica europeia, Julius Evola teria dito: à Tradição. Eles queriam dizer por aquilo que os Estados não deviam mais opor-se uns aos outros mas ser reconduzidos num “conjunto potencializador”.
Se Moeller van den Bruck e Eugen Rosenstock actuam em clubes, como o Juni-Klub, o Herren-Klub ou em círculos que gravitam em torno da revista de sociologia, economia e politologia Die Tat, os que desejam manter uma ética católica e cuja fé religiosa subjuga todo o comportamento, reagrupam-se em “círculos” mais meditativos ou em ordens de conotação monástica. Richard Feber calcula que estas criações católicas, neo-católicas ou para-católicas, de “ordens”, se efectuaram a 4 níveis:
1) No círculo literário e poético agrupado em torno da personalidade de Stefan George, aspirando a um “novo Reich”, isto é, um “novo reino” ou um “novo éon”, mais do que a uma estrutura política comparável ao império dos Habsbourg ou ao dos Hohenzollern.
2) No “Eranos-Kreis” (Círculo Eranos) do filósofo místico Derleth, cujo pensamento se inscreve na tradição de Virgílio ou Hölderlin, colocando-se sob a insígnia de uma “Ordem do Christus- Imperator”.
3) Nos círculos de reflexão instalados em Maria Laach, na Renânia-Palatinado, onde se elaborava uma espécie de neo-catolicismo alemão sob a direcção do teólogo Peter Wust, comparável, em muitos aspectos, ao “Renouveau Catholique” de Maritain na França (que foi próximo, a dado momento, da Acção Francesa) e onde a fé se transmitia aos aprendizes particularmente por uma poesia derivada dos cânones e das temáticas estabelecidas pelo “Circulo” de Stefan George em Munique-Schwabing desde os anos 20.
4) Nos movimentos de juventude, mais ou menos confessionais ou religiosos, particularmente nas suas variantes “Bündisch”, bom número de responsáveis desejavam introduzir, por via das suas ligas ou das suas tropas, uma “teologia dos mistérios”.
As variantes católicas ou catolizantes, ou pós-católicas, preconizaram então um regresso à metafísica política, no sentido em que queriam uma restauração do “Ordo romanus”, “Ordem romana”, definida por Virgílio como “Ordo aeternus”, “ordem eterna”. Este catolicismo apelava à renovação com esse “Ordo aeternus” romano que, na sua essência, não era cristão mas a expressão duma paganização do catolicismo, explica-nos o cristão católico de esquerda Richard Faber, no sentido em que, neste apelo à restauração do “Ordo romanus/aeternus”, a continuidade católica não é já fundamentalmente uma continuidade cristã mas uma continuidade arcaica. Assim, a “forma católica” veicula, cristianizando-a (na superfície?), a forma imperial antiga de Roma, como assinalou igualmente Carl Schmitt em Römischer Katholizismus und politische Form (1923). Nessa obra, o politólogo e jurista alemão lança de alguma maneira um duplo apelo: à forma (que é essencialmente, na Europa, romana e católica, ou seja, universal enquanto imperial e não imediatamente enquanto cristã) e à Terra (esteio incontornável de toda a acção política), contra o economicismo volúvel e hiper-móvel, contra a ideologia sem esteio que é o bolchevismo, aliado objectivo do economicismo anglo-saxónico.
Para os proponentes deste catolicismo mais romano que cristão, para um jurista e constitucionalista como Schmitt, o anti-catolicismo saído da filosofia das Luzes e do positivismo cienticista( referências do liberalismo) rejeita de facto esta matriz imperial e romana, este primitivismo antigo e fecundo, e não o eudemonismo implícito do cristianismo. O objectivo desta romanidade e desta “imperialidade” virgiliana consiste no fundo, queixa-se Faber, que é um anti-fascista por vezes demasiado militante, em meter o catolicismo cristão entre parênteses para mergulhar directamente, sem mais nenhum derivativo, sem mais nenhuma pseudo-morfose (para utilizar um vocábulo spengleriano), no “Ordo aeternus”.
Na nossa óptica este discurso acaba ambíguo, porque há confusão permanente entre Europa e Ocidente. Com efeito, depois de 1945, o Ocidente, vasto receptáculo territorial oceânico-centrado, onde é sensato recompor o “Ordo romanus” para estes pensadores conservadores e católicos, torna-se a Euroamérica, o Atlantis: paradoxo difícil de resolver, porque como ligar os princípios “térreos” (Schmitt) e os da fluidez liberal, hiper-moderna e economicista da civilização “estado-unidense”?
Para outros, entre o Oriente bolchevizado e pós-ortodoxo e o Hiper-Ocidente fluido e ultra-materialista, deve erguer-se uma potência “térrea”, justamente instalada sobre o território matricial da “imperialidade” virgiliana e carolíngia, e esta potência é a Europa em gestação. Mas com a Alemanha vencida, impedida de exercer as suas funções imperiais pós-romanas uma translatio imperii (translação do império) deve operar-se em beneficio da França de De Gaulle, uma translação imperii ad Gallos, temática em voga no momento da reaproximação entre De Gaulle e Adenauer e mais pertinente ainda no momento em que Charles De Gaulle tenta, no curso dos anos 60, posicionar a França “contra os impérios”, ou seja, contra os “imperialismos”, veículos da fluidez mórbida da modernidade anti-política e antídotos para toda a forma de fixação estabilizante (NdT. Daqui presume-se uma distinção entre imperialismo e imperialidade, daí o uso dos dois conceitos).
Se Eric Voegelin tinha teorizado um conservantismo em que a ideologia derivava da noção de “Ordo romanus”, ele colocava o seu discurso filosófico-político ao serviço da NATO, esperando deste modo uma fusão entre os princípios “fluidos” e “térreos” (NdT. naturalmente esta dicotomia que o autor usa recorrentemente no texto é uma referência à tradicional oposição entre ordenamentos marítimos e terrestres), o que é uma impossibilidade metafísica e prática. Se o tandem De Gaulle-Adenauer se referia também, sem dúvida, no topo, a um projecto derivado da noção de “Ordo aeternus”, colocava o seu discurso e as suas práticas, num primeiro momento (antes da viagem de De Gaulle a Moscovo, à América Latina e antes da venda dos Mirage à Índia e do famosos discursos de Pnom-Penh e do Quebeque), ao serviço de uma Europa mutilada, hemiplégica, reduzida a um “rimland” atlântico vagamente alargado e sem profundidade estratégica. Com os últimos escritos de Thomas Molnar e de Franco Cardini, com a reconstituição geopolítica da Europa, este discurso sobre o “Ordo romanus et aeternus” pode por fim ser posto ao serviço de um grande espaço europeu, viável, capaz de se impor sob a cena internacional. E com as proposições de um russo como Vladimir Wiedemann-Guzman, que percepciona a reorganização do conjunto euro-asiático numa “imperialidade” bicéfala, germânica e russa, a expansão grande-continental está em curso, pelo menos no plano teórico. E para terminar, parafraseando De Gaulle: A estrutura administrativa acompanhá-la-á?
Robert Steuckers
00:10 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : révolution conservatrice, allemagne, rome, rome antique, catholicisme, religion, carl schmitt |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Le regard de Dominique Venner sur le destin des armées blanches

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1997
Le regard de Dominique Venner sur le destin des Armées blanches
Pour la Russie et la Liberté,
Nous sommes prêts, nous les Kornilovtzy,
A nous jeter à l'eau,
A nous jeter au feu!
Marchons au combat, au sanglant combat!
Chant de marche des Volontaires, Campagne du Kouban, 1918.
Lors du cinquantième anniversaire du coup d'État bolchévique en 1967, on assista dans le monde entier, et tout spécialement en France, à une débauche de propagande et de bourrage de crâne en faveur du régime rouge: ce fut le délire, un délire soigneusement organisé, subsidié et contrôlé par les “Organes”. Combien d'intellos parisiens n'ont pas émargé aux fonds secrets soviétiques? Certains (les mêmes parfois) touchent aujourd'hui d'autres chèques... Ainsi va (leur) monde... En réaction contre cette désinformation, il y eut le livre de Marina Grey et de Jean Bourdier consacré aux Armées blanches (Stock 1968, paru en Livre de Poche, n°5116). Marina Grey est la fille du Général Dénikine, qui commanda la fameuse Division de Fer lors de la Première Guerre mondiale: le Maréchal Foch et Churchill ont dit de lui qu'il avait contribué à la survie des Alliés sur le front ouest. Anton Dénikine, pourtant acquis aux idées libérales et critique à l'égard des insuffisances de Nicolas II, sera Régent de Russie et l'un des principaux chefs blancs.
Sa fille, née en Russie libre, a écrit une excellente évocation de l'épopée des Vendéens russes, ces rebelles qui, refusant la servitude et la terreur bolchéviques, se battent à un contre cent avec un panache extraordinaire. Cette étude écrite comme un roman, se fondait sur des archives privées d'émigrés, des revues parues en exil, à Buenos Aires, Paris ou Bruxelles (saluons au passage Sa Haute Noblesse feu le capitaine Orekhoff, éditeur à Bruxelles de La Sentinelle et, en 1967, du Livre blanc sur la Russie martyre!), des mémoires rédigés en russe par des officiers rescapés du génocide communiste (au moins dix millions de morts pour la Guerre civile). P. Fleming, le frère de Ian, avait signé un beau livre sur l'amiral blanc Koltchak et plus tard, Jean Mabire avait sorti la belle figure d'Ungern de l'oubli dans un roman, qui a marqué toute une génération. Mais les Blancs, malgré ces efforts, restaient des maudits, bien plus en Occident qu'en Russie occupée!
Vers 1980, un texte du samizdat russe expliquait que, dans les cinémas soviétiques des années 70, lorsqu'on montrait des Gardes blancs (vrais ou non, mais montrés du doigt comme des vampires), souvent les jeunes se levaient d'un bloc, sans un mot. Un de ces adolescents avait écrit à une revue émigrée, une superbe lettre ouverte aux derniers Blancs pour leur dire son admiration. La SERP nous offre toujours un bel enregistrement de marches de l'ancienne Russie et les Cosaques de Serge Jaroff nous restituaient les chants des Blancs... autrement plus beaux que les chœurs de la défunte Armée rouge qui, pourtant, avaient une classe indéniable par rapport aux misérables chansonettes des armées anglo-saxonnes qu'on tente de nous faire passer pour le comble du génie.
Mais voilà que Dominique Venner, déjà auteur d'une Histoire de l'Armée rouge (ouvrage couronné par l'Académie française), vient combler ce vide regrettable. Il s'attaque à la Guerre civile, épisode soigneusement occulté de l'histoire soviétique. L'hagiographie marxiste passait sous silence la résistance des Blancs, ou alors ne parlait que de “bandes” de réactionnaires au service du capital, etc. Venner s'est replongé dans cette époque tout compte fait mal connue: peu de livres en langue occidentale, censure générale sur le sujet (tabou dans les universités européennes, alors que les chercheurs américains ont publié pas mal de thèses sur les Blancs), et surtout blocage mental sur ces épisodes qui contredisent la version officielle des faits pour une intelligentsia européenne qui subit encore une forte imprégnation marxisante, souvent inconsciente: une résistance populaire à la “révolution” communiste ne va pas dans le “sens de l'histoire”! Comme le dit justement Gilbert Comte dans le Figaro littéraire du 6 novembre 1997: «Triste modèle des démissions de l'intelligence, quand l'histoire écrite par les vainqueurs devient la seule qu'il soit possible d'écouter». On connaît cela pour d'autres épisodes de notre histoire et le procès Papon, une gesticulation inutile, en est le dernier (?) exemple. Il n'y a pas qu'à Moscou que les procès sont des farces orwelliennes...
Venner a donc lu des témoignages écrits à chaud (voyageurs, diplomates, journalistes), ce qui lui permet de rendre l'esprit de l'époque. Une seule critique vient à l'esprit à la lecture de son beau livre: peu de sources russes et pas de témoignages de première main. Il est vrai que pour trouver des rescapés des Armées blanches en 1996... Mais ces hommes, officiers, civils, soldats ont laissé des écrits: mémoires, archives, articles dans la presse émigrée. Paris, Kharbine en Mandchourie, Bruxelles, Berlin ou Buenos Aires furent des centres actifs de l'Emigratziya. Les revues, journaux, livres rédigés par des combattants blancs se comptent par centaines. Il y a là une masse de documents énorme à analyser. Il existe encore des Associations de la Noblesse russe où de Volontaires qui possèdent des archives du plus haut intérêt et les archives soviétiques doivent aussi receler des trésors... Mais ne faisons pas les difficiles! Le travail de Venner est une réussite complète. Signalons seulement qu'il reste du pain sur la planche pour de futurs chercheurs!
Venner étudie les Rouges et les Blancs, ce qui est neuf: il analyse les points forts et les faiblesses des uns et des autres. Sa description des événements est précise, militaire: il montre bien à quel point la guerre fut atroce. Surtout, il prouve que les Blancs, ces “vaincus” de l'histoire officielle, ne furent pas loin de l'emporter sur les Rouges. Fin 1919, Lénine s'écrie: «nous avons raté notre coup!». C'est Trotsky qui sauvera le régime, avec ses trains blindés et sa vision très militariste de la révolution. Il y a d'ailleurs chez Lev Davidovitch Bronstein un côté fascistoïde avant la lettre!
Pour la Russie, l'alliance avec la France fut une catastrophe: l'Etat-Major impérial est fidèle à ses promesses, jusqu'à la folie. Mal armée (usines d'armement peu productives), mal commandée (généraux incapables), sans doute trahie au plus haut niveau (la Tsarine ou son entourage), l'armée russe subit une terrible saignée: 2,5 millions de tués en 1915! Ces millions de moujiks tués ou estropiés sauvent la France du désastre: si le plan Schlieffen ne réussit pas à l'ouest, c'est en partie grâce aux divisions sacrifiées de Nicolas II. En 1940, ce même plan, actualisé (frappes aériennes et panzers) réussira grâce à l'alliance de fait germano-russe (pacte Ribbentrop-Molotov). En 1917, l'armée est à bout, et 1a personnalité du monarque, une vraie fin de race, n'arrange rien. Seul le Grand-Duc Nicolas aurait pu sauver la mise, après la mort de Stolypine (assassiné en 1911 par un revolutionnaire juif), ce qui fut un désastre pour toute l'Eurasie. Les trop vagues projets de coup d'état militaire visant à renverser ce tsar incapable ne se réalisent pas... mais le corps des officiers est préparé à lâcher ce dernier, que même le roi d'Angleterre n'a pas envie de sauver.
Ce sont des officiers comme Alexeiev ou Korniloff, futurs chefs blancs, qui joueront un rôle dans son abdication tardive. Preuve que les Blancs n'étaient pas des nostalgiques de l'ancien régime, mais des officiers qui souvent servent d'abord Kerenski, même s'ils méprisent à juste titre ce bavard incapable (un politicien). On peut d'ailleurs se demander si le ralliement au régime rouge de tant d'officiers tsaristes n'a pas été partiellement facilité premièrement par les revolvers (Nagan, au départ une conception liégeoise) délicatement braqués dans leur nuque, mais aussi par le dégoût inspiré par la cour de Nicolas II. Dénikine lui-même avait été scandalisé par le lâchage par le tsar de son meilleur ministre, Stolypine.
Un des nombreux mérites du livre de Venner est de camper tous ces personnages historiques avec un talent sûr. Le portrait de Lénine, qui était la haine pour le genre humain personnifiée, celui de Trostky, sont remarquables. Venner montre bien que là où les Bolchéviks trouvent face à eux une résistance nationaliste, ils sont vaincus, comme en Finlande, en Pologne. Les armées de paysans attachés à leurs traditions ancestrales sont toujours plus fortes que celles des révolutionnaires citadins, fanatiques mais divisés en chapelles. Un des mérites du livre est d'insister sur la respansabilité de Lénine dans le génocide du peuple russe: c'est lui qui met en place le système du goulag, et non Staline. Les premiers camps d'extermination communistes datent de l'été 1918. Toutes ces ignominies, dont Hitler ne fut qu'un pâle imitateur, découlent de l'idéologie marxiste, qui est celle de la table rase (au moins 25 millions de tués de 1917 à 1958!). La révolution blochévique vit une véritable colonisation de la Russie par des étrangers: Polonais, “Lettons”, et surtout des Juifs, animés d'une haine viscérale pour la Russie traditionnelle, qui ne leur avait jamais laissé aucune place au soleil.
Cette révolution est en fait le début d'une gigantesque guerre civile d'ampleur continentale: le fascisme, le nazisme sont des ripostes à cette menace, avec toutes les conséquences que l'on sait. L'historien allemand Ernst Nolte l'a très bien démontré au grand scandale des historiens établis qui aiment à répéter les vérités de propagande dans l'espoir de “faire carrière”. Mais ces vérités, dûment démontrées en Allemagne ou dans les pays anglo-saxons, passent mal en France où sévit encore un lobby marxisant, qui impose encore et toujours ses interdits. Voir les déclarations ridicules de Lionel Jospin, impensables ailleurs en Europe. Voir le scandale causé par le livre de S. Courtois sur les 85 millions de morts du communisme, qui réduit à néant les constructions intellectuelles du négationnisme des établissements, qui, s'ils ont souvent trahi leurs idéaux de jeunesse, ont gardé intactes leur volonté de pourrir notre communauté. Mais ces viles canailles politiques n'ont plus l'ardeur de la jeunesse: ils ne croient plus en rien et n'ont plus au cœur que la haine et le ressentiment pour toutes les innovations qui pointent à l'horizon. A leur tour de connaître la décrépitude et le mépris, des 20 à 30% de jeunes qu'ils condamnent au chômage, en dépit de leur beaux discours sur le “social”. Remercions Venner de nous avoir rendus, avec autant de sensibilité que d'érudition, les hautes figures de l'Amiral Koltchak, des généraux Dénikine, Korniloff ou Wrangel, de tous ces officiers, ces simples soldats blancs, héros d'autrefois qui nous convient à résister sans faiblir aux pourrisseurs et aux fanatiques.
Patrick CANAVAN.
Dominique VENNER, Les Blancs et les Rouges. Histoire de la guerre civile russe, Pygmalion 1997. 293 pages, 139 FF.
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, russie, tsars, tsarisme, guerre civile russe, 1917 |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 20 octobre 2009
Newsweek: campagne contre Berlusconi
Newsweek: campagne contre Berlusconi
On peut critiquer la politique de Berlusconi, qui n’est jamais qu’une variante de néo-libéralisme. Et dans la foulée de cette critique, on peut évidemment souhaiter à l’Italie un régime politique plus social et plus indépendant du “mainstream” néo-libéral qui afflige la planète. En revanche, quand “Il Cavaliere” annonce son intention de retirer les troupes italiennes d’Afghanistan et quand immédiatement après cette déclaration de bon sens, le magazine américain “Newsweek” appelle, tonitruant et sans aucune circonlocution, les Italiens “à laisser tomber Berlusconi”, le scepticisme doit être de mise. La litanie de griefs contre “Il cavaliere” qu’énonce “Newsweek” ressemble furieusement à celles qui, précédemment, annonçaient l’un ou l’autre lynchage médiatique au profit de figures, généralement falotes, qui conviennent à la politique internationale des Etats-Unis et font des marionnettes idéales.
Berlusconi serait impliqué dans trop de scandales et cela nuirait à la bonne réputation de l’Italie dans le monde, avance “Newsweek”, qui ajoute: “L’Italie ne peut plus se permettre les frasques de son playboy de leader”. Même si les sondages, à rebours de ces injonctions pressantes, créditent Il Cavaliere de 63% des intentions de vote dans la péninsule. Et “Newsweek” poursuit sa charge: “S’il reste au pouvoir en Italie, cela conduirait non seulement à un fiasco pour le pays mais cela pourrait aussi causer des dommages à l’Europe et à l’Alliance Atlantique”. Les menaces sont donc à peine voilées. L’Italie doit revenir au bercail atlantiste. Sans tergiverser. Et le peuple italien doit cesser de se choisir un leader qui déplait à Washington. Messieurs les Italiens, vous êtes priés de changer d’avis, vos opinions démocratiques ne sont pas “politiquement correctes”, elles ne correspondent pas à la “bonne gouvernance” que nous entendons faire triompher d’Honolulu aux Açores et des Açores à Midway, car elle est le seul mode accepté de “démocratie”. Le reste, c’est du “populisme”, donc du “fascisme” ou du “communisme”.
Cette menace, ces petits prémisses d’une campagne de presse internationale à venir, n’est-elle pas due à la politique énergétique de Berlusconi, qualifiée de “russophile” parce qu’elle privilégie “South Stream” au détriment de “Nabucco”? Et n’est-elle pas renforcée par l’annonce du retrait probable des bersaglieri italiens du théâtre afghan, au moment même où un certain Général McChrystal réclame des renforts considérables pour tenter de maîtriser enfin l’imbroglio d’Afghanistan?
00:25 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europe, italie, affaires européennes, etats-unis, manipulations médiatiques, diffamation, berlusconi |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
L'Irak demande à la Turquie de cesser ses incursions en pays kurde

L’Irak demande à la Turquie de cesser ses incursions en pays kurde
La Turquie vient, on le sait, de se faire rappeler à l’ordre par Israël pour deux motifs: le ministre israélien des affaires étrangères, Avigor Liebermann, dont on se souvient des propos fort indélicats à l’égard des voisins arabes de l’Etat hébreu, n’a guère apprécié les émissions de la télévision d’Etat turque, où les soldats israéliens sont campés comme de sombres brutes qui assassinent à qui mieux mieux des civils palestiniens; ensuite, Ankara s’est opposé à la participation israélienne à des manoeuvres dans l’espace aérien turc.
Mais il n’y a pas qu’Israël qui s’insurge. L’Irak aussi. Les relations turco-irakiennes s’étaient pourtant améliorées depuis 2003, l’année où l’invasion américaine avait mis un terme au pouvoir de Saddam Hussein. Les relations économiques entre les deux pays n’ont plus cessé de se renforcer. Mais, malgré cette amélioration des rapports commerciaux, deux problèmes demeurent: d’abord, les fréquentes violations de la frontière irakienne par des unités turques, cherchant à frapper les bases arrière du PKK kurde. Les incursions musclées de l’armée turque ont redoublé d’intensité ces derniers mois. Les Irakiens souhaitent que cela cesse.
Deuxième problème: l’eau. On sait que la maîtrise des eaux et des nappes phréatiques deviendra à très court terme le problème numéro un dans les pays semi-désertiques où les zones arables et irriguées sont réduites par rapport à une démographie en pleine croissance. La Turquie continue à pomper l’eau des fleuves mésopotamiens, le Tigre et l’Euphrate, qui prennent tous deux leurs sources sur territoire turc. L’Irak est en permanence menacé de sécheresse et, pire, sans eau et sans paix intérieure dans les régions septentrionales de son territorie, ne peut pas amorcer de reconstruction.
La violence continue aussi à frapper la communauté chiite irakienne, notamment à Kerbala. En tout, l’Irak doit déplorer 85.694 morts et quelque 147.000 blessés, dus à des attentats. Moralité générale: les Etats-Unis se sont montrés incapables d’assurer la paix dans le pays qu’ils ont envahi et occupé. Ils ne méritent pas le statut d’hegemon qu’ils prétendent exercer. La Turquie, qui n’a plus l’extension impériale qu’elle possédait du temps des sultans ottomans, tente de jouer un rôle accru de puissance régionale, mais le redécoupage territorial d’après 1918 dans la zone entre Méditerranée et Golfe Persique, partiellement révisé lors du Traité de Lausanne en 1923 (plus d’Arménie indépendante, plus de présence grecque à Smyrne), interdit de rejouer pleinement ce rôle: les entités étatiques nées des accords Sykes-Picot et des Traités de Sèvres et de Lausanne ont acquis un statut autonome, avec une géopolitique particulière, qui n’accepte plus l’ingérence ni la tutelle turques. Personne ne semble avoir relu les écrits des “arabistes” des décennies 1890-1914 qui avaient revendiqué, face à l’éclosion de l’idéologie pantouranienne en Turquie, dans le sillage de la prise de pouvoir des Jeunes Turcs, l’unité des Arabes de la péninsule arabique et des pays arabophones situés au sud de la Turquie (Syrie, Palestine, Liban, Irak).
Dans les écrits, rédigés souvent en français, de ces précurseurs du panarabisme de Michel Aflaq, on décèle la volonté de créer un bloc arabe au départ des régions arabophones de la péninsule arabique et du Croissant Fertile, dont le ciment ne serait pas tant l’islam que la langue arabe qui, elle, unit effectivement Arabes chrétiens et musulmans. Cette vision a servi à fomenter la révolte arabe patronné par le fameux Lawrence d’Arabie en 1916 puis à animer la plupart des visions politiques à l’oeuvre dans le futur Etat irakien. A méditer, car c’est, indépendamment de la présence américaine, l’idéologie qui anime tout décideur irakien. Dans cette optique, la Turquie s’occupe des affaires turques et les Arabes des affaires arabes. Chacun sur son territoire, chacun avec sa langue. Un partage des tâches qui ne doit pas empêcher l’entente économique.
(sources: “Iraq asks Turkey to stop cross-border raids on Kurds”, in: “International Herald Tribune”, Oct. 16, 2009).
00:20 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : irak, turquie, politique internationale, politique, moyen orient, mésopotamie, actualité, géopolitique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Pourparlers militaires sino-australiens
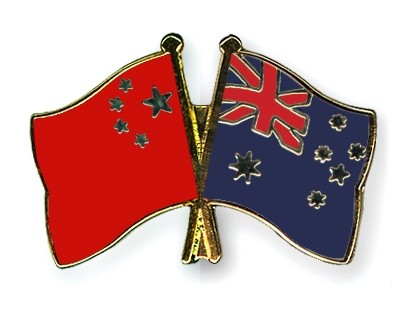 Pourparlers militaires sino-australiens
Pourparlers militaires sino-australiens
Les relations sino-australiennes se renforcent considérablement depuis quelques mois, en dépit de l’apprtenance de l’Australie à la sphère culturelle anglo-saxonne, dont elle est le bastion entre Océan Indien et Océan Pacifique. Désormais, c’est sur les plans militaire et stratégique que les deux puissances traitent à Canberra, après avoir régulé leurs relations commerciales. Le général chinois Chen Bingde vient de rencontrer le chef de l’armée de l’air australienne, Angus Houston, et le ministre de la défense, John Faulkner.
L’Australie est-elle progressivement attirée par l’informelle “sphère de co-prospérité est-asiatique”, qui existe de facto en dépit de l’ancienne volonté américaine de l’éliminer pendant la seconde guerre mondiale? Faut-il conclure qu’on ne contrarie pas la géographie et que les faits géographiques sont plus têtus que les discours idéologiques?
Restent quelques questions: la Chine cherche indubitablement une projection vers l’Océan Indien, par le Détroit de Malacca, par l’Isthme de Kra ou par des oléoducs traversant le Myanmar (Birmanie). Elle doit, pour ce faire, avoir les bonnes grâces de l’Australie. Mais l’Indonésie dans ce rapprochement, l’archipel indonésien qui est là, comme un verrou potentiel entre les deux puissances en phase de rapprochement accéléré? Quel rôle est-elle appelé à jouer? Celle d’un ami ou d’un ennemi du nouveau binôme sino-australien? Sa spécificité d’Etat à dominante largement musulmane déplait-elle à la Chine qui se méfie dorénavant de tout islamisme depuis les ennuis que lui procure sa minorité ouïghour dans le Sinkiang? Les implications potentielles du rapprochement sino-australien nous permettent encore de spéculer à l’infini. Un glissement géopolitique intéressant, dans une zone clef de la planète.
(sources: “International Herald Tribune”, Oct. 16, 2009).
00:20 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : asie, affaires asiatiques, océanie, chine, australie, extreme orient, géopolitique, politique internationale, politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Comportement social japonais

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1992
L'anatomie de la dépendance
L'interprétation du comportement social des Japonais par Takeo Doi
par Stefano BONINSEGNI
Edité au Japon en 1971, ce recueil d'articles écrits par un éminent psychiatre japonais se veut avant toute chose une contribution à la théorie psychanalytique, portée par une réflexion nouvelle sur le terme japonais amae —que l'on pourrait traduire, grosso modo, par «pulsion de dépendance». L'amae semble imprégner tous les aspects de la mentalité et de la pensée nipponnes. Le livre de Takeo Doi donne en bout de course une interprétation globale des comportements sociaux du peuple de l'Empire du Soleil Levant, comme le suggère d'ailleurs son sous-titre.
Prémisse de l'auteur: la psychologie spécifique d'un peuple, quel qu'il soit, ne peut s'étudier qu'en se familiarisant avec sa langue, car celle-ci englobe déjà tous les éléments intrinsèques de l'âme d'une nation. A toute langue correspondent des besoins et une vision du monde particulière. La langue japonaise étant radicalement différente des langues occidentales, les différences culturelles entre les mondes occidental et nippon sont très profondes. Par ailleurs, argumente Doi, il faut savoir que des pulsions et des émotions préexistent à l'émergence d'une langue; et le fait que la langue japonaise, à la différence de toutes les autres langues, possède le terme d'amae, lequel se réfère pourtant à une pulsion qui est en soi universelle, constitue un point de départ pour la réflexion, permettant de formuler des hypothèses suggestives, non seulement sur la mentalité japonaise mais aussi sur les différences de fond qui existent entre les cultures d'Occident et d'Orient.
La pulsion de dépendance surgit dès que le bébé perçoit, dans la douleur, la séparation entre son soi et le reste, c'est-à-dire sa mère. L'amae est la tentative de nier cette séparation douloureuse, de la même façon que le bébé, en s'attachant au sein de sa mère, satisfait (momentanément) son désir de subordination. Cette tentative d'échapper à ce détachement par rapport à un «tout originaire» façonne et conditionne la mentalité et la pensée japonaises. Les oppositions typiques qui structurent les langues occidentales —interne/externe, individuel/collectif, privé/public, etc.— sont toutes inadéquates pour cerner cette psychologie «infantile», qui idéalise la capacité de compter sur l'indulgence maximale d'autrui (amaeru), ce qui, en de nombreux cas, peut mal tourner.
Le modèle idéal de rapports, pour un Japonais, est celui qui unit géniteurs (en particulier la mère) et enfants, où la propension à la dépendance s'exprime de manière maximale. A l'opposé, face aux tanin (1), c'est-à-dire aux étrangers, l'amae n'est plus présente. Entre ces deux extrêmes, nous trouvons plusieurs groupes d'appartenance. Outre l'entourage immédiat d'un individu (uchi), les rapports se définissent par le ninjo (l'obligation sociale, le lien social), dans lequel sont présents et l'amae et l'enryo (la réserve, la distance tenue volontairement). Exemples: face à un collègue ou à un supérieur dans l'entreprise (qui est la «communauté» centrale dans la vie japonaise), le Japonais attend une certaine dose d'indulgence et de compréhension; par ailleurs, il se sent contraint de faire usage de sa réserve pour ne pas donner l'impression d'abuser de la condescendance d'autrui, sinon un conflit contraire aux intérêts de l'amae pourrait survenir. Le Japonais veut maintenir l'«harmonie».
L'idéal nippon dans le champ des rapports sociaux est toujours de pouvoir exprimer un maximum d'amaeru; en ce sens, l'enryo est perçu comme une douloureuse nécessité. Dans ce contexte mental et culturel, l'individualité vue comme séparation n'est pas considérée comme une valeur (la langue japonaise a dû introduire des termes spécifiques pour traduire plus ou moins les mots «individu» et «personnalité», vocables qui ne sont apparus qu'à l'ère de la modernisation au siècle passé). Ensuite, le «genre humain universel» n'est pas envisagé: seul le groupe et ses intérêts prévalent. Déjà, le Japon médiéval pouvait être considéré comme un ensemble de grands groupes (de clans) qui formaient un clan plus grand, la tribu Japon, dont l'Empereur est le symbole sacré de l'unité.
Dans la psychologie japonaise, il n'est pas possible d'envisager un conflit intérieur entre l'instance individuelle et le devoir public (chose fréquente, en revanche, dans la mentalité occidentale). Le conflit surgit bien plutôt entre les devoirs de l'individu à l'égard de différents niveaux d'appartenance, par exemple entre son entourage le plus intime et la nation. Selon Takeo Doi, c'est parce que la mentalité définie par l'amae est enracinée dans une histoire japonaise qui n'a jamais connu, même sous forme diffuse, une culture fondée sur les valeurs de l'individu. Tandis qu'en Occident l'individu a pris son envol par le christianisme, en Orient, et en particulier au Japon, s'est affirmée une culture de la communauté, ancrée dans une éthique de la fidélité au groupe, dont l'intérêt est toujours considéré comme supérieur.
Takeo Doi nous confirme en outre, dans les grandes lignes, l'idée qui se répand de plus en plus en Occident, selon laquelle le Japon, après avoir assimilé sans interruption des cultures ou des religions étrangères, aurait maintenu tout de même une identité de fond que la modernisation capitaliste n'a pas réussi à entamer de façon significative. Sur ce plan, justement, l'amae et son impact jouent un rôle fondamental. Le fait que le peuple japonais a été et, surtout, est encore enclin à assimiler des éléments de culture d'origine étrangère est du à cette pulsion de dépendance à l'égard d'autrui, dans la mesure où la fonction d'assimilation en est un mode opératoire caractéristique. Tout ce qui est assimilé est mis au service du groupe d'appartenance et de ses intérêts.
Nakamura Hajime, en prenant l'exemple de la religion, a cherché à expliquer cette attitude dans les termes suivants: «En règle générale, quand ils ont adopté des éléments issus de religions étrangères, les Japonais possédaient déjà un cadre éthique et pratique qu'ils considéraient comme absolu; ils n'ont donc recueilli ces éléments et ne les ont adaptés que dans la mesure où ces nouveautés ne menaçaient pas le cadre existant; au contraire, ils ne les adoptaient que s'ils encourageaient, renforçaient et développaient ce qui existait déjà chez eux [...]. Sans aucun doute, ceux qui embrassaient avec certitude les nouvelles religions le faisaient avec une piété sincère, mais il n'en demeurait pas moins vrai que la société japonaise se bornait en gros à adapter ces éléments pour atteindre plus facilement ces propres objectifs».
Takeo Doi, lui, donne une explication légèrement différente: «Pour m'exprimer en des termes légèrement différents de ceux qu'emploie Nakamura, je pourrais affirmer que, si les Japonais, au premier abord, semblaient accepter sans critique une culture étrangère, en fait, sur un mode tout à fait paradoxal, cette attitude les aidait à préserver la psychologie de l'amae, dans le sens où ce mode d'action, consistant à adopter et à accepter, est, en soi, une conséquence de cette mentalité».
Ensuite, par le fait de l'amae, la société et la mentalité japonaises se montrent extrêmement conservatrices, en dépit des convulsions profondes qui ont bouleversé, au cours de notre après-guerre, les institutions et les valeurs traditionnelles. Malgré ces mutations, il est possible de percevoir à quels moments de son histoire la mentalité japonaise a été entièrement compénétrée de cette pulsion de dépendance. Ainsi, tout fait penser, selon Doi, que même dans l'Empire du Soleil Levant, tôt ou tard, la tradition cèdera le pas à l'individualisme et à ses excès désagrégateurs: c'est une perspective qui rassure ceux qui craignent la résurgence du nationalisme et de l'expansionnisme nippons (aux Etats-Unis, la psychose va croissante!).
Que derrière le développement industriel et financier du Japon puisse se cacher et se réactiver un esprit belliciste et expansionniste indompté est admis partiellement, voire implicitement, par plus d'un observateur du monde nippon. Tant Antonio Marazzi que Guglielmo Zucconi, par exemple, perçoivent dans les attitudes des Japonais d'aujourd'hui, surtout dans leur univers du travail, une transfiguration moderne de l'esprit samouraï (2), qui prouve ainsi sa persistence. Selon cette interprétation, le facteur décisif, dans l'incroyable développement économique du pays, ne doit pas être recherché dans une quelconque qualité spéciale inhérente aux managers japonais ou dans l'utilisation massive et sophistiquée des technologies les plus modernes, mais bien plutôt dans le matériel humain japonais, caractérisé par un sens absolu du devoir du travailleur, vis-à-vis de son activité particulière, de son entreprise et de la «plus grande entreprise Japon».
Tout cela, selon Doi, ne correspond que superficiellement à la vérité; l'assiduité japonaise n'est rien d'autre que le résultat de la ki ga soumanaï, une tendance obsessionnelle qui dérive de la frustration d'amae: «Pour citer un seul exemple, la fameuse assiduité japonaise au travail pourrait très bien être liée à ce trait de caractère de nature obsessionnelle: si paysans, ouvriers et employés se jettent à corps perdu dans le travail, ce n'est pas tant par nécessité économique, mais plutôt parce que s'ils agissaient autrement, ils provoqueraient la ki ga soumanaï. Bien peu de salariés japonais se préoccupent de la signification de leur travail ou du bénéfice que la société, dans son ensemble, eux-mêmes et leur famille pourraient en tirer. Et pourtant, ils n'hésitent pas à se sacrifier. Cette attitude avantage évidemment le travail, même s'il est difficile de bien faire quelque chose sans une certaine dose d'enthousiasme».
Face à des observations de ce genre, on doit au moins remarquer qu'en dépit de ses origines, l'auteur se laisse contaminer par le vice européen, trop européen, de la psychanalyse, vice qui consiste à étendre démesurément les méthodes psychanalytiques, pour expliquer globalement tous les phénomènes d'ordre individuel ou social. Rappelons, au risque d'être répétitifs, que, en matière de conception du travail, la conception japonaise revêt au moins un aspect “sacré” qui transcende en tous points les visions actuelles et conventionnelles de l'Occident. Josei Toda, second président de la Soka Gakkaï (3), en pleine période de reconstruction, après la guerre en 1955, s'est adressé en ces termes à ses disciples: «Dès que l'on a compris le sentiment du Vrai Bouddha, comme est-il possible de négliger son travail? Pensez-y» (4). Il ne s'agit pas d'une apologie camouflée du capitalisme. Toda voulait mettre en exergue cet aspect bouddhique du don de soi absolu, idée qui, dans la mentalité occidentale est associée à la sphère religieuse ou à la rhétorique militaire. Il nous est difficile de croire qu'un tel esprit, qui s'est révélé essentiel pour arracher ce pays asiatique des décombres de la défaite et le projetter vers les sommets des statistiques de la production et du développement, ne hante plus aujourd'hui les coulisses de la «planète Japon», si complexe et si riche en contrastes.
Stefano BONINSEGNI.
Notes:
(1) L'indifférence à l'égard des tanin a des conséquences particulièrement désagréables pour les Coréens installés depuis des générations sur le territoire nippon et pour les eta, c'est-à-dire tous les Japonais qui exercent des professions considérées comme «impures» (bouchers et ouvriers des abattoirs, tanneurs, poissonniers, etc.).
(2) Cfr. Guglielmo ZUCCONI, Il Giappone tra noi, Garzanti, Milano, 1986; Antonio MARAZZI, Mi Rai. Il futuro in Giappone ha un cuore antico, Sansoni, Firenze, 1990.
(3) A la différence de ce que l'on dit et que l'on écrit, la Soka Gakkaï n'est pas, en fait, une nouvelle secte religieuse, mais une grande organisation laïque qui se réfère au clergé séculier bouddhiste de la Nichiren Shoshu. Récemment, ce clergé a destitué la Soka Gakkaï de ses prérogatives, en lui enlevant, entre autres choses, le droit de le représenter officiellement dans les milieux laïques et de diffuser le bouddhisme Nichiren. Au-delà des motivations exclusivement religieuses de cette dissension, il faut mentionner le fait que la Soka Gakkaï, sous la présidence de Daisaku Ikeda, a ajouté à sa mission traditionnelle de diffuser le bouddhisme un militantisme réformiste sur le plan social et des prises de position inspirées par un pacifisme absolu, qui déplaisaient forcément au clergé. Cette situation est révélatrice quant à l'atmosphère qui règne dans le Japon d'aujourd'hui.
(4) Cf. Il Nuovo Rinascimento, août 1991, p. 15.
00:11 Publié dans Sociologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sociologie, philosophie, japon, asie, affaires asiatiques, extrême orient |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 19 octobre 2009
Pakistan: un fondamentalisme anti-chiite?
 Pakistan: un fondamentalisme anti-chiite?
Pakistan: un fondamentalisme anti-chiite?
Dans une présentation didactique des principaux groupes fondamentalistes pakistanais actifs aujourd’hui, le quotidien flamand “De Morgen”, dans son édition du 16 octobre 2009, révèle les objectifs de base de quatre formations djihadistes:
- le Lashkar-e-Jhangri (LEJ)
- le Sipah-e-Sahaba Pakistan (SSP)
- le Jaish-e-Mohammed (JEM)
- le lashkar-e-Taiba (LET).
Le LEJ est une organisation sunnite née dans les années 90 et destinée à lutter, dans un premier temps, contre les chiites pakistanais. Ultérieurement le LEJ a opté pour un djihadisme généralisé. On lui attribue deux attentats: celui perpétré contre l’Hôtel Mariott à Islamabad et celui commis contre l’équipe de cricket du Sri-Lanka.
Le SSP (“Armée des Amis du Prophète”) a été fondé en 1985 dans l’intention de lutter contre les Chiites, parce que ceux-ci étaient majoritairement de gros propriétaires terriens dont les intérêts entraient en collision avec les hommes d’affaires et les professions indépendantes d’obédience sunnite. Le SSP est très lié au LEJ. Celui-ci est d’ailleurs issu des groupes les plus radicaux du SSP. Leur objectif est de faire du Pakistan un Etat exclusivement sunnite et de déclarer les chiites non musulmans et, par là même, parias et privés de tous droits de citoyenneté.
Le JEM (“Armée de Mohammed”), que l’on dit lié à Al Qaïda, avait été dissous après un attentat contre le Parlement indien en 2001. Au départ, ce groupe armé avait pour objectif de lutter contre les Indiens au Cachemire; plus tard, il a recentré ses activités dans la “zone tribale”, contigüe et du Penjab et de l’Afghanistan, pays auquel il a étendu ses activités, en liaison avec certains éléments des Talibans.
Le LET (“Armée des Justes”) a été constitué en 1990 pour lutter contre les Indiens au Cachemire avec, au départ, le soutien de l’armée et des services secrets pakistanais. On accuse le LET d’avoir commis l’attentat contre l’hôtel international de Mumbai (Bombay). Les Etats-Unis et l’Inde soupçonnent toujours le Pakistan de soutenir le LET.
(source: Ayfer ERKUL, “Dodelijke terreur in Pakistan”, in “De Morgen”, 16 oct. 2009).
Conclusion:
1) Le djihadisme, avec ses répercusssions “terroristes” avait pour objectif premier de lutter contre l’influence indirecte de l’Iran, qui aurait pu s’exercer via les communautés chiites, et contre l’Inde.
2) Le Pakistan, allié des Etats-Unis, a donc bel et bien servi d’instrument pour lutter contre le chiisme, en tant que prolongement de l’influence culturelle iranienne, et cela, sans doute dès l’époque du Shah. L’élimination de l’Empereur Pahlevi n’a nullement mis un terme aux persécutions anti-chiites, preuve que l’objectif final de Washington et d’Islamabad n’a jamais été d’éliminer un monarque qui aurait enfreint les droits de l’homme, comme on aimait dire du temps de Carter, ni d’éliminer de dangereux extrémistes fondamentalistes iraniens et chiites, mais de bloquer toute influence iranienne en direction de l’Afghanistan, du Pakistan et de l’Inde, selon les principes de “Grande Civilisation” théorisés par le dernier Shah et son entourage. De même, la manipulation de têtes brûlées djihadistes servait à enrayer le politique indienne dans la région (surtout au Cachemire), l’Inde étant soupçonnée de sympathies pour la Russie et de lui donner ainsi, indirectement, accès à l’Océan Indien.
3) L’alliance entre le fondamentalisme sunnite et les Etats-Unis se confirme, lorsqu’on examine les motivations premières des djihadistes pakistanais: leur ennemi, au départ, n’est ni l’Occident ni le communisme mais le chiisme et l’Inde. Les Etats-Unis ne pouvaient accepter ni une politique autonome de l’Iran impérial ni une politique autonome de la République Islamique d’Iran ni un tandem russo-indien dans l’Océan du Milieu.
4) L’option, récurrente dans certains milieux politiques ou métapolitiques non conformistes européens, de considérer que l’Islam est un bloc uni et, partant, une “force anti-impérialiste” dirigée contre les Etats-Unis en particulier et contre l’Occident en général, s’avère dès lors fausse et manichéenne. Le clivage sunnisme/chiisme est très souvent plus fort chez les djihadistes de base que le clivage Islam/Occident.
5) Les Etats-Unis, en appliquant la stratégie Brzezinski d’une alliance entre Mudjahhidins et Américains dès l’entrée des troupes soviétiques en Afghanistan en 1979, ont bel et bien ouvert une boîte de Pandore. Et les déboires que les Américains et leurs alliés doivent encaisser aujourd’hui dans la région sont les déboires de l’arroseur arrosé.
08:22 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : asie, affaires asiatiques, pakistan, fondamentalisme, extrémisme, islam, islamisme, terrorisme, djihad, djihadisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
L'Etat belge: un pantin aux mains de GDF-Suez
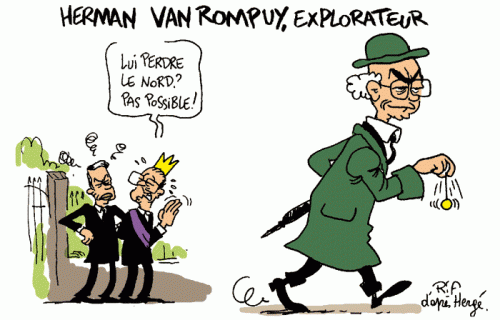
L’Etat belge: un pantin aux mains de GDF-Suez
On le sait: l’Etat belge a été ébranlé en ses fondements par la crise qui a fragilisé deux grandes banques au départ belges: DEXIA (ex-Crédit Communal) et Fortis (ex-Société Générale). Tout comme le secteur énergétique, avec Electrabel absorbé par GDF-Suez, les deux banques sont désormais les annexes de groupes français dont la BNP. L’indépendance belge n’est plus qu’une fiction: l’ennemi héréditaire français, de Philippe-Auguste à l’Universelle Aragne et de François I à Sarközy, a enfin colonisé économiquement et financièrement le dernier lambeau de l’ancienne Lotharingie, dont il ne reste plus que les Pays-Bas, rénégats à l’égard de tout passé impérial, la Suisse romande, le Luxembourg et la Padanie transalpine.
Pour éviter l’effondrement des deux grandes banques, l’Etat fédéral belge avait injecté des milliards dans leur escarcelle poreuse puis accepté leur absoprtion dans les groupes français. En compensation, l’Etat fédéral a demandé à ces banques et au secteur énergétique de soutenir son futur budget. Gérard Mestrallet, patron de GDF-Suez, vient de refuser tout net. Déjà, le géant français de l’énergie devait payer l’an dernier la somme de 250 millions d’euro. Il n’a pas versé un centime! La cotisation de cette année serait de 500 millions, que conteste GDF-Suez devant la Cour Constitutionnelle. L’erreur du Premier ministre démocrate-chrétien flamand Van Rompuy est d’avoir inscrit ces sommes au budget sans attendre l’arrêt de cette Cour Constitutionnelle. Minable expédient d’un gouvernement de nullités, de fantoches, de bas-de-plafond, condamné au “sur place”, faute de volonté et de moyens. Faute aussi de perspectives et de consciences historiques.
Toute l’affaire, explique l’éditorialiste du “Morgen”, Yves Desmet, rappelle les dures paroles de feu Karel Van Miert, leader socialiste flamand puis Commissaire européen à la concurrence (où il s’est aligné sur les critères imposés par le néo-libéralisme...). Van Miert: “Les hommes politiques belges ne font pas le poids devant Electrabel. Les consommateurs et les entreprises belges paieront encore leur électricité très cher et pendant très longtemps”. Et: “Aucun gouvernement n’a encore eu le courage de s’en prendreà Electrabel”.
Yves Desmet est encore plus caustique: “Mestrallet, avec une arrogance inimaginable, coiffe au poteau le gouvernement belge en annonçant sans sourciller qu’il peut se mettre où je pense, c’est-à-dire là où jamais ne luit l’astre solaire, la cotisation de 500 millions prévue pour Electrabel. Et voilà notre gouvernement belge envoyé au coin comme un morveux de maternelle”. Le contribuable, déjà saigné aux quatre veines, va devoir payer la facture! Alors que la prolongation de la mise en service des centrales nucléaires, accordée au bénéfice du secteur énergétique, va rapporter à celui-ci, sans plus aucun investissement nécessaire, plus de deux milliards d’euro, somme qui, normalement, si nous avions un gouvernement digne de ce nom, rapporter 610 millions d’impôts. Or Electrabel n’a jamais payé le moindre impôt en Belgique, s’empresse d’ajouter Yves Desmet (1). Qui va encore plus loin: “Le gouvernement Van Rompuy poursuit ici une tradition bien belge: en échange d’une aumône, on reste le paillasson de Paris, on accepte la totale dépendance énergétique et on empêche que la libre concurrence s’installe sur le marché de l’énergie”.
Pire: le second joueur sur le marché belge de l’énergie, Luminus, tombera bientôt entre les mains de l’EDF, autre géant français, dont l’Etat sarköziste est le principal actionnaire. Desmet: “Alors l’Elysée pourra, de son propre chef et sans jamais être soumis à aucun contrôle, fixer le prix que chaque Belge devra payer pour son énergie”. Alors qu’il paie déjà de 20 à 30% de plus que les autres Européens, grâce aux ponctions que lui administre l’Etat français, via le secteur de l’énergie. Vous avez dit “colonisation”? Les Sénégalais et les Tonkinois ont certainement été moins grugés à l’époque coloniale... Desmet poursuit: “Les politiciens belges pourraient en réaction menacer de fermer les centrales nucléaires. Mais ils sont là, immobiles et pantois, et laissent faire. Avec les doigts sur la couture du pantalon, en se rendant compte qu’ils ne sont que des nains”. Des nains, des gnômes, soumis à de perpétuels chantages: Suez menace tantôt d’abandonner le terminal gazier de Zeebrugge tantôt de retirer ses parts dans “Brussels’ Airlines”.
Le langage de Desmet et de ses collaborateurs à la rédaction du “Morgen” a des accents nationalistes, bien plus nationalistes que les discours de ceux qui revendiquent cette étiquette. Pour des hommes qui oeuvrent dans un journal qui affirme plonger ses racines dans l’esprit de mai 68, c’est effectivement un beau progrès.
Sources:
Johan CORTHOUTS, “België niet opgewassen tegen Electrabel”, in: “De Morgen”, 16 oct. 2009.
Yves DESMET, “Suez”, in: “De Morgen”, 16 oct. 2009.
Bart EECKHOUT / Johan CORTHOUTS, “Sue betaalt ‘zéro euro’”, in: “De Morgen”, 16 oct. 2009.
Note:
(1) Electrabel, explique le journaliste du “Morgen”, Johan Corthouts, ne paie aucun impôt de société grâce à des techniques fiscales très élaborées et à des ventes de parts en carroussel permanent; Electrabel ne paie pas davantage d’impôt sur ses dividendes grâce à l’artifice des “intercommunales”.
08:18 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : belgique, europe, affaire européennes, énergie, france, colonialisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
The Anglo-US Drive into Eurasia and the Demonization of Russia
 The Anglo-US Drive into Eurasia and the Demonization of Russia The Anglo-US Drive into Eurasia and the Demonization of RussiaReframing the History of World War II By Mahdi Darius Nazemroaya | |
| Global Research, October 2, 2009 | |
| As tensions mount between the U.S. and the North Atlantic Treaty Organization (NATO) on one side and Moscow and its allies on another, the history of the Second World War is being re-framed to demonize Russia, the legal successor state and largest former constituent republic (pars pro toto) of the Union of Soviet Socialist Republics (U.S.S.R.). In 2009, the U.S.S.R. and the Nazi government of Germany started being portrayed as the two forces that ignited the Second World War. The German-Soviet Non-Aggression Pact or the Ribeentrop-Molotov Pact caused shock waves in Europe and North America when it was signed. The German and Soviet governments were at odds with one another. This was more than just because of ideology; Germany and the Soviet Union were being played against one another in the events leading up to the Second World War, just as how previously Germany, the Russian Empire, and the Ottoman Empire were played against one another in Eastern Europe [3] British policy and the rationale for the non-aggression pact between the Soviets and Germans is described best by Carroll Quigley. Quigley, a top ranking U.S. professor of history, on the basis of the diplomatic agreements in Europe and insider information as an professor of the elites explains the strategic aims of British policy from 1920 to 1938 as:
It is because of this aim of nurturing Germany into a position of attacking the Soviets that British, Canadian, and American leaders had good rapports (which seem unexplained in standard history textbooks) with Adolph Hitler and the Nazis until the eve of the Second World War. In regards to appeasement under Prime Minister Neville Chamberlain and its beginning under the re-militarization of the industrial lands of the Rhineland, Quigley explains:
In regards to eventually creating a common German-Soviet, the French-led military alliance had to first be neutralized. The Locarno Pacts were fashioned by British foreign policy mandarins to prevent France from being able to militarily support Czechoslovakia and Poland in Eastern Europe and thus to intimidate Germany from halting any attempts at annexing both Eastern European states. Quigley writes:
The Anglo-German Naval Agreement of 1935 was also deliberately signed by Britain to prevent the Soviets from joining the neutralized military alliance between France, Czechoslovakia, and Poland. Quigley writes:
The Hoare-Laval Plan was also used to stir Germany eastward instead of southward towards the Eastern Mediterranean, which the British saw as the critical linchpin holding their empire together and connecting them through the Egyptian Suez Canal to India. Quigley explains:
Both the Soviet Union, under Joseph Stalin, and Germany, under Adolph Hitler, ultimately became aware of the designs for the planning of a German-Soviet war and because of this both Moscow and Berlin signed a non-aggression pact prior to the Second World War. The German-Soviet arrangement was largely a response to the Anglo-American stance. In the end it was because of Soviet and German distrust for one another that the Soviet-German alliance collapsed and the anticipated German-Soviet war came to fruition as the largest and deadliest war theatre in the Second World War, the Eastern Front. The Origins of the Russian Urge to Protect Eurasia | |
| | |
| | |
00:15 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, histoire, grande-bretagne, empire britannique, etats-unis, russie, eurasie, eurasisme, asie, affaires asiatiques, affaires européennes, impérialisme, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Ernst Krieck (1882-1947)
 KRIECK Ernst, 1882-1947
KRIECK Ernst, 1882-1947
Né à Vögisheim en pays de Bade le 6 juillet 1882, ce pédagogue entame une carrière d'instituteur en 1900, puis de directeur d'école primaire, pour devenir, après s'être formé en autodidacte, docteur honoris causa de l'Université de Heidelberg en 1923. En 1928, Krieck est nommé à l'«Académie pédagogique» de Francfort s.M. Ses convictions nationales-socialistes lui valent plusieurs mesures disciplinaires. Après la prise du pouvoir par Hitler, il est nommé professeur ordinaire à Francfort. De 1934 à 1945, il enseigne à Heidelberg. Avec ses amis M.R. Gerstenhauer et Werner Kulz, il édite de 1932 à 1934 la revue Die Sonne, fondée en 1924. A partir de 1933, il publie seul la revue Volk im Werden. Il collabore dans le même temps à plusieurs publications consacrées à la pédagogie. L'objectif de ses études historiques sur la pédagogie était d'ordre philosophique, écrit-il, car elles visaient à cerner le noyau commun de tous les modes d'éducation, juif, grec, romain, médiéval, allemand (de l'humanisme de la Renaissance au rationalisme du XVIIIième et de celui-ci au romantisme national(iste)). A partir de 1935, Krieck abandonne la pédagogie stricto sensu pour vouer tous ses efforts à l'élaboration d'une anthropologie «völkisch» au service du nouveau régime.
Krieck est surtout devenu célèbre pour sa polémique contre Heidegger, amorcée dans les colonnes de Volk im Werden et dans son discours de Rectorat à l'Université de Francfort prononcé le 23 mai 1933. Outre sa polémique agressive et sévère contre le langage abstrait, calqué sur les traditions grecques et juives, de l'auteur de Sein und Zeit, Krieck reprochait à Heidegger de vouloir sauver la philosophie, la «plus longue erreur de l'humanité hespériale», une erreur qui consiste à vouloir «refouler et remplacer le réel par le concept». Refoulement et oblitération du réel qui conduisent au nihilisme. Partisan inconditionnel de l'hitlérisme, Krieck affirme que la révolution nationale-socialiste dépassera ce nihilisme engendré par la dictature des concepts. Reviendra alors le temps des poètes homériques, inspirés par le «mythe», et des «historiens» en prise directe sur les événements politiques, dont l'ancêtre génial fut Hérodote, l'ami du tragédien Sophocle. Figure emblématique de la Terre-mère, idée mobilisatrice de la Vie, puissance du destin, sentiment tragique de l'existence, cosmos, sont les mots-clefs de cette pensée du pédagogue Krieck, en guerre contre la philosophie du concept. Le règne du logos, inauguré par Héraclite d'abord, puis surtout par Platon, l'ennemi des poètes, conduit les hommes à vivre dans un monde aseptisé, inerte, dépourvu de tragédie: le «monde des idées» ou de l'Etre. La pensée doit donc faire retour au charnel grouillant et bouillonant, aux matrices (Mutterschoß et Mutterboden), aux «lois incontournables du sang et de la race», dans un maëlstrom de faits et de défis sans cesse effervescent, ne laissant jamais aucun repos à la volonté, cette force intérieure qui arraisonne ce réel inépuisablement fécond.
Interné dans le camp de concentration de Moosberg en 1945, pour son appartenance aux cadres de la NSDAP, Krieck y meurt le 19 mars 1947.
L'idée de l'Etat allemand (Die deutsche Staatsidee), 1934
L'intérêt de cet ouvrage est de nous livrer une histoire de la pensée politique allemande, telle que peut la concevoir un vitaliste absolu qui adhère au mouvement hitlérien. Pour Krieck, les sources de l'Etat moderne résident dans l'absolutisme, instauré graduellement à partir de la fin du XVième siècle. Avant l'absolutisme règnait en Allemagne le droit communautaire germanique. L'irruption dans le discours politique de l'idée et de l'idéologie du droit naturel est le fruit du rationalisme et du mathématisme du XVIIième siècle, renforcé au cours du XVIIIième et trouvant son apothéose chez Kant. Dans l'optique du droit naturel et du rationalisme, le droit et l'Etat sont des formes aprioristiques de l'esprit et ne sont pas le résultat d'un travail, d'une action, d'une aventure historique tragique. En ce sens, le droit naturel est abstrait, explique Krieck. C'est une pensée politique idéaliste et non organique. Krieck définit ce qu'est pour lui l'organique: c'est l'unité vivante qu'il y a dans un être à composantes multiples. C'est la constance que l'on peut observer malgré les mutations successives de forme et de matière. C'est, enfin, l'immuabilité idéelle de certains traits essentiels ou de caractère. Le libéralisme s'est opposé au constructivisme absolutiste; en Angleterre, il vise à limiter l'emprise de l'Etat et à multiplier les droits politiques pour la classe possédante. En France, depuis la révolution jacobine, tout le poids décisionnaire de l'appareil étatique bascule entre les mains de la majorité électorale sans tenir compte des intérêts des oppositions. En Allemagne, le libéralisme anti-absolutiste est d'une autre nature: il est essentiellement culturel. Ses protagonistes entendent sans cesse se former et se cultiver car le droit à l'épanouissement culturel est le premier des droits de l'homme. L'Etat libéral allemand doit par conséquent devenir une sorte d'institut d'éducation éthique permanente. Dans cette optique, sont condamnables toutes les forces qui contrarient le développement de l'éducation. Humboldt est la figure emblématique de ce libéralisme. Krieck entend mettre les «illusions» de Humboldt en exergue: la figure de proue du libéralisme culturaliste allemand croit que l'homme, dès qu'il est libéré du joug de l'absolutisme, va spontanément adhérer à l'idéal de la culture. Cette vision idéalisée de l'homme est désincarnée et l'Etat se trouve réduit à un rôle minimal, même s'il est sublime. Humboldt a raison de dire que l'énergie est la première des vertus de l'homme mais l'idéal qu'il propose est, lui, dépourvu d'énergie, de socle dynamisant. L'humanité, contrairement à ce que croit Humboldt, ne se déploie pas dans l'espace en harmonie mais à partir d'une lutte constante entre entités vitales supra-personnelles. Il y a émergence d'une Bildung originale là où s'affirme une force dans une lutte qui l'oppose à des résistances. Mais quand on parle de force, on doit toujours parler en terme d'holicité et non d'individu. Une force est toujours collective/communautaire et révèle dans le combat son idée motrice, créatrice d'histoire. Humboldt, dit Krieck, est prisonnier d'une méthodologie individualiste, héritée de l'Aufklärung. Or la Bildung n'est pas le produit d'une individualité mais le reflet du meilleur du peuple, sinon elle ne serait qu'originalité inféconde. L'Etat doit organiser la Bildung et l'imposer à tout le corps social/populaire. Affirmer ce rôle de l'Etat: voilà le pas que n'a pas franchi Humboldt. Il rejette l'absolutisme et la bureaucratie, qui en découle, comme des freins à l'épanouissement de la Bildung sans conjuguer l'idée d'un Etat éthique avec l'idéal de cette Bildung.
L'Etat doit être la puissance éducatrice et «éthicisante» du peuple. Krieck reprend à son compte, dans sa synthèse, l'héritage de l'Aufklärung selon l'agitateur et pédagogue rousseauiste Basedow. Au XVIIIième siècle, celui-ci militait pour que l'Etat —et non plus l'Eglise— organise un système d'enseignement cohérent et fondateur d'une élite politique. Après l'échec de la vieille Prusse devant les canons napoléoniens, la pensée allemande prend conscience de la nécessité de structurer le peuple par l'éducation. Krieck rappelle une parole de Fichte qui disait que l'Etat allemand qui aurait pour programme de faire renaître la nation par l'éducation, tout en promouvant l'idée de l'Etat éducateur, en tirerait le maximum de gloire. Dans cette perspective pédagogisante fichtéenne/krieckienne, l'Etat, c'est l'organisation des moyens éducatifs au bénéfice de ses objectifs propres. Krieck se réfère ensuite au Baron von Stein qui avait la volonté de fusionner trois grands courants d'idées en Allemagne: le prussianisme (avec son sens du devoir et du service), l'idée de Reich et l'idée culturelle/spirituelle de Nation. De cette volonté de fusion découlait une vision originale de ce que doit être l'éducation: faire disparaître les disharmonies existant au sein du peuple et provoquées par les querelles entre états (Stände), de façon à ce que «chaque ressortissant du Volk puisse déployer ses forces dans un sens moral». Stein ne se contente donc pas de vouloir éliminer des barrières mais veut très explicitement diriger et encadrer le peuple façonné par la Bildung. L'éducation fait de l'Etat un organisme animé (beseelter Organismus) qui transmet sa force aux générations futures. Pour Fichte —et en écho, pour Krieck— l'éducation doit susciter une Tatbereitschaft, c'est-à-dire une promptitude à l'action, un ensemble de sentiments puissants qui, ajoutera ultérieurement Schleiermacher, donne une âme à l'Etat et cesse d'en faire un simple jeu de mécanismes et d'engrenages. Hardenberg est une autre figure de la Prusse post-napoléonienne qu'analyse Krieck. Souvent cité en même temps que Stein, Hardenberg est toutefois moins radical, parce que plus lié aux anciennes structures absolutistes: il prône un laissez-faire d'inspiration anglaise (Adam Smith) et ne conçoit l'Etat que comme police. Pour Krieck, c'est là une porte ouverte au primat de l'économie sur l'éducation, à l'emprise du manchesterisme et du monopolisme ploutocratique à l'américaine sur le devenir de la nation.
Krieck critique Schelling, personnage jugé par lui trop aristocratique, trop isolé du peuple, et qui, par conséquent, a été incapable de formuler une philosophie satisfaisante de l'Etat et de l'histoire. En revanche, certaines de ses intuitions ont été géniales, affirme Krieck. L'Etat, pour Schelling, n'est plus une «œuvre d'art», le produit d'une technique, mais le reflet de la vie absolue. Droit et Etat, chez Schelling, n'existent pas a priori pour qu'il y ait équilibre dans la vie mais l'équilibre existe parce que la vie existe, ce qui corrobore l'idée krieckienne qu'il n'y a que la vie, sans le moindre arrière-monde. Krieck regrette que Schelling ait enfermé cette puissante intuition dans une démarche trop esthétisante. Adam Müller complète Schelling en politisant, historicisant et économicisant les thèses de son maître à penser. Krieck énumère ensuite les mérites de Hegel. L'idée de l'Etat éducateur connaît par la suite des variantes conservatrices, réformistes et économistes. Les conservateurs cultivent l'idéal médiévisant d'un Etat corporatiste (Ständestaat) mais centralisé: ils retiennent ainsi les leçons de l'Aufklärung et de la révolution. Paul de Lagarde est un précurseur plus direct de l'Etat éducateur national-socialiste, qui ramasse toutes les traditions politiques allemandes, les fusionne et les ancre dans la réalité. Lagarde affirmait, lui aussi, que le premier but de la politique, c'était l'éducation: «la politique est à mon avis rien d'autre que pédagogie, tant vis-à-vis du peuple que vis-à-vis des princes et des hommes d'Etat». Dans cet ouvrage datant des premiers mois de la prise du pouvoir par Hitler, Krieck propose pour la première fois de transposer ses théories pédagogiques dans le cadre du nouveau régime qui, croit-il, les appliquera.
Anthropologie politique völkisch (Völkisch-politische Anthropologie), 1936
Les fondements du réel politique sont biologiques: ils relèvent de la biologie universelle. Tel est la thèse de départ de l'anthropologie völkisch de Krieck. La biologie pose problème depuis le XVIIIième siècle, où elle est entrée en opposition au «mécanicisme copernicien». La «Vie» est alors un concept offensif dirigé contre les philosophies mécanicistes de type cartésien ou newtonien; ce concept réclame l'autonomie de la sphère vitale par rapport aux lois de la physique mécanique. L'épistémologie biologique, depuis ses premiers balbutiements jusqu'aux découvertes de Mendel, a combattu sur deux fronts: contre celui tenu par les théologiens et contre celui tenu par les adeptes des philosophies mécanicistes. Leibniz avait évoqué la téléologie comme s'opposant au mécanicisme universel en vogue à son époque. Les théologiens, pressentant l'offensive de la biologie, ont mis tout en œuvre pour que la téléologie retourne à la théologie et ne se «matérialise» pas en biologie. Le débat entre théologiens et «réalitaires biologisants» a tourné, affirme, Krieck, autour du concept aristotélicien d'entéléchie, revu par Leibniz, pour qui l'entéléchie est non plus l'état de l'être en acte, pleinement réalisé, mais l'état des choses qui, en elles, disposent d'une suffisance qui les rend sources de leurs actions internes. La biologie est donc la science qui étudie tout ce qui détient en soi ses propres sources vitales, soit les êtres vivants, parmi lesquels les peuples et les corps politiques.
Pour Krieck, la Vie est la réalité totale: il n'y a rien ni derrière ni avant ni après la Vie; elle est un donné originel (urgegeben), elle est l'Urphänomen par excellence dans lequel se nichent tous les autres phénomènes du monde et de l'histoire. La conscience est l'expression de la Vie, du principe vital omni-englobant. Les peuples, expressions diverses de cette Vie, tant sur le plan phénoménal que sur le plan psychique, sont englobés dans cette totalité vitale. Le problème philosophique que Krieck cherche à affronter, c'est de fonder une anthropologie politique où le peuple est totalité, c'est-à-dire base de Vie, source vitale, où puisent les membres de la communauté populaire (les Volksgenoßen) pour déployer leurs énergies dans le cosmos. Tout peuple est ainsi une niche installée dans le cosmos, où ses ressortissants naissent et meurent sans cesser d'être reliés à la totalité cosmique. L'idée de Vie dépasse et englobe l'idée évangélique de l'incarnation car elle pose l'homme comme enraciné dans son peuple de la même façon que le Christ est incarné en Dieu, son Père, sans que l'homme ne soit détaché de ses prochains appartenant à la même communauté de sang. Le cycle vital transparaît dans la religiosité incarnante (incarnation catholique mais surtout mystique médiévale allemande), qui est une religion de valorisation du réel qui, pour l'homme, apparaît sous des facettes diverses: humanité, Heimat, race, peuple, communauté politique, communauté d'éducation, etc. Dans la sphère de l'Etat, se trouvent de multiples Volksordnungen, d'ordres dans le peuple, soit autant de niches où les individus sont imbriqués, organisés, éduqués (Zucht) et policés. Krieck oppose ensuite l'homme sain à l'homme malade; la santé, c'est de vivre intensément dans le réel, y compris dans ses aspects désagréables, en acceptant la mort (sa mort) et les morts. Cette santé est le propre des races héroïques dont les personnalités se perçoivent comme les maillons dans la chaîne des générations, maillons éduqués, marqués par l'éthique de la responsabilité et par le sens du devoir. Les hommes malades —c'est-à-dire les esclaves et les bourgeois— fuient la mort et la nient, éloignent les tombes extra muros, indice que l'idée d'une chaîne des générations a disparu.
Caractère du peuple et conscience de sa mission. L'éthique politique du Reich (Volkscharakter und Sendungsbewußtsein. Politische Ethik des Reiches), 1940
Cet ouvrage de Krieck comprend deux volets: 1) une définition du caractère national allemand; 2) une définition de la «mission» qu'implique l'idée de Reich. Le caractère national allemand a été oblitéré par la christianisation, même si les Papes évangélisateurs des régions germaniques ont été conscients du fait que l'esprit chrétien constituait une sorte d'Übernatur, d'adstrat artificiel imposé à l'aide de la langue latine, qui recouvrait tant bien que mal une naturalité foncièrement différente. Le Moyen Age a été marqué par un christianisme véhiculant les formes mortes de l'Antiquité. Seuls les Franciscains ont laissé plus ou moins libre cours à la religiosité populaire et permis au Lied allemand de prendre son envol. La Renaissance, l'humanisme et le rationalisme n'ont fait que séculariser une culture détachée du terreau populaire. Le national-socialisme est la révolution définitive qui permettra le retour à ce terreau populaire refoulé. Il sera la pleine renaissance de la Weltanschauung germanique, qui relaie et achève les tentatives avortées d'Albert le Grand, d'Eike von Repgow, de Walther von der Vogelweide, de Maître Eckehart, de Nicolas de Cues, de Luther, de Paracelse, etc. Sans cesse, l'Allemagne a affirmé son identité nationale grâce à un flux continu venu du Nord. S'appuyant sur les thèses du scandinaviste Grönbech, Krieck parle du sentiment nordique de la communauté, du service dû à cette communauté et à la volonté de préserver son ancrage spirituel contre les influences étrangères. Pour Grönbech et Krieck, l'individu ne s'évanouit pas dans la communauté mais résume en lui cette communauté dont les ressortissants partagent les mêmes sentiments, les mêmes projets, le même passé, le même présent et, res sic stantibus, le même avenir. Ce destin commun s'exprime dans l'honneur, la Ehre.
Krieck insiste sur la notion de Mittgart (ou Midgard) qui, dans la mythologie germanique/scandinave, désigne le monde intermédiaire entre l'Asgard (le monde des Ases, le monde de lumière) et l'Utgard (le monde de l'obscurité). Ce Mittgart est soumis au devenir (urd) et aux caprices des Nornes. C'est un monde de tensions perpétuelles, de luttes, de dynamique incessante. Les périodes de paix qui ensoleillent le Mittgart sont de brefs répits succédant à des victoires jamais définitives sur les forces du chaos, émanant de l'Utgard. Le mental nordique retient aussi la notion de Heil, une force agissante et fécondante, à connotations sotériologiques, qui anime une communauté. Cette force induit un flux ininterrompu de force qui avive la flamme vitale d'une communauté ou d'une personne et accroît ses prestations. Le substrat racial nordique irradie une force de ce type et génère un ordre axiologique particulier qu'il s'agit de défendre et d'illustrer. La foi nouvelle qui doit animer les hommes nouveaux, c'est de croire à leur action pour fonder et organiser un Reich, un Etat, un espace politique, pour accoucher de l'histoire.
Le droit doit devenir le droit des hommes libres à la façon de l'ancien droit communautaire germanique, où le Schöffe (le juge) crée sans cesse le droit, forge son jugement et instaure de la sorte un droit vivant, diamétralement différent du droit abstrait, dans la mesure où il est porté par la «subjectivité saine d'un homme d'honneur». Le droit ancestral spontané a été oblitéré depuis la fin du XVième siècle par le droit pré-mécaniciste de l'absolutisme, issu du droit romain décadent du Bas-Empire orientalisé. L'avénement de ce droit absolutiste ruine l'organisation sociale germanique de type communautaire. Néanmoins, au départ, l'absolutisme répond aux nécessités de la nouvelle époque; le Prince demeure encore un primus inter pares, responsable devant ses conseils. Le césaro-papisme, impulsé par l'Eglise, introduit graduellement le «despostisme asiatique», en ne responsabilisant le Prince que devant Dieu seul. Les pares se muent alors en sujets. L'arbitraire du Prince fait désormais la loi (Hobbes: auctoritas non veritas facit legem; Louis XIV: L'Etat, c'est moi!). Dans ces monarchies ouest-européennes, il n'y a plus de Reich au sens germanique, ni d'états mais un Etat. Le droit est concentré en haut et chichement dispersé en bas. Les devoirs, en revanche, pèsent lourdement sur les épaules de ceux qui végètent en bas et ne s'adressent guère à ceux qui gouvernent en haut. La révolution bourgeoise transforme les sujets en citoyens mais dépersonnalise en même temps le pouvoir de l'Etat et du souverain tout en absolutisant la structure dans laquelle sont enfermés les citoyens. Dans cette fiction règne le droit du plus puissant, c'est-à-dire, à l'âge économiste, des plus riches. L'essence de la justice se réfugie dans l'abstraction du «pur esprit», propre de l'humanisme kantien ou hégelien, une pensée sans socle ni racines. Cette idéologie est incapable de forger un droit véritablement vivant, comme le montre la faillite du système bismarckien, forgé par les baïonnettes prussiennes et la poigne du Chancelier de fer, mais rapidement submergé par l'éclectisme libéral et le marxisme, deux courants politiques se réclamant de ce droit universaliste-jusnaturaliste sans racines.
Krieck définit ensuite la Vie, vocable utilisé à profusion par toutes les écoles vitalistes, comme un «cosmos vivant», un All-Leben. Ce dynamisme de l'All-Leben, nous le trouvons également chez les Grecs d'avant Socrate et Platon. Mais les Grecs ont très tôt voulu freiner le mouvement, bloquer le dynamisme cosmique au profit d'un statisme et de formes (en autres, de formes politiques) fermées: la Polis, l'art classique, expressions du repos, de quiétisme. Les Germains n'ont pas connu ce basculement involutif du devenir à l'Etre. L'aristotélisme médiéval n'a pas oblitéré le sens germanique du devenir: le monachisme occidental et la scolastique n'ont jamais été pleinement quiétistes. Cluny et les bénédictins ont incarné un monachisme combattant donc dynamique, même si ce dynamisme a été, en fin de compte, dirigé par Rome contre la germanité. Après cette phase combattante seulement, la scolastique s'est détachée du dynamisme naturel des peuples germaniques, a provoqué une césure par rapport à la vie, césure qui a trouvé ultérieurement ses formes sécularisées dans le rationalisme et l'idéalisme, contesté par le romantisme puis par la révolution nationale-socialiste.
En proposant une «caractérologie comparée» des peuples, Krieck part d'une théorie racisante: les peuples produisent des valeurs qui sont les émanations de leur caractère biologiquement déterminé. Derrière toutes les écoles philosophiques, qu'elles soient matérialistes, idéalistes, logiques, sceptiques —orientations que l'on retrouve chez tous les peuples de la Terre— se profile toujours un caractère racialement défini. Les Allemands, tant dans leurs périodes de force (comme au Haut Moyen Age ottonien) que dans leurs périodes de faiblesse (le Reich éclaté et morcelé d'après 1648), se tournent spontanément vers le principe d'All-Leben, de cosmicité vitale, contrairement aux peuples de l'Ouest, produits d'une autre alchimie raciale, qui suivent les principes cartésiens et hobbesiens du pan-mécanicisme (All-Mechanistik). La pensée chinoise part toujours d'une reconnaissance du Tao universel et vise à y adapter la vie et ses particularités. L'ethos chinois exprime dès lors repos, durée, équilibre, régularité, déroulement uniforme de tout événement, agir et comportement. La pensée indienne résulte du mélange racial sans doute le plus complexe de la Terre. Contrairement à la Chine homogène, l'Inde exclut la réminiscence historique, la conscience historique et est, d'une certaine façon, impolitique. Autre caractéristique majeure de l'âme indienne, selon Krieck: l'ungeheure Triebhaftigkeit, la foisonnante fécondité des pulsions et la prolifération des expressions de la vie: fantaisie et spéculation, désir (Begier) et contemplation, sexualité et ascèse, systématique philosophique et méthodique psycho-technique, etc. Cette insatiabilité des pulsions fait de l'Inde le pôle opposé de la Grèce (mises à part certaines manifestations de l'hellénisme): l'âme indienne submerge toujours la forme dans l'informel, le démesuré, les figures grimaçantes et grotesques. L'hybris, faute cardinale chez les Grecs, est principe de vie en Inde: le roi n'y a jamais assez de puissance, l'ascète n'y est jamais assez ascétique, etc. Le génie grec, quant à lui, est génie de la mesure, de l'équilibre intérieur de la forme.
Le mécanicisme newtonien est l'expression du caractère anglais, surtout quand il met en exergue l'antagonisme des forces. Cet antagonisme s'exprime par ailleurs dans le bipartisme de la vie politique anglaise, dans la concurrence fairplay de la sphère économique, dans le sport. Le génie français (Descartes, Pascal, d'Alembert, H. Poincaré) procède d'une méthode analytique et géométrique. Ce géométrisme se perçoit dans l'architecture des jardins, de la poésie, de l'art dramatique du XVIIième siècle et du rationalisme politique centralisateur de la révolution de 1789.
Conclusion de Krieck: le peuple allemand est le seul peuple suffisamment homogène pour adhérer directement à la Vie sans le détour mutilant des schémas mécanicistes, du logos ou de la «philosophie de l'Etre». Adhésion à la vie qui s'accompagne toujours d'une discipline intérieure et d'un dressage.
L'idée de Reich, à rebours de toute soumission ou oppression, vise la communauté des Stämme (des tribus, des régions). Centre de l'Europe, enjeu de l'histoire européenne, le Reich offre, dit Krieck, une forme politique acceptable pour tous les Européens et pour tous les peuples extra-européens. Dans cette perspective, le monde doit être organisé et structuré d'après les communautés qui le composent, afin d'aboutir à la communauté des peuples. Tous, sur la Terre, doivent bénéficier d'espace et de droit: tel est la réponse de l'Allemagne au «moloch» qu'est l'impérialisme britannique. La mission universelle du Reich est d'assurer un droit à toutes les particularités ethniques/nationales nées de la vie et de l'histoire.
Enfin, il convient de former une élite disciplinée, qui dresse les caractères par la Zucht et la Selbstzucht (maîtrise de soi). La poésie et l'art ont un rôle particulier à jouer dans ce processus de dressage permanent, de lutte contre l'Utgard, l'Unheil.
Education nationale-politique (Nationalpolitische Erziehung), 1941
Ouvrage qui définit tout un ensemble de concepts pédagogiques et qui reprend les théories de Krieck pour les replacer dans le cadre du nouvel Etat national-socialiste. Les définitions proposées par l'auteur sont soumises à une déclaration de principe préalable: l'ère de la raison pure est désormais révolue, de même que celle de la science dépourvue de préjugés et de la neutralité axiologique (Wertfreiheit). La règle du subjectivisme absolu triomphe car la science prend conscience que des préjugés de tous ordres précèdent son action. L'acceptation de ces préjugés imbrique la science dans le réel. Son rôle n'est pas de produire quelques chose d'essentiel car le monde n'est jamais le produit des idées. La science doit au contraire se poser comme la conscience du devenir et, ainsi, pouvoir pré-voir, pressentir ses évolutions ultérieures, puis planifier en conséquence et se muer de la sorte en «technique», en force méthodique de façonnage, de mise en forme du réel. Grâce à la science/technique ainsi conçue, la pulsion (Trieb) devient acte (Tat), le grouillement de la croissance vitale (Wachsen) se transforme en volonté, l'événémentiel est dompté et permet un agir cohérent. Krieck annonce la fin de la science désincarnée; le sujet connaissant fait partie de ce monde sensoriel, historique, ethnique, racial, temporel. Il exprime de ce fait un ensemble de circonstances particulières, localisées et mouvantes. Reconnaître ces circonstances et les maîtriser sans vouloir les biffer, les figer ou les oblitérer: telle est la tâche d'une science réelle, incarnée, racisée. L'homme est à la fois sujet connaissant et objet de connaissance: il est certes le réceptacle de forces universelles, communes à toutes les variantes de l'espèce homo sapiens, mais aussi de forces particulières, raciales, ethniques, temporelles/circonstancielles qui font différence. Une différence que la science ne peut mettre entre parenthèses car ses multiples aspects modifient l'impact des forces universelles. Il y a donc autant de sciences qu'il y a de perspectives nationales (science française, allemande, anglaise, chinoise, juive, etc.). Krieck insiste sur un adage de Fichte: Was fruchtbar ist, allein ist wahr (Ce qui est fécond seul est vrai). Mais Krieck demeure conscient du danger de pan-subjectivisme que peuvent induire ses affirmations. Il pose la question: la science ne risque-t-elle pas, en perdant son autonomie et sa liberté par rapport au «désordre» des circonstances particulières, de n'être plus qu'une servante, une «prostituée» (Dirne) au service d'intérêts ou de stratégies partisanes? La réponse de Krieck tombe aussitôt, assez lapidaire: cela dépend du caractère de ceux qui instrumentalisent la science. Celle-ci a toujours été déterminée et instrumentalisée par le pouvoir. Le pouvoir indécis du libéralisme, démontre Krieck, a affaibli et la science et le peuple. Un pouvoir mené par des personnalités au caractère fort enrichit la science et le peuple.
Parmi les définitions proposées par Krieck, il y a celle de «révolution allemande», en d'autres termes, la révolution nationale-socialiste. La «révolution allemande» devra créer la «forteresse Allemagne», soit forger un Etat capable de façonner et de dresser (zuchten) les énergies du Volk, d'organiser l'espace vital de ce peuple. L'Etat doit éduquer les Allemands sur bases de leurs caractéristiques raciales et organiser la santé collective et la sécurité sociale. Cette révolution est organique et dépasse les insuffisances délétères des mécanicismes libéral et marxiste.
Krieck nous présente une définition du terme «race». La race consiste en l'ensemble transmissible par hérédité des caractéristiques déterminées des corps et des prédispositions spirituelles. Ces caractéristiques corporelles et ces prédispositions spirituelles dépassent l'individu; elles se situent au-delà de lui, dans sa famille, son clan, sa tribu, son peuple, sa race. La Zucht, le dressage, vise la rentabilisation maximale de cet héritage. L'absence de dressage conduit au mixage indifférencié et à la dégénérescence des instincts et des formes. La politique raciale, qui doit logiquement découler de cette définition, n'a pas que des facettes biologiques: elle a surtout une dimension psychique et spirituelle, greffée par l'éducation et le dressage. L'homme est néanmoins un tout indissociable qui doit être étudié sous tous ses aspects. Les interventions éducatives de l'Etat doivent progresser simultanément dans les domaines corporel, psychique et spirituel. En Allemagne, l'idéaltype racial qui doit prévaloir est le modèle nordique. La race nordique doit demeurer le pilier, l'assise de tout Etat allemand viable. La saignée de 1914-1918 a affaibli le corps de la nation allemande-nordique. Les idéologies universalistes étrangères ont eu le dessus pendant la période de Weimar, avant que le substrat racial-psychique-spirituel ne revienne à la surface par l'action des Nationaux-Socialistes. Ce mouvement politique, selon Krieck, constate la faillite du libéralisme diviseur et rassemble toutes les composantes régionales, confessionnelles, sociales du peuple allemand dans une action révolutionnaire instinctuelle et non intellectuelle.
Les diverses phases de l'éducation se déroulent dans la famille, les ligues de jeunesse et la formation professionnelle. L'ère bourgeoise a été l'ère de l'économie, affirme Krieck, et l'ère nationale (völkische) sera l'ère des métiers, de la créativité personnelle et de l'éducation professionnelle.
L'Etat doit être une instance portée par une strate sélectionnée, politisée et organisée en milice de défense, homogène et cohérente, recrutée dans tout le peuple et répartie à travers lui. C'est elle qui formera la volonté politique de la collectivité. Au XIXième siècle, cette «strate sélectionnée» était l'élite intellectuelle bourgeoise (bürgerliche Bildungselite), universitaire et savante. Mais cette bourgeoisie, en dépit de la qualité remarquable de ses productions intellectuelles, n'avait pas d'organisation qui traversait tout le corps social. Sa capillarisation dans le corps social était insuffisante: ce qui la condamnait à disparaître et à ne jamais revenir.
Krieck définit aussi ce qu'est la Weltanschauung, mot-clef des démarches organicistes de la première moitié du siècle. La Weltanschauung, pour Krieck, est la façon de voir le monde propre à un peuple et au mieux incarnée dans la strate sélectionnée. L'homme primitif élaborait une Weltbild, une image du monde magique-mythique. L'homme de la civilisation rationaliste est désorienté, sans image-guide, ne perçoit plus aucun sens. Sa pensée est dissociée de la vie. L'homme qui a dépassé la phase rationaliste/bourgeoise maîtrise et la vie et la technique, a le sens de la totalité/holicité (Ganzheit) de la vie, allie le magique et le rationnel, le naturel et l'historique. Trois types d'hommes se côtoient: ceux qui sont animés par la foi et ses certitudes, ceux qui imaginent tout résoudre par la raison et ses schémas et, enfin, ceux qui veulent plonger entièrement dans le réel et acceptent joyeusement les aléas du destin et du tragique qu'il suscite. Ces derniers sont les héros, porteurs de la révolution que Krieck appelle de ses vœux.
Dans la dernière partie de son ouvrage, l'auteur récapitule ses théories sur l'éducation et les replace dans le contexte national-socialiste.
(Robert Steuckers).
- Bibliographie: pour un recencement complet des écrits de Krieck, cf. Armin Mohler, Die Konservative Revolution in Deutschland 1918-1932, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1989 (3ième éd.). Nous recensons ci-dessous les principaux livres de l'auteur: Persönlichkeit und Kultur. Kritische Grundlegung der Kulturphilosophie, Heidelberg, 1910; Lessing und die Erziehung des Menschengeschlechtes, Heidelberg, 1913; Philosophie der Erziehung, Iéna, 1922; Menschenformung. Grundzüge der vergleichenden Erziehungswissenschaft, Leipzig, 1925; Bildungssysteme der Kulturvölker, Leipzig, 1927; Deutsche Kulturpolitik?, Francfort s.M., 1928 (2ième éd., Leipzig, 1936); Staat und Kultur, Francfort s.M., 1929; Nationalpolitische Erziehung, Leipzig, 1932; Völkisch-politische Anthropologie (3 vol., 1936, 1937, 1938; vol. I, Die Wirklichkeit; vol. II, Das Handeln und die Ordnungen; vol. III, Das Erkennen und die Wissenschaft); Leben als Prinzip der Weltanschauung und Problem der Wissenschaft, Leipzig, 1938; Mythologie des bürgerlichen Zeitalters, Leipzig, 1939; Volkscharakter und Sendungsbewußtsein. Politische Ethik des Reichs, Leipzig, 1940; Der Mensch in der Geschichte. Geschichtsdeutung aus Zeit und Schicksal, Leipzig, 1940; Natur und Wissenschaft, Leipzig, 1942; Heil und Kraft. Ein Buch germanischer Weltweisheit, Leipzig, 1943.
- Sur Krieck: W. Kunz, Ernst Krieck. Leben und Werk, 1942; Georg Lukacs, Die Zerstörung der Vernunft, 1962 (l'éd. originale hongroise est parue en 1954); E. Thomale, Bibliographie v. Ernst Krieck. Schriftum, Sekundärliteratur, Kurzbiographie, 1970; K. Ch. Lingelbach, Erziehung und Erziehungstheorien in national-sozialistischen Deutschland, 1970; Gerhard Müller, Ernst Krieck und die nationalsozialistische Wissenschaftsreform, 1978; Jürgen Schriewer, «Ernst Krieck», in Neue Deutsche Biographie, 13. Band, Duncker & Humblot, 1982; Giorgio Penzo, Il superamento di Zarathustra. Nietzsche e il nazionalsocialismo, 1987, pp. 312-318; Léon Poliakov & Josef Wulf, Das Dritte Reich und seine Denker, 1989 (2ième éd.).
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, pédagogie, national-socialisme, années 20, années 30, allemagne, vitalisme, panvitalisme, révolution conservatrice, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 18 octobre 2009
Unegrande Albanie parrainée par l'Occident

Menace d'un nouveau conflit en Europe: Une Grande Albanie parrainée par l'Occident Par Rick Rozoff | |
| Le 10 octobre 2009 | |
| L'Europe peut être perchée au-dessus du précipice de son premier conflit armé depuis les 78 jours de bombardement de la guerre de l'OTAN contre la Yougoslavie en 1999 et l'invasion armée de la Macédoine qui a suivi lancée à partir du Kosovo occupé par l'OTAN deux ans plus tard. | |
| | |
| | |
00:30 Publié dans Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europa, affaires européennes, atlantisme, otan, balkans, albanie, géopolitique, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Cosmetic Conservatism
Cosmetic Conservative
Describing what he sees as the relative powerlessness of talk radio, New York Times columnist David Brooks wrote last week: “Let us take a trip back into history… It is the winter of 2007. The presidential primaries are approaching. The talk jocks like Rush Limbaugh, Glenn Beck, Sean Hannity and the rest are over the moon about Fred Thompson. They’re weak at the knees at the thought of Mitt Romney. Meanwhile, they are hurling torrents of abuse at the unreliable deviationists: John McCain and Mike Huckabee. Yet somehow, despite the fervor of the great microphone giants, the Thompson campaign flops like a fish. Despite the schoolgirl delight from the radio studios, the Romney campaign underperforms. Meanwhile, Huckabee surges. Limbaugh attacks him, but social conservatives flock. Along comes New Hampshire and McCain wins! McCain wins the South Carolina primary and goes on to win the nomination. The talk jocks can’t even deliver the conservative voters who show up at Republican primaries. They can’t even deliver South Carolina!”
David Brooks is a man who does not, and probably cannot, understand a state like South Carolina. Nor does he understand talk radio, the conservative movement, or even himself.
Talk radio hosts gravitated toward Fred Thompson and Mitt Romney because both candidates best fit their ideal: non-threatening, marquee value GOP establishment types who project a “conservative” image, despite not having much of a record to match. The reason Mike Huckabee “surged” is because “values voters” cared more about electing one of their own than his lack of limited government credentials. John McCain won in South Carolina because the most military-heavy state in the union wanted to support a soldier, and the senator’s military record was valued more than his politics. Indeed, virtually every Republican who ran for president in 2008 represented a different form of identity politics on the Right.
And so does Brooks. Brooks advocates the same neoconservative Republican politics that animated Thompson, Romney, Huckabee and McCain, and his differences with the current conservative movement are more style than substance. The New York Times columnist would like to see a conservatism that stays faithful to the policies of the Bush administration, yet with the temperament and air-of- respectability of a New York Times columnist. His criticism is almost entirely cosmetic.
Calling himself a “reformist” Brooks seeks a conservative movement less abrasive than talk radio, less Christian than Mike Huckabee and pretty much exactly like John McCain, sans Sarah Palin. This kindler, gentler, or dare I say “compassionate” conservatism, differs little from the Republican brand that got its butt kicked in 2008, or as The American Conservative’s Jim Antle writes: “Much of reformist conservatism is really an aesthetic judgment about the Republican Party and conservative movement… the reformists tended to support the very Bush-era policies that ushered in the Obama administration and Democratic congressional majorities. Virtually all of them favored invading Iraq. Although many of them now concede that the war did not go as well, pre-surge, as they had hoped, most of them continue to believe the decision to attack Iraq was justified. The Iraq War and the foreign-policy ideas that gave rise to it are conspicuous by their absence from reformists’ list of areas where Republicans or conservatives need to change.”
Indeed. And now Brooks and his ilk still argue over the righteousness of the war in Iraq, the need to stay in Afghanistan and are keeping a hawk’s eye on Iran. In the mind of Brooks, the Republicans didn’t lose the White House in 2008 because of George W. Bush, his policies or his wars - Americans were simply turned off by Sarah Palin. Brooks’ conservatism is anything but, and despite his rationalizations, the man is basically just a snob.
But if Brook’s snob conservatism, Thompson and Romney’s wannabe-Reagan-imitations, Huckabee’s holy-rolling and McCain’s mad-bomber mentality are all just stylistic variations of the same Republican policies, it is worth noting the one candidate in 2008 who attracted widespread, bipartisan support, based not only almost purely on his ideas - but ideas that stood in stark contrast to the rest of his party. Texas Congressman Ron Paul’s 2008 campaign reflected the antiwar sentiment that helped elect Obama and the anti-government outrage that now defines the grassroots Right. Paul, unlike his fellow 2008 presidential contenders, not only rejected the failed policies of the Bush administration, but despite his lack of charisma, possessed the only political platform that might have had a chance of winning - while remaining conservative to the core.
But strict, limited government conservatism is of little concern to establishment men like Brooks, which makes him completely useless. Writes Antle: “the reformists, whose new ideas are not conservative and whose old ideas are the ones that destroyed the Bush GOP, are the very last pundits Republicans should heed.”
Indeed. And if the American Right needs a new, better identity - as many rightly believe it does - a good start might be to move as far away as possible from the politics and person of David Brooks.
Article URL: http://www.takimag.com/site/article/cosmetic_conservative/
00:15 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, etats-unis, conservatisme, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Europa-Russia-Eurasia: una geopolitica "orizzontale"

EUROPA-RUSSIA-EURASIA:
UNA GEOPOLITICA "ORIZZONTALE"
di Carlo Terracciano / Ex: http://eurasiaunita.splinder.com/
"L'idea eurasiatica rappresenta una fondamentale revisione della storia politica, ideologica, etnica e religiosa dell'umanità; essa offre un nuovo sistema di classificazione e categorie che sostituiranno gli schemi usuali. Così l'eurasiatismo in questo contesto può essere definito come un progetto dell'integrazione strategica, geopolitica ed economica del continente eurasiatico settentrionale, considerato come la culla della storia e la matrice delle nazioni europee".
Aleksandr Dugin
Continenti e geopolitica
L'Eurasia è un continente "orizzontale", al contrario dell'America che è un continente "verticale". Cercheremo di approfondire poi questa perentoria affermazione analizzando la storia e soprattutto la geografia, in particolare eurasiatica. Terremo ben presente che in geopolitica la suddivisione dei continenti non corrisponde a quella accademica, ancor oggi insegnata nelle nostre scuole fin dalle elementari, e che, comunque, se un continente è "una massa di terre emerse e abitate, circondata da mari e/o oceani", è evidente che l'Europa, come continente a sé stante (assieme ad Asia, Africa, America e Australia), non risponde neanche ai requisiti della geografia scolastica. Ad est infatti essa è saldamente unita all'Asia propriamente detta. La linea verticale degli Urali, di modesta altezza e degradanti a sud, è stata posta ufficialmente come la demarcazione trai due continenti, prolungata fino al fiume Ural ed al Mar Caspio; ma non ha mai rappresentato un vero confine, un ostacolo riconosciuto rispetto all'immensa pianura che corre orizzontalmente dall'Atlantico al Pacifico. La nascita e l'espansione della Russia moderna verso est, fino ad occupare e popolare l'intera Siberia, non è altro che la naturale conseguenza militare e politica di un dato territoriale: la sostanziale unità geografica della parte settentrionale della massa eurasiatica, la grande pianura che corre dall'Atlantico al Pacifico, distinta a sud da deserti e catene montuose che segnano il vero confine con l'Asia profonda.
Nel suo libro Pekino tra Washington e Mosca (Volpe, Roma, 1972) Guido Giannettini affermava: "Riassumendo, dunque, il confine tra il mondo occidentale e quello orientale non sta negli Urali ma sugli Altai". Inseriva quindi anche la Russia con la Siberia in "occidente" e ne specificava di seguitole coordinate geografiche: "la penisola anatolica, i monti del Kurdistan, l'altopiano steppico del Khorassan, il Sinkiang, il Tchingai, la Mongolia, il Khingan, il Giappone". Semplificando possiamo dire che il vero confine orizzontale tra le due grandi aree geopolitiche della massa continentale genericamente eurasiatica è quello che separa l'Europa (con la penisola di Anatolia) più la Federazione Russa, con tutta la Siberia fino a Vladivostok, dal resto dell'Asia "gialla" (Cina, Corea Giappone); nonché dalle altre aree geopoliticamente omogenee (omogenee per ambiente, storia, cultura, religione ed economia) dell'Asia (Vicino Oriente arabo-islamico, mondo turanico, Islam indoeuropeo dal Kurdistan all'Indo, subcontinente indiano, Sudest asiatico peninsulare e insulare fino all'Indonesia). Più che di un confine di tipo moderno si potrebbe parlare, specie nell'Asia centrale, di un limes in senso romano, di una fascia confinaria più o meno ampia che separa popoli e tradizioni molto differenti. In termini politici, specie dopo la dissoluzione dell'URSS, potremmo comunque porre questo confine asiatico attorno al 50° parallelo, per poi proseguire con gli attuali confini di stato tra Federazione Russa a nord e Cina-Mongolia-Giappone.
Del resto, in questo XXI secolo dell'era volgare la nuova concezione eurasiatista delle aree geopolitiche e geoeconomiche omogenee supera le concezioni politiche veteronazionaliste otto-novecentesche, basate su confini ritagliati a linee rette con squadra e compasso. Al contrario si considerano "aree" che spesso si sovrappongono ed integrano, come una serie di anelli concatenati tra loro (tipo i cerchi colorati della bandiera olimpica): ad esempio, l'arca mediterranea è certamente un'unità geopolitica in un mare interno, quasi chiuso agli oceani, che, come dice il suo stesso nome, rappresenta la medianità, il baricentro, il ponte tra le terre prospicienti. Ciò non toglie che i paesi europei che si affacciano sul sistema marittimo Mediterraneo - Mar di Marinara - Mar Nero facciano certamente parte integrante dell'Europa, a sua volta prolungamento occidentale dell'Asia settentrionale, cioè dello spazio russo-siberiano.
Come si noterà, le varie unità omogenee della massa eurasiatica sono disposte tutte in senso orizzontale. La geografia del Mondo Antico, di tutta la massa che con un neologismo potremmo definire Eufrasia, penetrata da un sistema marittimo interno, va in questo senso: da ovest ad est (o viceversa), nel senso dei paralleli. È lo stesso senso di marcia seguito dai ReitervöIker, i "popoli cavalieri" che corsero l'intera Eurasia fin dai più remoti tempi preistorici, i tempi dei miti e delle saghe dell'origine. È lo stesso tragitto, da est a ovest, delle invasioni che dalle steppe dell'Asia centralesi rovesciarono sulla penisola occidentale europea in ondate successive: quelle che noi definiamo "invasioni barbariche", nel periodo della caduta dell' Impero Romano. Poi vennero Tamerlano e Gengiz-Khan; quindi i Turchi, dapprima in Anatolia e poi nei Balcani.
Siberia russa
"Precisamente del Sur de Siberia y de Mongolia provencan las oleadas de los llamados 'bárbaros' que, a través de las estepas que rodean el Caspio y el Mar Negro, llegaron a Europa y cambiaron tanto su faz durante los primeros siglos de nuestra Era" (Alexandr Dugin, Rusia. El misterio de Eurasia, Madrid, GL 88,1992, p. 127).
Precedentemente la grande epopea araba dell'Islam, conquistatala penisola arabica, si era espansa sia verso ovest - nel Sahara e in Spagna – sia verso est - nel Vicino Oriente e fino al centro dell'Asia. Con l'avvento dell'età moderna sarà proprio la Russia, liberatasi dal dominio dell'Orda d' Oro e riunificata attorno al Principato di Moscoviti, a percorrere la strada lineare da ovest ad est. "Jermak è il Pizarro della Russia, l'uomo che sottomise la Siberia e la donò allo zar Ivan il Terribile. E con lui la famiglia degli Stroganoff e in generale i Cosacchi" (Juri Semionov, La conquista della Siberia, Sonzogno, Piacenza, 1974). Nell'arco di appena un secolo, dalla salita al trono di Ivan IV il Terribile nel 1547 alla scoperta dello stretto di Bering nel 1648, la conquista della Siberia è un fatto compiuto. Un evento quasi sconosciuto nei nostri testi di storia, ma che rappresenta e sempre più rappresenterà in futuro un fattore determinante per gli equilibri planetari, come intuì anche il geopolitico inglese Mackinder all'inizio del secolo scorso.
Lo spazio è potenza, anche uno spazio vuoto. La Siberia, con la sua vastità ancora in massima parte intatta, con le sue risorse energetiche e minerali, con la sua posizione, rappresenta una potenzialità unica per l' Eurasia, cioè per l'Europa e la Russia insieme: la possibilità di una possibile autarchia da contrapporre alla globalizzazione mondialista americanocentrica. La Siberia rappresenta per tutta l'Europa fino agli Urali quello che fu il "Far West" per le tredici colonie dei nascenti Stati Uniti: è il nostro "Far East"! Ma HeartIand mackinderiano può essere difeso solo con il controllo di tutta la penisola Europa e delle sue coste atlantiche. Come ben sanno i Russi dal '700 in poi.
Dal XVIII al XX secolo la Russia fu mira dell'espansionismo da occidente. Svezia, Francia, Germania hanno tentato invano di conquistare da ovest ad est lo spazio vitale russo: sempre e comunque in linea orizzontale, seguendo la conformazione geografica del continente.
E, in senso inverso, sarà l'impero russo, oramai divenuto sovietico, a espandere verso ovest la propria influenza dopo la Seconda Guerra Mondiale (la "Grande Guerra Patriottica" per i Russi), mentre gli USA conquisteranno la parte occidentale, marittima e oceanica della penisola europea.
La NATO in marcia verso l’Heartland
All'inizio dell'ultimo decennio del secolo scorso, il crollo implosivo dell'URSS e l'avanzata ad est della NATO portano le truppe e i missili USA nei paesi dell'ex blocco sovietico, del Patto di Varsavia, e della stessa URSS (paesi baltici). La talassocrazia americana, già padrona incontrastata degli oceani mondiali, penetra a fondo nel cuore d'Eurasia, all'assalto degli ultimi bastioni di resistenza rappresentati dalle potenze terrestri russa e cinese.
Pensare che la Russia possa fare a meno dell'Europa peninsulare (e viceversa l'Europa della Russia) di fronte a questa avanzata finale è assolutamente contrario alla geostrategia quanto al semplice buon senso. Consideriamo innanzitutto che l'Europa di cui parliamo non è una libera e sovrana unità di stati indipendenti, se non formalmente. In realtà dal '45 in poi il continente è sotto l'egemonia statunitense, cioè della talassocrazia atlantica. Con qualche rara eccezione, come in parte la Francia erede del gollismo, e con la conferma della Gran Bretagna quale appendice americana in Europa.
La NATO, non a caso, dal 1949 fino al crollo dell'URSS si estendeva su tutti gli stati europei rivieraschi dell'Atlantico e del Mediterraneo, per chiudere al Patto di Varsavia ogni accesso marittimo, isolando l' URSS e strangolandola nella sua dimensione territoriale: tanto estesa quanto chiusa alle grandi acque oceaniche e ai mari caldi interni. Dopo il fallimento dell'avventura afgana, preliminare ad uno sbocco all'Oceano Indiano che spezzasse l'accerchiamento nella massa eurasiatica, il contraccolpo derivato dalla sconfitta e dal ripiegamento ha mandato in frantumi l'oramai artificiosa struttura dell'impero sovietico, demotivato anche ideologicamente e stremato economicamente da un apparato militare obsoleto e chiaramente inadatto alle sfide del presente.
Oggi poi l'Alleanza Atlantica, lungi dall'essersi dissolta per "cessato pericolo", si è estesa sempre più ad est, toccando nel Baltico i confini russi. L'Ucraina è già sulla via dell'integrazione occidentale, il Caucaso è in fiamme, la Georgia è saldamente in mano a Washington.
Non è certo con la sola, ipotetica, alleanza di medie potenze regionali asiatiche che Mosca può pensare di vincere la partita con Washington; partita mortale, esiziale per la sua stessa integrità territoriale e sopravvivenza come impero.
Quello a cui punta l'America di Bush, di Brzezinski (ebreo di origine polacca) e di tutti i loro sodali biblici è semplicemente l'annientamento della Russia come entità storico-politica. L'alternativa alla Federazione Russa attuale è il ritorno al Principato di Moscovia, tributario stavolta di un'altra "Orda d'Oro", ben peggiore: quella dei finanzieri di Wall Street.
Da un punto di vista geopolitico russocentrico, l'unica sicurezza per i secoli a venire non può esser rappresentata che dal controllo sotto qualsiasi forma delle coste della massa eurasiatica settentrionale, quelle coste che si affacciano sui due principali oceani mondiali, l'Atlantico e il Pacifico. E se Vladivostok è la "porta d'Oriente" (e tale può restare, in accordo e collaborazione con il colosso nascente cinese, indirizzando Pechino al Pacifico e appoggiandone le giuste rivendicazioni perla restituzione di Taiwan), è ad occidente che si giocherà la partita decisiva: quella della salvezza della Russia come della liberazione dell'Europa dal giogo americano. Fino alla Manica, al Portogallo, a Reykjavik. O l'Europa si integrerà in una sfera di cooperazione economica, politica e militare con Mosca (il famoso asse Parigi-Berlino-Mosca), o sarà usata nell'ambito NATO dagli americani come una pistola puntata su Mosca. L'esperienza del Kossovo e della guerra alla Serbia dovrebbe aver insegnato qualcosa.
L'unica sicurezza per una potenza continentale estesa come la Federazione Russa è il controllo delle coste, di isole e penisole della sua area geopolitica di interesse; in caso contrario, l'Europa sarebbe prima o poi usata come un ariete americano per sfondare le porte della Federazione e dissolverla nelle sue cento realtà etno-politico-religiose.
La tentazione di risolvere per sempre la "questione russa" (anticipando anche lo sviluppo della Cina come grande potenza economica e militare) è forte, specialmente oggi che Washington resta l'unica superpotenza dominante nel globo.
L'Heartland, il "Cuore della Terra", è a portata di mano. La talassocrazia USA ha occupato buona parte di quel Rimland, di quell"'Anello Marginale" eurasiatico che era stato individuato dal geopolitico americano Spykman già durante la Guerra Mondiale. E Russia e Cina sono gli ultimi reali ostacoli a quella conquista definitiva dell'Isola del Mondo, ossia dell'Eurasia, che concluderebbe la conquista americana del pianeta. Le truppe a stelle e strisce sono a Kabul e a Bagdad, ma con basi avanzate anche a Tiblisi, Taškent, Biškek. Iran e Siria, potenziali alleati, sono sotto il mirino delle armate americane e dei missili atomici di Israele. E anche se l'occupazione a stelle e strisce dell'Iraq non è andata secondo i piani del Pentagono, è certo che le truppe americane non lasceranno il paese, le sue basi militari, i suoi pozzi petroliferi, neanche molti anni dopo le elezioni farsa del 2005.
Oriente e Occidente
Certo l'integrazione di due realtà complesse e per molto tempo separate, come sono Europa e Russia, non sarà semplice e immediata; d'altronde non lo fu neanche la creazione di Stati nazionali quali la Spagna, la Francia e specialmente l'Italia. Eppure oriente e occidente sono destinati ad incontrarsi e fondersi. L'Europa Unita dei capitali, dei mercati, della tecnologia, ma sradicata dalle proprie tradizioni e valori, trova nella Russia dei grandi spazi siberiani, della potenza militare nucleare e delle materie prime, una Russia ancora in parte legata alle proprie tradizioni, il suo stesso naturale proseguimento geografico, politico, storico, culturale. Una parte possiede quel che manca all'altra.
A questo punto va inserita una precisazione sui concetti di "Oriente" e "Occidente" conforme alla prospettiva eurasiatista di Dugin e della scuola geopolitica russa in generale. In un testo dell'ottobre 2001, intitolato "La sfida della Russia e la ricerca dell'identità", Aleksandr Dugin affermava tra l'altro: "Gli eurasiatisti considerano tutta la situazione presente da una loro peculiare prospettiva [rispetto ai nazionalisti slavofili e ai neosovietisti]: nemico principale è la civiltà occidentale. Gli eurasiatisti fanno proprie tutte le tesi antioccidentali: geopolitiche, filosofiche, religiose, storiche, culturali, socioeconomiche, e sono pronti ad allearsi con tutti i patrioti e con tutti coloro che propugnano una 'politica di potere' (derzhavniki) - siano essi di destra o di sinistra – che miri a salvare la 'specificità russa' di fronte alla minaccia della globalizzazione e dell'atlantismo". E ancora: "Per noi eurasiatisti, l'Occidente è il regno dell' Anticristo, il "luogo maledetto". Ogni minaccia contro la Russia viene dall'Occidente e dai rappresentanti delle tendenze occidentaliste in Russia".
È ovvio che Dugin, pensatore formatosi sul pensiero tradizionale, sulla cultura europea di Nietzsche, Guénon, Evola ecc., non confonde affatto l'Europa con l'Occidente, tant'è vero che di seguito indica giustamente il nemico comune dell'Uomo nell'atlantismo, nel Nuovo Ordine Mondiale, nella globalizzazione americanocentrica, ecc. ecc. La contrapposizione tra Oriente e Occidente, specialmente se riferita all'Europa del XX secolo, è, in termini politici e geografici, un' invenzione della propaganda atlantista, dopo la spartizione dell'Europa stessa a Jalta.
Quale Europa?
Possiamo anche aggiungere che la stessa contrapposizione "razziale" tra euro-germanici e slavi, assimilati alla "congiura ebraica" sulla base dell'esperienza della rivoluzione bolscevica in Russia e non solo, fu uno dei grandi errori della Germania, la quale, proprio per questo, perse la guerra, l'integrità territoriale e l'indipendenza. Valida in parte nella prima fase rivoluzionaria, tale contrapposizione non tenne conto della svolta staliniana in politica interna, né del rovesciamento di prospettiva tra Rivoluzione e Russia attuata dal dittatore georgiano, considerato dai russi "l'ultimo zar" rosso del paese: non la Russia come strumento e trampolino di lancio della "rivoluzione permanente" trotzkista in Europa, ma al contrario il marxismo come strumento ideologico-politico di conquista per iI rinato impero russo-sovietico.
Riproporre questa contrapposizione tra Europei, a ruoli rovesciati, sarebbe esiziale per i Russi oggi quanto lo fu per i Tedeschi ieri. La scuola geopolitica tedesca di Haushofer, al contrario, aveva sempre auspicato un'alleanza geostrategica tra Germania e Russia, estesa fino all'estremo limite dell'Eurasia, all'Impero del Sol Levante, bastione oceanico contro l'ingerenza espansionistica dell' imperialismo USA nel Pacifico.
Per oltre mezzo secolo l' Europa è stata divisa dai vincitori tra un Est e un Ovest; la Germania, tra una Repubblica Federale ad ovest e la DDR a est; la sua capitale, cuore d'Europa, tra Berlino Est e Berlino Ovest. Su questo falso bipolarismo per conto terzi si è giocata, per quasi mezzo secolo, la "guerra fredda" delle due superpotenze. "Fredda" in Europa, ma ben "calda" nel resto del mondo, in Asia, Africa e America Latina, con guerre, rivoluzioni, decolonizzazione, colpi di stato, dittature militari, invasioni, blocchi economici, minacce nucleari e via elencando. L’antitesi tra un'Europa "occidentale", progredita e democratica ed un Est "slavo" aggressivo e minaccioso, retrogrado e inaffidabile, è il residuo politico del passato prossimo, un rottame della Guerra Fredda, ma anche uno strumento dell'attuale politica di Bush e soci per tenere a freno un'Europa avviata all'unità economica, affinché non riconosca nella Russia il naturale complemento del proprio spazio geoeconomico vitale, bensì vi veda un pericolo sempre incombente. Il caso Ucraina, con ancora una volta europei e americani schierati contro la Russia, è la cartina di tornasole di queste posizioni residuali sorte dagli esiti della Seconda Guerra Mondiale, la Guerra Civile Europea per eccellenza.
Errore mortale quindi identificare Europa ed Occidente. Esiziale per l'Europa, ma soprattutto per la Russia e in ogni caso per l'Eurasia comunque intesa.
Certo l'Europa/Occidente a cui pensano gli eurasiatisti di Mosca è quella sorta dalla Rivoluzione francese, l'Europa degli "Immortali Principi" dell'89,dell'Illuminismo prima e del Positivismo poi, del modernismo e del materialismo estremo. Si tratta di quell'Occidente che ha tentato a più riprese di invadere lo spazio vitale russo, per poi attuare sul corpo vivo della Santa Russia ortodossa uno degli esperimenti politico-sociali più disastrosi della storia. Ebbene: questo "Occidente" ed i suoi falsi miti sono il nemico oggettivo anche dell'Europa, cioè della penisola eurasiatica d'occidente. L'Europa della tradizione, della vera cultura, della civiltà latina-germanica-slava. Alla fine del ciclo è l' antitradizione quella che coinvolge tutto il globo e travolge ogni distinzione, senza limiti né confini: a est, ad ovest, a nord, a sud. Sarebbe un errore, ripetiamolo, da pagare in futuro a caro prezzo, confondere le politiche dei singoli governi europei di oggi, o anche quella della UE in generale, con la realtà storica e geografica, con la geopolitica appunto, che vede Europa-Russia-Siberia come un unico blocco, una inscindibile unità geografica. Infatti essa ha prodotto per secoli e secoli una storia comune fatta sia di conflitti che di scambi, di reciproci imprestiti culturali, artistici, religiosi, economici, politici.
Russia vichinga, bizantina, tartara
Da un punto di vista etnico, la tendenza degli studi storici e geografici presso la scuola geopolitica russa contemporanea è quella di rivalutare la componente "orientale", in particolare l'influsso delle popolazioni nomadi dell'Asia centrale sulla formazione della Russia moscovita; influenza che avrebbe determinato una specificità "eurasiatica" dal Principato di Moscoviti all'Impero zarista, dalla Russia sovietica (in particolare nell'epoca staliniana) fino all'attuale Federazione Russa, che attraverso la C.S.I. (Comunità degli Stati Indipendenti) dovrebbe far recuperare a Mosca il ruolo egemone sui territori islamici dell'Asia Centrale: quelli, per inciso, che oggi sono sottoposti alla pressione statunitense, dopo l'invasione dell'Afghanistan e dell'Iraq. In questo contesto, la qualità "eurasiatica" non si riferirebbe tanto ad una realtà geopolitica unitaria da Reykjavik a Vladivostok, bensì ad una diversità tutta russa, rispetto sia alla parte occidentale sia all'Asia "gialla" vera e propria.
Gli autori citati da Dugin, Trubeckoj, Savickij, Florovskij e soprattutto Lev Gumilev (del quale è stato tradotto in italiano il fondamentale studio Gli Unni. Un impero di nomadi antagonista dell'antica Cina, Einaudi, Torino 1972) hanno rivalutato il ruolo, misconosciuto dai filoccidentalisti, della componente asiatica della Russia. L'influenza mongolo-tatara, il regno dell'Orda d'Oro che nel XIII secolo investì i territori russi e l'Europa orientale, arrivando fino a Cattaro sull'Adriatico, viene considerata determinante nella formazione della presunta specificità dell'"anima russa" e della corrispondente autocrazia politica e sociale. Quella che in passato rappresentava per gli studiosi occidentali e per i Russi occidentalizzati una macchia, un marchio per la Russia, è tradotto oggi dai neo-eurasiatisti in un dato positivo: si tratta di un fattore che segna la differenza nei confronti di un Occidente corrotto e corruttore, sicché le steppe d'Asia e la componente di sangue tataro vengono a recuperare le radici di un radicamento "altro", senza per questo confondersi con i popoli asiatici. In tal modo viene affermata una specificità eurasiatica differenziata, rispetto ai popoli d'occidente e a quelli d'oriente. Tutt'al più, la Russia è un ponte di passaggio, il "regno mediano" tra le due ali della massa eurasiatica genericamente intesa. Non europei, non asiatici, ma russi, cioè eurasiatici! In quanto tali, i Russi sono interessati ad una "sfera geopolitica" (potremmo definirla senza giri di parole con il termine geopolitico di spazio vitale?)che recuperi a Mosca le terre già sovietiche del centro dell'Asia, ed associ nuovi partner regionali fino al Golfo Persico e all'Oceano Indiano: Turchia, Iran, India.
Questo revisionismo storico dei neo-eurasiatisti russi del secolo appena trascorso e del XXI ineunte è certamente giusto e positivo rispetto allo sbilanciamento della proiezione, tutta occidentalista, iniziata da Pietro il Grande (di cui la capitale baltica, da lui voluta tre secoli or sono per proiettare il paese verso ovest e sui mari, è il simbolo più evidente) e proseguita con Caterina la Grande giù giù fino ai Romanov.
Ma, come sempre avviene, un' estremizzazione rischia di rovesciarsi nell'estremizzazione di segno contrario.
Aparte la devastante incursione del 1237 su Rjazan, Mosca e Vladimir, è al 1240 che si fa risalire il dominio del Canato dell'Orda d'Oro sulla Russia, cioè le conquiste occidentali di Batu, nipote di Temujin-Gengis Khan (1162-1227) e fondatore di questo regno gengiskhanide. Nello stesso anno tuttavia il principe Aleksandr, Duca di Novgorod e Granduca di Vladimir, combatteva contro gli Svedesi al fiume Neva (da cui il soprannome onorifico di Nevskij)e due anni dopo sconfiggeva l'Ordine Teutonico al lago Peipus (lo scontro reso celeberrimo anche dal film di Ejzenštein); poi faceva atto formale di sottomissione all'Orda. Così fece Mosca, che creò la propria fortuna quale tributaria dei Tartari presso le altre città russe.
Ma il dominio mongolo fu molto blando. Karakorum, capitale e baricentro dell'espansione, lontanissima. Un piccolo numero di baskaki (sorveglianti) furono insediati nelle città principali; ma solo la nobiltà e non il popolo ebbe un rapporto diretto, di vassallaggio, con i nuovi dominatori delle steppe, con l'istituzione dello jarlyk, cioè l'autorizzazione a governare. Già alla fine del XIII secolo il confine dell'Orda correva sotto la linea Viatka-Ni•nj Novgorod - Principato di Rjazan, mentre il Grande Principato di Mosca espandeva i suoi confini e iniziava la lunga marcia verso l'unificazione dei Russi. Con il Principato di Novgorod, di Tver, di Pskov, di Rjazan, Mosca era solo tributaria dell'Orda d'Oro. Nel 1480, con un semplice schieramento di eserciti sul fiume Ugra, senza quasi combattere, si poteva considerare finita la dominazione mongola sulla Moscovia e la Russia centro-settentrionale. Due secoli e mezzo.
A confronto di questi eventi nella formazione della Russia e dei Russi ci sono da ricordare i quattro secoli precedenti: in particolare influenza esercitata dalla popolazione vichinga dei Variaghi, pacificamente fusi con gli Slavi autoctoni, che li avevano chiamati a governarli. L'origine della Rus' è narrata in varie Cronache, la più nota delle quali è la Cronaca degli anni passati (1110-1120 circa, probabilmente ripresa da un manoscritto originale di sessanta anni prima). Dell'860 è l'attacco di Askold e Dir, sovrani di Kijev, a Costantinopoli. Poi vennero le imprese semi-leggendarie di Rjurik, dalla penisola scandinava a Novgorod, fondatore di una dinastia che regnerà fino al 1598. E poi Igor, "guerriero vichingo vagabondo e pagano, sebbene portasse un nome interamente slavo" (Robin Milney-Gulland e Nikolai Dejevsky, Atlante della Russia e dell'Unione Sovietica, Istituto Geografico De Agostani, Novara, 1991). E figlio Vladimir si convertirà al cristianesimo nel 988 d.C., trascinando la Russia alla fede ortodossa dipendente da Costantinopoli, ma soprattutto introducendola da allora in poi nel consesso della cultura e degli stati europei. Una conversione che a quei tempi comportava anche una nuova cultura, libri, architettura religiosa e civile e, in particolare, un nuovo assetto politico, modellato su quello del l'Impero Romano d' Oriente, del quale un giorno Mosca si proclamerà erede come "Terza Roma", ergendosi quindi a depositaria delle glorie di Roma antica e di Costantinopoli: cioè occidente e oriente dell'Europa. È evidente da tutto ciò, dalla storia, dalla geografia, dalla fede e dalla cultura, quale sia stato il peso dell'Europa (quella della Tradizione e non quella moderna dei Lumi),su tutta la Russia. Fu certo un peso preponderante, anche sotto l'aspetto etnico e culturale, rispetto a quello, pur importante, del successivo khanato mongolo; combattendo contro il quale, i Russi svilupparono nei secoli posteriori una coscienza nazionale. Dugin stesso è, nella sua figura, l'esempio nobile delle ascendenze nordico-vichinghe della Rus'.
Sarebbe dunque veramente assurdo contrapporre l'etnia slava (con la sua componente tatara) all'Europa germanica ed a quella latina, magari identificando l'Europa latino-germanica con l'occidente "atlantico" e con la mentalità razionalista, positivista e materialista propria degli ultimi secoli e resasi egemone particolarmente in America.
Le varie "famiglie" linguistiche europee hanno un'unica origine, un solo ceppo, radici comuni nell'Eurasia e nel Nord. E fanno parte a pieno titolo dell'Europa anche popoli come quelli ugrofinnici (Ungheresi, Finlandesi, Estoni), arrivati nella penisola continentale in epoche successive, da quel crocevia di popoli che fu il centro dell'Asia. E che dire dei Baschi o dei Sardi, popoli di origini controverse? Contrapporre le genti dell'est e dell'ovest dell'Europa, lo ripetiamo, sembra la riproposizione, fatta al contrario, di quella propaganda razziale che vedeva negli Slavi "razze inferiori" da sottomettere e utilizzare come manodopera servile. Fu una posizione ideologica che determinò in buona parte l'esito disastroso della Seconda Guerra Mondiale per chi si fece portatore non dell'indipendenza e unità dell'Eurasia, bensì di una visione razziale che comportava l'antagonismo tra gli Europei; una posizione condannata peraltro proprio dalla scuola geopolitica germanica di Haushofer, il quale vedeva giustamente nelle potenze talassocratiche anglofone il vero nemico comune di Tedeschi, Russi, Giapponesi: di tutta l'Eurasia, ad occidente come ad oriente.
Nord-Sud, Est-Ovest
I termini che Dugin pone in contrapposizione, oriente ed occidente, necessitano di un'ulteriore precisazione. Occidente non è una caratterizzazione geografica, più di quanto non lo sia oriente. L'occidente dell'America è l'Asia, la quale, a sua volta, ha nel continente americano il proprio oriente.
In realtà oggi "Occidente" e "Oriente" (ma, soprattutto dopo la fine del sistema dei blocchi contrapposti, "il Nord e il Sud del mondo") sono designazioni economiche, politiche, sociali di quelle potenze che rappresentano la parte industrialmente, finanziariamente e tecnologicamente avanzata del globo. E "G8", gli otto "grandi", è il club esclusivo che li raccoglie. Il Giappone è "Occidente" allo stesso titolo di USA e UE. La Cina si avvia a divenirlo, come la Russia che già lo è.
Allora, se ancora di Occidente ed Oriente si può e si deve parlare, la linea di demarcazione deve essere posta trai due emisferi, tra le due masse continentali separate dai grandi oceani: l'Occidente per antonomasia, la terra dell'occaso, del tramonto, la Terra Verde della morte è l'America, il Mondo "Nuovo" della fine del ciclo.
L'Oriente, o meglio il Mondo Antico, il mondo della Tradizione, sarà allora l'Europa, l'Asia, l'Africa; l'Eurasia in particolare, cioè l'intera Europa con la Russia e la Siberia, sarà la terra dell'alba radiosa di un nuovo cielo, ma anche la terra dell'origine dei popoli indoeuropei, la terra degli avi iperborei. Uno spazio vitale strategico peri destini mondiali, da riscoprire ritornando all'origine polare delle stirpi arie che, millenni e millenni or sono, la catastrofe climatica disperse dalla sede originaria del nord, verso est, sud, ovest, come semenze di quelle grandi civiltà che hanno fatto la storia e modellato la geografia del mondo antico. In questo contesto e solo in esso allora le collocazioni geografiche si armonizzano perfettamente con quelle della geografia sacra, della morfologia della storia, della tradizione ciclica, ma anche con la lotta di liberazione dell'intero continente dalla morsa mortale in cui lo costringe il blocco marittimo della talassocrazia imperialista USA.
Un mondo multipolare
Certo non ci nasconderemo che Europa, Russia, Asia hanno anche notevoli differenze tra loro. Lo ribadiamo: le civiltà d'Eurasia, pur traendo linfa vitale dall'unica matrice d'origine, hanno sviluppato nei secoli caratteristiche specifiche proprie: lingue, culture, legislazioni, arti e mestieri, fedi religiose, costumi e stili di vita, modelli di governo differenziati. È una ricchezza nella differenza, nella diversità, che rappresenta ora, alla fine dei tempi, il patrimonio forse più importante della nostra Eurasia, minacciata mortalmente dal monoculturalismo americano, da quell'American way of life che i selvaggi senza radici (le recisero approdando nel "Nuovo Mondo", nella "Seconda Israele") hanno imposto a tutti i popoli vinti e sottomessi o (quando fosse impossibile piegarli) sterminati. Il genocidio dopo l'etnocidio. Il più grande sterminio di massa dell'umanità: i 15 milioni di nativi amerindi trucidati dai "colonizzatori" yankee. Tutto questo come necessaria premessa per l'edificazione del loro Nuovo Ordine Mondiale, del Governo Unico Planetario, con sede ovviamente a Washington-Boston-New York, in attesa di esser portato a Sion!
"Gli eurasiatisti difendono logicamente il principio della multipolarità, opponendosi al mondialismo unipolare imposto dagli atlantisti. Come poli di questo nuovo mondo, non vi saranno più gli Stati tradizionali, ma un gran numero di nuove formazioni culturalmente integrate ('grandi aree'), unite in 'archi geoeconomici' ('zone geo-economiche')". Parole sacrosante di Dugin nel III capitolo del saggio intitolato La visione eurasiatista. Principi di base della piattaforma dottrinale eurasiatista.
Da discutere semmai, in termini geografici e storici, quindi geopolitici, sono proprio gli spazi privilegiati di queste grandi aree integrate. Geopoliticamente parlando, è indubbio che per Eurasia si debba intendere in primo luogo l'integrazione della grande pianura eurasiatica settentrionale dal canale della Manica allo stretto di Bering. Attorno a questo spazio vitale imperiale europeo, si affiancano in strati orizzontali successivi le altre realtà geopolitiche d'Asia e Africa, quelle sopra descritte, nel senso dei paralleli. L'Eurasia Unita sarà la garante della libertà, dell' indipendenza, dell' identità di queste altre realtà, di questi spazi vitali affiancati, contro l'egemonismo talassocratico delle stelle e strisce.
America o Americhe?
Ancor più. Bisognerà garantire che nei secoli futuri l'imperialismo mondialista dei fondamentalisti biblici della "Seconda Israele" non rialzi la testa e riprenda forza. Una forza che fin dall'inizio trasse energie, risorse, ricchezza dallo sfruttamento di tutto il resto del continente americano a sud del Rio Grande. L’America Latina, centrale-caraibica e meridionale, ha una propria storia, una propria cultura, un proprio spazio geopolitico e geoeconomico, che può svilupparsi liberamente e fruttuosamente solo se svincolato dal gigante a nord. Al contrario, oggi il pericolo più grande è che il NAFTA possa conglobare, oltre al Messico, tutto il Centro America e l'altra metà del continente.
Già nei tempi precolombiani le culture autoctone si erano completamente differenziate, pur traendo tutte origine dalle migrazioni siberiane, avvenute attraverso lo stretto di Bering tra i 40.000 e i 10.000 anni fa. Ma mentre nelle vaste pianure del Nord America i cacciatori nomadi seguivano i branchi di bisonti, divisi in tribù, con uno stile di vita e riti non molto dissimili da quelli dei cacciatori siberiani cultori dello sciamanesimo, nell'America Centrale e Meridionale fiorivano raffinate civiltà di coltivatori-allevatori, imponenti insediamenti urbani, religioni che riuscirono ad elaborare straordinari calendari con l'accurata osservazione astronomica, pittura, architettura, scultura, scienza, medicina che non temevano di rivaleggiare con le più avanzate civiltà d'Eurasia. Con la scoperta dell'America da parte di Colombo e con le successive invasioni europee (inglesi, francesi, olandesi a nord, ispano-lusitani al centro e al sud), le differenze si sono accentuate. Infatti, nonostante stragi, distruzioni culturali, malattie, schiavismo, imposizione della nuova religione, nella parte latina delle Americhe le popolazioni autoctone sono sopravvissute allo sterminio; nei nuovi stati, prima coloniali e poi nazionali, si sono venute a trovare in una posizione subordinata, a volte integrandosi e mischiandosi agli Europei. Dal Chiapas al Perù, dal Centro America alla Bolivia, passando per il Venezuela di Chavez, gli eredi degli antichi imperi meso-americani e andini oggi tornano alla ribalta, riprendono in mano le redini del proprio destino e, spesso, sono i più strenui difensori della diversità culturale latino-indio-americana contro l' influenza dei gringos nordisti e l'invadenza distruttiva delle loro multinazionali.
Vediamo dunque distintamente come l'America, diversamente dall'Eurasia e dall'Africa settentrionale, sia un "continente verticale". Da Nord a Sud, dallo stretto di Bering alla Terra del Fuoco, oltre diecimila anni or sono scesero le popolazioni siberiane: gli "indiani", i nativi americani poi sopraffatti e sterminati dall'invasione marittima da occidente. A loro volta gli Stati Uniti estenderanno la conquista ed egemonia da nord a sud: in Messico, nei Carabi e nell'America Centrale (il "cortile di casa" degli yankee), giù fino all'America meridionale, alla punta del Cile e all'Argentina. Dove peraltro, a smentire la Dottrina Monroe dell"'America agli Americani", l'Union Jack sventola ancora sulle Isole Malvinas argentine, anche grazie all'appoggio USA ai cugini inglesi. E dopo la conquista delle Americhe, seguendole indicazioni geopolitiche di Mahan gli Stati Uniti si lanciarono sul Pacifico e verso le coste dell'Asia. (Alfred Thayer Mahan, L'influenza del potere marittimo sulla storia. 1660-1783, Ufficio Storico della Marina Militare, Roma, 1994).
Dunque due "sensi", due direzioni opposte per le masse continentali dei due emisferi, rappresentanti ciascuno una diversa visione del mondo, ed assunti oggi a simboli dell'eterno scontro fra la Terra e il Mare, fra tellurocrazia e talassocrazia, ma anche tra mondo della tradizione e mondo moderno, tra identità dei popoli della terra e globalizzazione mondialista.
Ambigua quindi, quando non falsa e fuorviante, la distinzione tra Oriente ed Occidente. A questa caratterizzazione delle forze in campo tra Est e Ovest, possiamo aggiungere anche la suddivisione del pianeta in sfere d'influenza "verticali", praticamente da Polo a Polo: vi fa riferimento lo stesso Dugin sia nell' articolo sul primo numero di "Eurasia" (L'idea eurasiatista), sia in altri scritti più o meno recenti, come quelli raccolti e pubblicati in Italia dalle edizioni Nuove Idee, nel volume dal titolo Eurasia. La rivoluzione conservatrice in Russia.
Geopolitica "orizzontale" e geopolitica "verticale"
E qui veniamo ad affrontare il nodo centrale di queste chiose ai recenti articoli di Dugin, i quali potrebbero apparire come uno spostamento di prospettiva rispetto alle posizioni espresse dallo stesso autore dieci e più anni or sono, cioè al tempo del traumatico crollo dell'impero rosso, di cui Dugin (geopolitico moscovita di formazione tradizionale e traduttore di Evola) aveva ben compreso con largo anticipo l'irreversibile crisi.
Nell'articolo su "Eurasia" Dugin considera un ventaglio di possibilità per la realizzazione dell' "idea eurasiatista" dal punto di vista di Mosca, in particolare prospettando "l'Eurasia [dei] tre grandi spazi vitali, integrati secondo la latitudine": "tre cinture eurasiatiche" che si distendono in verticale sui continenti seguendone le meridiane. Ovviamente il nostro autore aveva premesso un "vettore orizzontale dell'integrazione, seguito da una direttrice verticale"; ma indubbiamente la seconda prospettiva sembra quella prevalente nel pensiero attuale di Dugin e, probabilmente, in quello degli strateghi dell'era Putin. Proprio nella pagina seguente si afferma a chiare lettere che "La struttura del mondo basata su zone meridiane è accettata dai maggiori geopolitici americani che mirano alla creazione del Nuovo Ordine Mondiale e alla globalizzazione unipolare" (!) L'unico "punto d'inciampo" sarebbe semmai rappresentato proprio dall'esistenza o meno di uno spazio geopolitico verticale, "meridiano", della Russia in Asia centrale, con la diramazione di tre assi principali: Mosca-Teheran, Mosca-Delhi, Mosca-Ankara. In quanto all'altro emisfero, l'egemonia USA, seguendo in questo caso la naturale disposizione geografica del continente (o due continenti, nord e sudamericano?) sarebbe assicurata dal Canada a Capo Horn. Proprio come recita la famigerata Dottrina Monroe: "l'America agli Americani", sottintendendo ovviamente ai nord-americani, i WASP statunitensi con il contorno di immigrati e neri integrati. L'attuale Amministrazione Bush è un tipico spaccato di questo assunto. Con l'aggiunta, semmai, che agli Americani del nord spetta sì tutta l' America, ma anche... il resto del mondo.
I loro geopolitici, passati e presenti, conoscono bene infatti la lezione mackinderiana sull'HeartIand, sul suo controllo per il dominio dell' intera Eurasia e quindi dell’"Isola del Mondo" e quindi delle "fasce marginali" (vedi lezione Afghanistan). In sintesi da Alfred T. Mahan a Spykman, passando per Mackinder, fino ai contemporanei Brzezinski, Huntington e ai vari neo-cons della lobby ebraico-sionista militante in Usa: i Perle, i Pipes, i Wolfowitz, i Cheney, i Kagan, i Kaplan, i Kristol, ma anche Ledeen e il e il vecchio Kissinger, pur con qualche differenza, e tanti altri. Consigliamo in proposito la lettura de I nuovi rivoluzionari. Il pensiero dei neoconservatori americani, a cura di Jim Lobe e Adele Oliveri (Feltrinelli, Milano, 2003).
Anche la suddivisione per sfere d'influenza verticale non è certo nuova, né tanto meno inventata da Dugin. Risale pari pari al grande padre della geopolitica tedesca ed europea, Karl Haushofer ed alle sue panidee: la Pan-America con guida USA, l'Eurafrica centrata sul III Reich con l'aggiunta del Vicino Oriente, la Pan-Russia estesa fino allo sbocco all'Oceano Indiano attraverso Iran e India, ma priva dello sbocco siberiano al Pacifico settentrionale, assegnato dal geopolitico monacense alla sfera di Coprosperità Asiatica ovviamente a guida nipponica.
La suddivisione duginiana segue lo stesso schema, ma con le modifiche dovute alla situazione politica internazionale attuale: la Pan-Eurasia a guida russa comprende tutti i territori ex-sovietici, il Vicino Oriente, l'Iran, il Pakistan, l'India, ma anche la Siberia fino a Vladivostok. La zona asiatica vera e propria si incentra oggi su Pechino. L'area americana comprende anche Islanda e isole britanniche (ma non la Groenlandia!) ecc...
Tanto per cominciare la suddivisione di Karl Haushofer è completamente superata, essendo propria ad un preciso periodo storico, cioè quello della Seconda Guerra Mondiale e del colonialismo europeo in Africa. Anche perché, in termini di geopolitica propriamente detta, l'Africa non è un' unità geopolitica unica, ma comprende almeno tre distinte unità. Il Nord-Africa, col Magreb, fa parte della più vasta unità geopolitica del Mediterraneo, di cui rappresenta la sponda sud. Poi c'è la vastissima fascia desertica del Sahara-Sahel, che rappresentala vera divisione, il "mare di sabbia" navigato soltanto dalle carovane di mercanti che importavano sale, spezie, schiavi. Infine, a sud, I'"Africa Nera", a sua volta composta di varie sottodivisioni. Come il cosiddetto "Corno d' Africa", una realtà sia geopolitica che etnica a sé stante.
Anche l'Asia odierna ha ben poco a che vedere con quella che Haushofer conosceva e tanto ammirava: specialmente il Giappone, o per dir meglio l'Impero Nipponico, oggi ridotto al rango di vassallo americano e base delle truppe, delle navi, dei missili USA puntati contro le coste orientali dell'Eurasia. L'Iran della Rivoluzione Islamica dell'Imam Khomeini ha rimescolato le carte di tutto il Vicino Oriente, dove, dal 1948, si èinstallato lo stato sionista di Israele, fidato baluardo invalicabile dell' imperialismo americano; piazzato proprio nel baricentro della massa eurasiatico-africana, a ridosso delle sue vie marittime interne, esso taglia a metà l'Umma islamica e la "Mezzaluna Fertile" del sistema potamico irriguo (Delta del Nilo - Giordano/Mar Morto - Tigri Eufrate).
Chi pensa che possa un domani esistere un "sionismo filo-eurasiatista" non ha evidentemente molto chiara la storia, la geografia e la stessa visione religioso-messianica che ha permesso all'entità sionista di installarsi proprio in quelle terre geostrategicamente così decisive per il controllo dell'intera massa eurasiatica e africana. Gli ebrei russi della diaspora tornati in Israele non sono russi: sono ebrei e israeliani a tutti gli effetti, e la Russia è il loro nemico storico, forse ancor più della Germania oramai domata.
È singolare poi, che parlando di Asia e di "sfere d'influenza e/o cooperazione" si tenda spesso a sminuire se non addirittura ignorare il ruolo decisivo della Cina. La storia da secoli e la geografia da sempre hanno delimitato lo spazio vitale del colosso asiatico (come anche è il caso dell' India). Russia e Cina sono destinate ad una stretta collaborazione che si basi sulla non ingerenza nelle rispettive sfere di appartenenza e nel riconoscimento di quella altrui.
È nell'interesse dell'imperialismo egemone statunitense metterei due colossi d'Asia l'uno contro l'altro; suo massimo danno è vederli alleati. Interesse della Russia è appoggiare la Cina nelle sue naturali rivendicazioni territoriali, a cominciare da Taiwan; ciò aprirebbe a Pechino lo sbocco al l'Oceano Pacifico, in aperta competizione con la talassocrazia USA in uno spazio marittimo che Washington considera un "lago americano", essendo propria di ogni potenza di questo tipo la spinta ad occupare entrambe le coste marittime su cui si affaccia.
Eurasia unita e lotta di liberazione
Alle pan-idee "verticali" haushoferiane, che interpretate alla luce dell'assetto internazionale attuale, assumono oggi vago sapore neocolonialista (l'esatto contrario delle posizioni anticoloniali del padre della geopolitica tedesca), noi sostituiamo la visione di una collaborazione paritaria e integrata fra realtà geopolitiche omogenee disposte a fasce orizzontali in Eurasia ed Africa.
Tale politica non esclude, ma semmai la allarga, la prospettiva dughiniana delle aree integrate verticali; essa infatti favorisce la creazione di una potenza "terrestre", quella nata dal l'unione di Europa e Federazione Russa, che allargherebbe al mondo la sua politica estera di collaborazione. Ciò permetterebbe a tutto il "Terzo Mondo" di sottrarsi al ricatto economico e finanziario nordamericano, riconoscendo nella grande potenza del Nord-Eurasia lo stato guida della lotta di liberazione mondiale antimondalista, la potenza veramente capace di contrastare l'egemonismo USA su tutte le aree geopolitiche della massa eurasiatica, delle "Afriche" e delle "Americhe".
A conclusione di queste brevi chiose all'intervento di Dugin, il cui contributo alla dottrina geopolitica e alla lotta di liberazione eurasiatica resta fondamentale, vogliamo riallacciarcialle stesse conclusioni del suo saggio L'idea eurasiatista.
La nuova Weltanschauung
L'eurasiatismo è una Weltanschauung (ecco il vero Dugin, formatosi alla cultura mitteleuropea!), una visione del mondo onnicomprensiva che, avendo come priorità la società tradizionale, "riconosce l'imperativo della modernizzazione tecnica e sociale". Il postmodernismo eurasiatico "promuove un'alleanza di tradizione e modernità come impulso energetico, costruttivo, ottimistico verso la creatività e la crescita". Come filosofia "aperta", l'eurasiatismo non potrà esser dogmatico e certo sarà differenziato nelle varie versioni nazionali: "Tuttavia, la struttura principale della filosofia rimarrà invariata". I valori della tradizione, il differenzialismo e pluralismo contro il monoculturalismo ideologizzante del liberal-capitalismo; la difesa delle culture, dei diritti delle nazioni e dei popoli, contro l'oro e l'egemonia neocoloniale del ricco Nord del mondo. "Equità sociale e solidarietà umana contro lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo". Verrebbe quasi da dire: il sangue (e il suolo) contro l'oro"!
Certo, la Terra contro il Mare: la terra degli avi contro il mare indifferenziato eppur sempre mutevole, percorso da moderni pirati, eredi di quei "corsari", che erano dotati dalla corona inglese di "lettere di corsa" per depredare ed uccidere in nome e a maggior gloria di Sua Maestà Britannica. Pirati odierni in giacca e cravatta, che con un tratto di penna fanno la fortuna o la disgrazia di popoli e continenti. E per chi non si piega alla logica del "libero mercato" imposta dalla moderna pirateria finanziaria internazionale, restano sempre gli "interventi umanitari", le "missioni di... pace (eterna), i "missili intelligenti". Come in Serbia, come in Afghanistan, come in Iraq, come ieri in Corea o in Vietnam, a Cuba, in America Latina, in Africa e ancor prima in Europa, in Giappone, ovunque. Forse domani in Iran, in Siria, in Sudan, di nuovo in Corea. Forse anche in Russia e in Cina.
Intanto le "rivoluzioni di velluto" sono arrivate a Kiev e a Tiblisi, circondando la Russia, insidiando la Cina, sottomettendo il Vicino Oriente, dove il progetto del "Grande Israele" è quasi cosa fatta. La Terza Guerra Mondiale (la quarta dopo quella "fredda", anch'essa vinta dagli Stati Uniti) è già cominciata, è in atto. Se dobbiamo porre una data ufficiale, scegliamo senza dubbio l'11 settembre 2001, il giorno in cui l'Amministrazione Bush ha ottenuto (sapremo mai come?) la sua Pearl Harbour, il suo 7 dicembre '41, cioè la giustificazione per un'aggressione mondiale preordinata nei mesi ed anni precedenti, specie approfittando del crollo dell'URSS di dieci anni prima. Proprio con l'Afghanistan come primo obiettivo.
La Russia è stata ingannata e condotta a collaborare con il suo nemico mortale sulla comune piattaforma della "lotta al terrorismo islamico"; è stata inchiodata alla guerra cecena, con il suo strascico di errori ed orrori da entrambe le parti, mentre la superpotenza USA si assicurava posizioni strategiche decisive nel cuore d'Eurasia.
Tsunami America
La talassocrazia americana opera come un devastante tsunami!
L'onda della potenza marittima nordamericana invade la terra in profondità e distrugge tutto quel che trova sul suo cammino: uomini, società, economie, culture, identità, storia, coscienza geopolitica, fedi, civiltà.
Dove passa, è morte, fame, distruzione, miseria, lacrime e sangue. È il Diluvio Universale del terzo millennio dell'Era Volgare.
Ma l'Eurasia è grande, troppo estesa e popolata anche per questo Leviatano moderno. E l'Eurasia propriamente detta, col suo retroterra logistico siberiano, l'Heartland di mackinderiana memoria è ancora abbastanza vasta e potenzialmente ricca in materie e uomini per resistere e respingere l'attacco del Rimland occupato dall'invasione marittima.
La volontà e la via
Cosa manca allora a tutt'oggi ?
La volontà, solo la volontà, nient'altro che la volontà. La volontà che è potere, che è fare, è quindi agire nello spazio vitale geopolitico assegnato dalla natura e dalla storia. La volontà di élites dirigenti rivoluzionarie d'Eurasia che, puntandolo sguardo ben oltre i ristretti limiti del veteronazionalismo sciovinista, sappia raccogliere la bandiera delle lotte di liberazione identitaria dei suoi popoli. Ma una simile volontà, scaturita da una fede indiscussa nei valori tradizionali, deve alimentarsi di una retta conoscenza dei fatti, della storia e della geografia, della geopolitica e delle sue leggi.
L'eurasiatismo sarà allora la bandiera, la spada e il libro di questa lotta titanica e veramente decisiva per i destini del pianeta nei prossimi secoli. Eurasiatismo come liberazione e unificazione statuale, imperiale, dell'unità geopolitica euro-siberiana, da Reykjavik a Vladivostok. Eurasiatismo come sistema di alleanze e sfere di cooperazione con tutti gli altri "spazi geopoliticamente omogenei" dell'Asia, dell'Africa, dell'America Latina. Quindi eurasiatismo come sacra alleanza di tutti gli sfruttati, di tutti i "diseredati della terra", come li definiva l'Imam Khomeini, contro tutti gli sfruttatori e i depredatori mondialisti delle multinazionali. Contro i corruttori dei popoli, contro gli apolidi del capitale, gli "eletti"... da nessuno che preparano l'avvento del Nemico dell'Uomo, la catastrofe dell'Armageddon, che pure li travolgerà. Eurasiatismo infine come contrapposizione, lotta senza quartiere tra civiltà e civilizzazione, tradizione e mondo moderno, terra e mare, imperium e imperialismo, comunitarismo e liberal-capitalismo.
Se un giorno la Russia (attraverso le sue élites politiche, militari, culturali, economiche e spirituali) saprà riconoscere il proprio ruolo guida, tradizionale e rivoluzionario, in questo "scontro dei continenti", lo dovrà essenzialmente ad una piena comprensione della geopolitica, dell'eurasiatismo, della Weltanschauung che esso rappresenta. E lo dovrà in massima parte a Dugin e a tutti quei geopolitica d'Eurasia che seppero indicare la via sulla quale indirizzare la volontà.
00:10 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, europe, affaires européennes, russie, eurasie, eurasisme, stratégie, géostratégie, histoire, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Otto Koellreutter (1883-1972)
KOELLREUTTER, Otto 1883-1972
Ce professeur de droit public nait à Fribourg en Brisgau le 26 novembre 1883. Etudiant en droit, il rédige une thèse sur la figure du juge anglais puis poursuit ses investigations après la première guerre mondiale, où il est appelé sous les drapeaux, en se spécialisant dans le droit administratif anglais. Enseignant à Halle et à Iéna, il formule un antiparlementarisme couplé à la recherche d'une forme d'«Etat populaire» (Volksstaat) reposant sur des principes radicalement autres que ceux du positivisme juridique. Il reçoit à cette époque l'influence des idées d'Oswald Spengler. De 1927 à 1944, il est le co-éditeur de la célèbre revue Archiv des öffentlichen Rechts. Militant national-socialiste depuis les élections du 14 septembre 1930, il espère que le nouveau régime transposera dans le réel ses théories de l'«Etat populaire». D'essence bourgeoise et d'inspiration anglo-saxonne, les idées de Koellreutter peuvent être qualifiées de conservatrices. En fait, elles relèvent d'un conservatisme particulier qui croit percevoir une alternative viable au libéralisme dans le mouvement hitlérien. De 1933 à 1942, Koellreutter édite la revue Verwaltungsarchiv (= Archives d'administration). Au fil du temps, ses espoirs sont déçus: le régime déconstruit l'Etat de droit sans rien construire de solide à la place. Il visite le Japon, en étudie le droit, et se transforme, à partir de 1938/39 en adversaire du régime dont il s'était fait le propagandiste zélé entre 1930 et 1936, en écrivant à son intention une longue série de brochures didactiques et précises. Ces nombreux écrits recèlent tous de pertinentes polémiques à l'encontre des thèses de Carl Schmitt, notamment de celle qui fait de la distinction ami/ennemi le fondement du politique. En 1942, la rupture est consommée: dans un article de la revue Verwaltungsarchiv, il compare le droit et la figure du juge tels qu'ils sont perçus en Allemagne et en Angleterre, démontrant que ce dernier pays respecte davantage les principes du vieux droit germanique. Koellreutter quitte l'université en 1952, rédige pendant sa longue retraite trois sommes sur le droit constitutionnel et administratif. Il meurt le 23 février 1972 dans sa ville natale.
Peuple et Etat dans la vision-du-monde du national-socialisme (Volk und Staat in der Weltanschauung des Nationalsozialismus), 1935
Brochure didactique destinée à dévoiler aux juristes allemands les nouveaux principes qui allaient dorénavant gouverner l'Allemagne. Elle est intéressante car elle résume toute la polémique entre l'auteur et Carl Schmitt. Koellreutter commence par expliquer en quoi sa position n'est nullement «objective», au sens conventionnel du terme. L'objectivité, telle que la conçoivent les libéraux, est a-politique; elle ne recèle aucune énergie politique. Les concepts politiques doivent être en rapport avec le réel et avec une substance politique concrète, en l'occurrence le peuple. L'idée d'Etat chez Carl Schmitt est purement constructive; les ressortissants de l'Etat ont le devoir moral de le construire mais Carl Schmitt ne précise pas quelle doit être l'essence de cet Etat que postule l'éthique. La distinction fondamentale opérée par Carl Schmitt entre l'ami et l'ennemi conduit à percevoir le travail politique comme un conflit perpétuel, où l'homme se transforme en «carnassier». Schmitt inverserait ainsi Rousseau, en transformant son idyllisme pastoraliste en idyllisme du carnassier. En ce sens, seule la guerre est politique, ce que conteste Koellreutter qui, comme Clausewitz, ne voit en elle qu'un moyen. Chez Schmitt, cette apologie implicite de la guerre participe du propre même des idéologies niant la primauté du Volk. Elle exprime bien l'essence du Machtstaat libéral ou de l'impérialisme. La pensée völkische du national-socialisme, elle, part du principe de la communauté, de la définition de l'ami, du camarade. Elle insiste sur ce qui unit les hommes et non sur ce qui les sépare. Dans une telle optique, la guerre n'a rien d'essentiel et la paix entre les nations est une valeur cardinale.
Dans Staat, Bewegung und Volk, le petit livre où Carl Schmitt tente de parfaire son aggiornamento national-socialiste, l'Etat est l'instance statique et conservante, porté par le fonctionnariat et l'armée; le mouvement est l'instance dynamique, qui recueille, trie et affecte les énergies émanant du peuple; quant à ce dernier, s'il n'adhère pas au mouvement, il n'est qu'une masse inerte a-politique. Pour Koellreutter, cette définition du peuple comme masse inerte a-politique relève d'une «doctrine du pouvoir étrangère aux lois du sang», dérivée de Hegel et de la pensée politique latine sans ancrage ethnique précis. Elle est fasciste, dans le sens où Guido Bartolotto, dans Die Revolution der jungen Völker , a défini l'idéologie italienne née sous l'impulsion de Mussolini: le national-socialisme repose sur la substance ethnique; le fascisme sur la culture, la tradition et l'éthique, toutes instances sans incarnation —au sens littéral du mot— précise. Toute pensée germanique, à la différence des pensées politiques romanes, s'ancre dans une substance populaire, ce qui interdit de penser le peuple comme une masse amorphe a-politique. Ce sont au contraire l'Etat et le mouvement qui puisent leurs énergies dans le peuple. Pour Koellreutter, l'Etat n'a pas de valeur en soi; il n'est qu'un moyen parmi d'autres moyens pour faire rayonner les énergies émanant du peuple. Cette idée de rayonnement génère la paix dans le monde, car le régime qui œuvre au rayonnement du peuple dont il est l'émanation politique respecte ipso facto les institutions qui permettent le rayonnement d'un peuple voisin.
Le droit constitutionnel allemand. Une vue d'ensemble (Deutsches Verfassungsrecht. Ein Grundriß), 1936
Ouvrage abordant l'ensemble des questions fondamentales de la politologie, Deutsches Verfassungsrecht commence par définir le politique comme l'expression d'une attitude spirituelle et d'un type humain particulier. Cette attitude et ce type humain varient selon les époques: c'est le bourgeois à l'heure où le libéralisme entre en scène; c'est le soldat politique après que les valeurs du libéralisme se soient écroulées dans les tranchées du front. D'emblée, Koellreutter formule sa critique majeure à l'endroit des thèses de Carl Schmitt. Celui-ci a déduit sa notion du politique à partir de la distinction ami-ennemi. La faiblesse de cette définition réside en ceci: l'ami n'est plus que le non-ennemi. D'où, estime Koellreutter, Schmitt évacue la dimension communautaire et pose un type d'homme politique purement formel qui risque, ambiance darwinienne aidant, par se transformer en «carnassier politique». C'est ce qui explique pourquoi Carl Schmitt affirme que seule la guerre relève du politique à l'état pur. Koellreutter refuse cette affirmation schmittienne car elle implique que l'essence de la politique extérieure ne réside que dans le conflit entre les peuples. Pour Carl Schmitt, seule la politique extérieure est essentiellement politique. Il y a chez Schmitt, constate et conteste Koellreutter, un primat de la politique extérieure.
A rebours de Schmitt, la conception völkische, ethniste et populiste, voit l'essence du politique dans l'orientation communautaire. Cette conception désigne plutôt l'ami, le Volksgenosse, le camarade. Elle est issue de la camaraderie des tranchées. Elle est l'expression typique du soldat politique qui participe et se donne à une communauté. Pour les nationaux-socialistes, il n'y a pas de primat de la politique extérieure; il n'y a en fait aucun primat qui soit. A l'intérieur, le national-socialisme veut forger la «communauté populaire» (la Volksgemeinschaft), c'est-à-dire une communauté de soldats politiques, qui englobe toute la réalité politique. A l'extérieur, Koellreutter veut qu'il y ait reconnaissance mutuelle entre les peuples et non conflit ou inimitié. L'accent n'est donc pas mis sur l'ennemi mais sur la solidarité. Le national-socialisme, du moins de la façon dont le conçoit Koellreutter, doit reconnaître la valeur des ethnicités étrangères. La guerre n'est pas un idéal social mais un moyen extrême pour conserver la plus haute valeur d'une communauté populaire: son honneur.
Avant l'avènement du national-socialisme, deux courants d'idées dominaient en Occident et dans le monde: le libéralisme anglais et la démocratie formelle française. Ces deux courants étaient déterminants pour l'ensemble des systèmes politiques. En Allemagne, pourtant, l'un et l'autre étaient incompatibles avec les racines du droit allemand. Koellreutter procède à une définition du libéralisme politique. Il correspond à la nature du peuple anglais et à la géographie insulaire. L'insularité met à l'abri d'attaques venues de l'étranger, ce qui donne un sentiment de liberté. Mais le libéralisme radical, comme par exemple celui que veut promouvoir un Hans Kelsen, dès qu'il est exporté en Allemagne, provoque la dissolution et la dégénérescence car il ne peut s'appliquer à un peuple qui est perpétuellement sur la défensive, le long de frontières ouvertes, menacées par plusieurs puissances ennemies. L'Allemagne a besoin de cohésion et de solidarité, vertus diamétralement opposées à la liberté au sens anglo-saxon.
La définition que nous donne Koellreutter de la démocratie formelle repose sur l'idée du contrat social de Rousseau, où l'on repère une exigence d'égalité formelle, laquelle doit, pour pouvoir s'appliquer, limiter la liberté personnelle. Les individus soumis à la démocratie formelle sont pensés dans l'abstrait et sont par principe porteurs de droits politiques égaux. Dans un tel contexte, c'est la majorité arithmétique qui règne, domine et, en certaines circonstances, écrase ses adversaires. Cette majorité arithmétique veut absolument faire l'identité entre dominants et dominés, les homogénéiser. C'est cette majorité circonstancielle qui détermine le contenu de la liberté et de l'égalité. De cet état de choses découle un relativisme que Koellreutter juge pernicieux car à chaque élection, ce contenu est susceptible de changer. Il n'y a plus de valeurs politiques absolues et permanentes, ancrées dans les tréfonds de l'âme populaire. Les seules valeurs qui subsistent sont celles, aléatoires, que crée l'individu au gré des circonstances. Ce qui interdit toute symbiose entre les individus et l'Etat, lequel déchoit en simple appareil, en «veilleur de nuit». Dans une démocratie formelle, les portes sont ouvertes au libéralisme, surtout dans le domaine de l'économie.
Le marxisme est fruit du libéralisme car sa position de base ne retient aucune forme d'ethnicité. Quant à l'Etat-appareil de la démocratie formelle, il se mue, après une révolution de type marxiste, en un Etat de classe. En effet, la seule réalité politique pour le marxisme, c'est la lutte des classes. Peuple et Etat ne relèvent que de la superstructure idéologique, ne sont finalement que du «vent». Pour les marxistes comme pour Carl Schmitt, c'est l'antagonisme qui prime. Les thèses des uns comme de l'autre ne retiennent aucun volet constructif impliquant qu'il faille forger la Volksgemeinschaft. Cette lacune explique pourquoi la démocratie libérale ne peut dépasser le marxisme. L'ère de Weimar a prouvé que la seule possibilité pour sauver le libéralisme et la démocratie formelle, c'est de s'allier aux marxistes. Mais ce compromis est fragile: le marxisme étant conséquent à l'extrême, comme l'a démontré le bolchévisme russe, il élimine en bout de course la démocratie bourgeoise. Ou bien, autre possibilité, il veut raviver les liens qui unissent l'individu à son peuple et à l'Etat comme en Italie et se mue alors en fascisme ou, dans le cas allemand, en national-socialisme.
Au vu de ces évolutions, Koellreutter conclut que seule la révolution nationale-socialiste est une vraie révolution car elle transforme de fond en comble les assises de l'Etat et crée le Führerstaat. Le peuple n'est plus alors une somme arithmétique de citoyens mais une unité vivante. La notion de race, l'accent mis sur le sol et la patrie charnelle, l'insistance sur le principe de totalité (Ganzheit) assurent la continuité du processus politique, reflet de la vie du peuple à travers les siècles. L'Etat n'a pas de valeur en soi. Il sert à donner forme, mais reste extérieur à la substance. Si la substance finit par se retrouver à l'étroit dans la forme étatique qui l'enserre, elle s'en débarrasse par une révolution et en crée une nouvelle. Pour Otto Koellreutter, l'idée d'Etat, comme «réalité de l'idée éthique» (Hegel), est un instrument précieux mais il faut se garder de l'idolâtrer.
Le droit que préconise Koellreutter est d'inspiration «communautaire». Ce droit, expression des idées innées du peuple, doit refléter ce qui apparaît juste pour la protection, la promotion et le développement du peuple. Le droit et l'Etat doivent être des fonctions multiplicatrices des forces vitales du peuple. Un tel Etat est de droit puisqu'il évacue les barrières qui s'opposent à ou freinent l'épanouissement des potentialités du peuple. Le droit qu'il défend et ancre dans la réalité est davantage légitimité que légalité, contrairement au libéralisme.
L'objet de toute constitution est de faire l'unité du peuple. La conception libérale de la constitution veut que l'Etat libéral soit un Etat constitutionnel capable de réaliser les idées de liberté et d'égalité. Elle laisse une large place aux droits fondamentaux de l'individu dans la pensée constitutionnaliste. Ensuite, le libéralisme veut écrire le droit donc le figer. Un droit écrit est très difficile à modifier car le juriste doit alors inventer des techniques juridiques excessivement complexes qui ralentissent les processus de transformation nécessaires de la société. A ce droit constitutionnel individualiste/libertaire et égalitaire, techniquement complexe, doit se substituer une pensée constitutionnaliste nationale-socialiste, écrit Koellreutter, inspirée du modèle anglais qui se passe de constitution, car, à l'époque de Cromwell (celle du Führerstaat anglais dans sa forme la plus pure), l'Angleterre ne connaissait pas les exagérations de l'individualisme. La constitution anglaise est en fait implicite et non écrite. Elle croît organiquement. Ont valeur de constitution des lois comme le Bill of Rights de 1689 qui assure les libertés individuelles ou le Parliament Act de 1911 qui diminue considérablement le rôle de la Chambre des Lords dans l'élaboration des lois. Ce mode de fonctionnement organique est d'essence germanique, conclut Koellreutter. Aussi, en Allemagne, il importe d'introduire une constitution vivante qui puisse répondre immédiatement aux impératifs de l'heure. Le national-socialisme a déjà procédé de la sorte, constate Koellreutter, en citant la loi de prise du pouvoir du 24 mars 1933 —la fameuse Ermächtigungsgesetz— la loi du plébiscite du 14 juillet 1933, la loi sur l'unité du parti et de l'Etat du 1er décembre 1933, les lois raciales de Nuremberg sur la «protection du sang et de l'honneur allemands» (15 septembre 1935). De telles lois peuvent être modifiées sans grandes complications d'ordre technique. L'objet ne doit donc pas être de construire un système écrit de normes mais de façonner politiquement et juridiquement le corps du peuple par une direction (Führung) liée à ce même peuple.
La science juridique libérale est positiviste, ce qui la fait basculer dans la technicité et la dogmatique juridiques. Le droit étatique déchoit en annexe du droit privé et lui est subordonné (cf. Paul Laband et Otto Mayer). Otto von Gierke a été pionnier, estime Koellreutter, en explorant le droit communautaire et le Genossenschaftsrecht allemands (le droit des compagnonnages). De cette exploration, il est permis de conclure que la veine communautaire constitue l'essentiel du droit allemand. Il s'avère donc nécessaire de hisser ces principes communautaires aux niveaux du peuple, de l'Etat et du droit. Ce sens inné du droit a rendu impopulaire la démocratie formelle et le positivisme juridique de Weimar, d'autant plus que la «camaraderie des tranchées» avait évacué les réflexes individualistes bourgeois. Koellreutter constate dès lors un rejet du constructivisme juridique pur, de la théorie pure du droit et de l'Etat (Hans Kelsen). Droit et Etat ne sont plus que des constructions abstraites. D'où le but des nouvelles sciences juridiques est désormais de forger un droit porté par les chefs naturels qui se sont imposés par leurs qualités personnelles dans les tranchées.
Le modèle du futur droit allemand est anglais. Car le droit anglais rejette les dogmes et les spéculations tout en allant droit au vécu. Il suscite une pensée juridique qui fusionne droit et politique. Le contenu, la substance politique, prime la forme juridique. Aux formes figées du droit, il faut donner un sens politique, sans pour autant les abolir. Il suffit de reprendre ce qui est utile. S'il y avait harmonie totale au sein de la communauté populaire, il n'y aurait pas besoin de droit ni d'Etat. Mais, tonne Koellreutter, il y a les indisciplinés et les «tire-au-flanc» (Drückeberger). Donc croire à une harmonie totale relève d'une pensée anti-politique (impolitique). L'esprit communautaire naît par l'action de fortes personnalités.
En présentant à ses lecteurs la pensée juridique völkische, Koellreutter formule une seconde critique à l'encontre de Carl Schmitt. Notamment contre sa distinction entre les Ordnungsdenken (les pensées de l'ordre) normatif, décisionniste et concret. La pensée juridique völkische refuse les distinctions trop discriminantes et, par conséquent, trop abstraites. Elle entend s'orienter par rapport à la réalité politique. Elle refuse la spéculation pour privilégier la mise en forme. La concrétude se manifeste toujours par le sens particulier, typé, de la concrétude que génère un peuple donné. Norme et décision jouent un rôle important car la norme met le sens de la concrétude en forme et la décision tranche dans le sens de l'épanouissement de la communauté populaire.
Koellreutter aborde également les fondements historiques du droit constitutionnel allemand depuis l'époque médiévale jusqu'au XIXième siècle, en abordant successivement l'essence du Reich, des pouvoirs territoriaux allemands (Prusse et Autriche), de la Confédération Germanique, le défi de l'unification économique graduelle, l'évolution du droit constitutionnel prussien (l'impact de la pensée du Baron von Stein), l'évolution du droit constitutionnel des Etats de l'Allemagne méridionale, la signification de l'Assemblée nationale de Francfort en 1848 (première représentation d'un mouvement populaire, issu des corporations étudiantes —les célèbres Burschenschaften— et des combattants de la guerre de libération de 1813). Cette histoire révèle une opposition constante entre la légitimité et la légalité. Opposition patente dans le cas du Parlement de Francfort qui sous-estimait le poids des constitutions prussienne et autrichienne, impossibles à évacuer sans combat donc sans guerre civile. Les juristes allemands ont tenté de combler le hiatus entre la légalité et la légitimité dans la nouvelle constitution du Reich de 1849 en introduisant un système bicaméral et en pensant juridiquement la Confédération nord-allemande (Norddeutscher Bund). Le Reich de Bismarck, porté par l'armée populaire victorieuse en 1871, était un Etat fédéral (Bundesstaat), où les Etats allemands gardaient leur souveraineté et le Bundesrat (le Conseil fédéral) regroupait les souverains de ces Etats membres de la confédération. Le Bundesrat était présidé par le roi de Prusse qui acquérait ainsi la dignité d'Empereur. Koellreutter explique que ce fédéralisme était perçu comme provisoire, ce que prouve également la querelle entre l'école du Bavarois von Seydel, pour qui les Etats du Reich demeurent pleinement souverains, et l'école de Laband, pour qui ces Etats ont transféré définitivement leur souveraineté à l'instance englobante qu'est le Reich. Koellreutter estime que le Bundesstaat bismarckien ne tenait que grâce à la personnalité charismatique du Chancelier de Fer. Ce dernier, pourtant, par manque de temps, n'a pas réussi à éduquer une caste de dirigeants nouveaux; son départ a provoqué le cafouillage du wilhelminisme, puis les querelles de prestige sur la scène internationale qui ont abouti aux carnages de 1914.
Koellreutter procède ensuite à une analyse de la constitution de Weimar. La République d'après 1918 est également un faux Etat fédéral. Son principal défaut est de n'avoir qu'une seule Volkskammer (Chambre du Peuple) et de refuser toute forme de Sénat comme contraire au principe d'égalité. Ensuite le système de Weimar laisse la bride sur le cou des partis. L'Etat partitocratique ne fonctionne que s'il y a unité de vue entre tous les partis sur les choses essentielles du politique. En Allemagne, cette unanimité était inexistante. Les partis se sont affrontés sans vouloir faire le moindre compromis parce qu'ils représentaient des Weltanschauungen trop différentes, sur les plans de l'économie, de la religion et de la culture. Les querelles ont provoqué la multiplication des partis donc l'ingouvernabilité du pays. Le système de Weimar est un liberaler Machtstaat qui ne défend que les intérêts d'une bourgeoisie numériquement infime, donc dépourvue d'assises tangibles dans la population. En fait, cette république et une dictature camouflée, explique Koellreutter, avec son Président comme «gardien de la Constitution». Elle maintient telle quelle une Constitution qui ne répond plus aux besoins de survie de la nation.
Koellreutter définit ensuite les notions de peuple (Volk) et de nation. La notion de Volk que propose Koellreutter s'oppose diamétralement à celle que suggère Carl Schmitt. Pour Koellreutter, le Volk n'est pas la masse non politisée de la nation: une telle définition serait le propre du libéralisme musclé ou du fascisme. Le Volk, bien au contraire, est source du droit et du pouvoir. Koellreutter insiste alors sur la spécificité raciale/biologique et entend dépasser la définition spenglérienne du Volk comme communauté d'histoire et de destin. Il reconnaît cependant que le peuple allemand est le résultat d'un mixage complexe qui doit être préservé comme telle en tant qu'Artgleicheit (égalité/homogénéité de l'espèce, de la race). Cette volonté de préservation s'exprime dans les lois de protection de la race et des terroirs.
Quant au concept de nation, c'est un concept français révolutionnaire ou italo-fasciste. Pour les idéologies françaises et italiennes, la nation est le produit d'un pouvoir; elle est créée par l'Etat. Koellreutter rejette ces définitions: pour lui, et pour la conception völkische qu'il entend défendre et illustrer, Volk et nation ne sont pas des notions essentiellement différentes. La nation est pour lui la volonté d'une communauté populaire de se positionner sur la scène internationale.
L'auteur aborde ensuite les fondements de la Führung. Le caractère populaire (völkisch) de la Führung permet de distinguer la «totalité de l'idée völkische» de l'«Etat total» d'inspiration mussolinienne ou latine. La différence est nette pour Koellreutter; il s'agit de deux totalités très différentes. L'idée völkische est une totalité naturelle; l'idée d'Etat total exprime la revendication de l'appareil du pouvoir dans son ensemble pour conserver sa position non völkische. L'autorité, pour Koellreutter et la tradition völkische, doit s'enraciner dans une éthique communautaire qui unit le peuple et la Führung et s'exprime dans une forme politique, un Etat. Les vrais chefs fusionnent en eux, dans leur personnalité, le Volksgeist et le Volkswille (la volonté populaire). Derrière de tels figures charismatiques, il convient de rassembler une Gefolgschaft (une suite), unissant de plus en plus de citoyens. L'histoire a révélé plusieurs types de chefs politiques. La Führung de l'Etat princier absolu (absoluter Fürstenstaat) est l'aristocratie. L'Etat libéral-démocratique porte au pouvoir les politiciens bourgeois. En Angleterre, l'aristocratie est une aristocratie «ouverte», incorporant des bourgeois méritants pour former la caste dirigeante baptisée society. L'Etat national-socialiste trouve ses racines dans l'esprit des combattants de la Grande Guerre et des militants politiques de la «longue marche» de la NSDAP vers le pouvoir.
La Führung politique nationale-socialiste se donne trois instruments de gouvernement: 1) le Parti (ou le Mouvement), instrument politique direct de la Führung; 2) le fonctionnariat professionnel, recruté dans toutes les strates du peuple est l'instrument traditionnel au service de toute Führung; 3) l'armée, la Wehrmacht, instrument militaire. Ces trois instruments s'enracinent dans l'ensemble du peuple. Les citoyens qui les servent doivent être éduqués dans l'esprit de l'Etat nouveau. Le parti dirige toutes les forces du peuple contre l'ancien appareil. Dès qu'il arrive au pouvoir, sa mission change. Il commande alors l'Etat et éduque le peuple. Koellreutter refuse la séparation des pouvoirs, car le législatif et l'exécutif sont deux modalités de la Führung qui doit rester unitaire. Pour assurer une représentation et donner forme à la pluralité du peuple, la Führung organise corporativement la nation.
L'ouvrage se termine par une théorie de l'organisation économique, religieuse et culturelle du nouvel Etat, accompagnée de projets d'organisation corporative. A la liberté d'opinion libérale doit succéder une régulation de la vie culturelle. Le nouvel Etat doit garantir la liberté de la recherche scientifique.
(Robert Steuckers).
- Bibliographie: Richter und Master, 1908 (dissertation); Verwaltung und Verwaltungsrechtsprechung im modernen England, 1920; Die Staatslehre Oswald Spenglers, 1924; Die politischen Parteien im modernen Staate, 1926; Staat, Kirche und Schule im heutigen Deutschland, 1926; Der deutsche Staat als Bundesstaat und als Parteienstaat, 1927; Integrationslehre und Reichsreform, 1929; Der Sinn der Reichtagswahlen vom 14. Sept. 1930 und die Aufgabe der deutschen Staatslehre, 1930; Der nationale Rechtsstaat. Zum Wandel der deutschen Staatsidee, 1932; Volk und Staat in der Verfassungskrise, 1933; Grundriß der allgemeinen Staatslehre, 1933; Vom Sinn und Wesen der nationalen Revolution, 1933; Der deutsche Führerstaat, 1934; Volk und Staat in der Weltanschauung des Nationalsozialismus, 1935; Deutsches Verfassungsrecht. Ein Grundriß, 1935 (2ième éd., 1938); Grundfragen unserer Volks- und Staatsgestaltung, 1936; Deutsches Verfassungsrecht, 1936 (2ième éd., 1938); Der heutige Staatsaufbau Japans, 1941; «Recht und Richter in England und Deutschland», in Verwaltungsarchiv, 47, 1942; Deutsches Staatsrecht, 1953; Staatslehre im Umriß, 1955; Grundfragen des Verwaltungsrechts, 1955.
- Sur Otto Koellreutter: C.H. Ule, in Verwaltungsarchiv, 63, 1972; Jürgen Meinck, Weimarer Staatslehre und Nationalsozialismus. Eine Studie zum Problem der Kontinuität im staatsrechtlichen Denken in Deutschland 1928 bis 1936, Frankfurt a.M., Campus, 1978; Michael Stolleis, «Otto Keullreutter», in Neue Deutsche Biographie, 12. Band, Duncker und Humblot, 1980; Joseph W. Bendersky, Carl Schmitt. Theorist for the Reich, Princeton University Press, 1983.
00:05 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politologie, sciences politiques, théorie politique, révolution conservatrice, allemagne, années 20, années 30, national-socialisme, droit, constitution, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 17 octobre 2009
Ben Laden a travaillé pour les Etats-Unis jusqu'au 11 septembre 2001
Bombe médiatique :
Ben Laden a travaillé pour les États-Unis jusqu’au 11 Septembre 2001

Invitée par l’animateur de l’émission radio Mike Malloy radio show [1], l’ancienne traductrice pour le FBI, Sibel Edmonds, a lancé une véritable bombe médiatique (audio, transcription partielle).
Lors de son interview, Sibel raconte comment les États-Unis ont entretenu des « relations intimes » avec ben Laden et les talibans, « tout du long, jusqu’à ce jour du 11 septembre. » Dans « ces relations intimes », Ben Laden était utilisé pour des “opérations” en Asie Centrale, dont le Xinjiang en Chine. Ces “opérations” impliquaient l’utilisation d’al-Qaida et des talibans tout comme « on l’avait fait durant le conflit afghano-soviétique », c’est à dire combattre “les ennemis” par le biais d’intermédiaires.
Comme l’avait précédemment [2] décrit Sibel, et comme elle l’a confirmé dans son dernier interview, ce procédé impliquait l’utilisation de la Turquie (avec l’assistance d’acteurs provenant du Pakistan, de l’Afghanistan et de l’Arabie Saoudite) en tant qu’intermédiaire, qui à son tour utilisait ben Laden, les talibans et d’autres encore, comme armée terroriste par procuration.
Le contrôle de l’Asie Centrale
Parmi les objectifs des “hommes d’État” américains [3] qui dirigeaient ces activités, il y avait le contrôle des immenses fournitures d’énergie et de nouveaux marchés pour les produits militaires. Pourtant, les Américains avaient un problème. Ils ne devaient pas laisser leur empreinte afin d’éviter une révolte populaire en Asie centrale (Ouzbékistan, Azerbaïdjian, Kazakhstan et Turkménistan), et aussi de sérieuses répercussions du côté de la Chine et de la Russie. Ils trouvèrent une ingénieuse solution : utiliser leur État fantoche, la Turquie, comme mandataire et en appeler à la fois aux sensibilités panturques et panislamiques.
Dans la région, la Turquie, alliée de l’OTAN, a beaucoup plus de crédibilité que les États-Unis ; avec l’histoire de l’Empire ottoman, elle pourrait appeler au rêve d’une plus large sphère d’influence panturque. La majorité de la population d’Asie Centrale partage le même héritage, la même langue, la même religion que les Turcs.
À leur tour, les Turcs ont utilisé les talibans et al-Qaida, en appelant à leur rêve d’un califat panislamique (sans doute. Ou bien les Turcs/Américains ont très bien payé).
Selon Sibel : « Ceci a commencé il y a plus de dix ans, dans le cadre d’une longue opération illégale et à couvert, menée en Asie centrale par un petit groupe aux États-Unis. Ce groupe avait l’intention de promouvoir l’industrie pétrolière et le Complexe Militaro-Industriel en utilisant les employés turcs, les partenaires saoudiens et les alliés pakistanais, cet objectif étant poursuivi au nom de l’Islam. »
Les Ouïghours
On a récemment demandé à Sibel d’écrire sur la récente situation de Ouïghours au Xinjiang, mais elle a refusé, disant simplement : « Notre empreinte y est partout. »
Bien sûr, Sibel n’est pas la première ou la seule personne à reconnaitre tout cela. Eric Margolis [4], l’un des meilleurs reporters occidentaux concernant l’Asie Centrale, a affirmé que les Ouïghours, dans les camps d’entrainement en Afghanistan depuis 2001, « ont été entrainés par ben Laden pour aller combattre les communistes chinois au Xinjiang. La CIA en avait non seulement connaissance, mais apportait son soutien, car elle pensait les utiliser si la guerre éclatait avec la Chine. »
Margolis a également ajouté que : « L’Afghanistan n’était pas un creuset du terrorisme, il y avait des groupes commando, des groupes de guérilla, entrainés à des buts spécifiques en Asie Centrale. »
Dans une autre interview, Margolis [5] dit: « Ceci illustre le bon mot (en français dans le texte, NDT) de Henry Kissinger affirmant qu’il est plus dangereux d’être un allié de l’Amérique, que son ennemi, car ces musulmans chinois du Xinjiang (la province la plus à l’ouest) étaient payés par la CIA et armée par les États-Unis. La CIA allait les utiliser en cas de guerre contre la Chine, ou pour provoquer le chaos là-bas ; ils étaient entrainés et soutenus hors d’Afghanistan, certains avec la collaboration d’Oussama ben Laden. Les Americains étaient très impliqués dans toutes ces opérations. »
La galerie de voyous
L’an dernier, Sibel a eu la brillante idée de révéler des activités criminelles dont elle n’a pas le droit de parler : elle a publié dix-huit photographies – intitulées la “Galerie ‘Privilège Secrets d’État’ de Sibel Edmonds” – de personnes impliquées dans les opérations qu’elle avait tenté de révéler. L’une de ces personnes est Anwar Yusuf Turani [6], le prétendu “Président en Exil” du Turkistan Est (Xinjiang). Ce prétendu gouvernement en exil a été établi à Capitol Hill (le siège du Congrès US, NdT) en septembre 2004, provoquant des reproches acerbes de la part de la Chine.
“L’ancienne” taupe, Graham Fuller, qui avait joué un rôle dans l’établissement du “gouvernement en exil” de Turani du Turkestan Est, figure également parmi la galerie de voyous de Sibel. Fuller a beaucoup écrit sur le Xinjiang et son “Projet pour le Xinjiang” remis à la Rand Corporation était apparemment le plan pour le “gouvernement en exil” de Turani. Sibel a ouvertement affiché son mépris à l’égard de M. Fuller.
Susurluk
La Turquie a une longue histoire d’affaires d’État mêlant terrorisme, au trafic de drogue et autres activités criminelles, dont la plus parlante est l’incident de Susurluk en 1996 [7] qui a exposé ce qu’on nommait le “Deep State” (l’État Profond : l’élite militarobureaucratique, NDT)
Sibel affirme que « quelques acteurs essentiels ont également fini à Chicago où ils ont centralisé “certains” aspects de leurs opérations (surtout les Ouighurs du Turkestan Est). »
L’un des principaux acteurs du “Deep State”, Mehmet Eymur, ancien chef du contre-terrorisme pour les services secrets de la Turquie, le MIT, figure dans la collection de photos de Sibel. Eymur fut exilé aux USA. Un autre membre de la galerie de Sibel, Marc Grossman [8] était l’ambassadeur de la Turquie au moment où l’incident de Susurluk révélait l’existence de “Deep State”. Il fut rappelé peu après, avant la fin de son affectation tout comme son subordonné, le commandant Douglas Dickerson qui tenta plus tard de recruter Sibel dans le monde de l’espionnage.
Le modus operandi du gang de Suruluk est identique à celui des activités décrites par Sibel en Asie Centrale, la seule différence étant que cette activité eut lieu en Turquie il y a dix ans. De leur côté, les organes d’État aux États-Unis, dont la corporation des médias, avaient dissimulé cette histoire avec brio.
La Tchétchénie, l’Albanie et le Kosovo
L’Asie centrale n’est pas le seul endroit où les acteurs de la politique étrangère américaine et ben Laden ont partagé des intérêts similaires. Prenons la guerre en Tchétchénie. Comme je l’ai écrit ici [9], Richard Perle et Stephan Solarz (tous deux dans la galerie de Sibel) ont rejoint d’autres néo-conservateurs phares tels que : Elliott Abrams, Kenneth Adelman, Frank Gaffney, Michael Ledeen, James Woolsey, et Morton Abramowitz dans un groupe nommé Le Comité Américain pour la Paix en Tchétchénie (ACPC) [10]. Pour sa part, ben Laden a donné 25 millions de dollars pour la cause, fourni des combattants en nombre, apporté des compétences techniques, et établi de camps d’entraînement.
Les intérêts des États-Unis convergeaient [9] aussi avec ceux d’al-Qaida au Kosovo et en Albanie. Bien sûr, il n’est pas rare que surviennent des circonstances où “l’ennemi de mon ennemi est mon ami.” D’un autre côté, dans une démocratie transparente, on attend un compte-rendu complet des circonstances menant à un événement aussi tragique que le 11/9. C’était exactement ce que la Commission du 11/9 était censée produire.
Secrets d’État
Sibel a été surnommée “la femme la plus bâillonnée d’Amérique”, s’étant vue imposer par deux fois l’obligation au secret d’État. Son témoignage de 3 heures et demie devant la Commission du 11/9 a été totalement supprimé, réduit à une simple note de bas de page qui renvoie les lecteurs à son témoignage classé. (donc non accessible, NdT)
Dans l’interview, elle révèle que l’information, classée top secret dans son cas, indique spécifiquement que les USA se sont servis de ben Laden et des taliban en Asie Centrale, dont le Xinjiang. Sibel confirme que lorsque le gouvernement US la contraint juridiquement au silence, c’est dans le but de « protéger “des relations diplomatiques sensibles”, en l’occurrence la Turquie, Israël, le Pakistan, l’Arabie saoudite… » C’est sans doute en partie vrai, mais il est vrai aussi qu’ils se protègent eux-mêmes : aux États-Unis, c’est un crime que d’utiliser la classification (confidentielle, NdT) et le secret pour couvrir des crimes.
Comme le dit Sibel dans l’interview : « Je dispose d’informations concernant des choses sur lesquelles le gouvernement nous a menti… on peut très facilement prouver que ces choses sont des mensonges, sur la base des informations qu’ils ont classées me concernant, car nous avons entretenu de très proches relations avec ces gens ; cela concerne l’Asie Centrale, tout du long, jusqu’au 11 Septembre. »
Résumé
L’information explosive ici est évidemment qu’aux États-Unis, certaines personnes se sont servies de ben Laden jusqu’au 11 septembre 2001.
Il est important de comprendre pourquoi : depuis de nombreuses années, les États-Unis ont sous-traité leurs opérations terroristes à al-Qaïda et aux talibans, encourageant l’islamisation de l’Asie centrale en vue de tirer profit des ventes d’armes tout comme des concessions pétrolières et gazières.
Le silence du gouvernement US sur ces affaires est aussi assourdissant que les conséquences (les attentats du 11/9, NDT) furent stupéfiantes.
Source: ReOpen911 [11]
Article printed from AMI France: http://fr.altermedia.info
URL to article: http://fr.altermedia.info/general/bombe-mediatique-ben-laden-a-travaille-pour-les-etats-unis-jusqu%e2%80%99au-11-septembre_25424.html
URLs in this post:
[1] Mike Malloy radio show: http://www.mikemalloy.com/
[2] précédemment: http://lukery.blogspot.com/2008/07/court-documents-shed-light-on-cia.html
[3] “hommes d’État” américains: http://letsibeledmondsspeak.blogspot.com/2008/01/sibel-names-names-in-pictures.html
[4] Eric Margolis: http://www.ericmargolis.com/biography.aspx
[5] Margolis: http://lukery.blogspot.com/2009/07/us-trained-uighur-terrorists.html
[6] Anwar Yusuf Turani: http://www.eastturkistangovernmentinexile.us/anwar_biography.html
[7] Susurluk en 1996: http://en.wikipedia.org/wiki/Susurluk_scandal
[8] Marc Grossman: http://en.wikipedia.org/wiki/Marc_Grossman
[9] ici: http://lukery.blogspot.com/2008/07/sibel-edmonds-case-central-asia.html
[10] Comité Américain pour la Paix en Tchétchénie (ACPC): http://www.rightweb.irc-online.org/profile/American_Committee_for_Peace_in_Chechnya
[11] ReOpen911: http://www.reopen911.info/News/2009/08/13/une-bombe-ben-laden-a-travaille-pour-les-etats-unis-jusquau-11-septembre/
00:20 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : etats-unis, services secrets, ben laden, m, etats-unis, islam, monde arabe, fondamentalisme, extrémisme, islamisme, moyen orient, proche orient, arabie saoudite |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook




