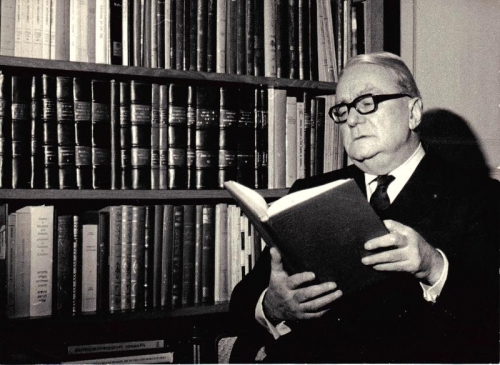mardi, 11 mars 2025
L'Éveil du Japon dans l'Ordre des Grandes Puissances

L'Éveil du Japon dans l'Ordre des Grandes Puissances
Avec le déclin des globalistes et la montée de la multipolarité, le Japon a désormais une chance rare de retrouver son indépendance.
Alexander Douguine
Quelle place pour le Japon dans l'ordre mondial des grandes puissances? Rappelons que Huntington a posé le Japon comme une civilisation bouddhiste distincte dans son célèbre texte de 1993. Cela n'avait pas de sens jusqu'à présent. Le Japon était totalement soumis au programme libéral et globaliste des gauches. Maintenant, que ce programme défaille, cela commence à prendre sens.
Trump signifie révolution. Pour le Japon (et les rapports Japon/Russie), cela oblige à tenir compte des faits suivants :
- Trump a déjà dit qu'il n'était pas heureux de l'aide militaire accordée au Japon.
- Trump est généralement en faveur de la tradition.
- Fini le thème habituellement récurrent de la russophobie.
Mettons maintenant ces trois points ensemble.
Quelles sont les inférences pour le Japon?
- Moins de dépendance vis-à-vis des globalistes libéraux américains.
- Invitation indirecte à restaurer le traditionalisme japonais.
- Porte ouverte pour le dialogue avec les traditionalistes russes.
L'OTAN est l'autre nom de l'État profond libéral globaliste et internationaliste. Dans un monde multipolaire, l'existence d'une telle structure n'a pas de sens. C'est juste une inertie obsolète issue de la guerre froide. L'ordre des grandes puissances exige une nouvelle stratégie de sécurité globale basée sur des pôles et des zones autour de ceux-ci, correctement et réalistement définis.
Il est maintenant temps de réfléchir à comment rendre sa grandeur au Japon. La Chine est grande. Le Japon, jusqu'à présent, était un appendice misérable du système globaliste. Un pays occupé avec zéro souveraineté. Seules des ombres de sa grandeurs passée subsistaient misérablement. Trump donne une chance de changer cela.

La philosophie est un piège pour la réalité. L'histoire oscille autour de l'axe de la "marche dogmatique des choses" (J. Parvulesco) - un pas d'un côté, un pas de l'autre. La philosophie attend le moment où la réalité approche de l'axe idéationnel et signale alors: voilà.
Le vieux libéralisme détestait le telos. La liberté l'interdit. Le libéralisme de gauche est un mélange entre libéralisme et communisme (surtout les linéaments qui sont qualifiables de "trotskystes"). Le cœur de la philosophie Tech Right (r/acc) est de dire: le libéralisme de gauche entrave le progrès technique en plaçant le telos (moralisant, woke) avant toutes autres choses.
La Tech Right veut annuler le libéralisme de gauche parce que le progrès technique exige une véritable liberté - une liberté grâce à l'absence de tout telos.
La fin de l'histoire hégélienne (dans une lecture de gauche, car il existe une autre lecture authentiquement hégélienne, qui est de droite et monarchiste) a été introduite dans le libéralisme de gauche de manière artificielle par d'anciens marxistes et trotskystes - A. Kojève, par exemple. La singularité n'est pas un telos. C'est une sorte de moment du libre marché.
Commentaire: Bonjour, M. Douguine. Dans ces temps changeants, surtout avec Trump critiquant l'accord concernant la protection que les États-Unis accordent au Japon comme "injuste", comment pensez-vous que le Japon devrait se positionner? Le Japon devrait-il se réarmer correctement? Quelle serait la position de la Russie sur cette question?
Ma réponse: Le Japon a maintenant une chance unique de s'éveiller et de commencer à restaurer sa souveraineté. La Russie n'est pas un ennemi inné et absolu de ce tournant. Cela pourrait s'inscrire dans une multipolarité totalement ignorée jusqu'à présent par un Japon trop docile et soumis (aux globalistes).

17:58 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre douguine, actualité, japon, asie, affaires asiatiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
L'Europe erre à l'aveuglette: pourquoi la brigade franco-allemande n'est pas une réponse

L'Europe erre à l'aveuglette: pourquoi la brigade franco-allemande n'est pas une réponse
Elena Fritz
Source: https://www.pi-news.net/2025/03/europa-im-blindflug-warum...
La Brigade franco-allemande (BFA) est érigée en levier d'une prétendue souveraineté - une approche qui fait l'impasse sur les réalités géopolitiques et qui colle aux illusions des élites européennes.
Le policy brief de la DGAP intitulé « Un leadership franco-allemand pour une Europe souveraine » (mars 2025) promet d'esquisser une orientation dans la crise de sécurité que traverse l'Europe, mais l'analyse demeure, in fine, un échafaudage fragile. La brigade franco-allemande (brigade FA) est érigée en levier d'une prétendue souveraineté - une approche qui fait l'impasse sur les réalités géopolitiques et qui colle aux illusions des élites européennes. Au lieu d'apporter des réponses, le rapport propose plutôt des rêves académiques.
La brigade FA : un symbole plutôt qu'une substance
La DGAP vante la Brigade, créée en 1989, comme un « test » pour le leadership franco-allemand. Mais le bilan après plus de trente ans est décevant. Des exercices comme « Kecker Spatz » (1987) avec 75.000 soldats en dehors des structures de l'OTAN ou le Conseil de sécurité et de défense (1988) ont été salués comme des déclenchements initiaux prometteurs - ce qui est resté, c'est l'immobilisme. Les interventions au Mali, en Bosnie ou en Afghanistan ont révélé le fossé : la France et l'Allemagne opèrent côte à côte, non pas ensemble. Au Mali (2014-2020), les Français ont combattu les terroristes, les Allemands se sont entraînés - avec une unité qui n'existait que sur le papier.
La brigade a peut-être un potentiel militaire - infanterie, artillerie, logistique - mais sans stratégie unifiée, elle reste un gros-œuvre coûteux. La DGAP propose des interventions sur le flanc est de l'OTAN, mais ne voit pas que les divergences entre Berlin et Paris paralysent tout concept. Le rapport s'accroche à un mythe d'intégration qui n'est jamais devenu réalité.

Le retour de Trump et la menace du retrait américain ravivent l'idée d'une « armée de l'UE » - la DGAP elle-même la qualifie de « totalement irréaliste ». Au lieu de cela, on promeut une « européanisation » de l'OTAN, avec la brigade comme pilier. La mise sous commandement de l'OTAN (janvier 2025) pour la Lituanie et la Roumanie est un pas, mais les oppositions stratégiques - l'Allemagne avec un rattachement à l'hégémon américain, la France avec des ambitions d'autonomie - persistent. L'Eurocorps, souvent salué comme une extension de la brigade, illustre le dilemme: 60.000 soldats en cas de guerre, mais pris entre des visions contradictoires. La souveraineté ne se construit pas ainsi.
Scepticisme à l'égard de la DGAP : une pensée trop étroite
La fixation sur l'axe franco-allemand semble naïve. Historiquement, des projets comme la Communauté européenne de défense (1952) ont échoué en raison d'intérêts nationaux - pourquoi en serait-il autrement aujourd'hui ? Le « dialogue stratégique » reste un vœu pieux tant que la volonté politique fait défaut. Considérer la brigade comme une « cellule germinale » ignore son histoire en tant que symbole sans substance. La rhétorique du flanc est contre la Russie semble en outre unilatérale - la véritable faiblesse de l'Europe réside dans son délitement, et pas seulement dans les menaces extérieures.
La DGAP reste silencieuse sur les alternatives. La dissolution de la brigade au profit de structures plus efficaces est mentionnée, mais pas approfondie. Au lieu de cela, le regard reste fixé sur un concept européen qui ne fait que remplacer la dépendance transatlantique par une coopération franco-allemande plus qu'aléatoire.

La chance de sortir de la servitude
Le cours suivi aujourd'hui par Trump offre toutefois une opportunité que la DGAP occulte: la possibilité de libérer l'Europe de la servitude transatlantique. Pendant des décennies, la dépendance vis-à-vis des garanties américaines a étranglé l'autonomie - une renégociation est désormais sur la table. Non pas une soumission aveugle, mais un partenariat d'égal à égal avec les Etats-Unis pourrait garantir la stabilité sans sacrifier la souveraineté. La Bundeswehr, qui n'est actuellement que l'ombre d'elle-même, devrait pour cela devenir une priorité - la force nationale comme base plutôt que des expériences diffuses.
Parallèlement, la Russie ne devrait pas être diabolisée. Le rapport considère implicitement Moscou comme une menace, mais une perspective sobre montre que la Russie est un voisin avec lequel une coexistence pragmatique est possible. La confrontation affaiblit l'Europe, la coopération - par exemple en matière d'énergie ou de sécurité - pourrait la stabiliser. L'hystérie du flanc est de l'OTAN a fait plus de mal que de bien.
Une communauté d'intérêts géopolitique plutôt qu'un isolement
Au lieu d'un cavalier seul franco-allemand, une autre stratégie s'offre à nous: une communauté d'intérêts géopolitique avec de grandes puissances. Les Etats-Unis restent une réalité militaire, la Russie un facteur eurasiatique - tous deux pourraient coopérer avec une Europe capable d'agir. La brigade pourrait jouer un rôle à cet égard, non pas en tant que projet de l'UE, mais dans des formats bilatéraux ou multilatéraux avec des objectifs clairs. Des modèles comme le corps germano-néerlandais prouvent que la coopération pragmatique fonctionne - sans le poids historique de l'axe franco-allemand.
Cette approche présuppose toutefois que l'Europe fasse ses devoirs: une défense nationale renforcée, des intérêts clairs, l'abandon des entraves idéologiques. La DGAP rêve d'une unité romantique - la réalité exige des calculs plus sobres.
Conclusion : il est temps d'y voir plus clair
Le rapport de la DGAP fournit des faits, mais ses conclusions relèvent du vœu pieux académique. La brigade franco-allemande n'est pas une clé de la souveraineté, mais un miroir des déchirements européens. La chance est ailleurs: dans la libération de la dépendance transatlantique, dans un voisinage pragmatique avec la Russie et dans une communauté d'intérêts qui présuppose la force nationale. Sans cela, l'Europe continuera à errer à l'aveuglette - et le temps presse.
17:32 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eurocorps, brigade franco-allemande, défense, europe, affaires européennes, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Merz vendra-t-il l'Allemagne à BlackRock ?

Merz vendra-t-il l'Allemagne à BlackRock ?
Le renard devient le patron du poulailler
Source: https://dissident.one/zal-merz-duitsland-verkopen-aan-bla...
Merz était l'homme de BlackRock en Allemagne jusqu'à il y a quelques années. S'il est élu chancelier, il accélérera la cannibalisation de l'économie allemande (et européenne) et la placera entre les mains du capital américain. « C'est laisser le renard gouverner le poulailler ».
À 69 ans, Friedrich Merz attend ce moment depuis des décennies. Depuis les élections de février dernier, il est le nouveau chancelier de l'Allemagne, son parti, la Christlich Demokratische Union (CDU), devait remporter 30% des suffrages. Il devra mettre sur pied une nouvelle coalition composée de divers partis, mais Merz n'y verra pas d'inconvénient. Le lundi matin qui suivit les élections, il avait réalisé l'une des plus remarquables remontées de l'histoire politique récente, écrit Thomas Fazi.
Merz a rejoint le parti quand il était étudiant il y a plusieurs dizaines d'années. Mais aujourd'hui, il fait campagne sur un programme intitulé « Make Germany Great Again » - une tentative calculée de gagner des voix sur l'Alternative für Deutschland (AfD) en déplaçant son parti vers la droite sur des questions telles que l'immigration. Son cynisme ne doit pas être sous-estimé: comme Donald Trump en Amérique, le millionnaire Merz est un roi de l'entreprise habillé en conservateur.
N'oublions pas que Merz représente depuis longtemps les intérêts de certaines des élites commerciales et financières les plus puissantes du monde, notamment en tant que représentant clé de BlackRock en Allemagne entre 2016 et 2020. Si Merz est élu, l'Allemagne deviendra le premier pays à être dirigé par un ancien représentant de BlackRock. Mais ses liens avec les institutions de l'élite remontent à bien plus loin: pendant plus de vingt ans, avant même de rejoindre BlackRock, il a incarné la porte tournante entre la politique, les affaires et la finance.

Après les élections fédérales de 2002, Angela Merkel, alors chef de file de la CDU, s'est vu confier la présidence du groupe parlementaire, tandis que Merz a été nommé son adjoint. Cependant, leur relation ont été loin d'être au beau fixe et Merz a démissionné deux ans plus tard, se retirant progressivement de la vie politique jusqu'à ce qu'il quitte le Parlement en 2009. Pourtant, avant même son départ, il avait de l'or entre les mains. En 2004, il est engagé en tant qu'avocat principal par le cabinet international de droit et de lobbying Mayer Brown, un poids lourd du secteur dont le chiffre d'affaires annuel se calcule en milliards.
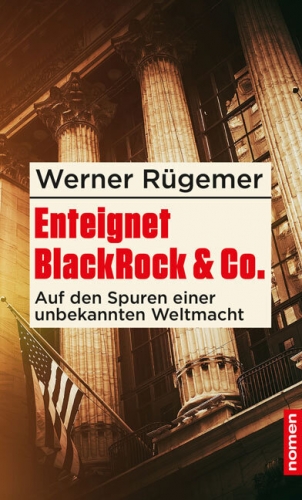
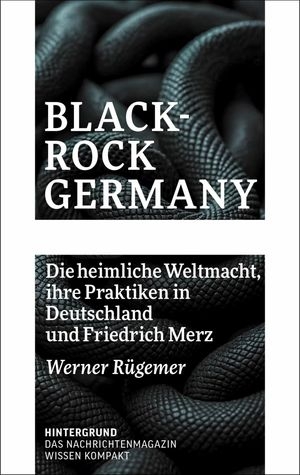
C'est là que Merz a découvert une relation beaucoup plus fructueuse. Comme l'explique Werner Rügemer, auteur de BlackRock Germany, Merz a contribué à faciliter des transactions chez Mayer Brown qui ont favorisé les intérêts des capitaux américains en Allemagne en encourageant les investisseurs américains à acheter des entreprises en République fédérale. Le résultat a été la vente et la restructuration de milliers d'entreprises allemandes, la suppression d'emplois et le gel des salaires - une approche ouvertement louée par Merz dans son livre Mehr Kapitalismus wagen (Oser plus de capitalisme).
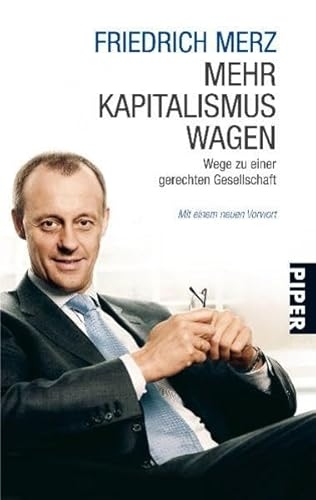
Il ne fait aucun doute que Merz voulait incarner la thèse de son livre, mais à l'époque, il siégeait également au conseil de surveillance et au conseil d'administration de plusieurs grandes entreprises. Et puis il a abouti chez BlackRock, peut-être l'une des entreprises les plus puissantes qui aient jamais existé et elle a frappé à sa porte. Comment Merz aurait-il pu refuser ? Produits pharmaceutiques, divertissement, médias et, bien sûr, industrie de guerre - il n'y a pratiquement aucun secteur sur lequel BlackRock n'essaiera pas de capitaliser.
L'intérêt qu'il avait à engager Merz n'est pas difficile à comprendre. Il a facilité les rencontres entre le PDG de BlackRock, Larry Fink, et les hommes politiques allemands, et a contribué à l'élaboration de politiques favorables à la société et à son énorme portefeuille d'investissements. Sous l'influence de Merz, par exemple, BlackRock est devenu l'un des principaux actionnaires non allemands de nombreuses grandes entreprises allemandes, de la Deutsche Bank à Volkswagen, en passant par BMW et Siemens. Cependant, son travail n'a pas seulement consisté à augmenter les profits des actionnaires; il a également consisté à façonner un environnement politique dans lequel les intérêts des entreprises étaient alignés sur la politique du gouvernement. Par une heureuse coïncidence, il a également créé un climat dans lequel quelqu'un comme Merz pouvait facilement faire la navette entre les grandes entreprises et le Bundestag.
« Le millionnaire Merz est un roi de l'entreprise habillé en conservateur », explique le président.

C'est ce qui s'est passé en 2021, lorsque Merz, armé d'un compte en banque bien rempli et de deux jets privés, est revenu sur la scène politique en tant que chef de file de la CDU. Sans surprise, sa philosophie politique est fermement ancrée dans le néolibéralisme. Il est un fervent défenseur de la privatisation et de la déréglementation. Ces mesures sont souvent accompagnées de promesses visant à réduire la bureaucratie et à attirer les investisseurs étrangers. Mais en réalité, ce langage corporatiste ambigu est destiné à souligner l'importance qu'il accorde à la recherche de solutions aux problèmes publics par le secteur privé.
Merz est un fervent partisan de la privatisation des systèmes de sécurité sociale, au profit d'entreprises telles que BlackRock, leader dans le domaine des régimes de retraite privés. Il est aussi traditionnellement un fervent opposant au salaire minimum et aux lois contre les licenciements abusifs. Sous son règne, les travailleurs allemands risquent de voir leurs salaires stagner, voire pire.
Mais il est difficile de croire que les Allemands ordinaires sont la préoccupation de Merz. Homme de Davos un jour, homme de Davos toujours - et sa longue histoire de représentant de puissantes industries, notamment les secteurs de la chimie, de la finance et de la métallurgie, suggère qu'il aura d'autres priorités. En tant que chancelier, Merz pourrait, par exemple, être appelé à réglementer des secteurs auxquels il est associé depuis longtemps - et que Mayer Brown, son ancien employeur, représente toujours.
Il faut également tenir compte du fait que, sous la direction de Merz, la CDU a reçu des millions d'euros en contributions de campagne de la part des intérêts commerciaux qu'il a représentés dans le passé - plus que tout autre parti. Ainsi, pour les lobbyistes allemands et internationaux, avoir Merz - un ancien collègue - comme chancelier serait un rêve devenu réalité. Ou, comme le dit Rügemer, « c'est faire du renard le patron du poulailler ».
Il ne s'agit pas seulement d'une question économique : les relations d'affaires de Merz déterminent également sa politique étrangère. Au fond, il est un atlantiste convaincu et un ardent défenseur du rôle de l'Amérique en tant que garant de l'ordre mondial. Cette position idéologique a conduit Merz à rejoindre les États-Unis sur des questions telles que le gazoduc Nord Stream 2, dont il a demandé l'annulation bien avant que la crise en Ukraine ne s'aggrave. Sa position agressive en matière de politique étrangère, notamment en ce qui concerne son soutien ferme à l'Ukraine, a encore illustré son alignement sur les anciennes priorités géopolitiques des États-Unis, même au détriment des intérêts fondamentaux de son propre pays. En effet, l'une des principales raisons de la contraction de l'économie allemande et de la poursuite de son industrialisation est sa décision de se dissocier du gaz russe sous la forte pression des États-Unis.
Bien entendu, Washington a désormais une politique très différente à l'égard de l'Ukraine. Merz sera-t-il alors contraint d'abandonner ses convictions atlantistes? Pas nécessairement. Bien que sa forte position anti-russe et ses tendances militaristes semblent en contradiction avec les tentatives de Trump de désamorcer le conflit, la réalité est que leurs visions sont plus en phase l'une avec l'autre qu'il n'y paraît de prime abord. Que demande finalement Trump à l'Europe? Une augmentation des dépenses de défense et un rôle majeur dans la prise en charge des responsabilités financières et stratégiques pour la sécurité de l'Ukraine après la guerre, ce qui pourrait même inclure le déploiement d'une « force de maintien de la paix » européenne.

Ces politiques s'inscrivent parfaitement dans la vision de Merz. Il plaide depuis longtemps en faveur d'une augmentation du budget de la défense de l'Allemagne, une position saluée par ses alliés du complexe militaro-industriel allemand. Aujourd'hui, il a même rejoint le chœur appelant l'Europe à « prendre sa sécurité en main ». Trump n'aurait pas pu rêver d'un meilleur choix. Cette convergence stratégique, associée aux tendances conservatrices de Merz, à ses liens étroits avec les secteurs financiers et commerciaux américains et à son atlantisme profondément enraciné, le placent en bonne position pour devenir le « vassal en chef » européen de l'Amérique dans notre ère post-libérale. L'Allemagne se retrouverait ainsi à la tête d'une Union européenne à la fois plus faible économiquement et plus puissante militairement, alors même qu'elle reste à la dérive sur le plan stratégique.
Cet arrangement s'accompagnera de nombreux discours sur l'« autonomie » allemande et européenne - et peut-être même de désaccords publics passionnés entre Berlin et Washington. En réalité, il s'agirait surtout d'une façade, car la nouvelle dynamique ne servirait que les élites européennes et américaines. Les premières continueront à alimenter la peur de la Russie pour justifier l'augmentation des dépenses de défense, détourner l'argent des programmes sociaux et légitimer la poursuite de leur approche musclée de la démocratie. Quant aux secondes, elles continueraient à bénéficier de la dépendance économique de l'Europe à l'égard des États-Unis. Pendant ce temps, des gens comme Merz seraient bien placés pour soutenir la poursuite de la cannibalisation de l'Europe par le capital américain.
Ce n'est pas que nous devions être surpris. Au cours des deux dernières décennies, Merz, comme Trump, a prouvé qu'il était d'abord un homme d'affaires et ensuite un politicien.
Mais contrairement à Trump, qui a au moins quelques références populistes, la victoire de Merz sera célébrée dans les salles de conseil d'administration de BlackRock et d'autres grandes entreprises, qui peuvent s'attendre à ce que leurs soldes bancaires augmentent régulièrement. Mais comme souvent, les électeurs ordinaires ne doivent pas s'attendre à ce que ce butin leur parvienne.
17:06 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : friedrich merz, allemagne, europe, affaires européennes, néolibéralisme, blackrock |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Comment les Européens font face à l'ère complexe

Comment les Européens font face à l'ère complexe
par Pierluigi Fagan
Source: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/29993-pier...
Les Américains se désengagent non seulement de l'Ukraine, mais plus généralement de l'Europe en termes de présence militaire directe et d'investissements. Ce désengagement s'inscrit dans leur stratégie de réduction des dépenses de l'Etat et rassure Moscou sur le fait que cette administration ne considère pas Moscou comme un ennemi stratégique. Ce retrait pourrait s'étendre, au-delà de l'Ukraine, aux pays européens annexés par l'OTAN depuis les années 1990.
Cela n'a rien à voir avec les retraits de l'OTAN qui ont fait couler beaucoup d'encre. L'OTAN est une alliance dans laquelle, selon Washington, chacun apporte sa contribution, mais ce n'est pas le cas de l'Europe. Washington vise stratégiquement le Pacifique; l'Europe doit donc créer une OTAN européenne et se débrouiller toute seule.
Moscou sera très heureux de traiter militairement avec l'Europe et non avec les États-Unis, à la fois parce que les Russes ne considèrent pas l'Europe comme un ennemi stratégique (la somme de l'arsenal atomique du Royaume-Uni et de la France représente 10% de celui de la Russie, mis à part le problème des transporteurs, soit les missiles et les avions, pour lesquels nous sommes un « ami très cher... », mais c'est un problème beaucoup plus complexe que l'inventaire des armes), et parce que la menace militaire européenne est et restera substantiellement dépourvue de réelle substance car, en théorie, elle sera « défensive », et certainement pas offensive.
Kiev aura donc son propre semblant de protection, même relative, un Kiev auquel les accords Trump-Poutine interdisent l'adhésion à l'OTAN, mais l'accordent à l'UE, en supposant que cette dernière soit disposée à assumer ce fardeau.

Puis d'aller justifier pourquoi continuer à l'armer, mais ne pas l'intégrer au marché commun et payer sa reconstruction. Sur le plan économique, Kiev cédera des sites miniers aux États-Unis, qui non seulement économiseront de l'argent, mais en gagneront aussi. Les investissements miniers et néo-technologiques américains (le vieux projet de Zelensky pour une nouvelle nation anarcho-capitaliste de start-up high-tech), seront « protégés » par les Européens, c'est un risque, mais un risque relatif.
Le levier utilisé par Washington à l'égard de l'Europe sera les tarifs douaniers, plus de dépenses militaires - moins de droits de douane, moins de dépenses militaires - plus de droits de douane. Avec une séduction fiscale supplémentaire en cas de délocalisation de leurs propres entreprises qui veulent continuer à vendre aux États-Unis. En outre, une grande partie des nouvelles dépenses militaires européennes bénéficiera directement à la vorace industrie militaire américaine sans avoir à lui livrer une guerre directe en tant que moteur de production et de profit (également parce que des réductions des dépenses militaires américaines directes et une reconfiguration des secteurs de pointe sont annoncées). Ce schéma sera également appliqué dans d'autres parties du monde des alliances et des protections américaines dans le monde (Japon, Corée, Taïwan, monde arabe, Asie, etc.). Pour Taïwan, le prix annoncé est le partage de la participation dans TSMC et la délocalisation de la production aux États-Unis. En ce sens, le monde sera momentanément plus « pacifique » alors qu'il a l'intention de s'armer. « Si vis pacem, para bellum », disait-on de Platon à Végèce, la paix s'obtient par la peur de la force de l'ennemi, disait Trump.
La nouvelle relation avec Moscou inclut la possibilité de reprendre les affaires directes dans l'extraction d'énergie fossile, même dans l'Arctique si ce n'est pas directement en Sibérie, du pain pour une bonne part des sponsors économico-politiques et pétro-carbonés de Trump, déjà obséquieux au tournant anti-écologique déguisé en anti-éveil pour le plaisir supplémentaire de vastes audiences d'imbéciles et de décérébrés.

L'Europe sait tout cela et c'est pourquoi elle continue et même amplifie la construction surréaliste que constitue le « grand danger russe », qui serait imminent et à sa porte. Quel électorat national européen pourrait accepter et partager ce virage militariste pour des économies, des budgets, des dettes publiques déjà sous pression, sans la construction du « grand ennemi qui est aux portes » ? Inversement, comment justifier, après trois ans d'illusions, un éventuel virage diplomatico-pacifique sans perdre complètement la face et toute crédibilité politique résiduelle pour ses élites ?
[En effet, malgré tous les efforts déployés depuis trois ans, une grande partie de l'Europe ne considère pas la Russie comme un adversaire stratégique, selon une étude menée par le Conseil européen des relations extérieures].
Cette bande de moutons bêlants du sous-continent est gouvernée par la vieille et perfide Grande-Bretagne. D'abord un article surréaliste de The Economist conseillant aux Européens de diminuer les dépenses sociales pour augmenter les dépenses militaires, puis hier le Financial Times est monté au créneau avec plus ou moins le même discours et même l'idée d'un fonds commun et d'une agence pour des dépenses communes, un commandement stratégique atomique commun, dans lequel Londres voit aussi un débouché pour « son » industrie militaire, ainsi que la possibilité plus large de recommencer à faire des affaires avec l'UE puisque le plan du Brexit n'a pas fonctionné stratégiquement comme on l'imaginait.
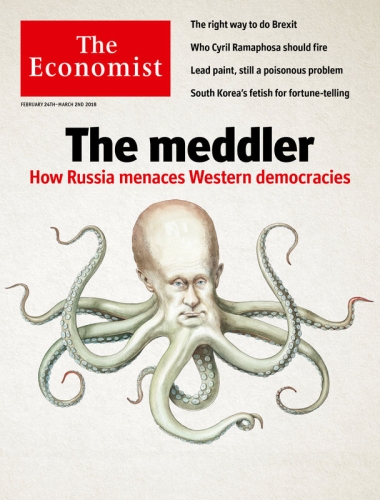
Londres préfère donc sans doute se tailler un rôle en rétablissant le triangle avec Paris et Berlin plutôt que de traiter directement avec Trump, même pour eux le « tournant » dans leur attitude vis-à-vis de Moscou est impossible, ni souhaité. Comme l'écrivent déjà les libéraux britanniques, tout cela est pro-tempore, c'est un « ha da passa » a' nuttata », Trump n'est pas éternel, tôt ou tard la donne changera à nouveau, mais cette nouvelle posture ne déplaira pas même à la restauration complète de l'internationale libérale une fois que - si et quand - Washington reviendra à la raison. Plus d'armes pour tous, c'est la voie à suivre pour le monde des années et des décennies à venir, alors mieux vaut faire de nécessité vertu. La guerre a toujours été le moteur du développement technologique et économique de l'Europe, depuis le début de la modernité, si ce n'est la transition du Moyen-Âge à l'ère moderne, puisque nous sommes maintenant sortis des nouveaux secteurs technologiques de pointe, que nous reste-t-il à faire ?
Les capitaux fuyant une Europe soumise à des tarifs douaniers et à des dépenses militaires exogènes et faiblement endogènes iront à Wall Street, mais pas seulement le capital financier, également le capital productif (les entreprises) et le capital fiscal (les capitalistes) à qui l'on promettra des conditions plus attrayantes. La cure de reconstitution du budget américain passera par la vampirisation de l'Europe et des Européens. Tout organisme en crise pompe davantage de sang de la périphérie vers les organes vitaux.

Pour les Arabes, le discours est bien connu, tout est aligné sur la nouvelle route du coton/les accords d'Abraham qui déboucheront sur les côtes méditerranéennes d'Israël avec Gaza transformée en paradis fiscal anarcho-capitaliste, utile non seulement pour toutes les entreprises et les investisseurs impliqués dans la mise en œuvre du plan sur dix ans, utile aussi pour saboter les derniers flous fiscaux des États européens alors aux prises avec la diaspora fiscale des entreprises et des contribuables fortunés, si ce n'est aux États-Unis, dans le nouveau paradis fiscal de la rive orientale de la Méditerranée. Moins d'impôts, moins d'aide sociale, plus de privatisations, plus de pâturages pour le capital anglo-saxon.
D'autre part, pour les Européens, un nouveau potentiel commercial avec l'Asie du Sud, des combustibles fossiles moins chers que le schiste américain, peut-être même quelques co-entreprises pour de nouveaux forages en Méditerranée. Cependant, rien de tout cela ne sera immédiat.
Oui, d'accord, il faudra gérer les divers maux et insatisfactions dont souffriront les Égyptiens, les Turcs et les Qataris, mais un moyen sera trouvé. L'Iran n'aura plus qu'à prier pour ne pas être directement attaqué par Tel-Aviv et à pêcher dans le baril, sinon il y aura de sérieuses douleurs. Non seulement Gaza deviendra une exclave américaine, mais même les Territoires seront absorbés par Tel-Aviv avec la dislocation d'une partie des Palestiniens, absorber des parts substantielles de la population palestinienne deviendra le nouveau prix à payer pour les Arabes, à condition qu'ils veuillent entrer dans le gâteau du méga-projet pour l'avenir de la région et ne pas se retrouver ostracisés (course à l'espace, nouvelles technologies diverses, fournitures militaires, etc.) et frappés par des droits et autres inconvénients stratégico-économico-financiers.
Certains seront horrifiés et soupireront qu'entre le dire et le faire, il y a l'impondérable. C'est vrai, mais dans la nouvelle ère complexe, soit vous avez un plan, soit vous serez écrasé par ceux qui en ont un et qui ont le pouvoir d'essayer de le mettre en œuvre. Nous, Européens, en supposant qu'une telle entité existe non seulement géographiquement (comme Metternich l'a dit de l'Italie), n'avons ni le plan, ni le pouvoir, ni le couplage adéquat des « élites » pour l'obtenir. Nous n'avons pas, ni ne pouvons avoir la subjectivité géopolitique qui présuppose l'existence d'un État, mais nous avons des légions d'aspirants à imiter Machiavel qui suggèreront que l'Europe devrait être et faire ceci et non cela, un volumineux théâtre de l'absurde. À ceux qui persistent à soupirer que « ce n'est pas bien », je conseillerais de prendre un long bain de réalisme brutal, car notre déni de la réalité est de plus en plus pathologique.
Après tout, certains ont répété pendant des années sur la question israélo-palestinienne « une terre, deux Etats », ce qui semble être une belle idée, dommage qu'elle soit impossible, pensiez-vous vraiment que Tel-Aviv accepterait un Etat palestinien à ses frontières ? C'est maintenant au tour de l'Europe pacifiste, socialiste, écologique, tiers-mondiste, bricsiste ou favorable à la Chine. Nous remplissons la réalité de paroles, de « bonnes choses à penser » et à dire qui ne sont pas réalistes. Cela réduit l'anxiété liée à la dissonance cognitive, mais cela ne peut rien produire de concret car cela ne repose pas sur une base réaliste, mais sur une base idéaliste. L'idéalisme peut nous donner un point à atteindre sur un horizon lointain, mais pour nous orienter et aller de l'avant, nous devons nous confronter au monde réel, construire au fil du temps des sujets dotés d'une stratégie articulée et très concrète et du pouvoir relatif de la mettre en œuvre.
Comme le disait le bon De Maistre, « Tout peuple a le gouvernement qu'il mérite » et nous méritons toutes ces élites, elles sont le miroir de notre insipidité (populaire, intellectuelle, culturelle, politique), on peut les insulter autant qu'on veut, mais c'est comme cracher sur un miroir.
16:09 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, affaires européennes, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Le Paradoxe de Platon: l’extrême contemporain et le super-mythologue
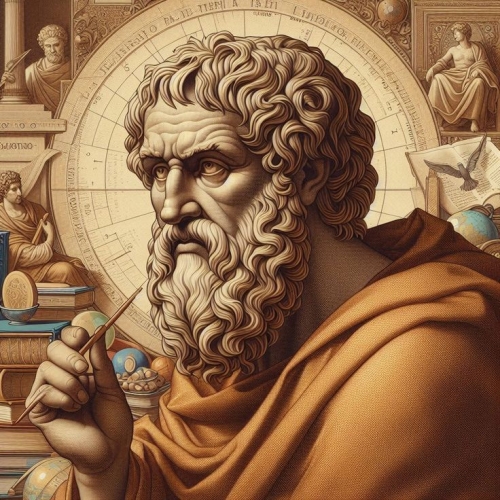
Le Paradoxe de Platon: l’extrême contemporain et le super-mythologue
François Mannaz
« Et si Platon revenait… » se demande Roger-Pol Droit. Olivier Battistini de lui répondre que Platon ne se sera jamais absenté. Il est notre « extrême contemporain ».
Cette proposition est la phrase-clé de l’ouvrage d'Olivier Battistini, consacré à Platon. Ce put en être le titre; ce sera la thèse du livre: « Platon Le philosophe-roi », bellement préfacé par Michel Maffesoli.
La biographie de Platon est courte. On sait peu de choses de lui. « Il est né » en 428 ou 427; « il est mort » en 347 ou 346. Mais il est le seul penseur grec dont l’œuvre complète nous est parvenue. (Etrange: pourquoi pas les autres? Désamour, mal-pensance, censure?)
Donc Platon tient la corde du théologiquement correct depuis deux millénaires et demi.
On saluera la judicieuse initiative de l’auteur de contextualiser son travail. Le livre contient en effet une imposante galerie des portraits: des interlocuteurs, adversaires, amis, clients, ou gitons de Platon. Cet utile catalogue fixe « les protagonistes » et « antagonistes », (ensemble leurs « caractères », statut, camp, rôle, pedigree) qui défilent sous la plume de l’auteur et constituent le paysage de « la scène à Athènes » sous Platon, Socrate et consorts.

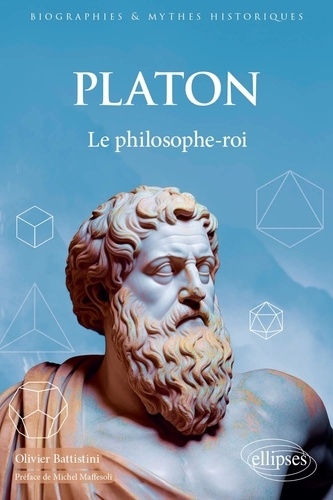
Platon « extrême contemporain », cela veut dire l’hypermoderne qui fonde et structure la modernité, ouvre et habite « l’âge axial » (Karl Jaspers) vieux de 2500 ans. Es klang so neu und war doch so alt…..
Curieusement Platon n’aura jamais été pris au sérieux de son vivant. Il n’a d’ailleurs inventé ni doctrine ni théorie, et se bornera à mettre en forme ce qui fut pensé avant lui (Battistini s’essaye à dire « système apparent »). Reste que sa griffe ne laisse de fasciner. Son savoir caché accouchera en mythe une causalité d’exception appelée à se fixer en horizon absolu de science.
Divers auteurs opinent que Platon aurait créé la « philosophie », comme si on n’avait pas pensé avant lui. Ce qui revient à faire peu de cas des millénaires de sagesse dite primordiale, des innombrables sages amants de la Sophia, et surtout des ennemis irréductibles de Platon qu’il racise en « Sophistes ». À preuve sont les écrits de bagarre de Platon lui-même. Comme Cicéron, il fait des livres de ses pugilats et les titre du nom de ses cibles. Il cogne et éborgne les porteurs de la Sophia. Parce qu’en eux le mythos honni brille de mille feux. Michel Maffesoli indique que ce mythos, c’est notre « Tradition ». Tandis qu’en face mugit leur déconstruction.
Platon n’aura de cesse que de provoquer à l’adultère philosophique. Il cancelle et wokise les mythèmes et les hérauts de la Sophia (Calliclès, Gorgias, Critias ou Protagoras). Il culpabilise ses adversaires à la faute d’impiété à l’encontre de son snobisme de clerc mercenaire. En toute occurrence, il fait « pliure » et excite au « devenir minoritaire -majoritaire » de conformation à son modèle (G. Deleuze).
Platon éclipse la « philosophie », invente le concept, la catégorie, le genre de la misosophie (doctrine accusatoire de détestation) et l’installe en tout théologique de négation de la négation, de l’en-même-temps de la théologie spéculative et de la théologie expérimentale.
Platon inaugure la figure, la fonction et l’impact de l’intellectuel, activiste, propagandiste. Un « possédé » insiste Battistini. Un « prédicateur contre l’ennemi » (Hermann Lübbe) qui excelle à faire la guerre avec les idées, les valeurs et les fétiches de la théologie expérimentale.
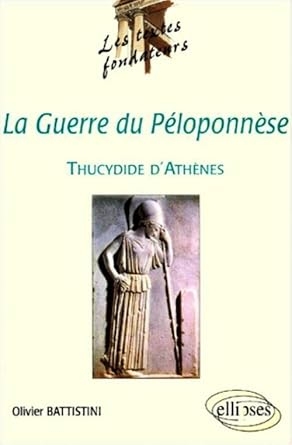
Platon est assurément un polémiste de la réaction théologique. Il n’a de cesse d’accumuler, d’activer et d’exciter à la controverse. Partout, il est à l’attraction – répulsion – scandale. Discourir toujours pour provoquer un effet théologico-matriciel. Son entreprise est toute d’agitation religieuse et politique. Platon pousse sans relâche au degré ultime d’association et de dissociation dans la cité. Il se fait bélier de la pressure policy. Sa stratégie est au choc contre la physique politique et le primat de l’autochtonie: la cité grecque n’est pour lui qu’une « hypothèse ». Platon est le mécanicien du basculement de l’état politique à l’état cosmopolitique. Il s’impose en chiffre d’une triplice particulière de métaphysique, de métapolitique et de métacognition (où meta s’entend en mise à distance du point de vue tiers). Cela donne un anti-système, une métathéologie, une épi-théologie patriarcale de la plus forte nuisance, médisance, fraudulence, modulant à la chute.
De la sorte Platon se retrouvera à la tête d’un mouvement de contestation théologique qui perdure à ce jour (Osons dire que le climat est permaplatonique). Son énergie mentale se déchaîne contre le mythe politique de la polis et du peuple politique. Son idéologie est à l’inversion; sa (mytho)graphie est à la misosophie; sa misosophie est commissionnaire et commissaire: elle charrie l’en-soph-ie ! Emblématiquement, Léo Strauss proclamera qu’avec Platon l’activité de penser revient à s’aligner, se soumettre, se conformer à l’instance supérieure du théologique. Désormais, misosopher est décision et méthode ad hoc de technique sociale (scripsit K. R. Popper).
Platon demeure la star de l’esprit néolithique qui s’étale en « dialogue » inquisitorial, en « maieutique » engagée et en « dialectique » ravageuse.
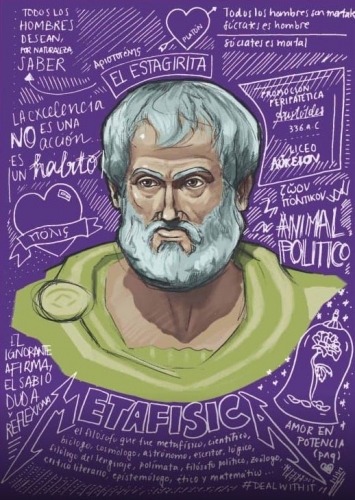
Sa rhétorique est fractale. La mise en état du monde est jeu d’attaques. La plus-value doit aller à l’insolence, à l’effronterie, à la cacologie. Il en va de « réduire l’adversaire à quia », de lui ôter toute légitimité, de le déposséder de son humanité !
Comme l’on voit, le terrorisme théologique est d’une antique actualité. Walter Benjamin précisera que « l’esprit est la capacité même à exercer la dictature » ! Pour forcer à lui obéir, ajoutera Léon Chestov !!
Le combat des idées est donc travail théologique: « Idée, c’est Dieu ». Le monde des idées c’est la pensée du dieu jaloux. C’est théâtralité de l’absence de « liberté des présupposés » (Julien Freund) et de la technologie téléologique du miraculisme . C’est surtout violence théologique qui motorise l’« image inversée », « opposé absolu », schème d’alter-culte à effet direct d’application immédiate. Qui métabolise l’excès, l’exception, l’abstraction. Qui est lavé de la Haine (Empédocle).
Et Platon sait hair: la cité, ses héros, les femmes, la mer, ses opposants, les dieux, les déesses, les poètes, les arts, les Muses,... jusqu’à « la démocratie » ! L’auteur de reproduire le brevet de M. I. Finley: « le plus puissant et le plus radical penseur antidémocratique que le monde ait jamais connu » ! Ergo, Platon roule pour l’élite. Un théologien, ça pense cybernétiquement, et politiquement ça veut » l’hégémonie ! « Les civilisations meurent »; les théologiens restent. Est-ce là « ce que penser veut dire » ?
La parole théologique est vendue comme logos Le « logos platonicien » est l’arme des armes, » l’outil politique par excellence », « theoria » en marche. Logos est toujours assaut contre ce qui est dit a-logique, c’est à dire a-causal, ir-rationnel, impie (Georg Lukacs a tout dit sur le sujet). Il mathétise la prise. Il ingéniérise la culbute de la Thèse en antithèse, de la physis en cosmos, du Nomos (ou habitus d’ordre) en « nomos » (complot, décision ou loi au sens de lex dei), du peuple (laos) en parti (demos), des dèmes en classes, de la politeia en république, de la politeia en ressentimentalité, de ressentiment en croisade de conversion, etc. Il met tout à l’envers et ostracise ceux qui sont déclarés incompatibles. Logos devient raison, grammaire, discours divin dévoilé… en égologie. Bien sûr, ce logos est proclamé « roi », totem, grenier à « valeurs ». Socrate expérimentera qu’on meure pour lui.
Dans son écrit le plus célèbre, La République, Platon déchaine sa théologie « naturelle » contre les possibles biologiques du politique mais se déploie en technocrate théocratique indexé à la loi du plus fort. Or le gars s’y connait en la matière: saches lecteur que « Platon » c’est un surnom, un nom de scène, une marque. « Platon » veut dire le balaise, le barraqué, le prolixe (la grande gueule?). Son vrai nom est Aristoclès et çà déplait à ses péripatéticiens camarades de lutte pour la dictature du socratisme (et que Saul de Tarse traitera de « chiens »).
Il convient dès lors de calibrer Platon en théologien et porteur des valises de la théologie (nous savons depuis Hans-Günther Adler qu’elle s’entend de la mentalité arrimée au désir insatiable d’expérimenter le grand remplacement du réel par une réalité nouvelle enchainée à sa causalité irrépressible). Il lui importe de déconstruire la dimension polaire de la cité, de dézinguer la physis (de l’incréé) et de mettre en déchéance théologique tout mythe alternatif au récit unique. Son but est de créer une « cité seconde « dans laquelle logos est théos », « la divinité mesure de toutes choses » (non l’hominidé… parce que homo est le jouet du dieu-dieu...), où machine quelque sombre « loi générale de l’humanité ».
Telle est la face 1 du disque Platon, celle du théologien commissionnaire des premières années.
Il est une face 2 de doxanalyse que nous offre avec brio l’auteur, celle de l’homme mûr , revenu de ses emportements pour compte d’autrui, l’homme du Mythe.

Olivier Battistini souligne la metanoia de l’homme et le tour « dans le sens opposé » de son œuvre. Il présente un Platon en sage révulsé par la « théonose », défroquant la fraude, marri de son avocature, qui fait anamnèse vers le plus lointain passé. S’agaçant d’évidence sur le tard de l’absurdité de l’idée théologique et la remisant en thèse déontologique, Platon renordisera ses réflexions. Il quêtera sur les terres inaugurales des peuples premiers en osant penser l’avant de la création confessionnelle, et donc « l’avant du mythe politique », l’hyper-alterité alternative. Il se consacrera désormais à Thulé, à l’Atlantide ou à la course fâcheuse du nomos-basileus.
Platon de nous décrire Thulé (Tula), l’ile fabuleuse de l’extrème-Nord, la matrie des Hyperboréens, « la grande aurore », par le menu. Il gagnera des renseignements de première main auprès de son marin-reporter, le navigateur Pytheas au soutien de son offre d’avoir à penser l’hyper-alternation primordialice. C’est donc fait historique avéré que Thulé aura été la terre du primordial. Celui-là même que la théologie jalousera au point d’y originer sa diatribe vengeresse contre toute fragrance et mémoire de certain passé à l’Infraction de « péché originel »qui n’en finit pas d’empester la planète. Au rebours, Platon en fait donnée qui appelle à « réminiscence », à la purge des vices, au soleil du Pôle. Ce faisant il nous offre de penser l’origine, le Nord, le paradis magnétique, loin de tout péché, hors la chute, à l’abri du sabir théomaniaque et pirate. Platon d’inviter in fine à l’hyper-sécession d’avec la modernité et de ses « ombres ».
Bien plus tard, Pierre-Simon Ballanche se résoudra à acter cette alternative de palingénésie. En deçà de la bifurcation, il y a re-départ, altercroisement, autre commencement. Inverser l’inversion est le programme. « Callipolis » ou l’architectonie à l’angle droit est le projet. Castoriadis parlera pertinemment de « contre-révolution platonicienne ».
Battistini renchérit. Il nous incite à penser Platon contre Platon, nous convoque à penser la technique de Platon contre la technologie de Platon, nous provoque à renverser la table et à nover l’espace-temps au devenir de l’extraordinaire !

Michel Maffesoli l’a bien compris, lui qui dans sa préface salue la « belle œuvre » valant « chemin initiatique » vers la Vérité. Là est le fil d’Ariane vers la vraie sagesse ayant origine et dévoilement propres; là est le socle des « potentialités » du « ce que penser veut dire » fondamentalement, fondativement, sophialogiquement; là est le travail de fixation et de concrétion à mythe contre mythe (théologie n’est d’ailleurs qu’un mythe parmi d’autres, contre tous les autres,avec une enseigne autre). La conflagration des mythes prend le nom maffésolique de « complexio oppositorum ».
Le Paradoxe de Platon signe la victoire oblique, rétroactive et sophistiquée des Sophistes et de la Sophia. Il culmine en schème de décolonisation, de désintoxication, de résonnance parfaites. Loin de toute interdiction de penser l’autre provenance-appartenance ou Denkverbot de l’épi-théologie (S. Freud). « Le réel est sophique » et nullement théologique, souligne Jean Vioulac avec force .
Olivier Battistini fait bien d’élever Platon à « génie », « maitre de la métapolitique » et réinitialisateur du devenir. C’est judicieuse offre télesmatique à la clôture de l’interrègne de la modernité. C-ar-thage n’a-t-elle pas vaincu Rome obliquement in fine ?
Après tout, Peter Sloterdijk ne conte-t-il pas que la terre est sphère, ronde, boule où tout peut rouler dans tous les sens? Dès lors, tout vient et revient, au point que l’on pourra se baigner à nouveau dans la polyversité de ses eaux… et de ses fleuves.
Lecteur, bon voyage en sophialogie.
13:22 Publié dans Livre, Livre, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : olivier battistini, platon, philosophie, antiquité grecque, hellénisme, platonisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
La chanson française ou la déconstruction en douceur
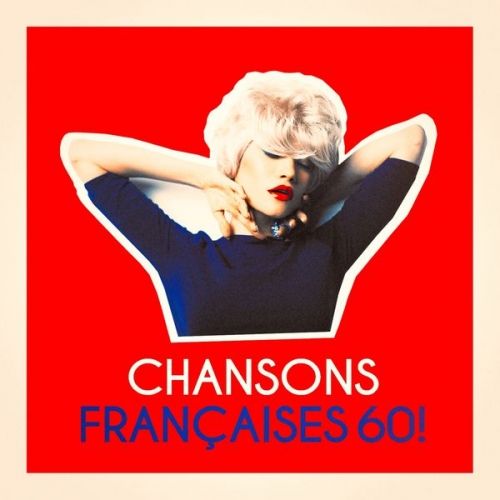
La chanson française ou la déconstruction en douceur
par Daniel COLOGNE
Texte préalablement paru sur le site Europe Maxima, le 29 novembre 2020
En 1860 est fondé le cabaret montmartrois « Le Lapin agile » (initialement « Lapin à Gilles », du nom de son fondateur André Gilles). Un siècle plus tard, Claude Nougaro y fait ses débuts, tandis que Jacques Brel et Georges Brassens chantent dans des cabarets concurrents comme « Les trois baudets » ou « Patachou ».

Bien que traversée par des courants très divers, la chanson française séculaire puise son inspiration dans l’amour du pays, de sa capitale, de ses terroirs, de son histoire souvent tourmentée et de ses paysages métamorphosés par les cycles saisonniers.
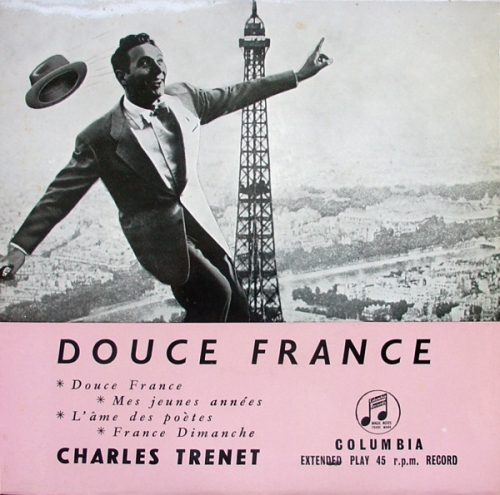
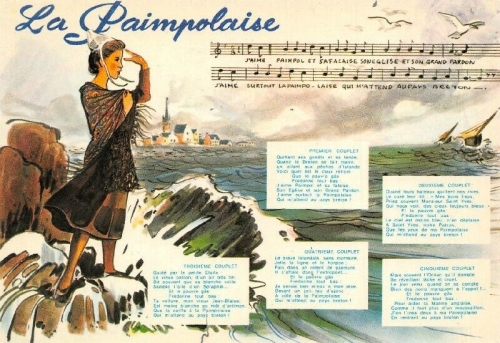
Des gens qui sont de quelque part
Rappelons-nous la Douce France de Charles Trénet et La Paimpolaise de Théodore Botrel qui exalte sa Bretagne comme Tino Rossi célèbre son « Île de Beauté ». De Fréhel à Édith Piaf en passant par Damia et Berthe Sylva, la chanson misérabiliste rend hommage au petit peuple parisien, à ses ouvrières qui meurent trop jeunes (Les Roses blanches), à ses gamins affligés d’un handicap (Le petit bosco), à ses accordéonistes qui demandent l’aumône sur les quais de la Seine en jouant l’air de L’Hirondelle du faubourg, des Petits pavés ou de la Valse brune.
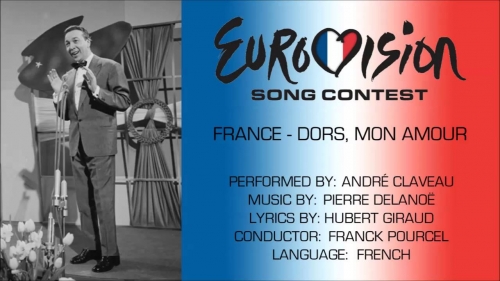
Vainqueur du premier concours Eurovision en 1956, André Claveau est la figure emblématique de cette chansonnette bien enracinée, amoureuse du petit train montagnard qui part pour son dernier voyage, nostalgique de la diligence qui mettait une semaine pour aller de Paris à Tours. Avec leur souvenir de la marelle enfantine sous les cerisiers roses et les pommiers blancs, ces refrains peuvent paraître surannés, mais savent parfois se revêtir d’une parure sensuelle de bon goût (Domino). Claveau change de registre lorsqu’il ravive la mémoire des combats vendéens (Les Mouchoirs rouges de Cholet, Prends ton fusil, Grégoire). Dans Trop petit, mon ami s’exprime une ferveur chrétienne qui rappelle La petite église de Jean Lumière.
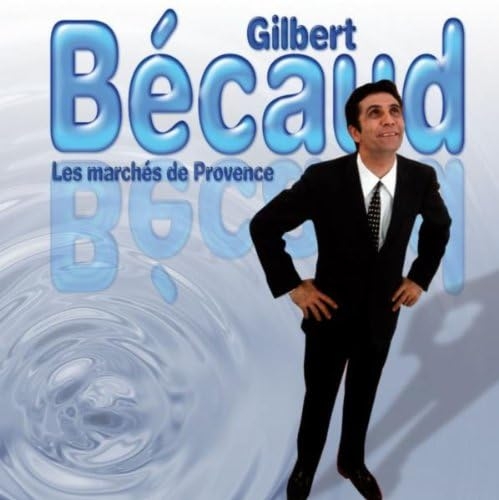
Après la Seconde Guerre mondiale s’affirme la brillante génération des chanteurs nés vers 1930, dont les répertoires glorifient encore souvent les lieux qui les ont vus naître. Pensons par exemple à Gilbert Bécaud, à ses Marchés de Provence ou à ce petit chef-d’œuvre intitulé C’est en septembre. Mais dans certaines discographies se glissent déjà des thèmes qui annoncent la « grande libéralisation » (David Goodhart) censée conduire vers l’Eldorado du village planétaire.
« Quand on n’a que l’amour »
Mon admiration pour cet artiste hors normes comporte sans doute une part de chauvinisme patriotique. Jacques Brel a fait revivre le Bruxelles des gibus et des crinolines. Il a dépeint les « chemins de pluie » du « plat pays » flamand. Il a saisi l’étrange atmosphère d’une cité wallonne figée par les rigueurs des nuits hivernales (Il neige sur Liège). Mais il ne faut pas oublier les maladresses de ses premiers « 78 tours » (La Foire, Au printemps, Il peut pleuvoir). Que serait-il advenu de lui sans la soudaine notoriété que lui confère une chanson de 1956 rivalisant d’audience radiophonique avec le Bambino de Dalida et le Deo d’Harry Belafonte ?
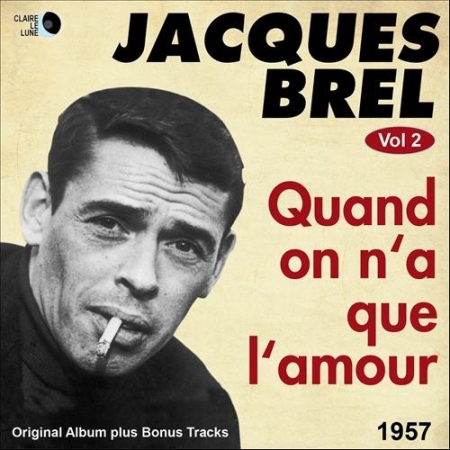
Quand on n’a que l’amour annonce déjà les appels d’aujourd’hui à accueillir toute la misère du monde.
« Quand on n’a que l’amour
À offrir à ceux-là
Dont l’unique combativité
Est de chercher le jour. »
Brel confond, comme la bien-pensance actuelle, le légitime désir d’éradiquer la misère et la glorification du délinquant, dans la ligne du Victor Hugo des Misérables (le bon Valjean, ex-bagnard, contre le méchant policier Javert).
« Quand on n’a que l’amour
Pour habiller matin
Pauvres et malandrins
De manteaux de velours. »
Mieux encore qu’aux Misérables hugoliens c’est aux Voyous de velours de Georges Eekhoud qu’il faut ici se référer. Et voici un autre couplet :
« Quand on n’a que l’amour
Pour parler aux canons
Et rien qu’une chanson
Pour convaincre un tambour. »
Arrivé à Paris en 1953, Brel est comme une éponge qui s’imbibe du pacifisme germano-pratin, des appels à la désertion de Boris Vian et de Mouloudji, du dégoût existentialiste inspiré par les guerres d’Indochine et d’Algérie. Mais cet irénisme va conduire l’Europe à oublier le vieil adage romain Si vis pacem, para bellum et notre continent deviendra un nain géopolitique dominé à l’Ouest par le pragmatisme anglo-saxon, menacé au Sud par un terrorisme religieux et condamné à l’Est à se heurter au Rideau de fer, puis à la muraille de Chine.
Quelques thèmes déconstructeurs seront ainsi charriés par le répertoire brellien que nous continuerons toutefois d’aimer jusque dans l’ultime petit chef-d’œuvre intitulé Orly et la dernière exclamation du grand Jacques trop tôt disparu :
« Mais nom de Dieu que c’est triste
Orly le dimanche
Avec ou sans Bécaud. »
« Je suis blanc de peau »
Les interprètes les plus mièvres se surpassent quand ils évoquent leur lieu de naissance : par exemple, Marseille et son accent que Mireille Mathieu a gardé depuis qu’elle a vu le jour dans la cité phocéenne.
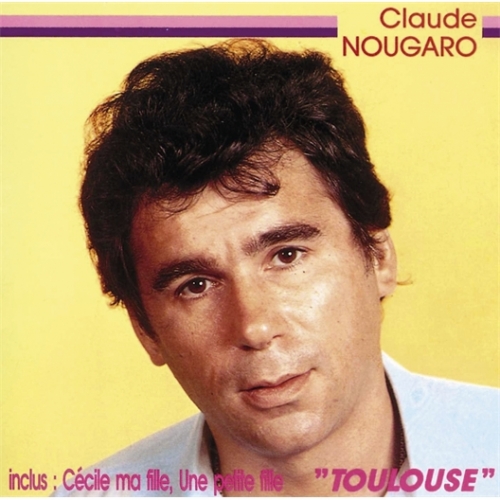
Que dire alors de Claude Nougaro, sublime quand il célèbre Toulouse : sommet d’un répertoire à forte personnalité, où se marient le jazz et la java, où les rythmes de La Nouvelle-Orléans s’intègrent au texte sans nuire à sa qualité poétique et où il est bien légitime que le fils d’un artiste lyrique du Capitole (« Papa, mon premier chanteur de blues ») rende hommage à Louis Armstrong. Mais pourquoi donc dénier à la race blanche l’aptitude à l’élan mystique ?
« Quel manque de pot
Je suis blanc de peau
Pour moi, rien ne luit là-haut
Les anges zéro
Je suis blanc de peau. »
« Il faut tourner la page
Déchirer le cahier
Le vieux cahier des charges. »
Vive l’humanité exonérée de ses devoirs ! C’est ce que semble s’écrier cette autre chanson, plus tardive, elle aussi bien construite, comme Quatre boules de cuir. Amoureux de la boxe, comme Maurice Maeterlinck, Nougaro se souvient que dans sa « ville rose » où « l’Espagne pousse un peu sa corne », « même les mémés aiment la castagne ». « Ici, si tu cognes, tu gagnes. » De la très bonne chanson, où se faufile insidieusement un embryon de la guerre des races où les villageois planétaires veulent nous entraîner.
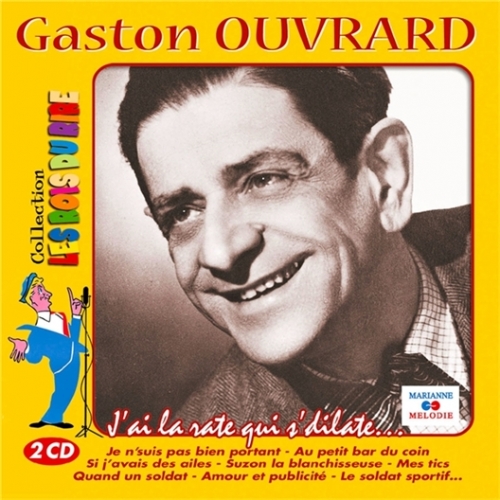
« Entre copains de tous les sexes »
La chanson « idiote » d’autrefois ne se moque pas seulement – et gentiment – des homosexuels, comme Fernandel dans Il en est. Milton brocarde les cocus et les couples mal assortis. Georgius ridiculise l’enseignement (Le lycée Papillon). Les jongleries verbales d’Ouvrard (« J’ai la rate qui se dilate », « Les rotules qui ondulent », etc.) sont une trouvaille de jeune recrue voulant se faire réformer.
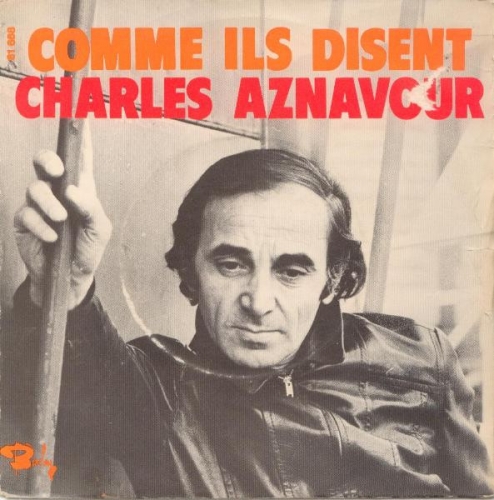
Comme ils disent (1972) de Charles Aznavour est à mi-chemin entre Il en est et les gay prides échevelées qui dégénèrent en paradodies de fêtes nationales. Le personnage retrouve chaque matin « son lot de solitude » après ses amours « dérisoires et sans joie », après son numéro de déshabillage finissant en nu intégral, après sa virée nocturne avec « des copains de tous les sexes » qui « lapident » les gens qu’ils « ont dans le nez » avec « des calembours mouillés d’acide ».
Voici donc l’immense Aznavour précurseur de la théorie du genre et de la multi-parentalité. Ces fleurons de la cynique ultra-modernité s’insinuent discrètement dans une œuvre gigantesque bercée par la nostalgie de la musique tzigane (Les deux guitares), obsédée par la rupture sentimentale (Et pourtant, Sur ma vie, Il faut savoir, Deux pigeons, Que c’est triste, Venise), magnifiée par le rappel du génocide arménien trop longtemps occulté.
« C’est une romance d’aujourd’hui »
Restons en 1972. Le grand succès de l’été est la Belle Histoire de Michel Fugain. C’est la rencontre d’un nomade et d’une citoyenne du monde. Ils s’étreignent au bord d’une route avant de repartir, l’un vers les brumes du Nord, l’autre vers le Soleil du Midi. La Providence est convoquée pour adouber cet amour éphémère. Plus tard, Fugain nous invitera à « marcher sur la tête pour changer les traditions ».
Il y a des années-charnières, des points d’inflexion de l’histoire de tous les secteurs, y compris ceux du sport, du cinéma et de la chanson. L’arrêt Bosman de 1995 transforme les équipes de football en tours de Babel, alors qu’en Belgique, par exemple, jusqu’en 1961, un joueur étranger devait évoluer une saison parmi les réserves avant d’accéder à une place de titulaire.
À partir de 1966 et de La Grande Vadrouille, les films détenant le record du nombre d’entrées dans les salles obscures sont presque exclusivement des comédies, alors qu’auparavant, le même record est détenu par Les Misérables, Quai des Orfèvres et Autant en emporte le vent. 1972 pourrait être le millésime-tournant de l’histoire de la chanson et 1974 celui de l’Eurovision. Vive le groupe Abba. Oubliés Jacqueline Boyer, Jean-Claude Pascal, Isabelle Aubret, France Gall et sa poupée offerte par Gainsbourg, le vainqueur espagnol de 1968 en qui l’on voyait un futur « Aznavour catalan ».
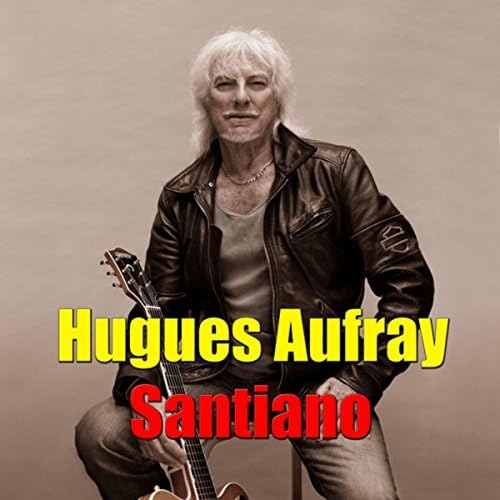
« Car le monde et les temps changent. »
Il nous grise avec son histoire de marin qui revient au pays. Il nous fait partager son émotion pour Céline et sa colère contre L’Épervier. Il nous conte une mésaventure sentimentale survenue quand refleurissent les jonquilles et les lilas. Il laisse gravé dans notre mémoire le « fameux trois-mâts » où Dieu est seul maître à bord (Santiano). Mais dans une de ses nombreuses adaptations de Bob Dylan, Hugues Aufray enjoint aux parents de « rester crachés ». « Vos enfants ne sont plus sous votre autorité », reprend l’icône noire Joséphine Baker peu avant son décès. « Le monde et les temps changent. »
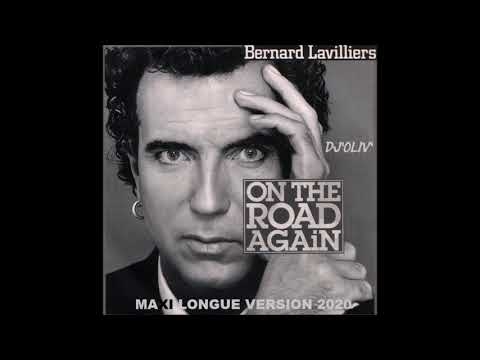
Sans aller jusqu’aux répertoires actuels, que je connais trop mal, on peut déceler la même ambiguïté chez des chanteurs nés vers 1950. Bernard Lavilliers peut à la fois se faire l’aède du nouveau nomadisme (On the road again) et exalter les travailleurs aux « mains d’or » de la sidérurgie de Thionville. Laurent Voulzy aime se produire dans les cathédrales où sa Jeanne trouve un décor de rêve, mais Le Pouvoir des Fleurs illustre l’utopique naïveté d’une certaine jeunesse d’après-guerre.
« Changer les choses
Avec des bouquets de roses. »
Mais revenons à Huges Aufray avec une autre chanson de la mer, au texte élaboré, au rythme entraînant, au contenu quasi messianique.
« Le jour où le bateau viendra »
C’est l’histoire d’un navire qui débarque sur un littoral imaginaire. Elle s’adresse aux hommes de la Fin des Temps. Ils pourront reposer sur le sable « leurs pieds fatigués », tandis que, planant au-dessus des dunes, « les oiseaux auront le sourire » et qu’au grand large, les pharaons sont promis à la noyade.
Ce navire a peut-être un lien avec « le bateau pensant et prophétique » de Léo Ferré, qui prend « le chemin d’Amérique », c’est-à-dire « le chemin de l’amour ». Il s’en va avec une Madone attachée « en poupe par le col », mais à son retour, il porte dans la même position une Madone « d’une autre couleur ».
Le bateau espagnol est un des plus beaux textes de poésie française mise ne musique, mais il n’est pas interdit d’y voir jaillir une des premières étincelles du feu que certains se plaisent à attiser aujourd’hui : celui de la guerre des races sur fond de revanchisme post-colonial.
Daniel COLOGNE
12:14 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, chansons françaises, chanson, années 60, années 70, variétés |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 10 mars 2025
Trump, les néocons et l'inversion du projet interventionniste mondialiste

Trump, les néocons et l'inversion du projet interventionniste mondialiste
Donald Trump est en train de revenir sur la politique interventionniste néoconservatrice, estime Frank-Christian Hansel dans son commentaire pour LIBRE. Le président américain offre ainsi à l'Europe une chance d'autonomie en matière de politique de sécurité.
par Frank-Christian Hansel
Source: https://www.freilich-magazin.com/welt/trump-die-neocons-u...
Depuis des années, Donald Trump est présenté par les politiciens mainstream et les médias européens comme un danger pour l'Occident. Sa critique de l'OTAN, son aspiration à une solution diplomatique en Ukraine et son rejet des projets mondialistes sont interprétés comme les preuves d'une volonté de détruire les valeurs de la communauté occidentale. Mais cette présentation méconnaît le véritable cœur de son programme politique, dans l'intérêt également du contribuable américain. Trump ne démantèle pas l'Occident, mais fait marche arrière sur un projet d'intervention néoconservateur qui a impliqué les États-Unis et l'Europe dans diverses guerres. Son objectif n'est pas l'isolationnisme, mais une réorientation pragmatique de la politique américaine, qui offre également à l'Europe une chance historique d'accéder à la souveraineté.
Les néocons et leur projet géopolitique
Le mouvement néoconservateur a marqué la politique étrangère américaine depuis les années 1990. Leur objectif était l'hégémonie incontestée des Etats-Unis, imposée par des interventions militaires ciblées et des changements de régime. La doctrine Wolfowitz de 1992 a fixé l'objectif stratégique d'étouffer dans l'œuf toute concurrence géopolitique. Le Project for the New American Century (PNAC) a exigé une politique d'intervention agressive, qui s'est exprimée dans les guerres en Irak, en Afghanistan et en Libye. L'Ukraine, en particulier, a joué un rôle décisif dans ce processus. Depuis 2014, elle a été systématiquement intégrée dans la sphère d'influence occidentale, le renversement du Maïdan a été activement soutenu, comme le prouvent des documents désormais publiés par l'autorité patronnée par Musk, et le pays a été positionné comme tampon géopolitique contre la Russie. Cette stratégie est l'expression du récit initial, celui du « Heartland » de Halford Mackinder, qui considère le contrôle de l'Europe de l'Est comme la clé de la domination mondiale.
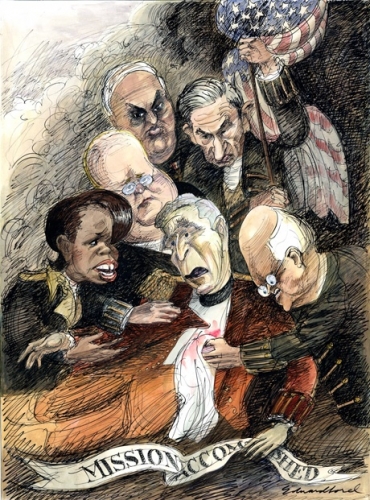
Cette politique d'expansion permanente et de démonstration de force militaire n'a toutefois pas apporté la stabilité, mais la déstabilisation à long terme - et était d'ailleurs tout sauf « basée sur des règles » ! Les conséquences des guerres au Proche-Orient et de la politique de confrontation avec la Russie ont été considérables pour l'Europe: mouvements migratoires, bouleversements économiques et dépendance militaire croissante vis-à-vis des États-Unis.
Trump comme contre-modèle : « America First » au lieu de l'interventionnisme mondial
Dès le début, Trump s'est opposé à cette orientation. Durant son mandat, il a empêché une nouvelle intervention militaire à grande échelle, a retiré les troupes américaines des zones de conflit et a privilégié les négociations plutôt que l'escalade. Sa critique de l'OTAN a souvent été présentée comme une intention malavisée d'affaiblir l'alliance occidentale, alors qu'elle visait à libérer l'Europe de sa dépendance vis-à-vis des États-Unis en matière de politique de sécurité. Son approche était claire: les États-Unis devraient se concentrer sur leurs intérêts nationaux au lieu de mener d'interminables guerres par procuration pour un ordre mondial qui sert avant tout les néocons.
Sa divergence sur la question ukrainienne était et reste particulièrement frappante. Contrairement à l'establishment de la politique étrangère, qui considérait le conflit comme une opportunité géopolitique, Trump a voulu rechercher une solution diplomatique dès 2019. Il a reconnu que la guerre ne pouvait pas prendre fin par des sanctions ou des livraisons d'armes, mais par des négociations qui tiendraient également compte des intérêts de sécurité russes. Cela signifiait toutefois un défi direct à la stratégie néoconservatrice.

La guerre en Ukraine, un test pour les intérêts géopolitiques
Dans ce contexte, la guerre d'Ukraine n'est pas simplement une escalade géopolitique spontanée, mais le résultat d'une stratégie néocon de longue date. Dès 2008, le projet d'élargir l'OTAN à la Géorgie et à l'Ukraine a provoqué des tensions de grande ampleur avec la Russie. Le renversement de Maïdan en 2014 n'était pas seulement un événement interne à l'Ukraine, mais le produit de l'influence occidentale, que la Russie a perçu comme une menace existentielle. La guerre à partir de 2022 - sans que cela puisse être lu comme une justification - était alors la conséquence logique d'un conflit par procuration qui s'était construit au fil des années. Trump reconnaît ce contexte et veut mettre fin à la guerre, non pas par sympathie pour Poutine, mais parce qu'il considère l'escalade comme une impasse stratégique.
C'est justement là que le conflit central entre Trump et l'establishment transatlantique/atlantiste apparaît. Ceux qui ont œuvré depuis des décennies à une confrontation militaire avec la Russie voient Trump comme une menace pour leur ordre géopolitique. Sa diplomatie est stigmatisée comme une trahison, ses efforts de paix sont considérés comme une faiblesse.
Ce n'est pas pour rien qu'il insiste sur le fait que cette guerre n'aurait jamais dû être déclenchée et qu'elle n'aurait pas eu lieu sous son égide. Il ne s'agit pas de valeurs, mais d'intérêts économiques et stratégiques solides. Le complexe militaro-industriel profite d'un conflit durable, et l'Europe, en tant que vassal géopolitique, est manœuvrée dans une situation qui sape sa souveraineté.
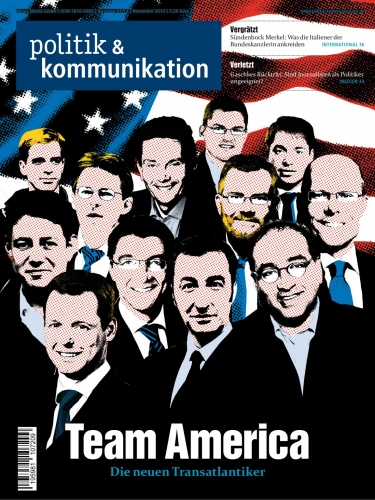
La position allemande : prisonnière du récit transatlantique ?
Dans ce débat, l'Allemagne en particulier révèle une désorientation stratégique. L'élite politique à Berlin, en particulier les transatlantiques d'inspiration ouest-allemande, représentés de Merz à Gabriel, continue finalement - qu'ils en soient conscients ou non - à s'accrocher aux concepts de l'ère néocon et à interpréter les bouleversements géopolitiques actuels non pas comme une opportunité de réorientation, mais comme une menace. Au lieu de considérer le cours de Trump comme une possibilité d'émancipation de l'Europe, la politique étrangère allemande s'accroche à une fidélité à une alliance dépassée et à une obéissance aveugle à Washington.
C'est pourquoi l'administration Trump, avec des figures comme Vivek Ramaswamy et Elon Musk, cherche logiquement à dialoguer avec les forces d'opposition aux formations politiques partisanes de l'euro-mondialisme en Europe, notamment avec des mouvements souverainistes comme l'AfD ou avec des personnalités comme Victor Orban. Alors que la politique allemande en place reste ancrée dans le vieux mode de la pensée transatlantique, l'AfD reconnaît la nécessité d'un véritable changement d'époque: s'éloigner de la dépendance militaire et de la gestion géopolitique étrangère pour s'orienter vers une politique européenne autonome en matière de sécurité et d'économie.

La chance géopolitique pour l'Europe: émancipation ou vassalité?
C'est pourtant là que réside la chance. Trump ne détruit pas l'Occident, mais donne à l'Europe la possibilité de s'affranchir de la tutelle des Etats-Unis en matière de politique de sécurité. Si les États-Unis se retirent de leur rôle de puissance protectrice mondiale, cela ne signifie pas l'effondrement de l'Occident, mais la nécessité d'une véritable ré-appropriation européenne. L'Europe pourrait développer une politique de sécurité autonome au lieu de continuer à se soumettre inconditionnellement à la doctrine américaine.
Cette émancipation aurait plusieurs avantages :
- Une plus grande autonomie stratégique: l'Europe pourrait développer sa propre politique de défense sans dépendre en permanence de l'approbation de Washington.
- Un rôle de médiateur diplomatique: une Europe indépendante pourrait servir d'intermédiaire entre les Etats-Unis, la Russie et la Chine, au lieu de se laisser entraîner unilatéralement dans des confrontations géopolitiques.
- Les intérêts économiques avant l'idéologie: l'Europe pourrait mener une politique économique pragmatique qui ne soit pas minée par des sanctions et des guerres commerciales avec de grands acteurs comme la Chine et la Russie.
Au lieu de cela, de nombreux gouvernements européens entendent demeurer dans un état de vassalité, où toute initiative stratégique personnelle est étouffée dans l'œuf. C'est particulièrement visible dans la question ukrainienne: alors que Washington négocie une éventuelle fin de la guerre, les élites européennes continuent d'exiger une escalade à tout prix. Cette myopie pourrait s'avérer fatale si les Etats-Unis entament effectivement un retrait et si l'Europe est confrontée aux conséquences de sa propre dépendance.
Conclusion : Trump comme correctif de l'ordre mondial
Trump ne met pas fin à l'Occident - il donne à l'Europe l'occasion de développer enfin sa propre identité géopolitique. Les années à venir montreront si l'Europe reconnaît les signes du temps ou si elle continue à s'enfermer dans d'anciennes structures de dépendance. Il en va de même pour l'Allemagne, quelle que soit la personne qui la gouvernera à l'avenir.
19:00 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, affaires européennes, donald trump, états-unis, otan, atlantisme, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Alaouites massacrés en Syrie: l’UE, complice silencieuse d’Al Jolani

Alaouites massacrés en Syrie: l’UE, complice silencieuse d’Al Jolani
par Roberto Vivaldelli
Source : Insideover & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/12336
Cela fait à peine quelques semaines que le Conseil de l’Union européenne a décidé de suspendre une série de sanctions économiques contre la Syrie. En effet, après la chute du régime alaouite de Bashar al-Assad, les dirigeants européens et occidentaux se sont précipités pour accueillir dans la « communauté internationale » son successeur, le président intérimaire Ahmed Husayn al-Sharaa, mieux connu sous le nom d’Abu Muhammad Al Jolani, leader du groupe jihadiste Hayat Tahrir al-Sham (HTS), avatar de Jabhat al-Nusrah ou « Front al-Nusra », l’ancienne branche d’Al-Qaïda en Syrie. En fait, l’Europe a accueilli positivement le changement de régime survenu à la fin de 2024, célébrant la chute du « tyran » Assad, coupable, entre autres choses, d’être un ami et un allié de Vladimir Poutine.
L’UE a salué l’ascension d’un terroriste islamiste
Pour célébrer comme il se doit l’ascension d’Al Jolani et du HTS, l’Union européenne a déclaré, le 25 février dernier, vouloir suspendre les sanctions afin de « faciliter le dialogue avec la Syrie, son peuple et ses entreprises dans les secteurs clés de l’énergie et des transports », ainsi que « faciliter les opérations financières et bancaires liées à ces secteurs et celles nécessaires à des fins humanitaires et de reconstruction ». La décision visait également à « soutenir la transition politique inclusive », la « reprise économique et la stabilisation du pays, avec des mesures qui allègent les restrictions dans les secteurs de l’énergie et des transports, en favorisant également les opérations financières à des fins humanitaires et de reconstruction ». Parmi les nouveautés, la « suppression de cinq entités, dont Syrian Arab Airlines, de la liste des sanctions et l’introduction d’exemptions bancaires ».
Exécutions sommaires dans le silence complice de l’Occident
Au cours des derniers mois, plusieurs dirigeants et représentants politiques occidentaux ont également été reçus par Ahmed Husayn al-Sharaa, dont Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères français – qui a visité Damas en janvier – et Annalena Baerbock – ministre des Affaires étrangères allemande – qui était également à Damas en janvier et y a rencontré al-Sharaa, qui a refusé de lui serrer la main. Nous ne parlons pas ici d’un saint (Assad), mais il ne fallait pas être devin pour comprendre qu’un ancien terroriste d’Al-Qaïda, responsable de massacres brutaux, finirait par dévoiler son vrai visage, comme cela est malheureusement en train de se produire en ce moment.
Selon le Syrian Observatory for Human Rights (qui n’est certainement pas pro-Assad), depuis jeudi dernier, les forces de sécurité et leurs alliés, affiliés au gouvernement d’Al Jolani, ont tué 340 civils alaouites suite à des exécutions sommaires, accompagnées de pillages de maisons et de biens, dans les zones de Lattaquié et alentours. L’agence d’État Sana a rapporté une attaque commise par des "restes du régime déchu" contre l’hôpital national de Lattaquié, repoussée par les forces de sécurité. Al-Sharaa, dans un discours sur Telegram, a invité les insurgés à se rendre, qualifiant leur attaque d’une erreur impardonnable.
Les dirigeants européens, qui ont salué l’ascension d’Ahmed al-Sharaa (alias Abu Mohammed al-Jolani) comme un tournant pour la Syrie post-Assad, se taisent face aux atrocités qui ont été perpétrées ces derniers jours. Comment peuvent-ils justifier leur enthousiasme initial face aux exécutions sommaires de centaines de civils alaouites, aux pillages et aux massacres documentés par le Syrian Observatory for Human Rights, avec des femmes et des enfants parmi les victimes ? En fait, l’UE ne le fait pas et, comme le note Glenn Diesen, en réponse aux meurtres de masse et aux exécutions de civils par Al Jolani, l’UE condamne les “éléments pro-Assad”. Sans vergogne.
18:38 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : alaouites, syrie, actualité, proche-orient, levant |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Le cirque s’en va en guerre et boum, et boum, badaboum…

Le cirque s’en va en guerre et boum, et boum, badaboum…
Andrea Marcigliano
Source: https://electomagazine.it/il-circo-va-alla-guerra/
Alors… pendant que Trump négocie avec Poutine, l'Europe, ou plutôt cette étrange fiction qu'on appelle l'Union européenne, va à la guerre.
Ou plutôt, au réarmement. Pour faire la guerre à la Russie.
Cela ferait déjà rire, comme une blague dépourvue de sens. Et pourtant, peut-être, nous devrions vraiment nous inquiéter. Et pleurer.
Parce que les soi-disant vents de guerre semblent souffler avec force dans les voiles de Bruxelles. Et trouver autant d'enthousiasme du côté de l'Élysée.
Ursula von der Leyen veut réarmer l'Europe. Pour faire face à Moscou. Elle demande 800 milliards d'euros à investir dans l'armement.
Vous avez bien compris… Huit cents, 800 milliards d'euros. Qui devraient bien sûr être tirés des pays membres. Donc des citoyens. Au détriment des dépenses sociales, des retraites, des salaires…
Des Européens, ou plutôt des Allemands, des Français, des Italiens, des Espagnols et d'autres seront de plus en plus appauvris. Plongés dans la misère. Réduits à une vie de plus en plus précarisée et difficile. Pour financer la guerre. Contre la Russie.
Parce que Lady Ursula et ses acolytes veulent la guerre. En paroles d'abord. Mais pour la mener, et en assumer les conséquences dans tous les sens, ce seront d'autres qui devront le faire. Vous, je suppose. Ou vos enfants et petits-enfants.

De plus, Ursula ne doit pratiquement rendre de comptes à personne. Elle n'a pas été élue par les peuples européens. Elle a été placée là par des intrigues de palais. Si elle se présentait à un vote réel, elle ne remporterait peut-être que les voix de ses proches.
Et sa Commission n'est pas un gouvernement. Elle n'a, ou plutôt ne devrait avoir, aucun pouvoir. Surtout en matière militaire. Et en ce qui concerne les guerres.
Mais l'incompétence des gouvernements nationaux lui permet d'assumer, en fait de s'approprier, ce rôle.
Et elle joue bien ce rôle, au service de ces pouvoirs financiers qui n'ont rien à voir avec l'Europe. Et avec les peuples qui devraient la composer. Et qui paient déjà les conséquences de ces politiques.
Puis il y a Macron. Pas la peine de parler de Merz, le nouveau chancelier allemand. C'est un homme de BlackRock. Et cela devrait suffire à nous faire comprendre. De plus, il n'a pas de majorité. L'Allemagne se prépare à une période, vraisemblablement longue, d'incertitude. Même, peut-être surtout, dans les rangs de la CDU-CSU.
Mais Macron semble très engagé. Un héraut de la guerre. Du réarmement. Lui qui a marqué, par son insouciance, la fin définitive de la domination française en Afrique. Qui gouverne sans majorité. Qui risque une révolte généralisée dans son propre pays.
Pourtant, il veut, en mots, la guerre. Avec la Russie.
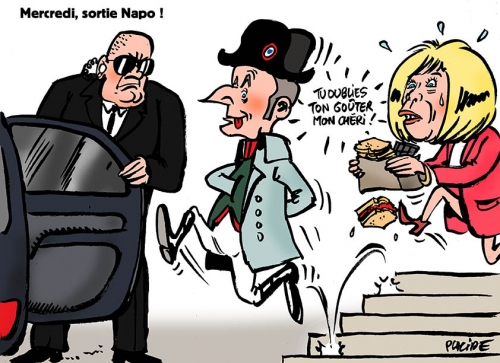
Les autres Européens s'exercent dans l'art de la pêche en baril. Ils font semblant d'être prêts. Mais ils comptent comme le classique deux de cœur quand l'atout est carreau ou trèfle.
Les Pays-Bas continuent à faire leurs affaires. Sous le radar. Les autres se taisent plus ou moins. La Hongrie, la Slovaquie, la Croatie, bientôt la Bulgarie et la Roumanie, se désengagent.
Il reste la Pologne. Mais, je le rappelle, le militarisme chronique des Polonais n'a jamais porté chance à personne. Surtout à eux. Et à ceux qui les ont suivis.
Un Cirque, donc, avec des figurants et des clowns. Qui crient: Guerre! Guerre!
Mais il n'a pas les forces nécessaire pour la soutenir, cette guerre.
Un Cirque qui sert, probablement, à masquer tout autre chose. Un jeu d'intérêts économiques. Ou, pour simplifier, le énième vol colossal qui se perpétra à nos dépens.
La Ligue de Salvini s'y est clairement opposée à cette guerre. Meloni semble encore incertaine.
Espérons… il ne nous reste plus rien d'autre à faire.
16:43 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, bellicisme, europe, affaires européennes, france, allemagne, emmanuel macron, ursula von der leyen |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 09 mars 2025
1965: Simon du désert et la fin du catholicisme
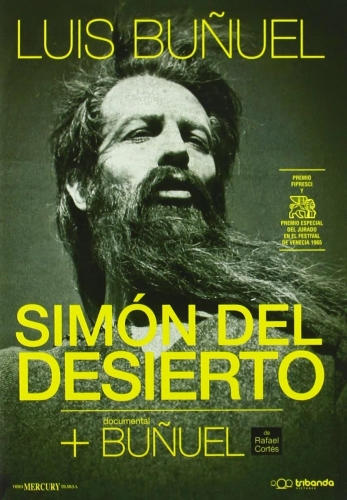
1965: Simon du désert et la fin du catholicisme
Nicolas Bonnal
1965 : on est dans la décennie qui a tout brisé, celle des Beatles et de BB, du gaullisme et de mai 68, de la télé et de la libération sexuelle, de l’Europe et des Trente Glorieuses, du gauchisme outrancier et du krach chrétien et familial. La société devient enfin surréaliste et refuse les « tiroirs du cerveau » du vieux Breton ou de Marcuse, tout en préparant à long terme un totalitarisme néo, plus informaticien et vicieux que l’ancien.
Debord (cité par mon ami Christophe Bourseiller dans sa bio plantureuse) parle « du processus de formation d’une société totalitaire cybernétisée à l’échelle planétaire ». Le fait est que quand on commence à interdire d’interdire on commence par une interdiction, et on va interdire tout ce qui interdisait peu ou prou comme on dit quelque chose : la famille, le sexe, la religion, l’Etat, la nation, tout sauf l’interdiction. On entre dans la société du numéro deux Keir Starmer et du Prisonnier de McGoohan. Ce dernier illustre le propos situ : l’insatisfaction devient une marchandise – et sera traitée comme telle, et la révolte ne peut être que formelle, entre deux enjeux dérisoires (IE les élections). Ergo à chaque évasion on revient avec notre numéro six bien-aimé et têtu au point de départ dans le quartier de Westminster : ici l’ombre !
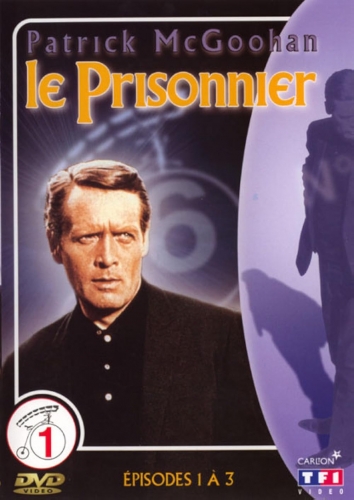
Les années soixante c’est aussi le progressif triomphe israélien, l’idiotisme voyageur, le déclin terminal du christianisme, notamment romain. Alors que les Palestiniens vont être chassés après avoir été plus ou moins exterminés dans une totale indifférence (ou même bienveillance) occidentale, on se demande à quoi finalement aura pu servir ce christianisme déchu ou manipulé depuis le début. A partir en croisade pour Jérusalem ? Quelle farce.
Après tout, comme le Christ le dit lui-même, le salut vient des Juifs, donc pas des Palestiniens. Tant pis donc pour Gaza. Les cathos, qui en ont vu d’autres, se soumettront un peu plus. Sur les cathos je ne sais rien de plus rafraîchissant que cet extrait du journal de Léon Bloy vers 1910…: « Le curé nous dit que ses paroissiens sont à un tel degré d’abrutissement qu’ils crèvent comme des bestiaux, sans agonie, ayant détruit en eux tout ce qui pourrait être l’occasion d’un litige d’Ame, à leur dernière heure. »
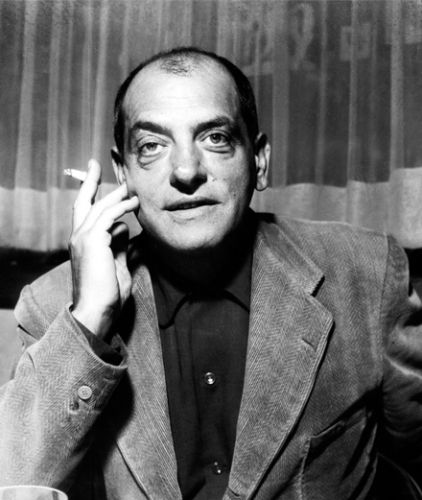
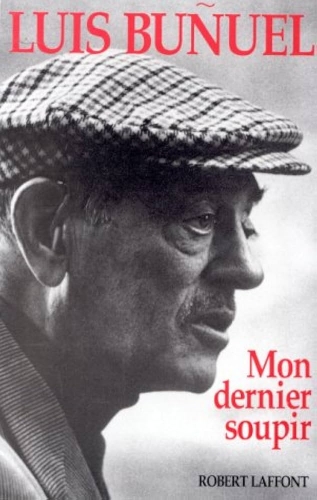
J’en viens brièvement à mon géant Luis Buñuel (voyez mon texte sur ses incroyables Mémoires) qui est selon moi le seul cinéaste chrétien avec l’oublié Bresson. Grâce à Dieu, je suis athée, a-t-il dit génialement un jour, en enchantant mon grand-oncle Georges Sadoul, communiste et critique de cinéma. Buñuel s’est acharné gentiment et savamment (la voie lactée…) sur le christianisme en évoquant l’embourgeoisement éternel de cette religion, sa vocation carcérale, son progressif abandon des pauvres et son déclin humain et sociologique, lié aux temps qui passent et à la civilisation industrielle agonisante muée en société du spectacle. McLuhan écrit quelque part que sans télévision on n’aurait pas eu Vatican 2.
...Et Céline que la vérité de ce monde c’est la mort.
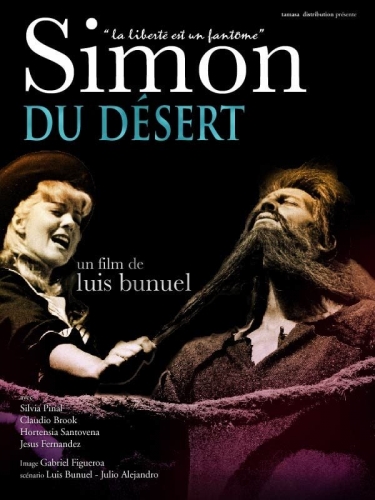
C’est là qu’intervient son Simon du désert. C’est un court-métrage avec l’impeccable Claudio Brook, acteur de la Grande Vadrouille et surtout de l’âge d’or mexicain, qui a accompagné Buñuel dans une nuée de chefs-d’œuvre. En une demi-heure la caméra explore le temps, liquide la furibarde vocation du saint (il se tient sur un pied sur sa colonne), découvre enfin la malignité des pauvres.
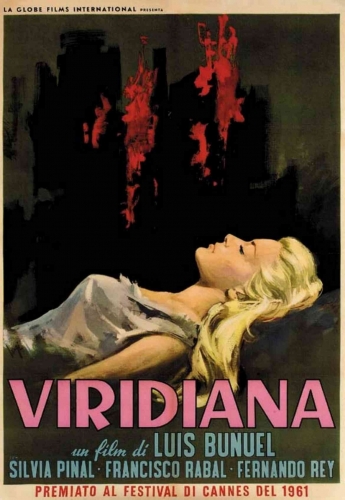
C’est un des traits de génie de Buñuel: le pauvre n’est ni bon ni chrétien, voyez Viridiana, en fait un bon pauvre, c’est un rêve de richard, cf. les migrants. Buñuel emmène avec le diable tentateur (géniale Silvia Pinal) notre saint aux enfers c’est-à-dire à New York. Cet enfer est d’abord signalé par un énième et satanique boucan d’aéroport (cf. l’interview de Parvulesco dans A bout de souffle), et c’est un espace dans lequel on s’acclimate et s’ennuie instantanément. C’est ce qui explique le succès de l’américanisation ou de la mondialisation : on s’y habitue instantanément. Richard Bandler, un des fondateurs de la PNL me raconta un jour qu’en Afrique on avait recours au psychiatre une fois qu’on y avait installé l’eau courante. L’eau des fontaines et des riantes conversations ne coulerait plus. Pensez au destin de Farrebique ou du village de Manon des sources, tournée dans une banlieue de Marseille…
La date choisie par Buñuel pour nous régaler de cet opus magique et définitif fait rêver.
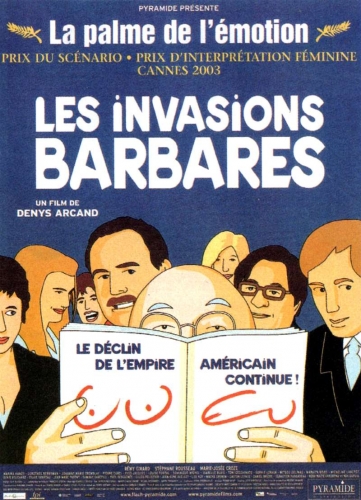
Je me souviens que dans ses provocantes (et bizarrement tolérées, plus que les films suivants) Invasions barbares, notre français du Canada Denys Arcand fait intervenir un prêtre québécois qui explique à une agente de Sotheby (ou de Christie’s) que la religion a disparu (et la pratique religieuse donc) EN QUELQUE MOIS vers 1966-67. Tout cela sent bon son 666 et son Québec libre.
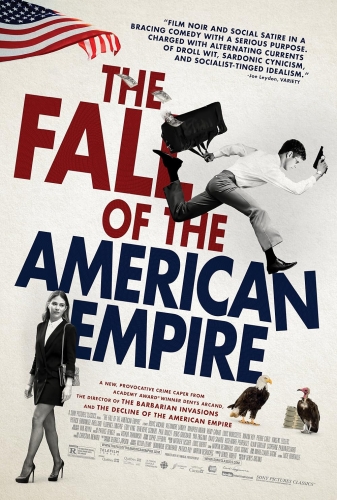
J’étais enfant, je peux en témoigner: tout disparaissait en quelques mois ou en quelques années (depuis il n’y a plus rien à détruire) ; on est passé, pour rester en bons termes avec le cinéma, de la civilisation de la Renaissance à la civilisation du cul (début de Pierrot le fou) et de la France de Jean Gabin à celle de Jean Yanne. Tout cela sous la houlette du gendarme hystérique Louis de Funès (voyez mon livre sur la destruction de la France au cinéma) et de celui qui voulait faire une France great again. On sait comment ça se termine.
Sources:
https://www.dedefensa.org/article/bunuel-et-le-grand-nean...
https://www.amazon.fr/DESTRUCTION-FRANCE-AU-CINEMA/dp/B0C...
17:19 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : déclin, nicolas bonnal, luis bunuel, cinéma, christianisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Les enseignements des législatives allemandes

Les enseignements des législatives allemandes
par Georges Feltin-Tracol
Le 23 février dernier, soixante millions et demi d’Allemands votaient pour désigner leur nouveau Bundestag, suite à la dissolution de la vingtième législature prononcée le 27 décembre 2024 par le président de la République fédérale.
L’élection se déroule selon un mode de scrutin mixte original. Chaque électeur détient deux voix. Sur le même bulletin de vote se présentent deux colonnes. La première concerne le mandat direct: 276 circonscriptions au scrutin majoritaire uninominal à un seul tour. La seconde porte sur une liste présente au niveau du Land, soit 354 sièges répartis à la proportionnelle selon la méthode de Sainte-Laguë qui favorise les minorités. L’électeur coche donc à deux reprises sans forcément choisir la même formation politique. L’accès au Bundestag suppose d’obtenir 5% au niveau fédéral ou bien de gagner trois mandats directs qui annulent ce seuil. Il est enfin possible pour une personne d’être à la fois candidate à un mandat direct et de figurer sur une liste régionale.
Une participation de 82,54%, soit près de six points et demi de hausse, marque ces élections anticipées. Il faut remonter aux législatives de 1987 pour observer un si fort engouement civique. La brièveté de la campagne électorale n’a pas empêché un réel intérêt accru par les attentats islamistes allogènes à la voiture et au couteau. La tendance finale confirme une fragilisation partielle du consensus outre-Rhin.
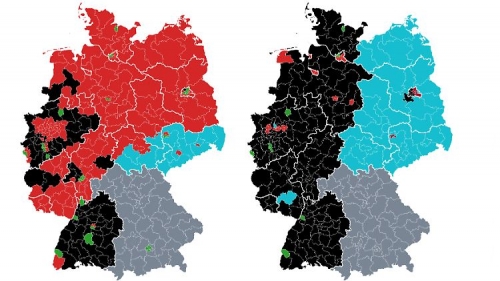
Résultats des élections de 2021 (à gauche) et de 2025 (à droite).
Les listes de la coalition CDU – CSU arrivent en tête avec 28,52%. Certes, elles remportent l’élection, mais leur résultat se trouve en dessous des 30% prévus par les sondages. Pressenti pour devenir le prochain chancelier fédéral, Friedrich Merz est dès à présent vulnérable, car ses 208 députés n’arrivent pas à la majorité absolue de 316 sièges.
Le chancelier sortant, le social-démocrate Olaf Scholz, perd son pari de conserver son poste. Avec 16,41%, le SPD réalise la plus mauvaise contre-performance électorale de son histoire. Perdant 86 sièges, les 120 heureux élus vont sûrement exiger quelques comptes à Scholz qui, tel un Biden obstiné et têtu, n’a pas voulu renoncer au profit de l’actuel ministre de la Défense, Boris Pistorius, plus populaire que lui d’après les enquêtes d’opinion.

Les libéraux-démocrates du FDP sortent du Bundestag avec 4,33 %. Dès l’annonce des premières tendances désastreuses, leur chef de file, Christian Lindner (photo), a démissionné de la présidence du parti et quitté la vie politique active. Ce vote confirme le déclin du FDP qui n’est plus représenté que dans neuf Länder sur seize. Bien que perdant 33 sièges, les Verts restent relativement stables (11,61% et 85 députés). Leur programme belliciste en politique étrangère et liberticide en politique intérieure ne gêne pas leurs électeurs nantis désormais, bien souvent retraités. Certains responsables Verts seraient néanmoins favorables à une entente gouvernementale avec Friedrich Merz. Mais cette hypothétique alliance noire – verte impliquerait un gouvernement minoritaire.
Toute la médiacratie occidentale bien-pensante s’indigne des 20,80% de l’AfD. Fondée en 2013, elle avait fait cette année-là 4,70% et aucun élu, puis 12,60% en 2017 (94 sièges) et 10,30% (83 sièges) en 2021. Dorénavant principale force d’opposition, l’AfD consolide sa domination dans l’ancienne RDA où elle rafle la quasi-totalité des mandats directs.

Son co-président Tino Chrupalla (photo) récolte par exemple 48,90% dans sa circonscription de Görlitz en Saxe. Exclu du groupe Europe des nations souveraines au Parlement de Strasbourg – Bruxelles pour un simple point de vue historique non conforme, Maximilian Krah remporte lui aussi un mandat direct (44,20%) à Chemnitz toujours en Saxe. Il appartient bien au groupe AfD. Toutefois, certains sondages pronostiquaient l’AfD à 22%. Fondée par des conservateurs – libéraux hostiles à l’euro et à l’intervention des États pour sauver le système financier en 2008 et la Grèce au début des années 2010, l’AfD reste plus que jamais ambivalente. La structure fédérale allemande influence l’organisation des partis politiques eux aussi fédéraux. Ainsi, dans l’AfD coexistent-ils la libertarienne Alice Weidel, le catholique de tradition Maximilian Krah, et Björn Höcke à la sensibilité identitaire plus affirmée. Ces deux derniers n’apprécient guère le tropisme trumpien de la direction plutôt nationale-libérale...


Maximilian Krah (en haut) et Björn Höcke (en bas).
Les nationaux-conservateurs de l’Alliance Allemagne n’obtiennent que 0,20% et ceux de l’Union des valeurs, une scission nationale-libérale de la CDU, 0%. Elle ne se présentait qu’en Rhénanie du Nord – Westphalie. Quant à Heimat, le nouveau nom du NPD (Parti national-démocrate d’Allemagne), il n’a pas pu participer au scrutin. Déjà privé pour cinq ans de tout financement public, ce mouvement national radical subit l’hostilité permanente du Régime et de ses sbires médiatiques. En outre, les conditions pour se présenter sont problématiques. Tout candidat aux législatives doit recueillir au préalable un nombre précis de parrainages de citoyens. Vu le climat de haine anti-nationale actuel, rares sont les Allemands prêts à signer pour les valeureux militants de Heimat. La liberté de candidature est donc biaisée et restreinte sans que cette infamie ne suscite la préoccupation du Conseil de l’Europe et de l’Organisation de sécurité et de coopération en Europe qui préfèrent dénoncer Tbilissi ou Budapest. En revanche, l’AfD ne risque plus l’interdiction, d’autant qu’elle bénéficie désormais du soutien tacite de l’administration Trump. La rencontre entre Alice Weidel et le vice-président JD Vance en fait foi.

La véritable surprise de ces élections revient cependant à Die Linke (8,77 % et 64 sièges). Les sondages la plaçaient en dessous des 5% fatidiques. Cette formation de gauche radicale qui prône l’immigration à outrance, a su tirer partie dans les dernières semaines de campagne de l’aura médiatique acquise par sa co-tête de liste Heidi Reichinnek (photo, ci-dessous) à travers des discours délirants d’antifascisme.

Plus inquiétant encore, maints primo-votants de 18 à 25 ans ont préféré Die Linke. Cinq – six ans auparavant, ces jeunes adultes manifestaient tous les vendredis à l’appel de « Sacrée Greta Thunberg » pour le climat, la planète et l’école buissonnière. Ce vote puéril en faveur des héritiers du communisme est-allemand provient en outre du bourrage incessant des crânes dans un système éducatif allemand largement déficient.
La remontée surprenante de Die Linke efface l’Alliance Sahra Wagenknecht (BSW) qui frôle les 5% avec 4,90%. Il aurait été exceptionnel qu’un parti lancé en janvier 2024 accède si tôt au Bundestag. Par ailleurs, BSW paie ses compromissions dans les Länder du Brandebourg et de Thuringe. Un mouvement estampillé anti-Système peut-il collaborer au sein des gouvernements régionaux avec la CDU et le SPD? Cet échec ne marque pourtant pas sa fin. BSW pourrait bientôt s’appeler l’Alliance pour la Sécurité et la Prospérité.
Pendant la campagne électorale, Friedrich Merz a vivement critiqué le SPD avec qui il devrait maintenant négocier un partenariat de gouvernement. En dépit de leur claque cinglante, les sociaux-démocrates deviennent des faiseurs de roi. Or bien peu d’entre-eux apprécient le président de la CDU. Ses prises de position jugées « droitières », son passé d’homme d’affaire millionnaire, son avion privé qu’il pilote le rendent antipathiques auprès des électeurs du SPD, des Verts et de Die Linke. Former une éventuelle coalition ne sera pas simple à moins que Merz renonce à son programme en matière d’immigration, de sécurité publique et de budget. Conscient de ces difficultés, il souhaiterait que l’actuel Bundestag qui, bien que dissout, n’en poursuit pas moins ses travaux, adopte avant l’entrée en fonction du nouveau un fonds spécial consacré à la défense et à l’armement. Il craint qu’avec la configuration politique à venir, ce fonds soit retoqué par la minorité de blocage exercée par l’AfD et Die Linke.

Plutôt que de rechercher une nouvelle « grande coalition » avec un SPD déchu, Friedrich Merz devrait solliciter l’AfD qui partage un libre-échangisme (l’AfD soutient l’accord de commerce avec le MERCOSUR) et un anti-merkelisme carabiné. Grand rival d’Angela Merkel au début des années 2000, Friedrich Merz renonça à la politique en 2009 avant d’y replonger en 2018 sur des thèmes libéraux et conservateurs. En brisant le « cordon sanitaire », il donnerait l’occasion aux membres de l’AfD de prouver leur valeur, leur sérieux et leur compétence à la tête de ministères majeurs. À diverses reprises, les conservateurs autrichiens l’ont fait avec le FPÖ qui perdit très vite et pour de courtes périodes sa dynamique auprès des électeurs. Mais il est exact qu’une pesante tyrannie mémorielle empêche toute transgression politique audacieuse en Allemagne. Le changement attendra.
GF-T
- « Vigie d’un monde en ébullition », n° 146, mise en ligne le 5 mars 2025 sur Radio Méridien Zéro.
14:57 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : affaires européennes, politique, actualité, europe, allemagne, législatives allemandes 2025 |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 08 mars 2025
La guerre secrète de Biden: saper la Syrie et Trump

La guerre secrète de Biden: saper la Syrie et Trump
Le coup d'État anti-Assad en Syrie a été orchestré par l'administration Biden avec l'implication active d'Erdoğan par le truchement des mandataires globalistes d'Al-Qaïda.
Alexander Douguine
Le coup d'État anti-Assad en Syrie a été orchestré par l'administration Biden avec l'implication active d'Erdoğan par le truchement des mandataires globalistes d'Al-Qaïda. L'objectif principal était de montrer la faiblesse de la Russie et de désinformer Trump à ce sujet. C'était un piège pour Trump.
La Syrie sous al-Sharaa n'a aucune chance de survie. Ce n'est pas un gouvernement, mais un spectacle globaliste qui ne durera que très peu de temps. Après le premier choc encaissé suit au départ d'Assad, viennent les conséquences inévitables. Les intérêts turcs, israéliens, sunnites, alaouites, chiites et kurdes en Syrie sont très différents les uns des autres.
En fait, c'est tout le contraire et le contraire de tout. La rupture, que provoquera la guerre civile, révèlera que personne ne pouvait éviter. Encore moins al-Sharaa.
Pam Bondi adopte une position antipopuliste en commentant l'affaire Epstein. Première déviation par rapport aux promesses électorales. Je ne sous-estimerais pas le peuple américain. Il veut connaître la vérité. Quoi qu'il en soit.

L'implication d'Erdoğan dans le coup d'État syrien a été une erreur stratégique. Cela ouvre la boîte de Pandore pour la Turquie. Pas seulement dans leur confrontation avec les Kurdes, mais aussi celles qui les opposent aux Arabes sunnites, aux salafistes, aux chiites, enfin à la Russie qui est durement touchée par ce mouvement. Israël ne travaille que pour ses propres intérêts.
Israël n'aidera pas la Turquie lorsque le moment difficile viendra, or il viendra.
Le mouvement trumpiste MAGA se forme de plus en plus comme un sujet politique et idéologique consolidé. Il acquiert de nouvelles caractéristiques. De nouveaux débats au sein du mouvement MAGA sont inévitables. L'un d'eux sera: sionisme inconditionnel ou non ?
Trump lui-même, Bannon, Hegseth sont plutôt des sionistes chrétiens, mais des figures comme Jeffrey Sachs, Mearsheimer, Alex Jones, Candace Owens et bien d'autres ont une opinion totalement différente. Il est intéressant de se demander: que pense Peter Thiel de cette question ?
L'hésitation à dévoiler la liste complète d'Epstein peut être liée au même choix : soutien total et inconditionnel à Israël (son implication probable dans l'opération "Île" pose certains problèmes) ou une attitude plus équilibrée et objective.
13:20 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : syrue, turquie, états-unis, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
La "menace de guerre", le RN et LFI

La "menace de guerre", le RN et LFI
Claude Bourrinet
Source: https://www.facebook.com/profile.php?id=100002364487528
Après avoir encouragé la guerre contre l’« agresseur » russe et le « dictateur » Poutine, après avoir consenti à un armement massif des Ukrainiens, et avoir de ce fait conforté un pouvoir clairement dictatorial à Kiev à teinture nettement néonazie, après avoir en grande partie repris la propagande déclamatoire de l’Otan et de Bruxelles, voire de Macron, à propos de cette guerre, le RN, par la voix de son vice-président, Sébastien Chenu (photo), semble changer d’appui, comme un dribbleur footeux qui esquive un adversaire, ou plutôt, tel il a toujours été, c’est-à-dire un parti électoraliste qui tire des bords à vue, selon les vents et les récifs, le principal étant d’atteindre enfin le port bénit du pouvoir.

Non que ce cynique ne dise vrai, mais l’on sait que la « vérité », enchâssée dans un écrin de mensonges, n’est là que pour servir d’alibi. En effet, son analyse ne manque pas de pertinence. Il déclare ne pas croire « du tout » au « scénario » des Russes aux portes de la capitale française, et à l’invasion de la Moldavie et de la Roumanie. Il est certain que Macron remue des peurs historiques, la mémoire de nos défaites humiliantes, apocalyptiques, telles qu’on les a connues en Juin 40, avec les Allemands dans les murs de Paris, ou en 1814, avec ces mêmes Russes, qui, selon Macron, nous « touchent ». Il a bien identifié le véritable dessein du Machiavel au petits pieds qui se moque de la France, et qui sait qu’on renforce son pouvoir quand on angoisse le peuple.
Chenu aurait pu de surcroît rappeler les épisodes du COVID, du confinement, du couvre-feu, les contrôles de papiers dans la rue, à chaque instant, qui nous faisaient revivre les heures sombres de notre histoire, comme on a l’habitude d’ânonner. Il se garde bien aussi de préciser que cette terreur a été plusieurs fois instillée sciemment, par exemple en prévoyant la fin du monde du fait d’un réchauffement climatique épouvantable, et aussi par l’agitation itérative du danger terroriste, de l’islamisme, menace sur laquelle nous reviendrons. Il aurait pu ajouter que cette stratégie de la tension ne vise pas seulement à faire accepter le fédéralisme européen, et l’abandon de notre souveraineté militaire, mais à organiser méthodiquement, depuis une dizaine d’années, un savant maillage policier de surveillance, de contrôles, d’encadrement de la population, qu’accompagnent une propagande de plus en plus pressante et une censure, voire une répression, de plus en plus féroces.

Mais de cela, nul mot. Le RN n’a jamais dénoncé la dictature qui est en train de se mettre en place, aussi bien dans notre pays que dans l’Union européenne, en Roumanie, par exemple, où les élections ont été annulées, où les opposants anti-Bruxelles et anti-Otan sont soumis à des mesures policières. C’est le cas en Allemagne, et on sent bien que la France est sur le point de basculer dans une politique plus qu’autoritaire.
Il est évident aussi, et il a raison sur ce point, qu’une telle montée d’adrénaline guerrière, pour autant qu’elle corresponde à quelque chose de sérieux (l’Europe a-t-elle les moyens de faire la guerre à la Russie?) vise à cacher les problèmes qui fâchent. Et là, Chenu ratisse dans sa clientèle : l’insécurité, l’immigration, les finances publiques, le Mercosur « qui tue nos agriculteurs ». Histoire de nous rappeler que ce parti bourgeois, qui aspire au gouvernement de la France avec les mêmes moyens autoritaires (et peut-être les mêmes ruses) que Macron, n’est pas avare de démagogie. On voit bien que des partis anti-immigrationnistes comme ceux de Meloni et d’Orban, on consenti à l’importation massive d’immigrés, ou à leur régularisation, dans le cas de l’Italie, tout simplement parce que l’Europe ne fait plus d’enfants, et qu’elle manque de main-d’œuvre. Il n’est qu’à écouter Orban : pour cette fois, ce n’est pas von der Leyen qui s’exprime.
En ce qui concerne le conflit en Ukraine, Chenu rappelle à bon escient les principes gaullistes : "Le budget de la défense française doit être financé par de l'argent français au bénéfice des Français", et "les Français doivent disposer d'une défense nationale propre pour défendre leurs intérêts ». En outre, "la France doit avoir une position indépendante et équidistante", et doit constituer l'un des "moteurs" dans un processus de paix entre l'Ukraine et la Russie.
On peut lui rétorquer que ce beau programme est maintenant obsolète, que la France, grâce à Macron, mais aussi à des séries d’assentiments médiatiques ou parlementaires visant à créditer l’appui à l’Ukraine de l’approbation de la quasi totalité des partis, ont convaincu les Russes que la France était finie comme puissance et comme interlocutrice légitime. Il est impossible dans les années qui viennent de recouvrer notre autorité, notre prestige, c’est-à-dire notre voix.
Il n’en demeure pas moins qu’au-delà de l’hypocrisie de Chenu et du RN, qui ont ouvertement appelé à combattre ce grand méchant de Poutine, sans compter les élans d’amour à l’égard des Américains, ce pseudo-parti soi-disant d’opposition a vu juste: les Français, si les choses deviennent concrètes, et qu’une mobilisation s’esquisse pour aller, la fleur au fusil, jusqu’à Moscou, regimberont. Sans doute faut-il faire la part, dans cette réticence, à l’amollissement d’une population vieillissante rongée par l’hédonisme consumériste et la peur de mourir, mais il faut accorder tout de même au peuple le sentiment plus ou moins conscient que cette guerre n’est pas la sienne.

Toujours est-il que LFI a encore perdu une occasion d’emprunter un boulevard qui lui était ouvert. Il semble évident que l’hostilité à la guerre va devenir « payante » électoralement. Or, on notera la surprenante discrétion de l’organisation de Jean-Luc Mélenchon, pourtant si hâbleur d’habitude. Et pour cause. D’abord, le parti est partagé, et si quelques-uns, dont peut-être le leader maximo, voient assez clair sur ce qui s’est passé à l’Est, à savoir que la Russie n’avait pas tout à fait tort d’intervenir, d’autres se sont abstenus prudemment de prendre position, et enfin une frange a appuyé l’Otan, en croyant bêtement au narratif propagandiste et manichéen des médias du système.
C’est bien là une des tares de la gauche contemporaine, bien plus niaise que ne le fut la gauche communiste, qui avait au moins un instrument d’analyse assez réaliste dans le marxisme et le concept de lutte des classes, et ne tombait pas – sinon pour s’en servir cyniquement - dans le moralisme plat et imbécile. Mais il semblerait que la dichotomie entre le Bien et le Mal fût devenue maintenant la science suprême de l’analyse politique à gauche, surtout dans le domaine des affaires étrangères.
Ajoutons à cela que LFI n’a pas intérêt à s’en prendre réellement à Bruxelles et à l’UE, qui défendent une politique immigrationniste massive, sans compter l’appui institutionnel, financier, et propagandiste au lobby lbgt. On ne scie pas une branche qu’on a enfourchée.
Revenons à Chenu. On notera qu’il n’a pas évoqué l’Amérique, qui est quand même le principal metteur en scène de ce qui s’est passé en Ukraine depuis une vingtaine d’années, et surtout depuis douze ans, depuis le putsch de Maidan. Il n’a pas non plus rappelé que l’achat volumineux d’armes se fera au profit du complexe militaro-industriel yankee, et que la guerre contre la Russie a correspondu au projet américain de ruiner l’Europe.
D’autre part, il n’a pas manqué d’entonner l’antienne obsessionnelle du RN qui, il faut bien le dire, a été rejoint sur ce terrain par un personnel politique de plus en plus tenté par la rhétorique d’extrême droite. Chenu dit bien que Poutine n’est pas le « danger principal » pour la France, ce qui laisse sous-entendre qu’il est quand même une menace, et qu’il s’agit encore de le combattre (on se garde bien, quand même, de quitter le rail qui conduit au pouvoir – atlantiste -. Courage n’est pas témérité !). Il aurait été bien plus judicieux d'insister sur ce que l'on aurait à gagner si la Russie redevenait une partenaire privilégiée. Mais, pour lui, le « danger principal", évidemment, est le « terrorisme » et l’« islamisme ».
Le problème, avec des mensonges simplistes et démagogiques tirés comme des pistolets de western, c’est qu’il faut des pages pour les désarmer, et qu’ils produisent tellement de réactions épidermiques, conditionnés, confits d’adrénaline, qui est fort difficile de faire entendre raison (la raison, en politique ? Vous plaisantez!), et de ne pas susciter des conclusions réductrices. Si l’on dit que le « terrorisme » est finalement assez rare, et que, par exemple, dans les pays occidentaux, les massacres occasionnés par des créatures qui pètent les plombs, et qui sont souvent « blanches » de souche « caucasienne » comme on dit aux États-Unis, on vous dit que c’est faux, ou que vous être complice. Si vous faites remarquer que le terrorisme de masse qui, probablement, est à l’origine des répliques dont l’on a souffert, ici, a été perpétré, par exemple, en Irak, où des centaines de milliers de civils ont été bombardés ou affamé par la libre « démocratie » occidentale, et que la non moins « morale » armée israélienne a exécuté froidement des dizaines de milliers de femmes et d’enfants, on vous fera un procès de collusion avec l’ennemi de notre civilisation judéo-chrétienne. Il est évident qu’en reprenant cette terminologie violemment connotée, un Chenu, qui soutient énergiquement le Likoud, et a pour l’Amérique les yeux de Chimène, fait d’une pierre deux coups : il s’assure d’un appui pour parvenir au pouvoir (il est toujours profitable, dans ce cas, d’être dans le camp des puissants), et il flatte un public électoral qui raffole de ce verbiage simpliste et bas, et qui, de toute façon, ne pense pas (ce qu’au RN on sait pertinemment).
La menace principale, il faudrait enfin le reconnaître, n’existe plus. On ne peut « menacer » un corps mort. La France non seulement n’est plus chrétienne, et donc qu’elle ne court pas le risque de voir une « civilisation » - qui n’existe plus – voler en éclats sous les coups de boutoir d’un islamisme fantasmatique, mais elle est décédée depuis des lustres, tuée, empoisonnée, achevée par l’américanisation. Le vrai « Grand Remplacement », c’est ça. Le « peuple » a consenti à son euthanasie pour un paradis artificiel, celui de la marchandise toxique, du spectacle abrutissant, de l’existence ramollie des esclaves volontaires. Les Français ont accepté que leur nation sorte de l’histoire, car cette dernière, si l’on veut être à son niveau, exige lucidité, courage, sacrifices, abnégation, virilité. Et ces qualités, les Russes les ont encore.
12:59 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, bellicisme, europe, france, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 07 mars 2025
Les grèves ont toujours existé...

Les grèves ont toujours existé...
Jan Huijbrechts
Quelle: https://www.facebook.com/jan.huijbrechts.9
Les prochains jours, semaines et peut-être même mois seront largement marqués par l’agitation sociale, avec des manifestations et des grèves contre les projets du gouvernement De Wever. Cela pourrait vous surprendre, mais les grèves ont existé de tout temps. La plus ancienne grève documentée de l’histoire a eu lieu pendant la construction des pyramides de Khéops, quelque part entre 2551 et 2472 avant notre ère. Lorsque les ouvriers de cet immense chantier ont constaté que leurs rations contenaient de moins en moins d’ail – l’assaisonnement local par excellence – ils ont spontanément cessé le travail. Mille ans plus tard, leurs descendants, qui bâtissaient plusieurs monuments pour le pharaon Ramsès III dans la Vallée des Rois, se mirent en grève après de graves retards dans l’approvisionnement alimentaire. Ils ne reprirent leurs marteaux et leurs burins qu’après la résolution définitive de ces problèmes.
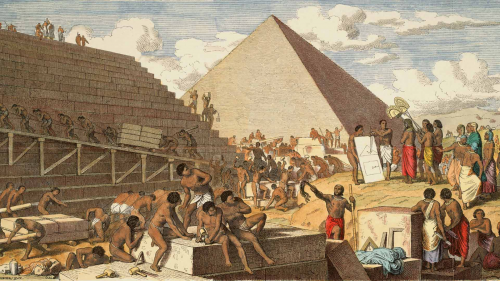
Dans la Rome antique existait la secessio plebis, une forme d’action informelle exercée par les plébéiens – citoyens ordinaires, souvent agriculteurs ou artisans propriétaires de terres – dans leurs conflits avec les patriciens, la classe dirigeante. Les plébéiens cessaient le travail et quittaient massivement la ville avec leurs familles. Une tactique qui mettait les patriciens, dépendants de la plèbe, dans une position difficile et qui porta ses fruits pour la première fois en 495 avant notre ère. Cette grève visait le sévère homme d’État aristocratique Appius Claudius Sabinus Irregillensis et un droit réglementant les dettes, que l'on jugeait injuste. Ce n’est qu’après l’annulation de leurs dettes et l’octroi d’une partie du pouvoir patricien à un tribun du peuple représentant la plèbe que les grévistes revinrent à Rome et reprirent le travail. La secessio plebis, utilisée avec succès en 449 et 287 avant notre ère, s’imposa comme un puissant moyen de pression permettant aux plébéiens d’obtenir davantage de droits et de lois en faveur du peuple.
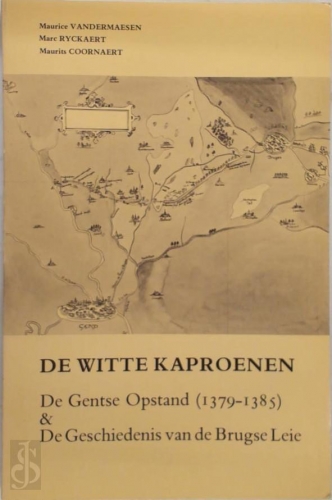
Durant le Moyen Âge tumultueux, l’Europe fut le théâtre de tensions socio-économiques récurrentes. Le comté de Flandre et le duché de Brabant se distinguèrent particulièrement par une agitation sociale qui, dans certains cas, déboucha sur de véritables révoltes. Jusqu’à la fin du 14ème siècle, lorsque les comtes de Flandre et les ducs de Brabant commencèrent à accorder des privilèges à leurs villes, les tensions politiques et sociales s’intensifièrent. La concentration de population, de pouvoir et de capitaux entraîna des conflits fréquents. Associé à une prise de conscience politique croissante, ce contexte donna naissance à une tradition quasi révolutionnaire dans les villes flamandes et brabançonnes, où la grève devint une arme redoutable. Dès 1240, on observe, notamment dans les grandes villes, les premières grèves. Les travailleurs – en particulier les fileurs, foulons, tisserands et teinturiers – mirent en place des bussen, sortes de caisses de solidarité destinées à venir en aide aux familles de compagnons décédés. Les autorités, craignant qu’elles ne servent aussi de caisses de grève, interdirent ces fonds. Cette crainte était fondée: après 1302, les guildes et corporations gagnèrent non seulement en autonomie, mais aussi en pouvoir politique. Elles soumirent des pétitions ou des lettres de doléances aux autorités et organisèrent des manifestations. Ces actions étaient souvent suivies de grèves ou de takehans, des confrontations directes avec les pouvoirs en place. Lorsqu’un arrêt de travail se produisait, on parlait de ledichganck. Parfois, les travailleurs organisaient une uutganck, une « sortie » massive vers une autre ville, comme les plébéiens romains lors de la secessio plebis. Pour éviter l’anarchie et le chaos, les villes conclurent des accords interdisant l’accueil d’ouvriers en grève venus d’ailleurs.
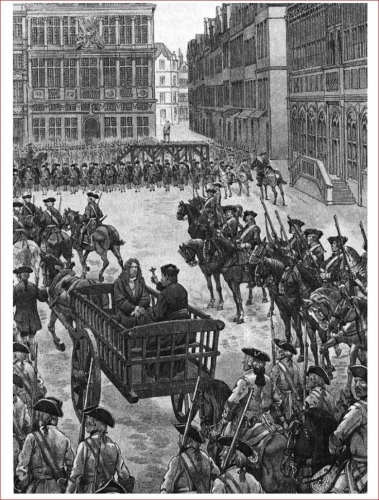
Sous l’Ancien Régime, la grève demeura un instrument de lutte sociale. L’exemple le plus célèbre est celui des grèves du printemps 1717 à Gand, Anvers, Malines et Bruxelles contre les nouvelles taxes exorbitantes imposées par les autorités de Vienne à nos provinces. À Bruxelles, les doyens des nations et des guildes invoquèrent les anciens privilèges urbains pour rejeter catégoriquement ces impôts. Lorsque cette vague de grèves menaça de se transformer en révolte ouverte, la ville fut occupée par les troupes impériales et une répression brutale s’ensuivit. Cela n’empêcha pas une nouvelle grève en 1719, accompagnée d’émeutes. Pour rétablir l’ordre, cinq doyens des corporations bruxelloises furent emprisonnés pendant six mois, et l’un d’eux, Frans Anneessens, âgé de 60 ans, fut décapité sur la Grand-Place le 19 septembre 1719 pour son rôle de leader dans les troubles.
Les grèves furent totalement interdites par Napoléon Bonaparte, qui exécrait l’agitation sociale. Peu après la Révolution française, le 14 juin 1791, la loi Le Chapelier fut adoptée en France, supprimant les guildes et autres organisations professionnelles, interdisant les syndicats et criminalisant les grèves. Après l’occupation française de nos territoires, cette loi fut intégrée dans le Code Napoléon et appliquée ici aussi.
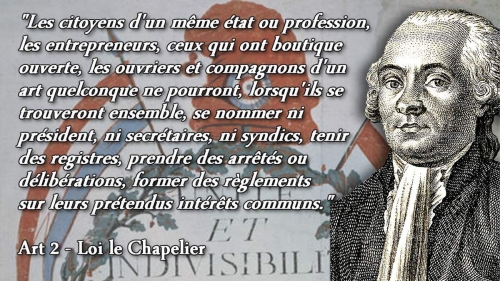
Dans la jeune Belgique, la loi Le Chapelier fut largement considérée – à juste titre – comme une atteinte au droit constitutionnel d’association et fut abrogée le 25 mai 1867. Cela ne signifiait cependant pas que les grèves étaient tolérées: l’article 310 du code pénal, qui remplaça la loi Le Chapelier, rendait toujours les grèves illégales. Cela n’empêcha pas la première vague de grèves, entre 1868 et 1880, souvent réprimée avec violence par la gendarmerie, l’armée et la garde civique. Ces confrontations sanglantes firent de nombreux morts.
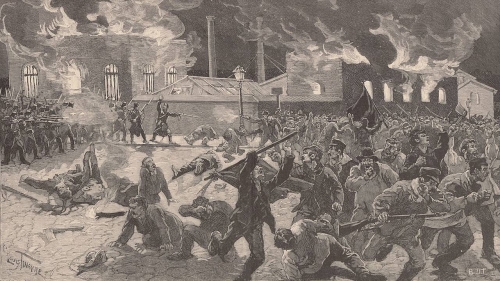
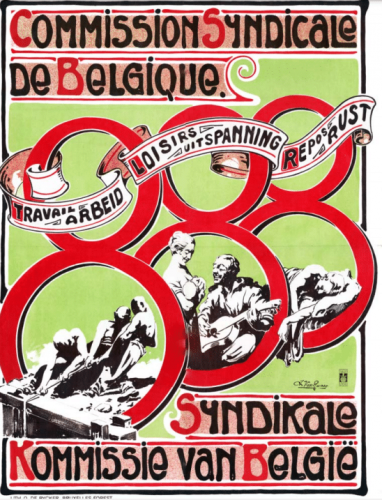
Avec la fondation du Parti Ouvrier Belge (POB) en 1885, la véritable organisation du mouvement ouvrier commença. Cette structuration exerça sans doute une pression supplémentaire, mais n’apporta pas immédiatement d’amélioration des conditions de travail ni des salaires, parmi les plus bas d’Europe.
Au fil des décennies suivantes, les syndicats eurent de plus en plus recours aux grèves générales ou massives, qui devinrent une composante essentielle de l’histoire sociale du pays. Les grèves générales de 1886, 1893, 1902, 1913, 1936, 1941, 1950, 1960-61 et 1993 mobilisèrent de larges pans de la population active. Ces actions débouchèrent souvent, mais pas toujours, sur des avancées sociales significatives.
21:27 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, grèves, mouvements sociaux |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Deux réflexions sur l'oeuvre de Henry Corbin
Deux réflexions sur l'oeuvre de Henry Corbin
Henry Corbin et les racines ésotériques de l'histoire
Troy Southgate
Source: https://troysouthgate.substack.com/p/henry-corbin-and-the...
Le philosophe français Henry Corbin (1903-1978) a été profondément influencé par L'Être et le Temps de Heidegger et s’est attaché à démontrer que la conscience ne peut être réduite à des forces physiques, sociales ou historiques. Il a ainsi développé une interprétation fascinante à la fois de l’espace et du temps. Concernant le premier, il affirme que nous n’existons pas dans l’espace tel que le suggèrent les positivistes newtoniens, mais que nous spatialisation le monde en accord avec la distinction faite par Heidegger entre l'existential (ce que signifie être) et l'existentiell (la vie dans une perspective profane). Comme l’explique Corbin :
"L’orientation est un phénomène primordial de notre présence au monde. Une présence humaine possède la propriété de spatialiser un monde autour d’elle, et ce phénomène implique une certaine relation de l’homme avec le monde, son monde, cette relation étant déterminée par le mode même de sa présence au monde. Les quatre points cardinaux, est et ouest, nord et sud, ne sont pas des choses rencontrées par cette présence, mais des directions qui expriment son sens, l’acclimatation de l’homme au monde, sa familiarité avec lui. Avoir ce sens, c’est s’orienter dans le monde."
Ainsi, notre manière d’interpréter l’espace n’est pas prédéterminée, en ce sens que nous devons nous adapter au monde et en tirer le meilleur parti, mais elle dépend plutôt de la façon dont nous nous concentrons sur l’acte de présence.
En ce qui concerne l’analyse du temps par Corbin, le penseur français s'inscrit dans la continuité de la philosophie de son homologue allemand en employant la notion heideggérienne d’historicité. Celle-ci constitue la structure ontologique cachée qui rend l’Histoire – et donc une temporalité plus fondamentale – possible. Si cela n’apparaît pas immédiatement, selon Heidegger, c’est en raison de la prédominance du monde profane. Même la culture, selon Corbin, renforce notre incapacité à percevoir ce qui se cache sous la surface du temps dans sa forme la plus basique et profane. Corbin rend hommage à la philosophie de Heidegger en ces termes :
"Je dois dire que le cours de mon travail a pris naissance dans l’analyse incomparable que nous devons à Heidegger, mettant en évidence les racines ontologiques de la science historique et prouvant qu’il existe une historicité plus originelle, plus primordiale que celle que nous appelons Histoire Universelle, l’histoire des événements extérieurs, la Weltgeschichte, l’Histoire au sens ordinaire du terme […] Il y a le même rapport entre historicité et historicité qu’entre l’existentiel et l’existentiell. Ce fut un moment décisif."
Plus intéressant encore, l’inspiration que Corbin a puisée dans cette interprétation phénoménologique unique du temps l’a conduit à conclure qu’une structure ontologique cachée ne nous rend pas totalement impuissants et que tout repose sur deux possibilités : "se jeter dans le courant ou lutter contre lui". Ironiquement, Corbin rejette ces deux options, car se soumettre ou combattre revient à accepter les limitations de l’espace quantitatif. Il nous rappelle donc que les objets du monde sont à notre merci, et non l’inverse.
En refusant de reconnaître "l’historicité de l’Histoire", comme Corbin la décrit, nous validons ainsi une historicité impliquant "les racines secrètes, ésotériques, existentielles de l’Histoire et de l’historique". Autrement dit, c’est la seule méthode véritablement efficace pour mener une guerre spirituelle contre le passage linéaire du temps.
* * *

Henry Corbin et «l’Être-vers-l’Autre-Côté-de-la-Mort»
Troy Southgate
Source: https://troysouthgate.substack.com/p/henry-corbin-and-bei...
J’ai récemment mentionné que Henry Corbin avait été profondément inspiré par l’approche phénoménologique dans L'Être et le Temps (1927) de Martin Heidegger, mais pour Corbin, ce dernier n'était qu'une clé philosophique ouvrant la voie à une potentialité bien plus grande.
Bien que Heidegger ait évoqué l’idée selon laquelle le Da du Dasein renvoie à la présence effective de l’individu dans le monde, Corbin estime que la focalisation du penseur allemand sur la notion d’« être-pour-la-mort » est trop ancrée dans la finitude humaine et qu’elle enferme inévitablement la pensée heideggérienne dans une historicité incapable d’appréhender une question bien plus essentielle : celle de « l’être-vers-l’autre-côté-de-la-mort ».
Le fait que Heidegger ait consacré bien moins de temps à la question de l’éthique humaine, selon Corbin, l’empêche de réaliser que sa propre analyse du Dasein contient en réalité le secret fondamental qui permet de s’éloigner d’une interprétation purement séculière de l’histoire. Une fois les limites de « l’être-pour-la-mort » dépassées, la réunification de l’éthique et de l’ontologie aboutira à un sens plus profond de la présence, permettant ainsi à l’humanité de dépasser l’horizon de la finitude et de poser la question essentielle : « À quoi la présence humaine est-elle présente ? »
15:42 Publié dans Philosophie, Traditions | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : henry corbin, martin heidegger, philosophie, tradition, traditionalisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Warnig, un proche de Poutine, prévoit-il de relancer Nord Stream 2?

Warnig, un proche de Poutine, prévoit-il de relancer Nord Stream 2?
Elena Fritz
Source: https://www.pi-news.net/2025/03/plant-putin-vertrauter-wa...
Selon un rapport du Financial Times, le manager allemand et ancien patron de Nord Stream 2 AG, Matthias Warnig, serait à l'origine d'une relance du projet de gazoduc Nord Stream 2.
Un rapport publié dimanche par le Financial Times suscite le débat : Des plans pour relancer Nord Stream 2 sont à l'étude - avec la participation des Etats-Unis et d'un proche de Vladimir Poutine (voir: https://www.firstpost.com/world/putin-ally-backed-by-us-investors-pushes-plan-to-restart-nord-stream-2-pipeline-13867961.html). Matthias Warnig, ancien officier de la Stasi et directeur de Nord Stream 2 AG sous Gazprom jusqu'en 2023, est dans la ligne de mire (voir: https://www.n-tv.de/politik/Bericht-Putin-Vertrauter-will-Nord-Stream-2-wiederbeleben-article25599222.html). L'objectif serait d'entrer en contact avec l'équipe de Donald Trump via des hommes d'affaires américains afin de mettre fin à la guerre en Ukraine et de relancer les livraisons d'énergie en Europe. On en est encore au stade des discussions, mais les dimensions géopolitiques ne sont pas à négliger.

Warnig (photo), qui a des racines en RDA et des liens étroits avec le Kremlin, est cité comme principale force motrice de ce projet. Le Financial Times fait état de négociations officieuses avec l'entourage de Trump: la paix en Ukraine contre des livraisons de gaz - avec des avantages pour les Etats-Unis. Warnig nie tout rôle et renvoie à sa situation de personne sous sanction. Son passé d'acteur à l'intersection de l'Est et de l'Ouest fait toutefois de lui un candidat plausible pour de telles discussions, qui pourraient tout autant attiser les tensions que créer des opportunités.
Trump et les États-Unis : l'énergie comme outil stratégique
Dans l'équipe de Trump, Nord Stream 2 est considéré comme un levier potentiel - non seulement pour le gaz, mais aussi pour l'influence sur l'Europe et la Russie. Des investisseurs comme Stephen Lynch se montrent intéressés et un fonctionnaire américain parle d'une opportunité de « restaurer la confiance avec la Russie ». Le Financial Times interprète cela comme le signe d'un rapprochement avec Moscou et stylise presque Trump comme un traître aux valeurs occidentales - un récit qui rappelle la polarisation de l'élection de 2024. Mais il s'agit moins de trahison que de pragmatisme: les sanctions pourraient être assouplies afin de garantir des avantages géopolitiques.
En mars 2025, la CDU et le SPD allemands explorent la possibilité d'une coalition, après l'effondrement du gouvernement dit "feu tricolore". Friedrich Merz, chancelier potentiel, est confronté à des défis peu clairs - il n'est pas certain qu'il soit au courant des discussions relatives à Nord Stream 2. Sa ligne met l'accent sur la force économique et la distance à prendre vis-à-vis de la Russie, mais la SPD pourrait avoir d'autres priorités. En l'absence d'informations claires, Berlin reste réactif plutôt que créateur d'opportunités réelles - une situation qui affaiblit la position allemande, alors que de grandes puissances comme les Etats-Unis et la Russie pourraient tirer les ficelles du jeu.
L'Europe : entre dépendance et autonomie
L'UE suit ces développements avec inquiétude. Après s'être détournée du gaz russe depuis 2022, une nouvelle dynamique menace désormais - non pas par le seul jeu de Washington, mais par l'interaction de grandes puissances. Un diplomate de l'UE met en garde anonymement: « Nous pourrions être broyés entre les intérêts des Etats-Unis et de la Russie ». L'Allemagne, très marquée par le sabotage de Nord Stream 1, est confrontée à un numéro d'équilibriste: la coopération énergétique pourrait apporter de la stabilité, mais le prix à payer serait une érosion de sa propre capacité d'action.
Les discussions sur Nord Stream 2 reflètent un monde en pleine mutation. Trump poursuit des objectifs pragmatiques, Poutine utilise des réseaux éprouvés et l'Europe cherche sa place. Le Financial Times peut présenter Trump comme un déviant, mais le véritable drame réside dans la lutte entre les grandes puissances. Si les plans prennent forme, l'Ukraine pourrait devenir un enjeu de négociation, tandis que l'UE perdrait de son poids. Pour l'Allemagne, ce serait une épreuve de force entre coopération et autonomie - sans que Berlin ne prenne pour l'instant l'initiative.
Perspectives d'avenir : Un terrain de jeu ouvert
Nord Stream 2 n'est pas encore un fait, mais les discussions dessinent les contours d'un nouvel ordre. Il s'agit d'énergie, d'influence et de savoir qui fixe les règles du jeu. Trump et Poutine pourraient forger un axe, tandis que l'Allemagne et l'UE hésitent entre adaptation et résistance.
Cette évolution le montre : la géopolitique est un jeu de pouvoir dans lequel les valeurs ne sont souvent que des décors - et les prochaines étapes pourraient marquer le monde de manière durable.
14:59 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nord stream, matthias warnig, allemagne, europe, affaires européennes, gaz, hydrocarbures |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Les politiques de Donald Trump et les analogies historiques

Les politiques de Donald Trump et les analogies historiques
Leonid Savin
Après le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, de nombreuses comparaisons avec les précédents présidents américains ont commencé à être énoncées. Pour la plupart, les commentateurs ont souligné que c'était la deuxième fois qu'un candidat ayant fait une pause entre deux mandats présidentiels devenait président pour un second mandat. La première fois, c'était avec Stephen Grover Cleveland (1885-89 et 1893-97, qui fut respectivement le 22ème et 24ème président). La comparaison avec Cleveland s'arrête là. Il s'agissait d'ailleurs d'un représentant du parti démocrate.
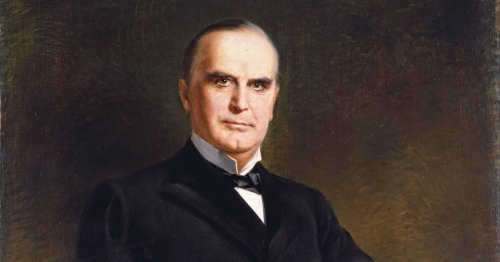
Le sociologue argentin Atilio Boron a attiré l'attention sur un autre personnage: William McKinley (tableau, ci-dessus), président des États-Unis de 1897 à 1901, qui a succédé à Cleveland. Et les comparaisons ne manquent pas. McKinley était un républicain et, sous sa présidence, les États-Unis ont considérablement accru leur puissance régionale. Les îles Hawaï ont été annexées, une guerre avec l'Espagne s'en est suivie et Washington a pris le contrôle de Porto Rico, de Guam, des Philippines et de Cuba. L'histoire de Cuba, qui menait à l'époque une guerre d'indépendance contre l'Espagne, est particulièrement intéressante. Les patriotes cubains n'ont pas demandé l'aide des États-Unis, car ils savaient comment cela pourrait tourner (Jose Marti, qui est mort au début de la troisième guerre d'indépendance, avait également mis en garde contre cette éventualité). En février 1898, les États-Unis ont introduit le cuirassé Maine dans la baie de La Havane, qui a étonnamment explosé quelques jours plus tard. Bien entendu, l'Espagne a été blâmée, même si elle a pris une part active à l'enquête.
La bravade similaire de Trump concernant la possibilité de prendre le contrôle du canal de Panama, d'acquérir le Groenland et d'incorporer le Canada aux États-Unis offre certains parallèles avec les activités de McKinley.
Dans l'ensemble, pour les pays d'Amérique latine dans le cadre de la stratégie de la Doctrine Monroe 2.0, cette comparaison entre Trump et McKinley a du sens.
Bien qu'il existe un autre personnage plus proche de Trump, à la fois dans l'esprit et dans le temps. Et du côté de la Russie, à la lumière des expériences négatives, il suscite également une certaine méfiance. Il s'agit de Ronald Reagan. D'ailleurs, Trump a connu Reagan personnellement et le considérait comme son idole politique. Quelles sont les comparaisons entre ces dirigeants?

Tout d'abord, tous deux étaient des outsiders politiques mais ont réussi à gagner les votes de la majorité des Américains. Tous deux ont fait l'objet de tentatives d'assassinat (Reagan a été plus gravement blessé que Trump, qui s'en est tiré avec une égratignure à l'oreille).
Et le slogan « Make America Great Again » nous vient de Ronald Reagan.
En outre, dans le domaine des guerres tarifaires, Reagan a imposé des droits de douane de 100% sur les produits électroniques japonais, restreignant ainsi efficacement le flux de marchandises en provenance de son satellite. Trump a fait la même chose, mais à plus grande échelle.
En outre, la déclaration de Donald Trump sur la nécessité de créer un « Dôme de fer pour l'Amérique » basé sur la révision du système de défense antimissile et l'implication de l'US Space Force (créée pendant le premier mandat présidentiel de Donald Trump) fait clairement écho à l'Initiative de défense stratégique de Ronald Reagan. Bien que datant des années 1980, cette initiative s'est soldée par un échec, les entreprises de défense en ayant profité. La détente avec l'Union soviétique a conduit à la réduction des armements, puis à l'effondrement de l'URSS. La défense contre les missiles nucléaires soviétiques n'était plus nécessaire, et les États-Unis ont directement contrôlé leur destruction, ainsi que le retrait des porteurs et des ogives existants de l'Ukraine, du Belarus et du Kazakhstan indépendants.
Les négociations actuelles entre les États-Unis et la Russie soulèvent également la question suivante: un scénario similaire pourrait-il se reproduire, lorsque Washington, animé de bonnes intentions, commence à recevoir des technologies russes (par exemple, des vecteurs hypersoniques) que les États-Unis ne possèdent pas? Ce n'est pas un hasard si, après les premiers pourparlers de Riyad, il a été question de coopération dans le domaine de l'espace. Les ressources constituent un autre intérêt possible pour les États-Unis et, là encore, les déclarations sur la coopération dans l'Arctique peuvent s'appuyer sur la position initiale de Washington.
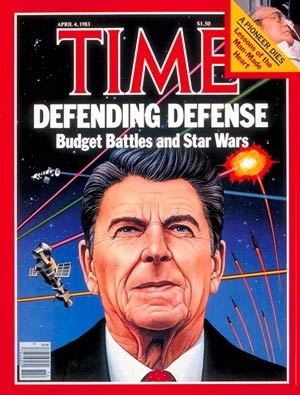
Il existe un autre point commun, non explicite mais très important dans la prise de décision. Il s'agit de la religion. Ronald Reagan et Donald Trump sont tous deux des presbytériens protestants, et gravitent dans des cénacles assez étranges. Par exemple, Reagan était exalté par une secte de dispensationalistes qui interprétaient la confrontation de la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS d'une manière particulière et liaient l'apocalypse à la guerre nucléaire. Selon ces croyances, les Américains élus par Dieu et certains Israéliens seraient miraculeusement sauvés après l'Armageddon, après quoi il y aurait une prospérité universelle. En général, le dispensationalisme dans ses diverses interprétations est devenu une sorte de religion civile aux États-Unis, où ses adeptes justifient toutes les actions de Washington en matière de politique étrangère, y compris les interventions militaires, parce que tout est fait « pour le bien de toute l'humanité ». Donald Trump a des opinions similaires, et son « confesseur » personnel est la télé-évangéliste Paula White. Cette pasteure en jupe dirige aujourd'hui le Bureau de la foi de la Maison Blanche.

À en juger par ses déclarations, ainsi que par les remarques faites lors d'une rencontre début février avec le Premier ministre Benjamin Natanyahu, elle appartient à un groupe de sionistes chrétiens. Et le soutien de Donald Trump aux actions d'Israël à l'égard des Palestiniens renforce le fait que les opinions religieuses sont à l'origine de certaines décisions politiques.
La différence la plus importante entre les politiques de Reagan et de Trump est peut-être la question des migrations. Le 6 novembre 1986, Ronald Reagan a promulgué la loi sur la réforme et le contrôle de l'immigration. L'effet le plus important de cette loi est qu'elle a permis aux immigrants entrés illégalement aux États-Unis avant le 1er janvier 1982 de demander un statut légal, à condition de payer les amendes et les impôts impayés. Cette disposition, que Reagan lui-même a qualifiée d'amnistie, a permis à environ 3 millions d'immigrants d'obtenir un statut légal en payant 185 dollars, en faisant preuve de « bonne moralité » et en apprenant à parler anglais.
Entre 1980 et 1990, période qui comprend les huit années de l'administration Reagan, la population américaine née à l'étranger est passée de 14,1 millions à 19,8 millions. Cette évolution s'est accompagnée d'une augmentation de 4 millions en provenance d'Amérique latine et de 2,4 millions en provenance d'Asie, et d'une baisse de près de 800.000 âmes venues d'Europe.
Donald Trump fait exactement le contraire. Dès les premiers jours de son second mandat présidentiel, des milliers de migrants illégaux ont commencé à être expulsés des États-Unis.
Il faut cependant noter que le contexte géopolitique était différent et que les objectifs, eux aussi, étaient différents. Sous Reagan, la naturalisation a eu lieu et les États-Unis ont accepté les migrants originaires de pays aux idéologies hostiles parce qu'ils étaient perçus comme des victimes du régime de leur pays. Aujourd'hui, la situation est différente et il semble y avoir un ensemble complexe de raisons derrière la décision de Trump. L'une d'entre elles est le coup porté à la base électorale des démocrates qui ont utilisé les sans-papiers pour étendre leur influence. Un thème connexe est également la corruption des dirigeants, une question qu'Elon Musk étudie activement en tant que chef du nouveau "département de l'efficacité".
Quoi qu'il en soit, ni sous McKinley ni sous Reagan, le monde n'était en paix, et les États-Unis ont pris des mesures sévères à l'encontre de leurs ennemis comme de leurs alliés. Il faut se préparer à un scénario similaire sous Donald Trump.
14:10 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : actualité, états-unis, ronald reagan, donald trump |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 06 mars 2025
Le cinéma et la prostration européenne
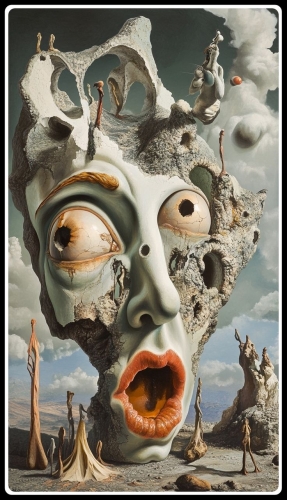
Le cinéma et la prostration européenne
Nicolas Bonnal
La vieille dame transie européenne rêve donc d’écraser, comme en 1941, et l’Amérique et la Russie et se suicide une nouvelle fois (voyez encore le livre de Laurent Guyénot sur la malédiction papale pour comprendre) en se pendant au premier joueur de bite venu, le nommé Zelenski. On ne sent aucune opposition autre que minoritaire poindre dans le vieil incontinent et on se demande si on rêve. Non, on fait on vit dans un continent zombi depuis longtemps, fils de Kafka, de Kubin et de Céline (autre auteur fantastique), et on ne fait qu’attendre la fin de la pièce. La société mortifère décrite par Chateaubriand après 1815 finira bien par crever et on laisse de vraies grandes puissances, l’Amérique ou la Russie, le soin de remodeler le monde, même si le résultat n’est ni brillant ni ragoutant.
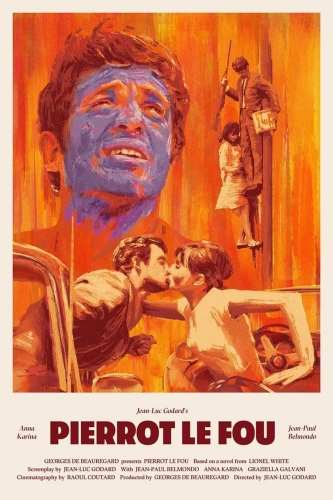
Une nouvelle fois le cinéma permet de bien saisir les choses. L’Europe est depuis longtemps, depuis très longtemps même, la terre de la prostration en matière de cinéma. On aime l’ennui, l’existentialisme, le sexe cheap, la bonne déprime, la pleurnicherie humanitaire, bref on se plonge dans le « qu’est-ce qu’on peut faire ? » du Pierrot le fou de Godard quand la gourde Karina arrive au bord de l’amer et commence à casser les pieds à son Jules.
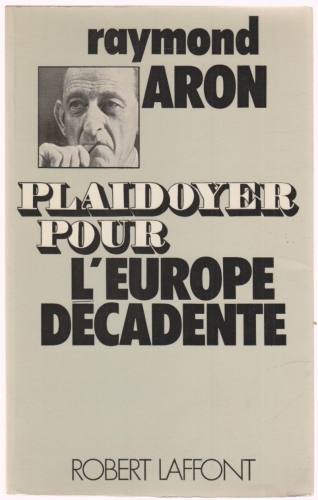
Dans les années soixante Raymond Aron, toujours aussi peu inspiré, avait publié un pensum universitaire de plus (les livres universitaires sont ceux qui vieillissent le plus vite dans l’Histoire, n’en ayant jamais fait partie) intitulé Plaidoyer pour l’Europe décadente. Mais ayant matériellement récupéré de la guerre, l’Europe était déjà moribonde sur le plan humain, culturel, philosophique : on relira avec intérêt Chevaucher le Tigre et l’Arc et la Massue de Julius Evola pour s’en rendre compte.
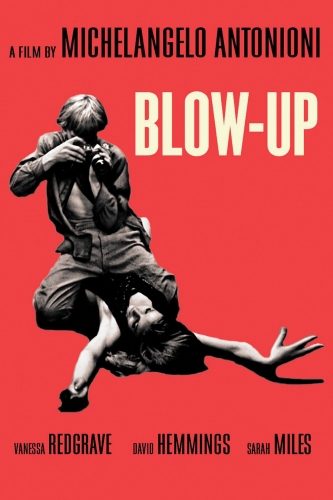
A cette époque, on a le cinéma d’Antonioni qui en inspira beaucoup d’autres. Prenons Blow up qui montre un Londres décadent, gauchiste, drogué, hagard, vide, politiquement correct, débauché, rocker et ennuyé. Une histoire encore plus ennuyeuse nous retient pendant une heure et demie. C’est l’époque où la cinéphilie qui était un émerveillement durant l’âge d’or hollywoodien (voyez mes livres !) devient une corvée : j’ai donné dans ma jeunesse.
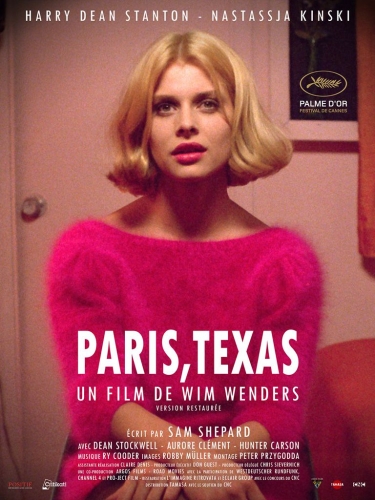
Antonioni a commis un navet avec Wenders qui lui-même avant, sans le vouloir, avait montré notre dépendance aux USA. On a eu l’Ami américain (très bons Blain et Hopper) puis l’Etat des choses qui montre une équipe de cinoche s’emmerder au Portugal, car elle n’a plus le pognon US pour continuer son navet apocalyptique (pour une fois qu’on sort de l’existentialisme !). Le réalisateur (excellent Patrick Bauchau, jadis acteur de Rohmer et copain de… Parvulesco) s’en va donc à Los Angeles, pendant que son équipe baise et fume à l’hôtel, pour se retrouver canardé dans un trailer avec son petit producteur victime de sa générosité. Métaphoriquement ce film était parfait : l’Europe attend toujours le pognon et le projet des USA. Le navet suivant de Wenders était Paris Texas, ce qui montrait le devenir ricain de l’Europe. Mais c’est un devenir volontaire, pas une conséquence de l’impérialisme américain. J’ai rappelé Trotski qui explique le devenir domestique de la social-démocratie européenne ou Dostoïevski qui dans ses Possédés montrent la fascination involontaire que les USA, alors puissance secondaire, exercent déjà sur l’Europe et ses bataillons de progressistes.
Ce n’est pas l’Amérique qui a conquis l’Europe. C’est l’Europe qui se vend en putain éternelle et qui voulait être bonne fille à Biden et aux présidents démocrates type Wilson-Obama-Roosevelt (voir mon texte sur l’Europe et les présidents démocrates). La révolte actuelle qui mènera à une implosion de l'UE ou à une guerre mortifère contre la Russie est celle d’un cadavre.
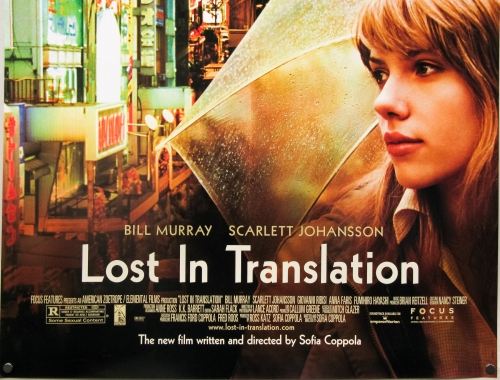
Mais j’en reviens brièvement au cinéma : on a d’un côté les maîtres du cinéma non subventionné (jusqu’à Joe Biden !), du cinéma d’action, au grand air, pour grand public, familial, aventurier ou policier, mais qui toujours veut dire quelque chose : et puis on a le cinéma qui ne veut rien dire, le cinéma du néant, que personne ne va voir, le cinéphile comme moi préférant encore le nihiliste ricain pour découvrir un monde sans sens : voyez Jim Jarmusch, qui s’est moqué de Trump et de son électorat dans son navet cannois (la France finance tous les films qui perdent du fric, c’est une obsession chez elle), sur les zombis. Voyez la fille Coppola qui dans Lost in translation avait très bien filmé l’effondrement ontologique du Japon, bien confirmé depuis par la diplomatie et par l’économie nippones.
Dans sa découverte de l’archipel, ouvrage qui m’avait fasciné jeune, Elie Faure (pote à Céline tout de même, érudit et médecin, adorateur de la psychologie des peuples – quand il y en avait une) avait excellemment écrit qu’il ne fallait pas parler de ploutocratie (la France en est une) mais de dynamocratie pour évoquer l’Amérique : Trump, Musk, Vance, avec « tous leurs défauts » le montrent nuit et jour à la face du vieux continent perdu qui ne rêve que de s’enfoncer dans la nuit à la suite de Zelenski et de ses légions nationalistes. Certes, il faut du fric en Amérique : eh bien, tu n’as qu’à en gagner, et c’est facile là-bas (Daniélou).
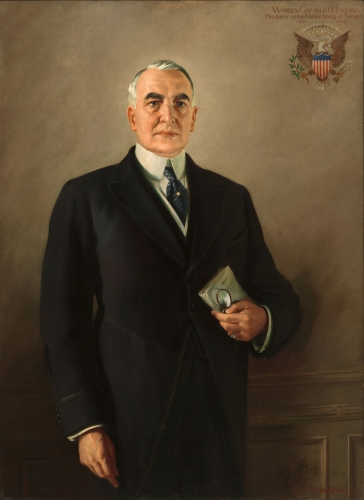
De la même manière que le cinéma américain est un pléonasme (comme disait Orson Welles, traité de fasciste par la critique gauchiste en France), la mondialisation est un phénomène moins américain que français (les idéaux de la révolution) ou britannique (l’Empire, les Huxley, les institutions) ; l’Amérique avait justement rejeté à l’époque du grand et méconnu président Harding la SDN (tableau, ci-dessus). Son instinct toujours isolationniste et non-interventionniste lui disait de ne pas s’en mêler, et il avait fallu la création de la Fed par des banquiers allemands pour la précipiter dans la catastrophe de 1914-1918 qui allait susciter d’autres catastrophes durant tout le vingtième siècle et après.
On verra s’il y a une justice et si l’Europe sera vraiment, justement punie cette fois, pour sa mauvaise politique et son cinéma désastreux. En dépit de rodomontades de certains, la soumission des droites et les dernières désastreuses élections allemandes montrent que l’Europe désire à nouveau être CORRIGEE.
20:43 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, europe, nicolas bonnal, déclin européen |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
La vitesse de Trump, l'immobilisme de Bruxelles

La vitesse de Trump, l'immobilisme de Bruxelles
Giuliano Lengo
Source: https://electomagazine.it/la-velocita-di-trump-limmobilis...
Il y a une centaine de décrets que Donald Trump a signés ou est en train de signer.
Certains d'entre eux sont déjà connus, tous cependant avec un grand impact et une grande discontinuité par rapport à l'ère Biden.
Maintenant, et c'est normal, ce sont les différents commentaires émis sur ces décisions rapides, qui comptent, dont certains avec lesquels nous sommes d'accord sur le timing, les mérites et les motions, mais posons-nous surtout une question.
Serons-nous un jour capables, en Europe, de décider de mesures urgentes susceptibles de contribuer sérieusement aux besoins des citoyens et de contrecarrer un déclin qui se manifeste désormais également dans le domaine industriel ?
Un exemple pour tous serait de revoir immédiatement les règles d'engagement pour la transition écologique..... même après ce qu'a décidé Trump !
A mon avis, l'articulation actuelle du Parlement européen (même avec un double siège et avec des déchets que nous ne pouvons plus nous payer) ne le permettrait pas, je pense, d'ailleurs une seule voix suffit à invalider toute délibération.
Une telle synthèse et action est trop fulgurante pour une bureaucratie aussi empêtrée et bloquée par l'unanimité du vote entre des états qui ont 1000 intérêts différents.
Si les Etats-Unis poursuivent ce qu'ils ont promis et que les autres grandes puissances y répondent, l'Europe, si elle ne change pas ses règles et son rythme, se dirige vers l'extinction politique et économique, en s'évaporant par elle-même !
Il est urgent de revoir en profondeur les concepts qui ont conduit à l'Union européenne, qui a été créée davantage pour élargir la zone de chalandise que pour mettre en place un système fonctionnel.
J'évite, en faisant semblant d'oublier, de m'attarder sur ce que M. Prodi et le gouvernement de l'époque ont fait en bradant notre lire (1936,27 pour 1 euro), ce qui, contrairement à ce qu'il a déclaré à l'époque, a conduit les Italiens à s'appauvrir.
Je me souviens que dans la « Charte », nous avons également renoncé à nos origines chrétiennes.., mais cela en valait-il la peine, même si la réflexion est faite avec le « recul » ?
19:22 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : donald trump, union européenne, affaires européennes, europe |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Les dirigeants européens craignent la paix

Les dirigeants européens craignent la paix
Wolfgang Hübner
Source: https://www.pi-news.net/2025/03/europas-machthaber-fuerch...
Rien ne donne une meilleure impression de la misère européenne que la photo de groupe de la conférence de crise anti-Trump de dimanche à Londres. Scholz a donc bien fait de se placer au dernier rang, afin de moins se faire remarquer lors de cette scène grotesque.
Rien ne donne une meilleure impression de la misère européenne que la photo de groupe de la conférence de crise anti-Trump de dimanche à Londres. Autour du « héros » de l'aveuglement occidental, toujours en fuite devant sa patrie exsangue, se sont rassemblés le Français Macron et le Britannique Starmer, la sélection politique négative d'un continent à la dérive dans presque tous les sens du terme, dont la splendeur est depuis longtemps révolue et dont la puissance n'est plus qu'une illusion. Le chancelier désormais déchu, celui qui se disait du « changement d'époque », a donc bien fait de se ranger discrètement au dernier rang, afin de moins se faire remarquer lors du grotesque spectacle londonien.

Après l'esclandre de Washington entre Trump et Selenskyj, de nombreux présidents et chefs d'Etat européens s'étaient rendus dans la capitale de la Petite-Bretagne, pris de panique, afin de contrebalancer les événements de l'autre côté de l'Atlantique. Même s'ils ont ostensiblement placé le buveur de sang ukrainien parmi eux, ils n'ont qu'un seul souci: la peur de la paix et donc de l'aveu de l'échec total de leur politique ukrainienne, qui, pour résumer, se limitait à vouloir la victoire pour Kiev et la défaite pour Moscou.
Depuis peu, leur haine ne s'adresse pas en premier lieu au président russe Poutine, mais au président américain Trump. Ses premiers pas vers des négociations de paix ont mis les dirigeants européens sur le mauvais pied, c'est-à-dire sur le pied de guerre. Ils voulaient (et veulent toujours) poursuivre la guerre aux dépens des Ukrainiens sous la protection de la puissance américaine. Certes, ils n'ont pas réussi à renverser Poutine et à faire passer le pays le plus riche en matières premières du monde sous contrôle occidental. Mais, néanmoins, les Russes doivent être affaiblis le plus longtemps possible.
Le nouveau shérif de Washington a toutefois d'autres projets, il veut faire des affaires avec Moscou dans un cadre pacifié. Jusqu'à présent, les participants à la conférence de Londres ne se sont vraiment pas efforcés d'obtenir cette paix. S'ils prétendent maintenant vouloir élaborer un plan de paix, ils auront fait le calcul sans la Russie. Car pourquoi Poutine et Lavrov devraient-ils faire confiance à des gens qui ont déjà si souvent menti et veulent désormais contraindre leurs peuples à des dépenses d'armement gigantesques pour être armés contre le prétendu «danger russe»?
Ce qui motive en réalité les politiques comme l'inénarrable belliciste de l'UE Ursula von der Leyen, le dépoussiéreur français ou les éternels impérialistes de l'île de la Pluie, bien plus que la paix, c'est qu'ils veulent encore s'emparer rapidement d'une partie des trésors de l'Ukraine moribonde, afin que Trump ne puisse pas tout avoir. Le comique de Kiev ne le comprend pas parce qu'il a déjà mis son gros butin à l'abri depuis longtemps. Les plus stupides dans ce jeu de pouvoir cynique sont une fois de plus les Allemands, qui font la morale sans conséquence, mais vont payer sans fin.
Trump a désormais le choix entre s'opposer à l'insolence européenne ou s'en accommoder d'une manière ou d'une autre. Quoi qu'il en soit, jusqu'à nouvel ordre, les soldats ukrainiens et russes continueront de mourir ou d'être blessés sur les fronts. La responsabilité principale en incombe au plus tard à partir de maintenant à ceux qui, à Londres, ont une fois de plus soutenu le dictateur Zelensky. Olaf Scholz aurait pu profiter de l'occasion pour s'opposer au courant de folie qui traverse l'Europe. Mais lui non plus n'a pas peur d'avoir du sang sur les mains.
19:10 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ukraine, europe, affaires européennes, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
L'accord du siècle entre l'UE et l'Inde ouvre la voie au pétrole russe vers l'Europe

L'accord du siècle entre l'UE et l'Inde ouvre la voie au pétrole russe vers l'Europe
Leonid Savin
Ursula von der Leyen, cheffe de la Commission européenne, a déclaré lors de sa visite à New Delhi le 28 février qu'un accord de libre-échange sans précédent entre l'UE et l'Inde pourrait être conclu d'ici la fin de l'année 2025.
Ursula von der Leyen a ajouté de manière pathétique que « cette visite marque le début d'une nouvelle ère » et « qu'il est temps de faire passer le partenariat stratégique entre l'UE et l'Inde au niveau supérieur ». Elle a également annoncé que l'Union européenne étudiait activement la possibilité d'un nouveau « partenariat de sécurité et de défense » avec l'Inde, similaire aux accords existants de l'UE avec des partenaires clés tels que le Japon et la Corée du Sud.
Un partenariat de longue date
Les relations entre l'Inde et l'Union européenne ne datent pas d'hier. L'Inde a été l'un des premiers pays à établir des relations diplomatiques avec la Communauté économique européenne en 1962.
Dans le cadre de l'accord de coopération UE-Inde de 1994, les deux parties ont mis en place un système complet de coopération et ont finalement transformé leurs relations en partenariat stratégique en 2004. En 2007, les deux parties ont entamé des négociations en vue d'un accord bilatéral de grande envergure sur le commerce et l'investissement. Toutefois, après 15 cycles de négociations en 2013, elles se sont retrouvées dans l'impasse. La faute incombe aux ambitions des parties.
Le 8 mai 2021, les dirigeants de l'UE et de l'Inde ont décidé de reprendre les négociations sur un accord commercial « équilibré, ambitieux, complet et mutuellement bénéfique » et de lancer des « branches » distinctes sur un accord de protection des investissements et un accord sur les indications géographiques. En avril 2022, il a été décidé de créer un Conseil du commerce et de la technologie UE-Inde.
Selon des documents officiels, l'Union européenne est le premier partenaire commercial de l'Inde. Elle représentait 12,2% du commerce total de l'Inde en 2023, avec un chiffre d'affaires de 124 milliards d'euros.
L'Inde est le neuvième partenaire commercial de l'UE, avec 2,2% du total des échanges de biens de l'UE en 2023. Le commerce des services entre l'UE et l'Inde atteindra 59,7 milliards d'euros en 2023, contre 30,4 milliards d'euros en 2020.
Les principaux thèmes des négociations commerciales sont: la suppression des obstacles et l'aide aux entreprises de l'UE; l'ouverture des marchés de services et des marchés publics; la garantie de la protection des indications géographiques; et les engagements en matière de commerce et de développement durable.
Le dernier cycle de négociations entre l'Inde et l'UE s'est tenu en novembre 2024 et portait sur les droits de douane applicables à un groupe de marchandises liées aux technologies de l'information et de la communication. Conformément au plan, les parties étaient censées présenter leur vision pour le 10 février. Apparemment, l'échange de données a été fructueux, ce qui explique pourquoi les fonctionnaires de l'UE ont déclaré que l'accord pourrait être signé dès cette année.

Circonstances géopolitiques
Au-delà des nuances purement techniques et de la protection des intérêts de l'UE et de l'Inde, les circonstances géopolitiques actuelles, qui laissent peu de marge de manœuvre, poussent Bruxelles à conclure l'accord.
Les nouveaux dirigeants américains ont promis d'imposer des droits de douane de 25% sur les produits européens à partir du mois d'avril en réponse aux mesures protectionnistes de Bruxelles. D'autre part, au sein de l'UE, on craint l'influence croissante de la Chine sur le marché européen, notamment dans le domaine des métaux rares et des produits de télécommunications.
L'UE peut également tirer parti de la confrontation stratégique entre l'Inde et la Chine, raison pour laquelle le chef de la Commission européenne a parlé de coopération en matière de défense. L'Inde essayant de diversifier ses approvisionnements en armes et de développer son propre complexe militaro-industriel, les propositions de l'UE en la matière pourraient s'avérer utiles pour New Delhi.
Il convient d'ajouter que l'Inde a déjà signé un certain nombre d'accords avec les États-Unis dans le domaine des technologies avancées et de la science, et que les relations personnelles entre le Premier ministre Narendra Modi et le président Donald Trump se développent plutôt bien. De plus, compte tenu des critiques de la Maison Blanche à l'égard de l'UE et de leurs désaccords persistants, l'Inde se trouve dans une position gagnante.
À cela s'ajoute la coopération en cours avec la Russie, qui aide l'Inde à développer sa propre économie.
Il est probable que la décision de l'UE d'instaurer le libre-échange avec l'Inde ait un double fondement: alors que certains produits pétroliers en provenance de Russie ont jusqu'à présent pénétré dans l'UE par l'intermédiaire de pays tiers, l'Inde pourrait déployer beaucoup plus d'activités dans ce domaine dans le cadre du nouvel accord.
Les produits pétroliers sont l'un des principaux produits de base que l'Inde fournit à l'UE. Et surtout, elle ne craint aucune sanction, car il est peu probable que les États-Unis et l'UE lui imposent des restrictions, ce que confirment les précédentes dérogations au régime des sanctions à l'encontre de New Delhi.
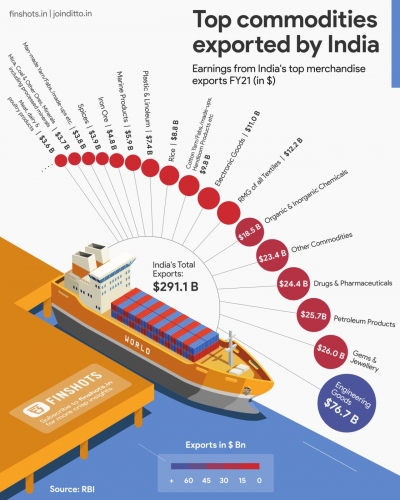
Agents de consommation
Parmi les autres produits indiens exportés vers l'UE figurent les vêtements prêts à porter, l'acier, les machines électriques et les produits pharmaceutiques. Les exportations de services tels que les télécommunications et les transports pourraient également augmenter de manière significative après la signature de l'accord.
L'UE devrait bénéficier de l'augmentation des exportations de biens tels que les avions et leurs pièces détachées, les équipements électriques, les produits chimiques et les diamants. Le secteur des services bénéficiera également de l'augmentation des échanges dans les domaines de la propriété intellectuelle, des télécommunications et des services informatiques.
Étant donné que deux millions et demi d'Indiens vivent dans les pays de l'UE, et que ce chiffre est clairement appelé à augmenter dans un avenir proche, l'Inde a en fait ses agents de consommation sur le terrain qui feront pression pour son entrée sur le marché européen.
Selon des rapports récents, l'UE cherche à supprimer les droits de douane sur plus de 95% de ses exportations, y compris les produits agricoles sensibles et les automobiles. L'Inde, quant à elle, ne souhaite ouvrir qu'environ 90% de son marché à l'UE, hésitant à réduire les droits de douane uniquement sur les produits agricoles.
En ce qui concerne la route directe pour les approvisionnements dans les deux sens, l'UE mise désormais sur le corridor du Moyen-Orient. L'itinéraire classique passant par le canal de Suez peut être utilisé, de même que des options alternatives via la Turquie, l'Irak et l'Iran.
Toutefois, à l'avenir, après la levée des sanctions, nous ne pouvons pas exclure l'itinéraire via la Russie. En outre, les produits de nos co-entreprises fabriqués en Inde peuvent également être livrés à l'UE.
18:35 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, géopolitique, union européenne, affaires européennes, europe, inde, asie, affaires asiatiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
BlackRock achète les deux ports du canal de Panama

BlackRock achète les deux ports du canal de Panama
Source: https://dissident.one/blackrock-koopt-beide-havens-van-he...
La société américaine BlackRock a annoncé mardi qu'un consortium dirigé par elle allait acheter 90% des actions des deux ports du canal de Panama. Grâce à cet achat, BlackRock contrôle désormais l'une des voies commerciales les plus importantes au monde.
Un consortium d'investisseurs dirigé par la société américaine BlackRock souhaite acquérir la majorité des parts des deux ports du canal de Panama. BlackRock l'a annoncé mardi et plusieurs médias en ont fait état. Le consortium d'acheteurs comprend la division infrastructure de la société, Global Infrastructure Partners, et Terminal Investment Limited, basée à Genève, rapporte RT.de.
Le géant de l'investissement va acquérir 90% de Panama Ports Company, l'ancien propriétaire et exploitant des deux ports, pour un montant de 22,8 milliards de dollars. Panama Ports appartient à son tour à CK Hutchison, un groupe technologique multinational basé à Hong Kong. La société basée à Hong Kong a également confirmé qu'elle vendrait les deux ports à un consortium américain. Les négociations se dérouleront sur une période de 145 jours, selon le rapport. En achetant les deux ports, BlackRock prendra désormais le contrôle de l'une des routes commerciales les plus importantes et les plus utilisées au monde, dont le canal de Panama fait partie.
Le président américain Donald Trump avait déjà déclaré pendant la campagne électorale que le canal de Panama devrait « revenir entre les mains des Américains ». L'influence chinoise au Panama étant une épine dans le pied de Trump, les États-Unis ont exercé une forte pression sur les résidents de Hong Kong.
Alors que les médias se sont concentrés sur les menaces de Trump, l'administration Trump s'est concentrée sur Hutchison Ports, le consortium basé à Hong Kong qui gère les principaux ports aux deux extrémités du canal. Ces dernières semaines, des rumeurs ont circulé selon lesquelles une entreprise américaine étroitement liée à la Maison Blanche était mentionnée comme candidat au rachat.
17:41 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : panama, canal de panama, amérique centrale, maérique ibérique, amérique latine, black rock, géopolitique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Mon idéal d'organisation politique

Mon idéal d'organisation politique
Claude Bourrinet
Source: https://www.facebook.com/profile.php?id=100002364487528
« Le temps qui uniformise tout, et qui, en uniformisant, détruit, n'a plus laissé subsister grand'chose de ces petites villes de résidence allemandes qui, au début de l'ère industrielle et à l'aube de l'autoritarisme forcené de Bismarck, conservaient encore tous leurs particularismes charmants. De petits souverains qui supportaient allègrement le souci d'administrer un minuscule État et les frais qu'entraînait l'entretien de quelques centaines de soldats, avaient tout le loisir de consacrer leur temps et leur argent à de nobles œuvres de culture. Ils rivalisaient à qui aurait les plus beaux théâtres, les meilleurs orchestres. Parfois leur capitale n'était qu'une toute petite cité posée sur la frange du grand parc princier. Dans ces Cours, l'étiquette était peu formaliste, les artistes et les poètes s'y trouvaient chez eux, et l'on y cultivait volontiers le talent, l'originalité, en attendant le jour où la poigne du Chancelier de Fer versera dans un moule commun, pour en tirer des modèles banals et tous semblables, les bizarres et délicieuses singularités de ces infimes principautés. » (Marcel Brion ; Goethe).
L'Occident, le monde, auraient pu être autrement.
La doxa politique, de droite (le royalisme, par exemple), comme de gauche (le républicanisme ou le marxisme) nous assène volontiers une téléologie historiciste, qui nous persuade que l'évolution du Regnum Francorum ne pouvait qu'aboutir à ce que nous sommes devenus, par la grâce de la Providence, ou du développement des moyens de production.

Si l'on met à part l'action de Dieu sur les sociétés humaines, pilotage auquel croyait aussi un Hegel, qui n'était pas chrétien, il faut accorder quelque crédit à la thèse matérialiste, qu'elle soit positiviste, comtienne, ou communiste, marxienne. L'uniformisation engendrée par l'économie et le triomphe quasi sans partage de l’État provient bien du triomphe de la machine, de l'industrie (par exemple, actuellement, tout ce qui concerne l’énergie, coeur du système), de l'accélération des communications, de la concentration de l'argent, via la dette, de la prolifération d'un appareil administratif autoritaire, et d'idéologies universalisantes, soucieux de contrôler les esprits.

Pour ce qui est de la liberté de l'esprit, de la tolérance, d'un certain affranchissement des mœurs, le 18ème siècle a été un âge d'or. De nombreux écrivains ou personnages considérables, comme Stendhal ou Talleyrand, ont loué son bonheur de vivre, gâté par le « sérieux » militant de l'ère révolutionnaire, qui versa les singularités individuelle dans la soupe populaire de la presse, qui nous convainquit de ce qu'il fallait penser.
La candide certitude de l'existence d'un mécanisme historique « allant de soi » et menant à l'emprise de l’État, concomitant de l’arasement des véritables et profondes différences d'existence des hommes, empêche de penser une autre hypothèse civilisationnelle, qui eût pu, peut-être, advenir, si l'on avait mis des garde-fous, qui ne pouvaient qu'être métaphysiques (l'Antiquité, comme les sociétés dites « primitives », ont bloqué, par leur Weltanschauung, l'une le développement technique et productif, les autres l'instauration de l’État). Le monde moderne, finalement très récent, ne s'amorce qu'au tournant des 12ème-13ème siècles.

L'éclosion des Universités et de la scolastique en fut l'un des symptômes. Jusqu'à l’État royal assumé comme un « empire » (ce terme désigne d'abord l'autorité absolue d'un pouvoir sur un territoire), à partir de Philippe Le Bel (illustration, ci-dessus), au début du 14ème siècle, la configuration politique et culturelle de l'Europe, pour ne pas parler des mondes musulman, chinois, japonais, indien, était complexe et diversifié. Les identités étaient enchâssées dans des « appartenances » graduelle, au-dessous d'une autorité qui n'avait guère de pouvoir que dans son pré carré, ou de manière formelle, comme la royauté française, ou l'Empire dit romano-germanique (on disait alors seulement « l'Empire »).

On pouvait se sentir français, parce qu'on parlait ou écrivait le français, et il y en avait plusieurs en même temps être sujet d'un roi qui ne l'était pas. Le premier poète que notre histoire littéraire a récupéré, qui est en vérité une poétesse, Marie de France (illustration, ci-dessus), qui était complètement anglaise. L'auteur de la Chanson de Roland, notre première grande œuvre, de génie, qui semble si accordée à notre âme, était très probablement anglais (Turold?). Saint Bernard n'était pas sujet du roi de France : il l'était des comtes de Champagne, de Troyes, et se sentait bien plus proche de l'Empire, de la Bourgogne, que de l'Île de France. Il entra en conflit avec Suger, le conseiller de Louis VI et de Louis VII, le bâtisseur de la basilique royale de Saint-Denis, le fondateur du « gothique », le promoteur de « l'art de France », et l'idéologue de la royauté française. Pourtant, qui pourrait nier que Saint Bernard fût un saint profondément français ?
Si l'on observe les mœurs, les particularités, les différents aspects de la société médiévale, on sera émerveillé par la bigarrure, la diversité, la richesse des coutumes, des modes de vie, des langages usités, qu'une telle civilisation générait. Les voyages de cette époque étaient une véritable aventure, pourvoyeuse de surprises et de savoirs fascinants. En outre, chaque communauté, qu'elle fût communale, princière, seigneuriale, avait ses coutumes, ses lois, des habitudes, ses liens entre les sujets et les pouvoirs. La bourgeoisie y a vu un intolérable obstacle à la raison organisatrice. Moyennant quoi, elle a tout arasé, fait table rase du passé si riche de différences, et emprunté l'uniforme gris-noir du gouvernement épicier.
13:55 Publié dans Réflexions personnelles, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : réflexions personnelles, théorie politique, idéal politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 05 mars 2025
Jünger dans les orages d’acier
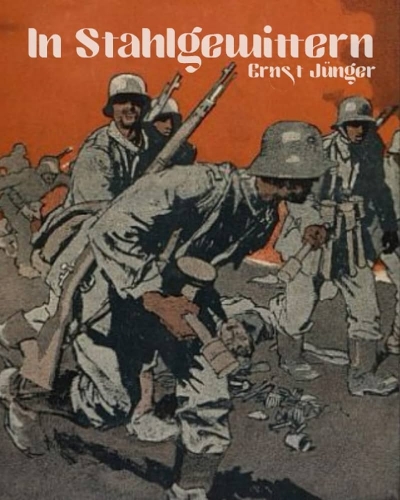
Jünger dans les orages d’acier
Un recueil documentaire et photographique de Nils Fabiansson pour Italia Storica
par Giovanni Sessa
Source: https://www.barbadillo.it/119340-junger-nelle-tempeste-da...
Ernst Jünger est, au-delà des jugements politiques portés sur son œuvre, l’un des grands noms de la littérature européenne du 20ème siècle. Un illustre « fils du 20ème siècle », période de contradictions et de tragédies, riche d’élans idéaux. Dans la vaste production jüngerienne, le livre qui l’a rendu célèbre auprès du grand public occupe une place centrale: Orages d’acier. Cet ouvrage est consacré à la narration, en prise directe, de la participation de l’écrivain à la Première Guerre mondiale sur le front occidental. Un nouveau volume de Nils Fabiansson, Ernst Jünger dans les tempêtes d’acier de la Grande Guerre, vient d’être mis à disposition du lecteur italien. Il est publié dans le catalogue d’Italia Storica Edizioni, et son titre explicite son contenu: un recueil documentaire et photographique sur l’expérience de guerre du lieutenant Ernst Jünger durant le premier conflit mondial (184 pages, 25,00 euros). L’ouvrage a été patronné par Andrea Lombardi et traduit par Vincenzo Valentini. Son auteur, un historien et archéologue suédois, a notamment écrit un guide de voyage sur le front occidental de la guerre qui inaugura le « siècle bref ».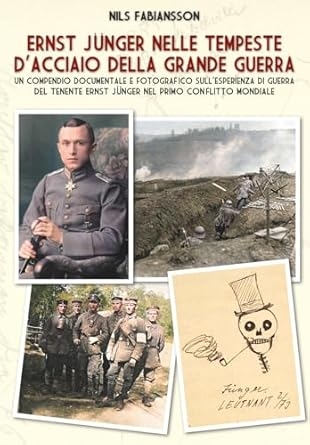

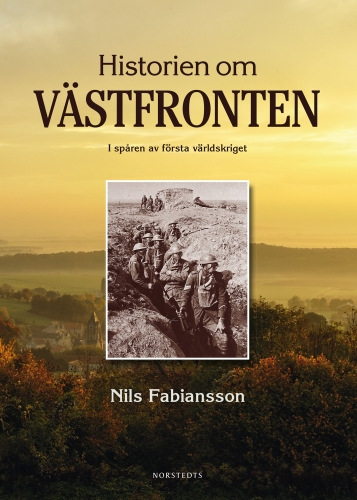
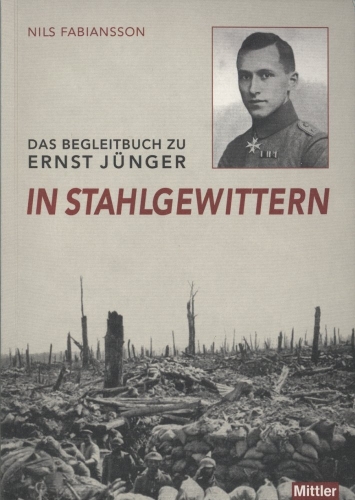
Pour comprendre les intentions du chercheur suédois, il est pertinent de partir des réflexions de Christopher Tilley, professeur d’histoire matérielle, qui a souligné que « les lieux ont toujours été bien plus que de simples points de localisation, car ils portent des significations et des valeurs distinctives pour les individus » (p.7). Jünger lui-même a affirmé à plusieurs reprises être magnétiquement attiré par certains « lieux ». C’est pour cette raison que Fabiansson emmène le lecteur sur les champs de bataille décrits par Jünger dans Orages d’acier, non seulement en analysant les multiples révisions que l’auteur a apportées à son œuvre, mais aussi en s’appuyant sur un riche appareil iconographique. Celui-ci comprend des photographies issues d’archives publiques et privées (notamment des images en noir et blanc particulièrement évocatrices de « l’atmosphère » et du « climat spirituel » qui régnait alors dans les tranchées), des pages des journaux de l’écrivain allemand, des cartes dessinées par lui dans ses carnets et des images des lieux de bataille tels qu’ils apparaissent aujourd’hui. Il convient de noter que Fabiansson ne cherche pas à faire du « tourisme bellico-littéraire », ce que Jünger lui-même aurait désapprouvé, mais reste fidèle au regard stéréoscopique et glacial de l’écrivain. Les textes de Jünger sur la guerre reposent sur ce qu’il appelait ses « pouvoirs perceptifs spéciaux », qui lui permettaient d’observer la douleur et la mort avec un regard exempt « de sentimentalismes, avec sécheresse et froide précision » (p. 9).

Le récit se structure en cinq chapitres analysant les différentes phases du conflit, depuis août 1914 jusqu’aux événements tragiques de novembre 1918. Au cœur de ce récit se dresse la figure de l’homme Jünger. Le livre se conclut par un épilogue où l’auteur recense les nombreuses traductions étrangères d'Orages d’acier. Trop souvent, on a présenté ce livre comme un simple témoignage de l’héroïsme de l’auteur au combat. Or, la lecture de Fabiansson nous dévoile un Jünger complexe, profondément humain, qui raconte à plusieurs reprises dans son livre que « à diverses occasions, il avait abandonné ses camarades à la merci de l’ennemi » (p. 9). Le fait qu’il mentionne ces échecs personnels est un élément significatif. Comme le montre cette étude, l’écrivain allemand a affronté la mort avec bravoure à de nombreuses reprises, subissant des blessures aux jambes et à la tête (il conserva d’ailleurs son casque transpercé par une balle), ce qui lui valut les plus hautes distinctions militaires. Pourtant, en 1972, il déclara que « ses souvenirs d’écolier étaient plus vivaces que ceux du combattant de guerre » (p. 10). Il se plaignait en effet que, malgré sa nouvelle vision de la vie, bien analysée par Evola, les lecteurs s’attardent encore, des décennies après leur publication, sur ses écrits de guerre, qu’il considérait désormais comme un « Ancien Testament » (p. 10).

Ce ne fut pas seulement son « cœur aventureux » qui poussa Jünger à s’engager volontairement, mais aussi une volonté précise de s’émerveiller et de comprendre en profondeur le sens de la guerre. Il se demanda si, au-delà des massacres imposés par la « guerre des matériaux », elle pouvait encore offrir, pour ceux qui la vivaient, une possibilité de réalisation personnelle. Sa réponse fut positive. Le combat permettait de dépasser la routine bourgeoise et plaçait l’homme face à la potestas qui l’anime et qui imprègne toute la nature. La guerre destructrice semble tout engloutir. Mais les descriptions des champs de bataille de Jünger nous plongent dans la réalité brute du paysage de guerre et nous confrontent à sa transformation cyclique et éternelle. Comme l’a relevé le philosophe Karl Löwith, Jünger comprenait que seul le dépassement de soi dans la nature conférait une permanence à l’existence humaine. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il nota que la Picardie, avec « ses douces ondulations, ses villages enchâssés dans les vergers, ses pâturages bordés de peupliers élancés […] » (p. 22), lui procurait une joie intense. Ce n’est pas un hasard si, durant son séjour à Monchy et à Douchy, comme il le raconte dans Jardins et routes, il se consacra à la « chasse subtile » des insectes dans les tranchées. Ainsi, même dans les circonstances dramatiques de la guerre, sa passion pour l’entomologie ne l’abandonna pas, convaincu que dans le « particulier » réside le principe universel. Il répertoria pas moins de 143 espèces d’insectes.

Le pouvoir d’Éros ne fut pas non plus effacé par l’omniprésence de la mort, car, dans une perspective grecque, Éros et Thanatos ne font qu’un. Ainsi, le 5 juin 1916, il nota laconiquement : « Jeanne à Cambrai » (p. 25), évoquant un amour fugace en temps de guerre. De même, il n’oublia jamais ses proches. Fabiansson relate avec émotion les rencontres de Jünger avec son frère Friedrich Georg, où les deux hommes savouraient les effets apaisants du vin de Bourgogne et fumaient du tabac Navycut anglais dans leurs pipes en écume de mer (durant la guerre, Jünger expérimenta également l’éther et d’autres substances psychotropes pour soulager ses blessures). L’écrivain nous a aussi laissé des souvenirs poignants de ses compagnons d’armes, officiers ou simples soldats, qui sacrifièrent leur vie pour lui.
L’ouvrage de l’historien suédois n’est donc pas un simple « recueil » pour lire Orages d’acier, mais un livre essentiel pour comprendre l’ensemble de l’œuvre d’Ernst Jünger.
14:22 Publié dans Littérature, Livre, Livre, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst jünger, révolution conservatrice, littérature, littérature allemande, lettres, lettres allemandes, première guerre mondiale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Jean Muno, Bruxelles et les peintres naïfs
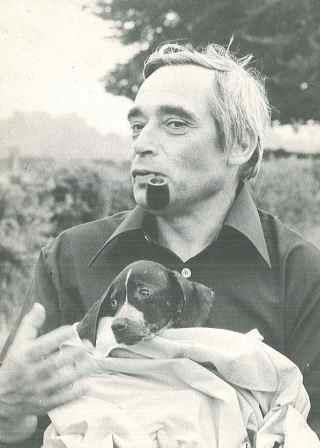
Jean Muno, Bruxelles et les peintres naïfs
par Daniel COLOGNE
(texte paru sur le site Europe Maxima, s.d.)
Jean Muno alias Robert Burniaux est né le 3 janvier 1924 à Molenbeek – Saint-Jean (1). Il passe son enfance au 32 de l’avenue Jean-Dubruck (2). Il est le fils de Constant Burniaux (1892 – 1975), instituteur et écrivain, dont il faut surtout souligner la poésie imprégnée d’une émouvante nostalgie de l’enfance. Sa maman Jeanne Taillieu est aussi institutrice. Le pseudonyme choisi par Robert Burniaux est le nom d’un village ardennais où il passe plusieurs fois d’heureuses vacances de jeunesse.
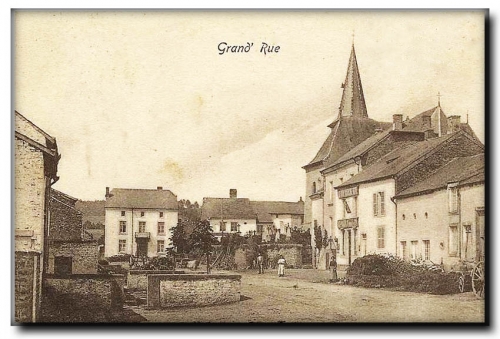
Photo ancienne du village de Muno.
Sa parentèle le destine tout simplement à l’enseignement et, après des études de philologie romane à l’Université libre de Bruxelles, il devient professeur de français et le reste jusqu’en 1974. Pouvant alors vivre de sa plume, il abandonne le professorat. Il a déjà à son actif le roman appelé Le Joker (Éditions Louis Musin, 1972) et plusieurs récits auréolés de prix littéraires et d’adaptations radiophoniques. Deux séjours en Hongrie (1974 et 1978) lui font découvrir Istvan Örkény et ses « mini-mythes » qu’il adapte en français. Il s’oriente alors vers la rédaction d’histoires très brèves, que nos amis anglais appelleraient des very short stories.
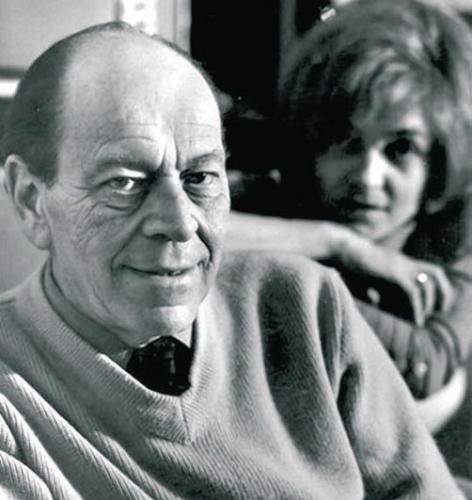
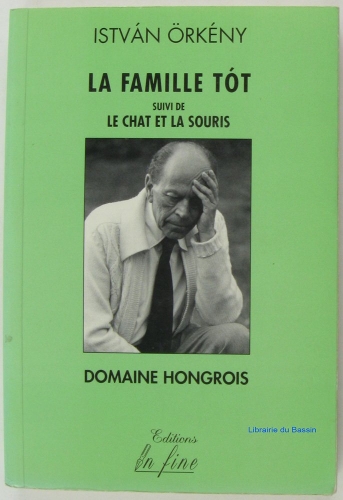
À l’époque, Jean Muno fait partie du « Groupe du Roman » aux côtés de Robert Montal (alias Robert Frickx), de Charles Pairon et de David Scheinert. Dans mon souvenir des quelques conversations que j’ai échangées avec Scheinert entre 1972 et 1974, un des deux voyages à Budapest (peut-être les deux) a été effectué par tous les membres du « Groupe du Roman ». J’encourage vivement l’un(e) ou l’autre étudiant(e) en philologie romane à faire une recherche (pour un mémoire ou une thèse) sur le « Groupe du Roman » et sur les Cahiers du Groupe, dont les rédacteurs ont projeté un éclairage positif sur les écrivains belges. Ils ont notamment contribué à tirer de l’oubli André Baillon (1875 – 1932), aujourd’hui reconnu comme un écrivain important, publié dans la collection « Espace Nord » (Éditions Luc Pire, ex-Éditions Labor).
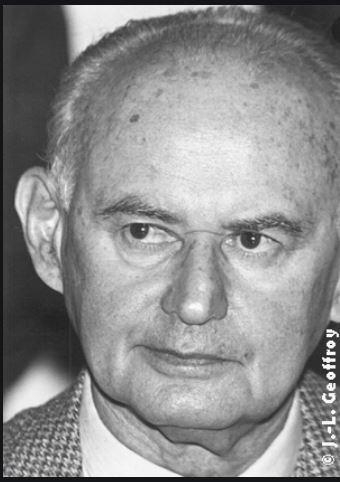
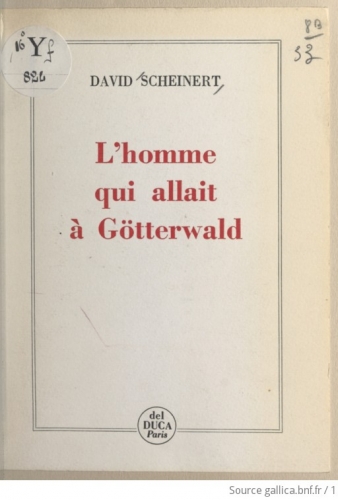
Pour ma part, j’ai rencontré David Scheinert (1916 – 1996) (photo, ci-dessus) en 1972 à Genève où était créée sa pièce de théâtre L’Homme qui allait à Götterwald. Je lui dois une bonne part de mon intérêt pour la belgitude littéraire tenue en haute estime par ce Polonais d’origine juive arrivé en Belgique à l’âge de huit ans. Après avoir été, sous le pseudonyme de Vinytres, le critique littéraire du journal communiste Le Drapeau Rouge, Scheinert admettait sans hésiter la valeur de certains écrivains de la Collaboration, comme René Verboor ou Constant Malva, ce dernier étant descendu dans la mine pour écrire Ma nuit au jour le jour.
En 1979, Bruxelles fête son millénaire et le bourgmestre Van Halteren lance l’idée d’un livre réunissant trente-cinq peintures naïves de sites bruxellois (comme le Château Malou ou les Étangs Mellaerts, rendez-vous des promeneurs du dimanche et des passionnés de canotage). Il demande à trois écrivains de commenter ces tableaux et, tandis que Carlo Bronne et Berthe Delepine se répandent en commentaires historiques, Jean Muno choisit d’intégrer une douzaine de toiles à des « mini-mythes » conçus selon son modèle hongrois. Jean Muno atteint le sommet de son art de conteur bref dans les textes inspirés par des sites qui lui sont familiers, car liés à ses souvenirs d’enfant : la Basilique nationale du Sacré-Cœur de Koekelberg et le château du Karreveld situé à Molenbeek.



Karreveld en bâtarde penchée met en scène une fillette née avant 1900. La narratrice d’un âge non précisé se rappelle ses exercices calligraphiques des années 1908 – 1910. La « bâtarde » doit son nom à son statut d’écriture intermédiaire entre la ronde et l’anglaise. « En ce temps-là, on nous apprenait quelque chose à l’école. » Ainsi commence ce « conte naïf » qui s’inspire d’un tableau dans le style du Douanier Rousseau et qui ressuscite le Bruxelles d’autrefois, lorsque la bien-nommée « Avenue de la Liberté », qui relie aujourd’hui « le Karreveld, le Parc Élisabeth et la Basilique, se perdait tout de suite dans la campagne », parmi « des arbres, des lisières, des talus et des fossés ».
« Des prairies qu’un ruisseau rendait ici ou là marécageuses » fournissaient aux écoliers « de quoi trouver à garnir amplement » les herbiers dont ils s’occupaient les jours de congé, alors situés le jeudi et le dimanche.
« Dans le fond, qui était boisé et humide, se cachait un vieux château-ferme, joliment situé derrière une mare. Une poterne surmontée d’une tour carrée donnait accès à une cour intérieure. Pour nous, c’était un endroit romanesque, un lieu d’intrigues; on y dansait au son de l’accordéon, les nuits d’été… Dieu sait pourquoi, je revois distinctement l’enseigne, en lettres noires sur la façade chaulée : Café – restaurant du château du Karreveld – Grande laiterie du Vélodrome. » Un champion cycliste s’est tué en 1908 sur le vélodrome du Karreveld, qui jouxte également, un peu plus tard, le premier studio belge de cinéma.
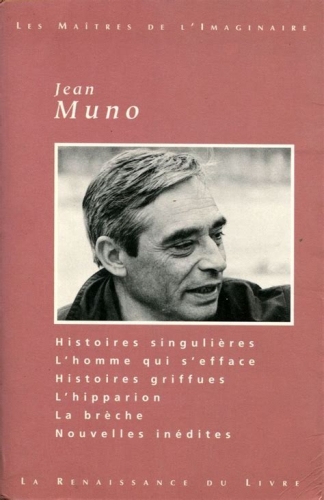
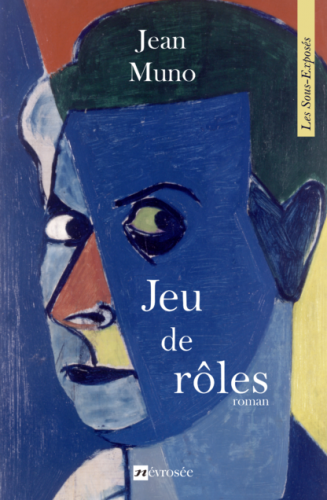
« À cette époque, avant la Basilique (3), ce n’était qu’avenues désertes autour du Parc Élisabeth, villas en retrait et hautes grilles fermées. » La foire annuelle de la place Simonis (4) toute proche apporte une touche de gaieté contrastant avec la mélancolie que distillent « les ifs et les cyprès du cimetière de Molenbeek ». À la fin du récit, un exhibitionniste vient troubler la fillette dans ses exercices d’écriture. Ce genre de passage à connotation sexuelle n’est pas rare dans les textes de Jean Muno. Citons par exemple cet extrait d’une autre nouvelle : « Clarisse sentait monter en elle, irrépressible comme un orgasme, le vertige oublié des grandes terreurs infantiles. »
L’hispaniste Isabelle Mareels établit un lien entre un récit de Jean Muno et une scène du film d’Almodovar (Hable con ella). Un homme devenu minuscule à la suite d’une expérience scientifique pénètre dans le vagin de son amante endormie, tandis que, dans Entre les lignes, autre recueil de brèves histoires munoliennes, un mari rapetisse au prorata du grossissement de sa femme, entreprend une excursion sur le corps assoupi de celle-ci et est finalement englouti dans le maquis pubien.
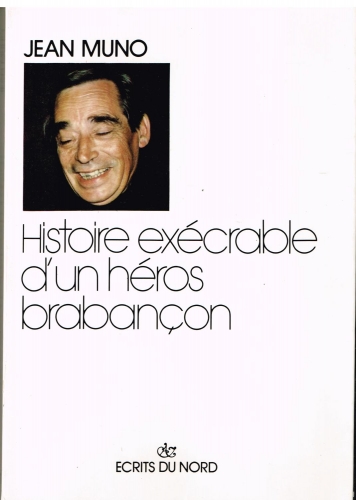
Loin de se confiner dans le domaine du sexe, Isabelle Mareels rapproche aussi Jean Muno du poète nicaraguayen Ernesto Cardinal, ministre de la Culture de son pays favorisant la production de peintures naïves. Elle montre comment Jean Muno infléchit la naïveté des tableaux qui l’inspirent, tantôt dans le sens de l’érotisme, tantôt dans la direction du fantastique, ou encore en ressenti d’un humour fondé sur les jeux de mots. Ce n’est pas par hasard que Jean Muno s’intéresse à Raymond Devos. Les peintures naïves de Fernande Crabbé, Francine Leuridan, Nadia Becker, ou Monique Schaar, qui nourrissent les Contes naïfs de Jean Muno, nous proposent un tour de Bruxelles, du château Ter Rivieren (Ganshoren) au parc ucclois de Wolvendael en passant par le Rouge-Cloître d’Auderghem, l’abbaye de Forest, une cité-jardin de Boitsfort ou des sites plus centraux comme le Jardin Botanique et l’église Saint-Nicolas.
Les Contes naïfs de Jean Muno paraissent de façon autonome en 1980 aux Éditions Cyclope – Dem. Deux ans plus tard, les Éditions Jacques-Antoine publient l’Histoire exécrable d’un héros brabançon. Jean Muno s’éteint le 6 avril 1988 des suites d’un cancer du nerf optique. Créateur du concept d’« école belge de l’étrange », lui-même auteur de récits fantastiques (Les Papillons noirs), Jean-Baptiste Baronian considère Jean Muno comme l’écrivain belge de langue française le plus important de la période 1970 – 1990. Son personnage récurrent du petit homme seul est peut-être la métaphore d’un belgitude en crise, d’un pays qui s’émiette en diverses communautés et régions, tandis que s’affirme le mouvement identitaire flamand et que Bruxelles devient une « ville-monde » sous le règne finissant du roi Baudoin.
Daniel COLOGNE
Notes:
1 : C’est aussi ma commune natale située dans l’Ouest de la périphérie bruxelloise.
2 : Jean Dubrucq est un riche industriel de l’Ouest bruxellois dont l’obsession fut de doter Bruxelles d’installations portuaires (XIXe siècle). Avec son savoureux mélange de patois flamand et de français, le petit peuple de la capitale belge l’a surnommé Jan-Port-de-Mer.
3 : L’auteur veut dire « avant que la construction de la Basilique ne soit achevée ».
4 : Enfant, j’ai fréquenté cette foire au début des années 1950. Eugène Simonis est un artiste bruxellois.
13:44 Publié dans art, Belgicana, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean muno, littérature, littérature belge, lettres, lettres belges, peintres naïfs |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook