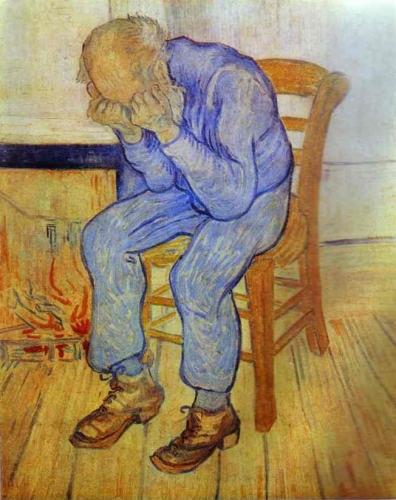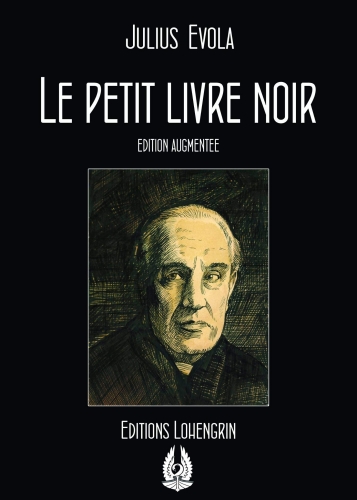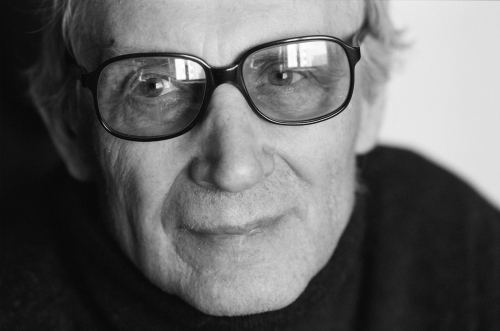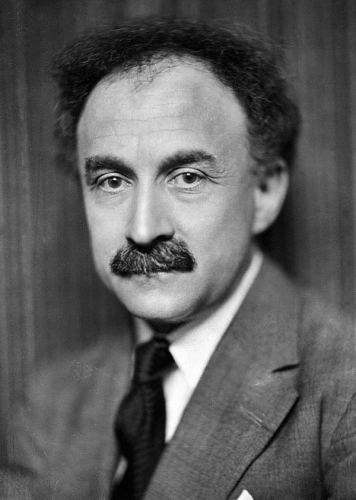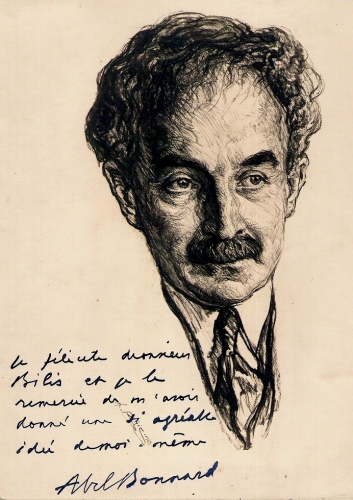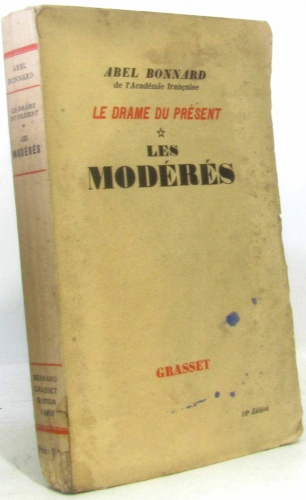mardi, 31 août 2021
La nécessité des apocalyptiques: le dernier essai de Geminello Alvi

La nécessité des apocalyptiques: le dernier essai de Geminello Alvi
Giovanni Sessa
Ex: ereticamente.net/2021/08/la-necessite-degli-apocalittici-lultimo-saggio-di-geminello-alvi-giovanni-sessa.html
Le dernier projet éditorial de Geminello Alvi peut être défini comme le livre de sa vie. De l'avis de l'auteur, il en est ainsi pour deux raisons. D'abord, parce qu'il est le résultat des réflexions de cet éminent universitaire sur le texte de l'Apocalypse depuis des décennies. Ensuite, parce que le volume, qui a la prétention justifiée d'être un commentaire du texte sacré, présente, à première vue, un trait labyrinthique et aporétique, en harmonie évidente avec l'Apocalypse elle-même. C'est ce qui rend l'exégèse d'Alvi véritablement "traditionnelle": elle est fidèle à la nature non transparente du texte, et non à ses aspects accessoires. Pour ceux qui sont habitués à des classifications simplistes, le livre est un exemple certainement réussi de non-fiction érudite et cultivée.

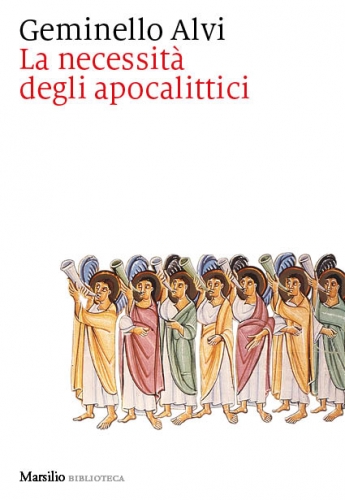
Alvi y parcourt les vicissitudes herméneutiques-philologiques que l'Apocalypse a subies au cours des millénaires de son histoire mais, en même temps, il est soutenu par un afflatus "poétique" irrépressible, au sens étymologique grec du terme, qui rend sa lecture, si elle est accompagnée du texte de l'Apocalypse, légère et libératrice. Nous faisons référence à La necessità degli apocalittici (La nécessité des apocalyptiques) publié dans le catalogue Marsilio (pp. 460, €30.00). Le sens du livre est clair dès l'incipit. L'Apocalypse est un texte qui ne peut être normalisé par une approche logico-philologique. Son contenu a un développement en spirale, labyrinthique. Il ne peut être simplement lu, mais nécessite une relecture continue pour révéler de nouvelles portes d'accès. Le sien est : "Une extermination de moins en moins dominable" (p. 11). L'interprète avisé sait que l'Apocalypse est: "encadrée entre le temps accéléré [...] et la fin des temps [...]. Le temps éteint se révèle être le seul vrai " (p. 12). Il parle non seulement au début du christianisme, mais dans tous les précipices du temps. Aujourd'hui plus qu'hier, parce que: "le film à happy end du progrès s'est transformé en cauchemar" (p. 12).
Dans le présent, le progrès a pris le visage de l'horreur. Dans chaque précipitation du temps, la force apocalyptique révèle un espace d'une verticalité impensable, induit la métanoïa chez l'individu qui en devient le porteur et, en un, la métamorphose du monde. Alvi conclut: "La seule révolution nécessaire est celle qu'impose l'Apocalypse, et dont le lecteur obtient une transmutation de lui-même et du monde qui est bien plus que comprendre, elle est agir" (p. 304-305). C'est pourquoi il ne s'attarde pas simplement sur l'analyse du texte, mais présente le monde idéal de quarante-deux "contaminés" par l'Apocalypse qui, entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle, ont reproposé la gnose chrétienne.

Tout d'abord, l'auteur prévient le lecteur que toute analyse du texte est compromise par les polarités antithétiques qui y apparaissent. Il rappelle donc les apports herméneutiques fournis par Robert Henry Charles et par le théologien Bousset, concernant l'identification probable de l'auteur de l'Apocalypse, retracée par les deux savants non pas à Jean l'Apôtre, mais à Jean le Presbytre. L'analyse d'Alvi procède en stigmatisant négativement la perversion rhétorique de l'Apocalypse, réalisée par des philologues peu avisés, opérant même dans les Églises: "Depuis au moins soixante-dix ans, presque toute la théologie de Rome [...] a en effet jugé l'Apocalypse comme un livre irréfléchi et incompréhensible" (p. 23), au point de la réduire à une œuvre anti-romaine de l'apocalyptique juive tardive. Le point de non-retour, dans la lignée de ces interprétations qui mènent au sociologisme, se trouve dans la thèse du dominicain Boismard, pour qui: "Une équation du premier degré aurait suffi à résoudre les énigmes de l'Apocalypse" (p. 25). L'apocalyptisme ne peut être catalogué par l'esprit abstrait, intellectualiste et combinatoire.
En outre, le critère d'ordre du texte se retrouve dans le retour des chiffres obsessionnels, renvoyant à une arithmétique qualitative et aux rythmes internes de l'écriture. Pour entrer dans les choses vivantes de l'Apocalypse, il faut se sentir "perdu dans ce temps et vouloir être apocalyptique, c'est-à-dire dans la torsion du texte pour être révélé, transmuté à un autre" (p. 29). L'Apocalypse subvertit le temps et l'espace, comme ont pu le faire deux des "apocalyptiques nécessaires", Guido de Giorgio, submergé par l'ouragan de dévotion qui lui a apporté l'expérience de l'inversion du temps, et Pavel Florenskij, à la recherche d'un espace analogique et non euclidien. Les premiers vivaient isolés dans un presbytère de montagne près de Mondovì. Le sodal d'Evola dans le "Groupe Ur" magique, il se rendit en train, immédiatement après la Seconde Guerre mondiale, pour rencontrer Padre Pio en personne à San Giovanni Rotondo: il fut tellement frappé par la rencontre qu'il jeûna pendant deux jours et écrivit, à l'improviste, pendant la célébration de la messe, ces mots: "nous transitoires, toi seul permanent, toi inconcevable infini, nous plate-forme de la mort" (p. 32).
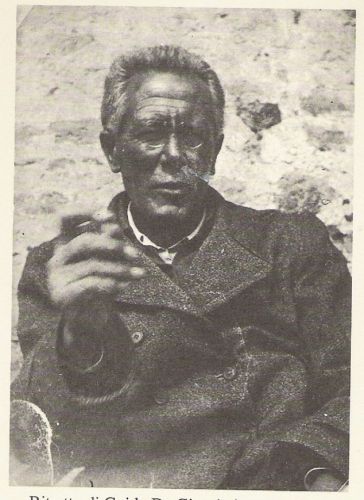
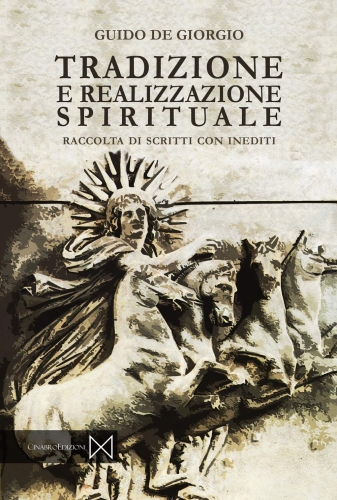
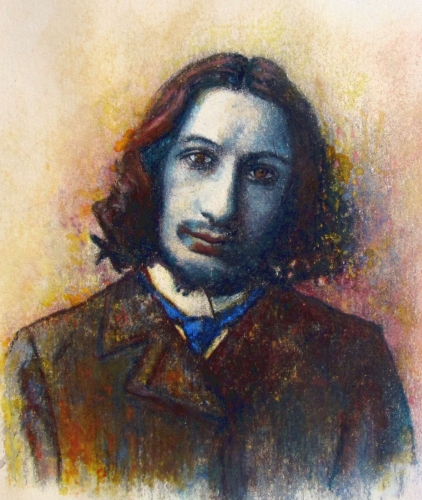
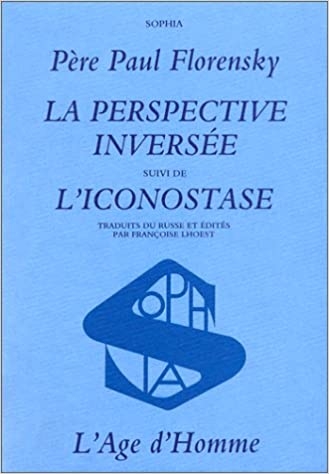
Ce n'est qu'en comprenant la dimension du miracle qu'il est possible d'accéder aux profondeurs apocalyptiques. Florensky était un moine, mathématicien et philosophe. Dans son œuvre, l'espace apocalyptique a trouvé sa pensabilité, suggère Alvi. C'est l'espace dont témoignent les icônes: "géométrie à courbure variable conquise par la prière, imperturbable" (p. 37). C'est l'espace dans lequel l'invisible fait irruption dans le visible, la "porte royale et dorée" ouverte sur l'au-delà. Le réalisateur Tarkovski a eu la même perception lorsqu'il a décrit l'Apocalypse comme étant "la plus grande création poétique qui ait jamais existé sur terre... C'est, en dernière analyse, un récit de notre destin" (p. 37).
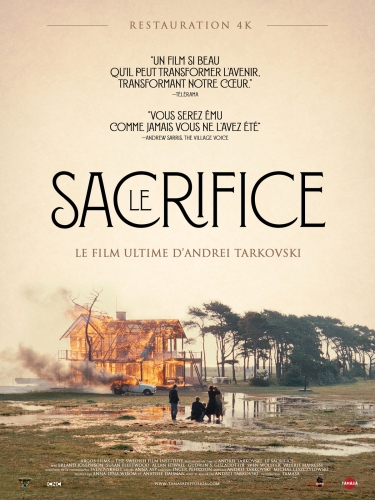
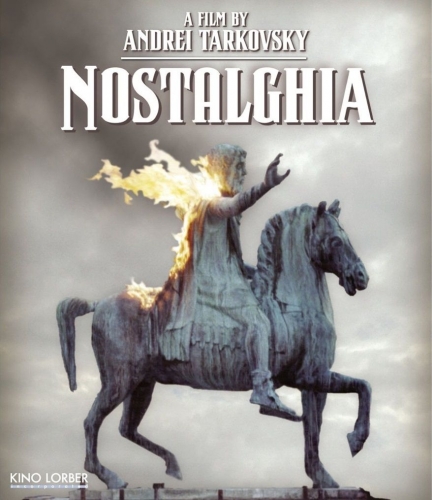
C'est pourquoi, à notre avis, le plexus le plus significatif et le plus révélateur du livre se trouve dans l'analyse du Parsifal de Wagner. Parsifal, le fou pur, fait l'expérience de la subversion de la perception habituelle, il fait l'expérience "du renversement du lien qui proportionne le temps à l'espace écoulé. Pour lui, le temps est désormais éteint, dilaté au-delà de toute distance" (p. 304). Il est nécessaire de ressentir ce que ressent Parsifal : "l'éternel qui s'accélère, la fin de toute mesure, sans précédent" (p. 304), afin d'expérimenter la "libération". De plus, notre auteur sait que de nombreux plexus de l'Apocalypse présentent une régression par rapport au mythe. Le programme exposé par Wagner, dans Religion et art, n'était-il pas une tentative de sauver, à une époque de sécularisation avancée, le Kern "chrétien par une œuvre d'art élevée au mystère" (p. 296)? En bref, le Graal de Parsifal est un rituel de l'ego qui, s'étant engagé sur la voie de la recherche, se trouve être apocalyptique. En conclusion: "Le mythe de Parsifal complète l'Apocalypse" (p. 297).
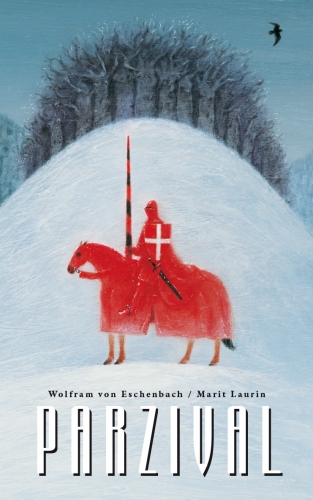
L'Apocalypse sape l'idée de réalité mais, en même temps, possède en elle-même, selon son prologue, un trait fondateur. Par conséquent, face au risque pandémique que nous vivons, occasion qui permet au Pouvoir homologuant de mettre en œuvre la dernière phase de son action dissolvante, il ne reste plus qu'à se tourner vers le salut apocalyptique. En effet: "Le souffle qui infecte est distrait, d'une âme séparée du ciel. Respirer, c'est prier, c'est monter à la colonne" (p. 423).
Giovanni Sessa
Giovanni Sessa est né à Milan en 1957. Il vit à Alatri (Fr) et est professeur de philosophie et d'histoire dans les écoles secondaires, ancien professeur adjoint de philosophie politique à la Faculté des sciences politiques de l'Université "Sapienza" de Rome et ancien professeur contractuel d'histoire des idées à l'Université de Cassino. Ses écrits ont été publiés dans des magazines, des journaux et des périodiques. Ses essais sont parus dans divers volumes et actes de conférences nationales et internationales. Il a publié les monographies Oltre la persuasione. Saggio su Carlo Michelstaedter, Settimo Sigillo, Rome 2008 et La meraviglia del nulla. Vita e filosofia di Andrea Emo, Bietti, Milan 2014, préface de R. Gasparotti, in Appendix Quaderno 122, inédit du philosophe vénitien. Il a également publié un recueil d'essais Itinerari nel pensiero di Tradizione. L'Origine o il sempre possibile, Solfanelli, Chieti 2015. Il est secrétaire de l'École romaine de philosophie politique, collaborateur de la Fondation Evola et porte-parole du Mouvement de pensée "Pour une nouvelle objectivité".
16:27 Publié dans Livre, Livre, Philosophie, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : apocalypse, philosophie, religion, tradition, traditionalisme, geminello alvi |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Heidegger et "l'oubli du Soi" : une pensée vigoureuse contre la civilisation technicisée qui est d'actualité tous les jours

Heidegger et "l'oubli du Soi": une pensée vigoureuse contre la civilisation technicisée qui est d'actualité tous les jours
Nicolas Mavrakis
Ex: http://www.elespiadigital.com/index.php/noticias/politica/35085-2021-08-27-09-00-05
Le 26 mai 1976, "après un réveil agréable le matin", note le biographe Rüdiger Safranski, l'un des plus grands philosophes du siècle, Martin Heidegger, s'endort à nouveau et meurt à l'âge de 87 ans.
Deux jours plus tôt, il avait écrit ses derniers mots, une salutation à Bernhard Welte, un théologien né dans la même ville allemande que lui, Messkirch, non loin de la Forêt Noire, où il évoque l'une des questions pour lesquelles la pensée heideggérienne, à travers le temps et la distance, est toujours présente: "Il faut réfléchir à la manière dont une patrie peut encore exister à l'époque de la civilisation uniformément technicisée du monde".
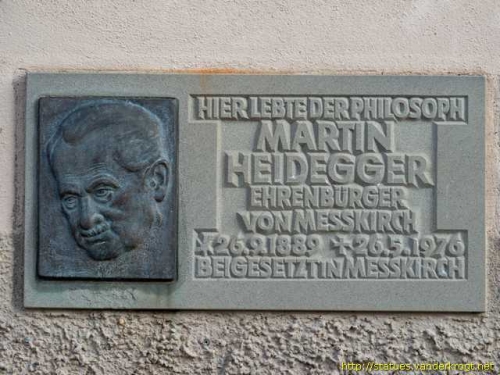

Cette préoccupation de l'impact de la technologie sur l'existence a accompagné Heidegger tout au long de sa vie. En 1910, à peine âgé de 21 ans, il reprochait déjà à la modernité son "atmosphère étouffante, le fait qu'elle soit une époque de culture extérieure, de vie rapide, de fureur innovatrice radicalement révolutionnaire, de stimuli de l'instant, et, surtout, le fait qu'elle représente une agression sauvage sur le contenu le plus profond de l'âme de la vie et de l'art", rappelle Safranski. Et cette condamnation du vertige provoqué par la technique (la technologie, dirions-nous maintenant) ne ressemble-t-elle pas à ce que n'importe quel critique contemporain reproche aujourd'hui à Internet de faire à nos vies ?

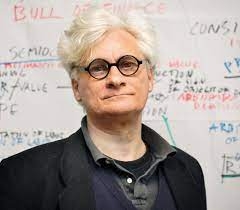

Si nous pensons aux philosophes actuels de la technologie tels que le Sud-Coréen et Allemand Byung-Chul Han, l'Italien Franco "Bifo" Berardi ou le Français Éric Sadin, les grandes lignes de leurs mises en garde contre une civilisation numérisée convergent vers la même chose: à l'ombre des idées de Heidegger, tous répètent à leur manière, avec des formules telles que "société de la performance et de la transparence", "tempête d'info-stimulation" ou "siliconisation du monde", que l'humanité est toujours vidée de son essence par l'avancée de la technologie (sous forme de réseaux sociaux, d'algorithmes et d'écrans), raison pour laquelle nous ne sommes guère plus que des maillons inertes dans un mécanisme de pure exploitation mercantile.
C'est cet "oubli de l'être", selon les mots de Heidegger, qui, au XXIe siècle, fixe encore les coordonnées du conflit entre l'homme et la machine. Pour le comprendre le plus simplement possible, rien de mieux que les mots de l'essayiste argentin Eduardo Grüner dans La obsesión del origen (Ubu Ediciones) : ce que révèle la question de Heidegger sur la technologie, c'est "une logique dont le but est la substitution de la Vérité de l'Être par un Savoir mécaniste qui fait du monde une image efficace, mais dépourvue de fondement et de valeur profonde".

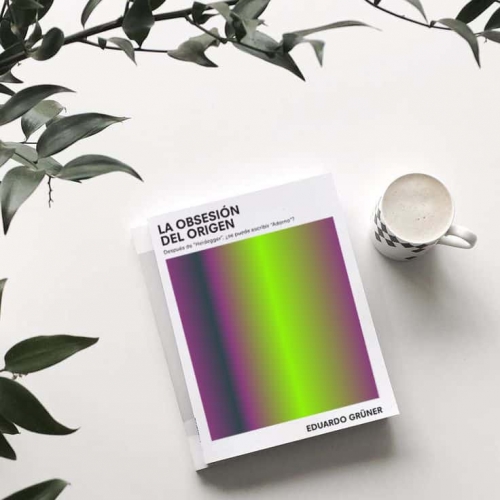
La frénésie d'une technologie débridée
Si Heidegger marque encore de son sceau la pensée portant sur la racine des grandes préoccupations provoquées par les dispositifs technologiques qui entourent notre existence, c'est parce que les ordinateurs, la télévision et les téléphones portables occupent de plus en plus une grande partie de notre temps "et la technologie présente ce fait comme un triomphe de l'esprit", explique l'essayiste argentin Oscar del Barco dans El estupor de la filosofía (Biblioteca Internacional Martin Heidegger). En fait, l'ingérence de la technologie jusque dans l'intimité de la vie est présentée comme ce qui "sauve", écrit del Barco, dans le sens où, comme l'indique la logique exhibitionniste des réseaux sociaux, "la transparence totale est exhibée comme un bonheur".
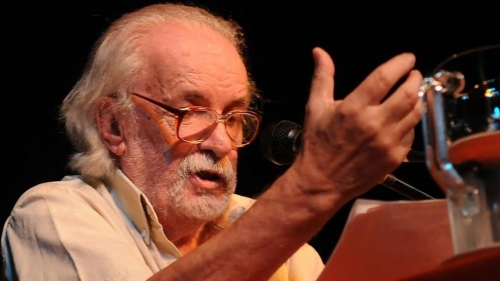
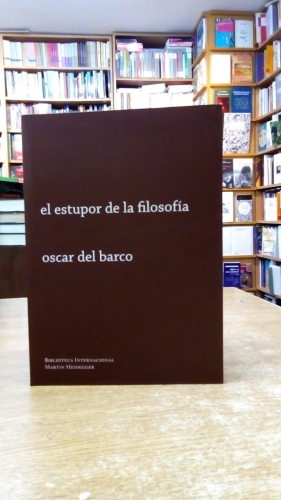
Le point essentiel est que ce processus conduit à un monde de plus en plus annulé, rigidement rationnel "et simultanément dépourvu de raison", souligne del Barco. Or, ce que le saut technologique numérique actuel nous montre quotidiennement, Heidegger l'a perçu avant (et mieux) sous l'idée d'une nature qui devient objet de calcul, de sorte que l'homme commence aussi à se regarder comme s'il était une chose parmi les choses. En termes heideggériens, l'Être, c'est-à-dire l'essence humaine qui devrait être "non cachée" pour que la vérité puisse advenir, est "voilé" par la technologie.
Quelques ouvrages de l'auteur allemand
Mais la différence entre ce que ces idées signifiaient pour Heidegger et ce qu'elles signifient aujourd'hui pour ses acolytes est marquée par le contexte historique unique du grand penseur allemand. Au début des années 1930, alors qu'au sommet de sa carrière Heidegger est déjà recteur de l'université de Fribourg, la technification de l'existence est contestée par deux grandes puissances idéologiquement antagonistes mais identiquement modernisatrices: le communisme et le capitalisme. Et face à "cette même frénésie sinistre de la technique débridée et de l'organisation sans racines de l'homme standardisé", comme l'écrit Heidegger, c'est alors que le national-socialisme d'Adolf Hitler séduit le philosophe avec ses promesses de récupération des valeurs du sol et de la tradition, comme option de dépassement.
Penser avant et après le nazisme
Parmi les perspectives qui se sont conjuguées au fil des décennies pour comprendre les racines philosophiques du lien entre Heidegger et le nazisme, l'une des plus intéressantes est celle qui trouve le point clé dans le caractère de "révolution conservatrice" du Troisième Reich. En tant que signe d'aversion pour le moderne, la décision de Heidegger en faveur du nazisme (auquel il est affilié et qu'il accompagne en public en tant qu'universitaire jusqu'en 1934, date à laquelle il démissionne de son poste de recteur de Fribourg) pourrait donc être pensée comme une position humaniste et, en même temps, antidémocratique, "repliée sur les valeurs de tradition et de racines représentées par le Führer", comme l'expliquent les Français Luc Ferry et Alain Renaut dans Heidegger et les Modernes.
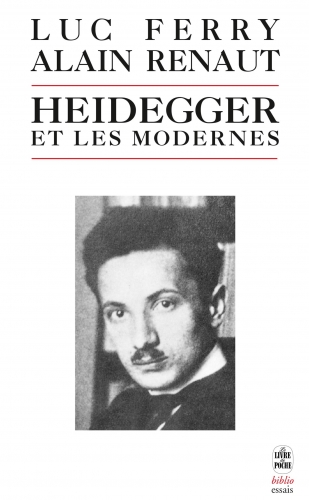
Selon cette explication, ce que Heidegger aurait valorisé dans le projet de pouvoir nazi, c'est un retour idéal à un "univers pré-moderne", capable d'établir au nom de l'identité et de la tradition germaniques une limite infranchissable à la technification écrasante de l'essence humaine (dont les effets incluent l'échec de la démocratie, puisqu'elle ne fait que reproduire la volonté du pouvoir technique sous l'illusion du vote). Bien que l'enthousiasme n'ait duré que jusqu'en 1934, l'intérêt de cette perspective est qu'elle soulève, à sa manière, un dilemme actuel: est-il possible de limiter le développement technologique? N'est-il pas encore possible, au XXIe siècle, de se demander quelle part de l'internet est positive et quelle part est négative? Et si une telle limite était mesurable et fixée au nom d'une tradition ou d'une utopie, qui la fixerait et comment serait-elle appliquée?
Bien sûr, aucune explication de la relation entre Heidegger et le nazisme ne peut éviter la contradiction entre les modes de pensée abstraits et les rails d'acier qui ont conduit des millions de Juifs vers les camps d'extermination (ce que le philosophe a appris après 1945). Cependant, affirmer que Heidegger était un antisémite est incompatible avec sa vie privée ou publique. Dans ce cas, si sa liaison avec Hannah Arendt, la brillante philosophe juive qu'il a rencontrée à Marbourg alors qu'elle n'était qu'étudiante, est souvent évoquée comme la preuve que Heidegger n'a manifestement pas pratiqué de "nazisme biologique" (comme le prouve également le lien tutélaire avec Leo Strauss, Karl Löwith ou Emmanuel Levinas), son refus de se rendre pendant la guerre dans les pays occupés en tant que représentant officiel de la pensée allemande marque sa nette réserve de "nazi politique". En ce sens, le retrait officiel des professeurs juifs à Fribourg, par exemple, était une politique raciale de la bureaucratie nazie à laquelle Heidegger (malgré ses remarques antisémites parfois caricaturales dans les Cahiers noirs) n'a jamais apporté un mot de soutien public.
Sérénité face aux choses et ouverture au mystère
Après la fin de la Seconde Guerre mondiale et du Troisième Reich, un long débat académique s'ouvrira (et pendant quelques années, Heidegger sera interdit d'enseignement universitaire) pour savoir si l'auteur de l'Être et le temps doit être "radié" en tant que philosophe, ou si, au mieux, il doit lui-même faire le mea culpa qui lui permettra d'être officiellement réhabilité en tant que penseur. Contre toute attente, cependant, Heidegger a maintenu un solide silence sur sa période de sympathie pour le nazisme qui, au fil des ans, a été comblé par l'admiration ouverte de son œuvre par de nouveaux diffuseurs reconnaissants, surtout français, tels que Jean-Paul Sartre, Jacques Lacan, Michel Foucault et Jacques Derrida, entre autres.

À peu près au même moment, la pensée de Heidegger prendra un tournant (ou un "retour en arrière approfondi", comme le note Grüner) vers une version plus étroitement liée à l'événement poétique de l'Être et de son histoire, mouvement avec lequel il reprendra la question de la technique telle qu'elle circule encore chez les philosophes du présent. Ce processus s'est déroulé pendant les années où, banni des milieux universitaires, Heidegger a poursuivi ses séminaires et ses conférences auprès d'un public très différent: la bourgeoisie de Brême et de Munich, villes dans lesquelles il a travaillé avec l'aide d'anciens étudiants, même si les hommes d'affaires, les commerçants et les femmes au foyer qui assistaient à ses leçons dans les clubs et les salons n'avaient pas la formation philosophique nécessaire pour le comprendre pleinement. En 1953, malgré cela, Heidegger prononce à Munich l'une de ses plus importantes conférences, La question de la technique.
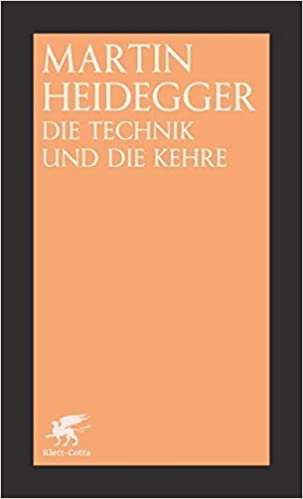
Mais c'est en 1955, dans sa ville natale de Messkirch, que Heidegger parle de "sérénité", un concept avec lequel il propose sa propre réponse à l'avancée des machines de la technification, qui marque, encore aujourd'hui, le paradoxe dans lequel se glissent ceux qui dénoncent avec effroi une société numérisée, contre laquelle une attitude de déni ou de fuite n'est pas non plus viable. Cette "sérénité", explique Heidegger, exige une "attitude de oui et de non simultané au monde technique avec un vieux mot: le détachement des choses", de sorte que nous devons laisser les objets techniques "à l'intérieur de notre monde quotidien et en même temps à l'extérieur". Bien sûr, la "sérénité" se réfère à une disponibilité pour un nouveau destin (qui en se produisant clarifie "l'essence de l'Être") plutôt qu'à une pratique concrète et calculée sur les dispositifs qui nous entourent. En attendant, nous devons assumer "la sérénité face aux choses et l'ouverture au mystère".
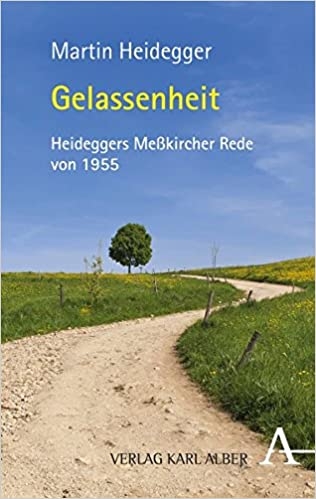 Un héritage philosophique incandescent pour et contre
Un héritage philosophique incandescent pour et contre
Martin Heidegger n'a pas seulement des adhérents rigoureux parmi les auteurs les plus populaires de la philosophie d'aujourd'hui (dans le nouveau livre de Byung-Chul Han, The Palliative Society, son concept de "terre" est même évoqué comme ce qui se cache contre "une curieuse pénétration calculatrice"), mais même un marxiste aussi étranger à ses idées que Slavoj Žižek le mentionne (également dans son nouveau livre, Like a thief in broad daylight) à la fois pour souligner l'importance d'une pensée prête à avancer contre elle-même et pour rappeler ce que signifie "la fin de la nature" aux mains de la biogénétique. La même piste traverse des auteurs argentins comme Eduardo Grüner et Oscar del Barco, capables d'éclairer les derniers débats autour de Heidegger, mais elle est également palpable dans d'autres lignes d'analyse qui, à partir des prémisses de leur philosophie de la technologie, proposent leurs propres idées pour penser le présent. C'est le cas de La imprevisibilidad de la técnica (UNR editora), de Margarita Martínez et Ingrid Sarchman.
À la lumière des disciples égarés de Heidegger comme le Français Gilbert Simondon ou l'Allemand Peter Sloterdijk, les auteurs tracent un rapport aux machines du XXIe siècle qui échappe à l'"hystérie anti-technologique" qui refuse d'assumer, précisément sous le poids des préceptes heideggériens, que la nature humaine est "le résultat de la technique ambiante".
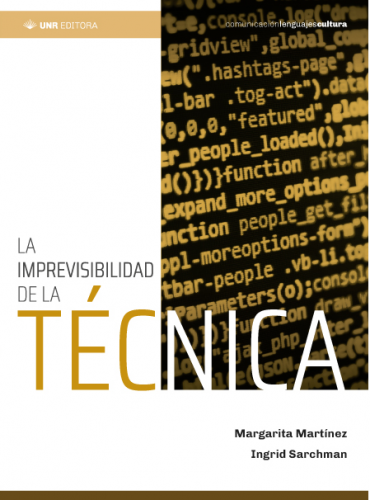
À partir de là, leurs discussions portent sur des questions aussi diverses que la signification du terme "déconstruction" (inventé par Derrida avant de réapparaître dans les conflits de genre par une réappropriation des concepts de langage technique de Heidegger) ou des processus urbains tels que la "gentrification", qui nous permet de comprendre comment fonctionne ce "spectre de la mélancolie", renouvelant sur une touche vintage la fascination pour les disques vinyles ou les cassettes, objets dont l'extinction est teintée des mêmes tons sépia avec lesquels Instagram expose notre dernier selfie. Et c'est donc à nouveau sur le territoire numérique que nos images virtuelles sont (et sont) mises en tension entre "dévoilement et dissimulation".
En outre, la présence de Heidegger se poursuit parmi ceux qui s'engagent à penser au sein des universités, ainsi que parmi ceux qui, au contraire, pensent au-delà de la salle de classe.
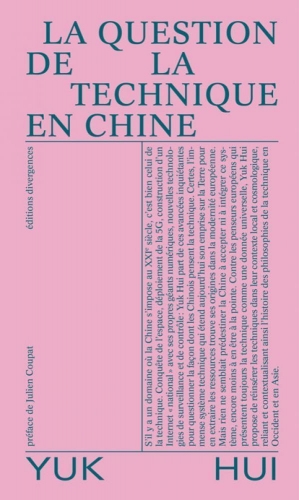
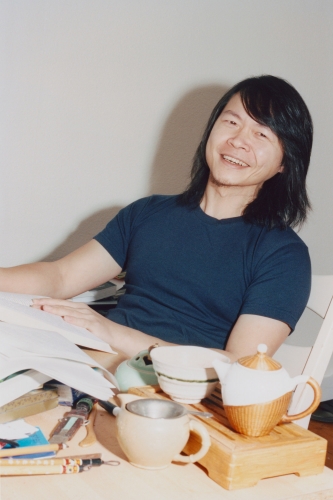
C'est pour cette raison que, même si les chercheurs qui analysent les moindres détails de son œuvre continuent à publier et à discuter de nouveaux livres année après année, dans le même temps, son nom réapparaît aussi bien dans l'œuvre d'un nouvel auteur comme le Chinois Yuk Hui, qui dans Fragmenting the Future (Black Box) tente de "dépasser le discours de Heidegger sur la technologie", et dans les articles de la Slovène Renata Salecl, dont la critique de "l'obsession de l'efficacité" dans El placer de la transgresión (Ediciones Godot) est redevable des mêmes intuitions formulées il y a plus de cent ans par l'un des plus grands et des plus polémiques philosophes du XXe siècle.

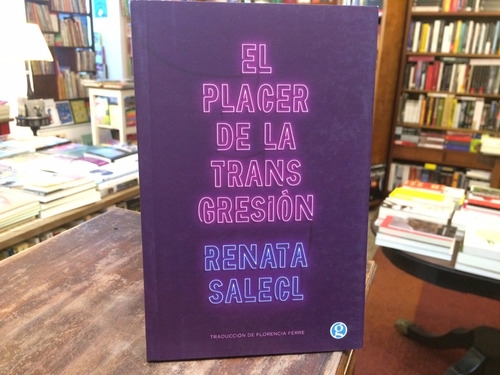
14:08 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : martin heidegger, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 28 août 2021
Etat et Nation : la pertinence de Hegel selon Domenico Fisichella
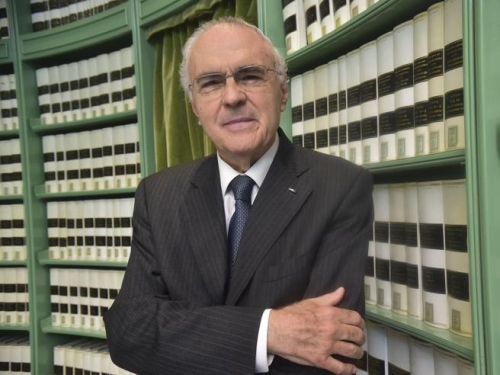
Etat et Nation: la pertinence de Hegel selon Domenico Fisichella
Sur le nouvel essai de l'universitaire conservateur paru chez Pagine editrice
par Giovanni Sessa
SOURCE : https://www.barbadillo.it/100421-stato-e-nazione-lattualita-di-hegel-secondo-domenico-fisichella/
Hegel est, sans aucun doute, l'un des penseurs les plus controversés de l'histoire. Son influence, bien que la distance de la philosophie contemporaine par rapport à l'idéalisme soit évidente, se fait sentir dans de nombreux domaines de la connaissance, de la logique à l'art. La discipline dans laquelle le magistère de l'Allemand est le plus évident aujourd'hui est probablement la philosophie politique. C'est ce que rappelle, avec des accents et des arguments convaincants, un récent ouvrage de Domenico Fisichella, éminent chercheur et professeur de sciences politiques, Stato e Nazione. Hegel e il suo tempo, publié par Pagine editrice (pour les commandes : 06/45468600, pp. 197, €18.00). Le texte vise à valoriser la doctrine hégélienne, le moment de l'État, dont le traitement est diriment par rapport à l'état actuel des choses.
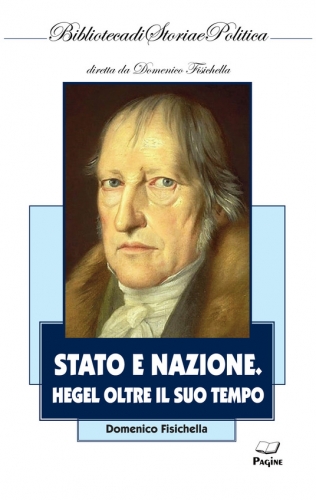
Dans la théorie et la pratique politiques de ces derniers temps, une tendance clairement identifiable a émergé, visant à remplacer l'institution étatique par "l'administration des choses et (par) la gestion des processus de production", en un mot par les procédures de gouvernance. Fisichella ne se contente pas de constater l'inanité d'une telle position, il se réfère également à Hegel, afin que le lecteur sache que l'État n'est en aucun cas voué à "l'extinction". Cet objectif est poursuivi par l'auteur à travers une exégèse astucieuse de la pensée politique du "panlogiste". Il a retracé quatre phases de développement dans l'histoire universelle: orientale, grecque, romaine et chrétienne-germanique, chacune caractérisée à sa manière.
Le point culminant de l'enquête de Hegel se trouve dans le cœur vital de la doctrine de l'État, l'éthique. L'éthicité "doit être comprise comme l'engagement unitaire qui combine la volonté et la rationalité, et qui s'exprime par l'addition en esprit des personnes, des peuples et des institutions" (p. 33). Dans ce sens, la famille est configurée comme la cellule de la tradition, puisque, d'une part, elle exprime l'éthicité dans la sublimation de la sexualité mise en œuvre dans la relation conjugale et, d'autre part, elle détermine le lien entre le présent, le passé et le futur, dans une fonction anti-individualiste et anti-atomiste.

Les classes, les guildes et les corporations réalisent l'éthique au sein de la société civile. Ils sont chargés d'élever l'intérêt particulier au rang de bien commun. Attention, cela ne peut être pleinement réalisé que dans l'Etat qui, pour Hegel, manifeste le Tout. L'histoire est le résultat agonistique des conflits entre différentes entités étatiques, et c'est la "ruse de la raison" qui fait que l'esprit du monde s'incarne, de temps à autre, dans un ethnos donné et dans des "individus cosmico-historiques". Pour l'auteur, le philosophe allemand, en fonction de la dimension polémologique qui sous-tend sa vision des choses, ne considérerait pas possible, à l'ère chrétienne-germanique, la réalisation de la "fin de l'histoire". De plus, pour Hegel, l'État est un a priori, vivant in interiore homine : si le peuple venait à faire fi de l'institution étatique, il serait relégué à la condition de simple "masse". En ce sens, les constitutions ne sont rien d'autre que la transcription juridique de l'ethos d'une gens donnée, et ne peuvent donc pas être définies par un bureau, comme le prétendaient les Lumières. Le cœur vital de l'État est le souverain qui incarne et défend l'équilibre entre les individus, les familles et la société civile. La monarchie vers laquelle Hegel se tourne est tempérée, constitutionnelle, fondée non pas tant sur la division des pouvoirs que sur leur "répartition", comme dans les accords de l'authentique "esprit des lois" de Montesquieu.
Fisichella note que la doctrine de Hegel ne conduit pas à la statolâtrie et au nationalisme, car elle postule un équilibre entre les pouvoirs et les différentes composantes sociales. Hegel avait pour objectif la création d'un État unitaire pour la nation allemande, en ce sens, l'esprit qui anime ses pages sur le sujet est machiavélique, regardant avec admiration le secrétaire florentin.
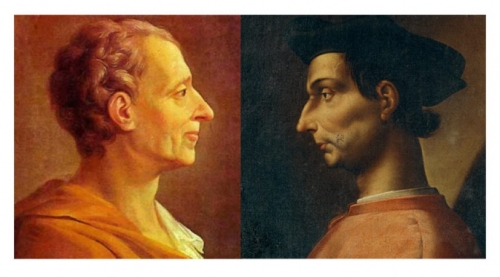
Une autre de ses références est Montesquieu, déjà cité, qui considérait que l'"exportation de la liberté" appartenait à la culture des Allemands. Ce n'est pas un hasard si l'ère chrétienne-germanique est, selon le théoricien du Geist, l'ère du déploiement de la liberté. Il y a donc chez Hegel une valorisation importante du principe de nationalité, qui ne dégénère jamais en exaltation nationaliste. De plus, la statolâtrie est exclue de son horizon de pensée, car, comme nous l'avons dit, entre les individus et l'État il y a de nombreuses étapes intermédiaires, qui permettent au philosophe de ne pas identifier "la partie avec le tout" (p.120). Même la guerre, dans l'exégèse hégélienne, n'est pas détachée du moment juridique. Elle ne peut pas devenir totale, elle ne peut pas perdre son caractère "conservateur" et devenir destructrice, comme le croyaient au contraire les révolutionnaires.
En ce qui concerne l'"état d'exception", Hegel garantit la nécessité de ne pas séparer les aspects politiques et juridiques. Sa position sur cette question diffère de celle développée au 20ème siècle par Carl Schmitt. L'éminent juriste interprétait la souveraineté de l'État comme un "monopole exclusif de la décision" (p. 130), et non en termes de monopole de la sanction, de la norme. Le souverain schmittien est, à deux moments différents, avant et pendant l'état d'exception, à l'intérieur et à l'extérieur du système juridique. Dans cette perspective, l'ordre normatif est fondé sur la décision. Hegel, dont la pensée est fondée sur le concret, considère au contraire que dans la modernité, le souverain, en tant que chef de la monarchie constitutionnelle, héréditaire et légitime, même face à un état d'exception, ne doit pas suspendre l'ordre existant, puisque la fonction royale lui est coéminente. En effet, la permanence de la fonction royale est suivie du maintien des "garanties qui lui sont liées pour les individus et les groupes sociaux" (p. 135). Hegel, en substance, est en phase avec la critique de la Révolution française par l'intermédiaire, entre autres, de Burke et de Maistre, et parvient à proposer une synthèse positive de la liberté et de l'autorité de l'État.
Sa leçon, suggère Fisichella, est d'un grand intérêt : actuellement, le particularisme politique, la démagogie et les pouvoirs oligarchico-financiers affaiblissent le rôle de l'institution étatique. En conclusion, la leçon politique hégélienne peut être résumée en ces termes: "Non au contractualisme [...], non à la souveraineté populaire, non à la liberté qui déborde sur le libertarisme, oui à l'égalité comme reconnaissance de la personne mais non à l'égalitarisme, [...] oui à l'individualité [...] mais non à l'individualisme, [...] oui enfin à l'organicité comme système" (p. 163).
Giovanni Sessa
14:16 Publié dans Livre, Livre, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, philosophie, hegel, état, nation, philosophie politique, domenico fisichella, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 27 août 2021
Sur les mensonges et la post-vérité
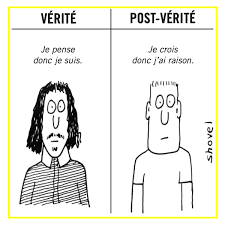
Sur les mensonges et la post-vérité
Par Alberto Buela*
Ex: https://nomos.com.ar/2020/04/24/sobre-la-mentira-y-la-posverdad/
 On constate que relativement peu de penseurs ont traité spécifiquement du sujet du mensonge. L'explication réside dans le fait que les philosophes ont ouvertement traité de son contraire: la vérité. Néanmoins, nous trouvons quelques auteurs significatifs qui ont étudié le mensonge: Saint Augustin dans deux petits livres: De mendacio (395 après J.-C.) et Contra mendacium (420 après J.-C.); Friedrich Nietzsche dans Sobre la verdad y la mentira en sentido extramoral (Über Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne), de 1873; et Alexandre Koyré dans Réflexions sur le mensonge. En outre, entre Saint Augustin et Nietzsche, il y a quatorze siècles pendant lesquels le sujet est traité par les grandes Summae theologicae, qui donnent aussi un certain traitement, collatéral au sujet de la vérité.
On constate que relativement peu de penseurs ont traité spécifiquement du sujet du mensonge. L'explication réside dans le fait que les philosophes ont ouvertement traité de son contraire: la vérité. Néanmoins, nous trouvons quelques auteurs significatifs qui ont étudié le mensonge: Saint Augustin dans deux petits livres: De mendacio (395 après J.-C.) et Contra mendacium (420 après J.-C.); Friedrich Nietzsche dans Sobre la verdad y la mentira en sentido extramoral (Über Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne), de 1873; et Alexandre Koyré dans Réflexions sur le mensonge. En outre, entre Saint Augustin et Nietzsche, il y a quatorze siècles pendant lesquels le sujet est traité par les grandes Summae theologicae, qui donnent aussi un certain traitement, collatéral au sujet de la vérité.
La première approche philosophique de tout sujet est étymologique. "Mentir" vient du latin mendacium, qui dérive du verbe mentior/ri (= "mentir"), lui-même issu de l'indo-européen "men" (= "esprit"). Le concept de mensonge est donc lié, tout d'abord, à celui d'esprit, comme nous pouvons le constater dans cette première approche philologique. A partir de là, nous pouvons tenter une première définition en disant que le mensonge consiste à dire quelque chose de contraire à ce que l'on pense ou à manigancer une tromperie par le truchement de son esprit. Et c'est là que se pose le premier problème, à savoir que la catégorie de la tromperie a une plus grande extension que celle du mensonge, puisqu'elle implique la dissimulation, la posture, le mensonge, l'insincérité, la prétention, la dissimulation, l'hypocrisie, le pharisaïsme, la simulation, la cajolerie, la fraude, la tromperie, la fausseté, la duplicité. L'intention délibérée d'affirmer ou de nier quelque chose de contraire à ce que l'on pense vraiment implique quelque chose qui n'est pas vrai, qui n'est pas réel. C'est une invention de l'esprit qui, par conséquent, n'a pas d'existence réelle. Les anciens philosophes scolastiques diraient que c'est un "être de raison", ce qui est dans notre esprit et qui s'oppose à l'existant, comme un cercle carré ou le néant absolu. Le mensonge est pensé par l'esprit comme "être", mais il n'a en lui-même aucune entité réelle, mais son être est seulement dans le fait d'être pensé. C'est-à-dire qu'il n'a d'être objectif que dans l'entendement (= quod habet esse objectivum tantum in intellectus).

De l'homme qui ment, à son tour, nous trouvons deux formes fondamentales de mensonge : a) lorsqu'un mensonge est expressément énoncé avec l'intention de tromper, et b) lorsqu'une information est dissimulée. Dans la dissimulation, ou "tuer en se taisant", pour parler en créole, l'information est retenue et la vérité n'est pas dite par omission. Dans le cas du mensonge express, une étape supplémentaire est franchie, car les fausses informations sont présentées comme si elles étaient vraies.
Il existe deux positions très claires sur le mensonge en général: ceux qui le condamnent sous toutes ses formes, purement et simplement (Saint Augustin, Kant, les philosophes analytiques d'aujourd'hui), et ceux qui sont tolérants à l'égard de certaines des formes mentionnées (Platon, Machiavel, Nietzsche).
Platon est le premier à traiter de la justification d'un certain type de mensonge, bien qu'il le condamnait auparavant. Ce qui est le plus intéressant à noter, c'est qu'il condamne le mensonge non seulement parce qu'il est haï par les dieux et les hommes, mais "parce qu'il produit l'ignorance dans l'âme de celui qui est trompé". En d'autres termes, le mensonge doit être combattu non pas tant pour le mal qu'il fait à soi-même que pour le mal qu'il fait aux autres. Immédiatement après, il se demande quand et pour qui le mensonge peut être utile et non détestable. Et il répond, aussi bien pour tromper ses ennemis que pour aider ses amis, quand par un mensonge on peut les empêcher de faire le mal. Ce dernier est le mensonge que l'on donne par tolérance, afin d'éviter un mal plus grand. En un mot, chez Platon, le mensonge lui-même est carrément condamné ou rejeté, mais il est évalué positivement ou négativement selon l'effet qu'il produit.
De plus, le mensonge, comme le mal, peut être réalisé de plusieurs façons, alors que la vérité, comme le bien, ne peut être réalisée que d'une seule façon. Verbigracia, par exemple, un rôti créole peut être très bien cuit, cru, étuvé, grillé, mais il n'est bien cuit que lorsqu'il est "juste à point". Et c'est pourquoi les types et les classifications de mensonges sont presque infinis. Saint Augustin leur donnait déjà une gradation selon qu'ils sont plus ou moins graves.
Considération actuelle
Aujourd'hui, le mensonge est partout et dans toutes les activités, mais s'il y en a une qui se distingue, c'est bien l'activité politique et financière à grande échelle. Le journalisme, qui devrait être le lieu de la vérité comme l'enseignent toutes les écoles de la profession, est devenu le canal naturel du mensonge, et les journalistes sont devenus des "analphabètes loquaces" en ne reflétant que ce qui apparaît et en n'examinant pas de manière critique les raisons de cette apparition. L'Internet n'inverse pas la tendance, puisqu'il dispose de multiples agences de diffamation politique et morale, comme Indymedia [et aujourd'hui Twitter]. L'homme (homme ou femme) du peuple a été réduit à un sujet de manipulation médiatique. Quant à ceux qui lisent un peu, ceux qui sont moyennement éduqués, ils ne peuvent échapper à l'emprise du politiquement correct qui, d'une part, leur offre une vision et une version uniformes de la réalité et, d'autre part, les effraie avec le sophisme de la reductio ad hitlerum s'ils pensent différemment. Et même le Pape n'est pas épargné par la pression internationale de ce mensonge. Nous en avons la preuve tous les jours. Après en avoir fini avec cette propédeutique, passons au sujet qui nous occupe: la post-vérité.
La post-vérité est une nouveauté philosophique inaugurée par les Anglais il y a quelques années avec Jayson Harbin en 2015, où l'on soutient que ce qui est intéressant n'est pas la réalité, mais ce qui est dit de la réalité. Cette position a donné lieu à différents "récits" sur la réalité, en laissant de côté ce qu'elle nous dit d'elle-même. Il s'agit essentiellement des récits politiques et culturels qui prétendent aller au-delà des anciennes idéologies, mais qui finissent par être une fraude. Les partisans de cette nouvelle théorie ont abandonné l'idée de la vérité comme adaequatio intellectus et rei et l'ont remplacée par adaequatio rei ad intellectum. C'est-à-dire que l'adéquation entre l'intellect et la réalité a été remplacée par l'adéquation de la réalité à ce que l'intellect dit d'elle, comme l'ont postulé les idéalistes et les illuministes du 18ème siècle. Ainsi, si nous allons mal dans ces démocraties post-modernes où personne ne s'occupe de nous et où nous sommes tués comme des chiens dans la rue, les partisans de la post-vérité nous disent: l'insécurité n'est qu'une sensation.
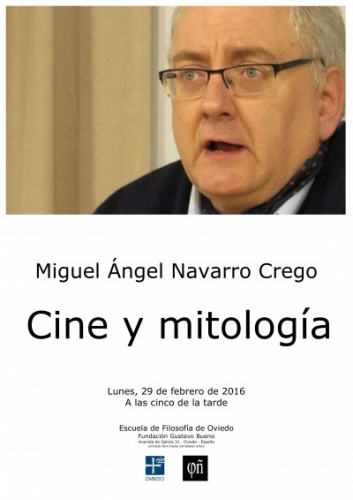
En outre, la post-vérité ne parle jamais d'elle-même. Un bon professeur espagnol, Miguel Navarro Crego, fatigué de donner des explications sur le sujet, déclare: "la post-vérité est le déguisement le plus récent et le plus carnavalesque de ce que l'on a toujours connu sous le nom de tromperie, fraude et mensonge".
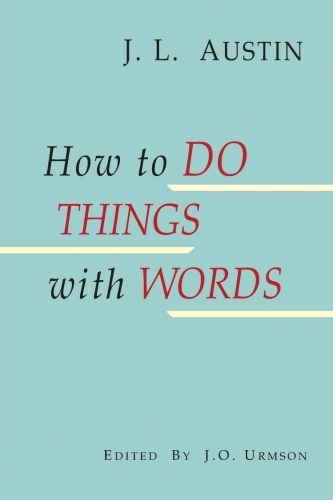
À mon avis, l'idée de post-vérité remonte également à une autre occurrence anglaise: les énoncés performatifs d'Austin dans son livre How to do things with words (1962). Pour lui, le langage ne se contente pas de décrire des faits, mais peut réaliser certains faits en les exprimant. Lorsque nous disons "je promets", puisque nous ne savons pas si cela sera vrai ou faux, nous faisons une promesse. Ou lorsque le prêtre dit "Je te baptise", cela produit le fait du baptême. Cette fonction du langage que les Anglais appellent performative, nos professeurs de base qui imitent toujours, mais qui comme un miroir opaque imitent mal, l'ont traduit par "performative" au lieu de "realizative" en bon espagnol, ce qui rend cette théorie plus compréhensible.
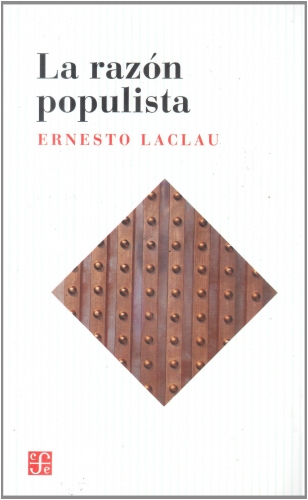
La conséquence politico-logique la plus importante de ces dernières années liée à l'idée de post-vérité est celle soutenue par un Argentin d'origine portugaise, Ernesto Laclau, qui dans son livre La razón populista (2005), compte tenu du fait que le marxisme a perdu le soutien du peuple, affirme que le peuple, les majorités populaires, doivent être remplacées par différents peuples ou collectifs ou différentes minorités, qui sont les véritables destinataires des gouvernements démocratiques. Ces derniers phénomènes sont une création intellectuelle (en Argentine, les Indiens réapparaissent, au Chili, une "république" mapuche, des genres différents au-delà du masculin et du féminin, etc.) Ces nouvelles oppositions dialectiques, gays contre hétérosexuels; Indiens contre Blancs; avorteurs contre pro-vie, etc., viennent remplacer [ou "s'articuler avec"] la dialectique marxiste épuisée entre bourgeois et prolétaires. Bien sûr, cela ne porte pas atteinte aux conditions actuelles de production, mais les consolide plutôt. L'impérialisme international de l'argent sautille sur une seule jambe. À cet égard, José Javier Esparza, peut-être la tête la plus pénétrante de l'Espagne d'aujourd'hui, observe: "Donner politiquement une identité unique à cette diversité d'antagonismes. Pour ainsi dire, le discours politique n'est plus la conséquence d'une réalité sociale objective qu'il tente, avec plus ou moins de succès, de décrire; au contraire, le discours est désormais le créateur de la réalité. En l'occurrence, le discours politique crée, constitue, invente un peuple".
La diffusion de cette théorie de la post-vérité a été largement favorisée par l'anthropologie culturelle américaine, lorsque la théorie du melting-pot n'a pas réussi à intégrer les Noirs dans un projet unitaire de la nation américaine et a créé le multiculturalisme. Cette théorie a mis les peuples hispano-américains en déroute et, si nous avons fait quelque chose de bien dans ce monde, c'est de produire une extraordinaire symbiose entre Indiens et Espagnols, ce qui a donné naissance au créole américain qui, comme le disait Bolívar, n'est ni tellement espagnol ni tellement indien.
On voit ainsi comment la théorie de la post-vérité finit par justifier dans le domaine politique l'exploitation de l'homme par l'homme, dans le domaine culturel le refus de l'intégration, et dans le domaine philosophique elle finit par soutenir que rien n'est vrai ou faux.
Le moment du triomphe de la post-vérité est celui où le préjugé ou l'idée préconçue s'installe dans la conscience du sujet post-moderne. Ce qui l'oblige à écouter et à lire, à voir et à écrire, à ne recevoir que ce qui coïncide avec lui et à rejeter "l'autre et l'autre". Cela se voit lorsque l'on sélectionne uniquement ce qui nous convient et que l'on n'accepte pas la réalité, c'est-à-dire les nouvelles qui ne nous satisfont pas, en changeant de chaîne. La post-vérité divertit l'homme dans de fausses disputes, le chargeant de fake news, et lui faisant croire que, tel un petit dieu, il peut créer par son logos, sa parole.
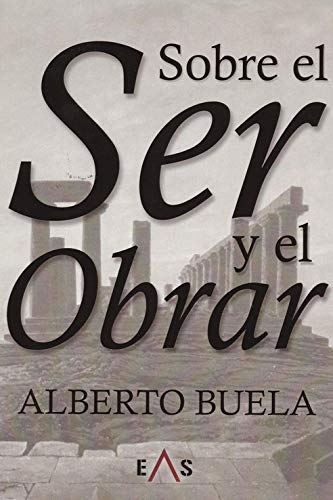
Mais en réalité, seul Dieu peut créer: "au commencement était le Verbe et le Verbe était Dieu" (en arche en ho logos kai ho logos en pros ton Theon). La fonction de l'homme est d'accompagner la création. Le monde est un cosmos, quelque chose de beau, c'est pourquoi il résonne encore en nous dans le terme "cosmétique" - l'art de l'embellissement. Et si nous l'accompagnons, voire la transformons, sans que cela se voie beaucoup, nous nous embellissons (Stefan George). Et si nous nous embellissons par notre action, nous nous rendons, sans nous en rendre compte, plus beaux. Et ainsi, nous arriverions à nouveau à l'idéal grec de la kalokagatia, l'union du beau et du bon comme perfection.
Quel est alors le mécanisme au niveau de l'action humaine pour se libérer de la formidable oppression du mensonge contemporain? La persévérance dans l'unité de ce qui est dit et de ce qui est fait. Dans l'affirmation toujours de ce qui est, de la vérité. Et dans le choix et la réalisation de ce qui perfectionne, de ce qui est bon. Nous savons que la vie quotidienne peint du gris sur du gris, et qu'il n'y a pas toujours et pas en toutes circonstances des disjonctions de ce genre, mais nous savons aussi que, pour exister véritablement, nous devons retrouver quelque chose d'aussi oublié que les aspects transcendantaux de l'être: unum, verum, bonum, avec tout ce que cela implique. Je m'arrête ici, car comme vous pouvez le constater, nous avons atteint le cœur de la métaphysique et il n'est pas approprié d'en parler ici et maintenant.
*Alberto Buela (1946-), diplômé en philosophie de l'Université de Buenos Aires, a complété sa formation par un doctorat en 1984 à Paris IV-Sorbonne, sous la direction de Pierre Aubenque. Pratiquant la phénoménologie existentielle, il a travaillé sur quatre thèmes spécifiques : le sens de l'Amérique, la métapolitique, la théorie de la dissidence et l'éthique de la vertu. Il a écrit plus de trente livres, quelque deux cents articles universitaires et autant de conférences.
10:13 Publié dans Actualité, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, philosophie, alberto buela, vérité, post-vérité, mensonge |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 25 août 2021
L'Occident et l'histoire universelle : pour une critique de l'universalisme abstrait

L'Occident et l'histoire universelle : pour une critique de l'universalisme abstrait
par Vincenzo Costa
Source : Vincenzo Costa & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/l-occidente-e-la-storia-universale-per-una-critica-dell-universalismo-astratto
"Le libéralisme n'est pas un terrain de rencontre possible pour toutes les cultures, il est l'expression politique d'un certain ensemble de cultures et semble être complètement incompatible avec d'autres ensembles". C'est ce qu'écrivait Charles Taylor, offrant une leçon déjà oubliée, et sur laquelle il convient de réfléchir pour comprendre ce qui se passe actuellement.
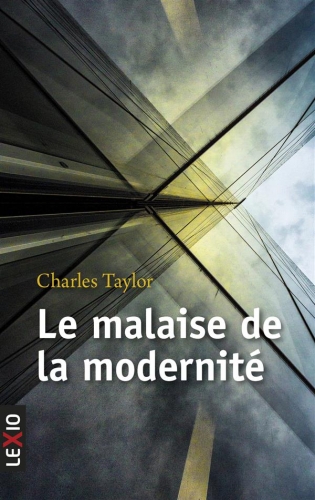
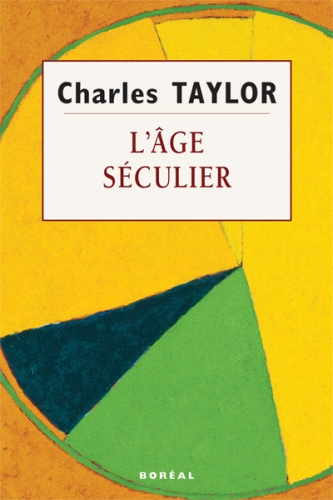
1. Valeurs et pouvoir : hypocrisie et complicité
La conquête et l'extermination des indigènes américains après la découverte de l'Amérique ont été justifiées par les Espagnols sur la base de valeurs, de vraies valeurs, comme un acte d'humanité, pour éliminer ces cultures inhumaines, ces coutumes aberrantes. Une tâche de civilisation.
L'extermination des Amérindiens en Amérique du Nord a été justifiée par les mêmes motifs: sauvages, égorgeurs, incapables de respecter les femmes et les enfants.
L'impérialisme et le colonialisme ont toujours été justifiés sur la base de valeurs, d'une mission prétendument civilisatrice, pour apporter aide et réconfort aux faibles et aux opprimés.
Puis vint une critique démystificatrice du colonialisme, qui montrait que derrière les valeurs se cachaient des intérêts féroces, qu'il y avait une lutte entre puissances impérialistes, une lutte géopolitique. Aucune trace de cette prise de conscience ne subsiste aujourd'hui dans la culture progressiste: tout a été effacé d'un coup de balai.
L'anéantissement est toujours le même: les valeurs universelles, qui bien sûr sont si peu universelles qu'elles varient : les valeurs universelles et absolues qui ont justifié l'extermination des Indiens ne sont pas celles qui ont justifié le colonialisme et celles qui justifient la propagande de guerre aujourd'hui envers l'Afghanistan et, en réalité, envers la Chine et envers 5 autres milliards de personnes qui ne sont pas tout à fait disposées à considérer les valeurs de l'Occident comme universelles.
Après tout, les valeurs ne sont jamais évoquées que lorsque cela convient : contre l'Afghanistan, contre la Chine, contre la Russie. En Arabie saoudite, cependant, on assiste à une nouvelle renaissance. Les valeurs montrent la dent d'or, elles sont guidées par les dollars. Ils deviennent non négociables en fonction du marché et des intérêts. Les valeurs sont un fonds de commerce à enrôler dans la grande entreprise libérale-progressiste, qui promet des récompenses à tous ses propagateurs.
2. Contre les talibans ou contre le peuple afghan ?
Dans cette nouvelle campagne de propagande de guerre, prélude à une campagne globale qui finira par impliquer la Chine et la Russie et nous conduira à nous casser les dents, une chose est mise en avant: il faut être du côté du peuple afghan. Et j'aime ça, j'aime beaucoup ça, ça fait partie de ma culture, qui n'est pas universelle et je ne prétends pas qu'elle le soit, mais c'est ma culture: être du côté du peuple.

Mais ce que veut le peuple afghan est précisément ce qui n'est pas clair, et de nombreux analystes, les plus sérieux (pas Botteri ou Saviano) indiquent que les talibans bénéficient du soutien d'une énorme partie du peuple afghan. Je ne sais pas, je ne sais pas comment les choses sont réellement, mais au moins certaines questions devraient être posées :
a) La majorité du peuple afghan se sent-elle opprimée par les talibans ou par les Occidentaux ?
b) Perçoivent-ils les talibans ou l'Occident comme une force d'occupation ?
c) Considèrent-ils la démocratie occidentale comme une force permettant d'organiser le consensus ou ont-ils d'autres moyens d'organiser le consensus ?
d) Perçoivent-ils les valeurs occidentales comme émancipatrices ou comme oppressives et étrangères ?
e) Les femmes afghanes, ou la majorité d'entre elles, celles qui vivent en dehors des grandes villes, désirent-elles des droits occidentaux ? Leur a-t-on demandé ce qu'elles désirent, ce qu'elles considèrent comme une vie digne et souhaitable pour elles ?
f) N'est-il pas vrai qu'en donnant la parole à certaines femmes, nous la retirons à beaucoup, beaucoup trop d'autres femmes ? Il est certain que de très nombreuses femmes ressentent les actions des talibans comme une oppression et une mutilation de leurs droits. Mais le conflit ne devient-il pas alors entre ces femmes et d'autres femmes ? Et pourquoi ces derniers n'ont-ils pas voix au chapitre dans nos journaux ?
g) S'agit-il d'imposer à ces femmes des valeurs occidentales, s'il y en a ? Pour les "rééduquer" ? Botteri est-il le modèle universel de la femme ?
Mais surtout : un régime peut-il tenir debout s'il a l'hostilité de la grande majorité de la population ?
3. L'Occident est-il la Raison qui se déploie dans le monde ?
Il fut un temps où l'Occident s'interprétait comme un point avancé, un leader, un modèle pour toute l'humanité. Il s'est interprété comme l'incarnation de la Raison universelle. Une revendication exorbitante: il avait choisi un lieu particulier pour se manifester : l'Occident. La Raison absolue, avec un rugissement assourdissant, choisissait un coin particulier de la terre pour s'y installer. D'où sa fonction légitime de guide, sa responsabilité de "racheter" les autres peuples de leurs erreurs, de leurs superstitions. Les peuples non occidentaux sont devenus de temps en temps des homoncules, des sauvages, des dégénérés, en tout cas placés à un niveau intermédiaire entre l'animal et l'homme, qui était évidemment l'homme rationnel de l'Occident.
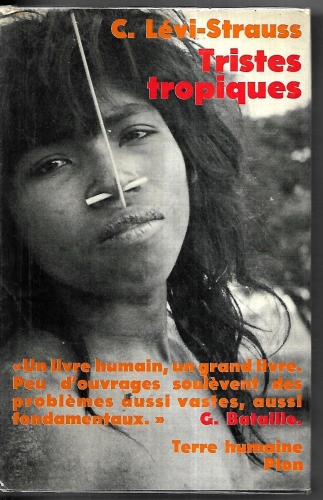
Ce modèle (massivement présent chez Hegel, dans le positivisme, dans la théorie des valeurs, dans le néo-kantianisme) a été démoli au cours du 20ème siècle d'un point de vue théorique. Leví-Strauss, parmi beaucoup d'autres, a montré qu'il n'y a pas LE récit, mais des récits, qu'il n'y a pas une direction unitaire, un telos auquel toutes les cultures doivent adhérer, mais un ensemble de récits, chacun avec son propre dynamisme, son propre schéma évolutif. Les autres cultures ne sont pas des cultures en retard, ce n'est pas le "Moyen Âge" (comme on l'a encore dit, avec un peu d'ignorance massive), ce n'est pas un arrêt du développement : c'est un processus de développement différent, avec son propre dynamisme, que nous devons comprendre si nous voulons dialoguer avec elles.
Et pour ce faire, nous devons abandonner l'idée que toutes les autres cultures n'ont qu'à adopter nos valeurs, abandonner les leurs et devenir occidentales.
Ce qui se passe aujourd'hui, c'est la reproposition, naïve et sans cohérence théorique, de l'ancien modèle téléologique: nous avons les vraies valeurs universelles, et nous les offrons généreusement aux autres (et certains disent même avec des bombardements), qui doivent les accepter avec gratitude. Ces valeurs sont les valeurs libérales, tout le monde doit devenir libéral, et celui qui n'aime pas les valeurs libérales est arriéré, loin du but ultime.

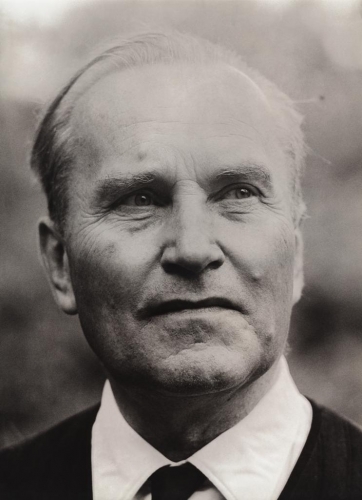
C'est le retour d'un arsenal théorique que beaucoup d'entre nous croyaient définitivement archivé, et d'autres pensées apparaissaient déjà, la nécessité de regarder, comme l'a dit Patocka, l'après-Europe. Mais non, il faut compter avec cette gigantesque régression culturelle qu'est la culture libérale-progressiste, avec la re-proposition de sa mythologie, son incompréhension de l'histoire. La nouvelle mythologie est celle des valeurs universelles : chaque culture a ses mythes, ses autels, et notre époque a cette mythologie, ses autels et ses prêtres.
Mais c'est une mythologie qui ne nous permet pas de comprendre ce qui se passe. Il s'agit d'une simple couverture idéologique qui masque le dynamisme de la réalité et produit des actions folles et inutiles, destinées à ne produire que du sang et des morts inutiles.
4. Il existe un noyau philosophique, qui revient aujourd'hui avec force sur le devant de la scène : les valeurs occidentales sont des valeurs universelles. Cette affirmation est-elle légitime ? D'où tire-t-elle sa légitimité ?
En fait, les valeurs universelles de l'Occident ne sont pas seulement relativement mais extrêmement récentes. Jusqu'à il y a quelques années, ils n'étaient même pas des valeurs en Occident. Les valeurs universelles sont donc celles qui, MAINTENANT, au cours de ces mêmes années, se sont imposées comme des valeurs pour nous. Qui, je tiens à le préciser, sont aussi mes valeurs, des valeurs que je défends, dans lesquelles je me reconnais. Mais il faudrait que je sois abandonné par tous les dieux pour penser qu'ils sont universels. Ils ne sont pas universels pour une raison simple : ils ne sont pas universels pour quelque cinq milliards de personnes.
5. Faut-il viser une européanisation du monde ?
La seule façon de sauver l'universalité des valeurs occidentales, étant donné qu'elles sont si récentes, est de présupposer une téléologie de l'histoire. Et en fait, c'est cette approche qui, de manière obscure, sous-tend la façon dont les événements contemporains sont interprétés et aussi les actions qui se sont terminées de manière si désastreuse : ces valeurs sont si belles qu'elles ne peuvent qu'être accueillies chaleureusement par d'autres peuples, elles peuvent être exportées, il suffit de détruire les égorgeurs et les obscurantistes.
Une idée qui était déjà derrière la tentative d'occidentalisation en Iran, dont on sait comment elle s'est terminée, et maintenant en Afghanistan, et que nous verrons bientôt en Libye, en Irak, etc.
Une revendication énorme : l'Occident pense à l'histoire universelle comme à une sorte d'occidentalisation de toute l'humanité. Les autres peuples ont tendance à s'occidentaliser, tandis que nous, si nous sommes conscients de nous-mêmes, ne souhaitons pas devenir des Indiens. L'histoire universelle signifie que d'autres peuples adoptent la culture et les valeurs occidentales, entrent dans l'histoire universelle. Un point caractérise cette idée : l'Occident est le dépositaire des valeurs universelles. L'Occident, cette culture particulière, c'est l'universalité.
Ce modèle ne peut que produire une série généralisée de conflits armés et violents : ce n'est pas un mode de pensée à la hauteur de la réalité historique.
Cette pensée est la pensée talibane de l'Occident. Cela nous mettra en conflit avec la Chine (encore une fois pour les droits universels), la Russie et l'Inde.
6. L'histoire universelle commence aujourd'hui
Ce qui se passe, avec le déclin économique et militaire de l'Occident, c'est une marginalisation progressive de l'Occident, qui cesse d'être à la pointe et devient une culture parmi d'autres. Ce qui s'achève, c'est l'idée que l'histoire universelle consiste en l'occidentalisation de l'ensemble de l'humanité, que le progrès est l'extermination des différences et des cultures non occidentales : celles-ci résistent. Parfois ils le font pacifiquement, au prix de sacrifices, comme en Nouvelle-Zélande, en Australie, parfois en cherchant leur propre voie, comme en Chine, parfois en réagissant violemment, comme dans le monde islamique.
Mais le message est clair :
Les peuples entrent dans l'histoire universelle avec leur identité, sans accepter l'effacement de leur différence.
L'histoire universelle qui ne fait que commencer est un jeu de contamination, de relations entre les différences, et non la réduction des différences à l'unité et au modèle occidental.
Pour commencer à y réfléchir, il faut se débarrasser de cette crampe intellectuelle qu'est l'idée de l'universalité des valeurs, cette folie qui nous conduit à considérer nos valeurs comme si elles étaient les valeurs universelles que tout le monde doit assumer. Chaque culture et chaque époque historique considère ses propres valeurs particulières comme si elles étaient les valeurs universelles, parce que dans un certain horizon historique certaines valeurs apparaissent évidentes, absolument évidentes.
Mais l'évidence aveugle, elle cache les processus de mise en évidence : quelque chose devient évident en supprimant les processus qui le font devenir évident. Les Talibans sont victimes de cet aveuglement, tout comme les libéraux le sont ici.
L'idée de valeurs universelles est une rechute dans le mythe, car le mythe est l'incapacité à se distancier de son propre point de vue, à saisir la différence entre notre représentation du monde et la vérité.
L'Occident à redécouvrir est - pour citer Husserl - l'Occident comme conscience de la différence entre son propre monde et la vérité, la conscience que la vérité est soustraite, et que c'est précisément parce qu'elle est soustraite qu'il y a une histoire. Lorsque cette conscience de la différence est perdue, il n'y a qu'une rechute dans le mythe : l'idée d'Europe est perdue.
16:09 Publié dans Actualité, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, occidentalisme, occidentisme, universalisme, valeurs universelles, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Prof. Alberto Buela & Carlo Cambescia: confrontation sur lamétapolitique (août 2021)

Confrontation sur la métapolitique entre les Prof. Carlo Gambescia et Alberto Buela, août 2021
Cette confrontation commence par un de mes articles intitulé : I.- La métapolitique, après un quart de siècle, qui est suivie par les deux réponses de Carlo Gambescia. II.- Buela et le concept de dissidence et III.- La métapolitique du "canon" d'Alberto Buela. Il est suivi de ma réponse: IV.- Commentaire sur Carlo Gambescia et se termine par une synthèse du sociologue romain: V.- Une synthèse de la controverse sur la métapolitique.
I.- La métapolitique, après un quart de siècle par Alberto Buela
À la demande d'un ami qui fait également office de disciple, je vais donner un séminaire de huit classes sur la métapolitique et la dissidence comme méthode. Je vais le faire en étant guidé par la saine intention de faire connaître tout ce qui a été fait au cours des vingt-cinq dernières années.
Lorsque j'ai publié pour la première fois l'ouvrage Qu'est-ce que la métapolitique? en 1995, je n'aurais jamais pensé qu'il serait aussi largement diffusé qu'il l'a été. Il a été traduit en plusieurs langues et a été pris comme texte de base par les auteurs qui ont étudié le sujet.
J'y ai soutenu que trois courants principaux peuvent être distingués dans la métapolitique:
a) celui du traditionalisme philosophique, dirigé par Silvano Panuncio, qui soutient que la métapolitique est la métaphysique de la politique;
b) le courant analytique-herméneutique de Manfred Ridel, qui affirme que la métapolitique ne peut être faite sans la politique, et
c) le courant culturaliste d'Alain de Benoist, qui soutient la thèse que la métapolitique doit être faite sans se mêler de politique.
 En ce presque quart de siècle, la discipline a beaucoup progressé. Après la saga de Silvano Panuncio, des œuvres importantes et des penseurs significatifs comme Aldo La Fata et Primo Siena sont apparus. Le premier, à notre demande, nous a aidé à obtenir le premier manuscrit sur la métapolitique : Metapolitica hoc est Tractatus de Repubblica, Philosophice considerata dont l'auteur était le moine cistercien Juan Caramuel y Lobkowitz (gravure, ci-contre), né à Madrid en 1606 et mort à Vigevano (Italie) en 1682, d'où le Fonds Caramuel dans cette ville de Lombardie. Le texte susmentionné est le premier connu à utiliser le terme métapolitique. Le texte a été écrit vers 1650 et se trouve dans les Archives historiques diocésaines de Vigevano. Le professeur La Fata est également le continuateur de la revue Metapolitica publiée à Rome.
En ce presque quart de siècle, la discipline a beaucoup progressé. Après la saga de Silvano Panuncio, des œuvres importantes et des penseurs significatifs comme Aldo La Fata et Primo Siena sont apparus. Le premier, à notre demande, nous a aidé à obtenir le premier manuscrit sur la métapolitique : Metapolitica hoc est Tractatus de Repubblica, Philosophice considerata dont l'auteur était le moine cistercien Juan Caramuel y Lobkowitz (gravure, ci-contre), né à Madrid en 1606 et mort à Vigevano (Italie) en 1682, d'où le Fonds Caramuel dans cette ville de Lombardie. Le texte susmentionné est le premier connu à utiliser le terme métapolitique. Le texte a été écrit vers 1650 et se trouve dans les Archives historiques diocésaines de Vigevano. Le professeur La Fata est également le continuateur de la revue Metapolitica publiée à Rome.
Quant au penseur italo-chilien Primo Siena, il a produit dans ces années-là un livre intitulé L'épée de Persée, dans lequel il soutient que l'une des tâches de la métapolitique est la critique et la démystification de la crypto-politique ou de la politique des loges.
Au sein du courant herméneutique, le Belge Robert Steuckers, l'Espagnol Javier Esparza et l'Italien Carlo Gambescia se sont distingués au cours de ce quart de siècle comme partisans d'une métapolitique qui cherche une issue et un changement de politique. Steukers est un travailleur et un diffuseur culturel infatigable, et ses blogs Euro-Synergies et Synergon-Info (en néerlandais et en allemand) sont des exemples incontestables de son travail éclairé. Esparza est la tête la plus lucide de l'Espagne actuelle, et son ouvrage Curso general de disidencia (1997) conserve toute sa vigueur. Quant à Gambescia, avec son livre Metapolítica : otra visión sobre el poder (2007), il est devenu un auteur de référence.
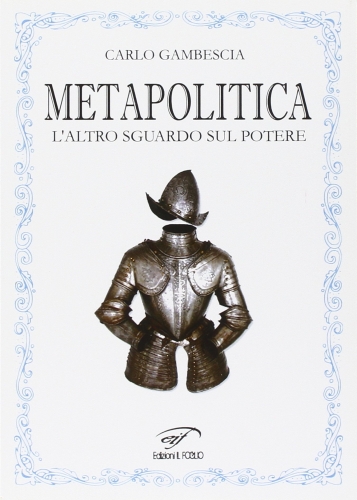
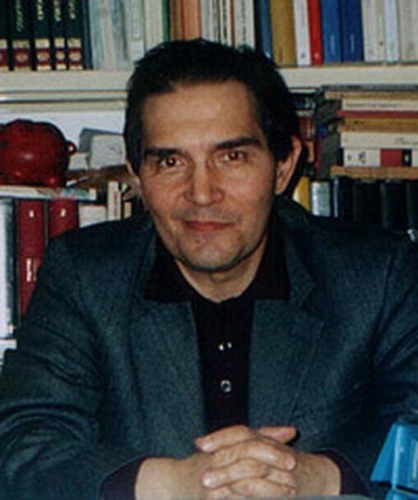
Enfin, le courant culturaliste a produit d'innombrables penseurs et travaux sur la métapolitique. Les articles d'Alain de Benoist, Marco Tarchi, Alessandro Campi, Alexander Douguine, Paul Gottfried, Ernesto Araújo, etc. peuvent être consultés avec grand profit. Ce courant, certainement le plus productif, n'a pas publié de traité spécifique. Mais c'est celui qui a généré, à partir du marxisme, le plus grand nombre d'ouvrages. Ainsi, Alain Badiou dans son Abrégé de la métapolitique (2010) soutiendra que la métapolitique est un label pour les modes politiques qui cherchent à changer les pratiques politiques établies. Giacomo Marramao, pour sa part, affirmera que la métapolitique a l'exigence d'identifier la diversité idéologique dans le domaine de la politique mondiale, régionale et nationale, en essayant de convertir cette diversité en un concept de compréhension politique.
Du Mexique, la revue sociale-démocrate Metapolítica, dirigée par le professeur César Cansino, est apparue dans une perspective universitaire, dans le but de "restructurer la face visible du public", selon A. Badiou. C'est là que j'ai publié dans le numéro 6 de 1998, Qu'est-ce que la métapolitique ?
En 2007, le professeur Carlo Gambescia observait à juste titre au début de son livre: "La metapolitica non e una disciplina accademica. Per quanto ne sappiamo, non esistono, almeno in Italia, cattedre di metapolitica" (= "La métapolitique n'est pas une discipline académique. Pour autant que nous le sachions, il n'existe pas, du moins en Italie, de chaires de métapolitique"). Sans aucun doute, son domaine d'étude est la science politique. Mais quatorze ans ont passé et nous voyons comment, à l'université de Navarre, des cours de métapolitique ont commencé à être dispensés afin de montrer que tant la nouvelle gauche que la nouvelle droite partagent une préoccupation pour la métapolitique. En même temps, il est indiqué que les deux branches de la métapolitique sont de démystifier les hypothèses politiques et de construire des communautés.
Parmi les universités ibéro-américaines, la seule expérience est celle que nous avons eu l'occasion de mener à l'Université de Feira de Santana (Brésil, 2013) sous la direction du philosophe Nilo Reis. Il serait souhaitable que nos universités imitent cet exemple, pour une meilleure compréhension et un approfondissement de la discipline.
Une rareté académique vient d'être publiée en Colombie: Martin Heidegger. Metapolítica : Cuadernos negros (1931-1938), Ed. Aula Humanidades, Colombie, 2019.
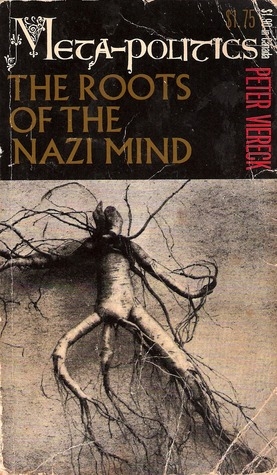 Le côté négatif de la métapolitique est apparu lorsque le terme a commencé à être utilisé uniquement comme une étiquette. Ainsi, le livre de Peter Viereck intitulé Metapolitics : the roots of the Nazi mind, écrit en 1941, a été réédité en 2008, un véritable non-sens dans l'utilisation du terme. Dans la même veine, nous pouvons caractériser le livre de Daniel Estulin, Metapolitics : Global Transformation and the War of Powers (2020), qui confond géostratégie et métapolitique. Et aussi Metapolitis : Public Enemy, Power and Civil Death in the Republican Tradition (2018) de Juan Acerbi, qui n'a rien à voir avec la métapolitique. De nombreux autres ouvrages sont également parus qui utilisent le terme comme une simple étiquette. Cela déroute le lecteur non averti, qui finit par être pris pour une bourrique. En réalité, ce que ces auteurs font, c'est mentir avec le titre, pensant que cela peut leur donner une plus grande diffusion ou un plus grand prestige. Je ne sais pas, mais mentir dans le titre d'un livre est une scélératesse exécrable, puisque sa fonction n'est autre que de tromper.
Le côté négatif de la métapolitique est apparu lorsque le terme a commencé à être utilisé uniquement comme une étiquette. Ainsi, le livre de Peter Viereck intitulé Metapolitics : the roots of the Nazi mind, écrit en 1941, a été réédité en 2008, un véritable non-sens dans l'utilisation du terme. Dans la même veine, nous pouvons caractériser le livre de Daniel Estulin, Metapolitics : Global Transformation and the War of Powers (2020), qui confond géostratégie et métapolitique. Et aussi Metapolitis : Public Enemy, Power and Civil Death in the Republican Tradition (2018) de Juan Acerbi, qui n'a rien à voir avec la métapolitique. De nombreux autres ouvrages sont également parus qui utilisent le terme comme une simple étiquette. Cela déroute le lecteur non averti, qui finit par être pris pour une bourrique. En réalité, ce que ces auteurs font, c'est mentir avec le titre, pensant que cela peut leur donner une plus grande diffusion ou un plus grand prestige. Je ne sais pas, mais mentir dans le titre d'un livre est une scélératesse exécrable, puisque sa fonction n'est autre que de tromper.
Aujourd'hui, la métapolitique en tant que multidiscipline ouvre un monde de significations qui ne peut être confiné à une seule formule, même si pour nous la meilleure reste : l'étude des grandes catégories qui conditionnent l'action politique.
La meilleure façon d'accéder à cette tâche est l'exercice de la dissidence, qui n'est rien d'autre que la capacité méthodologique et existentielle de proposer un autre sens à ce qui est donné et accepté par le statu quo régnant. Comme l'a dit un jour le président tchèque Valclav Havel: "Le dissident n'aspire pas à des postes officiels et ne cherche pas à obtenir des voix. Il ne cherche pas à plaire au public, il ne peut offrir que sa peau".
La dissidence en tant que méthode n'est pas autorisée aux observateurs du monde et de ses problèmes, mais à ceux qui sont engagés dans le monde et ses problèmes. La dissidence, comme accès le plus authentique à la métapolitique, contient une dimension existentielle irréductible au livre, car elle exige l'action. Mais quelle action ? Action sur la politique et non sur le politique. Cette dernière est réservée à la philosophie politique telle qu'elle a été historiquement.
Cette distinction, devenue classique, a été énoncée à l'époque moderne par Carl Schmitt, Julien Freund et Cornelius Castoriadis: les Grecs ont inventé la politique comme organisation du politique. Dans la mesure où le politique (le pouvoir) est possédé ou non... "Le politique dit qui fait la loi, et cela est nécessairement antérieur à toute loi (politique). La politique doit être au service du politique. "Si le politique (un projet national) disparaît et est remplacé par l'économique, comme cela tend à se produire aujourd'hui, la souveraineté collective s'éteint", affirme magistralement Javier Esparza.
La politique réside dans le pouvoir, qui s'exprime par la "décision" et repose sur l'autorité. La politique est une pratique, c'est un art d'exécution, comme disait Perón.
La métapolitique s'intéresse fondamentalement aux catégories présentées comme politiquement neutres (droits de l'homme, progrès, homogénéisation, multiculturalisme, etc.) tout en démasquant les intérêts de groupes ou de lobbies qui interviennent dans le pouvoir. C'est ce qu'il fait lorsqu'il travaille sur la crypto-politique.
Tel est l'état des lieux dans cette néo-discipline. Il existe encore trois courants qui y travaillent très sérieusement et quelques tentatives universitaires pour la normaliser comme discipline académique (le politologue César Cansino au Mexique, le philosophe Nilo Reis au Brésil et le sociologue Carlo Gambescia pour l'Italie). Nous voyons dans les faits comment trois disciplines différentes abordent la métapolitique, ce qui signifie qu'il s'agit d'une science recherchée. Dans le même temps, cependant, nous observons diverses tentatives fallacieuses de diabolisation et de déification, en fonction des intérêts politiques auxquels répondent ses auteurs.
II.- Alberto Buela et le concept de dissidence par Carlo Gambescia
Je ne pense pas que ce soit possible car le sujet est très intéressant, mais même au risque d'ennuyer les lecteurs, je voudrais aujourd'hui revenir sur un point précis de la pensée du professeur Buela : le concept de dissidence.
Je le prends cependant à distance. Parce que les définitions sont importantes. Je tiens à préciser que ma démarche est une approche sociologique de la question, et non une approche philosophique ou une histoire des idées.
Être en désaccord signifie ne pas être d'accord sur une certaine question. En bref, il s'agit de penser différemment.
La dissidence, qui se divise en théorie et en pratique, en tant que forme de relation (au sens de produire des conséquences), est un fait social de grande importance, car elle affecte la division sociale du travail, c'est-à-dire les conditions de vie normales de la société.
Par exemple, si un groupe de travailleurs est mécontent de son salaire, il exprimera son désaccord en faisant grève. La dissidence affectera donc la division sociale du travail, elle aura, pour ainsi dire, des conséquences bien précises : quelles que soient les raisons avancées, bonnes ou mauvaises.
Cela signifie qu'il faut faire une distinction entre la dissidence théorique, sur des idées, sans conséquences immédiates, comme cela arrive souvent lorsqu'un argument, même polémique, disparaît dans les brumes du discours public, et la dissidence pratique, avec des conséquences immédiates, comme dans le cas des travailleurs qui font grève.
D'une manière générale, lorsque le désaccord théorique se transforme en conflit pratique, il y a un risque de préjudice social. Contrairement à la dissidence théorique, la dissidence de conflit a des conséquences sociales réelles.
Quelles ont été, pour ainsi dire, les orientations du pouvoir politique à l'égard de la dissidence ?
Pendant des siècles, la dissidence-conflit a été durement réprimée et assimilée à la dissidence-théorie, tout aussi condamnée. Réprimée et condamnée au point de déclencher, à partir du XVIIe siècle, en réaction sociale, une longue série de révolutions visant à revendiquer, pour la première fois dans l'histoire, le droit à la dissidence en tant que telle.
Cependant, il reste un mérite fondamental des modernes d'avoir affirmé, outre le rôle socialement positif du dissensus, deux questions sociologiquement importantes : 1) la distinction entre dissensus conflictuel et dissensus théorique ; 2) la nécessité de garantir dans les limites du fonctionnement de la division sociale du travail la coexistence du dissensus conflictuel et du dissensus théorique.
Hier, j'ai longuement discuté des intéressantes thèses métapolitiques du professeur Buela. Il attribue à la dissidence un rôle fondamental, voire métapolitique. Plus d'informations ici :
https://cargambesciametapolitics.altervista.org/alberto-buela-e-il-concetto-di-dissenso/
Alberto Buela et le concept de dissidence
Blog de cargambesciametapolitics
"Aujourd'hui, la métapolitique, en tant que pluridiscipline, s'ouvre à un monde de significations qui ne peut être enserré en une formule, de ce fait, pour nous, le meilleur à dire consiste en ceci: la métapolitique est l'étude des grandes catégories qui conditionnent l'action politique. Pour parfaire cette tâche, la forme optimale qui y donne accès est la pratique d'exercer la dissidence, laquelle n'est pas autre chose que la capacité méthodologique et existentielle de proposer une autre vision que celle donnée et proposée par le statu quo en place. Comme l'a dit à de multiples occasions le président tchèque Vaclav Havel: le dissident n'aspire pas à recevoir des postes officiels ni ne cherche à obtenir des voix. Il ne s'agit pas d'aller s'imposer au public; le dissident ne peut offrir que sa peau". La dissidence comme méthode n'est pas le fait des simples observateurs des faits de monde et des problèmes y afférents. La dissidence comme accès le plus spécifique à la métapolitique comprend une dimension existentielle irrréductible au savoir livresque; elle exige l'action. Mais quelle action? L'action sur LA politique et non sur LE politique. Ce dernier est un objet d'étude qui demeure réservé à la philosophie politique, comme cela fut toujours le cas dans l'histoire".
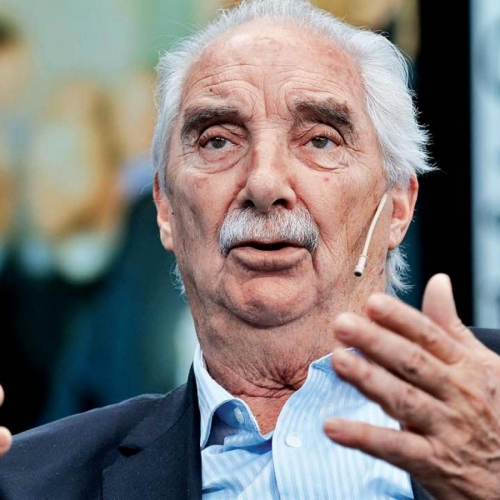
"El disenso (...) exige la acción" (= "La dissidence (...) exige l'action"). Le concept est clair. Cependant, le point essentiel est que l'action (ou la pratique, comme nous avions l'habitude de dire) transforme la théorie de la dissidence en conflit social, en dissidence-conflit. Et ici, nous devons nous rappeler que le conflit est une régularité métapolitique, quelque chose qui se répète dans l'histoire, et qui implique des conséquences précises.
D'abord, sur la division sociale du travail, en la modifiant. Deuxièmement, sur l'accomplissement ordonné des fonctions sociales normales, qui, à leur tour, reposent sur une autre régularité métapolitique : la distinction entre institution et mouvement (2).
Pour donner un exemple, des institutions telles qu'une école, un ministère, une usine, un parlement, ne peuvent survivre à une logique mouvementiste de type assemblée ou référendum.
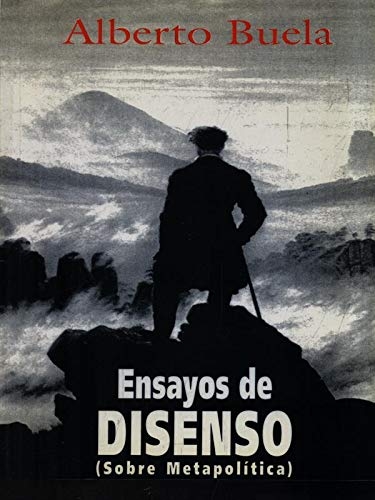
Tertium non datur. Soit ce sont des institutions, donc fondées sur une logique hiérarchique-organisationnelle, de type méritocratique, soit ce sont des mouvements, fondés sur une logique démagogique-assemblée, pour ainsi dire égalitaire. Les deux logiques s'opposent, avec des conséquences socialement désastreuses.
En bref, pour le dire politiquement, les institutions ne peuvent pas être socialistes et libérales en même temps... Elles ne permettent pas de troisième voie...
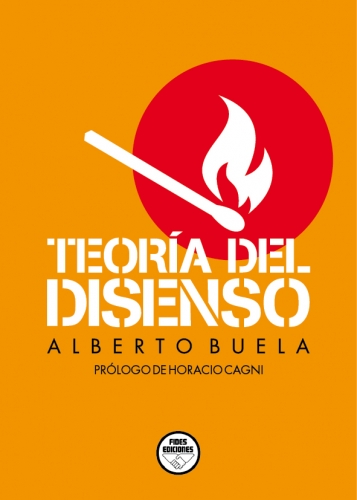
Il ne reste alors que la dissidence-théorie et la dissidence-conflit, qui, en tant que régularité métapolitique, nous le répétons, se répète dans le temps. Un désaccord-conflit qui, cependant, respecte, par l'expérience historique, sociologique et métapolitique, la distinction entre institution et mouvement (autre régularité métapolitique). Ce n'est qu'ainsi qu'il est possible de concilier la dissidence (sous ses deux formes) et la division sociale du travail (la forme unique et naturelle du social).
Par conséquent, le désaccord le plus large possible en théorie, en termes de discours public, doit être flanqué d'un désaccord-conflit plus limité, capable de s'arrêter prudemment, afin de ne pas compromettre les fonctions sociales normales, principalement la division sociale du travail.
La tâche de comprendre où s'arrêter n'incombe pas, du moins directement, aux intellectuels, qui ne doivent indiquer, comme nous avons essayé de le montrer dans notre article, que les conditions sociologiques, métapolitiques si l'on veut, préalables à l'exercice d'une dissidence bien tempérée, raisonnée, pour ainsi dire.
La tâche de comprendre puis de traiter la manière d'empêcher les dissensions-conflits de compromettre les fonctions sociales incombe aux hommes politiques.
Par conséquent, la grande question de savoir comment empêcher les conflits sociaux de se transformer en guerre sociale autodestructrice renvoie à la qualité de la classe politique et plus généralement de la classe dirigeante. Aux élites, du gouvernement et de l'opposition, en somme.
Il s'agit de questions d'autodiscipline, de prudence, si tant est qu'il faille faire preuve de sagesse, ou du moins de dosage prudent, de la part de l'élite dans son ensemble, d'un médicament, la dissidence, qui, s'il est "prescrit", vendu et consommé à des doses massives, peut empoisonner et tuer...
https://cargambesciametapolitics.altervista.org/alberto-buela-e-il-concetto-di-dissenso/
Une dernière question. La dissidence est-elle une régularité métapolitique ? C'est en termes de dynamique sociologique entre l'institution et le mouvement. En somme, dans chaque dissident, nous voyons un futur défenseur des institutions, puisque tout mouvement est destiné à périr ou à se transformer en institution s'il gagne. La poésie utopique du mouvement, si vous me permettez cette métaphore, est toujours destinée à se transformer en prose institutionnelle.
Le soi-disant politiquement correct n'est rien d'autre que de la prose libérale, à laquelle s'oppose désormais de la poésie anti-libérale. Elle aussi est destinée à devenir de la prose si elle "gagne".
De toute évidence, le jugement sur la qualité de la poésie et de la prose renvoie, selon les termes d'Augusto Del Noce, à une interprétation de l'histoire contemporaine.
Et l'interprétation du professeur Buela est probablement différente de la mienne. Il s'agit d'un cas de dissension théorique : des idées différentes, voire opposées, sur la nature du libéralisme et de l'anti-libéralisme. Mais c'est une autre histoire.
Carlo Gambescia
Notes:
(1) Par exemple, voir : http://hernandezarregui.blogspot.com/2021/08/metapolitica-despues-de-un cuarto-de.html
(2) En général, sur les régularités ou constantes métapolitiques, je me réfère à mon "Métapolitique". L'autre regard sur le pouvoir", Edizioni Il Foglio, Piombino (Li) 2009, pgs. 27-37. Plus précisément sur la régularité "Institution-Mouvement" cf. Francesco Alberoni, "Movimento e istituzione", il Mulino, Bologna 1977. Enfin, voir, comme une tentative d'étendre l'analyse métapolitique à la crise actuelle, donc des régularités ou des constantes, mon "Métapolitique du Coronavirus. Un diario pubblico", postface d'Alessandro Litta Modignani et Carlo Pompei, Edizioni Il Foglio, Piombino (Li) 2021.
III.- La "métapolitique du canon" d'Alberto Buela par Carlo Gambescia
Je tiens à remercier Alberto Buela, mon ami argentin, professeur d'université, philosophe de la politique, l'un des fondateurs ou plutôt refondateurs de la métapolitique, en tant que véritable discipline scientifique et académique, je le remercie, comme je le disais, d'avoir généreusement rappelé mon modeste travail dans ce domaine (1).
Je voudrais lui rendre la pareille en dressant un portrait de lui, avec une attention particulière à ses recherches métapolitiques. "Quiero". Cependant, je voudrais également souligner les différences entre ma pensée et la sienne (2).
À ce sujet, il faut absolument lire les Ensayos de Disenso (Sobre Metapolítica) (3) de Buela, au moins comme point de départ.
Pourquoi la métapolitique est-elle importante pour Buela ? D'une part, parce que c'est un système conceptuel qui permet d'étudier la politique (une heuristique), et d'autre part, parce que c'est un mode de pensée qui permet de changer la politique (une action métapolitique).
Il faut dire que cette distinction est fondamentale car elle délimite le champ de la métapolitique comme science de celui de la métapolitique comme pratique, comme action.
Chez Buela, nous pouvons distinguer une autre phase, pour ainsi dire, de synthèse : dans le sens de mettre l'heuristique au service de la transformation politique, de l'action.
Ce qui - évidemment ce qui suit est mon hypothèse - renvoie à l'utilisation métapolitique de ce qu'un grand sociologue américain, Robert Nisbet, a appelé les concepts fondamentaux de la sociologie (4). Ce sont des concepts qui, comme je le crois, reviennent dans la pensée de Buela : Communauté, Autorité, Statut, Sacré, Aliénation, comme opposés, respectivement, à ceux de Société, Pouvoir, Classe, Transcendant, Intégration.
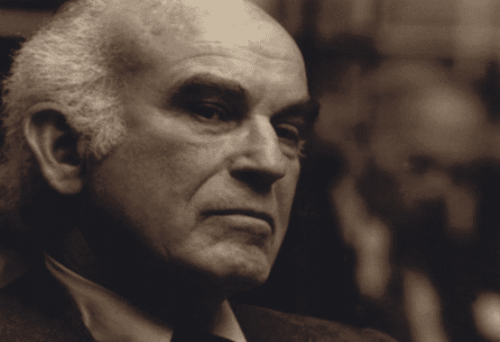
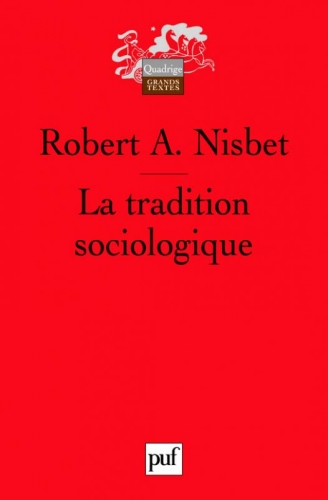
La Métapolitique d'Alberto Buela pourrait donc être appelée "Métapolitique du Canon" : je veux parler du canon sociologique, en tant qu'ensemble de valeurs conceptuelles, canoniques, normatives. Ils sont ramenés dans la sphère d'une processualité métapolitique (dialectique) entre théorie et pratique, en vue d'une synthèse. Le résultat, à son tour, d'une dialectique entre Communauté et Société, Autorité et Pouvoir, Statut et Classe, Sacré et Transcendant, Aliénation et Intégration-réalisation. Une dialectique qui, fermant le cercle sociologique de la synthèse, se réfère, comme prévu, à un schéma de base, le canon.
Il est évident que les facteurs contextuels, biographiques et socio-historiques entrent tumultueusement dans la théorie métapolitique de Buela, qui a le charme fou d'un fleuve en crue, et risquent de transformer l'heuristique en herméneutique.
Je pense à son ancien militantisme péroniste, à sa passion pour la philosophie antique et les sciences sociales, et à sa religiosité séculaire, curieusement ouverte au sacré comme au transcendant. Sans oublier sa vision de la politique qui renvoie à une sulfureuse approche révolutionnaire-conservatrice.
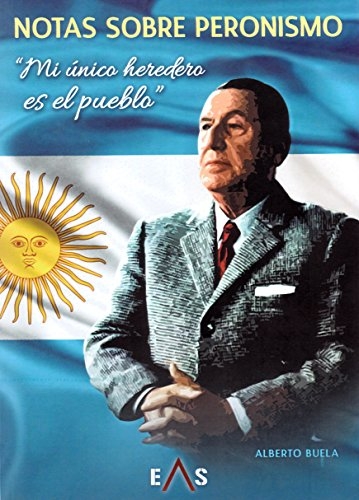
En outre, la longue période d'études en France, où Buela a étudié la philosophie et est entré en contact avec des penseurs comme Alain de Benoist, entre autres, a eu une influence considérable sur sa formation. Il voyait, et nous pensons qu'il voit toujours, la métapolitique comme une simple pratique, bien que de manière très brillante. Mais c'est une autre histoire.
En fait, le risque principal pour le chercheur qui s'occupe de métapolitique reste non seulement celui de ne pas distinguer entre théorie et pratique, entre concept et action, entre heuristique et transformation sociale, mais de confondre même les deux niveaux, en mettant l'heuristique au service d'une idée parfois utopique ou mythique de transformation politique et sociale. Transformer l'heuristique cognitive en herméneutique idéologique, comme cela arrive par exemple à un philosophe comme Badiou (5), qui mélange sans ménagement les concepts de révolution et de métapolitique.
Buela, en revanche, est plus prudent. D'une part, il considère le travail heuristique ou théorique comme préparatoire à la politique, mais d'autre part, il refuse de rompre le fil herméneutique entre la politique, qui est à son tour considérée comme préparatoire à la métapolitique.
Il s'agit d'une tension qui n'existe sans doute pas seulement dans la pensée de Buela. Parce qu'elle concerne l'ontologie de la connaissance, le rapport entre la pensée et l'action, entre la science et l'interprétation, donc l'herméneutique, en tant que fonction de l'action.
Une condition qui concerne tous les universitaires en tant qu'êtres humains. Et donc compréhensible.
Cependant, au niveau de l'institutionnalisation de la métapolitique, sa reconnaissance impose, pour éviter que la corde cognitive ne se rompe, le respect de deux points fondamentaux.
1) Approfondir l'heuristique ou la théorie du canon, en décomposant en régularités ou constantes, les concepts de Communauté, Autorité, Statut, Sacré, Aliénation et leurs antithèses respectives. C'est-à-dire se concentrer sur ce qui se répète historiquement et sociologiquement, comme, par exemple, la régularité-hégémonie des élites, la régularité-reconstitution du pouvoir, la régularité-ami-ennemi, et autres. La métapolitique, en somme, comme discours cognitif - heuristique - sur les formes politiques, et non sur les contenus, qui sont historiques, et changent de temps en temps, selon des herméneutiques différentes.
2) Se limiter, au niveau de la pratique, à l'indication de Weber (6), qui est alors un simple conseil pour tout bon politicien, de s'en tenir aux choses telles qu'elles sont, du point de vue des régularités métapolitiques, et non telles qu'elles devraient être du point de vue des différents et fantaisistes évangiles sociaux.
En bref, la métapolitique comme science des moyens et des fins. Conscient des limites inhérentes aux deux. Le savant métapolitique comme un scientifique et non un fantaisiste, souvent un fanatique, comme c'est le cas de Badiou, des idées. Enfin, le politicien, en tant que connaisseur avisé des régularités ou constantes métapolitiques, donc capable de les mettre en pratique "con juicio".
D'un point de vue disciplinaire et institutionnel, la question fondamentale est que la métapolitique est encore dans son enfance, ou si vous voulez vraiment, dans sa pré-adolescence. Il reste donc encore beaucoup de chemin à parcourir pour en faire une science.
D'où l'importance du travail d'Alberto Buela. Le philosophe argentin, contrairement à d'autres chercheurs, est très clair sur la question de l'institutionnalisation, ainsi que sur l'importante distinction entre métapolitique théorique et pratique.
Il sait très bien que le véritable enjeu n'est pas de ne pas "se salir" avec la politique, mais de faire en sorte, du point de vue du travail intellectuel et scientifique, que la politique prenne acte de ses limites.
En bref, de la distinction, pour reprendre les termes de Gaetano Mosca, entre "ce qui peut arriver [et] ce qui ne peut pas et ne pourra jamais arriver, évitant ainsi que de nombreuses intentions généreuses et de nombreuses bonnes volontés soient dispersées de manière inappropriée, et même dommageable, en voulant atteindre des degrés de perfection sociale qui sont inatteignables" (7).
Carlo Gambescia
Notes:
(1) Voir : http://hernandezarregui.blogspot.com/2021/08/metapolitica-despues-de-un-cuarto de.html
(2) Voir Carlo Gambescia, "Metapolitics. L'altro sguardo sul potere", Edizioni Il Foglio, Piombino (LI) 2009.
(3) Alberto Buela, "Ensayos de Disenso (Sobre la metapolítica)", Nuova República Ediciones, Barcelona 1999, en particulier pp. 93-123. Pour un rapide profil bio-bibliographique, cf.
https://institutodecultura.cudes.org.ar/profesor/alberto-buela/
(4) Robert A. Nisbet, "La tradition sociologique", La Nuova Italia, Florence 1977.
(5) D'Alain Badiou, voir l'ouvrage, véritable pastiche, "Métapolitique", Cronopio, Naples 2001. Pour une critique, je pense serrée, se référer à ma "Métapolitique", citée, pp. 21-27.
(6) Je me réfère, bien sûr, à la célèbre conférence de Max Weber, "Le travail intellectuel comme profession", note introductive de Delio Cantimori, Einaudi Editore, Turin 1980, en particulier, pp. 35-37.
(7) Gaetano Mosca, "Eléments de science politique", dans "Ecrits politiques", édité par Giorgio Sola, Utet, Turin 1982, vol. II, p. 1081.
IV.- Commentaire aux remarque de Carlo Gambescia par Alberto Buela
Métapolitique
Depuis des années, avec le sociologue italien Carlo Gambescia, auteur d'un magnifique ouvrage : Metapolítica. L'altro sgurado sul potere, Piombino, Ed. il Foglio, 2009, nous luttons depuis des années pour donner à la métapolitique un traitement académique. Et ainsi libérer la discipline des fantaisistes et des fanatiques qui créent des mythes inconductibles. Parmi ces derniers, nous pouvons sans risque placer Alain Badiou ou Daniel Estulin (russo-argentin).
Et c'est dans le cadre d'un séminaire que nous donnerons en septembre et octobre via Zoom, sur la base de ma publication Metapolítica, después de un cuarto de siglo, que le professeur Gambescia a écrit deux longs articles sur ma pensée par rapport à la discipline : La metapolítica del canon et Le concept de dissidence chez Alberto Buela. Et je vais m'y référer.
La première distingue la métapolitique comme science ou théorie et comme pratique ou action. Et il affirme : "Chez Buela, nous pouvons distinguer une autre phase, pour ainsi dire, de synthèse: dans le sens de mettre l'heuristique au service de la transformation politique, de l'action".
On sait que l'heuristique, dans son sens premier, est considérée comme l'art de l'invention, mais c'est plus proprement une méthode pour faire progresser la connaissance. Ou mieux encore, un ensemble de techniques utiles pour résoudre les problèmes.
Mais mon heuristique exige une herméneutique, une interprétation valorisante, qui devrait finalement conduire à l'action. C'est-à-dire dans la transformation politique du statu quo existant de la communauté politique.
Et ceci, observe à juste titre Gambescia, est un risque : "dans la théorie métapolitique de Buela, qui a le charme formidable du fleuve en crue, qui court le risque de transformer l'heuristique en herméneutique", car, commente-t-on, on court le risque de cesser de faire de la science pour faire de l'opinion. Pour céder au caprice subjectif du chercheur.
C'est le point crucial du commentaire du sociologue romain : comment faire de la science à partir de l'herméneutique sans tomber dans le subjectivisme ?
Et il le reconnaît: "C'est une tension qui existe sans aucun doute non seulement dans la pensée de Buela. Parce qu'il s'agit de l'ontologie de la connaissance, de la relation entre la pensée et l'action, entre la science et l'interprétation, donc l'herméneutique, en tant que fonction de l'action. Une condition qui touche tous les universitaires en tant qu'êtres humains. Et donc compréhensible. Cependant, au niveau de l'institutionnalisation de la métapolitique, sa reconnaissance nécessite la réalisation de deux points fondamentaux afin d'éviter de rompre la corde cognitive.
1. se concentrer sur ce qui se répète historiquement et sociologiquement : les régularités d'une dialectique entre Communauté et Société, Autorité et Pouvoir, Etat et Classe, Sacré et Transcendant, Aliénation et Intégration.
2. et de s'en tenir aux choses telles qu'elles sont, aux régularités métapolitiques.
Ces régularités métapolitiques que nous retrouvons aujourd'hui, hic et nunc, dans la tension dialectique entre consensus-dissensus ; droits de l'homme-droits du peuple ; progrès-croissance ; mémoire-histoire ; pensée unique-pensée dissidente ; pluralisme-relativisme ; globalisation-œcuménisme ; multiculturalisme-interculturalisme ; crise-décadence, etc. Ce sont les grandes catégories, l'objet même de la métapolitique. Car ce sont eux qui finissent par conditionner l'action politique des dirigeants ou des élites du moment.
 Je voudrais maintenant parler, de façon télégraphique, des rudiments de ce que signifie pour nous l'herméneutique, et pour cela il faut revenir à Frederich Schleiermacher (1768-1834), auteur de la théorie moderne de l'herméneutique en 1805/9/10/19, qui soutient qu'elle est à la fois une théorie de la compréhension et de l'interprétation. Le contexte du discours et de l'auteur doit être pris en compte, et l'interprète doit le partager, en connaissant la langue et son contexte historique et social. Schleiermacher ajoute au texte classique d'Aristote, Peri Hemeneias, l'aspect émotionnel et socio-politique. Il se situe dans la période des Lumières et du Romantisme. Il est le fondateur de l'université de Berlin et le premier idéologue de l'humanisme chrétien.
Je voudrais maintenant parler, de façon télégraphique, des rudiments de ce que signifie pour nous l'herméneutique, et pour cela il faut revenir à Frederich Schleiermacher (1768-1834), auteur de la théorie moderne de l'herméneutique en 1805/9/10/19, qui soutient qu'elle est à la fois une théorie de la compréhension et de l'interprétation. Le contexte du discours et de l'auteur doit être pris en compte, et l'interprète doit le partager, en connaissant la langue et son contexte historique et social. Schleiermacher ajoute au texte classique d'Aristote, Peri Hemeneias, l'aspect émotionnel et socio-politique. Il se situe dans la période des Lumières et du Romantisme. Il est le fondateur de l'université de Berlin et le premier idéologue de l'humanisme chrétien.
L'objet de l'herméneutique, dit Schleiermacher, est de comprendre un auteur mieux qu'il ne s'est compris lui-même. Un exemple argentin est celui de notre plus grand métaphysicien, Miguel Ángel Virasoro, avec sa traduction de L'être et le néant de Sartre, qui lui a fait comprendre le Français mieux qu'il ne s'était compris lui-même, selon les propres mots de Sartre.
Il a ainsi inauguré le "cercle herméneutique texte ou contexte-auteur-compréhension", où l'interprète doit se mettre à la place de l'auteur et de son contexte. Pour se mettre au même niveau que lui. Savoir, c'est essentiellement comprendre. Un deuxième cercle herméneutique apparaît alors entre la philosophie, la philologie et le langage.
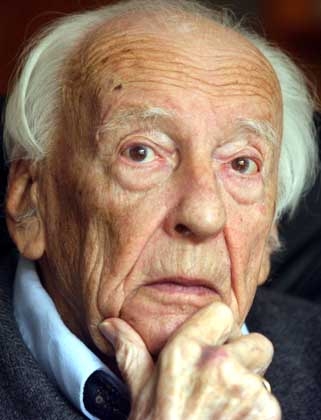 Le deuxième auteur vers lequel nous devons nous tourner pour nous expliquer l'herméneutique est notre contemporain Hans Georg Gadamer (1900-2002) qui a produit un renouveau de l'herméneutique. Pour comprendre l'herméneutique de Gadamer, nous devons prendre en compte deux éléments principaux : le sens du texte et la vérité du texte.
Le deuxième auteur vers lequel nous devons nous tourner pour nous expliquer l'herméneutique est notre contemporain Hans Georg Gadamer (1900-2002) qui a produit un renouveau de l'herméneutique. Pour comprendre l'herméneutique de Gadamer, nous devons prendre en compte deux éléments principaux : le sens du texte et la vérité du texte.
Par le sens du texte, nous entendons la connaissance scientifique-descriptive que nous avons de tout texte donné. La science, avec ses méthodes historiques et philologiques, nous dit quel est le sens du texte.
Par vérité du texte, nous entendons la connaissance à laquelle l'herméneutique nous conduit. Nous ne faisons l'herméneutique d'un texte ou d'un contexte que lorsque nous essayons de comprendre la vérité du texte.
Ainsi, celui qui ne voit pas la vérité du texte, pour Gadamer, n'a pas vu son sens. Nous ne comprenons sa signification que lorsque nous avons compris sa vérité. Par exemple : "Il vaut mieux subir une injustice que d'en commettre une" ou "Il vaut mieux vivre dans son propre pays qu'à l'étranger". Quiconque comprend le sens de ce texte ou de ce contexte et n'accepte pas sa vérité a compris son sens ? Il est évident que non. Est-il possible de considérer ce texte ou ce contexte de manière objective, détachée de sa vérité ? Évidemment non, dit Gadamer.
Il y a donc deux critères de vérité dans l'herméneutique dissidente que nous proposons : a) l'évidence, ce qui en soi n'a pas besoin de preuve et qui est là, présent, et qu'il suffit de décrire sous une forme achevée, et b) la vérification intersubjective, pour éviter que notre subjectivité ne nous trompe.
Comme on peut le voir dans tout cela, nous nous inspirons des enseignements de Franz Brentano et de la phénoménologie qu'il a inventée.
La métapolitique, à mon avis, fait cela : elle enquête sur l'art, sur la création, pour résoudre des problèmes qui ne sont pas dans les manuels de philosophie politique, qui sont ceux qui présentent les grandes catégories d'usage actuel, et conclut avec la compréhension de la vérité des problèmes.
En gardant toujours à l'esprit l'observation finale de Gambescia : "s'en tenir aux choses telles qu'elles sont et non telles qu'elles devraient être du point de vue des différents et imaginatifs évangiles sociaux".
En bref, tout comme la métapolitique ne peut pas être une métaphysique de la politique, une erreur de Dilthey, elle ne peut pas non plus être une éthique de la politique. Ce n'est pas non plus une philosophie politique qui traite du "politique", mais plutôt un "au-delà", qui doit être interprété comme un "après" de la politique.
Comme l'affirme avec poésie Monserrat Álvarez du Paraguay : "Avec le terme métapolitique, je veux me référer aux concepts subconscients de la politique. À la recherche, à l'enquête policière, du fondement implicite sous l'épiderme des faits que nous appelons politiques".
Dissidence
En ce qui concerne le deuxième article sur la dissidence, le sociologue Carlo Gambescia commence par déclarer, comme il l'a fait dans la métapolitique : "Le dissentiment qui se divise en théorie et en pratique, en tant que forme de relation (dans le sens de produire des conséquences), est un fait social de grande importance, car il affecte la division sociale du travail"... "il faut distinguer le dissentiment théorique, sur des idées, sans conséquences, comme cela arrive souvent, lorsqu'un argument, même polémique, disparaît dans les brumes du discours public, et le dissentiment pratique, avec des conséquences immédiates, comme dans le cas des travailleurs en grève"...
Et c'est très bien d'un point de vue sociologique, mais comme le dit mon ami Carlos Tonelli, spécialiste du sujet : "la grève (pour suivre son exemple) est sans aucun doute une manifestation de la dissidence ouvrière, mais ce n'est pas une dissidence en soi... Si je tue, je ne suis pas "pratiquement en dissidence" avec l'autre, je fais autre chose, différent de la dissidence, je commets un homicide". L'homicide, la grève, ne sont pas des dissidences pratiques, elles ont une autre nature".
Cette distinction entre dissidence théorique et pratique peut être utile pour la sociologie, mais elle est stérile pour la métapolitique.
Ce n'est pas ce que nous avons l'intention de faire avec la théorie de la dissidence, où nous essayons de la présenter d'un point de vue philosophique comme une dimension existentielle de tout être humain dans l'affirmation et la préférence de soi.
C'est pourquoi nous proposons une herméneutique dissidente comme méthode de métapolitique la plus appropriée. S'il est vrai que cette méthode ne possède pas la rigueur des sciences dures, elle n'est pas exacte, mais je suis convaincu qu'elle est rigoureuse, une caractéristique que les sciences de l'action humaine ne doivent pas perdre de vue. Si l'on se plonge dans l'histoire des sciences, ce n'est rien d'autre qu'une variation de l'endoxa aristotélicienne.
Pour sa part, Gambescia nous accompagne avec son affirmation : "la dissidence-conflit est une régularité métapolitique qui se répète dans l'histoire". "Une autre régularité métapolitique est la distinction entre institution et mouvement". Mais, objecte-t-il, "la dissidence, qui, si elle est "prescrite", vendue et consommée à doses massives, peut empoisonner et tuer..."
Il appelle donc à une dissidence qui respecte l'expérience historique et sociologique, car il ne faut pas oublier que "dans chaque dissident, on peut voir un futur défenseur des institutions".
Carlo Gambescia est un sociologue sérieux et rigoureux qui revendique une méthodologie scientifique aussi éloignée que possible du subjectivisme et de l'idéologie politique. C'est un réaliste politique qui attire mon attention sur le fait que je ne sors pas des voies du raisonnement réfléchi. Et en ce sens, je lui suis très reconnaissant.
V.- Alberto Buela et Carlo Gambescia, une synthèse de la confrontation sur la métapolitique par Carlo Gambescia
Si je devais indiquer un point de connexion entre mes recherches métapolitiques, en tant qu'humble sociologue italien, et celles d'Alberto Buela, brillant philosophe argentin, je ne pourrais le voir que dans la tentative commune de ramener la métapolitique dans le domaine de la recherche scientifique sérieuse.
Pourquoi "ramener" ? Pour la simple raison que dans le débat contemporain - en simplifiant - la métapolitique est soit présentée comme une pompeuse éthique de la politique, parfois même de type religieux, soit réduite à une grossière métapolitique de l'action, et donc mise au service d'une idéologie organisationnelle pure et simple.
Buela, quant à lui, a compris l'importance d'un fondement théorique pour toute discipline qui aspire à être scientifique.
Comment Buela développe-t-il cette intention ?
En introduisant, dans le domaine de la recherche métapolitique, le concept de "pensamiento disidente", basé sur la dissidence herméneutique. Cette approche est soutenue d'une part par l'herméneutique, en tant que lien entre le sens et la vérité dans la recherche métapolitique, et d'autre part par le concept de dissidence, qui s'inspire d'un certain nombre de disjonctions (consensus et dissidence ; droits de l'homme et droits des peuples ; progrès et décroissance ; mémoire et histoire ; pensée unique et pensée dissidente, etc.), à partir de la distinction métapolitique qui renvoie, peu ou prou, à une régularité précise des régularités : celle entre communauté et société.
Dans une certaine mesure, dans sa pensée, la régularité du dissentiment-consentement (qui renvoie à l'heuristique métapolitique : la boîte à outils des régularités), se transforme en un moment herméneutique fondamental. Le sens, donné par l'existence de régularités, donc aussi celui du dissensus-consensus, se transforme du côté du dissensus en dissensus herméneutique.
Le point fondamental, pour éviter que l'idéologie ne devienne vérité et que l'heuristique ne soit une pure et simple technique de contrôle social, reste celui de la recherche de la vérité, qui est bien différente de celle de l'opinion, comme le sait bien Buela, en bon connaisseur d'Aristote.
Mais quelle vérité ?
Eh bien, sur ce point précis, je crois que la vérité poursuivable est celle des faits. Donc autre que la métaphysique. Les faits, au sens de la nature cyclique, si l'on veut répétitive, factuelle des formes métapolitiques, parmi lesquelles la forme-dissolution se distingue comme l'opposé de la forme-consentement : une régularité, si l'on veut une polarité métapolitique, que l'on retrouve tout au long de l'histoire humaine.
Ce qui indique, je le répète, que nous avons affaire à un "fait", à une dynamique immanente, surtout à quelque chose de non transitoire, qui, en termes simples, demeure.
En bref, la dissidence et le consensus ne peuvent être expulsés de l'histoire d'un coup de baguette magique. De toute évidence, le consentement et le désaccord, en termes de contenu, renvoient à des articulations historiques et sociales différentes. Au "contexte" du texte anthropologique, en tant que comportement réel, pour le dire en termes herméneutiques. Un "contexte" qui doit être interprété.
En réalité, l'herméneute, l'interprète, doit être scientifiquement vertueux au point de ne pas superposer ses propres valeurs (en tant que sujet) aux faits étudiés (objet). Cela exige un grand engagement envers l'objectivité.
Laissez-moi vous donner un exemple. Un chercheur qui n'aime pas le monde moderne et ses valeurs, donc qui n'apprécie pas les manières libérales de gérer le consensus par des procédures constitutionnelles précises, pourra parler de consensus géré d'en haut, masqué, donc comme une forme de contrôle social hypocrite, rien de nouveau sous le soleil donc. En revanche, un chercheur qui aime le monde moderne et ses valeurs verra dans la gestion libérale du consentement un pas en avant vers un monde plus civilisé et tolérant. Des progrès, même timides.

On m'a fait remarquer que la grève, qui dans les démocraties industrielles modernes est un mode pratique de dissidence incorporé dans les codes libéraux (mode théorique), n'a rien à voir avec la dissidence réelle (théorique), car pendant la grève, des meurtres sont commis.
Cela peut être vrai dans certains cas, mais un bon herméneute, capable de lier le sens (la boîte à outils, l'heuristique) et la vérité (le factuel, cependant), sait bien que les grèves violentes, et même celles marquées par le meurtre, renvoient à des réalités où les codes libéraux du droit de grève, même si elles sont en vigueur, sont encore loin d'être acceptées dans les esprits comme dans les comportements, tant par les employeurs, qui voient dans le "gréviste" un révolutionnaire à écraser, que par les travailleurs, qui voient dans l'employeur, un exploiteur pur et simple à éliminer par la force.
Si un "mérite" ou un "avantage" fonctionnel peut être attribué au procéduralisme libéral en matière de dissidence, on ne peut nier qu'il est représenté par la transformation de l'ennemi en adversaire. Bien sûr, cela ne se produit pas toujours, et la raison pour laquelle cela ne se produit pas s'explique par les régularités métapolitiques, mais, ceci dit, la tolérance reste une idée régulatrice importante des systèmes libéraux modernes. Ce n'est pas une mince affaire.
Un herméneute, attentif au sens et à la vérité des faits, ne peut manquer d'en tenir compte. Évidemment, cela doit se faire sur la base d'une objectivité rigoureuse, un don dont notre ami Buela ne manque pas.

Max Weber, héritier de l'historicisme allemand et d'une glorieuse tradition herméneutique (également appréciée par Buela), estimait que la tâche des intellectuels, des professeurs en somme, n'était pas de prendre parti pour telle ou telle idéologie, mais de montrer à quiconque l'interrogeait non pas des solutions toutes faites, mais comment "réaliser le sens ultime de son propre travail". Ce passage mérite d'être cité dans son intégralité.
" C'est-à-dire que nous [les professeurs, ndlr] pouvons, ou plutôt devons, vous dire : telle ou telle position pratique peut être déduite avec une cohérence et un sérieux intimes, conformément à son sens, de telle ou telle conception fondamentale du monde [...], mais jamais de telle ou telle autre ". Vous servez ce dieu - pour parler au sens figuré - et vous offensez cet autre dieu, si vous optez pour cette attitude. Car vous arriverez à ces conséquences extrinsèques extrêmes et importantes si vous restez fidèles à vous-mêmes. Ce travail [de clarification des significations ultimes de l'action individuelle en politique, Ndlr] peut, au moins en principe, être fait [par le professeur, Ndlr]. (*).
Or, la dissidence herméneutique, et sur ce point je crois que l'accord avec mon ami Buela est absolu, ne peut pas, et même ne doit pas, ignorer cette précieuse indication wébérienne.
Enfin, et là aussi je crois que Buela est d'accord, le nœud de l'explication métapolitique renvoie à la question de l'intelligibilité des faits. De compréhension, ce qui n'est pas une justification, ou pire encore, de partage. Sur ce point, je me réfère, également sur le plan terminologique, au débat allemand sur l'historicisme (**).
Je parle d'un acte cognitif qui ne dérive pas de l'intuition ou de l'empathie de l'observateur envers le phénomène observé, mais de l'interprétation, donc de l'herméneutique, qui, selon nous, consiste, historiquement, à reconstruire, rationnellement, le monde dans lequel vit l'acteur historique et social étudié. Mais comment ? En recourant à des régularités métapolitiques, en tant que modèles de disposition, dans le sens de la manière dont l'homme est disposé en série, en termes de possibilités de comportement, compte tenu de certaines situations historiques et sociales.
Cela signifie que les régularités métapolitiques sont, au niveau de la métascience, des propositions qui avancent des hypothèses comportementales, en ce sens que - je le répète - dans certaines situations, il est possible, et donc pas nécessairement probable, que les hommes se comportent selon certaines régularités métapolitiques.
Par exemple, il est possible qu'une grève dans le cadre d'une dissidence pratique, liée à une procédure libérale, ne se termine pas par un bain de sang. De même, dans le même contexte, il est tout aussi possible, mais non probable, que les balles soient remplacées par des urnes. Cela renvoie à la régularité de la dissidence-consentement, en la contextualisant toutefois précisément dans une clé herméneutique, une clé qui nous renvoie au constitutionnalisme libéral et à ses principes régulateurs.
Évidemment, ce qui vient d'être dit renvoie à une autre série de problèmes : celui de la relation entre la cause et l'effet dans les actions sociales, qui n'est pas la même que celle des "sciences dures" comme le note Buela ; celui de la relation entre les actions individuelles et l'hétérogénéité des fins collectives ; celui, qui découle de l'observation précédente : de la relation entre les intentions sociales, même les plus nobles, et la misère des résultats finaux. Et ainsi de suite.
Le vrai nœud théorique, si vous voulez le vrai défi de la métapolitique, reste dans le fait que les hommes font l'histoire, donc ils ont recours à des moyens, mais ils font une histoire dont ils ne savent rien, sauf quand elle est faite. Ainsi, même lorsqu'ils font l'histoire sur la base d'intentions, même les plus nobles, et donc en visant certaines fins moralement justifiables, le risque d'obtenir des résultats contraires à ceux poursuivis est toujours possible, voire probable dans de nombreux cas. Certainement en rétrospective.
Pour ne donner que quelques exemples trop familiers, pensez à l'histoire romaine, notamment celle de la République, qui a construit un empire sans le savoir, revendiquant même les valeurs de la République, désormais dépassées par les faits. Ou, autre exemple, l'essor du christianisme, fondé sur le sermon de la montagne et culminant avec la destruction des temples païens.
La métapolitique, un point sur lequel je pense que Buela est d'accord, est une connaissance qui étudie les moyens ainsi que les fins, mais en se distanciant hermétiquement des deux, selon les dictats weberiens.
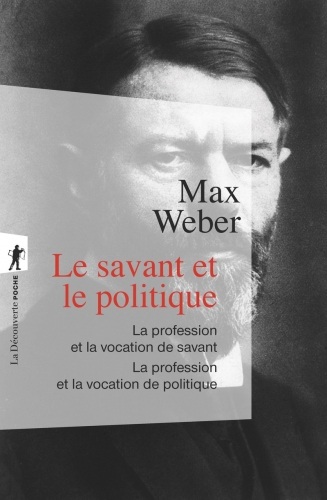
Ce qui, je le répète, n'est pas une blague ; Weber en était épuisé, même psychiquement. Mais, pour citer les anciens géographes, hic sunt leones. Je dois donc m'arrêter là.
Je tiens à remercier mon ami Alberto Buela pour l'intéressante discussion, qui s'est distinguée, plus par son mérite que par le mien, par un niveau culturel très élevé.
Une comparaison des idées sur la métapolitique qui, je crois, a vu les points d'accord dépasser les points de désaccord ou du moins de critique. Ce qui, précisément par les temps qui courent, n'est pas une mince affaire. Merci Alberto.
Carlo Gambescia
Notes:
(*) Max Weber, "Il lavoro intellettuale come professione", note introductive de Delio Cantimori, Einaudi, Turin 1980, p. 36.
(*) Voir Pietro Rossi, "Lo storicismo tedesco contemporaneo", Einaudi, Turin 1971, 2ème édition, ainsi que le très critique Carlo Antoni, "Dallo storicismo alla sociologia", Sansoni, Florence 1973 (1ère édition, ivi 1940).
14:02 Publié dans Définitions, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : métapolitique, carlo gambescia, alberto buela, dissidence, définition, philosophie, philosophie politique, politologie, sciences politiques, théorie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 21 août 2021
Marxisme rhénan
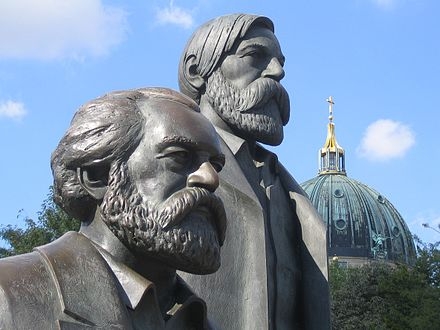
Marxisme rhénan
par Joakim Andersen
Ex: https://motpol.nu/oskorei/2021/08/17/rhenmarxism/
En 1848, des révolutions secouent plusieurs pays européens, une période mouvementée qui a été appelée, entre autres, le Printemps des peuples. C'est aussi une période intense pour deux futurs dieux de la maison marxiste-léniniste, Marx et Engels. Ils ont tous deux rapporté, analysé et essayé d'influencer les événements dans la Neue Rheinische Zeitung. Pour les historiens des idées, il s'agit d'une lecture enrichissante, notamment parce qu'elle nous permet de suivre les fils de leur analyse qui se sont ensuite faits plus diffus. La dialectique entre le peuple et la classe n'est pas la moindre, bien que nous trouvions également des éléments précoces comme l'attitude querelleuse envers Proudhon et l'intérêt pour l'économie politique.

Dans le premier numéro, Engels fait directement référence au peuple: "le peuple allemand a gagné son statut de souverain en combattant dans les rues de presque toutes les villes du pays... La proclamation publique et audacieuse de la souveraineté du peuple allemand aurait dû être le premier acte de l'Assemblée nationale". Dans la dernière partie, l'éditorial avertit les travailleurs que "la bourgeoisie envoie les travailleurs dans le feu et les trahit ensuite de la manière la plus infâme". Dans l'ensemble, le peuple, das Volk, joue un rôle central. Engels apparaît souvent comme un démocrate radical aux accents nationalistes, par exemple lorsqu'il affirme que la souveraineté du peuple doit être au cœur de la nouvelle constitution. Mais Marx mentionne également la nécessité d'un peuple armé, dans des termes qui rappellent le mouvement contemporain des milices américaines. Dans un texte sur les plans des opposants, il écrit que le "Berlin réactionnaire" "s'efforce de désarmer au plus tôt toutes les gardes civiques, surtout dans la région du Rhin, de détruire peu à peu tout l'armement du peuple qui se développe actuellement, et de nous livrer sans défense aux mains d'une armée composée surtout d'éléments étrangers, soit faciles à réunir, soit déjà préparés". Il est également intéressant de noter qu'une élite anti-populaire peut utiliser des "éléments étrangers" contre le peuple (voir Weber). Marx et Engels, d'ailleurs, soutenaient tous deux que "l'intimidation du peuple non armé ou l'intimidation par une soldatesque armée - voilà le choix qui s'offre à l'Assemblée". En bref, l'identité entre le peuple et l'armée semble être aussi décisive que l'armement du peuple.
Dans plusieurs textes, Engels développe l'argument de l'élite et des étrangers. Cela s'applique notamment à la politique d'échange de population menée dans la Pologne sous contrôle prussien. Il demande dans ce contexte "comment considérerions-nous des personnes qui ont acheté nos terres pour presque rien alors que la concurrence était exclue, et qui l'ont fait de surcroît avec le soutien du gouvernement ?" et note que "à Poznan, ces colons ont été envoyés méthodiquement, avec une persistance sans faille, dans les dèmes, les forêts et les domaines divisés de la noblesse polonaise afin d'évincer les Polonais de souche et leur langue de leur propre pays et de créer une province véritablement prussienne". Notez dans ce contexte le raisonnement pas tout à fait politiquement correct d'Engels et ses ambiguïtés sur la relation entre les intérêts juifs prussiens et locaux, en utilisant des mots tels que "avides de profits". La relation entre la minorité locale et l'autorité étrangère, que l'on pourrait qualifier de minorités compradores, en faisant une légère référence à la gauche des années 1970, présente un intérêt général. Quoi qu'il en soit, la perspective de base est que "tous les dirigeants existants jusqu'à présent et leurs diplomates ont utilisé leurs compétences et leurs efforts pour dresser une nation contre une autre et utiliser une nation pour en supprimer une autre, et de cette manière pour perpétuer le pouvoir absolu". Un thème qui revient dans leurs écrits ultérieurs, pour citer un Engels âgé, selon lequel "une véritable coopération internationale entre les peuples d'Europe n'est possible que lorsque chacun de ces peuples est pleinement et fermement le maître de sa propre maison".

L'intérêt pour le conflit entre, d'une part, un Occident libre et les classes et nations qui lui sont associées et, d'autre part, un Orient despotique, est lié à cela, principalement chez Engels. Mais on retrouve également ce thème chez Marx, qui écrit entre autres que "la défaite de la classe ouvrière en France et la victoire de la bourgeoisie française étaient en même temps une victoire de l'Orient sur l'Occident, la défaite de la civilisation par la barbarie". La suppression des Roumains par les Russes et leurs outils, les Turcs, a commencé en Valachie; les Croates, les Pandours, les Tchèques, les Serejanes et autres racailles similaires ont étranglé la liberté allemande à Vienne, et le Tsar est maintenant omniprésent en Europe. Le renversement de la bourgeoisie en France, le triomphe de la classe ouvrière française, et la libération de la classe ouvrière en général est donc le cri de ralliement de la libération européenne." L'eurocentrisme est plus qu'implicite ici. Il en va de même du scepticisme à l'égard de la "perfide Albion", Marx s'en prend ensuite à "l'Angleterre, le pays qui fait de nations entières ses prolétaires, qui embrasse le monde entier de ses bras énormes, qui a déjà une fois payé les frais d'une Restauration européenne, le pays dans lequel les contradictions de classe ont atteint leur forme la plus aiguë et la plus éhontée." Les courageux peuvent actualiser l'analyse jusqu'aux années 2020, date à laquelle un autre empire aura peut-être pris la place de l'Angleterre en Occident.
La distinction entre État et société est globalement intéressante, particulièrement évidente dans le cas de la Prusse, que les auteurs n'aiment pas. Entre autres choses, Engels écrit que "non seulement les Polonais, mais aussi les autres Prussiens, et surtout nous qui sommes originaires de Rhénanie, peuvent en raconter long sur les mesures "rigoureusement réglementées" et "strictement appliquées" de la digne bureaucratie prussienne, mesures qui ont "perturbé" non seulement les anciennes coutumes et les institutions traditionnelles, mais aussi toute la vie sociale, la production industrielle et agricole, le commerce, l'exploitation minière, bref toutes les relations sociales sans exception." La bureaucratie et l'État apparaissent ici comme des acteurs relativement autonomes, qui dominent souvent la bourgeoisie. La relation ambivalente de la bourgeoisie avec les travailleurs et la monarchie/bureaucratie/militaire est, selon les deux, particulièrement forte en Allemagne. Mais l'attitude de base, État contre société, est exprimée de façon lapidaire dans des passages tels que "les développements n'attendront pas que les lettres de change tirées par les États européens sur la société européenne expirent".

Dans ce contexte, l'accent mis par Engels sur la valeur de la centralisation, "une centralisation révolutionnaire rigoureuse", peut sembler quelque peu contradictoire. Mais il s'agit en fin de compte de géopolitique et de survie. Sinon, le libellé sur les taxes et les grèves fiscales est intéressant. Entre autres choses, Marx exhorte les lecteurs à "affamer l'ennemi et à refuser de payer des impôts ! Rien n'est plus stupide que de fournir à un gouvernement perfide les moyens de combattre la nation, et le moyen de tous les moyens est l'argent." Tout ami de l'ordre objectera que "c'était à l'époque, c'était l'ancienne monarchie, l'État de notre temps a une base de classe très différente". Mais la question est alors de savoir de quelle base de classe il s'agit réellement et si ce n'est pas aussi aujourd'hui un "gouvernement traître".
Quoi qu'il en soit, l'analyse du jeu est d'un grand intérêt. Il s'agit du jeu entre le peuple et le souverain, mais celui-ci se décompose ensuite en "tactiques d'essai" entre les ouvriers, les bourgeois et le souverain, où une partie du peuple risque constamment d'utiliser les ouvriers pour obtenir des concessions du souverain, mais change ensuite de camp. Pour compliquer encore les choses, Marx et Engels font également intervenir le Lumpenproletariat, parfois avec des connotations ethniques, dans des passages tels que "la bourgeoisie est liguée avec les lazzaroni contre la classe ouvrière". Le projet de la bourgeoisie de "transformer la monarchie féodale en monarchie bourgeoise par des moyens pacifiques" est simultanément saboté par le fait que "la vieille bureaucratie ne veut pas être réduite au statut de serviteur d'une bourgeoisie pour laquelle, jusqu'à présent, elle a été un tuteur despotique". Le facteur ethnique et le conflit entre l'Ouest et l'Est viennent encore compliquer la situation. En somme, un tableau complexe, mais un modèle utile pour comprendre notre époque également. Même si les classes et les États concrets d'aujourd'hui sont en partie différents de ceux d'alors.
En conclusion, nous notons qu'Engels a anticipé l'intuition de Carl Schmitt selon laquelle un ordre ne peut pas, à long terme, être basé sur deux principes opposés, "les résultats de la révolution ont été, d'une part, l'armement du peuple, le droit d'association et la souveraineté du peuple, gagnés de facto; d'autre part, le maintien de la monarchie et du ministère Camphausen-Hansemann, c'est-à-dire un gouvernement représentant la grande bourgeoisie. La révolution a donc produit deux séries de résultats, qui ne pouvaient que diverger. Le peuple était victorieux; il avait gagné des libertés de nature foncièrement démocratique, mais le contrôle direct passait dans les mains de la grande bourgeoisie et non dans celles du peuple." Dans l'ensemble, les articles des années révolutionnaires intenses de 1848 et 1849 présentent donc une certaine valeur, notamment pour ceux qui souhaitent trouver des analyses et des citations véritablement subversives à développer ou à jeter à la figure des "marxistes" établis.
Qu'est-ce que Motpol ?
Motpol est un groupe de réflexion identitaire et conservateur qui poursuit deux objectifs principaux : 1) mettre en évidence un spectre culturel qui est essentiellement laissé de côté dans une sphère publique suédoise de plus en plus encombrée et monotone, et 2) servir de forum pour la présentation et le débat de l'idéologie, de la théorie et de la pratique politiques. Les écrivains de Motpol viennent d'horizons divers et écrivent à partir de perspectives différentes.
Nous contacter
Motpol
Boîte 7129
402 33 Göteborg
Courriel : info@motpol.nu
Editeur responsable :
Daniel Friberg
Soutenir Motpol
Si vous appréciez le think tank Motpol et les activités que nous menons sous la forme de conférences, de séminaires et surtout de ce site web, et que vous souhaitez nous aider à nous développer, vous pouvez montrer votre soutien en apportant une contribution financière.
Les dons sont effectués via PayPal à l'adresse info@motpol.nu.
22:18 Publié dans Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : karl marx, friedrich engels, 19ème siècle, 1848, révolutions de 1848, histoire, marxisme, philosophie, philosophie politique, politologie, sciences politiques, théorie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 20 août 2021
La société analgésique

La société analgésique
par Roberto Pecchioli
Ex: https://grupominerva.com.ar/2021/08/roberto_pecchioli-la-sociedad-analgesica/
Si nous avons mal à la tête, nous nous tournons immédiatement vers les analgésiques. Si nous souffrons d'un échec, d'une perte ou d'une absence, ou si nous nous sentons un peu tristes, nous nous tournons vers les anxiolytiques. Nous n'avons plus la force d'accepter, de supporter, de surmonter de façon autonome, avec les ressources du corps et de l'âme, la douleur, la souffrance, la difficulté. Notre société est une société analgésique. L'expérience de la douleur - physique, morale, spirituelle, psychologique - est considérée comme intolérable et dénuée de sens. La philosophie et les religions ont toujours interprété la douleur comme un élément irrépressible de la condition humaine. Faire l'expérience de la douleur, affronter la souffrance signifiait accepter le drame de la vie et lui donner un sens. Pour le christianisme, la douleur était une épreuve à surmonter sur le chemin de la purification et pour mériter la vraie vie, la vie céleste. Pour l'humanité postmoderne, c'est simplement quelque chose à éviter à tout prix.
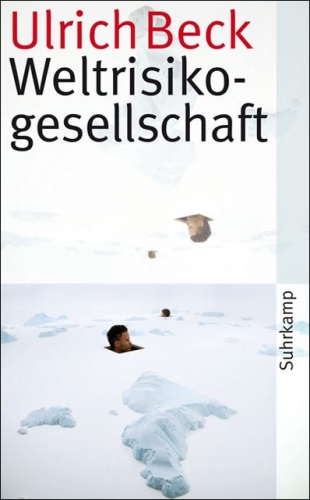
Le monde contemporain est tellement terrifié par la souffrance qu'il renonce à la liberté pour ne pas avoir à l'affronter. Nous vivons dans ce qu'Ulrich Beck appelle une "société du risque", qui vit dans l'anticipation de la douleur et de la catastrophe. Après tout, tout le système technologique d'accumulation des données vise à minimiser les risques - économiques, mais aussi existentiels - et donc, indirectement, à éliminer la souffrance. La société prédictive est une société qui tente d'abolir les risques et les échecs avec leur lot de douleur. La souffrance, cependant, n'est pas un élément statistique, une formule mathématique à laquelle on applique un algorithme.
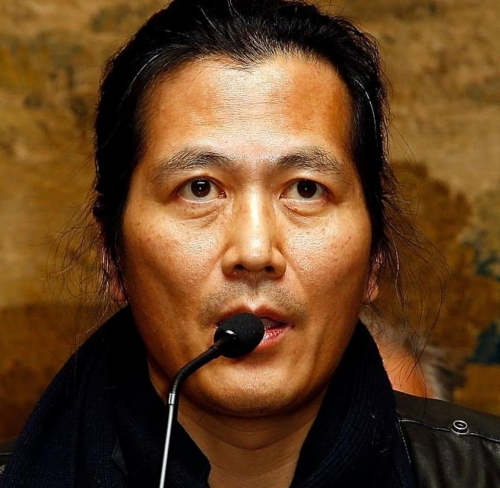
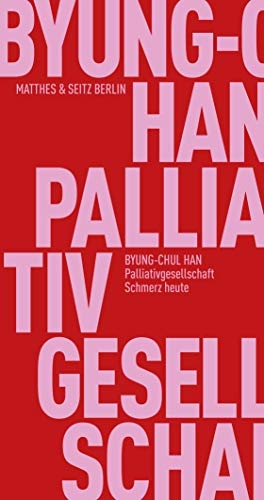
Le philosophe coréen germanophone Byung Chul Han en parle avec inquiétude dans sa récente "Société sans douleur" (Palliativgesellschaft - Schmerz heute). La fatigue existentielle de l'individu postmoderne, l'obsession de la transparence, combinée à la disparition de l'Autre dans l'essaim numérique. Pour Han, l'incapacité de s'identifier à la douleur pousse l'homme d'aujourd'hui à s'enfermer dans une bulle de fausse sécurité qui devient une cage de sédatifs. Au contraire, ce n'est que par la douleur que nous nous ouvrons au monde, et la pandémie dans laquelle nous vivons, couvrant le quotidien d'une infinie prudence, est le symptôme d'une condition qui nous précède, le rejet collectif de notre fragilité.
L'homme d'aujourd'hui, comme le disait Simone Weil, est suspendu dans l'abîme de l'histoire, de plus en plus convaincu de l'insignifiance de sa présence dans le monde. Afin d'oublier l'absence de sens, il recherche des paradis apaisants et artificiels, dont la conséquence est sa perdition. Des dernières ressources morales pour supporter le poids des problèmes et des douleurs de l'existence. Le refuge immédiat du nihilisme radical de masse est une médicalisation et une technification de la vie visant à éliminer toute expérience négative. Il en résulte une faiblesse croissante, un épuisement, l'incapacité de surmonter les obstacles, l'élimination obstinée du mal, ainsi que la perte d'autonomie.
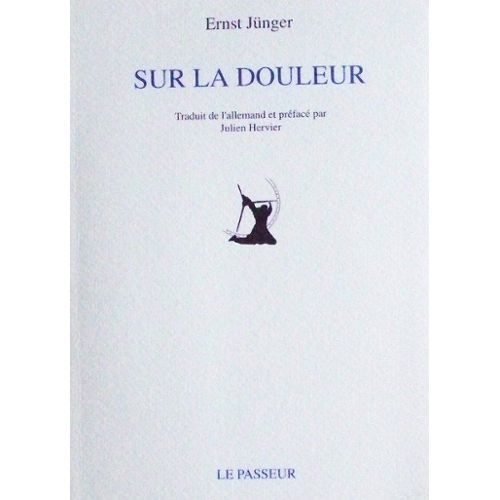
Pour Ernst Jünger, le rapport à la douleur révèle notre véritable personnalité. Han ajoute qu'une critique de la société n'est possible qu'à travers une "herméneutique de la douleur" particulière, c'est-à-dire son interprétation en tant que code pour comprendre le présent. Les souffrances sont des faits, mais aussi des signes, dont la nature nous échappe. Une société terrifiée par la douleur demande à vivre dans une anesthésie permanente. C'est-à-dire qu'il devient dépendant de l'anesthésiant - une drogue, un médicament, une consommation compulsive ou tout autre analgésique existentiel - et de ceux qui le dispensent. Se débarrasser de la douleur a des avantages immédiats, mais cela reste une thérapie palliative. Le résultat est un moyen de sortir du conflit pour éviter les confrontations douloureuses. Buyng Chul Han définit cette étrange condition comme "algophobie", la peur de la douleur, découvrant qu'il s'agit également d'un stratagème pour le pouvoir. Au lieu de lutter, nous nous abandonnons au système, aux responsables, à sa fatalité, sous la douleur de devoir gérer la souffrance. La société politique est également analgésique : elle n'affronte pas les problèmes de front, elle ne planifie pas et ne met pas en œuvre des changements incisifs : ils pourraient "faire mal". Après l'effet de la drogue, nous sommes de retour à la case départ. La clé de tout est la volonté de se débarrasser de tout ce qui est négatif, et la douleur est la négativité par excellence.
La poursuite du bonheur a été établie comme un droit naturel par la constitution américaine. Si ce n'est le bonheur, au moins un semblant de bien-être peut désormais être obtenu médicalement. Aux États-Unis, il existe une idéologie du bien-être qui passe par des médications consommées à grande échelle par des personnes en bonne santé. Un spécialiste de la douleur, David B. Morris, a été le premier à observer - fait inédit - que nous vivons dans une génération, la première au monde, "qui considère l'existence sans douleur comme une sorte de droit constitutionnel". La souffrance est un scandale. La recherche de supports pharmaceutiques coïncide avec l'anxiété suscitée par l'idéologie de la performance. Nous devons réaliser de nouvelles performances chaque jour - dans le travail compétitif, dans le sexe, dans les loisirs. Si nous n'y parvenons pas, nous souffrirons; la souffrance est une responsabilité de l'existence compétitive qui doit être maintenue à distance par tous les moyens.

Plus profondément, c'est une période où rien ne doit "blesser", offenser, provoquer un débat. Les limites, les conflits et les contradictions sont abolis: ils font mal, ils enlèvent le plaisir, ils déclinent de la manière la plus analgésique et la plus immédiate qui soit : les likes, les likes des médias sociaux. La désapprobation produit de la douleur, il vaut mieux dire, faire, penser comme la majorité. La dissidence cause également de la douleur, le fait de ne pas faire partie de la majorité cause de la souffrance. La douleur est dépolitisée, déclassée comme une question médicale: soyez heureux, conseille le pouvoir, et les masses subordonnées ne savent plus qu'elles le sont. La douleur qui compte n'est que "la mienne": la souffrance est privatisée. Chacun a les yeux rivés sur lui-même, attentif à chaque symptôme de douleur à contrer "techniquement". Les antidouleurs, prescrits en grande quantité et pris en masse, dissimulent les circonstances sociales qui induisent la douleur. La médicalisation et la pharmacologisation de la douleur empêchent la souffrance de devenir un langage, c'est-à-dire un jugement et une critique, lui ôtant son caractère collectif.
Même dans le sport, celui des amateurs, la souffrance est interdite. Les statistiques montrent une augmentation des supporters de trois à quatre équipes de haut niveau au détriment de toutes les autres. Nous voulons gagner facilement et ne pas souffrir, même à travers notre équipe favorite. La formule de Ruzzante, dramaturge caustique du XVIe siècle, devient l'héritage d'un sombre passé: pour chaque plaisir, il faut de la souffrance. Pourtant, c'est ainsi. La joie d'avoir surmonté des obstacles, d'entreprendre laborieusement un défi par engagement, avec la constance comme habitude, horrifie l'humanité qui veut tout immédiatement, avec un clic, une tablette ou une piqûre d'épingle. Le "temps réel" exclut l'attente, le temps mort inutile qui vous fait souffrir.

La marchandisation de tout est un allié puissant de la société analgésique. Pour être acheté et vendu, un produit doit être aimé, mais pour satisfaire les goûts du public, il faut éliminer les difficultés et les ruptures. La douleur et le commerce s'excluent mutuellement. Enfin, la douleur est une expérience; la vie qui rejette toute douleur est réifiée, elle devient une chose, une prisonnière de l'Égal. Ceux qui ne peuvent pas souffrir sont enclins à la capitulation: ils ne se battront jamais pour une idée ou un principe. Le serviteur reste prisonnier du Seigneur par paresse et par peur des conséquences. Les passions cessent; le mot même qui fait allusion à la souffrance le dit, mais le bonheur, quand il arrive, est un moment d'extrême intensité qui ne peut être perçu sans son contraire, la douleur. Si la douleur est étouffée, anesthésiée, le bonheur se dégrade aussi en un engourdissement apathique.

Une société analgésique est une société de survie. La pandémie nous l'a montré. La vie devient une danse macabre de survivants enveloppés dans la peur de la mort. La peur de la douleur - algophobie - devient thanatophobie, au moment où la mort, longtemps repliée sur elle-même, refait surface, redevient centrale par la surexposition médiatique. Face à elle, n'étant plus Sœur la Mort, ne passant plus dans une autre dimension, toute limitation de la liberté, de tout droit, de tout comportement qui "avant" rendait notre existence digne et humaine, est acceptée sans résistance. La société est organisée selon des lignes immunologiques, entourée de nouvelles clôtures. Les frontières dont on se moque deviennent de l'espoir. L'ennemi revient, invisiblement, porteur de la souffrance et de la mort. Pour Monsieur Teste, le personnage de Paul Valéry, la douleur est une chose, un objet terrible, une simple agonie. Si elle n'a pas de sens, notre vie non plus. Monsieur Teste est le père légitime de l'être humain post-moderne, hypersensible à la douleur parce qu'elle l'horrifie. Teste ausculte continuellement l'intérieur de son corps, dans une introspection hypocondriaque et narcissique.
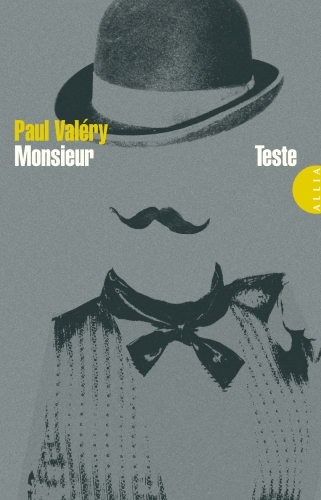
Pour Han, l'homme postmoderne souffre d'un curieux syndrome : celui de la "princesse et du petit pois". Dans le conte d'Andersen, un petit pois sous le matelas fait souffrir la princesse et l'empêche de dormir. Son hypersensibilité est notre hypersensibilité: nous souffrons de plus en plus, corps et âme, pour des choses de plus en plus insignifiantes. Le processus devient circulaire: une fois le petit pois éliminé, nous commencerons à nous plaindre des matelas trop mous. La véritable cause du mal est la croyance en la folie de la vie. La douleur est une force élémentaire que nous ne pouvons faire disparaître. Jünger a tout compris: "la douleur se pousse à la marge pour faire place à un bien-être médiocre". Si médiocre qu'elle devient de l'ennui: une douleur de l'âme qui se dilue avec le temps au point de devenir de l'ennui, la douleur de vivre.
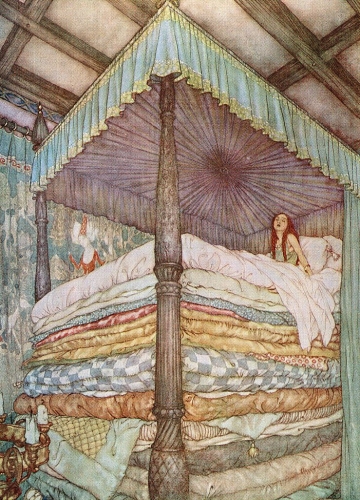
Un phénomène apparemment inexplicable dans la société analgésique est la propagation, surtout chez les jeunes, de l'automutilation. Il s'agit plutôt d'un mécanisme de substitution clair. La douleur de l'âme, dont le nihilisme pratique est une composante décisive, ne trouve d'autre remède qu'un sédatif homéopathique égal et opposé: combattre la souffrance de l'esprit vidé de la douleur physique, la blessure corporelle, visible et concrète, jetée à la face de l'indifférence universelle. L'automutilation est un appel au secours, un SOS des jeunes qui reste inaudible parce que c'est la société adulte qui a répandu le manque de sens.

La vérité est toujours douloureuse: c'est pourquoi on dit que la vérité fait mal. Son abolition postmoderne, cependant, est encore pire et produit une autre douleur, la douleur du manque, l'abolition de l'appartenance, la perte de la communauté. Cela s'appelle la nostalgie, la douleur du retour. Mais sans souffrance, nous n'aimons ni ne vivons: nous sacrifions la vie au nom d'un confort temporaire. Le lien est aussi une douleur: ceux qui le rejettent le font pour échapper à la souffrance de l'intensité, du lien qui peut faire mal. L'amour devient une consommation qui considère l'autre comme un produit jetable: l'amour et le désir font souffrir. Une expérience douloureuse vous fait "ressentir". Dans la langue vernaculaire de certaines vallées toscanes, pour décrire la douleur, on dit "je sens une dent, je sens ma tête".
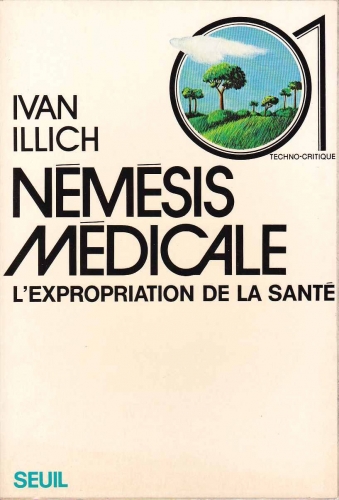
La société analgésique modifie la perception de la douleur physique et combat les souffrances intérieures en les confiant à un effacement éphémère par des moyens chimiques. Dans Nemesi (VER) medica, Ivan Illich écrit "dans une société anesthésiée, des stimuli toujours plus forts sont nécessaires pour donner le sentiment d'être vivant. La drogue, la violence, l'horreur deviennent des stimulants qui, à des doses toujours plus puissantes, parviennent encore à réveiller l'expérience de l'ego. Et il n'est pas rare qu'elle soit écrasée par la terreur d'être seul avec soi-même. De tout point de vue, la société analgésique est une addiction, imposée d'en haut par un dispositif qui surveille et contrôle nos vies, en les neutralisant de l'expérience de la souffrance.
Friedrich Nietzsche, sismographe ultrasensible en avance d'un siècle sur son temps, pressentait que le "tragique", qui affirme la vie malgré le tourment, allait disparaître de la vie. Une anesthésie prolongée nous prive du langage, la douleur devient un sujet médical, réglementé par des professionnels en blouse blanche, qui font cesser la souffrance en produisant un abrutissement spirituel progressif. Dans Le Gai Savoir, Nietzsche lui-même prononce des paroles décisives : "nous ne sommes pas des grenouilles pensantes, des appareils d'objectivation et d'enregistrement, des viscères gelés; nous devons générer nos pensées à partir de notre douleur et leur offrir maternellement tout ce que nous avons en nous de sang, de feu, de cœur, de plaisir, de passion, de tourment, de conscience, de destin, de fatalité". La société palliative déclare le contraire, nous plongeant dans une apparente et amniotique "absence de douleur" qui fuit convulsivement le négatif sans l'affronter. C'est l'éternel retour de l'Equal vulgarisé, car sans douleur, il n'y a ni changement, ni renouvellement, ni révolution; en définitive, il n'y a pas d'histoire.
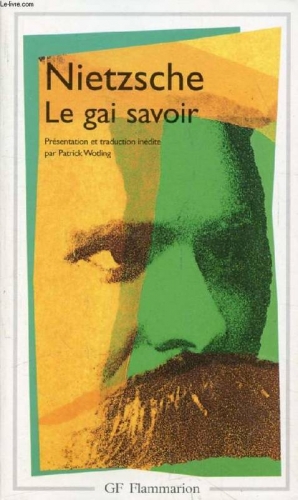
C'est peut-être aussi à cause de l'absence forcée de douleur que l'art contemporain est si dégradé. Un objet de consommation parmi d'autres, sans fondement, éloigné de la forme humaine et du récit de la réalité, réduit à un happening, une créativité bizarre, souvent induite par la drogue, sans intuition lyrique ni expression concrète.
Même l'image de la violence dans une société palliative et disciplinaire est une forme de consommation qui nous rend insensibles. Par excès, nous sommes rendus indifférents à la douleur des autres: l'Autre disparaît, devient un objet. De cette façon, il ne fait pas mal. En période de pandémie, la souffrance des autres se dissout dans les statistiques: le nombre de cas, le pourcentage d'écouvillons prélevés, le nombre de décès répartis par région et par groupe d'âge. La "distanciation sociale" entraîne une perte d'empathie. Éviter d'éprouver de la douleur nous transforme en automates dotés d'une sorte de callosité intérieure alimentée par la virtualité numérique.
"Un peu de poison de temps en temps: cela rend les rêves agréables. Et beaucoup de poison à la fin pour mourir agréablement. Un souhait pour le jour et un souhait pour la nuit : économiser en restant en bonne santé. Nous avons inventé le bonheur, disent les derniers hommes en clignant de l'œil. "Nous ne trouvons rien de plus efficace que les mots de Zarathoustra pour décrire la société analgésique convaincue d'avoir aboli la douleur. Heureusement, il n'y a pas que les derniers hommes, inventeurs ridicules d'un bonheur artificiel opaque. Certains, comme les poètes, se tiennent debout en serrant les dents. Le poète est un prétendant, qui prétend que la douleur qu'il ressent réellement est une douleur (Fernando Pessoa).
Tiré de : https://www.ereticamente.net/2021/03/la-societa-analgesica-roberto-pecchioli.html
Traduction espagnole par Alejandro Linconao
12:48 Publié dans Actualité, Philosophie, Psychologie/psychanalyse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, actualité, société analgésique, douleur, philosophie, problèmes contemporaines |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 17 août 2021
Ordre et Chaos: les piliers de la géographie sacrée

Ordre et Chaos: les piliers de la géographie sacrée
Luca Siniscalco
Ex: https://www.geopolitica.ru/en/article/order-and-chaos-pillars-sacred-geography
 Ordre et Chaos sont des concepts fondamentaux et archétypaux qui nous permettent de comprendre et d'ordonner la réalité. Grâce à la clé herméneutique qu'ils offrent, le présent article aborde la relation entre, d'une part, la tension vers l'ordre et la stabilité et, d'autre part, la dimension ontologique originelle indistincte et préformelle (distincte du désordre) dans le cadre de l'étude de la philosophie des lieux. Quelques déclinaisons plus spécifiques de cette question seront explorées le long de la trajectoire qui, partant de la géographie sacrée et de la figure du Genius loci, mène à des disciplines contemporaines telles que la géophilosophie et la géopolitique.
Ordre et Chaos sont des concepts fondamentaux et archétypaux qui nous permettent de comprendre et d'ordonner la réalité. Grâce à la clé herméneutique qu'ils offrent, le présent article aborde la relation entre, d'une part, la tension vers l'ordre et la stabilité et, d'autre part, la dimension ontologique originelle indistincte et préformelle (distincte du désordre) dans le cadre de l'étude de la philosophie des lieux. Quelques déclinaisons plus spécifiques de cette question seront explorées le long de la trajectoire qui, partant de la géographie sacrée et de la figure du Genius loci, mène à des disciplines contemporaines telles que la géophilosophie et la géopolitique.
1. Philosophie des lieux et géophilosophie
L'Ordre et le Chaos sont des structures fondamentales et constituent un pivot de la réalité dans son ensemble. Ces concepts peuvent donc être compris comme des pôles cohérents de la dynamique de base qui caractérise et produit la vie, le mouvement et la relation eux-mêmes: sans la connexion entre l'Ordre (le коород fixe, constant, qui assure la stabilité ontologique et épistémique de l'Unus Mundus) et le Chaos (la dimension énergétique préformelle dont tout dérive et vers laquelle tout revient, dans un processus dynamique, dialectique et polémologique) [1], rien ne pourrait être correctement compris - et même avant cela, rien ne pourrait apparaître dans le domaine de la visibilité, dans le règne de la "clairière", de la Lichtung, pour adopter le langage heideggérien (Di Somma, 2017 ; Chai, 2014). Comme on peut le constater, l'Ordre et le Chaos ont un noyau religieux, symbolique et métaphysique significatif, qui connote originellement ces concepts à travers leur origine cosmogonique et théologique qui est ensuite acquise, discutée et incarnée au sein de la spéculation philosophique.
Les domaines géographiques et géopolitiques peuvent également être interprétés à travers la lentille herméneutique de ces deux concepts. Ce que nous voulons montrer, cependant, c'est que ces archétypes sont en quelque sorte particulièrement adaptés à l'interprétation proposée ici en raison de la dimension sacrée fondamentale liée aux lieux eux-mêmes - et cette pertinence du sacré dans la structure des lieux rend les deux archétypes fondamentaux pour toutes les disciplines qui étudient et considèrent les lieux comme leur principal objet d'analyse. C'est précisément cette dimension sainte et sacrée qui lie Ordre et Chaos aux sciences géographiques et géopolitiques. Cette thèse pourrait étonner le lecteur contemporain, mais elle doit être considérée comme la simple reconnaissance que la relation originelle entre les hommes et la Terre, telle qu'elle est comprise par l'anthropologie et l'histoire des religions, est principalement mythico-symbolique et spirituelle. Cette connexion s'opère à travers la hiérophanie dans laquelle le sacré apparaît sous la forme de modèles archétypaux dans la réalité concrète et empiriquement expérimentable: "La manifestation du sacré fonde ontologiquement le monde (Eliade, 1961, p. 21) et au sein des communautés archaïques, les lieux eux-mêmes ne sont conçus comme réels, authentiques, pleins de sens, que lorsqu'ils sont imprégnés de la dimension suprasensible.
Cette herméneutique mythique-symbolique, que nous avons largement présentée et discutée ailleurs, en lien avec des questions de philosophie de la religion (Siniscalco, 2020a) et d'esthétique (Siniscalco, 2019), sera appliquée dans cet essai au rôle de l'Ordre et du Chaos au sein de l'interprétation de la philosophie des lieux, de la géographie sacrée et de la géopolitique - différentes branches d'une perspective de recherche commune sur la Terre, la signification des lieux qui la constituent, les personnes qui l'habitent et leurs relations de pouvoir.
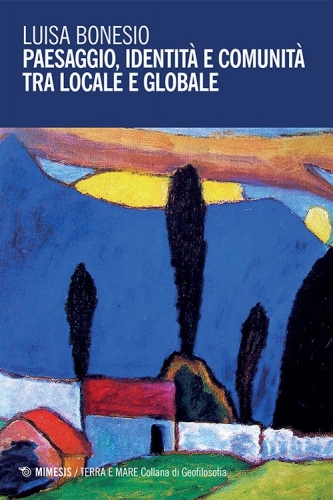
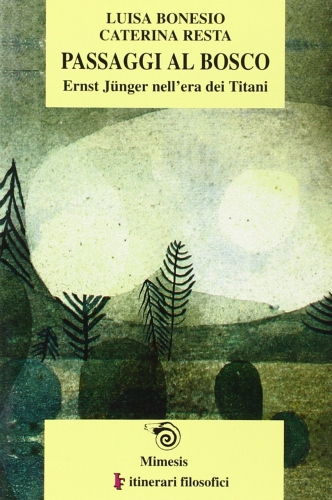
Particulièrement intéressante dans cette perspective est l'approche géophilosophique développée en Italie par Luisa Bonesio (2002) et Caterina Resta (2012): à travers leurs intérêts et approches philosophiques respectives et particulières, ces deux chercheuses ont identifié une perspective de recherche commune dans l'étude synthétique (et non analytique) de la géographie et de la morphologie des lieux à travers des structures symboliques, archétypales et ontologiques. Si le terme "géophilosophie" provient à l'origine de Deleuze et Guattari (notamment du quatrième chapitre de Qu'est-ce que la philosophie ?, publié en 1991) et du volume collectif Penser l'Euroре à ses frontières (Agamben et al., 1992), la conceptualisation de cette notion acquiert un point de vue différent chez Bonesio et Resta.
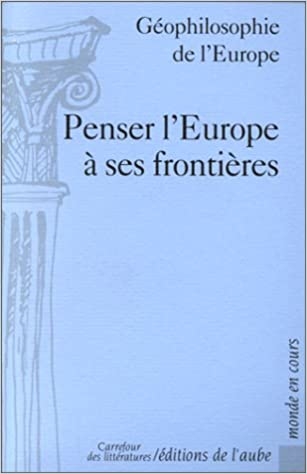 En effet, pour elles, la géophilosophie signifie une philosophie dirigée vers Gaea et sa topographie secrète et invisible. L'horizon de la géophilosophie est de "repenser radicalement l'habitation humaine sur la terre, en redécouvrant, après le drastique processus moderne d'uniformisation du monde, la qualité singulière des lieux, qui, non moins que la pluralité des existences singulières qui les habitent, ne peuvent être réduits à un simple "territoire" destiné, sous toutes ses formes, à la même exploitation intensive (Resta, 2010, p. 13). Les lieux sont caractérisés par des qualités spécifiques et irréductibles qui dérivent d'une relation féconde entre la nature, la culture et la civilisation humaine, et la dimension spirituelle. La géophilosophie n'a pas la prétention naïve de redécouvrir une nature "originelle" ou "pure" (et probablement jamais existante): sa composante "écologique" est liée à une approche holistique, fondée sur le mélange intégral et structurel d'une pluralité de niveaux d'être.
En effet, pour elles, la géophilosophie signifie une philosophie dirigée vers Gaea et sa topographie secrète et invisible. L'horizon de la géophilosophie est de "repenser radicalement l'habitation humaine sur la terre, en redécouvrant, après le drastique processus moderne d'uniformisation du monde, la qualité singulière des lieux, qui, non moins que la pluralité des existences singulières qui les habitent, ne peuvent être réduits à un simple "territoire" destiné, sous toutes ses formes, à la même exploitation intensive (Resta, 2010, p. 13). Les lieux sont caractérisés par des qualités spécifiques et irréductibles qui dérivent d'une relation féconde entre la nature, la culture et la civilisation humaine, et la dimension spirituelle. La géophilosophie n'a pas la prétention naïve de redécouvrir une nature "originelle" ou "pure" (et probablement jamais existante): sa composante "écologique" est liée à une approche holistique, fondée sur le mélange intégral et structurel d'une pluralité de niveaux d'être.
Afin d'élaborer une approche fructueuse pour conquérir cette relation aux loci d'une manière nouvelle, il est fondamental de surmonter les problèmes théoriques et pratiques que la Modernité apporte avec elle: le rationalisme extrême, le réductionnisme et le positivisme scientifiques, la mathématisation du monde, le sécularisme, le progressisme linéaire et mécanique, et l'idéologie de la croissance économique illimitée (c'est-à-dire le capitalisme) sont tous les côtés négatifs d'un paradigme culturel qui a conçu le monde soit comme un objet mort et réticent (avec lequel nous ne pouvons avoir aucune relation authentique), soit comme une pure création de la volonté d'un sujet dominant (c'est l'idéologie subjectiviste et prométhéenne/faustienne) [4]. Au contraire, la pars construens de réflexions philosophiques valables devrait établir l'interprétation du lieu comme topos, comme point de convergence et de recueillement, Versammlung selon Heidegger, comme sauvegarde significative de cette densité ontologique qui est particulièrement présente dans le symbole de l'Axis Mundi (Eliade, 1953, § 112), dans la Croix (Guénon, 2001) et dans le Geviert (le quadriparti ou figure quadripartite, fourfold en anglais, parfois "tétrade") - la carte fondamentale-ontologique heideggerienne qui nomme le "rassemblement" de la terre, du ciel, des mortels et des divinités (Heidegger, 2001a ; 2001b).

Dans tous ces paradigmes symboliques, les pôles de l'Ordre et du Chaos jouent un rôle significatif en tant que représentation archétypique de la tension dynamique ontologique et spirituelle. Cette relation est également fondamentale dans l'interprétation symbolique du symbole traditionnel de la montagne, lieu privilégié de rencontre avec le divin et le numineux, et incarnation valide de la connexion essentielle entre Ordre et Chaos. En effet, comme l'exprime De Tomatis dans sa reconnaissance philosophique de la dimension existentielle de l'alpinisme, ce n'est que sur l'amplitude sans fond du chaos, bien réel mais sans mesure, que les parcours d'ascension peuvent être véritablement interprétés [...]. Mais cela signifie que chaque élévation singulière vers des hauteurs vertigineuses dans une unicité archétypale, supra-céleste, est exposée au chaos aveugle du min, dans l'ascension continuellement libre en suspension, ouverte seulement par la grâce de l'horizon de plus en plus vide. Ce n'est qu'au sommet que le détachement de l'abîme est achevé, par la contemplation de toute sa mesure infondée. Mais même la sécurité du sommet, avec un plus grand vertige, nous dit combien il est lui-même l'abîme véritable, divin (2014, p. 233).
Dans la lignée de Caterina Resta, nous pouvons affirmer que le lieu préserve et sauvegarde le séjour de l'homme sur terre, non pas comme un écrin qui renferme en lui-même son précieux contenu, le rendant en quelque sorte inaccessible, mais, au contraire, en l'éclairant et en le faisant entrer dans cette lumière dans laquelle seule chaque chose pourra déployer son essence. C'est cet Ouvert qui, chaque fois, partout, ouvre un monde, le rendant habitable pour l'homme, dans la correspondance réciproque du ciel et de la terre, de l'humain et du divin, à la convergence de ces directions qui se croisent dans l'espace-temps, générant des Lieux.
La perspective géophilosophique a été résumée par Caterina Resta dans son manifeste, Dix thèses sur la géophilosophie (1996). Ces dix thèses, qui décrivent comment repenser profondément et radicalement la relation entre les hommes et leur habitation sur Terre, sont les suivantes :
1) L'assomption du nihilisme comme horizon d'époque.
2) La géophilosophie est une géopolitique
3) La géophilosophie doit contribuer au processus d'unification européenne
4) La géophilosophie est une philosophie radicale
5) La géophilosophie est une topologie
6) La géophilosophie est une idiologie et un idiome
7) La géophilosophie impose une autre conception de la frontière, de l'appartenance et de la communauté
8) La géophilosophie est une géo-sophie et une géographie de l'imaginaire
9) La géophilosophie est une pensée du cœur
10) La géophilosophie prépare la rencontre entre l'Est et l'Ouest, le Nord et le Sud du monde.
Tous ces points sont fondamentaux pour comprendre l'essence de la géophilosophie et ses itinéraires philosophiques. Mais les points 2, 5 et 8 sont les plus intéressants pour notre recherche actuelle. Ils nous permettent de relier, en confirmant notre perspective de recherche, les sciences géographiques et géopolitiques à un héritage philosophique et sapientiel ancien.
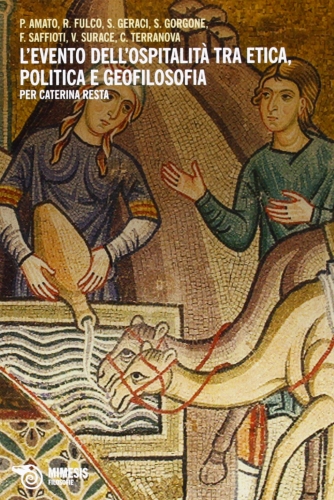
La caractéristique principale de la géophilosophie est l'invitation à considérer les lieux non pas comme des objets ou des représentations mortes que nous sommes obligés d'analyser uniquement à travers des paramètres analytiques, mais comme des niveaux vitaux, dynamiques, concrets de notre monde vivant, un nœud de réalité dans lequel les dimensions visibles et invisibles (culture et nature, mais aussi matière et esprit, archétypes archaïques et signes du futur) sont toujours en relation. En tant que topologie, la géophilosophie souligne l'importance centrale des lieux - compris comme ontologiquement différents du paysage, c'est-à-dire la reproduction esthétique, anthropocentrique, abstraite et représentationnelle du lieu concret et vivant (une production de cette raison moderne qui a été théorisée à travers la spéculation cartésienne, le produit du désenchantement des lieux sacrés et numineux). Cette vision est liée, en langage heideggérien, à une contestation du privilège accordé par l'Occident à l'Histoire. Elle juxtapose à une conception linéaire du temps l'idée d'une topologie comme espace-temps s'ouvrant à l'Événement, compris comme ayant lieu. L'événement ouvre, de temps à autre, un espace de temps singulier, inédit, bien que toujours inscrit dans une tradition. Comprendre un événement, c'est donc s'approcher de sa prise de place, le situer non pas dans une succession de faits mais dans l'espace du devenir ouvert par la venue de l'événement comme un espacement original, une ouverture spatio-temporelle inaugurale. La géophilosophie, en tant que topologie de l'avoir-lieu, découvre un allié précieux dans la géographie, surtout lorsqu'elle assume l'élément "physique" dans son innervation culturelle (Resta, 1996).
Cela signifie aussi redécouvrir le caractère symbolique et imaginal de la réalité, le savoir archaïque que la modernité semble avoir caché et oublié, mais que l'avènement de la postmodernité, dans sa structure contradictoire et dualiste, pourrait rouvrir [5] Si nous avons été habitués à demander: "Quelle modernité?", en mettant en cause les différentes options et choix politiques et culturels qui se sont affrontés à l'époque moderne, nous devrions aujourd'hui nous demander : "Quelle postmodernité?". C'est-à-dire: Est-il actuellement possible de construire (ou de laisser être) une postmodernité "mythique-symbolique" et pluraliste qui reconnaisse un rôle pivot à la dimension symbolique et à ses connexions géophilosophiques, avec une nouvelle perspective sur la relation entre global et local, ordre politique et chaos métaphysique, structures traditionnelles et impact de la désintermédiation virtuelle? Est-il possible de trouver, dans la lignée de l'héritage schmittien, une nouvelle légitimation communautaire du Politique (1996) - entendu génériquement comme le lieu où se prennent les décisions qui influencent les interrelations humaines?
En fait, à l'intérieur du symbole, les éléments spirituels et sensibles apparaissent parfaitement fondus dans la même image. La Terre sur laquelle nous vivons, avant d'être lisible dans les paradigmes des sciences exactes, [...] est le symbole incorruptible de la matrice d'où nous venons et dans laquelle nous sommes destinés à retourner, dans l'alternance incessante de la création et de la destruction. C'est aussi le symbole d'une perfection et d'une beauté extraordinaires, qui se manifestent dans le scannage ponctuel du jour et de la nuit, dans la succession des saisons, dans l'extraordinaire variété des espèces vivantes, des paysages, des morphologies. La géophilosophie est donc une géo-sophia, comme interrogation et contemplation de la face mystérieuse de la Terre, saisie dans ses éléments spirituels et symboliques (Resta, 1996).
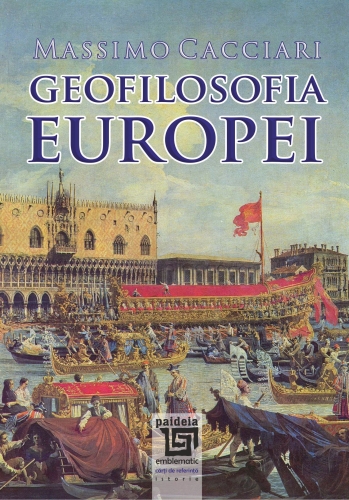
La géophilosophie, selon la deuxième thèse de Resta (1996), est aussi une géopolitique. Ce lien avait déjà été introduit par Massimo Cacciari dans ses célèbres textes Geo-filosofìa dell'Europa (1994) et L'Arcipelago (1997), où le radix géopolitique de la civilisation européenne est précisément reconnu au sein de sa racine et de son destin philosophiques, fondés sur la multiplicité, le pluralisme et les relations avec l'Autre. Chaque locus européen dit quelque chose de ce Nomos dynamique qui est récemment entré en crise au cours du processus menant à la modernité. Mais cette crise, ce crépuscule, révèle la nature essentielle de l'Occident en tant qu'occasus ou Abendland, la "région où le soleil se couche": en acceptant son propre crépuscule, l'Europe décidera de son essence même et trouvera peut-être une nouvelle relation fructueuse - Heidegger parlait du Neuer Anfang, le "Nouveau Départ" - également avec la Machenschaft, le domaine de la technique (le Gestell heideggérien).
Caterina Resta (1996) explique que l'actualité de la géophilosophie comme géopolitique est liée au récent effondrement de l'Empire soviétique et à l'avènement d'une perspective unipolaire monotone (pax americana). Mais cette situation internationale s'effondre aujourd'hui, en raison de l'émergence d'une pluralité de "chocs de civilisation" (Huntington, 2011) et du "retour inquiétant des conflits à arrière-plan ethnique, nationaliste et religieux, qui accompagnent la dissolution des systèmes précédemment imposés" (Resta, 1996).
Ici, les archétypes de l'Ordre et du Chaos émergent à nouveau. Toujours présents dans la constitution qualitative élémentaire des lieux - la terre, par exemple, incarne la qualité structurelle et originelle de l'Ordre cosmique, tandis que la mer est un archétype de la virtualité et de la dimension toujours changeante du Chaos - ils émergent clairement dans les relations de pouvoir étudiées en géopolitique. Dans ce domaine, la réalisation d'institutions politiques et de souverainetés structurées en éléments ordonnés ou chaotiques n'est pas une question de destin, mais dépend de décisions humaines. L'Untergang des Abendlandes (Spengler, 1991) peut toujours s'ouvrir à de nouvelles aubes - en effet, "que sont l'aube et le crépuscule dans l'absolu?". Les marques de stationnements humains (Jünger, 2009, p. 17).
En fait, il s'agit d'une décision que notre temps nous impose et à laquelle nous ne pouvons en aucun cas échapper. Un autre Nomos peut ordonner la Terre, si seulement nous sommes capables d'accueillir pleinement la dissolution des anciens systèmes, sans plus de nostalgie. L'hypothèse de Schmitt de grands espaces, chacun capable, dans sa propre sphère, d'exercer un ordre concret, à partir d'unités historiques et géographiques homogènes est en mesure, par exemple, de nous fournir des indications utiles en ce sens. Seules des formes fédératives de ce type, fondées sur l'autodétermination des peuples dans la reconnaissance d'un horizon culturel commun, peuvent empêcher que l'idée impériale du grand espace ne dégénère en une volonté impérialiste de puissance. Seule une pluralité de grands espaces est en mesure de rompre la monotonie de l'univers, donnant naissance à un plurivers dans lequel les différences sont non seulement tangibles mais doivent être sauvegardées, aucun n'aspirant à une hégémonie totale et planétaire. Bien entendu, pour qu'elles ne s'opposent pas, il est nécessaire d'accéder à une autre conception de la confrontation, de la force et du pouvoir. Au-delà de toute déclaration abstraite des droits des hommes abstraits, ce qui peut et doit être réellement partagé par tous, c'est la sauvegarde de la différence commune, qui ne génère ni intégration ni conflit, mais une confrontation et un dialogue inachevables. Ceci exclut a priori tout fantasme d'extermination et d'annulation de l'autre (Resta, 1996) [6].
Dans ce contexte géopolitique et culturel, orienté vers des horizons multipolaires et pluralistes, la géophilosophie " assume la tâche ardue de dresser la cartographie d'une terre oubliée et désormais invisible: cette terra incognita, pour être découverte, exige cependant une conversion drastique du regard, sans laquelle elle est destinée à sombrer dans l'oubli définitif" (Resta, 2010, p. 37). La géophilosophie, en conclusion, n'est pas seulement une méthode et un contenu, mais aussi une exigence spécifique pour une authentique métanoïa - à la fois intérieure et métaphysique -, une transformation intérieure radicale de notre vision du monde. Grâce à ce processus intérieur, la nouvelle figure anthropologique qui sera le personnage principal du nouveau monde s'élevant au-dessus des ruines de la civilisation précédente, percevra dans sa chair vivante la polarité de l'Ordre et du Chaos comme les principes originels, héraclitéens, de la réalité.
2. Genius loci : là où le Chaos établit l'Ordre
La dimension qualitative, spirituelle et archétypale des espaces - qui devrait définir, selon l'analyse précédente, la nouvelle structure des espaces qui nous attend dans un futur proche - est profondément liée au concept de Genius loci. Cette notion, récemment mise en évidence par Christian Norberg-Schulz (1979) - qui a théorisé la perte du Genius loci dans l'ère moderne comme une perte de mémoire, d'orientation et d'identification - [7] trouve son origine dans l'ancienne civilisation latine : selon une définition célèbre de Servius, "Nullus enim locus sine genio est (Servius, 1965). [Ce numen, ou esprit, qui protège un lieu est précisément le Genius loci, c'est-à-dire un compagnon divin et défenseur de la qualité et de l'essence intérieure d'un lieu. Chaque locus (ou topos) garantit par son Genius l'existence et la sauvegarde de l'immanence transcendante qui trouve des manifestations différentes dans les différents lieux. Ainsi, "dans la mythologie classique, grecque et romaine, le genius loci désigne l'esprit qui anime et soutient, en le protégeant, un lieu particulier habité par des êtres humains qui, en suivant et en accomplissant les rites essentiels à la sacralisation de l'espace choisi pour la fondation du village (ou de la ville) qui deviendra leur demeure stable, ont en quelque sorte reconnu la puissance de cet esprit et ont invoqué sa faveur et sa protection (Luppi, 2020, p. 487).
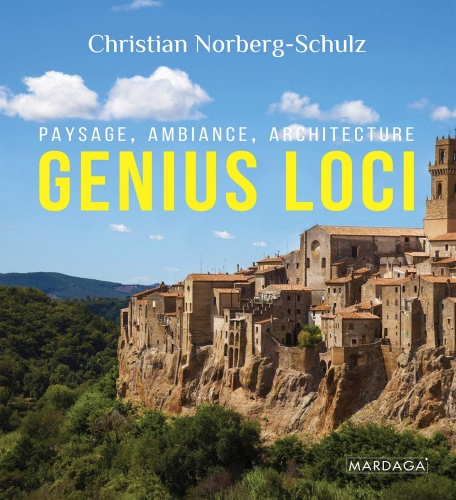
Le Génie latin est aussi profondément lié au Daimon grec, la figure numineuse qui anticipe en soi l'horizon hellénique: il s'agissait d'un Dieu mineur qui habitait les lieux sacrés mais aussi les âmes humaines (une anecdote célèbre raconte que Socrate avait l'habitude de prêter attention à son Daimon intérieur). Le philosophe Plotin (203/205-270 d.C.), dont l'œuvre a été recueillie par son disciple Porphyre dans les Ennéades, croyait également en l'existence d'une Anima Mundi qui procède comme une émanation de l'Unum (le principe métaphysique). Plotin pensait également que les âmes individuelles faisaient partie de l'Âme du monde et que cette Anima Mundi était disponible en tout lieu. Mais tous les lieux ne sont pas caractérisés par la même hiérophanie de l'Âme du monde.
Il existe donc une correspondance stricte entre un lieu et son propre Genius loci. Selon Douguine (2020a), nous devons comprendre le Genius loci comme la relation entière - donc au-delà de la dichotomie sujet-objet - de l'homme et de Dieu se produisant dans le lieu. Le lieu habité par le Genius est un lieu ouvert à l'Ereignis, l'événement eschatologique dans lequel l'Être (Sein) se rapporte à l'homme (Dasein). Cette dimension intégrale et holistique - que l'on retrouve, avec des noms et des définitions différents, dans toutes les civilisations humaines - [9] nous permet de souligner qu'une topologie sacrée est une autre manière de comprendre philosophiquement l'essence des espaces, au-delà du sécularisme moderne et du positivisme naïf. À cet égard, partout où, dans un lieu sacré, les subjectivités humaine et spirituelle entrent en relation, les figures de l'Ordre et du Chaos se manifestent également comme pôles de cet échange original, à la fois éternel et dynamique. Le Chaos est la puissance énergétique et primordiale qui donne vie au lieu et qui est maîtrisée par le Genius loci. Ainsi, selon Douguine (2020a), " le concept même de chaos était originellement lié d'un point de vue étymologique à l'espace vide. Le chaos est en fait un espace vide entre le ciel et la terre. C'est un état transitoire de l'espace, jusqu'à ce qu'il soit devenu un lieu, c'est-à-dire, par exemple, un lieu pour l'esprit. Par conséquent, les esprits du lieu sont les gardiens du chaos, ils l'organisent, transformant le vide en plein" (p. 368). Mais l'homme a aussi le chaos en lui, et il aspire donc à atteindre l'esprit du lieu (Genius loci) comme équilibre intérieur et centre métaphysique. Le lieu habité par le Genius loci rappelle en quelque sorte l'Axis Mundi, le centre symbolique du monde.
Le Genius loci devient visible et présent lorsque la dimension numineuse qui habite le lieu à travers les rites, les sacrifices, la liturgie et les expériences mystiques, se renforce et prend possession du sujet humain sur le chemin de la recherche intérieure. Dans ce phénomène, la relation entre le sujet, le Genius loci et le lieu dépasse tout dualisme et réalise la fondation d'un nouvel ordre, dans lequel la dimension chaotique peut être considérée comme le "moteur" central du processus.
La relation individuelle entre les hommes et les Genius loci a également une contrepartie communautaire. Selon Mircea Eliade, "l'une des caractéristiques marquantes des sociétés traditionnelles est l'opposition qu'elles assument entre leur territoire habité et l'espace inconnu et indéterminé qui l'entoure. Le premier est le monde (plus précisément, notre monde), le cosmos; tout ce qui est à l'extérieur n'est plus un cosmos mais une sorte d'"autre monde", "un espace étranger, chaotique, peuplé de fantômes, de démons, d'étrangers" (1961, p. 29). Dans cette perspective très spécifique, la fondation du village (ou de la ville) attribue une signification sacrale à l'espace par la reconnaissance du Genius loci et sa souveraineté sur le Chaos. En effet, "si tout territoire habité est un cosmos, c'est précisément parce qu'il a été consacré en premier lieu, parce que, d'une manière ou d'une autre, il est l'œuvre des dieux ou est en communication avec le monde des dieux. Le monde (c'est-à-dire notre monde) est un univers dans lequel le sacré s'est déjà manifesté" (Eliade, 1961, p. 30). Les Genius loci peuvent donc être compris symboliquement aussi comme des Genius terrae, au sein desquels le pôle spirituel du Genius est pris en compte en relation avec la dimension tellurique et élémentaire de Gaea, considérée comme lieu sacré par excellence. Comme nous l'avons souligné ailleurs :
Le Genius terrae peut être compris comme une clé herméneutique pour décrypter les bouleversements d'époque de l'actuelle ère postmoderne. Selon l'héritage jüngérien, nous pouvons affirmer que nous sommes aujourd'hui confrontés à un processus d'inversion de la Weltgeschichte - l'histoire du monde post-hérodotien, comprise linéairement au sens œdipien (histoire réduite aux mécanismes techniques, dominée par la "planétarisation", pour employer une notion heideggerienne) -, en Erdgeschichte, l'histoire de la terre conçue d'un point de vue organique et métamorphique, c'est-à-dire l'histoire qualitative traversée par des formes mythico-symboliques, des structures analogiques et archétypales. Nous assistons, en parallèle, à l'émergence - souvent confuse et partielle - de la domination de l'"underground", cette dimension soustraite à la culture occidentale des Lumières et du rationalisme, qui se déploie soit sur un plan de verticalité axiale (le sommet : la dimension archétypale et noétique), soit dans la profondeur tellurique (l'abîme : la dimension subrationnelle et démoniaque). Dans ce contexte, le Genius loci peut suggérer une discussion radicale de la question de la Terre - principalement considérée sur un plan symbolique et herméneutique, qui peut également acquérir des répercussions intéressantes sur un plan politique, géopolitique, voire économique (Siniscalco, 2020b, p. 800).
Les cultures profanes ont considéré la relation originelle entre Ordre et Chaos dans l'espace sacral du Genius loci comme une interprétation superstitieuse de la conscience religieuse. Ainsi, cette interprétation spirituelle de la relation entre transcendance et immanence a été transformée, surtout par le dualisme cartésien et la révolution scientifique du XVIIe siècle, en une sorte de relation mécanique, déterministe et causale. A cause de l'utilitarisme et du développement de la technique moderne, les lieux ont été compris comme de purs "conteneurs" de richesses, de profits matériels et d'énergie. Pourtant, le passage à l'ère postmoderne, déjà envisagé, peut ouvrir de nouvelles perspectives sur les "fissures dans la grande muraille" de la modernité, épaisses et denses (en appliquant à la postmodernité la célèbre image proposée par Guénon [2004, pp. 172-176]). En travaillant dans l'augmentation de ces fissures, de nouveaux espaces pour la défense du Genius loci (Sciortino, 2020) seront rouverts.
3. La géographie sacrée et le chemin vers la géopolitique
L'Ordre et le Chaos peuvent également être considérés comme les piliers fondamentaux de la géographie sacrée, qui est l'interprétation symbolique et ésotérique de l'essence des espaces. "Tous les loci ne sont évidemment pas les mêmes. L'espace concret n'est pas homogène, ni isotrope (comme l'espace cartésien): la géographie sacrée se fonde précisément sur une carte des lieux les plus pleins ou les plus sacrés, auxquels l'adjectif genialis ou daimonios est éminemment approprié" (Cuniberto, 2017, p. 266). La perspective de la géographie sacrée pourrait être considérée comme l'archétype de la vision des espaces qui anticipe et fonde correctement la philosophie des espaces déjà analysée. Le Genius loci est un personnage pivot de cette perception mythique et symbolique des espaces. C'est une perspective dont témoigne René Guénon déjà cité: "Il y a des lieux particulièrement aptes à servir de "support" à l'action des "influences spirituelles", et c'est sur ce fait que s'est toujours fondée l'implantation de certains "centres" traditionnels, principaux ou secondaires, les oracles de l'antiquité et les lieux de pèlerinage fournissant les exemples les plus apparents de tels "centres" (2004, p. 134).
L'espace sacré n'est pas toujours tridimensionnel et aréolaire. Stoddard (1987) affirme que les points et les lignes sacrés, ainsi que les surfaces, sont des composantes importantes de la géographie des espaces sacrés. Les croyants reconnaissent que les zones sacrées sont dotées d'une signification divine, qui les sépare qualitativement des lieux séculiers ou profanes. Les modèles de migration vers ces zones sacrées (comme dans le cas du pèlerinage) sont influencés davantage par des objectifs spirituels que pratiques, de sorte que la réduction des coûts ou de la distance est moins importante que le fait même de s'y rendre ou d'y être (Park, 2003, p. 251).

Cette conscience ancienne a survécu dans la civilisation chrétienne et sur sa carte spirituelle, faite de monastères, d'églises, de lieux rituels significatifs et de pèlerinages vers eux : il est significatif que les premiers géographes aient été des théologiens et des missionnaires - sur ce point, les spécialistes parlent de "géographie ecclésiastique" (Park, 2003, pp. 9-10) et de "géographie biblique" (Park, 2003, pp. 11- 12).
Aujourd'hui encore, à l'époque séculière, les centres spirituels n'ont pas cessé d'exister. Mais nous ne sommes plus capables de les reconnaître, c'est juste la communication entre les hommes modernes et le domaine spirituel subtil qui a été réduite au minimum. Il s'agit essentiellement d'une question de faculté de perception.
Une contribution importante à la reconstruction contemporaine de la géographie sacrée vient des recherches d'Alexandre Douguine. La conscience de Douguine que le territoire est profondément lié à l'histoire, à la culture, à la philosophie, à la sémantique, se reflète dans la compréhension et l'interprétation néo-eurasianiste du cosmos. Il s'agit, selon Dugin, d'un lieu d'Ordre spirituel dans lequel tous les niveaux de réalité sont interconnectés. "Le cosmos eurasianiste est imprégné de trajectoires subtiles parcourues par des idées ardentes, éternelles et des significations ailées. Lire ces trajectoires, les révéler à partir de la dissimulation, et extraire des significations complexes du plasma corporel de faits et de phénomènes disparates est la tâche de l'humanité" (Douguine, 2020b). Cela signifie que l'essence du lieu n'est pas seulement matérielle, mais strictement archétypale et symbolique: "Pour les eurasistes, le cosmos est une notion intérieure. Il se révèle non pas par l'expansion, mais plutôt, ou au contraire, par l'immersion en son sein, par la concentration sur les aspects cachés de la réalité donnée ici et maintenant" (Douguine, 2020b). Grâce à cette doctrine, qui n'est pas véhiculée comme une idéologie abstraite, mais comme une manière pragmatique et concrète d'expérimenter la réalité, les hommes peuvent percevoir dans le monde sa dimension sacrée. Chaque peuple, en fonction de ses traditions, maîtrise une interprétation différente des piliers sacrés des espaces. Le Cosmos russe, par exemple, est compris comme un plurivers dans lequel l'identité de la Russie sainte, sacrée, est l'énergie dynamique primaire, comprise comme relation entre le territoire russe (vu comme Coeur des terres, Heartland, Terre de civilisation) et l'homme russe. Comme nous l'avons envisagé en analysant la figure du Genius loci, l'expérience de la dimension cachée des lieux révèle une dimension post- ou extra-dualiste, où sujet et objet, matière et esprit, sont identiques.
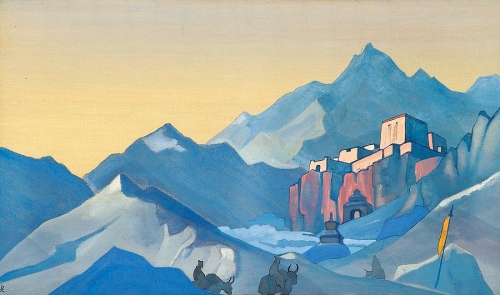


Ainsi, la notion même d'Eurasie englobe l'idée d'une synthèse entre l'Orient et l'Occident, l'Europe et l'Asie, ce point où les forces antagonistes de la géographie sacrée peuvent et doivent trouver un équilibre. En liaison avec la géographie sacrée et la topologie néo-platonicienne (dans l'esprit des commentaires de Proclus sur l'histoire de l'Atlantide dans le Critias et la République de Platon), la géopolitique confère au "monde russe" et au "cosmos russe" une autre dimension: la Russie n'est pas simplement un monde parmi d'autres, mais elle est ce monde qui est destiné à devenir l'espace le plus important de l'histoire mondiale où les antithèses historiques s'affrontent et où le destin de l'humanité atteint son point culminant (Douguine, 2020b).
En même temps, cependant, le pluriversum russe fait partie du pluriversum universel (mais pas universaliste ), où toutes les cultures peuvent trouver et exprimer leur propre identité. Il ne s'agit pas d'une perspective relativiste moderne, mais de la découverte d'un processus fondamental au cœur de la réalité, que nous pourrions définir comme un "perspectivisme ontologique". De nombreuses traditions et de nombreuses approches gnoséologiques de la réalité existent sur le même niveau, horizontal. Mais cette différence fascinante cache une profonde unité ontologique (Siniscalco, 2020c): chaque culture, en pénétrant dans son propre cosmos, peut s'approcher du sujet et de l'objet communs - cachés, "apophatiques" - véritables en tant que tels. En d'autres termes, le Russe devient un tout-humain dans la mesure où il est de plus en plus russe, et non l'inverse, sans perdre sa russéité en échange de quelque chose de formel et d'extérieur emprunté à d'autres peuples et cultures. On peut dire la même chose de tout représentant de tout autre cosmos. Mais la présence de cette unité supra-cosmique ne peut être une donnée connue. Elle doit être expérimentée dans la pratique. Il faut parcourir tout le chemin. On peut espérer qu'au bout de son chemin vers soi dans ses racines cosmiques, une personne atteindra le noyau commun de l'humanité, c'est-à-dire la matrice du cosmos en tant que tel, son centre secret. Mais cela ne peut être affirmé à l'avance. De plus, ce serait une erreur de substituer l'expérience concrète d'une culture en la présentant à l'avance comme quelque chose de commun à tous et d'universel (Dugin, 2020b).
Si nous considérons l'aspect visible et clair de la culture (Kultur) comme la manifestation concrète de l'Ordre céleste sur la Terre, nous sommes autorisés à considérer le noyau "caché, apophatique" de la géographie sacrée comme le pôle chaotique, la dimension métaphysique magmatique à partir de laquelle l'Ordre acquiert son propre fondement.
L'idée pragmatique du sacré de Douguine permet de conclure que "seuls ceux qui ont atteint le cœur de leur cosmos peuvent émettre un jugement lourd et solide concernant l'universel" (Douguine, 2020b). Ce type de "pluralisme cosmique", incarné par la géographie sacrée traditionnelle, peut encore être réactivé par un processus inverse à la fameuse tentative moderne de "désenchanter le monde", comme le souhaitait Max Weber. Il est, au contraire, nécessaire de "réenchanter le monde", en combattant la colonisation occidentale non seulement dans ses racines politiques et économiques, mais surtout dans sa puissante capacité à conditionner et à influencer l'imaginaire collectif.
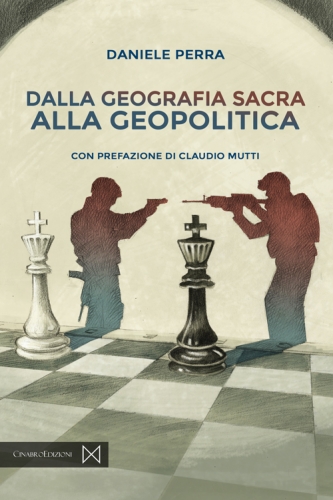
Cette opportunité a été récemment développée en Italie par l'analyste et chercheur en géopolitique Daniele Perra, dont la dernière publication (2020) est explicitement consacrée à retrouver le langage de la géographie sacrée à l'origine et au fondement - ou du moins le paradigme archétypal - de la géopolitique moderne. En considérant, à la suite de l'école traditionaliste, que les sciences profanes modernes ne sont que des traces des anciennes sciences traditionnelles [10], Perra trouve que ce processus opère également dans le domaine géopolitique: en effet, au cœur de celui-ci, il est possible de reconnaître "un profond impact résiduel des archétypes de la géographie sacrée, installés dans l'imaginaire collectif, qui détermine la structure même de la pensée géopolitique" (2020, p. 10). Parmi eux, nous pouvons considérer les pôles de l'Ordre et du Chaos. Ils apparaissent dans tant de mythologies, d'images et de récits concernant toutes les populations du monde qu'il n'est pas possible ici de présenter même une synthèse du rôle religieux et symbolique de ces concepts. Cependant, nous pouvons affirmer qu'ils apparaissent au moins sur deux niveaux herméneutiques principaux: le plus profond, d'un point de vue métaphysique et ésotérique, est l'unité ontologique déjà considérée que toutes les traditions reconnaissent comme la caractéristique principale de l'Origine métaphysique. Dans cette dimension, tous les opposés se dissolvent dans la coincidentia oppositorum (coïncidence des opposés), dans l'Unum. Dans ce domaine, nous pouvons considérer l'Ordre et le Chaos comme les deux faces du Même: le Chaos est le côté obscur magmatique et génératif qui se manifeste à travers la clarté et les structures formelles de l'Ordre cosmique. Ensuite, au deuxième niveau herméneutique, les cultures traditionnelles se définissent habituellement, ainsi que les espaces que leurs régimes politiques habitent, comme des royaumes d'Ordre, compris comme des incarnations politiques et séculaires de principes métaphysiques, par opposition aux pouvoirs négatifs du Chaos comme désordre, souvent lié à la corruption morale, à la décadence culturelle et religieuse - la Modernité. Si le premier niveau herméneutique compte dans l'expérience métaphysique et ésotérique, le second prévaut dans la philosophie de l'histoire et la phénoménologie des processus culturels.
De ces deux perspectives, la géopolitique hérite d'un style de description et d'expression basé sur une interprétation modernisée du symbolisme spatial. Des concepts aussi importants que l'Est et l'Ouest, le Nord et le Sud, la Terre et la Mer, les frontières et l'expansion territoriale, le pôle, le centre, l'Empire ont un large arrière-plan religieux et symbolique.
D'un point de vue traditionnel, nous pourrions considérer, par exemple, la géographie de l'Ouest comme l'incarnation symbolique de la décadence (le "coucher du soleil" de la spiritualité et de la culture), tandis que l'Est est le territoire où le soleil se lève (Ex Oriente lux), où les dieux et le sacré se manifestent toujours. Dans cette analyse, l'Occident se superpose au Chaos (Diable, décadence), l'Orient coïncide avec l'Ordre (Bien, Tradition). Ce paradigme affecte inévitablement - bien que la plupart du temps de manière inconsciente - la géopolitique actuelle, qui reste encore sous l'influence de cette géographie sacrée qui inclut la topologie néo-platonicienne, selon laquelle tout a une signification et une position ontologique spécifique, une structure et une raison métaphysique, et qui est attaquée par le rationalisme et le modernisme.
En outre, la géopolitique réfléchit sur le lien pertinent entre les populations, les structures politiques et les territoires. Éviter une interprétation déterministe stricte (l'origine et l'évolution d'une culture ou d'une religion spécifique dépendent exclusivement de son cadre géographique) ne signifie pas ignorer le lien profond entre ces pôles. La géographie sacrée doit donc être comprise comme une tentative de dépasser le dualisme épistémologique: sujet et objet, humain et nature, géo(graphie) et politique sont perçus en son centre sur le même plan. Là encore, les pôles de l'Ordre et du Chaos apparaissent comme une déclinaison de ces principes métaphysiques équilibrés que la cosmologie chinoise, par exemple, a développés à travers les concepts de Yin et de Yang.
L'importance de ces concepts a survécu dans la géopolitique contemporaine. Si l'on se réfère aux deux niveaux herméneutiques considérés précédemment, nous pouvons affirmer que c'est généralement le second qui est appliqué sous sa forme sécularisée dans la géopolitique. L'ordre est principalement compris comme un arrangement ou un modèle politique positif avec un côté interne (national) et externe (relations internationales). En géopolitique, le contraire de l'ordre est le désordre, c'est-à-dire une situation instable des relations politiques internationales. Le désordre n'est pas un synonyme strict du chaos, mais il possède des qualités similaires. C'est pourquoi les politologues associent généralement le désordre et le chaos, pour autant qu'ils soient utilisés pour décrire la même situation déstabilisée. La tentative de créer un ordre géopolitique et l'intention de déterminer la déstabilisation internationale sont deux tendances politiques et diplomatiques opposées mais parfois convergentes.
En géopolitique, l'ordre signifie également "modèle politique" ou "paradigme". Dans l'histoire récente, trois modèles principaux ont existé: la bipolarité (pendant la guerre froide); l'unipolarité (l'ordre américain après l'effondrement de l'URSS); la multipolarité (le cadre international actuel et encore émergent).
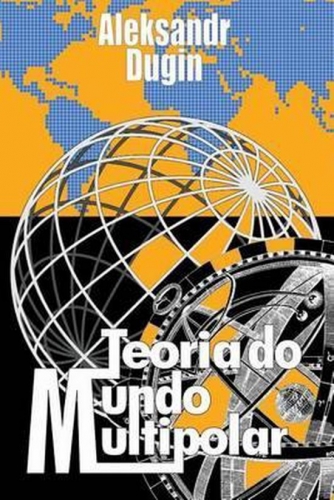
Selon la théorie de la multipolarité de Douguine (2019), il est possible de déduire que la multipolarité est le modèle géopolitique le plus adapté - en raison de son pluralisme intrinsèque - à une redécouverte de la dimension sacrée des lieux. Si l'on rappelle les principaux points abordés jusqu'à présent, cette conclusion apparaît tout à fait logique et évidente: la multipolarité permet de percevoir les relations internationales comme plurielles et multidimensionnelles; les différentes traditions et civilisations sont considérées comme simultanément coexistantes, dignes et politiquement pertinentes; le Genius loci de chaque territoire peut revenir et acquérir un statut public reconnaissable; la multipolarité est donc plus qu'un multilatéralisme basé sur les valeurs occidentales et ne se limite pas à la reconnaissance du rôle des nations modernes, qui sont considérées comme des états historiques contingents que la tendance actuelle va probablement éradiquer en restaurant, par la constitution d'immenses espaces continentaux (Grossräume, selon Carl Schmitt) d'intégration, l'ancienne idée d'Empire; les civilisations reviennent sur la scène de l'histoire, comme le souligne également Huntington (2011) - l'histoire n'est pas du tout terminée. Dans la perspective de Douguine, le concept de multipolarité a une valeur à la fois phénoménologique et programmatique: il décrit un état de fait que le chercheur voit de plus en plus se réaliser, sur la base des rapports de force établis entre les acteurs internationaux impliqués, mais il définit en même temps un scénario souhaitable et fécond, dont l'accélération est une tâche primordiale pour ceux qui sont intéressés par la reconquête de la souveraineté des peuples à travers l'intégration de grands espaces, où le choc des civilisations pourrait être substitué par un dialogue des civilisations.
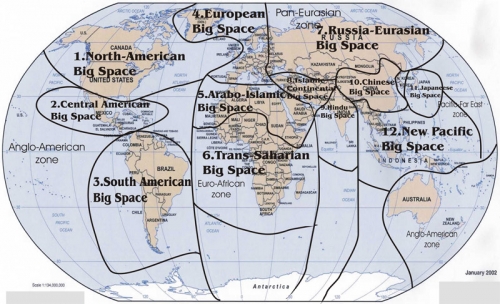
En traversant une période de Chaos international, un nouvel Ordre contre-hégémonique et multipolaire sera établi: ce sera le règne, en révisant la célèbre expression de Machiavel, de "la pluralité du Prince" (Dugin, 2019, pp. 191-197). Dans ces horizons, la notion de Chaos acquiert un sens nouveau et positif, concernant la structure dynamique de l'Ordre multipolaire, où l'équilibre des pôles peut toujours changer, ouvrant au rôle pivot de l'histoire et des décisions politiques: "Il y a toujours un moment, pour chaque civilisation du monde multipolaire, où de grandes décisions doivent être prises. Et à chaque fois, le principe de décision peut théoriquement fluctuer d'un segment de civilisation à l'autre. Cela complique grandement la structure du droit international [...]. Mais, en même temps, cela libère toute la force naturelle intérieure (potestas), l'élément de l'existence historique [...]. Ici, le concept de "chaos des relations internationales", également présent dans les paradigmes classiques, est tout à fait approprié et pertinent (Douguine, 2019, p. 199-200). L'analyste géopolitique russe Leonid Savin a également compris l'importance de l'Ordre et du Chaos comme piliers fondamentaux des affaires internationales actuelles. Dans sa récente "contribution au développement de la théorie de la multipolarité" (2020, p. 3), Savin considère, à travers de nombreuses références à la littérature académique, les différents scénarios que les universitaires imaginent comme concrètement possibles dans un "futur post-américain".
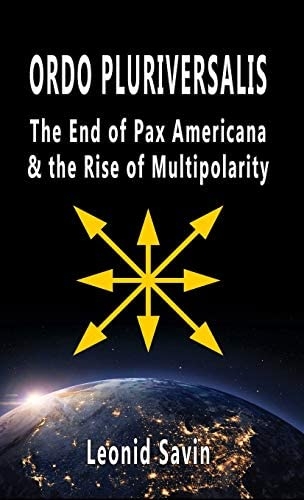
La fin de la récente "Pax Americana" pourrait créer soit un nouvel ordre mondial unipolaire hégémonique, dominé par des États-Unis réformés ou par une nouvelle puissance (comme la Chine), soit un ordre chaotique, caractérisé par un multilatéralisme vivant et dynamique, par un actif polycentrique et pluraliste, dans lequel différents pôles de civilisations pourraient conclure des alliances ou lutter ensemble pour développer un nouveau type de mondialisation multipolaire. Cette dernière option, qui selon Savin et ses diverses sources est la plus probable, nécessite une intervention significative de la Grande Politique afin de ne pas laisser le monde dans un état de désordre complet: la déconstruction dure et rigoureuse du paradigme rationaliste occidental moderne appelle à l'élaboration simultanée d'un "pluralisme équilibré", consacré à donner de l'ordre au chaos et à établir une structure de relations internationales afin d'éviter un état permanent de conflits. Une source d'inspiration pourrait venir du concept économico-matérialiste élaboré par Marx et Schumpeter et défini comme "destruction créatrice" (Savin, 2020, p. 75): "la non-polarité est un cadre théorique abstrait qui ne correspond pas à la réalité, qui suppose toujours une structure polarisée, dans laquelle chaque perturbation est liée à de nouvelles reconstructions. Le chaos et l'ordre sont toujours liés. Le chaos pur est une fausse hypothèse dans les scénarios géopolitiques; la question est la suivante: quelle quantité de désordre le cadre actuel peut-il accepter et équilibrer de manière constructive? La multipolarité semble être le choix le plus réaliste pour un paradigme géopolitique concret, pluraliste et polycentrique. En outre, selon Amaya Querejazu, "prendre le plurivers comme point de départ ontologique, implique de ne pas simplement tolérer la différence, mais de comprendre réellement que la réalité est constituée non seulement de plusieurs mondes, mais de plusieurs types de mondes, de plusieurs ontologies, de plusieurs façons d'être dans le monde, de plusieurs façons de connaître la réalité" (2016, p. 3).
La multipolarité elle-même présente de nombreux risques et dangers. En se référant à l'analyse de la multipolarité de John Mearsheimer (2014), Savin distingue une "multipolarité déséquilibrée" (un système multipolaire avec une hégémonie potentielle) et une "multipolarité équilibrée" (un système multipolaire asymétrique sans hégémonie) : cette dernière est la plus souhaitable, même s'il faut toujours se rappeler que "la multipolarité a souvent créé un monde instable et imprévisible, caractérisé par des alliances changeantes et par l'aspiration des puissances montantes à changer l'équilibre des forces et à créer un nouvel ordre" (Savin, 2020, p. 80).
Cependant, comme l'a déjà souligné Alexandre Douguine, la multipolarité semble être le paradigme géopolitique idéal pour permettre à la pluralité des traditions, métaphysiques et archétypes de se manifester à l'époque contemporaine. Savin montre que le concept de polycentricité et de pluriversalité (2020, pp. 125-148) a également été développé en dehors de la culture occidentale, avec l'élaboration de modèles vraiment intéressants qui dérivent directement de différentes cultures traditionnelles. Significative est, par exemple, la contribution chinoise à la théorie et à la pratique de la multipolarité (duojihua en chinois) qui a déjà été exprimée dans les cinq principes qui ont constitué la base du traité de 1945 avec l'Inde: "1. Respect mutuel de l'intégrité territoriale et de la souveraineté; 2. Non-agression; 3. Non ingérence dans les affaires intérieures; 4. Égalité et avantages mutuels; 5. Coexistence pacifique" (Savin, 2020, p. 85).
La confrontation avec différents paradigmes culturels et représentations symboliques est très fructueuse pour repenser le pluriversum mondial de manière plus complexe et partageable. Nous devons tenir compte du fait que "le monde dans lequel chaque être habite est peuplé d'entités (personnes, objets, théories, pratiques) qui sont ontologiquement configurées dans des processus de choix et de décisions qui produisent l'établissement de cadres de référence que les gens utilisent pour se situer dans le monde. Par conséquent, ces cadres de référence sont très différents pour une personne en Amazonie et pour une personne élevée dans une ville occidentale " (Querejazu, 2016, p. 5). Dans ce scénario postmoderne, selon Savin, il sera plus facile de prendre en considération les "principes de la division sacrée de l'espace" (2020, p. 185), en donnant une nouvelle reconnaissance au rôle métaphysique et mythico-symbolique de l'Ordre et du Chaos.
Notre bref itinéraire à travers différentes approches de la signification profonde et symbolique des espaces - philosophie des espaces, géographie sacrée, géopolitique - n'est bien sûr pas exhaustif. Il a été compris comme une présentation synthétique et incomplète de perspectives différentes mais convergentes visant à montrer les corrélations profondes entre les éléments archaïques et actuels de la compréhension contemporaine de la topologie. Notre recherche visait en particulier à souligner le rôle significatif de l'Ordre et du Chaos en tant qu'éléments pivots d'une herméneutique intégrale qui pourrait être développée de manière fructueuse à l'avenir à des fins théoriques et pragmatiques. En fin de compte, "il est clair qu'une géographie politique multipolaire et pluriverselle doit être consacrée à la cause du retour des nombreux espaces de notre planète à leur véritable statut ontologique" (Savin, 2020, p. 186).
Notes
[1] Le chaos, conçu dans cette dimension grecque et ontologique (Mutti, 2013), n'est pas du tout homologue de ce "rien" qui est devenu le protagoniste des réflexions spéculatives du XXe siècle dans le cadre du débat autour du nihilisme. Il s'agit en outre de la dimension générative et originelle qui précède toutes les formes visibles et phénoménologiques de la réalité. La sagesse orientale incarne également cette ancienne connaissance métaphysique, dans laquelle le Chaos peut être compris comme ouverture, pluralisme et fécondité spirituelle. Et aussi comme le vide, selon le bouddhisme. "Le vide - résume Andrei Plesu (photo) - est, pour les penseurs orientaux, la condition impérieusement nécessaire pour que le monde soit habitable. La conscience doit l'atteindre pour être habitée, le moment venu, par l'illumination. Parler de la vacuité du monde, ce n'est pas parler de sa relativité, mais de son extrême disponibilité " (2018, p. 166-67). Le vide est, en conclusion, "une possibilité infinie, l'universalité qui nourrit toute manifestation" (p. 170).

[2] La traduction de toutes les sources italiennes citées dans l'essai est due à l'auteur.
[3] Sur la discussion concernant l'origine étymologique du mot latin locus, voir les différentes interprétations de Cuniberto (2017, p. 264-267) et de Douguine (2020a, p. 358).
[4] L'idéologie prométhéenne/faustienne comme caractère distinctif de l'anthropologie moderne est un concept largement répandu (entre autres: Jünger, 1993 ; Baumann, 2013). Cette thèse, qui semble être acceptée par la grande partie des philosophes occidentaux du XXe siècle, est en réalité colorée de manière plus complexe et pluraliste, également chez les penseurs qui ont considéré de manière critique la question de la technique - comme Ernst Jünger, Oswald Spengler, Martin Heidegger, etc. La technique est un problème et un risque, mais aussi une opportunité historique pour une nouvelle civilisation. Cette attitude technique, que les réflexions de Resta et Bonesio tentent de combattre, est approfondie et appréciée aussi chez certains auteurs conservateurs-révolutionnaires, transhumanistes et néofuturistes, comme Locchi (1982), Faye (2010), Campa (2010) et Jorjani (2020). Voir aussi la grande synthèse proposée sur cette question par Boco (2009).
[5] Dans ce discours nous considérons la postmodernité comme l'époque où le cadre phénoménologique élaboré par le postmodernisme est devenu réalité. Et le postmodernisme "est fondamentalement une révolte contre la rationalité du modernisme [...] qui recherche une vérité et un sens universels, généralement à travers une sorte de métadiscours ou de métanarration [...]. En pratique, le postmodernisme a pris la forme d'une révolte contre les conventions trop rigides de la méthode et du langage existants" (Dear, 1988, p. 265).
[6] Resta définit cette perspective anthropologique (mais aussi éthique et politique), disponible dans un monde pluriversel et multipolaire de relations humaines et politiques, comme une "politique d'hospitalité" (vs "politique d'hostilité") se référant à la fois à Lévinas et à Derrida (Resta, 2010, pp. 17-18).

[7] De même, Heidegger avait parlé de l'Entortung comme de ce processus de délocalisation et d'éradication que Schmitt a compris comme la destruction du Nomos de la Terre - lié à la division entre l'Ordre (Ordnung) et le Lieu (Ortung) (Bonesio, 2000 ; Luppi, 2020).
[8] "Il n'y a pas de lieu sans Génie". Un commentaire intéressant de cette phrase est proposé par Bevilacqua (2010, pp. 11-16).
[9] La présence de mondes subtils dans l'expérience de toutes les cultures nous permet d'identifier une "écologie religieuse" qui dépend de la reconnaissance de la vénération de la nature comme lieu saint des esprits (et plus largement des forces divines) (Park, 2003, pp. 246-249).
[10] De même, Schmitt affirmait que "tous les concepts significatifs de la théorie moderne de l'État sont des concepts théologiques sécularisés" (1988, p. 36). Nous pourrions donc considérer la géopolitique comme une "théologie sécularisée" (Mutti, 2019). Cette idée converge avec la célèbre thèse de Mircea Eliade (1963, pp. 162-193) selon laquelle toute la culture moderne est traversée par une dissimulation du sacré dans la forme profane, mais aussi avec la thèse plus récente selon laquelle "les croyances religieuses, pour la plupart des croyants, ne sont pas seulement des théories. Elles proposent des codes de comportement moral qui servent de guide à l'action et à un style de vie particulier. Telle est [...] la fonction latente de la religion (elle fournit une force de cohésion sociale), par opposition à sa fonction manifeste (expliquer ce qui est extérieur à l'homme et mystérieux pour lui). Même de nombreuses sociétés récemment sécularisées conservent des caractéristiques de traditions religieuses passées, et il est souvent assez difficile de déterminer où s'arrêtent les facteurs religieux et où commencent les facteurs séculiers" (Park, 2003, p. 42).
[11] Nous avons essayé, lorsque cela était possible, d'utiliser et de citer les éditions anglaises des auteurs considérés. Dans les autres cas, nous nous sommes référés à la version originale des sources. Dans très peu de cas, à celles que nous avons eu l'occasion d'examiner.
Bibliographie [11]
Agamben et al. (1992). Géophilosophie de /'Europe. Penser /Europe à sesfrontiers. Editions de Г Aube. Baumann, Z. (2013). Legislators and Interpreters. On Modernity, Post-Modernity and Intellectuals.Polity Press.
Bevilacqua, F. (2010). Genius loci. Il dio dei luoghi perduti. Rubbettino.
Boco, F. (2009). Uomo faustiano e tecnica. In R. Campa (Ed.), Divenire 2. Rassegna di studi interdisciplinari sulla tecnica e ilpostumano. Sestante.
Bonesio, L. (2000). Terra, singolarità, paesaggi. In L. Bonesio (Ed.), Origyonti dellageofilosofia. Terra e luoghi nell'epoca della mondialigyafione (pp. 5-25). Arianna.
Bonesio, L. (2002). Oltre ilpaesaggio. I luoghi tra estetica e geofilosofia. Arianna.
Bonesio, L. & Resta, C. (2010). Intervista sulla geofilosofia (R. Gardenal, Ed.). Diabasis.
Cacciari, M. (1994). Geo filosofia dellEuropa. Adelphi.
Cacciari, M. (1997). L'Arcipelago. Adelphi.
Campa, R. (2010). Mutare о perire. La sfida del transumanesimo. Sestante.
Chai, D. (2014, March). Nothingness and the clearing: Heidegger Daoism and the quest for primal clarity. The Review of Metaphysics, 583-601.
Cuniberto, F. (2017). Paesaggi del Regno. Dai luoghi francescani al Luogo Assoluto. Neri Pozza.
De Tomatis, F. (2014). Filosofia della montagna. Bompiani.
Dear, M. (1988) The postmodern challenge: reconstructing human geography. Transactions of the Institute of British Geographers, 13, 262-274.
Deleuze, G. & Guattari, F. (1991). Qu'est-ce que laphilosophie?. Les Editions de Minuit.
Di Somma, A. (2017). Metafisica e Lichtung nelpensiero di Martin Heidegger. Armando.
Dugin, A. (2019). Teoria del mondo multipolare (G. Marro, introduction). AGA.
Dugin, A. (2020a). Genius Loci. Introduzione alla teoria del Soggetto Spaziale. In S. Bolognini (Ed.), Prospettiva Ponte e Genius loci. Materiali per una ricerca (pp. 357-374). Mimesis.
Dugin, A. (2020b, 25th October). The Battle for the Cosmos in Eurasianist Philosophy (J. Arnold, trans.). Eurasianist Archive, https://eurasianist-archive.com/2020/10/25/the-battle-for- the-cosmos-in-eurasianist-philosophy/
Eliade, M. (1953). Traité d'histoire des religions (G. Dumézil, preface). Payot.
Eliade, M. (1961). The Sacred and the Profane. The Nature of Religion (W.R. Trask, trans.). Harper Torchbooks.
Eliade, M. (1963). Myth and Reality (W.R. Trask, trans.). Harper & Row.
Faye, G. (2010). Archeofuturism. European Visions of the Post-catastrophic Age. Arktos.
Guénon, R. (2001). The Symbolism of the Cross (A. Macnab, trans.). Sophia Perennis.
Guénon, R. (2004). The Reign of Quantity (Lord Northbourne, trans.). Sophia Perennis.
Heidegger, M. (2001a). The Thing. In M. Heidegger, Poety, Language, Thought (A. Hofstadter trans.) (pp. 161-184). Harper Perennial.
Heidegger, M. (2001b). Building Dwelling Thinking. In M. Heidegger, Poetry, Language, Thought (A. Hofstadter trans.) (pp. 141-159). Harper Perennial.
Huntington, S.P. (2011). The Clash of Civilisations and the Remaking of World Order. Simon & Schuster.
Jorjani, J.R. (2020). Prometheism. Arktos.
Jünger, E. (2009). La capanna nella vigna. Gli anni dell’occupazione, 1945-1948 (A. Iadicicco, trans.). Guanda.
Jünger, F.G. (1993). Die Perfektion derTechnik. Klostermann.
Locchi, G. (1982). Nietgsche, Wagner e il mito sovrumanista. Akropolis.
Luppi, S.G. (2020). Dal mito classico al Nomos della Terra: Genius loci, diritto, localizzazione. In S. Bolognini (Ed.), Prospettiva Ponte e Genius loci. Materiali per una ricerca (pp. 487-510). Mimesis. Mearsheimer, J.J. (2014). The Tragedy of Great Power Politics. Norton & Company.
Mutti, C. (2013, 30 March). Chaos. EreticaMente. http: / / www.ereticamente.net/2013/03/chaos.html
Mutti, C. (2019). La geopolitica: una teologia secolarizzata?. In C. Mutti, Prospettive geopolitiche. Studi, analisi, considerazioni (pp. 13-34). Effepi.
Norberg-Schulz, C. (1979). Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture. Rizzoli.
Park, С.С. (2003). An introduction to geography and religion. Routledge.
Perra, D. (2020). Dalla geografia sacra alla geopolitica. CinabroEdizioni.
Plesu, A. (2018). Pittoresco e malinconia. Un’analisi del sentimento della natura nella cultura europea (A. Paolicchi, Ed.). ETS.
Querejazu, A. (2016). Encountering the Pluriverse. Looking for Alternatives in Other Worlds.
Revista Brasileira de Politica International, voi. 59, n. 2, 1-16. https://doi.org/10.1590/0034- 7329201600207
Resta, С. (1996). 10 tesi di Geofilosofia. In L. Bonesio (Là), Appartenendo, e località: duomo e il territorio. SEB (now available in Geofilosofia.it,http://www.geofilosofia.it/terra/Resta_geotesi.html).
Resta, C. (2002). Ricordare l’origine. Riflessioni geofilosofiche. DRP, 4, 11-18.
Resta, C. (2012) Geofilosofia del Mediterraneo. Mesogea.
Savin, L. (2020). Ordo Pluriversalis. The End of Pax Лтепсапа & the Rise of Multipolarity (J. Arnold, trans.). Black House Publishing.
Schmitt, C. (1988). Political Theology. Four Chapters on the Concept of Sovereignty (G. Schwab, trans.). MIT Press.
Schmitt, C. (1996). The Concept of the Political (G. Schwab, trans.). University of Chicago Press. Sciortino, L. (2020). Difesa del Genius loci. In S. Bolognini (Ed.), Prospettiva Ponte e Genius loci. Materiali per una ricerca (pp. 765-776). Mimesis.
Siniscalco, L. (2019, December). Cosmological Creativity: An Aesthetic World Perspective. Mntae, voi. 6, n. 2-3,118-132.
Siniscalco, L. (2020a). Antaios: A Mythical and Symbolic Hermeneutics. Forum Philosophicum, voi. XXV, n. 1, 123-139.
Siniscalco, L. (2020b).“Fedeltà alla terra”. Il Genius loci della Erdgeschichte. In S. Bolognini (Ed.),
Prospettiva Ponte e Genius loci. Materiali per una ricerca (pp. 799-816). Mimesis.
Siniscalco, L. (2020c). Unità metafisica e pluralità religiosa. Scenari possibili, a partire dalla philosophia perennis. Nuovo Giornale di Filosofia della Religione (ISSN 2532-1676), n. 13/14, 162- 172.
Spengler, O. (1991) The Decline of the West (A. Helps & H. Werner, eds.; C.F. Atkinson, trans.). Oxford University Press.
11:55 Publié dans Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, géophilosophie, géographie sacrée, théorie politique, géopolitique, sciences politiques, politologie, genius loci |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 16 août 2021
Aleksandr Dugin : "Evola, le populisme et la quatrième théorie politique"

Alexandre Douguine: "Evola, le populisme et la quatrième théorie politique"
Entretien recueilli par Andrea Scarabelli (2018)
Source: https://blog.ilgiornale.it/scarabelli/2018/06/25/aleksandr-dugin-evola-il-populismo-e-la-quarta-teoria-politica/
Un des traits de notre époque malheureuse consiste en la facilité avec laquelle on dispense des étiquettes, aux intellectuels comme aux courants et phénomènes politiques. De droite ou de gauche, populiste ou élitiste, progressiste ou conservateur... Mais en réalité, la seule distinction se fait entre les intellectuels du passé et ceux qui préfèrent être des contemporains de l'avenir. Le second groupe (qui n'est pas si nombreux, à vrai dire) est constitué d'esprits nés avec quelques décennies - voire quelques siècles, comme Nietzsche - d'avance sur le calendrier de l'Histoire, avant-gardes d'une réalité sur le point de se déployer bientôt dans sa totalité. L'histoire des grands précurseurs, de ces courts-circuits vivants du Temps, n'a pas encore été écrite. En attendant, il est bon d'apprendre à les reconnaître. La semaine dernière, Alexandre Douguine est venu à Milan pour présenter son ouvrage Poutine contre Poutine, qui vient d'être publié en Italie par AGA. Peu de temps auparavant, le "conseiller de Poutine" (qualification journalistique toujours rejetée au pied levé par l'intéressé) avait publié un monumental ouvrage intitulé La Quatrième théorie politique, aux éditions Nova Europa dans une traduction de Camilla Scarpa et avec une préface de Luca Siniscalco.
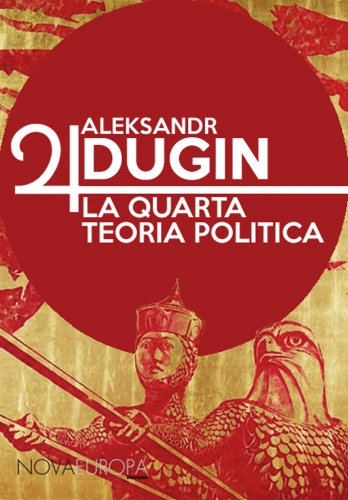
Plus qu'un livre, La Quatrième théorie politique est un authentique carrefour du passé, du présent et de l'avenir, qui discute de l'épuisement des catégories de la modernité et des scénarios à venir. Dans l'état actuel des choses, comme nous le disions, Douguine est l'un des rares "contemporains de l'avenir", et ce livre en est la démonstration, l'inversion d'un esprit aigu visant à dépasser les trois théories politiques de la modernité - libéralisme, fascisme et communisme - qui, après avoir enflammé le vingtième siècle, le "siècle des idéologies" par excellence, ont perdu leur force propulsive, se révélant incapables d'interpréter le nouveau.
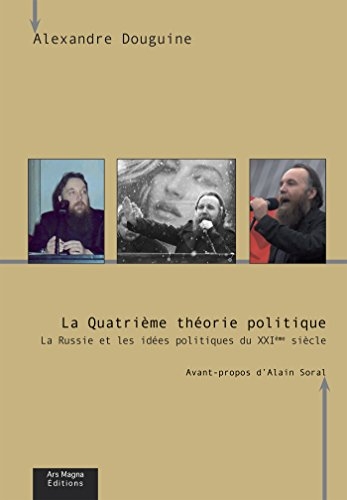
Nous avons besoin d'une nouvelle herméneutique, de nouvelles pratiques, de nouvelles méthodes: les défis de notre temps l'exigent. Et nous devons nous montrer à la hauteur. C'est de tout cela qu'est née la Quatrième théorie politique, une "mise au rebut" (pour utiliser un terme à la page) des trois théories précédentes, un effort titanesque pour adhérer au Zeitgeist, une vision transversale et non-conformiste capable de combiner Tradition et modernité, universum et pluriversum - une "métaphysique du populisme", comme on peut le lire dans les pages de l'ouvrage. Un livre lié d'une certaine manière à la réalité historique et "destinale" de la Russie, mais aussi un manifeste pour un monde multipolaire, multidimensionnel, complètement contraire à celui, monothéiste, rêvé par les mondialistes et les globalistes et opposé au "racisme historiographique" qui voit dans la modernité le sommet suprême de l'évolution humaine.
Ceux qui recherchent des recettes faciles peuvent oublier ce travail car ce livre n'est pas pour eux. La Quatrième théorie politique n'est pas une doctrine, mais avant tout une méthode, une vision du monde. Il ne s'agit pas d'une idéologie, mais d'une métaphysique de l'histoire, allergique au militantisme comme fin en soi, tant à la mode aujourd'hui, et partisan d'un changement avant tout interne. La preuve en est, entre autres, la présence d'une série d'auteurs impolitiques (dans le sens donné par Thomas Mann) et non-alignés, parmi lesquels se distingue, dès les premières pages, Julius Evola, une vieille passion de Douguine, qui a fait il y a quelques années une analyse "de gauche" de ses idées. Pour ce qui concerne le philosophe romain, je suis allé interviewer Douguine avec Luca Siniscalco, lui demandant comment il a connu ses œuvres, et quel est le premier livre d'Evola qu'il a lu.
Et maintenant, donnons la parole à Douguine.
J'ai appris à connaître Evola par certains de mes professeurs et amis russes, qui avaient à leur tour découvert la pensée traditionaliste dans les années 1960. Je n'étais alors qu'un enfant. Au début des années 1980, je suis entré en contact avec un tout petit groupe, pratiquement inexistant en Russie, inconnu des milieux officiels et composé uniquement de dissidents. Ils étaient la minorité de la minorité, à un niveau presque infinitésimal. Comme dans le sens de Guénon, qui établit une différence entre infinitésimal et inexistant, n'est-ce pas ?
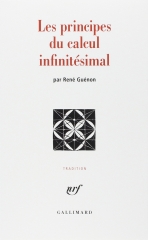 Dans les Principes du calcul infinitésimal, qui ont également été publiés en italien...
Dans les Principes du calcul infinitésimal, qui ont également été publiés en italien...
Certainement. Ils avaient une portée infinitésimale, mais ils existaient quand même. Plus tard, je suis tombé sur l'impérialisme païen, dans sa version allemande, Heidnischer Imperialismus. J'ai été tellement impressionné par ce travail que j'ai décidé de le traduire immédiatement en russe. C'était une rencontre cruciale, je dirais même radicale. L'univers décrit par Evola contenait le meilleur système idéal que j'avais jamais rencontré. À l'époque, je ne comprenais pas pourquoi: je venais d'une famille communiste, normale, de la classe moyenne, et pourtant j'avais le sentiment d'appartenir à l'univers décrit par Evola plus qu'à celui dans lequel je vivais. C'était une certitude sans aucune sorte de fondement. En même temps, j'eus l'occasion d'éditer la traduction de plusieurs livres de René Guénon à partir du français. Eh bien, depuis lors - c'était au début des années 1980 - je me considère comme un traditionaliste, et rien n'a essentiellement changé jusqu'à présent. J'appartiens à cet univers, à toutes fins utiles.
Quelles œuvres d'Evola avez-vous lues depuis lors ?
Chevaucher le Tigre, suivi de Révolte contre le monde moderne. Et puis tout le reste : la Tradition hermétique, le Mystère du Graal, la Métaphysique du sexe, les Hommes au milieu des ruines...
Quelle est votre œuvre préférée d'Evola ?
Les oeuvres d'Evola sont toutes très importantes, mais ma préférée reste Chevaucher le Tigre. Ce livre a eu une influence métaphysique fondamentale sur moi, notamment avec le concept de l'Homme différencié, qui est obligé de vivre dans la modernité tout en appartenant à un monde différent. C'est précisément à partir de cette idée que j'ai développé mes analyses du Sujet radical, c'est-à-dire de l'homme de la Tradition jeté dans un monde sans Tradition. Comment est-il possible pour un tel type humain, me suis-je demandé, de vivre dans un monde où la Tradition n'est pas présente, c'est-à-dire sans avoir reçu aucune sorte de tradition ? Eh bien, c'est là que surgit le sujet radical, qui ne s'éveille pas quand le feu du sacré est allumé, mais quand il ne trouve rien en dehors de lui qui soit lié à la Tradition.
Dans quel sens ?
L'essence de la vérité est sacrée. Aujourd'hui, le néant domine, mais il n'est pas possible que le néant existe. Le néant n'est qu'une forme extérieure, à l'intérieur de laquelle brûle le sacré. C'est précisément lorsque la transmission régulière des formes du sacré est rompue qu'apparaît ce que j'appelle le sujet radical. Et nous revenons ici à l'Homme différencié, qui est peut-être encore plus important aujourd'hui que la Tradition elle-même. Peut-être la Tradition a-t-elle disparu précisément pour laisser la place au Sujet radical. De ce point de vue, paradoxalement, le traditionalisme est aujourd'hui plus important que la Tradition elle-même. Toutes ces idées, déduites de Chevaucher le Tigre, n'impliquent évidemment pas la restauration de ce qui était, mais la découverte d'aspects qui n'existaient même pas dans le passé.
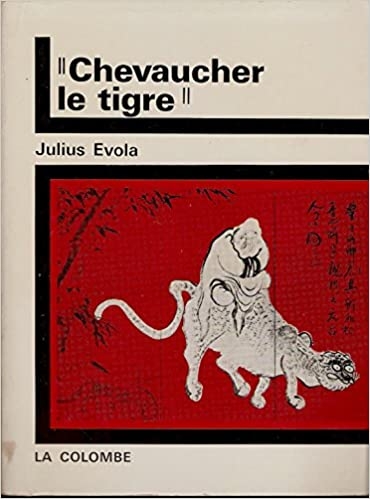
Il ne s'agit donc pas d'un simple conservatisme.
Pas du tout. Nous ne voulons pas restaurer quoi que ce soit, mais revenir à l'Éternel, qui est toujours frais, toujours nouveau : ce retour est donc un mouvement vers l'avant, et non vers l'arrière. Le Sujet radical, en outre, se manifeste entre un cycle qui se termine et un cycle qui naît. Cet espace liminal est plus important que tout ce qui vient avant et que tout ce qui viendra après. Nous pourrions utiliser une image tirée de la doctrine traditionnelle des "quatre cycles", des quatre âges (d'or, d'argent, de bronze et de fer), répandue dans des traditions très différentes: la restauration de l'âge d'or, de ce point de vue, est moins importante que l'espace entre la fin de l'âge de fer et le début de l'âge d'or lui-même. Qui est l'espace dans lequel nous vivons. Tous ces aspects, pour revenir à Evola, sont à mon avis implicites dans son idée d'Homme différencié.
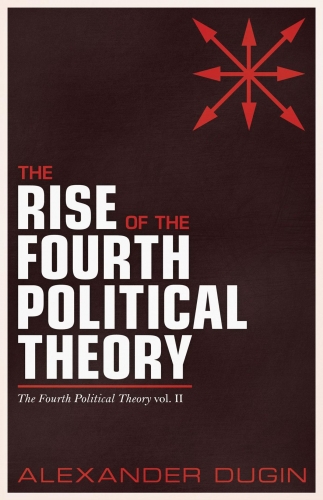
Votre livre La Quatrième Théorie politique a récemment été publié en Italie. Le sujet appelé à cette nouvelle métaphysique de l'histoire est le Dasein, l'être-là dont parlait Martin Heidegger. Y a-t-il un écho du Sujet radical dans le Dasein ?
Jusqu'à un certain point. Le Dasein n'est en fait pas le Sujet radical, mais, comme on l'a dit, cette terminologie philosophique remonte à Heidegger. D'ailleurs, je pense qu'Evola n'a pas très bien compris Heidegger. Dans Chevaucher le Tigre, il porte sur lui un jugement superficiel: Heidegger est plus intéressant et plus profond. J'ai étudié sa pensée pendant des années, écrivant quatre livres sur lui. La chose importante à propos du Dasein est qu'il décrit l'homme non pas comme une entité donnée. Nous pensons habituellement à l'homme en utilisant des catégories telles que l'individu, la classe, la société, la nation, mais ce ne sont que des formes secondaires. Si nous voulons définir l'homme à sa racine la plus profonde, le Dasein est ce qui reste lorsque nous le libérons de toutes ces préconceptions culturelles. Ce n'est pas très facile à comprendre: il faut procéder à une destruction radicale - ou à une déconstruction - de tous les aspects socioculturels, historiques, religieux (voire traditionnels) attribués à l'homme. Le Dasein ne correspond à aucune des définitions de l'homme. Ce n'est pas un individu, ce n'est pas un collectif, ce n'est pas non plus une âme, un esprit ou un corps: tout cela est secondaire. Il s'agit plutôt d'une pure présence de l'intellect, qui ne s'ouvre que lorsque nous sommes confrontés à la mort.
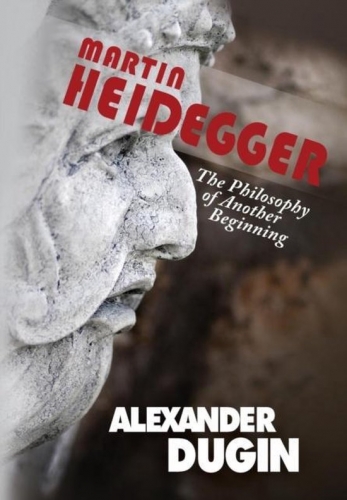
Cet être-à-la-mort dont parle Heidegger...
On ne peut pas parler du Dasein sans une confrontation avec la mort. À ce moment-là, il n'y a plus de noms, plus d'individus: c'est alors que s'ouvre l'essence du Dasein. Il est nécessaire, comme le propose Heidegger, de repenser tous les concepts du politique, de la société, de la philosophie, de la culture et des relations avec la nature, à partir de cette expérience radicale et existentielle, de ce moment de pensée. C'est seulement sur la base de cet espace existentiel libre de tout le reste qu'il est possible de reconstruire une ontologie scientifique, une ontologie politique, une ontologie socioculturelle... Mais toujours et seulement sur la base de cet éveil existentiel. Et cet éveil n'est pas une idée transcendante, mais une expérience immanente, qui doit redevenir la racine de la politique.
Dans la Quatrième théorie politique, vous avez également interprété le concept de peuple à la lumière du Dasein...
Le Dasein, à toutes fins utiles, est le peuple. Sans le peuple, aucune entité pensante ne peut exister. Le peuple assure en effet une langue, une histoire, un espace et un temps. Tout. A la réflexion, le Dasein devient des personnes. Je ne fais pas référence au concept de collectivité, qui n'est qu'une collection d'individus. En dehors du peuple, nous ne sommes rien. Et le peuple n'existe que comme Dasein, ni individuellement ni collectivement. C'est une manière existentielle de comprendre le peuple, qui s'oppose aux théories des libéraux, avec leur idée vide et insignifiante de l'individu; aux théories des communistes, basées sur les classes et les collectivités, concepts également vides qui ne s'opposent en rien aux libéraux, puisque ce type de collectivité n'est qu'une agglomération d'atomes individuels, comme nous l'avons déjà dit; et, enfin, aux théories des nationalistes, qui se réfèrent au concept d'État-nation, autre idée bourgeoise antithétique de l'Empire et de l'idée du Sacré. Evola, dans ce sens, a fait une critique très radicale du nationalisme. Les versions libérales, communistes et nationalistes sont toutes des tentatives désuètes d'interpréter le sujet de la politique.
Ce sont les trois théories politiques que la Quatrième théorie politique va mettre en avant....
C'est ainsi que nous arrivons au Dasein, le sujet de la Quatrième théorie politique. Elle ne peut se passer du peuple: il est en effet impossible de renoncer à la langue, à l'histoire, à une certaine mentalité... Il est impossible de penser sans une langue, n'est-ce pas ? La mienne est une vision métaphysique de l'intellect et de la linguistique, de l'histoire et de la société. Sur la base de tout cela, en renonçant aux trois théories politiques de la modernité - communisme, nationalisme et libéralisme - nous devons construire une nouvelle vision du monde, une politique au sens existentiel capable de répondre à tous les défis du présent : notre relation avec les autres, le genre, l'idée d'un monde multipolaire... Nous devons repenser tout cela en dehors de la modernité occidentale. Or, c'est précisément en comparant cette construction théorique et les trois régimes de la modernité occidentale que la Quatrième théorie politique est née.
Avez-vous vu cette théorie s'incarner dans une forme politique actuelle ?
Le chiisme moderne est une expression, dans la sphère islamique, de la Quatrième théorie politique. Mon livre a été traduit en persan, et on m'a fait remarquer qu'il traitait de la politique iranienne... ! Qui en fait n'est ni communiste, ni libérale, ni nationaliste. Je crois que le soi-disant "populisme" - y compris le populisme italien - est une forme de la Quatrième théorie politique. Même les populistes ne sont pas fascistes ou communistes, et ils sont profondément antilibéraux. Le populisme est une réaction existentielle des peuples, qui ne sont évidemment pas morts, comme le voudraient les libéraux, les mondialistes et les globalistes. Ce sont tous des exercices préparatoires à la Quatrième théorie politique - qui pourrait être définie comme une forme de populisme intégral. Ni de droite ni de gauche, naturellement doté de sympathies pour la justice sociale et l'ordre moral. De ce point de vue, la quatrième théorie politique est la métaphysique du populisme.
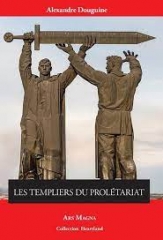 Pourtant, les aspects métapolitiques du soi-disant "populisme" sont passés inaperçus en Italie...
Pourtant, les aspects métapolitiques du soi-disant "populisme" sont passés inaperçus en Italie...
Le populisme est étiqueté de droite - fasciste, national-socialiste - ou de gauche - communiste, maoïste, trotskiste... Mais l'anticommunisme et l'antifascisme ne sont que des tentatives de diviser le peuple. Le populisme propose d'abandonner les deux, ainsi que les dogmes du nationalisme et du communisme, en unissant les forces populaires - droite et gauche - pour réaliser un populisme intégral, en faisant un front commun contre les libéraux, les mondialistes, les globalistes, les derniers vestiges du dernier cycle de l'Occident. Je suis convaincu que les mondialistes d'aujourd'hui sont les pires - pires que les fascistes ainsi que les communistes. Une révolution contre eux sera la dernière mission eschatologique de l'Occident. Le peuple va tenter une résistance organique, existentielle. La Quatrième théorie politique ouvre en outre la voie à la récupération de tout ce qui n'est ni moderne ni occidental: le pré-moderne, le post-moderne, l'anti-moderne, l'Asie, la tradition romaine, le christianisme orthodoxe, la Grèce, l'Islam. La modernité occidentale est la combinaison de tout ce qu'il y a de plus négatif, les Soros, les mondialistes, les libéraux... Mettre fin au libéralisme signifiera vaincre tout ce qui est néfaste en Occident. Il s'agit d'une lutte eschatologique, évidemment : et c'est là que la Quatrième théorie politique rejoint le traditionalisme. Toujours, cela va sans dire, avec un œil ouvert sur l'avenir.
Pour revenir à ce qui a été dit précédemment, le Dasein et le Sujet radical sont-ils donc différents ?
Ils sont similaires, mais je ne pense pas qu'il soit possible d'établir une identité. Ce sont des concepts nés dans des contextes différents. J'ai écrit un livre sur le sujet radical et son double - au sens que lui donnait Antonin Artaud, dans Le théâtre et son double. Pour moi, le sujet radical est une manière d'être contre le monde moderne, sans raison particulière, sans être aristocrate ou chrétien... Bref, sans avoir un quelconque contact avec une Tradition vivante. Eh bien, c'est le moment de la forme concrète et opératoire du Sujet radical, qui s'ouvre immédiatement à la Tradition, en étant une forme de celle-ci. Mais c'est une révolte qui ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Il s'agit évidemment d'une forme très particulière de métaphysique.
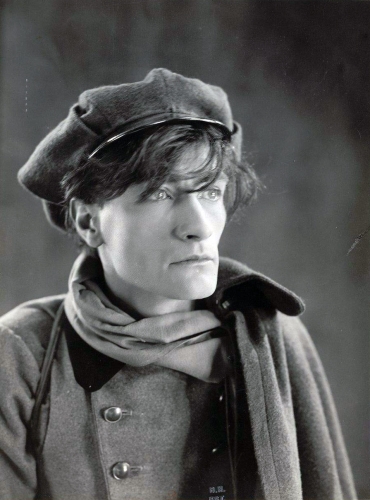
Une métaphysique intérieure, pour ainsi dire...
C'est l'homme différencié, précisément. Pas en tant que comte ou baron, ni en tant que chrétien, païen, soufi ou quoi que ce soit de ce genre. L'Occident n'a rien de tout cela : c'est pourquoi, comme le prétend Evola, il arrivera le premier à la renaissance, à la restauration, au nouveau cycle, que l'Orient. L'Occident est maintenant au fond du gouffre. Mais c'est là que le sujet radical renaîtra.
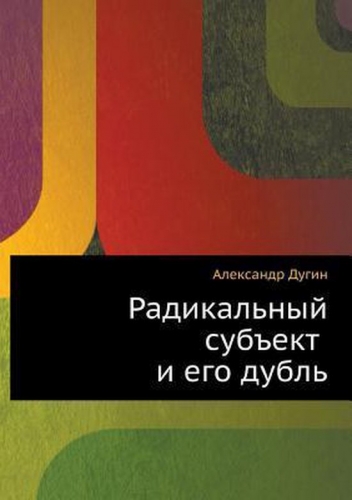
Le livre sur le sujet radical est évidemment en russe...
Bien sûr.
Il devrait être traduit...
Je pense que la seule langue, la seule culture qui pourrait le comprendre est l'italienne. La culture d'Evola, la langue dans laquelle Chevaucher le Tigre a été écrit, une culture qui possède un profond savoir traditionnel. Les Anglais ne connaissent pas du tout Evola. En France, il n'est considéré que comme l'un des nombreux disciples de Guénon, ou réduit au fascisme. Par conséquent, ils ne seraient pas en mesure de comprendre mon livre. Ce serait une excellente idée de le traduire en italien.
La Quatrième théorie politique critique l'Individu absolu d'Evola - précisant également que cette expression, au sens traditionnel, peut se référer à l'atman hindou. A votre avis, comment s'est opéré le passage d'Evola de l'Individu absolu aux grands espaces de la Tradition ?
Je pense qu'il s'agit simplement d'une question de terminologie. Je ne critique pas le concept de l'Individu absolu d'Evola, mais celui de l'individu, qui est un concept relatif par définition. L'expression "individu absolu" dépasse l'individualisme en soi. Je pense donc qu'il s'agit d'une simple question linguistique. La théorie d'Evola est mieux comprise, à mon avis, en recourant au concept de Personne, plutôt que d'individu. La personne est une forme qui peut être absolue ou relative, mais qui est toujours liée aux relations avec les autres - horizontalement ou verticalement, elle est toujours l'intersection de différentes relations. La Personne Absolue est donc la forme de l'Absolu personnifié. C'est l'idée traditionnelle de Selbst. Martin Heidegger parle par exemple du Selbst du Dasein: il s'agit précisément de l'individu absolu - ou sujet radical. On peut le comparer au Param Atman, qui est au centre de tout, même lorsqu'il n'est pas le centre, même en l'absence de symétrie pour lui donner une forme. Pour avoir un centre, nous devons en effet être en présence d'une figure qui le présuppose. Mais dans un monde postmoderne et rhizomatique, le centre est absent: le sujet radical est toujours le centre, même là où il n'est pas possible d'en avoir un. Il s'agit d'une forme de transcendance immanente.
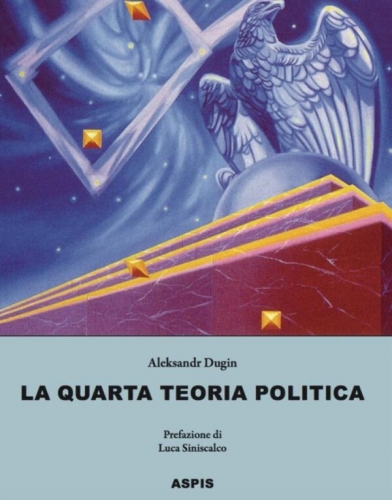
Il y a quelques années, vous avez développé une lecture intéressante d'Evola, pour ainsi dire "vu de gauche". Pouvez-vous expliquer brièvement de quoi il s'agit ?
C'était une petite provocation qui soulevait une question très sérieuse: il n'est pas possible de lire Evola comme le font beaucoup de petits-bourgeois et de conservateurs. Evola n'appartient pas à la droite économique: il est contre le monde moderne. Et le monde moderne peut être de gauche comme de droite. C'est une révolte absolue contre le monde qui nous entoure, contre le statu quo, une révolte incompatible avec le conservatisme de droite, le grand capital, la bourgeoisie, la xénophobie, toutes les positions qui résument le conformisme petit-bourgeois. Evola nous invite à nous engager dans un combat absolu, celui de la vérité. Ceux qui n'acceptent pas cette invitation défendent en fait le monde moderne. Il n'est pas possible d'être un traditionaliste et d'accepter les formes de l'occidentalisme moderne, le capitalisme, le libéralisme et le conservatisme. C'est pourquoi j'ai voulu souligner que la pensée d'Evola est révolutionnaire, conduisant à une révolte avec, en ce sens, une âme " de gauche ", visant à détruire tous les principes du statu quo. Le vôtre pourrait être, pour ainsi dire, un "anarchisme de droite", développé précisément dans Chevaucher le Tigre.
Dans cet essai, vous avez également réfléchi à l'interprétation "traditionnelle" des relations entre les travailleurs et la bourgeoisie...
Je crois que la défense par Evola et Guénon de la bourgeoisie contre le prolétariat est une erreur liée à l'application de la théorie qui voit quatre castes dans les sociétés indo-européennes. La première était sacerdotale et la seconde guerrière, du kshatrya: bien que, contrairement à Evola et Guénon, je sois convaincu que la troisième caste doit être identifiée à celle des paysans. Georges Dumézil a montré que dans la tradition indo-européenne, il y a trois castes et non quatre. Si c'est le cas, alors la bourgeoisie n'est même pas une caste, mais un groupe de paysans incapables de vivre dans les champs et qui ont déménagé dans les villes. Les plus honnêtes sont devenus des prolétaires; les pires sont devenus des capitalistes. La bourgeoisie devient ainsi une caste qui rassemble les pires guerriers, qui ont peur de se battre, et les paysans qui ne veulent pas travailler. C'était l'union des pires individus de toutes les castes. C'est pourquoi il ne faut pas défendre la bourgeoisie, car elle n'est pas une véritable caste indo-européenne. En haïssant les prêtres, les guerriers et les paysans, elle a créé une réalité défavorable à toutes les castes traditionnelles indo-européennes. Il est intéressant de noter que la révolution socialiste - le communisme soviétique - a d'abord été orientée contre la bourgeoisie, et pas tellement contre les guerriers, les prêtres ou les paysans. Je pense donc qu'il est possible de concevoir, pour ainsi dire, un socialisme - ou un communisme - indo-européen qui s'oppose complètement à la bourgeoisie, qui ne représente en aucun cas la Tradition. Cette analyse n'est pas une critique d'Evola, qui détestait la bourgeoisie, le statu quo et le monde moderne, mais plutôt une correction et une intégration de sa théorie.
Comment se présente alors l'Evola anti-bourgeois "vu de gauche" ?
Si aujourd'hui la bourgeoisie est l'ennemi absolu, tout ce qui n'est pas moderne, occidental et bourgeois, est de notre côté: les Chinois, les Russes, les Africains, les Arabes, tous les Occidentaux qui s'opposent au libéralisme. Cette dernière, en effet, est la pire cristallisation de l'âge des ténèbres dont parlaient les doctrines traditionnelles. Dans cette perspective, l'anti-moderne et anti-libéral Evola est un révolutionnaire total. On pourrait répéter à propos d'Evola ce que René Alleau a dit de Guénon en le qualifiant de "penseur le plus radical et le plus révolutionnaire de Marx". Il l'est bien plus que ces traditionalistes qui se vivent comme des bourgeois, se limitant à une lecture stérile et improductive de la pensée de la Tradition. Ce sont les traîtres à la Tradition: si c'est le cas, je préfère les anarchistes. Je crois que l'ordre bourgeois doit être détruit. Ma thèse est une conséquence logique des positions évolienne et traditionaliste.
Et comment se rapporte-t-elle à la Quatrième théorie politique ?
La Quatrième théorie politique propose la même chose, de manière plus académique, avec la déconstruction du libéralisme, de l'eurocentrisme et du modernisme. Il ne s'agit pas d'un dogme, mais d'une invitation à exercer la réflexion et la critique. Certains proposent de trouver un nom à cette théorie. Il est inutile de le faire: il délimitera un espace conceptuel qui trouvera son propre nom à un moment ultérieur, en temps voulu. Mais dès aujourd'hui, il est possible de travailler avec ce concept, en préparant le terrain pour sa manifestation. Les Iraniens, comme les Chinois, peuvent voir dans leur configuration politique une manifestation historique de la Quatrième théorie politique. C'est une invitation ouverte. C'est le côté faible mais aussi le côté fort de l'expression "Quatrième théorie politique". Je tiens à souligner qu'il ne s'agit pas d'une mascarade de la troisième théorie politique - du fascisme - mais d'un paradigme réellement alternatif aux trois premiers. Le fascisme, le communisme et le libéralisme sont pleinement imprégnés de modernité. Je critique le fascisme dans ses aspects bourgeois, racistes et nationalistes. La Quatrième théorie politique ouvre un autre espace conceptuel. Le problème est que presque tout ce que nous continuons à penser appartient à l'héritage des trois premières théories politiques. Une grande purification intérieure est nécessaire pour développer fructueusement le traditionalisme et en même temps la Quatrième théorie politique, qui est la forme logique d'un certain développement de certains aspects du traditionalisme lui-même.
15:54 Publié dans Définitions, Entretiens, Livre, Livre, Nouvelle Droite, Philosophie, Théorie politique, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre douguine, quatrième théorie politique, livre, entretien, définition, nouvelle droite, nouvelle droite russe, philosophie, philosophie politique, théorie politique, politologie, sciences politiques, tradition, julius evola, sujet radical, martin heidegger, traditionalisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 15 août 2021
Réflexions sur les thèses de Cornelius Castoriadis: Image de soi et servilité

Réflexions sur les thèses de Cornelius Castoriadis: Image de soi et servilité
par Joakim Andersen
Dans nos tentatives de comprendre la psyché de la gauche libérale dans toute sa complexité auto-contradictoire, nous avons remarqué qu'elle semble fonctionner à plusieurs niveaux. Le niveau rhétorique, la ritournelle qui dit que "la diversité est passionnante", ne correspond pas toujours, ni même souvent, à la vision du monde qui semble sous-tendre la pratique réelle (où, à intervalles réguliers, on entend le mot d'ordre suivant: "maintenant, nous nous distançons de cette diversité"). Ce phénomène ne se limite pas à la "diversité", mais semble être fortement lié, faute d'un meilleur terme, aux priorités discursives du pouvoir. Dans certaines questions politiques, le pouvoir, l'establishment ou les élites sont contrariés; être de la "gauche libérale" est lié à une capacité développée de sentir quand les choses se produisent puis d'ajuster ses positions en conséquence. La femme politique de gauche germano-iranienne Sahra Wagenknecht a mentionné dans son dernier livre Die Selbstgerechten, les slogans tels "réfugiés bienvenus", les discours écologistes sur le climat, le phénomène BLM et la pandémie comme exemples de ces marquages imposés par l'élite. Il semble possible d'établir un cycle dans lequel le pouvoir, tel un boxeur, nourrit son adversaire, le peuple, de coups de poing. Une fois que le peuple et les éléments subalternes des élites ont appris à gérer, disons, le facteur BLM, soit à la fois les arguments avancés par ce facteur et l'hystérie systémique initialement très effrayante qu'il a provoquée, il est temps de passer au coup suivant. Ce qui viendra après la pandémie est encore difficile à deviner, il pourrait s'agir d'un ennemi interne tels les "nationalistes blancs".
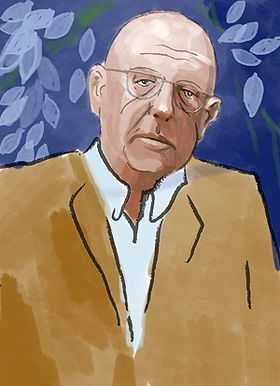
Quoi qu'il en soit, cela nous amène involontairement à une observation du penseur franco-grec Cornelius Castoriadis (1922-1997). Castoriadis est surtout connu aujourd'hui comme l'un des fondateurs et l'un des contributeurs les plus fréquents de Socialisme ou Barbarie, un groupe libertaire qui critiquait notamment l'empiètement de la bureaucratie à l'Est comme à l'Ouest. Il s'est inspiré du marxisme mais a également développé une critique parfois cinglante de certains de ses éléments. Castoriadis est souvent aussi prolifique que Debord et Burnham dans son analyse de la bureaucratisation de la société moderne (ses idées sur les personnes autonomes, les types humains et la "société de l'oubli" ont déjà été abordées à Motpol).
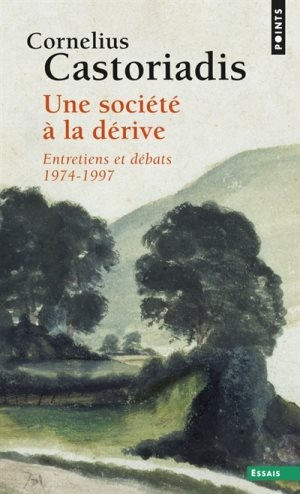
Dans Une société à la dérive, il explique comment nos sociétés étaient déjà fondamentalement antidémocratiques en 1992, "nos régimes sont faussement appelés démocratiques, alors qu'en réalité ce sont des oligarchies libérales". Aujourd'hui, une telle combinaison de mots au mauvais moment aurait pu faire bannir Castoriadis de Facebook; il a amorcé une analyse, pour savoir comment cet état de fait s'est produit et s'est reproduit. Selon cette analyse, "la domination d'une oligarchie et la passivité et la privatisation du peuple sont les deux faces d'une même médaille". Le terme "privatisation" était utilisé ici dans un sens légèrement différent de celui que l'on utilise dans la Suède d'aujourd'hui, Castoriadis faisant référence au retrait des personnes dans la sphère privée de la consommation et autres niches dépolitisées. Quant à l'économie, Castoriadis souhaitait en 1992 "un véritable marché, et non, comme aujourd'hui, un marché dominé par des monopoles et des oligopoles - ou par l'intervention de l'État".
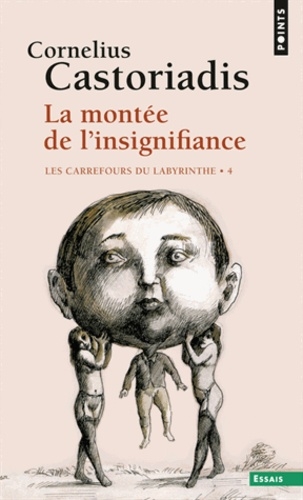
Mais revenons au sujet. Castoriadis a posé l'hypothèse d'une dichotomie anthropologique. Pour être libre (ou autonome dans la terminologie castorienne), l'homme doit vouloir être libre. De solides forces et tendances s'y opposent, notamment la canalisation de l'énergie individuelle et collective par la société de consommation. Aujourd'hui, nous observons des tendances totalitaires plus évidentes qu'à l'époque de Cornelius Castoriadis; les citoyens ont des raisons bien réelles de craindre les dirigeants d'aujourd'hui. Et c'est précisément pour cela que ce n'est pas quelque chose que l'on dit à voix haute dans une société civilisée.
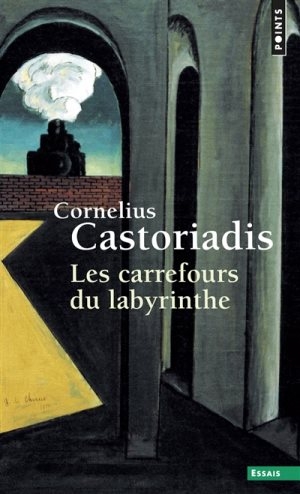
Le lien entre cette situation et les quatre niveaux du politiquement correct est, à mon humble avis, le suivant. La plupart des gens reconnaissent l'existence de conséquences prévisibles et imprévisibles pour ceux qui ne veulent ou ne peuvent pas jouer un rôle dans les questions où les élites ont placé et imposé leurs balises. Tout le monde sait aujourd'hui quiconque remet en question la politique d'immigration sera puni, soit directement par l'État, soit par d'autres avec le consentement plus ou moins tacite de l'État. Prétendre le contraire, c'est jouer les idiots. La "privatisation" et la logique bureaucratique que Castoriadis a identifiées signifient cependant que peu de personnes sont prêtes à risquer ces conséquences, notamment parce que beaucoup pensent qu'elles le feront seules et en vain (cette perception qu'il y a moins de critiques qu'il n'y en a réellement, d'ailleurs, sert une fonction politique et ne devrait jamais être encouragée).
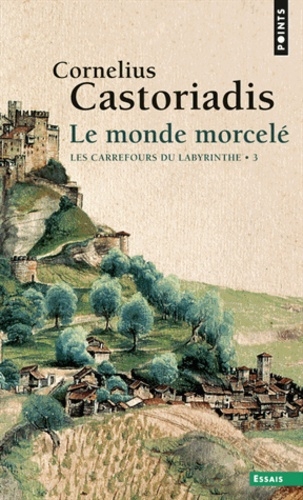
En clair, ce sont des lâches; dans les milieux dissidents, on les qualifie souvent de "moutons". Il est clair, cependant, que cela ne fait pas partie de l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, sauf dans des cas exceptionnels. L'image de soi est cruciale pour la plupart des gens. Un mécanisme psychologique veut donc qu'ils maintiennent à la fois leur image de soi et leur conformité au langage et aux réflexes idéologiques imposés en affectant une stupidité et un aveuglement sélectifs. Ils se convainquent de la justesse d'affirmations qu'ils ne peuvent pas vérifier, dialectiquement parlant, ils sont à la fois convaincus et non convaincus (tout comme ils peuvent être conscients ou non de leur stupidité sélective). Il faut savoir dans ce contexte que ce n'est pas la force des arguments qui les convainc, mais un autre processus, plus complexe. Pour certains, cette réminiscence (de la stupidité sélective pour laquelle ils ont opté) peut provoquer de forts sentiments d'agressivité à l'encontre du messager. Pour d'autres, cela peut être contre-productif, peut-être surtout pour ceux dont l'intégrité personnelle est plus forte. En tout cas, présenter les élites comme plus fortes ou plus unies, et le peuple comme plus faible, qu'ils ne le sont réellement, semble extrêmement contre-productif dans cette optique. Se déplacer uniquement sur le plan rhétorique et répondre à des arguments qui ne sont même pas honnêtes, peut dans de nombreux cas être une stratégie mieux combinée avec une méta- et/ou une psychanalyse plus risquée. Se limiter à une analyse individuelle, "tu es un mouton", n'est pas non plus juste et tactiquement correct lorsqu'il existe un contexte structurel à la lâcheté de l'individu.
Source : https://motpol.nu/oskorei/2021/08/05/sjalvbild-och-servilitet/
14:12 Publié dans Actualité, Philosophie, Sociologie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : philosophie, sociologie, cornelius castoriadis |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 14 août 2021
Désigner l’ennemi: les idéologies de «l’universel»
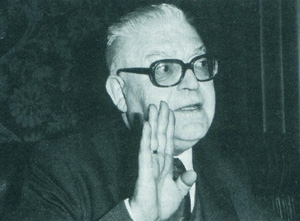
Désigner l’ennemi: les idéologies de «l’universel»
par Grégoire Gambier
Source: https://institut-iliade.com/gagner-la-guerre-informationnelle/
La relecture de Julien Freund est l’une des nécessités les plus impérieuses du moment. Son analyse du politique permet d’y voir plus clair dans l’opposition entre « indigénistes » et « universalistes ». Et de les renvoyer dos à dos : les ennemis de nos ennemis ne sont pas nécessairement nos amis…
Les très dynamiques éditions de la Nouvelle Librairie ont été particulièrement inspirées d’éditer il y a quelques mois un ouvrage qui s’avère aujourd’hui essentiel pour rendre intelligibles les débats politiques et idéologiques du moment. Le Politique ou l’art de désigner l’ennemi est un recueil de textes présentés par Alain de Benoist et Pierre Bérard, qui permet d’aller à l’essentiel dans la pensée foisonnante de Julien Freund (1921-1993). Philosophe, sociologue et professeur d’Université à Strasbourg, où il créa plusieurs institutions, dont un Laboratoire de sociologie régionale et un Institut de polémologie, Freund a contribué à la diffusion en France des travaux de Carl Schmitt et Max Weber, ainsi que de Georg Simmel et de Vilfredo Pareto. Il est surtout connu pour sa magistrale thèse soutenue en 1965 à la Sorbonne sur L’essence du politique. Pierre-André Taguieff le considère comme « l’un des rares penseurs du politique que la France a vu naître au XXe siècle ».
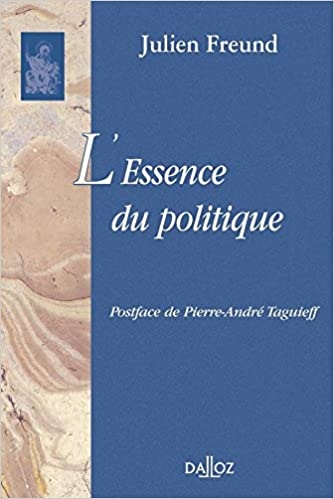
Dans son texte toujours très charpenté qui introduit l’ouvrage, Alain de Benoist rappelle les principales idées forces du philosophe. Ainsi de la distinction entre la politique (activité variable et circonstancielle) et le politique (catégorie conceptuellement immuable, disposant d’une « essence » propre). Mais aussi de la définition de la politique avant tout comme affaire de puissance : « Agir politiquement, c’est exercer une puissance (…) La souveraineté elle-même n’est pas fondamentalement un concept juridique, mais d’abord un phénomène de puissance. » Ou encore de la nature intrinsèquement conflictuelle du politique, qui suppose l’équilibre toujours précaire de dynamiques de forces opposées – d’ailleurs, « c’est le caractère provisoire de cet équilibre qui donne à la politique son caractère tragique »… L’ouvrage propose quatre études de Julien Freund, consacrées respectivement au politique, à l’aristocratie (« Plaidoyer pour l’aristocratie »), à la pensée politique de Carl Schmitt et enfin au fascisme. Il se clôt avec la correspondance entre Julien Freund et Alain de Benoist, et s’ouvre avec un témoignage original, tonique et « inflammable » de Pierre Bérard, qui a bien connu et fréquenté le maître, et en rapporte les propos sous la forme d’un dialogue imaginaire.
Contre l’entreprise de dénigrement des Européens
Avec le témoignage de Pierre Bérard, Julien Freund apparaît tel qu’en lui-même : malicieux, perspicace, drôle et profond à la fois. C’est dans ce texte que le lecteur trouvera sans doute les éléments de réflexions les plus pertinents pour penser l’époque – et les moyens de s’en sortir !
Ainsi, face aux négateurs de l’identité, Julien Freund rappelle qu’« être Européen, c’est être dépositaire d’un patrimoine spécifique et de s’en reconnaître comptable », alors que « le nouvel Européen qu’on nous fabrique est une baudruche aux semelles de vent ». Qui est à la manœuvre de cette « fabrique » ? Des « élites qui ne croient plus à la grandeur de notre continent », ces « élites qui vitupèrent, sermonnent, embarquant le pays dans une véritable industrie du dénigrement ». Bien avant d’autres, Julien Freund avait pressenti la nocivité de ce dénigrement perpétuel : à force de convoquer l’histoire au tribunal des sentiments du moment, on ne peut qu’encourager une sinistre compétition mémorielle, au risque de dissoudre tout lien social – toute démarche politique. Dès lors, le jugement est sans appel : ces « élites qui accablent les morts pour fustiger leur peuple ne sont pas dignes de gouverner ».
Désigner l’ennemi
À ceux qui prétendent faire de la politique, Julien Freund rappelle qu’elle n’est pas le domaine des bons sentiments, de l’opportunisme ou de la « gouvernance » inspirée des modèles économiques. Dès sa thèse de 1965, il en avait donné la définition la plus exacte, à savoir l’« activité sociale qui se propose d’assurer par la force, généralement fondée sur le droit, la sécurité extérieure et la concorde intérieure d’une unité politique particulière en garantissant l’ordre au milieu de luttes qui naissent de la diversité et de la divergence des opinions et des intérêts ». Fondée sur la force, en vue de la préservation du bien commun que vise un peuple sur un territoire, l’un et l’autre déterminés, la politique ne peut donc pas être « universelle », c’est-à-dire applicable à tous et en tout lieu. A fortiori lorsque cette « politique » a pour seuls fondements la démocratie de marché et les droits de l’individu, débouchant sur cette « métaphysique de l’illimité » qui l’assimile en réalité davantage à une religion.
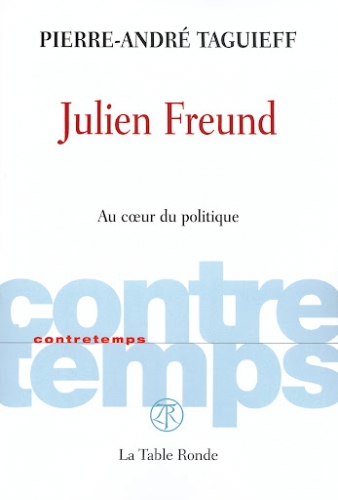
À cette aune, l’agitation « indigéniste » et la réaction « républicaine » doivent être considérées l’une l’autre comme impolitiques. Les premiers, héritiers des « l’antiracisme » que Dominique Venner avait déjà défini dans les années 1960, dans Europe-Action, comme un « racisme anti-blancs » (Dictionnaire du militant), entendent « raciser » les individus et les débats pour exiger des droits – et des réparations – au titre de leur seule couleur de peau. C’est l’Ethnos sans la Polis, soit une réduction de l’organisation sociale à sa forme la plus élémentaire, clanique et raciale, sans l’apport du politique. Mais c’est bien au nom de principes universels, égalitaires et revanchards, de l’« Humanité » tout entière, qu’ils entendent ainsi se venger du « monde blanc ». Comme le démontrent jusqu’au ridicule les initiatives de ses thuriféraires, la cancel culture est en réalité une culture cancel : une destruction de toute culture, à commencer par celle des Européens, censément dominante.
En face, les discours à prétention républicaine sonnent creux par excès inverse. En minimisant voire niant la réalité ethnique et historique du peuple, ils conçoivent une Polis sans Ethnos. L’appel à l’assimilation comme réponse aux problèmes massifs et existentiels que pose l’immigration est de ce point de vue illusoire : il est possible d’assimiler des individus, pas des peuples – l’exception n’est pas la règle ! C’est encore plus clairement une approche universaliste qui justifie cette posture, dont l’origine est à rechercher, à partir des Lumières, dans l’idéologie républicaniste elle-même et son cortège « d’idées chrétiennes devenues folles » (Chesterton). Son horizon ? Une société d’individus libres de toute attache particulière, détachés de toute communauté, ne partageant comme socle commun que l’adhésion à des « valeurs » vidées de toute substance à force d’être bêlées. Les « droits de l’homme » ayant finalement supplanté ceux du citoyen, chaque individu se voit reconnaître des droits imprescriptibles – y compris celui de s’implanter et de se fondre dans un pays autre que le sien. S’opposer à l’immigration au nom des seuls principes « républicains » est dès lors une imposture, car n’empêchant en rien le « Grand Remplacement » en cours.
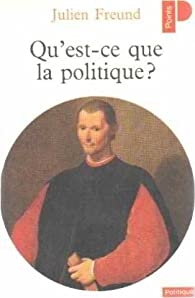 Il ne suffit donc pas que les « islamo-gauchistes » nous désignent, en tant qu’héritiers de la civilisation européenne, comme ennemis. Il nous revient de ne pas subir, mais au contraire de reprendre l’offensive en tenant compte de l’ensemble du problème. Au-delà de l’ennemi contingent, nous devons considérer comme ennemies, donc combattre, toutes les idéologies qui prétendent nier la réalité de notre identité au nom d’une religion de l’universel quasiment totalitaire, et priver nos peuples de leur droit inaltérable à la continuité historique, culturelle et biologique.
Il ne suffit donc pas que les « islamo-gauchistes » nous désignent, en tant qu’héritiers de la civilisation européenne, comme ennemis. Il nous revient de ne pas subir, mais au contraire de reprendre l’offensive en tenant compte de l’ensemble du problème. Au-delà de l’ennemi contingent, nous devons considérer comme ennemies, donc combattre, toutes les idéologies qui prétendent nier la réalité de notre identité au nom d’une religion de l’universel quasiment totalitaire, et priver nos peuples de leur droit inaltérable à la continuité historique, culturelle et biologique.
Rebâtir une civilisation…
Lucide, Julien Freund dit par ailleurs : « Nous sommes, je crois, en présence de la fin de la civilisation européenne ». En tout cas de la forme qu’elle a fini par prendre en devenant « occidentale », dilatée à l’échelle du monde, libérale dans tous les sens du terme. Au moins jusqu’au retour du tragique et de l’histoire auquel nous assistons depuis deux décennies. Toute civilisation étant mortelle, celle-ci peut disparaître – et le fera sous le poids des contradictions internes propres à sa prétention à l’universel et de son incapacité à en assumer les externalités négatives : individualisme, consumérisme, multiculturalisme… Julien Freund rappelle si besoin que « l’harmonie dans une société multiraciale est, plus que dans toute autre, une vue de l’esprit ».
Ce qu’il importe de préserver, ainsi que l’avait pressenti Spengler, c’est la culture. C’est donc la culture européenne, celle des peuples natifs de l’Europe depuis 5000 ans, qui doit être redécouverte, défendue, réappropriée, promue et sans cesse enrichie afin de servir de socle à une nouvelle Renaissance. Et celle-ci ne pourra être que la naissance d’une nouvelle civilisation, libérée des scories des idéologies de « l’universel », en renouant avec le génie des peuples et des lieux qui font l’identité de notre continent – comme celle des autres civilisations.
À ceux qui voient un monde qui leur était familier se dérober sous leurs pieds, tenaillés entre crispation réactionnaire, nostalgie incapacitante et crainte de l’avenir, Julien Freund livre un ultime conseil :
« Ne cultivons pas ce pessimisme qui est l’échappatoire des avortons ou l’alibi de la paresse. La messe n’est jamais dite et beaucoup de tâches nous requièrent. »
Grégoire Gambier
Julien Freund, Le Politique ou l’art de désigner l’ennemi, Paris, La Nouvelle Librairie, 2020, 340 p., 19,90 €.
12:54 Publié dans Livre, Livre, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, julien freund, philosophie, philosophie politique, politologie, sciences politiques, théorie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 13 août 2021
Giorgio Agamben: les vrais enjeux
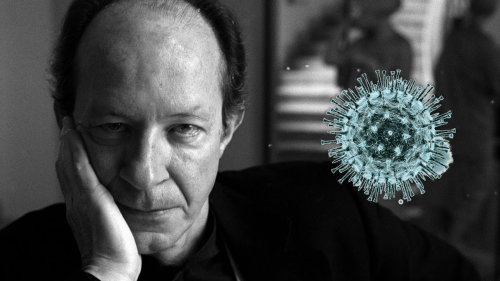
Les vrais enjeux
par Giorgio Agamben
Source : Giorgio Agamben & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/la-vera-posta-in-gioco
Ce qui est frappant dans les discussions sur le passeport vert et le vaccin, c'est que, comme cela se produit lorsqu'un pays glisse sans s'en apercevoir vers la peur et l'intolérance - et c'est sans doute ce qui se passe en Italie aujourd'hui - c'est que les raisons perçues comme contraires non seulement ne sont aucunement prises au sérieux, mais sont hâtivement rejetées, quand elles ne deviennent pas purement et simplement l'objet de sarcasmes et d'insultes. On pourrait dire que le vaccin est devenu un symbole religieux, qui, comme toute croyance, agit comme une division entre les amis et les ennemis, les sauvés et les damnés. Comment une thèse qui s'abstient d'examiner les thèses divergentes peut-elle être considérée comme scientifique et non religieuse ?
C'est pourquoi il est important de préciser tout d'abord que le problème pour moi n'est pas le vaccin, tout comme dans mes interventions précédentes ce n'était pas la pandémie, mais l'utilisation politique qui en est faite, c'est-à-dire la manière dont elle a été gouvernée depuis le début.
Aux craintes qui apparaissaient dans le document que j'ai signé avec Massimo Cacciari, quelqu'un a sagement objecté qu'il ne fallait pas s'inquiéter, "parce que nous sommes en démocratie". Comment est-il possible que nous ne nous rendions pas compte qu'un pays qui est en état d'exception depuis près de deux ans et dans lequel les décisions qui restreignent fortement les libertés individuelles sont prises par décret (il est significatif que les médias parlent même d'un "décret Draghi", comme s'il émanait d'un seul homme) n'est en fait plus une démocratie ? Comment est-il possible que la concentration exclusive de nos attentions sur les contagions et la santé empêche de percevoir la Grande Transformation qui est en train de se produire dans la sphère politique, dans laquelle, comme cela s'est produit avec le fascisme, un changement radical peut effectivement avoir lieu sans qu'il soit nécessaire de modifier le texte de la Constitution ?
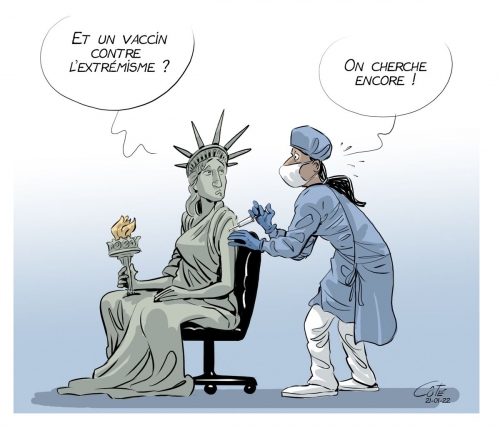
Et ne faut-il pas réfléchir au fait que les mesures exceptionnelles et les mesures ponctuelles ne sont pas dotées d'une échéance définitive, mais sont sans cesse renouvelées, comme pour confirmer que, comme les gouvernements ne se lassent pas de le répéter, rien ne sera plus jamais comme avant et que certaines libertés et certaines structures fondamentales de la vie sociale auxquelles nous étions habitués sont annulées sine die ? S'il est vrai que cette transformation - et la dépolitisation croissante de la société qui en résulte - est en cours depuis un certain temps, n'est-il pas d'autant plus urgent de faire une pause pour évaluer ses résultats extrêmes pendant qu'il est encore temps ? Il a été observé que le modèle qui nous gouverne n'est plus la société de discipline, mais la société de contrôle - mais jusqu'où pouvons-nous accepter ce contrôle ?

C'est dans ce contexte que le problème politique du passeport vert doit être posé, sans le confondre avec le problème médical du vaccin, auquel il n'est pas forcément lié (on a fait toutes sortes de vaccins dans le passé, sans que cela ne soit jamais discriminatoire pour deux catégories de citoyens). Le problème n'est pas, en effet, seulement celui, certes grave, de la discrimination d'une classe de citoyens de seconde zone: c'est aussi celui, qui tient certainement plus à cœur aux autres gouvernements, du contrôle généralisé et illimité qu'il permet sur les titulaires bêtement fiers de leur "carte verte".
Comment est-il possible - demandons-nous encore une fois - qu'ils ne se rendent pas compte que, obligés de montrer leur passeport même pour aller au cinéma ou au restaurant, ils seront contrôlés dans chacun de leurs mouvements ?
Dans notre document, nous avons établi une analogie avec la "propiska", c'est-à-dire le passeport que les citoyens de l'Union soviétique devaient présenter lorsqu'ils voyageaient d'un endroit à l'autre. C'est l'occasion de préciser, comme cela semble malheureusement nécessaire, ce qu'est une analogie juridico-politique. Nous avons été accusés, de manière injustifiée, d'établir une comparaison entre la discrimination résultant du passeport vert et la persécution des Juifs. Il devrait être clair une fois pour toutes que seul un imbécile mettrait sur un pied d'égalité ces deux phénomènes, qui sont évidemment très différents. Mais il ne serait pas moins stupide s'il refusait d'examiner l'analogie purement juridique - je suis un juriste de formation - entre deux lois, comme la législation fasciste sur les Juifs et celle sur l'institution du laissez-passer vert. Il n'est peut-être pas inutile de rappeler que les deux dispositions ont été adoptées par décret-loi et que toutes deux, pour ceux qui n'ont pas une conception purement positiviste du droit, sont inacceptables, car - quelles que soient les raisons invoquées - elles produisent nécessairement cette discrimination d'une catégorie d'êtres humains à laquelle un Juif devrait être particulièrement sensible.
Encore une fois, toutes ces mesures, pour ceux qui ont un minimum d'imagination politique, doivent être placées dans le contexte de la Grande Transformation que les gouvernements des sociétés semblent avoir à l'esprit - en supposant qu'il ne s'agisse pas plutôt, comme c'est possible, de l'avancée aveugle d'une machine technologique qui a désormais échappé à tout contrôle. Il y a de nombreuses années, une commission du gouvernement français m'a convoqué pour donner mon avis sur la création d'un nouveau document d'identité européen, qui contenait une puce avec toutes les données biologiques de la personne et toute autre information possible la concernant. Il me semble évident que la carte verte est la première étape vers ce document dont l'introduction a été retardée pour une raison quelconque.

Il y a une dernière chose que je voudrais porter à l'attention de ceux qui sont prêts à dialoguer sans insulter. L'être humain ne peut pas vivre s'il ne se donne pas des raisons et des justifications pour sa vie, qui, de tout temps, ont pris la forme de religions, de mythes, de croyances politiques, de philosophies et d'idéaux de toutes sortes. Ces justifications semblent aujourd'hui - du moins dans la partie la plus riche et la plus technologisée de l'humanité - avoir disparu, et les hommes sont peut-être pour la première fois confrontés à leur pure survie biologique, qu'ils semblent incapables d'accepter.
Cela seul peut expliquer pourquoi, au lieu d'assumer le simple et aimable fait de vivre côte à côte, on a ressenti le besoin d'établir une implacable terreur sanitaire, où la vie sans justification plus idéale est menacée et punie à chaque instant par la maladie et la mort. De même qu'il est insensé de sacrifier la liberté au nom de la liberté, il n'est pas possible de renoncer, au nom de la vie nue, à ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue.
20:05 Publié dans Actualité, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, définition, giorgio agamben, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
La théologie civile et scientifique du régime coercitif libéral
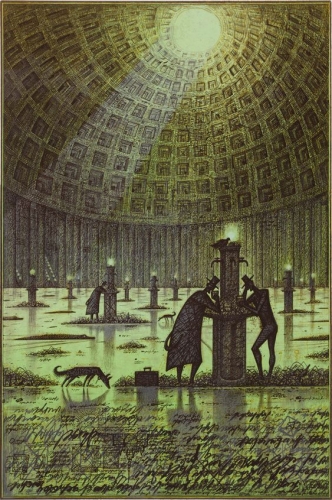
La théologie civile et scientifique du régime coercitif libéral
par Roberto Buffagni
Source : Roberto Buffagni & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/la-teologia-civile-scientista-del-regime-coercitivo-liberale
Andrea Zhok, a défini "LA COERCITION LIBERALE" dans un article récent, avec lequel je suis d'accord.
J'ai l'impression que nous assistons à la mise en place d'une véritable théologie civile légitimant l'ordre social, fondée sur le scientisme positiviste, dans une étonnante photocopie du programme d'Auguste Comte : "L'Amour pour principe et l'Ordre pour base ; le Progrès pour but" ("Système de politique positive", 1853). De cette théologie civile légitimante sur une base scientifique découlent les relatives inclusions et exclusions culturelles et politiques, qui absorbent et intègrent partiellement les précédentes, fascisme/antifascisme, sur la base d'une interprétation historique (à mon avis erronée) qui désigne les fascismes comme anti-modernes et réactionnaires, "René Guénon + le Panzerdivisionen".
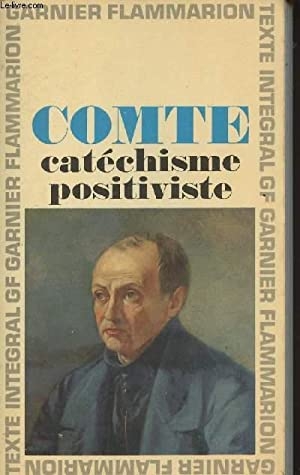
La définition des fascismes comme phénomène anti-moderne facilite évidemment l'intégration de l'ancien système d'exclusions et d'inclusions dans le nouveau, qui se définit lui-même en s'identifiant tout court à la modernité et au progrès (rien n'est plus moderne et progressiste que le scientisme).
Il est évident qu'une société fondée sur une théologie civile scientiste ne peut être démocratique, car il n'y a pas, et il ne peut y avoir, de population capable d'accéder en masse aux connaissances, par exemple les mathématiques, et aux méthodes qui permettent de se faire une idée des pratiques des sciences des phénomènes. La viabilité d'un régime démocratique dans la réalité historique nécessite de nombreuses conditions culturelles et sociales préalables, mais sur le plan des principes, la démocratie moderne a absolument besoin d'un accord sur les affirmations suivantes : a) tous les hommes sont égaux, en ce sens que tous peuvent, au moins virtuellement, participer à une discussion rationnelle des fins que doit poursuivre la communauté, bien que la discussion des moyens à employer, et leur mise en œuvre, puisse et doive être réservée à une minorité techniquement capable; ensuite, b) un corollaire de a) : les hommes sont, au moins virtuellement, persuadables par des moyens rationnels, c'est-à-dire que tous les hommes participent, au moins virtuellement, à la même Raison, que j'écris avec une majuscule car elle ne coïncide PAS avec le seul intellect abstrait, et à laquelle on peut accéder par des moyens philosophiques, artistiques, religieux, sapientiaux.
Il s'agit du plus petit dénominateur commun humaniste sur lequel des cultures aussi diverses que le christianisme, le libéralisme classique et le socialisme ont trouvé un accord politique.
Or, la science des phénomènes n'est PAS en mesure de fournir la moindre indication quant aux fins (pourquoi nous vivons, comment nous devons vivre, ce que nous devons faire des découvertes de la science, etc.) Comte s'est rendu compte de ce fait dans un moment très difficile de sa vie personnelle, et c'est pourquoi il a inventé (avec un peu de copier-coller à partir de Condorcet et de Turgot) son projet dément de "Religion de l'Humanité", avec une Église et un Catéchisme positivistes, un Conseil des Scientifiques, etc., en invitant le Père Général des Jésuites à collaborer avec lui (il n'a pas eu de réponse à l'époque, mais ses imitateurs feront beaucoup mieux aujourd'hui). Je ne sais pas si les pouvoirs actuels ont réalisé qu'ils copient le projet de Comte, le fait est qu'ils le copient parce qu'ils se sont heurtés au problème qui a conduit le vieux Comte à l'inventer, et qui n'existait pas (encore) à l'époque.
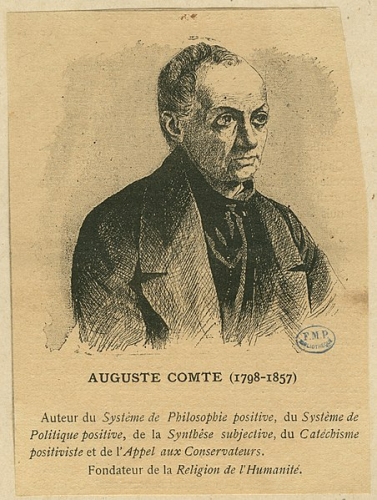
C'est-à-dire, le problème de gouverner une société composée de personnes qui, pour la plupart, ont introjecté le sens commun relativiste qui découle logiquement du scientisme et du libéralisme. Le bon sens relativiste, en termes simples mais clairs, dit que mon opinion est aussi bonne que la vôtre, et qu'il est impossible d'établir, par le biais d'une discussion rationnelle, qu'une affirmation est vraie et une autre fausse : "vraie" ou "fausse" non seulement sur le plan empirique, c'est-à-dire correcte ou incorrecte (par exemple parce que les données sur lesquelles nous basons l'argument sont correctes ou non) mais aussi, par exemple, sur le plan éthique et métaphysique, les niveaux les plus pertinents pour la détermination des fins ; car tout dépend du système de valeurs que l'on adopte, et on l'adopte toujours arbitrairement (= le système de valeurs affirmé par la plus grande force sociale s'applique, et il est inutile de se demander s'il est juste ou faux, bon ou mauvais).
Puisque toute société a besoin, pour ne pas imploser dans l'anarchie, que 90% du travail de contrôle social soit effectué par la norme interne, et seulement 10% par la norme externe (police, tribunaux, etc.), on voit bien à quel point est instable une société où 90% de la population partage un sens commun relativiste, chacun pensant avoir droit à son opinion qui est aussi bonne qu'une autre, et tendant à rejeter le principe d'autorité ("Qui suis-je pour juger ?" disait le Vicaire du Christ).
La seule bouée de sauvetage à laquelle s'accrocher pour ne pas se noyer dans l'anarchie et l'anomie, et pour contrôler, bien ou mal, une société très compliquée et délicate comme la société industrielle, semble être la science, que tout le monde respecte parce que a) elle garantit la vie quotidienne b) elle met à disposition un pouvoir immense, c'est-à-dire qu'elle remplace les deux sources traditionnelles de la norme intérieure, la coutume (vie quotidienne) et la religion (toute-puissance divine). Malheureusement, la science des phénomènes sait inventer des choses folles, mais elle ne nous dit absolument rien sur la façon de vivre, sur l'utilisation des choses folles qu'elle invente, etc.
À ce stade, le passage obligé pour les pouvoirs en place est la réédition du programme comtien, c'est-à-dire l'invention de toutes pièces d'une religion scientifique qui se sait fausse, parce qu'elle a une finalité purement instrumentale : il ne s'agit pas de la vieille politique d'instrumentalisation de la religion, mais de la fondation d'une nouvelle religion de parfaite et totale mauvaise foi, ou, en d'autres termes, de l'adoption totalement arbitraire - mais il n'y en a pas d'autre - d'un système de valeurs officiel qui se présente comme une religion laïque. Bien sûr, cela est fait "pour le bien de l'humanité". Comme le Don Juan de Molière dit au mendiant qui lui demande l'aumône "pour l'amour de Dieu" : "Je te la donne pour l'amour de l'humanité".
À l'époque de Comte, ses collègues, scientifiques et philosophes positivistes, attribuaient l'invention de la religion positiviste à un émoussement de ses facultés, car au milieu du XIXe siècle, le milieu social était encore nourri et stabilisé par des coutumes et une religion pré-modernes ; et non seulement il n'était pas nécessaire de formaliser la " religion de l'humanité ", mais tout le monde, positivistes compris, aurait réagi au moins avec embarras, sinon par rejet, devant cette parodie absurde, ridicule et inquiétante du christianisme. Eh bien, maintenant le besoin est là et la réaction de rejet n'est même pas le pape, et ainsi de suite avec le projet Comte 2, la Revanche.
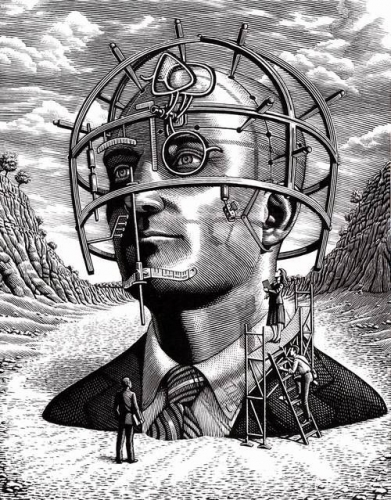
Dans le Projet Comte 2, la Revanche, la manipulation psychologique des masses prend une importance énorme, parce que a) la "science" ne nous dit rien sur la persuadabilité des hommes en tant que participants à une Raison commune (métèxis, un concept métaphysique ou religieux) b) la "science" nous dit par contre beaucoup de choses sur la manipulabilité psychologique des hommes. La règle de base du positivisme est la suivante : "il n'y a pas de science sans faits". Puisque l'observateur et l'organe observé coïncident, il n'est pas possible d'avoir une observation des phénomènes intellectuels en action, aussi, considérant comme impossible la description des processus mentaux et du psychisme comme indépendants des faits physiologiques ou sociaux, Comte ramène la psychologie à la biologie et à la sociologie : et c'est là que se trouve l'origine du Pass Vert et des méthodes behavioristes avec lesquelles il est introduit.
Je rappelle en passant qu'en ce qui concerne l'humanité sur laquelle se fonde la religion, la science des phénomènes - en l'occurrence la génétique - ne peut nous dire qu'une seule chose : que tous les hommes, quelle que soit la race à laquelle ils appartiennent, partagent, avec des variations minimes, le même patrimoine génétique, c'est-à-dire qu'ils appartiennent tous à l'espèce humaine. La science des phénomènes, cependant, ne nous dit PAS comment traiter cette espèce parmi les espèces qu'est l'espèce humaine. Si l'on voulait en maximiser le rendement, par exemple, même selon un critère positiviste classique comme l'utilitarisme, "le plus grand bien pour le plus grand nombre", il conviendrait certainement d'élaguer son bois mort, c'est-à-dire de prévoir avec des méthodes appropriées une vaste politique eugénique, qui favorise les caractéristiques génétiques les plus favorables et décourage les moins favorables, en s'insérant - comme c'est la norme pour toutes les sciences des phénomènes - dans les chaînes causales (pas toutes identifiées) du phénomène "espèce humaine". Dans un si petit projet, il y a tout, et dans ce tout, il y a des choses qu'aujourd'hui personne n'est capable d'imaginer, et c'est encore mieux parce que les imaginer pourrait donner des cheveux blancs.
19:41 Publié dans Définitions, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : définition, libéralisme, théologie civile, philosophie, positivisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Sur la coercition libérale
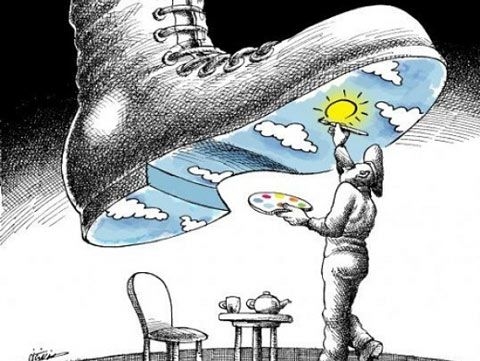
Sur la coercition libérale
par Andrea Zhok
Source : Andrea Zhok & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/sulla-coercizione-liberale
Les États peuvent, dans certaines conditions d'urgence, exercer des actes de contrainte et de coercition sur leur population.
La coercition classique, comme l'appel aux armes pour la défense de la patrie, était exercée à la fois comme un appel éthique à l'effort pour protéger l'ensemble de la communauté et comme une prise de responsabilité par le souverain, qui garantissait la justesse (et la bonne gestion) de l'initiative.
Cette prise de responsabilité, automatiquement implicite dans l'acte de coercition publique, n'est pas sans conséquences: en cas de résultat néfaste de cette initiative forcée, les gouvernants sont appelés à rendre des comptes. Pas légalement, avec une forme de "responsabilité limitée", mais physiquement, en personne. Le résultat typique des défaites militaires était, et est toujours, le renversement des dirigeants qui ont promu l'action, et souvent leur fin peu glorieuse ou violente.
Cette prémisse nous permet de nous concentrer sur ce qui est particulièrement indécent dans la forme de "coercition douce" associée à des initiatives telles que le Green Pass.
Si nos dirigeants étaient absolument sûrs de ce qu'ils font, s'il était vrai que le seul moyen de faire face à la pandémie à ce stade est la vaccination généralisée, s'ils étaient vraiment certains - comme ils le prétendent - que l'opération est totalement sûre en termes de conséquences pour la santé des citoyens, alors il n'y aurait aucun problème à prendre la voie de l'obligation universelle.
Cela créerait, comme il se doit, deux groupes clairement définis: ceux qui assument la responsabilité des décisions et ceux qui les subissent. L'ensemble des citoyens serait du même côté, serait uni par un destin commun, et pourrait éventuellement être mobilisé en commun si quelque chose dans la voie empruntée s'avérait erroné ou fatal.
Mais - en dépit de toutes les proclamations - ce n'est pas du tout le cas. Et c'est pourquoi la forme typique de la coercition libérale est adoptée : la coercition déguisée, jouée comme s'il s'agissait d'un libre choix.
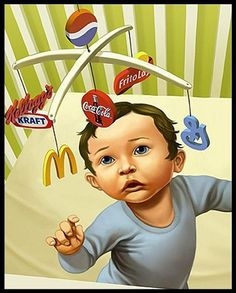
Il est important de voir qu'il s'agit d'un modèle classique, et non d'une invention récente datant de l'apparition du Covid. Le modèle libéral est celui qui vous dit que si vous ne voulez pas travailler pour une croûte de pain, vous êtes libre de mourir de faim. Le modèle libéral est celui qui lacère systématiquement la société parce qu'il met tout le monde en concurrence avec tout le monde, vous apprenant à voir votre voisin comme un adversaire.
Ainsi, le modèle libéral de coercition appliqué à l'urgence Covid est celui qui vous dit que personne ne vous oblige à vous vacciner, c'est votre libre choix.
Bien sûr, si vous ne le faites pas, ou si vous n'obligez pas vos enfants à le faire, eh bien, vous oubliez le cinéma, la salle de sport, le restaurant, le théâtre, le bar, la piscine, le train, l'avion, l'université et souvent même le travail.
Mais c'est votre choix et personne ne vous y oblige.
Alors, c'est vrai, à part ça, si vous ne le faites pas, vous êtes aussi montré du doigt comme un traître, un ennemi du pays, un crétin, un paranoïaque, un égoïste, un ignorant et un perdant, alimentant la haine ou le mépris des autres.
Mais soyons clairs, vous pouvez exercer un choix libre.
Et si vous voulez exercer votre libre choix, prendre votre propre rendez-vous, signer une renonciation, montrer votre consentement (non)éclairé, très bien.
N'oubliez pas que vous l'avez demandé.
Cette procédure permet à la gouvernante de faire face à n'importe quel pari en toute sérénité.
Qui aurait envie d'imposer un médicament expérimental à un jeune garçon ou à une femme enceinte en l'absence de preuves accablantes que les autres solutions sont pires?
Mais avec la forme libérale de la coercition, le problème ne se pose pas. L'obligation existe à toutes fins utiles, mais elle prend l'apparence d'un choix personnel, dont la personne qui choisit est responsable.
Si - Dieu nous en préserve - nous devions découvrir dans quelques années que le pari a mal tourné, qu'il y a eu des conséquences importantes, qui, selon vous, pourrait être appelé à rendre des comptes ?
Dans quelques années, les mêmes personnes qui se déchaînent aujourd'hui avec des règlements et des certitudes apodictiques ne seront plus disponibles.
Qui s'occupera de ses quatre grands danois dans sa propriété de campagne, qui bénéficiera d'une pension dorée, qui aura été promu à un autre poste prestigieux.
Toute plainte, tout dommage sera résolu par un haussement d'épaules des nouveaux "managers" et quelques gratifications extraites du trésor public.
En tout état de cause, même si le pari réussit, ou avec des dommages collatéraux qui ne sont pas massifs, nous en serons sortis grandis : le pays une fois de plus divisé, avec un sentiment généralisé d'impuissance et d'irresponsabilité générale.
19:17 Publié dans Définitions, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : définition, libéralisme, coercition, philosophie, philosophie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 12 août 2021
Fidélité et persévérance, la force d’orienter le combat (Julius Evola)
12:16 Publié dans Philosophie, Révolution conservatrice, Synergies européennes, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julius evola, tradition, traditionalisme, révolution conservatrice |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 11 août 2021
Etat d'exception et mort du politique

État d'exception et mort du politique
Mariano Allocco
SOURCE : https://electomagazine.it/stato-deccezione-e-morte-della-politica/
Début 2020, quelques jours de vie avec le virus ont suffi pour faire passer l'Italie d'un état de droit à un "état d'exception" et la prolongation du confinement, la cinquième, jusqu'au 31 décembre 2021, a consolidé un état d'urgence qui a débuté le 31 janvier 2020; les décrets du Premier ministre visant à contenir le Coronavirus sont en fait une limitation de nos libertés.
Un Occident fragile et présomptueux s'est soudainement retrouvé face à un redde rationem et la question qui se pose maintenant est la suivante : jusqu'où ira l'"État d'exception" et jusqu'où ira-t-il ?
En 1922, Carl Schmitt a défini le souverain comme "celui qui décide en état d'exception", un terme qui indique les mesures exceptionnelles prises en temps de crise et qui doit être compris à la lumière de l'ancienne maxime selon laquelle "necessitas legem non habet".
Cependant, nos Pères constituants n'ont pas pris cette hypothèse en considération, car il était impensable que le Premier ministre puisse devenir Souverain et cette hypothèse n'était pas non plus plausible pour le reste de l'Occident.
Au demeurant, c'est l'"état d'exception" du siècle dernier qui a accompagné les dérives qui ont conduit au totalitarisme.
Ce n'est pas un droit spécial, c'est la suspension plus ou moins modulée de la loi qui apparaît aujourd'hui comme une technique de gouvernement mise en œuvre avec l'extension toujours plus grande des pouvoirs de l'exécutif par l'émission de décrets et de mesures prises, justement, dans un "état d'exception".
L'exercice de cette prérogative érode de fait la démocratie, une institution récente telle que nous la connaissons, qui est aujourd'hui également mise à mal par un virus.
L'activité législative du Parlement est de facto marginale, tandis que dans le pays, par le bas, le pouvoir de décision des conseils locaux est désormais un simulacre.
L'"État d'exception" s'est imposé sur la base d'un principe selon lequel la nécessité caractérise une situation singulière dans laquelle la loi perd son pouvoir et devient progressivement le fondement et la source du droit.
Le droit n'admet pas de lacunes et si le juge doit juger même en présence de vides législatifs, par extension, lorsqu'une lacune du droit public apparaît, le pouvoir exécutif a l'obligation d'y remédier: c'est l'"État d'exception" qui s'est soudainement installé.
Les lois non écrites, celles de la nécessité, l'emportent sur le droit, qui réagit en conséquence, mais se trouve dans une position défensive, dénonçant la fragilité qui caractérise l'Occident même sur ces fronts.
Dans l'"état d'exception", la décision suspend ou annule les normes, les rituels, les délais et les procédures qui, dans une démocratie, constituent la substance.
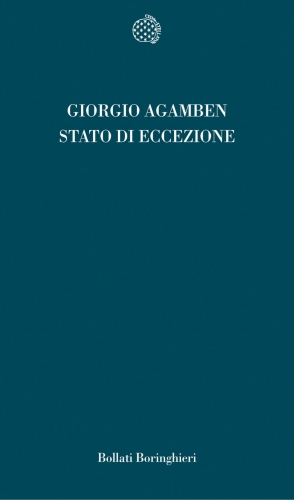
"Ce que l'arche du pouvoir contient en son centre, c'est "l'état d'exception" (Giorgio Agamben, 2003), et c'est une machine qui a fonctionné à travers le fascisme, le national-socialisme et les régimes communistes, nous atteignant de manière feutrée mais efficace, et qui se réaffirme aujourd'hui dans tout l'Occident à cause d'un virus.
"En temps de crise, le gouvernement constitutionnel doit être modifié dans la mesure où cela est nécessaire pour neutraliser le danger et rétablir la situation normale - .... - le gouvernement aura plus de pouvoir et les citoyens moins de droits... la démocratie est l'enfant de la paix et ne peut vivre sans sa mère" (C. L. Rossiter, NJ, 1948), des mots écrits dans l'immédiat après-guerre, mais toujours pertinents maintenant que l'État belligérant n'est pas nécessairement sanglant.
Brèves réflexions sur une question qui a refait surface avec ardeur dans un Occident caractérisé par une fragilité déjà évidente après le 11 septembre 2001, mais qu'il faut maintenant aborder, avant qu'elle ne devienne incontrôlable.
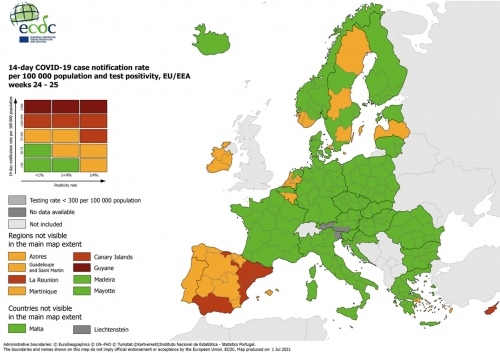
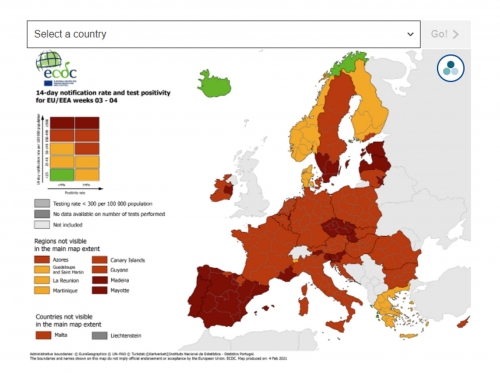
Les frontières mouvantes, à grande vitesse, s'instaurent à une cadence inouïe dans une Europe qui se voulait sans frontières, qui proclamait le droit de tous à la libre circulation...!
Une autre question est claire: le concept de "frontière" attaqué au début de ce millénaire est maintenant revenu avec toute son ancienne puissance pour marquer les cartes de différentes couleurs, à commencer par celle d'une Europe qui doit retrouver son âme, et ce qui s'est passé à Barcelone est un signe clair de fatigue.
L'obligation de rester chez soi, entre quatre murs, a également ravivé la signification du "mur" en tant qu'instrument de défense.
Un scénario complexe qui propose un défi à ramener dans la seule sphère possible, celle de la Politique, entendue comme l'art de rendre possibles les choses nécessaires.
La politique, cependant, est sans défense dans un état d'exception.
Mariano Allocco

19:31 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, philosophie politique, état d'exception, carl schmitt, giorgio agamben, théorie politique, droit, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 08 août 2021
"Qui suis-je ?" L'anthropologie métaphysique de Yuri Mamleev

"Qui suis-je ?" L'anthropologie métaphysique de Yuri Mamleev
Rosa Semikina
Traduction par Juan Gabriel Caro Rivera
Source: https://www.geopolitica.ru/es/article/quien-soy-yo-la-antropologia-metafisica-de-yuri-mamleev
Yuri Mamleev est une figure majeure de la littérature russe, considérée par beaucoup comme un mythe, ainsi qu'un écrivain radical et mystérieux. On peut même dire qu'il a été le "pionnier" de la littérature russe contemporaine, lorsqu'il a commencé à écrire en 1960 : ses écrits étaient très "différents" des tendances et des courants artistiques qui dominaient à l'époque. Mamleev était un mystique et un ésotériste, se définissant comme un esprit ou un témoin qui recevait des messages provenant d'une autre réalité ; c'est pourquoi ses œuvres créent un monde très particulier : les morts reviennent à la vie, les monstres, les psychopathes, les maniaques, les meurtriers et les suicidés rationalistes apparaissent aux côtés d'êtres marginaux, de "sous-hommes" et de créatures non anthropomorphes. Ces "êtres déroutants" (provocateurs) ne se trouvent que dans des situations extrêmes et exceptionnelles (aux frontières ou au milieu de l'"écart" entre l'être et le non-être) ; ils explorent tous le mystérieux, l'inexplicable, le transcendant, ils raisonnent sur l'éternité et l'infini, la mort et l'immortalité, en essayant de trouver des preuves de l'existence de la divinité, en essayant de trouver leur "chemin vers l'abîme" et de répondre à cette question éternellement dérangeante : "Qui suis-je ? Bien sûr, cette question est posée non pas dans un sens psychologique, mais dans un sens métaphysique.....
Mamleev explique cette dimension de son travail dans une interview : "Mon travail est une description matérialiste de l'enfer terrestre, des désastres spirituels, des faces cachées et non conventionnelles de l'âme humaine". Il admet que sa philosophie "est née d'une évaluation négative du monde". Mais la "nuit noire de l'âme", qu'il a un jour vécue en lui-même et qui est une constante de ses personnages, n'est rien d'autre qu'une étape nécessaire de l'"initiation" qui mène à la lumière, à Dieu et à la catharsis.
Par conséquent, la représentation fantasmagorique et surréaliste de ses personnages, des situations qu'ils vivent et des événements qu'ils vivent a, avant tout, une justification métaphysique, philosophique (car selon Mamleev le "réalisme métaphysique" de son œuvre "exige avant tout de s'immerger intensément dans notre réalité tout en traitant des problèmes globaux et métaphysiques") ou "intuitive" qui nous permet de démêler le sous-texte caché dans ses écrits. Deuxièmement, il s'agit de provoquer un choc ou un coup qui amène le lecteur à s'arrêter, à réfléchir et à commencer à "reconstruire" l'alchimie humaine qui se cache derrière tout cela. Bien sûr, cette "méta-exposition" ne garantit pas le retour à une pleine intégrité spirituelle, mais on ne peut ignorer qu'"une telle opération implique un processus de purification". Par exemple, dans l'histoire de Pensées du soir, Mikhaïl Saveliev, "un meurtrier et voleur bien connu et très âgé", se souvient un jour d'un événement qui s'est produit aux alentours de Pâques : alors qu'il était encore un jeune homme, il est entré dans l'appartement d'un autre et a tué deux personnes avec une hache, un homme et sa femme, mais "soudain, un petit garçon d'environ cinq ans, qui n'avait ni vu ni compris ce qui se passait, est sorti de la baignoire au bout du couloir : il était blanc, innocent, brillant et tendre. Il me regarde, regarde son oncle, et dit soudain : le Christ est ressuscité ! Il dit cela avec tant d'amour et de joie que j'ai compris ce qu'est vraiment Pâques. À ce moment-là, j'ai eu un malaise ; en un seul instant, j'ai eu l'impression que mon corps était traversé par un éclair et je suis tombé par terre, inconscient". Cet enfant grossier et innocent le sauve, car ses paroles ont un pouvoir surnaturel : cette "anecdote métaphysique" fait un trou dans l'âme du criminel qui le pousse à se repentir de ses crimes et à se retrouver dans un monastère.
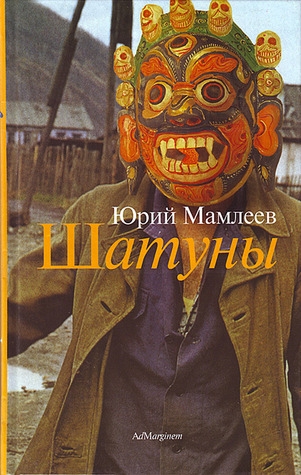 Les personnages de Mameleev sont souvent décrits comme des monstres, mais il s'agit là d'une appréciation superficielle : "ce sont des monstres parce qu'ils veulent percer les mystères qui se trouvent au-delà de l'esprit humain", déclare Mameleev. "Ils veulent briser le flux de la vie quotidienne et répondre à des questions éternelles hors de notre expérience, alors ils deviennent inévitablement des monstres. Je m'intéresse précisément à ces voyageurs et héros de l'au-delà.
Les personnages de Mameleev sont souvent décrits comme des monstres, mais il s'agit là d'une appréciation superficielle : "ce sont des monstres parce qu'ils veulent percer les mystères qui se trouvent au-delà de l'esprit humain", déclare Mameleev. "Ils veulent briser le flux de la vie quotidienne et répondre à des questions éternelles hors de notre expérience, alors ils deviennent inévitablement des monstres. Je m'intéresse précisément à ces voyageurs et héros de l'au-delà.
Les schémas inhabituels de pensée philosophique et artistique de Mamleev entraînent naturellement des divergences dans la définition de sa méthode de création, l'amenant même à dire que "ses créations pourraient être considérées comme une sorte de réalisme métaphysique". M. Mamleev a publié plus de quarante livres en Russie et à l'étranger. Il est également le fondateur d'une école littéraire et philosophique et le lauréat du prix Andrei Biely et du prix international Pouchkine. On sait qu'un groupe de jeunes auteurs s'est formé autour de lui et qu'ils ont tous participé à un projet philosophico-littéraire connu sous le nom de "Mystère de l'infini". La plupart des idées de ce projet ont été publiées dans divers almanachs tels que Mystery of Infinity, The Equinox et Equinoxe. Vers un nouveau mysticisme. Depuis 2005, les éditions Ripol-klassik publient une collection intitulée "Bibliothèque du réalisme métaphysique", également appelée "Métaprose". On pourrait dire que Mamleev est le fondateur d'un courant littéraire.
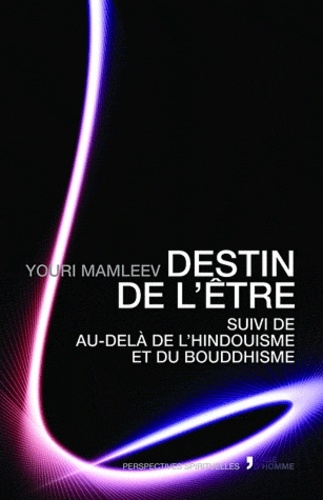 Mamleev explique sa conception du réalisme métaphysique et de la métaphysique en général dans son livre The Fate of Being.
Mamleev explique sa conception du réalisme métaphysique et de la métaphysique en général dans son livre The Fate of Being.
Si la philosophie académique définit la métaphysique comme l'origine des idées suprasensibles de l'être, "désignant ainsi la tentative de la pensée et de la raison d'aller au-delà du monde empirique pour atteindre une réalité extra-empirique", alors nous pouvons dire qu'il s'agit de la connaissance de "l'être comme étant", c'est-à-dire, de la "connaissance de Dieu et de la substance suprasensible" (Aristote), ce qui a ensuite conduit la philosophie à considérer la métaphysique comme une forme d'"interrogation par laquelle nous essayons d'embrasser la totalité de l'être et pour que finalement celui-ci, que nous interrogeons sans cesse, nous interroge aussi" (M. Heidegger, Problèmes fondamentaux de la phénoménologie).
Y. Mamleev considère que la métaphysique fait partie du "monde des essences spirituelles", c'est-à-dire de "la sphère du supra-cosmique, du divin, de ce qui fait partie de l'originel et du spirituel en soi : on peut dire que le monde du cosmos "invisible" fait partie d'un autre type de connaissance". C'est ce que Mamleev appelle les principes métaphysiques (ou "réalités") qui sous-tendent l'univers et qui nous révèlent le "cours nébuleux d'autres mondes" et d'autres époques, le tout nous aidant à déchiffrer les symboles cachés de l'existence humaine. Ces "questions éternelles que l'esprit humain adresse souvent à ce Principe Primordial - aussi naïf soit-il du point de vue de l'absolu - qui reste silencieux, ont souvent une dimension métaphysique".
La "réalité métaphysique" est présente a priori dans tous les mondes, indépendamment de leur degré de "matérialisation", de sorte qu'il leur est possible de s'exprimer plus profondément et plus complètement en littérature qu'en philosophie. En effet, l'"image" est beaucoup plus multiforme que l'"idée", car la première "exprime plus facilement ce qui ne peut être pensé" (La liberté dans la poésie russe). Les héros de ce genre de littérature seraient avant tout des réalités philosophiques et métaphysiques telles que le Néant, la chose-en-soi, le "je" transcendantal, etc. Il est possible qu'il s'agisse du type de littérature dont parle Daniel Andreïev dans son livre La Rose du monde : "Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez comprendre le sens des choses inhérentes à la Rose de la paix : car c'est ainsi que vous percerez la réalité physique pour accéder à différents niveaux, tant matériels que spirituels. <...> Je crois qu'un tel art... devrait être appelé réalisme translucide ou méta-réalisme". Sans aucun doute, c'est Y. Mamleev est l'auteur qui a le plus développé ce méta-réalisme.
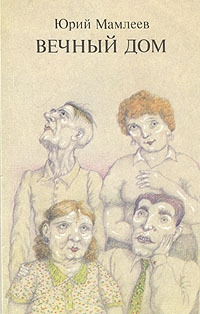 L'anthropologie de Mamleev part d'une compréhension du cosmicisme et des stratifications métaphysiques de l'homme, sans parler du lien métaphysique entre l'homme et le monde. Selon Mamleev, "... l'homme est un espace où le ciel et la terre sont reliés. En outre, l'homme est relié au monde physique, au monde intermédiaire (c'est-à-dire le monde subtil et parallèle) et au monde divin. Par conséquent, il existe des gouffres à l'intérieur de l'homme qui appartiennent à des mondes supérieurs, divins et ... sataniques..... L'homme est à la fois une bête et un ange, relié à des êtres qui lui sont inférieurs et supérieurs..... ... le ciel et la terre sont réunis en lui" (Russie éternelle).
L'anthropologie de Mamleev part d'une compréhension du cosmicisme et des stratifications métaphysiques de l'homme, sans parler du lien métaphysique entre l'homme et le monde. Selon Mamleev, "... l'homme est un espace où le ciel et la terre sont reliés. En outre, l'homme est relié au monde physique, au monde intermédiaire (c'est-à-dire le monde subtil et parallèle) et au monde divin. Par conséquent, il existe des gouffres à l'intérieur de l'homme qui appartiennent à des mondes supérieurs, divins et ... sataniques..... L'homme est à la fois une bête et un ange, relié à des êtres qui lui sont inférieurs et supérieurs..... ... le ciel et la terre sont réunis en lui" (Russie éternelle).
Le microcosme humain est un reflet du macrocosme du monde : la spécificité métaphysique de l'homme n'est pas seulement qu'il est un lieu où "le ciel et la terre sont reliés", mais aussi que les êtres humains sont des "fissures" par lesquelles on peut pénétrer dans d'autres mondes. L'âme humaine (Mamleev l'appelle "l'archétype de l'âme de l'Univers") contient en elle un code universel. L'homme en tant que phénomène psycho-bio-social n'a pas d'importance ("surtout parce qu'il a été tellement étudié dans la littérature"), car le but du réaliste métaphysique est de connaître "l'invisible, l'homme caché" et pour cela il faut aller au-delà de la psychologie des profondeurs. L'homme de chair et de sang n'est rien d'autre qu'un fragment du "lieu métaphysique qu'occupe l'homme". Et si le réalisme traditionnel nous amène à postuler l'existence de deux gouffres à l'intérieur de notre âme, l'inférieur et le supérieur, alors nous pouvons dire que le but de Mamleev est de créer une vision multidimensionnelle de l'espace intérieur de l'homme qui nous permet d'observer toute une multitude de gouffres en nous. Selon H. Hesse, "la vie de tous les hommes n'oscille plus entre deux pôles, par exemple l'instinct et l'âme, ou le saint et le libertin, mais oscille entre des milliers, entre d'innombrables paires de pôles.... c'est une fatale nécessité innée chez tous les hommes de se représenter chacun son moi comme une unité.... Mais en réalité, aucun moi, même le plus naïf, n'est une unité, mais un monde hautement multiforme, un petit ciel d'étoiles, un chaos de formes, de gradations et d'états, d'héritages et de possibilités..... Car, bien sûr, la poitrine, le corps n'est jamais plus qu'un ; mais les âmes qui vivent à l'intérieur ne sont pas deux, ni cinq, mais innombrables ; l'homme est un oignon de cent pelures, un tissu composé de nombreux fils" (Steppenwolf).

Une telle idée (ou "connaissance spéciale") de l'homme et du monde implique que l'écrivain ait une tâche très spécifique : premièrement, il doit voir derrière la vie visible les aperçus d'une "réalité beaucoup plus formidable", qui "doit être mise à nu et rendue visible et, malgré le caractère écrasant d'une telle tâche, nous devons découvrir les abîmes de l'être ; deuxièmement, il est nécessaire de révéler les abîmes intérieurs de l'âme humaine que nous observons dans notre comportement, notre vie spirituelle et nos peurs subconscientes. Une fois que nous avons obtenu que les personnages expriment ces comportements, nous obtenons ce que Dostoïevski appelle le "réalisme fantastique" (voir : La voix du néant. Histoires. M., 1991). Mamleev a trouvé plusieurs façons de représenter cet être métaphysique ou "situation métaphysique de l'homme". Par exemple, à travers la "profondeur du symbolisme", mais de manière à ce que l'on perçoive clairement que l'homme n'est pas seulement l'être humain, mais que "dans ses profondeurs... un autre être est caché", un être secret et transcendantal qui se dépasse en tant qu'homme de chair et de sang et dont nous n'avons aucune idée de l'existence ("car l'homme de chair et de sang n'est qu'un fragment de la réalité humaine"). Une autre façon de représenter ce problème serait de dire que l'homme extérieur n'est rien d'autre qu'une projection de l'homme intérieur, une fente ou une fenêtre qui nous permet d'entrevoir une sorte d'essence secrète. Il existe cependant un troisième mode de représentation qui consiste à penser l'homme comme une entité métaphysique, une monade originelle et éternelle, un archétype métaphysique, "un certain domaine autonome qui, bien sûr, n'est pas de ce monde...". L'homme n'est pas seulement un être mystérieux, mais aussi un être inconnaissable qui est "enraciné intérieurement dans l'infini et l'inconnu". Les limites de notre connaissance de nous-mêmes le prouvent". Il ne s'agit pas d'un type ou d'un caractère spécifique, mais d'une "centralité métaphysique" propre à notre moi intérieur.
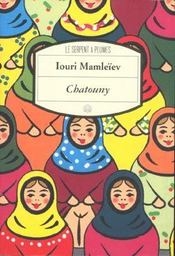 Mamleev ne se considère pas comme le créateur du réalisme métaphysique et cite donc comme exemples de cet art les créations de Dante ou l'alchimie spirituelle du Moyen Âge, qui révélait l'existence d'un homme caché qui "ne peut être réduit à la connaissance superficielle fournie par la psychologie moderne la plus sophistiquée". Seule la littérature russe, que Mamleev considère comme la plus philosophique de toutes, a "su éclairer [...] les abîmes spirituels de l'homme et sa constante disposition à se tourner vers l'extase ou le rêve [...]", de sorte que "la littérature est devenue une forme de vie et de mort" et le texte une "preuve de la vie intérieure de l'homme". Les héros de la littérature russe "glissent constamment dans l'abîme... dans un échec qui devient un échec complet de l'existence en raison de l'instabilité et du caractère catastrophique et apocalyptique de la vie terrestre". Dans la littérature russe du XIXe siècle, un tournant ontologique s'est opéré, les œuvres de Gogol et de Dostoïevski ayant donné naissance à la littérature métaphysique du futur. N.V. Gogol a été le premier à s'aventurer dans ce monde qui dépasse l'esprit du monde réel en appelant ses personnages des "âmes mortes". Dans ces mots, nous pouvons "voir" l'horreur métaphysique d'un écrivain qui s'approche des abîmes de l'être. En revanche, le "réalisme fantastique" de F.M. Dostoïevski rompt avec les codes esthétiques du XIXe siècle, puisque sa quête artistique repose sur une idée "fondamentale et clé" selon laquelle la vie est plus fantastique que toute fantaisie. Tout ceci définit le véritable programme du réalisme métaphysique.
Mamleev ne se considère pas comme le créateur du réalisme métaphysique et cite donc comme exemples de cet art les créations de Dante ou l'alchimie spirituelle du Moyen Âge, qui révélait l'existence d'un homme caché qui "ne peut être réduit à la connaissance superficielle fournie par la psychologie moderne la plus sophistiquée". Seule la littérature russe, que Mamleev considère comme la plus philosophique de toutes, a "su éclairer [...] les abîmes spirituels de l'homme et sa constante disposition à se tourner vers l'extase ou le rêve [...]", de sorte que "la littérature est devenue une forme de vie et de mort" et le texte une "preuve de la vie intérieure de l'homme". Les héros de la littérature russe "glissent constamment dans l'abîme... dans un échec qui devient un échec complet de l'existence en raison de l'instabilité et du caractère catastrophique et apocalyptique de la vie terrestre". Dans la littérature russe du XIXe siècle, un tournant ontologique s'est opéré, les œuvres de Gogol et de Dostoïevski ayant donné naissance à la littérature métaphysique du futur. N.V. Gogol a été le premier à s'aventurer dans ce monde qui dépasse l'esprit du monde réel en appelant ses personnages des "âmes mortes". Dans ces mots, nous pouvons "voir" l'horreur métaphysique d'un écrivain qui s'approche des abîmes de l'être. En revanche, le "réalisme fantastique" de F.M. Dostoïevski rompt avec les codes esthétiques du XIXe siècle, puisque sa quête artistique repose sur une idée "fondamentale et clé" selon laquelle la vie est plus fantastique que toute fantaisie. Tout ceci définit le véritable programme du réalisme métaphysique.
N. Berdiaev disait que F. Dostoïevski était "le plus grand métaphysicien russe", un "symboliste métaphysique", et il était donc convaincu que le monde artistique incarné dans les romans de Dostoïevski ne pouvait être compris qu'à la lumière de ses découvertes sur l'essence métaphysique de l'homme et sa position dans le monde. Lorsque Dostoïevski déclarait "Je ne suis pas psychologue...", il voulait dire précisément que l'homme psycho-social est impossible à représenter si l'on ignore sa dimension métaphysique, de sorte que l'homme doit être considéré comme une monade originelle et éternelle, un archétype métaphysique, un concept clé de la structure ontologique de la réalité et une "énigme cosmique" (I. Yevlampiev).
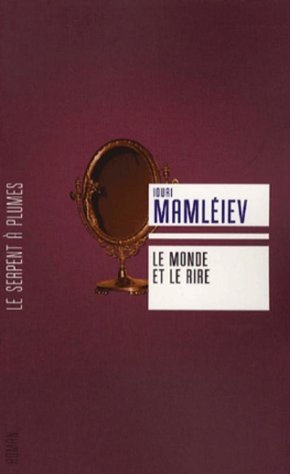 Le déploiement du code métaphysique caché qui se trouve au-delà de l'homme empirique (ou "externe", comme l'appelle Mamleev) est une tentative d'atteindre un "réalisme supérieur" (Dostoïevski : "Je suis un réaliste au sens le plus élevé du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui décrit les profondeurs de l'âme humaine"). Mamleev, qui suit en cela Gogol et Dostoïevski, considérait que ces antinomies, ces abîmes, ces orphelinats, ces destructions intérieures, ces omniprésences et la recherche de Dieu par l'âme russe n'étaient pas artificiels, mais faisaient partie de "l'hystérie métaphysique de l'esprit russe, de sa tentative de dépasser toutes les limites et les normes" (N. Berdyaev).
Le déploiement du code métaphysique caché qui se trouve au-delà de l'homme empirique (ou "externe", comme l'appelle Mamleev) est une tentative d'atteindre un "réalisme supérieur" (Dostoïevski : "Je suis un réaliste au sens le plus élevé du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui décrit les profondeurs de l'âme humaine"). Mamleev, qui suit en cela Gogol et Dostoïevski, considérait que ces antinomies, ces abîmes, ces orphelinats, ces destructions intérieures, ces omniprésences et la recherche de Dieu par l'âme russe n'étaient pas artificiels, mais faisaient partie de "l'hystérie métaphysique de l'esprit russe, de sa tentative de dépasser toutes les limites et les normes" (N. Berdyaev).
Saltikov-Chtchedrine a compris que Dostoïevski "ne se distancie pas seulement de nous", mais que le secret qui fait de lui un Autre réside dans le fait que l'écrivain "pénètre au-delà du champ de l'immédiat, dans la prospective et le pressentiment, ce qui est le champ des grandes questions de l'humanité". C'est précisément dans ce "champ" où l'on perçoit "le caché, l'incompréhensible, le chaotique, le grandiose et l'abîme sans fond" que pénètre le regard artistique de Mamleev, car c'est précisément cette recherche qui détermine l'être de tous ses personnages ou "êtres métaphysiques". Mamleev, cependant, donne à cet être une existence réelle, ce qui le rapproche du réalisme magique de la littérature latino-américaine du 20e siècle, où le réel et le magique, le banal et le fantastique se confondent. Mais contrairement au réalisme magique, Mamleev "n'a pas eu recours au mythe, mais à une sorte de prose très traditionnelle et ordinaire, incorporant toutes les facettes de la réalité en elle..... comme un tissu métaphorique... Nous parlons donc d'un genre complètement nouveau... où le métaphorique, le métaphysique et le symbolique finissent par être "incorporés" dans l'histoire réaliste et où tout cela réalise une synthèse" (1). Une telle synthèse est "l'une des variantes de tous les processus artistiques du vingtième siècle où interagissent des systèmes de pensée non classiques" (2).
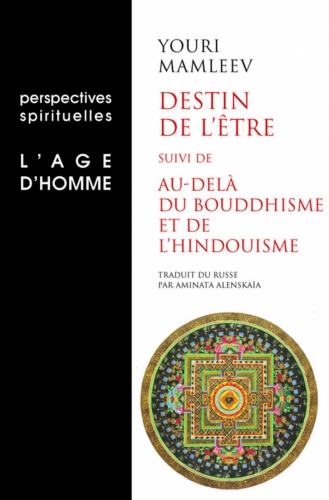
Toutefois, il est possible de parler d'un autre type d'"interaction". Les personnages de Mamleev, capturés par cette "autre réalité", changent non seulement extérieurement, mais aussi dans leur "essence", c'est-à-dire qu'une alchimie humaine a lieu. Mamleev appelle les transformations "miraculeuses" de ses personnages des métaphores : les critiques d'art contemporain considèrent qu'il ne s'agit pas de métaphores mais de simulacres, d'images artificielles ou "d'images d'une réalité absente". Les œuvres de Yuri Mamleev sont généralement surchargées de citations et sont immergées dans un contexte culturel et artistique très large, révélant l'existence de différentes traditions littéraires. On trouve des traces évidentes de traditions telles que les Ménippées (genre satirique romain, n.d.t.) et des réalités grotesques du carnaval, où la mort et la fête convergent, dans des nouvelles telles que Les Noces et Cruelles rencontres. Les personnages monstrueux des Cruelles rencontres semblent sortis des gravures de Bosch et de Goya : des corps à deux têtes, des cadavres ambulants et un homme-ours. L'influence de la littérature d'horreur gothique et du romantisme d'Hoffmann et d'E. Poe est également évidente dans ces contes. Poe dans de tels récits. En outre, l'inspiration de Mamleev pour le fantastique russe classique est très évidente dans son écriture, en particulier les nombreuses références au Marchand de cercueils et au Festin pendant la peste de Pouchkine ou au Journal d'un fou et aux Âmes mortes de Nikolaï Gogol, mais surtout les références à Fyodor Dostoïevski sont très claires.
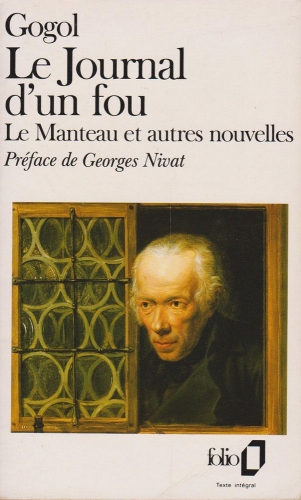
La poésie de Mamleev ne ressemble qu'extérieurement à des éléments postmodernes tels que la réalité virtuelle et les images-simulacres incarnées dans l'intertextualité brute, sombre, choquante, phénoménale et mixte de Mamleev qui polémique avec tous les auteurs qu'il cite (ces derniers dans le sens le plus large possible). La variabilité ludique qui se développe dans toutes ces collisions ou la manière dont les problèmes sont résolus donne parfois l'impression que la pensée de l'auteur est très incomplète et contribue à ce que ses œuvres soient perçues comme un texte ouvert et infini. Cependant, la réalité quotidienne est le fondement de toutes les œuvres de Mamleev. L'inconnu n'est pas conçu comme quelque chose de fantastique, mais comme une "réalité spirituelle intuitive". C'est pourquoi le réalisme de Mamleev est lié à sa tentative d'articuler son idée du monde avec une sorte de cosmo-anthropologie philosophique.
Vasia Kurolesov, l'un des "voyageurs métaphysiques" de Mamleev (L'abîme), confesse : "Tout est à sa place, comme il se doit, Dieu est Dieu, et pourtant, même après cela, je continue à courir et à courir ! Où devrais-je courir maintenant, ayant trouvé le Divin ? Seulement vers Toi, Seigneur, qui es en moi, vers le moi, ou bien je cours plutôt vers une distance qu'aucun signe ne peut révéler et que le vide ne peut exprimer ?
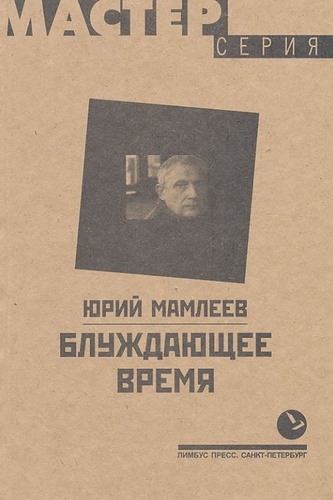 Ce sont des mots qui indiquent le chemin vers le supra-réel ou vers un abîme à l'extérieur - au-delà de tout ce qui est connu et imaginable - et à l'intérieur - où se trouvent les mystères de l'âme humaine. Cependant, il est inexact de définir les voyages dans ces œuvres par l'épithète "voyage dans l'espace". En outre, le chemin vers le transcendantal que suivent les personnages de Mamleev est toujours conditionné par le réalisme. Dans l'histoire du Coureur, la capacité de Vasia Kurolesov à voler à travers tout l'univers, visible et invisible, est le résultat de son imagination, étant en ce sens une conséquence (un symptôme) de la maladie mentale d'un homme qui a essayé de "se dépasser" et a dépassé ses limites. La partie la plus importante de l'histoire se trouve dans le chapitre intitulé "Notes d'un fou", qui est divisé en deux parties correspondant à deux phases de la maladie et à deux versions différentes de son fantasme : la première partie s'intitule "Notes de Vasia Kurolesov" ("quand il a fui son corps") et la deuxième partie s'intitule "Notes de Vasia Kurolesov après que Zamorisheva a vu qu'il était lui-même devenu un monstre de l'au-delà". Le personnage de Vasia Kurolesov fait référence à la tradition littéraire des "fous sages" (cf. Poprishchin dans le Journal d'un fou de Gogol). Bien qu'il ait sombré dans une sorte de psychose maniaque, Vasia conserve un sens aigu de l'observation et de la perspicacité, capable d'analyser et d'évaluer tout ce qu'il voit.
Ce sont des mots qui indiquent le chemin vers le supra-réel ou vers un abîme à l'extérieur - au-delà de tout ce qui est connu et imaginable - et à l'intérieur - où se trouvent les mystères de l'âme humaine. Cependant, il est inexact de définir les voyages dans ces œuvres par l'épithète "voyage dans l'espace". En outre, le chemin vers le transcendantal que suivent les personnages de Mamleev est toujours conditionné par le réalisme. Dans l'histoire du Coureur, la capacité de Vasia Kurolesov à voler à travers tout l'univers, visible et invisible, est le résultat de son imagination, étant en ce sens une conséquence (un symptôme) de la maladie mentale d'un homme qui a essayé de "se dépasser" et a dépassé ses limites. La partie la plus importante de l'histoire se trouve dans le chapitre intitulé "Notes d'un fou", qui est divisé en deux parties correspondant à deux phases de la maladie et à deux versions différentes de son fantasme : la première partie s'intitule "Notes de Vasia Kurolesov" ("quand il a fui son corps") et la deuxième partie s'intitule "Notes de Vasia Kurolesov après que Zamorisheva a vu qu'il était lui-même devenu un monstre de l'au-delà". Le personnage de Vasia Kurolesov fait référence à la tradition littéraire des "fous sages" (cf. Poprishchin dans le Journal d'un fou de Gogol). Bien qu'il ait sombré dans une sorte de psychose maniaque, Vasia conserve un sens aigu de l'observation et de la perspicacité, capable d'analyser et d'évaluer tout ce qu'il voit.
Contrairement au postmodernisme, ce n'est pas Vasia qui est malade (la maladie est une convention artistique, disait Dostoïevski), ce sont les "hommes moyens" modernes et philistins qui sont malades parce qu'ils se sont détournés des utopies traditionnelles et des mythes religieux : "Ma pensée et mon moi survolent tous ces mondes de merde, aussi béats soient-ils. Partout où je regarde et épie, partout où je mets mon nez... je donne aux passants un goût de folie et j'effraie les habitants de ce lieu. C'est comme si j'avais échappé à toutes les lois cosmiques, grâce à la volonté de l'Invisible, et que je pouvais ainsi effrayer tout le monde avec ma particularité. Oh, petites étoiles, petites étoiles ! Je meurs de rire". Je crois qu'il y a dans ces phrases une certaine allusion à l'"âge d'or" utopique décrit par Dostoïevski dans Le rêve d'un homme ridicule. Dans cette histoire, la vie des enfants d'une belle étoile dans laquelle tombe accidentellement un "homme ridicule", "ils vivaient dans l'état dans lequel nos ancêtres existaient dans le paradis terrestre. Parmi eux, il y avait de l'amour et des enfants sont nés, mais je n'ai jamais observé parmi eux de cruelles explosions de la luxure qui s'empare de presque tout le monde sur notre terre, et qui est la source de la plupart des péchés de notre humanité. Ils se réjouissaient de la naissance de leurs enfants, car ils partageaient désormais leur joie. Il n'y avait aucune querelle entre eux, aucune jalousie, et ils ne comprenaient même pas ce que cela signifiait. Leurs enfants appartenaient à tout le monde, car ils formaient tous une seule famille. Il n'y avait presque pas de maladie, mais la mort était là ; leurs vieux mouraient lentement, comme s'ils s'endormaient, entourés de gens qui leur disaient au revoir, les bénissaient et leur disaient adieu avec des sourires joyeux. Il n'y avait ni chagrin ni larmes à voir lorsque cela s'est produit, mais un amour qui semblait multiplié jusqu'à l'extase, mais une extase tranquille, complète et contemplative". Vasia Kurolesov parodie l'utopie dostoïevskienne lorsqu'il décrit l'une des nombreuses dimensions de l'Univers dans laquelle il a jeté un coup d'œil : "Leur vie, ma mère, ne se déroule pas comme la nôtre : elle est très, très lente, ce sont des sortes de parasites qui vivent pendant des millions et des millions d'années. Ils vivent béatement, satisfaits d'eux-mêmes, comme s'ils étaient des dieux dont le corps est fait de la plus fine substance de tout..... Et quel bien ont-ils trouvé dans cette joie et cette félicité ? Rien que de la stupidité et aucun abîme en eux, ils sont restés assis là béatement pendant des millions d'années. Nos compatriotes deviendraient fous en vivant comme ça". Cependant, Vasia critique également le monde souterrain et les démons lorsqu'il les considère du point de vue de l'expérience et des besoins humains plus importants : "Les démons... vivent encore plus mal que les dieux. De simples bâtards qui ne travaillent que pour eux-mêmes, mais qui, par-dessus tout, craignent leur maître. Et leur plus grande peur est de voir l'abîme, ce qui signifie qu'ils ne connaîtront jamais la profondeur de la réalité. Les célestes, surtout ceux de très haut rang, se réunissent sans cesse avec leur Maître en disant que nous vivons dans un monde clair où personne ne connaît le plus grand de tous les mystères. Les autres démons tremblent en entendant parler de l'Esprit de leur Maître et croient qu'ils disparaîtront dès qu'ils le connaîtront. Ils vivent dans la peur.
Mamleev soutient que l'aspiration de Vasia à atteindre l'abîme (même après avoir pénétré l'absolu, c'est-à-dire Dieu) est une manifestation de l'esprit russe, qui a pour principe cosmologique de servir de médiateur entre l'absolu (y compris Dieu lui-même) et l'abîme qui existe au-delà. Une telle interprétation de l'esprit russe amène Vasia à réaliser que la Russie n'est pas seulement un sixième du globe, mais quelque chose de plus : "D'ailleurs, la Russie n'est pas seule sur cette Terre de péché". Il est nécessaire d'expliquer cette phrase : Y. Mamleev et T. Goricheva ont écrit un livre intitulé La nouvelle ville de Kitezh dans lequel ils expliquent leur conception cosmologique ou métaphysique de la Russie. Selon eux, "l'essence historique de la Russie se situe bien au-delà de notre monde terrestre et constitue l'un des plus profonds mystères de la relation entre Dieu et le Cosmos..... Notre Russie historique n'est qu'une des nombreuses manifestations de la Russie cosmologique que l'on trouve sur d'autres planètes et dans d'autres réalités spatio-temporelles. L'idée de la Russie existe au-delà de notre monde terrestre et humain, si ce dernier est vrai, alors cette idée se manifestera inévitablement dans d'autres mondes également" (3). Ce concept de Russie cosmologique se retrouve chez N. Berdiaev et les "slavophiles radicaux", qui ont lié l'idée de la Russie à l'idée de l'humanité. Ainsi, les êtres vivant dans la Russie cosmologique ne sont pas seulement analogues à leurs homologues terrestres, mais sont liés à un certain archétype humain. Il est possible que des Russes vivant dans d'autres mondes russes soient en proie à l'"angoisse" et à la "folie". Bien sûr, pour cela, ces êtres doivent incarner une idée russe adaptée à leur monde.
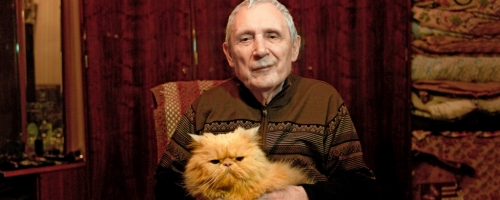
Le récit de la fuite du "sage fou" dans l'éternité révèle en fait le mythe de la Russie cosmologique auquel Mamleev croit.
Un autre mythe de Mamleev est son concept du "moi métaphysique", du "Dieu qui existe en moi", qu'il a exposé dans ses ouvrages philosophiques (Le destin de l'être ; La Russie éternelle) et dont les origines se trouvent dans la métaphysique orientale. Selon ce concept, l'homme est capable de trouver Dieu en lui-même. Pas seulement une étincelle de Dieu ou de sa conscience, mais Dieu dans son ensemble, jusqu'à la coïncidence totale avec l'Absolu. L'un des nombreux voyageurs métaphysiques de Mamleev, Andrei Artemievich (La route de l'abîme), "prêchait et pratiquait un certain enseignement ancien et traditionnel (Vedanta) né en Inde, mais une fois compris et éclairé par le fougueux esprit russe, il a fini par se transformer", raison pour laquelle il enseignait à ses étudiants "le concept du moi métaphysique" comme suit : "Selon l'Advaita-Vedanta... le principe absolu et suprême, éternel et supra-mondain, que la plupart appellent Dieu se trouve "en" nous, le reste n'est qu'un horrible rêve. Tout le monde peut découvrir ce Soi supérieur ou Dieu qui existe en soi et avec lequel on peut même s'identifier, mais pour cela il faut éliminer toute fausse identification avec son corps, sa psyché, son individualité et son esprit, afin de cesser d'être une "créature tremblante" ..... Et l'homme devient ce qu'il est vraiment : nous ne serons pas, par exemple, Nikolaï Smirnov, ni aucun autre homme, mais une réalité absolue éternelle, qui ne peut être exprimée en tant qu'existence individuelle au moyen du temps, des nombres ou de l'espace et qui peut exister même lorsque ni le monde ni l'univers n'existent".
L'anthropologie philosophique et artistique de Mamleev est une synthèse des concepts de la philosophie religieuse russe et de l'"idée russe", notamment des théories de N. Berdiaev, ainsi que de la métaphysique indienne, du Vedanta, de l'enseignement dogmatique chrétien sur la théosis de l'homme, de l'autodévouement nietzschéen et de certains éléments de la philosophie de Heidegger sur la manière dont l'homme s'approche de l'être. On y trouve également les idées de Dostoïevski selon lesquelles l'homme possède dans son âme une "étincelle de Dieu" qui le relie à Dieu et à son Fils.
Il ne s'agit pas d'un jeu de mots, ni d'une défense de l'impossibilité de parvenir à une Vérité absolue ou d'une sorte de justification du relativisme postmoderne. Il s'agit plutôt d'une synthèse très complexe de diverses idées autour desquelles tourne toute l'œuvre de Mamleev, sans parler de la pensée chaotique et des ténèbres dans lesquelles l'âme de l'homme moderne a pénétré et dont l'amour chrétien n'est plus en mesure de le sauver : l'homme d'aujourd'hui, même s'il reconnaît le Christ et l'accepte comme idéal, ne peut pas se sauver, car il doit "dépasser" le carrefour où Dieu et l'abîme se rencontrent.
Le concept de l'Homme en tant que "situation métaphysique" tel que le conçoit Yuri Mamleev est un "quadrilatère" qui se trouve "intuitivement" dans l'alchimie spirituelle de l'Homme.
Notes :
1. Метафизический реализм писателя-оптимиста. Беседа с А. Вознесенским. Независимая газета. 2000, 25 мая.
2. См.: Лейдерман Н. Л., Липовецкий М.Н. Современная русская литература: 1950-1990 годы. Т. 1. М., 2002. С.17.
3. Мамлеев Ю. В. Россия вечная. М., 2002. С. 116-125. Подробнее об этом см.: Мамлеев Ю. Судьба бытия (гл. “Последняя доктрина”). М., 1997.
Fuente: https://magazines.gorky.media/october/2007/3/kto-est-ya.h...
15:16 Publié dans Littérature, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : iouri mamleev, yuri mamleev, youri mamleev, russie, littérature, littérature russe, lettres, lettres russes, philosophie, métaphysique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 07 août 2021
Principe d'autorité. Ombres et lumières
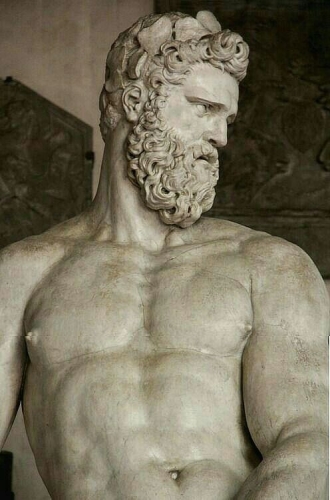
Principe d'autorité. Ombres et lumières
par Gonzalo Calabrese
Ex: https://grupominerva.com.ar/2021/07/gonzalo_calabrese-principio-de-autoridad/
Il est curieux de constater que, dans de nombreux cas, même les personnes les plus instruites ont tendance à recourir à l'autorité comme justification ultime de leurs opinions et de leurs actions. Bien sûr, cela n'est pas répréhensible en soi, mais c'est un outil très utile dans de nombreux cas. Par exemple, une telle ressource a la vertu non négligeable de nous permettre un certain "détachement mental". Il en est ainsi parce qu'il nous évite de devoir vérifier par nous-mêmes absolument toutes les données ou informations dont nous pourrions avoir besoin pour atteindre correctement nos objectifs.
La tradition fonctionne de manière similaire et, dans les deux cas, nous décidons de considérer certaines informations comme véridiques en fonction de la hiérarchie, de l'ancienneté ou de l'importance de la source dont elles proviennent.
Le problème se pose toutefois lorsque l'on oublie la possibilité d'erreur dans une telle ressource. Bien sûr, la simple existence d'une certaine marge d'erreur n'invaliderait pas en soi tout l'énorme édifice construit par la citation de l'autorité et/ou de la tradition sous le nom de "civilisation humaine". De nombreuses avancées techniques ont été développées avec succès sur la base de données précédemment collectées par d'autres. Ces données sont reprises par de nouveaux développeurs et chercheurs, qui n'ont pas forcément pris la peine de vérifier la véracité de tous les fondements de leur science ou technique. Au contraire, ils considèrent généralement qu'une grande partie de ces informations va de soi et s'en servent comme base pour leurs cogitations ultérieures. On comprend également combien il est peu pratique de remettre en question absolument tous les détails que l'on rencontre, ainsi que la difficulté découlant de l'impossibilité d'être un "connaisseur" dans la discipline que de telles données nous obligeraient à aborder.

Points cardinaux
Néanmoins, il est permis de rappeler, et surtout aujourd'hui, les points suivants :
● La tradition n'est pas une structure fixe ou rigide dans le temps, mais possède une certaine dynamique par laquelle elle est censée pouvoir se réadapter constamment et de la "meilleure façon possible" au milieu environnant. Ainsi, une telle tradition est mutable par nature, qu'elle progresse, stagne ou dégénère au fil du temps (toujours en fonction des exigences posées par l'environnement dans lequel elle se développe). Il pourrait en être de même pour l'utilisation de la citation d'une autorité. Il en est ainsi parce que la validité de certaines "autorités", dont émanerait la véracité de certains faits, serait limitée à un certain contexte dans certaines conditions spécifiques. En dehors de ces cas, il pourrait éventuellement devenir caduc ou être atténué pour diverses raisons.
La vérification empirique qui teste chaque hypothèse qui se présente. C'est, et ce n'est pas pour rien, la mère de nombreuses avancées indéniables de la science. Cette mise à l'épreuve de nos croyances est utile dans la mesure où elle permet la réadaptation susmentionnée des connaissances traditionnelles héritées au nouveau contexte. En d'autres termes, nous vérifions si les anciennes connaissances sont toujours applicables et utiles dans notre contexte actuel. Bien entendu, cette analyse peut être effectuée à différents niveaux. Par exemple, une certaine coutume héritée peut ne pas être spécifiquement utile au niveau de l'alimentation, comme dans le cas du maté argentin. Cependant, il pourrait être efficace tant qu'il est perçu comme un facteur d'identification et d'unité nationale, etc.
La nécessité de comprendre de manière pratique le contexte réel (qui inclut ces "autorités") qui nous entoure, en essayant de rendre nos connaissances et nos actions cohérentes entre elles.
● Favoriser la mémoire et l'acceptation d'une certaine marge d'incertitude.

Elites
Qui n'a pas, à un moment ou à un autre, éprouvé une profonde indignation à l'égard de la dégénérescence et de la corruption généralisées de nos classes dirigeantes (que ce soit dans n'importe quel pays, ou même au niveau des structures transnationales), ou à l'égard des nombreux éléments pervers au sein des élites dont l'influence considérable sur la majeure partie de notre espèce ne peut pas toujours être considérée comme utilisée de la manière la plus éthique ? La notion d'élite fait simplement référence à un groupe humain qui, situé dans un certain domaine ou une certaine pratique, se distingue des autres soit en termes de performances, soit par d'autres variables pertinentes dans ces domaines.
Mais malheureusement, nous constatons aujourd'hui que ce terme est intimement associé aux conséquences négatives que certaines élites corrompues ont générées. Ainsi, aujourd'hui, nous associons ce concept à des résultats négatifs. Par exemple, à une compétition impitoyable et inhumaine qui ne contribue en rien à l'amélioration de l'espèce. Ou à des inégalités extrêmes qui nient les bases d'une vie modérément digne et humaine, empêchant ainsi le plein développement des capacités propres de chaque individu. Ils reflètent également souvent des comportements hypocrites et contraires à l'éthique et à la déontologie. Nous serions probablement tous d'accord pour dire que c'est répréhensible et indésirable. Mon attaque contre la notion d'élite ne porte donc pas sur la notion fondamentale d'élite. En fait, je la considère comme un élément naturel et indispensable de toute société dont seul le ressentiment pourrait nous amener à la considérer comme négative.
Mon interrogation porte sur le groupe qui détient actuellement ce rôle de manière légale, certes, mais illégitime.
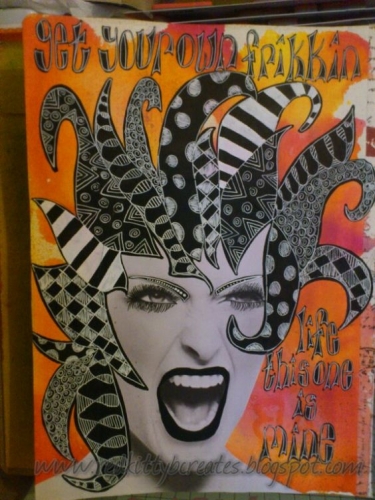
Terrain d'entente
Lorsque nous parlons à n'importe qui, qu'il soit éduqué, très éduqué ou moins éduqué, ils sont tous d'accord sur un point. Ils affirment tous être conscients qu'une grande partie des élites d'aujourd'hui (qu'il s'agisse de politiciens, de dirigeants de grandes entreprises pharmaceutiques, de médias locaux ou internationaux, etc.) ne sont pas des saints et qu'au fond d'eux-mêmes, ils sont mus par un utilitarisme économique froid avant tout. Nous prétendons être conscients que, pour eux, la vie elle-même, la nature et la condition humaine deviennent des "coûts à réduire", des "ressources à dilapider" ou des "dommages collatéraux" plus souvent qu'il n'est souhaitable. Il suffit d'ouvrir les journaux officiels pour trouver de multiples cas de corruption, par exemple, qu'ils soient actuels ou passés, qui sont ensuite "commodément oubliés".

Certains peuvent voir ces faits sous l'angle de certaines philosophies, idéologies politiques, d'autres sous l'angle d'approches religieuses, d'autres encore accuseront certaines différences en termes d'informations discordantes ou d'hypothèses alternatives, et ainsi de suite. Cependant, au-delà de ces éventuelles différences, beaucoup d'entre nous seront probablement d'accord pour dire qu'il y a là quelque chose de pourri. Au-delà de la couleur de la toile de fond que chacun préfère pour ces événements, nous savons tous qu'au moins en ce moment, quelque chose ne tourne pas rond dans ces strates...
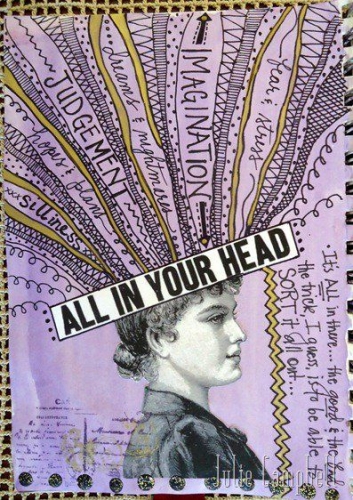
Incohérence
Ces idées partagées nous amènent donc à la conclusion générale que nous vivons à une époque où une confiance aveugle accordée à de telles "autorités" éthiquement et moralement corrompues serait un comportement franchement inadapté. En d'autres termes, il ne serait pas dans notre intérêt de nous perpétuer en tant qu'individus, société ou même en tant qu'espèce, et continuer à le faire ne serait que le signe d'une ignorance totale ou d'un manque de compréhension pratique ou profonde de l'environnement qui nous entoure. En d'autres termes, nous "faisons semblant" et prétendons savoir quelque chose, alors qu'en réalité nos actions pratiques ne le reflètent pas.
Bien sûr, il est difficile d'aller à l'encontre de tout ce que disent certaines autorités corrompues (surtout dans le cas des politiciens au pouvoir) sans se retrouver dans une position franchement hostile à leur égard et à leurs structures. Il peut même arriver que nous nous retrouvions en opposition avec la majeure partie d'une société manipulée par eux, subissant ainsi le rejet et la discrimination typiques de ceux qui ont des opinions "non massives" ("ex-centriques"). Cependant, sans qu'il soit nécessaire de spéculer à ce point, il suffit de comprendre que, de même qu'on ne se jetterait pas d'une falaise parce que sa mère nous dit de le faire, on le ferait encore moins à la demande d'une personne dont le bagage éthique et moral ne serait pas des plus limpides...
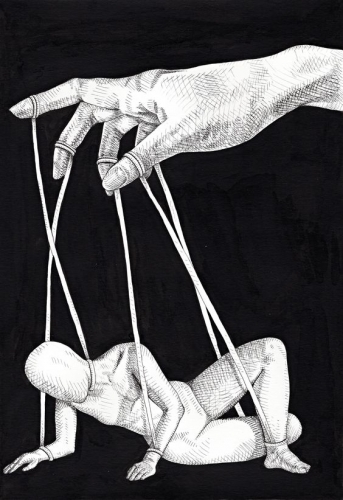
Questionnement constructif basé sur l'empirisme
Il est nécessaire de comprendre que la tradition et les autorités, ainsi que leurs conseils ou leurs connaissances, peuvent être discutables dans certains contextes. Je ne parle pas, bien sûr, de questionnements puérils, rebelles et sans raison, basés sur le ressentiment ou le manque de preuves. Cela ne mène qu'à de mauvais résultats, tant au niveau de la société qu'au niveau individuel. Je fais référence à la nécessité d'un questionnement basé sur l'examen empirique des faits qui ont été transmis jusqu'à présent afin de revalider leur validité, ou non, pour une meilleure adaptation de l'espèce dans son environnement.
Dès lors, si certaines "autorités" ou "éminences" du moment, aussi philanthropiques soient-elles, s'avèrent inopérantes ou, dans le pire des cas, totalement dépourvues d'éthique et de morale, il est alors licite de remettre au moins en question leurs exigences ou leurs suggestions. Pour nous, cela signifie que la "citation d'autorité", si répandue aujourd'hui (2021), perdrait une partie de sa validité lorsque la source y fait référence. Jusqu'à ce point, la plupart sont probablement d'accord.

Mémoire et incertitude
Malheureusement, c'est là qu'une mystérieuse amnésie envahit la population.
Ce manque de mémoire, qu'il soit dû à la paresse mentale ou à notre propre incapacité à surmonter notre confusion ou notre peur (et donc à avancer pour voir et admettre nos erreurs, nos manquements et nos incertitudes), nous amène à trébucher deux fois sur la même pierre. Il est essentiel de surmonter ce point et d'agir ensuite en fonction de nos connaissances. Une personne normale laisserait-elle volontiers le même voleur entrer chez elle deux fois ?
Il est donc essentiel de perdre la peur pour oser voir nos propres manquements, nos lacunes et nos éventuelles erreurs, tant en nous-mêmes que dans notre société. Il est essentiel de savoir les reconnaître, en laissant de côté sa propre fierté (individuelle et/ou sociale) pour faire place à la vérité.
Et si parvenir à "la vérité" est une entreprise trop prétentieuse pour notre simple condition humaine, nous pouvons au moins aspirer à écarter ce qui "n'est pas", atteignant ainsi une digne notion d'incertitude quant à ce qui "pourrait être". L'incertitude n'implique pas une absence totale de certitudes, mais plutôt que des certitudes peuvent exister, bien que non à un degré absolu et déterminant, mais disposées chacune selon une certaine marge de véracité possible que nous leur avons attribuée en fonction de nos recherches. Certaines hypothèses qui ont été réfutées par des tests empiriques sont écartées, ce qui nous amène à nous pencher sur d'autres qui ont plus de chances d'être correctes. Ainsi, admettre un certain degré d'incertitude est de loin plus précieux et plus franc que de prétendre à une certitude inexistante ou très discutable.
16:50 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 06 août 2021
Pourquoi ce sont toujours les pires qui gouvernent dans une démocratie ?
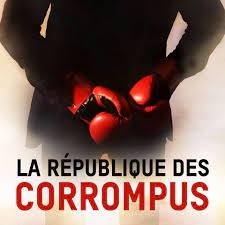
Pourquoi ce sont toujours les pires qui gouvernent dans une démocratie ?
"Ad punctum terre medium... ponderosa cuncta tendere naturaliter".
(Rolandino, Cronica, XII,8)
par Renzo Giorgetti
(extrait de La società da liquidare, cap. II ; republié sur heliodromos.it)
Il est un fait qui, dans tous les régimes démocratiques, se produit constamment, régulièrement et presque jamais sans exception. Tous les soi-disant représentants du peuple, ainsi que l'appareil gouvernemental, ministériel et tout ce que l'on pourrait appeler l'appareil du pouvoir, sont invariablement animés par une qualité humaine très basse, se distinguant au mieux par l'ignorance et l'incompétence ou, dans le pire des cas, par la nocivité intrinsèque, la méchanceté et la mauvaise foi systématique. Une sédimentation de spontanéité extravagante dans une sorte de grand réceptacle où convergent toutes les pires crapules antisociales, composées d'hommes d'affaires, d'escrocs, de fanfarons, de délinquants plus ou moins habituels, d'inadaptés, d'histrions, d'handicapés mentaux, d'intrigants de toutes sortes: un véritable " État dans l'État ", une petite république, non pas " des Lettres " mais de la pathologie criminelle.
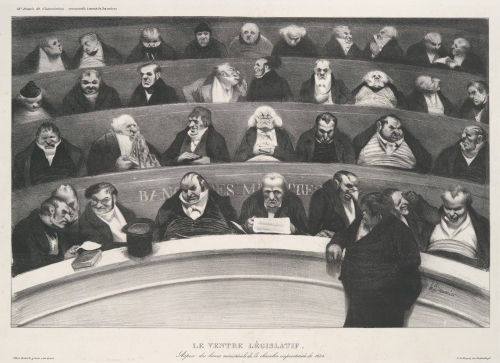
Cette "attraction gravitationnelle" de la racaille vers le sommet de l'État n'est pas du tout accidentelle et a en soi quelque chose d'inévitable, presque de mathématique, qui nous fait deviner l'existence de principes bien déterminés, encore à découvrir et à interpréter.
Selon un lieu commun abusif, la classe politique est le miroir de la nation : une banalité consolatrice et justificatrice qui doit être totalement rejetée, car elle est fausse et peu généreuse envers ceux qui mettent quotidiennement leurs qualités à profit, en construisant, en concevant et en agissant pour obtenir ensuite d'excellents résultats sur les plans personnel, professionnel et collectif. Toute personne ayant un minimum d'expérience peut facilement constater qu'en plus des nombreuses excellences individuelles, il y en a aussi beaucoup au niveau associatif dans les domaines de l'économie, de la science et de la culture, des hommes et des femmes réels qui, contre toute attente, s'honorent sur la scène nationale et internationale, malgré qu'ils soient souvent entravés par la politique.
Mais alors pourquoi ne pouvons-nous pas promouvoir une classe politique digne de respect ? La vieille critique selon laquelle la démocratie est un gouvernement de médiocres ne nous a jamais vraiment convaincus. La sélection inverse qui a lieu est trop précise, presque scientifique, pour être aléatoire, mais elle n'est même pas le produit d'un choix humain, car dans un tel cas, il devrait y avoir une marge d'erreur de toute façon. Il y a certainement quelque chose d'autre, une sorte de loi naturelle qui n'a pas encore été complètement clarifiée, qui agit dans ces contextes même à l'insu des protagonistes.
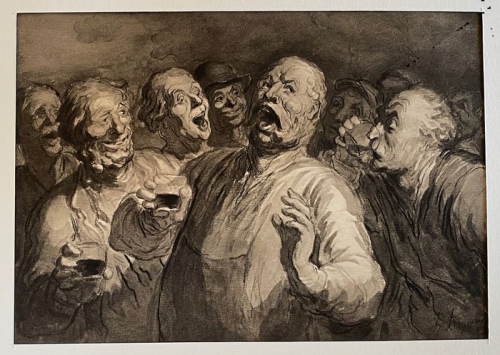
Pour l'expliquer, il faut remonter très loin, à l'époque de la démocratie antique d'Athènes (la seule, d'ailleurs, à pouvoir porter ce nom). Cette institution, héritière directe de la polis gentilice, a atteint son apogée et sa gloire éternelle tant qu'elle a pu maintenir son ossature aristocratique, en essayant de transfuser l'idéal héroïque dans l'idéal civique. La tentative était d'ennoblir le peuple plutôt que de démocratiser l'aristocratie. La citoyenneté était un privilège, elle n'était pas automatique et permanente, toutes les épreuves et les devoirs auxquels le citoyen était soumis avaient pour but de créer un type humain capable de commander et d'obéir avec le même esprit, avec la même capacité, jamais par individualisme et toujours pour les intérêts supérieurs de la communauté. Mais ce modèle idéal a rapidement décliné, se vulgarisant et se dégradant dans la cacophonie démagogique et la confusion des masses amorphes.
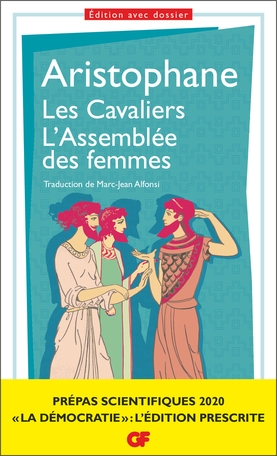 La dégénérescence démocratique est clairement exprimée par Aristophane dans sa comédie Les Chevaliers ou Les Cavaliers (424 av. J.-C.), une représentation pas trop métaphorique des dernières années de la vie politique athénienne. Dans le gouvernement (dans la fiction théâtrale comme dans la réalité) se succèdent des individus de plus en plus mauvais, dans une course à la bassesse et à la vulgarité. Le personnage du Paphlagonien, un des serviteurs du vieux Démos, est en fait le maître de maison, et impose sa volonté aux autres habitants de la maison (on reconnaît en lui la figure de Cléon, le premier dirigeant politique athénien à ne pas appartenir à une famille de la noblesse antique). Il dissimule des lectures oraculaires qui parlent de l'avenir de la ville : ceux qui gouvernent ne peuvent être remplacés que par des individus toujours plus mauvais. Ses adversaires, ayant découvert cette prédiction, se sont mis à la recherche d'un antagoniste pour vaincre le Paphlagonien, et l'ont trouvé dans un charcutier, un "homme misérable et sans vergogne qui a grandi sur la place", qui a tout ce qu'il faut pour devenir le chef du peuple: "une voix épouvantable, une naissance ignoble, et des manières dignes de la rue". Métaphoriquement parlant, la prophétie d'Aristophane ne fait que prendre acte des événements qui se sont déjà déroulés au cours de ces années: après la mort de Périclès, des personnages de bien moindre envergure s'affirmeront, d'abord le marchand d'orge Eucrates, puis le marchand de bétail Lysikles, "qui détiendra le pouvoir jusqu'à ce que survienne un plus infâme que lui", à savoir Cléon lui-même.
La dégénérescence démocratique est clairement exprimée par Aristophane dans sa comédie Les Chevaliers ou Les Cavaliers (424 av. J.-C.), une représentation pas trop métaphorique des dernières années de la vie politique athénienne. Dans le gouvernement (dans la fiction théâtrale comme dans la réalité) se succèdent des individus de plus en plus mauvais, dans une course à la bassesse et à la vulgarité. Le personnage du Paphlagonien, un des serviteurs du vieux Démos, est en fait le maître de maison, et impose sa volonté aux autres habitants de la maison (on reconnaît en lui la figure de Cléon, le premier dirigeant politique athénien à ne pas appartenir à une famille de la noblesse antique). Il dissimule des lectures oraculaires qui parlent de l'avenir de la ville : ceux qui gouvernent ne peuvent être remplacés que par des individus toujours plus mauvais. Ses adversaires, ayant découvert cette prédiction, se sont mis à la recherche d'un antagoniste pour vaincre le Paphlagonien, et l'ont trouvé dans un charcutier, un "homme misérable et sans vergogne qui a grandi sur la place", qui a tout ce qu'il faut pour devenir le chef du peuple: "une voix épouvantable, une naissance ignoble, et des manières dignes de la rue". Métaphoriquement parlant, la prophétie d'Aristophane ne fait que prendre acte des événements qui se sont déjà déroulés au cours de ces années: après la mort de Périclès, des personnages de bien moindre envergure s'affirmeront, d'abord le marchand d'orge Eucrates, puis le marchand de bétail Lysikles, "qui détiendra le pouvoir jusqu'à ce que survienne un plus infâme que lui", à savoir Cléon lui-même.
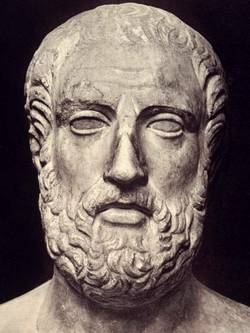
Aristophane.
En effet, on théorise ici une décadence qui est presque une nécessité naturelle, une loi physique, semblable à celle qui régit la chute des corps et qui, inéluctable dans son déroulement, ne peut que conduire à la fin des institutions et du modèle de vie qu'avait exprimé la polis.
Cette loi de la chute gravitationnelle est, à notre avis, la meilleure explication du très faible niveau humain de tous les représentants démocratiques, niveau qui ne cesse de se dégrader selon une accélération continue. René Guénon s'en rendait déjà compte et liait le démocratisme au poids, non seulement d'un point de vue strictement matériel mais aussi d'un point de vue "métaphysique". Selon son analyse, la tendance à la baisse du poids - que la philosophie Samkhya appelle tamas et qui peut aussi être assimilée à l'ignorance et à l'obscurité - "crée dans l'être une limitation toujours plus grande, qui en même temps va dans le sens de la multiplicité, représentée ici par une densité toujours plus grande". (1)
Une chute symbolique toujours plus basse, vers ce centre de la Terre, ce point vers lequel tend tout corps (selon l'expression de Dante "al qual si traggon d'ogne parte i pesi") (2).
Mais actuellement, nous avons une anomalie, car la chute va "vers le haut" et non plus "vers le bas": mais cela ne se produit que dans un sens relatif, en raison d'une erreur de perspective qui nous amène à voir les choses d'un point de vue inversé. Nous vivons actuellement dans un monde dit "à l'envers". Si l'on regarde de cette façon, tout est logique, car si la pyramide sociale est inversée, la montée n'est rien d'autre qu'une chute, et celui qui est au sommet l'est "méritoirement", mais seulement en vertu de ce bouleversement, comme dans le carnaval et les fêtes de fin d'année (dans toutes les cultures traditionnelles, dans toutes les cultures traditionnelles, dès les Babyloniens) où tout ordre est inversé et où les membres les plus vils de la population peuvent accéder à des postes de commandement, exerçant la souveraineté, même si ce n'est que pour une courte durée (il existe de nombreuses illustrations du "monde à l'envers" à l'époque moderne, mettant en scène des épisodes tels que des serviteurs commandant au maître, des élèves réprimandant les maîtres, le ciel à la place de la terre, etc.).
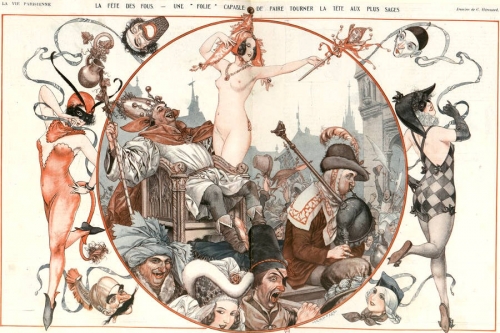

On comprend maintenant pourquoi cette sélection en politique est si précise et infaillible, répondant à une loi non seulement physique, mais aussi hyper-physique, qui n'est pas affectée par l'erreur et n'admet guère d'exceptions (les meilleurs, ou les moins mauvais, spécimens qui ont accédé au pouvoir dans un régime démocratique l'ont toujours fait de manière contre nature, par un acte de force).
Pour s'en convaincre, on peut aussi ajouter le traditionnel parallélisme entre la tendance tamas (lourdeur, grisaille, obscurité) et les parias, les intouchables, les exclus, qui trouvent leur satisfaction dans ce que les autres rejettent. Le paria, selon Frithjof Schuon, est un sujet qui "constitue un type défini qui vit normalement en marge de la société" et qui a souvent "quelque chose d'ambigu, de déséquilibré, parfois de simiesque et de protéiforme, qui le rend capable de tout et de rien", "acrobate, acteur, bourreau", protagoniste de "toute activité illicite ou sinistre", attitudes qui le font également ressembler à certains saints, mais seulement "par analogie inverse, bien sûr." (3)
Ce qui est en haut se reflète dans ce qui est en bas, comme un reflet plausible mais déformé qui ne laisse entrevoir, et de surcroît de manière négative, que la réalité authentique du modèle à suivre.
NOTES
1 R. Guénon, La crisi del mondo moderno, Mediterranee, Rome, 1972, p.110.
2 Inferno, XXXIV 111.
3 F. Schuon, Castes et Races, Edizioni all'insegna del Veltro, Parme, 1979, p.13.
Source: https://www.azionetradizionale.com/2021/07/05/perche-in-democrazia-governano-sempre-i-peggiori/
17:30 Publié dans Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, philosophie politique, théorie politique, tradition, traditionalisme, politologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
La philosophie de la chasse expliquée par Ortega y Gasset

La philosophie de la chasse expliquée par Ortega y Gasset
Le penseur espagnol a écrit ce texte en guise de préface à un volume écrit par le comte Eduardo de Yebes consacré à la chasse, qui a été publié à Madrid en 1943.
par Giovanni Sessa
Ex: https://www.barbadillo.it/99980-la-filosofia-della-caccia-spiegata-da-ortega-y-gasset/
La "religion" triomphante de la société post-moderne est celle des "droits de l'homme". Les grands récits, comme on dit, ont fait leur temps et auraient produit des désastres indescriptibles. La culture dominante "politiquement correcte" invite l'humanité à se prélasser sur le paisible rivage du "bon moralisme ambiant". Parmi ses commandements figure la pratique du véganisme total, auquel les rejetons des classes dirigeantes se donnent toto corde. Ils sont aussi les porte-flambeaux de l'écologisme dompté par les intérêts économiques, le nouvel évangile "selon Sainte Greta" de la post-modernité. Il va sans dire que la pratique de la chasse fait donc l'objet d'une excommunication absolue. Je crois que la chasse moderne est un massacre inutile, mais je crois aussi qu'en d'autres temps, la pratique de la chasse était très différente.
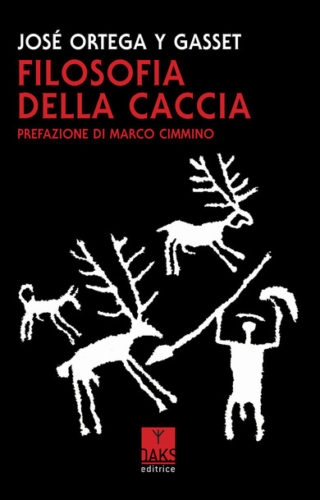
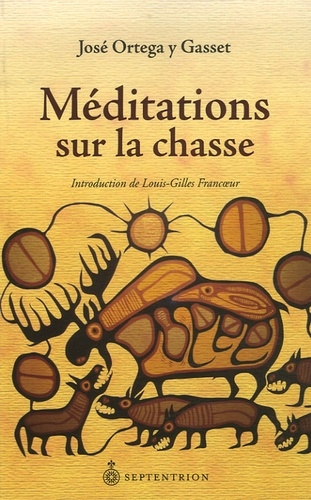
La récente publication d'un ouvrage du philosophe espagnol Ortega y Gasset, Philosophie de la chasse, avec une préface de Marco Cimmino (pour les commandes : info@oakseditrice.it, pp. 100, euro 12,00), nous a réconfortés à cet égard. Le penseur a écrit ce texte en guise de préface à un volume rédigé par le comte Eduardo de Yebes consacré à la chasse, qui a été publié à Madrid en 1943. Comme le texte avait acquis une certaine ampleur et mettait en évidence l'originalité de la position d'Ortega, il a été publié séparément sous la forme d'un bref essai. Le lecteur doit être conscient que le philosophe, dans ces pages, se livre, d'une part, à un exercice de divertissement intellectuel, comme en témoignent la légèreté et la fluidité de la prose dans certains passages, tandis que, d'autre part, il a engagé son génie érudit et académique dans la discussion d'un thème qui, peu à peu, l'a impliqué. C'est en effet paradoxal, puisque le penseur n'avait jamais participé à une partie de chasse.
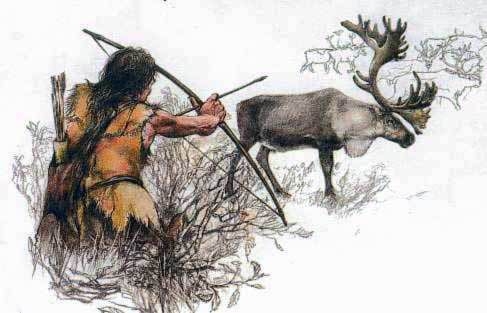

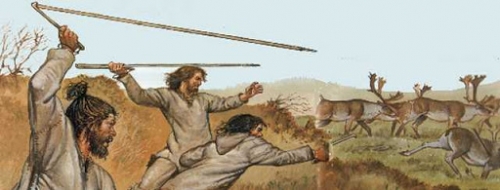
Cimmino fait remarquer à juste titre que l'exégèse du phénomène de la chasse chez Ortega repose sur une distinction essentielle : la chasse moderne par rapport à la chasse traditionnelle, pratiquée dans d'autres siècles. En effet, selon l'auteur, "les chasseurs d'Altamira et de Lascaux (Paléolithique) sont moins primitifs que le meurtrier moderne: en effet, il n'est souvent même pas un chasseur, mais un persécuteur" (p. II). La modernité a fourni aux prédateurs des armes raffinées, des fusils de précision, des carabines légères et faciles à manier même dans des conditions difficiles: nous avons assisté à une évolution des outils de chasse en parallèle avec l'involution des instincts et de la force de l'homme. La technologie a fait irruption dans ce domaine pour faire face aux déficits acquis par l'homme moderne du fait de sa vie sédentaire à laquelle la société industrielle et de consommation nous a contraints. Il s'agit notamment de notre capacité réduite à sentir, de l'augmentation des problèmes de vue et de la perte de vitesse du chasseur. La chasse représente donc pour le philosophe un retour à la nature, et il semble éprouver "une véritable nostalgie de la forêt [...] et du défi avec la bête" (p. III), dans une confrontation certes non égale, mais néanmoins juste, à armes égales, et non soutenue par des expédients techniques.
Dans ce contexte, l'homme apparaît à l'auteur comme le roi incontesté du règne animal, suggère le préfacier, dans une nature où "tous sont chasseurs et tous sont chassés" (p. III). Un monde, celui de la forêt d'Ortega, qui ne se plie en rien au paradigme démocratique, dans la mesure où le supérieur, également par la ruse et l'intelligence, s'impose aux inférieurs. La chasse révèle donc un monde hiérarchique basé sur des valeurs aristocratiques pour ceux qui la pratiquent à "l'ancienne".

Au Moyen Âge, Frédéric II en était bien conscient, puisqu'il s'est adonné à la pratique de la chasse au faucon, dont il nous a laissé un admirable témoignage dans un traité exemplaire. Plus généralement, le philosophe est convaincu - et l'historien néerlandais Huizinga avait la même intuition - que l'homme a une relation fondamentalement ludique avec la réalité et la vie. Alors que les autres êtres vivants se contentent de vivre, l'homme doit "consigner délibérément et sous sa propre responsabilité inaliénable sa vie [...] à certaines occupations" (p. 5). La chasse est un jeu, parmi d'autres jeux d'une importance essentielle. Ce qui la distingue des autres "pratiques" ludiques, c'est qu'il s'agit d'une activité exigeante, en aucun cas passive, et pas seulement d'un point de vue physique.
La brièveté de la vie oblige l'homme à s'engager dans des actions qui l'impliquent émotionnellement. La chasse est l'une d'entre elles: elle nous met en contact avec les puissances disparates qui composent le cosmos, quoique de manière paradoxale, puisque le but de cette action est la négation d'une vie palpitante dans le cadre global de la nature. Dans le monde romain, Scipion Aemilianus (Emilien) et Polybe, deux figures emblématiques dont parle Ortega, le savaient bien. Le premier, imprégné de culture hellénique, a connu le second comme stratège lors du siège de Numancia en Espagne. L'amitié entre les deux se resserre de plus en plus, passant des discussions sur les livres que Scipion fait lire à Polybe à la pratique commune de la chasse. Aemilianus avait appris les rudiments de l'art de la chasse lors de son séjour en Macédoine. De retour à Rome, conclut Polybe, "il a trouvé en moi la même passion pour la chasse, qui a fait croître la sienne" (pp. 21-22). (pp. 21-22).

La philosophie de la chasse a été écrite alors que l'Europe était dévastée par la Seconde Guerre mondiale et que l'Espagne avait pu maintenir une position de neutralité. Dans ces pages, l'auteur oppose les pratiques de chasse "anciennes" et modernes, les premières étant celles du gentleman car respectueuses des animaux, les secondes cruelles et exterminatrices, symbolisant la diversité radicale qui distinguait le monde de la Tradition, articulé autour du concept de limite, et le monde contemporain qui ne connaît pas de limites et, dans tous les domaines, procède à leur éradication, avec l'objectif consubstantiel de faire triompher la démesure. En transférant le contenu spécifique de ce texte à la dimension éthique, ses pages ont toute l'allure d'un appel, plus actuel que jamais, à la sobriété. La préface de Cimmino se termine par: "Le lecteur devrait donc apprécier ce diamant microscopique: cet essai éloquent sur la chasse" (p. IV).
Giovanni Sessa.
12:18 Publié dans Littérature, Livre, Livre, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : josé ortega y gasset, chasse, philosophie, lettres, lettres espagnoles, littérature, littérature espagnole |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 05 août 2021
Debord prophète: notre monde de choses

Debord prophète: notre monde de choses
par Joakim Andersen
Ex: https://motpol.nu/oskorei/2021/07/29/en-varld-av-ting/
Guy Debord a décrit dans La société du spectacle comment une telle société du spectacle a émergé, une société dans laquelle "le monde tangible est remplacé par une sélection d'images qui existent au-dessus de lui, et qui s'imposent simultanément comme le tangible par excellence". La société moderne est remplie de marchandises, d'images et de rôles, à tel point que ces marchandises, images et rôles apparaissent comme la réalité et que la propre vie de chacun est désormais posée comme irréelle. Debord s'est toujours exprimé de manière catégorique, souvent avec justesse. Il note notamment que "le spectacle est une guerre permanente de l'opium qui vise à faire identifier les biens aux marchandises et la satisfaction à la survie qui augmente selon ses propres lois." Il était marxiste, mais nombre de ses descriptions de la société du spectacle vont au-delà de la droite et de la gauche, certaines étant même plus proches de la droite que de la gauche. C'est notamment le cas de la distinction qu'il fait, à la manière de René Guénon, entre qualité et quantité.
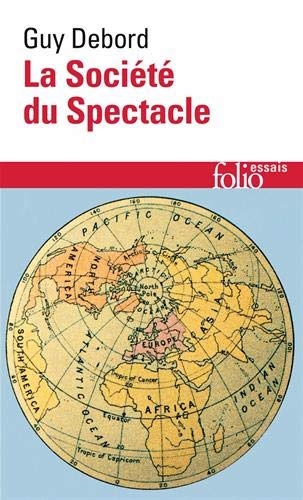
Debord écrit ici que "la perte de qualité est si évidente à tous les niveaux du langage spectaculaire, depuis les objets qu'il vante jusqu'aux comportements qu'il régule, et ne fait que traduire les traits fondamentaux de la production réelle qui balaie la réalité: la forme-marchandise est de part en part égale à elle-même, la catégorie du quantitatif."
Comme Klages, il a fait la distinction entre vivre et survivre, bien que la terminologie de Klages soit partiellement différente. Comme Klages, il s'est également intéressé au phénomène de l'idéologie matérialisée, un choix de mots qui nous rappelle que derrière chaque publicité IKEA et chaque bâtiment laid se cache une idéologie. Pour citer le comte Stenbock, "un lampadaire laid est un lampadaire maléfique".
Il est également intéressant de noter que Debord se concentre sur la bureaucratie étatique du monde moderne, un point de vue plus solide que celui de la plupart des marxistes, et qu'il utilise le concept marxien de "despotisme oriental" pour caractériser les tendances de la société moderne. Là où Michael Jones parle du "massacre des villes", Debord a plutôt soutenu la même approche sur la façon dont les conditions du despotisme oriental sont recréées artificiellement dans la métropole moderne (au paragraphe 177 de La société du spectacle, un livre dont la lecture devrait être obligatoire dans notre mouvance). Une population fragmentée et anhistorique est créée par l'urbanisme et le spectacle, Debord parle de "paysannerie artificielle" et comment les "villes nouvelles" de la pseudo-paysannerie technologique inscrivent clairement dans le paysage leur rupture avec le temps historique sur lequel elles ont été construites".
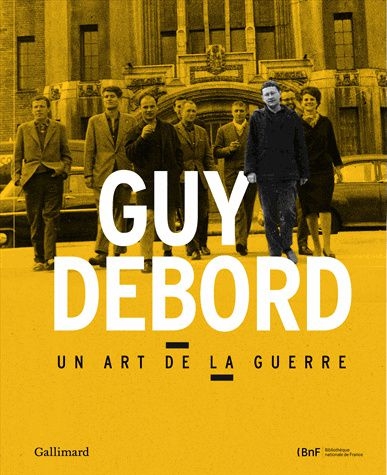
Quelle que soit l'opinion que l'on a des paysans historiques, c'est un aperçu fructueux; la bureaucratie et la société de consommation façonnent ensemble une population de sujets apathiques, anhistoriques et atomisés. Dans le même ordre d'idées, Debord a critiqué Marx pour sa vision linéaire de l'histoire et sa sous-estimation de l'importance économique de l'État moderne. Debord écrit au paragraphe 87 que "la simplification a conduit Marx à négliger le rôle économique de l'État dans la gestion d'une société de classe". Dans l'ensemble, des idées pertinentes, que l'on veuille lire Marx à partir de la droite, Rothbard à partir de la gauche, ou que l'on ait d'autres intentions suspectes.
L'essai fait constamment allusion à des éléments de l'idéologie dominante, qu'il s'agisse de l'africanisation des animaux dans les programmes pour enfants ou du remplacement de la "toute-puissance soudaine" par "la pratique ardue rend parfait" dans plusieurs films. Il est intéressant de noter qu'étant donné que Debord décrit le jeu comme un processus de préservation, dans lequel les marchandises sont parfois décrites presque comme des personnalités, "les choses règnent et sont jeunes; les choses s'affrontent et se remplacent", les marchandises ont tendance à devenir des personnages dans plusieurs programmes pour enfants. On est tenté de citer le Dr Ssempa, "c'est la marchandisation à un autre niveau", mais on cite plutôt Debord, "le spectacle ne chante pas les louanges des hommes et de leurs armes, mais des marchandises et de leurs passions".

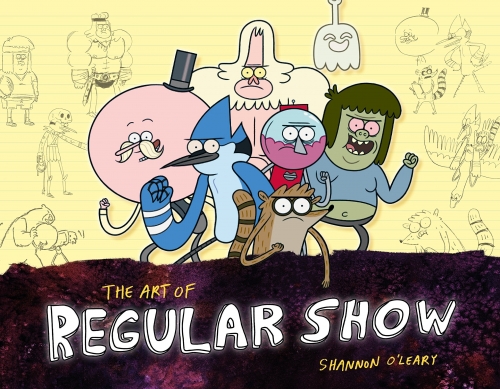

Pris isolément, les personnages principaux et secondaires de séries comme Shopkins et Regular show sont inoffensifs et parfois divertissants, et ces séries ne sont pas pires que d'autres dans leur genre. Mais en tant que phénomène historique, il convient de noter que la frontière entre l'imaginaire et le spectaculaire, pour combiner les perspectives de Castoriadis et Debord, s'est effondrée au point qu'un nombre croissant de biens de consommation vivants participent aux dessins animés. Ici, nous pouvons simultanément identifier comment les frontières entre les époques historiques et entre les genres se sont effondrées dans un éternel maintenant, semblable à un collage (comme, d'ailleurs, les frontières biologiques ont cessé dans la fraternité entre le cupcake vivant et le dinosaure). S'il est possible de séparer l'œuf de la poule dans la "totalité répressive" dont parlait Marcuse, il existe un lien évident entre cette tendance du spectacle et plusieurs tendances idéologiques contemporaines (voir le "remplacisme" de Renaud Camus). Nos arrière-grands-parents et nos grands-parents racontaient des histoires de souris grimpantes et d'ours, de gnomes et de lutins, parce que c'était leur réalité vécue. La réalité vécue par leurs petits-enfants est très proche de la pièce de théâtre, et c'est de là que viennent leurs personnages de contes de fées. De même, la forêt a été remplacée d'abord par la petite ville, puis par la grande ville ou même le quartier hipster comme toile de fond de leurs escapades.

18:18 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guy debord, philosophie, société du spectacle |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 04 août 2021
Philosophie de Don Quichotte

Philosophie de Don Quichotte
Par Juan Manuel de Prada
La philosophie de Don Quichotte consiste à se battre contre l'esprit de notre temps, mais sans espoir de victoire.
Avant de renverser Don Quichotte sur le sable de la plage de Barcelone, le célibataire Samson Carrasco (déguisé à l'époque en Chevalier de la Lune Blanche) détermine expressément les règles du défi. Si Don Quichotte est vaincu, il devra se retirer dans son village pendant un an ; mais il doit d'abord déclarer que Dulcinée du Toboso n'est pas la plus belle dame du monde. En lui faisant abjurer la dame de ses pensées, Samson Carrasco entend, en effet, que la retraite de Don Quichotte soit définitive ; car un chevalier qui abandonne sa cause devient un homme sans mission.
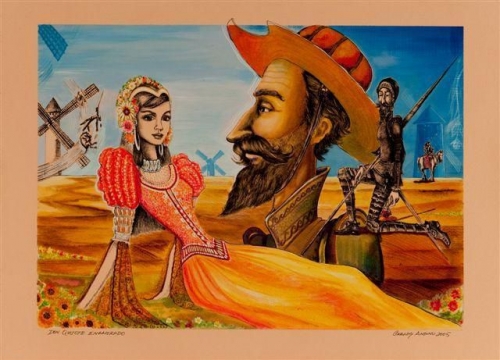
Mais lorsqu'il est renversé et à la merci de son vainqueur, la lance de celui-ci pointée sur sa gorge, Don Quichotte, "comme s'il parlait du fond d'une tombe, d'une voix affaiblie et malade", refuse de renier sa bien-aimée : "Dulcinée du Toboso est la plus belle femme du monde, dit-il, et moi le chevalier le plus déshonoré de la terre, et il n'est pas juste que ma faiblesse conteste cette vérité. Pousse, chevalier, la lance, et finis-en, car tu m'as déjà déshonoré". Don Quichotte s'est donné à Dulcinée sans conditions, sans rien demander en retour, sans exiger en contrepartie de sa fidélité que Dulcinée lui réponde. Pourquoi, alors, la grandeur de Dulcinée devrait-elle dépendre de la faiblesse de son bras ? Ce n'est pas la force de Don Quichotte qui a déterminé que Dulcinée est la plus belle femme du monde, l'opinion inconstante des hommes ne change pas l'essence de la vérité. La loyauté de Don Quichotte envers Dulcinée n'a pas changé même lorsqu'il l'a vue transformée en un paysan sans classe ; elle ne changera pas non plus lorsque la lance du Chevalier de la Lune Blanche lui coupera la gorge. Et la détermination de Don Quichotte est si belle que même le méchant Samson Carrasco se rend: " Vive, vive dans son intégralité la renommée de la beauté de la dame Dulcinée du Toboso, que je suis déjà satisfait si le grand Don Quichotte se retire chez lui pendant un an".

Miguel de Unamuno a affirmé à juste titre que cette scène résume la philosophie du "quichottisme". Peu importe si, en luttant pour défendre la vérité, nous sommes vaincus et humiliés ; peu importe si notre moi déchu est vaincu, car la vérité, où vit notre moi éternel, ne peut être vaincue. Et le paradoxe veut que, à travers notre défaite, cette vérité brille avec plus d'intensité. Don Quichotte se jette dans toutes les entreprises sans se soucier de la défaite, il sait accepter sereinement l'échec car il est pleinement convaincu de la vérité qu'il défend. Il n'a d'autre aspiration que de se faire le défenseur de cette vérité, aussi n'admet-il pas de la négocier, il n'est pas prudent et ne calcule pas, il n'hésite pas et ne recule pas. Même s'il sait que cette vérité sera attaquée par toutes les canailles, même s'il sait qu'en la défendant contre vents et marées il sera vilipendé et moqué, il ne veut pas renoncer à la défendre ; car l'adhésion à cette vérité qui s'est nichée dans son moi éternel l'a dépouillé de l'amour-propre et des peurs humaines. Celui qui est guidé par l'amour de soi et les peurs humaines finit par déformer les demi-vérités, finit par craindre davantage son propre sort - le rejet de ses contemporains, la perte de prestige, etc. - que l'obscurcissement de cette vérité qui illumine nos jours.

La philosophie de Don Quichotte, aujourd'hui, se résume à lutter contre l'esprit de notre époque, même sans espoir de victoire. Et pour cela, nous devons être prêts à prendre de nombreux coups et à nous rendre ridicules, non seulement devant des hommes façonnés par la mentalité de l'époque, mais aussi devant nous-mêmes. Miguel de Unamuno affirme à juste titre que cette philosophie quichottesque est "la fille de la folie de la croix", où, en effet, le Christ s'expose au ridicule, non seulement devant les bourreaux qui se moquent de lui en lui demandant, au milieu des rires, de descendre de la croix, mais devant lui-même, qui aurait pu accéder à cette demande s'il avait seulement "retrouvé sa raison", c'est-à-dire s'il s'était libéré de la nature mortelle qui le maintient emprisonné sur la croix.
Don Quichotte aurait également pu éviter de nombreux problèmes et afflictions s'il avait seulement "retrouvé la raison" : car, comme nous le remarquons souvent tout au long du roman, c'est un homme qui réfléchit de manière très subtile et prudente et, par conséquent, il aurait pu élaborer des plans pour échapper aux dangers et aux complots, sans renier complètement sa vérité, en acceptant seulement de la dissimuler par divers subterfuges. Mais il ne le fait pas. Et, vaincu, Don Quichotte gagne mystérieusement ; devenant la risée de ses détracteurs, il triomphe d'eux.
C'est une leçon de morale extraordinaire, mais il faut un courage héroïque pour l'assumer. Faisons comme Don Quichotte, même avec une lance sur la gorge, même si nous devons retourner vaincus au village.
Source: http://novaresistencia.org/2021/07/29/a-filosofia-quixotesca/
19:04 Publié dans Littérature, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : don quichotte, philosophie, littérature, espagne, lettres, lettres espagnoles, littérature espagnole, cervantès, miguel de unamuno |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 03 août 2021
"Les fondements historico-spirituels du parlementarisme dans sa situation actuelle" selon Carl Schmitt

"Les fondements historico-spirituels du parlementarisme dans sa situation actuelle" selon Carl Schmitt
Recension: Carl Schmitt, Los fundamentos históricos-espirituales del parlamentarismo en su situación actual, 2008, ISBN 978-8430948321,Tecnos, 264 p.
Ex: https://www.hiperbolajanus.com/2020/11/resena-de-los-fundamentos-historicos.html#more
La critique schmittienne du parlementarisme libéral doit être replacée dans le contexte de la crise du libéralisme de l'entre-deux-guerres, en pleine crise de l'État libéral, de la remise en cause du système parlementaire, de l'autoritarisme, de la démocratie libérale, etc. L'ouvrage a été publié à l'origine en 1923, après les conséquences du traité de Versailles et la chute de la monarchie et du Deuxième Reich, et en pleine République de Weimar, avec toutes les conséquences désastreuses d'instabilité politique et de crise économique qu'elle a générées. À tout cela, il faut ajouter les racines ténues de la tradition libérale dans l'Allemagne de Carl Schmitt, où les courants autoritaires et antilibéraux étaient prédominants.
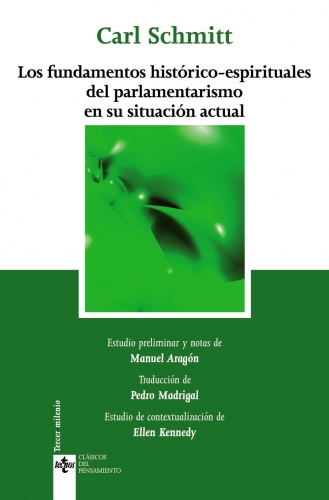
Au sein des critiques développées contre la démocratie parlementaire, on peut reconnaître deux voies différenciées dans la pensée de Schmitt :
- D'une part, la critique du parlementarisme en tant que forme de gouvernement. Schmitt critique donc le parlementarisme en tant que forme de gouvernement. En ce sens, il pointe du doigt la domination excessive des gouvernements par le parlement, qui conduirait à une instabilité rendant impossible toute gouvernance efficace. Dans ce contexte, le parlementarisme apparaît comme étant en contradiction avec la division des pouvoirs et inconciliable avec les besoins de l'État administratif. La République de Weimar sert d'exemple pour ces conclusions. De plus, il n'y a pas de solution de continuité possible s'il y a une relation inverse et que c'est le gouvernement qui domine à travers le parti politique sur le parlement, car dans ce cas on ne devrait pas parler de régime parlementaire, mais de régime gouvernemental. Dans le second cas, nous aurions un exemple très proche de notre époque, avec l'effondrement de l'ordre juridique et légal et l'inutilité des parlements dans la prise de décision. L'alternative proposée par Schmitt est une "dictature présidentielle".
- D'autre part, nous avons la critique du parlementarisme en tant que forme de gouvernement. Il s'agit d'une critique du parlement en tant qu'institution, en tant que forme de gouvernement, ainsi que de la démocratie parlementaire dans son ensemble en tant que système, une critique de la démocratie représentative.
En ce sens, Schmitt met en garde contre la confusion entre démocratie et élection, car la représentation n'est pas la même chose que l'élection. La démocratie en tant que telle n'a de sens que lorsque son objet d'intérêt présente des caractéristiques homogènes et qu'il est possible de le réduire à un seul centre d'intérêt, comme ce fut le cas des nations bourgeoises au XIXe siècle, où les démocraties de suffrage censitaire représentaient les intérêts du groupe social dominant. Dans le cas de la démocratie de masse, où les intérêts à représenter sont caractérisés par leur hétérogénéité, toute forme de pluralisme est incompatible avec le libéralisme. En ce sens, Schmitt fait une distinction claire entre la représentation des intérêts (partisans, économiques, etc.) et la représentation par laquelle le peuple s'identifie à ses dirigeants par acclamation ou assentiment. Et c'est le second type de représentation qui est le seul valable pour notre auteur, car il n'existe pas de volonté du peuple, et le pouvoir ne peut être délégué. Le leader politique est celui qui a la qualité de manifester cette volonté et de l'identifier. Pour Schmitt, il n'y a pas d'antithèse irréconciliable entre dictature et démocratie, de sorte que libéralisme et démocratie ne sont pas non plus synonymes, et toute doctrine politique antilibérale, comme le fascisme ou le communisme, qui étaient à l'apogée de leur popularité à son époque, n'est pas nécessairement anti-démocratique.


Bolcheviques à Petrograd, 1917.


Corps francs et milices paysannes bavaroises à Munich, 1919.
L'idée qui a présidé à la naissance du parlementarisme était de parvenir à des accords généraux et de représenter des intérêts hétérogènes, mais la vérité est que les démocraties libérales ont montré qu'en fin de compte elles servent de simple scène et de moyen pour imposer certains intérêts sur d'autres, et qu'en aucun cas elles n'obéissent au produit d'une discussion rationnelle. Au contraire, ils ont fini par imposer des décisions imposées en dehors de tout débat rationnel, car il n'y a pas de parlement législatif ou de démocratie parlementaire, c'est une forme vide et sans signification.
Une autre critique de Carl Schmitt se situe dans le domaine de la démocratie procédurale, et il se demande si la loi est vraiment ce que veut le législateur ou ce que veut la majorité parlementaire. Ainsi, au final, la démocratie parlementaire masque la dictature de la majorité, qui le reste même si des élections sont organisées de temps en temps.
Le parlementarisme et la démocratie se sont développés depuis le milieu du 19ème siècle sans que la distinction entre les deux concepts soit très claire, au point que lorsque celle-ci a finalement triomphé, des antagonismes entre les deux concepts ont également commencé à apparaître. Les contradictions apparaissent dans la fonction même que le Parlement est censé remplir, en tant que lieu de discussion et d'accord, et dans ce cas, parce que, comme nous l'avons souligné précédemment, les arguments rationnels devraient primer sur l'égoïsme et les liens des partis politiques et les intérêts exprimés par les différents groupes de pouvoir afin de convaincre. C'est précisément ce fondement du parlementarisme qui est en crise et qui a été réduit à une formalité vide. Schmitt souligne que ce ne sont plus les représentants des partis politiques qui argumentent, mais des groupes de pouvoir sociaux et économiques, on pourrait parler de lobbies qui négocient sur la base de compromis et de coalitions. Les parlements ne servent plus à convaincre l'opposition, et leur fonction politique et technique a disparu pour laisser place à la manipulation des masses et à l'obtention d'une majorité afin d'imposer ses propres critères.
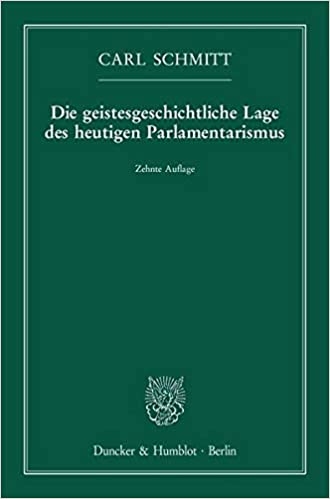
La démocratie est fondamentalement fondée sur la recherche de l'homogénéité, du "grand consensus", des majorités, de l'unification des volontés et de l'élimination de l'hétérogénéité, ce qui, dans la démocratie moderne d'inspiration libérale, repose sur le principe de rationalité. En ce qui concerne l'égalité tant vantée, la démocratie envisage l'inégalité et l'exclusion comme une stratégie de domination, et Schmitt nous renvoie à d'innombrables exemples de l'Empire britannique, comme paradigme du colonialisme moderne, dans lequel les habitants des colonies sont soumis à la loi de l'État démocratique de la métropole alors qu'ils sont en dehors de celle-ci et en contradiction ouverte avec ce qu'elle propose. Cela montre que la démocratie, comme c'était le cas pour la démocratie classique, n'est possible que lorsqu'elle est une affaire d'égaux. La démocratie libérale égalitaire, fondée sur des proclamations universalistes, sur des personnes d'origines et de milieux différents, en vertu d'un principe d'hétérogénéité, est ce qui, selon le juriste allemand, avait prévalu à son époque.
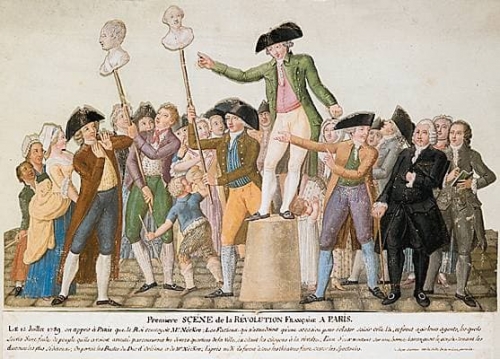
Ce modèle de démocratie, engendré par la Révolution française et mûri tout au long du XIXe siècle, a évolué vers des formes universelles, qui ont déplacé sa mise en œuvre sur un territoire spécifique, composé de personnes ayant une vision du monde unique et des origines particulières, vers un modèle universel, abstrait et hétérogène, donnant lieu à une égalisation absolue qui vide le concept de tout sens et perd ainsi toute sa signification. C'est pourquoi Schmitt affirme que la liberté de tous les hommes n'est pas la démocratie mais le libéralisme, tout comme elle n'est pas une forme d'État mais une conception individualiste et humanitaire du monde. C'est précisément la fusion de ces principes, le libéralisme et la démocratie, sur laquelle repose la société de masse moderne.
Les deux concepts sont en crise, et le libéralisme dénature la démocratie dans la mesure où la volonté du peuple n'est pas démocratique mais libérale, et entre l'action propre du gouvernant et la volonté des gouvernés il y a le parlement, qui apparaît comme un obstacle dépassé, inutile, incapable de remplir sa fonction. Et dans la mesure où la démocratie n'est pas l'héritage du libéralisme, elle peut se manifester au sein de la sphère antilibérale (fascisme ou bolchevisme) ou même sous des formes politiques étrangères à la tradition libérale, comme la dictature ou différentes formes de cessationnisme. De cette façon, Schmitt remet également en question les procédures considérées comme démocratiques, telles que le vote (le célèbre slogan "un homme, une voix") auquel participent des millions de personnes isolées, et la représentation indirecte représentée par les partis et le système parlementaire, qui sont après tout des formes proprement libérales qui ont été confondues avec les formes démocratiques. Schmitt fait allusion à des formes de démocratie directe comme l'acclamatio.
La démocratie dite libérale a commencé à prendre forme après la révolution de 1789, car la démocratie en tant que telle n'a pas de contenu politique spécifique, mais est un système organisationnel. La démocratie peut être socialiste, conservatrice, autoritaire, etc. et, dans le cas du libéralisme, elle est fondée sur des principes économiques qui trouvent leur origine dans le droit privé. En même temps, nous avons un de ses fondements les plus caractéristiques, la volonté générale, qui a un sens abstrait et incarne un principe de vérité alors qu'elle n'est jamais unanime. Il existe un système de représentations et d'identifications entre gouvernants et gouvernés sur le plan juridique, politique ou psychologique, mais jamais sur le plan économique. Pour Carl Schmitt, la minorité peut être plus représentative de la volonté du peuple qu'une majorité qui peut être soumise à la tromperie et au mensonge par l'action de la propagande. Ainsi, la défense de la démocratie n'implique pas un critère quantitatif de chiffres, mais un critère qualitatif, dans lequel les effets de la propagande peuvent être combattus par l'éducation et la connaissance.
En ce qui concerne le parlementarisme, il est né à l'origine comme une forme de lutte entre les représentants du peuple et la monarchie. Comme nous l'avons dit au début, en formulant l'une des thèses du livre, le parlementarisme constitue un obstacle au fonctionnement du gouvernement, en intervenant continuellement dans les nominations ou les prises de décision. Le parlementarisme, comme le libéralisme, est également étranger à la démocratie dans la mesure où le peuple ne peut pas rappeler ceux qui sont censés représenter ses intérêts au parlement, alors que le gouvernement peut le faire sans problème. D'autre part, le parlement sert souvent de cadre à des discussions sur des intérêts étrangers à ceux qui sont représentés, des intérêts de nature économique qui concernent des groupes privés, par exemple. Il s'agit d'une conséquence générale de l'application des principes libéraux, dont émanent les libertés associées à la démocratie libérale. C'est pour cette raison que ces libertés sont de nature individuelle, propres à des sujets privés, comme c'est aussi le cas de l'idée publique de la politique et de la liberté de la presse.
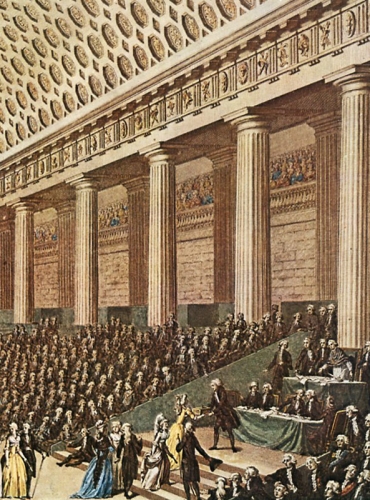
En ce qui concerne la séparation classique des pouvoirs, la répartition et l'équilibre des différentes parties qui composent l'État sont assurés par le Parlement, qui monopolise le pouvoir législatif. Schmitt plaide pour l'abolition de la division libérale des pouvoirs, et en particulier de la division entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif dans ce qui est un produit du rationalisme absolu et de l'idée des Lumières de l'équilibre des pouvoirs. En fait, le grand problème souligné par l'auteur allemand est que les Lumières elles-mêmes ont privilégié le pouvoir législatif par rapport au pouvoir exécutif, réduisant le premier à un principe ou à un mécanisme de discussion en vertu d'un rationalisme relativiste sans pouvoir aborder les questions importantes à partir de positions absolues. C'est dans ces principes que réside le problème posé par Carl Schmitt, dans la fondation d'un système global dans lequel le droit s'impose à l'État par un équilibre ou un pluralisme des pouvoirs dans lequel la discussion et la publicité deviennent la base de la justice et de la vérité.
Le problème est qu'aujourd'hui les parlements ne sont même plus des lieux de discussion ; ce sont les représentants du capital qui décident du sort de millions de personnes à huis clos, de sorte que le débat public finit par devenir un simulacre vide et sans substance.


Au-delà des critiques du parlementarisme et du libéralisme dans sa formulation démocratique, Carl Schmitt analyse également la dictature au sein de la pensée marxiste. La révolution de 1848 apparaît dans son schéma comme une date clé dans la lutte entre les forces politiques rationalistes à caractère dictatorial, représentées par le libéralisme d'origine jacobine de la France de Napoléon III, et le socialisme marxiste radical représenté par les conceptions hégéliennes de l'histoire. Le marxisme impose également une vision rationaliste et scientifique de la réalité, sur laquelle il prétend agir par le biais du matérialisme historique. Il croit connaître parfaitement les mécanismes de la vie sociale, économique et politique et croit aussi savoir comment les maîtriser dans un but absolument déterministe et mathématiquement exact. Mais en réalité, souligne Schmitt, le marxisme ne peut se comprendre que dans le développement dialectique de l'humanité, qui laisse une certaine marge d'action aux événements historiques dans les créations concrètes qu'il produit, indépendamment de toutes ses prétentions scientifiques de devenir. Et c'est dans Hegel que se trouve la base du concept marxiste de dictature rationnelle.
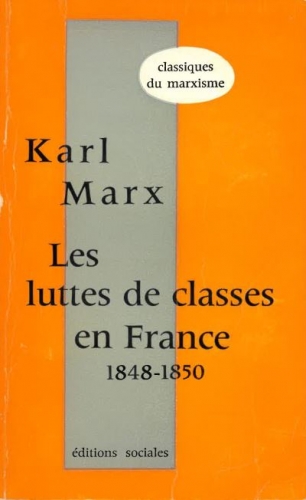
La figure du dictateur parvient à interpénétrer et à intégrer la complexité des relations antithétiques, des contradictions et des antagonismes générés par la dialectique hégélienne. Et face à la discussion permanente et à l'inexistence d'un principe éthique permettant de distinguer le bien du mal, la dictature apparaît comme une solution dialectique appropriée à la conscience de chaque époque. Et bien qu'il y ait chez Hegel un refus de la domination par la force, dans un monde livré à lui-même, sans référents absolus, la maxime abstraite de ce qui doit être prédomine.

Dans le domaine de l'irrationalisme, nous avons les doctrines politiques de l'action directe, et en particulier Schmitt fait allusion à George Sorel, qui, ayant pris comme point de référence les théoriciens anarchistes et la lutte syndicale et ses instruments comme la grève révolutionnaire, comprend non seulement un rejet absolu du rationalisme, mais aussi des dérivations de la démocratie libérale basée sur la division des pouvoirs et le parlementarisme. La fonction du mythe avait un caractère mystique et presque métahistorique, sur la base duquel un peuple comprenait que le moment était venu de construire un nouveau cycle historique. Et évidemment, la bourgeoisie et ses conceptions rationalistes du pouvoir n'avaient rien à voir avec la participation à ce destin. Car comme le souligne Schmitt, la démocratie libérale est en réalité une ploutocratie démagogique, et face à cela, le prolétariat industriel serait le sujet historique qui incarnerait le mythe par la grève générale et l'usage de la violence. Les masses prolétariennes apparaissent comme les créatrices d'une nouvelle morale supérieure au pacifisme et à l'humanitarisme bourgeois.
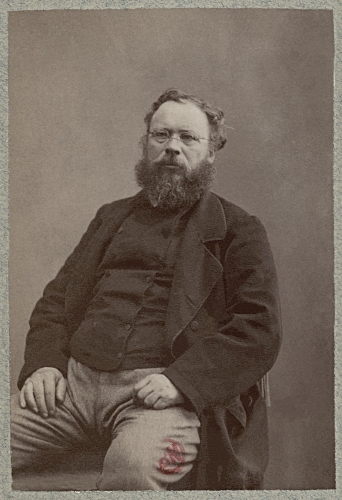

Proudhon et Donoso Cortès
Cependant, la lutte contre le constitutionnalisme parlementaire et le rationalisme libéral a trouvé des références intellectuelles et politiques plus tôt, au XIXe siècle, à travers les figures de Pierre Joseph Proudhon et de Donoso Cortés, issues de positions apparemment antagonistes comme l'anarcho-syndicalisme radical et le traditionalisme catholique contre-révolutionnaire. Ces auteurs, comme dans le cas de Sorel, étaient également favorables à l'action directe et à la violence contre ce que Donoso Cortés appelait "la classe querelleuse/discutailleuse", et face à la droite, ils étaient favorables à la dictature. De même, nous retrouvons une dimension eschatologique essentielle, ainsi que le même esprit combatif et le même appel à l'héroïsme. C'est la revendication de l'action, de la violence par opposition à l'acte parlementaire, à la discussion ou au pari sur les compromis si typiques des régimes libéraux.
Et la critique du parlementarisme s'étendrait logiquement au rationalisme lui-même, qui est la matrice d'où émergent tous les mécanismes politiques et institutionnels qui nourrissent la démocratie libérale. Le rationalisme est l'ennemi de la vie, de la tension spirituelle, de l'action, et il falsifie la réalité de l'existence, en la masquant sous les discours des intellectuels. Et c'est dans ces courants, a priori si divergents, que Schmitt trouve les principes et les idées nécessaires pour structurer un discours antilibéral et antiparlementaire, en opposition à ce que le libéralisme entend par démocratie, et en opposition au marxisme, qui pour Carl Schmitt continue à vivre dans un cadre conceptuel et politico-philosophique de formes héritées des Lumières, et par conséquent du même modèle rationaliste.
19:37 Publié dans Livre, Livre, Philosophie, Révolution conservatrice, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, carl schmitt, philosophie, révolution conservatrice, philosophie politique, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
De l’urgence d’une doctrine de droite (Abel Bonnard)
12:32 Publié dans Littérature, Livre, Livre, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : abel bonnard, france, histoire, livre, modérés, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook