
Hommage à Henry Corbin
Clavis hermeneutica
par Luc-Olivier d'Algange
La philosophie est cheminement, ou plus exactement, comme le disait Heidegger, « acheminement vers la parole ». Ce qui est dit porte en soi un long parcours, une pérégrination, à la fois historique et spirituelle. Avant de parvenir à l'oreille de celui à qui elle s'adresse, la parole humaine accomplit un voyage qui la conduit des sources du Logos jusqu'à l'entendement humain. Ce voyage, à maints égards, ressemble à une Odyssée. Dans l'éclaircie de la présence de la chose dite frémissent des clartés immémoriales, des songes et des visions. Toute spéculation philosophique témoigne, en son miroitement étymologique, d'une vision qui n'appartient ni entièrement au monde sensible, ni entièrement au monde intelligible, mais participe de l'un et de l'autre en les unissant, selon la formule de Platon, « par des gradations infinies ». L’idée est à la fois la « chose vue », l’Idea au sens grec, la forme, et la « cause » qui nous donne à voir. De même que la parole ne se situe ni exactement dans la bouche de celui qui parle ni exactement dans l'oreille de celui qui entend, mais entre eux, le monde imaginal, qui sera au principe de l'herméneutique corbinienne, se situe entre l'Intelligible et le sensible, donnant ainsi accès à la fois à l'un et à l'autre et favorisant ainsi l'étude historique la mieux étayée non moins que l'interprétation spirituelle la plus précise.
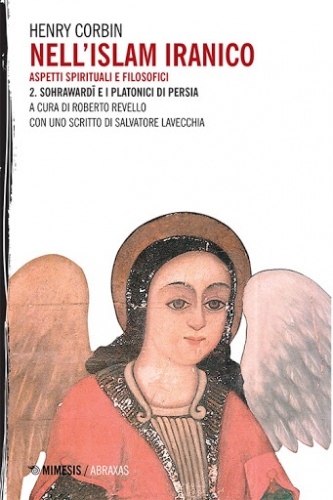 On pourrait, par analogie, transposer ce qu'à propos de Mallarmé, Charles Mauron nomma le « symbolisme du drame solaire ». De l'Occident extrême, crépusculaire, de Sein und Zeit, de la méditation allemande du déclin de l'Occident, une pérégrination débute, qui conduit, à travers l'œuvre-au-noir et la mise-en-demeure de « l’être pour la mort » à l'aurora consurgens de la « renaissance immortalisante ». Point de rupture, ni de renversement, ici, mais un patient approfondissement de la question. Le crépuscule inquiétant des poèmes de Trakl, la « lumière noire » de la foudre d'Apollon des poèmes d'Hölderlin, ne contredisent point mais annoncent l'âme d'azur, « dis-cédée », et la terre céleste dans le resplendissement du Logos. Le crépuscule détient le secret de l'aurore, l'extrême Occident tient, dans son déclin, le secret de la sagesse orientale. Au philosophe, pour qui, je cite, « les variations linguistiques ne sont que des incidents de parcours, ne signalent que des variantes topographiques d'importance secondaires », l'art de l'interprétation sera une attention matutinale. A l'orée des signes, entre le jour et la nuit, sur la lisière impondérable, il n'est pas impossible que le secret de l'aube et le secret du crépuscule, le secret de l'Occident et le secret de l'Orient soient un seul un même secret. L'attention herméneutique guette cet instant où le Sens s'empourpre comme l'Archange dont parle le Traité de Sohravardî.
On pourrait, par analogie, transposer ce qu'à propos de Mallarmé, Charles Mauron nomma le « symbolisme du drame solaire ». De l'Occident extrême, crépusculaire, de Sein und Zeit, de la méditation allemande du déclin de l'Occident, une pérégrination débute, qui conduit, à travers l'œuvre-au-noir et la mise-en-demeure de « l’être pour la mort » à l'aurora consurgens de la « renaissance immortalisante ». Point de rupture, ni de renversement, ici, mais un patient approfondissement de la question. Le crépuscule inquiétant des poèmes de Trakl, la « lumière noire » de la foudre d'Apollon des poèmes d'Hölderlin, ne contredisent point mais annoncent l'âme d'azur, « dis-cédée », et la terre céleste dans le resplendissement du Logos. Le crépuscule détient le secret de l'aurore, l'extrême Occident tient, dans son déclin, le secret de la sagesse orientale. Au philosophe, pour qui, je cite, « les variations linguistiques ne sont que des incidents de parcours, ne signalent que des variantes topographiques d'importance secondaires », l'art de l'interprétation sera une attention matutinale. A l'orée des signes, entre le jour et la nuit, sur la lisière impondérable, il n'est pas impossible que le secret de l'aube et le secret du crépuscule, le secret de l'Occident et le secret de l'Orient soient un seul un même secret. L'attention herméneutique guette cet instant où le Sens s'empourpre comme l'Archange dont parle le Traité de Sohravardî.
Cet Archange empourpré, dont une aile est blanche et l'autre noire, dont l'envol repose à la fois sur le jour et sur la nuit, est le Sens lui-même qui se refuse à l'exclusive ou à la division. Opposer l'Orient et l'Occident, ce serait ainsi refuser le drame solaire du Logos lui-même, découronner le Logos, le réduire à n'être qu'une monnaie d'échange, un or irradié, dont la valeur est attribuée, utilitaire au lieu d'être un or irradiant, donateur et philosophal, forgé dans l'œuvre-au-rouge de l'herméneutique. Tout homme habitué au patient compagnonnage avec des textes lointains ou difficiles connaît ce moment de l'éclaircie, où le Sens s'exhausse de sa gangue, où les signes s'irisent, où l'exil devient la fine pointe des retrouvailles. Après avoir affronté les tempêtes et le silence des vents, l'excès du mouvement comme l'excès de l'immobilité, la houle et la désespérance du navire encalminé, après avoir déjoué les ruses de Calypso, les asiles fallacieux, et la nuit et le jour également aveuglants, l'odyssée herméneutique entrevoit le retour à la question d'origine, enfin déployée comme une voile heureuse. L'acheminement se distingue du simple cheminement. L'herméneute s'achemine vers: il ne vagabonde point, il pèlerine vers le secret de la question qu'il se pose au commencement. Il ne fuit point, ne s'éloigne point, mais s'approche au plus près du Dire dans la chose dite, de l'essence même du Logos qui parle à travers lui.
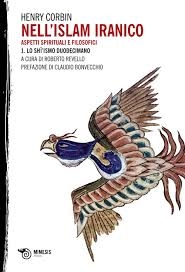 Toute herméneutique est donc odysséenne, par provenance et destination. Elle l'est par provenance, comme en témoigne le catalogue des œuvres détruites par le feu de la bibliothèque d'Alexandrie dont une grande part fut consacrée à la méditation du « logos intérieur » (selon la formule du Philon d'Alexandrie) de l'Odyssée, et dont quelques fragments nous demeurent, tel que L'Antre des Nymphes de Porphyre. L'Orient, comme l'Occident demeure spolié de cet héritage de l'herméneutique alexandrine où s'opéra la fécondation mutuelle du Logos grec et de la sagesse hébraïque. L'herméneutique est odysséenne par destination en ce qu'elle ne cesse de vouloir retrouver dans l'oméga, le sens de l'alpha initial. Pour l'herméneute, l'horizon du voyage est le retour. La ligne ultime, celle de l'horizon, comme « l'heure treizième » du sonnet de Gérard de Nerval, est aussi et toujours la première ligne de ce livre originel que figurent les rouleaux de la mer. L'herméneute, pour s'avancer sur les abysses, dont les couleurs assombries sont elles-mêmes l'interprétation de la lumière du ciel, pour s'orienter dans les étendues qui lui paraissent infinies, ne dispose que du sextant de son entendement qu'il sait faillible, dont il sait qu'il n'est qu'un instrument,- ce qui lui épargnera l'hybris de la raison qui omet de s'interroger sur elle-même et les errances du discours subjectif qui perd de vue l'alpha et l'oméga et restreint le sens dans l'aléatoire, l'éphémère et l'accidentel.
Toute herméneutique est donc odysséenne, par provenance et destination. Elle l'est par provenance, comme en témoigne le catalogue des œuvres détruites par le feu de la bibliothèque d'Alexandrie dont une grande part fut consacrée à la méditation du « logos intérieur » (selon la formule du Philon d'Alexandrie) de l'Odyssée, et dont quelques fragments nous demeurent, tel que L'Antre des Nymphes de Porphyre. L'Orient, comme l'Occident demeure spolié de cet héritage de l'herméneutique alexandrine où s'opéra la fécondation mutuelle du Logos grec et de la sagesse hébraïque. L'herméneutique est odysséenne par destination en ce qu'elle ne cesse de vouloir retrouver dans l'oméga, le sens de l'alpha initial. Pour l'herméneute, l'horizon du voyage est le retour. La ligne ultime, celle de l'horizon, comme « l'heure treizième » du sonnet de Gérard de Nerval, est aussi et toujours la première ligne de ce livre originel que figurent les rouleaux de la mer. L'herméneute, pour s'avancer sur les abysses, dont les couleurs assombries sont elles-mêmes l'interprétation de la lumière du ciel, pour s'orienter dans les étendues qui lui paraissent infinies, ne dispose que du sextant de son entendement qu'il sait faillible, dont il sait qu'il n'est qu'un instrument,- ce qui lui épargnera l'hybris de la raison qui omet de s'interroger sur elle-même et les errances du discours subjectif qui perd de vue l'alpha et l'oméga et restreint le sens dans l'aléatoire, l'éphémère et l'accidentel.
Ainsi devons-nous à Henry Corbin, non seulement la lumière faite sur des pans méconnus des cultures orientales et occidentales mais aussi le recouvrance de l'Art herméneutique à sa fine pointe, qui au-delà de l'exposition et de l'explication, serait une nouvelle implication du lecteur dans l'écrit qui se déroule sous ses yeux. Loin de considérer les œuvres de Mollâ Sadrâ ou de Ruzbéhan de Shîraz comme des objets culturels, délimités par l'histoire et la géographie, et dont nous séparerait à jamais la doxa de notre temps, Henry Corbin nous restitue à elles, à notre possibilité de les comprendre (dont dépend la possibilité de nous comprendre nous-mêmes), à cette implication, plus pointue que toute explication, à cette gnosis qui, je cite « convertit en jour cette nuit qui pourtant est toujours là, mais qui est une nuit de lumière ». « Ainsi donc, écrit Henry Corbin, lorsqu'il nous arrive de mettre en épigraphe les mots Ex oriente lux, nous nous tromperions du tout au tout en croyant dire la même chose que les Spirituels dont il sera question ici, si, pour guetter cette lumière de l'Orient, nous nous contentions de nous tourner vers l'orient géographique. Car, lorsque nous parlons du Soleil se levant à l'orient, cela réfère à la lumière du jour qui succède à la nuit. Le jour alterne avec la nuit, comme alternent deux contrastes qui, par essence, ne peuvent coexister. Lumière se levant à l'orient, et lumière déclinant à l'occident: deux prémonitions d'une option existentielle entre le monde du Jour et ses normes et le monde de la nuit, avec sa passion profonde et inassouvissable. Tout au plus, à leur limite, un double crépuscule: crepusculum vesperinum qui n'est plus le jour et qui n'est pas encore la nuit; crepusculum matutinum qui n'est plus la nuit et n'est pas encore le jour. C'est par cette image saisissante, on le sait, que Luther définissait l'être de l'homme ».
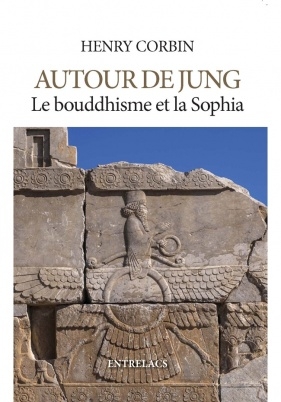 Dans ce crépuscule matutinal, auquel Baudelaire consacra un poème, dans cette lumière transversale, rasante, où le ciel semble plus proche de la terre, tout signe devient sacramentum, c'est-à-dire signe d'une chose cachée. L'oméga du crépuscule vespéral ouvre la mémoire à l'anamnésis du crépuscule matutinal. Par l'interprétation du « signe caché », du sacramentum, l'herméneute récitera, mais en sens inverse, le voyage de l'incarnation de l'esprit dans la matière, semblable, je cite « à la Columna gloriae constituée de toutes les parcelles de Lumière remontant de l'infernum à la terre de lumière, la Terra lucida ».
Dans ce crépuscule matutinal, auquel Baudelaire consacra un poème, dans cette lumière transversale, rasante, où le ciel semble plus proche de la terre, tout signe devient sacramentum, c'est-à-dire signe d'une chose cachée. L'oméga du crépuscule vespéral ouvre la mémoire à l'anamnésis du crépuscule matutinal. Par l'interprétation du « signe caché », du sacramentum, l'herméneute récitera, mais en sens inverse, le voyage de l'incarnation de l'esprit dans la matière, semblable, je cite « à la Columna gloriae constituée de toutes les parcelles de Lumière remontant de l'infernum à la terre de lumière, la Terra lucida ».
Matutinale est la pensée de l'implication dont l'interprétation est semblable à une procession liturgique, à une trans-ascendance vers la nuit lumineuse des Symboles. Voir les signes du monde et le monde des signes à la lumière de l'Ange suppose cette conquête du « suprasensible concret » qui n'appartient ni au monde matériel ni au monde de l'abstraction, mais à la présence même, qui selon la formule Héraclite, traduite par Battistini, « ne voile point, ne dévoile point, mais fait signe ». Or, si tout signe est signe d'éternité, la chance prodigieuse nous est offerte de lire les œuvres non plus au passé, comme s'y emploient les historiographies profanes et les fondamentalismes, mais bien au présent, à la lumière matutinale de l'Ange de la présence, témoin céleste de l'avènement herméneutique qui, souligne Henry Corbin, « implique justement la rupture avec le collectif, le rejonction avec la dimension transcendante qui prémunit individuellement la personne contre les sollicitations du collectif, c'est-à-dire contre toute socialisation du spirituel ».
L'implication de l'herméneute dans le déchiffrement des signes, le monde lui-même apparaissant, selon l'expression de Hugues de Saint-Victor, comme « la grammaire de Dieu », dévoile ainsi la vérité matutinale de l'Orient, en tant que « pôle de l'être », centre métaphysique, d'où l'Archange Logos nous invite à la transfiguration de l'entendement, à la conquête d'une surconscience délivrée des logiques grégaires, des infantilismes et des bestialités de ce que Simone Weil, après Platon, nomma « le Gros Animal », autrement dit, le monde social réduit à lui-même. « Le jour de la conscience, écrit Henry Corbin, forme un entre-deux entre la nuit lumineuse de la surconscience et la nuit ténébreuse de l'inconscience ». La psychologie transcendantale, dont Novalis, dans son Encyclopédie, déplorait l'inexistence ou la disparition, Henry Corbin en retrouvera non seulement les traces, mais la connaissance admirablement déployée dans la « Science de la Balance » et les théories chromatiques des soufis qui décrivent exactement l'espace versicolore entre la nuit ténébreuse et la nuit lumineuse, entre l'inconscience et la surconscience. L'intérêt de l'étude de cette psychologie transcendantale dépasse, et de fort loin, l'histoire des idées; elle se laisse si peu lire au passé, elle devance si largement nos actuels savoirs psychologiques que l'on doit imputer sans doute à une déplorable imperméabilité des disciplines qu'elle n'eût point encore renouvelé de fond en comble ces « sciences humaines » qui se revendiquent aujourd'hui de la psychologie ou de la psychanalyse, et semblent encore tributaires, à maint égards, du positivisme du dix-neuvième siècle.
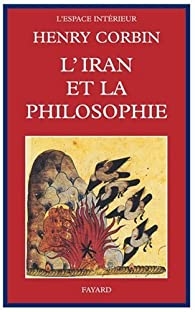 Sans doute le moment est-il venu de ressaisir aussi l'œuvre de Henry Corbin dans cette vertu transdisciplinaire, qui fut d'ailleurs de tous temps le propre de toutes les grandes œuvres philosophiques, à commencer par celle de Sohravardî qui, dans son traité de la Sagesse orientale, résume toutes les sciences de son temps, à l'intersection des sagesses grecques, abrahamiques, zoroastriennes et védantiques.
Sans doute le moment est-il venu de ressaisir aussi l'œuvre de Henry Corbin dans cette vertu transdisciplinaire, qui fut d'ailleurs de tous temps le propre de toutes les grandes œuvres philosophiques, à commencer par celle de Sohravardî qui, dans son traité de la Sagesse orientale, résume toutes les sciences de son temps, à l'intersection des sagesses grecques, abrahamiques, zoroastriennes et védantiques.
De l'herméneutique heideggérienne, dont il fut un des premiers traducteur, jusqu'à cette phénoménologie de l'Esprit gnostique, que sont les magistrales études sur l'imagination créatrice dans le soufisme d'Ibn’Arabî, Henry Corbin renoue avec la lignée des philosophes qui ne limitent point leur dessein à méditer sur l'essence ou la légitimité de la philosophie, mais œuvrent, à l'exemple de Leibniz ou de Pascal, à partir d'un savoir, d'un corpus de connaissances, qu'ils portent au jour et qui, sans eux fût demeuré voilé, méconnu ou hors d'atteinte. L'acheminement, à travers les disciplines diverses qu'il éclaire, rétablit l'usage d'une gnose polyglotte et transdisciplinaire qui s'affranchit des assignations ordinaires du spécialiste. Au voyage extérieur, historique et géographique, correspond un voyage intérieur vers la Jérusalem Céleste, pour autant que ces deux personnage: le Chevalier de la célèbre gravure de Dürer, chère à Gilbert Durand, qui s'achemine vers le Jérusalem Céleste, entre la Mort et le Diable, et Ulysse sont les deux versants, l'un grec et l'autre abrahamique, de l'aventure herméneutique.
Mais revenons, faisons retour sur le principe même de l'acheminement, à partir d'une phrase lumineuse d'Eugenio d'Ors qui écrivait, je cite « Tout ce qui n'est pas tradition est plagiat ». L'herméneute participe de la tradition en ce qu'il suppose possible la traduction, en ce qu'il ne croit point en la nature arbitraire, immanente et close des langues humaines. Traduire, suppose à l'évidence, que l'on ne récuse point l'existence du Sens. Hamann, dans sa Rhapsodie en prose Kabbalistique, éclaire le processus herméneutique même de la traduction: « Parler, c'est traduire d'une langue angélique en une langue humaine, c'est-à-dire des pensées en des mots, des choses en des noms, des images en des signes ». Ce qui, dans les œuvres se donne à traduire est déjà, à l'origine, la traduction d'une langue angélique. L'office du traducteur-herméneute consistera alors à faire, selon la formule phénoménologique, « acte de présence » à ce dont le texte qu'il se propose de traduire est lui-même la traduction. Les théologiens médiévaux nommaient cette « présence » en amont, la vox cordis, la voix du cœur.
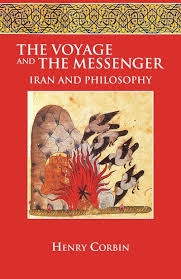 Loin de délaisser l'herméneutique heideggérienne et la phénoménologie occidentale, Henry Corbin en accomplit ainsi les possibles en de nouvelles palingénésies. A lire « au présent » les œuvres du passé, l'herméneute révèle le futur voilé inaccompli dans « l'Ayant-été ». « L'être-là, le dasein, écrit Henry Corbin, c'est essentiellement faire acte de présence, acte de cette présence par laquelle et pour laquelle se dévoile le sens au présent, cette présence sans laquelle quelque chose comme un sens au présent ne serait jamais dévoilé. La modalité de cette présence est bien alors d'être révélante, mais de telle sorte qu'en révélant le sens, c'est elle-même qui se révèle, elle-même qui est révélée ». L'implication essentielle de cette lecture au présent, qui révèle ce que le passé recèle d'avenir, fonde, nous dit Corbin, « le lien indissoluble, entre modi intellegendi et modi essendi, entre modes de comprendre et modes d'être ». Le dévoilement de ce qui est caché, c'est-à-dire de la vérité du Sens n'est possible que par cet acte de présence herméneutique qui, selon la formule soufie « reconduit la chose à sa source, à son archétype ». « Cet acte de présence, nous dit Henry Corbin, consiste à ouvrir, à faire éclore l'avenir que recèle le soi-disant passé dépassé. C'est le voir en avant de soi. ». A cet égard l'œuvre de Henry Corbin, bien plus que celle de Sartre ou de Derrida, qui usèrent à leur façon des approches de Sein und Zeit, semble véritablement répondre à la mise-en-demeure de la question heideggérienne, voire à la dépasser dans l'élan de son mouvement même.
Loin de délaisser l'herméneutique heideggérienne et la phénoménologie occidentale, Henry Corbin en accomplit ainsi les possibles en de nouvelles palingénésies. A lire « au présent » les œuvres du passé, l'herméneute révèle le futur voilé inaccompli dans « l'Ayant-été ». « L'être-là, le dasein, écrit Henry Corbin, c'est essentiellement faire acte de présence, acte de cette présence par laquelle et pour laquelle se dévoile le sens au présent, cette présence sans laquelle quelque chose comme un sens au présent ne serait jamais dévoilé. La modalité de cette présence est bien alors d'être révélante, mais de telle sorte qu'en révélant le sens, c'est elle-même qui se révèle, elle-même qui est révélée ». L'implication essentielle de cette lecture au présent, qui révèle ce que le passé recèle d'avenir, fonde, nous dit Corbin, « le lien indissoluble, entre modi intellegendi et modi essendi, entre modes de comprendre et modes d'être ». Le dévoilement de ce qui est caché, c'est-à-dire de la vérité du Sens n'est possible que par cet acte de présence herméneutique qui, selon la formule soufie « reconduit la chose à sa source, à son archétype ». « Cet acte de présence, nous dit Henry Corbin, consiste à ouvrir, à faire éclore l'avenir que recèle le soi-disant passé dépassé. C'est le voir en avant de soi. ». A cet égard l'œuvre de Henry Corbin, bien plus que celle de Sartre ou de Derrida, qui usèrent à leur façon des approches de Sein und Zeit, semble véritablement répondre à la mise-en-demeure de la question heideggérienne, voire à la dépasser dans l'élan de son mouvement même.
Ainsi de la notion fondamentale d'historialité (qu'Heidegger distingue de l'historicité en laquelle nous nous laissons insérer, nous interdisant par là même l'acte de présence phénoménologique) que Henry Corbin couronnera de la notion de hiéro-histoire: « histoire sacrale, laquelle ne vise nullement les fait extérieurs d'une "histoire sainte", d'une histoire du salut mais quelque chose de plus originel, à savoir l'ésotérique caché sous le phénomène de l'apparence littérale, celle des récits des Livres saints. » Si l'historialité permet de se déprendre des sommaires logiques déterministes, « en nous arrachant à l'historicité de l'Histoire », aux logiques purement discursives et chronologiques qui enferment les pensées dans leurs « contextes » sociologiques, la hiéro-histoire, elle, « nous apprend qu'il y a des filiations plus essentielles et plus vraies que les filiations historiques. » Non seulement les disparités linguistiques ou sociologiques ne nous interdisent pas de comprendre les œuvres du passé, mais, nous détachant des contingences de la chose dite, des écorces mortes, elles révèlent la vox cordis, la présence en acte, la vérité des filiations essentielles. L'empreinte visible détient le secret du sceau invisible et « la vieille image héraldique qui parlait en figures » dont parle Ernst Jünger dans La Visite à Godenholm, se révèle sous l'acception acquise des mots à celui interroge leur étymologie. Hamann, dans sa lumineuse « Rhapsodie » ne dit rien d'autre: « La poésie est la langue maternelle de l'humanité », de même que les alchimistes et des théosophes de l'Occident, les philosophes de la nature, les paracelsiens qui s'acheminent vers le déchiffrement des « signatures » de l'Invisible dans le visible et perçoivent la lumière révélante dans les éclats de la lumière révélée.

Le propre de cette langue, « qui parle en image », de cette langue prophétique et poétique sera, en dévoilant ce qui est caché, en laissant éclore et fleurir la lumière révélante, en élevant l'œcuménisme des branches et des racines jusqu'à la temporalité subtile de l'œcuménisme des essences et des parfums, de nous délivrer de la causalité historique, de transfigurer notre entendement, de l'ouvrir en corolle aux « Lumières seigneuriales » dont les lumières visibles et sensibles ne sont que les épiphénomènes ou les ombres. Lux umbra dei, disent les théologiens médiévaux: « La lumière est l'ombre de Dieu ». L'histoire n'est que l'ombre projetée dans les apparences de la hiéro-histoire. D'où, chez le gnostique, comme chez l'herméneute-phénoménologue, le nécessaire renversement de la métaphore.
Ce ne sont point l'Idée ou le Symbole qui sont métaphores de la nature ou de l'histoire, mais la nature et l'histoire qui sont une métaphore de l'Idée ou du Symbole. Ainsi, les interprétations allégoriques ou evhéméristes tombent d'elles-mêmes. Ce ne sont point les Symboles qui empruntent à la nature, ni les Mythes qui empruntent à l'histoire mais la nature et l'histoire qui en sont les reflets ou les réverbérations. Etre présent aux êtres et aux choses, c'est percevoir en eux l'éclat de la souveraineté divine dont ils procèdent. Le renversement de la métaphore dépasse la connaissance formelle, qui présume une représentation, pour atteindre à ce que les Ishrâqîyûns, les platoniciens de Perse, nomment une « connaissance présentielle ». Dès lors, les êtres et les choses ne sont plus des objets mais des présences. A « l'être pour la mort », qui fut pour un certain existentialisme, l'horizon indépassable de la pensée heideggérienne, et à la « laïcisation du Verbe » qui lui correspond (avec toutes les abusives et monstrueuses sacralisations de l'immanence qui s'ensuivirent), Henry Corbin répond par « l'être par-delà la mort » que dévoile « l'ek-stasis herméneutique » vers, je cite « ces autres mondes invisibles qui donnent son sens vrai au nôtre, à notre phénomène du monde. » Loin de débuter avec Sein und Zeit, comme sembleraient presque le croire quelques fondamentalistes heideggériens, la distinction classique entre l'Etre et l'étant (fut-il « Etant Suprême ») est précisément à l'origine de la méditation sur le tawhîd, sur « l'Attestation de l'Unique », qui est au cœur de la pensée d'Ibn’Arabî et de Sohravardî. Tout l'effort de ces gnostiques consiste à nous donner penser la distinction entre l'Unité théologique, exotérique, en tant que Ens supremum et l'Unificence ésotérique qui témoigne d'une ontologie de l'unité transcendantale de l'Etre. Nulle trace, ici, d'un « quiproquo onto-théologique », nul syncrétisme ou mélange malvenu. Pour reprendre la distinction platonicienne, la « doxa » ne confond pas avec la « gnosis ». Si la croyance s'adresse à un Dieu personnel ou à un Etant suprême, la gnose s'ordonne à la phrase ultime et oblative de Hallâj: « Le bon compte de l'Unique est que l'Unique le fasse unique », autrement dit, en langage eckhartien: « Le regard par lequel je vois Dieu et le regard par lequel Dieu me voit sont un seul et même regard. »

La Tradition, au sens d'art herméneutique de la traduction, Sapience de la « réelle présence », comme eût dit Georges Steiner, implication du « comprendre » dans l'être, est donc bien comme le suggère Eugenio d'Ors, recommencement, c'est-à-dire le contraire du plagiat ou du psittacisme. Ce qui est traduit recouvre son sens dans la traduction. Lorsque la traduction se prolonge en herméneutique, cette recouvrance est révélation. De même que les textes grecs nous sont parvenus par l'ambassade de la langue arabe, la traduction en français des textes persans et arabe de Sohravardî s'offre à nous comme un recommencement, une recouvrance, de la pensée grecque, aristotélicienne et platonicienne. L'œuvre de Henry Corbin s'inscrit ainsi dans une tradition et son art diplomatique, sinon par des circonstances contingentes, ne diffère pas essentiellement, des commentaires de ses prédécesseurs iraniens. Dans son mouvement odysséen, l'herméneutique, fut-elle le « commentaire d'un commentaire », ne s'éloigne point de la source du sens, mais s'en rapproche. Ainsi qu'Heidegger le disait à propos d'Hölderlin, certaines œuvres demeurent « en réserve »; et c'est bien à partir de cette « réserve », qui est le fret du navigateur, que s'accomplissent les renaissances, y compris artistiques. Point de Renaissance florentine, par exemple, sans le retour au texte, sans la volte néoplatonicienne de Pic de la Mirandole, de Marsile Ficin, ou celle kabbalistique et hébraïsante, du Cardinal Egide de Viterbe. La cause est entendue, ou devrait l'être depuis Saint-Bernard: « Nous sommes des nains assis sur les épaules des géants ». Non seulement les textes anciens ne nous sont pas devenus étrangers, incompréhensibles, inutiles, comme nous le veulent faire croire ces plagiaires qui s'intitulent parfois « progressistes », mais nos ombres qui nous devancent ne bougent que par la clarté antérieure qu'ils jettent sur nous. Traducteur, homme de Tradition, au sens étymologique, l'herméneute, ravive un lignage spirituel dont l'ultime manifestation, aussi obscurcie et profanée qu'elle soit, récapitule, pour qui sait se rendre attentif, l'entière lignée dont elle est l'aboutissement mais non la fin.
 Les ultimes sections d'En Islam iranien portent ainsi sur la notion de chevalerie spirituelle et de lignage spirituel. Ce lignage toutefois n'implique nulle archéolâtrie, nulle vénération fallacieuse des « origines ». Il n'est point tourné vers le passé, et sa redite, il n'est récapitulation morne ou cortège funèbre, mais renouvellement du Sens, fine pointe phénoménologique obéissant à l'impératif grec: sôzeïn ta phaïmomenon, sauver les phénomènes. « Ce qu'une philosophie comparée doit atteindre, écrit Henry Corbin, dans les différents secteurs d'un champ de comparaison défini, c'est avant tout ce que l'on appelle en allemand Wesenschau, la perception intuitive d'une essence ». Or cette perception intuitive dépend, non plus d'une nostalgie mais d'une attente eschatologique qui, nous dit Corbin « est enracinée au plus profond de nos consciences ». L'archéon de l'archéologie, ne suffit pas à la reconquête de l'eschaton de l'eschatologie. La transmutation du temps du ressouvenir en temps du pressentiment suppose que nous surmontions « la grande infirmité de la pensée moderne » qui est l'emprisonnement dans l'Histoire et que nous retrouvions l'accès à notre temps propre. « Un philosophe, écrit Henry Corbin, est d'abord lui-même son temps propre car s'il est vraiment un philosophe, il domine ce qu'il est abusivement convenu d'appeler son temps, alors que ce temps n'est pas du tout le sien, puisqu'il est le temps anonyme de tout le monde. »
Les ultimes sections d'En Islam iranien portent ainsi sur la notion de chevalerie spirituelle et de lignage spirituel. Ce lignage toutefois n'implique nulle archéolâtrie, nulle vénération fallacieuse des « origines ». Il n'est point tourné vers le passé, et sa redite, il n'est récapitulation morne ou cortège funèbre, mais renouvellement du Sens, fine pointe phénoménologique obéissant à l'impératif grec: sôzeïn ta phaïmomenon, sauver les phénomènes. « Ce qu'une philosophie comparée doit atteindre, écrit Henry Corbin, dans les différents secteurs d'un champ de comparaison défini, c'est avant tout ce que l'on appelle en allemand Wesenschau, la perception intuitive d'une essence ». Or cette perception intuitive dépend, non plus d'une nostalgie mais d'une attente eschatologique qui, nous dit Corbin « est enracinée au plus profond de nos consciences ». L'archéon de l'archéologie, ne suffit pas à la reconquête de l'eschaton de l'eschatologie. La transmutation du temps du ressouvenir en temps du pressentiment suppose que nous surmontions « la grande infirmité de la pensée moderne » qui est l'emprisonnement dans l'Histoire et que nous retrouvions l'accès à notre temps propre. « Un philosophe, écrit Henry Corbin, est d'abord lui-même son temps propre car s'il est vraiment un philosophe, il domine ce qu'il est abusivement convenu d'appeler son temps, alors que ce temps n'est pas du tout le sien, puisqu'il est le temps anonyme de tout le monde. »
A se délivrer du temps anonyme, autrement dit de la temporalité grégaire, propre au « Gros Animal », l'herméneute, je cite, « s'insurge contre la prétention de réduire la notion d'événement aux événements de ce monde, perceptibles par la voie empirique, constatables par tout un chacun, enregistrés dans les archives. » A cette conception de l'homme à l'intérieur de l'histoire, s'opposera, écrit Henry Corbin « une conception fondamentale, sans laquelle celle de l'histoire extérieure est privée de tout fondement. Elle considère que c'est l'histoire qui est dans l'homme ». Ces événements intérieurs, supra historiques, sans lesquels il n'y aurait point d'événements extérieurs, ces visions, intuitions ou extases qui nous font passer du monde des phénomènes à celui des noumènes sont à la fois le fruit de la grâce et d'une décision résolue. Dans sa temporalité propre reconquise Ruzbéhân de Shîraz écrit: « Il m'arriva quelque chose de semblable aux lueurs du ressouvenir et aux brusques aperçus qui s'ouvrent à la méditation. »
Ce quelque chose qui arrive, ou, plus exactement qui advient, qui n'appartient ni à la subjectivité ni à la perception empirique, n'arrive toutefois pas à n'importe qui et ne peut être jugée, ou contredit par n'importe qui. Ce que voient les yeux de feu ne saurait être contesté par les yeux de chair. « Que valent en effet, écrit Henry Corbin, les critiques adressées à ceux qui ont vus eux-mêmes, donc aux témoins oculaires, par ceux qui n'ont jamais vu et ne verront jamais rien ? La position est intrépide, je le sais, mais je crois que la situation de nos jours est telle que le philosophe, conscient de sa responsabilité, doit faire sienne cette intrépidité sohravardienne. » L'événement intérieur porte en lui le principe de la recouvrance d'une temporalité délivrée des normes profanes et de ces formes de socialisation extrême où se fourvoient les fondamentalismes religieux ou profanes. Ces événements hiérologiques dévoilent à l'intrépide, c'est-à-dire au chevalier spirituel, ce qui caché dans ce qui se révèle en frappant d'inconsistance le hiatus chronologique qui nous en sépare. Ce caché-révélé, qui réconcilie Héraclite et Platon, nous indique que l'Idée est à la fois immanente et transcendante. Elle est immanente, par les formes perceptibles qu'elle donne aux choses mais transcendante car, selon la belle formule platonisante d'André Fraigneau, « sans jeunesse antérieure et sans vieillesse possible ».
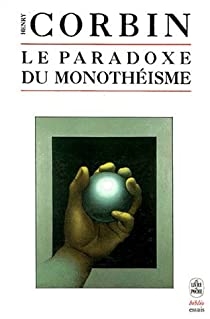 Ce paradoxe, que la philosophe platonicienne résout sous le terme de methexis, c'est-à-dire de « participation », précède un autre paradoxe. Les Platoniciens de Perse parlent en effet des Idées comme de natures ou de substances « missionnées » ou « envoyées ». Cet impérissable que sont les Idées n'est point figé dans un ciel immuable, mais nous est envoyé dans une perspective eschatologique, dans la profondeur du temps qui doit advenir. Dans le creuset de la pensée des Platoniciens de Perse, la fusion des Idées platoniciennes, des archanges zoroastriens, des Puissances divines (Dynameis) de Philon d'Alexandrie s'accomplit bien dans et par un feu prophétique. Les Lumières des Idées archétypes, comparables aux séphiroth de la kabbale hébraïque, ne demeurent point dans leur lointain: elles ont pour mission de nous faire advenir au saisissement de leur splendeur, elles nous sont « envoyées » pour que nous puissions établir un pont entre l'archéon et l'eschaton, entre ce que nous dévoile l'anamnésis et ce qui demeure caché dans les fins dernières. La Tradition à laquelle se réfère la chevalerie spirituelle n'a d'autre sens: elle est cette tension, dans la présence même de l'expérience intérieure, d'une relation entre ce qui n'est plus et ce qui n'est pas encore. Cette Tradition n'est point commémorative ou muséologique mais éveil du plus lointain dans la présence, fraîcheur castalienne, élévation verdoyante du Sens, semblable à l'Arbre qui, dans l'Ile Verte domine le temple de l'Imâm Caché.
Ce paradoxe, que la philosophe platonicienne résout sous le terme de methexis, c'est-à-dire de « participation », précède un autre paradoxe. Les Platoniciens de Perse parlent en effet des Idées comme de natures ou de substances « missionnées » ou « envoyées ». Cet impérissable que sont les Idées n'est point figé dans un ciel immuable, mais nous est envoyé dans une perspective eschatologique, dans la profondeur du temps qui doit advenir. Dans le creuset de la pensée des Platoniciens de Perse, la fusion des Idées platoniciennes, des archanges zoroastriens, des Puissances divines (Dynameis) de Philon d'Alexandrie s'accomplit bien dans et par un feu prophétique. Les Lumières des Idées archétypes, comparables aux séphiroth de la kabbale hébraïque, ne demeurent point dans leur lointain: elles ont pour mission de nous faire advenir au saisissement de leur splendeur, elles nous sont « envoyées » pour que nous puissions établir un pont entre l'archéon et l'eschaton, entre ce que nous dévoile l'anamnésis et ce qui demeure caché dans les fins dernières. La Tradition à laquelle se réfère la chevalerie spirituelle n'a d'autre sens: elle est cette tension, dans la présence même de l'expérience intérieure, d'une relation entre ce qui n'est plus et ce qui n'est pas encore. Cette Tradition n'est point commémorative ou muséologique mais éveil du plus lointain dans la présence, fraîcheur castalienne, élévation verdoyante du Sens, semblable à l'Arbre qui, dans l'Ile Verte domine le temple de l'Imâm Caché.
L'intrépidité sohravardienne qu'évoque Henry Corbin et qu'il fit sienne, cette vertu d'areté, qui est à la fois homérique et évangélique, donne seule accès à ce qu’il nomme, à partir de l'œuvre de Mollâ Sadrâ, « la métaphysique existentielle » des palingénésies et des métamorphoses que supposent le processus initiatique et la tension eschatologique: « L'acte d'exister, écrit Henry Corbin est en effet capable d'une multitude de degrés d'intensification ou de dégradation. Pour la métaphysique des essences, le statut de l'homme, par exemple, ou le statut du corps sont constant. Pour la métaphysique existentielle de Mollâ Sadrâ, être homme comporte une multitude de degrés, depuis celui des démons à face humaine jusqu'à l'état sublime de l'Homme Parfait. Ce qu'on appelle le corps passe par une multitude d'états, depuis celui du corps périssable de ce monde jusqu'à l'état du corps subtil, voire du corps divin. Chaque fois ces exaltations dépendent de l'intensification ou de l'atténuation, de la dégradation de l'existence, de l'acte d'exister ». Ce champ de variation, cette « latitude des formes » est au principe même de l'expérience intérieure, des événements du monde imaginal. Leur histoire est l'histoire sacrée de la temporalité propre du chevalier spirituel, le signe de son intrépidité à reconnaître dans les apparences la figure héraldique dont elles procèdent par la précision des lignes et l'intensité des couleurs. L'herméneutique tient ainsi à une métaphysique de l'attention et de l'intensité. La tension de l'attente eschatologique favorise l'intensité de l'attention. A l'opposé de cette tension, l'inattention à autrui, au monde et à soi-même est atténuation et dégradation de l'acte d'exister, par le mépris, l'indifférence, l'insensibilité, la complaisance dans l'illusion ou l'erreur, la vénération du confus ou de l'informe, qui engendrent les pires conformismes.
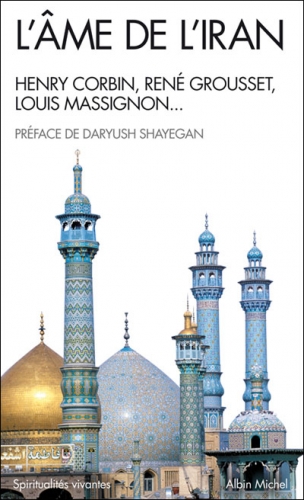 L'areté de l'herméneute, l'intrépidité chevaleresque précisent ainsi une éthique, c'est-à-dire une notion du Bien, indissociable du Vrai et du Beau qui s'exerce par l'attente et l'attention, en nous faisant hôtes, au double sens du mot: recevoir et être reçu. Si le voyage chevaleresque entre l'Orient et l'Occident définit une géographie sacrée avec ses épicentres, ses sites de haute intensité spirituelle, ses « cités emblématiques » où la Vision advint, où s'opéra la jonction entre le sensible et l'Intelligible, c'est bien parce qu'il se situe dans l'attente et dans l'attention, dans l'accroissement de la latitude des formes, et non dans la soumission aux opinions, aux jugements collectifs, fussent-ils de prétention religieuse. Que des temples eussent été édifiés à l'endroit où des errants, des déracinés, ont vu la terre et le Ciel s'accorder, que, de la sorte, l'espace et la géographie sacrée fussent déterminés par les révélations, les extases des « Nobles Voyageurs », cela suffirait à montrer que le mouvement, le tradere, la pérégrination précède les certitudes établies. D'où l'importance de la distinction, maintes fois réaffirmée par Henry Corbin et les auteurs dont il traite, entre la vérité ésotérique, intérieure, et l'exotérisme dominateur, qui veut emprisonner la spéculation et la vision dans l'immobilité d'une légalité outrecuidante et ratiocinante.
L'areté de l'herméneute, l'intrépidité chevaleresque précisent ainsi une éthique, c'est-à-dire une notion du Bien, indissociable du Vrai et du Beau qui s'exerce par l'attente et l'attention, en nous faisant hôtes, au double sens du mot: recevoir et être reçu. Si le voyage chevaleresque entre l'Orient et l'Occident définit une géographie sacrée avec ses épicentres, ses sites de haute intensité spirituelle, ses « cités emblématiques » où la Vision advint, où s'opéra la jonction entre le sensible et l'Intelligible, c'est bien parce qu'il se situe dans l'attente et dans l'attention, dans l'accroissement de la latitude des formes, et non dans la soumission aux opinions, aux jugements collectifs, fussent-ils de prétention religieuse. Que des temples eussent été édifiés à l'endroit où des errants, des déracinés, ont vu la terre et le Ciel s'accorder, que, de la sorte, l'espace et la géographie sacrée fussent déterminés par les révélations, les extases des « Nobles Voyageurs », cela suffirait à montrer que le mouvement, le tradere, la pérégrination précède les certitudes établies. D'où l'importance de la distinction, maintes fois réaffirmée par Henry Corbin et les auteurs dont il traite, entre la vérité ésotérique, intérieure, et l'exotérisme dominateur, qui veut emprisonner la spéculation et la vision dans l'immobilité d'une légalité outrecuidante et ratiocinante.
Ainsi, la notion de chevalerie spirituelle, que Henry Corbin définit comme un compagnonnage avec l'Ange, se donne à comprendre comme l'acheminement de la philosophie vers la métaphysique, c'est-à-dire vers son origine, sa source désempierrée. Loin d'être une philosophie plus abstraite que la philosophie, la métaphysique de la « latitude des formes » se distingue, comme le souligne Jean Brun par une relation concrète à des hommes concrets: « L'homme qui prétend atteindre une connaissance directe de Dieu par la nature ou par l'histoire se divinise et ne rend, en effet, témoignage que de lui-même. » Si la philosophie forge la clavis herméneutica, la métaphysique ouvre la porte qui nous porte au-delà du seuil. « Un mot simple comme l'être, écrit Jünger, a des profondeurs plus grandes qu'on ne saurait l'exprimer, ni même le penser. Par un mot comme sésame, l'un entend une poignée de graines oléagineuses, alors que l'autre, en le prononçant, ouvre d'un coup la porte d'une caverne aux trésors. Celui-ci possède la clef. Il a dérobé au pivert le secret de faire s'ouvrir la balsamine. » La clef n'est point la porte et la porte n'est point l'espace inconnu qu'elle ouvre à celui qui la franchit. Toutefois, ainsi que le souligne Jünger, « ce sont les grandes transitions que l'on remarque le moins. »
On ne saurait ainsi nier, que, par la vertu de l'art odysséen de l'herméneutique, une sorte de translation essentielle soit possible entre la philosophie et la métaphysique. Si la vérité ne se réduit pas à la cohérence des propositions logiques, si elle est bien aléthéia, dévoilement et ressouvenir, c'est-à-dire expérience intérieure où l'homme en tant qu'être du lointain s'éveille à la « coprésence », la conversion du regard qui change la philosophie en métaphysique, les yeux de chair en yeux de feu, échappe à toute contrôle, à toute vérification, voire à toute législation. De ce voyage intérieur, le grand soufi Djalal-ûd-din Rûmi put dire: « Ceci n'est pas l'ascension de l'homme jusqu'à la lune mais l'ascension de la canne à sucre jusqu'au sucre. » Le savoir ne devient Sapience, la philosophie ne devient métaphysique que par l'épreuve de la saveur, de l'essentielle intimité du voyage intérieur. S'adressant à nous, c'est-à-dire à ces êtres du lointain que nous étions pour lui, dans la coprésence du ressouvenir et de l'attente, Sohravardî nous dit « Toi-même tu es l'un des bruissements des ailes de Gabriel ». L'embarcation herméneutique est la clef de la mer et du ciel, le vaisseau subtil alchimique de l'interprétation infinie nous invite au dialogue où la lumière matérielle, sensible, devient la lux perpétua de la philosophie illuminative, autrement dit de la métaphysique. Ce que le ciel et la mer ont à se dire, en assombrissements et en splendeurs, nous invite à nous retrouver nous- mêmes. « Nous sommes un dialogue, écrit Heidegger, dans ses Approches de Hölderlin, l'unité du dialogue consiste en ce que chaque fois, dans la parole essentielle soit révélé l'Un et même sur lequel nous nous unissons, en raison duquel nous sommes Un et ainsi authentiquement nous -mêmes. » Loin de ramener le religieux au social, ou la philosophie à une religiosité grégaire, la conversion de la philosophie en métaphysique, telle qu'elle s'illustre dans l'œuvre de Henry Corbin, en ce voyage vers l'Ile Verte en la mer blanche nous conduit à une science de la vérité cachée, non détenue, et, par voie de conséquence, rétive à toute instrumentalisation.
 Ces dernières décennies nous ont montré, si nécessaire, que l'instrumentalisation du religieux en farces sanglantes appartenait bien à notre temps, qu'elle était, selon la formule de René Guénon, avec la haine du secret, un des « Signes des Temps » qui sont les nôtres. Si elle n'est pas cortège funèbre, fixation sur la lettre morte, idolâtrie des écorces de cendre, la Tradition est renaissance, recueillement dans la présence du voyage intérieur où l'Un dans son unificence devient principe d'universalité. « Il ne s'agit plus, écrit Jean Brun, de permettre à l'historicisme d'accomplir son travail dissolvant en laissant croire que la recherche des sources se situe dans le cadre d'une histoire comparée de la philosophie des religions ou de la mythologie. Toutes ces spécialités analysent des combustibles ou des cendres au lieu de se laisser illuminer par le feu de la Tradition. » Il ne s'agit pas davantage, de se soumettre, par fidélité aveugle, à des coutumes ou des dénomination confessionnelles, d'emprisonner la parole dans la catastrophe de répétition mais bien de comprendre la vertu paraclétique de la Tradition, qui n'est point un « mythe » au sens de mensonge, moins encore une réalité historique mais, selon la formule de Henry Corbin « un synchronisme réglant un champs de conscience dont les lignes de force nous montrent à l'œuvre les mêmes réalités métaphysiques. » Le Paraclet est la présence même dont l'advenue confirme en nous la pertinence de l'idée augustinienne selon laquelle le passé et le présent, par le souvenir et l'attente, sont présents dans la présence. « Tout se passe, écrit Henry Corbin, comme si une voix se faisait entendre à la façon dont se ferait entendre au grand orgue le thème d'une fugue, et qu'une autre voix lui donnât la réponse par l'inversion du thème. A celui qui peut percevoir les résonances, la première voix fera peut-être entendre le contrepoint qu'appelle la seconde, et d'épisode en épisode l'exposé de la fugue sera complet. Mais cet achèvement c'est le Mystère de la Pentecôte, et seul le Paraclet a mission de le dévoiler. »
Ces dernières décennies nous ont montré, si nécessaire, que l'instrumentalisation du religieux en farces sanglantes appartenait bien à notre temps, qu'elle était, selon la formule de René Guénon, avec la haine du secret, un des « Signes des Temps » qui sont les nôtres. Si elle n'est pas cortège funèbre, fixation sur la lettre morte, idolâtrie des écorces de cendre, la Tradition est renaissance, recueillement dans la présence du voyage intérieur où l'Un dans son unificence devient principe d'universalité. « Il ne s'agit plus, écrit Jean Brun, de permettre à l'historicisme d'accomplir son travail dissolvant en laissant croire que la recherche des sources se situe dans le cadre d'une histoire comparée de la philosophie des religions ou de la mythologie. Toutes ces spécialités analysent des combustibles ou des cendres au lieu de se laisser illuminer par le feu de la Tradition. » Il ne s'agit pas davantage, de se soumettre, par fidélité aveugle, à des coutumes ou des dénomination confessionnelles, d'emprisonner la parole dans la catastrophe de répétition mais bien de comprendre la vertu paraclétique de la Tradition, qui n'est point un « mythe » au sens de mensonge, moins encore une réalité historique mais, selon la formule de Henry Corbin « un synchronisme réglant un champs de conscience dont les lignes de force nous montrent à l'œuvre les mêmes réalités métaphysiques. » Le Paraclet est la présence même dont l'advenue confirme en nous la pertinence de l'idée augustinienne selon laquelle le passé et le présent, par le souvenir et l'attente, sont présents dans la présence. « Tout se passe, écrit Henry Corbin, comme si une voix se faisait entendre à la façon dont se ferait entendre au grand orgue le thème d'une fugue, et qu'une autre voix lui donnât la réponse par l'inversion du thème. A celui qui peut percevoir les résonances, la première voix fera peut-être entendre le contrepoint qu'appelle la seconde, et d'épisode en épisode l'exposé de la fugue sera complet. Mais cet achèvement c'est le Mystère de la Pentecôte, et seul le Paraclet a mission de le dévoiler. »
Loin de se réduire à un comparatisme profane, l'art de percevoir des résonances relève lui-même sinon du Mystère du moins d'une approche du Mystère. Husserl, qui définissait la phénoménologie comme une « communauté gnostique » disait que, pour mille étudiants capables de restituer ses cours de façon satisfaisante et même brillante, il ne devait s'en trouver que deux ou trois pour avoir vraiment réalisé en eux-mêmes l'expérience phénoménologique du « Nous transcendantal ». Sans doute en est-il de même des symboles religieux, qui peuvent être de banales représentations d'une appartenance collective ou pure présence d'un retour paraclétique à soi-même, c'est à dire au principe d'un au-delà de l'individualisme, d'une universalité métaphysique dont l'uniformisation moderne n'est que l'abominable parodie. « J'ai réfléchi, dit Hallâj, sur les dénominations confessionnelles, faisant effort pour les comprendre, et je les considère comme un Principe unique à ramification nombreuses. Ne demande donc pas à un homme d'adopter telle dénomination confessionnelle, car cela l'écarterait du Principe fondamental, et certes, c'est ce Principe Lui-même qui doit venir le chercher, Lui en qui s'élucident toutes les grandeurs et toutes les significations: et l'homme alors comprendra. »
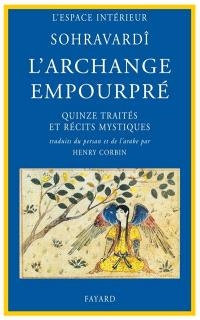 Que le Principe dût nous venir chercher, car il est de l'ordre du ressouvenir et de l'attente, de la nostalgie et du pressentiment, que nous ne puissions-nous saisir de Lui, nous l'approprier, le soumettre à l'hybris de nos ambitions trop humaines, il suffit pour s'en persuader de comprendre ce qu'Heidegger disait du langage: « Le langage n'est pas un instrument disponible, il est tout au contraire, cet historial qui lui-même dispose de la suprême possibilité de l'être de l'homme. » L'apparition vespérale-matutinale de l'Archange Logos, dont nous ne sommes qu'un bruissement, ce dévoilement de la vérité hors d'atteinte, à la fois anamnésis et désir, n'est autre, selon la formule de Rûmi que « la recherche de la chose déjà trouvée » qui, entre la nuit et le jour, réinvente le dialogue de l'Unique avec l'unique: « Si tu te rapproches de moi, c'est parce que je me suis rapproché de toi. Je suis plus près de toi que toi-même, que ton âme, que ton souffle ».
Que le Principe dût nous venir chercher, car il est de l'ordre du ressouvenir et de l'attente, de la nostalgie et du pressentiment, que nous ne puissions-nous saisir de Lui, nous l'approprier, le soumettre à l'hybris de nos ambitions trop humaines, il suffit pour s'en persuader de comprendre ce qu'Heidegger disait du langage: « Le langage n'est pas un instrument disponible, il est tout au contraire, cet historial qui lui-même dispose de la suprême possibilité de l'être de l'homme. » L'apparition vespérale-matutinale de l'Archange Logos, dont nous ne sommes qu'un bruissement, ce dévoilement de la vérité hors d'atteinte, à la fois anamnésis et désir, n'est autre, selon la formule de Rûmi que « la recherche de la chose déjà trouvée » qui, entre la nuit et le jour, réinvente le dialogue de l'Unique avec l'unique: « Si tu te rapproches de moi, c'est parce que je me suis rapproché de toi. Je suis plus près de toi que toi-même, que ton âme, que ton souffle ».
Loin d'être cet Etant suprême de la théologie exotérique, qui nous tient en exil de la vérité de l'être, séparé de l'éclaircie essentielle, Dieu est alors celui qui se voit lui-même à travers nous-mêmes, de même que nous ne parlons pas le langage mais que le langage se parle à travers nous, nous disant, par exemple, par la bouche d'Ibn’Arabî, à ce titre prédécesseur de la Mystique rhénane,: « C'est par mon œil que tu me vois , ce n'est pas par ton œil que tu peux me concevoir ». Croire que Dieu n'est qu'un Etant suprême, c'est confondre la forme avec ce qu'elle manifeste, c'est être idolâtre, c'est demeurer sourd à l'Appel, c'est renoncer à la vision du cœur et à l'attestation de l'Unique. A la tristesse, la morosité, l'ennui, la jalousie, le ressentiment qui envahissent l'âme emprisonnée dans l'exil occidental, dans le ressassement du déclin, dans l'oubli de l'oubli comme dans « la volonté de la volonté », la vertu paraclétique oppose la ferveur, la légèreté dansante, le tournoiement des possibles, l'intensification des actes d'exister. « Comment, écrit Rûmi, le soufi pourrait-il ne pas se mettre à danser, tournoyant sur lui-même comme l'atome au soleil de l'éternité afin qu'il le délivre de ce monde périssable ? » S'unissant en un même mouvement, dans un même tournoiement des possibles, la nostalgie et le pressentiment, le passé et le futur se délivrent d'eux-mêmes pour éclore dans la présence pure en corolle, qui est la réponse même, le répons, à « la question qui ne vient ni du monde, ni de l'homme ».
La clef herméneutique heideggérienne, trouvant son usage pertinent dans la métaphysique, qui n'est plus la métaphysique dualiste, et pour tout dire caricaturale, du platonisme scolaire, ni la théologie de l'Etant suprême, ni la soumission aveugle à la forme en tant que telle, - en nous ouvrant à la perspective de la « gradation infinie » des états de l'être et de la conscience, du plus atténué au plus intense, en graduant la connaissance selon les principes initiatiques, nous délivre ainsi, du même geste, de toute forme de socialisation extrême, de tout fondamentalisme, fût-il « démocratique ». L'Imâm caché sous le grand Arbre cosmogonique d'où jaillit la source la vie, l'eau castalienne de la mémoire retrouvée, interdit toute socialisation du religieux, toute réduction du Symbole à la part visible et immanente, à une beauté qui ne serait que purement terrestre, donc relative et variable selon les us et coutumes. La laideur qui s'empare des Symboles profanés, des coutumes instrumentalisées, est un signe de la fausseté qui en abuse. La Beauté prouve le Vrai, comme l'humilité et courtoisie prouvent le Bien. Si le monde sensible est la métaphore de l'intelligible, si la forme perçue est le miroir de la forme idéale, ce monde-ci, avec ses Normes profanes, ses communautés vindicatives, ne peut en aucune façon prétendre au Beau et au Vrai. « Dès que les hommes se rassemblent, écrit Henry de Montherlant, ils travaillent pour quelque erreur. Seule l'âme solitaire dialogue avec l'esprit de vérité. » Cette solitude cependant, par un paradoxe admirable, n'est point esseulement mais communion car elle suppose l'oubli de soi-même, l'extinction du moi devant l'Ange de la Face, le consentement à la pérégrination infinie loin de soi-même, dans les écumes de la mer blanche et le pressentiment de l'Ile Verte. Au relativisme absolu des Modernes, qui emprisonnent chaque chose dans une abstraction profane, pour lesquels « le corps n'est que le corps », la danse des soufis oppose l'absolu des relations tournoyantes dans l'approche d'une Beauté dont toutes les beautés relatives ne sont que l'émanation ou le reflet. A la philosophie, comme instrument de pouvoir (ce qu'elle fut, dans la continuité hégélienne, avec fureur) la métaphysique reconquise, par l'humilité et l'abandon à la grandeur divine, opposera ce décisif retournement de la métaphore qui laisse à la beauté de la vérité son resplendissement, comme le reflet du soleil sur la mer, comme la solitude de l'Unique pour un unique.
Luc-Olivier d'Algange.
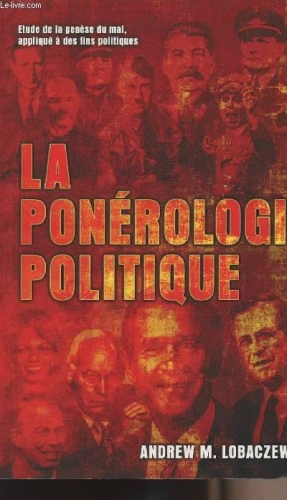 Le premier manuscrit de cet ouvrage a été jeté au feu cinq minutes avant l’arrivée de la police secrète en Pologne communiste.
Le premier manuscrit de cet ouvrage a été jeté au feu cinq minutes avant l’arrivée de la police secrète en Pologne communiste. 




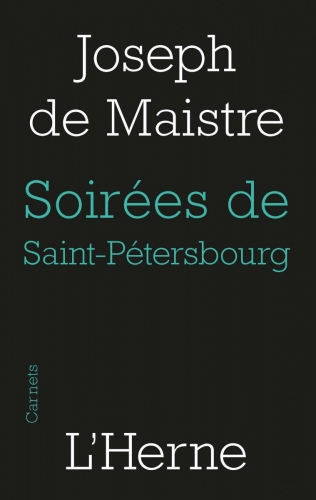
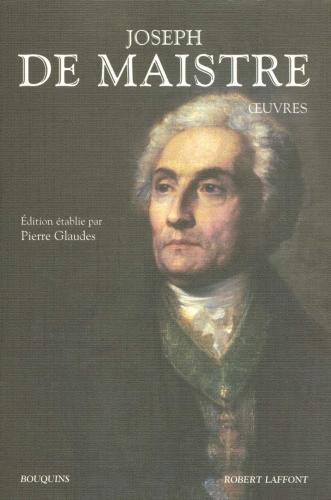
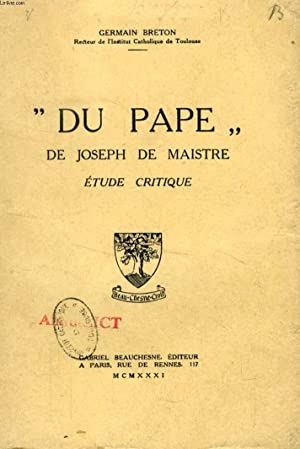 A mesure que nous nous éloignons de l'interprétation de la divine Providence, à mesure que nous nous emprisonnons dans notre refus d'être nous-mêmes interprétés par la Providence et plus nous nous soustrayons du sens, plus nous renonçons au pèlerinage pour vagabonder ; plus encore nous nous trouvons soumis, enchaînés, dépossédés, ombreux, somnambuliques. Il y a une allure propre à l'homme moderne, lente et lourde, hypnotisée et harassée. Le propre du somnambule est d'ignorer qu'il somnambulise. Quiconque s'avise de le réveiller suscitera sa rage meurtrière. Dans ce faux-sommeil nos songes sont téléguidés et nous conduisent. La difficulté à faire entrer nos contemporains dans la perspective métaphysique de Joseph de Maistre, leur antipathie instinctive pour toute considération de cette sorte tient sans doute à cette étrange addiction léthéenne. L'acte de pensée exige un effort, et de cet effort, il semble bien que les idéologies modernes soient les éminentes ennemies. Elles pourvoient inépuisablement à notre désir de ne pas penser, d'échapper à la perplexité, à l'inquiétude que suscite en nous l'idée d'une Providence. L'écrivain japonais Yasunari Kawabata définit le propre de son art comme l'exercice de ce qu'il nomme « le regard ultime »: « Si la nature est belle, c'est parce qu'elle se reflète dans mon regard ultime. »
A mesure que nous nous éloignons de l'interprétation de la divine Providence, à mesure que nous nous emprisonnons dans notre refus d'être nous-mêmes interprétés par la Providence et plus nous nous soustrayons du sens, plus nous renonçons au pèlerinage pour vagabonder ; plus encore nous nous trouvons soumis, enchaînés, dépossédés, ombreux, somnambuliques. Il y a une allure propre à l'homme moderne, lente et lourde, hypnotisée et harassée. Le propre du somnambule est d'ignorer qu'il somnambulise. Quiconque s'avise de le réveiller suscitera sa rage meurtrière. Dans ce faux-sommeil nos songes sont téléguidés et nous conduisent. La difficulté à faire entrer nos contemporains dans la perspective métaphysique de Joseph de Maistre, leur antipathie instinctive pour toute considération de cette sorte tient sans doute à cette étrange addiction léthéenne. L'acte de pensée exige un effort, et de cet effort, il semble bien que les idéologies modernes soient les éminentes ennemies. Elles pourvoient inépuisablement à notre désir de ne pas penser, d'échapper à la perplexité, à l'inquiétude que suscite en nous l'idée d'une Providence. L'écrivain japonais Yasunari Kawabata définit le propre de son art comme l'exercice de ce qu'il nomme « le regard ultime »: « Si la nature est belle, c'est parce qu'elle se reflète dans mon regard ultime. »  Les Soirées de Saint-Pétersbourg me semblent une méditation de cette envergure à nos usages français. Les voix qui s'entrecroisent au-dessus du cours du fleuve qui s'abandonne dans le soir édifient doucement, songeusement, une impondérable demeure de sérénité au-dessus des malheurs du temps. La conversation (et l'on ne saurait assez redire à quel point toute civilité, toute politique digne de ce nom, tout bonheur humain dépendent avant tout de l'art de converser) éveille, par touches successives, ce qui, dans l'entendement humain, s'est ensommeillé. Ces échanges poursuivent avec délicatesse le dessein de nous éveiller peu à peu de nos torpeurs. Sans doute a-t-il échappé aux quelques bons auteurs qui crurent voir dans les Soirées l'expression d'une pensée « fanatique » ou « totalitaire » que l'auteur désire à peine nous convaincre, à nous établir dans une conviction. On chercherait en vain, chez Joseph de Maistre, homme de bonne compagnie, cette compulsion à subordonner l'interlocuteur à ses avis par l'usage du chantage moral. Si quelques certitudes magnifiques fleurissent de ces entretiens, c'est dans l'entrelacs des voix humaines. Le lecteur auquel s'adresse Joseph de Maistre n'est point obligé à changer en mot d'ordre ou de propagande ces corolles de l'Intellect. Ce qui est exigé de lui, en revanche, c'est bien de se tenir attentif entre les échanges, d'être à l'affût entre les questions et les réponses qui ne sont elles-mêmes que de nouvelles questions. C'est à ce titre seulement qu'il pourra être au diapason de sa lecture, non par une adhésion, mais comme un quatrième interlocuteur.
Les Soirées de Saint-Pétersbourg me semblent une méditation de cette envergure à nos usages français. Les voix qui s'entrecroisent au-dessus du cours du fleuve qui s'abandonne dans le soir édifient doucement, songeusement, une impondérable demeure de sérénité au-dessus des malheurs du temps. La conversation (et l'on ne saurait assez redire à quel point toute civilité, toute politique digne de ce nom, tout bonheur humain dépendent avant tout de l'art de converser) éveille, par touches successives, ce qui, dans l'entendement humain, s'est ensommeillé. Ces échanges poursuivent avec délicatesse le dessein de nous éveiller peu à peu de nos torpeurs. Sans doute a-t-il échappé aux quelques bons auteurs qui crurent voir dans les Soirées l'expression d'une pensée « fanatique » ou « totalitaire » que l'auteur désire à peine nous convaincre, à nous établir dans une conviction. On chercherait en vain, chez Joseph de Maistre, homme de bonne compagnie, cette compulsion à subordonner l'interlocuteur à ses avis par l'usage du chantage moral. Si quelques certitudes magnifiques fleurissent de ces entretiens, c'est dans l'entrelacs des voix humaines. Le lecteur auquel s'adresse Joseph de Maistre n'est point obligé à changer en mot d'ordre ou de propagande ces corolles de l'Intellect. Ce qui est exigé de lui, en revanche, c'est bien de se tenir attentif entre les échanges, d'être à l'affût entre les questions et les réponses qui ne sont elles-mêmes que de nouvelles questions. C'est à ce titre seulement qu'il pourra être au diapason de sa lecture, non par une adhésion, mais comme un quatrième interlocuteur. 

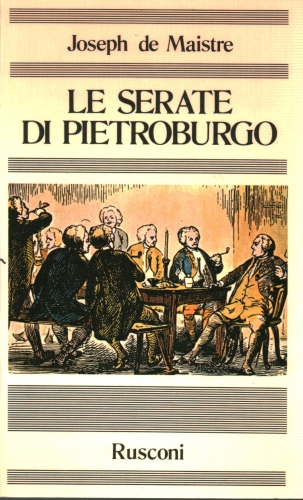
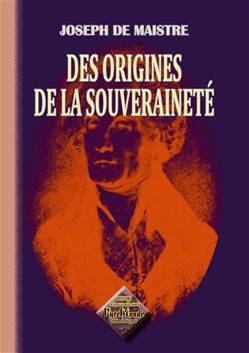 Ce philosophe que même un esprit affiné comme Cioran se laisse aller à qualifier de « dogmatique » ou « fanatique », notre privilège de quatrième interlocuteur nous donnera ainsi à le comprendre, au contraire, comme un professeur d'instabilité et d'inquiétude. Entre l'au-delà et l'en deçà se jouent nos carrières incertaines. Le sens hiérarchique que supposent de telles spéculations offusque nos égalitaristes qui, à refuser de penser la hiérarchie, succombent aux plus viles iniquités. Cette hiérarchie, qu'ils se sauraient voir, ils consentent à s'y plier aveuglement lorsqu'elle n'est plus que parodie et pure brutalité. De même, ces prétendus « individus libres » dont les bouches débordent de sarcasmes et de haine pour notre Royaume de France s'enfermeront dans leurs appartenances biologiques, sexuelles ou raciales, à triple tour, avec la bonne conscience des « minorités opprimées »; ces prétendus parangons d'universalisme s'acharneront sans relâche à la désagrégation du Pays, à sa décomposition en communautés d'intérêts ou de nature plus ou moins incertaines pour détruire toute trace de cette disposition providentielle que fut le Royaume de France et dont la nation fut l'héritière ingrate et quelque peu acariâtre. Les déterminismes les plus obtus, que la science consacre et qui les réduisent au rang de termites leur sembleront infiniment préférables aux libertés providentielles pourvu qu'ils en détinssent le pouvoir de cracher au visage de toute autorité, c'est-à-dire, de toute générosité. La tournure avaricieuse, cupide, égolâtrique de l'homme moderne tient là son origine, funeste à la fois pour la gloire et la grandeur de toute civilisation et pour la beauté des moments fugitifs qui nous étreignent et nous ravissent.
Ce philosophe que même un esprit affiné comme Cioran se laisse aller à qualifier de « dogmatique » ou « fanatique », notre privilège de quatrième interlocuteur nous donnera ainsi à le comprendre, au contraire, comme un professeur d'instabilité et d'inquiétude. Entre l'au-delà et l'en deçà se jouent nos carrières incertaines. Le sens hiérarchique que supposent de telles spéculations offusque nos égalitaristes qui, à refuser de penser la hiérarchie, succombent aux plus viles iniquités. Cette hiérarchie, qu'ils se sauraient voir, ils consentent à s'y plier aveuglement lorsqu'elle n'est plus que parodie et pure brutalité. De même, ces prétendus « individus libres » dont les bouches débordent de sarcasmes et de haine pour notre Royaume de France s'enfermeront dans leurs appartenances biologiques, sexuelles ou raciales, à triple tour, avec la bonne conscience des « minorités opprimées »; ces prétendus parangons d'universalisme s'acharneront sans relâche à la désagrégation du Pays, à sa décomposition en communautés d'intérêts ou de nature plus ou moins incertaines pour détruire toute trace de cette disposition providentielle que fut le Royaume de France et dont la nation fut l'héritière ingrate et quelque peu acariâtre. Les déterminismes les plus obtus, que la science consacre et qui les réduisent au rang de termites leur sembleront infiniment préférables aux libertés providentielles pourvu qu'ils en détinssent le pouvoir de cracher au visage de toute autorité, c'est-à-dire, de toute générosité. La tournure avaricieuse, cupide, égolâtrique de l'homme moderne tient là son origine, funeste à la fois pour la gloire et la grandeur de toute civilisation et pour la beauté des moments fugitifs qui nous étreignent et nous ravissent.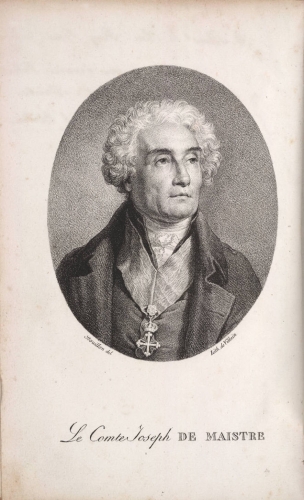
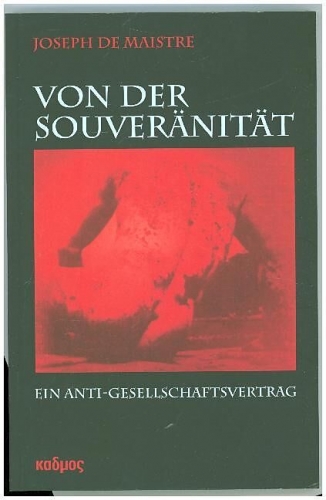
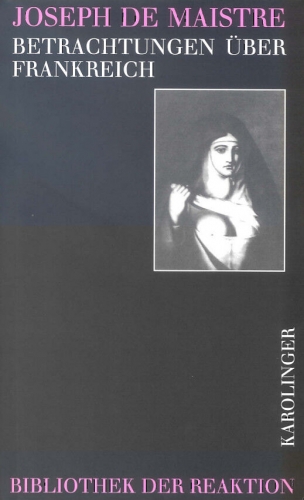
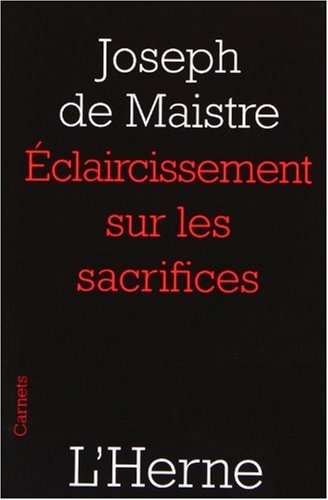 Les Soirées de Saint-Pétersbourg nous initient à une exactitude légère, une Sapience débarrassée de ses instrumentations techniques, une science noble et profonde dont le souci est d'alléger la vie, de la désentraver des déterminismes aussi fastidieux que faux qui nous emprisonnent dans l'immanence, dans la nature, dans la pesanteur. Ce qu'il importe d'aviver ou de raviver dans l'entendement humain n'est autre que la faculté d'intuition. A quoi bon une science qui nous rend plus sourd, plus lourd, plus soumis? De quelle vérité peut-elle bien se targuer si, par elle, la laideur nous entraîne vers le bas ? Il ne s'agit point de renoncer à la raison mais d'en susciter l'envol. D'une lecture maistrienne des temps présents, nous pourrons induire une attention nouvelle, une exactitude désentravée, vive pour tout dire. Alors que la critique moderne, comme l'eût dit Kierkegaard, n'aime les papillons que lorsqu'ils sont épinglés et les aigles qu'après leur passage chez le taxidermiste, la perspective maistrienne nous enseigne cette rayonnante humilité qui, pour éprise éperdument qu'elle soit du Vrai, n'en consent pas moins à le perdre de vue dans les envols de la beauté, sans en conclure pour autant que ce qui est perdu de vue n'existe pas.
Les Soirées de Saint-Pétersbourg nous initient à une exactitude légère, une Sapience débarrassée de ses instrumentations techniques, une science noble et profonde dont le souci est d'alléger la vie, de la désentraver des déterminismes aussi fastidieux que faux qui nous emprisonnent dans l'immanence, dans la nature, dans la pesanteur. Ce qu'il importe d'aviver ou de raviver dans l'entendement humain n'est autre que la faculté d'intuition. A quoi bon une science qui nous rend plus sourd, plus lourd, plus soumis? De quelle vérité peut-elle bien se targuer si, par elle, la laideur nous entraîne vers le bas ? Il ne s'agit point de renoncer à la raison mais d'en susciter l'envol. D'une lecture maistrienne des temps présents, nous pourrons induire une attention nouvelle, une exactitude désentravée, vive pour tout dire. Alors que la critique moderne, comme l'eût dit Kierkegaard, n'aime les papillons que lorsqu'ils sont épinglés et les aigles qu'après leur passage chez le taxidermiste, la perspective maistrienne nous enseigne cette rayonnante humilité qui, pour éprise éperdument qu'elle soit du Vrai, n'en consent pas moins à le perdre de vue dans les envols de la beauté, sans en conclure pour autant que ce qui est perdu de vue n'existe pas. 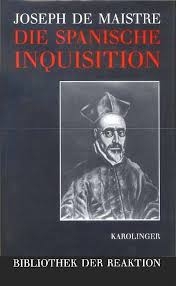 « Les témoins de la vérité viennent de tous les côtés et se présentent d'eux-mêmes: jamais ils ne se sont parlé, jamais ils ne se contredisent... » La vérité de la Tradition n'est point dans la reproduction des formes mais dans l'instant qui les suscite. Dans le très beau récit du retour à Beauregard, face à la déchéance des formes, de la tradition au sens historique, Joseph de Maistre fera intervenir la divine Providence. L'Idiot qui, par pure ingratitude a pris la place du Maître, est peut-être aussi la voix de Dieu. « Ce que Dieu fait n'est point sans raison pour votre bien. Levez-vous, c'est Dieu qui fait chanter là-bas cet idiot sur vos ruines pour vous montrer le néant des vanités humaines. Regardez en face le spectacle, car il est digne de vous, et redites-le à vos enfants. » Faire face à la destruction des formes, sans s'illusionner, peut-être est-ce en effet une chance d'atteindre au « sans-forme » dont parlent les métaphysiques les plus exigeantes d'Orient et d'Occident. Le Dieu apophatique de Maître Eckhart et de Jean Tauler, le « neti neti » du Védantâ, le « tao » de Lao-Tseu et de Lie-Tuez, « l'Inconditionné » dont parle René Guénon, sont peut-être la chance éblouissante à saisir dans la considération objective, à la fois distante et miséricordieuse, de la destruction des formes.
« Les témoins de la vérité viennent de tous les côtés et se présentent d'eux-mêmes: jamais ils ne se sont parlé, jamais ils ne se contredisent... » La vérité de la Tradition n'est point dans la reproduction des formes mais dans l'instant qui les suscite. Dans le très beau récit du retour à Beauregard, face à la déchéance des formes, de la tradition au sens historique, Joseph de Maistre fera intervenir la divine Providence. L'Idiot qui, par pure ingratitude a pris la place du Maître, est peut-être aussi la voix de Dieu. « Ce que Dieu fait n'est point sans raison pour votre bien. Levez-vous, c'est Dieu qui fait chanter là-bas cet idiot sur vos ruines pour vous montrer le néant des vanités humaines. Regardez en face le spectacle, car il est digne de vous, et redites-le à vos enfants. » Faire face à la destruction des formes, sans s'illusionner, peut-être est-ce en effet une chance d'atteindre au « sans-forme » dont parlent les métaphysiques les plus exigeantes d'Orient et d'Occident. Le Dieu apophatique de Maître Eckhart et de Jean Tauler, le « neti neti » du Védantâ, le « tao » de Lao-Tseu et de Lie-Tuez, « l'Inconditionné » dont parle René Guénon, sont peut-être la chance éblouissante à saisir dans la considération objective, à la fois distante et miséricordieuse, de la destruction des formes. 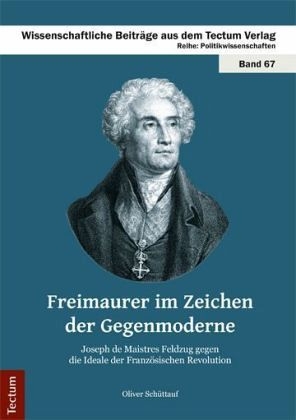 Qu'en est-il alors de la mise en demeure maistrienne ? Quel « Idiot » prophétique devrons-nous écouter comme étant la voix de Dieu, lorsque l'idiotie s'est généralisée et que la voix du Sage apparaît comme celle du fou? Quelle forme reste-t-il à détruire lorsque tout est déjà réduit à l'informe, de quelle condition se libérer lorsque nous en sommes à une reddition sans conditions ? A quelle défaite humblement consentir, lorsque le souvenir de toute victoire et de toute défaite nous a quittés ? Quelle anamnésis évoquer lorsque nous avons oublié notre oubli ? Dans quel exil puiser la force du retour, lorsque nous sommes exilés de l'exil ? Ce à quoi nous devons faire face est au-delà, désormais, de la situation maistrienne décrite par Charles-Albert de Costa de Beauregard: « Ainsi ballotté entre l'exil et une patrie plus inhospitalière encore, le pauvre esquif indécis ne savait où se rendre... » La patrie et l'exil sont oubliés et c'est au cœur de cet oubli que nous devons prendre source, établir notre règne en esprit, mais par quelle grâce ? L'enseignement du « regard ultime » abolit le temps, frappe d'inconsistance les religions elles-mêmes pour nous initier à la pure Sapience de la prière. Il n'y a plus même de formes à détruire, puisque nous sommes déjà dans l'informe et que l'informe est indestructible. Tel est bien le paradoxe admirable, ce paradoxe auquel il faut faire face, qu'il faut voir et regarder sans défaillir. Si la forme détruite peut nous donner accès au Sans-Forme, à la transcendance pure du « Sans Nom », l'informe, qui ne peut-être détruit, car il est lui-même destruction permanente de toute forme émergeante, ne donne accès à rien, sinon qu'à lui-même. De ce comble de ténèbres, il importe cependant de faire, à partir du plus infime iota de la lumière incréée, un embrasement.
Qu'en est-il alors de la mise en demeure maistrienne ? Quel « Idiot » prophétique devrons-nous écouter comme étant la voix de Dieu, lorsque l'idiotie s'est généralisée et que la voix du Sage apparaît comme celle du fou? Quelle forme reste-t-il à détruire lorsque tout est déjà réduit à l'informe, de quelle condition se libérer lorsque nous en sommes à une reddition sans conditions ? A quelle défaite humblement consentir, lorsque le souvenir de toute victoire et de toute défaite nous a quittés ? Quelle anamnésis évoquer lorsque nous avons oublié notre oubli ? Dans quel exil puiser la force du retour, lorsque nous sommes exilés de l'exil ? Ce à quoi nous devons faire face est au-delà, désormais, de la situation maistrienne décrite par Charles-Albert de Costa de Beauregard: « Ainsi ballotté entre l'exil et une patrie plus inhospitalière encore, le pauvre esquif indécis ne savait où se rendre... » La patrie et l'exil sont oubliés et c'est au cœur de cet oubli que nous devons prendre source, établir notre règne en esprit, mais par quelle grâce ? L'enseignement du « regard ultime » abolit le temps, frappe d'inconsistance les religions elles-mêmes pour nous initier à la pure Sapience de la prière. Il n'y a plus même de formes à détruire, puisque nous sommes déjà dans l'informe et que l'informe est indestructible. Tel est bien le paradoxe admirable, ce paradoxe auquel il faut faire face, qu'il faut voir et regarder sans défaillir. Si la forme détruite peut nous donner accès au Sans-Forme, à la transcendance pure du « Sans Nom », l'informe, qui ne peut-être détruit, car il est lui-même destruction permanente de toute forme émergeante, ne donne accès à rien, sinon qu'à lui-même. De ce comble de ténèbres, il importe cependant de faire, à partir du plus infime iota de la lumière incréée, un embrasement.
 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg

 Le loisir, période de temps échappant à l’empire de la nécessité et des activités en relation avec celle-ci (travail, économie, etc) s’identifie au bonheur personnel. Néanmoins sa condition de possibilité réside dans le bien de l’Etat. Ce dernier à son tour permet par son existence d’actualiser les capacités et les facultés spirituelles et morales de l’homme. Le but de la politique n’est pas la morale mais de rendre possible l’existence de celle-ci. C’est en ce sens que la morale dépend de la politique et non au sens où cette dernière dicterait les fins de la morale (tentation de la Pensée Unique contemporaine…). Pas plus qu’il ne s’agira de résorber le bonheur individuel dans un hypothétique bonheur collectif.
Le loisir, période de temps échappant à l’empire de la nécessité et des activités en relation avec celle-ci (travail, économie, etc) s’identifie au bonheur personnel. Néanmoins sa condition de possibilité réside dans le bien de l’Etat. Ce dernier à son tour permet par son existence d’actualiser les capacités et les facultés spirituelles et morales de l’homme. Le but de la politique n’est pas la morale mais de rendre possible l’existence de celle-ci. C’est en ce sens que la morale dépend de la politique et non au sens où cette dernière dicterait les fins de la morale (tentation de la Pensée Unique contemporaine…). Pas plus qu’il ne s’agira de résorber le bonheur individuel dans un hypothétique bonheur collectif.  Dans son dialogue “le Politique”, Platon rapporte le mythe selon lequel, dans un temps originel – celui de Cronos – toute chose fonctionnait en sens inverse de celui de l’ordre actuel, c’est-à-dire dans le sens originel. Cet ordre s’appliquait aussi bien aux cycles astronomiques qu’aux cycles vitaux,ainsi l’homme rajeunissait tout au long de sa croissance.
Dans son dialogue “le Politique”, Platon rapporte le mythe selon lequel, dans un temps originel – celui de Cronos – toute chose fonctionnait en sens inverse de celui de l’ordre actuel, c’est-à-dire dans le sens originel. Cet ordre s’appliquait aussi bien aux cycles astronomiques qu’aux cycles vitaux,ainsi l’homme rajeunissait tout au long de sa croissance. 
 Machiavel, lui, a désacralisé la politique, il en fait un simple instrument humain, profane, elle n’est plus ordonnée à une fin supérieure, transcendante. La question est de savoir comment prendre le pouvoir et le conserver. L’essentiel est la stabilité de l’Etat, ce qui est une redondance puisque “Lo Stato” est ce qui tient debout.
Machiavel, lui, a désacralisé la politique, il en fait un simple instrument humain, profane, elle n’est plus ordonnée à une fin supérieure, transcendante. La question est de savoir comment prendre le pouvoir et le conserver. L’essentiel est la stabilité de l’Etat, ce qui est une redondance puisque “Lo Stato” est ce qui tient debout.
 Poussée à l’extrême la thèse d’un droit naturel idéal débouche sur la conception d’un idéal de justice existant au-dessus du droit positif. “Il existe un Droit universel et immuable, source de toutes les législations positives, il n’est que la raison naturelle en tant qu’elle gouverne les hommes” (Avant-projet du Code Civil de l’An VIII).
Poussée à l’extrême la thèse d’un droit naturel idéal débouche sur la conception d’un idéal de justice existant au-dessus du droit positif. “Il existe un Droit universel et immuable, source de toutes les législations positives, il n’est que la raison naturelle en tant qu’elle gouverne les hommes” (Avant-projet du Code Civil de l’An VIII). 


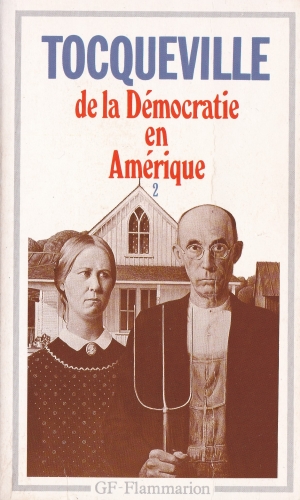 Pour imposer cela il a fallu rendre les gens bêtes. On est passé de Racine et Mozart au rap et au rock. Tocqueville écrit :
Pour imposer cela il a fallu rendre les gens bêtes. On est passé de Racine et Mozart au rap et au rock. Tocqueville écrit :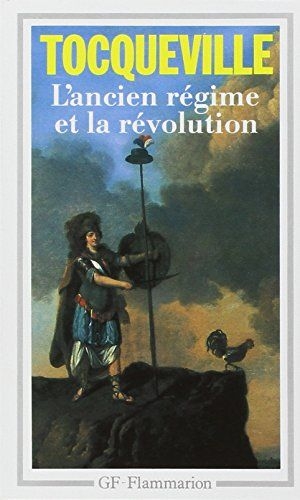 Et Tocqueville de conclure sur cette mondialisation industrielle et marchande des médiocrités partagées :
Et Tocqueville de conclure sur cette mondialisation industrielle et marchande des médiocrités partagées :
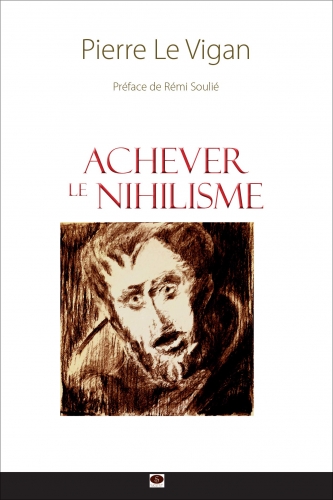
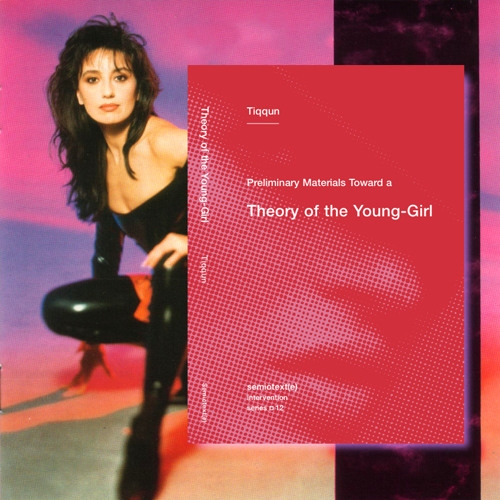
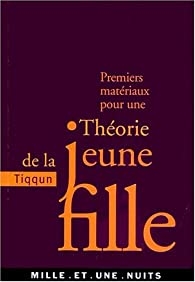 Alors que l’occident est sous contrôle psychiatrique-pathologique, belliciste-humanitaire, féministe-antiraciste, androphobe-russophobe et sociétal-transgenre, relisons ou découvrons un admirable ouvrage collectif (1) sur ce sujet instructif, la Jeune-Fille :
Alors que l’occident est sous contrôle psychiatrique-pathologique, belliciste-humanitaire, féministe-antiraciste, androphobe-russophobe et sociétal-transgenre, relisons ou découvrons un admirable ouvrage collectif (1) sur ce sujet instructif, la Jeune-Fille :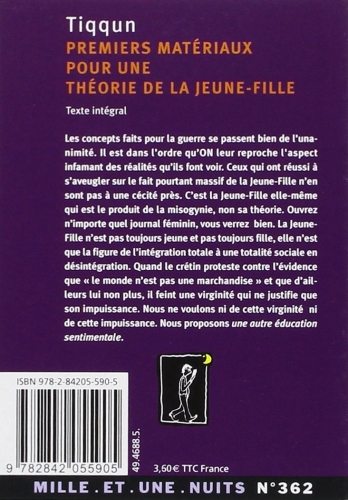

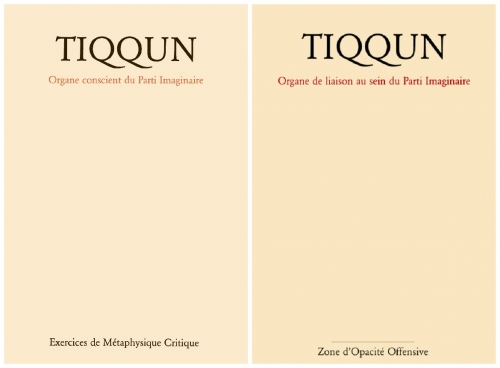
 D’où ce bon vieux virage bio :
D’où ce bon vieux virage bio : Succession d’aphorismes héraclitéens ou presque :
Succession d’aphorismes héraclitéens ou presque :
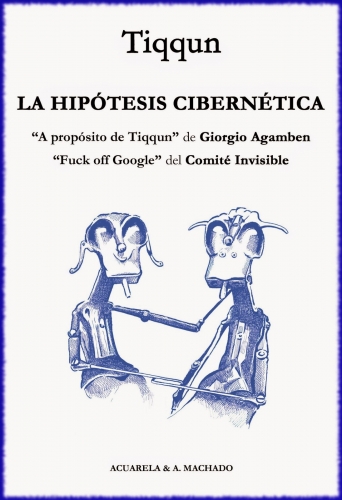








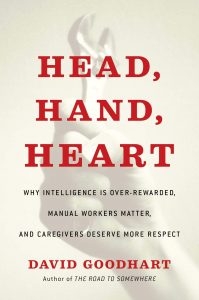 David Goodhart
David Goodhart Vocation
Vocation The three top professions are medicine, the law, and the clergy. If you feel called to do any of these jobs, don’t pass them up. As far as enlisting, I must state upfront that there are many ways to serve your country outside of the infantry. Some further advice on this can be found
The three top professions are medicine, the law, and the clergy. If you feel called to do any of these jobs, don’t pass them up. As far as enlisting, I must state upfront that there are many ways to serve your country outside of the infantry. Some further advice on this can be found 




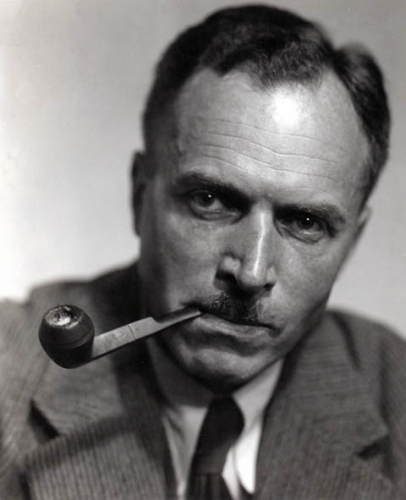

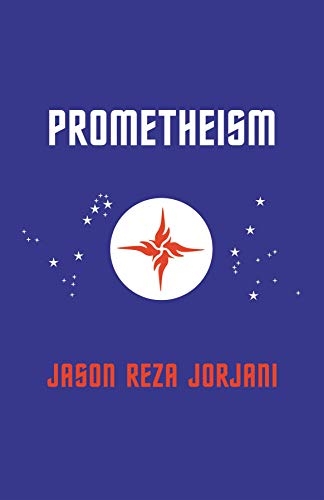


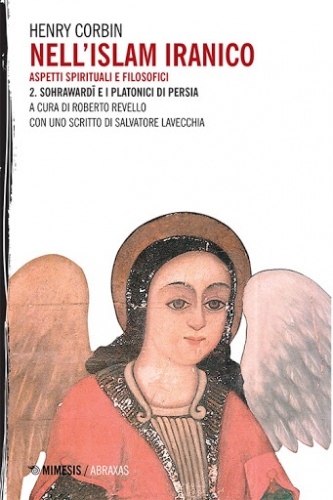 On pourrait, par analogie, transposer ce qu'à propos de Mallarmé, Charles Mauron nomma le « symbolisme du drame solaire ». De l'Occident extrême, crépusculaire, de Sein und Zeit, de la méditation allemande du déclin de l'Occident, une pérégrination débute, qui conduit, à travers l'œuvre-au-noir et la mise-en-demeure de « l’être pour la mort » à l'aurora consurgens de la « renaissance immortalisante ». Point de rupture, ni de renversement, ici, mais un patient approfondissement de la question. Le crépuscule inquiétant des poèmes de Trakl, la « lumière noire » de la foudre d'Apollon des poèmes d'Hölderlin, ne contredisent point mais annoncent l'âme d'azur, « dis-cédée », et la terre céleste dans le resplendissement du Logos. Le crépuscule détient le secret de l'aurore, l'extrême Occident tient, dans son déclin, le secret de la sagesse orientale. Au philosophe, pour qui, je cite, « les variations linguistiques ne sont que des incidents de parcours, ne signalent que des variantes topographiques d'importance secondaires », l'art de l'interprétation sera une attention matutinale. A l'orée des signes, entre le jour et la nuit, sur la lisière impondérable, il n'est pas impossible que le secret de l'aube et le secret du crépuscule, le secret de l'Occident et le secret de l'Orient soient un seul un même secret. L'attention herméneutique guette cet instant où le Sens s'empourpre comme l'Archange dont parle le Traité de Sohravardî.
On pourrait, par analogie, transposer ce qu'à propos de Mallarmé, Charles Mauron nomma le « symbolisme du drame solaire ». De l'Occident extrême, crépusculaire, de Sein und Zeit, de la méditation allemande du déclin de l'Occident, une pérégrination débute, qui conduit, à travers l'œuvre-au-noir et la mise-en-demeure de « l’être pour la mort » à l'aurora consurgens de la « renaissance immortalisante ». Point de rupture, ni de renversement, ici, mais un patient approfondissement de la question. Le crépuscule inquiétant des poèmes de Trakl, la « lumière noire » de la foudre d'Apollon des poèmes d'Hölderlin, ne contredisent point mais annoncent l'âme d'azur, « dis-cédée », et la terre céleste dans le resplendissement du Logos. Le crépuscule détient le secret de l'aurore, l'extrême Occident tient, dans son déclin, le secret de la sagesse orientale. Au philosophe, pour qui, je cite, « les variations linguistiques ne sont que des incidents de parcours, ne signalent que des variantes topographiques d'importance secondaires », l'art de l'interprétation sera une attention matutinale. A l'orée des signes, entre le jour et la nuit, sur la lisière impondérable, il n'est pas impossible que le secret de l'aube et le secret du crépuscule, le secret de l'Occident et le secret de l'Orient soient un seul un même secret. L'attention herméneutique guette cet instant où le Sens s'empourpre comme l'Archange dont parle le Traité de Sohravardî. 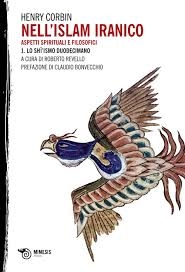 Toute herméneutique est donc odysséenne, par provenance et destination. Elle l'est par provenance, comme en témoigne le catalogue des œuvres détruites par le feu de la bibliothèque d'Alexandrie dont une grande part fut consacrée à la méditation du « logos intérieur » (selon la formule du Philon d'Alexandrie) de l'Odyssée, et dont quelques fragments nous demeurent, tel que L'Antre des Nymphes de Porphyre. L'Orient, comme l'Occident demeure spolié de cet héritage de l'herméneutique alexandrine où s'opéra la fécondation mutuelle du Logos grec et de la sagesse hébraïque. L'herméneutique est odysséenne par destination en ce qu'elle ne cesse de vouloir retrouver dans l'oméga, le sens de l'alpha initial. Pour l'herméneute, l'horizon du voyage est le retour. La ligne ultime, celle de l'horizon, comme « l'heure treizième » du sonnet de Gérard de Nerval, est aussi et toujours la première ligne de ce livre originel que figurent les rouleaux de la mer. L'herméneute, pour s'avancer sur les abysses, dont les couleurs assombries sont elles-mêmes l'interprétation de la lumière du ciel, pour s'orienter dans les étendues qui lui paraissent infinies, ne dispose que du sextant de son entendement qu'il sait faillible, dont il sait qu'il n'est qu'un instrument,- ce qui lui épargnera l'hybris de la raison qui omet de s'interroger sur elle-même et les errances du discours subjectif qui perd de vue l'alpha et l'oméga et restreint le sens dans l'aléatoire, l'éphémère et l'accidentel.
Toute herméneutique est donc odysséenne, par provenance et destination. Elle l'est par provenance, comme en témoigne le catalogue des œuvres détruites par le feu de la bibliothèque d'Alexandrie dont une grande part fut consacrée à la méditation du « logos intérieur » (selon la formule du Philon d'Alexandrie) de l'Odyssée, et dont quelques fragments nous demeurent, tel que L'Antre des Nymphes de Porphyre. L'Orient, comme l'Occident demeure spolié de cet héritage de l'herméneutique alexandrine où s'opéra la fécondation mutuelle du Logos grec et de la sagesse hébraïque. L'herméneutique est odysséenne par destination en ce qu'elle ne cesse de vouloir retrouver dans l'oméga, le sens de l'alpha initial. Pour l'herméneute, l'horizon du voyage est le retour. La ligne ultime, celle de l'horizon, comme « l'heure treizième » du sonnet de Gérard de Nerval, est aussi et toujours la première ligne de ce livre originel que figurent les rouleaux de la mer. L'herméneute, pour s'avancer sur les abysses, dont les couleurs assombries sont elles-mêmes l'interprétation de la lumière du ciel, pour s'orienter dans les étendues qui lui paraissent infinies, ne dispose que du sextant de son entendement qu'il sait faillible, dont il sait qu'il n'est qu'un instrument,- ce qui lui épargnera l'hybris de la raison qui omet de s'interroger sur elle-même et les errances du discours subjectif qui perd de vue l'alpha et l'oméga et restreint le sens dans l'aléatoire, l'éphémère et l'accidentel. 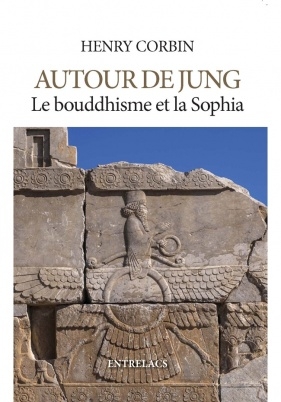 Dans ce crépuscule matutinal, auquel Baudelaire consacra un poème, dans cette lumière transversale, rasante, où le ciel semble plus proche de la terre, tout signe devient sacramentum, c'est-à-dire signe d'une chose cachée. L'oméga du crépuscule vespéral ouvre la mémoire à l'anamnésis du crépuscule matutinal. Par l'interprétation du « signe caché », du sacramentum, l'herméneute récitera, mais en sens inverse, le voyage de l'incarnation de l'esprit dans la matière, semblable, je cite « à la Columna gloriae constituée de toutes les parcelles de Lumière remontant de l'infernum à la terre de lumière, la Terra lucida ».
Dans ce crépuscule matutinal, auquel Baudelaire consacra un poème, dans cette lumière transversale, rasante, où le ciel semble plus proche de la terre, tout signe devient sacramentum, c'est-à-dire signe d'une chose cachée. L'oméga du crépuscule vespéral ouvre la mémoire à l'anamnésis du crépuscule matutinal. Par l'interprétation du « signe caché », du sacramentum, l'herméneute récitera, mais en sens inverse, le voyage de l'incarnation de l'esprit dans la matière, semblable, je cite « à la Columna gloriae constituée de toutes les parcelles de Lumière remontant de l'infernum à la terre de lumière, la Terra lucida ». 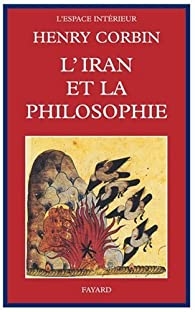 Sans doute le moment est-il venu de ressaisir aussi l'œuvre de Henry Corbin dans cette vertu transdisciplinaire, qui fut d'ailleurs de tous temps le propre de toutes les grandes œuvres philosophiques, à commencer par celle de Sohravardî qui, dans son traité de la Sagesse orientale, résume toutes les sciences de son temps, à l'intersection des sagesses grecques, abrahamiques, zoroastriennes et védantiques.
Sans doute le moment est-il venu de ressaisir aussi l'œuvre de Henry Corbin dans cette vertu transdisciplinaire, qui fut d'ailleurs de tous temps le propre de toutes les grandes œuvres philosophiques, à commencer par celle de Sohravardî qui, dans son traité de la Sagesse orientale, résume toutes les sciences de son temps, à l'intersection des sagesses grecques, abrahamiques, zoroastriennes et védantiques. 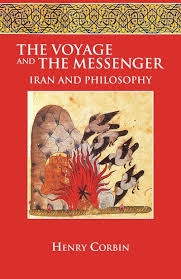 Loin de délaisser l'herméneutique heideggérienne et la phénoménologie occidentale, Henry Corbin en accomplit ainsi les possibles en de nouvelles palingénésies. A lire « au présent » les œuvres du passé, l'herméneute révèle le futur voilé inaccompli dans « l'Ayant-été ». « L'être-là, le dasein, écrit Henry Corbin, c'est essentiellement faire acte de présence, acte de cette présence par laquelle et pour laquelle se dévoile le sens au présent, cette présence sans laquelle quelque chose comme un sens au présent ne serait jamais dévoilé. La modalité de cette présence est bien alors d'être révélante, mais de telle sorte qu'en révélant le sens, c'est elle-même qui se révèle, elle-même qui est révélée ». L'implication essentielle de cette lecture au présent, qui révèle ce que le passé recèle d'avenir, fonde, nous dit Corbin, « le lien indissoluble, entre modi intellegendi et modi essendi, entre modes de comprendre et modes d'être ». Le dévoilement de ce qui est caché, c'est-à-dire de la vérité du Sens n'est possible que par cet acte de présence herméneutique qui, selon la formule soufie « reconduit la chose à sa source, à son archétype ». « Cet acte de présence, nous dit Henry Corbin, consiste à ouvrir, à faire éclore l'avenir que recèle le soi-disant passé dépassé. C'est le voir en avant de soi. ». A cet égard l'œuvre de Henry Corbin, bien plus que celle de Sartre ou de Derrida, qui usèrent à leur façon des approches de Sein und Zeit, semble véritablement répondre à la mise-en-demeure de la question heideggérienne, voire à la dépasser dans l'élan de son mouvement même.
Loin de délaisser l'herméneutique heideggérienne et la phénoménologie occidentale, Henry Corbin en accomplit ainsi les possibles en de nouvelles palingénésies. A lire « au présent » les œuvres du passé, l'herméneute révèle le futur voilé inaccompli dans « l'Ayant-été ». « L'être-là, le dasein, écrit Henry Corbin, c'est essentiellement faire acte de présence, acte de cette présence par laquelle et pour laquelle se dévoile le sens au présent, cette présence sans laquelle quelque chose comme un sens au présent ne serait jamais dévoilé. La modalité de cette présence est bien alors d'être révélante, mais de telle sorte qu'en révélant le sens, c'est elle-même qui se révèle, elle-même qui est révélée ». L'implication essentielle de cette lecture au présent, qui révèle ce que le passé recèle d'avenir, fonde, nous dit Corbin, « le lien indissoluble, entre modi intellegendi et modi essendi, entre modes de comprendre et modes d'être ». Le dévoilement de ce qui est caché, c'est-à-dire de la vérité du Sens n'est possible que par cet acte de présence herméneutique qui, selon la formule soufie « reconduit la chose à sa source, à son archétype ». « Cet acte de présence, nous dit Henry Corbin, consiste à ouvrir, à faire éclore l'avenir que recèle le soi-disant passé dépassé. C'est le voir en avant de soi. ». A cet égard l'œuvre de Henry Corbin, bien plus que celle de Sartre ou de Derrida, qui usèrent à leur façon des approches de Sein und Zeit, semble véritablement répondre à la mise-en-demeure de la question heideggérienne, voire à la dépasser dans l'élan de son mouvement même. 

 Les ultimes sections d'En Islam iranien portent ainsi sur la notion de chevalerie spirituelle et de lignage spirituel. Ce lignage toutefois n'implique nulle archéolâtrie, nulle vénération fallacieuse des « origines ». Il n'est point tourné vers le passé, et sa redite, il n'est récapitulation morne ou cortège funèbre, mais renouvellement du Sens, fine pointe phénoménologique obéissant à l'impératif grec: sôzeïn ta phaïmomenon, sauver les phénomènes. « Ce qu'une philosophie comparée doit atteindre, écrit Henry Corbin, dans les différents secteurs d'un champ de comparaison défini, c'est avant tout ce que l'on appelle en allemand Wesenschau, la perception intuitive d'une essence ». Or cette perception intuitive dépend, non plus d'une nostalgie mais d'une attente eschatologique qui, nous dit Corbin « est enracinée au plus profond de nos consciences ». L'archéon de l'archéologie, ne suffit pas à la reconquête de l'eschaton de l'eschatologie. La transmutation du temps du ressouvenir en temps du pressentiment suppose que nous surmontions « la grande infirmité de la pensée moderne » qui est l'emprisonnement dans l'Histoire et que nous retrouvions l'accès à notre temps propre. « Un philosophe, écrit Henry Corbin, est d'abord lui-même son temps propre car s'il est vraiment un philosophe, il domine ce qu'il est abusivement convenu d'appeler son temps, alors que ce temps n'est pas du tout le sien, puisqu'il est le temps anonyme de tout le monde. »
Les ultimes sections d'En Islam iranien portent ainsi sur la notion de chevalerie spirituelle et de lignage spirituel. Ce lignage toutefois n'implique nulle archéolâtrie, nulle vénération fallacieuse des « origines ». Il n'est point tourné vers le passé, et sa redite, il n'est récapitulation morne ou cortège funèbre, mais renouvellement du Sens, fine pointe phénoménologique obéissant à l'impératif grec: sôzeïn ta phaïmomenon, sauver les phénomènes. « Ce qu'une philosophie comparée doit atteindre, écrit Henry Corbin, dans les différents secteurs d'un champ de comparaison défini, c'est avant tout ce que l'on appelle en allemand Wesenschau, la perception intuitive d'une essence ». Or cette perception intuitive dépend, non plus d'une nostalgie mais d'une attente eschatologique qui, nous dit Corbin « est enracinée au plus profond de nos consciences ». L'archéon de l'archéologie, ne suffit pas à la reconquête de l'eschaton de l'eschatologie. La transmutation du temps du ressouvenir en temps du pressentiment suppose que nous surmontions « la grande infirmité de la pensée moderne » qui est l'emprisonnement dans l'Histoire et que nous retrouvions l'accès à notre temps propre. « Un philosophe, écrit Henry Corbin, est d'abord lui-même son temps propre car s'il est vraiment un philosophe, il domine ce qu'il est abusivement convenu d'appeler son temps, alors que ce temps n'est pas du tout le sien, puisqu'il est le temps anonyme de tout le monde. »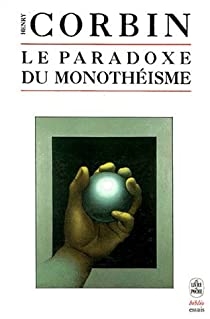 Ce paradoxe, que la philosophe platonicienne résout sous le terme de methexis, c'est-à-dire de « participation », précède un autre paradoxe. Les Platoniciens de Perse parlent en effet des Idées comme de natures ou de substances « missionnées » ou « envoyées ». Cet impérissable que sont les Idées n'est point figé dans un ciel immuable, mais nous est envoyé dans une perspective eschatologique, dans la profondeur du temps qui doit advenir. Dans le creuset de la pensée des Platoniciens de Perse, la fusion des Idées platoniciennes, des archanges zoroastriens, des Puissances divines (Dynameis) de Philon d'Alexandrie s'accomplit bien dans et par un feu prophétique. Les Lumières des Idées archétypes, comparables aux séphiroth de la kabbale hébraïque, ne demeurent point dans leur lointain: elles ont pour mission de nous faire advenir au saisissement de leur splendeur, elles nous sont « envoyées » pour que nous puissions établir un pont entre l'archéon et l'eschaton, entre ce que nous dévoile l'anamnésis et ce qui demeure caché dans les fins dernières. La Tradition à laquelle se réfère la chevalerie spirituelle n'a d'autre sens: elle est cette tension, dans la présence même de l'expérience intérieure, d'une relation entre ce qui n'est plus et ce qui n'est pas encore. Cette Tradition n'est point commémorative ou muséologique mais éveil du plus lointain dans la présence, fraîcheur castalienne, élévation verdoyante du Sens, semblable à l'Arbre qui, dans l'Ile Verte domine le temple de l'Imâm Caché.
Ce paradoxe, que la philosophe platonicienne résout sous le terme de methexis, c'est-à-dire de « participation », précède un autre paradoxe. Les Platoniciens de Perse parlent en effet des Idées comme de natures ou de substances « missionnées » ou « envoyées ». Cet impérissable que sont les Idées n'est point figé dans un ciel immuable, mais nous est envoyé dans une perspective eschatologique, dans la profondeur du temps qui doit advenir. Dans le creuset de la pensée des Platoniciens de Perse, la fusion des Idées platoniciennes, des archanges zoroastriens, des Puissances divines (Dynameis) de Philon d'Alexandrie s'accomplit bien dans et par un feu prophétique. Les Lumières des Idées archétypes, comparables aux séphiroth de la kabbale hébraïque, ne demeurent point dans leur lointain: elles ont pour mission de nous faire advenir au saisissement de leur splendeur, elles nous sont « envoyées » pour que nous puissions établir un pont entre l'archéon et l'eschaton, entre ce que nous dévoile l'anamnésis et ce qui demeure caché dans les fins dernières. La Tradition à laquelle se réfère la chevalerie spirituelle n'a d'autre sens: elle est cette tension, dans la présence même de l'expérience intérieure, d'une relation entre ce qui n'est plus et ce qui n'est pas encore. Cette Tradition n'est point commémorative ou muséologique mais éveil du plus lointain dans la présence, fraîcheur castalienne, élévation verdoyante du Sens, semblable à l'Arbre qui, dans l'Ile Verte domine le temple de l'Imâm Caché. 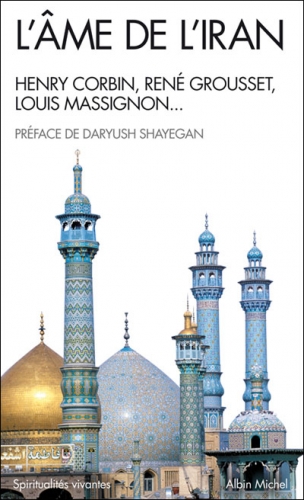 L'areté de l'herméneute, l'intrépidité chevaleresque précisent ainsi une éthique, c'est-à-dire une notion du Bien, indissociable du Vrai et du Beau qui s'exerce par l'attente et l'attention, en nous faisant hôtes, au double sens du mot: recevoir et être reçu. Si le voyage chevaleresque entre l'Orient et l'Occident définit une géographie sacrée avec ses épicentres, ses sites de haute intensité spirituelle, ses « cités emblématiques » où la Vision advint, où s'opéra la jonction entre le sensible et l'Intelligible, c'est bien parce qu'il se situe dans l'attente et dans l'attention, dans l'accroissement de la latitude des formes, et non dans la soumission aux opinions, aux jugements collectifs, fussent-ils de prétention religieuse. Que des temples eussent été édifiés à l'endroit où des errants, des déracinés, ont vu la terre et le Ciel s'accorder, que, de la sorte, l'espace et la géographie sacrée fussent déterminés par les révélations, les extases des « Nobles Voyageurs », cela suffirait à montrer que le mouvement, le tradere, la pérégrination précède les certitudes établies. D'où l'importance de la distinction, maintes fois réaffirmée par Henry Corbin et les auteurs dont il traite, entre la vérité ésotérique, intérieure, et l'exotérisme dominateur, qui veut emprisonner la spéculation et la vision dans l'immobilité d'une légalité outrecuidante et ratiocinante.
L'areté de l'herméneute, l'intrépidité chevaleresque précisent ainsi une éthique, c'est-à-dire une notion du Bien, indissociable du Vrai et du Beau qui s'exerce par l'attente et l'attention, en nous faisant hôtes, au double sens du mot: recevoir et être reçu. Si le voyage chevaleresque entre l'Orient et l'Occident définit une géographie sacrée avec ses épicentres, ses sites de haute intensité spirituelle, ses « cités emblématiques » où la Vision advint, où s'opéra la jonction entre le sensible et l'Intelligible, c'est bien parce qu'il se situe dans l'attente et dans l'attention, dans l'accroissement de la latitude des formes, et non dans la soumission aux opinions, aux jugements collectifs, fussent-ils de prétention religieuse. Que des temples eussent été édifiés à l'endroit où des errants, des déracinés, ont vu la terre et le Ciel s'accorder, que, de la sorte, l'espace et la géographie sacrée fussent déterminés par les révélations, les extases des « Nobles Voyageurs », cela suffirait à montrer que le mouvement, le tradere, la pérégrination précède les certitudes établies. D'où l'importance de la distinction, maintes fois réaffirmée par Henry Corbin et les auteurs dont il traite, entre la vérité ésotérique, intérieure, et l'exotérisme dominateur, qui veut emprisonner la spéculation et la vision dans l'immobilité d'une légalité outrecuidante et ratiocinante. Ces dernières décennies nous ont montré, si nécessaire, que l'instrumentalisation du religieux en farces sanglantes appartenait bien à notre temps, qu'elle était, selon la formule de René Guénon, avec la haine du secret, un des « Signes des Temps » qui sont les nôtres. Si elle n'est pas cortège funèbre, fixation sur la lettre morte, idolâtrie des écorces de cendre, la Tradition est renaissance, recueillement dans la présence du voyage intérieur où l'Un dans son unificence devient principe d'universalité. « Il ne s'agit plus, écrit Jean Brun, de permettre à l'historicisme d'accomplir son travail dissolvant en laissant croire que la recherche des sources se situe dans le cadre d'une histoire comparée de la philosophie des religions ou de la mythologie. Toutes ces spécialités analysent des combustibles ou des cendres au lieu de se laisser illuminer par le feu de la Tradition. » Il ne s'agit pas davantage, de se soumettre, par fidélité aveugle, à des coutumes ou des dénomination confessionnelles, d'emprisonner la parole dans la catastrophe de répétition mais bien de comprendre la vertu paraclétique de la Tradition, qui n'est point un « mythe » au sens de mensonge, moins encore une réalité historique mais, selon la formule de Henry Corbin « un synchronisme réglant un champs de conscience dont les lignes de force nous montrent à l'œuvre les mêmes réalités métaphysiques. » Le Paraclet est la présence même dont l'advenue confirme en nous la pertinence de l'idée augustinienne selon laquelle le passé et le présent, par le souvenir et l'attente, sont présents dans la présence. « Tout se passe, écrit Henry Corbin, comme si une voix se faisait entendre à la façon dont se ferait entendre au grand orgue le thème d'une fugue, et qu'une autre voix lui donnât la réponse par l'inversion du thème. A celui qui peut percevoir les résonances, la première voix fera peut-être entendre le contrepoint qu'appelle la seconde, et d'épisode en épisode l'exposé de la fugue sera complet. Mais cet achèvement c'est le Mystère de la Pentecôte, et seul le Paraclet a mission de le dévoiler. »
Ces dernières décennies nous ont montré, si nécessaire, que l'instrumentalisation du religieux en farces sanglantes appartenait bien à notre temps, qu'elle était, selon la formule de René Guénon, avec la haine du secret, un des « Signes des Temps » qui sont les nôtres. Si elle n'est pas cortège funèbre, fixation sur la lettre morte, idolâtrie des écorces de cendre, la Tradition est renaissance, recueillement dans la présence du voyage intérieur où l'Un dans son unificence devient principe d'universalité. « Il ne s'agit plus, écrit Jean Brun, de permettre à l'historicisme d'accomplir son travail dissolvant en laissant croire que la recherche des sources se situe dans le cadre d'une histoire comparée de la philosophie des religions ou de la mythologie. Toutes ces spécialités analysent des combustibles ou des cendres au lieu de se laisser illuminer par le feu de la Tradition. » Il ne s'agit pas davantage, de se soumettre, par fidélité aveugle, à des coutumes ou des dénomination confessionnelles, d'emprisonner la parole dans la catastrophe de répétition mais bien de comprendre la vertu paraclétique de la Tradition, qui n'est point un « mythe » au sens de mensonge, moins encore une réalité historique mais, selon la formule de Henry Corbin « un synchronisme réglant un champs de conscience dont les lignes de force nous montrent à l'œuvre les mêmes réalités métaphysiques. » Le Paraclet est la présence même dont l'advenue confirme en nous la pertinence de l'idée augustinienne selon laquelle le passé et le présent, par le souvenir et l'attente, sont présents dans la présence. « Tout se passe, écrit Henry Corbin, comme si une voix se faisait entendre à la façon dont se ferait entendre au grand orgue le thème d'une fugue, et qu'une autre voix lui donnât la réponse par l'inversion du thème. A celui qui peut percevoir les résonances, la première voix fera peut-être entendre le contrepoint qu'appelle la seconde, et d'épisode en épisode l'exposé de la fugue sera complet. Mais cet achèvement c'est le Mystère de la Pentecôte, et seul le Paraclet a mission de le dévoiler. » 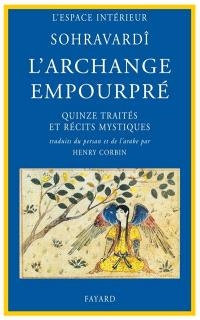 Que le Principe dût nous venir chercher, car il est de l'ordre du ressouvenir et de l'attente, de la nostalgie et du pressentiment, que nous ne puissions-nous saisir de Lui, nous l'approprier, le soumettre à l'hybris de nos ambitions trop humaines, il suffit pour s'en persuader de comprendre ce qu'Heidegger disait du langage: « Le langage n'est pas un instrument disponible, il est tout au contraire, cet historial qui lui-même dispose de la suprême possibilité de l'être de l'homme. » L'apparition vespérale-matutinale de l'Archange Logos, dont nous ne sommes qu'un bruissement, ce dévoilement de la vérité hors d'atteinte, à la fois anamnésis et désir, n'est autre, selon la formule de Rûmi que « la recherche de la chose déjà trouvée » qui, entre la nuit et le jour, réinvente le dialogue de l'Unique avec l'unique: « Si tu te rapproches de moi, c'est parce que je me suis rapproché de toi. Je suis plus près de toi que toi-même, que ton âme, que ton souffle ».
Que le Principe dût nous venir chercher, car il est de l'ordre du ressouvenir et de l'attente, de la nostalgie et du pressentiment, que nous ne puissions-nous saisir de Lui, nous l'approprier, le soumettre à l'hybris de nos ambitions trop humaines, il suffit pour s'en persuader de comprendre ce qu'Heidegger disait du langage: « Le langage n'est pas un instrument disponible, il est tout au contraire, cet historial qui lui-même dispose de la suprême possibilité de l'être de l'homme. » L'apparition vespérale-matutinale de l'Archange Logos, dont nous ne sommes qu'un bruissement, ce dévoilement de la vérité hors d'atteinte, à la fois anamnésis et désir, n'est autre, selon la formule de Rûmi que « la recherche de la chose déjà trouvée » qui, entre la nuit et le jour, réinvente le dialogue de l'Unique avec l'unique: « Si tu te rapproches de moi, c'est parce que je me suis rapproché de toi. Je suis plus près de toi que toi-même, que ton âme, que ton souffle ». 
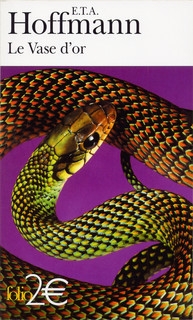 D'ordre prophétique, plutôt que systématique, les théories de Novalis éclairent la pensée qui, à l'œuvre dans Le Vase d'Or, risque de paraître allusive ou incertaine. Or, l'idée d'une intellectualité musicale, c'est-à-dire d'une intellectualité en mouvement suppose, dans la pensée de Novalis, que l'esthétique et la métaphysique soient indubitablement liées, unies, dans les variations infinies et les configurations sans cesse nouvelles de la musique. L'Intellect n'est point séparé des sens; il est, pour ainsi dire, le moyeu immobile de cette circularité synesthésique où, selon l'expression de Baudelaire, « les couleurs, les parfums et les sons se répondent. »
D'ordre prophétique, plutôt que systématique, les théories de Novalis éclairent la pensée qui, à l'œuvre dans Le Vase d'Or, risque de paraître allusive ou incertaine. Or, l'idée d'une intellectualité musicale, c'est-à-dire d'une intellectualité en mouvement suppose, dans la pensée de Novalis, que l'esthétique et la métaphysique soient indubitablement liées, unies, dans les variations infinies et les configurations sans cesse nouvelles de la musique. L'Intellect n'est point séparé des sens; il est, pour ainsi dire, le moyeu immobile de cette circularité synesthésique où, selon l'expression de Baudelaire, « les couleurs, les parfums et les sons se répondent. »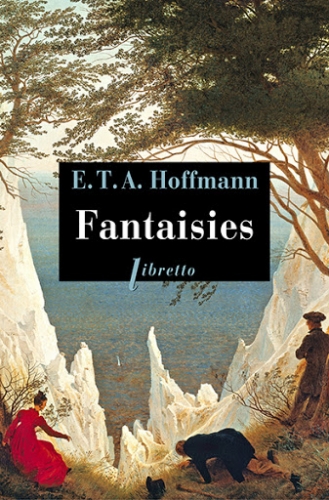 Les bruissements deviennent parole. L'inintelligible, le bruit sont gagnés par le Sens et par la musique: « Ici l'étudiant Anselme fut interrompu dans son soliloque par un étrange bruit de frôlements et de froufrous qui s'éleva dans l'herbe tout près de lui, pour glisser et monter bientôt après jusqu'aux branches et aux feuilles du sureau qui s'étalaient en voûte au-dessus de sa tête. On eût dit tantôt que le vent du soir secouait le feuillage, tantôt que les oiselets folâtraient dans les branches, agitant de-ci de-là leurs petites ailes en leurs capricieux ébats. Puis ce furent des chuchotements, des zézaiements, et il sembla que les fleurs tintaient comme autant de clochettes cristallines suspendues aux branches. Anselme ne se laissait pas de prêter l'oreille. Tout à coup, sans qu'il sut lui-même comment, ces zézaiements, ces chuchotements et ces tintements se changèrent en paroles à peine perceptibles, à moitié emportées par le vent... » La musicalité des mots coïncide avec leur ressaisissement par le sens: « Zwischen durch - zwischen ein - zwischen Zweigen, zwischen swellenden Bluten... » Le texte allemand, mieux que ses traductions françaises, restitue ce saisissement des rumeurs par la musicalité naissante du Sens dont la souveraineté soudaine tinte « comme un accord parfait de claires cloches cristallines » précédant l'apparition de Serpentina.
Les bruissements deviennent parole. L'inintelligible, le bruit sont gagnés par le Sens et par la musique: « Ici l'étudiant Anselme fut interrompu dans son soliloque par un étrange bruit de frôlements et de froufrous qui s'éleva dans l'herbe tout près de lui, pour glisser et monter bientôt après jusqu'aux branches et aux feuilles du sureau qui s'étalaient en voûte au-dessus de sa tête. On eût dit tantôt que le vent du soir secouait le feuillage, tantôt que les oiselets folâtraient dans les branches, agitant de-ci de-là leurs petites ailes en leurs capricieux ébats. Puis ce furent des chuchotements, des zézaiements, et il sembla que les fleurs tintaient comme autant de clochettes cristallines suspendues aux branches. Anselme ne se laissait pas de prêter l'oreille. Tout à coup, sans qu'il sut lui-même comment, ces zézaiements, ces chuchotements et ces tintements se changèrent en paroles à peine perceptibles, à moitié emportées par le vent... » La musicalité des mots coïncide avec leur ressaisissement par le sens: « Zwischen durch - zwischen ein - zwischen Zweigen, zwischen swellenden Bluten... » Le texte allemand, mieux que ses traductions françaises, restitue ce saisissement des rumeurs par la musicalité naissante du Sens dont la souveraineté soudaine tinte « comme un accord parfait de claires cloches cristallines » précédant l'apparition de Serpentina.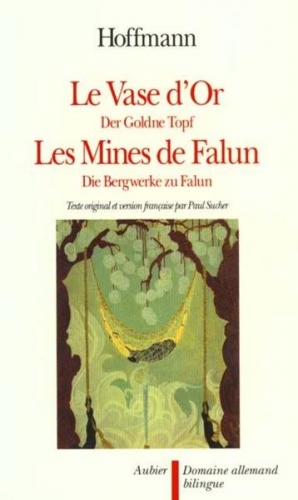 « Nullement allégoriques et littéralement vraies » sont, dans le Conte de Hoffmann, les métamorphoses. Les véritables « identités » ne sont pas détenues dans le monde profane mais elles sont les reflets des plus hautes et immémoriales identités des « seigneuries d'Atlantis ». De même que, selon Platon, le temps est l'image mobile de l'éternité, les identités des personnages sont les images mobiles d'une vérité provisoirement lointaine, mais source d'une lancinante nostalgie. Les objets eux-mêmes, menacés dans leur statut,- et par cela même menaçants,- ne sont pas exempts de ces métamorphoses. Ainsi en est-il du heurtoir de la porte de Lindhorst: « La figure de métal s'embrasant dans une hideuse fantasmagorie de lueurs bleues, se contracta en un grimaçant rictus...» Plus loin, c'est le cordon de la sonnette qui se change en reptile: « Le cordon de sonnette s'abaissant devint un serpent géant, blanc et diaphane qui l'enveloppa, l'étreignit; laçant ses anneaux de plus en plus serrés, si bien que les os flasques et broyés s'effritèrent en craquant et que le sang gicla de ses veines pénétrant le corps diaphane du serpent et le colorant de rouge. » Entre l'angoisse et l'extase, l'intellectualité musicale entraîne la pensée dans une imagerie mouvante où chaque thème et chaque image est en proie à l'exigence qui doit les changer en d'autres thèmes et d'autres images. Les métamorphoses angoissantes annoncent les métamorphoses extatiques. Le resserrement de l'angoisse va jusqu'à la pétrification. Face à l'archiviste Lindhorst, Anselme sent « un torrent de glace parcourir ses veines gelées » comme s'il était en train de se changer en statue de pierre. Par contraste, les métamorphoses extatiques n'en sont que plus ouraniennes et plus immatérielles. Sous le baiser de Phosphorus, la fleur de lys se défait de toute pesanteur et de toute compacité et s'embrase dans les hauteurs: « Et comme rayonnante de lumière, elle s'embrasa en hautes flammes, d'où fit irruption un être étranger, qui, laissant la vallée bien loi au-dessous de lui, erra en tous sens dans l'espace infini.»
« Nullement allégoriques et littéralement vraies » sont, dans le Conte de Hoffmann, les métamorphoses. Les véritables « identités » ne sont pas détenues dans le monde profane mais elles sont les reflets des plus hautes et immémoriales identités des « seigneuries d'Atlantis ». De même que, selon Platon, le temps est l'image mobile de l'éternité, les identités des personnages sont les images mobiles d'une vérité provisoirement lointaine, mais source d'une lancinante nostalgie. Les objets eux-mêmes, menacés dans leur statut,- et par cela même menaçants,- ne sont pas exempts de ces métamorphoses. Ainsi en est-il du heurtoir de la porte de Lindhorst: « La figure de métal s'embrasant dans une hideuse fantasmagorie de lueurs bleues, se contracta en un grimaçant rictus...» Plus loin, c'est le cordon de la sonnette qui se change en reptile: « Le cordon de sonnette s'abaissant devint un serpent géant, blanc et diaphane qui l'enveloppa, l'étreignit; laçant ses anneaux de plus en plus serrés, si bien que les os flasques et broyés s'effritèrent en craquant et que le sang gicla de ses veines pénétrant le corps diaphane du serpent et le colorant de rouge. » Entre l'angoisse et l'extase, l'intellectualité musicale entraîne la pensée dans une imagerie mouvante où chaque thème et chaque image est en proie à l'exigence qui doit les changer en d'autres thèmes et d'autres images. Les métamorphoses angoissantes annoncent les métamorphoses extatiques. Le resserrement de l'angoisse va jusqu'à la pétrification. Face à l'archiviste Lindhorst, Anselme sent « un torrent de glace parcourir ses veines gelées » comme s'il était en train de se changer en statue de pierre. Par contraste, les métamorphoses extatiques n'en sont que plus ouraniennes et plus immatérielles. Sous le baiser de Phosphorus, la fleur de lys se défait de toute pesanteur et de toute compacité et s'embrase dans les hauteurs: « Et comme rayonnante de lumière, elle s'embrasa en hautes flammes, d'où fit irruption un être étranger, qui, laissant la vallée bien loi au-dessous de lui, erra en tous sens dans l'espace infini.»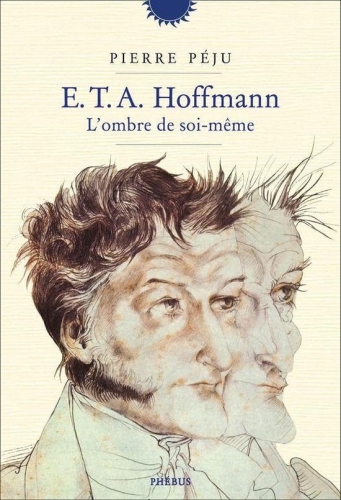
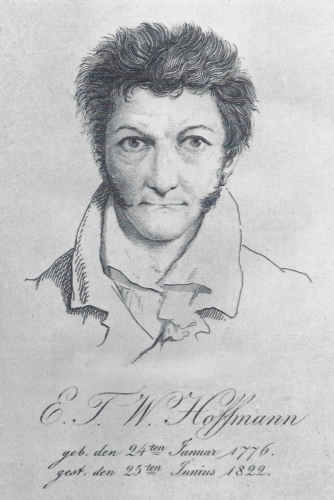

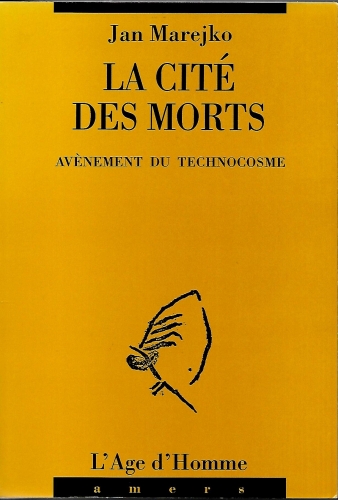
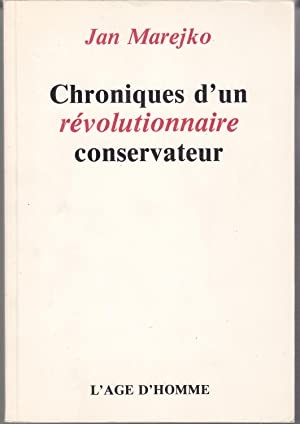 Deuxièmement, un tel discours qui, censément, n’est tenu par personne, s’énonçant par exemple en propositions mathématiques, est aussi un discours qui ne s’adresse à personne, et avec lequel on n’entre pas en conversation, un «discours qui n’est plus réponse à qui que ce soit, ni n’appelle une réponse» (CM, p. 133), et est donc littéralement sans réplique. Il s’est détaché de la relation intersubjective qui, moyennant différentes variantes ou modalités, sous-tend tout langage. C’est le second rabattement : il y a dénégation de toute interlocution.
Deuxièmement, un tel discours qui, censément, n’est tenu par personne, s’énonçant par exemple en propositions mathématiques, est aussi un discours qui ne s’adresse à personne, et avec lequel on n’entre pas en conversation, un «discours qui n’est plus réponse à qui que ce soit, ni n’appelle une réponse» (CM, p. 133), et est donc littéralement sans réplique. Il s’est détaché de la relation intersubjective qui, moyennant différentes variantes ou modalités, sous-tend tout langage. C’est le second rabattement : il y a dénégation de toute interlocution. «L’énoncé d’une parole crée une relation d’altérité entre l’esprit et son objet, de sorte que l’objet n’est plus tout à fait un objet : il est un autre à qui ou, pour mieux dire, à propos duquel se développe un discours. Et ce discours, on ne saurait affirmer avec certitude qu’il dérive du sujet qui l’énonce. [...] Puisque tout discours implique une relation d’altérité entre deux présences, il ne peut y avoir, lorsqu’une parole est prononcée, que celui qui la prononce» (CP, p. 135).
«L’énoncé d’une parole crée une relation d’altérité entre l’esprit et son objet, de sorte que l’objet n’est plus tout à fait un objet : il est un autre à qui ou, pour mieux dire, à propos duquel se développe un discours. Et ce discours, on ne saurait affirmer avec certitude qu’il dérive du sujet qui l’énonce. [...] Puisque tout discours implique une relation d’altérité entre deux présences, il ne peut y avoir, lorsqu’une parole est prononcée, que celui qui la prononce» (CP, p. 135). 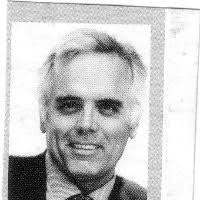 - Ce que Marejko appelle logalité rejoint la notion phénoménologique fondamentale d’intentionnalité (12). La conscience est conscience de quelque chose, ce qui suppose un «il y a»: il y a des choses, un réel, un monde –, mais inversement, ce quelque chose a besoin de la conscience ou du discours, ne disons pas pour «être»« ou pour «exister», mais pour accéder à la dimension supérieure du langage. L’intentionnalité est un mouvement de l’esprit vers les choses – c’est l’aspect principal – mais il s’accompagne d’un mouvement inverse des choses appelant leur saisie par l’esprit – il y a donc là une relation mutuelle et une certaine forme de circularité.
- Ce que Marejko appelle logalité rejoint la notion phénoménologique fondamentale d’intentionnalité (12). La conscience est conscience de quelque chose, ce qui suppose un «il y a»: il y a des choses, un réel, un monde –, mais inversement, ce quelque chose a besoin de la conscience ou du discours, ne disons pas pour «être»« ou pour «exister», mais pour accéder à la dimension supérieure du langage. L’intentionnalité est un mouvement de l’esprit vers les choses – c’est l’aspect principal – mais il s’accompagne d’un mouvement inverse des choses appelant leur saisie par l’esprit – il y a donc là une relation mutuelle et une certaine forme de circularité. 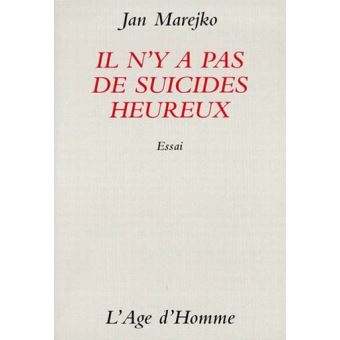 Serait-il alors erroné d’aspirer à un accord entre l’esprit et le monde, le Logos et l’Être, ou de postuler qu’un tel accord existerait déjà potentiellement ? Pas forcément. Ce qui est récusé, c’est l’idée d’un télescopage qui rend le logos superflu ou purement instrumental, et non la perspective d’un accord retrouvé ni même postulé. Comme en musique, l’accord, la concordance ou même l’harmonie ne signifient pas un total recouvrement; il n’y a accord que si existent des notes distinctes et autonomes. L’idée d’accord est parfaitement compatible avec celui d’une contingence ou d’une indétermination dans la rencontre, et c’est en cela qu’elle s’oppose à la congruence alogale. Sans doute faut-il récuser seulement l’idée d’une harmonie préétablie, sauf si, au risque d’introduire une contradiction dans les termes, on la comprend comme s’établissant «après coup» (mais alors elle n’est plus «préétablie»). On peut la caractériser aussi comme un «accord fondamental» ou une «confiance».
Serait-il alors erroné d’aspirer à un accord entre l’esprit et le monde, le Logos et l’Être, ou de postuler qu’un tel accord existerait déjà potentiellement ? Pas forcément. Ce qui est récusé, c’est l’idée d’un télescopage qui rend le logos superflu ou purement instrumental, et non la perspective d’un accord retrouvé ni même postulé. Comme en musique, l’accord, la concordance ou même l’harmonie ne signifient pas un total recouvrement; il n’y a accord que si existent des notes distinctes et autonomes. L’idée d’accord est parfaitement compatible avec celui d’une contingence ou d’une indétermination dans la rencontre, et c’est en cela qu’elle s’oppose à la congruence alogale. Sans doute faut-il récuser seulement l’idée d’une harmonie préétablie, sauf si, au risque d’introduire une contradiction dans les termes, on la comprend comme s’établissant «après coup» (mais alors elle n’est plus «préétablie»). On peut la caractériser aussi comme un «accord fondamental» ou une «confiance».  L’auteur
L’auteur

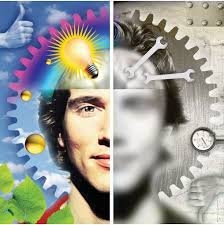

 Au dernier colloque de l’Institut Iliade, en date du 19 septembre 2020, dont le thème était
Au dernier colloque de l’Institut Iliade, en date du 19 septembre 2020, dont le thème était 
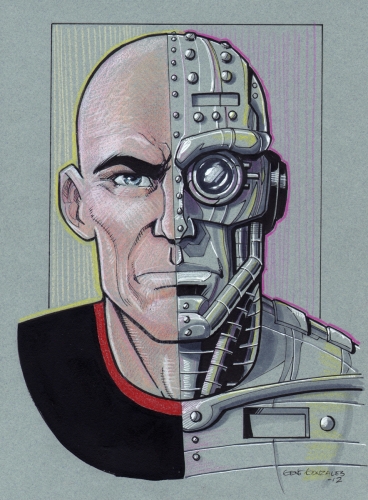
 Michel Maffesoli : Je crois que l’éclosion de cette sensibilité est inéluctable. La toute-puissance du progrès est un phénomène qui arrive à saturation, comme lors du processus chimique du même nom.
Michel Maffesoli : Je crois que l’éclosion de cette sensibilité est inéluctable. La toute-puissance du progrès est un phénomène qui arrive à saturation, comme lors du processus chimique du même nom.
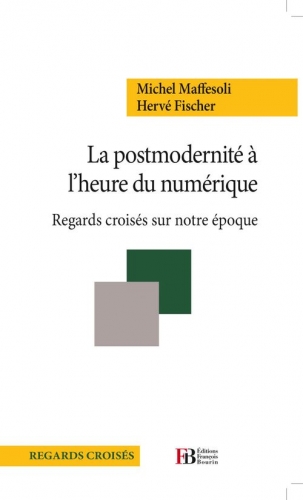

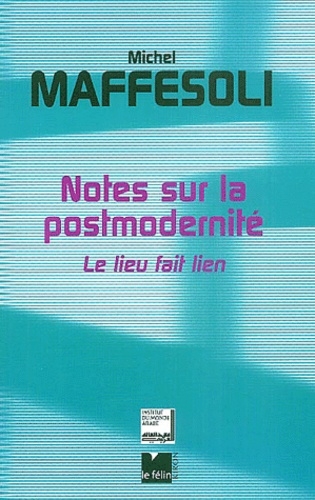

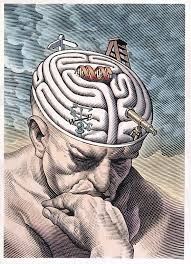
 Toute une sociologie se réjouit du développement de liens horizontaux, du co-voiturage, des co-locations (imposées par les loyers exorbitants), de la vitalité des tribus vestimentaires, sexuelles, comportementales qui irriguent la société française. C’est la France archipel qu’analyse fort bien Jérôme Fourquet. Certes, ces tribus se retirent totalement du politique - c’est le « retrait sur l’Aventin » dont parle Michel Maffesoli - mais elles seraient le lieu d’une éclosion de nouveaux liens, voire d’un nouveau lieu du sacré. Tout cela marquerait la revanche de l’émotion sur la raison, ou le basculement vers une raison sensible, à vrai dire plus sensible, comme les quartiers du même nom, que rationnelle, puisque – on l’oublie trop – la raison suppose une culture, alors que ces tribus postmodernes sont sans culture, autre que le présentisme.
Toute une sociologie se réjouit du développement de liens horizontaux, du co-voiturage, des co-locations (imposées par les loyers exorbitants), de la vitalité des tribus vestimentaires, sexuelles, comportementales qui irriguent la société française. C’est la France archipel qu’analyse fort bien Jérôme Fourquet. Certes, ces tribus se retirent totalement du politique - c’est le « retrait sur l’Aventin » dont parle Michel Maffesoli - mais elles seraient le lieu d’une éclosion de nouveaux liens, voire d’un nouveau lieu du sacré. Tout cela marquerait la revanche de l’émotion sur la raison, ou le basculement vers une raison sensible, à vrai dire plus sensible, comme les quartiers du même nom, que rationnelle, puisque – on l’oublie trop – la raison suppose une culture, alors que ces tribus postmodernes sont sans culture, autre que le présentisme. 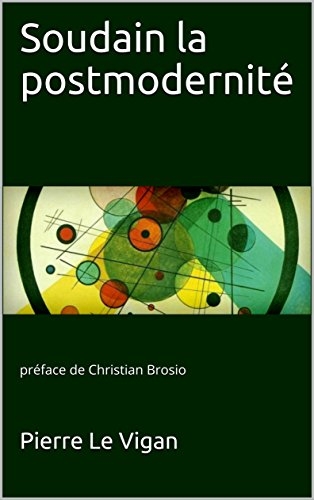 Cette vision, qui se veut un constat, n’est pas neutre. Ces théoriciens de la postmodernité heureuse, tels Michel Maffesoli, ne déplorent pas l’inexistence d’une spiritualité commune aux Français, d’un sacré unificateur ancré dans notre histoire, mais regrettent qu’une place plus grande ne soit pas faite aux autres spiritualités, et il n’y en a qu’une présente en masse, c’est l’islam, à qui une place plus grande devrait être faite (Maffesoli, Atlantico, 18 février 2015). Les djihadistes seraient en somme victimes du laïcisme français.
Cette vision, qui se veut un constat, n’est pas neutre. Ces théoriciens de la postmodernité heureuse, tels Michel Maffesoli, ne déplorent pas l’inexistence d’une spiritualité commune aux Français, d’un sacré unificateur ancré dans notre histoire, mais regrettent qu’une place plus grande ne soit pas faite aux autres spiritualités, et il n’y en a qu’une présente en masse, c’est l’islam, à qui une place plus grande devrait être faite (Maffesoli, Atlantico, 18 février 2015). Les djihadistes seraient en somme victimes du laïcisme français.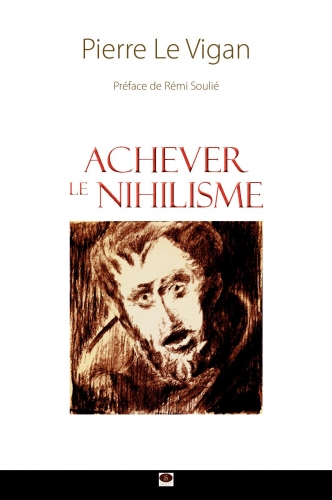 En vérité, il y a aussi de l’émotion du côté des élites, notamment l’émotion homogénéisatrice de l’interchangeabilité de tous les hommes, et l’immigrationnisme de principe, et il y a de la rationalité – les pieds sur terre, c’est rationnel – du côté du peuple. Les élites oligarchiques mettent de l’émotion dans la raison, le peuple, lui, met de l’émotion dans sa révolte rationnelle face à un pouvoir qui nie son droit à l’existence, à la fois matérielle, et c’est la question de la destruction des classes moyennes, et culturelle, et c’est la question de l’identité, et plus largement de la pérennité de soi comme Français. La lutte des classes, qui n’a été inventée par Marx, est toujours aussi une lutte pour déterminer quelles sont les valeurs qui dominent dans une société : l’argent ou la coopération, l’économie ou la pérennité des peuples, le court terme ou le long terme. Le peuple a besoin de la sécurité culturelle, du long terme et de ce qui n’a pas de prix : la patrie et donc la solidarité à l’intérieur de la patrie. Ce qui suppose une juste et nécessaire discrimination excluant tout devoir de solidarité avec les étrangers.
En vérité, il y a aussi de l’émotion du côté des élites, notamment l’émotion homogénéisatrice de l’interchangeabilité de tous les hommes, et l’immigrationnisme de principe, et il y a de la rationalité – les pieds sur terre, c’est rationnel – du côté du peuple. Les élites oligarchiques mettent de l’émotion dans la raison, le peuple, lui, met de l’émotion dans sa révolte rationnelle face à un pouvoir qui nie son droit à l’existence, à la fois matérielle, et c’est la question de la destruction des classes moyennes, et culturelle, et c’est la question de l’identité, et plus largement de la pérennité de soi comme Français. La lutte des classes, qui n’a été inventée par Marx, est toujours aussi une lutte pour déterminer quelles sont les valeurs qui dominent dans une société : l’argent ou la coopération, l’économie ou la pérennité des peuples, le court terme ou le long terme. Le peuple a besoin de la sécurité culturelle, du long terme et de ce qui n’a pas de prix : la patrie et donc la solidarité à l’intérieur de la patrie. Ce qui suppose une juste et nécessaire discrimination excluant tout devoir de solidarité avec les étrangers. 

 Ähnliche Artikel
Ähnliche Artikel

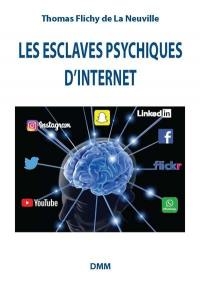 En réalité, ce primat de l’économie se révèle une illusion d’optique. Il est d’ailleurs contesté par les mouvements altermondialistes et écologiques, les chiffres de l’abstention électorale et le retour de la rhétorique patriotique. Partout, des appels à une autre « gouvernance » se font entendre. Un nouvel avenir est annoncé, celui du renversement des échanges de marchandises au profit des solidarités sociales. Mais, paradoxalement, la contestation altermondialiste ne remet pas fondamentalement en cause le primat de l’économie : la décroissance, l’inversion des profits et la taxation des bénéfices financiers ne servent qu’à promouvoir une nouvelle révolution matérielle mondiale. Bref, même chez ceux qui souhaitent abolir le capitalisme marchand, tout ne reste qu’économique. Or les données chiffrées ne nous offrent qu’une idée imparfaite des risques à venir. De plus, ces indicateurs complexes se manipulent aisément. La réduction du monde au simple jeu des forces économiques fait finalement obstacle à l’intelligence car elle passe deux dimensions essentielles sous silence : l’affirmation des cultures et la volonté de puissance.
En réalité, ce primat de l’économie se révèle une illusion d’optique. Il est d’ailleurs contesté par les mouvements altermondialistes et écologiques, les chiffres de l’abstention électorale et le retour de la rhétorique patriotique. Partout, des appels à une autre « gouvernance » se font entendre. Un nouvel avenir est annoncé, celui du renversement des échanges de marchandises au profit des solidarités sociales. Mais, paradoxalement, la contestation altermondialiste ne remet pas fondamentalement en cause le primat de l’économie : la décroissance, l’inversion des profits et la taxation des bénéfices financiers ne servent qu’à promouvoir une nouvelle révolution matérielle mondiale. Bref, même chez ceux qui souhaitent abolir le capitalisme marchand, tout ne reste qu’économique. Or les données chiffrées ne nous offrent qu’une idée imparfaite des risques à venir. De plus, ces indicateurs complexes se manipulent aisément. La réduction du monde au simple jeu des forces économiques fait finalement obstacle à l’intelligence car elle passe deux dimensions essentielles sous silence : l’affirmation des cultures et la volonté de puissance.
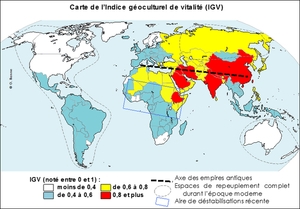
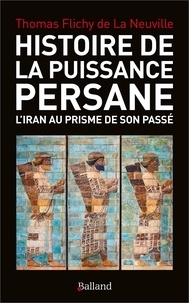 Or ce qui est vrai pour les empires ne l’est pas moins pour les entreprises, dont la durée de vie et la santé financière sont menacées par leur croyance au mythe techniciste. Ainsi en est-il au dernier stade pour les familles qui se perpétuent dans la longue durée lorsqu’elles adhèrent à des valeurs spirituelles forçant leurs membres à se dépasser ou à l’inverse s’atomisent en une multitude d’individus rivaux, attirés, tels des lucioles, vers le profit qui les calcinera. Les nations durables s’enracinent par conséquent dans des cultures qui peuvent être d’une variété inouïe, mais qui pour perpétuer la vie, doivent pouvoir se renouveler sans pour autant se renier.
Or ce qui est vrai pour les empires ne l’est pas moins pour les entreprises, dont la durée de vie et la santé financière sont menacées par leur croyance au mythe techniciste. Ainsi en est-il au dernier stade pour les familles qui se perpétuent dans la longue durée lorsqu’elles adhèrent à des valeurs spirituelles forçant leurs membres à se dépasser ou à l’inverse s’atomisent en une multitude d’individus rivaux, attirés, tels des lucioles, vers le profit qui les calcinera. Les nations durables s’enracinent par conséquent dans des cultures qui peuvent être d’une variété inouïe, mais qui pour perpétuer la vie, doivent pouvoir se renouveler sans pour autant se renier.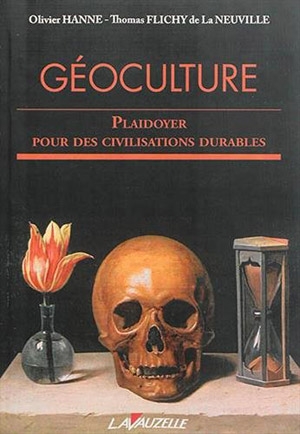
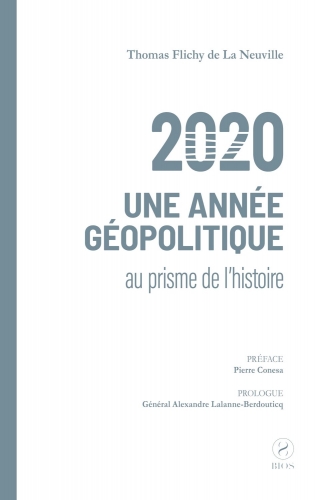

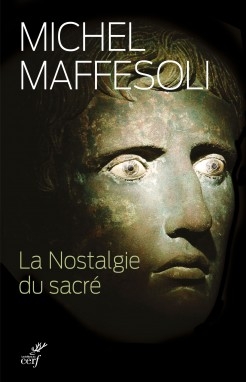 Pour aller plus loin :
Pour aller plus loin : 
 Fort peu de lecteurs auront la chance de tenir entre leurs mains la belle quadruple étude de Jacques Dewitte, Le pouvoir de la langue et la liberté de l'esprit, sous-titré Essai sur la résistance au langage totalitaire, que l'éditeur, Michalon, n'a pas jugé utile de rééditer depuis 2007. Il n'est donc pas étonnant que cet ouvrage atteigne désormais des sommes coquettes sur les différents sites de librairies en ligne. Au moins, ce lecteur curieux n'aura pas le regard épouvanté par la première de couverture, très laide illustration imbriquant un labyrinthe et un goéland toutes ailes déployées qui, je le suppose, dans l'esprit du crétin responsable d'un tel saccage inesthétique, doit parfaitement convenir au mouvement de balancier que l'auteur imprime à sa problématique : d'un côté le langage à visée totalitaire, englobant tout, prétendant du moins tout englober, de l'autre la réalité qu'il tente à n'importe quel prix de gauchir, de grimer, jusqu'à ce qu'elle corresponde à ses mots et slogans pourris. Il ne s'agit cependant point, en analysant le langage vérolé, de s'exonérer du langage lui-même, car Jacques Dewitte a raison de nous rappeler que, sans la médiation complexe qu'imposent les mots, la réalité n'est rien. Dès lors, il faut parier qu'il n'y a «dépassement de l'emprise totalitaire que par un mouvement double où l'on retrouve une forme de circularité», à savoir «un mouvement vers les choses», mais aussi la «mise en œuvre des mots», et, à cette fin, la «remise en route de la parole lorsqu'elle s'est enlisée, mais encore, compte tenu de sa fréquente détérioration», la «remise en état de la langue» (1). Nous verrons qu'il n'est pas si facile que cela, en soignant le langage contaminé par le bacille du slogan, de la langue de bois, de la fausse langue à visées hégémoniques, de retrouver le monde : le langage totalitaire, le langage maléfique, même, que Jacques Dewitte évoque hélas trop peu, ont pour particularité, en contaminant celles et ceux qui l'emploient, de saper les fondements de notre confiance dans le monde.
Fort peu de lecteurs auront la chance de tenir entre leurs mains la belle quadruple étude de Jacques Dewitte, Le pouvoir de la langue et la liberté de l'esprit, sous-titré Essai sur la résistance au langage totalitaire, que l'éditeur, Michalon, n'a pas jugé utile de rééditer depuis 2007. Il n'est donc pas étonnant que cet ouvrage atteigne désormais des sommes coquettes sur les différents sites de librairies en ligne. Au moins, ce lecteur curieux n'aura pas le regard épouvanté par la première de couverture, très laide illustration imbriquant un labyrinthe et un goéland toutes ailes déployées qui, je le suppose, dans l'esprit du crétin responsable d'un tel saccage inesthétique, doit parfaitement convenir au mouvement de balancier que l'auteur imprime à sa problématique : d'un côté le langage à visée totalitaire, englobant tout, prétendant du moins tout englober, de l'autre la réalité qu'il tente à n'importe quel prix de gauchir, de grimer, jusqu'à ce qu'elle corresponde à ses mots et slogans pourris. Il ne s'agit cependant point, en analysant le langage vérolé, de s'exonérer du langage lui-même, car Jacques Dewitte a raison de nous rappeler que, sans la médiation complexe qu'imposent les mots, la réalité n'est rien. Dès lors, il faut parier qu'il n'y a «dépassement de l'emprise totalitaire que par un mouvement double où l'on retrouve une forme de circularité», à savoir «un mouvement vers les choses», mais aussi la «mise en œuvre des mots», et, à cette fin, la «remise en route de la parole lorsqu'elle s'est enlisée, mais encore, compte tenu de sa fréquente détérioration», la «remise en état de la langue» (1). Nous verrons qu'il n'est pas si facile que cela, en soignant le langage contaminé par le bacille du slogan, de la langue de bois, de la fausse langue à visées hégémoniques, de retrouver le monde : le langage totalitaire, le langage maléfique, même, que Jacques Dewitte évoque hélas trop peu, ont pour particularité, en contaminant celles et ceux qui l'emploient, de saper les fondements de notre confiance dans le monde.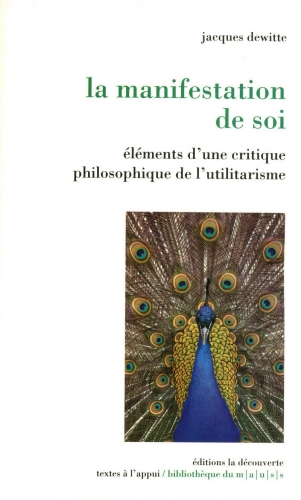 C'est dire qu'il ne faut pas seulement parler de «bouclage absolu» (2) à propos de la fable langagière génialement dépeinte par George Orwell dans 1984, mais, aussi et voilà qui ne laisse pas d'être inquiétant, pour notre si irénique et consensuelle société dont nous ne manquerions pas de choquer les commis si nous leur prouvions qu'ils ne tolèrent rien de ce qui serait susceptible de heurter leurs petites convictions normativement castrées. Et force est alors de constater que le langage totalitaire n'est pas celui, d'acier ou d'airain, mis en circulation par les seuls régimes autoritaires, puisque nous pourrions à bon droit prétendre que la novlangue (3) démocratique, comme n'importe lequel de ces langages cherchant à triompher de ses concurrents,
C'est dire qu'il ne faut pas seulement parler de «bouclage absolu» (2) à propos de la fable langagière génialement dépeinte par George Orwell dans 1984, mais, aussi et voilà qui ne laisse pas d'être inquiétant, pour notre si irénique et consensuelle société dont nous ne manquerions pas de choquer les commis si nous leur prouvions qu'ils ne tolèrent rien de ce qui serait susceptible de heurter leurs petites convictions normativement castrées. Et force est alors de constater que le langage totalitaire n'est pas celui, d'acier ou d'airain, mis en circulation par les seuls régimes autoritaires, puisque nous pourrions à bon droit prétendre que la novlangue (3) démocratique, comme n'importe lequel de ces langages cherchant à triompher de ses concurrents, 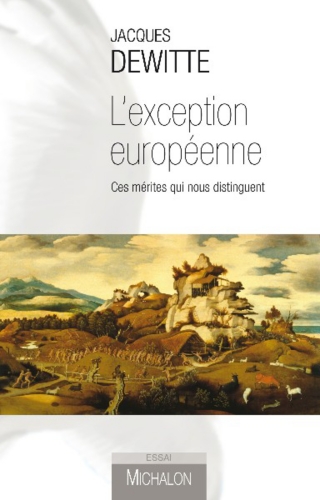 Jacques Dewitte, hélas, ne poursuit pas plus avant son exploration de ces contrées interdites, ne se dirige pas, hardiment, vers le Kurtz de Conrad et son décalque steinerien comme j'ai pu tenter de le faire dans
Jacques Dewitte, hélas, ne poursuit pas plus avant son exploration de ces contrées interdites, ne se dirige pas, hardiment, vers le Kurtz de Conrad et son décalque steinerien comme j'ai pu tenter de le faire dans 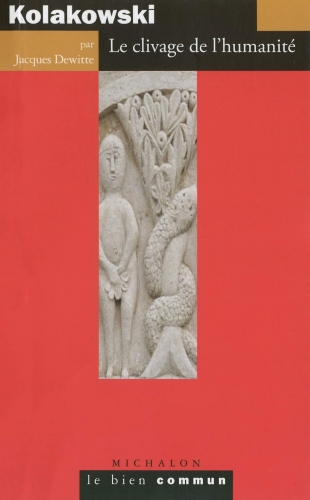 Cette confiance dans le langage sortira même renforcée de «l'expérience totalitaire» et de «la crise contemporaine» (p. 235) sur laquelle, hélas, Jacques Dewitte ne s'attarde guère (6), préférant insister, je l'ai dit, sur des remèdes qui sont à la portée de tout un chacun mais me paraissent pourtant absolument ridicules face au déferlement des langages viciés, dont la novlangue managériale, que Baptiste Rappin analyse comme le bras armé de la Machine, est le masque le plus grimaçant et redoutable. S'il est certes absolument évident à mes yeux que «l'existence d'un ordre stable du monde et de la langue (7) est une condition de la liberté (et pas seulement de la vérité), et qu'une liberté devenue un arbitraire institutionnalisé se révèle le pire ennemi de la vraie liberté individuelle» (p. 252), je suis bien davantage sceptique sur la belle confiance dont témoigne Jacques Dewitte évoquant «la fin du cauchemar engendré par les utopies», censé inaugurer «le retour à une vie humaine finie et imparfaite», ainsi qu'un «retour au champ où la parole rencontre la réalité, où une relation mutuelle peut s'établir entre elles», un «retour à une situation où la pensée qui se cherche doit aussi chercher et choisir ses mots, c'est-à-dire effectuer un va-et-vient entre la chose-à-dire et les ressources de la langue héritée, sans être d'emblée captivée par tel vocable devenu quasi compulsif».
Cette confiance dans le langage sortira même renforcée de «l'expérience totalitaire» et de «la crise contemporaine» (p. 235) sur laquelle, hélas, Jacques Dewitte ne s'attarde guère (6), préférant insister, je l'ai dit, sur des remèdes qui sont à la portée de tout un chacun mais me paraissent pourtant absolument ridicules face au déferlement des langages viciés, dont la novlangue managériale, que Baptiste Rappin analyse comme le bras armé de la Machine, est le masque le plus grimaçant et redoutable. S'il est certes absolument évident à mes yeux que «l'existence d'un ordre stable du monde et de la langue (7) est une condition de la liberté (et pas seulement de la vérité), et qu'une liberté devenue un arbitraire institutionnalisé se révèle le pire ennemi de la vraie liberté individuelle» (p. 252), je suis bien davantage sceptique sur la belle confiance dont témoigne Jacques Dewitte évoquant «la fin du cauchemar engendré par les utopies», censé inaugurer «le retour à une vie humaine finie et imparfaite», ainsi qu'un «retour au champ où la parole rencontre la réalité, où une relation mutuelle peut s'établir entre elles», un «retour à une situation où la pensée qui se cherche doit aussi chercher et choisir ses mots, c'est-à-dire effectuer un va-et-vient entre la chose-à-dire et les ressources de la langue héritée, sans être d'emblée captivée par tel vocable devenu quasi compulsif».