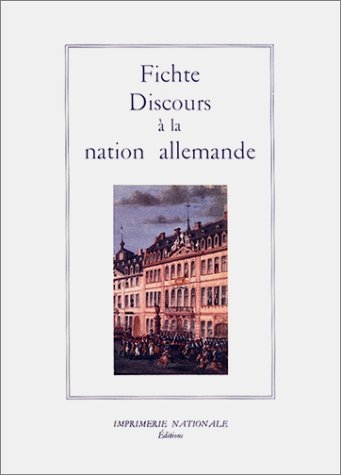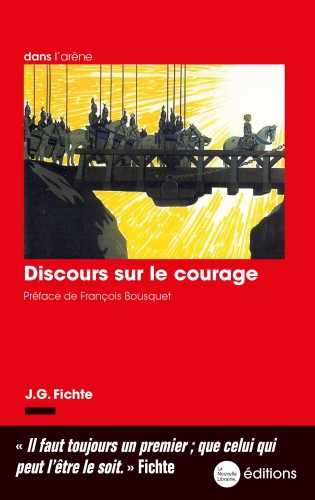samedi, 12 mars 2022
Idéologie, propagande et conflit
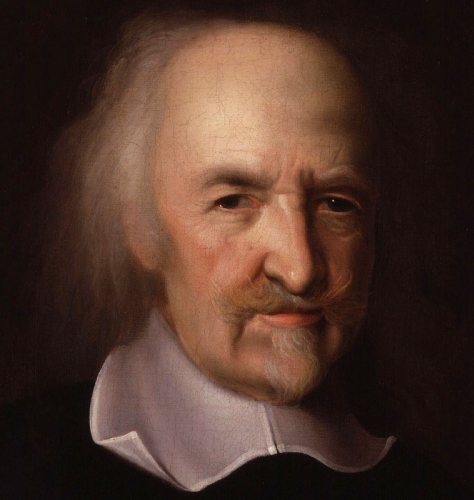
Idéologie, propagande et conflit
Par Daniele Perra
Source: https://www.eurasia-rivista.com/ideologia-propaganda-e-conflitto/
"Par conséquent, c'est un précepte ou une règle générale de la raison que tout homme doit s'efforcer d'obtenir la paix, dans la mesure où il a l'espoir de l'obtenir, et lorsqu'il ne peut l'obtenir, rechercher et utiliser toutes les aides et tous les avantages de la guerre. La première partie de cette règle contient la première loi fondamentale de la nature, qui est de rechercher la paix et de l'obtenir. La seconde, la somme de la loi de la nature, qui consiste à se défendre par tous les moyens possibles."
(Thomas Hobbes, Léviathan)
Dans son interprétation personnelle de l'œuvre la plus célèbre de Thomas Hobbes, Carl Schmitt souligne combien la figure du Léviathan évoque avant tout "un symbole mythique plein de significations cachées" [1]. Ce mythe, selon le grand juriste allemand, doit être compris avant tout comme une lutte séculaire d'images. En effet, dans le livre de Job, à côté de la figure du Léviathan (l'animal marin le plus fort et le plus indomptable), un autre animal est dépeint avec autant d'importance et de richesse de détails : le Béhémoth terrestre.
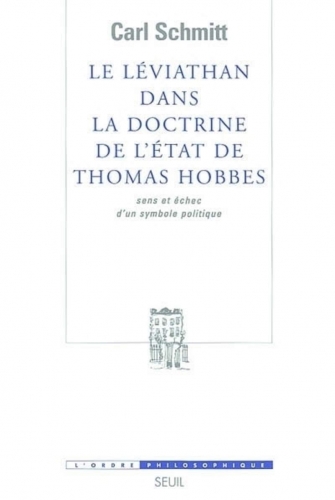
Après un rapide examen des interprétations chrétiennes de ce "mythe" (par exemple, selon l'Apocalypse de Jean, dans le célèbre Liber Floridus du 12e siècle, l'Antéchrist est représenté trônant sur Léviathan tandis qu'un démon chevauche Béhémoth), Schmitt se concentre sur l'exégèse juive, où les deux bêtes deviennent des symboles des puissances mondaines et païennes hostiles aux Juifs. "Le Léviathan", affirme Schmitt, "représente les bêtes sur mille montagnes (Psaumes 50:10), c'est-à-dire les peuples païens" [2]. Dans ce sens, l'histoire du monde est présentée comme une lutte des peuples païens les uns contre les autres. En particulier, la lutte se déroule entre le Léviathan - les puissances maritimes - et le Béhémoth - les puissances terrestres.

Béhémoth essaie de déchirer le Léviathan avec ses cornes, tandis que le Léviathan bouche la gueule et les narines de Béhémoth avec ses nageoires, le tuant. Ceci, poursuit Schmitt, est "une belle image de l'étranglement d'une puissance terrestre par un blocus naval" [3] (la référence, bien sûr, est au blocus naval avec lequel les Britanniques ont étranglé l'économie allemande pendant la Première Guerre mondiale). Dans tout cela, les Juifs regardent les peuples de la terre s'entretuer: "pour eux, ces massacres et égorgements mutuels sont légaux et casher. C'est pourquoi ils mangent la chair des peuples tués et en tirent la vie" [4].
Si l'interprétation schmittienne de ce thème biblique est appliquée aux événements actuels, il n'est pas particulièrement difficile d'identifier la Russie et l'Europe respectivement comme le Béhémoth et le Léviathan, et les États-Unis comme ceux qui "se nourrissent de la chair des tués et en vivent".
Dans deux articles publiés sur le site Eurasia, intitulés "L'ennemi de l'Europe" et "Comparaison des modèles géopolitiques", on a tenté d'expliquer comment les Etats-Unis, à travers deux guerres mondiales en l'espace de trente ans (ce n'est pas une coïncidence si l'historien Eric Hobsbawm a parlé d'une "deuxième guerre de trente ans" et Ernst Nolte d'une "guerre civile européenne"), ont réussi à évincer la Grande-Bretagne de son rôle de puissance mondiale, l'épuisant dans une lutte sans merci avec l'Allemagne. La "Grande Guerre" se prête particulièrement bien à ce schéma d'interprétation, puisque les États-Unis ne sont intervenus qu'après s'être transformés de pays débiteur en pays créditeur et après s'être assurés que les concurrents européens sortiraient du conflit, quelle que soit l'issue, dans des conditions économiques désastreuses. Et il ne semble pas déplacé d'utiliser le même schéma d'interprétation pour la crise actuelle en Europe de l'Est, étant donné que, aujourd'hui comme en 1914, les États-Unis sont le plus grand pays débiteur du monde.
Toutefois, une telle approche nécessite une réflexion approfondie. Nous avons choisi de commencer cette analyse par une citation de Thomas Hobbes pour la simple raison que le philosophe anglais reconnaît que l'État est avant tout un système de sécurité destiné à garantir la sécurité de son peuple et à éviter un retour à l'état de nature : la lutte de tous contre tous.
 Hobbes déclare expressément qu'il est du devoir de tout homme de rechercher la paix. Mais lorsque cela ne peut être réalisé, il a le droit d'utiliser les avantages de la guerre. Le penseur de Malmesbury, à son crédit, dit aussi autre chose. Plus précisément, il affirme la nécessité du respect des pactes, car : "sans une telle garantie les pactes sont vains et ne sont que des paroles vides, et le droit de tous les hommes à toutes choses demeurant, on est toujours dans la condition de la guerre [...] Mais quand un pacte est fait, alors le rompre est injuste et la définition de l'injustice n'est rien d'autre que le non-respect du pacte" [5].
Hobbes déclare expressément qu'il est du devoir de tout homme de rechercher la paix. Mais lorsque cela ne peut être réalisé, il a le droit d'utiliser les avantages de la guerre. Le penseur de Malmesbury, à son crédit, dit aussi autre chose. Plus précisément, il affirme la nécessité du respect des pactes, car : "sans une telle garantie les pactes sont vains et ne sont que des paroles vides, et le droit de tous les hommes à toutes choses demeurant, on est toujours dans la condition de la guerre [...] Mais quand un pacte est fait, alors le rompre est injuste et la définition de l'injustice n'est rien d'autre que le non-respect du pacte" [5].
Et encore : "C'est pourquoi celui qui rompt l'alliance qu'il a contractée, et qui déclare par conséquent qu'il pense pouvoir le faire avec raison, ne peut être reçu dans une société qui se réunit pour la paix et la défense, si ce n'est par l'erreur de ceux qui le reçoivent, ni, une fois reçu, rester sans que ceux qui voient le danger de leur erreur" [6].
Quelle est l'utilité de ces citations face au conflit actuel en Ukraine ? Il est bon de procéder par ordre. En 1987, les États-Unis et l'Union soviétique ont signé le traité INF - Intermediate-range Nuclear Force Treaty, qui réglementait le placement de missiles balistiques à courte et moyenne portée sur le sol européen. À peu près au même moment, Washington a donné à Moscou des garanties que l'OTAN ne s'étendrait pas vers l'est.
En 2014, l'Ukraine était dirigée par Viktor Ianoukovitch, dont le principal défaut (plus que la corruption généralisée) était d'avoir opté pour une éventuelle entrée du pays dans l'Union économique eurasienne. En effet, dans sa vision, l'ex-république soviétique était censée être un pont entre l'est et l'ouest et non une rupture géographique entre la Russie et le reste de l'Europe. Dans une interview accordée à CNN quelques semaines après le coup d'État à Kiev, le spéculateur ("philanthrope") George Soros a ouvertement déclaré qu'il avait contribué à renverser le "régime pro-russe" afin de créer les conditions nécessaires au développement d'une démocratie de type occidental. Non seulement cela, mais le gouvernement ukrainien post-golpiste a été sélectionné selon une méthodologie d'entreprise. Plus précisément, la sélection a été effectuée par deux cabinets de "chasseurs de têtes", Pedersen & Partners et Korn Ferry, qui ont choisi 24 personnes sur une liste de 185 candidats parmi les étrangers vivant en Ukraine (sans surprise, le gouvernement post-golpiste comprenait un Américain, un Lituanien et un Géorgien) et les Ukrainiens vivant au Canada et aux États-Unis. L'ensemble du processus - et cela ne devrait pas être une surprise - a été financé par Soros lui-même par le biais de la fondation Renaissance et du réseau de conseil politique [7].
Non moins troublant a été le processus de sélection de l'actuel président ukrainien, que la propagande atlantiste, dans un élan d'humour et de blasphème, a comparé à Salvador Allende. Volodymir Zelens'kyi, acteur et comédien d'origine juive aux talents incontestables (étant donné sa capacité à hypnotiser un public occidental déjà enivré par deux années de rhétorique pandémique militariste), avant de se consacrer à la politique était sous contrat avec la télévision privée du puissant oligarque Igor Kolomoisky. Également d'origine juive, ancien président de la Communauté juive unie d'Ukraine et du Conseil européen des communautés juives, Kolomoisky est également connu pour avoir financé les groupes paramilitaires qui massacrent les civils dans le Donbass depuis huit ans et pour avoir placé des primes de 10.000 dollars sur les têtes des miliciens séparatistes (Il va sans dire que ce sont les mêmes groupes qui ont assassiné le journaliste italien Andy Rocchelli (photo, ci-dessous) dans le silence absolu de nos médias, bien plus intéressés à défendre les droits bafoués d'un étudiant égyptien en études de genre).

Biographie: https://www.worldpressphoto.org/andy-rocchelli
Or, pour en revenir à l'affirmation hobbesienne selon laquelle "la définition de l'injustice n'est rien d'autre que le non-respect de l'alliance", on ne peut manquer de rappeler qu'en plus d'avoir accepté une large expansion de l'OTAN vers l'Est, les États-Unis ont opté en 2018 (sous l'administration Trump) pour un retrait unilatéral du FNI, sanctionnant de fait la possibilité d'amener leurs missiles aux frontières de la Russie. Comment la deuxième puissance militaire du monde aurait-elle dû réagir à un tel acte ? Il est bon de commencer par les aspects diplomatiques.
Le 17 décembre 2021, le ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie a publié le projet d'accord sur les garanties de sécurité soumis à l'OTAN et aux États-Unis. Il s'agissait notamment : a) d'exclure toute nouvelle expansion de l'OTAN vers l'est (y compris l'Ukraine) ; b) de ne pas déployer de troupes supplémentaires ; c) d'abandonner les activités militaires de l'OTAN en Ukraine, en Europe de l'Est, dans le Caucase et en Asie centrale ; d) de ne pas déployer de missiles à moyenne et courte portée dans des zones à partir desquelles d'autres territoires peuvent être touchés ; e) de s'engager à ne pas créer de conditions pouvant être perçues comme des menaces ; f) de créer une ligne directe pour les contacts d'urgence [8].
En outre, Moscou a expressément exigé le retrait de la déclaration de Bucarest dans laquelle l'OTAN a établi le principe de la "porte ouverte" en ce qui concerne l'adhésion de l'Ukraine et de la Géorgie à l'alliance. Naturellement, Washington et l'OTAN ont rejeté en bloc les demandes russes.
Il est essentiel de souligner ce fait, car la liberté invoquée aujourd'hui par le président ukrainien dans ses appels "sincères" n'est rien d'autre que la "liberté" de ses protecteurs de placer sur le sol ukrainien des missiles qui peuvent atteindre Moscou en quelques minutes, la détruisant avant même qu'elle ait une chance de réagir. Et la rhétorique belliqueuse utilisée par les gouvernements collaborationnistes européens (l'Italie en premier lieu) défend cette idée plutôt bizarre de liberté, sur la base de laquelle (nous le répétons) la deuxième puissance militaire du monde (ainsi que le principal fournisseur d'énergie de l'Europe) ne se voit pas garantir le droit à la sécurité.
Pour cette idée malsaine de la liberté (l'Italie est une fois de plus au premier rang, malgré la présence de plus de 70 têtes nucléaires américaines qui en font une cible directe en cas d'éventuelles représailles), il a été décidé d'envoyer des armes à Kiev (qui finiront dans les mains de groupes paramilitaires plus intéressés par la chasse à leurs concitoyens pro-russes que par la guerre contre les Russes) et de ne soumettre qu'un quart du système bancaire russe à des sanctions.
Au nom de cette idée de liberté, produit de la manipulation idéologico-géographique qui porte le nom d'Occident, le suicide économique et financier de l'Europe a été décidé (à la grande joie de Washington). Et toujours sur la base de cette idée dérangeante de la liberté, une "chasse aux sorcières" a été déclenchée, dans laquelle des artistes de renommée internationale sont priés d'abjurer leur patrie ; dans laquelle des cours sur Dostoïevski sont annulés, pour être ensuite rétablis lorsqu'un auteur ukrainien donne un avis "contradictoire" (comme si le par condicio pouvait s'appliquer à la littérature) ; dans laquelle toute voix en désaccord avec la vulgate officielle est réduite au silence et accusée de pro-poutinisme ; et dans laquelle les trente dernières années d'agression de l'OTAN (dont soixante-dix-huit jours de bombardement de la Serbie) et les huit années précédentes de guerre en Ukraine sont oubliées.
Il existe un terme pour tout cela : la guerre idéologique. La guerre idéologique est une guerre dans laquelle, pour reprendre la définition de Schmitt, l'ennemi est diabolisé et criminalisé. Par conséquent, elle devient digne d'être anéantie. La guerre idéologique ne connaît aucune limite et se fonde sur la subversion de la réalité. C'est la guerre imaginaire des pseudo-intellectuels, des journalistes et des analystes géopolitiques en proie à une surexcitation guerrière. C'est la guerre dans laquelle de faux mythes sont créés : la résistance héroïque des soldats ukrainiens sur l'île aux Serpents (qui se sont rendus sans tirer un coup de feu), le fantôme de Kiev abattant six avions de chasse russes (qui n'ont jamais existé), la résistance ukrainienne retournant les panneaux de signalisation pour confondre l'avancée russe (à l'ère de la guerre technologique). Cette guerre imaginaire est celle dans laquelle la Russie est décrite comme un pays isolé alors qu'en réalité elle renforce sa coopération avec la Chine et le Pakistan (deux puissances nucléaires) et dans laquelle l'UE et l'Anglosphère sont présentées comme le "monde entier".
NOTES
[1] C. Schmitt, Sul Leviatano, Il Mulino, Bologna 2011, p. 39.
[2] Ibid, p. 45.
[3] Ibid.
[4] Ibid.
[5] T. Hobbes, Leviatano, BUR, Milan 2011, p. 149.
[6] Ibidem, p. 155.
[7] Se Soros e la finanza scelgono il governo dell’Ucraina, www.ilsole24ore.com.
[8] Russie : les garanties de sécurité demandées à l'OTAN sont révélées, www.sicurezzainternazionale.luiss.it.
16:00 Publié dans Actualité, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : idéologie, propagande, conflit, thomas hobbes, carl schmitt, actualité, théorie politique, ukraine, europe, affaires européennes, politologie, sciences politiques, philosophie, philosophie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 11 mars 2022
À l'ère de la perte de la réalité Une nouvelle ère de l'irrationnel commence-t-elle ?

À l'ère de la perte de la réalité
Une nouvelle ère de l'irrationnel commence-t-elle ?
Andreas Mölzer
Source: https://andreasmoelzer.wordpress.com/2022/03/10/im-zeitalter-des-realitatsverlusts/
Quelle fierté n'avons-nous point de vivre à l'époque sublimes de nos belles Lumières, d'une société ouverte et d'une vision du monde libérale et scientifiquement fondée? Nous avions laissé derrière nous le sombre Moyen-Âge, l'époque des guerres de religion à caractère fondamentaliste et le XXe siècle avec ses idéologies totalitaires, le fascisme et le communisme soviétique. Et avec l'effondrement du socialisme réellement existant, on a même cru un moment que l'ère de la paix éternelle était arrivée. La fin de l'histoire et la victoire globale de la démocratie libérale ont été proclamées. La seule superpuissance restante, les États-Unis d'Amérique, a certes tenté d'imposer cette dernière à l'échelle mondiale, ou du moins de faire de cette démocratie libérale la référence pour tout État dans le monde entier.
Comme nous le savons aujourd'hui, il s'agit d'une tentative vaine et probablement insensée. Quant à la société ouverte et à son prétendu caractère éclairé et progressiste, il apparaît de plus en plus clairement que cette magnifique société ouverte est de plus en plus régulée par les impavides maximes du politiquement correct et qu'au lieu d'éclaircir et d'élargir nos horizons, ce sont désormais de nouveaux dogmes qui dominent, issus de tristes courants à la mode comme le féminisme, le gendérisme, le Black Lives Matter, la "wokeness" et autres fadaises du même acabit. Ainsi, en y regardant de plus près, on peut rapidement avoir l'impression que nous ne vivons pas du tout dans une ère éclairée, mais plutôt au début d'une ère d'irrationalité foncière.
Au début de celle-ci se trouve l'hypothèse de "l'homme nouveau", tel que la gauche le conçoit depuis la Révolution française, en passant par le marxisme pour aboutir à l'École de Francfort, et tel qu'elle veut le réaliser à tout prix - par la violence s'il le faut. Cet "homme nouveau", qui nie purement et simplement la nature humaine telle qu'elle s'est développée au cours de l'évolution, avec toutes ses profondeurs et ses abysses, est devenu la source du totalitarisme et des génocides partout où il a été tenté de le faire émerger par la violence, au forceps. Cela était déjà évident lors de la phase meurtrière de la Révolution française, où des milliers de personnes ont dû passer la tête sous la lunette de la guillotine. C'est également évident dans le cas de la politique meurtrière de Joseph Staline en Union soviétique, ainsi que dans le communisme de l'âge de pierre de Pol Pot au Cambodge ou dans la révolution culturelle de Mao Zedong en Chine.
Mais ce n'est pas seulement "l'homme nouveau" dans la société sans classes du socialisme réellement existant qui a donné naissance à de telles monstruosités. L'"homme nouveau" de sang aryen, né de l'illusion raciale et de l'idéologie de l'homme supérieur, devait lui aussi devenir la source d'atrocités terribles. La Seconde Guerre mondiale et le génocide en furent la conséquence. La négation de la nature humaine, qui allait de pair avec la conception de l'"homme nouveau", indiquait déjà un pas vers l'irrationalité. Ceux qui croient pouvoir changer la société en prenant l'attitude de l'ingénieur social et en ignorant, voire en niant l'homme dans ses forces et ses faiblesses, dans ses besoins et ses capacités, et en substituant à la psychologie et à la biologie humaines des prescriptions idéologiques comme mesure de toute chose, doivent finalement recourir à des moyens tyranniques et à l'ignorance de la réalité pour imposer leurs objectifs. Une entreprise qui a douloureusement échoué au siècle dernier, comme nous pouvons facilement le constater avec le fascisme national-socialiste, mais aussi avec le communisme soviétique.
L'hostilité à l'égard de la technique et l'ignorance des connaissances scientifiques, qui sont apparues comme un contre-mouvement à l'idolâtrie absolue de la technique après la révolution industrielle, constituent un pas supplémentaire vers l'ère de l'irrationnel en laquelle nous entrons. Si, après la révolution industrielle et dans le cadre du développement de technologies toujours plus performantes, on a cru que la technique permettrait de résoudre tous les problèmes de l'humanité, une sorte d'idéologie technophobe, d'hostilité à l'égard de la technique, s'est développée au cours des dernières décennies, en quelque sorte comme un mouvement inverse. Ce mouvement irrationnel et idéologisé est porté par les différents partis verts qui se sont constitués à travers l'Europe. La nouvelle gauche, issue du mouvement de 68, a rapidement récupéré le mouvement antinucléaire. Le mouvement hostile à la guerre du Vietnalm a donné naissance au mouvement pour la paix, qui s'est en outre opposé à l'utilisation militaire des armes nucléaires.
C'est sur la base de ces mouvements que se sont développés les partis verts qui, dans les années 80, étaient si puissants qu'ils ont fait leur entrée dans les assemblées et les parlements respectifs. A l'origine, la protection de l'environnement et de la nature était plutôt l'apanage de groupes conservateurs. L'ironie de l'histoire veut que ce soit justement la gauche marxiste, auparavant inspirée par l'Est soviétisé, qui ait réussi à camoufler son idéologie profondément rouge sous un vernis vert.

L'hostilité générale à l'égard de la technique qui en résulte, associée à une certaine critique générale de la croissance et du progrès, implique une nouvelle orientation vers une nouvelle irrationalité rédhibitoire. D'une part, les Verts ont revendiqué tous les bienfaits de l'ère technique et les avantages d'une civilisation hautement technologique, d'autre part, les technologies modernes ont été de plus en plus diabolisées. En outre, une profonde incompréhension du fonctionnement de la technologie elle-même s'est renforcée dans ces cercles. Par méconnaissance et ignorance des lois de la nature, ce sont des couches sociales qui ont la parole dans ces domaines et qui ne peuvent tout simplement plus comprendre comment et pourquoi les choses fonctionnent, sur quelle base les fonctions techniques se déroulent. On appuie sur l'interrupteur et la lumière s'allume. On ne sait pas pourquoi il en est ainsi. Une sorte de croyance au miracle s'est installée, semblable à celle qu'avaient les hommes de l'âge de pierre face aux phénomènes naturels : on ne comprend pas ce qui se passe, on croyait à l'époque à des puissances supérieures et aujourd'hui à l'évidence d'une civilisation hautement technologique.
A cela s'ajoute un autre facteur qui favorise la perte de contact avec la réalité dans notre société : l'oubli croissant de l'histoire. Pour comprendre et évaluer les relations politiques, économiques et sociales, il faudrait une connaissance approfondie de l'évolution historique. Or, ce sont précisément les couches sociales qui se considèrent à la pointe de l'esprit du temps et dont la religion civile politiquement correcte est l'hédonisme qui pratiquent une ascèse informationnelle consciente en matière de connaissances historiques. Et ce, non pas pour parvenir à leurs propres conclusions sans être influencés, mais par ignorance. De même que l'on tente d'ignorer la véritable nature de l'homme, telle qu'elle est donnée biologiquement et psychologiquement, on tente également d'ignorer l'histoire de l'humanité en croyant que l'on est plus intelligent aujourd'hui, ici et maintenant, que toutes les générations qui nous ont précédés.

L'affirmation du philosophe selon laquelle quiconque ne connaît pas son histoire est condamné à la revivre est totalement étrangère aux porteurs de la nouvelle ère irrationnelle. Même les lois du matérialisme dialectique, telles que nous les connaissons depuis Marx et Engels, ont complètement disparu de la conscience politique et sociale. On est certes de gauche dans l'air du temps, mais on croit pouvoir oublier la connaissance de l'histoire.
Pour l'essentiel, ce sont donc ces trois phénomènes - l'ignorance de la condition humaine biologique et psychologique par la quête de "l'homme nouveau", l'hostilité à la technique et l'ignorance des lois naturelles physiques et chimiques, et l'oubli de l'histoire - qui conditionnent la voie vers une nouvelle ère hautement irrationnelle. Il reste à voir quelles seront les conséquences néfastes de cette perte de contact avec la réalité dans l'ensemble de la société. Si l'humanisme, les Lumières et la recherche scientifique ont permis à l'humanité d'atteindre des sommets dans le cadre de son évolution culturelle, la nouvelle ère de l'irrationnel nous exposera probablement à des dangers que nous pensions avoir surmontés depuis longtemps.
10:32 Publié dans Actualité, Philosophie, Réflexions personnelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andreas mölzer, irrationalité, réflexions personnelles, actualité |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 10 mars 2022
Comment l'individualisme défait le conservatisme
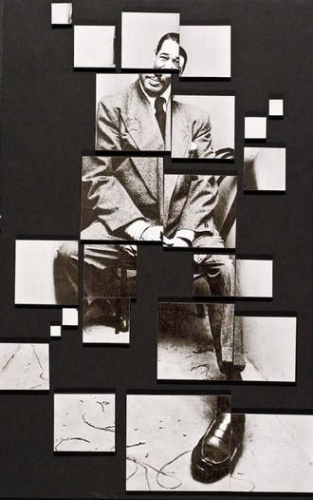
Comment l'individualisme défait le conservatisme
par Brett Stevens
Source: http://www.amerika.org/politics/how-individualism-defeats-conservatism/
Les conservateurs ne succombent pas directement à la gauche ; au contraire, selon la stratégie classique des gauches, ils sont secrètement envahis, divisés contre eux-mêmes, et ainsi subvertis et transformés en véhicule pour ces mêmes idées de gauche. Cela peut être observé dans le conservatisme traditionnel à travers la première loi de O'Sullivan :
- La première loi d'O'Sullivan stipule que toute organisation ou entreprise qui n'est pas expressément de droite deviendra de gauche avec le temps. La loi porte le nom du journaliste britannique et ancien rédacteur en chef de National Review, John O'Sullivan.
... [La motivation première d'un conservateur de gauche] est de signaler sa fidélité à la "seule vraie foi" en désignant l'hérétique le plus proche de lui et en criant "sorcière" [par] l'utilisation de la propriété transitive pour relier l'ennemi ciblé à un mal imaginaire et, bien sûr, l'exigence que la cible abandonne sa position ou risque d'être qualifiée d'hérétique [avec] ses interrogations dérangeantes qui sont jugées hors de portée des gens décents.
...Ils ont toujours été juste à la droite de la gauche officielle... [Leur présence sur l'échiquier politico-intellectuel n'a] jamais été expressément de droite, il s'agissait plutôt d'un véhicule de marketing pour les personnes qui les ont lancés. Tous sont passés à autre chose au fur et à mesure que l'entreprise remplissait son objectif.

En d'autres termes, une opportunité de marché est créée pour les droitiers, mais le meilleur produit est celui qui est comme tout le reste, mais suffisamment différent pour plaire, sans toutefois susciter l'ire du reste du troupeau. En conséquence, il fait fuir la droite de principe et attire les opportunistes, qui se font un revenu juteux en fanfaronnant sur leur différence, mais finissent par céder à la tendance dominante.
L'individualisme de ces opportunistes convertit le conservatisme en une autre forme de gauchisme, et le rend plus prompt à être accepté par le troupeau car il ressemble à ce que font les autres, et les humains ne sont rien d'autre que des conformistes.
La droite ne peut vaincre cela qu'en rendant la grande tente non pas intersectionnelle, mais hiérarchique. Le conservatisme doit redécouvrir ses principes fondamentaux de la manière la plus simple possible et faire dériver tous les autres principes de ceux-ci.
Comme écrit précédemment sur amerika.org, le noyau du véritable conservatisme est double :
- Des résultats éprouvés par le temps, ou un conséquentialisme basé non pas sur la préférence individuelle mais sur les effets observables dans la réalité, ce qui nous permet de faire correspondre la cause à l'effet et de comprendre les principes qui font une société prospère.
- Afin de comprendre pourquoi avoir une société prospère, et à quoi cela ressemble, le conservatisme s'appuie également sur le transcendantalisme ou la compréhension de l'ordre de la nature comme étant plus intelligent que l'humanité, et à travers cela, la découverte d'un désir d'exister en équilibre avec elle.
La forme corrompue du conséquentialisme, détruite de la même manière que le conservatisme l'a été, est une version basée sur les préférences qui assimile les "conséquences" à "ce que les gens pensent qu'ils aiment", dans un gambit utilitaire classique. Le conséquentialisme originel examine les résultats non seulement dans le présent, mais sur toute la durée, afin que nous puissions comparer avec précision et honnêteté différentes actions/causes.
Tant que la droite ne redécouvrira pas cette orientation primitive, elle sera à jamais subvertie parce que ses principes intermédiaires - marchés libres, liberté, liberté, petit gouvernement - sont en fait des orteils trempés dans l'eau tiède et putride du gauchisme, ou suffisamment proches pour que les deux deviennent rapidement identiques dans l'esprit de son public.
S'il revient à une voie distincte incompatible avec le gauchisme, et donc non sujette aux sottises du "bipartisme" et du "compromis", il peut atteindre son objectif de ralentir et éventuellement d'inverser le déclin de la civilisation. Mais lorsque ce conservatisme est transformé en un produit simplifié et juste axé sur la marge, comme un cheeseburger, il redevient la même chose que tout le reste, juste avec un arôme ajouté et sans réelle substance.
11:47 Publié dans Actualité, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : conservatisme, individualisme, droite, théorie politique, politologie, sciences politiques, john o'sullivan, philosophie, philosophie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Le côté obscur des Lumières

Le côté obscur des Lumières
Yoram Hazony
Source: http://novaresistencia.org/2020/08/14/o-lado-sombrio-do-iluminismo/
Dans ce texte, Yoram Hazony, philosophe et président de la "Fondation Edmund Burke", remet en question plusieurs dogmes de la littérature dite des "néo-Lumières".
Sur la base d'éléments historiques et conceptuels, l'auteur démontre que les différents courants conservateurs ont développé leurs propres idées sur la raison, l'équilibre des pouvoirs et la liberté. Ainsi, le siècle des Lumières n'a "inventé" aucune de ces vertus civiques et les a même persécutées et censurées à plusieurs reprises
Actuellement, de nombreuses personnes font la promotion des Lumières. Après le vote du Brexit et l'élection du président Trump, David Brooks a publié une proposition pour le "projet des Lumières", le déclarant attaqué et demandant aux lecteurs de se "lever" et de le sauver. Le magazine Commentary m'a envoyé une lettre demandant un don pour fournir aux lecteurs "les lumières que nous désirons tous si désespérément". Et maintenant, il y a le nouveau livre impressionnant de Steven Pinker, Enlightenment Now, qui pourrait être la déclaration définitive du mouvement néo-Enlightenment qui lutte contre la marée de la pensée nationaliste en Amérique, en Grande-Bretagne et au-delà.
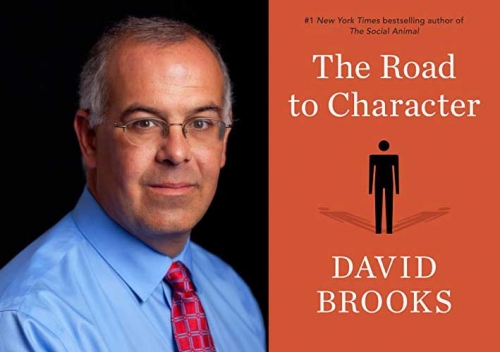
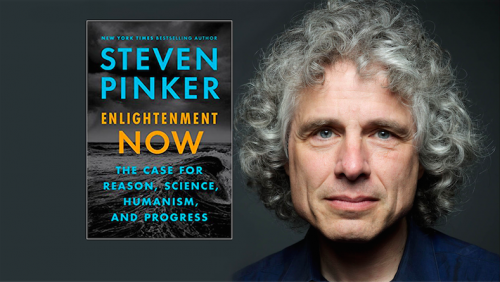
Avons-nous tous la nostalgie des Lumières? Moi pas. J'aime et je respecte M. Pinker, M. Brooks et d'autres personnes de leur camp, mais la philosophie des Lumières n'a pas obtenu une fraction du bien qu'ils prétendent apporter et, au contraire, a causé beaucoup de mal.
Les boosters actuels des Lumières sont un cas intéressant. La science, la médecine, les institutions politiques libres, l'économie de marché - ces choses ont considérablement amélioré nos vies. Ils sont tous, écrit Pinker, le résultat "d'un processus initié par les Lumières à la fin du 18e siècle", lorsque les philosophes "ont remplacé le dogme, la tradition et l'autorité par la raison, le débat et les institutions qui se donnaient pour tâche de rechercher la vérité". Brooks est d'accord, assurant à ses lecteurs que "le projet des Lumières nous a donné le monde moderne". Remerciez donc "des penseurs comme John Locke et Emmanuel Kant, qui ont fait valoir que les gens devraient cesser de se soumettre aveuglément à l'autorité" et plutôt "réfléchir à partir de zéro".
Comme le résume Pinker, "le progrès est un cadeau des idéaux des Lumières et se poursuivra dans la mesure où nous nous consacrons à ces idéaux."
Très peu de cela est vrai. Considérez l'affirmation selon laquelle la Constitution américaine est un produit de la pensée des Lumières, issue du rejet des traditions politiques du passé et de l'application sans retenue de la raison humaine. Pour réfuter cette idée, il suffit de lire les auteurs antérieurs qui ont contribué à asseoir la constitution anglaise. Le traité largement diffusé du 15e siècle In Praise of the Laws of England, écrit par le juriste John Fortescue, explique clairement la procédure régulière de la loi et la théorie aujourd'hui appelée checks and balances. Fortescue écrit que la constitution anglaise établit la liberté personnelle et la prospérité économique en protégeant l'individu et ses biens du gouvernement. Les protections qui figurent dans la Déclaration des droits des États-Unis ont été établies principalement dans les années 1600 par ceux qui ont rédigé les documents constitutionnels de l'Angleterre - des hommes comme John Selden, Edward Hyde et Matthew Hale.

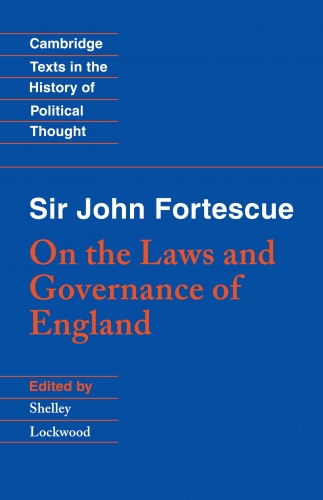
Ces hommes d'État et philosophes ont formulé les principes du constitutionnalisme anglo-américain moderne des siècles avant la création des États-Unis. Cependant, ils n'étaient pas des hommes des Lumières. Ils étaient religieux, nationalistes anglais et conservateurs politiques. Ils connaissaient l'affirmation selon laquelle la raison sans restriction devait refaire la société, mais ils l'ont rejetée en faveur de l'élaboration d'une constitution traditionnelle qui a fait ses preuves. Lorsque Washington, Jay, Hamilton et Madison ont mis en place un gouvernement national pour les États-Unis, ils se sont principalement tournés vers cette tradition conservatrice, en l'adaptant aux conditions locales.
Il n'y a pas non plus beaucoup de vérité dans l'affirmation selon laquelle nous devons la science et la médecine modernes à la pensée des Lumières. Une revendication d'origine plus sérieuse peut être faite par la Renaissance, la période entre le 15e et le 17e siècle, principalement en Italie, en Hollande et en Angleterre. Les rois anglais, liés à la tradition, ont par exemple parrainé des institutions scientifiques innovantes, comme le Collège royal des médecins, fondé en 1518. L'un de ses membres, William Harvey, a découvert la circulation sanguine au début du 17e siècle. La Royal Society of London pour l'amélioration des connaissances naturelles, fondée en 1660, était dirigée par des hommes comme Robert Boyle et Isaac Newton, des figures décisives dans l'évolution de la science physique et de la chimie. Là encore, il s'agissait de personnalités politiquement et religieusement conservatrices. Ils connaissaient les arguments, plus tard associés aux Lumières, pour renverser la tradition politique, morale et religieuse, mais les ont fondamentalement rejetés.
En bref, les principales avancées que les enthousiastes des Lumières d'aujourd'hui veulent revendiquer ont été "déclenchées" bien plus tôt. Et il n'est pas certain que les Lumières aient été utiles lorsqu'elles sont arrivées sur l'avant-scène intellectuelle.
Qu'est-ce donc que les "Lumières" ? Ce terme a été promu pour la première fois par le philosophe Emmanuel Kant, à la fin du 18e siècle. Pinker ouvre son premier chapitre en souscrivant à l'affirmation de Kant selon laquelle la raison seule permet aux êtres humains de sortir de leur "immaturité auto-imposée" en mettant de côté les "dogmes et formules" de l'autorité et de la tradition.

Pour Kant, la raison est universelle, infaillible et a priori - c'est-à-dire indépendante de l'expérience. En ce qui concerne la raison, il existe une réponse éternellement valable et inexactement correcte à toutes les questions de science, de moralité et de politique. L'homme n'est rationnel que dans la mesure où il le reconnaît et passe son temps à essayer d'arriver à cette réponse correcte.
Cette arrogance étonnante repose sur une idée-force : les mathématiques peuvent produire des vérités universelles en partant de prémisses évidentes - ou, comme l'avait dit René Descartes, "d'idées claires et distinctes" - puis en procédant par déductions infaillibles à ce que Kant appelait la "certitude apodictique". Puisque cette méthode fonctionnait en mathématiques, avait insisté Descartes, elle pouvait être appliquée à toutes les autres disciplines. Cette idée a ensuite été adoptée et affinée par Thomas Hobbes, Baruch Spinoza, John Locke et Jean-Jacques Rousseau, ainsi que par Kant.
Cette vision de la "raison" - et de son pouvoir, libérée des chaînes de l'histoire, de la tradition et de l'expérience - est ce que Kant a appelé les "Lumières". C'est complètement faux. La raison humaine est incapable d'atteindre des réponses universellement valides et inextricablement correctes aux problèmes de la science, de la morale et de la politique en appliquant les méthodes des mathématiques.
Le premier avertissement à ce sujet fut le magnum opus de Descartes en 1644, "Les principes de la philosophie", qui prétendait parvenir à une détermination finale de la nature de l'univers en passant des prémisses évidentes aux déductions infaillibles. Cet ouvrage volumineux est si outrageusement absurde qu'il n'existe aujourd'hui aucune version anglaise complète. Néanmoins, le chef-d'œuvre de Descartes a fait des ravages en Europe et a été pendant des décennies le principal manuel de l'école cartésienne des sciences. Kant a suivi cet exemple douteux avec ses "Fondements métaphysiques de la science naturelle" (1786), dans lesquels il prétendait avoir déduit les lois du mouvement de Newton en utilisant la raison pure, sans preuve empirique.
Il fut un temps où l'on comprenait bien qu'une grande partie du succès du monde moderne provenait de traditions conservatrices qui se méfiaient ouvertement de la raison. Lorsque j'étais étudiant diplômé à Rutgers dans les années 1980, le cours d'introduction à la théorie politique moderne comportait une section intitulée "Critiques des Lumières". Ces personnalités comprenaient des penseurs plus conservateurs tels que David Hume, Adam Smith et Edmund Burke. Ils ont souligné le manque de fiabilité du "raisonnement abstrait", qui, selon eux, pouvait finir par justifier pratiquement n'importe quelle idée, aussi déconnectée de la réalité soit-elle, tant qu'elle semblait évidemment vraie pour quelqu'un.
L'un de ces mythes était l'affirmation de Locke selon laquelle l'État était fondé par un contrat entre des individus libres et égaux - une théorie que les critiques des Lumières considéraient comme historiquement fausse et dangereuse. Bien que la théorie ait fait relativement peu de dégâts dans la Grande-Bretagne plus traditionnelle, elle a entraîné une catastrophe en Europe. Importée en France par Rousseau, elle a rapidement renversé la monarchie et l'État, produisant une série de constitutions ratées, le règne de la Terreur et enfin les guerres napoléoniennes - tout cela au nom de la raison infaillible et universelle. Des millions de personnes sont mortes alors que les armées de Napoléon tentaient de détruire et de reconstruire tous les gouvernements d'Europe, selon la théorie politique jugée correcte et seule autorisée par la philosophie des Lumières. Cependant, Napoléon essayait simplement, selon l'expression de Brooks, de "penser les choses à partir de zéro".
Les défenseurs des Lumières ont tendance à sauter cette partie de l'histoire. Le livre de 450 pages de Pinker ne mentionne pas la Révolution française. Pinker cite Napoléon comme un "exposant de la gloire martiale" mais ne dit rien sur le lancement d'une guerre universelle au nom de la raison. Ces auteurs ont également tendance à transmettre la dette de Karl Marx envers les Lumières. Marx se voyait comme le promoteur de la raison universelle, prolongeant l'œuvre de la Révolution française, insistant pour que les travailleurs du monde cessent (toujours selon les mots de Brooks) de "se soumettre aveuglément à l'autorité". La science que Marx a développée "à partir de rien" a tué des dizaines de millions de personnes au 20e siècle.
Les Lumières ont également propagé le mythe selon lequel les seules obligations morales des gens sont celles qu'ils choisissent librement par le raisonnement. Cette théorie a dévasté la famille, une institution fondée sur des obligations morales que beaucoup de gens, semble-t-il, ne choisiront pas à moins d'être guidés par la tradition. Le livre de Pinker est rempli de graphiques montrant l'amélioration des conditions matérielles au cours des derniers siècles. Il ne nous offre aucun graphique décrivant l'effondrement du mariage ou l'augmentation des naissances hors mariage dans les sociétés des "Lumières". Il n'est pas non plus préoccupé par la destruction de la religion ou de l'État-nation. Kant estimait que les deux étaient en contradiction avec la raison, et Pinker ne voit aucune raison de ne pas être d'accord.
Ce qui nous amène au cœur de ce qui ne va pas avec le mouvement néo-lumières. Pinker fait l'éloge du scepticisme en tant que pierre angulaire du "paradigme des Lumières sur la manière d'obtenir des connaissances fiables", mais les figures de proue de la philosophie des Lumières n'étaient pas des sceptiques. Bien au contraire, leur objectif était de créer leur propre système de vérités universelles et certaines, et dans cette quête, ils étaient aussi rigides que les médiévistes les plus dogmatiques.
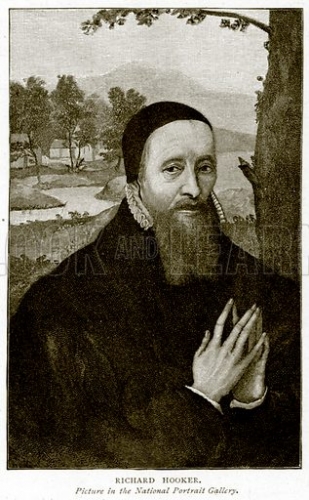
Les conservateurs anglo-écossais, de Richard Hooker et Selden à Smith et Burke, recherchaient quelque chose de très différent. Ils défendaient les coutumes nationales et religieuses tout en cultivant un "scepticisme modéré" - une combinaison que le monde anglophone appelle le "bon sens". Si les vieilles institutions n'ont pas besoin d'être réparées de manière évidente, le bon sens veut qu'on les laisse en l'état, car il y a toujours le risque d'aggraver la situation. Cependant, ils ont également vu le potentiel des tentatives d'amélioration des connaissances de l'humanité, tant que la faiblesse et le manque de fiabilité de la raison humaine étaient gardés en vue. Comme l'écrit Newton dans ses "Opticks" : "Argumenter à partir d'expériences et d'observations par induction n'est pas une démonstration de conclusions générales, mais c'est la meilleure façon d'argumenter ce que la nature des choses admet."
Je pense souvent à ces mots modérés et sceptiques ces jours-ci, alors que je suis la transformation politique et culturelle du monde anglophone. Les élites américaines et britanniques, autrefois attachées à un mélange de tradition et de scepticisme, réclament désormais les Lumières. Ils insistent sur le fait qu'ils ont atteint des certitudes universelles. Ils font preuve d'un mépris digne de Kant lui-même envers ceux qui refusent d'adopter leurs dogmes - les qualifiant de "non éclairés", "immatures", "illibéraux", "rétrospectifs", "déplorables", et pire encore.
Si ces élites avaient encore accès au bon sens, elles ne parleraient pas comme ça. L'excès de confiance dans les Lumières a suffisamment dérapé pour justifier de sérieux doutes sur les affirmations faites au nom de la raison - tout comme le doute est précieux pour aborder d'autres systèmes de dogmes. De tels doutes conseilleraient la tolérance à l'égard des différentes façons de penser. Les institutions nationales et religieuses ne correspondent peut-être pas au siècle des Lumières, mais elles peuvent néanmoins avoir des choses importantes à nous apprendre.
La vérité politique la plus importante de notre génération est peut-être celle-ci : vous ne pouvez pas avoir les Lumières et le scepticisme. Vous devez choisir l'un d'entre eux.
11:33 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lumières, idéologie des lumières, philosophie, 18ème siècle, néo-lumières |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Gadamer et la tradition

Luiz Campos
Gadamer et la tradition
Source: http://novaresistencia.org/2019/09/12/gadamer-e-o-tradicionalismo/
Est-il correct de considérer Hans-Georg Gadamer comme un traditionaliste ? Ses remises en question et ses critiques de la modernité et des principes des Lumières montrent qu'il l'est de fait. Le penseur allemand examine l'utilisation de la "méthode", qui cherche à atteindre une vérité incontestable, comme dans la philosophie de Descartes. L'erreur des Lumières a été la confiance aveugle dans la raison comme seul outil d'analyse pour les humains. L'ère moderne se caractérise par le mariage de la méthode et de la raison, une union qui a légitimé la connaissance scientifique comme source de vérité suprême.
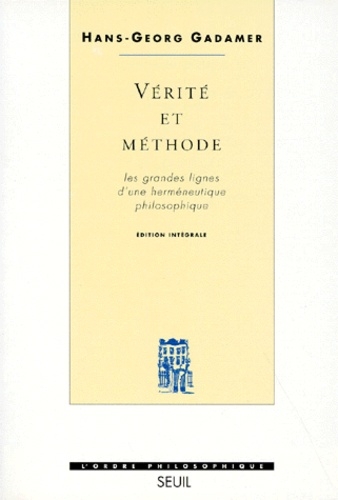
Descartes et les Lumières étaient des ennemis de la tradition, cherchant à la critiquer et à la juger. Gadamer, inspiré par des hautes figures du romantisme allemand comme Schleirmacher et Schlegel, et outre son maître Martin Heidegger, cherche à réhabiliter et à approfondir le sens de la tradition. Les philosophes des Lumières ont commis une grande erreur en pensant que toute forme de pensée pouvait se développer en s'isolant de la tradition.
La tradition n'est pas quelque chose qui peut être analysé par une raison qui prétend vainement être pure, car cette même raison fait partie d'une tradition qu'elle tente de juger. Pour Gadamer, la tradition est l'âme qui rend la culture vivante, et non un amas de valeurs illogiques et de connaissances sans fondement. Cette conception de Gadamer dialogue fortement avec notre vision des cultures traditionnelles, ce qui prouve qu'il est un penseur à étudier et à adapter à notre praxis. La tradition, en fait, est quelque chose de vivant, pas un fétiche du passé. Elle brille comme un soleil dont émanent les manifestations culturelles populaires les plus variées.
09:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hans-georg gadamer, gadamer, philosophie, tradition |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Nous devons parler de l'échec de la civilisation

Nous devons parler de l'échec de la civilisation
par Brett Stevens
Source: http://www.amerika.org/politics/we-must-talk-about-civilizational-failure/
Les gens avaient l'habitude de parler de l'éléphant dans la pièce, une métaphore pour désigner un sujet de conversation si sensible que tout le monde l'évite et parle de banalités à la place.
La métaphore fonctionne parce que vous pouvez facilement visualiser les gens discutant de toutes sortes de petites choses et ignorant la grande évidence, car c'est là le comportement humain par défaut.
Si vous reprenez une entreprise, un groupe militaire, une église ou un groupe d'amis, vous faites bien de commencer par une chasse à l'éléphant. Si l'entreprise n'est pas performante, il doit y avoir un tel "éléphant" ou quelque chose dont tout le monde nie l'existence.
Dans une entreprise, il s'agit généralement de la concurrence, d'une défaillance du produit ou d'un défaut de la chaîne d'approvisionnement. Dans un groupe, il peut s'agir de personnalités toxiques ou d'une situation où toutes les personnes talentueuses sont parties.
L'éléphant dans la pièce pour nous, en Occident, c'est l'échec patent de la civilisation. Notre civilisation a échoué lorsqu'elle a adopté la pathologie de l'individualisme, se manifestant par l'égalitarisme, y compris par la démocratie.
Son échec était patent à l'époque de la Première Guerre mondiale, et il est alors devenu évident que nous étions devenus fous parce que nous poursuivions des objectifs insensés qui sont paradoxaux par rapport à la réalité qui fonctionne en termes de cycles, de modèles et d'autres structures intangibles.
Nous devons parler de l'échec de la civilisation, de la manière de l'inverser et d'éviter qu'il ne se reproduise.
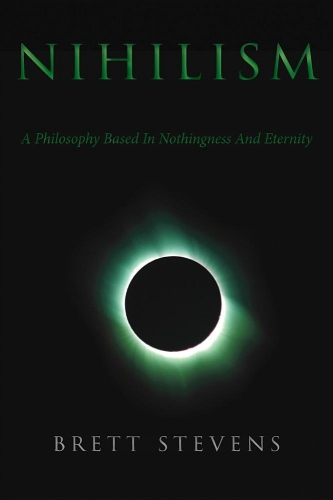
Tout le reste n'est que distraction. En tant qu'auteur d'une philosophie appelée Parallélisme, je me dois de signaler que nos échecs personnels sont parallèles aux échecs de notre civilisation.
Presque tout le monde en Occident a perdu la raison à ce stade, et presque tout ce qui est accepté comme "fait" ou comme "bien" est en fait une illusion. N.B. : le reste du monde est moins compétent et plus fou, mais cela n'a en fait aucune incidence sur notre avenir.
Les choses semblent sombres en ce moment, mais cela aussi est une illusion.
Nous sommes dans le déni de l'éléphant dans la pièce (EITR/"Elephant in the Room") depuis des siècles, voire plus. Notre civilisation a réussi, et nous avons donc perdu le sens de l'objectif fixé, et c'est alors que les personnes incapables de faire quoi que ce soit ont remplacé les personnes capables de faire quelque chose, en faisant appel à la peur collective de l'insuffisance personnelle.
La socialisation et le statut social ont remplacé la fonction. L'illusion populaire a remplacé l'élan vers la réalité et l'excellence en son sein (arete). L'égoïsme a remplacé la fierté de faire le bien et de faire partie d'une tribu.
Nous avons été dans le déni pendant des siècles. Maintenant, le déni prend fin. Oui, cela fera mal pendant un certain temps, mais une fois que nous aurons passé l'obstacle de notre propre illusion, nous aurons une grande opportunité de faire beaucoup mieux.
09:00 Publié dans Actualité, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : brett stevens, philosophie, nihilisme, civilisation, déclin, décadence |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 09 mars 2022
Lucian Blaga: Vision, identité et culture populaire

Augusto Fleck
Vision, identité et culture populaire
Source: http://novaresistencia.org/2022/03/08/visao-identidade-e-cultura-popular/
Il existe un long débat au sein des sphères dissidentes et conservatrices sur la position de la culture populaire, des structures les plus caractéristiques du peuple aux festivals et à l'art produit à l'écart des cercles élitistes et bourgeois. Avec l'aide de la philosophie du poète roumain Lucian Blaga, nous pouvons réfléchir à la manière dont cette culture est proprement le fruit de notre "vision".
Lucian Blaga est un philosophe peu connu en dehors de la sphère universitaire roumaine. Sa poésie, en revanche, est plus répandue et fait même l'objet de traductions en portugais, bien que son impression et sa lecture soient également limitées. Philosophe entre deux mondes, sous l'influence de l'idéalisme et de la poésie d'Allemagne ainsi que de la culture roumaine qui l'entourait, Blaga a également dialogué intensément avec la métaphysique et la phénoménologie.
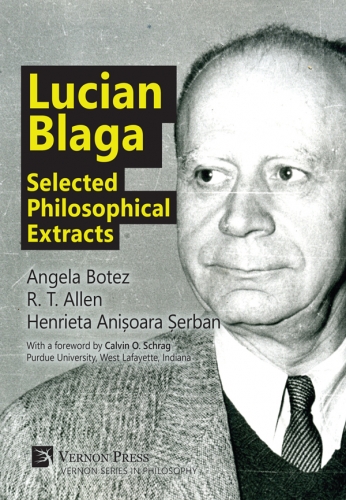
Dans le domaine de l'épistémologie, il a eu l'audace de réaliser que les catégories kantiennes qui sous-tendaient la physique moderne étaient insuffisantes pour lire adéquatement la nouvelle physique et pour saisir la conscience de la connaissance dans son ensemble, en proposant que dans l'horizon des mystères, non seulement la lumière qui atténue le mystère produit la connaissance, mais qu'il existe un autre type de "cognoscence" qui intensifie et radicalise le mystère jusqu'à sa limite.
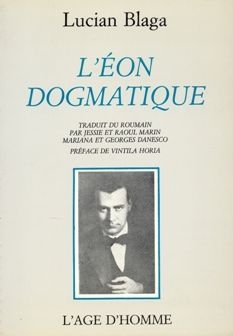 Comme produit de ses réflexions, une théorie entièrement nouvelle sur les processus de formation culturelle émerge, puisqu'il a compris l'homme lui-même comme une sorte de mutation ontologiquement culturelle, la culture étant une réponse imagée ou métaphorique de l'homme pour comprendre le mystère qui se trouve au-delà de l'horizon. L'horizon, pour Blaga, est une sorte d'atmosphère axiologique, d'orientation ou de forme, capable de donner un sens à la création culturelle. La culture est donc une manifestation ou une cristallisation anthropologique et géosophique d'horizons spatiaux subconscients.
Comme produit de ses réflexions, une théorie entièrement nouvelle sur les processus de formation culturelle émerge, puisqu'il a compris l'homme lui-même comme une sorte de mutation ontologiquement culturelle, la culture étant une réponse imagée ou métaphorique de l'homme pour comprendre le mystère qui se trouve au-delà de l'horizon. L'horizon, pour Blaga, est une sorte d'atmosphère axiologique, d'orientation ou de forme, capable de donner un sens à la création culturelle. La culture est donc une manifestation ou une cristallisation anthropologique et géosophique d'horizons spatiaux subconscients.
Dans l'ordre, cet horizon spatial subconscient produit chez l'homme une "vision", une capacité qui fait de lui, en fait, un Homme. C'est lorsqu'il contemple l'horizon et réfléchit à sa finitude, qui reflète la finitude même de l'être, que la nature "rompt" avec son imperturbable sommeil conscient et en vient à exister pour le mystère et à le tenter.
Cette vision, bien sûr, est la muse la plus fondamentale du processus créatif et culturel. La culture n'est pas, comme l'a supposé la modernité à bien des égards, un ensemble de structures fonctionnelles produites par l'homme pour le maintien de son bien-être physique et la garantie de ses biens, mais une condition stylistique et linguistique qui donne un sens au sujet, des outils pour traiter le mystère.

Dans le sillage de ce processus, chaque identité qui se forme est une matrice stylistique et structurelle correspondant à la relation entre l'horizon spatial (subconscient), la vision et l'horizon phénoménal de chaque peuple, un "être-avec historique". C'est pourquoi, contrairement aux animaux, la culture humaine posséderait, pour Blaga, tant de différences organisationnelles et dynamiques. Ainsi, exister ne peut réellement avoir un sens qu'à partir d'une vision spécifique sous laquelle nous modulons notre interaction avec le monde. Dans ce sens, Blaga dialogue à la fois avec les "styles civilisationnels" de Spengler, l'être de Heidegger et la cosmologie civilisationnelle de Douguine. Un amalgame presque typiquement roumain de leurs philosophies, pour être précis. Nonobstant la roumanité intrinsèque des images proposées par Blaga, ses catégories proposent une universalisation métaphysique, épistémologique et anthropologique qui peut être adéquate dans un autre système linguistique, tel que le nôtre (ndt: lusophone).

Par conséquent, la culture populaire en tant que création identitaire à partir de la vision est un élément irrémédiablement concret de la relation existentielle et quotidienne de l'homme avec ce qui le rend homme.
Cela nous ramène, en quelque sorte, au problème de la culture populaire vs la culture de masse, tant en ce qui concerne la production artistique que le statut de nos fêtes populaires, sévèrement critiquées pour être barbares, immondes, etc.
La critique de la culture populaire est un thème récurrent dans les milieux conservateurs comme symptôme de décadence. En fait, il ne semblera pas étrange à tout traditionaliste de réaliser que lorsqu'une civilisation s'épuise dans la véritable essence de son esprit et que le crépuscule approche - ou plutôt, lorsque sa vision devient floue et que l'horizon n'est pas plus contemplatif qu'une obscurité métaphysique - l'art même produit sera en quelque sorte d'affecté.
Le problème de cette interprétation et du comportement subséquent, consistant à fétichiser l'exotique et l'exogène culturel, est une mauvaise compréhension de la civilisation même dont on fait partie. Il faut reconnaître qu'à l'orée de notre existence, aucun type de création culturelle ne dialogue avec l'aspect mystérieux et révélateur de l'existence aussi bien que la nôtre. Douguine souligne cet aspect lorsqu'il applique au cosmos la condition d'accès à l'infini, l'unité dans la multiplicité, l'immersion totale dans le particulier comme condition de l'éternel.

Cela ne signifie pas, par exemple, un rejet total de ce qui est extérieur, car les grandes œuvres ont également le pouvoir de toucher le mystère par le biais de métaphores et de les exposer de telle sorte qu'une comparaison soit possible. La philosophie est aussi un art de la traduction.
Les deux éléments les plus troublants s'avèrent être : (1) une aliénation complète du sujet par rapport à son identité culturelle propre, tandis qu'il cherche dans le passé des cultures anciennes et éteintes, dans son sommet et sa mémoire apollinienne, une sorte d'ode à la beauté comme forme catégorique (2); une réduction de l'art populaire contemporain à l'état décadent du monde, une généralisation dangereuse et potentiellement délétère.
Même aux heures les plus sombres de la nuit de la civilisation, chaque peuple possède encore sa puissance immanente et un mouvement vers l'horizon et la cristallisation révélatrice. C'est cela qui potentialise le renouvellement de la puissance vers l'éternel que les fêtes populaires et l'art de notre peuple produisent, à travers notre matrice stylistique, sans avoir à recourir au plâtre effrité et décoloré des époques culturelles antérieures.
En réalité, toutes ces préoccupations et ces excès découlent de la même inquiétude et du même manque de soin qui imprègnent presque tout le travail intellectuel : savoir séparer ce qui est universel et qui relève de la démarche philosophique, anthropologique et métaphysique, de ce qui est particulier et qui reflète un horizon spécifique, qui ne manque pas, même dans l'abîme, de toucher et de dialoguer intimement avec le mystère qui nous rend humains.
11:38 Publié dans Littérature, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lucian blaga, philosophie, littérature, littérature roumaine, lettres, lettres roumaines, roumanie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 28 février 2022
Souvenir de Giorgio Locchi, qui a pressenti le "mal américain" avant les autres
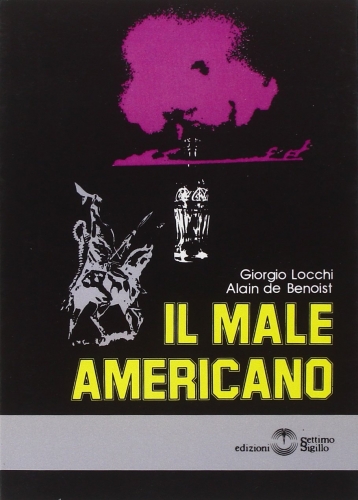
Souvenir de Giorgio Locchi, qui a pressenti le "mal américain" avant les autres
par Antonio Pannullo
Ex : http://www.secoloditalia.it
Giorgio Locchi est décédé à Paris, où il vivait depuis les années 50, le 25 octobre 1992. Aujourd'hui, Giorgio Locchi, journaliste, essayiste et écrivain, n'est plus très connu en Italie, surtout des jeunes, mais il est l'un des penseurs qui ont eu le plus d'impact sur la communauté anticommuniste européenne (il n'aimait pas le terme "droite") à partir des années 1970. On sait peu de choses de sa vie privée, et ce que l'on sait, on le doit à la fréquentation systématique de ses "disciples" italiens, des jeunes hommes issus du mouvement missiniste (MSI) des années 1970. Ces jeunes hommes, enflammés par le feu sacré de la politique et le désir de changer ce monde, se rendent à Paris, à Saint-Cloud, où Locchi vit et gagne sa vie comme correspondant du quotidien romain Il Tempo. Parmi ces jeunes hommes, nous nous souvenons certainement de Gennaro Malgieri, Giuseppe Del Ninno, Mario Trubiano, Marco Tarchi et d'autres. Quoi qu'il en soit, bien que méconnu en Italie, Giorgio Locchi a été en quelque sorte le "père noble" des grands bouleversements culturels européens dans la mouvance de la droite (nous n'écrivons le mot "droite" que par convention), lorsque de ce néofascisme missiniste pur est née la dimension culturelle, incarnée par une Nouvelle Droite, comme on l'a appelée en fait plus tard. Cette Nouvelle Droite regardait au-delà du régime fasciste mais pensait plutôt au potentiel, partiellement mis en pratique, de cette philosophie et doctrine européiste et anti-égalitaire, bien que modernisatrice, qui aurait encore beaucoup à dire et à donner à notre civilisation quelque peu décadente (pour être généreux). Ensuite, la figure de Giorgio Locchi a été révélée en France, mais grâce aux Italiens, comme le rappelle Del Ninno. Locchi était l'un des fondateurs du G.R.E.C.E., le Groupement de recherche et d'études pour la civilisation européenne, créé en 1968 notamment avec Alain de Benoist, un intellectuel et journaliste français bien connu, qui était avec Locchi dès le début, même si de Benoist était plus jeune.

Giorgio Locchi a vécu à Paris pendant de nombreuses années. Il est toutefois né à Rome en 1923, sa famille avait des liens avec le monde du cinéma et du doublage, il était lui-même un ami de la famille de Sergio Leone ; il a fait ses études à l'école classique nazaréenne où, bien que totalement non-catholique, il a gardé son estime et sa gratitude pour les pères piaristes, qui ont toujours respecté sa liberté de pensée et qui lui ont toujours garanti une autonomie maximale de jugement et de critique. Il a poursuivi ses études, notamment en germanistique, musique, sciences politiques, mais surtout en civilisation indo-européenne, sujet sur lequel il nous a laissé un livre et de nombreux écrits.
Les jeunes du Fronte della Gioventù et du MSI des années 1970 et 1980 ont été littéralement foudroyés par son livre Il male americano (Lede editrice), dans lequel Locchi prédisait tout ce qui ne devait pas arriver mais qui nous arrive encore. Pour Locchi, le fait d'avoir été vaincu par une guerre dévastatrice n'annihile pas les idées qui ont conduit à cette guerre. Ils survivent sous les formes et les nuances les plus disparates. Après la création du G.R.E.C.E., que nous appellerions aujourd'hui un think tank, la Nouvelle Droite a commencé à se faire un nom non seulement en France et en Italie, mais dans toute l'Europe occidentale. Et en parlant d'Europe, Locchi voulait se rendre à Berlin à l'époque de la réunification allemande. À partir de ce moment, la signature de Locchi, qui utilisait également le pseudonyme Hans-Jürgen Nigra, a commencé à apparaître dans des magazines proches de la Nouvelle Droite, tels que Nouvelle Ecole, Eléments, Intervento, la Destra, l'Uomo libero et bien sûr notre quotidien Secolo d'Italia. Entre-temps, il a fourni de précieuses informations aux lecteurs italiens avec une superbe correspondance sur les événements en Algérie, sur les Français de 68, et aussi sur la naissance de l'existentialisme.
Comme l'a clairement écrit Gennaro Malgieri dans son admirable hommage à Giorgio Locchi (1923-1992) dans Synergies européennes en février 1993 (ndt: dans la revue Vouloir, pour être exact), les idées de Locchi étaient en fait les idées d'une Europe qui n'existe plus, mais ce n'était pas une raison pour ne pas en défendre ou en illustrer les principes. Ces idées portent sur cette Europe éternelle à laquelle l'Europe économique de notre période d'après-guerre ne ressemble en rien. Par exemple, note encore Malgieri, l'attitude de Locchi à l'égard du fascisme n'est pas une simple nostalgie ou une protestation, mais il a recueilli dans le ferment culturel de cette époque et de cette expérience toutes les idées et initiatives qui n'étaient pas et ne sont pas obsolètes. "Il nous a fait part de ses réflexions à ce sujet dans son ouvrage intitulé L'essence du fascisme (Il Tridente, 1981). Il fait référence à la vision du monde qui a inspiré le fascisme historique, mais qui n'a pas disparu avec la défaite de ce dernier. Ce livre est encore un prodigieux "discours de vérité" au sens grec du terme, qui cherche à écarter du fascisme toutes les explications fragmentaires qui sont faites actuellement et toutes les formes de diabolisation visant à générer des préjugés". Giorgio Locchi a également écrit un livre sur le "mythe surhumaniste".
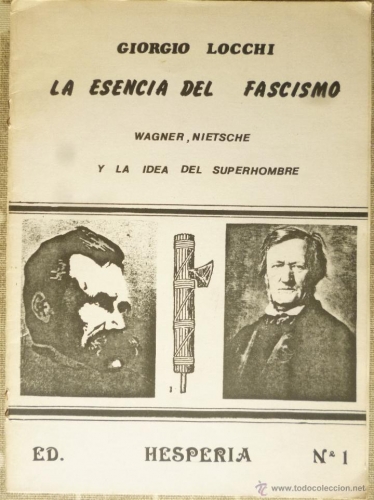
Dans son enquête, Locchi affirme qu'il n'est pas possible de comprendre le fascisme si l'on ne réalise pas qu'il est la première manifestation politique d'un phénomène spirituel plus large, dont il fait remonter les origines à la seconde moitié du XIXe siècle et qu'il appelle "surhumanisme". Les pôles de ce phénomène, qui ressemble à un énorme champ magnétique, sont Richard Wagner et Friedrich Nietzsche qui, à travers leurs œuvres, ont mélangé le nouveau principe et l'ont introduit dans la culture européenne à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Sur ce, Locchi a écrit le livre Wagner, Nietzsche et le mythe surhumaniste (éditions Akropolis), difficile mais extrêmement lucide, qui a eu les éloges du critique musical Paolo Isotta dans les colonnes du Corriere della Sera.
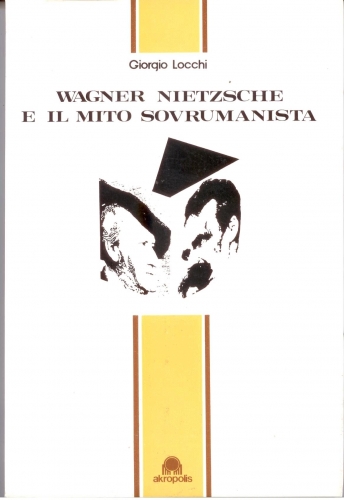

Locchi nous a laissé des livres peu nombreux mais importants. Sa vie témoigne d'un engagement cohérent, profond et crucial, qu'il serait bon d'explorer davantage aujourd'hui. Il y a quelques années, Francesco Germinario lui a consacré un livre, Tradizione, Mito e Storia (éditions Carocci), dans lequel l'auteur définit les caractéristiques de la droite radicale, en s'attardant sur ses exposants les plus significatifs. Il y a deux ans, au siège romain de Casapound, s'est tenue une conférence sur Giorgio Locchi en présence de son fils Pierluigi et d'Enzo Cipriano, également ami et disciple de Locchi depuis des années.

16:53 Publié dans Hommages, Nouvelle Droite, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : giorgio locchi, nouvelle droite, philosophie, hommage |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 26 février 2022
Katechon et Antikeimenos, la bataille géopolitique et spirituelle

Katechon et Antikeimenos, la bataille géopolitique et spirituelle
Lorenzo Maria Pacini
Source: https://www.geopolitica.ru/it/article/katechon-e-antikeimenos-la-battaglia-geopolitica-dello-spirito
Il ne s'agit pas d'une guerre qui a commencé en Ukraine il y a quelques heures, ni d'une vicissitude parmi d'autres vicissitudes entre deux nations qui sont déjà en conflit depuis des années. Nous assistons à un affrontement plus général entre deux visions du monde: d'une part, la vision postmoderne, techno-fluide, de l'empire matériel, de la démocratie importée à coup de bombes, des droits de l'homme et des révolutions de couleur qui se révèlent tyrannie, de big tech et de big pharma, de la destruction des identités et de l'assujettissement des masses aux élites du pouvoir oligarchique, soit le Great Reset ; d'autre part, la vision qui affirme l'autodétermination, la liberté, les identités de chaque peuple, la Tradition, les droits fondés sur l'ontologie, l'indépendance financière et la politique visant le bien commun, le Grand Réveil. Il s'agit d'un affrontement apocalyptique, intrinsèquement eschatologique, et ne pas comprendre la portée métaphysique de cette bataille revient à ignorer le cœur de ce qui est là, devant nous, en train de se passer.
Il ne s'agit pas, répétons-le, d'une guerre de simples intérêts, avec d'un côté l'Occident atlantiste qui tente, comme il l'a toujours fait, d'étendre son empire et d'écraser les peuples libres, actuellement représentés par la Russie en tant que leader d'un petit reste dans le monde ; nous ne sommes pas non plus simplement confrontés à deux visions politiques, l'une de la tyrannie libérale et l'autre du national-socialisme démocratique ; nous nous trouvons à un carrefour évolutif pour l'ensemble de l'humanité, une étape qui marque déjà une prise de position et un profond discernement entre ceux qui soutiennent et alimentent l'involution de la grande réinitialisation mondialiste et ceux qui, au contraire, sont les pionniers d'un monde nouveau qui jaillira de l'éveil global des consciences.

La confusion méphistophélique avec laquelle on communique sur ce qui se passe est si grande qu'elle laisse désorienté, mais cela aussi est utile, car seuls les esprits les plus fins parviennent à passer à travers les mailles de ce filet qui sépare l'ivraie du bon grain. C'est plutôt avec le cœur qu'il faut décider quel côté prendre, car ce n'est qu'à travers le cœur que le monde peut changer.

La Russie est actuellement le rempart contre l'hégémonie de l'Occident perverti, qui a trahi ses origines, sa Foi, qui a subjugué la majorité du monde par la violence, les guerres ouvertes et secrètes, la colonisation culturelle et militaire. Avec les autres États qui n'ont plié devant aucun maître politique et qui ont préservé leur identité et leur tradition, il existe une lumière venue d'Orient qui, dans l'effondrement de la dualité de ce monde, agit comme un contrepoids dans l'histoire et nous demande de choisir un camp. Ex oriente lux, disaient les anciens, et c'est précisément ce salut préconçu que nous pouvons reconnaître allégoriquement dans ce moment tragique.
Soyons clairs : la guerre n'est pas le moyen de faire la paix. Pas de guerre, d'aucune sorte. La guerre est un acte qui ne peut engendrer autre chose que la guerre, avant ou après, appelant la vengeance dans le sang même des peuples qui la font et qui la subissent. Ce n'est pas en alimentant davantage cette gigantesque monstruosité que le monde changera, quel que soit le camp dans lequel on décide de se placer. Ce que nous nourrissons vit, donc si nous continuons à nous faire la guerre, le monde ne peut être que guerre.
Or, c'est précisément par le biais de conflits à l'échelle mondiale que, selon les récits eschatologiques des différentes religions, s'établit d'abord le règne du Mal, puis triomphe le règne du Bien ; ce n'est que par l'effondrement total de ce monde tel que nous l'avons construit qu'il sera possible d'en bâtir un nouveau.
Tout ce qui a été prédit doit s'accomplir, c'est pourquoi nous sommes au milieu d'un conflit d'époque, inévitable pour le passage entre deux époques et deux mondes comme celui que nous traversons. C'est la bataille des Katechon contre les Antikeimenos (leurs adversaires qui s'exaltent et se révèlent "accélérationnistes" et eschtologistes, ndt), et les destins sont déjà écrits dans l'un ou l'autre camp.
19:32 Publié dans Philosophie, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : katechon, religion, théologie, théologie politique, tradition, traditionalisme, philosophie, antikeimenos |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 24 février 2022
La privatisation de la vie et les caprices des consommateurs sont appelés droits civils

La privatisation de la vie et les caprices des consommateurs sont appelés "droits civils"
Diego Fusaro
Source: http://adaraga.com/la-privatizacion-de-la-vida-y-los-caprichos-del-consumidor-se-llaman-derechos-civiles/
La pratique de l'agression menée par le suzerain financier contre le serf en retraite trouve son moment fondamental dans la reconfiguration des droits en tant que marchandises disponibles selon la valeur d'échange.
Alors que les droits étaient autrefois garantis inconditionnellement à chaque membre de la communauté en tant que tel (c'est-à-dire en tant que porteur libre et égal de droits et de devoirs liés à la citoyenneté), ils tendent aujourd'hui de plus en plus à devenir, comme les autres marchandises de la sphère de circulation, des biens achetables et donc dépendants de l'équivalent général et abstrait de la monnaie.
Les figures interconnectées de la citoyenneté et du citoyen, articulées avec l'éthique de l'État-nation souverain, sont désormais éclipsées. Et, conformément à la redéfinition de la société dans son ensemble comme un "système de besoins", ils tendent à être remplacés par les nouveaux profils du client et de la consommation, avec la centralité de la "marchandisation de la citoyenneté", de la forme marchandise et de la valeur d'échange différemment distribuée.
Dans la terminologie de l'essai marxien De la question juive (1843), le profil du bourgeois, de l'individu privatisé qui construit ses relations sur la base du théorème de l'"insupportable sociabilité" (ou, en termes hégéliens, de la "dépendance omnilatérale"), a été globalisé, non pas le profil du citoyen, qui est éclipsé, mais celui du bourgeois. Selon les termes de Das Kapital, "l'indépendance des hommes les uns par rapport aux autres est intégrée dans un système de dépendance omnilatérale imposé aux choses", au sommet de la réification.
C'est, comme on le sait, la socialité compétitive que, de la "main invisible" d'Adam Smith à la "sociabilité insupportable" de Kant en passant par les Dix-huit leçons sur la société industrielle de Raymond Aron (1955-1956), le système planétarisé des besoins promeut dans l'acte même de délégitimer les autres.
Selon les termes de la quatrième thèse de l'Idée d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolite de Kant (1784), "le moyen que la nature utilise pour amener le développement de toutes ses dispositions est son antagonisme dans la société, dans la mesure où cet antagonisme est finalement la cause d'un ordre civil de la société elle-même".
L'harmonie sociale de l'"ordre civil" est ainsi admise et reconnue comme le telos ultime : et, en même temps, on célèbre le chemin qui devrait mener (et qui a historiquement mené) au résultat opposé, à ce nouveau bellum omnium contra omnes planétaire, qui est l'antithèse de l'harmonie sociale.
Cela conduit à ce que Hegel appelle la "perte d'éthicité" (Sittlichkeit) : à ce niveau, la société civile se présente comme le "monde phénoménal de l'éthique". En fait, l'universel éthique n'existe que sous une forme apparente, le particularisme de l'intérêt individuel dé-éthique prévalant et se rapportant à tous les autres intérêts sous la forme d'une dépendance omnilatérale au système d'échange du marché.
La connectivité totale de l'insociable sociabilité est telle que tous, pour ne pas succomber, doivent se soumettre à la lex du libre-échange, qu'ils soient ou non motivés par l'appât du gain.
Célébrés d'un coup de chéquier par la même classe qui travaille avec zèle au démantèlement des droits sociaux et du travail, les soi-disant "droits civils" coïncident aujourd'hui presque entièrement avec les droits du bourgeois ou, plutôt, du consommateur : ce sont des droits sous forme de marchandises, disponibles dans l'abstrait pour tous et dans la pratique seulement pour ceux qui peuvent les payer.
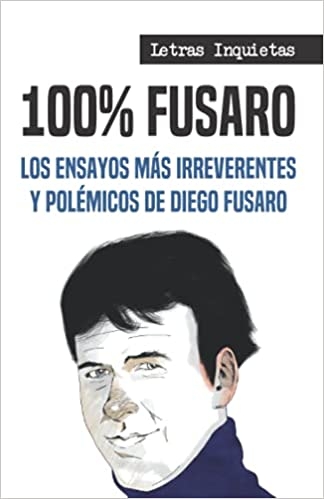
Diego Fusaro : 100% Fusaro, Les essais les plus irrévérencieux et polémiques de Diego Fusaro. Letras Inquietas (juillet 2021).
Pour commander le livre: https://www.amazon.com/100-Fusaro-irreverentes-pol%C3%A9micos-Inquietas/dp/B098WHPB64
16:25 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : diego fusaro, philosophie, philosophie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 22 février 2022
La noologie de l’ancienne tradition chinoise

La noologie de l’ancienne tradition chinoise
Alexandre Douguine
L’ontologie des souffles : le Dionysos jaune
La formule Yin-Yang, sa dimension donnée dans le Tao, et sa distribution dans le calendrier et la carte des cinq éléments, pris ensemble, décrivent la structure de l’ontologie spécifiquement chinoise qui diffère fondamentalement de toutes les autres ontologies. L’ontologie chinoise est basée sur des éléments et des approches qui correspondent à un modèle noologique spécial. L’essence de ce modèle est qu’il n’est pas simplement dominé par le Logos de Dionysos, mais que le Logos de Dionysos est le seul élément connu et accepté dans ce modèle, alors que toutes les autres zones noologiques « subissent » ce « dionysisme » chinois sans même acquérir de fixation autonome. Ici, dans l’ancienne tradition chinoise, le Logos de Dionysos est complet, et l’équilibre qui constitue son essence ne penche dans la direction d’aucun autre Logos – ni vers Apollon, comme c’est le cas dans la majorité des formes indo-européennes de dionysisme [1], ni dans la direction de Cybèle, comme dans de nombreuses cultures d’orientation chtonienne et titanique [2]. Le Yin-Yang et le Tao ne peuvent pas être corrélés avec le modèle platonicien du Logos apollinien, où le centre est le ciel éternel et où le niveau médian est le royaume des phénomènes temporels vivants, ni avec les doctrines matérialistes de la Grande Mère et du Titanisme, qui attachent les phénomènes et les choses à la dure section de l’espace et du temps ou à la figure du démiurge matériel, c’est-à-dire le Logos Noir de Cybèle.

Le Logos chinois se déploie exclusivement et absolument dans la sphère médiane, dans le monde intermédiaire qui est conçu comme le principal et unique. Ni le Ciel et le Yang ni l’Eau et le Yin, c’est-à-dire ni les hauteurs apolliniennes ni les profondeurs cybéliennes n’acquièrent une ontologie autonome ou un Logos particulier. Il n’y a pas d’extrêmes, il y a seulement le centre entre eux, qui les constitue au cours d’un subtil jeu dialectique. Les dieux, les humains, les éléments, les empires, les rites, les animaux, les luminaires, les cycles et les terres représentent tous le déploiement du Logos médian et ne sont que des traces de la pulsation rythmique et dynamique du Centre toujours situé également au milieu entre deux pôles qui sont dépourvus d’être autonome et qui se recoupent l’un l’autre en vertu de la grande harmonie. Ce monde médian se déployant autour du centre absolu peut être imaginé comme un navire qui a levé les ancres l’attachant au Ciel et au Monde Souterrain. Le monde phénoménal de l’ontologie du Yin-Yang n’a pas d’idées et de paradigmes archétypaux, et il ne tient pas non plus la présence matérielle comme une condition nécessaire de la manifestation. L’ontologie chinoise est principalement et fondamentalement légère, comme indiqué par Marcel Granet dans son expression « la magie du souffle ». Nous pouvons ainsi parler d’une « ontologie des souffles » évoluant avec un rythme complexe entre le Ciel et la Base terrestre, en vol libre. Le Ciel et le Monde Souterrain sont contenus dans le Centre et représentent ses projections, jamais complètement détachées de sa matrice vivipare.

Dans son essence, cette structure rappelle remarquablement l’ontologie fondamentale de Heidegger, et comme cela a été remarqué par de nombreux spécialistes, cela indique soit une similarité des approches soit la possibilité que Heidegger lui-même ait emprunté un certain nombre de motifs centraux à la philosophie chinoise (peut-être par l’intermédiaire de la culture japonaise dans sa version bouddhiste zen) [3]. Le Centre chinois, n’étant ni au-dessus du monde ni au-dessous du monde, correspond aussi précisément que possible au Dasein heideggérien et à sa phénoménologie spécifique que nous avons précédemment identifiée sans équivoque au Logos de Dionysos. De plus, la tradition chinoise présente cela sous une forme pure et extrêmement structurée qui nous pousse à rechercher cet Autre Commencement de la philosophie dont parlait Heidegger, et à nous tourner vers l’« ontologie du souffle » de la culture chinoise [4]. Quelque chose de similaire concernant l’importance fondamentale de la philosophie chinoise pour la reconstruction de la Tradition Primordiale fut exprimé par René Guénon [5].
Si nous corrélons la particularité de la zone ontologique de Dionysos dans la tradition chinoise avec les trois états de conscience de la philosophie indienne, nous pouvons noter que le monde médian, intermédiaire, correspond au royaume des rêves. Au-dessus de ce monde l’hindouisme place le monde de l’esprit pur (Svarga, le Ciel, et kāraṇa-śarira, le « corps causal ») et au-dessous de lui les images des formes corporelles (Bhur, la Terre, et shthūla-śarira, le « corps grossier ») [6]. Sur la base de ce modèle, concernant la particularité existentielle qui est dominante dans la culture chinoise, on peut faire la proposition que la culture chinoise est la culture des rêves, le domaine du monde médian où réside le Dasein dans un état d’intense incertitude rythmique ou de « suspension subtile », dont la structure est organisée en accord avec le rythme du Yin-Yang. Le « Dasein jaune » n’est pas seulement dormant, mais exclut la possibilité même d’un éveil. L’éveil est conçu non comme une alternative au sommeil, mais comme une transition vers un autre rêve, juste comme la transition entre l’hiver et le printemps.
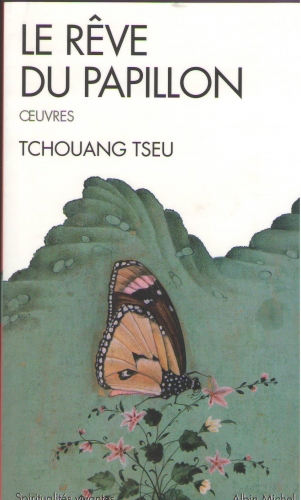
La pensée chinoise rejette toute exclusivité : le sommeil n’est pas aboli par la réalité, mais la réalité est incluse dans le sommeil sur un pied d’égalité. La métaphore du papillon de Tchouang-Tseu rêvé par Tchou acquiert ainsi une signification supplémentaire. Si nous utilisions auparavant la métaphore du sommeil pour décrire la transformation, alors maintenant cette métaphore de la transformation peut être employée pour décrire l’ontologie du rêve. La transformation est un synonyme du rêve, et le rêve est le dénominateur commun de la conscience dormante et de la conscience en éveil. Les structures de nombreuses autres cultures, particulièrement celles des religions monothéistes et la civilisation de la Modernité européenne, sont basées sur la conviction que la conscience en éveil est le dénominateur commun, ce qui existe toujours et « objectivement » et dont les conditions sont simplement pensées différemment selon qu’une personne est endormie ou éveillée ; si elle est éveillée, elle perçoit cette « réalité objective » en termes de contraste ; si elle est endormie, elle cesse simplement de la percevoir, mais cela ne change pas la « réalité objective » elle-même. Selon cette vision, nous sommes convaincus que le jugement juste est toujours porté par une personne éveillée sur une personne endormie, et jamais par une personne endormie sur une personne éveillée. C’est pourquoi l’éveil est considéré comme le dénominateur commun de la « réalité ». Mais c’est simplement une propriété de la philosophie de la Grande Mère et une forme de sa domination culturelle qui impose sa perception des choses depuis cet angle précisément. Le Logos apollinien (comme dans le platonisme, l’Avesta, et les Upanishads) voit le dénominateur commun comme la contemplation intérieure des idées par la conscience, qui peut être claire dans le sommeil mais vague dans l’éveil et vice-versa. La dernière est d’importance secondaire, dans la mesure où la plus importante de toutes est le sommeil transcendant et la pleine conscience du lieu où réside l’être et de ce qui ressemble le plus à la « réalité » (correspondant au monde des idées ou aux ennéades dans le néo-platonisme). La tradition chinoise, en tant que culture du Dionysos jaune, prend comme pivot non pas la pleine conscience et les mondes des paradigmes éternels, mais le rêve, qui est « changement » ou « altération », en chinois « i », 易. Cette « altération » est l’essence de l’existence chinoise. Cependant, ce « changement » n’est pas le « devenir » dans la mesure où il n’y a pas de but, pas d’accumulation ou de perte qui serait asymétrique. D’où l’idée que dans chaque dynastie seule une des cinq vertus pouvait dominer – associée, comme toujours, aux cinq éléments. Les quatre restantes étaient toujours envoyées en exil à la périphérie de la Chine, où elles restaient jusqu’à ce que la dynastie ait épuisé ses vertus et ait commencé à dégénérer. Après cela, une nouvelle vertu pouvait s’affirmer au Centre avec une nouvelle dynastie, la précédente étant envoyée en exil. Les vertus, les peuples, et les éléments – rien de tout cela ne disparaît jamais ; ils sont en fait transformés, mis en sommeil, et tous réveillés dans la structure de l’équation à multiple niveaux, non-intégrable, du sommeil et du rêve.
D’où la légèreté du style chinois dans la musique, la peinture, le langage, et l’architecture. C’est la légèreté de la transformation et des rêves portant leur propre ordre précis tout en restant fondamentalement ouverts aux séries infinies de variations saturées et inattendues. Ce n’est pas l’éternel retour du même (à la Nietzsche [7]), mais l’éternel retour de quelque chose de différent à chaque fois et éternellement.

L’expérience du Dragon
Dans la tradition chinoise, la figure du Dragon (Lun 龍) joue un rôle métaphysique majeur. La théorie chinoise des cinq éléments professe de strictes correspondances avec deux types d’animaux : ordinaires (le cochon, le chien, le mouton, le poulet, et la vache) et sacrés-mythologiques (la Tortue Noire ou le Serpent, le Dragon Jaune, le Phénix Rouge, la Licorne Jaune, et le Tigre Blanc). Si les animaux ordinaires sont situés sur la bordure externe du cercle ou du carré de la carte du calendrier, les animaux sacrés appartiennent au royaume au-delà de cette bordure. Dans la mesure où la métaphysique chinoise ne reconnaît aucune forme de transcendance, ce caractère d’« au-delà » des animaux sacrés est cependant inclus dans le système de la vision-du-monde chinoise pour la raison que, tout en étant à l’extérieur du monde, les dragons et les phénix sont maximalement éloignés du Centre, mais néanmoins à l’intérieur de la bordure. En règle générale, la structure du sacré combine en elle l’extrêmement éloigné et l’extrêmement proche, l’extrêmement grand et l’extrêmement petit [8]. Par conséquent, ce qui est le plus éloigné du Centre fait tout de même sentir sa présence dans le Centre lui-même, bien que dans sa dimension cachée. C’est ce qui rend le Centre sacré.
Le cercle des animaux sacrés est distribué selon la logique des cinq éléments : la Tortue Noire ou Serpent est associée à l’Eau et au Monde Souterrain (le pays des Sources Jaunes) ; le Dragon Jaune est associé au Bois, à l’Est, et à l’équinoxe de printemps ; le Phénix Rouge au Sud et au solstice d’été ; le Tigre Blanc au Métal, à l’Occident, et à l’équinoxe d’automne ; et la Licorne Jaune (chilin) à la Terre et au Centre. Tous ces êtres sacrés, cependant, sont décrits comme ayant tout un ensemble complexe de propriétés, par exemple des cornes, la queue des serpents ou des poissons, des ailes, des pattes, des écailles, etc. En d’autres mots, tous sont des pantheria, ou des « pan-bêtes » présentant des éléments d’autres animaux. Ce sont des proto-animaux, des esprits, et des symboles sacrés contenant les pouvoirs du rythme quintuple de la distribution du Yin-Yang. Dans un certain sens, ils pourraient être appelés des « dieux » ou des « onto-logoï » dans la mesure où ils exhibent les pouvoirs synthétiques les plus généraux conjugués à chacun des éléments ; mais en tant qu’êtres vivants et personnifiés, ils incarnent ces pouvoirs sous une forme concentrée attirée par un pôle unique. Faire appel aux pantheria est une sorte de magie visant à maîtriser les éléments qui, pour pouvoir être évoqués, doivent avoir des traits personnels.

Dans un sens étroit et dans ses racines les plus archaïques, le Dragon représente le pantherion associé à l’élément de l’Eau, c’est-à-dire qu’il est une entité portant les traits du serpent, du poisson, et de la tortue. Compris de cette façon, le Dragon était l’un des pantheria ou dieux/esprits de l’Eau, le Monde Souterrain, et l’élément du Yin symétriquement opposé à celui du Phénix Rouge, c’est-à-dire le pantherion ou dieu/esprit du Feu, du Ciel et du Yang. Cependant, cette stricte opposition, reflétée dans le mythe de la bataille entre l’esprit du Feu, Tchourong, et l’esprit de l’Eau, Gong-Gong, était résolue dans la dimension profonde de la tradition chinoise dans un esprit dionysiaque, puisque la circulation rythmique des éléments – Yin, Yang, et Tao – présuppose des transformations constantes. Ainsi, le serpent sacré obtint des ailes et gagna la possibilité de s’élever dans les Cieux, et l’oiseau sacré acquit des pattes bestiales et une queue de poisson ainsi que la capacité de plonger dans les rivières et les mers. Ainsi naquit la figure du Lun, le Dragon au sens large si fondamental en Chine, qui pouvait être noir (dans l’élément de l’Eau), vert (dans l’élément du Bois et au Printemps), rouge (dans l’élément du Feu), blanc (dans l’élément du Métal et en Automne) et finalement, jaune (dans l’élément de la Terre). Le Dragon Jaune est situé au Centre : il fait du Centre le Centre. De ce fait son image primitive devient la Licorne Jaune, qui porte toutes les caractéristiques du Dragon. Il s’ensuit que le Dragon Lun peut être interprété comme le pantherion chinois universel, le pan-animal combinant les caractéristiques du Yin-Yang, les cinq éléments, ainsi que la périphérie extrême et le Centre le plus sacré.
Le Dragon est un « dieu » dans le contexte chinois : il exprime le pur élément de la sacralité. La sacralité du Dragon Jaune Lun se trouve au cœur du culte de l’Empereur Sacré, le culte de la Chine comme territoire spécial et sacralisé, comme pôle du pouvoir de tous les cultes locaux des montagnes, des fleuves et des bois sacrés au cours desquels les Chinois accomplissaient des rites et des cérémonies de toutes sortes. C’est pourquoi l’Empereur était considéré comme l’incarnation du Dragon ou comme le Fils du Dragon, et c’est pourquoi les légendes disent fréquemment que les Empereurs étaient nés du Dragon, étaient ses traces, le voyaient dans leurs rêves, le contemplaient à distance, etc. La Chine était considérée comme la Terre du Dragon, et les Chinois eux-mêmes comme des incarnations du Dragon, le peuple du Dragon Jaune. Bien que le lien entre le Dragon et l’eau, la pluie, les inondations, et le lit des rivières était l’un de ses traits les plus stables, on prêtait aussi une grande attention à la fuite, aux danses, aux batailles et aux invasions du Dragon dans la vie humaine et politique. Certains des Empereurs sacrés de l’ancienne Chine engendraient des Dragons, d’autres mangeaient de la chair de dragon, et d’autres encore les domestiquaient. En tous cas, le Dragon Lun était le facteur fondamental dans la structure de l’ontologie des souffles.
Si nous nous tournons vers l’ontologie des rêves discutée plus haut, nous pouvons déterminer le statut du Dragon dans l’image chinoise de l’être. Ce statut est suprême dans tous les sens. Le Dragon Lun est suprêmement « réel » : c’est un être et une existence fiable, nécessaire, et prouvé précisément en vertu de son incarnation de la quintessence des rêves : parce qu’il est un rêve, et dans la mesure où il est le rêve le plus pur et le plus complet, entre tous il se tient le plus près du Tao, du code secret du rythme ontologique du Yin-Yang. Comprendre la Chine signifie connaître le Dragon et prendre connaissance en pratique des structures de sa présence onirique.
Il faut noter que dans ce contexte la Gestalt du Dragon est fondamentalement différente de ses interprétations dans les structures du Logos d’Apollon et du Logos de Cybèle. Pour la culture apollinienne, le Dragon est toujours l’ennemi, le titan, la force chtonienne de la Grande Mère contre laquelle le dieu ou le héros solaire mène un combat irréconciliable. Ici le Dragon est sujet à une exclusion radicale et dans cette capacité est doté de traits exclusivement chtoniens incarnant la féminité émancipée agressive et le Monde Souterrain se dressant contre le Ciel. Pour la civilisation de Cybèle, le Dragon est accepté comme une figure matriarcale, un époux de la Grande Mère, sa descendance et son partenaire. Dans ce dernier aspect, le Dragon est associé à la fonction générative de la Terre, de l’eau et des forces chtoniennes. D’où la légende de la princesse Nagi qui devient l’épouse du héros et du premier roi.

Dans l’horizon chinois, ce lien entre le Dragon et les couches chtoniennes de l’ontologie changent radicalement. Le Dragon chinois est tout aussi Yin que Yang, tout aussi chtonien que céleste ; il est Serpent tout autant qu’Oiseau, et ces deux aspects ne sont pas simplement réunis, mais précèdent plutôt toute division. Le Dragon est primordial pour le serpent, l’aigle, l’homme, et l’esprit. Le Dragon incarne la pensée, l’être vivant par excellence, à la fois phénoménal et idéal. En cela réside l’essence du fait que le Dragon Jaune est pleinement identifié à la Licorne Jaune ou à l’Empereur Jaune, c’est-à-dire la figure du Centre Absolu.
***
Notes
[1] C’est pourquoi, en parlant des cultures, religions et philosophies indo-européennes, nous avons fréquemment utilisé l’expression « structure Apollon-Dionysienne ».
[2] Quand il se produit une dérive du centre vers Cybèle, nous parlons du « double obscur de Dionysos », d’Adionysos et de la Gestalt du Titan.
[3] Ma Lin, Heidegger on East-West Dialogue: Anticipating the Event (London/New York: Routledge, 1996); May R., Heidegger’s Hidden Sources: East Asian Influences on His Work (London/New York: Routledge, 1996). Que Heidegger ait été influencé par les idées japonaises fut souligné par le philosophe et sinologue japonais Tomonubu Imamichi (1922-2012), qui argua que Heidegger emprunta la notion d’« être-dans-le-monde », In-der Welt-Sein, au Livre du Thé d’Okakura Kakudzō, où ce dernier interprétait les idées du sage taoïste Tchouang-Tseu. Voir Tomonubu Imamichi, In Search of Wisdom: One Philosopher’s Journey (Tokyo: International House of Japan, 2004).
[4] Voir Alexander Dugin, Noomakhia – The Three Logoi: Apollo, Dionysus, and Cybele (Moscow: Academic Project, 2014).
[5] Un autre exemple de l’Autre Commencement de la philosophie en-dehors du contexte de la tradition européenne occidentale pourrait être la pensée de Nagarjuna, qui se consacra au pivot (Kehre) radical de la tradition bouddhiste qui, originellement nihiliste, fut élevée dans le Mahayana au niveau d’une synthèse non-dualiste (Advaita). Voir Alexander Dugin, Noomakhia – Great India: Civilization of the Absolute (Moscow: Academic Project, 2017).
[6] Voir R. Guénon, La Grande Triade.
[7] En allemand : Die Ewige Wiederkunft des Gleichen.
[8] Voir Alexander Dugin, Sociology of the Imagination: An Introduction to Structural Sociology (Moscow: Academic Project, 2010).
19:09 Publié dans Nouvelle Droite, Philosophie, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre douguine, noologie, chine, tradition, tradition chinoise, traditionalisme, nouvelle droite, nouvelle droite russe, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Sur la "cancel culture"

Sur la "cancel culture"
Un regard sud-américain
Alberto Buela
Source: https://www.geopolitica.ru/es/article/la-cultura-de-la-cancelacion
Dans les années 1970, Jorge Luis Borges se plaignait déjà que les éditeurs américains ne voulaient pas publier ses romans et ses nouvelles parce qu'il n'appelait pas l'homme noir "homme de couleur" et l'aveugle "malvoyant".
À cette époque, les intellectuels yankees ont commencé à utiliser ce que l'on appelle aujourd'hui le "langage inclusif" : l'utilisation de la rhétorique inappropriée et la répétition de locutions généralisantes telles "tout le monde", "garçons et filles" ; "travailleurs", etc. En Yanquilandia, ce langage n'est plus utilisé mais, comme d'habitude, il est arrivé vingt ans plus tard en Amérique du Sud où les progressistes l'ont adopté comme une nouveauté.
Le progressisme, cette maladie sénile des vieilles idéologies comme le marxisme et le libéralisme, a trouvé dans ce pseudo-langage son expression la plus réussie : il parle sans rien dire et prétend définir sans rien définir. Sa méthode consiste à être toujours à l'avant-garde de tout. Il ne peut donc pas avoir de pro-projet (étymologiquement : quelque chose de "jeté en avant"/ pro-iacere) car il est son propre projet.
Lorsque les analystes politiques s'interrogent sur tel ou tel projet de gouvernement progressiste, ils posent une fausse question ou une question sans fondement. C'est comme prétendre interroger le pendu sur le nœud coulant ou la corde à laquelle il est suspendu.
Cette maladie sénile, mélange de libéralisme et de marxisme, soutenue par la religion séculière des droits de l'homme, occupe peu à peu tous les gouvernements de l'Occident, instaurant ainsi un mode de pensée unique et politiquement correct.
Les lieux communs de cette pensée sont presque toujours : le souci de l'humanité et non des besoins réels des gens ; le bien-être individuel et non celui des familles ; la consommation et non l'épargne ; la terre (entière) et non la glèbe des communautés rurales ; le rituel et non le sacré ; l'économie et non la politique ; l'esprit d'entreprise et non le travail, et ainsi de suite dans tous les domaines d'action et de pensée.
Dès 1927, Martin Heidegger dans L'Être et le temps (paragraphe 35) parlait de la dictature de "l'anonyme" (du "on") à travers le "on dit, pense et agit comme on dit, pense et agit", qui régit l'existence impropre/inauthentique. En presque cent ans, la question s'est accrue et approfondie.
Aujourd'hui, le pouvoir du progressisme en tant qu'hégémonie est inconditionnel. Cela explique pourquoi toute remise en question est considérée comme étant de droite, fasciste ou impérialiste. Si de multiples secteurs de la société disent "non" à des mesures erronées, la réponse est désormais "pas de réponse", soit le silence, l'ignorance, bref, l'annulation de l'objecteur.
L'annulation est devenue un mécanisme de déni de tout ce qui met le progressisme mal à l'aise ou le remet en question. Ce qui est grave, c'est qu'en même temps qu'il nie ou n'écoute pas les objections de ses opposants, il appelle au dialogue sur la base d'un consensus qui n'en est pas un, qui est un faux consensus.
Ce mécanisme pernicieux est à la base des actions de tout gouvernement libéral-progressiste. Massimo Cacciari a observé à juste titre que ces gouvernements ne résolvent pas les conflits mais se contentent de les gérer.
L'absence de définition idéologique ferme (le président argentin Fernández est à la fois péroniste et social-démocrate, comme il l'a déclaré) leur permet de prêter allégeance à Biden, Poutine et Xi Jinping en même temps.
Mais tout cela n'est rien d'autre qu'une panoplie de feintes, que des apparences utilisées par les gouvernements progressistes pour se joindre au processus de mondialisation qui semble se dérouler inéluctablement dans le monde.
Après deux ans de Covid, l'économie est devenue totalement indépendante de la politique. Les pouvoirs indirects, les lobbies, les méga-corporations et l'impérialisme international de l'argent, comme l'a si bien dit Pie XII, justifient leur travail dans et avec les gouvernements progressistes.
Bien entendu, les puissances économiques indirectes exigent que des gouvernements progressistes soient installés sur la base du mécanisme "un homme, une voix", car elles ont besoin de la légitimité offerte par le masque démocratique. La démocratie, se limitant à la seule légitimité d'origine (le vote), nie toute demande de légitimité d'exercice, qui est l'exigence de la bonne gouvernance, et ce sont les actions justes et correctes qui caractérisent la bonne gouvernance, c'est pourquoi il y a eu et il y aura de bons gouvernements sans qu'ils soient nécessairement démocratiques.
En Amérique du Sud, les dix gouvernements que nous avons sont progressistes dans leurs différentes variantes : en Argentine, un péroniste qui se définit comme un social-démocrate, au Chili, un marxiste qui se dit péroniste, en Bolivie, un marxiste qui se dit nationaliste, en Uruguay, un libéral qui se définit par l'Agenda 2030, au Paraguay, comme d'habitude, rien ; au Brésil, un nationaliste qui laisse les multinationales faire des affaires, au Pérou et en Équateur, des marxistes soumis au capitalisme le plus grossier, en Colombie, un partenaire libéral des États-Unis et au Venezuela, un marxiste qui a pour vocation de s'enrichir au détriment de son peuple.
Qui dirige l'Amérique du Sud ? En réalité, il s'agit de l'impérialisme monétaire international avec toutes ses ramifications, même si nominalement les dix gouvernements progressistes, dont le mépris de la légitimité de l'exercice du pouvoir facilite le travail de l'impérialisme.
À cet égard, la grande corruption de la classe dirigeante compte pour beaucoup. Pour donner un exemple indiscutable, mille kilos d'or et dix mille kilos d'argent quittent chaque année l'Argentine pour l'Europe et les États-Unis, pratiquement sans payer de taxes. Dans les ports du fleuve Paraná d'où part la substantielle production céréalière (blé, maïs, soja, tournesol), l'évasion fiscale annuelle s'élève à 10.000 millions de dollars, et la déprédation de la pêche dans l'Atlantique Sud par des centaines de navires chinois, espagnols, japonais, norvégiens et anglais demeure incontrôlée.
La culture de l'annulation a fait en sorte que ces questions et bien d'autres ne soient pas abordées. Le titre du film De eso no se habla de Marcello Mastroiani a été imposé.

Lorsque Perón revint d'exil en 1974, il déclara que l'homme argentin avait étébrisé et qu'il allait être très difficile de le récupérer. Depuis lors, aucune tentative n'a été faite pour récupérer systématiquement notre système de valeurs civiques telles que l'épargne, l'hygiène, la conduite, etc. ; il a été laissé, de plus en plus, à lui-même, sans être encadré. Ces institutions qui ont fait la grandeur de Buenos Aires (la piu grande cita italiana del mondo, selon les mots de Franco Cardini), comme les clubs de quartier, les bibliothèques et les piscines populaires, les écoles qui sortaient dans la rue, les paroisses avec leurs kermesses et leurs camps, tout cela a disparu. L'homme, qui animait tout cela et qui était tapi en chacun d'entre nous, a disparu. Ainsi, nous avons des enseignants qui ne lisent pas, des professeurs qui n'étudient pas, des prêtres qui ne se soucient pas de l'âme mais seulement de leur pitance, des bibliothécaires qui n'invitent pas les gens à lire, les clubs où la drogue et non le sport est la norme, la combinaison de tout cela a fini par promouvoir les médiocres. Et c'est cette médiocrité, aujourd'hui âgée de 40 à 60 ans, qui s'exerce dans les gouvernements progressistes d'Amérique du Sud.
Que faire d'un sous-continent comme l'Amérique du Sud, qui couvre près de 18 millions de kilomètres carrés, soit deux fois la taille de l'Europe ou deux fois celle des États-Unis. Il possède 50.000 km de voies navigables à l'intérieur qui nous mènent de Buenos Aires à Guaira au Venezuela. Ou de l'Atlantique à Belém do Pará au Brésil à Iquitos au Pérou (lorsque San Martín était gouverneur du Pérou en 1823, il a fait don de son salaire pour construire un navire destiné à contenir l'avancée bandeirante en naviguant sur l'Amazone d'un bout à l'autre). Ce continent possède des minéraux de toutes sortes, des forêts encore intactes. Du pétrole, du gaz, de l'énergie électrique, la plus grande réserve d'eau douce de la planète avec l'aquifère Guarani. Et surtout, il présente un type humain diversifié (environ 440 millions) mais qui a des usages, des manières et des coutumes similaires et qui parle la même langue, car l'homme hispanique, selon Gilberto Freyre, le plus grand sociologue brésilien, parle et comprend sans difficulté quatre langues : l'espagnol, le portugais, le galicien et le catalan. Cet avantage extraordinaire n'a jusqu'à présent jamais été promu comme politique d'État par aucun des dix pays qui le composent.
Toute personne qui nous étudie ne doit pas sous-estimer l'ordre de ces magnitudes. Hegel enseignait déjà que l'ordre des magnitudes, lorsqu'elles sont immenses, les transforme en qualités.
L'inconvénient de ce grand espace est que des puissances coloniales anti-hispaniques comme l'Angleterre (en Guyane, à Trinité-et-Tobago et aux Malouines), la Hollande à Aruba et au Surinam et la France en Guyane y sont toujours installées.
Tous les plans d'unité sous-continentale depuis l'époque de San Martin et Bolivar ont été avortés par la contre-intervention de ces trois pays.
Lors du Forum social de Porto Alegre en 2002, nous avons proposé la théorie du losange avec ses sommets à Buenos Aires, Lima, Caracas et Brasilia comme protection du cœur de l'Amérique du Sud, mais elle n'a pas abouti. Chávez s'est rendu à Cuba et Cuba, comme il le fait depuis 70 ans, stérilise tout projet nationaliste hispano-américain.
J'invite les chercheurs européens à étudier sine ira et studio le processus de cubanisation de Notre Amérique, source de toutes les tentatives ratées d'intégration régionale.
La question de Lénine se pose à nouveau : Que faire ? La dissidence, qui n'est rien d'autre que de soulever, de proposer "une autre version et vision" à ce qui est établi par la pensée unique. Pratiquer la dissidence sous toutes ses formes et de toutes les manières, c'est cesser d'être le chien muet de l'Évangile. La dissidence n'est pas une pensée négative qui dit non à tout. C'est une pensée propositionnelle et existentielle qui part de la préférence de nous-mêmes. Elle rejette l'imitation et s'appuie sur notre genius loci (climat, sol et paysage) et notre ethos (coutumes, expériences et traditions). Vous pouvez consulter mon livre Teoría del Disenso (publié à Buenos Aires, Barcelone, Porto Alegre et Santiago du Chili).

Enfin, vous pouvez noter que je n'ai jamais parlé d'Amérique latine car c'est un terme fallacieux, faux et trompeur, créé par les Français pour intervenir en Amérique. Vous, les Italiens, le savez très bien, car aucun d'entre vous ne se dit latin, sauf ceux du Latium. Le latin exclut les Basques qui ont tant fait pour l'Amérique depuis l'époque des conquistadors.
Le concept d'Amérique latine est clairement un concept politiquement correct car il est utilisé par tout le monde, l'Église, la franc-maçonnerie, les libéraux, les marxistes et, évidemment, les progressistes, même les nationalistes désemparés.
Ce qui est hispanique en Amérique n'est pas comme en Espagne, qui se limite à la monarchie et à la religion catholique. Ici, ce qui est hispanique nous ouvre à toute la culture méditerranéenne (Italie, France, Portugal, le monde arabe: Syrie, Liban, Maroc). Cela explique pourquoi l'immigration italienne et syro-libanaise, qui se chiffre en millions) en Amérique du Sud a été confortablement acceptée.
La première chose à perdre dans une lutte culturelle est la guerre sémantique, lorsqu'on adopte les dénominations de l'ennemi. Nous sommes hispano-créoles, ni vraiment européens ni vraiment indiens, comme le prétendait Bolívar.
Source: https://posmodernia.com/la-cultura-de-la-cancelacion/
18:16 Publié dans Actualité, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cancel culture, alberto buela, amérique ibérique, amérique du sud, dissidence, actualité, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 21 février 2022
Giorgio Locchi et la philosophie de l'origine (selon Giovanni Damiano)

Giorgio Locchi et la philosophie de l'origine (selon Giovanni Damiano)
Giovanni Sessa
Source: https://www.paginefilosofali.it/giorgio-locchi-e-la-filosofia-dellorigine-di-giovanni-damiano-giovanni-sessa/
Giorgio Locchi est un nom familier pour ceux qui ont appris à penser dans les années 1970. Le dernier ouvrage de Giovanni Damiano, consacré à l'exégèse de la contribution théorique de Locchi, a le mérite incontestable de raviver l'intérêt pour ce philosophe, dont la pensée vise à dépasser l'état actuel des choses. Nous nous référons à, Il pensiero dell'origine in Giorgio Locchi (La pensée de l'origine chez Giorgio Locchi), en librairie grâce à une belle initiative des éditions Altaforte Edizioni. Le texte est enrichi par un essai de Stefano Vaj, qui lit la contribution du philosophe en termes transhumanistes, et par la postface de Pierluigi Locchi, le fils du penseur (pp. 145, euro 15,00).

Le livre de Damiano analyse le sens de la démarche spéculative de Locchi, en mettant en évidence ses points essentiels. À cette fin, le chercheur de Salerne distingue son exégèse des clichés réducteurs qui ont lié, sic et simpliciter, le théoricien de l'histoire ouverte à l'expérience de la Nouvelle Droite: "Locchi [...] se place dans un excès, dans un no man's land, ni apologétiquement moderne, ni stérilement anti-moderne" (p. 8). Sa philosophie de l'origine se distingue des universalismes éthérisants et rassurants des traditionalistes, tout autant que "de la dynamique auto-fondatrice de la modernité" (p. 8).
Il était, par essence, un philosophe de la liberté. Sur la liberté, principe sans fondement, il a construit sa propre vision de la temporalité, comme on peut le voir dans les pages de, Wagner, Nietzsche et le mythe surhumaniste (Rome, 1982) et dans celles du livre Sur le sens de l'histoire (Padoue, 2016). Une telle conception vise à préserver "ce potentiel d'excédent et de surprise qui caractérise toute histoire" (p. 9), afin de soustraire le parcours humain aux déterminismes progressifs et/ou réactionnaires.
Locchi prône l'autodétermination historico-politique de l'humanité, en la fondant sur l'existence de possibilités alternatives existant dans le temps. Le philosophe romain croit également que le mode d'existence historique est propre à l'homme. À la différence des Lumières, qui ont pensé l'historicité de manière téléologique, en l'articulant, ipso facto, dans l'idée de progrès, et qui se sont faites les interprètes par excellence de ce processus d'immanentisation de la "fin" judéo-chrétienne de l'histoire (Löwith), Locchi évite toute eschatologie qui tendrait à identifier dans la "fin" de l'histoire, la "fin" de l'histoire: "D'où, au nom de la liberté, le refus [...] de la philosophie de l'histoire en tant que telle" (p. 19). L'histoire n'est pas écrite ab initio, elle est toujours exposée au possible, à l'imprévisible. Dans le monde post-moderne, au contraire "la dynamique du progrès finit par submerger même le présent, car si d'un côté elle rompt avec le passé, de l'autre elle transforme tout le temps en une sorte de sérialité homogène" (p. 22).
Le présent est, dans ce contexte, exclusivement déterminé par le futur : Heidegger, à cet égard, parlait d'une temporalité unidimensionnelle et inauthentique. Au contraire, Locchi, à travers le duo Wagner-Nietzsche, devient un témoin du temps authentique et tridimensionnel. L'histoire n'est pas un flux irréversible, mais des temps différents y sont détectables. Par conséquent : "le passé, le présent et le futur sont toujours présents en même temps" (p. 25). Le passé est dans le présent, dans le présent il est dé-composé et re-composé. Pour cette raison, et c'est le plexus de plus grande importance théorique mis en évidence par Damiano: "chaque moment peut et doit être considéré simultanément comme début, centre et fin" (p. 25).
À chaque instant, non seulement l'avenir mais aussi le passé lui-même sont décidés. L'origine "peut toujours recommencer (le nouveau départ), en partant d'un centre (d'un présent) à chaque fois différent, en vue d'une fin (un futur) qui n'est qu'un futur possible parmi d'autres" (p. 27). Cette thèse n'est pas différente, comme le souligne l'auteur, de la XIVe Thèse sur l'histoire de Benjamin, dans laquelle il est dit que l'origine est un "but", dans le cadre d'une vision de l'historicité non plus centrée sur le continuum du temps homogène, mais sur le discontinuum : "le sens de l'histoire doit être compris comme quelque chose qui doit être conquis, chaque fois à partir de zéro" (p. 29).

L'idée même de la Tradition comme trahison est remise en question. La véritable tradition surgira de la catastrophe du continuum, devenant la quintessence du nouveau départ. Cette tradition sera voulue, choisie, et non subie. Cela ne doit pas être trompeur. L'auteur souligne que Locchi va au-delà d'une vision simplement "humaniste" de l'histoire : "L'homme n'est qu'un administrateur de la liberté [...] la liberté maintenant [...] signifie : l'homme comme possibilité de liberté" (p. 31).
La conception tridimensionnelle de la temporalité réapparaît dans la musique tonale de Wagner comme un héritage ancestral et préchrétien des peuples d'Europe du Nord. Le centre de l'univers de valeurs de Locchi se trouve chez Nietzsche qui, avec le grand musicien allemand, a défini la vision du monde surhumaniste en conflit avec la vision égalitaire. Un Nietzsche, notons-le, lu par le penseur romain à travers des lentilles bӓumlériennes, sous le signe de la "liberté du devenir". Le monde et l'histoire sont secoués par l'action inépuisable de la liberté. Une liberté, plus naturelle, productive de conflits, exposée à l'issue tragique. L'éternel retour ne se réduit pas à une pure "mécanique", mais devient l'image d'une histoire ouverte, dans laquelle chaque "moment" est potentiellement le début et chaque lieu le "centre". Ce n'est pas un hasard si Klages, comme le rapporte Damiano, a placé l'image comme le cœur vital de sa propre proposition spéculative, capable de délier les constructions fictives et photogrammatiques de la logique éléatique.

La référence au mythe est également consubstantielle à la pensée de Locchi. Selon lui, "il n'y aurait pas de communauté sans mythe" (p. 68). Néanmoins, il évite la relation modèle-copie attribuée au mythe par Eliade. Car: "l'actualisation du mythe, avec la régénération du temps qui lui est associée, n'est pas du tout un nouveau départ, mais la répétition exacte du modèle" (p. 71). Le nouveau départ exige le courage du défi, l'ouverture d'un nouveau monde. En ce sens, même l'adhésion au mythe indo-européen est conditionnelle dans la mesure où: "Un 'Oui' au devenir, devient lui-même" (p. 76). Le mythe, comme l'origine, est placé par Locchi dans l'histoire. Sa philosophie se penche sur une origine qui n'est jamais définitivement possédée, exposée à une possible catastrophe. Dans les pages du philosophe, la référence au dieu Janus et à sa duplicité revient donc. Ce dernier représente la destination de sens de la philosophie de Locchi, car il est un dieu "qui se tourne non seulement vers le passé, mais aussi vers l'avenir [...] comme le seigneur des nouveaux commencements, confirmant sa fonction non statique [...] mais destinée à agir dans le devenir historique" (p. 94).
Nous devrions nous tourner vers elle, pour éviter les dérives dans lesquelles la pensée non-conformiste s'est échouée par le passé : le libéral-conservatisme, le national-bolchevisme ou les échappatoires vers un "ésotérisme" bon marché.
Giovanni Sessa
14:37 Publié dans Livre, Livre, Nouvelle Droite, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : giorgio locchi, philosophie, livre, temporalité, philosophie du temps, temporaité, nouvelle droite |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 14 février 2022
Pierre Boutang et la vox cordis

Luc-Olivier d'Algange:
Pierre Boutang et la vox cordis
Note sur l'art de la traduction
« Ainsi chaque réel poème a pour invisible
réserve, ce que le Moyen-Age nommait
vox cordis, une voix du cœur. »
Pierre BOUTANG
Il est de coutume de juger l'œuvre de Pierre Boutang, pour l'en louer ou l'en blâmer, peu importe, à l'aune de sa fidélité à Charles Maurras. Pierre Boutang ne cessa jamais, à l'inverse de tant d'autres, de mentalité honteuse ou renégate, de témoigner d'une fidélité essentielle à l'égard de l'auteur (enseveli sous l'opprobre, le mépris et l'indifférence) de L'Avenir de l'Intelligence. Etre fidèle à Charles Maurras, ce ne fut certes point, pour Pierre Boutang, s'obstiner, à l'exemple de quelques acariâtres, sur les vues partielles défendues par le Maître de Martigues dans tel ou tel éditorial malencontreux, mais bien accomplir cet acte de remémoration et de gratitude par lequel le disciple établit l'autorité du Maître dans son essence, sans pour autant éprouver la tentation « psittaciste », sans âme, qui accable l'oeuvre sous le poids de la lettre morte. Villiers de l'Isle-Adam dans un conte intitulé Les Plagiaires de la foudre traite la question sous forme de parabole.
Rien n'est moins aimable que le reniement. Déprécier le passé du monde, de son pays, ou ne fût-ce que de sa propre existence est, selon Nietzsche, le signe propre du nihilisme. Celui qui renie son passé ne fonde point le nouveau mais l'abolit. L'idée même d'un « couronnement des formes », d'un accomplissement du destin, d'une réalisation, au sens métaphysique, voire initiatique du terme, suppose que l'âme humaine, l’amoureuse amie de Mnémosyme, eût construit, pierre à pierre, et avec déférence, un édifice du Souvenir. Etre fidèle, ce n'est point idolâtrer le passé, c'est veiller sur la flamme, dispensatrice à la fois de chaleur et de lumière, afin qu'elle ne s'éteigne. Témoigner d'une fidélité essentielle, n’est-ce point comprendre alors la différence entre le Maître qui nous fait disciple et le Maître qui nous fait esclave ? Etre fidèle, n’est-ce point atteindre à cette liberté essentielle, caractère dominant de l'auteur Pierre Boutang : liberté qui est le « privilège immémorial de la franchise », signe de l'attachement de l'auteur à son Pays qui lui permet d'être lui-même, sans pour autant être « maurrassien » à la façon des épigones et des obtus? Ces nuances échapperont aux esprits mécaniques. Pierre Boutang sut rendre possible une telle méditation sur le Logos et la nécessaire convenance du monde au langage qui l'élucide et l'enchante et, par voie de conséquence, témoigner de la tradition, et de l'art du traducteur, qui présument l'autorité du sens.

Dès lors que l'on ne cède point à la superstition ou à l'idolâtrie du texte réduit à sa propre immanence, comme il était d'obligation naguère dans les sectes de la critique « matérialiste », il devient légitime de s'interroger sur les fonctions, non plus de l' « écriture » mais de l'auteur. Les fonctions de l'auteur sont de l'ordre de son magistère. Dans la perspective métaphysique ou plus exactement théologique, qui ne cessa jamais d'être celle de Pierre Boutang, même au cœur le plus ardent de son combat politique, l'œuvre est un moyen de connaissance et de justice. Si la fonction dévolue à quelques écrivains est de distraire, à d'autres, moins enviables, de relever la bonne conscience défaillante de leurs lecteurs, à d'autres encore plus simplement de « passer le temps », comme si temps n'accomplissait pas cette fonction de son propre chef, les fonctions de l'œuvre de Pierre Boutang sont infiniment plus complexes et d'une portée si grande que nous parions volontiers qu'elles ne commencent qu'à peine à être évaluées.
Pierre Boutang, « logocrate », monarchiste, philosophe et traducteur, fit donc de chacune de ses « vertus » au sens antique, une « fonction », au sens sacerdotal. Etre monarchiste loin d'être seulement l'expression d'une conviction, ce fut, pour lui, une poétique et une rhétorique, au sens noble, médiéval et théologique, c'est à dire la façon, également grammaticale et étymologique tout autant qu'architecturale et musicale, de comprendre l'ordre humain et l'ordre du monde en concordance avec l'ordre divin. Alors que le « monarchisme » de beaucoup d'autres n'est qu'une façon retorse d'avouer leurs nostalgies d'un monde réduit précisément aux valeurs de la « troisième fonction », au sens dumézilien, « travail, famille, patrie », c'est-à-dire aux « valeurs » bourgeoises dans toute leur horreur, à quoi s'ajoute le goût obscur pour la défaite, la contrition, et une forme vaniteuse d'irresponsabilité, pour Pierre Boutang être fidèle au Roi, ce fut d'abord se souvenir que la France, par provenance, et osons le croire par destination, est un Royaume, et que la « République » ( dont il est permis à présent de préférer l'aristocratisme jacobin, d'allure encore vaguement stendhalienne, à l'actuel totalitarisme démocratique) est elle- même faite avec ce Royaume dont elle décapita les symboles.
Etre monarchiste, pour Pierre Boutang, ce fut comprendre, par delà les considérations « positivistes » (inspirées d'Auguste Comte, d'Anatole France ou de Renan) de Maurras, que l'ordre politique et terrestre n'est digne d'être respecté que s'il reçoit humblement l'empreinte de l'Ordre du Ciel. La fonction d'Auteur monarchique que Pierre Boutang fut, avec Henry Montaigu, un des très rares à hausser à l'exigible dignité chevaleresque, annonce ainsi sa fonction de philosophe, c'est-à-dire d'amoureux de la sagesse. Car si l'Ordre est vénérable, en ce qu'il témoigne du permanent, et s'il est préférable a priori à la subversion, désastreuse par nature, il n'en demeure pas moins que l’auteur des Abeilles de Delphes, dans la fameuse querelle sur le « coup de force » qui eût libéré Socrate de ses geôliers, eût été enclin à passer outre aux recommandations légalistes de Socrate pour le sauver. L'Ordre est sacré, certes, mais encore faut-il qu'il ne contredise point le cri du coeur qui, en certaines circonstances, nous en révèle la nature parodique. Dans la honte et l'horreur où nous plonge le désastre du monde moderne, le grand péril est de céder à n'importe quelle « réaction », de nous contenter d'un « ersatz ». Mieux vaut approfondir en soi l'absence du Royaume, de l'Ordre, du Sacré que d'en faire un simulacre. Les temps modernes sont aux faux-semblants. Des fausses légions romaines de Hitler aux châteaux en carton-pâte des parcs d'attraction d'Outre-Atlantique venus s'installer chez nous, la ligne constante du monde moderne est de substituer le faux spectaculaire à « la simple dignité des êtres et des choses ».
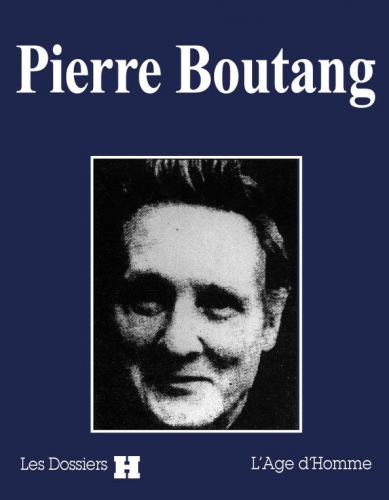
Amoureux de la sagesse, le philosophe est aussi amoureux du langage qui porte en lui, comme un secret et comme une évidence, les normes de la sagesse. Le pouvoir du Logos accroît notre liberté et notre autorité. L'oeuvre de Pierre Boutang se laisse lire comme une méditation sur le Logos incarné. Etre auteur, c'est remplir ces « fonctions » de l'auctoritas non sans un certain détachement, accomplir son destin, faire son oeuvre, être à la hauteur de cette « disposition providentielle » dont la surnature nous privilégie et dont tout combat humain n'est que la remémoration ou le remerciement.
Les talents ne sont pas donnés en vain et comme les hommes plus généreux sont aussi les plus prompts à révéler leurs talents, il est compréhensible que l'écart se creuse entre les hommes et entre leurs oeuvres. Mais cette inégalité est avant tout, pour reprendre le mot de Maurras, une « inégalité protectrice ». La méditation sur la Monarchie, sur le pouvoir du Logos et sur la rhétorique de Dieu que Pierre Boutang poursuit à travers son oeuvre ne sera point sans redonner, au grand scandale des bien-pensants, un sens profond, et dirions-nous profondément chrétien, - au mot hiérarchie. Parmi les rares écrits anglais trouvant grâce aux yeux de Maurras figurait le Colloque entre Monos et Una d'Edgar Poe qui comporte, il est vrai l'une des critiques métaphysiques les mieux formulées de l'idéologie démocratique: « Entre autres idées bizarres, celle de l'égalité universelle avait gagné du terrain, et à la face de l'Analogie et de Dieu, en dépit de la voix haute et salutaire des lois de gradation qui pénètrent si vivement toutes choses sur la Terre et dans le Ciel, des efforts insensés furent faits pour établir une Démocratie universelle. » Nous comprenons, alors que ce qui distingue les hommes en accord avec les profondeurs du temps et les « derniers des hommes » au sens nietzschéen, « ceux qui clignent des yeux », n’est autre que le sens des gradations.
Ce sens des gradations qui est d'abord résistance à la planification sera aussi une clef pour comprendre la pensée platonicienne de la Forme et du Logos dont Pierre Boutang ravive les prestiges et approfondit les possibilités. Il existe une façon matutinale d'être platonicien, de faire de la pensée un chant de gratitude dans le « matin profond », et cette « façon », cette poétique, en référence à l'étymologie du faire poétique, nous délivre de ce « dualisme morose » où certains voulurent enfermer l'oeuvre de Platon et de ces disciples. De même que Pierre Boutang eût été tenté de sortir Socrate de sa geôle, il saura prendre les mesures nécessaires pour sortir Platon de sa prison exégétique où, non sans les commodités propres aux prisons « modernes », Platon se trouve réduit à une triste « perpétuité ». L'oeuvre de Pierre Boutang réfute ainsi un nombre considérable de banalités fallacieuses. A commencer par la plus insistante de toutes qui consiste pour le premier venu à prétendre au « renversement du platonisme ». La belle affaire que de « renverser » : de quoi satisfaire à la fois au goût moderne de la subversion et à l'indéracinable vanité humaine. Pierre Boutang, en renouant avec une subtilité herméneutique perdue, fut sans doute, avec Henry Corbin et George Steiner, celui des philosophes qui nous offrit l'ultime chance de comprendre, avant la liquidation générale de tout, que ce platonisme « renversé » par une prétention qui se voudrait nietzschéenne (alors qu’elle n'est que bonhomesque) est une caricature.
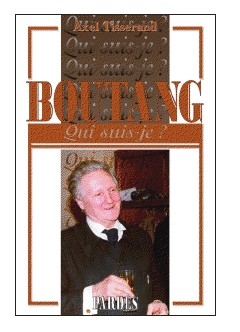
Poursuivant avec audace et humilité la méditation européenne sur la Forme et le Logos sans faire système ni doxa de ce qui ne s'y prête point, Pierre Boutang exige de son lecteur cette témérité et cette déférence qui, selon la formule d'Hölderlin, fondent « ce qui demeure ». Les philosophes modernes, loin d'avoir renversé le platonisme se sont contentés d'en fermer l'accès, d'en rendre l'approche impraticable par des approximations et des sophismes. Ainsi en est-il de la confusion assez systématiquement entretenue entre l'opposition et la distinction. Platon distingue le monde des Idées et le monde sensible, il ne les oppose point ni ne les sépare. Platon distingue car distinguer est le propre de la connaissance et l'art du poète comme du métaphysicien. De même que le musicien distinguera le timbre, le rythme et la mélodie, sans davantage concevoir qu'on dût les séparer, Platon distingue les idées et les réalités sensibles comme Julius Evola, l'un de ses lointains disciples, distinguera la forme de la matière. Platon lui-même parle des « gradations infinies » qui unissent les mondes que l'exigence de la connaissance distingue. Il y a dans l'insistance des Modernes à « renverser le platonisme » une volonté déterminée de ne pas comprendre la Forme, le Logos et l'Un qui fondent la métaphysique et l'ontologie européennes. Le grand mérite de Pierre Boutang sera de renouer la « catena aurea », qui nous unit à Platon, Parménide, Aristote et à la Théologie médiévale après laquelle une grande part de l'ingéniosité humaine consistera à déraisonner de façon de plus en plus utilitaire.
L'Idea, la Forme, au sens platonicien, ne se réfute qu'au profit d'un nouvel obscurantisme, peut-être le pire de tous, qui délie, scinde, déconstruit ; d'une relativisation générale qui, récusant la notion d'interdépendance universelle n'est plus qu'une méthode pour nier tout sens et toute orientation. Si nous ne pouvons nier la Forme, et que toutes les choses ont une forme qui correspond à un modèle, il demeure possible de contester ce que l'on suppose être l'intention de la métaphysique, qui est d'affirmer la précellence de l'Un et de l'Eternel sur le multiple et le fugace. Or le monde moderne a ceci d'étonnant qu'il choisit ses chantres parmi les hommes qui éprouvent le plus vive aversion pour la communion des esprits. Nier l'éternité, le Logos, l'Un, c'est rendre impossible la communion des esprits, c'est rejeter dans une multiplicité aléatoire un message réduit à sa propre immanence et vouée à ne « signifier » fugacement que dans un temps ou dans un lieu donné. Sous couvert de dénoncer toute hiérarchie, y compris celle qui, par gradations infinies embrasse toute chose dans un même amour (ou dans une même logique) et de refuser toute autorité (y compris celle qui est contre le pouvoir, dont la nature est d'abuser, le seul recours de la liberté), le Moderne invente un monde où la communion cède définitivement à la fascination, où les signes et les symboles réduits à eux-mêmes deviennent idoles et où la solitude, - n'étant plus glorifiée par l'unificence de Dieu - n'est plus que l'esseulement de l'insolite, de l'unité interchangeable, propre à cet individualisme de masse qui parachève les ambitions les plus folles du totalitarisme.

Ce n'est pas le caractère le moins diabolique de ce siècle étrange que d'avoir généralisé la « communication » tout en ôtant aux hommes la possibilité de la communion. Exception lumineuse, la rencontre de Pierre Boutang et de George Steiner, fut bien davantage qu'un heureux hasard médiatique. Pour peu que l'on cultive quelque peu, à l'exemple du bon maître d'Engadine, le goût de la généalogie des idées, l'importance de la théorie de la traduction, aussi bien dans l’œuvre de Boutang que de Steiner, ne manquera pas d'apparaître dans sa perspective métaphysique. La riposte à Derrida et à quelques autres, qui persistent à refuser le sens comme une déplorable « survivance platonicienne », vient ainsi étayer dans notre pensée l'Art poétique de Pierre Boutang, comme de juste dédié à Steiner, et qui est d'abord un traité de la traduction.
Que la traduction soit possible, nous dit Steiner, prouve l'existence du sens. Non point d'un « sens » comme épiphénomène, prolongement du « fonctionnement du texte » mais comme origine, voire comme Mystère, dont il reviendra à l'Art poétique de manifester la présence réelle. L'insistance du Moderne à nier la possibilité ou la légitimité de la traduction, toute traduction s'avérant pour lui inadéquate ou délictueuse, n'est rien moins qu'innocente ; à suivre le raisonnement de Steiner et celui de Boutang, si nous pouvons traduire, toute la doxa moderne et matérialiste se trouve récusée. Si le sens existe, s'il se manifeste en « présence réelle », ainsi que l'établit la simple possibilité de la traduction, l'intelligence même du mouvement renoue avec l'herméneutique, et, par voie de conséquence, avec la tradition.
Ce qui peut être traduit, cette possibilité universelle du sens, tel est le fondement de l'herméneutique et de la tradition. Interpréter, traduire, transmettre, telles sont, pour l'homme traditionnel, les fonctions essentielles de l'entendement humain, et l'aventure par excellence, dont la navigation d'Ulysse est la métaphore immense. Ce qui peut être traduit navigue sur le vaisseau du langage dont les cordes, les voiles et le bois sont la grammaire. L'herméneute est celui qui fait sienne cette beauté maritime, qui veille sur les variations météorologiques révélées par les souffles et les couleurs. Celui qui aborde un poème avec un cœur moins aventureux demeurera en deçà de l'honneur que la Providence lui fait d'une telle rencontre. Comme dans toutes les circonstances majeures de l'existence, tout se joue dans la déférence. S'orienter dans les ténèbres des signes réduits à eux-mêmes, jusqu'au matin, tel sera le courage du traducteur.

Avant de traduire d'une langue à une autre, dans ce monde « d'après Babel » où nous sommes précipités de naissance, le traducteur traduit du silence qui est en amont de l'oeuvre. Toute traduction est ainsi non seulement herméneutique, elle est aussi gnostique, à la condition de comprendre que le mot gnose ne renvoie pas ici aux théogonies des sectes d'Alexandrie qui voyaient en la création l'oeuvre du démon, mais à la connaissance, la gnosis que Platon distingue de l'opinion, de la doxa. Ce que le Moderne nie en niant la possibilité de la traduction, n'est rien d'autre que la tradition avec ses ramifications et ses arborescences. Enfermer chaque langue dans la prison de ses mécanismes, et chaque auteur dans le cachot de sa subjectivité intransmissible, soumettre les idées, les métaphysiques, les symboles et les mythes à des circonstances sociologiques, en un mot, expliquer le supérieur par l'inférieur, au point de ôter à l'esprit toute réalité, telle est l'ambition du Moderne qui ne peut établir son règne totalitaire qu'à ce prix. C'est à ce titre que l'on cherche, depuis plusieurs décennies, à nous faire croire que Platon, Dante, Shakespeare nous sont devenus incompréhensibles afin qu'ils le deviennent et que nous soit ôté ce lien aux gloires et aux autorités d'antan où nous puisons la force de résister aux offenses et aux pouvoirs d'aujourd'hui.
Ne voir que le mécanisme des êtres, des oeuvres et des choses, c'est hâter le moment où tous les êtres, toutes les oeuvres et toutes les choses seront entièrement livrés à un mécanisme. A l'analyse et à l'explication où le Moderne accomplit sa vocation titanique, Pierre Boutang oppose l'interprétation et la compréhension des gradations. A travers ses traductions de l'Ecclésiaste, de Sophocle, de Shelley ou de Rilke, Pierre Boutang fait l'expérience, non de mécanismes mais « d'une poésie secrètement unique dont il est naturel ou surnaturel qu'elle passe toute entière, non sans métamorphose, dans d'autres langues humaines parce qu'elle est la langue des dieux. Et puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu, il faut que ce soit parce qu'elle est poésie et non prose. »
Le rapport essentiel qui rend possible ce périple odysséen ne sera donc pas celui qui s'établit, ou manque à s'établir, entre le poète traduit et le poète traducteur, ou entre la langue d'origine et la langue destinée mais, plus profondément, entre le poème et l'Auteur « L'être du poème à traduire, écrit Pierre Boutang, n'est de personne, il est comme le poème, présent dans sa langue - au point décisif de l'expérience. » Cette affirmation suffit à elle seule à marquer le différend qui oppose Pierre Boutang à la presque totalité des critiques qui furent ses contemporains. Loin de lancer devant soi l'être du poème ou quelque audacieuse et peut-être salvatrice hypothèse ontologique, la critique moderne fit de son mieux pour dénier à la poésie tout être, voire toute existence, à la rendre dépendante, non seulement de l'humain mais d'un humain défini selon des critères strictement déterministes.
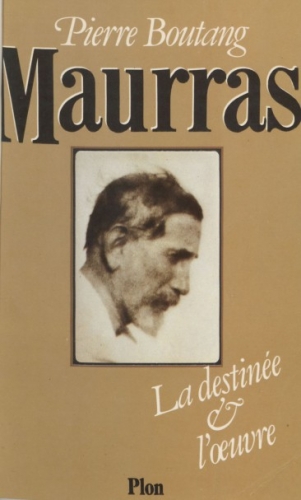
Qu'il y eût un être du poème et donc, de la part du poète, comme du traducteur, la possibilité d'une gnose et d'une ontologie poétique, c'est bien là une hypothèse qui, non seulement ne fut pas envisagée mais dont il parut nécessaire, pour d'évidentes raisons d'orthopraxie matérialiste, d'exclure toute approche possible. Telle fut la sereine fulgurance de Pierre Boutang, en concordance avec sa fidélité, de nous faire comprendre que le poète est à la poésie ce que l'homme est à Dieu, le plus simplement du monde « un éclair dans un éclair » selon la formule étonnante d'Angélus Silésius. « Le traducteur auprès de cet être, écrit Pierre Boutang, ne diffère pas foncièrement du poète, lui-même effacé par son ouvrage. » Le tout est d'entendre ce qui est dit. A peine sommes-nous présents à notre esprit que nous devenons l'infini à nous-mêmes. Les vertus réfléchissantes de notre spéculation que la vérité métaphysique embrase, comme un soleil la surface des eaux, s'incarnent dans le chant. Dans les éclats illustres de cette transcendance immanente, nous abandonnons l'illusion dérisoire d'un poème issu de l'humain pour rejoindre l'élan de l'hypothèse audacieuse, odysséenne, d'une poésie reçue des dieux ou de Dieu.
Certes, l'être simple du poème, en tant que pure transcendance, est au-delà de la subjectivité et de l'objectivité, de même qu'il ignore l'opposition coutumière entre l'intérieur et l'extérieur. Toutefois, la façon la moins malencontreuse d'aborder le poème est encore de commencer par lui reconnaître cette grande vertu d'objectivité, où le Moi s'efface, et qui est le propre des natures héroïques et sacerdotales. L'oeuvre de Pierre Boutang et de Henry Montaigu se rejoignent là encore pour reconnaître dans cette vertu une prédestination surnaturelle de la langue française dont Boutang souligne « l'universalité et la vocation à traduire les proses de Babel et à les attirer sur un terrain commun ». Une fois dépassées les contingences, par l'immensité des désastres qui survinrent, l’ « action française » ne saurait plus être qu'une action du Logos français, une action oblative, c'est-à-dire une prière du coeur d'où naissent surnaturellement les prosodies de Scève, de Nerval ou d'Apollinaire. Pierre Boutang en témoigne: « La langue française ne devrait d'abord établir ses titres et son privilège que dans la traduction du poème et de tout ce qui demeure d'héroïque et de divin dans l'existence des hommes de toute origine ». L'universalité métaphysique non seulement ne dénie pas cette « disposition providentielle », elle en accomplit la vocation profonde.
11:26 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : luc olivier d'algange, pierre boutang, philosophie, philosophie politique, traduction |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 09 février 2022
La nation, socle d'éternité à travers les générations (J. G. Fichte)
17:19 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ego non, philosophie, johann gottlob fichte, fichte, allemagne, 19ème siècle, philosophie politique, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 08 février 2022
Otto Braun, écrivain soldatique: "Je vais m'accrocher, quoi qu'il arrive"

Otto Braun, écrivain soldatique: "Je vais m'accrocher, quoi qu'il arrive"
Giovanni Sessa
Source: https://www.paginefilosofali.it/io-terro-duro-qualunque-cosa-accada-otto-braun-giovanni-sessa/
 Nous avons souvent noté que le destin des livres est insondable. Des volumes précieux, porteurs d'une nouvelle vision du monde, se sont révélés tels quelques décennies seulement après leur publication. D'autres, au contraire, moins significatives, mais imprégnées du bon sens de la conjoncture historique dans laquelle elles étaient appelées à voir le jour, ont obtenu un écho immédiat. Le livre que le lecteur s'apprête à lire, Io terrò duro, qualunque cosa accada. Il s'agit du Journal et de lettres d'un jeune volontaire de guerre, Otto Braun, et de son témoignage paradigmatique. La première édition italienne, publiée en 1923, a été éditée par le philosophe politique Enrico Ruta sous le titre Journal et lettres, et a attiré l'attention d'un petit groupe d'intellectuels dont, comme on le verra, les philosophes Benedetto Croce et Julius Evola. L'un des premiers à avoir saisi le caractère exceptionnel de ce recueil a été l'idéaliste magique, qui a identifié le jeune auteur comme un porte-flambeau ante litteram de ses propres positions spéculatives.
Nous avons souvent noté que le destin des livres est insondable. Des volumes précieux, porteurs d'une nouvelle vision du monde, se sont révélés tels quelques décennies seulement après leur publication. D'autres, au contraire, moins significatives, mais imprégnées du bon sens de la conjoncture historique dans laquelle elles étaient appelées à voir le jour, ont obtenu un écho immédiat. Le livre que le lecteur s'apprête à lire, Io terrò duro, qualunque cosa accada. Il s'agit du Journal et de lettres d'un jeune volontaire de guerre, Otto Braun, et de son témoignage paradigmatique. La première édition italienne, publiée en 1923, a été éditée par le philosophe politique Enrico Ruta sous le titre Journal et lettres, et a attiré l'attention d'un petit groupe d'intellectuels dont, comme on le verra, les philosophes Benedetto Croce et Julius Evola. L'un des premiers à avoir saisi le caractère exceptionnel de ce recueil a été l'idéaliste magique, qui a identifié le jeune auteur comme un porte-flambeau ante litteram de ses propres positions spéculatives.
[...] La publication de ce texte est également liée à un souvenir de l'écrivain. Il fait également référence au "destin" du livre que nous présentons. En 2008, j'ai contacté le philosophe Franco Volpi par téléphone, bien que je ne le connaisse pas personnellement. Quelques années auparavant, il avait écrit la préface des Essais sur l'idéalisme magique d'Evola : je lui ai demandé s'il accepterait de répondre à mes questions concernant son parcours intellectuel, l'état d'avancement de la traduction des œuvres de Heidegger dans laquelle il était engagé, la Révolution conservatrice et Evola. L'interview devait être publiée par un petit éditeur romain. Il a été très gentil, mais a décliné l'invitation. Au cours de la conversation, qui a duré plus d'une heure, nous avons longuement discuté de l'idéalisme magique. À la fin, il m'a dit, en tenant compte de mes intérêts : "Je vous conseille vivement de vous intéresser à Otto Braun. C'est un auteur vraiment extraordinaire, dont on sait peu de choses. J'ai demandé à mes étudiants de faire des recherches sur lui en Allemagne, mais la partie la plus importante de son œuvre est essentiellement son journal et ses lettres. Veuillez faire de votre mieux, si possible, pour réaliser une nouvelle édition afin que nous puissions enfin en discuter à nouveau. J'ai accepté son invitation. Je dédie ces brèves notes à la mémoire de Volpi, un intellectuel courageux et profond qui est toujours allé au-delà des barrières de l'"académiquement correct".

Otto Braun est né à Berlin le 27 juin 1897. Il était le fils du Dr Heinrich Braun et de Lily von Kretschmann, auteur de Memorien einer Sozialistin (1910-1911) inspiré du Memorien einer Idealistin de Malwida von Meysenburg, connu dans les milieux socialistes allemands pour avoir pris une part active à la controverse théorique et politique entre l'orthodoxie de Bebel et le révisionnisme de Bernstein. Dans cette diatribe, le jeune Otto et samère se sont rangés du côté de ces derniers. Le jeune homme est influencé intellectuellement par ses parents bien-aimés, mais il est aussi sensible à l'amour de son pays, qu'il vit avec enthousiasme, sans jamais atteindre le piètre niveau du nationalisme chauvin. Lorsque la guerre éclate, il tente de s'engager comme volontaire, mais sans succès. Il demanda de l'aide à un général connu et ami de la famille et put ainsi reprendre le mousquet. Il fut blessé à plusieurs reprises et tomba héroïquement au front en 1918, alors qu'il avait une vingtaine d'années.
Pour comprendre la valeur théorique et existentielle de l'expérience de cet enfant prodige, il faut tenir compte du fait suivant : son époque a vu la condensation de tensions inexplicables, qui ont agi avec force tant au niveau individuel que collectif en Europe, plus précisément en Europe centrale, qui, après la Grande Guerre, a vu la dissolution de deux structures impériales, l'empire des Habsbourg et le Second Reich.

D'un point de vue général, il est donc nécessaire de placer les pages de Io terrò duro, qualunque cosa accada (Je tiendrai bon, quoi qu'il arrive) à côté des expériences de vie et de pensée contemporaines d'Otto Weininger et de Carlo Michelstaedter, profondément marquées par la réémergence du tragique. Les trois auteurs appartiennent à ce vaste mouvement intellectuel qui a transcrit dans ses productions à la fois les signes tangibles de la fin d'un monde, le monde bourgeois-chrétien selon l'expression de Hegel, et la possibilité de la réalisation d'un Nouveau Départ de l'histoire européenne.
Nous faisons référence, ici, à ce corps de pensée que Massimo Cacciari a défini comme la "métaphysique de la jeunesse" et qui englobe la génération née "autour" du 20 novembre 1889, jour où Gustav Mahler a dirigé sa première symphonie à la Philharmonie de Budapest : "C'est le temps de la mémoire. Tous ceux qui sont nés "autour" de la première symphonie de Mahler y participent : leur "jeunesse" n'est qu'un élément de composition, un mouvement dans le contexte de la symphonie, fuyant vers leur propre Trauermarsch (marche funèbre)".
Une expérience spéculative marquée par le négatif et le refus de toute référence transcendante qui, traversant Stirner et Nietzsche, partageait aussi le platonisme inversé de Lukács: "L'absolu, ce qui n'admet pas de médiation, l'univoque, n'est que le concret, le phénomène individuel ". Nos auteurs ont été amenés à vivre socratiquement, en privilégiant la dimension éthique, la décision et le choix qui, chez eux, à la différence de Kierkegaard, ne visait plus le religieux au sens propre, mais le Werk, l'œuvre qui, de ce point de vue, aurait dû réaliser la réunification de la vie et de la pensée, du fini et de l'infini.
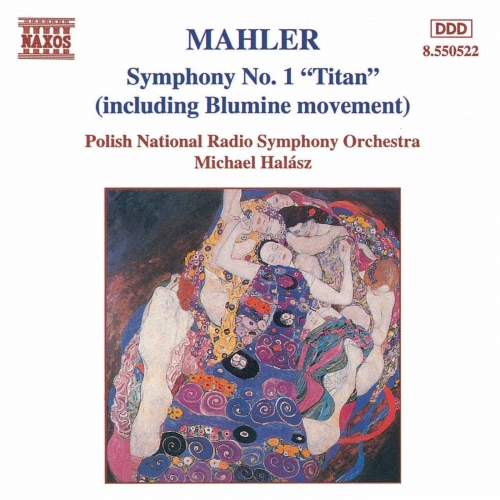
Weininger, Michelstaedter et Braun présupposent le fondement spéculatif non avoué de la philosophie weiningerienne du als-ob, du comme si. Selon Cacciari, l'"héroïsme" théorico-pratique auquel ils se consacrent "consiste [...] à nous préserver de toute illusion et, dans cet état d'âme, à viser à donner forme à notre in-dividuel, comme si nous vivions dans une Culture, comme si cet in-dividuel était réellement un symbole". [...]
Les pages de ce livre marquent les étapes de l'éducation d'Otto, visant à conquérir la dimension proprement humaine que les Grecs bien-aimés avaient attribuée au seul aner, et jamais au simple anthropos, l'homme "dimidié", centré sur la dimension biologique-existentielle. Dans la philosophie classique, l'homme était considéré comme "incapable de se posséder lui-même", en proie aux corrélations de la conscience induites par le rapport toujours changeant entre le moi et le monde, typique de l'homme "rhétorique", proie facile du dieu de la philopsuchía.
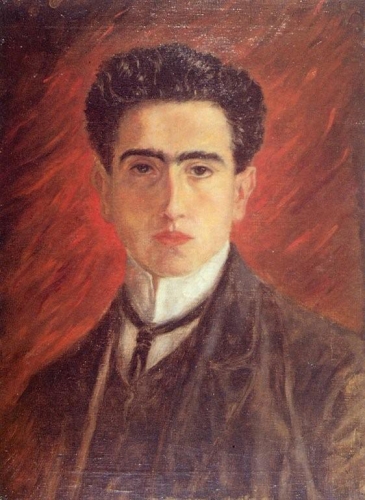
Michelstaedter (portrait, ci-dessus) dit de cet "animal humain": "Sa fin n'est pas sa fin, il ne sait pas ce qu'il fait ni pourquoi il le fait : son action est un être passif parce qu'il n'est pas lui-même tant que la faim de vie vit en lui, irréductible, obscure". Eh bien, le jeune Otto Braun, comme en témoignent les pages passionnées de ce volume, visait à réaliser en lui l'hégémonikon, le centre intérieur capable de donner une direction hyperbolique à notre parcours existentiel, à travers l'élan déterminé par l'acquisition de la qualité d'andreia, de "force d'âme". [...] Seuls des hommes puissants et vertueux auraient pu relever la fortune de l'Allemagne (pour le jeune homme, l'Allemagne, en raison de son intime relation de fraternité avec la Grèce antique, était synonyme d'Europe), la crise dans laquelle tombait la Kultur était trop grande : "a-t-on jamais vu chez les hommes une telle prostitution de tout sentiment, une désertion aussi maligne de tout ce qui est fort et sévère, une destruction aussi méthodique de toute idée de noblesse ?".
Il était certain que l'incipit vita nova porterait les stigmates de la civilisation hellénique, car : "l'homme futur portera inconsciemment en lui un esprit qui sera en partie conséquent à l'esprit grec". Il ne prône pas un retour au passé, rien à voir avec des perspectives régressives. Dans la nouvelle civilisation, les réalisations de la modernité et celles des Anciens palpitent ensemble. Le Nouveau Départ verrait la formation d'un monde ancien-moderne.
Ainsi, la prophétie de Gémiste Pléthon se serait réalisée : "Une religion s'élèvera, à laquelle tous les hommes se soumettront ; seulement elle ne sera ni chrétienne ni païenne, mais très semblable au paganisme". En Grèce, il a apprécié la superbe synthèse du dionysiaque et de l'apollinien dans toutes ses créations. Chez ce peuple, la forme conquise dans les arts, la poésie et la philosophie faisait pourtant allusion à l'origine chaotique du monde. La religion grecque, en outre, était "civile", politique, dans la mesure où elle avait son ubi consistam in : "un consentement du peuple". Cela a conduit ces hommes à ne pas se livrer à la contemplation de sur-mondes, ni à dissoudre leur individualité dans le Tout, à la recherche d'un nirvana annulateur. Au contraire, ils n'ont jamais fait de distinction entre nature et super-nature, corps et esprit. Otto a été confirmé dans cette conviction par sa lecture passionnée de Sappho et d'Alceus. Il s'est également attardé sur Protagoras et, réfléchissant à sa pensée, a compris la nécessité de laisser les Grecs parler enfin de leur propre voix, alors que nous, les modernes, "traduisons tout dans une terminologie chrétienne".
[...] D'où la déclaration explicite de lui-même comme "polythéiste", "païen", "fidèle à la vie". Cette profession de foi se manifeste le plus souvent par l'exaltation de la nature et de sa beauté. [...] L'intérêt d'Evola pour Braun, nous l'avons mentionné déjà dans ses lignes. A l'époque où le philosophe romain se proposait, après l'expérience Dada, de tracer les coordonnées théoriques sur lesquelles construire l'idéalisme magique, il regardait avec admiration Braun, dont il avait lu l'œuvre dans l'édition allemande de 1921. Le penseur traditionaliste place Braun aux côtés d'autres "esprits de la veille", tels que Weininger, Michelstaedter, Gentile, Hamelin et Keyserling [...] .
Dans Braun, selon Evola, "ce qui est mis en évidence [...], c'est essentiellement l'aspect de la puissance efficace, de la transformation de la valeur en force absolue opérant au sein même de l'antithèse de la réalité brute". Chez lui, il ne s'agirait pas de philosophie au sens scolastique, de l'élaboration d'un système, car ce qui intéresse vraiment le jeune Allemand, c'est : "le spectacle grandiose de l'autocréation d'une volonté titanesque, d'une foi inébranlable, d'un pouvoir démiurgique pour que la valeur devienne vie, réalité absolue". Le dieu auquel Braun fait référence veut devenir un "corps", l'homme. Par conséquent, à la lumière de "l'évangile de la volonté", noyau vital de la vision du monde d'Otto Braun, il est nécessaire de transformer ce que la vie nous offre, en le conformant à notre but. C'est en cela que réside la liberté de la volonté.
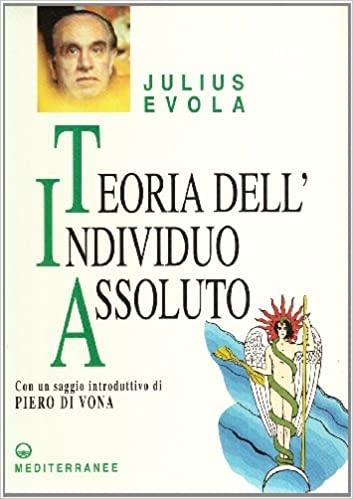
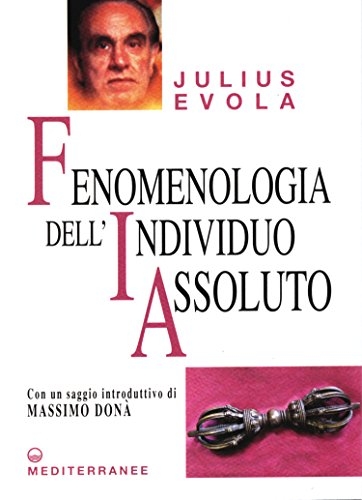
Evola ne peut manquer d'apprécier, chez le jeune homme, la "fidélité à la vie", le débarcadère grec impliquant la récupération de la physis et l'attribution à l'art d'un rôle essentiel sur le chemin de l'épanouissement. Il reconnaît également le trait carlylien de l'héroïsme politique de Braun, de son appréciation de l'homme d'État : "au religieux, au poète et au sage, il opposait le héros, et pour lui, de nos jours, héros signifiait homme d'État". Il était conscient que la véritable "domination" sur soi et sur la réalité ne devenait un fait réel que pour ceux qui avaient résolu la corporéité en liberté, comme cela se produit le long des chemins initiatiques, mais ce n'était qu'une intuition le long de ce chemin. La limite de la proposition de Braun se trouve, pour Evola, dans le fait qu'il a vécu la volonté de l'homme comme subordonnée : "à une obéissance supérieure, il a humilié le Moi en le soumettant à une tâche, à une mission qui semblait procéder presque d'un démon, d'une puissance supérieure". Le fait de " se mettre au service d'un dieu " aurait détourné Braun de la réalisation de l'immanence pure : le daimon, dans cette perspective, représentant une réalité transcendante. Michelstaedter s'était reconnu dans la centralité originelle de l'ego, la Persuasion, Braun, selon Evola, ancrait cette centralité au devoir. Il est donc inévitable, pour mettre véritablement en œuvre une vie de liberté et de puissance, qui sera pour Evola celle de l'individu absolu, d'intégrer les perspectives des deux jeunes "divins" en une seule.
En effet, il nous semble que, malgré une certaine ambiguïté théorique, liée au traitement du devoir à poursuivre résolument, qui pourrait lier l'ego, ne le rendant pas absolu, libre, Braun reste, en ce qui concerne le daimon, dans la perspective hellénique de la transcendance immanente, également typique de la vision évolienne. Selon la leçon de Gian Franco Lami, vivre "au service d'un dieu", n'implique pas l'abandon mystique au Principe, mais est un moment essentiel du parcours vertueux, anagogique, du philosophe qui, reconnaissant ses limites, n'a pas la prétention : "d'atteindre et de posséder définitivement la "vraie sagesse"". Dans l'acceptation du résultat aporétique du philosopher, dans la reconnaissance du "savoir socratique du non-savoir", l'homme prend conscience que le processus d'ordonnancement, en lui-même et dans la communauté, est toujours in fieri, comme la vie.


En outre, Lami lui-même a précisé comment le daimon pythagoricien-socratique "est qualifié au niveau terrestre, comme une fonction naturellement humaine, qui s'exprime dans l'accompagnement de l'individu, en tant qu'agent pensant, le long de son parcours existentiel spécifique". Dans ces mots nous pouvons voir le sens du destin personnel de Braun, fidèle au daimon, à la voie réalisable de la transcendance immanente toujours in fieri, pleinement en ligne avec l'idéalisme magique évolien. Le philosophe romain sait que le Moi, comme l'a précisé Massimo Donà "dans la mesure où il est inconditionné, ne peut être identifié à aucune forme", il doit nier toute norme irréfutable, se soustraire à tout impératif, même lorsqu'il est lié par "la liberté inconditionnelle elle-même". L'individu absolu, incapable de trouver la paix dans un positum, bien que non limité, ne manque pas le non-moi, n'exclut pas la limite. Cette situation l'incite à refaire, à refonder, à la lumière de l'infondabilité du principe, la liberté, lui-même et le monde. Raison de plus pour y retourner et lire, Je m'accrocherai, quoi qu'il arrive.
(extrait de la préface de Giovanni Sessa, Destinée et Postérité. Le Printemps Sacré d'Otto Braun, au livre d'Otto Braun, Io terrò duro, qualunque cosa accada. Journal et lettres d'un jeune volontaire de guerre, en librairie aux éditions OAKS à partir du 19 janvier - pp. 255, euro 20.00).
14:54 Publié dans Hommages, Littérature, Philosophie, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : otto braun, première guerre mondiale, hommage, giovanni sessa, philosophie, révolution conservatrice, allemagne, littérature, lettres, lettres allemandes, littérature allemande, littérature soldatique, esprit soldatique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 05 février 2022
L'hédonisme autarcique de l'école cyrénaïque
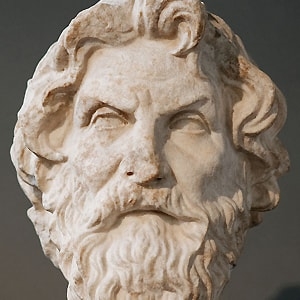
L'hédonisme autarcique de l'école cyrénaïque
Écrit par "Noorglo"
Ex: https://www.liberecomunita.org/index.php/filosofia/243-l-edonismo-autarchico-della-scuola-cirenaica
L'école cyrénaïque s'est développée à Cyrène, une ville grecque d'Afrique du Nord, dans la première moitié du IVe siècle av. J.C. L'école s'est formée quelques décennies après la mort de son initiateur Aristippe, un Cyrénéen qui avait émigré à Athènes, étudié avec Socrate et Protagoras, puis était retourné dans sa patrie pour diffuser sa pensée. Plus qu'une véritable école, on devrait parler d'une direction philosophique variée et non unique.

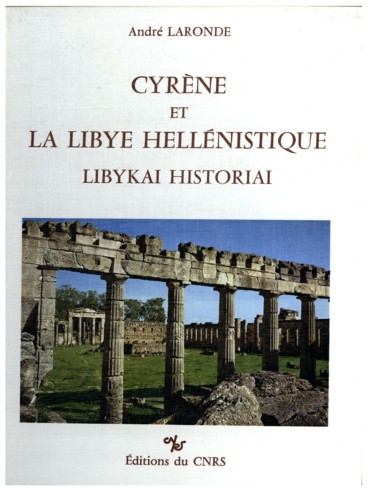
L'histoire de l'école cyrénaïque commence avec Aristippe de Cyrène, né vers 435 av. Il est venu à Athènes à un jeune âge et est devenu un disciple de Socrate. Nous disposons de peu d'informations sur ses déplacements après l'exécution de son maître en 399 avant J.-C., bien qu'il ait vécu un certain temps à la cour de Dionysius Ier de Syracuse. On ne sait pas exactement quelles doctrines philosophiques attribuées à l'école cyrénéenne ont été formulées par Aristippe. Diogène Laertius, à la suite de Diction le Péripatéticien et de Panetios, propose une longue liste de livres attribués à Aristippe, bien qu'il rapporte également que Sosicrate a déclaré qu'il n'avait rien écrit.
Parmi ses élèves, il y avait sa fille Arete, qui a transmis ses enseignements à son fils, Aristippe le Jeune. C'est lui, selon Aristocle de Messène, qui transforma les enseignements de son grand-père en un système complet, bien qu'il soit encore possible de dire que les bases de la philosophie cyrénaïque furent posées par Aristippe l'Ancien.
Plus tard, l'école se scinde en différentes factions, représentées par Annicéris de Cyrène, Hégésias de Cyrène, Théodore l'athée, qui développent des interprétations opposées de la philosophie cyrénaïque, dont beaucoup sont une réponse au nouveau système hédoniste posé par Épicure. Au milieu du IIIe siècle avant J.-C., l'école cyrénaïque était devenue obsolète ; l'épicurisme avait dépassé ses rivaux cyrénaïques en offrant un système plus sophistiqué.
L'école de philosophie cyrénaïque a donc été fondée par Aristippe, qui a fait du plaisir le but premier de l'existence. École non homogène, l'école cyrénaïque devait s'articuler intérieurement en diverses nuances éthiques et ne se retrouver que plus tard et en partie dans l'épicurisme. Épicure, en effet, a doté sa doctrine hédoniste d'un fondement ontologique et gnoséologique absent chez les Cyrénaïques, développant leur pensée exclusivement sur le terrain d'une éthique de la vie quotidienne, pragmatique et loin des principes théoriques. Aristippe caractérise cette orientation philosophique sur la base de l'anthropocentrisme, du sensualisme absolu, de la recherche du plaisir corporel et de l'autosuffisance individualiste.
Ce dernier point, qui caractérise l'hédonisme d'Aristippe, se traduit par l'énonciation d'un individualisme extrême et d'une autosuffisance non loin du cynisme, avec un certain mépris des conventions sociales et de toute tradition. Le plaisir immédiat et dynamique va de pair avec l'individualisme de la recherche du plaisir, embrassant chaque moment de l'existence qui peut l'offrir et sous quelque forme que ce soit. Seuls les faits humains sont dignes d'intérêt et les phénomènes naturels ne sont dignes d'intérêt que s'ils produisent du plaisir.
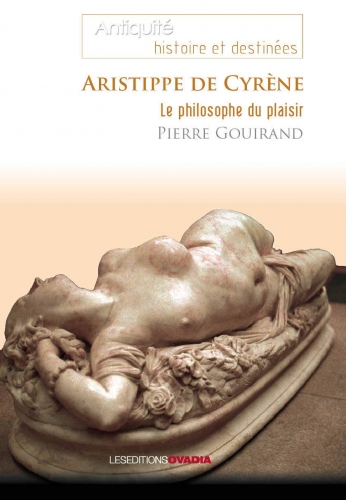
Mais l'autosuffisance, cet important principe aristippéen, concerne aussi le plaisir, qu'il faut poursuivre sans en devenir dépendant, car s'il est toujours bon, donc à poursuivre en toute situation et circonstance, s'il devient possédé, il doit être abandonné car l'autosuffisance et l'autonomie individuelle sont au-dessus de tout.
Le vrai plaisir est toujours et dans tous les cas dynamique (et non pas l'aponeia épicurienne = "absence de douleur") et constitue le véritable moteur positif de l'existence d'une personne, qui est une succession discontinue d'instants et qui doit être vécue uniquement dans le présent, en ignorant le passé et le futur : c'est une formulation ante litteram du soi-disant carpe diem, un message qui trouvera des adeptes et des interprètes surtout parmi de nombreux intellectuels du monde latin. Enfin, le phénoménalisme d'Aristippe est absolu, puisqu'il soutient que seul ce qui est perçu est réel: ce réductionnisme sensoriel et individualiste révèle également chez Aristippe des références indubitables à la philosophie sophistique.

Plusieurs chercheurs ont tendance à déplacer la théorisation de l'hédonisme cyrénaïque d'Aristippe (l'Ancien) à son petit-fils Aristippe le Métrodacte (également appelé Aristippe le Jeune) par l'intermédiaire de sa fille Arete (buste, ci-dessus), qui était une femme cultivée et sensible à la philosophie de son père. En d'autres termes, Aristippe l'Ancien se serait limité à orienter son comportement dans une direction hédoniste (mais tout de même avec une certaine mesure) et vers un certain détachement ironique aristocratique qui favorisait plutôt les éléments d'autonomie existentielle et d'autosuffisance. Selon cette interprétation, il se serait tenu à l'écart de l'hédonisme grossier dont l'école cyrénaïque fut souvent accusée par la suite.
Il serait resté fondamentalement un socratique, qui aurait conservé un certain détachement du plaisir, non sans réserves, exprimé dans l'aphorisme bien connu : "posséder le plaisir, mais ne pas être possédé par lui" (traduit en latin par habere non haberi). Il semble qu'il s'agissait d'une réponse à une critique concernant sa fréquentation d'une hétérosexuelle appelée Laide: "Je la possède, je ne suis pas possédé par elle" était sa réponse, ainsi que "il vaut mieux gagner et ne pas être esclave des plaisirs que de ne pas en profiter du tout".
Bien que, par conséquent, il ne recherchait pas seulement le plaisir catastématique "négatif" comme les épicuriens, mais surtout le plaisir cinétique et actif, Aristippe proposait la "mesure", contrairement à certains de ses élèves qui ont été définis comme proto-Libertins pour cette raison.
Après la mort du fondateur, l'école a d'abord été dirigée par sa fille Arete et son petit-fils Aristippe le Jeune. Les disciples d'Aristippe, comme nous l'avons déjà mentionné, ne constitueront jamais une école véritablement homogène, mais développent son hédonisme dans différentes directions. Cela peut être considéré comme une confirmation du manque de théorisation de sa philosophie, puisqu'il s'est limité à indiquer une direction éthique, qui à son tour peut être interprétée de diverses manières.
En dehors d'Aristippe le Jeune, dont nous avons parlé et auquel certains attribuent une intention de radicalisation dans le même cadre hédoniste, émergent comme successeurs ultérieurs trois personnages d'une profondeur notable, même s'ils ne sont pas très bien documentés, tous trois vivant entre la seconde moitié du IVe et la première moitié du IIIe siècle avant J.-C. (donc contemporains ou légèrement plus jeunes que le IIIe siècle avant J.-C.). (donc contemporains ou légèrement plus jeunes qu'Épicure) : Hégésippe, Annicéris (ou Annicerides) et Théodore l'athée.
Vision philosophique
Les Cyrénaïques étaient des hédonistes et croyaient que le plaisir, surtout le plaisir physique, était le bien suprême de la vie. Ils considéraient le type de plaisir physique comme plus intense et plus désirable que les plaisirs mentaux. Le plaisir était pour les Cyrénaïques le seul bien de la vie et la douleur le seul mal. Socrate avait considéré la vertu comme le seul bien humain, mais il avait également accepté un rôle limité pour son côté utilitaire, permettant au bonheur d'être un objectif secondaire de l'action morale. Aristippe et ses partisans en ont tiré parti et ont élevé le bonheur au rang de facteur primordial de l'existence, niant que la vertu ait une quelconque valeur intrinsèque.

Épistémologie
Les Cyrénaïques étaient connus pour leur théorie sceptique de la connaissance. Ils ont réduit la logique à une doctrine concernant le critère de la vérité. Selon eux, nous pouvons connaître avec certitude nos expériences sensorielles immédiates, mais nous ne pouvons rien savoir de la nature des objets qui provoquent ces sensations.
Toute connaissance est une sensation immédiate. Ces sensations sont des mouvements purement subjectifs, et sont douloureuses, indifférentes ou agréables, selon qu'elles sont violentes, tranquilles ou douces. En outre, elles sont entièrement individuelles et ne peuvent en aucun cas être décrites comme quelque chose qui constitue une connaissance objective absolue. La sensation est donc le seul critère possible de connaissance et de conduite. Les manières dont nous sommes affectés sont les seules que l'on puisse connaître, donc le seul but pour chacun doit être le plaisir.
Éthique
L'école cyrénaïque déduit un but unique et universel pour tous les hommes, à savoir le plaisir. Il s'ensuit que les plaisirs passés et futurs n'ont pas d'existence réelle pour nous, et que parmi les plaisirs présents il n'y a pas de distinction de genre. Socrate avait parlé des plaisirs supérieurs de l'intellect ; les cyrénaïques niaient la validité de cette distinction et affirmaient que les plaisirs du corps, plus simples et plus intenses, devaient être préférés. Le plaisir momentané, de préférence physique, est donc le seul bien pour les hommes.

Selon les Cyrénaïques, le sage doit avoir le contrôle des plaisirs plutôt que d'en être l'esclave, sinon il éprouvera de la douleur ; cela exige du jugement pour évaluer les différents plaisirs de la vie. Selon la doctrine cyrénaïque, les lois et les coutumes doivent être prises en compte, car bien qu'elles n'aient aucune valeur intrinsèque, leur violation entraînera des sanctions désagréables imposées par d'autres. De même, l'amitié et la justice sont utiles pour le plaisir qu'elles procurent.
Les derniers Cyrénaïques
Les cyrénaïques postérieurs, Annicéris de Cyrène, Hégésias de Cyrène, Théodore l'athée, ont tous développé des variantes de la doctrine cyrénaïque. Selon Annicéris, le plaisir est obtenu par des actes individuels de gratification, recherchés pour le plaisir qu'ils produisent ; Annicéris a beaucoup insisté sur l'amour de la famille, de la patrie, de l'amitié et de la gratitude, qui procurent du plaisir même lorsqu'ils exigent des sacrifices.

Hégésippide pense que le bonheur est impossible à atteindre et que, par conséquent, le but de la vie est d'échapper à la douleur et à la tristesse. Les valeurs traditionnelles telles que la richesse, la pauvreté, la liberté et l'esclavage sont toutes indifférentes et ne produisent pas plus de plaisir que de douleur. Selon le philosophe, l'hédonisme cyrénaïque était la façon la moins irrationnelle de gérer les peines de la vie.
Pour Théodore, en revanche, le but de la vie est le plaisir mental, et non le plaisir physique, et il s'attarde davantage sur la nécessité de la modération et de la justice. Dans une certaine mesure, tous ces philosophes tentaient de répondre au défi posé par l'épicurisme.
14:37 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, philosophie grecque, antiquité grecque, hellénisme, hellénité, cyrénaïques, cyrène, épicuriens, épicure |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 01 février 2022
L'être humain comme masse à disposition de l'Etat : réflexions philosophiques sur la biopolitique

L'être humain comme masse à disposition de l'Etat : réflexions philosophiques sur la biopolitique
Par Alexander Markovics
Depuis plus de deux ans, les Allemands se trouvent dans un état d'urgence qui n'en finit pas. Au vu de la violation quotidienne de la Constitution par de nouvelles "mesures", il est difficile de dire si nous vivons dans une démocratie de plus en plus tyrannique ou dans un totalitarisme aux allures démocratiques. Il semble donc d'autant plus nécessaire de s'arrêter, de remettre en question son fonctionnement, pour pouvoir ensuite lui opposer une résistance d'autant plus efficace.
Le pouvoir législatif a été remplacé, les yeux fermés, par le pouvoir exécutif qui prend sans cesse de nouvelles mesures. La séparation des pouvoirs est suspendue, et avec elle la démocratie. Les médecins et les virologues financés par l'État nous font peur 24 heures sur 24 en nous annonçant de nouvelles variantes de COVID qui seraient encore plus contagieuses, afin de faire adopter par le monde politique toujours plus de mesures visant à mettre les citoyens sous tutelle. Est souverain celui qui décide de l'état d'urgence, savait déjà Carl Schmitt. Aujourd'hui, les experts de la santé, sous la forme des médecins, donnent l'illusion de la souveraineté.

Jamais dans l'histoire les hommes n'ont été aussi isolés. L'isolement total est érigé en devoir civique suprême. La dimension sociale et culturelle de notre vie est perdue, nous sommes ramenés à la "vie nue" et nous végétons comme les détenus d'un goulag ou d'un camp de concentration. L'État acquiert ainsi un pouvoir sur l'homme et introduit une forme d'oppression à faire pâlir de jalousie le fascisme et le communisme. Discrètement, une nouvelle ère est entrée sur la scène de l'histoire : l'ère de la biopolitique.
Cette nouvelle ère a surtout deux accoucheurs : la médecine et la science modernes. Manifestée tout d'abord par les respirateurs artificiels, qui peuvent maintenir l'homme dans un état de suspension entre la vie et la mort, la vie humaine a été séparée en une vie nue, simplement existante, et une vie déterminée par les sentiments et la culture. Notre situation actuelle est déterminée par le fait que l'état végétatif de l'homme suspendu à un appareil respiratoire a été étendu à l'ensemble de la vie sociale. L'épidémie a transformé du jour au lendemain notre vie en un immense camp de concentration ou goulag, le seul autre lieu dans l'histoire où la "vie nue" est devenue la "nouvelle normalité". Elle ne consiste plus qu'à travailler et à mourir.

Comme l'a démontré le philosophe italien Giorgio Agamben, membre de la Nouvelle Gauche, dans son livre Homo sacer, une biopolitique qui a pour but de préserver la vie nue peut à tout moment se transformer en thanatopolitique, une politique de la mort. Nous le voyons non seulement aux nombreux décès liés aux nouveaux "vaccins" ARNM, mais aussi au fait que toute notre vie est soumise aux statistiques. La menace du triage dans les hôpitaux nous montre que l'on fait à nouveau la distinction entre les vies qui valent la peine d'être vécues et celles qui ne le valent pas. Aujourd'hui, ces "vies qui ne valent pas la peine d'être vécues" sont les retraités des maisons de retraite, qui ne peuvent même plus mourir entourés de leurs proches, et le nombre de suicides qui augmente de manière alarmante, notamment chez les jeunes et les personnes souffrant de problèmes psychiques. Le "lockdown" fait donc lui aussi des victimes, qui sont littéralement passées sous silence.

L'ennemi que nous devons combattre n'est pas visible à l'œil nu. Il est invisible, plus précisément en nous. C'est pourquoi nous nous retrouvons, selon Homère, dans un polemos epidemos, la guerre civile. La politique devient ainsi une guerre civile mondiale contre le virus, qui se concentre aussi de plus en plus sur la lutte contre les supposés collaborateurs de l'ennemi. Les opposants à la vaccination sont caricaturés comme les ennemis de la société ouverte, les opposants aux mesures sont déshumanisés et ridiculisés. La rhétorique martiale des "task forces", qui évoquent constamment une guerre, et les généraux camouflés du groupe "Gecko" en Autriche, qui n'hésite pas à recourir à la violence contre sa propre population, sont des signes de la guerre civile qui se déroule. Dans ces conditions, il est étonnant qu'il n'y ait pas encore eu de pogroms contre les personnes non vaccinées.
Non seulement notre vie est restreinte, mais les gens sont rendus étrangers les uns aux autres. Le port permanent de masques ne nous rend pas seulement étrangers les uns aux autres, il fait aussi de nous des personnes différentes. On ne nous définit plus par notre visage ou notre personnalité (persona = masque en grec), mais par le code QR du passeport vert. En fait, le "social distancing" obligatoire conduit à un nouveau transfert de la vie humaine dans la virtualité, le développement de la 5G a été radicalement accéléré par l'épidémie, le "métavers" nous est vanté par des entreprises technologiques américaines comme un substitut à de nombreuses formes de vie interpersonnelle. L'homme perd ainsi non seulement la communauté, mais aussi progressivement son moi, qui est décomposé en de plus en plus d'aspects de la personnalité et de pulsions. La biopolitique marque ainsi la fin non seulement du peuple, mais aussi de l'homme en tant que tel.

La mort marque considérablement notre vie. C'est pour cette raison que le philosophe allemand Martin Heidegger parlait de l'existence humaine comme d'un être à la mort. Si nous ne comprenons pas la mort comme faisant partie de la vie et si nous la fuyons, nous vivons de manière inauthentique, non authentique, et nous nous retrouvons dans la vie nue. La peur s'empare de nous à ce moment-là, la panique nous gagne et nous ne pouvons plus décider de notre vie. Mais il est également possible de faire face à la mort. Nous engageons alors un combat inégal avec elle, nous comprenons la mort comme faisant partie de notre vie, dont nous avons certes peur, mais qui devient une partie de notre monde. Nous pouvons ainsi vivre de manière authentique, comme nos ancêtres, toujours conscients du fait que l'arbre devant nous peut tomber et nous abattre, mais nous pouvons nous y préparer et organiser notre vie en toute confiance. La réflexion sur la mort nous conduit vers la liberté et nous éloigne de l'absence de liberté de la dictature biopolitique.
15:45 Publié dans Actualité, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : biopolitique, actualité, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 30 janvier 2022
Le recours aux forêts

Le recours aux forêts
par Roberto Pecchioli
Source : Ereticamente & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/passare-al-bosco
Les ivrognes accusent le dernier verre : avant, ils étaient encore sobres. Ce n'est pas vrai, mais il y a toujours une goutte qui fait déborder le vase lorsqu'un changement, une idée, une adhésion ou un refus radical se matérialisent et deviennent soudainement réalité. L'écrivain a décidé d'"aller dans les forêts", d'entrer dans la clandestinité.
Admirateurs d'Ernst Jünger, nous entendons suivre les indications du Traité du Rebelle, celui qui va dans les forêts, chassé corps et âme par un ordre qui exige avant tout un contrôle capillaire. Le Rebelle sent qu'il n'appartient plus à rien et "franchit le méridien zéro par ses propres forces". C'est le geste extrême de défiance au nom de la liberté la plus précieuse, celle de dire non.
Ces deux dernières années, les occasions de dissidence radicale se sont multipliées, et nous ressentons maintenant une accélération à laquelle nous ne pouvons échapper qu'en opposant un refus total, une distance existentielle, morale, voire physique. Nous pourrions énumérer une longue série de faits qui nous incitent à "recourir aux forêts", c'est-à-dire à franchir la frontière de la dissidence et à entrer dans le territoire de la rébellion. Citons-en quelques-uns : par exemple, les propos impromptus du président français Macron, le banquier de la galaxie Rothschild placé à la tête d'une grande nation. En inaugurant la présidence semestrielle de l'Union européenne, le jeune homme a demandé que l'avortement soit inclus comme un droit fondamental dans la Charte des droits de l'UE.
Nous ne voulons pas nous laisser entraîner dans un débat insidieux sur l'interruption volontaire de grossesse (IVG, acronyme bureaucratique neutre). Cependant, imaginer que se débarrasser des enfants à naître - c'est-à-dire des futurs membres de la communauté destinés à la perpétuer - puisse être un droit fondamental, c'est-à-dire quelque chose d'indiscutable, la pierre angulaire d'une société, est un signe de folie criminelle. Ce prétendu droit condamne une civilisation à la mort par extinction, foulant aux pieds le premier des "droits", le droit à la vie. De plus, ce serait un droit accordé à seulement la moitié de l'humanité, puisque - jusqu'à ce que les oligarques en décident autrement - les grossesses sont l'apanage des mammifères femelles. Nous utilisons le langage zoologique parce que c'est le seul langage compris par la culture post-humaine. Les pères - ou plutôt les fournisseurs de sperme - ne comptent pour rien, bien que cinquante pour cent du matériel génétique leur appartienne. A l'heure des droits inhumains et de la culture de l'effacement, le rôle des élites se confirme : fossoyeurs de la civilisation dont ils sont les enfants privilégiés.

Il ne reste que la forêt, ou l'image situationniste du petit homme derrière la grille de l'asile qui demande à un passant extérieur : comment c'est "là-dedans" ? Mauvais, merci. Pendant ce temps, le passeport sanitaire vert imposé aux Italiens sous sa super forme avance de manière menaçante. Mme Von der Leyen, l'angélique Ursula europoïde, prévient que la numérisation de l'existence doit se faire par étapes forcées. Frau Blue Eyes nous informe clairement que tous nos faits - compte bancaire, paiements, données de santé - deviendront numériques (une séquence de chiffres d'identification) insérés dans une sorte de carte d'identité universelle.
Qu'est-ce que le passeport vaccin si ce n'est le système d'exploitation, l'application matricielle dans laquelle nous pouvons insérer nos vies personnelles, intimes, économiques et relationnelles ? Même l'un des virologues vedettes de la télévision, Matteo Bassetti, commence à prendre ses distances, affirmant que ce pass n'a pas de réelle signification sanitaire et devient un instrument de division sociale. Bienvenue parmi nous, professeur. La preuve la plus éclatante en est le traitement réservé à une députée en exercice, Sara Cunial, qui n'est pas vaccinée et qui est empêchée de voter pour le président de la république. La presse en a peu parlé, sauf pour ridiculiser ou offenser la députée. Nous ne connaissons pas ses opinions politiques, mais nous sommes convaincus qu'elle a rendu un immense service à l'interprétation de ce qui se passe.
Récapitulons, pour que nous ayons le temps de réfléchir dans la forêt : le corps électoral qui vote pour le chef de l'État est composé de tous les députés et sénateurs, plus les représentants des régions. C'est ce que nous dit l'Article 83 de la Constitution (la plus belle du monde, hein !). En droit - c'est ce que nous ont appris ceux qui savaient, à l'époque de l'éducation civique - la forme est le fond. A tel point que les services parlementaires ont mis en place des formes de vote pour permettre au bureau de vote (le parlement en session commune) de ne pas exclure les malades, les personnes atteintes de la maladie de Covid et les positifs asymptomatiques. Un député étant décédé, ils se sont empressés, à juste titre, de proclamer élu son remplaçant afin de ne pas priver le corps électoral de son intégralité.

En revanche, Sara Cunial (photo), qui n'est pas vaccinée et ne dispose pas du sauf-conduit magique, ne peut pas voter bien qu'elle soit en parfaite santé. L'Italien moyen est indifférent aux questions de droit (en fait, il est constamment trompé par la loi) et tout au plus conseillerait-il au député vénitien de faire un tampon et d'exercer son droit sans faire d'histoires. Elle fait bien de ne pas s'incliner : elle va perdre sa bataille, mais elle a montré que la constitution ne compte pour rien, puisqu'un document administratif (le laissez-passer vert) vaut plus que le droit de vote. Dans quelques mois, il y aura des élections municipales : voulez-vous parier que vous ne pourrez pas voter sans laissez-passer vert, au mépris de l'article 48 de cet autre papier-là, dorénavant assimilé à des déchets à recycler ?
De cette façon, le système aura préétabli sa victoire, puisque les dissidents - ceux qui n'ont pas de laissez-passer et ceux qui ne veulent pas le montrer comme un signe de liberté - ne pourront pas exprimer leurs opinions. Pendant ce temps, celui qui possède la technologie qui a permis le laissez-passer vert et celui qui a le pouvoir de surveillance devient notre maître, mais qui s'en soucie. Nous ne nous plaindrons que lorsqu'ils nous empêcheront de retirer notre argent. Un puissant appareil de pouvoir privatisé (les géants de la technologie qui possèdent le savoir et les moyens de communication informatique ; les patrons de la finance qui créent de l'argent à partir de rien et nous le prêtent à titre gracieux, créant ainsi l'illusion de la dette ; les multinationales de la santé) fournit aux États - préalablement vidés de leur souveraineté et de leur pouvoir réel - l'arme du contrôle, devenu pouvoir sur la vie. Les peuples reculent devant la peur de la contagion et de la mort, devant la désinformation et la privation des outils de jugement.
Alexandre Soljenitsyne, qui comprenait la tyrannie, implorait ceux qui n'avaient pas le courage de la rébellion ouverte de ne pas devenir au moins complices du mal ; le message tombe dans l'indifférence. La tyrannie, écrit Jünger, n'est possible que si la liberté a été domestiquée, réduite à un concept vide. Tout a un prix et la condition de l'animal domestiqué entraîne celle de la bête de boucherie. Le système du politiquement correct et son extrême - la sous-culture des "réveillés" - est une expérience à grande échelle de domestication contrôlée. Il n'y a pas d'autre choix que de vivre en tant qu'immigrant illégal en essayant d'échapper à la Mégamachine et de maintenir la flamme de la liberté.

À une époque où la stupidité et l'ignorance sont élevées au rang de drapeau, rares sont ceux qui reconnaissent la grande portée symbolique et la tension morale d'un monument à Prague (photo, ci-dessous). Dédié à la mémoire de la violence communiste, il consiste en une série de figures humaines en bronze. Dans la première, on peut voir le corps intact ; dans la dernière, il ne reste que des lambeaux épars. Il s'agit d'un hommage aux victimes du communisme réel qui montre parfaitement comment la personne humaine est progressivement détruite afin de la soumettre jusqu'à sa disparition. Cela vaut pour tous les totalitarismes, même ceux qui avancent sur les ailes de la technologie et de la privatisation oligarchique de tout, insatiables dans leur volonté de dominer et d'annihiler l'autonomie intellectuelle et spirituelle.

Au début, il y a l'homme libre ; ensuite, la personne est conditionnée par le pouvoir de l'appareil de propagande et de répression. Au final, il reste une "entité" humaine, vouée à la seule survie biologique, privée de la volonté nécessaire pour penser, dans un contexte de démotivation, de désespoir et d'apathie.
Le vingtième siècle a changé la qualité de l'attaque contre la liberté, qui est devenue une science, assistée par de nouvelles connaissances appliquées contre l'homme, malgré les prémisses et les avertissements. Pensez au "conditionnement opérant" inventé par le psychologue comportementaliste Burrhus Skinner. Nous vivons enfermés dans la "cage" de Skinner. Le psychologue a placé une souris - ou un pigeon - dans une cage munie de deux leviers. L'un a transmis un choc électrique, l'autre de la nourriture. Après plusieurs essais, l'animal a compris quel levier délivrait la nourriture (renforcement positif) et a compris qu'il ne fallait pas appuyer sur celui qui donnait le choc (renforcement négatif).
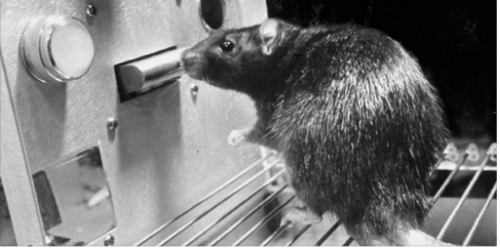
Le conditionnement opérant, récompense et punition, est né. Pour l'homme zoologique, la récompense est le droit à la pulsion libidinale ; la punition est la solitude, la dérision, la discrimination envers ceux qui n'appuient pas sur le bon levier. Le résultat est le conformisme plombé du troupeau.
L'université britannique de Northampton a récemment atteint la perfection, une autre goutte qui fait déborder le vase de la tolérance, un exemple brutal de conditionnement opératoire. Les professeurs de l'université - la classe dirigeante de la culture - ont décidé de mettre en garde les étudiants contre le contenu du roman 1984 de George Orwell, l'une des œuvres dans lesquelles la dénonciation du totalitarisme et l'aspiration à la liberté personnelle et communautaire sont les plus fortes. Le message transmis aux élèves est appelé "trigged warning", un avertissement psychologique qui rappelle une expérience traumatisante. "La lecture de 1984 peut aborder des sujets difficiles liés à la violence, au genre, à la sexualité, à la classe sociale, à la race, à la maltraitance, aux abus sexuels, aux idées politiques et au langage offensant."
Un travail sur l'absence de liberté est fortement déconseillé car il est le vecteur de déclenchements - de traumatismes psychologiques - au nom de la prudence, de la peur, du silence. Dans le monde sensible, craintif et hypersensible du politiquement correct, il vaut mieux éviter ce qui pourrait déranger, c'est-à-dire faire réfléchir et prendre parti. Tout cela non pas au détriment des analphabètes, mais des jeunes universitaires. La conséquence est que la future classe dirigeante ne connaîtra rien - sous peine de souffrir sous la forme traumatique du déclenchement - des vices des dictatures et de la censure. L'avertissement détournera d'une œuvre qui pose des questions inconfortables et deviendra une aide puissante pour ceux qui s'arrogent une supériorité morale si grande qu'ils effacent tout ce qui ne coïncide pas avec leurs vues.

Dans le roman 1984, les étudiants britanniques pourraient découvrir l'autocensure qui les entoure et les restrictions à la liberté d'expression (deux processus qui marchent ensemble), des indications que le totem et le tabou démocratiques sont faux, du moins estompés, et que les groupes de pression progressistes ont pris le contrôle de l'opinion publique, alternant habilement renforcements positifs et négatifs, récompenses et punitions. Un exemple très clair est lié aux mots, à savoir le néo-langage mentionné par le "dangereux" Orwell. Il y a quelques années encore, on parlait de réchauffement de la planète ; plus tard, l'expression "changement climatique" s'est imposée. La situation est désormais qualifiée d'"urgence climatique". Qu'est-ce qui a changé en quelques années? La réalité climatique planétaire s'est-elle soudainement précipitée ou le récit dominant a-t-il changé pour des raisons économiques et idéologiques ?
Décourager la lecture d'ouvrages qui obligent à la réflexion critique revient à s'enfermer dans la cage de Skinner. Des chocs électriques pour tout ce qui n'est pas un renforcement positif, la nourriture décidée par le pouvoir. Dans l'empire des Illuminati et des Eveillés, la déesse Raison se couche, dévorée par ses enfants. Laquelle des statues de Prague correspond à l'état de notre société ? Il est significatif que le monument se trouve dans la ville de Franz Kafka, qui a décrit avec lucidité la fragmentation de l'individu face à des structures sociales tellement plus fortes que lui.
Ce n'est qu'en passant par les forêts, exilés et clandestins, que nous pouvons rester semblables à la statue en position verticale, l'homme libre. Sans l'autonomie de lire et de tirer nos propres conclusions d'un livre, comme les étudiants de Northampton, nous sommes au bout du rouleau, la figure humaine brisée, sans bras, avec la moitié de la poitrine cassée, boiteuse. Les inquisiteurs sont au pouvoir, nous dirigeant vers un néo-monde qui cache la lumière comme dangereuse pour les yeux. Dans les forêts résonne l'admonition d'Augustin d'Hippone : "tant que nous vivons, nous luttons, et tant que nous luttons, c'est un signe que nous ne sommes pas encore vaincus et que l'Esprit vit en nous. Et si la mort ne vient pas à toi comme un vainqueur, qu'elle vienne à toi comme un guerrier."
16:39 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, dissidence, recours aux forêts |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 29 janvier 2022
Radiographie de l'homme dissolu
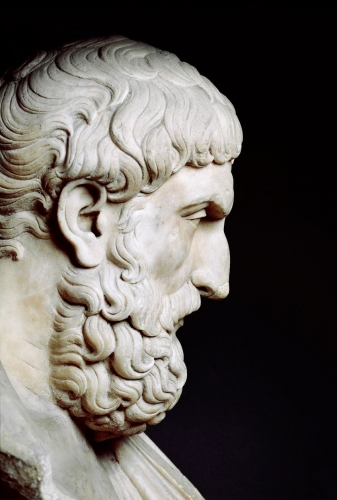
Radiographie de l'homme dissolu
Le vieil Epicure, le tetrapharmakos et l'hédoniste contemporain
Diego Chiaramoni
Ex: https://www.geopolitica.ru/es/article/radiografia-del-hombre-disoluto
"Personne parce qu'il est jeune n'hésite à philosopher, ni parce qu'il est vieux à philosopher ne devient blasé. Personne est jeune ou vieux pour la santé de son âme" Lettre à Ménécée, 122.
Les processus conjoncturels de l'histoire ont toujours invité certains hommes à la noble tâche de penser. La décadence, dont la loi spirituelle intime est de ne pas trouver de fond, c'est-à-dire qu'on peut toujours être plus décadent, a fait émerger certaines balises dans les nuits sombres de l'histoire. Le Danois Kierkegaard, par exemple, écrivait dans son journal : "Il y a un oiseau (le falco osiphraga ou halieto au Mexique) qui est appelé le précurseur de la pluie. Je le suis aussi. Lorsque la tempête commence à se former sur une génération, les individualités de mon espèce apparaissent" (1). Lorsque la communauté se désagrège, lorsque le "nous" qui galvanise les liens humains se fracture, des tentatives d'auto-préservation apparaissent toujours. Cela s'est produit hier et cela se produit aujourd'hui, bien qu'avec des nuances très différentes.

Épicure, né à Samos (Grèce) vers 341 avant J.-C., s'inscrit dans cette tradition qui tente de faire de la philosophie une médecine de l'âme. La crise des cités-États grecques, l'effondrement des traditions, le lent déclin de la Polis, ont incité certaines consciences à tenter de trouver des réponses à l'un des grands drames de l'homme : celui d'habiter un monde désenchanté. Platon et Aristote avaient défendu avec lucidité et autorité la Polis comme cadre de référence pour l'épanouissement du potentiel humain. L'homme isolé doit être une bête ou un dieu, mais jamais un homme.
Épicure va tenter de retrouver, désormais au sein de la vie intrapersonnelle, la sécurité que procurait autrefois la communauté civique. Ce nouveau support sur lequel l'homme doit trouver son bonheur est l'autarkia, c'est-à-dire le pouvoir sur lui-même, l'autosuffisance. En ce sens, le but de l'œuvre d'Épicure est donc de devenir une ascèse du plaisir qui, à son tour, doit nécessairement être interprétée comme un repli de l'individu dans la seule sphère du cosmos où il peut encore trouver sécurité et sens, la sphère intrapersonnelle. Comme on peut le constater, la politique avait été laissée trop loin derrière. Cette expérience d'impuissance, ce sentiment de vivre dans un monde pour lequel ma propre présence ne compte pas, engendre comme réaction la culture de l'indifférence (ataraxie).
Pour Épicure, vivre n'est alors plus, comme le voulait Platon, "une préparation à la mort", mais une adaptation à la vie. Ceci n'est pas accidentel, mais s'enracine également dans le fond ontologique de sa philosophie, qui est essentiellement sensualiste et tend donc à se désengager des questions spéculatives. Pour Épicure et son école, la philosophie devient une tâche stérile si elle n'est pas orientée vers l'atteinte du bonheur.
Après avoir exposé ces lignes propédeutiques, analysons ensuite la proposition épicurienne connue sous le nom de "tétrapharmachus" (τετραφάρμακος). Quatre sont les grandes peurs humaines que le philosophe de Samos développe entre autres dans sa célèbre Lettre à Ménécée, l'une des rares œuvres conservées au fil du temps et qui résume sa conception éthique. Ces peurs sont: des dieux, de la mort, de la douleur et de l'échec (qui concerne sans doute l'avenir). Epicure s'est inspiré d'un ancien médicament utilisé par les Grecs, fabriqué à partir d'un mélange de quatre éléments naturels: cire jaune, résine de pin, colophane et suif de bélier. Les propriétés médicinales de cette pommade étaient la purification et l'analgésie. Épicure donne alors forme à une pharmacologie des peurs. Voyons ce qu'il nous dit :
"N'est pas impie celui qui rejette les dieux du vulgaire, mais celui qui impute aux dieux les opinions du vulgaire. Car les affirmations du vulgaire sur les dieux ne sont pas des prénotions, mais de fausses suppositions" [2]. Les dieux ne sont pas à craindre car ce sont des êtres divins, d'une nature différente de la nature humaine. Par conséquent, la colère ou le courroux sont des projections anthropologiques qui sont imposées aux dieux. En tout cas, s'ils existent, les dieux devraient être un modèle à imiter".
"Habituez-vous à considérer que la mort n'est rien par rapport à nous. Car tout bien et tout mal est dans la sensation ; or la mort est la privation de la sensation. Il s'ensuit que la juste connaissance que la mort n'est rien par rapport à nous rend joyeuse la condition mortelle de la vie" [3].
Épicure montre sans équivoque sa conception sensualiste de l'existence. Tout est dans la sensation et, par conséquent, "le plus terrifiant des maux, la mort, n'est rien par rapport à nous, car, quand nous sommes, la mort n'est pas présente, et quand la mort est présente, nous ne sommes plus" [4].
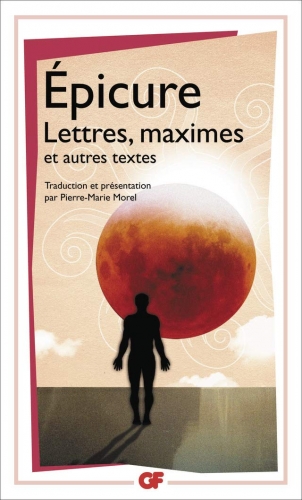
La peur de la douleur, qu'Épicure développe en termes de tension avec le plaisir, est pour le philosophe de Samos une peur infondée, car toute douleur est en réalité facilement supportable. S'il s'agit d'une douleur intense, sa durée sera courte, alors que, si la douleur est légère, malgré sa possible longue durée, elle sera facile à supporter. Ce principe est appelé "catastrophique" et concerne précisément l'évitement de la douleur.
"Il faut se rappeler que l'avenir n'est ni tout à fait à nous, ni tout à fait pas à nous, de sorte que nous ne l'attendons pas avec une certitude totale comme s'il devait être, ni ne le désespérons comme s'il ne devait pas être du tout" [5]. Dans ce cadre situationnel, il n'y a pas lieu de craindre l'avenir ou l'échec, puisque ce qui se passe dans le futur ne nous concerne pas directement, et que nous ne pourrions donc guère le changer.
Voilà pour Épicure et sa pharmacologie face aux grandes et éternelles peurs de l'homme. A ce stade, et comme promis dans le titre de cet article, la question suivante se pose : cette conception épicurienne peut-elle être mise en relation avec l'hédonisme contemporain ? Le premier point d'ancrage d'une réponse possible se trouve chez le philosophe de Samos lui-même, qui, semble-t-il, avec un zèle responsable envers sa doctrine, nous met en garde contre les déformations possibles de celle-ci. Épicure écrit :
" (...) Quand nous disons que le plaisir est la fin, nous ne parlons pas des plaisirs des dissolus ni à ceux qui résident dans la jouissance douée, comme le croient certains ignorants ou en désaccord ou qui interprètent mal la doctrine, mais du fait de ne pas souffrir de douleur dans le corps ou de trouble dans l'âme" [6].

Nous pensons que le terme "dissolu" est une définition exacte de l'homme contemporain. Un dissolu, selon son étymologie latine dissolutus, est celui dont la nature répond à la dissipation, celui qui dissout l'essentiel des choses. Un dissolu est un être dégradé dans son humanité profonde. L'hédoniste contemporain répond à un impératif catégorique: "tu dois jouir". Cette exigence de jouissance, liée à l'empire de la consommation et à la réification de l'autre, ternit la vie et les relations humaines avec l'encre visqueuse d'une fausse autosatisfaction. À cet égard, nous retrouvons les mots de Byung-Chul Han qui, dans son ouvrage L'agonie d'Eros, note avec lucidité :
"Le corps, avec sa valeur d'exposition, est assimilé à une marchandise. L'autre est sexualisé comme un objet excitant. On ne peut pas aimer l'autre dépouillé de son altérité, on ne peut que le consommer" [7]. L'hédoniste contemporain ne veut pas être une marchandise.

L'hédoniste contemporain ne craint pas les dieux, mais vénère des idoles. Comme le disait le grand Dostoïevski, la nature humaine ne peut vivre sans génuflexion et si elle ne s'agenouille pas devant Dieu, elle s'agenouille devant d'autres choses, car à proprement parler il n'y a pas d'athées mais des idolâtres. Le monde, sans charme ni transcendance, ne vaut pas le temps de la contemplation.
L'hédoniste contemporain ne craint pas la mort parce qu'elle est superficielle et improductive, ou peut-être la craint-il, ou même plus, il en a une terreur évitante, et pour cette raison, non seulement il a transformé les cimetières en prairies artificielles, mais il a vidé le culte des morts de son contenu pour imposer la procédure administrative de crémation soudaine et de pulvérisation des cendres.
L'hédoniste contemporain, lui aussi, ne regarde pas la douleur en face, car la souffrance n'a pas de sens et ne possède même pas la valeur d'offrande ou de purification. Même les nouvelles pseudo-religions ont inventé un slogan dans l'air du temps : "Arrêtez de souffrir".
Enfin, l'hédoniste contemporain ne craint pas l'avenir, non pas parce que "aujourd'hui son affliction lui suffit" comme l'écho de l'Évangile, mais parce que l'hédoniste d'aujourd'hui est un court-termiste. Son "carpe diem" ne fait pas référence à un profond carpir dans le verger du jour pour en saisir l'écho d'éternité, mais à presser la seule orange qu'il peut voir dans le tiroir.
Parmi nous, Argentins, le philosophe Silvio Maresca a consacré de fructueuses heures d'étude à la subjectivité moderne et à son écho dans la société contemporaine. Dans sa pratique pédagogique, il répétait sans cesse que le sujet moderne naît vide, est pensé de la pensée et, par conséquent, au cours des siècles, augmentera son besoin de compléter ce qu'il n'a pas. Ce caractère illimité du désir entraîne à son tour une illusion de plénitude. C'est la clé de voûte de l'hédonisme contemporain, que le lucide Schopenhauer observait aussi d'un œil clinique : à l'instant de plaisir succède l'ennui.
L'ennui est le noyau latent de l'hédoniste contemporain, de l'homme dissolu, car qu'est-ce que l'ennui sinon une tristesse sans amour ?
Notes:
[1] Kierkegaard. S. Journal intime. Santiago Rueda, Buenos Aires, 1955 : p. 141.
[2] Épicure. Lettre à Ménécée, 123-124. Traduction de Pablo Oyarzún (Université catholique du Chili).
[3] Ibidem, 124.
[4] Ibidem, 125.
[5] Ibidem, 127.
[6] Ibidem, 131.
[7] Byung-Chul Han. L'agonie d'Eros. Ed. Herder, Barcelone, 2014 : p. 23.
13:46 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, épicure, épicurisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 26 janvier 2022
Déconstruction - et après ?

Déconstruction - et après ?
par Klaus Kunze
Source: http://klauskunze.com/blog/2022/01/24/dekonstruktion-und-dann/
Ce que la droite peut apprendre des erreurs de la gauche
Chaque fin recèle un nouveau début. La vieille gauche était d'inspiration marxiste. Pour l'Occident libre, ses théories sur la lutte des classes étaient réfutées depuis des décennies par l'existence réelle du socialisme de l'Est. Après l'effondrement économique de ce dernier en 1989, même ses épigones marxistes tardifs s'en sont rendu compte. Seuls quelques éternels gauchistes et théoriciens de gauche dans les chaires allemandes conservent cet héritage poussiéreux.
De l'autre côté du spectre, la mutation idéologique du marxisme au post-marxisme n'a pas été reconnue à temps et pas complètement dans ses conséquences pour ses propres positions. Alors que l'ancienne droite a donné naissance à une nouvelle droite, l'ancienne gauche a également engendré une nouvelle gauche.
Les 19e et 20e siècles avaient été l'époque des grands projets idéologiques et des utopies. De nombreux anciens combattants n'ont pas réussi à se sortir de leurs sables mouvants. Ils se sont tus et se sont éteints avec leurs fantasmes.
La nouvelle gauche et la nouvelle droite ont structurellement utilisé la même méthode pour s'échapper des carcans de pensée de leurs prédécesseurs. Comme un papillon en éclosion, ils devaient toutefois d'abord faire éclater l'ancienne chrysalide. La droite a appelé sa méthode la critique métaphysique, la gauche la déconstruction.
La prison de la pensée, qu'il convient de briser, consiste, à chaque fois, en un normativisme. Est normative toute doctrine qui affirme qu'il existe un ordre universel de l'existence au-delà des lois de la nature, dont découle, pour chaque être humain, un devoir-être prédéfini et absolument valable. La philosophie appelle métaphysique la croyance en un tel ordre obligatoire.
Les métaphysiciens s'imaginent que tous les hommes sont soumis à un ordre, à un être objectif, valable par lui-même. Selon les goûts, il s'agirait de l'ordre de la création de Dieu, d'un éternel retour du même, d'une loi dialectique et matérialiste de l'histoire ; de la prétendue nature raisonnable de l'homme ou d'une loi du plus fort ; de l'égalité de tous ceux qui portent le visage de l'homme ou de la supériorité ou de l'infériorité des races ; de la communauté occidentale des valeurs et d'innombrables autres choses encore.
Klaus Kunze, Mut zur Freiheit, Esslingen 1995, p. 9.

La critique métaphysique de droite
Platon et Hegel n'ont laissé aucun intellectuel indifférent. En effet, l'idée que les idées doivent avoir existé avant les phénomènes semble à première vue trop séduisante. Si la fabrication de la première table semblait présupposer l'existence préalable d'une idée de table, les théologiens du Moyen-Âge considéraient les idées comme réelles : Universalia sunt ante rem.
Inspirés par de tels raisonnements fallacieux, on est parvenu depuis Fichte à des entités telles que l'esprit du peuple allemand, les peuples comme pensées de Dieu, les États comme incarnation de l'ordre moral, etc. Aujourd'hui, toutes ces conceptions sont regroupées sous le nom d'essentialistes : elles affirment l'existence essentielle d'ordres collectifs comme celui d'un peuple. Celui qui les défend encore aujourd'hui s'attire la malédiction de la Cour constitutionnelle fédérale. Il est soupçonné de vouloir instaurer un ordre collectiviste ethnique et de réduire les droits fondamentaux individuels de ceux qui ne sont pas "adaptés au peuple".
En 1995, dans ma critique de la métaphysique intitulée Mut zur Freiheit (= "Le courage de la liberté"), j'ai réfuté toute métaphysique de la culpabilité, en particulier celle qui veut nous imposer une responsabilité collective ou des devoirs particuliers simplement parce que nous sommes allemands. Le prix à payer a été l'impossibilité d'étayer à l'avenir les revendications nationales par une justification métaphysique. La sainte Allemagne de nos grands-pères est devenue l'Allemagne que j'imagine et que j'aime.
Si l'on ne considère pas la notion de peuple comme un simple terme générique désignant seulement de nombreux individus, on ne peut [...] que conclure que les peuples n'existent que dans notre imagination : "In mente", aurait dit Ockham : en esprit. Ce qui existe réellement, ce sont les liens de parenté, la langue commune et l'histoire commune des membres d'un peuple. Mais toutes ces circonstances ne préservent pas le phénomène "peuple" s'il n'est plus "in mente" en tant que peuple, c'est-à-dire dans la conscience de ses membres. L'"Allemagne que nous aimons et désirons voir n'a jamais existé et n'existera peut-être jamais. L'idéal est justement quelque chose qui est et n'est pas à la fois. C'est le soleil qui brille au plus profond du cœur des hommes et autour duquel tournent nos pensées"[1]. L'Allemagne réelle : ce ne peut être que des personnes concrètes, l'ensemble des Allemands. Celui qui se sent responsable d'elle et en fait l'affaire de son cœur, compte parmi eux l'ensemble des vivants, des morts et des non-nés. L'Allemagne secrète idéale, en revanche, chacun ne la porte qu'en lui-même.
Klaus Kunze, Mut zur Freiheit, 1ère édition, p.236.
Comme tout amour, celui-ci est sans but et n'a pas besoin d'être justifié. Si je décide de me laisser guider par lui, je renonce à invoquer l'esprit du peuple ou du monde avec une baguette magique métaphysique. Je dois en même temps renoncer à tout "Dieu le veut !", donc à toute prétention à une validité sociale pour tous. Je partage ce dilemme avec les néo-gauchistes :
Les gauchistes se déconstruisent eux-mêmes
Eux aussi revendiquent une validité sociale. Les anciens gauchistes l'ont présentée en affirmant qu'il existait des lois historiques qui, de la joyeuse société primitive au socialisme, en passant par la chute de la propriété privée des moyens de production, la lutte des classes et la révolution, aboutissaient inévitablement à un joyeux communisme. Les théories de Karl Marx contenaient donc de la métaphysique pure.

Lorsque les marxistes Ernesto Laclau et Chantal Mouffe (photo) publièrent en 1985 la première édition de leur livre précurseur sur la déconstruction du marxisme, il n'y avait déjà plus de classe ouvrière dans le monde, la paupérisation générale des masses n'avait pas eu lieu, du moins dans les pays industrialisés, et les prétendues lois du matérialisme historique s'étaient révélées être des bulles de savon. Les deux théoriciens ont reconnu très tôt les signes du temps. Ils argumentent radicalement dans le sens de la théorie constructiviste. Selon eux, toutes les unités sociales sont constituées d'individus et de rien d'autre. Dès qu'ils s'articulent dans le sens d'une action collective, ils donnent naissance à des entités éphémères telles que les familles, les associations, les groupes, les classes ou les peuples, qui peuvent s'effondrer à tout moment si elles ne sont plus "articulées".
Ils appliquent ainsi la structure de pensée de la critique classique de la métaphysique. Cela n'a rien d'original. Mais ce qui est impressionnant, c'est que les gauchistes aient été capables d'un tel changement de mentalité. Ils ont dû jeter par-dessus bord tout ce qu'ils avaient appris de Karl Marx et qu'ils avaient su apprécier. Mais lorsque le fossé entre sa description et la réalité du XXe siècle n'a plus pu être ignoré, ils ont osé déconstruire le marxisme.
Cela ne signifiait nullement qu'ils renonçaient à leurs sentiments révolutionnaires. Ils aspiraient toujours à l'égalité de tous les hommes et s'opposaient "à la reconstruction d'une société hiérarchisée". Citation:
"L'alternative de la gauche devait être de se situer pleinement dans le champ de la révolution démocratique et d'élargir les chaînes d'équivalence entre les différentes luttes contre l'oppression".
Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, Hegemonie und radikale Femokratie. Zur Dekonstriktion des Marxismus, p.219
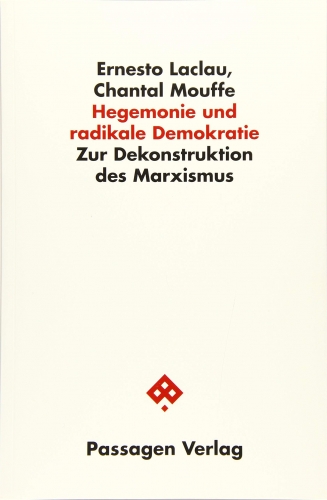
Toutes les affirmations métaphysiques prétendent à une validité universelle. Détruire cette prétention fait partie des tâches centrales de toute critique de la métaphysique, en d'autres termes, de la déconstruction :
Il n'y a pas de démocratie radicale et plurielle sans le renoncement au discours de l'universel et à son affirmation implicite d'un point d'accès privilégié à 'la vérité', qui ne peut être atteinte que par un nombre limité de sujets.
Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, Hegemonie und radikale Femokratie. Zur Dekonstriktion des Marxismus, 1991, 3e éd. 2006, p.237.
Le déconstructivisme radical ne reconnaît pas la forêt parce qu'il ne voit que des arbres.
J'avais justifié cela de manière un peu plus détaillée en 1995 :
L'aspiration à la domination atteint son intensité géographique maximale lorsque le normativiste étend sa prétention à la validité des normes au monde entier, en exigeant une validité universelle pour ses idées. La tactique la plus courante est d'absolutiser la vision subjective du monde et d'étendre ainsi au monde entier la revendication de validité de la norme : "Tout est soumis à mon commandement moral ! Dans le cas des religions, c'est la règle : tout désobéissant aura certainement des ennuis s'il ne se conforme pas aux commandements de son dieu respectif. Seuls les peuples très modestes n'attribuent pas immédiatement à leurs dieux la création de l'univers entier. De telles revendications de validité fondées sur l'au-delà, donc transcendées [2], relèvent du cas général de la légitimation du pouvoir social, elles sont le ciment de la communauté par excellence et jouent un rôle déterminant dans le maintien de tous les systèmes sociaux.
Klaus Kunze, Mut zur Freiheit, 1995, chapitre "Der Universalist", p.68 et suivantes.
L'un des points essentiels de la méthode déconstructiviste consiste à démontrer qu'il n'existe absolument pas de classe ouvrière en tant qu'"entité" historique. Il y a peut-être des intellectuels qui se l'imaginent ainsi par moments. Il y a eu et il y a aussi des ouvriers qui s'imaginent être des ouvriers. Mais il n'existe pas plus de sujet historique "classe ouvrière" que de sujet historique d'un peuple à travers les âges. Dans leur jargon, Laclau et Mouffe qualifient ces représentations d'essentialisme de la totalité :
Ce n'est que lorsque le caractère ouvert et non cousu du social est entièrement accepté, lorsque l'essentialisme de la totalité des éléments est rejeté, que ce potentiel devient clairement reconnaissable et que l''hégémonie' peut être un outil essentiel pour une analyse politique de la gauche.
Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, Hegemonie und radikale Femokratie. Zur Dekonstriktion des Marxismus,1991, 3e éd. 2006, p.238.
Le fait que "la classe ouvrière" n'existe pas en tant qu'"essence" constitue une prise de conscience essentielle des anciens marxistes. Ils deviennent des post-marxistes en conservant leurs idéaux, mais en ne les présentant plus comme des lois de l'histoire valables de manière absolue et universelle.
Le dilemme
Ils sont ainsi confrontés au même dilemme que la critique métaphysique postnationaliste. Comment prétendre à la validité sociale et à la suprématie de ses propres désirs si l'on ne peut plus les justifier par leur conformité aux lois éternelles de l'existence ?
Il ne reste ici à Laclau et Mouffe que l'espoir résigné que la voie démocratique devrait en même temps signifier le but. Ils considèrent peut-être la discussion toujours renouvelée par le bas et l'articulation de leurs propres exigences au niveau descriptif comme un principe de fonctionnement de tout ce qui est social, qu'ils revendiquent également au niveau normatif. Ils se rangent ainsi parmi les représentants des théories du discours au sens large. Ce qui resterait inexplicable, c'est comment l'histoire mondiale a pu fonctionner pendant des millénaires sans discours, par ordre du Mufti.
Mais pour les théoriciens de gauche, l'histoire mondiale n'a jamais été un domaine dans lequel ils pouvaient briller par leurs connaissances. Si nous supposons avec bienveillance qu'il n'a pas été explicitement dit ni voulu qu'ils aient découvert un principe de fonctionnement social intemporel, il reste à la fin un vide normatif. Il réside dans le fait que Laclau et Mouffe ne peuvent à aucun moment faire valoir dans leur ouvrage pourquoi leur rêve socialiste d'une révolution démocratique serait normativement contraignant. Celui qui ne peut pas répondre à la question de savoir pourquoi quelque chose doit être exactement comme il l'exige, renonce à toute prétention à la validité sociale.
Il ne lui reste alors, comme à moi, qu'à dire ouvertement : "Parce que c'est ce que je veux. Cela correspond à mes sentiments et à mes besoins". Certaines personnes ne peuvent pas se passer de leur Jésus, d'autres de leur patrie, d'autres encore de leur rêve de révolution rouge. Aux sentiments personnels succède la décision personnelle, la décision.
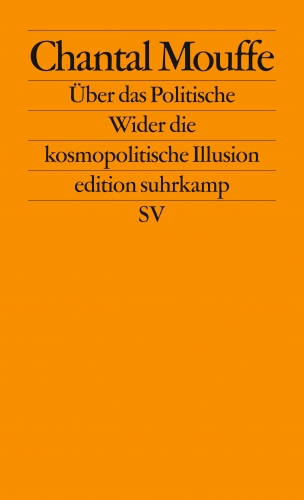
Il n'est pas étonnant que Chantal Mouffe, dans son petit livre Über das Politische (Sur le politique), ait fait référence en 2007 à Carl Schmitt, un éminent théoricien du décisionnisme : "Tout ordre n'est valable que si quelqu'un décide qu'il doit être valable. Schmitt était un fervent catholique, Mouffe est une socialiste. Les contenus de nos croyances sont séparés par des mondes. Mais la structure de pensée commune et la logique d'argumentation nous unissent.
Notes:
[1] Paul De Lagarde, Deutsches Wesen, p.83.
[2] Habermas, Faktizität und Geltung, p.23.
15:41 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, chantal mouffe, ernesto laclau, déconstructivisme, klaus kunze |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 24 janvier 2022
Relecture de Karl Löwith entre sacré et nature (au-delà de l'anthropocentrisme)

Relecture de Karl Löwith entre sacré et nature (au-delà de l'anthropocentrisme)
par Sandro Marano
Source : Barbadillo & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/rileggere-karl-lowith-sul-crinale-tra-sacro-e-natura-oltre-l-antropocentrismo
Giovanni Sessa, en commentant Il silenzio del cosmo : l'ecologia secondo il G.R.E.C.E. Italia (Le silence du cosmos : l'écologie selon le G.R.E.C.E. Italie) sur Barbadillo, suggère de reprendre la lecture approfondie des auteurs qui ont placé la physis [= nature vivante] au centre de leur réflexion, parmi lesquels une place de choix revient sans aucun doute à Karl Löwith (1897-1973), penseur allemand d'origine juive et élève de Martin Heidegger. Je me suis empressé d'accepter cette suggestion, en lisant et relisant (comme il faut le faire pour les livres importants) l'un de ses derniers essais Dieu, l'homme et le monde dans la métaphysique de Descartes à Nietzsche (éditions Donzelli, 1999) publié quelques années avant sa mort en 1967.
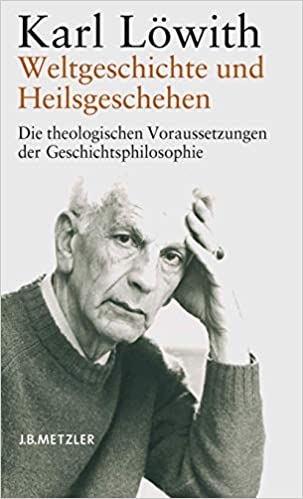 J'avoue, en passant, qu'il y a de nombreuses années, j'avais lu avec profit Da Hegel a Nietzsche (1941) de Löwith, un essai dans lequel, entre autres choses, il soutenait de manière convaincante la centralité de la dimension cosmologique, et donc de l'éternel retour, dans la philosophie de Nietzsche. "La mort de Dieu", écrit Löwith, "ouvre, par le nihilisme, la voie à la redécouverte du monde". Cela m'a permis de me diriger plus facilement vers une possible interprétation écologique de Nietzsche, que j'ai proposée dans un petit essai, Lo stupore del mattino. Nietzsche ecologista (Schena, 1997), dont le titre évocateur m'a été suggéré par l'écrivain de Bari Giorgio Saponaro.
J'avoue, en passant, qu'il y a de nombreuses années, j'avais lu avec profit Da Hegel a Nietzsche (1941) de Löwith, un essai dans lequel, entre autres choses, il soutenait de manière convaincante la centralité de la dimension cosmologique, et donc de l'éternel retour, dans la philosophie de Nietzsche. "La mort de Dieu", écrit Löwith, "ouvre, par le nihilisme, la voie à la redécouverte du monde". Cela m'a permis de me diriger plus facilement vers une possible interprétation écologique de Nietzsche, que j'ai proposée dans un petit essai, Lo stupore del mattino. Nietzsche ecologista (Schena, 1997), dont le titre évocateur m'a été suggéré par l'écrivain de Bari Giorgio Saponaro.
Le naturalisme cosmologique de Löwith
L'importance de cette œuvre de Löwith est due, comme le note l'éditeur et traducteur Orlando Franceschelli dans sa précieuse introduction, non seulement au fait qu'elle conclut la recherche philosophique du penseur allemand qui arrive, sur les traces de Nietzsche et de Spinoza, à une sorte de naturalisme cosmologique, mais aussi au fait que "sous la pression de la crise écologique et des défis bioéthiques", la redécouverte philosophique de la naturalité du monde peut contribuer "à la récupération d'un accord raisonnable entre l'homme et le monde". En effet, la philosophie de Löwith, en questionnant "non seulement l'anthropocentrisme de la tradition chrétienne, mais aussi les formes sécularisées sous lesquelles elle a diversement survécu", la "métaphysique de la subjectivité", peut, à notre avis, certainement être incluse parmi les philosophies de l'écologie.
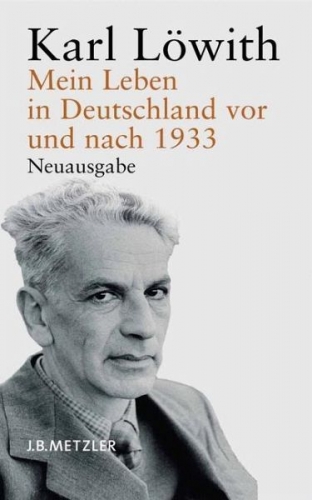 La cible polémique de Karl Löwith est avant tout le subjectivisme moderne et en particulier les philosophies qui cherchent à comprendre le monde à partir de soi et non pas soi à partir du monde, qui se sont succédé de Descartes à Heidegger et Sartre - à l'exception de Spinoza et Nietzsche et, dans une moindre mesure, de Feuerbach. Löwith écrit : "le chemin de l'histoire de la philosophie mène de la cosmo-theologie grecque à l'émancipation de l'homme, en passant par l'anthropo-théologie chrétienne. La philosophie devient anthropologie dans la mesure où l'homme s'émancipe du cosmos divin des Grecs et du Dieu surnaturel de la Bible, et prend finalement sur lui la création du monde humain. Au terme d'une telle libération de tout ce qui pourrait constituer une contrainte, vient la tentative unique de Nietzsche de récupérer le monde pré-chrétien par le biais de la doctrine du Surhomme, qui surgit en même temps que le déclin de Dieu et enseigne l'éternel retour d'un monde qui se veut lui-même, auquel Nietzsche, en le qualifiant de dionysiaque, reconnaît un caractère divin.
La cible polémique de Karl Löwith est avant tout le subjectivisme moderne et en particulier les philosophies qui cherchent à comprendre le monde à partir de soi et non pas soi à partir du monde, qui se sont succédé de Descartes à Heidegger et Sartre - à l'exception de Spinoza et Nietzsche et, dans une moindre mesure, de Feuerbach. Löwith écrit : "le chemin de l'histoire de la philosophie mène de la cosmo-theologie grecque à l'émancipation de l'homme, en passant par l'anthropo-théologie chrétienne. La philosophie devient anthropologie dans la mesure où l'homme s'émancipe du cosmos divin des Grecs et du Dieu surnaturel de la Bible, et prend finalement sur lui la création du monde humain. Au terme d'une telle libération de tout ce qui pourrait constituer une contrainte, vient la tentative unique de Nietzsche de récupérer le monde pré-chrétien par le biais de la doctrine du Surhomme, qui surgit en même temps que le déclin de Dieu et enseigne l'éternel retour d'un monde qui se veut lui-même, auquel Nietzsche, en le qualifiant de dionysiaque, reconnaît un caractère divin.
Le cul-de-sac de l'anthropocentrisme
Dans son texte, Löwith examine les principaux philosophes à partir de Descartes, en ayant pour boussole les notions métaphysiques de Dieu, de l'homme et du monde, ou plutôt la relation entre Dieu, l'homme et le monde. Sa thèse est que la "trinité métaphysique" originelle, après la "chute de Dieu", c'est-à-dire la perte de la foi dans le Dieu biblique, s'est progressivement réduite au simple rapport entre l'homme et le monde, jusqu'à faire de l'homme le centre et la mesure de toutes choses, finissant ainsi par nier le monde lui-même.
La philosophie chrétienne est à l'origine de la découverte de l'intériorité : "Noli foras ire, redi in te ipsum" (Ne sors pas de toi-même, reviens à toi-même), disait Augustin. Mais la découverte de l'intériorité correspond aussi à une méfiance à l'égard du monde: "La tendance de l'Antiquité tardive au détachement du monde rencontre le renoncement au monde par le christianisme. L'Ancien et le Nouveau Testament n'ont pas d'yeux pour le cosmos. [...] Toute la théologie, de Paul et Augustin à Luther et Pascal, s'accorde à dire que ce n'est pas le monde en tant que tel qui est digne d'amour, mais exclusivement Dieu, qui est lui-même amour, et le prochain, qui doit être aimé en lui".
Bien que le te ispsum soit interprété différemment par les philosophies modernes (du je pense de Descartes au je transcendantal de Kant, de l'être de Heidegger à la nausée de Sartre), la conséquence commune de cette vision est double: d'une part, "le monde n'est plus la réalité première et ultime, inconditionnellement autonome et embrassant tout"; d'autre part, "l'homme se retrouve sans place et perdu dans l'ensemble du monde, il devient une existence contingente et finalement absurde, jetée dans le monde on ne sait comment et d'où", ouvrant ainsi la voie au triomphe du nihilisme.
 Löwith tente de trouver une issue au nihilisme, au-delà du Dieu de la tradition biblique, qui selon lui n'est plus crédible aujourd'hui, et il se rattache à une ligne philosophique qui va de Spinoza à Nietzsche. Ce courant de pensée annonce un nouveau paradigme centré non pas sur la domination de la nature, mais sur la vie dans la nature.
Löwith tente de trouver une issue au nihilisme, au-delà du Dieu de la tradition biblique, qui selon lui n'est plus crédible aujourd'hui, et il se rattache à une ligne philosophique qui va de Spinoza à Nietzsche. Ce courant de pensée annonce un nouveau paradigme centré non pas sur la domination de la nature, mais sur la vie dans la nature.
La philosophie de Niezsche comme un tournant
Nietzsche représente sans doute le tournant: "La tentative de Nietzsche de "renouer" avec le monde représente, en pleine modernité, une reprise de l'ancienne certitude du monde ". C'est-à-dire d'un monde qui se génère et se détruit éternellement. Cependant, chez le philosophe de l'éternel retour, la métaphysique de la volonté d'origine chrétienne continue d'opérer, se manifestant par la superposition d'une dimension anthropologique (la volonté de puissance) et d'une dimension cosmologique (l'éternel retour).
L'approche de la philosophie de Spinoza
Löwith tente de dépasser la catégorie de la volonté et il rencontre ici Spinoza qui, avec sa natura naturans, est le penseur qui s'émancipe le plus de l'anthropocentrisme et semble aller encore plus loin que Nietzsche lui-même. Et ce n'est pas par hasard qu'il conclut sa reconstruction historico-philosophique par un chapitre sur Spinoza: en effet, "l'histoire de la philosophie ne constitue pas un progrès ininterrompu dans la conscience de la liberté, si ce qui compte est la connaissance vraie de la nature une et toujours égale de tout ce qui existe. La pensée qui est allée le plus loin dans la recherche de la vérité peut être une pensée historiquement placée dans le passé, mais pour cette raison même, elle peut encore avoir un avenir". Par ailleurs, Spinoza est le philosophe dont s'inspire également le philosophe norvégien Arne Naess, père de l'écologie profonde, pour son écosophie.
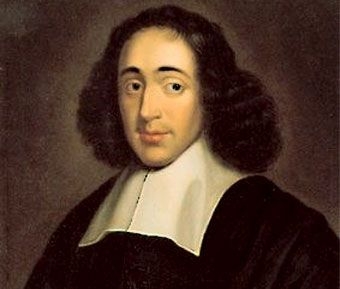
Une question ouverte
Löwith, séparant clairement la théologie, qui est la confiance dans la révélation de Dieu, de la philosophie comprise comme la recherche de la vérité et "la reconnaissance et l'acceptation de l'incertitude" (Orlando Franceschelli) - dans laquelle il se situe fermement - observe que nous nous sentons au-delà du Deus sive Natura de Spinoza lui-même, car "nous ne pouvons guère imaginer les raisons pour lesquelles la métaphysique a été, pendant si longtemps et si obstinément, une théologie métaphysique et a soutenu qu'elle devait penser en tout cas à Dieu et pas seulement à la totalité du monde, dont l'être sans Dieu est évident pour nous".
À la question du jeune Nietzsche sur ce qu'est l'anneau universel : "Est-ce Dieu ? Est-ce le monde ?" - qui, dans Zarathoustra, sera plus tard dissoute dans l'exhortation "reste fidèle à la terre !" - Löwith réagit également en se rangeant du côté du monde naturel contre l'esprit de Dieu. Peut-on dès lors considérer Löwith comme "vainqueur de Dieu et du Néant", comme Nietzsche le dit de lui-même dans la Généalogie de la morale ?
Certes, "une semblable admission qu'un monde devenu sans Dieu constitue aujourd'hui l'évidence dont notre conscience se sent le plus proche, doit toujours savoir préserver, comme Löwith lui-même nous l'a enseigné, la critique sceptique de la recherche" (Orlando Franceschelli).
A notre humble avis, cependant, une question fondamentale reste ouverte : celle de la nature énigmatique de l'homme, mi nature et mi culture ; de l'homme qui, bien que pleinement inséré dans la naturalité du monde, a la possibilité de modifier, d'altérer et de violer l'ordre naturel des choses.
14:52 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : karl löwith, philosophie, nietzsche, spinoza |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 23 janvier 2022
Éloge de la témérité spirituelle

Éloge de la témérité spirituelle
par Luc-Olivier d'Algange
« Le combat spirituel est aussi brutal que la bataille d’hommes ; mais la vision de la justice est le plaisir de Dieu seul »
Arthur Rimbaud
De toutes les témérités, la témérité spirituelle est la plus rare. Sa rareté la hausse désormais au rang de nécessité. Nous avons faim et soif de ce qui est rare. Dans l’équilibre du noble et de l’ignoble, dans l’harmonie des ombres et des lumières, des mélodies et des timbres de l’entendement humain, l’absence absolue de témérité spirituelle équivaut à une extinction massive des pouvoirs de l’intelligence. Le téméraire n’exige point qu’on le suive. Son amour-propre se satisfait d’avoir été « en avant », comme la poésie rimbaldienne. « La poésie ne rythmera plus l’action, elle sera en avant ». En avant, c’est-à-dire aussi au-devant des insultes, des médisances, des crachats. Ainsi que l’écrivait Ernst Jünger : « On ne peut empêcher un homme de vous cracher au visage, mais on peut l’empêcher de vous mettre la main sur l’épaule. » Ainsi commence la témérité spirituelle : elle éloigne les sympathies condescendantes, les tutoiements de porcherie, les petits signes de connivence que les médiocres s’adressent entre eux et auxquels il faut répondre sous peine d’être le bouc émissaire de toutes les lâchetés collectives. La témérité spirituelle est une tournure d’esprit. Elle tient autant du caractère que de l’intelligence. Pour le spirituel téméraire, l’intelligence et le caractère sont indissociables. Les grands caractères deviennent intelligents par la force des choses ; que serait une intelligence sans caractère sinon un leurre ? Comment exercer son intelligence des êtres et des choses sans caractère ?
L’intelligence périclite à défaut d’exercices. Si nous nous aventurons en quelques pages à esquisser un éloge de la témérité spirituelle, le moins que nous puissions faire sera de nous livrer à des exercices de témérité, en formulant quelques-uns de nos désaccords avec l’immense majorité de nos contemporains. Est-ce là une déplaisante prétention à l’intelligence ? Soit ! Donnons déjà à l’adversaire cet argument, dont sans doute il surestimera le poids. La véritable témérité spirituelle est si humble et si peu vaniteuse qu’elle peut sans crainte s’avancer au milieu des huées qui la disent orgueilleuse selon l’immémoriale parabole de la paille et de la poutre. Le téméraire en esprit n’a pas même besoin de se demander ce qu’il ne faut pas dire pour le dire. L’hérésie contre la bien-pensance fleurit naturellement dans son jardin. Certes, il ne faut point être « élitiste », feignons donc de l’être, mais comme par inadvertance. D’ailleurs, comment pourrions-nous être élitistes si nous sommes l’élite ? Un Roi, s’il règne, n’a guère besoin de se dire royaliste. La témérité spirituelle serait ainsi un mouvement de la pensée qui fait l’économie de la redondance, un mouvement qui va droit au but qu’il se fixe, même dans la nuit noire, comme la flèche des archets que manient les moines- guerriers du bouddhisme zen.

C’est assez dire que le téméraire en esprit n’est point entièrement ignorant de l’art de la guerre. Comme aux échecs, il est bon de temps à autre, ainsi que le suggérait Marcel Duchamp, de lancer une attaque audacieuse, et presque incompréhensible à soi-même, pour désarçonner l’adversaire, surtout lorsque celui-ci se trouve en bien meilleure position que nous. Rien ne sert de jouer en défensive lorsque les pièces de l’adversaire ont déjà conquis notre terrain. Il existe ainsi de presque imparables coups de force de l’intelligence. Un Non franc et massif aux ignominies du temps, un refus sans ambages peuvent être le cheval de Troie d’une approbation ultérieure.
Notre époque est celle des cléricaricatures. En toute chose elle pose la marque infâme d’un sacerdotal parodique, d’une religiosité du néant, d’un ritualisme confiné aux aspects les plus dérisoires et les plus mesquins de l’existence. Tout, dans le monde moderne, est devenu « grand-messe » : le caritatif spectaculaire, les expositions auto-mobiles, n’importe quoi. Les psychanalystes pratiquent des confessions stipendiées, les chanteurs de variété s’entourent de flammèches tremblantes dans l’obscurité des salles de spectacle comme les Saints dans les Églises, lorsque les Églises s’ornent de banderoles publicitaires vert salade ou rose bonbon, sans doute pour donner à leurs architectures vénérables, mais anciennes, le ton moderne des supermarchés. Les hommes de ces temps relatifs ne cessent de communier, mais dans le lâche et le ridicule et sont parvenus à cette fin que les théocrates ne se proposaient point : la disparition de tout esprit critique.
La cléricature des Modernes n’a nul besoin de Sommes théologiques, d’arguments ou de contre-arguments, de démonstrations de l’existence de Dieu, puisque l’esprit critique auquel s’adressaient ces œuvres de Foi et de Sapience a disparu. Dévote d’elle-même, contre toute bonne foi et toute raison, la modernité s’adore sans arguments ni retenue avec cette indécence vertueuse et puritaine qui lui est propre. Grenouilles de bénitiers, mais pratiquant exclusivement dans l’ersatz, nos intellectuels modernes « consensuels » eurent ainsi le mérite insigne de nous redonner le goût de nier, d’exalter en nous de munificentes négations. À charge de revanche, nous ne témoignerons jamais assez de gratitude à ces béni-oui-oui de nous avoir redonnés ce sens juvénile du Non qui scelle en lui, comme un secret admirablement gardé, un Grand Midi d’affirmations souveraines !

Cette belle époque libérale, tolérante, individualiste et « démocratique » tolère tout, sauf la vérité, laissant, par voie de conséquence, la vérité qu’ils insultent et bafouent sauve de leurs atteintes, secrète comme la lettre volée d’Edgar Poe, dissimulée par excellence d’être exposée à vue de tous. Les niaiseries les plus abominables, les considérations les plus mesquines et les plus perverses sont tolérées sous la condition qu’elles n’engagent que l’individu qui les formule. Les auteurs seraient ainsi conviés aux grandes fêtes d’une subjectivité enfin libérée des « formes », des Idées platoniciennes et des Principes théologiques. Dégagées des hiérarchies, des styles et des autorités anciennes, l’individu serait appelé à manifester son « originalité » et son « droit à la différence »... Le problème, c’est que de l’originalité, on n’en voit guère. Avec la disparition des formes anciennes, c’est bien l’informe qui règne, ce comble de l’uniformité. Rien n’est plus uniforme que l’informe. Et les cléricaricatures modernes sont là pour en être les garde-chiourmes obtus et féroces.
La technique n’est jamais que l’expression d’un vœu secret, d’un agir, dirait Heidegger, dont l’essence n’a pas été interrogée. Ainsi le clonage physique succède à un clonage mental déjà réalisé. Il est vain comme le font les « comités d’éthique » – fétus de pailles édictant des règles à l’ouragan ! – de vouloir contester à la Technique son évident pouvoir de planification et de contrôle, comme sont vains, et d’une vanité sans borne, ces adeptes du Démos qui prétendent s’opposer aux dictatures qui, sans le règne du Démos dont elles sont issues, seraient restés de sombres et absurdes fantasmagories emprisonnées en des subjectivités heureusement jugulées. L’histoire intellectuelle de ces dernières décennies a été faite et refaite, c’est-à-dire grugée entièrement par ces imbéciles, parfois d’une odieuse componction, souvent dégoulinants de bons sentiments et de « révoltes » tarifées. Jamais la charité ne fut aussi profanée qu’en ces temps qui ont vu l’interdiction théorique de la vérité.
Que disent nos lieux communs de la vérité ? « Chacun a la sienne » car, bien sûr, « tout est relatif ». L’uniformisation ayant fait en sorte que cette non-vérité de chacun soit, par surcroît, dans le grégarisme triomphant, la même que celle du voisin, le seul scandale, le seul interdit, la seule hérésie porte sur la vérité, et, par voie de conséquence, sur la beauté où elle resplendit. L’étalage du laid, du vulgaire et de l’ignoble est devenu si général qu’il ne suscite plus même le dégoût ou l’horreur. Que cette laideur fût le véhicule du mensonge, nul ne s’en avise, l’interdiction de la vérité ayant été concomitante de la disparition de l’esprit critique. Comment, alors, prendre la mesure de notre abandon ?
Les mesures de notre déchéance pourtant ne manquent pas : ce sont tous nos écrivains, arpenteurs de châteaux kafkaïens, auteurs par vertu d’auctoritas, maîtres des rapports et des proportions, stylistes pour tout dire, que, il est vrai, presque plus personne ne lit et dont on s’efforce, par « modernisations » successives, de faire disparaître jusqu’au souvenir dans le brouet culturel des « créatifs » et autres « concepteurs », après diverses manœuvres d’embaumements ou de feintes commémorations . Je recommande cet exercice aux quelques hérésiarques des cléricaricatures, mes amis : saisissez le monde moderne par l’œil de Montaigne ou de Molière, nourrissez-vous de la colère de Léon Bloy ou de Bernanos, ouvrez vos entendements aux vastitudes de Saint-John Perse ou d’André Suarès, aiguisez votre désespoir aux flammes froides et courtoises d’Albert Caraco, armez votre désinvolture « dans les trains de luxe à travers l’Europe illuminée » avec Valery Larbaud, soyez sébastianistes avec Pessoa et Dominique de Roux, et retrouvons-nous enfin à la fontaine claire de la Sagesse du Roi Dormant d’Henry Montaigu ! La fausseté s’en dissipera comme nuées, après la foudre et le vent.

Les Églises, les Dogmes, les Rites et les Symboles vidés de leur substance, devenus écorces mortes, mensonges, dérisoire « moraline » comme l’écrivit Nietzsche, c’est toute la société, ce Gros Animal, qui est devenue cléricale, despotique, inquisitoriale, s’adorant elle-même sous le nom de « Démocratie », insatiable de louanges, d’or, de vénérations et de crimes d’une ampleur dont aucun Empereur fou n’eût osé rêver ! Dans sa fange de hideurs médiatiques et de communication de masse, le Gros Animal se repaît de ses « vérités » digérées depuis longtemps. Tout est relatif, bien sûr, sauf lui, sauf son aptitude infinie à faire ses cellules à sa ressemblance. Qui, après Albert Cohen, saura reprendre la description de la « babouinerie » foncière de l’homme moderne, aussi policé qu’il se veuille, dans ses conseils d’administration, dans ses dîners, non moins que dans les stades, ou les boîtes de nuits, ces cavernes pour pithécanthropes énervés?
Que l’on s’avise de vouloir désabuser une seconde ses contemporains de leur illusion « moderne » : ils vous fusillent. « Les ratés ne vous rateront pas », sachez-le bien ! Comme disait Manet : « Ils vous fusillent et vous font les poches ». Hors de l’adoration unanime du Gros Animal nommé, pour la circonstance, « Démocratie », point de salut ! Le Démos est sacré, toutes ses erreurs deviennent la Vérité, qui, l’on sait, « est relative »... L’absolutisation du relatif, voilà bien la grande trouvaille imparable du Démos et de ses adorateurs. Que dit exactement le « nous » du Démos ? La réponse est chez Rimbaud, dans son poème précisément intitulé Démocratie :
« Aux centres nous alimenterons les plus cyniques prostitutions. Nous massacrerons les révoltes logiques... Aux pays poivrés et détrempés ! – au service des plus monstrueuses exploitations industrielles ou militaires. Au revoir, ici, n’importe où. Conscrits du bon vouloir, nous aurons la philosophie féroce ; ignorants pour la science, roués pour le confort ; la crevaison pour le monde qui va. C’est la vraie marche. En avant, route ! »

« Conscrit du bon vouloir », le « démocrate » moderne n’en finit plus de célébrer la liberté qu’il abandonna à la société de contrôle et « au service des plus monstrueuses exploitations industrielles ou militaires ». Tout lui va, et sa philosophie féroce, sa haine de toute Sapience, ira, sans états d’âme, faire les poches d’Arthur Rimbaud en personne pour en repeindre son ciel publicitaire, avec de bonnes intentions. « Roué pour le confort », on ne saurait mieux dire, tant il est vrai que le Moderne passe allègrement sur toutes les abominations, génocides, massacres, bombes atomiques du XXème siècle qui lui paraît, tout de même, bien aimable de lui avoir prodigué le four à micro-ondes et la voiture individuelle ! C’est bien : « la crevaison pour le monde qui va ». Je ne sais plus quel polémiste avait accusé les jeunes gens d’Action française d’être de ceux qui sont prêts à abattre une forêt pour se faire une badine. Le Moderne bien-pensant, lui, est prêt à consentir à l’extermination de peuples entiers, de préférence « archaïques », pour l’incalculable satisfaction que lui procurent ses nourritures congelées, ses gadgets technologiques, son chauffage tempéré, son cercueil de tôle puant, sa télévision et son ordinateur qui le relient en permanence à toutes les immondices du temps. Comment dire? « C’est la vraie marche » !
Je ne vois d’autre destination à cette marche que la disparition de la France. L’exercice permanent de contrition, d’autocritique, de dénigrement de soi-même auquel se livrent les intellectuels français, au point de ne plus tolérer dans le monde des lettres que le traduidu, fût-il directement écrit en français, relève, quand bien même il se targue d’être « de gauche », de cette vieille logique pétainiste selon laquelle les Français devaient expier leurs péchés en supportant la présence chez eux des Allemands. Le relativisme faisait aussi en ces temps-là ses ravages. Pourquoi être Français plutôt qu’Allemand ? L’exercice de contrition se poursuit de nos jours. Pourquoi être Français plutôt qu’Européen ou Américain ? Pour être, tout simplement, si le non-être nous ouvre ses bras pour disparaître délicieusement dans la consommation pure et simple des êtres et des choses ! Ce nihilisme est d’essence collaborationniste. Il invoque l’état de fait, la modernité, le réalisme comme autant d’instance auxquelles il est impossible de ne pas céder, il accable la France de tous les maux, lui dénie toute légitimité, l’écrase sous des fautes supposées ou réelles, se dresse en procureur ou en inquisiteur contre toutes les figures ayant incarné une part de notre tradition, de notre style et de notre liberté pour les ravaler plus bas que terre, les ridiculiser ou les bannir. Il n’est point d’auteur, de Prince, de chef d’État qui échappe à ces révisions dépréciatrices. Tout l’effort de nos intellectuels de ces dernières décennies semble avoir été porté par ce révisionnisme prétendument « démystificateur ». Ni Hugo, ni Baudelaire, ni Flaubert, ni Stendhal, ni Péguy, ni Malraux n’ont échappé à ces éreintages systé-matiques formulés en traduidu par des semi-illettrés bouffis de vanité. Les temps où l’on trouvait encore les œuvres complètes de La Fontaine, de Victor Hugo et d’Aragon dans les bibliothèques municipales est révolu. Place aux journalistes et aux présentateurs de télévision ! Même les auteurs chéris de la Gauche, cultivatrice avisée de la mauvaise conscience française, pour autant qu’ils étaient redevables à quelques grands ancêtres, sentent désormais le soufre pour les narines pincées des nouvelles cléricaricatures. Ni Breton, avec son style Grand Siècle, ni Gide, cet hédoniste protestant, ni Foucault, ni Deleuze, ces lettrés nietzschéens, ni même Sartre, épigone de Heideg-ger ou de Husserl, ne trouvent plus grâce dans ce nouvel ordre moral subjugué par l’idée enivrante de la disparition pure et simple de la France.
L’écrivain français, quel qu’il soit, on l’aura compris, est un empêcheur de penser en rond. Aussi bien, les cléricaricatures voudraient-elles en finir une fois pour toute avec ces survivances déplorables. L’abaissement du roman français de consommation courante ayant rompu toutes les amarres avec l’espace littéraire, on en finit presque par regretter Robbe-Grillet, artisan consciencieux de dédales à la syntaxe parfaite. La langue française ne serait-elle plus qu’une branche sèche, une substance lyophilisée à l’usage des pharmacopées universitaires ? Notre avenir littéraire n’est-il plus que dans la considération à peine nostalgique d’un alignement de bocaux étiquetés ? Soyons la preuve du contraire ! Les feuillages des Contemplations bruissent dans nos âmes, et la baudelairienne plongée dans l’inconnu ne laisse point d’exalter nos sens en tissages synesthésiques dans l’espace incandescent de notre entendement. Ce que nos auteurs éveillent en nous, ce n’est point l’hybris du glossateur, ou l’outrecuidance de l’historiographe, c’est un prodigieusement complexe sentiment de reconnaissance.

La reconnaissance certes est gratitude, mais cette gratitude se hausse jusqu’à la paramnésie. Ces paysages nous sont mystérieusement familiers et pourtant ils restent à découvrir. Les œuvres nous invitent ainsi à des missions de reconnaissance. Lorsque toutes les vérités sont détruites, nos Patries deviennent intérieures. Elles ne sont plus que de Ciel et de Mer, comme sont de Ciel, les pierres des chapelles romanes, et de Mer, les champs à perte de vue dans l’or du temps que récite Charles Péguy, chantre de Notre Dame. Connaître, c’est reconnaître et renaître à nouveau dans la mort immortalisante du Logos. Ces phrases que nous lisons, ne leur donnons-nous point une nouvelle vie ? Dans ce passage fulgurant du signe écrit à l’image de la pensée, n’est-ce point tout le mystère de la résurrection qui, à chaque fois, se joue ?
Comment ne pas comprendre, alors, que la volonté politique qui consiste à nous exiler de notre langue et de nos œuvres n’est autre qu’une volonté contre le Logos, contre le Verbe, un Dédire fanatique opposé au Dire des merveilles et des inquiétudes ? Comment ne pas comprendre que l’arasement de nos singularités porteuses de Formes signifie non seulement la destruction de la culture « élitiste », mais l’extinction des possibilités les plus inattendues de la vie magnifique ? Comment définir la « culture de masse », en dehors de ses caractéristiques de facilité et d’ignominie sinon par son caractère prévisible ? L’homme devant son poste de télévision ne s’annihile si considérablement que parce que toute sa satisfaction réside dans la prévisibilité absolue de ce qu’il va voir. Ce qu’il voit, il l’a déjà vu, et cette certitude lui permet de voir sans porter aucune attention à ce qu’il voit. Ainsi œuvre le Dédire, en défaisant peu à peu en nous cette faculté éminente de l’intelligence humaine : l’attention.
L’aversion de plus en plus ostensible que suscitent les œuvres littéraire trouve son origine dans l’attention qu’elles exigent. En perdant l’intelligence des œuvres, ce ne sont pas seulement les auteurs, ces hommes de bonne compagnie, qui s’éloignent de nous, c’est l’intelligence même du monde qui nous est ôtée à dessein. Ce qui se substitue au grand art littéraire, poétique et métaphysique n’est point une autre culture, que l’on voudrait orale ou imagée, mais l’omniprésence de l’écran publicitaire. Celui qui n’entend plus le chant du poète, comment entendrait-il le chant du monde ?

À parler ainsi du chant du monde, les modernes auront beau jeu de nous réduire à quelque lyrisme obsolète. Il ne s’agit pas seulement du chant, mais aussi de la vision, de la nuance, de la conversation, de l’attention pure et simple à la complexité rayonnante des choses. Il ne s’agit pas seulement de divaguer dans l’essor des voix, mais aussi de faire silence, d’entendre les qualités du silence, de l’attente. Il s’agit d’être à la pointe de l’attention, à l’entrecroisement fabuleux des synchronicités, à la fine pointe de l’esprit. Or, toutes ces merveilles, qui nous furent données, et qui justifient les prières de louange et de gratitude de toutes les religions, peuvent aussi nous être ôtées, non par la mort dont nous ne savons rien mais par l’inattention, le déclin de l’entendement. Dans ce combat, notre seule arme est le Logos, et la manifestation la plus immédiate et la plus humaine du Logos est notre langue, et notre langue est française.
Sitôt avons-nous énoncé cette évidence que les plus aimables de nos contemporains nous traitent de « souverainistes » et, pour les plus vindicatifs, de « nationalistes », voire de « fascistes » ! Quels temps étranges, vraiment, où la simple évidence, la vérité pure et simple fait de nous, pour d’autres qui prétendent ne croire en rien, des hommes de parti-pris, des réactionnaires et, pourquoi pas ? des « ennemis du Peuple ». Alors que nous n’avons d’autre parti que de nous déprendre, de laisser agir en nous à sa guise le génie d’une langue qui ordonne et dissémine nos pensées, nous voici soupçonnés d’être pris, et même d’être pris sur le fait. Le propre des ennemis du Logos n’est-il pas de ne rien entendre, d’être sourds aux arguments comme aux effusions de la beauté ? Aussi bien nous ne leur parlons pas : nous mettons simplement en garde ceux qui entendent contre ceux qui ne veulent rien entendre. Nous mettons en garde les esprits libres contre ceux qui n’aiment que la servitude, nous leur montrons où sont les armes de résistance et les instruments de connaissance. Aussi avancée – comme on le dit d’une viande avariée – que soit notre société, aussi perfectible que soit la planification, il suffit de quelques esprits pour se rendre victorieux des plus colossales négations de l’Esprit. L’Esprit, c’est là toute notre force, ne se mesure point en terme quantitatif. L’erreur indéfiniment propagée demeure impuissante contre la vérité la plus secrète, pourvu que quelques intelligences la redisent dans le secret du cœur. Selon Joseph de Maistre les adeptes de l’erreur se contredisent même lorsqu’ils mentent. Le plus titanesque amoncellement d’erreurs variées et de mensonges n’a pas plus de poids, dans les balances augurales de l’Esprit que la « montagne vide » des taoïstes. Le vide du mensonge revient à « rien », alors que le vide lumineux du Tao revient au Tout comme à sa source désempierrée. Le Logos est cette source qui désempierre les sources de l’âme, et, dans son frémissement immédiatement sensible, cette source, pour nous, est française. Pour le monde comme il va, pour cette marche, pour cette crevaison moderne, nous serons comme les Tarahumaras d’Antonin Artaud : nous refuserons d’avancer, nous nous rassemblerons autour de notre plus illustre bretteur, notre poète-guerrier, Cyrano de Bergerac, pour un voyage dans les empires de la Lune et du Soleil.
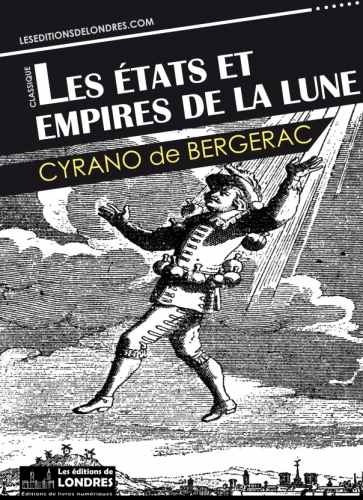
Soyons, comme Cyrano, téméraire. Cet au-delà du courage – que l’on répute parfois inconscient alors qu’il n’est peut-être qu’une conscience extrême consumée dans son propre feu de lumière – fait la force de nos désinvoltures charmantes. Les temps de la témérité spirituelle sont revenus, comme les cerisiers en fleurs. Soyons téméraires d’aimer notre langue et notre Patrie, soyons téméraires d’aimer ce qui nous enchante et nous allège ! Soyons téméraires d’envols et d’intelligences retrouvées avec nos Maîtres d’armes et de mots. Soyons téméraires à devancer nos grandes Idées, qui nous suivent, comme le disait Nietzsche « sur des pattes de colombe ». Soyons téméraires, car nous savons, de science certaine et aiguë, que nous avons tout à perdre et rien à gagner. Voici bien deux siècles que nous avons laissé gagner nos ennemis et ceux-ci pourrissent dans leur gain ou vont dans le sens de l’histoire, comme des animaux morts au fil de l’eau. Voici bien deux siècles, ou deux millénaires, que notre témérité de perdants éperdus nous tient en la faveur des Anges et des dieux.
Pour le téméraire, le temps ne compte pas, ni le décompte des secondes qui nous rapprochent de la mort, mais le vif de l’instant, dénombrement perpétuel de l’infini. Par « la preuve par neuf des neuf Muses », dont parlait Jean Cocteau, nous sommes assurés de retrouver le nombre exact de nos syllabes et de nos amis : ceux qui nous aiment dans les prosodies du temps qui passe. L’innocence du devenir nous convainc de la pérennité de l’être. Ne déméritons point de notre seule témérité d’être ! Rédimons les dieux bafoués par les temps moroses, les dieux qui dorment en nous, éveillons l’Ange de la fleur du cerisier, dans l’œcuménisme des racines, des branches, des fleurs, des parfums et des essences ! Éveillons l’Ange de la pierre et l’Ange du regard. Éveillons témérairement l’Archange de la France !

Il nous importe peu d’avoir contre nous l’Opinion majoritaire. Les majorités sont trompées, ou trompeuses. Une foule est toujours inférieure aux personnes qui la composent. Peut-on parler de l’intelligence d’une foule ou de son instinct ? Une foule ne pense pas davantage qu’une amibe. Régler sa pensée sur l’Opinion, c’est renoncer purement et simplement à la pensée. La première témérité spirituelle consiste à penser contre la foule, c’est-à-dire à penser. Ce que l’on nomme la transcendance n’est autre que cet instant où la pensée se dégage de l’Opinion. Cette pensée n’est point naturelle. Ce dont elle témoigne, aux risques et périls de celui qui s’en fait l’ambassadeur, est bien d’ordre surnaturel. Les philosophes de l’Antiquité ou du Moyen-Âge, qui croyaient en la divinité du Logos, portaient en leur croyance cette certitude pieuse et audacieuse d’une appartenance surnaturelle. N’être point soumis au Gros Animal, c’est être un Unique pour un Unique. Aussi bien la France dont nous parlons, dont nous chantons les Sacres et les prestiges, dont nous méditions la disposition providentielle, n’est point la nation, ni le peuple, concepts encore trop naturalistes à notre goût, mais une Idée, une Forme.
Cette Idée ou cette Forme sont l’espace de notre liberté sans cesse reconquise sur l’Opinion, le Gros Animal, le Démos, la Foule, la Quantité. Sans cesse, disons-nous, car sans fin est la bataille qui se déroule entre la perpétuité de la nature et l’éternité de la Surnature, entre l’immanence ourouborique et la transcendance sise dans l’Instant, entre le déroulement sans fin des temps et la présence immédiate de l’éternité. Nous ne célébrons point l’individu réduit à lui-même dans un monde « mondialisé » car cet individu ne serait qu’un atome interchangeable dans l’uniformité générale. Seule une Forme peut se rendre victorieuse de l’uniforme confusion des formes.
Les progrès de l’individualisme uniformisateur furent tels, ces derniers temps, que la nature même des hommes semble en avoir été changée. Détachée de la Sur-nature, la nature elle- même se soumet à l’uniformité industrielle. Les hommes de notre temps, comme les objets naguère artisanaux et devenu industriels, se ressemblent de plus en plus. Les voix, les intonations, les gestes, les situations des corps dans l’espace, les habillements, les complexions psycho-physiologiques, les dramaturgies intérieures deviennent de plus en plus identiques et méconnaissables. De cet étiolement des singularités témoigne aussi bien le spectacle de la rue, la lecture des premiers romans, les papiers des folliculaires que l’art cinématographique et le jeu des acteurs. Les singularités extrêmes de Louis Jouvet, de Michel Simon, de Sacha Guitry laissent la place à des voix, des élocutions, des discours, des présences, et mêmes des visages aux expressions de moins en moins dissemblables. Loin d’avoir libérés ou accrus les caractères propres des individus, l’individualisme moderne paraît avoir cédé à une codification de plus en plus stricte des comportements. Par un paradoxe que nos philosophes feraient bien de méditer, la disparition des types s’avère concomitante de celle des singularités.
On ne saurait trop surestimer les enjeux de la volonté générale. La prétendue « émancipation » du vouloir humain des Formes, des sagesses et des civilités antérieures, nous laisse avec une volonté de conformité sans exemple dans toute l’histoire humaine : les Formes traditionnelles étaient bien davantage les gardiennes de nos singularités par l’établissement dans un réseau d’appartenances, différent pour chacun. Dans les limites qu’elles prescrivaient, elles nous donnaient une chance d’être dissemblables et uniques. Les pédagogies anciennes si normatives, avec leur insistance sur la grammaire, la rhétorique, l’histoire enseignée comme la chronique d’une communauté de destin formaient des individus infiniment divers dans leurs goûts, leurs préférences, leurs styles et leurs allures, alors que les pédagogies modernes, où le professeur n’est plus qu’enseignant, où les cours magistraux sont bannis, où la « spontanéité » est considérée comme une valeur, nous donnent des générations de clones qui remâchent les mêmes idiomes, s’asservissent aux mêmes songes publicitaires et craignent par-dessus tout de paraître original le moins du monde. Il y eut, paraît-il, d’étranges temps heureux où l’inclination pour l’originalité, la distinction, le refus du conformisme, furent des signes de juvénilité. Le moins que l’on puisse dire, c’est que nous n’en sommes plus là. Ce monde nouveau est bien vieux. Si nous n’avions gardé souvenir de ces jeunes vieillards que furent Ernst Jünger ou Gustave Thibon, nous serions tenté de croire, au vu et su de ce qui nous entoure, que le propre de la nature humaine est d’être cacochyme du berceau à la tombe !
La témérité spirituelle nous enseignera qu’il n’est jamais trop tard pour devenir jeune, et qu’il n’est point d’uniformité qui ne puisse être vaincue par les ressources d’une singularité puisée aux profondeurs de la Tradition. Encore faut-il des sourciers qui nous indiquent le cours des sources profondes.
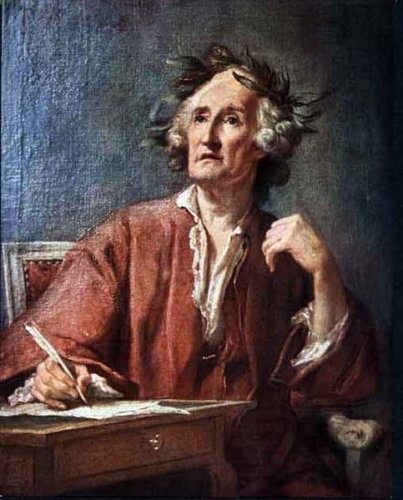
Les poètes sont nos sourciers. Il serait bien vain de chercher les preuves étincelantes de la témérité spirituelle chez les idéologues, les politiciens, même lors-qu’ils apparaissent comme des têtes brûlées, des instigateurs de chaos ou des terroristes, lorsque les temps que nous vivons sont déjà intégralement chaotiques et terroristes, lorsque de toute forme d’esprit il ne reste que des écorces de cendre. La tragédie dérisoire des nihilistes tient de cette évidence : l’époque où ils se manifestent est déjà plus nihiliste qu’eux. Leurs bombes, leurs vociférations, leurs « actes gratuits », la dégradation des valeurs, à laquelle ils s’appliquent méthodiquement, sont déjà en retard sur leur temps. En ces confins de l’Âge sombre où nous nous trouvons, le nihilisme actif ne passe plus qu’à travers des portes largement ouvertes. Les « démons » de Dostoïevski n’ont plus même affaire à des simulacres de valeurs, c’est le simulacre même de la négation des valeurs qui s’est érigé en valeur. La non-valeur règne théocratiquement, si bien que le nihilisme, pour âpre qu’il se veuille, fait désormais figure de passéiste. La « récupération » publicitaire des contestations n’est que la part la plus visible de ce phénomène. Lorsque l’espèce humaine en tant que telle, revêtue de la pourpre des suprêmes autorités travaille sans relâche à l’anéantissement de l’esprit humain, les révoltes contre l’esprit sont remises à leur place. Lorsque le nihilisme et l’anarchie sont généralisés, le nihiliste et l’anarchiste sont suprêmement conformistes, lorsque la négation de l’autorité est devenue le pouvoir incontesté, l’autorité seule devient l’expression de la véritable témérité spirituelle.
Les poètes sont nos sourciers, c’est assez dire qu’ils recueillent en eux des prérogatives immémoriales. Il n’y a point de grande différence de nature entre un vrai poète de notre siècle et Virgile ou Homère. Au meilleur de sa forme, le poète contemporain entre dans les pas de ces prédécesseurs. C’est toujours la célébration du beau cosmos miroitant, les exaltations de l’âme, les courants obscurs ou lumineux de la conscience, la fine pointe de l’intelligence qui font l’honneur de la poésie. La musique et l’architecture s’accordent toujours avec « l’âme de la danse » dont parlait Valéry. L’invisible et le visible s’entre-tissent toujours à la faveur de l’éclairement du langage humain lorsqu’il s’interroge sur la source silencieuse dont il provient. Le poète ne change ni de nature, ni de dessein. La bouche d’Ombre et les voix des ancêtres parlèrent à Victor Hugo comme aux temps les plus anciens de l’humanité, Antonin Artaud n’a rien à envier aux brutales ruptures de conscience provoquées autrefois par les chamanes, ni Mallarmé aux Mages égyptiens tels que les imaginèrent les philosophes néoplatoniciens. Saint-John Perse, Paul Claudel ou Ezra Pound établissent le Logos dans l’immémoriale vastitude épique ; l’effulgence des émanations plotiniennes frémit dans les prosodies de Shelley et les proses de Saint-Pol-Roux. Francis Ponge lui-même, qui tente de nous donner une poésie « matérialiste », se relie directement à Lucrèce. Quant aux Surréalistes, ils s’efforcèrent bravement de divaguer à l’exemple des Pythies.

Il n’est pas étonnant que le plus durable effort de la didactique moderne eût été d’en finir avec ce que Pierre Boutang nomme, à propos de Catherine Pozzi, « l’intention chrétienne » dans la poésie. En finir avec l’intention chrétienne, c’était aussi en finir avec l’intention païenne, platonicienne et plus généralement, avec le recours ultime et premier au langage comme processus de renaissance immortalisante. « Que le langage sauve l’existence, écrit Pierre Boutang, la retienne dans l’être, que de la pouvoir retenir soit comme une première preuve qui en appelle d’autres, et réfute le conseil désespéré des harpies et des oiseaux de nuit, Maurras n’en douta jamais ». Nous reviendrons une autre fois à Maurras ; laissons pour le moment chanter en nous l’idée téméraire du refus d’écouter le conseil des harpies. Qu’importe alors que l’intention soit chrétienne ou antérieure au christianisme si, en effet, toutes les merveilles ultérieures portent en elles les sapiences antérieures. L’interdiction, édictée par les sinistres satrapes de la « modernité poétique » de nommer le Christ ou Apollon, de confiner le grand art de la prosodie à de ridicules manipulations, témoigne assez que ni les Dieux, ni le Fils de Dieu n’ont plus leur place dans le Règne de la Quantité. Les poètes naguère encore ordonnés aux Muses, requis par l’impersonnalité active des visions et des Symboles, ou par la seule beauté fugitive en apparence des instants, furent enrôlés dans ces assez fastidieux travaux de démantèlement du langage, de déstructuration, de déconstruction, où la cuistrerie voisine avec l’ignorance pour mieux confirmer l’établissement déjà généralement acquis du néant du langage et de l’existence, et l’étrange décret du salut impossible.

Alors que la poésie fut, et demeure, dans son essence rendue hors d’atteinte, sauf, aux élus – précisément les poètes du Vrai et Beau ! – le chant des possibles, on voulut l’asservir à la seule tâche de se rendre impossible à elle-même, de s’exclure du possible salut, et du monde lui-même. « Il y a, écrit encore Pierre Boutang, une piété naturelle, ni chrétienne ni païenne exclusivement, liée à l’homme et à sa croyance que tout finalement est divin, reflète une transcendance et quelque influence plus qu’humaine. Ce qui n’est pas humain, c’est de ne croire qu’en l’homme, et prétendre que la nature, ce n’est que la nature. » Cette inhumanité foncière de l’homme ne croyant qu’en lui-même, il n’est que de parcourir les annales du XXème siècle qui vient de finir pour se convaincre qu’elle ne fut rien moins qu’abstraite. L’homme qui ne croit qu’en l’homme tient en piètre estime la vie de ses semblables et, sitôt ne distingue-t-il plus dans la nature l’émanation de la Surnature, qu’il s’autorise un pillage sans limite. Si le Moderne est enclin à l’éloge de l’infini, c’est avant tout cet infini du pillage qui lui plaît, avec la certitude, la seule qui lui reste, de ne plus jamais être redevable de rien. Si l’homme n’est que l’homme, si la nature n’est que la nature, toute exaction est permise, et l’on a beau dire que cette permission doit être mesurée, elle n’en demeure pas moins sans limites.
La poésie seule connaît le secret de la Mesure. Le paradoxe du temps est que cette Mesure est devenue hors d’atteinte et que la limite, la limite sacrée, semble perdue de vue. La nécessaire recouvrance de l’humilité tient désormais à la témérité spirituelle. L’infini moderne est l’infini du prisonnier, du maniaque, du disque rayé. On tourne en effet infiniment dans la cour de sa prison. Les ombres sur les murs de la caverne demeurent infiniment des ombres. La servitude se nourrit infiniment du nihilisme qu’elle croit opposer à sa propre conscience malheureuse. À la différence de la philosophie et de la médecine paracelsienne, qui préconisait de faire du mal un remède, et de changer ainsi le plomb en or, le Moderne excelle à faire du remède un mal et à changer l’or en plomb. À ce monde plombé, lourd et opaque, seule la témérité spirituelle du poète oppose une fin de non-recevoir. Cette fin, cette limite, est contenue dans le secret de la Mesure et dans le secret, plus profond encore, qui donne la Mesure. Dans le mouvement et l’immobilité du poème, le poète reçoit le don de la Mesure.
Transcendante, verticale, brisant le cercle de l’infini ourouborique, la Mesure s’établit dans un chant qui éveille toutes les vertus bienheureuses du silence. Par la Mesure, l’Intellect devient musique, les nombres se font incantation, et la prosodie art suprême de l’entendement. De même que les nihilistes étaient les retardataires du nihilisme de l’époque, l’arrière-garde se prenant, par une illusion touchante, pour l’avant-garde, les irrationalistes modernes s’acharnèrent sur une Raison déjà détruite, s’instaurèrent « déconstructeurs » de décombres sans comprendre que la raison qui ne veut être que raisonnable, oublieuse de sa profonde connivence avec le Mystère, n’est que pure déraison. Tel fut sans doute le sens du fruit biblique détaché de l’arbre de la connaissance. Ce n’est point la Connaissance qui nous perd, ni même le fruit de la connaissance, mais bien d’être un fruit détaché, réduit à la consommation ou à la mort.
Le poème, dont la nécessaire témérité spirituelle révèle en nous la sainte humilité est l’Arbre tout entier dont nous parlions, avec ses racines, ses branches, ses fruits, ses bruissements, et même les oiseaux qui viennent s’y poser et nous parlent la langue des Oiseaux. Sachons entendre ce qui nous est dit dans le silence du recueillement, sachons dire ce qui ne se dédit point, dans la fidélité lumineuse de la plus haute branche qui vague dans le vent. Les dieux sont d’air et de soleil, le Christ est Roi et l’Esprit-Saint veille, par sa présence versicolore, sur notre nuit humaine.
Luc-Olivier d'Algange.
17:22 Publié dans Littérature, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, lettres, lettres françaises, luc-olivier d'algange, philosophie, témérité |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 22 janvier 2022
L'ère hyperindustrielle et la misère du symbolique

L'ère hyperindustrielle et la misère du symbolique
Sur la parution en Italie d'un livre de Bernard Stiegler, qui s'est donné la mort en août 2020
par Giovanni Sessa
Source : Barbadillo & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/l-era-iperindustriale-e-la-miseria-del-simbolico
 Depuis quelque temps, nous soutenons qu'il serait nécessaire de se débarrasser de l'idée néfaste de la fin de l'histoire. La société contemporaine n'est pas le "meilleur des mondes possibles", elle est surmontable et amendable. Nous avons été confortés dans cette position par la lecture d'un récent ouvrage du philosophe français Bernard Stiegler, La miseria symbolica. L'epoca iperindustriale, publié par Meltemi (pour les commandes : redazione@meltemieditore.it ; 02/22471892, pp. 164, euro 16.00). Le volume comprend une introduction de Rossella Corda, une postface de Giuseppe Allegri et un essai du Gruppo di ricerca Ippolita, qui édite les œuvres de Stiegler en Italie.
Depuis quelque temps, nous soutenons qu'il serait nécessaire de se débarrasser de l'idée néfaste de la fin de l'histoire. La société contemporaine n'est pas le "meilleur des mondes possibles", elle est surmontable et amendable. Nous avons été confortés dans cette position par la lecture d'un récent ouvrage du philosophe français Bernard Stiegler, La miseria symbolica. L'epoca iperindustriale, publié par Meltemi (pour les commandes : redazione@meltemieditore.it ; 02/22471892, pp. 164, euro 16.00). Le volume comprend une introduction de Rossella Corda, une postface de Giuseppe Allegri et un essai du Gruppo di ricerca Ippolita, qui édite les œuvres de Stiegler en Italie.
Le lecteur doit savoir que le penseur français ne se limite pas à élaborer un diagnostic des causes qui ont produit l'ère hyperindustrielle, mais propose une thérapie pour le malaise individuel et communautaire qui caractérise les relations humaines en son sein. En premier lieu, il se débarrasse du cliché de la post-modernité lyotardienne et baumanienne, qui porte implicitement en soi la référence à un prétendu post-industrialisme, trompeur pour l'exégèse du présent. Il serait plutôt approprié d'utiliser l'expression d'âge hyper-industriel pour désigner notre époque: elle permet de comprendre l'ingérabilité de la tèchne et, surtout, le lien qui unit l'esthétique et le politique en un seul. Notre époque est celle de la misère du symbolique.

Ce paupérisme ne conduit pas à la définition "du je et du nous, à partir de la pauvreté d'un imaginaire colonisé ou surexploité par les technologies hyper-médiatiques [...] qui invalident la prolifération d'un narcissisme primaire physiologique" (p.9). Conscient de la leçon de Deleuze, Post-scriptum sur les sociétés de contrôle et, en ce qui concerne les processus d'individuation, de celle de Simondon, Stiegler présente une analyse de la pensée symbolique comme pharmakon, poison et antidote à la fois: "dans le sillage de cette longue tradition qui part de Platon" (p. 10), conclut Corda.
Certes, ni les guerres conventionnelles ni les conflits sociaux n'ont disparu, mais le monde contemporain connaît une guerre plus envahissante, celle qui se déroule dans la sphère "esthétique", où la con-sistance symbolique est en jeu. Pour Stiegler, le terme "esthétique" désigne le "sentiment" en général. Le politique vise la construction d'un pathos commun "qui intègre notre partialité-singularité réciproque [...] en vue d'un devenir-un" (p. 11), par l'établissement de relations de sympathie, fondées aristotéliciennement sur la philia. On peut en déduire que la politique est un acte esthétique basé sur "la participation e-motive-créative" (p. 11), visant à la construction du corps social. Elle peut induire la réalisation du nous ou ouvrir des échappatoires dissolvantes. La seconde hypothèse se produit lorsque les "affects" sont pris au piège de l'exploitation menée par la Forme-Capital qui, colonisant l'imaginaire par le marketing, dirige la dimension désirante de l'homme et marchandise la vie.
 Le capitalisme cognitif et la société de contrôle, son corrélat historique, vivent de cet abus esthétique, si subtilement puissant qu'il détermine la mise à zéro de la honte prométhéenne qui, selon Anders, aurait accompagné, en tant que trait "affectif", l'âge de la technologie. Il est nécessaire, souligne passionnément le penseur, d'échapper à l'emprise de l'hétéro-direction socio-existentielle et "de remettre en mouvement les processus de désir actif " (p. 11). La guerre esthétique peut être gagnée à condition de connaître les substrats complexes de rétentions sur lesquels se structure la production imaginale. Il ne suffit pas de s'arrêter aux rétentions primaires et secondaires analysées par Husserl. Les premières se constituent sur le présent de la perception (l'écoute d'une symphonie), les secondes sur les processus d'image (le souvenir de cette écoute), mais les plus pertinentes, dans la phase actuelle, sont les rétentions tertiaires, produites par la mémoire externalisée que nous fournit la technologie. Dans ce contexte, nous avons affaire à des "objets temporels industriels", qui donnent lieu à la répétition infinie des expériences et des perceptions et qui influencent la définition du moi et du nous: "ils se déposent dans une sorte d'archive de base, à la fois physique [...] et abstraite" (p. 13). De cette façon, nous atteignons le point d'écouter sans plus entendre, nous écoutons mécaniquement, comme des magnétophones humains.
Le capitalisme cognitif et la société de contrôle, son corrélat historique, vivent de cet abus esthétique, si subtilement puissant qu'il détermine la mise à zéro de la honte prométhéenne qui, selon Anders, aurait accompagné, en tant que trait "affectif", l'âge de la technologie. Il est nécessaire, souligne passionnément le penseur, d'échapper à l'emprise de l'hétéro-direction socio-existentielle et "de remettre en mouvement les processus de désir actif " (p. 11). La guerre esthétique peut être gagnée à condition de connaître les substrats complexes de rétentions sur lesquels se structure la production imaginale. Il ne suffit pas de s'arrêter aux rétentions primaires et secondaires analysées par Husserl. Les premières se constituent sur le présent de la perception (l'écoute d'une symphonie), les secondes sur les processus d'image (le souvenir de cette écoute), mais les plus pertinentes, dans la phase actuelle, sont les rétentions tertiaires, produites par la mémoire externalisée que nous fournit la technologie. Dans ce contexte, nous avons affaire à des "objets temporels industriels", qui donnent lieu à la répétition infinie des expériences et des perceptions et qui influencent la définition du moi et du nous: "ils se déposent dans une sorte d'archive de base, à la fois physique [...] et abstraite" (p. 13). De cette façon, nous atteignons le point d'écouter sans plus entendre, nous écoutons mécaniquement, comme des magnétophones humains.

Cette situation, et son possible renversement, peut être déduite, selon Stiegler, du film de Resnais, On connaît la chanson. La rétention tertiaire a ici le visage de la répétition du refrain des chansons, devenues "mémoire collective", non pas d'un "nous consolidé", mais du "on social inauthentique", dont Heidegger a parlé magistralement. En même temps, les protagonistes de ce film visent à transvaloriser, à transformer leur "souffrance" symbolique en une action symbolique. C'est la possibilité esthético-politique cachée dans la misère imaginaire. Le penseur stimule le trait poïétique des hommes, afin qu'ils adhèrent à "une autre capacité d'imaginer" (p. 15), qui ne peut se fonder sur un retour à un passé donné, non touché par le système technique, mais qui doit en découler. Le Gestell doit être considéré comme un lieu de décision : on peut y procéder à la mise à l'écart définitive du je et du nous (l'état actuel des choses) ou à leur re-constitution, au-delà de la marchandisation universelle en cours (cette position ne semble pas différente de celle du Travailleur de Jünger).
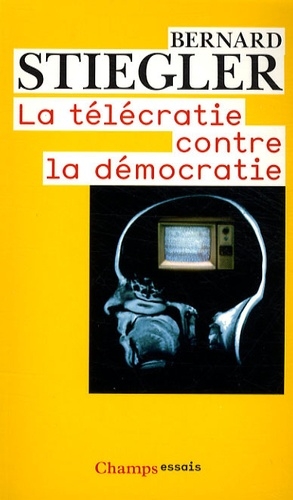 Seule l'adhésion à une philosophie imaginaire, a-logique, comme l'idéalisme magique évolutif, peut permettre au poietes de se sentir perpétuellement exposé au novum, aux rythmes de la physis et au fondement qui la constitue : la liberté.
Seule l'adhésion à une philosophie imaginaire, a-logique, comme l'idéalisme magique évolutif, peut permettre au poietes de se sentir perpétuellement exposé au novum, aux rythmes de la physis et au fondement qui la constitue : la liberté.
Nous avons trouvé la lecture du livre stimulante. Nous ne pouvons pas être d'accord avec l'auteur lorsqu'il affirme que la misère symbolique du présent s'est manifestée clairement dans le succès électoral des Lepénistes le 21 avril 2002. Peut-être pouvons-nous lire dans ce vote une réponse "instinctive" à la misère symbolique, qui nous semble au contraire incarnée de manière paradigmatique par le mouvement "En marche" d'Emmmanuel Macron, dans lequel les certitudes "solides" de la gauche se sont dissoutes.
Une dernière considération : il est paradoxal que des auteurs, issus de mondes intellectuels très éloignés de celui de Bernard Stiegler, partagent certaines de ses analyses. Sur ce sujet, nous attendons des contributions des représentants de la pensée de la Tradition, trop souvent engagés dans la répétition de vieilles leçons.
14:09 Publié dans Actualité, Livre, Livre, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, actualité, bernard stiegler, philosophie, sociologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Le platonisme numérique : théorie de l'information et philosophie

Le platonisme numérique : théorie de l'information et philosophie
Michael Kumpmann
Source: https://www.geopolitica.ru/de/article/digitalplatonismus-informationstheorie-und-philosophie
L'espace calculant : Konrad Zuse
Konrad Zuse n'était pas seulement un ingénieur qui a construit le premier ordinateur complet de Turing et a donc inventé un appareil qui peut théoriquement résoudre n'importe quelle énigme mathématique soluble. Dans son livre Der Rechnende Raum de 1969, Zuse s'est également penché sur des questions philosophiques. Sa thèse principale est que la physique se trouve dans une impasse et ne peut pas résoudre de nombreuses questions parce qu'elle est soumise à une interprétation fondamentalement erronée du monde : on voit le monde de manière matérialiste. Pourtant, de nombreux phénomènes de la physique montrent que le matérialisme est probablement une erreur et que toute la matière n'est qu'une illusion. Selon Zuse, la réalité vraiment "réelle" est plutôt l'information.

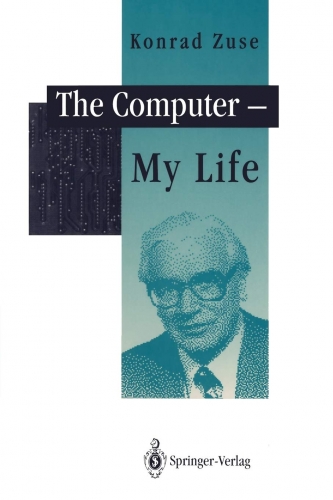
Grâce à l'informatique, Zuse est ainsi arrivé à la même conclusion que Platon, Hegel et la plupart des religions. Dans son œuvre philosophique majeure Tractates Cryptica Scriptura, l'auteur de science-fiction Philip Kindred Dick est parvenu à une idée similaire d'association idéaliste de la religion et des mathématiques, sauf que sa déduction n'était pas les mathématiques et la physique, mais l'analyse comparative des écrits religieux. Des auteurs ultérieurs comme Rizwan Virk ont développé ces thèses et décrit que, grâce au concept de réseaux neuronaux, on devrait voir l'univers comme le produit d'un immense "esprit du monde" hégélien.


Philipp K. Dick & Rizwan Virk
Loin des questions abstraites sur la cosmologie, la question se pose maintenant de savoir si l'on peut appliquer ces idées et ces modes de pensée à d'autres domaines de la philosophie. Et c'est possible. Et avec des résultats intéressants.
Le premier point intéressant est une question de prévisibilité. La prédictibilité décrit en gros les questions qu'un système donné peut "résoudre". La plupart du temps, il s'agit de machines concrètes. Mais les langues en font également partie. L'exhaustivité de Turing, déjà mentionnée au début, est ici particulièrement pertinente. Une machine de Turing est un appareil hypothétique composé d'un programme, d'une bande de mémoire et d'une "unité de lecture/écriture" mobile, qui peut calculer tous les problèmes calculables. En mathématiques, on considère qu'une question peut recevoir une réponse si on peut la formuler de manière à ce que cette machine fictive puisse la traiter. Ensuite, il y a la thèse de Church Turing, qui dit que du point de vue de la calculabilité, deux systèmes sont équivalents l'un à l'autre s'ils peuvent simuler mutuellement leur fonctionnement. (Pour illustrer cela de manière très simplifiée. Tout le monde ici peut télécharger la version des années 80 de Donkey Kong et la faire fonctionner sur son ordinateur portable normal, car la machine d'arcade sur laquelle fonctionnait Donkey Kong à l'époque et l'ordinateur portable actuel, sont fondamentalement tous deux des ordinateurs).
Et maintenant, le "point passionnant". Les hypothèses de simulation affirment que, parce que les ordinateurs peuvent simuler de mieux en mieux notre monde, il devient plus probable que le monde réel soit également une simulation calculée. Mais il y a encore un point qui a été négligé dans ces réflexions. Nous, les humains, avons d'abord conçu cette machine de Turing. Par conséquent, notre esprit est également soumis à ces lois. Nous sommes aussi Turing, voire plus puissants. Et nous comprenons de mieux en mieux l'univers et pouvons faire des prédictions et des calculs de plus en plus précis. Il existe donc un trait fondamental d'équivalence entre l'esprit créateur du monde et l'intellect humain. L'Esprit universel a créé l'homme à son image.
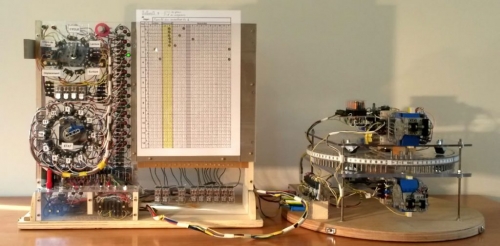
Il est toutefois évident qu'un seul esprit humain et un seul ordinateur ne peuvent pas résoudre toutes les questions de ce monde. C'est là qu'un autre élément entre en jeu. Il existe deux variantes de machines de Turing. Les machines universelles, qui peuvent tout calculer parce qu'elles ont une bande de mémoire infinie, et les machines de Turing limitées, qui sont limitées de manière finie. Et c'est la principale différence avec le "créateur". L'homme est fini (limité) et ne peut pas absorber toutes les informations.
Une bonne question est maintenant de savoir ce que signifie la technique pour l'homme. La technique est aussi souvent un moyen de stockage qui externalise l'information et la dissocie de l'esprit. Ce que l'homme ne peut pas mémoriser éternellement, il l'écrit afin de pouvoir le lire plus tard. Ainsi, la technique sert avant tout à élargir les capacités de mémoire de l'homme et à réduire la différence entre la machine de Turing limitée et la machine de Turing universelle. On pourrait ici utiliser la métaphore de Spengler sur "l'homme faustien" et dire que l'homme tente de se faire Dieu à l'aide de la technologie, en prenant le "fruit de l'arbre de la connaissance".

Un concept très similaire est l'idée de l'entropie de l'information et le concept associé du démon de Maxwell. L'entropie de l'information est, en gros, la valeur qui dit dans quelle mesure il est possible de reconstruire les infos manquantes à partir des informations existantes. Et quelle quantité peut manquer pour que quelque chose reste "lisible". Par exemple, on peut voir qu'il manque un S dans "Da ein". Là, l'entropie est faible. Mais pour "D n", l'entropie est si grande qu'il est difficile de deviner ce que l'on veut dire. L'entropie est donc aussi le degré d'incapacité à déduire ce qui vient ensuite à partir des connaissances existantes. L'entropie thermodynamique est considérée comme une conséquence de l'entropie de l'information. Dans un gaz chaud, tous les composants volent de manière chaotique. C'est pourquoi, à partir d'une image où tous les composants du gaz se trouvaient il y a 10 minutes, on ne peut pas vraiment déduire où ils se trouvent maintenant. Mais dans un cristal, c'est tout à fait possible, car tout y est rigide, immobile et ordonné. On pourrait dire ici que l'entropie est une valeur du chaos.
Selon l'entropie de l'information, il est également vrai que dans chaque système, l'entropie augmente inévitablement, l'information existante diminue et tout ordre est donc contraint de s'effondrer. Mais en même temps, le potentiel du type d'information qui pourrait exister augmente également [1] & [2]. Ce point est intéressant, car il correspond exactement à ce que Douguine a évoqué dans son texte La métaphysique du chaos: l'ordre est basé sur l'extinction ou l'exclusion du chaos. Or, le chaos permet l'émergence en son sein de différents ordres [3].
La théorie du démon de Maxwell est à son tour liée à l'entropie. Le démon de Maxwell est une machine hypothétique qui est placée sur un système chaotique (un gaz) et qui doit ordonner et trier les composants de ce système. Il est prouvé qu'un tel système ne peut pas fonctionner à long terme. Et cela parce que, entre autres, ce problème d'information potentielle fait que cette machine atteindrait ses limites de stockage. Le chaos ne pourrait être contrôlé durablement que si la machine disposait d'une mémoire infinie (voir les considérations ci-dessus à ce sujet). Comme la machine ne dispose pas d'une telle chose, le chaos devient à un moment donné si grand qu'il débouche sur une situation paradoxale où la machine doit elle-même créer le chaos et s'autodétruire lentement pour pouvoir se maintenir.
Ce démon de Maxwell se prête étonnamment bien à l'analyse de la modernité et du "cadre".
Chaque État moderne est en effet de facto un démon de Maxwell qui veut mettre fin à l'entropie et imposer l'ordre parfait. A commencer par les économies planifiées communistes, qui voulaient planifier les besoins des gens d'en haut. (Le sommet de cette évolution a été le Cybersyn de Salvador Allende - illustration ci-dessous-, où l'on voulait donner le contrôle d'une grande partie de l'État et de l'économie à un ordinateur central).

Le comportement de la troisième théorie politique et en particulier de l'Allemagne nazie avec l'eugénisme, les passeports généalogiques, les camps d'extermination, etc. peut être très fortement décrit comme une grande opération visant à éliminer le chaos, les impuretés et l'entropie, au détriment de la liberté, de l'humanité et de la vie humaine.
Les partisans de Popper vont maintenant prétendre que les sociétés libérales sont la protection contre de tels développements, mais cette propagande est une énorme tromperie. Voir le Patriot Act, les atrocités, l'oppression, l'expulsion et la rééducation des peuples indigènes au nom du colonialisme et du "fardeau de l'homme blanc", les guerres des néocons au nom de la démocratie, l'"État thérapeutique" envahissant qui veut éduquer les gens à la santé et contrôler sans cesse le citoyen dès l'enfance pour détecter les troubles de la santé, la Cancel Culture, la Political Correctness et d'autres formes de police de la pensée progressiste et antifasciste et de censure des réseaux, la surréglementation de l'UE, ainsi que de nombreux autres exemples. D'une certaine manière, les États libéraux poursuivent également l'eugénisme sous une forme privatisée grâce au Planned Parenthood et à d'autres initiatives. Et dans la crise du coronavirus, il existe désormais des certificats obligatoires de pureté biologique, même dans l'Occident libéral, et le thème des "camps pour impurs biologiques" revient régulièrement sous cette nouvelle forme. Voir l'Australie. (La principale différence entre le démon dans le libéralisme (2.0) et d'autres systèmes est qu'ici le démon est érigé comme un système qui inclut tout le monde et auquel personne ne doit refuser ou échapper, alors que d'autres systèmes étaient plutôt conçus pour refouler ou détruire les éléments chaotiques).

Camp Covid en Australie.
Quelle que soit la forme. Chaque théorie politique de la modernité et chaque État moderne est un démon maxwellien qui doit combattre toujours plus le chaos, au détriment de ses propres citoyens. D'une certaine manière, le démon maxwellien est aussi le noyau de la modernité, qui a été saisi par presque toutes les théories antimodernes. Qu'on l'appelle "Gestell" comme Heidegger, "Raison instrumentale" comme Adorno, "Société unidimensionnelle" comme Herbert Marcuse, "Règne de la quantité" comme René Guénon, "Intelligence solide" comme John C. Lilly ou autre. De Ted Kaczinsky à Rudolf Steiner en passant par Terence McKenna, tout concourt à démontrer que la modernité est un processus de mise en place d'une machine totale visant à éradiquer le chaos et menaçant d'éradiquer l'humanité. Et cela est presque perfectionné par des méthodes telles que les réseaux de neurones artificiels, la manipulation génétique, le transhumanisme, etc.
Seulement, comme nous l'avons déjà décrit, comme il n'existe pas de mémoire infinie, aucun démon maxwellien ne peut fonctionner à long terme. Tout ordre reste, pour le dire de manière bouddhiste, "annica", c'est-à-dire non durable, et menacé d'un effondrement permanent. L'entropie et le chaos ne sont pas éradiqués, mais seulement balayés sous le tapis à plus ou moins long terme. Et derrière les murs du monde ordonné de la modernité et dans son sous-sol, le chaos s'accumule jusqu'à ce qu'il fasse tomber les barrages. Le meilleur exemple en est le fait qu'en 2021, un bateau a eu un accident dans le canal de Suez, ce qui a failli déclencher une crise économique mondiale.
Seulement, selon le démon maxwellien, toute intervention des États modernes pour remédier au chaos ne fait qu'entraîner automatiquement plus de chaos et la nécessité d'autres interventions. (On pourrait appeler cela, avec Ludwig von Mises, la "spirale interventionniste").
Comment échapper à ce démon ? Probablement en regardant vers l'Orient et vers des enseignements comme le bouddhisme et le taoïsme, ainsi que l'école de Kyoto. Ces enseignements montrent très bien que tout finit par se désintégrer et que le but final de toute existence signifie à un moment donné le chaos, la désintégration et le néant absolu. Mais aussi que nous, les humains, ne pouvons pas vraiment lutter contre l'entropie, et que souvent une telle tentative ne fait qu'aggraver l'entropie. La seule solution est de prendre du recul par rapport à la matière et de se tourner vers des principes divins éternels et immuables. Comme l'éternel ne peut pas changer, l'entropie reste à zéro et ne peut pas se multiplier, car le double de zéro, par exemple, serait toujours zéro.
Notes:
[1] Voir https://www.uni-ulm.de/fileadmin/website_uni_ulm/archiv/haegele//Vorlesung/Grundlagen_II/_information.pdf page 6
[2] Un effet de l'entropie est également la dissolution de catégories strictement séparées et la fusion, vers une valeur moyenne. C'est le cas de la postmodernité.
[3] Voir également à ce sujet la citation suivante tirée de La métaphysique du chaos :
"Pour résoudre cette difficulté, nous devrions aborder le chaos non pas à partir de la position du logos, mais à partir de celle du chaos lui-même. Il peut être comparé à la vision féminine, à la compréhension féminine de l'autre, qui n'est pas exclue, mais au contraire incluse dans l'égalité.
Le logos se considère comme ce qui est et comme ce qui lui est égal. Il peut accepter les différences en lui parce qu'il exclut l'autre qui est à l'extérieur. C'est donc la volonté de puissance qui fonctionne, la loi de la souveraineté. Derrière le logos, affirme le logos, il n'y a rien, pas quelque chose. Les logos qui excluent tout autre qu'eux-mêmes excluent donc le chaos. Le chaos utilise une autre stratégie. Il inclut en lui tout ce qu'il est, mais en même temps aussi tout ce qu'il n'est pas. Le chaos englobant comprend donc également ce qui n'est pas inclus, à savoir ce qui exclut le chaos. Le logos ne perçoit donc pas le chaos comme l'autre, mais comme lui-même ou comme quelque chose de non-existant. Le logos, en tant que premier principe d'exclusion, est inclus dans le chaos, y est présent, enveloppé par lui et y a accordé une place, comme la mère qui porte le bébé porte en elle ce qui fait partie d'elle et ce qui n'est pas d'elle en même temps. L'homme conçoit la femme comme un être extérieur et tente de la pénétrer. La femme considère l'homme comme quelque chose d'intérieur et tente de le faire naître et de lui donner naissance.
Le chaos est l'éternelle genèse de l'Autre, c'est-à-dire du logos.
En résumé, la philosophie chaotique est possible parce que le chaos lui-même contient le logos comme une possibilité intérieure. Il peut l'identifier librement, l'apprécier et reconnaître son exclusivité, contenue dans sa vie éternelle. Nous arrivons ainsi à la figure du logos chaotique très particulier, c'est-à-dire d'un logos totalement et absolument frais, éternellement animé par les eaux du chaos. Ce logo chaotique est à la fois exclusif (c'est pourquoi ce sont en fait des logos) et inclusif (chaotique). Il traite différemment l'égalité et l'altérité".
11:58 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : chaos, physique, entropie, machine de turing, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook