Ex: http://www.counter-currents.com
1. Introduction
Those on the New Right are bound together partly by shared intellectual interests. Ranking very high indeed on any list of those interests would be the works of Martin Heidegger and those of the Traditionalist [1] [2] school, especially René Guénon and Julius Evola. My own work has been heavily influenced by both Heidegger and Traditionalism. Indeed, my first published essay (“Knowing the Gods [3]”) was strongly Heideggerian, and appeared in the flagship issue of Tyr [4], a journal that describes itself as “radical traditionalist,” and that I co-founded. This is just one example; many of my essays have been influenced by both schools of thought.
In my work, I have made the assumption that Heidegger’s philosophy and Traditionalism are compatible. This assumption is shared by many others on the Right, to the point that it is sometimes tacitly believed that Heidegger was some kind of Traditionalist, or that Heidegger and the Traditionalists had common values and, perhaps, a common project. These assumptions have never really been challenged, and it is high time to do so. The present essay puts into question the Heidegger-Traditionalism relationship.
Doing so will allow us to accomplish three things, at least:
(a) Arrive at a better understanding of Heidegger. This is vital, for my own study of Heidegger (in which I have been engaged, off and on, for over thirty years) has convinced me that he is not only the essential philosopher for the New Right, he is the only great philosopher of the last hundred years — and quite possibly the greatest philosopher who ever lived. I don’t make such claims lightly, and feel that I have only recently come to truly appreciate how much we need Heidegger. Yet reading Heidegger is extremely difficult. The present essay will help to clarify his thought by putting it into dialogue with the Traditionalists, whose writings are much more accessible, and much more familiar to my readers.

(b) Arrive at a better understanding of Traditionalism. We will find that in important ways Heidegger’s thought is not compatible with Traditionalism. The reason for this is that from a Heideggerian perspective Traditionalism is fundamentally flawed: it is thoroughly (and naïvely) invested in the Western metaphysical tradition which, according to Heidegger, sets the stage for modernity. In other words, because Traditionalism uncritically accepts the validity of Western metaphysical categories, it buys into some of the foundational assumptions of modernity. In the end, Traditionalism has to be judged a thoroughly modern movement, an outgrowth of the very epoch reviled by the Traditionalists themselves. All this, again, becomes clear only if we view Traditionalism, and Western intellectual history, from a Heideggerian perspective. I will argue that that perspective is correct. Thus, part of the purpose of this essay is to convince those on the Right that they need to take a more critical approach to Traditionalism.
(c) Arrive at a new philosophical approach. Although I will argue that Heidegger and Traditionalism are not compatible, the case can nonetheless be made that Heidegger is a traditionalist of sorts, and that, for Heidegger, something like a “primordial tradition” does indeed exist (though it is markedly different from the conceptions of Guénon and Evola). In short, through an engagement with Heidegger’s thought, and how it would respond to Traditionalism, we can arrive at a more adequate traditionalist perspective — one that shares a great many of the values and beliefs of Guénon and Evola, while placing these on a surer philosophical footing. In turn, I will also show that there are limits to Heidegger’s own approach, and that it is flawed in certain ways. Here we achieve a perfect symmetry, for these flaws are perceptible from a traditionalist perspective, broadly speaking. What I will have to say on this latter topic will also be of great interest to anyone influenced by Ásatrú, or the Germanic pagan revivalist movement.
In the end, we will not arrive simply at a fusion of Heidegger and Traditionalism, since both are transformed through the dialogue into which I put them. We will arrive instead at a new philosophical perspective, a new beginning and a new “program” for Western philosophy, one that has rejected Western metaphysics and that seeks to prepare the way for something yet to come, something beyond the modern and the “post-modern.” This new beginning is possible because the groundwork was laid by Heidegger, Guénon, and Evola (to name only three).
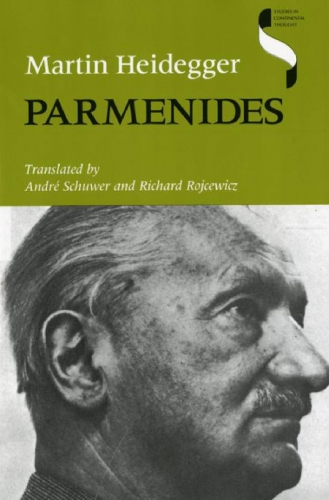
The project described above is quite ambitious, and it cannot be carried out in a single essay. Thus, the present text is the first in a series of several projected essays. (The outline of the series is presented as an Appendix, at the end of this essay.) Here, I will limit myself to a basic survey of Heidegger in relation to Traditionalism, his knowledge of Traditionalist writings, and the criticisms he would likely have leveled against this school of thought.
2. Anti-Modernism in Heidegger and the Traditionalists
The primary reason Heidegger gets associated with Guénon and Evola is that all three were trenchant critics of modernity. Heidegger and the Traditionalists hold that modernity is a period of decline, that it is a falling away from an “originary” [2] [5] position that was qualitatively different, and immeasurably superior. Further, the terms in which these authors critique modernity are often remarkably similar.
Consider these lines from Heidegger’s Introduction to Metaphysics, worth quoting at length because they sound like they could have come straight out of Guénon’s The Reign of Quantity and Signs of the Times:
When the farthest corner of the globe has been conquered technologically and can be exploited economically; when any incident you like, at any time you like, becomes accessible as fast as you like; when you can simultaneously “experience” an assassination attempt against a king in France and a symphony concert in Tokyo; when time is nothing but speed, instantaneity, and simultaneity, and time as history has vanished from all Dasein of all peoples; when a boxer counts as the great man of a people; when the tallies of millions at mass meetings are a triumph; then, yes then, there still looms like a specter over all this uproar the question: what for? — where to? — and what then? The spiritual decline of the earth has progressed so far that peoples are in danger of losing their last spiritual strength, the strength that makes it possible even to see the decline [which is meant in relation to the fate of “Being”] and to appraise it as such. This simple observation has nothing to do with cultural pessimism — nor with any optimism either, of course; for the darkening of the world, the flight of the gods, the destruction of the earth, the reduction of human beings to a mass, the hatred and mistrust of everything creative and free has already reached such proportions throughout the whole earth that such childish categories as pessimism and optimism have long become laughable. [3] [6]
In a later passage, Heidegger emphatically reiterates much of this: “We said: on the earth, all over it, a darkening of the world is happening. The essential happenings in this darkening are: the flight of the gods, the destruction of the earth, the reduction of human beings to a mass, the preeminence of the mediocre.” [4] [7] Consider also this passage:
All things sank to the same level, to a surface resembling a blind mirror that no longer mirrors, that casts nothing back. The prevailing dimension became that of extension and number. To be able — this no longer means to spend and to lavish, thanks to lofty overabundance and the mastery of energies; instead, it means only practicing a routine in which anyone can be trained, always combined with a certain amount of sweat and display. In America and Russia, then, this all intensified until it turned into the measureless so-on and so-forth of the ever-identical and the indifferent, until finally this quantitative temper became a quality of its own. By now in those countries the predominance of a cross-section of the indifference is no longer something inconsequential and merely barren but is the onslaught of that which aggressively destroys all rank and all that is world-spiritual, and portrays these as a lie. This is the onslaught of what we call the demonic [in the sense of the destructively evil]. [5] [8]
Finally, let us consider a passage from a later text, What Is Called Thinking? (1953):
The African Sahara is only one kind of wasteland. The devastation of the earth can easily go hand in hand with a guaranteed supreme living standard for man, and just as easily with the organized establishment of a uniform state of happiness for all men. Devastation can be the same as both, and can haunt us everywhere in the most unearthly way — by keeping itself hidden. Devastation does not just mean a slow sinking into the sands. Devastation is the high-velocity expulsion of Mnemosyne. The words, “the wasteland grows,” come from another realm than the current appraisals of our age. Nietzsche said, “the wasteland grows” nearly three quarters of a century ago. And he added, “Woe to him who hides wastelands within.” [6] [9]
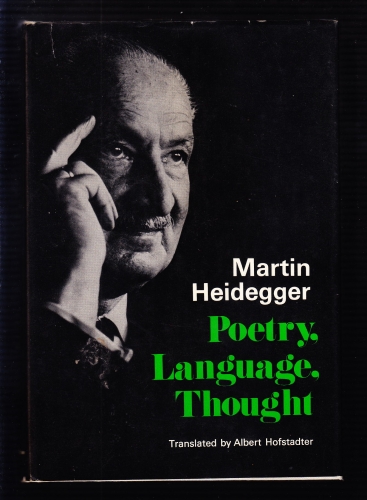
These passages give a fairly good summation of the essentials of Heidegger’s critique of modernity, which is worked out in much greater detail in his entire oeuvre. (Arguably, Heidegger’s confrontation with modernity is the central feature of his entire philosophy.) We may note here, especially, four major points. [7] [10] I will set these out below, along with quotations from Guénon’s Reign of Quantity, for comparison:
(a) The predominance of the “quantitative” in modernity; the triumph of the quantitative over the qualitative:
Guénon: “The descending movement of manifestation, and consequently that of the cycle of which it is an expression, takes place away from the positive or essential pole of existence toward its negative or substantial pole, and the result is that all things must progressively take on a decreasingly qualitative and an increasingly quantitative aspect; and that is why the last period of the cycle must show a very special tendency toward the establishment of a ‘reign of quantity.’” [8] [11]
(b) The cancellation of distance in the modern period; the increasing “speed” of modernity:
Guénon: “[Events] are being unfolded nowadays with a speed unexampled in the earlier ages, and this speed goes on increasing and will continue to increase up to the end of the cycle; there is thus something like a progressive ‘contraction’ of duration, the limit of which corresponds to the ‘stopping-point’ previously alluded to; it will be necessary to return to a special consideration of these matters later on, and to explain them more fully.” [9] [12]
And:
“The increase in the speed of events, as the end of the cycle draws near, can be compared to the acceleration that takes place in the fall of heavy bodies: the course of the development of the present humanity closely resembles the movement of a mobile body running down a slope and going faster as it approaches the bottom . . .” [10] [13]
(c) Modernity’s leveling effect; the destruction of an order of rank:
Guénon: “It is no less obvious that differences of aptitude cannot in spite of everything be entirely suppressed, so that a uniform education will not give exactly the same results for all; but it is all too true that, although it cannot confer on anyone qualities that he does not possess, it is on the contrary very well fitted to suppress in everyone all possibilities above the common level; thus the ‘leveling’ always works downward: indeed, it could not work in any other way, being itself only an expression of the tendency toward the lowest, that is, toward pure quantity . . .” [11] [14]
(d) Modernity’s reduction of everything to uniformity:
Guénon: “A mere glance at things as they are is enough to make it clear that the aim is everywhere to reduce everything to uniformity, whether it be human beings themselves or the things among which they live, and it is obvious that such a result can only be obtained by suppressing as far as possible every qualitative distinction . . .” [12] [15]

In later works, Heidegger explicitly ties modernity’s will towards uniformity to the “mechanization” of human beings. The spirit of technology becomes so totalizing that finally human beings themselves are “requisitioned” (to use a Heideggerian expression) and integrated as subsidiary mechanisms within the vast machine of modernity. In this connection, consider this passage from Guénon, worth quoting at length:
Servant of the machine, the man must become a machine himself, and thenceforth his work has nothing really human in it, for it no longer implies the putting to work of any of the qualities that really constitute human nature. The end of all this is what is called in present-day jargon ‘mass-production,’ the purpose of which is only to produce the greatest possible quantity of objects, and of objects as exactly alike as possible, intended for the use of men who are supposed to be no less alike; that is indeed the triumph of quantity, as was pointed out earlier, and it is by the same token the triumph of uniformity. These men who are reduced to mere numerical ‘units’ are expected to live in what can scarcely be called houses, for that would be to misuse the word, but in ‘hives’ of which the compartments will all be planned on the same model, and furnished with objects made by ‘mass-production,’ in such a way as to cause to disappear from the environment in which the people live every qualitative difference. [13] [16]
One last quotation from Guénon: “Man ‘mechanized’ everything and ended at last by mechanizing himself, falling little by little into the condition of numerical units, parodying unity, yet lost in the uniformity and indistinction of the ‘masses,’ that is, in pure multiplicity and nothing else. Surely that is the most complete triumph of quantity over quality that can be imagined.” [14] [17]
It would be pointless to amass further such quotations from Guénon since his work is replete with them — and since many of my readers are much more familiar with Guénon’s work than with Heidegger’s. It would be equally pointless to quote the many virtually identical observations from Evola (who is probably much more familiar to my readers even than Guénon). A substantial amount of Evola’s work is occupied with elaborating and extending Guénon’s critique of modernity, to which Evola devoted entire volumes (e.g., Revolt Against the Modern World, Ride the Tiger, Men Among the Ruins, etc.). However, their positions diverge when Evola advocates that the superior man respond to modernity by “riding the tiger” (i.e., utilizing certain negative elements of the modern world, which might destroy lesser men, for the positive purpose of self-realization).
3. The Evola Quotation in Heidegger’s Nachlass
The foregoing has hopefully demonstrated to the reader that Heidegger and Guénon held strikingly similar views on modernity. Although Heidegger knew individuals who respected Guénon (e.g., Carl Schmitt and Ernst Jünger), no evidence has emerged that Heidegger actually read Guénon’s work. Very recently, however, evidence has emerged that Heidegger read Evola. However, far from supporting the idea that Heidegger was influenced by Evola or sympathetic to him, an examination of this evidence will demonstrate exactly where Heidegger parts company with Traditionalism. [15] [20]

Amongst Heidegger’s Nachlass (the papers left behind after his death) a handwritten note has been found in which the philosopher quotes a passage from Friedrich Bauer’s 1935 German translation of Revolt Against the Modern World (Erhebung wider die moderne Welt). Here is the passage as Heidegger copied it out:
Wenn eine Rasse die Berührung mit dem, was allein Beständigkeit hat und geben kann — mit der Welt des Seyns — verloren hat, dann sinken die von ihr gebildeten kollektiven Organismen, welches immer ihre Größe und Macht sei, schicksalhaft in die Welt der Zufälligkeit herab.
And here is a translation:
When a race has lost contact with what alone has and can give it permanence [or “stability,” Beständigkeit] — with the world of Beyng [Seyns] then the collective organisms formed by it, whatever be their greatness and power, are destined to sink down into the world of contingency.
For comparison, here is the entire passage from Bauer’s text:
Wenn eine Rasse die Berührung mit dem, was allein Beständigkeit hat und geben kann — mit der Welt des “Seins” — verloren hat, dann sinken die von ihr gebildeten kollektiven Organismen, welches immer ihre Größe und Macht sei, schicksalhaft in die Welt der Zufälligkeit herab: werden Beute des Irrationalen, des Veränderlichen, des “Geschichtichen,” dessen, was von unten und von außen her bedingt ist. [16] [21]
We immediately notice two things when Heidegger’s handwritten version is compared to the original. First, Heidegger has rendered Sein as Seyn. [17] [22] Second, Heidegger replaces a colon with a period and omits the last part of the sentence entirely. The part after the colon can be translated as follows: “[to] become prey to the irrational, the changeable, the ‘historical,’ of what is conditioned from below and from the outside.” Why did Heidegger make these changes? Fully answering this question will allow us to see that Heidegger actually rejects Evola’s Traditionalism in the most fundamental terms possible.
First of all, it is likely that this undated note comes from sometime in the 1930s. During this time, Heidegger began utilizing Seyn, an archaic German spelling of Sein (Being). [18] [23] But why? What did this signify? It was not simply eccentricity on Heidegger’s part. By Seyn, Heidegger meant something distinct from Sein, which refers to the Being that beings have (“Being as such”). Seyn instead refers to what Heidegger calls elsewhere “the clearing” (die Lichtung). This metaphorical expression refers to a clearing in a forest, which allows light to enter in and illuminate what stands within the clearing. Thomas Sheehan describes Heidegger’s clearing as “the always already opened-up ‘space’ that makes the being of things (phenomenologically: the intelligibility of things) possible and necessary.” [19] [24] The clearing is what “gives” Being.

Heidegger writes in “The End of Philosophy and the Task of Thinking” (1964):
The forest clearing is experienced in contrast to dense forest, called Dickung in our older language. The substantive “opening” [Lichtung] goes back to the verb “open” [lichten]. The adjective licht “open” is the same word as “light.” To open something means: to make something light, free and open, e.g., to make the forest free of trees at one place. The openness thus originating is the clearing. . . . Light can stream into the clearing, into its openness, and let brightness play with darkness in it. But light never first creates openness. Rather, light presupposes openness. However, the clearing, the opening, is not only free for brightness and darkness, but also for resonance and echo, for sounding and the diminishing of sound. The clearing is the open region for everything that becomes present and absent. . . . What the word [opening] designates in the connection we are now thinking, free openness, is a “primal phenomenon” [Urphänomenon], to use a word of Goethe’s. [20] [25]
Consider a simple example. I approach an unfamiliar object sitting on my doorstep. I cannot place it; try as I might it remains a mystery. But as I approach closer still, all is revealed: I see now that it is an Amazon box. In this moment, what has occurred is that the Being of the object — what it is, what its meaning is — becomes present to me. [21] [26] In order for this to be possible at all, I must bear within me a certain special sort of “openness,” within which the Being of something makes itself known or makes itself present. [22] [27]
Contrary to how empiricists tend to conceive things, I don’t actually experience myself as hanging a label onto the object or slotting it within a mental category. This is an analysis after the fact of experience, not what I actually experience. If we are truer to the phenomenon than the empiricists (i.e., if we are good phenomenologists) we have to report that the experience is actually one in which the Being of the thing seems to “come forth,” or to display itself as we explore the object. But, again, this is only possible because of the “openness” referred to earlier. In this openness, Being displays itself; it is “lit up” within the space of the metaphorical “clearing.”

Thus, for Heidegger it is possible to speak of something deeper or more ultimate than Being itself (hence, an Urphänomenon): that which allows our encounter with the Being of beings in the first place; the open clearing. When Heidegger famously refers to “the forgottenness of Being” (Vergessenheit des Seins) he is actually referring to the forgottenness of the clearing. [23] [28] The clearing is forgotten in the sense that we have forgotten that in virtue of which Being is given to us. As I will discuss later, Heidegger holds that the Western metaphysical tradition, beginning with the Pre-Socratics, systematically forgets the clearing, and he traces all of our modern ills to this forgetting. He writes: “In fact, the history of Western thought begins, not by thinking what is most thought-provoking, but by letting it remain forgotten.” [24] [29]
Now, by contrast, when Evola speaks of “the world of being” (Welt des Seins; mondo di essere) in this passage and elsewhere, he is referring to a Platonic realm of timeless essences that are the true beings, in contrast to the changeful, impermanent terrestrial beings we encounter with the five senses. Traditionalism is heavily dependent on this Platonic metaphysics. Consider, for example, Evola’s words from the very beginning of Revolt:
In order to understand both the spirit of Tradition and its antithesis, modern civilization, it is necessary to begin with the fundamental doctrine of the two natures. According to this doctrine there is a physical order of things and a metaphysical one; there is a mortal nature and an immortal one; there is the superior realm of “being” and the inferior realm of “becoming.” Generally speaking, there is a visible and tangible dimension and, prior to and beyond it, an invisible and intangible dimension that is the support, the source, and the true life of the former. [25] [30]
Not only does Heidegger reject this Platonic metaphysics, he sees it as the first major stage in the decline of the West. Its inception is essentially identical with the “forgottenness” of the clearing spoken of a moment ago. All the aspects of modernity Heidegger was quoted earlier as deploring are ultimately traceable, he believes, to Platonic metaphysics. Thus, Heidegger completely rejects the idea that a “race” declines when it has “lost contact” with being, in the Platonic sense of “being” meant by Evola. Quite the reverse: a race — our race — has declined precisely through its turn toward Platonic metaphysics, and its turn away from the clearing. Thus, when Heidegger swaps Sein for Seyn, he is entirely changing the meaning of what Evola is saying. He is rewriting the passage so that it agrees with his own position: the decline of the West stems from its forgottenness of Seyn (the clearing) and its embrace of the Platonic Sein of the Western metaphysical tradition.

Heidegger omits the last part of Evola’s sentence for similar reasons. Let us look again at those words. Evola tells us that when a race has lost contact with “the world of being” it will “become prey to the irrational, the changeable, the ‘historical,’ of what is conditioned from below and from the outside.” Heidegger omits these words because he rejects Evola’s dichotomy between “being” and “the historical.” Heidegger argues, in fact, that Beyng/the clearing is inherently historical (geschichtlich), and changeable (veränderlich). The Being of things actually changes as culture changes. This is the same thing, fundamentally, as saying that the meaning of things changes over time.
But could the Being/meaning of the Amazon box on my doorstep ever change? Of course. Imagine a future world without Amazon, or one in which Amazon has been declared a monopoly and broken up into a number of different, competing entities. No more Amazon boxes on doorsteps. When you do see them, you see them in museums and you no longer see them simply as utilitarian objects. You no longer think, on glimpsing one, “Oh, my copy of Being and Time has arrived,” or some such. Instead, the Amazon box takes on a new meaning: as a symbol of a dark time we are, happily, well beyond; a time in which we allowed companies like Amazon not only to corner the market and put all smaller competitors out of business, but to shape the information we have access to through censorship and the banning of books [31].
Thus, if the Being or meaning that things have for us changes over the course of history, as culture and circumstances change, then, contra Evola, Being is inescapably “changeable” and “historical.” Evola also says that a race which loses contact with his idea of being falls prey to “the irrational” (das Irrational, in the German translation). Would Heidegger endorse this as well? Is his idea of Being “irrational”? Well, Heidegger does argue that historical-cultural shifts in Being/meaning are not fully intelligible to human beings. The reason for this is that it is always within Beyng/the clearing that things are meaningful or intelligible to us. It therefore follows that Beyng/the clearing itself is not ultimately intelligible. In a highly qualified sense, we could thus describe it as “irrational.” That Evola implicitly endorses the equation of being with “the rational” in this passage is extremely ironic. As we will see in a later installment, Heidegger argues that this equation is a key feature of the modern inflection of the Western metaphysical tradition, and that all the modern maladies Evola decries are ultimately attributable to it.
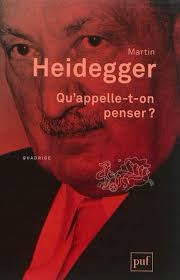 Heidegger would have regarded Guénon and Evola as philosophically naïve—for several reasons. First, they uncritically appropriate the Western metaphysical tradition in the name of combating modernity. Yet, as I have already mentioned, Heidegger argues that that tradition is implicated in the decline of the West. Second, the Traditionalists naïvely assert that this metaphysical tradition is “perennial” or timeless. They take Platonism as preserving elements of a primordial tradition that antedates Plato by millennia. They hold that the time of Plato belongs to the Kali Yuga (the fourth age, the decadent “Iron Age”), but they take Plato (and other ancient philosophers) to be preserving an older, indeed timeless wisdom. However, this is pure speculation, for which there is no solid scholarly evidence. [26] [32]
Heidegger would have regarded Guénon and Evola as philosophically naïve—for several reasons. First, they uncritically appropriate the Western metaphysical tradition in the name of combating modernity. Yet, as I have already mentioned, Heidegger argues that that tradition is implicated in the decline of the West. Second, the Traditionalists naïvely assert that this metaphysical tradition is “perennial” or timeless. They take Platonism as preserving elements of a primordial tradition that antedates Plato by millennia. They hold that the time of Plato belongs to the Kali Yuga (the fourth age, the decadent “Iron Age”), but they take Plato (and other ancient philosophers) to be preserving an older, indeed timeless wisdom. However, this is pure speculation, for which there is no solid scholarly evidence. [26] [32]
A further Heideggerian objection to Traditionalism may be considered at this point, and it is an extremely serious one. Both Heidegger and the Traditionalists decry rootless modern individualism. However, Heidegger’s critique goes much further. Recall that for the philosopher Being is inherently historical and changeable. What things are for us, or what they mean, is determined in part by our historical situation. Human Dasein is always embedded in a set of concrete historical, cultural circumstances. Heidegger writes: “Only insofar as the human being exists in a definite history are beings given, is truth given. There is no truth given in itself; rather, truth is decision and fate for human beings; it is something human.” [27] [33] This does not, however, mean that truth, as human, is something “subjective”:
We are not humanizing the essence of truth: to the contrary, we are determining the essence of human beings on the basis of truth. Man is transposed into the various gradations of truth. Truth is not above or in man, but man is in truth. Man is in truth inasmuch as truth is this happening of the unconcealment of things on the basis of creative projection. Each individual does not consciously carry out this creative projection; instead, he is already born into a community; he already grows up within a quite definite truth, which he confronts to a greater or lesser degree. Man is the one whose history displays the happening of truth. [28] [34]

As a result of this stance, Heidegger rejects both the Enlightenment ideal of a “view from nowhere,” as well as rootless, modern cosmopolitanism.
Consider, however, the following lines from The Reign of Quantity. Guénon writes disapprovingly of “those among the moderns who consider themselves to be outside all religion” — i.e., freethinking individualists. He asserts that such men are “at the extreme opposite point from those who, having penetrated to the principial unity of all the traditions, are no longer tied to any particular form.” This latter position, of course, is that of Guénonian Traditionalism itself. In a footnote, he then approvingly quotes Ibn ‘Arabî: “My heart has become capable of all forms: it is a pasture for gazelles and a monastery for Christian monks, and a temple for idols, and the Kaabah of the pilgrim, and the table of the Thorah and the book of the Quran. I am the religion of Love, whatever road his camels may take; my religion and my faith are the true religion.” [29] [35]
Though Guénon contrasts the position of the modern freethinker to the Traditionalist, Heidegger would doubtless argue that there is a fundamental identity between them. The freethinker imagines that he has freed himself from any cultural-religious context and become a kind of intellectual or spiritual cosmopolitan. Yet the Traditionalist thinks the exact same thing. The only difference is that the freethinker believes he has cast off religion or “spirituality” itself, whereas the Traditionalist imagines that he adheres to a decontextualized, ahistorical, and universal spiritual construct called “Tradition.” This standpoint too is fundamentally modern.

One might object, however, that Guénon’s decision to convert to Islam and “go native” in Cairo, where he spent the last twenty years of his life, indicates that he was aware that tradition could not be a free-floating abstraction, and that to be a true Traditionalist one had to choose a living tradition and immerse oneself in it. This is true, as a statement of Guénon’s views. But the very idea that one can choose a tradition buys into the modern conception of the autonomous self who may, from a standpoint of detachment from any cultural or historical context, survey the different traditions and select one. It is no use here to point out that all Muslims must, in a sense, “choose” Islam, as it is not an ethnic religion but a creedal one, whose faith all adherents must profess, and to which anyone may convert. This is a valid point, but a superficial one. Islam emerged from a cultural and historical context quite alien to the West, and which no Westerner may ever truly enter.
4. Conclusion
Let us now consider a couple of objections to this Heideggerian critique of Traditionalism.
First, defenders of Traditionalism might respond that Guénon and Evola are primarily grounded in the Indian tradition, and not in Western metaphysics at all. There are essentially two pieces of evidence for this claim. The first is Guénon and Evola’s endorsement of the Hindu cyclical account of time, of the yugas, which is indeed quite ancient. Both seem to accept this teaching in very literal terms, right down to the traditional Hindu calculations of the time span of each yuga (which strike most modern readers as arbitrary inventions). Second is the primacy granted by both thinkers to Vedanta. Both Guénon and Evola regard the teachings of the Upanishads as an expression of a very ancient ur-metaphysics, which constitutes a “perennial philosophy.”

The dependence of the Traditionalists on the Indian tradition is very real. The trouble, however, is that they interpret the Indian materials in terms of the categories and terminology of Western metaphysics. Indeed, this is especially true of Guénon, who shows no signs of recognizing that there is anything problematic about understanding the Upanishads in terms derived from Platonic and Aristotelian philosophy. For example, right at the beginning of The Reign of Quantity, Guénon discusses the duality of Purusha and Prakriti using the categories of “essence and substance” — then, a page later, he appeals to “form and matter,” then to “act and potency.” [30] [38] This is all Aristotelian terminology. Moreover, there is no attempt on Guénon’s part to recover the “originary” sense of these terms in Aristotle. Instead, he unhesitatingly adopts the medieval scholastic understanding of these distinctions.
It may be that Guénon thought it was valid to discuss Vedanta in Platonic-Aristotelian terms because he regarded the Platonic tradition as itself an expression of the perennial philosophy. Thus, he simply decided a priori that Vedanta and Platonism are two streams flowing from the same source: primordial Tradition. But, again, this is pure speculation. The bottom line is that Guénon and Evola do accord special primacy to the Indian tradition over Western metaphysics — but they see the former almost entirely through the lens of the latter. Thus, despite their interest in Indian thought, they are still thoroughly beholden to Western metaphysics.
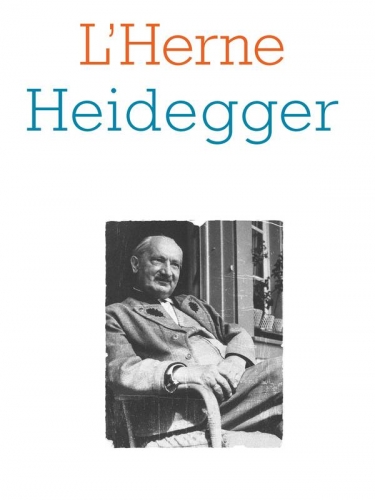
It remains to consider a further, much more significant, objection to these Heideggerian critiques of Traditionalism. The primary objection I have raised against Guénon and Evola is that they are thoroughly committed to Western metaphysics. This is a problem because Heidegger argues that the Western tradition is not only a falling away from a more primordial encounter with Being, it actually makes possible the modern decadence that Traditionalists rightly reject. But why we should follow Heidegger in any of this? Why should we accept Heidegger’s negative evaluation of Western metaphysics? Why should we accept the thesis that Platonic metaphysics made modernity possible? The next essay in this series will be devoted to addressing just these questions. It will be the first of several essays offering a compressed summary and commentary on Heidegger’s history and critique of metaphysics, demonstrating that the claims he makes are both plausible and profound. Heidegger is right in thinking that Western metaphysics lies at the root of modernity. We will begin with Heidegger’s critique of Plato.
What did Heidegger have to say about tradition? In “The Age of the World Picture” (1938) He warns us against “merely negating the age” and writes that “The flight into tradition, out of a combination of humility and presumption, achieves, in itself, nothing, is merely a closing the eyes and blindness towards the historical moment.” [31] [39] But Heidegger also argues that the turn toward metaphysics is a turn away from a more authentic way of encountering Being. It is in this latter conception that we find what may be the equivalent of “primordial tradition” in Heidegger’s thought. One of the conclusions that will be defended in this series of essays is that while Heidegger is clearly not a Guénonian or Evolian Traditionalist, he is actually more traditionalist than the Traditionalists.
Appendix. Outline of the Series:
Part One (the present essay): Why Heidegger and Traditionalism are not compatible; major errors in Traditionalism from a Heideggerian perspective.
Part Two: Heidegger’s history of metaphysics, focusing on his critique of Platonism. This account will deepen our understanding of why Heidegger would regard Traditionalism as a fundamentally modern movement, as well as deepen our understanding of modernity.
Part Three: The continuation of our account of Heidegger’s history of metaphysics, from Plato to Nietzsche. Among other things, Part Three will discuss Evola’s problematic indebtedness to German Idealism, especially J. G. Fichte, whose philosophy (I will argue) is like a vial of fast-acting, concentrated modern poison.
Part Four: From Nietzsche to the present age of post-War modernity, which Heidegger characterizes as das Gestell (“enframing”). Part Four will deal in detail with this fundamental Heideggerian concept, which is central to his critique of technology.
Part Five: How Heidegger proposes that we respond to technological modernity. His project of a “recovery” of a pre-metaphysical standpoint; his “preparation” for the next “dispensation of Beyng.” His phenomenology of authentic human “dwelling” (“the fourfold”), and Gelassenheit.
Part Six: A call for a new philosophical approach, building upon Heidegger and the Traditionalists, while moving beyond them. Three primary components: (1) The recovery of “poetic wisdom” (to borrow a term from G. B. Vico): Heidegger’s project of the recovery of the pre-metaphysical standpoint now applied to myth and folklore, and expanded to include non-Greek sources (e.g., the pre-Christian traditions of Northern Europe); (2) Expanding Heidegger’s project of the “destruction” of the Western tradition to include the Gnostic and Hermetic traditions, Western esotericism, and Western mysticism; (3) Finally, social and cultural criticism from a standpoint informed by the critique of metaphysics, critique of modernity, and recovery of “poetic wisdom.”

Notes
[1] [40] I will capitalize the “t” in Traditionalism to indicate the school of Guénon, Evola, et al., as opposed to “traditionalism” in the looser, broader sense of the term. This device is necessary, as I will be using the term in both senses. I should also note that it is primarily the Traditionalism of Guénon and Evola that I am concerned with here. I am comparatively less interested in the “softer” Traditionalism of figures like Coomaraswamy, Schuon, Huston Smith, etc. Most of the objections raised against Guénon and Evola herein would apply to these authors as well.
[2] [41] “Originary” (ursprünglich) is a term frequently used by Heidegger.
[3] [42] Martin Heidegger, Introduction to Metaphysics, trans. Gregory Fried and Richard Polt (New Haven, CT: Yale University Press, 2000), 40-41. This was originally a lecture course given by Heidegger in 1935. It was published for the first time in German in 1953. The material in square brackets was added by Heidegger when the lecture course was published in 1953.
[4] [43] Fried and Polt, 47.
[5] [44] Fried and Polt, 48-49. Bracketed phrase added by Heidegger for the 1953 edition.
[6] [45] Martin Heidegger, What is Called Thinking?, trans. J. Glenn Gray (New York: Harper Perennial, 1968), 30.
[7] [46] One point is omitted from the discussion below, one which my readers might expect me to discuss: “the flight of the gods.” What Heidegger means by this, however, is complicated, and far from obvious. I will discuss this issue in a later essay.
[8] [47] René Guénon, The Reign of Quantity and the Signs of the Times, trans. Lord Northbourne (Hillsdale, NY: Sophia Perennis, 2001), 43.
[9] [48] Reign, 42
[10] [49] Reign, 43. For similar remarks see Julius Evola, Meditations on the Peaks, trans. Guido Stucco (Rochester, Vermont: Inner Traditions, 1998), 45-46.
[11] [50] Reign, 51-52.
[12] [51] Reign, 48.
[13] [52] Reign, pp. 60-61. Compare this to some remarks by Alexandre Kojève: “Hence it would have to be admitted that after the end of history men would construct their edifices and works of art as birds build their nests and spiders spin their webs, would perform their musical concerts after the fashion of frogs and cicadas, would play like young animals and would indulge in love like adult beasts.” See Introduction to the Reading of Hegel, ed. Raymond Queneau and Allan Bloom, trans. James H. Nichols, Jr. (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1969), 159 (footnote).
[14] [53] Reign p. 194.
[15] [54] The discovery of the note in 2015 received some attention in the German press. Writing in the Frankfurter Allgemeine Zeitung [55], Thomas Vasek claims that “textual comparisons suggest that Heidegger had not only read Evola, as this note indicates, but was also influenced by his ideas from the mid-thirties on, from his critique of science and technology, his anti-humanism and rejection of Christianity, to his ‘spiritual’ racism.” This is a completely baseless, and, indeed, ludicrous assertion, as I will shortly demonstrate. See Greg Johnson’s analysis of the Heidegger note, and Vasek’s article, here [56].
[16] [57] Julius Evola, Erhebung wider die moderne Welt, trans. Friedrich Bauer (Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1935), 65. The translator actually leaves out portions of Evola’s text, but since Heidegger only read the translation and not the original, these omissions do not concern us here. For the full passage in English translation, see Julius Evola, Revolt Against the Modern World, trans. Guido Stucco (Rochester, VT: Inner Traditions, 1995), 56-57.
[17] [58] The “s” at the end of Seins/Seyns in the passage simply indicates the genitive case. The nominative is Sein/Seyn.
[18] [59] Anglophone translators of Heidegger have adopted the convention of rendering Seyn as “Beying.”
[19] [60] Thomas Sheehan, Making Sense of Heidegger: A Paradigm Shift (Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 2015), 20.
[20] [61] Martin Heidegger, Basic Writings, ed. David Farrell Krell (New York: Harper and Row, 1977), 384-385. This essay was translated by Joan Stambaugh; italics added.
[21] [62] Sheehan argues at length that, for Heidegger, Being and meaning are identical.
[22] [63] This way of expressing things should be understood as figurative, and preliminary. Actually, Heidegger wants to entirely avoid a “subjective” treatment of the clearing as some sort of “faculty” or Kantian a priori structure that I “bear within me.” The reason, at root, is that this treatment of the clearing is phenomenologically untrue. I do not, in fact, experience the clearing as something “in me” that is “mine.” Still less do I experience it as something over which I have any kind of influence or control. There is thus no real basis for “subjectivizing” the clearing; for locating it “within the subject.” Indeed, Heidegger critiques the subject/object distinction prevailing in philosophy since Descartes, which locates certain “properties” as “within” a subject, as if this subject is a kind of cabinet in which we dwell, removed from an “external world.” See Heidegger, Being and Time, trans. Joan Stambaugh, rev. Dennis J. Schmidt (Albany, NY: State University of New York Press, 2010), 60-61.
[23] [64] Generally speaking, this is correct. Unfortunately, Heidegger is inconsistent with his use of Sein/Seyn, sometimes referring to Being, sometimes to the clearing that gives Being.
[24] [65] What is Called Thinking?, 152.
[25] [66] Revolt, 3.
[26] [67] The Traditionalists are in much the same position as the Renaissance “Hermeticists” who falsely believed that the Corpus Hermeticum contained an Egyptian wisdom that far antedated Plato and the Greeks, and from whom those philosophers had taken their basic doctrines. In reality, the Corpus Hermeticum was no older than the first century BC, and it derived its doctrines, in large measure, from Plato and his school.
[27] [68] Martin Heidegger, Being and Truth, trans. Gregory Fried and Richard Polt (Bloomington: Indiana University Press, 210), 134. Italics in original.
[28] [69] Being and Truth, 136. Italics in original.
[29] [70] Reign, 62-63.
[30] [71] Reign, 11-12.
[31] [72] Martin Heidegger, Off the Beaten Track, trans. Julian Young and Kenneth Haynes (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), 72.

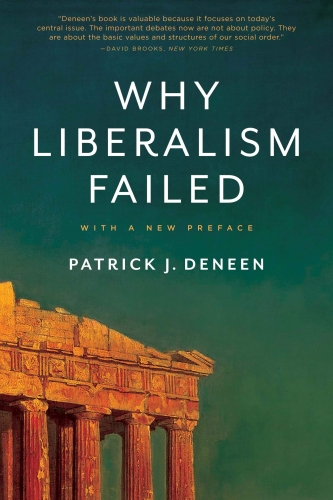








 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg
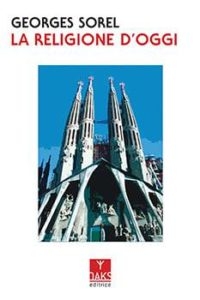 Parmi ces intellectuels figure Georges Sorel, dont un ouvrage a été récemment réédité, l'un des moins connus de ses lecteurs. Nous nous référons à La religione d'oggi, qui est parue en librairie grâce aux éditions OAKS (pour les commandes : info@oakseditrice.it, p. 126, 16 euros).
Parmi ces intellectuels figure Georges Sorel, dont un ouvrage a été récemment réédité, l'un des moins connus de ses lecteurs. Nous nous référons à La religione d'oggi, qui est parue en librairie grâce aux éditions OAKS (pour les commandes : info@oakseditrice.it, p. 126, 16 euros).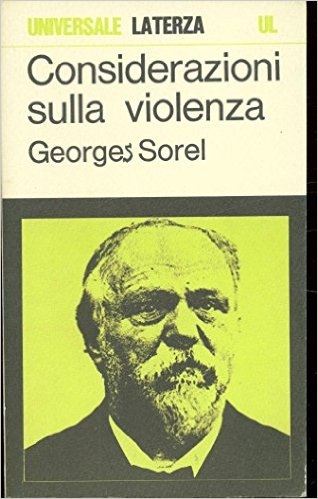 Le problème posé par Marx n'est pas, sic et simpliciter, économique, mais moral. Dans le travail en usine, l'ouvrier s'aliène sa propre condition d'être de raison. Kant, se référant dans la Raison pratique à la dignité de l'homme, n'avait fait que synthétiser les préceptes qui avaient initialement émergé de la bonne nouvelle chrétienne : "Derrière le concept d'aliénation [...] il y a la notion d'être humain développée par la philosophie moderne [...] à partir de la notion chrétienne d'égale dignité humaine" (p. XI). Quelle est la voie à suivre, selon Marx et Sorel, pour parvenir à la désaliénation ? La Révolution. Seul l'acte révolutionnaire humaniserait les circonstances historico-économiques dans lesquelles, en fait, l'homme vit concrètement. Le "soupir religieux" de la créature opprimée se transformerait ainsi en une lutte socio-politique : en elle, l'exigence éthique reste primordiale. Pour accéder aux thèses de Sorel dans le domaine religieux, il ne suffit pas de se référer au marxisme. En effet, à partir de la fin du XIXe siècle, les certitudes gnoséologiques du positivisme et du néo-positivisme ont progressivement disparu. Sorel soutient, dans le livre que nous présentons, les thèses probabilistes de Boutroux, selon lesquelles dans la sphère scientifique, il fallait toujours passer du dogmatisme positiviste au raisonnement suivant : « passer du nécessaire au probable, passer des mathématiques de la certitude aux mathématiques de l'incertitude" (p. XIV).
Le problème posé par Marx n'est pas, sic et simpliciter, économique, mais moral. Dans le travail en usine, l'ouvrier s'aliène sa propre condition d'être de raison. Kant, se référant dans la Raison pratique à la dignité de l'homme, n'avait fait que synthétiser les préceptes qui avaient initialement émergé de la bonne nouvelle chrétienne : "Derrière le concept d'aliénation [...] il y a la notion d'être humain développée par la philosophie moderne [...] à partir de la notion chrétienne d'égale dignité humaine" (p. XI). Quelle est la voie à suivre, selon Marx et Sorel, pour parvenir à la désaliénation ? La Révolution. Seul l'acte révolutionnaire humaniserait les circonstances historico-économiques dans lesquelles, en fait, l'homme vit concrètement. Le "soupir religieux" de la créature opprimée se transformerait ainsi en une lutte socio-politique : en elle, l'exigence éthique reste primordiale. Pour accéder aux thèses de Sorel dans le domaine religieux, il ne suffit pas de se référer au marxisme. En effet, à partir de la fin du XIXe siècle, les certitudes gnoséologiques du positivisme et du néo-positivisme ont progressivement disparu. Sorel soutient, dans le livre que nous présentons, les thèses probabilistes de Boutroux, selon lesquelles dans la sphère scientifique, il fallait toujours passer du dogmatisme positiviste au raisonnement suivant : « passer du nécessaire au probable, passer des mathématiques de la certitude aux mathématiques de l'incertitude" (p. XIV). Pour Sorel, la ligne moderniste en France était née dans le sillage des thèses d'Ernest Renan et du philosophe Eduard Hartmann. Les deux penseurs estimaient que l'affaiblissement dogmatique de la foi conduirait à l'émergence d'une religiosité intérieure plus authentique. Il s'agirait de vivre véritablement l'expérience religieuse, d'en témoigner concrètement dans les actes de la vie. Cela aurait déterminé la réduction du nombre de fidèles, qui se seraient toutefois transformés en authentiques croyants. Sorel, qui proposait aux masses le mythe de la grève générale, a montré, même si c'était avec une certaine ambiguïté, un intérêt sincère pour cette possible religion du futur. À notre avis, il était naïf, les instances modernistes au sein de l'Église, ainsi que dans la société, se sont avérées, en réalité, fonctionnelles au plein déploiement de la Forme-Capital, qui est devenue définitivement mondiale, des décennies plus tard, dans la mythique « révolution » de Soixante-Huit. Puis le Père, symbole de la Loi et de la Tradition, a été assassiné. De son sang est né le royaume de la marchandise absolue, dans lequel nous vivons encore.
Pour Sorel, la ligne moderniste en France était née dans le sillage des thèses d'Ernest Renan et du philosophe Eduard Hartmann. Les deux penseurs estimaient que l'affaiblissement dogmatique de la foi conduirait à l'émergence d'une religiosité intérieure plus authentique. Il s'agirait de vivre véritablement l'expérience religieuse, d'en témoigner concrètement dans les actes de la vie. Cela aurait déterminé la réduction du nombre de fidèles, qui se seraient toutefois transformés en authentiques croyants. Sorel, qui proposait aux masses le mythe de la grève générale, a montré, même si c'était avec une certaine ambiguïté, un intérêt sincère pour cette possible religion du futur. À notre avis, il était naïf, les instances modernistes au sein de l'Église, ainsi que dans la société, se sont avérées, en réalité, fonctionnelles au plein déploiement de la Forme-Capital, qui est devenue définitivement mondiale, des décennies plus tard, dans la mythique « révolution » de Soixante-Huit. Puis le Père, symbole de la Loi et de la Tradition, a été assassiné. De son sang est né le royaume de la marchandise absolue, dans lequel nous vivons encore.
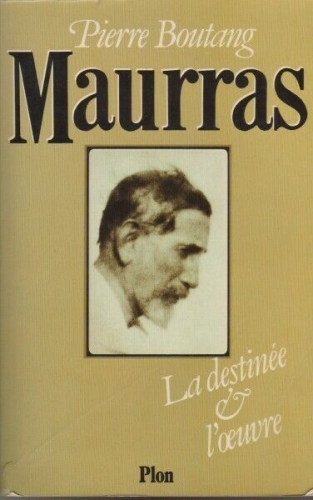 Pour Pierre Boutang, comme pour Dante ou pour Maurice Scève, la raison procède de la poésie, et non l'inverse. La raison poétique est la meilleure, car elle est une raison d'être. La poésie ouvre la voie de l'ontologie et de la métaphysique. En amont de la raison (mais non contre elle, comme le préconisaient les Surréalistes qui demeurent là, à leur façon, des positivistes) l'être est l'ensoleillement intérieur du Logos, sa gloire secrète. La poésie est raison d'être, car elle est victoire sur l'oubli de l'être, ressouvenir et pressentiment d'une civilité perdue. Qui entendre et de qui se faire entendre, si le chant ne domine point, si un Songe plus vaste que nous ne nous environne ? Pierre Boutang est poète, car il nous délivre de l'humanisme de la démesure, de l'humanisme outrecuidant.
Pour Pierre Boutang, comme pour Dante ou pour Maurice Scève, la raison procède de la poésie, et non l'inverse. La raison poétique est la meilleure, car elle est une raison d'être. La poésie ouvre la voie de l'ontologie et de la métaphysique. En amont de la raison (mais non contre elle, comme le préconisaient les Surréalistes qui demeurent là, à leur façon, des positivistes) l'être est l'ensoleillement intérieur du Logos, sa gloire secrète. La poésie est raison d'être, car elle est victoire sur l'oubli de l'être, ressouvenir et pressentiment d'une civilité perdue. Qui entendre et de qui se faire entendre, si le chant ne domine point, si un Songe plus vaste que nous ne nous environne ? Pierre Boutang est poète, car il nous délivre de l'humanisme de la démesure, de l'humanisme outrecuidant. 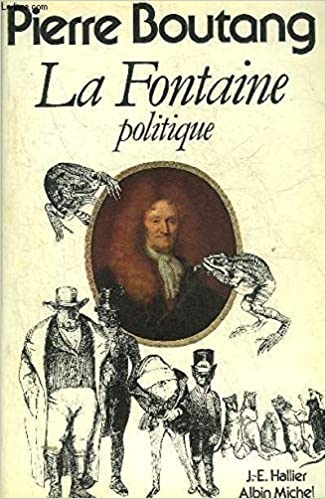 Délivrée de la subjectivité qui outrecuide, et de la bête de troupeau, l'aventure odysséenne de la pensée débute sous des auspices heureux : « Cette trace que nous suivons, lumineuse dans les mémoires, indistincte sous la poussière des livres, soudain fraîche comme les joues de la belle Théano, est celle de l'Aède divin. Tout ce qui est de lui nous trouble et nous enchante ». L'humilité est de consentir au ressouvenir et au trouble et à l'enchantement. Les retrouvailles de la poésie et de la raison disent ce consentement de la grande âme reçue par la grandeur du monde. L'intelligence n'est pas l'ennemie de l'enchantement. L'exactitude est enchanteresse, elle compose pour nous, à travers nous, un chant dont nous sommes les messagers. Nous traversons notre chant et ses possibilités prodigieuses de pensée comme Ulysse la mer violette, lorsque l'orage menace, que surviennent les éclaircies, que la chance magnifique est offerte.
Délivrée de la subjectivité qui outrecuide, et de la bête de troupeau, l'aventure odysséenne de la pensée débute sous des auspices heureux : « Cette trace que nous suivons, lumineuse dans les mémoires, indistincte sous la poussière des livres, soudain fraîche comme les joues de la belle Théano, est celle de l'Aède divin. Tout ce qui est de lui nous trouble et nous enchante ». L'humilité est de consentir au ressouvenir et au trouble et à l'enchantement. Les retrouvailles de la poésie et de la raison disent ce consentement de la grande âme reçue par la grandeur du monde. L'intelligence n'est pas l'ennemie de l'enchantement. L'exactitude est enchanteresse, elle compose pour nous, à travers nous, un chant dont nous sommes les messagers. Nous traversons notre chant et ses possibilités prodigieuses de pensée comme Ulysse la mer violette, lorsque l'orage menace, que surviennent les éclaircies, que la chance magnifique est offerte. 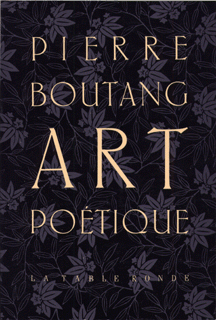 Pierre Boutang, et c'est tout l'enseignement de son Art poétique, ne croit pas en la formulation, il croit au silence antérieur, au silence lumineux de la toute-possibilité. Le « nationalisme » de Pierre Boutang ne se fonde pas sur un quelconque idéal « identitaire » (l'atrocité du néologisme trahissant déjà l'impasse de la pensée). Notons, en passant que De Gaulle ne parle pas davantage d'identité française, mais d'Idée, dans un sens platonicien. Certes, la formulation n'est pas hasardeuse, gratuite ou aléatoire, mais elle n'est point le tout. Elle témoigne d'une possibilité souveraine qui la dépasse et que Pierre Boutang nomme la « vox cordis », la voix du cœur : « A la différence de tous les "nationalitaires", écrit Pierre Boutang, comme Fichte, dont procèdent toutes les hérésies allemandes racistes ou national-socialistes, Maurras maintenait l'unité de l'esprit humain et se bornait à reconnaître dans la beauté athénienne, l'ordre romain et la civilisation française classique des réussites presque miraculeuses de l'humanité essentielle ».
Pierre Boutang, et c'est tout l'enseignement de son Art poétique, ne croit pas en la formulation, il croit au silence antérieur, au silence lumineux de la toute-possibilité. Le « nationalisme » de Pierre Boutang ne se fonde pas sur un quelconque idéal « identitaire » (l'atrocité du néologisme trahissant déjà l'impasse de la pensée). Notons, en passant que De Gaulle ne parle pas davantage d'identité française, mais d'Idée, dans un sens platonicien. Certes, la formulation n'est pas hasardeuse, gratuite ou aléatoire, mais elle n'est point le tout. Elle témoigne d'une possibilité souveraine qui la dépasse et que Pierre Boutang nomme la « vox cordis », la voix du cœur : « A la différence de tous les "nationalitaires", écrit Pierre Boutang, comme Fichte, dont procèdent toutes les hérésies allemandes racistes ou national-socialistes, Maurras maintenait l'unité de l'esprit humain et se bornait à reconnaître dans la beauté athénienne, l'ordre romain et la civilisation française classique des réussites presque miraculeuses de l'humanité essentielle ».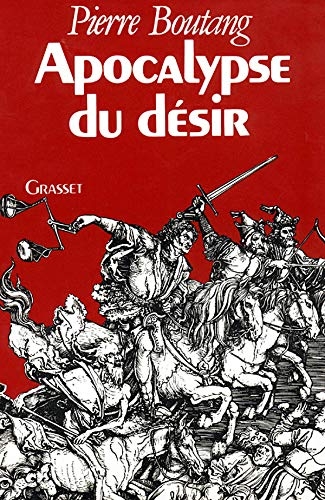 Le poète se tient dans le silence royal et sacré, il appartiendra au traducteur d'oser le même séjour, de faire par l'imagination créatrice ce retour au temps et au site excellents où l'image se manifestera, où elle surgira, prompte et souveraine, pour se saisir des mots qui n'attendaient qu'elle pour renaître des écorces de cendre de leurs usages profanes et profanateurs. Croire en la possibilité de la traduction, c'est parier sur l'esprit qui vivifie contre la lettre morte, c'est interroger la lettre, la prier, l'exhorter, la ravir amoureusement jusqu'à ce qu'elle cède et révèle la lumière incréée. Les lettres qu'écrivent les poètes sont des lettres de feu; elles scintillent dans les ténèbres avant d'être de nuit d'encre sur le papier. Elles sont la trace lumineuse, la trace de la lumière qui, hors d'elle, retrace dans l'entendement du traducteur, un autre poème, qui est le même.
Le poète se tient dans le silence royal et sacré, il appartiendra au traducteur d'oser le même séjour, de faire par l'imagination créatrice ce retour au temps et au site excellents où l'image se manifestera, où elle surgira, prompte et souveraine, pour se saisir des mots qui n'attendaient qu'elle pour renaître des écorces de cendre de leurs usages profanes et profanateurs. Croire en la possibilité de la traduction, c'est parier sur l'esprit qui vivifie contre la lettre morte, c'est interroger la lettre, la prier, l'exhorter, la ravir amoureusement jusqu'à ce qu'elle cède et révèle la lumière incréée. Les lettres qu'écrivent les poètes sont des lettres de feu; elles scintillent dans les ténèbres avant d'être de nuit d'encre sur le papier. Elles sont la trace lumineuse, la trace de la lumière qui, hors d'elle, retrace dans l'entendement du traducteur, un autre poème, qui est le même. 

 L'État moderne qui est né dans le cadre de l'économie capitaliste libérale s'est soumis à la loi aveugle de l'offre et de la demande comme seul critère de justice, mais ses contradictions et les demandes du peuple, surtout à partir du milieu du XIXe siècle, ont produit un changement qui s'est réalisé à partir de la troisième décennie du XXe siècle.
L'État moderne qui est né dans le cadre de l'économie capitaliste libérale s'est soumis à la loi aveugle de l'offre et de la demande comme seul critère de justice, mais ses contradictions et les demandes du peuple, surtout à partir du milieu du XIXe siècle, ont produit un changement qui s'est réalisé à partir de la troisième décennie du XXe siècle.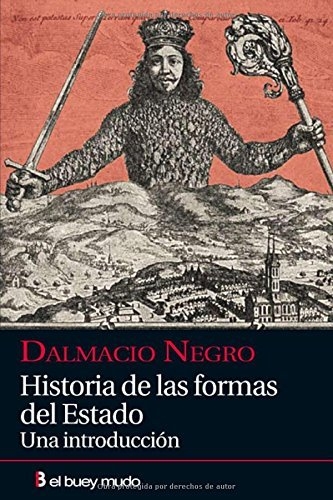
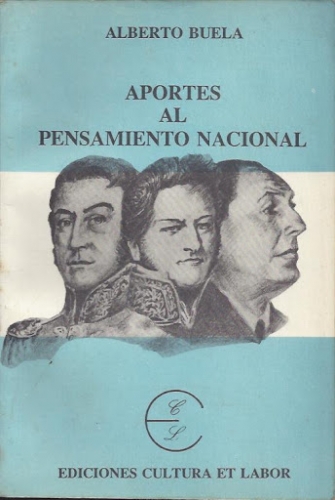
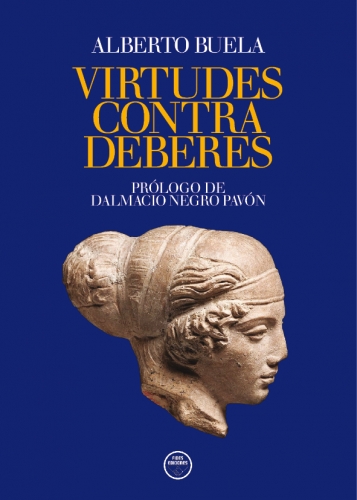


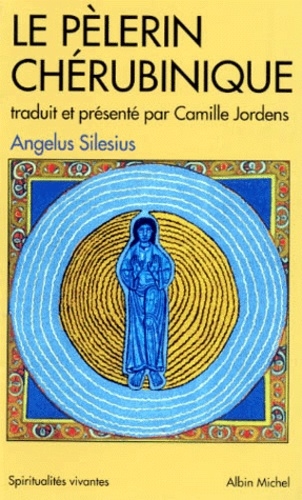 L'homme de peu de pouvoir, et que ce pouvoir déjà embarrasse et humilie, en viendra ainsi, dans le piège qui lui est tendu, à désirer non pas l'écart, le « recours aux forêts », la souveraineté perdue, mais un « plus de pouvoir », croyant ainsi, par ce pouvoir plus grand, qui est en réalité une plus grande servitude, se délivrer du pouvoir plus petit, sans voir qu'il augmente ce dont il souffre en croyant s'en départir. La puissance, lors, s'éloigne de plus en plus, au point de paraître irréelle, alors qu'elle est le cœur même du réel, la vérité fulgurante de tout acte d'être, « l'éclair dans l'Eclair » dont parlait Angélus Silésius.
L'homme de peu de pouvoir, et que ce pouvoir déjà embarrasse et humilie, en viendra ainsi, dans le piège qui lui est tendu, à désirer non pas l'écart, le « recours aux forêts », la souveraineté perdue, mais un « plus de pouvoir », croyant ainsi, par ce pouvoir plus grand, qui est en réalité une plus grande servitude, se délivrer du pouvoir plus petit, sans voir qu'il augmente ce dont il souffre en croyant s'en départir. La puissance, lors, s'éloigne de plus en plus, au point de paraître irréelle, alors qu'elle est le cœur même du réel, la vérité fulgurante de tout acte d'être, « l'éclair dans l'Eclair » dont parlait Angélus Silésius. 
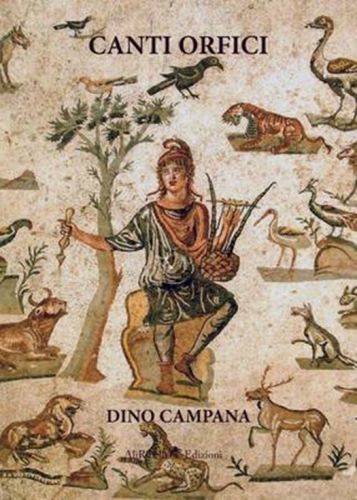 Le dessein est obscur, échappant sans doute, dans ses fins dernières, à ceux-là même qui le promeuvent, mais son mode opératoire, en revanche, est des plus clairs. Nous ne savons pas exactement qui est l'Ennemi, mais nous pouvons voir quels sont les adversaires de cet Ennemi: le sensible et l'intelligible dans leurs variations et leurs pointes extrêmes. On pourrait le dire d'un mot, chargé du sens de ce qui précède: le poème, non certes en tant que « travail du texte » mais comme expérience orphique, telle que la connut, dans son péril, Dino Campana, telle qu'elle s'irise dans les dizains de la Délie de Maurice Scève. Le poème, non comme épiphénomène mais comme la trame secrète sur laquelle reposent la raison et le réel; le poème comme reconnaissance que nous sommes bien là, dans un esprit, une âme et un corps, un dans trois et trois dans un. Le monde binaire, celui des moralisateurs et des informaticiens, en méconnaissant l'âme, nous prive, en les séparant, de l'esprit et du corps, lesquels se réduisent alors, l'un par la pensée calculante, l'autre comme objet publicitaire, à n'être que des enjeux de pouvoir.
Le dessein est obscur, échappant sans doute, dans ses fins dernières, à ceux-là même qui le promeuvent, mais son mode opératoire, en revanche, est des plus clairs. Nous ne savons pas exactement qui est l'Ennemi, mais nous pouvons voir quels sont les adversaires de cet Ennemi: le sensible et l'intelligible dans leurs variations et leurs pointes extrêmes. On pourrait le dire d'un mot, chargé du sens de ce qui précède: le poème, non certes en tant que « travail du texte » mais comme expérience orphique, telle que la connut, dans son péril, Dino Campana, telle qu'elle s'irise dans les dizains de la Délie de Maurice Scève. Le poème, non comme épiphénomène mais comme la trame secrète sur laquelle reposent la raison et le réel; le poème comme reconnaissance que nous sommes bien là, dans un esprit, une âme et un corps, un dans trois et trois dans un. Le monde binaire, celui des moralisateurs et des informaticiens, en méconnaissant l'âme, nous prive, en les séparant, de l'esprit et du corps, lesquels se réduisent alors, l'un par la pensée calculante, l'autre comme objet publicitaire, à n'être que des enjeux de pouvoir. 

 Quoique vous pensiez, l'idéologue, successeur de l'Inquisiteur, sait mieux que vous pourquoi vous le pensez. Vos intuitions, vos aperçus, ne sont pour lui qu'une façon de vous classer dans telle ou telle catégorie plus ou moins répréhensible, selon qu'il vous jugera plus ou moins hostile ou utile à ce qu'il voudrait prévoir, établir, consolider, - le tout aboutissant généralement à de sinistres désastres et des champs de ruines.
Quoique vous pensiez, l'idéologue, successeur de l'Inquisiteur, sait mieux que vous pourquoi vous le pensez. Vos intuitions, vos aperçus, ne sont pour lui qu'une façon de vous classer dans telle ou telle catégorie plus ou moins répréhensible, selon qu'il vous jugera plus ou moins hostile ou utile à ce qu'il voudrait prévoir, établir, consolider, - le tout aboutissant généralement à de sinistres désastres et des champs de ruines. 

 Entre les deux hommes, presque des contemporains, séparés par seulement quatre ans de vie, est née une amitié qui - entre les hauts et les bas de l’existence, comme cela arrive souvent aux hommes dotés de caractère et de profondeur spirituelle - a duré jusqu'à la fin des jours d'Eliade (Cioran le suivra en 1995). Un monument littéraire à cette relation de longue durée entre deux géants de l’esprit est Una segreta complicità (Adelphi), la première édition mondiale de la correspondance entre les deux exilés roumains, d'où émerge une incroyable complémentarité, mêlée d'antagonisme, souvent non exempte de virulente controverse, comme le rappellent les deux éditeurs, Massimo Carloni et Horia Corneliu Cicortaş, mais toujours sous la bannière d’une entente secrète que Cioran a témoigné à Eliade le jour de Noël 1935 :
Entre les deux hommes, presque des contemporains, séparés par seulement quatre ans de vie, est née une amitié qui - entre les hauts et les bas de l’existence, comme cela arrive souvent aux hommes dotés de caractère et de profondeur spirituelle - a duré jusqu'à la fin des jours d'Eliade (Cioran le suivra en 1995). Un monument littéraire à cette relation de longue durée entre deux géants de l’esprit est Una segreta complicità (Adelphi), la première édition mondiale de la correspondance entre les deux exilés roumains, d'où émerge une incroyable complémentarité, mêlée d'antagonisme, souvent non exempte de virulente controverse, comme le rappellent les deux éditeurs, Massimo Carloni et Horia Corneliu Cicortaş, mais toujours sous la bannière d’une entente secrète que Cioran a témoigné à Eliade le jour de Noël 1935 :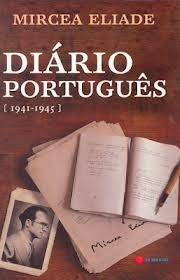 De même, la différence entre deux visions du monde opposées concernant l'Est et l'Ouest apparaît chez les deux hommes, Cioran cherchant pour ainsi dire à trouver un Est dans l'Ouest, et Eliade étant poussé à aller dans la direction opposée, sans toutefois se laisser aller à l'exotisme facile, tant à la mode à l’époque que maintenant. Il écrit à Cioran le 23 avril 1941 depuis Lisbonne, où il séjourne en tant qu'attaché de presse à la légation roumaine (le magnifique Journal portugais, publié en italien par Jaca Book, témoigne de son séjour en terres lusitaniennes) : "Vivant face à l'Atlantique, je me sens de plus en plus attiré par des géographies qui m'étaient autrefois insignifiantes. J'essaie de trouver mon salut en dehors de l'Europe. Vasco de Gama est toujours arrivé en Inde".
De même, la différence entre deux visions du monde opposées concernant l'Est et l'Ouest apparaît chez les deux hommes, Cioran cherchant pour ainsi dire à trouver un Est dans l'Ouest, et Eliade étant poussé à aller dans la direction opposée, sans toutefois se laisser aller à l'exotisme facile, tant à la mode à l’époque que maintenant. Il écrit à Cioran le 23 avril 1941 depuis Lisbonne, où il séjourne en tant qu'attaché de presse à la légation roumaine (le magnifique Journal portugais, publié en italien par Jaca Book, témoigne de son séjour en terres lusitaniennes) : "Vivant face à l'Atlantique, je me sens de plus en plus attiré par des géographies qui m'étaient autrefois insignifiantes. J'essaie de trouver mon salut en dehors de l'Europe. Vasco de Gama est toujours arrivé en Inde".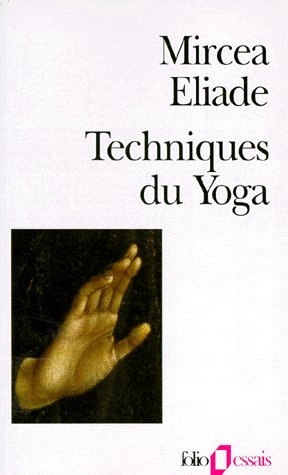 Leur relation épistolaire et humaine survivra à cette Europe dont ils avaient tous deux rédigé le rapport d’autopsie, vivant en ses derniers moments comme l’on vit la fin d'une saison, avec cette amère conscience qui transparaît d'une note du Journal portugais d'Eliade datant de novembre 1942 (un an après la lettre précitée) et écrite dans la ville espagnole d'Aranjuez avec ses mille palais et jardins caressés par le Tage : "Le palais rose. Les magnolias. A côté du palais, des groupes de statues en marbre. Vous pouvez entendre le bruit des eaux du Tage qui se déversent dans la cascade. Une promenade dans le parc du palais : de nombreuses feuilles sur le sol. L'automne est arrivé. Les rossignols. Le minuscule labyrinthe d'arbustes. Des bancs, des ronds-points. Nous sommes les derniers". J'aime à penser que dans cette lointaine année 1942, dans l'œil de la tempête, Eliade parlait implicitement de lui et de son vieil ami, à des centaines de kilomètres de là, mais partageant avec lui un destin bien plus élevé, que même la tragédie européenne qui a suivi n'a pas pu écraser.
Leur relation épistolaire et humaine survivra à cette Europe dont ils avaient tous deux rédigé le rapport d’autopsie, vivant en ses derniers moments comme l’on vit la fin d'une saison, avec cette amère conscience qui transparaît d'une note du Journal portugais d'Eliade datant de novembre 1942 (un an après la lettre précitée) et écrite dans la ville espagnole d'Aranjuez avec ses mille palais et jardins caressés par le Tage : "Le palais rose. Les magnolias. A côté du palais, des groupes de statues en marbre. Vous pouvez entendre le bruit des eaux du Tage qui se déversent dans la cascade. Une promenade dans le parc du palais : de nombreuses feuilles sur le sol. L'automne est arrivé. Les rossignols. Le minuscule labyrinthe d'arbustes. Des bancs, des ronds-points. Nous sommes les derniers". J'aime à penser que dans cette lointaine année 1942, dans l'œil de la tempête, Eliade parlait implicitement de lui et de son vieil ami, à des centaines de kilomètres de là, mais partageant avec lui un destin bien plus élevé, que même la tragédie européenne qui a suivi n'a pas pu écraser.


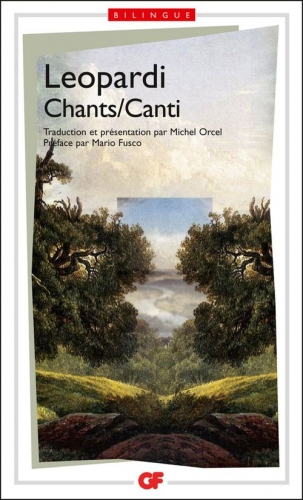 Revenons à Nietzsche et à Spinoza. Il y a une troisième figure sans laquelle la destruction ultime de la métaphysique n'aurait pas été accomplie par le philosophe allemand : elle s’appelle Leopardi, qui a eu une influence fondamentale sur la philosophie de Nietzsche. Car le "comte" de Recanati (qui ne connaissait pas l'allemand -mais il n'en avait pas besoin- car il possédait les langues anciennes comme le plus expert des philologues classiques, et ce dès son adolescence). Friedrich Nietzsche le connaissait bien. Et, chose que l'on oublie parfois, il est non seulement l'un des plus grands poètes du XIXe siècle - en italien, le plus grand, mais au sommet de tous les poètes de notre continent - mais aussi le plus grand philosophe italien du XIXe siècle, et l'un des plus grands d'Europe. Il ne faut pas oublier qu’il a fait largement usage d’une forme et d’un style qu'il partage avec Nietzsche : sa façon de penser par aphorismes. Hegel s'est lancé dans une divagation sur des systèmes d'une incroyable lourdeur et il a été le recréateur d'une théodicée moderne à laquelle nous devons, conjuguée à d'autres éléments, le nazisme. Le Zibaldone di pensieri de Leopardi semble être une suite d'aphorismes d'une concision latine apparemment désordonnée. Il possède cependant une formidable cohérence interne qui se fond avec la poésie de son auteur (même la poésie non "philosophique" : tout le monde peut comprendre que le Canto notturno di un pastore errante dell'Asia, ou La ginestra, sont de la philosophie chantée en vers sublimes, ou comprendre l'Operette morali et l'Epistolario. Et Friedrich Nietzsche était un connaisseur et un admirateur attentif de Leopardi. Sans lui, il serait resté prisonnier de la métaphysique wagnérienne.
Revenons à Nietzsche et à Spinoza. Il y a une troisième figure sans laquelle la destruction ultime de la métaphysique n'aurait pas été accomplie par le philosophe allemand : elle s’appelle Leopardi, qui a eu une influence fondamentale sur la philosophie de Nietzsche. Car le "comte" de Recanati (qui ne connaissait pas l'allemand -mais il n'en avait pas besoin- car il possédait les langues anciennes comme le plus expert des philologues classiques, et ce dès son adolescence). Friedrich Nietzsche le connaissait bien. Et, chose que l'on oublie parfois, il est non seulement l'un des plus grands poètes du XIXe siècle - en italien, le plus grand, mais au sommet de tous les poètes de notre continent - mais aussi le plus grand philosophe italien du XIXe siècle, et l'un des plus grands d'Europe. Il ne faut pas oublier qu’il a fait largement usage d’une forme et d’un style qu'il partage avec Nietzsche : sa façon de penser par aphorismes. Hegel s'est lancé dans une divagation sur des systèmes d'une incroyable lourdeur et il a été le recréateur d'une théodicée moderne à laquelle nous devons, conjuguée à d'autres éléments, le nazisme. Le Zibaldone di pensieri de Leopardi semble être une suite d'aphorismes d'une concision latine apparemment désordonnée. Il possède cependant une formidable cohérence interne qui se fond avec la poésie de son auteur (même la poésie non "philosophique" : tout le monde peut comprendre que le Canto notturno di un pastore errante dell'Asia, ou La ginestra, sont de la philosophie chantée en vers sublimes, ou comprendre l'Operette morali et l'Epistolario. Et Friedrich Nietzsche était un connaisseur et un admirateur attentif de Leopardi. Sans lui, il serait resté prisonnier de la métaphysique wagnérienne.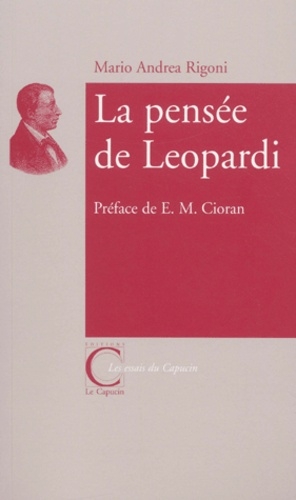 Rigoni connaît chaque virgule du Zibaldone, chaque ligne poétique, chaque épître du Contino ; chaque repli des Operette morali, qui sont un des sommets de la prose italienne et, venant du matérialisme français du XVIIIe siècle et de Fontenelle (auteur des Dialogues des morts), ils ont trouvé un Style Grotesque qui est soudé à l'ancien nihilisme, si je puis dire, de Lucian de Samosata. Même ses pages, ostensiblement un recueil d'essais successifs dans le temps (il a même l'habitude de dater chacun des essais), possèdent une formidable unité. Y a-t-il des livres qui ont été écrits par eux-mêmes ? En voici une. Les pages sont nées, recherchées et ensuite soudées.
Rigoni connaît chaque virgule du Zibaldone, chaque ligne poétique, chaque épître du Contino ; chaque repli des Operette morali, qui sont un des sommets de la prose italienne et, venant du matérialisme français du XVIIIe siècle et de Fontenelle (auteur des Dialogues des morts), ils ont trouvé un Style Grotesque qui est soudé à l'ancien nihilisme, si je puis dire, de Lucian de Samosata. Même ses pages, ostensiblement un recueil d'essais successifs dans le temps (il a même l'habitude de dater chacun des essais), possèdent une formidable unité. Y a-t-il des livres qui ont été écrits par eux-mêmes ? En voici une. Les pages sont nées, recherchées et ensuite soudées.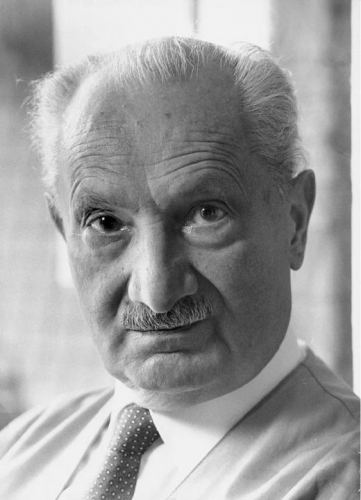

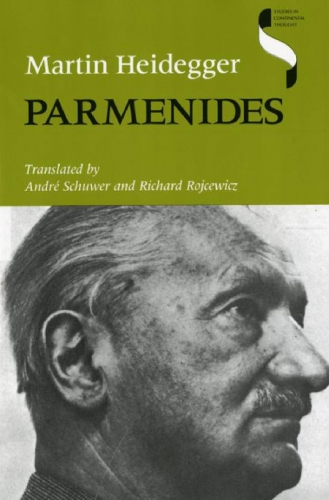
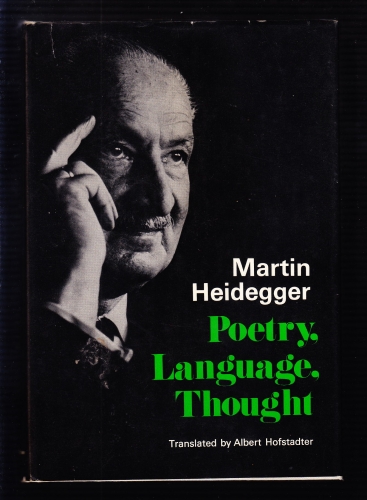





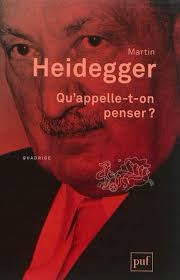 Heidegger would have regarded Guénon and Evola as philosophically naïve—for several reasons. First, they uncritically appropriate the Western metaphysical tradition in the name of combating modernity. Yet, as I have already mentioned, Heidegger argues that that tradition is implicated in the decline of the West. Second, the Traditionalists naïvely assert that this metaphysical tradition is “perennial” or timeless. They take Platonism as preserving elements of a primordial tradition that antedates Plato by millennia. They hold that the time of Plato belongs to the Kali Yuga (the fourth age, the decadent “Iron Age”), but they take Plato (and other ancient philosophers) to be preserving an older, indeed timeless wisdom. However, this is pure speculation, for which there is no solid scholarly evidence.
Heidegger would have regarded Guénon and Evola as philosophically naïve—for several reasons. First, they uncritically appropriate the Western metaphysical tradition in the name of combating modernity. Yet, as I have already mentioned, Heidegger argues that that tradition is implicated in the decline of the West. Second, the Traditionalists naïvely assert that this metaphysical tradition is “perennial” or timeless. They take Platonism as preserving elements of a primordial tradition that antedates Plato by millennia. They hold that the time of Plato belongs to the Kali Yuga (the fourth age, the decadent “Iron Age”), but they take Plato (and other ancient philosophers) to be preserving an older, indeed timeless wisdom. However, this is pure speculation, for which there is no solid scholarly evidence. 


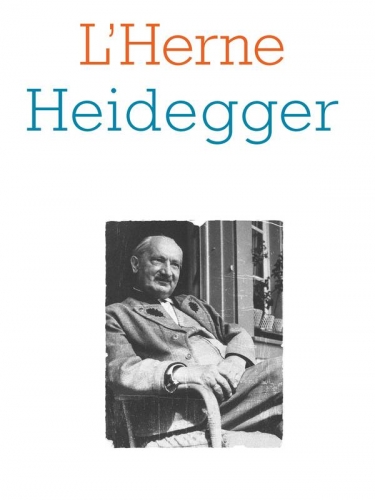


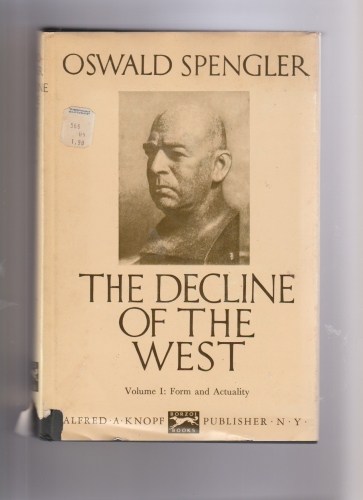
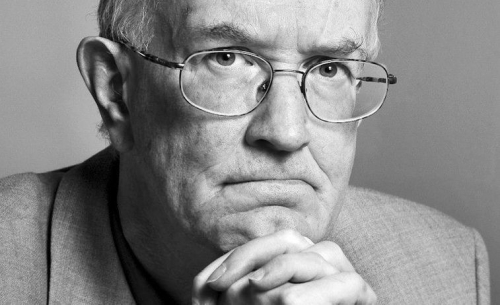
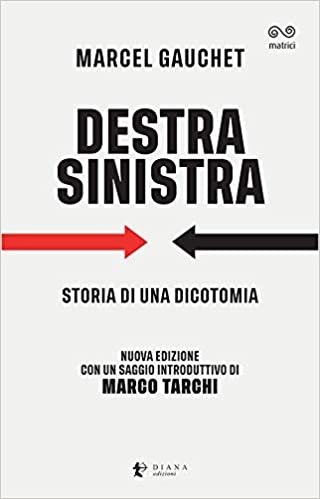 La maison d'édition Diana propose la réimpression d'un essai de Marcel Gauchet "Droite/Gauche - histoire d'une dichotomie", enrichi d'une introduction de Marco Tarchi et d'une postface de l'auteur, annexe nécessaire à une publication datant déjà de 1992.
La maison d'édition Diana propose la réimpression d'un essai de Marcel Gauchet "Droite/Gauche - histoire d'une dichotomie", enrichi d'une introduction de Marco Tarchi et d'une postface de l'auteur, annexe nécessaire à une publication datant déjà de 1992.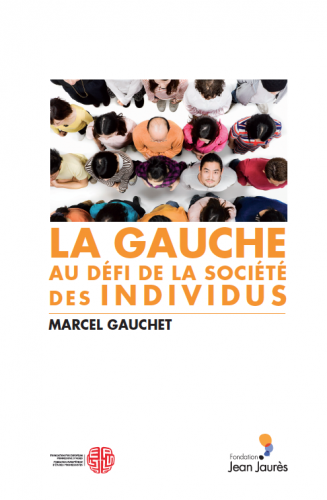 Les finalités, les contenus et les programmes changent mais l'"ordre de bataille" de la politique française reste formellement inchangé : dans un mélange de conflit et de fragmentation, les modérés et les alternances du centre continuent à gouverner, laissant "libre cours" aux doctrinaires des extrêmes et à un dualisme aussi élémentaire que manichéen, virulent et implacable.
Les finalités, les contenus et les programmes changent mais l'"ordre de bataille" de la politique française reste formellement inchangé : dans un mélange de conflit et de fragmentation, les modérés et les alternances du centre continuent à gouverner, laissant "libre cours" aux doctrinaires des extrêmes et à un dualisme aussi élémentaire que manichéen, virulent et implacable.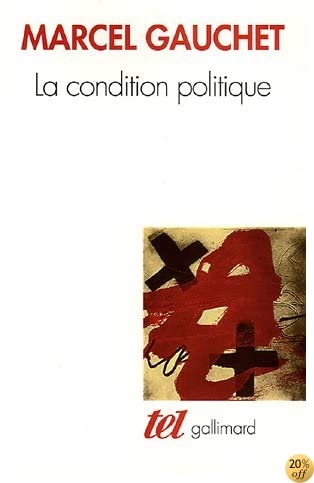 Cette approche contraste avec celle "essentialiste" (identifiable, en grande partie, dans les écrits de Norberto Bobbio), qui échappe au test empirique d'une discrimination claire entre les deux catégories et n'explique pas les transformations que le passage du temps et l'évolution des circonstances ont imposées aux pratiques des partis et mouvements politiques traditionnellement placés dans l'un ou l'autre domaine.
Cette approche contraste avec celle "essentialiste" (identifiable, en grande partie, dans les écrits de Norberto Bobbio), qui échappe au test empirique d'une discrimination claire entre les deux catégories et n'explique pas les transformations que le passage du temps et l'évolution des circonstances ont imposées aux pratiques des partis et mouvements politiques traditionnellement placés dans l'un ou l'autre domaine.
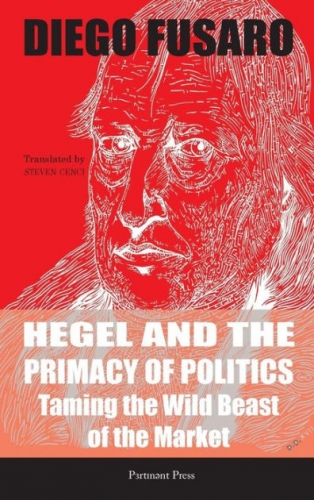 Bien sûr, la question de l'antifascisme est absolument décisive. Je voudrais résumer la question comme suit : à l'époque de Gramsci ou de Gobetti, en nous limitant au contexte italien, l'antifascisme était indispensable et fondamental, et il avait, du moins chez Gramsci, un but politique communiste, patriotique et anticapitaliste. Le problème, cependant, se pose lorsque l'antifascisme continue à se développer en l'absence de fascisme ou, plus précisément, lorsque le fascisme, si par cette expression nous entendons le pouvoir de manière générique, change de visage.
Bien sûr, la question de l'antifascisme est absolument décisive. Je voudrais résumer la question comme suit : à l'époque de Gramsci ou de Gobetti, en nous limitant au contexte italien, l'antifascisme était indispensable et fondamental, et il avait, du moins chez Gramsci, un but politique communiste, patriotique et anticapitaliste. Le problème, cependant, se pose lorsque l'antifascisme continue à se développer en l'absence de fascisme ou, plus précisément, lorsque le fascisme, si par cette expression nous entendons le pouvoir de manière générique, change de visage.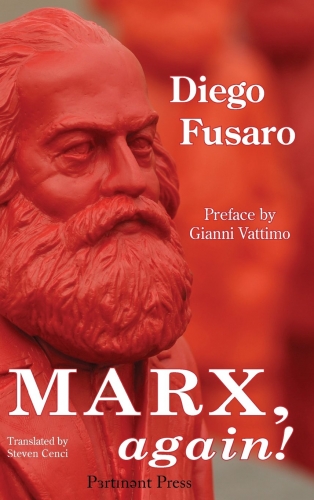 Par conséquent, la gauche, qui ne défend plus les idées de Gramsci et de Marx, mais qui défend directement le capital, du moins la plus grande partie de celui-ci, a besoin de maintenir l'antifascisme en vie pour se légitimer, afin que la contradiction ne soit pas visible et évidente ; c'est-à-dire que cette gauche veut dissimuler le fait pourtant patent que la gauche est restée antifasciste, alors que le fascisme n'existe plus mais n'est pas pour autant anticapitaliste, alors que le capitalisme progresse plus que jamais. Au contraire, les hommes de gauche utilisent l'antifascisme comme prétexte pour adhérer complètement au "fascisme" de la civilisation consumériste, à l'atout invisible de l'économie de marché. Je pense au cas français où la gauche forme un front antifasciste uni contre Le Pen pour accepter pleinement le "fascisme de marché" et l'élite financière cooptée par Rothschild, représentée par le libéral Macron.
Par conséquent, la gauche, qui ne défend plus les idées de Gramsci et de Marx, mais qui défend directement le capital, du moins la plus grande partie de celui-ci, a besoin de maintenir l'antifascisme en vie pour se légitimer, afin que la contradiction ne soit pas visible et évidente ; c'est-à-dire que cette gauche veut dissimuler le fait pourtant patent que la gauche est restée antifasciste, alors que le fascisme n'existe plus mais n'est pas pour autant anticapitaliste, alors que le capitalisme progresse plus que jamais. Au contraire, les hommes de gauche utilisent l'antifascisme comme prétexte pour adhérer complètement au "fascisme" de la civilisation consumériste, à l'atout invisible de l'économie de marché. Je pense au cas français où la gauche forme un front antifasciste uni contre Le Pen pour accepter pleinement le "fascisme de marché" et l'élite financière cooptée par Rothschild, représentée par le libéral Macron. Il n'y a pas d'autre réalité, dans la modernité, pour les droits sociaux et les démocraties en dehors des États souverains nationaux. C'est pourquoi l'expression de Che Guevara "la patrie ou la mort" a sa propre validité aujourd'hui encore, non seulement parce qu'elle revendique l'identité contre l'anonymat impersonnel des marchés, mais aussi parce qu'elle revendique l'idée de souveraineté nationale contre les processus de déracinement voulus par le capitalisme mondialiste. La classe dominante est de gauche en matière de coutumes et de culture parce qu'elle n'a pas fait sien l'impératif de la gauche anticapitaliste de Gramsci ou de Lénine, qu'elle a d'ailleurs répudié, mais a adopté celui de la gauche rose de 1968, qui identifie le communisme à la libéralisation individualiste de la consommation et des coutumes ; c'est-à-dire à la société de libre-service des consommateurs individuels qui ont toute la liberté qu'ils peuvent concrètement acheter et se sentir libres comme des atomes de Nietzsche, comme des surhommes avec une volonté de pouvoir illimitée, c'est-à-dire qu'ils conçoivent la liberté comme la propriété de l'individu déraciné par rapport aux communautés sédentaires qu’ils posent comme autoritaires : la communauté familiale, la communauté politique, la communauté religieuse.
Il n'y a pas d'autre réalité, dans la modernité, pour les droits sociaux et les démocraties en dehors des États souverains nationaux. C'est pourquoi l'expression de Che Guevara "la patrie ou la mort" a sa propre validité aujourd'hui encore, non seulement parce qu'elle revendique l'identité contre l'anonymat impersonnel des marchés, mais aussi parce qu'elle revendique l'idée de souveraineté nationale contre les processus de déracinement voulus par le capitalisme mondialiste. La classe dominante est de gauche en matière de coutumes et de culture parce qu'elle n'a pas fait sien l'impératif de la gauche anticapitaliste de Gramsci ou de Lénine, qu'elle a d'ailleurs répudié, mais a adopté celui de la gauche rose de 1968, qui identifie le communisme à la libéralisation individualiste de la consommation et des coutumes ; c'est-à-dire à la société de libre-service des consommateurs individuels qui ont toute la liberté qu'ils peuvent concrètement acheter et se sentir libres comme des atomes de Nietzsche, comme des surhommes avec une volonté de pouvoir illimitée, c'est-à-dire qu'ils conçoivent la liberté comme la propriété de l'individu déraciné par rapport aux communautés sédentaires qu’ils posent comme autoritaires : la communauté familiale, la communauté politique, la communauté religieuse.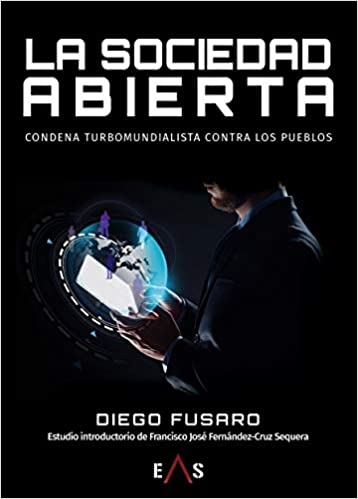 Une économie sans politique et sans État ne sera jamais démocratique ou socialiste, elle sera toujours l'humus idéal pour le capital cosmopolite, qui est tout sauf socialiste et démocratique. D'où l'importance de ce que j'appelle le souverainisme internationaliste et populiste. Souveraineté parce que la souveraineté nationale est pleinement récupérée comme base des droits et des démocraties, du socialisme et des conquêtes sociales. Internationaliste parce que ce n'est pas le nationalisme de la droite réactionnaire, xénophobe et autoritaire, c'est une souveraineté internationaliste ouverte aux autres nations socialistes et démocratiques, elle crée un internationalisme prolétarien, comme on l'appelait autrefois, qui est à l'opposé du nationalisme individualiste et réactionnaire et du cosmopolitisme libéral auxquels la gauche rose a vendu sa tête et son cœur, comme je l'ai dit précédemment.
Une économie sans politique et sans État ne sera jamais démocratique ou socialiste, elle sera toujours l'humus idéal pour le capital cosmopolite, qui est tout sauf socialiste et démocratique. D'où l'importance de ce que j'appelle le souverainisme internationaliste et populiste. Souveraineté parce que la souveraineté nationale est pleinement récupérée comme base des droits et des démocraties, du socialisme et des conquêtes sociales. Internationaliste parce que ce n'est pas le nationalisme de la droite réactionnaire, xénophobe et autoritaire, c'est une souveraineté internationaliste ouverte aux autres nations socialistes et démocratiques, elle crée un internationalisme prolétarien, comme on l'appelait autrefois, qui est à l'opposé du nationalisme individualiste et réactionnaire et du cosmopolitisme libéral auxquels la gauche rose a vendu sa tête et son cœur, comme je l'ai dit précédemment. Par conséquent, quiconque s'oppose à cette vision, revendiquant la primauté de l'humain et du politique, défendant la nécessité de réguler, réclamant la primauté du politique et de la démocratie sur les flux de capitaux, de personnes, de désirs, de consommation, est automatiquement calomnié comme fasciste par la gauche rose-fuchsia, pour qui tout ce qui ne se met pas au diapason avec le seigneur cosmopolite, dont ils sont les idiots utiles, est fasciste. Le paradoxe est le suivant, je le résume ainsi, cette gauche diffame tout ce qui s'oppose à l'ordre de la classe dominante sans-frontiériste, de la classe globocratique du capital, elle diffame comme fasciste l'idée de l'intervention de l'État dans l'économie, elle diffame comme fasciste le réveil des classes dominées, des opprimés qui, comme le disait Fichte, sont au-dessus de toute autorité qui prétend être supérieure.
Par conséquent, quiconque s'oppose à cette vision, revendiquant la primauté de l'humain et du politique, défendant la nécessité de réguler, réclamant la primauté du politique et de la démocratie sur les flux de capitaux, de personnes, de désirs, de consommation, est automatiquement calomnié comme fasciste par la gauche rose-fuchsia, pour qui tout ce qui ne se met pas au diapason avec le seigneur cosmopolite, dont ils sont les idiots utiles, est fasciste. Le paradoxe est le suivant, je le résume ainsi, cette gauche diffame tout ce qui s'oppose à l'ordre de la classe dominante sans-frontiériste, de la classe globocratique du capital, elle diffame comme fasciste l'idée de l'intervention de l'État dans l'économie, elle diffame comme fasciste le réveil des classes dominées, des opprimés qui, comme le disait Fichte, sont au-dessus de toute autorité qui prétend être supérieure.
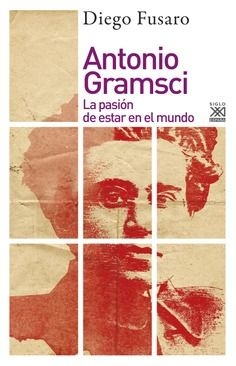 Si Gramsci était "le Marx italien", Diego Fusaro est peut-être l'actuel Gramsci. Les trois philosophes que je mentionne partagent une base philosophique commune, la dialectique hégélienne, et, même à un niveau plus général, sont les avatars de l'idéalisme allemand classique. De cet idéalisme, que Gramsci appelle "philosophie de la praxis", découle la non-conformité la plus radicale de Fusaro. Les trois auteurs sont clairement des non-conformistes. La non-conformité est une attitude qui transcende les catégories politiques vulgaires habituelles (gauche/droite, conservateur/progressiste, société ouverte/société fermée). La non-conformité est l’attitude d'un sujet collectif qui vit immergé dans une ontologie sociale. S'il n'y a pas d'analyse et de compréhension de cette ontologie sociale, la non-conformité n'est rien d'autre qu'un "état d'esprit", une pose, une rhétorique. Mais si cette attitude est ancrée dans l'analyse et la compréhension de la totalité sociale (de son ontologie), alors être contre "le fatal" devient une force révolutionnaire. Diego Fusaro est un bon connaisseur de Gramsci et a dédié un bel ouvrage documenté au "Marx italien", sur lequel nous avons déjà écrit quelques lignes : Antonio Gramsci. La pasión de estar en el mundo [XXIe siècle, Madrid, 2018 ; traduction de Michela Ferrante Lavín, à paraître dans El Inactual https://www.elinactual.com/].
Si Gramsci était "le Marx italien", Diego Fusaro est peut-être l'actuel Gramsci. Les trois philosophes que je mentionne partagent une base philosophique commune, la dialectique hégélienne, et, même à un niveau plus général, sont les avatars de l'idéalisme allemand classique. De cet idéalisme, que Gramsci appelle "philosophie de la praxis", découle la non-conformité la plus radicale de Fusaro. Les trois auteurs sont clairement des non-conformistes. La non-conformité est une attitude qui transcende les catégories politiques vulgaires habituelles (gauche/droite, conservateur/progressiste, société ouverte/société fermée). La non-conformité est l’attitude d'un sujet collectif qui vit immergé dans une ontologie sociale. S'il n'y a pas d'analyse et de compréhension de cette ontologie sociale, la non-conformité n'est rien d'autre qu'un "état d'esprit", une pose, une rhétorique. Mais si cette attitude est ancrée dans l'analyse et la compréhension de la totalité sociale (de son ontologie), alors être contre "le fatal" devient une force révolutionnaire. Diego Fusaro est un bon connaisseur de Gramsci et a dédié un bel ouvrage documenté au "Marx italien", sur lequel nous avons déjà écrit quelques lignes : Antonio Gramsci. La pasión de estar en el mundo [XXIe siècle, Madrid, 2018 ; traduction de Michela Ferrante Lavín, à paraître dans El Inactual https://www.elinactual.com/]. La droite ou la gauche, le bleu, le rouge ou le violet, sont tous identiques. Ce sont les couleurs des partis qui n'aspirent qu'à vivre de la partitocratie. Ils traient l'État, qui traie en réalité les classes productives : de l'ouvrier au paysan, en passant par l'indépendant et le propriétaire d'une PME. Tous ces secteurs de la population sont vampirisés par des groupes de marchands de pacotilles et d’inutilités, dont le seul lien essentiel avec la réalité consiste à être des entités ultra-subventionnées par un État qui cesse d'être un "État providence" et devient progressivement un "État extracteur de ressources" pour le maintien de la partitocratie et le maintien du capitalisme financier mondialiste.
La droite ou la gauche, le bleu, le rouge ou le violet, sont tous identiques. Ce sont les couleurs des partis qui n'aspirent qu'à vivre de la partitocratie. Ils traient l'État, qui traie en réalité les classes productives : de l'ouvrier au paysan, en passant par l'indépendant et le propriétaire d'une PME. Tous ces secteurs de la population sont vampirisés par des groupes de marchands de pacotilles et d’inutilités, dont le seul lien essentiel avec la réalité consiste à être des entités ultra-subventionnées par un État qui cesse d'être un "État providence" et devient progressivement un "État extracteur de ressources" pour le maintien de la partitocratie et le maintien du capitalisme financier mondialiste. "La rhétorique évoquant une réalité qui ne peut être changée, rhétorique qui triomphe aujourd'hui, finit par quitter et accepter le monde tel qu'il est. Comme Gramsci le savait bien, c'est notre indifférence qui transforme l'ordre des choses en fatalisme. Plus nous pensons qu'une situation historique est stable et irréversible, plus elle le devient vraiment. Le fanatisme économique est une tendance irrésistible si nous n'y résistons pas, une force incontrôlable si nous ne l’infirmons pas, et un processus irréversible si nous ne le transformons pas" (p. 162).
"La rhétorique évoquant une réalité qui ne peut être changée, rhétorique qui triomphe aujourd'hui, finit par quitter et accepter le monde tel qu'il est. Comme Gramsci le savait bien, c'est notre indifférence qui transforme l'ordre des choses en fatalisme. Plus nous pensons qu'une situation historique est stable et irréversible, plus elle le devient vraiment. Le fanatisme économique est une tendance irrésistible si nous n'y résistons pas, une force incontrôlable si nous ne l’infirmons pas, et un processus irréversible si nous ne le transformons pas" (p. 162).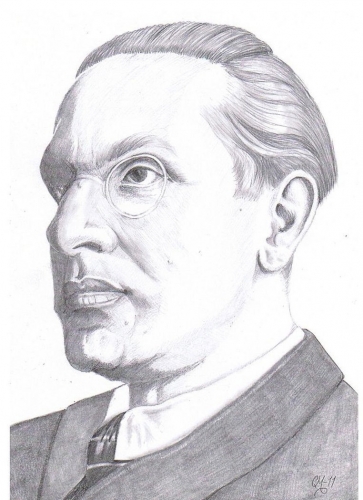
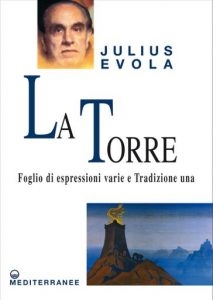 La nouvelle édition de La Torre, la revue mythique dirigée par Julius Evola en 1930, vient d'être publiée par la maison d’édition Mediterranee ; c’est une version critique, remise à jour, comprenant des notes, des bibliographies et des analyses approfondies. En plus d'être un document historique comme il y en a peu d'autres, cette réédition témoigne d'une approche "métapolitique" et "spirituelle", qui a tenté d'orienter la politique de l'époque dans un sens différent de celui pris dans les années ultérieures. À l'occasion de cette nouvelle édition, nous rapportons, avec l'aimable autorisation de l'éditeur, une note signée par Evola dans le quatrième numéro de la revue, le 16 mars 1930, dans la rubrique qu'il a dirigée, la rubrique L'Arco e la Clava. Ici, le philosophe répond clairement à tous ces périodiques (La Volontà d'Italia, Roma Fascista, L'Italia Letteraria, L'Ora, etc.) qui l'accusent de "catastrophisme", car, comme on le sait, il s’était penché sur le thème de la fin des civilisations. Dans cette réponse, Evola anticipe non seulement des analyses plus connues aujourd’hui de par le monde, contenues par exemple dans des textes tels que Le meilleur des mondes de Huxley (1932), La dialectique des Lumières d’Adorno de Horkheimer (1947), le 1984 d’Orwell (1949) et L'homme unidimensionnel de Marcuse (1964).De surcroît, iloffre un portrait impitoyable, une analyse quasi chirurgicale, de notre monde. Dans cette singulière variation sur le thème de la "fin du monde" (dont le spectre erre encore dans le débat public actuel), Evola imagine néanmoins une calamité bien différente de celles, littéraires et dystopiques, auxquelles nous nous sommes habitués, pour finir par décrire en fait... notre contemporanéité, avec ses tics et ses tabous, avec tous ses masques et ses acteurs que le lecteur - nous en sommes sûrs - n'aura pas de mal à reconnaître. C'est aussi parce qu'il n'y a souvent pas besoin de catastrophes naturelles - ou de pandémies, pourrait-on ajouter, pour basculer dans la dystopie. Une civilisation peut aussi mourir d'une mort naturelle. C'est peut-être le cas de la nôtre.
La nouvelle édition de La Torre, la revue mythique dirigée par Julius Evola en 1930, vient d'être publiée par la maison d’édition Mediterranee ; c’est une version critique, remise à jour, comprenant des notes, des bibliographies et des analyses approfondies. En plus d'être un document historique comme il y en a peu d'autres, cette réédition témoigne d'une approche "métapolitique" et "spirituelle", qui a tenté d'orienter la politique de l'époque dans un sens différent de celui pris dans les années ultérieures. À l'occasion de cette nouvelle édition, nous rapportons, avec l'aimable autorisation de l'éditeur, une note signée par Evola dans le quatrième numéro de la revue, le 16 mars 1930, dans la rubrique qu'il a dirigée, la rubrique L'Arco e la Clava. Ici, le philosophe répond clairement à tous ces périodiques (La Volontà d'Italia, Roma Fascista, L'Italia Letteraria, L'Ora, etc.) qui l'accusent de "catastrophisme", car, comme on le sait, il s’était penché sur le thème de la fin des civilisations. Dans cette réponse, Evola anticipe non seulement des analyses plus connues aujourd’hui de par le monde, contenues par exemple dans des textes tels que Le meilleur des mondes de Huxley (1932), La dialectique des Lumières d’Adorno de Horkheimer (1947), le 1984 d’Orwell (1949) et L'homme unidimensionnel de Marcuse (1964).De surcroît, iloffre un portrait impitoyable, une analyse quasi chirurgicale, de notre monde. Dans cette singulière variation sur le thème de la "fin du monde" (dont le spectre erre encore dans le débat public actuel), Evola imagine néanmoins une calamité bien différente de celles, littéraires et dystopiques, auxquelles nous nous sommes habitués, pour finir par décrire en fait... notre contemporanéité, avec ses tics et ses tabous, avec tous ses masques et ses acteurs que le lecteur - nous en sommes sûrs - n'aura pas de mal à reconnaître. C'est aussi parce qu'il n'y a souvent pas besoin de catastrophes naturelles - ou de pandémies, pourrait-on ajouter, pour basculer dans la dystopie. Une civilisation peut aussi mourir d'une mort naturelle. C'est peut-être le cas de la nôtre.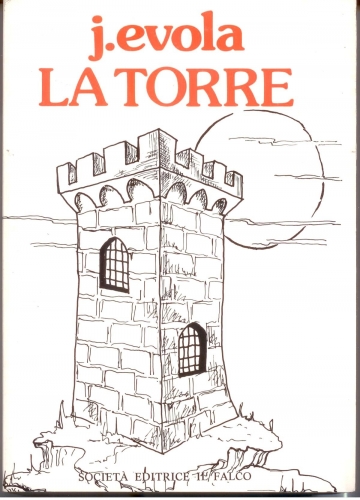

 Selon lui, la philosophie, pendant plus de 2000 ans d'histoire, a prêté attention à tout ce qui a les caractéristiques de l'"être" dans ce monde, y compris le monde lui-même, mais a oublié ce que cela signifie. C'est la "question de vie" de Heidegger, qui traverse toutes ses œuvres comme un fil rouge. Une des sources qui a influencé son interprétation de ce thème a été les travaux de Franz Brentano (photo) sur l'utilisation des différents concepts de l'être dans Aristote. Heidegger commence son œuvre principale, L’Etre et le Temps, par un dialogue tiré du Sophiste de Platon, qui montre que la philosophie occidentale a ignoré le concept d'être parce qu'elle considérait que sa signification allait de soi. Heidegger, pour sa part, exige que toute la philosophie occidentale retrace dès le début toutes les étapes de la formation de ce concept, appelant à un processus de "destruction" de l'histoire de la philosophie. Heidegger définit la structure de l'existence humaine dans son ensemble comme "Sorge" (= le Souci), qui est l'unité de trois moments : "être dans le monde", "courir en avant" et "être avec le monde de l'être". La "Sorge" est la base de "l'analyse existentielle" de Heidegger, comme il l'a appelée dans L'être et le temps. Heidegger pense que pour décrire une expérience, il faut d'abord trouver quelque chose pour laquelle une telle description a un sens. Ainsi, Heidegger déduit sa description de l'expérience à travers le Dasein, pour lequel l'être devient une question. Dans L’Etre et le Temps, Heidegger a critiqué la nature métaphysique abstraite des façons traditionnelles de décrire l'existence humaine, comme l’"animal rationnel", la personnalité, l'être humain, l'âme, l'esprit ou le sujet. Le Dasein ne devient pas la base d'une nouvelle "anthropologie philosophique", mais Heidegger le comprend comme une condition pour la possibilité de quelque chose comme "anthropologie philosophique". Selon Heidegger, le Dasein est "Sorge". Dans la partie sur l'analyse existentielle, Heidegger écrit que le Dasein, qui se trouve jeté au monde entre les choses et les Autres, trouve en lui la possibilité et l'inévitabilité de sa propre mort.
Selon lui, la philosophie, pendant plus de 2000 ans d'histoire, a prêté attention à tout ce qui a les caractéristiques de l'"être" dans ce monde, y compris le monde lui-même, mais a oublié ce que cela signifie. C'est la "question de vie" de Heidegger, qui traverse toutes ses œuvres comme un fil rouge. Une des sources qui a influencé son interprétation de ce thème a été les travaux de Franz Brentano (photo) sur l'utilisation des différents concepts de l'être dans Aristote. Heidegger commence son œuvre principale, L’Etre et le Temps, par un dialogue tiré du Sophiste de Platon, qui montre que la philosophie occidentale a ignoré le concept d'être parce qu'elle considérait que sa signification allait de soi. Heidegger, pour sa part, exige que toute la philosophie occidentale retrace dès le début toutes les étapes de la formation de ce concept, appelant à un processus de "destruction" de l'histoire de la philosophie. Heidegger définit la structure de l'existence humaine dans son ensemble comme "Sorge" (= le Souci), qui est l'unité de trois moments : "être dans le monde", "courir en avant" et "être avec le monde de l'être". La "Sorge" est la base de "l'analyse existentielle" de Heidegger, comme il l'a appelée dans L'être et le temps. Heidegger pense que pour décrire une expérience, il faut d'abord trouver quelque chose pour laquelle une telle description a un sens. Ainsi, Heidegger déduit sa description de l'expérience à travers le Dasein, pour lequel l'être devient une question. Dans L’Etre et le Temps, Heidegger a critiqué la nature métaphysique abstraite des façons traditionnelles de décrire l'existence humaine, comme l’"animal rationnel", la personnalité, l'être humain, l'âme, l'esprit ou le sujet. Le Dasein ne devient pas la base d'une nouvelle "anthropologie philosophique", mais Heidegger le comprend comme une condition pour la possibilité de quelque chose comme "anthropologie philosophique". Selon Heidegger, le Dasein est "Sorge". Dans la partie sur l'analyse existentielle, Heidegger écrit que le Dasein, qui se trouve jeté au monde entre les choses et les Autres, trouve en lui la possibilité et l'inévitabilité de sa propre mort.

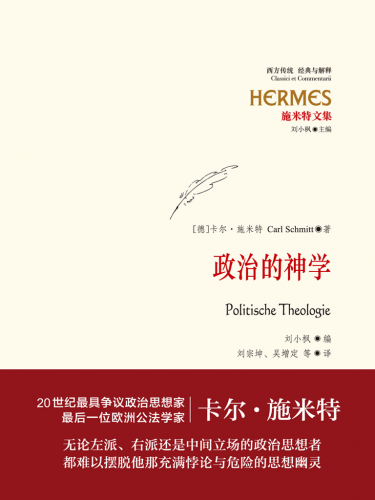
 Le professeur Xiao Bin a souligné dans son livre "De l'État, du monde et de la nature humaine à la politique : la construction du concept politique de Schmitt", que l'homme lui-même est un être dangereux. "Il prétend que la politique est un danger pour les gens." La question suivante qui se pose lorsque l'on participe à la politique est d'expliquer ce qu'est la politique, en particulier la nature de la politique. La survie de l'unité nationale exige comme condition préalable une distinction entre ennemis et amis. Une politique fondée sur la séparation des ennemis et des amis est non seulement le destin inévitable de l'unité de la nation et de l'État, mais aussi la base de son existence. Schmitt a une compréhension unique de la nature de la politique : la norme de la politique est de séparer les amis et les ennemis. En fait, ce que nous appelons la politique implique la relation entre un ami et un autre, et la différence est l'intensité de cette différence. Cependant, nous ne pouvons pas ignorer le fait que les origines théologiques les plus secrètes et les plus mystérieuses et le nationalisme allemand ont un niveau de critères différent pour séparer les amis des ennemis.
Le professeur Xiao Bin a souligné dans son livre "De l'État, du monde et de la nature humaine à la politique : la construction du concept politique de Schmitt", que l'homme lui-même est un être dangereux. "Il prétend que la politique est un danger pour les gens." La question suivante qui se pose lorsque l'on participe à la politique est d'expliquer ce qu'est la politique, en particulier la nature de la politique. La survie de l'unité nationale exige comme condition préalable une distinction entre ennemis et amis. Une politique fondée sur la séparation des ennemis et des amis est non seulement le destin inévitable de l'unité de la nation et de l'État, mais aussi la base de son existence. Schmitt a une compréhension unique de la nature de la politique : la norme de la politique est de séparer les amis et les ennemis. En fait, ce que nous appelons la politique implique la relation entre un ami et un autre, et la différence est l'intensité de cette différence. Cependant, nous ne pouvons pas ignorer le fait que les origines théologiques les plus secrètes et les plus mystérieuses et le nationalisme allemand ont un niveau de critères différent pour séparer les amis des ennemis. Du point de vue ci-dessus, la politique émerge des conflits humains et les phénomènes politiques de la société humaine sont inévitablement associés aux conflits et à la coopération. Même si vous comprenez la politique en termes de bonté et de moralité, comme Aristote, elle ne peut pas cacher l'existence du mal. Sous le bien suprême se trouve la crise du mal. L'homme est l'existence de l'incertitude, l'homme est un animal politique naturel, et où qu'il soit, il y aura des conflits. Dans les conflits, il y aura inévitablement deux camps opposés et la politique ne peut pas se débarrasser du conflit... Les deux aspects du conflit et de la confrontation nous donnent une base logique pour la division en amis et ennemis.
Du point de vue ci-dessus, la politique émerge des conflits humains et les phénomènes politiques de la société humaine sont inévitablement associés aux conflits et à la coopération. Même si vous comprenez la politique en termes de bonté et de moralité, comme Aristote, elle ne peut pas cacher l'existence du mal. Sous le bien suprême se trouve la crise du mal. L'homme est l'existence de l'incertitude, l'homme est un animal politique naturel, et où qu'il soit, il y aura des conflits. Dans les conflits, il y aura inévitablement deux camps opposés et la politique ne peut pas se débarrasser du conflit... Les deux aspects du conflit et de la confrontation nous donnent une base logique pour la division en amis et ennemis.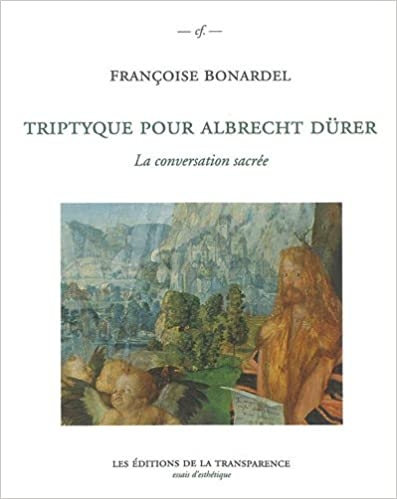
 Ce qui nous manque, Françoise Bonardel le nomme et l'illustre, le définit et l'exerce, n'est autre que la conversation sacrée. L'ouvrage, à cet égard, dépasse de loin l'intérêt que déjà nous pourrions porter à un travail fortement étayé sur Albrecht Dürer. On ne saurait mieux dire ce qu'est une conversation sacrée qu'en s'y livrant, c'est-à-dire en s'aventurant dans cette subversion du temps qui révèle les strates, le palimpseste, les nuées et les nuances des temporalités qui échappent habituellement à l'attention limitée, calculante, à l'égrènement uniforme, au cours linéaire qui est celui de l'usure.
Ce qui nous manque, Françoise Bonardel le nomme et l'illustre, le définit et l'exerce, n'est autre que la conversation sacrée. L'ouvrage, à cet égard, dépasse de loin l'intérêt que déjà nous pourrions porter à un travail fortement étayé sur Albrecht Dürer. On ne saurait mieux dire ce qu'est une conversation sacrée qu'en s'y livrant, c'est-à-dire en s'aventurant dans cette subversion du temps qui révèle les strates, le palimpseste, les nuées et les nuances des temporalités qui échappent habituellement à l'attention limitée, calculante, à l'égrènement uniforme, au cours linéaire qui est celui de l'usure.
















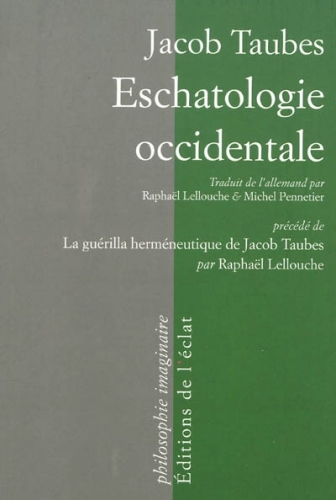
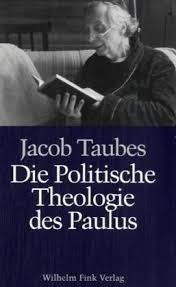 Abordons maintenant la thèse générale de Taubes, défendue dans cet ouvrage qui, en effet, peut parfois manquer d’originalité ainsi que le déploraient Strauss et Scholem. Lellouche résume fort bien le mouvement même de la pensée à laquelle nous sommes confrontés en identifiant ce courant eschatologique innervant l’histoire même de l’Occident. « L’histoire de l’Occident est un long conflit interne autour de l’enjeu central caché de l’apocalyptique. Dès les premiers siècles, le christianisme tend à se transformer en une mystique du Logos, en même temps que la dimension eschatologique perd son urgence politique et s’intériorise dans un « drame de l’âme » d’échelle cosmique. Ce n’est que résiduellement que l’apocalyptique fait résurgence dans l’ordre chrétien qui s’ouvre sur son refoulement. »
Abordons maintenant la thèse générale de Taubes, défendue dans cet ouvrage qui, en effet, peut parfois manquer d’originalité ainsi que le déploraient Strauss et Scholem. Lellouche résume fort bien le mouvement même de la pensée à laquelle nous sommes confrontés en identifiant ce courant eschatologique innervant l’histoire même de l’Occident. « L’histoire de l’Occident est un long conflit interne autour de l’enjeu central caché de l’apocalyptique. Dès les premiers siècles, le christianisme tend à se transformer en une mystique du Logos, en même temps que la dimension eschatologique perd son urgence politique et s’intériorise dans un « drame de l’âme » d’échelle cosmique. Ce n’est que résiduellement que l’apocalyptique fait résurgence dans l’ordre chrétien qui s’ouvre sur son refoulement. »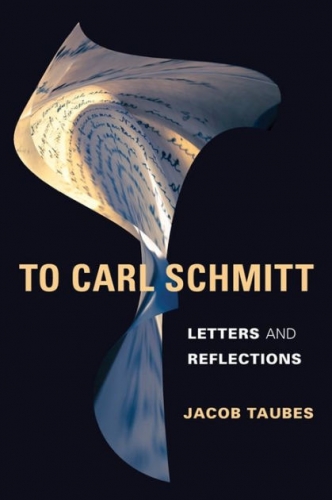 La solution à la question posée réside précisément dans la notion de fin comme eschaton : l’histoire ne semble possible que si, d’une part, se trouve posée une fin et si, d’autre part, entre le passé et la fin se trouve établi un rapport. Le moyen de parvenir à cette fin mettra en œuvre la volonté, et c’est là que l’influence de Carl Schmitt se fait certainement sentir. « Ainsi s’éclaire le rapport entre l’ordre du temps et l’ordre eschatologique du monde. Le sens unique du temps est fondé dans la volonté. »
La solution à la question posée réside précisément dans la notion de fin comme eschaton : l’histoire ne semble possible que si, d’une part, se trouve posée une fin et si, d’autre part, entre le passé et la fin se trouve établi un rapport. Le moyen de parvenir à cette fin mettra en œuvre la volonté, et c’est là que l’influence de Carl Schmitt se fait certainement sentir. « Ainsi s’éclaire le rapport entre l’ordre du temps et l’ordre eschatologique du monde. Le sens unique du temps est fondé dans la volonté. »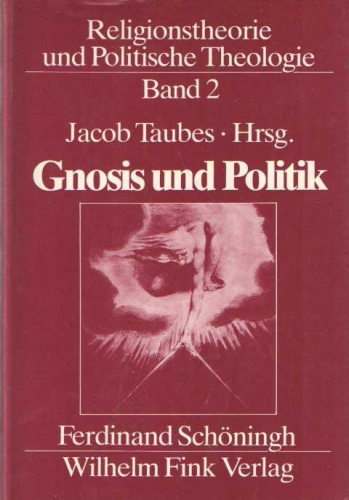 Plusieurs moments-clés de cette tendance vont être abordés : Joachim de Flore, Kant, Hegel, Marx, Kierkegaard, parmi les philosophes, mais aussi des endroits clés, si l’on peut dire, comme Israël qui va recevoir une caractérisation forte, en tant qu’il est le lieu par excellence de la révolution ; d’abord parce que le geste même d’Israël est celui de l’exil permanent, ce qui n’est autre que le sentiment général du gnostique, étant donné que le gnostique est celui qui a conscience d’avoir perdu sa patrie d’origine, qui a été exilé sur terre et dans le temps, mais aussi parce que l’exil répète le Désert : il y aurait un lien consubstantiel entre l’errance du désert et l’exil des Hébreux. « Ce sont leurs dispositions de type bédouin qui expliquent que les tribus semi-nomades d’Israël sortant d’Egypte n’aient pas élevé leur chef au rang de roi. La théocratie est construire sur le fond anarchisant de l’âme d’Israël. »
Plusieurs moments-clés de cette tendance vont être abordés : Joachim de Flore, Kant, Hegel, Marx, Kierkegaard, parmi les philosophes, mais aussi des endroits clés, si l’on peut dire, comme Israël qui va recevoir une caractérisation forte, en tant qu’il est le lieu par excellence de la révolution ; d’abord parce que le geste même d’Israël est celui de l’exil permanent, ce qui n’est autre que le sentiment général du gnostique, étant donné que le gnostique est celui qui a conscience d’avoir perdu sa patrie d’origine, qui a été exilé sur terre et dans le temps, mais aussi parce que l’exil répète le Désert : il y aurait un lien consubstantiel entre l’errance du désert et l’exil des Hébreux. « Ce sont leurs dispositions de type bédouin qui expliquent que les tribus semi-nomades d’Israël sortant d’Egypte n’aient pas élevé leur chef au rang de roi. La théocratie est construire sur le fond anarchisant de l’âme d’Israël. »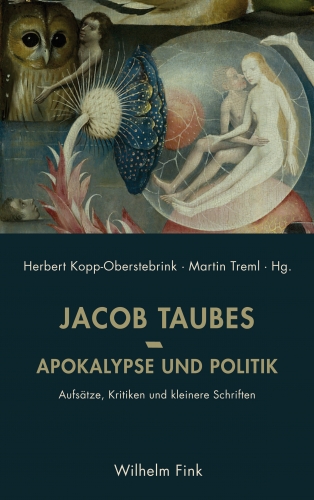 Taubes va fort logiquement accorder une place éminente à Joachim de Flore dans ce processus, dont il analyse subtilement le fameux transire qu’il rapproche de l’Aufhebung hégélienne, ainsi qu’à Thomas Münzer, pour lequel l’âme va se débarrasser de tous ses oripeaux pour renverser les puissances terrestres, afin qu’advienne ici et maintenant le règne de Dieu. Avec ces deux personnages, nous sommes en face de deux grands penseurs qui auront tenté de théoriser le moyen de dépasser dans l’immanence la simple condition mortelle. Et à partir de ce moment, toute la pensée, nous dit Taubes, va aller dans le sens d’une résorption sans cesse croissante de l’écart entre l’ici bas et la transcendance.
Taubes va fort logiquement accorder une place éminente à Joachim de Flore dans ce processus, dont il analyse subtilement le fameux transire qu’il rapproche de l’Aufhebung hégélienne, ainsi qu’à Thomas Münzer, pour lequel l’âme va se débarrasser de tous ses oripeaux pour renverser les puissances terrestres, afin qu’advienne ici et maintenant le règne de Dieu. Avec ces deux personnages, nous sommes en face de deux grands penseurs qui auront tenté de théoriser le moyen de dépasser dans l’immanence la simple condition mortelle. Et à partir de ce moment, toute la pensée, nous dit Taubes, va aller dans le sens d’une résorption sans cesse croissante de l’écart entre l’ici bas et la transcendance.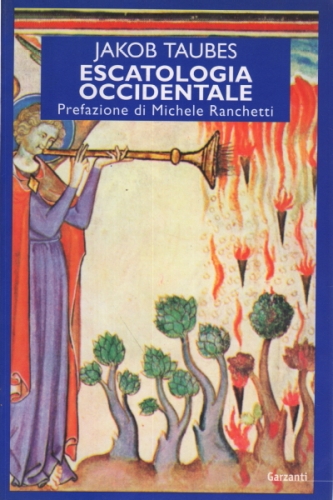 L’accomplissement de ces pensées, toujours pour Taubes, n’est autre que celle de Marx (et, dans une moindre mesure, celle de Kierkegaard) : « Si Marx philosophe sans Dieu et Kierkegaard devant Dieu, ils partagent cependant le même présupposé : la décomposition de Dieu et du monde. »
L’accomplissement de ces pensées, toujours pour Taubes, n’est autre que celle de Marx (et, dans une moindre mesure, celle de Kierkegaard) : « Si Marx philosophe sans Dieu et Kierkegaard devant Dieu, ils partagent cependant le même présupposé : la décomposition de Dieu et du monde. »
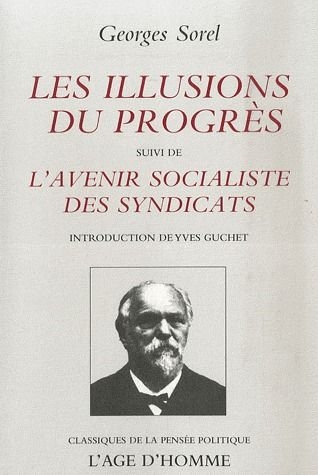 La Démocratie n’est que mensonge et tromperie
La Démocratie n’est que mensonge et tromperie

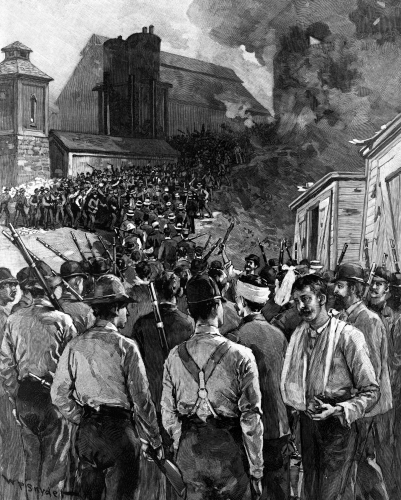







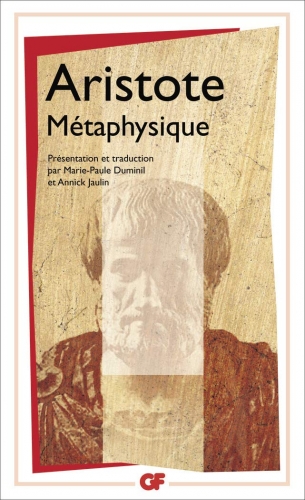 L’affaire Socrate crée un gouffre entre philosophie et politique. On s’est demandé si les idées de Socrate étaient entièrement reprises par Platon. En vérité, Socrate est un personnage de Platon, mais n’est pas tout Platon. Socrate fait douter Platon. Prenons le moment fort de Socrate, prenons le procès. Socrate essaie de convaincre les juges par la persuasion, qui est l’art rhétorique. Mais Socrate oscille entre rhétorique et dialectique dans sa défense. Il perd ainsi sur les deux tableaux. Consistant à s’adresser à plusieurs juges, sa rhétorique est tactiquement le meilleur choix. Mais elle consiste à chercher à convaincre, à chercher à l’emporter dans un débat, non à trouver la vérité. Socrate rhétoricien est en porte à faux avec lui-même. La dialectique est d’un autre ordre que la rhétorique. Elle n’est pas la persuasion politique. La dialectique est l’art de chercher la vérité par le discours philosophique, mais c’est le discours entre deux personnes. C’est le dialogue (à être trop utilisé de notre temps, le terme a perdu sa fraicheur. Il s’agit ici du dialogue au sens originel). Ce peut être plusieurs discours à deux, mais c’est un échange à deux, arguments contre arguments.
L’affaire Socrate crée un gouffre entre philosophie et politique. On s’est demandé si les idées de Socrate étaient entièrement reprises par Platon. En vérité, Socrate est un personnage de Platon, mais n’est pas tout Platon. Socrate fait douter Platon. Prenons le moment fort de Socrate, prenons le procès. Socrate essaie de convaincre les juges par la persuasion, qui est l’art rhétorique. Mais Socrate oscille entre rhétorique et dialectique dans sa défense. Il perd ainsi sur les deux tableaux. Consistant à s’adresser à plusieurs juges, sa rhétorique est tactiquement le meilleur choix. Mais elle consiste à chercher à convaincre, à chercher à l’emporter dans un débat, non à trouver la vérité. Socrate rhétoricien est en porte à faux avec lui-même. La dialectique est d’un autre ordre que la rhétorique. Elle n’est pas la persuasion politique. La dialectique est l’art de chercher la vérité par le discours philosophique, mais c’est le discours entre deux personnes. C’est le dialogue (à être trop utilisé de notre temps, le terme a perdu sa fraicheur. Il s’agit ici du dialogue au sens originel). Ce peut être plusieurs discours à deux, mais c’est un échange à deux, arguments contre arguments. 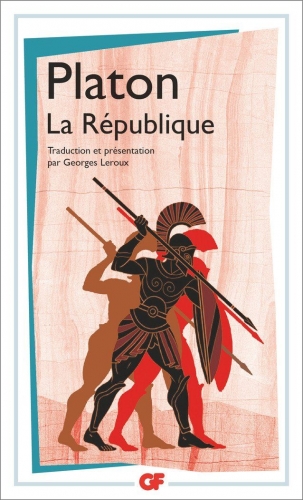 Pour que la compréhension mutuelle s’opère, il faut que chacun puisse comprendre autrui. La condition de cela, c’est que chacun se connaisse lui-même comme un autre. C’est la capacité réfléchissante. C’est le « Connais-toi toi-même » de Socrate, reprenant une devise inscrite sur le temple de Delphes [la formule est attribuée aussi à Thalès de Milet]. Socrate qui dit encore : « Une vie sans examen ne vaut d’être vécue ». Pour se connaitre, il faut se mettre à distance de soi. Il faut devenir ce que nous sommes, nous autres, humains : des êtres réflexifs. Des êtres qui se voient agir, qui se savent pensants. C’est en se connaissant que l’on peut être en accord avec soi-même. Pour Socrate, il n’y a pas de vérité absolue. [Absolu veut dire « séparé », mais aussi « qui existe par soi-même », qui n’est pas déterminé par un autre que lui. Causa sui : cause de soi. En ce sens, quand Platon définit le monde des Idées comme séparé du monde sensible, cela veut dire principalement ‘’existant par lui-même’’]. Il n’y a selon Socrate que des vérités en contexte. Des vérités en situation, dira Sartre. Des vérités pour soi, aurait dit Kant. « Je sais que je ne sais pas », dit encore Socrate. Cela veut dire : « Je sais que je ne sais pas, ou que je sais mal, la vérité de l’autre ». Je sais que j’ai du mal à me mettre à la place de l’autre, et de voir la vérité de l’autre. Il n’y a donc pas de vérité absolue, c’est-à-dire auto-fondée. Ce n’est pas une mauvaise nouvelle. C’est parce que les hommes ne sont pas interchangeables qu’il en est ainsi. Ma tâche, c’est de ne pas me mentir à moi-même. C’est d’être authentique (mais sachons-le : l’authenticité est un obstacle au pouvoir et à l’argent]. La naissance d’un monde commun réside justement dans le sentiment de la limite de ma connaissance. C’est dans la mesure où je ne connais que le monde qui m’apparait, tel qu’il m’apparait, à moi tel que je suis, avec mes limites, que je sais qu’il n’y a pas de vérité absolue. En même temps, je sais que mon opinion (si elle est sincère, vraiment vécue, et non une duplication de celle du groupe) n’est pas une illusion, qu’elle n’est pas fausse parce qu’elle est subjective. Je sais que ma subjectivité n’implique pas une fausseté, à condition de m’engager dans un travail dialogique, y compris avec moi-même. La sophistique est ainsi, non pas annihilée, mais dépassée. Elle est surmontée : c’est l’Aufhebung de Hegel.
Pour que la compréhension mutuelle s’opère, il faut que chacun puisse comprendre autrui. La condition de cela, c’est que chacun se connaisse lui-même comme un autre. C’est la capacité réfléchissante. C’est le « Connais-toi toi-même » de Socrate, reprenant une devise inscrite sur le temple de Delphes [la formule est attribuée aussi à Thalès de Milet]. Socrate qui dit encore : « Une vie sans examen ne vaut d’être vécue ». Pour se connaitre, il faut se mettre à distance de soi. Il faut devenir ce que nous sommes, nous autres, humains : des êtres réflexifs. Des êtres qui se voient agir, qui se savent pensants. C’est en se connaissant que l’on peut être en accord avec soi-même. Pour Socrate, il n’y a pas de vérité absolue. [Absolu veut dire « séparé », mais aussi « qui existe par soi-même », qui n’est pas déterminé par un autre que lui. Causa sui : cause de soi. En ce sens, quand Platon définit le monde des Idées comme séparé du monde sensible, cela veut dire principalement ‘’existant par lui-même’’]. Il n’y a selon Socrate que des vérités en contexte. Des vérités en situation, dira Sartre. Des vérités pour soi, aurait dit Kant. « Je sais que je ne sais pas », dit encore Socrate. Cela veut dire : « Je sais que je ne sais pas, ou que je sais mal, la vérité de l’autre ». Je sais que j’ai du mal à me mettre à la place de l’autre, et de voir la vérité de l’autre. Il n’y a donc pas de vérité absolue, c’est-à-dire auto-fondée. Ce n’est pas une mauvaise nouvelle. C’est parce que les hommes ne sont pas interchangeables qu’il en est ainsi. Ma tâche, c’est de ne pas me mentir à moi-même. C’est d’être authentique (mais sachons-le : l’authenticité est un obstacle au pouvoir et à l’argent]. La naissance d’un monde commun réside justement dans le sentiment de la limite de ma connaissance. C’est dans la mesure où je ne connais que le monde qui m’apparait, tel qu’il m’apparait, à moi tel que je suis, avec mes limites, que je sais qu’il n’y a pas de vérité absolue. En même temps, je sais que mon opinion (si elle est sincère, vraiment vécue, et non une duplication de celle du groupe) n’est pas une illusion, qu’elle n’est pas fausse parce qu’elle est subjective. Je sais que ma subjectivité n’implique pas une fausseté, à condition de m’engager dans un travail dialogique, y compris avec moi-même. La sophistique est ainsi, non pas annihilée, mais dépassée. Elle est surmontée : c’est l’Aufhebung de Hegel. 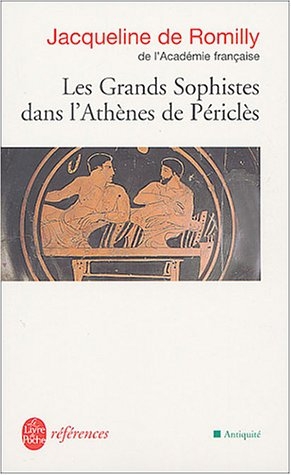 Socrate n’est pas si radicalement éloigné de ce qui sera, bien plus tard, la position de Nietzsche que l’on pourrait le penser au regard de la détestation nietzschéenne de Socrate. Socrate partage avec Nietzsche la même distance critique par rapport à l’idée d’un Moi-sujet homogène. La structure dialogique de la vérité, et par là même de la vertu, car c’est vertu que de chercher la vérité, et il n’est de vertu que la vérité. Cette structure dialogique vient de la nature même de l’homme : nous nous parlons à nous-mêmes. Tout le temps. Nous sommes déjà, avant même de converser avec autrui, « deux en un ». Nous sommes des êtres réfléchissants. Nous ne pouvons avoir des amis que si nous sommes d’abord en accord avec nous-mêmes. Sans autrui, je m’épuiserais dans le dialogue avec moi-même, justement parce que je suis « deux en un ». C’est grâce à autrui que je redeviens un car mes différences internes sont moins importantes que les différences externes, celles qui existent entre moi et les autres.
Socrate n’est pas si radicalement éloigné de ce qui sera, bien plus tard, la position de Nietzsche que l’on pourrait le penser au regard de la détestation nietzschéenne de Socrate. Socrate partage avec Nietzsche la même distance critique par rapport à l’idée d’un Moi-sujet homogène. La structure dialogique de la vérité, et par là même de la vertu, car c’est vertu que de chercher la vérité, et il n’est de vertu que la vérité. Cette structure dialogique vient de la nature même de l’homme : nous nous parlons à nous-mêmes. Tout le temps. Nous sommes déjà, avant même de converser avec autrui, « deux en un ». Nous sommes des êtres réfléchissants. Nous ne pouvons avoir des amis que si nous sommes d’abord en accord avec nous-mêmes. Sans autrui, je m’épuiserais dans le dialogue avec moi-même, justement parce que je suis « deux en un ». C’est grâce à autrui que je redeviens un car mes différences internes sont moins importantes que les différences externes, celles qui existent entre moi et les autres. 
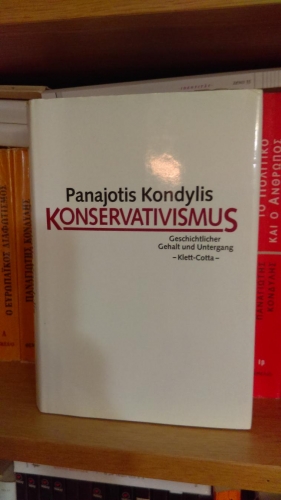
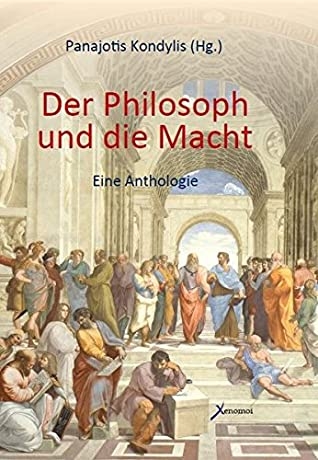 “[C]ommonplaces of conservative self-understanding and self-presentation have crept […] into the scientific discussion,” such as “the coquettish enmity of conservatives towards theory.” The prioritization of the “concrete” over the “abstract” is itself, or relies upon, an abstraction (p. 15).
“[C]ommonplaces of conservative self-understanding and self-presentation have crept […] into the scientific discussion,” such as “the coquettish enmity of conservatives towards theory.” The prioritization of the “concrete” over the “abstract” is itself, or relies upon, an abstraction (p. 15).