Hacia una Comunidad Orgánica de la mano de Ortega y Gasset.
Carlos Javier Blanco Martín
Doctor en Filosofía.
cblancomartin@yahoo.es
Ex: http://www.revistalarazonhistorica.com
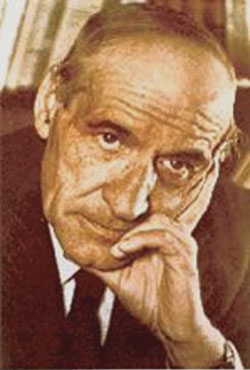 Resumen:
Resumen:
En este trabajo, de la mano de Ortega y Gasset, intentamos encontrar fórmulas que permitan sacar a España y a Europa de su marasmo. Fórmulas ya presentadas por el filósofo hace un siglo, aproximadamente, y que siguen siendo válidas en lo fundamental. Creemos que un pensamiento de tipo absolutista –absolutismo del individuo y absolutismo del Estado- es la raíz de tanto fracaso. En medio de estos dos absolutismos, Ortega defendió la vigorización de estructuras o entidades intermedias que hagan posible, en todos los órdenes (territorial, social, productivo), una Comunidad Orgánica u organizada.
Summary:
In this paper, by means of Ortega y Gasset, we try to find schemas to get Spain and Europe from its chaos. Schemas already presented by the philosopher a century ago, and which remain valid in principle. We believe that a type absolutist thought (absolutism of the individual and absolutism of the state) is the root of so much failure. In between these two absolutes, Ortega defended the invigoration of structures or intermediate entities in order to do, at all level (regional, social, and productive), an organic community or organized society.
1. Pueblo, territorio, comunidad y Estado.
Vivimos en tiempos de disolución. Especialmente sucede esto en el Reino de España. Este es un Reino de Europa arrinconado en un extremo del occidente del viejo continente, pero también abierto de puertas en un cruce de caminos, donde se acercan tanto el aroma de África como la juventud de América, y hasta aquí llegan todos los vientos, a las viejas orillas ibéricas, a las costas de la decadencia y el marasmo. Los filósofos del pesimismo nunca gozan de buena prensa (Schopenhauer, Spengler), pero nos enfrontan con una cruda realidad. En España, en unas condiciones que no resultan muy distintas a las de hace un siglo, se alzó una voz que no se hundió en ninguna clase de pesimismo ni de resignación, antes bien, propuso reformas y más que reformas, propuso revitalizar el Estado y el cuerpo de la nación. La voz de José Ortega y Gasset.
El Reino de España, hoy como entonces, sigue prisionero del caciquismo. El provincianismo denunciado en La Redención de las Provincias, no es hoy tan distinto del de entonces. La actual configuración del Estado de las Autonomías ha significado la síntesis del “madrileñismo”, en palabras de Ortega, esto es la miope visión del Estado hecha desde la Capital –villa y Corte- y con la configuración social específica de sus élites, por una parte, y el “provincianismo” más rústico y rastrero por parte de unos caciques de ciudad provincial y de villorrio, de la otra. En esta usurpación del Poder público a cargo de unos y otros, el Legislativo jamás acierta a planear un plan de reformas que mire por el bien común, a largo plazo y por encima de particularismos y de “ismos” ideológicos. Parece como si el terruño y la ideología nublaran la mente del Legislativo, por no decir nada del Ejecutivo.
En medio del marasmo, las que sufren son las Instituciones sociales propiamente dichas, las más antiguas y carnales, aquellas que preexistían a esta y a toda anterior Constitución, aquellas que tejen y hacen posible la Comunidad Orgánica antes de éste o del anterior Régimen. ¿Qué Instituciones son esas? La familia, la corporación local, las regiones y comarcas históricas, entre otras (no olvidemos las corporaciones productivas). Se trata de Instituciones que hacen la vida humana posible y mejor, en las que anida el individuo siendo cosa mayor y más excelsa que un individuo, porque lo califican como persona.
1.1. Fundamentalismo individualista.
Es preciso corregir el fundamentalismo individualista, la radicalidad con la que hoy se defiende, generalmente bajo el paraguas de la Declaración de los Derechos Humanos, una idea irracional, esto es, una ideología: la idea de que solamente los individuos son portadores de derechos. El Estado no puede consistir en una maquinaria exenta frente a un cúmulo de individuos átomos. Hay toda una serie de realidades intermedias entre el Estado y la masa de individuos, una red muy tupida que llamamos Sociedad, y en toda sociedad organizada ha de fundarse un Estado igualmente organizado. Esas entidades intermedias hacen la vida civilizada posible, permiten al hombre vivir de manera plenaria.
La ideología de los Derechos Humanos, aventada a todos los rincones del mundo desde 1789, fue resultado de una confluencia: el monoteísmo, el iusnaturalismo, la mentalidad burguesa. A la altura del siglo XX llegó a cristalizar como una especie de “ideología oficial” u obligatoria. La persona individual, que marcadamente se afirmaba en la teología cristiana, en el derecho romano así como en el derecho germano (o “feudal”) ante el dios, el Estado, o la Comunidad, llega a abstraerse por completo, a perder sus cualidades diferenciadoras, a situarse por encima y al margen de aquellos marcos con los que –siglos atrás- debía contrastarse: el individualismo concreto o personalista (en la Cristiandad, en el romanismo, en el germanismo) se convierte, por medio de la Economía burguesa o capitalista, en un individualismo abstracto. Y con la abstracción se cae en la unilateralidad, en la ceguera ante las dimensiones ora trascendentes (lo divino, el destino) ora inmanentes (el ethnos, la nación, el estamento, la comunidad). En términos similares a Ortega se presentó este tipo de crítica –décadas después- en algunos teóricos franceses de la conocida como “Nueva Derecha” (que, por cierto, también podría llamarse “Nueva Izquierda”), así Guillaume Faye y Alain de Benoist:
“El absoluto de la humanidad confluye entonces en el absoluto del individuo, de la misma forma que el objetivismo del “iusnaturalismo” (la teoría del “derecho natural”) converge en el subjetivismo individual más desenfrenado: prueba de que los extremos se tocan. La dimensión negada es la dimensión intermedia: la fijación en el seno de una cultura, de un pueblo o de una nación.
Ahora bien, las colectividades intermedias tienen tantos derechos como deberes. El pueblo tiene derechos. La nación tiene derechos. La sociedad y el Estado tienen derechos. Inversamente, el hombre individual tiene también derechos, en tanto que pertenece a una esfera histórica, étnica o cultural determinada –derechos que son indisociables de los valores y de las características propias de esta esfera. Es ésta la razón por la que, en una sociedad orgánica, no hay ninguna contradicción entre los derechos individuales y los derechos colectivos, ni tampoco entre el individuo y el pueblo al que se pertenece”.
1.2. Nación, Trabajo y Regiones.
El programa de José Ortega y Gasset, resumido en un tiempo bajo el lema “Nación y Trabajo” implicaba a todos los ciudadanos de España, unidos por encima de las banderías ideológicas, abrazados en un gran Cuerpo social, pues el Estado español no podía seguir siendo un mero formulismo, una cáscara vacía. Un Estado y una Constitución pensados en términos abstractos, desconocedores de que la gran masa de la población vive desorganizada, no “forma” sociedad, son por sí mismos un error, son ellos mismos una de las causas de los males nacionales. Para Ortega, se hacía preciso formar la Nación, y evitar el carácter doctrinario y abstracto de las leyes y documentos. En tal sentido, propone Ortega una descentralización y una autonomía de las “grandes comarcas” (dicho así bajo la censura) o más bien regiones histórico-naturales. Frente a las 17 autonomías actuales en España (muchas de ellas “cortadas” de forma arbitraria y ahistórica) Ortega propone un número más reducido de las mismas, con sus respectivas asambleas regionales y poder legislativo en asuntos que son de su competencia. Este era un modo de vigorizar el cuerpo de España, y no un federalismo que supondría una segmentación de su Soberanía. El filósofo madrileño no tuvo reparos en criticar el pésimo papel que la Capital había ejercido sobre la historia de España. Madrid había supuesto el lastre de no haber podido nacionalizar la provincia, como de forma inversa sí había hecho París con las provincias francesas. Un Madrid poco ejemplar y miope, compuesto principalmente por las élites que rodeaban la Corte, el gobierno, la burocracia civil, militar y eclesiástica, además de los rentistas y ricos venidos de la provincia, era un Madrid sociológicamente miope, ajeno por completo al gran agro que le rodeaba, una España profunda, la de la provincia, la del villorrio, la del mar inmenso de surcos de arado, que llegaba prácticamente a las puertas del “poblachón manchego”. El madrileño medio arrastraba el vicio de entender que España toda era una extensión de Madrid, y nada más, de ahí el esquema radial y centralista, que es el esquema de organización animal más primitivo de todos, y también sucede así en la política.
¿Significa esto que hay que descentralizar de manera radical, acudiendo al átomo de civilidad administrativa, esto es, el municipio? El municipio es, sin lugar a dudas, una importante institución civil, política, administrativa. Pero en lo político-económico constituye un mínimo absolutamente inoperante, que nada puede hacer si no es en coalición o mancomunidad con todos los demás municipios vecinos que comparten intereses con él, especialmente intereses de índole económica. El proyecto de Maura basado en la descentralización de España, polarizado ésta hacia los ayuntamientos, era visto por Ortega como algo completamente insuficiente. En el filósofo no se observa un romanticismo “tradicionalista” (por cierto muy cultivado por los liberales del XIX, y no solo por los tradicionalistas) que añora las pasadas juntas concejiles, verdadero embrión de la Democracia en el Medievo. Más abajo mostraremos qué es la Razón Histórica en Ortega, que no es precisamente “historicismo” ni simple y llano “tradicionalismo” en el sentido simple de pasto sabroso para los retrógrados.
La provincia tampoco es un cuerpo intermedio operativo, ni eficaz ni deseable para vigorizar España como cuerpo social. Con perfecto conocimiento histórico, Ortega ve que la división provincial sobrevuela la naturaleza histórica y étnica de las comarcas; son como los meridianos, rayas invisibles que han marcado los despachos de políticos doctrinarios en el siglo XIX. No, la descentralización de España, para que las provincias sean redimidas de una Capital impotente, y ella misma “provincializada”, consiste en las autonomías regionales. Pero éstas han de respetar las “vetas” que una España de mármol ya de por sí alberga. Estas vetas son el producto de la Historia, no son, en realidad, “naturales”. Algunas proceden de la gran divisoria entre pueblos prerromanos, son pues, muy antiguas (celtas, iberos y tartesios), pero de mayor enjundia para comprender la diversidad regional (y región, en Ortega, es concepto de marcado contenido étnico, frente a la Nación política, España, como comunidad de destino poliétnica), son las etnicidades desarrolladas durante la Reconquista.
Que las regiones (históricas) se doten de Asambleas con autonomía legislativa y ejecutiva, y que de éstas Asambleas o Cortes surja un número reducido de diputados para el Parlamento de Madrid (noventa o cien representantes), no es, exactamente, el modelo que se dio el Estado Español en 1978. Pero, sin duda, Ortega es un precedente teórico claro del “Estado de las autonomías” si bien el número de estos entes creados en 1978 puede considerarse excesivo y sus componentes y lindes territoriales son, en alto grado, arbitrarios. La confusión -deliberada o no- entre autonomismo y federalismo, y el olvido de las propias demarcaciones tradicionales de “Las Españas”, como era lícito decir en el Antiguo Régimen, antes de 1812, es una confusión que clama al cielo. No obstante, este asunto es demasiado complejo como para tratarlo ahora, mas debe consignarse que en Ortega las Instituciones han de mediar entre los individuos y el Estado, y aquí hemos hablado ya demasiado de Instituciones de carácter territorial y étnico, que el Estado encuentra ante sí, ya dadas, entregadas por la Historia. Pero hay otras.
1.3. Otras Instituciones Mediales.
La familia, además del municipio, además de la comarca natural, la Región histórica o la nacionalidad, los cuerpos profesionales, los “estamentos” (clero, milicia, jueces, docentes), etc. son realidades que también poseen derechos y deberes, que también constituyen sujetos colectivos dignos de consideración filosófica, sociológica y jurídica. Constituyen una suerte de Medio Ecológico [Umwelt, milieu] donde el individuo se “llena” de contenido en su vida, se dota de sentido, de proyecto. El capitalismo, tendencialmente, reconoce la individualidad pura y exenta, y al margen de ella, sólo el propio Capital en trance de producción y acumulación. Tendencialmente, el Capital tiende a instrumentalizar todas las instituciones sociales, el Estado mismo. El Estado como subordinado al Capital, la Política a las órdenes de la Economía.
Pero para valorar en sus justos términos tales Instituciones se hace precisa, urgente, una Razón Histórica que, al modo orteguiano, haga de ellas equipaje esencial para el presente, para que la sociedad y los Poderes públicos las tomen en cuenta y las protejan, para que las empleen como palancas para toda posible reforma de amplios vuelos, ya se trate de reformas de Estado o cambios de Régimen. Los males de nuestra sociedad se deben explicar- en gran medida- por la supeditación de la familia, el municipio y todo género de corporaciones apolíticas (incluyendo los lazos sociales con un territorio). La manera en la que se manipulan la familia y el ayuntamiento, por ceñirnos a unos ámbitos muy concretos, pues todo ciudadano forma parte de una familia y de un ayuntamiento, no puede calificarse sino de letal. El Legislador –acaso impregnado de un atroz positivismo y progresismo en sus pliegues cerebrales- tiende a creer, desde los ya lejanos tiempos jacobinos, que sus palabras escritas con fuego y sangre pueden alterar realidades extrañas a la Constitución desde la que él, como poder público, impera. Pero el imperium de un legislador, por muy legítimo y democrático que sea su fundamento, nunca puede extenderse hacia atrás, hacia realidades previas y constituyentes de toda Constitución Política. Dicho de otra manera: antes de una Constitución Política hay una Constitución Histórica o, si se quiere, una Tradición. No podemos creer, como Ortega, que un Régimen político pueda ser tan poderoso como para rectificar la Tradición en el sentido de conformación o constitución histórica de una comunidad humana.
2. La razón histórica.
El siglo XIX, especialmente el siglo XIX alemán, fue el siglo de la “ciencia histórica”. Toda una manera de trabajar en ciencia, toda una “ciencia del hombre”, germinó con los grandes sabios germanos que supieron ver que la Historia y todas las ciencias aledañas que versan sobre el hombre, el espíritu y la cultura, no podía ser campo provincial de la física. La razón físico-matemática no podía dar cuenta de los sucesos y realizaciones del hombre. El hombre, más allá de ser cuerpo y complejo de relaciones físico-matemáticas era también Historia. Pero si bien aquellos sabios del historicismo comprendieron la insuficiencia de la razón físico-matemática para las ciencias del espíritu y se alzaron en contra del imperialismo epistemológico de la física sobre los continentes de la antropología, ellos no supieron perfilar cuanto habría de ser una verdadera Razón Histórica. En el fondo se sumieron en un positivismo crudo, equivalente en no pocos puntos al positivismo de la ciencia físico-matemática y biológica por entonces triunfante. Los sabios historicistas, refunfuñando contra el positivismo del naturalista, cayeron en uno análogo en su enteca búsqueda en medio de archivos, rastros arqueológicos, reliquias y antigüedades. Estos sabios se rindieron ante la facticidad de un pasado que, como ya sido, no podía ser constituyente del hoy. Como los positivistas de toda laya, lo pasado ya descrito como cosa muerta, inerte, catalogado en el museo y en el archivo, encerrado en su “ya sido”, es un pasado deificado y, sin embargo no vivo, irreal. A este historicismo, nuestro Ortega opone la Razón Histórica. La Razón Histórica exige un trato diverso con el pasado: al pasado no le cabe ser cosificado, porque es real. Está inserto íntegramente en el pasado del hombre.
En el ser humano se da, por esencia, un pasado que siempre lleva a rastras. Nuestro pretérito forma parte de cada instante presente como si se tratara de nuestra espalda y nuestra sombra, pero no porque huyamos de ello al ir hacia un futuro dejamos de acarrearlo. El caminante viaja a su destino no por huir de sus espaldas y de sus sombras. Éstas son más bien sus acompañantes, los socios inevitables de todo peregrino. El pasado nunca es simplemente pasado, es parte integrante de un presente. El pasado es real, paradójicamente, como constitutivo de un presente y en la medida en que es constitutivo de un presente. La memoria es la facultad presente, actuante, que nos enlaza con lo ya sido. La memoria es ese motor retroactivo, pero su eficacia y su resultado solo puede ser proactivo.
Esto que llevamos dicho puede ser válido para el individuo y para los pueblos. La amnesia total de un pueblo o nación solo puede ser parcial, pero en cualquier caso es patológica. Todo cuanto ha sido experiencia histórica de una colectividad se encuentra entreverado en las más profundas entrañas de ésta, y es constitutiva de lo que ella, la colectividad orgánica, hace en este preciso instante. Bien es verdad que la tecnología y los medios de manipulación de masas poseen hoy más poder de extirpación del pasado que nunca, y esto es grave peligro para la conservación de la humanidad. No ya de la humanidad zoológica, que no sabemos si habrá de salir indemne de un conflicto nuclear, pero si la conservación de la humanidad espiritual.
Grande descubrimiento parecía ser, allá a finales del XIX y principios del XX, el descubrimiento del continente vida. Figuras como Dilthey o Bergson dieron ese paso, dejando atrás la vida en el sentido positivo-categorial (las “ciencias biológicas” experimentales y naturalistas) y alzando por fin una Ontología del devenir del hombre, la vida que es consciente de serlo, la vida que puede interpretarse a sí misma y no meramente arrastrarse como sustancia ejecutora de sus funciones. Ortega supera también su noción de Razón vital por la de Razón histórica: el verdadero devenir, la verdadera mudanza causal es la de la Historia. Los griegos, y su representante acaso más puro, Parménides, no pudieron arribar a esa Razón histórica. La sustantividad de las cosas y su identidad eran uno y lo mismo para un razonar helénico que condenaba todo cambio al ilógico no-ser. Lo que no es, no es. La marginalidad del enigmático Heráclito no se pudo rescatar, y esto de una forma tremenda, hasta el siglo XIX. Pero los “filósofos de la historia” nunca llegaron a ver la Historia como la Ontología misma, sino como campo presto para ser arado por ajeno labrador, labrado por un deus ex machina. Marx acudió al deus ex machina con su énfasis en el desarrollo de las fuerzas productivas, o Hegel y su Lógica; mucho antes los ilustrados se remontaban a la física, al clima, a la naturaleza. La Historia se explicaba desde la no-historia.
Grande fue la deuda, por cierto, de los historicistas alemanes con la Ilustración. La idea de una Razón narrativa que explicara el devenir de un Pueblo, la historia de su espíritu (Volkgeist) no es alemana en su origen. Procede del siglo XVIII francés, un siglo que de forma tópica se considera antihistórico (inhistórico, como traduce García Morente a Spengler). El concepto de Espíritu del Pueblo, ese devenir de cada nación que habría que estudiar, es idea que parte de Voltaire y de Montesquieu, y de ahí llega a los románticos, a Fichte, a Hegel. Después de una especie de “borrachera” idealista y romántica, los historicistas de la segunda mitad del XIX, según nos cuenta Ortega, hicieron degenerar su nuevo continente, y lo redujeron a un cúmulo de mera facticidad, de acumulación de viejos trastos de anticuario y a datos registrados de forma cosificada en un archivo. La curiosidad del “historicista” se rebajó a coleccionismo, a trato de ropavejero para con una mercancía prácticamente inservible a no ser que, como a veces ocurre, la utilidad se reduzca a alimento con el que nutrir la nostalgia. Puede que, en ocasiones la melancolía posea “utilidad”.
La Razón histórica de Ortega, muy por el contrario, interpreta las secuencias narrativas como constitituvas del presente y como orientadoras del porvenir. El hombre, en el ámbito personal tanto como en el colectivo lleva el pretérito y lo actualiza. El hombre, dice Ortega, no posee naturaleza sino que solo es historia. Durante tres siglos, Occidente ha vivido en la ceguera más absoluta, en la unilateralidad de una visión mecánica del mundo, que la química, la electrónica, la biología, etc. han ido sofisticando mas no modificando en lo fundamental. Pretender ver la realidad (histórica) que es lo humano a partir de las categorías del determinismo más o menos corregido de la física-matemática es un desiderátum que ha despistado la comprensión del hombre, como ser histórico, como ser que no es sino devenir y estructura histórica. Y no se piense que abogar por una Razón narrativa o histórica supone renunciar a la estructura, a la causa, al sistema. Ortega defiende que estas instancias cobran toda su plenitud, su fuerza conceptual para alzar un sistema en la Razón histórica, antes que en la razón físico-matemática, siempre tendente a la fragmentación, a la inconmensurabilidad en sus construcciones y hallazgos.
3. Europa mutila su Historia: neobarbarie.
Y he aquí a la vieja Europa, hija de Grecia, hija también de la voluntad fáustica germánica, recostada sobre sus cenizas, bajo una lluvia que no es la lluvia nuclear, pero que es como bombardeo de consumismo y tecnificación, Europa la vieja se ve inmersa en un ambiente de barbarie que ella misma ha potenciado y creado con su unilateralidad tecnológica. Esa Europa, según leemos en La Rebelión de las Masas, no se salvará mientras no florezca en ella una “nueva filosofía”. Una filosofía que será salvadora no por lo que ésta tenga de nueva sino de verdadera.
Vivimos desde las Guerras Mundiales en una era de impostores, en una era de derrota de la misma Europa como idea, como proyecto. Se trata de una verdadera crisis de fe. Se ha perdido la fe: la fe en los dioses es una de las formas en que podemos entender la piedad. El europeo ya no es piadoso y no solo porque siente que los dioses le han abandonado. Clavado a su propia cruz, la cruz de sentirse un “salvador” fracasado que, en su colonización y redención de todas las razas, ahora ve que las ha esclavizado y les ha sembrado resentimiento y también ve que éstas llaman a la puerta de su casa a pedirle cuentas. El europeo está clavado, decimos, a los propios maderos sobre los levantó una sociedad industrial mundial: el europeo ya no es piadoso ni siquiera para con los fundamentos de su mundo creado: la ciencia. La ciencia como tal no deja de ser pensamiento y fundamento, pero en la degeneración ahora vigente, la ciencia es solo recetario para la variación infinita de fruslerías (vide: Baudrillard ), hasta el punto que parece como que todo cuanto es fundamental en la civilización tecnológica ya está inventado y tan solo queda imponer y programar obsolescencias, sofisticaciones, bizarras combinaciones, etc.
La civilización tecnológica, de consumo de masas, y de imperio de masas insolentes es la antítesis misma de una civilización filosófica, como lo fue en otros tiempos.
¿Cuánto tiempo durará este sistema insostenible? La única civilización con conciencia histórica, la única que puede ejercer la Razón Histórica para no cosificarse, para construir narraciones rigurosas sobre sí misma y sobre la demás, está a punto de descender a un fondo irrecuperable de barbarie. El bárbaro ascendente es capaz de elevarse en espiritualidad y cultura: ese bárbaro celtogermánico en ascenso por la ayuda Roma, Grecia, la Cristiandad, llegó a ser el europeo. Pero el neobárbaro, el descendido, el envilecido por su propia unilateralidad y por su contacto acrítico con el resto de las culturas, es de muy difícil recuperación. En realidad se trata de una aculturación, de una preparación para su futura esclavitud ante “potencias emergentes”.
El individuo consumista, sin arraigo, la familia “funcional” basada en la pura conveniencia, la banalización de la vida, de la crianza, del lazo esencial con la familia y con la Comunidad orgánica, todo este cúmulo de nuevos hechos y procesos supone la neobarbarie de Europa: la bajada general de nivel, la falta de autoexigencia, el olvido y el rechazo de la Historia.
Nos preguntamos por algo fundamental que, precisamente las ideologías caducas niegan: ¿ya no hay patrias, ya no hay dioses? Al liberal, este género de preguntas le exaspera. Y al socialista, no menos: la cuestión le resulta impertinente y sumamente irritante. Como individuos anclados mentalmente en el siglo XIX, liberales y socialistas sostienen que esos dos principios fundantes de la vida humana, la Patria y el Dios, han de quedar desterrados de todo proyecto, de cualquier adhesión. El fantasma del siglo XIX se pasea por los corredores que llevan directamente al XXI con su inquina acartonada a cuanto ve como vieja superstición. ¡Qué vieja parece ya esa inquina contra la “vieja superstición”! Pero ese fantasma de otra época es, él mismo, una proyección: el fantasma ilustrado es el objeto de su propia superstición, él, el fantasma doctrinario que – dotado del andamiaje de la economía política- quería hacer de Europa y del Mundo un gran Mercado –en versión liberal- o una Gran Comunidad de Productores asociados, en versión socialista o comunista.
El Estado liberal y el Estado socialista –llevando al extremo sus presupuestos- no se asientan sobre Patrias, no necesita reconocer naciones ni cosa alguna que trascienda al Estado mismo. No reconoce esos fines que le trascienden -lo divino, el sino colectivo, la salvación, etc.- y como objetos que le trascienden deben ser fagocitados en el consumo privado de la conciencia, o desterrados por completo. El liberalismo y el socialismo son ideologías, esto es, pura inmanencia de la máquina política.
Realmente, como ideologías, el liberalismo y el socialismo, comprendiendo en su seno las más diversas variedades a la carta, ponen en la cumbre de sus aspiraciones una Humanidad abstracta, que no es más que la proyección del individualismo burgués que comparten. Son ideologías procedentes de la mentalidad burguesa que comienza en el Renacimiento y alcanza su apoteosis totalitaria en el siglo XIX. El individuo aislado de la familia, la tribu, el clan, la patria, la profesión, la comunidad es, como tal, una abstracción, pero si en un paso más de formalismo abstracto le retiramos a ese individuo su rostro, su piel, su sexo, su edad, su lengua, su fe… tenemos la Humanidad, una suerte de superhombre vacío, sin cuerpo, un ente por el que habría que sacrificarlo todo. El liberalismo, que partió de un Estado natural y entiende el Estado civil como mero instrumento y mal menor ante un mercado autorregulado de manera utópica. El socialismo, que arrancó del Estado de naturaleza que supone, en resumida cuenta, la lucha de clases bajo la anarquía capitalista, y restaurará –de manera utópica, una sociedad internacional de productores asociados… Dos grandes columnas ideológicas de nuestro tiempo que comparten su enfoque negador, en última instancia, e instrumentalizador, en primera moción, de la Patria. “El dinero no huele”, afirma el liberal, pues en efecto no tiene patria. Y el “Proletario no tiene patria”, afirma el internacionalista de izquierdas, de raíz marxista. Como escribe De Benoist:
“Liberalismo y socialismo tienden a la desaparición de las identidades colectivas intermedias entre el individuo y la humanidad. Provocan tanto la una como la otra el desmoronamiento de la noción de patria. Por ello, contribuyen en mayor medida que otras ideologías a borrar la distinción entre la guerra exterior y la guerra civil: si ya no hay más que pueblos, sino únicamente la “humanidad”, todas las formas de enfrentamiento dependen de la guerra civil”.
4. Europa: la Nación
Queremos ir de la mano de José Ortega y Gasset durante unos minutos, seguirle durante unos párrafos que, a tenor de los acontecimientos europeos que nos agitan desde –poco más o menos 2007, pero quizá desde 1945. El “europeísmo” de José Ortega es de una índole muy peculiar y el “-ismo” que colocamos al final de la raíz, contradice su filosofía. Otro tanto hay que decir respecto a su filosofía de la Nación. Es Ortega un filósofo nacional, y sonroja calificarle de “nacionalista” pues fue explícito en su condena de los “-ismos”, esto es, de las polarizaciones que se practican, desde mentes obtusas y parcialmente ciegas, de determinadas ideas. Es grave peligro para el filósofo, para el intelectual riguroso, derivar desde las ideas hasta las ideologías. Por ello, hay en la filosofía de Ortega un compromiso y una comprensión de lo nacional, más que un nacionalismo, y esto mismo queremos exponer.
Hay una breve obra orteguiana, su “Meditación de Europa”, que juntamente con otros escritos menores, anda perdida entre su ingente producción, y que me provoca inquietud y anhelo, y poco más se puede exigir a unas páginas filosóficas: que provoquen inquietud y anhelo, esto es, que sirvan de aguijón socrático al lector. Proceden de una conferencia dada ante alemanes, unos alemanes que, al decir del propio Ortega, aceptaban en la posguerra su derrota y concienzuda y tranquilamente (esa tranquilidad teutónica que le falta al latino) se componían para rehacer su nación tras el desastre de 1939-1945.
Me parece que aquellos alemanes derrotados, pero tenaces reconstructores de su nación, recibían con calidez y anhelo las reflexiones de Ortega, pues sobre naciones y nacionalismos, el madrileño pensador tenía mucho que decirles. De manera especial, como filósofo de la Cultura, como pensador de la Nación y la Ultra-nación que es Europa, Ortega llega –junto con Spengler- a las cimas del intelecto del siglo XX. Estos dos hombres, uno español y otro alemán, fueron (no será casualidad, acaso) los mejores pensadores de Europa y sobre Europa. La razón quizá estriba en su distancia explícita con respecto de las ideologías anti-nacionales por excelencia: la liberal y la socialista. Estas dos ideologías, que cegaron al hombre de occidente por espacio de dos siglos, si son contempladas como “productos” culturales y mentales, no dejan de ser obras europeas aunque sus fines se proyecten sobre un cielo soñado, el del fin de la Historia (que es como decir, el fin de Europa). Un Estado de Naturaleza donde productores, particulares o colectivizados (ahí sería de donde Locke y Marx surgen de una misma cuna) habría de significar, para las dos ideologías, el fin de la Historia y el trascender de toda vida nacional. Toda la Historia de las sociedades políticas sería la Historia de un Retorno a la Naturaleza. El Gran Mercado, la Gran Comunidad productora… pero la Nación, sobre los raíles de la economía política, ha de desaparecer. El capitalismo y el comunismo guardan, como axiomas, la muerte de la Nación. Esta ideologías nada más quieren noticias sobe los Estados, como unidades positivas, facticias, como entidades que a la postre fenecerán a favor de un ideal cosmopolita.
Pero la razón histórica, nos dice Ortega, nos disuelve constantemente la ilusión de esos Estados positivos, de ese conjunto de “naciones-estado” supuestamente canónicas en que se habría de componer una Europa sin centro, una Europa mosaico. El espejismo de la Modernidad ha de desaparecer. La razón histórica nos impone una visión de profundidad, en relieve, frente a la razón abstracta, “moderna”, burguesa. Hay profundidad, hay una vis a tergo, unas constantes ocultas que no por ocultas dejan de actuar y de determinar una esencia. Para mostrar esto, nada mejor que observar a nuestros más directos predecesores: el hombre antiguo, grecorromano, y el hombre gótico, medieval. En algún sentido razonable, ellos ya no son nosotros, pero también cabe decir con sensatez que ellos “ya eran” nosotros y que hay una precedencia: de ellos procede el hombre europeo occidental y a ellos se les debe mucho de cuanto nosotros somos.
5. Precedentes del Hombre Europeo.
5.1.El hombre antiguo.
Veamos al griego, principalmente. Dice Ortega que hay una espalda y una vista al frente en este tipo de hombre. A su espalda, el helenismo: lo más parecido a nuestra nación, el ethnos (pero embrionario e inconsciente, “inercial”, dice Ortega). Todo griego llevaba a sus espaldas esa condición, esa comunidad de raza, idioma, mito, rito, esa comunidad de usos, que es como orteguianamente podemos denominar sociedad o cultura. Pero, llevándolo consigo de manera inercial (inerte, sin vis movilizadora), el griego antiguo apenas lo veía, salía de su consciencia, apenas lo veía con el rabillo de los ojos ante situaciones como la amenaza persa, o los Juegos panhelénicos. Frente a sí, el hombre antiguo no veía más que su Polis: la asociación formal de ciudadanos, el “programa” de una vida en común acorde con el nomos. El hombre griego es un ser de realidad dúplice: hacia atrás, es un heleno, aunque no existe todavía una nación helénica, si existe un fondo común del que procedían jonios, dorios, etc. Y delante ¿qué veía el griego? Veía el presente, a lo sumo un futuro a corto plazo; la Polis, esa asociación, que no sociedad. Todavía hoy, el liberal y el socialista, el jacobino, todo formalista de la cultura urbana forman estirpes de hombres educados para comprender un nomos de la asociación política, contractual. Todo lo politizan, todo en ellos es “asunto de Estado” y se sienten incapacidades de comprender lo que trasciende ese nomos, este marco legalista del estado. La comunidad orgánica originaria, las lenguas maternas, los usos no escritos, cuanto hay de vida y de historia milenaria como fundamento del derecho consuetudinario… todo eso no lo ven. El hombre griego, y también el romano en cuanto que su Imperium era, en el fondo, la enorme hinchazón de una Polis, se parece al hombre de nuestro tiempo y de nuestro occidente cuando razona y legisla bajo unos legalismos y unos cauces que son, en el fondo, los que todavía manoseamos hoy como legado suyo. Por eso todo escolasticismo y todo esquema formalista y verbal de comprensión de la asociación, que no la vida social, nos resulta tan familiar.
Pero he aquí que entre el antiguo y el europeo se encuentra el hombre gótico. De él procedemos también nosotros, y en él hay una duplicidad.
5.2. El hombre gótico.
El hombre de la Edad Media, según decía Oswald Spengler, aparece en los espesos bosques, en la Centroeuropa habitada por esa miríada de pueblos celtogermánicos que ya se encontraban más o menos cristianizados allá por el año 1.000. No obstante, el tiempo y el lugar donde aconteció ese nacimiento yo lo desplazaría un tanto atrás. En la periferia norteña de una Hispania goda y romana recién invadida por tropas africanas, bereberes comandados por los árabes, y con no pocos colaboracionistas godos y judíos, fue donde los pueblos cantábricos (astures y cántabros) se levantan en armas contra tan magnífica fuerza, y acogiendo en su seno a unos refugiados godos irredentos, alzan un parapeto ante el vendaval orientalizador. El espíritu de la “Reconquista”, cuyo recuerdo quiere enterrarse hoy por bajo de tantas necedades sobre la “alianza de civilizaciones” supuso, factualmente, no la restauración de la Monarquía de Toledo sino el alzamiento de una nueva nación y un baluarte entre África y Europa. El Islam, como enemigo, como alteridad, hizo al Hombre Gótico: le hizo consciente de su especificidad, de su contextura distinta de la del Hombre antiguo y del oriental. El Islam fue detenido por los astures y los cántabros (acaso dos denominaciones para un mismo ethnos), y sólo después por los francos. Todo pueblo y toda nación debe cobrar conciencia de sí chocando con otros pueblos, y el choque más habitual es con las armas.
Pues bien, Ortega nos explica que el Hombre Gótico, de quien Spengler hace también repetidas referencias, vive como en dos estratos. Es la suya una existencia doble. Por un lado, en su bárbaro existir, los pueblos germánicos comparten el fondo común de sus instituciones, dioses, lenguas. En tiempos muy remotos, celtas, germanos, latinos, helenos, eslavos, compartían un mismo fondo. Sus asentamientos geográficos, sus adaptaciones ecológicas divergentes, sus respectivas experiencias particulares, el contorno de sus vecinos, los diversos influjos recibidos… todo esto puede explicar la posterior diferenciación.
En el caso que más nos concierne, la historia de la civilización de Europa, y más cerca, de la Península Ibérica, nos situamos en la presencia y aun convergencia étnica, en el más preciso sentido, de pueblos de tronco común, y esa copresencia nos permite entrever el nacimiento del Hombre Gótico. El Reino de Asturias como creación originaria, celtogermánica, puede interpretarse como resultado de la lucha entre dos almas, entendiendo por alma una entidad colectiva al estilo spengleriano: el alma del hispanogodo asentado en el Mediterráneo, en la urbe de la romanidad tardía, es ya un alma cansada. Su espiritualidad “cueviforme”, “mágica”, ya consistía en formarse como esponja en medio de rígidas pseudomorfosis, dispuesta a acoger a un Islam pujante: el brío guerrero y el ardor juvenil de la nueva raza invasora (brío de una fe deficiente, por lo bárbara y reciente) lo aportó el contingente árabe y berebere que penetró la Península. La vieja cultura (superior infinitamente, pero cansada) hispanogoda, espiritualmente árabe desde hacía tiempo, cambió de amos en el sur y en el Levante. Pero el tercio norte peninsular, también “romanizado” en un plano supremo conoció como un “despertar” de sus instintos indoeuropeos más profundos. Fueron las montañas astures una verdadera matriz de pueblos, y allí confluyeron una serie de etnicidades que el fuego de Roma había eclipsado de manera momentánea. El hombre Gótico resultante de la revuelta astur, es ya idéntico en todo, desde Finisterre hasta el Báltico, desde el Duero como orilla recuperada, hasta Escandinavia. No tanto la comunidad de sangre, hecho innegable pero puramente físico, como el rasgo fundamental de su alma les une a todos: un afán infinito de conquista. La fiereza de las cabalgadas de los grandes reyes astures (Alfonso I, II y III, Ramiro I) que, tras Pelayo, fundaron un Estado en dos “pisos” según la concepción orteguiana, es acaso comparable a otras gestas puramente fáusticas: las conquistas vikingas, las cruzadas, las órdenes teutónicas, la conquista de América.
Y el alma que, como realidad enteramente nueva, que se alzaba en dos planos ¿cómo era?
Claramente la lejana y al tiempo actual presencia de Roma era parte constitutiva. En una Edad Media que a nadie se le oculta como edad de hierro y de fiera crudeza, un alma de guerrero y de santo, y también de abnegado campesino que, a veces, no dejaba de ser guerrero para poderse defender del ataque mahometano o normando, era también un alma que aspiraba –al menos en una elite significativa- a aquel mundo supremo que en su subconsciente representaba Roma y su Imperium. La sencilla corte de Cangas de Onís, como después la de Oviedo, la de León o, en entre los francos, la de Aquisgrán, no dejaba de tener presente el fondo común, eclipsado pero no desaparecido, de una romanidad siempre deseada y respetada, una especie de cielo sito en el pasado. Ortega acierta a describir al Hombre Gótico: no es un bárbaro domesticado apenas de manera parcial por un romanismo perdido, decadente. Antes al contrario, el Hombre Gótico es un tipo de hombre nuevo, una mutación que no se reconoce ni se asimila al romano o al bárbaro que invadió los dominios latinos a partir del siglo V. Es la mixtura anímica de lo romano y lo germano la que dará lugar a ese “enjambre” étnico que en el Medievo florecerá como Cultura Europea.
Los siglos transcurridos a partir de aquella Cultura del Medievo, la cultura fresca germanolatina que después conoceremos como Cultura Europea, nos han ido introduciendo en diversos bancos de niebla, en espesos cortinajes de humo y en vapores de toxicidad varia, y ahora el cerebro y los ojos del europeo se ven muy dañados, no ejercen sus funciones de manera correcta. El propio esquema Edad antigua-Edad media-Edad moderna, que con energía desafiara Oswald Spengler en La Decadencia de Occidente, es una de las causas de nuestra ceguera histórica. En la Edad media se gestaron algunas de las grandes cosas que el hombre de Occidente ha logrado, en franca ventaja respecto al de Oriente. La consideración amigable y el respeto admirado e igualitario hacia la mujer fue fruto del espíritu caballeresco. Todo “romanticismo” nace de aquí, y no ya sólo como regusto literario, como actitud estética: el romanticismo como aplicación del “amor” a la compañera. El bárbaro sólo conoce ayuntamiento carnal o matrimonio “político”. El caballero cristiano ama a la compañera. Junto con el amor, en el sentido elevado y “caballeresco”, la cristiandad medieval nos legó la Propiedad. En este sentido hay que reconocer que la línea de los pensadores románticos y conservadores (Burke, Müller) fue la que pudo comprender, verdaderamente, los valores de la Edad Media. Todo lo contrario del cosmopolitismo ilustrado y revolucionario. La Tierra, nunca una mercancía, es a título individual, familiar y societario un punto de encuentro entre contemporáneos y coterráneos (Adam Müller), no puede ser nunca una mercancía. En la Tierra se vuelca el trabajo del hombre, es consustancial con el hombre como persona. El Medievo nos libró de la cosificación de la tierra, cosificación a la que ahora, bajo el dictado del capitalismo más aberrante, estamos regresando. Muchos otros logros en el orden del Derecho (personal y corporativo) nos llegan desde aquellos siglos, supuestamente “oscuros”: toda una red de defensas ante el poder omnímodo del Estado, la existencia de una doble concepción del poder y la autoridad: democrático y participativo en la base local y corporativa de la pirámide social, jerarquizado y concentrado en la cúspide de las grandes decisiones globales.
6. Restauración de la Comunidad Orgánica. La Razón Histórica mira hacia el futuro.
Pero no es esta ocasión para una defensa de la Edad media, empresa por lo demás impopular y estéril a un mismo tiempo. Estéril porque todo momento pasado, ya ha pasado, como con claridad de Perogrullo nos recuerda Ortega. La Historia es siempre un torrente hacia delante, siempre es avance contínuo hacia lo por-venir. Trazar épocas (epoché, “corte”) en nuestra retrospección es ya hacer ensayo interpretativo, es hermenéutica que sólo pude servirnos para la orientación en el presente y para dar luz en lo que está por-venir. Pero, además de hacer cortes que orienten adecuadamente y nos hagan escrutar el sino, al filósofo (o al historiador “analítico”, como dice Ortega) le conviene “destripar” los hechos fundamentales, allende la hojarasca de los detalles y las anécdotas, someter a disección anatómica la época, el corte seleccionado. Y bien, de la historia analítica de Europa podría sacarse la conclusión meridiana siguiente: a la llegada de la Revolución de 1789, en plena crisis de “crecimiento” de la Cultura Europea, se inicia desde la cumbre de sus logros (la idea de un “Derecho Natural” de la persona, la Razón, el Progreso, la Igualdad, la Libertad Civil…) un descenso, que es un descenso histórico o declive. La Decadencia (Untergang) de que nos habló Spengler es, en Ortega, más bien, declive de la conciencia histórica del hombre europeo, neobarbarie de las masas.
Los sistemas educativos aberrantes, verdaderas incubadoras de indolentes y consumidores bárbaros, no hacen otra cosa que fetalizar (persistencia de caracteres juveniles propios de una etapa salvaje), o incluso reducir a la vida vegetativa a adolescentes y adultos (en el sentido biológico) que, en otras épocas, ya se habrían incorporado plenamente a la vida plena (la milicia, el trabajo, la aventura). Ni siquiera se trata de una infantilización: el niño es creador de mundos fantásticos, el niño es juego y apertura a la vida (el niño es plenariamente humano a su edad: es Humanidad misma). Hay que hablar de fetalización, de sustitución de los vientres maternos por engranajes estatalistas que “tutelan” a individuos que ya no son niños y no quieren ser, tampoco, hombres ni mujeres. En España, las tropelías de la famosa L.O.G.S.E. (1991) esa ley educativa que consagró la bajada definitiva (como todo cuanto podemos llamar “definitivo” en Historia, esto es, a escala de siglos) del nivel de exigencia a que un pueblo se somete a sí mismo. Las sucesivas leyes de educación no han rectificado ni paliado los efectos desastrosos que sobre el intelecto de las masas ésta L.O.G.S.E. ha provocado. La transferencia de responsabilidad en la crianza, la tutela, la supervisión y –en definitiva- la Educación que las familias degradadas de nuestros días han realizado en beneficio de la acción del Estado, ha sido devuelta con un Estado intervencionista pero abstracto, ideologizador (la Asignatura de “Educación para la Ciudadanía” y la merma progresiva de contenidos filosóficos en la Enseñanza Media es prueba de ello), y sumamente ineficaz en la realización de sus propósitos. Hay que darle al César lo que es del Cesar, pero hay que impedir que su Imperium se extienda a las Instituciones y ámbitos intermedios entre el individuo y el aparato estatal. En este contexto, una relectura de la obra de José Ortega y Gasset no puede ser más inspiradora para relanzar un proyecto ambicioso de contención de le Decadencia, un proyecto que socialice a los pueblos, un afán de restaurar
LRH 22.4.pdf
Documento Adobe Acrobat [177.5 KB]
Descarga
 Il mondo non dobbiamo necessariamente accettarlo così com’è. L’uomo ha sempre la possibilità, grazie alla sua volontà creatrice, di trasformalo. È questo, in sostanza, il messaggio che ci viene dalla tradizione filosofica dell’idealismo. Ed è sempre questo il fil rouge lungo cui si dipana l’interessante volume di Diego Fusaro Idealismo e prassi: Fichte, Marx e Gentile (Il melangolo, pp. 414, € 35), uscito da qualche mese nelle librerie italiane.
Il mondo non dobbiamo necessariamente accettarlo così com’è. L’uomo ha sempre la possibilità, grazie alla sua volontà creatrice, di trasformalo. È questo, in sostanza, il messaggio che ci viene dalla tradizione filosofica dell’idealismo. Ed è sempre questo il fil rouge lungo cui si dipana l’interessante volume di Diego Fusaro Idealismo e prassi: Fichte, Marx e Gentile (Il melangolo, pp. 414, € 35), uscito da qualche mese nelle librerie italiane.





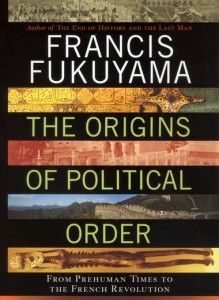 There’s so much meat in Francis Fukuyama’s The Origins of Political Order that someone could teach a college class on it, and someone should. It’s an expansive study of different political systems that attempts to develop a general theory of political development, and explain why different societies have formed different kinds of states — or none at all. The author also offers some explanations for why state-building efforts in the developing world have produced mixed results.
There’s so much meat in Francis Fukuyama’s The Origins of Political Order that someone could teach a college class on it, and someone should. It’s an expansive study of different political systems that attempts to develop a general theory of political development, and explain why different societies have formed different kinds of states — or none at all. The author also offers some explanations for why state-building efforts in the developing world have produced mixed results.
 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg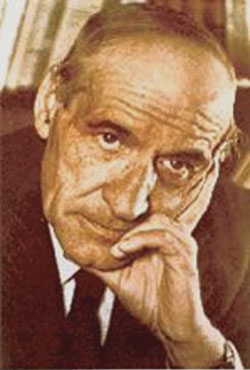




 L'ennemi de la France et de l'Europe, ce n'est pas la gauche, la droite, l'extrême-gauche ou l'extrême-droite dans la société !...
L'ennemi de la France et de l'Europe, ce n'est pas la gauche, la droite, l'extrême-gauche ou l'extrême-droite dans la société !...
 The following amplifies the concept of ur-fascism
The following amplifies the concept of ur-fascism 

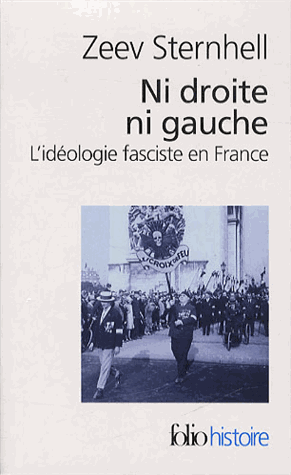 Nous ne partageons pas l'idée selon laquelle il y aurait la vraie gauche et la fausse gauche. Cela a été dit aussi de la droite, celle-ci étant accusée par certains de faire une politique de gauche. Ces notions trop galvaudées sont trompeuses et doivent être abandonnées. On ne manquera pas de nous objecter que le "Ni droite ni gauche" a un air de déjà vu et que cela rappellerait des thèmes en vogue dans les années 30. C'est évidemment très réducteur et occulte un peu facilement la diversité des courants représentés par ce qu'on appelé les non conformistes des années 30. On peut voir du fascisme partout à l'instar de Zeev Sternhell (Ni droite ni gauche L'idéologie fasciste en France) mais ce n'est pas très sérieux. Si être anti Système c'est être fasciste alors notre pays est majoritairement fasciste !! Le fascisme c'est FINI. Il est mort en 1945 et qu'on le laisse en paix. La réalité, c'est tout simplement que le peuple dans son infinie diversité ne se reconnaît plus dans ses élites et aspire (confusément sans doute) à un sursaut de salut public.
Nous ne partageons pas l'idée selon laquelle il y aurait la vraie gauche et la fausse gauche. Cela a été dit aussi de la droite, celle-ci étant accusée par certains de faire une politique de gauche. Ces notions trop galvaudées sont trompeuses et doivent être abandonnées. On ne manquera pas de nous objecter que le "Ni droite ni gauche" a un air de déjà vu et que cela rappellerait des thèmes en vogue dans les années 30. C'est évidemment très réducteur et occulte un peu facilement la diversité des courants représentés par ce qu'on appelé les non conformistes des années 30. On peut voir du fascisme partout à l'instar de Zeev Sternhell (Ni droite ni gauche L'idéologie fasciste en France) mais ce n'est pas très sérieux. Si être anti Système c'est être fasciste alors notre pays est majoritairement fasciste !! Le fascisme c'est FINI. Il est mort en 1945 et qu'on le laisse en paix. La réalité, c'est tout simplement que le peuple dans son infinie diversité ne se reconnaît plus dans ses élites et aspire (confusément sans doute) à un sursaut de salut public.
 Et jusqu’au 12 octobre 2014 se sont ouverts, les
Et jusqu’au 12 octobre 2014 se sont ouverts, les  « Un État fait la politique de sa géographie », pensait Napoléon. « C’est une évidence pour qui observe l’histoire des relations internationales », confirme Olivier Zajec dans Les secrets de la géopolitique (Tempora, 2008) – un petit ouvrage très éclairant réédité l’année dernière chez Artège. Saint-Cyrien et diplômé de Sciences Po Paris, agrégé et docteur en histoire, enseignant aujourd’hui à l’Université Lyon III, Zajec propose d’approcher la géopolitique par un retour aux sources, aux fondamentaux de la discipline : « La géopolitique étudie les inerties physiques et humaines qui affectent le comportement interne et externe des États. Elle éclaire ainsi les fondements politiques des actions pacifiques ou guerrières qui, par la conquête ou la défense de territoires, cherchent à assurer, par le biais de stratégies militaires, économiques et politiques, la pérennité d’une communauté dans l’Histoire ».
« Un État fait la politique de sa géographie », pensait Napoléon. « C’est une évidence pour qui observe l’histoire des relations internationales », confirme Olivier Zajec dans Les secrets de la géopolitique (Tempora, 2008) – un petit ouvrage très éclairant réédité l’année dernière chez Artège. Saint-Cyrien et diplômé de Sciences Po Paris, agrégé et docteur en histoire, enseignant aujourd’hui à l’Université Lyon III, Zajec propose d’approcher la géopolitique par un retour aux sources, aux fondamentaux de la discipline : « La géopolitique étudie les inerties physiques et humaines qui affectent le comportement interne et externe des États. Elle éclaire ainsi les fondements politiques des actions pacifiques ou guerrières qui, par la conquête ou la défense de territoires, cherchent à assurer, par le biais de stratégies militaires, économiques et politiques, la pérennité d’une communauté dans l’Histoire ». Ainsi de la Mer des Caraïbes, considérée par Washington comme un « lac américain », du Golfe persique, où s’exprime la vieille « rivalité géo-historique entre Perses et Arabes » sur fond de jeu pétrolier mondial, ou encore de la Mer de Chine méridionale, où « s’entrelacent d’innombrables îles et archipels, au croisement des routes d’approvisionnement en hydrocarbures de toute l’Asie, et des cultures chinoise, malaise et vietnamienne » – théâtre d’une stratégie chinoise aujourd’hui en pleine expansion.
Ainsi de la Mer des Caraïbes, considérée par Washington comme un « lac américain », du Golfe persique, où s’exprime la vieille « rivalité géo-historique entre Perses et Arabes » sur fond de jeu pétrolier mondial, ou encore de la Mer de Chine méridionale, où « s’entrelacent d’innombrables îles et archipels, au croisement des routes d’approvisionnement en hydrocarbures de toute l’Asie, et des cultures chinoise, malaise et vietnamienne » – théâtre d’une stratégie chinoise aujourd’hui en pleine expansion. Ce qui permet notamment à Christian Harbulot d’analyser ainsi la nature des rapports de forces à l’oeuvre sur l’échiquier géoéconomique (La machine de guerre économique, Economica, 1992) : « La guerre économique ressemble à toutes les guerres. Un peuple est d’autant plus motivé à se battre qu’il défend sa terre nourricière ». « Labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France », aimait à répéter Sully.
Ce qui permet notamment à Christian Harbulot d’analyser ainsi la nature des rapports de forces à l’oeuvre sur l’échiquier géoéconomique (La machine de guerre économique, Economica, 1992) : « La guerre économique ressemble à toutes les guerres. Un peuple est d’autant plus motivé à se battre qu’il défend sa terre nourricière ». « Labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France », aimait à répéter Sully.

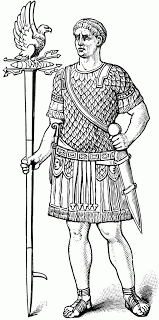 L’État-nation, dont la France est l’archétype, désire l’égalité, l’uniformité, la centralisation ; il établit une loi unique sur l’ensemble de son territoire. Il ne reconnaît pas la diversité des coutumes et tend à la suppression des différences locales. Il suppose que tous les peuples sous son empire adoptent les mêmes mœurs et s’expriment dans sa langue administrative.
L’État-nation, dont la France est l’archétype, désire l’égalité, l’uniformité, la centralisation ; il établit une loi unique sur l’ensemble de son territoire. Il ne reconnaît pas la diversité des coutumes et tend à la suppression des différences locales. Il suppose que tous les peuples sous son empire adoptent les mêmes mœurs et s’expriment dans sa langue administrative.
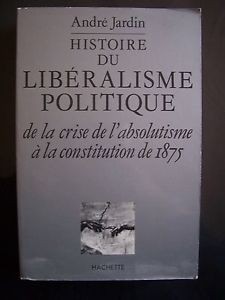



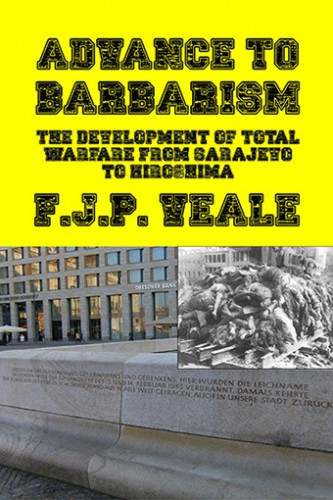 “
“
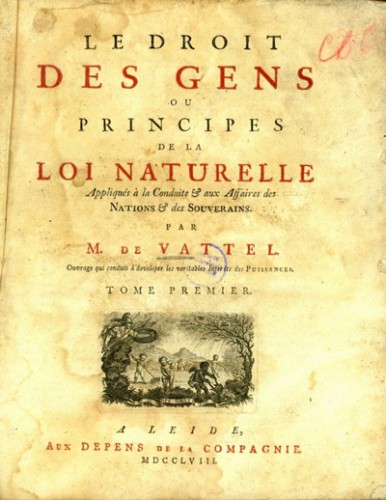 Vattel points out that war as a means to settle disputes “can only serve this purpose if, in the first place, it be conducted by methods which do not leave behind a legacy of hatred and bitterness…”
Vattel points out that war as a means to settle disputes “can only serve this purpose if, in the first place, it be conducted by methods which do not leave behind a legacy of hatred and bitterness…”
