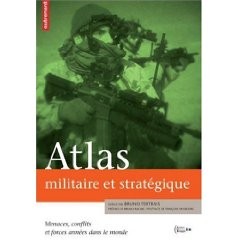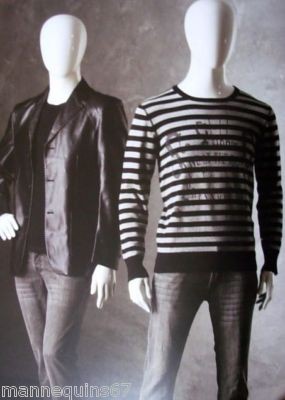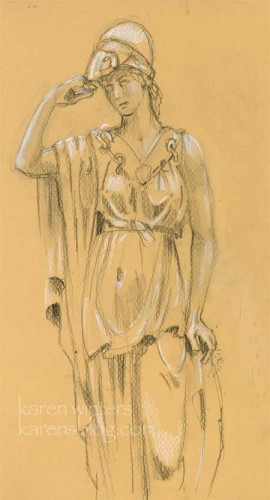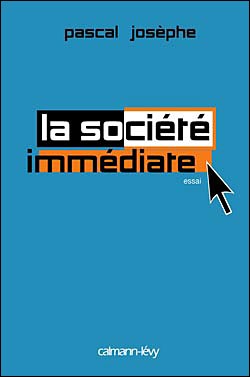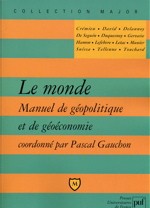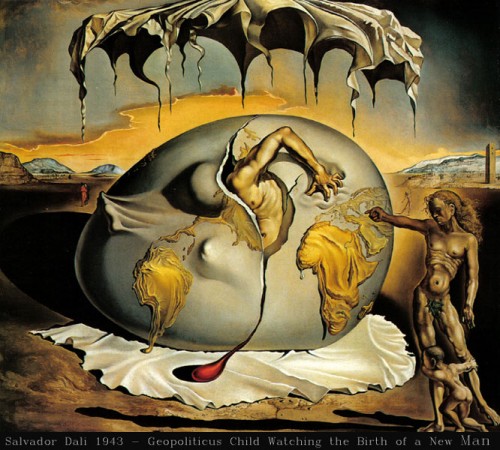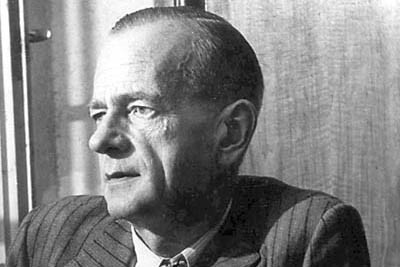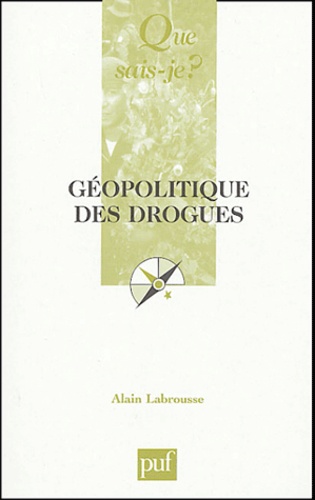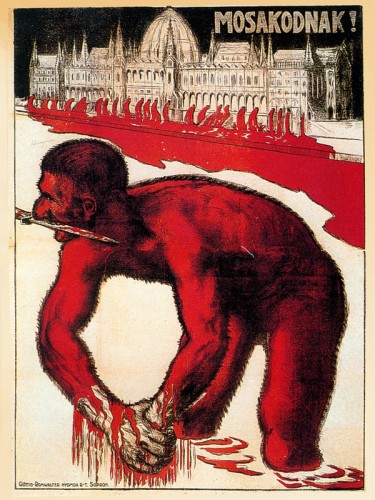| El entorno de su decisión de participar en las lides políticas está marcado por un acontecimiento de la mayor trascendencia para el futuro institucional de la España contemporánea. Me refiero a la cuestión sucesoria que se planteó ante el restablecimiento en 1830 de la pragmática sanción que restauró la sucesión al trono por línea directa, aunque fuera femenina. Su posterior derogación, en septiembre de 1832, y su definitivo restablecimiento, a consecuencia del golpe de Estado ocurrido días después de la anterior revocación, terminan por significar el afianzamiento del régimen político liberal en España. Es presumible la participación directa de Donoso Cortés en el mencionado golpe acontecido en La Granja [1] . Este fue organizado por sectores de la nobleza, con el apoyo de parte de la alta burguesía liberal. Entre sus ejecutores destacaron el marqués de Miraflores y los condes de Parcent, Puñonrostro y Cartagena, quienes contaron con la activa participación de los cuñados de Donoso, Juan José y Rufino García Carrasco. Sobre todos ellos hay que sumar el apoyo de María Cristina, esposa del, por entonces, moribundo Fernando VII, y además el de la persuasiva Luisa Carlota, hermana de María Cristina y esposa del infante Francisco de Paula, hermano menor del rey y del infante don Carlos. La primera sellaba de esta manera su alianza con el liberalismo, con el objeto de lograr la sucesión al trono de su hija Isabel. La influencia de la segunda, si bien no del todo aclarada, parece decisiva en el súbito cambio de opinión del monarca y en la destitución del Ministerio, asuntos vitales para el éxito del golpe [2] . La situación política que germina en los sucesos de La Granja, pese a la mejoría temporal de la salud de Fernando VII, quien no fallece sino un año después, supone, en definitiva, el fin del Antiguo Régimen, a través del establecimiento de la Regencia de María Cristina, en espera de la mayoría de edad de su hija Isabel. En lo que corría de siglo, era éste el tercer intento liberal en España por acabar con el Antiguo Régimen. Fue el que finalmente logró su objetivo, no sin tener que resolver por las armas el problema sucesorio que, desde sus orígenes, había planteado el carlismo. Donoso Cortés se incorpora a la política con decisión y compromiso, en torno a estos significativos "sucesos de La Granja"; reconozcamos, pues, cuál fue, entonces, su primer aporte intelectual en aquella hora de transición de la monarquía y del fundamento de su soberanía. Romanticismo Hemos anotado el ambiente poético y literario en el que se desenvuelve Donoso en su juventud. Ha recibido su formación universitaria en centros pre-románticos como Salamanca y Sevilla. Paralelamente, trató de cerca al poeta Quintana. En todo ello, se puede perfilar el tránsito del sentimiento ilustrado al romántico, fase que se completa en la generación del propio Donoso, la que ha nacido en el siglo XIX. No es fácil precisar el concepto de romanticismo o delimitarlo a una esfera literaria o estética, mucho menos a una política. Parece más bien una forma de enfrentar la vida, un estilo de comportamiento, una acusada mentalidad, que en un afán superador del racionalismo dieciochesco, tiende a valorar desmesuradamente el sentimiento, los instintos, el mero impulso. Así, la actitud propia del romántico es la pasión, el arrebato ligero e idealista que lo mueve a despreciar el análisis racional por considerarlo frío, impersonal, carente de vida. La valoración de la libertad y el sentimiento trágico de la vida, son otras dos características comunes al espíritu romántico, que bien pueden ayudar a entender algunas actitudes donosianas. Donoso formó parte y dio sus primeros pasos intelectuales junto a la primera generación del romanticismo español. La historiadora Iris M. Zavala lo incluye, en sus inicios, dentro del romanticismo progresista, que abandona durante la decada de los años treinta, para, en la siguiente, influir como pionero del romanticismo conservador junto a Balmes. Para ella, ambos pensadores alimentaron la defensa del altar y del trono, el retorno a las baladas y leyendas populares y la importancia de la religión ante los "extravíos" románticos [3] . Incluso hace hincapié en el ataque donosiano a la soberanía popular -cuando la calificó de absurda, imposible, y atea-, comparándolo con el significado salvífico que ésta había tenido para Larra y Espronceda. Esta distinción ayuda, en opinión de Zavala, a diferenciar ambas corrientes románticas. Lista, Martínez de la Rosa, Alcalá Galiano y el duque de Rivas, evolucionaron hacia esta tendencia literaria conservadora, que contó con exponentes de la talla de Nicomedes Pastor Díaz, Gabriel García Tassara y Joaquín Francisco Pacheco, los tres por entonces, amigos de Donoso. Más tarde incluye en esta corriente a Zorrilla, Navarro Villoslada y José María Quadrado. Si bien no todos compartieron los duros juicios de Donoso sobre la soberanía popular, para Zavala los uniría su común espíritu conservador. Literatura y política tienen en aquella época íntima conexión, son los años en que abunda la figura del político-literato, pero debemos cuidarnos de no diferenciarlas como corresponde. Con peculiariedad, el estilo y el pensamiento político de Donoso Cortés, tanto como su carácter personal, responden en medida importante a este espíritu romántico. De entre los pocos versos que se conservan, La venida de Cristina refleja su ánimo romántico ante la llegada de la bella joven y "las felices bodas con el Rey nuestro señor" [4] . Este poema es de felicidad y optimismo ante las perspectivas del nuevo matrimonio Real. Junto a la reina, ve venir la paz, "por la esperanza y el amor llevadas" [5] . No son versos políticos, pero no dejan de reflejar un profundo sentimiento de admiración y respeto por la institución monárquica, incluso un inesperado entusiasmo por lo que podría llegar a suponer para la frustración de la sucesión de don Carlos. Esta inicial simpatía poética llegó a plasmarse, respecto a María Cristina, a lo largo de una vida a su servicio, en una inquebrantable fidelidad. El régimen liberal que encabeza María Cristina cuenta en Donoso con una de sus principales figuras de apoyo, especialmente a través de la prensa. Luego, en 1840, tras la caída de la Reina Gobernadora, ésta le solicitará su colaboración personal durante su exilio en Francia. Es muy probable que Donoso en su primera estancia en Madrid, hacia 1828, recibiera a través de Agustín Durán la influencia del romanticismo schlegeliano, es decir, católico y conservador. De allí pueden provenir sus primeros contactos con las obras de Chateaubriand, M. de Staël y Scott. En su discurso de Cáceres al año siguiente hay palabras de elogio a Durán, cuya posición medievalista debe haber contrarrestado, al menos en parte, los tópicos ilustrados que habría recibido de Quintana. Hacia 1837-38, ya desilusinado del doctrinarismo, se vuelven a hacer notar en sus escritos estas lecturas románticas de matiz conservador y cristiano. Historia y revolución De los primeros escritos, generalmente cartas personales de 1828-29, destaca la alta consideración de sí mismo, y la gran estima intelectual que ya le demuestran sus compañeros de estudios. El joven extremeño demuestra en ellas poseer un considerable conocimiento de las tendencias filosóficas del momento, dejándose ver como un liberal optimista, confiado de la trascendencia positiva de los tiempos que corren [6] . Su Discurso de Apertura en el Colegio de Cáceres (1829), donde apoyado por Quintana comienza a ejercer, no del todo convencido, una cátedra, refleja su fuerte formación ilustrada. Prueba de ello es que la clasificación de la historia que allí utilizó responde al tópico racionalista y liberal apologético en su valoración de la Grecia clásica; recoge asímismo de la Ilustración la despreciativa valoración de la Edad Media como "siglos de barbarie" [7] , y una actitud de sincera admiración hacia el Renacimiento en las figuras de Dante y Petrarca. No obstante, el joven profesor, nada original hasta el momento, llega a afirmar que el surgimiento de la filosofía de las sensaciones, que origina Bacon en la Inglaterra del siglo XVI y que desarrollaron Locke, Condillac y Helvecio, determinó que desde entonces en Europa todo sea "disputa y agitación" [8] . Esta interpretación histórica la completa en el escrito que se le atribuye y que lleva por título Exposición a Fernando VII en favor de Juan José Carrasco, fechada, sin mayor precisión, entre los años 1831 y 1832. Allí Donoso agrega a su análisis que desde aquel instante de disputa y agitación, fue cuando el mundo entró en un caos: "Los filósofos quisieron explicar al hombre y constituir la sociedad, y la sociedad y el hombre se han aniquilado entre sus manos" [9] . Lo explica señalando que fue a partir de entonces cuando se introdujo el germen de la duda en el seno de los pueblos y, con él, el de las revoluciones. Una sociedad, dice Donoso, no puede existir sin una base común de creencia y el principio filosófico, que no es otro que la duda que origina la disputa, ha combatido el principio religioso, que es, dentro de su ideario, ya constitutivo y civilizador de los pueblos europeos [10] . De esta lucha entre ambos principios, en la que el religioso reúne para conservar y el filosófico individualiza para destruir, han nacido, en su opinión, todos los males de Europa. En esta interpretación, la Reforma fue el primer resultado de este enfrentamiento, aunque el triunfo de la filosofía no llegó hasta el siglo XVIII, cuando fue capaz de engendrar la revolución que "conduce a la religión al sepulcro" [11] . La sociedad ha perdido, desde entonces, su base común y no logra encontrar un principio que logre serenarla. El ejemplo lo tiene en Francia, en donde ni la República, ni el Imperio, ni la Restauración, ni siquiera aun las convulsiones recientes de julio de 1830, han encontrado un principio que logre dominar la disolución. Esta la explica afirmando que la derrota del principio religioso en Francia lleva consigo tres principios destructores: la destrucción de la unidad de creencia, la destrucción de costumbres y la destrucción del gobierno. Sin la unidad de creencia la sociedad se disuelve, ya que desaparece el principio de unidad y, en su lugar, se entroniza el espíritu de individualización que se apoderará de las masas; la destrucción de las costumbres es fruto de la corrupción que ha invadido todas las clases sociales; un pueblo corrupto, en consecuencia, no puede darse instituciones ya que aparece incapaz de generar estabilidad sin costumbres, o dicho de otra modo, la falta de una creencia disuelve las costumbres y las pasiones no son capaces de organizar instituciones. El problema está en que este desorden social provoca en la práctica: "la idea anárquica de que todo puede discutirse, de que todos los principios pueden ser falsos si los analiza la razón y de que nada debe respetarse sin haber sufrido el examen de las masas" [12] . En este temprano análisis encontramos ya el enfrentamiento "revolución contra religión", clave en su pensamiento posterior. El afirmar el triunfo de la primera sobre la segunda lleva consigo la denuncia de las consecuencias, inevitablemente anárquicas, que la sociedad ha de seguir: "si en este pueblo se discuten las grandes teorías de los poderes, si se analizan todas las formas de gobierno, todas las maneras de existencia política y social, el pueblo, que nada respeta, porque nada cree, y nada cree, porque no tiene religión, estará siempre en lucha con el Gobierno que le rige; si la imprenta periódica es la arena donde se combaten todos los principios, el pueblo es el juez que debe decidir sin apelación de la victoria; es decir, que un pueblo que sólo se gobierna por pasiones es llamado a decidir como soberano lo que sólo debiera decidir el tribunal de la conciencia y la razón; cuando el mundo moral ha perdido en este grado su nivel, cuando se han quebrantado de esta manera todas las relaciones de las cosas, cuando se ha organizado de esta manera el desorden en el seno de la sociedad, el Gobierno es una ilusión, la obediencia es un engaño y la sociedad es un abismo. Tal es el estado de la Francia: la discusión aniquiló la religión; la discusión ha aniquilado los Gobiernos" [13] . Donoso liga directamente el efecto disolvente de la revolución a la acometida de ésta en contra de la religión; la discusión, en una sociedad descreida, en definitiva, es el germen de la anarquía social. Está aquí presente su crítica a la soberanía popular, en la entrega a discusión de los principios fundamentales de la sociedad a una masa que, sin religión, al perder las costumbres, se regirá por la pasión. En este sentido, la destrucción del principio religioso, en su pensamiento, a diferencia de los filósofos ilustrados, significa una pérdida de análisis racional para hacer frente a los problemas políticos, ya que al final, se someterían únicamente a la resolución "sin apelación" de un pueblo que considera, por descreído, sin costumbres y corrupto. Razón y fe, aparecen ya indisolublemente ligadas en el pensamiento del joven Donoso Cortés. El divorcio de ambas es ya, para él, precisamente la causa de las convulsiones de Francia y el anuncio de catástrofes en toda Europa. Toda esta interpretación de la historia occidental supone un anticipo a tesis fundamentales de su polémico.Ensayo.(1851) La oposición religión católica-filosofía racionalista esta esbozada en estos poco estudiados escritos, como también su teoría de las revoluciones y, especialmente, la consideración negativa de toda discusión desvinculada de un principio que la ordene. Este Donoso, ciertamente, le debe aún mucho al liberalismo, pero su supuesto racionalismo inicial sufre altos y bajos como lo prueba su siguiente afirmación: "la filosofía por sí sola nada puede... de su divorcio con la religión han nacido todos los males que pesan sobre la Europa" [14] . El Donoso maduro, católico, enemigo innato de la revolución; aquél que percibe tras toda gran cuestión política un asunto teológico, se anuncia a ratos, pero con inusitada precisión. Hay quienes han dudado de la sinceridad de estas tempranas afirmaciones donosianas debido al carácter de los escritos en que están incluidas, teniendo en cuenta de que están dirigidos al rey. Sin embargo, la conformidad de ellas con sus posteriores ideas es en muchos casos tan estrecha que, en mi opinión, las liberan, en su mayor parte, de una justificada sospecha de hipocresía. Continuando con su rápida revisión de la historia, surgen algunas contradicciones. Si el siglo XVI había dado origen a las disputas morales con las ya señaladas repercusiones en la sociedad, el siglo XVIII, que por sus "profundos filósofos y celebres artistas" [15] lo tenía todo para ser el siglo de las luces fue, no obstante, el de las revoluciones. En este juicio del siglo que lo precedió, combina el reconocimiento de la magnitud de los pensadores que lo moldearon con los resultados sociales que generarían estas ideas en la práctica. Su viraje al interpretar de forma positiva la historia de lo que va corrido de su siglo vuelve a recordar su formación ilustrada y, fruto de ella, su íntima convicción optimista ante el presente y futuro de su siglo. El XIX deberá ser el siglo de las luces, "en el que se encuentran bastante discutidas todas las opiniones que dividieron a los filósofos y que abrazaron las escuelas" [16] . Es el momento, con todo el saber del pasado y la experiencia del presente, de avanzar con paso seguro y esperanzador en la carrera de la ilustración. Nuestro autor demuestra su juvenil entusiasmo ante el momento histórico que vive. Las disputas, no sabemos por qué razón, las siente superadas, como si se tratara de una lección asumida. No cabe duda, sin embargo que en la discusión, ajena a una creencia común, está considerando un aspecto negativo, disolvente de la sociedad, tesis que desarrolló con profundidad durante sus años de madurez [17] . Su interpretación de la historia es la que por entonces está en boga y que construyó la Ilustración, su juicio negativo del enfrentamiento a partir del siglo XVI de filosofía y religión, rompe el tópico racionalista, anuncia al futuro Donoso, pero no termina de enlazar con el resto de su visión. Nuestro joven intelectual apenas sobrepasa por entonces los veinte años de edad y, como veremos, sus ideas están en continuo desarrollo, no exentas de revisión a través de sus lecturas y en torno a los avatares políticos y sociales de su época. José Alvarez Junco ha creido ver, en estos primeros escritos donosianos, rasgos de un "teocratismo cristiano" al cual "regresará" tras las revoluciones del 48 [18] . Las revoluciones, cuyo estudio ya considera de fundamental importancia, son las que establecen el eslabón de los distintos períodos históricos, constituyen la marcha "constante y progresiva" [19] de los siglos; si bien, en carta a su amigo Gallardo, consideraba que aunque el espíritu humano avance, puede también encontrar retrocesos en su marcha [20] . Este avance progresivo de la historia es una idea muy propia del espíritu decimonónico, del cual Donoso no pretende prescindir, y contrasta con el tono pesimista que se deja ver en su prólogo a El cerco de Zamora (1833), en donde vuelve a perfilarse el último Donoso; en este caso diríamos el de siempre, porque advierte de las consecuencias catastróficas que la supresión de las jerarquías sociales anuncian a la sociedad [21] . Este punto, que ya por entonces llama a meditar, es una de sus constantes: Donoso fue siempre anti-igualitario, porque percibió en las jerarquías una resistencia natural al poder absoluto, a la omnipotencia social como luego lo denominaría. La duda ha sido el sepulcro de la razón y de la fe, pero esta situación anárquica, que a través de la revolución Francia extiende por Europa, encuentra en España un duro escollo. Donoso considera que, en su nación, el principio religioso se respeta, de lo que extrae dos inmediatas consecuencias: el trono tiene aun allí hondas raíces y las costumbres sociales, que sobreviven por la ausencia de principios destructores y la presencia del principio religioso, "hacen imposible en España una revolución" [22] . Así, la religión está reconocida ya en su primer pensamiento como requisito de la institución monárquica y fundamento básico de las costumbres sociales del pueblo español. Donoso no se detiene en señalar el porqué, a diferencia del caso francés, en España no se produjo el divorcio entre filosofía y religión. Siguiendo la lógica de su interpretación, deberíamos señalar que fue porque, en la península, la razón siguió caminando junto a la fe, ya que las consecuencias que él mismo describiera de la filosofía sensualista y la Reforma no lograron penetrar en el ambiente intelectual español sino varios siglos después, viéndose con ello retrasada la aparición de sus efectos. Fue precisamente la monarquía española la que tomó en sus manos la defensa de la religión católica y colaboró activamente en la llamada Contra-Reforma. Sin embargo, Donoso desconocía por completo, al menos durante su juventud, y muy probablemente por su formación liberal ilustrada, el pensamiento escolástico español. No logra por entonces despegarse de la mentalidad de su tiempo para explicar lo que ya comienza a percibir. Monarquía y propietarios Para nuestro pensador los reyes deben depender del "gran movimiento social que se verifica en Europa" y "no de la voluntad particular de un individuo cualquiera" [23] . El primero es el liberalismo, la segunda, el absolutismo. Sin embargo, hemos visto que Donoso, si es liberal por formación, es conservador por instinto y procedencia. Al liberalismo querrá despojarlo de su espíritu revolucionario, o como lo llamará después, de su ánimo disolvente de la sociedad. Aun si en España germinaran las causas de la revolución, ésta no encontraría el apoyo de los propietarios, quienes por su instinto de conservación tienden a proteger sus intereses. Ellos saben que las revoluciones promovidas por las masas estan escritas con la sangre de los propietarios, pueden "todavía consultar los sepulcros de la revolución francesa y no encontrarán sino los cadáveres de los que tuvieron" [24] . Esta relación antagónica revolución-propietarios es característica del liberalismo conservador, que surge una vez producida la revolución y trastocada la propiedad. Antes, como sugieren estos escritos del extremeño, parece señal del más mezquino inmovilismo, aquél que sacrifica toda dinámica política a la mera protección de su peculio. Hay, no obstante, que considerar que Donoso, en la cita anterior, está escribiendo a nombre de su cuñado y nada menos que al rey Fernando VII, y, evidentemente, no es el momento de sugerir cambios, ni de hacer críticas al absolutismo. Lo que pretende decir entonces Donoso, es que no se ha de buscar revolucionarios ni conspiradores en los propietarios, entre los que evidentemente estaría su cuñado. Finalizado el golpe de Estado de 1832, nuestro pensador insistirá en esta tesis, dividiendo a los españoles en los partidos"de la legitimidad y la usurpación" [25] . El primero incluye a todo el sector liberal que se ha hecho con el poder, precisamente un amplio grupo de la aristocracia apoyada por la alta burguesía, que más tarde llamará aristocracias legítimas, y que no son otras que las clases propietarias. Por otra parte, los usurpadores, son el bando carlista, donde deben encontrarse los conspiradores y revolucionarios, curiosamente el sector popular y rural, que políticamente califica de inmovilista, por ignorar la gran transformación que se implementa en Europa y pretender, en cambio, retrotraernos al siglo XII. Donoso proviene de una familia de propietarios terratenientes. Sin embargo, no parece mostrar intereses económicos, ni siquiera en éstos sus comienzos, más allá de los que le permitieran mantener una vida con la dignidad a la que parece acostumbrado. Por otra parte, obtiene el rápido reconocimiento público de sus personales capacidades intelectuales, de lo que sí se muestra orgulloso en esta etapa. Su carrera de funcionario, y el formar parte del selecto ambiente político e intelectual de Madrid, lo mantienen más que satisfecho. Su principal afán será influir a través de sus ideas en la política española e incluso europea. Siempre mantuvo cierto desdén hacia lo material, atributo más propio del ambiente romántico que de su formación liberal. Busca el extremeño en estos años de transición la liquidación del absolutismo, objetivo que mientras viva Fernando VII no corresponde plantear sino señalando que el rey debe depender del "gran movimiento social que se verifica en Europa", evitando los efectos perturbadores de la revolución. Donoso, como hombre de su siglo, acepta la corriente de su tiempo, un liberalismo superador del anquilosado absolutismo, y en este sentido progresista. Su espíritu se percata inmediatamente de la necesidad de controlar los efectos disociadores de la revolución. Si bien señala las causas de éstos en la pérdida del principio religioso, no alcanza aún a recomendar remedios, sino que trata de hacer ver, poco a poco, a la Iglesia y la religión no como un enemigo a destruir por el liberalismo, sino como una institución que ha sido garantía de libertades y de progreso. Así, en su análisis histórico, también pretende superar una visión negativa de la labor de la Iglesia en relación con el progreso de la economía, al ver en las Cruzadas el germen que introduce el entusiasmo y las virtudes, no por sus resultados políticos o por su carácter de empresa común, que obliga a descuidar la familia y la propiedad, incluso a disponer de la vida por un supuesto ideal religioso, sino porque las Cruzadas generaron un desarrollo del comercio que, a su juicio, ha significado un primer paso hacia la ilustración. El beneficio de las Cruzadas, mediante las cuales sorprende la unidad espiritual de Europa, está, para Donoso, en que permitieron el desarrollo comercial con Oriente y entre los mismos europeos [26] . De esta manera, la religión cristiana ha constituido y civilizado a los pueblos, y su mérito no es otro que el de haber dado impulso al desarrollo comercial. Pareciera querer hacer ver a quienes se rigen por intereses ajenos a la religión que la Iglesia no es una institución negativa, sino que por el contrario, como impulsora del comercio, sería fundamento de la felicidad liberal. Sus primeros escritos son liberales pese a su denuncia del divorcio entre fe y razón y las críticas ocasionales al proceso revolucionario contrario a la religión. No llega, sin embargo, a dilucidar las últimas consecuencias de aquella ruptura, sólo lo hará a partir de 1847. Por el contrario, ahora busca asignar a la religión un papel moderno dentro de su época, forzándole un logro económico como el comercial que acabamos de señalar. La defensa de la Pragmática Más allá de adelantarnos algunas consideraciones sobre la monarquía, su Memoria de 1832 buscó la legitimación del golpe del mismo año, incluyendo, para ello, argumentos en pro de la legalidad de la pragmática. Por otra parte supuso afirmar, con decisión, su primera posición política junto a la causa del liberalismo conservador. Sus duros juicios hacia el carlismo buscan identificarlo como el enemigo político sin cuya amenaza no podría justificarse el golpe de 1832. Más aún, Donoso busca legitimar jurídicamente el golpe afirmando la ilegalidad que constituía la medida impuesta en 1713 por el rey Felipe V, la cual supuso el impedimento a la sucesión femenina del trono de España. Partiendo de esta premisa, quiere reconocer como válida toda acción que busque remediar esta "ilegalidad". Una vez ordenada la anterior situación por Fernando VII mediante la pragmática sanción de 1830, juzga como "usurpadores" a quienes han pretendido ignorar ésta última, por oponerse, en definitiva, al restablecimiento de la tradición y la costumbre. Su dialéctica es hábil y oportuna, pero no analizaremos aquí la autoridad o validez de sus juicios históricos o jurídicos. Sí, en cambio, nos interesa la intencionalidad de sus argumentos en favor de la precisión de su inicial ideario. Como hemos señalado, su punto de partida sobre la cuestión es la tesis que considera la revocación de Felipe V como "ilegal y nula... concebida por la venganza y sancionada por la fuerza" [27] . Ilegal porque se acabó con una ley que recogía la costumbre: "las primeras leyes de los pueblos son siempre la expresión exacta de sus necesidades, porque son el resultado inmediato de las costumbres que ellas produjeron. Estas leyes deben ser siempre sagradas, porque han recibido la sanción de la experiencia y de los siglos" [28] . En su opinión, Felipe V, en pos de alejar a la Casa de Austria de la Corona y vengar el agravio de la guerra de sucesión, despojó a las hembras de sus derechos al trono en contra de la costumbre [29] . El asunto es que: "las leyes fundamentales de la Monarquía no pueden trasladarse nunca de una nación a otra, porque una nación no puede existir sino con los elementos que encierra dentro de sí misma. Cuando estas leyes son impuestas y no nacidas espontáneamente en el pueblo que las debe obedecer, ellas son el germen más fecundo de todas las revoluciones" [30] . En consecuencia, la medida de Felipe V lanzaba a España "al abismo de las revoluciones" [31] , precisamente porque la consideró contraria a sus tradiciones y resistida por sus costumbres. En aval de lo anterior, Donoso señala que, en su día, el Consejo de Castilla la acató por presión real: "es muy difícil que los reyes cuando han expresado su voluntad no encuentren medios de ser obedecidos" [32] . Por otra parte, mientras que en el Consejo "doblaron la cerviz y se sometieron al yugo" [33] , las Cortes de 1713, "sólo sirvieron de máscara para cubrir la ilegalidad de la ley que Felipe V había jurado imponer a la nación que gobernaba" [34] . Su aprobación por ellas careció de validez, para el extremeño, ya que constata y denuncia graves anomalías en su representación. En fin, para Donoso, "la disposición de Felipe V no puede tener fuerza de ley porque no fue libremente aprobada por la nación ni por los grandes Cuerpos del Estado" [35] . Por consiguiente, la pragmática sanción no hace sino colocar las cosas en su lugar. La argumentación de Donoso fue bien acogida por Fernando VII, quién ordenó su publicación, no sin provocarle al joven extremeño algunos disgustos por la censura a la que fue sometida su Memoria [36] . Fue éste el primer escrito de carácter político que publicó Donoso y mediante el cual, contando con tan sólo veintitrés años de edad, se da a conocer en torno a la Corte. Poco después, fue incorporado como oficial a la Secretaría de Gracia y Justicia, cargo que recibió, siguiendo a sus biógrafos, como recompensa de su hábil defensa de la pragmática. El joven abogado extremeño ha apoyado a conciencia la sucesión de Isabel, enfrentándose a la del infante don Carlos. Sus argumentos, sean válidos o no, son sí, muy oportunos. Con sagacidad ha defendido la situación que permitirá el establecimiento de un nuevo régimen liberal apelando, más que a la razón o a la inteligencia, a la tradición y la costumbre. Con ello pretende despojar al carlismo de sus títulos y banderas populares. Encasilla como usurpadores a quienes pretenden el trono para don Carlos. Encierra al carlismo en una actitud inmovilista, reflejada en el rechazo a la pragmática de Fernando VII, para calificarlo, finalmente, como revolucionario, por oponerse a lo que establecerían las costumbres y confirmaría la tradición. La prágmatica sanción de 1830, no obstante, responde, de acuerdo con las circunstancias históricas, más a una interesada presión de la nueva familia del Rey que al restablecimiento de una interrumpida tradición. Es publicada precisamente cuando la reina María Cristina estaba encinta y no antes. Sectores ilustrados, si no la promovieron, la acogieron como una ventana que se abría hacia una nueva liberalización del régimen, posibilidad hasta entonces cerrada por la personal aversión hacia los liberales, tanto de Fernando VII como de su hermano don Carlos, hasta poco después el indiscutible sucesor [37] . Donoso demostró muy joven su habilidad dialéctica. Como lo prueba esta Memoria sobre la Monarquía , comenzó a utilizarla para legitimar su objetivo político. Este, en sus inicios, no fue otro que el apoyar las circunstancias más proclives a la instauración de un régimen liberal, que quiso matizado por un peculiar tinte monárquico y conservador. Su énfasis, al comienzo, no responde en exclusiva a la luz de la razón que pretende imponer un sistema abstracto, sino más bien, y a diferencia de la generalidad de los liberales de su época, a una considerable valoración de las costumbres, la religión y la tradición. Donoso pretende legitimar la llegada del liberalismo, utilizando, paradojicamente, una argumentación más propia del tradicionalismo. Por otra parte, no es menos cierto que a Fernando VII, destinatario de la Memoria , no se le convencería apelando a ideas liberales. Liberalismo conservador y monarquía Donoso entra a la política en el mismo sentido en que avanza la corriente ideológica de su tiempo, el liberalismo, que en España tiene aun pendiente el fin del sistema absolutista. Su intención, acabar con el Antiguo Régimen y poder controlar la revolución a través de sus ideas, representa el afán de todo liberal conservador ante el nuevo régimen: acepta sus premisas, advierte sus negativos resultados y se siente capacitado para corregirlos. Valora en más el cambio, la necesidad de superar el absolutismo para marchar con la historia. Es aún optimista ante la revolución, porque se siente capacitado de dominar sus excesos en la medida en que sean sus ideas las que se sustenten desde el poder. Restableciendo un principio, ya distinto al revolucionario, que habría agotado su misión al acabar con el absolutismo, logrará evitar la disolución de la sociedad, estableciendo el orden en la nueva sociedad emancipada y libre. Todo ello debe hacerse desde el poder, requiere, en definitiva, de la monarquía. Análogamente a como en el siglo XVIII los primeros ilustrados se sirvieron del trono para llevar a cabo sus reformas, el liberalismo conservador es conciente de que su cambio deberá producirse desde arriba. En estos primeros años Donoso puede calificarse como liberal conservador: las características recién señaladas lo confirman. El golpe de Estado de 1832 supone la posibilidad de acabar con el Antiguo Régimen y acceder al poder. El adversario entonces es el carlismo y, por lo tanto, dentro de las filas liberales no es el momento de hacer diferencias, pese a que efectivamente existieron. En su Memoria sobre la Monarquía (octubre de 1832), aún con los sucesos de La Granja muy latentes, Donoso divide a los españoles en sólo dos partidos, los ya mencionados de la "legitimidad" y de la "usurpación". Esta clasificación está distorsionada ante la necesidad de evitar discrepancias y lograr así la unidad del liberalismo frente a la amenaza carlista. El mismo Donoso, unos años más tarde, al referirse en su Historia de la Regencia de María Cristina (1843) a la configuración política ante el golpe de La Granja, ya sin presiones contingentes o al menos no con las mismas, divide, como ya hemos visto, el espectro político español en tres: liberales, carlistas y monárquicos. Expresa aquí Donoso no sólo el problema del liberalismo español decimonónico, su creciente división interna a medida que se extingue el fenómeno carlista, sino también la estrecha relación del sector que él integra con la institución monárquica [38] a la que, teóricamente, defiende tanto del liberalismo progresista como del carlismo. Volviendo a su interesada clasificación inicial, su Memoria sobre la Monarquía responde a la necesidad de justificar el golpe de 1832 y el restablecimiento de la pragmática sanción que permite la sucesión femenina; quizás, como ha señalado Carlos Valverde, "para evitar que el vacilante y receloso rey diese otra vez un paso atrás y se retractase de lo hecho y para presentar como magnífica, patriótica y leal la actuación de los liberales" [39] . Esta memoria fue presentada a María Cristina, quien se la dió a conocer al rey, y luego publicada por orden real. De este escrito podemos recoger algunas impresiones con respecto al modelo de monarquía que comienza a sugerir Donoso Cortés. Destaca su insistencia en que el Gobierno requiere unidad en la cima del poder; una unidad que conciba un sistema, que sostenga un principio. Precisamente, en su opinión de lo que carece el partido de la legitimidad, entiéndase todo el liberalismo, es de organización, es decir, de unidad y de sistema. Por ello sugiere al monarca que se rodee de "personas fieles y decididas", unidas entre sí "por los mismos principios" [40] . Está pensando en el grupo que encabezó el golpe, en el sector monárquico del liberalismo, que más tarde se llamará moderado. Son ellos quienes ya han demostrado su decisión, en los mismos sucesos de La Granja, y su unidad debe estar en torno a una idea, a un principio que, precisamente, comienzan a formular. La unidad se requiere para conservar y controlar la espiral revolucionaria: "unamos para conservar; las sociedades no existen si se relajan los vínculos sociales" [41] . La unión que está en la mente de Donoso no es la del liberalismo exaltado o progresista, que tiene como norte la Francia revolucionaria, sino la de los monárquicos. En su lógica, los primeros disuelven, son los segundos los que conservan. La monarquía es entonces la institución política más útil, indispensable, para llevar a cabo esta labor de conservación. Ahora bien, esta monarquía no debe apoyarse en "las últimas clases" de la sociedad, ya que ello la conduciría al "despotismo oriental", que es como ha calificado al carlismo, o al"abismo de una democracia borrascosa" [42] , donde reconoce ya el destino del liberalismo revolucionario. Donoso esta afirmando que una monarquía que pretende sostenerse únicamente en el pueblo conduce, de forma inexorable, al absolutismo o a la anarquía. Es lo que años mas tarde redondeará, como veremos en su momento, en el concepto de omnipotencia social . La monarquía, entonces, debe fortalecer las clases intermedias, y buscar en ellas el necesario apoyo que requiere para su funcionamiento [43] . Como vemos, es el propio Donoso quien se encarga de buscar las ideas en torno a las cuales debe cimentarse el nuevo régimen. Aquí ya esta sugerido el gobierno de las clases intermedias que, poco más tarde, al establecer el principio de la soberanía de la inteligencia, llamará de las aristocracias legítimas . Otra de sus ideas, que en este caso reitera en la Memoria sobre la Monarquía, ya que la viene afirmando desde su Exposición a Fernando VII en favor de Carrasco, es la que establece que la fuerza del monarca deriva de su capacidad de representar todos los intereses de la sociedad [44] . Esta consideración fue una constante en la trayectoria de su pensamiento y fundamento de su posterior crítica a la división del poder. En este momento, sin embargo, este principio se muestra contradictorio con la concepción de una monarquía de clase, como es aquélla a la cual le basta el apoyo específico de las llamadas clases intermedias, a no ser que éstas representen por sí solas, en este momento del ideario donosiano, los intereses de toda la sociedad. Si así fuera, estamos frente a la pretensión de utilizar la monarquía, aceptada por entonces en todos los sectores sociales, para la puesta en práctica del sistema de uno sólo de ellos, el de las clases intermedias. Creado el sistema y dada la unidad en la cima del poder, Donoso nos hace pasar a la siguiente fase política, a saber,"crear la legalidad y el entusiasmo" [45] . Con ello, primeramente y sin querer, parece reconocer que el régimen que emana del golpe de La Granja carecía hasta entonces de estos atributos, porque de otro modo no sería necesario el llamar a crearlos. Para llevar a cabo esta nueva etapa, nuestro autor recurre a las Cortes. Esta institución es la que "representando la voz de la nación" establece las leyes fundamentales de la monarquía. Ella reviste a la ley "de un carácter sagrado, les da aquella perpetuidad solemne, les imprime la sabiduría de los siglos" [46] . No obstante, sabe bien Donoso que, en la práctica, y a consecuencia del sufragio censitario, a los intereses de las clases intermedias no les faltarán defensores en las Cortes. El modelo de la monarquía francesa de julio tuvo que estar presente en los sucesos de La Granja y en el proyecto que de ellos emerge. La necesidad de apoyar a la monarquía, como única institución capaz de detener la disolución revolucionaria, en la clase que emerge preponderante y conformar el poder político en torno a las clases intermedias, que consideraron por principio conservadoras, es la vía que escogen para establecer una monarquía que se haga con los beneficios de la revolución, que impida la posibilidad del retorno al absolutismo, como así mismo, que no permita el exceso revolucionario. Donoso pronto percibe que para todo ello finalmente se requiere de un principio político, una nueva concepción de la soberanía. Si los revolucionarios rinden pleitesía a la soberanía popular y la soberanía de derecho divino se entiende superada, necesitan los liberales conservadores establecer una tercera vía de soberanía. Hasta el momento se limita nuestro autor a criticar las dos primeras vías, más adelante recogerá la soberanía de la inteligencia, precisamente, como veremos, de los teóricos franceses de la monarquía de julio. Si han necesitado de la monarquía para reformar la sociedad desde arriba, no pueden afirmar su poder en la soberanía popular. Donoso al menos parece muy consciente de esto; pertenece a la generación post-revolucionaria y, como hemos visto, sus instintos son desde un comienzo conservadores. El conocido manifiesto a nombre de María Cristina, que es en realidad de Cea Bermúdez como primera cabeza del ministerio desde el golpe de La Granja, está fechado el 4 de octubre de 1833, días después de morir Fernando VII. Su texto está en buena parte circunscrito a la contingencia de una posible guerra civil, y demuestra este ánimo conservador que no pretende alterar nada sustancial en materia de soberanía real: "Yo mantendré religiosamente la forma y las leyes fundamentales de la Monarquía, sin admitir innovaciones peligrosas... la mejor forma de gobierno para el país es aquella a que está acostumbrado". No obstante, la actitud contraria de Cea a una reunión de Cortes propicia su salida en febrero de 1834. La intervención de los embajadores en torno a María Cristina, en especial el francés y el británico, manifiestan la tendencia a convertirse en no desestimables centros de presión en torno a la Regente y permanecerán como tales largamente durante los inicios del régimen liberal. El inmovilismo político de Cea fue aparente, ya que, junto a las declaraciones citadas, decreta una amplia amnistía y demuestra un afán de profundas reformas administrativas. La amnistía aparece como medida reconciliadora de la Corona ante los antiguos liberales, tan fustigados por Fernando VII luego del trienio, en pro de limar asperezas y fortificar la tan conveniente unidad del bando cristino. Donoso, respecto a esta medida, se refiere luego de unos años, señalando que "vino a abrir las puertas de España a las revoluciones" [47] , y ello porque, al regreso de los exiliados, el partido liberal (entiéndase progresista) tuvo por suya la victoria, ante un partido monárquico que se vió perdido con la llegada para la otra facción de los "capitanes ausentes" . Aún más, Donoso achaca al decreto de amnistía el afianzamiento del carlismo y con ello la prolongación de la guerra, al confirmar la tesis de éste acerca del carácter revolucionario de sus adversarios. No eran, a juicio de Donoso, los tiempos, "revueltos y banderizos" [48] , los oportunos para una amnistía general. Si bien estas consideraciones las realizó en 1843, es decir, diez años después de haberse tomado tal medida, su ininterrumpida denuncia del liberalismo progresista nos llevaría a pensar que en su momento, no debió verla tampoco con buenos ojos [49] . No obstante, sí podemos incluir a Donoso, al menos en parte, junto a aquéllos que propiciaron reformas en la administración. Para Cea éstas constituyeron el norte de su actuación; bien supo recoger el espíritu práctico de los ex-afrancesados, como el de su ministro Javier de Burgos, artífice de la división provincial de España. No se manifiesta el extremeño - mayormente aún- sobre estas materias, aunque sí asoma su interés por un sistema "sabio de administración" [50] . Su ideario aparece coincidente con los principales objetivos de las reformas. Por un lado, la consolidación del poder central del Estado, que en definitiva debía fortificar la autoridad real, amenazada por los excesos de la revolución. Por otro, las medidas destinadas a favorecer el movimiento de la riqueza, es decir a propiciar el desarrollo de la burguesía, de las clases intermedias que, como hemos visto, ha propuesto como principal sustento social del nuevo régimen, y en especial del trono. Recapitulando, durante estos años busca Donoso Cortés un principio que organice el nuevo régimen, en el cual colaboró desde su origen. Aunque todavía no lo encuentra, esboza ya la que será su teoría de las aristocracias legítimas e insiste en la necesidad de propiciar un sistema monárquico en torno a una idea nueva, es decir, que supere a las conocidas fórmulas de soberanía. La herencia de su formación ilustrada conforma sólo en parte su pensamiento en estos inicios, ya que demuestra una tendencia, luego interrumpida durante su paréntesis doctrinario, a no limitarse en un racionalismo meramente abstracto, sino a valorar lo que él llama la entraña de los pueblos: sus costumbres, su religión, el respeto a las jerarquías sociales. El ambiente romántico y su marcado espíritu conservador se sobreponen, en muchos casos, a su educación liberal ilustrada y tienen, p>or consiguiente, un peso considerable en la formación de su pensamiento. Gonzalo Larios
|





 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg