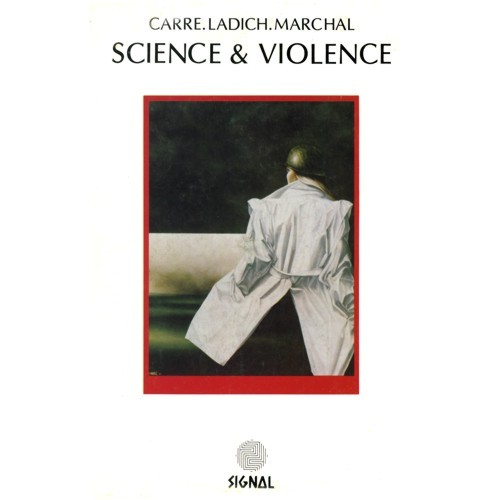 È il mese di gennaio del 1970 e i volantini e ciclostilati del GUD, in cui appare il “topo maledetto”, poi circondato da altri personaggi (belle ragazze e squallidi barbuti falsi rivoluzionari), hanno subito un grande successo fra gli studenti. Negli anni successivi Marchal e alcuni dei suoi amici entrano in contatto con l'area giovanile del Msi che fa riferimento a Pino Rauti, in particolare con il dirigente giovanile Marco Tarchi. Dall'esperienza francese di Alternative e dall'entusiasmo di decine di giovani irrequieti e stufi del sonnolento ambiente missino, nel '74 prende il via l'esperimento de La voce della fogna, “giornale differente”, come recitava lo slogan sotto la testata. Un periodico satirico, irriverente, politicamente scorretto nei confronti dello stesso ambiente di provenienza, aperto alle novità non solo politiche, ma anche di costume.
È il mese di gennaio del 1970 e i volantini e ciclostilati del GUD, in cui appare il “topo maledetto”, poi circondato da altri personaggi (belle ragazze e squallidi barbuti falsi rivoluzionari), hanno subito un grande successo fra gli studenti. Negli anni successivi Marchal e alcuni dei suoi amici entrano in contatto con l'area giovanile del Msi che fa riferimento a Pino Rauti, in particolare con il dirigente giovanile Marco Tarchi. Dall'esperienza francese di Alternative e dall'entusiasmo di decine di giovani irrequieti e stufi del sonnolento ambiente missino, nel '74 prende il via l'esperimento de La voce della fogna, “giornale differente”, come recitava lo slogan sotto la testata. Un periodico satirico, irriverente, politicamente scorretto nei confronti dello stesso ambiente di provenienza, aperto alle novità non solo politiche, ma anche di costume.vendredi, 25 mars 2011
Futurismo: Valentine de Saint-Point molto futurista, poco femminista
Futurismo: Valentine de Saint-Point molto futurista, poco femminista
Donna vera e genio puro, avanguardista e provocatrice fu autrice del “Manifesto delle Donne” e della “Lussuria”
Claudio Cabona
Ex: http://rinascita.eu/ Se non ora quando? La donna e la sua dignità, il suo ruolo sociale. La posizione da assumere all’interno e nei confronti del sistema Italia. Dibattiti su dibattiti, manifestazioni, mobilitazioni in nome di una rinascita in gonnella, appelli infuocati al popolo rosa. Costruzione di una nuova identità femminile o starnazzo di gallinelle? La donna paragonata all’uomo, divisione fra sessi al centro di battaglie e rivendicazioni che sanciscono nuove superiorità o inferiorità?
Se non ora quando? La donna e la sua dignità, il suo ruolo sociale. La posizione da assumere all’interno e nei confronti del sistema Italia. Dibattiti su dibattiti, manifestazioni, mobilitazioni in nome di una rinascita in gonnella, appelli infuocati al popolo rosa. Costruzione di una nuova identità femminile o starnazzo di gallinelle? La donna paragonata all’uomo, divisione fra sessi al centro di battaglie e rivendicazioni che sanciscono nuove superiorità o inferiorità?
“L’Umanità è mediocre. La maggioranza delle donne non è né superiore né inferiore alla maggioranza degli uomini. Sono uguali. Meritano entrambe lo stesso disprezzo. Nel suo insieme, l’umanità non è mai stata altro che il terreno di coltura donde sono scaturiti i geni e gli eroi dei due sessi. Ma vi sono nell’umanità, come nella natura, momenti più propizi a questa fioritura... E’ assurdo dividere l’umanità in donne e uomini. Essa è composta solo di femminilità e di mascolinità”.
La femminilità e la mascolinità sono due elementi che separano e caratterizzano i due sessi, ma che in quest’epoca moderna sembrano essersi in parte persi, lasciando spazio ad un indebolimento dell’individuo che è sempre più costruzione e non realtà.
“Un individuo esclusivamente virile non è che un bruto; un individuo esclusivamente femminile non è che una femmina.
Per le collettività, e per i diversi momenti della storia umana, vale ciò che vale per gli individui. Noi viviamo alla fine di uno di questi periodi. Ciò che più manca alle donne, come agli uomini, è la virilità. Ogni donna deve possedere non solo virtù femminili, ma qualità virili, senza le quali non è che una femmina. L’uomo che possiede solo la forza maschia, senza l’intuizione, è un bruto. Ma nella fase di femminilità in cui viviamo, soltanto l’eccesso contrario è salutare: è il bruto che va proposto a modello”.
Il rinnovamento? Una nuova donna non moralizzatrice, ma guerriera, scultrice del proprio futuro. Un cambiamento che passa attraverso una riscoperta del potenziale rivoluzionario della femminilità che non deve essere un artificio creato e voluto dall’uomo, ma una nuova alba. Non bisogna conservare, ma distruggere antiche concezioni.
”Basta le donne di cui i soldati devono temere le braccia come fiori intrecciati sulle ginocchia la mattina della partenza; basta con le donne-infermiere che prolungano all’infinito la debolezza e la vecchiezza, che addomesticano gli uomini per i loro piaceri personali o i loro bisogni materiali!... Basta con la donna piovra del focolare, i cui tentacoli dissanguano gli uomini e anemizzano i bambini; basta con le donne bestialmente innamorate, che svuotano il Desiderio fin della forza di rinnovarsi!. Le donne sono le Erinni, le Amazzoni; le Semiramidi, le Giovanne d’Arco, le Jeanne Hachette; le Giuditte e le Calotte Corday; le Cleopatre e le Messaline; le guerriere che combattono con più ferocia dei maschi, le amanti che incitano, le distruttrici che, spezzando i più deboli, agevolano la selezione attraverso l’orgoglio e la disperazione, la disperazione che dà al cuore tutto il suo rendimento”.
Non può e non deve esservi differenza fra la sensualità di una femmina, il suo essere provocante e la sua inclinazione a diventare madre, pura e cristallina. La demarcazione fra “donna angelo” e “donna lussuriosa” è puramente maschilista e priva di significato. Il passato e il futuro si incrociano nei due grandi ruoli che la donna ricopre all’interno della società: amante e procreatrice di vita. Figure diverse, ma al contempo tasselli di uno stesso mosaico.
“La lussuria è una forza, perché distrugge i deboli ed eccita i forti a spendere le energie, e quindi a rinnovarle. Ogni popolo eroico è sensuale. La donna è per lui la più esaltante dei trofei.
La donna deve essere o madre, o amante. Le vere madri saranno sempre amanti mediocri, e le amanti, madri inadeguate per eccesso. Uguali di fronte alla vita, questi due tipi di donna si completano. La madre che accoglie un bimbo, con il passato fabbrica il futuro; l’amante dispensa il desiderio, che trascina verso il futuro”.
Il sentimento e l’accondiscendenza non possono ergersi a valori centrali della vita. L’energia femminile non solo si manifesta come ostacolo, ma anche luce che illumina strade di conquista dell’umana voglia di esistere.
“La Donna che con le sue lacrime e con lo sfoggio dei sentimenti trattiene l’uomo ai suoi piedi è inferiore alla ragazza che, per vantarsene, spinge il suo uomo a mantenere, pistola in pugno, il suo arrogante dominio sui bassifondi della città; quest’ultima, per lo meno, coltiva un’energia che potrà anche servire a cause migliori”.
Queste parole, non moraliste né tanto meno prettamente femministe, non furono di una persona qualsiasi. Appartennero ad una donna sì, ma unica, che rigettò tutte le definizioni, stracciando etichette e pregiudizi. Il suo verbo, ancora oggi, nonostante la sua visione del mondo sia stata coniata nel 1912, è ancora attuale e può insegnare molto a chi si pone domande sul “mondo rosa” e non solo. Avanguardista, provocatrice e futurista. Lei fu Valentine de Saint-Point (1875-1953), autrice del “Manifesto delle Donne” e della “Lussuria”. Contribuì, come poche intellettuali nella storia, all’emancipazione della donna sia dal punto di vista dei diritti che del pensiero, partecipando anche a vari movimenti di rivendicazione. Odiava le masse, le certezze, i dettami borghesi, amava la libertà di pensiero, l’essere femmina, l’essere futuro. Concludo con l’ultima parte del manifesto, momento più alto della poetica di una delle grandi donne del ‘900. La speranza è che femmine come Valentine esistano ancora oggi, perchè l’Italia ha bisogno di loro, di voi.
”Donne, troppo a lungo sviate dai moralismi e dai pregiudizi, ritornate al vostro sublime istinto, alla violenza, alla crudeltà.
Per la fatale decima del sangue, mentre gli uomini si battono nelle guerre e nelle lotte, fate figli, e di essi, in eroico sacrificio, date al Destino la parte che gli spetta. Non allevateli per voi, cioè per sminuirli, ma nella più vasta libertà, perché il loro rigoglio sia completo.
Invece di ridurre l’uomo alla schiavitù degli squallidi bisogni sentimentali, spingete i vostri figli e i vostri uomini a superare sé stessi. Voi li avete fatti. Voi potete tutto su di loro.
All’umanità dovete degli eroi. Dateglieli”.
08 Marzo 2011 12:00:00 - http://rinascita.eu/index.php?action=news&id=6928
00:05 Publié dans art, Histoire, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : futurisme, avant-gardes, valentine de saint-point, littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, art, féminisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 20 mars 2011
Jack Marchal, ribelle senza confini

Articolo di Silvio Botto
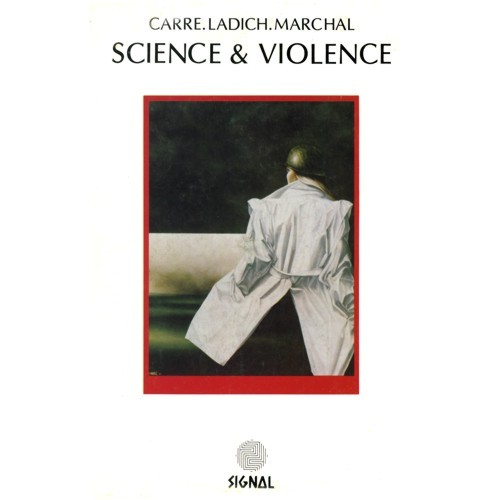 È il mese di gennaio del 1970 e i volantini e ciclostilati del GUD, in cui appare il “topo maledetto”, poi circondato da altri personaggi (belle ragazze e squallidi barbuti falsi rivoluzionari), hanno subito un grande successo fra gli studenti. Negli anni successivi Marchal e alcuni dei suoi amici entrano in contatto con l'area giovanile del Msi che fa riferimento a Pino Rauti, in particolare con il dirigente giovanile Marco Tarchi. Dall'esperienza francese di Alternative e dall'entusiasmo di decine di giovani irrequieti e stufi del sonnolento ambiente missino, nel '74 prende il via l'esperimento de La voce della fogna, “giornale differente”, come recitava lo slogan sotto la testata. Un periodico satirico, irriverente, politicamente scorretto nei confronti dello stesso ambiente di provenienza, aperto alle novità non solo politiche, ma anche di costume.
È il mese di gennaio del 1970 e i volantini e ciclostilati del GUD, in cui appare il “topo maledetto”, poi circondato da altri personaggi (belle ragazze e squallidi barbuti falsi rivoluzionari), hanno subito un grande successo fra gli studenti. Negli anni successivi Marchal e alcuni dei suoi amici entrano in contatto con l'area giovanile del Msi che fa riferimento a Pino Rauti, in particolare con il dirigente giovanile Marco Tarchi. Dall'esperienza francese di Alternative e dall'entusiasmo di decine di giovani irrequieti e stufi del sonnolento ambiente missino, nel '74 prende il via l'esperimento de La voce della fogna, “giornale differente”, come recitava lo slogan sotto la testata. Un periodico satirico, irriverente, politicamente scorretto nei confronti dello stesso ambiente di provenienza, aperto alle novità non solo politiche, ma anche di costume.
00:15 Publié dans art, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art, histoire, extrême droite, nationalisme, france, musique, musique alternative, rébellion, contestation |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 19 mars 2011
Une exposition et un artiste qui sentent le soufre...
Une exposition et un artiste qui sentent le soufre...
Par Pierre Vial
 Au Petit-Palais est organisée, jusqu’au 5 juin, une exposition consacrée à Jean-Louis Forain. Cet artiste, qui vécut de 1852 à 1931, est connu des amateurs pour ses dessins parus dans Le Figaro, Le Courrier français, L’Echo de Paris, Le Gaulois mais aussi le New York Herald. Mais il a fait plus et mieux. Forain a en effet été au cœur de l’impressionnisme : à partir de 1879 il est invité par Degas à participer aux expositions du groupe impressionniste. Ami, aussi, de Manet, de Toulouse-Lautrec, de Picasso, il a partagé, jeune homme désargenté, une misérable chambre de bonne avec un certain Arthur Rimbaud. Fondamentalement hostile au monde bourgeois, Forain, ami de Verlaine, dessine et met en couleurs, à la gouache et à l’aquarelle, des scènes de la vie parisienne qui illustrent les turpitudes de vieux messieurs bien comme il faut achetant les charmes de malheureuses gamines condamnées au trottoir ou au bordel. Forain tape fort et juste, avec un don d’observation qui frappe l’œil du spectateur le moins averti.
Au Petit-Palais est organisée, jusqu’au 5 juin, une exposition consacrée à Jean-Louis Forain. Cet artiste, qui vécut de 1852 à 1931, est connu des amateurs pour ses dessins parus dans Le Figaro, Le Courrier français, L’Echo de Paris, Le Gaulois mais aussi le New York Herald. Mais il a fait plus et mieux. Forain a en effet été au cœur de l’impressionnisme : à partir de 1879 il est invité par Degas à participer aux expositions du groupe impressionniste. Ami, aussi, de Manet, de Toulouse-Lautrec, de Picasso, il a partagé, jeune homme désargenté, une misérable chambre de bonne avec un certain Arthur Rimbaud. Fondamentalement hostile au monde bourgeois, Forain, ami de Verlaine, dessine et met en couleurs, à la gouache et à l’aquarelle, des scènes de la vie parisienne qui illustrent les turpitudes de vieux messieurs bien comme il faut achetant les charmes de malheureuses gamines condamnées au trottoir ou au bordel. Forain tape fort et juste, avec un don d’observation qui frappe l’œil du spectateur le moins averti.
Forain, donc, un grand artiste largement méconnu. Mais aussi un personnage hautement sulfureux. Tout au moins si on en croit Le Monde (13-14 mars 2011) qui, avec l’intense jouissance du délateur professionnel qu’il est, révèle à ses lecteurs l’abomination de la désolation : Forain était antisémite ! Non ? Si ! D’où une censure qui l’a frappée d’interdit, comme l’avoue ingénument Le Monde : « Si Jean-Louis Forain a été peu montré, la raison en est simple : au plus fort de l’affaire Dreyfus, il crée, avec le dessinateur Caran d’Ache, Psst… !, une revue antidreyfusarde. Il y publie des caricatures atroces des juges ou d’Emile Zola. Plusieurs sont antisémites ». Et, benoîtement, Le Monde commente : « Forain a été un artiste d’avant-garde aux innovations passionnantes. Il a aussi été antisémite. Le mérite ne saurait faire oublier le crime, pas même l’excuser ». « Le crime » ? Mais oui, vous avez bien lu, « le crime »…
Mais, alors, la liste des « criminels » est intéressante. C’est Degas qui, au sujet du « dessin insupportable » (dit Le Monde…) intitulé Cassation, écrit à Forain : « Forain, mon noble ami, que votre dessin est beau ! ». C’est aussi Auguste Renoir, Auguste Rodin, Paul Cézanne, Paul Valéry… tous antidreyfusards, tous antisémites. Ne serait-il pas urgent, du coup, de les sortir du dictionnaire ? Et puis de brûler leurs œuvres en place publique ? Par souci de moralité, bien entendu.
Exposition Forain cliquez ici
00:20 Publié dans Actualité, art, Evénement | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art, événement, paris |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 08 mars 2011
Het geheim der Perseïden
Het geheim der Perseïden
 In het slotartikel van ‘Het cultureel leven tijdens de bezetting’ (Diogenes, nr. 1-2, nov. ’90, blz. 57), schreef onze vriend Henri-Floris Jespers dat ik in het interview van de Heer Van de Vijvere te voorschijn gekomen was als een ‘ijverige en openlijke ultra’ (sic!). Niets is minder waar. Ik een ‘ultra’? Ik wens dit hier, zo mogelijk, te weerleggen. Eerst en vooral: in een passage van zijn artikel onderstreept H.F. Jespers dat werken van zijn grootvader Floris Jespers door de Brusselse Propaganda-Abteilung, niettegenstaande haar mild standpunt tegenover de zogenaamde Belgische ‘entartete Kunst’ gecensureerd werden. En hij citeert: ‘Joods meisje’ en ‘Joodse Bruiloft’. Dergelijke titels zijn, helaas, te beschouwen als naïeve provocatie! Hadden beide werken als titel meegekregen ‘Antwerps meisje’ en ‘Antwerpse bruiloft’, zou de Propaganda-Abteilung er voorzeker geen graten in gezien hebben… Laten we niet vergeten dat nazi-idioten onze grote Rembrandt als ‘entartet’ beschouwden omdat hij o.m. ‘Het Joods bruidje’ geschilderd heeft, alsmede portretten van rabbijnen die in de buurt van zijn Jodenbreestraat rondliepen in schilderachtige Oosterse gewaden… De heren van de Brusselse Propaganda-Abteilung, het dient gezegd te worden, interesseerden zich meer voor ‘wijntje en Trijntje’ dan aan censuur! Anderzijds heeft grootvader Jespers toch in Nazi-Duitsland tentoongesteld met de meeste Vlaamse expressionisten. Dit echter met eerder brave werken die de naam hadden te behoren tot een nieuwe strekking in de Belgische kunst, namelijk het ‘animisme’. Onder het mom van ‘Heimatkunst’ heeft Floris Jespers gedurende de bezettingsjaren Ardense landschappen geschilderd waar ik onlangs nog een prachtig staaltje van gezien heb in het Osterriethhuis, aan de Meir, te Antwerpen. Zelfs een Magritte heeft zich aan de nazi-bezetter trachten aan te passen met zijn ‘surrealisme en plein soleil’, dat Andre Breton achteraf als ‘surrealisme cousu de fil blanc’ bestempeld heeft, terwijl ikzelf gedurende die bezetting als echte surrealist, als ‘Entart’ verketterd werd!
In het slotartikel van ‘Het cultureel leven tijdens de bezetting’ (Diogenes, nr. 1-2, nov. ’90, blz. 57), schreef onze vriend Henri-Floris Jespers dat ik in het interview van de Heer Van de Vijvere te voorschijn gekomen was als een ‘ijverige en openlijke ultra’ (sic!). Niets is minder waar. Ik een ‘ultra’? Ik wens dit hier, zo mogelijk, te weerleggen. Eerst en vooral: in een passage van zijn artikel onderstreept H.F. Jespers dat werken van zijn grootvader Floris Jespers door de Brusselse Propaganda-Abteilung, niettegenstaande haar mild standpunt tegenover de zogenaamde Belgische ‘entartete Kunst’ gecensureerd werden. En hij citeert: ‘Joods meisje’ en ‘Joodse Bruiloft’. Dergelijke titels zijn, helaas, te beschouwen als naïeve provocatie! Hadden beide werken als titel meegekregen ‘Antwerps meisje’ en ‘Antwerpse bruiloft’, zou de Propaganda-Abteilung er voorzeker geen graten in gezien hebben… Laten we niet vergeten dat nazi-idioten onze grote Rembrandt als ‘entartet’ beschouwden omdat hij o.m. ‘Het Joods bruidje’ geschilderd heeft, alsmede portretten van rabbijnen die in de buurt van zijn Jodenbreestraat rondliepen in schilderachtige Oosterse gewaden… De heren van de Brusselse Propaganda-Abteilung, het dient gezegd te worden, interesseerden zich meer voor ‘wijntje en Trijntje’ dan aan censuur! Anderzijds heeft grootvader Jespers toch in Nazi-Duitsland tentoongesteld met de meeste Vlaamse expressionisten. Dit echter met eerder brave werken die de naam hadden te behoren tot een nieuwe strekking in de Belgische kunst, namelijk het ‘animisme’. Onder het mom van ‘Heimatkunst’ heeft Floris Jespers gedurende de bezettingsjaren Ardense landschappen geschilderd waar ik onlangs nog een prachtig staaltje van gezien heb in het Osterriethhuis, aan de Meir, te Antwerpen. Zelfs een Magritte heeft zich aan de nazi-bezetter trachten aan te passen met zijn ‘surrealisme en plein soleil’, dat Andre Breton achteraf als ‘surrealisme cousu de fil blanc’ bestempeld heeft, terwijl ikzelf gedurende die bezetting als echte surrealist, als ‘Entart’ verketterd werd!
***
Doch, laten we overgaan naar ‘het geheim der Perseïden’! Perseiden? Een geheim genootschap of eerder een vriendenkring van schrijvers, musici en vooral kunsthistorici die zich als ‘Groot-Nederlanders’ of ‘Dietsers’ aanstelden, en de roem van de ‘Groot-Nederlandse cultuur’ verdedigden en wensten te verspreiden, zelfs onder nazi-bezetting, die ‘Groot-Nederland’ als een onverdedigbare en voorbijgestreefde utopie beschouwde. Laat ons niet vergeten dat er tussen Vlaanderen en Nederland teen een haast onoverschrijdbare ‘Chinese muur!’ bestond, een echte ‘muur van de schande’, en toch werd die muur overschreden, namelijk door uw dienaar, de zogezegde ‘ultra’ Marc. Eemans. Maar van waar die Perseïdenaam? Laat ons gerust opklimmen tot de 16de en de 17de eeuw, toen de kloof tussen Noord en Zuid in de Nederlanden ontstaan is. Toen is er een wellicht eveneens geheim genootschap gesticht, dat naar rederijkersgewoonten een naam meekreeg ontleend aan de klassieke Oudheid, en de keuze viel op de held Perseus die Andromeda gered heeft. In rederijkerstaal was de arme, gekluisterde Andromeda het symbool van de verscheurde Nederlanden… Een van de topfiguren van dit geheim genootschap moet Petrus-Paulus Rubens geweest zijn, de hofschilder der aartshertogen Albert en Isabella, doch tevens een halfbroer van een prinses van Nassau, geboren uit overspel van de vader van Rubens met prinses Anna van Saksen, echtgenote van Willem de Zwijger.
Hier komt nu de spilfiguur van Dr Juliane Gabriëls op de voorgrond van de moderne ‘Perseiden’. Vriendin Juliane, een thans helaas haast vergeten topfiguur uit het Vlaamse cultureel leven in de eerste helft van onze eeuw, werd te Gent geboren in een francofone orangistische familie . Ze studeerde geneeskunde aan de Vrije Universiteit Brussel en werd de eerste vrouwelijke neuroloog dezer instelling, dit circa 1910, zo ik me niet vergis. Gedurende de Eerste Wereldoorlog werd ze docent aan de toen vervlaamste Universiteit van Gent, en werd ze in 1918, als zoveel andere ‘aktivisten’, vervolgd door het Belgische gerecht.
In de diaspora der vervolgde flaminganten belandde ze te Berlijn, waar ze o.m. bevriend werd met de eveneens uitgeweken jonge dichter Paul van Ostaijen en, zo men haar mag geloven, ontmoette ze hem geregeld in de lift van een groot Berlijns hotel, die hij bediende in een rood uniformpje in de trant van ‘le chasseur de chez ‘Maxim”…
Te Berlijn trad Juliane Gabriëls in de echt met de Duitse kunsthistoricus Dr Martin Konrad, de medewerker, onder de leiding van Dr Paul Clemens, van het verzamelwerk ‘Belgische Kunstdenkmäler. (Verlag F. Bruckmann A.G., München, 1923). Het werd voor Juliane Gabriels het begin van haar tweede roeping. Ze promoveerde toen te Berlijn tot doctor in de kunstgeschiedenis met een studie over ‘Artus Quellien, de Oude, Kunstryck Belthouwer’ (Uitg. ‘De Sikkel’, Antwerpen, 1930), met de beroemde Duitse kunsthistoricus A.E. Brinckmann als promotor.
Juliane Gabriëls vertoefde echter niet lang te Berlijn en ging zich te Blaricum, aan de Zuiderzee vestigen, waar ze de geboorte van het Vlaamse expressionisme meemaakte, met haar vrienden Gust en Gusta de Smet, Fritz van den Berghe, Jozef Canrre en het koppel Lucien Brulez-Mavromati, zonder de dichter Rene De Clercq te vergeten. Een herinnering aan dit ballingschapsoord is het ‘Portret van mevrouw G.’, geschilderd door Fritz van den Berghe.
Terug in het vaderland, vestigde Juliane Gabriëls zich te Antwerpen, in de Osijstraat, waar ze een dokterscabinet opende en een salon hield waar talloze Vlaamse en Noord-Nederlandse prominenten graag geziene gasten werden.
In dit salon is een haard van Vlaams culturele initiatieven ontstaan. Laat ons hier slechts vermelden: ‘Geschiedenis van de Vlaamsche kunst’ onder leiding van Prof. Dr Ir Stan Leurs (uitgeverij De Sikkel, Antwerpen, z.d.); stichting van de ‘Vlaamse Toeristenbond’, onder voorzitterschap van dezelfde Prof. Dr Ir Stan Leurs; stichting van een Vlaamse Akademie van de zeevaart; stichting van het ‘Busleyden-instituut’, onder voorzitterschap van de Noord-Nederlandse Prof. Dr G.J. Hoogewerff, voor de studie van de Groot –Nederlandse kunstgeschiedenis, enz.
Ik heb Juliane Gabriëls slechts twee dagen voor de inval van de Duitse legers in Belgie leren kennen. Bij een luchtaanval op Antwerpen, in mei 1940, werd haar huis in de Osijstraat door een bom getroffen en is ze een onderkomen te Brussel komen zoeken, hetgeen de aanleiding werd voor een meer uitgebreide kennismaking en de ontdekking van dezelfde interesse voor de Groot-Nederlandse idealen zowel op het gebied van de kunst als op dat van de Dietse belangen, zowel cultureel als politiek.
Groot was onze hoop toen we vernamen dat het gebied waarover de Duitse ‘Militärverwaltung’ zich uitstrekte tot aan de Somme reikte, dit is tot aan de zuidelijke grens van de aloude XVII Provincies; doch even groot werd onze teleurstelling toen we moesten vaststellen dat Noord-Nederland onder een ‘Zivilverwaltung’ viel en van Zuid-Nederland door een echte Chinese muur gescheiden werd. Onze sympathie voor de ‘Mythos van de XXe eeuw’ ten spijt, bracht dit ons, Juliane Gabriëls en mezelf, en onze gelijkgeoriënteerde vrienden, tot een eerder terughoudende gezindheid tegenover de bezetter. Dit belette echter niet, voor de meeste onder ons, een kollaboratie met voorbehoud.
Ikzelf, werkloos geworden door de oorlogsomstandigheden, ben aldus om den brode een vrije medewerker geworden aan allerlei zowel franstalige als nederlandstalige bladen en tijdschriften behorende tot de verscheidene strekkingen van de kollaboratie, dit echter op uitsluitend cultureel vlak, want politiek was me uit den boze… De Realpolitik van de bezetter was eerder dubbelzinnig en onaanvaardbaar wat ons Diets ideaal betrof. Ik heb trouwens eens gezegd aan Dr Jef van de Wiele, de leider van de Devlag en auteur van het boek ‘Op zoek naar een vaderland’, dat hij niet een lands-, maar een volksverrader was…
Zonder aan ‘weerstand’ te denken, hebben Juliane Gabriëls en onze Dietsgezinde vriende aan ‘weerstand’ gedaan onder het motto ‘onverfranst, onverduitst’. Maar hoe? Op allerlei wijzen, middels contacten met nietnazi-gezinde Duitse vrienden waaronder, o .m. de Brusselse leden van de Propaganda-Abteilung. Vandaar de milde houding van deze heren wat betreft de toepassing in Vlaanderen van de ‘entartete Kunstpolitik’ .
Ons Groot-Nederlands ideaal was anderzijds, hoe paradoksaal het ook moge klinken, gediend door een door ‘Ahnenerbe’, het wetenschappelijk organisme van de SS, gestichte uitgeverij geheten ‘De Burcht’. De zetel van deze uitgeverij werd aldus het ontmoetingscentrum van de ‘Perseïden’ en de haard van talrijke Groot-Nederlandse uitgaven, o.m. het maandblad ‘Hamer’ en het tijdschrift ‘Groot-Nederland’, waar zowel Noord-Nederlandse als Zuid-Nederlandse schrijvers regelmatig aan meegewerkt hebben.
Er waren verder nog andere mogelijkheden door andere uitgeverijen geboden. Zo is het dat bij De Sikkel een boek van Juliane Gabriëls en Adriaan Mertens in 1941 verschenen is, gewijd aan ‘De constanten in de Vlaamse kunst’, en van mezelf, bij de uitgever Juliaan Bernaerts (hij was eveneens de directeur van ‘De Burcht’) een kleine monografie over ‘De Vroeg-Nederlandse schilderkunst’ (Kleine Beer-reeks nr. 10 van de uitgeverij ‘De Phalanx’). Onze thans té vergeten vriend Urbain Van de Voorde publiceerde anderzijds bij een uitgeverij van het VNV een uitstekend overzicht van de schilderkunst der Nederlanden, dat vooral de nadruk legde op de eenheid van de zogeziene of zogenaamde ‘Vlaamse’ en ‘Hollandse’ schilderkunst, niettegenstaande de politieke verscheurdheid van ons gemeenschappelijk vaderland. Van dit boek bestaat een tot hiertoe onuitgegeven Franse vertaling. Anderzijds heb ik toen een uitvoerig, nog steeds onuitgegeven, essay in het Frans gewijd aan de Nederlandse poëzie (Noord en Zuid), vanaf de Middeleeuwen tot het midden van onze eeuw. Het draagt voor de ‘Perseïden’ de veel betekenende poëtische titel ‘Andromède révélée’.
Van een Duitse kunsthistoricus, de in Amsterdam vertoevende Friedrich-Markus Huebner, vertaalde ik verder een boek gewijd aan Jeroen Bosch dat na de oorlog, dank zij mij, nog een Franse vertaling kende onder de titel ‘Le mystere Jerome Bosch’ (uitgeverij Meddens, Brussel). Laat me er nog aan toevoegen dat ik eveneens de auteur ben (onder een deknaam!) van een boek gewijd aan ‘De Vlaamse Krijgsbouwkunde’ (Frans Vlaanderen inbegrepen), gedeeltelijk geschreven gedurende de Duitse bezetting (Drukkerij-Uitgeverij Lannoo, Tielt, 1950).
Met de bedoeling de nadruk te leggen op de voorrang van de Nederlandse op de Italiaanse kunst, gaf Juliane Gabriëls een lezing in het ‘Italiaans Instituut’ van de Livornostraat te Brussel, waarin ze betoogde dat de Renaissance niet in ltalië, doch in de Nederlanden was ontstaan met een Claus Sluter en een Jan van Eyck als boegbeelden. Na de lezing had een kleine ontvangst in de ‘dopo lavoro’ van het Instituut plaats. Bij het drinken van een uitstekende ‘chianti’ (toen een rariteit), werd een woordje gezegd ter ere van de Duce en van de leider Staf De Clercq, waarop een toevallig aanwezige Duitse SS-man, Unterscharführer Heinz Wilke, eveneens een woordje ter ere van zijn Führer wenste te zeggen. Het woord werd hem echter geweigerd omdat het voor ons uitsluitend ging om een Italiaans-Vlaamse verbroederingsavond. Heinz Wilke liep woedend weg en diende tegen ons een klacht in bij de S.D. met diplomatieke verwikkelingen tussen Brussel, Berlijn en Rome. Gelukkig genoeg voor ons, kwam de topfiguur van de SS in Belgie ons ter hulp en bleef de klacht bij de S.D. ten slotte zonder gevolg, zoniet waren Juliane Gabriëls en haar vrienden in een Duits concentratiekamp beland… Achteraf, na de val van de Duce, bleek de directeur van het ‘Italiaans Instituut’ te Brussel een Italiaanse verzetsman te zijn…
Een ander, eerder onschuldig exploot van de ‘Perseïden’ ten gunste van de Nederlandse kunstgeschiedenis, was de officiële ontvangst door het ‘Busleydeninstituut’, op het Mechelse stadhuis, van Prof. Dr Hans Gerard Evers ter gelegenheid van het verschijnen van zijn boek gewijd aan Peter Paul Rubens (Verlag F. Bruckmann, München, 1942). Het werd een heuglijke gebeurtenis met een ‘congratulatio’ van Juliane Gabriels, een dankwoord van Prof. Evers en de overhandiging van een erediploma aan de Duitse kunstgeleerde, dit in aanwezigheid van leden van het ‘Deutsches Institut’ te Brussel, waaronder weinig of geen Nazi-Iui, doch mooie jonge vrouwen, want vrouwelijk schoon heeft steeds de ‘Perseïden’ gesierd…
Een ‘Perseïde’ van over de ‘schreve’ was de Frans-Vlaamse priester Gantois, een persoonlijke vriend van de niet-katholieke Juliane Gabriëls, die reeds in het begin van de bezetting onder een deknaam een studie gewijd had aan het toen aktuele onderwerp ‘tot waar strekken zich de Nederlanden in Frankrijk uit?’ Natuurlijk tot aan de Somme! Ik licht hierbij dan uit mijn bibliotheek een vijfdelig boek uit de 18e eeuw (met een ‘imprimatur’ van 24 juni 1768) dat heet ‘Les delices des Pays-Bas ou description geographique et historique des XVII. Provinces Belgiques’, met een ‘Descriptio particuliere du Duche de Brabant et du Brabant Wallon’ .
In het Nederlands luidt dit boek (op de titelplaat) ‘Het Schouwburg der Nederlanden’, want de drukker-uitgever ervan was de Antwerpenaar C.M. Spanooghe, ‘Imprimeur-Ubraire’, gevestigd ‘sur la place de la Sucrerie’ (sic!). Een merkwaardige toeristische gids avant la lettre, waarvan de ‘Denombrement’ of inhoudstafel niet enkel de XVII provincies omvat, waaronder het hertogdom Luxemburg, het graafschap Artesie, het graafschap Henegouwen, enz., doch eveneens o.m. Waals Brabant, Frans-Vlaanderen, het Kamerijkse, ja zelfs het Prinsbisdom Luik en het Akense, dus een gedeelte van het huidige Duitslandl Aldus een echt kluitje voor de kultuteie expansiegeest van de ‘Perseïden’ die anderzijds niet terugdeinsden voor een kijk op de bestendige culturele invloed van de Nederlanden tot ver in Oost-Duitsland, o.m. Dantzig en Königsberg, ja ook in Zuid-Duitsland , tot in Tyrool (Innsbrück) en ook Frankrijk en Italië.
Een mooi geschenk in die zin was een in 1937 verschenen ‘Deutsch-Niederländische Symphonie’ onder leiding van Dr R. Oszwald en met een speciale hulde aan Prof. Raf Verhulst. Op het kaft prijkt een mooie foto van het Lierse stadhuis! Hier waren eveneens ‘Perseïden’, bewust of onbewust, aan het werk geweest. Ik denk o.m. aan de gewezen echtgenoot van Juliane Gabriels, Dr Martin Konrad en ons beider persoonlijke Nederduitse vriend Franz Fromme, of eerder Franske, de olijke anti-nazi, die het vertikte gedurende de bezetting een uniform te dragen en die aan zijn hiërarchische chef ooit de vraag stelde: ‘een uniform dragen? Wilt u dan dat ik zelfmoord pleeg?’ Deze kleine anekdote moge een, tenminste voorlopig eindpunt stellen aan rnijn beknopt relaas van wat het bewust of onbewust Diets cultureel ‘verzet’ geweest is van de kleine vriendengroep der ‘geheime Perseïden’ … Maar er bestond eveneens een politiek ‘Diets Verzet’!
POSTSCRIPTUM
Bij het redigeren van het hiervoor afgedrukt ‘Geheim der Perseïden’ zijn allerlei bedenkingen en bijkomende vaststellingen en wellicht niet altijd noodzakelijke toevoegingen aan mijn betoog komen opdoemen. En in de eerste plaats dan bedenkingen en vaststellingen bij het oorlogsgeweld dat niet voor elkeen geweld betekende. Inderdaad, zo dit geweld onvervangbaar cultuurgoed vernietigde, bracht het eveneens een cultuur opbloei mee, ten minste in onze Westerse landen. Gedurende de laatste wereldoorlog zijn in Vlaanderen uitgeverijen en vooral boekhandels als paddestoelen na de regen in groot ge tal uit de grond gerezen. Men verkocht soms zelfs mooie vergulde boekbanden aan de lopende meter… En het muziek- en toneelleven dan: talloze concerten, oprichting van nieuwe muziekensembles zoals een Vlaams filharmonisch orkest te Brussel en, eveneens te Brussel, de hernieuwing van de Alhambraschouwburg als operahuis. Ik herinner me, enkele dagen voor de ‘bevrijding van Brussel’, in augustus 1944, een opvoering van ‘De Vliegende Hollander’ . Begin september was er een Amerikaanse musicalshow met mooie, halfnaakte girls in ruil gekomen…
Amerikaanse cultuur?
Maar het oorlogsgebeuren brengt eveneens allerlei ontsporingen mee, vooral bij extraverte en ambitieuze naturen, zoals bv. een atheneumleraar die zich plots ontpopte als een toekomstig gouwleider of een dichter die zich reeds een Vlaamse Goebbels waande. Ja zelfs een naïeve Cyriel Verschaeve die het slagwoord van Rene De Clercq omvormde tot een potsierlijk ‘Wij zijn Duitsers, geen Latijnen’, in de waan dat het Nazi-Duitsland de mythe van het Heilig Roomse Rijk der Duitse Natie had doen herrijzen met een Hitler als de door de profetieën aangekondigde ‘derde Frederik’…
Aan de andere zijde, de zijde van ‘de goede Belgen’, zien we hoe de hoofdconservator van een onzer grote musea zijn museum, in mei 1940, in de steek liet om naar Engeland te vluchten om dan in 1944 naar het ‘bevrijde vaderland’ terug te keren als kapitein van het Belgische leger; een eenvoudige Gentse schoolmeester ontpopte zich tot kapitein van de ‘weerstand’, om achteraf diktator van de moderne kunst in Belgie te worden, terwijl een misdadiger van gemeenrecht als grote ‘weerstander’ uit Dachau terugkeerde, twintig kilo verzwaard, en in 1945 kabinetschef van een socialistische minister werd, om achteraf een hoge functie in een ministerie te bekleden… Er dient echter gezegd dat dezelfde man, in september 1940, een ‘Jeunesse Socialiste Nationale’ (hoe vertaalt men dit in het Nederlands?) had willen opdrichten.
Een andere goede socialist en volgeling van Hendrik De Man, en toekomstige hoge functionaris van de Spaarkas, had op datzelfde ogenblik een milde ‘Socialiste Nationale’ willen stichten… Gelukkig voor hen werd het hen door de Duitse bezetter niet toegelaten!
***
Doch laat ons tot ‘Het geheim der Perseïden’ terugkomen, om dan te herinneren aan een prent van Harrewijn uit Rubens’ tijd die ons de tuingevel van het Rubenshuis aan de Wapper toont waarop duidelijk, als een uithangbord, een voorstelling van Andromeda’s verlossing door Perseus te ontwaren is. Voor Dr Juliane Gabriëls was het een duidelijke bevestiging dat Rubens wel degelijk een lid van het geheim genootschap der ‘Perseïden’ geweest was…
Een andere stelling van Juliane Gabriëls was dat Rubens niet te Siegen geboren werd, zoals thans algemeen wordt beweerd, doch wel te Antwerpen.
Tot in het midden van verleden eeuw werd nog, historisch getrouw, aangenomen dat het te Keulen en niet te Siegen was. Ik bezit het programmaboekje van de feestelijkheden die te Antwerpen plaatsvonden van 15 tot 25 augustus 1840 ter gelegenheid van de inhuldiging van het standbeeld van P.P. Rubens op de Groenplaats aldaar. In een voorafgaande korte levensbeschrijving van de kunstenaar is deze nog steeds te Keulen geboren, en in 1840 of 1841, moet Victor Hugo nog zijn geboortehuis te Keulen bezocht hebben als toeristische bezienswaardigheid (cfr. ‘Le Rhin’, 1842).
In de ‘Aanteekeningen over den grooten meester en zijne bloedverwanten’, van de Antwerpse stadsarchivaris P. Genard, verschenen in 1877, vindt men trouwens op pagina 193 het volgende: ‘Omgeven van de zorgen eener teedere moeder en van duurbare verwanten, gaf Maria Pijpelinckx te Antwerpen, waarschijnlijk in het huis harer zuster Suzanna, het licht aan eenen zoon die den voorvaderlijken naam van’ Peeter ontving en later met fierheid den titel van geboren poorter van Antwerpen droeg.’ Het is hier niet de plaats om verder in te gaan op de echte geboorteplaats van Peter-Paulus Rubens: Siegen, Keulen of Antwerpen? Ik zal er echter aan toevoegen dat men op de Meir, te Antwerpen, een pand vindt dat, in het Latijn en met een borstbeeld van de kunstenaar, beweert zijn geboortehuis aldaar te zijn, alhoewel het slechts een huis uit de 18′ eeuw moet zijn. Hetgeen in bezettingstijd voor de ‘Perseïden’ vooral telde was dat Rubens wel te Antwerpen, in Brabant, geboren werd en niet te Siegen, in Duitsland… Dr Juliane Gabriëls, waarvan ik me als geestelijke erfgenaam beschouw (ik bezit van haar onuitgegeven geschriften, waaronder een uitgebreide stamboom van de familie Rubens), was een verwoede verdedigster van de geboorte te Antwerpen van de ‘zoon van de triomf’, zoals ze P.P. Rubens heette.
***
Alvorens dit reeds al te lang postscriptum te besluiten wil ik nog wijzen op een ander stokpaardje van Dr Juliane Gabriëls en haar vriendenkring, namelijk een te herwaarderen Vlaamse, thans totaal vergeten Jeanne d’ Arc. Zo ik me niet vergis, kent men niet eens meer haar naam en bekommeren de historici zich niet om haar bestaan. Ze was nochtans de ziel en de geestelijke aanvoerster van het Vlaamse heir dat onder het bevel stond van Filips van Artevelde en dat in 1382 te Westrozebeke vers lagen werd door Filips de Stoute en de Franse koning Charles VI.
Dit mochten de ‘Perseïden’ vernemen in ‘Het Schouwburg der Nederlanden’ dat het optekende in een ‘Histoire du Moine de St. Denis, auteur contemporain, mise en François par M. le Laboureur’ . We lezen aldus: ‘les Flamands étaient conduits par une vieille Sorcière, qui les avait assurés de la victoire, pourvu qu’on lui donnât à porter la bannière de St. Georges. Il ajoute que cette femme fut tuee au commencement du combat. Il y aurait bien des reflexions à faire sur cette particularité, qui n’a pas êté assez remarquée par les Historiens modernes.’ Ik zou nog verder kunnen citeren, maar zal het hierbij houden. ‘Het Schouwburg der Nederlanden’ verscheen in 1786 en tot hiertoe heeft geen enkele ‘Historien moderne’ het achterhaald wie deze ‘Sorcière’ kon geweest zijn. Dr Juliane Gabriels, als goede Vlaamse feministe en logezuster, heeft haar vrienden ‘Perseïden’ trachten te overhalen dit op te sporen. Het is nog niet gebeurd en ik ben, helaas, geen historicus doch slechts een Groot-Nederlander, thans eveneens, alhoewel door de na-oorlogse surrealistjes verketterd, als de ‘laatste historische surrealist’ beschouwd…
Diogenes, nr. 1, mei 1992, p. 99-103.
00:05 Publié dans art, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art, tradition, peinture, belgique, belgicana, flandre, marc eemans, avant-gardes, surréalisme, surréalisme flamand, années 40, deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 07 mars 2011
Marc. Eemans en de "gnostische" schilderkunst
Henri-Floris JESPERS
Marc. Eemans en de "gnostische" schilderkunst
Ex: http://marceemans.wordpress.com/ & http://mededelingen.over-blog.com/

Le but ultime (1928)
Kort na zijn ontslag uit het Klein Kasteeltje eind 1949 publiceerde Marc. Eemans onder pseudoniem De Vlaamse krijgsbouwkunde, een boek dat hij gedeeltelijk tijdens de bezetting geschreven had. Hij gaat opnieuw aan de slag in het uitgeversvak, nl. bij uitgeverij Meddens waar hij in contact komt met Jef L. de Belder (1912-1981) die in 1949 ontslagen was uit het interneringskamp van Merksplas. De Belder was redactiesecretaris van het door Meddens uitgegeven pasgeboren maandblad De Periscoop (1950-1980), een betrekking die hij aan hoofdredacteur René F. Lissens te danken had. Jef De Belder en zijn vrouw Line Lambert (1907-2005) runden de Colibrant-uitgaven te Lier, waar Eemans' Het boek van Bloemardinne in 1954 verscheen, twee jaar later gevolgd door Hymnode.
Jan Hugo Verhaert trad in 1956 bij Meddens in dienst als verantwoordelijke voor het tijdschrift World Theatre / Théâtre dans le Monde, een blad gesubsidieerd door de Unesco. Hij werd ook ingezet om de lay-out van De Periscoop te verzorgen, “het troetelkind” van directeur Theo Meddens (1901-1966). Op verzoek van prof. Lissens werd het hoofdredacteurschap in 1955 aan de De Belder overgedragen.
In 1956 nam hij jammer genoeg ontslag en bleven alleen nog Marc. Eemans, toen lector bij Meddens, en ikzelf over. Ik verzorgde de vormgeving. Eemans moest intussen alleen alles beredderen, wat hij graag deed, daar hij (die pottenkijkers schuwde als de pest) nu de vrije hand had. De nieuwe hoofdredacteur, dr. Frans van den Bremt, had van literatuur en hedendaagse kunst weinig kaas gegeten. Hij was musicoloog, zijn grootste hobby was fotografie en hij liet Eemans graag betijen.
In De Periscoop publiceerde Eemans een aantal lezenswaardige gelegenheidsbijdragen, onder meer over Henri de Braekeleer, William Degouve de Nuncques, Fritz van den Berghe, Max Ernst en E. L. T. Mesens. Zijn eerste bijdrage, 'Bij Paul van Ostaijen in de leer' (1 november 1956), verscheen in de periode dat de dichter van het Eerste boek van Schmoll dank zij de vierdelige publicatie van zijn Verzameld werk onder redactie van Gerrit Borgers volop in de belangstelling stond. Met die bijdrage eist Eemans opnieuw avant-gardistisch verleden op en situeert zichzelf – m.i. geheel onterecht – in de Ostaijense traditie. Twee jaar tevoren had hij het moeten slikken dat zijn vriend Mesens hem het predicaat 'surrealist' ontzegd had. In 'Les apprentis magiciens au pays de la pléthore' verweet Mesens hem met zoveel woorden enige “verwardheid” (ook op politiek vlak...), wat hem gebracht heeft tot een “culte mystico-panthéiste dont l'expression est symboliste et ne peut rien avoir de commun avec la réduction des antonomies que le surréalisme s'est toujours proposé”.
Dat stond echter hun vriendschap niet in de weg.
*
Na zijn vrijlating was Eemans ook als schilder opnieuw aan de slag gegaan – La vie méhaignée (le chant d'amour) dateert van 1950. In 1957 exposeerde hij een dertigtal werken in galerie Le Soleil dans la Tête te Parijs. De bescheiden catalogus werd ingeleid door een oude relatie van de schilder, Claude Elsen, pseudoniem van Gaston Derycke (1910-1975), die voor de oorlog aan Hermès meewerkte.
Gaston Derycke had in de jaren dertig enkele plaquettes gepubliceerd. Hij was redacteur bij het Amerikaanse persagentschap United Press, redactiesecretaris van het weekblad Cassandre, opgericht door Paul Colin, en had naam en faam verworven met zijn filmkritieken in Le Rouge et le Noir en in Les Beaux-Arts. Hij werkte ook mee aan de roemruchte Cahiers du Sud (1925-1966).
In 1937 schreef hij nog met zoveel woorden de haat te delen tegen het fascisme dat de cultuur en de intelligentie bedreigt, maar bij het begin van de bezetting werd hij toch maar hoofdredacteur van Cassandre en publiceerde hij kritieken in Le Nouveau Journal. In 1944 verscheen Destin du Cinéma, meer dan een tijdsdocument. Ondertussen had hij zich ook ontpopt als misdaadauteur met Je n'ai pas tué Barney (1940) en Quatre crimes parfaits (1941), verschenen in de populaire, door Stanislas-André Steeman gedirigeerde reeks 'Le Jury'. Relevanter zijn de kritische bijdragen waarin hij theoretische bespiegelingen verwoordt over het genre zelf en scherpzinnig de redenen analyseert waarom het als minderwaardig wordt geacht, een stelling die hij terecht betwist.
Bij de bevrijding kreeg Derycke het zwaar te verduren. Hij vlucht naar Frankrijk waar hij deel gaat uitmaken van het actieve netwerk van Belgische schrijvers die in min of meerdere mate gecompromitteerd waren door de collaboratie. Als Claude Elsen zet hij zijn literaire carrière in Parijs voort. Hij schrijft een paar jaar opgemerkte filmkritieken in het extreem-rechtse tijdschrift Écrits de Paris, opgericht in 1947 door René Malliavin die in januari 1951 Rivarol zou lanceren, 'hebdomadaire de l'opposition nationale' dat tot op heden verschijnt. Zijn belangstelling voor misdaadliteratuur blijft onverminderd. Wanneer Jean Paulhan hem uitnodigt mee te werken aan de herrezen NRF (anno 1953, nu als Nouvelle Nouvelle Revue Francaise) publiceert hij een bijdrage waarin hij de Amerikaanse 'roman noir' als antidotum stelt voor de dreigende sclerose van de klassieke politieroman.
Met de publicatie in 1953 van Homo eroticus: esquisse d'une psychologie de l'érotisme in de prestigieuze reeks 'Les Essais' van Gallimard (uitgever van de NNRF) verwerft de expat die tot dan slechts toegang had tot uiterst rechts gemarkeerde publicaties, een (bescheiden maar voor velen benijdenswaardige) plaats binnen de Franse literaire institutie. Hij zou echter vooral als vertaler van o.m. Norman Mailer, Angus Wilson, Kingsley Amis en anti-psychiater Ronald Laing waardering (en ook soms wel terechte kritiek) oogsten. Tot slot, in J'ai choisi les animaux komt een vroege maar niet minder radicale verdediger van de dierenrechten resoluut aan het woord.
*
Het is typisch voor Eemans' demarche dat hij bij zijn tentoonstelling in galerie Le Soleil dans la Tête, een manifestatie die hij ongetwijfeld als een vorm van rehabilitatie zag, een tekst vroeg aan uitgerekend een eveneens door de collaboratie zwaar gebrandmerkte relatie.
Claude Elsen onderstreept dat schilderkunst voor Eemans niets anders is dan :
Démarche spirituelle, conquête de l'invisible, elle annexe ce monde invisible à l'univers visible de l'art pictural, nous faisant voir ces choses dont saint Jean de la Croix dit qu'elles existent sans que nous les voyions, au contraire de celles que nous voyons et qui n'existent pas.
Cette peinture ne se réclame d'aucune mode, ne va dans le sens d'aucun courant actuel. Si l'on peut voir en elle, dans une certaine mesure, un prolongement du surréalisme, elle se rattache davantage à une Tradition plus secrète et plus profonde – à cette Tradition hermétique dont récemment encore André Breton lui-même déplorait que l'art moderne ignorât le message.
Claude Elsen zinspeelt hier op het pas verschenen L'art magique van Breton, die op ambigue wijze gefascineerd was door die “Tradition plus secrète et plus profonde”, die “Tradition hermétique” die hier nog ruim aan bod zal komen.
Eemans had nu blijkbaar een bruggenhoofd in Parijs. In de lente van 1959 publiceerde Le Soleil dans la Tête een voornaam uitgegeven monografie van Serge Hutin (1929-1997) en Friedrich-Markus Huebner (1886-1964), Ars magna. Marc. Eemans, peintre et poète gnostique.
Serge Hutin, doctor in de letteren verbonden aan het CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique), publiceerde in 1955 een Histoire des Rose-Croix. Hij had enkele deeltjes op zijn naam staan in de bekende reeks 'Que sais-je?' uitgegeven door de Presses Universitaires de France: L'alchimie, Les sociétés secrètes, La philosophie anglaise et américaine en Les gnostiques. Zijn belangrijkste publicaties waren toen nog in de pijpleiding: Les disciples anglais de Jacob Böhme en Henry More. Essai sur les doctrines théosophiques chez les Platoniciens de Cambridge.
Hutin wijst erop dat alleen al de titels van Eemans' schilderijen uit de periode 1950-1959 onmiskenbaar verwijzen naar diens esoterische bedoelingen: La gnose de la parturience, Le serpent hyperboréen, L'étoile anagogique, L'ascension originelle, enz. Met zijn werk wil Eemans de toeschouwer verheffen tot wat hij “l'état de mystère” noemt, waardoor hij, de toeschouwer, niet louter passief blijft maar integendeel toegang krijgt tot “le monde invisible des symboles, des illuminations et des rites”. Het komt erop aan een on-middellijke, niet gemedieerde 'communicatie' tot stand te brengen door het prikkelen of '(op)wekken' van de trans-rationele intuïtie'. Wanneer de kunstenaar daar in slaagt, dan gaat het niet langer om fantastische kunst – dit is de projectie van wonderbaarlijke of schrikwekkende fantasma's, “enfantés par le sommeil de la raison dont parle Goya” – maar wel om een waarachtige revelatie. De schilder reveleert, ont-hult (een) waarheid
(άληθεία, wat niet verhuld is).
De telles œuvres sont belles, certes, mais leur caractère d' 'art' n'est, somme toute, que secondaire: elles sont, avant toute, l'expression symbolique des expériences intérieures de l'artiste – expériences qui ne sont elles-mêmes qu'une découverte 'occulte' et magique.
Volgens Hutin verschijnt de contemporaine surrealistische schilderkunst als de laïcisering van een in se esoterische schilderkunst:
Il ne s'agit plus d'extérioriser une doctrine secrète traditionnelle, mais de découvrir, indépendamment de toute contrainte (religieuse ou initiatique), l'intrication 'dialectique' de la réalité et de la surréalité – du domaine des apparences sensibles et de celui des déterminismes subtils qui conditionnent les premières.
Hij stelt vast dat Salvador Dalí zijn 'mystiek' bewust heeft geïntegreerd in de traditie van de katholieke symboliek en dat Ernst Fuchs (°1930) de “koninklijke weg” van het zestiende-eeuwse hermetisme teruggevonden heeft. Maar zelfs kunstenaars die, vrij van welke sacrale traditie ook, een eigen, persoonlijke weg volgen, wars van welke vorm van esoteriek ook, blijken spontaan de uitbeelding en de regels te herontdekken van bepaalde vormen van traditionele symboliek, zoals bijvoorbeeld Leonor Fini die in haar werk de taal der alchemie als vanzelf hanteert. Eemans, van zijn kant, leunt doelbewust aan bij een “ésotérisme de type traditionnel”:
il dessine et peint dans un but initiatique: surtout il ne s'agit point de 'faire de jolies choses', même pas de faire de l'art pur mais de fournir à la méditation des 'supports' concrets et symboliques tout à la fois, qui permetttront au spectateur de répéter en lui-même le processus d'illumination intuitive par laquelle l'artiste est parvenu à la connaissance supra-rationnele, à la gnose.
Impliciet suggereert Hutin hier dat Eemans aanknoopt bij of deelachtig is aan de traditie van het kunstwerk als sacrale, geladen afbeelding. Aan de Byzantijnse iconen werden en worden wonderdadige en andere wonderbaarlijke vermogens toegekend. Voor de Renaissance-mens hadden (bepaalde) schilderijen en beeldhouwwerken een religieus of zelfs thaumaturgisch of minstens bezwerend karakter, net zoals de antieke, polychrome Griekse beelden die het voorwerp waren van cultische zorgen. Peter Burke stipt in dat verband aan dat (bepaalde) Renaissance-schilderijen lijken te behoren tot een magisch stelsel buiten het kader van het christendom (zo was Botticelli's Primavera wellicht een talisman).
Volgens Hutin zijn Eemans' schilderijen tegelijk concrete et symbolische 'dragers' voor meditatie, net als bijvoorbeeld mandala's, die moeten leiden tot illuminatie, supra-rationele kennis, gnosis. Hij gaat uitvoerig op dit thema in:
Ce n'est pas, bien au contraire!, une peinture 'anecdotique', 'allégorique' ou 'littéraire': il ne s'agit pas de 'raconter une histoire', ni d' 'illustrer une doctrine', ni de transformer des idées en allégories concrètes. Bon gré mal gré, celui qui regarde de telles œuvres est obligé de participer à un acte magique: même s'il ne retrouve pas l'illumination gnostique à laquelle le peintre est parvenu, il sera plongé dans un état de 'rêverie' singulièrement propice aux hantises métaphysiques. […] Ce peintre-penseur a retrouvé l'un des principes de la meilleure initiation: il ne s'agit pas d' 'apprendre' didactiquement tel ou tel système, mais de réaliser en soi un état d'illumination – condition nécessaire à l'acquisition ultérieure d'une connaissance métaphysique véritable. Il ne faut pas vouloir à tout prix découvrir une 'signification' précise aux scènes 'symboliques' que nous montre le peintre: il s'agit, tout simplement, de les regarder de la manière la plus 'intuitive', la plus spontanée possible. Aristote caractérisait ainsi l'enseignement des mystères d'Éleusis: 'Ne pas apprendre, mais éprouver', et, dans l'observation des tableaux de Marc. Eemans, c'est un peu la même chose.
Het gaat immers om een 'supra-picturale' schilderkunst die zich niet richt naar het materialistische genot van de kleur om de kleur en van de vorm om de vorm, maar wel om een “véritable tentative gnostique pour réconquérir les visions métaphysiques et les mythes'. Drie invalshoeken bepalen het esoterische universum van de schilder, aldus Hutin: de Griekse mysteriën en godenwereld, bepaalde vormen van christelijke gnosis en alchemistische overleveringen, vermengd met reminiscenties aan de Edda's. De inbreng van het surrealisme bestaat, ten eerste, uit vernuftige metaforische uitwerkingen (“dans lesquelles Eemans excelle autant que son compatriote Magritte”) en, ten tweede, uit een metafysica van de erotiek (“qui rejoint d'ailleurs d'authentiques secrets occultes”).
Hutin heeft nu meer dan de helft van zijn diepgravend essay achter de rug en beseft dat zijn discours nu ook iets concreets moet bevatten op louter schilderkunstig vlak, hoe profaan dit ook moge wezen... Sommigen zullen inderdaad de vraag stellen of de kunstenaar zoveel duistere literatuur van doen heeft, waarbij ze geringschattend insinueren dat de schilderijen van Eemans al te literair zijn en, vooral, dat hij zondigt door gebrek aan zin voor plastiek. Het volstaat echter, zegt Hutin, hen te wijzen op de subtiliteiten van zijn coloriet en op zijn voorkeur voor het clair-obscur – “ce mystère incarné dans toute vraie peinture de l'âme”. Bovendien moet gewezen worden op Eemans' diepe kennis van de compositie:
Tout dans ses œuvres, est harmonie rythmiquement ordonnée, non point en raison d'une idée ou d'une allégorie préétablie, mais bien en fonction de formes – peut-être toujours chargées de sens – qui sont là avant tout pour se répondre sur le plan des nécessités plastiques inhérentes à toute peinture digne de ce nom.
Volgens Hutin komt Eemans' kunst van de compositie rechtstreeks voort uit de surrealistische technieken van het 'papier collé' en van de foto-montage. Tot slot wijst hij op
une permanente fusion entre des images oniriques et celles qui relèvent du sentiment de l'infini, aussi bien dans le temps que dans l'espace, avec les analogies telluriques, lunaires et solaires, ou encore avec tous les reflets de dépaysement par rapport au moi discursivement tangible, dépaysement qui conduit à se sentir soit immensément grand, soit infiniment petit, ou bien encore à se voir emporté, tel une comète, à travers le monde sidéral.
De behandeling van het literaire werk van Eemans door Hutin en Huebner zal te zijner tijd aan bod komen. Wel dient hier al aangestipt dat Hutin de publicatie bij Le Soleil dans la Tête aankondigt van Eemans' Gnose de chair et de Silence. Daar kwam niets van in huis, en Eemans zou ook geen tweede keer exposeren bij de Parijse galerie. Het zou mij niet verwonderen dat hij zichzelf eens te meer in de weg heeft gestaan.
Henri-Floris JESPERS
00:05 Publié dans art | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art, art gnostique, peinture gnostique, peinture, marc eemans, avant-gardes, surréalisme, belgique, belgicana, flandre, art flamand, surréalisme flamand |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 24 février 2011
Futurisme et dadaisme chez Evola
Futurisme et dadaïsme chez Evola
Salvatore FRANCIA
 Nous devons également mentionner l'influence qu'exerça sur Evola adolescent le groupe qui s'était constitué autour des revues de Giovanni Papini et du mouvement futuriste. Le jeune Evola ne tarda pas à reconnaître toutefois que l'orientation générale du futurisme ne s'accordait que fort peu avec ses propres inclinaisons. Dans le futurisme, beaucoup de choses lui déplaisaient : le sensualisme, l'absence d'intériorité, les aspects tapageurs et exhibitionnistes, l'exaltation grossière de la vie et de l'instinct, curieusement mêlée avec celle du machinisme et d'une espèce d'américanisme, même si, par ailleurs, le futurisme se référait à des formes chauvines de nationalisme.
Nous devons également mentionner l'influence qu'exerça sur Evola adolescent le groupe qui s'était constitué autour des revues de Giovanni Papini et du mouvement futuriste. Le jeune Evola ne tarda pas à reconnaître toutefois que l'orientation générale du futurisme ne s'accordait que fort peu avec ses propres inclinaisons. Dans le futurisme, beaucoup de choses lui déplaisaient : le sensualisme, l'absence d'intériorité, les aspects tapageurs et exhibitionnistes, l'exaltation grossière de la vie et de l'instinct, curieusement mêlée avec celle du machinisme et d'une espèce d'américanisme, même si, par ailleurs, le futurisme se référait à des formes chauvines de nationalisme.
Justement, à propos du nationalisme, ses divergences de vue avec les futuristes apparaissent dès le déclenchement de la première guerre mondiale, à cause de la violente campagne interventionniste déclenchée par le groupe de Papini et le mouvement futuriste. Pour Evola, il était inconcevable que tous ces gens, avec à leur tête Papini, épousassent les lieux communs patriotards les plus éculés de la propagande anti-germanique, croyant ainsi sérieusement appuyer une guerre pour la défense de la civilisation et de la liberté contre la barbarie et l'agression.
Evola, à l'époque, n'avait encore jamais quitté l'Italie et n'avait qu'un sentiment confus des structures hiérarchiques, féodales et traditionnelles présentes en Europe centrale, alors qu'elles avaient quasiment disparu du reste de l'Europe à la suite de la révolution française. Malgré l'imprécision de ses vues, ses sympathies allaient vers l'Autriche et l'Allemagne et il ne souhaitait pas l'abstention et la neutralité italiennes, mais une intervention aux côtés des puissances impériales d'Europe centrale. Après avoir lu un article d'Evola dans ce sens, Marinetti lui aurait dit textuellement : « Tes idées sont aussi éloignées des miennes que celles d'un Esquimau ».
Après 1918, Evola est attiré par le mouvement dadaïste, surtout à cause de son radicalisme. Le dadaïsme défendait une vision générale de la vie sous-tendue par une impulsion vers une libération absolue se manifestant sous des formes paradoxales et déconcertantes, accompagnées d'un bouleversement de toutes les catégories logiques, éthiques et esthétiques. « Ce qui vit en nous est de l'ordre du divin, affirmait Tristan Tzara, c'est le réveil de l'action anti-humaine ». Ou encore : « Nous cherchons la force directe, pure, sobre, unique, nous ne cherchons rien d'autre ». Le dadaïsme ne pouvait conduire nulle part : il signalait bien plutôt l'auto-dissolution de l'art dans un état supérieur de liberté. Pour Evola, c'est en cela que résidait la signification essentielle du dadaïsme. C'est ce que nous constatons en effet à la lecture de son article « Sul significato dell'arte modernissima », reproduit en appendice de ses Saggi sull'idealismo magico, publiés en 1925. En réalité, le mouvement auquel Evola avait été associé n'a réalisé que bien peu de choses. Evola en avait espéré davantage. Si le dadaïsme représentait la limite extrême et indépassable de tous les courants d'avant-garde, tout ne s'auto-consommait pas dans l'expérience d'une rupture effective avec toutes les formes d'art.
Au dadaïsme succéda le surréalisme, dont le caractère, du point de vue d'Evola, était régressif, parce que, d'une part, il cultivait une espèce d'automatisme psychique se tournant vers les strates subconscientes et inconscientes de l'être (au point de se solidariser avec le psychanalyse elle-même) et, d'autre part, se bornait à transmettre des sensations confuses venues d'un « au-delà » inquiétant et insaisissable de la réalité, sans aucune ouverture véritable vers le haut.
Il est difficile de parler de la peinture d'Evola, vu l'abstraction des sujets. En contemplant les tableaux d'Evola et en lisant ses poèmes dadaïstes, on comprend que le monde moderne, tel que le percevaient les élites des premières années de notre siècle, apparaissait comme le symbole du dénuement et de la purification. Ces élites rejetaient les oripeaux de la culture bourgeoise du XIXème et voulaient créer rapidement une « nouvelle objectivité » que certains ont cru découvrir dans le bolchevisme et d'autres dans le nazisme.
À 23 ans, Evola cesse définitivement de peindre et d'écrire des poésies. Ses intérêts le portent vers une autre sphère.
(Extrait de Il pensiero tradizionale di Julius Evola, Società Editrice Barbarossa, Milano, 1994 ; ouvrage disponible auprès de notre service librairie. Prix: 240 FB ou 45 FF, port compris).
00:05 Publié dans art, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art, dadaïsme, futurisme, italie, julius evola, avant-gardes, tradition, traditionalisme, art, arts plastiques, peinture |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 04 février 2011
Evola: de Mafarka a Mitra

* * *
Para muitos espíritos, o futurismo estaria numa posição absolutamente antitética em relação à Tradição europeia. O percurso de Julius Evola dá-nos, sobre esse assunto, uma resposta de uma singular recorrência contra os a priori e os pronto-a-pensar.
Julius Evola nasce em Roma a 19 de Maio de 1898 - no seio de uma família da nobreza rural pela parte do seu pai, Vincenzo e, durante toda a vida, ficará ligado a esta cidade onde morre em 14 de Junho de 1974. Este pensador representa hoje uma das maiores figuras da filosofia tradicional. Partindo das fontes da mais longínqua antiguidade indo-europeia, constituiu, através da publicação dos seus livros, de um dos mais violentos requisitórios contra a ilusão moderna e os seus mitos contemporâneos: «a igualdade», «o regime da quantidade» e «o materialismo».
Romano em todas as fibras do seu ser, é sob a protecção do Império que ele coloca todas as perspectivas do seu combate «contra o mundo moderno». Eterno gibelino ao serviço do Imperium de forma quase sacerdotal, faz da sua vida uma luta contínua, luta contra as forças do niilismo actual (ou idade do ferro, segundo uma expressão sua). Teorizando, de uma forma determinista, o desaparecimento inevitável de todos os valores e concluindo pela necessidade de um retorno ao caos original através de uma paróptica «final dos tempos», tempera o seu pessimismo com nuances de uma eventual esperança de endireitamento provisório e momentâneo. No entanto, se este pensamento parece à primeira vista, na sua estrutura interna, estranho à teoria da «excitação dinâmica da História», tão cara aos futuristas, é bom conhecermos o papel que exerceu sobre Evola a vanguarda do princípio do século XX e o lugar (pouco conhecido) que ele aí detinha e a influência que isso teve na sua reflexão posterior.
Um artista de vanguarda
É, primeiro, como pintor e como poeta que Julius Evola se exprime no quadro da actividade artística das vanguardas. Pondo-se em contacto com a revista futurista Lacerba, descobre os fundamentos de uma crítica radical do sistema burguês, o anti-democratismo, ao mesmo tempo que nasce, segundo alguns autores, o seu interesse pelos místicos alemães e a tradição esotérica.
Lembremo-nos que numerosos artistas futuristas introduzem-se na pesquisa profunda e concreta do pensamento oculto. Bastará citar o caso muito conhecido de Russolo de que a obra «Para além da matéria» é uma exposição magistral de esoterismo operativo, para nos convencermos da permanência de uma curiosidade instintiva desta escola de arte sobre este assunto.
É necessário saber que Evola, mesmo durante o período do movimento futurista, nunca deixou de manifestar interesse pelo pensamento tradicional. Com efeito, bastará ler o seu texto Arte abstracta para melhor compreendermos o mecanismo intelectual do jovem Evola.
Vejamos o que ele escreve: «A consciência abstracta, suporte da estética mais acabada, liga-se, de facto, a um outro plano (quase a outra dimensão) do espírito, o qual não tem nada a ver com o que se desenrola a vida quotidiana prática e sentimental até àquele que encontra um eco nos clamores da humanidade trágica. E a via que aí conduz é difícil e dolorosa porque, para a percorrer, é necessário queimar tudo o que habitualmente os homens consideram como a sua vida mais profunda e mais autêntica. Se, por acaso, nos perguntarem a que devemos comparar isto, encontraremos, talvez, em alguns místicos qualquer coisa de aproximativo: na interioridade silenciosa e glacialmente ardente de um Ruysbroek ou de um Mestre Eckhart, por exemplo. Uma lógica que não tem mais nada a ver com aquela que todos os dias rege este mundo: nele, as luzes mais banais como as mais gloriosas enfraquecem, à imagem das débeis vegetações subterrâneas; a vontade comum reina, como que ébria; as palavras tornam-se incompreensíveis como se pertencessem a uma língua estrangeira. Diríamos que toda a vegetação se desagrega como que sugada por uma extrema rarefacção, e renova com o caos elementar, seco e ardente, ardente e monótono. Mas, para aquele que penetrou totalmente na natureza da arte abstracta, parece que esta incoerência, esta loucura, não é mais do que aparência, por detrás da qual palpita, numa luminosidade metálica, o sentido da absoluta liberdade do Eu».
Esta descoberta da expansão virtual dos sentidos e da matéria desenvolve um estudo preciso destes novos estados de consciência, regidos por esta luminosidade metálica, que ele recebe daquilo que podia, e pode ainda, aparecer como arte informal, caótica e sem ordem.
Uma nova objectividade
As pinturas de Evola que foram, na totalidade, objecto de compra por parte dos museus italianos não serão estranhas aos familiares da obra ulterior.
Elas apresentam todos os sinais da presença simbólica. «Ali encontramos», diz Romualdi *, «a interioridade ardente que Evola menciona no seu ensaio L'Arte Astratta. Os globos, de um vermelho ardente ou de um verde magnético, como acetato de cobre incandescente, de uma luz irreal sob os céus devastados; os cilindros rodam como as fábricas de fogo na noite; as formas luminosas ascendem ao céu enquanto se formam nuvens inquietantes. É uma visão poderosa do elementar apanhado, por meio de uma linguagem de formas geométricas, num espaço invisível procedido do espaço visível (comparável à Hiper-urânia platoniana ou ao goetiano "mundo das mães").»
De Mafarka a Mithra
A título de purificação
O convite que ele formulava para um «salto no brutal a título de purificação» é a exacta busca que, da via tradicional à disciplina do manifesto técnico futurista, exige do aluno ou do discípulo este rigor, esta contingência afim de atingir a mestria da sua arte, isto é, de si mesmo pela revelação da energia pura, numa espécie de metalurgia espiritual onde o metal vil é rudemente malhado afim de se tornar num ferro flamejante.
Esta ascese comum não deve escapar ao observador. As vias parecem diferentes, os caminhos comunicam.
Do futurismo à tradição, é o mesmo pensamento de ordem e o ultrapassar hierárquico pelo valor que se afirma. Exprime a permanência, através das épocas e das formas, de uma doutrina que extrai profundamente as suas raízes específicas da cultura indo-europeia.
(Jean-Marc Vivenza)
Notas:
* Adriano Romualdi, Julius Évola, l?homme et l?oeuvre, Guy Trédaniel, 1985.
** Ernst Jünger, O Trabalhador - Domínio e Figura, introdução, tradução e notas de Alexandre Franco de Sá, prefácio de Nuno Rogeiro, Hugin Editores, 2000.
00:05 Publié dans art, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art, peinture, tradition, traditionalisme, traditions, evola, avant-garde, futurisme, mafarka, marinetti, jean-marc vivenza |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 31 janvier 2011
Portrait of Julius Evola - Alexander Slavros
00:10 Publié dans art, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peinture, art, tradition, traditionalisme, evola, italie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 29 janvier 2011
Alexander Slavros - Portrait of Ernst Jünger
00:10 Publié dans art, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst jünger, révolution conservatrice, allemagne, weimar, art, peinture |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 30 décembre 2010
Arno Breker & the Pursuit of Perfection

Arno Breker & the Pursuit of Perfection
Jonathan BOWDEN
Ex: http://www.counter-currents.com/
Arno Breker (1900–1991) was the leading proponent of the neo-classical school in the twentieth century, but he was not alone by any stretch of the imagination. If we gaze upon a great retinue of his figurines, which can be seen assembled in the Studio at Jackesbruch (1941), then we can observe images such as Torso with Raised Arms (1929), the Judgment of Paris, St. Mathew (1927), and La Force (1939). All of these are taken from the on-line museum and linkage which is available at:
http://ilovefiguresculpture.com/masters/german/breker/bre...
The real point to make is that these are dynamic pieces which accord with over three thousand years of Western effort. They are not old-fashioned, Reactionary, bombastic, “facsimiles of previous glories,” mere copies or the pseudo-classicism of authoritarian governments in the twentieth century (as is usually declared to be the case). Joseph Stalin approached Breker after the Second European Civil War (1939–1945) in order to explore the possibility for commissions, but insisted that they involved castings which were fully clothed. At first sight, this was an odd piece of Soviet prudery — but, in fact, politicians as diverse as John Ashcroft (Bush’s top legal officer) and Tony Blair refused to be photographed anywhere near classical statuary for fear that any proximity to nudity (without Naturism) might lead to their tabloid down-fall.
 All of Breker’s pieces have precedents in the ancient world, but this has to be understood in an active rather than a passive or re-directed way. If we think of the Hellenism which Alexander’s all-conquering armies inspired deep into Asia Minor (and beyond), then pieces like the Laocoön at the Vatican or the full-nude portrait of Demetrius the First of Syria, whose modelling recalls Lysippus’ handling, are definite precursors. (This latter piece is in the National Museum in Rome.) Yet Breker’s work is quite varied, in that it contains archaic, semi-brutalist, unshorn, martial relief and post-Cycladic material. There is also the resolution of an inner tension leading to a Stoic calm, or a heroic and semi-religious rest, that recalls the Mannerist art of the sixteenth century. Certain commentators, desperate for some sort of affiliation to modernism in order to “save” Breker, speak loosely of Expressionist sub-plots. This is quite clearly going too far — but it does draw attention to one thing . . . namely, that many of these sculptures indicate an achievement of power, a rest or beatitude after turmoil. They are indicative of Hemingway’s definition of athletic beauty — that is to say, grace under pressure or a form of same.
All of Breker’s pieces have precedents in the ancient world, but this has to be understood in an active rather than a passive or re-directed way. If we think of the Hellenism which Alexander’s all-conquering armies inspired deep into Asia Minor (and beyond), then pieces like the Laocoön at the Vatican or the full-nude portrait of Demetrius the First of Syria, whose modelling recalls Lysippus’ handling, are definite precursors. (This latter piece is in the National Museum in Rome.) Yet Breker’s work is quite varied, in that it contains archaic, semi-brutalist, unshorn, martial relief and post-Cycladic material. There is also the resolution of an inner tension leading to a Stoic calm, or a heroic and semi-religious rest, that recalls the Mannerist art of the sixteenth century. Certain commentators, desperate for some sort of affiliation to modernism in order to “save” Breker, speak loosely of Expressionist sub-plots. This is quite clearly going too far — but it does draw attention to one thing . . . namely, that many of these sculptures indicate an achievement of power, a rest or beatitude after turmoil. They are indicative of Hemingway’s definition of athletic beauty — that is to say, grace under pressure or a form of same.
This is quite clearly missed by the well-known interview between Breker and Andre Muller in 1979 in which a Rottweiler of the German press (of his era) attempts to spear Breker with post-war guilt. Indeed, at one dramatic moment in the dialogue between them, Muller almost breaks down and accuses Breker of producing necrophile masterpieces or anti-art (sic). What he means by this is that Breker is artistically glorifying in war, slaughter, and death. As a Roman Catholic teacher of acting once remarked to me, concerning the poetry of Gottfried Benn, it begins with poetry and ends in slaughter. Yet the answer to this ethical ‘plaint is that it was ever so. Artistic works have always celebrated the soldierly virtues, the martial side of the state and its prowess, and all of the triumphalist sculpture on the Allied side (American, Soviet, Resistance-oriented in France, etc. . . .) does just that. As Wyndham Lewis once remarked in The Art of Being Ruled, the price of civility in a cultivated dictatorship (he was thinking of Mussolini’s Italy) might well be the provision of an occasional Gladiator in pastel . . . so that one could be free from communist turmoil, on the one hand, and able to continue one’s work in serenity, on the other. Doesn’t Hermann Broch’s great post-modern work, The Death of Virgil, which dips in and out of Virgil’s consciousness as he dies, rather like music, not speculate on his subservience to the Caesars and his pained confusion about whether the Aeneid should be destroyed? It survived intact.
Nonetheless, the interview provides a fascinating crucible for the clash of twentieth century ideas in more ways than one. At one point Muller’s diction resembles a piece of dialogue from a play by Samuel Beckett (say End-Game or Fin de Partie); maybe the stream-of-consciousness of the two tramps in Waiting for Godot. For, whether it’s Vladimir or Estragon, they might well sound like Muller in this following exchange. Muller indicates that his view of Man is broken, crepuscular, defeated, incomplete and misapplied — he congenitally distrusts all idealism, in other words. Mankind is dung — according to Muller — and coprophagy the only viable option. Breker, however, is of a fundamentally optimistic bent. He avers that the future is still before us, his Idealism in relation to Man remains unbroken and that a stratospheric take-off into the future remains a possibility (albeit a distant one at the present juncture).
 Another interesting exchange between Muller and Breker in this interview concerns the Shoah. (It is important to realise that this highly-charged chat is not an exercise in reminiscence. It concerns the morality of revolutionary events in Europe and their aftermath.) By any stretch, Breker declares himself to be a believer and that the criminal death through a priori malice of anyone, particularly due to their ethnicity, is wrong. At first sight this appears to be an unremarkable statement. A bland summation would infer that the neo-classicist was a believer in Christian ethics, et cetera. . . . Yet, viewed again through a different premise, something much more revolutionary emerges. Breker declares himself to be a “believer” (that is to say, an “exterminationist” to use the vocabulary of Alexander Baron); yet even to affirm this is to admit the possibility of negation or revision (itself a criminal offense in the new Germany). For the most part contemporary opinion mongers don’t declare that they believe in Global warming, the moon shot, or the link between HIV and AIDS — they merely affirm that no “sane” person doubts it.
Another interesting exchange between Muller and Breker in this interview concerns the Shoah. (It is important to realise that this highly-charged chat is not an exercise in reminiscence. It concerns the morality of revolutionary events in Europe and their aftermath.) By any stretch, Breker declares himself to be a believer and that the criminal death through a priori malice of anyone, particularly due to their ethnicity, is wrong. At first sight this appears to be an unremarkable statement. A bland summation would infer that the neo-classicist was a believer in Christian ethics, et cetera. . . . Yet, viewed again through a different premise, something much more revolutionary emerges. Breker declares himself to be a “believer” (that is to say, an “exterminationist” to use the vocabulary of Alexander Baron); yet even to affirm this is to admit the possibility of negation or revision (itself a criminal offense in the new Germany). For the most part contemporary opinion mongers don’t declare that they believe in Global warming, the moon shot, or the link between HIV and AIDS — they merely affirm that no “sane” person doubts it.
Similarly, even Muller raises the differentiation in Breker’s work over time. This is particularly so after the twin crises of 1945 and 1918 and the fact that these were the twin Golgothas in the European sensibility — both of them taking place, almost as threnodies, after the end of European Civil Wars. Germany and its allies taking the role of the Confederacy on both occasions, as it were. Immediately after the War — and amid the kaos of defeat and “Peace” — Breker produced St. Sebastien in 1948, St. George (as a partial relief) in 1952, and the more reconstituted St. Christopher in 1957. (One takes on board — for all sculptors — the fact that the Church is a valuable source of commissions in stone during troubled times.) All of this led to a celebration of re-birth and the German economic miracle of recovery in his unrealized Resurrection (1969) which was a sketch or maquette to the post-war Chancellor Adenauer. Saint Sebastien is interesting in its semi-relief quality which is the nearest that Breker ever comes to a defeated hero or — quite possibly — the mortality which lurks in victory’s strife. Interestingly enough, a large number of aesthetic crucifixions were produced around the middle of the twentieth century. One thinks (in particular) of Buffet’s post-Christian and existential Pieta, Minton’s painting in the ‘fifties about the Roman soldiery, post-Golgotha, playing dice for Christ’s robes, or Bacon’s screaming triptych in 1947; never mind Graham Sutherland’s reconstitution of Coventry Cathedral (completely gutted by German bombing); and an interesting example of an East German crucifixion.
This is a fascinating addendum to Breker’s career — the continuation of neo-classicism, albeit filtered through socialist realism, in East Germany from 1946–1987. An interesting range of statuary was produced in a lower key — a significant amount of it not just keyed to Party or bureaucratic purposes. In the main, it strikes one as a slightly crabbed, cramped, more restricted, mildly cruder and more “proletarianized” version of Breker and Kolbe. But some decisive and significant work (completely devalued by contemporary critics) was done by Gustav Seitz, Walter Arnold, Heinrich Apel, Bernd Gobel, Werner Stotzer, Siegfried Schreiber, and Fritz Cremer. His crucifixion in the late ‘forties has a kinship (to my mind) with some of Elisabeth Frink’s pieces — it remains a neo-classic form whilst edging close to elements of modernist sculpture in its chthonian power and deliberate primitivism. A part of the post-maquette or stages of building up the Form remains in the final physiology, just like Frink’s Christian Martyrs for public display. Perhaps this was the nearest a three-dimensional artist could get to the realization of religious sacrifice (tragedy) in a communist state.
Anyway, and to bring this essay to a close, one of the greatest mistakes made today is the belief that the Modern and the Classic are counterposed, alienated from one another, counter-propositional and antagonistic. The Art of the last century and a half is an enormous subject (it’s true) yet Arno Breker is one of the great Modern artists. One can — as the anti-humanist art collector Bill Hopkins once remarked — be steeped both in the Classic and the Modern. Living neo-classicism is a genuine contemporary tradition (post Malliol and Rodin) because photography can never replace three-dimensionality in form or focus. Above all, perhaps it’s important to make clear that Breker’s work represents extreme heroic Idealism . . . it is the fantastication of Man as he begins to transcend the Human state. In some respects, his work is a way-station towards the Superman or Ultra-humanite. This remains one of the many reasons why it sticks in the gullet of so many liberal critics!
One will not necessarily reassure them by stating that Breker’s monumental sculptures during his phase of Nazi Art were modeled (amongst other things) on the Athena Parthenos. The original was over forty feet high, came constructed in ivory and gold, and was made during the years 447–439 approximately. (The years relate to Before the Common Era, of course.) The Goddess is fully armoured — having been born whole as a warrior-woman from Zeus’ head. There may be Justice but no pity. A winged figure of Victory alights on her right-hand; while the left grasps a shield around which a serpent (knowledge) writhes aplenty. A re-working can be seen in John Barron’s Greek Sculpture (1965), but perhaps the best thing to say is that the heroic sculptor of Man’s form, Steven Mallory, in Ayn Rand’s Romance The Fountainhead is clearly based on Thorak: Breker’s great rival. Yet the “gold in the furnace” producer of a Young Woman with Cloth (1977) remains to be discovered by those tens of thousands of Western art students who have never heard of him . . . or are discouraged from finding out.
00:05 Publié dans art, Histoire, Hommages | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : arno breker, hommages, art, sculpture, arts plastiques, allemagne, art monumental, sculpture classique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 05 décembre 2010
Otto Dix, un regard sur le siècle

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1991
Otto Dix, un regard sur le siècle
Guillaume HIEMET
Le centième anniversaire de la naissance d'Otto Dix a été l'occasion pour le public allemand de découvrir la richesse de la production d'un peintre largement méconnu. Plus de 350 œuvres ont en effet été exposées jusqu'au 3 novembre 1991, dans la galerie de la ville de Stuttgart, puis, à partir du 29 novembre, à la Nationalgalerie de Berlin. Peu connu en France, classé par les critiques d'art parmi les représentants de la Nouvelle Objectivité (Neue Sachlichkeit), catalogué comme il se doit, Otto Dix a toujours bénéficié de l'indulgence de la critique pour un peintre qui avait dénoncé les horreurs de la première guerre mondiale, figure de proue de l'art nouveau dans l'entre-deux guerres, et ce, en dépit de son incapacité à suivre la mode de l'abstraction à tout crin dans l'après-guerre. Quelques tableaux servent de support à des reproductions indéfiniment répétées et à des jugements qui ont pris valeur de dogmes pour la compréhension de l'œuvre. A l'encontre de ces parti-pris, les expositions de 1991 permettent aux spectateurs de se faire une idée infiniment plus large et plus juste des thèmes que développent la production de Dix.
Dix est né le décembre 1891 à Untermhaus, à proximité de Gera, d'un père, ouvrier de fonderie. Un milieu modeste, ouvert cependant aux préoccupations de l'art; sa mère rédigeait des poèmes et c'est auprès de son cousin peintre Fritz Amann que se dessina sa vocation artistique. De 1909 à 1914, il étudie à l'école des Arts Décoratifs de Dresde. Ses premiers autoportraits, à l'exemple de l'Autoportrait avec oeillet de 1913, sont clairement inspirés de la peinture allemande du seizième siècle à laquelle il vouera toujours une sincère admiration. Ces tableaux de jeunesse témoignent déjà d'un pluralisme de styles, caractérisé par la volonté d'intégrer des approches diverses, par la curiosité de l'essai qui restera une constante dans son œuvre.
La guerre: un nouveau départ
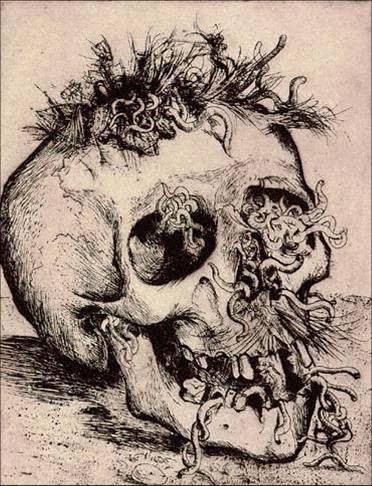 En 1914, Dix s'engageait en tant que volontaire dans l'armée. L'expérience devait, comme toute sa génération, profondément le marquer. S'il est une habitude de dépeindre Dix comme un pacifiste, son journal de guerre et sa correspondance montrent un caractère sensiblement différent. La guerre fut perçue par Dix, comme par beaucoup d'autres jeunes gens en Allemagne, comme l'offre d'un nouveau départ, d'une coupure radicale avec ce qui était ressenti comme la pesanteur de l'époque wilhelminienne, sa mesquinerie, son étroitesse, sa provincialité qu'une certaine littérature a si bien décrites. Elle annonçait la fin inévitable d'une époque. Les premiers combats, l'ampleur des destructions devaient, bien sûr, limiter l'enthousiasme des départs, mais le gigantisme des cataclysmes que réservait la guerre, n'en présentait pas moins quelque chose de fascinant. Le pacifiste Dix se rapproche par bien des aspects du Jünger des journaux de guerre. L'épreuve de la guerre pour Ernst Jünger trempe de nouveaux types d'hommes dans le monde d'orages et d'acier qu'offrent les combats dans les tranchées.
En 1914, Dix s'engageait en tant que volontaire dans l'armée. L'expérience devait, comme toute sa génération, profondément le marquer. S'il est une habitude de dépeindre Dix comme un pacifiste, son journal de guerre et sa correspondance montrent un caractère sensiblement différent. La guerre fut perçue par Dix, comme par beaucoup d'autres jeunes gens en Allemagne, comme l'offre d'un nouveau départ, d'une coupure radicale avec ce qui était ressenti comme la pesanteur de l'époque wilhelminienne, sa mesquinerie, son étroitesse, sa provincialité qu'une certaine littérature a si bien décrites. Elle annonçait la fin inévitable d'une époque. Les premiers combats, l'ampleur des destructions devaient, bien sûr, limiter l'enthousiasme des départs, mais le gigantisme des cataclysmes que réservait la guerre, n'en présentait pas moins quelque chose de fascinant. Le pacifiste Dix se rapproche par bien des aspects du Jünger des journaux de guerre. L'épreuve de la guerre pour Ernst Jünger trempe de nouveaux types d'hommes dans le monde d'orages et d'acier qu'offrent les combats dans les tranchées.
Avec nietzsche: “oui” aux phénomènes
Une philosophie nietzschéenne se dégage, “la seule et véritable philosophie” selon Dix, qui, en 1912, avait notamment élaboré un buste en platre en l'honneur du philosophe de la volonté de puissance. Des écrits de Nietzsche, Dix retient l'idée d'une affirmation totale de la vie en vertu de laquelle l'homme aurait la possibilité de se forger des expériences à sa propre mesure. Ainsi, il note: «Il faut pouvoir dire “oui” aux phénomènes humains qui existeront toujours. C'est dans les situations exceptionnelles que l'homme se montre dans toute sa grandeur, mais aussi dans toute sa soumission, son animalité». C'est cette même réflexion qui l'incite à scruter le champ de bataille, qui le pousse à observer de ses propres yeux, si importants pour le peintre, les feux des explosions, les couleurs des abris, des tranchées, le visage de la mort, les corps déchiquetés.
De 1915 à 1918, il tient une chronique des événements: ce sont des croquis dessinés sur des cartes postales, visibles aujourd'hui à Stuttgart, qui ramassent de façon simple et particulièrement intense l'univers du front. Le regard du sous-officier Dix a choisi de tout enregistrer, de ne jamais détourner le regard puis de tout montrer dans sa violence, sa nudité. Les notes du journal de guerre montrent crûment sa volonté de considérer froidement, insatiablement le monde autour de lui. Ainsi, en marche vers les premières lignes: «Tout à fait devant, arrivé devant, on n'avait plus peur du tout. Tout ça, ce sont des phénomènes que je voulais vivre à tout prix. Je voulais voir aussi un type tomber tout à côté de moi, et fini, la balle le touche au milieu. C'est tout ça que je voulais vivre de près. C'est ça que je voulais». Dans cette perception de la réalite, Dix souligne le jeu des forces de destruction, les peintures ne semblent plus obéir à aucune règle de composition si ce n'est les repères que forment les puissances de feu, les balles traçantes, les grenades. Tout dans la technique du dessin sert, contribue vivement à cette impression d'éclatement, les traits lourds brusquement interrompus, hachures des couleurs, parfois plaquées. Le regard est obnubilé par la perception d'ensemble, la brutalité des attaques, vision cauchemardesque qui emporte tout.
La dissolution de toute référence stable
Le réalisme de ces années 1917-1918 qui caractérise ces dessins et gouaches est dominé par cette absence d'unité, l'artiste a jeté sur la toile tel un forcené la violence de l'époque, la dissolution de toute reférence stable. L'abstraction dit assez cette incapacité de se détourner des éclairs de feu et de se rapprocher du détail. Cette peinture permettra pareillement à Dix de conjurer peu à peu les souvenirs de tranchées. Ce rôle de catharsis, cette lente maturation s'est faite dans son esprit pendant les années qui suivent la guerre. L'évolution est sensible. Ce sont en premier, le cycles des gravures intitulé la Guerre qu'il réalise en 1924 puis les grandes compositions des années 1929-1936. Les gravures presentent un nouveau visage de la guerre, Dix s'attarde à représenter le corps des blessés, les détails de leurs souffrances. Ici, le terme d'objectivité est peut-être le plus approprié, il n'est pas sans évoquer toutefois les descriptions anatomiques du poète et médecin Gottfried Benn. Le soin ici de l'extrême précision, de la netteté du rendu prend chez ces guerriers mourants, mutilés ou dans la description de la décomposition des corps une force incroyable.
Les souvenirs de guerre ne se laissaient pas oublier aisément, il avouait lui-même: «pendant de longues années, j'ai rêvé sans cesse que j'étais obligé de ramper pour traverser des maisons détruites, et des couloirs où je pouvais à peine avancer». Dans les grandes toiles qu'il a peintes après 1929, il semble que Dix soit venu à bout des stigmates, entaillés dans sa mémoire, que lui avaient laissées la guerre, ou tout du moins que l'unité ait pu se faire dans son esprit. La manière dont l'art offre une issue aux troubles des passions, ce rôle pacificateur, il l'évoque à plusieurs moments dans des entretiens à la fin de sa vie. Dans ces toiles grands-formats qui exposent maintenant, l'univers de la guerre, se conjuguent une extrême précision et l'entrée dans le mythe que renforce encore la référence aux peintres allemands du Moyen-Age. Dix a choisi pour la plus importante de ces oeuvres, un tryptique, La Guerre, la forme du retable. Le renvoi au retable d'Isenheim de Mathias Grünewald, étrange et impressionnant polyptique qui dans la succession de ses volets propose une ascension vers la clarté, l'aura de la Nativité et de la Résurrection, est explicite. En comparaison, le triptyque de Dix semble une tragique redite du premier volet de Grünewald, La tentation de Saint Antoine. Ici, l'univers apocalyptique de la guerre, la mêlée de corps sanglants, les dévastations de villages minés par les obus, correspondent aux visions délirantes de monstres horribles et déchainés, aux corps repoussants, aux gueules immondes mues par la bestialité de la destruction chez Grünewald.
des tranchées aux marges de la société
L'impossibilité de s'élever vers la clarté, l'éternel recommencement du cycle de destructions est accentué par l'anéantissement du pont qui ferme toute axe de fuite et le dérisoire cadavre du soldat planté sur l'arche de ce pont qui forme une courbe dont l'index tendu pointe en direction du sol. Le cycle du jour est rythmé par la marche d'une colonne dans les brouillards de l'aube, le paroxysme des combats du jour, et le calme, la torpeur du sommeil, les corps allongés dans leur abris que montre la predelle (le socle du tableau). L'effet mythique est encore accentué par la technique qu'utilise Dix pour ces toiles: la superposition de plusieurs couches de glacis transparents, technique empruntée aux primitifs allemands, qui nécessite de nombreuses esquisses et qui confère une perfection, une exactitude extraordinaire aux scènes représentées. Ainsi dans le tableau de 1936, la mort semble être de tout temps, la destinée des terres dévastées de Flandre —“en Flandre, la mort chevauche...”, selon les paroles d'un air de 1917—, et le combat dans son immensité parvient à une dimension cosmique.
Sous la République de Weimar, Dix conserve en grande partie le style éclaté des peintures de guerre. Il demeure successivement à Dresde, Düsseldorf, Berlin puis à nouveau Dresde jusqu'en 1933. Les thèmes que traite Dix se laissent difficilement résumer: le regard froid des tranchées se tourne vers la société, une société caractérisée, disons-le, par ces marges. Dix est fasciné par le mauvais goût, la laideur, les situations macabres, grotesques. L'esprit du temps n'est pas étranger à cet envoûtement pour la sordidité, et souvent ses personnages tiennent la main aux héroïnes de l'opéra d'Alban Berg Lulu: thèmes des bas-fonds de la littérature, aquarelles illustrants les amours vénales des marins, accumulation de crimes sadiques décrits avec la plus grande exactitude. Le cynisme hésite entre le sarcasme et l'ironie la moins voilée. L'atmosphère incite aux voluptés sommaires, comme disait un écrivain français. Une des figures qui apparaît le plus souvent et qui nous semble des plus caractéristiques, est celle du mutilé. La société weimarienne ne connaît pour Dix qu'estropiés, éclopés, que des bouts d'humanité, et tout donne à penser que ce qui est valable pour le physique l'est aussi pour le mental. Ainsi les cervelets découpés et asservis aux passions les plus vulgaires et les plus automatiques.
Déshumanisation, désarticulation, pessimisme
 Une des peintures les plus justement célèbres de Dix, la Rue de Prague en 1920, fournit un parfait résumé des thèmes de l'époque. D'une manière particulièrement féroce, Dix place les corps désarticulés de deux infirmes à proximité des brillantes vitrines de cette rue commerçante de Dresde, dans lesquelles sont exposés les mannequins et autres bustes sans pattes. Le processus de déshumanisation est complet, les infirmes détraqués, derniers restes de l'humain trouvent leur exact répondant dans la vie des marionnettes. La composition du tableau —huile et collage— accentue d'autant plus la désarticulation des corps, la régression des mouvements et pensées humains à des processus mécaniques dont l'aboutissement symbolique est la prothèse. Nihilisme, pessimisme complet, dégoût et aversion affichée pour la société, il y a sans doute un peu de tout cela.
Une des peintures les plus justement célèbres de Dix, la Rue de Prague en 1920, fournit un parfait résumé des thèmes de l'époque. D'une manière particulièrement féroce, Dix place les corps désarticulés de deux infirmes à proximité des brillantes vitrines de cette rue commerçante de Dresde, dans lesquelles sont exposés les mannequins et autres bustes sans pattes. Le processus de déshumanisation est complet, les infirmes détraqués, derniers restes de l'humain trouvent leur exact répondant dans la vie des marionnettes. La composition du tableau —huile et collage— accentue d'autant plus la désarticulation des corps, la régression des mouvements et pensées humains à des processus mécaniques dont l'aboutissement symbolique est la prothèse. Nihilisme, pessimisme complet, dégoût et aversion affichée pour la société, il y a sans doute un peu de tout cela.
Bien des toiles de cette époque pourraient être interprétées comme une allégorie méchante et sarcastique de la phrase de Leibniz selon laquelle “nous sommes automates dans la plus grande partie de nos actions”. L'absence de plan fixe, de point d'appui suggère cette dégringolade vers l'inhumain. Le rapprochement de certains tableaux de cette époque —Les invalides de guerre, 1920— avec les caricatures de George Grosz est évident, mais celui-ci trouve bientôt ses limites, car très vite il apparaît que si la source de tout mal pour Grosz se situe dans la rivalité entre classes, pour Dix, le mal est beaucoup plus profond. La société tout entière se vend, tel est le thème du grand triptyque de 1927-1928, La grande ville, misère et concupiscence d'une part, apparence de richesse, faste et vénalité de l'autre. Rien ne rachète rien. On a souvent reproché à Dix son attirance pour la laideur, la déchéance physique et la violence avec laquelle il traite ses sujets. La volonté de provocation rentre directement en ligne de compte, mais plus profondément, ces thèmes se présentaient comme un renouvellement de la peinture. Il avouait d'ailleurs: “j'ai eu le sentiment, en voyant les tableaux peints jusque là, qu'un côté de la réalité n'était pas encore représenté, à savoir la laideur”.
Haut-le-cœur, immuables laideurs
Si l'impressionnisme a porté le réalisme jusqu'à son accomplissement ce qui n'était pas sans signifier l'épuisement de ces ressources, les tentatives des années vingt restent exemplaires. Le beau classique s'était mû en un affadissement de la réalité, la perte de la force inhérente à la peinture ne pouvait être contrecarrée d'une part, que par une abstraction de plus en plus poussée à laquelle tend toute la peinture moderne, de l'autre, par la confrontation avec un réel non encore édulcoré. Naturellement, de la façon dont Dix, animé d'une sourde révolte, tire sur les conformismes du temps, on comprend le haut-le-cœur des contemporains devant ces corps qui semblent jouir du seul privilège de leur immuable laideur. Aujourd'hui cependant, le spectateur n'est pas sans sourire à cette atmosphère encanaillée des pièces de Brecht, aux voix légèrement discordantes, le parler-peuple de l'Opéra de Quatre-sous. Il en est de même de la caricature de la société de Weimar, attaque frontale contre les vices et vertus de l'époque à laquelle procède méthodiquement Dix, époque de vieux, de nus grossiers, de mères maquerelles, de promenades dominicales pour employés de commerce.
La toile Les Amants inégaux de 1925, dont il existe également une étude à l'aquarelle, condense particulièrement les obsessions chères à Dix. Un vieillard essaie péniblement d'étreindre une jeune femme aux formes imposantes qui se tient sur ses genoux. Le caractère vain du désir, l'intrusion de la mort dans les jeux de l'amour que symbolisent les longues mains décharnées du vieillard forment une danse étonnante de l'aplomb et de la lassitude, de la force charnelle et de sa disparition.
les révélations des autoportraits
Dix a tout au long de sa vie produit un grand nombre de portraits. L'exposition de Stuttgart en 1991 a montré le fabuleux coloriste qu'il fut. Il affectionne les rouges sang, le fard blanc qui donne aux visages quelque chose du masque, de tendu et de crispé, et les variations de noir et de marron que fournit la fourrure de Martha Dix dans le magnifique portrait de 1923. Selon l'aveu même du peintre, l'accentuation des traits jusqu'à la caricature ne peut que dévoiler l'âme du personnage et la résume d'une façon à peu près infaillible. Il n'est pas interdit de retourner cette remarque à Dix lui même, car il n'est pas sans se projetter dans sa peinture et tout d'abord, dans les nombreux autoportraits que nous disposons de lui. L'esprit qui anime les peintures de l'entre-deux guerres se retrouvent ici aisément: l'Autoportrait avec cigarettes de 1922, une gravure, partage la brutalité des personnages qu'il met en scène. Dix se présente les cheveux gominés, les sourcils froncés, le front décidément obtus, la machoire carrée, bref, une aimable silhouette de brute épaisse dont seul la finesse du nez trahit des instincts plus fins que viennent encore démentir la clope posée entre les lèvres serrées. Qui pourrait nier que ces autoportraits fournissent des équivalences assez exactes de la rudesse et de la brutalite de la peinture de Dix?
Art dégénéré ou retour du primitivisme allemand?
A partir de 1927, Dix fut nomme professeur à 1'Académie des Beaux-Arts de Dresde. En 1933, quelques temps après 1'arrivée au pouvoir du nouveau régime, il est licencié. Dix représentait pour le régime nazi le prototype de l'art au service de la décadence, et des œuvres tels que Tranchées, Invalides de guerre, eurent l'honneur de figurer dans l'exposition itinérante ”d'art dégenéré” organisée par la Propagande du Reich en 1937, plaçant Dix dans une situation délicate. Il est clair que Dix n'a jamais temoigné un grand intérêt pour la chose politique, refusant toute adhésion partisane avec force sarcasmes. Mais, rétrospectivement, ces jugements apparaissent d'autant plus absurdes que la manière de Dix depuis la fin des années vingt avait déjà considérablement évoluée et témoignait d'un très grand intérêt pour la technique des primitifs allemands que le régime vantait d'autre part. Situation ô combien absurde, mais qui devait grever toute la production des années trente.
En 1936, 1'insécurité présente en Saxe l'incite à s'installer avec sa famille sur les bords du lac de Constance dans la bourgade de Hemmenofen. A l'exil intérieur dans lequel il vit, correspond une production toute entière consacrée aux paysages et aux thèmes religieux. Tous ces tableaux montrent une maîtrise peu commune, l'utilisation des couches de glacis superposés, fidèle aux primitifs allemands du seizième, permet une extraordinaire précision et la description du moindre détail. Si Dix a pu dire qu'il avait été condamné au paysage qui, certes, ne correspondait pas au premier mouvement de son âme, on reste néanmoins émerveillé par certaines de ses compositions. Randegg sous la neige avec vol de corbeaux de 1935: la nuit de 1'hiver enclot le village recouvert d'une épaisse couche de neige, les arbres qui se dressent dénudés évoquent les tableaux de Caspar David Friedrich, unité que seule perçoit le regard du peintre. Loin de se contenter d'un plat réalisme, cet ensemble n'a jamais rendu aussi finement la présence du peintre, léger recul et participation tout à la fois à l'univers qui l'entoure.
Devant les gribouilleurs et autres tâcherons copieurs de la manière ancienne aux ordres des nouveaux impératifs, et dans une période où l'humour est si absent des œuvres de Dix, celui-ci semble dire magistral: “Tas de boeufs, vous voulez du primitif, en voilà!”. Art de plus en plus contraint à mesure que passaient les années, mais au moyen duquel Dix exposait une facette majeure de sa personnalité. Dès 1944, il éprouvait le besoin d'en finir avec cette technique minutieuse, exigeante qui bridait son besoin de créativité. La dynamique formelle reprend vivement le dessus dans ses Arbres en Automne de 1945 où les couleurs explosent à nouveau triomphantes. Les peintures de la fin de sa vie renouent avec la grossièreté des traits des œuvres des années vingt.
Peu reconnu par la critique alors que le combat pour l'art abstrait battait son plein, Dix est resté, dans ces années, en marge des nouveaux courants artistiques auxquels il n'éprouvait aucunement le besoin d'adhérer. Les thèmes religieux, ou plutôt une imagerie de la bible qu'il essaie étrangement de concilier avec la philosophie de Nietzsche, tiennent dans cette période un rôle fondamental. Sa peinture semble parvenir à une économie de moyens qui rend très émouvantes certaines de ses toiles —Enfant assis, Enfant de réfugiés, 1952—, la prédisposition de Dix pour les couleurs n'a jamais été aussi présente, l'Autoportrait en prisonnier de guerre de 1947 est organisé autour des taches de couleur, plaquées sur un personnage muet, vieilli, dont les traits se sont encore creusés. Après plusieurs années de vaches maigres, les honneurs des deux Allemagnes se succédèrent —il resta toujours attaché à Dresde où il se déplaçait régulièrement . Atteint d'une première attaque en 1967 qui le laissa amoindri, il devait néanmoins poursuivre son travail jusqu'à sa mort deux ans plus tard. Un des ces derniers autoportraits, l'Artiste en tête de mort, montre le crâne du peintre ricanant ceint de la couronne de laurier, image troublante qui rejette au loin les nullissimes querelles entre art figuratif et art abstrait.
Guillaume HIEMET.
Les citations sont tirées de : Eva KARCHNER, Otto Dix 1891-1969, Sa vie, son œuvre, Benedikt Taschen, 1989.
00:05 Publié dans art | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art, peinture, allemagne, weimar, otto dix, art plastique, années 20, années 30, expressionnisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 03 décembre 2010
Fauves français, expressionnistes allemands: "la peinture n'est pas un soulagement"
Fauves français, expressionnistes allemands : « la peinture n’est pas un soulagement »
par Pierre LE VIGAN
Ex: http://www.europemaxima.com/
 Quand deux mouvements artistiques se rencontrent, cela enrichit souvent les deux. C’est ce que démontre le Musée Monet-Marmottan avec l’exposition « Fauves et expressionnistes ». D’un côté, on trouve les « Fauves » français, de l’autre les expressionnistes allemands. Les œuvres exposées viennent du musée von der Heydt de Wuppertal, en Rhénanie du Nord. Les « Fauves », c’est Raoul Dufy (Le Port du Havre, 1906), Georges Braque, Auguste Herbin (Portrait de jeune fille, 1907), Maurice de Vlaminck (Trois maisons, 1910), Kees van Dongen, néerlandais d’origine (Nu couché, 1910), André Derain, Robert Delaunay… Du côté allemand, on trouve principalement deux groupes. Ils furent tous deux annoncés par la révolution artistique du Norvégien Edvard Munch (Jeune fille au chapeau rouge, 1905). L’un de ces groupes est Le Pont (Die Brücke). C’est une école artistique fondée à Dresde en 1905. Erich Heckel dira à propos du choix du nom, Le Pont , « parce que c’était un mot à double sens, et qui ne désignerait pas un programme précis, mais conduirait dans un certain sens d’une rive à l’autre ».
Quand deux mouvements artistiques se rencontrent, cela enrichit souvent les deux. C’est ce que démontre le Musée Monet-Marmottan avec l’exposition « Fauves et expressionnistes ». D’un côté, on trouve les « Fauves » français, de l’autre les expressionnistes allemands. Les œuvres exposées viennent du musée von der Heydt de Wuppertal, en Rhénanie du Nord. Les « Fauves », c’est Raoul Dufy (Le Port du Havre, 1906), Georges Braque, Auguste Herbin (Portrait de jeune fille, 1907), Maurice de Vlaminck (Trois maisons, 1910), Kees van Dongen, néerlandais d’origine (Nu couché, 1910), André Derain, Robert Delaunay… Du côté allemand, on trouve principalement deux groupes. Ils furent tous deux annoncés par la révolution artistique du Norvégien Edvard Munch (Jeune fille au chapeau rouge, 1905). L’un de ces groupes est Le Pont (Die Brücke). C’est une école artistique fondée à Dresde en 1905. Erich Heckel dira à propos du choix du nom, Le Pont , « parce que c’était un mot à double sens, et qui ne désignerait pas un programme précis, mais conduirait dans un certain sens d’une rive à l’autre ».
Avec Le Pont, ce qui était à l’ordre du jour, c’était de se dégager des pesanteurs, de retourner à l’origine. Des nus sont peints en plein air, exprimant le bonheur et la liberté des corps. C’est d’abord la période berlinoise vers 1911 puis, très vite, l’éclatement du groupe à partir de 1913. Chacun trace alors son propre sillon. C’est la montée en maîtrise artistique de Karl Schmidt-Rottluff (Deux femmes, 1914), Ernst Ludwig Kirchner, un des plus grands (Quatre baigneuses, 1910; Femmes dans la rue, 1914), Otto Müller (Deux filles se baignant, 1921, Autoportrait avec pentagramme, 1922), Emil Nolde (Crépuscule, 1916), Erich Heckel (Portrait d’Otto Müller, 1925, aquarelle), Max Pechstein (Portrait masculin, auto-portrait, 1917)…
Il se crée à côté des artistes de Die Brücke le N.K.V.M. (la Nouvelle association des artistes de Munich). Elle est fondée en 1909. L’ambition est peut-être plus grande encore qu’avec Le Pont, il s’agit de déterminer une nouvelle orientation spirituelle. L’état d’esprit est « un retour à l’homme primitif, proche de la nature et sans faute ». C’est la recherche d’un monde sans péché. L’influence de l’art nègre est sensible même si l’enracinement dans les influences européennes reste prépondérant. Le mouvement est plein de vitalité mais disparate : Alexej von Jawlensky, peu convaincant, côtoie le très remarquable Adolf Erbslöh (Maison dans le jardin, 1912, Jardin des parents de l’artiste à Barmen, 1912), le Russe Vassily Kandinsky avec sa formidable Église villageoise sur les bords du lac de Rieg (1908), Wladimir von Bechtejeff, qui atteint souvent au chef d’œuvre comme avec Rencontre sur un bord de rivière (sans date), et encore Gabriele Münter, une des rares femmes (Paysage sous le givre, 1911), Wilhem Morgner, plus inégal… Forces des couleurs et expression du mouvement sont les principes.
 En 1911, par scission du N.K.V.M. est fondé le mouvement Le Cavalier Bleu (Der Blaue Reiter) avec August Macke, Franz Marc, Paul Klee (le moins doué) et Vassily Kandinsky. L’idée du nom vient du Cavalier Bleu de Kandinsky (1903) tout autant que de la prédilection de Franz Marc pour les dessins et peintures de chevaux (Cheval bleu, 1911). Kandinsky déclare : « Le cheval porte son cavalier avec vigueur et rapidité, mais c’est le cavalier qui conduit le cheval. Le talent conduit l’artiste à de hauts sommets, mais c’est l’artiste qui maîtrise son talent ». August Macke, qui fut une des figures du N.K.V.M. illustre superbement la vitalité du Cavalier Bleu à ses débuts (Paysage avec trois jeunes filles, 1911). Il meurt sur le front de Champagne à 27 ans. Franz Marc est un artiste majeur lui aussi, c’est sans doute un des plus doués, des plus nets et affirmés du groupe (Renard d’un bleu noir, 1911). Il meurt en 1916 près de Verdun.
En 1911, par scission du N.K.V.M. est fondé le mouvement Le Cavalier Bleu (Der Blaue Reiter) avec August Macke, Franz Marc, Paul Klee (le moins doué) et Vassily Kandinsky. L’idée du nom vient du Cavalier Bleu de Kandinsky (1903) tout autant que de la prédilection de Franz Marc pour les dessins et peintures de chevaux (Cheval bleu, 1911). Kandinsky déclare : « Le cheval porte son cavalier avec vigueur et rapidité, mais c’est le cavalier qui conduit le cheval. Le talent conduit l’artiste à de hauts sommets, mais c’est l’artiste qui maîtrise son talent ». August Macke, qui fut une des figures du N.K.V.M. illustre superbement la vitalité du Cavalier Bleu à ses débuts (Paysage avec trois jeunes filles, 1911). Il meurt sur le front de Champagne à 27 ans. Franz Marc est un artiste majeur lui aussi, c’est sans doute un des plus doués, des plus nets et affirmés du groupe (Renard d’un bleu noir, 1911). Il meurt en 1916 près de Verdun.
D’autres artistes se rattachent aussi à cette sensibilité : le grand Max Beckmann (Autoportrait en infirmier, 1915; Vue à Berlin du quartier de la gare de Gesundbrunnen, 1914), Otto Dix, créatif mais un peu désarticulé, Georg Grosz, baroque et tourmenté, Conrad Felixmüller (Autoportrait avec femme, 1920), au projet artistique très cohérent et sûr, Christian Rohlfs (Jouvencelles, 1915)… C’est le courant de la Nouvelle Objectivité (Neue Sachlichkeit).
On y trouve aussi le puissant Franz Radziwill (Sombre paysage, 1923), Karl Hubbuch, jubilatoire et inspiré, Otto Griebel, peintre se voulant « prolétarien » et à vrai dire inégal… La Nouvelle Objectivité se scinda en deux : une aile « droite », qui fait parfois penser à Giorgio de Chirico, en moins apprêté, et une aile « gauche », proche des bolchéviques russes et allemands, à vrai dire fort loin du néo-classicisme stalinien vers lequel évoluera le bolchévisme culturel. Comme quoi la modernité est toujours ambivalente.
La notion d’authenticité sera toujours importante chez les expressionnistes. Emil Nolde le montrera sans cesse. De son côté, Max Pechstein, chassé de Poméranie par les Russes en 1945, écrira alors : « Mais qu’est-ce [que mes plaisirs actuels de création] en comparaison avec ma frénésie créative dans ma Poméranie bien aimée ? La vie authentique dans une nature authentique me manque. Je brûle d’y retourner et suis constamment nostalgique. J’espère pouvoir avoir encore une fois l’occasion d’y séjourner ». Cela ne se fera pas.
C’est Otto Dix qui constitue le point d’aboutissement de l’exposition. Il fut un exilé intérieur sous Hitler, même si en 1933 Goebbels avait salué « les saines conceptions de ce mouvement » (l’expressionnisme). Otto Dix avait marqué un tournant. À propos de son tableau À la beauté (1922), Lionel Richard a écrit : « L’Hommage à la Beauté d’Otto Dix, tableau de 1922, met en spectacle avec ironie cette défaite et cet effacement de l’expressionnisme. Le peintre en personne est au centre. Costume élégant, toilette soignée. Ce dandy tient dans une main l’écouteur d’un téléphone. Arrière-fond, un décor artificiel de style néo-classique, avec un salon de danse où un musicien noir rythme du jazz à la batterie. »
On a reproché aux expressionnistes allemands de se complaire dans la peinture des médiocrités du monde moderne voire des horreurs de la guerre. Pourtant, Otto Dix affirmait : « Je ne suis pas obsédé par le fait de montrer des choses horribles. Tout ce que j’ai vu était beau ». Il disait encore : « La peinture n’est pas un soulagement. La raison pour laquelle je peins est le désir de créer. Je dois le faire ! J’ai vu ça, je peux encore m’en souvenir, je dois le peindre ».
Pierre Le Vigan
• Exposition Fauves et expressionnistes. De Van Dongen à Otto Dix. Chefs d’œuvres du musée Von der Heydt, jusqu’au 20 février 2010. Musée Marmottan Monet, 2 rue Louis-Boilly 75016 Paris, Tél : 01.44.96.50.33. Catalogue Éditions Hazan.
Article printed from Europe Maxima: http://www.europemaxima.com
URL to article: http://www.europemaxima.com/?p=920
00:10 Publié dans art | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art, fauvisme, expressionnisme, avant-gardes, peinture, art plastique, france, allemagne, événement |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 02 décembre 2010
La CIA, mécène de l'expressionnisme abstrait
|
La CIA, mécéne de l’expressionnisme abstrait Ex: http://www.voltairenet.org/ L’historienne Frances Stonor Saunders, auteure de l’étude magistrale sur la CIA et la guerre froide culturelle, vient de publier dans la presse britannique de nouveaux détails sur le mécénat secret de la CIA en faveur de l’expressionnisme abstrait. La Repubblica s’interroge sur l’usage idéologique de ce courant artistique. |
|
|
Jackson Pollock, Robert Motherwell, Willem de Kooning, Mark Rothko. Rien moins que faciles et même scandaleux, les maîtres de l’expressionnisme abstrait. Un courant vraiment à contre-courant, une claque aux certitudes de la société bourgeoise, qui pourtant avait derrière elle le système lui-même. Car, pour la première fois, se confirme une rumeur qui circule depuis des années : la CIA finança abondamment l’expressionnisme abstrait. Objectif des services secrets états-uniens : séduire les esprits des classes qui étaient loin de la bourgeoisie dans les années de la Guerre froide. Ce fut justement la CIA qui organisa les premières grandes expositions du New American Painting, qui révéla les œuvres de l’expressionnisme abstrait dans toutes les principales villes européennes : Modern Art in the United States (1955) et Masterpieces of the Twentieth Century (1952). Donald Jameson, ex fonctionnaire de l’agence, est le premier à admette que le soutien aux artistes expressionnistes entrait dans la politique de la « laisse longue » (long leash) en faveur des intellectuels. Stratégie raffinée : montrer la créativité et la vitalité spirituelle, artistique et culturelle de la société capitaliste contre la grisaille de l’Union soviétique et de ses satellites. Stratégie adoptée tous azimuts. Le soutien de la CIA privilégiait des revues culturelles comme Encounter, Preuves et, en Italie, Tempo presente de Silone et Chiaramonte. Et des formes d’art moins bourgeoises comme le jazz, parfois, et, justement, l’expressionnisme abstrait. Les faits remontent aux années 50 et 60, quand Pollock et les autres représentants du courant n’avaient pas bonne presse aux USA. Pour donner une idée du climat à leur égard, rappelons la boutade du président Truman : « Si ça c’est de l’art, moi je suis un hottentot ». Mais le gouvernement US, rappelle Jameson, se trouvait justement pendant ces années-là dans la position difficile de devoir promouvoir l’image du système états-unien et en particulier d’un de ses fondements, le cinquième amendement, la liberté d’expression, gravement terni après la chasse aux sorcières menée par le sénateur Joseph McCarthy, au nom de la lutte contre le communisme.
Pour ce faire, il était nécessaire de lancer au monde un signal fort et clair de sens opposé au maccarthysme. Et on en chargea la CIA, qui, dans le fond, allait opérer en toute cohérence. Paradoxalement en effet, à cette époque l’agence représentait une enclave « libérale » dans un monde qui virait décisivement à droite. Dirigée par des agents et salariés le plus souvent issus des meilleures universités, souvent eux-mêmes collectionneurs d’art, artistes figuratifs ou écrivains, les fonctionnaires de la CIA représentaient le contrepoids des méthodes, des conventions bigotes et de la fureur anti-communiste du FBI et des collaborateurs du sénateur McCarthy. « L’expressionnisme abstrait, je pourrais dire que c’est justement nous à la CIA qui l’avons inventé —déclare aujourd’hui Donald Jameson, cité par le quotidien britannique The Independent [1]— après avoir jeté un œil et saisi au vol les nouveautés de New York, à Soho. Plaisanteries à part, nous avions immédiatement vu très clairement la différence. L’expressionnisme abstrait était le genre d’art idéal pour montrer combien était rigide, stylisé, stéréotypé le réalisme socialiste de rigueur en Russie. C’est ainsi que nous décidâmes d’agir dans ce sens ». Mais Pollock, Motherwell, de Kooning et Rothko étaient-ils au courant ? « Bien sûr que non —déclare immédiatement Jameson— les artistes n’étaient pas au courant de notre jeu. On doit exclure que des gens comme Rothko ou Pollock aient jamais su qu’ils étaient aidés dans l’ombre par la CIA, qui cependant eut un rôle essentiel dans leur lancement et dans la promotion de leurs œuvres. Et dans l’augmentation vertigineuse de leurs gains ».
[1] « Modern art was CIA ’weapon’ », par Frances Stonor Saunders, The Independent, 22 octobre 2010.
|
00:20 Publié dans art | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : art, peinture, arts plastiques, expressionnisme, cia, manipulation médiatiques, art moderne, art abstrait, impérialisme, etats-unis |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
L'ombra progressista della CIA
|
L'ombra progressista della CIA |
|
L'Agenzia sostenne l'espressionismo astratto di Pollock & co Jackson Pollock, Robert Motherwell, Willem de Kooning, Mark Rothko. Per niente facili e anche scandalosi, i maestri dell'Espressionismo astratto. Corrente davvero controcorrente, una spallata alle certezze estetiche della società borghese, che però aveva dietro il sistema stesso. Perché, per la prima volta, trova conferma una voce circolata per anni: la Cia finanziò abbondantemente l'Espressionismo astratto. Obiettivo dell'intelligence Usa, sedurre le menti delle classi lontane dalla borghesia negli anni della Guerra Fredda. Fu proprio la Cia a organizzare le prime grandi mostre del "new american painting", che rivelò le opere dell'Espressionismo astratto in tutte le principali città europee: "Modern art in the United States" (1955) e "Masterpieces of the Twentieth Century" (1952). Donald Jameson, ex funzionario dell'agenzia, è il primo ad ammettere che il sostegno agli artisti espressionisti rientrava nella politica del "guinzaglio lungo" (long leash) in favore degli intellettuali. Strategia raffinata: mostrare la creatività e la vitalità spirituale, artistica e culturale della società capitalistica contro il grigiore dell'Uonione sovietica e dei suoi satelliti. Strategia adottata a tutto campo. Il sostegno della Cia privilegiava riviste culturali come "Encounter", "Preuves" e, in Italia, "Tempo presente" di Silone e Chiaromonte. E forme d'arte meno borghesi come il jazz, talvolta, e appunto, l'espressionismo astratto.
|
Noreporter - Tutti i nomi, i loghi e i marchi registrati citati o riportati appartengono ai rispettivi proprietari. È possibile diffondere liberamente i contenuti di questo sito .Tutti i contenuti originali prodotti per questo sito sono da intendersi pubblicati sotto la licenza Creative Commons Attribution-NoDerivs-NonCommercial 1.0 che ne esclude l'utilizzo per fini commerciali.I testi dei vari autori citati sono riconducibili alla loro proprietà secondo la legacy vigente a livello nazionale sui diritti d'autore.
00:20 Publié dans art | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art, arts plastiques, peinture, expressionnisme, expressionnisme abstrait, art moderne, art abstrait, cia, manipulation médiatique, etats-unis, services secrets |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 08 novembre 2010
Fidus: c'est ainsi que se voyait la jeunesse
Michael MORGENSTERN :
Fidus : c’est ainsi que se voyait la jeunesse
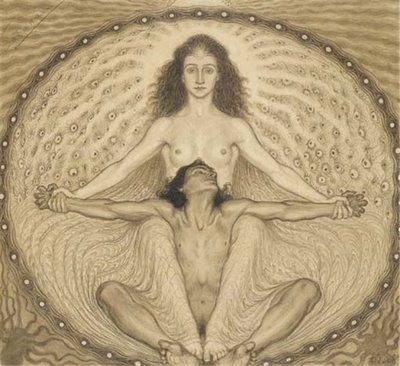 « Ce qui s’avère nécessaire pour nous, maintenant, ce n’est pas encore davantage d’artificialité ou de luxe technique, mais de nous habituer à éprouver à nouveau de la joie face à notre authenticité spirituelle et à la naturalité de nos corps ; oui, vraiment, nous avons besoin d’apprendre à tolérer la beauté naturelle, du moins dans le domaine de l’art », écrivait Fidus dans le volume édité par Eugen Diederichs pour donner suite de la fameuse rencontre organisée par le mouvement de jeunesse allemand sur le sommet du Hoher Meissner en 1913. Le motif qui l’avait incité à écrire ces lignes fut l’exposition d’un dessin qu’il avait réalisé à l’occasion de cette réunion des jeunes du Wandervogel, un dessin qui s’intitulait « Hohe Wacht » et qui représentait de jeunes hommes nus portant l’épée et aux pieds desquels se trouvaient couchées des jeunes filles, également nues. L’image avait causé un scandale. Plus tard, un dessin de Fidus deviendra l’image culte et le symbole du mouvement de jeunesse ; il était intitulé « Lichtgebet », « Prière à la Lumière ». Sur un rocher isolé, un jeune homme nu étendait les bras et le torse vers le soleil, le visage empreint de nostalgie.
« Ce qui s’avère nécessaire pour nous, maintenant, ce n’est pas encore davantage d’artificialité ou de luxe technique, mais de nous habituer à éprouver à nouveau de la joie face à notre authenticité spirituelle et à la naturalité de nos corps ; oui, vraiment, nous avons besoin d’apprendre à tolérer la beauté naturelle, du moins dans le domaine de l’art », écrivait Fidus dans le volume édité par Eugen Diederichs pour donner suite de la fameuse rencontre organisée par le mouvement de jeunesse allemand sur le sommet du Hoher Meissner en 1913. Le motif qui l’avait incité à écrire ces lignes fut l’exposition d’un dessin qu’il avait réalisé à l’occasion de cette réunion des jeunes du Wandervogel, un dessin qui s’intitulait « Hohe Wacht » et qui représentait de jeunes hommes nus portant l’épée et aux pieds desquels se trouvaient couchées des jeunes filles, également nues. L’image avait causé un scandale. Plus tard, un dessin de Fidus deviendra l’image culte et le symbole du mouvement de jeunesse ; il était intitulé « Lichtgebet », « Prière à la Lumière ». Sur un rocher isolé, un jeune homme nu étendait les bras et le torse vers le soleil, le visage empreint de nostalgie.
Fidus, un artiste célèbre de l’Art Nouveau (Jugendstil) et l’interprète graphique de la « Réforme de la Vie » (Lebensreform) et du néopaganisme, était né sous le nom de Hugo Höppener à Lübeck en 1868, dans le foyer d’un pâtissier. Ses parents l’envoyèrent à l’Académie des Beaux-Arts de Munich, où, très rapidement, il se lia d’amitié avec un peintre excentrique, apôtre d’une nouvelle adhésion à la nature, Karl-Wilhelm Diefenbach. Celui-ci, accompagné de quelques-uns de ses élèves, se retirait régulièrement dans une ancienne carrière abandonnée sur une rive de l’Isar pour y vivre selon les principes du mouvement « Réforme de la Vie ». Diefenbach pratiquait le naturisme, ce qui alerta les autorités bavaroises qui, très vite, firent condamner le fauteur de scandale à la prison. Höppener accepta de suivre son maître en prison, ce qui induisit Diefenbach à le surnommer « Fidus », le Fidèle.
Plus tard, revenu à Berlin, il prendra pour nom d’artiste le surnom que lui avait attribué son maître. Dans la capitale prussienne, il fut d’abord l’illustrateur d’une revue théosophique, Sphinx, ce qui lui permit d’accéder assez vite à la bohème artistique et littéraire berlinoise. Dès ce moment, on le sollicita constamment pour illustrer des livres et des revues ; il travailla aussi pour la revue satirique Simplizissimus puis pour la revue munichoise Jugend, créée en 1896. Cette revue doit son nom au Jugendstil, au départ terme injurieux pour désigner les nouvelles tendances en art. Contrairement au naturalisme, alors en vogue, le Jugendstil voulait inaugurer un style inspiré d’un monde posé comme harmonieux et empreint de spiritualité, que l’on retrouve dans l’univers onirique, dans les contes, dans les souvenirs d’enfance ; et inspiré aussi d’une nostalgie de la plénitude. Une ornementation végétale devait symboliser le refus du matérialisme banal de la société industrielle. Suite à une cure végétarienne de blé égrugé, qui le débarrassa d’une tumeur qui le faisait souffrir depuis son enfance, Fidus/Höppener devint un végétarien convaincu, ouvert, de surcroît, à toutes les médecines « alternatives ».
Il cherchait une synthèse entre l’art et la religion et se sentait comme le précurseur d’une nouvelle culture religieuse de la beauté qui entendait retrouver le sublime et le mystérieux. Cela fit de lui un visionnaire qui s’exprima en ébauchant des statues pour autels et des plans pour des halls festifs monumentaux (qui ne furent jamais construits). A ses côtés, dans cette quête, on trouve les frères Hart, Bruno Wille et Wilhelm Bölsche du cercle de Friedrichshagen, avec lesquels il fonda le « Bund Giordano Bruno », une communauté spirituelle et religieuse. En 1907, Fidus se fit construire une maison avec atelier dans le quartier des artistes « réformateurs » de Schönblick à Woltersdorf près de Berlin. Plus tard, une bâtisse supplémentaire s’ajouta à cet atelier, pour y abriter sa famille ; elle comptait également plusieurs chambres d’amis. Bien vite, cette maison devint le centre d’un renouveau religieux et un lieu de pèlerinage pour Wandervögel, Réformateurs de la Vie, Adorateurs de la Lumière et bouddhistes, qui voyaient en Fidus leur gourou. Le maître créa alors le « Bund de Saint Georges », nommé d’après le fils d’un pasteur de Magdebourg qui, après une cure de jeûne, était décédé à Woltersdorf. Fidus flanqua ce Bund d’une maison d’édition du même nom pour éditer et diffuser ses dessins, tableaux, impressions diverses et cartes postales. Dans le commerce des arts établis, le Jugendstil fut éclipsé par l’expressionisme et le dadaïsme après la première guerre mondiale.
 Les revenus générés par cette activité éditoriale demeurèrent assez sporadiques, ce qui obligea les habitants de la Maison Fidus, auxquels s’était jointe la femme écrivain du mouvement de jeunesse, Gertrud Prellwitz, à adopter un mode de vie très spartiate. L’avènement du national-socialisme ne changea pas grand chose à leur situation. Fidus avait certes placé quelque espoir en Adolf Hitler parce que celui-ci était végétarien et abstinent, voulait que les Allemands se penchent à nouveau sur leurs racines éparses, mais cet espoir se mua en amère déception. La politique culturelle nationale-socialiste refusa de reconnaître la pertinence des visions des ermites de Woltersdorf et stigmatisa « les héros solaires éthérés » de Fidus comme une expression de l’ « art dégénéré ». Dans le catalogue de l’exposition sur l’ « art dégénéré » de 1937, on pouvait lire ces lignes : « Tout ce qui apparaît, d’une façon ou d’une autre, comme pathologique, est à éliminer. Une figure de valeur, pleine de santé, même si, racialement, elle n’est pas purement germanique, sert bien mieux notre but que les purs Germains à moitié affamés, hystériques et occultistes de Maître Fidus ou d’autres originaux folcistes ». L’artiste ne recevait plus beaucoup de commandes. Beaucoup de revues du mouvement « Lebensreform » ou du mouvement de jeunesse, pour lesquelles il avait travaillé, cessèrent de paraître. Sa deuxième femme, Elsbeth, fille de l’écrivain Moritz von Egidy, qu’il avait épousée en 1922, entretenait la famille en louant des chambres d’hôte (« site calme à proximité de la forêt, jardin ensoleillé avec fauteuils et bain d’air, Blüthner-Flügel disponibles »). L’ « original folciste » a dû attendre sa 75ème année, en 1943, pour obtenir le titre de professeur honoris causa et pour recevoir une pension chiche, accordée parce qu’on avait finalement eu pitié de lui.
Les revenus générés par cette activité éditoriale demeurèrent assez sporadiques, ce qui obligea les habitants de la Maison Fidus, auxquels s’était jointe la femme écrivain du mouvement de jeunesse, Gertrud Prellwitz, à adopter un mode de vie très spartiate. L’avènement du national-socialisme ne changea pas grand chose à leur situation. Fidus avait certes placé quelque espoir en Adolf Hitler parce que celui-ci était végétarien et abstinent, voulait que les Allemands se penchent à nouveau sur leurs racines éparses, mais cet espoir se mua en amère déception. La politique culturelle nationale-socialiste refusa de reconnaître la pertinence des visions des ermites de Woltersdorf et stigmatisa « les héros solaires éthérés » de Fidus comme une expression de l’ « art dégénéré ». Dans le catalogue de l’exposition sur l’ « art dégénéré » de 1937, on pouvait lire ces lignes : « Tout ce qui apparaît, d’une façon ou d’une autre, comme pathologique, est à éliminer. Une figure de valeur, pleine de santé, même si, racialement, elle n’est pas purement germanique, sert bien mieux notre but que les purs Germains à moitié affamés, hystériques et occultistes de Maître Fidus ou d’autres originaux folcistes ». L’artiste ne recevait plus beaucoup de commandes. Beaucoup de revues du mouvement « Lebensreform » ou du mouvement de jeunesse, pour lesquelles il avait travaillé, cessèrent de paraître. Sa deuxième femme, Elsbeth, fille de l’écrivain Moritz von Egidy, qu’il avait épousée en 1922, entretenait la famille en louant des chambres d’hôte (« site calme à proximité de la forêt, jardin ensoleillé avec fauteuils et bain d’air, Blüthner-Flügel disponibles »). L’ « original folciste » a dû attendre sa 75ème année, en 1943, pour obtenir le titre de professeur honoris causa et pour recevoir une pension chiche, accordée parce qu’on avait finalement eu pitié de lui.
Pour les occupants russes, qui eurent à son égard un comportement respectueux, Fidus a peint des projets d’affiche pour la célébration de leur victoire, pour obtenir « du pain et des patates », comme il l’écrit dans ses mémoires en 1947. Le 23 février 1948, Fidus meurt dans sa maison. Ses héritiers ont respecté la teneur de son testament : conserver la maison intacte, « comme un lieu d’édification, source de force ». Jusqu’au décès de sa veuve en 1976, on y a organisé conférences et concerts. La belle-fille de Fidus a continué à entretenir vaille que vaille la maison, en piteux état, jusqu’à sa propre mort en 1988. La RDA avait classé le bâtiment. Les œuvres d’art qui s’y trouvaient avaient souffert de l’humidité et du froid : en 1991, la « Berlinische Galerie » a accepté de les abriter. La maison de Fidus est aujourd’hui vide et bien branlante, une végétation abondante de ronces et de lierres l’enserre, d’où émerge sa façade en pointe, du type « maison de sorcière ». Il n’y a plus qu’un sentier étroit qui mène à une porte verrouillée.
Michael MORGENSTERN.
(article paru dans « Junge Freiheit », n°5/1995 ; http://www.jungefreiheit.de/ - « Serie : Persönlichkeiten der Jugendbewegung / Folge 2 : Fidus » - « Série : Personnalités du Mouvement de Jeunesse / 2ième partie : Fidus » ; trad.. franc. : octobre 2010).
00:05 Publié dans art, Mouvements de jeunesse, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, art, peinture, dessin, artsplastiques, mouvement de jeunesse, jeunesse, weimar, jugendstil, art nouveau, fidus, années 20, années 30, années 40, révolution conservatrice, lebensreform, wandervogel, naturisme, fkk |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 31 octobre 2010
Archère par Dragos Kalajic

En souvenir de nos universités d'été communes, cher Dragos, et de notre intervention à Milan en 1999 contre l'intervention de l'OTAN en Serbie!
Que vive notre amitié au-delà de la mort !
00:10 Publié dans art | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : serbie, art, arts plastiques, peinture |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 30 octobre 2010
Aigle impérial par Dragos Kalajic

En souvenir de notre camarade serbe Dragos Kalajic, qui a quitté nos rangs trop tôt!
Notre souvenir ému !
00:10 Publié dans art | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : serbie, tradition, art, peinture, arts plastiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Filippo Marinetti
 Filippo Marinetti
Filippo Marinetti
The futurist response to the facts of the new age is therefore a quite unique reaction from the anti-liberal literati and artists and one that continues to influence certain aspects of industrial and post-industrial sub cultures. An example of a contemporary cultural movement paralleling Futurists is New Slovenian Art, which like futurism embodies music, graphic arts, architecture, and drama. It is a movement whose influence is felt beyond the borders of Slovenia. The best-known manifestation of this art form is the industrial music group Laibach.
Marinetti is also the inventor of free verse in poetry, and Futurist adherents have had a lasting impact on architecture, motion pictures and the theater. The Futurists were the pioneers of street theatre. They inspired both the Constructivist movement in the USSR and the English Vorticists Ezra Pound and Wyndham Lewis.
Marinetti was born in Alexandria Egypt in 1876. He graduated in law in Genoa in 1899. Although the political and philosophical aspects of the course held his interest, he traveled frequently between France and Italy and interested himself in the avant-garde arts of the later nineteenth Century promoting young poets in both countries. He was already a strong critic of the conservative and traditional approaches of Italian poets. He was at this time an enthusiast for the modern, revolutionary music of Wagner, seeing it as assailing “equilibrium and sobriety . . . meditation and silence . . . ”
By 1904, Futurist elements had manifested in his writing, particularly in his poem Destruction that he called “an erotic and anarchist poem,” a eulogy to the “avenging sea” as a symbol of revolution. After an apocalyptic destruction, the process of rebuilding begins on the ruins of the “Old World.” Here already is the praise of death as a dynamic and transformative.
 With the death of Marinetti’s father in 1907, his wealth allowed him to travel widely and he became a well-known cultural figure throughout Europe. Nietzsche was at this time one of the most well-known intellectuals who desired liberation from the old order. Nietzsche was widely read among the literati of Italy, and D’Annunzio was the most prominent in promoting Nietzsche. Among the other philosophers of particular importance whom Marinetti studied was the French syndicalist theorist Georges Sorel, who inclined towards the anarchism of Proudhon. This rejected Marxism in favor of a society comprised of small productive, cooperative units or syndicates; and founded a new myth of heroic action and struggle. Rejecting much of the pacifism of the left. Sorel viewed war as a dynamic of human action. Sorel in turn was himself influenced by Nietzsche, and applying the Nietzschean Overman to socialism, states that the working class revolution requires heroic leaders. Sorel became influential not only among Left wing syndicalists but also among certain radical nationalists in both France and Italy.
With the death of Marinetti’s father in 1907, his wealth allowed him to travel widely and he became a well-known cultural figure throughout Europe. Nietzsche was at this time one of the most well-known intellectuals who desired liberation from the old order. Nietzsche was widely read among the literati of Italy, and D’Annunzio was the most prominent in promoting Nietzsche. Among the other philosophers of particular importance whom Marinetti studied was the French syndicalist theorist Georges Sorel, who inclined towards the anarchism of Proudhon. This rejected Marxism in favor of a society comprised of small productive, cooperative units or syndicates; and founded a new myth of heroic action and struggle. Rejecting much of the pacifism of the left. Sorel viewed war as a dynamic of human action. Sorel in turn was himself influenced by Nietzsche, and applying the Nietzschean Overman to socialism, states that the working class revolution requires heroic leaders. Sorel became influential not only among Left wing syndicalists but also among certain radical nationalists in both France and Italy.
Futurist Manifesto
Marinetti’s artistic ideas crystallized in the Futurist movement that originated from a meeting of artists and musicians in Milan in 1909 to draft a Futurist Manifesto. With Marinetti were Carlo Carra, Umberto Boccioni, Luigi Russolo and Gino Severini. The manifesto was first published in the Parisian paper Le Figaro, and exhorted youth to, “Sing the love of danger, the habit of energy and boldness.”
 The Futurists were contemptuous of all tradition, of all that is past:
The Futurists were contemptuous of all tradition, of all that is past:
We want to exult aggressive motion . . . we affirm that the magnificence of the world has been enriched by a new beauty: the beauty of speed.
The machine was poetically eulogized. The racing car became the icon of the new epoch, “which seems to run as a machine gun.” The Futurist aesthetic was to be joy in violence and war, as “the sole hygiene of the world.” Motion, dynamic energy, action, and heroism were the foundations of “the culture of the Futurist future. The fisticuffs, the sprint and the kick were expressions of culture. The Futurist Manifesto is as much a challenge to the political and social order as it is to the status quo in the arts.
It declared:
1. We intend to sing the love of danger, the habit of energy and fearlessness.
2. Courage, audacity, and revolt will be essential elements of our poetry.
3. Up to now literature has exalted a pensive immobility, ecstasy, and sleep. We intend to exalt aggressive action, a feverish insomnia, the racer’s stride, the mortal leap, the punch and the slap.
4. We affirm that the world’s magnificence has been enriched by a new beauty: the beauty of speed A racing car whose hood is adorned with great pipes, like serpents of an explosive breath–a roaring car that seems to ride on grape shot is more beautiful than the victory of Samothrace.
5. We want to hymn the man at the wheel, who hurls the lance of his spirit across the Earth, along the circle of its orbit.
6. The poet must spend himself with ardor, splendor, and generosity, to swell the enthusiastic fervor of the primordial elements. Except in struggle, there is no more beauty. No work without an aggressive character can be a masterpiece. Poetry must be conceived as a violent attack on unknown forces, to reduce and prostrate them before man.
7. We stand on the last promontory of the centuries. Why should we look back when what we want is to break down the mysterious doors of the impossible? Time and space died yesterday. We already live in the absolute, because we have created eternal, omnipresent speed.
8. We will glorify war–the world’s only hygiene–militarism, patriotism, the destructive gesture of freedom-bringers, the beautiful ideas that kill, and scorn for women.
9. We will destroy the museums libraries academies of every kind, will fight moralism feminism, every opportunistic or utilitarian cowardice.
10. We will sing of great crowds excited by work, by pleasure, and by riot. We will sing of the multi-colored, polyphonic tides of revolution in the modem capitals, we will sing of the vibrant nightly fervor of arsenals and shipyards blazing with violent electric motors, greedy railway stations that devour smoke-plumed serpents, factories hung on clouds by the crooked lines of their smoke; bridges that stride the rivers like giant gymnasts, flashing in the sun with a glitter of knives; adventurous steamers that sniff the horizon: deep-chested locomotives whose wheels paw the tracks like the hooves of enormous steel horses bridled by tubing: and the sleek flight of planes whose propellers chatter in the wind like banners and seem to cheer like an enthusiastic crowd.
It is from Italy that we launch through the world this violently upsetting incendiary manifesto of ours. With it, today, we establish Futurism, because we want to free this land from its smelly gangrene of professors, archaeologists, ciceroni and antiquarians. For too long has Italy been a dealer in second-hand clothes. We mean to free her from the numberless museums that cover her like so many graveyards.
Museums: cemeteries! . . . Identical, surely, in the sinister promiscuity of so many bodies unknown to one another. Museums: public dormitories where one lies forever beside hated or unknown beings. Museums: absurd abattoirs of painters and sculptors ferociously slaughtering each other with color-blows and line-blows, the length of the fought-over walls!
That one should make an annual pilgrimage, just as one goes to the graveyard on All Souls’ Day, that we grant. That once a year one should leave a floral tribute beneath the Gioconda, I grant you that . . . but I don’t admit that our sorrows, our fragile courage, our morbid restlessness should be given a daily conducted tour through the museums. Why poison ourselves? Why rot? And what is there to see in an old picture except the laborious contortions of an artist throwing himself against the barriers that thwart his desire to express his dream completely? Admiring an old picture is the same as pouring our sensibility into a funerary urn instead of hurtling it far off in violent spasms of action and creation.
Do you then wish to waste all your best powers in this eternal and futile worship of the past, from which you emerge fatally exhausted, shrunken, beaten down?
In truth we tell you that daily visits to museums, libraries, and academies (cemeteries of empty exertion, Calvaries of crucified dreams, registries of aborted beginnings!) are, for artists, as damaging as the prolonged supervision by parents of certain young people drunk with their talent and their ambitious wills. When the future is barred to them, the admirable past may be a solace for the ills of the moribund, the sickly, the prisoner . . . But we want no part of it, the past, we the young and strong Futurists!
So let them come, the gay incendiaries with charred fingers! Here they are! Here they are! . . . Come on! set fire to the library shelves! Turn aside the canals to flood the museums! . . . Oh, the joy of seeing the glorious old canvases bobbing adrift on those waters, discolored and shredded! . . . Take up your pickaxes, your axes and hammers and wreck, wreck the venerable cities, pitilessly!
The oldest of us is thirty so we have at least a decade for finishing our work. When we are forty, other younger and stronger men will probably throw us in the wastebasket like useless manuscripts–we want it to happen!
They will come against us, our successors will come from far away, from every quarter, dancing to the winged cadence of their first songs, flexing the hooked claws of predators, sniffing dog-like at the academy doors the strong odor of our decaying minds which will have already been promised to the literary catacombs.
But we won’t be there . . . At last they’ll find us–one winter’s night–in open country, beneath a sad roof drummed by a monotonous rain. They’ll see us crouched beside our trembling aeroplanes in the act of warming our hands at the poor little blaze that our books of today will give out when they take fire from the flight of our images.
They’ll storm around us, panting with scorn and anguish, and all of them, exasperated by our proud daring, will hurtle to kill us. Driven by a hatred the more implacable the more their hearts will be drunk with love and admiration for us.
Injustice, strong and sane, will break out radiantly in their eyes. Art, in fact, can be nothing but violence, cruelty, and injustice.
The oldest of us is thirty: even so we have already scattered treasures, a thousand treasures of force, love, courage, astuteness, and raw will-power, have thrown them impatiently away, with fury, carelessly, unhesitatingly, breathless, and unresting . . . Look at us We are still untired! Our hearts know no weariness because they are fed with fire, hatred, and speed . . . Does that amaze you? It should, because you can never remember having lived! Erect on the summit of the world, once again, we hurl our defiance at the stars.
You have objections?–Enough! Enough! We know them . . . We’ve understood! . . . Our fine deceitful intelligence tells us that we are the revival and extension of our ancestors–Perhaps! . . . If only it were so!–But who cares? We don’t want to understand! . . . Woe to anyone who says those infamous words to us again! Lift up your heads. Erect on the summit of the world, once again we hurl our defiance after stars!”
A plethora of manifestos by Marinetti and his colleagues followed, futurist cinema, painting, music (“noise”), prose, plus the political and sociological implications.
Marinetti’s manifesto on war shows the central place violence and conflict have in the Futurist doctrine.
We Futurists, who for over two years, scorned by the Lame and Paralyzed, have glorified the love of danger and violence, praised patriotism and war, the hygiene of the world, are happy to finally experience this great Futurist hour of Italy, while the foul tribe of pacifists huddles dying in the deep cellars of the ridiculous palace at The Hague. We have recently had the pleasure of fighting in the streets with the most fervent adversaries of the war and shouting in their faces our firm beliefs:
1. All liberties should be given to the individual and the collectivity, save that of being cowardly.
2. Let it be proclaimed that the word Italy should prevail over the word Freedom.
3. Let the tiresome memory of Roman greatness be canceled by an Italian greatness a hundred times greater.
For us today, Italy has the shape and power of a fine Dreadnought battleship with its squadron of torpedo-boat islands. Proud to feel that the martial fervor throughout the nation is equal to ours, we urge the Italian government, Futurist at last, to magnify all the national ambitions, disdaining the stupid accusations of piracy, and proclaim the birth of Pan-Italianism.
Futurist poets, painters, sculptors, and musicians of Italy! As long as the war lasts let us set aside our verse, our brushes, scapulas, and orchestras! The red holidays of genius have begun! There is nothing for us to admire today but the dreadful symphonies of the shrapnel and the mad sculptures that our inspired artillery molds among the masses of the enemy.
Artistic Storm Trooper
Marinetti brought his dynamic character into an aggressive campaign to promote Futurism. The Futurists aimed to aggravate society out of bourgeoisie complacency and the safe existence through innovative street theater, abrasive art, speeches, and manifestos. The speaking style of Marinetti was itself bombastic and thunderous. The art was aggravating to conventional society and the art establishment. If a painting was that of a man with a mustache, the whiskers would be depicted with the bristles of a shaving brush pasted onto the canvas. A train would be depicted with the words “puff, puff.”
Both the words and deeds of the Futurists matched the nature of the art in expressing contempt for the status quo with its preoccupation with “pastism” or the “passe.” Marinetti for example, described Venice as “a city of dead fish and decaying houses, inhabited by a race of waiters and touts.”
To the Futurist Boccioni, Dante, Beethoven and Michelangelo were “sickening” Whilst Carra set about painting sounds, noises and even smells. Marinetti traversed Europe giving interviews, arranging exhibitions, meetings and dinners. Vermilion posters with huge block letters spelling ‘futurism’ were plastered throughout Italy on factories, in dance halls, cafes and town squares. Futurist performances were organized to provoke riot. Glue was put onto seats. Two tickets for the same seat would be sold to provoke a fight. “Noise music” would blare while poetry or manifestos were recited and paintings shown. Fruit and rotten spaghetti would be thrown from the audience, and the performances would usually end in brawls.
Marinetti replied to jeers with humor. He ate the fruit thrown at him. He welcomed the hostility as proving that Futurism was not appealing to the mediocre.
Politics

The first political contacts of Marinetti and the Futurists were from the Left rather than the Right, despite Marinetti’s extreme nationalism and call for war as the “hygiene of mankind.” There were syndicalists and even some anarchists who shared Marinetti’s views on the energizing and revolutionary nature of war and gave him a reception.
In 1909, Marinetti entered the general elections and issued a “First Political Manifesto” which is anti-clerical and states that the only Futurist political program is “national pride,” calling for the elimination of pacifism and the representatives of the old order. During that year, Marinetti was heavily involved in agitating for Italian sovereignty over Austrian-ruled Trieste. The political alliance with the extreme Left began with the anarcho-syndicalist Ottavio Dinale, whose paper reprinted the Futurist manifesto. The paper, La demolizione was not especially anarcho-syndicalist, but of a general combative nature, aiming to unite into one “fascio” all those of revolutionary tendencies, to “oppose with full energy the inertia and indolence that threatens to suffocate all life.” The phrase is distinctly Futurist.
Marinetti announced that he intended to campaign politically as both a syndicalist and a nationalist, a synthesis that would eventually arise in Fascism. In 1910, he forged links with the Italian Nationalist Association, which from its birth also had a pro-labor, syndicalist aspect. In 1913 a Futurist political manifesto was issued which called for enlargement of the military, an “aggressive foreign policy,” colonial expansionism, and “pan-Italianism”; a “cult” of progress, speed, and heroism; opposition to the nostalgia for monuments, ruins, and museums; economic protectionism, anti-socialism, anti-clericalism. The movement gained wide enthusiasm among university students.
Interventionism
The chance for Italy’s “place in the sun” came with World War I. Not only the nationalists were demanding Italy’s entry into the war, but so too were certain revolutionary syndicalists and a faction of socialists led by Mussolini. From the literati came D’Annunzio and Marinetti.
In a manifesto addressed to students in 1914 Marinetti states the purpose of Futurism and calls for intervention in the war. Futurism was the “doctor” to cure Italy of “pastism,” a remedy “valid for every country.” The “ancestor cult far from cementing the race” was making Italians “anaemic and putrid.” Futurism was now “being fully realized in the great world war.”
The present war is the most beautiful Futurist poem which has so far been seen. Futurism was the militarization of innovating artists.
The war would sweep away all the proponents of the old and senile, diplomats, professors, philosophers, archaeologists, libraries, and museums.
The war will promote gymnastics, sport, practical schools of agriculture, business and industrialists. The war will rejuvenate Italy: will enrich her with men of action, will force her to live no longer off the past, off ruins and the mild climate, but off her own national forces.
The Futurists were the first to organize pro-war protests. Mussolini and Marinetti held their first joint meeting in Milan on March 31st 1915. In April, both were arrested in Rome for organizing a demonstration.
Futurists were no mere windbags. Nearly all distinguished themselves in the war, as did Mussolini and D’Annunzio. The Futurist architect Sant Elia was killed. Marinetti enlisted with the Alpini regiment and was wounded and decorated for valor.
Futurist Party

In 1918, Marinetti began directing his attention to a new postwar Italy. He published a manifesto announcing the Futurist Political Party, which called for “Revolutionary nationalism” for both imperialism and social revolution. “We must carry our war to total victory.”
Demands of the manifesto included the eight hour day and equal pay for women, the nationalization and redistribution of land to veterans; heavy taxes on acquired and inherited wealth and the gradual abolition of marriage through easy divorce; a strong Italy freed, from nostalgia, tourists, and priests; industrialization and modernization of “moribund cities” that live as tourist centers. A Corporatist policy called for the abolition of parliament and its replacement with a technical government of 30 or 40 young directors elected form the trade associations.
The Futurist party concentrated its propaganda on the soldiers, and recruited many war veterans of the elite Arditi (daredevils), who had been the black-shirted shock troops of the army who would charge into battle stripped to the waist, a grenade in each hand and a dagger between their teeth.
In December 1919, the Futurists revived the “Fasci” or “groups.” which had been organized in 1914 and 1915 to campaign for war intervention, and from which was to emerge the Fascists.
Futurists and Fascists
The first joint post-war action between Mussolini and Marinetti took place in 1919 when a Socialist Party rally was disrupted in Milan.
That year Mussolini founded his own Fasci di Combattimento in Milan with the support of Marinetti and the poet Ungasetti. The futurists and the Arditi comprised the core of the Fascist leadership. The first Fascist manifesto was based on that of Marinetti’s Futurist party.
In April, against the wishes of Mussolini who thought the action premature, Marinetti led Fascists and Futurists and Arditi against a mass Socialist Party demonstration. Marinetti waded in with fists, but intervened to save a socialist from being severely beaten by Arditi. (To place the post-war situation in perspective, the Socialists had regularly beaten, abused, and even killed returning war veterans). The Fascists and futurists then proceeded to the offices of the Socialist Party paper Avanti, which they sacked and burned.
Marinetti stood as a Fascist candidate in the 1919 elections and persuaded Toscanini to do so. Whilst the Fascists held back, the Futurists threw their support behind the poet-soldier D’Annunzio’s takeover of Fiume. Marinetti arrived and was warmly welcomed by D’Annunzio.
When the Fascist Congress of 1920 refused to support the Futurist demand to exile the King and the Pope, Marinetti and other Futurists resigned from the Fascist party. Marinetti considered that the Fascist party was compromising with conservatism and the bourgeoisie. He was also critical of the Fascist concentration on anti-socialist agitation and on opposition to strikes. Certain futurist factions realigned themselves specifically with the extreme Left. In 1922, there were several Futurist exhibitions and performances organized by the Communist cultural association, Pro-letkul, which also arranged a lecture by Marinetti to explain the doctrine of Futurism.
Futurism and the Fascist Regime

When the Fascists assumed power in 1922 Marinetti, like D’Annunzio, was critically supportive of the regime. Marinetti considered: “The coming to power of the Fascists constitutes the realization of the minimum futurist program.”
Of Mussolini the statesman, Marinetti wrote: “Prophets and forerunners of the great Italy of today, we Futurists are happy to salute in our not yet 40-year-old Prime Minister of marvelous futurist temperament.”
In 1923, Marinetti began a rapprochement with the Fascists and presented to Mussolini his manifesto “The Artistic Rights Promoted by Italian Futurists.” Here he rejected the Bolshevik alignment of Futurists in the USSR. He pointed to the Futurist sentiments that had been expressed by Mussolini in speeches, alluding to Fascism being a “government of speed, curtailing everything that represents stagnation in the national life.”
Under Mussolini’s leadership, writes Marinetti:
Fascism has rejuvenated Italy. It is now his duty to help us overhaul the artistic establishment . . . . The political revolution must sustain the artistic revolutions Marinetti was among the Congress of Fascist Intellectuals who in 1923 approved the measures taken by the regime to restore order by curtailing certain constitutional liberties amidst increasing chaos caused by both out-of-control radical Fascist squadisti and anti-Fascists.
At the 1924 Futurist Congress, the delegates upheld Marinetti’s declaration:
The Italian Futurists, more than ever devoted to ideas and art, far removed from politics, say to their old comrade Benito Mussolini, free yourself from parliament with one necessary and violent stroke. Restore to Fascism and Italy the marvelous, disinterested, bold, anti-socialist, anti-clerical, anti-monarchical spirit . . . Refuse to let monarchy suffocate the greatest, most brilliant and just Italy of tomorrow . . . Quell the clerical opposition . . . . With a steely and dynamic aristocracy of thought.
In 1929, Marinetti accepted election to the Italian Academy, considering it important that “Futurism be represented” He was also elected secretary of the Fascist Writer’s Union and as such was the official representative for fascist culture. Futurism became a part of fascist cultural exhibitions and was utilized in the propaganda art of the regime. During the 1930s, in particular the Fascist cultural expression was undergoing a drift away from tradition and towards futurism, with the fascist emphasis on technology and modernization. Mussolini had already in 1926 defined the creation of a “fascist art” that would be based on a synthesis culturally as it was politically: “traditionalistic and at the same time modern.”
In 1943, with the Allies invading Italy, the Fascist Grand Council deposed Mussolini and surrendered to the occupation forces. The fascist faithful established a last stand, in the north, named the Italian Social Republic.
With a new idealism, even former Communist and liberal leaders were drawn to the Republic. The Manifesto of Verona was drafted, restoring various liberties, and championing labor against plutocracy within the vision of a united Europe. Marinetti continued to be honored by the Social Republic. He died in 1944.
00:05 Publié dans art | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : italie, art, avant-gardes, futurisme, marinetti |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 24 octobre 2010
Hergé (1907-1983) et la tradition utopique européenne
Hergé (1907-1983) et la tradition utopique européenne
 Georges Remi (devenu Hergé par inversion des initiales) est né à Etterbeek (Bruxelles) le 22 mai 1907 à 7h30. Il aimait à rappeler cette naissance sous le signe des Gémeaux (1). Peut-être explique-t-elle la récurrence du thème de la gémellité dans ses albums (les DupontDupond, les frères Halambique, etc.).
Georges Remi (devenu Hergé par inversion des initiales) est né à Etterbeek (Bruxelles) le 22 mai 1907 à 7h30. Il aimait à rappeler cette naissance sous le signe des Gémeaux (1). Peut-être explique-t-elle la récurrence du thème de la gémellité dans ses albums (les DupontDupond, les frères Halambique, etc.).
Il est également vrai que son père avait un frère jumeau. L’horoscope serait-il sans importance ? Rien n’est moins sûr. Remarquons-y la culmination exacte de Saturne (conjoint au Milieu du Ciel à 25°38’ des Poissons), statistiquement en relation avec un grand intérêt pour les savants et la science lato sensu (2).
Hergé grandit et évolue dans un milieu catholique, belgicain, fascisant et colonialiste. Tintin au Congo exalte la politique paternaliste de la Belgique en Afrique centrale. Les albums situés « au pays des soviets » et en Amérique renvoient dos à dos le communisme totalitaire et la frénésie capitaliste de l’exploitation industrielle.
Mais dès 1934, Hergé élargit sa perspective tandis que Tintin fait route vers l’Orient.
Dans Les Cigares du Pharaon, le professeur Philémon Siclone inaugure la galerie des portraits d’hommes de connaissance. Ceux-ci sont égyptologue, sigillographe (Halambique dans Le Sceptre d’Ottokar), ethnologue (Ridgewell dans L’Oreille cassée), psychiatre (Fan Se Yeng dans Le Lotus bleu), physicien (Topolino dans L’Affaire Tournesol). Quant à Tournesol lui-même, qui devient un personnage récurrent à partir du Trésor de Rackham le Rouge, il s’intéresse autant à la culture des roses (Les Bijoux de la Castafiore) qu’aux techniques de falsification de l’essence (Tintin au pays de l’or noir).
L’Île Noire envoie Tintin au large des côtes écossaises. Dans un château en ruines sévit une bande de faux-monnayeurs. La succession de symboles est évidente. Cet album de 1937 offre la contrefaçon de l’utopie insulaire, vieux thème de la littérature européenne de l’Atlantide platonicienne à sa version modernisée de Francis Bacon (1561-1626), de « l’île blanche » des Hyperboréens à la Cité du Soleil de Tommaso Campanella (1568-1639).
Au Moyen Âge, dans les récits du cycle du Graal, le château se substitue à l’île comme lieu utopique et objet de la quête.
Les premiers dessins d’Hergé paraissent dans le quotidien bruxellois Vingtième Siècle dirigé par l’abbé Wallez. Mais en 1936, l’hebdomadaire parisien Cœurs Vaillants sollicite Hergé pour la création de nouveaux personnages : Jo, Zette et leur petit singe Jocko.
Dans ces nouvelles aventures se confirment à la fois les influences de la tradition utopique européenne, les préfigurations thématiques des chefs d’œuvre futurs et la volonté d’Hergé d’en finir au préalable avec les contrefaçons.
Jo et Zette sont confrontés à des pirates qui annoncent les flibustiers du Secret de la Licorne et dont le repaire sous-marin renvoie aux motifs de l’utopie et de la contre-utopie souterraines. Le chef des pirates est un savant fou, reflet inversé du scientifique inspirant au saturnien Hergé un indéfectible respect. Les deux enfants et leur singe sont finalement recueillis sur une île par de « bons sauvages », réminiscences de Bernardin de Saint-Pierre (1737-1814). Le jeune Hergé n’est-il pas aussi l’auteur d’un Popol et Virginie chez les Lapinos, bande dessinée animalière dont le titre rappelle l’œuvre maîtresse du célèbre écrivain préromantique ?
La question des sources littéraires d’Hergé demeure controversée. Benoît Peeters estime par exemple excessifs les rapprochements qui ont été faits entre Jules Verne et Hergé.
Il n’en reste pas moins que le savant fou de la contre-utopie du fond des mers mène ses expériences dans sa cité-laboratoire à la manière de Mathias Sandorf dans son île utopique.
Dès 1942, au cœur du « combat de la couleur » (3), Hergé reçoit l’assistance d’Edgar-Pierre Jacobs pour le coloriage de ses albums antérieurs conçus en noir et blanc.
Lorsque Tintin devient un hebdomadaire en 1946, la collaboration de Jacobs s’avère précieuse. Les aventures de Blake et Mortimer reprennent le thème du savant fou (Septimus dans La Marque jaune), parfois récurrent (Miloch dans S.O.S. Météores et Le Piège Diabolique), le tandem Septimus-Miloch s’opposant par ailleurs au savant idéal que constitue le professeur Mortimer.
Parmi les autres collaborateurs du journal Tintin d’après-guerre, Raymond Macherot combine la bande dessinée animalière et l’utopie. Dans Les Croquillards, Chlorophylle et son ami Minimum parviennent à dos de cigogne dans l’île australe de Coquefredouille, où les animaux parlent comme les humains, circulent dans des voitures qui fonctionnent à l’alcool de menthe et sont organisés en une société idéale jusqu’à l’arrivée d’Anthracite, le rat noir perturbateur.
Chlorophylle et Minimum forment un couple inséparable, comme Tintin et le capitaine Haddock à partir du Crabe aux pinces d’or (1941). Chlorophylle rétablit le roi Mitron sur son trône de Coquefredouille de la même façon que Tintin restaure la monarchie syldave dans Le Sceptre d’Ottokar (1938).
La Syldavie est la principale utopie d’Hergé. Avant la guerre, elle n’est encore qu’un petit royaume d’Europe centrale reposant sur des traditions agricoles et menacée par des conspirateurs au service de la Bordurie voisine. L’Allemagne hitlérienne vient d’annexer l’Autriche. Comme pour la guerre entre le Paraguay et la Bolivie (devenus San Theodoros et Nuevo Rico dans L’Oreille cassée), Hergé s’inspire de l’actualité.
Trop perméable à « l’air du temps », Hergé se rend coupable de quelques dérapages dans L’Étoile mystérieuse (1942). Cet album nous interpelle surtout parce qu’il narre une sorte de navigation initiatique (4), à la manière du mythe grec de Jason et des Argonautes, vers une forme d’« île au trésor » (5). L’aérolithe qui s’abîme dans les flots arctiques recèle un métal inconnu sur Terre. Ce métal est la « Toison d’Or » découverte par Tintin, Haddock et leurs amis savants européens au terme d’une course qui les oppose à des Américains sans scrupules.
Onzième album dans une série de vingt-deux, en position centrale dans le corpus hergéen des aventures de Tintin, Le Trésor de Rackham le Rouge synthétise les thèmes utopiques de l’île, du château et du souterrain. Conçu en 1944, cet album met en scène une navigation infructueuse vers une île lointaine et la découverte finale du trésor dans la crypte du château de Moulinsart, et très précisément dans une mappemonde surmontée d’une statue de l’apôtre Jean. L’Apocalypse de Jean comporte vingt-deux chapitres. Cette apparente influence ésotérique sur Hergé est-elle due à la fréquentation de Jacques Van Melkebeke, initié à la Franc-Maçonnerie en 1937 ? Benoît Peeters en paraît convaincu (6).
Une chose est certaine : l’incontestable érudition littéraire de Van Melkebeke autorise à reposer le problème des sources d’Hergé, sur lesquelles le créateur de Tintin a peut-être été trop modeste (7).
Si l’île et le château sont deux thèmes majeurs de la tradition utopique européenne, l’un apparaît en filigrane de l’autre dans Le Grand Meaulnes d’Alain Fournier (1886-1914), dont aucun biographe d’Hergé ne signale l’influence. Le château des Galais est l’objet de la quête de Meaulnes. Le récit est criblé d’images marines. Alain-Fournier rêvait de devenir navigateur et a raté le concours d’admission à l’École Navale de Brest. La casquette à ancre de Frantz de Galais fait penser à celle du capitaine Haddock.
C’est avec des métaphores marines que Charles Péguy (1873-1914) présente sa région de la Beauce à Notre-Dame de Chartres, illustre vaisseau de l’architecture gothique. Péguy est un ami d’Alain-Fournier, originaire de Sologne, de l’autre côté de la Loire. Péguy est le chantre de la « cité harmonieuse » dont « personne ne doit être exclu ». Péguy est l’écrivain de référence des milieux catholiques des années vingt. L’ambiance intellectuelle où baigne le jeune Georges Remi et certains leitmotive de l’œuvre d’Hergé invitent à l’hypothèse d’une influence de Péguy et d’Alain-Fournier (8) sur le créateur de Tintin.
L’utopie souterraine apparaît dans la littérature européenne au XVIIe siècle avec l’Anglaise Margaret Cavendish (9) et dans l’œuvre d’Hergé dans l’immédiat après-guerre avec Le Temple du Soleil.
C’est en réalité la seconde partie d’un diptyque commencé avec Les Sept Boules de cristal, où l’on retrouve, comme dans L’Étoile mystérieuse, une expédition de sept savants, dont l’américaniste Bergamotte, spécialiste ès sciences occultes de l’ancien Pérou.
Cachée dans les contreforts des montagnes andines, la cité des Incas est atteinte après la périlleuse traversée d’une forêt. Le thème de l’épreuve forestière fait écho aux romans du Graal et à certains contes de Perrault (1628-1703), comme La Belle au bois dormant, dont une version est également fournie par Grimm (1786-1859).
Certes, les Incas punissent le sacrilège de mort et leur science n’est pas, sous le crayon d’Hergé, assez évoluée pour prévoir une éclipse solaire. Néanmoins, leur cité souterraine, qui abrite un trésor dérobé aux regards rapaces des conquistadores, est une sorte d’utopie dans la mesure où l’on y cultive les valeurs chevaleresques, le respect de la parole donnée, la réconciliation et la fraternisation avec l’adversaire. Au début de l’aventure, Tintin défend un petit Indien persécuté par d’odieux colons espagnols. Le grand prêtre inca observe en cachette la scène. Il comprend que Tintin n’est pas un ennemi de sa race. Bien qu’il soit chargé de barrer à Tintin la route du repaire montagnard, il lui offre un talisman protecteur.
Selon Raymond Trousson, l’étymologie du mot « utopie » est incertaine. Le terme vient du grec. Mais la racine est-elle ou-topos (le pays de nulle part) ou bien eu-topos (l’endroit où on est bien) ? L’œuvre d’Hergé est utopique dans les deux acceptions du vocable. Le château de Moulinsart est une « eutopie ». L’île au trésor inaccessible est une « outopie », cette terra australis dont ont rêvé de nombreux écrivains d’Europe, de Thomas More (1478-1535) à Nicolas Restif de la Bretonne (1734-1806).
L’utopie souterraine est conçue par Hergé comme une cité de la science (10), cachée dans les montagnes de Syldavie. De là part l’expédition vers le satellite de la Terre dans le célèbre diptyque du début des années cinquante : Objectif Lune et On a marché sur la Lune. Ainsi modernisée, la Syldavie refait irruption dans l’univers hergéen. Un savant-traître ne peut pas être totalement mauvais. Pour permettre aux autres occupants de la fusée d’économiser l’oxygène et de revenir sur Terre vivants, Wolff se sacrifie en se jetant dans le vide. Le suicide de Wolff est une autre forme de l’hommage d’Hergé à la science et aux savants.
La Syldavie apparaît une dernière fois dans L’Affaire Tournesol (1956). Pour Hergé commence l’époque du désenchantement, du brouillage des repères, de la progressive indistinction des valeurs. Les services secrets syldaves et bordures sont renvoyés dos à dos, comme le sont, dans Tintin et les Picaros (1974), les deux généraux de San Theodoros, le vieil ami Alcazar et son rival Tapioca.
Certes, entre-temps, il y a encore Tintin au Tibet (1960), Vol 714 pour Sydney (1968), où Hergé fait une concession à la mode « ufologique » (hypothèse des visiteurs extra-terrestres) et Les Bijoux de la Castafiore (1963), où Tintin se laisse enchanter par des airs de musique tzigane et où le château utopique de Moulinsart offre une étonnante unité de lieu. Les Tziganes sont accueillis dans le domaine, car ils ne sont pas « tous des voleurs », comme l’affirment stupidement les Dupont-Dupond.
L’esprit européen d’Hergé réside dans le mélange de fascination du savoir et de culte des vertus chevaleresques. Il faut y ajouter l’ouverture à l’Autre, malgré les bavures de la période d’occupation nazie. Car une question mérite d’être posée : le malencontreux financier juif de L’Étoile mystérieuse pèse-t-il si lourd au point de contrebalancer à lui seul la défense des Peaux-Rouges chassés de leur territoire pétrolifère, le secours porté au tireur de pousse-pousse chinois, au petit Zorrino et aux Noirs esclaves de Coke en Stock, la nuance admirative qui accompagne le commentaire de Tintin devant le seppuku du « rude coquin » Mitsuhirato, le plaidoyer pour les « gens du voyage » et leurs violons nostalgiques ?
Si nous sommes avec Benoît Peeters d’« éternels fils de Tintin », c’est parce que nous sommes des Européens capables de nous laisser bercer par des chants tziganes montant des clairières proches de Moulinsart et de toutes les forêts abritant nos châteaux de rêve.
Notes
1 : Benoît Peeters, Hergé. fils de Tintin, Paris, Flammarion, collection « Grandes Biographies », 2002, p. 26.
2 : Michel Gauquelin (1920-1991), Le Dossier des influences cosmiques, Éditions J’ai lu, 1973, et Les Personnalités planétaires, Guy Trédaniel Éditeur, 1975.
3 : Benoît Peeters, op. cit., p. 199.
4 : Jacques Fontaine, Hergé chez les initiés, Dervy-Livres, 2001.
5 : Le parallélisme entre Hergé et l’Écossais Robert Louis Stevenson (1850-1894) est remarquablement étudié par Pierre-Louis Augereau dans son Tintin au pays des tarots, Le Coudray-Maconard, Éditions Cheminements, 1999.
6 : Benoît Peeters, op. cit. Van Melkebeke est cité une quarantaine de fois, du début (p. 36) à la fin (p. 439) de l’ouvrage.
7 : Pudeur et modestie sont aussi des traits « saturniens » selon les statistiques astrologiques de Gauquelin.
8 : Sur la spiritualité d’Alain-Fournier, cf. Lettre inédite d’Isabelle Rivière (sœur du romancier) à Mademoiselle Renée Bauwin (étudiante à l’Institut des Sœurs de Notre-Dame de Namur), 22 janvier 1962.
9 : Raymond Trousson, Voyages aux pays de nulle part. Histoire littéraire de la pensée utopique, Éditions de l’Université Libre de Bruxelles, 1999.
10 : On peut la rapprocher de la « Maison de Salomon » de Francis Bacon (Nova Atlantis), qui inspira la Royal Society anglaise.
Texte paru précédemment dans Europe-Maxima
Le 3 mars 2003 correspondait au vingtième anniversaire de la mort d’Hergé. 2007 verra le centenaire de sa naissance. Opportun est le moment de retracer l’itinéraire du créateur de Tintin.
00:05 Publié dans art, Bandes dessinées | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bandes dessinées, tintin, hergé, belgique, belgicana, 9ème art, art, littérature, lettres |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 23 octobre 2010
Edgar-P. Jacobs (1904-1987): un maître de la "littérature dessinée"
EDGAR–P.JACOBS (1904-1987) : UN MAÎTRE DE LA « LITTERATURE DESSINEE »
A Clément Degeneffe (1939-1959)
Peu de temps avant sa tragique disparition dans un accident de voiture, ce cousin germain (du côté de ma maman) m’offrit l’album La Marque Jaune d’Edgar-P.Jacobs.
Dans l’Angleterre automnale des années 1950, le récit commence en des termes qui auraient pu me faire pressentir qu’un jour on parlerait, non plus de « bande dessinée », mais de « littérature dessinée ».
« Big Ben vient de sonner une heure du matin. Londres, la gigantesque capitale de l’Empire britannique, s’étend, vaste comme une province, sous la pluie qui tombe obstinément depuis la veille. Sur le fond du ciel sombre, la tour de Londres, cœur de la « City », découpe sa dure silhouette médiévale ».
J’avais 12 ans, j’étais familier d’Hergé et des scénaristes et dessinateurs du journal Tintin, mais je ne me rappelais aucune pareille élégance stylistique, sauf peut-être chez Cuvelier et ses aventures de Corentin, dont un autre cousin (du côté paternel cette fois) m’avait fait aussi cadeau d’un album.
 Edgar-P.Jacobs naît le 30 mars 1904. Ses parents habitent alors dans le quartier du Sablon, non loin du Conservatoire de Bruxelles, dont il deviendra un brillant élève. Il exercera notamment ses talents de chanteur lyrique à Lille. Son expérience scénique et musicale lui servira dans sa technique ultérieure du dessin. Qu’on se rappelle par exemple l’épisode de La Marque Jaune où le malfaiteur marche sur un câble et apparaît dans la clarté du projecteur que les policiers braquent sur lui. Un biographe de Jacobs résume son œuvre dessinée en un « opéra de papier ».
Edgar-P.Jacobs naît le 30 mars 1904. Ses parents habitent alors dans le quartier du Sablon, non loin du Conservatoire de Bruxelles, dont il deviendra un brillant élève. Il exercera notamment ses talents de chanteur lyrique à Lille. Son expérience scénique et musicale lui servira dans sa technique ultérieure du dessin. Qu’on se rappelle par exemple l’épisode de La Marque Jaune où le malfaiteur marche sur un câble et apparaît dans la clarté du projecteur que les policiers braquent sur lui. Un biographe de Jacobs résume son œuvre dessinée en un « opéra de papier ».
Tout au long de son parcours dans les écoles laïques (primaires et secondaires) et dans l’enseignement supérieur artistique, Jacobs noue des relations très étroites avec Van Melkebeke et Laudy. Les trois jeunes gens deviennent d’inséparables amis pour la vie. Jacques Van Melkebeke est un touche-à-tout très doué qui tombe en disgrâce après 1945 pour avoir collaboré à un journal contrôlé par l’occupant. Jacques Laudy, fils du portraitiste de la famille royale, également auteur de bande dessinée (Les Aventures d’Hassan et Kaddour), est surtout connu pour son attachement au style de vie d’autrefois et son opposition à la modernité assimilée à une décadence.
En 1942, Jacobs s’associe avec Hergé, dont il colorie les albums narrant les exploits de Tintin. Les deux hommes se brouillent rapidement et Jacobs vole de ses propres ailes à partir de 1946. Dans le Triptyque Le Secret de l’Espadon, il met pour la première fois en scène les personnages du capitaine Blake (qui ressemble physiquement à Laudy) et du professeur Mortimer (qui revêt les traits de Van Melkebeke), tandis que lui-même s’incarne dans le visage d’Olrik, le malfaiteur récurrent.
La collaboration de Jacobs et d’Hergé incite certains historiens de la B.D. à classer Jacobs dans l’école de la « ligne claire ». C’est inexact. La prédominance du noir est particulièrement visible dans La Marque Jaune et ses nombreuses péripéties automnales et nocturnes, tandis qu’Hergé produit avec Tintin au Tibet un album envahi par la couleur blanche comme les neiges de l’Himalaya, c’est-à-dire de tendance esthétique tout à fait à l’opposé de celle de Jacobs.
L’immédiat après-guerre et les années de « guerre froide » constituent l’arrière-plan historique de l’œuvre de Jacobs et expliquent pourquoi ses deux héros sont britanniques et l’antagonisme Orient-Occident est présenté à l’avantage du second. Dans Le Secret de l’Espadon, l’Ouest est menacé par un empire oriental centré sur Lhassa. Dans S.O.S. Météores, des espions au service de l’Est préparent une conquête de l’Europe à la faveur d’une apocalypse climatique.
Dans La Marque Jaune, dont je propose à présent une lecture approfondie, Blake et Mortimer forment plus que jamais un couple complémentaire. L’un illustre l’action, l’autre le savoir. Mais il ne s’agit pas d’une vision dualiste, car Philip Mortimer n’hésite pas à prendre des risques physiques et il arrive à Francis Blake de prendre de la hauteur par rapport aux événements et de les synthétiser en une théorie.
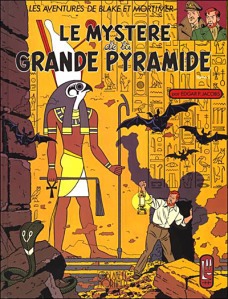 Comme chez Hergé et la plupart des premiers collaborateurs du journal Tintin (fondé en 1946), la femme tient peu de place dans le petit monde de Blake et Mortimer. Ce dernier utilise la concierge Miss Benson pour éloigner les importuns. Notons néanmoins la douceur de Madame Calvin, l’épouse du juge, qui tente de persuader son mari de se laisser protéger par la police.
Comme chez Hergé et la plupart des premiers collaborateurs du journal Tintin (fondé en 1946), la femme tient peu de place dans le petit monde de Blake et Mortimer. Ce dernier utilise la concierge Miss Benson pour éloigner les importuns. Notons néanmoins la douceur de Madame Calvin, l’épouse du juge, qui tente de persuader son mari de se laisser protéger par la police.
Miss Benson joue aussi le rôle de gouvernante pour les deux héros qui partagent le même appartement. Le procédé est utilisé par d’autres grands auteurs de polars : Conan Doyle et Agatha Christie. Le couple Blake-Mortimer est analogue aux tandems Holmes-Watson et Poirot-Hastings, avec cette importante différence : l’un des deux éléments de la paire ne sert pas de faire-valoir à l’autre. Blake et Mortimer fonctionnent sur un strict pied d’égalité, alors que Sherlock Holmes ironise au détriment du docteur Watson et qu’Hastings est le souffre-douleur d’Hercule Poirot.
Au niveau du suspense, et pour comparer avec des séries télévisées bien connues, La Marque Jaune est plus proche des enquêtes de Columbo (où le coupable est connu dès le début) que des Cinq dernières minutes et leur coup de théâtre final.
Le lecteur est tenu en haleine par l’investigation de Mortimer tout comme l’intérêt de la célèbre série californienne dépend de l’intelligence du lieutenant à la voiture branlante et à l’imperméable fripé.
Mortimer commence à entrevoir la solution de l’énigme dès la page 18 d’un album qui en compte 70.
Certains propos tenus par Septimus dès la page 10 peuvent le désigner comme le suspect principal. Le suspense est alors lié aux astuces technologiques qu’il déploie pour faire d’Olrik le robot parfait, dont il contrôle le cerveau et qui signe ses crimes à la craie jaune avec la lettre mu entourée d’un cercle.
Le dénouement réside dans l’exposé scientifique de Septimus qui rappelle la conférence finale d’Hercule Poirot dans les romans d’Agatha Christie.
Jacobs dépeint une capitale britannique noyée de pluie et de brouillard. Le Soleil est couché à 16 heures en cette fin d’automne où la neige apparaît à l’approche de Noël. L’heureuse fin de l’aventure coïncide avec la soirée de réveillon.
Le récit de science-fiction est évidemment un autre genre dans lequel se situent les albums de Jacobs, avec en filigrane une interrogation sur les rapports de la science et de l’homme. Celui-ci est au-dessus de celle-là : telle est la conclusion de La Marque Jaune. Compréhensible dans le contexte historique de la victoire des Alliés anglo-saxons, cet humanisme tolère toutefois quelques nuances, si on lit le récit entre les lignes et si on le narre du point de vue du « méchant », c’est-à-dire le docteur Jonathan Septimus.
Septimus ne symbolise pas le Mal absolu. Pendant la Seconde Guerre Mondiale, il se révèle un irréprochable patriote. Il confesse vers la fin du récit : « Ayant été requis par les services sanitaires de l’armée, j’obtins facilement de faire construire sous ma demeure, ce vaste abri avec sortie de secours sur les égouts, afin d’y installer une ambulance destinée à dégorger les hôpitaux débordés » (p.55).
Ce sont l’orgueil intellectuel et la soif de revanche qui entraînent à sa perte le médecin spécialisé en psychiatrie et en neurologie du cerveau. Le déclic fatal est la rencontre de Septimus et d’Olrik, ce dernier errant dans le désert du Soudan et dans un état proche de la folie après l’épilogue des albums précédents (les 2 tomes du Mystère de la Grande Pyramide). A ce moment-là, Septimus avoue : « J’avais presque oublié les avanies passées » (p.54), ce qui dénote un fond pas totalement mauvais.
L’intrigue de La Marque Jaune, album de la fin des années 1950, nous fait revenir plus de 30 ans en arrière.
En 1922 paraît chez l’éditeur Thornley un ouvrage intitulé The Mega Wave (L’Onde Mega) et signé par un certain Docteur Wade. Derrière Wade se cache en réalité Septimus, jeune chercheur en neurologie publiant le résultat de ses travaux sur le contrôle extérieur du cerveau humain.
Le journaliste Macomber et le professeur Vernay couvrent le livre de ridicule. S’estimant diffamé, Thornley intente un procès aux rédacteurs du Daily Mail et du Lancet. Le juge Calvin dirige les débats. Thornley est débouté. A l’écoute du jugement, il meurt d’une crise cardiaque. Protégé par son pseudonyme, Septimus part au Soudan où un poste de médecin est vacant.
Via des coupures de presse de l’époque, Jacobs fait revivre le drame avec objectivité (p.24). Certes, le livre de Wade est « indéfendable », car « plein de théories fumeuses », mais les plaisanteries de Macomber et Vernay sont qualifiées de « féroces ». Une « réputation d’originalité » est attribuée à Thornley, « l’honorable éditeur ». Ce drame est une « curieuse et pénible histoire » qui plonge « les éditeurs, auteurs et journalistes dans la consternation la plus profonde ».
Revenu d’Afrique avec un Olrik domestiqué, Septimus le manipule d’abord en lui faisant réaliser quelques exploits romanesques (par exemple le vol des joyaux de la Couronne britannique). Une fois son robot ainsi rôdé, Septimus peut s’attaquer à son véritable objectif : les enlèvements de Vernay, Macomber et Calvin. Il simule aussi son propre kidnapping.
Au début du récit (p.10), les quatre hommes rencontrent Blake et Mortimer dans un club typiquement british. Vernay déclare : « Ne prenez pas trop au sérieux nos petites algarades professionnelles, car en dépit de théories avancées, Septimus est un savant de valeur et par surcroît un excellent ami ». (C’est moi qui souligne).
Jacobs sous-entend que le progrès de la recherche ne souffre aucune limite et que ses résultats méritent d’être publiés sans que l’honorabilité éditoriale soit mise en cause et parce que des travaux non conformistes ont le mérite de l’originalité. Jacobs ne condamne que l’orgueil et le désir de vengeance. Son humanisme se combine donc à une apologie de l’audace techno-scientifique. Ce message nuancé est servi par un chef d’œuvre de « littérature dessinée » mêlant le polar classique au récit de science-fiction et au roman d’atmosphère. La Marque Jaune d’Edgar-P.Jacobs illustre parfaitement ce que Jean-Baptiste Baronian a nommé « l’école belge de l’étrange »
00:08 Publié dans art, Bandes dessinées | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bandes dessinées, belgique, belgicana, 9ème art |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 11 septembre 2010
Konstantin Vasiliev: Aigle
00:10 Publié dans art | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : russie, peinture, art, arts plastiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 01 septembre 2010
Kunstexpositie: Magievan de Herinnering
| Kunstexpositie: Magie van de Herinnering |
 Op zondag 5 september 2010 zal Dr. Pavel Tulaev, directeur van het Russisch tijdschrift "Atheneum", in Vlaanderen te gast zijn om enkele hedendaagse Russische schilderijen voor te stellen. Op zondag 5 september 2010 zal Dr. Pavel Tulaev, directeur van het Russisch tijdschrift "Atheneum", in Vlaanderen te gast zijn om enkele hedendaagse Russische schilderijen voor te stellen.De echte werken naar hier halen is op zo'n korte tijd onbegonnen werk. Daarom zullen de bezoekers kennis kunnen maken met prachtige reproducties. Deze reproducties zullen ter plaatse aan een prijsje aangekocht kunnen worden. Dr. Pavel Tulaev bezoekt Vlaanderen nadat hij in Italië deelneemt aan het World Congress for Ethnic Religions. U krijgt, met de medewerking van Euro-Rus, een unieke gelegenheid om met Dr. Pavel Tulaev en de werken van Russsische kunstenaars kennis te maken. De gallerijtentoonstelling vindt plaats te Dendermonde, zaal-taverne 't Peird, Kasteelstraat 1, vlakbij de Grote markt en op korte wandelafstand van het station. De deuren gaan open om 11u00. Dr.Pavel Tulaev zal het woord nemen om 11u30. De gallerijtentoonstelling eindigt om 16u00. Het wordt voor u zeker en vast een interessante en leuke zondagmiddag. Wij hopen u dan in Dendermonde te mogen begroeten, Euro-Rus ----------------------------------------------------------------------------------- Dr. Pavel Tulaev is de drijvende kracht achter het Russischtalige tijdschrift "Atheneum", reeds in 20 verschillende landen verkrijgbaar en verkocht. Hij zag het levenslicht op 20 februari 1959 te Krasnodar, Zuid-Rusland. In Moskou studeerde hij in 1982 af aan aan de Moskouse linguistische staatsuniversiteit met specialisaties voor Spaans, Engels en Frans. Hij is de drijvende kracht achter deze nieuw rechtse Russische denktank, die zich buigt over vraagstukken die de Russische, Slavische en Indo-Europese volkeren aangaan. Hij schreef zeer interessante en aan te raden stukken over Rusland, de Slaven, de Vierde Wereldoorlog, e.a. Verschillende werden reeds op de pagina's van Euro-Rus gepubliceerde. Hij publiceerde reeds meer dan 100 stukken over Rusland, Europa, Latijns-Amerika en de Verenigde Staten. Hij gaf reeds verschillende boeken uit : «Крест над Крымом» (1992), «Семь лучей» (1993), «К пониманию Русского» (1994), «Консервативная Революция в Испании» (1994), «Франко: вождь Испании» (1998), «Венеты: предки славян» (2000), «Афина и Атенеи» (2006), «Русский концерт Анатолия Полетаева» (2007), «Родные Боги в творчестве славянских художников» (2008). In niet-Russische talen publiceerde hij volgende teksten : Rusia y España se descubren una a otra. Sevilla, 1992; Sobor and Sobornost, – "Russian Studies in Filosophy", N.Y., 1993, vol. 31, № 4; Deutschen und Russen – Partneur mit Zukunft? – "Nation & Europa", 1998, № 11/12; Les guerres de nouvelles génération, – "Nouvelles de Synergies Européennes", Brussel, 1999, № 39; Intretien avec Pavel Toulaev, – Ibidem, № 40; Atak I zwyciestwo kazdego dnia.– "ODALA", SZCZECIN, 1999, numer V; Veneti: predniki slovanov.– Tretji venetski zbornik – Editiones Veneti, Ljubljana 2000; Сiм променiв – «Сварог», Киiв, 2003; Венети (превео са руског Владимир Карич), Београд, 2004; Pavel Tulaev: «Deutschland und Russland», "Der Vierte Weltkrieg" – DEUTSCHLAND UND RUSSLAND. Deutsche Sonderausgabe der Zeitschrift ATHENAEUM, Moskau, 2005; BUYAN SPEAKS. An interview with Pavel Tulaev conducted by Constantin von Hoffmeister for National Vanguard (USA), 2005; Рiдним богиням i берегиням – «Сварог», Киiв, 2006; Pavel Tulaev «Euro-Russia in the context of World War IV», Moscow, 2006; Pavel Toulaev «L'Euro-Russie dans le contexte de la Quatrieme Guerre Mondiale» Moscau, 2006; «La Russie: le grand retour» – Reflechir & Agir (Toulouse) №23, 2006; Pavel Tulaev «España y Rusia: dos suertes analogas» Discurso pronunciado en Madrid 4.11.2006; Павел Тулаев «Русия и Европа в условията на Четвърта Световна Война» 2006; ИнтервЉу са Павелом ТулаЉевом БУ£АН ГОВОРИ! (2007); Interview with Andrej Sletcha (Prage, 2008); etc. Ook organiseerde hij verschillende congressen, waaronder het succesvolle congres van 2007 te Moskou "Europa en Rusland, verschillende perspectieven" waar Kris Roman Euro-Rus vertegenwoordigde. Van 17 tot en met 25 juni 2010 organiseerde Dr. Pavel Tulaev een tentoonstelling van Russisch-Slavische meesterwerken. Met hetzelfde doel bevond hij zich reeds in West-Europese steden zoals Parijs. http://www.ateney.ru/art/index.htm |
18:23 Publié dans art, Evénement | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rusie, art, peinture, arts plastiques, tradition, traditions, traditionalisme, paganisme, ethnologie, anthropologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 06 avril 2010
Louis-Ferdinand Céline par Ioannis Mouhasiris
00:14 Publié dans art | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art, peinture, portrait, littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, france, céline |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 13 mars 2010
Marc. Eemans ou l'autre versant du surréalisme
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1989
Marc. Eemans ou l'autre versant du surréalisme
La conversion de Marc. Eemans au Surréalisme est contemporaine de celle de René Magritte et de ses amis. Elle s'est faite entre 1925 et 1926. A cette époque Marc. Eemans avait à peine dix-huit ans, alors que Magritte était son aîné de quelque neuf à dix ans.
 C'est grâce à la rencontre de Geert Van Bruaene, alors directeur du Cabinet Maldoror en l'Hôtel Ravenstein, que le jeune Marc Eemans a été intié à la poésie présurréaliste des «Chants de Maldoror» et c'est également alors qu'il entra en contact avec Camille Goemans et E.L.T. Mesens qui allaient bientôt devenir ses compagnons de route avec Paul Nougé, René Magritte, André Souris, paul Hooremans et Marcel Lecomte, dans l'aventure du premier groupe surréaliste belge, groupe où ils furent bientôt rejoints par Louis Scutenaire qui, à l'époque, se prénommait encore Jean.
C'est grâce à la rencontre de Geert Van Bruaene, alors directeur du Cabinet Maldoror en l'Hôtel Ravenstein, que le jeune Marc Eemans a été intié à la poésie présurréaliste des «Chants de Maldoror» et c'est également alors qu'il entra en contact avec Camille Goemans et E.L.T. Mesens qui allaient bientôt devenir ses compagnons de route avec Paul Nougé, René Magritte, André Souris, paul Hooremans et Marcel Lecomte, dans l'aventure du premier groupe surréaliste belge, groupe où ils furent bientôt rejoints par Louis Scutenaire qui, à l'époque, se prénommait encore Jean.
Certains historiens du Surréalisme en Belgique ont estimé qu'à ses débuts, Marc Eemans, en tant que peintre, n'était qu'un épigone, un imitateur de René Magritte, mais, qu'il n'y a pas eu imitation, tout au plus chemin parallèle, ce qui s'explique aisément, car il fut une époque où le Surréalisme vivait dans l'osmose de l'air du temps».
Pour s'en convaicnre, il suffit d'ailleurs de consulter la petite revue «Distances», éditée à Paris par Camille Goemans en 1928, à laquelle collabora Marc. Eemans (x). Ajoutons-y au même titre ses dessins à la plume dans le mensuel «Variétés», paraissant à la même époque à Bruxelles.
D'ailleurs, Marc. Eemans alla bien vite prendre définitivement un chemin tout autre que celui de René Magritte et de ses compagnons de route, à l'exception de Camille Goemans et de Marcel Lecomte. Nous en trouvons un témoignage irréfutable dans un album paru en 1930 aux Editions Hermès, fondées par Goemans et lui-même et au titre bien significatif! Eemans s'y révèle comme un adepte moderne de ce que Paul Hadermann, professeur à l'Université Libre de Bruxelles, a appelé le »trobar clus de Marc. Eemans» d'après le terme provençal propre aux troubadours et minnesänger qui pratiquaient jadis une poésie hermétique «close», accessibles aux seuls initiés. Cet album intitulé «Vergeten te worden» (Oublié de devenir) compte «dix formes linéaires influencées par dix formes verbales». Il est paru initialement en langue néerlandaise, mais une réédition, avec traduction française et une introduction du prof. Hadermann, à laquelle nous venons de faire allusion, en est parue en 1983.
La coloration du Surréalisme propre à Marc. Eemans est dès lors nettement affirmée. Ce Surréalisme s'est fortement éloigné de celui de René magritte que Salvador Dali a qualifié un jour d'«A.B.C. du Surréalisme».
Tandis que les options des membres de ce que Patrick Waldberg a appelé plus tard la «Société du Mystère» se sont trop souvent orientées vers les facilités d'un certain «néo-dadaïsme» au dogmatisme sectaire à la fois «cartésien» et «gauchisant» en lequel la contrepèterie se le dispute à l'humour noir et rose, voire au «prosaïsme» petit-bourgeois (le chapeau melon et la pipe, de Magritte!), Marc. Eemans, lui, accompagné en cela par Camille Goemans et Marcel Lecomte, s'est orienté derechef vers un autre versant du Surréalisme fort proche de l'Idéalisme magique d'un Novalis et du Symbolisme de la fin du siècle dernier.
Ce Surréalisme, que les historiens du Surréalisme en Belgique semblent ignorer ou plutôt passer sous silence, répond en quelque sorte à l'appel à l'«occultation» lancé par André Breton dans son «Second manifeste du Surréalisme». Rappelons d'ailleurs à ce propos à quel point Breton a été profondément touché par le Symbolisme, au point que Paul Valéry a été son témoin lors de son premier mariage et qu'en 1925, voire plus tard encore, lui-même ainsi qu'Eluard et Antonin Artaud se sont révélés comme des admirateurs inconditionnels du poète symboliste Saint-Pol-Roux.
La filiation du Romantisme au Surréalisme via le Symbolisme est d'ailleurs évidente, aussi Alain Viray a-t-il pu écrire qu'«il y a des liens entre Maeterlinck et Breton», à quoi nous pourrions ajouter qu'il y en a également entre Max Elskamp et Paul Eluard, tandis que l'ex néo-symboliste Jean De Bosschère a viré étrangement, vers la fin de sa vie, vers le Surréalisme, un certain Surréalisme il est vrai.
Quoi qu'il en soit, l'art que Marc. Eemans a pratiqué, dès sa vingtième année, est ce que l'on pourrait appeler un «Surréalisme ouvert», détaché de tout sectarisme et de cet esprit de chapelle cher aux surréalistes qui se considèrent de «stricte obédience». Dès lors la question se pose: Marc. Eemans est-il encore surréaliste? Mais en fait qu'est-ce qu'une étiquette? What is a name? En tout cas, Eemans a déclaré un jour, lors d'une enquête de la revue «Temps Mêlés» qu'il ne serait pas ce qu'il est sans le Surréalisme…
Parlons plutôt de la revue «Hermès» que Marc. Eemans fonda en 1933 avec ses amis René Baert et Camille Goemans (c'est ce dernier qui en rédigea toutes les «Notes des éditeurs»). C'était une revue d'études comparées en laquelle poésie, philosophie et mystique furent à l'honneur. Y collaborèrent activement e.a. Roland de Reneville (un transfuge du «Grand jeu» et auteur d'un «Rimbaud le Voyant»), le philosophe Bernard Groethuysen, l'arabisant Henri Corbin ainsi que le poète Henri Michaux qui en devint le secrétaire de rédaction. Revue surréaliste? Oui ou non, et nous croyons même que le mot «surréalisme» n'y a jamais figuré… Par contre y furent publiées les premières traductions en langue française de textes des philosophes Martin Heidegger et Karl Jaspers. Y collabora également le philosophe franças Jean Wahl tandis qu'y figurèrent des traductions de textes poétiques ou mystiques flamnds, allemands, anglais, tibétains, arabes et chinois, sans oublier l'intérêt porté à des poètes symbolistes, pré-symbolistes ou post-symbolistes.
En somme «Hermès» pratiqua un «Surréalisme occulté» qui a retenu l'attention d'André Breton, mais aussi l'indifférence, si pas l'hostilité de certains membres de la «Société du Mystère». Notons à ce propos que Breton a toujours préféré le «merveilleux» au «mystère», en prônant surtout le recours à la magie, sans toutefois pouvoir se soustraire à la tentation d'une magie de pacotille, celles des voyantes et des médiums. Du côté d'«Hermès», au contraire, il y eut toujours le souci d'un hermétisme davantage tourné vers l'austère éthique propre à tout ce qui relève de la «Tradition primordiale». Mais ne l'oublions pas:: le Surréalisme d'André Breton et de ses amis n'a jamais pu se défaire d'un certain «avant-gardisme» très parisien en lequel le goût de l'étrange, du bizarre à tout prix, de burlesque provocateur et de l'exotimse forment un amalgame des plus pittoresques fort éloigné des préoccupations profondes de Marc. Eemans et de ses amis de la revue «Hermès». Chez lui surtout prévaut avant tout la soumission à des mythes intérieurs nés de ses fantasmes. Il y a chez lui une gravité qui l'a conduit à une incessante quête de l'Absolu. En témoignent aussi bien ses peintures que ses écrits poétiques. Comme l'a écrit Paul Caso («Le Soir, 26-28.XII.1980): «On doit reconnaître l'existence de Marc. Eemans et la singularité d'un métier qui a choisi de n'être ni claironnant, ni racoleur. Il y a là un poids d'angoisse et de sensibilité».
Jean d'Urcq
00:05 Publié dans art | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art, avant-gardes, surréalisme, belgique, belgicana, flandre, peinture |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 07 janvier 2010
Entretien avec Marc. Eemans, le dernier des surréalistes de l'école d'André Breton
 Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1990
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1990
Entretien avec Marc. Eemans, le dernier des surréalistes de l’école d’André Breton
propos recueillis par Koenraad Logghe
et Robert Steuckers
Aujourd'hui âgé de 83 ans, Marc. Eemans affirme être le dernier des surréalistes. Après lui, la page sera tournée. Le surréalisme sera définitivement entré dans l'histoire. Qui est-il, ce dernier des surréalistes, ce peintre de la génération des Magritte, Delvaux et Dali, aujourd'hui ostracisé? Quel a été son impact littéraire? Quelle influence Julius Evola a-t-il exercé sur lui? Ce «vilain petit canard» du mouvement surréaliste jette un regard très critique sur ses compères morts. Ceux-ci lui avaient cherché misère pour son passé «collaborationniste». Récemment, Ivan Heylen, du journal Panorama (22/28.8.1989), l'a interviewé longuement, agrémentant son article d'un superbe cliché tout en mettant l'accent sur l'hétérosexualité tumultueuse de Marc. Eemans et de ses émules surréalistes. Nous prenons le relais mais sans oublier de l'interroger sur les artistes qu'il a connus, sur les grands courants artistiques qu'il a côtoyés, sur les dessous de sa «collaboration»...
Q.: La période qui s'étend du jour de votre naissance à l'émergence de votre première toile a été très importante. Comment la décririez-vous?
ME: Je suis né en 1907 à Termonde (Dendermonde). Mon père aimait les arts et plusieurs de ses amis étaient peintres. A l'âge de huit ans, j'ai appris à connaître un parent éloigné, sculpteur et activiste (1): Emiel De Bisschop. Cet homme n'a jamais rien réussi dans la vie mais il n'en a pas moins revêtu une grande signification pour moi. C'est grâce à Emiel De Bisschop que j'entrai pour la première fois en contact avec des écrivains et des artistes.
Q.: D'où vous est venue l'envie de dessiner et de peindre?
ME: J'ai toujours suivi de très près l'activité des artistes. Immédiatement après la première guerre mondiale, j'ai connu le peintre et baron Frans Courtens. Puis je rendai un jour visite au peintre Eugène Laermans. Ensuite encore une quantité d'autres, dont un véritable ami de mon père, un illustre inconnu, Eugène van Mierloo. A sa mort, j'ai appris qu'il avait pris part à la première expédition au Pôle Sud comme reporter-dessinateur. Pendant la première guerre mondiale, j'ai visité une exposition de peintres qui jouissent aujourd'hui d'une notoriété certaine: Felix Deboeck, Victor Servranckx, Jozef Peeters. Aucun d'entre eux n'était alors abstrait. Ce ne fut que quelques années plus tard que nous connûmes le grand boom de la peinture abstraite dans l'art moderne. Lorsque Servranckx organisa une exposition personnelle, j'entrai en contact avec lui et, depuis lors, il m'a considéré comme son premier disciple. J'avais environ quinze ans lorsque je me mis à peindre des toiles abstraites. A seize ans, je collaborais à une feuille d'avant-garde intitulée Sept Arts. Parmi les autres collaborateurs, il y avait le poète Pierre Bourgeois, le poète, peintre et dessinateur Pierre-Louis Flouquet, l'architecte Victor Bourgeois et mon futur beau-frère Paul Werrie (2). Mais l'abstrait ne m'attira pas longtemps. Pour moi, c'était trop facile. Comme je l'ai dit un jour, c'est une aberration matérialiste d'un monde en pleine décadence... C'est alors qu'un ancien acteur entra dans ma vie: Geert van Bruaene.
Je l'avais déjà rencontré auparavant et il avait laissé des traces profondes dans mon imagination: il y tenait le rôle du zwansbaron, du «Baron-Vadrouille». Mais quand je le revis à l'âge de quinze ans, il était devenu le directeur d'une petite galerie d'art, le «Cabinet Maldoror», où tous les avant-gardistes se réunissaient et où furent exposés les premiers expressionnistes allemands. C'est par l'intermédiaire de van Bruaene que je connus Paul van Ostaijen (3). Geert van Bruaene méditait Les Chants de Maldoror du soi-disant Comte de Lautréamont, l'un des principaux précurseurs du surréalisme. C'est ainsi que je devins surréaliste sans le savoir. Grâce, en fait, à van Bruaene. Je suis passé de l'art abstrait au Surréalisme lorsque mes images abstraites finirent par s'amalgamer à des objets figuratifs. A cette époque, j'étais encore communiste...
Q.: A l'époque, effectivement, il semble que l'intelligentsia et les artistes appartenaient à la gauche? Vous avez d'ailleurs peint une toile superbe représentant Lénine et vous l'avez intitulée «Hommage au Père de la Révolution»...
ME: Voyez-vous, c'est un phénomène qui s'était déjà produit à l'époque de la Révolution Française. Les jeunes intellectuels, tant en France qu'en Allemagne, étaient tous partisans de la Révolution Française. Mais au fur et à mesure que celle-ci évolua ou involua, que la terreur prit le dessus, etc., ils ont retiré leurs épingles du jeu. Et puis Napoléon est arrivé. Alors tout l'enthousiasme s'est évanoui. Ce fut le cas de Goethe, Schelling, Hegel, Hölderlin... Et n'oublions également pas le Beethoven de la Sinfonia Eroica, inspirée par la Révolution française et primitivement dédiée à Napoléon, avant que celui-ci ne devient empereur. Le même phénomène a pu s'observer avec la révolution russe. On croyait que des miracles allaient se produire. Mais il n'y en eut point. Par la suite, il y eut l'opposition de Trotski qui croyait que la révolution ne faisait que commencer. Pour lui, il fallait donc aller plus loin!
Q.: N'est-ce pas là la nature révolutionnaire ou non-conformiste qui gît au tréfonds de tout artiste?
ME: J'ai toujours été un non-conformiste. Même sous le nazisme. Bien avant la dernière guerre, j'ai admiré le «Front Noir» d'Otto Strasser. Ce dernier était anti-hitlérien parce qu'il pensait que Hitler avait trahi la révolution. J'ai toujours été dans l'opposition. Je suis sûr que si les Allemands avaient emporté la partie, que, moi aussi, je m'en serais aller moisir dans un camp de concentration. Au fond, comme disait mon ami Mesens, nous, surréalistes, ne sommes que des anarchistes sentimentaux.
Q.: Outre votre peinture, vous êtes aussi un homme remarquable quant à la grande diversité de ses lectures. Il suffit d'énumérer les auteurs qui ont exercé leur influence sur votre œuvre...
ME: Je me suis toujours intéressé à la littérature. A l'athenée (4) à Bruxelles, j'avais un curieux professeur, un certain Maurits Brants (5), auteur, notamment, d'une anthologie pour les écoles, intitulée Dicht en Proza. Dans sa classe, il avait accroché au mur des illustrations représentant les héros de la Chanson des Nibelungen. De plus, mon frère aîné était wagnérien. C'est sous cette double influence que je découvris les mythes germaniques. Ces images de la vieille Germanie sont restées gravées dans ma mémoire et ce sont elles qui m'ont distingué plus tard des autres surréalistes. Ils ne connaissaient rien de tout cela. André Breton était surréaliste depuis dix ans quand il entendit parler pour la première fois des romantiques allemands, grâce à une jeune amie alsacienne. Celle-ci prétendait qu'il y avait déjà eu des «surréalistes» au début du XIXième siècle. Novalis, notamment. Moi, j'avais découvert Novalis par une traduction de Maeterlinck que m'avait refilée un ami quand j'avais dix-sept ans. Cet ami était le cher René Baert, un poète admirable qui fut assassiné par la «Résistance» en Allemagne, peu avant la capitulation de celle-ci, en 1945. Je fis sa connaissance dans un petit cabaret artistique bruxellois appelé Le Diable au corps. Depuis nous sommes devenus inséparables aussi bien en poésie qu'en politique, disons plutôt en «métapolitique» car la Realpolitik n'a jamais été notre fait. Notre évolution du communisme au national-socialisme relève en effet d'un certain romantisme en lequel l'exaltation des mythes éternels et de la tradition primordiale, celle de René Guénon et de Julius Evola, a joué un rôle primordial. Disons que cela va du Georges Sorel du Mythe de la Révolution et des Réflexions sur la violence à l'Alfred Rosenberg du Mythe du XXième siècle, en passant par La Révolte contre le monde moderne de Julius Evola. Le seul livre que je pourrais appeler métapolitique de René Baert s'intitule L'épreuve du feu (Ed. de la Roue Solaire, Bruxelles, 1944) (6). Pour le reste, il est l'auteur de recueils de poèmes et d'essais sur la poésie et la peinture. Un penseur et un poète à redécouvrir. Et puis, pour revenir à mes lectures initiales, celles de ma jeunesse, je ne peux oublier le grand Louis Couperus (7), le symboliste à qui nous devons les merveilleux Psyche, Fidessa et Extase.
Q.: Couperus a-t-il exercé une forte influence sur vous?
 ME: Surtout pour ce qui concerne la langue. Ma langue est d'ailleurs toujours marquée par Couperus. En tant que Bruxellois, le néerlandais officiel m'a toujours semblé quelque peu artificiel. Mais cette langue est celle à laquelle je voue tout mon amour... Un autre auteur dont je devins l'ami fut le poète expressionniste flamand Paul van Ostaijen. Je fis sa connaissance par l'entremise de Geert van Bruaene. Je devais alors avoir dix-huit ans. Lors d'une conférence que van Ostaijen fit en français à Bruxelles, l'orateur, mon nouvel ami qui devait mourir quelques années plus tard à peine âgé de trente-deux ans, fixa définitivement mon attention sur le rapport qu'il pouvait y avoir entre la poésie et la mystique, tout comme il me parla également d'un mysticisme sans Dieu, thèse ou plutôt thème en lequel il rejoignait et Nietzsche et André Breton, le «pape du Surréalisme» qui venait alors de publier son Manifeste du Surréalisme.
ME: Surtout pour ce qui concerne la langue. Ma langue est d'ailleurs toujours marquée par Couperus. En tant que Bruxellois, le néerlandais officiel m'a toujours semblé quelque peu artificiel. Mais cette langue est celle à laquelle je voue tout mon amour... Un autre auteur dont je devins l'ami fut le poète expressionniste flamand Paul van Ostaijen. Je fis sa connaissance par l'entremise de Geert van Bruaene. Je devais alors avoir dix-huit ans. Lors d'une conférence que van Ostaijen fit en français à Bruxelles, l'orateur, mon nouvel ami qui devait mourir quelques années plus tard à peine âgé de trente-deux ans, fixa définitivement mon attention sur le rapport qu'il pouvait y avoir entre la poésie et la mystique, tout comme il me parla également d'un mysticisme sans Dieu, thèse ou plutôt thème en lequel il rejoignait et Nietzsche et André Breton, le «pape du Surréalisme» qui venait alors de publier son Manifeste du Surréalisme.
Q.: Dans votre œuvre, mystique, mythes et surréalisme ne peuvent être séparés?
ME: Non, je suis en quelque sorte un surréaliste mythique et, en cela, je suis peut-être le surréaliste le plus proche d'André Breton. J'ai toujours été opposé au surréalisme petit-bourgeois d'un Magritte, ce monsieur tranquille qui promenait son petit chien, coiffé de son chapeau melon...
Q.: Pourtant, au début, vous étiez amis. Comment la rupture est-elle survenue?
ME: En 1930. Un de nos amis surréalistes, Camille Goemans, fils du Secrétaire perpétuel de la Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal en Letterkunde ( = Académie Royale Flamande de Langue et de Littérature), possédait une galerie d'art à Paris. Il fit faillite. Mais à ce moment, il avait un contrat avec Magritte, Dali et moi. Après cet échec, Dali a trouvé sa voie grâce à Gala, qui, entre nous soit dit, devait être une vraie mégère. Magritte, lui, revint à Bruxelles et devint un miséreux. Tout le monde disait: «Ce salaud de Goemans! C'est à cause de lui que Magritte est dans la misère». C'est un jugement que je n'admis pas. C'est le côté «sordide» du Surréalisme belge. Goemans, devenu pauvre comme Job par sa faillite, fut rejeté par ses amis surréalistes, mais il rentra en grâce auprès d'eux lorsqu'il fut redevenu riche quelque dix ans plus tard grâce à sa femme, une Juive de Russie, qui fit du «marché noir» avec l'occupant durant les années 1940-44. Après la faillite parisienne, Goemans et moi avons fait équipe. C'est alors que parut le deuxième manifeste surréaliste, où Breton écrivit, entre autres choses, que le Surréalisme doit être occulté, c'est-à-dire s'abstenir de tous compromis et de tout particularisme intellectuel. Nous avons pris cette injonction à la lettre. Nous avions déjà tous deux reçu l'influence des mythes et de la mystique germaniques. Nous avons fondé, avec l'ami Baert, une revue, Hermès, consacrée à l'étude comparative du mysticisme, de la poésie et de la philosophie. Ce fut surtout un grand succès moral. A un moment, nous avions, au sein de notre rédaction, l'auteur du livre Rimbaud le voyant, André Rolland de Renéville. Il y avait aussi un philosophe allemand anti-nazi, qui avait émigré à Paris et était devenu lecteur de littérature allemande chez Gallimard: Bernard Groethuysen. Par son intermédiaire, nous nous sommes assurés la collaboration d'autres auteurs. Il nous envoyait même des textes de grands philosophes encore peu connus à l'époque: Heidegger, Jaspers et quelques autres. Nous avons donc été parmi les premiers à publier en langue française des textes de Heidegger, y compris des fragments de Sein und Zeit.
Parmi nos collaborateurs, nous avions l'un des premiers traducteurs de Heidegger: Henry Corbin (1903-1978) qui devint par la suite l'un des plus brillants iranologues d'Europe. Quant à notre secrétaire de rédaction, c'était le futur célèbre poète et peintre Henri Michaux. Sa présence parmi nous était due au hasard. Goemans était l'un de ses vieux amis: il avait été son condisciple au Collège St. Jan Berchmans. Il était dans le besoin. La protectrice de Groethuysen, veuve d'un des grands patrons de l'Arbed, le consortium de l'acier, nous fit une proposition: si nous engagions Michaux comme secrétaire de rédaction, elle paierait son salaire mensuel, plus les factures de la revue. C'était une solution idéale. C'est ainsi que je peux dire aujourd'hui que le célébrissime Henri Michaux a été mon employé...
Q.: Donc, grâce à Groethuysen, vous avez pris connaissance de l'œuvre de Heidegger...
ME: Eh oui. A cette époque, il commençait à devenir célèbre. En français, c'est Gallimard qui publia d'abord quelques fragments de Sein und Zeit. Personnellement, je n'ai jamais eu de contacts avec lui. Après la guerre, je lui ai écrit pour demander quelques petites choses. J'avais lu un interview de lui où il disait que Sartre n'était pas un philosophe mais que Georges Bataille, lui, en était un. Je lui demandai quelques explications à ce sujet et lui rappelai que j'avais été l'un des premiers éditeurs en langue française de ses œuvres. Pour toute réponse, il m'envoya une petite carte avec son portrait et ces deux mots: «Herzlichen Dank!» (Cordial merci!). Ce fut la seule réponse de Heidegger...
Q.: Vous auriez travaillé pour l'Ahnenerbe. Comment en êtes-vous arrivé là?
ME: Avant la guerre, je m'étais lié d'amitié avec Juliaan Bernaerts, mieux connu dans le monde littéraire sous le nom de Henri Fagne. Il avait épousé une Allemande et possédait une librairie internationale dans la Rue Royale à Bruxelles. Je suppose que cette affaire était une librairie de propagande camouflée pour les services de Goebbels ou de Rosenberg. Un jour, Bernaerts me proposa de collaborer à une nouvelle maison d'édition. Comme j'étais sans travail, j'ai accepté. C'était les éditions flamandes de l'Ahnenerbe. Nous avons ainsi édité une vingtaine de livres et nous avions des plans grandioses. Nous sortions également un mensuel, Hamer, lequel concevait les Pays-Bas et la Flandre comme une unité.
Q.: Et vous avez écrit dans cette publication?
ME: Oui. J'ai toujours été amoureux de la Hollande et, à cette époque-là, il y avait comme un mur de la honte entre la Flandre et la Hollande. Pour un Thiois comme moi, il existe d'ailleurs toujours deux murs séculaires de la honte: au Nord avec les Pays-Bas; au Sud avec la France, car la frontière naturelle des XVII Provinces historiques s'étendait au XVIième siècle jusqu'à la Somme. La première capitale de la Flandre a été la ville d'Arras (Atrecht). Grâce à Hamer, j'ai pu franchir ce mur. Je devins l'émissaire qui se rendait régulièrement à Amsterdam avec les articles qui devaient paraître dans Hamer. Le rédacteur-en-chef de Hamer-Pays-Bas cultivait lui aussi des idées grand-néerlandaises. Celles-ci transparaissaient clairement dans une autre revue Groot-Nederland, dont il était également le directeur. Comme elle a continué à paraître pendant la guerre, j'y ai écrit des articles. C'est ainsi qu'Urbain van de Voorde (8) a participé également à la construction de la Grande-Néerlande. Il est d'ailleurs l'auteur d'un essai d'histoire de l'art néerlandais, considérant l'art flamand et néerlandais comme un grand tout. Je possède toujours en manuscrit une traduction de ce livre, paru en langue néerlandaise en 1944.
Mais, en fin de compte, j'étais un dissident au sein du national-socialisme! Vous connaissez la thèse qui voulait que se constitue un Grand Reich allemand dans lequel la Flandre ne serait qu'un Gau parmi d'autres. Moi, je me suis dit: «Je veux bien, mais il faut travailler selon des principes organiques. D'abord il faut que la Flandre et les Pays-Bas fusionnent et, de cette façon seulement, nous pourrions participer au Reich, en tant qu'entité grande-néerlandaise indivisible». Et pour nous, la Grande-Néerlande s'étendait jusqu'à la Somme! Il me faut rappeler ici l'existence pendant l'Occupation, d'une «résistance thioise» non reconnue comme telle à la «Libération». J'en fis partie avec nombre d'amis flamands et hollandais, dont le poète flamand Wies Moens pouvait être considéré comme le chef de file. Tous devinrent finalement victimes de la «Répression».
Q.: Est-ce là l'influence de
Joris van Severen?
ME: Non, Van Severen était en fait un fransquillon, un esprit totalement marqué par les modes de Paris. Il avait reçu une éducation en français et, au front, pendant la première guerre mondiale, il était devenu «frontiste» (9). Lorsqu'il créa le Verdinaso, il jetta un oeil au-delà des frontières de la petite Belgique, en direction de la France. Il revendiqua l'annexion de la Flandre française. Mais à un moment ou à un autre, une loi devait être votée qui aurait pu lui valoir des poursuites. C'est alors qu'il a propagé l'idée d'une nouvelle direction de son mouvement (la fameuse «nieuwe marsrichting»). Il est redevenu «petit-belge». Et il a perdu le soutien du poète Wies Moens (10), qui créa alors un mouvement dissident qui se cristallisa autour de sa revue Dietbrand dont je devins un fidèle collaborateur.
Q.: Vous avez collaboré à une quantité de publications, y compris pendant la seconde guerre mondiale. Vous n'avez pas récolté que des félicitations. Dans quelle mesure la répression vous a-t-elle marqué?
ME: En ce qui me concerne, la répression n'est pas encore finie! J'ai «collaboré» pour gagner ma croûte. Il fallait bien que je vive de ma plume. Je ne me suis jamais occupé de politique. Seule la culture m'intéressait, une culture assise sur les traditions indo-européennes. De plus, en tant qu'idéaliste grand-néerlandais, je demeurai en marge des idéaux grand-allemands du national-socialisme. En tant qu'artiste surréaliste, mon art était considéré comme «dégénéré» par les instances officielles du IIIième Reich. Grâce à quelques critiques d'art, nous avons toutefois pu faire croire aux Allemands qu'il n'y avait pas d'«art dégénéré» en Belgique. Notre art devait être analysé comme un prolongement du romantisme allemand (Hölderlin, Novalis,...), du mouvement symboliste (Böcklin, Moreau, Khnopff,...) et des Pré-Raphaëlites anglais. Pour les instances allemandes, les expressionnistes flamands étaient des Heimatkünstler (des peintres du terroir). Tous, y compris James Ensor, mais excepté Fritz Van der Berghe, considéré comme trop «surréaliste» en sa dernière période, ont d'ailleurs participé à des expositions en Allemagne nationale-socialiste.
Mais après la guerre, j'ai tout de même purgé près de quatre ans de prison. En octobre 1944, je fus arrêté et, au bout de six ou sept mois, remis en liberté provisoire, avec la promesse que tout cela resterait «sans suite». Entretemps, un auditeur militaire (11) cherchait comme un vautour à avoir son procès-spectacle. Les grands procès de journalistes avaient déjà eu lieu: ceux du Soir, du Nouveau Journal, de Het Laatste Nieuws,... Coûte que coûte, notre auditeur voulait son procès. Et il découvrit qu'il n'y avait pas encore eu de procès du Pays réel (le journal de Degrelle). Les grands patrons du Pays réel avaient déjà été condamnés voire fusillés (comme Victor Matthijs, le chef de Rex par interim et rédacteur-en-chef du journal). L'auditeur eut donc son procès, mais avec, dans le box des accusés, des seconds couteaux, des lampistes. Moi, j'étais le premier des troisièmes couteaux, des super-lampistes. Je fus arrêté une seconde fois, puis condamné. Je restai encore plus ou moins trois ans en prison. Plus moyen d'en sortir! Malgré l'intervention en ma faveur de personnages de grand format, dont mon ami français Jean Paulhan, ancien résistant et futur membre de l'Académie Française, et le Prix Nobel anglais T.S. Eliot, qui écrivit noir sur blanc, en 1948, que mon cas n'aurait dû exiger aucune poursuite. Tout cela ne servit à rien. La lettre d'Eliot, qui doit se trouver dans les archives de l'Auditorat militaire, mériterait d'être publiée, car elle condamne en bloc la répression sauvage des intellectuels qui n'avaient pas «brisé leur plume», cela pour autant qu'ils n'aient pas commis des «crimes de haute trahison». Eliot fut d'ailleurs un des grands défenseurs de son ami le poète Ezra Pound, victime de la justice répressive américaine.
 Quand j'expose, parfois, on m'attaque encore de façon tout à fait injuste. Ainsi, récemment, j'ai participé à une exposition à Lausanne sur la femme dans le Surréalisme. Le jour de l'ouverture, des surréalistes de gauche distribuèrent des tracts qui expliquaient au bon peuple que j'étais un sinistre copain d'Eichmann et de Barbie! Jamais vu une abjection pareille...
Quand j'expose, parfois, on m'attaque encore de façon tout à fait injuste. Ainsi, récemment, j'ai participé à une exposition à Lausanne sur la femme dans le Surréalisme. Le jour de l'ouverture, des surréalistes de gauche distribuèrent des tracts qui expliquaient au bon peuple que j'étais un sinistre copain d'Eichmann et de Barbie! Jamais vu une abjection pareille...
Q.: Après la guerre, vous avez participé aux travaux d'un groupe portant le nom étrange de «Fantasmagie»? On y rencontrait des figures comme Aubin Pasque, Pol Le Roy et Serge Hutin...
ME: Oui. Le Roy et Van Wassenhove avaient été tous deux condamnés à mort (12). Après la guerre, en dehors de l'abstrait, il n'y avait pas de salut. A Anvers règnait la Hessenhuis: dans les années 50, c'était le lieu le plus avant-gardiste d'Europe. Pasque et moi avions donc décidé de nous associer et de recréer quelque chose d'«anti». Nous avons lancé «Fantasmagie». A l'origine, nous n'avions pas appelé notre groupe ainsi. C'était le centre pour je ne sais plus quoi. Mais c'était l'époque où Paul de Vree possédait une revue, Tafelronde. Il n'était pas encore ultra-moderniste et n'apprit que plus tard l'existence de feu Paul van Ostaijen. Jusqu'à ce moment-là, il était resté un brave petit poète. Bien sûr, il avait un peu collaboré... Je crois qu'il avait travaillé pour De Vlag (13). Pour promouvoir notre groupe, il promit de nous consacrer un numéro spécial de Tafelronde. Un jour, il m'écrivit une lettre où se trouvait cette question: «Qu'en est-il de votre "Fantasmagie"?». Il venait de trouver le mot. Nous l'avons gardé.
Q.: Quel était l'objectif de «Fantasmagie»?
ME: Nous voulions instituer un art pictural fantastique et magique. Plus tard, nous avons attiré des écrivains et des poètes, dont Michel de Ghelderode, Jean Ray, Thomas Owen, etc. Mais chose plus importante pour moi est la création en 1982, à l'occasion de mes soixante-quinze ans, par un petit groupe d'amis, d'une Fondation Marc. Eemans dont l'objet est l'étude de l'art et de la littérature idéalistes et symbolistes. D'une activité plus discrète, mais infiniment plus sérieuse et scientifique, que la «Fantasmagie», cette Fondation a créé des archives concernant l'art et la littérature (accessoirement également la musique) de tout ce qui touche au symbole et au mythe, non seulement en Belgique mais en Europe voire ailleurs dans le monde, le tout dans le sens de la Tradition primordiale.
Q.: Vous avez aussi fondé le Centrum Studi Evoliani, dont vous êtes toujours le Président...
ME: Oui. Pour ce qui concerne la philosophie, j'ai surtout été influencé par Nietzsche, Heidegger et Julius Evola. Surtout les deux derniers. Un Gantois, Jef Vercauteren, était entré en contact avec Renato Del Ponte, un ami de Julius Evola. Vercauteren cherchait des gens qui s'intéressaient aux idées de Julius Evola et étaient disposés à former un cercle. Il s'adressa au Professeur Piet Tommissen, qui lui communiqua mon adresse. J'ai lu tous les ouvrages d'Evola. Je voulais tout savoir à son sujet. Quand je me suis rendu à Rome, j'ai visité son appartement. J'ai discuté avec ses disciples. Ils s'étaient disputés avec les gens du groupe de Del Ponte. Celui-ci prétendait qu'ils avaient été veules et mesquins lors du décès d'Evola. Lui, Del Ponte, avait eu le courage de transporter l'urne contenant les cendres funéraires d'Evola au sommet du Mont Rose à 4000 m et de l'enfouir dans les neiges éternelles. Mon cercle, hélas, n'a plus d'activités pour l'instant et cela faute de personnes réellement intéressées.
En effet, il faut avouer que la pensée et les théories de Julius Evola ne sont pas à la portée du premier militant de droite, disons d'extrême-droite, venu. Pour y accéder, il faut avoir une base philosophique sérieuse. Certes, il y a eu des farfelus férus d'occultisme qui ont cru qu'Evola parlait de sciences occultes, parce qu'il est considéré comme un philosophe traditionaliste de droite. Il suffit de lire son livre Masques et visages du spiritualisme contemporain pour se rendre compte à quel point Evola est hostile, tout comme son maître René Guénon, à tout ce qui peut être considéré comme théosophie, anthroposophie, spiritisme et que sais-je encore.
L'ouvrage de base est son livre intitulé Révolte contre le monde moderne qui dénonce toutes les tares de la société matérialiste qui est la nôtre et dont le culte de la démocratie (de gauche bien entendu) est l'expression la plus caractérisée. Je ne vous résumerai pas la matière de ce livre dense de quelque 500 pages dans sa traduction française. C'est une véritable philosophie de l'histoire, vue du point de vue de la Tradition, c'est-à-dire selon la doctrine des quatre âges et sous l'angle des théories indo-européennes. En tant que «Gibelin», Evola prônait le retour au mythe de l'Empire, dont le IIIième Reich de Hitler n'était en somme qu'une caricature plébéienne, aussi fut-il particulièrement sévère dans son jugement tant sur le fascisme italien que sur le national-socialisme allemand, car ils étaient, pour lui, des émanations typiques du «quatrième âge» ou Kali-Youga, l'âge obscur, l'âge du Loup, au même titre que le christianisme ou le communisme. Evola rêvait de la restauration d'un monde «héroïco-ouranien occidental», d'un monde élitaire anti-démocratique dont le «règne de la masse», de la «société de consommation» aurait été éliminé. Bref, toute une grandiose histoire philosophique du monde dont le grand héros était l'Empereur Frédéric II de Hohenstaufen (1194-1250), un véritable héros mythique...
Q.: Vous avez commencé votre carrière en même temps que Magritte. Au début, vos œuvres étaient même mieux cotées que les siennes...
ME: Oui et pourtant j'étais encore un jeune galopin. Magritte s'est converti au Surréalisme après avoir peint quelque temps en styles futuriste, puis cubiste, etc. A cette époque, il avait vingt-sept ans. Je n'en avais que dix-huit. Cela fait neuf ans de différence. J'avais plus de patte. C'était la raison qui le poussait à me houspiller hors du groupe. Parfois, lorsque nous étions encore amis, il me demandait: «Dis-moi, comment pourrais-je faire ceci...?». Et je répondais: «Eh bien Magritte, mon vieux, fais comme cela ou comme cela...». Ultérieurement, j'ai pu dire avec humour que j'avais été le maître de Magritte! Pendant l'Occupation, j'ai pu le faire dispenser du Service Obligatoire, mais il ne m'en a pas su gré. Bien au contraire!
Q.: Comment se fait-il qu'actuellement vous ne bénéficiez pas de la même réputation internationale que Magritte?
ME: Voyez-vous, lui et moi sommes devenus surréalistes en même temps. J'ai été célèbre lorsque j'avais vingt ans. Vous constaterez la véracité des mes affirmations en consultant la revue Variétés, revue para-surréaliste des années 1927-28, où vous trouverez des publicités pour la galerie d'art L'Epoque, dont Mesens était le directeur. Vous pouviez y lire: nous avons toujours en réserve des œuvres de... Suivait une liste de tous les grands noms de l'époque, dont le mien. Et puis il y a eu le formidable krach de Wall Street en 1929: l'art moderne ne valait plus rien du jour au lendemain. Je suis tombé dans l'oubli. Aujourd'hui, mon art est apprécié par les uns, boudé par d'autres. C'est une question de goût personnel. N'oubliez pas non plus que je suis un «épuré», un «incivique», un «mauvais Belge», même si j'ai été «réhabilité» depuis... J'ai même été décoré, il y a quelques années, de l'«Ordre de la Couronne»... et de la Svastika, ajoutent mes ennemis! Bref, pas de place pour un «surréaliste pas comme les autres». Certaines gens prétendent qu'«on me craint», alors que je crois plutôt que j'ai tout à craindre de ceux qui veulent me réduire au rôle peu enviable d'«artiste maudit». Mais comme on ne peut m'ignorer, certains spéculent déjà sur ma mort!
Propos recueillis en partie par Koenraad Logghe, en partie par Robert Steuckers. Une version néerlandaise de l'entrevue avec Logghe est parue dans la revue De Vrijbuiter, 5/1989. Adresse: De Vrijbuiter, c/o Jan Creve, Oud Arenberg 110, B-2790 Kieldrecht.
(1) L'activisme est le mouvement collaborateur en Flandre pendant la première guerre mondiale. A ce propos, lire Maurits Van Haegendoren, Het aktivisme op de kentering der tijden, Uitgeverij De Nederlanden, Antwerpen, 1984.
(2) Paul Werrie était collaborateur du Nouveau Journal, fondé par le critique d'art Paul Colin avant la guerre. Paul Werrie y tenait la rubrique «théâtre». A la radio, il animait quelques émissions sportives. Ces activités non politiques lui valurent toutefois une condamnation à mort par contumace, tant la justice militaire était sereine... Il vécut dix-huit ans d'exil en Espagne. Il se fixa ensuite à Marly-le-Roi, près de Paris, où résidait son compagnon d'infortume et vieil ami, Robert Poulet. Tous deux participèrent activement à la rédaction de Rivarol et des Ecrits de Paris.
(3) Paul André van Ostaijen (1896-1928), jeune poète et essayiste flamand, né à Anvers, lié à l'aventure activiste, émigré politique à Berlin entre 1918-1920. Fonde la revue Avontuur, ouvre une galerie à Bruxelles mais miné par la tuberculose, abandonne et se consacre à l'écriture dans un sanatorium. Inspiré par Hugo von Hoffmannsthal et par les débuts de l'expressionnisme allemand, il développe un nationalisme flamand à dimensions universelles, tablant sur les grandes idées d'humanité et de fraternité. Se tourne ensuite vers le dadaïsme et le lyrisme exprérimental, la poésie pure. Exerce une grande influence sur sa génération.
(4) L'Athenée est l'équivalent belge du lycée en France ou du Gymnasium en Allemagne.
(5) Maurits Brants a notamment rédigé un ouvrage sur les héros de la littérature germanique des origines: Germaansche Heldenleer, A. Siffer, Gent, 1902.
(6) Dans son ouvrage L'épreuve du feu. A la recherche d'une éthique, René Baert évoque notamment les œuvres de Keyserling, Abel Bonnard, Drieu la Rochelle, Montherlant, Nietzsche, Ernst Jünger, etc.
(7) Louis Marie Anne Couperus (1863-1923), écrivain symboliste néerlandais, grand voyageur, conteur naturaliste et psychologisant qui met en scène des personnages décadents, sans volonté et sans force, dans des contextes contemporains ou antiques. Prose maniérée. Couperus a écrit quatre types de romans: 1) Des romans familiaux contemporains dans la société de La Haye; 2) des romans fantastiques et symboliques puisés dans les mythes et légendes d'Orient; 3) des romans mettant en scène des tyrans antiques; 4) des nouvelles, des esquisses et des récits de voyage.
(8) Pendant la guerre, Urbain van de Voorde participe à la rédaction de la revue hollando-flamande Groot-Nederland. A l'épuration, il échappe aux tribunaux mais, comme Michel de Ghelderode, est révoqué en tant que fonctionnaire. Après ces tracas, il participe dès le début à la rédaction du Nieuwe Standaard qui reprend rapidement son titre De Standaard, et devient principal quotidien flamand.
(9) Dans les années 20, le frontisme est le mouvement politique des soldats revenus du front et rassemblés dans le Frontpartij. Ce mouvement s'oppose aux politiques militaires de la Belgique, notamment à son alliance tacite avec la France, jugée ennemie héréditaire du peuple flamand, lequel n'a pas à verser une seule goutte de son sang pour elle. Il s'engage pour une neutralité absolue, pour la flamandisation de l'Université de Gand, etc.
(10) Le poète Wies Moens (1898-1982), activiste pendant la première guerre mondiale et étudiant à l'Université flamandisée de Gand entre 1916 et 1918, purgera quatre années de prison entre 1918 et 1922 dans les geôles de l'Etat belge. Fonde les revues Pogen (1923-25) et Dietbrand (1933-40). En 1945, un tribunal militaire le condamne à mort mais il parvient à se réfugier aux Pays-Bas pour échapper à ses bourreaux. Il fut l'un des principaux représentants de l'expressionnisme flamand. Il sera lié, à l'époque du Frontpartij, à Joris van Severen, mais rompra avec lui pour les raisons que nous explique Marc. Eemans.
Cfr.: Erik Verstraete, Wies Moens, Orion, Brugge, 1973.
(11) Les tribunaux militaires belges était présidés par des «auditeurs» lors de l'épuration. On parlait également de l'«Auditorat militaire». Pour comprendre l'abomination de ces tribunaux, le mécanisme de nomination au poste de juge de jeunes juristes inexpérimentés, de sous-officiers et d'officiers sans connaissances juridiques et revenus des camps de prisonniers, lire l'ouvrage du Prof. Raymond Derine, Repressie zonder maat of einde? Terugblik op de collaboratie, repressie en amnestiestrijd, Davidsfonds, Leuven, 1978. Le Professeur Derine signale le mot du Ministre de la Justice Pholien, dépassé par les événements: «Une justice de rois nègres».
(12) Pol Le Roy, poète, ami de Joris Van Severen, chef de propagande du Verdinaso, passera à la SS flamande et au gouvernement en exil en Allemagne de septembre 44 à mai 45. Van Wassenhove, chef de district du Verdinaso, puis de De Vlag (Deutsch-Vlämische Arbeitsgemeinschaft), à Ypres, a été condamné à mort en 1945. Sa femme verse plusieurs millions à l'Auditorat militaire et à quelques «magistrats», sauvant ainsi la vie de son époux. En prison, Van Wassenhove apprend l'espagnol et traduit plusieurs poésies. Il deviendra l'archiviste de «Fantasmagie».
(13) De Vlag (= Le Drapeau) était l'organe culturel de la Deutsch-Vlämische Arbeitsgemeinschaft. Il traitait essentiellement de questions littéraires, artistiques et philosophiques.
00:05 Publié dans art | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : surréalisme, andré breton, belgique, belgicana, flandre, mouvement flamand, tradition, traditionalisme, avant-gardes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook









