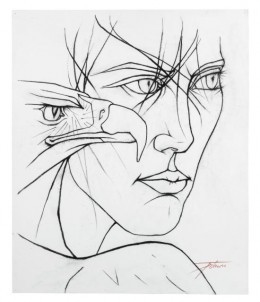 Frente al concepto totalitario y reduccionista del hombre como entidad unidimensional, acuñado por Herbert Marcuse, nosotros diversificamos lo que desde una posición clásica-liberal se vería como un único nivel, en multitud de dimensiones que –básicamente- se reagrupan en cuatro grandes estadios: la dimensión microfísica (la energía elemental), la macrofísica (la materia), la biológica (la vida como sistema orgánico) y la histórico-cultural. Así, el fundamento de lo específicamente humano se da por la intercombinación de las cuatro dimensiones, que sin ser de la misma naturaleza, guardan entre sí un equilibrio armónico, como un 'compositum', es decir, como un elemento estructural del que interesa retener, no difuminar, sus elementos reales y sustantivos.
Frente al concepto totalitario y reduccionista del hombre como entidad unidimensional, acuñado por Herbert Marcuse, nosotros diversificamos lo que desde una posición clásica-liberal se vería como un único nivel, en multitud de dimensiones que –básicamente- se reagrupan en cuatro grandes estadios: la dimensión microfísica (la energía elemental), la macrofísica (la materia), la biológica (la vida como sistema orgánico) y la histórico-cultural. Así, el fundamento de lo específicamente humano se da por la intercombinación de las cuatro dimensiones, que sin ser de la misma naturaleza, guardan entre sí un equilibrio armónico, como un 'compositum', es decir, como un elemento estructural del que interesa retener, no difuminar, sus elementos reales y sustantivos.mardi, 28 septembre 2010
El Hombre Multidimensional - 11 Tesis sobre el Hombre
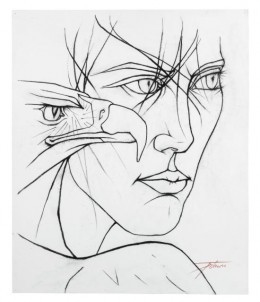 Frente al concepto totalitario y reduccionista del hombre como entidad unidimensional, acuñado por Herbert Marcuse, nosotros diversificamos lo que desde una posición clásica-liberal se vería como un único nivel, en multitud de dimensiones que –básicamente- se reagrupan en cuatro grandes estadios: la dimensión microfísica (la energía elemental), la macrofísica (la materia), la biológica (la vida como sistema orgánico) y la histórico-cultural. Así, el fundamento de lo específicamente humano se da por la intercombinación de las cuatro dimensiones, que sin ser de la misma naturaleza, guardan entre sí un equilibrio armónico, como un 'compositum', es decir, como un elemento estructural del que interesa retener, no difuminar, sus elementos reales y sustantivos.
Frente al concepto totalitario y reduccionista del hombre como entidad unidimensional, acuñado por Herbert Marcuse, nosotros diversificamos lo que desde una posición clásica-liberal se vería como un único nivel, en multitud de dimensiones que –básicamente- se reagrupan en cuatro grandes estadios: la dimensión microfísica (la energía elemental), la macrofísica (la materia), la biológica (la vida como sistema orgánico) y la histórico-cultural. Así, el fundamento de lo específicamente humano se da por la intercombinación de las cuatro dimensiones, que sin ser de la misma naturaleza, guardan entre sí un equilibrio armónico, como un 'compositum', es decir, como un elemento estructural del que interesa retener, no difuminar, sus elementos reales y sustantivos.
00:10 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, anthropologie, homme multidimensionnel |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 27 septembre 2010
Conservadurismo revolucionario frete a neoconservadurismo
00:10 Publié dans Philosophie, Révolution conservatrice, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, révolution conservatrice, théorie politique, politologie, sciences politiques, conservatisme, droite, néo-conservatisme, néo-conservateurs, idéologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 23 septembre 2010
Scruton over de Natiestaat, Nation-Building en Wagner
Scruton over de Natiestaat, Nation-Building en Wagner
 Op vrijdag 23 juni jl. gaf de conservatieve filosoof Roger Scruton een lezing over de crisis die het multiculturele dogma in onze samenleving heeft veroorzaakt. Net voor de lezing had ik een kort gesprek met Scruton over de natiestaat, nation-building in Irak en de opvoering van Wagners Ring-cyclus door de Vlaamse opera.
Op vrijdag 23 juni jl. gaf de conservatieve filosoof Roger Scruton een lezing over de crisis die het multiculturele dogma in onze samenleving heeft veroorzaakt. Net voor de lezing had ik een kort gesprek met Scruton over de natiestaat, nation-building in Irak en de opvoering van Wagners Ring-cyclus door de Vlaamse opera.
U noemt de natiestaat de grootste Europese verwezenlijking. De Europese Unie heeft dat erfgoed weggegooid. Waarom gelooft u niet dat economische samenwerking conflicten tussen Europese naties zal voorkomen?
Economische samenwerking heeft nooit conflicten voorkomen in het verleden, nietwaar? Natuurlijk is economische samenwerking een goede zaak op zich, maar conflicten hebben hun oorsprong in allerlei rivaliteiten die niets met economie hebben te zien: immigratie en emigratie, bedreigde grenzen, taalverschillen, religieuze verschillen, enz. Het volstaat niet om te zeggen dat we mensen gaan aanmoedigen om handel te drijven met elkaar. Samenwerking tussen a en b is enkel mogelijk indien a zich onderscheidt van b. Indien het onderscheid van de natiestaat verloren gaat, verlies je ook ondernemingen.
Uw verdediging van de natiestaat wordt bekritiseerd door diegenen die menen dat de geschiedenis van de Europese natiestaat samenvalt met de donkerste periode van de Westerse beschaving: kolonialisme, imperialisme, fascisme en nationaal-socialisme. Wat zegt u daarop?
Eerst en vooral, wat is er verkeerd met kolonialisme en imperialisme? Wat is de Europese Unie, als het geen imperialisme is? Empire is een natuurlijk iets voor mensen en het is een manier om conflicten te overwinnen. Over fascisme zou ik zeggen dat het uiteraard gaat om een verminkte vorm van de natiestaat. De natiestaat bestaat in Engeland op zijn minst sinds Shakespeare’s verheerlijking ervan. En de donkerste periode in de Europese geschiedenis werd veroorzaakt door een pathologische vorm van Duits nationalisme, niet door de natiestaat.
Menig islamitisch immigrant kent geen territoriale loyaliteit welke een voorwaarde is voor burgerschap in de natiestaat. Wat te doen met diegenen die niet willen assimileren?
Het correcte beleid tegenover diegenen die niet willen assimileren is hen de optie te geven om elders te gaan waar ze dat wel kunnen, zoals bijvoorbeeld, waar ze vandaan komen.
Er wordt nu veel gepraat over een Amerikaans imperium. Hoe kijkt u daar tegen aan?
Het gaat niet om imperialisme van de oude stempel. Natuurlijk gebruiken de Amerikanen hun macht om – in hun overtuiging – overal ter wereld democratische regeringen te stichten omdat zij denken dat democratie de enige weg naar stabiliteit is. Welke andere vorm van stabiliteit is er in deze moderne wereld? Ik zeg niet dat de Amerikanen het recht hebben om hun macht op deze wijze te gebruiken. Niettemin, dat is hoe ze het doen. Het is niet hetzelfde als imperialisme. Integendeel, het is een poging om onafhankelijke staten te creëren door dictators te verwijderen.
Irak is met zijn met artificiële grenzen een product van het kolonialisme. Zijn de Amerikanen niet gedoemd om te falen in hun nation-building aldaar?
Ik hoop het niet maar het is wel waarschijnlijk voor de redenen waarnaar je verwijst. Irak is een volkomen artificiële staat net zoals België. In een regio die de natiestaat niet heeft gekend is het zeer onwaarschijnlijk om te slagen. Mijn eigen mening is dat de correcte benadering tegenover Irak is om het op te splitsen in een Koerdisch, Sjiitisch en Soennitisch gedeelte.
U bent Wagner-kenner. De Vlaamse Opera gaat Wagners ‘Der Ring des Nibelungen’ (de Ring-cyclus) opvoeren. Momenteel wordt Das Rheingold vertoond. De regisseur heeft echter de context van de Germaanse mythologie overboord gegooid en plaats de opera in een geglobaliseerde internetgemeenschap. Wat denkt u van zo’n interpretatie?
De gewoonte om de opera’s van Wagner te verminken is nu zodanig diep in onze cultuur verankerd dat men niet kan hopen dat ze vertoond zullen worden zoals hij het bedoeld heeft. Indien men de Ring-cyclus ontdoet van de openbaring van de natuur, de jager-verzamelaar gemeenschap, de akkerbouw en de rol van de goden daarin, dan neem je de structuur van het muziekdrama weg. De Ring-cyclus heeft vele betekenissen maar het heeft deze omdat het ook een letterlijke betekenis heeft. Als je de letterlijke betekenis vernietigt, vernietig je ook al de andere.
De regisseur [Ivo Van Hove] zal zich waarschijnlijk verdedigen door te stellen dat hij Wagner vertaalt naar de moderne wereld van vandaag.
De Ring-cyclus is een schitterend portret van de moderne wereld, net omdat het gesitueerd is in mythische tijden. Door deze mythische tijden te creëren maakt Wagner het mogelijk om onze eigen toestand te zien. Als je het vastpint op het huidige moment van de internetcultuur, dan verlies je die mythische tijd en verlies je die eerste moderne betekenis zodat het morgen al verouderd zal zijn.
Scruton in het Nederlands:
Roger Scruton heeft een uitzonderlijk hoogstaand oeuvre van meer dan 30 boeken geschreven waarbij hij diepgang combineert met breedte: of hij nu schrijft over de dreiging van de islam, over Westerse filosofie, over het conservatisme, over esthetica, over moderne cultuur en zelfs over seksuele begeerte, het is steeds met een professionalisme dat de specialist versteld doet staan.
De betekenis van het conservatisme (Edmund Burke Lezing I, Aspekt, 2001)
Voor de Edmund Burke Stichting sprak Scruton over zijn eigen conservatieve overtuiging en zijn ervaring met mei ’68. Een ideale inleiding met bibliografie.
Het Westen en de islam – Over globalisering en terrorisme (Houtekiet, 2003)
De botsing met de islam dwingt ons, aldus Scruton, om grondig na te denken over de fundamenten van onze politieke ordening.
Moderne cultuur – Een gids voor kritische mensen (Agora, 2003)
Tegenover de richtingloze moderne cultuur plaatst Scruton het spirituele houvast dat onze traditie biedt en houdt hij een warm pleidooi voor ‘hoge cultuur’.
Andere: Filosofisch denken – Een handleiding voor nieuwsgierige mensen (Bijleveld, 2000). In de reeks ‘Kopstukken Filosofie’ verschenen tevens vertalingen van zijn werken over Spinoza en Kant (Lemniscaat, 2000).
Meer informatie op Scrutons website.
00:15 Publié dans Philosophie, Réflexions personnelles, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théorie politique, grande-bretagne, angleterre, conservatisme, nationalisme, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Serge Latouche et le refus du développement

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1986
La problématique, universelle, du développement économique et social des pays faisant partie de ce que l'on appelle le Tiers Monde, constitue, depuis maintenant plusieurs décennies, un champ de débats et de controverses interminables. Deux écoles se présentent. L'une prétend que, dans une vision linéaire occidentale de l'histoire des peuples, la voie du développement est le passage obligé de tous les peuples sur le chemin de leur "évolution". Cette vision regroupe dans une conclusion commune les émules de l'école libérale (favorable non seulement au développement d'un marché mondial mais aussi à la liberté totale des échanges de biens et marchandises) et une partie de l'école marxiste, issue partiellement des mêmes doctrines propres aux économistes du XVIIIème siècle. L'autre école ne présente pas la même cohérence. Globalement, elle nie que le développement soit le résultat d'une série de mécanismes socio-économiques répétitifs et affirme même que les formes du développement "à l'occidentale" ne sont pas nécessairement positives en soi, ne favorisent pas obligatoirement le bien-être de ces peuples et ne contribuent pas automatiquement à la préservation de leurs identités.
Serge LATOUCHE, spécialiste du Tiers Monde, épistémologue des sciences sociales, est aussi professeur d'économie politique. Sa démarche se présente, dès le départ, comme un refus de l'école matérialiste orthodoxe, que ce soit dans sa version libérale ou marxiste. Pour lui, l'idéologie du développement constitue d'une part une idéologie de camouflage et, d'autre part, une négation plus ou moins avouée des identités ethno-culturelles. Idéologie de camouflage: l'idée de développement cache médiocrement un paradigme essentiel de la pensée issue de la matrice judéo-helléni- stique. Il y a probablement une forme de "ruse de la raison occidentale" qui assure ainsi son pouvoir de domination, pouvoir colonial proprement dit, sur les pays dits "sous-développés" ou "moins avancés" (la variété des catégories de dénomination de ces pays révèlent bien le caractère idéologique des analyses et non la neutralité du langage prétendument scientifique).
Qu'est-ce que le développement? Une approche vulgaire répondrait sans hésitation: le bien-être des masses et un "niveau de vie" élevé (équivalent au moins à l'American Way of Life). Cette réponse constituerait une fois de plus un camouflage du véritable discours idéologique qui sous-tend cette déclaration de principe aussi simpliste qu'intéressée. Serge LATOUCHE nous le rappelle: jusqu'à présent, toutes les expériences de politiques de développement ont échoué... Toutes les techniques ont fait la preuve de leur inefficacité... D'ailleurs face à ces échecs répétés, certains ont pu parler de "mythe du développement" (Cf. Celso FURTADO ou Candido MENDES). Le résultat de ces tentatives est catastrophique: exode rural massif, qui a entraîné non seulement une désertification des campagnes (avec des effets explicites comme la baisse de la capacité de production agricole du pays, donc l'aggravation de la dépendance alimentaire et, en même temps, la dégradation des conditions écologiques sur les terres laissées à l'abandon) mais aussi une "clochardisation" monstrueuse des paysans dans les périphéries des grandes cités occidentalisées (le phénomène des bidonvilles dans les mégalopoles comme Mexico, le développement de la criminalité juvénile comme à Rio de Janeiro ou certaines grandes villes africaines, l'augmentation des activités économiques parallèles à l'économie mondiale localisée, etc..). Phénomène aussi de destructions des tissus locaux de production s'inscrivant dans une logique mondialisée de division et de délocalisation des tâches (Cf. les stratégies des firmes transnationales).
Dans un certain nombre de ces pays, les recettes nouvelles procurées par l'exploitation des ressources locales, soit directement exploitées par l'Etat (version post-nassérienne en Egypte, par ex.) soit concédées à des entreprises étrangères (Cf. le cas d'Elf Aquitaine, multinationale pétrolière française, au Gabon), ces profits réalisés par cette rente naturelle, furent réutilisés dans le sens d'un mode de développement copié des modes des pays du centre du système. La construction d'énormes complexes industriels (Nigéria, par ex.), qui exigeait d'énormes investissements et dont les profits espérés en termes de développement industriel national et d'implantation sur les marchés mondiaux, fut refusée malgré les espoirs des dirigeants locaux. Ces investissements furent surtout l'occasion, pour les entreprises étrangères (bâtiments et travaux publics comme Bouygues en France), de réaliser de substantiels chiffres d'affaires sur les chantiers ouverts. Parallèlement à ces recettes, on constate que le système bancaire occidental, alléché par ce "développement" des pays du Tiers Monde, pratique alors une politique de crédit très large, dépassant même souvent les règles de sécurité généralement admises en la matière par les professionnels eux-mêmes. D'où, dans les années 80, l'affolement du système bancaire occidental face au montant de la dette internationale, surtout aggravé par l'insolvabilité évidente des pays endettés (la crise pétrolière de 1973 est aujourd'hui passée et on peut constater sans aucun effort que le marché pétrolier est aujourd'hui victime d'une crise des prix à la baisse). La rente n'est plus le gage certain d'une solvabilité.
Pour E. MORIN, cette crise du développement, c'est à la fois la crise de l'idéologie occidentale sous la forme de deux de ses mythes fondateurs (conquête de la nature-objet par l'homme souverain et triomphe de l'individu atomisé bourgeois) et "le pourrissement du paradigme humanistico-rationnel de l'homo sapiens/faber"...
Par ailleurs, Serge LATOUCHE pose ensuite la question fondamentale, valable pour toute idéologie universaliste: "Y a-t-il un niveau de bien-être quantitativement repérable et ayant une signification dans l'absolu?" (p.9). Cette "absolutisation", dans le temps et dans l'espace, des valeurs occidentales, tant au niveau des valeurs fondamentales que dans les pratiques concrètes de réalisation, se pose aussi dans la remise en question des idéaux occidentaux: 1) idéologie des droits de l'homme (qui ne sont plus les droits que l'on peut concevoir dans un système de valeurs spécifiques comme celles qui président à l'Habeas Corpus des cultures anglo-saxonnes) à prétention universaliste et impérialiste (Reagan prétend justifier ses multiples agressions dans le monde au nom d'une vague référence à cette idéologie), 2) système de "démocratie représentative" idéologiquement et politiquement hégémo- nique (cette valorisation absolue impliquant aussi une dévalorisation des autres systèmes, de tous les autres systèmes politiques), etc... Le paradigme occidental du développement se traduit en fait dans ce que Serge LATOUCHE nomme une "objectivation du social".
Cette objectivation, qui passe par l'acquisition théorique des formes de vie occidentales (possession des biens de consommation utiles) se conjugue avec une utilisation neutralisée de la technique. Cette dernière est alors perçue comme purement "naturelle", moyen objectif de maîtrise, donc sans caractère culturel et "engagé". Serge LATOUCHE ajoute: "L'objectivation du développement est la source de la conception "technique" des stratégies de développement". La question, précise-t-il afin de parer à toute fausse critique (du style: "c'est trop facile de refuser le développement quand on en bénéficie soi-même"), n'est pas de dire non à une augmentation des conditions matérielles d'existence des hommes, mais de traduire le développement dans un schéma qui respecte et tienne compte des spécificités culturelles de chaque peuple. Le développement ne doit pas, en sus d'une paupérisation des peuples, favoriser le phénomène majeur de déculturation. L'auteur précise que le tort provoqué par le développement aux peuples est bien celui-là et que sa nature est d'être radical. En effet, le développement est -il faut le souligner- un "paradigme occiden- tal". Il s'agit d'une expérience historique liée à un ensemble de valeurs propres à une aire culturelle, globalement judéo-chrétienne. LATOUCHE écrit: "Le développement, c'est un regard sur le monde qui vise à valoriser celui dont il émane et à dévaloriser l'autre". Il ajoute que proposer cette expérience en modèle universel indépassable est un "maquillage" de l'impérialisme de l'Occident. Certains, plus précis, préfèrent parler de "néo-colonialisme".
Nous ne prétendons pas épuiser toute la richesse des réflexions économiques et culturelles de ce livre. Les analyses des principes d'autodynamisme du capital, le débat sur l'antériorité du capitalisme sur l'impérialisme (thèse léniniste classique) contesté par Serge LATOUCHE, sont quelques-uns des éléments de ce livre magistral. Citons, en guise de conclusion, ces quelques phrases: "Finalement, par des voies différentes, libéraux et marxistes se rejoignent sur ce même "diagnostic réaliste". Ils communient dans la même vision occidentale d'une histoire unidimensionnel- le". "En limitant dans le résultat du mouvement de leur analyse théorique la portée des destructions à leur portée strictement économique, les marxistes réduisent le sous-développement des pays victimes à un recul des forces productives et non à la destruction des bases d'une autre forme d'épanouissement historique. L'équation 'sous-développement = retard' n'est tautologique que si le champ du possible est réduit à une ligne d'évolution unique, sur laquelle on ne peut effectivement qu'être en avance ou en retard".
Deux citations qui résument la position de Serge LATOUCHE: refuser les analyses purement économiques pour introduire les paramètres culturels et politico-historiques, non pas comme critères exogènes, de pure extériorité par rapport à un soi-disant "système" infrastructurel de nature quantitative et économique, mais comme sujets actifs de la réflexion analytique. Une indépendance intellectuelle que tous nos lecteurs apprécieront.
Ange SAMPIERU.
Serge LATOUCHE, Faut-il refuser le développement?, PUF, Paris, 1986, 135 FF.
00:05 Publié dans Economie, Philosophie, Sociologie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : économie, développement, philosophie, sociologie, théorie politique, politologie, sciences politiques, anti-utilitarisme, mauss, serge latouche |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 20 septembre 2010
Gnose et politique chez Jacob Taubes
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1986
Gnose et politique chez Jacob Taubes
 Gnose et politique. Apparamment deux do- maines sans rapports aucuns l'un avec l'autre. La Gnose, c'est la théologie, la religion de la fuite hors des vanités de ce bas monde. La Gnose, c'est le refus de l'histoire, donc l'exact opposé du politique qui, lui, est immersion totale dans l'imma- nence de la Cité, dans le grouillement des passions et des intérêts. Pour Jacob TAUBES, pourtant, il est possible d'interpré- ter historiquement le déploiement des idéaux gnostiques, de repérer les traces que le mental gnostique a laissé, par le truchement du christianisme, dans les idéologies politiques. Ce travail de recherche, il l'a entrepris lors d'un colloque de la Werner-Reimers-Stiftung, tenu à Bad Homburg en septembre 1982. Les actes de ce colloque sont désormais disponibles sous forme de livre (références infra).
Gnose et politique. Apparamment deux do- maines sans rapports aucuns l'un avec l'autre. La Gnose, c'est la théologie, la religion de la fuite hors des vanités de ce bas monde. La Gnose, c'est le refus de l'histoire, donc l'exact opposé du politique qui, lui, est immersion totale dans l'imma- nence de la Cité, dans le grouillement des passions et des intérêts. Pour Jacob TAUBES, pourtant, il est possible d'interpré- ter historiquement le déploiement des idéaux gnostiques, de repérer les traces que le mental gnostique a laissé, par le truchement du christianisme, dans les idéologies politiques. Ce travail de recherche, il l'a entrepris lors d'un colloque de la Werner-Reimers-Stiftung, tenu à Bad Homburg en septembre 1982. Les actes de ce colloque sont désormais disponibles sous forme de livre (références infra).
Le thème central, celui de la Gnose comme phénomène religieux, a déjà été abondem- ment exploré. Mais uniquement en tant que phénomène religieux de la fin de l'antiquité. Lors du colloque de Bad Homburg, la plupart des participants ont d'ailleurs abordé la Gnose sous l'angle strictement théologique, relatant ses avatars antiques. La Gnose n'est pourtant pas morte; elle s'est infiltrée dans le discours politique moderne. Odo MARQUARD définit la Gnose comme suit: "La Gnose est la positivisation de la Weltfremdheit (le fait d'être étranger au monde) et la négativisation du monde". Selon MARQUARD, la Gnose génère une conception eschatologique de l'histoire qui juge mauvais le monde tel qu'il est et valorise du même coup toute marginalité affichée par rapport à lui. Le Moyen Age jugule les débordements de l'eschatologisme, en posant un Dieu "bon", créateur d'un monde globalement positif. Ce monde, produit d'un créateur bon, ne peut en conséquence qu'être bon, conforme à sa bonté infinie. Le Moyen Age met donc un terme à la Weltfremdheit de la Gnose et revalorise la création. L'Augustinisme part du principe que cette "bonne création", ce "bon monde" a été perverti(e) par l'homme qui a abusé de sa liberté et s'est servi des richesses de cette création pour satisfaire des appétits de puissance. Le "bon monde", comme le "Bon Dieu", sont victimes de la "malifacture" de l'homme. Pour MAR- QUARD comme pour le théologien et philosophe Hans BLUMENBERG, le nomina- lisme constitue un retour de la Gnose en restituant au "Bon Dieu" une totale liberté d'action et donc une irresponsabilité vis-à-vis de ses créations qui, automatiquement, ne sont plus globalement considérées comme positives.
Cette "maléfaction" du monde provoque l'âge des révolutions populaires, des contestations sociales, des guerres de religions, parce que les hommes veulent abattre le monde tel qu'il est pour le remplacer par un monde idéal. A la suite de ces querelles, de ces guerres civiles perma- nentes, l'Europe connaîtra un deuxième dépassement du mental gnostique grâce à la "neutralisation" (Carl SCHMITT en parlera abondemment, dans le sillage de ses études sur HOBBES). L'Etat hobbesien neutralise ainsi les querelles religieuses; il valorise le monde régi par le Prince. Un siècle plus tard, LEIBNIZ parlera du meilleur Dieu, créateur du meilleur des mondes possibles. Dans cette optique, l'immanence acquiert à nouveau une valeur positive. La réalité de l'existence est acceptée telle quelle par les Lumières anglo-saxonnes. Le monde est acceptée mais, simultanément, dépourvu de tout caractère sensationnel.
A cette disparition du merveilleux et de l'enthousiasme eschatologique, succédera iné- vitablement la récidive gnostique, avec le pessimisme de ROUSSEAU et le concept marxiste d'aliénation. Pour MARQUARD, cette récidive gnostique recèle un danger très sérieux: celui de ne plus tenir compte des réalités complexes du monde immanent (jugées reflets du mal en soi) et d'engendrer une praxis du politique reposant sur le tout-ou-rien.
L'objet du colloque de Bad Homburg était d'accepter cette interprétation de l'histoire des idées politiques en Europe ou de la réfuter. Pour le professeur berlinois Richard FABER, pourfendeur génial de la notion d'Occident (Cf. Orientations no.5), le chemi- nement de MARQUARD est typiquement libéral, rattachable aux Lumières anglo-saxonnes, qui biffent des esprits les enthousiasmes et les fureurs révolutionnaires. Le Dieu "bon" des Lumières anglo-saxonnes, mais aussi de LEIBNIZ, est, pour MARQUARD, mort sous les coups de la récidive gnostique et du romantisme comme le signale un autre participant au colloque, Ioan P. CULIANU. Pour FABER, les thèses de MARQUARD expriment ipso facto un néo-conservatisme rigide, à mettre en parallèle avec la renaissance des thèses néo-libérales anti-révolutionnaires de HAYEK et de von MISES. L'alibi de MARQUARD, affirme FABER, est son "polythéisme", en tant qu'acceptation des diversités du monde. Mais ce polythéisme, ajoute encore FABER, minimise la fonction politique, qui est par définition transformatrice et quasi-prophéti- que. Les dieux du polythéisme marquardien sont "la science, la technique et l'économie" qui engendreront la neutralisation dont notre époque, héritière directe des gnoses romantique et marxiste, aurait rudement besoin.
Dans une seconde contribution au colloque de Bad Homburg, FABER s'attaque au théologien et philosophe germano-américain Eric VOEGELIN. Si MARQUARD et BLUMENBERG valorisaient essentiellement l'anti-gnosticisme des Lumières anglo-saxon- nes, VOEGELIN valorise, lui, la neutralisation médiévale de l'eschatologisme gnostique. Il y voit le véritable génie de l'Occident car, dans le libéralisme philoso- phique du XVIIIème siècle et dans le positivisme comtien, se cache l'idée d'une révolution permanente, d'une incomplétude du monde qui se "guérit" par de petites interventions chirurgicales. Le monde n'est pas accepté, dans ces philosophies sociales et politiques, comme globalement "bon". Dans les débats politiques, cela engendre une praxis marquée d'indécision voire un chaos non violent. Pour FABER, pourtant, VOEGELIN, BLUMENBERG et MARQUARD doivent être renvoyés dos à dos comme produits "occidentaux" qui refusent de percevoir le monde comme tissu conflictuel incontournable.
On le constate: le débat est sans fin, il interpelle toute l'histoire spirituelle et intel- lectuelle de l'Europe. Le politique véhicule nécessairement la gnose et nier les éléments gnostiques correspond à une négation partielle du politique.
Autre trésor que nous avons découvert dans les actes de cet époustouflant colloque, qui nous ouvre de vastes horizons: un essai d'Ekkehard HIERONIMUS sur le dualisme et la Gnose dans le mouvement völkisch allemand et plus précisément dans les cénacles qui ont adhéré au national-socialisme. Nous y reviendrons dans une prochaine contribution...
Robert STEUCKERS.
Jacob TAUBES, Gnosis und Politik, (Religionstheorie und Politische Theologie, Band II), Wilhelm Fink Verlag / Verlag Ferdinand Schöningh, München/Paderborn, 1984, 306 S., 78 DM.
00:05 Publié dans Philosophie, Théorie politique, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gnose, politique, politologie, sciences politiques, philosophie, jacob taubes, tradition, eschatologie, christianisme, judaïsme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 19 septembre 2010
J. J. Esparza: de la postmodernité
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1986 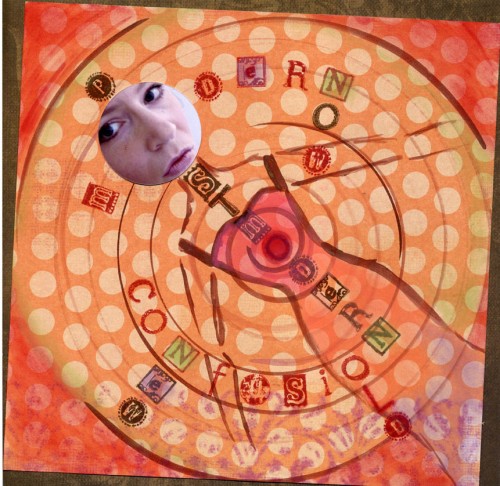
De la post-modernité
José Javier ESPARZA
La post-modernité est à la mode depuis une bonne décennie. Le terme "post-moderne" a été forgé par le philosophe français Jean-François LYOTARD qui entendait exprimer un sentiment hyper-critique, généré par le désenchantement que suscitaient notre époque (in: La condition postmoderne, Editions de Minuit, Paris, 1979). Depuis lors, les interprétations du phénomène post-moderne se sont succédé pour être appliquées sans trop d'ordre ni de rigueur. On en est même venu à l'identifier à une mode musicale, ce qui, finalement, revient à ne percevoir que la partie d'un tout. La musique hyper-sophistiquée par la technique, les "comics" américains ou la bande dessinée européenne, la mode, le foisonnement des manifestations artistiques de coloration dionysia- que ne sont ni plus ni moins que des facettes de la post-modernité. Mais les facettes les plus visibles donc, a fortiori, les plus appréciées par la culture mass-médiatique. Avant toute chose, il convient de comprendre ce qui a précédé ces phénomènes pour éviter de nous fourvoyer dans une analyse trop fragmentaire de la post-modernité.
Présentisme et désenchantement
Quels sont les facteurs sociologiques qui définissent la post-modernité? Pour Fernando CASTELLO, journaliste à El Pais, il s'agit de la vogue post-industrielle, portée par l'actuelle révolution scientifique et technique qui implique l'abandon des fonctions intellectuelles à la machine et se manifeste dans l'univers social par une espèce de nihilisme inhibitoire, par un individualisme hédoniste et par le désenchante- ment (1). D'autres, tel Dionisio CAÑAS, nous décrivent l'ambiance émotionnelle de l'attitude post-moderne comme un déchantement par rapport au passé marqué par l'idéologie du "progrès". Cette idéologie a donné naissance à la modernité et aujourd'hui, sa disparition engendre une désillusion face à un présent sans relief ainsi qu'une forte sensation de crainte face au futur immédiat. L'ensemble produit une vision apocalyptique et conservatrice, négatrice de la réalité, vision qui, selon CAÑAS, coïncide avec une esthétique "réhumanisante", anti-moderne et, parfois, engagée. Une telle esthétique avait déjà été annoncée par Gimenez CABALLERO, dans son ouvrage Arte y Estado, publié en 1935 (2). Pour ces deux auteurs, il s'agit, en définitive, d'un retour au conservatisme.
Entendons, bien sûr, que ce conservatisme ne saurait se réduire à un mental "droitier". Guillau- me FAYE (3) parle, par exemple, d'un néo-conservatisme des gauches, régressif mais tou- jours égalitaire, qui survient lorsque le progressisme se rétracte en un présent sans perspective, une fois coupées la mémoire et la dimension vivantes du passé. La post-modernité, l'attitude post-moderne, restent "progressistes" (du moins en paroles) et égalitaire, mais le progrès qu'elles évoquent est mis à l'écart lorsqu'il affronte, dans la réalité concrète, un futur incertain et critique. Le discours progressiste est, à l'épreuve des faits, freiné et immobilisé par la menace d'une crise mondiale. Mais s'il veut conserver sa valeur et sa légitimité, il doit continuer sa marche en avant tout en maintenant son utopie de normalisation du monde. Le résultat est que l'utopie progressiste commence à perdre sa crédibilité, faisant place à une forme élégante et sophistiquée de présentisme en laquelle le lyrisme technique de la modernité devient un snobisme technologique.
Le manque de perspectives que nous offre le futur crée un vide fatal, une sensation de désenchantement vis-à-vis du présent. Dans la modernité, le présent avait toujours été la préfiguration du futur, sa mise en perspective, qu'il s'agissait de la lutte des classes pour une société communiste ou de la normalisation légale pour aboutir au règne sans partage de la société marchande. Lorsque l'idéologie sociale, la modernité, n'a plus la possibilité de préfigurer quoi que ce soit, la post-modernité émerge. Mais pourquoi la modernité n'est-elle plus à même d'offrir un futur? Pourquoi est-on arrivé au point final de la modernité?
La mort du finalisme
L'idée de fin se trouve dans l'embryon même des idéologies de la modernité. Toutes partent d'un point de départ négatif (exploitation d'une classe prolétaire par une classe plus élevée, impossibilité de mener à bien les échanges naturels entre les individus, etc.) pour arriver à un point final positif (la société sans classes, le libre-échange, etc.). Dès lors, le finalisme est partie intégrante de la modernité en tant qu'idéologie.
Il est évident que la modernité n'est pas seulement une idéologie. La modernité est un phénomène ambigu parce qu'elle contient tant une idéologie homogénéisante et inorganique qu'un vitalisme transformateur de la nature organique. Ainsi, aux yeux d'Oswald SPENGLER, la modernité présente d'un côté la vitalité faustienne et aventurière qui est en grande partie à la base de la force d'impulsion du devenir historique européen, mais d'un autre côté, elle présente des tendances meurtrières qui prétendent normaliser (moderniser) la planète entière, en promouvant une vision inorganique. Une telle normalisation signifie pour SPENGLER la fin de l'âge des "hautes cultures" (Hochkulturen), la fin de l'ère des spiri- tualités et de la force vitale des peuples. Il existe donc un divorce entre la modernité comme vitalisme, comme aventure, comme "forme". La première est la vision progressiste de l'histoire, la seconde est la vision tragique du monde et de la vie. La première est celle qui a prédominé.
Le souci d'homogénéiser et de normaliser le monde, pour qu'il accède enfin à la fin paradisiaque promise, trouve son cheval de bataille dans l'idéologie du progrès, véhiculant une vision du temps linéaire qui relie le monde réel négatif au monde idéal positif. Cette particularité rappelle ce que NIETZSCHE nommait l'inversion socratique: la césure du monde en deux mondes, germe de toutes les utopies. Le progrès idéologique se perçoit comme matrice de la modernité. Mais ce progrès signifie aussi la certitude de l'existence d'un point final, puisqu'on ressent l'infinitude du progrès comme une hypocrisie et que, dans ce cas, il faudra un jour cesser de croire en lui. NIETZSCHE n'a-t-il pas écrit dans l'Antéchrist: "L'humanité ne représente pas une évolution vers quelques chose de meilleur ou de plus fort, ou de plus haut, comme on le croit aujourd'hui; le progrès est purement une idée moderne; c'est-à-dire une idée fausse". Par sa propre nature, la notion de progrès implique la fin de l'histoire. C'est ce que pressentait sans doute Milán KUNDERA, lorsqu'il écrivait: "Jusqu'à présent, le progrès a été conçu comme la promesse d'un mieux incontestable. Aujourd'hui cependant, nous savons qu'il annonce également une fin" (4). Cette certitude qu'une fin surviendra est cela précisément qui produit le désenchantement. Tous les finalismes sont à présent morts parce qu'ils ne sont légitimes que dans la mesure où ils atteignent un but hic et nunc.
Régression et fin de l'histoire
Mais quid dans le cas où l'on affirmerait aucun finalisme? Dans le cas où l'on ne prétendrait pas arriver à une fin de l'histoire, à la fin des antagonismes et des luttes entre volontés oppo- sées? Cette conclusion, consciemment ou inconsciemment, des milliers d'intellectuels l'ont déjà tirée. En se posant une question très simple: où se trouve ce fameux paradis annoncé par les progressistes? La réponse est lapidaire: nulle part. Déduction: la seule possibilité qui reste pour sauver l'utopie, c'est de cultiver une idéologie de la régression. On passe de ce fait à un culte du "régrès" qui remplace la culte du "progrès" devenu désuet et sans objet.
Ce n'est pas un hasard si la gauche de notre époque vire au "vert" et à un certain passéisme idyllique. Pour la gauche actuelle, l'Arcadie pastoraliste s'est substituée à l'Utopie constructiviste. Cette mutation est dans la logique des choses. Le progrès avait été conçu selon une double optique: idéologique et technologique. Le progrès technologique, véhiculé par cet esprit faustien et aventurier (SPENGLER), qui donna toute son impulsion au développement de l'Europe, a, plutôt que de normaliser et de pacifier, créé plus de tensions et d'antagonismes. Prométhée, dit-on, est passé à droite... La gauche a réagi, consciente que le progrès technique était par définition sans fin et limitait ipso facto son "monde idéal"; elle délaissa la technique, abandonna son promé- théisme (sauf, bien sûr en URSS où le technicisme marxiste se couple au mythe de Gengis Khan). La gauche a opéré un tour de passe passe conceptuel: elle n'a plus placé la fin de l'histoire, l'homogénéisation de la planète, dans un avenir hypothétique. Sur le plan des idées et de la praxis, elle a replacé cette fin dans l'actualité. Attitude clairement observable chez les idéologues de l'Ecole de Francfort et leurs disciples.
Cette mutation s'est effectuée de manière relativement simple. Il s'agit, dans la perspective actuelle de la gauche, de vivre et de penser comme si la révolution et le paradis sans classes, idéaux impossibles à atteindre, existaient de manière intemporelle et pouvaient être potentialisés par l'éducation, le combat culturel et la création de mœurs sociales nouvelles. On constate que la gauche intellectuelle effectue cette mutation conceptuelle au moment où sociaux-démocrates et sociaux-libéraux affirment de fait la fin de l'histoire parce qu'ils estiment, sans doute avec raison, que leur société-marché a abouti. On croit et l'on estime qu'est arrivé le moment d'arrêter le mouvement qui a mis fin jadis à l'Ancien Régime et implanté l'ordre social-bourgeois.
Mais que faire si ce mouvement ne s'arrête pas partout, en tous les points de la planète? Si le principe de révolution agite encore certains peuples sur la Terre? En Occident, on a décrété que l'histoire était terminée et que les peuples devaient mettre leurs volontés au frigo. Et en ce bel Occident, c'est chose faite. Elles croupissent au frigidaire les volontés. Ailleurs dans le monde, la volonté révolutionnaire n'est pas extirpée. Le monde effervescent du politique, la Vie, les relations entre les peuples et les hommes n'obéissent pas partout à la règle de la fin des antagonismes. Croire à cette fiction, c'est se rendre aveugle aux motivations qui font bouger le monde. C'est déguiser la réalité effeverscente de l'histoire et du politique avec les frusques de l'idéologie normalisatrice et finaliste.
Là nous percevons clairement la contradiction fondamentale de la société post-moderne.
Un doux nihilisme
Dans de telles conditions, nos sociétés ne peuvent que vivre en complet dysfonctionnement. D'un côté, nous avons un monde idéal, suggéré par les idéologies dominantes, conforme à ses présupposés moraux qu'il convient de mettre en pratique dans sa vie quotidienne pour ne pas se retrouver "marginal" (humanitarisme, égalitarisme, bien-être). D'un autre côté, nous voyons un monde réel qui, en aucun cas, n'obéit à l'idéologie morale moderne et qui nous menace constamment d'une crise finale, d'une apocalypse terrible.
La technique qui nous permet de survivre dans cette contradiction est simple: c'est la politique de l'autruche. Le divorce entre les deux réalités crée une formidable schizophrénie sociale. Selon les termes de BAUDRILLARD: Perte du rôle social, déperdition du politique... De toutes parts, on assiste à une perte du secret, de la distance et à l'envahissement du domaine de l'illusion... Person- ne n'est actuellement capable de s'assumer en tant que sujet de pouvoir, de savoir, d'histoire (5). Le spectateur a supplanté l'acteur. Quand les hommes, les citoyens avaient un rôle, le jeu social détenait un sens. N'étant plus que des spectateurs impuissants, tout sens s'évanouit. Et derrière le spectacle, en coulisses, se déploie un monde qui n'a rien à voir avec celui qui nous est offert, suggéré, vanté. Le système cherche à ce que nous vivions comme si la fin de l'histoire, du politique, du social était déjà survenue. Autrement dit, le système simule la disparition du sens que nous évoquions.
Il ne reste plus aux hommes qu'à s'adonner au nihilisme "soft" d'un monde sans valeurs. Mais le sens des valeurs a-t-il réellement disparu? Non. Il se cache. Il est imperceptible dans les sociétés de consommation de masse d'Europe mais reste vivace là où se manifeste une volonté collective d'affirmation. Du point de vue de l'idéologie occidentale dominante, les signes d'un tel sens restent cachés comme un visage derrière un masque. Pourtant, ce visage est celui d'un être bien vivant. C'est ce qui explique pourquoi l'homo occidentalis ne mesure les phénomènes nationalistes du Tiers-Monde que sous l'angle de folies individuelles alors qu'en réalité, il s'agit de volontés nationales d'échapper à la dépradation américaine ou soviétique. Dans nos sociétés, au contraire, il n'y a déjà plus de volonté collective mais il règne un individualisme englouti dans l'indifférence généralisée de la massification. C'est un univers où chacun vit et pense comme tous sans pour autant sortir de son petit monde individuel. C'est là une autre forme de nihilisme et l'on ne détecte rien qui puisse affirmer une quelconque volonté.
Cet individualisme a déteint sur toute la société post-moderne. Il a suscité tous les phénomènes qui caractérisent ce post-modernisme, y compris ce nihilisme hédoniste, né de la disparition du sens. Gilles LIPOVETSKI confirme cet individualisme intrinsèque de la société post-moderne en énumérant les traits qui la caractérisent: recherche de la "qualité de la vie", passion pour la personnalité, sensibilité "écolo", désaffection pour les grands systèmes qui exigent la motivation, culte de la participation et de l'expression, mode rétro,... (6).
Arrêtons nous un moment à ce culte de la participation et de l'expression qui sont symptômes supplémentaires de la schizophrénie sociale et, par là, facteurs de nihilisme. Il existe dans nos sociétés une impulsion de type moral qui appelle constamment à la participation dans la vie publique et à l'expression de la volition individuelle par le biais de la communication. Ainsi, l'on prétend que nos sociétés sont des sociétés de communication, thème que l'on retrouve chez des auteurs aussi éloignés l'un de l'autre que HABERMAS, MARSHALL McLUHAN ou Alvin TOFFLER. Mais où participer, où s'exprimer quand les institutions qui avaient traditionnelle- ment la fonction de canaliser ces pulsions et ces nécessités ont cessé de posséder un sens, ont succombé aux impulsions commerciales de la communication de masse? Comme l'a vu justement BAUDRILLARD (7), le système appelle sans cesse à la participation, il veut sortir la masse de sa léthargie, mais la masse ne réagit pas: elle est trop bien occupée à assurer son bien-être individuel. La participation et l'expression jouent aujourd'hui le même rôle de norme sociale que l'idée que le souverain était l'incarnation d'un pouvoir divin. Actuellement, les normes morales -déjà non politiques- du système social-démocratique ne sont qu'un simple vernis, comme le fut, à la fin du XVIIème siècle, l'idée du souverain comme principe incarnateur. Cela signifierait-il que nous sommes à la fin d'un cycle? En termes clairs: le silence des masses, l'impossibilité des dogmes fondamentaux du système démocratique signifie- raient-ils le terme, la mort de l'idée démocratique de participation du peuple, laissant cette participation à une simple fiction juridique, comme le pense Jürgen HABERMAS (8)?
Ainsi, l'impossibilité de réaliser ce qui paraît le plus important dans toute société démocratique qui se respecte pourrait donner naissance à un nouveau facteur de nihilisme qui s'ajouterait à ceux déjà énumérés. D'autre part, à la vision apocalyptique inhérente à tout finalisme, se joignent actuellement divers paramètres de crise: économiques, écologiques, géostratégiques... Tous pourraient, à un moment donné, converger. En réalité, la crise est l'état habituel du monde depuis que l'homme existe sur cette planète. Le sens que l'on donnait à la vie était celui qui réduisait l'acuité des crises; il y avait alors quelque chose à leur opposer. Aujourd'hui, en revanche, la crise se profile avec netteté et le consensus a disparu. L'appareil macroéconomique transnational qui régit actuellement l'Occident est occupé à régulariser un système de crise. Mais cette crise ne peut être régularisée indéfiniment. Après la crise viendra inéluctablement la guerre... ou une autre situation conflictuelle qui ne prendra pas nécessairement le visage de la confrontation militaire directe; Songeons aux guerres économiques et culturelles qui affaiblissent déjà l'Europe, avec parfois la frappe chirurgicale et précise d'un terrorisme manipulé...
Parier pour l'interrègne
Le nihilisme de notre actuelle quotidienneté n'a rien à voir avec le nihilisme classique, exprimé par le terrorisme urbain et le chaos social. Le nihilisme actuel est un nihilisme doux, "soft", accepté comme tel par le système en tant que rouage de son mécanisme complexe. Un nihilisme qui peut se présenter comme inhibiteur, c'est-à-dire comme une acception des normes politiques et morales du système couplée à un refus d'avaliser son fonctionnement et les hiérarchies qu'il implique. Mais un nihilisme qui peut aussi se présenter comme nihilisme "exhibé", comme c'est le cas pour les "nouveaux barbares". Finalement, aucun des deux modèles n'est réellement nocif pour le système. Ce flou est précisément ce qui fait de la post-modernité une époque potentiellement décisive, dans la mesure où on peut franchement la définir comme un interrègne. Interrègne obscur, chargé d'ivresse dionysiaque sourde, comme nous l'a décelé Guillaume FAYE (9). Interrègne qui est prémisse de quelque chose d'encore incertain. Quelque chose qui pourrait rendre à notre monde son enthousiasme, son sens de l'aventure, la nécessité du risque et la volonté de prendre à nouveau des décisions. Tel est le pari de tout interrègne.
Giorgio LOCCHI écrit que les représentants les plus autorisés de la Révolution Conservatrice allemande du temps de Weimar, de JüNGER à HEIDEGGER, ont appelé "interrègne" cette période d'attente durant laquelle le destin bascule entre deux possibilités: 1) achever le triomphe de la conception du monde égalitaire avec sa "fin de l'histoire" ou 2) promouvoir une régénération de l'histoire (10). La post-modernité actuelle est un interrègne. Pour cela elle peut être le creuset d'une nouvelle révolution culturelle comme celles qu'a connues l'Europe tout au long de son histoire. En dernière instance, la balance penchera de l'un ou de l'autre côté...
Dès lors, nous pouvons affirmer qu'il existe quatre attitudes fondamentales en jeu actuellement. L'une de ces attitudes est proprement post-moderne, elle est hédoniste, éclectique, dionysiaque, indécise. Cette atittude-là est celle du pari pour les mutations superficielles mais contestatrices. Une deuxième attitude est également conforme au système; elle intériorise les présupposés "progressistes" et prône l'aveuglement face à l'histoire en marche, face au devenir du réel; elle fuit tout espèce de pari. Une troisième attitude pourrait être celle de nouveaux barbares, citadins ou ruraux. Elle consiste à sortir du système, à en sortir psychiquement pour les premiers, physiquement pour les secondes. Il s'agit de tuer les parieurs en "cassant le jeu". Enfin, la quatrième attitude est l'attitude faustienne et aventurière: miser et gagner. Mais pour quel enjeu? La régénération de l'histoire européenne. La décision de miser constitue alors un moment-clef. Telle pourrait être l'attitude d'une Nouvelle Révolution, inspirée de la révolution conservatrice allemande des années 20. Tous les révolutionnaires conservateurs, écrit Louis DUPEUX (12), se définissent comme résolument modernes... Loin de la peur et des tourments qu'engendre le pessimisme conservateur traditionnel, la Révolution Conservatrice dégage une modernité contre le modernisme ou le progressisme, une contre-modernité. Il s'agit, en clair de se décider pour le côté organique de la modernité et d'abandonner les chimères inorganiques. Accepter et assumer la modernité comme forme vitale, comme impulsion et non comme sens orienté vers un finalisme inéluctable (et finalement misérabiliste) qu'on n'atteindra en fin de compte jamais. Rappellons-nous l'expression de JüNGER: fondre passé et futur en un présent vivant, ardent.
Il faut que dès maintenant, ceux qui ont décidé de parier pour cette nouvelle révolution spirituelle prennent conscience que le destin de notre culture et de notre continent se trouve entre leurs mains. Il serait toutefois assez ingénu de rejeter simplement les manifestations sociales et esthétiques de la post-modernité au nom d'un "conservatisme" qui, au bout du compte, ne pourrait conduire à rien. Il s'agit de savoir ce que peut donner comme résultat "l'orgiasme" en lequel se plonge la post-modernité. FAYE a écrit que dans les orgies romaines, seul l'amphitryon reste sobre: parce que le "climax", l'apogée du dionysisme n'est autre que le signal du prochain retour d'Apollon. Dans la perspective de cette nouvelle révolution culturelle, notre nouvelle révolution culturelle, la post-modernité ne peut être que la certitude, esthétique et mobilisatrice, que Dionysos sait ce qu'il fait même si ses serviteurs ignorent ses desseins.
Javier ESPARZA.
(traduction française de Rogelio PETE).
Cet article de Javier ESPARZA, traduit par Rogelio PETE est extrait de la revue PUNTO Y COMA (N°2, décembre 85 - février 1986). Adresse: Revista PUNTO Y COMA, Apartado de Correos 50.404, Madrid, España. Tel.: 410.29.76. Abonnement pour six numéros pour tout pays européen: 2600 pesetas. Tarif étudiant: 2200 pesetas.
Notes
(1) Castello, F., Tiempos Posmodernos, El Pais, 30/1/1985.
(2) Cañas, D., La posmodernidad cumple 50 años en España, El Pais, 28/4/1985.
(3) Faye, G., La modernité, ambigüités d'une notion capitale, in: Etudes et Recherches n°1 (2ème série), printemps 1983.
(4) Kundera, M., cité par Régis Debray in Le pouvoir intellectuel en France, Ramsay, Paris, 1979.
(5) Baudrillard, Jean, Les stratégies fatales, Grasset, 1983.
(6) Lipovetsky, G., L'ère du vide, Gallimard, 1983.
(7) Baudrillard, J., Cultura y Simulacro, Kairos, 1984.
(8) Habermas, J., Historia y crítica de la opinión pública, Gili, Col. Mass Media, 1982.
(9) Faye, G., La nouvelle société de consommation, Le Labyrinthe, 1984.
(10) Locchi G., Wagner, Nietzsche e il mito sovrumanista, Akropolis, 1982.
(11) L'auteur du présent article ne trouve pas, dans la "révolution conservatrice" actuelle des Etats-Unis, d'éléments valables pour une régénération historico-culturelle de l'Europe. Il estime que ces éléments sont davantage à rechercher dans le sillage de la "Nouvelle Droite" française et des mouvements qu'elle a influencé ou dont elle a reçu l'influence en Europe.
(12) Dupeux L., Révolution Conservatrice et modernité, in Revue d'Allemagne, Tome XIV, Numéro 1, Janvier-Mars 1982.
00:05 Publié dans Philosophie, Sociologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, sociologie, art, postmodernité, postmodernisme, modernité, 20ème siècle |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 17 septembre 2010
L'après-démocratie
L'après-démocratie
« L’Après-démocratie » est un recueil de textes, dans lequel Eric Werner (EW) défend la thèse générale suivante : plus personne ne peut décemment croire que nous vivions en démocratie. Il ne reste, du projet démocratique, que des traces – telles que les élections, tous les cinq ans, et qui consistent désormais à choisir entre l’aile gauche et l’aile droite d’un seul et même parti institutionnel.
Aile gauche et aile droite qui, au demeurant, font en pratique à peu près la même politique, imposée par « le vrai pouvoir ».
Un vrai pouvoir qui se situe au niveau de l’hyperclasse, et de son gouvernement mondial. Un vrai pouvoir échappe à tout contrôle démocratique, influence de manière décisive la « ligne éditoriale » de la presse, et pilote à distance la plupart des institutions, justice incluse, via des réseaux d’influence ramifiés. Ce vrai pouvoir décide de ce que vous ignorez, donc de ce que vous savez. Il vous éduque, il vous surveille, il vous juge. Il contrôle la démocratie, elle ne le contrôle pas.
Nous voici dans « l’après démocratie ».
*
Comment en est-on arrivé là ?
Fondamentalement, pour EW, il s’agit tout simplement de la mise à jour de ce que la « démocratie occidentale » était de manière latente – mise à jour rendue possible par la disparition de l’ennemi.
Un disparition de l’ennemi qui a levé les barrières que le système était obligé d’entretenir devant lui, pour échapper à son cours spontané…
Depuis que le communisme a été vaincu, l’Occident n’a plus besoin d’entretenir une façade pluraliste. Il s’engage donc dans la voie totalitaire, qu’il a longtemps combattue, mais qui est aussi, secrètement, son essence profonde.
Chronologiquement, l’adoption de la loi Gayssot arrive juste après la chute du Mur de Berlin : le totalitarisme occidental a littéralement éclaté au grand jour, dès que son adversaire ne fut plus là pour l’empêcher de s’exprimer.
Totalitarisme d’ailleurs d’autant plus redoutable que, fait observer EW, il est dissimulé par un formidable voile propagandiste de dénégation, bien plus habile que celui tendu jadis par les systèmes hitlériens ou staliniens.
EW nous renseigne, à ce propos, sur ce qui se produit en ce moment dans le monde germanophone (EW est suisse) – une évolution d’un monde voisin dont nous sommes, nous, en France, sans doute assez mal informés.
Un chiffre : en Allemagne, le nombre de personnes ayant fait l’objet de procédures pour « connections avec des groupes extrémistes » et « excitation du peuple » se montait, en 1998, à 9.549. En Suisse, deux juges ont été mis en vacances forcées après avoir prononcé une peine jugée trop légère contre un politicien d’extrême droite coupable d’un délit d’opinion. L’affaire fut rejugée, et le politicien a été condamné à 15 mois de prison ferme – pour comprendre l’échelle des peines sous-jacentes à cette décision, notons qu’à la même époque, l’auteur d’un viol sur une fillette de cinq ans fut condamné à une peine de neuf mois de prison avec sursis. Le monde germanophone est majoritairement en train, tout doucement, de basculer dans un totalitarisme ouvert, une répression judiciaire de la pensée dissidente – bien plus vite, bien plus nettement qu’en France.
*
Après avoir planté le décor, EW analyse cette dérive totalitaire.
Reprenant la distinction d’Arendt entre pensée et raisonnement, il montre que l’Occident contemporain est peuplé d’idéologues des Droits de l’homme qui raisonnent, mais ne pensent plus – en ce sens que leur raisonnement ne se réfère plus à la réalité. Cette disposition d’esprit particulière se combine avec des intérêts objectifs (toujours implicites) pour créer une ambiance générale d’intimidation. De là, vers la terreur, qui est désormais repositionnée dans le cadre général de l’insécurité – on ne terrorise plus en brutalisant, mais en exposant à une brutalité latente (économique, sociale, voire physique, avec une délinquance tolérée). Sous l’angle organisationnel, il n’y a évidemment aucun rapport entre l’arrestation par le NKVD au petit matin dans l’URSS des années 30 et l’agression au coin de la rue dans la France de 2010 ; mais sur le plan fonctionnel, le rôle de la terreur dans une mécanique d’intimidation générale et de sidération populaire est comparable. Le « racaille » raciste antiblanc est le SA du totalitarisme multiculturel américanomorphe (un point sur lequel EW revient fréquemment).
Plus profondément, une guerre cognitive est faite aux populations, par des moyens plus subtils que ceux dont disposaient les anciens totalitarismes. La dissolution du « nous » (famille, coutume, tradition, enracinement local et national) rend le « je » impensable (puisqu’il n’est plus inscrit dans rien, il « flotte »), et l’opinion bascule dans la formulation moue d’un consensus auquel « on » se rallie (« on » étant, finalement, un corps collectif « non-social », la somme des individualités disjointes reliées uniquement par le réseau médiatique). Il y a explosion des frontières de l’être mental des occidentaux, ce sont des organismes sans peau, en voie de dilution, « clients » parfaits du néo-totalitarisme occidental. L’ultime rempart contre l’illusion, l’école, est même désormais tombé, avec la généralisation du « pédagogisme », c'est-à-dire la manipulation des enfants pour leur faire intérioriser des attitudes bien précises, compatibles avec le système dominant.
Au-delà de ce constat somme toute aujourd’hui presque devenu banal, EW tente de mettre en lumière les causalités profondes du mécanisme décrit. Il s’intéresse, par exemple, à la sociologie de cette nouvelle domination, et souligne le rôle particulier qu’y tient manifestement la pègre – historiquement très souvent associée aux régimes totalitaires ou dictatoriaux. Les tyrans, rappelle EW, se méfient toujours beaucoup plus des honnêtes gens que des voyous, chez qui ils vont souvent recruter leur garde personnelle.
D’où une hypothèse sur la convergence spontanée entre l’idéologie de certains sociologues de l’excuse (« pro-racailles ») et le totalitarisme des marchés : version renouvelée du mécanisme décrit par La Boëtie et d’autres, mécanisme qui voulait que le tyran, pour garder sous contrôle les « abeilles domestiques », importât des « frelons étrangers ».
Dans cette optique, l’incubation d’une idéologie de la haine de soi n’est, en réalité, qu’un dispositif annexe ; le but est de tenir les « abeilles » dans la peur des « frelons ». Ce n’est ni plus ni moins que la généralisation des techniques utilisées, pendant la période de dénazification de l’Allemagne, par les conquérants américains (destruction programmée du modèle anthropologique germanique, supposé créateur de la « personnalité autoritaire » de type « fasciste » - d’où la fabrication d’une population féminisée, fragilisée, en quête de protection et donc facile à dominer).
D’où, encore, une hypothèse sur l’attitude différenciée des idéologues néo-totalitaires à l’égard du religieux. D’une manière générale, ils s’en méfient, puisque la religion définit un espace mental collectif structuré, donc de nature à s’opposer aux forces de dilution que le néo-totalitarisme instrumentalise. Mais ils se méfient du christianisme plus que des autres religions (islam en particulier), parce que le christianisme construit une métaphysique de la liberté, où la conscience individuelle peut en quelque sorte être équipée de manière autonome – ce qui implique que même si les forces de dilution détruisent toute structure collective, le christianisme peut continuer à structurer une révolte individuelle (chose que l’islam peut plus difficilement faire). D’où sans doute le fait que nos dirigeants combattent l’islam là où il est structurant d’une identité collective réelle (donc en Dal-el-Islam), mais en encourage l’importation chez nous, où il contribue à la déchristianisation.
*
Comment résister à ce néo-totalitarisme ? Voilà, évidemment, la question qu’EW ne peut éviter ; à quoi bon décrire l’ennemi, si ce n’est pas pour le combattre ?
EW souligne tout d’abord qu’il faut combattre en nous la tendance au défaitisme. Quand nous apprenons que 5 % des Suisses n’ont pas la télévision, ne nous lamentons pas qu’ils ne soient que 5 % ; prenons note du fait qu’ils sont déjà 5 %.
Ensuite et surtout, il faut, nous dit-il, sortir du piège consistant à reconnaître au pouvoir actuel un monopole de la capacité à gérer les problèmes qu’il a lui-même créer (l’immigration inassimilable, par exemple). Il faut poser le problème en termes renouvelés, et cesser de confondre révolte et résistance.
Le révolté et le résistant disent « non », l’un et l’autre. Mais pas de la même manière. Le révolté, c’est l’esclave fouetté qui, soudain, se retourne et fait face à son maître. Le résistant, lui, ne fait pas face : il s’efface, il sort du cadre de gestion construit par son maître.
C’est pourquoi le résistant est avant tout un adepte de la stratégie indirecte ; à l’opposé du révolté, qui cherche la confrontation directe avec le tyran à l’intérieur d’un contexte donné, le résistant pense l’action dans la durée, et cette action n’est pas nécessairement un affrontement avec le tyran – c’est avant tout un effort pour se préparer à la modification du contexte.
Le plus souvent, cette modification du contexte est obtenue tout simplement en durant : le résistant gagne tant qu’il ne perd pas, c'est-à-dire tant qu’il n’est pas anéanti. Et finalement, le résistant l’emporte s’il parvient à faire durer sa retraite flexible une seconde de plus que l’élan du pouvoir qui tentait de l’anéantir. Ensuite, une fois que le pouvoir s’est usé, qu’il a fabriqué lui-même la masse de contradictions internes qu’il ne peut plus gérer, alors la résistance peut passer à la contre-offensive.
Et donc, pour conclure, ce que sous-entend EW, c’est qu’il ne faut pas accepter la logique selon laquelle nous devrions tolérer le système parce qu’il est le seul à pouvoir gérer les problèmes qu’il a créés. Nous devons lui résister, pour être là quand il ne pourra plus gérer ces problèmes.
00:08 Publié dans Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : démocratie, théorie politique, philosophie, sciences politiques, politologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 16 septembre 2010
Konrad Lorenz, uno scienziato antimoderno

di Stefano Di Ludovico I pregiudizi scientisti e progressisti di cui è impregnata la nostra cultura ci portano spesso a vedere in ogni visione alternativa rispetto al mondo moderno il portato di mentalità antiscientifiche ed arcaiche, sogno di visionari metafisici che ignorano i fondamenti e le regole più elementari del sapere positivo. Sembra quasi che la critica al mondo moderno sia prerogativa di culture inevitabilmente “altre” rispetto a quel sapere che di tale mondo si reputa a fondamento, e che la scienza sia necessariamente al servizio della modernità e della società a cui essa ha dato origine. La figura e l’opera di Konrad Lorenz smentiscono clamorosamente tali pregiudizi: universalmente considerato uno dei maggiori “scienziati” del XX secolo, padre dell’etologia moderna e Nobel per la fisiologia e la medicina nel 1973, è stato al tempo stesso uno dei più lucidi e feroci critici della modernità e dei suoi miti, anticipatore di molte di quelle tematiche oggi fatte proprie dai movimenti e dalle culture ambientaliste e no-global.
Fonte: Centro Studi Opifice [scheda fonte]
A rileggere la sua opera, sviluppatasi lungo l’arco di un quarantennio, dal dopoguerra agli anni Ottanta del secolo appena trascorso, ci ritroviamo al cospetto di un vero e proprio “profeta” dei mali che affliggono il nostro mondo e dei problemi che la nostra generazione è chiamata ad affrontare. E tutto ciò da una prospettiva che pur rimanendo fedele ai fondamenti positivisti ed evoluzionisti della sua visione di fondo, ha saputo essere al tempo stesso radicalmente anticonformista ed “inattuale” rispetto ai valori ed alle tesi di cui quella visione si è fatta spesso portatrice. Ci sembra essere proprio questa, alla fine, la cifra del pensiero di Konrad Lorenz, uno scienziato “antimoderno”. A diciotto anni dalla sua morte - avvenuta nel 1989 - proprio oggi che molte delle sue analisi si sono rivelate profetiche e che l’eco delle polemiche, anche accese, che hanno accompagnato la sua vicenda culturale ed umana si va ormai spegnendo, è possibile, e al tempo stesso doveroso, guardare alla sua opera con maggiore interesse, curiosità ed obiettività, attribuendole la valenza e la riconoscenza che meritano.
Konrad Lorenz nasce a Vienna nel 1903. Studia medicina a New York e a Vienna, laureandosi nel 1928. Nel 1933 consegue anche la laurea in zoologia, assecondando i suoi veri interessi che si stavano orientando sempre più verso il mondo animale e l’ornitologia in particolare. Nel 1937 diventa docente di psicologia animale e anatomia comparata presso l’Università di Vienna e, a partire dal 1940, di psicologia all’Università di Königsberg. Scoppiata la guerra, combatte nell’esercito tedesco. Durante il conflitto viene fatto prigioniero dai russi; così dal 1944 al 1948 è trattenuto in un campo di detenzione sovietico fino alla fine delle ostilità. Nel 1949 viene pubblicato L’anello di Re Salomone, destinato a rimanere la sua opera più celebre, dove Lorenz rivela quelle doti di abile ed affascinante divulgatore che resero i suoi testi famosi nel mondo, avvicinando alle tematiche etologiche e naturalistiche un vasto pubblico di non addetti ai lavori; doti confermate nel successivo E l’uomo incontrò il cane, del 1950. Nel 1961 diviene Direttore dell’Istituto Max Plank per la fisiologia del comportamento di Starnberg, in Baviera, carica che manterrà fino al 1973. E’ proprio a partire da tali anni che, accanto a testi a contenuto prettamente scientifico, Lorenz inizia ad estendere i suoi interessi alla sfera sociale e culturale, per arrivare ad affrontare le tematiche dell’attualità del suo tempo, lette all’interno di un’ottica che faceva tesoro di quanto via via egli stava maturando e scoprendo in ambito naturalistico. Dall’etologia animale si passa così all’etologia umana. Tali nuovi interessi iniziano per la verità a fare capolino già nelle opere a carattere scientifico, rivelando la vastità degli orizzonti e delle prospettive che fin dagli inizi hanno accompagnato la sua ricerca.
L’opera Il cosiddetto male, del 1963, che affronta il tema dell’aggressività intraspecifica, è un tipico esempio di tale prospettiva. In questo scritto Lorenz sostiene che l’aggressività, al pari di diversi altri istinti quali la sessualità o la territorialità, sia un comportamento innato, come tale insopprimibile e spontaneo, impossibile da far derivare dai soli stimoli ambientali. Essendo un istinto innato, l’aggressività è in quanto tale “al di là del bene e del male” (di qui anche il carattere ironico e polemico del titolo del libro; modificato, in alcune delle edizioni successive, nel più neutro L’aggressività), componente strutturale di ogni essere vivente e svolgente un ruolo fondamentale nell’ambito dei processi evolutivi e quindi della sopravvivenza della specie. Basti pensare al ruolo che la conflittualità intraspecifica gioca nell’ambito della delimitazione del territorio, della scelta del partner nella riproduzione, dell’instaurazione delle gerarchie all’interno del gruppo. Lorenz sostiene altresì che gli stessi istinti “buoni”, ovvero quelli gregari e amorosi, derivino evoluzionisticamente dalla stessa aggressività, essendo modificazioni selettive di questa indirizzati a finalità differenti, tanto che sopprimere l’aggressività significherebbe sopprimere la vita stessa. Il libro suscitò polemiche violentissime, dato che Lorenz non limitò le sue riflessioni all’ambito animale, ma le estese anche a quello umano e storico-sociale. Le accuse si sprecarono e la polemica, dal terreno scientifico su cui Lorenz intendeva mantenerla, scivolò, com’era prevedibile, su quello politico ed ideologico: gli diedero del razzista e del guerrafondaio. In realtà il proposito del testo era quello di criticare le correnti comportamentiste e behavioriste, allora molto in voga, secondo cui tutti i comportamenti derivano in ultima analisi dalle influenze e dagli stimoli ambientali, modificati i quali sarebbe possibile modificare gli stessi comportamenti, aggressività inclusa. Per i comportamentisti, quindi, non vi sarebbe nulla di innato. Lorenz, al contrario, considera l’istinto un dato originario, geneticamente condizionato: in quanto tale, esso vive di vita autonoma, non vincolandosi necessariamente all’azione di quelle influenze ambientali aventi la funzione di stimoli scatenanti. Anzi, secondo Lorenz più un istinto non trova occasione di scatenamento, più aumenta la possibilità che esso si scarichi prima o poi in maniera ancor più dirompente, anche in assenza degli stimoli corrispondenti. Se così non fosse, per Lorenz sarebbero difficilmente spiegabili i fenomeni di aggressività cosiddetta “gratuita”, così diffusi sia nel mondo animale che tra gli uomini. Lungi dal costituire un’apologia della violenza e della guerra, l’opera di Lorenz intendeva innanzi tutto mettere in guardia da ogni posizione utopica circa la convivenza umana e la risoluzione dei conflitti, risoluzione che, per essere realistica e antropologicamente fondata, non poteva prescindere da dati e analisi che egli riteneva incontrovertibili. Al contrario, proprio la mancata conoscenza del funzionamento dei comportamenti innati poteva portare a risultati opposti a quelli auspicati, finendo per favorire proprio l’innesco di comportamenti deleteri per la pacifica convivenza. Sostenendo l’impermeabilità di fondo ai condizionamenti ambientali degli istinti basilari dell’uomo come di tutte le specie animali, Lorenz vuole evidenziare così le illusioni insite nella convinzione secondo cui l’educazione e la trasformazione dell’assetto politico-sociale sarebbero di per sé sufficienti a modificare e plasmare i comportamenti umani. E questo non perché egli negasse ogni valore alla cultura o alla dimensione spirituale dell’uomo, quasi a volerlo ridurre a un animale tra i tanti e per ciò vincolato esclusivamente ai suoi istinti. Alieno da ogni visione irenistica e bucolica dell’uomo così come della natura in genere, critico di ogni antropologia che risentisse del mito rousseauiano del “buon selvaggio”, egli sottolineò piuttosto come la “pseudospeciazione culturale” tipica della specie umana ha portato i gruppi umani – siano essi i clan, le tribù, le etnie o le moderne nazioni - una volta raggiunto un determinato grado di differenziazione reciproca, a relazionarsi in modo molto simile a quello delle specie animali più evolute, specie tra le quali, come accennato sopra, la conflittualità intraspecifica gioca un ruolo fondamentale all’interno dei processi adattativi. Lorenz evidenzia come diversi comportamenti risalenti a fattori culturali rivelino una fenomenologia sorprendentemente simile a quelli di origine genetica, facendo risaltare così una certa convergenza tra le dinamiche animali e quelle umane, convergenza che in fenomeni come non solo l’aggressività, ma anche ad esempio la territorialità, l’imprinting, il gioco ed i riti risalta con chiarezza.
E’ soprattutto però con opere quali Gli otto peccati capitali della nostra civiltà, del 1973 e Il declino dell’uomo, del 1983, che le problematiche del proprio tempo e la critica alle convinzioni ed alle ideologie dominanti diventano i temi centrali della sua ricerca; temi che, comunque, continuano a trovare ampio spazio anche nelle opere a contenuto scientifico di questo periodo. Tra queste ricordiamo L’altra faccia dello specchio, del 1973, dedicata alla disamina dei processi conoscitivi della specie umana da un punto di vista storico-evoluzionistico, Natura e destino, del 1978, dove viene ripreso il confronto tra innatismo e ambientalismo, e Lorenz allo specchio, scritto autobiografico del 1975. Nel 1973, intanto, tra le ennesime e strumentali polemiche scatenate in particolare dagli ambienti culturali di sinistra, viene insignito, come accennato, del Premio Nobel per la fisiologia e la medicina, unitamente ad altri due etologi, Nikolaas Tinbergen e Karl Ritter von Frisch. Pur di infangare la sua figura, non bastando le meschine accuse già rivoltegli in occasione de Il cosiddetto male, per l’occasione vennero tirati in ballo presunti atteggiamenti di condiscendenza verso il regime nazista, strumentalizzando ad arte tesi espresse a suo tempo in merito all’eugenetica. In realtà, ciò che non gli veniva perdonato erano le posizioni controcorrente verso i miti progressisti-rivoluzionari così prepotentemente in voga nel clima caldo degli anni settanta, così come il temperamento libero e non curante verso il “politicamente corretto”, che lo portavano a confrontarsi senza pregiudizi con gli ambienti intellettuali più disparati, come dimostra l’attenzione mostrata verso il GRECE, il “Gruppo di ricerca e studio per la civilizzazione europea”, fondato in Francia da Alain De Benoist, dalla cui collaborazione nacque anche un libro-intervista pubblicato nel 1979 con il titolo Intervista sull’etologia. Sempre nel 1973 si stabilì ad Altenberg, in Austria, assumendo la direzione del Dipartimento di sociologia animale dell’Accademia Austriaca delle Scienze. Tra le altre più significative opere ricordiamo L’etologia (1978), vasta sintesi del suo pensiero etologico, e i due libri-intervista Salvate la speranza (1988) e Il futuro è aperto (postumo del 1996, in collaborazione con il filosofo Karl Popper), in cui torna ad affrontare anche tematiche più specificatamente filosofico-sociali.
Gli otto peccati capitali della nostra civiltà, destinata a diventare una delle sue opere più note, vuole essere un’analisi delle cause della decadenza della civiltà e dei pericoli che incombono sull’umanità. Come il successivo Il declino dell’uomo, è un’opera intrisa di un cupo pessimismo, a volte radicale, pessimismo che in seguito lo stesso Lorenz avrebbe ritenuto esagerato. Gli otto “peccati capitali” della civiltà sarebbero a suo dire i seguenti: l’abnorme aumento della popolazione mondiale; la devastazione dell’ambiente; la smisurata competizione economica tra gli individui; l’affievolirsi dei sentimenti; il deterioramento del patrimonio genetico; l’oblio della tradizione; l’omologazione culturale; la proliferazione nucleare. Come vediamo, si tratta di “peccati” ancor oggi all’ordine del giorno e con i quali l’attuale umanità continua a fare i conti, ma che al tempo di Lorenz ancora non venivano individuati e denunciati come tali in tutta la loro gravità. Addirittura tali “peccati” rischiano per Lorenz di portare l’umanità verso l’estinzione. Questa visione apocalittica gli è suggerita, secondo un’ottica seguita un po’ in tutte le sue opere, dal parallelo che egli istituisce con il mondo dell’evoluzione animale e naturale in genere. Più che eventi causati da specifici accadimenti storico-sociali, essi vengono letti infatti quali veri e propri fenomeni degenerativi dell’evoluzione umana: come avviene per molte specie viventi che, ad un certo punto della propria storia evolutiva, imboccano un vicolo cieco avviandosi verso l’estinzione, lo stesso sembra stia accadendo per la specie umana. “Quale scopo – si chiede Lorenz – possono avere per l’umanità il suo smisurato moltiplicarsi, l’ansia competitiva che rasenta la follia, la corsa agli armamenti sempre più micidiali, il progressivo rammollimento dell’uomo inurbato? A un esame più attento, quasi tutti questi fatti negativi si rivelano però essere disfunzioni di meccanismi comportamentali ben determinati che in origine esercitavano probabilmente un’azione utile ai fini della conservazione della specie. In altre parole, essi vanno considerati alla stregua di elementi patologici”. Al di là delle legittime perplessità e delle riserve che una simile chiave di lettura – vincolata ad un’impostazione in ultima analisi biologista ed naturalista dei processi storico-sociali – può suscitare, l’opera di Lorenz rappresenta una delle più lungimiranti e pionieristiche denuncie della società moderna, di cui vengono con vigore demistificati i miti ed i valori fondanti. Fenomeni che secondo la tradizione del pensiero moderno venivano considerati quali espressione della più intima natura umana – la competizione economica, la ricerca del benessere materiale, l’indefinito progresso tecnologico – vengono denunciati, al contrario, quali vere e proprie “patologie”, che stanno allontanando sempre più l’uomo dalla sua vera essenza, riducendolo a mero strumento delle forze tecno-economiche da egli stesso messe in moto. “La competizione tra gli uomini – afferma – che promuove, a nostra rovina, un sempre più rapido sviluppo della tecnologia, rende l’uomo cieco di fronte a tutti i valori reali e lo priva del tempo necessario per darsi a quella attività veramente umana che è la riflessione”. Estraniatosi dal mondo e dai ritmi della natura, l’uomo vive ormai in una nuova dimensione puramente artificiale, dove sono le leggi ed i ritmi della tecnica a regolare la sua vita. Ciò ha condotto a stravolgere l’identità e la specificità stesse dell’uomo, con il progressivo inaridimento dei sentimenti e delle emozioni, l’estinzione del senso estetico, la distruzione delle tradizioni e delle istituzioni che avevano da sempre regolato la convivenza umana prima dell’avvento della società industriale. Lorenz arriva a sostenere che la situazione dell’umanità contemporanea può essere paragonata a quella delle specie animali allevate ed selezionate a scopi produttivi, presso le quali l’addomesticamento ha determinato una vera e propria alterazione dei loro caratteri naturali.
In tal senso, Lorenz pone le basi per un ambientalismo che, non limitandosi a denunciare la perturbazione degli ecosistemi o la devastazione dell’habitat naturale dell’uomo, mette l’accento sulla necessità di recuperare un’esistenza più conforme ai dettami ed ai limiti della natura; natura accettata e fatta propria anche nella sua dimensione tragica e dolorosa. Il progetto della modernità di voler bandire il dolore e la fatica dal mondo è visto infatti da Lorenz come una vera e propria iattura: “il progresso tecnologico e farmacologico favorisce una crescente intolleranza verso tutto ciò che provoca dolore. Scompare così nell’uomo la capacità di procurarsi quel tipo di gioia che si ottiene soltanto superando ostacoli a prezzo di dure fatiche”. Nella società del benessere e del comfort “l’alternarsi di gioia e dolore, voluto dalla natura, si riduce a oscillazioni appena percettibili, che sono fonte di una noia senza fine”, noia che è alla base di quella illimitata ricerca del “piacere” – che della “gioia” è solo la caricatura parossistica - su cui fa leva la società dei consumi. In tal senso Lorenz, che si impegnò spesso anche sul piano delle battaglie concrete intervenendo nei dibattiti pubblici e partecipando a molte iniziative ambientaliste, espresse anche posizioni controcorrente e trasversali rispetto a certo ambientalismo anche oggi prevalente, difendendo, ad esempio, la legittimità della caccia, e battendosi invece contro l’aborto, ritenuto una pratica innaturale. Al tempo stesso prese le distanze da ogni naturalismo inteso quale ritorno ad utopici quanto irrealistici “stati di natura”, in quanto vedeva la dimensione culturale e spirituale come consustanziale all’uomo, che privato di essa sarebbe privato quindi della sua “natura” più autentica. Lo stesso studio del mondo animale, che ha impegnato tutta la sua vita, non è stato mai inteso da Lorenz in senso puramente tecno-scientifico: “vorrei dire innanzitutto che io non ho cominciato a tenere degli animali perché ne avevo bisogno per scopi scientifici: no, tutta la mia vita è stata legata strettamente agli animali, fin dalla prima infanzia… Crescendo ho allevato gli animali più diversi… Mi sono comportato sempre in questo modo: per conoscere a fondo un animale superiore, ho vissuto con lui. L’arroganza di certi scienziati moderni, che credono di poter risolvere tutti i problemi studiando un animale soltanto a livello sperimentale, è stata sempre estranea alla mia mente”. Più che il canonico approccio “scientifico”, quello di Lorenz sembra essere, almeno nelle sue finalità ultime e al di là dei suoi fondamenti epistemologici, un atteggiamento di tipo “intuitivo”, volto ad una comprensione complessiva dei fenomeni naturali e alieno da ogni visione meramente sperimentale e quantitativa. Ciò che davvero gli interessava era alla fine risensibilizzare l’uomo moderno al legame simpatetico con il mondo degli animali e della natura in genere, legame andato quasi completamente perduto per l’uomo civilizzato. Questi paga tale perdita anche con l’estinzione del senso estetico, che per Lorenz si lega strettamente al contatto con l’incredibile varietà della forme naturali e la grandezza della creazione che sovrasta l’uomo. Per Lorenz i sentimenti estetici sono infatti parte del patrimonio genetico dell’umanità, e hanno svolto anch’essi, quindi, un compito importate nel corso dell’evoluzione umana ai fini adattativi; mentre oggi l’uomo si va pericolosamente assuefacendo al “brutto” che domina incontrastato nelle nostre metropoli, dove ogni senso della bellezza sembra essersi obliato. La disarmonia che caratterizza la vita del moderno uomo inurbato si lega ad un altro infausto fenomeno, quello della sovrappopolazione, che Lorenz non vede solo nell’ottica economicistica - anche oggi spesso prevalente nei movimenti ambientalisti e terzomondisti - dello squilibrio tra risorse disponibili e popolazione, ma sempre in rapporto a dimensioni “esistenziali” più profonde, ancora una volta suggeritegli dagli studi etologici. Come ogni specie vivente ha bisogno, in base all’istinto di territorialità, di un suo ben delimitato “spazio vitale” (inteso in senso “psicologico” e non solo materiale), anche l’uomo difficilmente può adattarsi a vivere tra folle anonime di individui sconosciuti, dato che il forzato contatto ravvicinato e permanente con “estranei” genera inevitabilmente tensione ed aggressività, favorendo l’insorgere di quelle patologie tipiche della modernità quali stress e nevrosi.
La radicale critica della società moderna portò Lorenz a scontrarsi violentemente con la cultura progressista che monopolizzava il dibattito intellettuale degli anni sessanta e settanta ed ispirava i movimenti politici alternativi di quegli anni, movimenti che auspicavano una “rivoluzione” che andava, per molti aspetti, nel senso contrario a quello indicato da Lorenz. Critico verso ogni ottimismo progressista che esaltasse “le magnifiche sorti e progressive” dell’era della tecnica, Lorenz denunciò con altrettanto vigore l’ideologia del “nuovismo”, che egli considerava espressione di puro infantilismo, dato che è tipico dei bambini l’ingenuo entusiasmo verso tutto ciò che si presenta come “nuovo”. Contro i miti contestatari giovanili, Lorenz difese invece le tradizioni, la cultura e le strutture sociali sulle quali si erano funzionalmente rette le comunità e le società del passato, con accenti che non ci aspetteremmo da uno scienziato del XX secolo, come difese il principio di autorità nei processi educativi, vedendo in tutto ciò il portato di dinamiche socio-adattative coerenti con i dettati dell’evoluzione naturale. Lo stesso concetto di “rivoluzione” era del resto vivacemente contestato da Lorenz, dato che “la natura non fa salti” e che l’evoluzione procede per passi lenti e spesso impercettibili. Per questo l’incomprensione generazionale tra padri e figli che caratterizzava quegli anni era da lui vista come un fenomeno deleterio e pericoloso per un armonioso sviluppo della società. La stessa valorizzazione della fatica e della sofferenza andava contro le spinte moderniste di gran parte del movimento contestatore, che le considerava assurde sopravvivenze di secoli oscuri che grazie al progresso della tecnica e allo sviluppo economico l’uomo si sarebbe lasciato completamente alle spalle, essendo la liberazione dal dolore e il perseguimento del benessere “diritti” inalienabili che a tutti dovevano essere garantiti. Indifferente alle critiche che gli venivano mosse, forte delle sue convinzioni, Lorenz non si peritò di mettere in discussione lo stesso principio dell’uguaglianza tra gli uomini, che egli vedeva come una malsana distorsione del legittimo riconoscimento dell’eguale dignità di ogni uomo così come di ogni essere vivente. Secondo Lorenz l’egualitarismo, unito a quella che egli chiama la dottrina “pseudo-democratica” di ispirazione comportamentista secondo cui sarebbe possibile cambiare gli uomini a piacimento se solo si muta il contesto ambientale in cui essi si trovano a vivere, altro non è che un falso mito espressione della progressiva omologazione culturale che caratterizza la società moderna; omologazione di cui egli individuava le responsabilità nello strapotere del mercato, delle multinazionali e dei mezzi di comunicazione di massa. Il mondo moderno è caratterizzato da “una uniformità di idee quale non si era mai vista in nessun’altra epoca della storia” – sottolinea Lorenz - a tutto detrimento del pluralismo culturale, che, quale espressione del più vasto fenomeno naturale della diversità biologica, è un patrimonio da salvaguardare come uno dei cardini su cui si reggono l’evoluzione e la possibilità di riproduzione della vita stessa. Lorenz ritiene pertanto l’ineguaglianza un fattore costitutivo della natura, senza il quale essa perderebbe la sua forza creativa ed espansiva, non solo in termini biologici, ma anche e soprattutto a livello sociale e culturale, in quanto è proprio “l’ineguaglianza dell’uomo – affermò - uno dei fondamenti ed una delle condizioni di ogni cultura, perché è essa che introduce la diversità nella cultura”. Allo stesso modo egli individuava già allora nella perniciosa influenza della cultura americana le origini dei mali che attanagliavano l’umanità: “le malattie intellettuali della nostra epoca – sostiene - usano venire dall’America e manifestarsi in Europa con un certo ritardo”, così come al dominio delle ideologie egualitarie e pseudo-democratiche “va certamente attribuita una gran parte della responsabilità per il crollo morale e culturale che incombe sugli Stati Uniti”.
Figura proteiforme, difficilmente inquadrabile secondo gli schemi consueti, Lorenz visse profondamente le forti contraddizioni e i radicali cambiamenti che caratterizzarono il suo tempo. La sua complessa disamina della società moderna, intrisa di un così esasperato pessimismo, sfugge anch’essa a facili classificazioni, suscitando spesso sbrigative prese di distanza così come semplicistiche ed entusiastiche adesioni. Se il parallelismo che egli pone tra i processi evolutivi del regno animale e le dinamiche storico-sociali può lasciare perplessi, prestando il fianco ad accuse di riduzionismo biologista, lo sfidare gli apologeti del progresso tecno-scientifico sul loro stesso terreno dell’argomentazione positiva spiazza molti dei suoi detrattori. Anche i suoi toni a volte apocalittici possono sembrare eccessivi ed ingiustificati; ma non bisogna dimenticare che Lorenz scriveva in un periodo in cui i problemi da lui diagnosticati stavano per la prima volta presentando i loro risvolti devastanti su scala planetaria, senza che si fosse ancora sviluppata una forte sensibilità condivisa verso di essi. Come accennato, Lorenz stesso rivide progressivamente alcune delle sue posizioni e ritenne non più giustificabile il radicale pessimismo che aveva espresso, costatando come le tematiche su cui aveva richiamato l’attenzione fin dagli anni sessanta erano sempre più al centro del dibattito culturale e ormai nell’agenda di impegni di molti gruppi e movimenti politici e ambientalisti. “Colui che credeva di predicare solitario nel deserto, parlava, come si è dimostrato, davanti ad un uditorio numeroso ed intellettualmente vivo” - riconosce Lorenz, e “i pericoli della sovrappopolazione e dell’ideologia dello sviluppo vengono giustamente valutati da un numero rapidamente crescente di persone ragionevoli e responsabili”. Per questo Lorenz finì per prendere le distanze dai “catastrofisti”, da coloro che credevano possibile figurarsi con certezza l’avvenire dell’umanità predicando la sua prossima fine, dato che, come recita il titolo del succitato libro scritto con Karl Popper, il “futuro è aperto”, e l’irriducibilità ad ogni possibile determinismo costituisce pur sempre la cifra dell’uomo e della storia. Se il futuro è certamente aperto e la critica all’ideologia sviluppista non è più patrimonio di isolati predicatori nel deserto, è pur vero, però, che molti dei “peccati della civiltà” stigmatizzati da Lorenz restano ancor oggi impuniti, se non si sono addirittura aggravati. Di fronte alla sua disamina, si ha anzi l’impressione, a volte, che molte delle sue riflessioni e degli allarmi lanciati appaiano scontati e banali; e ciò non perché l’odierna umanità abbia risolto o quanto meno imboccato la strada giusta per risolvere i mali denunciati, ma - ed è quel che è più disperante - semplicemente perché vi si è ormai assuefatta. Ecco perché, al di là di quanto è stato fatto o resta da fare, e al di là dei giudizi e dei convincimenti di ciascuno, riteniamo quanto meno indispensabile e di grande attualità, oggi, la rilettura della sua opera.
Tante altre notizie su www.ariannaeditrice.it
00:15 Publié dans anthropologie, Philosophie, Science, Sciences | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : biologie, étologie, sciences, science, sciences biologiques, animaux, konrad lorenz |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 12 septembre 2010
Heidegger: la thématisation de l'être et ses énigmes
Archives de SYNERGIES EUROPENNES - 1996
HEIDEGGER : La thématisation de l'être et ses énigmes
Sens de la question
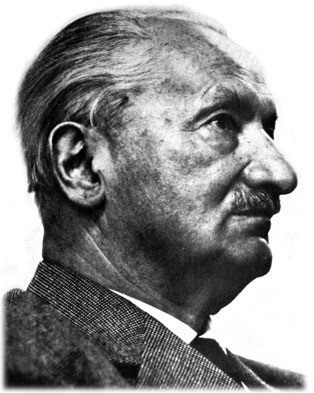 Nous avons tous entendu un jour ou l'autre que Heidegger, le métaphysicien, avait reposé le problème de l'Etre. Très bien, mais que signifie cette phrase et dans quelle mesure nous perrnet-elle de nous orienter?
Nous avons tous entendu un jour ou l'autre que Heidegger, le métaphysicien, avait reposé le problème de l'Etre. Très bien, mais que signifie cette phrase et dans quelle mesure nous perrnet-elle de nous orienter?
La culture contemporaine favorise les mystifications. La philosophie de Heidegger reste ainsi abandonnée aux associations prévisibles, à l'avidité des théologiens estampillés, aux apologies et aux dénonciations faciles. Les diatribes du jeune Carnap possèdent quelque chose d'aristocratique par comparaison avec les jugements sommaires de notre époque. L'inquisiteur Levinas, par exemple, a trouvé que les incursions étymologiques et les métaphores rupestres de Heidegger dénonceraient une pensée liée au Sol et au Sang, étrangère aux aspirations de ces tribus de nomades philanthropiques qui vaguaient, dépourvues de tout, par le désert. Expert en lamentations, Levinas déplore également que le philosophe s'inspire de la poésie de Holderlin et non pas, par exemple, des Lamentations de Job. Heidegger, par conséquent, un antisémite larvé. Admettons. Et alors?
D'autres esprits critiques proches de la Nouvelle Droite, comme par exemple Pierre Chassard dans son ~u-delà des choses (1992), nous avertissent que cet Etre heideggérien cohabite avec un universalisme suspect, que la distance de l'Etre par rapport aux choses réelles et sa parenté avec le Néant font de lui le pendant du Dieu de l'Exode, que les textes pertinents accusent l'influence de Maïmonide... Heidegger, donc, un philosémite subreptice. Admettons. Et alors?
Le caractère alternatif ou périphérique d'une culture ne nous dispense pas d'un minimum de sérieux. Il est temps que nous commencions à accéder à la pensée de Heidegger en tant que pensée philosophique, la jugeant de ce point de vue, et non selon ses affinités avec les idéologies des Systèmes dominants ou de leurs rivaux contestataires. C'est là la question générique.
Consentons à un usage ambigu de l'expression "I'Etre", puisque aussi bien il s'agira d'une ambiguïté nécessaire et provisoire. La Philosophie que nous pouvons qualifier de "classique", avec Parménide tout d'abord, puis Platon, Aristote et la Scolastique, a commis une thématisation de l'Etre qui disparait avec la Modernité: de Descartes à Fichte, nul philosophe (qu'il soit rationaliste, empiriste, criticiste ou idéaliste) ne croit que la solution des vrais problèmes philosophiques dépende de certaines précisions, intuitions ou thèses sur l'Etre... Si toutefois l'Etre réapparaît dans l'idéalisme de Hegel comme Leitmotiv de quelques philosophèmes, ce n'est qu'avec Heidegger qu'est rétablie une thématisation comparable aux précédentes, et qui leur est probablement supérieure, tant par son obstination que par son caractère problématique.
C'est dans la compréhension du sens de l'Etre que réside le destin de l'Occident et l'histoire de la Philosophie se déroule conformément à l'élucidation ou à l'occultation de l'Etre. Que peut bien signifier une telle assertion? Les difficultés interprétatives soulevées par les textes de Heidegger sont bien connues. Je vais tenter ici une reconstruction des idées qu'il paraît suggérer - reconstruction qui doit être jugée non pas pour sa fidélité à la lettre ni pour sa fidélité à un "esprit" insaisissable (nous laissons cela à la Heideggerphilologie) mais pour son degré de fécondité explicative. C'est là la question spécifique. Notre explanandum est constitué par les solutions persistantes ou par l'absence non moins persistante de solution dans le traitement classique des problèmes ontologiques. Le chercheur contemporain, s'il est honnête, éprouve une série de désarrois devant des énigmes qui lui paraissent plus suscitées que découvertes. Par exemple:
a) Comme peuvent l'attester les élèves du Kindergarten néothomiste le plus proche, c'est dans la Différence Ontologique Etre/Étant que réside la clef de la Philosophie; mais une telle différence s'articule sur un mode inintelligible et nous conduit parfois à identifier l'Etre et le Néant. Pourquoi devrions-nous accepter ce jargon?
b) La Métaphysique (par exemple dans la première douzaine de Disputationes de Suarez) établit de fastidieuses équations entre transcendantaux pour nous informer que l'étant est un, etc.; information qui ne nous paraît pas trop excitante. A quoi vise-t-elle?
c) Depuis Platon on se demande "Qu'est-ce que l'Etre?" et l'on répond par telle ou telle catégorie de prédilection (Substance, Esprit, Matière). Mais il paraît absurde et capricieux de définir le plus général par seulement l'un de ses genres.
d) Fréquemment, depuis Aristote, la Métaphysique oscille entre une Ontologie du plus universel et une Théologie du plus singulier; on ne voit pas pour quelle raison on a pu unir des disciplines aussi disparates.
e) A peine l'Ontologie, qui prétend être la science de l'être en tant qu'être, nous introduit-elle à lui qu'elle nous signale avec impatience la porte de sortie (avec un écriteau "analogia entis" pour les sorties de secours) et qu'elle nous propose de diviser et subdiviser des entités spécifiques.
f~ L'Etre, de par son degré de généralité, ne paraît pas apte à abriter des contenus spécifiqu~s de telle sorte qu'il puisse inclure dans sa compréhension "le destin d'un peuple", ou quelque chose d'une pareille importance.
Cette liste sélectionne quelques sujets de perplexité. Une explication doit venir mitiger l'impression d'absurdité crasse que la Métaphysique produit aujourd'hui et l'inventaire précédent offre certains critères pour juger de l'hypothèse proposée. L'explication, contrairement à ce que l'on pourrait croire à première vue, ne sera pas simplement linguistique: il s'agit de discerner des structures ontologiques différentes qui sont parfois unifiées par de vieilles habitudes verbales.
Homonymie Ontologique Tran~cntégorielle: un Trépied
L'expression "I'Etre" n'est pas utilisée normalement comme une description définie, à la manière de "I'auteur du Quichotte". Les acceptions les plus fréquentes paraissent hésiter entre trois catégories:
1. une propriété, que nous désignerons par S
2... Ia classe E des objets qui satisfont cette propriété
3. Ies éléments de E, spécialement cet élément qui possède la propriété S d'une façon nécessaire et éternelle.
Le langage de tous les jours adjuge des termes de propriété au moyen du verbe avoir et des termes de classe au moyen du verbe être. Nous disons que Socrate est un sage ou qu'il a de la sagesse, mais nous ne disons pas qu'il est de la sagesse ou qu'il a un sage. En revanche, ce test linguistique est défaillant avec l'Etre: on dit sans problème de cohérence qu'il est un être ou qu'il a un être, qu'il est un étant ou qu'il a une entité. Nous pouvons supposer qu'ici il y a une distinction qui s'est obscurcie.
Les propriétés, par exemple la blancheur, définissent une classe, celle du blanc. Si nous distinguons la classe de la propriété qui la définit, il paraît naturel d'interpréter dans l'usage philosophique l"Etant" comme un terme qui se réfère à la classe (2) et l"'Etre" comme la désignation de (1). La priorité de la propriété qui définit sur la classe définie rend évident de quelle manière l'Étant se fonde sur l'Etre. Quand on dit que l'Etre "fait" que l'étant soit, on ne doit pas considérer un tel "faire" comme l'exercice d'une causalité. Il ne s'agit pas non plus du problème de l'Unité versus la Multiplicité, mais de la dépendance d'une classe - qui pourrait bien être unitaire - à l'égard de la propriété qui la détermine.
S'il y a plusieurs éléments dans cette classe E, qu'on appelle les "étants", ils peuvent se trouver dans dif~érentes relations de dépendance (par exemple, causalité, inhérence, composition), mais cette dépendance horizontale n'affecte ni n'annule la dépendance verticale à l'égard de S. Par exemple, un étant suprême, cause totale de tous les autres, etc., ne pourrait de ce fait équivaloir à la propriété. Lorsque l'on dit "Deus est ipsum esse" on semble tomber dans une erreur catégorielle, qui fait d'un élément d'une classe l'équivalent de la propriété qui définit cette classe. Il pourrait arriver qu'un élément de cette classe possède la propriété de façon nécessaire, sempiternelle, éminente, infinie etc., mais il apparaît qu'il continuerait à être différent de la propriété. Une propriété est infinie en tant qu'elle peut être le prédicat d'un nombre illimité d'objets. L'erreur se produit quand on assimile l'Etre et l'Acte, de telle sorte que l'Acte est compris comme une sorte de pensée universelle; à la suite de quoi on interprète l'Acte - par opposition à la Puissance - comme une Perfection. De là surgit un Etre comme infinie perfection et actualité, qui va comme un gant àl certaines représentations de la déité (voir les trois premières des vingt-quatre Thèses Thomistes). On déambule d'une catégorie à l'autre. De toute manière, les hésitations relatives à ces catégories expliquent que l'on puisse penser à une Onto-Théologie, à laquelle on faisait allusion en (d). Cette affirmation sera confirmée plus loin.
On a l'habitude de caractériser l'Ontologie comme une discipline de l'Etre, assimilant S et E. La distinction précédente dissipe l'inquiétude (e), quant aux deux voies que peut adopter une Ontologie: ou bien tenter de discriminer des régions et des relations à l'intérieur de la classe E des étants (ce qui paraît superficiel) ou bien élucider cette propriété fondatrice, ses relations avec d'autres propriétés et avec les divers étants (ce qui paraît profond). Il y a cependant une perturbation dans la diffusion pacifique du travail. Gilson a déclaré, dans son galimatias: "on peut penser qu'etre, c'est être un etre - mais aussi qu'etre un etre, c'est simplement etre". C'est-à-dire: nous pouvons privilégier dans notre spéculation les sujets de la propriété ou la propriété elle-même. Ainsi le galimatias disparaît, et le chemin s'ouvre aux vraies difficultés.
Jusqu'à présent l'idée était très simple. Mais si S est la propriété et E la classe des étants (c'est-à-dire des individus qui possèdent cette propriété), alors l'Etre sera-t-il un étant (non pas la classe E mais un élément de E)? Considérons attentivement la question et le dilemme. Si l'Etre n'est pas un étant, alors c'est qu'il manque de la propriété qui définit les étants, ce qui signifie : I 'Etre n 'est pas. C'est pourquoi bien souvent l'être est perçu comme un Néant, soit absolu, soit qualifié ("Néantd'Étant" - mais, pourrait-il y avoir un autre Néant?). Si l'on admet l'existence d'une classe complémentaire de l'Étant, le Néant, remplie de tout ce qui manque d'Etre, alors l'Etre sera un élément du Néant. Il paraît très curieux que le Néant ne soit pas quelque chose de plus ou moins similaire à l'ensemble vide. Nous savons que Hegel s'est trouvé dans une perplexité semblable, mais celle de Heidegger mérite plus d'attention.
Prenons l'autre terme du dilemme: la possibilité que S soit un étant. Alors une classe comprendrait la propriété qui la définit parmi ses éléments. Ce n'est pas à première vue impossible. D'une part il y a des propriétés qui se distinguent de leurs sujets: la proprieté "être un nombre pair" n'est ni paire, ni un nombre - la propriété qui définit la liste 2, 4, 6, 8... n'est pas l'un des nombres qui apparaissent dans cette liste. Mais d'autre part il y a des propriétés plus exotiques. Par exemple, la propriété "être pensable" est elle-même quelque chose de pensable: la propriété détermine la totalité de ce qui est pensable et elle est elle-même membre de cette totalité. Est-ce que la relation entre l'Etre et la classe des étants est de cette nature? Et nous voyons déjà que la question de l'Onto-Théologie se présente d'une manière moins capricieuse.
Si nous admettons avec beaucoup de libéralité ce type de propriétés et de classes exotiques, nous pouvons nous embrouiller dans des problèmes. Par exemple, on peut présumer que la classe des étants E, non seulement comprendrait l'Etre comme élément, mais aussi posséderait elle-même l'être. Ainsi E serait élément d'elle-même, et la totalité d'une collection ferait partie d'elle-même.
Assurément l'astuce des logiciens permet d'endiguer ces libéralités au moyen de divers traitements: ce qui n'empêche pas la persistance d'un symptôme alarmant. L'intuition primordiale qui guidait ces réflexions imposait une hiérarchie entre individus, classes et propriétés. Les propriétés sont universelles, les individus non: par conséquent, si l'Etre était un étant, il serait un universel et un individu. Et si parmi les éléments on admet des individus et des propriétés universelles, l'ordre rêvé se désagrège.
Ici le dilemme dé~ouche sur une confusion, un balbutiement sur la différence ontologique, affection facilement explicable vue l'hypothèse que nous avons introduite sur la thématisation de l'être et la possibilité de voir en lui une propriété. Ce qui conduit Heidegger plus d'une fois à voir dans l'Etre un Néant. Et qu'il ne s'agit pas là d'une idée accidentelle de Heidegger, on peut le vérifier en étudiant le "parricide" de l'Étranger d'Élée (Platon, Sophiste 241 d) et la polémique d'Aristote contre Melissô et Parménide (spécialement le texte de Physique I c.3, 186 a: 2531). Ainsi est satisfaite la requête (a). Il ne s'agit pas toujours d'un verbiage arbitraire au sujet de la Différence Ontologique, mais aussi d'une série de difi~lcultés pressel1ties sans que l'on possède l'instrument conceptuel pour les mettre en ordre.
Homonymie Ontologique Catégorielle ~ ventail de propriétés
Tant chez Aristote que chez Heidegger on rencontre une préoccupation liée à la pluralité des propriétés visées par le terme "l'Etre" (ne pas confondre avec l'analogia entis). L'expression "l'Etre" ne désignerait pas, comme on l'a supposé, une propriété, mais un éventail de propriétes. Ce fait dénote une homonymie catégorielle (puisque l'on se restreint à la catégorie des propriétés). L'interrogation sur l'Etre peut être comprise comme l'examen desdites propriétés et des relations qu'il pourrait y avoir entre elles. Sans vouloir être exhaustifs, nous pourrions consigner une série de propriétés compatibles et (au moyen de quelques raccords) coextensives entre elles:
- l'existence dans le temps présent
chose
- I'existence en général
- la possibilité d'existence
- I'identité
- la prédication
- I'affirmation
- la possibilité d'être pensé la possibilité d'être estimé en termes de volonté le fait d'être en relation de fondement, de cause ou d'effet avec quelque
- le fait d'être déterminé par quelque propriété
- le fait de posséder, pour un couple quelconque de propriétés contradictoires, I'une d'entre elles.
Cette deuxième homonymie explique les diverses formes dans lesquelles s'est développée une bonne part de la spéculation métaphysique traditionnelle, que ce soit dans le traitement des "transcendantaux" (un, vrai, bon), ou dans les explications sur son "objet" (étant nominal, étant participial, le "Meinbare" de Meinong, etc.). Les équations fastidieuses sont un effort pour explorer les distinctes propriétés auxquelles il a été fait confusément allusion. Les catégories (prédicaments) s'imposent comme la seule manière d'étudier les diverses prédications. Une oeuvre aussi influente que méconnue, celle de Josef Maréchal Le Point de Départ de la Métaphysique, se nourrit de l'assimilation des termes prédication, affirmation et existence (interprétée comme acte infini): le fait que nous puissions énoncer des jugements assertoriques ne serait explicable, selon Maréchal, que parce que nous supposons une synthèse de la copule de la prédication avec un acte infini: ici se révèlent certains thèmes de Malebranche, Fichte et peut-être Bradley, mais ce n'est que grâce à l'homonymie catégorielle qu'ils peuvent apparaître dans ce contexte métaphysique de façon assez naturelle.
Si Heidegger insis~e sur sa démonstration que l'Etre est essentiel au Langage, c'est qu'il pense à l'Etre comme faisant référence à la propriété de déterminer la prédication; s'il établit une relation avec le Temps, c'est que l'actualité de l'existence réclame le présent. La préférence des métaphysiciens qui placent au premier plan un certain type d'étants et à l'arrière-plan la généralité, se comprend s'ils croient voir chez certains étants une exemplification plus juste des propriétés qui dans tel ou tel système sont considérées comme remarquables. De telle sorte que l'interrogation "qu'est-ce que l'être?" acquiert un autre sens, libérée de son absurdité. Et s'il existe plusieurs propriétés implicites dans l'Etre, l'objet de l'ontologie est loin d'être simple et le recours à des divisions et subdivisions s'impose. Ainsi sont satisfaits, selon moi, les critères (b), (c) et (e) de notre liste.
Mais nous arrivons ici à une thèse cruciale pour la pensée heideggérienne: I'expansion de l'Etre en éventail nous permet de passer à une compréhension dialectique de ces propriétés (ceci renvoie au passage de Platon dans le Sophiste, 254 b sqq.). Etre, comme propriété centrale s'oppose à Devenir (Werden), à Apparence (Schein), à Penser (Denken) et à Devoir-Etre (Sollen) comme à des propriétés périphériques constituant une trame de propriétés.
Chaque fac,on de saisir une propriété centrale conditionnerait de manière radicale la façon de saisir une propriété périphérique proche. Ces propriétés sont à leur tour centrales par rapport à d'autres propriétés, et ainsi de suite. Une propriété centrale peut se comporter ou non comme un genre (un déterminable); sa centralité ne dépend pas de cela, mais d'un système de positions, tensions et compléments étendu non seulement au sens de la propriété mais aussi aux représentations qui l'enveloppent. "Devenir" signifie une succession continue de situations, mais représentée par le cours d'un fleuve, le bourgeonnement d'un arbre, la vague qui croît sans être une chose mais le déploiement d'une force qui se manifeste dans l'euphorie de l'aube. L'Art et la Poésie, créant un lien entre représentation et sens, peuvent donner accès à ces dimensions et placer les choses sujettes à l'expérience dans une perspective métaphysique - si tant est que la Métaphysique nous engage dans cette trame de propriétés. Ceci nous foumit la raison de cette étrange affirmation sur le destin d'un peuple et sa compréhension de l'Etre, sa façon d'aborder la question de l'Etre. Cette compréhension est portée par un langage naturel, qui est nécessairement collectif, et elle s'étend à travers lui au peuple qui le parle, et qui, de par cette compréhension athématique de l'Etre, se situe dans-le-monde d'une façon ou de l'autre. Ceci satisfait le réquisit (f).
L"'Interrogation Fondamentale de la Métaphysique"
La question (d) au sujet de l'Onto-Théologie n'était pas encore suf~lsamment résolue. Ainsi donc, si l'Etre instaure un ordre de fondements et de raisons suff1santes, il paraît adéquat d'instaurer un tel ordre dans la contingence générale de l'étant, introduisant par là une entité nécessaire. Mais si Heidegger feint de répéter la question de Leibniz "pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien?" il le fait seulement pour la rejeter, bien que d'une manière très diplomatique. Et il fait bien, car une question qui ~ne peut avoir de réponse est nulle et non avenue. J'omets de faire la démonstration exacte de cette nullité, mais j'en suggérerai les grandes lignes.
Appliquant le principe de raison suffisante nous imaginons deux situations contradictoires, toutes les deux possibles prises séparément: un monde vide ou un monde non vide. Chacune des deux situations paraît logiquement contingente, peut se présenter ou non, et la question fondamentale devrait conduire à donner raison de la contingence en général. Mais si la réponse est également contingente, on aurait seulement ajourné la question: comme avec le monde soutenu par un éléphant, qui devrait être soutenu par une tortue... etc.
Mais si la réponse n'était pas logiquement contingente et impliquait, par exemple "il existe une entité nécessaire" alors cette conclusion devrait être nécessaire et sa négation impossible. Est-ce là un résultat admissible? Non. De là suivraient deux inconvénients: l'un, qu'on disposerait alors d'un argument ontologique, car rendant superflue toute preuve à partir de la contingence; dans le fameux débat radial de Russell et Copleston en 1948 ce problème reste sousjacent, dominant ce qu'on voit à la surface. L'autre inconvénient est que du nécessaire ne peut s'ensuivre le contingent: la réponse ne peut donc donner raison de la contingence. C'est pourquoi l'Onto-Théologie implose quand elle tente d'expliquer la création a parte dei, dans la mesure où elle fait de Dieu un Créateur. Cette création (ou le fait qu'il y ait un Dieu créateur plutôt qu'un Dieu qui ne l'est pas) est une question logiquement contingente, comme l'existence même du monde. Si l'on introduit ici la Liberté divine, en réalité on ne fait que hisser un drapeau blanc, et ce principe de raison suffisante qui avait rendu de si précieux services se rend pieds et poings liés Le théologien propose un armistice: "Bâillonnons le principe de raison suffisante et parlons d'autre chose, de Dieu qui est amour, ou de la dignité de la personne humaine. " Le philosophe fait observer : "Comment? Dieu s'était introduit pour rationaliser le scandale de la contingence et puis, pour la compréhension de cet être nécessaire, on réintroduit en lui la contingence, l'affiublant du nom de Liberté." Spinoza en son Ethica (Pars I, prop. 17, 29 et 32) est plus conséquent que les Onto-Théologiens: ayant admis l'argument ontologique il nie qu'il puisse y avoir au monde quelque chose de contingent... Du nécessaire ne peut découler que le nécessaire.
En résumé: une réponse sensée à ce qu'on appelle la Question Fondamentale de la Métaphysique ne peut être ni une proposition nécessaire ni une proposition contingente. Mais une question qui empêche en principe toute réponse est une pseudoquestion - le résultat vaut indépendamment de toute théorie de vérification du sens et des critères similaires. Rien ne peut donc constituer une réponse à la question, qui s'annule par ce fait même, ce qu'il fallait démontrer. La démonstration exacte exige plus de précisions.
Il est clair que le chemin indiqué par Heidegger est différent, plus conforme à son style, difficile à abréger. Disons: la question peut s'autoabolir dans le questionnement "pourquoi un Pourquoi?". Nous trouverons seulement la propriété de l'Etre comme exigence de fondements des étants, et donation de ces fondements. Remplaçons alors la question abolie par la question sur la propriété centrale, et ce faisant nous retomberons sur nos pieds.
~eidegger et la Kulturphilosophie
Si de ce qui pre!cède on peut inférer des conséquences agréables ou désagréables au judéochristianisme et à ses institutions, c'est là une question qui intéresse plus le propagandiste que le philosophe. Ce qui est certain, c'est que Heidegger (considéré comme l'archétype du métaphysicien par des épigones insignifiants) déplace le centre de gravité de l'Ontologie vers ce qu'on peut appeler Philosophie de la Culture. J'ai proposé au début d'aborder Heidegger sous un angle philosophique et de juger sa pensée dans ce sens. Je vais risquer un jugement: si nous le comparons en tant que philosophe de la culture à Nietzsche, à Spengler, à Evola, il n'occupe pas la première place, nous sommes gênés par ses détours excessifs et le manque d'évidence des faits qu'il allègue. Si nous le considérons comme un philosophe de la ligne classique et théorique, nous sommes déconcertés par le peu de sensibilité de Heidegger à l'égard des problèmes métaphysiques. Depuis la cime de sa propre position, qu'il ne se donne jamais la peine d'expliciter, il se met à historiciser, émettant des opinions sur les penseurs qui l'ont précédé. Ce qui alimente la plèbe de la Philosophie, les professeurs sans idées qui tournent comme des vautours autour des grands morts. Heidegger se prête bien à une justification de la phrase de Nietzsche sur l'Histoire qui se convertit en fossoyeuse du présent. Dans nos institutions académiques - et dans une bonne partie de celles d'Europe, avoir été un philosophe est un honneur - vouloir parvenir à l'être, un opprobre.
Mais la Philosophie, après deux millénaires de lutte avec les mythologies judéochrétiennes et leurs sécularisations, est pour la première fois une nouvelle possibilité. C'est ici qu'il y a une splendeur de Heidegger. Sa grandeur est dans ce mode du philosopher à la frontière de la Science et de la Weltanschauung, sur cette mince ligne qui peut fasciner et confondre, induire au vertige ou empêcher la pensée. Heidegger nous éveille à de nouvelles possibilités épurées de toute tradition supposée. C'est cela que nous pouvons apprendre de Heidegger, non pas son jargon ou son désordre, son hostilité à l'égard de la science ou ses mauvaises argumentations. Ce ne sont pas ses thèses qui nous importent, mais les voies qui s'ouvrent en elles. Ce n'est pas tant la thématisation de l~tre qui nous intéresse, mais un retour de ce qui survint dans l'Hellade, le penser entre Mythos et Logos.
Carlos Dufour. Traduit de l'espagnol (argentin) par Bruno Dietsch.
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : philosophie, heidegger, existentialisme, allemagne, révolution conservatrice |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 11 septembre 2010
La metafisica del sesso in Mircea Eliade
di Giovanni Casadio* Mircea Eliade nacque nel marzo 1907 e morì nel 1986, quindi a poco più di 79 anni. Trascorse 3 anni in India, quasi un anno in Inghilterra, quasi 5 anni in Portogallo (Lisbona e Cascais), 11 anni a Parigi, 30 anni in America (Chicago) e naturalmente 33 anni in Romania, gli anni della formazione, durante i quali fece continui viaggi in Italia e in Germania. Durante i 30 anni di relativa stabilità a Chicago, quasi tutte le estati traslocava in Francia, con lunghe trasferte prima nel Canton Ticino e poi in Italia.
Fonte: Rinascita [scheda fonte]
“La vita è fatta di partenze”
Jurnalul Portughez, 19 luglio 1945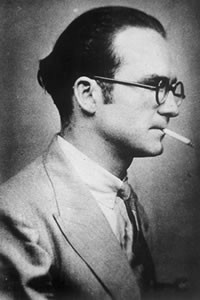
Si sposò due volte (come adombrato nel proverbio “di Venere e di Marte non si sposa e non si parte”, le nozze sono come un imbarco per un viaggio assai incerto). La prima moglie Nina Mareş (dal 1934 al 1944), la seconda Christinel Cottescu (dal 1950 al 1986) furono devotissime amanti, massaie e segretarie. Ebbe una decina di amori extraconiugali importanti (i più notevoli, quello con Maitreyi, per il contesto orientale e il libro – anzi i due libri – che ne seguirono, e quello con Sorana, per l’exploit orgasmico di cui parlerò nel seguito). E svariate altre donne: non tantissime come il coetaneo Georges Simenon (1903-1989), che si vantava di aver consumato un numero di donne superiore a quello delle matite usate nei suoi innumerevoli scritti (quattrocento e più romanzi e migliaia di articoli) e in un’intervista al vitellone romagnolo Federico Fellini dichiarava: “Fellini, je crois que, dans ma vie, j’ai été plus Casanova que vous! J’ai fait le calcul, il ya un an ou deux. J’ai eu dix mille femmes depuis l’âge de treize ans et demi. Ce n’est pas du tout un vice. Je n’ai aucun vice sexuel, mais j’avais besoin de communiquer!”
Ma anche i libri o gli articoli che si scrivono e poi (non sempre) si pubblicano sono partenze. Un elenco provvisorio, probabilmente in difetto, potrebbe essere il seguente: Romanzi o racconti lunghi: 15 - volumi di novelle: 4 - diari: 5 - volumi di memorie: 2 - drammi: 4 - saggi di storia delle religioni, di filosofia, di critica letteraria: 34 e più - curatele di opere singole o collettive: 2 tomi (Bogdan Hasdeu); 1 tomo (Nae Ionescu); 4 tomi (From Primitives to Zen: fonti di storia delle religioni), 15 voll. (Encyclopedia of Religion) - riviste fondate e dirette o co-dirette: 1. Zalmoxis, 2. Antaios, 3. History of Religions.
Aggiungiamo più di 1900 articoli, pubblicati in riviste e miscellanee di varia cultura soprattutto nel periodo romeno, ripresi solo in minima parte nelle opere menzionate sopra. E non parliamo degli infiniti frammenti inediti: abbozzi di libri non condotti a termine, note erudite, appunti di diario smarriti nei vari traslochi o da lui stesso gettati nelle fiamme o distrutti nel grande incendio che devastò il suo ufficio all’Università di Chicago un anno prima della morte. Molto si trova ancora nei 177 scatoloni del fondo Eliade conservato allo “Special Collections Research Center” presso la Regenstein Library della Università di Chicago, insieme alla corrispondenza, i manoscritti e le prime copie a stampa di tutti i libri pubblicati da Eliade, scritti su di lui e altro materiale interessante, compreso la famosa pipa, 5 temperini e un calzascarpe. Certo una bagattella al confronto della produzione del quasi coetaneo teologo indo-catalano Raimon Panikkar (1918-), al quale si devono più di 60 voll. e più di 1500 articoli, ma – si sa – i teologi scrivono sotto la dettatura di Dio (ed Eliade non era un teologo, contrariamente a quanto molti pensano). Ma un numero abbastanza cospicuo per comprendere che siamo di fronte a un essere fenomenale: un individuo ossessionato da una specie di delirio della scrittura-confessione, in funzione di una fuga dalla realtà (in gergo psicologico “escapismo”), che è poi una forma estrema di svago o distrazione, il cui scopo è d’estraniarsi da un’esistenza nei confronti della quale si prova disagio.
Infinite (in svariate lingue) le monografie, le miscellanee, gli articoli, le voci d’enciclopedia, le recensioni, le tesi di laurea sui più disparati aspetti della sua vita e della sua opera. E – ed è ciò che più conta – infinite citazioni dei suoi scritti in opere di storia delle religioni e di ogni altro genere letterario; per fare un esempio, Eliade è l’unico storico delle religioni menzionato in due opere chiave di due papi, Karol Józef Wojtyła (Varcare la soglia della speranza) e Joseph Ratzinger (Fede, verità, tolleranza).
La sua vita in Portogallo
In questa sede, ci proponiamo di affrontare alcuni momenti del suo vissuto interiore nel periodo portoghese. Premettiamo che Eliade stette in Portogallo, prima come addetto stampa, poi come consigliere culturale, poi di nuovo come addetto stampa, poi come privato cittadino (in ragione dei mutamenti del vento politico romeno) dal 10 febbraio 1941 al 13 sett. 1945, esattamente 4 anni e 7 mesi: sono date che parlano da sé …
Il Jurnal portughez è il più importante dei diari di Eliade per due motivi. Anzitutto esso si diversifica da Şantier (“Cantiere”, noto in Italia come Diario d’India) e dai tre voll. di Fragments d’un journal ovvero Journalul in romeno (che vanno dall’arrivo in Francia nel ’45 alla morte dell’autore nell’86) perché non fu ridotto (e censurato) dall’Autore per la pubblicazione, sia perché non ne ebbe il tempo sia perché non si trovò mai nella disposizione d’animo adatta per fare i conti con il vissuto psichico di quegli anni colmi di avvenimenti funesti per lui, per il suo paese e per il resto del mondo. Sia chiaro: quando Eliade scrive, scrive sempre col pensiero al lettore. Una volta, infatti, osserva che solo quando lui avrà sessant’anni quei pensieri potranno essere resi di pubblico dominio, e solo allo stato di “frammenti”, estrapolati dall’insieme delle confessioni: così scrive il 5 febbraio 1945. Alla sua morte la moglie Christinel non si è mai decisa a dare il permesso della pubblicazione: solo pochissimi intimi hanno avuto accesso al manoscritto conservato nel fondo Eliade della Biblioteca Regenstein di Chicago, tra i quali l’amico romeno Matei Calinescu (1934-2009) e il fedelissimo allievo e biografo McLinscott Ricketts. Ricapitolando, il testo manoscritto è stato pubblicato così come era stato buttato giù dall’autore, e sarebbe dunque la prima volta che ci troviamo di fronte ai pensieri immediati di Eliade, un autore che anche critici benevoli come N. Spineto e B. Rennie considerano un grande bugiardo, costruttore e manipolatore del proprio personaggio per la posterità.
Abbiamo detto che il Jurnal del periodo portoghese è più importante di tutti gli altri diari per due motivi. Il primo, si è visto, risiede nel suo carattere di documento genuino, immediato, in quanto presenta i suoi pensieri senza tagli o rielaborazioni. Il secondo motivo è di ordine contenutistico, e non è meno essenziale. In esso infatti sono narrati: 1) i pensieri e le emozioni che fanno da sostrato alle due opere di Eliade (apparse entrambe nel 1949 ma cominciate in quegli anni luttuosi) di gran lunga più lette e citate, cioè il Traité d’histoire des religions (prima concepito come “Prolegomeni” e poi ripresentato in inglese come Patterns) e il Mythe de l’éternel retour (successivamente presentato in inglese col titolo più descrittivo Cosmos and History); 2) le emozioni e i pensieri generati dal progressivo disfacimento – cui seguirà un inesorabile collasso – delle due cose che al Nostro erano più care, la patria -nazione romena, neamul românesc (sotto il rullo compressore delle armate sovietiche e per la inettitudine o complicità di “piloti orbi” di varie tendenze), e la sposa Nina Mareş (in seguito agli effetti devastanti di un cancro all’utero). E – come è stato notato anche da Alexandrescu, che definisce il Diario portoghese “Apocalisse di Eliade” o “secondo Mircea Eliade” (p. 317, trad. ital.; p. 26, ed. romena) – tra le due catastrofi esiste un inscindibile nesso, quale quello che può sussistere tra le vicende del macrocosmo-mondo e quelle del microcosmo-uomo, per restare nei termini di una polarità derivata da una tradizione – quella indiana – a lui estremamente familiare (si veda, ad es. nel Diario, la riflessione del 25 sett. 1942: “Quando l’uomo scopre sé stesso, ātman, scopre l’assoluto cosmico, brahman, e nello stesso tempo coincide con esso”, p. 49, trad. it.). In queste circostanze, e da esse condizionato e afflitto, egli elabora una serie di formule ermeneutiche che anticipano la filosofia delle due opere. Da queste circostanze, in maniera ancora più evidente, nascono una serie di riflessioni assolutamente brutali sulla situazione politica del tempo e sulla propria intimità personale, riflessioni che non mancheranno di suscitare gli strilli indignati delle anime belle e dei corifei della correttezza politica. Diamo quindi la parola all’autore stesso: all’Eliade intimo.
La bella giudea di Cordova
Anzitutto una riflessione sulla donna come virtuale soggetto e oggetto di desiderio e di innamoramento. Il 5 ottobre 1944 Eliade è a Cordova per un congresso in cui avrebbe parlato di miti sull’origine delle piante. Nella piazzetta di Maimonide adocchia “dal gruppo di curiosi che ci guardano passare, una ragazza straordinariamente bella, con una macchia bruna sotto gli occhi. Un tipo marcatamente ebraico” (p. 169 trad. it.). In lui si accende la fiamma del desiderio; non lo dice – secondo lo stile reticente e allusivo che è tipico del suo diario –, ma è evidente dalla narrazione che segue. “Al Depósito de Sementales (cioè il deposito degli stalloni), perché ci vengano mostrati i cavalli. Il primo cavallo che ci presentano è da monta: poderoso, ma terribile. In effetti il sesso non è mai bello, manca di grazia, non ha altra qualità tranne quella della riproduzione potenziata in modo mostruoso. Sono convinto che la maggior parte dei cavalli arabi e arabo-ispanici che ci vengono fatti vedere, superbi, nervosi e fieri, siano impotenti, o quasi. Il pensiero che la forza generativa che sento turbarmi sin dall’adolescenza potrebbe essere il grande ostacolo tra me e lo spirito puro, l’uccello del malaugurio del mio talento, mi deprime. Che cosa avrei potuto creare se fossi stato meno schiavo della carne!”. Eliade fu certo ossessionato dall’antitesi tra libido copulandi e libido scribendi (sentite entrambe come forme di creazione potenziale), ma non ricorse mai come il giudeo greco alessandrino Origene al rimedio estremo della castrazione. Per domare le urgenze della carne dovette attendere il naturale sedarsi dell’istinto sessuale, in seguito al trascorrere degli anni e grazie alla compagnia di una donna castrante come Christinel Cottescu. Lì a Cordova, la visione in rapida successione della bella giudea e dei potenti/impotenti stalloni fa scattare nella sua mente un’intuizione sulle modalità dell’eros femminile che è certo basata sulla sua ventennale esperienza di seduttore ma anche su una raffinata capacità di cogliere gli aspetti sottili della realtà, capacità che è poi anche quella che contraddistingue la sua ermeneutica dei fenomeni religiosi nei loro aspetti simbolici. “Dubito che le donne amino la violenza come stile erotico e abbiano un debole per gli uomini brutali. La donna è sensibile in primo luogo all’intelligenza (come la intende lei, ovviamente: “vivacità di spirito”, “facezia” [spirt, drăcos, glumeţ], ecc.); più che alla stessa bellezza. In secondo luogo, è sensibile alla bontà. Tutti i racconti con donne ossessionate da uomini brutali, ecc., sono invenzioni letterarie di certi decadenti. Statisticamente, e soprattutto nei villaggi, ciò che attrae nel 90 % le donne è il “cervello” (deşteptăciunea) e la bontà. Non è la capacità generativa a distinguerci dalle donne, ma l’intelligenza” (p. 170 trad. it.).
La conclusione di Eliade, per quanto generalizzante, è sicuramente fondata e potrebbe assegnare al suo autore un posto d’onore tra i trattatisti dell’amore nella serie che va da un Andrea Cappellano a un Henri Stendhal, fino a un Francesco Alberoni, si licet parvis componere magnis. Merita attenzione il corollario di questa riflessione che sembra caratteristico di una mentalità tipicamente maschilista, piuttosto disinvolta nei riguardi delle capacità intellettuali del gentil sesso: “Non è la capacità generativa a distinguerci dalle donne, ma l’intelligenza”.
Intelligenza e gentil sesso
Vuole egli intendere, con questa asserzione, che le donne sono prive di intelligenza?
Probabilmente sì, nel senso che le donne sarebbero prive di quel certo tipo di intelligenza o prontezza di spirito che esse prediligono in quegli uomini che ai loro occhi ne appaiono dotati. E credo invero che quel suo insistere sulla differenza (quella certa cosa che ci distingue dalle donne, “ne distingue de femei”), debba intendersi nel senso che le donne – come del resto gli uomini – sono naturalmente attratte (per la nota legge chimico-fisica sull’attrazione tra poli contrari) da quegli uomini che possiedono in maniera marcata una caratteristica di cui esse si sentono prive: il che naturalmente è vero solo in certi casi. E sarà lo stesso Eliade a notarlo in un pensiero successivo che sembra in netta contraddizione con questo.
L’11 aprile 1945, meno di un anno dopo, il Nostro è in uno stato di acuta irritazione nei riguardi dei suoi compatrioti maschi (in particolare i funzionari del ministero degli Esteri, pronti a inchinarsi di fronte al nuovo padrone sovietico) e in più soggetto a una crisi nevrastenica, “alimentata in modo naturale dalla mia insoddisfazione erotica”. Il suo pessimismo “per quel che riguarda la condizione attuale dell’uomo” lo induce ad impietose considerazioni che smascherano la (presunta) superiorità dell’intelligenza maschile. “Certe volte mi deprime l’enorme ruolo che continua a svolgere la vanità nella vita di quasi tutti gli uomini; superiore a quello del sesso, della fame o della paura della morte. Mi convinco egualmente che il maschio ‘in generale’ è di gran lunga più stupido di quello che ritenevo sino a qualche anno fa. La lucidità del maschio è una leggenda. Conosco, oggi, moltissimi uomini che sono stati scelti, menati per il naso e ‘acchiappati’ da donne completamente prive di ogni tipo di attrattiva – senza che essi avessero anche solo il sospetto del ruolo passivo che hanno avuto. (…) In moltissime coppie che ho conosciuto negli ultimi sette, otto anni, le mogli sono molto al di sotto del livello dei mariti, ma infinitamente più intelligenti e abili di loro, prova ne sia il fatto che se li tengono. Al contrario, quasi tutte le donne ammirevoli che ho conosciuto in questo lasso di tempo sono rimaste senza marito, perché nessun uomo ha saputo sceglierle. D’altronde, credo che quasi nessun uomo scelga. È sempre scelto. Come spiegarmi, altrimenti, tante coppie assurde che conosco? La stupidità dei maschi non è mai tanto evidente come quando, dopo molti amoreggiamenti e avventure, decidono di sposarsi. Quasi sempre la sposa ‘scelta’ è di gran lunga inferiore alle donne con le quali hanno flirtato, ecc.” (p. 264-265, trad. it.). Sei mesi prima, come abbiamo visto, pare che egli pensasse esattamente il contrario. Anche se sembra evidente che nell’un caso egli si riferisce alle condizioni in base alle quali la donna si lascia sedurre, nell’altro alla strategia che mette in atto per sedurre – a fini matrimoniali. Sulla donna, sul mistero della mente femminile, comunque, fa cilecca la razionalità di Mircea Eliade, come faceva cilecca la razionalità di un Platone o di un Schopenhauer.
L’eros come emozione
e orgasmo
E dall’eros come “innamoramento” passiamo a un’altra serie di riflessioni attorno a un altro aspetto paradossale della tematica erotica: l’eros come emozione legata all’evento fisiologico dell’eccitazione e dell’orgasmo, di nuovo da un punto di vista prettamente maschile. Tra il 2 e il 3 di febbraio del 1945, quando la disperazione per la “sparizione di Nina” gli pare intollerabile, quando la lettera di quasi licenziamento del Ministero degli Esteri lo getta praticamente sul lastrico, egli giunge, come avrebbe detto Eschilo, al mathein attraverso il pathein: a un intuizione geniale attraverso l’angoscia e la sofferenza (p. 227, trad. it.). Egli si domanda: “Che cosa significa la perdita di tua moglie, in confronto alla grande catastrofe mondiale, nella quale lasciano la vita decine di migliaia di persone al giorno, che annienta città e strema nazioni?”. La risposta che Eliade dà è lucidissima, e getta, per così dire, un ponte tra il macro- e il microcosmo; e significa, nel fondo, che la massa non è che una somma di individui tra loro incomunicabili. “Gli risponderei: immaginati un giovane innamorato da tanto tempo, che, un bel giorno, riesce a far sua la donna amata. È felice, e nel vederlo traboccare di felicità tu gli dici: ‘Che interesse può avere il fatto che tu oggi abbia posseduto una donna! Alla stessa ora, in tutto il mondo, almeno un milione di coppie stavano facendo, come te, l’amore. Non c’è nulla di straordinario in quello che ti è successo!’. E, malgrado ciò, lui, innamorato, sa che ciò che gli è successo è stato straordinario”. In questa minirealtà – che poi tanto minima non è – Eliade dà mostra di una capacità introspettiva che gli fa cogliere quel tanto di banale e di balordo che è implicito nell’atto della consumazione, che assume significato solo attraverso l’amore, amore che è in grado di produrre una trasformazione quasi alchemica dell’evento fisiologico. Una capacità introspettiva che è in fondo in sintonia (ci sia concesso questo accostamento che ad alcuni potrà apparire irriverente o impertinente) con la sua riflessione su tempo ed eternità, quale si ritroverà appunto nel libro alla stesura del quale si accingerà il mese successivo e che apparirà in Francia quattro anni dopo col titolo Le mythe de l’éternel retour. Archétypes et répétition (Paris 1949). Per il resto della notte lo rode l’insonnia, durante la quale si accavallano pensieri dominati da una disperazione atroce e senza apparente via di uscita (“sento che qualsiasi cosa faccia il risultato è la disperazione”). E di nuovo si rifugia nell’escamotage del libertinaggio fine a se stesso, svuotato di ogni dimensione romantica.
“E ho un’alternativa: se mi getterò di nuovo in esperienze (leggi: erotismo), mi consumerò invano, perché nessun piacere fisico può essermi di consolazione una volta estinto (può forse consolarmi l’aver stretto tra le braccia Rica, Maitrey, Sorana e qualche altra? Mai un ricordo erotico consola; tutto si consuma per sempre nell’atto; si ricorda l’amore, l’amicizia, la storia legata a una donna, ma ciò che è stato essenzialmente erotico, il fatto in sé diventa nulla nell’istante successivo alla sua consumazione). Così, mi dico che devo accontentarmi di un equilibrio fisiologico acquisito senza grattacapi (un’avventura qualunque e comoda) e concentrarmi sulla mia opera, lasciandomi passare accanto la vita senza sentirmi costretto ad assaporarla, a cambiarla né ad avvicinarmela”. Alla lucidità della diagnosi (effettivamente è così: il ricordo erotico non consola, tutto si consuma per sempre nell’atto, da cui il pessimismo sull’eros come adempimento fisiologico frustrante di Lucrezio nel IV libro del De Rerum Natura e l’insaziabile concupiscenza di Don Giovanni nel mito e nella letteratura) segue la banalità della terapia: “un’avventura qualunque e comoda”, cioè evidentemente mercenaria.
Insomma, per salvarsi dalla depressione conseguente alla débacle sua personale e della sua patria, Eliade (in fondo ha solo 38 anni, un’età in cui gli ormoni sono ancora assai attivi) si rifugia nel sesso come atto biologico di puro consumo. Nei giorni e nelle notti che vanno dal 5 marzo al 15 aprile 1945, mentre la storia macina gli eventi (per usare un’espressione carducciana) come in nessun altro momento del secolo testé trascorso, il Nostro macina i propri testicoli con accanimento per così dire terapeutico. Negli intervalli della cronaca del pellegrinaggio a Fatima, “per il riposo dell’anima di Nina e la salvezza della mia integrità spirituale” (18 marzo, p. 252, trad. it.), e del successivo ritorno a Cascais ove si ritrova a lottare con i tira e molla del Ministero degli Esteri romeno e con i fantasmi del proprio passato, è tutto un susseguirsi di annotazioni di eventi crudamente neurologici e fisiologici (p. 249-269 trad. it.). Il 5 marzo egli comincia a sperimentare la sua inedita tecnica di liberazione dalla crisi nevrastenica dando briglia sciolta alla sua sensualità e ad una sfrenata ginnastica sessuale. “Oggi – annota – sono tornato alla fisiologia. In un’ora ho fatto l’amore tre volte con la stessa donna, un po’ meravigliata, bisogna dirlo, del mio vigore. Domani o dopodomani consulterò un neurologo: voglio tentare tutto. Mi affliggerebbe apprendere, ad esempio, che la mia nevrastenia e la mia melanconia sono dovute alle adorabili funzioni seminali” (p. 249, trad. it.). Il 14 marzo, alla vigilia della partenza per Fatima, annota: “Ripeterò la mia arcinota tecnica di liberazione attraverso l’eccesso, di purificazione attraverso l’orgia. (…) Voglio sapere se la mia melanconia ha o no radici fisiologiche. Voglio liberarmi da ogni influenza seminale, anche se questa liberazione implicherà sedurre un centinaio di donne” (p. 251, trad. it.). Il 16 marzo riceve dal neurologo la risposta che si attendeva: “le melanconie dipendono da cause spirituali”, ma la crisi generale ha motivazioni più biologiche, legate alla sua ipersessualità insoddisfatta: “non posso raggiungere l’equilibrio se non solo dopo la realizzazione di quello erotico” (p. 252, trad. it.). E durante il viaggio, nonostante le consolazioni spirituali del paesaggio “archetipico” si ritrova a lottare coi soliti fantasmi ormonali: “Tutto ieri e oggi ossessionato dal sesso” (22 marzo, p. 257, trad. it.). L’11 aprile, di nuovo a Cascais, ripete a sé stesso che la crisi nervosa è basata sull’insoddisfazione erotica. Ma i rapporti saltuari, per quanto spinti al massimo della sollecitazione ormonale, non lo soddisfano abbastanza: “avrei bisogno di un’amante giorno e notte” (11 aprile, p. 264, trad. it).
La politica, la pausa,
il lavoro
Il 15 aprile finalmente il Nostro riprende a lavorare (dopo la crisi di melanconia del giorno precedente in cui ha vissuto “un distacco definitivo dall’opera, dalla cultura, dalla filosofia, dalla vita e dalla salvezza”), ed è alle prese con la rilettura di Isabel şi apele diavolului (1929/30), in vista di un’eventuale nuova edizione. E allora, quasi proustianamente, riaffiorano in lui sensazioni e ossessioni che lo perseguitavano al momento della stesura del libro e immediatamente dopo la sua apparizione in Romania. “Un particolare mi turba: l’accento che pongo sulla sterilità, sull’impotenza. … Mi sono chiesto se il mio rifiuto (nel romanzo) di possedere Isabel non potrebbe interpretarsi psicoanaliticamente come un’ossessione di impotenza. Visto che non ho mai avuto tale ossessione, mi chiedo da dove provenga il rifiuto di possedere una ragazza che ti si offre, complicato dalla gioia sadica di vederla posseduta da un altro. È probabile che questa domanda se la siano posta anche gli altri. Rammento che Sorana, dopo una giornata eroica [meglio: “brava”, romeno: zi de vitejie] nel rifugio di Poiana Braşov dove feci dieci volte l’amore con lei, mi confessò che il mio vigore l’aveva sorpresa; perché, dopo aver letto Isabel, mi credeva quasi impotente. Ma, spaventata dalla mia energia, si confidò con Lily Popovici, che lei riteneva avesse avuto più esperienze in fatto di uomini. Lily le disse che, se non mi avesse conosciuto, avrebbe pensato che mi fossi drogato, che avessi preso delle pillole, ecc. La cosa più divertente è che io neppure mi rendevo conto d’essere in realtà messo tanto “bene”. Mi sembrava che qualsiasi uomo, se una donna gli piaceva, ed era rilassato, poteva fare l’amore dieci volte! Più tardi, ho capito che questo è un privilegio abbastanza raro” (p. 268, trad. it.). Questa ossessione della virilità, presente nella sua narrativa giovanile, è certo esistente allo stato latente nella sua psiche (per quanto egli si affretti a precisare il contrario: “Il problema della potenza o dell’impotenza non mi ha mai preoccupato”), altrimenti mal si spiegherebbe questa sua ricorrente, quasi puerile compiacenza nell’esibizione delle sue prodezze priapiche, ed è da Eliade ricollegata a un rifiuto ben più radicato e conscio: il rifiuto di generare prole, che si lega poi al lacerante senso di colpa prodotto dalla morte di Nina per cause probabilmente legate a un aborto violento che lui stesso le aveva imposto.
In queste meditazioni di un Eliade alla soglia dei quarant’anni è teorizzata, sul piano individuale, una tecnica di liberazione dall’angoscia (in altre parole, una tecnica di “salvezza”), basata sulla ginnastica copulatoria e l’estasi eaiaculatoria, senza che si tenti di elevarla su un piano di trascendenza metafisica o di stabilire alcun rapporto con i valori catartici e salvifici dell’orgia, temi peraltro assai familiari all’Eliade autore, nel 1936, di Yoga, essai sur les origines de la mystique indienne. L’aggancio di questo tema con più ampie realtà filosofiche e storico-religiose sarà invece compiuto da un altro storico e pensatore che è stato un suo dialettico compagno di strada in varie imprese, l’italiano Julius Evola (1898-1974), in Metafisica del sesso (1958; II ed. 1969). Un libro, questo, anch’esso frutto di una catastrofe personale mirabilmente metabolizzata, un libro che Eliade non avrebbe mai potuto scrivere, anche se fu testimone della sua gestazione in un incontro avvenuto nel maggio del 1952. In esso, in particolare nel terzo capitolo (Fenomeni di trascendenza nell’amore profano), Evola tratta dell’amplesso da un punto di vista superiore, cercando di cogliere quegli effetti trascendenti che rappresentano l’acme dell’atto sessuale. Come ha scritto Franco Volpi nel Dizionario delle opere filosofiche (Milano 2000, p. 357), nella voce appositamente dedicata a quest’opera apparentemente così poco filosofica, “Evola sviluppa una considerazione metafisica del sesso, ritenendo tale fenomeno un elemento troppo importante nella vita degli esseri per lasciarlo a spiegazioni semplicemente positivistiche e sessuologiche. Il sesso è la forza magica più intensa della natura, capace di esercitare su tutti i viventi un’attrazione irresistibile e tale da fornire, secondo Evola, l’occasione per trascendere la mera corporeità ed elevarsi fino al piano dello spirito. Il fenomeno del sesso implica dunque un potenziale estatico, iniziatico, che può essere portato alla luce soltanto guardando a esso dalla prospettiva metafisica”. E, conclude Volpi, “nell’eros – nei suoi attimi sublimi, ma a volte anche in esperienze d’amore quotidiane particolarmente intense – balugina la trascendenza, la quale può infrangere i limiti della coscienza quotidiana e produrre un’apertura spirituale. Il fenomeno del sesso getta così un ponte tra la fisica e la metafisica, tra la natura e lo spirito”. Ma queste cose l’Eliade del 1945, innamorato senza speranza di una donna che è ormai un fantasma e soggetto ancora a violente tempeste ormonali, non poteva o non voleva dirle.
*Ordinario di Storia delle Religioni all’Università di Salerno
Tante altre notizie su www.ariannaeditrice.it
00:10 Publié dans Philosophie, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, métaphysique, sexualité, roumanie, mircea eliade, tradition, traditionalisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 09 septembre 2010
Johann Nepomuk Ringseis (1785-1880)
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1991
Robert STEUCKERS:
RINGSEIS, Johann Nepomuk 1785-1880
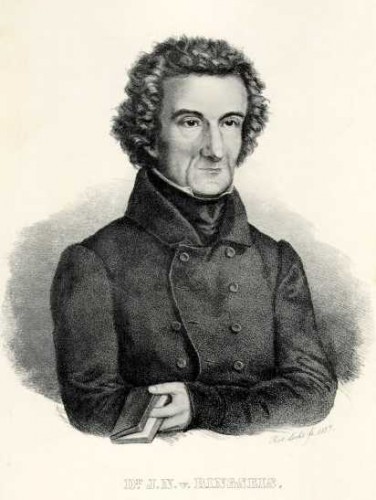 Né le 16 mai 1785 à Schwarzhofen en Bavière, le jeune Ringseis, très tôt orphelin, fréquentera l'école abbatiale des Cisterciens à Walderbach, puis le séminaire d'Amberg, avant de commencer des études de médecine en 1805 à Landshut sous la direction d'Andreas Röschlaub, dont il deviendra l'assistant. Influencé par les Lumières lors de sa première année d'étude, Ringseis se dégage vite du rationalisme étroit sous l'influence des idées de Stolberg et des écrits de Baader et des romantiques (surtout Joh. Mich. Sailer). Les mesures de confiscation des biens d'église en Bavière, dues à l'influence française, le choquent, le révoltent et ancrent définitivement ses convictions anti-révolutionnaires . Ringseis entame une brillante carrière médicale; philosophes célèbres, membres de la famille royale bavaroise sont ses patients attitrés. Plusieurs séjours en Italie avec le Kronprinz de Bavière contribuent à conforter son catholicisme. Quand le prince héritier, devenu Louis Ier, monte sur le trône en 1825, Ringseis est nommé Obermedicinalrath (ce qui équivaut à Ministre de la santé), avec pour mission de réformer la médecine en Bavière. C'est dans le cadre de ces activités politico-médicales que paraît en 1841 son ouvrage le plus célèbre: System der Medizin. Avec l'appui du roi Louis Ier, Ringseis devient en quelque sorte le promoteur de la nouvelle université de Munich, où se télescoperont et se fructifieront mutuellement les idées protestantes et catholiques de l'époque. Son engagement ultramontain se précise. Entre 1848 et 1850, période agitée dans toute l'Europe, Ringseis participe à la vie politique bavaroise. En 1852, il quitte l'université pour marquer son désaccord avec les réformes envisagées mais y revient en 1855 et prononce un discours sur la nécessité de l'autorité dans les hautes sphères de la science. En 1872, à 87 ans, il quitte ses fonctions ministérielles. Il meurt à Munich le 22 mai 1880.
Né le 16 mai 1785 à Schwarzhofen en Bavière, le jeune Ringseis, très tôt orphelin, fréquentera l'école abbatiale des Cisterciens à Walderbach, puis le séminaire d'Amberg, avant de commencer des études de médecine en 1805 à Landshut sous la direction d'Andreas Röschlaub, dont il deviendra l'assistant. Influencé par les Lumières lors de sa première année d'étude, Ringseis se dégage vite du rationalisme étroit sous l'influence des idées de Stolberg et des écrits de Baader et des romantiques (surtout Joh. Mich. Sailer). Les mesures de confiscation des biens d'église en Bavière, dues à l'influence française, le choquent, le révoltent et ancrent définitivement ses convictions anti-révolutionnaires . Ringseis entame une brillante carrière médicale; philosophes célèbres, membres de la famille royale bavaroise sont ses patients attitrés. Plusieurs séjours en Italie avec le Kronprinz de Bavière contribuent à conforter son catholicisme. Quand le prince héritier, devenu Louis Ier, monte sur le trône en 1825, Ringseis est nommé Obermedicinalrath (ce qui équivaut à Ministre de la santé), avec pour mission de réformer la médecine en Bavière. C'est dans le cadre de ces activités politico-médicales que paraît en 1841 son ouvrage le plus célèbre: System der Medizin. Avec l'appui du roi Louis Ier, Ringseis devient en quelque sorte le promoteur de la nouvelle université de Munich, où se télescoperont et se fructifieront mutuellement les idées protestantes et catholiques de l'époque. Son engagement ultramontain se précise. Entre 1848 et 1850, période agitée dans toute l'Europe, Ringseis participe à la vie politique bavaroise. En 1852, il quitte l'université pour marquer son désaccord avec les réformes envisagées mais y revient en 1855 et prononce un discours sur la nécessité de l'autorité dans les hautes sphères de la science. En 1872, à 87 ans, il quitte ses fonctions ministérielles. Il meurt à Munich le 22 mai 1880.
System der Medizin. Ein Handbuch der allgemeinen und speziellen Pathologie und Therapie; zugleich ein Versuch zur Reformation und Restauration der medicinischen Theorie und Praxis (System de la médecine. Manuel de pathologie et thérapie générales et spéciales; en même temps tentative de réformer et de restaurer la théorie et la pratique médicales) 1841
Les thèses principales de cet ouvrage très contesté dans les milieux médicaux du XIXième siècle sont: a) chaque organisme est dominé par un principe vital unitaire et individuel; b) la santé est l'état dans lequel ce principe domine seul; c) la maladie est l'état dans lequel ce principe ne domine plus seul mais est troublé par un élément étranger qu'il ne peut pas assimiler ni dominer; d) la guérison survient quand la force vitale, éventuellement soutenue par des médications, soumet et assimile le principe étranger entré dans le corps, l'élimine ou le maintient inoffensif; elle est complète quand la force vitale spécifique règne à nouveau seule dans l'organisme. Ce qui est pertinent dans cet ouvrage de médecine, c'est que Ringseis perçoit nettement la faiblesse des rationalismes issus du "satanique Descartes": ceux-ci imposent une logique qui ne vaut que pour les phénomènes extérieurs, dispersés et juxtaposés dans l'espace, et rejettent toutes formes de logique qui vaudraient pour les phénomènes intérieurs, qui s'emboîtent les uns dans les autres et se compénètrent mutuellement. Cette idée d'un "imbriquement quasi infini" (ein fast unendliches Ineinander) rejoint les critiques contemporaines des rationalités unilinéaires et unidimensionnelles, notamment les épistémologies philosophiques inspirées par les sciences physiques modernes de Heisenberg à Prigogine, de même que certaines audaces postmodernes.
(Robert Steuckers).
- Bibliographie complète, articles et discours universitaires et circonstantiels compris, dans E.R., "Johann Nepomuk Ringseis", Allgemeine Deutsche Biographie, 28. Band, Leipzig, Duncker & Humblot, 1889; comme textes principaux: Über den revolutionären Geist der deutschen Universitäten, Rectoratsantrittsrede, Munich, 1833; Manifest der bayerischen Ultramontanen, écrit anonyme, Munich, 1848; Über die Nothwendigkeit der Autorität in den höchsten Gebieten der Wissenschaft, Rectoratsantrittsrede, Munich, 1855 (2ième et 3ième éd. complétées, 1856); Über die naturwissenschaftliche Auffassung des Wunders, Munich, 1861; Über das Ineinander in den Naturdingen, texte publié par les Dr. Schmauß et Geenen dans Beilage zum Tagblatt der 36. Versammlung deutscher Naturforscher und Aertze in Speyer, 1861.
- En français: références in Georges Gusdorf, L'Homme romantique, Payot, 1984, pp. 273-277; Georges Gusdorf, Du néant à Dieu dans le savoir romantique, Payot, 1983, pp. 242-245.
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, allemagne, 19ème siècle |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 03 septembre 2010
El filosofo come intelectual pùblico
El filósofo como intelectual público 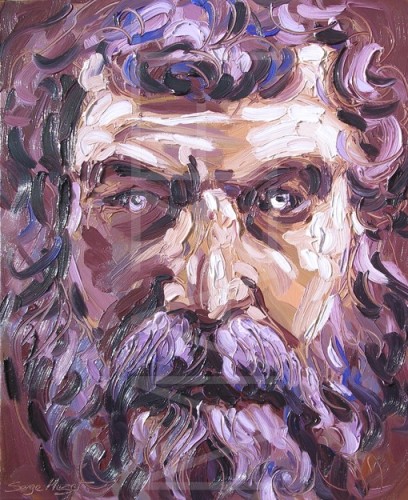
Le ha pasado a muchos, y nos ha pasado también a nosotros, que después de dictar clase durante años en la universidad, dejaron la enseñanza para limitarse a la investigación propia, a pensar sin ataduras, programas ni horarios.
Pero, por qué se toma este tipo de decisión tan vital: a) Por la íntima y subjetiva convicción del filósofo (ocurre con otras disciplinas también), que si bien la práctica filosófica requiere como condición el ejercicio académico, al menos durante un tiempo, esa práctica filosófica no se agota en ejercicio académico. Y b) porque son muy pocos los que pueden soportar la presión del ejercicio simultáneo de la filosofía en dos escenarios tan diferentes como el público y la academia. No sólo porque existen dos juegos de lenguajes: el propio de la academia con sus tecnicismos, cuanto más mejor, que circula en el interior de las facultades de filosofía y se expresa en las publicaciones especializadas. Esa verborrea bizantina que hizo exclamar a Nietzsche: “ciertos profesores de filosofía oscurecen las aguas para que parezcan más profundas” .
Y el propio de lo público, vinculado a las formas de opinión pública (TV, radio, diarios, conferencias abiertas) y al uso del lenguaje cotidiano. Y en este campo vale el apotegma de Ortega: “la claridad es la cortesía del filósofo”.
A esto hay que agregar que, quien decide intervenir sobre lo público corre el riesgo de perder el empleo público como profesor universitario o investigador. La reticencia de los académicos a pegar el salto es más bien por este último motivo que por el anterior.
Además desde el lado académico se lo comienza a considerar en una categoría menor como la de “ensayista”. Dice Owe Wikstrom en Elogio de la lentitud que el ensayo es un intento, ese es su sentido etimológico, donde el autor mezcla lo pequeño y lo grande de manera personal [1]. Y agregamos nosotros, El ensayo llega a conclusiones, enumera las pruebas más que detenerse en el método que convalida las pruebas. Por otra parte el ensayo fue durante muchos años un producto típicamente hispanoamericano, tenido por un género menor por los autores de manuales académicos al estilo europeo.
Es interesante notar que la figura del intelectual público es tan vieja como el ejercicio de la filosofía, el ejemplo clásico es Sócrates. En cuanto al intelectual académico recién aparece con cierta regularidad a partir de la década del cuarenta del siglo XX. El caso argentino es emblemático, antes del 40 todos los filósofos, no había tantos, eran intelectuales públicos y es a partir de esos años que son incorporados a sueldo mensual en las plantillas universitarias. Esto produce un enriquecimiento de la Universidad que luce con las mejores ropas de toda su historia durante 15 años hasta que en 1955 es intervenida por el poder político de turno. Las consecuencias fueron nefastas pues la Universidad se encerró en sí misma y ya no produjo filósofos[2] sino, a lo sumo, buenos investigadores.
En estos últimos veinte años ha aparecido una variante del intelectual público, la del “yeite o curro filosófico”, para decirlo en lunfardo. La de aquellos profesores de filosofía que le han buscado la vuelta a tan noble disciplina para ganar dinero con ella. Así aparecieron los filósofos terapeutas como Lou Marinoff (Más Platón y menos Prozac), los filósofos de la vida que dictan seminarios en su casa, los filósofos mundanos como nuestro Sebrelli que dicta seminarios de verano en las playas de Punta del Este, los filósofos críticos de la sociedad que dictan sus clases en algún organismo internacional bien pagos, los filósofos que dictan ética empresaria, a empresarios ricos con empleados pobres, etc., etc.
La figura del intelectual público no es ni la de un académico erudito ni la de un experto “chanta o farabute” como los que acabamos de mencionar. Él posee una cultura general y se interesa en poner ideas nuevas o viejas, pero siempre diferentes en debate. Deja de lado las interpretaciones especializadas que los académicos discuten entre pares y busca o intenta la interpretación sencilla y general. Es que él, como buen filósofo, es un maestro en generalidades. Piensa a partir del disenso frente a lo políticamente correcto y al pensamiento único. Es no conformista y rechaza la especialización siempre vinculada a una pequeña elite. Es que la universidad moderna ha legitimado un saber de eruditos y ha terminado minando la cultura intelectual común de los pueblos. Su saber no es un saber ilustrado, un saber sólo de libros, sino que intenta un saber sobre las cosas que son y suceden en la vida pública, que no es otra cosa, reiteramos, que la vida de los pueblos.
El filósofo como intelectual público pierde mucho tiempo de su vida hablando con unos y con otros, en reuniones infinitas y en conferencias multitudinarias en donde no se sabe bien qué es lo que llega a entender el receptor. De ahí su exigencia de claridad expositiva. Se le va gran parte de su vida tratando de construir una opinión distinta a la dada en o sobre personajes que puede llegar a tener alguna ingerencia política o social. Trabaja sobre “lo que es” pero con vistas “al deber ser”, pues para él, el ser es lo que es más lo que puede ser. Ningún profesor de filosofía de los miles de cagatintas que existen puede llegar a pensar así, pues sólo recitará al respecto las lecciones de Aristóteles o Heidegger.
Hace unos años apareció un libro de Richard Posner Intelectual público, un estudio de su decadencia [3] en donde sostiene que “el intelectual público es un no especialista y eso mismo era, tradicionalmente, el filósofo” [4], y a reglón seguido nombra todos “paisanos” como él (¡qué vocación de autobombo que tienen!) Nussbaum, Habermas, Dworkin, Nagel, Singer, Putman, etc., cuando en realidad son otros los genuinos intelectuales públicos en el mundo: los Franco Cardini, Massimo Cacciari, Marco Tarchi, Pietro Barcelona, Giacomo Marramao, Marcello Veneziani, Gustavo Bueno, Fernández de la Mora, Aquilino Duque, Sánchez Dragó, Javier Ruiz Portella, Javier Esparza, Claude Rousseau, Alain de Benoist, Julián Freund, Michel Maffesoli, Jean Cau, Tomislav Sunic, Günter Maschke, Ernst Nolte, Alexander Dugin et alli. Y aquí en nuestro medio se destacan Silvio Maresca, Máximo Chaparro, Luís María Bandieri, Jorge Bolivar, Alberto Caturelli, Oscar del Barco, González Arzac y tantos otros.
Tenemos también nosotros, hoy como moda, otros intelectuales mucho más promocionados y publicitados por los mass media como Feimann, Forster, Aguinis, Kovaldoff, T. Abraham, Rotzitchner, pero no pueden ser considerados “intelectuales públicos” porque son intelectuales orgánicos del gobierno de turno o del régimen político. O peor aún están al servido del lobby explotador del pobrerío más poderoso de Argentina.
Es que el intelectual público tiene como método el disenso sobre el orden constituido que siempre le parece un poco injusto. La premisa que guía su pensamiento es aquella de Platón: “la filosofía es ruptura con la opinión”, y sobre todo con la “opinión publicada”. Y este el es criterio para juzgar adecuadamente a un intelectual público.
Es apropiado distinguir que lo público está constituido por el ámbito de interés compartido de las fuerzas de una sociedad. Cuando a partir de los años 80 se limitó lo público al espacio se le castró su sentido, su finalidad y al ser reducido solo a espacio (el gravísimo error de Habermas) pasó a ser entendido como de nadie y por lo tanto lo puedo tomar. Claro está, esto no pasa en Alemania que son todos ilustrados, pero sucede a diario en todo el mundo bolita que es el nuestro.
Lo público debe de ser pensado como función (vgr.: la empresa pública, la tierra pública, la televisión pública) no puede ni debe quedar reducido a espacio público donde la práctica deliberativa de la democracia discursiva (sic Habermas) tiene lugar. El espacio público como lugar de la asamblea. Esto es una estupidez, un engaña pichanga, un gatopardismo para que todo siga igual[5].
De modo que el intelectual público no es un simple discutidor, un charlatán, un hablador por hablar sino que antes que nada y sobre todo tiene que tener en cuenta la función o finalidad de lo público y de aquellas cosas que se presentan como problemas públicos-políticos.
De modo tal que si juntamos ruptura con la opinión publicada, práctica del disenso y producción de sentido obtendremos un genuino intelectual público
(*) alberto.buela@gmail.com – Univ.Tec. Nac. (UTN)
[1] Owe Wikstrom: Elogio de la lentitud, Ed. Norma, Bs.As. 2005
[2] Nunca más filósofos de la talla de un Luís Juan Guerrero, Saúl Taborda, Nimio de Anquín, Miguel Ángel Virasoro, Alberto Rougés. Una de las grandes mentiras es que la decadencia de la universidad de Buenos Aires se produjo en 1966 durante el gobierno de Onganía. Eso es lo que nos ha hecho creer el pensamiento políticamente correcto de los marxistas, los liberales, los democristianos y los progresistas, el golpe de gracia a la Universidad se lo dio la intervención de la revolución “entregadora” de 1955.
[3] Postner, Richard: Public intellectuals. A study of decline, Cambridge, Harvard University Pres, 2001
[4] Ibídem, p. 323
[5] Cfr. Nuestro artículo en Internet
Algo sobre lo público
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, argentine, amérique latine, amérique ibérique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 30 août 2010
L'ennui et la condition humaine
L’ennui et la condition humaine
par Pierre LE VIGAN
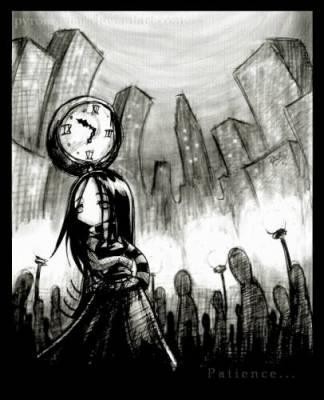 Le Magazine littéraire consacrait jadis un dossier à l’ennui (n° 400, juillet – août 2001) sous le titre : « Éloge de l’ennui. Un mal nécessaire ». En d’autres termes, il s’agissait d’une interrogation sur la positivité de l’ennui au travers une enquête sur l’ennui au travers le travail de divers écrivains, notamment Flaubert, Proust, Pascal, Beckett, Moravia, Cioran.
Le Magazine littéraire consacrait jadis un dossier à l’ennui (n° 400, juillet – août 2001) sous le titre : « Éloge de l’ennui. Un mal nécessaire ». En d’autres termes, il s’agissait d’une interrogation sur la positivité de l’ennui au travers une enquête sur l’ennui au travers le travail de divers écrivains, notamment Flaubert, Proust, Pascal, Beckett, Moravia, Cioran.
Le point de départ littéraire de la question se justifie. Montaigne relève que l’écriture est un remède contre l’angoisse de lire. La lecture est en effet inséparable de l’ennui. Plus précisément, elle se pratique sur fond de vacuité : sur ce fond sans fond que Flaubert appelle « marinade ». Mais de quel ennui est-il question ? C’est selon. C’est pourquoi une généalogie de la notion est ici nécessaire.
Sénèque distingue l’ennui du chagrin. Ce dernier a généralement des causes précises, comme la douleur. L’ennui est plus vague et plus insidieux. Dans les Lettres à Lucilius, Sénèque voit bien que l’ennui peut aller avec l’agitation, et donc peut être une « activité oisive » : un divertissement impuissant à guérir de l’ennui. Comme remède à l’ennui, Sénèque propose l’activité qui remplit la vie, mais une activité sans se projeter dans l’avenir, une activité d’ici et pour maintenant. Parmi ces activités peut se situer l’écriture, non pas comme divertissement, non plus comme recherche esthétique (une création qui ne serait pas tout à fait une activité), mais comme art de s’appliquer dans l’effectuation des choses. Comme art, aussi, de gérer son emploi du temps. Car l’ennui, comme état de « plein repos » (Pascal), est le fond de la condition de l’homme. Quand l’homme est en repos, il repose sur quoi ? Sur rien. D’où la nécessité de se détourner du repos – d’un repos comme gouffre, d’un repos sans fatigue qui n’est alors qu’une chute. Corollaire inquiétant : si l’homme ne doit jamais être en repos, ne doit-il jamais faire retour sur soi ? L’état de réflexion serait en lui-même source d’angoisse, de rupture de l’élan vital, d’acédie et d’ennui. C’est contre cette conception pessimiste – la lucidité inséparable de la dépression – que s’élève le janséniste Nicole. « L’ennui, soutient Nicole, touche l’âme quand elle est privée de cet aliment indispensable que sont pour elle les pensées » (Laurent Thirouin).
Pascal, de son côté, ne considère pas que les divertissements suppriment les côtés positifs de l’ennui que sont le sentiment de la gravité des choses et de la fragilité de notre être dans le monde. La légèreté du divertissement n’est pas une faute : elle protège, et c’est tant mieux, contre l’excès d’angoisse. C’est au fond une forme de lucidité que de rechercher le divertissement. Il faut savoir « être superficiel par profondeur », comme Nietzsche le disait des Grecs. En d’autres termes, pour Pascal, c’est parce que l’ennui a sa place, mais ne doit avoir rien que sa place, que le divertissement a aussi sa place. Même si le seul vrai divertissement positif, c’est-à-dire le seul remède authentique à l’ennui, devrait venir de l’intérieur, et être la recherche constante du chemin qui mène à Dieu.
Dans la grande réhabilitation d’une nature humaine sans Dieu qu’opèrent les philosophes des Lumières, l’ennui comme péril devient le moteur de la recherche du beau, mais aussi bien du terrifiant que du « sublime » (Burke). Face à l’ennui d’un bonheur possible mais qui n’est jamais gai, l’effusion religieuse, ou amoureuse, ou les deux à la fois, apparaît une voie naturelle. Comme les Anciens, les philosophes des Lumières redécouvrent que la vie ne peut qu’osciller entre une léthargie qui n’est pas sérénité, et une inquiétude qui pousse, au mieux, à l’action pour l’action, au pire à l’agitation. « Vous me mandez que vous vous ennuyez, et moi je vous réponds que j’enrage. Voilà les deux pivots de la vie, de l’insipidité ou du vide », écrit Voltaire. « Ou l’on baille ou l’on est ivre », résume de son côté Diderot. L’équilibre est ainsi difficile « entre la léthargie et la convulsion » (Sénac de Meilhan).
Le romantisme fait une grande place à l’ennui : « ennui d’exister » chez Senancour, désabusement chez Mme de Staël, « analyse perpétuelle » incapacitante chez Benjamin Constant. De son côté, Chateaubriand donne de l’ennui une interprétation particulière en écrivant : « On habite avec un cœur plein un monde vide; et sans avoir joui de rien, on est désabusé de tout ». L’ennui peut ainsi se nourrir du sentiment de n’être pas né pour le monde tel qu’il est : pas né pour le monde de la Révolution française (Adolphe de Custine), pas né non plus pour le monde de la Restauration et de la France post-napoléonienne et post-héroïque (Julien Sorel).
Au-delà de l’esprit du temps, ou du désaccord avec l’esprit du temps, l’ennui, comme le voit bien Stendhal, est une disposition psychologique, un sentiment profond d’incomplétude, d’impossibilité de saisir et de se saisir. « Notre plus grand ennemi est le temps » explique de son coté Alfred de Vigny. Et c’est de l’usure du temps, de l’usure par le temps qu’il s’agit dans le romantisme. De fait, quand le temps ne permet pas une mise en tension du présent, ce dernier s’étire à l’infini, dans une durée torpide et Pise. Mais une durée qu’un souffle suffit à soulever. « L’ennui du constamment nouveau, l’ennui de découvrir sous la différence des choses et des idées, la permanente identité de tout, […] l’éternelle concordance de la vie avec elle-même, la stagnation de tout ce que je vis, au premier mouvement tout s’efface » (F. Pessoa, Le livre de l’intranquillité, Christian Bourgois Éditions, 1988). L’action sauve de l’ennui, d’où la supériorité de l’écriture sur la lecture.
Cet ennui qui est presque une figure du mal, voire du péché se trouve telle une « torture morale » (Pierre-Marc de Biasi) chez Baudelaire. L’introspection amène l’homme à se voir lui-même comme « une oasis d’horreur dans un désert d’ennui ». Cet ennui écœuré est tout différent de la sensibilité atmosphérique de Gustave Flaubert. Car c’est la question de l’identité, vue d’une façon très moderne, qui est au cœur non pas de l’ennui flaubertien mais bien plutôt de la mélancolie flaubertienne c’est-à-dire de son extrême et douloureuse attention aux questions du sens. « Quelque chose d’indéfini vous sépare de votre propre personne et vous rive au non – être », écrit-il. Ce « quelque chose d’indéfini », c’est l’énigme de l’« ennui profond » (Heidegger), c’est cette profondeur sans fond qui est l’exister lui-même. L’ennui, ainsi, n’est pas le contraire de la jouissance. Il en est la mesure même. C’est parce que l’ennui menace toujours que la jouissance est possible et qu’elle est nécessaire. Car l’ennui est moins ce qui est que ce qui éloigne de ce qui est. Il est une fatigue comme prédisposition de l’être. Il est ce qui « suscite le désir de rien » (Jean Roudaut). Mais le désir de rien est encore un désir; c’est l’ennui des bouddhistes : un vide qui manifeste le plein. Un vide qui est volupté.
Tout autre est l’ennui qui vient de la révélation que « tout est déjà fini », que l’adhésion aux choses est précisément la chose la plus difficile du monde. C’est l’ennui de Cioran, l’ennui occidental, ennui d’une civilisation du sujet, et à ce titre un ennui fécond, un ennui qui pousse à l’écriture, comme l’écrit encore Jean Roudaut à propos de Samuel Beckett : « Écrire du coup est bien plus que faire l’exercice intellectuel de la mort, au sens où Montaigne prenait le verbe philosopher. C’est l’habiter ». Telle est l’ambivalence de l’ennui, entre la mélancolie qui ouvre à l’homme un site (il y a une jubilation du spleen), et l’acédie qui est l’expérience extrême de la non-prise, de la déprise sur les choses et sur soi. La modernité aimerait bien nous débarrasser de l’ennui. Mais nous n’avons pas fini de nous ennuyer, c’est-à-dire d’éprouver notre condition humaine.
Pierre Le Vigan
Article printed from Europe Maxima: http://www.europemaxima.com
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, problèmes contemporains, ennui, condiiton humaine, anthropologie, psychologie, psychiatrie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 29 août 2010
Henry Williamson: Nature's Visionary
Henry Williamson: Nature’s Visionary
 The fact that the name of Henry Williamson is today so little known across the White world is a sad reflection of the extent to which Western man has allowed himself to be deprived of his culture and identity over the last 50 years. Until the Second World War Williamson was generally regarded as one of the great English Nature writers, possessing a unique ability to capture the essential essence and meaning of the natural world in all its variety and forms.
The fact that the name of Henry Williamson is today so little known across the White world is a sad reflection of the extent to which Western man has allowed himself to be deprived of his culture and identity over the last 50 years. Until the Second World War Williamson was generally regarded as one of the great English Nature writers, possessing a unique ability to capture the essential essence and meaning of the natural world in all its variety and forms.
His most famous Nature book, Tarka the Otter, was published in 1927 and became one of the best-loved children’s books of all time, with its vivid descriptions of animal and woodland life in the English countryside. It was publicly praised by leading English literary figures such as Thomas Hardy, Arnold Bennett, and John Galsworthy. Hardy called Tarka a “remarkable book,” while Bennett declared it to be “marvelous.” Even T. E. Lawrence, also known as Lawrence of Arabia, admitted that “the book did move me and gratify me profoundly.”
Tarka was awarded the coveted Hawthornden Prize for literature in 1928 and eventually attracted the interest of Walt Disney, who offered a small fortune for the film rights. Williamson, however, was concerned that such an arrangement might compromise his artistic integrity, and he rejected the offer.
Seventy years later, however, Tarka, like the majority of Williamson’s books, is relatively unknown and has only just become available in print again. The reason: Like several other leading European authors, Williamson was a victim of the Second World War. Not only did his naturalistic message conflict with the materialistic culture that has pervaded the Western world since 1945, but he himself was a political fighter who actively opposed the war on ideological grounds.
Born in Brockley, southeast London, in December 1895, Williamson was educated at Colfe’s Grammar School, Lewisham. He spent much of his early life exploring the nearby Kent countryside, where his love of Nature and animals and his artistic awareness and sensitivity were first stimulated. Never satisfied unless he had seen things for himself, he always made sure that he studied things closely enough to get the letter as well as the spirit of reality. This enabled him to develop a microscopic observational ability which came to dominate his life.
Williamson joined the British Army at the outbreak of war in 1914 and fought at the Battle of the Somme and at Passchendaele, where he was seriously wounded. It was this experience as a frontline soldier which was the redefining moment in his life and artistic development, stimulating in him a lifelong Faustian striving to experience and comprehend the “life flow” permeating his own, and all, existence.
His spiritual development continued after the war. In 1919 he read for the first time the visionary The Story of My Heart, which was written by the English Nature writer Richard Jefferies and published in 1893. For Williamson, discovering Jefferies acted as a liberation of his consciousness, stimulating all the stored impressions of his life to return and reveal a previously smothered and overlaid self. It was not just an individual self that he discovered, however, but a racial self in which he began to recognize his existence as but a link in an eternal chain that reached back into the mists of time, and which — if it were permitted — would carry on forever.
Williamson sensed this truth in his own feeling of oneness with Nature and the ancient, living, breathing Universe as represented by the life-giving sun. It also was reflected in his idea of mystical union between the eternal sunlight and the long history of the earth. For Williamson the ancient light of the sun was something “born in me” and represented the real meaning of his own existence by illuminating his ancestral past and revealing the truth of redemption through Nature. Like Jefferies before him, Williamson “came to feel the long life of the earth back in the dimmest past while the sun of the moment was warm on me … This sunlight linked me through the ages to that past consciousness. From all the ages my soul desired to take that soul-life which had flowed through them as the sunbeams had continually found an earth.” [1]
After the war Williamson became a journalist for a time while beginning work on his first novel, The Beautiful Years (1922). Finally he decided to break all contact with London and in 1922 moved to an ancient cottage in Georgham, North Devon, which had been built in the days of King John. Living alone and in hermit fashion at first, Williamson disciplined himself to study Nature with the same meticulous observations as Jefferies, tramping about the countryside and often sleeping out. The door and windows of the cottage were never closed, and his strange family of dogs and cats, gulls, buzzards, magpies, and one otter cub were free to come and go as they chose.
 It was his experiences with the otter cub which stimulated Williamson to write Tarka. He had rescued it after its mother had been shot by a farmer, and he saved its life by persuading his cat to suckle it along with her kitten. Eventually the otter cub was domesticated and became Williamson’s constant companion, following him around like a dog. On one walk, however, it walked into a rabbit trap, panicked, and ran off. Williamson spent years following otters’ haunts in the rivers Taw and Torridge, hunting for his lost pet.
It was his experiences with the otter cub which stimulated Williamson to write Tarka. He had rescued it after its mother had been shot by a farmer, and he saved its life by persuading his cat to suckle it along with her kitten. Eventually the otter cub was domesticated and became Williamson’s constant companion, following him around like a dog. On one walk, however, it walked into a rabbit trap, panicked, and ran off. Williamson spent years following otters’ haunts in the rivers Taw and Torridge, hunting for his lost pet.
The search was in vain, but his intimate contact with the animal world gave him the inspiration for Tarka: “The eldest and biggest of the litter was a dog cub, and when he drew his first breath he was less than five inches long from his nose to where his tail joined his back-bone. His fur was soft and grey as the buds of the willow before they open up at Eastertide. He was called Tarka, which was the name given to the otters many years ago by men dwelling in hut circles on the moor. It means Little Water Wanderer, or Wandering as Water.”
Williamson never attempted to pass any kind of moral judgment on Nature and described its evolutionary realities in a manner reminiscent of Jack London:
Long ago, when moose roamed in the forest at the mountain of the Two Rivers, otters had followed eels migrating from ponds and swamps to the seas. They had followed them into shallow waters; and one fierce old dog had run through the water so often that he swam, and later, in his great hunger, had put under his head to seize them so often that he dived. Other otters had imitated him. The moose are gone, and their bones lie under the sand in the soft coal which was the forest by the estuary, thousands of years ago. Yet otters have not been hunters in water long enough for the habit to become an instinct.
Williamson actually rewrote Tarka 17 times, “always and only for the sake of a greater truth.” [2] Mere polishing for grace and expression or literary style did not interest him, and he strove always to illuminate a scene or incident with what he considered was authentic sunlight.
He also believed that European man could be spiritually healthy and alive to his destiny only by living in close accord with Nature. Near the end of Tarka, for instance, he delightfully describes how “a scarlet dragonfly whirred and darted over the willow snag, watched by a girl sitting on the bank … Glancing round, she realized that she alone had seen the otter. She flushed, and hid her grey eyes with her lashes. Since childhood she had walked the Devon rivers with her father looking for flowers and the nests of birds, passing some rocks and trees as old friends, seeing a Spirit everywhere, gentle in thought to all her eyes beheld.”
Williamson’s sequel to Tarka was Salar the Salmon, which was also the result of many months of intimate research and observation of Nature in the English countryside. Then came The Lone Swallow, The Peregrine’s Saga, Life in a Devon Village, and A Clear Water Stream, all of which, in the eyes of the English writer Naomi Lewis, displayed “a crystal intensity of observation and a compelling use of words, which exactly match the movement and life that he describes.”
To Williamson himself, however, his Nature stories were not the most important part of his literary output. His greatest effort went into his two semi-autobiographical novel groups, the tetralogy collected as The Flax of Dreams, which occupied him for most of the 1920s, and the 15-volume A Chronicle of Ancient Sunlight, which began with The Dark Lantern in 1951 and ended with The Gale of the World in 1969.
Williamson’s experiences during the First World War had politicized him for life. A significant catalyst in this development was the Christmas truce of 1914, when British and German frontline soldiers spontaneously left their trenches, abandoned the fighting, and openly greeted each other as brothers.
Williamson later spoke of an “incoherent sudden realization, after the fraternization of Christmas Day, that the whole war was based on lies.” Another experience that consolidated this belief was when a German officer helped him remove a wounded British soldier who was draped over barbed wire on the front line. He was thus able to contrast his own wartime experiences with the vicious anti-German propaganda orchestrated by the British political establishment both during and after the war, and he was able to recognize the increasing moral bankruptcy of that establishment. In Williamson’s view the fact that over half of the 338 Conservative Members of Parliament who dominated the 1918 governing coalition were company directors and financiers who had grown rich from war profits was morally wrong and detestable.
This recognition, in itself a reflection of an already highly developed sense of altruism, meant that Williamson could never be content with just isolating himself in the countryside. He had to act to try to change the world for the better. Perhaps not surprisingly he came to see in the idea of National Socialism a creed which not only represented his own philosophy of life, but which offered the chance of practical salvation for Western Civilization. He saw it as evolving directly from the almost religious transcendence which he, and thousands of soldiers of both sides, had experienced in the trenches of the First World War. This transcendence resulted in a determination that the “White Giants” of Britain and Germany would never go to war against each other again, and it rekindled a sense of racial kinship and unity of the Nordic peoples over and above separate class and national loyalties. [3]
Consequently, not only was Williamson one of the first of the “phoenix generation” to swear allegiance to Oswald Mosley and the British Union of Fascists, but he quickly came to believe that National Socialist Germany, under the leadership of Adolf Hitler, pointed the way forward for European man. Williamson identified closely with Hitler — “the great man across the Rhine whose life symbol is the happy child,” seeing him as a light-bringing phoenix risen from the chaos of European civilization in order to bring a millennium of youth to the dying Western world. [4]
Williamson visited Germany in 1935 to attend the National Socialist Congress at Nuremberg and saw there the beginnings of the “land fit for heroes” which had been falsely promised the young men of Britain during the First World War by the government’s war propagandists. He was very impressed by the fact that, while the British people continued to languish in poverty and mass unemployment, National Socialism had created work for seven million unemployed, abolished begging, freed the farmers from the mortgages which had strangled production, developed laws on conservation, and, most importantly, had developed in a short period of time a deep sense of racial community. [5]
Inspired to base their lives on a religious idea, Williamson believed that the German people had been reborn with a spiritual awareness and physical quality that he himself had long sought. Everywhere he saw “faces that looked to be breathing extra oxygen; people free from mental fear.” [6]
Through the Hitler Youth movement, which brought back fond memories of his own time as a Boy Scout, he recognized “the former pallid leer of hopeless slum youth transformed into the suntan, the clear eye, the broad and easy rhythm of the poised young human being.”
In Hitler’s movement Williamson identified not only an idea consistent with Nature’s higher purpose to create order out of chaos, but the physical encapsulation of a striving toward Godhood. Influenced by his own lifelong striving for perfection, Williamson believed that the National Socialists represented “a race that moves on the poles of mystic, sensual delight. Every gesture is a gesture from the blood, every expression a symbolic utterance … Everything is of the blood, of the senses.” [7]
Williamson always believed that any spiritual improvement could only take place as a result of a physical improvement, and, like his mentor Richard Jefferies, he was a firm advocate of race improvement through eugenics. He himself was eventually to father seven children, and he decried the increasing lack of racial quality in the mass of the White population. He urged that “the physical ideal must be kept steadily in view” and called for the enforcement of a discipline and system along the lines of ancient Sparta in order to realize it. [8]
In 1936 Williamson and his family moved to Norfolk, where he threw himself into a new life as a farmer, the first three years of which are described in The Story of a Norfolk Farm (1941). But with the Jews increasingly using England as a base from which to agitate for war against Germany, Williamson remained very active through his membership in the British Union of Fascists in promoting the idea of Anglo-German friendship. Until it was banned in 1940, Williamson wrote eight articles for the party newspaper Action and had 13 extracts reprinted from his book The Patriot’s Progress. He called consistently for Hitler to be given “that amity he so deserved from England,” so as to prevent another brothers’ war that would see the victory only of Asiatic Bolshevism and the enslavement of Europe. On September 24, 1939, for instance, he wrote of his continuing conviction that Hitler was “determined to do and create what is right. He is fighting evil. He is fighting for the future.”
Williamson viewed the declaration of war on Germany by Britain and France as a spiteful act of an alien system that was determined to destroy the prospect of a reborn and regenerated European youth. And his continued opposition to it led to his arrest and internment in June 1940, along with Mosley and hundreds of others. His subsequent release on parole was conditional upon his taking no further action to oppose the war. Silently, however, Williamson remained true to his convictions. Visiting London in January 1944, he observed with satisfaction that the ugliness and immorality represented by its financial and banking sector had been “relieved a little by a catharsis of high explosive” and somewhat “purified by fire.”
National Socialism’s wartime defeat, however, dealt Williamson a heavy blow. Decrying the death struggle of “the European cousin nations” he lamented that “the hopes that have animated or agitated my living during the past thirty years and four months are dead.” [9]
Consequently, his first marriage broke up in 1947, and he returned to North Devon to live in the hilltop hut which he had bought in 1928 with the prize money from Tarka.
But it was not in Williamson’s character to give up on what he knew to be true and right, and, as his most recent biographer makes clear, he never recanted his ideas about Hitler. [10]
On the contrary, he continued to publicly espouse what he believed, and he fervently contested the postwar historical record distorted by false Jewish propaganda — even though his effort resulted, as he realized it would, in his continued literary ostracism.
In The Gale of the World, the last book of his Chronicle, published in 1969, Williamson has his main character Phillip Maddison question the moral and legal validity of the Nuremberg Trials. Among other things, he muses why the Allied officers who ordered the mass fire bombing of Germany, and the Soviet generals who ordered the mass rape and mass murder during the battle for Berlin, were not on trial; and whether it would ever be learned that the art treasures found in German salt mines were put there purely to be out of the way of the Allied bombing. He also questions the official view of the so called “Holocaust,” stating his belief that rather than being the result of a mass extermination plan, the deaths in German concentration camps were actually caused by typhus brought about by the destruction of all public utility systems by Allied bombing.
In the book Williamson also reiterates his belief that Adolf Hitler was never the real enemy of Britain. And in one scene Phillip Maddison, in conversation with his girl friend Laura, questions whether it was Hitler’s essential goodness and righteousness that was responsible for his downfall in the midst of evil and barbarity:
Laura: I have a photograph of Hitler with the last of his faithful boys outside the bunker in Berlin. He looks worn out, but he is so gentle and kind to those twelve- and thirteen-year-old boys.
Phillip: Too gentle and kind Laura … Now the faithful will be hanged.
Williamson also remained loyal in the realm of political ideas and action. When Oswald Mosley had returned to public life in Britain in 1948 by launching the Union Movement, Williamson was one of the first to give his support for an idea which he had long espoused: the unity of Western man. Contributing an article to the first issue of the movement’s magazine, The European, he called for the development of a new type of European man with a set of spiritual values that were in tune with himself and Nature.
Such positive and life-promoting thinking did not endear Williamson to the powers that be in the gray and increasingly decadent cultural climate of post-Second World War Britain. His books were ignored, and his artistic achievement remained unrecognized, with even the degrees committee at the university to which he was a benefactor twice vetoing a proposal to award him an honorary doctorate. The evidence suggests, in fact, that Williamson was subject to a prolonged campaign of literary ostracism by people inside the British establishment who believed he should be punished for his political opinions.
For Williamson, however, the machinations of trivial people in a trivial age were irrelevant; what was important was that he remained true in the eyes of posterity to himself, his ancestors, and the eternal truth which he recognized and lived by. In fact, as one observer described him during these later years, he remained a “lean, vibrant, almost quivering man with … blazing eyes, possessing an exceptional presence [and a] … continued outspoken admiration for Hitler … as a ‘great and good man.’” [11]
Certainly, Williamson knew himself, and he knew what was necessary for Western man to find himself again and to fulfill his destiny. In The Gale of the World he cited Richard Jefferies to emphasize that higher knowledge by which he led his life and by which he was convinced future generations would have to lead their lives in order to attain the heights that Nature demanded of them: “All the experience of the greatest city in the world could not withhold me. I rejected it wholly. I stood bare-headed in the sun, in the presence of earth and air, in the presence of the immense forces of the Universe. I demand that which will make me more perfect now this hour.”
Henry Williamson’s artistic legacy must endure because, as one admirer pondered in his final years, his visionary spirit and striving “came close to holding the key to life itself.”
He died on August 13, 1977, aged 81.
Notes
[1] Ann Williamson, Henry Williamson: Tarka and the Last Romantic, (London, 1995), 65.
[2] Eleanor Graham, “Introduction” to the Penguin edition of Tarka the Otter (1985).
[3] Higginbottom, Intellectuals and British Fascism , (London, 1992), 10.
[4] Henry Williamson, The Flax of Dreams (London, 1936) and The Phoenix Generation (London, 1961).
[5] Henry Williamson, A Solitary War (London, 1966).
[6] Higginbotham, op. cit., 41-42.
[7] J. W. Blench, Henry Williamson and the Romantic Appeal of Fascism , (Durham, 1988).
[8] Henry Williamson, The Children of Shallow Ford, (London, 1939).
[9] Higginbotham, op. cit., 49.
[10] Ann Williamson, op. cit., 195.
[11] Higginbotham, op. cit., 53.
National Vanguard, 117 (1997), 17-20.
00:09 Publié dans Ecologie, Littérature, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres anglaises, littérature anglaise, écologie, nature, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 28 août 2010
Reflections on the Aesthetic & Literary Figure of the Dandy
Reflections on the Aesthetic & Literary Figure of the Dandy
Translated by Greg Johnson
Before getting to the quick of the subject, I would like to make three preliminary remarks:
I hesitated to accept your invitation to speak on the figure of the dandy, for this sort of issue is not my main subject of interest.
I finally accepted because I rediscovered a magisterial and lucid essay by Otto Mann, published many years ago in Germany: “Dandyism as Conservative Lifestyle” (“Dandysmus als konservative Lebensform”). This essay deserves to be republished, with commentaries.
My third remark is methodological and definitional. Before speaking of the “dandy,” and relating the subject to the excellent work of Otto Mann, I must set forth the different definitions of the “dandy.” These definitions are for the most part erroneous, or superficial and insufficient.
Some define the dandy as “a pure phenomenon of fashion,” as an elegant personage, nothing more, concerned only to dress himself in the latest style. Others define him as a superficial personage who loves the good life and wanders idly from cabaret to cabaret. Françoise Dolto has painted a psychological portrait of the dandy. Still others emphasize almost exclusively the homosexual dimension of certain dandies like Oscar Wilde. Less commonly, the dandy is assimilated to a sort of avatar of Don Juan, who filled his emptiness by racking up female conquests. These definitions are not those of Otto Mann, which I have adopted.
The Archetype: George Bryan Brummell
Following Otto Mann, I hold that the dandy has a far deeper cultural significance than superficial Epicureans, hedonists, homosexuals, Don Juans, and fashion victims. For Otto Mann, the model, the archetype of the dandy remains George Bryan Brummell, a figure of the early 19th century, which he opposed.
Brummell, contrary to certain later pseudo-dandies, was a discrete man, who did not seek to draw attention to himself by vestimentary or behavioral eccentricities. Brummell avoided loud colors, did not wear jewels, was not devoted to purely artificial social games. Brummell was distant, serious, dignified; he did not try to make an impression, as did later figures as varied as Oscar Wilde, Stefan George, or Henry de Montherlant. For him, spiritual tendencies predominate. Brummell engaged society, conversed, told stories, using irony and even mockery. To speak like Nietzsche or Heidegger, we could say that he rose above the “human, too human” or quotidian banality (Alltäglichkeit).
Brummell, a first generation dandy, incarnates a cultural form, a way of being, that our contemporary society should accept as valid, indeed as solely valid, but that it can no longer generate, or generate sufficiently. Which is why the dandy opposes our society. The principal reasons that underlie his opposition are the following: (1) society appears as superficial and marked with inadequacies and insufficiencies; (2) the dandy, as a cultural form, as the incarnation of a manner of being, poses as superior to this inadequate and mediocre society; (3) the Brummellian dandy does nothing exaggerated or scandalous (sexually, for example), does not commit crimes, does not have political commitments (contrary to the dandies of the second generation like Lord Byron). Brummell himself could not maintain this attitude to the end of his days, because he was crippled by debts and died in poverty in a hospice in Caen. At a certain point, he had turned his back on the fragile equilibrium required by the initial posture of the dandy, of which he was the first incarnation.
An Ideal of Culture, Balance, & Excellence
If the dandy’s behavior and way of being contain no exaggeration, no flamboyant originality, then why does he appear important, or merely interesting, to us at all? Because he incarnates an ideal, which is to some extent, mutatis-mutandis, the same as Greek paiedeia or Roman humanitas. In Evola and Jünger, there is nostalgia for Latin magnanimitas, for the hochmuote of the Germanic knights of the 12th and 13th centuries, Roman or medieval avatars of a Persian proto-historical model, first advanced by Gobineau then by Henry Corbin. The dandy is the incarnation of this ideal of culture, balance, and excellence during one of the most trivial periods in history, where the crude, calculating bourgeois and the rowdy militant of the Hébertist or Jacobin sort took the place of the aristocrat, the knight, the monk, and the peasant.
At the end of the 18th century, with the French Revolution, these virtues, rising from the oldest proto-historical depths of European humanity, were completely called into question. First by the ideology of the Enlightenment and its corrolary, militant egalitarianism, which would erase all the visible and invisible traces of this ideal of excellence. Then, by the Sturm und Drang and Romanticism, which, by way of reaction, sometimes tilted toward ineffectual sentimentalism, which is also an expression of disequilibrium. The immemorial models, sometimes blurred and diffuse, the surviving archetypal attitudes . . . disappear.
The English first became aware of it, at the end of the 17th century, even before the upheavals of the 18th: Addison and Steele in the columns of the Spectator and the Tatler noted the urgent necessity of preserving and maintaining a system of education, a general culture able to guarantee the autonomy of man. A value that the current media do not promote, quiet proof that we have indeed fallen into an Orwellien world, which dons the mask of the “good democratic apostle,” inoffensive and “tolerant,” but pitilessly hounds down all residues of autonomy in the world today. In their successive articles, Addison and Steele bequeathed us an implicit vision of the cultural and intellectual history of Europe.
The highest cultural ideal Europe has ever known is of course ancient Greek paideia. It had been reduced to naught by primitive Christianity, but, from the 14th century on, one sees throughout Europe a desire for ancient ideals to be reborn. The dandy, and, long before his emergence on the European cultural scene, the two English journalists Steele and Addison, wished to incarnate this nostalgia for paideia, in which the autonomy of each individual is respected. In fact, they try to concretely realize in society Goethe’s objective: to incite their contemporaries to forge and fashion a personality, which will be moderate in its needs, satisfied with little, but above all capable, through this quiet asceticism, of reaching the universal, of being a model for all, without betraying its original humanity (Ausbildung seiner selbst zur universalen und selbstgenugsamen Persönlichkeit).
This Goethean ideal, shared avant la lettre by the two English publicists then incarnated by Brummell, was not unscathed by the vicissitudes of the French Revolution, the industrial revolution, and the assorted scientific revolutions. Under the blows of modernity’s contempt for the Ancient, Europe found itself devoid of any substantial culture, any ethical backbone. The consequences are fully apparent today in the decline of education.
From 1789 throughout the 19th century, the cultural level steadily collapsed. Cultural decline started at the top of the social pyramid, henceforth occupied by the triumphant bourgeoisie which, contrary to the dominant classes of former times, has no moral (sittlich) base capable of maintaining a high level of civilization; it has no religious base, nor any real professional ethic, unlike the craftsmen and tradesmen once supervised by their guilds or corporations (Zünfte). The sole aim of the bourgeoisie is the contemptible accumulation of cash, which allows us to speak, following René Guénon, of a “reign of quantity” in which all quality is banished.
In the disadvantaged classes at the bottom of the social ladder, any element of culture is eradicated quite simply because the pseudo-elites no longer uphold a cultural standard; the people, alienated, insecure, proletarianized, are no longer a matrix of specific enthnically determined values, much less a matrix capable of generating an active counter-culture that could easily nullify what Thomas Carlyle called the “cash-flow mentality.” In short, we are witnessing the rise of an affluent barbarism (eine ökonomisch gehobene Barbarei), economically advanced and culturally void.
One cannot be rich in the bourgeois style and also refined and intelligent. This is obviously true: nobody cultivated wants to find himself at dinner, or in conversation, with billionaires like Bill Gates or Albert Frère, nor with bankers or manufacturers of automobiles or refrigerators. The true man of culture, who would be lost in the presence of such dismal characters, would continually have to repress yawns at their inept chatter. (Those of a more volcanic temperament would have to repress the desire to rub a pie in the fat faces of these nullities.) The world would be purer—and surely more beautiful—without such creatures.
The Mission of the Artist According to Baudelaire
For the dandy, it is necessary to reinject aesthetics into this barbarism. In England, John Ruskin (1819–1899), the Pre-Raphaelites with Dante Gabriel Rossetti and William Morris, went to work. Ruskin elaborated architectural projects to embellish the cities made ugly by the anarchic industrialization of the Manchesterian era. Specifially, this led to the construction of “garden cities.” Henry van de Velde and Victor Horta, Belgian and German Art Nouveau or Jugendstil architects, took up this torch. But all the while, in spite of these concrete achievements—for architecture more easily allows concrete realization—the gulf between the artist and society never ceased growing. The dandy is like the artist.
In France, Baudelaire, in his theoretical writings, sets the artist up as the new “aristocrat,” whose attitude must be stamped with distant coldness, whose feelings should neither be excited nor irritated beyond measure, whose principal quality must be irony, along with the ability to tell pleasant anecdotes. The artistic dandy takes a distance from all the conventional hobby-horses of society.
Baudelaire’s views are summarized in the words of a character of Ernst Jünger’s novel Heliopolis: “I became a dandy, who makes the unimportant important, who smiles at the important” (“Ich wurde zum Dandy, der das Unwichtige wichtig nahm, das Wichtige belächelte”). Baudelaire’s dandy, following the example of Brummell, is thus not a scandalous and sulfurous character like Oscar Wilde, but a cold observer (or, to paraphrase Raymond Aron, a “disengaged spectator”), who sees the world as a mere theatre, often insipid, where characters without real substance move about and gesticulate. The Baudelairian dandy has a bit of a taste for provocation, but it remains confined, in most cases, by irony. These later exaggerations, often mistaken for expressions of dandyism, do not correspond to the attitudes of Brummell, Baudelaire, or Jünger.
Thus Stefan George, in spite of the great interest of his poetic work, pushes aestheticism to the point of self-parody. For George, it is a small price to pay in an era when the “loss of every happy medium” becomes the rule. (Hans Sedlmayr explained this loss of the “happy medium” quite clearly in a famous book on contemporary art, Verlust der Mitte.) Sedlmayr clarifies this urge to seek the “piquant.” George found it in the revival of classical Greece.
Oscar Wilde ultimately put only himself on stage, proclaiming himself “aesthetic reformer.” Art, from his point of view, is nothing more than a space of contestation destined ultimately to absorb all social reality, becoming the only true reality. The economic, social, and political spheres are devalued; Wilde denies them all substantiality, reality, concreteness. If Brummell retained an entirely sober taste, if he kept his head on his shoulders, Oscar Wilde posed from the start as a demigod, wore extravagant clothing, with loud colors, a bit like the Incroyables and the Merveilleuses of the French Revolution. A provocateur, he also started a negative process of “feminization/ devirilisation,” walking through the streets with flowers in his hand. One can regard it as a precursor of today’s “gay pride” parades. His poses are pure theatre, far removed from Brummell’s tranquil feeling of superiority, of virile dignity, of “nil admirari.”
Self-Satisfaction & the Expansion of the “Ego”
For Otto Mann, this quotation from Wilde is emblematic:
The gods had given me almost everything. I had genius, a distinguished name, high social position, brilliancy, intellectual daring: I made art a philosophy, and philosophy an art: I altered the minds of men and the colours of things: there was nothing I said or did that did not make people wonder: I took the drama, the most objective form known to art, and made it as personal a mode of expression as the lyric or the sonnet, at the same time that I widened its range and enriched its characterisation: drama, novel, poem in rhyme, poem in prose, subtle or fantastic dialogue, whatever I touched I made beautiful in a new mode of beauty: to truth itself I gave what is false no less than what is true as its rightful province, and showed that the false and the true are merely forms of intellectual existence. I treated Art as the supreme reality, and life as a mere mode of fiction: I awoke the imagination of my century so that it created myth and legend around me: I summed up all systems in a phrase, and all existence in an epigram. Along with these things I had things that were different. (De Profundis)
The patent self-satisfaction, the expansion of the “ego,” reach the point of mystification.
These exaggerations kept growing, even in the orbit of the stoic virility dear to Montherlant. He too strikes exaggerated poses: as practitioner of an extremely ostentatious bullfighting, being photographed wearing the mask of a Roman Emperor, etc. Lesser followers risk falling into flashy “lookism” and bad taste, formalizing to the extreme the attitudes or postures of the poet or the writer. In any case, they are not a solution to the phenomenon of decadence.
As regards dandyism, the only way out is to return calmly to Brummell himself, before he sank under financial vexations. Because this return to Brummell is equivalent, if one remembers the earlier exhortations of Addison and Steele, to a more modern—more civil and perhaps more trivial—form of paideia or humanitas. But, trivial or not, these values would be still be maintained, would continue to exist and shape minds.
This mix of good sense and the dandy aesthetic would make it possible to pursue a practical political objective: to defend the school in the classical sense of the term, to increase its power to transmit the legacy of Hellenic and Roman antiquity, to envisage a new and effective pedagogy, which would mix the idealism of Schiller, traditional methods, and the methods inspired by Pestalozzi.
Return to Religion or “Unhappy Consciousness”?
The figure of the dandy must thus be put back in the context of the 18th century, when the ideals and classical models of traditional Europe were being battered and destroyed under the butcher’s blows of leveling modernity. The substance of religion—whether Christian or pre-Christian under Christian varnish—becomes hollow and exhausted. The Moderns take the place of the Ancients. This process led inevitably to an existential crisis throughout European civilization.
Two paths are available to those who try to escape this sad destiny: (1) The return to religion or tradition, important paths that are not our topic today, to the extent that it represents an extremely vast continent of thought, deserving a complete seminar to itself. (2) To cultivate what the Romantics called Weltschmerz, the pain caused by a disenchanted world, which amounts to assuming an attitude of permanent critique toward the manifestations of modernity, developing an unhappy consciousness that generates a self-marginalizing culture where the political spirit can formulate an opposition to the mainstream.
For the dandy and the Romantic who oscillate between the return to religion and the feeling of Weltschmerz, the latter is most deeply felt. In the interiority of the poet or the artist this feeling will mature, grow, develop. To the point of becoming immune to the power of the unhappy consciousness to cause both languid and violent emotions. In the end, the dandy must become a cold and impartial observer in control of his feelings and emotions. If his blood boils at “economic horrors” it must quickly cool, leading to impassiveness, if he is to be able to face them effectively. The dandy who underwent this process thus reached a double impassibility: nothing external can shake him any longer; but neither can any interior emotion.
Pierre Drieu La Rochelle was never able to arrive at such a balance, which gives a very peculiar and seductive note to his work, quite simply because it reveals this process underway, with all its eddies, calms, and advances. Drieu suffers from the world, is tested on the front lines, is seduced by the discipline and “metallic” aspects of “immense and red” Fascism, on the march in his time, mentally accepts the same discipline in the Communists and Stalinists, but never really becomes a “cold and impartial observer” (Benjamin Constant). The work of Drieu La Rochelle is justly immortal because it reveals this permanent tension, this fear to falling into the ruts of a barren emotion, this joy at seeing vigorous alternatives to modern torpor, like Fascism or the satire of Doriot.
Strengthening Mind & Character
In short, the deconstruction of the ideas of ancient paideia and the deliquescence of immemorial religious substantialities beginning at the end of the 18th century, is equivalent to an existential crisis throughout all Western countries. The response of intelligence to this crisis is double: either it calls for a return to religion or it causes a deeply rooted pain in the depths of the soul, the famous Weltschmerz of the Romantics.
Weltschmerz is felt in the deepest interiority of the man who faces this crisis, but it is also in his interiority that he works silently to rise above this pain, to make it the material from which he forges the answer and alternative to this terrible loss of substantiality that is presided over by a deleterious economicism. It is thus necessary to harden the mind and character against the pangs entailed by the loss of substantiality without inventing out of whole cloth a rather lame substitute for what has been lost.
Baudelaire and Wilde think, each in his own way, that art will offer an alternative to the old substantialities that is almost identical in all ways but more flexible and moving. But in this case, art need not be understood as simple aestheticism. The toughening of the mind and character must serve to combat the ambient economicism, to fight against those who incarnate it, accept it, and puts their energies in its service. This toughness must be used as the firm moral and psychological base of the ideals of political and metapolitical struggle.
This toughness must be the carapace of what Evola called the “differentiated man,” he who “rides the tiger,” who wanders, unperturbed and imperturbable, “among the ruins,” the one Jünger called the “Anarch.” “The differentiated man who rides the tiger among the ruins” or the “Anarch” are described as impartial, impassive observers. These tough, differentiated men rise above two kinds of obstacles: external obstacles and those generated from their own interiority. That is to say, the impediments posed by inferior men and the weaknesses of a soul in distress.
Chandala Figures of Decadence
The existential crisis that began around the middle of the 18th century led to nihilism, quite judiciously defined by Nietzsche as an “exhaustion of life,” as a “devaluation of the highest values,” which is often expressed by a frantic agitation and the inability to really enjoy leisure, an agitation that accelerates the process of exhaustion.
The abstraction of existence is the clear indication that our “societies” no longer constitute “bodies” but, as Nietzsche says, mere “conglomerates of Chandalas,” in whom nervous and psychological maladies accumulate, a sign that the defensive power of strong natures is no more than a memory. It is precisely this “defensive power” that the “differentiated” man must—at the end of his search for traditional mysteries—reconstitute in himself.
Nietzsche very clearly enumerates the vices of the Chandala, the emblematic figure of European decadence, resulting from the existential crisis and nihilism: the Chandala suffers various pathologies: an increase in criminality, generalized celibacy and voluntary sterility, hysteria, constant weakening of the will, alcoholism (and various drug addictions as well), systematic doubt, a methodical and relentless destruction of any residue of strength.
Among the Chandala figures of decadence and nihilism, Nietzsche includes those he calls “official nomads” (Staatsnomaden), who are civil servants without real fatherlands, servants of the “cold monster,” with abstract minds that, consequently, generate always more abstractions, whose parasitic existence generates, by their appalling but persistent sluggishness, the decline of families, in a environment made of contradictory and crumbling diversities, where one finds the “discipline” (Züchtung) of characters to serve the abstractions of the cold monster—a generalized lubricity in the form of irritability and as the expression of an insatiable and compensatory need for stimuli and excitations—neuroses of all types—political “presentism” (Augenblickdienerei) in which long memory, deep perspectives, or a natural and instinctive sense for the right no longer prevail—pathological sensitiveness—barren doubts proceeding of a morbid fear of the unyielding forces that made and will still make history/power—a fear of mastering reality, of seizing the tangible things of this world.
Victor Segalen in Oceania, Ernst Jünger in Africa
In this complex of frigidity, of agitated opposition to change, barren frenzies, and neuroses, one primary response to nihilism is to exalt and concretize the principle of adventure, in which the protester will leave the bourgeois world, with its tissue of artifices, moving towards virgin spaces that are intact, authentic, open, mysterious.
Gauguin left for the Pacific Islands.
Victor Segalen, in his turn, praises primordial Oceania and imperial China perishing under the blows of the Westernization. Segalen remains Breton, according to what he calls the “return to the ancestral marrow,” denounces the invasion of Tahiti by the “American romantics,” these “filthy parasites,” writes an “Essay on Exoticism” and “An Aesthetics of the Different.” The rejection of bits and pieces without much of a past cost Segalen an unjustified ostracism in his fatherland. From our point of view, he is an author worth rediscovering.
The young Jünger, still in adolescence, dreamed of Africa, the continent of elephants and other fabulous creatures, where spaces and landscapes are not ravaged by industrialization, where nature and indigenous people preserved a formidable purity, where everything was still possible. The young Jünger joined the French Foreign Legion to realize this dream, to be able to land on this new continent, glutted with mysteries and vitality.
The year 1914 gave him, and his whole generation, a chance to abandon an enervating existence. In the same vein, Drieu La Rochelle spoke of the élan of Charleroi. And later, Malraux, of “Royal roads.”
On the “left” (in so far as this political distinction has any meaning), one instead speaks of “engagement.” This enthusiasm was especially apparent at the time of the Spanish Civil War, where Hemingway, Orwell, Koestler, and Simone Weil joined the Republicans, and Roy Campbell the Nationalists, who were also lauded by Robert Brasillach.
The adventure and engagement, in the uniform of a soldier of the phalangist militia, in the ranks of the international brigades or the partisans, are perceived as antidotes to the hyperformalism of a colorless civilian life. “I was tired of civilian life, therefore I joined the IRA,” goes the Irish nationalist song, which, in its particular context, proclaims, with a jaunty tune, this great existentialist uprising of the early 20th century with all the ease, vivacity, rhythm, and humor of Green Éire.
 Intoxication? Drugs? Amoralism?
Intoxication? Drugs? Amoralism?
But if political or military commitment fulfills the spiritual needs of those those who are bored by the unrelieved formalism of civilian life without traditional balance, the rejection of all formalism can lead to other less positive attitudes. The dandy, who departs from the balanced pose of Brummell or the delicately crafted criticism of Baudelaire, will want to experience ever new excitations, merely for the sterile pleasure of trying them.
Drugs, drug-addiction, the excessive consumption of alcohol constitute possible escapes: the romantic figure created by Huysmans, Des Esseintes, fled to liquor. Thomas De Quincey evoked “The Opiumeaters.” Baudelaire himself tried opium and hashish.
Falling into drug-addiction is explained by the closing of the world, after the colonization of Africa and other virgin territories; real, dangerous adventure is no longer possible there. War, tested by Jünger around the same time as “drugs and intoxications,” lost its attraction because the figure of the warrior becomes an anachronism as wars are excessively professionalized, mechanized, and technologized.
Amorality and anti-moralism are more dead-ends. Oscar Wilde frequented sleazy bars, ostentatiously flaunting his homosexuality. His character Dorian Gray becomes a criminal in order to press his transgressions ever further, with a pitiful sort of hubris. One might also recall Montherlant’s painful end and keep in mind his dubious heritage, continued to this day by his executor, Gabriel Matzneff, whose literary style is certainly quite brilliant but in whose wake the saddest scenarios unfold, carried on in secret, in closed circles, all the more perverse and ridiculous since the sexual revolutuion of the 1960s also allows enjoyment without petty moralism of many strong pleasures.
These drugs, transgressions, and sex-crazed buffooneries, are just so many existential traps and cul-de-sacs where unfortunates ruin themselves in search of their “spiritual needs.” They wish to “transgress,” but this, to the ironical observer, is nothing more than a sad sign of wasted lives, the absence of real vitality, and sexual frustrations due to defects or physical infirmities. Certainly, one cannot “ride the tiger”—indeed it would be hard to find one—in the salons where the old fop Matzneff lets drop tidbits of his sexual encounters to his creepy little admirers.
Religious Asceticism
The true alternative to the bourgeois world of “little jobs” and “petty calculations” mocked by Hannah Arendt, in a world now closed, where adventures and discoveries are henceforth nothing but repetitions, where war is “high tech” and no longer chivalrous, lies in religious asceticism, in a certain return to the monarchism of meditation, in the return to Tradition (Evola, Guénon, Schuon). Drieu La Rochelle evokes this path in his “Journal,” after his political disappointments, and gives an account of his reading of Guénon.
The Schuon brothers are exemplary in this context: Frithjof joined the Foreign Legion, surveyed the Sahara, made the acquaintance of the Sufis and the marabouts of the desert and the Atlas Mountains, adhered to an Isamized Sufi mysticism, then went to the Sioux Indian reservations in the United States, and left a stunning and astounding body of pictorial work.
His brother, named “Father Galle,” surveyed the Indian reservations of North America, translated the Gospels into the Sioux language, withdrew to a Trappist monastery in Walloonia, where he trained young horses Indian-style, met Hergé, and became friends with him.
Their lives prove that adventure and total escape from the artificial and corrupting world of the Westernization (Zinoviev) remains possible and fruitful.
For the rebellion is legitimate, if one does not fall into the traps.
Contribution to the “SYNERGON-Deutschland” seminar, Lower Saxony, May 6, 2001.
00:10 Publié dans Littérature, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, lettres, dandy, dandysme, philosophie, théorie littéraire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 27 août 2010
Right-Wing Anarchism
Right-Wing Anarchism
Ex: http://www.counter-currents.com/
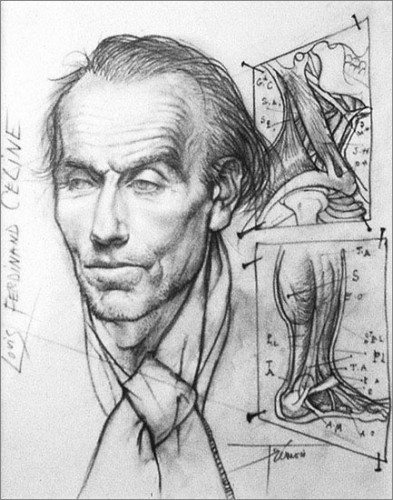 The concept of right-wing anarchism seems paradoxical, indeed oxymoronic, starting from the assumption that all “right-wing” political viewpoints include a particularly high evaluation of the principle of order. . . . In fact right-wing anarchism occurs only in exceptional circumstances, when the hitherto veiled affinity between anarchism and conservatism may become apparent.
The concept of right-wing anarchism seems paradoxical, indeed oxymoronic, starting from the assumption that all “right-wing” political viewpoints include a particularly high evaluation of the principle of order. . . . In fact right-wing anarchism occurs only in exceptional circumstances, when the hitherto veiled affinity between anarchism and conservatism may become apparent.
Ernst Jünger has characterised this peculiar connection in his book Der Weltstaat (1960): “The anarchist in his purest form is he, whose memory goes back the farthest: to pre-historical, even pre-mythical times; and who believes, that man at that time fulfilled his true purpose . . . In this sense the anarchist is the Ur-conservative, who traces the health and the disease of society back to the root.” Jünger later called this kind of “Prussian” . . . or “conservative anarchist” the “Anarch,” and referred his own “désinvolture” as agreeing therewith: an extreme aloofness, which nourishes itself and risks itself in the borderline situations, but only stands in an observational relationship to the world, as all instances of true order are dissolving and an “organic construction” is not yet, or no longer, possible.
Even though Jünger himself was immediately influenced by the reading of Max Stirner, the affinity of such a thought-complex to dandyism is particularly clear. In the dandy, the culture of decadence at the end of the 19th century brought forth a character, which on the one hand was nihilistic and ennuyé, on the other hand offered the cult of the heroic and vitalism as an alternative to progressive ideals.
The refusal of current ethical hierarchies, the readiness to be “unfit, in the deepest sense of the word, to live” (Flaubert), reveal the dandy’s common points of reference with anarchism; his studied emotional coldness, his pride, and his appreciation of fine tailoring and manners, as well as the claim to constitute “a new kind of aristocracy” (Charles Baudelaire), represent the proximity of the dandy to the political right. To this add the tendency of politically inclined dandies to declare a partiality to the Conservative Revolution or to its forerunners, as for instance Maurice Barrès in France, Gabriele d’Annunzio in Italy, Stefan George or Arthur Moeller van den Bruck in Germany. The Japanese author Yukio Mishima belongs to the later followers of this tendency.
Besides this tradition of right-wing anarchism, there has existed another, older and largely independent tendency, connected with specifically French circumstances. Here, at the end of the 18th century, in the later stages of the ancien régime, formed an anarchisme de droite, whose protagonists claimed for themselves a position “beyond good and evil,” a will to live “like the gods,” and who recognized no moral values beyond personal honor and courage. The world-view of these libertines was intimately connected with an aggressive atheism and a pessimistic philosophy of history. Men like Brantôme, Montluc, Béroalde de Verville, and Vauquelin de La Fresnaye held absolutism to be a commodity that regrettably opposed the principles of the old feudal system, and that only served the people’s desire for welfare. Attitudes, which in the 19th century were again to be found with Arthur de Gobineau and Léon Bloy, and also in the 20th century with Georges Bernanos, Henry de Montherlant, and Louis-Ferdinand Céline. This position also appeared in a specifically “traditionalist” version with Julius Evola, whose thinking revolved around the “absolute individual.”
In whichever form right-wing anarchism appears, it is always driven by a feeling of decadence, by a distaste for the age of masses and for intellectual conformism. The relation to the political is not uniform; however, not rarely does the aloofness revolve into activism. Any further unity is negated already by the highly desired individualism of right-wing anarchists. Nota bene, the term is sometimes adopted by men–for instance George Orwell (Tory anarchist) or Philippe Ariès–who do not exhibit relevant signs of a right-wing anarchist ideology; while others, who objectively exhibit these criteria–for instance Nicolás Gómez Dávila or Günter Maschke–do not make use of the concept.
Bibliography
Gruenter, Rainer. “Formen des Dandysmus: Eine problemgeschichtliche Studie über Ernst Jünger.” Euphorion 46 (1952) 3, pp. 170-201.
Kaltenbrunner, Gerd-Klaus, ed. Antichristliche Konservative: Religionskritik von rechts. Freiburg: Herder, 1982.
Kunnas, Tarmo. “Literatur und Faschismus.” Criticón 3 (1972) 14, pp. 269-74.
Mann, Otto. “Dandysmus als konservative Lebensform.” In Gerd-Klaus Kaltenbrunner, ed., Konservatismus international, Stuttgart, 1973, pp. 156-70.
Mohler, Armin. “Autorenporträt in memoriam: Henry de Montherlant und Lucien Rebatet.” Criticón 3 (1972) 14, pp. 240-42.
Richard, François. L’anarchisme de droite dans la littérature contemporaine. Paris: PUF, 1988.
______. Les anarchistes de droite. Paris: Presses universitaires de France, 1997.
Schwarz, Hans Peter. Der konservative Anarchist: Politik und Zeitkritik Ernst Jüngers. Freiburg im Breisgan, 1962.
Sydow, Eckart von. Die Kultur der Dekadenz. Dresden, 1921.
Karlheinz Weißman, “Anarchismus von rechts,” Lexikon des Konservatismus, ed. Caspar von Schrenck-Notzing (Graz and Stuttgart: Leopold Stocker Verlag, 1996). Translator anonymous. From Attack the System, June 6, 2010, http://attackthesystem.com/2010/06/right-wing-anarchism/
00:05 Publié dans Philosophie, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : révolution conservatrice, droite, conservatisme, anarchisme, anarchisme de droite, céline, ernst jünger, allemagne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 26 août 2010
Leadership & the Vital Order
Leadership & the Vital Order:
Selected Aphorisms by Hans Prinzhorn, Ph.D., M.D.
Translated and edited by Joseph D. Pryce
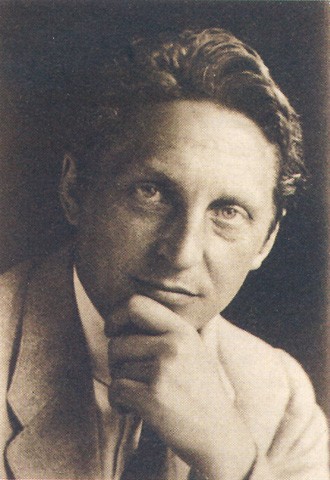 The enduring fame of German psychotherapist Hans Prinzhorn (1886–1933) is based almost entirely upon one book, Bildnerei der Geisteskranken (Artistry of the mentally ill), that brilliant and quite unprecedented monograph on the artistic productions of the mentally ill, which appeared in 1922. Sadly, it is too often forgotten that Hans Prinzhorn was the most brilliant and independent disciple of Germany’s greatest 20th-Century philosopher, Ludwig Klages (1872–1956).
The enduring fame of German psychotherapist Hans Prinzhorn (1886–1933) is based almost entirely upon one book, Bildnerei der Geisteskranken (Artistry of the mentally ill), that brilliant and quite unprecedented monograph on the artistic productions of the mentally ill, which appeared in 1922. Sadly, it is too often forgotten that Hans Prinzhorn was the most brilliant and independent disciple of Germany’s greatest 20th-Century philosopher, Ludwig Klages (1872–1956).
Although Prinzhorn himself would have protested against the oblivion into which his mentor’s life’s work has fallen, it is a fact that Prinzhorn is still a major presence in the technical literature, whilst his hero, paradoxically, has been “killed by silence.” One should be thankful for even the smallest mercies.
Prinzhorn is even now a not inconsiderable presence in the field that he made his own, and he will remain a major figure, albeit a controversial one, in the field of psychology, as long as his discoveries are cherished and his insights developed as a living heritage by those who recognize, and are willing to repay, at least some small portion of the debt that scholarship still owes to his memory.
Humanitarian Demagogues, Egalitarian Rabble. Whether today’s mechanistic and atomistic experiments with human beings originated in the Orient or in the Occident, the result is always the same: the tyranny of a clique in the name of the equality of all. And it is from this very tendency that the fantastic pipe dream of human individuals being reduced to the status of mere numbers arises. This wishful thinking is a symptom of the nihilistic Will to Power that conceals its true nature behind the cloak of such humanitarian ideals as humility, solicitude for the weak, the awakening of the oppressed masses, the plans for universal happiness, and the fever-swamp vision of perpetual progress. All of these lunatic projects invariably result in a demagogic assault on the part of the inferior rabble against the nobler type of human being. These mad projects, it need hardly be said, are always concocted in the name of “humanity,” in spite of the fact that decades earlier Nietzsche had conclusively demonstrated that it was the ressentiment, or “life-envy,” of those who feel themselves to be oppressed by fate that was at the root of all such tendencies. Indeed, it is even now quite difficult for the select few who have no wish to enroll themselves among the oppressed mob to understand the realities of their situation!
The Goals of Socialism. When we set our goals in the direction of socialism, whether in the sphere of politics, of welfare work, or of the ideal community, the fanaticism that inspires the socialist is customarily tinged with Christianity. Thus the socialist urges the citizen to progress from wicked egoism to a more social attitude. Even when we ignore the social, religious, or political nature of the ideologue’s desiderata, there is one positive aspect to this development, for socialism at least directs our attention away from the tyrannical ego and towards the world that surrounds us, thus calling upon the only one of socialism’s fundamental motives that we can regard as positive and biologically sensible.
Characterological Truth vs. Psychoanalytical Error. The most extensive, pleasant, and (one might even say) amusing effects wrought by the application of the psychoanalytic treatment depended on the fact that the most wretched and feeble blockhead was now able to convince himself that he was equal to Goethe in that the instincts that played so decisive a role in the cretin’s development were identical with those that were operative in the case of Goethe, and it was only a malicious practical joke on the part of Destiny that permitted Goethe to find in poetry a congenial sublimation of his sexuality.
The Psychopath and the Revolution. We can hold out no hope whatever for the successful creation of the sort of community that is constructed by ideologists on the basis of purely rational considerations, for the projects that are hatched out in the mind of the rationalist are most definitely not analogous to the development of living forms in nature, no matter how often the contrary position has been proclaimed by false prophets. Thus, the delusive hopes that are cherished for the successful implementation of the simple-minded schemes of our socialist and humanitarian ideologists must fail in the future as they have always failed in the past. The only tangible result of these schemes has been to intoxicate the isolated psychopath with an egalitarian frenzy, from which his tormented ego awakens, more desperate than ever, in order to plunge once again, with ever-increasing violence, into his political ecstasies, into bellowing his eulogies to those nameless “masses” who are so dear to the ideologue that he has appointed them to be the sole beneficiaries of his activism, now that he has been made sufficiently mad by a nebulous and insatiable longing for “liberation.” But the “sham” anonymity, which functions effectively as the cloak for politicians who pretend to act in the name of “the masses,” can only benefit clever, robust, and willful politicians, such as those who rule the Soviet Union; the real psychopath, on the other hand, who often possesses a taste for novel sensations and who, perhaps, may also be seeking personal publicity, will never be able to conform to the prescriptions of such an icy, strict self-discipline. As a result, he “breaks out,” and is soon overwhelmed by calamities from which he thinks he can only escape by resorting to even more violent attempts to achieve “liberation.” From the standpoint of psychology, the history of revolutions is very helpful to those who wish to increase their understanding of the “everyday” behavior—as well as the political actions—of his fellow human beings, not least to the physician who seeks enlightenment as to the nature of the motivations that drive men to perform violent deeds in situations to which they lend the halo of freedom, equality, and fraternity.
Heredity as Destiny (and Tabula Rasa as Sheer Nonsense). The life-curve of an individual’s development is a single event, which arrays itself along the lines of irrevocable changes. Strictly speaking, therefore, every occurrence, no matter how insignificant, involves an irrevocable change: in life nothing can be reversed, nothing repudiated, nothing ventured without an attendant responsibility, nothing can be annihilated: that formula constitutes the biological basis of destiny. Just as the individual must accept his biological heritage as a whole, whether he likes it or not, in precisely the same fashion must he accept the pre-ordained pattern of obscure rhythms transpiring within him.
Today we have become tragically unconcerned with our biological destiny, to say nothing of the fact that we refuse to feel the slightest reverence to the sphere of life, to which we owe everything. …That very attitude accounts for the success that has greeted the claims advanced by Alfred Adler and his followers, who advance the dogma that the hitherto customary views on heredity are fundamentally false, since man is born as a tabula rasa whereon his environment makes impressions that, by means of education, one can direct at will, and according to the capacity of that will, toward any desired goal. Adler compounds his felony by claiming that there is no such thing as inborn talent or traits of disposition. …
It would be impossible to reject the principles of biological theory more absolutely than Adler and his cohorts have done. Even that which we understand by the old, almost obsolescent name of “temperament”—that which represents the sum-total of the somatically connected, permanent tendencies of an individual—even this link between the purely psychological and the purely somatic view is repudiated by Adler in his grotesquely teleological and hyper-rationalist construction. … Since there is no biological basis whatsoever for his stupendous assertions, one must seek for such a basis in another sphere, viz., the author’s ideology. Sure enough, we learn that Adler is a fanatical believer in the coming Utopia of socialism, and, as we all recognize, no Utopia can prosper until a faceless equality of disposition has been forced upon every individual by the ideological zealots who will run the show. Therefore I denounce the politically tendentious World-View that Adler and his apostles put forward as “science,” for it is a perfect example of nihilism passing itself off as scholarship, and no cloak of pedantic and prudent caution can hide the fact.
Genetic Endowment and Environmental Conditioning. Upon his entry into individual existence, the human being’s development as a psychosomatic creature is determined as regards substance, capacity for expansion, and direction, in the first place by his genetic endowment as a whole; in the second place by his pre-natal environment; and lastly by the circumstances of his birth. That almost all the active factors rise and fall in varying phases, makes a rational interpretation and estimate of the state of things at any given moment impossible in the strictest sense of that word.
But the fact that such an admission of the difficulties that arise due to methodological limitations is exploited by false prophets in order to deceive the world as to the real nature of biological facts—usually in order to breathe some life into the defunct heresy of the infant born as a tabula rasa—is either a sad indication of their childish mentality or additional evidence that they are indulging their ideological proclivities in the wrong place. What Goethe described as “the law under which you entered the world,” what Kant, Schopenhauer, and others called the “intelligible character,” is the first unavoidable actuality that we must accept as the destiny of our being, and as the starting-point of all investigation and thinking that relates to the human being. All experience and all reasonable thinking drives us back to this basic fact.
The Occidental Observer, August 8, 2010, http://www.theoccidentalobserver.net/authors/Pryce-Prinzhorn.html
Joseph Pryce (email him) is a writer and poet and translator from New York. He is author of the collection of mystical poems Mansions of Irkalla, reviewed here. His translation of the German philosopher Ludwig Klages’ work will be published shortly.
00:18 Publié dans Philosophie, Psychologie/psychanalyse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : psychologie, philosophie, allemagne, ordre, ordre vital, leadership, élite, élitisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 25 août 2010
Spengler: Criticism & Tribute
Spengler: Criticism & Tribute
Ex: http://www.counter-currents.com/
Editor’s Note:
Oswald Spengler’s Man and Technics and Revilo Oliver’s America’s Decline: The Education of a Conservative and The Origins of Christianity are available for purchase on this website.
 Conceived before the First World War is Oswald Spengler’s magisterial work, Der Untergang des Abendlandes (Munich, 1918). Read in this country chiefly in the brilliantly faithful translation by Charles Francis Atkinson, The Decline of the West (New York, two volumes, 1926-28), Spengler’s morphology of history was the great intellectual achievement of our century. Whatever our opinion of his methods or conclusions, we cannot deny that he was the Copernicus of historionomy. All subsequent writings on the philosophy of history may fairly be described as criticism of the Decline of the West.
Conceived before the First World War is Oswald Spengler’s magisterial work, Der Untergang des Abendlandes (Munich, 1918). Read in this country chiefly in the brilliantly faithful translation by Charles Francis Atkinson, The Decline of the West (New York, two volumes, 1926-28), Spengler’s morphology of history was the great intellectual achievement of our century. Whatever our opinion of his methods or conclusions, we cannot deny that he was the Copernicus of historionomy. All subsequent writings on the philosophy of history may fairly be described as criticism of the Decline of the West.
Spengler, having formulated a universal history, undertook an analysis of the forces operating in the immediately contemporary world. This he set forth in a masterly work, Die Jahre der Entscheidung, of which only the first volume could be published in Germany (Munich, 1933) and translated into English (The Hour of Decision, New York, 1934). One had only to read this brilliant work, with its lucid analysis of forces that even acute observers did not perceive until 25 or 30 years later, and with its prevision that subsequent events have now shown to have been absolutely correct, to recognize that its author was one of the great political and philosophical minds of the West. One should remember, however, that the amazing accuracy of his analysis of the contemporary situation does not necessarily prove the validity of his historical morphology.
The publication of Spengler’s first volume in 1918 released a spate of controversy that continues to the present day. Manfred Schroeter in Der Streit um Spengler (Munich, 1922) was able to give a précis of the critiques that had appeared in a little more than three years; today, a mere bibliography, if reasonably complete, would take years to compile and would probably run to eight hundred or a thousand printed pages.
Spengler naturally stirred up swarms of nit-wits, who were particularly incensed by his immoral and preposterous suggestion that there could be another war in Europe, when everybody knew that there just couldn’t be anything but World Peace after 1918, ’cause Santa had just brought a nice, new, shiny “League of Nations.” Such “liberal” chatterboxes are always making a noise, but no one with the slightest knowledge of human history pays any attention to them, except as symptoms.
Unfortunately, much more intelligent criticism of Spengler was motivated by emotional dissatisfaction with his conclusions. In an article in Antiquity for 1927, the learned R. G. Collingwood of Oxford went so far as to claim that Spengler’s two volumes had not given him “a single genuinely new idea,” and that he had “long ago carried out for himself” — and, of course, rejected — even Spengler’s detailed analyses of individual cultures. As a cursory glance at Spengler’s work will suffice to show, that assertion is less plausible than a claim to know everything contained in the Twelfth Edition of the Encyclopaedia Britannica. Collingwood, the author of the Speculum Mentis and other philosophical works, must have been bedeviled with emotional resentments so strong that he could not see how conceited, arrogant, and improbable his vaunt would seem to most readers.
It is now a truism that Spengler’s “pessimism” and “fatalism” was an unbearable shock to minds nurtured in the nineteenth-century illusion that everything would get better and better forever and ever. Spengler’s cyclic interpretation of history stated that a civilization was an organism having a definite and fixed life-span and moving from infancy to senescence and death by an internal necessity comparable to the biological necessity that decrees the development of the human organism from infantile imbecility to senile decrepitude. Napoleon, for example, was the counterpart of Alexander in the ancient world.
We were now, therefore, in a phase of civilizational life in which constitutional forms are supplanted by the prestige of individuals. By 2000, we shall be “contemporary” with the Rome of Sulla, the Egypt of the Eighteenth Dynasty, and China at the time when the “Contending States” were welded into an empire. That means that we face an age of world wars and what is worse, civil wars and proscriptions, and that around 2060 the West (if not destroyed by its alien enemies) will be united under the personal rule of a Caesar or Augustus. That is not a pleasant prospect.
Oswald Spengler, 1880 - 1936
The only question before us, however, is whether Spengler is correct in his analysis. Rational men will regard as irrelevant the fact that his conclusions are not charming. If a physician informs you that you have symptoms of arteriosclerosis, he may or may not be right in his diagnosis, but it is absolutely certain that you cannot rejuvenate yourself by slapping his face.
Every detached observer of our times, I think, will agree that Spengler’s “pessimism” aroused emotions that precluded rational consideration. I am inclined to believe that the moral level of his thinking was a greater obstacle. His “fatalism” was not the comforting kind that permits men to throw up their hands and eschew responsibilities. Consider, for example, the concluding lines of his Man and Technics (New York, 1932):
Already the danger is so great, for every individual, every class, every people, that to cherish any illusion whatever is deplorable. Time does not suffer itself to be halted; there is no question of prudent retreat or wise renunciation. Only dreamers believe that there is a way out. Optimism is cowardice.
We are born into this time and must bravely follow the path to the destined end. There is no other way. Our duty is to hold on to the lost position, without hope, without rescue, like that Roman soldier whose bones were found in front of a door in Pompeii, who, during the eruption of Vesuvius, died at his post because they forgot to relieve him. That is greatness. That is what it means to be a thoroughbred. The honorable end is the one thing that can not be taken from a man.
Now, whether or not the stern prognostication that lies back of that conclusion is correct, no man fit to live in the present can read those lines without feeling his heart lifted by the great ethos of a noble culture — the spiritual strength of the West that can know tragedy and be unafraid. And simultaneously, that pronouncement will affright to hysteria the epicene homunculi among us, the puling cowards who hope only to scuttle about safely in the darkness and to batten on the decay of a culture infinitely beyond their comprehension.
That contrast is in itself a very significant datum for an estimate of the present condition of our civilization …
Three Points of Criticism
Criticism of Spengler, therefore, if it is not to seem mere quibbling about details, must deal with major premises. Now, so far as I can see, Spengler’s thesis can be challenged at three really fundamental points, namely: (1) Spengler regards each civilization as a closed and isolated entity animated by a dominant idea, or Weltanschauung, that is its “soul.” Why should ideas, or concepts, the impalpable creations of the human mind, undergo an organic evolution as though they were living protoplasm, which, as a material substance, is understandably subject to chemical change and hence biological laws? This logical objection is not conclusive: Men may observe the tides, for example, and even predict them, without being able to explain what causes them. But when we must deduce historical laws from the four of five civilizations of which we have some fairly accurate knowledge, we do not have enough repetitions of a phenomenon to calculate its periodicity with assurance, if we do not know why it happens.
(2) A far graver difficulty arises from the historical fact that we have already mentioned. For five centuries, at least, the men of the West regarded modern civilization as a revival or prolongation of Graeco-Roman antiquity. Spengler, as the very basis of his hypothesis, regards the Classical world as a civilization distinct from, and alien to, our own — a civilization that, like the Egyptian, lived, died, and is now gone. It was dominated by an entirely different Weltanschauung, and consequently the educated men of Europe and America, who for five centuries believed in continuity, were merely suffering from an illusion or hallucination.
Even if we grant that, however, we are still confronted by a unique historical phenomenon. The Egyptian, Babylonian, Chinese, Hindu, and Arabian (“Magian”), civilizations are all regarded by Spengler (and other proponents of an organic structure of culture) as single and unrelated organisms: Each came into being without deriving its concepts from another civilization (or, alternatively, seeing its own concepts in the records of an earlier civilization), and each died leaving no offspring (or, alternatively, no subsequent civilization thought to see in them its own concepts). There is simply no parallel or precedent for the relationship (real or imaginary) which links Graeco-Roman culture to our own.
Since Spengler wrote, a great historical discovery has further complicated the question. We now know that the Mycenaean peoples were Greeks, and it is virtually certain that the essentials of their culture survived the disintegration caused by the Dorian invasion, and were the basis of later Greek culture. (For a good summary, see Leonard R. Palmer, Mycenaeans and Minoans, London, 1961). We therefore have a sequence that is, so far as we know, unique:
Mycenaean>Dark Ages>Graeco-Roman>Dark Ages>Modern.
If this is one civilization, it has had a creative life-span far longer than that of any other that has thus far appeared in the world. If it is more than one, the interrelations form an exception to Spengler’s general law, and suggest the possibility that a civilization, if it dies by some kind of quasi-biological process, may in some cases have a quasi-biological power of reproduction.
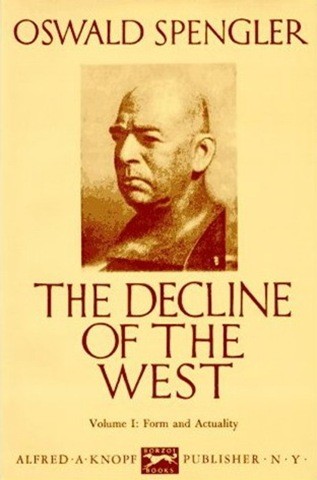 The exception becomes even more remarkable if we, unlike Spengler, regard as fundamentally important the concept of self-government, which may have been present even in Mycenaean times (see L. R. Palmer, Mycenaeans and Minoans, cited above, p. 97). Democracies and constitutional republics are found only in the Graeco-Roman world and our own; such institutions seem to have been incomprehensible to other cultures.
The exception becomes even more remarkable if we, unlike Spengler, regard as fundamentally important the concept of self-government, which may have been present even in Mycenaean times (see L. R. Palmer, Mycenaeans and Minoans, cited above, p. 97). Democracies and constitutional republics are found only in the Graeco-Roman world and our own; such institutions seem to have been incomprehensible to other cultures.
(3) For all practical purposes, Spengler ignores hereditary and racial differences. He even uses the word “race” to represent a qualitative difference between members of what we should call the same race, and he denies that that difference is to any significant extent caused by heredity. He regards biological races as plastic and mutable, even in their physical characteristics, under the influence of geographical factors (including the soil, which is said to affect the physical organism through food) and of what Spengler terms “a mysterious cosmic force” that has nothing to do with biology. The only real unity is cultural, that is, the fundamental ideas and beliefs shared by the peoples who form a civilization. Thus Spengler, who makes those ideas subject to quasi-biological growth and decay, oddly rejects as insignificant the findings of biological science concerning living organisms.
It is true, of course, that man is in part a spiritual being. Of that, persons who have a religious faith need no assurance. Others, unless they are determined blindly to deny the evidence before us, must admit the existence of phenomena of the kind described by Franz E. Winkler, M.D., in Man: The Bridge Between Two Worlds (New York, Harper, 1960), and, of course, by many other writers. And every historian knows that no one of the higher cultures could conceivably have come into being, if human beings are merely animals.
But it is also true that the science of genetics, founded by Father Mendel only a century ago and almost totally neglected down to the early years of the Twentieth Century, has ascertained biological laws that can be denied only by denying the reality of the physical world. Every educated person knows that the color of a man’s eyes, the shape of the lobes of his ears, and every one of his other physiological characteristics is determined by hereditary factors. It is virtually certain that intellectual capacity is likewise produced by inheritance, and there is a fair amount of evidence that indicated that even moral capacities are likewise innate.
Man’s power of intervention in the development of inherited qualities appears to be entirely negative, thus affording another melancholy proof that human ingenuity can easily destroy what it can never create. Any fool with a knife can in three minutes make the most beautiful woman forever hideous, and one of our “mental health experts,” even without using a knife, can as quickly and permanently destroy the finest intellect. And it appears that less drastic interventions, through education and other control of environment, may temporarily or even permanently pervert and deform, but are powerless to create capacities that an individual did not inherit from near or more remote ancestors.
The facts are beyond question, although the Secret Police in Soviet Russia and “liberal” spitting-squads in the United States have largely succeeded in keeping these facts from the general public in the areas they control. But no amount of terrorism can alter the laws of nature. For a readable exposition of genetics, see Garrett Hardin’s Nature and Man’s Fate (New York, Rinehart, 1959), which is subject only to the reservation that the laws of genetics, like the laws of chemistry, are verified by observation every day, whereas the doctrine of biological evolution is necessarily an hypothesis that cannot be verified by experiment.
The Race Factor
It is also beyond question that the races of mankind differ greatly in physical appearance, in susceptibility to specific diseases, and in average intellectual capacity. There are indications that they differ also in nervous organization, and possibly, in moral instincts. It would be a miracle if that were not so, for, as is well known, the three primary races were distinct and separate at the time that intelligent men first appeared on this planet, and have so remained ever since. The differences are so pronounced and stable that the proponents of biological evolution are finding it more and more necessary to postulate that the differences go back to species that preceded the appearance of the homo sapiens. (See the new and revised edition of Dr. Carleton S. Coon’s The Story of Man, New York, Knopf, 1962.)
That such differences exist is doubtless deplorable. It is certainly deplorable that all men must die, and there are persons who think it deplorable that there are differences, both anatomical and spiritual, between men and women. However, no amount of concerted lying by “liberals,” and no amount of decreeing by the Warren [Supreme Court] Gang, will in the least change the laws of nature.
Now there is a great deal that we do not know about genetics, both individual and racial, and these uncertainties permit widely differing estimates of the relative importance of biologically determined factors and cultural concepts in the development of a civilization. Our only point here is that it is highly improbable that biological factors have no influence at all on the origin and course of civilizations. And to the extent that they do have an influence, Spengler’s theory is defective and probably misleading.
Profound Insights
One could add a few minor points to the three objections stated above, but these will suffice to show that the Spenglerian historionomy cannot be accepted as a certainty. It is, however, a great philosophical formulation that poses questions of the utmost importance and deepens our perception of historical causality. No student of history needed Spengler to tell him that a decline of religious faith necessarily weakens the moral bonds that make civilized society possible. But Spengler’s showing that such a decline seems to have occurred at a definite point in the development of a number of fundamentally different civilizations with, of course, radically different religions provides us with data that we must take into account when we try to ascertain the true causes of the decline. And his further observation that the decline was eventually followed by a sweeping revival of religious belief is equally significant.
However wrong he may have been about some things, Spengler has given us profound insights into the nature of our own culture. But for him, we might have gone on believing that our great technology was merely a matter of economics — of trying to make more things more cheaply. But he has shown us, I think, that our technology has a deeper significance — that for us, the men of Western civilization, it answers a certain spiritual need inherent in us, and that we derive from its triumphs as satisfaction analogous to that which is derived from great music or great art.
And Spengler, above all, has forced us to inquire into the nature of civilization and to ask ourselves by what means — if any — we can repair and preserve the long and narrow dikes that alone protect us from the vast and turbulent ocean of eternal barbarism. For that, we must always honor him.
Journal of Historical Review, vol. 17, no. 2 (March-April 1998), 10-13.
00:07 Publié dans Philosophie, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, révolution conservatrice, oswald spengler, droite, conservatisme, civilisations, cultures, weimar, années 20, années 30 |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 23 août 2010
Paganismo y filosofia de la vida en Knut Hamsun y D. H. Lawrence
Paganismo y filosofía de la vida en Knut Hamsun y D.H. Lawrence
Robert STEUCKERS
Knut Hamsun en "Dikterstuen", Nørholm, 1930

Robert Steuckers*
El filólogo húngaro Akos Doma, formado en Alemania y los Estados Unidos, acaba de publicar una obra de exégesis literaria, en el que hace un paralelismo entre las obras de Hamsun y Lawrence. El punto en común es una “crítica de la civilización”. Concepto que, obviamente, debemos aprehender en su contexto. En efecto, la civilización sería un proceso positivo desde el punto de vista de los “progresistas”, que entienden la historia de forma lineal. En efecto, los partidarios de la filosofía del Aufklärung y los adeptos incondicionales de una cierta modernidad tienden a la simplificación, la geometrización y la “cerebrización”. Sin embargo, la civilización se nos muestra como un desarrollo negativo para todos aquellos que pretenden conservar la fecundidad inconmensurable de los veneros culturales, para quienes constatan, sin escandalizarse por ello, que el tiempo es plurimorfo; es decir, que el tiempo para una cultura no coincide con el de otra, en contraposición a los iluministas quienes se afirman en la creencia de un tiempo monomorfo y aplicable a todos los pueblos y culturas del planeta. Cada pueblo tiene su propio tiempo. Si la modernidad rechaza esta pluralidad de formas del tiempo, entonces entramos irremisiblemente en el terreno de lo ilusorio.
Desde un cierto punto de vista, explica Akos Doma, Hamsun y Lawrence son herederos de Rousseau. Pero, ¿de qué Rousseau? ¿Quién que ha sido estigmatizado por la tradición maurrasiana (Maurras, Lasserre, Muret) o aquél otro que critica radicalmente el Aufklärung sin que ello comporte defensa alguna del Antiguo Régimen? Para el Rousseau crítico con el iluminismo, la ideología moderna es, precisamente, el opuesto real del concepto ideal en su concepción de la política: aquél es antiigualitario y hostil a la libertad, aunque reivindique la igualdad y la libertad. Antes de la irrupción de la modernidad a lo largo del siglo XVIII, para Rousseau y sus seguidores prerrománticos, existiría una “comunidad sana”, la convivencia reinaría entre los hombres y la gente sería “buena” porque la naturaleza es “buena”. Más tarde, entre los románticos que, en el terreno político, son conservadores, esta noción de “bondad” seguirá estando presente, aunque en la actualidad tal característica se considere en exclusiva patrimonio de los activistas o pensadores revolucionarios. La idea de “bondad” ha estado presente tanto en la “derecha” como en “izquierda”.
Sin embargo, para el poeta romántico inglés Wordsworth, la naturaleza es “el marco de toda experiencia auténtica”, en la medida en que el hombre se enfrenta de una manera real e inmediatamente con los elementos, lo que implícitamente nos conduce más allá del bien y del mal. Wordsworth es, en cierta forma, un “perfectibilista”: el hombre fruto de su visión poética alcanza lo excelso, la perfección; pero dicho hombre, contrariamente a lo que pensaban e imponían los partidarios de las Luces, no se perfecciona sólo con el desarrollo de las facultades de su intelecto. La perfección humana requiere sobre todo pasar por la prueba de lo elemental natural. Para Novalis, la naturaleza es “el espacio de la experiencia mística, que nos permite ver más allá de las contingencias de la vida urbana y artificial”. Para Eichendorff, la naturaleza es la libertad y, en cierto sentido, una trascendencia, pues permite escapar a los corsés de las convenciones e instituciones.
Con Wordsworth, Novalis y Eichendorff, las cuestiones de lo inmediato, de la experiencia vital, del rechazo de las contingencias surgidas de la artificialidad de los convencionalismos, adquieren un importante papel. A partir del romanticismo se desarrolla en Europa, sobre todo en Europa septentrional, un movimiento hostil hacia toda forma moderna de vida social y económica. Carlyle, por ejemplo, cantará el heroísmo y denigrará a la “cash flow society”. Aparece la primera crítica contra el reino del dinero. John Ruskin, con sus proyectos de arquitectura orgánica junto a la concepción de ciudades-jardín, tratará de embellecer las ciudades y reparar los daños sociales y urbanísticos de un racionalismo que ha desembocado en puro manchesterismo. Tolstoi propone una naturalismo optimista que no tiene como punto de referencia a Dostoievski, brillante observador este último de los peores perfiles del alma humana. Gauguin transplantará su ideal de la bondad humana a la Polinesia, a Tahití, en plena naturaleza.
Hamsun y Lawrence, contrariamente a Tolstoi o a Gauguin, desarrollarán una visión de la naturaleza carente de teología, sin “buen fin”, sin espacios paradisiacos marginales: han asimilado la doble lección del pesimismo de Dostoievski y Nietzsche. La naturaleza en éstos no es un espacio idílico propicio para excursiones tal y como sucede con los poetas ingleses del Lake District. La naturaleza no sólo no es un espacio necesariamente peligroso o violento, sino que es considerado apriorísticamente como tal. La naturaleza humana en Hamsun y Lawrence es, antes de nada, interioridad que conforma los resortes interiores, su disposición y su mentalidad (tripas y cerebro inextricablemente unidos y confundidos). Tanto en Hamsun como en Lawrence, la naturaleza humana no es ni intelectualidad ni demonismo. Es, antes de nada, expresión de la realidad, realidad traducción inmediata de la tierra, Gaia; realidad en tanto que fuente de vida.

D H Lawrence
Frente a este manantial, la alienación moderna conlleva dos actitudes humanas opuestas: 1.º necesidad de la tierra, fuente de vitalidad, y 2.º zozobra en la alienación, causa de enfermedades y esclerosis. Es precisamente en esa bipolaridad donde cabe ubicar las dos grandes obras de Hamsun y de Lawrence: Bendición de la tierra, para el noruego, y El arcoiris del inglés.
En Bendición de la tierra de Hamsun, la naturaleza constituye el espacio el trabajo existencial donde el hombre opera con total independencia para alimentarse y perpetuarse. No se trata de una naturaleza idílica, como sucede en ciertos utopistas bucólicos, y además el trabajo no ha sido abolido. La naturaleza es inabarcable, conforma el destino, y es parte de la propia humanidad de tal forma que su pérdida comportaría deshumanización. El protagonista principal, el campesino Isak, es feo y desgarbado, es tosco y simple, pero inquebrantable, un ser limitado, pero no exento de voluntad. El espacio natural, la Wildnis, es ese ámbito que tarde o temprano ha de llevar la huella del hombre; no se trata del espacio o el reino del hombre convencional o, más exactamente, el acotado por los relojes, sino el del ritmo de las estaciones, con sus ciclos periódicos. En dicho espacio, en dicho tiempo, no existen interrogantes, se sobrevive para participar al socaire de un ritmo que nos desborda. Ese destino es duro. Incluso llega a ser muy duro. Pero a cambio ofrece independencia, autonomía, permite una relación directa con el trabajo. Otorga sentido, porque tiene sentido. En El arcoiris, de Lawrence, una familia vive de forma independiente de la tierra con el único beneficio de sus cosechas.
Hamsun y Lawrence, en estas dos novelas, nos legan la visión de un hombre unido al terruño (ein beheimateter Mensch), de un hombre anclado a un territorio limitado. El beheimateter Mensch ignora el saber libresco, no tiene necesidad de las prédicas de los medios informativos, su sabiduría práctica le es suficiente; gracias a ella, sus actos tienen sentido, incluso cuando fantasea o da rienda suelta a los sentimientos. Ese saber inmediato, además, le procura unidad con los otros seres.
Desde una óptica tal, la alienación, cuestión fundamental en el siglo XIX, adquiere otra perspectiva. Generalmente se aborda el problema de la alienación desde tres puntos de vista doctrinales:
1.º Según el punto de vista marxista e historicista, la alienación se localizaría únicamente en la esfera social, mientras que para Hamsun o Lawrence, se sitúa en la naturaleza interior del hombre, independientemente de su posición social o de su riqueza material.
2.º La alienación abordada a partir de la teología o la antropología.
3.º La alienación percibida como una anomalía social.

D H Lawrence
En Hegel, y más tarde en Marx, la alienación de los pueblos o de las masas es una etapa necesaria en el proceso de adecuación gradual entre la realidad y el absoluto. En Hamsun y Lawrence, la alienación es un concepto todavía más categórico; sus causas no residen en las estructuras socioeconómicas o políticas, sino en el distanciamiento con respecto a las raíces de la naturaleza (que no es, en consecuencia, una “buena” naturaleza). No desaparecerá la alienación con la simple instauración de un nuevo orden socioeconómico. En Hamsun y Lawrence, señala Doma, es el problema de la desconexión, de la cesura, el que tiene un rango esencial. La vida social ha devenido uniforme, desemboca en la uniformidad, la automatización, la funcionalización a ultranza, mientras que la naturaleza y el trabajo integrado en el ciclo de la vida no son uniformes y requieren en todo momento la movilización de energías vitales. Existe inmediatez, mientras que en la vida urbana, industrial y moderna todo está mediatizado, filtrado. Hamsun y Lawrence se rebelan contra dichos filtros.
Para Hamsun y, en menor medida, Lawrence las fuerzas interiores cuentan para la “naturaleza”. Con la llegada de la modernidad, los hombres están determinados por factores exteriores a ellos, como son los convencionalismos, la lucha política y la opinión pública, que ofrecen una suerte de ilusión por la libertad, cuando en realidad conforman el escenario ideal para todo tipo de manipulaciones. En un contexto tal, las comunidades acaba por desvertebrarse: cada individuo queda reducido a una esfera de actividad autónoma y en concurrencia con otros individuos. Todo ello acaba por derivar en debilidad, aislamiento y hostilidad de todos contra todos.
Los síntomas de esta debilidad son la pasión por las cosas superficiales, los vestidos refinados (Hamsun), signo de una fascinación detestable por lo externo; esto es, formas de dependencia, signos de vacío interior. El hombre quiebra por efecto de presiones exteriores. Indicios, al fin y a la postre, de la pérdida de vitalidad que conlleva la alienación.
En el marco de esta quiebra que supone la vida urbana, el hombre no encuentra estabilidad, pues la vida en las ciudades, en las metrópolis, es hostil a cualquier forma de estabilidad. El hombre alienado ya no puede retornar a su comunidad, a sus raíces familiares. Así Lawrence, con un lenguaje menos áspero pero acaso más incisivo, escribe: “He was the eternal audience, the chorus, the spectator at the drama; in his own life he would have no drama” (“Era la audiencia eterna, el coro, el espectador del drama; pero en su propia vida, no había drama alguno”); “He scarcely existed except through other people” (“Apenas existía, salvo en medio de otras personas”); “He had come to a stability of nullification” (“Había llegado a una estabilidad que lo había anulado”).
En Hamsun y Lawrence, el Ent-wurzelung y el Unbehaustheit, el desarraigo y la carencia de hogar, esa forma de vivir sin fuego, constituye la gran tragedia de la humanidad de finales del siglo XIX y principios del XX. Para Hamsun el hogar es vital para el hombre. El hombre debe tener hogar. El hogar de su existencia. No se puede prescindir del hogar sin autoprovocarse una profunda mutilación. Mutilación de carácter psíquico, que conduce a la histeria, al nerviosismo, al desequilibro. Hamsun es, al fin y al cabo, un psicólogo. Y nos dice: la conciencia de sí es a menudo un síntoma de alienación. Schiller, en su ensayo Über naive und sentimentalische Dichtung, señalaba que la concordancia entre sentir y pensar era tangible, real e interior en el hombre natural, al contrario que en el hombre cultivado que es ideal y exterior (“La concordancia entre sensaciones y pensamiento existía antaño, pero en la actualidad sólo reside en el plano ideal. Esta concordancia no reside en el hombre, sino que existe exteriormente a él; se trata de una idea que debe ser realizada, no un hecho de su vida”).
Schiller aboga por una Überwindung (superación) de dicha quiebra a través de una movilización total del individuo. El romanticismo, por su parte, considerará la reconciliación entre Ser (Sein) y conciencia (Bewußtsein) como la forma de combatir el reduccionismo que trata de arrinconar la conciencia bajo los corsés de entendimiento racional. El romanticismo valorará, e incluso sobrevalorará, al “otro” con relación a la razón (das Andere der Vernunft): percepción sensual, instinto, intuición, experiencia mística, infancia, sueño, vida bucólica. Wordsworth, romántico inglés, representante “rosa” de dicha voluntad de reconciliación entre Ser y conciencia, defenderá la presencia de “un corazón que observe y apruebe”. Dostoievski no compartirá dicha visión “rosa” y desarrollará una concepción “negra”, donde el intelecto es siempre causa de mal, y el “poseso” un ser que tenderá a matar o a suicidarse. En el plano filosófico, tanto Klages como Lessing retomarán por su cuenta esta visión “negra” del intelecto, profundizando, no obstante, en la veta del romanticismo naturalista: para Klages, el espíritu es enemigo del alma; para Lessing, el espíritu es la contrapartida de la vida, que surge de la necesidad (“Geist ist das notgeborene Gegenspiel des Lebens”).
Lawrence, fiel en cierto sentido a la tradición romántica inglesa de Wordsworth, cree en una nueva adecuación del Ser y la conciencia. Hamsun, más pesimista, más dostoievskiano (de ahí su acogida en Rusia y su influencia en los autores llamados ruralistas, como Vasili Belov y Valentín Rasputín), nunca dejará de pensar que desde que hay conciencia, hay alienación. Desde que el hombre comienza a reflexionar sobre sí mismo, se desliga de la continuidad que confiere la naturaleza y a la cual debiera estar siempre sujeto. En los ensayos de Hamsun, encontramos reflexiones sobre la modernidad literaria. La vida moderna, ha escrito, influye, transforma, lleva al hombre a arrancarlo de su destino, a apartarlo de su punto de llegada, de sus instintos, más allá del bien y del mal. La evolución literaria del siglo XIX muestra una fiebre, un desequilibrio, un nerviosismo, una complicación extrema de la psicología humana. “El nerviosismo general (ambiente) se ha adueñado de nuestro ser fundamental y se ha fijado en nuestra vida sentimental”. El escritor se nos muestra así, al estilo de un Zola, como un “médico social” encargado de diagnosticar los males sociales con objeto de erradicar el mal. El escritor, el intelectual, se embarca en una tarea misionera que trata de llegar a una “corrección política”.

Nietzsche con el uniforme de artillero prusiano, 1868
Frente a esta visión intelectual del escritor, el reproche de Hamsun señala la imposibilidad de definir objetivamente la realidad humana, pues un “hombre objetivo” es, en sí mismo, una monstruosidad (ein Unding), un ser construido como si de un mecano se tratase. No podemos reducir al hombre a un compendio de características, pues el hombre es evolución, ambigüedad. El mismo criterio encontramos en Lawrence: “Now I absolutely flatly deny that I am a soul, or a body, or a mind, or an intelligence, or a brain, or a nervous system, or a bunch of glands, or any of the rest of these bits of me. The whole is greater than the part” (“Bien, yo niego absoluta y francamente ser un alma, o un cuerpo, o un espíritu, o una inteligencia, o un cerebro, o un sistema nervioso, o un conjunto de glándulas, o cualquier otra parte de mí mismo. El todo es más grande que las partes”). Hamsun y Lawrence ilustran en sus obras la imposibilidad de teorizar o absolutizar una visión diáfana del hombre. El hombre no puede ser vehículo de ideas preconcebidas. Hamsun y Lawrence confirman que los progresos en la conciencia de uno mismo no conllevan procesos de emancipación espiritual, sino pérdidas, despilfarro de la vitalidad, del tono vital. En sus novelas, son las figuras firmes (esto es, las que están arraigadas a la tierra) las que logran mantenerse, las que triunfan más allá de los golpes de suerte o las circunstancias desgraciadas.
No se trata, en absoluto, repetimos, de vidas bucólicas o idílicas. Los protagonistas de las novelas de Hamsun y Lawrence son penetrados o atraídos por la modernidad, los cuales, pese a su irreductible complejidad, pueden sucumbir, sufren, padecen un proceso de alienación, pero también pueden triunfar. Y es precisamente aquí donde intervienen la ironía de Hamsun o la idea del “Fénix” de Lawrence. La ironía de Hamsun taladra los ideales abstractos de las ideologías modernas. En Lawrence, la recurrente idea del “Fénix” supone una cierta dosis de esperanza: habrá resurrección. Es la idea de Ave Fénix, que renace de sus propias cenizas.
El paganismo de Hamsun y Lawrence
Si dicha voluntad de retorno a una ontología natural es fruto de un rechazo del intelectualismo racionalista, ello implica al mismo tiempo una contestación de calado al mensaje cristiano.
En Hamsun, se ve con claridad el rechazo del puritanismo familiar (concretado en la figura de su tío Han Olsen) y el rechazo al culto protestante por los libros sagrados; esto es, el rechazo explícito de un sistema de pensamiento religioso que prima el saber libresco frente a la experiencia existencial (particularmente la del campesino autosuficiente, el Odalsbond de los campos noruegos). El anticristianismo de Hamsun es, fundamentalmente, un acristianismo: no se plantea dudas religiosas a lo Kierkegaard. Para Hamsun, el moralismo del protestantismo de la era victoriana (de la era oscariana, diríamos para Escandinavia) es simple y llanamente pérdida de vitalidad. Hamsun no apuesta por experiencia mística alguna.
Lawrence, por su parte, percibe la ruptura de toda relación con los misterios cósmicos. El cristianismo vendría a reforzar dicha ruptura, impediría su cura, imposibilitaría su cicatrización. En este sentido, la religiosidad europea aún conservaría un poso de dicho culto al misterio cósmico: el año litúrgico, el ciclo litúrgico (Pascua, Pentecostés, Fuego de San Juan, Todos los Santos, Navidad, Fiesta de los Reyes Magos). Pero incluso éste ha sido aherrojado como consecuencia de un proceso de desencantamiento y desacralización, cuyo comienzo arranca en el momento mismo de la llegada de la Iglesia cristiana primitiva y que se reforzará con los puritanismos y los jansenismos segregados por la Reforma. Los primeros cristianos se plantearon como objetivo apartar al hombre de sus ciclos cósmicos. La Iglesia medieval, por el contrario, quiso adecuarse, pero las Iglesias protestantes y conciliares posteriores han expresado con claridad su voluntad de regresar al anticosmicismo del cristianismo primitivo. En este sentido, Lawrence escribe: “But now, after almost three thousand years, now that we are almost abstracted entirely from the rhythmic life of the seasons, birth and death and fruition, now we realize that such abstraction is neither bliss nor liberation, but nullity. It brings null inertia” (“Pero hoy, después de tres mil años, después que estamos casi completamente abstraídos de la vida rítmica de las estaciones, del nacimiento, de la muerte y de la fecundidad, comprendemos al fin que tal abstracción no es ni una bendición ni una liberación, sino pura nada. No nos aporta otra cosa que inercia”). Esta ruptura es consustancial al cristianismo de las civilizaciones urbanas, donde no hay apertura alguna hacia el cosmos. Cristo no es un Cristo cósmico, sino un Cristo rebajado al papel de asistente social. Mircea Eliade, por su parte, se ha referido a un “hombre cósmico”, abierto a la inmensidad del cosmos, pilar de todas las grandes religiones. En la perspectiva de Eliade, lo sagrado es lo real, el poder, la fuente de vida y de la fertilidad. Eliade nos ha dejado escrito: “El deseo del hombre religioso de vivir una vida en el ámbito de lo sagrado es el deseo de vivir en la realidad objetiva”.

Knut Hamsun, 1927
La lección ideológica y política de Hamsun y Lawrence
En el plano ideológico y político, en el plano de la Weltanschauung, las obras de Hamsun y de Lawrence han tenido un impacto bastante considerable. Hamsun ha sido leído por todos, más allá de la polaridad comunismo/fascismo. Lawrence ha sido etiquetado como “fascista” a título póstumo, entre otros por Bertrand Russell que llegó incluso a referirses a su “madness”: “Lawrence was a suitable exponent of the Nazi cult of insanity” (“Lawrence fue un exponente típico del culto nazi a la locura”). Frase tan lapidaria como simplista. Las obras de Hamsun y de Lawrence, sgún Akos Doma, se inscriben en un cuádruple contexto: el de la filosofía de la vida, el de los avatares del individualismo, el de la tradición filosófica vitalista, y el del antiutopismo y el irracionalismo.
1.º La filosofía de la vida (Lebensphilosophie) es un concepto de lucha, que opone la “vivacidad de la vida real” a la rigidez de los convencionalismos, a los fuegos de artificio inventados por la civilización urbana para tratar de orientar la vida hacia un mundo desencantado. La filosofía de la vida se manifiesta bajo múltiples rostos en el contexto del pensamiento europeo y toma realmente cuerpo a partir de la reflexiones de Nietzsche sobre la Leiblichkeit (corporeidad).
2.º El individualismo. La antropología hamsuniana postula la absoluta unidad de cada individuo, de cada persona, pero rechaza el aislamiento de ese individuo o persona de todo contexto comunitario, familiar o carnal: sitúa a la persona de una manera interactiva, en un lugar preciso. La ausencia de introspección especulativa, de conciencia y de intelectualismo abstracto hacen incompatible el individualismo hamsuniano con la antropología segregada por el Iluminismo. Para Hamsun, sin embargo, no se combate el individualismo iluminista sermoneando sobre un colectivismo de contornos ideológicos. El renacimiento del hombre auténtico pasa por una reactivación de los resortes más profundos de su alma y de su cuerpo. La suma cuantitativa y mecánica es una insuficiencia calamitosa. En consecuencia, la acusación de “fascismo” hacia Lawrence y Hamsun no se sostiene en pie.
3.º El vitalismo tiene en cuenta todos los acontecimientos de la vida y excluye cualquier jerarquización de base racial, social, etc. Las oposiciones propias del vitalismo son: afirmación de la vida / negación de la vida; sano / enfermo; orgánico / mecánico. De ahí, que no se pueda reconducirlas a categorías sociales, a categorías políticas convencionales, etc. La vida es una categoría fundamental apolítica, pues todos los hombres sin distinción están sometidos a ella.
4.º El “irracionalismo” reprochado a Hamsun y Lawrence, igual que su antiutopismo, tienen su base en una revuelta contra la “viabilidad” (feasibility; Machbarkeit), contra la idea de perfectibilidad infinita (que encontramos también bajo una forma “orgánica” en los románticos ingleses de la primera generación). La idea de viabilidad choca directamente con la esencia biológica de la naturaleza. De hecho, la idea de viabilidad es la esencia del nihilismo, como ha apuntado el filósofo italiano Emanuele Severino. Para Severino, la viabilidad deriva de una voluntad de completar el mundo aprehendiéndolo como un devenir (pero no como un devenir orgánico incontrolable). Una vez el proceso de “acabamiento” ha concluido, el devenir detiene bruscamente su curso. Una estabilidad general se impone en la Tierra y esta estabilidad forzada es descrita como un “bien absoluto”. Desde la literatura, Hamsun y Lawrence, han precedido así a filósofos contemporáneos como el citado Emanuele Severino, Robert Spaemann (con su crítica del funcionalismo), Ernst Behler (con su crítica de la “perfectibilidad infinita”) o Peter Koslowski. Estos filósofos, fuera de Alemania o Italia, son muy poco conocidos por el gran público. Su crítica a fondo de los fundamentos de las ideologías dominantes, provoca inevitablemente el rechazo de la solapada inquisición que ejerce su dominio en París.
Nietzsche, Hamsun y Lawrence, los filósofos vitalistas o, si se prefiere, “antiviabilistas”, al insistir sobre el carácter ontológico de la biología humana, se opusieron a la idea occidental y nihilista de la viabilidad absoluta de cualquier cosa; esto es, de la inexistencia ontológica de todas las cosas, de cualquier realidad. Buen número de ellos —Hamsun y Lawrence incluidos— nos llaman la atención sobre el presente eterno de nuestros cuerpos, sobre nuestra propia corporeidad (Leiblichkeit), pues nosotros no podemos conformar nuestros cuerpos, en contraposición a esas voces que nos quieren convencer de las bondades de la ciencia-ficción.
La viabilidad es, pues, el “hybris” que ha llegado a su techo y que conduce a la fiebre, la vacuidad, la ligereza, el solipsismo y el aislamiento. De Heidegger a Severino, la filosofía europea se ha ocupado sobre la catástrofe que ha supuesto la desacralización del Ser y el desencantamiento del mundo. Si los resortes profundos y misteriosos de la Tierra o del hombre son considerados como imperfecciones indignas del interés del teólogo o del filósofo, si todo aquello que ha sido pensado de manera abstracta o fabricado más allá de los resortes (ontológicos) se encuentra sobrevalorado, entonces, efectivamente, no puede extrañarnos que el mundo pierda toda sacralidad, todo valor. Hamsun y Lawrence han sido los escritores que nos han hecho vivir con intensidad dicha constante, por encima incluso de algunos filósofos que también han deplorado la falsa ruta emprendida por el pensamiento occidental desde hace siglos. Heidegger y Severino en el marco de la filosofía, Hamsun y Lawrence en el de la creación literaria, han tratado de restituir la sacralidad en el mundo y revalorizar las fuerzas que se esconden en el interior del hombre: desde ese punto de vista, estamos ante pensadores ecológicos en la más profunda acepción del término. El oikos nos abre las puertas de lo sagrado, de las fuerzas misteriosas e incontrolables, sin fatalismos y sin falsa humildad. Hamsun y Lawrence, en definitiva, anunciaron la dimensión geofilosófica del pensamiento que nos ha ocupado durante toda esta universidad de verano. Una aproximación sucinta a sus obras se hacía absolutamente necesaria en el temario de 1996.
________________
* Comentario al libro de Akos Doma, Die andere Moderne. Knut Hamsun, D.H. Lawrence und die lebensphilosophische Strömung des literarischen Modernismus (Bouvier, Bonn, 1995), leído como conferencia en Lombardía, en julio de 1996. Traducción de Juan C. García Morcillo.
[Tomo el artículo del archivo de su fuente primera, la asociación Sinergias Europeas, que editaba el boletín InfoEuropa. Ya no cabalgan.]
00:10 Publié dans Littérature, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres norvégiennes, lettres scandinaves, lettres anglaises, littérature anglaise, littérature norvégienne, littérature scandinave, norvège, angleterre, scandinavie, paganisme, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Heidegger "The Nazi"
Heidegger “The Nazi”
Ex: http://www.counter-currents.com/
 Emmanuel Faye
Emmanuel Faye
Heidegger: The Introduction of Nazism into Philosophy in Light of the Unpublished Seminars of 1933-1935
Trans. Michael B. Smith, foreword Tom Rockmore
New Haven: Yale University Press, 2009
National Socialism was defeated on the field of battle, but it wasn’t defeated in the realm of thought.
Indeed, it’s undefeatable there because the only thing its enemies can do to counter its insidious ideas is to ban those thinkers, like Martin Heidegger, whose works might attract those wanting to know why National Socialism is undefeatable and why its world view continues to seduce the incredulous.
Or, at least, so thinks Emmanuel Faye in his recently translated Heidegger, l’introduction du nazisme dans la philosophie (Paris: Albin Michel, 2005).
Why, though, all this alarmed concern about a difficult, some say unreadable, philosopher of the last century?
The reason, Tom Rockmore says, is that he lent “philosophical cover to some of the darkest impulses that later led to Nazism, World War II, and the Holocaust.”
One.
The Scandal
Faye’s book is part of a larger publishing phenomenon — in all the major European languages — related to the alleged National Socialism of the great Freiburg philosopher.
Like many prominent German academics of his age, Heidegger joined Hitler’s NSDAP shortly after the National Revolution of 1933.
He was subsequently made rector of the University of Freiburg, partly on the basis of his party affiliation, and in a famous rectorial address — “The Self-Assertion of the German University” — proposed certain reforms that sought to free German universities from “Jewish and modernist influences,” reorienting it in this way to the needs and destiny of the newly liberated Volksgemeinschaft.
Heidegger’s role as a public advocate of National Socialist principles did not, however, last very long. Within a year of his appointment, he resigned the rectorship.
As he told the de-Nazification tribunal in 1945, his resignation was due to his frustration in preventing state interference in university affairs, a frustration that soon turned him away from all political engagements.
The story he told to the liberal inquisitors (which most Heideggerians accepted up to about 1988) was one in which a politically naive academic, swept up in the revolution’s excitement, had impulsively joined the party, only to become quickly disillusioned.
The story’s “dissimulations and falsehoods” were, indeed, good enough to spare him detention in a Yankee prison — unlike, say, Carl Schmitt who was incarcerated for two years after the war (though the only “Americans” Schmitt ever encountered there were German Jews in the conquerors’ uniform) — but not good enough to avoid a five-year ban on teaching.
In any case, it has always been known that Heidegger had at least a brief “flirtation” with “Nazism.”
Given the so-called “negligibility” of his National Socialism, he was able, after his ban, to resume his position as Germany’s leading philosopher. By the time of his death (1976), he had become the most influential philosopher in the Western world. His books have since been translated into all the European languages (and some non-European ones), his ideas have come to dominate contemporary continental thought, and they have even established a beachhead in the stultifying world of the Anglo-American academy, renowned for its indifference to philosophical issues.
Despite Heidegger’s enormous influence as “the century’s greatest philosopher,” he never quite shed the stigma of his early brush with National Socialism. This was especially the case after 1987 and 1988.
For in late 1987 a little known Chilean-Jewish scholar, Victor Farìas, produced the first book-length examination of Heidegger’s “brush” with National Socialist politics.
His Heidegger and Nazism was not a particularly well-researched work, and there was a good deal of speculation and error in it.
It nevertheless blew apart the story Heidegger had told his American inquisitors in 1945, revealing that he had been a party member between 1933 and 1945; that his National Socialism was something more than the flirtation of a politically naive philosopher; and that his affiliation with the Third Reich was anything but “fleeting, casual, or accidental but [rather] central to his philosophical enterprise.”
This “revelation” — that the greatest philosophical mind of the 20th century had been a devoted Hitlerite — provoked a worldwide scandal.
In the year following Farìas’ work, at least seven books appeared on the subject.
The most impressive of these was by Hugo Ott, a German historian, whose Martin Heidegger: A Political Life (1994) lent a good deal of historically-documented substance to Farìas’ charges.
In the decades since the appearance of Farìas’ and Ott’s work, a “slew” of books and articles (no one is counting any more) have continued to probe the dark recesses of Heidegger’s scandalous politics.
Almost every work in the vast literature devoted to Heideggerian philosophy must now, in testament to the impact of these studies, begin with some sort of “reckoning” with his “Nazism” — a reckoning that usually ends up erecting a wall between his philosophy and his politics.
In this context, Emmanuel Faye’s book is presently being touted as the “best researched and most damaging” work on Heidegger’s National Socialism — one that aims to tear down the wall compartmentalizing his politics and to brand him, once and for all, as an apologist for “the greatest crime of the 20th century.”
It’s fitting that Faye, an assistant professor of philosophy at the University of Paris-Nanterre, is French, for nowhere else have Heidegger’s ideas been as influential as in France.
Heidegger began appearing in French translation as early as the late 1930s. The publication in 1943 of Jean-Paul Sartre’s Being and Nothingness, based on a misreading of Heidegger, gave birth to “existentialism,” which dominated Western thought in the late 1940s and 1950s, helping thus to popularize certain Heideggerian ideas.
At the same time, French thinkers were the first to pursue the issue of Heidegger’s alleged National Socialism.
Karl Löwith, one of the philosopher’s former Jewish students exiled in France, argued in 1946 that Heidegger’s politics was inseparable from his philosophical thought. Others soon joined him in making similar arguments.
Though Löwith’s critique of Heidegger appeared in Les Temps Modernes, Sartre’s famous journal, the ensuing, often quite heated, French controversy was mainly restricted to scholarly journals. Faye’s father, Jean-Pierre Faye, also a philosopher, figured prominently in these debates during the 1960s.
It was, though, only with Farìas and Ott that the debate over Heidegger’s relationship to the Third Reich spread beyond the academic journals and touched the larger intellectual public.
This debate continues to this day.
Part of the difficulty in determining the exact degree and nature of Heidegger’s political commitment after 1933 is due to the fact that Heidegger’s thought bears on virtually every realm of contemporary European intellectual endeavor, on the right as well as the left, and that there’s been, as a consequence, a thoughtful unwillingness to see Heidegger’s National Socialism as anything other than contingent — and thus without philosophical implication.
This unwillingness has been compounded by the fact that the Heidegger archives at Marbach are under the control of Heidegger’s son, Hermann, who controls scholarly access to them, hindering, supposedly, an authoritative account of Heidegger’s thinking in the period 1933-1945.
Moreover, only eighty of the planned 120 volumes of Heidegger’s Gesamtausgabe have thus far appeared and, as Faye contends, these are not “complete,” for the family has allegedly prevented the more “compromising” works from being published.
The authority of Faye’s Heidegger — which endeavors to eliminate everything separating his politics from his philosophy — rests on two previously unavailable seminars reports from the key 1933-34 period, as well as certain documents, letters, and other evidence, which have appeared in little known or obscure German publications — evidence he sees as “proving” that Heidegger’s “Nazism” was anything but contingent — and that this “Nazism” was, in fact, not only inseparable from his thought, but formative of its core.
On this basis, along with Heidegger’s collaboration with certain NSDAP thinkers, Faye claims that the philosophy of the famous Swabian is so infused with National Socialist principles that it ought no longer to be treated as philosophy at all, but, instead, banned as “Nazi propaganda.”
Two.
Faye’s Argument
Heidegger’s seminars of 1933 and 1934, in Emmanuel Faye’s view, expose the “fiction” that separates Heidegger’s philosophy from his politics. For these seminars reveal a brown-shirted fanatic who threw himself into the National Revolution, hoping to become Hitler’s philosophical mentor.
At the same time, Faye argues that Heidegger’s work in the 1920s, particularly his magnum opus, Being and Time (1927), was already infected with pre-fascist ideas, just as his postwar work, however much it may have resorted to a slightly different terminology, would continue to propagate National Socialist principles.
Earlier, however, when the young Heidegger was establishing himself in the world of German academic philosophy (the 1920s), there is very little public evidence of racial or anti-Jewish bias in his work. To explain this, Faye quotes Heidegger to the effect that “he wasn’t going to say what he thought until after he became a full professor.” His reticence on these matters was especially necessary given that his “mentor,” Edmund Husserl, was Jewish and that he needed Husserl’s support to replace him at Freiburg.
(For those militant Judeophobes who might think this is somehow compromising, let me point out that Wilhelm Stapel [1882-1954], after also doing a doctorate in Husserlian phenomenology, was a Protestant, nationalist, and anti-Semitic associate of the Conservative Revolution who played an important early role in NSDAP politics.)
Faye nevertheless claims that Heidegger’s early ideas, especially those of Being and Time, were already disposed to themes and principles that were National Socialist in nature.
In Being and Time, for example, Heidegger rejects the Cartesian cogito, Kant’s transcendental analytic, Husserlian phenomenology — along with every other bloodless rationalism dominating Western thought since the 18th century — for the sake of an analysis based on “existentials” (i.e., on man’s being in the world).
Like other intellectual members of Hitler’s party, Heidegger disparaged all forms of universalist thought, dismissing not only notions of man as an individual, but notions of the human spirit as pure intellect and reason.
In repudiating universalist, humanist, and individualist thought associated with liberal modernity, Faye’s Heidegger is seen not as contesting the underlying principles of liberal modernity, which he, as a former Catholic traditionalist, thought responsible for the alienation, rootlessness, and meaninglessness of the contemporary world. Rather he is depicted as preparing the way for the “Nazi” notion of an organic national community (Volksgemeinschaft) based on racial and anti-Jewish criteria.
Revealingly, this is about as far as Faye goes in treating Heidegger’s early thought. In fact, there is very little philosophical analysis at all of Being and Time or any other work in his book. Every damning criticism he makes of Heidegger is based on Heidegger’s so-called affinity with National Socialist themes or ideas — or what a liberal defending a Communist would call guilt by association.
Worse, Faye lacks any historical understanding of National Socialism, failing to see it as part of a larger anti-liberal movement that had emerged before Hitler was even born and which influenced Heidegger long before he had heard of the Führer.
For our crusading anti-fascist professor, however, the anti-liberal, anti-individualist, and anti-modern contours of Heideggerian thought are simply Hitlerian — because of their later association with Hitler’s movement — unrelated to whatever earlier influences that may have affected the development of his thought. Q.E.D.
Faye, though, fails to make the case that Heidegger’s pre-1933 thought was “Nazi,” both because he’s indifferent to Heidegger’s philosophical argument in Being and Time, which he dismisses in a series of rhetorical strokes, and, secondarily, because he doesn’t understand the historical/cultural context in which Heidegger worked out his thought.
More generally, he claims Heidegger negated “the human truths that are the underlying principle of philosophy” simply because whatever doesn’t accord with Faye’s own liberal understanding of philosophy (which, incidentally, rationalizes the radical destructurations that have come with the “Disneyfication, MacDonaldization, and globalization” of our coffee-colored world) is treated as inherently suspect.
Only on the basis of the 1933-34 and ‘34-35 seminars does Faye have a case to make.
For the Winter term of 1933-34 Heidegger led a seminar “On the Essence and Concepts of Nature, History, and State.” If Faye’s account of the unpublished seminar report is accurate (and it’s hard to say given the endless exaggerations and distortions that run through his book), Heidegger outdid himself in presenting National Socialist doctrines as the philosophical basis for the new relationship that was to develop between the German people and their new state.
Like other National Socialists, Heidegger in this seminar views the “people” in völkisch terms presuming their “unity of blood and stock.”
Faye is particularly scandalized by the fact that Heidegger values the “people” (Volk) more than the “individual” and that the people, as an organic community of blood and spirit, excludes Jews and exalts its own particularity.
In this seminar, Heidegger goes even further, calling for a “Germanic state for the German nation,” extending his racial notion of the people to the political system, as he envisages the “will of the people” as finding embodiment in the will of the state’s leader (Führer).
Faye contends that people and state exist for Heidegger in the same relation as beings exist in relation to Being.
As such, Heidegger links ontology to politics, as the “question of all questions” (the “question of being”) is identified with the question of Germany’s political destiny.
Heidegger’s rejection of the humanist notion of the individual and of Enlightenment universalism in his treatment of Volk and Staat are, Faye thinks, synonymous with Hitlerism.
Though Faye’s argument here is more credible, it might also be pointed out that Heidegger’s privileging of the national community over the interests and freedoms of the individual has a long genealogy in German thought (unlike Anglo-American thought, which privileges the rational individual seeking to maximize his self-interest in the market).
The second seminar, in the Winter term of 1934-35, “On the State: Hegel,” again supports Faye’s case that Heidegger was essentially a “Nazi” propagandist and not a true philosopher. For in this seminar, he affirms the spirit of the new National Socialist state in Hegelian terms, spreading the “racist and human-life destroying conceptions that make up the foundations of Hitlerism.”
In both courses, Faye sees Heidegger associating and merging philosophy with National Socialism.
For this reason, his work ought not to be considered a philosophy at all, but rather a noxious political ideology.
Faye, in fact, cannot understand how Heidegger’s insidious project has managed to “procure a planetary public” or why he is so widely accepted as a great philosopher.
Apparently, Heidegger had the power to seduce the public — though on the basis of Faye’s account, it’s difficult to see how the political hack he describes could have pulled this off.
In any case, Faye warns that if Heidegger isn’t exposed for the political charlatan he is, terrible things are again possible. “Hitlerism and Nazism will continue to germinate through Heidegger’s writings at the risk of spawning new attempts at the complete destruction of thought and the extermination of humankind.”
Three.
Race and State

From the above, the reader might conclude that Faye’s Heidegger is a wreck of a book. And, in large part, it is, as I will discuss in the conclusion.
However, even the most disastrous wrecks (and this one bears the impressive moniker of Yale University Press) usually leave something to be salvaged. There are, as such, discussions on the subjects of “race” and “the state,” which I thought might interest TOQ readers.
A) Race
National Socialism, especially its Hitlerian distillation, was a racial nationalism.
Yet Heidegger, as even his enemies acknowledge, was contemptuous of what at the time was called “biologism.”
Biologism is the doctrine, still prevalent in white nationalist ranks, that understands human races in purely zoological and materialist terms, as if men were no different from the lower life forms — slabs of meat whose existence is a product of genetics alone.
Quite naturally, Heidegger’s anti-biologism was a problem for Faye, for how was it possible to claim that Heidegger was a “Nazi racist,” if he rejected this seemingly defining aspect of racial thought?
In an earlier piece (”Freedom’s Racial Imperative: A Heideggerian Argument for the Self-Assertion of Peoples of European Descent,” TOQ, vol. 6, no. 3), I reconstructed the racial dimension of Heidegger’s thought solely on the basis of his philosophy.
But Faye, who obviously doesn’t put the same credence in Heidegger’s thought, is forced, as an alternative, to historically investigate the different currents of NSDAP racial doctrine.
In his account (which should be taken as suggestive rather than authoritative), the party, in the year after the revolution, divided into two camps vis-à-vis racial matters: the camp of the Nordicists and that of the Germanists.
The Nordicists were led by Hans K. Günther, a former philologist, and had a “biologist” notion of race, based on evolutionary biology, which sought, through eugenics, to enhance the “Nordic blood” in the German population.
By contrast, the Germanists, led by the biologist Fritz Merkenschlager and supported especially by the less Nordic South Germans, held that blood implied spirit and that spirit played the greater role in determining a people’s character. (This ought not to be confused with Klages’ “psychologism.”)
The Germanists, as such, pointed out that Scandinavians were far more Nordic than Germans, yet their greater racial “purity” did not make them a greater people than the Germans, as Günther’s criteria would lead one to believe.
Rather, it was the Germans’ extraordinary Prussian spirit (this wonder of nature and Being) that made them a great nation.
This is not to say that the Germanists rejected the corporal or biological basis of their Volk — only that they believed their people’s blood could not be separated from their spirit without misunderstanding what makes them a people.
For the Germanists, then, race was not exclusively a matter of biological considerations alone, as Günther held, but rather a matter of blood and spirit.
(As an aside, I might mention that Julius Evola, whose idea of race represents, in my view, the highest point in the development of 20th-century racial thought, was much influenced by this debate, especially by Ludwig Ferdinand Clauss, whose raciology was a key component of the Germanist conception, emphasizing as it does the fact that one’s idea of race is ultimately determined by one’s conception of human being.)
Faye claims that, in a speech delivered in August 1933, Hitler emphasized the spiritual determinants of race, in language similar to Heidegger’s, and that he thus came down on the side of the Germanists.
The key point here is that, for Faye, the “völkisch racism” of the Germanists was no less “racist” than that of the biological racialists — implying that Heidegger’s Germanism was also as “racist.”
The Germanist conception, I might add, was especially well-suited to a “blubo” (a Blut-und-Boden nationalist) like Heidegger. Seeing man as Dasein (a being-there), situated not only in a specific life world (Umwelt), but in exchange with beings (Mitdasein) specific to his kind, his existence has meaning only in terms of the particularities native to his milieu, (which is why Heidegger rejected universalism and the individualist conception of man as a free-floating consciousness motivated strictly by reason or self-interest).
Darwinian conceptions of race for Heidegger, as they were for other Germanists in the NSDAP, represented another form of liberalism, based on individualistic and universalist notions of man that reduced him to a disembedded object — refusing to recognize those matters, which, even more than strictly biological differences, make one people unlike another.
Without this recognition, Germanists held that “the Prussian aristocracy was no different from apples on a tree.”
B) The State
As a National Socialist, Faye’s Heidegger was above all concerned with lending legitimacy to the new Führer state.
To this end, Heidegger turned to Carl Schmitt, another of those “Nazi” intellectuals, who, for reasons that are beyond Faye’s ken, is seen by many as a great political thinker.
In his seminar on Hegel, Heidegger, accordingly, begins with the 1933 third edition of Schmitt’s Concept of the Political (1927).
There Schmitt defines the concept of the state in terms of the political — and the political as those actions and motives that determine who the state’s “friends” and who its “enemies” are.
But though Heidegger begins with Schmitt, he nevertheless tries to go beyond his concept of the political.
Accepting that the “political” constitutes the essence of the state, Heidegger contends that Schmitt’s friend/enemy distinction is secondary to the actual historical self-affirmation of a people’s being that goes into founding a state true to the nation.
In Heidegger’s view, Schmitt’s concept presupposes a people’s historical self-affirmation and is thus not fundamental but derivative.
It is worth quoting Heidegger here:
There is only friend and enemy where there is self-affirmation. The affirmation of self [i.e., the Volk] taken in this sense requires a specific conception of the historical being of a people and of the state itself. Because the state is that self-affirmation of the historical being of a people and because the state can be called polis, the political consequently appears as the friend/enemy relation. But that relation is not the political.
Rather, it follows the prior self-affirmation.
For libertarians and anarchists in our ranks, Heidegger’s modification of Schmitt’s proposition is probably beside the point.
But for a statist like myself, who believes a future white homeland in North America is inconceivable without a strong centralized political system to defend it, Heidegger’s modification of the Schmittian concept is a welcome affirmation of the state, seeing it as a necessary stage in a people’s self-assertion.
Four.
Conclusion
From the above, it should be obvious that Faye’s Heidegger is not quite the definitive interpretation that his promoters make it out to be.
Specifically, there is little that is philosophical in his critique of Heidegger’s philosophy and, relying on his moralizing attitude rather than on a philosophical deconstruction of Heidegger’s work, he ends up failing to make the argument he seeks to make.
If Faye’s reading of the seminars of 1933-34 are correct, than Heidegger was quite obviously more of a National Socialist than he let on. But this was already known in 1987-88.
Faye also claims that Heidegger’s pioneering work of the 1920s anticipated the National Socialist ideas he developed in the seminars of 1933-34 and that his postwar work simply continued, in a modified guise, what had begun earlier. This claim, though, is rhetorically asserted rather than demonstrated.
Worse, Faye ends up contradicting what he sets out to accomplish. For his criticism of Heidegger is little more than an ad hominem attack, which assumes that the negative adjectives (”abhorrent,” “appalling,” “monstrous,” “dangerous,” etc) he uses to describe his subject are a substitute for either a proper philosophical critique or a historical analysis.
In thus failing to refute the philosophical basis of Heidegger’s National Socialism, his argument fails, in effect.
But even if his adjectives were just, it doesn’t change the fact that however “immoral” a philosopher may be, he is nevertheless still a philosopher. Faye here makes a “category mistake” that confuses the standards of philosophy with those of morality. Besides, Heidegger was right in terms of his morals.
Faye is also a poor example of the philosophical rationalism that he offers as an alternative to Heidegger’s allegedly “irrational” philosophy — a rationalism whose enlightenment has been evident in the great fortunes that Jews have made from it.
Finally, in insisting that Heidegger be banned because of his fascist politics, Faye commits the “sin” that virtuous anti-fascists always accuse their opponents of committing.
In a word, Faye’s Heidegger is something of a hatchet job that, ultimately, reflects more on its author’s peculiarities than on his subject.
Yet after saying this, let me confess that though Faye makes a shoddy argument that doesn’t prove what he thinks he proves, he is nevertheless probably right in seeing Heidegger as a “Nazi.” He simply doesn’t know how to make his case — or maybe he simply doesn’t want to spend the years it takes to “master” Heidegger’s thought.
Even more ironic is the scandal of Heidegger’s “Nazism” seen from outside Faye’s liberal paradigm. For in this optic, the scandal is not that Heidegger was a National Socialist — but rather that the most powerful philosophical intelligence of the last century believed in this most demonized of all modern ideologies.
But who sees or cares about this real scandal?
00:10 Publié dans Livre, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : heidegger, national-socialisme, philosophie, livre, allemagne, révolution conservatrice, théorie politique, politologie, sciences politiques, anées 20, années 30 |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 22 août 2010
We Anti-Moderns
We Anti-Moderns
Ex: http://www.counter-currents.com/
Antoine Compagnon
Les antimodernes:
De Joseph de Maistre à Roland Barthes
Paris: Gallimard, 2005
“Ce qu’on appelle contre-révolution ne sera
point une révolution contraire, mais le
contraire de la révolution.”
—Joseph de Maistre
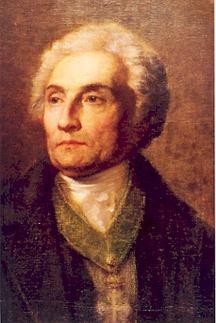 Though Antoine Compagnon’s eloquently written and extensively researched essay won a number of prizes and set off a stir among France’s literati, there is little to recommend it here—except for its central theme, which speaks, however implicitly, to the great question of our age in defining and classifying a form of thought whose mission is to arrest modernity’s seemingly heedless advance toward self-destruction.
Though Antoine Compagnon’s eloquently written and extensively researched essay won a number of prizes and set off a stir among France’s literati, there is little to recommend it here—except for its central theme, which speaks, however implicitly, to the great question of our age in defining and classifying a form of thought whose mission is to arrest modernity’s seemingly heedless advance toward self-destruction.
The antimoderne, Compagnon argues, was born with the birth of liberal modernity. Neither a reactionary nor an antiquarian, the anti-modernist is himself a product of modernity, but a “reluctant” one, who, in the last two centuries, has been modernity’s most severe critic, serving as its foremost counter-point, but at the same time representing what is most enduring and authentic in the modern. This makes the antimoderne the modern’s negation, its refutation, as well as its double and its most authentic representative. As such, it is inconceivable without the moderne, oscillating between pure refusal and engagement. The anti-modernist is not, then, anyone who opposes the modern, but rather those “modernists” at odds with the modern age who engage it and theorize it in ways that offer an alternative to it.
Certain themes or “figures” distinguish anti-modernism from academism, conservatism, and traditionalism. Compagnon designates six, though only four need mentioning. Politically, the antimoderne is counter-revolutionary; unlike contemporary conservatives, his opposition to modernity’s liberal order is radical, repudiating its underlying premises. Philosophically, the antimoderne is anti-Enlightenment; he opposes the disembodied rationalism born of the New Science and its Cartesian offshoot, and he sides with Pascal’s contention that “the heart has its reasons that reason knows not.” Existentially, the antimoderne is a pessimist, rejecting the modern cult of progress, with its feel-good, happy-ending view of reality. Morally or religiously, the antimoderne accepts the doctrine of “original sin,” spurning Rousseau’s Noble Savage and Locke’s Blank Slate, along with all the egalitarian, social-engineering dictates accompanying modernity’s optimistic onslaught.
The greatest and most paradigmatic of the antimoderns was Joseph de Maistre (1753–1821). Prior to the Great Revolution of 1789, which ushered in the modern liberal age, Maistre had been a Freemason and an enthusiast of the Enlightenment. The Revolution’s wanton violence, combined with Burke’s Reflections, helped turn him against it. Paradoxically indebted to the style of Enlightenment reasoning, his unorthodox Catholic critique of the Revolution became the subsequent foundation not only for the most meaningful distillations of Continental conservatism, but of the antimodern project.
The tenor of Maistre’s anti-modernism is probably best captured in his contention that the counter-revolution would not be a negation of the Revolution, but its dépassement (i.e., its overtaking or transcendence). Unlike certain reactionary anti-revolutionaries who sought a literal restoration of the old regime, the grand Savoyard realized the Revolution had wreaked havoc upon Europe’s traditional order, and nothing could ever be done to undo this, for history is irreversible. The counter-revolution would thus have to be revolutionary, going back not to the old regime, but beyond it, to a new order representing both the Revolution’s completion and transcendence. In this sense, the anti-modern project—by rejecting what is decadent and perverted in the modern, while defending what is great and necessary in it—holds out the prospect of rebirth.
Between the Great Revolution and the Second World War, as anti-modernists were excluded from the leading spheres of French political and social life, they took refuge, Compagnon argues, in literature and letters—their “ideological resistance [being] inseparable from [their] literary audacity.” Balzac, Baudelaire, Flaubert, Proust, Péguy, Céline—to name those most familiar to English-speaking readers—are a few of the great figures of French literature who, in implicit dialogue with Maistre, resisted the modern world in modernist ways. (Not coincidentally, for it was also a European phenomenon, the great Welsh Marxist scholar, Raymond Williams, makes a similar argument for English literature in his Culture and Society, 1780–1950 [1958], though in anti-capitalist rather than anti-modernist terms.)
But if Compagnon develops a suggestive term to designate the nineteenth- and twentieth-century resistance to modern liberal dogmas, he himself is no anti-modernist—which is what one would expect from this professor of French literature occupying prestigious chairs at both the Sorbonne and Columbia University. For anti-modernism is not simply modernity’s aesthetic auxiliary, as Compagnon would have it, but an ideological-cultural tradition frontally challenging the modern order. Given, moreover, the anti-liberal and frequently anti-Semitic implications of the anti-modern temper, as well as its uncompromising resistance to the reigning powers, no feted representative of the system’s academic establishment could possibly champion its tenets. Thus, despite Compagnon’s invaluable designation of one of the great figures opposing modernity’s destructive onslaught, he not only characterizes the antimoderne in exclusively literary terms, missing thereby its larger historical manifestations and contemporary relevance, he never actually comes to term with its defining antonym: the “moderne.”
The concept of modernity, though, is crucial not only to an understanding of the anti-modern, but to an understanding of—and hence resistance to—the forces presently threatening the European life world. There are, of course, a number of different ways to understand these anti-white threats. In an earlier piece in TOQ, I argued that they stem ultimately from the ontological disorder (“consummate meaninglessness”) that marks the foundation of the modern age. Others in these pages have pointed to the Jewish “culture of critique” and the managerial revolution of the Thirties, both of which throw light on the subversive forces threatening us. At other venues, there are those emphasizing the predatory nature of international capitalism, the suicidal disposition of our secular, humanist civilization, or the complex and perplexing forces of modern structural differentiation, to mention just a few of the contending interpretations. Because the historical process is a complicated affair and rarely lends itself to a single monolithic interpretation, the wisest course is probably an eclectic one accommodating a variety of interpretations.
However, if it were necessary to put a single label on the historical process responsible for the “decomposition and involution” preparing the way for our collective demise as a race and a culture, the best candidate in my view is the admittedly imprecise and difficult to define term “modernity”—and its variants (modernism, modernization, modern times, etc.). Over the last century and a half, some of our greatest thinkers have wrestled with this term, offering a variety of not always compatible interpretations of that “certain something” which distinguishes modern life from all former or traditional modes of existence. Compagnon adopts the view of Baudelaire, who invented the term, defining “modernité” as an experience “which is always changing, which does not remain static, and which is most clearly felt in the [bustling] metropolitan center of the city [where everything is] constantly subject to renewal.” The Baudelairian conception, like other interpretations of the modern stressing its fleeting, fragmented, and discordant nature, relates back to the Latin modernus or the early French modo, meaning “just now”—that is, something that is of present and not of past or “old-fashioned” times. In this sense, it is associated, positively, with the new, the improved, the unquestionably superior; negatively, with the ephemeral, the fashionable, and the superficial.
Here is not the place to review the history of this key term. Suffice it to note that the modernist sees life in the present as fundamentally and qualitatively different from life in the past. In contrast to traditionalists, who view the present as a continuation, a transmission, and a recuperation of the past, modernists (and today we are all, to one degree or another, modernists) emphasize discontinuity, favoring reason’s endless capacity to create ever more desirable forms of existence, opposing, thus, the historic, organic, and traditional orders of earlier social forms and identities. Racially, culturally, and in other ways, modern civilization cannot, then, but pursue its abstract, disordering cult of progress in a manner that contests who we are.
There is also a geography to modernity. It began as a European idea, but its fullest historical realization came in lands where the European tradition was weakest, specifically in America (“the home of unrelenting progress . . . where tomorrow is always better than today”) and, to a lesser extent, Soviet Russia. Thus it was that up to 1945 anti-modernists dominated European literature and letters and anti-modernist principles not infrequently found their way into the European public sphere. Since das Jahre Null, however, all has changed, and anti-modernists have been largely exiled to Samizdat and marginal publications—a sign of modernity’s increasingly totalitarian disposition to regulate, level, and homogenize for the sake of America’s modern “way of life.”
Flawed as it may be, Compagnon’s book not only helps us rediscover the anti-modern tradition that stands as an antidote to a runaway modernity, it comes at a time when modern civilization, in the form of globalization, faces its gravest crisis. Phillipe Grasset (at dedefensa.org), arguably the greatest living student of modern, especially American, civilization, claims that a triumphant modernity is today completely unchained, drunk on its own power, as it remakes the planet and transforms our lives in ways that destructure all known identities and beliefs. Like earlier French Jacobins, who exported their revolution to the rest of Europe, American Jacobins in the White House and on Wall Street are today imposing their revolutionary disorder on the rest of the world, as they turn it into a monochrome, amorphous herd of consumers shorn of everything that has traditionally been the basis of our civilization.
A single force compels the spiritless modernism of these latter-day Jacobins: the chaos-creating imperatives of their techno-economic cult of progress, which runs roughshod over every organic, historic, and traditional reference. Evident in Iraq, along our southern border, and in the antechambers of the European Commission, they thrive not just on the illusion that the past is discontinuous with the present, but on a “virtualism” whose artificial and self-serving constructions bear little relationship to the realities they endeavor to affect. As one White House official said to a New York Times reporter (October 17, 2004) on the subject of Bush’s “faith-based community”: “When we act, we create our own reality.” The modernist is prone, thus, to taking refuge in the illusory idea he makes of reality. This “virtualist” affirmation of illusion as reality inevitably leads to chaos, madness, and a world which is no longer our own.
Because our age’s defining conflict increasingly revolves around the battle between a destructuring modernity, in the form of globalism, and the anti-modernist forces of order rooted in the cultural and genetic heritage defining the European, the anti-modernist project has never been more pertinent. In Grasset’s view, what is at stake in this conflict is “the consciousness of existing as a specific phenomenon”—that is, identity. For as the modernist impetus of an American-driven globalism imposes its virtualist identities (based on creedal abstractions, not history, nature, or tradition), it clashes with the anti-modern project of forging an identity based on a synthesis of primordial identities and modern imperatives, as the temporal and the untimely meet and merge in a higher dialectic.
Throughout the nineteenth century and into the first half of the twentieth century, anti-modernists commanding the cultural heights of modern civilization were able, at times, to mitigate modernity’s destructive import. Since the American triumph of 1945, especially since 1989, as liberals and globalists subjected the spirit to new, more iron forms of conformity, this has changed, and anti-modernist writers and critics have been systematically purged from the public sphere.
The anti-modern, though, is not so easily suppressed, for it is the voice of history, heritage, and a reality that refuses to adapt to the modernist’s Procrustean demands.
Banned now from literature and letters, it is shifting to other fields. With the terrorist assault of 9/11, fourth-generation war in Iraq, the European referendum of 2005, etc.—the anti-modern forces of history and heritage continue to make themselves felt, for as our clueless modernists fail to understand, the past is never dead and gone.
TOQ, vol. 7, no. 4, Winter 2007–2008
00:16 Publié dans Philosophie, Théorie politique, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : révolution, conttre-révolution, modernité, modernisme, anti-modernité, anti-modernisme, philosophie, france, 19ème siècle, théorie politique, sciences politiques, politologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 21 août 2010
Pensare come una montagna
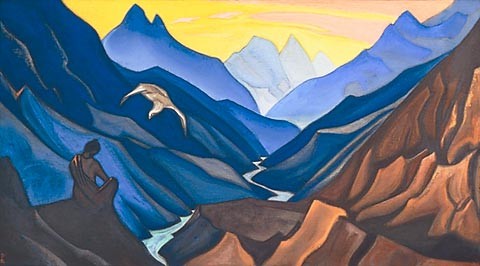
di Luisa Bonesio
Fonte: Geofilosofia
1. Volti di montagna
“Pensare come una montagna”: una proposizione che fa sobbalzare ogni buon filosofo accademico o gridare allo scandalo di un palese antiumanesimo gli zelanti neoilluministi come Luc Ferry, eppure non estranea, nel suo spirito, al “sentire cosmico”, come l’anima “immota e chiara come la montagna prima del meriggio”, o la “saggezza selvatica” (1) dello Zarathustra nietzschiano. “Pensare come una montagna”, motto del fondatore dell’ecologia profonda Aldo Leopold, tuttavia è anche una proposizione che rischia di non venire intesa in tutte le sue possibilità nemmeno da chi fa della difesa dell’ambiente la sua bandiera, e nemmeno comprensibile nella retorica di molto alpinismo. Nondimeno, credo che si debba riflettere attentamente su questa espressione provocatoria, ben al di là dell’intenzionalità con cui fu pronunciata.
Nell’ampiamente nota storia della “invenzione” moderna dei paesaggi alpestri, che avviene sotto il segno congiunto dell’estetica e degli interessi naturalistici, si nota uno strabismo nel modo di considerare la montagna: all’interesse degli artisti, e poi dei touristi, fa da contraltare una sorta di cecità estetica dei locali. Famosi gli esempi dell’ascesa di Petrarca al Monte Ventoso, in cui gli abitanti del luogo tentano ripetutamente di dissuadere il poeta e suo fratello dall’impresa; e la testimonianza di Cézanne: “Il contadino che vuol vendere le sue cose al mercato non ha mai visto la montagna Sainte-Victoire [...]. Sa cosa viene seminato là o qui lungo la strada, come sarà il tempo l’indomani, se la montagna Sainte-Victoire porterà o no il suo cappello [...] ma che gli alberi sono verdi e che questo verde è un albero, che questa terra è rossa, e questo detrito rosso sono colline, credo veramente che la maggior parte non lo senta non sapendo nulla al di fuori della propria inconsapevole inclinazione verso ciò che è utile” (2). Il che è molto simile a quanto accadde ai primordi della scoperta alpinistica: furono uomini “venuti da fuori”, cittadini, stranieri a “conquistare” quelle vette alla cui ombra vivevano le guide locali. In questa iniziale divaricazione degli sguardi - quelli “disinteressati”, estetici e artistici, e poi del cliché turistico da un lato, e quelli “volti all’utile”, di quelli che il geografo Cosgrove (3) chiamerebbe gli “insiders”, si prefigura la vicenda successiva e il destino moderno delle montagne, e delle Alpi in particolare.
Per andare in montagna, per guardarla esteticamente e “con sentimento”, occorre poterla “vedere”, “metterla a fuoco”. Con Petrarca - per quanto da Rudatis la sua modesta ascesa sia potuta essere sminuita, da un punto di vista alpinistico, come “una turlupinatura” - s’intravede il modo moderno di guardare la natura, la curiosità di scoprire paesaggi mai visti prima, il desiderio di godere la bellezza multiforme degli spettacoli naturali ma anche delle proprie sensazioni al loro cospetto, indipendentemente dalla conoscenza scientifica che potrebbe spiegarli. La scoperta della montagna si inscrive in questa più ampia vicenda dell’affermazione moderna della soggettività, della valorizzazione estetica del sentimento, dell’emozione individuale. La natura da un lato è scrutata e violata con ogni mezzo dalla scienza, assoggettata alla calcolabilità in vista del suo sfruttamento; viene oggettivata, misurata, analizzata, tradotta in cifre ed equazioni, ridotta a pura materialità disanimata passibile di manipolazione; ma dall’altro, in assoluta complementarità, trova una valorizzazione nel sentimento privato dei singoli, che si dilettano delle sue scene, paurose o pittoresche, sublimi o idilliache, in cui proiettare le proprie sensazioni e i propri stati d’animo. Nella grande stagione iniziale dell’estetica settecentesca come nuova disciplina filosofica, sapere di ciò di cui non si può dare spiegazione concettuale, conoscenza di un piacere che rischia sempre di chiudersi nel solipsismo, nella contemplazione solitaria, al pari di tutti gli aspetti disumani e selvaggi della natura, non ancora addomesticati dalla civiltà, la montagna è la grande protagonista del moderno sentimento del paesaggio.
Prima che Paccard e Balmat aprissero la via alle spedizioni scientifiche di Horace Bénédict de Saussure, e poi alle innumerevoli ascensioni ed escursioni, è proprio l’estetica a “inventare” la via alla montagna, nella forma delle poetiche del sublime. La natura impervia, se non ostile e minacciosa, dei monti esercita una sua specifica fascinazione, analoga a quella dell’oceano in tempesta, di uno spettacolo di grandezza e di potenza che eccede i limiti umani. La smisuratezza della montagna intimorisce, ma al tempo stesso fa piacevolmente sperimentare all’uomo la propria capacità di tradurre in godimento estetico, grazie alla sensibilità e alla cultura, qualsiasi aspetto della natura, anche il più terribile e minaccioso, affermando così, in ultima istanza, ancora una volta la propria superiorità. Ed è anche, se non nelle intenzioni dei filosofi e degli artisti settecenteschi, certamente negli effetti storici, un modo per sottomettere ancora una volta la natura alla misura umana, nei suoi aspetti più soggettivistici e idiosincratici, riducendola a semplice correlato emotivo o a occasione per provare sempre nuove situazioni. E’ da notare come qui sia la radice prima, anche se ormai inconsapevole, della ricerca di quell’“estremo” che caratterizza così fortemente un approccio sempre più in voga alla montagna.
Quando la via alla montagna è così aperta, dalla letteratura e dalle arti, su di essa comincia a focalizzarsi l’attenzione e la curiosità di un pubblico che, mutando i tempi, da colto e poco numeroso, assume dimensioni sempre maggiori fino a diventare quello di massa dei giorni nostri. Parallelamente all’invenzione (4) estetica della montagna, ne avviene un’altra, non meno rilevante, di ordine scientifico e naturalistico: mi limito a ricordare le menzionate spedizioni pionieristiche di Saussure sul Monte Bianco, e in seguito i vari viaggi di Alessandro Volta nelle Alpi svizzere. La cultura occidentale torna in tal modo a guardare le montagne, iscrivendole in un sistema di rappresentazioni che le correla alla soggettività, al sentire del singolo: così che, quando si daranno le condizioni sociali ed economiche, oltre che ideologiche, per un consumo “di massa” della natura come paesaggio e luogo di salubrità, il turismo non farà che usare, ridotte a slogan, le parole dell’estetica del pittoresco e del sublime, degradando a kitsch la natura selvaggia e retorizzando, spesso fino al caricaturale, le virtù salutari del clima. Oggi noi siamo in grado di cogliere appieno gli effetti di questa vicenda di uso “estetico” delle montagne, con le differenze innegabili che esistono fra singole regioni o località. A questa inscrizione nella logica cittadina come spazio turistico o sportivo, si aggiunge una più generale inscrizione - che non è sempre forzosa, ma spesso auspicata dagli stessi abitanti - nella grande logica globale, mediante vie di comunicazione, trasporto di energia, assedio dell’industria e dei suoi rifiuti. Contro i fianchi delle montagne battono sempre più insistentemente le mareggiate dell’industrialismo, della logica di massa, dell’assalto a uno degli ultimi territori differenziati del continente europeo, che fino a qualche generazione fa era rimasto in un equilibrio intatto, di tipo preistorico (5).
Se la codificazione estetica delle montagne è stata l’occasione per estrarle da quell’aura di leggendarie paure e di diffidente tenuta a distanza, essa, però, le ha inevitabilmente “tradotte” in un sistema di rappresentazioni in cui esse non “parlano”, né tantomeno “pensano”, né sfiora la mente dell’homo tecnicus la preoccupazione di comprendere che cosa possa voler dire “pensare” come loro. Per molti versi, le montagne “sono” così come la ha costruite un’operazione immaginale che ha l’età della modernità: imponenti, sublimi, terribili, minacciose, affascinanti... Chi potrebbe resistere alla tentazione di appropriarsene, almeno in immagine, o per impresa sportiva, o per partecipazione al grande rito collettivo delle vacanze? Il valore estetico finisce con il diventare sempre più un valore economico e del consumo, cui nulla sembra potersi sottrarre nel nostro mondo, e quindi finisce con l’essersi trasformato, da sguardo alla gloria delle montagne in strumento del loro stravolgimento. Non si guardano più i monti per intenderne il nomos, non se ne contempla il volto per imparare a conoscerlo e ad accordarsi con esso, ma dei monti e delle valli si fanno scenari e pretesti di svago o di titanismi.
Ma quei locali che ai cittadini apparivano così indifferenti al bello, perché gravati dal duro e sapiente compito del sopravvivere in montagna, e che invece ne erano stati i consapevoli partners nel cooperare alla formazione di quei paesaggi tanto ambiti, forse avevano consapevolezza di cosa potrebbe voler dire “pensare come una montagna”: là dove la distruzione moderna, l’abbandono, lo stravolgimento non hanno agito del tutto, là si vede (ammesso che si sia ancora in grado) come quella lentezza, quell’immobilità tanto sbeffeggiata dai contemporanei, sia stata una delle cifre più profonde dell’abitare la montagna. Altro ritmo, altro tempo in cui si salvaguardava (e si esprimeva) l’estraneità di questi luoghi alla logica del novum, del consumo, dell’accelerazione: niente di meno futuristico delle montagne, con buona pace di varie utopie architettoniche (da Viollet-le-Duc a Bruno Taut) che hanno maggior parentela con l’opprimente assurdità della geometria aliena delle Montagne della follia di H.P. Lovecraft (6) che con un pensiero consono ai luoghi, una sapienza della località, una consapevolezza del genius loci. Domandarsi se gli attuali abitanti delle montagne abbiano conservato questa sapienza dell’equilibrio con il proprio luogo è altrettanto importante dell’interrogarsi sulle modalità di accostarsi ai monti da parte dei turisti e degli appassionati.
2. “Le culminazioni dell’alpe” Abbiamo già visto come non necessariamente quelli “che vanno in montagna” coincidano con quelli “che stanno in montagna”: o almeno, ne siano, almeno inizialmente, profondamente diversi gli intenti. Ancora oggi, per lo più, un caricatore d’alpe ha del territorio montano una visione assai diversa da quella dell’escursionista o del turista, sia in termini di conoscenza che di individuazione dei suoi possibili usi; così come un cercatore di cristalli all’epoca della scoperta del Monte Bianco rispetto a un artista che ne immortalava le vedute. Sicuramente anche il modo di “vedere” le montagne dei monaci tibetani o di quanti si recano in pellegrinaggio sul Kailash (o su qualsiasi altra montagna sacra) è diverso da quello degli occidentali che vi si recano per le loro ascese.
Nella cultura del Novecento esistono significative posizioni di critica i miti della modernità - progresso, democraticismo, economicismo, fede nella scienza e nella tecnica, materialismo -, in cui il turismo viene interpretato come una forma massificata e priva di consapevolezza dell’accostarsi alla natura. Il turismo e il mito della natura incontaminata appaiono come uno dei segni della decadenza spirituale della nostra epoca, oltre che fenomeni che finiscono col distruggere o compromettere l’ambiente naturale, senza peraltro assicurare durevolmente quei benefici che fungono ormai per lo più da alibi e retorica per la commercializzazione di qualcosa che non dovrebbe poter essere considerato una merce. Questo punto di vista non vuole ripristinare un passato improbabile, ma, al contrario, richiamare l’attenzione sul fatto che ogni luogo richiede comportamenti e misure specifiche che ne rispettino il nomos sapendone riconoscere il significato.
Una declinazione particolare di questa attitudine di rifiuto dello svilimento delle montagne nella logica consumistica o sportiva è ravvisabile nell’interpretazione della pratica alpinistica come disciplina ascetica e spirituale. L’alpinismo di chi si rifà a valori spirituali e metafisici si distacca recisamente da ogni interpretazione della disciplina in senso agonistico e sportivo. Lo sport è infatti una delle manifestazioni della civiltà di massa e del culto della forma fisica fine a se stessa che caratterizza il nichilismo contemporaneo, viceversa significativamente poco preoccupato della salute spirituale -, costitutivamente volto all’agonismo, o addirittura al superomismo - dunque prodotto estremo della volontà i potenza che pretende di essere metro di tutte le cose, visibili e invisibili, signoria sulla terra che, faustianamente, non tollera alcun limite alle sue conquiste, ma è sempre proteso ad affermarsi in nome di quel titanismo con cui ha cambiato la faccia della terra (7).
Se l’ascensione viene considerata per le possibilità spirituali e iniziatiche che offre, la sacralità della montagna, testimoniata dal suo universale simbolismo come corrispondente di stati interiori trascendenti o sede di divinità, o di eroi trasfigurati, insomma luogo di partecipazioni a forme di vita più alta, diventa luogo di manifestazione simbolica di significati trascendenti, come l’esperienza stessa della montagna alla nostra più profonda interiorità, purché venga realizzata adeguatamente, suggerisce.
Questo modo di accostarsi alla montagna respinge sia l’atteggiamento “lirico”, ossia sentimentale in senso banalizzante e retorico - il cliché della montagna-panorama secondo gli standard del pittoresco e di un certo lirismo ottocentesco - estraneo sia agli abitanti dei monti che ai veri alpinisti; sia l’atteggiamento “naturistico”, che come abbiamo già visto, è piuttosto un sintomo di decadenza spirituale, una sorta di misticismo primitivistico della natura che rimane segnato da un carattere di reazione e di evasione dalla negatività della vita quotidiana; sia l’atteggiamento per cui il valore di un’ascesa è visto nella sensazione e nell’eroismo fisico, in cui il rischio è l’esasperazione di una fisicità fine a se stessa, un ideale della prestazione agonistica che di fatto è già ampiamente sviluppato nel carattere di lavoro che permea tutti gli aspetti della vita sociale, ma non può essere in sé considerato la base per conquistare una spiritualità superiore. Questo punto merita attenzione, dal momento che qui si può far rientrare, oltre alla caccia all’emozione, all’eccitante, all’“estremo”, al “no limits”, anche una certa esasperazione degli aspetti e dei supporti tecnici dell’arrampicare. In secondo luogo, è da notare come a questo orizzonte di esasperazione sportiva si scateni appartenga la corsa al primato, la competizione, la rincorsa alla scoperta di nuove montagne, che è anche l’escogitazione delle “vie”, delle difficoltà, ecc. Come se alla montagna non ci si potesse accostare che con un atteggiamento di competizione, di sfida, di appropriazione (significativo il gesto del piantare la bandiera sulla vetta), di “conquista”. Anche questo aspetto, in realtà, è perfettamente coerente con l’affermazione del soggettivismo che contrassegna l’epoca moderna: come nella scienza non vi deve essere, per definizione, alcun aspetto che possa sottrarsi all’indagine, come il cammino della cosiddetta civiltà prevede la sottomissione e l’affermazione della libertà umana sui vincoli della natura, analogamente e come logica conseguenza, non deve restare dominio o recesso del mondo naturale nel quale l’uomo non porti la propria presenza appropriante, non “firmi” - di solito con ingombranti rifiuti - il suo passaggio.
Quando le vette sono tutte conquistate, dunque, inizia la retorica della “sfida” al pericolo, alla difficoltà, ai limiti, con tutte le sue infinite, per quanto ripetitive, varianti. Nella visione e nella pratica più diffusa della “sfida” al pericolo e alle difficoltà agisce un paradigma superomistico che ha poco a che vedere con l’effettiva concezione nietzschiana dell’oltreuomo, ma molto con una certa vulgata che afferma i valori, che un tempo erano quelli dell’ascesi e della fortificazione dello spirito, in un contesto completamente secolarizzato e con un’intenzione del tutto profana: si tratta di superare i propri limiti di resistenza fisica, di vincere le paure, di lottare contro la montagna per dimostrarsi metaforicamente e letteralmente alla sua altezza, si affrontano sacrifici, pericoli, si rischia la vita in una sorta di eroismo solitario, ma il fine è semplicemente quello di un’affermazione di sé, una specie di narcisismo eroicizzante. Semplificando per far emergere con chiarezza l’essenziale, si potrebbe dire che in quest’ottica non conta la montagna per quello che è, ma come supporto, occasione e oggetto dell’impresa di un singolo. Portato alle sue estreme, ma del tutto coerenti, conseguenze, si tratta sempre di quell’atteggiamento di riduzione di tutto l’esistente alle ragioni o alle sensazioni soggettive: si tratta pur sempre di un accostarsi estetico o estetizzante - cioè tale da privilegiare la sensazione, l’emozione, il sentimento individuale, l’autorappresentazione fino al punto di non “vedere” più la montagna, ridotta ormai a scenario delle imprese umane-troppo umane. Anzi, a rigore non è più in gioco “la montagna” (come qualsiasi altro paesaggio), ma una finzione rappresentativa e fortemente artificiale, in cui non si mette in gioco la propria vita, ma si fa, piuttosto “teatro”: è l’atteggiamento “di chi cerca la natura per eseguire in essa l’ultima possibile recita in un mondo per il resto totalmente umanizzato. [...] Ovunque, in montagna, in viaggio nei deserti, sulle spiagge, come nel paesaggio urbano l’individuo si comporta sempre più da attore che recita, seguendo un copione che suggerisce non solo i comportamenti ma anche i luoghi giusti, gli ambienti adatti a esprimersi, secondo i modi che tornano a vantaggio dell’economia consumistica” (8).
Quello che ancora una volta rimane inascoltata è l’eco contenuta nell’emozione e nell’intuizione che portano verso la montagna: grandezza che richiama a qualcosa che non è più umano, che è primordiale, inaccessibile, enigmatico, immutabile (9). Se si “pensasse come una montagna”, si lasciassero risuonare questi richiami, cercando di trasformarli in meditazione, contemplazione, si potrebbe avviare una realizzazione spirituale corrispondente all’esperienza della montagna: si tratterebbe di recare l’illuminazione di una visione simbolica adeguata sull’esperienza della montagna, trasformando la vita quotidiana, diventando quelli che non ritornano mai dalle vette in pianura (10). Non tornare in pianura, ossia a quelle che Nietzsche chiamava le “bassure” della vita comune che cerca le sue piccole sicurezze e il suo confortevole benessere, significa in realtà che non vi sarebbe più né andare né tornare, una volta “realizzata” la Montagna nel proprio spirito, tradotto il simbolo in realtà. E’ superfluo sottolineare quanto una visione del genere, pur in un’attività che superficialmente sembrerebbe essere la stessa di ogni alpinista, si distacchi, nei suoi aspetti ascetici e conoscitivi, ma anche in quelli del comportamento verso la montagna, da ogni pratica sportiva che della montagna faccia solo un pretesto, una palestra o un palcoscenico di avventure narcisistiche e di comportamenti consumistici: è, come ha detto efficacemente Rudatis, “la scalata che va oltre tutte le scalate” (11).
Questo significato forte dell’ascensione conduce a riflettere sul pericolo di degradazione simbolica che le montagne corrono nei nostri tempi. Oggi che tutte - o quasi - le montagne sono state conquistate materialmente, esiste il rischio che anche questo volto della natura perda il residuo significato simbolico, e dunque le montagne siano “abbassate” e rese equivalenti a tutto il resto. E’ quanto si è già verificato, anche solo a livello del consumo estetico, nella inesorabile progressiva appropriazione immaginale, prima dalla rappresentazione artistica e letteraria, poi dal mondo della vita sociale che li fruisce come luoghi turistici e, così facendo, li consuma secondo la logica moderna della ricerca incessante della novità, che spinge inesorabilmente alla “scoperta” e all’appropriazione di paesaggi e aspetti della natura sempre diversi (12). In questa forma del consumo estetico-turistico di massa è racchiuso un enorme pericolo, di ordine economico e di ordine simbolico (13). Ma se è dalla perdita del valore simbolico che deriva ogni altro fenomeni di degrado, materiale, immaginario ed estetico, la riflessione circa i modi di “valorizzare” le montagne può ricevere una nuova luce: valorizzare dovrebbe voler dire: salvaguardare il valore intrinseco della montagna, non svenderla o tramutarla nella caricatura di una periferia metropolitana; e preservare l’intangibilità delle montagne, salvaguardarne il carattere appartato e selvatico, mediante zone di rispetto, una viabilità non corriva verso le spinte commerciali, una rinnovata educazione alla loro grandezza .
Una montagna vista innanzitutto nel suo carattere “alto”, impervio, selettivo, ascensionale e solitario non può favorire comportamenti di facile appropriazione, di consumo e distruzione indiscriminata, di annessione indifferente. Una montagna come axis mundi, luogo sacrale, cratofania o santuario, o anche semplicemente come luogo di una singolarità irripetibile, se davvero compreso come tale, non può essere considerata come un bene di cui disporre indiscriminatamente, neppure nell’immaginario. Ma anche una montagna compresa come luogo delle culture che vi sono insediate, come sempre più precario retaggio tradizionale sopravvivente nell’estrema modernità, non dovrebbe essere cancellata nella sua identità con gli alibi della valorizzazione commerciale, che è l’acido più corrosivo nei confronti del senso di appartenenza.
3. Mons silvaticus L’orizzonte di tutte queste considerazioni è la questione epocale dell’identità dei luoghi, della loro salvaguardia e del loro significato. Rilke, alla svolta del secolo, affermava la necessità di sottrarre alla consuetudine le nostre immagini della natura e dei paesaggi, logorate dalle molte rappresentazioni letterarie e iconografiche, fino ad essere diventate un cliché che impedisce lo sguardo su ciò che veramente è. Lasciare che la natura ci ridiventi straniera, per coglierne l’effettiva estraneità al mondo delle nostre rappresentazioni, e, misurando questa distanza, lasciar essere la differenza, accettare che tutto quanto vi è di comune fra uomini e cose si ritiri nella “profondità comune donde traggono nutrimento le radici di ogni divenire” (14). L’esigenza di lasciare che la natura si ritragga nell’enigmaticità e quindi riconquisti, nella distanza, la sua aura, è la sostanza delle posizioni di difesa della Wilderness, gli aspetti selvatici del paesaggio terrestre, non certo per amore di esotismo, ma nel nome di un’estrema difesa delle radici selvatiche della stessa umanità, di quella radicatezza senza la quale la cultura è messa a repentaglio. La selvatichezza è il terreno vitale in cui crescono le culture attente alla necessità di non interrompere la comunicazione con l’altro, e dunque consapevoli della loro dipendenza dall’altro: sia nel senso della sopravvivenza e prosperità materiale, che in quello simbolico, della differenza in relazione alla quale soltanto può sussistere identità. Quando la dimensione della selvatichezza viene attaccata e distrutta, la terra feconda in cui si radicano le civiltà si trasforma nel deserto di cui parla la filosofia del Novecento. Desolazione di un luogo andato in rovina, sia negli aspetti naturali che nelle realizzazioni della cultura: solitudo, in cui l’uomo è rimesso alla via senza uscita della propria stoltezza. La desertica ripetitività del sempre uguale è il destino di chi pensa che la natura, soprattutto nei suoi aspetti indomiti, sia un fastidioso contrattempo sul cammino della progettualità umana.
La Wildnis è la questione dell’intera civiltà terrestre nell’epoca della tarda modernità. Occorre perciò salvaguardare attivamente la fisionomia singolare dei luoghi riconoscendone le radici selvatiche: senza la presenza e la simbolizzazione dell’estraneazione incarnata nel lato ombroso della civiltà, nel selvatico appunto, la costruzione umana è destinata a somigliare a una torre di Babele cui venga meno il fondamento. La presunta razionalità che vige nell’ordine metropolitano, assieme a tutte le sue realizzazioni, assomiglia sempre più a una sopravvivenza fantasmatica di cui l’immaginario legato alla realtà virtuale è un’eloquente manifestazione.
Ma le radici selvatiche, di cui la montagna è emblema e riserva, non potrebbero essere lasciate disseccare senza un più generale svigorimento simbolico. Si potrebbe dire che quando i simboli cominciano a diventare muti, le foreste cominciano a essere ridotte a riserva di legname o ad ostacolo all’espansione cittadina e le montagne a parco di divertimenti. È per questo che la montagna deve tornare a poter essere vista come l’emblema dello spazio elevato e sacro, del luogo dell’aprirsi, reale e simbolico, di una dimensione la cui alterità e distanza, anche fisica, dall’usuale, mostra una dimensione di verticalità essenzialmente estranea al mondo del nichilismo. In ogni luogo, oltre agli elementi visibili, oggetto dell’indagine geografica e storico-artistica, vi sono elementi non obiettivabili, non suscettibili di quantificazione scientifica, e nondimeno simbolicamente essenziali. Nel riconoscimento della profonda simbolicità delle manifestazioni della natura è racchiusa ogni possibilità di armonizzazione con la morfologia ambientale e di suo sapiente assecondamento, che si traduce sempre anche in opera di bellezza.
La tarda modernità tende a esotizzare sempre più “la natura”, “il selvatico”, il “tradizionale”, rescindendoli come riserve o come mere citazioni, quando non come oggetti dell’industria culturale o turistica. D’altra parte, però, si assiste alla diffusione di un desiderio di appartenenza, o di “ritorno” alla “natura” che per molti versi è un fenomeno di provenienza urbana. Ritorno dunque “sentimentale”, avrebbe detto Schiller, e non “ingenuo”: come è ogni vero ritorno (15). Ma già in questo è forse possibile intravedere il ridestarsi di una memoria e l’affiorare di una consapevolezza differenziale nell’omologazione contemporanea. Gli sviluppi in senso sempre più immateriale della tecnica, l’uso di sistemi di comunicazione che rendano obsoleto il proliferare di grandi strade, assieme a una chiara comprensione dei limiti da rispettare, potrebbero rendere meno utopica e nostalgica la difesa dell’individualità dei luoghi, e nella fattispecie della montagna, sottraendola al tempo stesso alla prospettiva della mera esteticità o di un devastante consumo sportivo. Ritornare, dunque, con nuova consapevolezza, nei pressi delle radici selvatiche e rocciose della civiltà, prima che tutto sia distrutto nichilisticamente - ossia anche per superficialità, tracotanza o rassegnazione o appagamento nell’integrazione (16) - per salvaguardarne almeno la memoria: primo, indispensabile, passo verso quel riorientamento che solo potrebbe salvare la terra.
Quest’opera della memoria non è volta a fabbricare un ricordo, né un ennesimo simulacro di un “regno perduto”: è piuttosto un’opera di meditazione sul volto della terra a venire che procede da uno scavo nelle rovine del presente, si immerge nella solitudo dell’oggi come in un controluce che ne rivela i tratti essenziali, o in un’algidezza in cui si trasfigura il crescente irrigidimento della vita nell’ascesi della riflessione, in cui le “montagne da pascolo” del turismo possano riassumere il sembiante di Mons Victorialis, di luogo solstiziale dello spirito. Le radici selvatiche, le forme dell’elevatezza e della distanza, quelle che Evola chiamava “le culminazioni dell’alpe”, sono per noi l’ultimo punto di vista differenziale dal quale comprendere il mondo e metterlo in prospettiva. Che si possa anche solo per un momento sostare nel silenzio della montagna e intenderne la voce, è una delle estreme possibilità di salvaguardia di questo mondo. Ma chi lo potrà fare non sarà né turista, né sportivo, né collezionista di record o di imprese estreme, ma qualcuno che avrà compreso la legge del luogo e si sarà messo in consonanza con essa: montanaro, pastore, boscaiolo o incamminato sulla via del Sé, tutti attenti e responsabili della conservazione delle condizioni di appartatezza, della costitutiva ed essenziale distanza, tutte figure del “pensare come una montagna”, della consapevolezza che essa deve tornare segreta e salva come un vero Montsalvat: monte della salvazione, perché montagna della selvatichezza.
| Note: |
1. Cfr. L. Bonesio, La saggezza selvatica di Zarathustra, “Letteratura Tradizione”, 5, 1998.
2. Cit. in J. Ritter, Paesaggio. Uomo e natura nell’età moderna, a cura di M. Venturi Ferriolo, Guerini e Associati, Milano 1994, pp. 68-69.
3. D. Cosgrove, Realtà sociali e paesaggio simbolico, a cura di C. Copeta, Unicopli, Milano 1990.
4. Per il termine “invenzione”, nella sua duplice accezione di scoperta e produzione di qualcosa che non c'era, cfr. Ph. Joutard, L'invenzione del Monte Bianco, tr. it. di P. Crivellaro, Einaudi, Torino 1993.
5. Cfr. F. Fedele, Inventare le Alpi: archeologie, abitanti, identità, in Appartenenza e località: l’uomo e il territorio, a cura di L. Bonesio, SEB, Milano 1996.
6. “A poco a poco, però, (le cime) si innalzarono minacciose nel cielo occidentale permettendoci di distinguere diverse cime nude, squallide e nerastre e di cogliere lo strano senso di fantastico che ispiravano viste così nella luce rossastra dell’Antartico con lo sfondo suggestivo di nuvole iridescenti di polvere di ghiaccio. Da quello spettacolo derivava un senso di stupenda segretezza e di potenziale rivelazione. Era come se queste cuspidi da incubo fungessero da piloni di uno spaventoso ingresso nelle sfere proibite dei sogni, nei complessi golfi del passato remoto, dello spazio e dell’ultradimensionalità” (H.P. Lovecraft, Le montagne della follia, tr. it. di G. De Luca, Sugarco, Milano 1983, p. 39). “L’effetto era quello di una città ciclopica di architettura ignota all’uomo o all’immaginazione umana, con un vasto aggregato di costruzioni nere come la notte costruite con mostruose perversioni delle leggi geometriche. C’erano coni tronchi, talvolta disposti a terrazza o scanalati, sormontati da alti steli cilindrici, che qua e là si slargavano a bulbo e spesso terminavano in una serie di dischi dentellati e assottigliantisi...” (Ivi, pp. 40-41). La descrizione della città in rovina sulle montagne antartiche prosegue con tutti i dettagli di “sagome deformate da un’odiosità ancora maggiore” (Ibidem).
7. “L’impulso di natura plutonica non sorge più alla ricerca dell’oro, ma di energie capaci di trasformarsi in utopie, dai combustibili fossili fino all’uranio. Mossi da tale ricerca, non si agisce secondo criteri di economia, ci si comporta invece come lo scialacquatore che dissipa l’intera eredità per perseguire un’idea fissa. Nei sogni di Plutone non vi sono tesori nascosti, ma il vulcano. E’ attratto dall’Everest non per la vista che può offrire, ma per il record che gli consente di raggiungere. La biblioteca non è per lui il luogo delle Muse, ma uno spazio di lavoro, completo di arredo tecnico. Trascura di onorare i morti, ma va a frugare dentro alle tombe più antiche” (E. Jünger, La forbice, tr. it. di A. Iadicicco, Guanda, Parma 1996, p. 157).
8. E. Turri, Il paesaggio come teatro. Dal territorio vissuto al territorio rappresentato, Marsilio, Venezia 1998, p. 132. Sono tutti atteggiamenti, come si può constatare, che derivano da un'esasperazione di aspetti della personalità in senso soggettivistico, limitati a un'idea povera e in sostanza ampiamente consumistica dell'affermazione di sé e a un mondo che “comporta la riduzione dello scenario a un paesaggio del tutto denaturalizzato, che anche nei suoi aspetti selvaggi è ricondotto, fittiziamente, alla nuova e totale teatralizzazione del mondo” (Ivi, p. 133).
9. Un significativo esempio di questo arrampicare attento a connotazioni simboliche ed esoteriche sono gli scritti di D. Rudatis, in particolare Liberazione, Nuovi Sentieri, Belluno 1985.
10. J. Evola, Spiritualità della montagna, in Meditazioni delle vette, Il tridente, La Spezia 19863, ora raccolto in J. Evola-Samivel, Il sorriso degli dèi. Note su uomini di montagna e montagne degli dèi, Barbarossa, Milano 1996. Sia pure in un più ampio contesto di pensiero, le riflessioni di Evola su questo tema, insieme con quelle dell'accademico del CAI Domenico Rudatis, sono del massimo interesse. Un’utile raccolta di scritti appartenenti a questa prospettiva è il volumetto di AA.VV., Il regno perduto. Appunti sul simbolismo tradizionale della montagna, Il cavallo alato, Padova 1989.
11. D. Rudatis, Sulla via del senso cosmico, “Annuario CAAI”, 1990, p. 14.
12. Cfr. J. Ritter, op. cit., n. 57.
13. In un contributo molto significativo da questo punto di vista, Evola annovera tra i sintomi di decadenza spirituale l’approccio “discendente” alla montagna rappresentato dallo sci (di discesa): “Laddove l’alpinismo è caratterizzato dall’ebrezza dell’ascesa come conquista, lo sciismo è caratterizzato dall’ebrezza della discesa, della velocità e quasi diremmo della caduta” (J. Evola, Ascendere e discendere, in Meditazioni delle vette, cit., p. 71). La caratterizzazione evoliana dello sci può facilmente essere estesa, oggi, a tutti gli sport che perseguono “tecnica, giuoco ed ebbrezza della caduta”: in essi si esprime lo spirito della modernità, “spirito ebbro di velocità, di ‘divenire’, di un moto accelerato, incomposto, fino a ieri celebrato come quello di un progresso, laddove esso, sotto molti aspetti, altro non è che quello di un franare e di un precipitare” (Ivi, pp. 71 e 72).
14. R.M. Rilke, Del paesaggio e altri scritti, tr. it. di G. Zampa, Cederna, Milano 1949, p. 33.
15. Sul tema del viaggio e del ritorno in patria, cfr. la lettura heideggeriana di Hölderlin (M. Heidegger, La poesia di Hölderlin, a cura di L. Amoroso, Adelphi, Milano 1988).
16. Jünger ha sottolineato come il carattere devastante del nichilismo contemporaneo provenga dal buon adattamento dell’“ultimo uomo” di nietzschiana memoria a condizioni di vita impossibili per una civiltà “normale” (nel senso che la Tradizione attribuisce a questo aggettivo). Cfr., ad esempio, E. Jünger, Oltre la linea, in M. Heidegger-E. Jünger, Oltre la linea, tr. it. di F. Volpi e A. La Rocca, Adelphi, Milano 1989.
Tante altre notizie su www.ariannaeditrice.it
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : montagne, alpes, alpinisme, philosophie, géophilosophie, italie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 20 août 2010
La croisade de Thomas Molnar contre le monde moderne
La croisade de Thomas Molnar contre le monde moderne
par Arnaud FERRAND-LÉGER
Ex: http://www.europemaxima.com/
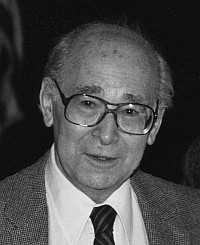 Dans le monde clos des intellectuels catholiques, Thomas Molnar reste un penseur à part. Philosophe, universitaire, écrivain et journaliste, l’ancien exilé hongrois réfugié aux États-Unis est rentré dans sa patrie dès la chute du communisme. Depuis il enseigne la philosophie religieuse à l’Université de Budapest. Mieux, avec la victoire des jeunes-démocrates de Viktor Orban, le professeur Molnar fut le conseiller culturel du jeune Premier ministre magyar avant de retourner dans l’opposition.
Dans le monde clos des intellectuels catholiques, Thomas Molnar reste un penseur à part. Philosophe, universitaire, écrivain et journaliste, l’ancien exilé hongrois réfugié aux États-Unis est rentré dans sa patrie dès la chute du communisme. Depuis il enseigne la philosophie religieuse à l’Université de Budapest. Mieux, avec la victoire des jeunes-démocrates de Viktor Orban, le professeur Molnar fut le conseiller culturel du jeune Premier ministre magyar avant de retourner dans l’opposition.
En France, les interventions de Thomas Molnar se font maintenant rares dans la presse, y compris parmi les journaux catholiques et nationaux. Il publia longtemps dans le bimensuel Monde et Vie d’où, d’une plume acérée, il diagnostique d’un œil sévère et avisé le délabrement du monde postmoderniste. En revanche, il continue la publication de ses ouvrages. Le dernier, Moi, Symmaque et L’Âme et la Machine, composé de deux essais, porte encore un regard inquiet sur le devenir de la société industrielle occidentale. Rarement, un livre aura justement traduit la crise mentale profonde dans laquelle sont plongés les catholiques de tradition. Il faut croire que l’accélération du monde soit brusque pour que le catholique Molnar se mette à la place du sénateur romain Symmaque, dernier chef du parti païen au IVe siècle. Symmaque fut le dernier à essayer de restaurer les cultes anciens…
Tel un nouveau Symmaque, Thomas Molnar charge, sabre au clair !, contre le relativisme moral, le multiculturalisme, l’inculture d’État, la perte des valeurs traditionnelles, l’arnaque artistique… Il n’hésite pas à affronter les grandes impostures contemporaines ! Mais le docteur Molnar ouvre un corps social entièrement métastasé.
Découvrir Thomas Molnar
Cette nouvelle dénonciation – efficace – permettra-t-elle à son œuvre prodigieuse de sortir enfin du silence artificiel dans lequel la pensée dominante l’a plongée ? Jean Renaud le croit puisqu’il relève le défi. A travers cinq entretiens, précédées d’une étude fine et brillante de l’homme et de ses livres, Jean Renaud se propose de faire découvrir cet étonnant universitaire hongrois. Même si son ouvrage se destine en priorité au public francophone d’Amérique du Nord (Pour les « Américains nés dans un monde unilatéral, programmé, horizontal, indifférencié ! Un de [leurs] ultimes recours, ce sont ces quelques Européens qui, de par le monde, persistent »), le lectorat de l’Ancien Monde peut enfin connaître la pensée originale de cet authentique réactionnaire, entendu ici dans son acception bernanosienne.
Non sans une pointe d’humour, Jean Renaud présente le professeur Molnar comme « toujours prêt à attaquer et à tenir, même pour soutenir des causes impopulaires, cet ennemi de l’Europe politique, cet exilé en terre d’Amérique mérite néanmoins parfaitement le titre d’Européen. Non seulement possède-t-il les principales langues du vieux continent, il est d’abord et surtout resté fidèle à un héritage, multiple, ondoyant, traversé de lignes harmoniques, de fragiles équilibres. Cet héritage européen n’est point porté par lui comme une cape décorative ornée de nostalgies : il est vivant et doit être protégé par le verbe et par la pensée ». Ce combat qui fait frémir toute la grande conscience humaniste n’est pas « sans taches, puisque [son promoteur] est blanc, mâle et hétérosexuel, ni impertinence, car il n’en manifeste aucune honte ». D’ailleurs, insatisfait d’exposer ses opinions incongrues, il osa s’exprimer dans la presse nationale-catholique et participa à plusieurs colloques du G.R.E.C.E.; c’est dire la dangerosité du personnage !
Bien sûr, Thomas Molnar n’adhère pas à la Nouvelle Droite. Il en diverge profondément sur des points essentiels. Ce catholique de tradition reste un fervent défenseur du principe national. Il « préfère ce nationalisme que l’on dit “ étroit ” et “ identitaire ” au mondialisme homogénéisé, uniforme, forcément totalitaire. Bref [il ne veut] pas que les “ valeurs ” américaines, après celles de Moscou, soient imposées à l’humanité. […] Les petits peuples, ajoute-t-il, à l’égal des puissants, sont indissolublement attachés à leur identité nationale : langue, littérature, souvenirs historiques incrustés dans les monuments, les chansons, les proverbes et les symboles. Voilà les seuls outils propres à résister aux conquêtes et aux occupations. Pour la même raison, il est impossible d’organiser des alliances ou des fédérations de petites nations : les haines et les méfiances historiques les empêchent de se fédérer. C’est un malheur, mais que voulez-vous ? »
Contempteur des fausses évidences
Auteur d’une remarquable contribution à l’histoire de la Contre-Révolution, sa vision de la droite est impitoyable de lucidité. Après avoir montré que « le libéralisme […] est antinational par essence, morceau difficile à avaler pour ces hommes de droite qui se veulent des conservateurs à l’américaine, tels Giscard, Barre et Balladur. […] Il est significatif, continue-t-il, de constater que l’histoire de la droite est jalonnée de grandes illusions et, partant, de grandes déceptions. […] La droite n’a pas de politique, elle a une “ culture ”. La politique ne se trouve qu’à gauche depuis 1945; la droite ne fait que “ réagir ” de temps en temps avec un Pinochet au Chili, un Antall en Hongrie. C’est de courte durée. […] La droite n’a pas le choix : autoexilée de la politique, elle déplore cet exil qui promet d’être permanent, elle ferme les yeux et préfère s’illusionner ».
Persuadé de l’importance du combat métapolitique et de son enjeu culturel, Thomas Molnar note, avec une précision de chirurgien, que « l’opinion de droite, et la droite catholique en fait partie intégrante, ne s’intéresse guère aux arguments, aux raisonnements, au jeu subtil de la culture. Elle se sent, depuis 1789, lésée dans ses droits, dans sa vérité, et cherche à regagner ses positions d’antan. Elle se laisse enfermer dans un ghetto, pleine de ressentiment, et fait tout pour limiter sa propre influence, son propre poids, afin de pouvoir dire par la suite qu’elle est victime de l’histoire et de ses influences sataniques ». Ce réac suggère des orientations nouvelles qui détonnent dans un milieu sclérosé. Il propose par conséquent une rénovation radicale du discours banalement conservateur.
La partie la plus intéressante des entretiens concerne toutefois la Modernité, ses conséquences et son avenir. Respectueux d’« un réel multiforme jamais possédé, dans son intégralité, par la raison humaine », Thomas Molnar observe que « le ciel de la modernité est fermé; les certitudes d’antan ont mauvaise presse. Mettons-nous dans la peau de l’homme moderne : ses deux poteaux indicateurs sont l’utopie et la technologie, le miracle politique et le miracle matériel, idéaux éphémères qui s’écroulent à chaque instant. Fini le rêve marxiste, vive le libéralisme ! Plus de voyage dans la lune, vive l’intervention biotechnique ! Le cosmos, jadis peuplé de dieux, ressemble aujourd’hui à quelques gros cailloux qui tourne et éclatent, naissent et s’éteignent ». Voilà le triste bilan de « la philosophie moderne [… qui] est le refus des essences et l’accueil de l’existence brute, du devenir […] plutôt que de l’être. […] La perte de l’essence entraîne celle des structures, puis celle des significations. on peut dire n’importe quoi, à l’instar de la peinture moderne. Nous habitons le paradis des tartuffes et des charlatans, paradis où fleurit la dégringolade du sens ».
La crise de la Modernité
Or la désespérance nihiliste est superfétatoire. Pis elle est inutile, car si l’« on se sert, aujourd’hui, de ce mot “ désenchantement ” pour décrire la perte du sacré; n’oublions pas qu’il peut y avoir, dans un avenir proche ou lointain, une perte du profane, plus exactement une perte du noyau de notre civilisation technicienne et mécanicienne ». Il envisage alors tranquillement « l’effondrement graduel (toujours la fatigue des civilisations) de la mentalité technicienne, voire scientifique, par le reflux de la civilisation occidentale, qui a atteint, avec la domination américaine sur la planète, une espèce de nec plus ultra ». Certes, «l’idéologie industrielle, profondément subversive, la publicité, l’étalage du privé sur la place publique, la confusion des sexes, le règne de la machine et des robots bloquent, pour le moment, notre horizon », mais « les modernes ont tout perdu, souligne à son tour Jean Renaud; ils nous ont peut-être profondément offensés, mais ils sont fous. Leur univers est imaginaire. Chacun à notre place, il nous est possible de résister, de tenir quotidiennement, de refuser l’isolement d’aider le jeune et le vieux, d’accumuler ces actes modestes que nous avons désappris, ces actes par lesquels l’âme se fortifie. Le monde moderne existe de moins en moins ». Si les catholiques actuels savaient encore penser et s’ils cessaient de suivre les sirènes de la confusion moderne, le professeur Molnar serait sans conteste leur référence intellectuelle.
« Pour la liberté de l’âme face à la robotisation », tonne Thomas Molnar qui poursuit ainsi une véritable croisade spirituelle contre un monde déshumanisé et mécanisant, toujours plus négateur de la diversité naturelle. En d’autres temps et en d’autres lieux, Thomas Molnar aurait été un croisé de haute tenue, car il est dans l’âme un Croisé contre le Désordre contemporain. Ode alors à l’homme qui fut la Chrétienté…
Arnaud Ferrand-Léger
• Moi, Symmaque, suivi de L’Âme et la machine, Éditions L’Âge d’Homme, 167 p.
• Du mal moderne. Symptômes et antidotes, cinq entretiens de Thomas Molnar avec Jean Renaud, précédé de « Thomas Molnar ou la réaction de l’esprit » par Jean Renaud, Québec, Canada, Éditions de Beffroi, 1996.
Article printed from Europe Maxima: http://www.europemaxima.com
URL to article: http://www.europemaxima.com/?p=475
00:11 Publié dans Hommages, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hommage, philosophie, théorie politique, politologie, sciences politiques, modernité, contre-révolution, conservatisme, droite |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
In memoriam: Thomas MOlnar (1921-2010)
 Thomas Molnar, the esteemed political philosopher and historian, passed away on July 20 at the age of eighty-nine. Dr. Molnar was a friend of ISI from its earliest days. He lectured frequently for the Institute and contributed many articles to the Intercollegiate Review and Modern Age. In 2003 ISI awarded him its Will Herberg Award for Outstanding Faculty Service.
Thomas Molnar, the esteemed political philosopher and historian, passed away on July 20 at the age of eighty-nine. Dr. Molnar was a friend of ISI from its earliest days. He lectured frequently for the Institute and contributed many articles to the Intercollegiate Review and Modern Age. In 2003 ISI awarded him its Will Herberg Award for Outstanding Faculty Service.
Requiescat in pace.
The following profile of Dr. Molnar was originally published in American Conservatism: An Encyclopedia (ISI Books, 2006). Also, consult the First Principles archival section to read some of Dr. Molnar’s fine essays.
A political philosopher by training, Thomas Molnar was born June 26, 1921, in Budapest and studied in France just before the Second World War, by the end of which he found himself interned in Dachau for anti-German activities. His first book, Bernanos: His Political Thought and Prophecy (1960), was a pioneering study of the work of the famous French Catholic novelist, who had moved from membership in the Action Française to writing on behalf of the French resistance. Taking his cue from Bernanos, Molnar would, like the novelist, go on to become a fiercely independent and contrarian writer, as well as a critic of modern political and economic systems that attempted to deny or transform man’s nature and his place in the cosmos. As Molnar would write of Teilhard de Chardin in perhaps his most wide-ranging book, Utopia: The Perennial Heresy (1967): “[Teilhard’s] public forgets . . . that man cannot step out of the human condition and that no ‘universal mind’ is now being manufactured simply because science has permitted the building of nuclear bombs, spaceships and electronic computers.” Throughout his career, Molnar would remain the enemy of such transformative philosophical endeavors—whether they came in the form of Soviet communism or Western technological hubris. In this respect, his critique of classical and modern “Gnosticism” mirrored the work of the philosophical historian Eric Voegelin.
Revolted by the communist conquest (and 1956 suppression) of his homeland, Molnar early found himself interested in twentieth-century counterrevolutionary movements such as the Action Française and the Spanish Falangists. He examined such movements in his penetrating study The Counter-Revolution (1969), pointing to the quality they shared with their counterparts on the Left: a loathing of the rise of the commercial class and its mores. Regardless of the important constituencies such movements might find in the middle class—Engels was a factory owner’s heir, Maurras got his funding from French manufacturers—Molnar concluded that the animating sentiment of each such movement was hostility to the “bourgeois spirit.”
Molnar’s study of these secular counterrevolutionary movements revealed their limitations and their participation in the modern spirit that aims to “manage” human nature by means of state or party in accord with an ideological plan. Molnar rediscovered his childhood Catholic faith in the early 1960s, and it would ever after serve as the lodestar guiding his political, cultural, and philosophical writings. Among his most important books are Twin Powers: Politics and the Sacred (1988) and The Church: Pilgrim of Centuries (1990), which examine the struggle between church and state in medieval and early-modern history—and this battle’s continuing implications for politics and ecclesiastical governance. Molnar identifies two destructive tendencies rooted in the medieval and early-modern periods whose implications only became obvious in the twentieth century: first, Erastianism, the subjection of spiritual authority to the power of the state or the preferences of civil society; and second, Puritanism, a claim by the state to spiritual power and redemptive purpose.
Molnar was one of the earliest writers and academics to associate himself with the Intercollegiate Society of Individualists (later Intercollegiate Studies Institute), joining its lecture program and frequently publishing in the Intercollegiate Review and Modern Age. His writing also appeared in dozens of other publications and in several European languages on topics ranging from classical history and French literature to foreign policy and modern philosophy. Molnar traveled to every inhabited continent and moved increasingly in his later years toward a global, world-historical (rather than particularly Western) view of events; he retained, however, a firmly Catholic faith that rendered him skeptical of secular undertakings, including the conservative movement. A personal friend of luminaries Russell Kirk and Wilhelm Röpke, Molnar was more pessimistic than either of those thinkers about the prospects of saving the essentials of Western civilization from the advancing effects of the “ideology of technology,” which promised with more apparent plausibility than did previous systems (such as Marx’s) to make man into a different animal, if not in fact a god. Molnar was the author of more than thirty books.
Further Reading- Molnar, Thomas. The Decline of the Intellectual. Cleveland: World, 1961.
- ———. The Emerging Atlantic Culture. New Brunswick, N.J.: Transaction, 1994.
- ———. The Pagan Temptation. Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 1988.
00:10 Publié dans Hommages, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : catholicisme, conservatisme, droite, contre-révolution, philosophie, théorie politique, sciences politiques, politologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Pavel Florenskij : Il pensiero contro l'ideologia
di Vito Mancuso
Fonte: La Repubblica [scheda fonte]
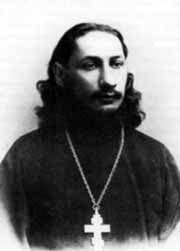 L'incontro con Pavel Florenskij ha segnato profondamente la mia vita e quindi questo articolo lo si deve intendere come una dichiarazione d'amore. L'occasione è la nuova edizione del capolavoro del 1914 La colonna e il fondamento della verità grazie al contributo encomiabile di Natalino Valentini, al quale si deve la cura di molti altri scritti, tra cui Bellezza e liturgia, l'epistolario dal gulag Non dimenticatemi e le memorie Ai miei figli. Come ogni dichiarazione d'amore, anche questa si rivolge alla più intima umanità dell'interessato, a quel mistero personale non riassumibile nelle sue conoscenze. Dico questo per liberare Florenskij dall'incanto della sua genialità («il Leonardo da Vinci della Russia») per l'essere stato matematico, fisico, ingegnere, e, sull'altro versante, teologo, filosofo, storico dell'arte. Marito e padre di cinque figli, fu anche sacerdote ortodosso, status che gli costò la vita nel 1937. Essere sacerdote e insieme scienziato era una smentita vivente dell'ideologia comunista, per la quale la fede era solo ignoranza: la dittatura non poteva tollerarlo e non lo tollerò.
L'incontro con Pavel Florenskij ha segnato profondamente la mia vita e quindi questo articolo lo si deve intendere come una dichiarazione d'amore. L'occasione è la nuova edizione del capolavoro del 1914 La colonna e il fondamento della verità grazie al contributo encomiabile di Natalino Valentini, al quale si deve la cura di molti altri scritti, tra cui Bellezza e liturgia, l'epistolario dal gulag Non dimenticatemi e le memorie Ai miei figli. Come ogni dichiarazione d'amore, anche questa si rivolge alla più intima umanità dell'interessato, a quel mistero personale non riassumibile nelle sue conoscenze. Dico questo per liberare Florenskij dall'incanto della sua genialità («il Leonardo da Vinci della Russia») per l'essere stato matematico, fisico, ingegnere, e, sull'altro versante, teologo, filosofo, storico dell'arte. Marito e padre di cinque figli, fu anche sacerdote ortodosso, status che gli costò la vita nel 1937. Essere sacerdote e insieme scienziato era una smentita vivente dell'ideologia comunista, per la quale la fede era solo ignoranza: la dittatura non poteva tollerarlo e non lo tollerò.
Da una lettera del 1917 emerge la sua inconfondibile personalità: «Nello spazio ampio della mia anima non vi sono leggi, non voglio la legalità, non riesco ad apprezzarla... Non mi turba nessun ostacolo costruito da mani d'uomo: lo brucio, lo spacco, diventando di nuovo libero, lasciandomi portare dal soffio del vento». Eccoci al cospetto di un nesso incandescente: dedizione assoluta per «la colonna e il fondamento della verità» e insieme vibrante ribellione a ogni legaccio della libertà. Si comprende così come non solo per il regime ma anche per la Chiesa gerarchica il suo pensiero era ed è destabilizzante, tant'è che ancora oggi, nonostante il martirio, Florenskij non è stato beatificato. Durante la prigionia scriveva al figlio Kirill: «Ho cercato di comprendere la struttura del mondo con una continua dialettica del pensiero». Dialettica vuol dire movimento, pensiero vivo, perché «il pensiero vivo è per forza dialettico», mentre il pensiero che non si muove è quello morto dell'ideologia, che, nella versione religiosa, si chiama dogmatismo.
Il pensiero si muove se è sostenuto da intelligenza, libertà interiore e soprattutto amore per la verità, qualità avverse a ogni assolutismo e abbastanza rare anche nella religiosità tradizionale. Al riguardo Florenskij racconta che da bambino «il nome di Dio, quando me lo ponevano quale limite esterno, quale sminuimento del mio essere uomo, era in grado di farmi arrabbiare tantissimo». La sua lezione spirituale è piuttosto un'altra: la fede non è un assoluto, è relativa, relativa alla ricerca della verità. Quando la fede non si comprende più come via verso qualcosa di più grande ma si assolutizza, si fossilizza in dogmatismo e tradisce la verità.
La dialettica elevata a chiave del reale si chiama antinomia, concetto decisivo per Florenskij che significa «scontro tra due leggi» entrambe legittime. L'antinomia si ottiene guardando la vita, che ha motivi per dire che ha un senso e altri opposti. Di solito gli uomini scelgono una prospettiva perché tenerle entrambe è lacerante, ma così mutilano l'esperienza integrale della realtà. Ne viene che ciò che i più ritengono la verità, è solo un polo della verità integrale, per attingere la quale occorre il coraggio di muoversi andando dalla propria prospettiva verso il suo contrario. Conservando la propria verità, e insieme comprendendone il contrario, si entra nell'antinomia.
«La verità è antinomica e non può non essere tale», scrive Florenskij nello straordinario capitolo della Colonna dedicato alla contraddizione dove convengono Eraclito, Platone, Cusano, Fichte, Schelling, Hegel. Ma è per Kant l'elogio più alto: «Kant ebbe l'ardire di pronunciare la grande parola "antinomia", che distrusse il decoro della pretesa unità. Anche solo per questo egli meriterebbe gloria eterna». In realtà questa celebrazione della vita aldilà del concetto è il trionfo dell'anima russa, quella di Puskin, Gogol', Dostoevskij, Tolstoj, Cechov, Pasternak, e che pure traspare da molte pagine di Florenskij cariche di poesia.
Per lui anche la Bibbia e la dottrina sono colme di antinomie, in particolare la Lettera ai Romani è «una bomba carica di antinomie». Ma di ciò si deve preoccupare solo chi ha una concezione dottrinale del cristianesimo, non chi, come Florenskij, lo ritiene funzionale alla vita.
Tra i due nomoi dell'antinomia non c'è però per Florenskij perfetta simmetria: operativamente egli privilegia il polo positivo. Pur sapendo bene che «la vita non è affatto una festa, ma ci sono molte cose mostruose, malvagie, tristi e sporche», non cede mai alla rassegnazione o al cinismo; al contrario insegna ai figli che «rendendosi conto di tutto questo, bisogna avere dinnanzi allo sguardo interiore l'armonia e cercare di realizzarla».
Tale armonia non può venire dal mondo, dove regna l'antinomia, ma da una dimensione più profonda. La voglio illustrare con alcune righe del testamento spirituale, iniziato nel 1917, l'anno della rivoluzione, avendo subito intuito la minaccia che incombeva su di lui: «Osservate più spesso le stelle. Quando avrete un peso sull'animo, guardate le stelle o l'azzurro del cielo. Quando vi sentirete tristi, quando vi offenderanno, quando qualcosa non vi riuscirà, quando la tempesta si scatenerà nel vostro animo, uscite all'aria aperta e intrattenetevi, da soli, col cielo. Allora la vostra anima troverà la quiete».
Tante altre notizie su www.ariannaeditrice.it
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : russie, lettres russes, littérature russe, lettres, littérature, orthodoxie, slavisme, slavistique, études slaves, religion, chrisitanisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook



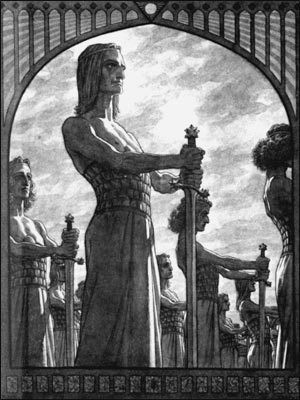 Bajo la fórmula “Revolución Conservadora” acuñada por Armin Mohler (Die Konservative Revolution in Deutschlan 1918-1932) se engloban una serie de corrientes de pensamiento contemporáneas del nacionalsocialismo, independientes del mismo, pero con evidentes conexiones filosóficas e ideológicas, cuyas figuras más destacadas son Oswald Spengler, Ernst Jünger, Carl Schmitt y Moeller van den Bruck, entre otros. La “Nueva Derecha” europea ha invertido intelectualmente gran parte de sus esfuerzos en la recuperación del pensamiento de estos autores, junto a otros como Martin Heidegger, Arnold Gehlen y Konrad Lorenz (por citar algunos de ellos), a través de una curiosa fórmula retrospectiva: se vuelve a los orígenes teóricos, dando un salto en el tiempo para evitar el “interregno fascista”, y se comienza de nuevo intentando reconstruir los fundamentos ideológicos del conservadurismo revolucionario sin caer en la “tentación totalitaria” y eludiendo cualquier “desviacionismo nacionalsocialista”.
Bajo la fórmula “Revolución Conservadora” acuñada por Armin Mohler (Die Konservative Revolution in Deutschlan 1918-1932) se engloban una serie de corrientes de pensamiento contemporáneas del nacionalsocialismo, independientes del mismo, pero con evidentes conexiones filosóficas e ideológicas, cuyas figuras más destacadas son Oswald Spengler, Ernst Jünger, Carl Schmitt y Moeller van den Bruck, entre otros. La “Nueva Derecha” europea ha invertido intelectualmente gran parte de sus esfuerzos en la recuperación del pensamiento de estos autores, junto a otros como Martin Heidegger, Arnold Gehlen y Konrad Lorenz (por citar algunos de ellos), a través de una curiosa fórmula retrospectiva: se vuelve a los orígenes teóricos, dando un salto en el tiempo para evitar el “interregno fascista”, y se comienza de nuevo intentando reconstruir los fundamentos ideológicos del conservadurismo revolucionario sin caer en la “tentación totalitaria” y eludiendo cualquier “desviacionismo nacionalsocialista”. 







