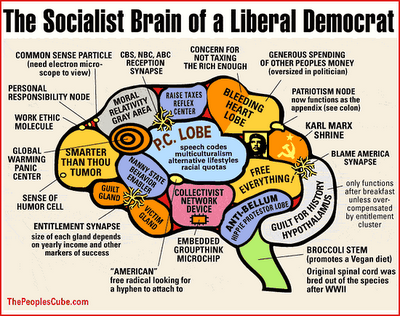mardi, 26 avril 2011
Nicola Bombacci: de Lênin a Mussolini

Nicola Bombacci: de Lênin a Mussolini
Nicola Bombacci nasce no seio de uma família católica (o seu pai era agricultor, antigo soldado do Estado Pontifício) da Romagna, na província de Forli, a 24 de Outubro de 1879, a escassos quilómetros de Predappio, onde quatro anos mais tarde nascerá o futuro fundador do Fascismo. Trata-se de uma região marcada por duras lutas operárias e por um campesinato habituado à rebelião, terra de paixões extremas. Por imposição paterna ingressa no seminário mas rapidamente o abandona aquando da morte do seu progenitor. Em 1903 ingressa no anticlerical Partido Socialista (PSI) e decide tornar-se professor para poder assim servir as classes menos favorecidas na sua luta (novamente as semelhanças com o Duce são evidentes, tendo chegado a estudar na mesma escola superior) mas rapidamente passa a dedicar-se de corpo e alma à revolução socialista. A sua capacidade de trabalho e os seus dotes de organizador valem-lhe a direcção dos órgãos da imprensa socialista, o que lhe permitirá aumentar a sua influência no seio do movimento operário, chegando a ser Secretário do Comité Central do Partido, onde conhecerá um jovem uns anos mais novo: Benito Mussolini, que, não nos esqueçamos, foi a promessa do socialismo italiano antes de se tornar nacional-revolucionário. [1]
Opondo-se à linha moderada da social-democracia, Bombacci fundará juntamente com Gramsci o Partido Comunista de Itália após a cisão interna do PSI e viajará em princípios dos anos 20 para a URSS, para participar na revolução bolchevique, aonde já antes tinha estado como representante do Partido Socialista tendo sido conquistado pela causa dos sovietes. Aí trava amizade com o próprio Lenine que lhe dirá numa recepção no Kremlin estas famosas palavras sobre Mussolini: “Em Itália, companheiros, em Itália só há um socialista capaz de guiar o povo para a revolução: Benito Mussolini”, e pouco depois o Duce encabeçaria uma revolução, mas fascista… [2]
Como líder (António Gramsci era o teórico, Bombacci o organizador) do recém-criado PCI, torna-se no autêntico “inimigo público nº 1” da burguesia italiana, que o apoda de “O Papa Vermelho”. Revalidará brilhantemente o seu lugar de deputado, desta vez nas listas da nova formação, enquanto que as esquadras fascistas começam a tomar as ruas enfrentando as milícias comunistas em sangrentos combates. Bombacci empenhar-se-á em deter a marcha para o poder do fascismo mas fracassará, desde as páginas dos seus jornais lança invectivas contra o fascismo arengando a defesa da revolução comunista. É uma época em que os esquadristas de camisa negra cantam canções irreverentes como “Não tenho medo de Bombacci / Com a barba de Bombacci faremos spazzolini (escovas) / Para abrilhantar a careca de Benito Mussolini”. Etapa em que o comunismo se vê imerso em numerosas tensões internas e o próprio Bombacci entra em polémica com os seus companheiros de partido sendo um dos pontos de fricção a opção entre nacionalismo e internacionalismo. Já antes tinha demonstrado tendências nacionalistas, que faziam pressagiar a sua futura linha. Quando ainda estava no Partido Socialista e como consequência de um documento protestando contra a acção de Fiume levada a cabo por D’Annunzio que o Partido queria apresentar, Bombacci rebelou-se e escreveu sobre este que era “Perfeita e profundamente revolucionário; porque D’Annunzio é revolucionário. Disse-o Lenine no Congresso de Moscovo”. [3]
Em 1922 os fascistas marcham sobre a capital do Tibre; nada pode impedir que Mussolini assuma o poder, ainda que este não seja absoluto durante os primeiros anos do regime. Como deputado e membro do Comité Central do Partido, assim como encarregado das relações exteriores do mesmo, Bombacci viaja ao estrangeiro frequentemente. Participa no IV Congresso da Internacional Comunista representando a Itália, e, no Comité de Acção Antifascista, entrevista-se com dirigentes bolcheviques russos. Leva já metade da sua vida dedicada à causa do proletariado e não está disposto a desistir do seu empenho em levar à prática o seu sonho socialista. Torna-se fervente defensor da aproximação da Itália à URSS na Câmara e na imprensa comunista, falando seguramente em nome e por instigação dos dirigentes moscovitas, mas utilizando um discurso nacional-revolucionário que incomoda no seio do Partido, que por outro lado está em plena debandada após a vitória fascista. As relações com o revolucionário Estado soviético seriam uma vantagem para a Itália enquanto nação que também atravessa um processo revolucionário, ainda que fascista. É imediatamente acusado de herético e pedem-lhe que rectifique as suas posições. Não podem admitir que um comunista exija, como o faz Bombacci, “superar a Nação (sem) a destruir, queremo-la maior, porque queremos um governo de trabalhadores e agricultores”, socialista e sem negar a Pátria “direito incontestável e sacro de todo o homem e de todos os grupos de homens”. É a chamada “Terceira Via” onde o nacionalismo revolucionário do fascismo se encontra com o socialismo revolucionário comunista.
Bombacci é progressivamente marginalizado no seio do PCI e condenado ao ostracismo político, embora não deixe de manter contactos com alguns dirigentes russos e com a embaixada russa para a qual trabalha, além de que um dos seus filhos vivia na URSS. Acreditava sinceramente na revolução bolchevique e que, ao contrário dos camaradas italianos, os russos tinham um sentido nacional da revolução pelo que jamais renegará a sua amizade para com a URSS, nem sequer depois de aderir definitivamente ao fascismo.
Com a expulsão definitiva do partido em 1927, Bombacci entra numa etapa que podemos qualificar como os anos do silêncio que dura até 1936, altura em que lança a sua editorial e a revista homónima baptizada “La Veritá” e que culminará em 1943 numa progressiva conversão ao fascismo. No entanto é demasiado fácil considerar que Bombacci simplesmente se passou de armas e bagagens para o fascismo como pretendem os que o acusam de ser um “traidor”. Assistiremos a um processo lento de aproximação, não ao fascismo mas sim a Mussolini e à ala esquerdista do movimento fascista, onde Bombacci se sente aconchegado e em família, próximo das suas concepções revolucionárias, o corporativismo e as leis sociais deste fascismo de que “todo o postulado é um programa do socialismo”, segundo dirá em 1928 reconhecendo a sua identificação. [4]
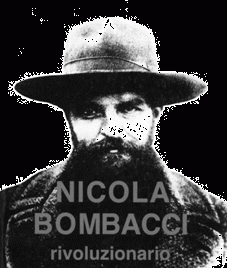 Comprovamos assim que Bombacci não é um fascista, mas defende as conquistas do regime e a figura de Mussolini. Não se aproximou do partido fascista – jamais se inscreveu no Partido Nacional Fascista – apesar da sua amizade reconhecida com Mussolini, não aceitou cargos que lhe poderiam oferecer nem renegou as suas origens comunistas. A sua independência valia mais. No entanto convenceu-se de que o Estado Corporativo proposto pelo fascismo era a realização mais perfeita, o socialismo levado à prática, um estado superior ao comunismo. Jamais camuflará os seus ideais, em 1936 escrevia na revista “La Veritá”, confessando a sua adesão ao fascismo mas também ao comunismo:
Comprovamos assim que Bombacci não é um fascista, mas defende as conquistas do regime e a figura de Mussolini. Não se aproximou do partido fascista – jamais se inscreveu no Partido Nacional Fascista – apesar da sua amizade reconhecida com Mussolini, não aceitou cargos que lhe poderiam oferecer nem renegou as suas origens comunistas. A sua independência valia mais. No entanto convenceu-se de que o Estado Corporativo proposto pelo fascismo era a realização mais perfeita, o socialismo levado à prática, um estado superior ao comunismo. Jamais camuflará os seus ideais, em 1936 escrevia na revista “La Veritá”, confessando a sua adesão ao fascismo mas também ao comunismo:“O fascismo fez uma grandiosa revolução social, Mussolini e Lenine. Soviete e Estado fascista corporativo, Roma e Moscovo. Muito tivemos que rectificar, nada de que nos fazer perdoar, pois hoje como ontem move-nos o mesmo ideal: o triunfo do trabalho”. [5]
Enquanto isto sucedia Bombacci tem um longo intercâmbio epistolar com o Duce tentando influenciar o antigo socialista na sua política social. O máximo historiador do fascismo, Renzo de Felice, escreveu a este respeito que Bombacci tem o mérito de ter sugerido a Mussolini mais do que uma das medidas adoptadas nesses anos 30. [6] Numa destas missivas, datada de Julho de 1934, propõe um programa de economia autárquica (que Mussolini aplicará) que, diz Bombacci ao Duce, é mostra da sua “vontade de trabalhar mais naquilo que agora concerne, no interesse e pelo triunfo do Estado Corporativo…”, como faz também desde as páginas da sua revista onde uma e outra vez batalha por uma autarcia que faça da Itália um país independente e capaz de enfrentar as potências plutocráticas (entenda-se os EUA, mas também a França e a Inglaterra). Por isso apoia decididamente a intervenção na Etiópia em 1935, mas não como campanha colonial senão como prelúdio da confrontação entre os países “proletários” (entre os quais estaria a Itália fascista) e os “capitalistas” que irremediavelmente chegaria, essa “revolução mundial (que) restabelecerá o equilíbrio mundial”. A acção italiana seria uma “típica e inconfundível conquista proletária”, destinada a derrotar as potências “capitalistas” e cuja experiência “deverá ser assumida… como um dado fundamental para a redenção das gentes de cor, ainda sob a opressão do capitalismo mais terrível”. [7]
Contra Estaline
Entre os anos de 1936 e 1943, difíceis para o fascismo pois iniciam-se os conflitos armados, prelúdio da derrota, Bombacci acrescenta a sua adesão ideológica a Mussolini. É um homem com quase 60 anos, viu como muitos dos seus sonhos socialistas não se realizaram, mas é um eterno idealista e não está disposto a abandonar a luta pelo socialismo, por “essa obra de redenção económica e de elevação espiritual do proletariado italiano que os socialistas da primeira hora tínhamos iniciado”. A sua editorial é uma ruína económica, os seus biógrafos deixaram constância das dificuldades e penúrias que sofre. Ter-lhe-ia bastado um passo oportunista e integrar-se no fascismo oficial e teria disposto de todas as ajudas do aparato do Estado mas não quer perder a sua independência ainda que em ocasiões deva aceitar subvenções do Ministério de Cultura Popular.
Esta etapa coincide com uma profunda reflexão sobre os seus erros passados e uma série de ataques ao comunismo russo que se tinha vendido às potências capitalistas traindo os postulados de Lenine. Assim, escreve Bombacci em Novembro de 1937, as relações entre a URSS e os países democráticos só tinha uma explicação que revelaria tudo o resto: “a razão é só uma, frívola, vulgar, mas real: o interesse, o dinheiro, o negócio”, pelo que este antigo comunista podia declarar abertamente que “nós proclamamos com a consciência limpa que a Rússia bolchevique de Estaline se tornou uma colónia do capitalismo maçónico-hebraico-internacional…”. A alusão anti-semita não é nova em Bombacci, nem nos teóricos socialistas do início do século, pois não devemos esquecer que o anti-semitismo moderno teve os seus mais ferventes defensores precisamente entre os doutrinários revolucionários de finais do século XIX, quando o judeu encarnava a figura do odiado capitalista. Em Bombacci não encontramos um anti-semitismo racialista mas sim social, de acordo com os posicionamentos mediterrânicos do problema judeu diferentemente do anti-judaismo alemão ou gaulês.
Quando estala a II Guerra Mundial, e especialmente ao estalar na frente Leste, Bombacci participa em pleno nas campanhas anticomunistas do regime. Como dirigente comunista conhecedor da URSS a sua voz faz-se ouvir. No entanto não renega os seus ideais, pelo contrário aprofunda a tese de que Estaline e os seus acólitos traíram a revolução. Escreve numerosos artigos contra Estaline, sobre as condições reais de vida no chamado “paraíso comunista”, as medidas adoptadas por este para destruir todos os sucessos do socialismo leninista. Em 1943, pouco antes da queda do Fascismo, concluía Bombacci resumindo a sua posição num folheto de propaganda:
“Qual das duas revoluções, a fascista ou a bolchevique, fará história no século XX e ficará na história como criadora de uma ordem nova de valores sociais e mundiais?
Qual das duas revoluções resolveu o problema agrário interpretando verdadeiramente os desejos e aspirações dos camponeses e os interesses económicos e sociais da colectividade nacional?
Roma venceu!
Moscovo materialista e semi-bárbara, com um capitalismo totalitário de Estado-Patrão quer juntar-se à força (planos quinquenais), levando à miséria mais negra os seus cidadãos, à industrialização existente nos países que durante o século XIX seguiram um processo de regime capitalista burguês. Moscovo completa a fase capitalista.
Roma é outra coisa.
Moscovo, com a reforma de Estaline, retrata-se institucionalmente ao nível de qualquer Estado burguês parlamentar. Economicamente há uma diferença substancial, porque, enquanto que nos Estados burgueses o governo é formado por delegados da classe capitalista, aqui o governo está nas mãos da burocracia bolchevique, uma nova classe que na realidade é pior que essa classe capitalista porque dispõe sem qualquer controlo do trabalho, da produção e da vida dos cidadãos”. [8]
A República Social Italiana
 Quando Mussolini é deposto em Julho de 1943 e resgatado pelos alemães uns meses depois, o Partido Nacional Fascista já se desagregou. A estrutura orgânica desapareceu, os dirigentes do partido, provenientes das camadas privilegiadas da sociedade passaram-se em massa para o governo de Badoglio e a Itália encontra-se dividida em dois (ao sul de Roma os Aliados avançam em direcção ao norte). Mussolini reagrupa os seus mais fiéis, todos eles velhos camaradas da primeira hora ou jovens entusiastas, quase nenhum dirigente de alto nível, que ainda acreditam na revolução fascista e proclama a República Social Italiana. Imediatamente o fascismo parece voltar às suas origens revolucionárias e Nicola Bombacci adere à república proclamada e presta a Mussolini todo o seu apoio. O seu sonho é poder levar a cabo a construção dessa “República dos trabalhadores” pela qual tanto ele como Mussolini se bateram juntos no início do século. Tal como Bombacci, outros conhecidos intelectuais de esquerda juntam-se ao novo governo: Carlo Silvestri (deputado socialista, depois da guerra defensor da memória do Duce), Edmondo Cione (filosofo socialista que será autorizado a criar um partido socialista aparte do Partido Fascista Republicano), etc.
Quando Mussolini é deposto em Julho de 1943 e resgatado pelos alemães uns meses depois, o Partido Nacional Fascista já se desagregou. A estrutura orgânica desapareceu, os dirigentes do partido, provenientes das camadas privilegiadas da sociedade passaram-se em massa para o governo de Badoglio e a Itália encontra-se dividida em dois (ao sul de Roma os Aliados avançam em direcção ao norte). Mussolini reagrupa os seus mais fiéis, todos eles velhos camaradas da primeira hora ou jovens entusiastas, quase nenhum dirigente de alto nível, que ainda acreditam na revolução fascista e proclama a República Social Italiana. Imediatamente o fascismo parece voltar às suas origens revolucionárias e Nicola Bombacci adere à república proclamada e presta a Mussolini todo o seu apoio. O seu sonho é poder levar a cabo a construção dessa “República dos trabalhadores” pela qual tanto ele como Mussolini se bateram juntos no início do século. Tal como Bombacci, outros conhecidos intelectuais de esquerda juntam-se ao novo governo: Carlo Silvestri (deputado socialista, depois da guerra defensor da memória do Duce), Edmondo Cione (filosofo socialista que será autorizado a criar um partido socialista aparte do Partido Fascista Republicano), etc.O primeiro contacto com Mussolini ocorre a 11 de Outubro, apenas um mês depois da proclamação da RSI, e é epistolar. Bombacci escreve a Mussolini a partir de Roma, cidade onde o fascismo ruiu estrepitosamente (os romanos destruíram todos os símbolos do anterior regime nas ruas), mas onde ainda existem muitos fascistas de coração, e é este o momento que escolhe para declarar a Mussolini que está consigo. Não quando tudo corria bem, mas sim nos momentos difíceis como tão-só o fazem os verdadeiros camaradas:
“Estou hoje mais que ontem totalmente consigo” – confessa Bombacci – “a vil traição do rei-Badoglio trouxe por todos os lados a ruína e a desonra de Itália mas libertou-a de todos os compromissos pluto-monárquicos de 22.
Hoje o caminho está livre e em minha opinião só se pode recorrer ao abrigo socialista. Acima de tudo: a vitória das armas.
Mas para assegurar a vitória deve ter a adesão da massa operária. Como? Com feitos decisivos e radicais no sector económico-produtivo e sindical…
Sempre às suas ordens com o grande afecto já de trinta anos.”
Se para muitos o último Mussolini era um homem acabado, títere dos alemães, não deixa de surpreender a adesão que recebe de homens como Bombacci, um verdadeiro idealista, de estatura imponente, com a barba crescida e uma oratória atraente, alérgico a tudo o que pudesse significar acomodar-se ou aburguesar-se, que tão-pouco agora aceitará salário ou prebendas (apenas em princípios de 1945 aparecerá o seu nome numa lista de propostas de salários do ministério da Economia ou como Chefe da Confederação Única do Trabalho e da Técnica). Bombacci tornar-se-á assessor pessoal e confidente de Mussolini, para atrair de novo às bases do partido os trabalhadores. Propõe a criação de comités sindicais, abertos a não militantes fascistas, eleições sindicais livres, viajará pelas fábricas do norte industrializado (Milão-Turim) explicando a revolução social do novo regime e o porquê da sua adesão. O velho combatente revolucionário parece de novo rejuvenescer, após um comício em Verona e várias visitas a empresas socializadas escreve ao Duce a 22 de Dezembro de 1944: “Falei durante uma hora e trinta minutos num teatro entregue e entusiasta… a plateia, composta na maior parte por operários vibrou gritando: sim, queremos combater por Itália, pela república, pela socialização… pela manhã visitei a Mondadori, já socializada, e falei com os operários que constituem o Conselho de Gestão que achei cheio de entusiasmo e compreensão por esta nossa missão”. Enquanto a situação militar se deteriorava, os grupos terroristas comunistas (os tragicamente famosos GAP) já tinham decidido eliminá-lo pelo perigo que a sua actividade representava para os seus objectivos. [9]
Mas a guerra está a chegar ao fim. Benito Mussolini, aconselhado pelo deputado ex-socialista Carlo Silvestri e Bombacci, propõe entregar o poder aos socialistas, integrados no Comité Nacional de Libertação. [10] Em Abril de 1945 as autoridades militares alemãs rendem-se aos Aliados, sem informar os italianos, é o fim. Abandonados e sós.
Durante os últimos meses da RSI Bombbaci continuou a campanha para recuperar as massas populares e evitar que se decantassem pelo bolchevismo. Em finais de 1944 publicava um opúsculo intitulado «Isto é o Bolchevismo», reproduzido no jornal católico «Crociata Italica» em Março de 1945. Bombacci insiste nas críticas aos desvios estalinistas do comunismo real que destruiu o verdadeiro sindicalismo revolucionário na Europa com as ingerências russas. Nestas últimas semanas de vida da experiência republicana, Bombacci está ao lado dos que ainda acreditam numa solução de compromisso com o inimigo para assim evitar a ruína do país. Leal até ao fim, ficará com Mussolini mesmo quando tudo já está definitivamente perdido. Profeticamente fala disso aos seus operários numa das suas últimas aparições públicas, em Março de 1945:
“Irmãos de fé e de luta… não reneguei aos meus ideais pelos quais lutei e pelos quais, se Deus me deixar viver mais, lutarei sempre. Mas agora encontro-me nas fileiras das cores que militam na República Social Italiana, e vim outra vez porque agora sim é a sério e é verdadeiramente decisivo reivindicar os direitos dos operários…”
Nicola Bombacci, sempre fiel, sempre sereno, acompanhará Mussolini na sua última e dramática viagem até à morte. A 25 de Abril está em Milão. O relato de Vittorio Mussolini, filho do Duce, sobre o seu último encontro com o seu pai, acompanhado por Bombacci, mostra-nos a inteireza deste:
“Pensei no destino deste homem, um verdadeiro apóstolo do proletariado, em certa altura inimigo acérrimo do fascismo e agora ao lado do meu pai, sem nenhum cargo nem prebenda, fiel a dois chefes diferentes até à morte. A sua calma serviu-me de consolo”. [11]
Pouco depois, após Mussolini se separar da coluna dos seus últimos fiéis para os poupar ao seu destino, Bombacci é detido por um grupo de guerrilheiros comunistas junto com um grupo de hierarcas fascistas. Na manhã de 28 de Abril era colocado contra o paredão em Dongo, no norte do país, ao lado de Barracu, valoroso ex-combatente, mutilado de guerra, de Pavolini, o poeta-secretário do partido, de Valério Zerbino, um intelectual e Coppola, outro pensador. Todos gritam, perante o pelotão que os assassina, “Viva Itália!”. Bombacci, enquanto tomba crivado pelas balas dos comunistas, grita: “Viva o Socialismo!”.
_____________
Notas:
1. Em português, sobre o movimento revolucionário do pré-fascismo veja-se o excelente trabalho do professor israelita Zeev Sternhell e dos seus colaboradores, «Nascimento da ideologia fascista», onde curiosamente quase não se menciona Bombacci.
2. Sobre a trajectória revolucionária de Bombacci há um excelente trabalho de Gugliemo Salotti intitulado «Nicola Bombacci, da Mosca a Saló».
3. Referimo-nos à tomada da cidade dálmata em 1919 pelo poeta-soldado Gabrielle D’Annunzio, que é considerada por muitos autores como o primeiro capítulo da revolução fascista. Veja-se Carlos Caballero, “La fascinante historia D’Annunzio en Fiume”, em Revisión, Alicante, ano I, 2, vol. IV, Outubro de 1990.
4. Sobre a ala esquerdista do fascismo: Luca Leonello Rimbotti, «Il fascismo di sinistra. Da Piazza San Sepolcro al congresso di Verona», Roma, Settimo Sigillo, 1989. Ver também: Giuseppe Parlato, “La Sinistra fascista. Storia de un progetto mancato”, Bolinia, Il Mulino, 2000.
5. Cit. Arrigo Petacco, «Il comunista in camicia nera. Nicola Bombacci tra Lenin e Mussolini», Milão, Mondadori Editori, 1996, p. 115.
6. «Mussolini il Duce. II. Lo Stato totalitario 1936-1940», Turim, Einaudi, 1981 (2a, 1996), p. 331 n.
7. A correspondência de Bombacci para Mussolini (mas não a do Duce para este) está conservada em parte no Arquivo Central do Estado Italiano.
8. Nicola Bombacci, «I contadini nell’Italia di Mussolini», Roma, 1943, pp. 34 e ss.
9. Mais de 50 mil fascistas serão executados por estes grupos terroristas durante estes dois anos, e mais 50 mil na trágica Primavera-Verão de 1945. Foram especialmente visados os dirigentes fascistas que possuíssem uma certa aura de popularidade e que pudessem encarnar uma face mais populista do fascismo. O caso mais chamativo foi o do filósofo Giovanni Gentile, que deu lugar inclusivamente a protestos no seio da resistência antifascista. Existe uma ampla bibliografia sobre o assunto, embora na actualidade se tente reduzir as cifras e o impacto desta sangrenta guerra civil.
10. É curioso comprovar como em vários países da Europa, com o aproximar do final da guerra, os únicos elementos fieis à nova ordem são as chamadas alas “proletárias” dos movimentos nacional-revolucionários e que se negoceie a entrega do poder aos grupos socialistas da resistência por oposição aos comunistas e aos burgueses. Assim sucederá na Noruega onde os sectores sindicais propõe um governo de coligação à resistência social-democrata em Abril de 1945, ou em França onde após a queda do governo de Petain no Outono de 1944 Marcel Deat e Jacques Doriot pugnam por instaurar um governo socialista.
11. «La vida con mi padre», Madrid, Ediciones Cid, 1958, p. 267.
00:05 Publié dans Biographie, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, italie, fascisme, communisme, années 20, années 30, années 40, deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale, politique, théorie politique, sciences politiques, politologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 10 avril 2011
Guerre et psychologie
Guerre et psychologie
par Jean-Gilles Malliarakis
 L'opération de Libye comme la tragédie de la Côte d'Ivoire nous ramènent durement à la réalité du monde. L'Europe consommatique comme l'éducation soixante huitarde avaient voulu, depuis un demi-siècle, ignorer : la guerre. La voilà de retour. On ne peut pas s'en réjouir, on peut seulement espérer que son avertissement, aujourd'hui encore à moindre frais, du moins vu de Paris, réveille les opinions.
L'opération de Libye comme la tragédie de la Côte d'Ivoire nous ramènent durement à la réalité du monde. L'Europe consommatique comme l'éducation soixante huitarde avaient voulu, depuis un demi-siècle, ignorer : la guerre. La voilà de retour. On ne peut pas s'en réjouir, on peut seulement espérer que son avertissement, aujourd'hui encore à moindre frais, du moins vu de Paris, réveille les opinions.
Entre l'époque du Livre banc sur la Défense de 1972, écrit sous l'influence ministérielle du jacobin Michel Debré, et celui de 2008, les doctrines stratégiques et les capacités militaires de la France ont changé, radicalement. La nature même des conflits, les ennemis potentiels ou déclarés, les théâtres d'opérations se sont déplacés.
Paradoxalement aussi, un chef d'État-major de l'armée de Terre tel que le général Elrick Irastorza a pu estimer le 22 octobre 2010 à Coëtquidan "particulièrement compliqué" voire même "anxiogène" le format actuel et futur de nos moyens de défense. Et, simultanément, jamais l'uniforme français n'a été déployé sur autant de territoires, pour des missions éloignées, aux caractères de plus en plus complexes.
De la guerre coloniale selon Gallieni à la contre-insurrection du général américain Petraeus l'objectif semble cependant toujours le même : "transformer l'adversaire en administré". Et, tragiquement, l'épée demeure aujourd'hui encore "l'axe du monde" – ceci pour reprendre la formule d'un homme qui sut si bien, tout au long de sa propre carrière, utiliser, par ailleurs, les micros.
Or, dans la préparation comme dans la gestion des conflits, dans le vote des budgets des armées comme dans la conduite et l'exécution des opérations, l'état d'esprit des individus, des foules et des dirigeants, joue le rôle fondamental.
La psychologie de la guerre redevient dès lors une matière urgente.
En 1915, Gustave Le Bon, dont l'ouvrage sur la "Psychologie des Foules" (1895) fait aujourd'hui encore autorité, lui consacrait un livre. Dans le contexte du premier conflit mondial, l'éditeur avait intitulé l'édition originale : "Enseignements psychologiques de la Guerre européenne". Sous-titre explicatif dans la manière du temps : "Les causes économiques, affectives et mystiques de la guerre. Les forces psychologiques en jeu dans les batailles. Les variations de la personnalité. Les haines de races. Les problèmes de la paix. L'avenir."
L'ambition scientifique, sociologique et objective y tranche avec ce qui se publiait à l'époque, dans le cadre de ce terrible contexte d'affrontement européen. Il étonnera peut-être le lecteur actuel par les développements qu'il consacre au bellicisme allemand, à son hégémonisme commercial d'avant-guerre et au pangermanisme. On remarquera cependant qu'il demeure singulièrement libre, d'esprit et d'écriture, s'agissant des motivations des Alliés. Il ne les résume aucunement en une simple, fraîche et joyeuse "guerre du Droit". Présentée pour telle par ses propagandistes, elle se révélera tout autre.
On notera en particulier un aspect essentiel des années qui avaient précédé le déclenchement de cet "orage d'acier". Elles avaient été marquées, de manière pacifique, par une influence de plus en plus forte, au centre du continent, du pays alors le plus puissant et le plus dynamique, rival sans cesse grandissant des empires maritimes et financiers.
On remarquera également ici un parallélisme très fort entre les deux guerres mondiales : on est tenté de considérer que, de ce point de vue, elles en forment une seule, comme si la seconde prolongeait la première dont elle accentuait simplement les traits, comme le conflit que Thucydide décrivit, expliqua et synthétisa sous le nom de Guerre du Péloponnèse. Celle-ci, à la fin du Ve siècle avait frappé à mort la Grèce des cités. La nôtre allait mettre un terme en Europe, au XXe siècle à l'idée de souveraineté des nations.
Résolument, Gustave Le Bon (1841-1931) s'inscrit en faux face aux explications d'inspiration matérialiste et marxisante.
"Derrière les événements dont nous voyons se dérouler le cours, écrit-il ainsi, se trouve l’immense région des forces immatérielles qui les firent naître.
Les phénomènes du monde visible ont leur racine dans un monde invisible où s’élaborent les sentiments et les croyances qui nous mènent.
Cette région des causes est la seule dont nous nous proposons d’aborder l’étude.
La guerre qui mit tant de peuples aux prises éclata comme un coup de tonnerre dans une Europe pacifiste, bien que condamnée à rester en armes."
Tout conspirait donc pour qu'un tel écrit soit relégué dans l'oubli des textes maudits, politiquement incorrects.
Au lendemain de la victoire de 1918, les Alliés tournèrent en effet le dos aux enseignements de son auteur. On s'engouffra dans le mythe de la sécurité collective. On prétendit mettre "la guerre hors la loi" : on connaît la suite. Cet ouvrage terrible et prophétique, annonçait en somme la reprise des hostilités. Il démontre, aussi, combien les dirigeants politiques, bien connus du public, rois ou ministres, se trouvent régulièrement dépassés par les forces intérieures, celles de l'inconscient des peuples.
JG Malliarakis
Si cette chronique vous a intéressé, vous aimerez peut-être :
"Psychologie de la Guerre" par Gustave Le Bon,
un livre de 372 pages en vente au prix de 29 euros franco de port, à commander en ligne ou par correspondance aux Éditions du Trident 39 rue du Cherche Midi 75006 Paris tel : 06 72 87 31 59.
Puisque vous avez aimé l'Insolent
00:25 Publié dans Philosophie, Polémologie, Psychologie/psychanalyse, Sociologie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guerre, psychologie, militaria, philosophie, sociologie, polémologie, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Machiavelli the European
Machiavelli the European
Dominique Venner
Translated by Greg Johnson
Ex: http://www.counter-currents.com/
 Even his own name has been turned against him. Indeed it is hardly flattering to be described as “Machiavellian.” One immediately envisions a hint of cunning and treacherous violence. And yet what led Machiavelli to write his most famous and scandalous works, The Prince
Even his own name has been turned against him. Indeed it is hardly flattering to be described as “Machiavellian.” One immediately envisions a hint of cunning and treacherous violence. And yet what led Machiavelli to write his most famous and scandalous works, The Prince, was concern for his fatherland, Italy.In his time, in the first years of the 16th century, he was, moreover, the only one who cared about this geographical entity. Then, one thought about Naples, Genoa, Rome, Florence, Milan, or Venice, but nobody thought of Italy. For that, it was necessary to wait three more centuries. Which proves that one should never despair. The prophets always preach in spiritual wastelands before their dreams rouse the unpredictable interest of the people.
Born in Florence in 1469, dying in 1527, Niccolò Machiavelli was a senior civil servant and diplomat. He participated in the great politics of his time. What he learned offended his patriotism, inciting him to reflect on the art of leading public affairs. Life enrolled him in the school of great upheavals. He was 23 years old when Lorenzo the Magnificent died in 1492. That same year, Alexander VI Borgia became pope. He temporarily made his son Cesare (in this time, the popes were not always celibate) a very young cardinal. Then he became Duke of Valentinois thanks to the king of France. This Cesare, who was tormented by a terrible ambition, never troubled himself about means. In spite of his failures, his ardor fascinated Machiavelli.
But I anticipate. In 1494, an immense event occurred that upset Italy for a long time. Charles VIII, the young and ambitious king of France, carried out his famous “descent,” i.e., an attempt at conquest that upset the balance of the peninsula. After being received in Florence, Rome, and Naples, Charles VIII met with resistance and had to withdraw, leaving Italy in chaos. But it was not over. His cousin and successor, Louis XII, returned in 1500, staying longer this time, until the rise of Francis I. In the meantime, Florence had sunk into civil war and Italy had been devastated by condottieri avid for plunder.
Dismayed, Machiavelli observed the damage. He was indignant at the impotence of the Italians. From his reflections was born The Prince, the famous political treatise written thanks to a disgrace. The argument, with irrefutable logic, aims at the conversion of the reader. The method is historical. It rests on the comparison between the past and the present. Machiavelli states his conviction that men and things do not change. He continues to speak to the Europeans who we are.
In the manner of the Ancients – his models – he believes that Fortune (chance), illustrated as a woman balancing on an unstable wheel, determines one half of human actions. But, he says, that leaves the other half governed by virtue (the virile quality of audacity and energy). To the men of action whom he calls to do his wishes, Machiavelli teaches the means of governing well. Symbolized by the lion, force is the first of these means to conquer or maintain a state. But it is necessary to join it with the slyness of the fox. In reality, it is necessary to be lion and fox at the same time: “It is necessary to be a fox to avoid the traps and a lion to frighten the wolves” (The Prince, ch. 18). Hence his praise, stripped of all moral prejudice, of pope Alexander VI Borgia who “never did anything, never thought of anything, but deceiving people and always found ways of doing it” (The Prince, ch. 18). However, it is the son of this curious pope, Cesare Borgia, whom Machiavelli saw as the incarnation of the Prince according to his wishes, able “to conquer either by force or by ruse” (The Prince, ch. 7).
Put on the Index, accused of impiety and atheism, Machiavelli actually had a complex attitude with respect to religion. Certainly not devout, he nevertheless bowed to its practices. In his Discourses on the First Ten Books of Titus Livy, drawing on the lessons of ancient history, he wonders about the religion that would be best suited for the health of the State: “Our religion placed the supreme good in humility and contempt for human things. The other [the Roman religion] placed it in the nobility of soul, the strength of the body, and all other things apt to make men strong. If our religion requires that one have strength, it is to be more suited for suffering than for strong deeds. This way of life thus seems to have weakened the world and to have made it prey for scoundrels” (Discourses, Book II, ch. 2). Machiavelli never hazarded religious reflections, but only political reflections on religion, concluding, however: “I prefer my fatherland to my own soul.”
Source: http://www.dominiquevenner.fr/#/edito-nrh-53-machiavel/3813836
00:10 Publié dans Nouvelle Droite, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : nouvelle droite, dominique venner, philosophie, théorie politique, politologie, sciences politiques, machiavel, italie, renaissance, 16ème siècle |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 08 avril 2011
Per il popolo, con il popolo - Il messagio di Evita e l'Argentina peronista
 Eva Maria Ibarguren nacque il 7 maggio 1919 a Los Toldos, ultima di cinque figli illegittimi (Elisa, Blanca, Juan Ramòn, Erminda ed Eva) di, Juana Ibarguren, figlia di un carrettiere basco, e di un fattore di Chivilcoy (cittadina situata trecento chilometri a ovest di Buenos Aires), Juan Duarte. Eva scoprì con sofferta stupefazione la prima grande umiliazione della sua vita a sette anni. Quando, nel 1926, il padre (ormai vedovo, la moglie legittima, Estela Grisolia, era morta nel 1922) morì in un incidente d’auto e la famiglia legittima volle impedire a Juana e ai suoi figli di seguire il corteo funebre. Eva scriverà nella Razòn de mi vida: “Ho scoperto nel mio cuore un sentimento fondamentale che mi domina completamente lo spirito e la volontà: questo sentimento è l’indignazione dinanzi all’ingiustizia”.
Eva Maria Ibarguren nacque il 7 maggio 1919 a Los Toldos, ultima di cinque figli illegittimi (Elisa, Blanca, Juan Ramòn, Erminda ed Eva) di, Juana Ibarguren, figlia di un carrettiere basco, e di un fattore di Chivilcoy (cittadina situata trecento chilometri a ovest di Buenos Aires), Juan Duarte. Eva scoprì con sofferta stupefazione la prima grande umiliazione della sua vita a sette anni. Quando, nel 1926, il padre (ormai vedovo, la moglie legittima, Estela Grisolia, era morta nel 1922) morì in un incidente d’auto e la famiglia legittima volle impedire a Juana e ai suoi figli di seguire il corteo funebre. Eva scriverà nella Razòn de mi vida: “Ho scoperto nel mio cuore un sentimento fondamentale che mi domina completamente lo spirito e la volontà: questo sentimento è l’indignazione dinanzi all’ingiustizia”.“Da che io lo ricordi, ogni ingiustizia mi fa dolere l’anima come se mi conficcassero dentro qualcosa. Di ogni età conservo il ricordo di qualche ingiustizia che mi fece indignare, dilaniando il mio intimo”.
Sua sorella Erminda sottolineò queste emozioni del cuore di Eva e disse: “Tu, Eva, vedevi il cielo proprio perché non smettevi di guardare negli occhi dei poveri … Il fatto è che gli avvenimenti dell’infanzia sono come radici, che non si vedono ma che continuano ad alimentarci …”. Eva stessa scriverà, ancora, nella Razòn de mi vida: “la ricchezza della nostra terra non è che una vecchia menzogna per i suoi figli. Durante un secolo nelle campagne e nelle città argentine sono state seminate la miseria e la povertà. Il grano argentino non serviva che ad appagare i desideri di pochi privilegiati … ma i peones che seminavano e raccoglievano questo grano non avevano pane per i loro figli”. Eva, a scuola, era la prima in recitazione e, nel 1933, a quattordici anni, ebbe l’ispirazione definitiva, recitando per la prima volta in pubblico, in un lavoro, preparato dalla scuola, intitolato Viva gli studenti. Un giorno offrirono a Eva la possibilità di fare un saggio a Radio Belgrano, a Buenos Aires, e, sebbene non precisato nelle date, il racconto dell’impressione che le produsse la metropoli, la Reina del Plata, si trova riflesso nel suo libro La Razòn de mi vida: “Un giorno visitai la città per la prima volta. Arrivando scoprii che non era come io l’avevo immaginata. Improvvisamente vidi i suoi quartieri miseri e capii dalle strade e dalle case che anche in città vi erano poveri e ricchi. Quella constatazione doveva colpirmi nel profondo, perché ogni volta che rientro in città da uno dei miei viaggi all’interno del Paese, mi ritorna quel primo impatto con la sua grandezza e la sua miseria: e provo la stessa sensazione di profonda tristezza che provai allora”. All’età di 15 anni (ritornata, nel frattempo, a Junin, la città in cui Juana Ibarguren e i suoi figli erano andati ad abitare fin dal 1931), il 2 gennaio 1935, dopo essere rimasta in attesa della chiamata da Radio Belgrano che non arrivò, Eva, che non era persona da aspettare a lungo, lasciò la madre, le sorelle e prende il treno per Buenos Aires, dicendo alla sua maestra, Palmira Repetti: “Vado lo stesso a Buenos Aires. In un modo o nell’altro mi sistemerò”. Dopo quattro mesi dal suo arrivo, Eva ottenne la parte di una delle sorelle di Napoleone, in Madame Sans-Gene, di Moreau e Sardou. Nel 1937, Eva ottenne una parte in un film, Seguendos afuera, una sua foto fu pubblicata sulla rivista “Sintonia” e ebbe un ruolo in No hay su egra como la mìa. (Mia suocera è unica), trasmessa anche da Radio Splendid. Si trattava, tuttavia, ancora di briciole di teatro, di frammenti di personaggi che non consentirono a Eva di uscire dall’anonimato, di affrancarsi dallo stato di bisogno, né dalla sensazione di insicurezza e di incertezza del futuro. Il 4 giugno 1943, un colpo di stato, fomentato dal generale Arturo Rawson, destituì il presidente Ramòn J. Castillo e lo sostituì con il generale Pedro Pablo Ramirez. Questa rivoluzione si opponeva alla candidatura, patrocinata dal presidente Castillo, di Robustiano Patron Costas, che significava la continuità del potere oligarchico e del feudalesimo dei proprietari terrieri. Il colonnello Juan Domingo Peròn ( che era uno dei giovani ufficiali del Gou, ovvero Grupo Obra de Unificacìon, una di quelle conventicole militari, la cui politica era fondata principalmente sull’obiettivo di liberare l’Argentina dalla dipendenza economica inglese) assunse la direzione, con l’incarico di trasformarla in una Segreteria, del Lavoro e della Previdenza sociale. Le idee politiche di Peròn non volevano limitarsi a conseguire l’indipendenza economica dall’Inghilterra. Peròn voleva trasformare l’Argentina in una nazione “economicamente libera, socialmente giusta e politicamente sovrana”. Riunì al suo fianco, alla Segreteria, uomini come Cipriano Reyes, un sindacalista, capo della C.G.T. (Confederacion General de Trabajo); José Figuerola, che gli avrebbe redatto tutto quanto si riferiva alla riforma sociale e ai piani quinquennali; Miguel Miranda, abile economista, che Jaruteche definì “grande argentino” per il magnifico programma di riforme economiche; Atilio Bramuglia, ministro degli Affari Esteri durante la prima presidenza Peròn, il colonnello Mercante, uno dei suoi collaboratori più fedeli che nei primi anni di governo poté essere considerato il delfino di Peròn, Cereijo, presidente della Banca Centrale, che diventò ministro delle Finanze, Borlenghi, ministro degli Interni; e infine il dottor Carrillo, ministro della Sanità, gabinetto che prima non esisteva e dal quale vennero promosse importanti campagne che sfociarono in un sensibile miglioramento dell’igiene e della salute degli argentini. Durante questi primi mesi d’attività alla Segreteria, Peròn adotta così una serie di misure che faranno fare all’Argentina spettacolari balzi in avanti nel settore della sicurezza sociale. Venne stabilito il principio del salario minimo, venne data la pensione dello stato a circa due milioni di lavoratori, si crearono i tribunali del Lavoro che garantivano parità di diritti tra datori di lavoro e lavoratori nei conflitti sociali, vennero istituite le commissioni paritetiche, con lo Stato cioè in qualità di mediatore. Inoltre fu emanata un’apposita legislazione per gli incidenti sul lavoro, le malattie professionali, la tredicesima mensilità, le ferie retribuite (già da allora di quattro settimane) e la durata della settimana lavorativa. A completamento del “pacchetto” venne poi formalmente riconosciuto lo stato giuridico dei sindacati, la cui costituzione era fortemente incoraggiata, i cui mezzi e le cui strutture furono notevolmente ampliati, consolidando definitivamente la natura riformista del sindacalismo argentino, dopo le precedenti tendenze anarchiche e nichiliste. Il 15 gennaio del 1944, la città di San Juan venne quasi totalmente distrutta da un terremoto. Città già povera, subì danni per un valore di 300 milioni di pesos e fu necessario evacuare i 50.000 abitanti sopravvissuti. Peròn, attraverso la sua Segreteria, organizzò tutti i soccorsi, l’evacuazione della popolazione e la riparazione dei danni. Peròn convocò una riunione di artisti del cinema, del teatro e della radio nella sede del Consejio Deliberante, allo scopo di organizzare uno spettacolo, la celebre festa del Luna Park, per raccogliere fondi destinati ai terremotati. Eva partecipò al grande avvenimento del Luna Park, nel quale vennero raccolti 21 mila pesos e Peròn dirà che “Il mondo si evolve verso i valori spirituali che trovano un baluardo negli artisti ai quali il popolo argentino deve il suo costante progresso”. Eva incontrò Peròn a questa festa, dove i biografi dicono che abbia avuto inizio la loro storia d’amore. Peròn la ricordò così: “Aveva la pelle bianca ma, quando parlava, il volto le si infiammava. Le mani diventavano rosse a forza d’intrecciarsi le dita. Quella donna aveva del nerbo”. Peròn schierandosi dalla parte dei lavoratori, fece avanzare quell’incendio, intraprese quel “cammino nuovo”, quel “percorso difficile”, quella “rivoluzione” di cui parlava Evita. Quella Rivoluzione Nazionale, i cui punti fondamentali erano: nazionalizzazione dei servizi pubblici, previdenza sociale, sovranità popolare, riforma agraria e organizzazione del lavoro. Sfidando così gli “uomini comuni” dell’oligarchia, gli “eterni nemici di tutto ciò che è nuovo, di ogni progresso, di ogni idea straordinaria”. Già il 16 giugno 1945 gli industriali avevano inviato un esposto al governo con il quale esigevano la rettifica della sua politica sociale. Naturalmente i sindacati reagirono in difesa della Segreteria. Nello scontro, le due forze si misurarono sullo steso terreno: la piazza. Cominciarono gli industriali con la Marcia della Costituzione e della Libertà che ebbe luogo il 17 settembre 1945. il governo dichiarò lo stato d’assedio e, per reazione, gli studenti occuparono numerose facoltà. Peròn affermò che era “naturale” che contro le riforme si fossero “sollevate “le forze vive” che altri chiamano “i pesi morti”. Ma chi erano queste “forze vive”? “La Borsa: cinquecento persone che vivono trafficando su quanto producono gli altri; o l’Unione degli Industriali: dodici signori che, come ben si sa, vivono imponendo la loro dittatura al Paese”. L’8 ottobre, un gruppo di allievi della Scuola Superiore di Guerra chiese al generale di brigata Eduardo Jorge Avalos, comandante della guarnigione di Campo de Mayo, di togliere a Peròn qualsiasi incarico. La richiesta arrivò al presidente Farrell, il quale si rese conto che, non accogliendola, avrebbe provocato inevitabilmente un sollevamento militare. Gli Stati Uniti, tramite l’ambasciatore Spruille Braden, diedero il loro appoggio a questa coalizione di industriali, studenti e militari. Ai loro occhi Però rappresentava un militare troppo rivoluzionario che esasperava l’atteggiamento dell’oligarchia. Peròn presentò, dunque, le proprie dimissioni scrivendo poche parole al presidente Farrell per comunicargli che si dimetteva “dalle cariche conferitegli di Vice – Presidente, di Ministro della Guerra e di Segretario di Stato al Lavoro e alla Previdenza sociale”. Il 10 ottobre Peròn rivolse un saluto d’addio ai 50.000 operai che lo acclamavano dinanzi alla sede della Segreteria: “Se la rivoluzione si fosse limitata a permettere comizi liberi avrebbe favorito esclusivamente un partito politico. Questo non poté, non può e non potrà essere mai il fine esclusivo della rivoluzione. E’ quanto avrebbero voluto alcuni politici per poter tornare; ma la rivoluzione incarna le riforme fondamentali che si è proposta di realizzare a livello economico, politico e sociale. Questa trilogia rappresenta la conquista della rivoluzione, che è ancora in marcia, e quali che siano gli avvenimenti, essa non potrà mai essere svilita nel suo significato più profondo. L’opera compiuta sinora è di una consistenza tale che non cederà di fronte a nulla, e viene riconosciuta non da quanti la denigrano, ma dagli operai che la sentono. Quest’opera sociale che soltanto i lavoratori apprezzano nel suo vero valore, dev’essere difesa da essi in tutti i campi. Ho approvato anche in decreto di straordinaria importanza per i lavoratori, riguardante gli aumenti salariali, l’instaurazione del salario mobile, cosa vitale e basilare, e la partecipazione ai profitti. Chiedo a tutti voli che portate nel cuore la bandiera delle rivendicazioni, di pensare ogni giorno della vostra vita che dobbiamo continuare a lottare ininterrottamente per quelle conquiste che sono gli obiettivi che porteranno la nostra repubblica alla testa delle nazioni del mondo. Ricordate e tenete ben impresso questo motto: “da casa al lavoro e dal lavoro a casa”, perché con esso vinceremo. Concludendo, non vi dico addio. Vi dico invece hasta siempre perché da oggi in poi starò con voi, adesso più che mai. E, infine, accettate questa raccomandazione che vi fa la Segreteria del “Lavoro e Previdenza”: unitevi e difendetela perché è la vostra e la nostra opera”. Quando un gruppo di ufficiali della Marina arrestò il colonnello e lo condusse a bordo della cannoniera Independencia, Eva si rivolse alla piazza e questa fu la sua prima importante azione politica. Il momento era storico ed Eva si lanciò nella lotta (“Bussai di porta in porta. In quel doloroso e interminabile peregrinare, sentivo ardere nel mio cuore la fiamma di un incendio, che annullava la mia assoluta piccolezza”), percorse in macchina i quartieri popolari chiamando gli operai allo sciopero (“A mano a mano che scendevo dai quartieri orgogliosi e ricchi verso quelli poveri e umili le porte si aprivano generosamente, con più cordialità”), partecipando ai preparativi del movimento – guidato da capi sindacali come Cipriano Reyes, Luis Gay e Luis Monzalvo – e al presidente Farrell non rimase che far rientrare Peròn dal confino nell’isola di Martin Garcia. Peròn apparve al balcone della Casa Rosada alle 11,10 di sera del 17 ottobre 1945 e nella moltitudine di operai, che aveva atteso per l’intera giornata scoppiò un’oceanica e interminabile ovazione, un solo grido si innalzò all’unisono dalle trecentomila bocche dei descamisados: “Peròn Presidente!”, “Peròn Presidente!”. Solo due mesi dopo Peròn ed Eva si sposarono con il matrimonio sia civile (il 22 ottobre 1945 a Junin) che religioso (il 10 dicembre a La Plata). Per Evita (così amava essere chiamata dal popolo) “descamisados” sarà la definizione – cito La Razòn de mi vida – che più si addice al peronista militante: “Sono descamisados tutti coloro che si trovavano nella Plaza de Mayo il 17 ottobre 1945; quelli che hanno attraversato a nuoto il Riachuelo provenienti da Avellaneda, dalla Boca e dalla provincia di Buenos Aires, quelli che in colonne allegre, ma disposti a tutto, anche alla morte, quel giorno indimenticabile sono sfilati per l’Avenida de Mayo”. “Ciò che spinse le masse verso Peròn – scrisse Jaruteche – non fu il risentimento, fu la speranza”. La situazione, nell’ottobre 1945, era perciò allarmante per l’oligarchia che costituiva un gruppo di enorme influenza economica, che dirigeva la vita politica del paese, erigendo barriere insuperabili a livello di comunicazione sociale. Venne costituito un fronte unico chiamato Uniòn Democratica (fronte vasto ed eterogeneo che comprendeva radicali, socialisti, comunisti, demo – progressisti e contava sull’appoggio dell’unione industriali), sotto la protezione dell’allora ambasciatore americano Spruille Braden, il quale era all’origine del Libro blu, pubblicato dal Dipartimento di Stato, che denunciava il nazismo di Peròn. Manovra particolarmente infelice per un diplomatico, la cui prima regola di condotta dovrebbe essere quella di non ingerirsi negli affari interni del paese di accreditamento. Peròn seppe, infatti, sfruttare questa gaffe e riuscì a porre il nazionalismo dei suoi compatrioti di fronte all’alternativa efficacemente espressa dalla formula “Braden o Peròn”.
Peròn, d’accordo con Cipriano Reyes, capo della C.G.T., creò il Partito Laburista Argentino, che consisteva in un “raggruppamento di lavoratori urbani e rurali il scopo è di battersi per l’emancipazione politica e sociale delle classi lavoratrici, migliorandone le condizioni di lavoro, elevandone il tenore di vita e per l’instaurazione nel paese della democrazia integrale”, cioè una “democrazia sociale”, derivante dal superamento di quella “democrazia liberale” che, in realtà, era espressione di élite e di potentati economici. Non a caso uno dei presidenti che successero a Peròn, Arturo Frondizi, sottolineò che l’unica forza reale e concreta che abbia cambiato il volto dell’Argentina è stato il peronismo e che “appartiene ad una distorsione europea l’idea che il peronismo non sia stata una forma democratica”. Nel programma vennero riprese le tematiche sui cui Peròn aveva già basato la sua azione di Segretario del Lavoro e della Previdenza sociale, e, in particolare, partecipazione degli operai agli utili dell’impresa, lotta alla speculazione, salario minimo garantito e indicizzato, indennità di disoccupazione, riduzione dell’orario di lavoro, lotta contro il caro – vita, nazionalizzazione dei mezzi di produzione, ridimensionamento del grande latifondo, con distribuzione della terra a piccole cooperative, controllo della grandi holding inglesi e americane presenti nel paese. Venne aggiunto, infine, su intelligente ispirazione di Evita, un ulteriore obiettivo, d realizzare in tempi brevi: l’estensione dei diritti politici alle donne, una misura che del rivoluzionario in un paese dove tradizionalmente l’elemento femminile viene tenuto ben lontano dalla politica e dalle grandi questioni economiche e sociali. Se gli uomini delusero Peròn, sua moglie e il suo Paese, l’Argentina, gli furono fedeli in modo difficilmente superabile. E per l’Argentina, per arricchirla, propose la creazione di grandi capitali che fossero frutto del lavoro e non della speculazione. E gli argentini scelsero naturalmente Peròn, il quale, il 24 febbraio 1946, con il fedele e scaltro Hortensio Quijano (un membro del partito radicale, che era stato ministro degli Interni e aveva avuto un ruolo decisivo negli avvenimenti del settembre e ottobre 1945) in qualità di candidato alla vicepresidenza, ottenne 1.479.511 voti contro 1.201.822 di Tamborini e di Mosca, notabili appartenenti all’ Uniòn Democratica, dando come risultato la vittoria peronista. Il trionfo ottenuto nelle elezioni aprì le porte della Presidenza a Peròn che assunse il potere il 4 giugno 1946. Evita, da allora, assunse un ruolo fondamentale. Non volle seguire “l’antico modello della moglie del presidente”. E’ chiaro, insomma, che Evita non si lasciò rinserrare dall’oligarchia nel ruolo di consorte del presidente della repubblica. Disse chiaramente nel suo libro La Razòn de mi vida: “Alcuni giorni dell’anno ero Eva Peròn [la moglie cioè del Presidente] e lo facevo molto bene. Tutto il resto del tempo ero Evita, l’ambasciatrice del popolo presso Peròn. Compito difficilissimo e richiedente sforzi continui … Se mi domandaste che cosa preferisco, la mia risposta sarebbe immediata e spontanea: mi piace di più il nome che mi dà il popolo. Quando un bambino mi dice Evita, mi sento madre di tutti i bambini, di tutti deboli e i diseredati della terra. Quando un operaio mi dice Evita mi sento compagna di tutti gli uomini che lavorano nel mio paese e nel mondo intero. Quando una donna della mia patria mi dice Evita mi sembra di essere sorella di quella e di tutte le donne dell’umanità …”. Evita, pur erssendo una donna di temperamento, che non si fermava né davanti alle parole, né davanti ai fatti, conosceva, tuttavia, i limiti della sua sfera d’azione che sapeva di non dover superare, e l’armonia fra i due fu, grazie al tatto di lei, costante fino alla fine. Peròn mantenne per sé il comando delle Forze Armate, la direzione della diplomazia, la direzione dell’economia e lasciò ad Evita la Segreteria del Lavoro, dove sbrigava le questioni coi dirigenti sindacali e incontrava i descamisados; faceva numerose visite e presenziava a inaugurazioni. Dell’equipe di Evita facevano parte Oscar Nicolini, nominato nel 1945 ministro delle Comunicazioni, e José Espejo, diventato, nel 1948, segretario della C.G.T., dopo l’uscita di scena di Luis Gay e di Aurelio Hernàndez. Nel 1947 venne intrapresa l’impresa più spettacolare: il viaggio in Europa di Evita. Il 6 giugno 1947 un quadrimotore Douglas DC4 dell’Iberia, messo a disposizione dalle autorità spagnole, decollò dall’aeroporto di Buenos Aires per portare in Spagna Evita Peròn. Il viaggio in Europa fu l’opportunità di presentare Evita a livello internazionale: con il fascino, la sua giovinezza, la vitalità, sarebbe stata certamente in grado di conquistare le simpatie e i cuori della vecchia classe dirigente europea, facendo uscire il suo paese dallo stato d’emarginazione nel quale l’Argentina si trovava a causa della volontà di liberarsi dalla dipendenza, sia economica che politica, dalla Gran Bretagna e degli Stati Uniti, nazionalizzando la rete ferroviaria (posseduta, fin dal 1907, da società britanniche) e quella telefonica (detenuta fin dagli anni ’20 dalla multinazionale americana ITT). Peròn volle mantenere fede alle promesse elettorali, realizzando queste prime riforme, approfittando di una congiuntura internazionale favorevole all’Argentina. Gli indicatori macro – economici prospettavano, infatti, un futuro di benessere e di sviluppo: la ricomposizione degli equilibri internazionali nel dopoguerra favoriva la collocazione delle esportazioni argentine nel mercato mondiale; la bilancia commerciale era in forte attivo ed il paese disponeva di ingenti risorse d’oro e di valuta estera; la situazione occupazione era buona; inoltre la scelta di una crescita basata sui comparti leggeri dell’industria, puntando cioè su un settore che produceva beni per il mercato anziché capitali, s’intendeva non penalizzare i consumi e, soprattutto, utilizzare il settore industriale come strumento di assorbimento della disoccupazione (se nel 1943 le persone occupate nell’industria erano 488.700, nel 1949 raggiungevano la cifra di 955.900, cioè i posti di lavoro erano aumentati di circa il 96%) e di redistribuzione del reddito in favore delle classi lavoratrici urbane. Infatti, il soli tre anni dal 1946 al 1949, il reddito reale aumentò di più del 40%, trainando i consumi interni. Evita arrivò in Spagna domenica 8 giugno, alle sette del pomeriggio, accolta dal generalissimo Franco, affiancato da sua moglie, dona Carmen Polo de Franco e da sua figlia, Carmen Franco Polo. All’aeroporto c’erano trecentomila madrileni in delirio che gridavano il suo nome. Un po’ più in là, un gruppo di ragazze della Falange agitava i fazzoletti. Dappertutto fiori e bandiere spagnole, rosso – giallo – rosso, e argentina azzurro – bianco – azzurro. Ricevuta dalla mani del generalissimo Franco la Grande Croce d’Isabella la Cattolica, che metterà in occasione del colloquio con Pio XII., Evita pronunziò, lunedì 9 giugno, nella piazza d’Oriente, un discorso breve ma efficace, in cui parlò solo di questioni sociali e di lavoratori, dicendo ciò che sentivano nella nuova Argentina, cercando di trasmettere la profonda aspirazione a una società nuova, nella quale “non vi siano né troppi ricchi né troppi poveri”, e la preoccupazione di rendere ogni giorno più concreta e reale, per ogni uomo e per ogni famiglia , la sicurezza della vita e la speranza di un costante miglioramento. Evita disse di essere venuta in Spagna non per formare “assi”, ma per tendere “arcobaleni di pace”, a portare un messaggio di speranza al Vecchio Mondo e anche un messaggio d’amore a tutti gli spagnoli da parte dei descamisados argentini. Più tardi la stessa Evita definirà questo ruolo con un’immagine altrettanto forte: “Sono il ponte che collega Peròn con il popolo. Attraversatemi!”. Il suo amore per i bisognosi la portò a voler visitare misere catapecchie dove vivevano donne malate e uomini senza lavoro. Evita, recandosi nelle principali località del paese, tenne una serie impressionante di interventi (a Madrid, in una scuola di orientamento professionale, a Granata, in una fabbrica, a Vigo, nella Casa del Pescatore) per esaltare l’instaurazione di “un ordine basato sulla giustizia sociale secondo i principi proclamati dal presidente Peròn, dove tutti possano godere di una giusta retribuzione; dove l’operaio possa vivere in condizioni di lavoro dignitose e possa conservare la sua salute, godere di benessere fisico e spirituale, proteggere la propria famiglia, innalzare il suo livello economico” affinché “nessuno soffra e nessuno si veda assediato da una terribile miseria”. Il 26 giugno 1947 lasciò la Spagna esclamando “Addio Spagna mia”. Purtroppo non altrettanto bene andarono le cose in Italia, Francia, Svizzera e Inghilterra: a Roma, l’ambasciata argentina era situata in piazza dell’Esquilino, di fronte alla sede di un sindacato italiano di ispirazione comunista e l’arrivo di Evita venne accolto da urla, parolacce e insulti terribili; a Parigi, la visita, pur essendo caratterizzata dalla migliore accoglienza ufficiale (sia da parte del presidente della Repubblica Vincent Auriol, che dal ministro degli Affari Esteri Georges Bidault), venne ridimensionata da numerosi ricevimenti privati, che mostrarono, come le autorità francesi si sforzassero di togliere ogni significato politico di “avvicinamento” tra i due paesi; a Berna un giovane svizzero aggredì Evita, lanciando dei sassi contro la sua macchina, rompendo il parabrezza e ferendo l’autista; la visita a Londra, fu annullata, perché la corte britannica si rifiutò di riceverla, proponendo, invece, che la visita avesse carattere privato. Proprio durante il viaggio di sua moglie in Europa, Peròn lanciò un messaggio di pace al mondo, affermando la sua teoria politica della “terza posizione”, elemento di stabilità, all’interno, tra lo sfruttamento capitalista e la disumanizzazione marxista e fattore di equilibrio, all’esterno, tra i due blocchi emersi dalla logica di Yalta: “… in questo momento è in corso una lotta tra il comunismo e il capitalismo … noi non vogliamo essere né contro l’uno né contro l’altro. Noi realizziamo nel nostro paese la dottrina dell’equilibrio e dell’armonia tra l’individuo e la collettività attraverso la giustizia sociale che rende dignità al lavoro, che armonizza il capitale, che eleva la cultura sociale … di modo che il noi sociale si realizza e si perfeziona attraverso l’io dell’individuo considerato come un essere umano …”. Infatti, un paese come la nuova Argentina era in grado di sfamare, con carne e grano, l’intero continente europeo lacerato e disorientato dalla recente guerra: “L’unico rischio che correrà il mondo in futuro è la fame ma noi abbiamo il cibo dei nostri campi”, ripeteva spesso Peròn. La fornitura di prodotti alimentari ai paesi belligeranti aveva consentito di accumulare già durante la guerra ingenti riserve in moneta estera. Inoltre le difficoltà di pagamento e di trasferimento delle valute intervenute nel periodo bellico, fecero sì che l’Argentina vantasse crediti non incassati nei confronti di diverse nazioni. Tra le quali c’era proprio la Gran Bretagna, che ancora nel 1946 non aveva saldato un debito di 150 milioni di sterline.
Deciso a portare avanti il proprio programma sociale e politico, Peròn adottò misure tipicamente keynesiane: : sussidio al credito, politica dei redditi, espansione della spesa pubblica e, di conseguenza, del deficit statale. Peròn giustificò, nell’ottobre del 1951, tale strategia con queste parole: “L’Argentina giustizialista dirige tutti i suoi sforzi verso al’affermazione della sovranità nazionale, cercando le basi per il sostenimento in una volontà popolare nitida ed internamente inattaccabile”. Infatti, la politica economica peronista aveva tra i propri obiettivi prioritari un rapido recupero di risorse che consentisse di realizzare una decisa redistribuzione del reddito in favore dei ceti urbani. Le cifre si riferivano al totale delle ore lavorative di un operaio nel 1949 che, messe a confronto con quelle del 1943, rivelavano un aumento del 16,6% mentre la retribuzione era superiore, rispetto a quella del 1943, del 388,5%. Peròn rafforzò la politica d’intervento diretto dello stato in economia con la costruzione di centrali idroelettriche e gasdotti, con l’ammodernamento delle reti di trasporto urbano ed extra – urbano, con l’istituzione della compagnia aerea di bandiera (le “Aerolìneas Argentinas”) e della flotta mercantile nazionale. Inoltre lo stato diventò anche produttore, gestendo con funzionari propri (spesso ufficiali e tecnici delle forze armate) l’industria bellica e le imprese del gruppo DINIE, costituito da società confiscate ai proprietari tedeschi all’indomani dell’entrata in guerra argentina, dichiarata il 27 marzo 1945, al fianco degli Alleati. Ma l’intervento che più d’ogni altro sancì la volontà innovatrice del nuovo governo fu la nazionalizzazione del Banco Central, che diventò la chiave di volta della politica economica di Peròn, tramite il controllo del Banco Industrial e dell’Instituto Argentino de Promocìon del Intercambio (IAPI). Quest’ultimo, cui venne assegnato il monpolio del commercio con l’estero, acquistava direttamente dai produttori a prezzo amministrato i beni destinati all’esportazione – tipicamente cereali e prodotti di macellazione – , rivendendoli a prezzo di mercato sulle piazze internazionali e trasferendo i profitti ottenuti al Banco Industrial, che li avrebbe trasformati in capitali da assegnare in prestito a tassi iper – vantaggiosi al settore industriale per approvvigionarsi di materie prime, quali combustibile, macchinari e pezzi di ricambio. Tra il 1945 e il 1948 il Pil aumentò del 29%, trainato dalla crescita dell’industria leggera (tessile e alimentare in primis, impoverendo però il settore agricolo, cioè quello che fu il motore stesso dello sviluppo), che fece registrare un picco del 12,1% nel 1947.
Una delle riforme più importanti e popolari intraprese da Peròn fu la concessione alle donne del diritto di voto. La legge 13010 venne approvata il 9 settembre da una storica seduta del Parlamento, davanti al quale Peròn spiegò che “il riconoscimento dei diritti politici della donna costituisce un atto di giustizia in quanto la donna coopera con i suoi sforzi e con la stessa energia dell’uomo alla difesa degli interessi e dei diritti collettivi sacrificando spesso anche la vita, la famiglia e la serenità; sarebbe quindi inconcepibile che rimanesse esclusa dalla difesa dei suoi stessi diritti e interessi”. Da parte sua Evita , il 23 settembre 1947, giorno della promulgazione della legge, completò così il pensiero del marito: “Mi tremano le mani al contatto dell’alloro che sancisce la vittoria, perché qui, sorelle mie, in pochi articoli concentrati è riassunta una lunga storia di lotte, di scontri e di speranze …”.
“Noi donne siamo le missionarie della pace. I sacrifici e le lotte sono riusciti finora solo a raddoppiare la nostra fede. Innalziamo, tutte assieme, questa fede e con essa illuminiamo il sentiero del nostro destino. E’un destino grande, appassionato e felice. Per farlo nostro e meritarlo, disponiamo di tre elementi incorruttibili e inalterabili: una fiducia illimitata in dio e nella sua infinita giustizia; una Patria incomparabile da amare con passione e un leader che il destino ha forgiato per affrontare vittoriosamente i problemi: il generale Peròn. Col voto e con lui contribuiremo alla perfezione della democrazia argentina”.
L’8 luglio 1949 fu creata ufficialmente la Fondazione di Aiuto Sociale Maria Eva Duarte de Peròn, istituzione la cui responsabilità “compete unicamente e esclusivamente alla sua fondatrice”, che rappresentò un concetto di giustizia sociale molto lontano dal modo d’intendere la carità a parte delle dame dell’oligarchia: era regolata da uno statuto in accordo con le norme stabilite dal Ministero della Giustizia. Erano membri fissi del suo Consiglio Direttivo il Ministro delle Finanze e il segretario generale della C.G.T. i consiglieri erano nominati per metà dalla fondazione, e i restanti da rappresentanti operai del sindacato. Mille scuole e diciotto pensionati furono costruiti in provincia. Gli alunni, circa tremila, venivano da famiglie che vivevano nei ranchos de adobe e dormivano per terra. Evita fece costruire anche dei quartieri per studenti a Còrdoba e a Mendoza. Ma le sue grandi passioni erano il Quartiere degli studenti di Buenos Aires, che occupava cinque blocchi di case, e la Città dei bambini Amanda Allen (un’infermiera della fondazione, morta in un incidente aereo mentre rientrava in Argentina dopo essere andata in soccorso delle vittime di un terremoto che aveva scosso l’Ecuador), inaugurata il 14 luglio 1949. Oltre alle colonie di vacanza create a Ezeiza, vicino a Buenos Aires, Evita fece costruire delle “unità turistiche” a Chapadmalal (non lontano da Mar del Plata), a Uspallata (Mendoza) e a Embalse Rìo Tersero (Còrdoba). Ognuna di queste comprendeva un centro alberghiero che poteva ospitare da tremila a quattromila persone, operai, pensionati, studenti. Soltanto a Buenos Aires la fondazione aveva costruito quattro policlinici. Altri centri simili furono inaugurati in nove province. A Termas de Reyes (Jujuy, nel Nord – ovest del paese) e a Ramos Mejia (nella periferia di Buenos Aires) furono costruite delle cliniche pediatriche. Purtroppo l’ospedale dei bambini di Buenos Aires e un altro a Corrientes, sul litorale argentino, furono abbandonati dopo la caduta del peronismo. Nell’agosto 1948 il ministero del Lavoro proclamò solennemente la Dichiarazione dei diritti degli anziani. Nel luglio 1950, al teatro Colòn, Evita pianse per la gioia di poter assicurare una vecchiaia serena agli anziani argenti argentini quando diede le prime mille pensioni ad altrettanti anziani. La casa di riposo di Burzaco, vicino a Buenos Aires si sviluppava su due ettari e poteva accogliere duecento persone in un ambiente caloroso, tanto che Evita in La Razòn de mi vida: (che pure scrisse quando la sua malattia era ormai una realtà) sognava del giorno in cui, forse, lei stessa avrebbe potuto abitarvi. E, ancora, furono creati altri centri che accoglievano donne senza lavoro e senza domicilio, finché non si fossero trovati loro l’uno e l’altro. Ma il fiore all’occhiello di Evita era il Pensionato dell’impiegata, sull’Avenida de Mayo, che accolse cinquecento donne venute a lavorare nella capitale. Tutte opere necessarie per accrescere il legame comunitario e solidaristico della gente. Questo fu un merito fondamentale della politica di Evita. La sua opera non era soltanto un impegno a favore dei più deboli, dei suoi descamisados , ma la volontà precisa di radicare nel profondo del suo popolo un legame molto forte, un senso di appartenenza che travalicasse ogni rivendicazione sociale, uno spirito di unione talmente forte da trasformare la popolazione argentina in un popolo unito: “Siamo un popolo che ha in mano il timone del proprio destino”, disse Evita “che è grande perché è popolare, che è degno perché è giustizialista , he è nobile perché è argentino e che è sublime perché c’è Peròn. E’ stato un miracolo che ha avuto conseguenze enormi a livello economico, politico e sociale. In primo luogo ha creato una giustizia sociale che ha riordinato i criteri distributivi, mobilitando le masse a favore delle grandi battaglie per l’indipendenza economica nazionale … Questa rinascita del nostro spirito che l’oligarchia non ha potuto vendere come ha venduto le nostre fonti di ricchezza, ha portato con sé la suprema dignità del lavoro e la definitiva liberazione dell’uomo. Abbiamo abbattuto con gioia i cupi orfanotrofi per innalzare le pareti chiare ed allegre della “Città dell’Infanzia”, dei convitti, dei policlinici, delle case – parcheggio, della casa dell’impiegata e dell’anziano, della “Città dello Studente”, delle città universitarie, delle colonie per le vacanze, delle case per la madre, delle scuole e delle mense popolari. On l scopa giustizialista abbiamo fatto piazza pulita delle capanne e delle baracche e abbiamo costruito quartieri operai, necessari per la dignità sociale delle nostre masse lavoratrici. Abbiamo esiliato l’elemosina per esaltare la solidarietà come criterio di giustizia. E continuiamo gioiosamente nella lotta perché il repmio è troppo grande e troppo bello per rinunciarvi. Questo premio è la felicità, il benessere e l’avvenire del nostro amato popolo descamisado”.
Il 26 luglio del 1949, mille donne si radunarono al Teatro Nazionale Cervantes di Buenos Aires dove si tenne il Primo Congresso del Movimento Peronista Femminile. Con la fondazione di questo movimento riemerse con forza la volontà di occuparsi delle donne, dei loro problemi, di seguirle da vicino. Questo rapporto, però, si è evoluta, è diventato politico. Evita volle rivoluzionare anche il ruolo delle donne nella vita politica argentina. Disse Evita a quel pubblico femminile: “le donne sono state doppiamente vittime di tutte le ingiustizie. In famiglia soffrivano più d’ogni altro membro perché si assumevano tutta la miseria, la desolazione e sacrifici per evitarli ai propri cari. Portate in fabbrica, subivano tutta la prepotenza padronale. Tormentate dalla sofferenza, stroncate dai bisogni, stordite dalle giornate estenuanti e dalle pochissime ore destinate al riposo, distrutte dai lavori domestici, le nostre compagne di allora – che in molti paesi del mondo sono le nostre compagne di oggi, anche se è vergognoso ricordarlo – non trovarono altra soluzione se non rassegnarsi di fronte all’accumulazione sempre maggiore degli insensibili e bastardi capitalisti. Come se non bastasse, il destino riservava loro un’altra sofferenza. Scoperte dall’industriale come forza – lavoro meno cara, le donne che lavorano diventano le concorrenti dei fratelli lavoratori, compiendo – costrette dalle circostanze e dal bisogno di mandare avanti la famiglia – i loro stessi lavori pur ricevendo un salario inferiore”. Nel 1949, quando le ingenti risorse valutarie accumulate durante la guerra andarono esaurendosi, la favorevole congiuntura esterna in cui mosse i suoi primi passi lo stato peronista cominciò ad invertirsi. La bilancia commerciale, dopo quattro anni consecutivi di surplus, fece registrare un deficit di 160 milioni di dollari, dovuto principalmente al ritorno alla normalità dei prezzi agricoli e della carne; lo sviluppo dell’industria leggera, inoltre, rese il paese sempre più dipendente da materie prime e semi – lavorati esteri, cosa che comportò l’ascesa dei costi di produzione e dei prezzi al consumo dei prodotti. La conseguenze ultime di questo processo fu il riaccendersi dell’inflazione, dal 13% del 1947 al 29% nel 1949. Per spiegare che il governo aveva la possibilità d’inaugurare una politica di austerità, davanti ad un comitato di 300 persone, in maggioranza donne, che, il 29 settembre 1950, fece visita a Peròn protestando contro il carovita e chiedendo misure contro gli speculatori, Peròn, ricorrendo a un’immagine forte, disse: “Se il governo volesse deflazionare lo otterrebbe in una settimana. Con le ferrovie abbiamo comprato 23.000 proprietà. Basterebbe venderle, raccogliere il denaro, portarlo alla Caja de la Conversiòn e bruciarlo, in tal modo la circolazione diminuirebbe di circa il 39, 40 e 50%. Ma dopo, chi vedrebbe più un peso? Chi troverebbe più un peso dopo aver rarefatto in questo modo i mezzi di pagamento?”.
Il 2 agosto 1951, una folla di duecento sindacalisti della C.G.T. chiesero a Peròn di accettare la candidatura alla rielezione presidenziale ed espressero il “vivo desiderio” che Evita fosse candidata alla vicepresidenza. Il 22 agosto fu la data fissata per annunciare la candidatura di Evita. Ma ciò non avvenne, l’esercito si oppose perché se Evita fosse stata eletta vicepresidente e se Peròn fosse morto prima di lei, Evita avrebbe preso il suo posto alla presidenza dell’Argentina e, dunque, al comando delle forze armate, come fece vent’anni dopo Isabelita Peròn. Il 31 agosto, Evita rinunciò alla candidatura alla vicepresidenza: “Ho solo un’ambizione personale, che il giorno in cui si scriverà il capitolo meraviglioso della storia di Peròn, di me si dica questo: c’era, al fianco di Peròn, una donna che si era dedicata a trasmettergli le speranze del popolo. Di questa donna si sa soltanto che il popolo la chiamava con amore Evita”. E un mese dopo questo messaggio radiofonico, Evita si mise a letto e comiciò a morire. E il paese stava morendo assieme a lei. il 1952 fu l’anno in cui la crisi raggiunse il suo culmine, anche per effetto delle avverse condizioni climatiche: la produzione agricola risultò del 15% inferiore all’anno precedente, il Pil calò del 6%, il tasso di inflazione sfiorò il 50%, mentre il salario reale diminuì tra il 1948 ed il ’52 di circa il 20%. Il 28 settembre 1951, proprio mentre stavano facendo a Evita una trasfusione di sangue data la sua estrema debolezza, il generale Benjamìn Menéndez si mise alla testa di un’insurrezione, che sarà facilmente domata. tesa a far crollare il governo peronista, ma le cui conseguenze matureranno nel 1955, il 16 settembre, con la Revoluciòn libertadora, diretta dal generale Lonardi, che pose fine al governo di Peròn. Le elezioni dell’11 novembre 1951 segnarono per il Partito Peronista (frutto della fusione tra il Partido Laburista, la Unión Cívica Radical Junta Renovadora e il Partido Independiente di Alberto Tessaire, che raggruppava i conservatori che appoggiavano Peròn) un vero trionfo. Peròn venne eletto per la seconda volta con 4.652.000 voti contro i 2.358.000 del suo avversario, Ricardo Balbin della Unión Cívica Radical. Un margine notevolmente superiore a quello della prima elezione che consentì ai peronisti di conquistare tutti i seggi del Senato e centrotrentacinque dei centoquarantanove seggi della Camera. Non bisogna poi dimenticare che, per la prima volta, votarono anche 3.816.654 donne, i cui suffragi andarono all’unico partito, cioè a quello peronista, che inserì delle donne nelle sue liste. Alla fine risultarono elette ventitre deputate e sei senatrici.
Il 3 novembre 1951 Evita fu ricoverata al policlinico Presidente Peròn, dove il ginecologo Humberto Dionisi le diagnosticò un carcinoma. All’inizio di novembre, il chirurgo George Pack, specialista del Memorial Cancer Hospital di New York, procedette a un’isterectomia totale. La vita di Evita si stava spegnendo, le restavano solo alcune gocce di vita e le offrì il 1° maggio, in un discorso carico di accenti di incredibile bellezza, l’ultima volta che Evita parlò in pubblico, sorretta dal marito sul balcone della Casa Rosada. “Miei cari descamisados. Ancora una volta siamo qui riuniti, lavoratori e donne del popolo; ancora una volta ci ritroviamo, noi descamisados, in questa storica piazza del 17 ottobre 1945 per dare la risposta al leader del popolo che questa mattina, a conclusione del suo messaggio, ha detto: “Chi vuole ascoltare, ascolti; chi vuole seguire, segua”. Ed è questa la risposta, o mio generale. E’ il popolo lavoratore, è il popolo umile della Patria che qui e in tutto il Paese si è levato in piedi ed è pronto a seguire Peròn, il leader del popolo, il leader dell’umanità, che ha innalzato la bandiera della redenzione e della giustizia delle masse lavoratrici; esso lo seguirà contro l’oppressione dei traditori interni ed esterni, che, nell’oscurità della notte, vogliono iniettare il loro veleno di vipere nell’anima nel corpo di Peròn, che è l’anima e il corpo stesso della Patria. Ma non ci riusciranno, così come l’invidia dei rospi non è riuscita a far tacere il canto del usignoli e le vipere non hanno impedito il volo dei condor”.
“Io chiedo a Dio di non permettere che degli insensati alzino la mano contro Peròn, perché guai a quel giorno! Quel giorno, mio generale, io marcerò alla testa dei descamisados per non lasciare interno nemmeno un sasso che non sia peronista. Noi non ci lasceremo schiacciare dallo stivale oligarca e traditore dei “vendipatria” che hanno sfruttato la classe lavoratrice. Noi non ci lasceremo più sfruttare da quelli che, vendutisi per quattro soldi, servono i padroni stranieri e consegnano il popolo della loro Patria con la stessa tranquillità con cui hanno venduto il loro Paese e le loro coscienze”.
“Ma noi siamo il popolo, e io so che il popolo sta all’erta, siamo invincibili, perché noi siamo la Patria”.
E’ una dichiarazione di guerra, ma Evita, la grande lottatrice era colpita a morte.
Evita si spense dolcemente, respirando appena. Poi emise un sospiro e il suo cuore si fermò. La sua morte fu annunciata ufficialmente il 26 luglio 1952 alle 8,30 di sera. Una terribile solitudine avvolse l’Argentina. Una solitudine che non si dissipò nemmeno al ritorno di Peròn in patria, dopo vent’anni di esilio. Evita presagì bene l’avvenire del suo Paese quando gridava e piangeva nell’agonia: “Chi, ma chi si prenderà cura dei mie poveri?”.
GINO SALVI
BIBLIOGRAFIA
Evita, un mito del nostro secolo, di Alicia Dujovne Ortiz, 1995, Mondatori.
Chiamatemi Evita, di Carmen Llorca, 1984, Mursia.
Evita Peròn, la madonna dei descamisados, di Domenico Vecchioni, 1995, Eura Press.
La ragione della mia vita, introdotto da Vanni Blengino, 1996, Editori Riuniti.
Evita, il mio messaggio, introdotto da Joseph A. Page, 1996, Fazi.
L’Argentina da Peròn a Cavallo (1945-2002), di Francesco Silvestri, 2003, Clueb
00:05 Publié dans Histoire, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, argentine, amérique latine, amérique du sud, evita peron, péronisme, populisme, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 07 avril 2011
Les droits de l'homme contre la démocratie directe
Les droits de l’homme contre la démocratie directe
par Yvan Blot
Texte paru sur le site de la Fondation Polémia [1] sous le titre Droits de l’Homme et Démocratie directe : le problème du contrôle de constitutionnalité. Yvan Blot, auteur de La Démocratie confisquée (éd. Picollec, 1988), est président de Agir pour la Démocratie directe [2].
 1/ Initialement, les droits de l’homme sont des libertés fondamentales
1/ Initialement, les droits de l’homme sont des libertés fondamentales
Les droits du citoyen à voter la loi et l’impôt, donc la démocratie directe, sont d’ailleurs cités explicitement dans les articles 6 et 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui fait partie de nos textes constitutionnels. La protection de ces droits est plus une affaire de culture que de droit. Ainsi, le Royaume-Uni comme la Suisse ne connaissent aucun mécanisme de contrôle de la constitutionnalité des lois, et ces deux pays n’en sont pas devenus des dictatures pour autant. Si la culture de la liberté est développée, on n’a pas de besoin de juge de la constitutionnalité. Si par contre la culture de la liberté est sous-développée, battue en brèche par des éléments de culture totalitaire, le juge constitutionnel peut devenir le pire ennemi des libertés, et donc de la démocratie directe.
2/ Actuellement, les droits de l’homme font souvent l’objet d’une dérive totalitaire et se retournent alors contre les libertés des citoyens.
Si les droits de l’homme sont interprétés de façon égalitariste (au sujet de l’immigration par exemple), ou comme droits de créance sur la société (droit à l’emploi ou au logement par exemple), ils servent à tuer les libertés. Ainsi, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) dans l’affaire Lautsi a demandé en 2009 à l’Italie de retirer les crucifix présents dans les écoles publiques. Suite aux protestations de 20 Etats européens, en général de l’Est, elle a inversé sa jurisprudence le 18 mars dernier. La Cour européenne de Justice de son côté interdit aux assureurs de fixer des primes d’assurance plus faibles pour les femmes qui ont statistiquement moins d’accidents que les hommes, au nom de l’égalité des sexes ! Dans son récent arrêt Hirst, la CEDH a demandé au Royaume-Uni, au nom de l’égalité, de redonner le droit de vote aux condamnés à la prison ce qui a suscité un tollé au Parlement britannique et dans le peuple.
 S’agissant de la Suisse, la Cour européenne des droits de l’homme a été saisie par un recours de M. Hafid Ouardiri [3] contre le résultat de la votation populaire interdisant la construction de minarets. Mais des problèmes de procédures pourraient empêcher ce recours d’aboutir. De même, des intellectuels de gauche ont évoqué un recours contre les résultats de la votation populaire exigeant l’expulsion des étrangers condamnés à des crimes graves. Certains pensent qu’il faut restreindre la démocratie directe pour donner la priorité aux droits de l’homme interprétés par des cours européennes. Le juge se substitue alors au peuple et intervient dans la législation : il ne reste plus grand-chose de la séparation des pouvoirs ! C’est le poison de l’égalitarisme qui fait tourner la sauce des droits de l’homme et en fait une arme contre les libertés !
S’agissant de la Suisse, la Cour européenne des droits de l’homme a été saisie par un recours de M. Hafid Ouardiri [3] contre le résultat de la votation populaire interdisant la construction de minarets. Mais des problèmes de procédures pourraient empêcher ce recours d’aboutir. De même, des intellectuels de gauche ont évoqué un recours contre les résultats de la votation populaire exigeant l’expulsion des étrangers condamnés à des crimes graves. Certains pensent qu’il faut restreindre la démocratie directe pour donner la priorité aux droits de l’homme interprétés par des cours européennes. Le juge se substitue alors au peuple et intervient dans la législation : il ne reste plus grand-chose de la séparation des pouvoirs ! C’est le poison de l’égalitarisme qui fait tourner la sauce des droits de l’homme et en fait une arme contre les libertés !
3/ Gouvernements des juges et « recall » aux Etats-Unis
En Amérique où, dans certains Etats, les juges des cours suprêmes sont élus, il existe la procédure de révocation ou « recall » qui est une procédure de démocratie directe. Une pétition de citoyen peut déclencher un référendum pour demander la révocation d’un juge ou d’un gouverneur. L’idée est que le peuple a le droit de révoquer ceux qu’il élit. En effet, le juge n’est qu’un homme et il peut aussi se retourner par idéologie contre la protection des libertés. Il faut alors que le citoyen ait un recours.
 4/ Démocratie directe et contrôle de la constitutionnalité
4/ Démocratie directe et contrôle de la constitutionnalité
Les systèmes varient selon les pays. En Suisse, un tel contrôle n’existe pas et le peuple peut modifier la constitution par initiative populaire. Aux Etats-Unis, des référendums peuvent avoir lieu sur toutes sortes de sujets dans les 27 Etats fédérés qui le permettent mais le citoyen peut toujours se plaindre du résultat d’un référendum s’il estime que celui-ci viole ses droits. L’ennui est que la Cour annule parfois le résultat : 9 juges ont-ils raison contre la majorité du peuple ? Cela créé un malaise. En Allemagne, c’est le tribunal constitutionnel de chaque Etat fédéré (Land) qui interdit a priori les référendums sur des sujets qu’il déclare inconstitutionnel. Mais alors tout dépend de la jurisprudence : dans certains Etats, les juges ont étouffé la démocratie directe, dans d’autres non !
Conclusion :
Aucun système n’est parfait. En pratique, le contrôle de constitutionnalité a parfois tendance à restreindre abusivement les droits politiques des citoyens. L’oligarchie judiciaire vient alors au secours des autres oligarchies et le peuple est lésé. En fait, la protection des libertés est plus affaire de culture que de droit comme on l’a dit au début. Avec une culture de liberté, contrôle de constitutionnalité ou pas, les libertés fondamentales sont protégées. Avec l’égalitarisme, les droits de l’homme deviennent une arme dévoyée pour réduire la liberté des citoyens et la souveraineté des Etats !
Yvan Blot
Yvan Blot donnera une conférence le lundi 4 avril à l’Hôtel Néva (rez-de-chaussée) 14, rue Brey, 75017 Paris (près de l’Etoile).
Contact : atheneion@free.fr
Article printed from :: Novopress.info France: http://fr.novopress.info
URL to article: http://fr.novopress.info/81539/les-droits-de-lhomme-contre-la-democratie-directe-par-yvan-blot/
URLs in this post:
[1] Fondation Polémia: http://www.polemia.com/
[2] Agir pour la Démocratie directe: http://www.democratiedirecte.fr/
[3] M. Hafid Ouardiri: http://www.tdg.ch/actu/suisse/recours-depose-strasbourg-contre-initiative-anti-minarets-2009-12-15
00:15 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : démocratie, démocratie directe, théorie politique, sciences politiques, politologie, référendum, yvan blot |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
La visione "corporativa" di Ugo Spirito
 Nel 1935, il filosofo Ugo Spirito (Arezzo, 1896 – Roma, 1979) presentava al Convegno di studi corporativi di Roma la sua relazione – intitolata Corporativismo e libertà – con la quale esprimeva la convinzione che la sfida al capitalismo dovesse essere vinta tanto sul piano tecnico quanto su quello spirituale, marcando una superiorità di tipo gerarchico-totalitario “in cui i valori umani si differenzino al massimo”. La concezione corporativistica di Spirito è infatti una visione, poiché non si derubrica a semplice metodologia, a insieme di processi di funzionalità tecnica, ma si eleva a momento spirituale nel quale la vita sociale si unifica moralmente “nella gioia del dare e del sacrificarsi”; in buona sostanza nel rifiuto di ogni fine privato dell’esistenza. In uno scritto del 1934, significativamente intitolato Il corporativismo come negazione dell’economia, Spirito afferma chiaramente che il corporativismo “non è economia, ma politica, morale, religione, essenza unica della rivoluzione fascista”. E proprio per questa ragione egli parlò di “comunismo gerarchico”, dove il primo termine va inteso in un senso assai distante da qualsiasi dogmatismo marxista-bolscevico; mentre il secondo rimanda alla libertà caratterizzata dal diritto al lavoro che seleziona un’èlite umana in grado di accedere ai vertici della comunità. Il comunismo inteso da Spirito è stile di vita più che sistema politico. Come scriverà nel 1947 in Filosofia del comunismo: “…Il comunismo può dare luogo ad istituzioni sociali e giuridiche…Può tendere ad una vita collettiva in cui il criterio di distribuzione dei beni sia fissato in funzione della produttività di ognuno; può eliminare le sperequazioni più gravi della vita attuale e le forme più chiare di sfruttamento. Ma detto questo risulta altresì è evidente che il comunismo può realizzarsi prima e senza la trasfigurazione della società, [può realizzarsi] in quella più profonda società che è in ognuno di noi – la societas in interiore homine – e che da noi soltanto acquista valore”. Il comunismo di Spirito è quindi più platonico che marxista, nell’affermazione che questo può realizzarsi prima e senza la rivoluzione delle strutture socio-economiche, in quanto rivoluzione interiore delle coscienze. Ma a questo proposito, Ugo Spirito chiarisce ulteriormente il suo punto di vista “Quando spontaneamente e gioiosamente rinuncio al di più, so di avere realizzato, anche nel mezzo del più anticomunistico regime politico, l’ideale del comunismo. Ideale che può sussistere non soltanto in un solo Paese…ma anche e soprattutto in un solo uomo, vale a dire nella coscienza del singolo; là dove può rivelarsi nella pura spiritualità”. Di qui l’apparentemente paradossale affermazione che non è il proletariato a costituire la forza realizzante l’avvento della società comunista – dato che esso aspira in fondo solo al comfort borghese. Soltanto il borghese che ha preso coscienza della metafisica comunista –cioè di una coscienza anticonsumistica – può rappresentare la forza trainante della Rivoluzione.
Nel 1935, il filosofo Ugo Spirito (Arezzo, 1896 – Roma, 1979) presentava al Convegno di studi corporativi di Roma la sua relazione – intitolata Corporativismo e libertà – con la quale esprimeva la convinzione che la sfida al capitalismo dovesse essere vinta tanto sul piano tecnico quanto su quello spirituale, marcando una superiorità di tipo gerarchico-totalitario “in cui i valori umani si differenzino al massimo”. La concezione corporativistica di Spirito è infatti una visione, poiché non si derubrica a semplice metodologia, a insieme di processi di funzionalità tecnica, ma si eleva a momento spirituale nel quale la vita sociale si unifica moralmente “nella gioia del dare e del sacrificarsi”; in buona sostanza nel rifiuto di ogni fine privato dell’esistenza. In uno scritto del 1934, significativamente intitolato Il corporativismo come negazione dell’economia, Spirito afferma chiaramente che il corporativismo “non è economia, ma politica, morale, religione, essenza unica della rivoluzione fascista”. E proprio per questa ragione egli parlò di “comunismo gerarchico”, dove il primo termine va inteso in un senso assai distante da qualsiasi dogmatismo marxista-bolscevico; mentre il secondo rimanda alla libertà caratterizzata dal diritto al lavoro che seleziona un’èlite umana in grado di accedere ai vertici della comunità. Il comunismo inteso da Spirito è stile di vita più che sistema politico. Come scriverà nel 1947 in Filosofia del comunismo: “…Il comunismo può dare luogo ad istituzioni sociali e giuridiche…Può tendere ad una vita collettiva in cui il criterio di distribuzione dei beni sia fissato in funzione della produttività di ognuno; può eliminare le sperequazioni più gravi della vita attuale e le forme più chiare di sfruttamento. Ma detto questo risulta altresì è evidente che il comunismo può realizzarsi prima e senza la trasfigurazione della società, [può realizzarsi] in quella più profonda società che è in ognuno di noi – la societas in interiore homine – e che da noi soltanto acquista valore”. Il comunismo di Spirito è quindi più platonico che marxista, nell’affermazione che questo può realizzarsi prima e senza la rivoluzione delle strutture socio-economiche, in quanto rivoluzione interiore delle coscienze. Ma a questo proposito, Ugo Spirito chiarisce ulteriormente il suo punto di vista “Quando spontaneamente e gioiosamente rinuncio al di più, so di avere realizzato, anche nel mezzo del più anticomunistico regime politico, l’ideale del comunismo. Ideale che può sussistere non soltanto in un solo Paese…ma anche e soprattutto in un solo uomo, vale a dire nella coscienza del singolo; là dove può rivelarsi nella pura spiritualità”. Di qui l’apparentemente paradossale affermazione che non è il proletariato a costituire la forza realizzante l’avvento della società comunista – dato che esso aspira in fondo solo al comfort borghese. Soltanto il borghese che ha preso coscienza della metafisica comunista –cioè di una coscienza anticonsumistica – può rappresentare la forza trainante della Rivoluzione.
Spirito contro la ‘Carta del Lavoro’ del 1927
Per questo Ugo Spirito percepì come insufficiente la ‘Carta del Lavoro’ del 1927 che conservava gli aspetti di quel mondo borghese-capitalistico contro cui il fascismo, ispirandosi ad un’altra Carta, quella del Carnaro, era sorto. Il fascismo nasceva infatti per contrapporsi all’’individuocrazia’ liberale, affermando l’immanenza dello Stato nelle singole parti che lo compongono. Tuttavia, tentando di conciliare la proprietà privata con il dovere di metterla al servizio della collettività – al di là della reale capacità e volontà politica di trovare la giusta sintesi a tutto ciò – di fatto cedeva alla superiorità della prima, il cui diritto rimaneva intangibile. Nel Convegno di Ferrara del 1932, Spirito propose di tagliare il nodo di Gordio con la spada della “corporazione proprietaria”: tesi con la quale si affermava che la proprietà privata dei mezzi di produzione doveva passare alla corporazione intesa come corpo sociale intermedio tra individuo e Stato. In questo modo la Rivoluzione fascista avrebbe superato quella francese e la sua egoistica rivendicazione della proprietà privata, con un concetto di proprietà non più volto a fare di essa un inalienabile e assoluto diritto dell’individuo, ma una funzione utile all’interesse della Nazione. Concezione che in parte il fascismo faceva propria se pensiamo che la legge sulla Bonifica integrale autorizzava la revoca della proprietà qualora questa fosse stata lasciata inattiva. In ogni caso, se la ‘Carta del Lavoro’ aveva giustapposto l’interesse pubblico e quello privato, la tesi di Spirito tendeva a fonderli nell’identità di capitale e lavoro, di sindacalismo e proprietà. Con la corporazione “proprietaria”, il capitale sarebbe infatti passato dagli azionisti ai lavoratori, i quali avrebbero acquisito la proprietà in base a meriti gerarchici determinati da competenza e impegno.
L’’eresia’ di Ugo Spirito venne immediatamente tacciata di bolscevismo. Reazione abbastanza scontata, anche perché lo stesso filosofo chiuse la sua relazione ferrarese dichiarò che la proposta da lui fatta andava verso un certo tipo di ‘socialismo nazionale’. Se l’oggi vedeva contrapposti Fascismo e Bolscevismo, il domani sarebbe stato di quel sistema che avrebbe saputo non negare l’altro, ma incorporarlo e superarlo in una forma più elevata. Ragione per cui “il Fascismo ha il dovere di fare sentire che esso rappresenta una forza costruttrice storicamente all’avanguardia, capace di lasciarsi alle spalle, dopo averli riassorbiti, Socialismo e Bolscevismo”. Chiuse il convegno il ministro Giuseppe Bottai (1895 –1959) che difese l’autonomia di corporazione, sindacato, impresa e Stato che Spirito voleva fondere nella già citata ‘corporazione proprietaria’; ma che nel contempo prese le distanze da quelli che, indossata la “maschera di cartone” del liberalismo, consideravano conclusa la sperimentazione corporativa.
Il periodo della ‘rielaborazione’
Negli anni successivi, Ugo Spirito abbandonò la tesi ‘eretica’ sostenuta a Ferrara, pur riaffermando costantemente il carattere pubblicistico della proprietà e dichiarando un controsenso il concepirla privatisticamente. Tanto più che la fondazione dell’IRI sembrò a tutti gli effetti un passo avanti verso il riconoscimento della proprietà come res pubblica, attraverso un deciso intervento dello Stato in economia. Ancora nel 1941, Spirito scriveva in Guerra rivoluzionaria (rimasto inedito fino al 1989) che la Rivoluzione fascista non avrebbe mai condotto ad un comunismo ‘livellatore’, figlio diretto delle democrazie liberali: “Non aristocrazia ereditaria e neppure il suo astratto opposto segnato dalla democrazia maggioritaria, bensì la gerarchia di tutti continuamente formantesi e rinnovantesi nell’assolvimento delle funzioni sociali, dalle più elevate e complesse alle più umili e semplici. Non comunismo, dunque, fondato sul peso della massa come numero, ma ‘comunismo gerarchico’, ossia collaborazione di tutti all’opera comune, determinata in ogni suo aspetto con il solo criterio della competenza”. Proprio in quell’anno, tuttavia, il nuovo Codice civile stabiliva sì la funzione sociale della proprietà, ma ne tutelava comunque il carattere privatistico. La necessità di conseguire scopi sociali veniva affidata dunque all’impulso individuale e all’iniziativa del proprietario secondo la nota favola liberale, stando alla quale dall’interesse privato di alcuni nascerebbe l’utile per tutti. Nulla di strano però, se consideriamo i mille compromessi con le forze borghesi e clericali, con i grandi gruppi finanziari che certamente trovavano sponda e sostegno nella monarchia “borghese” dei Savoia, ai quali era ormai costretto il fascismo. Quando però la trahison des clercs – cioè il vero o presunto abbandono del fascismo da parte della borghesia – e il tradimento del re fecero venire meno la ragione stessa dei compromessi, fu però possibile un’accelerazione dell’evoluzione del sistema corporativo in direzione delle tesi di Spirito. Ma ciò avvenne troppo tardi, soprattutto in quanto il regime aveva ormai di fronte un ostacolo nuovo, oltre che poco disposto a compromessi: la Germania. La necessità da parte di quest’ultima di trasferire in patria lavoratori italiani e di utilizzare pure le industrie ubicate in Nord Italia per le proprie necessità, comportò l’opposizione del generale Hans Leyers, capo della Commissione Guerra e Armamenti del Nord d’Italia, al processo di socializzazione.
Fu comunque significativo che il ‘Manifesto’ di Verona venne redatto dal segretario del partito Alessandro Pavolini insieme con Nicola Bombacci, e rivisto infine dal duce. Nel documento si parlò di socializzazione, ovvero della cooperazione delle forze del lavoro nella gestione delle imprese, eliminando così il dualismo tra lavoratori e datori di lavoro. Nella sostanza, l’obiettivo era certo quello di un miglioramento delle condizioni di vita degli operai delle industrie – il cui appoggio risultava fondamentale anche per la Repubblica Sociale Italiana – anche se attraverso la ‘socializzazione’ si riproponeva di realizzare una nuova concezione del lavoro, capace di sviluppare un senso di appartenenza, di solidarietà, di responsabilità. Un ethos capace di rivoluzionare il rapporto tra cittadini e quello tra popolo e Stato. Il lavoro si sarebbe ‘spiritualizzato’ poiché il peso fondamentale non sarebbe stato più attribuito alla semplice materialità del possesso dei mezzi di produzione. Ed era poi il senso di quanto il filosofo Giovanni Gentile, maestro di Spirito ebbe a dire in Genesi e struttura della società a proposito dell’Umanesimo del lavoro. Detto ciò, occorre riconoscere che la “corporazione proprietaria” di Spirito si spinse oltre la stessa socializzazione che, in ogni caso, avrebbe conservato il principio della proprietà privata intesa come beneficio esclusivo del capitalista.
Il ruolo sociale ed etico della Corporazione
Spirito attribuiva infatti la proprietà dei mezzi di produzione alla corporazione, affermando che la stessa produzione, avendo un ruolo sociale, non avrebbe potuto di conseguenza essere abbandonata all’arbitrio individuale del proprietario. La tesi di Spirito eliminava dunque ogni rischio; ma la socializzazione lasciò però uno spiraglio di cui i capitalisti del Nord seppero approfittare. Essa ebbe comunque il merito di introdurre principi di quel ‘socialismo nazionale’ auspicato da Spirito, riconsegnando dignità spirituale al lavoro e al lavoratore, nel rifiuto di ogni materialismo marxistico, di ogni determinismo storico e della lotta di classe. A guerra conclusa, il CNLAI dominato dai comunisti decretò l’abrogazione della legge sulla socializzazione delle imprese. E mentre il bolscevismo non abolì il capitalismo, la ‘socializzazione’ ebbe il merito di sapere ipotizzare un ‘socialismo nazionale’ assai prossimo alla Volksgemeinschaft, la Comunità di popolo tedesca. Un organismo in grado di eliminare ogni antagonismo di classe e capace di realizzare nelle aziende un modello di Stato nazionalsocialista. Ma la fine del Secondo Conflitto fece naufragare anche questo tentativo rivoluzionario, consentendo al mondo borghese-capitalistico si riappropriarsi dei suoi privilegi. Tuttavia, pochi anni dopo in Filosofia del comunismo, Spirito scriveva ancora: “…la civiltà liberale e borghese ha potuto fare della libertà il monopolio di una classe solo a patto che i molti non liberi ne pagassero il prezzo; ma se oggi la stessa libertà vuole essere rivendicata da tutti, sì che nessuno resti a condizionarne il privilegio, la lotta di classe si muta in lotta di gruppi e di individui, tutti al privilegio anelanti e tutti impegnati nella corsa degli egoismi più sfrenati. La presunta libertà diventa il principio della disgregazione, dell’atomismo e del conseguente caos, del quale già si avvertono i segni premonitori. Perché a questa logica sia dato sottrarsi, occorre vivere di un’altra fede, credere in un nuovo mondo sociale, che vada al di là del liberalismo e realizzi nella comunità degli uomini un ideale che non sia quello del tornaconto del singolo e del calcolo economico di chi guarda alla propria persona come centro del mondo”. Negli anni successivi, questa fede prese per Spirito sempre più il nome di comunismo; ma nonostante una sua certa ammirazione per il mondo sovietico (che ebbe modo di visitare in un viaggio di appena un mese), il comunismo di Spirito si identificava pur sempre in una forma di ‘corporativismo antindividualistico’ e antimaterialistico che con il realismo sovietico non aveva proprio nulla da spartire.
Rielaborazioni. La ‘nuova religione’
Nello scritto del 1958, Cristianesimo e comunismo, Spirito vide nel socialismo e nel comunismo addirittura i veri continuatori della ‘rivoluzione cristiana’ in virtù della rivendicazione della dignità del lavoro nelle sue forme più umili e per la definitiva negazione della proprietà privata, caposaldo della rivoluzione borghese. Il comunismo avrebbe realizzato ciò non con la lotta di partito e con le sue rivendicazioni – che Spirito giudicava mere continuazioni del mondo borghese – ma trasformandosi in ‘nuova metafisica’ e ‘nuova religione’ fondata sul rifiuto dello stesso principio individualistico. Un ideale compiuto che avrebbe consegnato alle coscienze un programma che “nasce dalla collaborazione di tutti, come ragione d’essere di una vita comune” in cui la volontà di ognuno si risolve nella volontà sociale. “Nessuno appartiene più a se stesso perché ognuno diventa soltanto parte di un organismo e dell’organismo acquista il carattere superiore, la forza, la coscienza e la finalità”. Ora, agli inizi del XXI secolo, dove il principio individualistico e il privilegio borghese sembrano avere trionfato ovunque, al di là del nome che ognuno di noi attribuisce alla ‘nuova fede’ di cui parla Spirito, non si può tralasciare di realizzarla dentro di noi, affinché la civiltà europea possa ancora guardare al futuro con un briciolo di speranza.
Rodolfo Sideri
00:05 Publié dans Histoire, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, philosophie, théorie politique, sciences politiques, politologie, italie, corporations, corporatisme, sociologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 05 avril 2011
Carl Schmitt, the Inquisition, and Totalitarianism
Carl Schmitt, the Inquisition, and Totalitarianism
Arthur VERSLUIS
Ex: http://www.esoteric.msu.edu/
The work of Carl Schmitt, on its face, presents us with enigmas; it is esoteric, arcane, words that recur both in scholarship about Schmitt and in his own writings. Jan-Wenner Müller observes that Schmitt “employed what has been called a kind of philosophical ‘double talk,’ shifting the meaning of concepts central to his theory and scattering allusions and false leads throughout his work.”[1] And Müller goes on to remark about Heinrich Meier’s work on Schmitt that ultimately Meier too “lapsed into the kind of double talk, allusiveness, and high-minded esoteric tone so typical of Strauss and, to a lesser extent, Schmitt.”[2] Indeed, Schmitt himself writes, in The Leviathan in the State Theory of Thomas Hobbes that “like all great thinkers of his times, Hobbes had a taste for esoteric cover-ups. He said about himself that now and then he made ‘overtures,’ but that he revealed his thoughts only in part and that he acted as people do who open a window only for a moment and closely it quickly for fear of a storm.”[3] This passage could certainly be applied to Schmitt himself, whose work both makes direct reference to Western esoteric traditions, and itself has esoteric dimensions. These esoteric allusions and dimensions of Schmitt’s thought are, in fact, vitally important to understanding his work, but the question remains: what place do they have in it?

Carl Schmitt and Early Modern Western Esotericism
Much has been made of the exoteric-esoteric distinction in the thought of Leo Strauss. Some authors suggested that a Straussian esotericism guided the neonconservative cabal within the Bush II administration, after all a secretive group that disdained public opinion and that was convinced of its own invincible rectitude even in the face of facts.[4] It is true that Strauss himself distinguished between an esoteric and an exoteric political philosophy. In perhaps his most open statement, Strauss writes, coyly, of how “Farabi’s Plato eventually replaces the philosopher-king who rules openly in the virtuous city, by the secret kingship of the philosopher who, being a ‘perfect man,’ precisely because he is an ‘investigator,’ lives privately as a member of an imperfect society which he tries to humanize within the limits of the possible.”[5] Strauss’s “secret kingship of the philosopher” is, by its nature, esoteric; as in Schmitt’s, there is in Strauss’s work a sense of the implicit superiority of the esoteric political philosopher.
But in fact those who are searching for esotericism have much more to find in the work of Schmitt, not least because Schmitt’s references to classical Western esotericism are quite explicit. Schmitt refers directly to Kabbalism and to Rosicrucianism, to Freemasonry, and, most importantly for our purposes, to Gnosticism. It is quite important, if one is to better understand Schmitt, to investigate the meanings of these explicitly esoteric references in his work. While there are allusions to such classical Western esoteric currents as Jewish Kabbalah, Rosicrucianism, and Freemasonry scattered throughout Schmitt’s writings, those references are concentrated in Schmitt’s 1938 The Leviathan in the State Theory of Thomas Hobbes. There are a number of reasons why Western esoteric currents should form a locus in this particular work, among them the fact that many of these traditions (notably, Rosicrucianism, Freemasonry, and Christian theosophy) emerged precisely in the early modern period of Hobbes himself and so correctly, as Schmitt recognized, represent historical context as well as contribute to Schmitt’s larger argument.
Both Schmitt and Guénon came from a Catholic background and perspective—and Guénon’s broader thesis was that the advent of early modernity represented one stage in a much larger tableau of decline in which modernity (representing the kali yuga or final age) would conclude in the appearance of the Antichrist and the end of the world. In this Guénonian tableau of decline, the emergence of individualistic Protestantism represented an important step downward from the earlier corporate unity of Catholicism, and a similar perspective inheres in Schmitt’s work, no doubt why he alludes to Guénon in the first place. Hence, in the important Chapter V of Leviathan, Schmitt refers to the “separation of inner from outer and public from private” that emerged during the early modern period, and in particular to “secret societies and secret orders, Rosicrucians, freemasons, illuminates, mystics and pietists, all kinds of sectarians, the many ‘silent ones in the land,’ and above all, the restless spirit of the Jew who knew how to exploit the situation best until the relation of public and private, deportment and disposition was turned upside down.”[8]
At this point, we can see Schmitt’s perspective is implicitly critical of the subjectification and inward or contemplative turn characteristic of those who travel “the secret road” “that leads inward.” He opposes the split between private spiritual life and public life, which Schmitt associates with Judaism as well as with Protestantism and the profusion of esoteric groups during this period—and by implication, affirms a unified, corporate inner and outer life that is characteristic of Catholicism. Schmitt remarks that “as differently constituted as were the Masonic lodges, conventicles, synagogues, and literary circles, as far as their political attitudes were concerned, they all displayed by the eighteenth century their enmity toward the leviathan elevated to a symbol of state.”[9] He sees Protestantism and the variety of esoteric groups or currents during the early modern period as symptomatic—like Guénon, he sees the emergence of modernity as a narrative of cultural disintegration.
It becomes clearer, then, how Schmitt could have seen in National Socialism a secular alternative to modernity. Fascism represented for him, at least potentially, the re-unification of inner and outer life, a kind of modern re-unification of the mythic and spiritual with the outer public life. It at first seemed to conform to the Hobbesian notion that in exchange for obedience, one receives protection from the state; it represented a new form of corporatism as an alternative to the socio-political disintegration represented by parliamentary democracy in the Weimar era; and it even offered an apparent unity of esoteric and exoteric through its use of symbolism and mythology in the service of the state. But to the extent that he allied with the Nazis, Schmitt was consciously siding with the Inquisitors, and with totalistic state power. In retrospect and by comparison, perhaps the “secret road” inward as represented by eighteenth-century esotericism was not quite so bad as all that. Yet to understand more completely Schmitt in relation to the esoteric, we must turn to a subject he treats somewhat more explicitly: Gnosticism.
Schmitt writes that oppositions between friend and enemy are “of a spiritual sort, as is all man’s existence.”[11] In Politische Theologie II, he writes that Tertullian is the prototype of the theological possibilities of specific judicial thinking, and refers to him as the “jurist Tertullian.”[12] Heinrich Meier discusses Schmitt’s indebtedness to Tertullian and in fact remarks that “Tertullian’s guiding principle We are obliged to something not because it is good but because God commands it accompanies Schmitt through all the turns and vicissitudes of his long life.”[13] What is it about Tertullian that Schmitt found so fascinating that he returned to his work again and again? Divine authority as presented by Tertullian divides men: obedience to divine authority divides the orthodox from the heretics, the “friends of God” from the “enemies of God,” and the political theologian from the secular philosopher. Here we are reminded of perhaps Tertullian’s most famous outcry: “What then does Athens have to do with Jerusalem? What does the Academy have to do with the Church? What do the heretics have to do with Christians?”[14] Tertullian was, of course, a fierce enemy of Gnosticism, and his works, especially De praescriptione haereticorum, belong to the genre of heresiophobic literature.
Now with Tertullian’s antignosticism in mind, we should turn to the afterword of Schmitt’s Politische Theologie II, in which “gnostische Dualismus” figures prominently. There, Schmitt remarks that Gnostic dualism places a God of Love, strange to this world, in opposition to the lord and creator of this evil world, the two conflicting in a kind of “cold war.”[15] This he compares to the Latin motto noted by Goethe in Dichtung und Wahrheit, “nemo contra deum nisi deus ipse”—only a god can oppose a god.[16] With these references, Schmitt is alluding to the Gnostic dualism attributed to the Gnostic Marcion, who reputedly posited two Gods, one a true hidden God, the other an ignorant creator God.
So virulent is Tertullian in his hatred of those he perceives as heretics that he goes so far as to imagine that “There will need to be carried on in heaven persecution [of Christians] even, which is the occasion of confession or denial.”[18] Here we begin to see the dynamic that impels Tertullian’s hatred of those he designates as heretical. On the one hand, Tertullian belongs in the context of Roman persecution of Christians as a whole—but on the other hand, he in turn carries on an intellectual persecution of heretics whom he sees as scorpions, that is, as vermin.[19] Thus we see Tertullian’s perception of himself as defender of the historicist orthodox, the strength of whose identity comes on the one hand, from affirmation of faith in the historical Christ against the Romans, on the other hand, from rejection of the Gnostics who seek to transcend history and who affirm, for example, a docetic Christ. Tertullian’s very identity exists by definition through negation—he requires the persecution of “heretics.” Tertullian is the veritable incarnation of a friend/enemy dynamic, and he exists and defines himself entirely through such a dynamic. We can even go further, and suggest that the background of persecution by the Romans in turn inevitably impels the persecuted historicist Christians to themselves become persecutors of those whom they deem heretics—a dynamic that continues throughout the subsequent history of Christianity (from the medieval condemnation of Eckhart right through the various forms of early modern and modern anti-mysticism within Protestant and Catholic Christianity alike).[20] Tertullian, for all his fulminations against what he imagines as Gnostic dualism, is in fact himself the ultimate dualist [or duelist]. He cannot exist without historical enemies, without persecutors and without those whom he can persecute in his turn.
Now I am not arguing that Schmitt’s work—and in particular his emphasis on the role of antagonism and hostility as defining politics, nor his emphasis on historicity—derives only from Tertullian. Rather, I hold that Schmitt refers to Tertullian because he finds in him a kindred spirit, and what is more, that there really is a continuity between Schmitt’s thought and the anti-heretical writings of Tertullian. Both figures require enemies. Schmitt goes so far as to write, in The Concept of the Political, that without the friend-enemy distinction “political life would vanish altogether.”[23] And in the afterword to Political Theology II, Schmitt—in the very passages in which he refers to Gnosticism and in particular to dualism—ridicules modern “detheologization” [Die Enttheologisierung] and “depoliticization” [Die Entpolitisierung] characteristic of a liberal modernity based upon production, consumption, and technology. What Schmitt despises about depoliticizing or detheologizing is the elimination of conflict and the loss thereby of the agonistic dimension of life without which, just as Tertullian wrote, the juridical trial and judging of humanity cannot take place. Tertullian so insists upon the primacy of persecution/prosecution that he projects it even into heaven itself. Schmitt restrains himself to the worldly stage, but he too insists upon conflict as the basis of the political and of history; and both are at heart dualists.
The work of Schmitt belongs to the horizontal realm of dualistic antagonism that requires the antinomies of friends and enemies and perpetual combat. Schmitt is a political and later geopolitical theorist whose political theology represents, not an opening into the transcendence of antagonism, but rather an insistence upon antagonism and combat as the foundation of politics that reflects Tertullian’s emphasis on antagonism toward heretics as the foundation of theology. When Schmitt writes, in The Concept of the Political, that “a theologian ceases to be a theologian when he . . . no longer distinguishes between the chosen and the nonchosen,” we begin to see how deeply engrained is his fundamental dualism.[24] This dualism is bound up with Schmitt’s insistence upon “the fundamental theological dogma of the evilness of the world and man” and his adamant rejection of those who deny original sin, i.e., “numerous sects, heretics, romantics, and anarchists.”[25] Thus “the high points of politics are simultaneously the moments in which the enemy is, in concrete clarity, recognized as the enemy.”[26] The enemy, here, just as in Tertullian’s work, is those deemed to be heretical.
As perhaps Tertullian once did, Schmitt too came up against the command of Christ to “love your enemies” (Matt. 5.44; Luke 6.27). His interpretation of it is befitting a wily attorney—he takes it only on a personal level. “No mention is made of the political enemy,” Schmitt writes. “Never in the thousand-year struggle between Christians and Moslems did it occur to a Christian to surrender rather than to defend Europe,” he continues, and the commandment of Christ in his view “certainly does not mean that one should love and support the enemies of one’s own people.”[28] Thus, Christ can be interpreted as accepting political antagonism and even war—while forgiving one’s personal enemies along the way. Schmitt conveniently overlooks the fact that nowhere in the New Testament can Christ be construed as endorsing, say, political war against Rome—His Kingdom is not of this world. Is it really so easy to dismiss the power of the injunction to love one’s enemies?
There is more. For Schmitt’s distinction between the personal and the political here makes possible what his concept of the katechon also does: Christian empire. Here we see the exact point at which the Christian message can be seen to shift from the world-transmuting one of forgiving one’s enemies to the worldly one that leads inexorably toward the very imperial authority and power against which Christ himself stood as an alternative exemplar. “My Kingdom is not of this world,” Christ said. But somehow a shift took place, and suddenly Christ was being made to say that his kingdom is of this world, that rather than forgiving one’s enemies, one should implacably war against them. Thus we have the emergence of Christian empire. But the collapse of feudalism and of the medieval polis, and the emergence of modernity ultimately meant the de-politicization of the world—the absence of enemies, of heretics, of those against whom others can define themselves—none other than the cultural vacuum represented by technological-consumerist modern society.
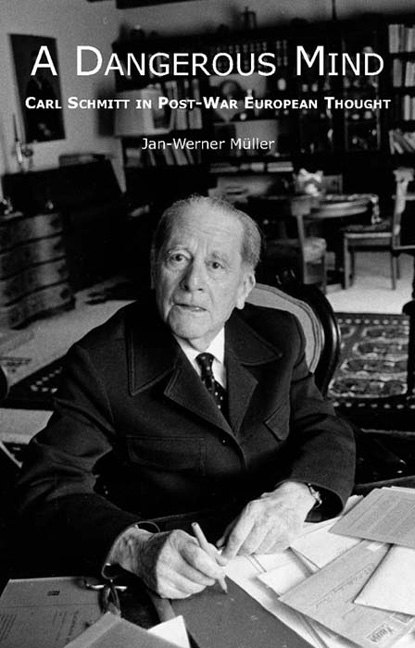
Conclusions
And so we again reach the argument that I began to suggest in “Voegelin’s Antignosticism and the Origins of Totalitarianism,” but from a very different angle. There, I argued that rather than attempting (like Voegelin and his acolytes) to blame the victims—the Gnostics and ‘heretics’—for the advent of modernity and for totalitarianism, it might be more reasonable to take a closer look at the phenomenon of the Inquisition and of historicist Christianity (particularly millennialist Christianity) for the origins of modern secular chiliasm. After all, it wasn’t the heretics or the Gnostics who burned people at the stake, or created institutional torture chambers, or who slaughtered the Albigensians. Rather, it was the institutional church that did this. Our analysis of Schmitt’s work has brought us, unexpectedly, back to the same general terrain.
Schmitt’s work belongs to the juridical tradition of Tertullian and he inherits Tertullian’s need for enemies, for heretics by which one can define oneself. Thus it was not too difficult for Schmitt to organize the 1936 conference to weigh the “problem” of “the Jews”—he was predisposed toward the division of “us” and “them” by the triumphant Western historicist Christian tradition that peremptorily and with the persistence of two thousand years, rejected “heretics” who espoused gnosis and, all too frequently, rejected even the possibility of transcending dualism. Indeed, Schmitt’s work allows us to see more clearly the historical current that was operative in National Socialism as well as in Mussolini’s Fascist party—and that brought Schmitt to open his 1936 conference remarks with the words of Hitler: “In that I defend myself against the Jews, I struggle to do the work of the Lord.”[30] The murder of heretics has a theological origin; the murder of secular opponents has a political origin—but often the two are not so far apart, and so one could even speak of political theology in which to be the enemy is to be de facto heretical.
Thus, after the “Night of the Long Knives” and after Goebbels and Himmler carried out the murder of various dissidents, Schmitt published an article defending the right of the Third Reich and its leader to administer peremptory justice—and, in an interview published in the party newspaper Der Angriff, defending none other than the Inquisition as a model of jurisprudence.[31] Schmitt argued there that when Pope Innocent III created the juridical basis for the Inquisition, the Church inaugurated perhaps the “most humane institution conceivable” because it required a confession. Of course, he goes on, the subsequent advent of confessions extracted by torture was unfortunate, but in terms of legal history, he thought the Inquisition a fine model of humane justice. He managed to overlook the fact that the “crimes,” both in the case of the Inquisition and in the case of National Socialism in mid-1930s Germany, were primarily “crimes” of dissidence.
[1] See Jan-Werner Müller, A Dangerous Mind: Carl Schmitt in Post-War European Thought, (New Haven: Yale UP, 2003), p. 7
[2] Ibid., p. 205
[3] See Carl Schmitt, G. Schwab, trs., The Leviathan in the State Theory of Thomas Hobbes, (Westport: Greenwood, 1996), p. 26.
[4] See Hugh Urban, “Religion and Secrecy in the Bush Administration: The Gentleman, the Prince, and the Simulacrum,” in Esoterica VII(2005): 1-38.
[5] See Leo Strauss, Persecution and the Art of Writing, (Chicago: U. of Chicago P., 1952), p. 17; Leo Strauss, “Farabi’s Plato,” Louis Ginzberg Jubilee Volume, New York: American Academy for Jewish Research, 1945), pp. 357-393, p. 384.
[6] Schmitt, Leviathan, op. cit., p. 3.
[7] Ibid., p. 29.
[8] Ibid., p. 60.
[9] Ibid., p. 62.
[10] Ibid., pp. 96-97.
[11] See Heinrich Meier, Carl Schmitt and Leo Strauss: The Hidden Dialogue, (Chicago: U of Chicago P, 1995), p. 59, citing The Concept of the Political (1933 ed.) III.9.
[12] See Schmitt, Politische Theologie II, (Berlin: Duncker und Humblot, 1970), p. 103, to wit: “Für eine Besinnung auf die theologischen Möglichkeiten spezifisch justischen Denkens ist Tertullian der Prototyp.”
[13] Heinrich Meier, The Lesson of Carl Schmitt, (Chicago: U of Chicago P, 1998), p. 92.
[14] See Meier, op. cit., p. 94, citing Tertullian, De praescriptione haereticorum, VII. 9-13: “Quid ergo Athenis et Hierosolymis? Quid academiae et ecclesiae? Quid haereticis et Christianis?”
[15] Schmitt, PTII, op. cit., p. 120: “Der gnostische Dualismus setzt einen Gott der Liebe, einen welt-fremden Gott, als den Erlöser-Gott gegen den gerechten Gott, den Herrn und Schöpfer dieser bösen Welt. . . [einer Art gefährlichen Kalten Krieges]”.
[16] Ibid., p. 122.
[17] See A. Roberts and J. Donaldson, eds., Ante-Nicene Fathers, (Edinburgh: T & T Clark, 1989), III.521.
[18] Ibid., III. 643.
[19] See Tertullian’s treatise “Scorpiace,” op. cit., III.633-648.
[20] Here we might remark that Western forms of Christianity are strikingly different in this respect from those in the Eastern Church, where mysticism remained (however uneasily at times) incorporated into orthodoxy itself and not imagined as inherently inimical to orthodoxy.
[21] See Carl Schmitt, The Nomos of the Earth in the International Law of the Jus Publicum Europaeum, G.L. Ulmen, trs., (New York: Telos, 2003), pp. 59-60.
[22] Ibid., p. 60.
[23] Carl Schmitt, G. Schwab, trs., The Concept of the Political, (New Brunswick: Rutgers, 1976), p. 51.
[24] Ibid., p. 64.
[25] Ibid., p. 65.
[26] Ibid., p. 67.
[27] I write “supposedly” dualist and “reputedly” held the world to be evil because these accusations, repeated by Tertullian and several other ante-Nicene Fathers, are hardly borne out as characteristics of all the works we see in the Nag Hammadi library, the collection of actual Gnostic writings discovered in 1945.
[28] Ibid., p. 29.
[29] See Luciano Pellicani, Revolutionary Apocalypse: Ideological Roots of Terrorism, (Westport: Praeger, 2003), pp. xi. I wholeheartedly agree with Pellicani’s basic thesis that “The expansion on a planetary scale of a new form of chiliasm that substituted transcendence with absolute immanence and paradise with a classless and stateless society is the most extraordinary and shattering historical-cultural phenomenon of the secular age.” But this “new form of chiliasm” has nothing whatever to do with Gnosticism as an actual historical phenomenon. One cannot find a single instance in late antiquity among the Gnostics themselves for such a phenomenon—but if one were to refer instead to “the destructive calling of modern pseudo-gnostic revolution” that seeks to “purify the existing through a policy of mass terror and annihilation,” Pellicani’s thesis would no longer be quite as subject to the criticism of an anachronistic misuse of terms. Later in the book, Pellicani discusses the cases of the Pol Pot regime and of Communist China—both of which illustrate his larger thesis well. But neither of these have anything whatever to do with the phenomenon of Gnosticism in any historically meaningful sense. Even Voegelin himself expressed doubts about attempting to apply “Gnosticism” to the case of Communist Russia—let alone to Cambodia! Such cases could be construed to illustrate a uniquely modern pseudo-gnosticism—though one could with more accuracy dispense entirely with the dubious references to “Gnosticism” and simply refer to secular millennialism.
[30] See Carl Schmitt, “Das Judentum in der deutschen Rechtswissenschaft,” in “Die deutsche Rechtswissenschaft im Kampf gegen den jüdischen Geist,” in Deutsche Juristen-Zeitung, 41(15 Oct. 1936)20:1193-1199, cited in Gopal Balakrishnan, The Enemy: An Intellectual Portrait of Carl Schmitt, (London: Verso, 2000), p. 206.
[31] See “Können wir uns vor Justizirrtum schützen?” Der Angriff, 1 Sept. 1936, cited in Andreas Koenen, Der Fall Carl Schmitt, (Darmstadt: Wissenschaftliche, 1995), p. 703; see also Balakrishnan, op. cit., pp. 202-203.
00:05 Publié dans Philosophie, Révolution conservatrice, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, révolution conservatrice, allemagne, weimar, théorie politique, sciences politiques, politologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 18 mars 2011
La démocratie et le mythe du long fleuve tranquille
La démocratie et le mythe du long fleuve tranquille
par Jean-Gilles MALLIARAKIS
Dans les années 1920 Henri Lammens (1) annonçait, contre tous les sachants, tous les faux spécialistes et autres francs-maçons du grand orient de France, le réveil islamique. On ne l'a pas cru.
Tout cela recommence encore, hélas, chaque jour. Des monceaux d'absurdités sont déversés à propos des événements survenus, depuis le début de cette année, au Maghreb et au Proche orient, puis sur la Libye. À peine vieilles de six semaines, les involutions de l'Égypte et de la Tunisie étaient présentées comme des tournants définitifs, aboutissant à des situations figées et irrévocables.
De ces fleuves naissants, aux sources mal explorées, qui pourrait cependant soutenir qu'il connaît d'ores et déjà l'embouchure ?
Salués pour magnifiques, ces troubles n'ont jusqu'ici produit, en effet, que la chute des gouvernements. Certes on peut tenir ces régimes arabes pour sénescents, presque autant que notre Cinquième république. On les jugera probablement corrompus puisqu'ils sont dirigés par les amis de nos ministres intègres. Mais pour l'instant les transitions sont assumées au gré de l'arbitrage des militaires. Pas bien représentatif pour une démocratie.
Dès que les Libyens ont commencé à bouger, on a jugé inéluctable la victoire du peuple, la déconfiture du tyran, et donc l'établissement paisible de la démocratie sur les décombres de la dictature.
Les architectes virtuels d'un Westminster futur de la Cyrénaïque se demandent seulement si la maison Hermès pourra fournir à temps les cuirs verts de la chambre des Communes et les rouges de la chambre des Lords. Et Comme tout va très vite, on s'interroge quand même sur la pertinence de recourir à John Galliano pour dessiner la perruque des juges. Le bon goût change à chaque instant, dès lors qu'il se passe quelque chose aux Galeries Lafayette.
Les jours du clown sanglant de Tripoli étaient comptés, Juppé dixit. En matière de prédiction, voilà une référence qui fait trembler.
Le "frangin" (2) Ollier remballait très vite sa présidence de "France-Libye", presque aussi discrètement qu'il l'avait exercée. Curieusement, en notre temps, si affolé pourtant de ragots, de rumeurs et de faux scandales, celui-ci ne semble, à ce jour, intéresser personne. À défaut de faire travailler l'industrie d'armement on allait fournir des contrats au commerce du luxe. Les champions nationaux sont sauvés. Tout allait bien. De mieux en mieux plutôt, puisqu'on n'arrête pas le progrès.
Un peu de patience quand même, s'il vous plaît. La démocratie exemplaire britannique ne s'est instituée, chez ce très grand peuple, qu'après deux révolutions (3) et, plus encore, après trois siècles de fonctionnement du régime parlementaire. Il faut n'avoir rien lu de Jacqueline de Romilly qui, pourtant, admirait tant la démocratie athénienne, pour croire que celle-ci résume à elle seule l'Histoire et la pensée de l'Antiquité grecque, et encore plus pour imaginer que cette "invention" fonctionnait dans des conditions analogues à celles que nous connaissons de nos jours, et qu'hélas nous pouvons en partie déplorer.
Croire naïvement qu'il suffit d'une étincelle pour mettre le feu à la prairie, et plus encore pour imaginer que cet incendie, après avoir éclairé le monde, réchauffera nécessairement les peuples convient sans doute à notre époque superficielle et décadente. Tout, tout de suite, sans effort, sans lutte, sans douleur. Nietzsche y voyait la marque du nihilisme. "Point de berger un seul troupeau". On pourrait y voir aussi l'annonce de bien des désillusions.
JG Malliarakis
Apostilles
- cf. "l'Islam croyances et institutions" pp 183-225.
- cf. Le Point n° 2001 du 20 janvier 2011 page 50.
- cf. "Les Deux Révolutions d'Angleterre" par Edmond Sayous
Vous pouvez entendre l'enregistrement de notre chronique
sur le site de Lumière 101
00:20 Publié dans Actualité, Définitions, Réflexions personnelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : démocratie, mythe politique, théorie politique, politologie, sciences politiques, définition |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Bonald's Theory of the Nobility
Bonald’s Theory of the Nobility
F. Roger Devlin
Ex: http://www.counter-currents.com/
 Unlike Edmund Burke and Joseph de Maistre, Louis de Bonald devoted little space to analyzing the French Revolution itself. His focus instead was on understanding the traditional society which had been swept away. His review of Mme. de Staël’s Considerations on the Principal Events of the French Revolution
Unlike Edmund Burke and Joseph de Maistre, Louis de Bonald devoted little space to analyzing the French Revolution itself. His focus instead was on understanding the traditional society which had been swept away. His review of Mme. de Staël’s Considerations on the Principal Events of the French Revolution, e.g., ends up turning into a theory of the nobility and its function. Bonald scholar Christopher Olaf Blum calls this “his most original contribution to the theory of the counter-revolution.”
Any advanced society requires men who devote themselves to the public good in preference to the private good of their families. This is particularly so in the professions of law and war: Bonald calls judges and warriors “merely the internal and external means of society’s conservation,” and hence the two fundamentally political or public professions.
To entice men into public service, two things are required. First, such men must be economically independent. They cannot rely on the changeable will of an employer who pays them a salary, however generous. Nor would their public duties allow them leisure to busy themselves with commerce. Therefore they must be landholders.
Second, men must be socialized to see public service as an honor and a distinction:
The [pre-revolutionary] constitution said to every private family: “when you have fulfilled your destination in domestic society, which is to acquire an independent property through work, order and thrift—when, that is, you have acquired enough that you have no need of others and are able to serve the state at your own expense, from your own income and, if necessary, with your capital—the greatest honor to which you can aspire will be to pass into the order particularly devoted to the service of the state.
In reality, this is a kind of noble fiction: the service nobility’s “distinction, by a strange reversal of conceptions, has seemed, even to them, to be a prerogative, while it is in fact nothing but servitude.” Their own interest would dictate their continued devotion to their families and the concerns of private life.
Pre-revolutionary France had a remarkable way of filling public offices: they were sold. Known as the “venality of offices,” the system is most often cited as an example of the irrationality of the ancien régime’s finances. Liberal historians especially have criticized the system for delaying the onset of large-scale capitalism in France: instead of expanding their commercial operations indefinitely, successful merchants would convert their fortunes into land in order to purchase more ‘honorable’ offices for themselves or their sons. Bonald warmly defends the custom:
There could be no more moral institution than one which, by the most honorable motive, gave an example of disinterestedness to men devoured by a thirst for money in a society in which the passion was a fertile source of injustice and crime. There could be no better policy than to stop, by a powerful yet voluntary means, and by the motive of honor, the immoderate accumulation of wealth in the same hands.
A large payment for occupying offices of public trust, he says, functioned as proof of a candidate’s independence and disinterestedness. The ‘opening of careers to talents’ (which the Revolution made such a fuss over) merely encouraged bribery and endless strife over who was talented. Open venality was, strange to say, the more objective procedure.
Bonald contrasts the service nobility of France favorably with what he calls the political nobility of England: the English peers were “no body of nobles destined to serve political power but a senate destined to exercise it.” Nor were they wholly devoted to public duties: “The peer who makes laws for three months of the year sells linens for the other nine.”
The liberal might respond that “private” linen merchants are serving the public just as much as judges or military men: they provide merchandise to the “general public.” Contemporary libertarians have effectively satirized the notion of “public servants” who consume half our incomes, while “selfish businessmen” labor so that we may feed, clothe, and house ourselves more cheaply than any people in history.
Bonald mentions someone’s suggestion that actors be considered “public servants” since they perform for the public: this notion was universally and deservedly ridiculed, even by many who could not explain why actors were not “public men.”
The case with merchants is similar: “the merchant who arranges for a whole fleet of sugar and coffee serves individuals no less than the shopkeeper who sells them to me.” But the soldier who sacrifices his life for his country does not act merely for the benefit of the particular persons who make up the country at a particular moment. Justice has a similar irreducibly impersonal or universal intention: it is ideally “blind” or without regard for persons. Economic thinking cannot account for these types of human action.
(The philosophically inclined may wish to consult my discussion of the essential difference between universalist vs. particularist action in Alexandre Kojeve and the Outcome of Modern Thought, p. 92ff. Bonald’s views on this matter are quite similar to Hegel’s.)
It should be acknowledged that Bonald’s theory of the nobility is an idealizing interpretation. Since the time of Louis XIV, the grande noblesse at Versailles had not performed much of any function, and well before the Revolution, many noblemen bore a closer resemblance to the dissolute characters in Les liaisons dangereuses than to the ideal type described by Bonald. As Blum says, “in making [his] argument, [Bonald] was a reformer, for the French nobility had shown itself willing to jettison its duties in favor of the kind of freedom that would enable them, the wealthy, to dominate more effectively and without the hindrance of traditional strictures.”
Recommended reading:
Louis de Bonald
The True & Only Wealth of Nations: Essays on Family, Economy, & Society
Translated by Christopher Olaf Blum
Naples, Fla.: Sapientia Press of Ave Maria University, 2006
Critics of the Enlightenment: Readings in the French Counter-Revolutionary Tradition
Edited and translated by Christopher Olaf Blum
Wilmington, Del.: ISI Books, 2004
Louis de Bonald
On Divorce
Translated and edited by Nicholas Davidson
New Brunswick, N.J.: Transaction Publishers, 1992
TOQ Online, Dec. 4, 2009
00:05 Publié dans Histoire, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, théorie politique, sciences politiques, politologie, sociologie, philosophie, conservatisme, réaction, 19ème siècle, france, noblesse, aristocratie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 11 mars 2011
G. Adinolfi: "Het fascisme heeft de antwoorden op de huidige problemen"

Gabriele Adinolfi: "Het fascisme heeft de antwoorden op de huidige problemen"
Gabriele Adinolfi is een van de meest prominente non-conformistische intellectuelen van Italië. Deze sterk door Julius Evola beïnvloede nationaal-revolutionaire militant heeft twintig jaar in gedwongen Franse ballingschap geleefd. Van zijn hand zijn twee opmerkelijke recente werken: Nos belles années de plomb (Onze mooie loden jaren) uit 2004 en Pensées Corsaires. Abécédaire de lutte et de victoire (Kapersgedachten. Het ABC van strijd en van overwinning) uit 2008. Hij staat méér dan ooit in het brandpunt van de strijd in Italië en heeft toegestemd om enkele vragen van ons te beantwoorden.
Rivarol: Allereerst, meneer Adinolfi, kunt u – die een zeer ervaren militant bent en talloze offers voor het fascistische ideaal hebt gebracht – ons vertellen hoe u de toekomst van Italië en die van zijn jeugd ziet?
Gabriele Adinolfi: Heel negatief. Italië is een vergrijzend land met het laagste geboortecijfer van de wereld; het heeft bijna geen industrie meer, een kleine landbouwsector en een zeer beperkte soevereiniteit. De enige elementen die Italië tegenwoordig van de ondergang redden, zijn de nationale energiemaatschappijen (in het bijzonder ENI), de wapenindustrie, de kleine ondernemingen en wat overblijft van het spaargeld van de families.
In de huidige globaliseringscontext geeft dat ons amper enkele jaren om te overleven als de feiten niet radicaal veranderen.
R: Welke rol kan het fascisme in de toekomst van Italië spelen?
GA: Het is een paradox. Het fascisme biedt nog steeds alle antwoorden op de huidige problemen. Men kan zeggen dat het het enige denk- en organisatiesysteem is dat de oplossingen voor de grote uitdagingen van onze tijd bezit. Maar het slaagt er nog steeds niet in om zich in de huidige omstandigheden te plaatsen. De Italianen die het echte fascisme in het dagelijkse leven gekend hebben, blijven het werk van Mussolini waarderen en er zelfs van houden: zij hebben van al zijn sociale, economische, ethische en culturele weldaden genoten. Dat is heel anders voor degenen die van het fascisme slechts de "zwarte legende" hebben gekend en die het, zoals de Fransen, nooit hebben meegemaakt (Vichy kwam voort uit even onverwachte als ongunstige omstandigheden en belichaamde in elk geval geen fascistisch project).
Die nostalgie groeit met de dag door de eenvoudige vergelijking van het Italië van Mussolini met eerst het antifascistische en daarna het post-fascistische Italië. Niettemin ontbreken alle objectieve voorwaarden voor de vestiging van een fascistisch geïnspireerde natiestaat, waardoor het fascisme zich in de huidige toestand niet zal kunnen aanbieden. Toch is het mogelijk om aan het fascisme een hele reeks oplossingen te ontlenen voor de problemen die ons overspoelen. Laten we zeggen dat, als een bepaald aantal voorwaarden is vervuld, we kunnen hopen op een gemengde formule in de Italiaanse toekomst: een soort peronisme op zijn Italiaans.
R: Waaruit bestaat uw activiteit vandaag?
GA: Ik analyseer, becommentarieer, stel voor, schrijf. Ik leid een internetkrant, geef lezingen, houd debatten met mensen van alle gezindten, neem met Soccorso Sociale (Sociale Hulp) deel aan concrete acties voor de rechten van de zwaksten. Ik coördineer een studiecentrum, Polaris, dat een driemaandelijks tijdschrift uitgeeft, dat al een reeks overzichtswerken heeft voortgebracht en dat openbare bijeenkomsten inricht met vertegenwoordigers van de cultuur en de lokale of internationale instellingen. Ik weiger ook nooit om in een meer militant kader deel te nemen aan de ethische vorming en de intellectuele vorming. Ik volg met bijzonder veel aandacht en betrokkenheid het Casa Pound. Ik verzorg ook internationale betrekkingen, steeds in de geest van de heropleving en de "culturele revolutie" alsook met zeer veel aandacht voor het ontkrachten van gemeenplaatsen uit het antifascistische discours, dat met zijn nefaste effect de geschiedschrijving en de ideologie van het post-fascistische tijdperk beïnvloedt.
R: Hoe beoordeelt u de rol van het Vaticaan en, in bredere zin, die van de Kerk in het Italiaanse leven?
GA: Al 17 eeuwen lang, afgezien van een korte onderbreking in Avignon, moet Italië samenleven met de Kerk, wat eerst de burgeroorlogen tussen Welfen en Ghibellijnen heeft voortgebracht, daarna lange tijd de eenwording van Italië heeft verhinderd en na 1945 heeft bijgedragen aan de internationalisering van de Italiaanse politiek. Vandaag heeft de katholieke godsdienst veel minder invloed op het dagelijkse leven, maar hij behoudt een zekere algemene macht zoals blijkt uit de absolute meerderheid die in het parlement de euthanasiewet heeft weggestemd. De conciliaire Kerk is vorig jaar ook een kruistocht begonnen tegen het restrictieve immigratiebeleid van de regering-Berlusconi.
Het Vaticaan steunt de immigratie om ideologische, maar ook om economische redenen. "Migrantes", een kerkelijke organisatie van "Caritas", stelt officieel dat de "vermenging van culturen een bron van rijkdom is" en besteedt de helft van het Italiaanse(!) belastinggeld dat voor het Vaticaan bestemd is aan immigratie. De krachtmeting tussen het Vaticaan en de Italiaanse regering, die in 2010 naar schatting 400.000 immigranten zou hebben tegengehouden, is uitgedraaid op een compromis waarbij Italië wordt verplicht om – begin 2011 – bijna 100 000 nieuwe immigranten binnen te laten. Het Vaticaan lijkt te hebben gewonnen, wat de ontscheping van vreemdelingen alleen nog zal vergemakkelijken.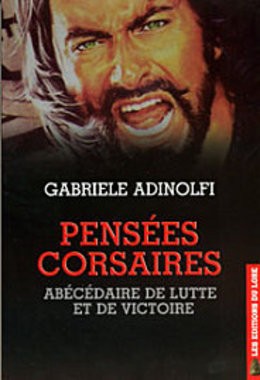 R: Heb je sterk het gevoel dat de Italiaanse fascistische dynamiek een marginaal verschijnsel in Europa is?
R: Heb je sterk het gevoel dat de Italiaanse fascistische dynamiek een marginaal verschijnsel in Europa is?
GA: Eerder dat het een zeer typisch en zeer Italiaans verschijnsel is. Wat de sociologische achtergronden van de beweging betreft en de ideologische impulsen die haar kenmerken, denk ik dat het West-Europa – en niet Europa – is dat zo sterk afwijkt van de Italiaanse dynamiek. De redenen zijn veelvuldig, maar de gebreken van de westerse nationalisten zijn niet onbelangrijk. Het moet worden gezegd dat de westerse nationalisten – politiek gemarginaliseerd als gevolg van ongelijke krachtverhoudingen – ook dikwijls de belichaming van de marginalisering zijn geweest door al de complexen van marginalen en mislukkelingen aan te nemen. Ze hebben hun politieke onmacht weggemoffeld achter het rookgordijn van de holle taal en de meest stompzinnige clichés. Dat alles verwijdert hen van de werkelijkheid en maakt van hen dikwijls de levende bevestiging van de antifascistische karikatuur van het “zwarte schaap”. Een zwart schaap [bête noire] dat voor de rest dikwijls méér dom [bête] dan zwart [noire] is... [woordspeling]
R: Wat is volgens u de belangrijkste bedreiging voor de Europese wereld?
GA: De Europese wereld zélf. De ouderdom van Europa, zijn geestelijke, psychologische en biologische doodsstrijd, zijn afnemende geboortecijfer gekoppeld aan de schuldcomplexen en aan de verafgoding van het burgerlijke concept van "verworven rechten", de afwezigheid van machtswil en veroveringszin – dat zijn de elementen die ons veroordelen. Vervolgens zijn er de verloochening van onze economische productie en onze gewapende landsverdediging, de afwijzing van de oorlogsgeest die ons veroordelen. Die effecten zijn ons gedeeltelijk opgedrongen door de overwinnaars van Europa, d.w.z. de multinationale reus die zijn gezag heeft gevestigd op een bondgenootschap tussen de financiële wereld en de georganiseerde misdaad (en die vandaag nog steeds New York als hoofdstad heeft en Washington als bijhuis). De rest – al de rest – zijn slechts de gevolgen daarvan. De massa-immigratie en het multiculturalisme komen ervandaan en worden er dikwijls door gevoed.
Wat men er ook van denke, we hoeven geen enkele oplossing te verwachten als we niet onze levensenergie terugvinden en afstand nemen van de overwinnaar van Europa. Degenen die denken dat onze problemen in de omgekeerde zin kunnen worden opgelost, d.w.z. van beneden naar boven, dwalen. Het idee om de immigratie tegen te gaan via een enge "religieuze oorlog" (die wordt gesteund door CNN, maar die noch het Vaticaan noch de meeste moslims bereid zijn te voeren) is een ware manipulatie.
Proberen om een "verdediging van het Westen" op de been te brengen, een Westen dat wel héél ruim wordt opgevat – gaande van Londen tot New York en van Washington tot Tel Aviv – is gewoonweg belachelijk.
Het volstaat te bekijken wie de islamitische drugsmaffiastaten in Europa (Bosnië en Kosovo) steunen: de VS en Israël; Al Qaeda hebben uitgevonden: de VS; en Hamas hebben gesteund om de Palestijnse eenheid te ondermijnen: Israël. Dan begrijpt men dat zij die hopen op een Amerikaanse (= WASP) en "joods-christelijke" (volgens een neologisme dat in zwang is) “herovering” op een verkeerd spoor zitten. Of beter nog: het helemaal verkeerd voorhebben. Overigens zitten ze op een dood spoor.
R: De marxisten hebben het fascisme dikwijls verweten zich niet tegen het kapitalisme te verzetten. Wat denkt u van een dergelijke bewering?
GA: Het is pure onwetendheid en/of propaganda. Het volstaat erop te wijzen dat het kapitalisme het fascisme de oorlog heeft verklaard en er een wereldoorlog tegen heeft gevoerd, terwijl het altijd wel gemene zaak heeft gemaakt met elke marxistisch geïnspireerde regering. Dat is de moeite van een debat niet waard.
R: Het experiment van Mussolini heeft geleid tot de totale verstaatsing van Italië (naar Jacobijns model). Wat denkt u daarvan? Welke rol zou u geven aan de staat?
GA: We moeten altijd de werkelijkheid van de propaganda onderscheiden. De Italiaanse staat was autoritair en overweldigend vóór Mussolini. De Duce heeft hem een totalitaire impuls gegeven, maar tegelijkertijd het initiatief en de vrijheid van de individuen, de families en het maatschappelijke middenveld bevordert. Ik zie geen andere formules om enerzijds een lotsgemeenschap aaneen te smeden en te versterken; en anderzijds alle vrijheid om te leven te waarborgen. Wat vandaag gebeurt, is het omgekeerde. De instellingen vernietigen de families en het maatschappelijke middenveld, leggen alles op: op cultureel, ideologisch, financieel, economisch, moreel en zelfs gastronomisch vlak. We leven in een beschaving die alles verbiedt, met rokersgetto's en een schuldgevoel voor vleeseters, alcoholdrinkers en rokkenjagers. Het is het Grote Chicago van de gangsters. Ik kan geen enkele rol aan de staat toekennen om de redenen die ik in het begin heb aangehaald: hij heeft geen enkel concreet gezag meer, noch op wetgevend, noch op economisch, noch – en het minst van al – op militair vlak.
Er is vóór alles een ethische, spirituele en biologische wedergeboorte nodig én voor een lange periode; terwijl we de nieuwe elites trachten te vormen, zal het nodig zijn om te strijden voor de vormen van autonomie die de verdere uitverkoop van de staat zullen kunnen verzachten. Zonder ooit te vergeten dat het uiteindelijke doel de wederopbouw van de staat is.
R: Hoe ziet u het Franse politieke en intellectuele leven van vandaag?
GA: Frankrijk is altijd een "poolster" op intellectueel vlak geweest. Toch heb ik de indruk dat het vandaag in een impasse zit. Het moet ook worden gezegd dat Frankrijk in tegenstelling tot Italië, dat al 66 jaar een kolonie is, decennialang een rol in de wereld heeft gespeeld. De snelle geopolitieke opgave van Frankrijk in Afrika; de geleidelijke, maar versnelde opgave van zijn beschaving, zelfs in eigen land – hoewel gecompenseerd met beursbelangen en aandelen in de meest duistere handels van Latijns-Amerika, iets waarvan Frankrijk voordien nooit had geprofiteerd – dat alles heeft de Fransen ineens van elk optimisme beroofd in het eerste decennium van deze eeuw. Al was het maar op economisch vlak.
Uit de cijfers blijkt dat, hoewel ze hogere lonen hebben, de Fransen veel meer hebben betaald dan wij, Italianen, voor de wereldwijde en door de financiële wereld ontketende economische crisis.
Anderzijds gaat de Franse cultuur erop achteruit, zelfs op de scholen in Frankrijk, waar de taal is verworden tot een vervangingsmiddel voor elke idioot en een zeldzaam en kostbaar goed is bij de min-45-jarigen. Buiten enkele Frans-kosmopolitische miljonairs heeft niemand redenen om enthousiast te zijn over de toestand waarin Frankrijk nu verkeert. En bij gebrek aan een cultuur en een filosofie – vakkundig ontmanteld door professoren met linkse psychopathieën – is het zelfs moeilijk om in de wereld van de kunst een uitweg voor de wanhoop te vinden. Noch vrolijk noch tragisch voelen de Fransen zich opgesloten in hun ellende. Een beetje zoals de Amerikanen die ze de laatste kwarteeuw zijn beginnen na te bootsen. En zoals de Amerikaanse burgers ondergaan, niet delen in de veroveringen van de oligarchieën die hen regeren, zo doen de Franse hetzelfde ten opzichte van hun heersers, die in de abstracties van een andere werkelijkheid leven. Om onszelf een toekomst te geven moeten we voorkomen dat dit proces van "zelfverlies" zich over heel Europa verspreidt. Daarom moeten we weten én willen. Want het is tegen de wil en de kennis dat de helse machine die de beschaving aan het vermorzelen is al haar middelen inzet. De uitdaging is groot, maar de wil kan des te groter zijn. En als de wil zich voedt met kennis is niets definitief gedaan. Niets.
Vraaggesprek afgenomen door Yann KERMADEC voor "Rivarol”.
Lees ook: Casapound, "de fascisten van het derde millennium" (Rivarol)
00:15 Publié dans Actualité, Entretiens, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : entretiens, actualité, politique, théorie politique, politologie, sciences politiques, fascisme, néo-fascisme, italie, gabriele adinolfi |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 08 mars 2011
Alain Soral: Mieux comprendre l'empire afin de mieux le combattre...
Mieux comprendre l’empire afin de mieux le combattre…
 S’il y a un livre tombant à point nommé, à en juger de l’actualité, c’est bien celui-ci : le dernier essai de notre chroniqueur. En exclusivité, il nous en dit plus (paru dans Flash Magazine N°59).
S’il y a un livre tombant à point nommé, à en juger de l’actualité, c’est bien celui-ci : le dernier essai de notre chroniqueur. En exclusivité, il nous en dit plus (paru dans Flash Magazine N°59).
Vous nous aviez habitués à parler légèrement de choses graves et là, on sent une rupture de ton dans ce dernier ouvrage… C’est la cinquantaine qui vous change ou sont-ce les temps qui changent ?
Disons que nous ne sommes plus dans les années 1990/2000 où quelque chose se mettait en place avec l’UE, l’Euro, mais où la tentative de putsch mondialiste n’était pas aussi imminente et visible. À cette époque, on pouvait encore tergiverser, mais là, entre la crise financière américaine, les déficits publics européens, les tensions ethniques et sociales qui se généralisent, et pas seulement dans le monde musulman, plus ici l’écroulement de la classe moyenne et la candidature de Strauss-Kahn qui s’avance… Vous conviendrez que les temps ne sont plus à la rigolade, à moins d’être Martien !
Vous êtes de formation marxiste et pourtant vous continuez de défendre la monarchie capétienne. Le paradoxe est plaisant, mais on sent du fond derrière ce raisonnement. Dites-nous en un peu plus…
Pour apaiser nos lecteurs de droite, je vais commencer par une citation de Marx, afin de bien leur faire sentir quelle était la position de ce grand penseur sur l’Ancien régime et le monde bourgeois qui lui a succédé : “Partout où la bourgeoisie est parvenue à dominer, elle a détruit toutes les conditions féodales, patriarcales, idylliques. Impitoyable, elle a déchiré les liens multicolores de la féodalité qui attachaient l’homme à son supérieur naturel, pour ne laisser subsister d’autre lien entre l’homme et l’homme que l’intérêt tout nu, l’inexorable “paiement comptant”. Frissons sacrés et pieuses ferveurs, enthousiasme chevaleresque, mélancolie béotienne, elle a noyé tout cela dans l’eau glaciale du calcul égoïste.”
Ceci pour rappeler que le sujet de Marx c’est la critique de la bourgeoisie, pas de l’Ancien régime ! En revanche, l’outil sociologique marxiste est très utile pour comprendre le renversement de la monarchie française par le nouvel ordre bourgeois. Et ces deux siècles de régime démocratique nous permettent aussi de juger largement des promesses et des mensonges de notre fameuse République égalitaire et laïque, en réalité démocratie de marché et d’opinion sous contrôle de l’argent et des réseaux maçonniques… Je peux donc, à la façon de Maurras, conclure de cette analyse objective que la monarchie catholique, comme système politique, était meilleure garante de l’indépendance nationale et de la défense des intérêts du peuple, que la finance apatride qui se trouve aujourd’hui au sommet de la pyramide démocratique qui n’a, en réalité, de démocratique que le nom !
De même, vous avez rejoint le PCF au début de sa dégringolade et refusez de vous acharner sur la défunte URSS, y voyant une sorte de tentative maladroite de lutter contre un empire encore plus puissant. On se trompe ?
Je suis persuadé, par intuition, mais aussi par l’analyse philosophique et historique, que le communisme n’a pu séduire une grande partie des masses travailleuses et des élites intellectuelles en Occident, que parce qu’il renouait avec la promesse chrétienne du don et du nous, détruite par le libéralisme bourgeois et son apologie de l’égoïsme individuel. Tout le reste n’est qu’une histoire de manipulation et de récupération, comme il en va toujours des religions par les Églises. Comme Tolstoï à son époque, je ne vois donc pas le communisme comme une aggravation du matérialisme bourgeois, mais comme une réaction au matérialisme bourgeois. Une tentative de respiritualiser le monde, malgré la mort de Dieu, et il y a pour moi, à l’évidence, bien plus de spiritualité et de christianisme dans l’espoir communiste tel que l’avaient compris le peuple et les poètes, que dans la bigoterie catholique de la IIIe République !
Par ailleurs, le monde bipolaire USA/URSS était la chance de la France, qui pouvait faire valoir, dans ce rapport de force, sa petite troisième voie. Ce qu’avait parfaitement compris de Gaulle dès 1940. Se réjouir, pour raison doctrinale, de la chute de l’URSS, alors que la nouvelle hégémonie américaine qui en a résulté nous a fait tout perdre, n’est donc pas une attitude de patriote français intelligent.
Bref, comme je l’explique aussi dans mon livre : l’ennemi de la France catholique est, et reste, la perfide Albion et ses rejetons, le monde judéo-protestant anglo-saxon libéral ; pas la rêveuse Russie d’hier, pas l’Orient complexe et compliqué d’aujourd’hui…
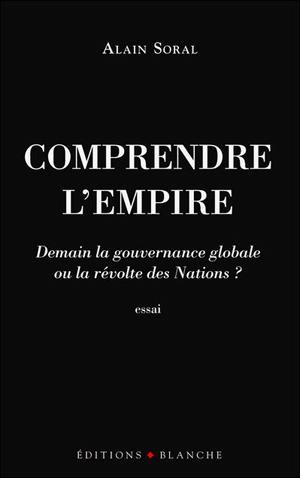 Continuons à parler de vous. De tous les intellectuels “alternatifs” ou “déviants”, vous êtes l’un des meilleurs dans la maîtrise des codes de la “modernité”. Mais aussi l’un des plus en pointe dans la défense de la tradition, gréco-romaine et chrétienne. Un autre paradoxe ?
Continuons à parler de vous. De tous les intellectuels “alternatifs” ou “déviants”, vous êtes l’un des meilleurs dans la maîtrise des codes de la “modernité”. Mais aussi l’un des plus en pointe dans la défense de la tradition, gréco-romaine et chrétienne. Un autre paradoxe ?
Merci du compliment. Mais je crois que ma réponse précédente éclaire en partie cette juste remarque. La France, qui a été la grande Nation, a produit les plus grands penseurs occidentaux du XVIIe et XVIIIe siècle – les Allemands ayant pris le relai au XIXe après que l’Angleterre nous eut détruits avec Napoléon, comme elle détruira ensuite l’Allemagne avec Hitler… – la France donc, pour des raisons sociologiques et épistémologiques, reste encore aujourd’hui, malgré sa faiblesse politique, la citadelle morale capable de résister, en Occident, au rouleau compresseur judéo-protestant anglo-saxon. À ce rouleau compresseur qui avance en détruisant les deux piliers de notre civilisation qui sont le logos grec et la charité chrétienne. Cette pensée et cette vision du monde helléno-chrétienne – celle de Pascal – qui est française par excellence et européenne, au sens euro-méditerranéen du terme. Une compréhension spirituelle de l’Europe qui passe malheureusement très au-dessus de la tête des Identitaires et de leurs fatales alliances judéo-maçonniques (Riposte laïque + LDJ) d’adolescents niçois…Toute la modernité, comme sa critique intelligente, c’est-à-dire la compréhension et la critique du processus libéral-libertaire provient de cette épistémè helléno-chrétienne, si française. Il est donc logique que quelqu’un qui prétende maîtriser la modernité défende cet outil et cet héritage national incomparable…
Cela vous amène tout naturellement à prendre la défense d’un islam dont on sent bien que les élites dominantes souhaitent la diabolisation, après avoir eu la peau du catholicisme. Une fois de plus, vous ramez à contre-courant…
Pour enfoncer le même clou, je rappellerai qu’un Français, donc un catholique, se situe à égale distance d’un anglo-saxon judéo-protestant et d’un arabo-musulman. Et c’est de cet équilibre, comme l’avait déjà compris François 1er, qu’il tire son indépendance et sa puissance. Une réalité spirituelle et géopolitique encore confortée par notre héritage colonial, l’espace francophone qui en a résulté… En plus, la situation aujourd’hui est d’un tel déséquilibre en faveur de la puissance anglo-saxonne, et cette hyper-puissance nous coûte si cher en termes de soumission et de dépendance, qu’il faut être un pur agent de l’Empire – comme Sarkozy et nos élites stipendiées pour se tromper à ce point d’ennemi principal !
Quant à la question de l’immigration, qui est la vraie question et pas l’islam, il est évident que pour la régler il faudra d’abord que la France reprenne le pouvoir sur elle-même. Or, ce pouvoir en France qui l’a ? Pas les musulmans…
Revenons-en à votre livre. Si on le résume à une charge contre le Veau d’or et ceux qui le servent, la définition vous convient-elle ?
Oui. “Comprendre l’Empire” c’est comprendre l’Empire de l’Argent. Et la lutte finale n’est pas contre la gauche ou la droite, les Allemands ou les Arabes, mais contre la dictature de Mammon. C’est en cela que le combat actuel rejoint la tradition…
 Un dernier petit mot d’optimisme pour nos lecteurs, histoire de les inviter à ne pas désespérer ?
Un dernier petit mot d’optimisme pour nos lecteurs, histoire de les inviter à ne pas désespérer ?
D’abord pour citer Maurras après Marx : “Tout désespoir en politique est une sottise absolue”. N’oubliez pas que, contrairement au football, l’Histoire est un match sans fin. On peut donc être mené 20-0, rien n’est jamais perdu. De plus, notre empire mondialiste en voie d’achèvement ressemble de plus en plus à l’URSS. Un machin techno-bureaucratique piloté par une oligarchie délirante, stupide et corrompue, ne régnant plus sur le peuple, contre ses intérêts, que par le mensonge et la coercition. Le Traité de Lisbonne et la réforme des retraites en témoignent. Il n’est donc pas exclu que, comme pour l’URSS, l’Empire mondialiste s’écroule sous le poids de ses mensonges et de ses contradictions, au moment même où il pensait arriver aux pleins pouvoirs officiels par le Gouvernement mondial, après deux siècles de menées souterraines…
De ce point de vue, les soulèvements populaires au Maghreb, et qui pourraient bien culminer par la chute d’Israël et la défaite du lobby sioniste aux USA, sont un signe d’espoir bien plus probant que la montée des extrêmes droites sionistes et libérales européennes !
Propos recueillis par Béatrice PÉREIRE
00:20 Publié dans Actualité, Politique, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, france, alain soral, etats-unis, théorie politique, sciences politiques, politologie, empire, hegemon, hegemon américain |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 03 mars 2011
Liberalism is the cause of inequality
One of the pitfalls of being human is the many perceptual traps that can ensnare us. Spotting an object in water is difficult because of refraction; our ability to estimate the lengths of lines is hampered by nearby objects. Colors surrounding an object affect how we perceive it.
For the past five hundred years, a perceptual trap has gained momentum. This trap starts simply: we see civilization around us, and that it provides for us, and we assume that it will always be that way, even if we make changes. So greedily we demand as much as possible for ourselves and ignore the consequences of those acts.
More than a political movement, this is a social movement based on the wishful thinking of people who are not engaged in maintaining the civilization itself. They view society as like a supermarket: you take what you want, pay your money, and worry about nothing else.
In the USA and Europe, a resistance movement has awakened to resist this perceptual trap. We resist it both as an economic doctrine (socialism/liberalism) and as a philosophy of civilization (narcissism). We don’t want it in any form because it is the opposite of a healthy attitude toward life, and its results are correspondingly bad.
A huge share of the nation’s economic growth over the past 30 years has gone to the top one-hundredth of one percent, who now make an average of $27 million per household. The average income for the bottom 90 percent of us? $31,244. – MJ
The good liberals over at MotherJones.com, who provided us the above quotation and several informative charts, have stepped into a perceptual trap. They assume that individual equality exists, therefore that if inequality exists, something must be wrong.
They point out an interesting fact, however: the average income in the USA is dropping, while the incomes of the “super-rich” are rising, which is symptomatic of a third-world population. However, what they forget is that liberalism caused this vast inequality by undermining the middle class:
- Spreading the wealth. The agenda of liberalism is equality, which becomes filtered through the socialist notion of redistributing the wealth from rich to poor; if we’re all equal, the rich have that wealth unfairly, they think. The problem is that in doing this they take money away from those who are more competent, and who will use it to make more money, and spread it to people who are by definition less able to make competent financial decisions.
- Importing voters. A favorite liberal tactic since 1965 has been to import voters from third-world nations. The problem with this is that it skews the population demographic toward low-income low-skilled workers. This cheapens our cost of basic labor-oriented tasks, but in turn, forces the same amount of value to go to more people and ensures that any given task requires more people. The result is a dissipation of value, so that even if the number values remain the same, quality declines, as we’ve seen happen in American construction, poultry/meat and manufacturing since the 1990s.
- Fast money. Bill Clinton effected an economic miracle by making money easy and quick to borrow. While this provided a great stimulus to business in the short-term, in the long-term it shifted profitability from production of value-adding goods to the shuffling of paper and reselling of financial instruments. This produced an economy that while “profitable” existed entirely on paper. This not only creates a new class of super-rich manipulators, but also devalues the currency as investors worry about its actual value.
- Red tape. Affirmative action, H1-B visas, anti-discrimination legislation, Obamacare, environmental regulations, extensive safety rules and a Byzantine tax code afflict our businesses with miles of red tape. This in turn makes them less competitive, which they compensate for by cutting corners, which in turn reduces the value of their goods relative to those who have fewer obligations. Even more, this tempts them to outsource, where they don’t have to pay these costs.
- Unions. Unions combine the worst of all of the above: they spread money to the wrong people, including organized crime; they create violent social polarization between classes; they support and encourage immigration; they generate miles of red tape; they spread the wealth from those who make more wealth to those who sit in offices and pore over books of rules. In addition, unions wreck our competitiveness by creating more internal communication over non-productive issues, having more rules and more people to buy in on any compromise. If unions were biological we’d call them cancers.
- Allegiance. Removing the more organic questions of culture, heritage and ability, the liberal Utopia promotes people based on their allegiance to political concepts. Whether Viet Cong recruits reciting Mao, or Bono from U2 having the “right opinions,” we make a new elite for political motives. Surely Barack Obama, with his missing dissertation and questionable accomplishments, serves as a vanguard for this new political ueber-class.
All of the above are liberal darlings because the above support the liberal agenda of equality through wealth distribution and fragmentation of any majority group (who could possibly be more equal than the rest of us). In addition, the American left gets most of its funding from unions and associated concerns.
Unions, most of whose members are public employees, gave Democrats some $400 million in the 2008 election cycle. The American Federation of State, County and Municipal Employees, the biggest public employee union, gave Democrats $90 million in the 2010 cycle.
Follow the money, Washington reporters like to say. The money in this case comes from taxpayers, present and future, who are the source of every penny of dues paid to public employee unions, who in turn spend much of that money on politics, almost all of it for Democrats. In effect, public employee unions are a mechanism by which every taxpayer is forced to fund the Democratic Party. – Washington Examiner
If you want to know why your money is decreasing in value, and thus inequality is increasing, it is because of the liberal left’s attempts to make inequality disappear.
Before the left took over, the philosophy of Europe and the United States was that we would provide opportunity and reward those who were more competent. This natural philosophy, a lot like natural selection, enabled us to grow and challenge ourselves and produce an elite of smart, capable, dedicated people.
As the fight over the federal budget gathers pace, we will also see big confrontations between the reformers and the hostages to the status quo in Washington. Democrats are salivating over a possible backlash against Republican lawmakers if they force a government shutdown in early March by insisting on spending cuts. And complacent Republicans are dreading that very possibility in the face of the onslaught from the more energetic House Republican freshmen who recently passed that bold measure to reduce the federal budget by $61 billion.
The United States has been getting away with surreal levels of debt for far too long. If the dollar were not the world’s reserve currency, a major debt crisis would have exploded by now. The total outstanding federal debt has reached $14.1 trillion, almost the equivalent of what the economy produces in a year. Meanwhile, the annual deficit, a major source of that ever-mounting debt, stands at more than $1.6 trillion for 2011. It represents almost 11 percent of the nation’s gross domestic product — which compares pitifully even with Greece, whose deficit in 2010 amounted to 8 percent of that country’s economy.
As a result of these imbalances, and of the illusion that unemployment can be brought down with government spending, the Federal Reserve has been printing dollars like crazy — half of them to purchase Treasury bonds. The policy of easy money has contributed to skyrocketing commodity prices, whose ugly political, social and economic consequences we are only beginning to see around the world. – Real Clear Politics
As the left got more popular, it introduced the perceptual trap: why can’t we all just be equal, spread the wealth, be pacifists, and live in tolerance of each other. The problem is that wealth redistribution penalizes the competent and responsible, and replaces them with a few vicious controllers and vast clueless masses who do not care about social problems they cannot understand.
There’s a major difference between the US aristocracy and the meritocracy though. Aristocrats like Henry Chauncey, bred at Saint Grottlesex boarding schools and the Ivy League, were conscious of their privilege and social responsibility, and focused on developing the character and leadership skills necessary for public service. Many of today’s meritocrats, in contrast, don’t believe it’s a rigged game in their favour, and commit themselves to winning it at all costs, which means stepping on everyone else. As a result, too many lack self-reflection or self-criticism skills, meaning even those who are grossly overpaid give themselves outrageous bonuses.
…
But as long as the global elite is armed with and shielded by the belief that they are a genuine meritocracy they’d find it morally repulsive to make the necessary compromises. Whether American or Chinese, individuals who focus too much on ‘achievement,’ and who believe the illusion that they’ve achieved everything simply through their own honest hard work, often think very little of everyone else as a result.
That’s the ultimate irony of the otherwise admirable efforts of Conant and Chauncey to create a fairer world: in giving opportunities for the bright and able (regardless of whether they are rich or poor), they’ve created a selfish and utilitarian elite from which no Conant or Chauncey will be likely to appear from in the future. – The Diplomat
Liberal policies create inequality. By enforcing an equality of political means, instead of practical ones, they create a false elite. This false elite then takes from the middle class, and funnels that wealth into a cancerous government and a new “elite” fashioned out of those who benefit from gaming the system. These aren’t innovators and trailblazers; they’re people who have learned to manipulate society for their benefit.
In addition, much like the Soviet Union and the ill-fated Southern European socialist states, these entitlement states spread the wealth too thin and re-direct it from growth areas into dead-ends, resulting in not only bankruptcy but a delusional population who, when the money runs out, won’t stop their own benefits in order to get everyone through the trouble. A nation that is disunified like that isn’t a nation; it’s a supermarket.
Traditional peasant societies believe in only a limited amount of good. The more your neighbor earns, the less someone else gets. Profits are seen as a sort of theft; they must be either hidden or redistributed. Envy, rather than admiration of success, reigns.
In contrast, Western civilization began with a very different, ancient Greek idea of an autonomous citizen, not an indentured serf or subsistence peasant. The small, independent landowner — if he was left to his own talents, and if his success was protected by, and from, government — would create new sources of wealth for everyone. The resulting greater bounty for the poor soon trumped their old jealousy of the better-off. – National Review
The psychology of hating inequality produces greater inequality. Where natural inequality may seem unfair, it works to produce “more equal” people who rise above the rest and, through their competence, give to the rest of us a functional society with profitable industries. Artificial equality on the other hand forces us all to the same level of poverty, leaving a few cultural/political elites to rule us, as is the case in most third-world nations.
The choice is upon us: first-world inequality, or third-world equality? The battle in Wisconsin is symbolic more than it is a choice of Wisconsin as a place particularly in need of fixing; it’s a battle over the philosophy that will define us, and decide which of these two societies we pick.
00:15 Publié dans Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, libéralisme, gauche, inégalité, égalitarisme, théorie politique, sciences politiques, politologie, etats-unis |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 02 mars 2011
Reflections on Carl Schmitt's "The Concept of the Political"
Reflections on Carl Schmitt’s The Concept of the Political
Greg Johnson
Ex: http://www.counter-currents.com/
“Why can’t we all get along?”–Rodney King
 Carl Schmitt’s short book The Concept of the Political
Carl Schmitt’s short book The Concept of the Political (1932) is one of the most important works of 20th century political philosophy.
The aim of The Concept of the Political is the defense of politics from utopian aspirations to abolish politics. Anti-political utopianism includes all forms of liberalism as well as international socialism, global capitalism, anarchism, and pacifism: in short, all social philosophies that aim at a universal order in which conflict is abolished.
In ordinary speech, of course, liberalism, international socialism, etc. are political movements, not anti-political ones. So it is clear that Schmitt is using “political” in a particular way. For Schmitt, the political is founded on the distinction between friend and enemy. Utopianism is anti-political insofar as it attempts to abolish that distinction, to root out all enmity and conflict in the world.
Schmitt’s defense of the political is not a defense of enmity and conflict as good things. Schmitt fully recognizes their destructiveness and the necessity of managing and mitigating them. But Schmitt believes that enmity is best controlled by adopting a realistic understanding of its nature. So Schmitt does not defend conflict, but realism about conflict. Indeed, Schmitt believes that the best way to contain conflict is first to abandon all unrealistic notions that one can do away with it entirely.
Furthermore, Schmitt believes that utopian attempts to completely abolish conflict actually increase its scope and intensity. There is no war more universal in scope and fanatical in prosecution than wars to end all war and establish perpetual peace.
Us and Them
What does the distinction between friend and enemy mean?
First, for Schmitt, the distinction between friend and enemy is collective. He is talking about “us versus them” not “one individual versus another.”
Schmitt introduces the Latin distinction between hostis (a collective or public enemy, the root of “hostile”) and inimicus (an individual and private adversary, the root of “inimical”). The political is founded on the distinction between friend (those on one’s side) and hostis (those on the other side). Private adversaries are not public enemies.
Second, the distinction between friend and enemy is polemical. The friend/enemy distinction is always connected with the abiding potential for violence. One does not need to actually fight one’s enemy, but the potential must always be there. The sole purpose of politics is not group conflict; the sole content of politics is not group conflict; but the abiding possibility of group conflict is what creates the political dimension of human social existence.
Third, the distinction between friend and enemy is existentially serious. Violent conflict is more serious than other forms of conflict, because when things get violent people die.
Fourth, the distinction between friend and enemy is not reducible to any other distinction. For instance, it is not reducible to the distinction between good and evil. The “good guys” are just as much enemies to the “bad guys” as the “bad guys” are enemies to the “good guys.” Enmity is relative, but morality—we hope—is not.
Fifth, although the friend/enemy distinction is not reducible to other distinctions and differences—religious, economic, philosophical, etc.—all differences can become political if they generate the friend/enemy opposition.
In sum, the ultimate root of the political is the capacity of human groups to take their differences so seriously that they will kill or die for them.
It is important to note that Schmitt’s concept of the political does not apply to ordinary domestic politics. The rivalries of politicians and parties, provided they stay within legal parameters, do not constitute enmity in Schmitt’s sense. Schmitt’s notion of politics applies primarily to foreign relations — the relations between sovereign states and peoples — rather than domestic relations within a society. The only time when domestic relations become political in Schmitt’s sense is during a revolution or a civil war.
Sovereignty
If the political arises from the abiding possibility of collective life or death conflict, the political rules over all other areas of social life because of its existential seriousness, the fact that it has recourse to the ultimate sanction.
For Schmitt, political sovereignty is the power to determine the enemy and declare war. The sovereign is the person who makes that decision.
If a sovereign declares an enemy, and individuals or groups within his society reject that declaration, the society is in a state of undeclared civil war or revolution. To refuse the sovereign’s choice of enemy is one step away from the sovereign act of choosing one’s own enemies. Thus Schmitt’s analysis supports the saying that, “War is when the government tells you who the bad guy is. Revolution is when you decide that for yourself.”
Philosophical Parallels
The root of the political as Schmitt understands it is what Plato and Aristotle call “thumos,” the middle part of the soul that is neither theoretical reason nor physical desire, but is rather the capacity for passionate attachment. Thumos is the root of the political because it is the source of attachments to (a) groups, and politics is collective, and (b) life-transcending and life-negating values, i.e., things that are worth killing and dying for, like the defense of personal or collective honor, one’s culture or way of life, religious and philosophical convictions, etc. Such values make possible mortal conflict between groups.
The abolition of the political, therefore, requires the abolition of the human capacity for passionate, existentially serious, life and death attachments. The apolitical man is, therefore, the apathetic man, the man who lacks commitment and intensity. He is what Nietzsche called “the last man,” the man for whom there is nothing higher than himself, nothing that might require that he risk the continuation of his physical existence. The apolitical utopia is a spiritual “boneless chicken ranch” of doped up, dumbed down, self-absorbed producer-consumers.
Schmitt’s notion of the political is consistent with Hegel’s notion of history. For Hegel, history is a record of individual and collective struggles to the death over images or interpretations of who we are. These interpretations consist of the whole realm of culture: worldviews and the ways of life that are their concrete manifestations.
There are, of course, many interpretations of who we are. But there is only one truth, and according to Hegel the truth is that man is free. Just as philosophical dialectic works through a plurality of conflicting viewpoints to get to the one truth, so the dialectic of history is a war of conflicting worldviews and ways of life that will come to an end when the correct worldview and way of life are established. The concept of human freedom must become concretely realized in a way of life that recognizes freedom. Then history as Hegel understands it—and politics as Schmitt understands it—will come to an end.
Hegel’s notion of the ideal post-historical state is pretty much everything a 20th (or 21st) century fascist could desire. But later interpreters of Hegel like Alexandre Kojève and his follower Francis Fukuyama
, interpret the end of history as a “universal homogeneous state” that sounds a lot like the globalist utopianism that Schmitt wished to combat.
Why the Political Cannot be Abolished
If the political is rooted in human nature, then it cannot be abolished. Even if the entire planet could be turned into a boneless chicken ranch, all it would take is two serious men to start politics—and history—all over again.
But the utopians will never even get that far. Politics cannot be abolished by universal declarations of peace, love, and tolerance, for such attempts to transcend politics actually just reinstitute it on another plane. After all, utopian peace- and love-mongers have enemies too, namely “haters” like us.
Thus the abolition of politics is really only the abolition of honesty about politics. But dishonesty is the least of the utopians’ vices. For in the name of peace and love, they persecute us with a fanaticism and wanton destructiveness that make good, old-fashioned war seem wholesome by comparison.
Two peoples occupying adjacent valleys might, for strategic reasons, covet the high ground between them. This may lead to conflict. But such conflicts have finite, definable aims. Thus they tend to be limited in scope and duration. And since it is a mere conflict of interest—in which both sides, really, are right—rather than a moral or religious crusade between good and evil, light and darkness, ultimately both sides can strike a deal with each other to cease hostilities.
But when war is wedded to a universalist utopianism—global communism or democracy, the end of “terror” or, more risibly, “evil”—it becomes universal in scope and endless in duration. It is universal, because it proposes to represent all of humanity. It is endless, of course, because it is a war with human nature itself.
Furthermore, when war is declared in the name of “humanity,” its prosecution becomes maximally inhuman, since anything is fair against the enemies of humanity, who deserve nothing short of unconditional surrender or annihilation, since one cannot strike a bargain with evil incarnate. The road to Dresden, Hiroshima, and Nagasaki was paved with love: universalistic, utopian, humanistic, liberal love.
Liberalism
Liberalism seeks to reduce the friend/enemy distinction to differences of opinion or economic interests. The liberal utopia is one in which all disputes can be resolved bloodlessly by reasoning or bargaining. But the opposition between liberalism and anti-liberalism cannot be resolved by liberal means. It is perforce political. Liberal anti-politics cannot triumph, therefore, without the political elimination of anti-liberalism.
The abolition of the political requires the abolition of all differences, so there is nothing to fight over, or the abolition of all seriousness, so that differences make no difference. The abolition of difference is accomplished by violence and cultural assimilation. The abolition of seriousness is accomplished by the promotion of spiritual apathy through consumerism and indoctrination in relativism, individualism, tolerance, and diversity worship—the multicult.
Violence, of course, is generally associated with frankly totalitarian forms of anti-political utopianism like Communism, but the Second World War shows that liberal universalists are as capable of violence as Communists, they are just less capable of honesty.
Liberalism, however, generally prefers to kill us softly. The old-fashioned version of liberalism prefers the soft dissolution of differences through cultural assimilation, but that preference was reversed when an unassimilable minority rose to power in the United States, at which time multiculturalism and diversity became the watchwords, and the potential conflicts between different groups were to be managed through spiritual corruption. Today’s liberals make a fetish of the preservation of pluralism and diversity, as long as none of it is taken seriously.
Multicultural utopianism is doomed, because multiculturalism is very successful at increasing diversity, but, in the long run, it cannot manage the conflicts that come with it.
The drug of consumerism cannot be relied upon because economic crises cannot be eliminated. Furthermore, there are absolute ecological limits to the globalization of consumerism.
As for the drugs of relativism, individualism, tolerance, and the multi-cult: only whites are susceptible to their effects, and since these ideas systematically disadvantage whites in ethnic competition, ultimately those whites who accept them will be destroyed (which is the point, really) and those whites who survive will reject them. Then whites will start taking our own side, ethnic competition will get political, and, one way or another, racially and ethnically homogeneous states will emerge.
Lessons for White Nationalists
To become a White Nationalist is to choose one’s friends and one’s enemies for oneself. To choose new friends means to choose a new nation. Our nation is our race. Our enemies are the enemies of our race, of whatever race they may be. By choosing our friends and enemies for ourselves, White Nationalists have constituted ourselves as a sovereign people—a sovereign people that does not have a sovereign homeland, yet—and rejected the sovereignty of those who rule us. This puts us in an implicitly revolutionary position vis-à-vis all existing regimes.
The conservatives among us do not see it yet. They still wish to cling to America’s corpse and suckle from her poisoned tit. But the enemy understands us better than some of us understand ourselves. We may not wish to choose an enemy, but sometimes the enemy chooses us. Thus “mainstreamers” will be denied entry and forced to choose either to abandon White Nationalism or to explicitly embrace its revolutionary destiny.
It may be too late for mainstream politics, but it is still too early for White Nationalist politics. We simply do not have the power to win a political struggle. We lack manpower, money, and leadership. But the present system, like all things old and dissolute, will pass. And our community, like all things young and healthy, will grow in size and strength. Thus today our task is metapolitical: to raise consciousness and cultivate the community from which our kingdom—or republic—will come.
When that day comes, Carl Schmitt will be numbered among our spiritual Founding Fathers.
00:15 Publié dans Philosophie, Révolution conservatrice, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, révolution conservatrice, théorie politique, politologie, sciences politiques, weimar, allemagne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
La revanche de Dieu et du roi
La revanche de Dieu et du roi
par Jean-Gilles MALLIARAKIS
On doit se féliciter des trois césars récompensant ce 25 février le travail de Xavier Beauvois et de son équipe (1). Deux importantes émotions cinématographiques ont, en effet, sollicité les Français ces derniers mois : "Des Hommes et des Dieux", qui retrace la marche au martyre des moines trappistes de Tibhérrine et, dans un registre bien différent, "Le Discours d'un roi". Ce dernier film évoque le destin du duc d'York, qui deviendra George VI d'Angleterre.
On peut regarder ces œuvres de plusieurs manières, bien évidemment. On leur trouvera telles qualités, tels défauts.
Si l'on se passionne par exemple pour le personnage du frère aîné, l'énigmatique et éphémère Édouard VIII, lequel ne régnera que de janvier à décembre 1936, pour sa liaison avec Wallis Simpson, jugée scandaleuse à l'époque, on trouvera peut-être un peu caricaturale la présentation du personnage. Ce prince, dans la réalité historique, s'est montré d'abord un fort courageux soldat de la première guerre mondiale. Proche du peuple, attaché à la paix, il refusera toujours, après son abdication, de servir en quoi que ce soit, les desseins des ennemis de son pays. Celle qui devint la duchesse de Windsor lui demeura fidèle, jusqu'au bout, dans l'exil.
S'il s'agit, pour le premier film, de disserter une fois de plus sur le rapport à l'islam, à l'islamisme, à l'islamo-terrorisme, pas sûr du tout qu'il faille s'aligner, du point de vue étroitement politique, sur la logique du rôle occupé, et remarquablement incarné, par Lambert Wilson.
La question qui nous préoccupe aujourd'hui tient à tout autre chose. Le succès, légitime, des deux films que je viens de citer doit certes beaucoup au talent des réalisateurs et des acteurs. Mais il correspond aussi aux questions profondes qui touchent le public. Il suggère une réhabilitation diffuse, implicite et non dite, de tout ce que le Grand Orient de France s'attache à détruire depuis le XVIIIe siècle.
Ne nous dissimulons pas en effet que, sous le nom [en partie usurpé] (2) de "francs-maçons" une secte, ouvertement athée depuis 1877, travaille à déchristianiser la France comme elle s'est employée à détruire la royauté, symbole de l'unité véritable et fédérateur de l'identité française (3).
Ce pauvre pays répond assez exactement à l'image poétique d'Ezra Pound : "Ce corps décapité qui cherche la Lumière". Certes, en deux siècles, les opérations de substitution, les ersatz de monarchie, bonapartisme et gaullisme, les faux semblants de sacré, les prétendus suppléments d'âme se sont succédés. Sans succès. La dernière incarnation du présidentialisme émané du suffrage universel pourvoit suffisamment elle-même à sa propre caricature. Inutile d'épiloguer. Victor Hugo appelait cela "les Châtiments"
L'affreuse marche des laïcards et de leur république est explicitée dans le livre d'Alfred Vigneau par un dialogue qui remonte à 1933 entre l'auteur et le grand maître de la Grande Loge de France :
« — Mon Frère Vigneau, déclarera le Grand-Maître, vous ne connaissez pas les grands secrets de la Franc-Maçonnerie : n’oubliez pas que, c’est un 33e, membre du Suprême Conseil qui vous parle ; a-t-il besoin de vous apprendre que les buts secrets de la Franc-Maçonnerie sont la déchristianisation de la France. »
Le Grand-Maître rappela que la Franc-Maçonnerie avait trois buts principaux :
«1° Venger la mort des Templiers ; mission de laquelle sont chargés les Chevaliers Kadosch, 30e grade, qui doivent exercer cette vengeance sur l’Église Catholique.
2° Abattre les frontières pour établir la République universelle, mission de laquelle sont chargés les Sublimes Princes du Royal Secret, 32e.
3° Supprimer la Famille traditionnelle pour émanciper les enfants et l’épouse selon la bonne morale laïque, buts vers lesquels tendent les Souverains Grands inspecteurs Généraux, 33e. »
Vigneau quittera la maçonnerie et publia son livre (4) l'année suivante, en 1934, où l'affaire Stavisky montre non seulement l'utilisation des réseaux de l'Ordre par des escrocs de bas étage, mais aussi l'impunité largement assurée à ceux-ci, contrairement aux lois et contrairement à toutes les règles morales.
Pour Dieu et le Roi, nous disons donc aujourd'hui "revanche", mais contrairement aux jacobins des loges maçonniques, et d'ailleurs, nous ne crierons jamais "vengeance".
JG Malliarakis
Apostilles
- Nominée dans 11 catégories, l'évocation de la marche au martyre des moines de Tibéhirine, assassinés dans l'Algérie de 1996, a obtenu, d'un jury politiquement et culturellement très correct, 3 récompenses dont celle du Meilleur Film.
- Dans son livre "La Voie substituée" Jean Baylot, lui-même dirigeant de la maçonnerie "traditionnelle et régulière", retrace les étapes de cette prise de pouvoir au sein des principales obédiences françaises par les adeptes du jacobinisme, en contradiction absolue avec les "constitutions d'Anderson" adoptées au début du XVIIIe siècle par la grande loge unie d'Angleterre.
- Dans son petit livre sur "La Franc-maçonnerie dans la révolution française" Maurice Talmeyr souligne la part des loges dans la préparation et la symbolique du séisme.
- cf. "La Loge maçonnique", qui vient d'être réédité.
Vous pouvez entendre l'enregistrement de notre chronique
sur le site de Lumière 101
00:10 Publié dans Histoire, Livre, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, livre, théorie politique, sociétés secrètes, franc-maçonnerie, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 26 février 2011
The Radical Tradition
The Radical Tradition
- TOMISLAV SUNIC – History and Decadence: Spengler’s Cultural Pessimism Today
- JONATHAN BOWDEN – A Polyp Devours Its Feed, Paracelsus Unzipped: An Analysis of F.W. Murnau’s Film, Nosferatu
- TROY SOUTHGATE – Heidegger: The Application of Meaning in An Increasingly Transient World
- WAYNE JOHN STURGEON – Anarcho-National-Syndicalist: Some Reflections on Being Shot by Both Sides
- ALEX KURTAGIC – Lessons From the Music Industry

BRETT STEVENS – The Civilisation Cycle and its Implications for the Individual
MAXIM BOROZENEC – An Introduction to Intertraditionale
DR. K.R. BOLTON – The Art of Rootless Cosmopolitanism: America’s Offensive Against Civilisation
VINCE YNZUNZA – The Manifesto of the Psychedelic Conservative
TROY SOUTHGATE – Schopenhauer and Suffering: Eternal Pessimist or Prophet for our Times?
WAYNE JOHN STURGEON – Anarcho-Gnosticism: Golgotha of the Absolute Mind
SEAN JOBST – Towards a Sufi Anarch: The Role of Islamic Mysticism Against Modernist Decay
BEN CRAVEN – Are Human Rights a Fiction of Modern, Western Liberal Democracies That Bring Us No Closer to a Shared Ethical Framework?
TONY GLAISTER – 50 Years On: Notes on the New Right
WAYNE JOHN STURGEON – The Impossible Dream: An Introduction to Christian Anarchism
KEITH PRESTON – The Nietzschean Prophecies: Two Hundred Years of Nihilism and the Coming Crisis of Western Civilization
TROY SOUTHGATE – Transcending the Beyond: Third Position to National-Anarchism
GWENDOLYN TOYNTON – Reforming the Modern World: Addressing the Issue of Cultural Identity
You may recognize some of these names from around here. We’re looking forward to this interesting release which takes politics from beyond the narrow linear confines of self-interest into a concept of human life as more than the sum of its parts.
Available in March 2011 from Primordial Traditions.
00:15 Publié dans Livre, Révolution conservatrice, Théorie politique, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, tradition radicale, tradition, radicalisme, nouvelle droite, traditionalisme, politique, théorie politique, sciences politiques, politologie, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Le désenchantement du monde (de Marcel Gauchet)

Le désenchantement du monde (M. Gauchet)
Gauchet reprend l’expression de « désenchantement du monde », utilisée par Max Weber pour décrire l’élimination du magique dans la construction du Salut, mais ce qu’il désigne par là va au-delà de l’objet désigné par Weber. Pour Marcel Gauchet, le religieux en tant que principe extérieur au social, et qui modèle le social depuis l’extérieur, c’est fini. Et l’originalité de l’Occident aura consisté, précisément, à opérer cette incorporation totale, dans le social, des fonctions traditionnellement allouées au religieux.
Le « désenchantement du monde », version Gauchet, ce n’est donc pas seulement l’élimination du magique dans le religieux, c’est bien encore la disparition du religieux en tant qu’espace collectif structurant et autonome.
Il s’agit donc ici de comprendre pourquoi le christianisme aura été, historiquement, la religion de la sortie de la religion. L’enjeu de cette histoire politique de la religion : comprendre, au-delà des naïvetés laïcardes, quelles fonctions la religion tenait dans les sociétés traditionnelles, et donc si d’autres moyens permettront de les maintenir.
*
Commençons par résumer « l’histoire politique de la religion », vue par Marcel Gauchet. C’est, après tout, pratiquement devenu un classique – un des très rares grands textes produits par la pensée française de la fin du XX° siècle.
Le fait est que jusqu’ici, le religieux a existé dans toutes les sociétés, à toutes les époques connues. Qu’il ait tenu une fonction dans chaque société, à chaque époque, n’est guère douteux. Une première question est de savoir si cette fonction fut constamment la même, et, dans le cas contraire, comment elle a évolué.
Pour Gauchet, il faut mettre à jour une structure anthropologique sous-jacente dont le religieux fut l’armature visible à un certain stade du développement historique. Cette structure fondamentale, c’est ce qu’il appelle : « L’homme contre lui-même ». Il entend par là la codification par l’homme d’un espace mental organisé autour du refus de la nature (celle du sujet, celle des autres hommes, celle de l’univers), afin de rendre possible un contrepoids salvateur, le « refus du refus » (qui permet d’accepter les autres hommes au nom du refus du sujet auto référant, d’accepter le sujet au nom de son refus, et finalement d’accepter la nature de l’univers au nom du refus général appliqué à la possibilité de la refuser). Le religieux a été, pour Marcel Gauchet, la forme prise, à un certain moment de l’histoire de l’humanité, par une nécessité incontournable induite par la capacité de refus propre à l’esprit humain : l’organisation du refus du refus, de la négation de la négation – bref, du ressort de la pensée même.
Gauchet renverse ici la conception classique, qui voit dans la religion un obstacle à la perspective historique. Faux, dit-il : la religion a eu pour mission de rendre possible l’entrée de l’humanité dans l’histoire, précisément en organisant une entrée « à reculons ». L’humanité ne voulait pas, n’a jamais voulu être historique. L’historicité lui enseigne une mortalité qu’elle redoute, qu’elle abhorre. La religion, en organisant le refus dans l’ordre symbolique, a été la ruse par laquelle l’humanité, tournant le dos à son avenir, pouvait aller vers lui sans le voir. Une méthode de gestion psychologique collective, en somme : en refusant dans l’ordre symbolique, on rend possible l’acceptation muette du mouvement permanent qu’on opère, par ailleurs, dans l’ordre réel, à un rythme si lent qu’on peut maintenir l’illusion d’une relative stabilité.
Sous cet angle, la « progression du religieux » peut être vue comme son oblitération progressive, au fur et à mesure que l’humanité accepte de regarder en face son inscription dans l’histoire, et d’assumer, donc, son refus de la nature. Des religions primitives au christianisme, on assiste ainsi à une lente réappropriation du fondement du religieux par l’homme, jusqu’à ce que « Dieu se fasse homme ».
C’est un long trajet car, au départ, dans la religion primitive, les Dieux sont radicalement étrangers à l’homme. Leur puissance le surpasse infiniment. Les succès humains ne peuvent être dus qu’à la faveur divine, les échecs à la colère (forcément juste) des divinités offensées. Voilà toute la religion primitive. Elle est étroitement associée à un système politique de chefferie, où l’opposition pouvoir-société est neutralisée par l’insignifiance (réelle) du premier, rendue possible par l’insignifiance (volontairement exagérée) de la seconde. La création d’une instance symbolique de régulation au-delà de la compétence humaine a d’abord été, pendant des millénaires, une manière de limiter la compétence des régulateurs humains. Le holisme fondamental des sociétés religieuses, nous dit Gauchet, ne doit pas être vu comme le contraire de notre individualisme, mais comme une autre manière de penser le social : un social qui n’était pas, et n’avait pas besoin d’être, un « social-historique ». C’était un social « non historique », où la Règle était immuable, étrangère au monde humain, impossible à contester.
Cette altérité du fondement de la règle, propre aux religions des sociétés primitives, est, pour Gauchet, « le religieux à l’état pur ». En ce sens, l’émergence progressive des « grandes religions » ne doit pas être pensée comme un approfondissement, un enrichissement du religieux, mais au contraire comme sa déconstruction : plus la religion va entrer dans l’histoire, moins elle sera extérieure au social-historique, et moins, au fond, elle sera religieuse.
Cette remise en cause du religieux s’est faite par étapes.
D’abord, il y eut l’émergence de l’Etat. En créant une instance de régulation mondaine susceptible de se réformer, elle a rendu possible le questionnement de la régulation. Il a donc fallu codifier un processus de mise en mouvement de « l’avant » créateur de règles. Les dieux se sont mis à bouger ; jusque là, ils vivaient hors du temps, et soudain, ils ont été inscrits dans une succession d’évènements. L’intemporel s’est doté de sa temporalité propre. Enjeu : définir, par la mythologie, une grille de cautionnement de la domination politique, ancrée dans un récit fondateur. La hiérarchie des dieux impose la hiérarchie des hommes à travers la subordination des hommes aux dieux, subordination rendue possible par le début de l’effacement de la magie (où le magicien maîtrise les forces surnaturelles) et l’affirmation du cultuel (où le prêtre sert des forces qui le dépassent). Le processus de domination mentale (des prêtres par les dieux, des hommes par les prêtres) devient ainsi l’auxiliaire du processus d’assimilation/englobement par l’Etat, donc de la conquête. Ce processus s’est accompli progressivement, en gros entre -800 et -200, dans toute l’Eurasie.
Le contrecoup de ce mécanisme, inéluctablement, fut le tout début de l’émergence de l’individu. Le pôle étatique définit un universel ; dès lors, le particulier devient pensable non par opposition aux autres particuliers, mais par opposition à l’universel. L’individu commence alors à être perçu comme une intériorité. Et du coup, l’Autre lui-même est perçu dans son intériorité.
D’où, encore, l’invention de l’Outre-Monde. Pour un primitif, le surnaturel fait partie du monde. Il n’existe pas de rupture entre le naturel et le surnaturel, entre l’immanent et le transcendant. Au fond, il n’existe pas d’opposition esprit/matière : tout est esprit, ou tout est matière, ou plutôt tout est esprit-matière, « souffle ».
Et d’où, enfin, le mouvement interne du christianisme occidental.
*
Progressivement, dans le christianisme, la dynamique religieuse se déplace pour s’installer à l’intérieur de l’individu. Le temps collectif étant historique, le temps religieux devient le temps individuel. Ce déplacement de la dynamique religieuse est, pour Gauchet, le mouvement interne spécifique du christianisme occidental.
Les autres mondes sont restés longtemps bloqués au niveau de la religion-Etat, du temps historique religieux ; seul le monde chrétien, surtout occidental, a totalement abandonné le temps collectif à l’Histoire, pour offrir à la religion un terrain de compensation, le temps individuel. Gauchet écrit : « Avec le même substrat théologique qui a porté l’avènement de l’univers capitaliste-rationnel-démocratique, la civilisation chrétienne eût pu rejoindre la torpeur et les lenteurs de l’Orient. Il eût suffi centralement d’une chose pour laquelle toutes les conditions étaient réunies : la re-hiérarchisation du principe dé-hiérarchisant inscrit dans la division christique du divin et de l’humain. »
Il n’en est pas allé ainsi. L’Occident est devenu une exception, et sa dynamique religieuse est allée jusqu’à son terme.
Il en est découlé, dans notre civilisation et au départ seulement dans notre civilisation, un accroissement des ambitions et de l’Histoire, et de la religion.
Jusque là, les deux termes étaient limités l’un par l’autre. De leur séparation découle la disparition de leurs limitations. L’Histoire peut théoriquement se prolonger jusqu’à sa fin. Elle a cessé d’être cyclique. La religion, de son côté, peut poursuivre la réunification de l’Etre à l’intérieur de la conscience humaine.
L’adossement de ces deux termes ouvre la porte à une conception du monde nouvelle, dans laquelle l’homme est son co-rédempteur, à travers la Foi (qui élève son esprit jusqu’à l’intelligence divine) et les œuvres (qui le font participer d’une révélation, à travers l’Histoire). Seul le christianisme, explique Gauchet, a défini cette architecture spécifique – et plus particulièrement le christianisme occidental.
Progressivement, à travers le premier millénaire, d’abord très lentement, le christianisme élabore cette architecture. Avec la réforme grégorienne et, ensuite, l’émergence des Etats français et anglais, l’Occident commence à en déduire des conclusions révolutionnaires mais logiques. Le pouvoir politique et le pouvoir spirituel se distinguent de plus en plus clairement. La grandeur divine accessible par la conscience devient étrangère à la hiérarchie temporelle, elle lui échappe et fonde un ordre autonomisé à l’égard du politique. En retour, le politique se conçoit de plus en plus comme un produit de l’immanence. Le souverain, jadis pont entre le ciel et la terre, devient la personne symbolique d’une souveraineté collective, issue des réalités matérielles et consacrée avant tout à leur administration. Avec la Réforme, l’évolution est parachevée : l’Etat et l’Eglise sont non seulement distincts, mais progressivement séparés.
Les catégories de la « sortie de la religion », c'est-à-dire le social-historique dans le temps collectif, le libre examen dans le temps individuel, sont issues directement de cette évolution. Ici réside sans doute un des plus importants enseignements de Gauchet, une idée qui prend à revers toute la critique classique en France : notre moderne appréhension du monde en termes de nécessité objective n’est pas antagoniste de la conception chrétienne de l’absolu-divin personnel : au contraire, elle en est un pur produit.
*
La conclusion de Gauchet est que la « sortie de la religion » ouvre la porte non à une disparition du religieux, mais à sa réduction au temps individuel (une évolution particulièrement nette aux USA, où la religion est surpuissante comme force modelant les individus, mais quasi-inexistante comme puissance sociale réelle). Et d’ajouter qu’avec l’émergence puis la dissolution des idéologies, nous avons tout simplement assisté à la fin des religions collectives, qui sont d’abord retombées dans le temps historique à travers la politique, et s’y sont abîmées définitivement.
Sous-entendu : voici venir un temps où il va falloir se débrouiller sans la moindre religion collective, et faire avec, dans un cadre en quelque sorte purement structuraliste, en nous résignant à être des sujets, sans opium sacral pour atténuer la douleur de nos désirs. Car c’est à peu près là, au fond, la seule fonction du religieux qui, aux yeux de Gauchet, ne peut pas être assurée par le social radicalement exempt de la religion.
En quoi, à notre avis, Gauchet se trompe…
L’expulsion du religieux, retiré totalement du temps collectif, implique que ce temps-là, le temps collectif, ne peut plus être pensé en fonction de la moindre ligne de fuite. S’il n’y a plus du tout de religieux dans le temps collectif, alors la mort des générations en marque les bornes. Et donc, il n’y a plus de pensée collective sur le long terme, au-delà de la génération qui programme, qui dirige, qui décide (aujourd’hui : la génération du baby-boom).
Eh bien, n’en déplaise à Marcel Gauchet et sans nier que le structuralisme soit une idée à creuser, il nous semble, quant à nous, que les ennuis de l’Occident commencent là, dans cette désorientation du temps collectif. Tant que le religieux se retirait du temps collectif, il continuait à l’imprégner d’une représentation du très long terme, et aspirait en quelque sorte le politique vers cette représentation : ce fut la formule de pensée qui assura l’expansion de l’Occident, le retrait du religieux ouvrant un espace de développement accru au politique, à l’économique, au scientifique, tous lancés secrètement à la poursuite du religieux qui s’éloignait. MAIS à partir du moment où le religieux s’est retiré, l’espace qu’il abandonne est déstructuré, et il n’y a plus de ligne de fuite pour construire une représentation à long terme.
La dynamique spirituelle de la chrétienté occidentale a suscité des forces énormes aussi longtemps qu’elle était mouvement ; dès l’instant où elle parvient à son aboutissement, elle débouche sur une anomie complète. Oserons-nous confesser que le vague « structuralisme » de Gauchet, conclusion mollassonne d’un exposé par ailleurs remarquable, nous apparaît, à la réflexion, comme une posture de fuite, et une manière pour lui de ne pas tirer les conclusions logiques de sa propre, brillante et tout à fait involontaire enquête sur la décadence occidentale ?
00:10 Publié dans Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, marcel gauchet, théorie politique, sciences politiques, politologie, france, religion, désenchantement |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 25 février 2011
Democracy Needs Aristocracy
Democracy Needs Aristocracy, by Sir Peregrine Worsthorne
Democracy Needs Aristocracy
by Sir Peregrine Worsthorne
221 pages, Harper Collins, $15.
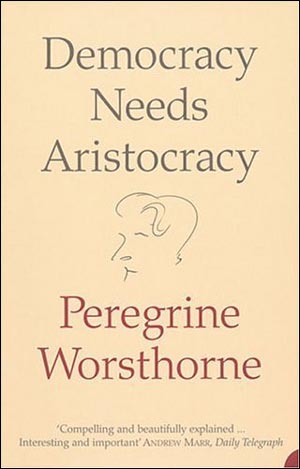 In the early pages of Democracy Needs Aristocracy the author mentions Alexis de Toqueville and his groundbreaking Democracy in America and not surprisingly, the newer work continues in the footsteps of that classic with a broad-reaching thesis on the nature of government that sides with the organic over the mechanistic.
In the early pages of Democracy Needs Aristocracy the author mentions Alexis de Toqueville and his groundbreaking Democracy in America and not surprisingly, the newer work continues in the footsteps of that classic with a broad-reaching thesis on the nature of government that sides with the organic over the mechanistic.
Experienced writer Peregrine Worsthorne mixes his far-reaching thesis with personal narrative and precise examples in the form of contradictions that eliminate exceptions to his arguments. He writes in a hybrid style somewhere between relaxed academia and vivid popular non-fiction but with the logical thoroughness of a legal brief. Like the topic of the book itself, his style spans a vast breadth of knowledge and distills it into a single voice, like condensation turning mist to rain.
As a consequence, Democracy Needs Aristocracy is both one of those books that zooms by at light speed as massive ideas thrust the reader across time and space, and is also like a textbook an exacting read that requires the full attention of the reader. Each chapter drops important pieces into our understanding of history and how we arrived at the present time, not all of them controversial assertions so much as forgotten and decontextualized ones.
The style is not circular so much as it returns to core concepts after breaking them apart, bringing the forgotten but necessary counterpart to deconstruction, re-integration, to the reading process. As a result reading this book is like peeling an onion, with each layer revealing more of the big picture. It offers what few books can manage anymore: a vertiginous sense of discovery and concepts dropping into place that can explain the subtle mysteries of our present political climate.
Worsthorne’s thesis suggests that aristocracy, or an organic social order of the most qualified who enforce a balance that linear-thinking government cannot, not only arises naturally but if well-selected, provides an elite who are dedicated to public service more than themselves. It succeeds because it is decidedly non-mechanistic: he delights in the social aspects of an elite dedicated to stewardship, and illustrates how civility as a guiding principle ensures politics do not become abandoned to abstractions unrelated to life itself.
Finally, he contrasts society under rule by aristocracy, whose members are secure in their position and steeped in its tradition, with the “meritocratic” rise of the “classless society,” and points out in detail how the classless society fails to achieve its objectives and may achieve instead the inverse. As both an aristocrat and a journalist, Worsthorne describes the view from both sides of the bench on this issue.
A good part of the book addresses the necessary conditions of his thesis, including the most difficult to define parts such as “civility” and the notion of an organic, non-governmental caste who nonetheless provide the backbone to all governmental activities. For moderns, understanding caste is like trying to understand the use of a pressure cooker inside a black hole; Worsthorne elaborates slowly, but works up to his point:
“Aristocracy, however, is different because the bonds forged at birth and maintained at every subsequent stage in life, create a degree of loyalty between members as strong as, if not stronger than, those that bind together the members of a nation. The Old Etonian George Orwell tried to escape them but never wholly succeeded, concluding sadly, at the end of his life, that it was easier to change your party than change your class. Speaking personally, I cannot imagine life without class, which is not a passive condition but one that provides you with a general culture, a network to which you naturally belong, a stream of history in which you feel free and safe — almost a collective individuality.” (86)
In his retelling of history, the UK survived the time of the French Revolution because unlike the French, the English did not centralize their power into a single agency, but made government less efficient and instead cultivated a class of experts, united by a code of civility or “gentlemanly” conduct, such that they could conduct the appropriate circumventions of authority in smoke-stained lounges over glasses of cognac.
In this Worsthorne’s view is a hybridization of elitism and anarchy, in which the purpose of aristocracy is to avoid a powerful central government and its Boolean rules, and instead to cultivate a pool of talent that can organically and covertly address problems that are beyond the understanding of the electorate. His appeal to civility, the mode of aristocracy, is a call for a moral renovation to the modern state.
“For as a result of this method of selection, Britain’s political class had inherited enough in-built authority — honed over three centuries — and enough ancestral wisdom — acquired over the same period — to dare to defy both the arrogance of intellectuals from above and the emotions of the masses from below; to dare to resist the entrepreneurial imperative; to dare to try to raise the level of public conversation; to dare to put the public interest before private interests; to dare to try to shape the nation’s will and curb its appetites.” (50)
Bureaucracies, which he describes as the “natural enemies” of aristocrats, rely on rigid rules of a binary nature. When triggered, they must follow through blindly, causing periodic outrages so ludicrous they remind us of the rote actions of a machine out of control. In contrast, Worsthorne advocates the reliance on a class of people he describes as devoted to public duty, and their ability to intervene in place of blind rules.
As he reminds us, good leadership is unpopular because it does not pander to the arrogant intellectuals or emotional masses. In fact, it avoids special interests so that the nation as a whole can thrive. He describes it with a metaphor from his boarding school:
“I wanted the best of both worlds: authority figures who at one and the same time both protected me and left me alone; who came to my aid in emergencies but otherwise allowed me to mind my own business. Officious busybody prefects who kept an eye on one all the time were more a liability than an asset. But unofficious prefects who noticed what was going on from a corner of the eye were the opposite. Even more to be desired were the few older boys who turned down the office of prefect but were natural authority figures on the side of justice and order requiring, by virtue of strong individual character, no official badge of office.” (22)
This winding book, arcane like an ancient castle yet refreshing like finally finding the answer to your research in a footnote in the last book even tangential to your “official” topic, provides many such challenging ideas. Underlying every part of it is a distrust in the idea of a government that unites its public and private faces and thus is manipulable by special interests; Worsthorne argues for an older yet, if you look at it critically, more mature form of government, where rule by quality of people predominates under rule by book of rules.
Democracy Needs Aristocracy is a challenging and engrossing read, and even for those hostile to aristocracy, provides a thorough exploration of where our current systems of government fail. His thesis is flexible, and deliberately written from a liberal-friendly position, to show that democracy becomes anti-elitist mob rule without some mediating elite to keep anti-egalitarianism from becoming crowd revenge. As such, it is every bit as eternal as de Toqueville, and presents a vision of government that none can afford to fully ignore today.
You can find this book at Amazon for $15 or from Harper Collins UK for £9.
00:05 Publié dans Livre, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, aristocratie, démocratie, théorie politique, sciences politiques, politologie, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 19 février 2011
La politique actuelle d'un point de vue schmittien
LA POLITIQUE ACTUELLE D’UN POINT DE VUE SCHMITTIEN
Nous le savons, Carl Schmitt est un politologue controversé : ne lui furent pas pardonnées ses accointances avec le national-socialisme triomphant en Allemagne, son pays, même s’il fut, à la fin, surveillé par la SS ; ou même s’il fut, avant 33, un opposant à Hitler. Qu’on le prenne avec des pincettes ou non, il reste un des plus grands spécialistes de la sociologie politique du XXe siècle, digne héritier de Max Weber et écrivain extrêmement prolixe, dans de nombreux domaines, qui vont du droit constitutionnel à la polémologie.
Nous le savons aussi, la définition de Schmitt de la « politique », au sens strict, a de quoi surprendre par son apparence violente : la politique, ce serait pour lui le lieu du conflit, le domaine dans lequel naitrait et vivrait une opposition caractérisable par une dialectique ami/ennemi. En somme, un groupement politique comme un parti doit nécessairement se fixer un ennemi, et toute son idiosyncrasie à son encontre doit être d’une humeur belliqueuse, conflictuelle, afin qu’il soit, à proprement parler, politique.
Regardons donc notre politique actuelle avec des yeux schmittiens, et tâchons de saisir les différentes oppositions ami/ennemi qui doivent, normalement, la constituer. La gauche et la droite semblent être toujours les deux adversaires principaux, les deux parties au conflit qu’est la politique. Cependant, lorsque nous regardons le PS et l’UMP, il est difficile d’appréhender l’ennemi que chacun détermine pour son camps ; précisons : il y a fort à parier qu’en demandant aux cadres respectifs de ces deux grands partis quel serait leur ennemi, ils répondent chacun de manière floue, car idéologiquement parlant, ces deux comparses sont sur la même ligne, s’échangent même parfois les ministres grâce au principe de « l’ouverture », et mènent, peu ou proue, une politique semblable, pour la simple et bonne raison qu’ils ont tous deux les mêmes amis : l’Union Européenne, la mondialisation, les Etats-Unis, la politique libérale, etc. Ayant les mêmes amis, comment, dès lors, discerner une opposition réelle entre eux ? Comment croire que « l’ennemi », dans la dialectique qui fonde le politique, soit pour eux, dans le même temps, l’ami de leurs amis ? C’est donc que cette opposition est biaisée ; or, si cette dialectique est défaillante, c’est qu’il n’existe plus en eux, chez eux, de politique à proprement parler. Par conséquent, Le PS et l’UMP, si l’on s’arrêtait à leur conflit d’apparat, ne feraient en vérité plus de politique.
Mais puisque ces deux partis majoritaires sont dans le jeu politique, le dominent et le mènent, il faut bien tout de même qu’ils aient des ennemis, même s’ils ne sont pas officiels. Quoique, là encore, un peu de perspicacité, quelques coups d’œil et un brin de probité permettent de découvrir que leur ennemi principal se trouve être, en vérité, celui qui remet en cause le système libéral dont ils sont à la fois les gérants et les humbles exécutants. Officiellement, ils ne disent pas tout à fait cela, surtout à gauche où l’on s’accommode parfaitement du système, mais pas encore du mot (libéral). Comme ersatz rhétoriques, ils disent combattre « l’intolérant », le « fanatique » ou « l’extrémiste », qui est en fin de compte, presque à chaque fois, qu’un simple opposant à ce système.
Les partis dits « extrémistes », l’extrême-gauche et l’extrême-droite, seraient donc les seuls à assumer complètement, dans une vraie transparence, la dialectique ami/ennemi. Car autant pour l’un que pour l’autre, c’est le système libéral mondialiste qui est l’ennemi, et eux ne se partagent pas les amis (sauf pour l’extrême-gauche, qui coltine parfois avec les partis au pouvoir dans tout ce qui a trait aux conséquences du libéralisme mondialisé : la révolution des mœurs, l’immigration etc.). La logique du conflit étant plus prégnante chez eux, l’opposition étant plus claire, plus assumée, plus nette – c’est à croire que la politique, au sens schmittien, n’existerait réellement que chez eux. Seuls les partis que l’échiquier en vigueur placerait aux extrêmes feraient, en somme, de la politique. Le reste ne serait que du secrétariat.
Ce point de vue schmittien de la politique, s’il est original et sans doute pas tout à fait valable à cent pour cent, a au moins le mérite de nous faire réfléchir et de remettre en cause l’idée que la politique ne serait faite que par ceux qui seraient véritablement aux manettes, les autres n’ayant qu’une fonction tribunicienne, et qui devraient toujours souffrir du reproche de leur soi-disant inutilité. En effet, combien de fois avons-nous entendu des membres de l’UMP dirent à ceux du Front National qu’ils ne servaient à rien, si ce n’est râler, sous prétexte qu’ils n’obtenaient jamais le pouvoir ? Et de même aujourd’hui pour le PS à l’égard du Front de gauche de Mélenchon ?
Mais si, en fait, il n’y avait plus qu’eux qui faisaient de la… politique ?
00:15 Publié dans Actualité, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : carl schmitt, politique, actualité, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
The horizontally totalitarian future-world
The horizontally totalitarian future-world
Ex: http://majorityrights.com/
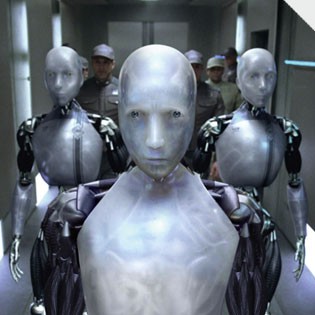 Last February, by way of an introduction, I put up a post about the great German jurist Carl Schmitt. He is a highly useful guide to the ways of Power. His elucidation of the theoretics of state power in extraordinary times established the framework employed by many, and probably most, thinkers in this, let’s say, increasingly topical field. In particular, Schmitt’s concepts of the decision and the state of exception open up the operation of total power for examination like a dead butterfly on a display board.
Last February, by way of an introduction, I put up a post about the great German jurist Carl Schmitt. He is a highly useful guide to the ways of Power. His elucidation of the theoretics of state power in extraordinary times established the framework employed by many, and probably most, thinkers in this, let’s say, increasingly topical field. In particular, Schmitt’s concepts of the decision and the state of exception open up the operation of total power for examination like a dead butterfly on a display board.
As Tom Sunic wrote in Homo Americanus: child of the postmodern age:-
Carl Schmitt ... realized an age old truth; namely, political concepts acquire their true meanings only when the chief political actor, i.e. the state and its ruling class, find themselves in a sudden and unpredictable state of emergency. Then all former interpretations of “self-evident” truths become obsolete. One could witness that after the terrorist attack of 9/11 in America — an event that was never fully elucidated — the ruling class in America used that opportunity to redefine the legal meaning of the expressions “human rights” and “freedom of speech.” After all, is not the best way to curb real civic rights the adoption of abstract incantations, such as “human rights” and “democracy”?
What just about everyone with a triple-digit IQ understands is that the events of 11th September 2001 and the subsequent War on Terror have been ruthlessly exploited throughout the West to advance a profoundly undemocratic and disturbing domestic security agenda. Whether a true state of exception ever existed is highly doubtful. But Power decides what is moral and what is, in a vulgar sense, true. It has decided that its officers shall usurp the legal code at will, and shall stipulate on their own authority the terms under which its citizens go about their business.
I happen to live under the most abusive of any Western government in this respect. The UK authorities have the Civil Contingencies Act already, and a growing DNA database to which it is intent upon adding us all, and on top of that it is constructing the complete surveillance society. But the trend is appearing everywhere.
What this amounts to is an impressively uniform and aggressive war on the defence of civic liberties which have informed Western legal codes for centuries. Its significance is vast and unmistakable: the foundations are being laid for a different kind of political regime, to be conducted in a permanent state of exception. The Executive is strengthening and freeing itself as a body empowered, but in no way constrained, by ad hoc procedural law subject only to official decision.
The big question is: what structure of global/local government will emerge out of this new strength and freedom?
In local, day-to-day terms, it will decide for domestic policy blandness and irrelevance - the towering racial injustice of an anti-white MultiCult make that inevitable. Meanwhile, the moral duty of government and public alike will be directed to far-flung places where “profitable problems” require corporate-military intervention.
To all intents and purposes, this will be a totalitarianism or dictatorship, if only because it must regulate more and more social relations in the interests of racial panmixia in order to resolve the problem of the European natives. But I can’t see how any form of world-wide imperial police state can emerge from the new dispensation, even given the coming of global economic unity.
If one assumes, as I do, that this dispensation represents the deepest political convictions of a diverse, internationalist power elite, and not only the will of bankers and mega-corporations, it is apparent that there is no “centre” capable of, or needful of, global government through a totalitarian vertical heirarchy. Schmitt holds the key. A permanent, global state of exception and the distribution of decision are enough. The governing class will operate as it does today, patronised and informed of its obligations by the higher elites without those elites ever comprising a structured global government themselves.
In a word, the deracinated, de-sovereignised, and legally denuded post-nation ...
“There is no place in modern Europe for ethnically pure states. That is a 19th-century idea, and we are trying to transition into the 21st century, and we are going to do it with multi-ethnic states.”
Wesley Clark, to a CNN reporter in 1999“The president believes the world will be a better place if all borders are eliminated—from a trade perspective, from the viewpoint of economic development and in welcoming [the free movement of] people from other cultures and countries.”
Tom Hogan, president of Vignette Corporation, speaking after a convseration with Bill Clinton in Australia in 2001
... can be governed by a structure no different than the one that governs it now.
The future will, then, continue to be plural, and yet will be totalitarian. Our lives will be free in the ways that we are required to live them, but will be regulated in every other. We shall have “nothing to fear if we are innocent” from a non-law that is subject wholly to the decision of the, of course, always benign official.
Leviathan will command a near borderless world of super-diversity filled with national symbols. And we WILL be happy, although it will be as impossible to struggle for happiness as it will for political freedom.
00:10 Publié dans Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, théorie politique, politologie, sciences politiques, carl schmitt, totalitarisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 10 février 2011
Vizier: Politieke manipulatie corrumpeert taal
http://www.tertio.be/sitepages/index.php?page=archief&...
Vizier: Politieke manipulatie corrumpeert taal Is het niet vreemd dat op de website van Amnesty International Vlaanderen niets te vinden is over de vervolging van christenen in moslimlanden?
Is het niet vreemd dat op de website van Amnesty International Vlaanderen niets te vinden is over de vervolging van christenen in moslimlanden?
Primeert bij Amnesty Vlaanderen het ideologische verhaal, waardoor de waarheid geweld wordt aangedaan? Die onmiskenbare christenvervolging mag niet langer worden verdoezeld.
Miel Swillens | George Orwell merkte op dat “the restatement of the obvious is the first duty of intelligent men.” Daarmee bedoelde hij dat je moet
blijven hameren op onmiskenbare waarheden. Zo niet worden die verdoezeld wanneer ze niet passen in het vigerende ideologische denkraam. Orwell wist
waarover hij het had. Hij maakte zelf mee hoe zijn relaas over de Spaanse Burgeroorlog, Homage to Catalonia, werd uitgespuwd door de Britse
intelligentsia, omdat het niet strookte met haar pro-Sovjet en pro-Stalin gezindheid. Om diezelfde reden weigerden linkse uitgeverijen Animal Farm te
publiceren, waarin de auteur onder het mom van een dierenfabel de ontaarding van de Russische Revolutie op de korrel nam. Orwell, een overtuigde maar eigenzinnige socialist, haatte elke orthodoxie, zowel van links als van
rechts. Ideologische taal, zo stelde hij, is ontworpen om de leugen als waarheid te doen klinken, en een schijn van vastheid te geven aan pure wind.
Ik moest aan Orwells afkeer van geprefabriceerde termen en holle frases
denken, toen ik op de website van Amnesty International Vlaanderen
terechtkwam. Eigenlijk was ik op zoek naar informatie over de vervolging van
christenen in moslimlanden. Maar daarover was niets te vinden. Bij
mensenrechten per land wordt noch bij Irak noch bij Egypte melding gemaakt
van vervolgde christenen. Ook als thema komt het niet aan bod. Tik je het
trefwoord ‘kopten’ in, dan krijg je als antwoord: “uw zoekopdracht heeft
geen resultaat opgeleverd”. Tik je daarentegen ‘Guantanamo’ in, dan vind je
niet minder dan 45 items. Ben ik bevooroordeeld wanneer ik de indruk krijg
dat Amnesty Vlaanderen vooral aandacht heeft voor de troetelthema’s van de
linkse intelligentsia?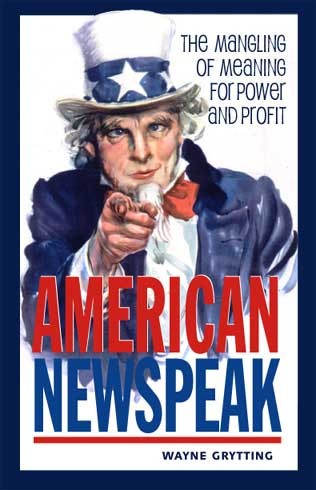 Cultuurrelativisme
Cultuurrelativisme
Maar terug naar Orwell en zijn afkeer van geprefabriceerde termen en holle frases. In het jaarrapport 2010 van de mensenrechtenorganisatie wordt België bestempeld alseen land van “willekeurige arrestaties en opsluitingen” en van “buitensporig gebruik van geweld door politie en veiligheidsdiensten”. Is dat een correcte weergave van de Belgische realiteit? België lijkt wel Iran of Zimbabwe. Maar wellicht is dat ook de bedoeling. Een westers land als België mag er blijkbaar niet beter uitkomen dan een derdewereldland. Vandaar de suggestie van morele equivalentie. Wanneer het ideologische verhaal primeert, wordt de waarheid geweld aangedaan.
Soms wordt het taalgebruik ronduit orwelliaans, zoals in het standpunt van Amnesty over een mogelijk boerkaverbod in België: “Amnesty stelt vast dat een algemeen boerkaverbod in strijd is met de godsdienstvrijheid en de vrijheid van meningsuiting. Bovendien beperkt een dergelijke wet het recht van vrouwen op een leven vrij van dwang, intimidatie en discriminatie.” (mijn cursivering). De geperverteerde logica van dat standpunt shockeert. De tekst illustreert hoe de capitulatie van de
mensenrechtenorganisatie voor het cultuurrelativisme haar taalgebruik corrumpeert. Wie Orwells toekomstroman Nineteen Eighty-Four kent, denkt daarbij aan de fameuze Newspeak met slogans zoals “Slavery is freedom”.
Politiek correct
Taal dient om te communiceren over de werkelijkheid, om die zo getrouw mogelijk weer te geven. Ideologieën verdoezelen of ontkennen de werkelijkheid, telkens die botst met hun politieke discours. Dat leidt tot corruptie van de taal. Denk maar aan de vroegere Sovjet-Unie. Correcte taal is een democratische opdracht en ethische plicht. Wellicht moeten ze bij Amnesty Vlaanderen ook maar eens Orwell lezen, zijn essay Politics and the English Language bijvoorbeeld. Daarin staat onder andere het volgende: “But if thought corrupts language, language can also corrupt thought. A bad usage can spread by tradition and imitation, even among people who should and do know better.”
00:15 Publié dans Actualité, Philosophie, Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : langage, langue, manipulation médiatique, philosophie, george orwell, théorie politique, poklitologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 09 février 2011
Abbé Jean-Marie Gantois: à l'école de Proudhon
A l’école de Proudhon
par Jean-Marie Gantois
 Proudhon, qui, en 1863 déjà, proclamait la nécessité « du principe fédératif », mettait ses disciples en garde contre cette déformation et cet abus. De cet ouvrage fameux, il est de bon ton de répéter une phrase : « Le vingtième siècle ouvrira l’ère des fédérations, ou l’humanité recommencera un purgatoire de mille ans » et d’en citer … implicitement une autre, en négligeant d’en Indiquer la source : « L’Europe serait encore trop grande pour une confédération unique : elle ne pourrait former qu’une confédération de confédérations ». Il semble que ce soit là tout ce qu’on ait retenu de ce traité fondamental. N’oublie-t-on pas un peu trop facilement avec quelle force il s’est lui-même déclaré « républicain, mais irréductiblement hostile au républicanisme tel que l’ont défiguré les jacobins » ? N’oublie-t-on pas qu’aucune insistance ne lui paraissait indiscrète quand il s’agissait de répéter à ses correspondants : « Méfiez-vous des jacobins qui sont les vrais ennemis de toutes les libertés, des unitaristes, des nationalistes, etc … »
Proudhon, qui, en 1863 déjà, proclamait la nécessité « du principe fédératif », mettait ses disciples en garde contre cette déformation et cet abus. De cet ouvrage fameux, il est de bon ton de répéter une phrase : « Le vingtième siècle ouvrira l’ère des fédérations, ou l’humanité recommencera un purgatoire de mille ans » et d’en citer … implicitement une autre, en négligeant d’en Indiquer la source : « L’Europe serait encore trop grande pour une confédération unique : elle ne pourrait former qu’une confédération de confédérations ». Il semble que ce soit là tout ce qu’on ait retenu de ce traité fondamental. N’oublie-t-on pas un peu trop facilement avec quelle force il s’est lui-même déclaré « républicain, mais irréductiblement hostile au républicanisme tel que l’ont défiguré les jacobins » ? N’oublie-t-on pas qu’aucune insistance ne lui paraissait indiscrète quand il s’agissait de répéter à ses correspondants : « Méfiez-vous des jacobins qui sont les vrais ennemis de toutes les libertés, des unitaristes, des nationalistes, etc … »
Renvoyons au maître incomparable, au maître français du fédéralisme ceux de ses compatriotes qui affectent de se réclamer de sa doctrine :
« Il a été parlé maintes fois, parmi les démocrates de France, d’une confédération européenne, en d’autres termes des « Etats-Unis de l’Europe ». Sous cette désignation, on ne paraît pas avoir jamais compris autre chose qu’une alliance de tous les Etats, grands et petits, existant actuellement en Europe, sous la présidence permanente d’un Congrès. Il est sous-entendu que chaque Etat conserverait la forme de gouvernement qui lui conviendrait le mieux … Une semblable fédération ne serait qu’un piège ou n’aurait aucun sens…
« J’ai entendu d’honorables citoyens des Flandres se plaindre de manquer de notaires et de magistrats qui comprissent leur langue et accuser très haut la malveillance du gouvernement. Une domestique flamande, envoyée à la poste pour retirer ou affranchir une lettre, ne trouvait à qui parler. « Apprenez le français », lui disait brusquement l’employé. MM. les gens de lettres parisiens observeront sans doute que l’extinction du flamand ne serait pas pour l’esprit humain une grande perte ; il en est même qui poussent l’amour de l’unité jusqu’à rêver d’une langue universelle. En tous cas ce n’est pas de la liberté, ce n’est pas de la nationalité, ce n’est pas du droit …
« Est-ce que cette démocratie qui se croit libérale et qui ne sait que jeter l’anathème au fédéralisme et au socialisme, comme en 93 le leur ont jeté ses pères, a seulement l’idée de la liberté ?
« Si demain la France impériale se transformait en Confédération, l’unité serait de fait maintenue. Mais… les influences de race et de climat reprenant leur empire, des différences se feraient peu à peu remarquer dans l’interprétation des lois, puis dans le texte; des coutumes locales acquerraient autorité législative, tant et si bien que les Etats (« les nouveaux Etats confédérés au nombre de vingt ou trente », écrivait quelques lignes plus haut Proudhon) seraient conduits à ajouter à leurs prérogatives celles de la législature elle-même. Alors vous verriez les nationalités dont la fusion plus ou moins arbitraire et violente, compose la France actuelle, reparaître dans leur pureté native et leur développement original, fort différentes de la figure de fantaisie que vous saluez aujourd’hui…
« La nation française est parfaitement bien disposée pour cette réforme … La tradition n’y est pas contraire : ôtez de l’ancienne monarchie la distinction des castes et les droits féodaux. La France avec ses Etats de province, ses droits coutumiers et ses bourgeoisies n’est plus qu’une vaste confédération, le roi de France un président fédéral. Au point de vue géographique, le pays n’offre pas moins de facilités : parfaitement groupé et délimité dans sa circonscription générale, d’une merveilleuse aptitude à l’unité on ne l’a que trop vu, il convient non moins heureusement à la fédération par l’indépendance de ses bassins dont les eaux se versent dans trois mers (1). C’est aux provinces à faire les premières entendre leurs voix» (2).
Une organisation pseudo-fédérale qui négligerait les diversités des « minorités ethniques» ne serait qu’une immense et cruelle duperie. M. Denis De Rougement ne serait pas Suisse s’il n’en avertissait dûment l’opinion française dans « L’Europe en jeu »: « Seul, le fédéralisme ouvre des voies nouvelles. Seul, il peut surmonter – voyez la Suisse – les vieux conflits de races, de langues et de religions sclérosés dans le nationalisme ». Mais est-ce vraiment l’idéal d’une « Europe helvétisée » qui inspire nos fédéralistes officiels de tous plumages ? Qui nous garantira que la formule fédérale, avant de régir les relations entre Etats, s’appliquera à leur constitution interne ? Telle est pourtant la condition préalable de l’aménagement correct et loyal d’un ordre fédéraliste digne de ce nom.
Fabre-Luce l’indique avec sa hauteur de vues coutumière, dans son livre sur « Les Etats-Unis d’Europe » :
« Il faut rompre les anciennes habitudes de penser qui associent impérieusement dans l’esprit public, d’une part Liberté et Nation, d’autre part Organisation et Centralisation. C’est au contraire en « élargissant » l’espace politique qu’on arrivera à « tempérer » certains excès d’autorité et à créer des autonomies provinciales. C’est dans une Europe fortement constituée que l’individu -, aujourd’hui opprimé, dans des cadres trop étroits, par des pouvoirs inefficaces – retrouvera son plein épanouissement. Dans une telle époque on ne peut assumer la liberté des individus qu’en retirant aux Etats la possibilité même de l’arbitraire. L’union de l’Europe consacrerait ce fait d’expérience que, dans le monde moderne, malgré les affirmations contraires de certaines propagandes, la « région » est un élément plus important que la « classe ».
Est-ce vraiment vouloir l’Europe que de refuser d’y réserver une fonction essentielle aux provinces-charnières de la communauté européenne ? Est-on absolument de bonne foi quand on réclame, pour l’amélioration des relations européennes, l’enseignement du français dans le Val d’Aoste et qu’on s’oppose à celui du breton en Bretagne, du flamand en Sud-Flandre, de l’occitan en Occitanie, du catalan en Roussillon, Cerdagne, Vallespir, Conflent, Capcir, du basque en Soule, labourd et Basse-Navarre ? A-t-on des chances sérieuses de paraître de bonne foi quand on propose d’aménager les frontières et qu’on laisse en place d’appareil douanier et policier monstrueux qui semble appartenir à un autre âge et à une autre civilisation et qui tranche dans la chair vive .de populations semblables en tous points de part et d’autre d’artificielles limites d’Etats ?
Tandis que de médiocres politiciens qui se baptisent du nom de « chrétiens » rabâchent, sous prétexte de « civisme », ce que Proudhon (qui décidément avait tout compris et tout prévu) appelait de misérables « paralogismes catholico-jacobiques », le Pape PIE XII ne lasse pas de répéter en chacun de ses messages :
« L’Eglise ne peut penser ni ne pense à attaquer ou à mésestimer les caractéristiques particulières que chaque peuple, avec une piété jalouse et une compréhensible fierté, conserve et considère comme un précieux patrimoine. Toutes les orientations, toutes les sollicitudes, dirigées vers un développement sage et ordonné des forces et tendances particulières, qui ont leur racine dans les fibres les plus profondes de chaque rameau ethnique. L’Eglise les salue avec joie et les accompagne de ses vœux maternels. »
(Octobre 1939),
« Dans le champ d’une nouvelle organisation fondée sur les principes moraux, il n’y a pas place pour l’oppression ouverte ou dissimulée, des particularités culturelles et linguistiques des minorités nationales. »)
(Noël 1941).
« La longue expérience de l’Eglise l’oblige à. conclure que la stabilité du territoire et l’attachement aux traditions ancestrales, indispensables à la saine intégrité de l’homme sont aussi des éléments fondamentaux pour la communauté humaine. »
(20 février 1946).
-
Recevant dernièrement les congressistes de l’Union Européenne des Fédéralistes, le Souverain Pontife tenait expressément à les mettre en garde contre la plus illogique et la plus pharisaïque des contradictions :
« On ne fera pas l’Europe avec des déracinés. »
Il serait fâcheux, pour le crédit de la France, que le monde reste sur l’impression que la « doctrine » fédéraliste française est réservée à l’usage des peuples de couleur, à l’exclusion des… indigènes de la métropole, ou qu’elle n’est strictement qu’un article d’exportation destiné à la consommation outre-Rhin et, à la rigueur, tra los montes, histoire d’embêter Franco.
Il y va de l’honneur du fédéralisme français, et de l’honneur de la France. Les fédéralistes français authentiques et sincères ont la parole.
PARIS, le 8 décembre 1948.
Henri DUMESNIL.
(1) Et même dans quatre mers : corrigeons Proudhon qui semble oublier la mer du Nord et son rivage, naturellement cher à nos amis flamands. (Rédaction des Cahiers).
(2) Pour ne pas allonger outre-mesure ce document, bornons-nous à rappeler que Proudhon, dans ses divers écrits, revient avec prédilection sur ces idées du Principe fédératif : « Les auteurs de la Constitution de 1848 s’imaginaient-ils, par hasard, que les douze ou quinze peuples parfaitement distincts dont la réunion forme ce qu’on appelle vulgairement le peuple français, ne sont pas de vraies nationalistes ? » (Théorie du mouvement constitutionnel) – « La nation française actuelle se compose d’au moins vingt nations distinctes … Le Français est un être de convention» (France et Rhin). Dans le système fédéral, « chaque race, chaque langue est maitresse sur son territoire. L’unité n’est plus marquée dans le droit que par la promesse que se font les uns aux autres les divers groupes souverains. » (De la capacité. politique des classes ouvrières). – « La France périra, à moins qu’elle ne se sauve une seconde fois par le fédéralisme qui, découpant toutes les grandes unités, fera reparaître toutes les nationalités et sauvera de cette manière tout le monde » (Lettre à- M. JOLTRAND, 14 décembre 1863). -« Faites de la France douze républiques confédérées, et vous trouverez la France aussi jeune qu’en 93. » (Lettre à M. DELHASSE, 8 août 1861). – Une pensée familière, en outre, à Proudhon es+ que le fédéralisme détient le secret non seulement de prévenir les luttes entre les Etats, mais d’éviter les conflits à l’intérieur de chacun d’eux.
P.S – Ce texte était rédigé lorsque nous avons pris connaissance d’une note envoyée à la rédaction des « Cahiers » par un de nos amis Lillois et relative aux « Journées d’Etudes Européennes » qui ont eu lieu à Lille les 17, 18 et 19 décembre 1948 à l’instigation du groupe de la « Région Nord » de la « Fédération ». Nous faisons suivre ici cette communication :
« L’objet de ces réunions était, parait-il, de « définir la position de la région du Nord devant les perspectives d’une Fédération Européenne ». Nous avons l’impression que les congressistes auraient pu tenir leurs assises tout aussi bien à Romorantin, à Saint-Jean-d’Angély, à Pampelune ou à Famagouste, sans avoir à changer un mot à leurs exposés et leurs échanges de vues. On y a beaucoup insisté sur « la nécessité de faire participer les communautés naturelles à la construction de l’Europe » : ces communautés seraient-elles seulement la famille, la commune, le syndicat ? La région ne serait-elle pas de ces « communautés naturelles de vie » dont on proclame les droits ? La Flandre n’a-t-elle pas un rôle à jouer dans une Europe honnêtement fédéralisée ? André Therive l’a naguère reconnu : « Sachons bien que flamand a quelques titres à vouloir dire européen ». On aurait pu s’en souvenir à Lille-en-Flandre. Le docteur Carl Burkhardt, ministre de Suisse, en France, recevant récemment le titre de docteur « honoris causa » de l’Université de Lille, dans une promotion comprenant le Professeur Blancquaert, de Gand, et le Professeur De Boer de Leyde, déclarait aux Lillois : « Votre cité me parait l’un des points de l’Europe où peut se forger une renaissance européenne ».
« Le docteur Brugmans aurait-il si peu la notion de ce que les divers cantons des anciens Pays-Bas peuvent apporter à l’élaboration d’un statut européen ? Faut-il lui rappeler, pour nous borner à quelques souvenirs qu’on suppose devoir lui être chers, que l’aumônier de la Cour de Guillaume d’Orange, rédacteur de l’ « Apologie », du « Père de la Patrie », Pierre Loyseleur de Villiers et van Westhove, était un Lillois, et semblablement un Lillois son fidèle médecin, Matthias Delobel ? Ne doute-t-il pas qu’à quelques kilomètres de Lille le néerlandais est la langue courante de la population et qu’il est parlé par une partie des habitants à l’intérieur même des murs de la cité ? N’aurait-il rien aperçu des monuments anciens et modernes de la « Capitale des Flandres », de l’intérieur de la Vieille Bourse, par exemple, et du beffroi de l’Hôtel de Ville ? N’aurait-il pas eu un regard pour le « paysage humain » de cette antique métropole thioise et de son terroir, où Anatole France, Arsène Dumont, Henri Baudrillart, Ludovic Naudeau, Ardouin-Dumazet, Jean Cassou, Georges Blachon, Armand Guillon et tant d’autres visiteurs de marque se sont cru transportés au cœur des Pays-Bas ? Nous conseillerions volontiers à M. Brugmans de trouver le temps de jeter un coup d’œil sur quelques-unes des gravures de l’album, récemment paru du Dr V. Celen : « Frans-Vlaanderen in Woord en Beeld », Où trouvera-t-il à travers les Pays-Bas, des images plus typiquement néerlandaises ? »
On s’étonne d’autant plus, en effet, des silences lillois de M. Brugmans que le précédent Congrès de l’Union Européenne des Fédéralistes qui s’est tenu quelques semaines lus tôt à Nantes, a mis en évidence, grâce surtout à M. Pierre Mocaer et à M. Joseph Martray, le rôle naturellement dévolu au peuple breton et à la culture bretonne dans l’édification d’une communauté européenne libérée de l’oppression étatiste. N’est-ce pas à Nantes que le Dr Brugmans lui-même avait tenu à préciser :
« Nous ne voulons pas faire des Etats-Unis d’Europe, c’est-à-dire une union des nations telles qu’elles sont actuellement constituées, étatisées à outrance ; mais une Fédération de nations profondément changées dans leur structure, dans lesquelles toutes les régions les groupes ethniques dont certains chevauchent les frontières auront un rôle à jouer dans la communauté nationale et Internationale. »
Où donc un rappel de ce langage aurait-il été plus de circonstance qu’en Flandre et à Lille ?
H. D.
Article printed from :: Novopress.info Flandre: http://flandre.novopress.info
URL to article: http://flandre.novopress.info/4519/a-l%e2%80%99ecole-de-proudhon-par-jean-marie-gantois/
URLs in this post:
[1] Image: http://flandre.novopress.info/wp-content/uploads/2009/06/proudhon.jpg
00:13 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : abbé gantois, flandre, pays-bas, flandre française, proudhon, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 08 février 2011
La société civile: de l'état libéral à la gouvernance réactionnaire
La société civile : de l’état libéral à la gouvernance réactionnaire
Ex: http://www.mecanopolis.org/
Une société libérale réfute théoriquement l’idée d’une surcharge juridique, l’Etat se place donc en retrait de tout interventionnisme dans les champs de l’individualité. Il s’agit d’un modèle de société qui, en théorie, n’est pas gouvernée par une autorité morale, et dont les principes traditionnels sont pour la plupart devenus de simples pièces de la mosaïque des subjectivités. Mais à la tradition, s’est en réalité substitué un ordre moral, dont l’exercice provient désormais d’une autorité anti-traditionnelle : la classe dirigeante. Cette dernière détient son pouvoir grâce à l’appui d’une entreprise globale de manipulation: pas de médias indépendants, des processus électoraux manipulés ou absents, et une frontière poreuse entre le privé et la classe dirigeante.
La morale quant à elle est réservée à ce qui est en dehors de l’état, au non-gouvernemental, soit à la société civile. Bien que les instances religieuses y soient représentées conformément à la loi de 1905, leurs influences restent mineures. Car la société civile est avant tout le foyer des associations, des lobbys, et des think-tanks, qui selon l’organisme auquel ils s’adressent, peuvent avoir un degré d’influence différent. Mais pour y parvenir, il leur faut être reconnu en tant qu’organisme de la société civile (OSC), et obtenir un statut de la part de la classe dirigeante. La morale provient donc d’un appareil qui est à l’initiative du pouvoir et ce dernier organise l’écoute des revendications de l’ “appareil moral ».
Comme le disait Foucault : « la société civile, ce n’est pas une réalité première et immédiate […], c’est quelque chose qui fait partie de la technologie gouvernementale moderne« . En effet, il s’agit avant tout d’un outil de régulation de l’opinion qui sert des intérêts précis et temporels. En utilisant la morale et donc en s’octroyant le droit de déterminer ce qui est juste, la société civile permet à la classe dirigeante d’élargir son champ de possibilités. Par conséquent la promotion de causes présentées comme justes par la sphère extra-étatique, permet d’acquérir par avance l’aval du peuple.
La société civile est par ailleurs moins hétérogène que ce qu’on peut en penser au premier abord. En effet, il existe des causes pour lesquelles l’extrême majorité des associations, think-tanks, etc. s’accordent sans le moindre problème. Ces accords peuvent parfois surprendre comme dans le cas du Centre d’Étude et de Prospection Stratégique (CEPS). Le CEPS est une ONG dotée du statut participatif au Conseil de l’Europe. Elle fonctionne essentiellement à travers ses clubs de réflexions, sur le modèle suivant: « Nous adoptons les « Chatham house rules », c’est-à-dire que nous avons tous le droit de reprendre des idées exprimées pendant ces rencontres, mais ne devons jamais communiquer d’informations sur l’auteur des propos, ni sur le lieu où ils ont été tenus. Ces rencontres sont exclusivement destinées aux membres du club, lesquels font tous l’objet d’une cooptation. » Parmi les partenaires et animateurs du CEPS, on trouve : SOS-Racisme; l’OTAN; Areva; JP Morgan; Endemol, EADS, La Croix Rouge, L’OCDE, L’Institut Robert Schuman pour l’Europe, etc. On pourrait se demander quel intérêt commun officiel ces organismes partagent-ils. Mais il est évident que la réponse réside dans l’existence même de la société civile et de son homogénéité effective.
Dans cette mesure, il est tout à fait logique que la société civile et la classe dirigeante ne fassent qu’un. Un des buts recherchés étant de parvenir à une morale qui soutient la doctrine de la globalisation libéral: en instaurant un tas d’organismes réactionnaires, en soutenant l’émergence de structures supra-étatiques et en organisant la tenue d’un monde organisé autour du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Tout ce qui n’entre pas dans ce cadre est immédiatement considéré comme irrecevable car en-dehors du consentement global. Il s’agit donc, pour la société civile, d’installer une instance réactionnaire d’une part, et de soutenir l’action de la classe dirigeante d’autre part. Pour conclure, le décryptage du rôle de la société civile incite à se référer à la théorie de Tittytainment de Zbigniew Brzezinski : la volonté de construire une lente dépolitisation de l’humanité, en procédant en premier lieu par la construction d’une morale qui va manifestement à l’encontre de l’humanité.
Julien Teil, pour Mecanopolis [2]
Notes :
[1] FOUCAULT Michel, Naissance de la Biopolitique, Cours au Collège de France, 1978-1979,
Paris : Gallimard/Seuil, 2004, p.300
[1] http://www.ceps.asso.fr/Nos-actions/Les-Clubs [3]
[1] http://www.ceps.asso.fr/Le-CEPS/Nos-partenaires [4]
Article printed from Mecanopolis: http://www.mecanopolis.org
URL to article: http://www.mecanopolis.org/?p=20982
URLs in this post:
[1] Image: http://www.mecanopolis.org/wp-content/uploads/2010/12/barcode.png
[2] Mecanopolis: http://www.mecanopolis.org
[3] http://www.ceps.asso.fr/Nos-actions/Les-Clubs: http://www.ceps.asso.fr/Nos-actions/Les-Clubs
[4] http://www.ceps.asso.fr/Le-CEPS/Nos-partenaires: http://www.ceps.asso.fr/Le-CEPS/Nos-partenaires
00:20 Publié dans Actualité, Sociologie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, société civile, sociologie, libéralisme, réaction, gouvernance, théorie politique, sciences politiques, politologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Michel Drac: entretien avec E&R-Bretagne
Michel Drac, entretien avec E&R Bretagne
Ex: http://www.scriptoblog.com/
Les ouvrages du Retour Aux Sources font la part belle aux méthodes d’organisation et d'action pensées par la gauche radicale (TAZ d’Hakim Bey, théorie des multitudes de Négri, éco-villages, …).
 Croyez-vous la droite anti-libérale incapable de produire des idées pertinentes et des outils opérationnels adaptés à notre époque en crise ?
Croyez-vous la droite anti-libérale incapable de produire des idées pertinentes et des outils opérationnels adaptés à notre époque en crise ?
La droite anti-libérale a de toute évidence un problème pour se penser en rupture avec le Système. Ceci peut paraître curieux, dans la mesure où elle est objectivement plus étrangère au Système que n’importe quelle autre tendance politique. Mais au fond, c’est logique : pour se penser en rupture avec le Système, il faudrait que la droite anti-libérale conceptualise une rupture au sein du concept général de « droite », car une partie de la « droite » est dans le Système. Or, la droite anti-libérale, prisonnière de l’illusion d’un continuum de la « droite », ne parvient pas à penser cette rupture.
Ici, il faut bien dire que les logiques de classe ont tendance à prendre le pas sur les logiques purement politiques : il y a toujours un moment où le bon bourgeois anti-libéral est renvoyé à ses contradictions : comment être un bourgeois anti-libéral, aujourd’hui ?
Bref, je ne crois pas que la droite anti-libérale soit incapable de produire des idées pertinentes. Je constate en revanche qu’elle a du mal à les concrétiser, et même à les amener au stade du programme, du plan d’action. La droite anti-libérale est une sensibilité qui ne peut pas s’organiser.
Penser restaurer le système, l'aider à s'auto-corriger ou lutter pour le réformer (comme le font les réactionnaires, par exemple) n'aura pour résultat que de retarder la fin du Cycle et le début du suivant, selon vous. Quel peut donc être le rôle à jouer et la voie à suivre par des hommes différenciés en cette fin de Kali-Yuga? Cultiver une conscience politique propre à la formation d'une élite capable d'encadrer une (hypothétique et future) révolte des masses? Montrer l'exemple en se plaçant en dehors du jeu (retraite physique, élévation individuelle)? Ou combiner les deux?
L’économie occidentale contemporaine n’est pas réformable. C’est une énorme machine hypersophistiquée, une bonne partie des pièces s’est mise à fonctionner sans souci de l’ensemble, on a perdu le cahier de maintenance, et pour tout arranger, le pilote de machine est sourd, fou et ivre mort. La seule chose à faire, c’est d’attendre que le moteur explose, en se protégeant autant que possible contre les projections ! La priorité pour des hommes différenciés, comme vous dites, c’est de se préparer à se sauver eux-mêmes, alors que nous allons vers une période très, très dure.
Au demeurant, je pense que ce travail, s’il est conduit à termes, portera des fruits au-delà de son objectif immédiat. Au fond, si nous nous organisons pour nous en tirer le mieux possible, nous produisons simultanément et spontanément un modèle que d’autres voudront imiter. Paradoxalement, penser un égoïsme collectif, dans le contexte actuel, c’est aussi une manière d’aider tous ceux qui ne peuvent plus penser que l’égoïsme individuel. Plus que la noblesse des intentions, il faut juger l’efficacité concrète, et sous cet angle, la démarche consistant à structurer une contre-société me paraît aujourd’hui la plus porteuse.
Le narrateur de Vendetta explique ses actes (des assassinats, ndlr) à mots (ironiquement) choisis : ceux du champs-lexical managérial (« expérience passionnante et vie pleine de sens », etc.).
Penser les médiations nécessaires à une révolution, avec les concepts du système, résonne comme un aveu d'incapacité à produire du sens à l’extérieur de la matrice. Sens que le dernier opus du Retour au Sources (G5G – La Guerre de Cinquième génération) se propose, lui, de recréer. Pouvez-vous nous en dire plus?
Vous avez très bien saisi l’esprit des deux livres. Vendetta est une description de ce que l’on peut redouter, si la démarche proposé dans G5G est empêchée.
Il ne faut pas perdre de vue que les révoltés structurent toujours leur révolte avec, à la base, les concepts, les catégories du système qu’ils combattent. C’est pourquoi le parti communiste soviétique avait repris une partie des « techniques de gouvernement » propres à l’Eglise orthodoxe. C’est pourquoi le cérémonial napoléonien avait récupéré une partie des us et coutumes de la société de cour à la française. Etc.
Vendetta a été écrit pour expliquer, en gros : le Hitler, le Staline, le Mao de demain sont dans les tuyaux, et c’est la « démocratie libérale » contemporaine qui est en train de les incuber. Elle les incube d’une part parce que son dérèglement finit par rendre la vie impossible aux gens, ce qui va les pousser à la révolte ; et d’autre part parce qu’elle leur apporte sur un plateau les ingrédients de la violence révolutionnaire future : primat de la jouissance, de l’instantanéité, réduction de l’expérience humaine à l’individualité, compensée par un fonctionnement en réseau fluide.
On commence d’ailleurs à voir poindre cette nouvelle violence politique. Cette semaine (NB : début janvier 2011), nous avons eu une tuerie aux USA, avec un type qui a ouvert le feu en aveugle, lors d’un rassemblement politique. C’est là une pulsion de destruction (et d’autodestruction) qui ne s’organise pas, ou alors seulement de manière informelle, en réseau, et qui ne poursuit aucun autre objectif que la satisfaction de ceux qui s’y livrent. C’est ce vers quoi nous allons : la dictature par l’anarchie, l’extrême violence incontrôlable servant de prétexte à l’encadrement paranoïaque, partout, tout le temps.
G5G, à l’inverse, consiste à dire : dépêchons-nous d’offrir une issue, une voie vers le dehors de ce Système devenu fou, et qui nous rend fous. G5G, c’est le seul antidote à Vendetta, si vous voulez.
Dans De la souveraineté, vous expliquez que le mondialisme néolibéral se caractérise par l'absence d'idéologie originelle, combinée à une pathologie narcissique et au profit comme finalité - ce tout menant, selon vous, à la dictature du matérialisme bourgeois (fortification de l'élite du capital et asservissement de la masse).
Vous y opposez une posture européenne et traditionnelle : celle de la soumission du corps à la force, et de la force à l'esprit. Cette posture est-elle consubstantielle, comme mentionné par ailleurs, d’un certain élitisme et d’une purification éthique (mais pas ethnique) inévitable?
Dans De la souveraineté, j’ai essayé de faire comprendre rapidement quelque chose à mes lecteurs, tout en sachant que c’est quelque chose qu’on ne peut faire comprendre rapidement qu’au prix d’un certain simplisme. Ce quelque chose, c’est : le Système dans lequel nous vivons est une idéologie, à l’intérieur de laquelle nous habitons, et si nous avons l’impression qu’il n’y a pas d’idéologie, c’est parce que nous sommes dedans. L’absence d’idéologie originelle perçue par nous à la racine du Système provient uniquement du fait que nous confondons notre habitation au monde avec le rapport spontané, naturel, immédiat, de l’homme au monde. C’est la différence entre notre totalitarisme et les défunts modèles soviétiques et nazis : chez Goebbels, chez Souslov, tout le monde savait qu’il existait une idéologie ; c’était visible, revendiqué, même. Chez nous, cela reste caché. A aucun moment, le capitalisme et le consumérisme contemporain ne se donnent explicitement pour des constructions idéologiques. Le néolibéralisme lui-même se vit comme une simple description du réel. Quand un économiste néolibéral confond profit comptable et richesse, il ne sait pas qu’il opère un choix idéologique ; dans son esprit, c’est pareil, forcément pareil.
Ce qui permet, à mon avis, de prendre conscience du caractère idéologique du mondialisme néolibéral, c’est le rappel tranché, brutal, des alternatives possibles. On ne se sait enfermé dans l’idéologie que quand on en voit le dehors. C’est pourquoi j’ai rappelé qu’il avait existé, et qu’il existait encore, des mondes où l’impératif consumériste en contrepoint de l’impératif productiviste aurait été à peu près complètement dénué de sens – des mondes où le corps était là pour construire la force, et la force nécessaire pour préserver l’esprit. Des mondes, en somme, où l’être se réalise en réalisant sa nature, et non en violant la nature autour de lui. Ce rappel permet de faire comprendre en quoi le mondialisme néolibéral est idéologique : quand on voit le dehors, on comprend qu’on est à l’intérieur de quelque chose, d’une construction, qui n’est pas tout le monde, seulement un certain rapport au monde.
Quant à la question de l’élitisme, à la nécessité d’une forme de purification, il ne faut pas en faire un impératif figé, une sorte d’affirmation par hypothèse, que je donnerais là, au nom de je ne sais quelle autorité imaginaire. Il s’agit surtout dans mon esprit de rendre pensable une alternative, donc de rendre possible l’énonciation du négatif. Que ce négatif soit énoncé à partir d’une alternative élitiste ou non-élitiste, en fait, peu m’importe : à mes yeux, l’essentiel, c’est qu’il soit à nouveau énoncé. C’est la dynamique collective qui doit définir l’alternative au nom de laquelle le négatif est énoncé.
Sous diverses formes (action violente, retraite armée), l’engagement physique tient une place de choix dans les ouvrages du Retour Aux Sources.
Si le Grand Jihad (lutte intérieure contre ses mauvais penchants) doit précéder le Petit Jihad (lutte physique), pourquoi choisir de mettre plus en lumière l’action de révolte – au détriment du cheminement intérieur et individuel qui y mène ?
Vous trouvez que l’engagement physique tient une place de choix ? Pour l’instant, ce n’est que du papier… Plus tard, on verra de quoi il retourne, quand on passera à la pratique.
On sait, grâce à Norbert Elias notamment, que l’interdiction de la violence conduit à un auto-contrôle qui s’étend inexorablement à tous les domaines de la moralité (autocensure,…).
Rejoignez-vous cette idée que, pour redevenir humain, il faut d’abord redevenir barbare ?
Je pourrais vous répondre que les barbares sont généralement contraints à un très fort autocontrôle, puisque leur barbarie peut à tout moment se manifester entre eux. En ce sens, on pourrait tout aussi bien retourner le propos, et dire que pour nous libérer de l’obligation de l’auto-contrôle, il faut au contraire nous re-civiliser.
C’est la Loi qui libère. L’auto-contrôle, l’auto-censure contemporains trouvent leur source dans la disparition de la Loi. On ne sait plus ce qu’on a le droit de dire, de prôner. On ne sait plus où est l’orthodoxie. La Loi existe peut-être, mais elle est fixée si haute, si loin, qu’on ne peut plus la lire, tout au plus la deviner.
Ce que nous devons faire, c’est nous organiser entre nous pour définir une Cité à nous, distincte de la fausse cité définie par le Système. Et dans notre Cité à nous, nous fixerons notre Loi à nous. Et tout le monde pourra la lire, et tout le monde saura ce qu’on peut dire ou ne pas dire, et pourquoi. Alors nous serons libres. Il ne s’agit donc pas d’être barbares : il s’agit d’avoir une ville à nous, pour être civilisés entre nous.
Dans vos livres, l’individualité des personnages et leur temporalité (vie et mort) ne sont que des moyens au service d'une tâche (combat) sans cesse à recommencer. L'assurance de ne pas voir "le jour de la victoire" peut décourager certains de passer à l'action ("A quoi bon?") – mais constitue aussi pour d'autres l'essence de leur engagement (dépassement de la peur de la mort). Comment peut-on (ou pourquoi doit-on) lutter, en ces temps de chaos, dans la joie et l'espérance?
Je n’ai écrit aucun roman, je suppose donc que le « vos » de « vos livres » fait référence ici aux romans publiés par le Retour aux Sources. Ou alors, il s’agit d’Eurocalypse, auquel j’ai participé ?
Bref. En tout cas, à titre personnel, je crois qu’un homme ne peut échapper à l’Absurde qu’en préparant sa mort. C’est sans doute en quoi je suis radicalement étranger à mon époque, d’ailleurs. Je n’arrive pas à comprendre à quoi rime l’existence qu’on nous propose, et qui pourrait se résumer ainsi : vous allez consommer le plus possible pour penser le moins possible à la mort, et quand vous mourrez, ce sera discrètement, dans une chambre d’hôpital, avec des soins palliatifs pour que vous ne fassiez pas de bruit et une euthanasie pour économiser les frais médicaux. Où est l’intérêt ?
 Je trouve qu’une vie intéressante est une vie où l’on se bat, où l’on souffre, où l’on affronte l’adversité, et surtout, où l’on s’affronte soi-même. Je trouve qu’une vie intéressante est une vie difficile. C’est ce qui me donne de la joie, en tout cas, et peut-être de l’espérance ; je me dis que quand je partirai, couché sur un lit à regarder le plafond en sentant le froid qui remonte de mes pieds vers mon cœur, je pourrai dire au patron, dont je suppose qu’il m’attend de l’autre côté : j’ai joué ma partition, maintenant, tu décides pour la suite. Je trouve que ce qui rend la vie intéressante, c’est de se battre pour en arriver là : savoir qu’on a lutté.
Je trouve qu’une vie intéressante est une vie où l’on se bat, où l’on souffre, où l’on affronte l’adversité, et surtout, où l’on s’affronte soi-même. Je trouve qu’une vie intéressante est une vie difficile. C’est ce qui me donne de la joie, en tout cas, et peut-être de l’espérance ; je me dis que quand je partirai, couché sur un lit à regarder le plafond en sentant le froid qui remonte de mes pieds vers mon cœur, je pourrai dire au patron, dont je suppose qu’il m’attend de l’autre côté : j’ai joué ma partition, maintenant, tu décides pour la suite. Je trouve que ce qui rend la vie intéressante, c’est de se battre pour en arriver là : savoir qu’on a lutté.
Donc, en somme, pour répondre à votre question : c’est la lutte qui donne joie et espérance. Il ne s’agit donc pas de trouver joie et espérance pour lutter, mais de lutter pour trouver joie et espérance. Enfin, c’est comme ça que je vois les choses.
On trouve dans Vendetta cette sentence très juste : « On peut tout vouloir (…) à condition de vouloir les conséquences de ce qu’on veut ».
Dans un contexte de tensions réelles, et de surenchère générale – consciente ou ignorée - peut-on réellement vouloir précipiter le chaos?
Le narrateur de Vendetta est un homme absolument désespéré. Et c’est terrifiant : imaginez un monde où on aurait fabriqué des millions de fils uniques narcissiques, shootés à la consommation, plongés dans une absurdité radicale, et du jour au lendemain, réduits à la pauvreté, à l’impossibilité de se délivrer de l’Absurde par la consommation, de l’absence de transcendance par la mondanité. C’est le monde de demain, si la machine économique occidentale tombe complètement en panne, d’un coup, alors que le conditionnement consumériste des populations s’est poursuivi jusqu’au dernier moment.
Alors là, oui, en effet, on va avoir des gens qui pourront tout vouloir…
Vous explorez, à travers l'écriture, deux scenarii envisageables dans un futur proche : version décliniste, l’élite continue de piloter sans rencontrer d’écueil majeur et nous mourrons spirituellement. Version catastrophiste (Eurocalypse), l'accident se produit et laisse place au désastre. Comme les survivalistes, croyez-vous à la possibilité d'un collapse rapidement généralisable? Dans ce cas, pourquoi l'élite prendrait-elle le risque d'un clash intégral, alors que le chaos modéré lui permet de régner?
Je suppose que « l’élite », qui a manifestement créé le chaos, est persuadée qu’elle pourra le contrôler de bout en bout, dans un scénario décliniste. Mais la question, c’est : est-ce qu’elle pourra le contrôler de bout en bout ?
Vous savez, le Système n’est pas aussi fort qu’on le croit. Oh, certes, ce n’est pas nous qui allons le renverser frontalement. Mais le risque est réel qu’il se renverse lui-même. Tenez, imaginez, dans quelques années : révolte au Congrès des USA, audit de la FED, fin du financement de la dette par la dette, faillite des Etats US, réduction drastique du budget militaire étatsunien, évacuation des bases US un peu partout dans le monde. Peu après, l’Iran, délivré de la pression US, annonce disposer de l’arme nucléaire. Une « super-Intifada » traverse les « territoires occupés », le Hezbollah multiplie les attaques contre Israël. La Chine, furieuse que les Occidentaux aient organisé la déstabilisation du Soudan pour en récupérer le pétrole, laisse faire la révolte musulmane, et même la soutient discrètement. Paniquée, Tel-Aviv ordonne au MOSSAD de déclencher une série d’attentats sous faux drapeau, en Europe occidentale, pour obliger les Européens à s’engager massivement au Proche-Orient. La France, dont le président est un certain Dominique Strauss-Kahn, envoie des troupes en Palestine. Les banlieues françaises, du coup, s’enflamment…
C’est un scénario possible, parmi des dizaines qui peuvent nous plonger, très vite et presque sans crier gare, dans un contexte si instable que plus personne ne pourra vraiment le maîtriser. Alors la question, ce n’est pas est-ce que « l’élite » veut le chaos (elle le veut), ni elle est-ce qu’elle pense le maîtriser (elle le pense). La question, c’est : est-ce qu’elle pourra le maîtriser ?
Entre violence de bande synonyme de « refus de l’atomisation imposée par le monde moderne » (M. Maffesoli), et dépouille de blancs nantis interprétée comme de la « lutte des classes qui s’ignore » (A. Soral), la banlieue française est-elle en train de « rappeler au peuple qu’il s’est éloigné de la vertu » (in Vendetta)? Peut-elle, entre islam modéré et frustration exaspérée, constituer un relais de force révolutionnaire?
La banlieue française, peut-on en parler au singulier ? « On » voudrait nous faire croire qu’elle est peuplée majoritairement d’islamo-gangsters violeurs, ce qui est ridicule. Il serait tout aussi ridicule de prétendre qu’elle n’est peuplée que de gens vertueux…
La banlieue française me semble surtout, aujourd’hui, faire l’objet de beaucoup de fantasmes. En pratique, j’ai plutôt l’impression qu’on a affaire à un patchwork très hétérogène, où les forces les plus positives coexistent avec des forces extrêmement négatives. Le jeu, de mon point de vue de « de souche », consiste à nouer des alliances avec les forces positives pour neutraliser et si possible éradiquer progressivement les forces négatives.
D’où, soit dit en passant, l’intérêt d’une démarche comme E&R : il est essentiel que les hommes de bonne volonté réfléchissent ensemble à la manière dont on peut sortir de la situation inextricable où notre classe dirigeante nous a mis. Il s’agit de définir un processus de ré-enracinement des populations déportées chez nous par le capitalisme mondialisé – un ré-enracinement soit ici, soit dans leur pays d’origine, selon les cas, mais toujours dans le respect du droit des gens, sans naïveté mais sans préjugés. Il va falloir que tout le monde y mette du sien.
Votre idée de BAD (Base Autonome Durable), ilot fractionnaire, est pensée comme un système superposable au Système. Une alternative en lisière, reposant sur l'autonomie sécuritaire et médiatique, la construction d'une économie alternative et "une esthétique de la rareté, de la conscience et de la possession de soi". L'autonomie de la communauté y serait assurée par le trinôme Gardes (sécurité), Référents (éducation) et Intendants (production visant l'autarcie). Vous soulignez par ailleurs l'importance du légalisme ("c'est de loin la meilleure subversion").
Pourtant, entre bouc-émissairisation (cf. Tarnac) et accomplissement limité (cf. la Desouchière), la BAD n'est-elle pas une idée "grillée"? Par ailleurs, accepter de ne pas dépasser les bornes du système, n'est ce pas réduire sa marge de manœuvre?
Tout d’abord, je vous ferai remarquer une chose : si j’avais décidé de « dépasser les bornes du système », je ne préviendrais pas…
Ensuite, je reste ouvert à toute autre proposition. Quel concept alternatif à la BAD peut-on me proposer ? Pour l’instant, j’observe qu’on ne m’a rien avancé de bien concluant. Alors la BAD n’est pas la panacée, certes, mais en attendant, c’est une expérimentation à conduire.
Les modes de vie alternatifs existent d'ores et déjà : dans le domaine de l'éducation (écoles Montessori, Steiner, homeschooling,…), de l'autonomie alimentaire (AMAP, magasins de producteurs, …), de l'habitat (auto construction, énergies renouvelables,…),…
Quelle urgence ou nécessité implique de penser l'autonomie sous forme communautaire, comme dans le cas de la BAD ?
Je ne sais pas si la BAD sera nécessairement communautaire. Ce qui est certain, c’est que si vous voulez résister à la pression du Système, il faut que ce soit collectif. Mais communautaire, ce n’est pas obligatoire. On peut très bien imaginer d’ailleurs plusieurs niveaux d’intégration, avec des noyaux communautaires et des entreprises non communautaires gravitant autour, et intégrant progressivement des individus « à cheval », un pied « dans le Système », un pied dehors.
Bref, sur le plan organisationnel, tout est à construire, tout est ouvert. Je crois qu’il faut tester, et c’est l’expérimentation qui nous dira progressivement comment faire.
Nombre de nos camarades s’interrogent sur l’organisation concrète d’une BAD. Se rapproche-t-on des écos-villages développés par Diana Leafe Christian ? Selon vous, qu’elle serait - entre petites structures totalement autarciques et communautés plus poreuses, donc dépendantes -, la taille optimale d’une BAD? Comment y gérer l’humain (« recrutement », sélection, …) en fonction des différentes sensibilités (du néo-baba au survivaliste) ?
Je n’ai pas d’opinion arrêtée sur la taille des BAD. Il est très possible qu’il existe plusieurs « formats » de BAD, et que ces formats présentent tous points faibles et points forts, à étudier selon les circonstances, les choix des individus constituant le groupe, etc. Nous allons d’ailleurs tester prochainement, avec quelques amis, un projet collectif : nous nous ferons un plaisir d’informer E&R Bretagne sur le déroulement de ce projet, ce sera l’occasion d’échanger des expériences.
Cela dit, ce n’est pas la question-clef.
La question-clef, pour moi, ce n’est pas la BAD, mais le réseau des BAD. Là où la démarche « fractionnaire » que je propose se distingue des solutions « survivalistes » ou « écolos » préexistantes, c’est que je ne suggère pas d’installer des BAD ici, là, et là, d’une certaine manière et pas d’une autre. Ce que je suggère, c’est de construire progressivement, par le réseau des BAD, une contre-société.
Pour moi, si un jour on met au point la « BAD idéale », ce sera très bien, mais ce n’est pas l’objectif. L’objectif, c’est par exemple qu’un jour, la population « ordinaire » apprenne qu’il existe désormais un tribunal d’appel pour traiter en deuxième instance tous les litiges que les tribunaux locaux des BAD auront jugés, en fonction d’un code juridique « fractionnaire » (appelez ça autrement si vous voulez, du moment que cela veut dire : séparé, distinct, de l’autre côté d’une ligne imaginaire séparant Système et contre-société). Ce jour-là, le jour où il existera une Loi de la contre-société, je peux vous dire que nous aurons porté au Système que nous combattons le coup le plus rude que nous pouvions lui porter, avec nos faibles ressources : nous aurons repris la parole.
C’est de cela qu’il s’agit. Et comme vous le voyez, ça n’a rien à voir avec les néo-babas.
Pour conclure cet entretien, et avant de laisser nos lecteurs retourner fourbir leurs armes contre l’hétéronomie, avez-vous quelque chose à ajouter ? Une remarque, un conseil de lecture, une recommandation ou une digression sur un sujet de votre choix, …
Peut-être un mot sur votre président, Alain Soral, qui a (encore) des démêlés avec le lobby qui n’existe pas.
Nous ne sommes pas tout à fait d’accord sur cette question : lui, il croit que c’est la question centrale, et moi, je crois qu’elle est très périphérique, même si elle est très perceptible. En outre, peut-être influencé par le protestantisme, je porte sur le monde juif un regard beaucoup plus nuancé que le sien – et même, dans certains cas, un regard de sympathie. J’aurais sans doute, un jour, pas mal de choses à lui dire sur le livre d’Ezéchiel, l’éthique de responsabilité et la question du « contrat » passé entre l’homme et Dieu dans la religion hébraïque… où notre ami pourrait voir que lire Ezéchiel comme un texte « sioniste », c’est faire un léger anachronisme !
Mais, en attendant, je trouve lamentable qu’on attaque quelqu’un en justice pour des propos où il ne fait que formuler une opinion sur l’état du pays et le rôle d’une communauté. Si ces propos sont fallacieux, qu’on en apporte la preuve dans une discussion ouverte et contradictoire. Depuis quand, en France, la justice doit-elle sanctionner les simples opinions ? Il est possible que celles de monsieur Soral soient erronées : eh bien, qu’on le prouve, qu’on déconstruise son propos, qu’on en montre les limites ou les erreurs. Mais la justice n’a pas à intervenir dans le débat d’idées, ou alors, et qu’on nous le dise franchement, nous vivons sous une dictature.
La judiciarisation du débat, en France, devient étouffante. Elle participe d’une entreprise générale d’intimidation des esprits libres. C’est pourquoi, indépendamment de notre opinion sur le fond, nous devons soutenir Alain Soral quand on prétend le faire taire par décision de justice, alors qu’il n’a formulé aucun appel explicite à commettre le moindre acte illégal.
Sinon, après, à qui le tour, et sous quel prétexte ?
Pour E&R en Bretagne,
Mathieu M. et Guytan
00:15 Publié dans Actualité, Entretiens, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : entretiens, france, michel drac, politique, politique internationale, sionisme, europe, affaires européennes, sociologie, théorie politique, sciences politiques, politologie, problèmes contemporains, alain soral |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 07 février 2011
Mircea Eliade über Carl Schmitt und René Guénon
Mircea Eliade über Carl Schmitt und René Guénon
Ex: http://traditionundmetaphgysik.wordpress.com/
Er [Carl Schmitt] sagt mir, er sei ein Optimist in Bezug auf die Zukunft Europas. Nationalismus wie Internationalismus sind gleichermaßen überholte Modelle.
(Eintrag vom Mai 1944, S. 108)
 Die State University of New York Press hat die englische Übersetzung des „portugiesischen Tagebuchs“ (Jurnalul portughez) von Mircea Eliade – er war von 1941-45 rumänischer Botschafter in Lissabon – veröffentlicht:
Die State University of New York Press hat die englische Übersetzung des „portugiesischen Tagebuchs“ (Jurnalul portughez) von Mircea Eliade – er war von 1941-45 rumänischer Botschafter in Lissabon – veröffentlicht:
Mircea Eliade: The Portugal Journal. Translated with a preface and notes by Mac Linscott Ricketts. SUNY Press, 296 Seiten, Hardcover/Paperback, Neu-York 2010.
(Rumänische Ausgaben:
Ernst Jünger hatte in den „Strahlungen“, seinem Kriegstagebuch, Carl Schmitts Bericht von Eliades Besuch in Berlin wiedergegeben (Eintrag vom 15.11.1942, über Jüngers Gespräch mit Schmitt über Eliade wird dieser wiederum am 27.12.1942 informiert, siehe S. 54). In Eliades Tagebuch findet sich nun sein Bericht über die Begegnung, demzufolge Eliade von Schmitts Werk nur „Die romantische Politik“ [recte: Politische Romantik] kenne, die in Rumänien großen Einfluß auf Nae Ionescu und dessen Kreis ausgeübt habe. Aber Schmitt zeigt kein Interesse, das Gespräch in diese Richtung lenken zu lassen, lieber spricht er über die Politik der Regierung Salazars. Allerdings noch mehr lebt Schmitt zu dieser Zeit im symbolischen Gehalt des „Leviathan“ auf (vier Jahre nach Erscheinen des Buches, aber sicher vor allem auch im Hinblick auf die im Jahr 1942 erscheinende weltgeschichtliche Betrachtung „Land und Meer“), erwähnt selbstverständlich „Moby Dick“ und wünscht sich von Eliade entsprechende Literatur über Mythen und Symbolik, insbesondere „Zalmoxis“. Und nun unsere Übersetzung des restlichen Eintrags, der nur auf „Berlin, September [1942]“ datiert ist:
Was mich an Schmitt beeindruckt, ist sein metaphysischer Mut, sein Nonkonformismus, die Weite seiner Sicht. Er bietet uns eine Flasche Rheinwein an und bedauert, daß ich morgen bereits nach Madrid abreise. Er sagt, der interessanteste lebende Mensch ist René Guénon (und er ist erfreut, daß ich ihm zustimme).
(S. 32)
In „Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes. Sinn und Fehlschlag eines politischen Symbols“ (1938, Nachdruck Köln 1982) erwähnt Schmitt bekanntlich Guénons „La crise de la monde moderne“ aus dem Jahr 1927 in einer Fußnote auf S. 44 mit dessen Feststellung daß
„die Schnelligkeit, mit der die ganze mittelalterliche Zivilisation dem Vorstoß des 17. Jahrhunderts unterlag, unbegreiflich sei, ohne Annahme einer rätselhaften, im Hintergrund bleibenden ‘volonté directrice’ und eine ‘idée préconçue’.“
Die von Schmitt zitierte Stelle lautet in der deutschen Übersetzung „Die Krisis der Neuzeit“ (Köln 1950), S. 33:
Wir wollen uns hier nicht unterfangen, den gewiß sehr verwickelten Beweggründen nachzugehen, die sich zu diesem Wandel vereinigten. So grundstürzend war er, daß schwerlich anzunehmen ist, er habe ganz von selbst eintreten können ohne das Eingreifen einer lenkenden Willensmacht, deren wahres Wesen notwendigerweise rätselhaft genug bleibt. Es gibt da Umstände, die im Hinblick darauf doch recht sonderbar sind: Dinge, die in Wirklichkeit längst bekannt waren, werden zu einem bestimmten Zeitpunkt der Allgemeinheit zugänglich gemacht und dabei als neu entdeckte hingestellt; bis dahin waren sie um gewisser ihrer Nachteile willen, die ihre Vorteile aufzuheben drohten, in der Öffentlichkeit unbekannt geblieben.
Schmitt erwähnt dies im Zusammenhang mit den rosenkreuzerischen Verbindungen des offiziellen Vaters der Neuzeit, René Descartes. Interessanterweise hat Schmitt gerade, wie wir seit Mehrings Biographie wissen, in dem Jahr der Enstehung des „Leviathan“ häufiger Julius Evola getroffen (ebenso Johann von Leers, der eine Besprechung des „Leviathan“ für den „Weltkampf“ verfaßt und ironischerweise in den Fünfziger Jahren – wie Guénon – nach Kairo übersiedeln und sich zum Islam bekennen wird.)
 Evola hat 1942 „Il filosofo mascherato“, die Besprechung eines Buches von Maxime Leroy über Descartes’ deviantes Rosenkreuzertum und seine Rolle im Rahmen der Gegeninitiation, in „La Vita Italiana“ veröffentlicht. (Deutsche Übersetzung: Der Philosoph mit der Maske, in: Kshatriya-Rundbrief, Nr. 7, 2000) Schmitts „Leviathan“ besprach Evola bereits 1938 in „La Vita Italiana“ (nachgedruckt in zwei weiteren wichtigen italienischen Zeitschriften). Evola kommt im übrigen in Eliades Tagebuch laut Index nicht vor.
Evola hat 1942 „Il filosofo mascherato“, die Besprechung eines Buches von Maxime Leroy über Descartes’ deviantes Rosenkreuzertum und seine Rolle im Rahmen der Gegeninitiation, in „La Vita Italiana“ veröffentlicht. (Deutsche Übersetzung: Der Philosoph mit der Maske, in: Kshatriya-Rundbrief, Nr. 7, 2000) Schmitts „Leviathan“ besprach Evola bereits 1938 in „La Vita Italiana“ (nachgedruckt in zwei weiteren wichtigen italienischen Zeitschriften). Evola kommt im übrigen in Eliades Tagebuch laut Index nicht vor.
Am 17. Februar 1943 trifft Eliade jedenfalls den Pariser Korrespondenten der „Kölnischen Rundschau“, Dr. Mário, der einst für den „Cuvântul“ geschrieben hat und sich als Freund von Nae Ionescu bezeichnet.
Wir sprachen eine lange Zeit. Er ist gerade aus Paris gekommen. Er scheint kein großer Anhänger von Hitler zu sein. Er ist der Überzeugung, daß René Guénon die interessanteste Person unserer Zeit sei. (Ich glaube das nicht immer, tue es aber oft. Obwohl ich Aurobindo Ghose für „verwirklichter“ halte.)
(…) Ich berichte ihm über mein Gespräch mit Carl Schmitt im Sommer vergangenen Jahres. Er ist überrascht, daß Schmitt Guénon schätzt.
(S.37)
Selbstverständlich finden sich in Eliades Tagebuch zahlreiche Eintragungen über Nae Ionescu, Emil Cioran, Constantin Noica, und im Westen weniger bekannte Vertreter dieses Kreises, und auch über den eigenständigen Religionsphilosophen Lucian Blaga (in dessen Raumkonzeption Schmitt interessante Aspekte zu finden hoffte, den er aber in Bukarest nicht treffen konnte, S. 108).
Zum Kontext des Kreises der „Generaţia nouă“ um ihren Lehrer Nae Ionescu und „Cuvântul“ siehe:
Corneliu Codreanu und die „Federn“ des Erzengels
Constantin Noica, der letzte große Metaphysiker
Cristiano Grottanelli hat das Gespräch Eliade/Schmitt über den abwesenden Guénon bereits zum Thema eines Aufsatzes gemacht:
Mircea Eliade, Carl Schmitt, René Guénon, 1942.
00:05 Publié dans Philosophie, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mirceaeliade, carl schmitt, rené guénon, roumanuie, allemagne, france, mythologie, politologie, théorie politique, sciences politiques, philosophie, métaphysique, tradition, traditionalisme, traditionalisme intégral |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 05 février 2011
De lo politico en el pensamiento de Carl Schmitt

Vamos a comenzar esta parte con la definición de Schmitt de lo político. Como se verá, se trata de un concepto sustancialista asociado al origen de las naciones y a la posibilidad de la guerra. En esta marco, hablaremos del sentido o sinsentido que tendría hablar de una guerra contra la humanidad y, sobre ello, nos referiremos al ‘enemigo absoluto’ desde la distinción entre régimen y Estado. Y esto nos llevará finalmente hacia algunas conclusiones del tipo de la filosofía práctica para los sucesos contemporáneos de la política peruana.
Para comenzar, la definición de Schmitt sobre lo político se basa en el criterio de distinción amigo – enemigo, de la misma forma que la moral requiere de la distinción entre el bien y el mal, y la estética posee el criterio de la distinción entre lo bello y lo feo. Una comparación analógica que no debe significar en ningún caso una equiparación entre lo bueno y el amigo o entre lo malo y el enemigo, de la misma manera que lo bello tampoco puede identificarse ni con lo bueno ni con el amigo. Además, es importante indicar que lo político no se reduce a una identificación con lo estatal, pues en las sociedades democráticas contemporáneas el Estado no tiene el monopolio de lo político sino que ámbitos tales como la religión, la cultura o la economía misma, que son instancias sociales, dejan de ser neutrales y se vuelven potencialmente políticas. Así, el Estado tal y como lo conocemos ya no puede ser considerado como un ámbito distintivo de lo que llamamos precisamente ‘lo político’.
Las razones de un conflicto pueden ser religiosas, culturales o económicas, pero lo que las hace eminentemente políticas es el carácter mismo de conflicto que subyace a la lucha política en cuanto tal. Esto significa que la autonomía de tal criterio no supone necesariamente una independencia en la realidad pero sí supone un diferente modo de ser constitutivo de lo humano. Lo que ocurre es que la manifestación del conflicto en esas otras áreas es sólo la expresión de una naturaleza más originaria del hombre y del Estado. Así, esta concepción esencialista de la política subyace al origen de las naciones cuya naturaleza es entendida desde una perspectiva romántica en tanto que apela a la idea de una especie de sentimientos originarios puros. Desde esta perspectiva es que se afirma que los pueblos se definen en tanto que se agrupan como amigos y por negación de sus enemigos.
Ahora bien, el surgimiento de las nacionalidades y de los Estados – nación es un hecho que, generalmente, tendemos a ubicar en la Reforma Luterana. Sin embargo, el carácter conflictivo de la naturaleza política en su sentido óntico parecería estar inscrito en todo individuo si nos ceñimos a la concepción sustancialista de Schmitt. Por lo tanto, los Estados – nación que conocemos no serían sino una de las últimas expresiones de este concepto de lo político. Estados que, incluso, al ser invadidos por la sociedad civil, como se ha señalado, no suponen ya una identificación simple con el hecho político.
De la misma forma, este carácter esencial de la distinción amigo – enemigo también se puede referir a las diferencias partidarias que se producen en el interior de un Estado. Así, no se entienden como simples discusiones sino que la “lucha partidaria” conlleva necesariamente la idea de “lucha hostil”, entendida ésta como posibilidad eventual siempre presente dada su naturaleza existencial. Por ello, desde esta perspectiva, el nivel máximo de la enemistad encuentra su cumplimiento en la guerra, ya sea como guerra externa o como guerra civil. Esto no hay que entenderlo en el sentido de Clausewitz, para quien la guerra no era sino la continuación de la política por otros medios. Sino que ha de comprenderse en el sentido de que la guerra es el presupuesto de la política en tanto que es una posibilidad real siempre presente a partir de la cual se origina la misma conducta política.
Así, se puede considerar que Schmitt no tiene propiamente un discurso belicista mi militarista pues asume que, incluso, una actuación políticamente correcta en contra de la guerra presupondría la distinción amigo – enemigo. También la neutralidad conlleva la posibilidad de que el Estado neutral pueda aliarse con otro Estado como amigo en contra de otro que considera como enemigo. Esto significa un concepto esencialista de la política pero que no resulta determinante de una realidad concreta sino que permite diversas formas de realización existencial. Aunque la definición de Schmitt de lo político no significa por sí mismo un criterio valorativo, puede permitir pensar de manera valorativa la acción política. Una tal valoración a posteriori no anula la descripción a priori ni viceversa. Tampoco debemos entender el principio sustancial de la relación amistad – enemistad como un principio zoológico a la manera de Hobbes, quien repetía la famosa sentencia homo homini lupus, sino que la determinación existencial sobre quién en concreto es el amigo y quién el enemigo procede invariablemente de la libertad del hombre que le es consustancial. Por lo cual, la sentencia latina antes señalada resulta ser cambiada por la afirmación de que “el hombre es el hombre para el hombre”.
Aunque la definición del enemigo depende del ejercicio de dicha libertad en el marco de las agrupaciones políticas, tal libertad no puede llegar razonablemente al punto en que se pueda pensar en una lucha de la humanidad toda en su conjunto pues, entonces, ¿quién sería el enemigo? Ni siquiera el enemigo deja de ser hombre de modo que no hay aquí ninguna distinción específica”.
Si pensamos en la humanidad como el conjunto de todos los seres humanos es imposible pensar en un enemigo de tal humanidad de forma que toda ella pueda agruparse frente a un enemigo común en el sentido de otra agrupación o pueblo de hombres.
Sería posible pensar en un enemigo de la humanidad en el sentido de alguien que desee exterminar la raza humana por considerarse un ser superior más que humano. Sin embargo, Schmitt podría responder que esta última disquisición no tiene que ver con su criterio teórico en tanto que principio distintivo de carácter óntico, sino que podría explicarse como una retórica política que pretende justificar una guerra apelando a un conjunto de nociones alteradas de la idea propia de humanidad. En ese sentido, también aquellos que actuarían en las guerras posteriores bajo la idea de que están defendiendo tal humanidad, lo que en realidad hacen, por contrapartida, es convertir al enemigo en un ser inhumano por razones morales y proclamar su necesario aniquilamiento. Se trata, en este último caso, de la utilización de un criterio moral en un área distinta de la suya, subsumiendo lo político de tal forma que el enemigo termina siendo degradado a la condición de criminal. Una intromisión de discursos que, en realidad, se podría entender como una manipulación del discurso moral para justificar una agresión de carácter hegemónico o en pro de un imperialismo económico. De esta manera, el concepto de humanidad no sólo se impondría acríticamente eliminando el significado de lo político mismo, sino que, además, se convierte en uno de los tantos conceptos ideológicos antifaz hechos para justificar lo injustificable.
Si pensamos estrictamente en una reducción de lo político a categorías morales tal como lo entiende Schmitt, se ha convertido al enemigo en criminal de guerra. Pero habría que diferenciar si se trata de una ideologización previa (como cuando Bush hablaba de la “libertad infinita”), con lo cual la intromisión de lo moral en lo político resulta ser simplemente tendenciosa e hipócrita; o si se trata de la consecuencia de la violación de los usos de la guerra del Derecho Internacional establecido. Una cosa es un gobierno genocida y otra cosa es una unidad política cuya existencia va más allá de un régimen eventual y pasajero. No era lo mismo combatir a los nazis que luchar contra Alemania ¿o acaso correspondió el holocausto con una forma de ser de la unidad política alemana? Por consiguiente, la criminalización del enemigo no puede significar la criminalización de todo un país o una nación. Una absolutización del concepto de enemigo que sí ha ocurrido en la retórica del caso de Irak con la estigmatización del Islam y, en consecuencia, con la criminalización de tal religión.
Por otro lado, en la obra El concepto de lo político, redactada en el período de entreguerras, se criticaba a la liga existente en aquellos años por confundir lo interestatal con lo internacional. El primero de estos conceptos se refiere a la garantía del status quo de las fronteras nacionales por parte de la Liga. Pero el concepto de internacional, como en el caso de la Internacional Socialista, supone una sociedad universal despolitizada al responder a la tendencia imprecisa de buscar el Estado único como un postulado ideal. Para Schmitt queda claro que sólo un Estado ideal apolítico, es capaz de dar tal paso y convertir el enemigo en un criminal.
Sin embargo, tal Estado es para Schmitt una imposibilidad práctica, aunque se preconice teóricamente. Las tendencias hacia esta situación vienen del lado de un liberalismo individualista que, buscando eliminar todo lo que puede coaccionar su libertad (incluyendo el propio Estado y su correspondiente monopolio organizado de la violencia legítima), termina por entronizar el imperio de lo económico y poniendo el aspecto ético – espiritual en la dinámica de una eterna discusión. Precisamente por el lado de lo económico es que tal Estado único resulta ser tan sólo una ficción pues lo que ocurre, en realidad, es que la economía se vuelve en un hecho político al desarrollar nuevos tipos de oposición que llevarían claramente a la guerra, aunque ésta no deba ser entendida necesariamente en el sentido de la lucha de clases marxista. Lo mismo ocurre bajo la idea de declarar una “guerra contra la guerra”, pues ello haría dividir la humanidad entre dos agrupaciones políticas y el criterio amigo – enemigo seguiría siendo la distinción específica de lo político. Ningún autoproclamado Estado universal podría anular lo que es una naturaleza de carácter óntico. Sólo podrá haber el intento de una agrupación de países de apropiarse del derecho a la guerra estructurando el Derecho Internacional bajo sus propios intereses. Así se entiende a la ley positiva como la búsqueda de la legitimación de una situación en la que los interesados sólo pretenderían encontrar estabilidad para su ventaja económica y poder político aunque lo disfracen de discursos moralistas.
Para Schmitt, a pesar de la voluntad de los juristas internacionales de que esto no sea así, ningún sistema de leyes puede evitar la diferenciación sustancial entre enemigos que presupone la guerra. Esto no significa que no se deba trabajar en beneficio de un nuevo orden que establezca “nuevas líneas de amistad” entre los pueblos, al margen de la eficacia o ineficacia de la actual ONU. Para Schmitt, el error está en que el organismo surgido de la Segunda Guerra Mundial fue una construcción de los vencedores que creyeron que su victoria era la victoria definitiva y ello los incapacitaba para poder plantear nuevas respuestas a los Challenges de la historia. ¿No son los sucesos contemporáneos, además de un nuevo Challenge, una nueva llamada de atención sobre la futilidad de un modelo liberal de carácter monista? Schmitt vislumbró que el orden futuro del mundo se convertiría en un pluralismo multipolar y que, aquello que marcará el desarrollo de los grandes espacios, dependerá de la fuerza en que una agrupación de pueblos o de naciones puede mantener el proceso de desarrollo industrial siendo fieles a sí mismos y no sacrificando su identidad por el carácter tecnológico de dicho desarrollo, “no solamente por la técnica, sino también por la sustancia espiritual de los hombres que colaboraron en su desarrollo, por su religión y su raza, su cultura e idioma y por la fuerza viviente de su herencia nacional”.
En otras palabras, que el orden del globo dependerá de un comunitarismo amplio de mundos de la vida fuertes ante toda racionalización sistémica dominante de la techne y el progreso.
Ahora bien, las consecuencias de esta reflexión para la comprensión de los sucesos políticos contemporáneos que nos impelen directamente deberían ser más que evidentes. Tanto si hablamos de los sucesos de Bagua, como de la situación del VRAE o de las relaciones entre el Perú y los demás Estados en los momentos de una aparente carrera armamentista. Una vez que el Estado peruano ha sido invadido por la Sociedad Civil, se pierde paulatinamente el principio del monopolio de la violencia. ONGs, movimientos políticos de naturaleza anarquista con características delictivas, así como partidos de carácter revanchista que estigmatizan al Estado colaboran para la destrucción de cualquier tipo de unidad sustancial o espiritual nacional que debería personalizar nuestro sistema político. Así se termina haciéndole el juego al liberalismo económico y político internacional cuyo resultado no puede ser otro que la crisis mundial.
El ideal de nuestro Estado ha de ser que las formas políticas expresen nuestra herencia cultural y ello no parece haber ocurrido precisamente a lo largo de nuestra república en todo sentido. El desprecio por comunidades andinas o del oriente peruano de parte de un régimen que, por ejemplo, se dedica principalmente a Tratados de Libre Comercio, significa, a la larga, una destrucción física y moral que justificaría una lucha constante contra este sistema. Ello, por supuesto con las salvedades apropiadas: no se justifica ninguna intervención extranjera ni tampoco el terrorismo indiscriminado porque eso precisamente destruye las comunidades que pretendemos defender.
Por otra parte, así como las Convenciones por sí solas no son suficientes para evaluar la justicia en la Guerra, la terquedad en aferrarse a leyes positivas es una ingenuidad jurídica, además de ser un abandono de las experiencias humanas morales que están a la base de cualquier sistema de Derecho. Las relaciones entre personas son más primigenias que las relaciones jurídicas y esto es algo que se ha olvidado tanto en el ámbito internacional como en el ámbito de nuestro país. Asimismo las políticas de la amistad no pueden ser tan ingenuas como para creer que no va a haber conflicto porque nos sometemos a los Tratados
Es en esta línea en que se debe plantear la cuestión de los Derechos. Tan malo es una imposición jurídica de Derechos entendidos en sentido liberal moderno a la manera norteamericana, como el desprecio por la vida y la libertad. Así, la defensa de la comunidad debe verse como defensa de la riqueza cultural, alimentada por la naturaleza material propia. Ni la salvaguarda de un modelo liberal ni la repetición de rebeliones de países vecinos resulta auténtica.
Bagua, el VRAE o lo que se venga en las relaciones internacionales es y será precisamente el resultado de este conflicto irresoluble sintéticamente entre la globalización y la defensa de la comunidad. Así, hemos asistido, y probablemente seguiremos asistiendo, a conflictos sociales con el peligro de que devengan en cosas mayores; y todo es y será el resultado tanto del eterno y dinosáurico paternalismo económico que, no solo está fuera de nuestras fronteras, sino que está dentro y que, incluso, nos gobierna, así como de la marginación y el caos burocrático. Razón que nos lleva a repetir una vez más, junto con las encíclicas sociales de la Iglesia Católica que “No habrá paz sin una verdadera justicia social”.
00:05 Publié dans Philosophie, Révolution conservatrice, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : révolutionconservatrice, carl schmitt, politologie, philosophie, allemagne, sciences politiques, politologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook