lundi, 12 avril 2010
Derechos humanos, propaganda moralista
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 2001
Derechos Humanos, propaganda moralista
 Aparato central de la ideología moderna del progreso y del igualitarismo individualista, y medio por el cual se instaura una policía del pensamiento así como la destrucción de los derechos de los pueblos.
Aparato central de la ideología moderna del progreso y del igualitarismo individualista, y medio por el cual se instaura una policía del pensamiento así como la destrucción de los derechos de los pueblos.
Síntesis de la filosofía política (a menudo mal entendida) del siglo XVIII, la propaganda moralista es el horizonte inevitable de la ideología dominante. Con el antirracismo, funciona como uno de los dispositivos centrales del acondicionamiento mental colectivo, del pensamiento facil y de la parálisis de toda rebelión. Profundamente hipócrita, la ideología de los derechos humanos se adapta a todas las miserias sociales y justifica todas las opresiones. Funciona como una verdadera religión laica. "el hombre" es aqui un ser abstracto, un consumidor- cliente, un átomo despojado de sus lazos comunitarios y de sus propiedades diferenciales. Es sorprendente constatar que la ideología de los derechos humanos fue formulada por la Convención de la Revolución francesa en imitación de los puritanos americanos.
La ideología de los derechos humanos consiguió legitimarse basándose en dos imposturas históricas: la de la caridad y la filantropía, así como la de la libertad.
"El hombre" (concepto ya bastante vago) no posee derechos universales y fijos, sino solamente los que se derivan de cada civilización, de cada tradición. A los derechos humanos, es necesario oponer dos conceptos centrales: el de los derechos del pueblo (o "derecho de gentes") a la identidad, y el de justicia, este último concepto siendo variable según las culturas y suponiendo que todos los individuos son también respetables. Pero estos dos conceptos no podrían basar en la preconcepción de un hombre universal abstracto, sino más bien en el de hombres concretos, situados en culturas particulares.
Criticar la religión laica de los derechos humanos no es obviamente hacer la apología de la barbarie, puesto que la ideología de los derechos humanos garantizó en varias ocasiones la crueldad y la opresión (la masacre de los Vendeanos o de los Indios de América). La ideología de los derechos humanos fue muy a menudo el pretexto de persecuciones. En nombre del "bien".
No representa de ninguna manera la protección del individuo, no más que el comunismo. Al contrario, se impone como un nuevo sistema opresivo, fundado sobre libertades formales. En su nombre, se va a legitimar, el menosprecio de toda democracia, la colonización poblacional de Europa (cualquiera tiene el "derecho" a instalarse en Europa), la tolerancia hacia las delincuencias liberticidas, las guerras de agresión (Serbia, Irak, etc) que se reclaman en el "derecho de injerencia", la inexpulsabilidad de los trabajadores colonizadores; pero esta ideología no se pronuncia sobre la contaminación masiva del medio ambiente o sobre el caos social causado por la economía globalizada.
Y sobre todo, la ideología de los derechos humanos es un medio hoy estratégico para desarmar al pueblo europeo culpabilizándolo en todos los ámbitos. Es la legitimación del desarme y la parálisis. Los derechos humanos son una especie de inversión perversa de la caridad cristiana y el dogma igualitario según el cual todos los hombres se salvarian.
La ideología de los derechos humanos es el arma central actual de destrucción de la identidad de los pueblos y de la colonización alogena de Europa.
[Texto extraído del libro de Guillaume Faye: Pourquoi nous combattons, l'Aencre 2001.]
00:05 Publié dans Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle droite, droits de l'homme, philosophie, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 11 avril 2010
La Légion Nationale / Het Nationaal Legioen
La Légion Nationale / Het Nationaal Legioen
 De eerste Derde Weg-beweging in België was het zeer radicale Nationaal Legioen of Légion Nationale, dat in mei 1922 ontstond uit de Fraternelles (oudstrijdersbonden) en vanaf midden 1924 opbloeide onder impuls van de Luikse ex-christen-democraat, advocaat, oorlogsvrijwilliger en voormalig officier Paul Hoornaert (1888-1944). Vanaf 1927 werd het Legioen geleid door hem en zijn compagnon Breughelmans.
De eerste Derde Weg-beweging in België was het zeer radicale Nationaal Legioen of Légion Nationale, dat in mei 1922 ontstond uit de Fraternelles (oudstrijdersbonden) en vanaf midden 1924 opbloeide onder impuls van de Luikse ex-christen-democraat, advocaat, oorlogsvrijwilliger en voormalig officier Paul Hoornaert (1888-1944). Vanaf 1927 werd het Legioen geleid door hem en zijn compagnon Breughelmans.
Voornoemde Fraternelles verenigden voormalige soldaten van het IJzerfront en zagen de opgang van socialisme, algemeen stemrecht en flamingantisme met lede ogen aan. In de jaren 1920 evolueerden de Belgisch-nationalistische kringen in de richting van Derde Weg-ideologieën. Zo ontstonden naast het Nationaal Legioen/Légion Nationale ook de Action Nationale van de katholieke senator Pierre Nothomb, het Légion Patriotique en de Faiseau Belge. Allen werden daarbij aanvankelijk sterk geïnspireerd door de Franse Action Française van Charles Maurras en later door de machtsovername van Derde Weg-bewegingen in Italië en Portugal. De meeste leden van Nothombs Action Nationale liepen over naar het Legioen.
Het Nationaal Legioen/Légion Nationale was met 5.000 leden en afdelingen in heel België een sterke organisatie. Aanvankelijk was het ideologisch en organisatorisch sterk beïnvloed door het Italiaanse fascisme. Het Legioen wou een nationale revolutie om in België een Nieuwe Orde te installeren, waarbij de politieke partijen en het parlement zouden vervangen worden door een krachtdadige regering onder leiding van de koning. Verder was het Legioen antimarxistisch, antiparlementair, antisemitisch, Belgisch-nationalistisch, royalistisch en wees iedere deelname aan verkiezingen af. Echte toenadering tot Degrelles Vlaams-Waalse partij Rex was dan ook onmogelijk.
Hoornaert richtte de gedisciplineerde en op Italiaanse leest geschoeide militie Services de Protection op, met helmen, knuppels en donkerblauwe uniformen en geleid door ‘commandanten’. Dit was de éérste militie in België en ze schuwde gewelddadige confrontaties met flaminganten, socialisten en communisten niet. De militie veranderde later haar naam in Groupes Mobiles en vanaf 1934 in Nationalistische Jonge Wacht/Jeunes Gardes Nationalistes.
 Het Nationaal Legioen/Légion Nationale was onderverdeeld in centuriën en gebruikte de Romeinse groet en de fasces. Naast een eigen militie had het ook ‘sportafdelingen’ (die de facto voor paramilitaire training zorgden). Dit laatste werd door de Wet op de Privé-milities van 1934 aan banden gelegd, hoewel dit geenszins de verdere groei van het Legioen hinderde. De leden legden de eed van trouw af aan Vorst, Volk en Vaderland en droegen ook een ring van het Nationaal Legioen.
Het Nationaal Legioen/Légion Nationale was onderverdeeld in centuriën en gebruikte de Romeinse groet en de fasces. Naast een eigen militie had het ook ‘sportafdelingen’ (die de facto voor paramilitaire training zorgden). Dit laatste werd door de Wet op de Privé-milities van 1934 aan banden gelegd, hoewel dit geenszins de verdere groei van het Legioen hinderde. De leden legden de eed van trouw af aan Vorst, Volk en Vaderland en droegen ook een ring van het Nationaal Legioen.
Verder had het Nationaal Legioen/Légion Nationale veel invloed in het Belgische leger, waarin het opereerde onder de naam MDS (Le Mot du Soldat). Tijdens de Tweede Wereldoorlog vormde MDS zich om tot een geheime postdienst voor het verzet (cfr. infra). De beweging was ook betrokken bij de mislukte staatsgreep van Rex-leider Léon Degrelle op 25 oktober 1936 en onderhield nauwe banden met vermoedelijk zowel de Belgische als Franse inlichtingendiensten.
Hoewel het Legioen vooral sterk stond in Franstalig België, had het toch ook in Vlaanderen enige aanhang. Zo had het Nationaal Legioen in Gent een secretariaat aan de Nederkouter 32 en werd reeds in 1924 een afdeling in Antwerpen opgericht, die vanaf 1929 opbloeide toen het Nederlandstalige ledenblad Het Belgisch Nationaal Legioen verscheen. Deze periodiek kende een aantal naamsveranderingen: Het Nationaal Legioen (1934), Het Legioen (1935) en Storm (1939). De verantwoordelijke voor dit blad was de Deurnse uitgever-publicist Raymond Gilbert. Onder de leiders van de Antwerpse Legioen-afdeling vinden we Melchior Peeters en H.C. Frederiks als propagandaleiders en de ex-flamingant Arthur Rotsaert, die overgestapt was van de Action Nationale. Ook sommige andere Antwerpse Legioen-leiders, zoals de advocaten René Lambrichts, Edouard Van Lil en Ferdinand Van de Vorst, waren afkomstig uit de kringen rond Pierre Nothomb. Bij de gewone leden van het Antwerpse Legioen was er een sterke katholieke inslag.
De Antwerpse afdeling was gevestigd in het Nationaal Huis in de Lange Gasthuisstraat 42, waarin ook een andere Antwerpse Belgisch-nationalistische organisatie, de Jonge Belgen/Jeunes Belges, gevestigd was. De Jonge Belgen gingen in de eerste helft van de jaren 1930 grotendeels op in het Legioen. Zo was Antwerps Legioen-gouwleider André Van Meel afkomstig uit de Jonge Belgen, evenals de Franstalige edelman Charles Decallone en de Belgisch-nationalistische militante Yvonne Mabesoone.
Na de Duitse bezetting van België in 1940 weigerde het virulent anti-Duitse Nationaal Legioen/Légion Nationale te collaboreren, maar ging daarentegen in het verzet. De Duitsers lieten het Legioen aanvankelijk met rust. Vergaderingen en oefenkampen, zelfs in uniform, bleven mogelijk. Toen de bezetters merkten dat ze het Legioen niet in een knechtenrol zoals de Eenheidsbeweging-VNV of Rex konden duwen, werd in augustus 1941 een compleet activiteitsverbod opgelegd. Vanaf dat ogenblik zat het Legioen in de clandestiniteit. In september 1941 ondernamen de Duitsers een enorme razzia in heel het land, waarbij ruim 200 Legioen-leiders werden gearresteerd. Velen daarvan belandden definitief in concentratiekampen. Leider Paul Hoornaert werd in 1941 door de Gestapo opgepakt en stierf in 1944 in het Duitse concentratiekamp Sonnenburg. Het volledige Legioen werd in juni 1941 onder de naam Groep Hoornaert-Dirix in het vanuit Londen gedirigeerde Geheim Leger opgenomen en verspreidde onder andere illegale pamfletten, pleegde sabotage en bespioneerde Duitse troepenbewegingen.
Het getuigt dan ook zonder meer van een gebrek aan historische kennis dat toenmalig Minister van Defensie André Flahaut tijdens een plechtigheid van de Koninklijke Verbroederingen van het Geheim Leger op 28 april 2002 de voormalige verzetstrijders loofde om hun “toewijding aan de democratische zaak” en hen tevens waarschuwde voor de volgens hem opkomende antidemocratische tendenzen. En wel om de simpele reden dat de kern van het Belgische verzet zo zwart als de nacht was, iets wat na de oorlog ‘vergeten’ werd omdat dit soort clichés politiek bruikbaar was. Het Belgische verzet ontstond immers vooral uit Belgisch-nationalistische motieven en was antidemocratisch …
00:10 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : belgique, belgicana, flandre, wallonie, années 20, années 30, nationalisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
El liberalismo y la semilla de la destruccion
EL LIBERALISMO Y LA SEMILLA DE LA DESTRUCCIÓN
"Cuando la idea de la propiedad descaece, el sentido de la familia se disuelve en nada. Quienquiera impugna la primera, ataca también a la segunda. La idea de herencia, adherida a la existencia de todo cortijo, todo taller y toda antigua firma comercial, así como a las profesiones continuadas de padres a hijos, y que ha encontrado su más alta expresión simbólica en la monarquía hereditaria, garantiza la fortaleza del instinto de raza."
OSWALD SPENGLER
Pocos intelectuales han sido tan certeros como nuestro Donoso Cortés ante la cuestión de diagnosticar -y en ocasiones profetizar- la naturaleza del tumor maligno que, ya a mediados del siglo XIX, carcomía el alma de nuestra civilización mediante la propagación de las ideas racionalistas.
Y es que Donoso, en un alarde de preclara objetividad, mostró hasta qué punto el utillaje ideológico de la escuela socialista fue extraído de la escuela liberal; la única diferencia estriba en que aquélla se atrevió a hacer explícitas las últimas consecuencias que ya anidaban, bien que de forma implícita, en los dogmas de ésta. Podríamos decir, pues, que el gran mérito del socialismo fue que llegó a ser más consecuente que su progenitor ideológico: simplemente, dio una vuelta de tuerca más a un programa liberal que, por mucho que sus acérrimos defensores lo nieguen, llevaba en su seno la semilla de la destrucción.
Conviene repasar, sin embargo, algunos de los textos que nos legó este genial escritor. En especial, ciertos capítulos publicados en su obra "Ensayo sobre el Catolicismo, el Liberalismo y el Socialismo", donde expresa con argumentos inatacables cómo la "igualdad" que preconizaban las corrientes liberales, en la que se incluía una concepción materialista e insolidaria de la sociedad, desembocaban irremediablemente en la disolución de la familia y la consiguiente expropiación económica por parte del Estado (que es, precisamente, la piedra angular de todo el andamiaje socialista). Escuchemos a Donoso:
"De aquí se deducen las siguientes consecuencias : Siendo los hombres perfectamente iguales entre sí, es una cosa absurda repartirlos en grupos, como quiera que esa manera de repartición no tiene otro fundamento sino la solidaridad de esos mismos grupos, solidaridad que viene negada por las escuelas liberales como origen perpetuo de la desigualdad entre los hombres. Siendo esto así, lo que en buena lógica procede es la disolución de la familia : de tal manera procede esta disolución del conjunto de los principios y de las teorías liberales, que sin ella aquellos principios no pueden realizarse en las asociaciones políticas."
Otros de los aspectos en los que incide Donoso es en el "giro copernicano" que el liberalismo otorgó al significado de la propiedad. Antes de la irrupción del racionalismo, el sentido de la propiedad se hallaba indisolublemente unido al símbolo familiar; de esta suerte, era la propiedad hereditaria y lo que ésta representaba quien "poseía" al titular de la misma. En cambio, con la aparición de las ideas liberales esta relación se invierte: ahora es el "individuo"- esa abstracción que tanto daño ha causado a nuestra perspectiva histórica- el que posee una propiedad que, desligada del elemento hereditario y familiar, se transforma en mera cosa. El tránsito del patrimonio raigal al dinero queda así abierto. De nuevo Donoso nos alerta de la enorme trascendencia de este cambio de mentalidad:
"Pero la supresión de la familia lleva consigo la supresión de la propiedad como consecuencia forzosa. El hombre, considerado en sí, no puede ser propietario de la tierra, y no puede serlo por una razón muy sencilla : la propiedad de una cosa no se concibe sin que haya cierta manera de proporción entre el propietario y su cosa, y entre la tierra y el hombre no hay proporción de ninguna especie. Para demostrarlo cumplidamente bastará observar que el hombre es un ser transitorio, y la tierra una cosa que nunca muere y nunca pasa. Siendo esto así, es una cosa contraria á la razón que la tierra caiga en la propiedad de los hombres, considerados individualmente. La institución de la propiedad es absurda sin la institucion de la familia (...) La tierra, cosa que nunca muere , no puede caer sino en la propiedad de una asociación religiosa ó familiar que nunca pasa. (...) La escuela liberal, que de todo tiene menos de docta, no ha comprendido jamas que siendo necesario para que la tierra sea susceptible de apropiación, que caiga en manos de quien pueda conservar su propiedad perpetuamente, la supresión de los mayorazgos y la expropiación de la Iglesia con la cláusula de que no pueda adquirir es lo mismo que condenar la propiedad con una condenación irrevocable. (...) La desamortizacion eclesiástica y' civil, proclamada por el liberalismo en tumulto, traerá consigo (...) la expropiación universal. Entonces sabrá lo que ahora ignora : que la propiedad no tiene razón de existir sino estando en manos muertas, como quiera que la tierra, perpetua de suyo, no puede ser materia de apropiación para los vivos que pasan, sino para esos muertos que siempre viven."
Ahora bien, tras conseguir el objetivo de desarraigar a los hombres, la "sociedad"-o lo que queda de ella- se convierte en un despojo compuesto por "individuos" aislados y anónimos. Así es como el siglo XX conoció la disputa, puramente económica, entre el "liberalismo" y el "socialismo", esto es, entre los "individuos" y el Estado. Y si hoy en día se sigue hablando de la victoria del liberalismo frente al estatalismo soviético tras la caída del muro de Berlín, es porque se ignora la deriva estatalista que las democracias "liberales" impulsaron, sobre todo a mediados de siglo, merced a las modernas teorías del Estado Social. De ahí la sorprendente actualidad de las proféticas conclusiones de Donoso:
"Cuando los socialistas, despues de haber negado la familia como consecuencia implícita de los principios de la escuela liberal ,- y la- facultad de adquirir en la Iglesia, principio reconocido así por los liberales como por los socialistas, niegan la propiedad como consecuencia última de todos estos principios, no hacen otra cosa sino poner término dichoso a la obra comenzada cándidamente por los doctores liberales. Por último, cuando despues de haber suprimido la propiedad individual el comunismo proclama al Estado propietario universal y absoluto de todas las tierras, aunque es evidentemente absurdo por otros conceptos , no lo es si se le considera bajo nuestro actual punto de vista. Para convencerse de ello basta considerar que, una vez consumada la disolucion de la familia en nombre de los principios de la escuela liberal , la cuestion de la propiedad viene agitándose entre los individuos y el Estado únicamente. Ahora bien: planteada la cuestion en estos términos, es una cosa puesta fuera de toda duda que los títulos del Estado son superiores á los de los individuos, como quiera que el primero es por su naturaleza perpetuo, y que los segundos no pueden perpetuarse fuera de la familia."
00:10 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, révolution conservatrice, libéralisme, déclin, décadence, théorie politique, sciences politiques, politologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Le mandat d'arrêt européen, une arme pour l'Europe libérale?
 Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 2004
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 2004
Le mandat d'arrêt européen, une arme pour l'Europe libérale ?
« La loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en application des actes pris sur le fondement du Traité sur l'Union européenne. » Ainsi complété l'article 88-2 de la constitution (1), autorisera la transposition en loi nationale et la mise en oeuvre au 1er janvier 2004 d'une décision-cadre de l'union européenne, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres.
Créer un un espace de liberté, de sécurité et de justice
Cette décision-cadre s'inscrit dans la démarche engagée en 1997 lors de la signature du traité d'Amsterdam, qui faisait de la création d'un espace « de liberté, de sécurité et de justice » un des objectifs déclaré de l'Union européenne. Deux solutions étaient alors envisagées : l'harmonisation progressive des législations pénales des Etats membres ou bien la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires. Sous la pression britannique, le conseil des 14 et 15 juin 1998 à Cardiff, demandait l'évaluation du bénéfice de l'extension de la notion de reconnaissance mutuelle aux décisions en matière pénale, notion déjà bien connue, et éprouvée dans l'espace communautaire dans le domaine commercial et civil. Le conseil de Tampere, en octobre 1999, décida d'appuyer ce principe.
Après les évènements du 11 septembre 2001, fut réuni en toute hâte (2) le conseil des ministres chargés de la justice et des affaires intérieures. Il aboutit à un accord politique qui se traduisit par l'adoption, le 13 juin 2002, de la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres. Particulièrement vague en matière de terrorisme, il permet une interprétation très large et pour le moins dangereuse. Sont ainsi considérés comme infractions terroristes, des « actes intentionnels qui, par leur nature ou leur contexte, peuvent porter gravement atteinte à un pays ou à une organisation internationale », et sont commis « dans le but de gravement intimider une population » ou de « contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir une acte quelconque » ou enfin de « gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou d'une organisation internationales. » Cette définition permet, en fait, de considérer comme élément spécifiant une infraction terroriste, toute opposition active au pouvoir, toute manifestation anti-système, du simple mouvement social à la lutte syndicale elle-même (3).
Un mandat plus répressif et plus expéditif
C'est donc dans ce contexte que le mandat d'arrêt européen s'apprête à entrer en scène pour se substituer à la procédure normale d'extradition. Cette dernière reposait sur plusieurs principes censés garantir la protection des individus tels que l'exigence de la double incrimination (4), le contrôle politique (décision du gouvernement quant à l'opportunité politique de la procédure) et bien sûr le contrôle judiciaire qui portait sur la matérialité des faits et la légalité de la demande. Or, avec le mandat d'arrêt européen, on privilégie le développement de procédures plus répressives et surtout plus expéditives.
En effet, le principe de double incriminations disparaît pour trente-deux infractions considérées comme grave par la décision-cadre, dont notamment le terrorisme, le trafic de drogues, d'armes, le blanchiment, etc... mais, comme par hasard, pas l'abus de confiance (sic) - les cols blancs pourront donc dormir tranquilles ! Ainsi, à partir du 1er janvier 2004, il ne sera pas exclu, de voir par exemple un juge français recevoir un mandat d'arrêt lui demandant de remettre telle ou telle activiste ou syndicaliste vivant sur le territoire français qui aurait participé à l'occupation d'un site ou à une manifestation à Gênes, et qui relèverait en droit Italien d'activité assimilable au terrorisme. La procédure, exclusivement judiciaire, se réduit alors au simple contrôle de la régularité formelle du document ; ce qui revient à rendre quasi automatique l'extradition sans que l'Etat ne puisse s'y opposer, sauf à risquer de violer le droit.
De plus, est également concernée par une telle procédure, toute personne soupçonnée d'avoir commis un crime puni d'au moins un an d'emprisonnement, ou étant condamnée à quatre mois ferme. Finalement, et même si dans ces cas là la règle de la double incrimination reste de mise, ce sera pratiquement l'ensemble des infractions du Code pénal français qui sera touché. Et c'est d'autant plus grave encore qu'avec le mandat d'arrêt européen disparaît le principe de spécialisation. Principe qui liait l'extradition au chef d'inculpation. En d'autres termes, on ne pouvait être condamné pour des faits autres que ceux explicitement mentionnés dans la demande d'extradition. Avec le mandat, l'Etat requérant l'extradition est délié de la qualification de l'incrimination qu'il a fourni. Un mineur britannique, réfugié dans un des États membres par exemple, pourrait alors être livré au Royaume-Uni pour des faits de grève, et poursuivi, une fois extradé, sur la base de lois anti-terreur bien plus sévères.
Adapter la constitution pour respecter un décret !
Le remplacement de l'extradition par le mandat d'arrêt européen, et surtout le choix de l'Etat français de se soumettre à la décision-cadre, démontrent encore une fois que nos gouvernements sont les fossoyeurs et de la construction politique européenne et de la souveraineté de la nation. Sans aucune légitimité démocratique, il a été décidé d'adapter la constitution pour respecter un texte qui finalement n'est qu'un décret communautaire !
Mais, surtout, dans un espace où le fichage des individus est maintenant une réalité (5), il s'agit ni plus ni moins que d'affirmer un modèle judiciaire européen assujetti à la rationalité technicienne tout en permettant « la coexistence de profondes disparités entre les États membres. » (6) Ainsi, le texte, dont l'objectif déclaré est pourtant de rapprocher les codes pénaux de chacun en matière d'incrimination de faits graves, en fait, légitime et justifie, au niveau locale, des procédures d'exceptions et l'emploie de techniques spéciales d'enquêtes. Né comme un espace de libre échange, l'Union Européenne, en instaurant la primauté de la procédure sur le droit, nous montre définitivement qu'elle ne se conçoit pas comme un espace social, soucieux de la protection des droits et des libertés des peuples qui y résident, mais bien plutôt comme une entité technocrate, entièrement dévoué à la rentabilité, qu'elle soit économique, ou policière. Aujourd'hui, la construction de l'europe libérale s'accompagne d'une judiciarisation de la société comme modèle de gouvernement et de l'idée que l'action pénale puisse être un instrument de régulation sociale. Et les « entrepreneurs de l'urgence », ces démagogues mus par le souci de l'image médiatique, viennent ainsi au secours des « entrepreneurs du profit », en imposant et en justifiant la mise en place de législations toujours plus liberticides.
Aurélien Durand.
Note :
(1) Paru au Journal officiel le 26 mars 2003.
(2) Le 6 décembre 2001
(3) Au début des années quatre-vingt, Mme Thatcher, alors Premier ministre britannique, tenta de s'appuyer sur un texte identique pour briser la grève des mineurs. D'ailleurs, la décision-cadre relative relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres est directement, en ce qui concerne le terrorisme, inspiré du Terrorism Act britannique.
(4) L'extradition n'est possible que si le fait poursuivi constitue un délit tant dans le pays demandeur de la personne incriminée que dans le pays sollicité.
(5) « L'europe en liberté surveillée », Résistance n° 10.
(6) « Poursuivre un crime ou criminaliser la contestation : faux-semblants du mandat d'arrêt européen », Jean Claude Paye, Le Monde diplomatique, février 2002.
00:05 Publié dans Droit / Constitutions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europe, affaires européennes, union européenne, mandat d'arrêt, justice, droit, totalitarisme, arbitraire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 10 avril 2010
Filoamericanismo, ideologia di deresponsabilizzazione
di Costanzo Preve
Fonte: Bye Bye Uncle Sam [scheda fonte]

“In Italia i filoamericani in servizio puramente effettivo sono particolarmente numerosi in ambiente giornalistico. Da Rossella a Riotta c’è solo l’imbarazzo della scelta. I giornalisti sono il clero secolare di questo nuovo medioevo capitalistico, laddove il clero regolare è piuttosto composto dai professori universitari di filosofia e di scienze sociali. Ritengo riduttivo ed economicistico l’approccio per cui questi servi laureati si comportano così perché sono sul libro paga della CIA. I soldi non sono tutto nella vita, anche se comunque non fanno mai schifo. Il filoamericanismo è certamente ben pagato, ma resta comunque un’attività prevalentemente gratuita, una passione, una passione che un tempo sarebbe stato battezzata “cupidigia di servilismo”. Il vecchio Tacito usava l’espressione latina ruere in servitium per indicare coloro che si affrettavano talmente a compiere atti di servilismo verso Tiberio da finire con l’inciampare. Nel dicembre del 2003, in occasione della cattura in Irak di Saddam Husseyn, abbiamo assistito ad episodi incredibili di questo ruere in servitium, e fra essi vorrei citare solo i nomi dei giornalisti Galli della Loggia e Rondolino.
Ma cerchiamo di stringere sulla natura del filoamericanismo. Ritengo si tratti in ultima istanza della manifestazione di una sindrome di impotenza storica interiorizzata, per cui si delega ad un potere esterno salvifico un insieme di compiti economici, politici e culturali che non si ritiene di poter più svolgere autonomamente. Il 1945 è ormai lontano, ma si continua a ripetere salmodiando che se non fossero arrivati gli americani noi europei saremmo ancora qui a gemere sotto la dittatura. L’apporto sovietico alla sconfitta di Hitler è ovviamente censurato, e curiosamente viene di fatto anche censurato il fenomeno storico della resistenza europea 1941-45. Ma si tratta solo di dettagli. In realtà si è di fronte alla ricostruzione della intera storia europea del Novecento in base ai due fondamenti metafisici della Malvagità e dell’Impotenza. In questo modo l’Europa avrebbe commesso una sorta di Colpa Assoluta integralmente Irriscattabile, e per questa ragione l’occupazione militare americana diventa non solo un fatto geopolitico, ma la si erge a fatto metafisico totale. In caso contrario ci si potrebbe laicamente chiedere che cosa ci fanno basi militari americane potentemente armate ad Aviano in Italia, a Ramstein in Germania, a Suda in Grecia, eccetera, dal momento che è venuta meno da tempo la cosiddetta minaccia sovietica. Ma è appunto questa domanda laica e pacata che il filoamericanismo non può neppure sopportare.
Il filoamericanismo è allora prima di tutto una ideologia di deresponsabilizzazione europea. Quando lo studioso americano Kagan parla degli USA come di Marte e dell’Europa come di Venere egli è purtroppo ancora al di qua della comprensione minima del problema. In realtà l’Europa ha deciso di essere come Tersite, l’oggetto dello scherno degli Achei e della umiliante punizione inflittagli da Odisseo.”
Tante altre notizie su www.ariannaeditrice.it
00:10 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : etats-unis, américanisme, amérique, idéologie, libéralisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Jünger, los mitos y el mar
Ex: http://losojossinrostro.blogspot.com/
 Me encuentro inmerso en la lectura de “Mitos griegos”, un libro de Friedrich Georg Jünger, el hermano de Ernst, que fue editado en España el año pasado por la editorial Herder. Surcando sus páginas alcancé un pasaje realmente especial, por su extraordinaria fuerza evocadora (al menos por lo que a su humilde servidor respecta). Es precisamente eso lo que hace de ese libro algo interesante; los mitos no se presentan como reliquias del pasado, como equivalencias despojadas de poder fascinador y ambiguo (Apolo=sol, Marte=guerra) y petrificadas por el proceso alegórico. No; los mitos aquí son algo vivo, real, palpitante, pletórico de belleza y terror a partes iguales.
Me encuentro inmerso en la lectura de “Mitos griegos”, un libro de Friedrich Georg Jünger, el hermano de Ernst, que fue editado en España el año pasado por la editorial Herder. Surcando sus páginas alcancé un pasaje realmente especial, por su extraordinaria fuerza evocadora (al menos por lo que a su humilde servidor respecta). Es precisamente eso lo que hace de ese libro algo interesante; los mitos no se presentan como reliquias del pasado, como equivalencias despojadas de poder fascinador y ambiguo (Apolo=sol, Marte=guerra) y petrificadas por el proceso alegórico. No; los mitos aquí son algo vivo, real, palpitante, pletórico de belleza y terror a partes iguales.
El pasaje está dentro del fragmento que hace referencia a dos titanes, Océano y Tetis. Océano está vinculado, como otros titanes, con los fenómenos elementales. Se relaciona con las aguas, con la corriente universal que envuelve la tierra, con un rumor fluido y pacífico –Océano es el único que no interviene en la lucha entre Crono y Urano- pero también persistente. Siempre es igual a sí mismo y, también como los otros titanes, es presa de un “eterno retorno” (hay un inconfundible eco nietzscheano en la prosa de Jünger). Tetis es su esposa, madre de las oceánides y divinidades del agua.
Pero es cuando habla de Poseidón cuando aparece este pasaje, abismado en la contemplación de las formas marinas:
circunvoluciones y curvaturas. Determinadas criaturas marinas poseen una estructura estrictamente simétrica a partir de la cual configuran formas estrelladas y radiales, imágenes en las que también el agua interactúa con su fuerza moldeadora, radial y estrellada. Otras, como las medusas, son transparentes, su cuerpo entero está bañado en luz y avivado por exquisitos tornasoles. A todo lo nacido en el agua le es propio un esmalte, un color y un brillo que sólo el agua puede conferir. Es iridiscente, fluorescente, opalino y fosforescente. La luz que penetra a través del agua se deposita sobre un fondo sólido que refleja las delicadas refracciones y los destellos de la luz. Este tipo de brillo se observa en el nácar y aún más en la perla misma. Al mar no le faltan joyas, es más, todas las alhajas están en relación con el agua, poseen también una naturaleza acuática que les confiere un poder lumínico. En él los colores son más bien fríos“El reino de Poseidón está mejor ordenado que el de Océano. Es más suntuoso y armonioso. La corriente universal que fluye poderosamente lo encierra con un cinturón, lo encierra como centro a partir del cual la entera naturaleza marítima adquiere su forma (…) Todo lo que procede del mar muestra un parentesco, tiene algo en común que no oculta su origen. Los delfines, las nereidas, los tritones, todos emergen del medio húmedo y su complexión muestra el poder del elemento del que proceden. Las escamas, las aletas, las colas de pez únicamente se forman en el agua y, por el modo en que se mueven, están en correspondencia con la resistencia de las corrientes. Algo parecido muestran las conchas y las caracolas en sus formas planas, en sus y aún así resplandecientes, y se reflejan los unos en los otros. Prevalecen el verde y el azul, oscuros y claros a través de todos los matices. Al agitarse, las aguas se tornan negras y arrojan una espuma color de plata. También allí donde asoma el rojo, o el amarillo en estado puro, el agua participa de su formación.
Al que contempla estas formas admirables y a primera vista, a menudo, tan extrañas, le recuerdan ante todo los juegos de las nereidas. Son los juegos que ellas juegan en las aguas cristalinas, en sus cuevas verdes. Al nadador, al bañista le vienen a la mente estos juegos y lo serenan. La fertilidad del mar oculta un tesoro de serenidad; por mucho que se extraiga de él, siempre permanecerá inagotable. Quien descienda a las profundidades, sentirá el cariño con el que el mar se apodera del cuerpo y lo penetra, sentirá los abrazos que reparte. De la caracola en forma de espiral hasta el cuerpo blanco y níveo de Leucótea, de la que se enamoró el tosco Polifemo cuando la miraba jugar con la espuma de la orilla, todo sigue en él la misma ley. También Afrodita Afrogeneia emergió del mar; su belleza y su encanto son un obsequio del mar.
Del ámbito de Poseidón, del reino de Poseidón depende todo esto. Todo lo que se halla bajo la tutela del tridente tiene algo en común y muestra un parentesco inconfundible, Fluye, se mueve, es luminoso, transparente, cede a la presión y ejerce presión. Se eleva y se hunde rítmicamente, y en su formación revela el ritmo que lo impregna.”
¡Cuántas imágenes ha conjurado este texto en mi imaginación! Recuerdo aquel verano en la Costa Brava, hace ya muchos años, en el que me dediqué casi exclusivamente a recoger erizos de mar entre las rocas; era como una obsesión. Trataba de encontrar algo reconocible entre ese bosquecillo de púas, hasta que finalmente pasaba el dedo por él... y las púas respondían con un parsimonioso movimiento, todas hacia un mismo punto. Probablemente estuve haciendo eso durante horas y horas; alrededor había también estrellas y caballitos de mar, organismos que en su singularidad no pueden más que asombrar a los niños.
Por supuesto, recuerdo también el brillo de los corales y las procesiones de destellos plateados, y recuerdo también su nuca, cuando nadamos juntos aquella noche, hace ahora algo más de un año… el agua acariciaba nuestros cuerpos pero también infundía un terror primordial; era, de nuevo, una danza de sexo y muerte. Hubo otras muchas noches antes en que fuimos mecidos por ese rumor… todas iguales y diferentes a un tiempo.
Ah, me vienen tantas imágenes a la cabeza...
00:10 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : révolution conservatrice, littérature, lettres, lettres allemandes, littérature allemande, allemagne, mythes, mythologie, tradition, traditions, traditionalisme, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
George Soros, ou la "conscience du monde"
 Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 2004
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 2004
George SOROS,
ou la "conscience" du Monde
Par Heather Cottin
(http://www.artel.co.yu)
« OUI, J’AI UNE POLITIQUE ETRANGERE : MON OBJECTIF EST DE DEVENIR LA CONSCIENCE DU MONDE. »
Il ne s’agit nullement d’un cas de trouble narcissique de la personnalité; voici, en fait, comment George Soros applique aujourd’hui le pouvoir de l’hégémonie des Etats-Unis dans le monde. Les institutions de Soros et ses machinations financières sont en partie responsables de la destruction du socialisme en Europe de l’Est et dans l’ancienne URSS. Il a également jeté son dévolu sur la Chine. Il a également fait partie de toute cette entreprise d’opérations en tous genres qui ont abouti au démantèlement de la Yougoslavie. Alors qu’il se donne du philanthrope, le rôle du milliardaire George Soros consiste à resserrer la mainmise idéologique de la globalisation et du nouvel ordre mondial tout en assurant la promotion de son propre profit financier. Les opérations commerciales et « philanthropiques » de Soros sont clandestines, contradictoires et coactives. Et, pour ce qui est de ses activités économiques, lui-même admet qu’il n’a pas de conscience, en capitaliste fonctionnant avec une amoralité absolue.
SON GOUROU ? SIR KARL POPPER, THéORICIEN DE LA “SOCIéTé OUVERTE”
En maître d’œuvre du nouveau secteur de la corruption qui trompe systématiquement le monde, il se fraie un chemin jusqu’aux hommes d’Etat planétaires et ils lui répondent. Il a été proche de Henry Kissinger, de Vaclav Havel et du général polonais Wojciech Jaruzelski.(2) Il soutient le dalaï-lama, dont l’institut est installé au Presidio, à San Francisco, lequel Presidio héberge également, entre autres, la fondation dirigée par l’ami de Soros, l’ancien dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev.(3) Soros est une figure de pointe du Conseil des Relations extérieures, du Forum économique mondial et de Human Rights Watch (HRW). En 1994, après une rencontre avec son gourou philosophique, Sir Karl Popper, Soros ordonnait à ses sociétés de se mettre à investir dans les communications en Europe centrale et de l’Est.
L’administration fédérale de la radio et télévision de la République tchèque a accepté son offre de eprendre et de financer les archives de Radio Free Europe. Soros a transféré ces archives à Prague et a dépensé plus de 15 millions de dollars pour leur entretien.(4)
Conjointement avec les Etats-Unis, une fondation Soros dirige aujourd’hui Radio Free Europe/Radio Liberty, laquelle a étendu ses ramifications au Caucase et en Asie.(5) Soros est le fondateur et le financier de l’Open Society Institute. Il a créé et entretient le Groupe international de Crise (GIC) qui, entre autres choses, est actif dans les Balkans depuis le démantèlement de la Yougoslavie. Soros travaille ouvertement avec l’Institut américain pour la Paix – un organe officiellement reconnu de la CIA.
Lorsque les forces hostiles à la globalisation battaient de la semelle dans les rues entourant le Waldorf-Astoria, à New York, en février 2002, George Soros était à l’intérieur et tenait un discours devant le Forum économique mondial. Quand la police entassa les manifestants dans des cages métalliques à Park Avenue, Soros vantait les vertus d’une « société ouverte » et rejoignait ainsi Zbigniew Brzezinski, Samuel Huntington, Francis Fukuyama et d’autres.
QUI EST CE TYPE ?
George Soros est né en Hongrie en 1930 de parents juifs si éloignés de leurs racines qu’ils passèrent même une fois leurs vacances en Allemagne nazie.(6) Soros vécut sous le régime nazi mais, au moment du triomphe des communistes, il alla s’installer en Angleterre en 1947.
Là, à la London School of Economics, il subit l’influence du philosophe Karl Popper, un idéologue anticommuniste adulé dont l’enseignement constitua la base des tendances politiques de Soros. Il est malaisé de trouver un discours, un ouvrage ou un article de la plume de Soros qui n’obéisse à l’influence de Popper.
Anobli en 1965, Popper inventa le slogan de « Société ouverte », qu’on allait retrouver plus tard dans l’Open Society Fund and Institute de Soros. Les disciples de Popper répètent ses mots comme de véritables fidèles. La philosophie de Popper incarne parfaitement l’individualisme occidental. Soros quitta l’Angleterre en 1956 et trouva du travail à Wall Street où, dans les années 60, il inventa le « fonds de couverture » : « (…) les fonds de couverture satisfaisaient les individus très riches (…) Les fonds en grande partie secrets, servant habituellement à faire des affaires en des lieux lointains (…) produisaient des retours astronomiquement supérieurs. Le montant des ‘enjeux’ se muaient souvent en prophéties qui se réalisaient d’elles-mêmes : ‘les rumeurs circulant à propos d’une situation acquise grâce aux énormes fonds de couverture incitaient d’autres investisseurs à se hâter de faire pareil’, ce qui, à son tour, augmentait les mises de départ des opérateurs en couverture. »(7)
Soros met sur pied le Quantum Fund en 1969 et se met à boursicoter dans la manipulation des devises. Dans les années 70, ses activités financières glissent vers « l’alternance entre les situations à long et à court terme (…) Soros se mit à gagner gros à la fois sur la montée des trusts d’investissement dans l’immobilier et sur leur effondrement ultérieur. Durant ses vingt années de gestion, Quantum offrit des returns étonnants de 34,5% en moyenne par an. Soros est particulièrement connu (et craint) pour sa spéculation sur les devises.
(…) En 1997, il se vit décerner une distinction rare en se faisant traiter de scélérat par un chef d’Etat, Mahathir Mohamad, de Malaisie, pour avoir participé à un raid particulièrement rentable sur la monnaie de ce pays. »(8)
C’est via de telles martingales financières clandestines que Soros va devenir multimilliardaire. Ses sociétés contrôlent l’immobilier en Argentine, au Brésil et au Mexique, la banque au Venezuela et elles figurent au nombre des commerces de devises les plus rentables au monde, donnant naissance à la croyance générale que ses amis très haut placés l’ont aidé dans ses aventures financières, et ce pour des raisons tant politiques que liées à l’appât du gain.(9)
SOROS ? UN DRACULA QUI SUCE LE SANG DU PEUPLE !
George Soros a été blâmé pour avoir fait sombrer l’économie thaïlandaise en 1997.(10) Un activiste thaï a même déclaré : « Nous considérons George Soros comme une sorte de Dracula. Il suce le sang du peuple. »(11) Les Chinois l’appellent « le crocodile » du fait que ses efforts économiques et idéologiques en Chine n’étaient jamais satisfaits et parce que ses spéculations financières ont engendré des millions de dollars de profit lorsqu’il a mis le grappin sur l’économie thaï et sur celle de la Malaisie.(12)
Un jour, Soros s’est fait un milliard de dollars en un jour en spéculant (un mot qu’il déteste) sur la livre britannique. Accusé de prendre « de l’argent à chaque contribuable britannique lorsqu’il spéculait contre le sterling », il avait répondu : « Lorsque vous spéculez sur les marchés financiers, vous ne vous embarrassez pas de la plupart des préoccupations morales auxquelles est confronté un homme d’affaires ordinaire. (…) Je n’avais pas non plus à m’embarrasser de questions de morale sur les marchés financiers. »(13)
Soros est schizophréniquement insatiable quand il s’agit de s’enrichir personnellement de façon illimitée et il éprouve un perpétuel désir d’être bien considéré par autrui : « Les commerçants en devises assis à leurs bureaux achètent et vendent des devises de pays de tiers monde en grande quantités. L’effet des fluctuations des cours sur les personnes qui vivent dans ces pays n’effleure même pas leurs esprits.
Il ne devrait pas le faire non plus : ils ont un travail à faire. Si nous nous arrêtons pour réfléchir, nous devons nous poser la question de savoir si les commerçants en devises (…) devraient contrôler la vie de millions de personnes. »(14)
C’est George Soros qui a sauvé la peau de George W. Bush lorsque la gestion par celui-ci d’une société de prospection pétrolière était sur le point de se solder par un échec. Soros était le propriétaire de la Harken Energy Corporation et c’est lui qui avait racheté le stock des actions en baisse rapide juste avant que la société ne s’effondre. Le futur président liquida a presque un million de dollars. Soros déclara qu’il avait agi de la sorte pour acheter de « l’influence politique ».(15) Soros est également un partenaire du tristement célèbre Carlyle Group. Officiellement fondée en 1987, la « plus importante société privée par actions du monde », qui gère plus de 12 milliards de dollars, est dirigée par « un véritable bottin mondain d’anciens dirigeants républicains », depuis l’ancien membre de la CIA, Frank Carlucci, jusqu’à l’ancien chef de la CIA et ancien président George Bush père. Le Carlyle Group tire la majeure partie de ses rentrées des exportations d’armes.
L’ESPION PHILANTHROPE
En 1980, Soros commence à utiliser ses millions pour s’en prendre au socialisme en Europe de l’Est. Il finance des individus susceptibles de coopérer avec lui. Son premier succès, c’est en Hongrie qu’il l’obtient. Il reprend le système éducatif et culturel hongrois, mettant hors d’état de fonctionnement les institutions socialistes partout dans le pays. Il se fraie directement un chemin à l’intérieur du gouvernement hongrois. Ensuite, Soros se tourne vers la Pologne, contribuant à l’opération Solidarité, financée par la CIA, et, la même année, il étend également ses activités à la Chine. L’URSS vient ensuite.
Ce n’est nullement une coïncidence si la CIA a mené des opérations dans tous ces pays. Son objectif était également le même que celui de l’Open Society Fund : démanteler le socialisme. En Afrique du Sud, la CIA dénichait des dissidents anticommunistes. En Hongrie, en Pologne et en URSS, via une intervention non dissimulée menée à partir de la Fondation nationale pour la Démocratie, l’AFL-CIO, l’USAID et d’autres institutions, la CIA soutenait et organisait les anticommunistes, le type même d’individus recrutés par l’Open Society Fund de Soros. La CIA allait les appeler ses « atouts ». Comme le dit Soros : « Dans chaque pays, j’ai identifié un groupe de personnes – certaines sont des personnalités de premier plan, d’autres sont moins connues – qui partageaient ma foi… »(16)
L’Open Society de Soros organisait des conférences avec des anticommunistes tchèques, serbes, roumains, hongrois, croates, bosniaques, kosovares.(17) Son influence sans cesse croissante le fit soupçonner d’opérer en tant que partie du complexe des renseignements américains. En 1989, le Washington Post se faisait l’écho d’accusations d’abord émises en 1987 par des officiels du gouvernement chinois et prétendant que le Fonds de Soros pour la Réforme et l’Ouverture de la Chine avait des connexions avec la CIA.(18)
AU TOUR DE LA RUSSIE
Après 1990, les fonds de Soros visent le système éducatif russe et fournissent des manuels à toute la nation.(19) En effet, Soros se sert de la propagande de l’OSI pour endoctriner toute une génération de la jeunesse russe. Les fondations de Soros ont été accusées d’avoir orchestré une stratégie visant à s’assurer le contrôle du système financier russe, des plans de privatisation et du processus des investissements étrangers dans ce pays. Les Russes réagissent avec colère aux ingérences de Soros dans les législations. Les critiques de Soros et d’autres fondations américaines ont affirmé que l’objectif de ces manœuvres était de « faire échouer la Russie en tant qu’Etat ayant le potentiel de rivaliser avec la seule superpuissance mondiale ».(20)
Les Russes se mettent à soupçonner que Soros et la CIA sont interconnectés. Le magnat des affaires, Boris Berezovsky, allait même déclarer : « J’ai presque tourné de l’œil en apprenant, il y a quelques années, que George Soros était un agent de la CIA. »(21) L’opinion de Berezovsky était que Soros, de même que l’Occident, « craignaient que le capitalisme russe ne devînt trop puissant ».
Si l’establishment économique et politique des Etats-Unis craint la concurrence économique de la Russie, quelle meilleure façon y a-t-il de la contrôler que de dominer les médias, l’éducation, les centres de recherche et le secteur scientifique de la Russie ? Après avoir dépensé 250 millions de dollars pour « la transformation de l’éducation des sciences humaines et de l’économie au niveau des écoles supérieures et des universités », Soros injecte 100 millions de dollars de plus dans la création de la Fondation scientifique internationale.(22) Les Services fédéraux russes de contre-espionnage (FSK) accusent les fondations de Soros en Russie d’« espionnage ». Ils font remarquer que Soros n’opère pas seul ; il fait partie de tout un rouleau compresseur recourant, entre autres, à des financements de la part de Ford et des Heritage Foundations, des universités de Harvard, Duke et Columbia, et à l’assistance du Pentagone et ses services de renseignements américains.(23) Le FSK s’indigne de ce que Soros a graissé la patte à quelque 50.000 scientifiques russes et prétend que Soros a cultivé avant tout ses propres intérêts en s’assurant le contrôle de milliers de découvertes scientifiques et nouvelles technologies russes et en s’appropriant ainsi des secrets d’Etats et des secrets commerciaux.(24)
CUNY, AGENT DE LA CIA EN TCHéTCHéNIE?
En 1995, les Russes avaient été très en colère suite aux ingérences de l’agent du Département d’Etat, Fred Cuny, dans le conflit tchétchène. Cuny se servait du secours aux sinistrés comme de couverture, mais l’histoire de ses activités dans les zones de conflit internationales intéressant les Etats-Unis, auxquelles venaient s’ajouter les opérations d’investigations du FBI et de la CIA, rendaient manifestes ses connexions avec le gouvernement américain. A l’époque de sa disparition, Cuny travaillait sous contrat pour une fondation de Soros.(25) On se sait pas assez aux Etats-Unis que la violence en Tchétchénie, une province située au cœur de la Russie, est généralement perçue comme étant le résultat d’une campagne de déstabilisation politique que Washington voit d’un très bon œil et, en fait, orchestre probablement. Cette façon de présenter la situation est suffisamment claire aux yeux de l’écrivain Tom Clancy, au point qu’il s’est senti libre d’en faire une affirmation de fait dans son best-seller, La somme de toutes les peurs. Les Russes ont accusé Cuny d’être un agent de la CIA et d’être l’un des rouages d’une opération de renseignements destinée à soutenir l’insurrection tchétchène.(26) L’Open Society Institute de Soros est toujours actif en Tchétchénie, comme le sont également d’autres organisations sponsorisées par le même Soros.
La Russie a été le théâtre d’au moins une tentative commune de faire grimper le bilan de Soros, tentative orchestrée avec l’aide diplomatique de l’administration Clinton. En 1999, la secrétaire d’Etat Madeleine Albright avait bloqué une garantie de prêt de 500 millions de dollars par l’U.S. Export-Import Bank à la société russe, Tyumen Oil, en prétendant que cela s’opposait aux intérêts nationaux américains. La Tyumen voulait acheter des équipements pétroliers de fabrication américaine, ainsi que des services, auprès de la société Halliburton de Dick Cheney et de l’ABB Lummus Global de Bloomfield, New Jersey.(27) George Soros était investisseur dans une société que la Tyumen avait essayé d’acquérir. Tant Soros que BP Amoco avaient exercé des pressions afin d’empêcher cette transaction, et Albright leur rendit ce service.(28)
L’ENTRETIEN D’UN ANTISOCIALISME DE GAUCHE
L’Open Society Institute de Soros trempe les doigts dans toutes les casseroles. Son comité de directeurs est un véritable « Who's Who » de la guerre froide et des pontifes du nouvel ordre mondial. Paul Goble est directeur des communications : « Il a été le principal commentateur politique de Radio Free Europ ». Herbert Okun a servi dans le département d’Etat de Nixon en tant que conseiller en renseignements auprès de Henry Kissinger. Kati Marton est l’épouse de Richard Holbrooke, l’ancien ambassadeur aux Nations unies et envoyé en Yougoslavie de l’administration Clinton. Marton a exercé des pressions en faveur de la station de radio B-92, financée par Soror, et elle a également beaucoup œuvré en faveur d’un projet de la Fondation nationale pour la démocratie (une autre antenne officielle de la CIA) qui a collaboré au renversement du gouvernement yougoslave.
Lorsque Soros fonde l’Open Society Fund, il va chercher le grand pontife libéral Aryeh Neier pour la diriger. A l’époque, Neier dirige Helsinki Watch, une prétendue organisation des droits de l’homme de tendance nettement anticommuniste. En 1993, l’Open Society Fund devient l’Open Society Institute.
Helsinki Watch s’est mué en Human Rights Watch en 1975. A l’époque, Soros fait partie de sa Commission consultative, à la fois pour le comité des Amériques et pour ceux de l’Europe de l’Est et de l’Asie centrale, et sa nébuleuse Open Society Fund/Soros/OSI est renseignée comme bailleuse de fonds.(29) Soros a des relations étroites avec Human Rights Watch (HRW) et Neier écrits des articles pour le magazine The Nation sans mentionné le moins du monde qu’il figure sur les fiches de paie de Soros.(30)
Soros est donc étroitement lié à HRW, bien qu’il fasse de son mieux pour le dissimuler.(31) Il déclare qu’il se contente de bailler des fonds, de mettre les programmes au point et de laisser les choses aller d’elles-mêmes. Mais les actions de HRW ne s’écartent en aucune façon de la philosophie de son bailleur de fonds. HRW et OSI sont très proches l’un de l’autre. Leurs vues ne divergent pas. Naturellement, d’autres fondations financent également ces deux institutions, mais il n’empêche que l’influence de Soros domine leur idéologie.
Les activités de George Soros s’inscrivent dans le schéma de construction développé en 1983 et tel qu’il est énoncé par Allen Weinstein, fondateur de la Fondation nationale pour la démocratie. Wainstein déclare ceci : «Une grande partie de ce que nous faisons aujourd’hui était réalisée en secret par la CIA voici 25 ans. »(32)
LéGITIMER LES STRATéGIES AMéRICAINES
 Soros opère exactement dans les limites du complexe de renseignements. Il diffère peu des trafiquants de drogue de la CIA au Laos, dans les années 60, ou des moudjahidine qui tiraient profit du trafic de l’opium tout en menant des opérations pour le compte de la CIA contre l’Afghanistan socialiste des années 80. Il canalise tout simplement (et ramasse) beaucoup plus d’argent que ces marionnettes et une partie bien plus importante de ses affaires se font au grand jour. Sa franchise, dans la mesure où il en fait preuve, réside dans un contrôle factice des dégâts, lequel sert à légitimer les stratégies de la politique étrangère américaine.
Soros opère exactement dans les limites du complexe de renseignements. Il diffère peu des trafiquants de drogue de la CIA au Laos, dans les années 60, ou des moudjahidine qui tiraient profit du trafic de l’opium tout en menant des opérations pour le compte de la CIA contre l’Afghanistan socialiste des années 80. Il canalise tout simplement (et ramasse) beaucoup plus d’argent que ces marionnettes et une partie bien plus importante de ses affaires se font au grand jour. Sa franchise, dans la mesure où il en fait preuve, réside dans un contrôle factice des dégâts, lequel sert à légitimer les stratégies de la politique étrangère américaine.
La majorité des Américains qui, aujourd’hui, se considèrent politiquement au centre-gauche, sont sans aucun doute pessimistes à propos des chances d’assister un jour à une transformation socialiste de la société. Par conséquent, le modèle de « décentralisation » à la Soros, ou l’approche « fragmentée » de «l’utilitarisme négatif, la tentative de réduire au minimum la quantité de misère », qui constituait la philosophie de Popper, tout cela leur plaît, en gros.(33) Soros a financé une étude de HRW qui a été utilisée pour soutenir l’assouplissement de la législation en matière de drogue dans les Etats de Californie et d’Arizona.(34) Soros est favorable à une législation sur les drogues – une manière de réduire provisoirement la conscience de sa propre misère. Soros est un corrupteur qui tutoie le concept de l’égalité des chances. A un échelon plus élevé de l’échelle socio-économique, on trouve les social-démocrates qui acceptent d’être financés par Soros et qui croient aux libertés civiques dans le contexte même du capitalisme.(35) Pour ces personnes, les conséquences néfastes des activités commerciales de Soros (lesquelles appauvrissent des gens partout dans le monde) sont édulcorées par ses activités philanthropiques. De la même manière, les intellectuels libéraux de gauche, tant à l’étranger qu’aux Etats-Unis, ont été séduits par la philosophie de l’« Open Society », sans parler de l’attrait que représentait ses donations.
La Nouvelle Gauche américaine était un mouvement social-démocratique. Elle était résolument antisoviétique et, lorsque l’Europe de l’Est et l’Union soviétique se sont effondrées, peu de gens au sein de cette Nouvelle Gauche se sont opposés à la destruction des systèmes socialistes. La Nouvelle Gauche n’a ni gémi ni protesté lorsque les centaines de millions d’habitants de l’Europe de l’Est et de l’Europe centrale ont perdu leur droit au travail, au logement à loyer décent et protégé par la loi, à l’éducation gratuite dans des écoles supérieures, à la gratuité des soins de santé et de l’épanouissement culturel. La plupart ont minimisé les suggestions prétendant que la CIA et certaines ONG – telles la Fondation nationale pour la Démocratie ou l’Open Society Fund – avaient activement participé à la destruction du socialisme. Ces personnes avaient l’impression que la détermination occidentale à vouloir détruire l’URSS depuis 1917 avait vraiment peu de chose à voir avec la chute de l’URSS. Pour ces personnes, le socialisme a disparu de son plein gré, du fait de ses défauts et lacunes.
LA “NOUVELLE GAUCHE” IGNORE TOUJOURS LES MACHINATIONS AMéRICAINES
Quant aux révolutions, comme celles d’un Mozambique, de l’Angola, du Nicaragua ou du Salvador, annihilées par des forces agissant sous procuration ou retardées par des « élections » très démonstratives, les pragmatistes de la Nouvelle Gauche n’en ont eu que faire et ont tourné les talons. Parfois même, la Nouvelle Gauche a semblé ignorer délibérément les machinations post-soviétiques de la politique étrangère américaine.
Bogdan Denitch, qui nourrissait des aspirations politiques en Croatie, a été actif au sein de l’Open Society Institute et a reçu des fonds de ce même OSI.(36) Denitch était favorable à l’épuration ethnique des Serbes en Croatie, aux bombardements par l’Otan de la Bosnie et de la Yougoslavie et même à une invasion terrestre de la Yougoslavie.(37) Denitch a été l’un des fondateurs et le président des Socialistes démocratiques des Etats-Unis, un groupe prépondérant de la gauche libérale aux Etats-Unis. Il a également présidé longtemps la prestigieuse Conférence des Universitaires socialistes, par le biais de laquelle il pouvait aisément manipuler les sympathies de beaucoup et les faire pencher du côté du soutien à l’expansion de l’Otan.(38) D’autres cibles du soutien de Soros comprennent Refuse and Resist the American Civil Liberties Union (refus et résistance à l’Union américaine de défense des libertés civiques), et toute une panoplie d’autres causes libérales.(39) Soros allait acquérir un autre trophée invraisemblable en s’engageant dans la Nouvelle Ecole de Recherches Sociales de New York, qui avait été longtemps une académie de choix pour les intellectuels de gauche. Aujourd’hui, il y sponsorise le Programme pour l’Europe de l’est et l’Europe centrale.(40)
MICHEL KOZAK : INSTALLER DES “DIRIGEANTS SYMPATHIQUES”
Bien des gens de gauche inspirés par la révolution nicaraguayenne ont accepté avec tristesse l’élection de Violetta Chamorro et la défaite des sandinistes en 1990. La quasi-totalité du réseau de soutien au Nicaragua a cessé ses activités par la suite. Peut-être la Nouvelle Gauche aurait-elle pu tirer quelque enseignement de l’étoile montante qu’était Michel Kozak. L’homme était un vétéran des campagnes de Washington visant à installer des dirigeants sympathiques au Nicaragua, à Panama et à Haïti, et de saper Cuba – il dirigeait la Section des Intérêts américains à La Havane.
Après avoir organisé la victoire de Chamorro au Nicaragua, Kozak a poursuivi son chemin pour devenir ambassadeur des Etats-Unis en Biélorussie, tout en collaborant à l’Internet Access and Training Program (IATP – Progr. d’accès et d’initiation au net), sponsorisé par Soros et qui œuvrait à la « fabrication de futurs dirigeants » en Biélorussie.(41) Dans le même temps, ce programme était imposé à l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Géorgie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Turkménistan et l’Ouzbékistan. L’IATP opère à visière relevée avec le soutien du département d’Etat américain. Au crédit de la Biélorussie, il faut ajouter qu’elle a fini par expulser Kozak et toute la clique de l’Open Society de Soros et du département d’Etat américain. Le gouvernement d’Aleksandr Lukachenko a en effet découvert que, quatre ans avant de s’installer à Minsk, Kozak organisait la ventilation des dizaines de millions de dollars destinés à alimenter l’opposition biélorusse. Kozak travaillait à l’unification du coalition d’opposition, il créait des sites web, des journaux et des pôles d’opinion, et il supervisait un mouvement de résistance estudiantine semblable à l’Otpor en Yougoslavie. Kozak fit même venir des dirigeants de l’Otpor pour former des dissidents en Biélorussie.(42) Juste à la veille du 11 septembre 2001, les Etats-Unis relançaient une campagne de diabolisation contre le président Aleksandr Lukachenko. Cette campagne allait toutefois être remise sur feu doux pour donner la priorité à la « guerre contre le terrorisme ».
Par l’entremise de l’OSI et du HRW, Soros était l’un des principaux sponsors de la station de radio B-92 à Belgrade. Il fonda l’Otpor, l’organisation qui recevait ces « valises d’argent » afin de soutenir le coup d’Etat du 5 octobre 2000 qui allait renverser le gouvernement yougoslave.(43) Un peu plus tard, Human Rights Watch aidait à légitimer l’enlèvement et la médiatisation du procès de Slobodan Milosevic à La Haye sans aucunement faire état de ses droits.(44)
Louise Arbour, qui a œuvré comme juge au sein de ce tribunal illégal, siège actuellement au conseil du Groupe international de crise de Soros.(45) Le gang de l’Open Society et de Human Rights Watch a travaillé en Macédoine, disant que cela faisait partie de sa « mission civilisatrice ».(46) Il faut donc s’attendre à ce qu’on « sauve » un jour cette république et que s’achève ainsi la désintégration de l’ancienne Yougoslavie.
DES MANDATAIRES DU POUVOIR
En fait, Soros a déclaré qu’il considérait sa philanthropie comme morale et ses affaires de gestion d’argent comme amorales.(47) Pourtant, les responsables des ONG financées par Soros ont un agenda clair et permanent. L’une des institutions les plus influentes de Soros n’est autre que le Groupe international de Crise, fondé en 1986.
Le GIC est dirigé par des individus issus du centre même du pouvoir politique et du monde des entreprises. Son conseil d’administration compte entre autres en ses rangs Zbigniew Brzezinski, Morton Abramowitz, ancien secrétaire d’Etat adjoint aux Etats-Unis; Wesley Clark, ancien chef suprême des alliés de l’Otan pour l’Europe; Richard Allen, ancien conseiller national à la sécurité des Etats-Unis. Il vaut la peine de citer Allen : l’homme a quitté le Conseil national de la sécurité sous Nixon parce qu’il était dégoûté des tendances libérales de Henry Kissinger; c’est encore lui qui a recruté Oliver North pour le Conseil national de la sécurité sous Reagan, et qui a négocié l’échange missiles-otages dans le scandale des contras iraniens. Pour ces quelques individus, « contenir des conflits » équivaut à assurer le contrôle américain sur les peuples et ressources du monde entier.
Dans les années 1980 et 1990, sous l’égide de la doctrine reaganienne, les opérations secrètes ou à ciel ouvert des Etats-Unis battaient leur plein en Afrique, en Amérique latine, dans les Caraïbes et en Asie. Soros était ouvertement actif dans la plupart de ces endroits, oeuvrant à corrompre d’éventuels révolutionnaires en devenir, à sponsoriser des hommes politiques, des intellectuels et toute autre personne susceptible d’arriver au pouvoir lorsque l’agitation révolutionnaire serait retombée. Selon James Petras : « A la fin des années 1980, les secteurs les plus perspicaces des classes néo-libérales au pouvoir comprirent que leurs menées politiques polarisaient la société et suscitaient un ample mécontentement social.
UNE STRATéGIE PARALLèLE “à PARTIR DE LA BASE”
Les politiciens néo-libéraux se sont mis à financer et à promouvoir une stratégie parallèle ‘à partir de la base ‘, la promotion d’organisations en quelque sorte ‘tirées du sol’, à l’idéologie ‘anti-étatique’ et censées intervenir parmi les classes potentiellement conflictuelles, afin de créer un ‘tampon social’. Ces organisations dépendaient financièrement de ressources néo-libérales et étaient directement engagées dans la concurrence avec des mouvements socio-politiques pour la fidélité des dirigeants locaux et des communautés militantes. Dans les années 1990, ces organisations, décrites comme ‘non gouvernementales’, se comptaient par milliers et recevaient quelque 4 milliards de dollars pour l’ensemble de la planète. »(48)
Dans Underwriting Democracy (Garantir la démocratie), Soros se vante de « l’américanisation de l’Europe de l’Est ». Selon ses propres dires, grâce à ses programmes d’éducation, il a commencé à mettre en place tout un encadrement de jeunes dirigeants « sorosiens ». Ces jeunes hommes et femmes issus du moule éducatif de la Fondation Soros sont préparés à remplir des fonctions de ce qu’on appelle communément des « personnes d’influence ». Grâce à leur connaissance pratique des langues et à leur insertion dans les bureaucraties naissantes des pays ciblés, ces recrues sont censées faciliter, sur le plan philosophique, l’accès à ces pays des sociétés multinationales occidentales. Le diplomate de carrière Herbert Okun, qui siège en compagnie de George Soros au Comité européen de Human Rights Watch, entretient d’étroites relations avec toute une série d’institutions liées au département d’Etat, allant de l’USAID à la Commission trilatérale financée par Rockefeller. De 1990 à 1997, Okun a été directeur exécutif d’une organisation appelée le Corps des bénévoles des Sercvices financiers, qui faisait partie de l’USAID, « afin d’aider à établir des systèmes financiers de marché libre dans les anciens pays communistes ».(49) George Soros est en complet accord avec les capitalistes occupés à prendre le contrôle de l’économie mondiale.
LA RENTABILITE DU NON-MARCHAND
Soros prétend qu’il ne fait pas de philanthropie dans les pays où il pratique le commerce des devises.(50) Mais Soros a souvent tiré avantage de ses relations pour réaliser des investissements clés. Armé d’une étude de l’ICC et bénéficiant du soutien de Bernard Kouchner, chef de l’UNMIK (Administration intérimaire des Nations unies au Kosovo), Soros a tenté de s’approprier le complexe minier le plus rentable des Balkans.
En septembre 2000, dans sa hâte de s’emparer des mines de Trepca avant les élections en Yougoslavie, Kouchner déclarait que la pollution dégagée par le complexe minier faisait grimper les taux de plomb dans l’environnement.(51) C’est incroyable, d’entendre une chose pareille, quand on sait que l’homme a applaudi lorsque les bombardements de l’Otan, en 1999, ont déversé de l’uranium appauvri sur le pays et ont libéré plus de 100.000 tonnes de produits cancérigènes dans l’air, l’eau et le sol.(52) Mais Kouchner a fini par obtenir gain de cause et les mines ont été fermées pour des « raisons de santé ». Soros a investi 150 millions de dollars dans un effort pour obtenir le contrôle de l’or, l’argent, le plomb, le zinc et le cadmium de Trepca, lesquels confèrent à cette propriété une valeur de 5 milliards de dollars.(53)
Au moment où la Bulgarie implosait dans le chaos du « libre marché », Soros s’acharnait à récupérer ce qu’il pouvait dans les décombres, comme Reuters l’a rapporté au début 2001 : « La Banque européenne de Reconstruction et de Développement (BERD) a investi 3 millions de dollars chez RILA [une société bulgare spécialisée dans les technologies de pointe], la première société à bénéficier d’un nouveau crédit de 30 millions de dollars fixé par la BERD pour soutenir les firmes de high-tech en Europe centrale et de l’Est. (…) Trois autres millions de dollars venaient du fonds américain d’investissements privés Argus Capital Partners, sponsorisé par la Prudential Insurance Company of America et opérant en Europe centrale et de l’Est. (…) Soros, qui avait investi quelque 3 millions de dollars chez RILA et un autre million de 2001 (…) demeurait le détenteur majoritaire. »(54)
CERNER LES PROBLEMES
Ses prétentions à la philanthropie confèrent à Soros le pouvoir de modeler l’opinion publique internationale lorsqu’un conflit social soulève la question de savoir qui sont les victimes et qui sont les coupables. A l’instar d’autres ONG, Human Rights Watch, le porte-voix de Soros sur le plan des droits de l’homme, évite ou ignore la plupart des luttes de classes ouvrières organisées et indépendantes.
En Colombia, des dirigeants ouvriers sont très fréquemment assassinés par des paramilitaires opérant de concert avec le gouvernement sponsorisé par les Etats-Unis. Du fait que ces syndicats s’opposent à l’économie néo-libérale, HRW garde à propos de ces assassinats un relatif silence. En avril dernier, José Vivanco, de HRW, a témoigné en faveur du Plan Colombia devant le Sénat américain (55) : « Les Colombiens restent dévoués aux droits de l’homme et à la démocratie. Ils ont besoin d’aide. Human Rights Watch ne voit pas d’inconvénient fondamental à ce que ce soient les Etats-Unis qui fournissent cette aide. »(56)
HRW met les actions des combattants de la guérilla colombienne, qui luttent pour se libérer de l’oppression de la terreur d’Etat, de la pauvreté et de l’exploitation, sur le même pied que la répression des forces armées financées par les Etats-Unis et celle des escadrons paramilitaires de la mort, les AUC (Forces colombiennes unies d’autodéfense). HRW a reconnu le gouvernement de Pastrana et de ses militaires, dont le rôle était de protéger les droits à la propriété et de maintenir le statu quo économique et politique. Selon HRW, 50% des morts de civils sont l’œuvre des escadrons de la mort tolérés par le gouvernement.(57). Le pourcentage exact, en fait, est de 80%.(58)
HRW a validé les élections dans leur ensemble et l’accession au pouvoir du gouvernement Uribe, en 2002. Uribe est un parfait héritier des dictateurs latino-américains que les Etats-Unis ont soutenu dans le passé, bien qu’il ait été « élu ». HRW n’a pas eu de commentaire à propos du fait que la majorité des habitants ont boycotté les élections.(59)
CUBA DéMONISé PAR “HUMAN RIGHTS WATCH”
Dans le bassin caraïbe, Cuba est un autre opposant au néo-libéralisme à avoir été diabolisé par Human Rights Watch. Dans l’Etat voisin de Haïti, les activités financées par Soros ont opéré de façon à venir à bout des aspirations populaires qui ont suivi la fin de la dictature des Duvalier, et ce, en torpillant le premier dirigeant haïtien, démocratiquement élu, Jean-Bertrand Aristide. Ken Roth, de HRW, a abondé utilement dans le sens des accusations américaines reprochant à Aristide d’être « antidémocratique ». Pour étayer son idée de la « démocratie », les fondations de Soros ont entamé à Haïti des opérations complémentaires de celles si inconvenantes des Etats-Unis, telles la promotion par USAID de personnes associées aux FRAPH, les fameux escadrons de la mort sponsorisés par la CIA et qui ont terrorisé le pays depuis la chute de « Baby Doc » Duvalier.(60)
Sur le site de HRW, le directeur Roth a critiqué les Etats-Unis de ne pas s’être opposés à la Chine avec plus de véhémence. Les activités de Roth comprennent la création du Tibetan Freedom Concert (Concert pour la liberté du Tibet), un projet itinérant de propagande qui a effectué une tournée aux Etats-Unis avec d’importants musiciens de rock pressant les jeunes à soutenir le Tibet contre la Chine.(61) Le Tibet est un projet de prédilection de la CIA depuis de nombreuses années.(62)
Récemment, Roth a réclamé avec insistance que l’on s’oppose au contrôle de la Chine sur sa province riche en pétrole du Xinjiang. Avec l’approche colonialiste du « diviser pour conquérir », Roth a essayé de convaincre certaines membres de la minorité religieuse des Ouïgours au Xinjiang que l’intervention des Américains et de l’Otan au Kosovo contenait une promesse en tant que modèle pour eux-mêmes. Déjà en août 2002, le gouvernement américain avait soutenu quelque peu cette tentative également.
Les intentions américaines à propos de cette région sont apparues clairement lorsqu’un article du New York Times sur la province de Xinjiang, en Chine occidentale, décrivait les Ouïgours comme une « majorité musulmane vivant nerveusement sous domination chinoise. Ils « sont bien au courant des bombardements de la Yougoslavie par l’Otan, l’an dernier, et certains les encensent pour avoir libéré les musulmans du Kosovo; ils s’imaginent pouvoir être libérés de la même manière ici ».(63) Le New York Times Magazine, de son côté, notait que « de récentes découvertes de pétrole ont rendu le Xinjiang particulièrement attrayant au yeux du commerce international » et, en même temps, comparaît les conditions de la population indigène à celles du Tibet.(64)
DES DEFICIENCES EN CALCUL
Lorsque les organisations sorosiennes comptent, elles semblent perdre toute notion de vérité. Human Rights Watch affirmait que 500 personnes, et non pas plus de 2.000, avaient été tuées par les bombardiers de l’Otan au cours de la guerre de Yougoslavie, en 1999.(65) Elles prétendent que 350 personnes seulement, et non pas plus de 4.000, étaient mortes suite aux attaques américaines en Afghanistan.(66) Lorsque les Américains ont bombardé Panama en 1989, HRW a préfacé son rapport en disant que « l’éviction de Manuel Noriega (…) et l’installation du gouvernement démocratiquement élu du président Guillermo Endara amenait de grands espoirs au Panama (…) ». Le rapport omettait de mentionner le nombre de victimes.
Human Rights Watch a préparé le travail de terrain pour l’attaque de l’Otan contre la Bosnie, en 1993, avec de fausses allégations de « génocide » et de viols par milliers.(67) Cette tactique consistant à susciter une hystérie politique était nécessaire pour que les Etats-Unis puissent mener à bien leur politique dans les Balkans. Elle a été réutilisée en 1999 lorsque HRW a fonctionné en qualité de troupes de choc de l’endoctrinement pour l’attaque de la Yougoslavie par l’Otan. Tout le bla-bla de Soros à propos du règne de la loi a été oublié d’un seul coup. Les Etats-Unis et l’Otan ont imposé leurs propres lois et les institutions de Soros étaient derrière pour les soutenir.
Le fait de trafiquer des chiffres afin d’engendrer une réaction a été une composante importante de la campagne du Conseil des relations étrangères après le 11 septembre 2001. Cette fois, il s’agissait des 2.801 personnes tuées au World Trade Center. Le Conseil des relations étrangères (CRE) se réunit le 6 novembre 2001 afin de planifier une « grande campagne diplomatique publique ». Le CRE créa une « Cellule de crise indépendante sur la réponse de l’Amérique au terrorisme ». Soros rejoignit Richard C. Holbrooke, Newton L. Gingrich, John M. Shalikashvili (ancien président des chefs d’état-major réunis) et d’autres individus influents dans une campagne visant à faire des morts du WTC des outils de la politique étrangère américaine. Le rapport du CRE mit tout en œuvre pour faciliter une guerre contre le terrorisme.
VANTER ET DéFENDRE LA POLITIQUE éTRANGèRE AMéRICAINE
On peut retrouver les empreintes de George Soros un peu partout, dans cette campagne : « Il faut que les hauts fonctionnaires américains pressent amicalement les Arabes amis et autres gouvernements musulmans non seulement de condamner publiquement les attentats du 11 septembre, mais également de soutenir les raisons et les objectifs de la campagne antiterroriste américaine. Nous n’allons jamais convaincre les peuples du Moyen-Orient et de l’Asie du Sud de la légitimité de notre cause si leurs gouvernements restent silencieux. Il nous faut les aider à éviter tout retour de flamme pouvant émaner de telles déclarations, mais il faut que nous les convainquions de s’exprimer de vive voix. (…) Encouragez les musulmans bosniaques, albanais et turcs à apprendre à des auditoires étrangers à considérer le rôle des Américains dans le sauvetage des musulmans de Bosnie et du Kosovo en 1995-1999 ainsi que nos liens étroits et de longue durée avec les musulmans dans le monde entier. Engagez les intellectuels et les journalistes du pays à prendre la parole également, quels que soient leurs points de vue. Informez régulièrement la presse régionale en temps réel pour encourager des réponses rapides. (…) Insistez sur la nécessité de faire référence aux victimes (et citez ces dernières nommément afin de mieux les personnaliser) chaque fois que nous discutons de nos motifs et de nos objectifs.»(68)
Bref, les déficiences sorosiennes en calcul servent à vanter et à défendre la politique étrangère américaine.
Soros est très ennuyé par le déclin du système capitaliste mondial et il veut faire quelque chose à ce propos, et maintenant, encore. Récemment, il déclarait : « Je puis déjà discerner les préparatifs de la crise finale. (…) Des mouvements politiques indigènes sont susceptibles d’apparaître qui chercheront à exproprier les sociétés multinationales et à reprendre possession des richesses ‘nationales’. »(69)
Soros suggère le plus sérieusement du monde un plan pour contourner les Nations unies. Il propose que les « démocraties du monde devraient prendre les rênes et constituer un réseau mondial d’alliances qui pourraient travailler avec ou sans les Nations unies ». Si l’homme était psychotique, on pourrait penser qu’il était en crise, à ce moment précis. Mais le fait est que l’affirmation de Soros : « les Nations unies sont constitutionnellement incapables de remplir les promesses contenues dans le préambule de leur Charte » reflète la pensée des institutions réactionnaires du genre de l’American Enterprise Institute.(70) Bien que maints conservateurs font référence au réseau de Soros comme étant de gauche, si l’on aborde la question de l’affiliation des Etats-Unis aux Nations unies, Soros est exactement sur la même longueur d’onde que les semblables de John R. Bolton, sous-secrétaire d’Etat pour le Contrôle des Armes et les Affaires de Sécurité internationale qui, en même temps que « de nombreux républicains du Congrès, croient qu’il ne faut pas accorder davantage de crédit au système des Nations unies ».(71) La droite a mené une campagne de plusieurs décennies contre l’ONU. Aujourd’hui, c’est Soros qui l’orchestre. Sur divers sites web de Soros, on peut lire des critiques des Nations unies disant qu’elles sont trop riches, qu’elles ne sont guère désireuses de partager leurs informations, ou qu’elles se sont affaiblies dans des proportions qui les rendent impropres à la manière dont le monde devrait tourner, selon George Soros, du moins.
LES “PROGRESSISTES” OCCIDENTAUX ONT DONNé UN BLANC-SEING à SOROS
Même les auteurs écrivant dans The Nation, des auteurs censés en savoir beaucoup plus, ont été influencés par les idées de Soros. William Greider, par exemple, a récemment découvert quelque pertinence dans la critique de Soros disant que les Nations unies ne devrait pas « accueillir les dictateurs de pacotille et les totalitaristes ni les traiter en partenaires égaux ».(72) Ce genre de racisme eurocentrique constitue le noyau de l’orgueil démesuré de Soros. Quand il affirme que les Etats-Unis peuvent et devraient diriger le monde, c’est un plaidoyer pour le fascisme à l’échelle mondiale. Pendant bien trop longtemps, les « progressistes » occidentaux ont donné un blanc-seing à Soros. Il est probable que Greider et les autres trouvent que l’allusion au fascisme est excessive, injustifiée et même insultante.
Mais écoutez plutôt, et d’une oreille attentive, ce que Soros lui-même a à dire : « Dans la Rome ancienne, seuls les Romains votaient. Sous le capitalisme mondial moderne, seuls les Américains votent. Les Brésiliens, eux, ne votent pas. »
Heather COTTIN.
00:05 Publié dans Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : économie, mondialisme, globalisation, libéralisme, ultra-libéralisme, néo-libéralisme, etats-unis, finance |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 09 avril 2010
Ernst Niekisch: un rivoluzionario tedesco (1889-1967)
ERNST NIEKISCH
UN RIVOLUZIONARIO TEDESCO (1889-1967)
di Josè Cuadrado Costa
Ex: http://eurasiaunita.splinder.com/
 Ernst Niekisch è la figura più rappresentativa del complesso e multiforme panorama che offre il movimento nazional-bolscevico tedesco degli anni 1918-1933. In lui si incarnano con chiarezza le caratteristiche - e le contraddizioni - evocate dal termine nazional-bolscevico e che rispondono molto più ad uno stato d'animo, ad una disposizione attivista, che ad una ideologia dai contorni precisi o ad una unità organizzativa, poiché questo movimento era composto da una infinità di piccoli circoli, gruppi, riviste ecc. senza che ci fosse mai stato un partito che si fosse qualificato nazional-bolscevico. E’ curioso constatare come nessuno di questi gruppi o persone usò questo appellativo (se escludiamo la rivista di Karl Otto Paetel, "Die Sozialistische Nation") bensì che l’aggettivo fu impiegato in modo dispregiativo, non scevro di sensazionalismo, dalla stampa e dai partiti sostenitori della Repubblica di Weimar, dei quali tutti i nazional-bolscevichi furono feroci nemici non essendoci sotto questo punto di vista differenze fra gruppi d’origine comunista che assimilarono l’idea nazionale ed i gruppi nazionalisti disposti a perseguire scambi economici radicali e l’alleanza con l'URSS per distruggere l'odiato sistema nato dal Diktat di Versailles. Ernst Niekisch nacque il 23 maggio 1889 a Trebnitz (Slesia). Era figlio di un limatore che si trasferì a Nordlingen im Reis (Baviera-Svevia) nel 1891. Niekisch frequenta gli studi di magistero, che termina nel 1907, esercitando poi a Ries e Augsburg. Non era frequente nella Germania guglielmina - quello Stato in cui si era realizzata la vittoria del borghese sul soldato secondo Carl Schmitt - che il figlio di un operaio studiasse, per cui Niekisch dovette soffrire le burle e l’ostilità dei suoi compagni di scuola. Già in quel periodo era avido di sapere ("Una vita da nullità è insopportabile", dirà) e divorato da un interiore fuoco rivoluzionario; legge Hauptmann, Ibsen, Nietzsche, Schopenhauer, Kant, Hegel e Macchiavelli, alla cui influenza si aggiungerà quella di Marx, a partire dal 1915. Arruolato nell’esercito nel 1914, seri problemi alla vista gli impediscono di giungere al fronte, per cui eserciterà, sino al febbraio del 1917, funzioni di istruttore di reclute ad Augsburg. Nell’ottobre del 1917 entra nel Partito Socialdemocratico (SPD) e si sente fortemente attratto dalla rivoluzione bolscevica. E' di quell’epoca il suo primo scritto politico, oggi perso, intitolato significativamente Licht aus dem osten (Luce dall’Est), nel quale già formulava ciò che sarà una costante della sua azione politica: l’idea della "Ostorientierung". La diffusione di questo foglio sarà sabotata dallo stesso SPD al cui periodico di Augsburg "Schwabischen Volkszeitung" collaborava Niekisch. Il 7 novembre 1918 Eisner, a Monaco, proclama la Repubblica. Niekisch fonda il Consiglio degli Operai e Soldati di Augsburg e ne diviene il presidente, dopo esserlo già stato del Consiglio Centrale degli Operai, Contadini e Soldati di Monaco nel febbraio e nel marzo del 1919. Egli è l’unico membro del Comitato Centrale che vota contro la proclamazione della prima Repubblica sovietica in Baviera, poiché considera che questa, in ragione del suo carattere agrario, sia la provincia tedesca meno idonea a realizzare l’esperimento. Malgrado ciò, con l’entrata dei Freikorps a Monaco, Niekisch viene arrestato il 5 maggio - giorno in cui passa dal SPD al Partito Socialdemocratico Indipendente (USPD). lI 22 giugno viene condannato a due anni di fortezza per la sua attività nel Consiglio degli Operai e Soldati, per quanto non abbia avuto nulla a che vedere con i crimini della Repubblica sovietica bavarese. Niekisch sconta integralmente la sua pena, e nonostante l’elezione al parlamento bavarese nelle liste della USPD non sarà liberato fino all’agosto del 1921. Frattanto, si ritrova nel SPD per effetto della riunificazione dello stesso con la USPD (la scissione si era determinata durante la guerra mondiale). Niekisch non è assolutamente d’accordo con la politica condiscendente dell’SPD - per temperamento era incapace di sopportare le mezze tinte o i compromessi - ed a questa situazione di sdegno si aggiungevano le minacce contro di lui e la sua famiglia (si era sposato nel 1915 ed aveva un figlio); così rinuncia al suo mandato parlamentare e si trasferisce a Berlino, dove entra nella direzione della segreteria giovanile del grande sindacato dei tessili, un lavoro burocratico che non troverà di suo gradimento. I suoi rapporti con L'SPD si deteriorano progressivamente, per il fatto che Niekisch si oppone al pagamento dei danni di guerra alla Francia e al Belgio e appoggia la resistenza nazionale quando la Francia occupa il bacino della Ruhr, nel gennaio del 1923. Dal 1924 si oppone anche al Piano Dawes, che regola il pagamento dei danni di guerra imposto alla Germania a Versailles. Niekisch attaccò frontalmente la posizione dell’SPD di accettazione del Piano Dawes in una conferenza di sindacalisti e socialdemocratici scontrandosi con Franz Hilferding, principale rappresentante della linea ufficiale.
Ernst Niekisch è la figura più rappresentativa del complesso e multiforme panorama che offre il movimento nazional-bolscevico tedesco degli anni 1918-1933. In lui si incarnano con chiarezza le caratteristiche - e le contraddizioni - evocate dal termine nazional-bolscevico e che rispondono molto più ad uno stato d'animo, ad una disposizione attivista, che ad una ideologia dai contorni precisi o ad una unità organizzativa, poiché questo movimento era composto da una infinità di piccoli circoli, gruppi, riviste ecc. senza che ci fosse mai stato un partito che si fosse qualificato nazional-bolscevico. E’ curioso constatare come nessuno di questi gruppi o persone usò questo appellativo (se escludiamo la rivista di Karl Otto Paetel, "Die Sozialistische Nation") bensì che l’aggettivo fu impiegato in modo dispregiativo, non scevro di sensazionalismo, dalla stampa e dai partiti sostenitori della Repubblica di Weimar, dei quali tutti i nazional-bolscevichi furono feroci nemici non essendoci sotto questo punto di vista differenze fra gruppi d’origine comunista che assimilarono l’idea nazionale ed i gruppi nazionalisti disposti a perseguire scambi economici radicali e l’alleanza con l'URSS per distruggere l'odiato sistema nato dal Diktat di Versailles. Ernst Niekisch nacque il 23 maggio 1889 a Trebnitz (Slesia). Era figlio di un limatore che si trasferì a Nordlingen im Reis (Baviera-Svevia) nel 1891. Niekisch frequenta gli studi di magistero, che termina nel 1907, esercitando poi a Ries e Augsburg. Non era frequente nella Germania guglielmina - quello Stato in cui si era realizzata la vittoria del borghese sul soldato secondo Carl Schmitt - che il figlio di un operaio studiasse, per cui Niekisch dovette soffrire le burle e l’ostilità dei suoi compagni di scuola. Già in quel periodo era avido di sapere ("Una vita da nullità è insopportabile", dirà) e divorato da un interiore fuoco rivoluzionario; legge Hauptmann, Ibsen, Nietzsche, Schopenhauer, Kant, Hegel e Macchiavelli, alla cui influenza si aggiungerà quella di Marx, a partire dal 1915. Arruolato nell’esercito nel 1914, seri problemi alla vista gli impediscono di giungere al fronte, per cui eserciterà, sino al febbraio del 1917, funzioni di istruttore di reclute ad Augsburg. Nell’ottobre del 1917 entra nel Partito Socialdemocratico (SPD) e si sente fortemente attratto dalla rivoluzione bolscevica. E' di quell’epoca il suo primo scritto politico, oggi perso, intitolato significativamente Licht aus dem osten (Luce dall’Est), nel quale già formulava ciò che sarà una costante della sua azione politica: l’idea della "Ostorientierung". La diffusione di questo foglio sarà sabotata dallo stesso SPD al cui periodico di Augsburg "Schwabischen Volkszeitung" collaborava Niekisch. Il 7 novembre 1918 Eisner, a Monaco, proclama la Repubblica. Niekisch fonda il Consiglio degli Operai e Soldati di Augsburg e ne diviene il presidente, dopo esserlo già stato del Consiglio Centrale degli Operai, Contadini e Soldati di Monaco nel febbraio e nel marzo del 1919. Egli è l’unico membro del Comitato Centrale che vota contro la proclamazione della prima Repubblica sovietica in Baviera, poiché considera che questa, in ragione del suo carattere agrario, sia la provincia tedesca meno idonea a realizzare l’esperimento. Malgrado ciò, con l’entrata dei Freikorps a Monaco, Niekisch viene arrestato il 5 maggio - giorno in cui passa dal SPD al Partito Socialdemocratico Indipendente (USPD). lI 22 giugno viene condannato a due anni di fortezza per la sua attività nel Consiglio degli Operai e Soldati, per quanto non abbia avuto nulla a che vedere con i crimini della Repubblica sovietica bavarese. Niekisch sconta integralmente la sua pena, e nonostante l’elezione al parlamento bavarese nelle liste della USPD non sarà liberato fino all’agosto del 1921. Frattanto, si ritrova nel SPD per effetto della riunificazione dello stesso con la USPD (la scissione si era determinata durante la guerra mondiale). Niekisch non è assolutamente d’accordo con la politica condiscendente dell’SPD - per temperamento era incapace di sopportare le mezze tinte o i compromessi - ed a questa situazione di sdegno si aggiungevano le minacce contro di lui e la sua famiglia (si era sposato nel 1915 ed aveva un figlio); così rinuncia al suo mandato parlamentare e si trasferisce a Berlino, dove entra nella direzione della segreteria giovanile del grande sindacato dei tessili, un lavoro burocratico che non troverà di suo gradimento. I suoi rapporti con L'SPD si deteriorano progressivamente, per il fatto che Niekisch si oppone al pagamento dei danni di guerra alla Francia e al Belgio e appoggia la resistenza nazionale quando la Francia occupa il bacino della Ruhr, nel gennaio del 1923. Dal 1924 si oppone anche al Piano Dawes, che regola il pagamento dei danni di guerra imposto alla Germania a Versailles. Niekisch attaccò frontalmente la posizione dell’SPD di accettazione del Piano Dawes in una conferenza di sindacalisti e socialdemocratici scontrandosi con Franz Hilferding, principale rappresentante della linea ufficiale.
NeI 1925 Niekisch, che è redattore capo della rivista socialista Firn (Il nevaio), pubblica i due primi lavori giunti fino a noi: Der Weg der deutschen Arbeiterschaft zum Staat e Grundfragen deutscher Aussenpolitik. Entrambe le opere testimoniano una influenza di Lassalle molto maggiore di quella di Marx/Engels, un aspetto che fa somigliare queste prime prese di posizione di Niekisch a quelle assunte nell’immediato dopoguerra dai comunisti di Amburgo, che si separarono dal Partito Comunista Tedesco (KPD) per fondare il Partito Comunista Operaio Tedesco (KAPD), guidato da Laufenberg e Wolffheim, che era un accanito partigiano della lotta di liberazione contro Versailles (questo partito, che giunse a disporre di una base abbastanza ampia, occupa un posto importante nella storia del nazionalbolscevismo). Nei suoi scritti del 1925, Niekisch propone che l'SPD si faccia portavoce dello spirito di resistenza del popolo tedesco contro l'imperialismo capitalista delle potenze dell’Intesa, ed allo stesso tempo sostiene che la liberazione sociale delle masse proletarie ha come presupposto inevitabile la liberazione nazionale. Queste idee, unite alla sua opposizione alla politica estera filofrancese dell’SPD ed alla sua lotta contro il Piano Dawes, gli attirano la sfiducia dei vertici socialdemocratici. Il celebre Eduard Bernstein lo attaccherà per suoi atteggiamenti nazionalistici sulla rivista "Glocke". In realtà, Niekisch non fu mai marxista nel senso ortodosso della parola: concedeva al marxismo valore di critica sociale, ma non di WeItanschauung, ed immaginava lo Stato socialista al di sopra di qualsiasi interesse di classe, come esecutore testamentario di Weimar e Königsberg (cioè di Goethe e Kant). Si comprende facilmente come questo genere di idee non fossero gradite all'imborghesita direzione dell’SPD... Ma Niekisch non era isolato in seno al movimento socialista, poiché manteneva stretti rapporti con il Circolo Hofgeismar della Gioventù Socialista, che ne rappresentava l’ala nazionalista fortemente influenzata dalla Rivoluzione conservatrice. Niekisch scrisse spesso su "Rundbrief", la rivista di questo circolo, dal quale usciranno fedeli collaboratori quando avrà inizio l’epoca di "Widerstand": fra essi Benedikt Qbermayr, che lavorerà con Darré nel Reichsmährstand. Poco a poco l’SPD comincia a disfarsi di Niekisch: per le pressioni del suo primo presidente, Niekisch fu escluso dal suo posto nel sindacato dei tessili, e nel luglio del 1925 anticipò con le dimissioni dall'SPD il provvedimento di espulsione avviato contro di lui, ed il cui risultato non dava adito a dubbi. Inizia ora il periodo che riserverà a Niekisch un posto nella storia delle idee rivoluzionarie del XX secolo: considerando molto problematico lo schema "destra-centro-sinistra", egli si sforza di raggruppare le migliori forze della destra e della sinistra (conformemente alla celebre immagine del ferro di cavallo, in cui gli estremi si trovano più vicini fra loro di quanto non lo siano con il centro) per la lotta contro un nemico che definisce chiaramente: all’esterno l’Occidente liberale ed il Trattato di Versailles; all’interno il liberalismo di Weimar. Nel luglio del 1926 pubblica il primo numero della rivista Widerstand ("Resistenza"), e riesce ad attirare frazioni importanti - per numero ed attivismo - dell’antico Freikorps "Bund Oberland" mentre aderisce all'Altsozialdemokratische Partei (ASP) della Sassonia, cercando di utilizzarlo come piattaforma per i suoi programmi di unificazione delle forze rivoluzionarie. Per questa ragione si trasferisce a Dresda, dove dirige il periodico dell’ASP ("Der Volkstaat"), conducendo una dura lotta contro la politica filo-occidentale di Stresemann, opponendo al trattato di Locarno, con il quale la Germania riconosceva come definitive le sue frontiere occidentali ed il suo impegno a pagare i danni di guerra, lo spirito del trattato di Rapallo (1922), con il quale la Russia sovietica e la Germania sconfitta - i due paria d'Europa - strinsero le loro relazioni solidarizzando contro le potenze vincitrici. L'esperienza con l’ASP termina quando questo partito è sconfitto nelle elezioni del 1928, e ridotto ad entità insignificante. Questo insuccesso non significa assolutamente che Niekisch abbandoni la lotta scoraggiato. Al contrario, è in questo periodo che scriverà le sue opere fondamentali: Gedanken über deutsche Politik, Politik und idee (entrambe del 1929), Entscheidung (1930: il suo capolavoro), Der Politische Raum deutschen Widerstandes (1931) e Politik deutschen Widerstandes (1932). Parallelamente a questa attività pubblicistica, continua a pubblicare la rivista "Widerstand", fonda la casa editrice che porta lo stesso nome nel 1928 e viaggia in tutti gli angoli della Germania come conferenziere. Il solo elenco delle personalità con le quali ha rapporti è impressionante (dal maggio 1929 si trasferisce definitivamente a Berlino): il filosofo Alfred Baeumler gli presenta Ernst e Georg Jünger, con i quali avvia una stretta collaborazione; mantiene rapporti con la sinistra del NSDAP. il conte Ernst zu Reventlow, Gregor Strasser (che gli offrirà di diventare redattore capo dei "Voelkischer Beobachter") e Goebbels, che è uno dei più convinti ammiratori del suo libro Entscheidung (Decisione). E’ pure determinante la sua amicizia con Carl Schmitt. Nell'ottobre del 1929, Niekisch è l’animatore dell’azione giovanile contro il Piano Young (un altro piano di "riparazioni"), pubblicando sul periodico "Die Kommenden", il 28 febbraio del 1930, un ardente appello contro questo piano, sottoscritto da quasi tutte le associazioni giovanili tedesche - fra le quali la Lega degli Studenti Nazionalsocialisti e la Gioventù Hitleriana -, e che fu appoggiato da manifestazioni di massa. I simpatizzanti della sua rivista furono organizzati in "Circoli Widerstand" che celebrarono tre congressi nazionali negli anni 1930-1932. Nell'autunno del '32 Niekisch va in URSS, partecipando ad un viaggio organizzato dalla ARPLAN (Associazione per lo studio del Piano Quinquennale sovietico, fondata dal professor Friedrich Lenz, altra figura di spicco del nazional-bolscevismo). Questi dati biografici erano indispensabili per presentare un uomo come Niekisch, che è praticamente uno sconosciuto; e per poter comprendere le sue idee, idee che, d'altra parte, egli non espose mai sistematicamente - era un rivoluzionario ed uno scrittore da battaglia -, ne tenteremo una ricostruzione. Dal 1919 Niekisch era un attento lettore di Spengler (cosa che non deve sorprendere in un socialista di quell' epoca, nella quale esisteva a livello intellettuale e politico una compenetrazione tra destra e sinistra, quasi una osmosi, impensabile nelle attuali circostanze), del quale assimilerà soprattutto la famosa opposizione fra "Kultur" e "Zivilisation". Ma la sua concezione politica fu notevolmente segnata dalla lettura di un articolo di Dostoevskij che ebbe una grande influenza nella Rivoluzione conservatrice tramite il Thomas Mann delle Considerazioni di un apolitico, e di Moeller van den Bruck con Germania, potenza protestante (dal Diario di uno scrittore, maggio/giugno 1877, cap. III). Il termine "protestante" non ha nessuna connotazione religiosa, ma allude al fatto che la Germania, da Arminio ad oggi, ha sempre "protestato" contro le pretese romane di dominio universale, riprese dalla Chiesa cattolica e dalle idee della Rivoluzione francese, prolungandosi, come segnalerà Thomas Mann, sino agli obiettivi dell' Intesa che lottò contro la Germania nella Prima Guerra Mondiale. Da questo momento, l’odio verso il mondo romano diventa un aspetto essenziale del pensiero di Niekisch, e le idee espresse in questo articolo di Dostoevskij rafforzano le sue concezioni. Niekisch fa risalire la decadenza del germanesimo ai tempi in cui Carlomagno compì il massacro della nobiltà sassone ed obbligò i sopravvissuti a convertirsi al cristianesimo: cristianesimo che per i popoli germanici fu un veleno mortale, il cui scopo è stato quello di addomesticare il germanesimo eroico al fine di renderlo maturo per la schiavitù romana. Niekisch non esita a proclamare che tutti i popoli che dovevano difendere la propria libertà contro l’imperialismo occidentale erano obbligati a rompere con il cristianesimo per sopravvivere. Il disprezzo per il cattolicesimo si univa in Niekisch all’esaltazione del protestantesimo tedesco, non in quanto confessione religiosa (Niekisch censurava aspramente il protestantesimo ufficiale, che accusava di riconciliarsi con Roma nella comune lotta antirivoluzionaria), ma in quanto presa di coscienza orgogliosa dell’essere tedesco e attitudine aristocratica opposta agli stati d’animo delle masse cattoliche: una posizione molto simile a quella di Rosenberg, visto che difendevano entrambi la libertà di coscienza contro l’oscurantismo dogmatico (Niekisch commentò sulla sua rivista lo scritto di Rosenberg "il mito del XX secolo").Questa attitudine ostile dell'imperialismo romano verso la Germania è continuata attraverso i secoli, poiché "ebrei", gesuiti e massoni sono da secoli coloro che hanno voluto schiavizzare ed addomesticare i barbari germanici. L’accordo del mondo intero contro la Germania che si manifesta soprattutto quando questa si è dotata di uno Stato forte, si rivelò con particolare chiarezza durante la Prima Guerra Mondiale, dopo la quale le potenze vincitrici imposero alla Germania la democrazia (vista da Niekisch come un fenomeno di infiltrazione straniera) per distruggerla definitivamente. Il Primato del politico sull' economico fu sempre un principio fondamentale del pensiero di Niekisch.
 Fortemente influenzato da Carl Schmitt, e partendo da questa base, Niekisch doveva vedere come nemico irriducibile il liberalismo borghese, che valorizza soprattutto i principi economici e considera l'uomo soltanto isolatamente, come unità alla ricerca del suo esclusivo profitto. l'individualismo borghese (con i conseguenti Stato liberale di diritto, libertà individuali, considerazioni dello Stato come un male) e materialismo nel pensiero di Niekisch appaiono come caratteristiche essenziali della democrazia borghese. Nello stesso tempo, Niekisch sviluppa una critica non originale, ma efficace e sincera, del sistema capitalista come sistema il cui motore è l’utile privato e non il soddisfacimento delle necessità individuali e collettive; e che, per di più, genera continuamente disoccupazione. In questo modo la borghesia viene qualificata come nemico interno che collabora con gli Stati occidentali borghesi all’oppressione della Germania. Il sistema di Weimar (incarnato da democratici, socialisti e clericali) rappresentava l’opposto dello spirito e della volontà statale dei tedeschi, ed era il nemico contro il quale si doveva organizzare la “Resistenza". Quello di "Resistenza" è un'altro concetto fondamentale dell'opera di Niekisch. La rivista dallo stesso nome recava, oltre al sottotitolo (prima "Blätter für sozialistische und nationalrevolutionäre Politik", quindi "Zeitschrift für nationalrevolutionäre Politik") una significativa frase di Clausewitz: "La resistenza è un'attività mediante la quale devono essere distrutte tante forze del nemico da indurlo a rinunciare ai suoi propositi". Se Niekisch considerava possibile questa attitudine di resistenza è perché credeva che la situazione di decadenza della Germania fosse passeggera, non irreversibile; e per quanto a volte sottolineasse che il suo pessimismo era “illimitato", si devono considerare le sue dichiarazioni in questo senso come semplici espedienti retorici, poiché la sua continua attività rivoluzionaria è la prova migliore che in nessun momento cedette al pessimismo ed allo sconforto. Abbiamo visto qual era il nemico contro cui dover organizzare la resistenza: “La democrazia parlamentare ed il liberalismo, il modo di vivere francese e l’americanismo". Con la stessa esattezza Niekisch definisce gli obiettivi della resistenza: l’indipendenza e la libertà della Germania, la più alta valorizzazione dello Stato, il recupero di tutti i tedeschi che si trovavano sorto il dominio straniero. Coerente col suo rifiuto dei valori economici, Niekisch non contrappone a questo nemico una forma migliore di distribuzione dei beni materiali, né il conseguimento di una società del benessere: ciò che Niekisch cercava era il superamento del mondo borghese, i cui beni si devono “detestare asceticamente". Il programma di "Resistenza" dell’aprile del 1930 non lascia dubbi da questo punto di vista: nello stesso si chiede il rifiuto deciso di tutti i beni che l’Europa vagheggia (punto 7a), il ritiro dall'economia internazionale (punto 7b), la riduzione della popolazione urbana e la ricostituzione delle possibilità di vita contadina (7c-d), la volontà di povertà ed un modo di vita semplice che deve opporsi orgogliosamente alla vita raffinata delle potenze imperialiste occidentali (7f) e, finalmente, la rinuncia al principio della proprietà privata nel senso del diritto romano, poiché “agli occhi dell’opposizione nazionale, la proprietà non ha senso né diritto al di fuori del servizio al popolo ed allo Stato”. Per realizzare i suoi obiettivi, che Uwe Sauermann definisce con precisione identici a quelli dei nazionalisti, anche se le strade e gli strumenti per conseguirli sono nuovi, Niekisch cerca le forze rivoluzionarie adeguate. Non può sorprendere che un uomo proveniente dalla sinistra come lui si diriga in primo luogo al movimento operaio. Niekisch constata che l’abuso che la borghesia ha fatto del concetto "nazionale", impiegato come copertura dei suoi interessi economici e di classe, ha provocato nel lavoratore l’identificazione fra "nazionale" e "socialreazionario", fatto che ha portato il proletariato a separarsi troppo dai legami nazionali per crearsi un proprio Stato. E per quanto questo atteggiamento dell’insieme del movimento operaio sia parzialmente giustificato, non sfugge a Niekisch il fatto che il lavoratore in quanto tale è solo appena diverso da un "borghese frustrato” senz’altra aspirazione che quella di conseguire un benessere economico ed un modo di vivere identico a quello della borghesia. Questa era una conseguenza necessaria al fatto che il marxismo è un ideologia borghese, nata nello stesso terreno del liberalismo e tale da condividere con questo una valorizzazione della vita in termini esclusivamente economici.La responsabilità di questa situazione ricade in gran parte sulla socialdemocrazia che "è soltanto liberalismo popolarizzato e che ha spinto il lavoratore nel suo egoismo di classe, cercando di farne un borghese". Questa attitudine del SPD è quella che ha portato, dopo il 1918, non alla realizzazione della indispensabile rivoluzione nazionale e sociale, bensì "alla ricerca di cariche per i suoi dirigenti” ed alla conversione in una opposizione all'interno del sistema capitalista, anziché in un partito rivoluzionario: L’SPD è un partito liberale e capitalista che impiega una terminologia socialrivoluzionaria per ingannare i lavoratori. Questa analisi è quella che porta Niekisch a dire che tutte le forme di socialismo basate su considerazioni umanitarie sono "tendenze corruttrici che dissolvono la sostanza della volontà guerriera del popolo tedesco". Influenzata molto dal “decisionismo" di Cari Schmitt, l’attitudine di Niekisch verso il KPD è molto più sfumata. Prima di tutto, ed in opposizione al SPD, fermamente basato su concezioni borghesi, il comunismo si regge “su istinti elementari". Del KPD Niekisch apprezza in modo particolare la “struttura autocratica”, la “approvazione a voce alta della dittatura”. Queste caratteristiche renderebbero possibile utilizzare il comunismo come “mezzo” ed il percorrere insieme una parte della strada. Niekisch accolse con speranza il "Programma di Liberazione Nazionale e Sociale" del KPD (24 agosto 1930) in cui si dichiarava la lotta totale contro le riparazioni di guerra e l’ordine dì Versailles, ma quando ciò si rivelò solo una tattica - diretta a frenare i crescenti successi del NSDAP-, cosi come lo era stata la "linea Schlagater" nei 1923, Niekisch denunciò la malafede dei comunisti sul problema nazionale e li qualificò come incapaci di realizzare il compito al quale lui aspirava poiché erano "solo socialrivoluzionari" e per di più poco rivoluzionari. Il ruolo dirigente nel partito rivoluzionario avrebbe quindi dovuto essere ricoperto da un "nazionalista" di nuovo stampo, senza legami con il vecchio nazionalismo (è significativo che Niekisch considerasse il partito tradizionale dei nazionalisti, il DNVP, incapace di conseguire la resurrezione tedesca perché orientato verso l'epoca guglielmina, definitivamente scomparsa). Il nuovo nazionalismo doveva essere socialrivoluzionario, non condizionato, disposto a distruggere tutto quanto potesse ostacolare l’indipendenza tedesca, ed il nuovo nazionalista, fra i cui compiti c’era quello di utilizzare l’operaio comunista rivoluzionario, doveva avere la caratteristica fondamentale di volersi sacrificare e voler servire. Secondo una bella immagine di Niekisch, il comunismo non sarebbe altro che “il fumo che inevitabilmente sale dove un mondo comincia a bruciare”.Si è vista l’immagine offerta da Niekisch della secolare decadenza tedesca, ma nel passato tedesco non tutto è oscuro; c’è un modello al quale Niekisch guarderà costantemente: la vecchia Prussia o, come egli dice, l'idea di Potsdam, una Prussia che con l'apporto di sangue slavo possa essere l’antidoto contro la Germania romanizzata.E così che esigerà, fin dai primi numeri di "Widerstand", la resurrezione di "una Germania prussiana, disciplinata e barbara, più preoccupata del potere che delle cose dello spirito". Cosa significa esattamente la Prussia per Niekisch? O.E. Schüddekopf lo ha indicato esattamente quando dice che nella "idea di Potsdam" Niekisch vedeva tutte le premesse del suo nazional-bolscevismo: "Lo Stato totale, l’economia pianificata, l’alleanza con la Russia, una condizione spirituale antiromana, la difesa contro l'Ovest, contro l'Occidente, l'incondizionato Stato guerriero, la povertà...". Nell'idea prussiana di sovranità Niekisch riconosce l'idea di cui hanno bisogno i tedeschi: quella dello "Stato totale", necessario in quanto la Germania, minacciata dall'ostilità dei vicini per la sua condizione geografica, ha bisogno di diventare uno Stato militare. Questo Stato totale deve essere lo strumento di lotta cui deve essere tutto subordinato - l'economia come la cultura e la scienza - affinchè il popolo tedesco possa ottenere la sua libertà. E’ evidente, per Niekisch - ed in questo occorre ricercare una delle ragioni più profonde del suo nazional-bolscevismo -, che lo Stato non può dipendere da un’economia capitalista in cui offerta e domanda determinino il mercato; al contrario, l’economia deve essere subordinata allo Stato ed alle sue necessità. Per qualche tempo, Niekisch ebbe fiducia in determinati settori della Reichswehr (pronunciò molte delle sue conferenze in questo ambiente militare) per realizzare l’"idea di Potsdam”, ma agli inizi del 1933 si allontanò dalla concezione di una "dittatura della Reichswehr" perché essa non gli appariva sufficientemente "pura" e "prussiana" tanto da farsi portatrice della "dittatura nazionale", e ciò era dovuto, sicuramente, ai suoi legami con le potenze economiche. Un'altro degli aspetti chiave del pensiero di Niekisch è il primato riconosciuto alla politica estera (l'unica vera politica per Spengler) su quella interna. Le sue concezioni al riguardo sono marcatamente influenzate da Macchiavelli (del quale Niekisch era grande ammiratore, tanto da firmare alcuni suoi articoli con lo pseudonimo di Niccolò) e dal suo amico Karl Haushofer. Del primo, Niekisch conserverà sempre la Realpolitik, la sua convinzione che la vera essenza della politica è sempre la lotta fra Stati per il potere e la supremazia, dal secondo apprenderà a pensare secondo dimensioni geopolitiche, considerando che nella situazione di allora - ed a maggior ragione in quella attuale - hanno un peso nella politica mondiale solamente gli Stati costruiti su grandi spazi, e siccome nel 1930 l'Europa centrale di per sè non avrebbe potuto essere altro che una colonia americana, sottomessa non solo allo sfruttamento economico, ma "alla banalità, alla nullità, al deserto, alla vacuità della spiritualità americana", Niekisch propone un grande stato "da Vladivostok sino a Vlessingen", cioè un blocco germano-slavo dominato dallo spirito prussiano con l'imperio dell'unico collettivismo che possa sopportare l'orgoglio umano: quello militare. Accettando con decisione il concetto di "popoli proletari" (come avrebbero fatto i fascisti di sinistra), il nazionalismo di Niekisch era un nazionalismo di liberazione, privo di sciovinismo, i cui obbiettivi dovevano essere la distruzione dell'ordine europeo sorto da Versailles e la liquidazione della Società delle Nazioni, strumento delle potenze vincitrici. Agli inizi del suo pensiero, Niekisch sognava un "gioco in comune" della Germania con i due Paesi che avevano saputo respingere la "struttura intellettuale" occidentale: la Russia bolscevica e l'Italia fascista (è un'altra coincidenza, tra le molte, fra il pensiero di Niekisch e quello di Ramiro Ledesma). Nel suo programma dell'aprile del 1930, Niekisch chiedeva "relazioni pubbliche o segrete con tutti i popoli che soffrono, come il popolo tedesco, sotto l'oppressione delle potenze imperialiste occidentali". Fra questi popoli annoverava l'URSS ed i popoli coloniali dell'Asia e dell'Africa. Più avanti vedremo la sua evoluzione in relazione al Fascismo, mentre ci occuperemo dell'immagine che Niekisch aveva della Russia sovietica. Prima di tutto dobbiamo dire che quest' immagine non era esclusiva di Niekisch, ma che era patrimonio comune di quasi tutti gli esponenti della Rivoluzione Conservatrice e del nazional-bolscevismo, a partire da Moeller van den Bruck, e lo saranno anche i più lucidi fascisti di sinistra: Ramiro Ledesma Ramos e Drieu la Rochelle. Perchè, in effetti, Niekisch considerava la rivoluzione russa del 1917 prima di tutto come una rivoluzione nazionale, più che come una rivoluzione sociale. La Russia, che si trovava in pericolo di morte a causa dell'infiltrazione dei valori occidentali estranei alla sua essenza, "incendiò di nuovo Mosca" per farla finita con i suoi invasori, impiegando il marxismo come combustibile. Con parole dello stesso Niekisch: "Questo fu il senso della Rivoluzione bolscevica: la Russia, in pericolo di morte, ricorse all'idea di Potsdam, la portò sino alle estreme conseguenze, quasi oltre ogni misura, e creò questo Stato assolutista di guerrieri che sottomette la stessa vita quotidiana alla disciplina militare, i cui cittadini sanno sopportare la fame quando c'è da battersi, la cui vita è tutta carica, fino all'esplosione, di volontà di resistenza". Kerenski era stato solo una testa di legno dell' Occidente che voleva introdurre la democrazia borghese in Russia (Kerenski era, chiaramente, l’uomo nel quale avevano fiducia le potenze dell’Intesa perché la Russia continuasse al loro fianco la guerra contro la Germania); la rivoluzione bolscevica era stata diretta contro gli Stati imperialisti dell’Occidente e contro la borghesia interna favorevole allo straniero ed antinazionale. Coerente con questa interpretazione, Niekisch definirà il leninismo come "ciò che rimane del marxismo quando un uomo di Stato geniale lo utilizza per finalità di politica nazionale", e citerà con frequenza la celebre frase di Lenin che sarebbe diventata il leit-motiv di tutti i nazional-bolscevichi: "Fate della causa del popolo la causa della Nazione e la causa della Nazione diventerà la causa del popolo". Nelle lotte per il potere che ebbero luogo ai vertici sovietici dopo la morte di Lenin, le simpatie di Niekisch erano dirette a Stalin, e la sua ostilità verso Trotzskij (atteggiamento condiviso, fra molti altri, anche da Ernst Jünger e dagli Strasser). Trotzskij ed i suoi seguaci, incarnavano, agli occhi di Niekisch, le forze occidentali, il veleno dell’Ovest, le forze di una decomposizione ostile a un ordine nazionale in Russia. Per questo motivo Niekisch accolse con soddisfazione la vittoria di Stalin e dette al suo regime la qualifica di "organizzazione della difesa nazionale che libera gli istinti virili e combattenti". Il Primo Piano Quinquennale, in corso quando Niekisch scriveva, era "Un prodigioso sforzo morale e nazionale destinato a conseguire l’autarchia". Era quindi l’aspetto politico-militare della pianificazione ciò che affascinava Niekisch, gli aspetti socio-economici (come nel caso della sua valutazione del KDP) lo interessavano appena. Fu in questo modo che poté coniare la formula: "collettivismo + pianificazione = militarizzazione del popolo". Quanto Niekisch apprezzava della Russia è esattamente il contrario di quanto ha attratto gli intellettuali marxisti degenerati: “La violenta volontà di produzione per rendere forte e difendere lo Stato, l’imbarbarimento cosciente dell’esistenza... l’attitudine guerriera, autocratica, dell’élite dirigente che governa dittatorialmente, l’esercizio per praticare l’ascesi di un popolo...”. Era logico che Niekisch vedesse nell’Unione Sovietica il compagno ideale di un’alleanza con la Germania, poiché incarnava i valori antioccidentali cui Niekisch aspirava. Inoltre, occorre tener presente che in quell’epoca l’URSS era uno Stato isolato, visto con sospetto dai paesi occidentali ed escluso da ogni tipo di alleanza, per non dire circondato da Stati ostili che erano praticamente satelliti della Francia e dell’Inghilterra (Stati baltici, Polonia, Romania); a questo bisogna poi aggiungere che fino a ben oltre gli inizi degli anni ‘30, l’URSS non faceva parte della Società delle Nazioni né aveva rapporti diplomatici con gli USA. Niekisch riteneva che un'alleanza Russia-Germania fosse necessaria anche per la prima, poiché "la Russia deve temere l'Asia", e solo un blocco dall'Atlantico al Pacifico poteva contenere "la marea gialla", allo stesso modo in cui solo con la collaborazione tedesca la Russia avrebbe potuto sfruttare le immense risorse della Siberia. Abbiamo visto per quali ragioni la Russia appariva a Niekisch come un modello. Ma per la Germania non si trattava di copiare l'idea bolscevica, di accettarla in quanto tale. La Germania - e su questo punto Niekisch condivide l'opinione di tutti i nazionalisti - deve cercare le sue proprie idee e forme, e se la Russia veniva portata ad esempio, la ragione era che aveva organizzato uno Stato seguendo la "legge di Potsdam" che avrebbe dovuto ispirare anche la Germania. Organizzando uno Stato assolutamente antioccidentale, la Germania non avrebbe imitato la Russia, ma avrebbe recuperato la propria specificità, alienata nel corso di tutti quegli anni di sottomissione allo straniero e che si era incarnata nello Stato russo. Per quanto gli accordi con la Polonia e la Francia sondati dalla Russia saranno osservati con inquietudine da Niekisch, che difenderà appassionatamente l'Unione Sovietica contro le minacce di intervento e contro le campagne condotte a sue discapito dalle confessioni religiose. Inoltre, per Niekisch "una partecipazione della Germania alla crociata contro la Russia significherebbe... un suicidio". Questo sarà il rimprovero più importante - e convincente - di Niekisch al nazionalsocialismo, e con ciò giungiamo ad un punto che non cessa di provocare una certa perplessità: l'atteggiamento di Niekisch verso il nazionalsocialismo. Questa perplessità non è solo nostra; durante l'epoca che studiamo, Niekisch era visto dai suoi contemporanei più o meno come un "nazi". Certamente, la rivista paracomunista "Aufbruch" lo accomunava a Hitler nel 1932; più specifica, la rivista sovietica "Moskauer Rundschau" (30 novembre 1930), qualificava il suo "Entscheidung" come "l'opera di un romantico che ha ripreso da Nietzsche la sua scala di valori". Per dei critici moderni come Armin Mohler "molto di quanto Niekisch aveva chiesto per anni sarà realizzato da Hitler", e Faye segnala che la polemica contro i nazionalsocialisti, per il linguaggio che usa "lo colloca nel campo degli stessi". Cosa fu dunque ciò che portò Niekisch ad opporsi al nazionalsocialismo? Da un'ottica retrospettiva, Niekisch considera il NSDAP fino al 1923 come un "movimento nazional-rivoluzionario genuinamente tedesco", ma dalla rifondazione del Partito, nel 1925, pronuncia un'altro giudizio, nello stesso modo in cui modificherà il suo precedente giudizio sul fascismo italiano. Troviamo l'essenziale delle critiche di Niekisch al nazionalsocialismo in un opuscolo del 1932: "Hitler - ein deutsches Verhängnis" (Hitler, una fatalità tedesca) che apparve illustrato con impressionanti disegni di un artista di valore: A. Paul Weber. Dupeux segnala con esattezza che queste critiche non sono fatte dal punto di vista dell'umanitarismo e della democrazia, com'è usuale ai nostri giorni, e Sauermann lo qualifica come un "avversario in fondo essenzialmente rassomigliante". Niekisch considerava "cattolico", "romano" e "fascista" il fatto di dirigersi alle masse e giunse ad esprimere "l'assurdo" (Dupeux) che: "che è nazista, presto sarà cattolico". In questa critica occorre vedere, per cercare di comprenderla, la manifestazione di un atteggiamento molto comune fra tutti gli autori della Rivoluzione conservatrice, che disprezzavano come "demagogia" qualsiasi lavoro fra le masse, ed occorre ricordare, anche, che Niekisch non fu mai un tattico né un "politico pratico". Allo stesso tempo occorre mettere in relazione la sfiducia verso il nazionalsocialismo con le origini austriache e bavaresi dello stesso, poiché abbiamo già visto che Niekisch guardava con diffidenza ai tedeschi del sud e dell'ovest, come influenzati dalla romanizzazione. D'altra parte, Niekisch rimprovera al nazionalsocialismo la sua "democraticità" alla Rousseau e la sua fede nel popolo. Per Niekisch l'essenziale è lo Stato: egli sviluppò sempre un vero "culto dello Stato", perfino nella sua epoca socialdemocratica, per cui risulta per lo meno grottesco qualificarlo come un "sindacalista anarchico" (sic). Niekisch commise gravi errori nella sua valutazione del nazionalsocialismo, come il prendere sul serio il "giuramento di legalità" pronunciato da Hitler nel corso del processo al tenente Scheringer, senza sospettare che si trattava di mera tattica (con parole di Lenin, un rivoluzionario deve saper utilizzare tutte le risorse, legali ed illegali, servirsi di tutti i mezzi secondo la situazione, e questo Hitler lo realizzò alla perfezione), e ritenere che Hitler si trovasse molto lontano dal potere...nel gennaio del 1933. Questi errori possono spiegarsi facilmente, come ha fatto Sauermann, con il fatto che Niekisch giudicava il NSDAP più basandosi sulla propaganda elettorale che sullo studio della vera essenza di questo movimento. Tuttavia, il rimprovero fondamentale concerne la politica estera. Per Niekisch, la disponibilità - espressa nel "Mein Kampf" - di Hitler ad un'intesa con Italia ed Inghilterra e l'ostilità verso la Russia erano gli errori fondamentali del nazionalsocialismo, poiché questo orientamento avrebbe fatto della Germania un "gendarme dell'Occidente". Questa critica è molto più coerente delle anteriori. L'assurda fiducia di Hitler di poter giungere ad un accordo con l'Inghilterra gli avrebbe fatto commettere gravi errori (Dunkerque, per citarne uno); sulla sua alleanza con l'Italia, determinata dal sentimento e non dagli interessi - ciò che è funesto in politica - egli stesso si sarebbe espresso ripetutamente e con amarezza. Per quanto riguarda l'URSS, fra i collaboratori di Hitler Goebbels fu sempre del parere che si dovesse giungere ad un intesa, e perfino ad un'alleanza con essa, e ciò non solo nel periodo della sua collaborazione con gli Strasser, ma sino alla fine del III Reich, come ha dimostrato inequivocabilmente il suo ultimo addetto stampa Wilfred von Owen nel suo diario ("Finale furioso. Con Goebbels sino alla fine"), edito per la prima volta - in tedesco - a Buenos Aires (1950) e proibito in Germania sino al 1974, data in cui fu pubblicato dalla prestigiosa Grabert-Verlag di Tübingen, alla faccia degli antisovietici e filo-occidentali di professione. La denuncia, sostenuta da Niekisch, di qualsiasi crociata contro la Russia, assunse toni profetici quando evocò in un' immagine angosciosa "le ombre del momento in cui le forze...della Germania diretta verso l'Est, sperperate, eccessivamente tese, esploderanno...Resterà un popolo esausto, senza speranza, e l'ordine di Versailles sarà più forte che mai". Indubbiamente Ernst Niekisch esercitò, negli anni dal 1926 al 1933, una influenza reale nella politica tedesca, mediante la diffusione e l'accettazione dei suoi scritti negli ambienti nazional-rivoluzionari che lottavano contro il sistema di Weimar. Questa influenza non deve essere valutata, certamente in termini quantitativi: l'attività di Niekisch non si orientò mai verso la conquista delle masse, né il carattere delle sue idee era il più adeguato a questo fine. Per fornire alcune cifre, diremo che la sua rivista "Widerstand" aveva una tiratura che oscillava fra le 3.000 e le 4.500 copie, fatto che è lungi dall'essere disprezzabile per l'epoca, ed in più trattandosi di una rivista ben presentata e di alto livello intellettuale; i circoli "Resistenza" raggruppavano circa 5.000 simpatizzanti, dei quali circa 500 erano politicamente attivi. Non è molto a paragone dei grandi partiti di massa, ma l'influenza delle idee di Niekisch dev'essere valutata considerando le sue conferenze, il giro delle sue amicizie (di cui abbiamo già parlato), i suoi rapporti con gli ambienti militari, la sua attività editoriale, e soprattutto, la speciale atmosfera della Germania in quegli anni, in cui le idee trasmesse da "Widerstand" trovavano un ambiente molto ricettivo nelle Leghe paramilitari, nel Movimento Giovanile, fra le innumerevoli riviste affini ed anche in grandi raggruppamenti come il NSDAP, lo Stahlhelm, ed un certo settore di militanti del KPD (come si sa, il passaggio di militanti del KPD nel NSDAP, e viceversa, fu un fenomeno molto comune negli ultimi anni della Repubblica di Weimar, anche se gli storici moderni ammettono che vi fu una percentuale maggiore di rivoluzionari che percorsero il primo tipo di tragitto, ancor prima dell'arrivo di Hitler al potere). Queste brevi osservazioni possono a ragione far ritenere che l'influenza di Niekisch fu molto più ampia di quanto potrebbe far pensare il numero dei suoi simpatizzanti. Il 9 marzo del 1933 Niekisch è arrestato da un gruppo di SA ed il suo domicilio perquisito. Viene posto in libertà immediatamente, ma la rivista "Entscheidung", fondata nell'autunno del 1932, viene sospesa. "Widerstand", al contrario, continuerà ad apparire sino al dicembre del 1934, e la casa editrice dallo stesso nome pubblica libri sino al 1936 inoltrato. Dal 1934 Niekisch viaggia per quasi tutti i paesi d'Europa, nei quali sembra abbia avuto contatti con i circoli dell'emigrazione. Nel 1935, nel corso di una visita a Roma, viene ricevuto da Mussolini. Non si può fare a meno di commuoversi nell'immaginare questo incontro, disteso e cordiale, fra due grandi uomini che avevano iniziato la loro carriera politica nelle file del socialismo rivoluzionario. Alla domanda di Mussolini su che cosa aveva contro Hitler, Niekisch rispose:"Faccio mie le vostre parole sui popoli proletari". Mussolini rispose."E' quanto dico sempre a Hitler". (Va ricordato che questi scrisse una lettera a Mussolini - il 6 marzo 1940 - in cui gli spiegava il suo accordo con la Russia, perché "ciò che ha portato il nazionalsocialismo all'ostilità contro il comunismo è solo la posizione - unilaterale - giudaico-internazionale, e non, al contrario, l'ideologia dello Stato stalinista-russo-nazionalista". Durante la guerra, Hitler esprimerà ripetutamente la sua ammirazione per Stalin, in contrasto con l'assoluto disprezzo che provava per Roosevelt e Churchill). Nel marzo del 1937 Niekisch è arrestato con 70 dei suoi militanti (un gran numero di membri dei circoli "Resistenza" aveva cessato la propria attività, significativamente, nel constatare che Hitler stava portando avanti realmente la demolizione del Diktat di Versailles che anch'essi avevano tanto combattuto). Nel gennaio del 1939 è processato davanti al Tribunale Popolare, accusato di alto tradimento ed infrazione sulla legge sulla fondazione di nuovi partiti, e condannato all'ergastolo. Sembra che le accuse che più pesarono contro di lui furono i manoscritti trovati nella sua casa, nei quali criticava Hitler ed altri dirigenti del III Reich. Fu incarcerato nella prigione di Brandenburg sino al 27 aprile del 1945, giorno in cui viene liberato dalle truppe sovietiche, quasi completamente cieco e semiparalitico. Nell'estate del 1945 entra nel KPD che, dopo la fusione nella zona sovietica con l'SPD, nel 1946 si denominerà Partito Socialista Unificato di Germania (SED) e viene eletto al Congresso Popolare come delegato della Lega Culturale. Da questo posto difende una via tedesca al socialismo e si oppone dal 1948 alle tendenze di una divisione permanete della Germania. Nel 1947 viene nominato professore all'Università Humboldt di Berlino, e nel 1949 è direttore dell' "Istituto di Ricerche sull'Imperialismo"; in quell'anno pubblica uno studio sul problema delle élites in Ortega y Gasset. Niekisch non era, ovviamente, un "collaborazionista" servile: dal 1950 si rende conto che i russi non vogliono un "via tedesca" al socialismo, ma solo avere un satellite docile (come gli americani nella Germania federale). Coerentemente con il suo modo di essere, fa apertamente le sue critiche e lentamente cade in disgrazia; nel 1951 il suo corso è sospeso e l'Istituto chiuso. Nel 1952 ha luogo la sua scomunica definitiva, effettuata dall'organo ufficiale del Comitato Centrale del SED a proposito del suo libro del 1952 "Europäische Bilanz". Niekisch è accusato di "...giungere a erronee conclusioni pessimistiche perché, malgrado l'occasionale impiego della terminologia marxista, non impiega il metodo marxista...la sua concezione della storia è essenzialmente idealista...". Il colpo finale è dato dagli avvenimenti del 17 giugno del 1953 a Berlino, che Niekisch considera come una legittima rivolta popolare. La conseguente repressione distrugge le sue ultime speranze nella Germania democratica e lo induce a ritirarsi dalla politica. Da questo momento Niekisch, vecchio e malato, si dedica a scrivere le sue memorie cercando di dare al suo antico atteggiamento di "Resistenza" un significato di opposizione a Hitler, nel tentativo di cancellare le orme della sua opposizione al liberalismo. In ciò fu aiutato dalla ristretta cerchia dei vecchi amici sopravvissuti. Il più influente fra loro fu il suo antico luogotenente, Josef Drexel, vecchio membro del Bund Oberland e divenuto, nel secondo dopoguerra, magnate della stampa in Franconia. Questo tentativo può spiegarsi, oltre che con il già menzionato stato di salute di Niekisch, con la sua richiesta di ottenere dalla Repubblica Federale (viveva a Berlino Ovest) una pensione per i suoi anni di carcere. Questa pensione gli fu sempre negata, attraverso una interminabile serie di processi. I tribunali basarono il rifiuto su due punti: Niekisch aveva fatto parte di una setta nazionalsocialista (sic) ed aveva collaborato in seguito al consolidamento di un'altro totalitarismo: quello della Germania democratica. Cosa bisogna pensare di questi tentativi di rendere innocuo Niekisch si deduce da quanto fin qui esposto. La storiografia più recente li ha smentiti del tutto. Il 23 maggio del 1967, praticamente dimenticato, Niekisch moriva a Berlino. Malgrado sia quasi impossibile trovare le sue opere anteriori al 1933, in parte perché non ripubblicate ed in parte perché scomparse dalle biblioteche, A. Mohler ha segnalato che Niekisch torna farsi virulento, e fotocopie dei suoi scritti circolano di mano in mano fra i giovani tedeschi disillusi dal neo-marxismo (Marcuse, Suola di Frankfurt). La critica storica gli riconosce sempre maggiore importanza. DI quest'uomo, che si oppone a tutti i regimi presenti nella Germania del XX secolo, bisogna dire che mai operò mosso dall'opportunismo. I suoi cambi di orientamento furono sempre il prodotto della sua incessante ricerca di uno Stato che potesse garantire la liberazione della Germania e dello strumento idoneo a raggiungere questo obiettivo. Le sue sofferenze - reali - meritano il rispetto dovuto a quanti mantengono coerentemente le proprie idee. Niekisch avrebbe potuto seguire una carriera burocratica nell'SPD, accettare lo splendido posto offertogli da Gregor Strasser, esiliarsi nel 1933, tacere nella Germania democratica...Ma sempre fu fedele al suo ideale ed operò come credeva di dover fare senza tener conto delle conseguenze personali che avrebbero potuto derivargli. La sua collaborazione con il SED è comprensibile, ed ancor più il modo in cui si concluse. Oggi che l'Europa è sottomessa agli pseudovalori dell'Occidente americanizzato, le sue idee e la sua lotta continuano ad avere un valore esemplare. E' quanto compresero i nazional-rivoluzionari di "Sache del Volches" quando, nel 1976, apposero una targa sulla vecchia casa di Niekisch, con la frase: "O siamo un popolo rivoluzionario o cessiamo definitivamente di essere un popolo libero".
Fortemente influenzato da Carl Schmitt, e partendo da questa base, Niekisch doveva vedere come nemico irriducibile il liberalismo borghese, che valorizza soprattutto i principi economici e considera l'uomo soltanto isolatamente, come unità alla ricerca del suo esclusivo profitto. l'individualismo borghese (con i conseguenti Stato liberale di diritto, libertà individuali, considerazioni dello Stato come un male) e materialismo nel pensiero di Niekisch appaiono come caratteristiche essenziali della democrazia borghese. Nello stesso tempo, Niekisch sviluppa una critica non originale, ma efficace e sincera, del sistema capitalista come sistema il cui motore è l’utile privato e non il soddisfacimento delle necessità individuali e collettive; e che, per di più, genera continuamente disoccupazione. In questo modo la borghesia viene qualificata come nemico interno che collabora con gli Stati occidentali borghesi all’oppressione della Germania. Il sistema di Weimar (incarnato da democratici, socialisti e clericali) rappresentava l’opposto dello spirito e della volontà statale dei tedeschi, ed era il nemico contro il quale si doveva organizzare la “Resistenza". Quello di "Resistenza" è un'altro concetto fondamentale dell'opera di Niekisch. La rivista dallo stesso nome recava, oltre al sottotitolo (prima "Blätter für sozialistische und nationalrevolutionäre Politik", quindi "Zeitschrift für nationalrevolutionäre Politik") una significativa frase di Clausewitz: "La resistenza è un'attività mediante la quale devono essere distrutte tante forze del nemico da indurlo a rinunciare ai suoi propositi". Se Niekisch considerava possibile questa attitudine di resistenza è perché credeva che la situazione di decadenza della Germania fosse passeggera, non irreversibile; e per quanto a volte sottolineasse che il suo pessimismo era “illimitato", si devono considerare le sue dichiarazioni in questo senso come semplici espedienti retorici, poiché la sua continua attività rivoluzionaria è la prova migliore che in nessun momento cedette al pessimismo ed allo sconforto. Abbiamo visto qual era il nemico contro cui dover organizzare la resistenza: “La democrazia parlamentare ed il liberalismo, il modo di vivere francese e l’americanismo". Con la stessa esattezza Niekisch definisce gli obiettivi della resistenza: l’indipendenza e la libertà della Germania, la più alta valorizzazione dello Stato, il recupero di tutti i tedeschi che si trovavano sorto il dominio straniero. Coerente col suo rifiuto dei valori economici, Niekisch non contrappone a questo nemico una forma migliore di distribuzione dei beni materiali, né il conseguimento di una società del benessere: ciò che Niekisch cercava era il superamento del mondo borghese, i cui beni si devono “detestare asceticamente". Il programma di "Resistenza" dell’aprile del 1930 non lascia dubbi da questo punto di vista: nello stesso si chiede il rifiuto deciso di tutti i beni che l’Europa vagheggia (punto 7a), il ritiro dall'economia internazionale (punto 7b), la riduzione della popolazione urbana e la ricostituzione delle possibilità di vita contadina (7c-d), la volontà di povertà ed un modo di vita semplice che deve opporsi orgogliosamente alla vita raffinata delle potenze imperialiste occidentali (7f) e, finalmente, la rinuncia al principio della proprietà privata nel senso del diritto romano, poiché “agli occhi dell’opposizione nazionale, la proprietà non ha senso né diritto al di fuori del servizio al popolo ed allo Stato”. Per realizzare i suoi obiettivi, che Uwe Sauermann definisce con precisione identici a quelli dei nazionalisti, anche se le strade e gli strumenti per conseguirli sono nuovi, Niekisch cerca le forze rivoluzionarie adeguate. Non può sorprendere che un uomo proveniente dalla sinistra come lui si diriga in primo luogo al movimento operaio. Niekisch constata che l’abuso che la borghesia ha fatto del concetto "nazionale", impiegato come copertura dei suoi interessi economici e di classe, ha provocato nel lavoratore l’identificazione fra "nazionale" e "socialreazionario", fatto che ha portato il proletariato a separarsi troppo dai legami nazionali per crearsi un proprio Stato. E per quanto questo atteggiamento dell’insieme del movimento operaio sia parzialmente giustificato, non sfugge a Niekisch il fatto che il lavoratore in quanto tale è solo appena diverso da un "borghese frustrato” senz’altra aspirazione che quella di conseguire un benessere economico ed un modo di vivere identico a quello della borghesia. Questa era una conseguenza necessaria al fatto che il marxismo è un ideologia borghese, nata nello stesso terreno del liberalismo e tale da condividere con questo una valorizzazione della vita in termini esclusivamente economici.La responsabilità di questa situazione ricade in gran parte sulla socialdemocrazia che "è soltanto liberalismo popolarizzato e che ha spinto il lavoratore nel suo egoismo di classe, cercando di farne un borghese". Questa attitudine del SPD è quella che ha portato, dopo il 1918, non alla realizzazione della indispensabile rivoluzione nazionale e sociale, bensì "alla ricerca di cariche per i suoi dirigenti” ed alla conversione in una opposizione all'interno del sistema capitalista, anziché in un partito rivoluzionario: L’SPD è un partito liberale e capitalista che impiega una terminologia socialrivoluzionaria per ingannare i lavoratori. Questa analisi è quella che porta Niekisch a dire che tutte le forme di socialismo basate su considerazioni umanitarie sono "tendenze corruttrici che dissolvono la sostanza della volontà guerriera del popolo tedesco". Influenzata molto dal “decisionismo" di Cari Schmitt, l’attitudine di Niekisch verso il KPD è molto più sfumata. Prima di tutto, ed in opposizione al SPD, fermamente basato su concezioni borghesi, il comunismo si regge “su istinti elementari". Del KPD Niekisch apprezza in modo particolare la “struttura autocratica”, la “approvazione a voce alta della dittatura”. Queste caratteristiche renderebbero possibile utilizzare il comunismo come “mezzo” ed il percorrere insieme una parte della strada. Niekisch accolse con speranza il "Programma di Liberazione Nazionale e Sociale" del KPD (24 agosto 1930) in cui si dichiarava la lotta totale contro le riparazioni di guerra e l’ordine dì Versailles, ma quando ciò si rivelò solo una tattica - diretta a frenare i crescenti successi del NSDAP-, cosi come lo era stata la "linea Schlagater" nei 1923, Niekisch denunciò la malafede dei comunisti sul problema nazionale e li qualificò come incapaci di realizzare il compito al quale lui aspirava poiché erano "solo socialrivoluzionari" e per di più poco rivoluzionari. Il ruolo dirigente nel partito rivoluzionario avrebbe quindi dovuto essere ricoperto da un "nazionalista" di nuovo stampo, senza legami con il vecchio nazionalismo (è significativo che Niekisch considerasse il partito tradizionale dei nazionalisti, il DNVP, incapace di conseguire la resurrezione tedesca perché orientato verso l'epoca guglielmina, definitivamente scomparsa). Il nuovo nazionalismo doveva essere socialrivoluzionario, non condizionato, disposto a distruggere tutto quanto potesse ostacolare l’indipendenza tedesca, ed il nuovo nazionalista, fra i cui compiti c’era quello di utilizzare l’operaio comunista rivoluzionario, doveva avere la caratteristica fondamentale di volersi sacrificare e voler servire. Secondo una bella immagine di Niekisch, il comunismo non sarebbe altro che “il fumo che inevitabilmente sale dove un mondo comincia a bruciare”.Si è vista l’immagine offerta da Niekisch della secolare decadenza tedesca, ma nel passato tedesco non tutto è oscuro; c’è un modello al quale Niekisch guarderà costantemente: la vecchia Prussia o, come egli dice, l'idea di Potsdam, una Prussia che con l'apporto di sangue slavo possa essere l’antidoto contro la Germania romanizzata.E così che esigerà, fin dai primi numeri di "Widerstand", la resurrezione di "una Germania prussiana, disciplinata e barbara, più preoccupata del potere che delle cose dello spirito". Cosa significa esattamente la Prussia per Niekisch? O.E. Schüddekopf lo ha indicato esattamente quando dice che nella "idea di Potsdam" Niekisch vedeva tutte le premesse del suo nazional-bolscevismo: "Lo Stato totale, l’economia pianificata, l’alleanza con la Russia, una condizione spirituale antiromana, la difesa contro l'Ovest, contro l'Occidente, l'incondizionato Stato guerriero, la povertà...". Nell'idea prussiana di sovranità Niekisch riconosce l'idea di cui hanno bisogno i tedeschi: quella dello "Stato totale", necessario in quanto la Germania, minacciata dall'ostilità dei vicini per la sua condizione geografica, ha bisogno di diventare uno Stato militare. Questo Stato totale deve essere lo strumento di lotta cui deve essere tutto subordinato - l'economia come la cultura e la scienza - affinchè il popolo tedesco possa ottenere la sua libertà. E’ evidente, per Niekisch - ed in questo occorre ricercare una delle ragioni più profonde del suo nazional-bolscevismo -, che lo Stato non può dipendere da un’economia capitalista in cui offerta e domanda determinino il mercato; al contrario, l’economia deve essere subordinata allo Stato ed alle sue necessità. Per qualche tempo, Niekisch ebbe fiducia in determinati settori della Reichswehr (pronunciò molte delle sue conferenze in questo ambiente militare) per realizzare l’"idea di Potsdam”, ma agli inizi del 1933 si allontanò dalla concezione di una "dittatura della Reichswehr" perché essa non gli appariva sufficientemente "pura" e "prussiana" tanto da farsi portatrice della "dittatura nazionale", e ciò era dovuto, sicuramente, ai suoi legami con le potenze economiche. Un'altro degli aspetti chiave del pensiero di Niekisch è il primato riconosciuto alla politica estera (l'unica vera politica per Spengler) su quella interna. Le sue concezioni al riguardo sono marcatamente influenzate da Macchiavelli (del quale Niekisch era grande ammiratore, tanto da firmare alcuni suoi articoli con lo pseudonimo di Niccolò) e dal suo amico Karl Haushofer. Del primo, Niekisch conserverà sempre la Realpolitik, la sua convinzione che la vera essenza della politica è sempre la lotta fra Stati per il potere e la supremazia, dal secondo apprenderà a pensare secondo dimensioni geopolitiche, considerando che nella situazione di allora - ed a maggior ragione in quella attuale - hanno un peso nella politica mondiale solamente gli Stati costruiti su grandi spazi, e siccome nel 1930 l'Europa centrale di per sè non avrebbe potuto essere altro che una colonia americana, sottomessa non solo allo sfruttamento economico, ma "alla banalità, alla nullità, al deserto, alla vacuità della spiritualità americana", Niekisch propone un grande stato "da Vladivostok sino a Vlessingen", cioè un blocco germano-slavo dominato dallo spirito prussiano con l'imperio dell'unico collettivismo che possa sopportare l'orgoglio umano: quello militare. Accettando con decisione il concetto di "popoli proletari" (come avrebbero fatto i fascisti di sinistra), il nazionalismo di Niekisch era un nazionalismo di liberazione, privo di sciovinismo, i cui obbiettivi dovevano essere la distruzione dell'ordine europeo sorto da Versailles e la liquidazione della Società delle Nazioni, strumento delle potenze vincitrici. Agli inizi del suo pensiero, Niekisch sognava un "gioco in comune" della Germania con i due Paesi che avevano saputo respingere la "struttura intellettuale" occidentale: la Russia bolscevica e l'Italia fascista (è un'altra coincidenza, tra le molte, fra il pensiero di Niekisch e quello di Ramiro Ledesma). Nel suo programma dell'aprile del 1930, Niekisch chiedeva "relazioni pubbliche o segrete con tutti i popoli che soffrono, come il popolo tedesco, sotto l'oppressione delle potenze imperialiste occidentali". Fra questi popoli annoverava l'URSS ed i popoli coloniali dell'Asia e dell'Africa. Più avanti vedremo la sua evoluzione in relazione al Fascismo, mentre ci occuperemo dell'immagine che Niekisch aveva della Russia sovietica. Prima di tutto dobbiamo dire che quest' immagine non era esclusiva di Niekisch, ma che era patrimonio comune di quasi tutti gli esponenti della Rivoluzione Conservatrice e del nazional-bolscevismo, a partire da Moeller van den Bruck, e lo saranno anche i più lucidi fascisti di sinistra: Ramiro Ledesma Ramos e Drieu la Rochelle. Perchè, in effetti, Niekisch considerava la rivoluzione russa del 1917 prima di tutto come una rivoluzione nazionale, più che come una rivoluzione sociale. La Russia, che si trovava in pericolo di morte a causa dell'infiltrazione dei valori occidentali estranei alla sua essenza, "incendiò di nuovo Mosca" per farla finita con i suoi invasori, impiegando il marxismo come combustibile. Con parole dello stesso Niekisch: "Questo fu il senso della Rivoluzione bolscevica: la Russia, in pericolo di morte, ricorse all'idea di Potsdam, la portò sino alle estreme conseguenze, quasi oltre ogni misura, e creò questo Stato assolutista di guerrieri che sottomette la stessa vita quotidiana alla disciplina militare, i cui cittadini sanno sopportare la fame quando c'è da battersi, la cui vita è tutta carica, fino all'esplosione, di volontà di resistenza". Kerenski era stato solo una testa di legno dell' Occidente che voleva introdurre la democrazia borghese in Russia (Kerenski era, chiaramente, l’uomo nel quale avevano fiducia le potenze dell’Intesa perché la Russia continuasse al loro fianco la guerra contro la Germania); la rivoluzione bolscevica era stata diretta contro gli Stati imperialisti dell’Occidente e contro la borghesia interna favorevole allo straniero ed antinazionale. Coerente con questa interpretazione, Niekisch definirà il leninismo come "ciò che rimane del marxismo quando un uomo di Stato geniale lo utilizza per finalità di politica nazionale", e citerà con frequenza la celebre frase di Lenin che sarebbe diventata il leit-motiv di tutti i nazional-bolscevichi: "Fate della causa del popolo la causa della Nazione e la causa della Nazione diventerà la causa del popolo". Nelle lotte per il potere che ebbero luogo ai vertici sovietici dopo la morte di Lenin, le simpatie di Niekisch erano dirette a Stalin, e la sua ostilità verso Trotzskij (atteggiamento condiviso, fra molti altri, anche da Ernst Jünger e dagli Strasser). Trotzskij ed i suoi seguaci, incarnavano, agli occhi di Niekisch, le forze occidentali, il veleno dell’Ovest, le forze di una decomposizione ostile a un ordine nazionale in Russia. Per questo motivo Niekisch accolse con soddisfazione la vittoria di Stalin e dette al suo regime la qualifica di "organizzazione della difesa nazionale che libera gli istinti virili e combattenti". Il Primo Piano Quinquennale, in corso quando Niekisch scriveva, era "Un prodigioso sforzo morale e nazionale destinato a conseguire l’autarchia". Era quindi l’aspetto politico-militare della pianificazione ciò che affascinava Niekisch, gli aspetti socio-economici (come nel caso della sua valutazione del KDP) lo interessavano appena. Fu in questo modo che poté coniare la formula: "collettivismo + pianificazione = militarizzazione del popolo". Quanto Niekisch apprezzava della Russia è esattamente il contrario di quanto ha attratto gli intellettuali marxisti degenerati: “La violenta volontà di produzione per rendere forte e difendere lo Stato, l’imbarbarimento cosciente dell’esistenza... l’attitudine guerriera, autocratica, dell’élite dirigente che governa dittatorialmente, l’esercizio per praticare l’ascesi di un popolo...”. Era logico che Niekisch vedesse nell’Unione Sovietica il compagno ideale di un’alleanza con la Germania, poiché incarnava i valori antioccidentali cui Niekisch aspirava. Inoltre, occorre tener presente che in quell’epoca l’URSS era uno Stato isolato, visto con sospetto dai paesi occidentali ed escluso da ogni tipo di alleanza, per non dire circondato da Stati ostili che erano praticamente satelliti della Francia e dell’Inghilterra (Stati baltici, Polonia, Romania); a questo bisogna poi aggiungere che fino a ben oltre gli inizi degli anni ‘30, l’URSS non faceva parte della Società delle Nazioni né aveva rapporti diplomatici con gli USA. Niekisch riteneva che un'alleanza Russia-Germania fosse necessaria anche per la prima, poiché "la Russia deve temere l'Asia", e solo un blocco dall'Atlantico al Pacifico poteva contenere "la marea gialla", allo stesso modo in cui solo con la collaborazione tedesca la Russia avrebbe potuto sfruttare le immense risorse della Siberia. Abbiamo visto per quali ragioni la Russia appariva a Niekisch come un modello. Ma per la Germania non si trattava di copiare l'idea bolscevica, di accettarla in quanto tale. La Germania - e su questo punto Niekisch condivide l'opinione di tutti i nazionalisti - deve cercare le sue proprie idee e forme, e se la Russia veniva portata ad esempio, la ragione era che aveva organizzato uno Stato seguendo la "legge di Potsdam" che avrebbe dovuto ispirare anche la Germania. Organizzando uno Stato assolutamente antioccidentale, la Germania non avrebbe imitato la Russia, ma avrebbe recuperato la propria specificità, alienata nel corso di tutti quegli anni di sottomissione allo straniero e che si era incarnata nello Stato russo. Per quanto gli accordi con la Polonia e la Francia sondati dalla Russia saranno osservati con inquietudine da Niekisch, che difenderà appassionatamente l'Unione Sovietica contro le minacce di intervento e contro le campagne condotte a sue discapito dalle confessioni religiose. Inoltre, per Niekisch "una partecipazione della Germania alla crociata contro la Russia significherebbe... un suicidio". Questo sarà il rimprovero più importante - e convincente - di Niekisch al nazionalsocialismo, e con ciò giungiamo ad un punto che non cessa di provocare una certa perplessità: l'atteggiamento di Niekisch verso il nazionalsocialismo. Questa perplessità non è solo nostra; durante l'epoca che studiamo, Niekisch era visto dai suoi contemporanei più o meno come un "nazi". Certamente, la rivista paracomunista "Aufbruch" lo accomunava a Hitler nel 1932; più specifica, la rivista sovietica "Moskauer Rundschau" (30 novembre 1930), qualificava il suo "Entscheidung" come "l'opera di un romantico che ha ripreso da Nietzsche la sua scala di valori". Per dei critici moderni come Armin Mohler "molto di quanto Niekisch aveva chiesto per anni sarà realizzato da Hitler", e Faye segnala che la polemica contro i nazionalsocialisti, per il linguaggio che usa "lo colloca nel campo degli stessi". Cosa fu dunque ciò che portò Niekisch ad opporsi al nazionalsocialismo? Da un'ottica retrospettiva, Niekisch considera il NSDAP fino al 1923 come un "movimento nazional-rivoluzionario genuinamente tedesco", ma dalla rifondazione del Partito, nel 1925, pronuncia un'altro giudizio, nello stesso modo in cui modificherà il suo precedente giudizio sul fascismo italiano. Troviamo l'essenziale delle critiche di Niekisch al nazionalsocialismo in un opuscolo del 1932: "Hitler - ein deutsches Verhängnis" (Hitler, una fatalità tedesca) che apparve illustrato con impressionanti disegni di un artista di valore: A. Paul Weber. Dupeux segnala con esattezza che queste critiche non sono fatte dal punto di vista dell'umanitarismo e della democrazia, com'è usuale ai nostri giorni, e Sauermann lo qualifica come un "avversario in fondo essenzialmente rassomigliante". Niekisch considerava "cattolico", "romano" e "fascista" il fatto di dirigersi alle masse e giunse ad esprimere "l'assurdo" (Dupeux) che: "che è nazista, presto sarà cattolico". In questa critica occorre vedere, per cercare di comprenderla, la manifestazione di un atteggiamento molto comune fra tutti gli autori della Rivoluzione conservatrice, che disprezzavano come "demagogia" qualsiasi lavoro fra le masse, ed occorre ricordare, anche, che Niekisch non fu mai un tattico né un "politico pratico". Allo stesso tempo occorre mettere in relazione la sfiducia verso il nazionalsocialismo con le origini austriache e bavaresi dello stesso, poiché abbiamo già visto che Niekisch guardava con diffidenza ai tedeschi del sud e dell'ovest, come influenzati dalla romanizzazione. D'altra parte, Niekisch rimprovera al nazionalsocialismo la sua "democraticità" alla Rousseau e la sua fede nel popolo. Per Niekisch l'essenziale è lo Stato: egli sviluppò sempre un vero "culto dello Stato", perfino nella sua epoca socialdemocratica, per cui risulta per lo meno grottesco qualificarlo come un "sindacalista anarchico" (sic). Niekisch commise gravi errori nella sua valutazione del nazionalsocialismo, come il prendere sul serio il "giuramento di legalità" pronunciato da Hitler nel corso del processo al tenente Scheringer, senza sospettare che si trattava di mera tattica (con parole di Lenin, un rivoluzionario deve saper utilizzare tutte le risorse, legali ed illegali, servirsi di tutti i mezzi secondo la situazione, e questo Hitler lo realizzò alla perfezione), e ritenere che Hitler si trovasse molto lontano dal potere...nel gennaio del 1933. Questi errori possono spiegarsi facilmente, come ha fatto Sauermann, con il fatto che Niekisch giudicava il NSDAP più basandosi sulla propaganda elettorale che sullo studio della vera essenza di questo movimento. Tuttavia, il rimprovero fondamentale concerne la politica estera. Per Niekisch, la disponibilità - espressa nel "Mein Kampf" - di Hitler ad un'intesa con Italia ed Inghilterra e l'ostilità verso la Russia erano gli errori fondamentali del nazionalsocialismo, poiché questo orientamento avrebbe fatto della Germania un "gendarme dell'Occidente". Questa critica è molto più coerente delle anteriori. L'assurda fiducia di Hitler di poter giungere ad un accordo con l'Inghilterra gli avrebbe fatto commettere gravi errori (Dunkerque, per citarne uno); sulla sua alleanza con l'Italia, determinata dal sentimento e non dagli interessi - ciò che è funesto in politica - egli stesso si sarebbe espresso ripetutamente e con amarezza. Per quanto riguarda l'URSS, fra i collaboratori di Hitler Goebbels fu sempre del parere che si dovesse giungere ad un intesa, e perfino ad un'alleanza con essa, e ciò non solo nel periodo della sua collaborazione con gli Strasser, ma sino alla fine del III Reich, come ha dimostrato inequivocabilmente il suo ultimo addetto stampa Wilfred von Owen nel suo diario ("Finale furioso. Con Goebbels sino alla fine"), edito per la prima volta - in tedesco - a Buenos Aires (1950) e proibito in Germania sino al 1974, data in cui fu pubblicato dalla prestigiosa Grabert-Verlag di Tübingen, alla faccia degli antisovietici e filo-occidentali di professione. La denuncia, sostenuta da Niekisch, di qualsiasi crociata contro la Russia, assunse toni profetici quando evocò in un' immagine angosciosa "le ombre del momento in cui le forze...della Germania diretta verso l'Est, sperperate, eccessivamente tese, esploderanno...Resterà un popolo esausto, senza speranza, e l'ordine di Versailles sarà più forte che mai". Indubbiamente Ernst Niekisch esercitò, negli anni dal 1926 al 1933, una influenza reale nella politica tedesca, mediante la diffusione e l'accettazione dei suoi scritti negli ambienti nazional-rivoluzionari che lottavano contro il sistema di Weimar. Questa influenza non deve essere valutata, certamente in termini quantitativi: l'attività di Niekisch non si orientò mai verso la conquista delle masse, né il carattere delle sue idee era il più adeguato a questo fine. Per fornire alcune cifre, diremo che la sua rivista "Widerstand" aveva una tiratura che oscillava fra le 3.000 e le 4.500 copie, fatto che è lungi dall'essere disprezzabile per l'epoca, ed in più trattandosi di una rivista ben presentata e di alto livello intellettuale; i circoli "Resistenza" raggruppavano circa 5.000 simpatizzanti, dei quali circa 500 erano politicamente attivi. Non è molto a paragone dei grandi partiti di massa, ma l'influenza delle idee di Niekisch dev'essere valutata considerando le sue conferenze, il giro delle sue amicizie (di cui abbiamo già parlato), i suoi rapporti con gli ambienti militari, la sua attività editoriale, e soprattutto, la speciale atmosfera della Germania in quegli anni, in cui le idee trasmesse da "Widerstand" trovavano un ambiente molto ricettivo nelle Leghe paramilitari, nel Movimento Giovanile, fra le innumerevoli riviste affini ed anche in grandi raggruppamenti come il NSDAP, lo Stahlhelm, ed un certo settore di militanti del KPD (come si sa, il passaggio di militanti del KPD nel NSDAP, e viceversa, fu un fenomeno molto comune negli ultimi anni della Repubblica di Weimar, anche se gli storici moderni ammettono che vi fu una percentuale maggiore di rivoluzionari che percorsero il primo tipo di tragitto, ancor prima dell'arrivo di Hitler al potere). Queste brevi osservazioni possono a ragione far ritenere che l'influenza di Niekisch fu molto più ampia di quanto potrebbe far pensare il numero dei suoi simpatizzanti. Il 9 marzo del 1933 Niekisch è arrestato da un gruppo di SA ed il suo domicilio perquisito. Viene posto in libertà immediatamente, ma la rivista "Entscheidung", fondata nell'autunno del 1932, viene sospesa. "Widerstand", al contrario, continuerà ad apparire sino al dicembre del 1934, e la casa editrice dallo stesso nome pubblica libri sino al 1936 inoltrato. Dal 1934 Niekisch viaggia per quasi tutti i paesi d'Europa, nei quali sembra abbia avuto contatti con i circoli dell'emigrazione. Nel 1935, nel corso di una visita a Roma, viene ricevuto da Mussolini. Non si può fare a meno di commuoversi nell'immaginare questo incontro, disteso e cordiale, fra due grandi uomini che avevano iniziato la loro carriera politica nelle file del socialismo rivoluzionario. Alla domanda di Mussolini su che cosa aveva contro Hitler, Niekisch rispose:"Faccio mie le vostre parole sui popoli proletari". Mussolini rispose."E' quanto dico sempre a Hitler". (Va ricordato che questi scrisse una lettera a Mussolini - il 6 marzo 1940 - in cui gli spiegava il suo accordo con la Russia, perché "ciò che ha portato il nazionalsocialismo all'ostilità contro il comunismo è solo la posizione - unilaterale - giudaico-internazionale, e non, al contrario, l'ideologia dello Stato stalinista-russo-nazionalista". Durante la guerra, Hitler esprimerà ripetutamente la sua ammirazione per Stalin, in contrasto con l'assoluto disprezzo che provava per Roosevelt e Churchill). Nel marzo del 1937 Niekisch è arrestato con 70 dei suoi militanti (un gran numero di membri dei circoli "Resistenza" aveva cessato la propria attività, significativamente, nel constatare che Hitler stava portando avanti realmente la demolizione del Diktat di Versailles che anch'essi avevano tanto combattuto). Nel gennaio del 1939 è processato davanti al Tribunale Popolare, accusato di alto tradimento ed infrazione sulla legge sulla fondazione di nuovi partiti, e condannato all'ergastolo. Sembra che le accuse che più pesarono contro di lui furono i manoscritti trovati nella sua casa, nei quali criticava Hitler ed altri dirigenti del III Reich. Fu incarcerato nella prigione di Brandenburg sino al 27 aprile del 1945, giorno in cui viene liberato dalle truppe sovietiche, quasi completamente cieco e semiparalitico. Nell'estate del 1945 entra nel KPD che, dopo la fusione nella zona sovietica con l'SPD, nel 1946 si denominerà Partito Socialista Unificato di Germania (SED) e viene eletto al Congresso Popolare come delegato della Lega Culturale. Da questo posto difende una via tedesca al socialismo e si oppone dal 1948 alle tendenze di una divisione permanete della Germania. Nel 1947 viene nominato professore all'Università Humboldt di Berlino, e nel 1949 è direttore dell' "Istituto di Ricerche sull'Imperialismo"; in quell'anno pubblica uno studio sul problema delle élites in Ortega y Gasset. Niekisch non era, ovviamente, un "collaborazionista" servile: dal 1950 si rende conto che i russi non vogliono un "via tedesca" al socialismo, ma solo avere un satellite docile (come gli americani nella Germania federale). Coerentemente con il suo modo di essere, fa apertamente le sue critiche e lentamente cade in disgrazia; nel 1951 il suo corso è sospeso e l'Istituto chiuso. Nel 1952 ha luogo la sua scomunica definitiva, effettuata dall'organo ufficiale del Comitato Centrale del SED a proposito del suo libro del 1952 "Europäische Bilanz". Niekisch è accusato di "...giungere a erronee conclusioni pessimistiche perché, malgrado l'occasionale impiego della terminologia marxista, non impiega il metodo marxista...la sua concezione della storia è essenzialmente idealista...". Il colpo finale è dato dagli avvenimenti del 17 giugno del 1953 a Berlino, che Niekisch considera come una legittima rivolta popolare. La conseguente repressione distrugge le sue ultime speranze nella Germania democratica e lo induce a ritirarsi dalla politica. Da questo momento Niekisch, vecchio e malato, si dedica a scrivere le sue memorie cercando di dare al suo antico atteggiamento di "Resistenza" un significato di opposizione a Hitler, nel tentativo di cancellare le orme della sua opposizione al liberalismo. In ciò fu aiutato dalla ristretta cerchia dei vecchi amici sopravvissuti. Il più influente fra loro fu il suo antico luogotenente, Josef Drexel, vecchio membro del Bund Oberland e divenuto, nel secondo dopoguerra, magnate della stampa in Franconia. Questo tentativo può spiegarsi, oltre che con il già menzionato stato di salute di Niekisch, con la sua richiesta di ottenere dalla Repubblica Federale (viveva a Berlino Ovest) una pensione per i suoi anni di carcere. Questa pensione gli fu sempre negata, attraverso una interminabile serie di processi. I tribunali basarono il rifiuto su due punti: Niekisch aveva fatto parte di una setta nazionalsocialista (sic) ed aveva collaborato in seguito al consolidamento di un'altro totalitarismo: quello della Germania democratica. Cosa bisogna pensare di questi tentativi di rendere innocuo Niekisch si deduce da quanto fin qui esposto. La storiografia più recente li ha smentiti del tutto. Il 23 maggio del 1967, praticamente dimenticato, Niekisch moriva a Berlino. Malgrado sia quasi impossibile trovare le sue opere anteriori al 1933, in parte perché non ripubblicate ed in parte perché scomparse dalle biblioteche, A. Mohler ha segnalato che Niekisch torna farsi virulento, e fotocopie dei suoi scritti circolano di mano in mano fra i giovani tedeschi disillusi dal neo-marxismo (Marcuse, Suola di Frankfurt). La critica storica gli riconosce sempre maggiore importanza. DI quest'uomo, che si oppone a tutti i regimi presenti nella Germania del XX secolo, bisogna dire che mai operò mosso dall'opportunismo. I suoi cambi di orientamento furono sempre il prodotto della sua incessante ricerca di uno Stato che potesse garantire la liberazione della Germania e dello strumento idoneo a raggiungere questo obiettivo. Le sue sofferenze - reali - meritano il rispetto dovuto a quanti mantengono coerentemente le proprie idee. Niekisch avrebbe potuto seguire una carriera burocratica nell'SPD, accettare lo splendido posto offertogli da Gregor Strasser, esiliarsi nel 1933, tacere nella Germania democratica...Ma sempre fu fedele al suo ideale ed operò come credeva di dover fare senza tener conto delle conseguenze personali che avrebbero potuto derivargli. La sua collaborazione con il SED è comprensibile, ed ancor più il modo in cui si concluse. Oggi che l'Europa è sottomessa agli pseudovalori dell'Occidente americanizzato, le sue idee e la sua lotta continuano ad avere un valore esemplare. E' quanto compresero i nazional-rivoluzionari di "Sache del Volches" quando, nel 1976, apposero una targa sulla vecchia casa di Niekisch, con la frase: "O siamo un popolo rivoluzionario o cessiamo definitivamente di essere un popolo libero".
Josè Cuadrado Costa
Articolo tratto dai numeri 56 e 57 di Orion
Per l'approfondimento dell'argomento si consigliano:
- AA.VV., Nazionalcomunismo. Prospettive per un blocco eurasiatico. Ed. Barbarossa 1996
- Origini n°2, L'opposizione nazionalrivoluzionaria al Terzo Reich 1988
- E. Niekisch, Est & Ovest. Considerazioni in ordine sparso. Ed. Barbarossa 2000
- E. Niekisch, Il regno dei demoni. Panorama del Terzo Reich. Feltrinelli Editore 1959
- A. Mohler, La Rivoluzione Conservatrice. Ed. Akropolis 1990
00:14 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : révolution conservatrice, socialisme, nationalisme révolutionnaire, nationalisme, national-bolchevisme, allemagne, weimar, années 20, années 30, histoire, biographie, idéologie, théorie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Avant-Garde Fascism
Avant-Garde Fascism
 Avant-Garde Fascism: The Mobilization of Myth, Art, and Culture in France, 1909–1939
Avant-Garde Fascism: The Mobilization of Myth, Art, and Culture in France, 1909–1939
Mark Antliff
Durham and London: Duke University Press, 2007
Mark Antliff, a professor of Art, Art History, and Visual Studies at Duke University, has put together a useful analysis of the cultural-aesthetic memes utilized by French fascists of 1909-1939 to promote their visions of national renewal. Antliff’s analysis focuses on the connection between fascist ideologies and the European avant-garde, which most people would more likely associate with the anti-national left. Antliff is fairly even handed in the book, with the occasional use of scare quotes to express his skepticism/disdain for certain “fascist ideas.”
In contrast, I believe his use of the term “democracy” should always have scare quotes, as “democratic” systems deceive the populace into believing that someone other than self-interested elites are running the show; however, apparently, Antliff and I disagree on our political preferences. Antliff also concludes the book with a line about how the ideas of the French fascists were not able to stem the tide of the “bloodshed” caused by the military aggressions of Hitler and Mussolini (including the invasion of France). Very well. One hopes an academic will write about the real blood that has been shed imposing “equality” on “the people” – either that of the mass-murdering Marxists or the genocidal globalist multiculturalists and their plans for a multiracial West. So much for my complaints about the book. What about fascism and avant-garde aesthetics?
Roger Griffin, in his Fascism (Oxford: Oxford University Press, 1995), famously described fascism as “palingenetic populist ultra-nationalism” – making the elements of renewal, rebirth, and regeneration central to all permutations of this ideology. It is also important to differentiate between real fascism and “para-fascist” ersatz fascism. Para-fascism is often confused with real fascism in the public mind, which gives the false impression that fascism is ossified reactionary conservatism, rather than a revolutionary movement interested in avant-garde themes and ideas.
The differences between real revolutionary fascism and para-fascism are easily summarized: Para-fascist regimes are authoritarian, traditionalist, reactionary regimes, often military dictatorships, that fossilize a status quo favoring traditional elites of business, nobility, religion, and the military. Such regimes want nothing to do with the revolutionary and palingenetic aspects of true fascism; the idea that the secular religious, Futuristic, and avant-garde characteristics of, say, (early) Italian Fascism has anything to do with Franco’s Spain or Pinochet’s Chile is absurd.
 Indeed, as Griffin makes clear, fascists and para-fascists are usually, by their very nature, bitter enemies. While para-fascists may co-opt some superficial characteristics of their fascist opponents, in power they tend to ruthlessly suppress the expression of revolutionary fascism. When para-fascism attempts to co-opt fascism by sharing power – as Antonescu attempted in Romania with the Legionaries — conflict is inevitable, since the objectives of the two parties are completely different: para-fascist ossification vs. fascist palingenetic regeneration. Thus, in Romania, civil war between para-fascists and fascists led to the victory of the para-fascists, and the exile of the fascist forces. The idea that Antonescu was “fascist” is a byproduct of either ideological ignorance or ideological mendacity, a Marxist desire to strip their fascist competitors of revolutionary dynamism and reduce them to mere “bourgeois hooligans.”
Indeed, as Griffin makes clear, fascists and para-fascists are usually, by their very nature, bitter enemies. While para-fascists may co-opt some superficial characteristics of their fascist opponents, in power they tend to ruthlessly suppress the expression of revolutionary fascism. When para-fascism attempts to co-opt fascism by sharing power – as Antonescu attempted in Romania with the Legionaries — conflict is inevitable, since the objectives of the two parties are completely different: para-fascist ossification vs. fascist palingenetic regeneration. Thus, in Romania, civil war between para-fascists and fascists led to the victory of the para-fascists, and the exile of the fascist forces. The idea that Antonescu was “fascist” is a byproduct of either ideological ignorance or ideological mendacity, a Marxist desire to strip their fascist competitors of revolutionary dynamism and reduce them to mere “bourgeois hooligans.”
Not all fascisms were equally “fascist” and revolutionary, and even individual fascist movements have oscillated between revolutionary ideals and borderline reactionary para-fascism.
For example, Italian fascism went through three distinct phases. In the years before the seizure of power and in the first half-dozen years of Mussolini’s regime, Italian fascism was in its “purest” form – revolutionary and palingenetic – emphasizing the regeneration of the Italian people and the Italian nation-state. Avant-garde themes and theorists, particularly Futurism, were important in this period, and individuals such as Marinetti were influential in early day Italian fascism.
However, the forces of reaction and of compromise with the establishment were always present; the presence of the King and the Vatican were two impediments to the process of “fascistization” that Mussolini could not, or would not, deal with. In the end, the Concordat was a turning point and the regime’s second phase veered to the “right” in the 1930s, becoming more conservative and reactionary, replacing internal regeneration with external imperialism. Without WW II, chances were good that Italian fascism would have degenerated into a stagnant para-fascist regime similar to that of Franco’s Spain.
Military defeat and the overthrow of Il Duce stopped that process; in the last and third phase of Italian fascism, the “Salo Republic,” the ideology shifted to the left, embracing a militant socialism, and becoming overtly pan-European in scope.
What about the Hitler and the Nazis? There has been some debate as to whether German National Socialism was a form of fascism. It seems to me obvious that it was; that differences existed between the Italian and German forms of fascism is not an argument against that conclusion. All genuine fascisms displayed important differences, yet still contained within themselves the core components of Griffin’s “palingenetic populist ultra-nationalism.”
In the case of National Socialism, the palingenesis was biological; Nazism was a heavily racialized and materialist form of fascism. The German National Socialists were tribalistic in worldview rather than Futurist, and, internal debates aside; Hitler himself was very hostile to the European avant-garde.
Thus, key differences between fascist forms are observed. The German brand had the biopolitical advantage of recognizing the importance of race. On the other hand, the Italian brand had the sociopolitical advantage of a more optimistic Futurist orientation, and was more open-minded with respect to tapping into the cultural energies created by the avant-garde artistic and sociopolitical movements extant in the first decades of the twentieth century.
 In some sense, perhaps the “purest” brand of fascism was that of Codreanu and his “Legion of the Archangel Michael,” also known as the Iron Guard. This intensely palingenetic movement emphasized spiritual and moral regeneration to create a Romanian “New Man” to lead the nation to a higher level and fulfill the destiny of the Romanian people. This highly “virulent” form of “palingenetic populist ultra-nationalism” proved itself unable to co-exist with Antonescu’s conservative authoritarian para-fascism; the Legionary movement’s attempt to seize full power for itself (rather than share it with para-fascists; this sharing was correctly seen by the Legionaries as being an emasculating compromise of their ideology) was crushed by the para-fascist military apparatus.
In some sense, perhaps the “purest” brand of fascism was that of Codreanu and his “Legion of the Archangel Michael,” also known as the Iron Guard. This intensely palingenetic movement emphasized spiritual and moral regeneration to create a Romanian “New Man” to lead the nation to a higher level and fulfill the destiny of the Romanian people. This highly “virulent” form of “palingenetic populist ultra-nationalism” proved itself unable to co-exist with Antonescu’s conservative authoritarian para-fascism; the Legionary movement’s attempt to seize full power for itself (rather than share it with para-fascists; this sharing was correctly seen by the Legionaries as being an emasculating compromise of their ideology) was crushed by the para-fascist military apparatus.
Three fascisms, three different movements. But the revolutionary energies unleashed by these ideologies stand in sharp contrast to the moribund and ossified conservatism of the para-fascists. The political/cultural avant-garde (Italian), the biological-racialist (German), and the spiritual/moral (Romanian) components of these fascisms are important to us today.
And it is probably wrong to separate out the avant-garde mindset as being only applicable to the political/cultural sphere. After all, we really do need new, cutting-edge memes with respect to both materialist race and non-materialist morality. To quote a certain pro-fascist poet: “Make it new!”
 With respect to Antliff’s book itself, chapter topics include Sorelian myth and anti-Semitism, and the fascistic politics of Valois, Lamour, and Maulnier. The importance of Sorelian myth was underscored by a recent Michael O’Meara piece that appeared on TOQ Online. Antliff stresses that culture and aesthetics were extremely important to Sorel in his quest to formulate a doctrine of instrumentally utilizing myth to overturn the hated rationalist-capitalist-democratic system. Art is part of this aesthetic emphasis and, truth be told, Sorel focused on culture over politics; indeed, he was scornful of the power of the myth being used and squandered for low-level political aims.
With respect to Antliff’s book itself, chapter topics include Sorelian myth and anti-Semitism, and the fascistic politics of Valois, Lamour, and Maulnier. The importance of Sorelian myth was underscored by a recent Michael O’Meara piece that appeared on TOQ Online. Antliff stresses that culture and aesthetics were extremely important to Sorel in his quest to formulate a doctrine of instrumentally utilizing myth to overturn the hated rationalist-capitalist-democratic system. Art is part of this aesthetic emphasis and, truth be told, Sorel focused on culture over politics; indeed, he was scornful of the power of the myth being used and squandered for low-level political aims.
Further, Sorel went through a distinctly “anti-Semitic” phase, in which Jews were considered the exemplars of ultra-rationalist anti-creators, whose worldview set them in opposition to native peoples and native cultural expressions and aesthetics. Opposing the pro-Dreyfus “French” journal La revue blanche, Sorel sarcastically referred to the journal’s Jewish founders as “two Jews come from Poland in order to regenerate our poor country, so unhappily still contaminated by the Christian civilization of the seventeenth century.” Sorel accused Jewish intellectuals of wanting to promote an abstract (i.e., non-ethnic, non-national, non-cultural) concept of (French) citizenship and to also promote “cosmopolitan anarchy.”
Related to this “anti-Semitism,” Sorel admired and promoted the Classical World; the values of classical heroes, such as the Greeks at Thermopylae, were something counterpoised against the Jewish ethic and the degeneration of parliamentary democracy.
Sorel considered art as related to the creativity of work, a creativity that he wished to inculcate into the “productive workers” in place of assembly line mass capitalism and rationalized “one man-one vote” democracy. He also considered an enlightened “proletariat” as being able to reinvigorate a stagnant bourgeoisie through class conflict.
Georges Valois, 1878–1945

Georges Valois (born Alfred-Georges Gressent) went through a wide variety of ideological contortions in his lifetime, from fascism to “libertarian communism,” ending up dying in a Nazi concentration camp after being captured as a member of the “French Resistance.” While such an unbalanced individual represents much of what is wrong with the “movement” (changing your mind is one thing – completely switching your worldview from one moment to the next is another), some of his activities during his “fascist stage” are of interest.
Particularly enlightening is the focus on the urbanism of Le Corbusier, which stands in contrast to much of the American “movement” and its anti-urbanist emphasis on militant ruralism. No doubt, in the West today, the city is an anti-white, anti-Western disaster, full of racial enemies. No doubt as well that throughout much of human history, the city was an unhealthy and sterilizing place, inimical to racial survival and racial progress.
However, in our modern technological age, if we can solve our racial problems, the city itself does not necessarily have to be a racial evil. As part of a natural continuum of human ecologies – isolated rural, rural, suburban/town, small city, larger cities, etc. – the city may play an important role in the Futurist racial ethnostate of tomorrow, a place of technological advancement, racially healthy avant-garde memes, and sociopolitical dynamism. Racial nationalism can and should be reconciled to a certain degree of urbanism – not the urbanism of degeneration, but that of regeneration.
This of course underlies a schism within activism that often goes unnoticed – between modernist, technological tribalist-racialist Futurism and a ruralist anti-technological ecotribalism. It is clear that the French fascists described by Antliff for the most part fall into the first group. Thus, a major divide exists between the Futurist-Modernist fascists (think Marinetti in Italy) and the ruralist soil-oriented romantic past-oriented fascists (think Darre in Germany, or the agrarian-nostalgic Vichy regime in France).
Of course, a healthy society needs both worldviews, and in practical terms a balance is required. For example, Valois incorporated a “love for the native soil” along with his Futurist mindset. Indeed, Valois contrasted “Asiatic nomadness” associated with communism with the “Latin sedentary” style — derived from “cultured Roman legions” — of the French, tied to the native soil and inclined to fascism. He also associated the hated nomadic lifestyle with capitalism, since hyper-rational capitalism uprooted the workers from grounding in an organic society and turned them into atomized, rootless “nomads.”
A related issue is the relationship between Futurism and the veneration of the past. Antliff makes clear that the emphasis on the past in fascism (e.g., the Greco-Roman classical world) was not meant to mean turning back the clock and shunning progress. Instead, this look to the past was, paradoxically, futurist, in that the fascists wanted to take from the past certain noble values and behaviors and use these to help build the modern, technological world of tomorrow. Therefore, one need not discard the past to build a new future, but judiciously use elements of the past as necessary building blocks for the projected futurist edifice. Different strands of fascist thought need not be incompatible, just as common ground must be found between the tribalist futurist and tribalist ruralist strands of modern racial nationalist thought.
Another French fascist, Philippe Lamour, also went through many ideological “twists and turns,” ultimately rejecting fascism in favor of anti-fascism and syndicalism. Lamour originally represented the fascist variant of “machine primitivism” – that is, an anti-rationalist “new consciousness attuned to the dynamism of technology.” Thus, urban industrialism, technology, productivity, and futurist modernism need not be associated with “rational” egalitarianism but with tribalistic fascism. Lamour wished to create a “community of producers” integrating the different classes of French society to overturn liberal democracy in favor of a modernist technologically dynamic fascist state.
Early French fascists such as Lamour also promoted the idea of a European federation, and attempted to make common cause with more pan-European and “leftist” German National Socialists, such as the Strasserian “Black Front,” who favored European cooperation as opposed to Hitler’s hegemony through military conquest. Not coincidentally, before he fell into Hitler’s orbit, Mussolini also favored an alliance of European (fascist) states, promoted through the doctrine of “Roman Universality,” with practical expression through events such as the pan-fascist Montreux conference.
Lamour’s greatest contribution to French fascism was the promotion of the “conflict of generations,” pitting the younger fascistic generation of WW I against the older generation of parliamentary democrats. This latter group was seen as being out of touch with the new age of national regeneration, avant-garde culture and politics, Sorelian myth, as well as technological productivity. Lamour and his “war generation” were at the forefront of the battle of youth vs. the image of fossilized reactionary status quo politicians.
Aesthetically, the work of German artist Germaine Krull and even Soviet filmmaker Sergei Eisenstein influenced the avant-garde sensibilities of “machine primitive” young French fascists such as Lamour. Antliff summarizes Lamour’s unique contribution to the ideology of interwar French fascism as the melding of “machine aesthetics” to the concept of generational warfare. Thus, to Lamour, technological dynamism and the replacement of the ossified previous generation with fresh youth were the Sorelian myths required to spark an era of national renewal.
Thierry Maulnier, 1908–1988

Thierry Maulnier (born Jacques Talagrand), author of “Crisis Is in Man,” had as his concept of Sorelian myth “classical violence.” Within the journal Combat, Maulnier and colleagues opposed the leftist French Popular Front’s Marxist-themed “culture” with their own view of aesthetics in architecture and sculpture. Antliff describes Combat’s as focusing on “three interrelated spheres: political institutions, human spirituality, and aesthetics.” The classicism of the Maulnier school promoted the idea of a “synthesis of Dionysian energy and Apollonian restraint.”
Politically, Maulnier wished for a form of French fascism that rejected parliamentary democracy but which still supported the rights and aspirations of the individual, as opposed to what was perceived as the more authoritarian and collectivist societies of Fascist Italy and National Socialist Germany. These distinctions between French and other fascisms became more salient after Mussolini fell into Hitler’s orbit and became hostile to French national interests. Indeed, before the start of WW II, Maulnier advocated a “minimal fascist program” for France that would be both a short-term “fix” to bolster the French military for confrontation with the Axis, as well as preparation for the long-term and permanent fascistic remodeling of society after the Axis threat had dissipated.
It must be noted that the Valois, Lamour, and Maulnier fascist ideologies, while linked together by a palingenetic call for national renewal and a rejection of parliamentary democracy, did differ in important ways. In particular, the classicism of Maulnier can be contrasted with the militant futurism and “machine primitivism” of Lamour. Although Antliff stresses that the French fascist focus on the classical world does not necessarily imply a rejection of modernism per se, the specific differences between Maulnier and Lamour were the greatest of any of the individuals profiled by Antliff. Valois and Lamour both embraced the image of “industrial production” as a central motif of their ideology; however, while Lamour spun together a myth of generational conflict, Valois instead emphasized a “spirit of victory” in which the heroism of WW I will now be turned to a battle of the entire nation to create an organized fascist-industrial society. Of these three men, it was Lamour who was the most steadfastly “avant-garde” in cultural-aesthetic orientation, Maulnier the least.
Crude ethnic stereotyping may lead one to conclude that an emphasis on art, culture, and aesthetics in the creation of fascist ideology was (and is) a particularly “French” phenomenon. Of course, other fascist movements were concerned with these issues, sometimes to a significant extent, but none of them incorporated such memes into the core of the political thinking as did French fascist thinkers. Indeed, the cultural-aesthetic emphasis of the French strain of fascism is a breath of fresh air after immersion in the more focused political thought of the Italian Fascists and the racialist ideals of the German National Socialists.
In fact, all three areas of focus – cultural-aesthetic, political, and racialist – are required for a complete memetic complex to promote fascistic ideals. As a biological reductionist, I would emphasize the racialist first of all, but doing so with respect to modern genetic science rather than the sort of quackery that passed as “racial science” under the Nazis. However, biological racialism by itself is not enough. Without an edifice of political and cultural-aesthetic memes, the foundation of ultimate interests will go nowhere.
Related to this issue of political aesthetics, I was impressed by Alex Kurtagic’s analysis of “semiotic systems” and the importance of style in shaping perceptions of status within nationalist memes. This is important. Of course, the enemy will, as a matter of course, attempt to oppose this approach through co-option and/or mockery.
Co-option is a problem for any memetic threat to establishment power; for example, the GOP has effectively co-opted “rightist, racist” concerns through the exploitation of “implicit whiteness.” This strategy has enabled the Republicans to retain white support while at the same time moving continuously leftward in the direction of overtly anti-white policies.
Thus, while aesthetics and style are important, they always must be innately linked to content to prevent the establishment from utilizing the same semiotic systems to promote the exact opposite of our objectives. Dealing with co-option will be difficult, and it is crucially important that the problem be analyzed from the beginning in a proactive fashion.
In other words, right from the start, the construction of unique avant-garde racial-nationalist semiotic systems must incorporate strategies for preventing co-option and dealing with co-option if these preventive measures fail. Therefore, we must identify, in advance, as many problems with each approach as possible, and develop multiple contingency plans for dealing with each emergent counter-move of the establishment.
Mockery is also a problem; the establishment, utilizing its control of the mass media and its stable of celebrity puppets, can subject any racial-nationalist semiotic system to a barrage of withering ridicule. It is important that the elitist and superior nature of the system be of sufficient strength that adherents can turn around such ridicule and assert it as a matter of pride and not shame. In other words, the establishment ridicule itself must be mocked as the pathetic attempts of a dying and out-of-touch system to delegitimize a novel movement of which they are afraid.
Again, careful planning is required to plan against the establishment’s ridicule strategy, but if both co-option and mockery can be successfully dealt with, the semiotic-aesthetic strategy has a chance to achieve its objectives. And those objectives are, in essence, to defuse the “social pricing” attacks of the establishment against racial-nationalist activists and adherents, by providing an alternative value system opposed to, and independent of, establishment standards and acceptance.
In summary, Antliff has dissected a particularly interesting and heretofore unexplored strain of French fascism characterized by an embrace of avant-garde cultural concepts, modernism, Futurism, productivity and the planned society, urbanism and industrial technology, exemplified by so-called “machine primitivism.”
With today’s worries of “peak oil,” and concerns that the multiracial West will collapse, visions of decentralized ruralistic tribalism have again become prominent in nationalist thought. However, the white man is endlessly inventive, and free of the shackles of genocidal globalist multiculturalism, the technological genius of whites, so unleashed, may provide the foundation for a Futurist, technologically advanced and tribalist society. Such a society would have options for both the urbanist technological and ruralist agrarian lifestyles for those whose preferences are for one or the other.
Although I am sure he is an “anti-fascist,” Antliff’s work helps us to consider one technological Futurist option. The major conclusion from both Antliff’s and Kurtagic’s analyses is that staid and conformist methods for sociopolitical activism may be best replaced, at least in part, by avant-garde memes that let some “fresh air” into stale “movement” environs.
00:13 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, littérature italienne, lettres italiennes, art, avant-gardes, futurisme, fascisme, années 20, années 30 |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Pas d'Europe unie sans la Russie!
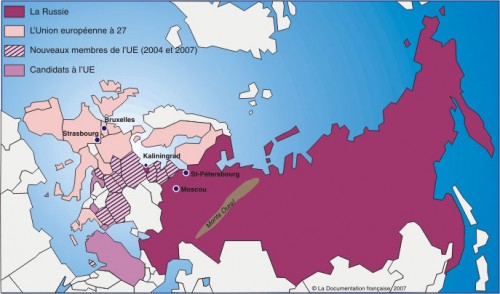
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 2004
Pas d'Europe unie sans la Russie
Article de Vladimir Simonov,
commentateur politique de RIA-Novosti, 24 février 2004.
Les ultimatums posés à la Russie dans l'histoire contemporaine n'ont jamais aidé leurs auteurs à atteindre leurs objectifs.
La déclaration conjointe adoptée lundi à Bruxelles à la rencontre des chefs des diplomaties des pays membres de l'Union européenne rappelle beaucoup un ultimatum. L'Union européenne évoque devant la Russie les "graves conséquences" qu'entraînerait son refus d'étendre l'Accord de partenariat et de coopération conclu en 1997 aux nouveaux pays qui adhéreront à l'UE le 1er mai.
Moscou souhaite revoir cet accord, car la Russie a des échanges commerciaux avec les pays d'Europe de l'Est, nouveaux membres de l'Union européenne en vertu de traités dont les délais n'expireront pas vers mai prochain, loin s'en faut.
L'UE s'y oppose catégoriquement. Selon la déclaration adoptée à Bruxelles, l'Accord de partenariat et de coopération doit s'étendre automatiquement aux nouveaux membres du club européen. Bruxelles laisse entendre par là que l'élargissement de l'Union européenne est une affaire intérieure de l'organisation et qu'elle le restera même si cela ne plaît pas à Moscou. Mais le problème est ailleurs: les belles formules de la "Stratégie générale de l'UE à l'égard de la Russie", document fondamental adopté en juin 1999 par le Conseil de l'Europe à Cologne, garderont-elles leur sens après l'élargissement de l'UE? Ce document mentionne maintes fois des objectifs stratégiques de l'UE comme "l'intensification de la coopération avec la Russie", la création d'une "Russie prospère", d'une "économie de marché florissante dans l'intérêt de tous les peuples de la Russie", etc.
Cependant, Bruxelles ne peut pas ne pas comprendre que l'extension automatique des normes de l'Accord de partenariat et de coopération à 10 nouveaux membres de l'UE portera un coup dur aux intérêts économiques de la Russie. Les dizaines de traités et d'accords commerciaux et économiques qui sont aujourd'hui en vigueur seront résiliés. L'exportation d'aluminium, de céréales, d'engrais chimiques et de combustibles nucléaires vers l'Europe centrale et en Europe de l'Est se heurtera à une multitude de facteurs négatifs.
Bref, selon les estimations des experts russes et occidentaux, l'élargissement d'après la variante que Bruxelles essaie d'imposer à Moscou causera à l'économie russe un préjudice d'au moins 300 millions d'euros, ce qui permet de juger des propos sur le souci de créer une "Russie prospère".
Il est à remarquer qu'en refusant à Moscou le droit de défendre ses intérêts contre les conséquences négatives de l'élargissement de l'UE, ses membres n'ont pas l'intention de sacrifier leurs propres droits à l'autodéfense.
Ainsi, 14 des 15 membres de l'Union européenne adoptent en hâte, ces derniers mois, toutes sortes de lois et de normes qui leur permettraient de réduire considérablement l'arrivée d'immigrés des pays qui adhéreront au club européen le 1er mai. La Belgique introduit des restrictions sur l'octroi des permis de travail qui seront en vigueur pendant les deux années suivant l'élargissement de l'UE, sans donner d'éclaircissements à ce sujet. L'Allemagne prévoit de prolonger ces restrictions jusqu'à 7 ans. Les Pays-Bas établissent le quota de 22 000 ouvriers immigrés par an pour ceux qui arrivent des pays d'Europe de l'Est. La Grande-Bretagne les prive de la plupart des allocations sociales.
Personne n'a l'intention d'étendre automatiquement aux nouveaux membres de l'Union européenne les règles conformes à la situation précédant le 1er mai 2004.
Se rendant compte de l'absence de logique des exigences présentées à Moscou d'étendre l'Accord de partenariat et de coopération à 25 pays (aujourd'hui, il concerne 15 pays), Bruxelles veut noyer cette iniquité dans son mécontentement face à la politique intérieure des autorités russes.
Dans la même déclaration conjointe, les ministres des Affaires étrangères de l'UE rappellent la violation des droits de l'homme en Tchétchénie, "l'imperfection du système électoral russe", ils proposent à Moscou de ratifier dans les plus brefs délais le protocole de Kyoto sur le réchauffement du climat global et de récupérer les immigrés illégaux russes expulsés par les pays de l'UE.
Moscou connaît ses côtés faibles mieux que n'importe quel critique. La Russie est prête à accepter graduellement les valeurs européennes, mais, pour l'instant, elle déploie ses efforts principaux en vue de remplacer l'économie centralisée par l'économie de marché. La Russie traverse une période transitoire dramatique et voudrait compter sur la compréhension, la coopération et le partenariat de l'UE, et pas seulement sur les observations critiques formulées sur un ton sans appel à son adresse.
Pour l'instant, Moscou soupçonne de plus en plus que l'élargissement de l'Union européenne dans sa variante actuelle représente probablement une tentative de créer un espace européen sans la participation de la Russie, ou bien une zone géopolitique où le rôle réservé à la Russie serait secondaire, celui de pays de seconde zone.
Multipliant les prétentions et les exigences adressées à Moscou, Bruxelles méprise en même temps les intérêts nationaux de la Russie. L'exigence d'étendre automatiquement l'Accord de partenariat et de coopération aux nouveaux membres de l'UE ne fait que mettre en lumière un problème plus important. Le mémorandum du ministère russe des Affaires étrangères envoyé fin janvier à la Commission européenne en parle de manière plus détaillée. L'élargissement de l'Union européenne serait moins douloureux, laisse entendre ce document, si les milieux dirigeants de Bruxelles comprenaient mieux ce que la Russie veut obtenir de l'UE.
Elle ne veut rien d'extraordinaire et, d'autant moins, rien d'injustifié du point de vue des intérêts nationaux réels de la grande puissance européenne qui assure 36 % des livraisons de gaz et 10 % de celles de pétrole aux pays de l'UE.
La Russie voudrait participer plus dignement à l'adoption de décisions au sein de l'Union européenne, à plus forte raison après l'adhésion à cette organisation des pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, ses partenaires économiques traditionnels. Moscou saluerait les tarifs commerciaux plus équitables de l'UE pour l'acier, les produits pharmaceutiques, le matériel aéronautique et les technologies nucléaires russes.
La Russie ne comprend pas non plus pourquoi l'Union européenne hésite à inviter l'Estonie, surtout la Lettonie, c'est-à-dire ses nouveaux membres, à garantir l'accès aux valeurs européennes pour la minorité russophone de ces pays, notamment la liberté d'étudier et de développer sa culture en langue maternelle.
Moscou compte sur une attitude moins indifférente de Bruxelles vis-à-vis du problème du transit de Kaliningrad et, dans un avenir prévisible, envers les voyages sans visas entre la Russie et l'UE.
Le problème principal se profile derrière cette avalanche de souhaits, de prétentions et de remarques critiques qui s'accroît dans les rapports entre la Russie et l'Union européenne: dans quelle mesure Bruxelles est-il prêt au partenariat stratégique réel, et non déclaratif, avec Moscou, partenariat décrit d'une manière si attrayante dans l'Accord de 1997 ? D'ailleurs, il ne faut pas oublier un axiome: il est impossible de créer la communauté paneuropéenne sans la présence de la Russie.
Vladimir SIMONOV.
00:05 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, russie, europe, affaires européennes, politique internationale, eurasie, eurasisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 08 avril 2010
über die Mechanismen der Medienmanipulation
Weg mit der Schweigespirale!
Über die Mechanismen der Medienmanipulation
Wie ehrlich kann man heute noch sein? Was darf man noch ungestraft sagen? Kann jeder gefahrlos seine eigene Meinung, abseits des Mainstream, äußern? Werden wir immer sachlich von den Medien unterrichtet und informiert? Nein! Ganz sicher nicht!
 Die Pionierin der Meinungsforschung, Elisabeth Noelle-Neuman (vor wenigen Tagen 93-jährig gestorben), wusste über das Thema Meinungsfreiheit theoretisch viel zu sagen, mehr übrigens, als sie selbst es häufig praktisch umzusetzen wagte. Ihre Vorliebe für die Mächtigen hat sich bis heute in ihrem Meinungsforschungsinstitut »Demoskopie Allensbach« erhalten, was einige Beispiele gleich zeigen werden. So galt sie als enge Vertraute der meist konservativen Polit-Elite: Mit Adenauer trank sie Tee, Kohl verehrte sie und pflegte einen jahrelangen »Beratungskontakt«. Vielleicht gerade durch diese nicht unerheblichen Verflechtungen konnte sie genau erkennen, wohin zu viel Macht und Einfluss führen können: in die sogenannte »Schweigespirale«, deren Begriff sie schließlich erschuf und prägte! Schweigespirale? Was ist das denn? Und wo gibt’s die? Überall! Und zunehmend mehr! Sie hat die Menschen fest im Griff, diese Schweigespirale. Ihre Existenz allein beweist, dass sich viele Menschen im Lande ihre Meinung nicht auszusprechen getrauen, aus Angst, ausgelacht und ausgegrenzt zu werden. Es ist an der Zeit, offen über die Meinungsfreiheit als eine der wichtigsten gesellschaftspolitischen Forderungen zu diskutieren, diese endlich mit allen Mitteln einzufordern und die Schweigespirale zu zerstören!
Die Pionierin der Meinungsforschung, Elisabeth Noelle-Neuman (vor wenigen Tagen 93-jährig gestorben), wusste über das Thema Meinungsfreiheit theoretisch viel zu sagen, mehr übrigens, als sie selbst es häufig praktisch umzusetzen wagte. Ihre Vorliebe für die Mächtigen hat sich bis heute in ihrem Meinungsforschungsinstitut »Demoskopie Allensbach« erhalten, was einige Beispiele gleich zeigen werden. So galt sie als enge Vertraute der meist konservativen Polit-Elite: Mit Adenauer trank sie Tee, Kohl verehrte sie und pflegte einen jahrelangen »Beratungskontakt«. Vielleicht gerade durch diese nicht unerheblichen Verflechtungen konnte sie genau erkennen, wohin zu viel Macht und Einfluss führen können: in die sogenannte »Schweigespirale«, deren Begriff sie schließlich erschuf und prägte! Schweigespirale? Was ist das denn? Und wo gibt’s die? Überall! Und zunehmend mehr! Sie hat die Menschen fest im Griff, diese Schweigespirale. Ihre Existenz allein beweist, dass sich viele Menschen im Lande ihre Meinung nicht auszusprechen getrauen, aus Angst, ausgelacht und ausgegrenzt zu werden. Es ist an der Zeit, offen über die Meinungsfreiheit als eine der wichtigsten gesellschaftspolitischen Forderungen zu diskutieren, diese endlich mit allen Mitteln einzufordern und die Schweigespirale zu zerstören!
Die Begriffserschafferin Noelle-Neumann, die jegliche Manipulationsmechanismen aus dem FF kannte und nicht selten nutzte, definierte einmal selbst, die Schweigespirale führe dazu, dass ein politisches Lager oder eine öffentliche Mehrheit sich für schwach erklärt und immer mehr verstummt, während das andere, durchaus kleinere Lager Oberwasser bekommt und siegesgewiss auftritt. Die Frage muss hier lauten: Durch was und wen bekommt denn die andere Seite eigentlich Oberwasser? Natürlich durch Einfluss und Macht! Welche gesellschaftliche Gruppe besitzt diese Macht? Zum Beispiel die Politik, deren Verbindung und Einfluss auf die Medien nicht unerheblich ist! Ein gut organisiertes Netz funktioniert doch hier seit vielen Jahren bestens. Zu wessen Vorteil? Sicher nicht zu dem der Bürger.
Kommt einem irgendwie bekannt vor, oder? Die angebliche bundesdeutsche Meinungsfreiheit und Demokratie ist vielerorts zu einer fast alles beherrschenden »Mediokratie« verkommen. Was nicht in den »Mainstream«, nicht in die politisch gedachten Vorgaben, was nicht in das globalisierte, modernisierte, feminisierte und »fortschrittliche« Weltbild passt, wird oft lächerlich gemacht, zerredet und vernichtet: als Verschwörungstheorie, als politisch Unkorrektes! Manchmal werden dazu Methoden benutzt, die nicht nur allein dem Ansehen jener »Störer« schaden, sondern ihnen oft schwere persönliche, wirtschaftliche und berufliche Nachteile bringen, sie nicht selten gar sozial und öffentlich erledigen und vernichten. Jene Menschen, die anderer Meinung sind als die der politisch und medial hergestellten, angeblichen »Mehrheit«, die aber in Wirklichkeit einer »Mini-Größe« entsprechen und lediglich künstlich aufgeblasen werden durch mediale Machtpositionen, ziehen sich zurück und verstummen, um nicht verspottet zu werden. Dass zu den enttäuscht Schweigenden inzwischen längst eine ganze Reihe von einst unabhängigen Journalisten gehört, die ihre »Einzelmeinung« medial kaum noch umzusetzen in der Lage sind, ist kein Geheimnis mehr. Sie fürchten um ihre Reputation und um ihren Arbeitsplatz!
»Wer sieht, dass seine Meinung an Boden verliert, verfällt in Schweigen«, schrieb Noelle-Neumann einmal. So entstünden verzerrte Mehrheits- und Stärkeverhältnisse in öffentlichen Debatten oder auch bei Wahlen, da sich eine schweigende Minder- oder gar Mehrheit einer vermeintlichen Mehrheitsmeinung (oft die der links-liberalen Medien) anpasse, aus der Furcht heraus, isoliert zu werden. Der links-liberalen Medien? Wo sind die denn? Sie sind inzwischen überall! Oder wer von den sogenannten Journalisten fällt heute noch durch konservative Werte-Berichterstattung und ihre Einforderung auf?
Kritiker warfen Noelle-Neumann und ihrem Meinungsforschungsinstitut »Demoskopie Allensbach« übrigens nicht selten »Vetterleswirtschaft« mit der jeweiligen Regierung und ihren Parteien vor, zu denen Manipulation und Suggestion von Meinungen gehört. Aha? Interessant. Diese Frau war immerhin die deutsche Erfinderin der Wahlprognosen und Meinungsumfragen. Noch heute arbeiten die meisten Berliner Bundesministerien mit dem Allensbacher »Haus«-Institut am Bodensee zusammen. Und nicht selten fallen die von den politischen Einrichtungen beauftragten Umfragen überraschenderweise anders aus als jene von den meisten übrigen Instituten. Komisch, oder?
Hier einige Beispiele über merkwürdige Widersprüche in unterschiedlichen Studien zum Thema »Familie – ein Auslaufmodell?« anlässlich einer verstärkten Diskussion im Zeitraum 2006 bis 2009 über die Frage, ob die klassische Familie ausgedient habe und dem neuen, globalisierten Bild der erwerbstätigen Frau, des fremdbetreuten Kindes und dem Haushalt führenden Mann etwa gewichen sei:
Eine EU-Studie über »Werteorientierungen« in europäischen Ländern, über die die Weltwoche im Mai 2007 ausführlich berichtete, ergab, dass die Familie bei den Befragten beinahe ohne Ausnahme zu alleroberst steht, vor allen anderen Beurteilungen wie Arbeit, Freunde, Freizeit, Partnerschaft, Religion und Politik. Bevorzugt wurde in den Ergebnissen das Zusammensein der Mütter mit ihren Kleinstkindern, anstatt sie in die Fremdbetreuung zu geben. Selbst die Akademiker, denen man diese Gesinnung eher nicht unterstellen würde, die bekanntermaßen später heiraten und weniger Kinder bekommen, äußerten sich bei dieser Studie ausgesprochen positiv zum klassischen Familienbild. Eine andere Untersuchung, die des Österreichischen Instituts für Familienforschung, ergab im etwa gleichen Zeitraum ein ähnliches Ergebnis: Nämlich dass die politisch vorangetriebene Außerhausbetreuung von Kleinkindern auf keine großen Sympathien in diesem Land stößt. Nur sechs Prozent aller Befragten sprachen sich dafür aus, jedoch über 70 Prozent nannten sich selbst oder den Partner als ideale Bezugsperson für ihre Kleinsten.
Umfragen des »Generationen-Barometer 06« korrigierten das Bild von der Familie als Auslaufmodell ebenfalls. 84 Prozent der Befragten bezeichneten laut Institut für Demoskopie Allensbach (Noelle-Neumann) den Zusammenhalt in ihrem engeren Familienkreis als »stark« oder sogar als »sehr stark«. Noch mehr Anlass zur Irritation boten die Ergebnisse des Mikrozensus 2005, nach denen in Deutschland neun von zehn Paaren Ehepaare und drei Viertel aller deutschen Familien traditionelle »Vater-Mutter-Kind-Familien« waren.
Die Universität Hohenheim bei Stuttgart führte eine Untersuchung durch, bei der knapp 94 Prozent der Befragten sich eine Familie wünschten. Geborgenheit und Rückhalt brachten sie mit dieser Lebensform in Verbindung. Auch die gewünschte Kinderzahl lässt aufhorchen: 2,4 Kinder, also eins mehr als der deutsche Durchschnitt, so ergab die Untersuchung, seien das Traumziel der jungen Akademiker. Überraschend auch die Aussage, dass sie zwar alternative Lebensformen akzeptierten, für sich selbst jedoch das klassische Familienbild anstreben. Und auch die Bereitschaft, Karrierepläne, persönliche Freiheiten und sogar das Einkommen einzuschränken zugunsten von eigenen Kindern, war erstaunlich hoch: Auf einer Skala von eins bis fünf lag der Durchschnittswert bei 3,9.
»Eine Emanzipation der Emanzipationsbewegung«, so nannte die Schweizer Weltwoche angesichts dieser Zahlen denn auch den neuen Zeitgeist: »Nach Jahrzehnten der Abwertung, die ironischerweise durch die Frauenrechtsbewegung mit verursacht wurde, treten Hausfrauen mit neuem Selbstbewusstsein auf. Sie werben für die Attraktivität eines Berufs, den sie aus eigenen Stücken gewählt haben.« Es wurde offensichtlich, dass es eine große Kluft zwischen guten Erfahrungen in der eigenen Familie und dem schlechten, öffentlichen Image dieser Institution gab. Auch wenn bereits seit einiger Zeit ein Rückgang der klassischen Familie zu beobachten war, zumindest, was die Zahlen angeht, so war und ist die Qualität und die soziale Leistung der großen Mehrheit der Familien bei Weitem unterbewertet. Es gilt somit gestern wie heute: Familie ist besser als ihr Ruf. Was also veranlasst die Politiker anzunehmen, dass die traditionelle Familie passé sei? Nun, Gründe dafür gibt es genug: Internationale Programme wie Gender Mainstreaming, die EU-Vorgaben wie den massiven Krippenausbau in den EU-Ländern zur Folge haben, Geldnöte etc.
Jetzt könnte man also bereits verlässlich feststellen, dass ein erheblicher Unterschied zwischen der politischen und medialen Forderung nach mehr Fremdbetreuung und Erwerbstätigkeit der Frau einerseits, und dem Wunsch der Menschen im Lande andererseits nach Familienzusammenhalt und mehr gemeinsamer Zeit füreinander besteht. Fazit: Man muss nach Kompromissen, nach einem fairen Dialog suchen. Doch was passiert? Wenn sich ganz offensichtlich die überwiegende Haltung der Menschen im Lande eindeutig für die Familie zeigt, gibt es plötzlich immer wieder andere Umfragen, die erstaunlicherweise überraschend ein völlig gegenteiliges Ergebnis erbringen können. Die Verwirrung ist dann groß, denn es erscheint geradezu grotesk, dass heute der überwiegende Teil der Bevölkerung gegen Krippen, morgen jedoch dafür sein soll.
So geschehen Anfang März 2007 durch, ja, durch wen? Durch eine Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach, jenes Unternehmens, das von Frau Noelle-Neumann gegründet und von jeher von Kennern als durchaus regierungsfreundlich eingeordnet wird. Hier ergab es sich nach all den genannten Umfragen, die sich positiv über Familie aussprachen, plötzlich, dass fast drei Viertel der Befragten sich nun dagegen und für den Ausbau von Kinderkrippen aussprachen. Fünf Tage zuvor hatte das Familiennetzwerk Deutschland eine ähnliche Umfrage beim renommierten IPSOS-Institut in Hamburg in Auftrag gegeben, mit dem Ergebnis, dass sich über 80 Prozent gegen Krippen aussprachen.
Jeder normal denkende Mensch fasst sich spätestens an dieser Stelle an den Kopf und fragt verzweifelt danach, wie ein ganzes Volk innerhalb weniger Tage seine Meinung derartig beeindruckend verändern kann. Die Antwort ist recht einfach: Es kommt bei Umfragen in erster Linie auf die Fragestellung und die Möglichkeiten, zu antworten, an. Hier liegt der Schlüssel für Wahrheit oder eventuelle Manipulation. Sieht man sich die Formulierung der Frage genauer an, mit der das überraschende Ergebnis vom März 2007, der Anfangsphase eines langen Entscheidungsweges der Bundesregierung zum Ausbau von 750.000 Krippenplätzen, zustande kam, kommt Licht ins Dunkel. Hier die Frage des Instituts Demoskopie Allensbach:
»Kürzlich ist vorgeschlagen worden, das Angebot an Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren in Deutschland deutlich zu erhöhen. Damit soll Müttern von kleinen Kindern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert werden. Halten Sie das für einen guten oder keinen guten Vorschlag?«
In dieser Frage ist – wie leicht erkennbar wird – bereits eine manipulierende Hilfestellung enthalten, sich für eine bestimmte Richtung zu entscheiden. Wenn über ein Angebot abgestimmt wird, das Müttern eine Vereinbarkeit von Beruf und Familie erleichtern will, kann man dem eigentlich nur zustimmen. Wer von den Befragten also nicht ganz genau aufpasst und blitzschnell den wahren Sinn erfasst und reagiert, gibt vielleicht eine Antwort, die er am Ende gar nicht geben wollte. Es handelt sich hierbei um eine sogenannte Suggestiv-Frage, die einem die Antwort praktisch gleich mit in den Mund legt. Und auch die Möglichkeiten der Antwort spielen eine nicht unerhebliche Rolle. So erbringt eine Wahlmöglichkeit mehrerer Antworten immer ein objektiveres Ergebnis. In diesem Fall gab es jedoch lediglich die Möglichkeit, »Ja« oder»Nein« zu sagen. Das Institut veröffentlichte seine ermittelten Zahlen übrigens zusammen mit einer für die Medien ungewöhnlich präzise vorformulierten Textofferte:
»Der Vorschlag von Familienministerin Ursula von der Leyen, das Angebot an Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren deutlich zu erhöhen, hat in den Medien zu lautstarken Diskussionen geführt. In der Bevölkerung hat das jedoch nicht zu viel Uneinigkeit geführt. Im Gegenteil, es gibt wenige sozialpolitische Fragen, in denen soviel Zustimmung und Einigkeit in der Bevölkerung bestehen. 74 Prozent empfinden den Vorschlag der Familienministerin als gut. Nur eine Minderheit von 16 Prozent glaubt, es sei keine gute Idee, die Zahl der Betreuungsplätze für Kleinkinder stark zu erhöhen.« Wer will da noch widersprechen? Schaut man sich dagegen die IPSOS–Umfrage an, die fünf Tage zuvor veröffentlicht worden war, erkennt man die faire und sachliche Fragestellung mit immerhin zwei Antwortmöglichkeiten. Hier der Text:
»Wo glauben Sie, ist ein Kind in den ersten drei Jahren am besten aufgehoben: Zu Hause bei Vater und Mutter oder in der Kinderkrippe?« Die Antwort fiel deutlich aus: 81 Prozent aller Befragten entschieden sich für das Elternhaus, 16 Prozent für die Krippe. Noch einmal: Zwischen diesen beiden Umfragen lagen genau fünf Tage. Doch wird durch diese Veranschaulichung mehr als deutlich, wie leicht die Ergebnisse sogenannter offizieller Umfragen und Statistiken von namhaften Instituten zu lenken sind, auf die sich zum Beispiel ein Bundesministerium nachdrücklich berufen kann, um konkrete Regierungsvorhaben und eventuelle Gesetzesänderungen durchzusetzen. Und es offenbart, dass auch die Realitätswahrnehmung unserer Gesellschaft durch sorgfältig geplante und gezielte Manipulation spielend leicht verändert werden kann. Auf die Allensbach-Umfrage stützen sich das Ministerium und die Medien übrigens bis heute und verweisen hartnäckig auf die genannten, durch in Wirklichkeit manipulierende Fragen erzielten Zahlen. Diese werden bis heute von zahlreichen, durchaus »seriösen« Medien verbreitet, und niemand scheint sich je näher für die Frage interessiert zu haben, wie diese überraschend differierenden Ergebnisse zustande gekommen waren. Wer nun vielleicht noch glauben könnte, dass die Ursache für derartig abweichende Ergebnisse in den unterschiedlichen Mentalitäten der beiden Institute zu finden sein könnte, dem sollte die Information über eine ähnliche, etwas länger zurückliegende Umfrage im Jahr 2002 weiteren Aufschluss geben:
Dasselbe Institut »Demoskopie Allensbach«, bei dem im Jahr 2007 drei Viertel der Befragten sich gegen Krippenbetreuung aussprachen, erzielte im April 2002, zu einer Zeit also, in welcher der Ausbau von Kinderkrippen noch nicht offiziell und derart hartnäckig wie heute zum Regierungsprogramm gehörte, im Großraum Karlsruhe die beeindruckende Antwort, dass 89 Prozent aller Befragten für die häusliche Betreuung von Kleinstkindern durch die Mutter waren und ihr eindeutig den Vorrang vor einer außerhäuslichen Betreuung gaben.
Zwischen den genannten Beispielen und heute liegen nur wenige Jahre. Erkennbar ist, dass heutzutage inzwischen nahezu alle Leute im Land glauben, dass jede Frau arbeiten gehen und ihr Kind gern in die Krippe geben will. Die Gehirnwäsche hat in einem Zeitraum von drei, vier Jahren ihr Ziel erreicht. Jene Menschen, die in Wirklichkeit anders denken, befinden sich zwar in der überwältigenden Mehrheit, aber das wissen sie nicht! Und sie würden es auch nicht glauben! So funktioniert die Schweigespirale! Ein seit Jahren etabliertes Instrument der Einschüchterung und Manipulation, das freie Meinungsäußerung verhindert, indem Menschen verunsichert und falsch informiert werden. Aus Angst, sich zu isolieren, verzichten sie, häufig auch unbewusst, ihre Meinung zu sagen. Die Zeit ist gekommen, diese Schweigespirale endlich zu vernichten!
Dienstag, 30.03.2010
© Das Copyright dieser Seite liegt, wenn nicht anders vermerkt, beim Kopp Verlag, Rottenburg
Dieser Beitrag stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers dar. Er muß nicht zwangsläufig die Meinung des Verlags oder die Meinung anderer Autoren dieser Seiten wiedergeben.
00:20 Publié dans Manipulations médiatiques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : manipulations médiatiques, médias, conspiration du silence, sociologie, problèmes contemporains, actualité |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
L'expédition allemande au Tibet de 1938-39
Synergies européennes – Bruxelles/Munich/Tübingen – Novembre 2006
Detlev ROSE :
L’expédition allemande au Tibet de 1938-39
Voyage scientifique ou quête de traces à motivation idéologique ?
 Le 20 avril 1938 cinq jeunes scientifiques allemands montent à bord, dans le port de Gènes, sur le « Gneisenau », un navire rapide qui fait la liaison avec l’Extrême-Orient. Le but de leur voyage : le haut plateau du Tibet, entouré d’une nuée de mystères, le « Toit du monde ». Sous la direction du biologiste Ernst Schäfer, s’embarquent pour une aventure hors du commun pour les critères de l’époque, Bruno Beger (anthropologue et géographe), Karl Wienert (géophysicien et météorologue), Edmund Geer (en charge de la logistique et directeur technique de l’expédition) et Ernst Krause (entomologiste, cameraman et photographe).
Le 20 avril 1938 cinq jeunes scientifiques allemands montent à bord, dans le port de Gènes, sur le « Gneisenau », un navire rapide qui fait la liaison avec l’Extrême-Orient. Le but de leur voyage : le haut plateau du Tibet, entouré d’une nuée de mystères, le « Toit du monde ». Sous la direction du biologiste Ernst Schäfer, s’embarquent pour une aventure hors du commun pour les critères de l’époque, Bruno Beger (anthropologue et géographe), Karl Wienert (géophysicien et météorologue), Edmund Geer (en charge de la logistique et directeur technique de l’expédition) et Ernst Krause (entomologiste, cameraman et photographe).
Tous les participants à cette expédition étaient membres des « échelons de protection » (SS), mais ce fait justifie-t-il d’étiqueter cette expédition d’ « expédition SS », comme on le lit trop souvent dans maints ouvrages ? Cette étiquette fait penser qu’il s’agissait d’une expédition officielle du Troisième Reich. Est-ce exact ? Les SS avaient-il vraiment quelque chose à voir avec ce voyage de recherche vers cette lointaine contrée de l’Asie ? Quel intérêt les dirigeants nationaux-socialistes pouvaient-ils bien avoir au Tibet ? Comment cette expédition a-t-elle été montée ; quels étaient ses objectifs, ses motifs ? A quoi a-t-elle finalement abouti ? Beaucoup de questions, qui ont conduit à des études sérieuses mais aussi à l’éclosion de mythomanies, de légendes.
Des sources non encore étudiées…
« On a raconté et écrit beaucoup de sottises sur cette expédition au Tibet après la guerre », disait le dernier survivant Bruno Beger (1). Cela s’explique surtout par la rareté des sources, qui rend l’accès à ce thème fort malaisé. Il existe certes des travaux à prétention scientifique sur ce sujet, mais, jusqu’il y a peu de temps, nous ne disposions d’aucune analyse complète et détaillée sur les recherches tibétaines entreprises sous le Troisième Reich. Cette lacune est désormais comblée, grâce à une thèse de doctorat de Peter Mierau, un historien issu de l’Université de Würzburg (2). Le thème de ses recherches était la « politique nationale socialiste des expéditions ». Dans le cadre de cette recherche générale, il aborde de manière fort complète cette expédition allemande au Tibet de 1938-39. Mierau a découvert des sources qui n’avaient pas encore été étudiées (ou à peine) jusqu’ici. Certes, ce travail ne répond pas encore à toutes les questions mais, quoi qu’il en soit, les connaissances actuellement disponibles sur cette mystérieuse expédition se sont considérablement élargies.
Cette remarque vaut surtout pour les prolégomènes de cette entreprise aventureuse. Le biologiste et ornithologue Ernst Schäfer s’était taillé une bonne réputation en Allemagne, comme spécialiste du Tibet. Deux fois déjà, il avait participé, en 1931-32 et de 1934 à 1936, aux expéditions américaines de Brooke Dolan au Tibet oriental et central. En 1937, Himmler, Reichsführer SS, avait remarqué ce jeune scientifique prometteur et dynamique. Il prit contact avec lui. Schäfer était en train de préparer une nouvelle expédition. Himmler voulait simplement profiter du prestige acquis par le jeune savant. Il voulait inclure l’expédition dans le cadre de l’ « Ahnenerbe », la structure « Héritage des Ancêtres » qu’il avait créée en 1935, et, ainsi, placer l’expédition sous patronage SS (3). Le spécialiste du Tibet était certes déjà membre des SS à ce moment-là, mais il aurait préféré placer son expédition sous le patronage du département culturel des affaires étrangères ou de la très officielle DFG (« Communauté scientifique allemande ») et avait effectué des démarches en ce sens (4).
En l’état actuel des connaissances, il n’est donc pas possible d’affirmer ou d’infirmer clairement que les préparatifs de l’expédition aient été entièrement effectués sous la houlette des SS ou de l’Ahnenerbe (5). Le nom officiel de l’expédition était le suivant : « Expédition allemande Ernst Schäfer au Tibet » (= « Deutsche Tibetexpedition Ernst Schäfer »). Himmler eut droit au titre de « patron » de l’expédition et avait tenu à connaître personnellement tous les participants avant qu’ils ne partent et de donner le titre de SS à deux des scientifiques qui ne l’avaient pas encore (Krause et Wienert). Dans les articles des journaux, l’entreprise était souvent citée comme « Expédition SS ». Schäfer lui-même a utilisé cette dénomination à plusieurs reprises (6).
Le rôle très restreint de l’Ahnenerbe
Il a été question de faire de l’Ahnenerbe, la communauté scientifique fondée par les SS, l’un des commanditaires de cette expédition. On peut le prouver par l’existence d’un programme de travail provisoire intitulé « Ziele und Pläne der unter Leitung des SS-Obersturmführer Dr. Schäfer stehenden Tibet-Expedition der Gemeinschaft « Das Ahnenerbe » (Erster Kurator : Der Reichsführer SS)“ (= Objectifs et plans de l’expédition au Tibet de la Communauté „Héritage des Ancêtres » sous la direction du Dr. Schäfer, Obersturmführer des SS (Premier curateur : le Reichsführer SS) ». Muni de ce document, le département d’aide économique de l’état-major personnel du Reichsführer SS a appuyé le dossier de Schäfer auprès de la DFG (7). Après cette démarche, l’Ahnenerbe n’a plus joué aucun rôle officiel dans les préparatifs et la tenue de l’expédition. L’historien canadien Michael H. Kater, dans son ouvrage de référence sur la question, note que cette « vague institution », aux contours flous, a causé bien des tensions entre Schäfer et les dirigeants de l’Ahnenerbe Wolfram Sievers et Walter Wüst. De plus, l’Ahnenerbe ne semblait pas en mesure de financer quoi que ce soit relevant de l’expédition (8).
Ce qui est certain, en revanche, c’est que l’expédition a été financée par des cercles ou initiatives privées. Bruno Beger dit qu’Ernst Schäfer a été en mesure de rassembler quelque 70.000 Reichsmark, dont 30.000 provenaient du « conseil publicitaire » des cercles économiques allemands ; 20.000 RM de la DFG (qui s’appelait jusqu’en 1935 : « Notgemeinschaft Deutscher Wissenschaft ») ; 15.000 RM sont entrés dans les caisses grâce à l’entremise du père de Schäfer, qui était à l’époque le directeur de la fabrique de produits de caoutchouc Phoenix à Hambourg-Harburg ; les 5.000 RM restants ont été offerts par le « Frankfurter Zeitung » (9). Ces donateurs enthousiastes et généreux avaient été séduits par la passion et l’engagement des participants, surtout d’Ernst Schäfer. Beger se souvient encore : « Les instruments scientifiques, les appareils, les équipements photographiques, cinématographiques, sanitaires, presque tout nous a été prêté et même donné » (10).
Himmler, pour sa part, s’adressa à Göring pour que celui-ci mette 30.000 RM en devises à la disposition des explorateurs. Il fit verser cette somme à l’avance. Ce n’était pas une maigre somme car il fallait que l’expédition puisse disposer de toutes les sommes nécessaires en devises, pour qu’elle soit tout simplement possible (11).
Les premiers Allemands dans la « Cité interdite »
Ernst Schäfer s’occupa seul des préparatifs politiques et diplomatiques du voyage scientifique. Vu la situation internationale à l’époque, le chemin vers le Tibet ne pouvait se faire qu’au départ de l’Inde sous domination britannique : il fallait donc obtenir l’autorisation de la Grande-Bretagne. L’adhésion au projet de Britanniques en vue, Schäfer l’obtint grâce à son habilité diplomatique. Il s’embarqua lui-même pour l’Angleterre et en revint avec bon nombre de lettres de recommandation. Les participants à l’expédition ne savaient pas s’il allait être possible d’entrer dans le Tibet, alors indépendant, ni au début de leur voyage ni pendant les premiers mois de leur séjour, qu’ils passèrent pour l’essentiel dans la province septentrionale de l’Inde britannique, le Sikkim. Ce n’est qu’en novembre 1938, après de longues négociations et grâce aux bons travaux préparatoires, que leur parvint une invitation du gouvernement tibétain, comprenant également une autorisation à séjourner dans la « Cité interdite » de Lhassa. Au départ, cette autorisation de séjourner à Lhassa ne devait durer que deux semaines, mais elle a sans cesse été prolongée, si bien que les chercheurs allemands finirent par y rester deux mois. Ils étaient en outre les premiers Allemands à avoir pu pénétrer dans Lhassa.
Ce résultat, impressionnant vu les difficultés de l’époque, est dû principalement au travail et à la persévérance personnelle d’Ernst Schäfer et de ses compagnons plutôt qu’à l’action hypothétique des SS et de l’Ahnenerbe. Ernst Schäfer, quand il a organisé cette expédition, a toujours mis l’accent sur son indépendance, sur ses initiatives personnelles ; il a toujours voulu mettre cette entreprise en branle de ses propres forces, pour autant que cela ait été possible. Dans ces démarches, il jouait aussi, bien sûr, la carte de ses contacts SS, les utilisait et les mobilisaient, tant que cela pouvait lui être utile ou se révélait nécessaire (12). Mais en ce qui concerne les préparatifs et le financement (mis à part l’octroi des 30.000 RM en devises), le rôle des SS est finalement fort limité, d’après les nouvelles sources découvertes et exploitées par nos nouveaux historiens.
Mais cette modestie s’avère-t-elle pertinente aussi quand il s’est agi de déterminer les buts de l’expédition ? Quels étaient en fait les objectifs que s’était assignés Schäfer en préparant sa troisième expédition au Tibet ? Et que voulait Himmler ? Cette dernière question est bien évidemment la plus captivante, mais aussi celle à laquelle il est le plus difficile d’apporter une réponse précise ; les sources ne nous révèlent rien de bien substantiel. Il n’y a aucune déclaration ni aucun commentaire écrit du Reichsführer SS à propos de cette expédition. Seuls quelques indices existent. Ainsi, Schäfer rapporte, dans ses mémoires non encore publiées, une conversation qu’il a eue avec Himmler et quelques-uns de ses intimes. Himmler lui aurait demandé, lors de cette rencontre, « s’il avait vu au Tibet des hommes aux cheveux blonds et aux yeux bleus ». Schäfer aurait répondu non puis aurait explicité, à l’assemblée réduite des intimes de Himmler, tout son savoir sur l’histoire phylogénétique des hommes de là-bas. Himmler se serait révélé à l’explorateur, ce jour-là, comme un adepte de la « doctrine des âges de glace de Hanns Hörbiger ». Il aurait également fait part à Schäfer qu’il supposait qu’au Tibet « l’on pourrait trouver les vestiges de la haute culture de l’Atlantide immergée » (13). Ernst Schäfer n’a pas cédé : son expédition avait des buts essentiellement scientifiques et aucun autre. Schäfer n’a pas accepté l’exigence première de Himmler d’adjoindre à l’équipe un « runologue », un préhistorien et un chercheur ès-questions religieuses. Il n’a pas davantage accepté de rencontrer l’éminence grise de Himmler, Karl Maria Wiligut pour que celui-ci fasse part de ses théories aux membres de l’expédition (14). Schäfer ne voulait apparemment rien entendre des théories et doctrines occultistes et mythologisantes de Himmler et n’a jamais omis de le faire entendre et savoir (15).
Les thèses de Christopher Hale
Pourtant, on n’hésite pas à affirmer encore et toujours que cette expédition allemande au Tibet avait un but idéologique. Ainsi, dans un film documentaire de 2004, intitulé « Die Expeditionen der Nazis. Abenteuer und Rassenwahn » (= Les expéditions des nazis. Aventure et folie racialiste) (16), cette rengaine est réitérée. Le témoignage magistral que sortent les producteurs de ce documentaire de leur chapeau est un certain Christopher Hale, journaliste britannique de son état, qui venait de publier un livre sur la question et s’était par conséquent recommandé comme « expert » (17). La voix off commence par dire dans l’introduction : « Déjà vers la moitié des années 30, les chercheurs SS recherchaient dans le monde entier les traces d’une race des seigneurs évanouie ». Cette recherche aurait été motivée par la « doctrine des âges de glace », déjà évoquée ici, et théorisée par l’Autrichien Hanns Hörbiger. Hale ajoute alors qu’il est parfaitement absurde d’aller chercher des lointains parents des « Aryens » en Asie, sur le « Toit du monde ». Or, c’est ce que voulait, affirme Hale, l’expédition allemande au Tibet. La raison, pour Hale, réside tout entière dans les théories qui veulent que, dans une période très éloignée dans le temps, une civilisation nordique ou aryenne, supérieure à toutes les autres, ait existé et régné sur un gigantesque empire s’étendant de l’Europe au Japon. Cet empire se serait ensuite effondré à cause du mélange entre ses porteurs nordiques et les « races inférieures ». Il aurait cependant laissé des traces, même dans les coins les plus reculés de la Terre. Au Tibet, auraient affirmé ces théories selon l’expert Hale, de telles traces se retrouveraient dans l’aristocratie. Voilà en gros ce que ce Hale a tenté de démontrer. En même temps, il a essayé implicitement de prouver que les SS et l’Ahnenerbe auraient eu un grand rôle dans la préparation et l’exécution de l’expédition.
Cette interprétation, proposée par Hale, cadre sans doute fort bien avec les théories occultistes du Reichsführer SS, telles que les décrit Schäfer dans ses souvenirs. La « doctrine des âges de glace », la « doctrine secrète » de Madame Blavatsky et le livre paru en 1923 de l’occultiste russe Ferdinand Ossendowski (« Bêtes, hommes et dieux ») auraient donc été les principales sources d’inspiration de Himmler. La conception qu’évoque Christopher Hale d’un « grand empire aryen » remontant à la nuit des temps nous rappelle aussi les doctrines dualistes et racialistes de ceux que l’on nommait les « Ariosophes ». C’est plus particulièrement Jörg Lanz von Liebenfels qui présentait l’effondrement des anciens aryens comme la conséquence d’un mélange interracial. Les adeptes de ces théories, que l’on pose un peu arbitrairement comme les précurseurs occultes du national socialisme (18), ne voulaient absolument rien entendre d’une raciologie et d’une anthropologie scientifiques, comme celles de E. von Eickstedt et de H. F. K. Günther.
Une démarche rigoureusement scientifique
Le documentaire « Les expéditions des nazis » suggère donc que les vues bizarres de Himmler, qui sont sans aucun doute attestées, ont influencé les objectifs de l’expédition au Tibet. Ce serait aussi vrai que deux et deux font quatre, alors que les documents préparatoires de l’expédition ne prouvent rien qui aille dans ce sens (19) ! Himmler aurait certes aimé convaincre Schäfer d’aller rechercher au Tibet les traces d’une antique haute culture aryenne disparue. Mais il n’y est pas parvenu. Les membres de l’expédition se posaient tous comme des scientifiques et comme rien d’autre. Ainsi, par exemple, quand Bruno Beger a photographié et pris les mesures anthropomorphiques, crânologiques et chirologiques, ainsi que les empreintes digitales, de sujets appartenant à divers peuples du Sikkim ou du Tibet, quand il a examiné leurs yeux et leurs cheveux, quand il a procédé à une quantité d’interviews, il a toujours agi en scientifique, en respectant les critères médicaux et biologiques de l’époque, appliqués à l’anthropologie et à la raciologie, sans jamais faire intervenir des considérations fumeuses ou des spéculations farfelues.
Nous pouvons parfaitement étayer cela en nous référant à un essai de Beger, sur l’imagerie raciale des Tibétains, parue en 1944 dans la revue « Asienberichte » (20). Dans cet essai, Beger nous révèle les connaissances scientifiques gagnées lors de l’expédition. D’après le résultat de ses recherches, les Tibétains sont le produit d’un mélange entre diverses races de la grande race mongoloïde (ou race centre-asiatique ou « sinide »). On peut certes repérer quelques rares éléments de races europoïdes. Ce sont surtout celles-ci, écrit Beger : « Haute stature, couplée à un crâne long (ndt : dolichocéphalie), à un visage étroit, avec retrait des maxillaires, avec nez plus proéminent, plus droit ou légèrement plus incurvé avec dos plus élevé ; les cheveux sont lisses ; l’attitude et le maintien sont dominateurs, indice d’une forte conscience de soi » (21). Il explique la présence de ces éléments europoïdes, qu’il a découverts, par des migrations et des mélanges ; il évoque ensuite plusieurs hypothèses possibles pour expliquer « les rapports culturels et interraciaux entre éléments mongoloïdes et races europoïdes, surtout celles présentes au Proche-Orient ». Il a remarqué, à sa surprise, la présence « de plusieurs personnes aux yeux bleus, des enfants aux cheveux blonds foncés et quelques types aux traits europoïdes marqués » (22) (ndt : cette présence est sans doute due aux reflux des civilisations et royaumes indo-européens d’Asie centrale et de culture bouddhiste après les invasions turco-mongoles, quand les polities tokhariennes ont cessé d’exister ; cette présence est actuellement attestée par les recherches autour des fameuses momies du Tarim). Les remarques formulées par Beger s’inscrivent entièrement dans le cadre de l’anthropologie de son époque ; son essai ne contient aucune de ces allusions ou conclusions « mythologiques », contraire aux critères scientifiques ; Beger n’emploie jamais les vocables typiques de l’ère nationale socialiste tels « Aryens », « nordique » ou « race supérieure » ou « race des seigneurs » (23).
Ernst Schäfer a explicité les buts de son expédition
Dans le même numéro d’ « Asienberichte », Ernst Schäfer publie, lui aussi, un essai, sous le titre de « Forschungsraum Innerasien » (= « Espace de recherche : Asie intérieure) (24), dans lequel il explique quelles ont été les motifs de son expédition. Après les recherches pionnières effectuées dans le cœur du continent asiatique, lors des premières expéditions qui y furent menées, il a voulu procéder à des recherches plus systématiques en certains domaines et fournir par là même une synthèse des résultats obtenus en diverses disciplines. « Tel était l’objectif de ma dernière expédition au Tibet en 1938-39 ; … elle visait à obtenir une vue d’ensemble, après avoir tâté la réalité sur le terrain à l’aide de diverses disciplines scientifiques, ce qui constitue la condition première et factuelle pour que des spécialistes en divers domaines puissent travailler main dans la main, en s’explicitant les uns aux autres les matières traitées, de façon à compléter leurs savoirs respectifs ; toujours dans le but de faire apparaître plus clairement les tenants et aboutissants de toutes choses ». La tâche principale, qu’il s’agissait de réaliser, était la suivante : « Saisir de manière holiste l’espace écologique exploré », raison pour laquelle « la géologie, la flore, la faune et les hommes ont constitué les objets de nos recherches » (25).
Obtenir une synthèse globale et scientifique de ce qu’est le Tibet dans sa totalité, tel a donc été le but de l’expédition allemande au Tibet en 1938-39. Il n’existe aucun indice quant à d’autres motivations ou objectifs dans les rapports rédigés par les membres de l’expédition, qui décrivent leurs faits et gestes au Tibet de manière exhaustive et détaillée (26). L’image qu’ils donnent du Tibet se termine par un résumé des résultats obtenus par leurs recherches, accompagné d’une liste méticuleuse de toutes leurs activités et des échantillons prélevés, ainsi que le texte d’un exposé, prononcé par Schäfer à Calcutta. Parmi les résultats, nous trouvons des rapports sur le magnétisme tellurique, sur les températures, sur la salinité des lacs, sur les plans des bâtiments visités, sur la cartographie relative aux structures géologiques, sur les échantillons de pierres et de minéraux, sur les fossiles découverts, sur les squelettes d’animaux, sur les reptiles, les papillons et les oiseaux, sur les plantes séchées, les graines de fleurs, de céréales et de fruits, auxquels s’ajoutent divers objets à l’attention des ethnologues tels des outils et des pièces d’étoffe. A tout cela s’ajoutent 20.000 photographies en noir et blanc et 2000 photographies en couleurs, ainsi que 18.000 mètres de films (27), dont les explorateurs ont tiré, après leur retour, un documentaire officiel (28).
Aucun indice pour justifier les hypothèses occultistes
Le livre de Hale ne résiste pas, comme nous venons de le démontrer, à une analyse critique sérieuse. Cette faiblesse s’avère encore plus patente quand il s’agit d’analyser les thèses aberrantes de l’auteur, qui cherche à expliquer l’avènement du Troisième Reich par les effets directs ou indirects de toutes sortes de thèses et théories occultistes ou conspirationnistes. L’historien Peter Mierau l’explique fort bien dans sa thèse de doctorat : « Dans les années qui viennent de s’écouler, la double thématique du national socialisme et du Tibet a été dans le vent dans plusieurs types de cénacles. Les activités de chercheur de Schäfer, dans l’entourage de Heinrich Himmler, sont mises en rapport avec des théories occultistes, ésotéristes de droite, sur l’émergence du monde, avec des mythes germaniques et des conceptions bouddhistes ou lamaïstes de l’au-delà. Pour étayer ces thèses, on ne trouve aucun indice ou argument dans les sources écrites disponibles » (29).
Les occultistes endurcis ne se sentent nullement dérangés par ce constat scientifique. Ils affirment alors, tout simplement, que le caractère officiel d’une telle entreprise n’est que façade, pour dissimuler la nature de la « mission secrète » et les « motifs véritables ». Quand on sort ce type d’argument (?), inutile d’insister : ces spéculations ne sont ni prouvables ni réfutables.
Tant les tenants des thèses occultistes les plus hasardeuses que les dénonciateurs inscrits dans le cadre de la « correction politique » contemporaine, ne trouveront, dans les sources disponibles sur l’expédition allemande au Tibet de 1938-39, aucun élément pour renforcer leurs positions. Même si les explorateurs ont appartenu aux SS et s’ils ont eu des rapports étroits, dès leur retour en août 1939, avec l’Ahnenerbe (dans le département des recherches sur l’Asie intérieure), l’expédition proprement dite ne poursuivait aucun objectif d’ordre idéologique, comme l’ont affirmé les participants eux-mêmes. Bruno Beger, dans son rapport (30), écrit : « Tous les objectifs et toutes les tâches effectuées dans le cadre de nos recherches ont été déterminés et fixés par les participants à l’expédition, sous la direction de Schäfer. Objectifs et tâches à accomplir avaient tous un caractère scientifique sur base des connaissances acquises dans les années 30 ». Certes, les SS espéraient que les résultats scientifiques de l’expédition permettraient une exploitation d’ordre idéologique, mais cela, c’est une autre histoire ; Himmler espérait sans nul doute que les explorateurs découvrissent au Tibet des preuves capables d’étayer ses théories. Par conséquent, la leçon à tirer de cette expédition allemande au Tibet en 1938-39 est la suivante : elle constitue un exemple évident que même dans un Etat totalitaire, comme voulait l’être l’appareil national socialiste et le « Führerstaat », où le parti et la volonté du chef auraient compénétré ou oblitéré l’ensemble des activités des citoyens, le doigté et l’habilité personnelles, chez un homme comme Schäfer, permettaient malgré tout de se donner une marge de manœuvre autonome et des espaces de liberté.
Detlev ROSE.
(Article tiré de la revue « Deutschland in Geschichte und Gegenwart », n°3/2006).
Notes:
(1) Bruno BEGER, Mit der deutschen Tibetexpedition Ernst Schäfer 1938/39 nach Lhasa, Wiesbaden, 1998, page 6. Ce livre récapitule les notes du journal de voyage de Beger, réadaptées pour publication. Il n’a été tiré qu’à une cinquantaine d’exemplaires.
(2) Peter MIERAU, Nationalsozialistische Expeditionspolitik. Deutsche Asien-Expeditionen 1933-1945, Munich, 2006 (cet ouvrage est également une thèse de doctorat de l’Université de Munich, présentée en 2003). On y trouve une vue synoptique des sources et de l’état des recherches en ce domaine aux pages 27 à 34. Les expéditions de Schäfer sont décrites de la page 311 à la page 363.
(3) Michael H. KATER, Das Ahnenerbe der SS 1935-45. Ein Beitrag zur Kulturpolitik im Nationalsozialismus, Stuttgart, 1974, page 79.
(4) MIERAU, op. cit., p. 327, note 2.
(5) Ibidem, p. 329.
(6) Ibidem. Les participants auraient marqué leur désaccord quant à la qualification de leur expédition. Cette révélation a été faite à l’auteur de ces lignes par Bruno Beger, via une lettre à son fils Friedrich (6 août 2006).
(7) MIERAU, op. cit., p. 332, note 2.
(8) KATER, op. cit., p. 79, note 3.
(9) Communication de Bruno Beger dans une lettre de Friedrich Beger à l’auteur (27 mars 2006). Kater estime que la totalité des frais s’élève à 60.000 RM (p. 79 et ss.). Dans le documentaire « Die Expeditionen der Nazis. Abenteuer und Rassenwahn » (MDR, ZDF Enterprises & Polarfilm, 2004), on prétend que les frais totaux se seraient élevés à plus de 112.000 RM. Le documentaire produit un document, mais le narrateur du film n’en dit pas davantage. Pour en savoir plus sur le financement, cf. MIERAU, op. cit., p. 329 et ss., note 2.
(10) Bruno BEGER, op. cit., p. 8, note 1.
(11) MIERAU, p. 330, note 2. On trouve également un indice dans un discours tenu par Schäfer, peu avant le vol de retour, le 25 juillet 1939, à la tribune de l’Himalaya Club de Calcutta, une association de tourisme et d’alpinisme. Dans ce discours, Schäfer dit avoir reçu le soutien d’Himmler et de Goering ; cf. « Lecture to be given on the 25.7.39 by Dr. Ernst Schäfer at the Himalaya Club », page 4, Bundesarchiv R135/30, 12). Bruno Beger souligne lui aussi l’importance des devises (voir note 6).
(12) MIERAU, ibidem, p. 331.
(13) Ernst SCHÄFER, Aus meinem Forscherleben (autobiographie non publiée), 1994, p. 168 et ss. Voir également MIERAU, op. cit., p. 334 et ss. Cf. Rüdiger SÜNNER, Schwarze Sonne. Entfesselung und Missbrauch der Mythen in Nationalsozialismus und rechter Esoterik, Fribourg, 1999, p. 48.
(14) SÜNNER, ibidem, pp. 49 à 53. MIERAU, pp. 335-342; l’auteur y évoque de manière exhaustive les idées que se faisait Himmler sur le Tibet et leurs sources.
(15) KATER, op. cit., p. 79. SÜNNER, ibidem, p. 49 et ss. BEGER (voir note 9): « Le caractère de Schäfer était tel, qu’il ne permettait pas qu’on lui donne des instructions pour organiser ses voyages et pour lui en dicter les missions ; cela valait aussi pour Himmler ».
(16) Documentaire sur DVD, Die Expeditionen der Nazis. Abenteuer und Rassenwahn, MDR, ZDF Enterprises & Polarfilm, 2004.
(17) Christopher HALE, Himmler’s Crusade. The True Story of the 1938 Nazi Expedition into Tibet, Londres, 2003.
(18) Pour comprendre cet univers complexe, voir Nicholas GOODRICK-CLARKE, Die okkulten Wurzeln des Nationalsozialismus, Graz, 1997.
(19) MIERAU, p. 342, note 2, note en bas de page 1120.
(20) Bruno BEGER, « Das Rassenbild des Tibeters in seiner Stellung zum mongoliden und europiden Rassenkreis », in : Asienberichte. Vierteljahresschrift für asiatische Geschichte und Kultur, n°21, Avril 1944, pp. 29-53.
(21) Ibid., p. 45.
(22) Ibidem, p. 47.
(23) Rüdiger SÜNNER, op. cit. (note 13). R. Sünner se trompe lui aussi, lorsqu’il écrit que Beger “est allé indirectement à l’encontre des fantaisies himmlériennes sur l’Atlantide » (p. 51). « J’avais reçu une invitation pour participer à un débat sur la doctrine des âges de glace en 1937. Je n’ai pu que secouer la tête devant le caractère abscons des opinions qui y ont été exprimées. Mes camarades de l’expédition, y compris Schäfer, riaient bien fort des thèmes qui y avaient été débattus » : c’est en ces mots que Friedrich Beger reprend les paroles de son père (lettre à l’auteur en date du 22 juin 2006).
(24) Ernst SCHÄFER, « Forschungsraum Innerasien », in : Asienberichte. Vierteljahresschrift für asiatische Geschichte und Kultur, n°21, avril 1944, pages 3 à 6.
(25) Ibidem, page 4. Cette présentation correspond à la teneur de la conférence tenue par Schäfer à Calcutta, voir note 11, pages 3 et ss.
(26) Ernst SCHÄFER, Geheimnis Tibet. Erster Bericht der Deutschen Tibet-Expedition Ernst Schäfer 1938-39, Schirmherr: Reichsführer SS, München 1943. En outre, se référer aux notes de Bruno Beger, voir note 1.
(27) Cf. Lecture…. (voir note 11), page 6 et ss.
(28) Ce film est actuellement disponible grâce aux efforts de Marco Dolcetta qui l’a réédité en 1994. A ce propos, cf. H. T. HAKL, « Nationalsozialismus und Okkultismus », in : N. GOODRICK-CLARKE (voir note 18), pp. 194-217, ici p. 204. Hakl, lui aussi, souligne le caractère strictement scientifique de l’expédition, en s’appuyant notamment sur l’essai de Reinhard Greve, „Tibetforschung im SS-Ahnenerbe“, paru dans l’ouvrage collectif, édité par Thomas HAUSCHILD, Lebenslust und Fremdenfurcht. Ethnologie im Dritten Reich, Francfort sur le Main, 1995, pp. 168-209.
(29) MIERAU, op. cit., p.28. L’auteur vise ici tout particulièrement le roman de Russell McCloud, intitulé, dans sa version allemande, Die Schwarze Sonne von Tashi Lhunpo, paru à Vilsbiburg en 1991. Dans ce roman, un ancien SS explique à l’un des protagonistes que l’histoire mondiale est le produit d’une lutte entre deux puissances occultes (pp. 144 à 173).
(30) BEGER, op. cit., p. 278 (voir note 1). Je remercie du fond du coeur monsieur Bruno Beger et son fils Friedrich Beger pour m’avoir permis de consulter notes et documents, pour avoir répondu avec patience à mes nombreuses questions, pour avoir mis à ma dispositions les photographies qui illustrent mon article. A ce propos, je remercie également Monsieur Dieter Schwarz.
00:10 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, allemagne, tibet, asie, himalaya, explorations, expéditions, ernst schäfer, années 30, eurasie, eurasisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
La religion de los derechos humanos
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1981
La religión de los derechos humanos
Guillaume Faye
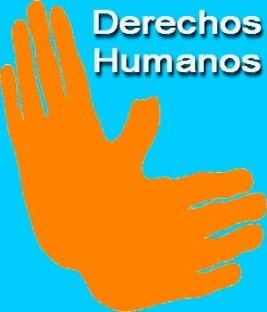 Primera en aparecer, en 1776, bajo la forma de la Declaración de Independencia, la versión americana de la ideología de los derechos humanos hace más hincapié en la busqueda por el hombre de la felicidad, en el derecho del individuo a resistir a toda soberanía que obstaculizaría su "libre árbitro" y su placer, que en los derechos políticos del ciudadano. La Constitución americana refleja esta concepción del Estado de Derecho: los gobernantes tienen por principal objetivo la garantía de los derechos humanos. La finalidad asignada a la política es permitir que los hombres gocen, en seguridad, de sus bienes. Tal filosofía, que se inspira directamente en los hédonistas anglosajones y en los topicos del Segundo Tratado de Locke, presenta ya los fundamentos doctrinales del Estado benefactor occidental moderno, para el cual la gestión de la "felicidad pública" (common good) prevalece sobre la dirección política del destino de la nación. En este sentido, si la Revolución francesa fue fundadora de una "nación", la Revolución americana lo fue de una "sociedad", instancia despolitizada, dónde lo cotidiano y no la historia pasa a ser, como dice Baudrillard, el "destino social".
Primera en aparecer, en 1776, bajo la forma de la Declaración de Independencia, la versión americana de la ideología de los derechos humanos hace más hincapié en la busqueda por el hombre de la felicidad, en el derecho del individuo a resistir a toda soberanía que obstaculizaría su "libre árbitro" y su placer, que en los derechos políticos del ciudadano. La Constitución americana refleja esta concepción del Estado de Derecho: los gobernantes tienen por principal objetivo la garantía de los derechos humanos. La finalidad asignada a la política es permitir que los hombres gocen, en seguridad, de sus bienes. Tal filosofía, que se inspira directamente en los hédonistas anglosajones y en los topicos del Segundo Tratado de Locke, presenta ya los fundamentos doctrinales del Estado benefactor occidental moderno, para el cual la gestión de la "felicidad pública" (common good) prevalece sobre la dirección política del destino de la nación. En este sentido, si la Revolución francesa fue fundadora de una "nación", la Revolución americana lo fue de una "sociedad", instancia despolitizada, dónde lo cotidiano y no la historia pasa a ser, como dice Baudrillard, el "destino social".
En esta sociedad (podemos también hablar de "Sistema", en comparación con las ideologías políticas de los pueblos), la filosofía de los derechos humanos tiene por vocación de convertir al mundo entero. Mientras que la concepción rousseauista del derecho de la Revolución francesa profesaba un universalismo político, que pretendía convencer a los otros pueblos de organizarse civicamente bajo el régimen representativo de la "nación soberana", sin que la política o la historia fuesen suprimidas, la filosofía americana de los derechos humanos marginaliza estas dimensiones históricas y políticas: el universalismo no es político, toma matices de cruzada social; determina, para todos los hombres, más allá de sus culturas particulares, un ideal universal (libre-arbitro, felicidad individual, etc) y asigna a todos los Gobiernos de la Tierra la misión de satisfacerlo y en consecuencia de cumplir con sus exigencias existenciales. Esta extravagante pretensión, que se encuentra hoy formalizada como compromiso jurídico internacional por la Declaración universal, traduce la influencia bíblica muy profunda que se ejerció sobre los juristas americanos. Los Estados Unidos se creen implícitamente los depositarios de lo que un sociólogo americano llama "el Arco de las libertades del mundo". Se detectan en la concepción americana de los Derechos, además de un jusnaturalismo (creencia en "derechos naturales") dogmático, el sentimiento "de la elección divina" de los Americanos cuyo destino providencial sería el de un nuevo pueblo judío. No es asombroso, en estas condiciones, que en cuanto se alejaron de su preocupación las guerras exteriores, los Estados Unidos de Jimmy Carter hayan encontrado naturalmente en la cruzada por los derechos humanos el eje principal de su acción y de su "misión" internacional.
Es necesario hablar bien de "misión", y no de política, en la medida en que ésta supone un poder cuyos constituyentes americanos, impregnados de biblismo, en rebelión contra el rey de Inglaterra, no pensaban sino en limitar las prerrogativas "históricas", en favor de subordinarlo a la economia y a la teologia.
En la Declaración de Independencia (Filadelfia, 4 de julio 1776), se encuentra en efecto esta fórmula reveladora: "consideramos como verdades evidentes que los hombres nacen iguales; que son dotados por su Creador con ciertos derechos inalienables, entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad (individuales); que se instituyó a los Gobiernos humanos para garantizar estos derechos."
En el idéologèma de la felicidad, la versión americana de los derechos humanos incluye este concepto, formulado en Hobbes, Locke o Rousseau, en el que el individuo constituye la unidad básica de la vida. Tal idea, hoy rechazada por las ciencias sociales y por la étologia, proviene, como lo mostraron Halbwachs y Baudrillard, de la transposición política del dogma cristiano de la salvación individual. El destino colectivo e histórico se encuentra puesto entre paréntesis, negado, en favor del destino existencial del individuo. Mientras que la práctica religiosa garantizaba a este destino individual una realización trascendente, tolerando en el tiempo la historia humana, con la laicización del cristianismo fueron los derechos humanos los que se volvieron los instrumentos de la realización immanente de ese destino.
Para Hobbes, en quien se inspiró Rousseau, la sociedad es un "ser artificial" (Léviathan, CH XXI). Los derechos humanos constituyen, en el autor del Discurso sobre el origen de desigualdad, el medio para liberarse de la dependencia de los hombres (beneficiándose al mismo tiempo de las ventajas de la vida en sociedad), idea que se encontrará en Jean-Paul Sartre. Rousseau admitía sin embargo la permanencia de la lucha "insuperable" contra la dependencia de las cosas. Pero la filosofía de los derechos humanos, prosiguiendo las concepciones lockianas, pretende liberar al hombre de la dependencia de las cosas. Los derechos deben garantizar la felicidad que es concebida como sosiego económico y psíquico, liberación de las dificultades fisiológicas y materiales, y no solamente políticas. Este deslizamiento hacia una concepción radicalmente pasiva de la existencia social señala paradójicamente la perversión de todo derecho. La función de los derechos humanos no es jurídica; ejerce una función suprema de legitimación del Sistema comercial occidental.
Como lo mostramos anteriormente, la civilización comercial, seguida en eso con algún retraso por la sociedad soviética, esta caracterizada por la extensión de subsistemas racionales y técnicos de actividad. Una dirección política ya no mantiene la cohesión del grupo sino, como lo mostro Max Weber, por medio de una autorregulación descentralizada de carácter tecnócratico. El consenso social se basa en la adhesión práctica y espontánea de los individuos a un estilo de vida del que ya no pueden prescindir, adhesión que opera en los subsistemas (la empresa, el medio profesional, el universo del automóvil, el domicilio, el mundo del ocio, etc), y no en el conjunto de la sociedad. Para legitimar su soberanía, el Sistema no necesita pues ya un discurso político que atraiga la adhesión, ni de mitos movilizadores nacionales. De ahí la déspolitización y la desnacionalización de la sociedad civil, lo que Weber llama su "secularización". La validación de las estructuras sociales por argumentaciones políticas o "tradiciones indudables" cede el lugar a una validación por ideologías económicas y pragmaticas, como lo mostró Louis Dumont, o éticas privadas que justifican un estilo materialista de vida; estas últimas copian el aspecto mecanicista y economista del sistema internacional que trata de legitimar, y que, como lo vieron Weber, Gehlen, Schelsky y Heidegger, está basado en una interpretación de la ciencia y la técnica como actividades racionales y necesariamente orientadas hacia la obtención de la felicidad (económica) individual.
Las ideologías modernas del sistema comercial van, pues, mundialmente, a valorizar estos dos idéologèmas-clave de la racionalidad y la felicidad. ¿Pero dónde van a encontrar, superando sus diferencias, el punto común donde puedan converger, el "cobertizo" que legitimará estas dos ideas? En la filosofía mundial de los derechos humanos, precisamente, que funciona también como legitimación suprema y sintética del sistema comercial. Solo sera pues al final del siglo XX que esta filosofía, que transporta la visión mecanicista del mundo del siglo XVIII, encontrara su aplicación práctica.
Otra ventaja de la ideologia mundial de los derechos humanos: es que oculta la impotencia y la insignificancia del discurso político de las esferas dirigentes; las cuáles, en efecto, como proceden por medio de una gestión autoritaria de la sociedad-economia, no tienen más discursos ideológicos coherentes, que correspondan a una legitimación democrática práctica. Por otra parte, un discurso muy tecnócratico seria mal recibido. De ahí la necesidad implícita, o incluso inconsciente de recurrir a un discurso sintético que recupera, por medio de grandes principios, la idea democrática. Un discurso sintético, es decir, un humanitarismo vulgar, que mezcla y simplifica la moral del cristianismo, del liberalismo y del socialismo. Como lo observa Habermas, "la solución de los problemas técnicos escapa al debate público, que (...) correría el riesgo de poner en cuestión las condiciones que definen el sistema" (1).
La filosofía de los derechos humanos presenta otras ventajas: legitima la desaparición progresiva de las especificidades etnoculturales, siempre problematicas para el poder establecido, validando la mejoria economica del nivel de vida como ideal oficial y "éxito indudable" del Sistema; tal es el sentido, por ejemplo, de las recientes declaraciones internacionales sobre los "derechos económicos y sociales". Del mismo modo, los temas relativos a los "derechos a la diferencia" solo están allí para neutralizar la idea de diferencia etnocultural, marginalizandola como derecho secundario a una diferenciación subcultural. El ideal antihistórico de los derechos humanos, común a los liberales y a los filósofos de la escuela de Frankfurt, trae también, como lo formuló ingenuamente Habermas (2), una "perspectiva de nivelación y satisfacción en la existencia". Tal perspectiva, incompatible con toda especifidad cultural, nacional o política viva y movilizadora, intenta hoy imponerse como mito mundial.
Mito paradójico: se considera a si mismo como racionalidad y moralidad pura, y declina al mero bienestar económico, pero pretende al mismo tiempo actuar efectivamente (por medio de topicos negativos donde se condenan las "tiranías" y no por medio de movilizaciones positivas). Así pues, como hecho novedoso, el derecho toma las funciones del mito. ¡Suprema paradoja de este siglo! Este fenómeno se produce a escala planetaria y, si falla, su quiebra dejará un vacío planetario, el de la ilegitimidad global de toda una civilización, que habría intentado reconciliar el derecho, al pensamiento positivo, recurrente, memorizado y normativo, con el mito, pensamiento irracional, proyectado, emocional. Bonita utopía.
Si la filosofía contemporánea de los derechos humanos señala el punto de convergencia de todas las corrientes de la ideología igualitaria, no es solamente porque el Sistema necesita una legitimación teórica suprema; es también porque el tema de los derechos humanos constituye un aspecto histórico común del pasado de todas esas ideologías, y que a ese respecto, las reúne en un momento en el que tienen necesidad. Liberalismos y racionalismos de tradición anglosajona o francesa, socialismos reformistas, kantianismo, marxismo (por medio del hegelianismo), cristianismo social, todas estas corrientes pasaron, en "la historia de su gran relato ideológico", para emplear la expresión de Jean-Pierre Faye, por el idealismo racional de los derechos humanos. Incluso el cristianismo integrista, que no rechaza los fundamentos del derecho natural canónico, puede tambien unirse a ellas.
De ahí proviene la regresión intelectual, el retorno teórico de la inteligensia occidental a los derechos humanos que, por las concepciones que tienen, corresponden finalmente a las necesidades de legitimación de una civilización planetaria economista y mecanicista.
En el momento en que esta civilización controvertida por todas las partes (excepto en la vida de sus subsistemas) no encuentra ideología política para legitimarse, los derechos humanos son los unicos con poder establecer un consenso en la forma de un pequeño denominador común ideológico.
Esta simplificación ideológica es acentuada por las deformaciones que hacen sufrir a todo discurso los mass-media de comunicacíon internacionales. Aparece entonces una especie de dogma, revelado en la prensa, sobre las ondas, en la televisión, etc. Una verdadera "religión" de los derechos humanos inunda el Sistema, en la forma de filosofía emocional y simple; es su sistema sanguíneo, su alimento espiritual.
En este sentido, solamente la filosofía de los derechos humanos podía agrupar a una inteligensia occidental sollozante, desde una decena de años, por el desmoronamiento de su discurso teórico y el hundimiento de sus modelos sociales. Que marxistas o socialistas revolucionarios, cuya familia de pensamiento había pretendido superar la fase "del idealismo pequeño- burgués" (Lénine) y del "formalismo" (Marx) de los derechos humanos, vuelvan de nuevo a su defensa, es la evidencia un retroceso teórico del pensamiento igualitario. Este retroceso, esta regresión ideológica, coinciden por otra parte con el paso del igualitarismo de una fase dialéctica, inaugurada en los siglos 17 y 18, y caracterizada por la inventividad y el autorebasamiento intelectuales, donde la formulación de las ideas precedía su aplicación política y social, a una fase sociológica, en la cual la difusión social y comportamental masiva de las formas de vida igualitarias y el triunfo del tipo burgués han producido la decadencia de las formulaciones ideológicas revolucionarias y el retorno a una sensibilidad humanitaria. Los hechos sociales controlan entonces las ideas, que se simplifican y adoptan la forma que les imponen los medios de comunicación y las normas de bronce de un periodismo mundial. Al triunfar, la ideología igualitaria deja poco a poco de ser inventiva; tiende a homogenizarse y a masificarse. La filosofía de los derechos humanos, como discurso de una burguesía planetaria y sentido de su proyecto, constituye la forma axial de esta masificación de las ideas.
Las trayectorias intelectuales de antiguos izquierdistas, hoy agrupados en la Universidad de Vincennes en torno al grupo "Dire", de antiguos situacionistas, las de Henri Lefebvre, de Bernard-Henri Lévy, de André Glucksmann, para no hablar de las de Jean-Paul Sartre o de Maurice Clavel, corroboran este cambio, esta "Unión consagrada" en torno a una nueva religión de los derechos humanos que habría hecho sonréir a los gurúes "antiburgueses" de los años sesenta. Ciertamente, se dirá que esta reagrupación en torno al mismo discurso de todas las corrientes igualitarias es acentuada por la decepción de los ex-revolucionarios ante los fracasos de sus modelos (la URSS, Cuba, Camboya, etc), pero se puede también pensar que ha sido acelerada por la aparición de un adversario común detectado a través de la reciente presencia, en varios países de Europa, de una corriente teórica y cultural no igualitaria y "suprahumanista", sumariamente calificada por Maurice Clavel de "neopaganismo"...
Significativas son a este respecto las trayectorias convergentes de las ideologías cristianas y marxistas que, partiendo de una oposición al humanismo de los derechos humanos, llegan hoy a colocarlo en el centro de sus tesis.
El cristianismo católico, en particular, combatió durante mucho tiempo la filosofía de los derechos, no sobre el fondo sino sobre la forma, acusándola fundar el derecho natural sobre "el orgullo del hombre", sobre principios profanos, y no desde una moral revelada por Dios.
El cristianismo moderno, que se separa de la fe religiosa y la teología clásica, no tiene necesidad, para laicizarse, de recurrir a otros fundamentos que los del propio evangelio. Hay una moral civil sentada sobre el derecho natural y la superioridad del individuo en la Biblia. Por ello, los temas de los derechos humanos le parecen perfectamente admisibles, lo que no era el caso a principios de este siglo. El padre Michel Lelong veía incluso recientemente en la adhesión a los derechos humanos un criterio de juicio de las familias de pensamiento, más importante que las posiciones sobre la religión. Explicaba que importaba poco que se fuese ateo o creyente con tal que se creyera en los derechos humanos (3).
En la tradición marxista, que distinguía entre "libertades formales" (burguesas) y "libertades reales" (socialistas), los derechos humanos se rechazaban como una fase histórica pasada. Marx lanza en el Manifiesto su famoso anatema: "Su derecho no es más que la voluntad de su clase (burguesa) manifestada en la ley". Los marxistas modernos, mucho menos revolucionarios que sus grandes antepasados y más preocupados con la conveniencia humanista, dudan en renovar esta condena del derecho burgués como discurso de legitimación económica.
La crítica del "derecho humanitario burgués" no es realizada más, desde que la revolución se sospecha de quienes se oponen a la "felicidad." Este abandono del antihumanismo no fue iniciativa de Roger Garaudy o del pensamiento publicitario de Henri Lefebvre. Como en otros temas, los intelectuales franceses vuelven a copiar evoluciones conceptuales ya realizadas en otra parte. Fue en realidad la escuela de Frankfurt y su más famoso representante, Max Horkheimer, quien inicio el retorno desengañado y doloroso al humanismo de los derechos humanos, que será reanudado más tarde por la inteligensia occidental de izquierdas, cuando no marxista.
En 1937, como buen marxista ortodoxo que era aún, Horkheimer escribía: "la creencia idealista en un llamado a la conciencia moral que constituiría una fuerza decisiva en la historia es una esperanza que sigue siendo extranjera al pensamiento materialista" (4). En 1970, después de haber sido chocado por la experiencia estalinista, el mismo Horkheimer escribía: "Antes, deseábamos la revolución, pero hoy nos dedicamos a cosas más concretas (...) la revolución conduciría a una nueva forma de terrorismo." Es mejor, sin rechazar el progreso, conservar lo que se puede considerar de positivo, como, por ejemplo, la autonomía de la persona individual (...) debemos más bien preservar, entonces, lo mejor del liberalismo "(5)."
Así pues, para Horkheimer que, significativamente, fue el más profundo de los pensadores marxistas del siglo XX, el materialismo histórico, el liberalismo burgués y el cristianismo deben unirse, ya que tienen el mismo discurso y defienden la misma trilogía fundamental: individualismo, felicidad (o salvación), racionalidad.
Este acuerdo en torno un mínimo ideológico, es pues, paralelo a la voluntad de extensión de esa ideología a todo el Sistema occidental, a toda la "americanosfera". Una única sociedad, una única cultura, un único pensamiento.
Notas
(1) Jürgen Habermas, la ciencia y la técnica como ideología, Gallimard 1973. ver también Helmut Schelsky, Der Mensch en Der technischen Zivilisation, Düsseldorf 1961.
(2) Jürgen Habermas, opus cit.
(3) Le Monde, 28 de agosto de 1980.
(4) Max Horkheimer, "Materialismo y moral", en Teoría crítica, Payot 1978.
(5) ibídem.
[Texto extraído del libro de Guillaume Faye: Le Système à tuer les peuples, Copernic 1981.]
00:05 Publié dans Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle droite, droits de l'homme, philosophie, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 07 avril 2010
Eugen Diederichs, der Sera-Kreis und die Sonnenwendfeiern auf dem Hohen Lehden bei Jena
| :D:H: Eugen Diederichs, der Sera-Kreis und die Sonnenwendfeiern auf dem Hohen Lehden bei Jena |
| Ex: http://www.eiwatz.de/
Ihr Edelsten seid hingemäht als Opfer. Wem? Wir wissen’s nicht. Der Kranz des Fests mit Kränzen nicht des Siegs vertauscht. Freunde im Grab, Ihr seid Statthalter unseres Todes. Statthalter Eurer Kraft sind wir im Licht geblieben und Euer Wille wird in unserm Bauwerk sein.
|
00:14 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, révolution conservatrice, philosophie, édition, éditeurs, néo-paganisme, paganisme, solstices |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
La geopolitica di Karl Haushofer ha ancora qualcosa da insegnare al mondo attuale?
Fonte: Arianna Editrice [scheda fonte]
![[Abbildung]](http://www.dhm.de/lemo/objekte/pict/haushofe/index.jpg)
È giusto buttare via il bambino insieme all’acqua sporca?
Dal momento che la geopolitica ha un’origine in gran parte tedesca, e poiché è servita a razionalizzare, in parte, gli obiettivi di guerra della Germania nelle due guerre mondiali, la cultura liberaldemocratica oggi dominante l’ha sdegnosamente rigettata, insieme ai vecchi e lugubri armamentari del nazismo.
Tuttavia, a parte il fatto che le potenze liberaldemocratiche - Stati Uniti e Gran Bretagna in testa - perseguono, con altri nomi e sotto alte maschere, un obiettivo strategico globale molto simile a quello che la geopolitica, tedesca e non, indicava come proprio oggetto di studi, ci sembra che molta confusione ipocrita e molta voluta ambiguità siano alla radice di questa operazione di rifiuto e di radicale rimozione dal salotto buono della cultura odierna.
Fra parentesi, osserviamo che si tratta della stessa confusione ipocrita e della stessa voluta ambiguità che hanno presieduto all’abbandono degli studi geopolitici in Italia, dopo che essi avevano ricevuto un impulso originale fra il 1939 e il 1942, ad opera della omonima rivista e degli studiosi Giorgio Roletto ed Ernesto Massi dell’Università di Trieste. Caduto il fascismo, anche la geopolitica italiana è stata gettata nel cestino della storia, come un lontano cugino impresentabile, di cui doversi vergognare tra la gente “per bene”.
Dunque: in primo luogo, la geopolitica non è solo di origine tedesca, ma anche inglese e americana; anzi, a fondarla è stato uno studioso svedese, Rudolf Kjellen, nel 1904. E la sua idea fondamentale, ossia la contesa naturale ed incessante fra le potenze marittime o talassocratiche e quelle continentali, deriva dal libro di uno studioso inglese, Sir Halford Mackinder, «The Geographical Pivot of History».
In secondo luogo, anche la geopolitica tedesca non è affatto un prodotto del nazismo e la si può benissimo immaginare anche senza Hitler. Il terreno è stato preparato dalla geografia politica di Friedrich Ratzel (1844-1904) e il suo massimo esponente è stato Karl Haushofer (1869-1946) che non era nazista, anzi che ebbe un figlio giustiziati dai nazisti, ma era piuttosto un militare conservatore della vecchia scuola, le cui idee fondamentali si concretizzarono fra due eventi che precedettero entrambi l’avvento del nazismo: da un lato il “Drang nach Osten”, la “marcia verso Oriente” della Germania guglielmina, che sembrò concretizzarsi con la costruzione della ferrovia Berlino-Baghdad; dall’altro la sconfitta tedesca nella prima guerra mondiale e il fortissimo sentimento di frustrazione nazionale che si impadronì allora della Germania, sotto il peso del punitivo trattato di Versailles.
La Germania è una potenza continentale e sempre i suoi governi hanno ragionato in termini di politica continentale. La corsa all’accaparramento delle colonie, nel 1884, fu una eccezione alla regola, concessa da Bismarck per dare un contentino agli ambienti della Marina e a taluni settori industriali e finanziari; ma la rivendicazione delle colonie perdute non sarebbe stato che un elemento del tutto secondario nel disegno rivendicazionista di Hitler.
Viceversa, la Gran Bretagna è sempre stata una potenza marittima il cui obiettivo è quello di impedire che, sul continente europeo, si affermi una potenza egemone, ciò che metterebbe in forse i suoi interessi commerciali e strategici; per questo essa ha sempre profuso grandi somme di denaro per armare delle coalizioni contro la potenza egemone del momento, che fosse la Francia di Luigi XIV o di Napoleone, oppure la Germania di Guglielmo II e, poi, di Hitler.
Altrettanto evidente che, per Mackinder, il potere talassocratico fosse di segno positivo, mentre per Haushofer era quello continentale a rappresentare il “bene”: ciascuno vede la verità secondo il proprio specifico angolo visuale. Le potenze marittime sono isole e arcipelaghi (Gran Bretagna, Giappone) o penisole (Italia); quelle continentali sono al centro dei continenti (Germania) o, spingendosi da una costa all’altra, appaiono in grado di unificarli (Russia, poi Unione Sovietica; Stati Uniti; e, oggi, anche la Cina).
Per questo la Gran Bretagna non voleva né poteva rinunciare a Gibilterra, a Suez, ad Aden, a Singapore e Hong Kong, a Città del Capo e alle Isole Falkland: perché solo per mezzo di quelle basi strategiche avrebbe potuto stringere in una morsa le potenze continentali. E per questo la Germania, in entrambe le guerre mondiali, ha puntato a est, al grano dell’Ucraina, al petrolio della Romania e poi del Caucaso, al ferro della Svezia, alle immense steppe dell’Asia centrale: perché solo così avrebbe potuto spezzare l’accerchiamento marittimo e l’inevitabile strangolamento economico cui, con il dominio inglese dei mari, era inevitabilmente esposta.
Ma una cosa è certa: che, mentre per la Gran Bretagna la posta in gioco era la conservazione dell’impero coloniale e, quindi, del benessere legato allo sfruttamento di immense risorse mondiali e alla penetrazione commerciale nei più lontani mercati, per la Germania invece (o, prima di essa, per la Francia e, dopo di essa, per l’Unione Sovietica) la posta in gioco era, in un certo senso, la pura e semplice sopravvivenza. Perciò, a dispetto di tutte la apparenze, le guerre di Napoleone contro le varie coalizioni finanziate dall’Inghilterra erano essenzialmente difensive, come lo furono quelle di Hitler, ivi compreso l’attacco all’Unione Sovietica, spada continentale dei banchieri della City Londinese (e di Wall Street); mentre le guerre condotte e soprattutto finanziate dalla Gran Bretagna, nel corso di oltre due secoli, contro la potenza continentale di turno, a partire dalla Guerra dei Sette anni (1756-63), furono guerre prettamente offensive.
Entrambe le guerre mondiali possono essere considerate come un gigantesco scontro geopolitico fra le potenze talassocratiche e quelle continentali.
Nella prima, la potenza marittima egemone (Gran Bretagna), alleata con due potenze continentali marginali dell’area euroasiatica (Francia e Russia) e con due potenze extraeuropee, una continentale ed una marittima (Stati Uniti e Giappone), nonché con una potenza marittima europea (Italia), ha avuto la meglio sulle due potenze continentali europee (Germania e Austria-Ungheria) e su una potenza continentale marginale (Impero Ottomano).
Nella seconda, una potenza continentale e due potenze marittime dell’area euroasiatica (Germania, Italia e Giappone) hanno tentato, fallendo, di spezzare l’accerchiamento del maggiore potenziale integrato, marittimo e terrestre, che esistesse a livello mondiale (Gran Bretagna e Stati Uniti), alleato - per l’occasione - con l’altra potenza continentale (Unione Sovietica; la Francia essendo stata eliminata già nelle primissime fasi del conflitto).
Insomma, si arriva sempre alla medesima conclusione: che il dominio dei mari, alla lunga, assicura la vittoria, perché consente lo sfruttamento delle maggiori fonti di ricchezza mondiali; ma che le potenze marittime, per strappare la decisione finale, devono o allearsi con delle potenze terrestri, di cui si servono come di altrettante spade continentali, oppure devono trasformarsi esse stesse anche in potenze continentali: come è stato il caso della Gran Bretagna, che, attraverso colonie-continenti come l’Australia, ha decentrato i propri gangli vitali; tanto che è stato osservato come neppure l’invasione tedesca dell’Inghilterra, nel 1940, l’avrebbe costretta alla resa, poiché essa avrebbe potuto benissimo continuare la lotta trasferendo il proprio governo nel Canada e potendo contare sull’appoggio sempre più deciso degli Stati Uniti.
Infine potremmo dire che, negli ultimi decenni, la superpotenza americana (continentale, ma divenuta anche marittima per le necessità della sua politica imperiale), dopo aver avuto la meglio sulla superpotenza sovietica (anch’essa continentale, e anzi bicontinentale, improvvisatasi marittima per ragioni strategiche globali), deve ora fronteggiare l’ascesa irresistibile di una potenza squisitamente continentale, la Cina - e, in prospettiva, anche l’India - divenuta erede dello slogan panasiatico lanciato dai Giapponesi durante la guerra del Pacifico.
Ma sarà bene delineare, adesso, un rapido profilo della figura e dell’opera del controverso “padre” della geopolitica, Karl Haushofer, servendoci della penna di un valente studioso italiano.
Ha scritto Alessandro Corneli, esperto di relazioni internazionali e strategia, nel suo volume «Geopolitica è. Leggere il mondo per disegnare scenari futuri» (Fondazione Achille e Giulia Boroli, 2006, pp. 123-27):
«Karl Haushofer (1869-1946) è il pensatore geopolitico tedesco per eccellenza, ma il suo nome è Anche legato alla parabola nazista. Ufficiale di carriera senza particolari meriti, in missione diplomatica in Estremo Oriente Giappone e Manciuria, scrive le sue impressioni, restando particolarmente colpito dalla corsa alla modernizzazione dell’Impero del Sol Levante. Durante la partecipazione alla prima guerra mondiale legge “Lo Stato come organismo” dello svedese Kjellén e apprende il significato della geopolitica: scienza dello Stato in quanto organismo geografico, così come si manifesta nello spazio; lo Stato inteso come Paese, come territorio, e come impero. Convinto che la guerra in corso sia una guerra di annientamento della Germania, vuole che il suo paese sia una potenza mondiale. Così, all’indomani della sconfitta, ormai cinquantenne, fa il professore , il conferenziere, e dà vita alla “Rivista di geopolitica”, imponendosi come un’autorità intellettuale.
Nel 1919 aveva conosciuto il giovane Rudolf Hess (1894-1987). Hess, volontario nella prima guerra mondiale, si era arruolato nel reggimento List, in cui combatteva anche un ancora oscuro caporale di origine austriaca, Adolf Hitler, che lo convinse a entrare in politica, nel 1920, abbandonando l’università di Monaco dove stava per laurearsi in filosofia. Stretta amicizia con Hermann Göring (1893-1946, che durante la guerra aveva acquistato fama di grande aviatore e fu poi il creatore della’armata aerea tedesca, anche se fallì l’impresa contro la Royal Air Force inglese nella Battaglia d’Inghilterra), Hess partecipò al fallito putsch nazista di Monaco nel 1923, e fu arrestato insieme a Hitler. In carcere, Hess aiutò il futuro Führer a scrivere il “Mein Kampf” (“La mia battaglia”), opera destinata a diventare il testo sacro del nazismo. Da quel momento egli divenne uno dei più stretti collaboratori di Hitler, tanto da esserne considerato il suo delfino (che in gergo politico indica il successore alla guida di un partito). Hess, ma non era il solo, coltivava studi esoterici. Per il tramite di Hess, Haushofer incontrò Hitler almeno una dozzina di volte tra il 1922 e il 1938, ma non ne resta traccia documentaria. E soprattutto nasce il suo rapporto ambiguo con il nazismo. Dapprima, almeno fino al 1939, lo studioso riconosce al Führer il merito di avere ristabilito l’ordine, di avere unificato tutti i tedeschi in un solo Stato (Reich), di avere rimediato alle ingiustizie che il trattato di Versailles aveva imposto alla Germania vinta, considerata anche colpevole di avere scatenato la guerra. Ma la sua natura d’intellettuale un po’ distaccato dalla realtà, in difficoltà a capire i politici e i loro giochi tortuosi, di strenuo difensore della coerenza delle sue teorie, non gli permise di integrarsi nel sistema, tanto è vero che non ebbe mai la tessera del partito. In fiondo, egli era rimasto un nazionalista conservatore, un esponente della società tedesca guglielmina, aristocratica e gerarchica, , di cui erano espressione le alte cariche dell’esercito, diffidente nei confronti dei “parvenus” un po’ plebei che affollavano il mondo nazista. Nel 1939 ci fu anche uno screzio profondo: nel libro “Le frontiere “ aveva sollevato la questione della popolazione tedesca del Tirolo meridionale, annesso all’Italia nel 1919, e la cosa doveva turbare i rapporti tra Hitler e il suo principale alleato, Benito Mussolini,.
L’inizio della guerra fece registrare un progressivo isolamento di Haushofer. La moglie, di discendenza non ariana, era stata salvata per amicizia politica; uno dei figli, Albrecht, si trovò implicato, nell’aprile 1941q, in un complotto per arrivare a una pace separata; il 10 maggio dello stesso anno, il suo amico e protettore, Hess, compì il misterioso volo in Inghilterra e venne catturato dagli inglesi; la “Rivista di geopolitica” si dibatteva tra molte difficoltà, tra la necessità di giustificare la politica hitleriana e il pensiero del suo fondatore, che nell’ottobre 1945 dichiarerà che dopo il 1933, cioè dopo l’ascesa di Hitler al potere, la rivista stessa era sempre stata “sotto pressione”. Dopo l’attentato a Hitler del 20 luglio 1944, Haushofer venne sospettato e incarcerato: il figlio Albrecht era stato già giustiziato in aprile. Arrestato dagli americani dopo la resa della Germania (8 maggio 1945), Haushofer fu ascoltato come testimone durante il processo di Norimberga: messo a confronto con Hess, questi dichiarò di non conoscerlo. Il 10 maggio 1946 Haushofer e la moglie si suicidarono.
Affrontiamo adesso gli elementi fondamentali del suo pensiero geopolitico, dicendo anzitutto che è figlio della sconfitta tedesca nella prima guerra mondiale: il problema era a quel punto di andare oltre la conoscenza di sé, chiesta da Ratzel, e di fondare un progetto politico ricavandolo dalla geopolitici, perché la geopolitica, come affermava Haushofer, rappresenta il ponte tra il sapere e il potere, una specie di autocoscienza che conduce alla decisione.
Il lavoro dei precedenti studiosi viene utilizzato a fondo. Anzitutto la nozione di spazio vitale aggravato dalle ingiustizie del trattato di Versailles. In secondo luogo, e questo è un suo contributo originale, l’insistenza sulle idee globali o “pan-idee”, come il pangermanesimo, il panslavismo o il panasiatismo. Sono queste idee in grado di costruire vasti consensi, al di là di quelli che si possono costruire intorno a un piccolo stato, e anzi sono, rispetto ai confini statali, transfrontaliere, disegnando grandi complessi continentali. L’Impero Britannico, secondo Haushofer, è destinato a essere stritolato da queste pan-idee: l’India, per esempio, non si riconoscerà in un pan-britannismo. L’Unione Sovietica, invece, potrà far leva, data la sua estensione su due continenti, sulle idee panasiatica ed euroasiatica; gli Stati Uniti, a loro volta, sulle idee panamericana e pan pacifica.
Bisogna riconoscere a Haushofer una fantasia non priva d’illuminazioni anticipatrici, , anche se egli generalizza l’dea di alcuni fatti concreti, quali l’idea di “sfera di coprosperità asiatica” con cui il Giappone giustificava il proprio espansionismo o addirittura l’idea di una Comunità Economica Europea lanciata, tra il 1940 e il 1944, dal ministero dell’economia e presidente della Reichsbank e sostenuta dal mondo industriale tedesco: una comunità, beninteso, di cui la Germania sarebbe stata il fulcro. Ma non è ciò che sta accadendo adesso per via pacifica?
Ciò che i geopolitici tedeschi aborrivano sopra ogni altra cosa era il modello imperiale britannico e, accanto a coloro che sostenevano la possibilità di distruggerlo con una guerra vittoriosa, c’erano altri che pensavano di aggirarlo e in qualche modo disgregarlo. La seconda strada, per esempio, era alla base del progetto della ferrovia che, iniziata nel 1903, avrebbe dovuto collegare Berlino con Baghdad passando per Istanbul e che doveva coronare il sogno orientale di Guglielmo II, protagonista di un celebre viaggio a Gerusalemme e di un incontro con il gran muftì., al quale l’imperatore aveva promesso tutto il suo appoggio contro il sionismo, considerato lo strumento di penetrazione della Gran Bretagna in Medio oriente. Se il disegno fosse riuscito, analogamente alla spedizione di Napoleone in Egitto, , sarebbe stato spezzato l’accerchiamento britannico che andava dall’Africa (Gibilterra) all’Asia del sud-est (Singapore, Hong Kong).
Molte di queste idee sono proliferate dopo la seconda guerra mondiale. A patte la linea antisionista, antiamericana e antiamericana ben radicata in tutto il mondo islamico, specie nel Medio Oriente, idee come “l’Asia agli asiatici” o “l’Africa agli africani”, e lo stesso movimento dei “non allineati” o terzomondisti, e recentemente l’opposizione alla globalizzazione, considerata il nuovo strumento di dominio mondiale da parte degli anglo-americani, trovano molti spunti nell’opera dei geopolitici tedeschi e in particolare di Haushofer.
Quando la Germania di Hitler e l’Unione Sovietica di Stalin firmarono il patto Molotov Ribbentrop (23 agosto 1939), che prevedeva la spartizione della Polonia e quindi l’inizio della guerra tedesca per la conquista a est della spazio vitale, Hashofer vide che l’incubo di Mackinder, cioè la concentrazione dell’Heartland a spese delle potenze marittime, si era realizzato e definì quel’evento il più grande e importante cambiamento nella politica mondiale. Entusiasmo prematuro, non solo perché il Giappone non condivideva l’alleanza russo-tedesca, mirando a erodere la presenza russa in Asia, ma soprattutto perché a meno di due anni da quella firma la Germania attaccò l’Unione Sovietica.
Un Paese inoltre Haushofer sottovalutò, come del resto Hitler: gli Stati Uniti, , considerati come una potenza che si era chiusa nell’isolazionismo, gelosa del proprio benessere (nonostante la crisi devastante del 1929), soprattutto una società così impregnata di individualismo che non sarebbe stata in gradi di esprimere una forte volontà. Secondo Hitler una plutocrazia giudeizzata, concentrata sugli affari, priva di virtù guerriere, non era portata per la guerra. Un abbaglio reso possibile dai pregiudizi, come spesso accade. Eppure, proprio gli Stati Uniti avevano a loro vantaggio, a guerra scoppiata, fattori determinanti: la sicurezza del loro territorio, una straordinaria capacità industriale, produttiva e organizzativa, e poi due alleati all’interno dello stesso Heartland che la Germania aveva pensato di avere posto sotto il proprio controllo: la Gran Bretagna e l’Unione Sovietica.»
L’obiezione più forte che i moderni studiosi di tendenza liberaldemocratica muovono all’idea stessa della geopolitica è che, nelle condizioni proprie seguite alla seconda guerra mondiale e alla fine della “guerra fredda”, è anacronistico pensare ancora la politica come lotta per l’espansione territoriale, dato che i sistemi democratici non punterebbero all’ingrandimento del proprio territorio, ma all’espansione di pacifiche relazioni commerciali e alla libertà dei mari.
Tutte queste buone intenzioni sono state compendiate nella cosiddetta Carta Atlantica, sottoscritta dal capo del governo inglese Churchill e dal presidente statunitense Roosevelt nel 1941 (quando, si noti, gli Stati Uniti d’America e i governi dell’Asse non erano ancora formalmente in stato di guerra gli uni contro gli altri).
Tuttavia, vi sono pochi dubbi sul fatto che dietro quelle formule si celava, da un lato, la tenace, rancorosa volontà di Churchill di punire la Germania e l’Italia e di conservare a ogni costo l’Impero britannico, l’India specialmente (anche se, poi, le cose sono andate altrimenti); e, dall’altro lato, la determinazione americana di rilanciare la propria economia - mai uscita dalla crisi del 1929, nonostante l’apparato propagandistico del New Deal - ed anche il proprio ruolo politico mondiale, mediante la colonizzazione finanziaria del mondo intero.
C’è, poi, bisogno di notare che molte idee, e persino molti uomini, della geopolitica nazista, sono passati, quatti quatti, proprio nei meccanismi strategici del Pentagono dopo il 1945, tanto che si può parlare di una autentica ripresa di quei temi e di quelle concezioni in chiave liberaldemocratica? Ne abbiamo già parlato in un precedente articolo, su questo stesso sito (intitolato «Da Hitler a Bush, ovvero come si passa dal Terzo al Quarto Reich», pubblicato in data 01/02/2008), per cui rimandiamo il lettore a quelle riflessioni.
È davvero insopportabile l’ipocrisia del totalitarismo democratico: il quale, mentre respinge con orrore tutto ciò che la cultura politica tedesca (e italiana) ha prodotto negli anni del fascismo, contemporaneamente si serve di gran parte del suo armamentario ideologico, rivisto e riverniciato, per perseguire sempre più spregiudicatamente i propri disegni di dominio mondiale.
00:10 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, histoire, allemagne, théorie politique, sciences politiques, politologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
L'Europe à la croisée des chemins

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 2004
L'EUROPE A LA
CROISEE DES CHEMINS
Trouvé sur : http://www.mr-bretagne.org/
Comme il était prévisible, l'attaque américaine contre l'Irak a eu lieu, sans l'accord de l'ONU dont l'importance et le rôle réels apparaissent à leur juste mesure : dérisoires.
Nous ne faisons pas nôtre l'opposition "onusiste" et pacifiste à la guerre, parce que nous ne sommes pas pacifistes et que nous ne croyons pas à la possibilité qu'une organisation internationale telle l'ONU puisse pacifier définitivement la planète. L'ONU peut permettre de régler certains conflits marginaux à condition que les puissances concernées s'accordent sur un mode de règlement, mais elle ne peut pas mettre fin à des différends entre grandes puissances (c'est l'équilibre des puissances militaires qui a empêché qu'un conflit éclate entre les USA et l'URSS, pas l'ONU), ni empêcher une grande puissance d'agresser un petit pays (comme c'est le cas en Irak).
Si nous sommes opposés à l'attaque américaine, c'est parce que nous n'acceptons pas qu'un Etat nie la souveraineté d'un autre Etat, même au nom de principes qui se veulent généreux. L'argument des américains qui afforment vouloir libérer l'Irak d'un dictateur parfaitement odieux n'est pas satisfaisant parce qu'il n'y a que cinquante démocraties sur la planète et cent cinquante dictatures ; pourquoi s'en prendre d'abord à l'Irak, si ce n'est parce que le sous-sol de cet Etat recèle des quantités importantes d'or noir ? Nous reconnaissons bien là l'hypocrisie de la politique américaine qui revêt toujours ses actions militaires d'un voile moral, même quand elles sont motivées par des intérêts économiques ou géopolitiques.
Nous refusons l'idée qu'un ou plusieurs Etats décident d'imposer à l'ensemble des peuples une culture et une civilisation uniques : celles de l'occident américain en l'occurrence. Les peuples doivent choisir librement leur mode de vie et leur organisation politique et économique, telle est la règle essentielle de notre vision du monde ; nous sommes radicalement hostiles à toute forme d'impérialisme et de colonialisme, y compris bien sûr de la part des Etats européens.
Notons au passage que la volonté affichée par les Etats-Unis de démocratiser l'Irak est puérile car la démocratie ne se décrète pas de l'extérieur ; la démocratie ne peut surgir que des profondeurs culturelles d'un peuple.
Les mérites de la deuxième crise irakienne
Les récents évènements concernant le règlement de la question irakienne ont eu le mérite de mettre en évidence un certain nombre de réalités du plus grand intérêt : l'incohérence et l'inexistence politique de l'Europe (des quinze et des vingt-cinq) et l'impossibilité éclatante d'une action diplomatique commune ; l'opposition entre l'opinion des peuples et celle des élites politiques dans de nombreux pays européens (Espagne, Italie…) ; l'attitude agressive des Etats-Unis vis-à-vis des pays qui refusent de s'aligner sans discussion sur leurs positions ; l'attitude des Allemands qui, pour la première fois depuis 1945, s'opposent frontalement aux Américains ; le refus concerté de la France, de l'Allemagne et de la Russie d'accepter la politique unilatérale agressive des USA ; la facticité de l'ONU (à quoi sert une organisation qui ne peut prendre aucune décision opposée à la volonté de la superpuissance du moment ?) et l'obsolescence de l'OTAN qui n'a plus de raison d'être compte tenu de la disparition de l'Union soviétique, qui ne sert plus qu' à maintenir les pays d'Europe centrale dans le giron américain et qui, de plus, est désormais profondément divisée. Par ailleurs, elle a permis de pointer les pays et les personnalités inconditionnellement soumis aux volontés américaines.
Ainsi Messieurs Blair et Aznar peuvent être dé-sormais considérés comme des personnages néfastes d'un point de vue européen ; il semble que ce dernier envisage de devenir Président de l'Union Européenne, avec l'appui des USA sans doute qui s'assureraient ainsi du contrôle de l'Europe ! (Notons que l'ineffable Madelin a montré à cette occasion son vrai visage qui est celui d'un harki des Américains et des multinationales; le Financial Times l'a consacré du titre de "plus sûr des hommes politiques français" !).
Par ailleurs, la plupart des Etats d'Europe centrale ont eu l'occasion d'afficher leur inféodation aux Etats-Unis, ce qui pose un problème majeur : celui de l'impossibilité de construire une Europe politique dotée d'une diplomatie et d'un système de défense autonomes avec ces Etats dans l'état actuel des choses. Le cas de la Pologne, par exemple, qui après avoir marchandé son entrée dans l'UE, a commandé des avions de guerre aux Etats-Unis avant de s'aligner sur les choix diplomatiques américains, illustre parfaitement la problématique de la construction européenne.
Pour un monde multipolaire
Le refus d'un monde dominé par une superpuissance est un des impératifs prioritaires ; il est plus que jamais évident qu'une autorité "morale" telle que l'ONU , sans soubassement populaire ni puissance autonome, n'est qu'une fiction intellectuelle qui ne résiste pas à l'épreuve des faits. Depuis la disparition de l'Union Soviétique, l'ONU est l'exécutrice des volontés américaines ; le "machin" qu'évoquait le Général de Gaulle ne peut être le garant de la paix, seul l'équilibre des puissances peut la permettre tout en autorisant l'indépendance des peuples. C'est à la construction d'un monde multipolaire d'inspiration gaullienne qu'il faut œuvrer afin de réduire l'unilatéralisme américain ; le mythe d'un pouvoir supra-étatique s'avère être, pour la seconde fois, une farce (la première expérience de ce type fût la SDN qui s'acheva comme l'on sait).
Messianisme mou et messianisme dur
Le refus français de s'aligner sur la politique américaine a surpris tout le monde et nous a fait plaisir mais il ne nous satisfait pas dans la mesure où il s'appuie sur une conception juridique et morale des relations internationales ; or comme nous l'avons déjà dit, cette conception conforme à l'esprit des Lumières a toujours été battue en brèche par la réalité brutale. La conception des radicaux-socialistes Chirac et Villepin en matière de politique internationale est un messianisme mou dont la France, avant-garde de l'idéologie universaliste, serait le porte-voix. Ce messianisme mou, qui pense pacifier le monde et convaincre tous les peuples de la planète d'adopter la civilisation libéralo-occidentale à coups de sermons moralisateurs, s'oppose mollement au messianisme dur professé par les Etats-Unis ; ces deux messianismes ont le même but : créer un monde unifié, libéral, occidentalisé, individualiste et universaliste. La seule divergence réside dans la méthode: le discours moral et juridique chez les Français, la guerre chez les Américains.
Plutôt que de faire des discours aussi creux que moralisateurs, Chirac et Villepin (dont l'action en Côte d'Ivoire a été couronné du succès que l'on sait !) feraient mieux de réfléchir aux moyens de doter l'Europe d'un système militaire efficace et dissuasif. La propension des hommes politiques européens, et français en particulier, à cultiver les rêveries kantiennes est un signe du déclin du courage et de la volonté.
La vision du Général
Au cours d'une conférence de presse qui eût lieu le 29 mars 1949, le Général de Gaulle dit : "Moi je dis qu'il faut faire l'Europe avec pour base un accord entre Français et Allemands (…). Une fois l'Europe faite sur ces bases, alors, on pourra se tourner vers la Russie. Alors, on pourra essayer une bonne fois pour toutes de faire l'Europe tout entière avec la Russie aussi, dut-elle changer son régime. Voilà le programme des vrais Européens. Voilà le mien". Ce point de vue prophétique dut sembler alors utopique et même fou, mais aujourd'hui, sa concrétisation est rendue possible par la disparition du calamiteux communisme soviétique et par l'intelligence géopolitique du Président Poutine qui est sans nul doute le plus intéressant des hommes politiques européens actuels.
Poutine ou le retour de la Russie en Europe
Au cours d'un discours remarquable prononcé en allemand devant le Bundestag le 25 septembre 2001, le Président Poutine disait : "Je crois que l'Europe ne peut à long terme affermir sa réputation de puissant et indépendant centre de la politique mondiale seulement si elle unifie ses moyens avec les hommes, les territoires et les ressources naturelles russes ainsi qu'avec le potentiel économique, culturel et de défense de la Russie”. Le Président russe nous a fait une proposition inespérée qu'il serait déraisonnable de refuser, tant il est évident que les ressources énergétiques et minérales d'une part (la Russie est le deuxième producteur de pétrole et le premier producteur de gaz au niveau mondial) , les compétences techno-scientifiques de la Russie d'autre part (3600 scientifiques et ingénieurs pour 100000 habitants en Russie, pour 2600 en France) contribueraient à faire de la Grande Europe l'ensemble géopolitique le plus puissant et le seul à pouvoir être quasiment autarcique.
La réalisation du rêve "grand-européen" est désormais à notre portée mais comme le dit Emmanuel Todd (Ouest-France du 28/3/2003) : "Tout dépendra de l'entente des Européens, qui détiennent la puissance économique, et des Russes, qui possèdent la réserve énergétique et la capacité stratégique nucléaire. De la capacité des Européens à comprendre que la Russie n'est plus une menace, mais un partenaire".
Construction européenne : il faut changer de cap
Le processus de construction européenne en cours est ordonné à une vue-du-monde fondamentalement libérale et par conséquent universaliste et individualiste. La vision de l'Europe qui prévaut à Bruxelles est celle d'un espace économique ouvert à tous les flux et pouvant à terme absorber tout ou partie de la planète . L'Europe que nous construisent les eurocrates n'est pas une union des peuples européens afformant sa puissance et son indépendance, mais l'embryon d'une utopique cité mondiale. L'actuel projet européen tend à créer un "ventre mou" sans volonté de puissance et inféodé aux Etats-Unis (l'adhésion des pays d'Europe centrale va renforcer le poids des pro-américains qui seront majoritaires après 2004). Ce projet européen reposant sur une utopie moralisatrice et mondialiste, nous le rejetons.
Nous n'adhérons pas à cette utopie et nous souhaitons qu'elle avorte rapidement ; les premiers signes d'un échec prévisible sont déjà perceptibles tant du point de vue économique (montée sans fin du chômage, délocalisations innombrables) que politique (l'affaire des signataires du manifeste des Etats pro-américains par exemple).
Nous doutons de la capacité de la Convention sur la réforme des institutions européennes à sortir l'Union Européenne de l'ornière dans laquelle elle est enlisée et nous pensons qu'il serait plus réaliste de changer de cap en tirant un trait sur les derniers traités (Maastricht, Amsterdam et Nice) et en limitant l'objectif de l'Union à celle d'une union économique appliquant le principe de la préférence communautaire qui figure dans le Traité de Rome et pratiquant un protectionnisme mesuré.
Dans cette perspective, l'objectif serait de mettre de côté le projet fédéraliste qui n'est pas réaliste dans l'immédiat (sauf à prendre le risque de construire un ensemble incohérent aux plans politique et diplomatique) tant les divergences de point de vue en matière de politique internationale sont inconciliables pour l'instant, et de construire une Europe en plusieurs cercles : un cercle économique constitué par l'actuelle Union revue et corrigée (voir ci-dessus) qui pourrait passer des accords de coopération avec les pays d'Europe centrale et la CEI en attendant leur intégration future, un cercle techno-scientifique permettant de mener des programmes communs de recherche fondamentale ou appliquée, un cercle industriel concernant des programmes tels Airbus ou Ariane, un cercle diplomatique et de défense construit autour d'un Pacte Européen se substituant au Traité de l'Atlantique Nord qui pourrait rassembler dans un premier temps la France, l'Allemagne et la Russie (l'axe Paris-Berlin-Moscou décrit par Henri de Grossouvre) et ceux des Etats plus petits qui seraient prêts pour une telle entreprise ; ainsi la Belgique et le Luxembourg.
Ce cercle de défense comprendrait un volet techno-scientifique et industriel visant à développer des matériels militaires spécifiquement européens. A ces quatre cercles, il conviendrait d'ajouter un cercle culturel visant à développer des programmes télévisuels et cinématographiques pan-européens mais aussi à promouvoir nos origines communes et la grandeur de notre civilisation à la fois une et diversifiée.
Le projet européen devrait se limiter à la "Grande Europe" définie par Yves Lacoste, laquelle comprend tout les pays situés au nord de la Méditerranée ainsi que les pays slaves (y compris la Russie, l'Ukraine et la Biélorussie), à l'exclusion de la Turquie qui n'est pas de culture européenne. Les Etats européens seraient libres d'adhérer à tous les cercles ou seulement à certains d'entre eux et ils auraient la possibilité de s'en retirer.
Ce dispositif aurait l'avantage de permettre la création d'une association d'Etats viable reposant sur une volonté résolue de construire une puissance européenne diplomatique et militaire, en permettant aux pays qui souhaitent rester indépendants d'une organisation militaire et diplomatique strictement européenne de le faire tout en participant au renforcement de l'Europe économique qui est déjà la première puissance économique de la planète. L'impossibilité de construire une Europe politique et militaire à quinze ou à vingt-cinq devient si évidente qu'à la fin mars, les autorités luxembourgeoises ont proposé de créer une association de défense commune rassemblant la France, l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg. Michel Barnier, membre de la Convention chargée de la réforme des institutions européennes, a clairement dit le 3 avril 2003 sur France Culture qu'une Union militaire et politique à quinze est rigoureusement impossible. Valéry Giscard d'Estaing, quant à lui, souhaite annexer au projet de constitution auquel il travaille, une déclaration d'indépendance de l'Europe (cette indépendance concerne d'abord les relations avec les Etats-Unis) ; ce faisant, il sait très bien que les Etats américanophiles ne pourront la signer, ce qui implique que l'Europe politique et militaire qu'il souhaite construire ne concernera qu'une partie de l'Europe de l'Ouest et du Centre (minoritaire sans doute).
Cette Europe en anneaux olympiques pourrait être une première étape vers une Europe plus intégrée ; peu ambitieux en terme d'intégration, ce projet aurait l'avantage de permettre des avancées importantes en terme de construction d'un pôle militaire et diplomatique spécifiquement européen, laquelle est une nécessité absolue parce que l'Europe doit devenir une grande puissance politique et militaire indépendante des Etats-Unis.
Puissance impériale et puissance tranquille
Les Etats-Unis qui croient avoir une mission divine consistant à imposer au monde entier leur civilisation et leur culture, ont entrepris de le faire par la force quand cela est nécessaire. Ce projet qui est à la fois totalitaire et psychopathe, ne pourra pas aboutir parce qu'en fait les USA surestiment leur force et sous-estiment leurs faiblesses.
Comme l'a mis en évidence Emmanuel Todd, les USA ne sont capables d'affronter que des petites armées du Tiers-Monde sous-équipées d'une part et d'autre part ils sont rongés par des maux bien visibles : affaiblissement scientifique et technique interne (le pourcentage de diplômés bac+3 et plus ne cesse de diminuer aux Etats-Unis depuis vingt ans), endettement des particuliers et des entreprises, déficit du commerce extérieur gigantesque et croissant (50 milliards de dollars en 1990 ; 450 milliards en 2002 ; plus de 500 milliards en 2003) qui traduit la surconsommation américaine, faible productivité, problèmes de cohésion sociale liés à la multi-ethnicité, dérive oligarchique enfin (une oligarchie liée aux milieux industriels d'une part et aux sectes protestantes fondamentalistes d'autre part maîtrise le pouvoir politique). Pour Todd, les Etats-Unis sont un colosse aux pieds d'argile qui finira par s'effondrer. Notre sociologue compare la situation des Etats-Unis à celle de la Rome finissante et en effet, comme la Rome du troisième siècle, les Etats-Unis ont besoin des ressources matérielles de l'Empire pour assurer le pain et les jeux à des citoyens jouisseurs qui ne sont même plus capables de se battre (pour cette guerre contre l'Irak, les Etats-Unis ont massivement fait appel à des mercenaires mexicains auxquels ils ont promis d'octroyer la nationalité américaine !).
Quel que soit le devenir des Etats-Unis, l'Europe ne peut rester indifférente à leur entreprise totalitaire et culturicide. Face à la volonté hégémonique américaine, nous devons répliquer en construisant une organisation militaire européenne indépendante et farouchement opposée à tout empiètement américain (ou autre).
Cette puissance européenne devrait être, comme le disait récemment Tsvetan Todorov sur France Culture, une " puissance tranquille", suffisamment puissante pour imposer le respect aux au-tres puissances mais sans volonté expansionniste et impérialiste d'une part et respectant la diversité des cultures et des civilisations d'autre part. Cette Europe cultivant son jardin (autocentrée en fait) mais disposant de moyens militaires importants et toujours prête à se défendre énergiquement, pourrait être, selon Todorov, un modèle à opposer à l'anti-modèle américain.
Notons que Todorov a affirmé au cours de cette émission radiophonique du 3 avril dernier, que le maintien d'une culture européenne spécifique passe nécessairement par la mise en place de frontières européennes suffisamment étanches . Il fallait oser le dire ; merci Monsieur Todorov !
Mikael Treguely.
00:05 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europe, union européenne, affaires européennes, politique internationale, politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 06 avril 2010
South Stream: Russlands Pipeline-Strategie gegenüber der Türkei
»South Stream«: Russlands Pipeline-Strategie gegenüber der Türkei
Während Moskau inzwischen zahlreiche politische Hindernisse beim Bau der »Nord Stream«-Gaspipeline nach Greifswald in Deutschland überwinden konnte, konzentriert Washington seine geopolitische Strategie auf den Aufbau einer zweiten Front im russisch-amerikanischen »Pipelinekrieg«: eine durch die Türkei verlaufende südosteuropäische Konkurrenz-Pipeline namens »Nabucco«. Der Name ist von der berühmten Verdi-Oper entlehnt, die vom erzwungenen Exil des hebräischen Volkes unter dem babylonischen König Nebukadnezar handelt. Washington setzt sich ganz offen für das Projekt »Nabucco«-Pipeline ein. Moskau dagegen wirbt für das eigene Projekt, die »South Stream«, eine südeurasische Schwesterpipeline zur »Nord Stream« im nördlichen Teil Europas. Für beide Seiten steht enorm viel auf dem Spiel.
 Am 12. Dezember 2009 gab die Regierung von Bulgarien – ehemaliges Mitgliedsland des Warschauer Pakts und heute NATO- und EU-Mitglied – bekannt, man werde sich ungeachtet erheblichen Drucks vonseiten Washingtons an Moskaus South-Stream-Projekt beteiligen.
Am 12. Dezember 2009 gab die Regierung von Bulgarien – ehemaliges Mitgliedsland des Warschauer Pakts und heute NATO- und EU-Mitglied – bekannt, man werde sich ungeachtet erheblichen Drucks vonseiten Washingtons an Moskaus South-Stream-Projekt beteiligen.
Im Juni 2007 haben Gazprom und der italienische Energiekonzern ENI eine Absichtserklärung über Planung, Finanzierung, Bau und Betrieb der South Stream unterzeichnet. ENI, der größte italienische Industriekonzern, der in den 1950er-Jahren vom legendären Enrico Mattei gegründet worden ist, befindet sich teilweise in Staatsbesitz und ist seit Anfang der 1970er-Jahre in Gasgeschäften mit Russland tätig.
Der Offshore-Abschnitt der South Stream wird in einer Länge von ca. 550 Kilometern von der russischen zur bulgarischen Küste in einer Tiefe von bis zu zwei Kilometern durch das Schwarze Meer verlaufen; die volle Kapazität der Pipeline wird 63 Milliarden Kubikmeter, also mehr als die der Nord Stream, betragen.
In Bulgarien wird sich die South Stream in zwei Stränge teilen, der nördliche Strang verläuft über Rumänien, Ungarn und die Tschechische Republik nach Österreich, der südliche durch Bulgarien nach Süditalien. Die neue Gaspipeline soll 2013 in Betrieb genommen werden.
Gazprom hat vertraglich zugesichert, Italien bis 2035 mit Gas zu versorgen, South Stream ist dabei die wichtigste Lieferroute. Das Unternehmen South Stream AG, ein Joint Venture zu gleichen Teilen zwischen Gazprom und ENI, ist in der Schweiz eingetragen. Bisher hat Gazprom Transitabkommen für die Pipeline mit Serbien, Griechenland und Ungarn geschlossen. (1) Darüber hinaus hat das Unternehmen im Januar 2008 51 Prozent der Anteile des serbischen staatlichen Energiemonopolisten NIS aufgekauft, um sich die Präsenz in diesem Land zu sichern.
Welchen Druck Washington bezüglich der Beteiligung an der russischen South Stream auf Bulgarien ausübt, wurde daran deutlich, dass Bulgarien sich im Dezember 2009 auch zur Beteiligung an dem Nabucco-Projekt verpflichtet hat. Gegenüber der Presse kommentierte der bulgarische Regierungschef Boyko Borisov die doppelte Unterschrift: »Nabucco bedeutet für die Europäische Union eine Priorität, gleichzeitig kommt die russische South Stream sehr schnell vorankommt; fast täglich beteiligen sich weitere europäische Länder daran.« (2)
Am 3. März 2010 hat die neue kroatische Regierung von Ministerpräsidentin Jadranka Kosor eine Vereinbarung mit dem russischen Ministerpräsidenten Wladimir Putin unterzeichnet, nach der die Pipeline über kroatisches Gebiet geführt werden darf. Ein neu gegründetes Joint Venture zu gleichen Anteilen wird den Bau ausführen.
Laut Kosor liefert die Vereinbarung »Über Bau und Nutzung einer Gaspipeline auf kroatischem Territorium« den rechtlichen Rahmen für die Beteiligung Kroatiens an South Stream und ermöglicht den beteiligten Parteien die Bildung eines Joint Ventures zu gleichen Teilen. Zwei Tage später schien der Zuspruch zu dem Gazprom-Projekt bereits lawinenartig gewachsen: die bosnische Republika Srpska kündigte an, auch sie werde sich an der South-Stream-Gaspipeline beteiligen. Sie schlägt den Bau einer 480 Kilometer langen Pipeline in Nord-Bosnien vor, die an die South Stream angeschlossen werden soll. Damit ist die Zahl der Länder, die entsprechende Verträge mit Gazprom unterzeichnet haben, auf sieben angewachsen. (3)
Zusätzlich zur bosnischen Republika Srpska sind mittlerweile Bulgarien, Ungarn, Griechenland, Serbien, Kroatien und Slowenien Partner von Gazprom. Das entspricht praktisch derselben Route über den Balkan wie bei der umstrittenen Bagdad-Bahn, die in den britischen Machenschaften, die letztendlich nach der Ermordung des österreich-ungarischen Thronfolgers Erzherzog Franz Ferdinand zum Ersten Weltkrieg führten, eine äußerst wichtige Rolle spielte. (4)
Die zentrale Frage der beiden konkurrierenden Pipelineprojekte South Stream und Nabucco ist nicht, wer das transportierte Gas kaufen wird. Wie bereits erwähnt, geht man allgemein davon aus, dass die Nachfrage nach Erdgas in Europa in den kommenden Jahren dramatisch steigen wird. Wichtiger ist die Frage, woher das Gas stammen wird, das die Pipeline füllt. Hier hat Moskau jetzt offensichtlich alle Trümpfe in der Hand.
Zusätzlich zu dem Gas, das direkt von den russischen Gasfeldern stammt, wird ein erheblicher Teil des durch die South Stream transportierten Gases aus Turkmenistan und Aserbaidschan kommen, ein weiterer Teil möglicherweise aus dem Iran. Im Dezember 2009 reiste der russische Präsident Dmitri Medwedew zur Unterzeichnung umfangreicher Vereinbarungen über eine Kooperation im Bereich Energie nach Turkmenistan.
Bis zum Zerfall der Sowjetunion im Jahr 1991 zählte Turkmenistan als Turkmenische Sozialistische Sowjetrepublik oder TuSSR zu den Teilrepubliken der Sowjetunion. Das Land grenzt im Südosten an Afghanistan, im Süden und Südwesten an den Iran, im Osten und Nordosten an Usbekistan, im Norden und Nordwesten an Kasachstan und im Westen an das Kaspische Meer. Bisher war die russische Gazprom der dominierende Wirtschaftspartner des Landes, in dem erst kürzlich neue Gasvorkommen bestätigt worden sind. Das Gas aus Turkmenistan ist für die Lieferkette von Gazprom sehr bedeutsam, und das bereits seit der Zeit, als Turkmenistan noch zur Sowjetunion gehörte und Teil der sowjetischen Wirtschaftsinfrastruktur war.
Als der »auf Lebenszeit gewählte Präsident« Saparmyat Nyasov, der auch als »Türkmenbaşy« oder »Führer der Turkmenen« bekannt war, im Dezember 2006 unerwartet verstarb, weckte dies in Washington die Hoffnung, den neuen Präsidenten Gurbanguly Berdimuhamedow von Russland lösen und unter amerikanischen Einfluss bringen zu können. Bislang allerdings ohne großen Erfolg.
Das Abkommen zwischen Medwedew und Berdimuhamedow vom Dezember umfasste neue Vereinbarungen über langfristige Lieferung von turkmenischem Gas an Gazprom, mit dem entweder die South-Stream-Pipeline direkt gefüllt werden oder die entsprechende Menge russischen Gases ersetzt werden soll – was bedeutet: Nabucco zieht den kürzeren.
Nabucco auf dem Trockenen …
Mit ihrer aktiven Pipeline-Diplomatie der vergangenen Monate setzen Russland und die Gazprom dem Nabucco-Projekt, der von Washington favorisierten Alternative, schwer zu. Mit der geplanten Nabucco-Pipeline soll die Region um das Kaspische Meer und der Nahe Osten über die Türkei, Bulgarien, Rumänien, Ungarn mit Österreich verbunden werden, und von dort aus sollen die Gasmärkte in Zentral- und Westeuropa beliefert werden. Bei einer Länge von ca. 3300 Kilometern würde sie von der georgisch-türkischen und/oder iranisch-türkischen Grenze nach Baumgarten in Österreich führen. Sie soll parallel zu der bereits bestehenden, von den USA unterstützten Ölpipeline Baku-Tiflis-Erzurum verlaufen und jährlich 20 Milliarden Kubikmeter Gas transportieren. Zwei Drittel der geplanten Pipeline würden über türkisches Gebiet verlaufen.
Nach seinem zweitägigen Ankara-Besuch im April 2009 sah es zunächst so aus, als habe US-Präsident Obama einen Sieg für Nabucco errungen, denn der türkische Ministerpräsident Erdogan willigte ein, das Projekt nach mehrjähriger Verzögerung im Juli 2009 mit seiner Unterschrift abzusegnen. Nabucco ist Teil der amerikanischen Strategie, die vollständige Kontrolle über die Energieversorgung nicht nur der EU-Länder, sondern ganz Eurasiens zu übernehmen. Die Pipeline wurde explizit so geplant, dass sie nicht über russisches Territorium führt; die Kooperation zwischen Russland und Westeuropa im Bereich Energie soll dadurch geschwächt werden. Diese bisherige Kooperation war ihrerseits ein maßgeblicher Beweggrund für die deutsche und französische Regierung, dem Druck aus Washington für die Aufnahme Georgiens und der Ukraine in die NATO nicht nachzugeben.
Heute steht die Zukunft von Nabucco in den Sternen, denn die russische Gazprom hat sich langfristige Verträge mit praktisch allen potenziellen Gaslieferanten für Nabucco gesichert. Nabucco sitzt also auf dem Trockenen. Deshalb werden jetzt Aserbaidschan, Usbekistan, Turkmenistan, Iran und Irak als potenzielle Lieferanten für Nabucco umworben.
Bisher war Aserbaidschan als Hauptgaslieferant für Nabucco vorgesehen. Die großen aserbaidschanischen Ölvorkommen hat sich ein anglo-amerikanisches Konsortium unter Führung der BP bereits gesichert, das unabhängig von Moskau Öl aus Baku am Kaspischen Meer nach Westen transportiert. Die Ölpipeline Baku-Tiflis-Ceyhan war ein wichtiges Motiv für Washington, 2004 die »Rosen-Revolution« in Georgien zu unterstützen, die den Diktator Micheil Saakaschwili an die Macht brachte.
Im Juli 2009 reisten Russlands Präsident Medwedew und Gazprom-Chef Alexei Miller gemeinsam nach Baku und unterzeichneten dort einen langfristigen Vertrag über den Kauf der gesamten Erdgasproduktion auf dem dortigen Offshore-Gasfeld Shah Denzi II, auf das auch die Planer von Nabucco spekuliert hatten. Aserbaidschans Präsident Alijew spielt anscheinend ein Katz-und-Maus-Spiel mit Russland auf der einen und mit der EU und Washington auf der anderen Seite. In der Hoffnung, dabei den höchstmöglichen Preis herauszuschlagen, versucht er, beide gegeneinander auszuspielen. Gazprom hat eingewilligt, den ungewöhnlich hohen Preis von 350 Dollar für 1.000 Kubikmeter Shah-Deniz-Gas zu bezahlen – eine offensichtlich politisch, nicht wirtschaftlich motivierte Entscheidung der Regierung in Moskau, die die Mehrheitsbeteiligung an Gazprom hält. (5) Anfang Januar 2010 gab die Regierung von Aserbaischan auch den Verkauf von einem Teil ihres Gases an den benachbarten Iran bekannt, ein weiterer Rückschlag für die Belieferung für Nabucco. (6)
Selbst wenn Aserbaidschan einwilligen sollte, Gas zu verkaufen und selbst wenn Nabucco dieses zu vergleichbaren Bedingungen wie Gazprom kaufen würde, so reichte das aserbaidschanische Gas alleine nach Auskunft von Branchenkennern nicht aus, die Pipeline zu füllen. Woher könnte das verbleibende Volumen kommen? Eine Möglichkeit wäre der Irak, die andere der Iran. Doch beides würde Washington, vorsichtig formuliert, gewaltige geopolitische Probleme bereiten.
Zurzeit ist nicht einmal ein Minimal-Abkommen zwischen der Türkei und Aserbaidschan über die Lieferung von aserbaidschanischem Öl in Sicht. Trotz der 2009 mit großer Fanfare bekannt gegebenen Entscheidung der türkischen Regierung, dem Nabucco-Projekt beizutreten, befinden sich die Gespräche zwischen der türkischen und aserbaidschanischen Regierung in der Sackgasse. Trotz wiederholter Interventionen vonseiten des amerikanischen Sondergesandten für eurasische Energiefragen, Richard Morningstar, ein Abkommen zustande zu bringen, sind die Gespräche derzeit noch immer blockiert. Washingtons Nabucco-Träume wurden zusätzlich getrübt, als die österreichische OMV, ein weiterer wichtiger Nabucco-Partner, Ende Januar gegenüber der Nachrichtenagentur Dow Jones erklärte, Nabucco werde nicht gebaut, wenn es keine ausreichende Nachfrage gebe. (7)
Auch andere in Washington ins Spiel gebrachte Optionen wären problematisch. Um beispielsweise irakisches Gas in die Nabucco-Pipeline einzuspeisen, müsste dieses auf irakischer und türkischer Seite über kurdisches Gebiet transportiert werden, was der jeweiligen kurdischen Minderheit eine willkommene neue Einkommensquelle bescheren würde – und das kommt in Istanbul gar nicht gut an. Den Iran hat Washington gegenwärtig als Gaslieferanten wegen der Spannungen über das iranische Atomprogramm nicht auf der Rechnung; wichtiger ist allerdings noch der enorme iranische Einfluss auf die Zukunft des Irak mit seiner mehrheitlich schiitischen Bevölkerung.
Usbekistan und Turkmenistan verfügen zwar beide über erhebliche Erdgasvorkommen, kommen jedoch politisch und geografisch schwerlich als Gaslieferanten für ein im Kern anti-russisches Projekt infrage. Ihre entfernte Lage bedeutet darüber hinaus enorme Kosten, denn dieses Gas wäre erheblich teurer als das vom Konkurrenten Gazprom über die South-Stream-Pipeline transportierte.
In klassischer Manier byzantinischer Diplomatie hat der türkische Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan sowohl Russland als auch den Iran eingeladen, sich an dem Nabucco-Projekt zu beteiligen. Laut RIA Novosti erklärte Erdogan: »Wir möchten, dass sich der Iran an dem Projekt beteiligt, wenn es die Bedingungen erlauben, und hoffen ebenfalls auf die Beteiligung Russlands.« Während Putins Besuch in Ankara im August 2009, also nur wenige Wochen nach der formellen Unterzeichnung des Nabucco-Vertrags mit den USA, gewährte die Türkei dem staatlichen russischen Erdgasmonopolisten Gazprom die Nutzung der territorialen Gewässer im Schwarzen Meer. Russland will die South-Stream-Pipeline nach West- und Südeuropa durch das Schwarze Meer führen. Im Gegenzug sagte Gazprom den Bau einer Pipeline vom Schwarzen Meer zum Mittelmeer über türkisches Gebiet zu. (8)
Anfang Januar 2010 bestärkte die türkische Regierung während eines zweitägigen Moskau-Besuchs von Ministerpräsident Erdogan, bei dem über Energie und die Süd-Kaukasus-Region gesprochen wurde, die entstehenden Bindungen an Russland. Washingtons Radio Liberty spricht von einer »neuen strategischen Allianz« zwischen den früheren erbitterten Gegnern im Kalten Krieg. Die Türkei ist schließlich auch Mitglied der NATO. (9)
Diese Entwicklung ist keine vorübergehende Modeerscheinung. In den Medien beider Länder ist von einer russisch-türkischen »strategischen Partnerschaft« die Rede. (10) Heute bildet die Türkei den größten Markt für den Export von russischem Öl und Gas. Beide Länder beraten auch über russische Pläne für den Bau des ersten Kernkraftwerks in der Türkei zur Deckung des dortigen Energiebedarfs. Der Handel zwischen beiden Ländern erreichte im vergangenen Jahr ein Volumen von 38 Milliarden Dollar; damit war Russland der größte Handelspartner der Türkei. Für die nächsten fünf Jahre wird eine Steigerung um etwa 300 Prozent erwartet, dementsprechend bildet sich in der Türkei eine solide und wachsende pro-russische Handelslobby. Die beiden Länder verhandeln derzeit konkret über weitere Handelsabkommen in Höhe von ca. 30 Milliarden Dollar, einschließlich des geplanten Kernkraftwerks in der Türkei sowie der Gaspipelines South Stream und Blue Stream zwischen Russland und der Türkei sowie einer Ölpipeline Samsun–Ceyhan von Russland an die türkische Mittelmeerküste. (11)
Doch den Nabucco-Befürwortern, besonders denen in Washington, droht noch manch anderer politische Sprengsatz: So verabschiedete das türkische Parlament zwar am 4. März 2010 ein Gesetz zum Bau der Nabucco-Pipeline, doch am selben Tag stimmte der Auswärtige Ausschuss des US-Repräsentantenhauses für eine nicht-bindende Resolution, in der die Morde an den Armeniern in der Zeit des Ersten Weltkriegs als Völkermord bezeichnet werden.
Sofort nach diesem Votum wurde der türkische Botschafter aus Washington zurückgerufen. Immerhin kann genau dieses Votum zu einer engeren Zusammenarbeit zwischen Moskau und Ankara in Fragen von beiderseitigem Interesse führen, South Stream eingeschlossen.
Die Europäische Union hat gerade ein drei Milliarden Dollar schweres Konjunkturpaket bewilligt, das auch 273 Millionen Dollar für Nabucco beinhaltet. Angesichts erwarteter Gesamtkosten von elf Milliarden Dollar bedeutet dieser Betrag nicht gerade eine überwältigende Unterstützung für Nabucco. Außerdem liegt das Geld bis zum endgültigen Start von Nabucco auf Eis, was darauf hindeutet, dass die EU-Länder weit weniger darauf erpicht sind als Washington, bei der riskanten Gegenstrategie Nabucco zu Moskaus South Stream mitzumachen. Die EU hat erklärt, das Geld werde für andere Zwecke verwendet, falls es zwischen den Nabucco-Befürwortern und Turkmenistan nicht innerhalb von sechs Monaten zu einer Einigung über die Gaslieferung käme.
Das zeitliche Zusammentreffen der Neutralisierung eines NATO-Beitritts der Ukraine mit dem Beginn des Baus der strategisch wichtigen Nord-Stream-Pipeline von Russland nach Deutschland sowie Russlands Pläne für die South-Stream-Gaspipeline hat die Nabucco-Pipeline, Washingtons Gegenmaßnahme, praktisch wertlos gemacht. Durch diese Entwicklungen ist gewährleistet, dass Russland wichtigster Energielieferant für Europa bleibt. In den vergangenen Jahren ist der Anteil russischer Energielieferungen nach Europa auf fast 30 Prozent aller Energieimporte gestiegen, beim Erdgas ist Russland sogar der wichtigste Lieferant. (12) Das Ganze hat weitreichende strategische und geopolitische Bedeutung, was Washington sicher nicht entgangen sein dürfte.
__________
(1) Gazprom, »Major Projects: South Stream«, unter http://old.gazprom.ru/eng/articles/article27150.shtml
(2) Trend, »Bulgaria ready to participate in both South Stream and Nabucco«, Baku, Aserbaidschan, 5. Dezember 2009, unter http://en.trend.az
(3) Olja Stanic, »Bosnian Serbs to join Russia-led gas pipeline«, Reuters, 5. März 2005, Banja Luka, Bosnien, unter http://in.reuters.com/article/oilRpt/idINLDE6241B920100305
(4) Mehr über diese faszinierende und fast vergessene Geschichte der deutsch-britischen imperialen Rivalität in Bezug auf die Bagdad-Bahn im Vorfeld des Ersten Weltkriegs siehe: F. William Engdahl, Mit der Ölwaffe zur Weltmacht – Der Weg zur neuen Weltordnung, Kopp Verlag, Rottenburg, 3. Auflage 2008, S. 42ff. (Englische Originalausgabe: A Century of War: Anglo-American Oil Politics and the New World Order, Pluto Press, London 2004, pp. 22–28)
(5) Mahir Zeynalov, »Azerbaijan-Gazprom agreement puts Nabucco in jeopardy, Today’s Zaman« 16. Juli 2009, unter http://www.todayszaman.com/tz-web/sabit.do?sf=aboutus
(6) Saban Kardas, »Delays in Turkish-Azeri Gas Deal Raises Uncertainty Over Nabucco«, Eurasia Daily Monitor, Jhrg. 7, Heft 39, 26. Februar 2010
(7) Ebenda
(8) Rian Whitmore, »Moscow Visit by Turkish PM Underscores New Strategic Alliance«, Radio Liberty/Radio Free Europe, 13. Januar 2010, unter http://www.rferl.org/content/Moscow_Visit_By_Turkish_PM_Underscores_New_Strategic_Alliance/1927504.html
(9) Ebenda
(10) Faruk Akkan, »Turkey and Russia move closer to building strategic partnership«, RIA Novosti, 15. Januar 2010, unter http://en.rian.ru/valdai_foreign_media/20100115/157554880.html
(11) RIA Novosti, »Russian delegation to discuss Turkey nuclear power plant plan«, Ankara, 18. Februar 2010, unter http://en.rian.ru/world/20100218/157927131.html
(12) Kommersant, »Nabucco's future depends on Turkmenistan«, Moscow, 9. März 2010, unter http://en.rian.ru/papers/20100309/158135872.html
Mittwoch, 31.03.2010
© Das Copyright dieser Seite liegt, wenn nicht anders vermerkt, beim Kopp Verlag, Rottenburg
Dieser Beitrag stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers dar. Er muß nicht zwangsläufig die Meinung des Verlags oder die Meinung anderer Autoren dieser Seiten wiedergeben.
00:20 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : turquie, russie, politique internationale, hydrocarbures, gaz, gazoducs, énergie, géopolitique, europe, affaires européennes, méditerranée, mer noire, balkans |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Louis-Ferdinand Céline par Ioannis Mouhasiris
00:14 Publié dans art | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art, peinture, portrait, littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, france, céline |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
La corrispondenza tra Julius Evola e Gottfried Benn
La corrispondenza tra Julius Evola e Gottfried Benn
 L’accusa più scontata che l’intellighenzia ufficiale lancia contro Julius Evola è quella di essere un “nazista”, più che di essere stato (come innumerevoli altri uomini di cultura italiani) un “fascista”. Accusa ovvia e prevedibile, ma superficiale, che si basa su alcune apparenze: il suo retroterra culturale che si rifaceva ad una certa filosofia tedesca (a partire da Nietzsche); il suo essere caratterialmente più “tedesco” che “italiano, il suo interessamento tra le due guerre per far conoscere nel nostro Paese una certa cultura di lingua tedesce (da Bachofen a Spengler a Meyrink); i suoi contatti con la Germania del Terzo Reich; il suo aver ricordato come avesse conosciuto Himmler, visitato ai castelli dell’Ordine, tenuto conferenze in ambienti diversi come l’Herrenklub da un lato e le SS dall’altro; l’aver scritto articoli sulla politica estera, interna, culturale ed economica della Germania nazionalsocialista e sulle stesse SS (articoli di cui si ricordano gli eventuali apprezzamenti ma non le innumerevoli riserve critiche); e così via. Da tutto questo sfondo gli orecchianti derivano l’etichetta appunto di “nazista”: raramente si va alle fonti e si leggono nel loro complesso, a partire almeno dal 1930, con articoli e saggi su “Vita Nova” e “Nuova Antologia”, sino agli interventi su “Il Regime Fascista”, “Lo Stato” e “La Vita Italiana” del maggio-luglio 1943.
L’accusa più scontata che l’intellighenzia ufficiale lancia contro Julius Evola è quella di essere un “nazista”, più che di essere stato (come innumerevoli altri uomini di cultura italiani) un “fascista”. Accusa ovvia e prevedibile, ma superficiale, che si basa su alcune apparenze: il suo retroterra culturale che si rifaceva ad una certa filosofia tedesca (a partire da Nietzsche); il suo essere caratterialmente più “tedesco” che “italiano, il suo interessamento tra le due guerre per far conoscere nel nostro Paese una certa cultura di lingua tedesce (da Bachofen a Spengler a Meyrink); i suoi contatti con la Germania del Terzo Reich; il suo aver ricordato come avesse conosciuto Himmler, visitato ai castelli dell’Ordine, tenuto conferenze in ambienti diversi come l’Herrenklub da un lato e le SS dall’altro; l’aver scritto articoli sulla politica estera, interna, culturale ed economica della Germania nazionalsocialista e sulle stesse SS (articoli di cui si ricordano gli eventuali apprezzamenti ma non le innumerevoli riserve critiche); e così via. Da tutto questo sfondo gli orecchianti derivano l’etichetta appunto di “nazista”: raramente si va alle fonti e si leggono nel loro complesso, a partire almeno dal 1930, con articoli e saggi su “Vita Nova” e “Nuova Antologia”, sino agli interventi su “Il Regime Fascista”, “Lo Stato” e “La Vita Italiana” del maggio-luglio 1943. Visione aristocratica
Julius Evola non fu né “fascista” né “antifascista” (come già scriveva polemicamente sul suo quindicinale “La Torre” all’inizio del 1930), e di conseguenza non fu poi né “nazista” né “antinazista”: fu allora un incerto, un attendista, un ipocrista, un – come si suol dire – “pesce in barile”? No: del fascismo, e quindi del nazismo, accettò quelle idee, tesi, posizioni, atteggiamenti, scelte pratiche che si accordavano con quelle di una Destra Tradizionale e, poi, di quella che è stata definita la Rivoluzione Conservatrice tedesca. Una visione all’epoca ghibellina, imperiale, aristocratica che – se pur “utopica” – lo allontanava di certo dalla Weltanschauung populista “democratica” e “plebea” del fascismo ma soprattutto del nazismo, il cui materialismo biologico gli era del tutto insopportabile. Non si tratta di giustificazioni a posteriori, come qualcuno ha malignamente pensato leggendo le pagine de Il cammino del cinabro (1963), dato che Evola non è quello che oggi si suol dire un “pentito”: non ha mai rinnegato o respinto nulla del suo passato; anche se ha rettificato e preso le distanze da alcune sue posizioni giovanili (tutti dimenticano quel che scrisse circa Imperialismo pagano del 1928: “Nel libro, in quanto seguiva – debbo riconoscerlo – lo slancio di un pensiero radicalistico facente uso di uno stile violento, si univa ad una giovanile mancanza di misura e di senso politico e ad una utopica incoscienza dello stato di fatto”: non “pentimento” bensì logica maturazione di un uomo di pensiero). E che non si tratti di giustificazioni, lo stanno a dimostrare i documenti che nel corso degli anni, dopo la sua morte nel 1974, vengono lentamente alla luce dagli archivi pubblici e privati italiani e tedeschi. Da essi emerge un Julius Evola tutt’altro che “organico al regime” come addirittura si è scritto, ma nemmeno tanto marginale come si credeva: un saggista, giornalista, polemista, conferenziere che proseguì tra alti e bassi e che, dopo la crisi del 1930 con la chiusura de “La Torre” e la sua emarginazione, accettò di avvicinarsi a personaggi come Giovanni Preziosi, Roberto Farinacci, Italo Balbo, cioè si potrebbe dire i fascisti più “rivoluzionari” e “intransigenti”, per poter esprimere le proprie idee critiche al riparo di quelle nicchie, agendo come una specie di “quinta colonna” tradizionalista per tentare l’utopica impresa di “rettificare” in quella direzione il Regime: e così iniziò a scrivere a partire dal marzo 1931 su “La Vita Italiana”, dal gennaio 1933 su “Il Corriere Padano” e “Il Regine Fascista”, e quindi – uscito dal “ghetto” dei caduti in disgrazia – dall’aprile 1933 su “La Rassegna Italiana”, dal febbraio 1934 su l’autorevole “Lo Stato” e sul “Roma”, dal marzo 1934 su “Bibliografia Fascista”.
Sorvegliato speciale
Nonostante ciò Evola venne costantemente sorvegliato dalla polizia politica sia in Italia che all’estero: la corrispondenza controllata, gli amici che frequentava identificati (anche le amiche), le sue affermazioni in confidenza riferite, varie volte gli venne tolto il passaporto per le cose assai poco ortodosse che andava a dire sul fascismo e nazismo nelle sue conferenze in Germania e Austria. Come risulta dai documenti ormai pubblicati dei Ministeri degli Esteri e dell’Interno del Reich e da quelli provenienti dall’Ahnenerbe, era appena tollerato: non era un vero nemico, ma le sue idee non venivano apprezzate dai vertici nazionalsocialisti, dato che era considerato un “romano reazionario” che aspirava a far “sollevare l’aristocrazia” e non accettava molto il riferimento tedesco a “sangue e suolo”.
Un’adesione molto critica, dunque, quella di Julius Evola tale da non poterlo semplicisticamente definire né un “fascista”, né un “nazista” di pieno diritto. Il suo punto di riferimento era invece la Konservative Revolution ed i suoi esponenti dell’epoca. Sentiamo le sue stesse parole tratte da Il cammino del cinabro: “Già l’edizione tedesca del mio Imperialismo pagano, dove le idee di base erano state staccate dai riferimenti italiani, aveva fatto conoscere il mio nome in Germania negli ambienti ora indicati. Nel 1934 feci il mio primo viaggio nel nord, per tenere una conferenza in una università di Berlino, una seconda conferenza a Brema nel quadro di un convegno internazionale di studi nordici (il secondo Nordisches Thing, promosso da Roselius) e, cosa più importante di tutto, un discorso per un gruppo ristretto dell’Herrenklub di Berlino, il circolo della nobiltà tedesca conservatrice la cui parte di rilievo nella politica tedesca più recente è ben nota. Qui trovai il mio ambiente naturale. Da allora, si stabilì una cordiale e feconda amicizia fra me e il presidente del circolo, barone Heinrich von Gleichen. Le idee da me difese trovarono un suolo adatto per essere comprese e valutate. E quella fu anche la base per una mia attività in Germania, in seguito ad una convergenza di interessi e finalità”.
Altri contatti e collegamenti in quest’area conservatrice furono con il filosofo austriaco Othmar Spann e il principe Karl Anton Rohan, sulla cui “Europaische Revue” Evola aveva esordito sin dal 1932 e su cui continuò a pubblicare sino al 1943. Si tenga conto dell’anno. Il 1934 fu importante: dal 2 febbraio usciva il quotidiano di Cremona “Il Regime Fascista” una pagina quindicinale intitolata con stile tipicamente evoliano “Diorama Filosofico. Problemi dello spirito nell’etica fascista”, pubblicato con varia periodicità e interruzioni sino al 18 luglio 1943.
Mancano ancora studi complessivi su una iniziativa che fu unica nel Ventennio come intenti e complessità: un vero e proprio progetto culturale con cui Julius Evola intendeva esporre costruttivamente e criticamente il punto di vista della Destra tradizionale e conservatrice rispetto al fascismo. Su quella pagina scrissero molti autorevoli esponenti della cultura europea di tale tendenza: italiani, ma anche tedeschi, austriaci, francesi, inglesi. Fra i tedeschi anche il medico e poeta Gottfried Benn, con cui Evola era in contatto epistolare a quanto pare sin dal 1930.
Nella prima metà del 1934 uscì anche l’opera principale che Julius Evola aveva scritto – incredibilmente e per l’età e per l’attività che in quel momento stava svolgendo – fra il 1930 e il 1932: Rivolta contro il mondo moderno presso Hoepli; e venne effettuato quel viaggio in Germania ricordato nell’autobiografia. Durante la tappa berlinese vi fu il primo incontro diretto con Benn: molti erano i punti in comune fra il medico-scrittore, che era di dieci anni più vecchio di Evola (era nato nel 1886 e sarebbe morto nel 1956), e quest’ultimo. Di Benn si tende og gi a mettere in risalto il suo aspetto nichilista, ateo e astratto dagli aspetti più orribili della realtà umana, e si tende a dimenticare il suo apporto alla Rivoluzione Conservatrice tedesca. Sta di fatto che il contatto fra Evola e Benn ad una certa comunanza di idee portò ad un famoso saggio-recensione alla traduzione tedesca di Rivolta che apparve sul fascicolo del marzo 1935 della rivista «Die Literatur» di Stoccarda. È una specie di “canto del cigno” in cui Benn espone le sue idee e concorda con la «visione del mondo» evoliana: infatti, quello fu “il suo ultimo testo in prosa pubblicato sotto il Terzo Reich”, perché in seguito Rosenberg e Goebbels gli vietarono di scrivere alcunché. Recensione di profonda analisi di cui Evola stesso riconosceva l’importanza e volle porre in appendice alla sua raccolta di saggi L’arco e la clava (Scheiwiller, 1968), mentre adesso sarà posta in appendice alla nuova edizione di Rivolta che uscirà entro il 1998. Egli stesso amava ricordare soprattutto una frase: “Un ‘opera, la cui importanza eccezionale apparirà chiara negli anni che vengono. Chi la legge, si sentirà trasformato e guarderà l’Europa con un sguardo nuovo”.
“Rivolta” in Germania
Ora a confermare e precisare i rapporti Evola-Benn vi sono tre lettere del primo al secondo che sono state rintracciate da Francesco Tedeschi, studioso soprattutto dell’Evola artista, nello Schiller-Nationalmuseum Deutsches Literaturarchiv (Handschriften Abteilung) di Marbach, e che qui si pubblicano grazie alla sua fattiva collaborazione e al suo consenso: due manoscritte sono del 30 luglio e del 9 agosto 1934, una dattiloscritta del 13 settembre 1955 e se ne dà la traduzione integrale dovuta a Quirino Principe. Dai primi due scritti emergono alcuni fatti noti ed un altro assolutamente nuovo: i fatti noti sono che Benn ed Evola già si conoscevano almeno per lettera (“Ella ha ripetutamente mostrato un cordiale interesse per le mie fatiche”: 20 luglio), che sono effettivamente incontrati nel corso del viaggio evoliano in Germania (“Le sarei molto obbligato se ella mi offrisse le possibilità di punti di vista e di una più lunga conversazione tra noi due”: 9 agosto), che esisteva un reciproco apprezzamento su una medesima Weltanschauung “conservatrice” o “tradizionale” (“l’assoluta competenza che a mio giudizio Ella possiede su questi argomenti e la Sua grandissima conoscenza e intelligenza delle tradizioni cui io mi ricollego”: 20 luglio), che entrambi non si riconoscevano nel nazismo da poco salito al potere (“sono sempre più convinto che a chi voglia difendere e realizzare senza compromessi di sorte una tradizione spirituale e aristocratica non rimanga purtroppo, oggi. e nel mondo moderno, alcun margine di spazio; a meno che non si pensi unicamente a un lavoro elitario”: 9 agosto).
Il fatto nuovo e di enorme interesse è nella richiesta avanzata da Evola il 20 luglio, e accettata da Benn nella sua risposta (che non possediamo) del 27 luglio, di “sottoporre a revisione il manoscritto della traduzione” tedesca di Rivolta effettuata da Friedrich Bauer. Il particolare era del tutto sconosciuto ed Evola non ne ha mai parlato anche se esso – la revisione linguistica da parte di un poeta noto e apprezzato come Gottfried Benn – avrebbe potuto dare lustro al suo maggior libro. Non pare ci siano dubbi che tale revisione sia stata effettivamente compiuta, non tanto per i ringraziamenti alla “gentilissima intenzione” (9 agosto), quanto per il fatto che si danno specifici riferimenti sul manoscritto della traduzione stessa presso la casa editrice tedesca e, si può dedurre, per l’ampio interesse manifestato da Benn con la recensione su “Die Literatur” (il libro aveva dunque visto la luce entro il marzo 1935): non solo, allora, adesione alla “visione del mondo” esposta nell’opera, ma anche l’averla considerato come un testo al quale – per averne rivista la traduzione – si è particolarmente vicini. Un nuovo tassello che si aggiunge a comporre il quadro (ancora incompleto) del rapporto fra Julius Evola e la cultura conservatrice tedesca fra le due guerre. Si può quindi immaginare che il contatto epistolare con il medico poeta sia continuato ma per ora non se ne hanno altre tracce.
Ci si sposta allora in avanti di vent’anni, al 1955. La lettera del 13 settembre s’inquadra nel tentativo del filosofo di riprendere i contatti proprio con quegli esponenti anticonformisti che aveva conosciuto negli anni Trenta e Quaranta: si sa che nel 1947 aveva scritto a Guénon, nel 1951 a Eliade e Schmitt, nel 1953 a Jünger, per ricollegarsi ad un discorso intellettuale interrotto dagli eventi bellici, ma anche per proporre traduzioni dei loro libri in italiano, dato che potevano essere utili per una nuova Kulturkampf. Spesso le sue aspettative andarono deluse: non tutti erano rimasti fermi su certe idee, ovvero non ritenevano opportuno il momento per ricordarle, a causa dell’ombra negativa che ancora si stendeva su di loro dopo il 1945. E proprio per i suoi “recenti successi letterari” Benn non intese forse rispondere a quello che era stato un po’ più di un conoscente, dato che non risultavano altre lettere di Evola nel Nationalmuseum: sicché, si deve pensare che gli “antichi rapporti” non vennero ripresi. Certo è che Evola non faceva mistero di essere rimasto lo stesso (“Io sono sempre rimasto sulle mie antiche posizioni, per quanto riguarda l’orientamento intellettuale e i miei interessi prevalenti”) e non è detto che tali precisazioni non siano state controproducenti …
Quel che è invece un po’ singolare è il non ricordare a dovere il tipo di rapporti intercorsi vent’anni prima: non solo l’incontro a Berlino, ma la reciproca conoscenza delle opere e la questione di Rivolta. Il mancato accenno alla revisione della traduzione, ma anche al saggio su “Die Literatur” (poi però fatto pubblicare tredici anni dopo in appendice a L’arco e la clava, come si è già ricordato) è dovuto ad una défaillance mnemonica, o magari ad un senso di opportunità, per non imbarazzare forse il medico-poeta? È anche vero che Benn sarebbe morto solo dieci mesi dopo, il 7 luglio 1956, a settant’anni, e quindi ogni illazione può essere valida. Così come resta aperta ogni ipotesi sul perché Julius Evola, sia nelle lettere private, sia nel la sua autobiografia pubblica, abbia dimenticato molti episodi e personaggi importantissimi nelle vicende della sua vita: e non certo in senso positivo, tali da accrescere l’importanza della sua opera complessiva. Forse normalissimi vuoti di memoria come possono accadere a tutti, ma forse anche quella tendenza “impersonale” a minimizzare un certo suo lavoro conferendo così poca importanza – tanto da non ritenere che certi particolari valessero la pena di essere citati – a determinati momenti della sua vita. Sta di fatto, comunque, che queste lettere a Gottfried Benn riempiono in modo significativo una delle tante lacune che ancora rimangono per ricostruire compiutamente l’intensa vita di Julius Evola.
Note
(1) Il cammino del cinabro, Scheiwiller, Milano, 1972, p.79.
(2) Heidnischer Imperialismus, Armanen Verlag, Lipsia, 1933.
(3) Cioè, da un lato gli esponenti della “tradizione prussiana” e dall’altro la corrente di quegli scrittori, come Moeller van den Bruck, Bluher, Jünger, von Salomon e così via, che era stata definita Rivoluzione Conservatrice.
(4) Il cammino del cinabro cit., p.137.
(5) Alain de Benoist, Presenza di Got!fried Benn, in Trasgressioni n.19, 1990, p.84.
(6) Circa la Rivolta scrive Evola a Giuseppe Laterza in una lettera da Karthaus in Alto Adige del 16 settembre 1931: “Sono in via di ultimarlo, quindi non so precisamente circa la sua lunghezza … “ (cfr. La Biblioteca ermetica, a cura di Alessandro Barbera, Fondazione J. Evola, Roma, 1997, pp.57-58).
(7) Lionel Richard, Nazismo e cultura, Garzanti, Milano, 1982, p.280.
(8) Cito in Il cammino del cinabro cit., p.138.
* * *
Tratto da Percorsi di politica, cultura, economia (6/1998).
00:10 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : italie, allemagne, révolution conservatrice, années 30, littérature, lettres, lettres allemandes, littérature allemande, correspondance |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Tomislav Sunic répond aux identitaires
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 2004
Tomislav SUNIC répond aux Identitaires
Le 30 Janvier 2004
 Rencontre avec le docteur Tomislav SUNIC, enseignant en sciences politiques aux Etats Unis et écrivain croate.
Rencontre avec le docteur Tomislav SUNIC, enseignant en sciences politiques aux Etats Unis et écrivain croate.
Pamphlétaire et contestataire de la droite antilibérale croate, ancien diplomate, il est l’auteur d’ouvrages traitant entre autre de la géopolitique dans les Balkans, de la démocratie et de l’utopie égalitaire. Tom Sunic dénonce inlassablement le danger de la globalisation mondialiste en train d’éclore sur les décombres du communisme dans les pays de l’Est. Tomislav Sunic est également le correspondant en Croatie de la revue Nouvelle Ecole.
Aujourd'hui, il milite notamment pour un véritable rapprochement entre les deux frères ennemis croates et serbes. Cette guerre larvée servant, selon Tomislav SUNIC, les intérêts des ennemis de l'Europe.
Au début des années 90, les occidentaux voyaient s'engager le provisoire dernier acte d'une guerre civile européenne qui avait commencé presque 80 ans plus tôt. Quels étaient les ingrédients récurrents de ce conflit yougoslave encore mal compris en France ?
Tomislav SUNIC : Les responsables de cet acte de guerre sont à chercher chez les jacobins français, chez Clemenceau, dans le Traité de Versailles, chez Mitterrand, et bien sûr, chez les Américains qui avaient prêché, à partir de 1948 et jusqu’en 1990, “ l’unité et l’intégrité ” d’un pays artificiel, connu sous le nom de “ Yougoslavie ”.
Aujourd'hui, vous souhaitez un rapprochement entre les deux frères ennemis croates et serbes. Celui-ci semble encore bien précaire. Comme l'ont démontré les affrontements sérieux survenus lors de rencontres sportives, notamment au cours du match Croatie-Serbie de water-polo du dernier championnat d'Europe, les cicatrices semblent profondes. Bien sûr, les ennemis de l'Europe s'en réjouissent. Une normalisation réelle des rapports croato-serbes est-elle concevable ou encore illusoire ?
TS : Laissons le sport à part. Lorsque les équipes de différentes villes croates s’affrontent, il y a toujours une pagaille - comme d’ailleurs partout chez les supporters en Europe. Le problème réside dans la mythologie grande-serbe et la martyrologie grande-croate. Au cours des dernières 70 années, à savoir depuis la fondation de la Yougoslavie en 1919, les intellectuels serbes et croates, n’ont jamais jugé nécessaire de se débarrasser de leurs mythes pseudo-historiques. Le vrai délire commença en 1945 lors de la prise du pouvoir par les communistes, et lorsque l’hagiographie serbe imposa dans les écoles, et auprès du grand public occidental, sa victimologie “ anti-fasciste ” s’élevant à 600.000 Serbes prétendument tués par les fascistes croates de 1941 à 1945. Cette surenchère a eu pour cause, chez les Croates, de profondes frustrations, un romantisme politique souvent bête, et une poussée révisionniste qui aboutit en 1990 à l’éclatement du pays. Hélas, le nationalisme croate est également à la base de sa “ légitimité négative ” ; malheureusement on reste un bon Croate en fonction de son anti-serbisme, c’est-à-dire en diabolisant l’Autre. Le résultat fut la deuxième guerre entre les Serbes et les Croates en 1991.
Tant que les intellectuels serbes et croates ne se mettront pas sérieusement au travail pour examiner leurs victimologies respectives, et qui remontent à la deuxième guerre mondiale, la guerre larvée sera là, au grand plaisir des ennemis de l’Europe.
Croatie et Serbie semblent rivaliser d'ardeur pour livrer leurs patriotes respectifs au Tribunal Pénal International de La Haye. Quel est votre avis sur cette Cour et sa légitimité ?
TS : Aucun. La Cour de La Haye fonctionne d’après le principe du “ deux poids deux mesures. ” Ce qui n’est pas permis aux Serbes et aux Croates, est loisible pour les guerriers américains, israéliens, etc… Revenons à la phrase lapidaire de Carl Schmitt : “ Auctoritas non veritas facit legem ” (*). En bon français, c’est la qualité du flingue qui décide qui ira à La Haye, qui aura raison et qui aura tort, et qui va façonner par la suite le droit international. Le Tribunal de La Haye est un alibi pour l’incompétence de la classe politique en Union Européenne, qui fut d’ailleurs totalement incapable de mettre fin au conflit yougoslave dans les années 90.
Bien que les composants soient un peu différents – distinctions ethniques plus franches – les gouvernements des principales capitales européennes continuent leur politique de l'autruche, et semblent nier l'évidence en minimisant la possibilité d'affrontements multiculturels et/ou multiethniques graves dans les années à venir. Est-ce, selon vous, lâcheté ou volonté délibérée de refuser l'évidence ? Qu'est-ce qui pourrait faire échapper l'UE a une crise “ à la yougoslave ” ?
TS : “ L’Euroslavie ” actuelle ressemble étrangement à l’ex-Yougoslavie. Soyons sérieux. Le système bruxellois n’est pas conçu comme vecteur pour réunir les peuples européens dans un destin commun. L’UE est un vaste marché, un bazar dont l’avenir dépend uniquement d’un perpétuel bond économique en avant.
En effet, qui aurait cru que la Yougoslavie multiculturelle allait éclater en décombres ? Je crois que la même “ balkanisation ” attend l’Union européenne demain, avec des conséquences beaucoup plus graves. Tant que l’État-providence fonctionne, bon gré mal gré, tant que les allogènes reçoivent leur morceau de sucre de la part des contribuables européens, le calme est garanti. Une fois que la crise économique deviendra palpable, nous serons témoins d’une guerre civile autrement plus sauvage que dans les Balkans. Victime de ses illusions du progrès, et croyant naïvement en la théologie du marché libre, l’Union Européenne va devenir la proie de ses propres chimères. Le soi-disant bon fonctionnement de l’UE, avec son prétendu élargissement à l’Est, ressort d’un nouveau romantisme politique. Ce projet reste la plus grande imposture après la deuxième guerre mondiale.
Pertes des valeurs traditionnelles, plaisirs petits-bourgeois, dévirilisation, paradis artificiels, le matérialisme libéral triomphe en Europe occidentale. Quelle est votre réponse au chaos du monde moderne ?
TS : Lorsqu’on lit les écrivains des années trente nous nous rendons compte du même scénario en Europe. Nul doute, le libéralisme touche a sa fin. Le roi est nu ; il n’a plus de repoussoir communiste. Donc sa dégénérescence apparaît plus clairement. Tant mieux. Il faut que la situation empire davantage, pour que davantage de gens puissent déchiffrer l’ennemi principal.
On a dit que Rome était tombée car ses Dieux l'avaient abandonnée. Voyez-vous dans la perte totale de sens du sacré en Occident, une des causes profondes de son déclin ?
TS : Bien entendu. Même les grandes religions monothéistes ne sont plus capables d’insuffler le sens du sacré à leurs brebis. Hélas, dans la perspective historique, cinquante, voire une centaine d’années, ne veulent rien dire. Mais pour nous-mêmes, pour qui le temps vole si rapidement, il est peu probable que le grand retour des dieux ait lieu pendant notre parenthèse terrestre… Mais, peut-être dans une vingtaine d’années, verrons-nous la grande renaissance des dieux européens !
Les hommes debout au milieu des ruines - identitaires éveillés- ont coutume de dire que le soleil se lèvera à l'Est. Le salut de l'Occident peut-il venir de l'exemple des jeunes générations d'Europe de l'Est ? Et, selon vous, un rapprochement concret des forces nationales de chacun des pays de l'Ouest et de l'Est pour une renaissance européenne est-il sérieusement envisageable ?
TS: Le grand avantage du communisme fut sa barbarie et sa transparence vulgaire. Son grand avantage fut également qu’il sut préserver, malgré son dogme international, l’homogénéité ethnique des Européens de l’Est. La Russie, la Croatie, la Serbie, l’Estonie, etc. restent des enclaves blanches, de solides “ camps des saints ”. Espérons que la classe dirigeante en Europe orientale ne va pas tomber dans la surenchère du mimétisme pro-occidental et qu’elle ne va pas remplacer sa maladie de “ l’homo sovieticus ” par la nouvelle pathologie de “ l’homo occidentalis ”. Il y a quelques signes encourageants que cette Europe cioranienne commence à s’apercevoir de l’imposture occidentalo-libérale. Mais pour mener le travail de renaissance à son terme, il faut que ses citoyens fassent table rase de leur petit nationalisme et qu’ils abandonnent la haine de l’Autre, c’est-à-dire de leurs voisins. Les individus sages et cultivés de l’Europe occidentale pourraient y aider et cela d’une manière considérable.
Pour finir, un message pour les visiteurs du site “ les-identitaires.com ” ?
TS : Unissons nos forces identitaires et patriotiques, apprenons les langues et la culture de nos voisins européens ! Pratiquons l’identification – non seulement avec notre tribu – mais surtout avec l’Autre, à savoir nos frères voisins européens !
(*) Littéralement : “ C’est l’opinion et non la vérité qui fait la loi ”, à prendre ici au sens de “ C’est l’autorité et non la vérité qui commande à la loi ”.
Propos recueillis par Renaud BOIVIN
Pour en savoir plus : http://doctorsunic.netfirms.com
00:05 Publié dans Entretiens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : entretiens, balkans, croatie, ex-yougoslavie, europe, politique internationale, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 05 avril 2010
Brzezinski sta per finire nella pattumeria della storia?
di Alessandro Lattanzio
Fonte: saigon2k [scheda fonte]
Tante altre notizie su www.ariannaeditrice.it
 Il 23 Febbraio 2010, l’intelligence iraniana assestava un duro colpo alla strategia neo-mackinderiana dell’amministrazione Obama, catturando Abdolmalek Rigi, il capo del gruppo terroristico Jundallah, responsabile di stragi, rapina a mano armata, sequestro di persona, atti di sabotaggio, attentati e operazioni terroristiche contro i civili, esponenti del governo e militari dell’Iran, assassinando in 6 anni oltre 150 persone in Iran, per la maggior parte civili.
Il 23 Febbraio 2010, l’intelligence iraniana assestava un duro colpo alla strategia neo-mackinderiana dell’amministrazione Obama, catturando Abdolmalek Rigi, il capo del gruppo terroristico Jundallah, responsabile di stragi, rapina a mano armata, sequestro di persona, atti di sabotaggio, attentati e operazioni terroristiche contro i civili, esponenti del governo e militari dell’Iran, assassinando in 6 anni oltre 150 persone in Iran, per la maggior parte civili.
Nell’ultimo attentato compiuto dal Jundullah, il 18 ottobre 2009, nella regione di Pishin, nel Sistan-Baluchistan (sud-est dell’Iran, al confine col Pakistan), rimasero uccise più di 40 persone, tra cui 15 componenti e alti ufficiali del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica (Pasdaran), e diversi capi tribali dell’area. Rigi era su un aereo di linea, in un volo notturno, proveniente da Dubai e diretto in Kirghizistan, ma l’aereo è stato intercettato dai caccia dell’aeronautica iraniana e costretto ad atterrare nell’aeroporto di Bandar Abbas, in territorio iraniano. Rigi viaggiava con passaporto afgano, e infatti, probabilmente nell’aprile 2008, aveva incontrato proprio in Afghanistan l’allora segretario generale della NATO, dopo esser stato ospitato presso una base statunitense non precisata. Il fratello di Abdolmalek, Abdulhamid Rigi, che era stato arrestato in precedenza, ha affermato che suo fratello aveva stabilito dei contatti con l’amministrazione statunitense, tramite un certo Amanollah-Khan, il cui nome completo è Amanollah-Khan Rigi, sostenitore del regime dello Shah. Dopo la Rivoluzione del ‘79, Rigi lasciò il paese chiedendo asilo politico negli Stati Uniti. Secondo Abdulhamid gli statunitensi avrebbero arruolato Amanollah-Khan per stabilire un collegamento tra gli USA e il gruppo terroristico Jundallah, e nell’ambito di queste operazioni, Abdolhamid Rigi avrebbe incontrato l’ambasciatore statunitense in Pakistan che gli aveva promesso finanziamenti e un sicuro rifugio in Pakistan. E difatti, sempre secondo Abdolhamid, il governo pakistano è perfettamente al corrente di queste manovre e dove operi il gruppo terroristico Jundallah.
Abdolmalek Rigi ha poi completato le dichiarazioni del fratello:
“Dopo che Obama venne eletto, gli americani ci contattarono e mi incontrarono in Pakistan. Lui mi disse che gli americani chiedevano un colloquio. Io all’inizio non accettai ma lui promise a noi grande cooperazione. Disse che ci avrebbe dato armi, mitragliatrici ed equipaggiamenti militari; loro ci promisero pure una base militare in Afghanistan, a ridosso del confine con l’Iran. Il nostro meeting avvenne a Dubai, e anche lì ripeterono che avrebbero dato a noi la base in Afghanistan e che avrebbero garantito la mia sicurezza in tutti i paesi limitrofi dell’Iran, in modo che io possa mettere in atto le mie operazioni”.
Rigi era diretto a Bishkek, in Afghanistan perché:
“Mi dissero che un alto esponente americano mi voleva vedere e che lui mi aspettava nella base militare di Manas, vicino Bishkek, in Kirghizistan. Mi dissero che se questo alto esponente viaggiava negli Emirati, poteva essere riconosciuto e perciò dovevo andare io da lui. Nei nostri meeting gli americani dicevano che l’Iran aveva preso la sua strada e che al momento il loro problema era proprio l’Iran e non al-Qaida e nemmeno i taliban; solo e solamente l’Iran. Dicevano di non avere un piano militare adatto per attaccare l’Iran. Questo, dicevano, è molto difficile per noi. Ma dicevano che la CIA conta su di me, perché crede che la mia organizzazione è in grado di destabilizzare il paese. Un ufficiale della CIA mi disse che era molto difficile per loro attaccare l’Iran e che, perciò, il governo americano aveva deciso di dare supporto a tutti i gruppi anti-iraniani capaci di creare difficoltà al governo islamico. Per questo mi dissero che erano pronti a darci ogni sorta di addestramento, aiuti, soldi quanti ne volevamo e la base per poter mettere in atto le nostre azioni”.
Il personaggio statunitense che Rigi avrebbe dovuto incontrare, nella base aera dell’USAF di Manas, assieme a un alto funzionario dell’intelligence USA, sarebbe stato Richard Holbrooke, inviato speciale statunitense per l’Afghanistan e il Pakistan, che quel giorno si trovava proprio in Kirghizistan. Ma a un certo punto, le cose, per Rigi, si mettono male: i servizi segreti di Afghanistan e Pakistan, dopo averlo sostenuto per anni nella sua attività terroristica, avrebbero deciso di abbandonarlo all’indomani dell’attentato di Pishin. I servizi segreti pakistani gli dissero, rimanendo però inascoltati, di sparire dalla circolazione, di lasciare la città di Quetta e di rifugiarsi nelle zone montuose del Pakistan. Il 18 Marzo, membri di Jundallah, armati e a bordo di jeep, tentavano di oltrepassare il confine tra Pakistan e Iran, ma appena entrati in territorio iraniano, i terroristi sono caduti in una trappola tesa dalle unità d’élite dei Pasdaran, causando l’eliminazione di numerosi terroristi. Così le forze di sicurezza iraniane infliggevano un altro colpo devastante al Jundullah.
In parallelo con lo smantellamento del Jundullah, l’intelligence iraniana metteva a segno un altro colpo: il 14 Marzo 2010 venivano arrestate trenta persone coinvolte in una cyber-guerra contro la sicurezza nazionale iraniana. La rete clandestina avrebbe ricevuto aiuti dagli Stati Uniti e avrebbe cooperato con gruppi controrivoluzionari monarchici e con l’organizzazione terroristica dei Mujaheddin e-Khalq. Tra i compiti della rete ci sarebbe stata la raccolta di informazioni sugli scienziati coinvolti nel programma nucleare iraniano. In effetti, il giornalista del New Yorker Seymour Hersh rivelò che nel 2006 il Congresso statunitense aveva acconsentito alla richiesta dell’ex presidente George W. Bush di finanziare operazioni coperte in Iran. Hersh, citando Robert Baer, un ex agente della CIA in Medio Oriente, affermò che così vennero stanziati 400 milioni di dollari per le operazioni condotte da al-Qaida, Jundallah e Mujaheddin-e Khalq, con lo scopo di creare il caos in Iran e di screditarne il governo. Inoltre, anche la manipolazione dell’informazione rientrava nel piano di Bush, mentre la CIA stanziava oltre 50 milioni di dollari per attivare un comitato anti-iraniano, denominato IBB, presso il Dipartimento di Stato USA.
Il 17 Marzo 2010, a suggellare il mutamento del quadro strategico regionale, segnalato dalla suddetta svolta nella lotta al terrorismo alimentato dagli apparati d’intelligence e militari statunitensi, Iran e Pakistan hanno firmato l’accordo finale della costruzione del gasdotto TAPI, con cui si trasporterà il gas iraniano in Pakistan, Turchia, e forse India o Cina. Si tratta di un progetto, da completare entro il 2014, che consentirà all’Iran di esportare, per 25 anni, 750 milioni di metri cubi di gas al giorno.
Difatti, il percorso di collaborazione e sovranismo economico-strategico, percorso da Turchia, Iran e Pakistan, non fa altro che cementare e rafforzare la stabilità, già sufficientemente precaria, della regione. Un obiettivo perseguito da Washington, non solo contro Tehran e Islamabad, ma anche contro Ankara. E in effetti, il 22 febbraio 2010, il primo ministro turco, Recep Tayyip Erdogan annunciava che la magistratura turca aveva sventato un tentato golpe militare, arrestando in tutto il paese 51 militari (17 tra generali e ufficiali in pensione, quattro ammiragli e almeno altri 28 ufficiali in servizio) accusati di tentato colpo di stato e di associazione per delinquere. Si trattava dell’operazione ‘Bayloz’ (Martello), volta a rovesciare il governo del Partito Giustizia e Sviluppo (AKP) del premier Erdogan. Ai vertici del complotto vi erano Ibrahim Firtina, ex-capo di stato maggiore dell’aeronautica militare turca ed i suoi omologhi Ozden Ornek, della marina e Ergin Saygun, dell’esercito, che nel 2007 accompagnò a Washington il premier Erdogan, nella sua visita al presidente degli USA George W. Bush, l’ex capo delle forze speciali, il generale Engin Alan, e l’ex comandante del primo corpo d’armata, il generale Cetin Dogan. Inoltre almeno altri sette ufficiali in congedo e sette in servizio sono stati fermati. Lo smantellamento dell’organizzazione ‘Bayloz’ è un effetto collaterale dell’inchiesta su un altro golpe, dell’organizzazione clandestina ‘Ergenekon’ che coinvolse più di 300 persone, ora sotto processo e sorvegliate dalle autorità turche, che venne sventata nel 2003 e che prevedeva attentati terroristici contro due moschee di Istanbul, attacchi con ordigni incendiari a dei musei, oltre all’omicidio del premio nobel per la letteratura, Orhan Pamuk, e dello stesso Erdogan. Tutte azioni volte ad alimentare la ‘strategia della tensione’. Infine era previsto anche l’abbattimento di un aereo di linea turco nel Mar Egeo da attribuire a un caccia greco, con ciò richiamandosi espressamente all’operazione di provocazione ‘Northwood’, stilata dagli Stati Maggiori Riuniti degli Stati Uniti, all’epoca della crisi con la Cuba rivoluzionaria. Tutti aspetti che mostrano chiaramente l’origine di queste organizzazioni eversive turche. Infatti ‘Ergenekon’ era un’organizzazione simile a ‘Gladio’, funzionale quindi alla strategia del piano ‘Stay Behind’ della NATO, con una struttura orizzontale che aveva aderenti in tutti i campo: civili, accademici e militari.
Tali eventi avvengono mentre il Pakistan compie la svolta politica decisiva, attuata a seguito della scoperta e denuncia di una rete clandestina, collegata all’intelligence statunitense, che operava nel suo territorio. Si trattava di un’organizzazione costituita da mercenari, terroristi e squadroni della morte che spargevano terrore presso la popolazione ed effettuavano raid contro svariati obiettivi, pretestuosamente indicati come terroristi o fiancheggiatori dei taliban. Non va escluso che tale rete sia coinvolta nell’ondata dei devastanti attentati che ha colpito il Pakistan negli ultimi anni. Infatti un funzionario del dipartimento alla Difesa USA, Michael Furlong, con la copertura di un programma per la raccolta di informazioni, aveva creato degli squadroni della morte utilizzando una rete di contractor di agenzie paramilitari private, segnatamente un reparto d’elite della Xe Service (ex Blackwater), composta soprattutto da ex membri della CIA e delle forze speciali. Come detto, l’obiettivo era scovare e uccidere presunti taliban e militanti di al-Qaida, sia in Afghanistan che in Pakistan. Furlong aveva assunto i mercenari allo scopo, apparente, di effettuare operazioni di intelligence contro i combattenti e i campi di addestramento taliban, con cui sostenere i militari e i servizi segreti nell’effettuare azioni d’attacco in Afghanistan e in Pakistan (in questo caso aggirando il divieto di operare in territorio pakistano, imposto da Islamabad agli USA), rimanendo al di fuori dalla catena di comando della NATO. In realtà la rete era “al centro di un programma segreto in cui si pianificavano assassinii mirati, azioni mordi e fuggi contro obiettivi importanti ed altre azioni segrete all’interno ed all’esterno del Pakistan”. Probabilmente, la rete occulta di Furlong era controllata dalle gerarchie militari e politiche di Washington, e finanziata sia con fondi distolti dal programma per la raccolta di informazioni, sia probabilmente con lo sfruttamento del narco-traffico della regione. In Germania, in effetti, un servizio trasmesso a febbraio dalla Norddeutsche Rundfunk, la TV pubblica tedesca, ha rivelato che la NATO e il ministero della Difesa tedesco starebbero investigando sulle attività della Ecolog, una multinazionale di proprietà della famiglia albano-macedone Destani, di Tetovo, che con un contratto della NATO, dal 2003, opera in Afghanistan fornendo servizi logistici alle basi dell’ISAF e all’aeroporto militare di Kabul. La Ecolog sarebbe coinvolta nel contrabbando internazionale di eroina dall’Afghanistan. “C’è il rischio che sia stata contrabbandata droga, quindi valuteremo se la Ecolog è ancora un partner affidabile per noi“, ha dichiarato alla Tv tedesca il generale Egon Ramms del NATO Joint Force Command di Brussum, in Olanda. “Siamo al corrente della questione e stiamo investigando con le autorità competenti“, ha confermato un portavoce del ministero della difesa tedesco. Nel 2006 e nel 2008 la Ecolog era stata indagata, in Germania, per traffico di eroina dall’Afghanistan e riciclaggio di denaro sporco. Nel 2002, quando la Ecolog operava in Kosovo per conto del contingente tedesco della KFOR, i servizi segreti di Berlino informarono i vertici della Nato che il clan Destani, collegato all’UCK, controllava il traffico di droga, armi e esseri umani al confine macedone-kosovaro. Il 90 per cento dei quattromila dipendenti della Ecolog sono albano-macedoni.
Non è un caso che rotte del narcotraffico e linee di frattura conflittuali si dispieghino, in modo parallelo, dalle propaggini dell’Himalaya all’Europa balcanica. I fatti su riportati, sono collegati alla politica internazionale enunciata da Obama fin da quando si era candidato alla carica presidenziale degli Stati Uniti d’America, e non a caso Obama è un allievo del neomackinderiano polacco-americano Zbignew Brzezinsky. Brzezinsky ha indicato come obiettivo centrale della politica globale statunitense, impedire che si formi un blocco economico-strategico eurasiatico, intervenendo in quello che Brzezinsky ritiene il ventre molle dell’Eurasia, la macro-regione Balcani-Medio Oriente-Pashtunistan.
Memore del suo successo con i ‘Freedom fighters’, ovvero con i mujahidin afgani che armò e finanziò per combattere la presenza sovietica e il Partito Democratico Popolare in Afghanistan, Bzrezinsky, tramite il suo seguace Barack Obama, ha voluto riprendere la sua vecchia strategia, convinto che la debolezza della Russia e le divisioni fra Iran, Pakistan, India e Cina potessero aiutare gli USA ad approfondire e allargare l’arco delle crisi artificiali che si dipana sulla regione balcanico-mediorientale. Ma l’usura subita dalla forza, vera e immaginaria, degli USA, avutasi grazie alle politiche dell’amministrazione di Bush junior, coniugata all’avanzata economica-strategica di New Delhi e Beijing, alla politica di decisa tutela della propria sovranità da parte di Tehran e alla ripresa, da parte di Mosca, di una politica internazionale di ampio respiro, tesa a creare stretti rapporti di collaborazione e buon vicinato con il suo estero vicino e le altre potenze eurasiatiche, stanno mettendo sotto scacco tutte le mosse di Washington, ideate appunto dal gruppo di Brzezinsky, volte a impedire la realizzazione del peggior incubo per un mackinderiano: la formazione di un blocco economico-strategico in Eurasia. Se, in tale quadro, s’inserisce la crisi con Tel Aviv, conseguenza del riorientamento geostrategico e geopoltico brezinskiano, ossessivamente puntato verso l’Heartland, si può prevedere che il programma neomackinderiano di Washington sia entrato in un vicolo cieco che potrebbe procurare una grave crisi all’amministrazione Obama, che magari potrebbe portare all’abbandono di tale strategia quasi fallimentare. E forse, l’ostinata ricerca di un consenso sul piano interno, procacciato con il varo di una riforma (in realtà demolitoria) per l’estensione della sanità a tutta la popolazione statunitense, rientra nella previsione di questa possibile prossima crisi acuta.
00:10 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : etats-unis, politique internationale, géopolitique, géopolitique américaine, brzezinski, afghanistan, asie centrale, eurasie, affaires asiatiques, moyen orient |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Der Begriff des Politischen aus der Idee des Volkes bei Carl Schmitt
| Ex: http://www.eiwatz.de/ |
00:10 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : révolution conservatrice, catholicisme, allemagne, weimar, théorie politique, sciences politiques, politologie, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Les Etats-Unis et l'Eurasie: fin de partie pour l'ère industrielle

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 2003
Les Etats-Unis et l'Eurasie :
fin de partie pour l'ère industrielle
Avec l’aube du 21ème siècle, le monde est entré dans une nouvelle phase du combat géopolitique. La première moitié du 20ème siècle peut être comprise comme une longue guerre entre la Grande-Bretagne (et des alliés variables) et l’Allemagne (et des alliés variables) pour la suprématie européenne. La seconde moitié du siècle fut dominée par une Guerre Froide entre les Etats-Unis, qui émergèrent comme la principale puissance militaro-industrielle du monde après la 2ème Guerre Mondiale, et l’Union Soviétique et son bloc de protectorats. Les guerres américaines en Afghanistan (en 2001-2002) et en Irak (qui, en comptant les sanctions économiques et les bombardements périodiques, s’est poursuivie de 1990 jusqu’au moment présent) ont inauguré la dernière phase, qui promet d’être le combat géopolitique final de la période industrielle – un combat pour le contrôle de l’Eurasie et de ses ressources d’énergie.
Mon but est ici de tracer les contours généraux de ce chapitre culminant de l’histoire tel qu’il est actuellement en train de s’écrire. D’abord, il est nécessaire de discuter de géopolitique en général et depuis une perspective historique, en relation avec les ressources, la géographie, la technologie militaire, les monnaies nationales, et la psychologie de ses praticiens.
Les fins et les moyens de la géopolitique
Il n’est jamais suffisant de dire que la géopolitique concerne le « pouvoir », le « contrôle », ou l’« hégémonie » dans l’abstrait. Ces mots n’ont un sens qu’en relation avec des objectifs et des moyens spécifiques : pouvoir sur quoi ou sur qui, exercé par quelles méthodes ? Les réponses différeront quelque peu dans chaque situation ; cependant, la plupart des objectifs et des moyens stratégiques tend à avoir certaines caractéristiques en commun.
Comme les autres organismes, les humains sont sujets aux perpétuelles contraintes écologiques de l’accroissement de la population et de l’appauvrissement des ressources. S’il est peut-être simpliste de dire que tous les conflits entre sociétés sont motivés par le désir de surmonter des contraintes écologiques, la plupart le sont certainement. Les guerres sont généralement menées pour des ressources – terre, forêts, voies maritimes, minerais, et (durant le siècle passé) pétrole. Les gens combattent occasionnellement pour des idéologies et des religions. Mais même alors les rivalités pour les ressources sont rarement loin de la surface. Ainsi les tentatives d’expliquer la géopolitique sans référence aux ressources (un récent exemple est Le choc des civilisations de Samuel Huntington) sont soit erronées soit délibérément trompeuses.
L’ère industrielle diffère des périodes précédentes de l’histoire humaine par l’exploitation à grande échelle des ressources en énergie (charbon, pétrole, gaz naturel, et uranium) pour les objectifs de production et de transport – et pour l’objectif plus profond d’accroître la capacité de notre environnement terrestre à supporter les humains. La totalité des réalisations scientifiques, des consolidations politiques, et des immenses accroissements de population des deux derniers siècles sont des effets prévisibles de l’utilisation croissante et coordonnée des ressources en énergie. Dans les premières décennies du vingtième siècle, le pétrole a émergé comme la plus importante ressource en énergie à cause de son faible coût et de sa facilité d’utilisation. Le monde industriel dépend maintenant d’une manière écrasante du pétrole pour l’agriculture et le transport.
La géopolitique mondiale moderne, parce qu’elle implique des systèmes de transport et de communication à l’échelle mondiale basés sur les ressources en énergie fossile, est par conséquent un phénomène unique de l’ère industrielle. Le contrôle des ressources est largement une question de géographie, et secondairement une question de technologie militaire et de contrôle sur les monnaies d’échange. Les Etats-Unis et la Russie étaient tous deux géographiquement bénis, étant auto-suffisants en ressources énergétiques durant la première moitié du siècle. L’Allemagne et le Japon ne parvinrent pas à atteindre l’hégémonie régionale en grande partie parce qu’ils manquaient de ressources énergétiques domestiques suffisantes et parce qu’ils ne parvinrent pas à gagner et à conserver l’accès à des ressources à un autre endroit (en URSS pour l’une et dans les Indes Néerlandaises pour l’autre).
Néanmoins si les Etats-Unis et la Russie furent tous deux bien dotés par la nature, tous deux ont dépassé leurs pics de production pétrolière (qui furent atteints en 1970 et 1987, respectivement). La Russie reste un exportateur net de pétrole parce que son niveau de consommation est faible, mais les Etats-Unis sont de plus en plus dépendants des importations de pétrole tout comme de gaz naturel.
Les deux nations ont commencé depuis longtemps à investir une grande partie de leur richesse basée sur l’énergie dans la production de systèmes d’armes fonctionnant avec du carburant pour accroître et défendre leur intérêts en ressources à l’échelle mondiale. En d’autres mots, tous deux ont décidé il y a des décennies d’être des joueurs géopolitiques, ou des concurrents pour l’hégémonie mondiale.
A peu près les trois-quarts des réserves pétrolières cruciales restantes du monde se trouvent à l’intérieur des frontières des nations à prédominance musulmane du Moyen-Orient et d’Asie Centrale – des nations qui, pour des raisons historiques, géographiques et politiques, furent incapables de développer des économies militaro-industrielles indépendantes à grande échelle et qui ont, au long du dernier siècle, surtout servi de pions des Grandes Puissances (Grande-Bretagne, Etats-Unis, et l’ex-URSS). Dans les récentes décennies, ces nations riches en pétrole à prédominance musulmane ont rassemblé leurs intérêts dans un cartel, l’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP).
Si les ressources, la géographie et la technologie militaire sont essentielles à la géopolitique, elles ne sont pas suffisantes sans un moyen financier de dominer les termes du commerce international. L’hégémonie a eu une composante financière aussi bien que militaire déjà depuis l’adoption de l’argent par les empires agricoles de l’Age de Bronze ; l’argent, après tout, est une revendication sur les ressources, et la capacité à contrôler la monnaie d’échange peut affecter un subtil transfert en cours de richesse réelle. Celui qui émet une monnaie – particulièrement une monnaie fiduciaire, c’est-à-dire une monnaie qui n’est pas soutenue par des métaux précieux – a un pouvoir sur elle : chaque transaction devient une prime pour celui qui frappe ou imprime l’argent.
Durant l’ère coloniale, les rivalités entre le real espagnol, le franc français et la livre britannique furent aussi décisives que des batailles militaires pour déterminer la puissance hégémonique. Pendant le dernier demi-siècle, le dollar US a été la monnaie internationale de référence pour presque toutes les nations, et c’est la monnaie avec laquelle toutes les nations importatrices de pétrole doivent payer leur carburant. C’est un arrangement qui a fonctionné à l’avantage de l’OPEP, qui conserve un consommateur stable avec les Etats-Unis (le plus grand consommateur de pétrole du monde et une puissance militaire capable de défendre les royaumes pétroliers arabes), et aussi des Etats-Unis eux-mêmes, qui perçoivent une subtile dîme financière pour chaque baril de pétrole consommé par toutes les autres nations importatrices. Ce sont quelques-uns des faits essentiels à garder à l’esprit lorsqu’on examine le paysage géopolitique actuel.
La psychologie et la sociologie de la géopolitique
Les objectifs géopolitiques sont poursuivis dans des environnements spécifiques, et ils sont poursuivis par des acteurs spécifiques – par des êtres humains particuliers avec des caractéristiques sociales, culturelles et psychologiques identifiables. Ces acteurs sont, dans une certaine mesure, les incarnations de leur société dans son ensemble, recherchant des bénéfices pour cette société en compétition ou en coopération avec d’autres sociétés. Cependant, de tels individus puissants sont inévitablement tirés d’une classe sociale particulière à l’intérieur de leur société – généralement, la classe riche, possédante – et tendent à agir d’une manière telle qu’elle bénéficie de préférence à cette classe, même si agir ainsi signifie ignorer les intérêts du reste de la société. De plus, les acteurs géopolitiques individuels sont aussi des êtres humains uniques, avec des connaissances, des préjugés et des obsessions religieuses qui peuvent occasionnellement les conduire à agir en représentants non seulement de leur société, mais aussi de leur classe.
Du point de vue de la société, la géopolitique est un combat darwinien collectif pour une capacité de support accrue ; mais du point de vue du géostratège individuel, c’est un jeu. En effet, la géopolitique pourrait être considérée comme le jeu humain absolu – un jeu avec d’immenses conséquences, et un jeu qui ne peut être joué qu’à l’intérieur d’un petit club d’élites.
Depuis qu’il y a eu des civilisations et des empires, les rois et les empereurs ont joué une certaine version de ce jeu. Le jeu attire un type particulier de personnalités, et il favorise une certaine manière de pensée et de perception concernant le monde et les autres êtres humains. L’acte de participer au jeu confère un sentiment d’immense supériorité, de distance, de pouvoir, et d’importance. On peut commencer à apprécier la drogue suprêmement excitante que constitue le fait de participer au jeu géopolitique en lisant les documents rédigés par les principaux géostratèges – des textes sur la sécurité nationale signés par des gens comme George Kennan et Richard Perle, ou les livres d’Henry Kissinger et de Zbigniew Brzezinski. Prenons, par exemple, ce passage de l’Etude de Planification Politique N° 23 du Département d’Etat, par Kennan en 1948 : “Nous avons 50 pour cent de la richesse mondiale, mais seulement 6,3 pour cent de sa population. Dans cette situation, notre véritable travail pour la période à venir est de concevoir un modèle de relations qui nous permette de maintenir cette position de disparité. Pour ce faire, nous devons nous dispenser de toute sentimentalité … nous devons cesser de penser aux droits de l’homme, à l’élévation des niveaux de vie et à la démocratisation”.
Une prose aussi sèche et fonctionnelle est à sa place dans un monde de services, de téléphones et de limousines, mais c’est un monde totalement coupé des millions – peut-être des centaines de millions ou des milliards – de gens dont les vies subiront l’impact écrasant d’une phrase par-ci, d’un mot par là. A un niveau, le géostratège est simplement un homme (après tout, le club est presque entièrement un club d’hommes) faisant son travail, et tentant de la faire de manière compétente aux yeux des spectateurs. Mais quel travail ! – déterminer le cours de l’histoire, décider du sort des nations. Le géostratège est un Surhomme, un Olympien déguisé en mortel, un Titan en tenue de travail. Un bon poste, si vous pouvez l’obtenir.
L’Eurasie – le Grand Prix du Grand Jeu
En regardant leur cartes et leurs globes terrestres, les géostratèges britanniques des 18ème et 19ème siècles ne pouvaient pas manquer de noter que les masses de terre du globe sont hautement asymétriques ; l’Eurasie est de loin le plus grand des continents. Il est clair que s’ils voulaient eux-mêmes bâtir et maintenir un empire vraiment mondial, il serait d’abord essentiel pour les Britanniques d’établir et de défendre des positions stratégiques dans tout ce continent riche en minerais, densément peuplé, et chargé d’histoire.
Mais les géostratèges britanniques savaient parfaitement bien que la Grande-Bretagne elle-même est seulement une île au large du nord-ouest de l’Eurasie. Sur ce plus grand des continents, la nation la plus étendue était de loin la Russie, qui dominait géographiquement l’Eurasie ainsi que l’Eurasie dominait le globe. Ainsi les Britanniques savaient que leurs tentatives pour contrôler l’Eurasie se heurteraient inévitablement aux instincts d’auto-préservation de l’Empire Russe. Durant tout le 19ème siècle et au début du 20ème, des conflits russo-britanniques éclatèrent à maintes reprises sur la frontière indienne, notamment en Afghanistan. Un fonctionnaire impérial nommé Sir John Kaye appela cela le « Grand Jeu », une expression immortalisée par Kipling dans Kim.
Deux guerres mondiales coûteuses et un siècle de soulèvements anti-coloniaux ont largement guéri la Grande-Bretagne de ses obsessions impériales, mais l’Eurasie ne pouvait pas manquer de rester centrale pour tout plan sérieux de domination mondiale.
Ainsi en 1997, dans son livre The Grand Chessboard: American Primacy and its Geostrategic Imperatives [Le grand échiquier : la primauté américaine et ses impératifs géostratégiques] , Zbigniew Brzezinski, ancien conseiller à la Sécurité Nationale du président américain Jimmy Carter et géostratège par excellence, soulignait que l’Eurasie devait être au centre des futurs efforts des Etats-Unis pour projeter leur propre puissance à l’échelle mondiale. « Pour l’Amérique », écrivait-il, “le grand prix géopolitique est l’Eurasie. Pendant un demi-millénaire, les affaires mondiales ont été dominées par des puissances et des peuples eurasiens qui se combattaient les uns les autres pour la domination régionale et qui aspiraient à la puissance mondiale. Maintenant une puissance non-eurasienne est prééminente en Eurasie – et la primauté mondiale de l’Amérique dépend directement de la durée et de l’efficacité avec lesquelles sa prépondérance sera soutenue” [1].
L’Eurasie a un rôle de pivot, d’après Brzezinski, parce qu’elle « compte pour 60 pour cent du PNB mondial et environ les trois-quarts des ressources énergétiques connues du monde ». De plus, elle contient les trois-quarts de la population mondiale, « toutes les puissances nucléaires déclarées sauf une et toutes les [puissances nucléaires] secrètes sauf une » [2].
Dans la vision de Brzezinski, de même que les Etats-Unis ont besoin du reste du monde pour les marchés et les ressources, l’Eurasie a besoin de la domination américaine pour sa stabilité. Malheureusement, cependant, les Américains ne sont pas accoutumés aux responsabilités impériales : « La recherche de la puissance n’est pas un but qui soulève la passion populaire, sauf dans des conditions d’une menace ou d’un défi soudain pour le sens public du bien-être domestique » [3].
Quelque chose de fondamental a basculé dans le monde de la géopolitique avec les attaques terroristes du 11 septembre 2001 – qui a clairement présenté « une menace soudaine … pour le sens public du bien-être domestique». Ce basculement a été de nouveau perçu avec la détermination de la nouvelle administration américaine – exprimée avec une insistance croissante en 2002 et pendant les premières semaines de 2003 – d’envahir l’Irak. Ces changements géostratégiques semblent s’être centrés dans une nouvelle attitude américaine envers l’Eurasie.
A la fin de la 2ème G.M., quand les Etats-Unis et l’URSS émergèrent comme les puissances dominantes du monde, les Etats-Unis avaient établi des bases permanentes en Allemagne, au Japon, et en Corée du Sud, toutes pour encercler l’Union Soviétique. L’Amérique mena même une guerre manquée et extrêmement coûteuse en Asie du Sud-Est pour acquérir encore un autre vecteur d’encerclement de l’Eurasie.
Quand l’URSS s’écroula à la fin des années 80, les Etats-Unis semblèrent libres de dominer l’Eurasie, et donc le monde, plus complètement que toute autre nation dans l’histoire mondiale. La décennie qui suivit fut surtout caractérisée par la mondialisation – la consolidation de la puissance économique collective largement centrée aux Etats-Unis. Il sembla que l’hégémonie US serait maintenue économiquement plutôt que militairement. Le livre de Brzezinski reflète l’esprit de ces temps, recommandant le maintien et la consolidation des liens de l’Amérique avec les alliés de longue date (Europe de l’Ouest, Japon et Corée du Sud) et la protection ou la cooptation des nouveaux Etats indépendants de l’ancienne Union Soviétique.
Contrairement avec cette prescription, la nouvelle administration de George W. Bush sembla prendre un virage plus brutal – un virage qui tenait pour acquis les vieux alliés dans son unilatéralisme sans complexes. Par son viol des accords internationaux pour l’environnement, les droits de l’homme, et le contrôle des armes ; par sa poursuite d’une doctrine d’action militaire préventive ; et particulièrement par son obsession apparemment inexplicable de l’invasion de l’Irak, Bush dépensa un énorme capital politique et diplomatique, se créant inutilement des ennemis même parmi les alliés éprouvés. Son motif de guerre – l’élimination des armes de destruction massive de l’Irak – était manifestement ridicule, puisque les Etats-Unis avaient fourni beaucoup de ces armes et que l’Irak ne constituait alors une menace pour personne ; de plus, une nouvelle guerre du Golfe risquait de déstabiliser tout le Moyen-Orient [4]. Qu’est-ce qui pouvait bien justifier un tel risque ? Quelle était la motivation de ce bizarre nouveau changement de stratégie ? A nouveau, une discussion d’arrière-plan est nécessaire avant de pouvoir répondre à cette question.
Les Etats-Unis : un colosse à cheval sur le globe
A l’aube du nouveau millénaire, les Etats-Unis avaient la technologie militaire la plus avancée du monde et la monnaie la plus forte du monde. Tout au long du vingtième siècle, l’Amérique avait patiemment bâti son empire, d’abord en Amérique Centrale et en Amérique du Sud, à Hawaï, à Puerto Rico, et aux Philippines, et ensuite (après la 2ème G.M.) par des alliances et des protectorats en Europe, au Japon, en Corée, et au Moyen-Orient. Son armée et son agence de renseignement étaient actives dans presque tous les pays du monde alors que son immense puissance semblait tempérée par sa défense ostensible de la démocratie et des droits de l’homme.
Dans les années 80, le gouvernement US tomba sous le contrôle d’un groupe de stratèges néo-conservateurs entourant Ronald Reagan et George Herbert Walker Bush. Pendant des années, ces stratèges travaillèrent à détruire l’URSS (ce qu’ils réussirent à faire en minant l’économie soviétique) et à consolider leur puissance en Amérique Centrale et au Moyen-Orient. Ce dernier projet culmina avec la première guerre USA-Irak en 1990-91. Leur but ouvertement déclaré n’était rien moins que la domination mondiale.
Alors que l’administration Clinton-Gore insistait sur la coopération multilatérale, son effort pour la mondialisation commerciale – qui transférait impitoyablement la richesse des nations pauvres aux nations riches – était essentiellement une prolongation des politiques Reagan-Bush. Pourtant, les néo-conservateurs enrageaient d’être exclus des reines du pouvoir. Ils se considéraient comme le leadership légitime du pays, et regardaient Clinton et ses partisans comme des usurpateurs. Quand la Cour Suprême nomma George W. Bush Président en 2000, les néo-conservateurs eurent leur revanche. Avec l’assistance des médias serviles, Bush – le fils choyé d’une famille de la côte Est, riche et avec de puissants liens politiques qui avait fait sa fortune dans la banque, les armes, et le pétrole – réussit à se présenter comme un pur Texan « homme du peuple ». Il s’entoura immédiatement du groupe des stratèges géopolitiques - Donald Rumsfeld, Dick Cheney, Paul Wolfowitz, et Richard Perle – qui avaient développé la politique internationale de la première administration Bush.
Dans son récent article « La poussée pour la guerre », l’analyste des affaires internationales Anatol Lieven fait remonter les racines du programme stratégique d’extrême-droite à une mentalité persistante de guerre froide, au fondamentalisme chrétien, à des politiques intérieures de plus en plus diviseuse, et à un soutien inconditionnel à Israël. Le but basique de domination militaire totale du globe, écrivait Lieven, “était partagé par Colin Powell et le reste de l’establishment de sécurité. Ce fut, après tout, Powell qui, en tant que Président du Conseil des Chefs d’Etat-Major, déclara en 1992 que les Etats-Unis avaient besoin d’une puissance suffisante « pour dissuader n’importe quel rival de simplement rêver à nous défier sur la scène mondiale ». Cependant, l’idée de défense préventive, à présent doctrine officielle, pousse cela un pas plus loin, beaucoup plus loin que Powell aurait souhaité aller. En principe, elle peut être utilisée pour justifier la destruction de tout autre Etat s’il semble même que cet Etat puisse être capable de défier les Etats-Unis dans le futur. Quand ces idées furent émises pour la première fois par Paul Wolfowitz et d’autres après la fin de la Guerre Froide, elles se heurtèrent à une critique générale, même de la part des conservateurs. Aujourd’hui, grâce à l’ascendance des nationalistes radicaux dans l’Administration et à l’effet des attaques du 11 septembre sur la psyché américaine, elles ont une influence majeure sur la politique US” [5].
Que l’administration ait orchestré d’une certaine manière les événements du 11 septembre – comme cela fut suggéré par les commentateurs Michael Ruppert et Michel Chossudovsky – ou pas, elle était clairement prête à en tirer avantage [6]. Bush proclama immédiatement au monde que « soit vous êtes avec nous, soit vous êtes avec les terroristes ».
Avec un budget militaire gonflé, un établissement médiatique craintif et obéissant, et un public effrayé au point d’abandonner volontairement les protections constitutionnelles de base, les néo-conservateurs semblaient avoir gagné le plein contrôle de la nation et être devenus les maîtres de son empire mondial. Mais même alors que leur victoire semblait complète, des rumeurs de dissidence commençaient à se répandre.
Insubordination dans les rangs
La résistance populaire à la mondialisation commerciale commença à se matérialiser à la fin des années 90, s’unissant pour la première fois dans la manifestation massive anti-OMC à Seattle en novembre 1998. Dès lors, le mouvement anti-mondialisation sembla grandir avec chaque année qui passait, se transformant en un mouvement anti-guerre mondial en réponse aux plans US d’envahir d’abord l’Afghanistan et ensuite l’Irak.
Mais le mécontentement vis-à-vis de la domination US du globe ne se limita pas à des gauchistes brandissant des marionnettes géantes dans des manifestations. Alors que les bases militaires américaines s’installaient dans les Balkans dans les années 90, et en Asie Centrale après la campagne d’Afghanistan, les géostratèges en Russie, en Chine, au Japon et en Europe de l’Ouest commencèrent à examiner leurs options. Seule la Grande-Bretagne semblait rester ferme dans son alliance avec le colosse américain.
Une réponse apparemment inoffensive à l’hégémonie US mondiale fut l’effort de onze nations européennes pour établir une monnaie commune – l’Euro. Quand l’Euro fut lancé au tournant du millénaire, beaucoup prédirent qu’il serait incapable de rivaliser avec le dollar. En effet, pendant des mois la valeur comparative de l’Euro se fit attendre. Cependant, elle se stabilisa bientôt et commença à monter.
Un développement plus inquiétant, du point de vue de Washington, fut la tendance croissante de nations de second ou de troisième rang à abandonner ouvertement les politiques économiques néo-libérales au cœur du projet de mondialisation, puisque les nouveaux gouvernements du Venezuela, du Brésil et de l’Equateur rompirent publiquement avec la Banque Mondiale et déclarèrent leur désir d’indépendance vis-à-vis du contrôle financier américain.
En même temps, en Russie le théoricien politique Alexandre Douguine gagnait une influence croissante avec ses écrits géostratégiques anti-américains. En 1997, la même année où parut le livre de Brzezinski Le grand échiquier, Douguine publia son propre manifeste, Les fondements de la géopolitique, recommandant un Empire Russe reconstitué, composé d’un bloc continental d’Etats alliés pour nettoyer la masse terrestre eurasienne de l’influence US. Au centre de ce bloc, Douguine plaçait un « axe eurasien » avec la Russie, l’Allemagne, l’Iran, et le Japon.
Alors que les idées de Douguine avaient été bannies à l’époque soviétique à cause de leurs échos de fantaisies pan-eurasiennes nazies, elles gagnaient graduellement de l’influence parmi les officiels russes post-soviétiques. Par exemple, le ministère russe des Affaires Etrangères a récemment décrié la « tendance croissante vers la formation d’un monde unipolaire sous la domination financière et militaire des Etats-Unis » et a appelé à un « ordre mondial multipolaire », tout en soulignant la « position géopolitique [de la Russie] en tant que plus grand Etat eurasien ». Le parti communiste russe a adopté les idées de Douguine dans sa plate-forme ; Gennady Zyouganov, président du parti communiste, a même publié son premier ouvrage de géopolitique, intitulé La géographie de la victoire. Bien que Douguine reste une figure marginale sur le plan international, ses idées ne peuvent qu’avoir une résonance dans un pays et un continent de plus en plus cernés et manipulés par une nation hégémonique puissante et arrogante de l’autre coté du globe.
Extérieurement, la Russie – comme l’Allemagne, la France, le Japon, et la Chine – est encore déférente avec les Etats-Unis. Même la dissidence vis-à-vis du montage de Bush pour la guerre en Irak est restée assez modérée. Mais en privé, les dirigeants de tous ces pays sont sans aucun doute en train de faire de nouveaux plans. Peu iraient cependant jusqu’à approuver l’idée d’Alexandre Douguine que l’Eurasie finira par dominer les Etats-Unis, ni l’idée inverse. Néanmoins, en seulement trois ans, l’attitude de nombreux dirigeants eurasiens envers l’hégémonie américaine est passée de l’acceptation tranquille à une critique mordante associée à un examen sérieux des alternatives.
Le dilemme américain
Douguine et d’autres critiques eurasiens de la puissance américaine commencent par une prémisse qui semblerait ridicule pour la plupart des Américains. Pour Douguine, les Etats-Unis agissent non par force, mais par faiblesse.
Pendant de longues années, l’Amérique a supporté une balance commerciale très fortement négative – qu’elle pouvait se permettre seulement à cause du dollar fort, permis à son tour par la coopération de l’OPEP dans la facturation des exportations pétrolières en dollars. La balance commerciale de l’Amérique est négative en partie parce que sa production intérieure de pétrole et de gaz naturel a atteint son point culminant et que la nation dépend maintenant de plus en plus des importations. De même, la plupart des sociétés américaines ont transféré leurs opérations de fabrication outre-mer. Une autre faiblesse systémique vient de la corruption largement répandue dans les sociétés – révélée de façon aveuglante par l’effondrement de Enron – et des liens étroits entre les sociétés et l’establishment politique américain. Bulle après bulle – haute technologie, télécommunications, dérivés, immobilier – ont déjà éclaté ou sont sur le point de le faire.
Après le dollar fort, l’autre pilier de la force géopolitique US est son pilier militaire. Mais même dans ce cas il y a des fissures dans la façade. Personne ne doute que l’Amérique possède des armes de destruction massive suffisantes pour détruire le monde plusieurs fois. Mais les Etats-Unis utilisent en fait leur armement de plus en plus à des fins de ce que l’historien français Emmanuel Todd a appelé du « militarisme théâtral ». Dans un essai intitulé « Les Etats-Unis et l’Eurasie : militarisme théâtral », le journaliste Pepe Escobar note que cette stratégie implique que Washington … ne doit jamais apporter une solution définitive à un problème géopolitique, parce que l’instabilité est la seule chose qui peut justifier des actions militaires à l’infini de la part de l’unique superpuissance, n’importe quand, n’importe où … Washington sait qu’elle est incapable de se mesurer aux véritables joueurs dans le monde – Europe, Russie, Japon, Chine. Elle cherche donc à rester politiquement au sommet en brutalisant des joueurs mineurs comme l’Axe du Mal, ou des joueurs encore plus mineurs comme Cuba [7].
Ainsi les attaques américaines contre l’Afghanistan et l’Irak révèlent simultanément la sophistication de la technologie militaire US et les fragilités inhérentes de la position géopolitique US. Le militarisme théâtral a le double but de projeter l’image de l’invincibilité et de la puissance américaines tout en maintenant ou en accroissant la domination militaire US sur les nations du tiers-monde riches en ressources. Cela explique largement la récente invasion de l’Afghanistan et l’attaque imminente contre Bagdad. Cette stratégie implique que les actions terroristes contre les Etats-Unis doivent être secrètement encouragées comme justification pour davantage de répression intérieure et d’aventures militaires à l’étranger.
Néanmoins nous n’avons pas pleinement répondu à la question posée précédemment – pourquoi la présente administration veut-elle dépenser un si grand capital politique intérieur et international pour mener la guerre imminente en Irak ? Les critiques de l’administration soulignent que c’est une guerre pour le pétrole, mais la situation est en fait plus compliquée et ne peut être comprise qu’à la lumière de deux facteurs cruciaux non pleinement reconnus.
La puissance du dollar est remise en question
Le premier est que le maintien de la puissance du dollar est en question. En novembre 2000, l’Irak annonça qu’il cesserait d’accepter des dollars en échange de son pétrole, et n’accepterait plus que des Euros. A l’époque, les analystes financiers suggérèrent que l’Irak perdrait des dizaines de millions de dollars à cause de ce changement de monnaie ; en fait, dans les deux années suivantes, l’Irak gagna des millions. D’autres nations exportatrices de pétrole, incluant l’Iran et le Venezuela, ont déclaré qu’elles prévoyaient un changement similaire. Si toute l’OPEP passait des dollars aux Euros, les conséquences pour l’économie US seraient catastrophiques. Les investissements fuiraient le pays, les valeurs immobilières plongeraient, et les Américains se retrouveraient rapidement dans des conditions de vie du Tiers-Monde [8].
Actuellement, si un pays souhaite obtenir des dollars pour acheter du pétrole, il ne peut le faire qu’en vendant ses ressources aux Etats-Unis, en souscrivant un emprunt à une banque américaine (ou à la Banque Mondiale – en pratique la même chose), ou en échangeant sa monnaie sur le marché libre et ainsi en la dévaluant. Les Etats-Unis importent en effet des biens et des services pour presque rien, son déficit commercial massif représentant un énorme emprunt sans intérêts au reste du monde. Si le dollar devait cesser d’être la devise de réserve mondiale, tout cela changerait du jour au lendemain.
Un article du New York Times daté du 31 janvier 2003, intitulé « Pour les indicateurs russes, l’Euro dépasse le dollar », notait que « les Russes semblent avoir accumulé jusqu’à 50 milliards de dollars américains en paquets de café et sous leurs matelas, la plus grande réserve parmi toutes les nations ». Mais les Russes échangent tranquillement leurs dollars contre des Euros, et des articles de luxe comme les voitures affichent maintenant des prix en Euros. Plus loin, « La banque centrale de Russie a dit aujourd’hui qu’elle a accru ses avoirs en Euros durant l’année passée jusqu’à 10 pour cent de ses réserves [en devises] étrangères, partant de 5 pour cent, alors que la part de dollars a chuté de 90 à 75 pour cent, reflétant le faible retour d’investissements en dollars » [9].
Ironiquement, même l’Union Européenne est préoccupée par cette tendance, parce que si le dollar chute trop bas alors les firmes européennes verront leurs investissements aux Etats-Unis perdre de la valeur. Néanmoins, à mesure que l’UE grandit (elle a programmé l’entrée de dix nouveaux membres en 2004), sa puissance économique est de plus en plus perçue comme dépassant inévitablement celle des Etats-Unis.
Pour les géostratèges US, la prévention d’un passage de l’OPEP des dollars aux Euros doit donc sembler capitale. Une invasion et une occupation de l’Irak donnerait effectivement aux Etats-Unis une voix dans l’OPEP tout en plaçant de nouvelles bases américaines à bonne distance de frappe de l’Arabie Saoudite, de l’Iran, et de plusieurs autres pays-clés de l’OPEP.
Le second facteur pesant probablement sur la décision de Bush d’envahir l’Irak est l’appauvrissement des ressources énergétiques US et donc la dépendance américaine croissante vis-à-vis de ses importations pétrolières. La production pétrolière de tous les pays non-membres de l’OPEP, pris ensemble, a probablement culminé en 2002. A partir de maintenant, l’OPEP aura toujours plus de pouvoir économique dans le monde. De plus, la production pétrolière mondiale culminera probablement dans quelques années. Comme je l’ai expliqué ailleurs, les alternatives aux carburants fossiles n’ont pas été suffisamment développés pour permettre un processus coordonné de substitution dès que le pétrole et le gaz naturel se feront plus rares. Les implications – particulièrement pour les principales nations consommatrices comme les Etats-Unis – seront finalement ruineuses [10].
Les deux problèmes sont d’une urgence écrasante. La stratégie de Bush en Irak est apparemment une stratégie offensive pour élargir l’empire américain, mais en réalité elle est principalement d’un caractère défensif puisque son but profond est de devancer un cataclysme économique.
Ce sont les deux facteurs de l’hégémonie du dollar et de l’épuisement du pétrole – encore plus que l’arrogance des stratèges néo-conservateurs à Washington – qui incitent à un total mépris des alliances de longue date avec l’Europe, le Japon et la Corée du Sud, et au déploiement croissant de troupes US au Moyen-Orient et en Asie Centrale.
Même si personne n’en parle ouvertement, les échelons supérieurs dans les gouvernements de la Russie, de la Chine, de la Grande-Bretagne, de l’Allemagne, de la France, de l’Arabie Saoudite et d’autres pays sont pleinement conscients de ces facteurs – d’où les changements d’alliance, les menaces de veto, et les négociations d’arrière-salle conduisant à l’inévitable invasion US de l’Irak.
Mais la guerre, bien que devenue inévitable, reste un coup hautement risqué. Même s’il se termine en quelques jours ou en quelques semaines par une victoire américaine décisive, nous ne saurons pas immédiatement si ce coup a payé.
Qui contrôlera l’Eurasie ?
Alors que j’écris ces lignes, les Etats-Unis préparent des plans pour bombarder Bagdad, une ville de cinq millions d’habitants, et pour déverser pendant les deux premiers jours de l’attaque deux fois plus de missiles de croisière qu’il n’en fut utilisé dans toute la première guerre du Golfe. Les obus et les balles à uranium appauvri seront à nouveau employés, transformant une grande partie de l’Irak en désert radioactif et condamnant les futures générations d’Irakiens (et les soldats américains et leurs familles) à des malformations de naissance, à des maladies et à des morts prématurées. Il est difficile d’imaginer que le spectacle de tant de mort et de destruction non-provoquées ne puisse manquer d’inspirer des pensées de vengeance dans les cœurs de millions d’Arabes et de musulmans.
Les stratèges géopolitiques américains diront que l’attaque est un succès si la guerre se termine rapidement, si la production des champs pétrolifères irakiens remonte rapidement, et si les nations de l’OPEP sont contraintes de conserver le dollar comme monnaie courante. Mais cette opération (on ne peut pas réellement l’appeler une guerre), entreprise comme un acte de désespoir économique, ne peut que temporairement endiguer une marée montante.
Quelles sont les conséquences à long terme pour les Etats-Unis et l’Eurasie ? Beaucoup sont imprévisibles. Les forces qui sont en train d’être libérées pourraient être difficiles à contenir. Les tendances à long terme les mieux prévisibles ne sont pas favorables. Epuisement des ressources et pression démographique ont toujours été annonciateurs de guerre. La Chine, avec une population de 1,2 milliards, sera bientôt le plus grand consommateur de ressources dans le monde. Dans une époque d’abondance, cette nation peut être vue comme un immense marché ouvert : il y a déjà plus de réfrigérateurs, de téléphones mobiles et de télévisions en Chine qu’aux Etats-Unis. La Chine ne souhaite pas défier les Etats-Unis militairement et a récemment obtenu des privilèges commerciaux en soutenant tranquillement les opérations militaires américaines en Asie Centrale. Mais alors que le pétrole – la base de tout le système industriel – se fait de plus en plus rare et que ses réserves sont plus chaudement disputées, on ne peut pas s’attendre à ce que la Chine reste docile.
La Corée du Nord, un quasi-allié de la Chine, était tranquillement neutralisée au moyen de négociations pendant l’ère Clinton, mais s’irrite maintenant d’être classée par Bush dans « l’axe du mal » et de voir un embargo US imposé à ses importations en ressources énergétiques cruciales. Par désespoir, elle tente d’attirer l’attention de Washington en réactivant son programme d’armes nucléaires. En même temps, le nouveau gouvernement sud-coréen est totalement opposé à l’unilatéralisme US et veut négocier avec le Nord. Les Etats-Unis menacent de détruire les installations nucléaires de la Corée du Nord par des frappes aériennes, mais cela provoquerait la formation d’un nuage nucléaire mortel sur toute l’Asie du nord-est.
Dans le même temps, l’Inde et le Pakistan ont aussi des intérêts qui finiront probablement par diverger de ceux des Etats-Unis. Ces nations voisines sont, bien sûr, des puissances nucléaires et des ennemis jurés avec des querelles frontalières de longue date. Le Pakistan, actuellement un allié des Etats-Unis, est aussi un fournisseur important de matières nucléaires pour la Corée du Nord, et a apporté une aide aux Talibans et à Al-Qaïda – des faits qui soulignent bien à quel point la stratégie de Washington est devenue tortueuse et contre-productive ces derniers temps.
Pour les Etats-Unis, le danger est clair : une hypothétique alliance entre l’Europe, la Russie, la Chine et l’OPEP
Le pire cauchemar des Américains serait une alliance stratégique et économique entre l’Europe, la Russie, la Chine, et l’OPEP. Une telle alliance possède une logique inhérente du point de vue de chacun des participants potentiels. Si les Etats-Unis devaient tenter d’empêcher une telle alliance en jouant la seule bonne carte encore dans leurs mains – leur armement de destruction massive – alors le Grand Jeu pourrait se terminer par une tragédie finale.
Même dans le meilleur cas, les ressources en pétrole sont limitées et, puisqu’elles vont progressivement diminuer pendant les prochaines décennies, elles seront incapables de supporter l’industrialisation prochaine de la Chine ou le maintien de l’infrastructure industrielle en Europe, en Russie, au Japon, en Corée, ou aux Etats-Unis.
Qui dominera l’Eurasie ? Finalement, aucune puissance isolée ne sera capable de le faire, parce que la base de ressources énergétiques sera insuffisante pour supporter un système de transport, de communication et de contrôle à l’échelle du continent. Ainsi les fantaisies géopolitiques russes sont tout aussi vaines que celles des Etats-Unis. Pour le prochain demi-siècle il restera juste assez de ressources énergétiques pour permettre soit un combat horrible et futile pour les parts restantes, soit un effort héroïque de coopération pour une conservation radicale et une transition vers un régime d’énergie post-carburant fossile.
Le prochain siècle verra la fin de la géopolitique mondiale, d’une manière ou d’une autre. Si nos descendants ont de la chance, le résultat final sera un monde formé de petites communautés, bio-régionalement organisées, vivant de l’énergie solaire. Les rivalités locales continueront, comme elles l’ont fait tout au long de l’histoire humaine, mais l’arrogance des stratèges géopolitiques ne menacera jamais plus des milliards d’humains d’extinction.
C’est-à-dire si tout se passe bien et si tout le monde agit rationnellement.
NEW DAWN MAGAZINE, Melbourne, Australia.
Notes:
[1] Zbigniew Brzezinski, The Grand Chessboard : American Primacy and its Geopolitical Imperatives (Basic Books, 1997), p. 30.
[2] Ibid., p. 31.
[3] Ibid., p. 36.
[4] Voir Richard Heinberg, "Behold Caesar," MuseLetter N° 128, octobre 2002,
http://www.newdawnmagazine.com/articles/www.museletter.com.
[5] Anatol Lieven, "The Push for War," London Review of Books, 30 décembre 2002,
http://www.newdawnmagazine.com/articles/www.lrb.co.uk/v24/n19/liev01_.html.
[6] Voir les sites web de Michael Ruppert, From the Wilderness www.fromthewilderness.com ; et de Michel Chossudovsky, Centre for Research on Globalisation,
http://www.newdawnmagazine.com/articles/www.globalresearch.ca/articles/CHO206A.html.
[7] Pepe Escobar, "Us and Eurasia: Theatrical Militarism," Asia Times Online, 4 décembre 2002,
http://www.newdawnmagazine.com/articles/www.atimes.com/atimes/archive/12_4_2002.html.
[8] W. Clark, "The Real but Unspoken Reasons for the Upcoming Iraq War,"
http://www.newdawnmagazine.com/articles/www.indymedia.org/front.php3?article_id=231238&group=webcast
[9] Voir Michael Wines, "For Flashier Russians, Euro Outshines the Dollar," New York Times, 31 janvier 2003.
[10] Richard Heinberg, The Party’s Over : Oil, War and the Fate of Industrial Societies (New Society, 2003).
Richard Heinberg, journaliste et enseignant, est membre de la faculté du New College de Californie à Santa Rosa, où il enseigne un programme sur la culture, l’écologie, et la communauté viable. Il rédige et publie la « MuseLetter » mensuelle : http://www.newdawnmagazine.com/articles/www.museletter.com. Cet article est une adaptation de son livre à paraître, The Party’s Over: Oil, War, and the Fate of Industrial Societies [La partie est finie : pétrole, guerre, et le sort des sociétés industrielles] (New Society Publishers,
http://www.newdawnmagazine.com/articles/www.newsociety.com).
[Cet article a été publié dans New Dawn N° 77 (mars-avril 2003)].
00:05 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, etats-unis, politique internationale, eurasie, russie, eurasisme, histoire, asie, affaires asiatiques, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 04 avril 2010
Stärkung der eurasischen Energiekooperation zwischen Russland und Asien
Stärkung der eurasischen Energiekooperation zwischen Russland und Asien
Russlands Position als wichtigster Energielieferant für Deutschland und die EU scheint gefestigt, die Orangene Revolution ist de facto rückgängig gemacht. Jetzt richtet sich die russische Politik vermehrt ostwärts auf den Energiebedarf des dortigen Kooperationspartners China, des ehemaligen Feindes in der Zeit des Kalten Krieges. Diese Entwicklung sorgt im Pentagon für Kopfschmerzen und schlaflose Nächte, denn hier wird Halford Mackinders schlimmster Albtraum wahr – die friedliche wirtschaftliche Vereinigung der Region, die er das Herzland der Weltinsel nannte.
Moskau orientiert sich gen Osten
 Ende 2009 hat Moskau genau zum geplanten Zeitpunkt und zur großen Überraschung Washingtons nach vierjähriger Bauzeit die Ostsibirien-Pazifik-Pipeline (East Sibiria Pacific Ocean, ESPO) in Betrieb genommen. Der Bau der Ölpipeline hat etwa 14 Milliarden Dollar gekostet. Sie ermöglicht Russland nun den direkten Export von Öl aus den ostsibirischen Feldern nach China sowie nach Südkorea und Japan – ein großer Schritt zu einer engeren wirtschaftlichen Integration zwischen Russland und China. Die Pipeline verläuft zum etwas nördlich der chinesischen Grenze gelegenen Ort Skoworodino am Fluss Bolschoi Newer. Dort wird das Öl für den Transport zum Pazifikhafen Kozmino in der Nähe von Wladiwostok zurzeit noch auf Eisenbahntankwagen umgeladen. Allein der Bau dieser Station hat zwei Milliarden Dollar gekostet. Dort können täglich bis zu 300.000 Barrel Rohöl verladen werden. Das Öl, das von vergleichbarer Qualität ist wie die im Nahen Osten geförderten Sorten, dominiert mittlerweile den Markt in der Region. Der russische staatliche Pipelinemonopolist Transneft hat noch einmal zwölf Milliarden Dollar in die 2.700 Kilometer lange Pipeline durch die ostsibirische Wildnis investiert, die eine Verbindung zu den verschiedenen, von den russischen Großunternehmen Rosneft, TNK-BP und Surgutneftegaz erschlossenen Ölfelder in der Region herstellt.
Ende 2009 hat Moskau genau zum geplanten Zeitpunkt und zur großen Überraschung Washingtons nach vierjähriger Bauzeit die Ostsibirien-Pazifik-Pipeline (East Sibiria Pacific Ocean, ESPO) in Betrieb genommen. Der Bau der Ölpipeline hat etwa 14 Milliarden Dollar gekostet. Sie ermöglicht Russland nun den direkten Export von Öl aus den ostsibirischen Feldern nach China sowie nach Südkorea und Japan – ein großer Schritt zu einer engeren wirtschaftlichen Integration zwischen Russland und China. Die Pipeline verläuft zum etwas nördlich der chinesischen Grenze gelegenen Ort Skoworodino am Fluss Bolschoi Newer. Dort wird das Öl für den Transport zum Pazifikhafen Kozmino in der Nähe von Wladiwostok zurzeit noch auf Eisenbahntankwagen umgeladen. Allein der Bau dieser Station hat zwei Milliarden Dollar gekostet. Dort können täglich bis zu 300.000 Barrel Rohöl verladen werden. Das Öl, das von vergleichbarer Qualität ist wie die im Nahen Osten geförderten Sorten, dominiert mittlerweile den Markt in der Region. Der russische staatliche Pipelinemonopolist Transneft hat noch einmal zwölf Milliarden Dollar in die 2.700 Kilometer lange Pipeline durch die ostsibirische Wildnis investiert, die eine Verbindung zu den verschiedenen, von den russischen Großunternehmen Rosneft, TNK-BP und Surgutneftegaz erschlossenen Ölfelder in der Region herstellt.
Der Anschluss zum Endhafen Kozmino soll 2014 fertiggestellt sein, der Bau verschlingt noch einmal zehn Milliarden Dollar. Die Gesamtpipeline hat dann eine Länge von 4.800 Kilometern, das ist mehr als die Strecke von Los Angeles nach New York. Darüber hinaus haben sich Moskau und Peking auf den Bau eines Abzweigs von Skoworodino nach Daqing in der nordostchinesischen Provinz Heilongjiang geeinigt. Die Provinz ist das Zentrum der chinesischen petrochemischen Industrie, dort findet sich auch das größte Erdölfeld in China. Nach der Fertigstellung werden pro Jahr etwa 80 Milliarden Tonnen sibirisches Öl über die Pipeline transportiert und 15 Milliarden Tonnen über einen weiteren Abzweig aus China.
Welche Wichtigkeit man im energiehungrigen China dem russischen Öl beimisst, zeigt sich daran, dass China Russland ein Darlehen über 25 Milliarden Dollar gewährt hat, als Gegenleistung für Öllieferungen in den nächsten zwei Jahrzehnten. Im Februar 2009, als der Ölpreis von seinem vorherigen Höchststand von 147 Dollar pro Barrel innerhalb weniger Monate auf 25 Dollar pro Barrel gefallen war, standen der russische Rosneft-Konzern und der Pipeline-Betreiber Transneft kurz vor dem Zusammenbruch. Peking reagierte damals sehr schnell und sicherte sich die künftige Lieferung von Öl aus den sibirischen Feldern: Die staatliche Chinesische Entwicklungsbank bot Rosneft und Transneft Darlehen in Höhe von zehn bzw. 15 Milliarden Dollar an, insgesamt also eine Investition über 25 Milliarden Dollar für den beschleunigten Bau der Pazifik-Pipeline. Russland versprach seinerseits die Erschließung weiterer neuer Felder sowie den Bau des ESPO-Abschnitts nach Daqing von Skorowodino bis zur chinesischen Grenze, eine Entfernung von knapp 70 Kilometern. Außerdem werden mindestens 300.000 Barrel Öl der sehr gefragten schwefelarmen Sorte Sweet Crude an China geliefert. (1)
Jenseits der russischen Grenze, auf der chinesischen Seite, will Peking eine eigene knapp 1.000 Kilometer lange Pipeline nach Daqing bauen. Das chinesische Darlehen wurde mit sechs Prozent Zinsen vergeben, das russische Öl müsste also für 22 Dollar pro Barrel an China verkauft werden. Heute liegt der Ölpreis international wieder bei durchschnittlich 80 Dollar pro Barrel – China macht also wirklich ein sehr gutes Geschäft. Anstatt nun über den vereinbarten Preis neu zu verhandeln, ist man in Moskau offensichtlich zu der Erkenntnis gekommen, dass der strategische Vorteil der Verbindung mit China den möglichen Einnahmeverlust wettmacht. Man behält sich die Preisfestsetzung für das restliche Öl vor, das durch die ESPO-Pipeline bis zum Pazifik zu anderen asiatischen Märkten fließt.
Während die Energiemärkte in Westeuropa die Aussicht auf relativ stabile Nachfrage bieten, boomen die Märkte in China und ganz Asien. Deshalb orientiert sich Moskau deutlich gen Osten. Ende 2009 hat die russische Regierung einen umfassenden Energiebericht mit dem Titel Energy Blueprint for 2030 (zu Deutsch: Energieplan für 2030) herausgegeben. Darin werden umfangreiche inländische Investitionen in die ostsibirischen Ölfelder gefordert, es ist die Rede von einer Verschiebung der Ölexporte nach Nordostasien. Der Anteil der russischen Exporte in die Asien-Pazifik-Region soll von acht Prozent im Jahr 2008 im Verlauf der nächsten Jahre auf 25 Prozent steigen. (2) Das hat sowohl für Russland als auch für Asien, besonders für China, bedeutende Konsequenzen.
China hat Japan bereits vor einigen Jahren als zweitgrößter Öl-Importeur nach den Vereinigten Staaten überholt. China misst der Frage der Energiesicherheit große Bedeutung bei, deshalb ist Ministerpräsident Wen Jiabao soeben zum Leiter eines ressortübergreifenden Nationalen Energierats ernannt worden, der Chinas Energiepolitik koordinieren soll. (3)
Russland beginnt mit der Lieferung von LNG-Gas nach Asien
Wenige Monate vor Fertigstellung der ESPO-Ölpipeline zum Pazifik hat Russland mit der Lieferung von Flüssig-Erdgas (Liquified Natural Gas, LNG) innerhalb des Projektes Sachalin-II begonnen, einem Joint Venture unter Führung von Gazprom, an dem auch die japanischen Konzerne Mitsui und Mitsubishi sowie die britisch-niederländische Shell beteiligt sind. Russland sammelt mit dem Projekt unschätzbar wichtige Erfahrungen auf dem sehr schnell wachsenden LNG-Markt, d.h. einem Markt, der nicht auf den Bau langfristig festgelegter Pipelines angewiesen ist.
China macht auch anderen Ländern der ehemaligen Sowjetunion Offerten, um sich künftige Energielieferungen zu sichern. Ende 2009 wurde der erste Abschnitt der Zentralasien-China-Pipeline, die auch als Turkmenistan-China-Pipeline bekannt ist, fertiggestellt. Sie befördert Erdgas aus Turkmenistan über Usbekistan nach Südkasachstan und verläuft parallel zu der bereits bestehenden Pipeline Buchara–Taschkent–Bischkek–Almaty. (4)
In China schließt die Pipeline an die bestehende West-Ost-Gaspipeline an, die quer durch das Land verläuft und weit entfernt gelegene Städte wie Schanghai und Hongkong versorgt. Etwa 13 Milliarden Kubikmeter sollen 2010 über diese Pipeline transportiert werden, die Menge soll bis 2013 auf über 40 Milliarden Kubikmeter steigen. Später soll über diese Pipeline mehr als die Hälfte des chinesischen Erdgasverbrauchs gedeckt werden.
Es war die erste Pipeline, über die Gas aus Zentralasien nach China gebracht wurde. Die Pipeline aus Turkmenistan, die 2011 in Betrieb genommen werden soll, wird mit einem aus Westkasachstan kommenden Strang verbunden. Sie wird Erdgas von mehreren kasachischen Feldern nach Alashankou in der chinesischen Provinz Xingjiang befördern. (5) Kein Wunder, dass die chinesischen Behörden alarmiert waren, als im Juli 2009 Unruhen unter den dort lebenden ethnischen Uighuren ausbrachen. Die chinesische Regierung beschuldigte den in Washington ansässigen Weltkongress der Uighuren und dessen Vorsitzende Rebiya Kadeer, den Aufstand angezettelt zu haben. Der Weltkongress unterhält angeblich enge Verbindungen zu der vom US-Kongress unterstützten und mit Regimewechseln erfahrenen Nicht-Regierungs-Organisation National Endowment for Democracy. (6) Xinjiang wird für den künftigen Energiefluss in China immer wichtiger.
Entgegen den Behauptungen einiger westlicher Kommentatoren stellt die Turkmenistan-China-Pipeline keineswegs eine Bedrohung für Russlands Energiestrategie dar. Sie festigt vielmehr die wirtschaftlichen Verbindungen zu den Mitgliedsländern der Shanghai Cooperation Organization (SCO). Gleichzeitig wird darüber ein erheblicher Teil des Gases aus Turkmenistan nach China transportiert, der sonst über die von Washington favorisierte Nabucco-Pipeline geflossen wäre. Aus geopolitischer Sicht kann dies für Russland nur von Vorteil sein, denn ein Erfolg von Nabucco würde für Russland erhebliche Einbußen an wirtschaftlichem Einfluss bedeuten.
Die 2001 von den Staatschefs Chinas, Kasachstans, Kirgisistans, Russlands, Tadschikistans und Usbekistans in Shanghai gegründete SCO hat sich mittlerweile zu Mackinders schlimmsten Albraum entwickelt – in ein Instrument enger wirtschaftlicher und politischer Kooperation zwischen den Schlüsselländern Eurasiens, unabhängig von den Vereinigten Staaten. In seinem 1997 erschienenen Buch The Grand Chessboard (deutscher Titel: Die einzige Weltmacht: Amerikas Strategie der Vorherrschaft) hat Brzezinski unverblümt erklärt: »… lautet das Gebot, keinen eurasischen Herausforderer aufkommen zu lassen, der den eurasischen Kontinent unter seine Herrschaft bringen könnte und damit auch für Amerika eine Bedrohung darstellen könnte. Ziel dieses Buches ist es deshalb, im Hinblick auf Eurasien eine umfassende und in sich geschlossene Geostrategie zu entwerfen.« (7) Später schreibt er warnend: »Von nun an steht Amerika vor der Frage, wie es mit regionalen Koalitionen fertig wird, die es aus Eurasien herauswerfen wollen und damit seinen Status als Weltmacht bedrohen.« (8)
Nach den Ereignissen vom September 2001, die viele russische Geheimdienstexperten nicht für das Werk einer Gruppe von bunt zusammengewürfelten muslimischen Al-Qaeda-Fanatikern halten wollten, hat die SCO genau die Gestalt einer ernsten Bedrohung angenommen, vor der der Mackinder-Schüler Brzezinski gewarnt hat. Bei einem Interview mit The Real News bemängelte Brzezinski jüngst auch das Fehlen einer kohärenten Eurasien-Strategie bei der Regierung Obama, vor allem in Afghanistan und Pakistan.
__________
(1) Greg Shtraks, »The Start of a Beautiful Friendship? Russia begins exporting oil through the Pacific port of Kozmino«, Jamestown Foundation Blog, Washington D.C., 11. Dezember 2009, unter http://jamestownfoundation.blogspot.com/2009/12/start-of-beautiful-friendship-russia.html
(2) Ebenda
(3) Moscow Times, »Putin Launches Pacific Oil Terminal«, 29. Dezember 2009, unter http://www.themoscowtimes.com
(4) Zhang Guobao, »Chinese Energy Sector Turns Crisis into Opportunities«, 28. Januar 2010, unter www.chinadaily.com.cn
(5) Isabel Gorst, Geoff Dyer, »Pipeline brings Asian gas to China«, Financial Times, London, 14. Dezember 2009
(6) Reuters, »China calls Xinjiang riot a plot against its rule«, 5. Juli 2009, unter http://www.reuters.com/article/idUSTRE56500R20090706
(7) Zbigniew Brzezinski, The Grand Chessboard: American Primacy and It's Geostrategic Imperatives, Basic Books, New York 1998 (Paperback), p. xiv. Deutsche Ausgabe: Die einzige Weltmacht – Amerikas Strategie der Vorherrschaft, Beltz Quadriga Verlag, Weinheim und Berlin 1997, S. 16
(8) Ebenda, S. 86f.
Donnerstag, 01.04.2010
© Das Copyright dieser Seite liegt, wenn nicht anders vermerkt, beim Kopp Verlag, Rottenburg
Dieser Beitrag stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers dar. Er muß nicht zwangsläufig die Meinung des Verlags oder die Meinung anderer Autoren dieser Seiten wiedergeben.
00:20 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, géopolitique, gazoducs, gaz, hydrocarbures, pétrole, énergie, asie, russie, affaires asiatiques, affaireseuropéennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Evola e la "notte dei lunghi coltelli"
Evola e la ”notte dei lunghi coltelli”
| di: Luigi Carlo Schiavone |
 In un articolo del marzo 1935 dal titolo “Il nazismo sulla via di Mosca?” apparso sul quotidiano “Lo Stato”, Julius Evola, allora umile pensatore ai margini del fascismo italiano, prendendo spunto dalle vicende occorse il 30 giugno del 1934 in Germania storicamente note come “Notte dei lunghi coltelli” e cioè la decapitazione sanguinosa, da parte della “destra” hitleriana, delle S.A., le Squadre di Assalto di Roehm e di Strasser che volevano – conquistato il potere – che la rivoluzione nazionalsocialista mettesse in opera il programma sociale, la cosiddetta “seconda rivoluzione” - muove una profonda critica alle posizioni espresse da Carl Dryssen nella sua opera “Fascismo nazionalsocialismo, prussianesimo”, considerato da Evola come il testo guida delle volontà dei rivoluzionari delle SA, facenti capo ad Ernst Röhm, nel quale si rintracciava la linea che essi volevano imporre al movimento nazionalsocialista.
In un articolo del marzo 1935 dal titolo “Il nazismo sulla via di Mosca?” apparso sul quotidiano “Lo Stato”, Julius Evola, allora umile pensatore ai margini del fascismo italiano, prendendo spunto dalle vicende occorse il 30 giugno del 1934 in Germania storicamente note come “Notte dei lunghi coltelli” e cioè la decapitazione sanguinosa, da parte della “destra” hitleriana, delle S.A., le Squadre di Assalto di Roehm e di Strasser che volevano – conquistato il potere – che la rivoluzione nazionalsocialista mettesse in opera il programma sociale, la cosiddetta “seconda rivoluzione” - muove una profonda critica alle posizioni espresse da Carl Dryssen nella sua opera “Fascismo nazionalsocialismo, prussianesimo”, considerato da Evola come il testo guida delle volontà dei rivoluzionari delle SA, facenti capo ad Ernst Röhm, nel quale si rintracciava la linea che essi volevano imporre al movimento nazionalsocialista.Dryssen, partendo da considerazioni di carattere prettamente politico- economico, delinea due mondi contrapposti, l’Oriente e l’Occidente, che, oltre a risultar divisi da un punto di vista ideologico, trovano in Dryssen anche una frontiera naturale rappresentata dalla linea del Reno.
Il mondo dell’ “Occidente”, in cui Dryssen inquadrava gli Stati Uniti, la Francia e la Gran Bretagna, è identificato come la patria del liberalismo, della democrazia, dell’internazionalismo e del capitalismo, fondamenta del libero commercio e dell’imperialismo finanziario. Un mondo in cui, secondo Dryssen, vigevano due principi: quello dell’individualismo che ne regolava i rapporti in ambito interno e quello dell’imperialismo su cui venivano fondati i rapporti verso l’esterno a servizio di un liberalismo “ipocrita”, generatore di un’azione egemonica o distruttrice a danno di altri popoli.
Radicalmente opposti risultavano essere, nella visione del Dryssen, i tratti caratterizzanti il mondo orientale. Nell’ “Oriente”, identificato territorialmente nella Germania, vigeva un diverso tipo di Stato caratterizzato da un ampio spirito sociale ed essenzialmente agrario sorretto da un’economia di consumo fondata, principalmente, sulla relazione del “Blut und Boden” (sangue e suolo); un’impostazione, questa, totalmente diversa dall’economia imperialistica ed internazionalistica tipica dello Stato Occidentale.
È in forza di suddette considerazioni che Dryssen fornisce una versione della prima guerra mondiale vista, dall’autore, come un’aggressione dell’Occidente ai danni dell’Oriente dettata da una volontà individualista-capitalistica di piegare l’unica parte d’Europa che ancora le resisteva. Dal caos ideologico scaturito nel dopoguerra, inoltre, Dryssen vede il sorgere di due visioni contrapposte che identifica nella corrente riformistica-romana, incarnatasi nel fascismo, e nella corrente germanico-rivoluzionaria, propria del movimento nazionalsocialista.
Secondo Dryssen, infatti, il movimento fascista, sebbene caratterizzato da originari tratti rivoluzionari e socialistici, non avrebbe avuto la forza di travolgere l’antico sistema di marca romana, base del sistema occidentale, ma vi avrebbe apportato solo delle modeste correzioni identificabili nell’instaurazione di un “capitalismo autoritario” sottoposto al controllo dello Stato, evitando così la rivoluzione. Un’altra motivazione, caratterizzante la volontà del movimento fascista di non rivoluzionare ma solo di riformare l’antico sistema, è da trovarsi, secondo l’autore tedesco, nel mantenimento dell’imperialismo. Questa nuova Roma, quindi, considerata da Dryssen come “salvatrice del capitalismo occidentale” viene avvertita come un nuovo ostacolo per la tradizione anticapitalista e socialistica tedesca; compito del nazionalsocialismo, quindi, era quello di dar vita ad una rivoluzione “social prussiana” che, rifacendosi al motto di luterana memoria, Los von Rom! (via da Roma!) avrebbe tutelato la tradizione germanica dalla minaccia occidentale e capitalistica e da Roma, ultimo baluardo di un mondo ormai agonizzante. Ad Adolf Hitler, innalzato da Dryssen a novello Vidukind, (il duce sassone che si oppose a Carlo Magno) il compito di orientare la Germania verso il socialismo nazionale e improntarla su una visione “eroica” e non prettamente economica dell’esistenza. […]
In merito al fascismo, invece, sono altri gli elementi che Evola cita per smantellare l’impostazione di Dryssen: dall’ “educazione guerriera” impartita alle nuove generazioni, ai processi di agrarizzazione e alla lotta contro l’urbanizzazione oltre alla concezione del diritto di proprietà del fascismo, che trasforma il detto, di proudhoniana memoria, “la proprietà è un furto” in la “proprietà è un dovere”.
La proprietà in Evola assume, quindi, una caratterizzazione differente rispetto alla considerazione che se ne ha nella visione “occidentale” data da Dryssen; considerata come una delle condizioni materiali imprescindibili per la dignità e l’autonomia della persona è opportunamente ridimensionata in un sistema, come quello fascista, non asservito al capitalismo e che mira a capovolgere la dipendenza della politica all’economia subordinando nuovamente quest’ultima alla prima in forza di un’idea superiore rappresentata in un primo momento dalla Nazione e successivamente dall’Impero.
Un ulteriore errore da parte di Dryssen, e di alcuni esponenti di spicco dello N.S.D.A.P., è da rintracciarsi, secondo Julius Evola, nell’errata considerazione del binomio individualismo-personalità. Se è lecito, secondo Evola, opporsi all’individualismo, concezione maturata in seno al liberalismo, non alla stessa stregua deve essere considerata la personalità, elemento essenziale per il recupero di buona parte dei valori indoeuropei. Se il socialismo e l’individualismo possono essere considerati come due facce della stessa medaglia in quanto figlie di un’unica decadenza materialistica, antiqualitativa e livellatrice, infatti, diversi sono i tratti tipici del pensiero indoeuropeo miranti alla realizzazione di realtà organiche e gerarchiche che, caratterizzate proprio dall’ideale di personalità libere, virili e differenziate, mirino, ciascuna nel proprio ambito, ad assegnare ad ogni cittadino una propria funzione e una propria dignità. Un ideale, questo, che Evola considera superiore sia al liberalismo che al socialismo, che si è protratto nel tempo approdando dalla comune matrice indoeuropea alla tradizione classica prima e alla tradizione classico-germanica poi, per consolidarsi, infine, nella tradizione romano-germanica medioevale.
Per quel che concerne l’antiromanità professata da Dryssen, essa è da considerarsi, secondo Evola, come diretta emanazione di quel processo di allontanamento della Germania che, come già citato, ebbe inizio con Lutero e che in quel determinato periodo storico favoriva esclusivamente un riposizionamento della stessa a favore della Russia, che a detta dello stesso Dryssen, era l’unica grande potenza ad essersi elevata contro l’Occidente e contro Roma oltre che al capitalismo. L’assenza di reali frontiere spirituali fra l’Elba e gli Urali avrebbe favorito, inoltre, una maggior unione fra il nazionalsocialismo e il bolscevismo. La fusione dell’antico sistema tedesco dell’Almende e del Mir slavo avrebbe finito, secondo Dryssen, per patrocinare una nuova forma di collettivismo che, in Russia come in Germania, sarebbe stato tutelato da uno Stato agrario socializzato ed armato. Nella visione di Dryssen, inoltre, Evola rintraccia un ulteriore parallelismo tra l’ateismo sovietico e la riforma luterana.
L’ateismo sovietico, infatti, mutuerebbe dalla riforma luterana la volontà di battersi contro una religiosità ufficiale, mondanizzata, legata alle ricchezze e romanizzata; solo dalla rivolta, pertanto, sarebbero potute nascere nuove religioni interiori e a favore del popolo al pari degli effetti che Lutero anelava dalla sua riforma.
A favore di suddetta visione, che porterebbe la Germania all’accordo con la Russia, Dryssen evoca più volte, secondo Evola, lo spauracchio dell’imperialismo italiano quasi come se esso fosse una tendenza esclusivamente romana e non riscontrabile presso altri popoli. Dimenticando, quindi, il primo verso dell’inno tedesco (Deutschland Deutschland über alles, über alles in der Welt) e ponendosi negativamente contro l’universalità romana Dryssen, secondo Evola, accettava implicitamente l’internazionalismo bolscevico all’interno del quale, ricorda il filosofo tradizionalista, scarso posto trovavano i concetti di Patria e di Nazione e ancor meno quello di tradizione nel senso più ampio del termine, tutti e tre più volte ripresi dallo stesso Dryssen. […]
Antiromanità, antiaristocrazia, antitradizione, sono gli elementi che si trovano alla base della visione di quanti, secondo Evola, volevano che il Reich volgesse lo sguardo verso la Russia e concludendo il suo articolo auspicava invece che l’Italia fascista tracciasse una propria strada che si trovasse ad egual distanza dall’Occidente delineato da Dryssen che dalla Russia bolscevica.
Che ci si ritrovi maggiormente nelle posizioni di Carl Dryssen o in quelle espresse da Julius Evola, è indubbio lo stupore di fronte a simili analisi volte ad individuare, tramite profonde riflessioni e ricerche, le soluzioni migliori per l’attuazione di piani politici volti a cesellare, come si trattasse di statue antiche, i tratti ed i caratteri di interi popoli. Uno stupore che si fa ancora più grave se si pensa che tali analisi vennero svolte in quell’epoca che tutti additano come la più oscura d’Europa mentre oggi, nell’epoca delle libertà, si è costretti ad assistere ad ignominiosi spettacoli nei quali, oltre ad essere ripetuti costantemente i medesimi mantra salvifici, l’individuo, sempre più asservito alla tecnocrazia di jungeriana memoria, non è più essere da formare ma tifoso da consolidare.
00:10 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tradition, traditions, traditionalisme, evola, julius evola, italie, allemagne, révolution conservatrice, histoire, années 30 |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook






 Zum Ende des 19. Jahrhunderts klingt ein Zeitalter der europäischen Kultur- und Geistesgeschichte aus, welches zugleich den Wendepunkt zur Moderne darstellt. Auf der Suche nach einem neuen Sinn und einem neuen Halt begibt sich die nun folgende Generation von Künstlern, Dichtern, Denkern und Ästhetikern. Einer dieser Suchenden ist Eugen Diederichs. Er wird den Weg eines Verlegers bestreiten, um auf diese neue Epoche nach seinen Vorstellungen einzuwirken. Im Jahr 1896 gründet er sein Unternehmen in Italien und verlegt kurze Zeit später den Sitz des Geschäftes nach Jena – in die Nähe seines Geburtsortes. Einen Versammlungsort moderner Geister will er begründen. Modern meint bei ihm aber nicht fortschrittlich und sich nach aktuellen Erscheinungen richtend. Bei der Auswahl seiner Autoren und deren Werke wird er nicht fragen, ob diese dem Geschmack des deutschen Lesers entsprechen und zeitgemäß sind, sondern er wird abwägen, inwiefern diese einer neuen Kultur zu gute kommen, die sich nicht nur von Rationalität und Wissenschaftlichkeit vereinnahmen lässt. Eugen Diederichs fragt nicht, was das deutsche Volk lesen will – er möchte jene Bücher darreichen, die seines Erachtens notwendig sind, um dem beginnenden Jahrhundert die richtigen Impulse zu geben. Die Gebiete auf denen er dies tun möchte sind vielfältig: Theosophie, Religion, Bildung und Pädagogik sind nur einige davon. Man kann ihn hinsichtlich seiner Programmatik nicht in eine Schublade stecken. Ob Neuromantiker, konservativer Revolutionär oder Antimodernist – nichts von alledem war er durch und durch, doch sicherlich kann man ihm für gewisse Anschauungen dieses oder jenes Etikett aufdrücken. Eines will er jedoch sein – und so definiert er auch seine eigene Tätigkeit: Kulturverleger. Viele seiner Autoren wollen mit ihrem Verleger reformieren, Neues gestalten, aber auch Altes bewahren. Dass diese Vorstöße nicht alle in die gleiche Richtung zielen versteht sich bei der Menge von verlegten Schriften, die diese Absicht verfolgen, von selbst. Dies kann auch kein Vorwurf an den Verleger sein – selbst wenn jener versucht Gegensätzliches zusammenzuführen. Nach dem 1. Weltkrieg schlägt Diederichs Enthusiasmus und Tatendrang manchmal in Resignation sowie Willen- und Ideenlosigkeit um. Er wird von so manchen verhöhnt und belächelt. Doch im Glauben an das nach seinen Grundsätzen neu zu schaffende Deutschland bleibt er seinen Prinzipien treu.
Zum Ende des 19. Jahrhunderts klingt ein Zeitalter der europäischen Kultur- und Geistesgeschichte aus, welches zugleich den Wendepunkt zur Moderne darstellt. Auf der Suche nach einem neuen Sinn und einem neuen Halt begibt sich die nun folgende Generation von Künstlern, Dichtern, Denkern und Ästhetikern. Einer dieser Suchenden ist Eugen Diederichs. Er wird den Weg eines Verlegers bestreiten, um auf diese neue Epoche nach seinen Vorstellungen einzuwirken. Im Jahr 1896 gründet er sein Unternehmen in Italien und verlegt kurze Zeit später den Sitz des Geschäftes nach Jena – in die Nähe seines Geburtsortes. Einen Versammlungsort moderner Geister will er begründen. Modern meint bei ihm aber nicht fortschrittlich und sich nach aktuellen Erscheinungen richtend. Bei der Auswahl seiner Autoren und deren Werke wird er nicht fragen, ob diese dem Geschmack des deutschen Lesers entsprechen und zeitgemäß sind, sondern er wird abwägen, inwiefern diese einer neuen Kultur zu gute kommen, die sich nicht nur von Rationalität und Wissenschaftlichkeit vereinnahmen lässt. Eugen Diederichs fragt nicht, was das deutsche Volk lesen will – er möchte jene Bücher darreichen, die seines Erachtens notwendig sind, um dem beginnenden Jahrhundert die richtigen Impulse zu geben. Die Gebiete auf denen er dies tun möchte sind vielfältig: Theosophie, Religion, Bildung und Pädagogik sind nur einige davon. Man kann ihn hinsichtlich seiner Programmatik nicht in eine Schublade stecken. Ob Neuromantiker, konservativer Revolutionär oder Antimodernist – nichts von alledem war er durch und durch, doch sicherlich kann man ihm für gewisse Anschauungen dieses oder jenes Etikett aufdrücken. Eines will er jedoch sein – und so definiert er auch seine eigene Tätigkeit: Kulturverleger. Viele seiner Autoren wollen mit ihrem Verleger reformieren, Neues gestalten, aber auch Altes bewahren. Dass diese Vorstöße nicht alle in die gleiche Richtung zielen versteht sich bei der Menge von verlegten Schriften, die diese Absicht verfolgen, von selbst. Dies kann auch kein Vorwurf an den Verleger sein – selbst wenn jener versucht Gegensätzliches zusammenzuführen. Nach dem 1. Weltkrieg schlägt Diederichs Enthusiasmus und Tatendrang manchmal in Resignation sowie Willen- und Ideenlosigkeit um. Er wird von so manchen verhöhnt und belächelt. Doch im Glauben an das nach seinen Grundsätzen neu zu schaffende Deutschland bleibt er seinen Prinzipien treu.
 Wintergrau liegt auf der Heimat. Eisig fegen frostige Stürme über kahle Felder, darüber ziehen Krähenschwärme hin. Am Horizont versinkt ein matter Sonnenball ins Grau das über die Welt gekommen ist mit dem Fall der letzten Blätter - von ferne kündet Trommelschlag: SCHWERTZEIT bricht an!
Wintergrau liegt auf der Heimat. Eisig fegen frostige Stürme über kahle Felder, darüber ziehen Krähenschwärme hin. Am Horizont versinkt ein matter Sonnenball ins Grau das über die Welt gekommen ist mit dem Fall der letzten Blätter - von ferne kündet Trommelschlag: SCHWERTZEIT bricht an!