 Dès le milieu du siècle, la seconde guerre mondiale offre une occasion inespérée pour l’Amérique, dans une Europe affaiblie et divisée, puisque des deux rivaux continentaux (Allemagne nazie et Russie soviétique), il n’en reste qu’un. Cette lutte contre l’URSS a en fait un autre objectif : la prise de pouvoir économique par l’accès aux matières premières et aux ressources naturelles, concentrées au cœur de l’Eurasie. Pour ce faire, l’Amérique propose à l’Europe dévastée le "plan marshall" (1947) destiné à sa reconstruction. 16 états Européens, et la Turquie se partageront les fonds en créant l’OECE dont le but public était "la coordination de l’effort de reconstruction et la libéralisation du commerce et des échanges monétaires". Ce plan Marshall nous le verrons était en fait un cheval de troie, pour "infiltrer" le continent et assouvir la domination Américaine en Europe de l’ouest dans un premier temps, puis vers l’est, au fur et à mesure de l’effondrement de l’URSS.
Dès le milieu du siècle, la seconde guerre mondiale offre une occasion inespérée pour l’Amérique, dans une Europe affaiblie et divisée, puisque des deux rivaux continentaux (Allemagne nazie et Russie soviétique), il n’en reste qu’un. Cette lutte contre l’URSS a en fait un autre objectif : la prise de pouvoir économique par l’accès aux matières premières et aux ressources naturelles, concentrées au cœur de l’Eurasie. Pour ce faire, l’Amérique propose à l’Europe dévastée le "plan marshall" (1947) destiné à sa reconstruction. 16 états Européens, et la Turquie se partageront les fonds en créant l’OECE dont le but public était "la coordination de l’effort de reconstruction et la libéralisation du commerce et des échanges monétaires". Ce plan Marshall nous le verrons était en fait un cheval de troie, pour "infiltrer" le continent et assouvir la domination Américaine en Europe de l’ouest dans un premier temps, puis vers l’est, au fur et à mesure de l’effondrement de l’URSS. dimanche, 21 février 2010
Lawrence of Arabia - the conflicted colonialist
Lawrence of Arabia - the conflicted colonialist
No wonder Lawrence is regarded with suspicion by the contemporary Arab world.
Lawrence was born in 1888 and went to Oxford. His boyish enthusiasm for medieval knights led him to walk across Syria and the Middle East in 1909, studying crusader castles for his university thesis, the fortresses that formed a chain of foreign, Christian domination over the local population.
Lawrence’s first job was as an archaeologist in a remote area of Syria, managing a huge native workforce for the Palestine Exploration Fund, an archaeological society whose survey of the region served as cover for British intelligence-gathering during the build-up to war with the Ottoman empire and Germany. Lawrence, with his excellent Arabic and local knowledge, drew up an ethnic map that detailed the many different tribal and religious areas.
During the First World War the Ottomans called for a jihad against the British. In response, Lawrence promised the Emir of Mecca, leader of the 1916 anti-Ottoman Arab revolt, support for a pan-Arab empire after the war if he launched a counter jihad against the Turks. It was this ability to “walk into the crowd” and harness Arab nationalism that marked him out as a first rate colonial soldier, according to leading British Arabist and former MI6 officer Sir Mark Allen.
Understanding the Ottomans’ difficulties in effectively patrolling the vast expanse of their desert territories, Lawrence used highly mobile Bedouin troops to ambush the enemy in a new form of guerilla warfare, targeting the Damascus-Medina railway, the sole supply line to the Ottoman garrison of Medina in Arabia. Using locals to do the bulk of the fighting, he went on to capture the strategically important Red Sea port of Aqaba, an exploit that shot him to fame and set the template for future special forces operations.
When British general Allenby marched as a modern crusader into Jerusalem in 1917, with Lawrence by his side as a Major, it was through the symbolically important Jaffa Gate, the ‘Conquerors’ Gate, and on foot rather than horseback because Christ had walked not ridden. This was for Lawrence “the supreme moment of his career.”
Yet when he learned of the secret British and French deal to divide the Arabian kingdom into two imperial possessions after the war, Lawrence wrote to his commanding officer: “We’ve asked them to fight on a lie, and I can’t stand it.”
Lawrence rushed his Arab fighters, who were loyal to the Emir and his son Faisal Hussein, to Damascus with the aim of taking it from the Ottomans before the British army arrived, gambling that once Faisal was established as king in this capital of the Arab world, it would be hard for Britain to topple him.
On October 1st 1918, wearing Arab clothes and riding in a Rolls Royce, Lawrence was cheered by a Damascus crowd of up to 150,000 people, having “inspired and ignited” their revolutionary fervour, according to Syrian historian Sami Moubayed. Faisal Hussein, a hero of the Arab revolt, followed two days later. But Lawrence had underestimated his own imperialism.
Under the infamous Sykes-Picot agreement the Middle East was divided “from the E of Acre to the last K of Kirkuk” in a straight, diagonal line across the map. France got Syria, Britain oil-rich Mosul and Palestine. It was a moment that “still rankles in the Arab psyche”, says Jordan’s foreign minister, a moment when “the western countries succeeded in … demolishing the hopes of the Arabs.” Bin Laden’s description of the deal as one which “dissected the Islamic world into fragments” underlines its contemporary resonance.
The Damascus meeting in 1918, at which Faisal was read out the Foreign Office telegram outlining the betrayal by France and Britain, marked “the start of the next 90 years of antagonism between the West and the Arab world. Lawrence left Damascus immediately, a failure, having delivered the Arabs to his British masters,” says Stewart.
Lawrence tried to break the Sykes-Picot agreement at Versailles in 1919, acting as Faisal’s adviser, but he merely became an embarrassment to the establishment. Defeated, he returned to England, where over a million people went to see a show at Covent Garden featuring ‘Lawrence of Arabia’.
When the British occupied Iraq, dropping bombs and gas to quell the insurgency, Lawrence wrote to the Times in 1920: “The people of England have been led into a trap in Iraq… it’s a disgrace to our imperial record”. Then in 1921, with the occupation failing, he was called on to advise Churchill, the Colonial Secretary, and Faisal was installed as a puppet ‘king’. The “last relic of Lawrence’s vision” lives on today in the shape of the pro-British kingdom of Jordan, still ruled by Faisal’s family.
What should we make of Lawrence today? Sami Moubayed describes him as “a British officer serving his nation’s interests. He was one of the many foreigners… who definitely does not deserve the homage you see nowadays.”
Stewart takes a different view, seeing Lawrence as a prophetic figure for our times. Stewart himself was deputy governor of two Iraqi provinces in 2003, where he initially “thought we could do some good”. He tried to “bring some semblance of order and prepare the country for independence,” but in the face of the insurgency he came to share Lawrence’s disillusionment with colonial rule.
Similarly disillusioned is Carne Ross, Britain’s former key negotiator at the UN, who resigned over the WMD issue. He tells Stewart: “I found it a deeply embittering experience… I think I was naïve about it…Ultimately my conclusion is one of deep skepticism of the state system and indeed of this place [the UN].”
These men’s disappointment is revealing. Stewart believes that “if generals and politicians now could see what Lawrence saw we would not be in the mess today”. He condemns the American misuse of Lawrence – troops shown David Lean’s swashbuckling film and made to read Lawrence’s 27-point guide to “try to… enter the Arab mindset”. He exposes the hollowness of General Patraeus’ new counter-insurgency manual enjoining troops “to work with local forces” by walking round Baghdad in the company of a US officer who speaks no Arabic and is ignorant of local politics.
Stewart, like Lawrence, rejects foreign occupation of the Middle East as unsustainable. “However much you do to overcome these cultural divides, in the end you don’t have the consent of the people; it’s not your country,” he says, echoing Lawrence, who called for “every single British soldier” to leave, creating “our first brown dominion, not our last brown colony.”
But unlike the hero of Avatar, (see Going traitor: Avatar versus imperialism) Lawrence never fully broke with his own imperialist masters. Caught between the demands of colonial rule and his admiration for the ‘natives’, he could never resolve the contradiction and died a broken man.
Stewart, following in Lawrence’s footsteps, walked across Asia as a young man and found in the dignity of the locals “a great deal about how to live a meaningful life.” But though admiring the people and recognizing the failings of colonial rule, he remains wedded to the power of which he is part. A prospective Tory candidate, ex-Etonian, diplomat’s son, he has set up a school in Kabul to teach Afghan craftsmen skills to restore old buildings, a pet project of Hamid Karzai’s. Though he calls for troops out of Iraq and Afghanistan, he implicitly believes imperialism capable of arranging the world in gentlemanly fashion, if only it would take on board Lawrence’s “political vision”. Lawrence didn’t question imperialism itself, and Stewart’s Orientalist vision suffers from the same limited horizon.
00:10 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, proche orient, palestine, monde arabe, première guerre mondiale, impérialisme, empire britannique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
La leçon du philosophe et sociologue Hans Freyer
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1987
La leçon du sociologue et philosophe Hans Freyer
Ex: http://vouloir.hautetfort.com/
 Pour Hans Freyer (1887-1969), sociologue allemand néo-conservateur (« jeune-conservateur », jungkonservativ) qui sort du purgatoire où l'on avait fourré tous ceux qui ne singeaient pas les manies de l'École de Francfort ou ne paraphrasaient pas Saint Habermas, la virtù de Machiavel n'est pas une "vertu" ou une qualité statique mais une force qui n'attend qu'une chose : se déployer dans l'aire concrète de la Cité, dans l'épaisseur de l'histoire et du politique. Fondateur de l’École de Leipzig, d’où seront issus les meilleurs cadres de la sociologie historique de Weimar (il est parmi les fondateurs, avec Werner Conze, de la nouvelle histoire sociale allemande), puis de la sociologie nazie et une grande partie des sociologues conservateurs allemands d’après-Guerre (not. Helmuth Schelsky), ce sociologue a une solide formation de philosophe, dont l’ouvrage fondateur, Theorie des objektiven Geistes (1928) qui poursuit les pensées de Hegel et de Wilhelm Dilthey, va préparer le projet sociologique, not. dans son ouvrage Soziologie als Wirklichkeitswissenschaft (1930), d’une « révolution de droite » qui prendrait acte de l’anomie de la société industrielle et de l’échec de la lutte des classes, en lui opposant un État autoritaire. Ayant pris ses distances avec le nazisme – il sera professeur à Budapest entre 1941 et 1945 – il est l’exemple même du penseur conservateur, du théoricien de cette Révolution conservatrice qui aura grand mal à se justifier au moment de la dénazification. Il n’en est pas moins l’un des premiers sociologues professionnels qui, après la mort de Max Weber et de Georg Simmel, dont il ne cesse de se nourrir de manière critique, va lancer des projets innovateurs en sociologie industrielle, des organisations et de l’administration publique.
Pour Hans Freyer (1887-1969), sociologue allemand néo-conservateur (« jeune-conservateur », jungkonservativ) qui sort du purgatoire où l'on avait fourré tous ceux qui ne singeaient pas les manies de l'École de Francfort ou ne paraphrasaient pas Saint Habermas, la virtù de Machiavel n'est pas une "vertu" ou une qualité statique mais une force qui n'attend qu'une chose : se déployer dans l'aire concrète de la Cité, dans l'épaisseur de l'histoire et du politique. Fondateur de l’École de Leipzig, d’où seront issus les meilleurs cadres de la sociologie historique de Weimar (il est parmi les fondateurs, avec Werner Conze, de la nouvelle histoire sociale allemande), puis de la sociologie nazie et une grande partie des sociologues conservateurs allemands d’après-Guerre (not. Helmuth Schelsky), ce sociologue a une solide formation de philosophe, dont l’ouvrage fondateur, Theorie des objektiven Geistes (1928) qui poursuit les pensées de Hegel et de Wilhelm Dilthey, va préparer le projet sociologique, not. dans son ouvrage Soziologie als Wirklichkeitswissenschaft (1930), d’une « révolution de droite » qui prendrait acte de l’anomie de la société industrielle et de l’échec de la lutte des classes, en lui opposant un État autoritaire. Ayant pris ses distances avec le nazisme – il sera professeur à Budapest entre 1941 et 1945 – il est l’exemple même du penseur conservateur, du théoricien de cette Révolution conservatrice qui aura grand mal à se justifier au moment de la dénazification. Il n’en est pas moins l’un des premiers sociologues professionnels qui, après la mort de Max Weber et de Georg Simmel, dont il ne cesse de se nourrir de manière critique, va lancer des projets innovateurs en sociologie industrielle, des organisations et de l’administration publique.
Victor Leemans, qui avant-guerre avec Raymond Aron introduisit en Belgique et en France les grands noms de la sociologie allemande, écrivait, à propos de Hans Freyer, dans son Inleiding tot de sociologie (Introduction à la sociologie, 1938) :
« Pour Freyer, toute sociologie est nécessairement "sociologie politique". Ses concepts sont toujours compénétrés d'un contenu historique et désignent des structures particulières de la réalité. Dans la mesure où la sociologie se limite à définir les principaux concepts structurels de la vie sociale, elle doit ipso facto s'obliger à prendre le pouls du temps. Elle doit d'autant plus clairement nous révéler les successions séquentielles irréversibles où se situent ces concepts et y inclure les éléments de changement, Les catégories sont dès lors telles : communauté, ville, état (Stand), État (Staat), etc., tous maillons dans une chaîne processuelle concrète et réelle. Ces concepts ne sont pas des idéaltypes abstraits mais des réalités liées au temps. (...)
Selon Freyer, aucune sociologie n'est donc pensable qui ne débouche pas dans la connaissance de la réalité contemporaine. À ce concept de réalité ne s'attache pas seulement la connaissance des structures immédiatement perceptibles mais aussi et surtout la connaissance des volontés de maintien ou de transformation qui se manifestent en leur sein. La connaissance sociologique opte nécessairement pour une direction déterminée découlant d'une connaissance de la Realdialektik (dialectique réalitaire [ou dialectique réelle, c'est-à-dire non simplement discursive])... ».
Une sociologie de l'homme total
Malgré cette définition courte de l'œuvre de Freyer, définition qui veut souligner le recours au concret postulé par le sociologue allemand, nous avons l'impression de nous trouver face à un édifice conceptuel horriblement abstrait, détaché de toute concrétude historique. Ce malaise, qui nous saisit lorsque nous sommes mis en présence de l'appareil conceptuel forgé par Freyer, doit pourtant disparaître si l'on fait l'effort de situer ce sociologue dans l'histoire des idées politiques. Avec les romantiques, les jeunes hégéliens (Junghegelianer), Feuerbach et Karl Marx, le XIXe siècle montre qu'il souhaite abandonner définitivement l'homme des humanistes, cet homme perçu comme figure universelle, comme espèce générale dépouillée de sa dimension historico-concrète. Désormais, sous l'influence et les coups de boutoir de ces philosophies concrètes, l'épaisseur historique sera rendue à l'homme : on le percevra comme seigneur féodal, comme serf, bourgeois ou prolétaire.
Une « objectivité » qui doit mobiliser l'homme d'action
Mais ces hégéliens et marxistes, qui dépassent résolument l'idéalisme fixiste de l'humanisme antérieur au XlXe, demeurent mécaniquement enfermés dans la vision de l'homo œconomicus et n'explorent que chichement les autres domaines où l'homme s'exprime. À cette négligence des matérialistes marxistes répond l'hyper-mépris des économismes d'un Wagner ou d'un Schopenhauer, d'un Nietzsche ou d'un Jakob Burckhardt. L'homme total n'est appréhendé ni chez les uns ni chez les autres. Pour Freyer, les essayistes et polémistes anglais Carlyle et John Ruskin nous ont davantage indiqué une issue pour échapper à ce rabougrissement de l'homme. Leurs préoccupations ne les entraînaient pas vers des empyrées légendaires, néo-idéalistes ou spiritualistes mais les amenaient à réfléchir sur les moyens de dépasser l'homme capitaliste, de restituer une harmonie entre le travail et la Vie, entre le travail et la création intellectuelle ou artistique.
Dans deux postfaces aux travaux de Freyer sur Machiavel (ou sur l'Anti-Machiavel de Frédéric Il de Prusse), Elfriede Üner nous explique comment fonctionne concrètement la sociologie de Freyer, qui cherche, au-delà de l'abstractionnisme matérialiste marxiste et de l'abstractionnisme humaniste pré-marxiste, à restaurer l'homme total. Pour parvenir à cette tâche, la sociologie et le sociologue ne peuvent se contenter de décrire des faits sociaux passés ou présents, mais doivent forger des images mobilisatrices tirées du passé et adaptées au présent, images qui correspondent à une volition déterminée, à une volition cherchant à construire un avenir solide pour la Cité.
La méthode de Freyer repose au départ, écrit Elfriede Üner, sur la théorie de "l'esprit objectif" (Theorie des objektiven Geistes). Cette théorie recense les faits mais, simultanément, les coagule en un programme revendicateur et prophétique, indiquant au peuple politique la voie pour sortir de sa misère actuelle. Le sociologue ne saurait donc être, à une époque où le peuple cherche de nouvelles formes politiques, un savant qui fuit la réalité concrète pour se réfugier dans le passé : « Qu'il se fasse alors historien ou qu'il se retire sur une île déserte ! », ironisera Freyer. Cette parole d'ironie et d'amertume est réellement un camouflet à la démarche "muséifiante" que bon nombre de sociologues "en chambre" ne cessent de poser.
Les écrits de sociologie politique doivent donc receler une dimension expressionniste, englobant des appels enflammés à l'action. Ces appels aident à forger le futur, comme les appels de Machiavel et de Fichte ont contribué à l'inauguration d'époques historiques nouvelles. Fichte parlait d'un « devoir d'action » (Pflicht zur Tat). Freyer ajoutera l'idée d'un « droit d'action » (Recht zur Tat). « Devoir d'action » et « droit d'action » forment l'épine dorsale d'une doctrine d'éthique politique (Sittenlehre). L'activiste, dans cette optique, doit vouloir construire le futur de sa Cité. Anticipation constructive et audace activiste immergent le sociologue et l'acteur politique dans le flot du devenir historique. L'activiste, dans ce bain de faits bruts, doit savoir utiliser à 100 % les potentialités qui s'offrent à lui. Cette audacieuse mobilisation totale d'énergie, dans les dangers et les opportunités du devenir, face aux aléas, constitue un "acte éthique".
Une immersion complète dans le flot de l'histoire
L'éthique politique ne découle pas de normes morales abstraites mais d'un agir fécond dans la mouvance du réel, d'une immersion complète dans le flot de l'histoire. L'éthique freyerienne est donc "réalitaire et acceptante". Agir et décider (entscheiden) dans le sens de cette éthique réalitaire, c'est rendre concrètes des potentialités inscrites dans le flot de l'histoire. Freyer inaugure ici un "déterminisme intelligible". Il abandonne le concept de "personnalité esthétisante", individualité constituant un petit monde fermé sur lui-même, pour lancer l'idée d'une personnalité dotée d'un devoir précis, celui de fonctionner le plus efficacement possible dans un ensemble plus grandiose : la Cité. L'éthique doit incarner dans des images matérielles concrètes, générant des actes et des prestations individuels concrets, pour qu'advienne et se déploie l'histoire.
Selon cette vision freyerienne de l'éthique politique, que doit nécessairement faire sienne le sociologue, un ordre politique n'est jamais statique. Le caractère processuel du politique dérive de l'émergence et de l'assomption continuelles de potentialités historiques. Le développement, le changement, sont les fruits d'un déplacement perpétuel d'accent au sein d'un ordre politique donné, c'est-à-dire d'une politisation subite ou progressive de tel ou tel domaine dans une communauté politique. Le développement et le changement ne sont donc pas les résultats d'un "progrès" mais d'une diversification par fulgurations successives [fractales], jaillissant toutes d'une matrice politico-historique initiale. La logique du sociologue et du politologue doit donc viser à saisir la dynamique des fulgurances successives qui remettent en question la statique éphémère et nécessairement provisoire de tout ordre politique.
Une sociologie qui tient compte des antagonismes
Cette spéculation sur les fulgurances à venir, sur le visage éventuel que prendra le futur, contient un risque majeur : celui de voir la sociologie dégénérer en prophétisme à bon marché. Le sociologue, qui devient ainsi "artiste qui cisèle le futur", poursuit, dans le cadre de l'État, l'œuvre de création que l'on avait tantôt attribué à Dieu tantôt à l'Esprit. L'homme, sous l'aspect du sociologue, devient créateur de son destin. Au Dieu des humanistes chrétiens, s'est substitué une figure moins absolue : l'homo politicus... Cette vision ne risque-t-elle pas de donner naissance aux pires des simplismes ?
Elfriede Üner répond à cette objection : la reine Rechtslehre (théorie pure du droit) du libéral Hans Kelsen, idole des juristes contemporains et ancien adversaire de Carl Schmitt, constitue, elle aussi, une "simplification" quelque peu outrancière. Elle n'est finalement que repli sur un formalisme juridique qui détache complètement le système logique, constitué par les normes du droit, des réalités sociales, des institutions objectives et des legs de l'histoire. Rudolf Smend, lui, parlera de la "domination" (Herrschaft) comme de la forme la plus générale d'intégration fonctionnelle et évoquera la participation démocratique des dominés comme une intégration continue des individus dans la forme globale que représente l'État.
Cette idée d'intégration continue, que caressent bon nombre de sociaux-démocrates, évacue tensions et antagonismes, ce que refuse Freyer. Si, pour Smend, la dialectique de l'esprit et de l'État s'opère en circuit fermé, Freyer estime qu'il faut dépasser cette situation par trop idéale et concevoir et forger un modèle de système plus dynamique, capable de saisir les fluctuations tragiques d'une ère faite de révolutions. L'idéal d'une intégration totale s'effectuant progressivement ne permet pas de projeter dans la praxis politique des "futurs imaginés" qui soient réalistes : un tel idéal s'abrite frileusement derrière la muraille protectrice d'un absolu théorique.
À droite : utopies passéistes, à gauche : utopies progressistes
La dialectique de l'esprit et du politique (de l'État), c'est-à-dire de l'imagination constructive et des impératifs de la Cité, de l'imagination qui répond aux défis de tous ordres et des forces incontournables du politique, n'a reçu, en ce siècle de turbulences incessantes, que des interprétations insatisfaisantes. Freyer estime que la sociologie organique d'Othmar Spann (1878-1950) constitue une impasse, dans le sens où elle opère un retour nostalgique vers la structuration de la société en états (Stände) avec hiérarchisation pyramidale de l'autorité. Cette autorité abolirait les antagonismes et évacuerait les conflits : ce qui indique son caractère finalement utopique. À "gauche", Franz Oppenheimer élabore une sociologie "progressiste" qui évoque une succession de modèles sociaux aboutissent à une société sans classes et sans plus aucun antagonisme : cet espoir banal des gauches s'avère évidemment utopique, comme l'ont indiqué quantité de critiques et de polémistes étrangers à ce messianisme. Freyer renvoie donc dos à dos les utopistes passéistes de droite et les utopistes progressistes de gauche.
Ces systèmes utopiques sont "fermés", signale Freyer longtemps avant Popper, et trahissent ipso facto leur insuffisance fondamentale. Les concepts scientifiques doivent demeurer "ouverts" car l'acteur politique injecte en eux, par son action concrète et par son expérience existentielle, la quintessence innovante de son époque. Freyer privilégie ici l'homo politicus agissant, le sujet de l'histoire. Les acteurs politiques, dans l'optique de Freyer, façonnent le temps.
L'idée essentielle de Freyer en matière de sociologie, c'est celle d'une construction pratique ininterrompue de la réalité [les époques sont en relation les unes aves avec les autres dans la dynamique de la continuité historique]. Aux époques politiquement instables, les normes scientifiques (surtout en sciences humaines) sont décrétées obsolètes ou doivent impérativement subir un aggiornamento, une re-formulation. L'histoire est, par suite, un chantier où œuvrent des acteurs-artistes qui, à la façon des expressionnistes, recréent des mondes à partir du chaos, de ruines. Freyer, écrit Elfriede Üner, glorifie, un peu mythiquement, l'homme d'action.
Le peuple (Volk) est le dépositaire de la virtù
Le personnage de Machiavel, analysé méthodiquement par Freyer, a projeté dans l'histoire des idées cette notion expressionniste/ créatrice de l'action politico-historique. Le concept machiavelien de virtù, estime Freyer, ne désigne nullement une "vertu morale statique" mais représente la force, la puissance de créer un ordre politique et le maintenir. Virtù recèle dès lors une qualité "processuelle", écrit Elfriede Üner. Par le biais de Machiavel, Freyer introduit, dans la science sociologique jusqu'alors "objective" et statique à la Comte, un ferment de nietzschéisme, dans le sens où Nietzsche voyait l'existence humaine comme un imperfectum qui ne pouvait jamais être "parfait" mais qu'il fallait sans cesse façonner et travailler.
Le "peuple", dans la vision freyerienne du social et du politique, est, grâce à sa mémoire historique, le dépositaire de la virtù, c'est-à-dire de la "force créatrice d'histoire". Le peuple suscite des antagonismes quand les normes juridiques et/ou institutionnelles ne correspondent plus aux défis du temps, aux impératifs de l'heure ou au ni veau atteint par la technologie. Un système "ouvert" implique de laisser au peuple historique toute latitude pour modifier ses institutions.
Le système freyerien est, en dernière instance, plus démocratique que le démocratisme normatif qui, à notre époque, prétend, sur l'ensemble de la planète, être la seule forme de démocratie possible. Quand Freyer parle de « droit à l'action » (cf. supra), corollaire d'un « devoir éthique d'action », il réserve au peuple un droit d'intervention sur la trame du devenir, un droit à façonner son destin. En ce sens, il précise la vision machiavelienne du peuple dépositaire de la virtù, oblitérée, en cas de tyrannie, par l'arbitraire du tyran individuel ou oligarchique.
Relire Freyer
Relire Freyer, contemporain de Schmitt, nous permet de déployer une critique du normativisme juridique, au nom de l'imbrication des peuples dans l'histoire et du décisionnisme. L'État de droit, c'est finalement un État qui se laisse réguler par la virtù enfouie dans l'âme collective du peuple et non un État qui voue un culte figé à quelques normes abstraites qui finissent toujours par s'avérer désuètes.
Et cette volonté freyerienne de s'imbriquer totalement dans le réel pour échapper aux mondes stérilisés des réductionnismes matérialistes, économistes et caricaturalement normatifs que nous lèguent les marxismes et libéralismes vulgaires, ne pourrait-on pas la lire parallèlement à Péguy ou aux génies de l'école espagnole : Unamuno avec sa dialectique du cœur, Eugenio d'Ors, Ortega y Gasset ?
► Robert STEUCKERS, Vouloir n°37/39, 1987.
1) Hans FREYER, Machiavelli (mit einem Nachwort von Elfriede Üner), Acta Humaniora, Weinheim, IX/133 p.
2) Hans FREYER, Preussentum und Aufklärung und andere Studien zu Ethik und Politik (herausgegeben und kommentiert von Elfriede Üner), Acta Humaniora, Welnheim, 222 p.
¤ Compléments bibliographiques :
- Les Fondements du monde moderne - Théorie du temps présent, H. Freyer, Payot, coll. Bibliothèque scientifique, 1965.
- « Romantisme et conservatisme. Revendication et rejet d'une tradition dans la pensée politique de Thomas Mann et Hans Freyer », C. Roques, in : Les romantismes politiques en Europe, dir. G. Raulet, MSH, avril 2009.
- « Die umstrittene Romantik. Carl Schmitt, Karl Mannheim, Hans Freyer und die "politische Romantik" », C. Roques, in : M. Gangl/ G. Raulet (dir.), Intellektuellendiskurse in der Weimarer Republik. Zur politischen Kultur einer Gemengelage, 2. neubearbeitete und erweiterte Auflage, Frankfurt/M., Peter Lang Verlag 2007 [= Schriftenreihe zur Politischen Kultur der Weimarer Republik, Bd. 10]. [cf. sur ce thème : Les formes du romantisme politique]
- Nationalité et Modernité, D. Jacques, Boréal, Montréal, 1998, 270 p.
- The Other God that Failed : Hans Freyer and the Deradicalization of German Conservatism, J. Z. Muller, Princeton Univ. Press, 1987. Cf. [pt] Reinterpretar Hans Freyer.
- « The Sociological Theories of Hans Freyer : Sociology as a Nationalistic Program of Social Action », Ernest Manheim in : An Introduction to the History of Sociology, H. E. Barnes (éd.), Chicago Univ. Press, 1948.
¤ Citation :
- « Il faut une volonté politique pour avoir une perception sociologique ».
¤ Liens :
- « La sociologie historique en Allemagne et aux États-Unis : un transfert manqué », G. Steinmetz [ref.]
- « De Tönnies à Weber : sur l'existence d'un "courant allemand" en sociologie », S. Breuer
- Die Bewertung der Wirtschaft im philosophischen Denken des 19. Jahrhunderts, H. Freyer (1921)
¤ Évocations diverses :
1) LE CARACTÈRE INHUMAIN DU CAPITALISME : Mais comment se présente plus précisément le capitalisme moderne comme système d’action? Un grand sociologue humaniste du XXe siècle, Hans Freyer, peut nous aider à répondre. Dans son livre Theorie des gegenwärtigen Zeitalters (Théorie de l’époque actuelle, 1956), il parle des "systèmes secondaires" comme de produits spécifiques du monde industrialisé moderne et en analyse la structure avec précision. Les systèmes secondaires sont caractérisés par le fait qu’ils développent des processus d’action qui ne se rattachent pas à des organisations préexistantes, mais se basent sur quelques principes fonctionnels, par lesquels ils sont construits et dont ils tirent leur rationalité. Ces processus d’action intègrent l’homme non comme personne dans son intégralité, mais seulement avec les forces motrices et les fonctions requises par les principes et par leur mise en œuvre. Ce que les personnes sont ou doivent être reste en dehors. Les processus d’action de ce genre se développent et se consolident en un système répandu, caractérisé par sa rationalité fonctionnelle spécifique, qui se superpose à la réalité sociale existante en l’influençant, la changeant et la modelant. Voilà la clé qui permet d’analyser le capitalisme comme système d’action. (S. Magister)
2) En ce qui concerne la tradition sociologique allemande, qui est marquée par l'influence de nombreuses conceptions philosophiques (notamment celles du système de Hegel), elle subit en particulier l'influence néfaste de la distinction opérée par Wilhelm Dilthey (1833-1911) entre les systèmes de culture (art, science, religion, morale, droit, économie) et les formes «externes» d'organisation de la culture (communauté, pouvoir, État, Église). Cette dichotomie fut encore aggravée par Hans Freyer (1887-1969) qui distinguait les « contenus objectifs » ou « signification devenue forme », qui sont les « formes objectivisées de l'esprit » dont l'étude relève des « sciences du logos », de leurs « être et devenir réels » qui sont l'objet des « sciences de la réalité ». Le caractère insupportablement artificiel de cette opposition ne saurait être mieux démontré qu'en rappelant que dans cette conception, le langage lui-même est défini comme un « assemblage de mots et de significations, de formes mélodiques et de formations syntaxiques », comme si on pouvait appréhender le langage indépendamment de l'organisation sociale des hommes qui l'emploient. Bien entendu, les langues (Langage) présentent aussi des structures intellectuelles qu'on ne peut expliquer par la sociologie sans tomber dans l'erreur du sociologisme; mais ces structures ne constituent que la moitié du problème. En outre, les entités intellectuelles objectives ne peuvent jamais être opposées au devenir social, mais seulement former avec lui une corrélation fonctionnelle dans des complexes d'action culturelle (A. Silbermann). Dilthey lui-même adoptait à cet égard une position radicalement plus ouverte, aussi bien dans ses explications réelles, opposées à son projet, que dans beaucoup d'autres occasions, comme le prouvent ses tentatives pour établir les fondements psychologiques des sciences humaines et ses tentatives périodiques pour mettre sur pied une éthologie empirique (que l'on pourrait également définir comme une science empirique de la culture). Le danger que recèle cette distinction consiste avant tout dans ce qu'elle ouvre la voie à une sorte de distinction hiérarchique à une culture « supérieure », en quelque sorte proche de l'« esprit », et une culture « inférieure » ; celle-ci se confond facilement avec le concept de « civilisation » (matérielle), ce qui introduit dans toute cette approche du problème une évaluation patente. Il semble préférable de passer de ces conceptions fortement teintées de philosophie à une approche plus réaliste. Après la destruction totale de l'ancienne théorie des aires culturelles par l'ethnologie moderne, la dernière possibilité apparente de séparer certains contenus culturels de leurs rapports fonctionnels avec la société a définitivement disparu. (R. König)
3) La conférence « Normes éthiques et politiques » que Freyer a tenue en mai 1929 devant la Kant-Gesellschaft, souligne encore la primauté de l'État [comme fondement de la vie politique] sur le peuple. « L'État est celui qui rassemble et éveille les forces du peuple au service d'un projet culturel caractéristique ; sa politique est le fer de lance dans lequel le peuple devient historique ». Deux ans plus tard [en pleine crise de la République de Weimar], Freyer voit la signification véritable de la « révolution de droite » dans la résolution avec laquelle elle mobilise le peuple contre l'État. Et trois ans plus tard, il est avéré, pour Freyer, « qu'il existe aussi un véritable esprit du peuple en dehors des frontières politiques de l'État-Nation ». L'esprit du peuple, lit-on alors dans un sens tout à fait national-populiste, « doit être autre chose qu'un contexte fondé sur la politique. Le peuple doit être autre chose qu'un rassemblement d'hommes au sein d'un système étatique » (1934). Les singulières variations qui caractérisent la définition par Freyer du rapport de l'État et du peuple sont bien mises en valeur chez Üner (Soziologie als „geistige Bewegung“. Hans Freyers System der Soziologie und die „Leipziger Schule“, 1992). (S. Breuer)
00:05 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : révolution conservatrice, allemagne, années 30, années 40, années 50, philosophie, sociologie, histoire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 20 février 2010
Céline vient de débarquer
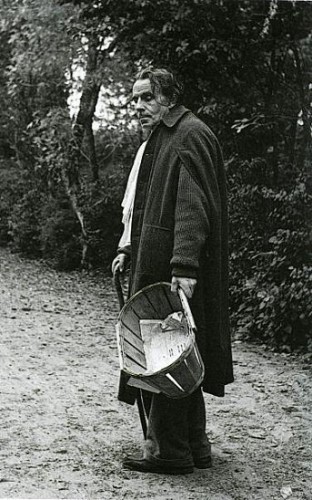 Céline vient de débarquer...
Céline vient de débarquer...
Lucien Rebatet
Ex: http://zentropa.splinder.com/
"Quand un matin du début de novembre 1944, le bruit se répandit dans Sigmaringen : « Céline vient de débarquer », c’est de son Kränzlin que le bougre arrivait tout droit. Mémorable rentrée en scène. Les yeux encore pleins du voyage à travers l’Allemagne pilonnée, il portait une casquette de toile bleuâtre, comme les chauffeurs de locomotive vers 1905, deux ou trois de ses canadiennes superposant leur crasse et leurs trous, une paire de moufles mitées pendues au cou, et au-dessus des moufles, sur l’estomac, dans une musette, le chat Bébert, présentant sa frimousse flegmatique de pur parisien qui en a bien connu d’autres. Il fallait voir, devant l’apparition de ce trimardeur, la tête des militants de base, des petits miliciens : « C’est ça, le grand écrivain fasciste, le prophète génial ? » Moi-même, j’en restais sans voix. Louis-Ferdinand, relayé par Le Vigan, décrivait par interjections la gourance de Kränzlin, un patelin sinistre, des Boches timbrés, haïssant le Franzose, la famine au milieu des troupeaux d’oies et de canards. En somme, Hauboldt était venu le tirer cordialement de ce trou, et Céline, apprenant l’existence à Sigmaringen d’une colonie française, ne voulait plus habiter ailleurs.
La première stupeur passée, on lui faisait fête. Je le croyais fini pour la littérature. Quelques mois plus tôt, je n’avais vu dans son Guignol’s Band qu’une caricature épileptique de sa manière (je l’ai relu ce printemps, un inénarrable chef d’œuvre, Céline a toujours eu dix, quinze ans d’avance sur nous). Mais il avait été un grand artiste, il restait un grand voyant. Nous nous sommes rencontrés tous les jours pendant quatre mois, seul à seul, ou en compagnie de La Vigue, de Lucette, merveilleuse d’équilibre dans cette débâcle et dans le sillage d’un tel agité. Céline, outre sa prescience des dangers et cataclysmes très réels, a été constamment poursuivi par le démon de la persécution, qui lui inspirait des combinaisons et des biais fabuleux pour déjouer les manœuvres de quantités d’ennemis imaginaires. Il méditait sans fin sur des indices perceptibles de lui seul, pour parvenir à des solutions à la fois aberrantes et astucieuses. Autour de lui, la vie s’enfiévrait aussitôt de cette loufoquerie tressautante, qui est le rythme même de ses plus grands bouquins. Cela aurait pu être assez vite intolérable. Mais la gaité du vieux funambule emportait tout.
Le « gouvernement » français l’avait institué médecin de la colonie. Il ne voulait d’ailleurs pas d’autre titre. Il y rendit des services. Abel Bonnard, dont la mère, âgée de quatre-vingt-dix ans, se mourait dans une chambre de la ville, n’a jamais oublié la douceur avec laquelle il apaisa sa longue agonie. Il pouvait être aussi un excellent médecin d’enfants. Durant les derniers temps, dans sa chambre de l’hôtel Löwen, transformée en taudis suffocant (dire qu’il avait été spécialiste de l’hygiène !) il soigna une série de maladies intrinsèquement célinesques, une épidémie de gale, une autre de chaudes-pisses miliciennes. Il en traçait des tableaux ébouriffants. L’auditoire des Français, notre affection le ravigotaient d’ailleurs, lui avaient rendu toute sa verve. Bien qu’il se nourrît de peu, le ravitaillement le hantait : il collectionnait par le marché noir les jambons, saucisses, poitrines d’oies fumées. Pour détourner de cette thésaurisation les soupçons, une de ses ruses naïves était de venir de temps à autre dans nos auberges, à l' « Altem Fritz », au « Bären », comme s'il n'eût eu d'autres ressources, partager la ration officielle, le « Stammgericht », infâme brouet de choux rouges et de rutabagas. Tandis qu'il avalait la pitance consciencieusement, Bébert le « greffier » s'extrayait à demi de la musette, promenait un instant sur l'assiette ses narines méfiantes, puis regagnait son gîte, avec une dignité offensée.
— Gaffe Bébert ! disait Ferdinand. Il se laisserait crever plutôt que de toucher à cette saloperie... Ce que ça peut être plus délicat, plus aristocratique que nous, grossiers sacs à merde ! Nous on s'entonne, on s'entonnera de la vacherie encore plus débectante. Forcément !
Puis, satisfait de sa manœuvre, de nos rires, il s'engageait dans un monologue inouï, la mort, la guerre, les armes, les peuples, les continents, les tyrans, les nègres, les Jaunes, les intestins, le vagin, la cervelle, les Cathares, Pline l'Ancien, Jésus-Christ. La tragédie ambiante pressait son génie comme une vendange. Le cru célinien jaillissait de tous côtés. Nous étions à la source de son art. Et pour recueillir le prodige, pas un magnétophone dans cette Allemagne de malheur ! (Il en sort à présent cinquante mille par mois chez Grundig pour enregistrer les commandes des mercantis noyés dans le suif du « miracle » allemand.)
Dans la vaste bibliothèque du château des Hohenzollern Céline avait choisi une vieille collection de la Revue des Deux Mondes, 1875-1880. Il ne tarissait pas sur la qualité des études qu'il y trouvait : « Ça, c'était du boulot sérieux... fouillé, profond, instructif... Du bon style, à la main... Pas de blabla. » C'est la seule lecture dont il se soit jamais entretenu devant moi. Il était extrêmement soucieux de dissimuler ses « maîtres », sa « formation ». Comme si son originalité ne s'était pas prouvée toute seule, magnifiquement.
De temps à autre, quand nous nous promenions tous deux sans témoin, le dépit lui revenait de sa carrière brisée, mais sans vaine faiblesse, sur le ton de la gouaille :
— Tu te rends compte ? Du pied que j'étais parti... Si j'avais pas glandé à vouloir proférer les vérités... Le blot que je me faisais... Le grand écrivain mondial de la « gôche »... Le chantre de la peine humaine, de la connarderie absurde... Sans avoir rien à maquiller. Tout dans le marrant, Bardamu, Guignol, Rigodon... Prix Nobel... Les pauvres plates bouses que ça serait, Aragon, Malraux, Hemingway, près du Céline... gagné d'avance... Ah ! dis donc, où c'est que j'allais atterrir !... « Maî-aître »... Le Nobel... Milliardaire... Le Grand Crachat... Doctor honoris causa... Tu vois ça d'ici !
Bien entendu, il ne fut pas question un seul instant d’employer Céline à une propagande quelconque, hitlérienne ou française. Moi-même, tout à fait indifférent aux bricolages « ministériels », je passai l’hiver à compulser les livres d’art du Château et à grossir le manuscrit de mon roman, les Deux Etendards.
Nous devions en grande partie ces privilèges à notre ami commun, le cher Karl Epting, qui avait dirigé l’Institut allemand à Paris, le vrai lettré européen, demeuré d’une francophilie inaltérable, même après les deux années de Cherche-Midi dont il paya.
Outre cette amitié précieuse, la mansuétude de tous les officiers allemands était acquise à Céline. Et il la fallait très large, pour qu’ils pussent fermer leurs oreilles à ses sarcasmes. Car Louis-Ferdinand était bien le plus intolérant, le plus mal embouché de tous les hôtes du Reich. Pour tout dire, il ne pardonnait pas à Hitler cette débâcle qui le fourrait à son tour dans de si vilains draps. C’était même le seul chapitre où il perdît sa philosophie goguenarde, se fît hargneux, méchant. Par réaction, par contradiction, l’antimilitariste saignant du Voyage se recomposait un passé, une âme de patriote à la Déroulède. Ah ! l’aurai-je entendu, le refrain de son fait d’armes des Flandres, « maréchal des logis Destouches, volontaire pour une liaison accomplie sous un feu d’une extrême violence », et du dessin qui l’avait immortalisé à la première page de l’Illustré National.
– En couleurs… Sur mon gaye… Au galop, le sabre au vent… Douzième cuirassier !... Premier médaillé militaire sur le champ de bataille de la cavalerie française… C’est moi, j’ai pas changé. Présent !... qui c’est qui me l’a tiré ma balle dans l’oreille ? C’est pas les Anglais, les Russes, les Amerlos… J’ai jamais pu les piffer, moi les Boches. De les voir se bagotter comme ça partout, libres, les sales « feldgrau » sinistres, j’en ai plein les naseaux, moi, plein les bottes !
– Mais enfin, Louis, tu oublies. Ils sont chez eux, ici !
– J’oublie pas, j’oublie pas, eh ! fias ! C’est bien la raison… Justement… Les faire aux pattes, sur place ! Une occasion à profiter, qui se retrouvera pas… Au ch’tar, les Frizons, tous, les civils comme les griviers. Au « Lag », derrière les barbelés, triple enceinte électrique… Tous, pas de détail. Voilà comment je la vois, moi, leur Bochie.
Il écumait, réellement furieux. Alors qu’il reniflait des traquenards sous les invites les plus cordiales, qu’il se détournait d’un kilomètre pour éviter une voiture dont le numéro ne lui paraissait « pas franc », il se livrait devant les Allemands à son numéro avec une volupté qui écartait toute prudence. Karl Epting avait projeté de constituer, pour notre aide, une Association des intellectuels français en Allemagne. Un comité s’était réuni, à la mairie de Sigmaringen. Céline y avait été convié, en place d’honneur. Au bout d’une demi-heure, il l’avait transformée en pétaudière dont rien ne pouvait plus sortir.
Un dîner eut lieu cependant le soir, singulièrement composé d’un unique plat de poisson et d’une kyrielle de bouteilles de vin rouge. De nombreuses autorités militaires et administratives du « Gau » s’étaient faites inviter, friandes d’un régal d’esprit parisien. Il y avait même un général, la « Ritterkreuz » au cou. Céline, qui ne buvait pas une goutte de vin, entama un parallèle opiniâtre entre le sort des « Friquets », qui avaient trouvé le moyen de se faire battre, mais pour rentrer bientôt chez eux, bons citoyens et bons soldats, consciences nettes, ne devant des comptes à personne, ayant accompli leur devoir patriotique, et celui des « collabos » français qui perdaient tout dans ce tour de cons, biens, honneur et vie. Alors ; lui, Céline, ne voyait plus ce qui pourrait l’empêcher de proclamer que l’uniforme allemand, il l’avait toujours eu à la caille, et qu’il n’avait tout de même jamais été assez lourd pour se figurer que sous un pareil signe la collaboration ne serait pas un maléfice atroce. Mais les hauts militaires avaient décidé de trouver la plaisanterie excellente, ils s’en égayèrent beaucoup, et Ferdinand fut regretté quand il alla se coucher.
Les Allemands passaient tout à Céline, non point à cause de ses pamphlets qu'ils connaissaient mal, mais parce qu'il était chez eux le grand écrivain du Voyage, dont la traduction avait eu un succès retentissant. Le fameux colonel Boemelburg lui-même, terrible bouledogue du S.D. et policier en chef de Sigmaringen, s'était laissé apprivoiser par l'énergumène. Il fallait bien d'ailleurs que Céline fût traité en hôte exceptionnel pour être arrivé à décrocher le phénoménal « Ausweis », d'un mètre cinquante de long, militaire, diplomatique, culturel et ultra-secret, qui allait lui permettre, faveur unique, de franchir les frontières de l'Hitlérie assiégée.
Il n'avait pas fait mystère de son projet danois : puisque tout était grillé pour l'Allemagne, rejoindre coûte que coûte Copenhague, où il avait confié dès le début de la guerre à un photographe de la Cour son capital de droits d'auteur, converti en or, et que ledit photographe avait enterré sous un arbre de son jardin. L'existence, la récupération ou la perte de ce trésor rocambolesque n'ont jamais pu être vérifiées. Mais sur la fin de février ou au début de mars, on apprit bel et bien que Céline venait de recevoir le mythique « Ausweis » pour le Danemark.
Deux ou trois jours plus tard, pour la première fois, il offrit une tournée de bière, qu'il laissa du reste payer à son confrère, le docteur Jacquot. À la nuit tombée, nous nous retrouvâmes sur le quai de la gare. Il y avait là Véronique, Abel Bonnard, Paul Marion, Jacquot, La Vigue, réconcilié après sa douzième brouille de l'hiver avec Ferdine, deux ou trois autres intimes. Le ménage Destouches, Lucette toujours impeccable, sereine, entendue, emportait à bras quelque deux cents kilos de bagages, le reliquat sans doute des fameuses malles, cousus dans des sacs de matelots et accrochés à des perches, un véritable équipage pour la brousse de la Bambola-Bramagance. Un lascar, vaguement infirmier, les accompagnait jusqu'à la frontière, pour aider aux transbordements, qui s'annonçaient comme une rude épopée, à travers cette Allemagne en miettes et en feu. Céline, Bébert sur le nombril, rayonnait, et même un peu trop. Finis les « bombing », l'attente résignée de la fifaille au fond de la souricière. Nous ne pèserions pas lourd dans son souvenir. Le train vint à quai, un de ces misérables trains de l'agonie allemande, avec sa locomotive chauffée au bois. On s'embrassa longuement, on hissa laborieusement le barda. Ferdinand dépliait, agitait une dernière fois son incroyable passeport. Le convoi s'ébranla, tel un tortillard de Dubout. Nous autres, nous restions, le cœur serré, dans l'infernale chaudière. Mais point de jalousie. Si nous devions y passer, du moins le meilleur, le plus grand de nous tous en réchapperait.
Lucien REBATET, Mémoires d’un fasciste II, Pauvert, 1976, p. 218 – 224.
00:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, céline, années 40, deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale, france |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
The death and life of James Connolly
The death and life of James Connolly
In that rising, the men and women who took on the overwhelming military might of the British Empire held out for four days. Their leaders were rounded up afterwards and shot, each of them defiant to the end. The aftermath was the armed struggle waged by the IRA under Michael Collins, leading to the formation in 1921 of the Irish Free State; following which there was a civil war which lasted a further two years.
The life of James Connolly, a key leader of the Easter Rising, is worthy of special attention. It is a tale which begins amid the grinding poverty of a disease-ridden slum populated by Irish immigrants in Edinburgh towards the end of the 19th century.
Anti-Irish sentiment in Scotland was commonplace during this period, with the poison of religious sectarianism exacerbated by the poverty which resulted from a laissez faire capitalist model- an unremitting struggle of all against all for the crumbs from the table, while the capitalist bosses made their profits. In Edinburgh, the poor Irish immigrants were squeezed together in their own ghetto in the centre of the city. The locals named it 'Little Ireland', and here the ravages of poverty – in the shape of alcoholism, crime, and diseases such as cholera and typhus - were part of every day life.
James Connolly, born 5 June 1868, was the youngest of three brothers. At the age of ten, after his mother died, he lied about his age and began work in the print-shop of a local newspaper.
At an age when his life might otherwise have consisted of going to school and running free with other boys his age, here he was being introduced to the cruel world of employment under lightly-regulated capitalism; a mere child experiencing all the dirt and noise and smells of heavy machinery amongst the worn and broken men who toiled long hours for starvation wages.
Desperate to escape this fate, at the age of fourteen Connolly once again lied about his age and joined the British Army. He was posted to Ireland, the birthplace of his parents, and it was there, witnessing the atrocities being carried out against the Irish people by the British Army, that the seeds of class consciousness and hatred of oppression were planted.
It was also during this period that he met his wife, Lillie Reynolds, who worked as a domestic servant for a prominent unionist family in Dublin. An outstanding figure in her own right, Lillie would remain by her husband’s side to the end of his life, sharing in his triumphs and defeats.
Connolly deserted from the British Army at the age of 21, moved back to Scotland with Lillie and there began his involvement in the working class movement. In 1889 whilst living in Dundee, he joined the Socialist League, an organisation committed to revolutionary internationalism and which which received the endorsement of Friedrich Engels.
A year later he moved to Edinburgh with his wife and by then two children, where he returned to the grind of manual labour, picking up work here and there as he and his wife struggled against poverty. Throughout, Connolly continued to find time for politics and he became secretary of the Scottish Socialist Federation. He entered a municipal election as a socialist candidate around this period and received 263 votes.
In 1896, James Connolly returned to Dublin, a city he'd grown to love while posted there in the British Army, in response to an offer to work for the Dublin Socialist Club. Shortly after his arrival he founded the Irish Socialist Republican Party. In his first statement on behalf of the ISRP, he wrote:
“The struggle for Irish freedom has two aspects: it is national and it is social. The national ideal can never be realised until Ireland stands forth before the world as a nation, free and independent. It is social and economic, because no matter what the form of government may be, as long as one class owns as private property the land and the instruments of labour from which mankind derive their substance, that class will always have it in their power to plunder and enslave the remainder of their fellow creatures.”
At this time there were two strands of revolutionary thought in Ireland, national liberation and socialism. Connolly had decided by this point that, rather than being antagonistic, these strands were in fact complementary.
This was a view which ran counter to the prevailing current in the socialist movements in continental Europe during that period, including most of those who ascribed to the legacy of Karl Marx. The dominant view among the leading socialist theorists was that the struggle for socialism must reach across the false divisions of national, ethnic and cultural identity. Nationalist movements as such were scorned. But most of those European Marxists had no experience of living under the domination of a foreign empire; for them the 'national question' only existed in the abstract.
Much of Connolly’s most powerful writing and thinking focused on this very issue. As he put it:
“The struggle for socialism and national liberation cannot and must not be separated.”
And:
“The cause of labour is the cause of Ireland; the cause of Ireland is the cause of Labour.”
In his synthesis of the cause of the working class with the cause of liberation from imperial domination, James Connolly was a major progenitor of the left politics of the 20th Century, and also of the early 21st Century.
Connolly was also an early champion of women's rights. He argued:
“The worker is the slave of capitalist society, the female worker is the slave of that slave.”
'I know of no foreign enemy except the British government'
In 1903, as work and finances in Dublin dwindled, Connolly moved to the United States. He'd visited there the year before; travelling across the country lecturing on political philosophy and trade unionism, and his lectures had received a warm reception and much praise from leading figures within the nascent US socialist movement of the period, in particular Daniel De Leon.
After a hard initial few years in his adopted country, Connolly eventually managed to find stable work, and in 1906 became a paid organiser for the recently formed Industrial Workers of the World (IWW), led by the legendary Big Bill Haywood. He also joined the American Socialist Labor Party and founded a monthly newspaper, The Harp, with which he aimed to reach the East Coast's huge Irish immigrant population.
Largely due to Connolly's focus on Irish immigrants, he and De Leon soon split. De Leon, an orthodox Marxist, abhorred Connolly's belief that Marxism should be adapted to varying cultures and traditions if a nation of immigrants was to be mobilized in the cause.
The split was acrimonious, Connolly accusing De Leon of being elitist, De Leon questioning Connolly's methods and grasp of Marxist theory and practice. However, Connolly continued on the path he had chosen, and it was obvious by now that a large part of his motivation in doing so was an increasing homesickness for his beloved Ireland.
In 1910 his dream of returning to Ireland became reality. He returned after being invited to become national organizer for the newly-formed Socialist Party of Ireland. Soon after his return he published a number of pamphlets, one of which, Labour in Irish History, was was a major step in the development of an understanding of the history of Ireland.
By now possessing an unshakable belief in the importance of the trade union movement for the revolutionary struggle, Connolly joined with James Larkin in his Irish Transport and General Workers Union. Connolly moved north to Belfast to organize for the ITGWU, hoping to smash down the barriers of religious sectarianism and unite the working class in the shipyards around which the city was built.
He had little success.
In 1913, he moved back to Dublin to join Larkin in the titanic struggle which began when the Dublin employers locked out thousands of workers in an attempt to break the increasing influence and strength of the ITGWU.
A protest meeting of the workers was held despite a ban on such meetings having been ordered by the authorities. It was savagely attacked and broken up by baton-wielding police, and afterwards Connolly was arrested. He refused bail for good behaviour and was sentenced to three months in prison. Immediately embarking on a hunger strike, he was released after just one week.
Connolly's first endeavour upon his release was to form a workers' militia. Never again, he vowed, would workers be trampled into the ground by police horses or beaten down under police batons. He called this new militia, which comprised around 250 volunteers, the Irish Citizen Army (ICA). The day after its formation, Connolly spoke at a meeting:
“Listen to me, I am going to talk sedition. The next time we are out on a march, I want to be accompanied by four battalions of trained men.”
When Larkin left Ireland for a fundraising tour of the United States in 1914, Connolly became acting general secretary of the ITGWU. The same year, watching as millions of workers went off to be slaughtered in the First World War, he was devastated:
“This war appears to me as the most fearful crime of the centuries. In it the working class are to be sacrificed so that a small clique of rulers and armament makers may sate their lust for power and their greed for wealth. Nations are to be obliterated, progress stopped, and international hatreds erected into deities to be worshipped.”
All over Europe, even socialists succumbed to the poison of patriotism, joining the war efforts in their respective countries and thus heralding the end of the Second International in which socialist parties and figures representing Europe's toiling people had vowed to campaign against the war and the slaughter of worker by worker. Connolly's analysis of the war was scathing:
“I know of no foreign enemy in this country except the British Government. Should a German army land in Ireland tomorrow, we should be perfectly justified in joining it, if by so doing we could rid this country for once and for all the Brigand Empire that drags us unwillingly to war.”
That British Government attempted to buy off Irish sentiment, hitherto in support of outright independence from the Empire, with a Home Rule bill, which in effect promised devolved power if the political leadership in Ireland at that time - people like John Redmond of the Irish Parliamentary Party - would agree to the recruitment of Irish workers to be slaughtered in the trenches in an imperialist war.
The bill split the Irish national liberation movement into those who supported it as a step towards outright independence and those, like Connolly, who were totally against it. He declaimed:
“If you are itching for a rifle, itching to fight, have a country of your own. Better to fight for our own country than the robber empire. If ever you shoulder a rifle, let it be for Ireland.”
It was then that Connolly's position shifted with regard to 'physical force'. Previously, he had wanted no part in it, eschewing it as reckless and contrary to Marxist doctrine of a mass revolution of the working class, whereby consciousness precedes action.
But with the retreat of the European socialists, and the failure of the trade unions to act against the war, Connolly despaired of ever achieving the society he’d dedicated his life to without armed struggle. An organisation called the Irish Republican Brotherhood was planning just the kind of insurrection which Connolly had in mind. Connolly had taken a dim view of the IRB and its leaders up until then, viewing them as a bunch of feckless romantics. However, when they revealed their plans to him at a private meeting – plans involving the mobilization of 11,000 volunteers throughout the country - and that a large shipment of arms was on the way from Germany, he agreed to join them with his own ICA volunteers.
Connolly was respected enough by the IRB leaders, in particular Padraig Pearse, to be appointed military commander of Dublin's rebel forces. Pearse, a school teacher, was certain that they would all be slaughtered. He was imbued with a belief in the necessity of a blood sacrifice to awaken the Irish people, holding obscurantist beliefs that were steeped in Irish history and the Gaelic culture. But for all that he was no less committed to his cause than Connolly to his, and as a consequence they soon developed a grudging respect for one another.
In the end, the plan for the Easter Sunday insurrection went awry. Rebel army volunteers deployed outwith Dublin received conflicting orders and failed to mobilize, leaving Dublin isolated. After postponing the insurrection for a day due to the confusion, the Dublin leadership decided to press on regardless. Connolly assembled his men outside their union headquarters, known as Liberty Hall.
By now he knew their chances for success were slim at best, and indeed it is said that he turned to a trusted aide as the men formed up and, in a low voice, announced:
“We’re going out to be slaughtered.”
With Padraig Pearse beside him, Connolly marched his men to their military objective, the General Post Office building on O'Connell Street in the centre of Dublin. They rushed in, took control of the building, and barricaded themselves in to await the inevitable military response from the British.
Connolly, Pearse and one of the other leaders of the insurrection, Thomas C. Clarke, marched out into the street to read out the now famous proclamation of the Irish Republic.
In it, at Connolly's insistence, the rights of the Irish people to the ownership of Ireland, to equality and to the ending of religious discrimination were included:
“The Republic guarantees religious and civil liberty, equal rights and equal opportunities to all its citizens, and declares its resolve to pursue the happiness and prosperity of the whole nation and of all its parts, cherishing all the children of the nation equally, and oblivious to the differences carefully fostered by an alien government, which have divided a minority from the majority in the past.”
After holding out against the British Army for four days, during which Connolly inspired the men under his command with his determination and courage, in the process suffering wounds to the chest and ankle, British reinforcements and artillery arrived from the mainland to begin shelling rebel positions throughout the city.
The leadership, upon realizing the hopelessness of their situation, and in order to prevent the deaths of any more of their volunteers and civilians in a losing fight, reluctantly decided to surrender.
In the aftermath the ringleaders of the Rising were executed. Connolly was saved for last, the severity of his wounds failing to deter the British from taking their revenge as they tied him to a chair in the courtyard of Kilmainham Jail, where he was executed by firing squad.
At his court martial days prior, held in his cell in deference to those same wounds, James Connolly made the following statement:
“Believing that the British Government has no right in Ireland, never had any right in Ireland, and never can have any right in Ireland, the presence, in any one generation of Irishmen, of even a respectable minority, ready to die to affirm that truth, makes the Government forever a usurpation and a crime against human progress. I personally thank God that I have lived to see the day when thousands of Irishmen and boys, and hundreds of women and girls, were ready to affirm that truth, and to attest to it with their lives if need be.”
When news of the Rising was released, some prominent European socialists dismissed it as a putsch of little or no great consequence. But a leading Russian activist, Vladimir Lenin, was not of that opinion, and went so far as to refute such criticisms in his article, The Results of the Discussion on self-determination. To him, the Easter Rising stood as an example of the awakening of the working class and the masses that was taking place across Europe, providing hope that global revolution was on the horizon.
He wrote:
“Those who can term such a rising a Putsch are either the worst kind of reactionaries or hopeless doctrinaires, incapable of imagining the social revolution as a living phenomenon.”
Today, a statue of James Connolly stands in pride of place at the centre of Dublin. A brass engraving of the Proclamation of the Irish Republic also sits at pride of place in the window of the General Post Office headquarters, where Connolly made his stand for the liberty of his nation and the working class during four fateful days in April 1916.
00:10 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, irlande, socialisme, nationalisme iralandais, celtisme, celtes, pays celtiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Réflexions sur la chute des empires
Colloque de Londres, 19 novembre 1995
Réflexions sur la chute des empires
(Intervention de Robert Steuckers)
 1.
1.
Lorsqu'après la perestroïka, après la chute du Mur de Berlin, après le retrait des troupes soviétiques hors d'Europe orientale, après l'effondrement des structures étatiques soviétiques en 1991, les Etats-Unis sont demeurés la seule et unique superpuissance en lice sur la scène internationale et le Président Bush pouvait effectivement espérer qu'un “Nouvel Ordre Mondial” allait émerger sous la direction de son pays, béni par le Tout-Puissant. Mais la tâche de diriger le monde n'est pas aisée, si l'on se souvient des prophécies du Prof. Paul Kennedy sur l'“hypertrophie impériale”. Bon nombre d'empires dans l'histoire ont sombré dans le déclin jadis simplement parce qu'ils ne pouvaient plus contrôler tous les territoires se trouvant sous leur juridiction ou, pour être plus précis, toutes les grandes voies de communication de l'Empire sur terre comme sur mer. Cette tâche nécessite une mobilisation constante de tous les moyens militaires, diplomatiques et économiques.
- Mobiliser les moyens militaires coûte très cher et soumet la nation impériale au risque de négliger ses problèmes domestiques, comme l'éducation et la santé. L'écroulement de l'empire peut alors avoir pour cause un manque de dirigeants et de gestionnaires qualifiés pour les grandes entreprises ou même pour les armées, ou par un le poids excessif des classes sociales exclues.
- Mobiliser tous les moyens diplomatiques implique une recherche constante de nouveaux alliés fiables. Mais l'art de la diplomatie nous enseigne qu'il faut éviter de trop se fier aux alliés qui risquent de devenir trop puissants et de vous lancer un défi ultérieurement. Aujourd'hui, les Etats-Unis, en tant que seul superpuissance demeurant en lice, essaiyent de mobiliser des musulmans modérés autour de la Turquie, des musulmans fondamentalistes-conservateurs autour de l'Arabie Saoudite, des musulmans fondamentalistes révolutionnaires autour du Soudan, afin d'acquérir un certain contrôle de l'Asie Centrale, de la région du Golfe ou de l'Afrique du Nord. Ce constat doit nous amener à poser une question: ces nouveaux alliés seront suffisamment fiables à long terme? Une partie d'entre eux, ou même l'ensemble, ne pourrait-elle pas évoluer comme l'Iran et devenir en un tourne-main des ennemis fanatiques de la superpuissance dirigeante? Les philosophes parmi nous se remémoreront la dialectique du Maître et de l'Esclave chez Hegel. L'Esclave obéira aussi longtemps qu'il ne pourra pas faire autrement, tant qu'il sera payé pour accomplir sa tâche. Il se rendra indispensable. Mais dès qu'il prendra conscience de son pouvoir en tant qu'adjoint ou qu'allié, il défiera son Maître. C'est là une loi de l'histoire bien connue.
- Mobiliser tous les moyens économiques implique de dépenser des sommes considérables pour la défense et de rogner dans les autres domaines, comme la santé et l'éducation. Sur le long terme, avec une telle politique, la solidarité nationale s'évanouit, la nation cesse d'être une communauté, le sens du respect mutuel disparaît, la moralité publique demeure un vague souvenir et la cohésion du pays ne peut plus œuvrer pour soutenir la puissance de l'Etat sur la scène internationale. Le manque d'investissements dans le domaine de l'éducation conduit à engager du personnel enseignant à l'étranger, même dans des pays potientiellement ennemis. Les Etats et les peuples soumis à la superpuissance impériale peuvent tirer avantage du fait que les charges militaires sont supportées par la puissance hégémonique et investir dans les affaires sociales domestiques, gagnant du même coup en cohésion et en qualité d'enseignement, c'est-à-dire en pariant sur une politique qui leur donnera très vite de meilleures gestionnaires et de meilleurs ingénieurs.
A cause de l'“hypertrophie impériale” et à certaines faiblesses domestiques, les Etats-Unis doivent aujourd'hui pratiquer la politique suivante dans le monde:
- Premièrement, contrôler l'Asie Centrale pour contenir la Russie;
- Deuxièmement, contrôler la région du Golfe pour contenir et l'Irak et l'Iran ou pour empêcher toute affirmation européenne ou japonaise dans cette zone recelant les plus grands gisements de pétrole du globe;
- Troisièmement, contrôler tous les pays situés entre la Méditerranée et la Corne de l'Afrique;
Cette triple nécessité implique d'ores et déjà de déléguer du pouvoir à la Grande-Bretagne, pour qu'elle négocie avec les challengeurs islamiques en Algérie; à l'Allemagne, pour qu'elle négocie directement avec l'Iran, comme l'a annoncé officiellement la semaine dernière le Ministre des Affaires Etrangères allemand, Klaus Kinkel, dans les colonnes du plus important des hebdomadaires de l'Europe continentale, Der Spiegel (Hambourg). Si le boycott de l'Iran est la politique officielle de Washington, la nouvelle politique de Berlin à l'égard de Téhéran sera celle du “dialogue critique”.
Déléguer de telles tâches à Londres ou à Berlin constitue en fait un recul de la stratégie impériale américaine parce que cela signifie réintroduire Londres et Berlin dans des zones d'où ces pays avaient été exclus au cours des événements de ce siècle par une intervention directe ou indirecte des Etats-Unis. Il nous reste à poser une question: les Etats-Unis seront-ils capables de contrôler entièrement la politique des diplomates et des industriels allemands en Iran, surtout sur les Allemands agiront dans les premières étapes de leur “dialogue critique” avec l'accord tacite de Washington? La délégation de pouvoir indique que l'hypertrophie impériale n'est déjà plus gérable.
2.
Mais outre la difficulté croissante à contrôler tout ce qui devrait être contrôlé, comment l'impérialisme se présente-t-il aujourd'hui?
a) L'IMPÉRIALISME MILITAIRE. L'impérialisme militaire de la seule superpuissance de 1995 consiste en résidus d'alliances forgées au temps de la Guerre Froide. L'OTAN ne peut évidemment plus avoir le même but et les mêmes objectifs aujourd'hui qu'il y a dix ans lorsque Berlin était encore divisé par un Mur et des champs de mines et quand les troupes russes étaient concentrées en Thuringe, à 70 km de Francfort, où l'on trouve l'aéroport stratégique le plus important d'Europe Centrale. L'évolution la plus logique que pourrait subir l'OTAN dans les années à venir serait une fusion du pilier européen avec l'UEO et un désengagement graduel des Etats-Unis sur le théâtre européen. L'UEO, en tant que pilier européen de l'OTAN, absorbera dans une seconde phase des nouveaux pays comme l'Autriche, la Hongrie, la Slovénie et la République Tchèque, donnant à l'alliance un profil beaucoup plus européen et de moins en moins atlantique. Ensuite, nous devons espérer une fusion graduelle de l'UEO et de l'OSCE, afin d'établir la paix dans toute l'Europe et en Asie septentrionale et centrale. Espérons que cette OSCE acquerra de plus en plus de substance dans les décennies qui viennent.
b) L'IMPÉRIALISME DIPLOMATIQUE. La première tâche que se donnera Washington, c'est de susciter du désordre partout dans le monde, spécialement dans les régions d'importance hautement stratégique, afin qu'aucune autre puissance ne soit en mesure de les contrôler et de glâner quelques bribes d'hégémonie régionale. ce désordre mobilisera des forces qui ne pourront plus consacrer leurs énergies à des fusions régionale ou à des processus de pacification ou à des processus impériaux au sens antique et non impérialiste du terme. La tâche que s'assignera Washington —comme le fait généralement toute puissance hégémonique— sera d'éviter l'émergence de tout challengeur. Mais sera-t-il possible, sur le très long terme, de confiner la Turquie dans un rôle mineur si la Turquie reçoit pour mission de coordonner les énergies des peuples turcophones d'Asie Centrale et deviendra ainsi une puissance hégémonique sur un groupe de pays comptant plus de 130 millions d'habitants? Sera-t-il possible d'obliger Berlin à suivre gentiment toutes les politiques suggérées par Washington si l'Allemagne, en tant que pays industriel très puissant et très efficace, amorce un travail en tandem avec une grande puissance pétrolière comme l'Iran, potentiellement forte aussi sur le plan militaire? Surtout si l'on se souvient que la première guerre mondiale a éclaté en partie parce que l'on voulait éviter que l'industrie de l'Allemagne de Guillaume II n'exerce une domination hégémonique sur le Moyen-Orient...
c) L'IMPÉRIALISME TECHNOLOGIQUE. Washington contrôle le commerce mondial par le biais du GATT ou du FMI. Mais l'idéologie qui se cache derrière ces structures nées immédiatement après la seconde guerre mondiale est une idéologie du libre-marché, visant à détruire toutes les barrières douanières protectrices, pour créer, en bout de course, un monde unifié, heureux et uniforme, soit le monde que craignait de voir émerger un Georges Orwell. Les barrières douanières était un système utilisé par les pays les moins puissants au niveau industriel pour aider leur population à développer en toute autonomie une industrie nationale, capable d'évoluer selon les schèmes culturels du peuple autochtone. Entre 1944 et 1946, les Etats-Unis, étant devenus le pays industriel le plus puissant, désiraient maintenir le monde tel qu'il était à ce moment-là de l'histoire, où Washington régnait sur de vastes groupes de pays dévastés ou sous-équipés. Le développement du Japon et de l'Allemagne, de même que celui des Nouveaux Pays Industriels (NPI) d'Asie orientale, constituent un danger pour le marché domestique américain lui-même, tout simplement parce que le Japon, l'Allemagne, Taïwan et Singapour n'ont pas la charge de financer une armée colossale et une technologie militaire hautement avancée capable d'intervenir partout dans le monde. Le résultat est que les voitures et les gadgets japonais envahissent les magasins aux Etats-Unis, en vertu du principe du libre marché imposé jadis par Roosevelt et Truman, mais les voitures et les gadgets américains n'envahissent pas les boutiques japonaises...
Mais dans un domaine, l'Amérique se défend sans efforts avec un indéniable succès: dans les médias. Elle garde un atout gagné lors de la seconde guerre mondiale: l'utilisation généralisée d'un anglais appauvri à travers le monde entier, comme une sorte de nouveau pidgin. Mais ce phénomène de “pidginization” permet à l'Amérique de lancer partout dans le monde des produits scientifiques ou culturels, de mettre sur pied des banques de données et de contrôler l'industrie informatique. Mais cet état de “pidginization” ne constitue-t-il pas une situation temporaire? Des méthodes pour apprendre la langue anglaise ont été répandues dans le monde, si bien qu'une élite pragmatique, qui n'est ni américaine ni britannique, est désormais capable d'utiliser cette langue correctement et d'envoyer des informations en anglais dans les banques de données ou sur internet. C'est déjà le cas, surtout dans les pays européens où l'anglais s'apprend et s'enseigne facilement parce que les langues locales lui son apparentées, comme en Allemagne, en Scandinavie et dans les pays du Bénélux. De ce fait, des informations reposant sur une base culturelle différente peuvent désormais modifier l'idéologie dominante en utilisant la langue de l'idéologie dominante. D'autres schèmes philosophiques ou spirituels peuvent d'ores et déjà avoir un certain impact sur l'idéologie globale et relativiser ses certitudes. A la fin du processus, l'idéologie globale ne sera plus la même. Les cultures dominées infiltreront le discours dominant. Un processus semblable se déroulera du fait de l'anglicisation de l'Inde. D'ores et déjà les Indiens écrivent et impriment en anglais et injectent simultanément des conceptions et des modes de pensée indiens dans l'ensemble de la sphère anglophone ou dominée par l'anglais. L'Inde devient ainsi, petit à petit, la première voix du monde non-européen et non-blanc, directement dans la langue d'origine européenne la plus répandue dans le monde.
3.
Comment lutter contre ces diverses formes d'impérialisme?
a) Contre l'IMPÉRIALISME MILITAIRE, la meilleur politique que l'Europe puisse suivre aujourd'hui est une politique d'inertie, une politique qui s'interdit d'embrayer sur les bellicismes américains et les condamnations unilétérales d'ennemis désignés par Washington. La meilleur chose que les puissances européennes puissent faire, c'est d'attendre, de retarder les paiements dans le cadre des alliances avec les Etats-Unis, de développer lentement le pilier européen et de favoriser à terme la fusion avec l'UEO. Mais nous devons également être fort attentifs et ne pas nous faire dérober des opportunités au Moyen-Orient, ne pas nous faire barrer l'accès à des voies maritimes ou fluviales ou à des marchés équilibrés avec des puissances de moindres dimensions en dehors d'Europe, puissances que nous ne pourront jamais considérer comme des semi-colonies mais toujours comme des partenaires à part entière.
b) Face à l'IMPÉRIALISME DIPLOMATIQUE, les journalistes, politiciens, intellectuels, professeurs d'université, initiatives privées européens doivent sans cesse suggérer des alternatives à l'actuel Ordre mondial, qui est basé sur une idéologie accordant trop d'importance à l'argent et trop peu d'importance à la culture, l'éducation, la recherche, les traditions et la religion. Nous devons combler le “vide spirituel” qui s'est constitué au fil des décennies, justement parce que nous n'avions pas de “vide technologique”.
c) Contre l'IMPÉRIALISME TECHNOLOGIQUE, nous devons absolument focaliser nos attentions sur la responsabilité de chacun pour les atouts irremplaçables que nous offre la Terre-Mère, c'est-à-dire focaliser nos attention sur les matières écologiques, parce que l'environnement malade de ce XXième siècle finissant nous a fait découvrir que toutes les choses que recelait la Terre avaient des limites et qu'il n'est plus possible désormais d'ignorer ces limites purement et simplementn comme nous l'avait enseigné une certaine philosophie étroitement rationaliste et cartésienne, surtout dans le cadre de nos pratiques économiques. Nous devons également respecter le principe de RÉCIPROCITÉ au niveau global. Ce n'est pas une bonne politique de laisser des continents entiers mourir de faim ou plongés dans les plus affreux désastres de la guerre, du génocide ou des dissensions civiles. Nous ne pouvons pas offrir à l'Afrique une solution qui serait purement et simplement une reprise du vieil impérialisme colonialiste ni accentuer le néo-colonialisme financier en Amérique latine: seul sera cohérent l'avenir qui généralisera les principes de coopération et de réciprocité. Par exemple, les productions bon marché des pays du Tiers-Monde doivent être taxées si elles sont importées chez nous mais de la façon suivante: les pays du Tiers-Monde exportateurs doivent avoir la chance d'acheter des produits de haute technologie dans les pays riches qui importent les biens qu'ils produisent, de façon à ce que les travailleurs des pays développés puissent conserver leur emploi; l'économiste français Lauré suggère une TVA pour les produits du Tiers-Monde qui serait thésaurisée pour acheter des produits de plus haute technologie ou d'autres biens nécessaires au pays importateurs; en effet, les pays industriels ne peuvent tolérer une dialisation de leurs propres sociétés, ou quelques happy fews viveraient dans l'opulence à côté de masses clochardisées. Les sociétés duales émergent quand les marchandises bon marché du monde extérieur remplacent les mêmes marchandises produites dans le cadre domestique. Une telle situation crée les problèmes que nous connaissons: chômage et misère dans les pays développés, pas de décollage et famine dans les pays en voie de développement. Un cul-de-sac dont nous devons tous sortir.
Et si le GATT vise en dernière instance à interdire les douanes, il ne dit rien de bien précis quant aux normes. La stabilisation des marchés domestiques pourrait dès lors s'opérer dans l'avenir non pas en appliquant des tarifs douaniers mais en imposant des normes de qualité afin de protéger des branches performantes de l'économie domestique et d'éviter ainsi le chômage, de conserver l'emploi et d'empêcher toute dualisation de la société.
Les chutes d'empires au cours de l'histoire ont toujours obligé les peuples à agir localement, à se tourner vers la planification régionale. Ce fut le cas immédiatement après l'effondrement de l'empire romain en Europe. Aujourd'hui, l'aménagement territorial sur base régionale est redevenu une nécessité, surtout dans les régions demeurées en marge, comme l'“Arc Atlantique” (du Portugal à la Bretagne) ou le Mezzogiorno. Même aux Etats-Unis, l'idée d'un vaste réaménagement territorial sur base régionale est aujourd'hui perçue comme une nécessité plutôt urgente, ainsi que nous le constatons dans les mouvements biorégionalistes et communautariens, qui peuvent être considérés comme les deux projets politiques les plus intéressants d'Outre-Atlantique à ce jour. Mais ce retour aux racines et aux faits régionaux est possible aujourd'hui en interaction avec des technologies globales telles Internat. La coopération, les échanges d'informations, l'éducation interculturelle sont désormais possibles sans violence ou sans contrôle colonial, c'est-à-dire sans qu'il ne soit nécessaire de perdre ses racines ou ses traditions. Etre membre d'un peuple spécifique, parler une langue très difficile et très ancienne, apprendre les langues antiques, mortes ou subsistantes, s'immerger totalement dans une tradition religieuse ou culturelle seront des atouts et non plus des inconvénients. Mais pour atteindre cette diversité globale, nous allons devoir nous armer de patience. La route sera longue qui nous mènera à cette diversité. Mais nous invitons tous les hommes à marcher joyeusement avec nous dans cette direction.
Comme l'écrivait récemment Hermann Scheer, un ingénieur allemand spécialisé en énergie solaire, dans son ouvrage Zurück zur Politik (Piper, Munich, 1995), nous devons combattre pour construire un ordre économique global permettant à chaque Etat de forger sa propre politique énergétique et écologique, afin de démanteler les monopoles en économie, en politique et dans les médias, de lutter pour imposer un nouvel ordre agricole débarrassé des monopoles céréaliers et des manipulations génétiques, pour restaurer l'agriculture écologique et créer des systèmes de communication respectueux de l'environnement.
Comme l'écrivait le philosophe italo-slovène Danilo Zolo (in Cosmopolis, Feltrinelli, Milano, 1995), “le vieux modèle hiérarchisant... sera remplacé par une nouvelle logique, la logique du pacifisme faible, c'est-à-dire un pacifisme qui n'est pas le pacifisme habituel et conventionnel, visant à supprimer définitivement les guerres dans le monde, mais un pacifisme nouveau qui respecte la diversité des cultures et accepte la compétition entre les intérêts divergents”. Mais sans planétariser les guerres et les conflits.
Atteindre une anti-utopie de ce type est possible. Mais, comme je viens de le dire, le chemin qui y mène est très très long. Et je répète: marchons joyeusement dans cette direction.
Robert STEUCKERS.
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, déclin, décadence, empires |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 19 février 2010
A l'assaut de l'Eurasia
A l'assaut de l'Eurasie
 Dès le milieu du siècle, la seconde guerre mondiale offre une occasion inespérée pour l’Amérique, dans une Europe affaiblie et divisée, puisque des deux rivaux continentaux (Allemagne nazie et Russie soviétique), il n’en reste qu’un. Cette lutte contre l’URSS a en fait un autre objectif : la prise de pouvoir économique par l’accès aux matières premières et aux ressources naturelles, concentrées au cœur de l’Eurasie. Pour ce faire, l’Amérique propose à l’Europe dévastée le "plan marshall" (1947) destiné à sa reconstruction. 16 états Européens, et la Turquie se partageront les fonds en créant l’OECE dont le but public était "la coordination de l’effort de reconstruction et la libéralisation du commerce et des échanges monétaires". Ce plan Marshall nous le verrons était en fait un cheval de troie, pour "infiltrer" le continent et assouvir la domination Américaine en Europe de l’ouest dans un premier temps, puis vers l’est, au fur et à mesure de l’effondrement de l’URSS.
Dès le milieu du siècle, la seconde guerre mondiale offre une occasion inespérée pour l’Amérique, dans une Europe affaiblie et divisée, puisque des deux rivaux continentaux (Allemagne nazie et Russie soviétique), il n’en reste qu’un. Cette lutte contre l’URSS a en fait un autre objectif : la prise de pouvoir économique par l’accès aux matières premières et aux ressources naturelles, concentrées au cœur de l’Eurasie. Pour ce faire, l’Amérique propose à l’Europe dévastée le "plan marshall" (1947) destiné à sa reconstruction. 16 états Européens, et la Turquie se partageront les fonds en créant l’OECE dont le but public était "la coordination de l’effort de reconstruction et la libéralisation du commerce et des échanges monétaires". Ce plan Marshall nous le verrons était en fait un cheval de troie, pour "infiltrer" le continent et assouvir la domination Américaine en Europe de l’ouest dans un premier temps, puis vers l’est, au fur et à mesure de l’effondrement de l’URSS.
Du prométhéisme au Heartland
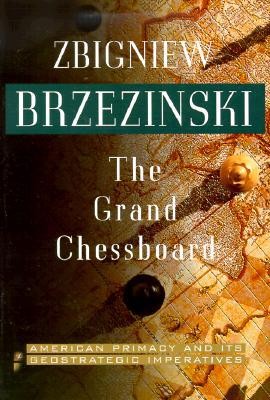 L’histoire du mouvement prométhéen remonte au début du siècle, lorsque des responsables de « républiques Russes », notamment musulmanes se concertent afin de discuter leur "indépendance". Au début du siècle, lors de ces premiers congrès, deux lignes s’opposent, les partisans d’un nationalisme territorial et les partisans d’une union panturque (le rôle d’intellectuel Turc appelant à la réunification panturque étant relativement importante au sein de ce mouvement). Rapidement, ces questions d’indépendance gagneront les républiques non musulmanes de Russie, notamment dans le Caucase.
L’histoire du mouvement prométhéen remonte au début du siècle, lorsque des responsables de « républiques Russes », notamment musulmanes se concertent afin de discuter leur "indépendance". Au début du siècle, lors de ces premiers congrès, deux lignes s’opposent, les partisans d’un nationalisme territorial et les partisans d’une union panturque (le rôle d’intellectuel Turc appelant à la réunification panturque étant relativement importante au sein de ce mouvement). Rapidement, ces questions d’indépendance gagneront les républiques non musulmanes de Russie, notamment dans le Caucase.
00:25 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : géopolitique, eurasie, eurasisme, politique internationale, asie, affaires asiatiques, europe, affaires européennes, impérialismes, lobbies, etats-unis |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Der Engel der Vernichtung
Der Engel der Vernichtung
Angriff gegen den aufklärerischen Optimismus, verdunkelt von Kraftworten: Zum 250. Geburtstag von Joseph de Maistre
Günter Maschke - Ex: http://www.jungefreiheit.de/
 La neve sulla tosta, ma il fuoco nella bocca!", rief ein begeisterter Italiener aus, der das einzige überlieferte Portrait Joseph de Maistres betrachtete, das kurz vor dessen Tode entstand. Das Haupt weiß, wie von Schnee bedeckt und aus dem Munde strömt Feuer: De Maistre gehört zu den wenigen Autoren, die mit zunehmenden Jahren stets nur radikaler und schroffer wurden und sich der sanft korrumpierenden Weisheit des Alters entschlungen, gemäß der man versöhnlicher zu werden habe und endlich um die Reputation bemüht sein müsse. Fors do l'honneur nul souci, außer der Ehre keine Sorge, war der Wahlspruch des Savoyarden, und zu seiner Ehre gehörte es, immer unvermittelter, schonungsloser und verblüffender das Seine zu sagen.
La neve sulla tosta, ma il fuoco nella bocca!", rief ein begeisterter Italiener aus, der das einzige überlieferte Portrait Joseph de Maistres betrachtete, das kurz vor dessen Tode entstand. Das Haupt weiß, wie von Schnee bedeckt und aus dem Munde strömt Feuer: De Maistre gehört zu den wenigen Autoren, die mit zunehmenden Jahren stets nur radikaler und schroffer wurden und sich der sanft korrumpierenden Weisheit des Alters entschlungen, gemäß der man versöhnlicher zu werden habe und endlich um die Reputation bemüht sein müsse. Fors do l'honneur nul souci, außer der Ehre keine Sorge, war der Wahlspruch des Savoyarden, und zu seiner Ehre gehörte es, immer unvermittelter, schonungsloser und verblüffender das Seine zu sagen.
Der Ruhm de Maistres verdankt sich seinen Kraftworten, mit denen er den ewigen Gutmenschen aufschreckt, der sich's inmitten von Kannibalenhumanität und Zigeunerliberalismus bequem macht. "Der Mensch ist nicht gut genug, um frei zu sein", ist wohl noch das harmloseste seiner Aperçus, das freilich, wie alles Offenkundige, aufs Äußerste beleidigt. Beharrliche Agnostiker und schlaue Indifferenzler entdecken plötzlich ihre Liebe zur Wahrheit und erregen sich über den kaltblütigen Funktionalismus de Maistres, schreibt dieser: "Für die Praxis ist es gleichgültig, ob man dem Irrtum nicht unterworfen ist oder ob man seiner nicht angeklagt werden darf. Auch wenn man damit einverstanden ist, daß dem Papste keine göttliche Verheißung gegeben wurde, so wird er dennoch, als letztes Tribunal, nicht minder unfehlbar sein oder als unfehlbar angesehen werden: Jedes Urteil, an das man nicht appellieren kann, muß, unter allen nur denkbaren Regierungsformen, in der menschlichen Gesellschaft als gerecht angesehen werden. Jeder wirkliche Staatsmann wird mich wohl verstehen, wenn ich sage, daß es sich nicht bloß darum handelt, zu wissen, ob der Papst unfehlbar ist, sondern ob er es sein müßte. Wer das Recht hätte, dem Papste zu sagen, daß er sich geirrt habe, hätte aus dem gleichen Grunde auch das Recht, ihm den Gehorsam zu verweigern."
Der Feind jeder klaren und moralisch verpflichtenden Entscheidung erschauert vor solchen ganz unromantischen Forderungen nach einer letzten, alle Diskussionen beendenden Instanz und angesichts der Subsumierung des Lehramtes unter die Jurisdiktionsgewalt erklärt er die Liebe und das Zeugnisablegen zur eigentlichen Substanz des christlichen Glaubens, den er doch sonst verfolgt und haßt, weiß er doch, daß diesem die Liebe zu Gott wichtiger ist als die Liebe zum Menschen, dessen Seele "eine Kloake" (de Maistre) ist.
Keine Grenzen mehr aber kennt die Empörung, wenn de Maistre, mit der für ihn kennzeichnenden Wollust an der Provokation, den Henker verherrlicht, der, zusammen mit dem (damals) besser beleumundeten Soldaten, das große Gesetz des monde spirituel vollzieht und der Erde, die ausschließlich von Schuldigen bevölkert ist, den erforderlichen Blutzoll entrichtet. Zum Lobpreis des Scharfrichters, der für de Maistre ein unentbehrliches Werkzeug jedweder stabilen gesellschaftlichen Ordnung ist, gesellt sich der Hymnus auf den Krieg und auf die universale, ununterbrochene tobende Gewalt und Vernichtung: "Auf dem weiten Felde der Natur herrscht eine manifeste Gewalt, eine Art von verordneter Wut, die alle Wesen zu ihrem gemeinsamen Untergang rüstet: Wenn man das Reich der unbelebten Natur verläßt, stößt man bereits an den Grenzen zum Leben auf das Dekret des gewaltsamen Todes. Schon im Pflanzenbereich beginnt man das Gesetz zu spüren: Von dem riesigen Trompetenbaum bis zum bescheidensten Gras - wie viele Pflanzen sterben, wie viele werden getötet!"
Weiter heißt es in seiner Schrift "Les Soirées de Saint Pétersbourg" (1821): "Doch sobald man das Tierreich betritt, gewinnt das Gesetz plötzlich eine furchterregende Evidenz. Eine verborgene und zugleich handgreifliche Kraft hat in jeder Klasse eine bestimmte Anzahl von Tieren dazu bestimmt, die anderen zu verschlingen: Es gibt räuberische Insekten und räuberische Reptilien, Raumvögel, Raubfische und vierbeinige Raubtiere. Kein Augenblick vergeht, in dem nicht ein Lebewesen von einem anderen verschlungen würde.
Über alle diese zahllosen Tierrassen ist der Mensch gesetzt, dessen zerstörerische Hand verschont nichts von dem was lebt. Er tötet, um sich zu nähren, er tötet, um sich zu belehren, er tötet, um sich zu unterhalten, er tötet, um zu töten: Dieser stolze, grausame König hat Verlangen nach allem und nichts widersteht ihm. Dem Lamme reißt er die Gedärme heraus, um seine Harfe zum Klingen zu bringen, dem Wolf entreißt er seinen tödlichsten Zahn, um seine gefälligen Kunstwerke zu polieren, dem Elefanten die Stoßzähne, um ein Kinderspielzeug daraus zu schnitzen, seine Tafel ist mit Leichen bedeckt. Und welches Wesen löscht in diesem allgemeinen Schlachten ihn aus, der alle anderen auslöscht? Es ist er selbst. Dem Menschen selbst obliegt es, den Menschen zu erwürgen. Hört ihr nicht, wie die Erde schreit nach Blut? Das Blut der Tiere genügt ihr nicht, auch nicht das der Schuldigen, die durch das Schwert des Gesetzes fallen. So wird das große Gesetz der gewaltsamen Vernichtung aller Lebewesen erfüllt. Die gesamte Erde, die fortwährend mit Blut getränkt wird, ist nichts als ein riesiger Altar, auf dem alles, was lebt, ohne Ziel, ohne Haß, ohne Unterlaß geopfert werden muß, bis zum Ende aller Dinge, bis zur Ausrottung des Bösen, bis zum Tod des Todes."
Im Grunde ist dies nichts als eine, wenn auch mit rhetorischem Aplomb vorgetragene banalité supérieure, eine Zustandsbeschreibung, die keiner Aufregung wert ist. So wie es ist, ist es. Doch die Kindlein, sich auch noch die Reste der Skepsis entschlagend, die der frühen Aufklärung immerhin noch anhafteten, die dem Flittergold der humanitären Deklaration zugetan sind (auch, weil dieses sogar echtes Gold zu hecken vermag), die Kindlein, sie hörten es nicht gerne.
Der gläubige de Maistre, der trotz all seines oft zynisch wirkenden Dezisionismus unentwegt darauf beharrte, daß jede grenzenlose irdische Macht illegitim, ja widergöttlich sei und der zwar die Funktionalisierung des Glaubens betrieb, aber auch erklärte, daß deren Gelingen von der Triftigkeit des Glaubens abhing - er wurde flugs von einem bekannten Essayisten (Isaiah Berlin) zum natürlich 'paranoiden' Urahnen des Faschismus ernannt, während der ridiküle Sohn eines großen Ökonomen in ihm den verrucht-verrückten Organisator eines anti-weiblichen Blut- und Abwehrzaubers sah, einen grotesken Medizinmann der Gegenaufklärung. Zwischen sich und der Evidenz hat der Mensch eine unübersteigbare Mauer errichtet; da ist des Scharfsinns kein Ende.
Der hier und in ungezählten anderen Schriften sich äußernde Haß auf den am 1. April 1753 in Chanbéry/Savoyen geborenen Joseph de Maistre ist die Antwort auf dessen erst in seinem Spätwerk fulminant werdenden Haß auf die Aufklärung und die Revolution. Savoyen gehörte damals dem Königreich Sardinien an und der Sohn eines im Dienste der sardischen Krone stehenden Juristen wäre wohl das ehrbare Mitglied des Beamtenadels in einer schläfrigen Kleinstadt geblieben, ohne intellektuellen Ehrgeiz und allenfalls begabt mit einer außergewöhnlichen Liebenswürdigkeit und Höflichkeit in persönlich-privaten Dingen, die die "eigentliche Heimat aller liberalen Qualitäten" (Carl Schmitt) sind.
Der junge Jurist gehörte gar einer Freimaurer-Loge an, die sich aber immerhin kirchlichen Reunionsbestrebungen widmet; der spätere, unnachgiebige Kritiker des Gallikanismus akzeptiert diesen als selbstverständlich; gelegentlich entwickelte de Maistre sogar ein wenn auch temperiertes Verständnis für die Republik und die Revolution. Der Schritt vom aufklärerischen Scheinwesen zur Wirklichkeit gelang de Maistre erst als Vierzigjährigem: Als diese in Gestalt der französischen Revolutionstruppen einbrach, die 1792 Savoyen annektierten. De Maistre mußte in die Schweiz fliehen und verlor sein gesamtes Vermögen.
Erst dort gelang ihm seine erste, ernsthafte Schrift, die "Considérations sur la France" (Betrachtungen über Frankreich), die 1796 erschien und sofort in ganz Europa Furore machte: Die Restauration hatte ihr Brevier gefunden und hörte bis 1811 nicht auf, darin mehr zu blättern als zu lesen. Das Erstaunliche und viele Irritierende des Buches ist, daß de Maistre hier keinen Groll gegen die Revolution hegt, ja, ihr beinahe dankbar ist, weil sie seinen Glauben wieder erweckte. Zwar lag in ihr, wie er feststellte, "etwas Teuflisches", später hieß es sogar, sie sei satanique dans sons essence. Doch weil dies so war, hielt sich de Maistres Erschrecken in Grenzen. Denn wie das Böse, so existiert auch der Teufel nicht auf substantielle Weise, ist, wie seine Werke, bloße Negation, Mangel an Gutem, privatio boni. Deshalb wurde die Revolution auch nicht von großen Tätern vorangetrieben, sondern von Somnambulen und Automaten: "Je näher man sich ihre scheinbar führenden Männer ansieht, desto mehr findet man an ihnen etwas Passives oder Mechanisches. Nicht die Menschen machen die Revolution, sondern die Revolution benutzt die Menschen."
Das bedeutete aber auch, daß Gott sich in ihr offenbarte. Die Vorsehung, die providence, leitete die Geschehnisse und die Revolution war nur die Züchtigung des von kollektiver Schuld befleckten Frankreich. Die Furchtbarkeit der Strafe aber bewies Frankreichs Auserwähltheit. Die "Vernunft" hatte das Christentum in dessen Hochburg angegriffen, und solchem Sturz konnte nur die Erhöhung folgen. Die Restauration der christlichen Monarchie würde kampflos vonstatten gehen; die durch ihre Gewaltsamkeit verdeckte Passivität der Gegenrevolution, bei der die Menschen nicht minder bloßes Werkzeug sein würden. Ohne Rache, ohne Vergeltung, ohne neuen Terror würde sich die Gegenrevolution, genauer, "das Gegenteil einer Revolution", etablieren; sie käme wie ein sich sanftmütig Schenkender.
Die konkrete politische Analyse aussparen und direkt an den Himmel appellieren, wirkte das Buch als tröstende Stärkung. De Maistre mußte freilich erfahren, daß die Revolution sich festigte, daß sie sich ihre Institution schuf, daß sie schließlich, im Thermidor und durch Bonaparte, ihr kleinbürgerlich-granitenes Fundament fand.
Von 1803 bis 1817 amtierte de Maistre als ärmlicher, stets auf sein Gehalt wartender Gesandter des Königs von Sardinien, der von den spärlichen Subsidien des Zaren in Petersburg lebt - bis er aufgrund seiner lebhaften katholischen Propaganda im russischen Hochadel ausgewiesen wird. Hier entstehen, nach langen Vorstudien etwa ab 1809, seine Hauptwerke: "Du Pape" (Vom Papste), publiziert 1819 in Lyon, und "Les Soirées de Saint Pétersbourg" (Abendgespräche zu Saint Petersburg), postum 1821.
Die Unanfechtbarkeit des Papstes, von der damaligen Theologie kaum noch verfochten, liegt für de Maistre in der Natur der Dinge selbst und bedarf nur am Rande der Theologie. Denn die Notwendigkeit der Unfehlbarkeit erklärt sich, wie die anderer Dogmen auch, aus allgemeinen soziologischen Gesetzen: Nur von ihrem Haupte aus empfangen gesellschaftliche Vereinigungen dauerhafte Existenz, erst vom erhabenen Throne ihre Festigkeit und Würde, während die gelegentlich notwendigen politischen Interventionen des Papstes nur den einzelnen Souverän treffen, die Souveränität aber stärken. Ein unter dem Zepter des Papstes lebender europäischer Staatenbund - das ist de Maistres Utopie angesichts eines auch religiös zerspaltenen Europa. Da die Päpste die weltliche Souveränität geheiligt haben, weil sie sie als Ausströmungen der göttlichen Macht ansahen, hat die Abkehr der Fürsten vom Papst diese zu verletzlichen Menschen degradiert.
Diese für viele Betrachter phantastisch anmutende Apologie des Papsttums, dessen Stellung durch die Revolution stark erschüttert war, führte, gegen immense Widerstände des sich formierenden liberalen Katholizismus, immerhin zur Proklamation der päpstlichen Unfehlbarkeit durch Pius IX. auf dem 1869 einberufenen Vaticanum, mit dem der Ultramontanismus der modernen, säkularisierten Welt einen heftigen, bald aber vergeblichen Kampf ansagte.
Die "Soirées", das Wesen der providence, die Folgen der Erbsünde und die Ursachen des menschlichen Leidens erörternd, sind der vielleicht schärfste, bis ins Satirische umschlagende Angriff gegen den aufklärerischen Optimismus. Hier finden sich in tropischer Fülle jene Kraftworte de Maistres, die, gerade weil sie übergrelle Blitze sind, die Komplexität seines Werkes verdunkeln und es als bloßes reaktionäres Florilegium erscheinen lassen.
De Maistre, der die Leiden der "Unschuldigen" ebenso pries wie die der Schuldigen, weil sie nach einem geheimnisvollen Gesetz der Reversibilität den Pardon für die Schuldigen herbeiführen, der die Ausgeliefertheit des Menschen an die Erbsünde in wohl noch schwärzeren Farben malte als Augustinus oder der Augustinermönch Luther und damit sich beträchtlich vom katholischen Dogma entfernte, der nicht müde wurde, die Vergeblichkeit und Eitelkeit alles menschlichen Planens und Machens zu verspottern, - er mutete und mutet vielen als ein Monstrum an, als ein Prediger eines terroristischen und molochitischen Christentum.
Doch dieser Don Quijote der Laientheologie - doch nur die Laien erneuerten im 19. Jahrhundert die Kirche, deren Klerus schon damals antiklerikal war! -, der sich tatsächlich vor nichts fürchtete, außer vor Gott, stimmt manchen Betrachter eher traurig. Weil er, wie Don Quijote, zumindest meistens recht hatte. Sein bis ins Fanatische und Extatische gehender Kampf gegen den Lauf der Zeit ist ja nur Gradmesser für den tiefen Sturz, den Europa seit dem 13. Jahrhundert erlitt, als der katholische Geist seine großen Monumente erschuf: Die "Göttliche Komödie" Dantes, die "Siete Partidas" Alfons' des Weisen, die "Summa" des heiligen Thomas von Aquin und den Kölner Dom.
Diesem höchsten Punkt der geistigen Einheit und Ordnung Europas folgte die sich stetig intensivierende Entropie, die, nach einer Prognose eines sanft gestimmten Geistesverwandten, des Nordamerikaners Henry Adams (1838-1918), im zwanzigsten und einundzwanzigsten Jahrhundert zur völligen spirituellen, aber auch politischen und sittlichen Anomie führen würde.
Der exaltierte Privatgelehrte, der in St. Petersburg aufgrund seiner unbedeutenden Tätigkeit genug Muße fand, sagte als erster eine radikale, blutige Revolution in Rußland voraus, geleitet von einem "Pugatschev der Universität", was wohl eine glückliche Definition Lenins ist. Die Prophezeiung wurde verlacht, war Rußland doch für alle ein Bollwerk gegen die Revolution. Er entdeckte, neben Louis Vicomte de Bonald (1754-1840), die Gesetze politisch-sozialer Stabilität, die Notwendigkeit eines bloc des idées incontestables, Gesetze, deren Wahrheit sich gerade angesichts der Krise und des sozialen Atomismus erwies: Ohne Bonald und de Maistre kein August Comte und damit auch keine Soziologie, deren Geschichte hier ein zu weites Feld wäre. De Maistre, Clausewitz vorwegnehmend und Tolstois und Stendhals Schilderung befruchtend, erkannte als erster die Struktur der kriegerischen Schlacht und begriff, daß an dem großen Phänomen des Krieges jedweder Rationalismus scheitert; der Krieg war ihm freilich göttlich, nicht wie den meist atheistischen Pazifisten ein Teufelswerk; auch ihn durchwaltete die providence.
Endlich fand de Maistre den Mut zu einer realistischen Anthropologie, die Motive Nietzsches vorwegnahm und die der dem Humanitarismus sich ausliefernden Kirche nicht geheuer war: Der Mensch ist beherrscht vom Willen zur Macht. Vom Willen zur Erhaltung der Macht, vom Willen zur Vergrößerung der Macht, von Gier nach dem Prestige der Macht. Diese Folge der Erbsünde bringt es mit sich, daß, so wie die Sonne die Erde umläuft, der "Engel der Vernichtung" über der Menschheit kreist - bis zum Tod des Todes.
Am 25. Februar 1821 starb Joseph de Maistre in Turin. "Meine Herren, die Erde bebt, und Sie wollen bauen!" - so lauteten seine letzten Worte zu den Illusionen seiner konservativen Freunde. Das war doch etwas anderes als - Don Quijote.
Joseph de Maistre (1753-1821): Außer der Ehre keine Sorge, lautete der Wahlspruch des Savoyarden, und zu seiner Ehre gehörte es, immer unvermittelter und schonungsloser das Seine zu sagen
Günter Maschke lebt als Privatgelehrter und Publizist in Frankfurt am Main. Zusammen mit Jean-Jacques Langendorf ist er Hausgeber der "Bibliothek der Reaktion" im Karolinger Verlag, Wien. Von Joseph de Maistre sind dort die Bücher "Betrachtungen über Frankreich", "Die Spanische Inquisition" und "Über das Opfer" erschienen.
00:10 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, contre-révolution, conservatisme, révolution française, révolution, hommage, savoie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
USA: l'intégration forcée a-t-elle fait faillite?
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1995
USA: l'intégration forcée a-t-elle fait faillite?
 Louis Farrakhan n'est pas le seul Américain qui exprime aujourd'hui du scepticisme à l'égard de l'idéal d'intégration raciale. Tony Brown, Républicain noir et hôte de la chaîne de télévision PBS, condamne, lui aussi, cette tendance contemporaine à l'“assimilation raciale”. Voici son argument majeur: «Nous pouvons rester séparés racialement tout en maintenant une nation saine et productive». Clarence Thomas, de la Cour Suprême de Justice, a condamné les projets d'intégration scolaire fondés sur le principe que les non-Blancs doivent s'asseoir à côté des Blancs dans les école pour acquérir de l'éducation (!). Tant parmi les Noirs que parmi les Blancs, le projet d'intégration est respecté par conformisme et non plus par conviction réelle, comme l'indique du reste le fait patent que dans tous les domaines sociaux où l'intégration n'est pas imposée par coercition, les races choisissent toutes de vivre séparément. Dans les églises, les prisons, à l'armée, dans les équipes professionnelles d'athlétisme, sur les campus universitaires, les races suivent toutes leur propre voie. Nous avons donc affaire à une ségrégation que les gens, toutes races confondues, s'imposent spontanément à eux-mêmes: reste à savoir si cet état de choses est aussi choquant et aussi indésirable que les commentateurs médiatiques veulent nous le faire croire...
Louis Farrakhan n'est pas le seul Américain qui exprime aujourd'hui du scepticisme à l'égard de l'idéal d'intégration raciale. Tony Brown, Républicain noir et hôte de la chaîne de télévision PBS, condamne, lui aussi, cette tendance contemporaine à l'“assimilation raciale”. Voici son argument majeur: «Nous pouvons rester séparés racialement tout en maintenant une nation saine et productive». Clarence Thomas, de la Cour Suprême de Justice, a condamné les projets d'intégration scolaire fondés sur le principe que les non-Blancs doivent s'asseoir à côté des Blancs dans les école pour acquérir de l'éducation (!). Tant parmi les Noirs que parmi les Blancs, le projet d'intégration est respecté par conformisme et non plus par conviction réelle, comme l'indique du reste le fait patent que dans tous les domaines sociaux où l'intégration n'est pas imposée par coercition, les races choisissent toutes de vivre séparément. Dans les églises, les prisons, à l'armée, dans les équipes professionnelles d'athlétisme, sur les campus universitaires, les races suivent toutes leur propre voie. Nous avons donc affaire à une ségrégation que les gens, toutes races confondues, s'imposent spontanément à eux-mêmes: reste à savoir si cet état de choses est aussi choquant et aussi indésirable que les commentateurs médiatiques veulent nous le faire croire...
Les Américains Noirs et Blancs vivent dans des univers mentaux fort différents, ce qui les conduit à percevoir hommes et choses de façons différentes. On pouvait s'en apercevoir bien avant les réactions divergentes qui ont secoué les deux communautés à la suite du verdict du procès O.J. Simpson. Les sondages ont montré qu'un grand nombre de Noirs croient aujourd'hui que les armes à feu et les drogues ont été délibérément introduites dans leur communauté par les Blancs, afin d'accélérer leur destruction. Un tiers des Afro-Américains prétendent que le SIDA a été inventé par les Blancs pour exterminer les Non-Blancs.
Que les différences raciales soient d'ordre génétique ou non, une chose est certaine, c'est qu'elles sont profondément ancrées en l'homme. Quarante ans de subventions à grande échelle et d'assistance spéciale en matières juridiques et sociales n'ont pas changé grand'chose à cette réalité. Bien au contraire, les races semblent diverger encore davantage. La sagesse politique la plus largement acceptée répète, de façon finalement fort simpliste: «Nous devons nous montrer plus compréhensifs et apprendre à vivre ensemble». Mais peut-être est-il temps que les Américains tiennent compte du nombre sans cesse croissant de citoyens, toutes races confondues, qui disent: «Notre faculté de comprendre est en ordre, et nous ne désirons plus vivre ensemble».
D'aucuns répondront qu'il s'agit là d'une réaction exagérée, négative et condamnable aux maux d'ordres économique et social qui frappent la nation toute entière. Et ces mêmes personnes vous diront qu'il ne faut pas désespérer, que les tensions interethniques vont diminuer dès que les groupes bénéficieront d'un même niveau de vie élevé, ou dès que le racisme des Blancs disparaîtra, ou dès que les problèmes liés à la pauvreté seront éliminés d'une façon ou d'une autre. Mais même si tous ces objectifs désirables seront un jour atteints, la question demeurera ouverte: les citoyens ont-ils le droit, voire l'obligation, de survivre en première instance en tant que groupe homogène, uni par une identité commune, sur base d'un héritage biologique commun?
En tant que Juif hassidique, mes sympathies vont tout naturellement vers ce désir puissant de conserver, de maintenir et d'entretenir un mode de vie distinct de tous les autres. La culture aujourd'hui dominante aux Etats-Unis tolère de tels sentiments quand ils sont exprimés par des minorités mais considère que ces mêmes sentiments sont “mauvais” quand les Blancs les expriment. Les Noirs et les Hispaniques ont pourtant clairement exprimé leur désir de suivre leurs propres voies dans le domaine de l'instruction publique, dans le maintien de l'ordre et dans les gouvernements locaux; ils veulent par ailleurs que leurs enfants continuent à parler la langue de leurs ancêtres, apprennent la geste de leurs héros nationaux, et soient éduqués selon les critères de leurs propres cultures et non pas selon les critères des Blancs. Ce sont là des sentiments humains bien naturels; sont-ils mauvais? Doivent-ils être tolérés chez les Non-Blancs et refoulés chez les Blancs?
Si l'on interroge l'histoire, on constate que des Américains célèbres comme Abraham Lincoln ou le leader noir Marcus Garvey ont pensé qu'une séparation des races, acceptées par les uns comme par les autres, dans le respect mutuel, était la meilleure solution pour tous les Américains, quelle que soit la race à laquelle ils appartiennent. Les idées de Lincoln et de Garvey pourraient-elles redevenir les nôtres? Une chose est d'ores et déjà certaine, les efforts visant à donner davantage d'espace libre et autonome aux races conduiront à éliminer tous les discours sur la supériorité de telle ou telle race et à affirmer le principe moral que tous les groupes ethniques possèdent un droit égal à l'auto-détermination. Les Non-Blancs semblent plus capables de trouver leur voie et de s'élever au rang d'une culture solide, à part entière, lorsqu'ils se débarrasseront une bonne fois pour toutes de ses béquilles incapacitantes que sont le recours constant au “racisme blanc” et les subsides des contribuables blancs. En avançant ses arguments pour défendre sa notion personnelle de la séparation future entre les races aux Etats-Unis, Tony Brown, le Républicain noir, affirme que les arrangements multiracialistes actuels ne font qu'accentuer le paternalisme blanc et que susciter le racisme violent des Blancs comme des Noirs. Chaque groupe racial, poursuit-il, doit être égal en dignité, dans le respect mutuel.
Aristote croyait, pour sa part, que le ciment qui lie les citoyens d'un pays est constitué par le sens de la communauté et par l'amitié entre tous. Aristote nous a également enseigné que l'amitié ne s'épanouit que lorsque tous les citoyens jouissent plus ou moins d'une égalité de condition. En Amérique, cette égalité de condition pourra sans doute s'obtenir par un abandon de cette politique d'intégration forcée, pratiquée depuis quelques décennies.
Les esprits critiques nous rétorqueront peut-être que, même si elle n'est pas foncièrement immorale en dernière instance, la séparation ne peut être mise en pratique. Je peux très bien admettre cette argumentation, car le processus de séparation des races actuellement mêlées sur le territoire ne se fera pas sans âpres discussions. Chaque groupe doit dire à l'autre: «Oui, c'est évident, vous souhaitez avoir votre propre place pour déployer votre propre socialité, vous voulez des écoles dans votre proximité, où vos enfants pourront étudier et aimer votre culture spécifique. Cela, nous aussi, nous le voulons». Dans la simplicité de cet argument, les hommes de bonne volonté retrouveront aisément le plaidoyer de la plupart des conservateurs en faveur d'un gouvernement décentralisé et les concepts avancés par la “Nouvelle Gauche” qui veut généraliser partout sur le territoire américain le principe de l'“action locale”, seule condition pratique capable de rapprocher les gouvernants des gouvernés.
Accorder à des communautés basées sur des affinités culturelles électives une plus grande auto-détermination implique de délester de leur graisse inutile les léviathans de l'Etat fédéral (i. e. “central” aux USA, ndt). Un premier pas dans ce sens serait de supprimer les lois qui encouragent la discrimination en faveur de certains groupes dans le secteur public, de même que les lois qui interdisent toutes formes de préférence au niveau privé. A long terme, nous allons sans doute voir les comtés, les “voisinages”, les états et les régions se pencher sur les moyens d'organiser une sécession, comme le Québec est en train de le faire actuellement. Certes, les expériences en matière d'intégration mandatée pourront continuer à se faire, dans des circonscriptions ad hoc (mais nous verrons bien combien de familles libérales de gauche blanches opteront réellement pour que leurs enfants y vivent et y fréquentent l'école).
A la lecture de mes arguments, vous pourriez parfaitement me reprocher de naviguer dans l'absurbe. Avec l'oeil d'un citoyen de 1995, c'est peut absurde, en effet. Mais a-t-on envisagé dans les années 60 que l'Amérique deviendrait ce chaudron bouillonnant, prêt à exploser, où les races se regardent en chiens de faïence et sont sur le point de s'affronter? Une prophétie aussi noir aurait été jugée incongrue il y a trente ans.
La séparation dans le respect mutuel ne signifie par l'indifférence à l'égard du sort des autres groupes, car nous pouvons remplir nos devoirs moraux et religieux à l'égard des Autres sans les incorporer de force dans notre propre culture et sans leur imposer nos propres critères de comportement. Ensuite, un abandon de l'intégration forcée ne signifie pour autant que les différences raciales sont la source de tous les échecs culturels et sociaux de notre époque contemporaine. Nous sommes confrontés à des problèmes sociaux de bien plus grande envergure mais je crois que de nouvelles occasions vont s'ouvrir aux Américains, s'ils parviennent à se donner plus de marge de manœuvre en obéissant aux multiples spontanéités qui sont en eux et qu'ils ont héritées de leurs ancêtres si différents les uns des autres. Une intégration forcée dans une société multiraciale artificielle impliquerait un abandon de ce vaste éventail de différences et de potientialités enrichissantes.
Rabbi MAYER-SCHILLER.
(Rabbi M-Sch. enseigne le Talmud à la “Yeshiva University High School”, New York City).
00:05 Publié dans Sociologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : etats-unis, amérique, intégration, melting pot, multiculture, multiculturalisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 18 février 2010
Lesrévolutions de couleur à l'assaut du Heartland
Les révolutions de couleur à l’assaut du Heartland
 Le concept à été popularisé dans les années 2000, pour définir les " transformations politiques dans l’espace post soviétique". C’est du moins la façon dont cela nous a été présenté. En fait, le concept est bien plus ancien, puisqu’il date des années 80, en pleine guerre froide. A l’époque le gouvernement Reagan nous l’avons vu a financé et développé une kyrielle d’institutions, d’organisations destinées à "contrer" par tous les moyens non violents l’influence Soviétique. La plupart étant nous l’avons démontré liées structurellement et bénéficiant de financement indirect du gouvernement Américain via l’USAID. En plus de la NED et de son réseau tentaculaire, en 1983 sera créé l’USIP, et l’Albert Einstein Institution. Cette dernière organisation était initialement chargée d’imaginer une forme de défense civile pour les populations d’Europe de l’Ouest en cas d’invasion par le Pacte de Varsovie. Elle a rapidement pris son autonomie et modélisé les conditions dans lesquelles un pouvoir étatique, de quelque nature qu’il soit, peut perdre son autorité et s’effondrer. Le concept des révolutions de couleurs, soit d’organiser des coups d’états sans violences était né.
Le concept à été popularisé dans les années 2000, pour définir les " transformations politiques dans l’espace post soviétique". C’est du moins la façon dont cela nous a été présenté. En fait, le concept est bien plus ancien, puisqu’il date des années 80, en pleine guerre froide. A l’époque le gouvernement Reagan nous l’avons vu a financé et développé une kyrielle d’institutions, d’organisations destinées à "contrer" par tous les moyens non violents l’influence Soviétique. La plupart étant nous l’avons démontré liées structurellement et bénéficiant de financement indirect du gouvernement Américain via l’USAID. En plus de la NED et de son réseau tentaculaire, en 1983 sera créé l’USIP, et l’Albert Einstein Institution. Cette dernière organisation était initialement chargée d’imaginer une forme de défense civile pour les populations d’Europe de l’Ouest en cas d’invasion par le Pacte de Varsovie. Elle a rapidement pris son autonomie et modélisé les conditions dans lesquelles un pouvoir étatique, de quelque nature qu’il soit, peut perdre son autorité et s’effondrer. Le concept des révolutions de couleurs, soit d’organiser des coups d’états sans violences était né.Grèce 2008 : des manifestations estudiantines paralysent la Grèce à la suite du meurtre d’un jeune homme de 15 ans par un policier. Rapidement des casseurs font leur apparition. Ils ont été recrutés au Kosovo voisin et acheminés par autobus. Les centres-villes sont saccagés. Washington cherche à faire fuir les capitaux vers d’autres cieux et à se réserver le monopole des investissements dans les terminaux gaziers en construction. Une campagne de presse va donc faire passer le gouvernement Karamanlis pour celui des colonels et entrainer un changement de premier ministre pour permettre la nomination de Papandreaou.
00:15 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : révolution, politique internationale, eurasisme, eurasie, révolutions de couleur |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Die Türkei und die angelsächsischen Mächte

Robert Steuckers:
Die Türkei und die angelsächsischen Mächte
Geschichte der britischen und amerikanischen Einmischungen im Raum Mittel-Osten
Beziehungen mit der Türkei
Auszug aus einer Rede - Gehalten in Bayreuth für die Gesellschaft für Freie Publizistik (April 2006)
Wenn England 1759 Weltreich wird, nachdem Indien und Kanada völlig unter dessen Kontrolle kommen, galt von damals ab die Regel, die schwächste Macht Europas als Bundgenosse zu haben, um die Stärkste auszuschalten. Auch werden zu dieser Zeit die Landmassen zwischen den europäischen Hoheitsgebieten und Indien strategisch wichtig. Keine Macht sollte die beherrschen und somit Indien bedrohen. Nichts scheint zwischen 1759 und 1783 die Alleinherrschaft Englands in der Welt zu verhindern. Im Schicksalsjahr 1783 ändern sich die strategischen Gegebenheiten: Ludwig XVI. von Frankreich rächt sich für den Verlust Indiens und Kanadas, indem er als Ehemann der Kaiserschwester Marie-Antoinette und Bundgenosse des deutschen Kaisers, die britische Flotte in Yorktown während der amerikanischen Unabhängigkeitskrieg zerstört; zur gleichen Zeit eroberten die Armeen der russischen Kaiserin Katharina die Krim, die ein Stützpunkt im Schwarzen Meer wird, bloss sieben Jahre nachdem die russische Flotte im Mittelmeer 1779 erfolgreich die ottomanische bekämpft hatte. Zwei kontinentale Mächte behaupten sich so auf dem Meer. Die Antwort der Britten wurde 1791 dargestellt in einem anonymen Memorandum, das „Russian Armament“ als Titel trug. In diesem Dokument befanden sich schon alle Elemente und Kriterien des „containments“ Russlands. Dabei wurde das ottomanische Reich als ein Riegelterritorium gegen jede russische Ausdehnung in der Richtung des Mittelmeeres, Ägyptens, des persischen Golfes und des Indischen Ozeans betrachtet. Zehn Jahre später, im Jahre 1801, wenn der Zar Paul I. zusammen mit Napoleon eine Eroberung Indiens plant, bevor er mysteriös Opfer eines Mordes wurde, entwickelten die Londonschen Gremien die Strategie, alle mögliche Völker und Stämme des „rimlands“ als potentielle Verriegelungselemente zu benutzen, damit die Armeen des Zaren nie die Ufer des Indischen Ozeans erreichten. In 1828, wenn unter russischem Druck Griechenland unabhängig wurde, wird England systematisch die türkische Rechte auf den Seestrassen verteidigen und dabei für sich selbst das Recht, diese Seestrassen zu befahren, eisen. Wenn im gleichen Jahr Persien auch durch die russischen Armeen besiegt wurde, wurde die russische Gefahr noch grösser in den Augen Englands. Russland besetzte von jetzt ab Nord- und Südkaukasien und bedrohte damit sehr ernst die Integrität des ottomanischen Hoheitsgebietes, indem Russland sich als Aufgabe gab, die rechtsgläubige Christenheit vom türkischen Joch zu befreien. Der Krimkrieg war die Rache Englands und beim Pariser Vertrag von 1856 wurde Russland dazu behindert, seine Schiffe über die Meerstrassen fahren zu lassen. Im 1877-78, erreicht Russland einen militärischen Sieg nach einigen Feldzügen im Balkan aber eine diplomatische Niederlage in Berlin in 1878.
Die zweite Politik der Türkei gegenüber
Nachdem das ottomanische Reich ab ungefähr 1890 zusammen mit den II. Reich eine gemeinsame Politik rund der Bagdad-Bahn zu entwickeln begann, fingen die Londonschen Gremien an, eine neue türkische Politik zu entwickeln, nämlich eine, die die Zerstückelung des ottomanischen Reichsgebietes vorsah. Das Hauptinstrument, das in diesem Sinn geschmiedet wurde, war die Schaffung eines anti-türkischen arabischen Nationalismus. Die englische Unterstützung des arabischen Nationalismus entfaltete sich in zwei Stufen : In der ersten dieser Stufen unterstützten protestantische angelsächsische Institute oder Stiftungen einen liberal-verwestlichen Arabismus, den die Türken schnell grausam niederhalten werden, mit öffentlichen Hinrichtungen von liberalen Intellektuellen in Beirut und Damas. Nach dem Scheitern dieses Versuches, wobei festgestellt musste, dass der Liberalismus überhaupt keine Anziehungskraft im arabischen Raum hatte, brauchte dringend eine neue Strategie geschmiedet zu werden. Die Stämme Arabiens sollten dann „bearbeitet“ werden und dabei ihre beduinische Identität bewahren, damit sie als „nützliche“ Barbaren der Peripherie gegen das Zentrum oder zumindest gegen Zentren des ottomanischen Reiches am rechten Zeitpunkt gebraucht werden könnten. Aber die Stämme waren gegeneinander tief befeindet seit den blutigen Ereignissen des 19. Jahrhunderts : im Norden herrschte Hussein über die Hedschas-Stämme und etwa südlicher, herrschte Saud im Neschd. Die strategischen Schwierigkeiten, die die Briten zu lösen hatten, waren hauptsächlich dazu orientiert, es zu vermeiden, dass die südlichsten Stämme als Rückenbundgenossen der Türken eventuell funktionieren könnten. Aber die wahhabitischen Neschd-Stämme waren seit der grausamen Repression von Mehmet Ali und Ibrahim Pascha von einem zu tiefen Hass den Ottomanen und Ägyptern gegenüber belebt, um sich instrumentalisieren zu können. Hussein im Hedschas war am Anfang eher dazu geneigt, die Türken zu Hilfe zu können; Die diplomatische Fähigkeiten des Lawrences und seine guten Kenntnisse des arabischen Stammessystems erlaubten es, Hussein für die Sache der Briten zu gewinnen. So entstand was man heute wieder die „Insurgency-Strategie“ nennt; die wurde nochmals kürzlich im Afghanistan angewendet. Türken und Deutschen werden trotzdem aber erfolglos Rückenbundgenossen haben : die Schiiten des Jemens und die Senussisten entlang der ägyptisch-libyschen Grenze. Die Jemeniten werden eigentlich nicht viele britische Truppen festhalten. Die Senussisten werden „raids“ bis tief in der südalgerischen Wüste veranstalten, die dann eine Revolte im marokkanischen berbersprechenden Mittelatlas-Gebirge entzündet haben. Dort werden wohl viele französische Regimenter festgehalten.
Echtes Ziel der britischen Tätigkeiten in der arabischen Halbinsel war selbstverständlich, die Ölfelder zu kontrollieren und, nach der Ausschaltung der mit dem Reich befreundeten Türkei und des jungtürkischen Regimes, eine Türkei ohne Öl zu schaffen. Kennzeichnet für diesen Prozess ist die Mossul-Frage; Das an Ölfelder reiche Mossul-Gebiet im nördlichen kurdischsprechenden Teil des heutigen Iraks gehörte dem Ottomanischen Reich, wurde Frankreich im Text der 1916 Sykes-Picot-Agreements versprochen und, nach späteren Nachkriegsdiskussionen rasch dem englischen Protektorat Irak angeschlossen, weil dort umfangreiche Ölreserven von britischen Geologen entdeckt wurden. So wurden zwei Fliegen in einer Klappe erledigt: sowohl Frankreich als die neue Türkei blieben manipulierbare ölarme Mächte, die keine eventuelle Herausforderungen stellen konnten.
In der Zwischenkriegszeit, schlug die Stunde des Ibn Sauds. Nach langen Kämpfen und mit Hilfe der Ichwan-Bewegung, befestigte er seine Macht über das heutige Saudi-Arabien, nur mit der Ausnahme des Südens unter britischer Obhut.
Die Politik der Türkei gegenüber nach 1945
Nach der deutschen Niederlage in Europa 1945, erhielt die Türkei wieder ihre Rolle als Riegelterritorium wie zur Zeit Napoleons. In 1942 hatten die pantürkischen Nationalisten auf einem deutschen Sieg gesetzt, in der Hoffnung im Kaukasus unter den dort lebenden Türkenvölker erneut Einfluss zu gewinnen. In einem Schauprozess, unmittelbar bevor die Türkei rein formell Deutschland den Krieg 1945 erklärte, wurden die Pantürkisten zu langen Haftstrafen verurteilt aber nach ein Paar Wochen oder Monate wieder freigelassen. 1949 trat die Türkei die NATO bei, wobei die Armee die Hüterin des Laizismus und des Verwestlichungsprozesses wurde. Der Blutzoll als Eintrittspreis zahlte diese Armee während des Koreakrieges. Aber wenn der Ministerpräsident Menderes 1960 für eine lockere Haltung der Religion gegenüber plädierte, wurde er rasch durch einen Armeeputsch gestürzt, und nach einem kurzen Verfahren öffentlich gehenkt (Bild hierunten). So wurde der Türkei die am meist geliebte verbündete Macht bis Bush Junior.
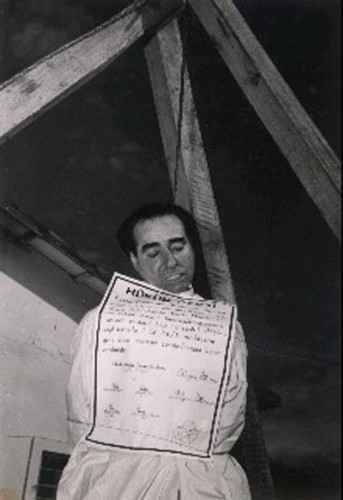 Interessant ist es, die Clintonsche Politik der Türkei gegenüber zu analysieren: der amerikanische Präsident versprach, unter anderem während eines offiziellen Besuchs in Istanbul und Ankara, die Türkei wieder eine Rolle im Balkan nach der Unabhängigkeit Bosniens spielen zu lassen, die EG-Kandidatur der Türkei zu unterstützen, eine Schlüsselrolle in der Ausschaltung des Iraks mitspielen zu lassen, und ihr eine getarnte und faktische Anwesenheit im ölreichen nordirakischen ethnisch-kurdischen Mossul-Gebiet zu garantieren. So hätte die Türkei als Preis einer Intervention an der Seite der US-Amerikaner eine Teilnahme in der Ölförderung in diesem kurdischen Gebiet gewonnen.
Interessant ist es, die Clintonsche Politik der Türkei gegenüber zu analysieren: der amerikanische Präsident versprach, unter anderem während eines offiziellen Besuchs in Istanbul und Ankara, die Türkei wieder eine Rolle im Balkan nach der Unabhängigkeit Bosniens spielen zu lassen, die EG-Kandidatur der Türkei zu unterstützen, eine Schlüsselrolle in der Ausschaltung des Iraks mitspielen zu lassen, und ihr eine getarnte und faktische Anwesenheit im ölreichen nordirakischen ethnisch-kurdischen Mossul-Gebiet zu garantieren. So hätte die Türkei als Preis einer Intervention an der Seite der US-Amerikaner eine Teilnahme in der Ölförderung in diesem kurdischen Gebiet gewonnen.
Die Verwaltung des Bush Juniors hat diese Lösung abgelehnt, was die Beziehungen zwischen Washington und Ankara stark gekühlt hat. Zeichen dieser Verschlechterung sind die Bücher von jungen türkischen Autoren wie Burak Turna und Orkun Ucar. In einem Roman, der einen Riesenerfolg in der heutigen Türkei gekannt hat und dessen Titel „Metal Firtina“ (d. h. „Metallsturm“) ist, erwähnen einen künftigen Krieg gegen die Türkei, die am Ende durch eine deutsch-französisch-russische Allianz gerettet wird. Ein anderer Roman fantasiert über einen Bündnis zwischen Russland und der Türkei, der Europa erobert und es von der amerikanischen Einflusssphäre befreit. Die Enttäuschung in der Türkei ist sehr gross, seitdem die US-Amerikaner der Clintonschen Politik nicht gefolgt haben. Die Türkei bleibt ein ölarmes Land und gewinnt keine Ausdehnungsmöglichkeit mehr. Die Lage ist heute interessant zu beobachten. Die grösste strategische Dummheit der neokonservativen Bush-Gremien ist eben, den Verlust der türkischen Bundgenossenschaft ausgelockt zu haben.
(weitere Auszüge dieser Rede folgen).
00:12 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, turquie, politique internationale, géopolitique, etats-unis, empire birtannique, proche orient, asie mineure, méditerranée |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Réalité virtuelle et économie
Archives de Synergies Européennes - 1995
RÉALITÉ VIRTUELLE ET ÉCONOMIE
 La lecture d'Aristote nous enseigne que l'argent naquit pour faciliter le troc, et que dès lors il est une convention, un artifice, un signe. Ce signe alimenta l'imagination et développa l'illusion qui corrompit les âmes et les sociétés, car il magnifia la richesse créée par l'argent-papier en lieu et place de la richesse réelle issue de la production de biens et de services. L'éthique aristotélicienne se fondait sur le concept de la limitation des richesses; tant que l'économie de troc fonctionnait, il ne pouvait y avoir de richesse illimitée car, par exemple, la récolte de grains est limitée comme le sont les semailles. Mais l'argent introduisit le concept de richesse illimitée; et contrairement aux grains de céréales, les monnaies peuvent s'accumuler indéfiniment, et quand cela survient, la richesse se transforme en une fin en soi, et non plus en un moyen; l'homme ne vit plus de la richesse, il vit pour elle.
La lecture d'Aristote nous enseigne que l'argent naquit pour faciliter le troc, et que dès lors il est une convention, un artifice, un signe. Ce signe alimenta l'imagination et développa l'illusion qui corrompit les âmes et les sociétés, car il magnifia la richesse créée par l'argent-papier en lieu et place de la richesse réelle issue de la production de biens et de services. L'éthique aristotélicienne se fondait sur le concept de la limitation des richesses; tant que l'économie de troc fonctionnait, il ne pouvait y avoir de richesse illimitée car, par exemple, la récolte de grains est limitée comme le sont les semailles. Mais l'argent introduisit le concept de richesse illimitée; et contrairement aux grains de céréales, les monnaies peuvent s'accumuler indéfiniment, et quand cela survient, la richesse se transforme en une fin en soi, et non plus en un moyen; l'homme ne vit plus de la richesse, il vit pour elle.
Le Moyen Age condamna le développement des taux d'intérêt, considérés comme anti-naturels sur base d'une éthique aristotélicienne; cependant, le judaïsme et le protestantisme les prirent à leur compte, développant ainsi le commerce et l'économie en général. Actuellement, les chroniques économiques journalières qui nous retracent les turbulences économico-financières mondiales nous révèlents par la même occasion l'hégémonie décisive de la sphère financière sur le plan réel de la production, l'investissement, l'emploi et le salaire. Ceci est un phénomène à portée planétaire, mais dont le pouvoir de nuisance nous semble se manifester avec une véhémence toute particulière dans les économies périphériques (notamment en Amérique latine, ndt), excessivement dépendantes des financements externes. La globalisation financière est à l'origine de la concetration d'énormes actifs dans les mains de quelques méga-opérateurs qui obtiennent de forts taux d'intérêt, aux dépens des pays périphériques qui se trouvent ainsi sous leur pouvoir direct. Du reste, il est significatif que le commerce mondial ne dépasse pas 4000 milliards de dollars tandis que l'argent électronique qui circule dans le “marché ouvert” atteindra les 210.000 milliards à la fin de 1995.
En 1990, le Prix Nobel d'économie fut octroyé à un trio de fins connaisseurs dans l'art de maximiser les rentes speculatives: Harry Markowitz, Merton Miller et William Sharpe. Plus tard, en 1991 (Ronald Coase) et en 1994 (John Nash, Reinhard Selten et Janos Harsanyi), les Prix Nobel récompensèrent les travaux apportant les signes d'une science encore plus fine dans ce domaine. Nous y voyons une manifestation éblouissante de la dérive financière et des significations qu'elle est en mesure de proposer. Sous le doux euphémisme de “produits dérivés”, l'ingénierie financière sauvage invente tout un large éventail d'accords financiers d'où naît une immense timballe financière grâce à laquelle des sommes énormes peuvent être gagnées après avoir parié des sommes bien plus minimes. Spéculer avec des instruments aussi volatiles crée des risques élevés: dès que le moindre maillon de la chaîne s'interrompt, il en résulte des pertes astronomiques; par exemple, si un pays en voie de développement entre en cessation de paiements, ce sont des milliards de dollars “dérivés” qui volent instantanément en fumée.
Un système développé de satellites, ordinateurs et autres moyens technologiques à portée globale amplifient la dimension des transactions financières de tous types qui débordent le monde de l'économie réelle, en rapidité comme en intensité. L'argent électronique dégage une chaleur moite: cette fiction est propice au pullulement de la faune “yuppy”, qui jongle tour à tour avec des profits mirobolants et avec des banqueroutes foudroyantes, au rythme éperdu des capitaux lancés dans leur course à travers les divers marchés de capitaux.
A l'ère de la réalité virtuelle, quand les signes se rebellent envers les réalités, il est nécessaire de récupérer l'essence des valeurs philosophiques. Les finances doivent être remises dans un état de subordination à l'égard des productions réelles de biens et de services, car c'est de là que des possibilités naissent pour l'être humain de se réaliser en tant que tel. La dépendance des populations humaines envers le pouvoir diffus et essentiellement cruel du monde financier est extrêmement dangereuse, elle annule le pouvoir décisionnel des gouvernements et ne saurait avoir qu'un impact social traumatique. Les stratégies de développement qu'il nous faut créer, une fois pour toutes, seraient basées sur la production et les exportations: la production des choses au-dessus du règne des signes.
Manuel Agustin GAGO.
(article tiré de Disenso, n°4, hiver 1995).
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : philosophie, économie, sociologie, modernité, postmodernité, réalité virtuelle, argentine, amérique du sud, amérique latine |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 17 février 2010
Russie: ce qui va changer en 2010!
Russie : ce qui va changer en 2010
 Au premier janvier 2010 :
Au premier janvier 2010 :
13:15 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, russie, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Islamfundamentalismus, öl und angelsächsische Weltmächte

Robert STEUCKERS:
Islamfundamentalismus, Öl und angelsächsische Weltmächte
Auszug aus einer Rede - Gehalten in Bayreuth für die Gesellschaft für Freie Publizistik (April 2006)
Eine erste Idee, um das Thema „Sturm auf Europa“ hier einzuleiten: Dem Rest der Welt gegenüber, sagen einige falschen Propheten Europas, sollte man die Strategie des Igels wählen. Das könnte zwar eine gute Idee sein, um seine Kräfte zu versammeln, ohne messianisch wie die VSA, anderen Völkern unsere Prinzipien oder politischen Modellen aufpropfen zu wollen und dabei unsere Grenzen zu verriegeln, um eine gefürchtete „Umvolkung“ zu vermeiden. Aber gezwungen sind wir alle doch, festzustellen, dass es dem Igel an Bewegungskraft fehlt. Genauso wie Admiral Tirpitz und der Geopolitiker Ratzel einst sagten, brauchen die Kontinentalmächte schwimmen zu können, also sich der Weite der Weltozeanen zu öffnen. Jetzt brauchen sie auch fliegen zu können, d. h. ihre Luftwaffekapazitäten zu entwickeln, und eben auch sehr hoch zu fliegen, bis zu den stratosphärischen Ebenen, da Gesamteuropa strategische Trabanten ziviler und militärischer Nützlichkeit braucht, um in der künftigen Welt konkurrenzfähig zu werden.
Eine zweite Idee, um das heutige Thema nochmals einzuleiten: Die Notwendigkeit, die Sachlage kühl, sachlich, ohne Floskelngefühle jeder Art zu analysieren. Die Hauptfrage zu beantworten kann wirklich ohne Panik oder Schadenfreude passieren. Es genügt zu fragen: Wie funktioniert dieser „Sturm“? Die Antwort sollte aus Sachen, Fakten und ohne fromme Wünsche bestehen. Hier ein Paar Beispiele:
- Die Immigration aus afrikanischen bzw. arabisch-islamischen Ländern ist zwar ein Problem ungeheueren Umfangs, sie bleibt trotzdem ein Problem zweiten Ranges, da sie nicht als ein Phänomen an sich betrachtet werden sollte, sondern als das effizientste Instrument des Hauptfeindes. Darf man also wie Samuel Huntington von einem Gegeneinanderprallen von Kulturen sprechen? Meine Antwort ist : Jein! Gegen diejenigen, die Huntington banalisieren oder vulgarisieren, sage ich, dass ein solches Gegeneinanderprallen der Kulturen immer schon da war, und hat, was Europa und den Islam betrifft, fast ein Jahrtausend gedauert. Nur diejenigen, die kein historisches Gedächtnis mehr haben, werden der „Clash“ Huntingtonscher Prägung, als eine Neuheit empfinden. Gegen diejenigen, die Huntingtons Hauptthese total im Namen des politisch-korrekten Universalismus ablehnen und als „neo-Spenglerisch“ oder als „neokonservativer Parafaschismus“ bestempeln, sage ich, dass es eben Amerika ist, die diesen „Clash“ heute inszeniert, um Europa und Russland der islamischen Welt gegenüber zu schwächen. Ich will hier einen Mittelweg suggerieren: Der Begriff des „Clash of Civilizations“ zwischen Europa oder Russland einerseits und der islamischen Welt andererseits, ist zwar eine nicht zu leugnende Wirklichkeit, aber der Ursprung dieses Konfliktes heute befindet sich nicht im Islam selbst sondern wird von Pentagon-Strategen ferngesteuert. Der Islam ist ein Feind Europas und Russlands heute geworden, aber nur indem er ein Bundgenosse des Hauptfeindes Amerika ist.
- Hauptfeind bleibt noch immer Amerika, als Seemacht, als neues Karthago, wie Carl Schmitt so treffend analysiert hat. Warum? Weil Amerika noch stets Territorien oder Seeräume in Europa besetzt. Weil Amerika Satelliten im Weltall schickt, um unsere militärische und zivile Tätigkeiten zu beobachten und zu spionieren. Weil Strategien der Charakterwäsche noch immer in Deutschland wie überall in Europa angewendet werden, wie damals Caspar von Schrenck-Notzing sie meisterhaft entlarvt hatte. Die weltweite Medienmanipulation macht es unmöglich, einen unabhängigen Blick auf die Weltereignisse zu werfen. Die Mediendominanz Amerikas, mit CNN und andere mächtige Presseagenturen, erlaubt die einzig gebliebene Supermacht, Greuelpropaganda zu verbreiten, damit spontan die Ziele Washingtons als das Gute schlechthin angenommen werden. Beispiele gibt es in Hülle und Fülle: Die Massaker von Timisoara/Temeschburg zur Zeit des Ceaucescu-Sturzes, wo die gezeigten Leichen aus den Kühlschränken des Uni-Krankenhauses oder aus frischen Gräbern kamen; die Flüchtlinge, die im Kosovo ständig vorbeipassierten und die eigentlich immer die gleichen Bilder und Menschen waren, die aus anderen Winkeln technisch-filmisch aufgenommen wurden; die von serbischen Schergen angeblich gegrabenen Massengräber, die kein medischer UNO-Ausschuss je gefunden hat; die Säuglinge, die die Soldaten Saddam Husseins in Kuweit angeblich massakriert hätten, indem sie die elektrischen Stecker der Brutinstrumente ausgerissen hatten. Die Liste ist selbstverständlich hier weit unvollständig. Solange solche Manipulationen inszeniert werden oder bloss möglich bleiben, um die Interessen Europas oder Russlands zu torpedieren, bleiben unsere Völker unfrei, ihr weiteres Schicksal zu gestalten. Die europäischen Staaten sind unfähig, ihre eigene Ziele und Interessen ihren eigenen Bürgern in einer eigenen Mediensprache deutlich zu machen. Deshalb, und solange eine solche Sachlage herrscht, kann man kühl und sachlich feststellen, dass ihr Status den Status von Marionnetten-Staaten ist. Wir sind die Hampelmännchen und -frauen von Marionnetten-Staaten und keine Bürger von normal funktionierenden Staatswesen.
- Die Energiepolitik der Vereinigten Staaten zielte immer darauf, eine Maximisierung des Öl-Konsums zu erreichen. Man kann es die „Politik des Nur-Öls“ nennen. Diese Option hat als Ursprung das blosse Fakt, dass das konsumierte Öl in der Welt bis 1945 hauptsächlich aus den Vereinigten Staaten kam. Die VSA waren also die Hauptlieferanten dieses Rohstoffes in der Welt und verstanden daraus, dass dieser Rohstoff ihr besseres Instrument werden könnte, um allerlei strategische Vorteile zu gewinnen. Lange Zeit haben die Vereinigten Staaten ihr eigenes Öl als Reserve bewahrt, um strategische Trümpfe im Falle von Weltkriegen zu halten. Ziel der Propagandafeldzüge jeder Schattierung wurde stets, es zu vermeiden, dass andere Mächte solche Reserven oder Reserven anderer Art aufstapelten. Die „Nur-Öl-Politik“ Washingtons war gegen jede energetische Diversifikation gerichtet. Wenn Völker ihre Energie-Quellen vervielfachen, schaffen sie die Bedingungen einer Unabhängigkeit, die die Vereinigten Staaten nicht tolerieren können, da sie für immer Hauptlieferanten auf dieser Erde bleiben wollten. Jetzt stellt sich die Frage über die reale oder angebliche Ölknappheit in der heutigen Welt. Werden wir bald einen „pick“ erleben, nachdem die Reserven sich allmählich ausschöpfen werden? Gibt es Reserven etwa in Mittelafrika oder in Alaska, die die Wichtigkeit der saudischen Reserven bald relativieren wurden? Die Frage bleibt selbstverständlich offen. Sicher ist aber das die Amerikaner so viele Ölfelder in den Händen ihrer eigenen Ölgesellschaften sehen wollen, um Meister dieser Rohstoffsquellen so lang wie möglich zu bleiben und die Wirtschaftslage der trabantisierten Völker zu kontrollieren und, wenn nötig, zu erdrosseln. Würden diese Völker energetisch durch Diversifikation unabhängig und frei, wäre eine solche Erdrosselung nicht möglich.
- Sehr früh, sofort es sicher war, dass die Ölreserven der arabischen Halbinsel die umfangreichsten der Welt waren, hat die amerikanischen Führung unter Franklin Delano Roosevelt ein Bündnis mit dem saudischen König Ibn Saud geschmiedet. Der US-Präsident und der arabische König trafen sich am Bord des US-Kriegsschiffes USS Quincy im Roten Meer. Dort wurde schon vor der deutschen Niederlage eben dieses Bündnis mit einem fundamentalistisch-wahhabitischen Königreich Wirklichkeit. Die geistige Lage in diesem Königreich war ganz anders als im mehr oder weniger islamisierten oder schiitischen Persien oder als im Ottomanischen Reich. Beide Reiche waren alte staatliche Strukturen, die religiös bunt waren und die auch Elemente aus anderen Quellen als aus denjenigen arabisch-islamischer Herkunft eingebürgert oder Formen des Islams wie der Sufismus oder die Mystik entwickelt und gefördert hatten. Für die wahhabitischen Saudi-Araber waren alle diese Beimischungen zoroastrisch-persischer, byzantinisch-griechischer oder schamanisch-zentralasiatisch-türkischer Herkunft ketzerisch oder unrein. Diese kulturtragenden Beimischungen wurden durch den Wahhabismus abgelehnt, zur Gelegenheit zerstört oder systematisch als Ketzerei abgetan. Nach Roosevelt und Nachfolger, sei dabei doch ironisch erwähnt, hätten alle Völker der Erde die Menschenrechte volens nolens übernehmen sollen (besonders in ihre spätere San-Francisco-Verfassung des Jahres 1948), nicht als tatkräftige eingewurzelte Rechte historischen Ursprungs sondern als auflösende Keime gegen jede geschichtlich gewachsene nicht amerikanisierte Institution (dieser letzte Terminus benutze ich hier im Sinne Arnold Gehlens); diese Menschenrechte sollten in einer zweiten Stufe dazu dienen, in aller Ecken der Welt eine amerikanisierte nicht heimatliche Pseudo-Demokratie zu stützen, und diese sollte überall gelten, nur nicht in Saudi-Arabien. Der Fall zeugt von einer evidenten Doppelmoral: Die amerikanische Führung glaubt nicht an den Menschenrechte als ob diese eine Art ziviler Ersatzreligion wären, sondern benutzen diese Ideologie, um feindliche oder konkurrierende Staaten zu schwächen, und tolerieren die grobsten Kränkungen dieser Menschenrechte, wenn ihre Interessen damit gedient werden.
- Die Allianz zwischen den Vereinigten Staaten und dem Saudi-Islamismus basiert sich auf einer „Insurgency-Strategie“. Mit saudischen Geldern werden Erhebungen islamitischer Ideologie veranstaltet sowie im Afghanistan gegen das Regime, das die Sowjets damals unterstützten, oder in Bosnien und Kosovo, zur Zeit Clintons und Albrights, um Unruheherde in Europa permanent zu schaffen, oder in Tschetschenien, um Russland im Gebiet des Nordkaukasus auszuschalten. Jedesmal gab es saudische Gelder, um die afghanischen Mudschahiddin oder Talibane, die bosnischen Verbände oder die UCK-Milizionäre oder die tschetschenischen Terroristen zu finanzieren. Auf jedem Kampfgebiete fanden Beobachter saudische Kriegsherren oder Freiwilligen. Die Ziele dieser Insurgency-Kämpfe entsprachen immer die geopolitischen Stossrichtungen die Washington sich wünschte. Die islamfundamentalistische Gefahr entspricht also schlicht ein Instrument des US-Imperialismus. Ohne amerikanische Deckung des saudischen-wahhabitischen Systems, hätten diese Erhebungen nie stattgefunden. Afghanistan wäre ein Trabant der Sowjetunion bzw. Russland geblieben. Serben und Kroaten hätten sich Bosnien geteilt. Der Kosovo-Krieg hätte nie stattgefunden. Tschetschenien und Daghestan wären ruhig geblieben. Bin Laden war letztes Endes ein Söldner Amerikas; deshalb vielleicht konnte er so einfach verschwinden, derweil sein Mitkämpfer der Mullah Omar mit einem Motorrad entwischen konnte, ohne dass die Satteliten der amerikanischen Streitkräfte oder der allwissenden NSA-Agentur, die uns hier alle sehen können, dieses verdammte Motorrad mit dem bösen Mullah drauf entdecken konnten! Vielleicht eine unerwartete Panne, eben am diesen Tag!
Bin Laden, der Mullah Omar, der Bassajew in Tschetschenien und die vielen anderen treiben also was man im militärischen Jargon seit Lawrence of Arabia eine „Insurgency“ auf abseitigen Gebieten um den Hauptfeind zu destabilisieren. Die Immigration innerhalb der europäischen Staaten heute dient dazu, und nur dazu, einen künftigen Insurgency-Krieg im Herzen unseres Kontinents zu leiten. Die breiten Massen entwurzelten junge Muslims, die hier ohne Arbeit herumlaufen, machen es möglich, dass eine solche „Insurgency“-Strategie hier künftig inszeniert werden könnte. Die These wird ganz au sérieux in Frankreich genommen und der Hauptreferent in dieser Sache ist der französische Politikwissenschaftler algerischer Herkunft Ali Laïdi. Dieser stellt ganz sachlich fest, dass die aufgehetzten Köpfe in den Randstädten rund Paris, Lyon oder Marseille, systematisch von Geistlichen fanatisiert werden, die irgendwie von saudisch-finanzierten Gremien abhängen. Solche Geistlichen predigen überhaupt nicht die Integration, sondern einen rückwärtsorientierten Islam, wobei weite Teile dieser arabisch-mahomedanischen Bevölkerungsgruppe der Leitkultur völlig entfremdet und, schlimmer noch, ihr tiefer und tiefer befeindet werden, sowie die fanatischen wahhabitischen Krieger der arabischen Halbinsel die kulturreiche Islam-Synthese Persiens oder des Ottomanischen Reiches entfremdet wurden. In dieser verschwächten Bevölkerungsgruppe herrscht von jetzt ab ein Misstrauen, wobei alles was man als Europäer sagt, stillschweigend oder vehement abgelehnt wird. Intoleranz taucht inmitten eines langweiligen Toleranz-Diskurses.
Geschichte des Islamfundamentalismus
◊ 1. Erklärung der Begriffe
Der sogenannte Islamfundamentalismus hat seine Wurzeln in verschiedenen Denkschulen, die im Laufe der Geschichte in islamischen Ländern entstanden sind. Die heutigen Strömungen des Islamfundamentalismus finden ihre Quellen eben in diesen Denkschulen. Es scheint mir deshalb wichtig, diese fundamentalistischen Richtungen und ihre Folgen zu kennen.
- Die erste Denkschule ist der Hanbalismus. Gründer dieser Schule sind Achmad Ibn Hanbal (780-855) und später, in einer zweiten Stufe der Entwicklung dieser Schule, Taqi Ad-Dinn Ibn Taymijah (1263-1328). Die vier Hauptgrundrichtungen dieses Denkens sind : 1) Eine Reaktion gegen die Verwendung philosophischer Begriffe griechischer oder persischer Prägung im Raum des Islams. Die Reaktion ist also anti-europäisch; 2) Eine buchstäbliche Interpretation des Korans, wobei keine Innovationen toleriert werden; 3) Der Muslim darf keine persönliche Urteilskraf und keine theologische Spekulationen entwickeln. Opfer dieser strengen Restriktion wurde der Mystiker Ibn Arabi, einer der gründlichsten Denker unseres Mittelalters (wobei der Begriff ‘Mittelalter” für den Islam überhaupt nicht passt); 4) Die Feindschaft gegen den Sufismus, d. h. gegen breitdenkenden Schulen, die ihre Ursprung im iranischen Raum fanden.
- Der zweite Denkschule ist der bekanntste Wahhabismus, von Muhammad Ibn Abd Al-Wahhab gegründet. Al-Wahhab wurde ungefähr 1703 in Naschd-Provinz in der Arabischen Halbinsel geboren. Die Merkmale seines rigoristischen Systems sind: 1) Er ist unmittelbar ein Anhänger der hanbalistischen Tradition; er will deren Strengheid im späteren saudischen Raum wieder erwecken; 2) Al-Wahhab behauptet, der Kultus sei unrein geworden, weil zuviele Devotionalien den reinen Geist des Islams besuddeln; er will jeden Rückkehr zu vorislamischen Riten bekämpfen, da diese Riten im arabischen Halbinsel wieder üblich geworden waren, weil das Land weit von den Zentren des islamischen Hauptkultur entfernt war; 3) Al-Wahhab rechtfertigt die systematische Anwendung von Terror gegen Andersdenkenden, wie, zum Beispiel, Schiiten oder andere “Abweichler”. Terror wird Mittel zum Zweck; 4) Al-Wahhab behauptet auch, daß das Besuchen von heiligen Stätte ketzerisch sei; Objekte wie Rosenkränze, das Rauchen, die Musik, das Tanzen werden also verboten; Männer sollten immer auch Bart tragen.
- Die dritte Denkschule ist die Ichwan-Bewegung. Nach eine langen Zeit des Wirrens, erobert der Neschd-König Ibn Saud die arabische Halbinsel. Seine Truppen —die Ichwan-Verbände— werden von den Wahhabiten fanatisiert. Ibn Saud, ein schlauer König, weiss aber, daß das Nomadentum die Araber der Halbinsel schwächt. Er will sie seßhaft machen und militarisieren. Deshalb gründet er eine Bewegung von Soldaten-Kolonisten, die streng wahhabitisch erzogen werden. Diese Militarisierung durch Religion ist eine Grundtendenz des heutigen Fundamentalismus und hat, u. a. Bin Laden inspiriert. Die Geschichte der Ichwan-Bawegung, d. h. die Bewegung der Bruderschaft, zwingt uns, die Geschichte Saudi-Arabiens besser zu kennen und zu verstehen.
- Die vierte Denkschule ist die Bewegung der Islam-Bruderschaft oder Muslim-Bruderschaft in Ägypten. Gründer der Bewegung war Hassan Al-Banna, der sie Ende der 40er Jahre ankurbelte. Hauptidee war, daß die arabisch-muslimischen Völker den Westen nicht knechtisch nachahmen sollten. Er plädierte für eine allgemeine Reislamisierung und gründete deshalb auch eine paramilitärische Organisation, die Kata’ib (die Phalange). Al-Banna wurde 1949 in offener Strasse von ägyptischen Polizisten erschossen, nachdem Demonstranten englische Soldaten gelyncht hatten. Es ist merkwürdig zu notieren, dass am Anfang seiner Laufbahn Al-Banna ein liberaler verwestlicher Intellektuelle war. Er hatte in den Vereinigten Staaten studiert. Nach seiner Rückkehr nach Ägypten, lehnte er die westlichen Ideen ab und wurde streng islamitisch. In der ersten Phase der Bewegung, unterstützte Al-Banna die “Freien Offiziere” Nassers, aber danach, entstand eine totale Opposition gegen Nasser mit Hilfe der Kommunisten. Die Tätigkeiten der Islam-Bruderschaft hat systematisch das Nasser-Regime geschwächt. Insofern har die Bewegung die Amerikaner und Israelis geholfen, Ägypten als auftauchende Macht innerhalb der arabischen Welt auszuschalten, besonders nach der Niederlage von Juni 1967. In 1955, wurde die Bewegung für das erste Mal von den ägyptischen Behörden aufgelöst und verboten. Die ersten Hinrichtungen von Bruderschaftsaktivisten finden statt. Sayyib Qutb (1906-1966) wurde dann der Nachfolger Al-Bannas. Er entwickelte die Bewegung weiter und gab sie eine islamistisch-sozialistische Orientierung, wiederholte und rekapitulierte die hanbalistische Dimension seiner Islamsvision; die eigentliche Neuheit war, dass er den Dschihad, den heiligen Krieg, gegen ungenügende, zu tolerante oder ketzerische muslimische Regierungen. Zwischen 1954 und 1964, flog er manchmals ins Gefängnis. 1966 wird er endlich hingerichtet.
Die geschichtlichen Kenntnisse sollten auch mit geographischen Kenntnissen erweitert werden. Die Bühne, wo alles entstanden ist, ist selbstverständlich das heutige Territorium Saudi-Arabiens. Mohammed in seiner Zeit war ein kluger Geopolitiker: Er hat die Halbinsel geeinigt und der Netz der Karawanen-Straßen gegen alle Einflüsse von ausserhalb der arabischen Halbinsel sichergestellt. Nichts läßt vermuten, daß er weitere Länder erobern wollte. Aber einige Jahre nach seinem Tod, war der Kontext völlig anders. Mohammed wurde im Jahre 570 geboren, also im sogenannten Huluban-Jahr oder Elefanten-Jahr, wenn abyssinische Truppen im Dienst des byzantinischen Reiches Arabien vom jemenitischen Süden erobert hatten, um die Perser von den Ufern des Roten Meeres fernzuhalten. Mohammed wollte es nicht, dass die Halbinsel und die Karawanen-Straßen Bühne eines Krieges zwischen raumfremden Mächten wurde. Nach seinem Tode, kämpften Perser und Byzantiner weiter, mit als Verbündeten die semitisch-aramäiche Stämme des heutigen Jordaniens und Iraks. Die Nachfolger des Propheten zerschlugen unerwartet byzantinische Verbände im Raum Südjordaniens und Palästinas. Später werden auch persische Truppen zerrüttet. Die semitisch-aramäischen Völker, die von diesem ständigen Krieg müde waren, bekehren sich zum Islam. Die Zeit war gekommen, um ein riesengrosses Islam-geprägtes Reich zu gestalten.

Die arabische Halbinsel bestand und besteht noch heute aus hauptsächlich vier Hauptgebieten : Das Hedschas-Gebiet, das Neschd, das Assir und die Hassa-Provinz.
Das Hedschas-Gebiet wird von nicht-wahhabitischen Sunniten beherrscht und ist der Ort der heiligen Stätte des Islams, wo die Pilger sich begeben. Im 1916-17, organisiert der britische Offizier Lawrence die Hedschas-Stämme rund dem Häuptling Hussein, der damals ein Feind Sauds war. Die Hedschas-Stämme sind Bundgenossen der Briten, die Stämme unter der Führung Sauds aber den Briten gegenüber sehr misstrauisch und spâter Amerika-hörig.
Das Neschd-Gebiet ist das zentralgelegene Gebiet der Halbinsel, aus dem die Anhänger des Wahhabismus und später die verbündeten Stämme des Sauds ihre Eroberungszüge anfangen werden. Im berühmten Buch des ehemaligen Vichy-Minister und Historiker des deutschen Militärwesen Benoist-Méchin, wird das Neschd-Gebiet sehr genau beschrieben. Die eigentliche Urheimat der semitischen Völker befindet sich im heutigen Jemen und Assir-Gebiet, die bis spät ein eher reiches und furchtbares Land mit sesshaften Stämmen, die eine effiziente Landwirtschaft entwickelt hatten. Die Römer sprachen von „Arabia felix“, d.h. „Glückliches Arabien“. Es ist also falsch zu behaupten, dass die semitischen Völker alle ursprünglich Nomaden waren. Wenn das fruchtbare Land Jemens zu viele Kinder erzeugte, mussten die notgezwungen nordwärts auswandern, und eine kriegerische nomadische Kultur im Neschd-Gebiet zu schaffen. Im dürren Norden entstanden also nach einem langen Voklswerdungsprozess eben diese Krieger-Stämme, die den Islam und viel später den Wahhabismus ihre ersten Impulse gaben. Wir finden deshalb im Kern der arabischen Halbinsel die übliche Dialektik Zentrum-Peripherie, wobei das dürre unfruchtbare Zentrum nicht das zeitlich erste Element des dialektischen Prozesses ist, sondern das Produkt einer reichen Peripherie, die später nach einer mehr oder weniger langen Reifungsprozess das Entstehungsgebiet einer eigenartigen geistigen Revolution geworden ist. Dieses Modell ist nicht einzig in der Geschichte des Islams: Auch das dürre steppische Zentralasien als Urheimat oder als Sprungbrett der Türkvölker in Richtung der bunten Reichsgebiete des sogenannten „Rimländer“ (Persien, Byzanz und das indische Gupta-Reich) kann als eine Zentrum zweiter dialektischen Hand betrachtet werden.
Das dritte Gebiet der Halbinsel ist das Assir, das von Jemeniten bewohnt wird, die stark schiitisch geprägt sind. Assir ist ein Bergland mit feuchterem Klimat. Die Stämme im Assir haben sich immer gegen diejenigen des Neschds gewehrt.
Das vierte Gebiet ist die Hassa-Provinz, die sich der Ostküste der Halbinsel entlang befindet, wo die Ölfelder liegen. Die arabisch-semitische Urbevölkerung war dort ursprünglich schiitisch und pflegte enge Bände mit den Schiiten Iraks.
Die Geschichte des Wahhabismus
Im 18. Jahrhundert, nachdem das Ottomanische Reich und sein Verbündeter der französischen „Sonnen-König“ endgültig durch den Prinzen Eugen im Schach gehalten wurden, war der Islam weltmächtig auf dem Ruckzug. Das türkisch-ottomanische Hegemon konnte sich Europa gegenüber nicht mehr behaupten. In diesem Kontext entwickelte der Geistliche Al-Wahhab in einem abgelegenen Ort im Neschd seine rigoristische Lehre, um den Islam wieder kampffähig zu machen und das türkische Hegemon durch ein neues arabisches zu ersetzen. Um dieses Ziel zu erreichen, schmiedet er 1744 ein Bündnis mit dem Stammeskönig Mohammed Ibn Saud, Gründer der noch heute herrschenden Dynastie. Die Allianz zwischen dem Geistlichen und dem Krieger erlaubte in einer ersten Phase die komplette Eroberung des Neschd, wo alle Feinde ausgeschaltet bzw. ausgerottet wurden. Während dieser langen Auseinandersetzungen wurde die schiitische Pilgerstadt Kerbala im heutigen Irak erobert und völlig zerstört, weil die Wahhabiten die Reliquien der Martyrer und die Volksfrömmigkeit rund diesen religiösen Überlieferungen als ketzerisch und Götzenanbetung betrachteten. Hier liegt die Wurzel der Erzfeindschaft zwischen Schiiten und Saudi-Wahhabiten, die heute durch die Ereignisse im Irak wieder angekurbelt wird, wobei die amerikanischen Geheimstrategien des „divide ut impera“ (Teile und Herrsche“) eine erhebliche Rolle spielen. Die Kriegszüge Al-Wahhabs und Mohammed Ibn Sauds führten damals auch westwärts mit schweren Angriffen gegen die Hauptkultstätte von Mekka und Medina, wo auch Schreine und Kultortschaften in Namen des religiöse Rigorismus der Wahhab-Lehre zerstört wurden. Hier liegen dann die Keime der späteren Feindschaft zwischen Neschd-Stämmen und Hedschas-Stämme.
Am Anfang des 19. Jahrhunderts im Kontext der Napoleontischen Kriege, wurden de facto die wahhabitischen Stämme in ihrer Feindschaft der Ottomanen gegenüber die Bundgenossen Frankreichs, weil einfach weil die Machtkonstellation damals die folgende war: Das Ottomanische Reich sowie Persien waren die Verbündeten Englands. Wenn aber Napoleon in Russland 1812 besiegt wird, verminderte das Interesse Englands an diesen fernen exotischen Bundgenossen. Die Ottomanen und die Ägypter, unter der Leitung des Albaners Mehmet Alis und dessen Sohn Ibrahim Pascha, versammelten ihre Kräfte, um die Wahhabiten auszuschalten. Das Neschd-Königreich wurde unerbärmlich zerstört, eben die Quellen in diesem Wüstengebiet wurden trocken gelegt, um jede Logistik und jede Bewegung weiten Umfangs zu verhindern. Nach den Racheoperationen Mehmet Alis und Ibrahims, herrschte in der Halbinsel eine Zeit der Wirren, wo sich Stämme gegen Stämme einander bekriegten. Der zweite Ibn Saud (1880-1953) beginnt erneut die Eroberung des Neschd-Zentralgebietes, diesmal mit der anfänglichen Unterstützung Englands. Die Operationen entwickelten sich mit der extremsten Gewalt. Grausame Ereignisse und Ströme Blutes erschütterten Arabien. Wenn der Erste Weltkrieg in Europa ausbricht, versuchen die Briten sofort Verbündeten in der Halbinsel, um die Ottomanen auf ihrer südlichen Flanke einzukreisen. Das Kairo Büro mit Lawrence suggerierte ein Bündnis mit Hussein und Feisal im Hedschas-Gebiet, aber das Bombay Büro mit Shakespear wählte eher Ibn Saud als Verbündeter. Lawrence bekommt die Kredite, ganz einfach weil er schneller die Hedschas-Stämme in Akaba bringen könnte, um eine Küstenstreife frei für eine britische Landung am Endpunkt der Damas-Jerusalem-Akaba-Eisenbahn sicherzustellen, und auch komischerweise weil er akzeptierte, einen arabischen Kopftuch statt einer Offizier-Mütze europäischer Art zu tragen, was Shakespear immer hartnäckig und schneidig abgelehnt hatte. In seinen Notizen über seine arabischen Feldzüge, spricht Lawrence ausführlich darüber, dass Araber tief davon schockiert und gekränkt werden, wenn Europäer in ihrer Anwesenheit Hüte oder Mützen tragen.
In den 20er Jahren, als die Sprösse der Hedschas-Häuptlinge über Jordanien und den Irak mit britischer Unterstützung herrschen, wiederholte der zweite Ibn Saud seine frühere Feldzüge bis er endlich wieder die ganze Halbinsel kontrollierte. Um dieses Ziel zu erreichen, bediente er sich dem Instrument der Ichwan-Bewegung, die er dann, sofort er gesiegt hatte, auflösen liess. Mit der Macht fest in den Händen und nachdem Ölfelder auf seinem Hoheitsgebiet entdeckt wurden, konnte Ibn Saud II. 1945 mit Roosevelt verhandeln und seine britische Feinde im Kampf um das Öl ausschalten. 1953 stirbt der Beduinen-Herrscher nachdem die Bedingungen des Bündnisses mit Amerika fest und endgültig festgelegt wurden. Hier beginnt wirklich die Geschichte der engen Zusammenarbeit zwischen Washington und Riad.
(weitere Auszüge später).
00:15 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : islam, fondamentalisme, wahhabisme, wahhabites, pétrole, arabie saoudite, péninsule arabique, monde arabo-musulman, géopolitique, politique internationale, empire britannique, etats-unis, théologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Culture médiatique
Archives de Synergies Européennes - 1995
Alberto Buela:
Culture médiatique
 A en croire l'intuition du philosophe danois —sans doute le plus grand d'entre eux, Søren Kierkegaard (1813-1855), pasteur protestant contre sa religion, le protestantisme, père de la philosophie existentialiste—, la culture médiatique trouverait sa source en Luther: «Oh, Luther, combien énorme est ta responsabilité! Car plus j'y songe, plus j'entrevois que si tu as entrepris d'abattre le Pape... c'est pour introniser le Public. Tu as enseigné aux hommes à vaincre par la force du nombre» (Journal intime, 1854).
A en croire l'intuition du philosophe danois —sans doute le plus grand d'entre eux, Søren Kierkegaard (1813-1855), pasteur protestant contre sa religion, le protestantisme, père de la philosophie existentialiste—, la culture médiatique trouverait sa source en Luther: «Oh, Luther, combien énorme est ta responsabilité! Car plus j'y songe, plus j'entrevois que si tu as entrepris d'abattre le Pape... c'est pour introniser le Public. Tu as enseigné aux hommes à vaincre par la force du nombre» (Journal intime, 1854).
Un des ingrédients de la culture médiatique est le public comme masse de consommateurs. Les peuples deviennent des marchés solvables. Et, à coup sûr, la valeur d'un programme télévisuel est proportionnelle aux indices d'écoute. Nous entendons par “culture médiatique” l'ensemble des manifestations émises par les mass media qui tendent à fondre en un même amalgame uniforme le message émis et l'homme qui le reçoit.
La culture médiatique est une culture d'interposition entre l'homme et les choses. Mais à vrai dire, c'est en matière de culture au vide intersidéral qu'elle correspond. Car la culture est essentiellement l'activité de l'homme cultivant son propre être, son humanitas. Et c'est ce devenir humain qui est, sans plus, la racine ultime de la culture. D'où cette contradictio in terminis lorsqu'il est fait mention de cette sorte d'entité mi-chair mi-poisson qu'est la culture médiatique.
Par rapport à celle-ci, l'homme en est réduit purement et simplement à un consommateur: en tant que lecteur, auditeur ou téléspectateur. Les messages médiatiques sont indifférents aux individualités auxquelles ils s'adressent; maigre exutoire, celui proposé par certains journaux dans le “courrier des lecteurs”. Tous ces messages sont uniquement conçus en fonction d'un accroissement escompté de la consommation des produits dont la publicité soutient économiquement les mass media. Publicité et consommation, telles sont les finalités auxquelles l'être humain est confronté, dans ce qui pourrait être qualifié de “cercle herméneutique de production de sens”.
De pas son exaltation paroxystique du public, la culture médiatique est l'expression la plus achevée de la modernité; elle gave un public anesthésié d'images télévisées à travers cette immense vitrine que constituent les innombrables écrans de télévision. L'existence en est réduite au niveau de celle des stocks de marchandises, si sagement alignés, par la publicité qui ne connaît d'autre vocation que de vendre: et en l'occurence, de tout vendre. Le sens ultime de l'existence est compris dans ce tout.
la société opulente, celle de l'ostentation, des shoppings, a réduit la domaine du privé au dégré zéro: depuis la mise à nu de l'inconscient par Freud jusqu'aux dernières manipulations génétiques, depuis les bombardements défoliants sur la forêt amazonienne jusqu'aux cartes de crédit qui rendent impossible l'intimité des dépenses, depuis les édifices en verre jusqu'aux vêtements transparents.
Toute vie privée, comprise comme domaine d'expression de la singularité et de l'unique, ayant été balayée par le message homogénéisant de la culture médiatique, la voie est largement ouverte à l'anéantissement des identités des hommes et des peuples, pour en arriver au règne du blue jeans et du light, adoptés par un homme moderne qui n'est plus que pure apparence d'humanité.
Apparences dans le vêtement, dans le langage, par un baby talk monosyllabique qui permet de paraître plus rude, par la démarche, en se balançant pour paraître plus méchant, par l'allure, en affichant une barbe de quelques jours pour faire “bonne impression”. Mais, bien sûr, paraître ne suffit pas: l'essentiel est d'apparaître. Il faut se montrer en public. Le leitmotiv sera d'attirer l'attention par un aspect de “transgresseur light”. Avec des vêtements paraissant défaits et vieillis mais de bonnes marques. Avec des cheveux à l'indienne mais soigneusement couverts de gel. Avec un mouchoir qui pend un peu à la façon tzigane mais en soie italienne. Est-il malaisé d'ironiser sur l'intensité des soucis que de tels transgresseurs peuvent causer aux tenants du pouvoir en place? La dissidence pourrait-elle être plus finement domestiquée?
Tel est l'empire des choses et, pour ainsi dire, des entités, qui, n'obéissant qu'à la loi de leur inertie, écransant l'être humain et donnent ainsi le ton de cette fin de millénaire. Ainsi donc, être signifie avoir. Et cela va jusqu'à acheter des choses dans le seul but de les posséder, indépendemment de l'usage qui peut en être fait. Le zapping, succession d'images tronquées, devient une attitude générale face à la vie. L'image, apparence de la réalité, s'est imposée en lieu et place des concepts véhiculés jadis. Ne voyons-nous pas la part des photos s'accroître dans la presse, les textes se faisant au contraire de moins en moins denses.
Les voyages de masse, le pélérinage des touristes qui voudraient être partout mais qui en définitive ne se dirigent nulle part, nous montrent l'homme moderne sous son jour le plus authentique: un voyeur qui veut tout regarder, même s'il a du mal à voir. Car pour voir il faut posséder une vision préalable de l'objet recherché. Connaissance préconceptuelle. Le regard qui voit est celui qui s'insère dans une totalité de sens. Platon affirmait: «La meilleure preuve qu'une nature soit douée ou non de sagesse, c'est la capacité que seul le sage possède, d'avoir une vision d'ensemble» (République, 537a, 10-15).
Or, c'est à une succession ininterrompue d'images tronquées et sans aucun sens que se livre l'homme médiatique. Lorsque celui-ci se spécialise en quelque chose, c'est dans l'art que nous pourrions qualifier de “minimalisme”. Le profil de l'homme médiatique est light, sa pensée est faible, privée de convictions. Seul savoir en mesure de l'intéresser: celui de savoir ce qui se passe; il ne songe à poursuivre nulle investigation personnelle ni a fortiori nul changement en quoi que ce soit. Moralement, il ne parvient même pas à être un hédoniste: il ne cherche pas le plaisir, il ne fait qu'être permissif. De cette permissivité il glisse vers un scepticisme et une indifférence généralisée envers toute vérité. L'interminable tolérance qui l'anime en toutes circonstances est le berceau douillet de son relativisme et de son atomisme social.
Ces jours-ci (15 décembre 1994), le projet de “télévision interactive” a connu une première phase d'accomplissement. Le firme nord-américaine Time Warner a installé dans cinq foyers de la ville d'Orlando un ordinateur, une télévision et une imprimante grâce auxquels les usagers visionneront des films choisis parmi une cinquantaine, commanderont leurs courses dans plusieurs magasins de la ville, dialogueront avec leurs voisins, utiliseront le service de coursiers et liront sur écran les nouvelles locales du journal Orlando Sentinel.
Tout indique que désormais la télévision, la vidéo, le téléphone, le courrier, l'informatique et beaucoup d'autres éléments s'intègreront dans une autoroute informatique dont le vecteur sera la fibre optique. L'interactivité intégrera l'homme en tant que simple apparence, son image parlant à sa place tandis que l'homme en chair et en os en sera réduit à taper sur le clavier de son terminal.
Autrefois, avant même que n'apparaisse la télévision, Leopoldo Marechal affirma: «Bien rares sont ceux aujourd'hui qui ne reconnaissent et ne vénèrent la radiotéléphonie, un des miracles de la science qui a le plus contribué à exlater la foi en un avenir plein d'artifices admirables, qui, en meublant leurs maisons et en démeublant leurs âmes, permettra aux humains d'atteindre le règne d'une béatitude débarrassée de tout casse-têtes».
Meubler leurs maisons de divers appareils électro-domestiques et démeubler leurs âmes: l'homme perd la capacité d'instaurer des valeurs, construire un monde lorsque seuls des désirs préfabriqués l'anime. Sa liberté n'est plus qu'une illusion. Son pouvoir est celui que les mass media lui offrent. Le développement des communications nous a fait passer de l'ère atomique à l'ère satellitaire ou informatique; le sens naturel du monde, comme lieu pour habiter, est annulé: le monde devient un écran où la virtualité supplante la réalité.
L'accès instantané à l'informatisation, la planétarisation des produits choisis par les mass media incitent l'homme dérivé de la culture médiatique à croire que ce qui apparaît est réel. L'éloignement de l'homme envers lui-même ne connaît dès lors plus de frontière. Dans les sociétés dépendantes comme sont les nôtres, en ce cône méridional du continent américain, l'aliénation médiatique atteint des niveaux invraisemblables. La boîte à assomer, autrement dit la télévision, s'adresse à une population dont 40% survivent dans la pauvreté absolue pour proposer une vision totalement mercantile du monde. Notons que 85% de cette même population possède un téléviseur.
Serait-ce par hasard, à cause précisément de cette masse d'hommes et de femmes constamment menacés de noyade par les flots déchaînés de la misère, et qui parviennent de temps à autre à émerger pour assister au spectacle de la société de consommation, que nos technocrates de service appellent nos sociétés du doux euphémisme d'“émergentes”? Songeons aux 15.000 Mexicains qui tous les ans meurent de diarrhée dans la région de Chiapas. Qu'en est-il de ceux qui périssent, en dehors de toute statistique, en Bolivie, au Pérou, au Paraguay et au Brésil, emportés par le choléra?
Ce sont des millions de personnes qui vivent le nez collé à l'écran, voyant, désirant, rêvant un monde auquel ils n'auront jamais accès, et qui pour eux existe réellement, alors que, pour notre part, nous savons qu'il n'est que virtualité et apparence.
A l'adage hégélien, selon lequel tout ce qui est rationnel est réel et tout ce qui est réel est rationnel, nous pouvons rétorquer désormais que tout ce qui est apparent est réel et que tout ce qui est réel est apparent. L'illusion rationaliste a véritablement été éventrée par la mystification, plus puissante et plus radicale, qu'est la culture médiatique. L'homme conditionné par celle-ci, après avoir pris l'image pour une réalité, en finira par jeter sur sa réalité environnante un regard lourd de scepticisme: car sa réalité finit par être moins réelle à ses yeux que les images télévisées. De ce fait, il marquera son renoncement face à l'entreprise médiatique de déculturation et de colonisation culturelle. L'homme abandonne sa capacité d'être soi-même en perdant son appartenance, son enracinement, ses valeurs, son langage.
L'homme médiatisé ne médiatisera rien qui lui soit propre; au contraire, il est l'objet de cette médiatisation qui accapare son être. Combien de fois n'entendons-nous pas affirmer innocemment: «Je ne peux vivre sans la télévision, la radio, le walkman, le journal, etc.». L'homme secrété par la culture médiatique réalisara les travaux les plus abrutissants, les plus aliénants, comme si la réalité dans laquelle il baigne ne fût telle; la réalité s'efface et il n'a de cesse de s'identifier au message que les mass media lui envoient sans discontinuer. Deux exemples extrêmes illustrent cette dialectique. Nous trouvons le premier dans les transports en commun, à Buenos Aires, avec les colectiveros: faune si commune et quotidienne, dont la réalité s'écarte notablement de celles des passagers et dont le souci n'est pas de prendre soin de cette clientèle mais bien d'accomplir leur mission au rythme des messages que les radios, tournées à plein volume, leur divulguent: telle est la réalité illusoire dans laquelle ils se plongent. A l'autre extrême se trouvent les yuppies de la Bourse, engloutis dans la masse des données que leur vomissent leurs ordinateurs, contemplant les va-et-vient de leur fortune. La transaction financière est douée d'une vélocité bien supérieure à celle de l'opération commerciale, d'où une “mobilité électronique”, ainsi dénommée par l'économiste Marcelo Lascano, qui permet au spéculateur de réaliser plusieurs transactions financières, totalement fictives, sur une opération commerciale réelle. Couronnées de succès, de telles transactions transforment le yuppie en un millionnaire virtuel, fermé certes à toute considération quant à la virtualité de sa richesse. Son contact avec la réalité, à travers les revers de fortune occasionnels, le remplira de perplexité.
Ce chemin est-il sans retour? Existe-i-il une sortie? Il se trouve des sociologues, des anthropologues, des intellectuels, qui se fondent sur un volontarisme optimiste pour parier que notre société et nos peuples d'Amérique latine ont suffisamment de forces inconscientes pour rejeter les valeurs de la contre-culture imposée par les mass media. Nous voyons, pour notre part, une possibilité de sortie non pas dans un appel romantique adressé au Volksgeist mais en une prise de conscience qui nous permet, face aux mass media et à leurs techniques, leur toute-puissance, de dire: NON. Mais NON peut se dire de plusieurs façons. L'une de ces façons consiste à clôturer toute possibilité de contact. Il faut éteindre la télévision a conseillé Jean-Paul II l'année passée. L'autre de ces façons, tournée vers le discours heideggerien, est de dire “NON et OUI” aux objets techniques. Avoir la capacité de nous en emparer dans la seule mesure de leur utilité. L'utile étant ce que détermine l'être.
Il s'agit d'une désaffection, un détachement envers les choses, envers la technique comme déesse salvatrice, envers la consommation. Ce qui conduit nécessairement à une conduite austère. Heidegger caractérise cette attitude par l'antique vocable germanique Gelassenheit, sérénité. Ainsi affirmait-il, “la sérénité envers les choses et l'ouverture aux mystères nous ouvrent la perspective d'un nouvel enracinement”. Les philosophes grecs dénommaient phroneseos cette sorte d'hommes, ce qui, par la suite, a été mal traduits par “prudents”. Nous préférons traduire, comme le philosophe italien Giorgio Colli (1917-1978), par “savants”. Mais “savant” au sens véritablement, profondément, étymologique, dérivé de sapio, qui signifie “saveur” (et non au sens donné par le terme hellénique sophos). N'est pas sage celui ayant englobé de vastes quantités de données encyclopédiques, à la façon des érudits, mais celui capable de prendre son temps pour goûter la vie.
Nous voyons ainsi comment la dialectique médiatique, apparemment sans retour, peut être dépassée par la science de se donner le temps nécessaire à donner à chaque chose sa place.
Prof. Alberto BUELA.
(article tiré de Disenso, n°4, hiver 1995).
00:05 Publié dans Manipulations médiatiques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : médias, sociologie, philosophie, presse, argentine, amérique latine, amérique du sud |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 16 février 2010
Slavoj Zizek: le philosophe le plus dangereux d'Occident
|
Slavoj Zizek : le philosophe le plus dangereux d'Occident |
| « Slavoj Zizek – philosophe issu de la minuscule Slovénie, dont la renommée sulfureuse est devenue mondiale : le bandeau entourant son dernier le présente comme “le philosophe le plus dangereux d’Occident” – fait paraître ces jours-ci un essai qui vise à requinquer l’idée communiste. Après la tragédie, la farce ! est un livre hirsute, aux accents prophétiques : dressant le bilan d’un capitalisme libéral rongé par des contradictions insurmontables, il prédit même que l’avenir devrait se jouer entre le socialisme et le communisme. Féru de psychanalyse lacanienne, le philosophe résume son programme par une formule qui pastiche Marx : “Dans nos sociétés, les gauches critiques n’ont fait jusqu’à présent que souiller ceux qui sont au pouvoir ; ce qui importe, c’est de les castrer...” Slavoj Zizek résiste toujours mal au plaisir d’une bonne provocation. Son succès doit sans doute beaucoup à ce tempérament. On se délecte du personnage mal peigné, agité, tonitruant, zézayant, qui plonge la philosophie dans un bain d’extravagance balkanique. Le lire est un exercice parfois éprouvant, en particulier quand il brasse le jargon lacanien. Sa désinvolture intellectuelle peut agacer. Ses concepts restent souvent fumeux (comme cette idée communiste qu’il manipule sans vraiment la définir). Mais on sort de ses livres intrigué, dérangé, stimulé et récompensé par quelques passages d’une grande drôlerie : Slavoj Zizek est un marxiste de tendance Groucho. Aux Etats-Unis, ses conférences sont prises d’assaut. A Buenos Aires, près de 2500 personnes se sont massées pour l’écouter philosopher en plein air. A Londres, Tokyo ou New Delhi, sa réputation n’est plus à faire. La France, en revanche, s’est longtemps montrée plus réservée sur ce philosophe sorti de nulle part. A cet égard, une page est en train de se tourner. La récente venue de Slavoj Zizek à Paris aura été l’occasion d’une véritable intronisation. […] Le Nouvel Observateur a décidé d’organiser le match au sommet en opposant l’énergumène slovène au champion hexagonal, Bernard-Henri Lévy. […] “Vous savez, glisse Zizek, quel est le problème de Bernard-Henri Lévy ? Cela fait des années qu’il essaie de pénétrer le marché américain, avec le soutien de CNN, mais ça ne marche pas! Pour lui, c’est un mystère: comment se fait-il qu’Alain Badiou, le philosophe le plus radical de la gauche européenne, réussisse mieux que lui aux Etats-Unis ? Moi, j’y vois plutôt un bon signe. Cela montre qu’on ne doit pas sous-estimer intellectuellement les Etats-Unis !” »
L’Hebdo, 21 janvier 2010 |
00:15 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, slovénie, occident |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Nouvelles études sur la guerre des partisans en Biélorussie (1941-1944)

Dag KRIENEN :
Nouvelles études sur la guerre des partisans en Biélorussie (1941-1944)
Deux historiens, Bogdan Musial et Alexander Brakel ont analysé la guerre des partisans contre l’occupation allemande en Biélorussie entre 1941 et 1944
Parmi les mythes appelés à consolider l’Etat soviétique et la notion de « grande guerre patriotique de 1941-45 », il y a celui de la résistance opiniâtre du peuple tout entier contre l’ « agresseur fasciste ». Cette résistance se serait donc manifestée dans les régions occupées avec le puissant soutien de toute la population, organisée dans un mouvement de partisans patriotiques, qui n’aurait cessé de porter de rudes coups à l’adversaire et aurait ainsi contribué dans une large mesure à la défaite allemande.
Après l’effondrement de l’Union Soviétique et avec l’accès libre aux archives depuis les années 90 du 20ème siècle, ce mythe a été solidement égratigné. Pourtant, en Russie et surtout en Biélorussie, la guerre des partisans de 1941-45 est à nouveau glorifiée. Ce retour du mythe partisan a incité l’historien polonais Bogdan Musial à le démonter entièrement. Après avoir publié en 2004 un volume de documents intitulé « Partisans soviétiques en Biélorussie – Vues intérieures de la région de Baranovici 1941-1944 », il a sorti récemment une étude volumineuse sur l’histoire du mouvement partisan sur l’ensemble du territoire biélorusse. Au même moment et dans la même maison d’édition paraissait la thèse de doctorat d’Alexander Brakel, défendue en 2006 et publiée cette fois dans une version légèrement remaniée sur « la Biélorussie occidentale sous les occupations soviétiques et allemandes », ouvrage dans lequel l’histoire du mouvement local des partisans soviétiques est abordé en long et en large.
Ce qui est remarquable, c’est que nos deux auteurs ont travaillé indépendamment l’un de l’autre, sans se connaître, en utilisant des sources russes et biélorusses récemment mises à la disposition des chercheurs ; bien qu’ils aient tous deux des intérêts différents et utilisent des méthodes différentes, ils concordent sur l’essentiel et posent des jugements analogues sur le mouvement des partisans. Tant Musial que Brakel soulignent que le mouvement des partisans biélorusses, bien que ses effectifs aient sans cesse crû jusqu’en 1944, jusqu’à atteindre des dimensions considérables (140.000 partisans au début du mois de juin 1944), n’a jamais été un mouvement populaire au sens propre du terme, bénéficiant du soutien volontaire d’une large majorité de la population dans les régions occupées par les Allemands. Au contraire, la population de ces régions de la Biélorussie occidentale, qui avaient été polonaises jusqu’en septembre 1939, était plutôt bien disposée à l’égard des Allemands qui pénétraient dans le pays, du moins au début.
Jusqu’à la fin de l’année 1941, on ne pouvait pas vraiment parler d’une guerre des partisans en Biélorussie. Certes, les fonctionnaires soviétiques et les agents du NKVD, demeurés sur place, ont été incités depuis Moscou à commencer cette guerre. Mais comme en 1937 le pouvoir soviétique a décidé de changer de doctrine militaire et d’opter pour une doctrine purement offensive, tous les préparatifs pour une éventuelle guerre des partisans avaient été abandonnés : inciter les représentants du pouvoir soviétique demeurés sur place à la faire malgré tout constituait un effort somme toute assez vain. Le même raisonnement vaut pour les activités des petits groupes d’agents infiltrés en vue de perpétrer des sabotages ou de glaner des renseignements d’ordre militaire. Pour créer et consolider le mouvement des partisans en Biélorussie à partir de 1942, il a fallu faire appel à une toute autre catégorie de combattants : ceux que l’on appelait les « encerclés », soit les unités disloquées à la suite des grandes batailles d’encerclement de 1941 (les « Kesselschlachten »), et aussi les combattants de l’Armée Rouge qui s’étaient échappés de captivité ou même avaient été démobilisés ; vu le destin misérable qui attendaient les prisonniers de guerre soviétiques, ces hommes cherchaient à tout prix à échapper aux Allemands. De très nombreux soldats de ces catégories ont commencé à monter dès l’automne 1941 des « groupes de survie » dans les vastes zones de forêts et de marécages ou bien ont trouvé refuge chez les paysans, où ils se faisaient passer comme ouvriers agricoles. Peu de ces groupes ont mené une véritable guerre de partisans, seuls ceux qui étaient commandés par des officiers compétents, issus des unités encerclées et disloquées par l’avance allemande, l’ont fait. La plupart de ces groupes de survie n’avaient pas l’intention de s’attaquer à l’occupant ou de lui résister activement.
Sous la pression de la crise de l’hiver 1941/42 sur le front, les autorités d’occupation allemandes ont pris des mesures au printemps 42 qui se sont révélées totalement contre-productives. Avec des forces militaires complètement insuffisantes, les Allemands ont voulu obstinément « pacifier » les régions de l’arrière et favoriser leur exploitation économique maximale : pour y parvenir, ils ont opté pour une intimidation de la population. Ils ne se sont pas seulement tournés contre les partisans mais contre tous ceux qu’ils soupçonnaient d’aider les « bandes ». Pour Musial, ce fut surtout une exigence allemande, énoncée en avril 1942, qui donna l’impulsion initiale au mouvement des partisans ; cette exigence voulait que tous les soldats dispersés sur le territoire après les défaites soviétiques et tous les anciens prisonniers de guerre se présentent pour le service du travail, à défaut de quoi ils encourraient la peine de mort. C’est cette menace, suivie d’efforts allemands ultérieurs pour recruter par la contrainte des civils pour le service du travail, qui a poussé de plus en plus de Biélorusses dans les rangs des partisans.
C’est ainsi que les partisans ont pu étoffer considérablement leurs effectifs et constituer des zones d’activités partisanes de plus en plus vastes, où l’occupant et ses auxiliaires autochtones n’avaient plus aucun pouvoir. Mais l’augmentation des effectifs partisans ne provient pas d’abord pour l’essentiel d’autochtone biélorusses volontaires, car ceux-ci ne rejoignent les partisans que rarement et presque jamais pour des motifs idéologiques ou patriotiques mais plutôt pour échapper à la pression et aux mesures coercitives imposées par les Allemands. Dans « leurs » régions, les partisans, à leur tour, ont recruté de force de jeunes hommes et, pour leur échapper, certains fuiront également dans les forêts.
Malgré l’augmentation considérable des effectifs partisans à partir de 1942, le bilan militaire de la guerre des partisans en Biélorussie demeure vraiment maigre. Elle n’a pas provoqué, comme le veut le mythe soviétique, la perte de près d’un demi million de soldats allemands, mais seulement de 7000. A ce chiffre, il faut ajouter un nombre bien plus considérable de policiers et de gardes autochtones, en tout entre 35.000 et 50.000 hommes. Comme la plupart des unités d’occupation engagées en Biélorussie étaient inaptes au front, le fait qu’elles aient été décimées ou maintenues sur place n’a pas pour autant affaibli les premières lignes. De même, la « guerre des rails », amorcée par les partisans en 1943, avait pour but d’interrompre les voies de communication ferroviaire des Allemands mais n’a jamais atteint l’ampleur qu’escomptaient les Soviétiques ; à aucun moment, cette guerre des rails n’a pu bloquer l’acheminement logistique allemand vers le front. Quant aux renseignements militaires que devaient glaner les partisans pour le compte de l’Armée Rouge, ils n’ont guère fourni d’informations utiles. En revanche, ce qu’il faut bien mettre au compte des partisans, c’est 1) d’avoir rendu de vastes zones de Biélorussie inexploitables sur le plan économique et 2) d’avoir rendu peu sûres les positions de l’occupant sur les arrières du front.
Le peu d’importance stratégique de la guerre des partisans en Biélorussie a plusieurs causes. Les partisans ont certes pu se fournir en armes, au début, en puisant dans les stocks abandonnés sur les champs de bataille de 1941, mais, dans l’ensemble, leur base logistique est demeurée faible, en dépit d’approvisionnements aériens sporadiques. Les armes et surtout les munitions, de même que les explosifs pour les actions de sabotage, sont demeurés des denrées rares. Plus grave encore : les partisans disposaient de trop peu d’appareils radio. Même si, à partir de 1942, le mouvement partisan disposait d’un état-major central et d’états-majors régionaux, qui lui étaient subordonnés, et donc d’une structure de commandement solide à première vue, il lui manquait surtout de moyens de communiquer, pour permettre au mouvement partisan de se transformer en une force combattante dirigée par un commandement unitaire et opérant à l’unisson. On en resta à une pluralité de « brigades » isolées, sous la férule de commandants locaux de valeurs très inégales et que l’on ne pouvait que difficilement coordonner.
On ne s’étonnera donc pas d’apprendre que la plupart des groupes partisans évitaient autant que possible de perpétrer des attaques directes contre les Allemands et se bornaient à combattre les collaborateurs de ceux-ci, comme les gardes de village, les maires et les policiers ; ou exerçaient la terreur contre tous ceux qui, forcés ou non, travaillaient pour les Allemands. Les principales actions qu’ils ont menées, et quasiment les seules, furent des « opérations économiques » : se procurer des vivres, de l’alcool et d’autres biens d’usage auprès de la population rurale. Celle-ci ne cédait pas ses avoirs aux partisans volontairement et de gaîté de cœur, contrairement à ce qu’affirme le mythe soviétique. Les paysans donnaient mais sous la contrainte ou sous la menace de violences et de représailles. Dans le meilleur des cas, les partisans tenaient plus ou moins compte des besoins vitaux de la population rurale mais, dans la plupart des cas, ils pillaient sans le moindre état d’âme, incendiaient, violaient et assassinaient. Pour la plupart des paysans biélorusses, les partisans n’étaient rien d’autre que des bandes de pillards.
Quasiment nulle part les partisans se sont montrés à même d’offrir une véritable protection à la population autochtone contre les troupes allemandes et contre les raids de confiscation et de réquisition qu’elles menaient. Lors d’actions ennemies de grande envergure, les partisans se retiraient, s’ils le pouvaient. Les ruraux habitant les zones tenues par les partisans risquaient en plus d’être considérés par les Allemands comme des « complices des bandes » et de subir des représailles : villages incendiés, massacres ou déportation de la population. Les survivants juifs des mesures allemandes de persécution et d’extermination n’ont que rarement trouvé refuge et protection chez les partisans, tandis que ces mesures cruelles étaient acceptées sans trop de réticence par les autochtones biélorusses ou polonais.
Musial et Brakel ne cessent, dans leurs études respectives, de souligner la situation désespérée dans laquelle fut plongée la majeure partie de la population biélorusse après le déclenchement de la guerre des partisans. Dans leur écrasante majorité, les Biélorusses, les Polonais et aussi les Juifs —auxquels les intentions exterminatrices, motivées par l’idéologie nationale-socialiste, du SD et de la SS, ne laissaient aucune chance, même si les pratiques avaient été plus ou moins « rationalisées » dans le but de ne pas laisser trop d’habitants filer vers les partisans— aspiraient à sortir de la guerre sains et saufs, sans avoir à prendre parti. La politique violente pratiquée tant par les occupants que par les partisans soviétiques (et, dans les régions anciennement polonaises, par l’armée secrète polonaise) ne leur laissait pourtant pas d’autres choix que de prendre parti.
Dans ce glissement, les affinités politiques et idéologiques et l’appartenance ethnique ne jouèrent pratiquement aucun rôle. La plupart optaient pour le camp dont il craignaient le plus la violence. Dans les grandes villes et le long des principales voies de chemin de fer, l’option fut généralement pro-allemande ; dans les zones forestières tenues par les partisans, l’option fut en faveur du camp soviétique, ou, dans certaines régions, en faveur de l’ « Armia Krajowa » polonaise. Dans ce contexte, la guerre des partisans en Biélorussie constitue une guerre civile, ce que corrobore notamment les pertes en vies humaines ; une guerre civile où, dans tous les camps, on trouve plus de combattants forcés que volontaires. Il y eut des centaines de milliers de victimes civiles, devenues auparavant, sans l’avoir voulu, soit des « complices des bandes » soit des « collaborateurs des fascistes » ou ont été déclarées telles avant qu’on ne les fasse périr. Brakel résume la situation : « Le combat partisan contre le cruel régime allemand d’occupation est bien compréhensible mais, pour les habitants de l’Oblast de Baranowicze, il aurait mieux valu qu’il n’ait jamais eu lieu ». Cette remarque est certes valable pour la région de Baranowicze et vaut tout autant pour le reste de la Biélorussie. Et pour la plupart des guerres de partisans ailleurs dans le monde.
Ce qui est intéressant à noter, c’est que deux historiens, indépendants l’un de l’autre, ne se connaissant pas, l’un Allemand et l’autre Polonais, ont eu le courage de mettre cette vérité en exergue dans leurs travaux et de démonter, par la même occasion, le mythe des « partisans luttant héroïquement pour la patrie soviétique », tenace aussi dans l’Allemagne contemporaine. On ne nie pas qu’il eut des partisans communistes soviétiques en Biélorussie pendant la seconde guerre mondiale : on explique et on démontre seulement qu’ils étaient fort peu nombreux. Brakel et Musial ne sont pas des « révisionnistes », qui cherchent à dédouaner l’occupant allemand et ses auxiliaires : ils incluent dans leurs démonstrations certains leitmotive des historiographies à la mode et ne tentent nullement de se mettre délibérément en porte-à-faux avec l’esprit de notre temps. Dans leur chef, c’est bien compréhensible.
Dag KRIENEN.
(Recension parue dans « Junge Freiheit », Berlin, n°47/2009 ; trad. franc. : Robert Steuckers).
Sources :
Bogdan MUSIAL, « Sowjetische Partisanen 1941-1944 – Mythos und Wirklichkeit », Schöningh Verlag, Paderborn, 2009, 592 pages, 39,90 Euro.
Alexander BRAKEL, « Unter Rotem Stern und Hakenkreuz : Baranowicze 1939 bis 1944. Das westliche Weissrussland unter sowjetischer und deutsche Besatzung », Schöningh Verlag, Paderborn, 2009, XII et 426 pages, nombreuses illustrations, 39,90 Euro.
00:10 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale, biélorussie, pologne, allemagne, partisans, urss, union soviétique, histoire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Les visions d'Europe à la base de la "Révolution Conservatrice"
Université d'été de la F.A.C.E. (juillet 1995) - Résumé des interventions
Vendredi 28 juillet 1995 (après-midi)
Les visions d'Europe à la base de la “Révolution Conservatrice”
(Intervention de Robert Steuckers)
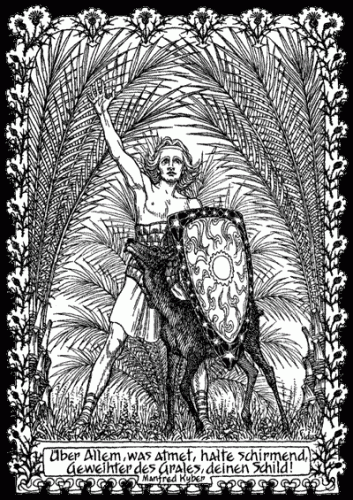 Première question: la révolution conservatrice allemande a-t-elle développé des visions d'Europe nouvelles et vraiment spécifiques? Réponse: pas vraiment. Des visions d'Europe très différentes se bousculent dans les corpus théoriques de ceux qu'Armin Mohler compte parmi les représentants de ce courant de pensée, né au cours d'une longue “période axiologique” de l'histoire, soit une période où de nouvelles valeurs se pensent, s'insinuent (lentement) dans les esprits et s'installent dans la société et dans le concert des nations. Les valeurs que représente la “révolution conservatrice” sont des valeurs qui entendent remplacer celles mises en avant pas les formes involuées de christianisme anorganique et par l'idéologie des Lumières, induite par la révolution française. L'idéologie de la révolution conservatrice ne date donc pas de ce siècle. Elle n'est pas tombée subitement du ciel après 1918.
Première question: la révolution conservatrice allemande a-t-elle développé des visions d'Europe nouvelles et vraiment spécifiques? Réponse: pas vraiment. Des visions d'Europe très différentes se bousculent dans les corpus théoriques de ceux qu'Armin Mohler compte parmi les représentants de ce courant de pensée, né au cours d'une longue “période axiologique” de l'histoire, soit une période où de nouvelles valeurs se pensent, s'insinuent (lentement) dans les esprits et s'installent dans la société et dans le concert des nations. Les valeurs que représente la “révolution conservatrice” sont des valeurs qui entendent remplacer celles mises en avant pas les formes involuées de christianisme anorganique et par l'idéologie des Lumières, induite par la révolution française. L'idéologie de la révolution conservatrice ne date donc pas de ce siècle. Elle n'est pas tombée subitement du ciel après 1918.
La RC consiste en un interprétation nouvelle de l'héritage nationaliste, protestant et hégélien (où la “nation” particulière, en l'occurrence la nation allemande) est l'instrument du Weltgeist); elle est une traduction idéologico-politique des philosophies de la Vie, mâtinée de darwinisme ou de biologisme matérialiste (Haeckel) voire d'une interprétation vitaliste du “mystère de l'incarnation” cher à beaucoup de catholiques populistes et/ou conservateurs; enfin, elle est un espace idéologique où l'on tente de concrétiser la vision nietzschéenne de la volonté de puissance ou la notion bergsonienne d'“élan vital”.
En ce qui concerne les visions d'Europe, la RC a aussi des antécédents. A l'époque des Lumières, les intellectuels européens décrivent l'Europe comme un espace de civilisation, de “bon goût”. Mais un certain pessimisme constate que cette civilisation entre en déclin, qu'elle est inadaptée aux premières manifestations d'industrialisme, que le culte de la raison, qui est son apanage, bat de l'aile et que le modèle français, qui en est le paradigme, vient à être de plus en plus souvent contesté (hostilité à la “gallomanie”, non seulement dans les pays germaniques, mais aussi dans les pays latins).
Herder propose dans ce contexte une vision, une manière de voir (Sehweise), qui met en exergue le sens de l'individualité historique des constructions collectives. Contrairement à Rousseau, qui raisonne en termes d'individus, de nations et d'universalité, et qui juge, péremptoire, que l'Europe est “moralement condamnable”, Herder voit des peuples et des cultures enracinés, dont il faut conserver et entretenir les spécificités. L'Europe qu'il appelle de ses vœux est un concert de peuples différents et enracinés. L'Europe, telle qu'elle existe, n'est pas “moralement condamnable” en soi, mais il faut veiller à ne pas exporter, en dehors d'Europe, une européisme artificiel, basé sur les canons de la gallomanie et du culte figé d'une antiquité greco-romaine ad usum delphini. L'Europe dont rêve Herder n'est pas une société d'Etats-personnes mais doit devenir une communauté de personnalités nationales.
Tel était le débat juste avant que n'éclate la révolution française. Après les tumultes révolutionnaires, Napoléon crée le bloc continental par la force des armes. Ce bloc doit devenir autarcique (Bertrand de Jouvenel écrira dans les années 30 l'ouvrage le plus précis sur la question). Napoléon a à ses côtés des partisans allemands de ce grand dessein continental (Dalberg, Krause, le poète Jean-Paul). Ce bloc doit être dirigé contre l'Angleterre. A Paris, le Comte d'Hauterive décrit ce bloc autarcique comme un “système général”, orchestrée par la France, qui organisera le continent pour qu'il puisse s'opposer efficacement à la “mer”. Dès 1795, le Prussien Theremin, dans un ouvrage écrit en français (Des intérêts des puissances continentales relativement à l'Angleterre), s'insurge contre la politique anglaise de colonisation commerciale de l'Europe et des Indes. Le système libre-échangiste anglais est dès lors un “despotisme maritime” (idée qui sera reprise par l'école des géopolitologues, rassemblée autour de la personne du Général Haushofer). Le Baron von Aretin (1733-1824), revendique une “Europe celtique”, fusion de la romanité française et de la germanité catholique de l'Allemagne du Sud, qui s'opposerait au “borussisme”, à l'“anglicisme” et au “protestantisme” particulariste. Après 1815, les “continentalistes” ne désarment pas: Welcker propose une alliance entre la France et la Prusse pour réorganiser l'Europe; Glave, lui, propose une alliance entre la France et l'Autriche, pour exclure la Russie et l'Empire ottoman du concert européen. Woltmann, dans Der neue Leviathan, propose une Gesamteuropa contre l'universalisme thalassocratique, thèses qui annoncent celles de Carl Schmitt. Bülow suggère l'avènement d'une “monarchie européenne universelle” qui procèdera à la conquête de l'Angleterre et unifiera le continent par le truchement d'un projet culturel, visant à éliminer les petits particularismes pouvant devenir autant de prétextes à des manipulations ou des pressions extérieures.
Parmi les adversaires conservateurs et légitimistes de Napoléon, nous trouvons les partisans d'un équilibre européen, où toutes les nations doivent s'auto-limiter dans la discipline (principe en vigueur dans l'Europe actuelle). Les Républicains nationalistes (Fichte, Jahn) qui se sont opposés à Napoléon parce qu'ils l'accusaient de faire du “néo-monarchisme” veulent un repli sur le cadre national ou sur de vastes confédérations de peuples apparentés par la langue ou par les mœurs. Les partisans de la restauration autour de Metternich plaident pour un bloc européen assez lâche, la Sainte-Alliance de 1815 ou la Pentarchie de 1822. La Restauration veut réorganiser rationnellement l'Europe sur base des acquis de l'Ancien Régime, remis en selle en 1815. Franz von Baader, dans ce contexte, suggère une “Union Religieuse” (qui sera refusée par les catholiques intransigeants), où les trois variantes du christianisme européen (catholicisme, protestantisme, orthodoxie) unifieraient leurs efforts contre les principes laïques de la révolution française. A cette époque, la Russie est considérée comme le bastion ultime de la religion (cf. les textes du Russe Tioutchev, puis ceux de Dostoïevski, notamment le Journal d'un écrivain). Cette russophilie conservatrice et restauratrice explique l'Ostorientierung de la future RC, initiée par Moeller van den Bruck. Le continentaliste russophile le plus cohérent est le diplomate danois Schmidt-Phiseldeck qui plaide, dans un texte largement répandu dans les milieux diplomatiques, pour un eurocentrage des forces de l'Europe, contre les entreprises colonialistes; Schmidt-Phiseldeck veut l'“intégration intérieure”. Il avertit ses contemporains du danger américain et estime que la seule expansion possible est en direction de Byzance, c'est-à-dire que la Pentarchie européenne doit lever un corps expéditionnaire qui envahira l'Empire Ottoman et l'incluera dans le concert européen. Cette volonté d'expansion concertée et paneuropéenne vers le Sud-Est sera reprise en termes pacifiques sous Guillaume II, avec le projet de chemin de fer Berlin-Bagdad qui suscitera la fameuse “question d'Orient”. Görres, ancien révolutionnaire, voit dans l'Allemagne recatholicisée l'hegemon européen pacifique, contraire diamétral du bellicisme moderne napoléonien. L'Allemagne doit joue ce rôle parce qu'elle est la voisine de presque tous les autres peuples du continent: elle en est donc l'élément fédérateur par destin géographique. L'universalité (c'est-à-dire l'“européanité”) de l'Allemagne vient de l'hétérogénéité de son voisinage, car elle peut intégrer, assimiler et synthétiser mieux et plus que les autres.
Constantin Frantz met en garde ses contemporains contre les fanatismes idéologiques: l'ultramontanisme catholique, le particularisme catholique en Bavière, le national-libéralisme prussien, le capitalisme, etc. Le Reich doit organiser la Mitteleuropa, se doter d'une constitution fédéraliste, conserver et renforcer sa place au sein de l'équilibre pentarchique européen. Mais celui-ci est en danger, à cause de l'extraversion que provoquent les aventures coloniales de l'Angleterre, qui se cherche un destin sur les mers, et de la France, qui s'est embarquée dans une aventure algérienne et africaine. Les Occidentaux provoquent la guerre de Crimée, en prenant le parti d'un Etat qui n'appartient pas à la Pentarchie (la Turquie) contre un Etat qui en est un pilier constitutif (la Russie).
Sous Guillaume II, les plans de réorganisation de la Mitteleuropa, plans tous parfaitement extensibles à l'ensemble de notre sous-continent, se succèdent. La plupart de ces projets évoquent une alliance et une fusion (d'abord économique) entre l'Allemagne forgée par Bismarck et l'Empire austro-hongrois. Dans l'optique des protagonistes, il s'agissait de parfaire une élargissement grand-allemand du Zollverein, en marche depuis le milieu du siècle. Le Français Guillaume de Molinari, “doctrinaire” du libéralisme, envisage une alliance entre l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la France, la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark et la Suisse, dans un article qui connaîtra un grand retentissement dans les milieux industriels et diplomatiques: «Union douanière de l'Europe centrale» (in: Journal des économistes, V, 4, 1879, pp. 309-318). Paul de Lagarde, l'orientaliste aux origines intellectuelles du mouvement pangermaniste (Alldeutscher Verband) et, pour certains, du national-socialisme, la “Mitteleuropa” devait se limiter aux espaces germaniques et s'organiser comme un bloc contre la Russie. Paul de Lagarde est ainsi le premier homme de droite, élaborant des projets européens, qui est russophobe et non pas russophile. La russophobie étant une tradition de gauche au XIXième siècle. La tradition pangermaniste/pré-nationale-socialiste est donc russophobe et la RC, initiée par Moeller van den Bruck, reste russophile, en dépit de l'avènement du bolchevisme. Telle est la grande différence entre les deux mouvements. En 1895, l'industriel et économiste autrichien Alexander von Peez exhorte les Européens à prendre conscience des dangers du panaméricainisme, incarné par les actions de la Navy League de l'Amiral Mahan. Pour von Peez, l'Europe doit se constituer en un bloc pour s'opposer à la Panamérique, sinon tous les peuples de la Terre risquent de périr sous les effets de l'“américanisation universelle”. Plus tard, ce type d'argumentation sera repris par Adolf Hallfeld, Giselher Wirsing et Haushofer (dans sa dénonciation de la “politique de l'anaconda”).
Les libéraux de gauche Ernst Jäckh et Paul Rohrbach restent russophobes, parce que c'est la tradition dans le milieu politico-idéologique dont ils sont issus, mais suggèrent une alliance ottomane et militent en faveur du chemin de fer Berlin-Bagdad. En fait, ils reprennent l'idée d'un contrôle européen (ou simplement allemand) de l'Anatolie, de la Mésopotamie et de la Palestine que l'on trouvait jadis chez Schmidt-Phiseldeck. Mais ce contrôle s'effectuera dans la paix, par la coopération économique et l'aide au développement et non pas par une conquête violente et un peuplement de ces régions par le trop-plein démographique russe. L'alliance entre les Empires européens et la Sublime Porte sera une alliance entre égaux, sans discrimination religieuse. Paradoxalement, ce faisceau d'idées généreuses, annonciatrices du tiers-mondisme désintéressé, hérisse les Britanniques, déjà agacés par l'accroissement en puissance de la flotte allemande, créée non pas pour s'opposer à l'Angleterre mais pour faire pièce à la Navy League américaine. Ce n'est donc pas le pangermanisme, dénoncé effectivement dans les propagandes anglaise et française, qui est le véritable prétexte de la première guerre mondiale. Les discours nationalistes et racialistes des pangermanistes ne choquaient pas fondamentalement les Anglais, qui en tenaient d'aussi radicaux et d'aussi vexants pour les peuples colonisés, mais cette volonté de coopération entre Européens et Ottomans en vue de réorganiser harmonieusement les zones les plus turbulentes de la planète.
Robert Steuckers n'a pu, en deux heures et demie, que nous donner une fraction infime de ce grand travail sur l'Europe. A la suite des thématiques et des figures analysées, son texte écrit compte une analyse de la situation sous Weimar, les pourparlers entre Briand et Stresemann, la vision européenne des conservateurs catholiques et de Hugo von Hoffmannstahl, la logique paneuropéenne dans l'école de haushofer et plus particulièrement chez Karl C. von Loesch, les idées de Ludwig Reichhold, celles du Prince Karl Anton Rohan (ami d'Evola), du grand sociologue Eugen Rosenstock-Huessy, de l'esthète Rudolf Pannwitz, de Leopold Ziegler, la diplomatie classique de Staline pendant la seconde guerre mondiale (qui explique la russophilie d'une bonne part de la droite allemande, conservatrice ou nationaliste). Le texte paraîtra in extenso sous forme de livre.
00:05 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : révolution conservatrice, allemagne, europe, affaires européennes, théorie politique, philosophie, sciences politiques, politologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 15 février 2010
Offizielle Anfrage der französische Regierung an die USA über geheime LSD-Experimente in den 1950er-Jahre
Offizielle Anfrage der französischen Regierung an die USA über geheime LSD-Experimente in den 1950er-Jahren
Dieser Tage entsteht ein diplomatischer und politischer Skandal, der erhebliche Auswirkungen auf die amerikanisch-französischen Beziehungen haben könnte. Ausgelöst wurde er durch neue Untersuchungen des mysteriösen Ausbruchs von »Massenwahnsinn« in einem südfranzösischen Dorf, bei dem etwa 500 Menschen erkrankten und fünf starben.
 Wie zuverlässige amerikanische Quellen berichten, ist beim Bureau of Intelligence and Research des US-Außenministeriums eine vertrauliche Anfrage des Büros von Erard Corbin de Mangoux, dem Chef des französischen Auslandsnachrichtendienstes DGSE (Direction Générale de la Sécurité Extérieure) eingegangen. Den Berichten zufolge bezieht sich die Anfrage auf die kürzlich veröffentlichte Darstellung über die Mitschuld der US-Regierung an dem mysteriösen Ausbruch von Massenwahnsinn in dem südfranzösischen Dorf Pont-Saint-Esprit im Jahr 1951.
Wie zuverlässige amerikanische Quellen berichten, ist beim Bureau of Intelligence and Research des US-Außenministeriums eine vertrauliche Anfrage des Büros von Erard Corbin de Mangoux, dem Chef des französischen Auslandsnachrichtendienstes DGSE (Direction Générale de la Sécurité Extérieure) eingegangen. Den Berichten zufolge bezieht sich die Anfrage auf die kürzlich veröffentlichte Darstellung über die Mitschuld der US-Regierung an dem mysteriösen Ausbruch von Massenwahnsinn in dem südfranzösischen Dorf Pont-Saint-Esprit im Jahr 1951.
Fast 500 Menschen waren damals betroffen, mindestens fünf von ihnen sind gestorben. Beinahe 60 Jahre lang hat man den Vorfall von Pont-St.-Esprit entweder auf eine Mutterkorn-Vergiftung – angeblich hatten die Dorfbewohner Brot gegessen, das mit bewusstseinverändernd wirkendem Schimmel verunreinigt war – oder auf eine organische Quecksilbervergiftung geschoben.
Ein kürzlich in den USA erschienenes Buch erhebt aufgrund von ausführlichen Interviews mit inzwischen pensionierten US-Geheimdienstmitarbeitern, die über die Vorgänge in Frankreich im Jahr 1951 direkt informiert waren, den Vorwurf, bei dem bis heute nicht geklärten Ausbruch von »Massenwahnsinn« in dem entlegenen Dorf handele es sich in Wirklichkeit um ein Top-Secret-CIA-Experiment, das im Rahmen des CIA-Forschungsprogramms MKULTRA (wie in ultra-geheim) durchgeführt wurde.
In seinem Buch A Terrible Mistake: The Murder of Frank Olson and the CIA’s Secret Cold War Experiments zu (Deutsch: Ein schrecklicher Fehler: Der Mord an Frank Olson und die CIA-Experimente im Kalten Krieg) dokumentiert der investigative Journalist H.P. Albarelli, dass der Krankheitsausbruch in Pont-St.-Esprit auf ein geheimes Projekt unter der Leitung der streng geheimen Abteilung Special Operations Division der US Army in Fort Detrick im US-Bundesstaat Maryland zurückzuführen ist, bei dem LSD versprüht wurde. Seiner Schilderung nach arbeiteten die Wissenschaftler, die mit der falschen Begründung verunreinigten Brotes oder einer Quecksilbervergiftung die wahre Ursache des Vorfalls vertuscht haben, für das Pharmaunternehmen Sandoz, das sowohl der US Army als auch der CIA mit LSD für Forschungszwecke geliefert hatte.
Eine französische Zeitung hatte damals über bizarre Vorfälle berichtet: »Es ist weder Shakespeare noch Edgar Poe. Es ist – leider! – die traurige Realität von Pont-St.-Esprit und seiner Umgebung, wo sich furchtbare Szenen von Halluzinationen abspielen, die geradewegs aus dem Mittelalter stammen könnten, Szenen voller Schrecken und Pathos, voll dunkler Schatten.« Die amerikanische Zeitschrift Time Magazine, deren Herausgeber Henry Luce eng mit den Propagandaaktivitäten der CIA in den 1950er-Jahren verbunden war, berichtete: »Betroffene fielen ins Delirium: Patienten warfen sich auf dem Bett hin und her, sie schrien entsetzt, aus ihrem Körper sprießten rote Blumen, ihre Köpfe hätten sich in geschmolzenes Blei verwandelt. Aus dem Krankenhaus von Pont-Saint-Esprit wurden vier Selbstmordversuche gemeldet.«
Laut Albarelli heißt es auf der Website des US-Justizministeriums bezüglich der Gefahren von LSD, Anfang der 1950er-Jahre sei »das Chemieunternehmen Sandoz so weit gegangen, der US-Regierung LSD als potenzielle geheime Waffen chemischer Kriegsführung anzupreisen. Sein Hauptverkaufsargument war dabei, schon eine kleine Menge könne, dem Trinkwasser zugesetzt oder in der Luft versprüht, eine ganze Armee von Soldaten orientierungslos, psychotisch und damit kampfunfähig machen.«
Seiner Darstellung nach lagen der CIA verschiedene Vorschläge amerikanischer Wissenschaftler vor, der Wasserversorgung einer mittelgroßen bis großen Stadt eine größere Menge LSD unterzumischen, doch nach Angaben ehemaliger Beamter der Behörde »ist das Experiment wegen der unerwarteten Zahl von Todesopfern bei der Operation in Frankreich nie genehmigt worden«.
Im Rahmen der Forschung über LSD als Offensivwaffe hat die US Army laut Albarelli in der Zeit von 1953 bis 1965 über 5.700 ahnungslose amerikanischen Militärangehörigen Drogen verabreicht. Aufgrund geheimer Verträge mit mehr als 325 Colleges, Universitäten und Forschungseinrichtungen in den USA, Kanada und Europa wurden gemeinsam mit der CIA an weiteren 2.500 Personen umfangreiche Tests mit LSD und anderen Drogen durchgeführt, viele davon waren Krankenhauspatienten und College-Studenten.
Ein Beamter der DGSE, der nicht namentlich genannt werden wollte, erklärt: »Sollten sich die Enthüllungen im Einzelnen als wahr erweisen, wäre dies für die Menschen in Pont-St.-Esprit und für alle Bürger Frankreichs äußerst bedrückend. Dass Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bewusst unschuldige ausländische Bürger zur Zielscheibe eines solchen Experiments machen würden, stellt einen Verstoß gegen das Völkerrecht und eine Verletzung internationaler Verträge dar.«
Montag, 08.02.2010
© Das Copyright dieser Seite liegt, wenn nicht anders vermerkt, beim Kopp Verlag, Rottenburg
Dieser Beitrag stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers dar. Er muß nicht zwangsläufig die Meinung des Verlags oder die Meinung anderer Autoren dieser Seiten wiedergeben.
00:21 Publié dans Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : affaires européennes, politique internationale, actualité, france, etats-unis, drogues, cia, lsd, services secrets, années 50 |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Quais de Meuse à Fumay

00:10 Publié dans Photos | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : meuse, vallée mosane, terres d'europe, terroirs, racines, paysages, architecture, 17ème siècle, fumay |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Per Olov Enquist et le traumatisme des Suédois
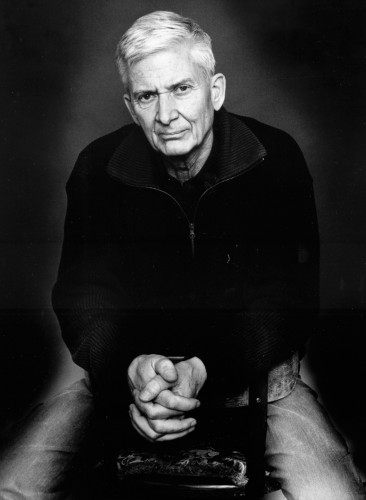
Per Olov Enquist et le traumatisme des Suédois
Il y a quelques semaines sont parues en langue néerlandaise les mémoires du très célèbre romancier suédois, mondialement connu, Per Olov Enquist, sous le titre de « Een ander leven » (= « Une autre vie »). Dans ces mémoires, il consacre plusieurs passages (pages 191 à 207) à un roman documentaire, « Legionärerna » (= Les légionnaires »), dont il existe également une version néerlandaise, ouvrage qu’il avait publié en 1968. Le livre traite des Baltes et des Allemands réfugiés en Suède et livrés aux Soviétiques entre novembre 1945 et janvier 1946. Ce livre a permis aussi, ultérieurement, de réaliser un film sur cet événement qui constitue toujours un traumatisme permanent en Suède. Le livre d’Enquist est paru à un moment où la Suède s’imaginait être la conscience morale du monde. Cette situation mérite quelques explications.
A la fin de la deuxième guerre mondiale, 3000 soldats de la Wehrmacht allemande avaient trouvé refuge sur le territoire suédois. Ils avaient été internés dans le pays. Ils avaient tenté d’échapper à l’Armée Rouge en imaginant se mettre à l’abri dans une Suède jugée sûre. L’histoire a très mal fini. Le 2 juin 1945, l’Union Soviétique exige que tous les soldats arrivés en Suède après le 8 mai 1945 leur soient livrés. Le gouvernement socialiste de Stockholm répondit le 16 juin 1945 qu’il livrerait tous les soldats de la Wehrmacht, donc aussi ceux qui avaient débarqué en Suède avant le 8 mai. Le gouvernement suédois tenait absolument à garder de bonnes relations avec l’Union Soviétique, surtout qu’il avait tout de même certaines choses à se reprocher. Pendant la guerre, les Suédois n’avaient jamais cessé de livrer du minerais de fer aux Allemands et avaient autorisé le transport de troupes allemandes à travers le territoire suédois, en direction de la Finlande.
A la fin du mois de novembre 1945, un navire soviétique, un transporteur de troupes, arrive dans le port de Trelleborg. Immédiatement, les soldats menacés d’être livrés optent pour la résistance passive. Plusieurs d’entre eux font la grève de la faim. Une tempête de protestation secoue les médias. Dans le centre de la capitale suédoise, des citoyens outrés organisent des manifestations. Les manifestants suédois savaient que les soldats qui seraient livrés allaient au devant d’une mort certaine. Bon nombre d’officiers suédois refusèrent d’exécuter les ordres. On chargea donc la sûreté de l’Etat d’exécuter l’ordre d’expulsion.
Le premier jour, soit le 30 novembre 1945, les agents de la sûreté parvinrent à mettre de force 1600 soldats sur le navire soviétique. Il y eut des scènes déchirantes. Plusieurs soldats se suicidèrent et environ 80 hommes s’automutilèrent. Ceux-ci furent à nouveau internés et échappèrent ainsi au sort fatal qu’on leur réservait, car ils furent confiés à des autorités civiles. Les blessés furent acheminés vers l’Union Soviétique en deux transports, les 17 décembre 1945 et 24 janvier 1946. Ensuite, 310 internés furent mis à la disposition des Britanniques et 50 autres livrés aux Polonais.
Au total, 2520 soldats de la Wehrmacht ont été déportés de Suède en Union Soviétique. On n’a jamais rien su de leur sort ultérieur. Aujourd’hui encore, le mystère demeure. Parmi eux se trouvaient 146 soldats de la Waffen SS originaires des Pays Baltes. Ce fut surtout leur sort qui a ému les Suédois. La trahison à l’égard des Baltes est devenu le traumatisme récurrent de la Suède contemporaine. Le gouvernement a essayé de se défendre en arguant que les Britanniques avaient, eux aussi, livré aux Soviétiques des dizaines de milliers de cosaques et de soldats russes de l’Armée Vlassov. L’émoi national eut toutefois pour résultat que le gouvernement suédois refusa de livrer les réfugiés civils issus des Pays Baltes. La livraison des soldats baltes, en revanche, a déterminé toute la période de la Guerre Froide en Suède.
Le 20 juin 1994, le ministre suédois des affaires étrangères s’est excusé, au nom de son gouvernement, auprès de la Lituanie, de l’Estonie et de la Lettonie, parce que la Suède avait livré jadis leurs compatriotes à l’empire rouge de Staline.
« Maekeblyde » / « ‘t Pallieterke ».
(article paru dans « ‘t Pallieterke », Anvers, 3 février 2010 ; trad. franc. : Robert Steuckers).
Source :
Per Olov ENQUIST, « Een ander leven », Amsterdam, Anthos, 2009, 493 pages, 25,00 Euro – ISBN 978 90 4141 416 8.
00:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres suédoises, littérature suédoise, lettres scandinaves, littérature scandinave, scandinavie, suède, deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale, pays baltes, allemagne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Guillaume Faye et la "convergence des catastrophes"
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 2006
Guillaume Faye et la “Convergence des catastrophes”
par Robert STEUCKERS
Introduction à la présentation par Guillaume Faye du livre “La convergence des catastrophes”, signé Guillaume Corvus, Bruxelles, Ravensteinhof, 21 janvier 2006
 Dans l’introduction à l’une des versions italiennes du premier livre de Guillaume Faye, “Le système à tuer les peuples”, j’avais tenté de brosser succinctement son itinéraire politique, depuis ses années d’étudiant à l’IEP et à la Sorbonne. J’avais rappelé l’influence d’un Julien Freund, des thèses de Pareto, de Bertrand de Jouvenel sur ce jeune étudiant dont la vocation allait être de mener un combat métapolitique, via le “Cercle Spengler” d’abord, via le GRECE (Groupe de Recherche et d’Etudes sur la Civilisation Européenne) ensuite. J’avais insisté aussi sur son interprétation de Nietzsche, où, comme Alexis Philonenko, il pariait sur un rire sonore et somme toute rabelaisien, un rire déconstructeur et reconstructeur tout à la fois, sur la moquerie qui dissout les certitudes des médiocres et des conformistes. Je ne vais pas répéter aujourd’hui tout cet exposé, qu’on peut lire sur internet, mais je me concentrerai surtout sur une notion omniprésente dans les travaux de Faye, la notion cardinale de “politique”, oui, sur cette “notion du politique”, si chère au Professeur Julien Freund. L’espace du politique, et non pas de la politique (politicienne), est l’espace des enjeux réels, ceux qui décident de la vie ou de la survie d’une entité politique. Cette vie et cette survie postulent en permanence une bonne gestion, un bon “nomos de l’oikos” —pour reprendre la terminologie grecque de Carl Schmitt— une pensée permanente du long terme et non pas une focalisation sur le seul court terme, l’immédiat sans profondeur temporelle et le présentisme répétitif dépourvu de toute prospective.
Dans l’introduction à l’une des versions italiennes du premier livre de Guillaume Faye, “Le système à tuer les peuples”, j’avais tenté de brosser succinctement son itinéraire politique, depuis ses années d’étudiant à l’IEP et à la Sorbonne. J’avais rappelé l’influence d’un Julien Freund, des thèses de Pareto, de Bertrand de Jouvenel sur ce jeune étudiant dont la vocation allait être de mener un combat métapolitique, via le “Cercle Spengler” d’abord, via le GRECE (Groupe de Recherche et d’Etudes sur la Civilisation Européenne) ensuite. J’avais insisté aussi sur son interprétation de Nietzsche, où, comme Alexis Philonenko, il pariait sur un rire sonore et somme toute rabelaisien, un rire déconstructeur et reconstructeur tout à la fois, sur la moquerie qui dissout les certitudes des médiocres et des conformistes. Je ne vais pas répéter aujourd’hui tout cet exposé, qu’on peut lire sur internet, mais je me concentrerai surtout sur une notion omniprésente dans les travaux de Faye, la notion cardinale de “politique”, oui, sur cette “notion du politique”, si chère au Professeur Julien Freund. L’espace du politique, et non pas de la politique (politicienne), est l’espace des enjeux réels, ceux qui décident de la vie ou de la survie d’une entité politique. Cette vie et cette survie postulent en permanence une bonne gestion, un bon “nomos de l’oikos” —pour reprendre la terminologie grecque de Carl Schmitt— une pensée permanente du long terme et non pas une focalisation sur le seul court terme, l’immédiat sans profondeur temporelle et le présentisme répétitif dépourvu de toute prospective.
Le bon “nomos” est celui qui assure donc la survie d’une communauté politique, d’un Etat ou d’un empire, qui, par la clairvoyance et la prévoyance quotidiennes qu’il implique, génère une large plus-value, en tous domaines, qui conduit à la puissance, au bon sens du terme. La puissance n’est rien d’autre qu’un solide capital de ressources matérielles et immatérielles, accumulées en prévision de coups durs, de ressacs ou de catastrophes. C’est le projet essentiel de Clausewitz, dont on fait un peu trop rapidement un belliciste à tous crins. Clausewitz insiste surtout sur l’accumulation de ressources qui rendront la guerre inutile, parce que l’ennemi n’osera pas affronter une politie bien charpentée, ou qui, si elle se déclenche quand même, fera de mon entité politique un morceau dur ou impossible à avaler, à mettre hors jeu. Ce n’est rien d’autre qu’une application du vieil adage romain: “Si vis pacem, para bellum”.
L’oeuvre immortelle de Carl Schmitt et de Julien Freund
D’où nous vient cette notion du “politique”?
Elle nous vient d’abord de Carl Schmitt. Pour qui elle s’articule autour de deux vérités observés au fil de l’histoire :
1) Le politique est porté par une personne de chair et de sang, qui décide en toute responsabilité (Weber). Le modèle de Schmitt, catholique rhénan, est l’institution papale, qui décide souverainement et en ultime instance, sans avoir de comptes à rendre à des organismes partiels et partisans, séditieux et centrifuges, mus par des affects et des intérêts particuliers et non généraux.
2) La sphère du politique est solide si le principe énoncé au 17ième siècle par Thomas Hobbes est honoré : “Auctoritas non veritas facit legem” (C’est l’autorité et non la vérité qui fait la loi/la norme). Nous pourrions, au seuil de ce 21ième siècle, qui s’annonce comme un siècle de catastrophes, tout comme le 20ième, étendre cette réflexion de Hobbes et dire : “Auctoritas non lex facit imperium”, soit “C’est l’autorité et non la loi/la norme qui fait l’empire”. Schmitt voulait dénoncer, en rappelant la science politique de Hobbes, le danger qu’il y a à gouverner les états selon des normes abstraites, des principes irréels et paralysants, parfois vecteurs de dissensions calamiteuses pouvant conduire à la guerre civile. Quelques décennies d’une telle gouvernance et les “noeuds gordiens” s’accumulent et figent dangereusement les polities qui s’en sont délectée. Il faut donc des autorités (personnelles ou collégiales) qui parviennent à dénouer ou à trancher ces “noeuds gordiens”.
Cette notion du politique nous vient ensuite du professeur strasbourgeois Julien Freund, qui était, il est vrai, l’un des meilleurs disciples de Carl Schmitt. Il a repris à son compte cette notion, l’a appliquée dans un contexte fort différent de celui de l’Allemagne de Weimar ou du nazisme, soit celui de la France gaullienne et post-gaullienne, également produit de la pensée de Carl Schmitt. En effet, il convient de rappeler ici que René Capitant, auteur de la constitution présidentialiste de la 5ième République, est le premier et fidèle disciple français de Schmitt. Le Président de la 5ième République est effectivement une “auctoritas”, au sens de Hobbes et de Schmitt, qui tire sa légitimité du suffrage direct de l’ensemble de la population. Il doit être un homme charismatique de chair et de sang, que tous estiment apte à prendre les bonnes décisions au bon moment. Julien Freund, disciple de Schmitt et de Capitant, a coulé ses réflexions sur cette notion cardinale du politique dans un petit ouvrage qu’on nous faisait encore lire aux Facultés Universitaires Saint-Louis à Bruxelles il y a une trentaine d’années: “Qu’est-ce que le politique?” (Ed. du Seuil). Cet ouvrage n’a pas pris une ride. Il reste une lecture obligatoire pour qui veut encore, dans l’espace politique, penser clair et droit en notre période de turbulences, de déliquescences et de déclin.
René Thom et la théorie des catastrophes
Comment cette notion du politique s’articule-t-elle autour de la thématique qui nous préoccupe aujourd’hui, soit la “convergences des catstrophes”? Faye est le benjamin d’une chaine qui relie Clausewitz à Schmitt, Schmitt à Capitant, Capitant à Freund et Freund à lui-même et ses amis. Ses aînés nous ont quittés : ils ne vivent donc pas l’ère que nous vivons aujourd’hui. D’autres questions cruciales se posent, notamment celle-ci, à laquelle répond l’ouvrage de Guillaume Corvus: “Le système (à tuer les peuples) est-il capable de faire face à une catastrophe de grande ampleur, à plusieurs catastrophes simultanées ou consécutives dans un laps de temps bref, ou, pire à une convergences de plusieurs catastrophes simultanées?”. Au corpus doctrinal de Schmitt et Freund, Corvus ajoute celui du mathématicien et philosophe français René Thom, qui constate que tout système complexe est par essence fragile et même d’autant plus fragile que sa complexité est grande. Corvus exploite l’oeuvre de Thom, dans la mesure où il rappelle qu’un événement anodin peut créer, le cas échéant, des réactions en chaîne qui conduisent à la catastrophe par implosion ou par explosion. On connait ce modèle posé maintes fois par certains climatologues, observateurs de catastrophes naturelles: le battement d’aile d’un papillon à Hawai peut provoquer un tsunami au Japon ou aux Philippines. Les théories de Thom trouvent surtout une application pratique pour observer et prévenir les effondrements boursiers : en effet, de petites variations peuvent déboucher sur une crise ou un krach de grande ampleur.
Corvus soulève donc la question sur le plan de la gestion des Etats voire du village-monde à l’heure de la globalisation: l’exemple de l’ouragan qui a provoqué fin août les inondations de la Nouvelle-Orléans prouve d’ores et déjà que le système américain ne peut gérer, de manière optimale, deux situations d’urgence à la fois : la guerre en Irak, qui mobilise fonds et énergies, et les inondations à l’embouchure du Mississippi (dont la domestication du bassin a été le projet premier de Franklin Delano Roosevelt, pour lequel il a mobilisé toutes les énergies de l’Amérique à l’ “ère des directeurs” —ces termes sont de James Burnham— et pour lequel il a déclenché les deux guerres mondiales afin de glaner les fonds suffisants, après élimination de ses concurrents commerciaux allemands et japonais, et de réaliser son objectif: celui d’organiser d’Est en Ouest le territoire encore hétéroclite des Etats-Unis). La catastrophe naturelle qui a frappé la Nouvelle-Orléans est, en ce sens, l’indice d’un ressac américain en Amérique du Nord même et, plus encore, la preuve d’une fragilité extrême des systèmes hyper-complexes quand ils sont soumis à des sollicitations multiples et simultanées. Nous allons voir que ce débat est bien présent aujourd’hui aux Etats-Unis.
Qu’adviendrait-il d’une France frappée au même moment par quatre ou cinq catastrophes ?
En France, en novembre 2005, les émeutes des banlieues ont démontré que le système-France pouvait gérer dans des délais convenables des émeutes dans une seule ville, mais non dans plusieurs villes à la fois. La France est donc fragile sur ce plan. Il suffit, pour lui faire une guerre indirecte, selon les nouvelles stratégies élaborées dans les états-majors américains, de provoquer des troubles dans quelques villes simultanément. L’objectif d’une telle opération pourrait être de paralyser le pays pendant un certain temps, de lui faire perdre quelques milliards d’euros dans la gestion de ces émeutes, milliards qui ne pourront plus être utilisés pour les projets spatiaux concurrents et européens, pour la modernisation de son armée et de son industrie militaire (la construction d’un porte-avions par exemple). Imaginons alors une France frappée simultanément par une épidémie de grippe (aviaire ou non) qui mobiliserait outrancièrement ses infrastructures hospitalières, par quelques explosions de banlieues comme en novembre 2005 qui mobiliserait toutes ses forces de police, par des tornades sur sa côte atlantique comme il y a quelques années et par une crise politique soudaine due au décès inopiné d’un grand personnage politique. Inutile d’épiloguer davantage : la France, dans sa configuration actuelle, est incapable de faire face, de manière cohérente et efficace, à une telle convergence de catastrophes.
L’histoire prouve également que l’Europe du 14ième siècle a subi justement une convergence de catastrophes semblable. La peste l’a ravagée et fait perdre un tiers de ses habitants de l’époque. Cette épidémie a été suivie d’une crise socio-religieuse endémique, avec révoltes et jacqueries successives en plusieurs points du continent. A cet effondrement démographique et social, s’est ajoutée l’invasion ottomane, partie du petit territoire contrôlé par le chef turc Othman, en face de Byzance, sur la rive orientale de la Mer de Marmara. Il a fallu un siècle —et peut-être davantage— pour que l’Europe s’en remette (et mal). Plus d’un siècle après la grande peste de 1348, l’Europe perd encore Constantinople en 1453, après avoir perdu la bataille de Varna en 1444. En 1477, les hordes ottomanes ravagent l’arrière-pays de Venise. Il faudra encore deux siècles pour arrêter la progression ottomane, après le siège raté de Vienne en 1683, et presque deux siècles supplémentaires pour voir le dernier soldat turc quitter l’Europe. L’Europe risque bel et bien de connaître une “période de troubles”, comme la Russie après Ivan le Terrible, de longueur imprévisible, aux effets dévastateurs tout aussi imprévisibles, avant l’arrivée d’un nouvel “empereur”, avant le retour du politique.
“Guerre longue” et “longue catastrophe”: le débat anglo-saxon
Replaçons maintenant la parution de “La convergence des catastrophes” de Guillaume Corvus dans le contexte général de la pensée stratégique actuelle, surtout celle qui anime les débats dans le monde anglo-saxon. Premier ouvrage intéressant à mentionner dans cette introduction est celui de Philip Bobbitt, “The Shield of Achilles. War, Peace and the Course of History” (Penguin, Harmondsworth, 2002-2003) où l’auteur explicite surtout la notion de “guerre longue”. Pour lui, elle s’étend de 1914 à la première offensive américaine contre l’Irak en 1990-91. L’actualité nous montre qu’il a trop limité son champ d’observation et d’investigation : la seconde attaque américaine contre l’Irak en 2003 montre que la première offensive n’était qu’une étape; ensuite, l’invasion de l’Afghanistan avait démontré, deux ans auparavant, que la “guerre longue” n’était pas limitée aux deux guerres mondiales et à la guerre froide, mais englobait aussi des conflits antérieurs comme les guerres anglo-russes par tribus afghanes interposées de 1839-1842, la guerre de Crimée, etc. Finalement, la notion de “guerre longue” finit par nous faire découvrir qu’aucune guerre ne se termine définitivement et que tous les conflits actuels sont in fine tributaires de guerres anciennes, remontant même à la protohistoire (Jared Diamonds, aux Etats-Unis, l’évoque dans ses travaux, citant notamment que la colonisation indonésienne des la Papouasie occidentale et la continuation d’une invasion austronésienne proto-historique; ce type de continuité ne s’observa pas seulement dans l’espace austral-asiatique).
Si l’on limite le champ d’observation aux guerres pour le pétrole, qui font rage plus que jamais aujourd’hui, la période étudiée par Bobbitt ne l’englobe pas tout à fait: en effet, les premières troupes britanniques débarquent à Koweit dès 1910; il conviendrait donc d’explorer plus attentivement le contexte international, immédiatement avant la première guerre mondiale. Comme l’actualité de ce mois de janvier 2006 le prouve : ce conflit pour le pétrole du Croissant Fertile n’est pas terminé. Anton Zischka, qui vivra centenaire, sera actif jusqu’au bout et fut l’une des sources d’inspiration majeures de Jean Thiriart, avait commencé sa très longue carrière d’écrivain journaliste en 1925, quand il avait 25 ans, en publiant un ouvrage, traduit en français chez Payot, sur “La guerre du pétrole”, une guerre qui se déroule sur plusieurs continents, car Zischka n’oubliait pas la Guerre du Chaco en Amérique du Sud (les tintinophiles se rappelleront de “L’oreille cassée”, où la guerre entre le San Theodoros fictif et son voisin, tout aussi fictif, est provoquée par le désir de pétroliers américains de s’emparer des nappes pétrolifières).
Aujourd’hui, à la suite du constat d’une “longue guerre”, posé par Bobbitt et, avant lui, par Zischka, l’auteur américain James Howard Kunstler, dans “La fin du pétrole. Le vrai défi du XXI° siècle” (Plon, 2005) reprend et réactualise une autre thématique, qui avait été chère à Zischka, celle du défi scientifique et énergétique que lancera immanquablement la raréfaction du pétrole dans les toutes prochaines décennies. Pour Zischka, les appareils scientifiques privés et étatiques auraient dû depuis longtemps se mobiliser pour répondre aux monopoles de tous ordres. Les savants, pour Zischka, devaient se mobiliser pour donner à leurs patries, à leurs aires civilisationnelles (Zischka est un européiste et non un nationaliste étroit), les outils nécessaires à assurer leurs autonomies technologique, alimentaire, énergétique, etc. C’est là une autre réponse à la question de Clausewitz et à la nécessité d’une bonne gestion du patrimoine naturel et culturel des peuples. Faye n’a jamais hésité à plaider pour la diversification énergétique ou pour une réhabilitation du nucléaire. Pour lui comme pour d’autres, bon nombre d’écologistes sont des agents des pétroliers US, qui entendent garder les états inclus dans l’américanosphère sous leur coupe exclusive. L’argument ne manque nullement de pertinence, d’autant plus que le pétrole est souvent plus polluant que le nucléaire. Pour Corvus, l’une des catastrophes majeures qui risque bel et bien de nous frapper bientôt, est une crise pétrolière d’une envergure inédite.
La fin du modèle urbanistique américain
Les arguments de Corvus, nous les retrouvons chez Kunstler, preuve une nouvelle fois que ce livre sur la convergence des catstrophes n’a rien de marginal comme tentent de le faire accroire certains “aggiornamentés” du canal historique de la vieille “nouvelle droite” (un petit coup de patte en passant, pour tenter de remettre les pendules à l’heure, même chez certains cas désespérés… ou pour réveiller les naïfs qui croient encore —ou seraient tentés de croire— à ces stratégies louvoyantes et infructueuses…). Kunstler prévoit après la “longue guerre”, théorisée par Bobbitt, ou après la longue guerre du pétrole, décrite dans ses premiers balbutiements par Zischka, une “longue catastrophe”. Notamment, il décrit, de manière fort imagée, en prévoyant des situations concrètes possibles, l’effondrement de l’urbanisme à l’américaine. Ces villes trop étendues ne survivraient pas en cas de disparition des approvisionnements de pétrole et, partant, de l’automobile individuelle. 80% des bâtiments modernes, explique Kunstler, ne peuvent survivre plus de vingt ans en bon état de fonctionnement. Les toitures planes sont recouvertes de revêtements éphémères à base de pétrole, qu’il faut sans cesse renouveler. Il est en outre impossible de chauffer et d’entretenir des super-marchés sans une abondance de pétrole. La disparition rapide ou graduelle du pétrole postule un réaménagement complet des villes, pour lequel rien n’a jamais été prévu, vu le mythe dominant du progrès éternel qui interdit de penser un ressac, un recul ou un effondrement. Les villes ne pourront plus être horizontales comme le veut l’urbanisme américain actuel. Elle devront à nouveau se verticaliser, mais avec des immeubles qui ne dépasseront jamais sept étages. Il faudra revenir à la maçonnerie traditionnelle et au bois de charpente. On imagine quels bouleversements cruels ce réaménagement apportera à des millions d’individus, qui risquent même de ne pas survivre à cette rude épreuve, comme le craint Corvus. Kunstler, comme Corvus, prévoit également l’effondrement de l’école obligatoire pour tous : l’école ne sera plus “pléthorique” comme elle l’est aujourd’hui, mais s’adressera à un nombre limité de jeunes, ce qui conduira à une amélioration de sa qualité, seul point positif dans la catastrophe imminente qui va nous frapper.
La “quatrième guerre mondiale” de Thierry Wolton
Pour ce qui concerne le défi islamique, que Faye a commenté dans le sens que vous savez, ce qui lui a valu quelques ennuis, un autre auteur, Thierry Wolton, bcbg, considéré comme “politiquement correct”, tire à son tour la sonnette d’alarme, mais en prenant des options pro-américaines à nos yeux inutiles et, pire, dépourvues de pertinence. Dans l’ouvrage de Wolton, intitulé “La quatrième guerre mondiale” (Grasset, 2005), l’auteur évoque l’atout premier du monde islamique, son “youth bulge”, sa “réserve démographique”. Ce trop-plein d’hommes jeunes et désoeuvrés, mal formés, prompts à adopter les pires poncifs religieux, est une réserve de soldats ou de kamikazes. Mais qui profiteront à qui? Aucune puissance islamique autonome n’existe vraiment. Les inimitiés traversent le monde musulman. Aucun Etat musulman ne peut à terme servir de fédérateur à une umma offensive, malgré les rodomontades et les vociférations. Seuls les Etats-Unis sont en mesure de se servir de cette masse démographique disponible pour avancer leurs pions dans cet espace qui va de l’Egypte à l’Inde et de l’Océan Indien à la limite de la taïga sibérienne. Certes, l’opération de fédérer cette masse territoriale et démographique sera ardue, connaîtra des ressacs, mais les Etats-Unis auront toujours, quelque part, dans ce vaste “Grand Moyen Orient”, les dizaines de milliers de soldats disponibles à armer pour des opérations dans le sens de leurs intérêts, au détriment de la Russie, de l’Europe, de la Chine ou de l’Inde. Avec la Turquie, jadis fournisseur principal de piétaille potentielle pour l’OTAN ou l’éphémère Pacte de Bagdad du temps de la Guerre froide dans les années 50, branle dans le manche actuellement. Les romans d’un jeune écrivain, Burak Turna, fascinent le public turc. Ils évoquent une guerre turque contre les Etats-Unis et contre l’UE (la pauvre….), suivie d’une alliance russo-turque qui écrasera les armées de l’UE et plantera le drapeau de cette alliance sur les grands édifices de Vienne, Berlin et Bruxelles. Ce remaniement est intéressant à observer : le puissant mouvement des loups gris, hostiles à l’adhésion turque à l’UE et en ce sens intéressant à suivre, semble opter pour les visions de Turna.
Dans ce contexte, mais sans mentionner Turna, Wolton montre que la présence factuelle du “youth bulge” conduit à la possibilité d’une “guerre perpétuelle”, donc “longue”, conforme à la notion de “jihad”. Nouvelle indice, après Bobbitt et Kunstler, que le pessimisme est tendance aujourd’hui, chez qui veut encore penser. La “guerre perpétuelle” n’est pas un problème en soi, nous l’affrontons depuis que les successeurs du Prophète Mohamet sont sortis de la péninsule arabique pour affronter les armées moribondes des empires byzantins et perses. Mais pour y faire face, il faut une autre idéologie, un autre mode de pensée, celui que l’essayiste et historien américain Robert Kaplan suggère à Washington de nos jours : une éthique païenne de la guerre, qu’il ne tire pas d’une sorte de new age à la sauce Tolkien, mais notamment d’une lecture attentive de l’historien grec antique Thucydide, premier observateur d’une “guerre longue” dans l’archipel hellénique et ses alentours. Kaplan nous exhorte également à relire Machiavel et Churchill. Pour Schmitt hier, comme pour Kaplan aujourd’hui, les discours normatifs et moralisants, figés et soustraits aux effervescences du réel, camouflent des intérêts bornés ou des affaiblissements qu’il faut soigner, guérir, de toute urgence.
L’infanticide différé
Revenons à la notion de “youth bulge”, condition démographique pour mener des guerres longues. Utiliser le sang des jeunes hommes apparait abominable, les sacrifier sur l’autel du dieu Mars semble une horreur sans nom à nos contemporains bercés par les illusions irénistes qu’on leur a serinées depuis deux ou trois décennies. En Europe, le sacrifice des jeunes générations masculines a été une pratique courante jusqu’à la fin de la seconde guerre mondiale. Ne nous voilons pas la face. Nous n’avons pas été plus “moraux” que les excités islamiques d’aujourd’hui et que ceux qui veulent profiter de leur fougue. La bataille de Waterloo, à quinze kilomètres d’ici, est une bataille d’adolescents fort jeunes, où l’on avait notamment fourré dans les uniformes d’une “Landwehr du Lünebourg” tous les pensionnaires des orphelinats du Hanovre, à partir de douze ans. La lecture des ouvrages remarquables du démographe français Gaston Bouthoul, autre maître à penser de Faye, nous renseigne sur la pratique romaine de l’”infanticide différé”. Rome, en armant ces légions, supprimait son excédent de garçons, non pas en les exposant sur les marges d’un temple ou en les abandonnant sur une colline, mais en différant dans le temps cette pratique courante dans les sociétés proto-historiques et antiques. Le jeune homme avait le droit à une enfance, à être nourri avant l’âge adulte, à condition de devenir plus tard soldat de dix-sept à trente-sept ans. Les survivants se mariaient et s’installaient sur les terres conquises par leurs camarades morts. L’empire ottoman reprendra cette pratique en armant le trop-plein démographique des peuples turcs d’Asie centrale et les garçons des territoires conquis dans les Balkans (les janissaires). La raison économique de cette pratique est la conquête de terres, l’élargissement de l’ager romanus et l’élimination des bouches inutiles. Le ressac démographique de l’Europe, où l’avortement remboursé a remplacé l’infanticide différé de Bouthoul, rend cette pratique impossible, mais au détriment de l’expansion territoriale. Le “youth bulge” islamique servira un nouveau janissariat turc, si les voeux de Turna s’exaucent, la jihad saoudienne ou un janissariat inversé au service de l’Amérique.
Que faire ?
L’énoncé de tous ces faits effrayants qui sont ante portas ne doit nullement conduire au pessimisme de l’action. Les réponses que peut encore apporter l’Europe dans un sursaut in extremis (dont elle a souvent été capable : les quelques escouades de paysans visigothiques des Cantabriques qui battent les Maures vainqueurs et arrêtent définitivement leur progression, amorçant par là la reconquista; les Spartiates des Thermopyles; les défenseurs de Vienne autour du Comte Starhemberg; les cent trente-cinq soldats anglais et gallois de Rorke’s Drift; etc.) sont les suivantes :
- Face au “youth bulge”, se doter une supériorité technologique comme aux temps de la proto-histoire avec la domestication du cheval et l’invention du char tracté; mais pour renouer avec cette tradition des “maîtres des chevaux”, il faut réhabiliter la discipline scolaire, surtout aux niveaux scientifiques et techniques.
- Se remémorer l’audace stratégique des Européens, mise en exergue par l’historien militaire américain Hanson dans “Why the West has always won”. Cela implique la connaissance des modèles anciens et modernes de cette audace impavide et la création d’une mythologie guerrière, “quiritaire”, basée sur des faits réels comme l’Illiade en était une.
- Rejeter l’idéologie dominante actuelle, créer un “soft power” européen voire euro-sibérien (Nye), brocarder l’ “émotionalisme” médiatique, combattre l’amnésie historique, mettre un terme à ce qu’a dénoncé Philippe Muray dans “Festivus festivus” (Fayard, 2005), et, antérieurement, dans “Désaccord parfait” (coll. “Tel”, Gallimard), soit l’idéologie festive, sous toutes ses formes, dans toute sa nocivité, cette idéologie festive qui domine nos médias, se campe comme l’idéal définitif de l’humanité, se crispe sur ses positions et déchaîne une nouvelle inquisition (dont Faye et Brigitte Bardot ont été les victimes).
C’est un travail énorme. C’est le travail métapolitique. C’est le travail que nous avons choisi de faire. C’est le travail pour lequel Guillaume Faye, qui va maintenant prendre la parole, a consacré toute sa vie. A vous de reprendre le flambeau. Nous ne serons écrasés par les catastrophes et par nos ennemis que si nous laissons tomber les bras, si nous laissons s’assoupir nos cerveaux.
00:05 Publié dans Synergies européennes | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : nouvelle droite, synergies européennes, identité, mouvement identitaire, guillaume faye, théorie politique, politologie, sciences politiques, politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook



 T.E. Lawrence’s book Seven Pillars of Wisdom is on the syllabus at the elite US army training college at Fort Leavenworth, Kansas. Seen as the man who “cracked fighting in the Middle East”, Lawrence is a “kind of poster boy” of how to do colonial rule, according to writer-presenter Rory Stewart, in The Legacy of Lawrence of Arabia (BBC2, Jan 16 and 23 2010).
T.E. Lawrence’s book Seven Pillars of Wisdom is on the syllabus at the elite US army training college at Fort Leavenworth, Kansas. Seen as the man who “cracked fighting in the Middle East”, Lawrence is a “kind of poster boy” of how to do colonial rule, according to writer-presenter Rory Stewart, in The Legacy of Lawrence of Arabia (BBC2, Jan 16 and 23 2010).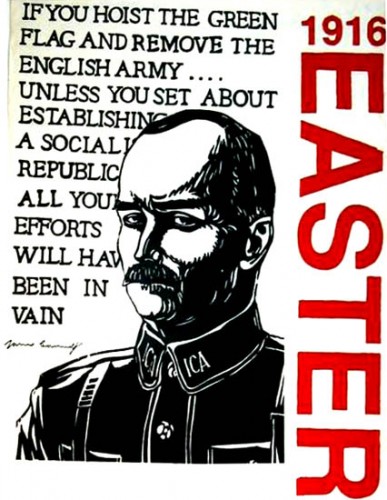 In Dublin's Kilmainham Jail on 12th May 1916, a working class man born in Scotland was executed for his part in the Easter Rising, an attempt to liberate Ireland from 800 years of foreign occupation. Because his injuries aquired in the defeated insurrection were so severe that he was unable to stand, the British soldiers tied James Connolly to a chair in order that he could face the firing squad.
In Dublin's Kilmainham Jail on 12th May 1916, a working class man born in Scotland was executed for his part in the Easter Rising, an attempt to liberate Ireland from 800 years of foreign occupation. Because his injuries aquired in the defeated insurrection were so severe that he was unable to stand, the British soldiers tied James Connolly to a chair in order that he could face the firing squad.