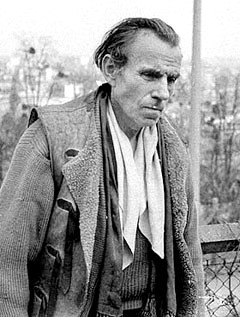Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1997
MISHIMA: L'HOMME, L'ŒUVRE, LA MORT
Dans son autobiographie Le Soleil et l'Acier, Kimitake Hiraoka, bien plus connu sous le pseudonyme qui le révèlera à l'humanité, Mishima Yukio, confessait son irréfragable désir d'assouvissement tragique par ces quelques mots, jetés en une fausse interrogation, et alors fort peu écoutés: «Qu'est-ce qui distingue une mort héroïque d'une mort décadente? (...) Résister à la mort et à l'oubli». Cette phrase, le 25 novembre 1970 consommé, personne ne devait plus l'oublier. De fait, pacte suicidaire du plus célèbre des auteurs japonais marque aujourd'hui encore les esprits à un point tel qu'elle recouvre d'ombre sa pourtant foisonnante et géniale œuvre littéraire. La biographie recomplétée de son ami journaliste Henry Scott-Stokes est éclairante en la matière, qui lui consacre près de 400 pages à décortiquer la troublante personnalité du dernier samouraï nippon, rejetant l'étude de ses textes à une simple énumération-explicitation insipide et sans profondeur aucune.
Etonnante inconséquence bien ancrée à “droite” également, pour qui le seppuku du Grand Quartier Général de Tokyo, plus coup d'éclat que coup d'état, est devenu un évènement prépondérant sa mythologie, qu'il est inutile ici d'évoquer à nouveau, tant il l'a déjà à maintes reprises été: «Yukio Mishima choisit d'être le dernier samourai. Sa sortie fulgurante hors d'un monde qu'il abhorrait se camoufle sous une tentative de putsch. Mais un putsch à la nippone, voué à l'échec, ayant pour seul dessein de mettre en scène un évènement inoubliable» (Jean Mabire). Pourtant, un rapide retour sur ses écrits jette un éclairage nouveau et bien plus instructif que tous les cours de psychologie ou études de philosophie orientale (sa vie durant, il restera sceptique à l'égard du bouddhisme et du shintoïsme institutionnels) que depuis vingt-sept ans littérateurs, critiques journalistiques ou prétendus exégètes nippophiles s'acharnent à plaquer sur la personne de Mishima pour en finir avec son geste fatal.
Tout dans ses romans, nouvelles, essais et recueils autobiographiques annonçaient par la plume ce que leur auteur allait bientôt sceller par le sang. L'idée précède l'action, l'action la complète. Le mot, trompeur, factice transposition scripturale du fatum humain, pallié, transcendé par l'action elle-même. Et si Mishima nous paraît si proche, c'est que derrière le vernis de l'artiste insulaire imprégné de culture sino-nippone se profile, tantôt en filigrane, tantôt frappant d'évidence, l'écrivain baigné de littérature européenne, de philosophie allemande, de mythologie hellénique. Ceux qui l'ont connu ou approché s'accordent tous à le reconnaître: sa maison, délirant bâtiment baroque mariant avec plus ou moins bon goût pilastres massifs, fioritures et plâtres moulés de statues de l'antiquité et de la renaissance, sa passion pour la Grèce, son culte de l'haltérophilie, son goût immodéré pour Thomas Mann et Friedrich Nietzsche, le philosophe au marteau, attestent de son regard tourné vers le berceau de la tragédie. «Il faut ne jamais s'être ménagé soi-même, il faut avoir fait de la dureté une habitude pour rester serein et de bonne humeur parmi de dures vérités», quelle meilleure traduction que cet aphorisme nietzschéen tiré d'Ecce Homo pourrait mieux percer à jour la complexité de Mishima, sa pensée profonde et la vision unique qui guida sa vie, son œuvre, et, point d'orgue terrible, sa mort par suicide.
Mishima, d'abord un écrivain européen? Perspective ambitieuse certes, mais qui s'appuie sur des faits et des écrits-mêmes de Mishima qu'il serait navrant de vouloir oblitérer, au titre fallacieux d'une compréhension plus aisée d'un auteur ultra-nationaliste et impérialiste en rupture de ban. En un dernier aveu au monde qu'il allait définitivement quitter, il laissait sur son bureau, accompagnant la dernière partie manuscrite de sa tetralogie La Mer de la Fertilité, ce billet, disant «La vie est brève, mais je voudrais vivre toujours». Espoir d'éternité concrétisé certes par sa postérite littéraire, que confirme la récente sortie dans la prestigieuse collection NRF-Gallimard du Pélerinage aux Trois Montagnes, mais qui, s'il n'avait été qu'un «quelconque» écrivain de talent, lui aurait au contraire évité sa mort volontaire et prématurée. Son acte, s'il reste nimbé de mystère, doit sa raison d'être à une toute autre inspiration, divine ou classique, indubitablement tragique, nourrie de références européennes, classiques grecs, littérature du «Grand Siècle» et bréviaires sils-mariens, juste retour des choses pour un Nietzsche volontiers «schopenhaueriennement» vulgarisateur du bouddhisme. Mishima, le plus occidental des écrivains asiatiques, tellement opposé au précepte Zen «Aller droit devant soi, sans se retourner et sans se poser aucune question».
*
«L'homme qui sait mourir ne sera jamais esclave» prêchait déjà Sénèque, conseiller de l'Empereur Néron et maître de la Rome stoïcienne, pour qui la vie, ascèse virile et souveraineté aristocratique sur ses pulsions tendues vers la LIBERTE absolue de l'Etre, trouvait sa conclusion la plus pure et olympienne dans son propre abandon volontaire. Mais se sacrifier sous le coup de la passion, preuve de son inaptitude à s'affirmer contre le monde, ne saurait mériter que mépris et déshonneur. Or, c'est bien dans ce sens qu'abonde Henry Scott-Stokes quand il affirme péremptoirement que le suicide de Mishima ne fut jamais que shinju, double suicide amoureux en compagnie de son prétendu amant et second au sein de la Tatenokai; Morita Masakatsu, connotant l'acte d'une homosexualité sado-masochiste honteuse qui ne résiste pas devant l'examen des faits. Quand meurt Mishima, il y a longtemps qu'il s'est défait de ses oripeaux romantiques. Son passage à la Bungei Bunka, association militariste de littérateurs nationalistes et son appartenance au mouvement Nippon Roman-Ha («les Romantiques japonais») regroupés derrière la figure du romancier Yasuda Yajura remonte aux dernières années du second conflit mondial.
Glorifiant la «guerre sainte» et prônant la valeur salvatrice du sacrifice et de l'autodestruction du peuple japonais guidé par l'infaillabilité de son Empereur-thaumaturge, seul aux yeux de ce cercle avait droit de cité l'exploit intrinsèque, la défaite et la mort, inéluctables, magnifiant comble du romantique la plus belle des victoires, d'ores et déjà acquise par le seul fait que le Japon, peuple à la supériorité divine, ait osé lever le sabre sur l'Asie et s'aliéner la haine de l'Occident. Profondément influencé en ses jeunes années par l'école néo-confucéenne Wang-Yang-Ming du Dr Inoue Tetsujuio («La mort du corps n'est rien face à la mort de l'esprit»), Mishima confiera bien plus tard, dans Le Soleil et l'Acier (1968), son progressif changement d'orientation: «L'élan romantique, à partir de l'adolescence, avait toujours été en moi une veine cachée, n'ayant de signification qu'en tant que destruction de la perfection classique (...) En l'espèce, je chérissais un élan romantique vers la mort, tout en exigeant en même temps comme véhicule un corps strictement classique (...). Me manquaient, en bref, les muscles qui convenaient à une mort tragique».
Le grand bouleversement de sa vie a lieu en 1952, lorsque Mishima, alors tout jeune romancier mondialement célébré pour Confession d'un Masque (1949) met le pied en Grèce. Lecteur assidu d'Homère, Eschyle et Sophocle, des classiques grecs et du «Grand Siècle», cas rarissime dans le Japon post-1945, il «tombe amoureux des mers bleues et des ciels vifs de cette terre classique» et echafaude une théorie pour sublimer son Voyage à Sparte: dans les temps anciens, la spiritualité («cette excroissance grotesque du christianisme»), inexistante, était palliée par un équilibre précaire entre le corps et l'esprit nécessitant un effort constant pour le préserver, que les Grecs sublimèrent dans la beauté et la tragédie, punition infligée aux hommes par les dieux pour leur arrogance. «Mon interprétation était peut-être fausse, mais telle était la Grèce dont j'avais besoin». Aristote ne disait-il pas qu'un «beau pied est l'indice d'une belle âme»?
A travers cette nouvelle grille de lecture éthique, le jeune et chétif écrivain désapprend la solitude, la haine de soi et découvre la beauté du corps travaillé, sculpté par l'exercice. A son retour au Japon, dégoûté du romantisme, «caractéristique typiquement bourgeoise (...) fadaises poétiques, héroïsmes mélodramatiques, pathétiques complications d'amour» (dixit Julius Evola), il décide que l'heure est venue pour lui désormais d'écrire des «œuvres classiques», et, en corollaire, autre lecon rapportée de l'Hellade, de s'adonner au culturisme. «Le bon endroit, c'est le corps, l'apparence physique, le régime, la physiologie -et le reste suit de lui-même (...) c'est pourquoi les Grecs constituent toujours le premier évènement capital de la culture de l'humanité. Ils savaient -et ils faisaient-, ce qu'il fallait». (Nietzsche in Crépuscule des Idoles).
La mort, qui jusque là n'était que trouble nihilisme destructeur, et attrait morbide pour la souffrance («Le penchant de mon cœur vers la mort, la nuit et le sang était indéniable» notera-t-il à l'occasion de la publication de Confession pour un Masque) se voit rehaussé au rang d'idéal, de suprême geste de domination, de puissance et de liberté. Patet Exitus: «Lorsque vous ne voulez plus combattre, il vous est toujours possible de vous retirer. Rien ne vous est plus facile que de mourir» (Sénèque). Chacune des œuvres qui paveront le panthéon de sa gloire littéraire sera dorénavant un pas supplémentaire dans son approche définitive du néant.
En 1951 puis 1953 paraissent deux versions de Couleurs Interdites, évocation de la société homosexuelle de Tokyo et des relations tumultueuses qui unissent le vieil écrivain Shinsuke et le bel éphèbe ingrat Yuichi, conclue par la mort par injection de drogue du vieillard, au terme d'un sermon inutile. Saisissante préfiguration de ce qui allait attendre Mishima... Cette même année 1953 sort La Mort en été, roman qui conte l'histoire d'une femme désespérée après la noyade accidentelle de ses deux enfants. Se profile à nouveau l'étude d'une âme en proie au chaos existentiel, qui lutte pour sa dignité dans le dépassement de ses sentiments. Définissant sa perception de la tragédie classique, Mishima écrit, toujours dans Le Soleil et l'Acier: «Selon ma définition de la tragédie, le pathos tragique naît lorsqu'une sensibilité parfaitement moyenne assume pour un temps une noblesse privilégiée qui tient les autres à distance, et non pas quand un type particulier de sensibilité émet des prétentions particulières (...). Pour que, parfois, un individu touche au divin, il faut dans des conditions normales, qu'il ne soit lui-même ni divin ni rien qui en approche. C'est seulement lorsque, à mon tour, je vis le ciel bleu, étrange et divin, uniquement perçu par ce type d'individu, qu'enfin j'eus confiance en l'universalité de ma propre sensibilité, que je pus étancher ma soif et que fut dissipée ma foi aveugle et maladive dans les mots. A cet instant, je participai à la tragédie de tout être».
La parution du Pavillon d'Or en 1956, qui confère définitivement à Mishima le rang d'écrivain à la renommée mondiale, entérine son rejet viscéral de la laideur physique et mentale, son mépris pour ce qu'incarne ici le personnage de Kashiwagi, être vil dont les pieds bots ne sont qu'extériorisation corporelle de sa bassesse intérieure, dans la formule toute kantienne «le beau est le symbole du bien moral»: «Il avait pour marque particulière deux pieds aussi bots que pieds peuvent l'être et une démarche extrêmement étudiée. Il avait toujours l'air de marcher dans la boue: lorsqu'une jambe parvenait, non sans peine, à s'extraire, l'autre au contraire paraissait s'engluer. En même temps, tout son corps s'agitait avec véhémence; sa démarche était une espèce de danse extraordinaire, aussi peu banale que possible». Autre approche de la mort avec Le Marin Rejeté par la Mer (1963), qui voit une bande d'adolescents nihilistes combattant leur sensibilité s'essayer à l'exercice macabre de la mise à mort de Ryuji, l'officier de marine marchande, amant de la mère de Noboru, membre du groupe, par l'ignoble sacrifice longuement détaillé par l'auteur d'un innocent chaton abandonné.
A cette époque Mishima a déjà pris conscience, au cours des évènements de 1960, de son intérêt pour la politique. Les émeutes qui émaillèrent le renouvellement de l'ANPO (traité de sécurité américano-japonais), humiliante charte imposée par Mac Arthur en 1945, agirent sur Mishima comme le révélateur d'un engagement à venir. C'est alors qu'il découvre la richesse de la tradition militariste nippone. A l'automne 1960, il termine la nouvelle Yûkoku (Patriotisme, aujourd'hui insérée dans le volume La Mort en été) qui traite à travers l'histoire d'un jeune officier, le lieutenant Takeyama Shinji, de l'affaire Ni Ni Roku, putsch entrepris le 26 février 1936 par la société secrète impérialiste Kodo-Ha. Tiraillé entre sa fidélité pour l'Empereur et celle pour la Kodo-Ha, Takeyama préfère se suicider en compagnie de son amie Reiko, shinju fort idéalisé et accompagné d'un véritable luxe de détails: «Il est difficile d'imaginer spectacle plus héroïque que le sursaut du lieutenant qui brusquement rassembla ses forces et releva la tête (...). Il y avait du sang partout. Le lieutenant baignait jusqu'aux genoux et demeurait écrasé et sans force, une main sur le sol. Une odeur âcre emplissait la pièce. Le lieutenant, tête ballante, hoquetait sans fin et chaque hoquet ébranlait ses épaules. Il tenait toujours dans sa main droite la lame de son sabre, que repoussaient les intestins et dont on voyait la pointe».
A deux reprises, Mishima reprend ce thème, dans la pièce Toka no Kiku puis dans l'essai Eirei No Koe (La Voix des Morts héroïques, parue en 1966). De Patriotisme, il dira: «Ce n'est ni une comédie, ni une tragédie, mais simplement l'histoire d'un bonheur... Le douloureux suicide du soldat équivaut à une mort honorable sur le champ de bataille». De cette nouvelle devait être tiré un film éponyme en 1965, où Takeyama sera joué par... Mishima lui-même. On se souvient de la honte qui l'étouffa sa vie durant d'avoir triché au conseil de révision en 1945, alors que le Japon mobilisait ses dernières forces pour repousser l'hydre américaine. Dix ans après ce film, Mishima se rejouait la même scène, sans caméra cette fois.
Mais si Mishima manifeste un réel intérêt pour la politique, il reste un parfait apoliteia, seulement préoccupé par la figure de l'Empereur, à qui il reproche d'avoir trahi et sa charge divine et son peuple, sacrifié en son nom propre pendant huit ans de guerre. «Pourquoi fallait-il qu'il devienne un être humain...», écrira-t-il. La lecture de son roman Après le Banquet (1960) prouve quant à elle le profond mépris que ressentait Mishima pour la classe politique en général et le rôle prégnant qu'y tient l'argent. Le ridicule dont il affuble des personnages à l'identité réelle à peine voilée que manipule allègrement une sombre prostituée ne manqua pas de lui causer des déboires avec les milieux politiciens et certains groupes extrémistes.
Il s'initie aux règles du Bushido ainsi qu'aux arts martiaux (Kendo et Karaté), réédite le premier en 1967 le bréviaire du Samurai condamné par l'occupant en 1945, le Hagakuré, du guerrier Yamamoto Jocho (XVIIIième siècle), qu'il adapte aux conditions du XXième siècle et sous-titre Le Japon Moderne et l'Ethique Samourai: il en retient particulièrement quelques idées-clés, la soumission à son destin et à la mort, au relent fortement teinté de stoïcisme: «La mort recèle toujours un combat obscur entre la liberté de l'homme et un destin qui le dépasse». En introduction, il note: «Un homme d'action est destiné à subir une longue période de tension et de concentration jusqu'au dernier instant où il achève sa vie par son acte final: la mort —soit par causes naturelles, soit par seppuku» Si la mort l'obsède depuis son enfance, sa propre mort lui devient dès à présent prépondérante. «Aux abords de la quarantaine, l'âge commence à tracasser Mishima» remarque Scott-Stokes dans sa biographie. Toujours en excellente condition physique, ses muscles se font maintenant moins proéminents, ses contractions moins impressionnantes. Comment un homme si pétri d'esthétique classique pourrait s'en contenter, lui qui écrivait, toujours dans Le Soleil et l'Acier, qu'à un muscle dur correspond la force de caractère et «la sentimentalité à un ventre flasque».
Impossible d'accepter l'inéluctable décrépitude de l'âge, lui qui sait que la grande idée de l'art classique se trouve dans la commémoration dans le marbre de l'instant parfait où s'affirme la beauté ultime, l'extrême moment qui précède le déclin et derrière lui, la mort. C'est désormais à elle qu'il consacrera ses dernières années. Dans l'ouvrage Shobu No Kokoro (L'Ame des Guerriers), reprise d'un dialogue avec Murakami Ichiro, paru après son décès, il confie: «On doit assurer la responsabilité de ses paroles, une fois qu'on les a prononcées. Il en va de même du mot écrit. Si l'on écrit: Je mourrai en novembre, alors on doit mourir. Si l'on fait une fois bon marché des mots, on continuera de le faire». Sa tétralogie achevée, La Mer de la Fertilité, certainement le sommet de son écriture, et interrogation sur la réincarnation où s'exprime un bouddhisme plus universitaire que mystique, Mishima Yukio pourra se considérer enfin au bord de la falaise et rejoindre le héros qu'il vénère le plus, lui-même. «Le suicide est quelque chose qui s'organise dans le silence du cœur, comme une œuvre d'art» disait Albert Camus. Alors que persomne ne voulait voir en Mishima la réunion de la plume et de l'épée, il décidait de mourir fièrement, puisqu'il ne lui était plus permis de vivre avec fierté.
Dans son excellente biographie, Mishima ou la vision du vide, Marguerite Yourcenar devait écrire: «Il y a deux sortes d'êtres humains: ceux qui écartent la mort de leur pensée pour mieux et plus librement vivre, et ceux qui, au contraire, se sentent d'autant plus sagement et fortement exister qu'ils la guettent dans chacun des signaux qu'elle leur fait à travers les sensations de leur corps ou les hasards du monde extérieur. Ces deux sortes d'esprit ne s'amalgament pas. Ce que les uns appellent une manie morbide est pour les autres une héroïque discipline». Mishima aura vécu en artiste tragique, acceptant posément de se retirer en «joyeux pessimiste». Dyonisien aurait sans doute conclu Nietzsche.
*
Quand du haut du balcon du GQG des Jieitaï, ce 25 novembre fatidique de 1970, Mishima, revêtu de son uniforme moutarde, le front masqué par son hachi-maki, le poing tendu vers la foule qui le conspue, s'écrie «Au nom du passé, à bas l'avenir!», c'est d'abord et surtout à lui-même qu'il s'adresse, lui, subtile réunion d'irrationalisme nippon et d'universalisme européen, ayant décidé d'en finir avec une vie qui ne peut plus répondre à son idéal de beauté physique, de grandeur virile, de pureté olympienne. Sa résolution est prise, recouvrer sa liberté dans l'extase finale de la mortification purificatrice, à l'image de ce Saint Sébastien agonisant peint par Gueno Reni qu'il ne cessera jamais de révérer dans son martyre, allant jusqu'à l'imiter pour le photographe Shinoyama Kishi. Deux mois avant son seppuku, il posait encore pour un recueil de photos jamais publié et intitulé Otoko no Shi (La Mort d'un Homme). Sur certaines on le voit couvert de sang, sur d'autres mimant son seppuku. «Qu'est-ce que l'éternité», s'interrogeait Pierre Drieu la Rochelle. «Une minute excessivement intense». De son amour pour Saint Sébastien devait découler sa passion pour Gabriele d'Annunzio, dont il traduisit Le Martyre de Saint Sébastien et comme lui s'écriant: «J'ai tout risqué, j'ai tout donne, j'ai vaincu», il put lancer fièrement à la face de ce monde vieillot et assoupi, dernier acte d'insoumission à la fatalité, cet épitaphe: «La mort violente est l'ultime beauté, toujours, et surtout quand on est jeune».
Laurent SCHANG,
le 27 juin 1997.




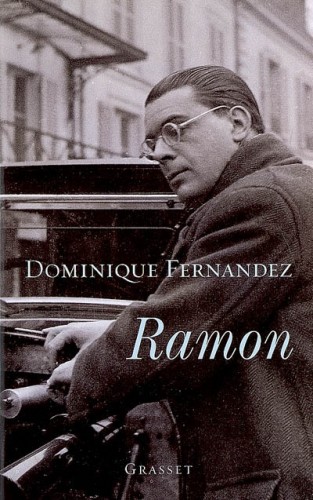

 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg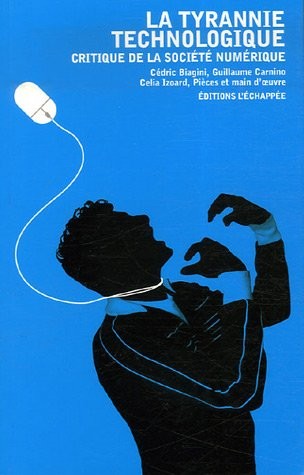
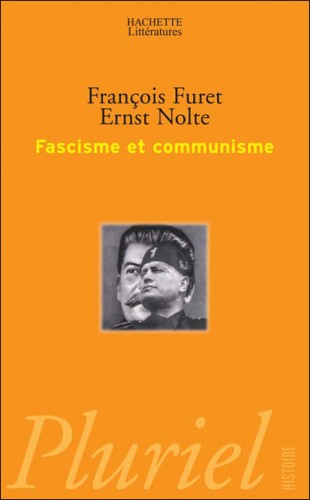

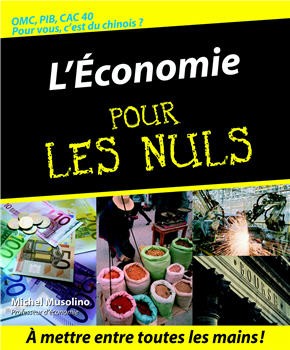
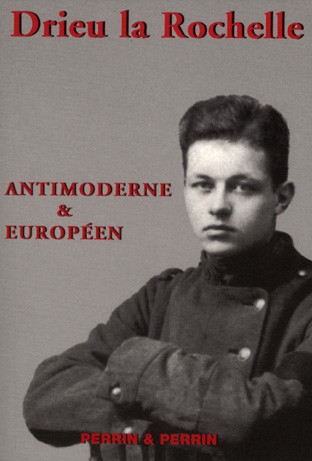



 Avec neuf millions d’habitants et une côte longue de 3 300 km, la Somalie est, depuis 1991, un patchwork formé au sud par la Somalie proprement dite, au nord-ouest par le Somaliland bordant le Golfe d’Aden et au nord-estpar le Puntland, région semi autonome perchée sur sa corne. Dans chaque zone, la situation diffère, le nord-est et le sud, étant les plus instables.
Avec neuf millions d’habitants et une côte longue de 3 300 km, la Somalie est, depuis 1991, un patchwork formé au sud par la Somalie proprement dite, au nord-ouest par le Somaliland bordant le Golfe d’Aden et au nord-estpar le Puntland, région semi autonome perchée sur sa corne. Dans chaque zone, la situation diffère, le nord-est et le sud, étant les plus instables.


 20/04/2009 –19h00
20/04/2009 –19h00
 Ex : Nieuwsbrief Deltastichting nr. 24 – April 2009
Ex : Nieuwsbrief Deltastichting nr. 24 – April 2009