AUßENPOLITISCHES
Freihandelsabkommen
USA rechnen mit schnellem Erfolg bei TTIP-Verhandlungen
Millionäre flüchten aus Europa
Eine Studie zur Migration von Millionären liefert alarmierende Erkenntnisse: Immer mehr Reiche verlassen Europa aus Angst vor Anschlägen und religiösen Spannungen.
Panama Papers
Die Geheimnisse des schmutzigen Geldes
„Panama Papers“
Medien enthüllen internationalen Finanzskandal
Geldschein unter Terrorverdacht
Der 500er soll verschwinden
Energiepolitik
Wie die Anti-Rußlandpolitik unsere Energieversorgung bedroht
von Thomas Fasbender
Frankreich
Ausschreitungen bei Protesten gegen Arbeitsrecht-Reform
Frankreich
Das Elsaß verliert seinen Namen
Präsidentenwahl: Wende in Österreich
Asylpolitik
Asselborn beschimpft Orbán und kritisiert Kohl
Belgischer Minister: Moslems haben nach Anschlägen getanzt
UN-Tribunal spricht Nationalisten Vojislav Šešelj frei
Islam-Extremisten in schwedischer Regierung
(Ankara stellt nun seine zu erwartenden Forderungen)
Visafreiheit
Asylabkommen mit Türkei auf der Kippe
Kritik an Regierungsnähe
Türkei hat 970 Prediger nach Deutschland geschickt
Sie predigen in deutschen Moscheen, finanziert von der türkischen Regierung: Fast 1000 Imame wurden vom Verein Ditib entsandt - als verlängerter Arm von Präsident Erdogan, sagen Kritiker.
Projekt "Aghet": Türkische Kritik an Konzert in Dresden sorgt für Empörung
Weil sich die Türkei über ein Kunstprojekt in Dresden beschwerte, hat die EU-Kommission einen entsprechenden Programmhinweis von ihrer Webseite entfernt. "Absolut falsches Signal", sagen die Grünen.
(Anzeichen für Spannungen zwischen den USA und Saudi-Arabien?)
9/11: Saudi-Arabien droht mit Verkauf von US-Papieren im Wert von 750 Milliarden Dollar
Katar darf „Krebsgeschwür des Weltfußballs“ genannt werden
Vorfall in Indonesien
Deutsche Touristin im Bikini verärgert Scharia-Polizei
Norfolk-Island
Die "Bounty"-Nachfahren meutern erneut
INNENPOLITISCHES / GESELLSCHAFT / VERGANGENHEITSPOLITIK
Patriotische Solidarität und das Sozialsystem
Renten-Debatte
Schäuble für späteren Rentenbeginn
Gesetzespläne
Nahles will Sozialhilfe für EU-Bürger kürzen
Am Sonntag dürfte einigen CDU-Politikern der Atem stocken
Die CDU-Spitze lehnt eine konservative Renaissance ab – zum Unmut vieler Parteifreunde. Merkels Hausdemoskop gibt der Führung recht: Die AfD sei auch eine "Chance". Durch die Grünen drohe aber Gefahr.
Flüchtlingspolitik: Kohl gegen Merkel
Der Altkanzler unterstützt seinen Freund Viktor Orbán. Vor seinem Treffen mit dem ungarischen Ministerpräsidenten kritisiert Helmut Kohl seine Nachfolgerin.
Renommierte Auszeichnung
Kanzlerin Merkel für "moralische Führung" geehrt
Deutschlandtrend
SPD sackt in Umfrage auf Allzeittief
AfD: Einstweilige Verfügung gegen Ralf Stegner (SPD)
Zwickau: Rede von Heiko Maas erstickt in Buh- und „Volksverräter“-Chören (VIDEO)
Nordrhein-Westfalen
Wegen Vertuschungsvorwurf
AfD fordert Rücktritt von Innenminister Jäger
Landtagswahl 2016
Wer hat in Freiburg welche Partei gewählt?
Die AfD ist männlich, die Linke jung, die SPD alt. Bei der Landtagswahl hat die Stadt Freiburg eine Wählerbefragung durchgeführt – wir präsentieren die Ergebnisse.
Wo die AfD für die Linke zur größten Gefahr wird
Die Flüchtlingskrise hat rechte Ressentiments im Ostteil Berlins bestärkt. Vor allem die AfD profitiert: Ausgerechnet in ehemaligen Hochburgen der Linken scheint sie am besten anzukommen.
(Die linken Publizisten üben sich natürlich mit sorgenvoller Miene in der alten Brückfunktions-Theorie. Es ist ihre größte Angst, dass das bürgerliche Lager seine Scheu vor "rechts" verlieren könnte.)
Warum es ein Glücksfall für Deutschland wäre, wenn Petry aus der AfD fliegt
Leitantrag zum Parteitag
Empörung über Islamkritik in der AfD
(Dazu)
Meinung
Kein Schüren von Religionshaß
von Karlheinz Weißmann
Programmdebatte
AfD-Vize Gauland lehnt Nato-Austritt ab
Neues AfD-Grundsatzprogramm: Die wichtigsten Beschlüsse im Überblick
(Nicht anders zu erwarten…)
Nach Drogenfund: Verfahren gegen Volker Beck eingestellt
Die Berliner Staatsanwaltschaft stellt das Verfahren gegen Volker Beck ein. Der grüne Bundestagabgeordnete muss wegen seiner Crystal-Meth-Affäre aber 7000 Euro zahlen.
Berlin
Grünen-Politiker wegen Mieterhöhung in der Kritik
Renten
Deutschen droht flächendeckende Altersarmut
(Für ein Einheitsdenkmal ist kein Geld da…)
Koalition will Einheits- und Freiheitsdenkmal kippen - Einheitswippe wird voraussichtlich nicht gebaut
Haushaltsausschuss stoppt Berliner Einheitsdenkmal
Thüringen
Frühere Stasi-Landesbeauftragte protestiert gegen Abwicklung
(Systemkonforme Vergangenheitsbewältigung)
Literatur„Frankfurt verboten“: 80 Veranstaltungen widmen sich einem Buch
("theologisch nicht zu rechtfertigen")
Kamp-Lintfort
Gemeinde entfernt Kriegerdenkmal
Linkspartei fordert 8. Mai als Feiertag
LINKE / KAMPF GEGEN RECHTS / ANTIFASCHISMUS / RECHTE
 Radio Bremen
Radio BremenAfD darf nicht in den Rundfunkrat und wittert eine Verschwörung
In den ARD-Rundfunkräten sitzen die Vertreter der Parlamentsparteien. In Bremen müsste daher auch die AfD ihren Abgeordneten entsenden. Doch wegen einer Gesetzesänderung bleiben die Rechtspopulisten außen vor. Zufall?
Extremismus-Vorwürfe
AfD stellt sich hinter Greifswalder Professor
(Das Volk soll lieber konsumieren oder Aktien kaufen…)
Goldrausch bei der Neuen Rechten
(JU und solid)
Hamburg
Junge Union paktiert mit Linksextremisten
Die FAZ über Kositza und Kubitschek – Lückenpresse zu Besuch
„Rechtsextreme Bedrohungskampagne“
Amadeu-Antonio-Stiftung beklagt „rechte Haßtiraden“
(Linke Wagenburg-Areale)
Reportage
„Refugees welcome“ – aber nicht bei uns
von Lukas Steinwandter
Tirol
Ausschreitungen bei Kundgebung gegen Grenzschließungen
Den Grünen aufs Dach gestiegen – Patrick Lenart (IBÖ) im Gespräch
Schutzbefohlene: Identitäre beteiligen sich performativ an Jelinek-Stück
EinProzent aktiv: Das „lebende Banner“ vom 16. April
Jutta Ditfurth verläßt Bündnis
1. Mai-Demo: Antisemitismusstreit in linksextremer Szene
Buchbinder
München: Autoverleiher kämpft gegen „Rechts“
Rechte spenden für Flüchtlinge
So wischt Buchbinder AfD, Pegida & Co. eins aus
(Hetze aus dem Schulbuchverlag Schroedel)
Schulen
Wie ein Schulbuchverlag gegen die AfD wettert
von Henning Hoffgaard
("Slime")
Hamburger Hafengeburtstag
Polizeigewerkschaft kritisiert linksextremes Konzert
Umstrittene Band: Demo gegen Frei.Wild-Konzert in Kiel
Konzert von Echo-Gewinnern : „Kein (Park)Platz für Nationalismus“: Demo gegen „Freiwild“ in Kiel
Antifa verwüstet ehemaligen Rechten-Treff Angriff in Karben auf AfD-Funktionär
Unbekannte haben die Räume des ehemaligen rechten Treffpunkts „Projektwerkstatt“ in Karben verwüstet.
Erneut Anschläge
Linksextreme Szene ruft zur Verhinderung von AfD-Parteitag auf
Linksextreme bekennen sich zu Anschlag auf Pirinçcis Haus
Gewalt gegen IfS-Aktiven und Antaios-Autor
Akif Pirinçci über sein Buch »Umvolkung«: Wir retten dieses Land!
Warum „Umvolkung“ von Akif Pirinçci bei Antaios erscheint
Gelsenkirchen
AfD-Veranstaltung
Hotel läßt Linken-Abgeordneten auflaufen
(Anti-Höcke-Demonstrationen)
Thüringen
Ramelow wirft Antifa „Nazi-Methoden“ vor
Linksextreme Demonstration
Ramelow taugt nicht zur demokratischen Lichtgestalt
von Felix Krautkrämer
Die willigen Helfer der Antifa
Jena am 20. April 2016. Eine offenbar von Neonazis dominierte Truppe, die sich Thügida nennt, hatte einen Fackelzug angemeldet. Den wollte die Stadt nicht dulden, scheiterte aber vor Gericht, das den Aufmarsch am Geburtstag des Führers, der längst vergessen wäre, wenn wir nicht immer wieder daran erinnert würden, erlaubte.
(Versuchter Mord durch polnische Silvesterkracher? Dann sind an Silvester und auf Antifa-Demonstrationen ja massenhaft Mörder unterwegs… Wohl eher Show-Aktionismus der Innenbehörden)
Großeinsatz in Freital: GSG 9 nimmt fünf mutmaßliche Rechtsterroristen fest
(Hier hingegen wird nur wegen Sachbeschädigung ermittelt, obwohl wirklich Menschenleben gefährdet waren)
Entsetzen nach Brandanschlag auf Studentenverbindung
(Zum Freitaler Aktionismus ein treffender Kommentar)
Meinung
Wo der Generalbundesanwalt nicht ermittelt
(Kotelett-Alarm. Staatsschutz ermittelt.)
Barsinghausen Koteletts am Flüchtlingsheim abgelegt
Mitarbeiter der Baufirma haben am Mittwoch um 12 Uhr vier Koteletts auf Fensterbänken an der Rückseite des Flüchtlingswohnheims an der Hannoverschen Straße entdeckt. Sie informierten die Polizei.
Wien
Linksextremisten griffen Lokal wegen patriotischer Veranstaltung an
EINWANDERUNG / MULTIKULTURELLE GESELLSCHAFT
Frans Timmermans: Der Große Austausch als „Manifest Destiny“
#Multikultischadet - Die Nebeneffekte von Multikulti
Silvesternacht - Pegida Demo | Multikulti trifft Nationalismus
EU-Kommissar: Brauchen über 70 Mio. Migranten in 20 Jahren
Neues Verteilungssystem
EU-Kommission plant Asylverfahren auf EU-Ebene
Meinung
Das „Integrations“-Sammelsurium
von Michael Paulwitz
Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts
Zu langsam abgeschoben: Abgelehnte Asylbewerber dürfen in Deutschland bleiben
Asylbewerber kosten bis zu 400 Milliarden Euro
Obama lobt Merkels Asylpolitik
CSU-Plan
Türkische Gemeinde und Grüne empört über Integrationspflicht
Asylwelle
Idomeni: Griechischer Minister befürchtet Radikalisierung
Illegale Einwanderung
Wieder Ausschreitungen in Idomeni
Gelinkte Flüchtlinge
Asylhelfer in Griechenland verhaftet
(Klassenkampf dank "Flüchtlings"-Proletariat)
Linken-Chefin
Kipping: „Geflüchtete sind Boten der Systemfrage“
Organisierte Kriminalität
Arabische Großfamilien rekrutieren in Asylunterkünften
Pilotprojekt bei Amazon: Flüchtlinge beginnen Ausbildung
Jugendhilfe überfordert
Minderjährige Flüchtlinge: Söder kritisiert hohe Kosten
Wirbel in Österreich
Afghanische Familie bezieht über 8.200 Euro Mindestsicherung
Umverteilung im Sozialstaat
Einwanderung macht unsolidarisch
Je mehr Ausländer in einer Gesellschaft leben, umso geringer wird offenbar die Bereitschaft, zugunsten der Armen umzuverteilen. Woran liegt das?
von Lena Schipper
Bericht aus einem Job-Center
Integration – Für sozialen Frieden Geschenke an Hartz IV-Empfänger
(Zitat: "Konkurrenzdruck über billigere Arbeitskräfte aus Südosteuropa")
Löhne auf hessischen Baustellen besonders niedrig
Arbeit mit „Flüchtlingen“: »Wir haben es einfach verbockt«
(Erstaufnahmeeinrichtung)
Einsatz während Obama-Besuch
NRW-Polizisten sollten in Ekel-Kaserne schlafen
Bürgermeister empört
Asylbewerber fordert eigenes Haus und blockiert Straße
Sachsen
Islamisten sollen an Anti-Rechts-Programm teilnehmen
Religionsunterricht in Bayern
Lehrerverband fordert Islamunterricht an allen Schulen
Muslimische Schüler dürfen Lehrerin Händedruck verweigern
Muslimen ist es laut islamischen Rechtsschulen nur erlaubt, die eigene Ehefrau zu berühren. Diesem Umstand gibt nun offenbar eine Schulleitung in Therwil BL nach.
Straßenkrieg - Kurden vs. Türken, 10.4.16, Stuttgart
Zwei Schwerverletzte nach Messer- und Knüppelattacken
Türken- und Kurdenrocker auf Kriegspfad
Am Frankfurter Flughafen
Asylbewerber läuft auf A3 und wird getötet
(Refugees ziehen ins ehemalige Kurhaus)
Aachen
Nichts geht mehr? Kasino spielt Flüchtlingsheim
Offenburg
Asylbewerber boykottieren Essen
Interview
„Es macht mich wütend“
Die Fälle gehen in die Tausende: Sexuelle Übergriffe, Raub, Körperverletzungen. Die Täter: Ausländer, darunter nicht selten Asylsuchende. Petra Berger (Name von der Redaktion geändert) hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Straftaten zu dokumentieren. Ihr Projekt hat sie „Einzelfall“ genannt. Anlaß waren die Ereignisse der Silvesternacht.
Übergriffe in Köln
Hannelore Kraft sperrt Unterlagen zu Silvester
Übergriff
Polizei verschweigt Sex-Attacke von Asylbewerbern in Meschede
Prozeß
Silvesterübergriffe: Angeklagter bekommt Alibi von 16jähriger
Afghanen sollen Zwölfjährigen mißbraucht haben
Verhinderter Taschendiebstahl
„Scheiß Deutschland“: Asylbewerber beschimpft Polizisten
("Die Mahnwache gegen rechts findet trotzdem statt"… Man braucht eben gar keinen Anlass, man findet ihn ohnehin immer in sich selbst.)
Bingen
Syrer gesteht Brandlegung mit Hakenkreuz-Schmiererei
Als Motiv nennt er seine Lage: Ein 26-jähriger Syrer hat den Brand in einem Bingener Rasthaus gelegt. Mit Hakenkreuzen legte er eine falsche Fährte. Die Mahnwache gegen rechts findet trotzdem statt.
Attacke auf Asylunterkunft Bingen
Mahnwache gegen Rechts nach Anschlag durch Syrer
Drei Verletzte bei Explosion in Sikh-Tempel in Essen
In Essen ist es in einem Gebetshaus zu einer Explosion gekommen. Drei Menschen wurden verletzt, einer schwer. Der Polizei zufolge haben Zeugen eine maskierte Person gesehen.
16-jähriger Salafist bekennt sich zu "Terrorakt" in Essen
Ein 16-Jähriger hat gestanden, den Bombenanschlag auf ein Sikh-Gebetshaus in Essen verübt zu haben. Die Polizei spricht von einem "Terrorakt". Der Jugendliche ist den Beamten kein Unbekannter.
Algerier verhöhnt österreichisches Gericht
Dortmund
Diebestour endet für Asylsuchende in Polizeigewahrsam
Fulda
Körperverletzung und Erpressung: Somalier zu Bewährungsstrafe verurteilt
'Rape'fugees in France
Asylant schlägt mutiges sexy Mädchen
Afghanische Asylanten rasten im Gericht aus Scheiß Deutschland, Kinderficker alles Nazis 1

KULTUR / UMWELT / ZEITGEIST / SONSTIGES
Statt Styropor: Häuser dämmen mit Schilfgras im Putz
Warum die Bauindustrie Millionen Häuser abreißen will
Alt, eng, dunkel – in Millionen deutschen Wohnhäusern will niemand mehr leben. Hier hilft nur noch Abriss und Neubau - sagt die Baulobby. Aber ein zweiter Blick zeigt: Ganz so einfach ist es nicht.
(Wie einem Hausbesitzer in den 70er Jahren ein Flachdach aufgezwungen wurde…)
Ascheberg im Wandel, 1 Flachdach war nicht zu verhindern
(Vergangenheits-Bewältigungs-Probleme…)
Streit um Hitlers Geburtshaus
Gelber Kasten, braune Lasten
Umstrittene "Rückkehr" des zerstörten Triumphbogens
In London wurde eine Replik des Triumphbogens von Palmyra aufgebaut. Bald soll er nach Syrien "zurückkehren". Aber darf man Geschichte einfach so zurückdrehen und zerstörte Kunst rekonstruieren?
Streit um Nacktbilder
Religiöse Gefühle: Berliner Rathaus entfernt Aktfotos
ZDF-Moderator
Böhmermann: Regierung prüft Forderung nach Strafverfolgung
Der politisch allzu korrekte „ZDF-Satiriker“
Warum Böhmermann kein Held der Meinungsfreiheit ist
Satire-Streit
Pirinçci: Böhmermann ist kein Held
von Felix Krautkrämer
Jan Böhmermann: Bernd Lucke beleidigt Satiriker als "feige Drecksau"
In der Bosporus-Falle auf einem Schmutzreim ausgerutscht
Die Kanzlerin ist in der Böhmermann-Krise in Bedrängnis: Die Geschichte vom langsamen Niedergang von Bundeskanzlern wiederholt sich offenbar gelegentlich. Mal als Tragödie, diesmal wohl als Farce.
GEZ-Verweigerung: Thüringerin seit zwei Monaten in Haft
GEZ: Frau Fischer will standhaft bleiben
Kein Radio- und kein Fernsehgerät: 84-jährige Löningerin wehrt sich gegen Rundfunkgebühren
Nicht gezahlte GEZ-Gebühren: ARD-Chefredakteur kritisiert Beatrix von Storch
KEF-Vorsitzende Heinz Fischer-Heidlberger
Experte warnt vor GEZ-Anstieg: "Wird auf jeden Fall richtig teuer werden ab 2021"
(Hetzpropaganda in der ZDF heute-Show)
ZDF heute-show
Alles Nazis außer Mutti
von Harald Vilimsky
Bei der ARD sitzt die Atlantik-Brücke in der ersten Reihe: Ingo Zamperoni wird Tagesthemen-Moderator
(Anti-AfD-Stimmung bei Maischberger)
Fernseh-Kritik
Die Angst geht um
von Lukas Steinwandter
AfD-Chefin Petry holt sich Spindoktor vom "Focus"
Frauke Petry holt sich Michael Klonovsky als Kommunikationsberater. Der "Focus"-Autor gilt als jemand, der polarisiert. Einmal schrieb er: "Jeder Muezzinruf beinhaltet eine Feinderklärung."
Ex-Focus-Journalist
Michael Klonovsky wird Medienberater von AfD-Chefin Petry
EU-Reform: Facebook und Co. möglicherweise erst ab 16 Jahren
Sinus-Jugendstudie 2016
Die Enkel der 68er: Angepaßt, tolerant und auf der Suche nach Halt
von Martin Voigt
Wegen Übergriffen von Köln
Maas will sexistische Werbung verbieten
(dazu ein Kommentar)
Berlin-Brandenburg
Evangelische Kirche erlaubt Homo-Ehe
Gender Mainstreaming
Conchita Wurst als Ideal
von Martin Voigt
Aus der (T)Raum – Micha Brumliks linker Universalismus
KenFM im Gespräch mit: Eugen Drewermann
("Wunschdenken", das neue Buch von Thilo Sarrazin)
Buchvorstellung Sarrazins
"Emotionale Attacken" gegen "analytische Kälte"
von Christian Dorn
Satire
Himmel Honecker wünscht AfD zur Hölle
SED-Generalsekretär - in bewehrter rhetorischer Brillianz
(Kommentar zu den verkommenen deutschen Amtskirchen)
Meinung
Islam-Lobbyisten im Meßgewand
von Michael Paulwitz
Beschwerden wegen der Bibel
Das „Büro für intellektuelle Freiheit“ der amerikanischen Bibliotheksvereinigung veröffentlicht jedes Jahr eine Liste mit den offiziell am häufigsten eingereichten Beschwerden über Bücher. Diese seien Versuche, bestimmte Werke aus Bibliotheken zu verbannen. Erstmals erscheint auf dieser Liste die Bibel.
Schleier tragen könnte bald der letzte Schrei sein
(auch eine Form der Globalisierung)
Sesamstraße in Afghanistan Manchmal trägt Zari einen Schleier
"Sesamstraße": Eine Puppe für Afghanistans Mädchen
Schützenfest abgesagt
Wenn Bürokratie Traditionsfeste verhindert
von Lukas Steinwandter
(Querulanten beschäftigen die Justiz…)
"Spaghettimonster" scheitern
Die letzte Nudel ist noch nicht gegessen
Ein "Hauch der Geschichte" aus dem Mund Bismarcks
Von wegen Fistelstimme! Der spektakuläre Fund einer Tonaufnahme Bismarcks rehabilitiert den "Eisernen Kanzler". Doch warum singt er wohl die Hymne des damaligen Feindes?
Selbstverteidigung – realistisch und effektiv
Sonnenkreuz-Modeversand
Filmkritik: Der schwarze Nazi im Kino
Ahnenheil: Wenn wir in Staub zerfallen
 Le déni des cultures est un déni anthropologique grave, qui conduit, à terme, à une inintelligibilité du monde semeuse de tensions et de conflits. Le déni des cultures est un déni du réel.
Le déni des cultures est un déni anthropologique grave, qui conduit, à terme, à une inintelligibilité du monde semeuse de tensions et de conflits. Le déni des cultures est un déni du réel.


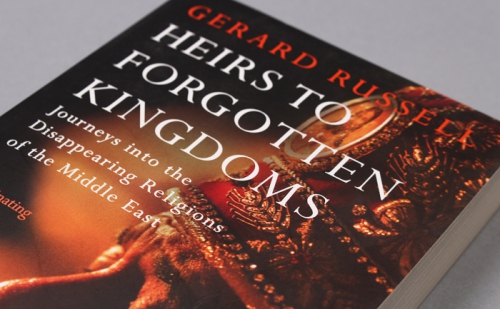



 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg
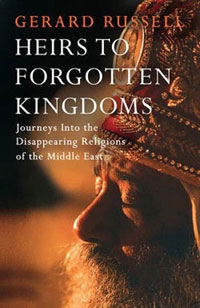 In the spring of 2006, Gerard Russell was a bored British diplomat stewing in the heat of the Green Zone in Baghdad, “a five-mile 21st-century dystopia filled with concrete berms and highway bridges that ended in midair where a bomb had cleaved them”. Then he received a call from the high priest of the Mandeans.
In the spring of 2006, Gerard Russell was a bored British diplomat stewing in the heat of the Green Zone in Baghdad, “a five-mile 21st-century dystopia filled with concrete berms and highway bridges that ended in midair where a bomb had cleaved them”. Then he received a call from the high priest of the Mandeans.





 Moreover, the integration initiatives in Eurasia are not limited to the EEU, the Silk Road Economic Belt and the SCO. In this context, the Eurasian initiative of South Korean President Park Geun-hye, Kazakhstan’s ‘Nurly Zhol’ programme and Mongolia’s Steppe Route project are also worth mentioning. The fundamental difference between all of these projects and the TTP and TTIP projects being promoted and financed by the US is as follows. The main objective of the TPP and TTIP (besides subordinating the member countries’ economies) is to impede the economic growth of the leading Eurasian countries, primarily China and Russia, and prevent their integration into the Asia-Pacific Region and Eurasia. Thus the TPP and TTIP initiatives are exclusive, they deliberately exclude America’s main economic and political rivals. In contrast, the EEU, the Silk Road Economic Belt, the SCO and all the other projects and initiatives mentioned above are by definition inclusive. They are not only open to participation by all the countries in the region, but would simply be unrealisable if just one of the countries located in an area where major infrastructure projects were being implemented was unable, for whatever reason, to take part.
Moreover, the integration initiatives in Eurasia are not limited to the EEU, the Silk Road Economic Belt and the SCO. In this context, the Eurasian initiative of South Korean President Park Geun-hye, Kazakhstan’s ‘Nurly Zhol’ programme and Mongolia’s Steppe Route project are also worth mentioning. The fundamental difference between all of these projects and the TTP and TTIP projects being promoted and financed by the US is as follows. The main objective of the TPP and TTIP (besides subordinating the member countries’ economies) is to impede the economic growth of the leading Eurasian countries, primarily China and Russia, and prevent their integration into the Asia-Pacific Region and Eurasia. Thus the TPP and TTIP initiatives are exclusive, they deliberately exclude America’s main economic and political rivals. In contrast, the EEU, the Silk Road Economic Belt, the SCO and all the other projects and initiatives mentioned above are by definition inclusive. They are not only open to participation by all the countries in the region, but would simply be unrealisable if just one of the countries located in an area where major infrastructure projects were being implemented was unable, for whatever reason, to take part.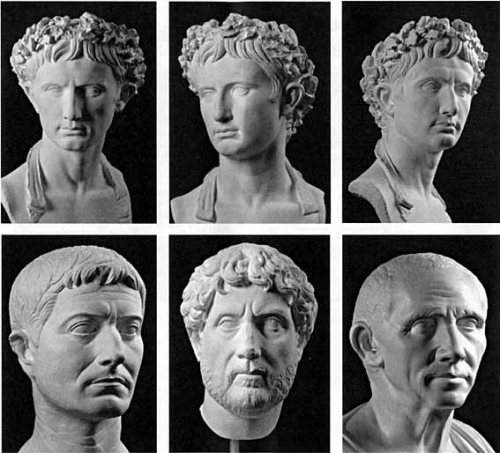
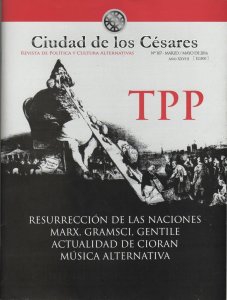 Con este Equinoccio de Otoño se inicia el XXVIII año de Ciudad de los Césares. Como ya en ocasiones anteriores, los aniversarios –jalones que marcan el camino recorrido- sirven para tomar nuevos alientos, mirar hacia atrás por un momento –medir la distancia recorrida- y reemprender la marcha. Es posible que algunos caminantes se hayan rezagado; y es que, como en una peregrinación, nadie –dice nuestro recordado José Luis Ontiveros en el último artículo entregado a Ciudad de los Césares- está excluído de trazar sobre su alma el itinerario de su cura o de su perdición; y, al fin, es el corazón el camino que nunca se equivoca.
Con este Equinoccio de Otoño se inicia el XXVIII año de Ciudad de los Césares. Como ya en ocasiones anteriores, los aniversarios –jalones que marcan el camino recorrido- sirven para tomar nuevos alientos, mirar hacia atrás por un momento –medir la distancia recorrida- y reemprender la marcha. Es posible que algunos caminantes se hayan rezagado; y es que, como en una peregrinación, nadie –dice nuestro recordado José Luis Ontiveros en el último artículo entregado a Ciudad de los Césares- está excluído de trazar sobre su alma el itinerario de su cura o de su perdición; y, al fin, es el corazón el camino que nunca se equivoca.




 Radio Bremen
Radio Bremen
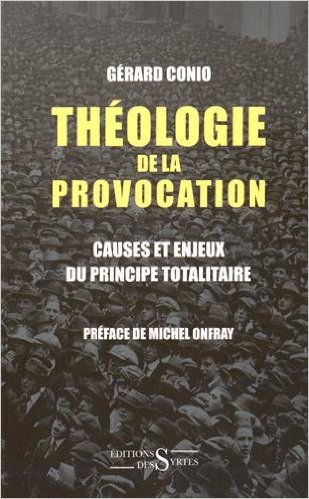
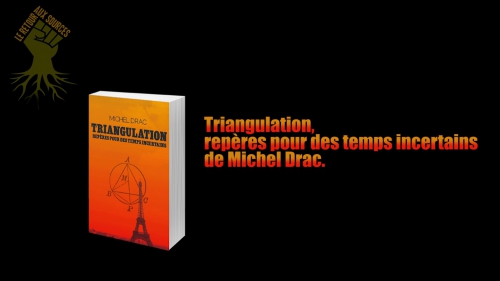


 Professor Hans Giffhorn of Germany has made studying the Chachapoyan civilization his life’s work and has advanced an interesting theory regarding its origin. After many years of research starting in the 1990’s, Professor Giffhorn published a fascinating German language book in 2013 entitled
Professor Hans Giffhorn of Germany has made studying the Chachapoyan civilization his life’s work and has advanced an interesting theory regarding its origin. After many years of research starting in the 1990’s, Professor Giffhorn published a fascinating German language book in 2013 entitled 



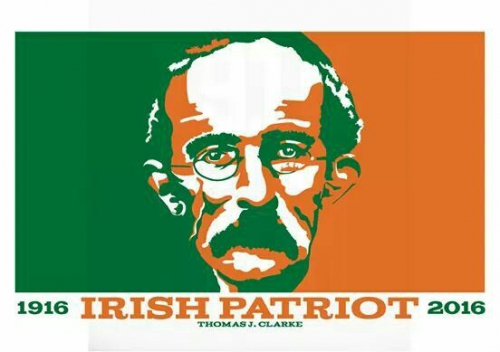
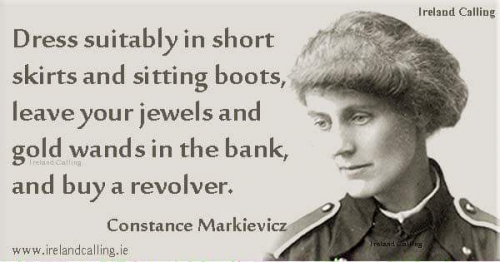






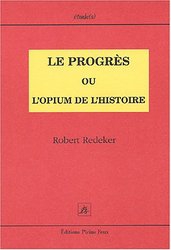 Robert Redeker : Pourquoi ces livres ? D’abord, il y a l’urgence d’établir le droit d’inventaire philosophique de la période historique que nous venons de vivre depuis le XVIIIe siècle et qui paraît se clore – c’est la période que l’on appelle “la Modernité”, qui a été marquée par une religion inédite, celle du progrès. Ce livre pourrait se découper ainsi : le progrès, sa naissance, sa vie, son déclin, sa mort. Il s’agit du progrès entendu comme idéologie, c’est-à-dire comme grille métaphysique de lecture du monde, et comme valeur identifiée au Bien. Ensuite, j’ai voulu continuer à penser les mutations de l’homme et du monde dans une lignée que je trace depuis mes premiers livres (Le déshumain ; Nouvelles Figures de l’Homme ; L’emprise sportive) et d’autres plus récents (Egobody). Enfin, le monde en charpie dans lequel nous vivons, et la “
Robert Redeker : Pourquoi ces livres ? D’abord, il y a l’urgence d’établir le droit d’inventaire philosophique de la période historique que nous venons de vivre depuis le XVIIIe siècle et qui paraît se clore – c’est la période que l’on appelle “la Modernité”, qui a été marquée par une religion inédite, celle du progrès. Ce livre pourrait se découper ainsi : le progrès, sa naissance, sa vie, son déclin, sa mort. Il s’agit du progrès entendu comme idéologie, c’est-à-dire comme grille métaphysique de lecture du monde, et comme valeur identifiée au Bien. Ensuite, j’ai voulu continuer à penser les mutations de l’homme et du monde dans une lignée que je trace depuis mes premiers livres (Le déshumain ; Nouvelles Figures de l’Homme ; L’emprise sportive) et d’autres plus récents (Egobody). Enfin, le monde en charpie dans lequel nous vivons, et la “ La majuscule au “P” de “Progrès” dit tout. Le Progrès ainsi saisi a le statut d’une entité métaphysique planant sur l’histoire et dirigeant sa marche. Il prend la place de Dieu comme directeur de l’histoire – un Dieu dépersonnalisé, désindividualisé, n’existant pas, réduit à un concept exsangue. Cette conception du progrès fut beaucoup plus qu’une idée philosophique (celle de Kant, Condorcet, Hegel, Comte, Marx), ce fut une opinion populaire, répandue dans les masses, en ce sens-là elle fit l’objet d’une croyance collective. Elle fut distribuée comme l’hostie des curés par des milliers de hussards noirs de la République tout au long de la IIIe République. On – surtout à gauche – croyait au progrès comme on avait cru en Dieu. Tous – Kant aussi bien que, quoique confusément, les masses – attribuaient une valeur métaphysique aux évolutions de la technique, de l’industrie, du droit, de la politique. Ma critique n’est pas celle du progrès des connaissances, de l’évolution des techniques et des améliorations de l’existence humaine, ce qui serait aussi absurde que grotesque, mais du sens abusivement conféré à ces évolutions, de leur transformation en fétiche et idole. Je ne développe pas une technophobie encore moins un irrationalisme. On peut plutôt comprendre ma démarche comme une critique de l’idolâtrie.
La majuscule au “P” de “Progrès” dit tout. Le Progrès ainsi saisi a le statut d’une entité métaphysique planant sur l’histoire et dirigeant sa marche. Il prend la place de Dieu comme directeur de l’histoire – un Dieu dépersonnalisé, désindividualisé, n’existant pas, réduit à un concept exsangue. Cette conception du progrès fut beaucoup plus qu’une idée philosophique (celle de Kant, Condorcet, Hegel, Comte, Marx), ce fut une opinion populaire, répandue dans les masses, en ce sens-là elle fit l’objet d’une croyance collective. Elle fut distribuée comme l’hostie des curés par des milliers de hussards noirs de la République tout au long de la IIIe République. On – surtout à gauche – croyait au progrès comme on avait cru en Dieu. Tous – Kant aussi bien que, quoique confusément, les masses – attribuaient une valeur métaphysique aux évolutions de la technique, de l’industrie, du droit, de la politique. Ma critique n’est pas celle du progrès des connaissances, de l’évolution des techniques et des améliorations de l’existence humaine, ce qui serait aussi absurde que grotesque, mais du sens abusivement conféré à ces évolutions, de leur transformation en fétiche et idole. Je ne développe pas une technophobie encore moins un irrationalisme. On peut plutôt comprendre ma démarche comme une critique de l’idolâtrie.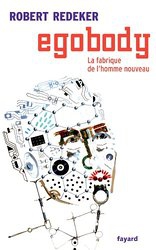 Cette croyance au progrès nous a rendu criminels et aveugles, criminels par aveuglement (le progrès est alors l’opium et l’ivresse de l’histoire) et dévastateurs pour la nature. Par sa faute nous avons confondu le ménagement du monde – le monde que l’on tient comme on fait le ménage, avec amour et précaution, “ménager” – et l’exploitation du monde, sa dévastation. Les utopies politiques ont conduit au crime, le capitalisme à la dévastation. Or, le capitalisme n’a pas besoin de la croyance métaphysique dans le progrès pour aller de l’avant. Il se peut se contenter d’ériger l’innovation, le mouvement, “le bougisme”, comme dit
Cette croyance au progrès nous a rendu criminels et aveugles, criminels par aveuglement (le progrès est alors l’opium et l’ivresse de l’histoire) et dévastateurs pour la nature. Par sa faute nous avons confondu le ménagement du monde – le monde que l’on tient comme on fait le ménage, avec amour et précaution, “ménager” – et l’exploitation du monde, sa dévastation. Les utopies politiques ont conduit au crime, le capitalisme à la dévastation. Or, le capitalisme n’a pas besoin de la croyance métaphysique dans le progrès pour aller de l’avant. Il se peut se contenter d’ériger l’innovation, le mouvement, “le bougisme”, comme dit  Comme programme, le transhumanisme est une utopie post-progressiste qui ne conserve de ce progressisme que le fétichisme de la science et de la technique. La dimension morale, historique et métaphysique du progressisme est jetée par-dessus bord. De fait, le transhumanisme est un scientisme et un technicisme de la plus consternante naïveté. Il n’est que l’un des produits de la décomposition du cadavre du progrès, une sorte de jus de cadavre du progrès. Mais il est aussi une réalité sociale sous la forme d’un fantasme qui hante la médecine, le show-business, le sport. Peu à peu l’homme “naturel” est remplacé par un homme d’un type nouveau, indéfiniment réparable, dont les organes sont des pièces détachées remplaçables, dont le corps est entièrement composé de prothèses. Une figure du sport comme Oscar Pistorius peut être prise pour l’emblème de cette transformation anthropologique. Nommons egobody
Comme programme, le transhumanisme est une utopie post-progressiste qui ne conserve de ce progressisme que le fétichisme de la science et de la technique. La dimension morale, historique et métaphysique du progressisme est jetée par-dessus bord. De fait, le transhumanisme est un scientisme et un technicisme de la plus consternante naïveté. Il n’est que l’un des produits de la décomposition du cadavre du progrès, une sorte de jus de cadavre du progrès. Mais il est aussi une réalité sociale sous la forme d’un fantasme qui hante la médecine, le show-business, le sport. Peu à peu l’homme “naturel” est remplacé par un homme d’un type nouveau, indéfiniment réparable, dont les organes sont des pièces détachées remplaçables, dont le corps est entièrement composé de prothèses. Une figure du sport comme Oscar Pistorius peut être prise pour l’emblème de cette transformation anthropologique. Nommons egobody 



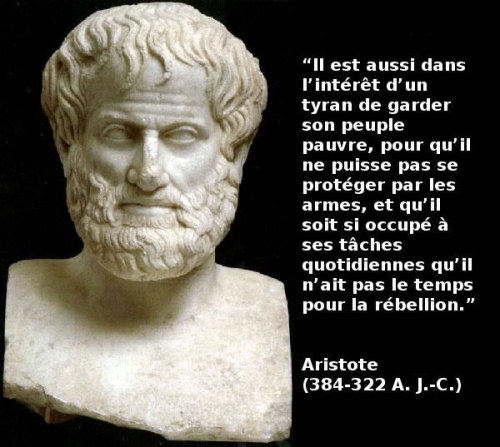

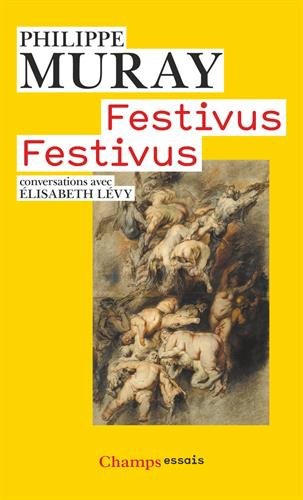 À partir de là advient la société acculturée, hédoniste, massifiée, et donc ochlocratique ; l’homo festivus succède à l’homo sapiens sapiens. Le démos n’existe plus pour la simple et bonne raison que le peuple ne se reconnaît plus après la longue et savante aliénation de lui-même. Il doit faire corps avec les pulsions qu’on lui inculque, corps avec l’Entreprise qui ne voit en lui qu’un consommable comme n’importe quel autre dont elle nécessite les services à un instant T ; bref, il doit s’oublier dans les grands ensembles qu’on lui impose aussi bien comme cadre de vie maximaliste qu’intimiste. Quand le retour des lubies liées à la Patrie ou à la Culture resurgissent inopinément par la force majeure, elles sont immédiatement avilies ; on leur fait dire leur exact contraire, on fait passer le festivisme pour une résistance culturelle contre la barbarie avec tout l’art de nous faire prendre des vessies pour des lanternes en comptant sur le concours bienveillant de la manufacture du consentement, parce que justement « les flatteurs sont à l’honneur », toujours plus agréables aux oreilles des foules que ces donneurs de leçons ataviques venant d’un autre temps. La docilité de l’homme moderne face aux décrets des démagogues est précisément l’un des points centraux de l’ochlocratie. Sénèque disait de la vie heureuse ne peut se traduire par un quelconque vote majoritaire, tout simplement parce qu’« il n’en va pas si bien avec les affaires humaines que ce qui est le meilleur plaise au plus grand nombre : une preuve du pire, c’est la foule ». La société de consommation en est l’application moderne parfaite, puisqu’elle ne tolère ni vie privée, ni intimité, ni pensée personnelle. Elle se donne dans le voyeurisme le plus grossier, mais aussi le plus violent, puisque ceux qui refusent de s’y soumettre sont aussitôt suspicieux aux yeux de la fatuité des masses. Le corps en est objectivisé, puisque devenu objet de consommation et de jouissance immédiate, dont les innombrables concours de beauté procèdent sans la moindre honte. Celui qui, par malheur, prend le temps de la contemplation et de l’épanouissement intellectuel et spirituel est aussitôt jugé « bizarre », déprécié, comme un fort au pays des faibles. Il s’attire le ressentiment de tous, parce qu’il leur rappelle leur propre médiocrité.
À partir de là advient la société acculturée, hédoniste, massifiée, et donc ochlocratique ; l’homo festivus succède à l’homo sapiens sapiens. Le démos n’existe plus pour la simple et bonne raison que le peuple ne se reconnaît plus après la longue et savante aliénation de lui-même. Il doit faire corps avec les pulsions qu’on lui inculque, corps avec l’Entreprise qui ne voit en lui qu’un consommable comme n’importe quel autre dont elle nécessite les services à un instant T ; bref, il doit s’oublier dans les grands ensembles qu’on lui impose aussi bien comme cadre de vie maximaliste qu’intimiste. Quand le retour des lubies liées à la Patrie ou à la Culture resurgissent inopinément par la force majeure, elles sont immédiatement avilies ; on leur fait dire leur exact contraire, on fait passer le festivisme pour une résistance culturelle contre la barbarie avec tout l’art de nous faire prendre des vessies pour des lanternes en comptant sur le concours bienveillant de la manufacture du consentement, parce que justement « les flatteurs sont à l’honneur », toujours plus agréables aux oreilles des foules que ces donneurs de leçons ataviques venant d’un autre temps. La docilité de l’homme moderne face aux décrets des démagogues est précisément l’un des points centraux de l’ochlocratie. Sénèque disait de la vie heureuse ne peut se traduire par un quelconque vote majoritaire, tout simplement parce qu’« il n’en va pas si bien avec les affaires humaines que ce qui est le meilleur plaise au plus grand nombre : une preuve du pire, c’est la foule ». La société de consommation en est l’application moderne parfaite, puisqu’elle ne tolère ni vie privée, ni intimité, ni pensée personnelle. Elle se donne dans le voyeurisme le plus grossier, mais aussi le plus violent, puisque ceux qui refusent de s’y soumettre sont aussitôt suspicieux aux yeux de la fatuité des masses. Le corps en est objectivisé, puisque devenu objet de consommation et de jouissance immédiate, dont les innombrables concours de beauté procèdent sans la moindre honte. Celui qui, par malheur, prend le temps de la contemplation et de l’épanouissement intellectuel et spirituel est aussitôt jugé « bizarre », déprécié, comme un fort au pays des faibles. Il s’attire le ressentiment de tous, parce qu’il leur rappelle leur propre médiocrité. Un livre très intéressant vient de paraître, publié chez un petit éditeur, c’est Silence Coupable de Céline Pina [1]. L’auteur est une élue locale PS, qui fut conseillère régionale d‘Île de France. Son livre se veut un cri d‘alarme, mais aussi un cri de détresse, quant à l’abandon de la laïcité qu’elle perçoit et qu’elle analyse dans plusieurs domaines. Elle dénonce une politique d’abandon de la part des politiques, qui ne peut que mener le pays soit à la tyrannie soit à la guerre civile.
Un livre très intéressant vient de paraître, publié chez un petit éditeur, c’est Silence Coupable de Céline Pina [1]. L’auteur est une élue locale PS, qui fut conseillère régionale d‘Île de France. Son livre se veut un cri d‘alarme, mais aussi un cri de détresse, quant à l’abandon de la laïcité qu’elle perçoit et qu’elle analyse dans plusieurs domaines. Elle dénonce une politique d’abandon de la part des politiques, qui ne peut que mener le pays soit à la tyrannie soit à la guerre civile. Le premier chapitre s’ouvre sur une dénonciation au vitriol des méfaits du clientélisme qui fut pratiqué tant par les partis de « gauche » que par ceux de droite. On sent ici nettement que c’est l’expérience de l’élue de terrain qui parle. La description des petites comme des grandes compromissions, que ce soit lors du « salon de la femme musulmane » ou dans l’éducation nationale (et le rôle funeste à cet égard de la Ligue de l’enseignement ou de la Ligue des droit de l’Homme sont ici très justement pointés du doigt) montre que Céline Pina connaît parfaitement son sujet. Il est clair que certains élus cherchent à s’allier avec les islamistes tant pout avoir le calme ans un quartier que pour faire jouer une « clientèle » électorale. Le procédé est anti-démocratique. Il est surtout suicidaire dans le contexte actuel. Malek Boutih l’avait déjà énoncé et Céline Pina enfonce le clou et donne des exemples.
Le premier chapitre s’ouvre sur une dénonciation au vitriol des méfaits du clientélisme qui fut pratiqué tant par les partis de « gauche » que par ceux de droite. On sent ici nettement que c’est l’expérience de l’élue de terrain qui parle. La description des petites comme des grandes compromissions, que ce soit lors du « salon de la femme musulmane » ou dans l’éducation nationale (et le rôle funeste à cet égard de la Ligue de l’enseignement ou de la Ligue des droit de l’Homme sont ici très justement pointés du doigt) montre que Céline Pina connaît parfaitement son sujet. Il est clair que certains élus cherchent à s’allier avec les islamistes tant pout avoir le calme ans un quartier que pour faire jouer une « clientèle » électorale. Le procédé est anti-démocratique. Il est surtout suicidaire dans le contexte actuel. Malek Boutih l’avait déjà énoncé et Céline Pina enfonce le clou et donne des exemples.