vendredi, 10 juin 2022
Conflit ukrainien: un champ d'expérimentation pour de nouvelles armes américaines?

Conflit ukrainien: un champ d'expérimentation pour de nouvelles armes américaines?
Erich Körner-Lakatos
Source: https://zurzeit.at/index.php/ukraine-konflikt-experimentierfeld-fuer-neue-us-waffen/
Washington aide Kiev, mais au compte-gouttes
Les observateurs intéressés ont de plus en plus l'impression que les Etats-Unis - ou plus précisément leur complexe militaro-industriel (© Dwight Eisenhower) - considèrent le conflit en Ukraine comme un laboratoire pour tester l'efficacité de leurs différentes armes dans des conditions aussi proches que possible de la guerre.
L'exemple historique est la guerre civile espagnole (1936-1939), où la Russie soviétique et le Reich allemand ont tous deux utilisé leurs armes ultramodernes pour l'époque afin de tester leur efficacité au combat, en quelque sorte dans des conditions de temps réel. Citons par exemple le char russe T-26 et le bombardier en piqué allemand Ju-87 (Stuka), ainsi que le canon de DCA de 88 mm. Ce dernier est ensuite utilisé - une autre innovation ! - par l'Afrikakorps allemand dans le combat terrestre contre les chars.

Le 1er juin, Washington a annoncé qu'il fournissait désormais aux Ukrainiens des lance-roquettes multiples M142 Himars (automoteurs mais non blindés). Il s'agit du plus efficace des trois types d'artillerie fournis à Kiev par les Américains.

Jusqu'à présent, quatre-vingt-dix M777 (ci-dessus) ont été mis à la disposition des troupes de Zelenski. Il s'agit d'obusiers non blindés tirés par des tracteurs, dont les munitions standard peuvent neutraliser des cibles jusqu'à 25 km de distance, voire 40 km avec des munitions spéciales. Les obusiers, comme les canons, peuvent également neutraliser des cibles ennemies en tir direct (tir à plat), mais seulement à une distance plus courte. Il est également prévu d'envoyer des obusiers blindés M109, dont la portée est comparable à celle de l'obusier M777.
Toutefois, les lance-roquettes M142 Himars sont beaucoup plus efficaces et permettent d'attaquer des objets ennemis à une distance comprise entre 40 et 75 km. "Himars" signifie "High Mobility Artillery Rocket System" (système de roquettes d'artillerie à haute mobilité). Six missiles d'artillerie guidés avec précision par satellite peuvent être tirés par l'engin. Les forces de Zelenski disposeront ainsi à l'avenir d'une arme équivalente au lance-roquettes multiple russe BM-30 Smertch (Tornado) (ci-dessous), capable de couvrir des distances allant jusqu'à 70 km.

Le lance-roquettes M142 Himars est moins destiné à fournir un appui-feu immédiat aux unités de combat sur le terrain qu'à neutraliser les pièces d'artillerie ennemies positionnées plus en arrière (tir de contre-batterie). Mais surtout, un lanceur M142 peut agir dans la profondeur de l'espace ennemi, détruisant ainsi des cibles logistiques (bases de ravitaillement en nourriture, armes et munitions) ou des bases d'engins de combat et d'hélicoptères.
Pour l'instant, les experts militaires américains semblent vouloir observer les effets du lanceur en utilisant des munitions standard. L'étape suivante pourrait être l'utilisation de munitions dites "Atacms"." Atacms" est l'abréviation de "Army Tactical Missile System". Ces munitions spéciales sont actuellement refusées aux Ukrainiens, et Kiev n'est pas autorisé à tirer sur des cibles en Russie, c'est-à-dire de l'autre côté de la frontière, avec des armes américaines.
Pourtant, cela aurait des conséquences durables. Les missiles Atacms à courte portée, tirés par le lanceur M142 Himars, peuvent être utilisés contre des cibles situées à une distance de trois cents kilomètres (soit la distance entre Vienne et Salzbourg). De nombreuses unités de ravitaillement russes se trouvent entre cent et deux cents kilomètres en arrière de la ligne de front respective.
Depuis l'est de l'Ukraine, la région de Belgorod, où des unités de combat russes sont formées en masse et prêtes à être déployées sur le front, et les aérodromes militaires tels que la base aérienne de Voronej, d'où décollent les bombardiers Su-34 pour les missions au-dessus de l'Ukraine, se trouvent dans le rayon d'action potentiel des armes Atacms. Il y a aussi l'aéroport de Szhcha, près de la frontière orientale de la Biélorussie.
Vladimir Poutine ne reste pas inactif pour autant. L'armée russe a déjà commencé à cibler les voies de transport par lesquelles les nouvelles armes sont livrées depuis l'Ouest, c'est-à-dire principalement les lignes de chemin de fer à partir de la frontière occidentale de l'Ukraine. Une grande partie des lance-roquettes M142 pourrait également être victime de ces contre-attaques. M. Zelenski ne devrait donc pas se réjouir trop vite.
18:55 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : armements, actualité, ukraine, états-unis, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
La famille: crise ou transformation? Des idées pour vaincre par la verticalité

La famille: crise ou transformation? Des idées pour vaincre par la verticalité
par Giovanni Terlizi
Source: https://www.centrostudipolaris.eu/2022/06/02/famiglia-crisi-o-trasformazione-idee-per-un-superamento-con-verticalita/
La crise actuelle de la famille et de son institution peut devenir l'occasion de revenir à une approche plus "platonique" de l'éducation des jeunes.
Mais quel type d'éducation doit-on donner aux enfants ?
Aucune éducation ne sera efficace si elle reste clouée au dualisme idéologique et aux schémas qui prévalent encore.
"L'eugénisme répugne à ceux qui craignent son verdict" - Nicolàs Gòmez Dàvila
La crise actuelle dans la définition de la famille et de l'institution qu'elle représente peut devenir une opportunité pour une transformation et une approche plus "platonique" de l'éducation des jeunes. Mais quel type d'éducation doit-on donner aux enfants ? Aucune éducation ne sera efficace si elle reste rivée au dualisme idéologique et aux schémas qui prévalent encore aujourd'hui.
Prisonniers des vieux schémas socio-éducatifs
Le modèle actuel selon lequel les jeunes sont éduqués est issu de logiques schématiques anciennes. Essayons de comprendre sa genèse.
La "Droite" - si elle connaît sa matrice - est pour la "Transcendance Immanente" (Transcendance Absolue) et cherche à établir un Centrage de type "Transcendant" qui régit le Devenir qui, lui, est dans l'immanence, contrairement à la "Gauche" qui - si elle connaît sa matrice - est plutôt pour l'"Immanence Transcendantale" (c'est-à-dire l'Immanence Absolue). Cependant, cette "Immanence absolue" de la "Gauche" n'implique pas nécessairement la société nivelée et horizontale, mais est plutôt une Verticalité qui, au lieu de partir de la "Centralité du Sujet" avec lui-même et avec les autres, est produite dans l'immanence de la Multiplicité et de la "Multiplicité du Devenir", comme un "Processus de Verticalité sans Sujet". Un exemple de cette "verticalité sans sujet" de la "gauche" peut être trouvé chez les Situationnistes, ou même chez Carmelo Bene et sa "verticalité du verso".
La "gauche" du "syndicalisme révolutionnaire" venait du socialisme, mais a pourtant créé une doctrine hiérarchique - c'est parce que la "gauche" du "syndicalisme révolutionnaire" a compris que le socialisme et la gauche n'impliquent pas du tout la "société horizontale" dans laquelle nous vivons aujourd'hui. En fait, la "société horizontale", plutôt que d'être le fruit du socialisme, est le fruit de l'actionnisme et du "Parti d'action", c'est-à-dire de cette collaboration entre libéraux et socialistes que l'on retrouve ensuite aussi dans la "société ouverte" de Karl Popper et dans l'"Open Society" de George Soros (Soros lui-même, d'ailleurs, était un étudiant de Karl Popper).
En outre, nous avons l'une des premières formes de "société ouverte" dans la logique de la technocratie du Vatican: nous pouvons dire que le Vatican est l'une des premières formes de "société ouverte", mais nous devons souligner que le vaticanisme commence bien avant le catholicisme et qu'il s'agit de "l'idée technocratique" de "négocier avec la divinité", la même idée qui s'était répandue dans le sénat corrompu de l'empire tardif et qui a ensuite généré l'immigrationnisme du "Ius Soli romain", qui a ensuite jeté les bases du "baptême universel" et du monothéisme du catholicisme romain et du christianisme, ce même marchandage avec la divinité que nous retrouvons plus tard dans la "vente des indulgences".
Cela ne veut pas dire que tout le patrimoine culturel, spirituel et artistique du catholicisme doit être rejeté - en fait, cet article commence par la phrase même de Nicolás Gómez Dàvila, qui était un philosophe catholique, connu pour ses aphorismes. Comme nous le voyons clairement, ce qui est important se situe toujours dans la dimension de l'Esprit, et non dans l'étiquette à laquelle appartient une personne ou une pensée.
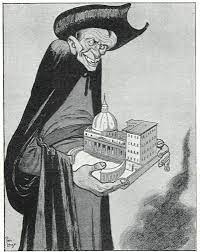 La version la plus forte et la plus emblématique du vaticanisme est le jésuitisme. Les Jésuites sont nés en tant que bras armé de la papauté à une époque de crise pour le Saint-Siège. Le jésuitisme est cette pratique dans laquelle l'habileté diplomatique du Vatican oriente les "tendances" de la société par des choix politiques et sociaux qui solidifient la relation structurelle entre l'Église et l'État. Voyez en ce sens comment un pape jésuite comme Bergoglio est étroitement lié à la vague de néo-humanitarisme progressiste et actionniste de notre époque.
La version la plus forte et la plus emblématique du vaticanisme est le jésuitisme. Les Jésuites sont nés en tant que bras armé de la papauté à une époque de crise pour le Saint-Siège. Le jésuitisme est cette pratique dans laquelle l'habileté diplomatique du Vatican oriente les "tendances" de la société par des choix politiques et sociaux qui solidifient la relation structurelle entre l'Église et l'État. Voyez en ce sens comment un pape jésuite comme Bergoglio est étroitement lié à la vague de néo-humanitarisme progressiste et actionniste de notre époque.
La "société nivelée" - et donc la "société horizontale" - est ce que l'anarchiste Max Stirner a défini comme la "société en haillons", où le terme "en haillons" désigne une société dans laquelle la verticalité a été supprimée, et ce qui est réalisé à la place est l'incapacité du "Vivant" à étendre son pouvoir d'une manière plus affirmative, verticale et élevée. Rappelons que Max Stirner est issu de la "gauche hégélienne" de Marx, Feuerbach, Bakounine, Bruno Bauer, etc.
La société qui a conçu l'actionnisme et le parti de l'action était une société très semblable à celle d'aujourd'hui, dans laquelle les vivants sont comme des voitures coincées dans un embouteillage, et où les "choix personnels" sont produits par des tendances et des courants - c'est-à-dire par la "file d'attente" qui se forme - et par conséquent, ces choix ne peuvent être faits par la Tradition (comme le voudrait la droite), et encore moins par les instances socialistes de la Révolution (comme le voudrait la gauche).
Le modèle critique actuel avec lequel on procède à l'éducation des jeunes découle précisément de la perspective "actionnariale" qui prévaut actuellement. Voilà donc le besoin d'éducateurs et de tuteurs, capables de libérer les âmes du tourbillon produit par la "société ouverte", qui confond l'hospitalité avec le trafic d'êtres humains, habillé d'une sorte de movida touristique et post-sexuelle - l'Erasmus des esclaves - ce "trafic d'êtres humains" qui est pratiqué non seulement sur les immigrants, mais aussi sur ceux qui vivent dans leur propre nation. Reste le trafic de ce nouveau "capital humain" et ce nouveau tourbillon que l'on retrouve dans le "fondamentalisme immigré" de notre époque, habillé d'une sorte de messianisme progressiste post-identitaire qui remplace l'éducation (de e-ducere) par le formatage.
La famille et la nouvelle éducation des jeunes : le "Projet Solaris"
La crise actuelle dans la définition de la famille et l'institution qu'elle représente, avons-nous dit, peut et doit donc devenir une opportunité pour une approche plus "platonique" de l'éducation des jeunes, où l'enfant n'est pas élevé par les parents biologiques - qui sont très souvent plus intéressés par le fait "d'avoir un enfant" que par l'éducation elle-même. Cela fait partie de l'"ego robotique" qui, ayant peur de mourir, veut se répliquer comme un virus biologique ou un virus informatique. Un "ego robotique" qui veut prendre la place du "Moi divin" plus profond, spirituel et radical.
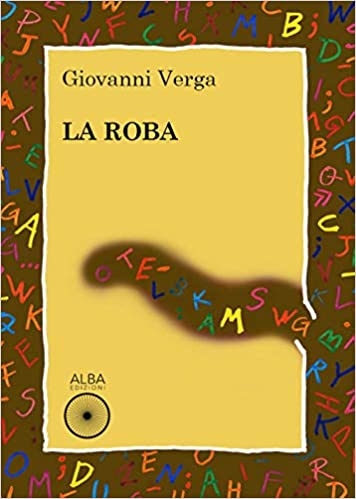 Sous prétexte d'amour parental, la phrase "Roba mia, vienitene con me" du personnage de Mazzarò tiré de la plume de Giovanni Verga dans la nouvelle "La Roba" est fréquemment dissimulée. Mazzarò est un propriétaire terrien, maintenant un vieil homme, qui est sur le point de mourir et qui, n'acceptant pas de perdre tout ce qu'il a eu de sa vie, commence à tuer les canards et les poulets qu'il possède avec son bâton, en disant "Roba mia vienitene con me" . Un exemple typique d'un ego réactif et robotique.
Sous prétexte d'amour parental, la phrase "Roba mia, vienitene con me" du personnage de Mazzarò tiré de la plume de Giovanni Verga dans la nouvelle "La Roba" est fréquemment dissimulée. Mazzarò est un propriétaire terrien, maintenant un vieil homme, qui est sur le point de mourir et qui, n'acceptant pas de perdre tout ce qu'il a eu de sa vie, commence à tuer les canards et les poulets qu'il possède avec son bâton, en disant "Roba mia vienitene con me" . Un exemple typique d'un ego réactif et robotique.
Si l'objectif est l'éducation des jeunes pour qu'ils puissent découvrir l'eugénisme de l'Esprit, c'est-à-dire l'eugénisme qui n'exclut pas l'importance de la biologie, mais la traverse pleinement pour mieux la vivifier à travers leur propre "daimon intérieur" qui est dans l'Âme, alors il faut revenir aux tuteurs et aux gouvernantes, et surtout, les jeunes doivent vivre davantage avec leurs gouvernantes qu'avec leurs parents biologiques, car la généalogie la plus importante est la généalogie spirituelle, qui passe par l'aspect biologique - sans toutefois le supprimer - pour ensuite "renaître dans l'Esprit". En fait, l'Esprit n'est pas l'âme, mais l'"âme éveillée". Ce qu'il faut donc, c'est une discipline capable de réveiller les âmes de manière radicale, et cela peut se faire par le biais de mentors et de tuteurs.
Dans une proposition éducative nouvelle et "Verticale" - que nous appellerons "Projet Solaris" - nous pouvons envisager des camps de scouts visant à atteindre un style de vie philosophique, spirituel et communautaire. Une fois la figure du précepteur institutionnalisée, la figure d'un "intermédiaire" entre le précepteur et le parent biologique pourrait également être appropriée, puisque l'aspect du parent biologique ne doit pas être supprimé, mais est complété dans ceux du tuteur et du curateur.
18:27 Publié dans Actualité, Sociologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : famille, éducation, verticalité |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Anarchie au Royaume-Uni: Boris Johnson sur le point de tomber

Anarchie au Royaume-Uni: Boris Johnson sur le point de tomber
Par Wolfgang Eggert
Source: https://www.compact-online.de/anarchy-in-the-uk-boris-johnson-vor-dem-fall/?mc_cid=4c30a4c7c2&mc_eid=128c71e308
 Le Premier ministre britannique a été victime d'un vote de défiance. Qu'est-ce qui se cache réellement derrière tout cela - et qu'arrivera-t-il ou qui viendra après Boris-Brexit ? La ministre des Affaires étrangères Liz Truss est pressentie pour lui succéder. Nous dressons le portrait de cette figure de la ligne dure russe dans le numéro de juin de COMPACT, que vous pouvez commander ici: https://www.compact-shop.de/shop/compact-magazin/compact-6-2022-gruene-im-krieg/.
Le Premier ministre britannique a été victime d'un vote de défiance. Qu'est-ce qui se cache réellement derrière tout cela - et qu'arrivera-t-il ou qui viendra après Boris-Brexit ? La ministre des Affaires étrangères Liz Truss est pressentie pour lui succéder. Nous dressons le portrait de cette figure de la ligne dure russe dans le numéro de juin de COMPACT, que vous pouvez commander ici: https://www.compact-shop.de/shop/compact-magazin/compact-6-2022-gruene-im-krieg/.
Le disque punk par excellence - Never Mind the Bollocks ("Oublie les C*** à l'air") - est sorti en 1977 pour le 25e anniversaire de l'accession au trône de la reine d'Angleterre. Avec des chansons comme l'ironique "God save the Queen" ou "Anarchy in the UK". Tout le monde pensait que les interprètes - les Sex Pistols - étaient des gauchistes. Et c'était sans doute le cas. À l'époque en tout cas.
Aujourd'hui, alors que la Queen fête une fois de plus son anniversaire, le chanteur John Lydon, alias Jonny Rotten, a fait savoir que la révolte contre "le haut" ou "le système" n'existait plus que du côté de la droite. L'homme ne se soucie toutefois pas de ce décalage. Il reste fidèle à lui-même. Et à sa coiffure, qui donne l'impression qu'il vient de se faire sécher les cheveux fraîchement lavés sur un bateau de pêche au milieu de la mer du Nord.
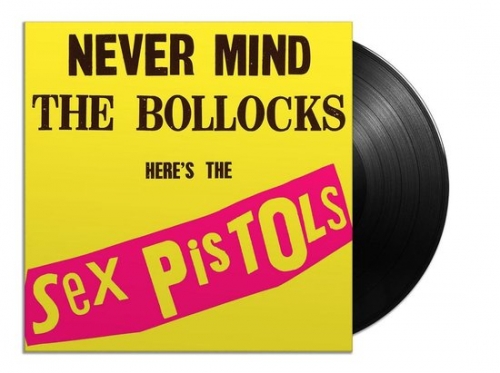

Ce n'est pas la seule raison pour laquelle Lydon ressemble au Premier ministre anarchique de son pays. Le 6 juin, Boris Johnson a dû faire face à un vote de défiance interne à son parti. Le "partygate" aurait été l'élément déclencheur: Plus d'une douzaine de festivités, longtemps vendues par Johnson comme des "réunions de travail", ont eu lieu au 10 Downing Street - alors que l'élite politique avait envoyé le reste du pays dans son bureau à domicile dans un isolement confinatoire et monacal pour cause de Corona.

Des photos prises à la sauvette ont fait le tour du monde. On y voyait des tables de bureau décorées de confettis et de serpentins, sur lesquelles étaient posées des boissons alcoolisées, avec en arrière-plan le Premier ministre éméché essayant de nouer sa cravate.
Ne vous y trompez pas. Ce procédé, ou plus exactement ces procédés, ne sont pas de nature à créer un fossé entre le peuple et les dirigeants de l'île. Bien au contraire. Tout Anglais s'y reconnaît: les hommes, comme - particularité européenne - les femmes d'ailleurs, se lâchent quand on le leur permet.
Si c'est interdit, c'est encore mieux: c'est pourquoi les images du ministre britannique de la Santé Matt Hancock, qui, marié et annonçant chaque jour de nouvelles règles de distance, embrassait sa secrétaire avec la langue dans le couloir du bureau, capturées en secret puis publiées, n'ont pu susciter qu'admiration et jalousie au pays de la bière chaude.

Malgré cela, le Premier ministre, qui planait au-dessus de tout, a été conduit par des rabat-joie devant l'échafaud moral de son parti, pour y être renvoyé et envoyé dans le désert "par manque de moralité et de crédibilité" (comme si les politiciens dits démocratiques n'avaient jamais possédé aucune de ces deux qualités).
Une vengeance tardive
Il n'est pas nécessaire d'être très malin pour découvrir qui étaient les instigateurs de ce théâtre et de quoi il s'agissait réellement : La véritable toile de fond est - toujours - le Brexit, qui a considérablement entamé l'existence du royaume. L'Irlande du Nord et l'Écosse sont sur le point de quitter le Royaume-Uni, avec l'aide de l'UE, qui devrait également avoir de nombreux acteurs de la presse britannique sur ses listes de paie.
Ce qui explique que les journalistes mentent sur ce même vote de défiance, comme ils l'ont toujours fait. De même que les arguments sur la nécessité du vote étaient mensongers, l'analyse du résultat des élections peut également être considérée comme tirée par les cheveux.
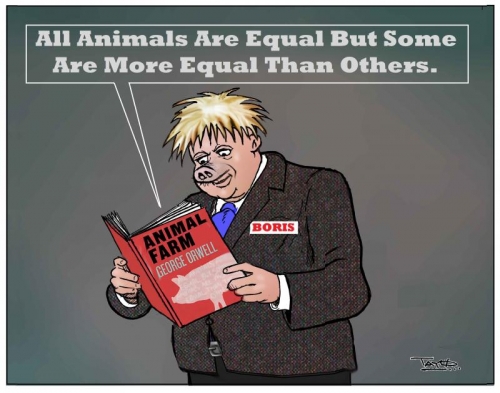
Oui, il est vrai que si l'on demande à un groupe politique s'il apprécie le président, 40% de "non" sont un désaveu. Mais il serait faux de conclure, comme l'ont fait les médias, que Johnson a perdu la confiance de son propre camp.
En réalité, c'est plutôt le contraire qui s'est produit: lorsque Boris Brexit a été soumis au vote des Tories, ce sont même des députés moins "conservateurs" qui ont voté pour lui - non pas parce qu'il était trop conservateur pour eux, mais tout simplement parce qu'il voulait répondre au souhait de son peuple de quitter l'UE.
De ce point de vue, Johnson a même réussi à gagner quelques voix dans les rangs de son parti, soudoyé par les lobbyistes (on pense involontairement à Trump et aux républicains américains). Le fait qu'il ait réussi, en passant outre la couche sociale éloignée de Whitehall, à servir aux Tories dans les urnes le meilleur résultat électoral de mémoire d'homme - c'est cadeau !
Conséquences géopolitiques
Reste la question de savoir ce que l'on souhaite à cet homme, à ce pays... et, d'un point de vue allemand, à soi-même.
Il y a plusieurs réponses à cette question, qui sont tout à fait contradictoires :
1) Pour sa position d'incitation à la guerre dans le conflit ukrainien, cet homme devrait partir ; et le plus vite possible, car il risque la guerre nucléaire, après laquelle notre continent aurait (encore !) l'air pire que la coiffure du Premier ministre anglais aujourd'hui déjà. Tant les Britanniques que les Européens continentaux peuvent - et même doivent ! - penser ainsi s'ils ont encore un peu de bon sens.

Mais les deux parties devraient maintenant
- 2) en ce qui concerne l'UE, croiser les doigts pour que Boris puisse continuer à se débattre aussi longtemps que possible. Les Britanniques peuvent le faire dans l'espoir que l'île, libérée de l'étau bruxellois, ne sera pas entraînée dans la chute du continent ou qu'elle pourra - déjà avant - reconquérir davantage de libertés nationales ; les Européens de l'UE, en particulier ceux de Paris et de Berlin, devraient également se réjouir d'une nouvelle dérive de l'ancienne Grande-Bretagne, car un retour de Londres compliquerait à nouveau le transfert de pouvoir vers l'Allemagne et la France - et donc la ligne géopolitique.
Le vote de défiance semble maintenant tout droit imposé par le continent, de sorte que l'on peut se demander s'il y a encore ici (chez "nous") des romantiques désespérés qui veulent ramener les Britanniques dans le bateau ? Ou s'agit-il seulement d'une punition au vu et au su de tous, afin que les éventuels sortants puissent voir ce qui les attend si, un jour, ils abandonnent Bruxelles - et deviennent "bornés" ?
C'est dans ce dernier groupe que l'on peut trouver un certain nombre de représentants du Grand Jeu qui peuvent encore considérer comme "historique" la lutte pour le globe (qui ne peut être menée que dans le cadre de grandes alliances). Ils savent à quel point Britannia a joué un rôle hostile à l'Europe pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale.

Et qui, dans un certain esprit de revanche territoriale, souhaitent aux Lords et aux Dames, en plus d'une nourriture médiocre et de coups de soleil sévères, que Boris Johnson continue à les harceler. Car lui, et lui seul, peut poursuivre le Brexit avec suffisamment de courage pour que la fédéralisation naissante du Royaume-Uni (c'est-à-dire la souverainisation de l'Écosse et de l'Irlande du Nord sous le drapeau européen) soit menée à bien.
Qui succèdera à Boris-Brexit ?
Pendant ce temps, dans les médias britanniques, les journalistes et les soi-disant experts férus de l'UE et/ou du Nouvel Ordre Mondial discutent de l'impact du vote précédent. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que Boris "est fini". Presque personne ne lui accorde plus d'une année de survie politique. Presque tout le monde, y compris Nigel Farage, s'attend à une débâcle électorale conservatrice dans le cas contraire. La question est de savoir qui les Tories veulent mettre en avant comme candidat de remplacement pour éviter un tel désastre.

Les patriotes allemands, du moins ceux qui sont prêts et capables de penser leurs rêves politiques "à l'anglaise" - un défi de taille, il est vrai -, peuvent souhaiter Jacob Rees-Mogg (foto), ministre du Brexit enrichi par la Bourse dans le cabinet Johnson, une caricature de l'Angleterre d'avant-hier dans sa présentation et son apparence. L'effet serait une dérive immédiate de l'île vers l'Atlantique, ce qui, du point de vue local, n'est pas la pire des solutions.
Mais il est plus probable que l'intronisation d'un "candidat du centre", que l'establishment du vieux parti croit capable de réconcilier les camps, un candidat qui laisse les Saxons pêcheurs poser à nouveau leurs filets dans le reste de l'Europe. Que Dieu lui-même nous en préserve !
Dans le numéro de juin de COMPACT, dont le thème principal est "Les Verts en guerre", nous montrons comment l'ancien parti pour la paix se plaît à être le moteur d'un échange de coups nucléaires. Baerbock, Habeck, Hofreiter & Co. mènent leur combat sur deux fronts : à l'extérieur contre la Russie, à l'intérieur contre leur propre peuple. Commandez ici - ou abonnez-vous dès maintenant avec ce numéro (https://www.compact-shop.de/shop/compact-magazin/compact-6-2022-gruene-im-krieg/ ).
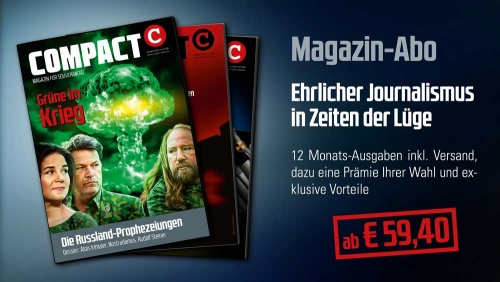
17:58 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, royaume-uni, boris johnson, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 09 juin 2022
La gauche et le relativisme: le triomphe de la raison "faible"
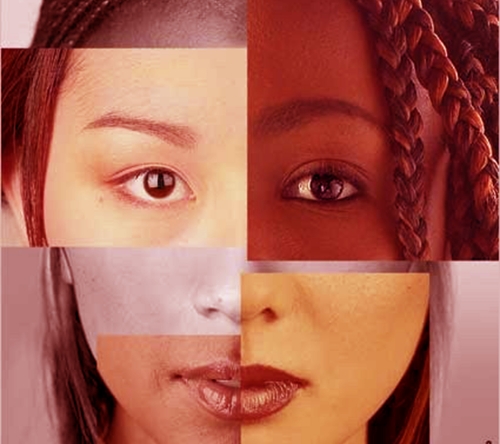
La gauche et le relativisme: le triomphe de la raison "faible"
par Daniele Trabucco
Source: https://www.ideeazione.com/la-sinistra-ed-il-relativismo-ovvero-il-trionfo-della-ragione-debole/
Après la fin de la Seconde Guerre mondiale (1939-1945), la gauche italienne a suivi à la lettre, avec la complicité des démocrates-chrétiens de l'époque, la leçon gramscienne de conquête du pouvoir via les "casemates de l'État". Cela a malheureusement conduit à une véritable hégémonie culturelle qui s'est traduite et se traduit encore par les "occupations" des universités, des associations (véritables "réserves" électorales), des écoles et de la plupart des lieux de culture. La gauche, en d'autres termes, a transformé la société civile en un véritable "appareil" idéologique qui, sur la base de ses "enzymes", criminalise, adultère, ghettoïse le point de vue de ceux qui proposent (et non imposent) une lecture différente.
Pour réussir dans sa démarche, il utilise trois leviers :
1) la simplification linguistique qui, sous des termes qui ont pris un sens dogmatiquement univoque, sous-tend un jugement de valeur inavouable (le no-pass n'est pas celui qui, à juste titre, considère que la certification verte Covid-19 manque de preuves scientifiques, mais le subversif irresponsable qui sape la coexistence sociale et répand l'agent viral Sars-Cov2);
2) accepter la logique financière qui façonne de l'intérieur les institutions nationales et supranationales (voir, sur ce point, les contributions de Dardot et Laval);
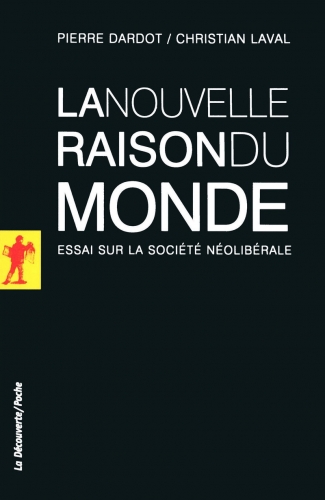
3) l'hypothèse d'une pensée "faible", ou plutôt relativiste, comme moyen d'analyser et de juger la réalité. En fait, la gauche adhère à une raison inspirée de la critique kantienne, à savoir que la connaissance humaine ne peut atteindre la réalité en elle-même, qu'elle ne peut tendre vers un savoir incontestable et qu'elle a donc besoin d'une réalité "liquide" dans laquelle puiser des droits de plus en plus insatiables (la bataille des droits dits civils qui n'ont rien de civil) et dans laquelle modeler, tel le démiurge platonicien, des adversaires à abattre pour se légitimer sans cesse.
Celui qui choisit une force politique "de gauche" (je suis d'accord avec Norberto Bobbio (1909-2004) pour dire que la distinction droite/gauche est toujours valable et pertinente), nie (d'abord par rapport à lui-même) que la nature humaine puisse tenter de connaître ce quid qui tient et ne se laisse pas contredire. La gauche abhorre le concept de l'homme en tant que substance et adopte, à la place, celui de l'homme/projet en perpétuel devenir et capable d'autodétermination contre l'ordre naturel lui-même, dont la négation conduit à l'affirmation de l'indifférentisme et à la contradiction évidente selon laquelle, même si l'homme peut être n'importe quoi, il ne sera finalement jamais capable de poursuivre les fins inhérentes à la nature de ce qu'il croit être à ce moment-là (un homme peut se sentir comme un serpent, mais vous ne serez jamais capable de vous glisser comme lui sur le sol).
Bien que vaincu, il suffit de voir comment les électeurs et les votants italiens ont sanctionné, le 04 mars 2018, le Parti démocrate de Matteo Renzi, aujourd'hui leader d'Italia Viva, détient habilement le pouvoir et soutient, depuis août 2019, l'Exécutif grâce à notre " belle ", autant qu'hypocrite, forme de gouvernement parlementaire à " faible rationalisation " (la critique de Carlo Costamagna (1881-1965) après-guerre était prophétique). Tout cela peut-il être changé ? Non seulement nous le pouvons, mais nous le devons : il est nécessaire de rejeter, avec la logique de fer de la raison et du bon sens, l'éternel retour des stéréotypes de ceux qui se sentent moralement supérieurs alors qu'ils ne le sont pas.
17:50 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, gauche, gauche relativiste, relativisme, pensée faible, philosophie, philosophie politique, italie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
La dimension religieuse de la guerre en Ukraine

La dimension religieuse de la guerre en Ukraine
Par Silvia Palacios et Lorenzo Carrasco
Source: https://jornalpurosangue.com/2022/05/31/a-dimensao-religi...
Au-delà des implications militaires et géo-économiques évidentes, la guerre en Ukraineprésente un aspect plus profond, culturel et spirituel, un domaine qui a prospéré dans la reconstruction de la Russie, accompagnant sa renaissance chrétienne après la désintégration de l'Union soviétique.
Depuis le début du conflit, pour sa simple défense des valeurs chrétiennes, le patriarche de Moscou et de toute la Russie, Cyrille Ier, a été placé au centre d'une féroce campagne internationale orchestrée par les hautes sphères du pouvoir anglo-américain, notamment le Conseil œcuménique des Églises (COE), également connu sous le surnom d'"ONU des Églises", exigeant l'expulsion du chef religieux de cet organisme. Incapable de prendre des mesures positives pour arrêter la guerre, l'ONU se dirige vers l'obsolescence et on peut en dire autant du COE.
Après la chute du mur de Berlin en novembre 1988, au lieu d'accueillir et de collaborer avec un pays sortant pacifiquement du communisme, les puissances occidentales ont tenté d'ériger un autre mur, cette fois conçu pour contenir la Russie, en la traitant comme une "station-service dotée d'armes nucléaires". Du point de vue de l'hégémonisme, cela signifiait la désigner comme un simple fournisseur de matières premières, en particulier d'énergie, obligé de se plier sans condition aux règles des "valeurs occidentales" de plus en plus éloignées de leurs racines culturelles chrétiennes.
Adhérer à l'agenda LGBT, au néo-malthusianisme et à l'idéologie du genre, est devenu le passeport pour entrer dans la civilisation européenne. Mais si cette idéologie déformée est ancrée dans les sièges de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et de l'Union européenne (UE) à Bruxelles, elle ne représente pas le sentiment profond des nations du Vieux Continent et n'est pas non plus partagée par la tradition russe, qui rend des hommages très spécifiques à la patrie, à la famille et à la religion.
Ainsi, faire de la renaissance culturelle et spirituelle de la nation slave un objectif national se heurte évidemment à l'apostasie européenne, à laquelle le président Vladimir Poutine et d'autres membres de son cabinet, ainsi qu'une grande partie de l'élite pensante du pays, se sont publiquement confrontés à plusieurs reprises.
Le sentiment national qui imprègne la population russe a été exprimé par Nikolai Patrushev, secrétaire général du Conseil de sécurité nationale de Russie, dans une interview accordée au journal officiel Rossyiskaya Gazeta le 29 avril :
"(...) A cet égard, la Russie a choisi la voie de la protection intégrale de sa souveraineté, de la défense ferme des intérêts nationaux, de l'identité culturelle et spirituelle, des valeurs traditionnelles et de la mémoire historique.
"Nos valeurs spirituelles et morales nous permettent de rester nous-mêmes, d'être honnêtes avec nos ancêtres, de préserver l'individu, la société et l'État. Les Européens, par exemple, ont fait un choix différent. Ils ont adopté des valeurs dites libérales, alors qu'en réalité elles sont néo-libérales. Ils favorisent la priorité du privé sur le public, l'individualisme qui supprime l'amour de la patrie et la disparition progressive de l'État. Il est désormais évident qu'avec une telle doctrine, l'Europe et la civilisation européenne n'ont aucun avenir. Apparemment, ils répéteront les leçons qu'ils n'ont pas encore apprises."
Le phénomène historique de la négation de ces splendides racines est typique de la décadence civilisationnelle et marque la distinction entre civilisation et culture. L'Europe et les États-Unis sont riches et civilisés, mais avec des cultures décadentes, car la culture présuppose l'exercice de valeurs de transcendance, dans la compréhension que la prospérité et le progrès économique - aujourd'hui en déclin - ne sont pas les seules causes du bonheur.
Lorsque Poutine a ordonné le début des opérations militaires en Ukraine, il savait, avec les dirigeants politico-militaires et religieux russes, qu'il donnait un "coup de pied dans la table" de l'ordre hégémonique euro-atlantique, qui a converti l'Ukraine, depuis le coup d'État de 2014, en un bélier contre la sécurité territoriale russe.
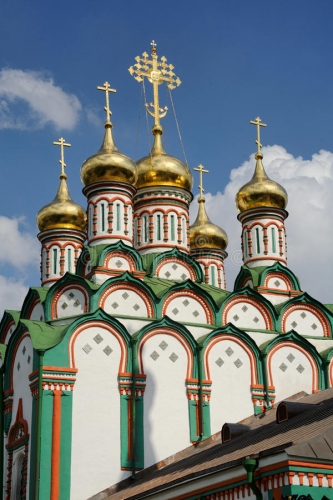
D'autre part, la plupart des dirigeants européens, qui sont les figurants dans une comédie bouffonne dirigée depuis Bruxelles et Washington, savent qu'une victoire russe en Ukraine signifierait la fin de l'utopie mondiale entretenue depuis la naissance de l'Establishment anglo-américain, lors des conférences de paix de Paris en 1919, à la fin de la Première Guerre mondiale. Sans entrer dans le sujet pour le moment, les conséquences de ces accords pour l'Europe sont connues.
Le Conseil Œcuménique des Églises (COE)
Des années plus tard, cette utopie d'un gouvernement mondial s'est concrétisée et, entre autres, en 1937, des personnalités prestigieuses du pouvoir anglo-américain ont fondé le Conseil œcuménique des Églises (COE) pour stimuler le dialogue interreligieux d'une manière si pâle qu'elle ouvre la porte à une vague interprétation d'un nécessaire œcuménisme. Parmi ses fondateurs figurent John Foster Dulles, futur secrétaire d'État américain et agent de la guerre froide, et le Britannique Philip Kerr, Lord Lothian, qui a qualifié l'État souverain d'"instance démoniaque", à l'origine de guerres et de conflits.
Depuis lors, le COE s'est consacré à la promotion et au soutien vigoureux de causes séculières compatibles avec un corps de doctrine relativiste, à la limite de l'absurde avec la postmodernité, dont les objectifs sont de déstabiliser, de subvertir et de démembrer les États nationaux souverains. En substance, leur mission consiste à consolider les structures gouvernementales du "One World" mondialiste, puisque le nationalisme est, selon eux, la principale cause des guerres. Ce n'est pas un hasard si, en Europe, le terme "nationalisme" est devenu presque synonyme de nazisme et que tous ceux qui s'opposent à ce programme "politiquement correct" sont volontiers qualifiés d'ultra-droitiers et essuient d'autres épithètes insultantes.
La vaste structure du COE lui permet d'être un contributeur précieux à la guerre culturelle menée dans le monde libéral occidental pour noyer la société dans l'hédonisme radical, la disparition de la famille naturelle, l'agenda "identitaire", le mouvement "woke", le transhumanisme et d'autres agendas créés par les oligarchies transnationales.
Inquisition contre le patriarche Cyril I
Le 7 mars, le patriarche Cyrille Ier a prononcé un sermon sans ménagement qui a eu un grand retentissement international, évoquant le fait que la charte d'admission au monde occidental libéral exige la reddition à un système de convictions aux antipodes du christianisme, dont les manifestations sont accueillies en fanfare, comme dans les manifestations du mouvement LGBT+ et autres.

Une autre homélie de Cyrille Ier, commentée dans AsiaNews le 27 avril, illustre sa lutte contre ce qu'il décrit comme des "contre-valeurs" occidentales. Dans la cathédrale historique de l'Assomption, à l'intérieur du Kremlin, il a appelé le peuple à se rassembler autour de "la ville de Moscou, le centre de toutes les Russies" pour se défendre contre "les centres de pouvoir de l'étranger".
Selon lui, le peuple russe doit redécouvrir son unité intérieure, "car seule l'unité fait notre force, et si nous gardons la foi de nos pères dans nos cœurs, alors la Russie sera invincible". Il a ajouté que "la victoire n'est pas toujours celle des armes, mais aussi celle de l'esprit, et beaucoup aujourd'hui voudraient que cet esprit disparaisse". Il a énuméré les tactiques de l'ennemi qui "sème la confusion, crée de nouvelles idoles, attire l'attention sur de nouvelles pseudo-valeurs, pour inverser la dimension de la conscience de l'homme, de cette verticale qui l'unit à Dieu à cette horizontale, sur laquelle sont implantées toutes les exigences de la chair humaine".
Rien de plus illustratif contre le rôle joué par Cyrille Ier et l'Église orthodoxe que deux articles récents publiés par le Financial Times, porte-parole de la City de Londres, dans les éditions des 18 et 19 avril. Les titres respectifs, "L'Église orthodoxe russe donne une légitimité à la guerre de Vladimir Poutine en Ukraine" et "La 'guerre sainte' du Kremlin contre l'Ukraine", trahissent la crainte que l'exemple d'une Russie défendant les valeurs chrétiennes ne se propage à d'autres pays, dont la Hongrie de Viktor Orbán. Quelques paragraphes donnent une idée de ce sentiment : "L'idée d'une 'guerre sainte' en Europe peut sembler être un retour aux siècles passés. C'est pourtant, en substance, la manière dont l'Église orthodoxe russe et son chef, le patriarche Cyrille de Moscou, ont dépeint l'invasion russe en Ukraine. "Un tel comportement ne montre pas seulement comment l''église et l'État se sont entremêlés dans la Russie de Vladimir Poutine, mais il est également important de comprendre les motivations de la Russie moscovite. Bien qu'elle n'en fasse pas officiellement partie, l'Église orthodoxe russe est devenue un pilier de facto du régime autocratique de Poutine.
"La plupart des paroisses en Ukraine ont choisi de rester soumises au patriarche Cyrille même après 2019 [lorsqu'il y a eu une scission dans l'Église orthodoxe ukrainienne], environ 12.000 paroisses, soit environ un tiers de toutes les paroisses restent sous le contrôle de Moscou. Maintenant, de nombreux partisans del'Eglise de Moscou en Ukraine laissent le patriarche Cyrille en dehors de leurs prières.
"Des centaines de prêtres ukrainiens qui restent formellement membres de l'Église de Moscou ont demandé que le patriarche soit jugé par un tribunal ecclésiastique spéciale pour avoir béni la guerre."
Ajoutant à la vague inquisitoriale, le Financial Times déclare : "Lord Rowan Williams, l'ancien archevêque de Canterbury, après avoir visité l'Ukraine au cours de la deuxième semaine d'avril, a déclaré qu'il y a de 'solides arguments' en faveur de l'expulsion de l'Église russe du Conseil œcuménique des Églises, à moins que le patriarche Cyrille Ier ne condamne le meurtre de membres de son 'propre troupeau'.
Lord Rowan a été le chef spirituel de l'Eglise anglicane entre 2002 et 2012 et est célèbre pour ses sympathies envers les demandes du lobby LGBT au sein de l'Église d'Angleterre. Cette déviation, ainsi que d'autres, a accéléré l'effondrement de cette institution.
D'autre part, encourageant le lynchage du patriarche, le Parlement européen l'a condamné le 7 avril dans une déclaration: "Le rôle du patriarche Cyrille Ier de Moscou, chef de l'Église orthodoxe russe, est condamné pour avoir fourni une justification théologique à la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine ; et loue le courage des 300 prêtres de l'Église orthodoxe russe qui ont signé une lettre condamnant l'agression".
Dans la même veine, aux Etats-Unis, tous les réseaux du COE dans les fondations, les églises et les universités, sont mobilisés pour sanctionner le patriarche. Par exemple, l'Institut Dietrich Bonhoeffer de Washington a alerté ses affiliés, appelant à faire pression pour que, lors de la prochaine assemblée du COE en septembre, l'adhésion de l'Église orthodoxe russe soit annulée ou du moins suspendue indéfiniment, "parce que Cyrille Ier persiste à justifier l'agression de Poutine en qualifiant l'invasion de croisade religieuse".
17:29 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : russie, ukraine, cyrille i, église orthodoxe, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Le rejet du processus de Bologne et les convulsions idéologiques de l'élite

Le rejet du processus de Bologne et les convulsions idéologiques de l'élite
Alexandre Douguine
Source: https://www.geopolitika.ru/en/article/rejection-bologna-process-and-ideological-convulsions-elite?fbclid=IwAR3e0i0ctc2K_xnV04MyAx2pbVwdyoUSAjQxy83p61YhJbOFtdOayDtS2zM
Parlons du rejet du processus de Bologne [NDLR : Il s'agit du processus de réforme du système d'enseignement supérieur au niveau international, qui a débuté en 1999 à l'Université de Bologne, dont il tire son nom. Cet accord a permis la mise en place d'un système presque unifié de reconnaissance et d'équivalence des qualifications académiques. De nombreux États européens adhèrent au processus, mais depuis trois ans, on assiste à un abandon progressif de la convention]. Le point central est une question de principe. L'introduction du système de Bologne faisait partie d'un projet global : la pleine intégration de la Russie dans le monde global, ce qui signifie l'adoption sans restrictions de toutes les normes et règles de l'Occident. Il ne s'agissait pas seulement d'éducation, mais de la principale stratégie du gouvernement russe depuis 1991. L'adaptation de tous les niveaux de vie - éducation, économie, culture, science, politique, technologie, mode, art, éducation, sports, médias - aux normes de l'Occident moderne était le principal objectif de toutes les réformes. Cela s'appliquait à tout et constituait l'objectif principal des autorités, tant sous Eltsine que sous Poutine. La mise en œuvre du système de Bologne est un élément mineur de cette stratégie globale.
Bien sûr, il y a une différence entre les années 1990 et les années 2000. Sous Eltsine, l'acceptation totale des normes et modèles occidentaux s'accompagnait d'une intégration dans le monde global et d'une volonté de tout sacrifier pour elle, y compris la souveraineté et l'indépendance. La standardisation est donc allée de pair avec la dé-souverainisation.
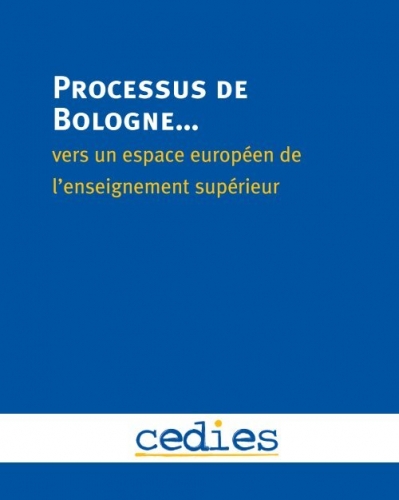
Sous Poutine, la souveraineté a été proclamée comme la valeur la plus élevée, mais l'occidentalisation et la standardisation se sont poursuivies. Apparemment, suivant l'exemple de Pierre le Grand, Poutine a décidé d'utiliser la technologie occidentale pour renforcer le pays et, à un moment donné, en s'appuyant sur ces normes empruntées, de frapper un grand coup. Pierre lui-même a ouvert une fenêtre sur l'Europe pour les canons russes. Dans le même temps, Pierre brisait également la tradition russe, alors que Poutine a hérité d'une société dans laquelle la tradition était déjà brisée.
Si l'on accepte l'hypothèse selon laquelle Poutine poursuivait une stratégie consistant à copier le système occidental dans le but de renforcer la souveraineté russe, et il n'y a pas d'autre hypothèse intelligible, alors avec le début de l'OMU est venu le moment de vérité: il était temps de contre-attaquer, l'Occident, qui s'était entêté à essayer de nous arracher l'Ukraine en trompant et en hypnotisant la population naïve de la Petite Russie, était touché. Là encore, il y a un parallèle avec Pierre: celui qu'évoque la bataille de Poltava, modèle que la Russie actuelle s'entête à poursuivre depuis février 2022. Tout s'emboîte.
Cependant, il y a une différence entre le 18ème siècle et le 21ème siècle : la technologie occidentale moderne est inextricablement liée à l'idéologie, la technologie elle-même porte un code clair de globalisme et de libéralisme. Ni les biens ni les objets ne sont idéologiquement neutres, et encore moins les méthodes d'enseignement et les disciplines universitaires, que la Russie actuelle a servilement copiées au cours des 30 dernières années. Au début, c'était un signe de défaite, puis un "plan astucieux" pour se concentrer et se préparer à une attaque en représailles. Maintenant, que faire de ces éléments, technologies et institutions que la Russie a copiés de l'Occident ? Pas seulement le système éducatif, mais tout le reste : les technologies de l'information, les institutions financières, les codes culturels, les mécanismes du marché, la mondialisation de la main-d'œuvre et de l'approvisionnement en énergie, et même la démocratie elle-même, le parlementarisme, les élections, les droits de l'homme, bref, tout...
Après 30 ans de domination de cette stratégie particulière, la Russie n'a rien, ou presque rien, qui lui soit propre. Le système de Bologne n'est qu'un syndrome. Dans ce problème, comme dans un miroir, on peut voir tout le reste.
Alors que faire des normes occidentales dans une situation où l'Occident nous a jetés et où nous devons lui donner une réponse civile globale ?
C'est généralement le principal problème aujourd'hui. Il est devenu si aigu avec le début de l'opération militaire spéciale et, à son tour, notre propre victoire en dépend directement. Après tout, même les relations avec Kiev, malgré toute sa folie depuis Maidan 2014, nous renvoient à ce dilemme.
Moscou insiste : soyez avec nous.
Kiev demande : où allez-vous, car nous pouvons décider d'être avec vous ou de ne pas être avec vous ?
Moscou répond : nous allons vers l'Occident, vers le monde global, et c'est pourquoi nous standardisons tout. Nous avons également introduit le système de Bologne.
Kiev proteste : si vous allez vers l'Ouest, nous y allons aussi, nous sommes plus proches, et maintenant nous aurons, nous aussi, le système de Bologne.
Moscou commence à s'énerver : nous allons vous faire du mal !
Kiev n'abandonne pas et parle de lard, de "héros", de voyages sans visa et... de Bandera.
Nous le savons tous.
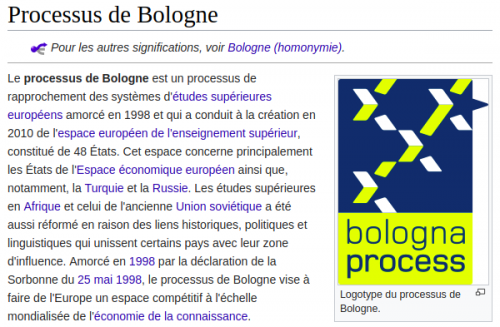
Mais il s'agit de répondre à la question raisonnable de Kiev : où allez-vous ? Si la Russie va à l'Ouest, toutes les autres nations fraternelles sont parfaitement capables de le faire par elles-mêmes, sans elle. Il est assez facile de traduire des manuels et des guides occidentaux de l'anglais ou du chinois en ukrainien, en kazakh, en tadjik et même en tchétchène ou en tatar. Le russe comme intermédiaire n'est pas du tout nécessaire.
C'est pourquoi sous Eltsine, tout le monde nous fuyait, mais c'est aussi pourquoi ils ne se précipitent pas vers nous sous Poutine, car tant que nous sommes encore dans le paradigme occidental, tout le monde veut aussi aller à l'Ouest.
Aujourd'hui, ce slogan s'est effondré. Il s'avère que nous n'irons pas nous-mêmes, et l'Occident non seulement ne nous attend pas, mais il nous déteste avec férocité - d'où la vague frénétique de russophobie, inaugurée par l'Opération militaire spéciale. Mais pendant 30 ans, nous avons marché et dit que nous marchions, à nous-mêmes et aux autres, dans la direction de l'Occident. Maintenant, la direction est devenue claire et les responsables de l'OMS s'empressent de se montrer comme des patriotes radicaux. À bas le système de Bologne. Mais tout cela ne semble-t-il pas trop facile ?
Tout d'abord, nous pouvons et devons supprimer le système de Bologne (nous, les patriotes, nous battons pour cela depuis longtemps), mais revenir simplement au modèle soviétique n'est pas du tout une solution, c'est même impossible et inutile. Nous avons besoin d'une idéologie claire de l'éducation qui correspond à la Russie en tant que civilisation, et en tant que civilisation qui a défié l'Occident. Qui, parmi les fonctionnaires du ministère de l'éducation, peut réfléchir ne serait-ce qu'un instant à des questions aussi graves ? On ne trouve pas de telles personnes dans la nature.
Deuxièmement, le système de Bologne concerne la forme de l'éducation, mais n'affecte en rien le contenu. Revenir aux normes spécialisées et soviétiques et maintenir le contenu libéral des humanités de base est absolument absurde. Le système de Bologne a été conçu pour synchroniser le libéralisme et le mondialisme inhérent au contenu de l'éducation avec les formes d'apprentissage et d'évaluation généralement acceptées en Occident. L'éducation est le principal instrument de pouvoir sur les esprits. Ce n'est pas une coïncidence si, au cours des 30 dernières années, les libéraux ont formé une armée d'éducateurs comme agents d'influence libérale. Toutes les institutions éducatives russes, principalement les universités, en sont remplies. Dirigés par les services spéciaux occidentaux et soutenus activement par des fondations qui leur sont associées, comme dans le cas de Soros, mais pas seulement, ils ont accordé la plus grande attention au contenu, c'est-à-dire aux paradigmes idéologiques. Et ce n'est pas une question pour les bureaucrates. Ni, je le crains, aux Tchécoslovaques, car quelle a été leur éducation ? D'un genre particulier ? Oui, le patriotisme était mis en avant, mais qui s'est occupé du contenu idéologique ? Une fois encore, le retour aux anciens cadres soviétiques n'est pas une option. Ces personnes sont souvent respectables, mais elles ne comprennent que partiellement le nouveau monde, même si le vecteur éthique a été préservé. Cela, hélas, ne suffit pas.
Troisièmement, même si nous supposons que les autorités réalisent la gravité du problème de l'éducation souveraine, autrefois à la merci des agents libéraux, et qu'elles s'en préoccupent réellement, le problème ne peut être résolu sans transformations similaires dans d'autres domaines. Comment est-il possible de dé-libéraliser l'éducation et de maintenir en même temps les normes libérales occidentales dans tous les autres domaines de la vie ? Le marché, le capitalisme, la numérisation, l'intelligence artificielle, la croyance non critique dans le progrès scientifique et technologique, la robotisation, finalement la démocratie, le parlementarisme, la société civile et les droits de l'homme sont tous des copies des normes libérales occidentales et sont si profondément ancrés dans la société que la simple pensée de devoir les éradiquer horrifierait toute personne au pouvoir, et certainement pas le peuple (qui comprend tout plus clairement et plus simplement).
Cela conduit inévitablement à des convulsions idéologiques. Continuer à copier l'Occident et ses normes, standards et règles n'est plus possible. Nous avons été déconnectés de la mise à niveau et, de plus, les failles et les correctifs intégrés à la technologie ont déjà été activés pour s'autodétruire et effacer les données. Nous nous sommes fiés à cette technologie et avons été légitimement déçus. Alors nous nous sommes précipités désespérément vers la substitution d'importations, sous prétexte de construire pour nous un Occident moderne, égalitaire mais sans les LGBT+, voire avec eux mais dans une version " patriotique ", fidèle au gouvernement.
Rejetons ce satané système de Bologne occidental et mettons en place notre propre "système de Bologne russe", et ainsi de suite pour tout. C'est une solution très intelligente. Bien sûr, il y a une issue, mais le gouvernement doit d'abord s'assurer que ce qu'il propose aujourd'hui n'est pas du tout une escroquerie. Si nous ne commençons pas à penser souverainement, il s'agira de traduire le mode d'emploi d'un aspirateur en vieux slavon ou d'y attacher une cravate rouge.
Je me suis convaincu qu'il est totalement inutile et même pervers de donner des conseils à des personnes qui n'en ont pas besoin et qui, de plus, sont convaincues de tout savoir elles-mêmes. Nous devons donc nous préparer à un jeu de miroirs : rejet du système de Bologne, rejet du système de Bologne, rejet du système de Bologne, rejet du système de Bologne, et ainsi de suite jusqu'à la période suivante, pour toutes les autres substitutions d'importation. Lorsque ce cycle sera terminé, nous parlerons alors sérieusement des réformes de l'éducation. Et pas avec n'importe qui.
16:13 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Ecole/Education | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : éducation, actualité, europe, russie, affaires européennes, processus de bologne, alexandre douguine |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
La Finlande dans l'OTAN

La Finlande dans l'OTAN
Leonid Savin
Source: https://katehon.com/ru/article/finlyandiya-v-nato
Le 12 mai, le Premier ministre et le Président finlandais ont officiellement annoncé qu'ils avaient décidé de demander à adhérer à l'OTAN. Évidemment, il n'y aura pas de référendum sur la question, tout sera décidé arbitrairement par les autorités actuelles.
Il faut se poser la question : la Finlande était-elle vraiment un pays neutre ? Bien que le traité de paix de Paris de 1947 et le traité d'amitié avec la Russie soient toujours en vigueur, Helsinki est depuis de nombreuses années un membre de facto de la communauté politico-militaire occidentale. Le fait que cette adhésion ne soit pas légalement formalisée ne signifie pas que la Finlande n'a pas concocté de plans russophobes ou qu'elle n'a pas été conciliante envers ses partenaires de l'OTAN.
La Finlande est l'un des partenaires élargis de l'OTAN et participe activement au processus de planification et de révision de l'OTAN depuis 1995. En outre, la Finlande a participé à plusieurs opérations de gestion des crises de l'OTAN et est régulièrement invitée aux réunions de l'OTAN, notamment depuis la fin février 2022. Actuellement, la Finlande compte au total 300 soldats chargés de la gestion des crises et du maintien de la paix - déployés au Liban, au Kosovo, en Irak, au Mali, en Somalie, en Méditerranée et au Moyen-Orient.
En février 2022, la Finlande a participé à l'exercice de l'OTAN "Cold Response" en Norvège avec 680 soldats, dont 470 conscrits [i].
En ce qui concerne l'Union européenne, la Finlande a été l'un des États membres les plus actifs dans le développement de la politique de sécurité et de défense commune ces dernières années et a souligné les responsabilités de l'UE en tant que "communauté de sécurité", rappelant aux autres États membres qu'ils ont convenu d'une défense mutuelle (Traité sur l'Union européenne, article 42.7).
Depuis 2014, la Finlande participe à l'initiative de la plate-forme d'interopérabilité de l'OTAN (avec la Suède, l'Ukraine, la Jordanie, l'Australie et la Géorgie) [ii]. Cette initiative vise à développer des normes, doctrines, procédures et applications d'équipement communes. De toute évidence, l'OTAN ne s'adapte pas aux normes géorgiennes ou jordaniennes, mais les membres invités adoptent l'expérience de l'OTAN et introduisent les normes nécessaires. En fait, la Finlande a passé huit ans à s'adapter et à se réorganiser selon les critères de l'OTAN.
Le "Centre d'excellence pour les menaces hybrides" a été déployé à Helsinki en 2017 [iii]. Ses fondateurs sont l'UE et l'OTAN, entre autres.
Le flirt actif des dirigeants du pays avec l'OTAN a commencé en 2018. À l'époque, le président finlandais, qui avait déjà été réélu à la tête de l'État, s'exprimant en septembre à la Brookings Institution, une institution néoconservatrice américaine, a déclaré :
"Une Europe forte signifie une OTAN plus forte. Et une Europe plus forte est un partenaire plus utile pour les États-Unis... La Finlande prend sa défense très au sérieux. Nous n'avons jamais affaibli notre garde depuis la fin de la guerre froide. Le désir de nos citoyens de défendre leur pays est le plus fort d'Europe.
Le maintien d'une défense nationale forte nous envoie deux messages puissants. Il s'agit d'un seuil contre les agresseurs potentiels. Et cela fait de nous un partenaire plus intéressant. Cela se traduit par une coopération bilatérale étroite avec de nombreux pays de l'OTAN, dont les États-Unis... La Russie le fait de manière agressive, en roulant les mécaniques sur le plan militaire et en utilisant également ses forces armées, comme nous l'avons vu en Ukraine et en Syrie" [iv]. Son message était clair.
Le mois suivant, l'armée de l'air finlandaise a participé à un exercice international organisé sous les auspices des États-Unis en Alaska et au Nevada. C'était la première du genre pour la partie finlandaise [v].
En général, avec l'OTAN, la Finlande effectue régulièrement des exercices militaires, y compris sur son propre territoire. L'exercice naval multinational le plus récent s'est déroulé au large des côtes finlandaises, face à la ville de Turku [vi].

Du 2 au 13 mai, la Finlande a accueilli l'exercice de chars Arrow, auquel ont également participé des militaires de Grande-Bretagne, de Lettonie, d'Estonie et des États-Unis[vii].
De manière révélatrice, le 13 avril 2022, le Président de la République a adopté une nouvelle loi sur le service militaire volontaire des femmes.
Plus tôt en Finlande, une campagne médiatique sur le sujet de l'engagement des réservistes dans l'armée s'est intensifiée. "En raison de la situation en Ukraine, les forces armées reçoivent maintenant de nombreuses demandes de la part des citoyens - par exemple, des instructions sur la possibilité de demander à servir même à un âge légèrement plus avancé.
C'est une belle démonstration de la motivation et de la volonté des Finlandais de participer à la défense du pays, si nécessaire. Les forces armées comptent environ 900.000 soldats formés dans les unités de réserve. Les réservistes sont l'épine dorsale de la capacité de défense de la Finlande, puisque 97 % de nos forces armées sont des réservistes", a déclaré le colonel Jukka Nurmi de l'état-major général, qui est chargé de l'inspection des réservistes.
Dans le même temps, il a été noté qu'"il n'y a pas de menace militaire immédiate pour la Finlande. La formation systématique des réservistes et des conscrits se poursuivra dans les forces de défense afin de maintenir et d'accroître leurs capacités en fonction des besoins actuels et futurs" [viii].
La question se pose : s'il n'y a pas de menace militaire, pourquoi la Finlande rejoindrait-elle l'OTAN ?
Il est clair que ce n'est pas pour les Finlandais, mais pour Bruxelles et Washington, qui saisissent chaque occasion d'encourager Helsinki dans cette direction.
Par exemple, une étude du Centre américain d'études stratégiques et internationales offre une justification plutôt bizarre de l'adhésion de la Finlande à l'OTAN. Il indique que les Finlandais ne sont pas intéressés à inviter des contingents militaires étrangers sur leur territoire, afin de ne pas provoquer la Russie.
Mais pour justifier en quelque sorte le conflit russo-finlandais, les auteurs avancent une version sur l'occupation des îles Aland, à laquelle Helsinki devra répondre. Mais la Finlande ne dispose ni d'une aviation de combat de la classe nécessaire, ni de systèmes de défense aérienne pour contrer la Russie. Par conséquent, si l'OTAN veut venir à la rescousse, cela prendra beaucoup de temps en raison de la géographie et de la distance [ix].
D'un point de vue fiscal, les experts américains estiment qu'il faudrait un peu plus d'un milliard de dollars pour équiper la Finlande de façon minimale, et 5,3 milliards de dollars pour un renforcement plus qualitatif [x].
Le budget annuel actuel de la Finlande en matière de défense est fixé à 5,1 milliards d'euros - soit 1,9 % du PIB. Il y a seulement deux ans, la part de la défense dans le PIB était de 1,3 % [xi].
Soit dit en passant, l'augmentation des dépenses militaires a commencé précisément en 2018, lorsqu'un rapprochement actif avec l'OTAN a eu lieu.
Cette année-là, une augmentation aussi rapide est également due à l'achat de nouveaux avions de combat F-35 aux États-Unis (qui sont de mauvaise qualité et Washington essaie de vendre les marchandises en retard à qui il peut). Toutefois, en raison de la crise en Ukraine, l'armée finlandaise recevra un financement supplémentaire de 700 millions d'euros en 2022 et de 788 millions d'euros en 2023, ce qui portera son budget à 2,2 % du PIB. La publication libérale finlandaise Yle écrit que cela est justifié par la situation en Ukraine [xii].
Alors, que peut donner la Finlande à l'OTAN sur le plan militaire ?
Le nombre de militaires actifs dans les forces de défense finlandaises est faible : environ 19.000, plus une unité de gardes-frontière paramilitaires d'environ 3000 soldats, qui peut être totalement ou partiellement intégré aux forces de défense après mobilisation. Cependant, en raison du système de conscription, il existe une grande réserve. L'armée de campagne entièrement mobilisée compte 280.000 hommes, avec plusieurs centaines de milliers de réservistes disponibles pour compenser les pertes [xiii].
Les unités finlandaises peuvent être grossièrement divisées en trois catégories principales : les unités opérationnelles les mieux entraînées et les mieux équipées, les forces régionales et les unités locales (dont certaines sont fréquemment entraînées et maintiennent un haut niveau de préparation au combat).

L'armée de l'air et la marine utilisent des équipements très sophistiqués, tels que des missiles air-sol compatibles, des missiles antinavires Gabriel et des missiles RIM-162 Sea Sparrow, et sont très performants sur le plan opérationnel. Néanmoins, tout le personnel de l'armée de l'air et de la marine (et, dans le cas de la marine, la plupart des membres du personnel de quart des navires) sont des conscrits ou des réservistes.
L'industrie de la défense finlandaise étant hautement spécialisée, le pays se procure une grande quantité de machines et d'équipements à l'étranger. C'est pourquoi elle coopère activement avec d'autres partenaires nordiques et européens en matière d'approvisionnement. Environ 40 à 60 % des équipements, munitions et outils militaires sont exportés, y compris les systèmes de communication, les véhicules, les bateaux et les équipements de défense.
L'industrie de la défense autochtone est principalement composée de petites et moyennes entreprises privées, le chiffre d'affaires total des secteurs de la défense, de l'aérospatiale et de la sécurité s'élevant à 1,84 milliard d'euros en 2020. À quelques exceptions près, comme Patria, fabricant du véhicule modulaire blindé et du système de mortier NEMO, il n'y a pas d'acteurs industriels majeurs.
Compte tenu de la spécialisation au sein de l'OTAN, il est probable que la Finlande se retrouve avec un petit segment basé sur sa capacité de production existante. L'une des plus grandes forces de l'armée finlandaise, en ce qui concerne les normes européennes, est l'artillerie. La Finlande possède environ 1500 systèmes d'artillerie.
Indépendamment de la manière dont l'infrastructure militaire et les capacités de combat de la Finlande évolueront après son adhésion à l'OTAN, la Russie devra y répondre. Il a déjà été indiqué qu'une telle action ferait automatiquement passer le statut de la Finlande à celui d'un "état inamical".
Évidemment, cela ne suffira pas, car de telles actions doivent être sanctionnées par un effet stratégique à long terme. Une question distincte devrait être la probabilité de livraisons d'armes de la Finlande à l'Ukraine (probablement via la Pologne), car après avoir rejoint l'OTAN, Helsinki aura moins de souveraineté et devra faire plus de concessions à la fois à Washington et à Bruxelles.
En outre, un accord technique a été signé le 24 mai entre le gouvernement finlandais et le Haut Commandement de l'OTAN, en vertu duquel la Finlande met son territoire à la disposition des pays de l'OTAN pour accueillir des bases militaires et fournir toute logistique. Ainsi, même sans être officiellement membre de l'Alliance, Helsinki est déjà pleinement engagée dans l'expansion de l'OTAN.
Les Finlandais ont également signé récemment un accord avec la Grande-Bretagne visant à renforcer la coopération militaire.
[i] https://maavoimat.fi/en/-/finland-to-participate-in-cold-...
[ii] https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_132726.htm
[iii] https://www.hybridcoe.fi/
[iv] https://www.brookings.edu/events/a-stronger-europe-our-co...
[v] https://puolustusvoimat.fi/-/1951206/ilmavoimat-red-flag-...
[vi] https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_195001.htm
[vii] https://maavoimat.fi/en/-/army-mechanised-exercise-arrow-...
[viii] https://puolustusvoimat.fi/-/reservilaisilta-runsaasti-yh...
[ix] https://www.csis.org/analysis/future-nato-enlargement-for...
[x] https://www.geopolitika.ru/article/vo-chto-mozhet-oboytis...
[xi] https://www.defmin.fi/files/5209/TAE_2022_GDPshare_27.9.2...
[xii] https://yle.fi/news/3-12393378
[xiii] https://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2021/03/65...
11:12 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : finlande, espace baltique, otan, europe, affaires européennes, politique internatioale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 08 juin 2022
L'Inde est en passe de devenir une puissance géo-économique avec laquelle il faudra compter en Eurasie

L'Inde est en passe de devenir une puissance géo-économique avec laquelle il faudra compter en Eurasie
Andrew Korybko
Source: http://www.elespiadigital.com/index.php/noticias/geoestrategia/37949-2022-06-07-15-00-03
L'un des résultats les plus inattendus de l'opération militaire russe en cours en Ukraine a été la montée en force de l'Inde en tant que grande puissance eurasienne. Delhi est intervenue de manière décisive pour devenir la soupape irremplaçable de Moscou face à la pression occidentale, ce qui a permis d'éviter de manière préventive une dépendance potentiellement disproportionnée du Kremlin vis-à-vis de Pékin dans ces nouvelles conditions difficiles et a ainsi renforcé mutuellement l'autonomie stratégique complémentaire de la Russie et de l'Inde.
Il s'agit d'un développement qui a changé la donne et qui a considérablement modifié le cours de la nouvelle guerre froide à ses débuts, influençant grandement la trajectoire stratégique de tous les acteurs clés à l'avenir.
Les doutes concernant les allégeances géopolitiques de l'Inde ont été dissipés une fois pour toutes: cet État-civilisation place ses propres intérêts au premier plan selon le ministre des Affaires étrangères Jaishankar, ce qui ne signifie pas nécessairement qu'il promeut ses intérêts au détriment des autres. L'Inde aspire plutôt à maintenir une équidistance entre l'ordre mondial unipolaire libéral-mondialiste (ULG/Unipolar-Liberal-Globalist) représenté par l'Occident dirigé par les États-Unis et l'ordre mondial multipolaire conservateur-souverainiste (MCS/Multipolar-Conservative-Souverainist) dirigé conjointement par la Russie et la Chine. Le premier partage les intérêts de l'Inde dans la "gestion" de la montée en puissance de la Chine, tandis que le second s'aligne sur la détermination de Delhi à réformer progressivement les relations internationales pour les rendre plus équitables, plus justes et plus stables.
Rien n'a changé en ce qui concerne les liens de l'Inde avec les ULG, puisqu'elle participe toujours au Quad, mais ce qui est nettement différent ces derniers mois, c'est le rôle qu'elle joue dans les efforts du MSC pour intégrer le cœur de l'Eurasie. Le corridor de transport Nord-Sud (NSTC) entre l'Iran et la Russie (où l'Azerbaïdjan représente la route terrestre continue entre eux, tandis que la mer Caspienne est la route maritime alternative) est devenu le seul corridor logistique viable pour l'économie mondiale selon le ministre des transports de ce pays à la fin du mois dernier. Ce fait géo-économique confère à l'Inde, ancrage méridional du NSTC, une importance sans précédent pour la Russie et donc pour le reste de l'Eurasie.
En outre, son partenaire iranien commun est également devenu la porte d'entrée de l'Inde en Afghanistan et en Asie centrale. Dans le premier cas, l'État-Civilisation d'Asie du Sud a récemment envoyé ses diplomates tenir sa première réunion officielle avec les Talibans depuis le retour au pouvoir de ce groupe en août, tandis que dans le second cas, l'Inde tombe de plus en plus sous la coupe économique de ses rivaux chinois. La Russie espère que l'accès à l'Afghanistan facilité par l'Iran pour l'Inde servira de tremplin à Delhi pour équilibrer géo-économiquement Pékin dans cette région plus vaste afin de permettre à Moscou d'y maintenir son influence traditionnelle, d'autant plus que le potentiel de projets communs est passionnant.
Si le lecteur jette un rapide coup d'œil à la carte, il constatera que ces deux couloirs de transit géo-économiques iraniens couvrent une grande partie du cœur de l'Eurasie, ce qui témoigne de l'influence croissante de l'Inde au sein du supercontinent. Cela ne serait pas possible si l'Iran ne coopérait pas étroitement avec l'Inde à cette fin, avec la bénédiction de la Russie. Ces trois grandes puissances réalisent à quel point elles ont besoin les unes des autres en ce moment crucial de la transition systémique mondiale vers la multipolarité. Les relations internationales se trouvent actuellement dans ce que l'on peut décrire comme une phase intermédiaire bi-multipolaire caractérisée par les superpuissances américaine et chinoise exerçant la plus grande influence sur le système mondial.
La Russie, l'Inde et l'Iran ne veulent pas devenir les "partenaires juniors" de l'un ou l'autre de ces deux pays, mais cherchent à créer ensemble un troisième pôle d'influence au sein de cet ordre en évolution, d'où leur étroite coopération depuis le début de l'opération spéciale de Moscou et depuis les sanctions occidentales sans précédent prises par les États-Unis en réponse. La cheville ouvrière de ce paradigme est l'Iran, sans lequel les ambitions de ses partenaires proches, grandes puissances beaucoup plus influentes, seraient impossibles à réaliser. C'est pourquoi il est si important de prêter attention au voyage du ministre des Affaires étrangères Abdollahian en Inde la semaine prochaine, au cours duquel il devrait discuter des détails de sa stratégie géo-économique trilatérale visant à intégrer le cœur de l'Eurasie.

Le public n'est peut-être pas au courant de tous les résultats de sa visite, mais personne ne devrait douter qu'il s'agira de l'un des engagements diplomatiques les plus importants pris entre l'Iran et l'Inde depuis des années, compte tenu du contexte mondial dans lequel il se déroule. Il ne s'agit pas de minimiser l'importance de la Chine et de la Turquie dans l'intégration du cœur de l'Eurasie par le biais du Corridor du Milieu, mais seulement de souligner que la République populaire n'est plus seule aux commandes. L'initiative "Belt & Road" (BRI) de Pékin restera toujours l'un des véhicules les plus puissants de la multipolarité, mais elle n'est désormais plus la seule, car le NSTC et son corridor complémentaire de Chabahar transforment également l'Inde en une puissance eurasienne majeure.
C'est cette tendance, plus que toute autre chose qui s'est développée depuis que la nouvelle guerre froide s'est réchauffée de façon spectaculaire après le début de l'opération spéciale de la Russie, qui constitue l'un des développements les plus inattendus de ces derniers mois. Il est difficile de surestimer l'importance de ce phénomène, car il se produit au début d'une nouvelle phase de la transition systémique mondiale, ce qui signifie que son impact est bien plus important que si tout cela se produisait progressivement. Peu de gens ont encore reconnu le rôle que l'Inde est sur le point de jouer dans l'intégration du cœur de l'Eurasie, mais plus tôt ils le feront, plus tôt ils pourront contribuer à aider le monde à mieux comprendre cette tendance fondamentale.
21:06 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : russie, inde, iran, asie, eurasie, affaires asiatiques, géopolitique, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Division parmi les élites du Japon

Division parmi les élites du Japon
Elena Panina
Source: http://www.elespiadigital.com/index.php/noticias/politica/37934-2022-06-06-16-02-44
Récemment, l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe a fait une déclaration intéressante, évoquant la raison de l'opération spéciale russe en Ukraine et la justifiant par le refus de Zelensky de garantir la neutralité de Kiev et la non adhésion du pays à un bloc quelconque.
Shinzo Abe est l'un des hommes politiques les plus influents et les plus respectés du Japon. Pendant dix ans (de 2006 à 2007 et de 2012 à 2020), il a occupé le poste de premier ministre. De nombreuses réalisations sont associées à ses activités, principalement dans le domaine économique. C'est grâce aux politiques d'Abe que les Japonais ont pu surmonter le "choc de Fukushima", se relever après l'accident de la centrale nucléaire en 2011, qui a remis en question le succès du Japon d'après-guerre en matière de développement technologique, le statut de "superpuissance technologique" du Pays du Soleil Levant.
Jusqu'à la fin des années 2020, alors qu'Abe était au pouvoir, Tokyo avait également une position indépendante en matière de politique étrangère. Restant généralement fidèle à ses relations alliées avec les États-Unis, le Japon a agi dans son propre intérêt national.

Toutefois, ces derniers mois, depuis que Fumio Kishida (photo) a pris le poste de premier ministre, la situation a radicalement changé. En peu de temps, le Japon est en fait devenu "garçon de courses", non seulement en suivant tous les ordres des États-Unis, mais aussi en essayant, comme on dit, d'être "en avance", de prendre une place à l'avant-garde du chœur anti-russe.
Les relations russo-japonaises, qui avaient été consolidées par Abe et ses prédécesseurs, Kishida a pu littéralement les réduire à néant en quelques semaines. La rhétorique de Kishida parle d'elle-même, appelant, par exemple, à "aider le monde à réaliser la dé-russification énergétique".
De telles déclarations sont courantes de la part des représentants de la Lituanie, de la Lettonie ou de tout autre nain politique agressif qui se retrouve dans un contexte de confrontation et décide de s'agiter dans l'intérêt de Washington. Pour le dirigeant japonais, cependant, un tel ton est tout à fait ridicule, induit une forte baisse du statut du Japon, le relègue à la position de vassal américain de second rang.
Tout cela a été pleinement ressenti lors du récent sommet QUAD à Tokyo, où l'événement principal était les négociations entre les États-Unis et l'Inde, et où le Japon s'est vu attribuer le rôle d'un satellite américain, avec lequel tout avait déjà été décidé depuis longtemps.
La question se pose raisonnablement : pourquoi, dans quel but, Kishida fait-il tout cela ? Le problème est que le Premier ministre japonais est convaincu que les partenaires américains remercieront généreusement Tokyo pour sa position anti-russe. Par exemple, ils lui donneront l'occasion de rester sur les marchés américains dans ses créneaux traditionnels (l'électronique, y compris la microélectronique, l'automobile), l'aideront à concurrencer les fabricants chinois, qui ont récemment houspillé de plus en plus les produits japonais.
Le problème du Japon est que Kishida est un fonctionnaire politique typique qui, au fil des années de sa carrière, s'est occupé de tout sauf d'économie. Toute son "expérience économique" s'épuise dans les années lointaines de sa jeunesse, lorsque le futur premier ministre a travaillé pendant plusieurs années comme employé de banque.
En fait, Kishida ne comprend pas les processus mondiaux et sa pensée économique est extrêmement primitive. Pour cette raison, Kishida ne comprend probablement pas que les États-Unis eux-mêmes connaissent aujourd'hui de graves problèmes économiques et que, par conséquent, tous les créneaux qui l'intéressent, même si la Chine les abandonne, seront occupés exclusivement et uniquement par des entreprises américaines. Aucune autre option n'est envisagée.
Au nom d'imaginaires gains futurs, parfaitement illusoires, Kishida prend des mesures qui aggravent encore davantage la situation de l'économie japonaise. La rupture totale des liens économiques avec la Russie, à laquelle conduit l'affaire Kishida, est porteuse d'énormes problèmes pour l'économie japonaise.
Des industries entières sont déjà menacées d'effondrement. Par exemple, la pêche qui, si la zone économique russe est fermée aux navires japonais, ne pourra plus approvisionner le pays en poissons et fruits de mer, privant ainsi les Japonais de leur alimentation habituelle, portera un coup sévère au mode de vie japonais. Au total, selon des études récentes, plus de 15.000 entreprises japonaises ont déjà subi les conséquences des sanctions anti-russes.
Et l'idée de Kishida de refuser de participer au projet Sakhaline-2 et au GNL des champs de Sakhaline sera un coup dur pour les plus grandes sociétés japonaises, Mitsui et Mitsubishi, des entreprises publiques qui participent depuis longtemps au projet. Et d'ailleurs, les géants chinois de l'énergie font déjà la queue pour acheter des parts d'entreprises japonaises dans Sakhalin Energy. En outre, les actions des entreprises japonaises peuvent être vendues avec une très forte décote. Nous parlons de pertes de plusieurs milliards de dollars.

A propos, il est bon de rappeler que l'histoire de ce projet a commencé en 1994. Les propriétaires de Sakhalin LNG sont alors devenus l'anglo-néerlandais Shell (55%) et les japonais Mitsui (25%) et Mitsubishi (20%). En d'autres termes, ces dépôts sont détenus à 100% par des sociétés étrangères.
Cependant, en 2007, la situation a changé. Les dirigeants du pays ont liquidé les accords de partage de la production et ont proposé de vendre la moitié des actions de la société russe Gazprom. Dans le même temps, Sakhalin Energy s'est vu infliger une amende de 30 milliards de dollars pour des dommages environnementaux.
C'est ainsi qu'a commencé la décolonisation du sous-sol russe, grâce à laquelle la majorité des parts de Sakhalin Energy appartient aujourd'hui à Gazprom (50% des parts plus une action), Shell a 27,5% des parts moins une action, Mitsui et Mitsubishi ont respectivement 12,5% et 10% des parts. Et maintenant, la Russie a la possibilité de remplacer sans douleur un participant au projet par un autre sans nuire au processus.
En particulier, Shell est contraint, sous la pression politique des autorités britanniques, de vendre sa participation à des entreprises chinoises en acceptant une perte énorme. Et si les dirigeants japonais ne changent pas de position, le même sort sera réservé à Mitsui et Mitsubishi. Dans une large mesure, c'est ce qui a motivé la déclaration d'Abe.
Il faut dire que la position de Kishida avait été soigneusement remise en question auparavant par le ministre des Finances, Koichi Hagiuda, qui avait clairement indiqué qu'il serait difficile de mettre en œuvre les idées du premier ministre concernant les sanctions économiques contre la Russie. Et, en principe, la culture politique japonaise repose sur le fait que tout désaccord au sein du parti au pouvoir, le LDP, est résolu en coulisses et n'est pas rendu public.
Aujourd'hui, cependant, une partie importante des hommes d'affaires et des politiciens japonais comprend que la confrontation avec Moscou est allée trop loin à cause des positions bancales de Kishida, que les choses ont pris une tournure trop dangereuse pour le Japon. Et dans ce contexte, les déclarations de Shinzo Abe ne représentent pas seulement son opinion personnelle, mais aussi la position d'une partie importante de l'establishment japonais.
Cela témoigne d'une division évidente au sein des élites dirigeantes japonaises sur la question des relations avec la Russie, qui sont vitales pour Tokyo. Et il y a des raisons de croire qu'avec le temps, cette division ne fera que s'accentuer.
*directeur de l'Institut RUSSTRAT
20:50 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : japon, asie, affaires asiatiques, sakhaline, russie, hydrocarbures, géopolitique, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Les États-Unis mènent en Ukraine une guerre aux frais de l'Union européenne contre... l'Union européenne

Les États-Unis mènent en Ukraine une guerre aux frais de l'Union européenne contre... l'Union européenne
Alexander Gorokhov
Source: http://www.elespiadigital.com/index.php/noticias/politica/37922-2022-06-05-15-47-02
Ce n'est un secret pour personne que l'opération militaire spéciale (OMS) actuellement en cours en Ukraine est en réalité une confrontation non pas tant des troupes russes contre les troupes ukrainiennes, mais plutôt une confrontation des grands projets du monde russe, d'une part, et de l'union euro-américaine, d'autre part. Guerre par procuration classique, lorsque quelqu'un tente de protéger ses intérêts mondiaux par procuration sur un territoire étranger aux dépens de quelqu'un d'autre, affaiblissant ainsi l'ennemi.
Les marionnettistes dans les plans des marionnettistes
À première vue, la situation donne l'impression que la guerre est menée contre la Russie par l'entremise de l'Ukraine sur le territoire de celle-ci et à ses dépens. Mais la définition même d'une guerre par procuration, que nous avons prise comme point de départ, nie le rôle de l'Ukraine en tant que véritable partie dans le conflit. Et une étude plus approfondie de la question confirme cette conclusion.
Commençons par le fait que l'Ukraine a cessé d'être un sujet des relations internationales pour devenir un objet des relations internationales après le coup d'État de février 2014. Et cela est confirmé par la discussion publique de l'assistante du chef du Département d'État, Victoria Nuland, avec l'ambassadeur américain en Ukraine sur la candidature du futur premier ministre "carré". Et plus tard, la nomination, à la suggestion des États-Unis, d'étrangers comme membres du gouvernement ukrainien, diverses "réformes" et remaniements de personnages clés sous la pression des États-Unis.
Et si pendant près de sept ans, l'objectivité de l'Ukraine a été diplomatiquement réduite au silence, au cours de la dernière année avant l'opération militaire russe, les dirigeants russes n'ont plus caché le fait que toute négociation sur les affaires ukrainiennes ne devait pas être menée avec Kiev, mais avec Washington, qui décide de tout ce que l'Ukrainien est autorisé à faire.

En outre, les événements précédant le début du conflit démontrent que les Etats-Unis ont ouvertement poussé l'Ukraine à opter pour une solution militaire dans la question de la propriété du Donbass et de la Crimée. En outre, les dirigeants militaro-politiques de l'Ukraine ont même essayé pendant un certain temps d'éviter la "phase chaude", réalisant que le potentiel militaire de l'Ukraine n'était en rien comparable à celui de la Russie. Mais, étant a priori dépendante, elle a été contrainte de se préparer à une attaque suicide dans le Donbass. Les documents trouvés confirment les plans visant à lancer une "opération de restitution des territoires temporairement saisis" à partir du 8 mars 2022. En outre, les plans dont ont hérité les militaires russes et ceux de Donetsk à Mariupol indiquent que le but de l'opération dans le Donbass était d'obtenir un accès ultra-rapide à la frontière russe.
La thèse selon laquelle les hostilités actuelles sont menées aux dépens des fonds ukrainiens n'est pas vraie du tout. Oui, une partie du financement provient bien sûr des poches des contribuables ukrainiens. Mais le transfert massif d'armes, de munitions et d'équipements militaires à l'Ukraine par les pays de l'OTAN, ainsi que d'autres aides militaires (y compris la fourniture de renseignements en ligne), ont approché, s'ils ne les ont pas encore dépassés, les coûts de la guerre pour l'Ukraine. Et le fait que la loi Lend-Lease pour l'Ukraine (rappelez-vous que le concept même de Lend-Lease implique une assistance aux États menant des hostilités dans l'intérêt des États-Unis) ait été introduite plus d'un mois avant le début du conflit, témoigne d'un conflit militaire planifié par les États-Unis entre l'Ukraine et la Russie.
Ainsi, l'Ukraine est un outil et un champ de bataille pour les États-Unis afin de défendre leurs propres intérêts. Mais ce n'est qu'une première approche pour comprendre la situation. Avec la deuxième approche, tout est encore plus intéressant.
Si la Russie n'est pas un concurrent des États-Unis, qui l'est ?
Au cours des cent dernières années, l'Union soviétique et la Fédération de Russie, malgré des périodes de rapprochement et même de relations d'alliance avec les États-Unis, ont vécu sans sanctions américaines... moins d'un mois : entre l'abrogation de l'amendement Jackson-Vanik et l'adoption de la loi Magnitsky. Même pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque l'aide Lend-Lease était fournie à la Russie soviétique, il existait des listes de matériaux, d'équipements et d'armes dont la fourniture à l'URSS était interdite. Sans surprise, l'ancien commandant de l'OTAN en Europe, Philip Breedlove (photo), a admis que la Russie constitue une menace existentielle durable pour les États-Unis et leurs alliés. Et la menace implique son élimination ou du moins son affaiblissement. Et mieux, par les mains d'une puissance ou un acteur tiers.
"Au cœur de toute stratégie en Europe doit se trouver la prise de conscience que la Russie constitue une menace existentielle durable pour les États-Unis, leurs alliés et l'ordre international".

Malgré cette déclaration tapageuse, la "menace russe" n'est que militaire pour les États-Unis. Et Washington est bien conscient que la puissance militaire russe est nettement inférieure à la puissance militaire des États-Unis, sans parler de la puissance combinée des États membres de l'Alliance de l'Atlantique Nord. Et puisque Moscou est également consciente de cette vérité immuable, il ne faut pas s'attendre à ce que la Russie fasse la guerre. Ni une guerre avec des armes conventionnelles, encore moins une attaque suicidaire avec des armes nucléaires. La domination économique mondiale est bien plus importante pour les États-Unis. Et dans cette affaire, la Russie n'est pas du tout un concurrent des États-Unis.
Et qui sont les concurrents ? Il y en a deux : la Chine et l'Union européenne. En outre, l'affaiblissement économique de l'un entraînera automatiquement l'affaiblissement de l'autre : les fabricants chinois et les consommateurs européens sont fortement interconnectés. Et leur affaiblissement conduit inévitablement au renforcement d'"un singe rusé assis dans un grand arbre, au pied duquel deux tigres se battent". De plus, il est également saturé de bananes qui sont soudainement devenues disponibles pour lui. Après tout, avec le début de l'opération militaire des forces armées russes en Ukraine, les actions du complexe militaro-industriel américain ont considérablement augmenté. Et ceci avant même le début du plan proposé par la Pologne pour remplacer l'équipement militaire obsolète datant de l'époque de l'URSS, qu'elle se proposait de livrer à l'Ukraine, par un équipement américain plus récent et plus coûteux.
En d'autres termes, en incitant les marionnettes polonaises à faire un tel pas dans le temps, les États-Unis ne tuent pas deux, mais beaucoup d'oiseaux d'une seule pierre. Premièrement, elle soutient sa propre économie, deuxièmement, elle oblige les Européens à acheter des armes américaines, ce qui affaiblit l'un des deux principaux concurrents économiques et, troisièmement, elle affaiblit délibérément la Russie, la forçant à dépenser des fonds supplémentaires pour "éliminer" la "ferraille" fournie à l'Ukraine, quatrièmement, elle augmente la saturation de l'OTAN en systèmes d'armes modernes et, cinquièmement, elle prolonge l'agonie de la "guerre pour les intérêts américains jusqu'au dernier Ukrainien".
Mais ce n'est pas tout. Les Américains eux-mêmes admettent déjà que la Russie, à leur indescriptible surprise, s'en sort bien avec des sanctions record en termes quantitatifs et qualitatifs. En outre, les réserves financières de la Russie non seulement n'ont pas diminué suite à leur introduction, mais ont augmenté après le début de l'opération militaire d'environ 12 milliards de dollars en raison de la hausse des prix de l'énergie. Dans le même temps, pour la même raison, l'économie de l'UE subit d'énormes pertes, la production la plus importante est arrêtée à cause de la hausse des prix du gaz, et en raison de l'embargo sur l'importation d'engrais russes et biélorusses, le spectre de la pénurie alimentaire plane aux portes de l'Europe. Bien sûr, ils essaient de régler ce dernier problème en exportant à la hâte quelques dizaines de millions de tonnes de céréales d'Ukraine, condamnant le pays à la famine : en raison de la pénurie de carburant et des hostilités, la saison des semailles en Ukraine a en fait été interrompue. Le pain de la prochaine récolte, semble-t-il, les Européens devront l'acheter à un prix plus élevé aux États-Unis.
Faut-il s'étonner que les alliés américains de la coalition anti-russe souffrent de la guerre en Ukraine ? Dans le paradigme de la guerre par procuration, il n'est non seulement pas étrange, mais naturel : que la guerre soit menée sur le territoire ukrainien, mais principalement aux frais de l'Union européenne contre... l'Union européenne. Et le fait que les querelles des Ukrainiens et des Russes ne soient pas non plus un problème : l'essentiel est que ce sont les Américains qui sont les principaux bénéficiaires de cette guerre hybride par procuration.
Que devons-nous faire, comment devons-nous être ?
Dans une guerre, même s'il s'agit d'une guerre hybride contre la Russie et non associée à des hostilités "chaudes", cela signifie que la question aiguë est de savoir comment traiter ceux qui se sont impliqués du côté de nos adversaires. En fait, ils se sont maintenant tirés une balle dans le pied en Europe : dans le contexte des sanctions anti-russes imposées, le taux d'inflation dans tous les pays de l'UE et de l'OTAN, y compris les États-Unis, a fortement augmenté.
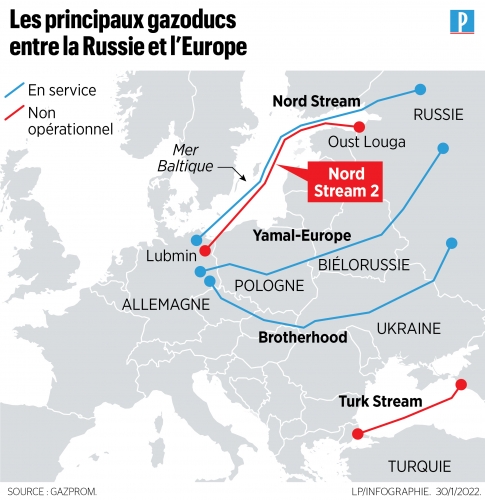
La "guerre du gaz" a entraîné un bond sans précédent des prix du "combustible bleu" et, par exemple, en Allemagne, les industriels disent déjà franchement qu'il est moins cher de fermer de nombreuses entreprises que de poursuivre leur production. Les tentatives de limiter l'approvisionnement en pétrole russe ont déjà entraîné une forte hausse des prix du carburant en Europe et aux États-Unis. Qui, soit dit en passant, n'a rien pour remplacer le pétrole de l'Oural dans un certain nombre de raffineries qui sont prêtes à le traiter. Il y a une forte probabilité de crise alimentaire en raison des restrictions sur les importations d'engrais russes. En outre, une hausse des prix du blé a déjà été observée. Et que se passera-t-il après la récolte, qui n'est évidemment pas suffisante sans l'approvisionnement en blé russe ? Après tout, la pénurie de céréales qui se profile en Inde aura également une incidence sur le prix.
Je ne veux pas hausser les épaules, en répondant de manière absolument symétrique, comme pour l'expulsion mutuelle des diplomates. Dites ce que vous voulez, mais le gaz, le pétrole, les engrais, les matières premières industrielles, la nourriture, c'est aussi de l'argent qui sert à renflouer le budget russe. Oui, il existe un certain nombre de pays qui peuvent théoriquement acheter littéralement tous les volumes de ces biens, ce que l'Europe et les États-Unis refusent à leur propre détriment.
Ce qui se passe aujourd'hui avec les prix, en fait, est une répétition, un avertissement aux ennemis de ce qui les attend s'ils entrent dans une confrontation militaire ouverte avec la Russie sous la pression de Washington.
Et ce n'est que le début. Une proposition a déjà été soumise à la Douma d'État pour que la Russie se retire de l'OMC, ce qui permettra une réponse plus ciblée à la pression des sanctions. Par exemple, en modifiant le montant des droits d'importation et d'exportation des pays, en fonction de leur degré de loyauté envers la Russie.
Oui, les revenus de la Russie provenant des hausses de prix "sanctionnées" aujourd'hui battent des records: selon les analystes de Citi, Gazprom reçoit environ 200 millions de dollars par jour, et ses revenus cette année pourraient être le double de ceux de l'année dernière. Mais aujourd'hui, l'Occident discute de plans visant à créer un cartel pour "contrôler" le prix du pétrole russe. Et cela a-t-il un sens de continuer à "gronder gentiment" les pays que nous considérons toujours comme nos "alliés", malgré leurs mesures véritablement anti-russes ? Après tout, comme vous le savez, la Russie n'a que trois alliés : l'armée, la flotte et les forces spatiales nouvellement créées.
Bien sûr, il ne faut pas prendre de décisions drastiques, créant des difficultés pour notre économie avec des contre-mesures. Mais c'est pour cela que le gouvernement existe, pour évaluer et calculer soigneusement les conséquences de ces mesures. Que les circonstances évoluent de telle sorte que notre pays soit devenu un instrument de la guerre géopolitique par procuration menée par les États-Unis contre l'Europe et la Chine, mais il est en notre pouvoir de faire en sorte que cet instrument ne soit pas aveugle, afin que nous ayons la possibilité de tirer le maximum de profit de notre position, et que la Russie en sorte renforcée. L'essentiel est de comprendre la véritable nature du conflit actuel, dans lequel nous avons été poussés avec tant de force : avertis, nous sommes donc armés.
19:00 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, affaires européennes, russie, états-unis, otan, union européenne, géopolitique, politique internationale, ukraine |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
L'anarchie liberticide et les "valeurs" du marché libre. Sur la marchandisation de la vie et la commercialisation du corps

L'anarchie liberticide et les "valeurs" du marché libre. Sur la marchandisation de la vie et la commercialisation du corps
Par Cristian Taborda
Source: https://noticiasholisticas.com.ar/la-anarquia-liberticida-y-los-valores-del-mercado-libre-sobre-la-mercantilizacion-de-la-vida-y-comercializacion-del-cuerpo-por-cristian-taborda/
Laissez faire laissez passer est le mantra du libéralisme, avec lequel les physiocrates ont synthétiquement posé les bases de l'idéologie libérale. "Laissez faire, laissez passer", rien ne doit intervenir, il ne doit y avoir aucune restriction, aucune réglementation, tout doit circuler librement et absolument sans frontières ni interdictions, des flux de capitaux financiers purement spéculatifs aux migrations massives, de la drogue aux armes. L'État ne devrait pas intervenir car il interrompt la libre circulation des capitaux-individus-biens et le libre échange par "accord mutuel", violant ainsi la liberté individuelle. La libéralisation et son "progrès" ne doivent pas être freinés.
Mais loin de représenter une idéologie proprement politique, la libéralisation absolue de l'économie s'est posée comme un fanatisme irrationnel, avec des aspirations plus proches de celles d'une pseudo-religion, qui ne peut être remise en question, que d'une théorie économique; elle s'est érigée en théologie du marché, le revers de la médaille de l'omnipotence de l'État. Si l'étatisme prétend tout réglementer, même les aspects de la vie privée, conduisant à un totalitarisme étatique qui insécurise l'homme en annulant sa liberté, la libéralisation absolue prétend tout déréglementer et aboutit à une situation liberticide, conduisant au désordre total, à l'anarchie libérale. Pour cette vision anarcho-libertaire, tout doit circuler librement en tant que marchandise, y compris les personnes. Sans aller plus loin, cette vision cosmopolite du monde a nourri la mondialisation néolibérale et le mondialisme progressiste qui en découle, qui sont aujourd'hui en train de s'effondrer.
La personne humaine devient ainsi non pas une fin en soi mais un moyen, une autre marchandise qui doit circuler librement sur le marché mondial, fonctionnant dans de nombreux cas comme un instrument de pression géopolitique par les États, les fondations, les organisations internationales ou les ONG, et dans d'autres cas par le marché comme une main-d'œuvre bon marché.
La vie humaine est instrumentalisée, au mépris de toute forme d'éthique et de dignité, n'étant qu'un moyen au service d'autres fins. Mais pour en arriver là, il faut une destruction et un remplacement culturels, en faisant fi de l'éthique qui découle de la culture, et de la culture qui a un fondement moral dans la religion. Les valeurs de Dieu doivent être remplacées par celles de l'argent, c'est-à-dire la culture par le marché, où il n'y a pas de valeurs mais des prix et des intérêts. L'annihilation des différentes cultures et de leurs valeurs par les besoins et les intérêts du marché mondial.
Dépourvu de toute culture et de toute éthique, le marché devient ainsi une "bête sauvage" où toute activité commerciale sans scrupules peut être menée sans tenir compte des dommages causés à la communauté et à la vie elle-même sous l'excuse de "l'accord mutuel", du "libre arbitre" et du "choix individuel". On en trouve la synthèse dans le slogan propagandiste "Mon corps, ma décision"; ce slogan peut effectivement tout justifier, de la vente d'organes et la consommation de drogues aux pratiques d'avortement et à la location d'utérus, ou à la commercialisation de fœtus comme le fait la multinationale Planned Parenthood. La vie et le corps humain deviennent une marchandise, un produit destiné à la consommation et à la commercialisation. La vie cesse d'avoir de la valeur et devient un prix, comme les esclaves l'avaient autrefois, en fait c'est un nouvel esclavage.

Pier Paolo Pasolini a parfaitement décrit comment ce pouvoir totalitaire s'est emparé des revendications de "Liberté", propres des libéraux et des progressistes. Dans ses "Ecrits corsaires", condamnant l'avortement, le poète italien décrivait déjà la désacralisation de la vie par le nouveau pouvoir consumériste : "Maintenant, la vie n'est plus sacrée, mais l'est au sens de maudite (sacer a les deux sens)".
En désacralisant la vie et en la rendant maudite, la culture et la patrie étant remplacées par la société de marché et le déracinement, le corps et la vie peuvent alors être utilisés pour n'importe quoi, y compris pour la commercialisation des enfants, comme l'a soutenu le paléolibertaire Murray Rothbard dans The Ethics of Freedom:
"Nous devons faire face au fait que dans une société absolument libre, il peut y avoir un marché libre florissant des enfants" (...).
Si le marché libre des enfants était autorisé, ce déséquilibre serait éliminé et un transfert de bébés et d'enfants aurait lieu des parents qui n'en veulent pas ou n'en prennent pas soin vers les parents qui souhaitent ardemment les avoir".
Cette "éthique de la liberté" libertaire n'est pas l'éthique, ni la liberté, c'est l'immoralité et l'esclavage, un trafic de personnes sous le couvert du "marché libre". Le résultat est la marchandisation de la vie, où, pour le plus grand plaisir des progressistes, l'homme a cessé de servir Dieu pour servir l'argent, et pour le plus grand dégoût des libéraux, la vraie liberté est détruite et les gens deviennent des esclaves. Loin de promouvoir la valeur de la liberté en tant que bien suprême, l'engagement en faveur de la libéralisation absolue de l'économie relève d'une intention liberticide et la libéralisation de la culture du libertarisme.
Tocqueville avait déjà mis en garde contre cette situation. Fort de l'expérience de la Révolution française, il s'interrogeait sur les barrières qui, dans le passé, arrêtaient la tyrannie, et se demandait lesquelles tenaient encore debout, soulignant que la religion ayant perdu son empire sur les âmes, tout semble incertain dans le monde moral, condamnant dans cette situation : "personne ne peut dire où sont les limites naturelles du despotisme et les frontières de l'anarchie". C'est la restauration des valeurs de notre culture qui peut mettre une limite au projet liberticide.
18:27 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, libéralisme, néolibéralisme, libéralisme liberticide |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 07 juin 2022
La présidence Macron, l’Etat et la dé-civilisation française

La présidence Macron, l’Etat et la dé-civilisation française
Avec un appendice sur les historiens libertariens américains
Nicolas Bonnal
On a vu sur Telegram (c’est censuré en France) des images de Paris, après le marché de Belleville, qui font penser à une mégapole africaine en pleine déconfiture (beau résultats pour une ville nécrosée par sa dette et sa fonction publique pléthorique, par sa population remplacée aussi) ; on a vu que l’OMS va diriger un Etat mondialiste et vaccinateur furieux, qui privera huit milliards de citoyens de leur liberté sinon de leur santé/vie ; on a vu un grand effondrement culturel français, et ce pays qui était jadis le phare de la civilisation est devenu le réceptacle des daubes cannoises ou autres (lisez ou relisez l’Etat culturel de Fumaroli ou les livres de mon ami Paucard) ; on a aussi vu que l’Etat espagnol mitraille chimiquement sa population et qu’il se prépare à voler toute sa population : énième version des corralitos latinos – ce n’est pas dans les webzines complotistes mais dans les journaux Mainstream maintenant. On a vu aussi que le super-Etat totalitaire européen dirigé par la très folle administration Leyen se renforce par sa guerre avec la Russie et prépare un cocktail de pénurie, de déglingue et de contrôle informatique globalitaire des populations hébétées ; car si l’Etat est un destructeur de la civilisation il détruit aussi les populations.
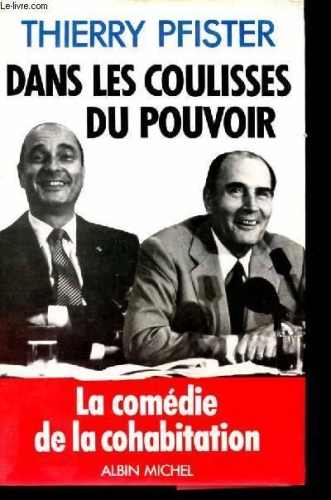 L’Etat romain dégénéré a créé le citoyen idiot (tonto) dont a parlé Ortega y Gasset dans sa rébellion des masses. Ces masses sont d’ailleurs des créations de l’Etat moderne: c’est le dernier homme de Nietzsche et le citoyen transformée en Turc dont parle Tocqueville, qui ajoute qu’on lui ôtera, au citoyen moderne, le trouble de penser et la peine de vivre, l’euthanasie mentale précédant l’autre. Et ce peuple nouveau pour parler comme l’autre semble content de son sort puisqu’on le voit revoter Macron (je sais, il y a des abstentions…) aux législatives sans oublier Mélenchon. Ces deux individus sont des émanations du PS, le parti fourre-tout et catho de gauche qui a aujourd’hui gangréné tous les partis: le PS c’était le parti fonctionnaire, le parti totalitaire à la française qui aura tout créé même ses milliardaires: c’est le parti de la gauche caviar et de la bourgeoisie sauvage (Taine dit que le bourgeois est une création de l’Etat – pas du commerce - et comme il a raison) dénoncées en leur temps par des hommes de gauche courageux comme mon éditeur Thierry Pfister (chez Albin Michel) ou comme Guy Hocquenghem.
L’Etat romain dégénéré a créé le citoyen idiot (tonto) dont a parlé Ortega y Gasset dans sa rébellion des masses. Ces masses sont d’ailleurs des créations de l’Etat moderne: c’est le dernier homme de Nietzsche et le citoyen transformée en Turc dont parle Tocqueville, qui ajoute qu’on lui ôtera, au citoyen moderne, le trouble de penser et la peine de vivre, l’euthanasie mentale précédant l’autre. Et ce peuple nouveau pour parler comme l’autre semble content de son sort puisqu’on le voit revoter Macron (je sais, il y a des abstentions…) aux législatives sans oublier Mélenchon. Ces deux individus sont des émanations du PS, le parti fourre-tout et catho de gauche qui a aujourd’hui gangréné tous les partis: le PS c’était le parti fonctionnaire, le parti totalitaire à la française qui aura tout créé même ses milliardaires: c’est le parti de la gauche caviar et de la bourgeoisie sauvage (Taine dit que le bourgeois est une création de l’Etat – pas du commerce - et comme il a raison) dénoncées en leur temps par des hommes de gauche courageux comme mon éditeur Thierry Pfister (chez Albin Michel) ou comme Guy Hocquenghem.
Il est hallucinant de voir qu’on nous fait la farce du néolibéralisme alors qu’on vit une phase crépusculaire et folle de super-étatisme planétaire ; que cet étatisme s’entende avec les oligarques vaccinateurs et les GAFAM, eux-mêmes émanations du Deep State et du Pentagone n’étonnera que les idiots du village médiatique. C’est l’Etat qui créé ces boîtes, qui a privatisé les monstres, comme c’est l’Etat français ou autre qui a liquidé l’activité économique nationale ou remplacé la population ; le grand remplacement est du reste surtout psychologique (le peuple nouveau) comme je le rappelle inutilement en citant toujours Don Siegel et ses profanateurs de sépultures.
L’Etat moderne (Maistre a évoqué ce pullulement des lois lors des premières années de la Révolution, pullulement dépassé depuis) est depuis deux siècles le grand facteur de la décivilisation en Occident et maintenant dans le monde. Le traditionaliste guénonien (et musulman) Titus Burckhardt en a parlé à propos du Maroc, devenu depuis son indépendance un bon petit élève de la mondialisation. Hans Hoppe a souligné le rôle destructeur de l’Etat en matière de famille: l’avortement, l’enseignement (limité à: « tes pas un garçon, t’es une fille ! »), le divorce, l’aide à la femme célibataire, la misandrie administrative, tout a été fait par les fonctionnaires pour détruire la famille, ce seul Etat, disait Chesterton qui crée et aime ses citoyens. L’Etat moderne lui les hait et les détruit ou les remplace, ses citoyens. C’est pour cela aussi qu’il aime les guerres, « cette santé de l’Etat », et c’est comme cela que les guerres mondialistes se sont multipliées à partir du moment où on a évoqué le nouvel ordre mondial qui enchante des millions de bureaucrates et de politiciens à travers la planète.
Le contrôle des oppositions politiques par le fric et le financement des campagnes politiques accélère cette entropie. Tout le monde se bat du coup pour imposer la pénurie, le couvre-feu, la guerre, la Terreur et le bataclan médiatique destiné à contrôler des populations toujours plus stupides et formées à l’être depuis l’école qui n’a jamais été aussi peu libre dans notre histoire (relisez Chaunu et découvrez quelle liberté aux siècles des Lumières).
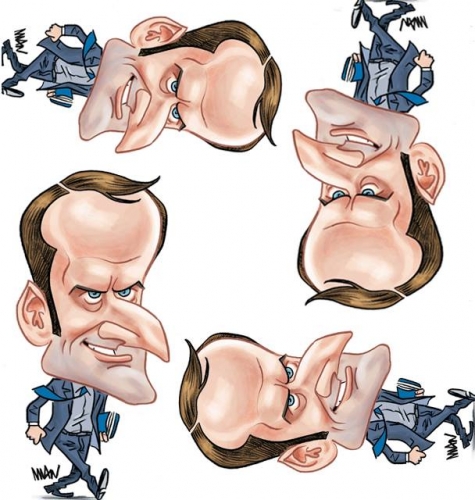
Revenons à notre hexagone si bien nommé. Entre Notre-Dame, le Stade de France (sic), les gilets jaunes, le délitement de l’école, de la police, de l’hôpital et tout le reste, nous assistons avec la résidence Macron (il sera réélu trois ou quatre autres fois, ne vous en faites pas, son peuple nouveau y pourvoira), à la fin de la civilisation française, plus exactement à la fin de ses restes ; à la formation aussi d’une population neuve et nécrosée, usée et anesthésiée ; l’historien Stanley Payne en a parlé aussi à propos de l’Espagne ; l’Etat a progressivement engendré un mouton républicain qui lui est parfaitement soumis et ne se rend plus compte non plus des coups de pied au cul ou du grand effondrement de son niveau de vie. On a parlé de citoyen ludique enfant ou adolescent, mais vu Macron et son électorat je dirais plutôt qu’on voit un citoyen vieux (y compris quand il est jeune), gavé de BFM, propre à illustrer la tirade des sept âges de Shakespeare: en fait on est dans un monde de vieillards inactifs, craintifs et peu créatifs et on demande à cet hexagone administratif «(« plus froid des monstres froids »…) de ressembler aux territoires protocolaires dont il a recouvré une terre sacrée jadis couverte de champs, de villages et de chapelles.
Sources
https://www.amazon.fr/Chroniques-sur-lHistoire-Nicolas-Bo...
https://www.amazon.fr/gp/product/B0B2HND9MM/ref=dbs_a_def...
https://www.amazon.fr/territoires-protocolaires-Nicolas-B...
Je joins à ces quelques lignes désabusées (c’est un peu tard pour espérer…) une ancienne bibliographie des meilleurs auteurs libertariens américaines. Eux ont parfaitement compris et expliqué comment Lincoln, Wilson, Roosevelt, Johnson, Biden ou autres ont créé leur Etat totalitaire et belliqueux.
Auteurs libertariens : une bonne petite bibliographie
Les intellectuels libertariens ont révisé toute leur histoire américaine. À l’heure de l’État profond devenu fou et rigolo, ce n’est pas une inutile affaire ; deuxièmement, ils se rapprochent du guénonisme (c’est très visible chez l’Allemand Hans Hoppe). La montée de l’État, de la bureaucratie, de la réglementation, de la fiscalisation suppose une dégénérescence métaphysique, celle que pressentaient d’ailleurs les taoïstes chinois il y a plus de deux mille ans, quand les empereurs (relisez René Grousset) organisaient déjà des Grands remplacements de population: un autre livre à écrire ! La réfutation taoïste de l’État providence fut il y a vingt ans mon premier texte posté sur le web, par Alain Dumait, aux 4 vérités. Tout est disponible gratuitement sur Mises.org. Vous donnez ce que vous voulez. Je ne sais pas si j’écrirai un livre de présentation de cette splendide école, qui se rattache à Tocqueville, Benjamin Contant, et Frédéric Bastiat. Raico n’aimait pas trop Hayek et il adorait ces penseurs français. Une grande partie des libéraux que j’ai connus dans les années quatre-vingt-dix ont fini néocons.
J’ai insisté surtout sur les travaux historiques, plus intéressants pour nous.

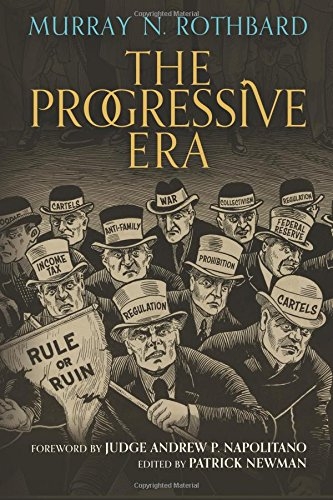
On commence par Murray Rothbard, auteur du manifeste libertarien. Ses pages sur l’histoire diplomatique sont extraordinaires de culot, de bon sens et d’autorité. Il exonère Staline pour la Guerre Froide, comme Ralph Raico d’ailleurs. On peut lire aussi son livre sulfureux sur Wall Street et les banques. Enfin, bien sûr, Rothbard irrépressible, où il défend sa conception de la culture et du cinéma, qui est la mienne ; et le film de Corneau Tous les matins du monde. Dans le même livre, Murray faisait la chasse aux chasseurs d’antisémites ! On n’a pas fini de rire ! C’était à propos des menaces et des insultes qui frappaient le pauvre Buchanan. Murray définit nûment la théorie de la conspiration « Ce qui s’oppose au mensonge des historiens officiels. »

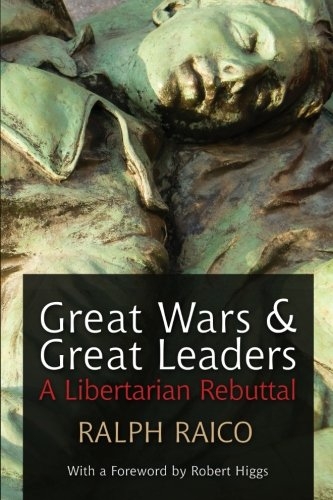
Ralph Raico vient de mourir, raison de plus pour l’honorer, ce maître. Son chef-d’œuvre concerne les grands leaders et les grandes guerres. Ces grands leaders sont tous des catastrophes car pour devenir un grand président, il faut la guerre, civile ou mondiale. Wilson, Lincoln, Roosevelt, etc. sont restés dans les mémoires grâce à leurs horreurs.
Lisez aussi le Raico sur les libéraux romantiques français.

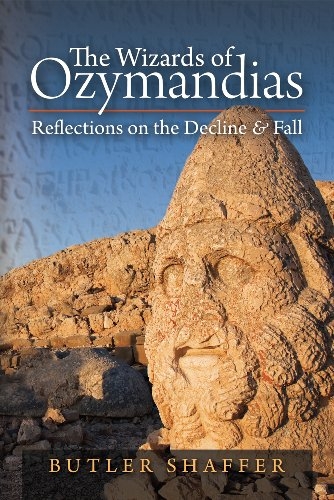
Butler Shaffer: Les magiciens d’Ozymandia, d’après le beau poème oublié de Shelley. Le ton est plus philosophique et traditionnel. Butler fait le commentaire de l’écroulement vaseux de la civilisation US et occidentale. C’est lui l’auteur du « test Hitler », d’où il ressort que « l’écolo antitabac, contrôleur de vitesse, végétarien et guerrier humanitaire Hitler est, quand il est présenté anonymement, plus populaire auprès des jeunes que Jefferson (esclavagiste, rebelle armé, contrebandier, planteur de tabac,…) »
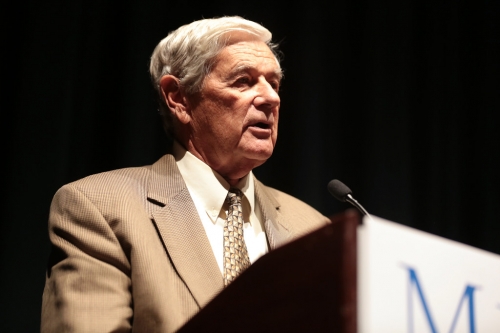
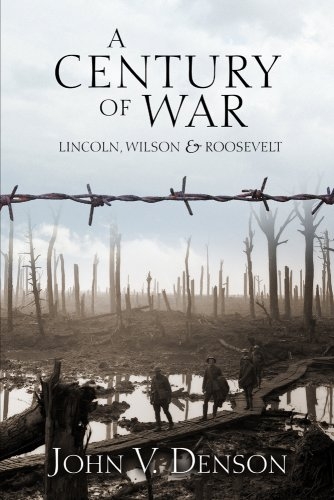
John Denson, Les reconsidérations sur la présidence. Livre collectif et splendide sur la montée du totalitarisme américain. Une contribution de l’universitaire Michael Levin, sur le président comme ingénieur social. Comment aussi on a saboté les études (un autre grand humaniste juif, Harold Bloom, en avait parlé), l’armée, tout au nom du Politiquement correct.
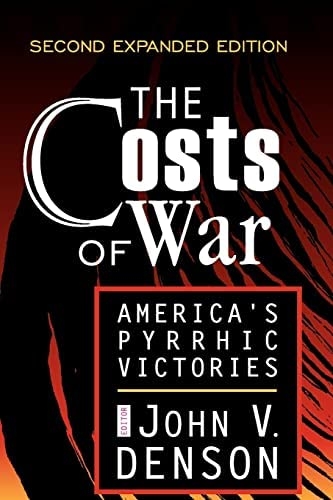
Les coûts de la guerre, essai sur les victoires pyrrhiques de l’Amérique. Merveilleux ouvrage collectif. Édité encore par John Denson. Extraordinaire contribution de Rothbard sur les deux seules guerres justes (1776 et Sécession, côté sudiste bien sûr) et de Joseph Stromberg sur la guerre hispano-américaine de 1898, qui démarra avec un faux attentat et se termina par un génocide aux Philippines, puis la fondation de l’interventionnisme destructeur et presque calamiteux (Cuba, Corée, Vietnam, l’Amérique centrale…).
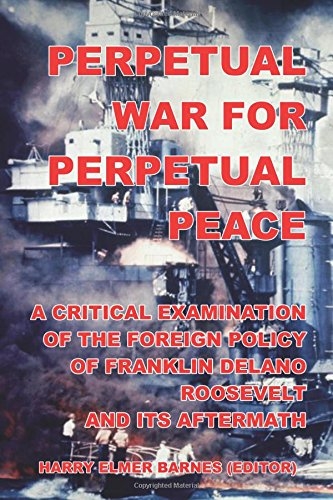
La Guerre perpétuelle pour une paix perpétuelle par Harry Elmer Barnes. J’ai évoqué Frédéric Sanford sur la manière dont Roosevelt empêcha un règlement européen et antihitlérien à Munich. Sur ces sinistres affaires, lire et relire aussi Guido Preparata. Hitler, le monstre anglophile et utile pour la dominance anglo-saxonne dans ce monde…
Le mythe de Roosevelt de John Flynn qui a vu la montée de l’ère managériale en même temps que James Burnham. Livre effarant par sa justesse. Lisez tout John Flynn, journaliste et héros de la guerre antisystème.

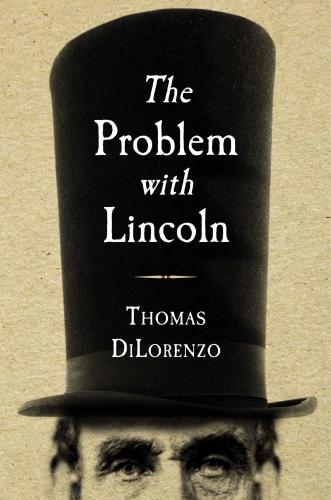
Thomas Di Lorenzo : Lincoln, qui montre ce que tous les lecteurs de mémorialistes savaient : Lincoln détraqué, homme du business et des tarifs douaniers, fanatique étatique de la loi, et qui prépara sur les cendres du vieux sud (600 000 morts pour abolir un esclavage aboli partout ?) le nouveau désordre américain.
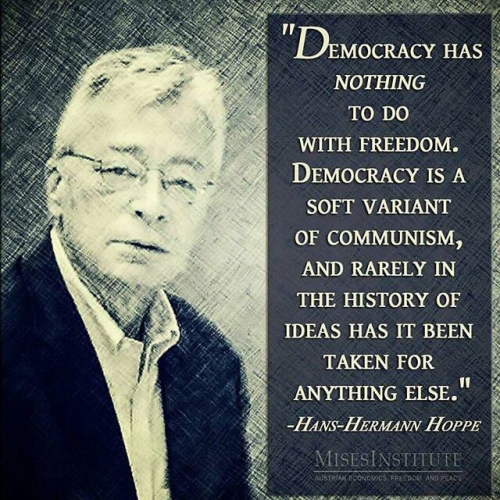
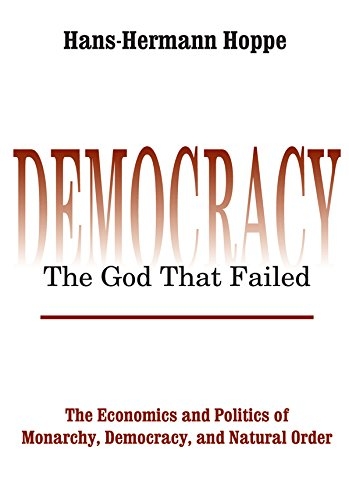
Démocratie, le dieu qui a échoué, de l’Allemand Hans-Hermann Hoppe. Un régal pour les réacs.
19:40 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, france, emmanuel macron, affaires européennes, statolâtrie, nicolas bonnal, libertariens, libertariens américains |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Cosaques: dans les deux camps de la guerre d'Ukraine

Cosaques: dans les deux camps de la guerre d'Ukraine
Dans l'histoire des cosaques, une relation ambivalente avec le pouvoir central russe était déjà une tradition avant Vladimir Poutine
Bodo Bost
Source: https://paz.de/artikel/in-beiden-lagern-des-ukrainekrieges-a6767.html
Dans les régions steppiques situées le long des fleuves frontaliers Volga, Don, Dniepr et Oural, les Cosaques ont constitué une force d'intervention rapide pour le tsar à partir du XVe siècle, mais ils n'ont jamais renoncé à leur liberté et à leur autonomie. Les Cosaques ont été la force motrice de la Russie dans la lutte contre son ennemi juré, les Tatars. Les Cosaques les ont vaincus parce qu'ils avaient eux-mêmes adopté leur mode de vie et s'étaient mélangés avec eux, tout en restant chrétiens.
Les Cosaques étaient à la fois des mercenaires et des "guerriers libres", ils combinaient un patriotisme fidèle à l'État et un fort amour de la liberté. C'est pourquoi ils sont restés suspects aux yeux des tsars. Les Cosaques aidaient les paysans qui voulaient se soustraire au servage des tsars et les vieux croyants qui ne voulaient pas suivre les réformes de l'Eglise orthodoxe d'Etat. Alors que certaines parties des Cosaques sont devenues des avant-postes coloniaux de la Russie, d'autres sont devenues des éléments porteurs des révoltes populaires régionales contre le tsar. Sous le régime soviétique, les Cosaques, qui avaient pour la plupart combattu aux côtés des ennemis des bolcheviks, sont devenus les ennemis publics numéro un.

Le Kremlin encourage le néo-cosaquisme
Seul Vladimir Poutine a redécouvert leur utilité guerrière et leur nationalisme. Même la fonction d'ataman, nom traditionnel du chef cosaque, a été réintroduite sous Poutine. L'ataman Nikolai Doluda (photo) a été nommé par Poutine à la tête de la Société cosaque de toute la Russie. Sous Poutine, les Cosaques sont mis à contribution pour l'éducation patriotique des jeunes et pour la fonction publique. L'offre va du jardin d'enfants à l'école en passant par les universités cosaques. Les associations de Cosaques sont même autorisées depuis quelques années à défiler lors de la grande parade militaire sur la place Rouge le jour de la victoire, bien que la majorité des Cosaques aient alors combattu dans la Wehrmacht contre l'Union soviétique.
Poutine avait remarqué qu'avec l'effondrement de l'Union soviétique, il manquait un élément fédérateur dans la société russe. Pour combler ce vide, il a encouragé l'Église orthodoxe et le cosaquisme.
Aujourd'hui, il existe plus de 2600 sociétés cosaques avec 170.000 membres en Russie, environ sept millions de Russes et plus d'un million d'Ukrainiens se sentent descendants des Cosaques. Le Kremlin encourage et utilise le néo-cosaquisme post-soviétique à ses propres fins.
Des unités cosaques ont été engagées dans toutes les guerres menées par la Russie depuis celle de 1992 en Transnistrie et autour de celle-ci. Elles n'ont échoué que lors des deux guerres de Tchétchénie de 1994 à 1996 et de 1999 à 2009. Le Caucase était pourtant l'une de leurs zones de combat traditionnelles.
L'histoire officielle de l'Ukraine, indépendante depuis 1991, se fonde également sur l'hetmanat des Cosaques zaporogues, fondé en 1648, bien que sous Catherine la Grande, l'hetmanat zaporogue, le cœur de l'Ukraine actuelle, soit devenu une province russe en 1765. Un retour aux traditions cosaques s'est exprimé lors des manifestations du Maïdan de Kiev fin 2013 sous la forme de tendances démocratiques de base et pro-occidentales. Une cinquantaine d'organisations cosaques ont soutenu et soutiennent encore l'intégrité territoriale de l'Ukraine pendant la guerre du Donbass et aujourd'hui contre la Russie.

Les Cosaques d'Ukraine défendent le pays
Sur le plan militaire, les associations cosaques sont toutefois plus actives du côté russe dans le conflit ukrainien qui a éclaté en 2014. 5000 citoyens ukrainiens ont combattu pour la cause russe en tant que membres d'associations cosaques dans les régions de Lougansk et de Donetsk. Cependant, lorsque les unités de volontaires ukrainiens ont progressé en 2015, certaines unités cosaques ont abandonné leurs positions dès les premiers tirs.
Surtout depuis la proclamation de la République populaire de Lougansk en 2014, l'Ataman Kositsyn espère, avec l'aide de sa Garde nationale cosaque, créer un hetmanat ukraino-russe dans le cœur du territoire des Cosaques du Don, soit la région de Rostov, dans la tradition de la République du Don qui existait à l'époque de la guerre civile russe de 1918 à 1920.
Cependant, pour de nombreux Russes, le défilé de cosaques n'est rien de plus qu'une mascarade historique, au mieux du folklore, même s'il est soutenu par le Kremlin. Même dans une région comme Krasnodar, autrefois un centre cosaque dans le sud de la Russie, où le soutien de l'État est particulièrement fort, les cosaques ne définissent plus aujourd'hui l'identité régionale, tout au plus le folklore. Le recours par l'État au symbole historique du cosaque n'est qu'une pièce de la mosaïque d'une évolution nationaliste et nostalgique par laquelle Poutine pousse la Russie encore plus loin dans l'isolement et la complaisance de soi.
18:56 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cosaques, russie, ukraine, traditions |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Le triangle de l'or noir. L'autre jeu de la Russie

Le triangle de l'or noir. L'autre jeu de la Russie
Lorenzo Vita
SOURCE : https://it.insideover.com/politica/sistema-petrolio-russo-cremlino-golfo.html
Le pétrole russe est au centre de la scène mondiale. Après le sixième train de sanctions contre Moscou, des sanctions nullement sévères mais néanmoins incisives, l'or noir est redevenu l'un des nœuds stratégiques des relations entre la Russie et l'Occident.
Mais le pétrole, peut-être plus que le gaz, ne concerne pas seulement la guerre diplomatique qui se joue entre le Kremlin et les chancelleries d'Europe et d'outre-mer. Pour Moscou, en effet, la question du pétrole a une portée qui passe aussi par les relations avec les États du Moyen-Orient, et en particulier avec les monarchies du Golfe. Un monde bien différent de celui représenté par le bloc euro-atlantique, mais qui, d'un point de vue économique et stratégique, représente une zone décisive pour les équilibres internationaux. Sur le plan énergétique, sur le plan financier, mais aussi sur le plan stratégique.
Ce n'est pas une coïncidence si le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, s'est rendu dans les pays arabes du Golfe Persique alors que les combats font encore rage en Ukraine. Une tournée qui, entre autres, est arrivée juste au moment de l'annonce des sanctions européennes sur le pétrole importé par voie maritime de Russie.

Le chef de la diplomatie russe est arrivé à Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite, en récoltant une victoire diplomatique particulièrement importante. Oui, le Golfe ne peut officiellement que condamner l'agression. Les pays du Conseil de coopération du Golfe ont exprimé une "position unifiée" sur la guerre en Ukraine et son "impact négatif". Et le ministre saoudien des Affaires étrangères, Faisal bin Farhan, a rappelé que même après la vidéoconférence avec le ministre ukrainien, Dmitro Kuleba, les chefs des diplomaties du Golfe avaient mis l'accent sur "la sécurité alimentaire dans les pays touchés et dans le monde". Mais surtout, le Conseil de coopération du Golfe a officialisé que, du moins pour l'instant, il n'imposera pas de sanctions contre Moscou. Et, comme le rapporte Al Arabya, Lavrov lui-même a exprimé la gratitude du gouvernement russe envers ces pays pour "la position équilibrée qu'ils adoptent sur cette question dans les forums internationaux, refusant de se joindre aux sanctions illégitimes et unilatérales de l'Occident qui ont été introduites contre la Russie".
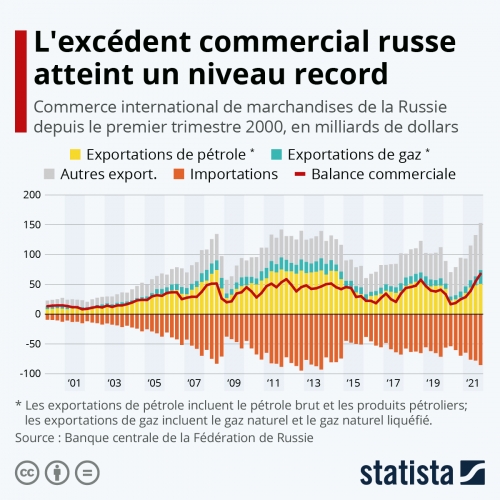
La prise de position n'est certainement pas mineure. Comme le rappelle Rosalba Castelletti dans Repubblica, le Wall Street Journal avait même craint, ces derniers jours, "une possible exclusion de Moscou du système de quotas du consensus élargi des producteurs de pétrole", c'est-à-dire l'Opec+. L'hypothèse du journal américain apparaît plutôt comme un vœu pieux, car elle aurait signifié une plus grande production des producteurs arabes afin de combler le vide laissé par un éventuel embargo sur la Russie. Mais ce que les Américains attendaient, ou suggéraient, n'est pas advenu. Ce n'est pas nouveau : le bloc des pays du Golfe, mais aussi l'Opep+ lui-même, ont toujours été très réticents à accepter un système de sanctions de type occidental, et surtout lié à des directives politiques qui ne cadrent pas avec les canons de la plupart des États producteurs de pétrole. Et en cela, Vladimir Poutine s'est certainement senti rassuré.
Une assurance qui découle non seulement de la tradition politique de l'Opep et des pays du Golfe, mais aussi des relations qui ont rapproché la Russie des monarchies de la région ces dernières années. Des relations qui vont de la guerre en Syrie à celle en Libye, des problèmes du Sahel à l'équilibre précisément du pétrole et notamment de son prix. Les relations entre ces gouvernements sont extrêmement complexes et articulées, au point qu'il est aujourd'hui difficile de trouver des questions purement bilatérales et homogènes. Et cela signifie que la synergie que l'on attend de l'Occident au Moyen-Orient ne peut être accueillie ici pour une série de facteurs humains, culturels, économiques et stratégiques indissociables.
Tout cela devient encore plus évident lorsque le pétrole est en jeu. Car dans ce cas, les intérêts deviennent mondiaux et pas seulement régionaux, affectant les relations que tous les pays entretiennent non seulement avec la Russie, mais aussi avec d'autres clients indirects. Le blocus du pétrole russe vers l'Europe par voie maritime, que certains ont appelé l'embargo sur les pétroliers, est déjà un exemple de ce qu'est réellement ce marché. Un système fait de triangulations dans lequel la Russie perd, bien sûr, mais dans lequel il y a le risque d'enrichir les autres. Le même Wall Street Journal a récemment raconté comment "des carburants supposés être partiellement produits à partir de pétrole brut russe ont atterri à New York et dans le New Jersey le mois dernier". Et tout cela en profitant des échanges des raffineries indiennes, qui achètent d'énormes quantités de brut russe à des prix inférieurs à ceux du marché. Dans l'anarchie de la mer, tout ceci peut se dérouler de manière légale, démontrant une fois de plus combien il est alors vraiment difficile d'identifier une matrice capable de cibler l'État sanctionné. Et dans l'intervalle, les relations construites au cours de ces décennies empêchent toute limitation réelle au détriment exclusif d'un pays.
Lorenzo Vita.
18:35 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, pétrole, pétrole russe, russie, monarchies du golfe, hydrocarbures, sanctions, sanctions antirusses |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
La bataille de l'opinion et de l'espace public
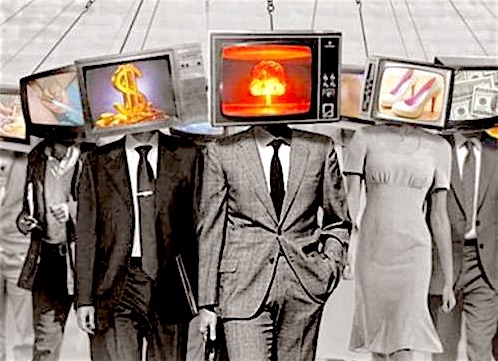
La bataille de l'opinion et de l'espace public
Lander Kerkhofs
Source: https://www.feniksvlaanderen.be/blog/931110_de-strijd-om-de-opinie-en-de-openbare-ruimte
Quelles sont les limites de la liberté d'expression ? Les universités et les médias grand public doivent-ils être ouverts à toutes les opinions ? Ou doivent-ils refuser les orateurs au nom de la démocratie et de la tolérance ? Une attitude ouverte les fait-elle faire partie d'une "brigade de normalisation de l'extrême droite" ? Ou bien font-ils le pont nécessaire pour transcender la polarisation de la société ? La question est de retour après n'avoir jamais vraiment disparu.
"Qu'est-ce qu'il y a dans un nom ?" / What's in a name?
Pour reprendre l'expression anglaise, what's in a name ?: Une avalanche de termes perdent rapidement leur sens et sont utilisés de manière inappropriée.
Un exemple frappant en est le terme "haine" et plus précisément : la propagation de la haine dans le but de miner la démocratie. La grande lutte fantôme contre le "fascisme". Ce ne sont là que quelques exemples des insultes qui sont invoquées à maintes reprises pour faire taire les opposants politiques.
Alors qu'y a-t-il de détestable dans un message partagé par quelque 25% du peuple flamand qui devraient être entendus lors de la formation d'un gouvernement ? N'est-ce pas là l'essence même de la démocratie, que ce sont les partis gagnants qui ont le dessus et non les partis qui perdent les uns après les autres depuis 30 ans ? L'extrémisme est-il alors le refus de recourir à la violence pour atteindre des objectifs ? Alors, d'où vient-elle cette violence politique de droite ? Reste-t-il vraiment un fascisme, sauf peut-être le gouvernement avec son élan vers l'autoritarisme et les mesures collectives pour exclure les non-vaccinés ?
Ceux qui veulent élever le spectacle de bretelles de Lieven De Boeve lors du carnavalesque défilé annuel de la Gay Pride à la norme sexuelle en Flandre décideront pour vous, à votre place, de ce que vous devez trouver de formidable. Vous-même n'aurez plus le droit de le faire.
La fausse justification de Popper
La justification intellectuelle que vous voyez alors émerger est celle du théoricien libéral Karl Popper. A savoir, qu'il faut limiter les avantages de la démocratie pour ceux qui la menacent. Karl Popper se référait en particulier aux exemples historiques d'Hitler, des staliniens, etc.
Il n'en est même pas question aujourd'hui, puisque les votes ici en Flandre, ou, par extension, en Belgique, n'appellent pas à l'abolition de la démocratie, mais au contraire à son renforcement par l'application du principe de subsidiarité, entre autres.
À propos, là où Karl Popper en tant que théoricien, et beaucoup de ceux qui le suivent, se sont trompés, c'est que leur vision de la démocratie est liée au principe du libéralisme. En fin de compte, démocratie et libéralisme sont tout le contraire l'un de l'autre. Avec son concept négatif de la liberté, le libéralisme a érodé la démocratie. Pour cette vision libérale de la démocratie, la libération de l'individu par rapport aux liens qui soudent la communauté est devenue le point central pour les libéraux poppériens, qui ne considèrent pas que la liberté individuelle découle de la croissance organique et des droits et devoirs de la communauté.
Plus encore que le concept erroné de liberté individuelle, le libéralisme a érodé les valeurs communes de la communauté afin de trouver facilement un consensus sur des questions éthiques et morales (non communautaires), par exemple. Ce n'est pas pour rien que le centre politique s'effondre autant dans les sondages.
Pourtant, la société ouverte, telle que définie au départ par Karl Popper, est très clairement la chose même que combattent les voix qui appellent au rétrécissement du débat public. À savoir, qu'en tant qu'être humain et en tant que société, vous êtes ouvert à l'imperfection des idées et des opinions. Pour Karl Popper, les ennemis de la société ouverte étaient les régimes qui n'étaient pas ouverts à l'idée qu'ils pouvaient y avoir de mauvaises idées. Prendre la fin de l'histoire comme point final était également, selon Karl Popper, basé sur la fausse supposition qu'à un moment donné, il y aurait une civilisation mondiale dans laquelle toutes les questions politiques auraient été résolues et combattues. C'était la tension et le prix que nous devons tous payer pour vivre dans une société ouverte. Peut-être que ceux qui pensent suivre aujourd'hui ce récit poppérien devraient être ouverts à la possibilité qu'ils aient pu un jour faire une erreur dans leur raisonnement. Reconnaître cela dans le monde réel, en dehors des idéaux abstraits aux objectifs éventuellement nobles, est précisément la meilleure défense d'une société ouverte.

Le chantage comme outil de guerre politique
La K.U.L. (Katholieke Universiteit Leuven) est sous les feux de la rampe aujourd'hui parce qu'elle offre, dit-on, une plate-forme à l'"extrême droite". Ne partent-ils pas du principe que les universitaires peuvent par eux-mêmes être critiques ? Ou pensent-ils que cette catégorie de la population est si impressionnable qu'elle est capable de sombrer dans l'extrémisme après une "fausse" conférence? Pour les personnes tolérantes et vertueuses qui se targuent d'avoir une image positive de l'humanité, un tel raisonnement ne serait pas de mise.
Bien sûr, il y a une autre stratégie derrière cela... Si vous pensez, par exemple, aborder leur récit d'une manière quelque peu critique, vous serez accueilli par un coup de la massue du politiquement correct. Vous êtes invariablement critiqué ou soupçonné d'appartenir secrètement au grand mouvement extrémiste qui connaît une recrudescence depuis 1946. L'idée derrière cela n'est pas si nouvelle et ne vient même pas à l'origine d'un cénacle d'incorrigibles féroces, mais plutôt des idées de Carl Schmitt selon lesquelles la démocratie libérale est en fait un système politique faible, à savoir que cette démocratie libérale est capable de se dissoudre elle-même. Schmitt affirme que la politique se définit à partir de ceux que nous considérons comme des amis et des ennemis. En d'autres termes, pour faire de la politique, il ne faut pas tant utiliser des arguments mais il faut plutôt définir une certaine image de l'ami et de l'ennemi. C'est à partir de cette ligne de démarcation que les mondialistes mènent la guerre politique. Dès que l'on peut attacher à un groupe ou à des personnes individuelles un terme hostile, qui ne doit certainement pas être basé sur des faits ou des arguments par souci de clarté, on n'a plus à s'occuper du contenu de leurs discours ou écrits et on s'arroge le droit d'utiliser tous les moyens pour leur nuire tels que le chantage ou la diffamation.

Un bon exemple de cela, outre les discussions classiques gauche-droite, est la manière dont les voix critiques au sein du débat sur l'affaire du Coronavirus ont été contrées au cours des deux dernières années. L'exemple archétypique de Sam Brokken (photo), chercheur au Collège universitaire PXL de Hasselt, a été disqualifié de son poste alors qu'on lui a donné raison par la suite. La stigmatisation des anti-vaxxers étaient la même que celle qui frappait les négateurs irrationnels de la science. Ce n'est pas une coïncidence si les théoriciens zélés de la conspiration cherchent à les lier les uns aux autres.
Le facteur de connexion
Il existe toujours un facteur de connexion, même si les acteurs tels que les journalistes, les politiciens, les scientifiques et les activistes ne se connaissent souvent pas. Qu'est-ce qui lie alors ces différents acteurs dans leur idéologie ? Ou, où se trouve laligne de démarcation politique, qui, finalement, n'est pas si nouvelle que cela ?
Tout d'abord, il y a le facteur unificateur que constitue l'image de l'ennemi. Les ennemis communs font souvent de bons amis, également en politique. Même lorsque l'histoire qui est écrite crée une image fantôme, à savoir que toute personne critiquant la migration de masse est un fasciste, que toute personne critiquant l'impérialisme des États-Unis et de l'OTAN est un partisan de Poutine et que toute personne critiquant l'approche coercitive des confinements et des vaccinations (semi-)obligatoires est un négateur de la science. Il est plus difficile de vendre ce que vous défendez que de se concentrer sur un ennemi commun et de faire partie d'une majorité imaginaire dans laquelle vous pouvez frapper vos adversaires politiques (souvent sans les connaître) à cœur joie.
Un deuxième facteur de connexion qui crée immédiatement une ligne de démarcation entre la foule et les voix critiques, d'une part, et celles du système politique, d'autre part, est la croyance en un être humain "socialement modifiable". Une croyance en un homme et une société socialement façonnées, sans plus de frontières et avec seulement des connexions artificielles. Du communisme utopique au transhumanisme en passant par un État mondial unipolaire dirigé par les puissances anglo-saxonnes, nous avons là des alliés parfaits en dépit des différences idéologiques. Même si ces idéologies (même résiduaires et marginales) ne sont soutenues que par une minorité absolue, qu'elles présentent des positions excessives et même très extrêmistes et qu'elles rencontrent une résistance intuitive de la part d'une partie toujours plus grande de la population, elles tentent de se présenter comme le centre de la société, ce qui peut pousser les autres (même majoritaires) à la marge.

Opinions dans l'espace public
Ils sont convaincus qu'il faut empêcher toutes les voix critiques, qui s'opposent à l'ingénierie sociale, de se faire entendre dans les universités, dans les médias et dans la rue. Ils ne croient plus que l'on puisse encore diriger la société en présentant des arguments, d'où ils recourent aux attaques toujours plus nombreuses contre des individus spécifiques. Ces individus sont ceux que les mondialistes appellent "la brigade de normalisation" de l'extrême-droite ou les intellectuels du mouvement wappie. Ces personnalités formeraient une communauté soudée, insufflant une nouvelle vigueur aux débats de société, alors que le gros de la population et même les tenants du pouvoir n'ont plus aucune foi dans les idéologies mainstream.
Pour le résumer par une citation de Hannah Arendt : "Il n'y a pas de pensées dangereuses, la pensée elle-même est dangereuse."
Lander Kerkhofs.
18:19 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, espace public, opinion publique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 06 juin 2022
Embargo pétrolier de l'UE: se tirer une balle dans le genou (ou un peu plus haut)

Guerre économique
Embargo pétrolier de l'UE: se tirer une balle dans le genou (ou un peu plus haut)
Thomas Röper
Source: https:// _wp_cron=1654348907.0830259323120117187500 & www.anti-spiegel.ru/2022/eu-oelembargo-der-schuss-ins-eigene-knie-oder-etwas-hoeher/?doing
Après un mois d'âpres négociations, l'UE s'est mise d'accord sur un mini-embargo pétrolier contre la Russie. Toutefois, l'embargo risque de toucher les citoyens de l'UE bien plus durement que la Russie.
Alors que la prospérité de l'Allemagne et d'autres pays de l'UE fond comme neige au soleil, l'UE vient d'adopter une mesure qui va fortement aggraver cette tendance.
La chute des revenus réels
Le revenu réel est défini comme suit :
"Le revenu réel est un indicateur qui représente le pouvoir d'achat en tenant compte de l'inflation. Il décrit donc la quantité de biens que l'on peut acheter sur le marché avec le revenu nominal "+.
En clair, le revenu réel décrit le pouvoir d'achat. Lorsque les revenus réels augmentent, les gens peuvent se permettre de dépenser plus, lorsqu'ils baissent, les gens s'appauvrissent, même si leurs salaires augmentent sur le papier mais qu'ils ne peuvent se permettre de dépenser plus en raison de la hausse des prix due à l'inflation.
En Allemagne, les revenus réels ont fortement baissé depuis 2020. Grâce aux mesures Covid, les revenus réels se sont effondrés de 4,7% au deuxième trimestre 2020. Il s'agit d'un record absolu, car la plus forte baisse des revenus réels en Allemagne à ce jour depuis 2000 a eu lieu suite à la crise financière de 2008: au deuxième trimestre 2009, les revenus réels ont baissé de 0,9%.
Ce que nous vivons depuis 2020 n'a jamais été observé depuis la dernière guerre en Europe et, de facto, les politiques ne font rien pour y remédier, mais continuent de prendre des décisions qui accélèrent même le processus. Au dernier trimestre, les revenus réels en Allemagne ont chuté de 1,8%, soit le troisième plus haut niveau depuis l'an 2000, après les 4,7% du deuxième trimestre 2020 et la baisse de 2% du premier trimestre 2021.
Ce à quoi nous assistons actuellement est un appauvrissement massif de larges couches de la population, comme le confirment les banques alimentaires. Ces dernières années, de plus en plus de personnes en Allemagne sont devenues dépendantes des banques alimentaires si elles ne veulent pas mourir de faim. La situation est donc, même si tous les Allemands ne le ressentent pas encore, particulièrement dramatique.

L'appauvrissement est fait maison
Les médias affirment que la pandémie de Covid est responsable de l'appauvrissement des années 2020 et 2021. Ce n'est pas vrai, car la raison de la baisse massive des revenus réels n'était pas le Covid-19, mais les mesures imposées par les gouvernements pour lutter contre le Covid-19. Ce n'était pas le virus qui était en cause, mais les fermetures massives d'entreprises dans le cadre des mesures de confinement.
Ce sont les mesures prises par les gouvernements qui ont provoqué l'appauvrissement, et pour une raison quelconque, les médias ne veulent pas le formuler ainsi. Entre-temps, des études de l'OMS montrent également que les mesures n'ont pas eu de succès sanitaires mesurables, car dans des pays comme la Suède, où il n'y a pratiquement pas eu de restrictions, la grande extinction de masse n'a pas eu lieu. En revanche, les pays qui ont renoncé à des mesures radicales - en Europe, on peut citer la Suède, la Biélorussie et la Russie comme exemples - ont beaucoup mieux traversé la pandémie sur le plan économique.
Maintenant que la pandémie est en grande partie surmontée, l'économie devrait normalement repartir à la hausse, mais l'UE et ses États membres continuent de prendre des décisions qui vont poursuivre et même accélérer l'appauvrissement. Les Allemands en font déjà l'expérience depuis des mois avec l'augmentation du prix du gaz et donc du coût de l'électricité et du chauffage. Cette évolution a commencé dès 2021 et j'ai signalé depuis l'été 2021 que l'UE avait elle-même créé ce problème.
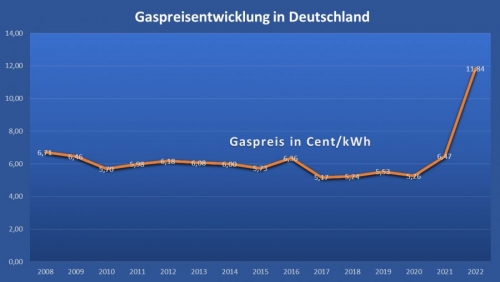
Les "médias de qualité" n'ont découvert le sujet qu'à partir d'octobre 2021, lorsque les gens ont commencé à le ressentir. J'ai décrit très souvent pourquoi la hausse des prix du gaz est un problème créé par l'UE, pour ne pas le répéter, vous pouvez le lire sur mon site (cf. supra), si c'est nouveau pour vous.
L'"embargo pétrolier"
Maintenant, après presque un mois de querelles, l'UE s'est mise d'accord sur un embargo pétrolier contre la Russie, bien qu'il soit difficile de le qualifier ainsi. Les points essentiels sont que l'UE n'importera plus de pétrole russe livré par pétroliers. Et ce, seulement à partir de la fin de l'année.
Cette mesure aura pour conséquence que les pays de l'UE importeront probablement plus de pétrole de Russie d'ici là afin de constituer des réserves. La Russie peut donc se réjouir d'une demande plus élevée et de prix plus élevés.
D'ici la fin de l'année, les marchés pétroliers internationaux seront donc perturbés, car l'UE devra trouver de nouveaux fournisseurs pour remplacer le pétrole russe, sous la pression du temps. La Russie devra également trouver de nouveaux acheteurs, mais cela devrait être plus facile pour elle que de trouver de nouveaux fournisseurs pour les Européens. Comme l'UE est pressée par le temps, elle sera inévitablement obligée de proposer des prix plus élevés, ce dont la Russie peut se réjouir, des prix en hausse sur les marchés mondiaux permettront à la Russie de vendre son pétrole à ses nouveaux clients pour plus d'argent également.
La stupidité de la Commission européenne
C'est la Commission européenne qui a voulu imposer l'embargo sur le pétrole à tout prix, mais certains pays de l'UE ne voulaient pas d'embargo sur le pétrole, l'exemple le plus connu étant la Hongrie. Comme l'UE doit prendre de telles décisions à l'unanimité, la Hongrie pouvait demander des exceptions pour elle-même et elle l'a fait. La Hongrie (ainsi que la République tchèque et la Slovaquie) n'a pas de ports et dépend donc du pétrole amené par l'oléoduc russe. Par conséquent, l'"embargo pétrolier" de l'UE ne concerne que le pétrole livré par navires-citernes. Le pétrole russe acheminé par oléoduc peut continuer à être importé. La Hongrie a donc obtenu gain de cause.
Mais il y a mieux : si l'UE ne parvient pas à remplacer entièrement le pétrole russe livré par tankers d'ici la fin de l'année, la Hongrie devrait devenir un vendeur de pétrole russe, car elle pourra, si nécessaire, importer plus de pétrole via l'oléoduc russe qu'elle n'en consomme elle-même. Comme le pétrole russe acheminé par oléoduc devrait également être moins cher que le pétrole commandé dans l'urgence et livré par tankers, je suis prêt à parier qu'à la fin de l'année et au début de l'année 2023, nous verrons la Russie pomper plus de pétrole dans ses oléoducs vers l'Europe, plutôt que moins.
Ce que la Commission européenne a fait passer en force et qu'elle appelle "l'embargo pétrolier" va très probablement rapporter à la Russie plus d'argent qu'elle n'en a gagné jusqu'à présent sur son pétrole, car les prix du pétrole vont augmenter. De plus, le pétrole russe continuera d'arriver en Europe par les oléoducs. Voilà ce que j'appelle un embargo efficace !
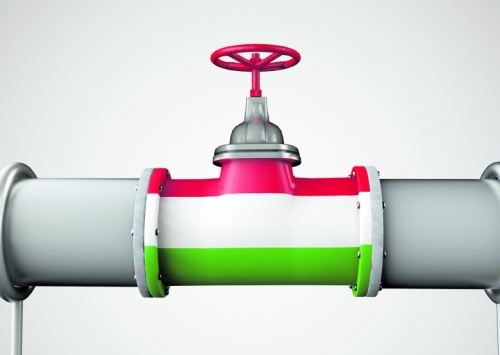
Le conflit au sein de l'UE va même si loin que des pays comme la Grèce ou Chypre ont pu obtenir que leurs pétroliers puissent continuer à transporter du pétrole russe, par exemple pour le vendre en Inde ou dans d'autres pays. Voilà ce que j'appelle un embargo pétrolier contre la Russie ! Ou est-ce plutôt un embargo de l'UE contre elle-même ?
Les pétroliers européens ne transporteront bientôt plus le pétrole russe vers l'UE, mais vers l'Asie, où les pays paieront probablement plus que ce que les États membres de l'UE ont payé jusqu'à présent, en raison des bouleversements attendus sur le marché international du pétrole. Cela ne manquera pas d'énerver Poutine.
C'est vous qui payez la facture !
En revanche, la Commission européenne a réussi à faire en sorte que le prix du pétrole continue à augmenter, ce qui entraînera inévitablement une nouvelle hausse de l'inflation en Europe, qui bat déjà régulièrement de nouveaux records. En effet, le prix du pétrole n'est pas seulement synonyme de hausse du prix de l'essence, mais aussi de hausse du prix de tout.
Lorsque l'essence et le diesel deviennent plus chers, les prix de tout augmentent, car les marchandises que vous achetez dans les magasins sont transportées par camion, entre autres, et cela devient plus cher. De plus, les prix de l'énergie continuent d'augmenter, ce qui rend la production de tous les biens plus chère, car rien ne peut être produit sans énergie.
Il est donc aussi certain que le fameux "Amen à l'église" que l'inflation va continuer à augmenter (ou du moins rester très élevée) et que, par conséquent, les revenus réels vont continuer à baisser. En d'autres termes, vous, vos amis et vos voisins, ainsi que tous les autres consommateurs, payez la facture de la politique insensée de la Commission européenne et l'appauvrissement ne fera qu'augmenter.
Au slogan lancé par les Verts "geler contre Poutine" s'ajouteront probablement des slogans tels que "avoir faim contre Poutine" ou "s'appauvrir contre Poutine". Un commentateur de la télévision russe vient de commenter la politique de l'UE en ces termes :
"Pour faire chier Moscou, on va se geler les oreilles, on va affamer le monde pour... Oui, pour faire quoi ? Ce n'est pas vraiment clair".

Pénurie d'essence en été ?
Der Spiegel a interviewé le chef de l'Agence internationale de l'énergie, qui prévient qu'il pourrait y avoir une pénurie d'essence, de diesel et de kérosène cet été. Nous ne parlons donc pas seulement de prix plus élevés, mais même du risque que les stations-service européennes manquent d'essence pendant la saison des vacances d'été. Et ce n'est pas la méchante propagande russe qui le dit, c'est l'Agence internationale de l'énergie.
En Russie, on ne peut que secouer la tête, car ce que fait la Commission européenne est presque un suicide économique. Elle a d'abord abattu l'économie avec les mesures Covid et maintenant, alors que l'économie pourrait se redresser, elle lui donne un coup de boule avec ses mesures énergétiques et ses sanctions contre la Russie.
Mais selon les médias, la Commission européenne n'est pas à blâmer. Au début, c'était la faute du Covid, alors que ce sont les mesures Covid qui ont abattu l'économie. Maintenant, c'est prétendument la faute de Poutine, alors qu'en réalité, ce sont les sanctions anti-russes, totalement incongrues, qui créent les problèmes dont souffrent de plus en plus les Européens.
À qui cela fait-il le plus mal ?
Bien sûr, les sanctions créent des problèmes pour la Russie, cela ne fait aucun doute. Mais je vis en Russie et dans la vie de tous les jours, on ne remarque presque rien des sanctions. Certes, de nombreux prix ont brièvement augmenté en mars lorsque le rouble s'est effondré, mais entre-temps, le rouble ne s'est pas seulement redressé, il a tellement augmenté par rapport à l'euro que le rouble est jusqu'à présent la monnaie la plus forte du monde cette année. Par conséquent, l'inflation en Russie est à nouveau en baisse.
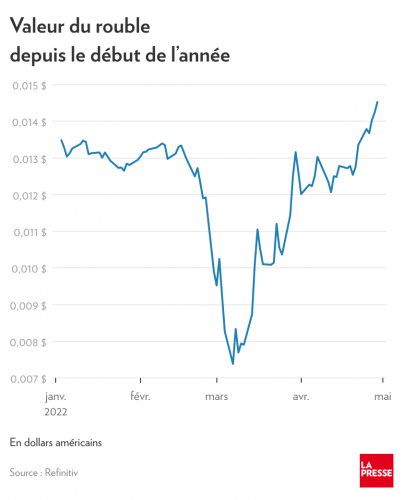
Comment cela s'accorde-t-il avec les prévisions des experts occidentaux du début du mois de mars, selon lesquelles les sanctions occidentales allaient rapidement anéantir l'économie russe, dévaluer complètement le rouble et conduire la Russie à la faillite ?
En Russie, l'essence coûte l'équivalent de 80 centimes d'euro et son prix en roubles n'a pas changé. Les rayons des supermarchés en Russie sont pleins, à aucun moment il n'y a eu de pénurie de quoi que ce soit (ou d'huile de tournesol, etc.). La population russe ne ressent guère les sanctions et pour compenser les hausses de prix qui ont eu lieu en mars, le gouvernement russe a décidé d'augmenter les prestations sociales au 1er juin. Parmi celles-ci, il y a d'ailleurs une augmentation des retraites de 10%. Quand cela a-t-il été fait pour la dernière fois en Allemagne ou dans d'autres pays européens ?
Et si vous pensez que les retraites en Russie ne sont pas suffisantes pour vivre, vous êtes encore victime de vieux préjugés. Les retraités russes peuvent désormais se permettre à peu près la même chose que les retraités européens, car ils bénéficient de toutes sortes de réductions et ont donc des frais nettement moins élevés que les retraités européens. J'en ai déjà parlé en détail, mais si c'est nouveau pour vous, vous pouvez le lire sur mon site (cf. supra).
Je ne peux pas le qualifier autrement: l'UE est en train de se tirer une balle dans le genou, ou comme Poutine l'a dit il y a quelque temps à propos des sanctions américaines : "Ils ne se tirent pas seulement une balle dans le genou, mais un peu plus haut" (ndt: et risquent d'atteindre l'artère fémorale...).
17:38 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europe, russe, affaires européennes, commission européenne, embargo pétrolier, sanctions, sanctions antirusses, inflation, pétrole, gaz, hydrocarbures |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Vers une "RAF verte" ?

Mouvement pour le climat
Vers une "RAF verte" ?
Des militants radicaux pour le climat appellent à des actes de violence
Robert Mühlbauer
Source: https://paz.de/artikel/kommt-eine-gruene-raf-a6935.html
Une partie du mouvement pour la sauvegarde du climat se radicalise, appelle à la violence et aux actes de sabotage et bénéficie encore et toujours du soutien des médias établis. Ainsi, le marxiste et activiste climatique suédois Andreas Malm (photo) a récemment été autorisé à publier un pamphlet de plusieurs pages dans le Spiegel, dans lequel il faisait la promotion d'actions militantes. Selon lui, face à la progression du réchauffement climatique, les formes de protestation démocratiques et légales ne suffisent plus. "Nous n'avons pas besoin de grands concepts pour nous rendre compte que seuls le sabotage et les dégâts matériels sont désormais utiles. C'est le capital fossile lui-même et les réalités qu'il a créées qui nous y poussent", écrit l'auteur, présenté avec bienveillance par le "Spiegel" comme le "maître à penser d'un mouvement climatique radical".

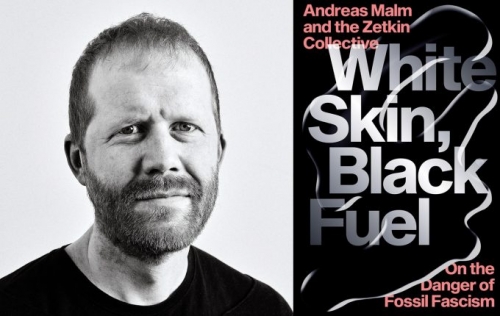
Les premières actions violentes ont déjà eu lieu : Malm rappelle "Ende Gelände", qui voulait occuper par la force une mine à ciel ouvert, les "Fridays for Sabotage", qui ont endommagé des infrastructures gazières, ou le dégonflage des pneus des véhicules SUV. Malm considère comme un fanal de la lutte pour le climat une attaque menée en février par des activistes anonymes cagoulés sur un site de construction de pipeline de l'Ouest canadien, sur la rivière Wedzin Kwa en Colombie Britannique. "Ils ont détruit des bulldozers et des camions et fracassé d'autres machines, des générateurs, de l'équipement lourd et des remorques". Les dégâts matériels se sont élevés à plusieurs millions de dollars. Malm invite ouvertement ses amis à commettre davantage de sabotages de ce type.
Sabotage et dommages matériels
La vice-présidente de l'AfD, Beatrix von Storch, a annoncé qu'elle porterait plainte contre l'"extrémiste climatique" pour incitation au crime (article 111 du code pénal). Le fait que le "Spiegel" publie l'appel de Malm au sabotage et à la destruction de biens sans aucune prise de distance critique, ce qui peut être considéré comme une approbation. Le magazine d'information de centre-gauche avait déjà eu peu de scrupules à publier des pamphlets extrémistes. En 1970, le magazine de Hambourg avait publié le tristement célèbre essai d'Ulrike Meinhof intitulé "Natürlich kann geschossen werden" (Bien sûr, on peut tirer), qui a été à l'origine des autres actes de la RAF. Meinhof est entrée dans une frénésie de haine avec des déclarations telles que "Les flics sont des porcs, nous disons que tout type en uniforme est un porc, ce n'est pas un être humain, et c'est ainsi que nous devons nous occuper de lui". Selon lui, il est erroné de parler avec les "flics", on ne peut que tirer.
Certes, le radical de gauche suédois, à qui le "Spiegel" offre désormais une grande tribune, s'efforce de prendre formellement ses distances avec tout plaidoyer visant à infliger des dommages corporels. Aucune personne ne devrait être attaquée physiquement . Mais certains militants du mouvement radical pour le climat ont pourtant déjà franchi cette limite. Lors d'affrontements entre des occupants de mines à ciel ouvert ou de forêts, ils ont attaqué des policiers. Malm lui-même rappelle le militant allemand pour le climat Tadzio Müller (photo) qui - toujours dans le Spiegel - prédisait l'année dernière qu'une partie de la jeunesse, qui milite pour le climat, était en train de se radicaliser au point de pouvoir créer à terme une "RAF verte". "Celui qui empêche la protection du climat contribue indirectement à créer la future RAF verte. Ou des cellules de partisans clandestins et climatistes", a déclaré ce conférencier de longue date de la Fondation Rosa Luxemburg.

Prétendument en état d'urgence
La plupart des penseurs du mouvement climatiste extrême s'efforcent d'éviter tout parallèle avec l'évolution vers la violence terroriste qu'avait connue la RAF en s'attaquant à des personnes concrètes. La RAF déshumanisait les policiers, les chefs d'entreprise ou les hommes politiques, qu'elle faisait abattre en tant que représentants du "système". "Les gens ne sont pas le problème", écrit aujourd'hui Malm dans le Spiegel. Il serait "gravement préjudiciable à la lutte pour le climat que des activistes franchissent cette limite - par exemple en attaquant des mineurs dans les gisements charbonniers ou en assassinant des cadres du secteur pétrolier". La question est de savoir si tout le monde pense ainsi.
Des activistes climatiques complètement excités et aveuglés par des idées apocalyptiques délirantes pourraient à un moment donné franchir cette limite. De toute façon, beaucoup ont déjà renoncé aux méthodes démocratiques et légales. Lorsque les protestations démocratiques ne leur permettent pas d'avancer, ils parlent de "changer de système" - c'est le cas de la militante de "Fridays for Future" Luisa Neubauer, qui a parfois exprimé sa sympathie pour la manière dont la Chine, pays à économie communiste planifiée, transforme son économie et son approvisionnement énergétique, soi-disant beaucoup plus rapidement et efficacement que l'Occident. Les activistes qui évoquent en permanence la fin du monde à cause du changement climatique pensent pouvoir en tirer une sorte de justification pour la transgression des lois. La Terre est en feu, l'urgence climatique n'a pas de délai. Ils s'imaginent être dans une situation d'urgence qui nécessite d'enfreindre la loi.
16:20 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Ecologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, allemagne, europe, affaires européennes, militants climatistes, raf, raf verte, verts, andreas malm |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
La guerre hybride: encadrer le discours

La guerre hybride: encadrer le discours
Leonid Savin
Source: https://www.geopolitika.ru/article/gibridnaya-voyna-teper-uzhe-diskurs-freym
Outre les militaires de haut niveau et les décideurs politiques, des institutions et organisations de recherche occidentales s'impliquent dans l'étude du phénomène de la guerre hybride (qui est devenu un domaine interdisciplinaire). L'Université arctique norvégienne, par exemple, dispose d'un groupe de recherche sur la zone grise et la guerre hybride. Il compte 20 membres, dont sept professeurs. Les domaines de recherche comprennent la géopolitique, la technologie, le droit et la sociologie. Les résultats sont des propositions de gestion des conflits, de stratégies, de défense, etc. Le site Web du groupe indique que "nous explorons à la fois la manière dont ces concepts sont définis et compris, ainsi que les différentes menaces et la manière dont elles sont perçues, de l'individu et du public aux niveaux national et international. Nos sujets de recherche incluent : "Personnes", "Géopolitique", "Droit" et "Technologie". Nous examinons les différentes manières de gérer les menaces, les crises et les guerres possibles, y compris la préparation locale et la confiance du public, les stratégies de préparation nationales, la défense commune, les approches pan-gouvernementales et intégrées. Nous souhaitons comprendre les complexités du vaste tableau des menaces, de l'utilisation de la désinformation et des opérations psychologiques/d'information aux cyberattaques sur les infrastructures et aux incursions militaires qui conduisent à l'érosion de la confiance et de la sécurité dans les sociétés" (1).
L'une des publications d'un auteur de ce groupe, Krister Pursiainen (photo), porte sur l'infrastructure critique de la Russie (2). Elle fournit une analyse des définitions, une liste des installations et des structures qui traitent de la sécurité dans leur domaine.
La responsable du groupe, le professeur Gunhild Hoogensen Gjorv, est également l'une des responsables du groupe international EU-HYBNET, un réseau paneuropéen de lutte contre les menaces hybrides qui est financé par la Commission européenne dans le cadre du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'UE et lancé en mai 2020 (le projet lui-même est d'une durée de 60 mois, soit cinq ans). Le projet est coordonné par l'Université des sciences appliquées d'Espoo, en Finlande.

Le réseau comprend le Centre d'excellence européen pour les menaces hybrides (European Hybrid CoE (3), le Centre de ressources communes de la Commission européenne (4), l'Organisation européenne pour la sécurité (5) représentant la communauté des chercheurs et des CSI de 15 pays de l'UE, la Plate-forme polonaise pour la sécurité intérieure et plusieurs autres institutions, organisations et agences gouvernementales de toute l'Europe.

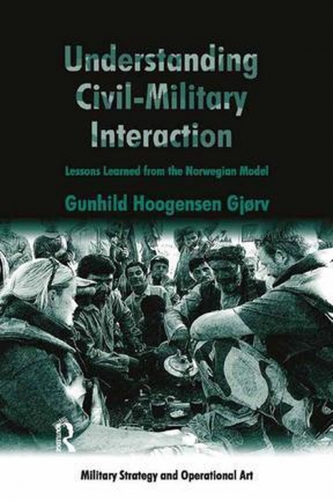
Il ressort de ces publications que les auteurs de l'équipe de recherche de l'Université de l'Arctique adoptent une large approche interdisciplinaire. Par exemple, dans une publication, Gunhild Hoogensen Gjorv (photo) écrit que "bien qu'il n'existe pas de définition convenue des menaces et/ou de la guerre hybrides, certaines caractéristiques peuvent être mises en évidence. En général, la guerre hybride 1) utilise une combinaison de techniques militaires et non militaires, englobant les domaines militaire, politique, économique, civil et de l'information ; 2) l'adversaire est souvent caché ou dispersé et peut être un acteur étatique ou non étatique (ou les deux) ; 3) elle contrôle le récit par des combinaisons d'informations et de désinformation ; 4) elle utilise des cyberattaques contre des infrastructures critiques ; 5) elle est conçue pour déstabiliser ou affaiblir la cible, ce qui se traduit par des attaques souvent inférieures aux "seuils définis par l'article 5 de l'OTAN". En bref, cela conduit à une distinction floue entre la paix et le conflit. La guerre hybride s'appuie fortement sur des sphères non militaires. Les civils jouent un rôle central dans le conflit en tant que source de vulnérabilité sociopolitique potentielle pour la société et en tant que cibles de menaces et d'attaques non militaires, y compris de campagnes de désinformation" (6).
Un autre article examine la question du genre dans le contexte des menaces hybrides. Il indique que "la dynamique qui sous-tend les menaces hybrides démontre la complexité des différentes manières dont le genre et les autres marqueurs d'identité sont définis et manipulés pour atteindre des objectifs spécifiques. Le genre est un concept relatif dont la construction varie en fonction de l'espace géographique et du temps. L'influence des constructions de genre doit être comprise en relation avec d'autres catégories et hiérarchies de pouvoir socialement construites, telles que la race et la classe. La conceptualisation et la définition du genre sont très fluides et dynamiques, en fonction des événements et des acteurs impliqués dans le processus de construction. Les catégories de genre peuvent être manipulées et modifiées dans les discours, utilisées en politique ou reconstruites par les individus et les communautés pour répondre à la vulnérabilité sociale. Les menaces hybrides ... montrent comment le genre est complexe et s'entrecroise avec d'autres identités. Dans les situations de menace qui se concentrent sur les identités (généralement) marginalisées ou non dominantes, l'identité de l'autre est créée par rapport à soi-même et posée comme anormale, ne correspondant pas au groupe dominant" (7).
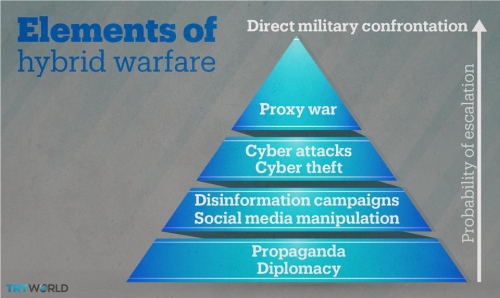
Il convient de noter que l'article fait référence à des dimensions mondiales, ce qui indique une tentative des pays de l'OTAN d'élaborer un plan d'action en dehors de leur domaine d'expertise. "L'utilisation d'approches intersectorielles de l'analyse nous permet de comprendre des régions plus vastes et plus complexes qui sont de plus en plus ciblées par des menaces hybrides. Mais nous devons aller plus loin. Certaines recherches s'accumulent sur les démocraties du nord du monde, mais on en fait moins sur le sud du monde, où un nombre croissant de nouvelles démocraties émergentes peuvent être extrêmement vulnérables à d'éventuelles opérations d'influence et de désinformation. Il existe une lacune dans la littérature qui explore les divers aspects des menaces et des guerres hybrides dans le sud du monde, en particulier en Afrique. La littérature existante sur les cas africains fait très peu de recherches sur la mesure dans laquelle la technologie affecte les institutions, la gestion de crise ou les normes (et vice versa) " (8).
Étant donné l'activisme politique des États-Unis dans la diffusion de l'idéologie des minorités sexuelles sous le couvert de la normalité, on peut dire que la Maison Blanche et le Département d'État américain mènent une guerre hybride en instrumentalisant le genre comme objectif politique.
Le numéro de février 2022 de leur lettre d'information aborde le thème de la manipulation et de l'interférence des informations. "L'action proposée est considérée comme un moyen de renforcer la réponse paneuropéenne aux menaces hybrides survenant dans le domaine de l'information. En outre, les actions proposées pourraient être un moyen de soutenir la mise en œuvre du système d'alerte rapide des États membres de l'UE et la mise en œuvre du plan d'action de l'UE pour la démocratie, axé sur la "lutte contre la désinformation, l'ingérence étrangère et les opérations d'ingérence dans l'information". La solution proposée contribuerait également aux actions prévues dans la stratégie de sécurité de l'UE en mettant l'accent sur les menaces hybrides.
Un autre membre du groupe, Arsalan Bilal, a publié son texte directement sur le site de l'OTAN. Il stipule que "la guerre hybride implique l'interaction ou la fusion d'instruments de pouvoir conventionnels et non conventionnels et d'instruments de subversion. Ces outils se combinent de manière synchronisée pour exploiter les vulnérabilités de l'antagoniste et obtenir des effets synergiques. L'objectif de la combinaison d'outils cinétiques et de tactiques non cinétiques est d'infliger des dommages à l'État en guerre de manière optimale. En outre, la guerre hybride présente deux caractéristiques distinctives. Premièrement, la frontière entre la guerre et le temps de paix devient floue. Cela signifie qu'il est difficile de définir ou de distinguer le seuil de la guerre. La guerre devient insaisissable car elle est difficile à mettre en œuvre.
La guerre hybride en deçà du seuil de la guerre ou de la violence ouverte et directe rapporte des dividendes, même si elle est plus facile, moins chère et moins risquée que les opérations cinétiques. Il est beaucoup plus facile, disons, de parrainer et de diffuser de la désinformation en collaboration avec des acteurs non étatiques que d'introduire des chars sur le territoire d'un autre pays ou de faire voler des avions de chasse dans son espace aérien. Les coûts et les risques sont sensiblement moindres, mais les dégâts sont réels. La question clé ici est : peut-il y avoir une guerre sans hostilités directes ou confrontation physique ? Étant donné que la guerre hybride imprègne les conflits interétatiques, on peut répondre à cette question par l'affirmative. Elle reste également étroitement liée à la philosophie de la guerre. L'art suprême de la guerre consiste à soumettre l'ennemi sans combattre, comme le suggérait l'antique stratège militaire chinois Sun Tzu.
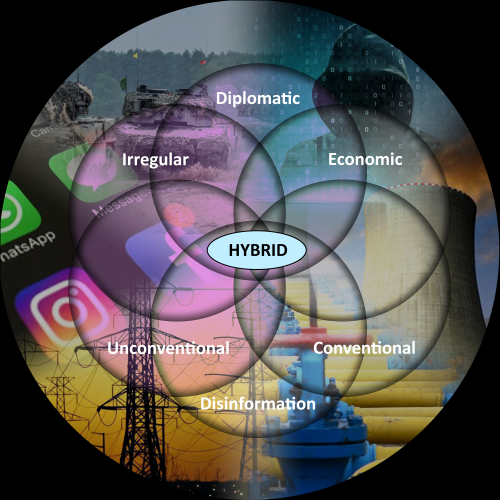
La deuxième caractéristique déterminante de la guerre hybride concerne l'ambiguïté et l'attribution. Les attaques hybrides ont tendance à se caractériser par une grande ambiguïté. Cette ambiguïté est délibérément créée et étendue par les acteurs hybrides afin de compliquer l'attribution ainsi que la réponse. En d'autres termes, le pays visé est soit incapable de détecter l'attaque hybride, soit incapable de l'attribuer à un État susceptible de la perpétrer ou de la parrainer. En utilisant les seuils de détection et d'attribution, l'acteur hybride rend difficile pour l'État cible l'élaboration de réponses politiques et stratégiques... La guerre hybride rend la dynamique du conflit peu claire non seulement parce qu'elle offre une boîte à outils vaste et en expansion pour miner l'ennemi, mais aussi parce qu'elle permet de miner sa sécurité sur deux fronts simultanément. Cela s'applique également aux objectifs primordiaux de la guerre hybride. Le front des capacités exploite les vulnérabilités de l'État cible dans les sphères politique, militaire, économique, sociale, informationnelle et infrastructurelle jusqu'à l'affaiblir de manière tangible et fonctionnelle" (10).
Bilal qualifie le paysage complexe du conflit lui-même de zone grise, confondant ainsi les deux concepts. Selon cette approche, une guerre hybride elle-même peut se dérouler dans une zone grise, tandis que la zone grise crée par conséquent les conditions d'une guerre hybride.
Ensuite, selon la logique de Bilal, la Russie n'a pas mené de guerre hybride contre l'Ukraine en 2014, lorsque les troupes russes sont arrivées en Crimée, car il s'agit d'un niveau différent et évident d'utilisation des forces armées. Mais alors, pourquoi les représentants de l'OTAN et de l'Ukraine ont-ils constamment accusé la Russie de mener une guerre hybride ? La pluralité des interprétations de ce terme continue de différer de façon spectaculaire.
Les chercheurs de l'Université de la défense nationale de Suède ont également tendance à confondre zone grise et guerre hybride. Dans une monographie sur le sujet, ils écrivent que "l'environnement de sécurité internationale a évolué ces dernières années en une zone instable et de plus en plus grise de guerre et de paix. Les défis de sécurité posés par les menaces et les guerres hybrides figurent désormais en bonne place sur l'agenda de la sécurité dans le monde entier. Cependant, malgré l'attention et le nombre croissant de recherches sur des questions spécifiques, il existe un besoin urgent de recherches qui attirent l'attention sur la façon dont ces questions peuvent être abordées afin de développer une approche globale pour identifier, analyser et contrer la violence liée au sexe" (11).
Il est intéressant de noter qu'un chapitre a inclus le référendum catalan sur l'indépendance en Espagne parmi les cas de guerre hybride. Cependant, il a été déclaré (sans aucune preuve) que les forces de sécurité russes étaient impliquées dans ce projet.
Ainsi, nous pouvons constater que la guerre hybride en Occident devient un concept de plus en plus confus et flou, mais de plus en plus commode à utiliser à des fins politiques, car pratiquement n'importe quel domaine de la vie peut être attribué à la guerre hybride et ainsi justifier l'ingérence des gouvernements dans la vie privée, restreindre les droits et libertés des citoyens, et justifier leurs propres échecs, leur corruption et leur ignorance par certaines menaces hybrides émanant d'autres États.
Sources :
1) https://uit.no/research/thegreyzone
2 Christer Pursiainen. Russia’s Critical Infrastructure Policy: What do we Know About it? European Journal for Security Research (2021) 6:21–38. https://doi.org/10.1007/s41125-020-00070-0
4 https://ec.europa.eu/info/index_en
6 Gunhild Hoogensen Gjørv. Hybrid Warfare and the Role Civilians Play, Aug 2, 2018.
https://www.e-ir.info/2018/08/02/hybrid-warfare-and-the-r...
7 Jane Freedman, Gunhild Hoogensen Gjørv, Velomahanina Razakamaharavo. Identity, stability, Hybrid Threats and Disinformation // Icono 19 (1), 2021. Р. 43. doi:10.7195/ri14.v19i1.1618
https://uit.no/Content/713066/cache=20210201130129/2021%2...
8 Ibidem. Р. 61.
9 EU-HYBNET Policy Brief No3. Information Manipulation and Interference. Empowering a Pan-European Network to Counter Hybrid Threats, February 2022. Р. 4.
https://euhybnet.eu/wp-content/uploads/2022/02/EU-HYBNET_...
10 Arsalan Bilal. Hybrid Warfare – New Threats, Complexity, and ‘Trust’ as the Antidote. 30 November 2021.
https://www.nato.int/docu/review/articles/2021/11/30/hybr...
11 Niklas Nilsson, Mikael Weissmann, Björn Palmertz, Per Thunholm and Henrik Häggström. Hybrid Warfare - Security and Asymmetric Conflict in International Relations. Bloomsbury Publishing, 2021.
14:16 Publié dans Actualité, Définitions, Militaria | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : leonid savin, guerre hybride, guerre, militaria |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 05 juin 2022
Alexandre Douguine: la philosophie gagnante
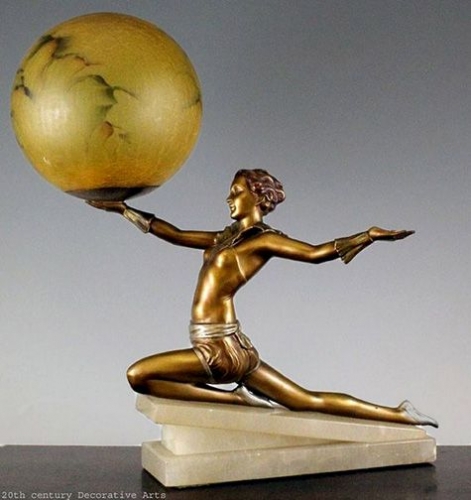
La philosophie gagnante
Alexandre Douguine
Source: https://www.geopolitika.ru/en/article/winning-philosophy?fbclid=IwAR0XdgpI5Ub792MgePrqc09IXFY3Ryt4BTMcLvSOX0EdASDw-j3DGR-bXjo
Des réformes internes significatives devraient logiquement commencer en Russie. C'est ce qu'exige l'OMS, qui, à l'extrême, a aggravé les contradictions avec l'Occident - avec toute la civilisation occidentale moderne. Aujourd'hui, tout le monde peut voir qu'il n'est plus sûr d'utiliser simplement les normes, les méthodes, les concepts, les produits de cette civilisation. L'Occident répand son idéologie en même temps que ses technologies, imprégnant toutes les sphères de la vie. Si nous nous reconnaissons comme faisant partie de la civilisation occidentale, nous devrions accepter volontairement cette colonisation totale et même en profiter (comme dans les années 1990), mais dans le cas de la confrontation actuelle - qui est fatale ! - cette attitude est inacceptable. De nombreux occidentaux et libéraux en ont pris pleinement conscience et ont quitté la Russie au moment même où la rupture avec la civilisation occidentale était devenue irréversible; et la situation est bel et bien devenue irréversible le 24 février 2022, et même deux jours plus tôt - au moment de la reconnaissance de l'indépendance de la RPD et de la RPL - le 22 février 2022.
En principe, chacun a le droit de faire un choix de civilisation entre la loyauté et la trahison. Le libéralisme est en train de perdre en Russie et les libéraux sont cohérents lorsqu'ils partent. C'est plus compliqué avec ceux qui sont encore là. Je fais référence aux Occidentaux et aux libéraux qui partagent encore les normes de base de la civilisation occidentale moderne, mais qui, pour une raison quelconque, continuent à rester en Russie malgré le fossé qui s'est déjà formé entre la Russie et l'Occident; ils constituent le principal obstacle à des réformes patriotiques authentiques et significatives.
Les réformes sont inévitables car la Russie se retrouve non seulement coupée de l'Occident, mais essentiellement en guerre avec lui. À la veille de la Grande Guerre patriotique, l'URSS disposait d'un nombre suffisant d'importantes entreprises stratégiques créées par l'Allemagne nazie, et les relations entre l'URSS et le Troisième Reich n'étaient pas particulièrement hostiles ; mais après le 22 juin 1945, la situation a évidemment changé radicalement. Dans ces circonstances, la poursuite de la coopération avec les Allemands - légitime et encouragée avant la guerre - a pris une toute autre signification. Il s'est passé exactement la même chose après le 22 février 2022: ceux qui ont continué à rester dans le paradigme de la civilisation hostile - libérale-fasciste - avec laquelle nous étions en guerre, se sont retrouvés en dehors de l'espace idéologique qui avait clairement émergé avec le début de la Seconde Guerre mondiale.
Entre-temps, la présence de l'Allemagne à la veille de la Seconde Guerre mondiale a été identifiée en URSS, tandis que la présence de l'Occident libéral-fasciste russophobe à la veille de l'OMS était presque totale. Les technologies méthodologiques, les normes, le savoir-faire et, dans une certaine mesure, les valeurs occidentales imprègnent toute notre société. C'est ce qui nécessite une refonte radicale. Mais qui y parviendra ? Les personnes qui ont été formées pendant la perestroïka ? Les libéraux et les criminels des années 1990 ? Les personnes des années 1980 et 1990 qui ont été formées et éduquées dans les années 2000 ? Toutes ces périodes ont été fondamentalement influencées par le libéralisme en tant qu'idéologie, en tant que paradigme, en tant que position fondamentale et globale dans la philosophie, la science, la politique, l'éducation, la culture, la technologie, l'économie, les médias, et même la mode et la vie quotidienne. La Russie contemporaine ne connaît que les vestiges inertes du paradigme soviétique et tout le reste est pur occidentalisme libéral.

Il n'existe tout simplement pas de paradigme alternatif, du moins aucun au pouvoir ou parmi les élites, au niveau où devrait se dérouler la confrontation actuelle des civilisations.
Aujourd'hui, nous opposons l'Occident en tant que civilisation contre "la" civilisation, et nous devons préciser quel type de civilisation nous sommes, sinon aucun succès militaire, politique et économique ne nous aidera et tout sera réversible, la tendance changera et tout s'effondrera. Je ne parle même pas de la nécessité d'expliquer aux Ukrainiens qu'à partir de maintenant ils seront dans notre zone d'influence ou directement en Russie, qui sommes-nous après tout ? Pour le moment, il n'y a que l'inertie de la mémoire soviétique ("la grand-mère avec le drapeau"), la propagande nazie occidentale ("vatniki", "occupants"), nos succès militaires - pour l'instant seulement initiaux - et... la confusion totale de la population locale. Ici, la voix de la civilisation russe doit être entendue. Clairement, distinctement, de manière convaincante, et ses bruits devraient être entendus en Ukraine, en Eurasie et dans le monde entier. Ce n'est pas seulement souhaitable, c'est vital, tout comme les munitions, les missiles, les hélicoptères et les gilets pare-balles sont nécessaires au front.
L'endroit le plus logique pour commencer les réformes est la philosophie. Il est nécessaire de former du personnel au Logos russe, soit sur la base d'une institution existante (après tout, aujourd'hui, aucune institution humanitaire ne fait, ne peut ou ne veut le faire - le libéralisme et l'occidentalisme dominent encore partout), soit sous la forme de quelque chose de fondamentalement nouveau. Hegel disait que la grandeur d'une nation commence par la création d'une grande philosophie. Il l'a dit et il l'a aussi fait. C'est exactement ce dont les philosophes russes ont besoin aujourd'hui, et non d'un vague accord à l'emporte-pièce avec l'Opération Militaire Spéciale. Nous avons besoin d'une nouvelle philosophie russe. Russe dans son contenu, dans son essence.
Par conséquent, la réforme de toutes les autres branches des sciences humaines et des sciences naturelles devrait partir de ce paradigme. La sociologie, la psychologie, l'anthropologie, la culturologie, ainsi que l'économie, et même la physique, la chimie, la biologie, etc. sont basées sur la philosophie, en sont des dérivés. Les scientifiques l'oublient souvent, mais écoutez comment sonne le synonyme occidental de PhD : n'importe laquelle des sciences humaines et naturelles ! - Ph.D. - Docteur en philosophie. Si vous n'êtes pas philosophe, vous êtes au mieux un apprenti, pas un scientifique (docteur est le mot latin pour "érudit", "savant").
C'est ici que se déroulera la bataille interne la plus importante pour l'initiation de réformes civilisatrices en Russie même (ainsi que dans tout l'espace de notre expansion, toute la zone de notre influence): la bataille pour la philosophie russe.
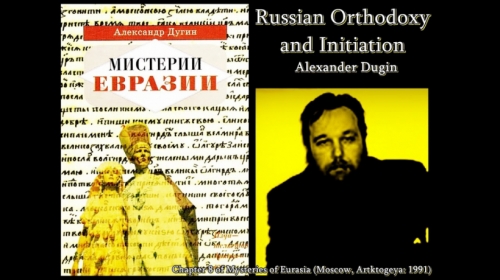
Il y a ici un pôle clairement modélisé de l'ennemi interne. Il s'agit des représentants du paradigme libéral, de la philosophie analytique au post-modernisme en passant par les cognitivistes et les transhumanistes, qui insistent de façon maniaque pour réduire l'homme à une machine. Je ne parle même pas des libéraux et des progressistes, des partisans du concept totalitaire de "société ouverte", du féminisme, des études et de la culture queer, élevés à la bourse des fraternités. Il s'agit d'une pure "cinquième colonne", quelque chose qui ressemble au bataillon Azov interdit en Russie.
Le portrait de l'ennemi philosophique de l'Idée russe, de la civilisation russe, est très facile à tracer. Il ne s'agit pas simplement de liens avec les centres scientifiques et de renseignement occidentaux (qui sont souvent des concepts assez proches), mais aussi de l'adhésion à un certain nombre d'attitudes plutôt formalisables :
- la croyance en l'universalité de la civilisation occidentale moderne (eurocentrisme, racisme civilisationnel),
- l'hyper-matérialisme, en passant par l'écologie profonde et l'ontologie orientée objet,
- l'individualisme méthodologique et éthique - d'où la philosophie du genre (comme option sociale) et, à la limite, le transhumanisme,
- le techno-progressisme, le développement de l'intelligence artificielle et des réseaux neuronaux "pensants",
- la haine des théologies classiques, de la Tradition spirituelle, de la philosophie de l'éternité,
- le déni de l'identité ou son dénigrement par ironie, en la ridiculisant,
- l'anti-essentialisme, etc...
Il s'agit d'une sorte d'"Ukraine philosophique", disséminée dans presque toutes les institutions scientifiques et universitaires qui ont un rapport quelconque avec la philosophie ou les épistèmes scientifiques de base. Ce sont des signes de russophobie philosophique, puisque l'Idée russe est construite sur la base de principes directement opposés.
- L'identité de la civilisation russe (slavophiles, danilovistes, eurasiens),
- le fait de placer l'esprit avant la matière,
- la communauté, la collégialité - une anthropologie collectiviste,
- un humanisme profond,
- la dévotion à la tradition,
- la préservation minutieuse de l'identité, de la nationalité,
- la croyance en la nature spirituelle de l'essence des choses, etc.
Ceux qui donnent le ton à la philosophie russe contemporaine défendent avec véhémence les attitudes libérales et rejettent avec la même véhémence les attitudes russes. C'est un puissant bastion du nazisme libéral en Russie.
C'est ce point du champ de tir de l'ennemi, cette hauteur, qu'il faut conquérir dans la phase suivante, et les nazis libéraux se défendent contre la philosophie avec la même férocité qu'Azov ou les terroristes ukrainiens désespérés de Popasna. Ils mènent des guerres d'information, écrivent des dénonciations sur les patriotes et utilisent tous les leviers de la corruption et de l'influence des appareils.
Il convient maintenant de rappeler une petite histoire - personnelle, mais très révélatrice - concernant mon renvoi de la MSU à l'été 2014 (notez la date) [Ed. Dugin en 2014 a été démis de sa chaire à l'Université d'État de Moscou au moment où le "printemps russe" dans le Donbass a échoué]. De 2008 à 2014, au département de sociologie de l'université d'État de Moscou, avec le recteur et fondateur du département, Vladimir Ivanovitch Dobrenkov (photo), nous avons organisé un centre actif d'études conservatrices, où nous nous occupions précisément de cela : le développement d'un paradigme épistémologique de la civilisation russe.

Nous n'avions pas hésité à soutenir le Printemps russe. En réponse, cependant, nous avons reçu une pétition cinglante de... philosophes ukrainiens (promue par le nazi de Kiev Sergey Datsyuk) appelant à "l'expulsion de Dobrenkov et de moi-même de l'Université d'État de Moscou" ; le plus étrange - mais à l'époque ce n'était pas très étrange - est que la direction de la MSU a fait exactement cela. Dobrenkov a été démis de ses fonctions de recteur et moi, franchement, je suis parti de mon propre chef, même si cela ressemblait à un licenciement. On m'a également proposé de rester, mais à des conditions humiliantes. Bien sûr, ce n'est pas Sadovnichy, qui s'était auparavant montré très courtois et ouvert, qui a approuvé ma nomination à la tête du département et a suivi toutes les procédures de vote du conseil académique de la MSU. Mais quelque chose s'est ensuite produit : le Printemps russe a été mis en veilleuse et la question du monde russe, de la civilisation russe et du Logos russe a été complètement retirée de l'ordre du jour ; toutefois, ceci est symbolique : les promoteurs de la suppression du Centre d'études conservatrices de l'Université d'État de Moscou étaient des nationalistes ukrainiens, des théoriciens et des praticiens du génocide russe dans le Donbass et dans l'ensemble de l'Ukraine orientale, exactement ceux avec qui nous sommes en guerre actuellement.
C'est ainsi que le nationalisme libéral a pénétré à l'intérieur de la Russie. Ou plutôt, il y a pénétré il y a longtemps, mais c'est ainsi que ses mécanismes fonctionnent. Une plainte vient de Kiev, quelqu'un au sein de l'administration la soutient, et une autre initiative visant à déployer l'Idée russe s'effondre. Bien sûr, vous ne pouvez pas m'arrêter: au fil des ans, j'ai écrit 24 volumes de ma "Noomachia", et les trois derniers sont consacrés au Logos russe, mais l'institutionnalisation de l'Idée russe a encore été retardée. Mon exemple, bien sûr, n'est pas un cas isolé. Quelque chose de similaire a été vécu par tous ou presque les penseurs et théoriciens engagés dans la justification de l'identité de la civilisation russe. Il s'agit d'une guerre philosophique, d'une opposition féroce et bien organisée à l'Idée russe, supervisée depuis l'étranger, mais menée par des libéraux locaux ou de simples fonctionnaires, qui suivent passivement les modes, les tendances et une stratégie d'information bien organisée d'agents d'influence directs.
Nous en sommes maintenant au point où l'institutionnalisation du discours russe est nécessaire. Tout le monde a vu dans notre guerre de l'information à quel point les humeurs et les processus de la société sont contrôlables et manipulables. Les affrontements les plus graves se produisent au niveau des paradigmes et des épistèmes. Celui qui contrôle le savoir, écrivait Michel Foucault, détient le vrai pouvoir. Le vrai pouvoir est le pouvoir sur l'esprit et l'âme des gens.
La philosophie est la ligne de front la plus importante, dont les conséquences sont bien plus importantes que les nouvelles d'Ukraine, que chaque Russe recherche si avidement en se demandant comment vont les soldats, quelles nouvelles lignes ont été saisies, ou si l'ennemi a faibli. C'est là que réside le principal obstacle à notre victoire.
Nous avons besoin d'une philosophie de la victoire. Sans elle, tout sera vain et tous nos succès se transformeront facilement en défaites.
Toutes les véritables réformes doivent commencer dans le royaume de l'Esprit. Et puisqu'il faut chercher des nouvelles du front dans les actualités - eh bien, qu'en est-il de l'Institut de philosophie ? Toujours debout ? A-t-il déjà capitulé ?
12:15 Publié dans Actualité, Nouvelle Droite, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, actualité, russie, alexandre douguine, nouvelle droite, nouvelle droite russe, logos russe |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
La Turquie ébranle l'OTAN

La Turquie ébranle l'OTAN
Source: https://www.geopolitika.ru/it/article/la-turchia-scuote-la-nato
La relation de la Turquie avec l'OTAN met en évidence l'incompatibilité entre la préservation de sa souveraineté et le fait d'être un allié des États-Unis.
Les défis des Américains en Syrie, en mer Noire et en mer Égée
Le 1er juin, le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé le début d'une opération militaire en Syrie. "Une nouvelle phase commence avec la formation (en Syrie) d'une 'zone de sécurité' à 30 kilomètres à l'intérieur de la frontière avec la Turquie. Nous enleverons Tall Rifat et Manbij aux terroristes", a déclaré l'agence de presse Anadolu citant le dirigeant turc. Sont visées des formations de Kurdes syriens fidèles au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), qui constituent l'épine dorsale des "Forces démocratiques syriennes" (FDS) soutenues par les États-Unis.
Officiellement, l'opération se déroulera dans la zone où la Russie et la Turquie ont précédemment convenu de retirer les formations séparatistes kurdes de la frontière turque. Cependant, ces formations sont étroitement liées aux États-Unis et font preuve de loyauté, avant tout, envers les États-Unis. Cela rend leur protection officielle par la Russie et Damas inappropriée.
Selon des sources de l'opposition syrienne, les troupes russes ont quitté cette zone plus tôt que prévu.
Les États-Unis se sont liés si étroitement aux séparatistes qu'une attaque contre les forces syriennes dans n'importe quelle zone de responsabilité sera considérée comme une preuve de l'impuissance américaine. Cela affectera les relations avec d'autres alliés au Moyen-Orient, en premier lieu avec les pays du golfe Persique, qui deviennent de moins en moins dépendants des États-Unis et développent des contacts intensifs avec la Russie et la Chine.
La veille, le 30 mai, une conversation téléphonique a eu lieu entre les présidents de la Russie et de la Turquie, Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan. La veille, le 29 mai, le président Erdogan a accusé les États-Unis d'aider les terroristes kurdes.
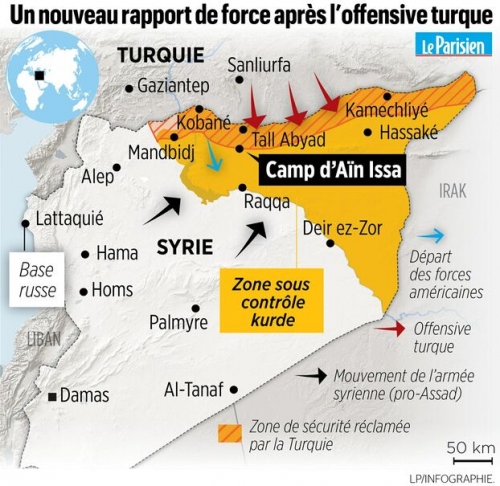
"Les États-Unis continuent de fournir des armes à des organisations du nord de la Syrie que la Turquie considère comme terroristes", a déclaré Erdogan. Le président a noté que la Turquie est déterminée à "éradiquer le terrorisme" dans le nord de l'Irak et en Syrie, tandis que le pays n'a pas l'intention d'obtenir la permission de quiconque, y compris des États-Unis, pour mener une éventuelle nouvelle opération en Syrie.
Plus récemment, le 12 mai, le Trésor américain a publié sur son site Internet une licence permettant d'opérer dans 12 secteurs différents de l'économie dans les zones occupées par les États-Unis et les zones séparatistes kurdes du nord-est de la Syrie. La licence ouvre également la possibilité d'un commerce gris de produits pétroliers, "destinés à être utilisés en Syrie". Auparavant, les États-Unis avaient imposé un embargo sur le commerce du pétrole syrien. Toutefois, une exception a maintenant été faite pour les zones contrôlées par les Kurdes.
Les intentions d'Ankara de mener une nouvelle opération militaire dans les zones contrôlées par les Kurdes, réitérées à plusieurs reprises ces derniers jours, compliquent une fois de plus ses relations avec Washington.
"Nous sommes profondément préoccupés par les rapports et les discussions concernant une éventuelle escalade de l'activité militaire dans le nord de la Syrie et, en particulier, par son impact sur la population civile", a déclaré la veille le porte-parole du département d'État, Ned Price, aux journalistes. "Nous condamnons toute escalade. Nous soutenons le maintien des lignes de cessez-le-feu existantes."
Le 1er juin, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a déclaré que les États-Unis étaient opposés à une éventuelle opération militaire de la Turquie. Lors d'une conférence de presse conjointe avec le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, le chef de la diplomatie américaine a déclaré que "nous nous opposerons à toute escalade dans le nord de la Syrie", soulignant que Washington soutient "le maintien des lignes de cessez-le-feu existantes".
La Russie, en revanche, comprend les préoccupations turques. "Jusqu'à présent, l'armée américaine, qui a occupé une partie importante de la rive orientale de l'Euphrate, y a ouvertement créé une formation quasi-étatique, encourageant directement le séparatisme, utilisant à cette fin l'humeur d'une partie de la population kurde d'Irak. Ici, les problèmes surgissent entre les différentes structures qui unissent les Kurdes irakiens et syriens. Tout ceci affecte la tension dans cette partie de la région. La Turquie, bien sûr, ne peut pas rester à l'écart", a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, dans une interview accordée à RT Arabic.
Dans le contexte de la déclaration du Royaume-Uni sur la nécessité d'envoyer des navires de guerre pour exporter des céréales depuis les ports ukrainiens, Ankara a annulé le passage des navires de guerre de l'OTAN dans la mer Noire, se référant à la convention de Montreux.
Un nouveau conflit turco-grec éclate. Ankara accuse Athènes de violer ses obligations internationales de démilitarisation des îles de la mer Égée. La Grèce a reçu le soutien du président français Emmanuel Macron. Les traditionnelles contradictions turco-grecques ont déjà dépassé le conflit bilatéral au sein de l'OTAN, certes désagréable, mais non critique pour la structure de l'Alliance. Si les États-Unis étaient auparavant perçus comme au-dessus de la mêlée, la Turquie ne le voit plus de cette façon maintenant.
Le 31 mai, l'allié politique d'Erdogan, le nationaliste Devlet Bahceli, a de nouveau publié une déclaration anti-américaine, affirmant que les neuf bases militaires établies par les États-Unis en Grèce constituent une menace pour la sécurité nationale de la Turquie. Le leader du Parti du mouvement nationaliste (MHP) a déclaré que les Etats-Unis utilisent la Grèce comme un "pion" et entraînent la Turquie "dans l'abîme des préoccupations stratégiques et tentent de la pousser dans un environnement de conflit chaud".

La géographie de la confrontation en mer Noire et en mer Égée rappelle la doctrine de la "patrie bleue" (Mavi Vatan) du géopoliticien turc moderne, l'amiral Cem Gürdeniz. L'objectif principal de la doctrine est le renforcement du contrôle turc sur les régions de la mer Noire, de la mer Égée, du golfe Persique et de la mer Rouge, la perception des États-Unis comme une puissance hostile et la recherche d'un terrain d'entente avec la Russie en tant qu'adversaire de l'hégémonie maritime américaine.
Ultimatum turc
Une autre question sérieuse qui démontre les différences entre l'OTAN et la Turquie est l'admission de la Suède et de la Finlande dans l'Alliance. L'expansion proposée de l'OTAN dans le nord pour inclure la Suède et la Finlande ne peut pas encore surmonter l'opposition de la Turquie. Malgré les déclarations du ministère suédois des Affaires étrangères sur des discussions "constructives" à Ankara, les dirigeants turcs indiquent qu'ils maintiendront leur position et insistent pour que toutes les demandes soient satisfaites.
Auparavant, les parlements et les gouvernements de la Suède et de la Finlande ont approuvé les demandes d'adhésion à l'OTAN. Ils devraient être examinés lors du sommet de l'OTAN à Madrid à la fin du mois de juin. Toutefois, le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré le 13 mai que son pays ne laisserait pas les deux pays rejoindre l'Alliance de l'Atlantique Nord si certaines conditions n'étaient pas remplies. Il s'agit principalement du soutien de la Suède et de la Finlande aux séparatistes kurdes opérant en Syrie, de la fourniture d'asile et d'armes aux séparatistes et aux terroristes, et des activités permanentes des structures de Fethullah Gülen dans les pays scandinaves. Ankara demande également à Stockholm de lever l'embargo sur les armes à destination de la Turquie.
Il ressort des déclarations des responsables turcs que les demandes ne visent pas seulement la Finlande et la Suède, mais aussi d'autres membres de l'OTAN. Outre les membres potentiels de l'OTAN, le 13 mai, Erdogan a accusé un membre de longue date de l'Alliance, les Pays-Bas, d'abriter des terroristes. Le 1er juin, le dirigeant turc a étendu ses allégations, affirmant que les organisations terroristes sont soutenues non seulement par la Suède et la Finlande, non seulement par les Pays-Bas, mais aussi par l'Allemagne et la France.
Des revendications ont été formulées à l'encontre des pays européens qui ont imposé des restrictions à la coopération en matière de défense avec la Turquie en raison de leurs actions contre les séparatistes kurdes et les États-Unis. Washington a humilié la Turquie en refusant de participer au programme de production et de fourniture de chasseurs-bombardiers multirôles F-35 après qu'Ankara ait acheté des systèmes de défense aérienne russes S-400. Aujourd'hui, la Turquie tente de montrer qu'elle cherchera à modifier son statut inégal au sein de l'Alliance, sinon elle ralentira son expansion vers le nord.
Officiellement, il n'existe pas de mécanisme tel que le "droit de veto" à l'OTAN. Toutefois, l'article 10 du Traité de l'Atlantique Nord de 1949 stipule que les membres de l'OTAN "peuvent inviter tout autre État européen capable de développer les principes du présent Traité et de contribuer à la sécurité de la région de l'Atlantique Nord à adhérer au présent Traité" uniquement par "consentement général". Par conséquent, Ankara pourrait empêcher l'invitation de la Finlande et de la Suède à l'OTAN. Tous les récents élargissements de l'OTAN ont également exigé des membres existants de l'Alliance qu'ils signent les protocoles d'adhésion des nouveaux membres, puis les ratifient.
Dans un article du magazine britannique The Economist, Recep Tayyip Erdogan a laissé entendre que les relations avec l'OTAN pourraient se détériorer si les préoccupations de la Turquie ne sont pas prises en compte : "Nous pensons que si les membres de l'OTAN appliquent deux poids deux mesures dans la lutte contre le terrorisme, la crédibilité de l'Alliance sera menacée.

"La sortie de l'OTAN doit être mise à l'ordre du jour"
En Turquie même, un débat public animé a eu lieu sur la nécessité de l'adhésion du pays à l'OTAN et sur les perspectives d'admission de la Suède et de la Finlande. Le 12 mai, dans une interview accordée aux médias turcs, Ismail Hakkı Pekin (photo), lieutenant-général à la retraite et ancien chef du renseignement militaire sous le chef d'état-major des forces armées turques, a déclaré que "la Turquie devrait opposer son veto à l'expansion de l'OTAN". Selon un officier militaire de haut rang, l'élargissement de l'Alliance conduit à une extension de la confrontation avec la Russie, ce qui pourrait plonger la Turquie dans un conflit inutile. Un autre ancien officier militaire de haut rang, le contre-amiral Deniz Kutluk (photo, ci-dessous), a déclaré que l'expansion de l'OTAN "réduit la sécurité de la Turquie".

Le partenaire d'Erdogan dans la coalition au pouvoir, Devlet Bahçeli, chef du MHP, a déclaré qu'Ankara pourrait envisager de quitter l'OTAN si ses conditions ne sont pas respectées : "La Turquie n'est pas prise au dépourvu. Si les conditions deviennent inacceptables, la sortie de l'OTAN devrait également être mise à l'ordre du jour comme une option alternative".
En réponse, le leader du "Parti républicain du peuple" Kilichdaroglu (auparavant neutre-positif envers les États-Unis) a proposé de fermer toutes les bases militaires américaines dans le pays. "Les États-Unis ont rempli la Grèce de bases, leur objectif est évident. Si [le parti de Bahceli] présente au Parlement un projet de loi visant à fermer les installations militaires américaines en Turquie, nous le soutiendrons", a écrit le politicien sur Twitter. Ainsi, tant les représentants des autorités que ceux de l'opposition partagent une attitude neutre-négative envers l'OTAN.

Detlev Bahçeli.
Les frictions entre l'OTAN et la Turquie sont complexes. Elle implique des contradictions sur la question kurde (les États-Unis et leurs alliés utilisent les Kurdes séparatistes comme un outil pour miner les pays du Moyen-Orient et faire avancer leurs intérêts), les différends territoriaux entre la Grèce et la Turquie, et l'expansion économique des entreprises françaises, italiennes et américaines en Méditerranée orientale - la zone des intérêts turcs et de la rivalité franco-turque en Libye et en Afrique en tant que telle. De manière générale, les tentatives de la Turquie moderne de jouer le rôle d'un pôle de puissance souverain, l'un des centres de la civilisation islamique, contredisent l'essence même de l'existence de l'OTAN en tant que pilier militaire de l'hégémonie américaine et de la démocratie laïque libérale en Europe.
Interaction compétitive
Certains experts turcs estiment qu'il est nécessaire d'étendre la coopération avec la Russie dans les domaines où les intérêts coïncident ou ont un adversaire commun, qui devient très souvent les États-Unis.
"Au risque de paraître vulgaire et d'être accusé d'être pro-russe, je dois dire qu'il ne semble pas y avoir d'autre issue pour la Turquie que de prendre le contrôle de la question à travers ses relations avec la Russie - ou plutôt, les relations entre le président Recep Tayyip Erdogan et son homologue russe Vladimir Poutine, qui ont gagné en profondeur pratique et empirique", a déclaré Suleiman Seyfi Yegun, chroniqueur pour la publication pro-gouvernementale Yeni Safak.
Outre la Syrie, où les Kurdes pro-américains des Forces démocratiques syriennes sont un élément indésirable, la Libye a été mentionnée comme un point de contact possible.
"Pour Washington, tant Moscou que son 'soi-disant allié' Ankara constituent un obstacle au contrôle de la Libye, qui revêt une importance stratégique en Afrique du Nord et en Méditerranée. Déjà en 2020, le Congrès américain a appelé à des sanctions contre la Turquie et la Russie", indique la publication turque Aydinlik. "La Turquie et la Russie pourraient conclure un accord et mettre fin à la politique impérialiste américaine en Libye et dans toute l'Afrique."

Les opposants à la Turquie et à la Russie ont longtemps surnommé la propension des deux puissances à "l'interaction contradictoire". Ainsi, l'Institut allemand pour les relations internationales et la sécurité (Stiftung Wissenschaft und Politik) note les avantages pour Ankara: "En Syrie, en Libye et dans le Caucase du Sud, il y a plusieurs avantages significatifs que la Turquie peut obtenir en coopérant avec la Russie. L'aide russe en Syrie pourrait empêcher la création d'une autonomie kurde de jure dans le pays. En Libye, la mise à l'écart d'autres partisans de Haftar et du gouvernement de Tripoli pourrait contribuer à garantir les intérêts économiques et politiques turcs, notamment en forçant la Libye à soutenir la revendication de la Turquie concernant les zones économiques exclusives en Méditerranée orientale. Grâce à la coopération turco-azerbaïdjanaise dans le Haut-Karabakh, Ankara cherche à accroître sa présence militaire et à engager les dirigeants azerbaïdjanais dans des partenariats contre des tiers dans toute la région. Alors que les relations entre la Russie et la Turquie deviennent encore plus complexes, compte tenu des efforts coordonnés et de la rivalité entre les trois pays, ainsi que d'autres relations bilatérales entre la Turquie et la Russie, les risques liés à chaque théâtre de guerre sont encore réduits. Les deux sont toujours en mesure de contenir les problèmes sur un théâtre de guerre distinct grâce à des contreparties dans divers domaines de leur relation".
Les relations entre la Russie et la Turquie ne sont pas antagonistes, ce que l'on ne peut pas dire des relations d'Ankara avec Washington - et en particulier Washington et Moscou. Dans ces conditions, la Turquie se transforme en un pays qui divise l'unité euro-atlantique. D'autre part, Ankara ne considère plus l'OTAN comme un facteur de sa propre sécurité, mais comme un système relativement hostile qui peut toutefois être partiellement contrôlé. La Turquie n'a pas encore fait un pas décisif vers l'abandon de l'OTAN, mais une puissance souveraine consciente de sa mission de centre du monde islamique est déjà trop proche de cette structure.
11:46 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, géopolitique, politique internationale, turquie, russie, otan |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
"L'hypermoralisme fait partie du mode de vie actuel" - Entretien avec Thor Kunkel

"L'hypermoralisme fait partie du mode de vie actuel"
Entretien avec Thor Kunkel
Propos recueillis par Bernhard Tomaschitz
Source: https://zurzeit.at/index.php/hypermoralische-haltung-gehoert-zum-heutigen-lifestyle/
L'écrivain Thor Kunkel évoque les Verts, qui ont sacrifié le pacifisme sur l'autel du pouvoir et se sont entendus avec les Etats-Unis, et le risque que cette politique entraîne l'Allemagne dans la guerre en Ukraine.
Si l'on regarde la position des Verts en République fédérale d'Allemagne sur la guerre en Ukraine, ils n'ont aucun scrupule face aux livraisons d'armes. Où est passé le mouvement pacifiste dont sont issus en partie les Verts ?
Thor Kunkel : Nous avons tous été surpris, je pense, par la rapidité avec laquelle ce parti, qui s'est longtemps revendiqué du mouvement pour la paix et qui jouit donc d'une sympathie sans précédent auprès des jeunes électeurs, s'est transformé en très peu de temps. On pourrait parler d'un parti de politiciens au pouvoir. Remarquez qu'il s'agit de politiciens de pouvoir dépourvus de tout bagage professionnel.
Thor Kunkel fait partie des écrivains germanophones modernes. Il a étudié les arts plastiques, notamment à Francfort-sur-le-Main et à San Francisco, et a travaillé pendant de nombreuses années comme créatif pour des agences de publicité britanniques et néerlandaises (photo : Thor Kunkel).
Ce ne sont donc pas les bonnes personnes qui occupent des postes à responsabilité ?
Kunkel : C'est une certaine tradition chez les Verts. Pensez au fameux discours de Joschka Fischer en 1999 sur l'entrée en guerre de l'OTAN au Kosovo : on a découvert après coup que M. Fischer n'avait même pas lu le traité de Rambouillet. On a alors dit que si les chapitres 7 et 8 avaient été connus auparavant, de nombreux députés Verts n'auraient pas voté pour la guerre à l'époque. En d'autres termes, un certain manque de professionnalisme est tout à fait typique des Verts.
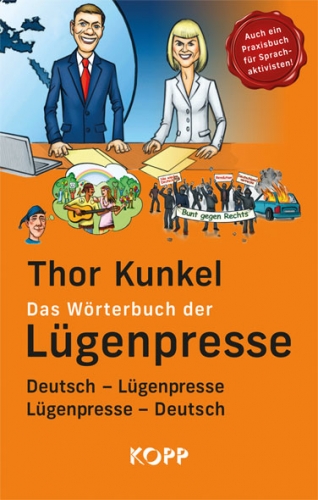
En ce qui concerne le pacifisme, ou plutôt la non-violence, il n'y a jamais eu de condamnation claire de la RAF de la part des Verts, et des représentants des Verts continuent de faire des mamours avec le petit monde des Antifa, qui est tout sauf pacifique.
Kunkel : Je dirais que la base du parti est relativement violente. Mais en ce qui concerne le comportement de Mme Baerbock et de M. Habeck, il y a encore d'autres raisons déterminantes, - la vassalité vis-à-vis des Américains et aussi l'intention de ne décevoir aucun des amis transatlantistes.
Si nous jetons un bref coup d'œil à l'histoire, lors de la guerre du Vietnam, le mouvement pacifiste a violemment critiqué les États-Unis et a quasiment glorifié les Nord-Vietnamiens et Ho Chi Minh. Au début des années 80, lors de la double décision de l'OTAN sur le réarmement, les États-Unis ont à nouveau été vivement critiqués, tandis que le rôle de l'URSS était occulté. D'où vient cette divergence ?
Kunkel : Tout d'abord, la gauche a fait à l'époque ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle s'est solidarisée avec les peuples coloniaux exploités, parmi lesquels elle comptait les Nord-Vietnamiens. Par ailleurs, l'impérialisme géopolitique des États-Unis était alors à son apogée, ce qui correspondait très, très bien à la phase de légitimation des partis de gauche et des partis verts. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation différente : les Verts font partie de l'establishment. Ils sont choyés par les médias qui leur sont favorables, et ils savent aussi que la jeune génération les soutient. Ils cultivent un style de vie élitiste et ont appris à s'accommoder de la dernière grande puissance occidentale, les États-Unis. Les élites s'arrangent toujours avec les dirigeants, et cela explique le changement que vous venez d'évoquer.
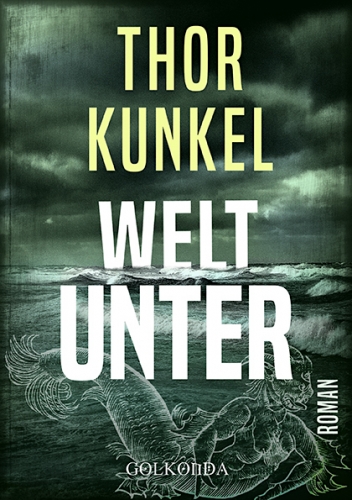
Le nouveau roman de Thor Kunkel, "Welt unter", va bientôt paraître.
Cela signifie que les choses vont probablement continuer ainsi avec les Verts, car la coalition "feux de circulation" va, selon les prévisions actuelles, tenir jusqu'à la fin de la législature.
Kunkel : Nous devons partir de ce principe. La majorité des Allemands approuvent cette orientation belliciste, cette "attitude", comme on dit, de la ministre des Affaires étrangères. On dit qu'elle fait du bon travail et que les Allemands sont également satisfaits du travail de M. Habeck. Bien entendu, ces déclarations des médias grand public doivent être prises avec précaution. Je pense toutefois qu'ils n'ont pas perdu la confiance en adoptant une position qui consiste à livrer des armes lourdes à un seul des belligérants. La majorité des Allemands semble les soutenir.
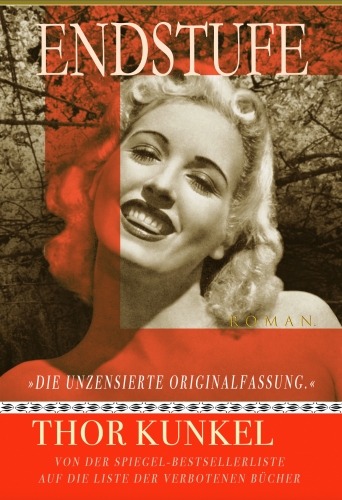
Parce qu'ils pensent être du bon côté sur le plan moral ?
Kunkel : Cela correspond exactement à cette attitude hypermoraliste qui fait aujourd'hui partie du style de vie vert, on est alors "moralement protégé". De nos jours, le prestige, la réputation et cette attitude morale sont presque devenu des avantages en monnaie sonnantes et trébuchantes. On sait aussi, bien sûr, que si l'on adopte une position critique - du moins en Allemagne -, on risque aujourd'hui de perdre son gagne-pain ou de ruiner sa carrière. Celui qui fait partie du système et tous ceux qui gagnent simplement leur vie se taisent.
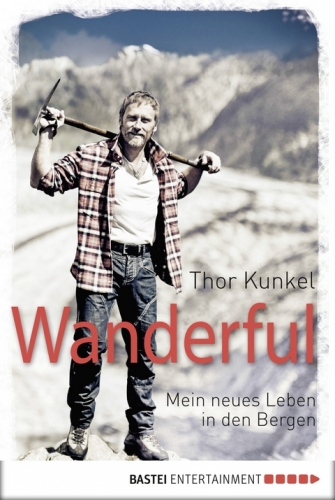
Pourrait-on également formuler cela de manière un peu provocante en disant que l'opinion dominante est que "le monde doit être sauvé par l'hypermoralisme allemand" ?
Kunkel : Si vous faites allusion aux années 30 et 40, je ne peux que vous donner raison. J'ai l'impression que le risque d'être impliqué d'une manière ou d'une autre dans cette guerre est pris à la légère. On fait semblant de ne pas être impliqué dans la guerre, ce qui n'est pas vrai dans les faits. On ne peut pas livrer systématiquement des armes lourdes à une partie belligérante et prétendre ensuite ne pas être impliqué. Si des soldats ukrainiens sont formés par des Américains en Allemagne pour pouvoir maîtriser certains systèmes de missiles qui tuent des soldats russes, il s'agit clairement d'une forme de "service de guerre". S'il devait y avoir des réactions, s'il devait y avoir des explosions nucléaires, cette guerre se déroulerait principalement en Europe et les États-Unis seraient, comme toujours, en dehors du jeu.
C'est ce qui avait été envisagé dans les années 1970 comme le pire scénario de la 3ème Guerre mondiale. Un éventuel échange de coups devait se limiter au sol européen, plus précisément au territoire de l'Allemagne vaincue. En raison de leur manque de souveraineté, les gouvernements de l'époque - Schmidt, Kohl - ont accepté que des armes nucléaires soient installées sur le territoire allemand. Dans le pire des cas, on pourrait s'attendre à ce que ces systèmes d'armes fixes soient utilisés. Curieusement, cela semble laisser la population allemande indifférente, car elle n'a guère tiré de leçons des événements fatals de la Seconde Guerre mondiale.
Pendant longtemps, la grande maxime politique de la République fédérale était "plus jamais la guerre", et l'armée allemande ne devait pas participer à des opérations de guerre à l'étranger. Puis, comme vous l'avez déjà mentionné, le gouvernement fédéral rouge-vert et le ministre des Affaires étrangères Fischer ont déclenché la guerre de l'OTAN contre la Serbie, et l'Allemagne risque maintenant d'être entraînée dans la guerre qui sévit aujourd'hui en Ukraine. Comment expliquer tout cela ?
Kunkel : Je ne sais pas. Il s'agit vraisemblablement de certains schémas de réaction qui semblent se répéter. En arrière-plan, il semble y avoir un objectif supérieur et symboliquement chargé - un objectif fixé par nos "amis" transatlantiques, dont la géopolitique doit être accomplie par le vassal. Un État souverain se comporterait différemment dans cette situation, et surtout, les politiciens allemands ne seraient pas prêts à risquer la vie de millions d'Allemands pour une politique absurde basée sur des "valeurs" (occidentales). Même si la catastrophe n'arrive pas tout de suite, plus les belligérants s'échauffent, plus le risque est grand que cela ait des conséquences que les "professionnels de la politique" comme Mme Baerbock et M. Habeck ne peuvent pas prévoir. Ce qui m'inquiète, c'est que la caste politique semble considérer 89 millions d'Allemands comme une masse de manœuvre qui doit simplement rester immobile.
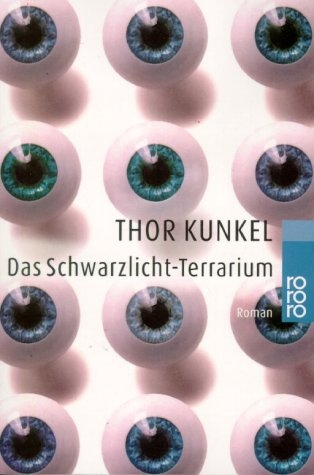
J'aimerais vraiment entendre un jour un M. Scholz déclarer clairement: "Le bien du peuple, que je représente en vertu de ma fonction, passe avant tout". Avant les "valeurs" (occidentales), avant la politique symbolique, et même avant les victimes de la guerre, dans laquelle l'Allemagne n'a aucune responsabilité. En revanche, une guerre nucléaire en Europe serait si terrible qu'on ne veut pas y penser. Le comportement arrogant de certains personnages clés du gouvernement ukrainien suggère d'ailleurs de qui pourrait provenir une première frappe nucléaire en cas de doute. Je pense qu'un macho comme Zelenski n'a pas grand-chose à envier à Poutine.
Pour revenir brièvement au pacifisme : Peut-on résumer cela en disant que le pacifisme n'était ou n'est toujours qu'un slogan politique de la gauche ?
Kunkel : Il semblerait que oui. Pour le parti, c'était un terme de combat utile dans la boîte à outils du marketing politique, bien que je ne veuille pas nier à de nombreux membres de la gauche et du parti des Verts une attitude pacifiste de base. Dans la vie politique quotidienne, l'affirmation d'être un mouvement pacifiste était bien sûr un plus émotionnel et une feinte rhétorique visant à discréditer indirectement l'adversaire politique.
Il est également significatif que le terme ait récemment été utilisé dans le débat politique. M. Habeck a fait savoir que, bien qu'il éprouve du respect pour une "position de pacifisme inconditionnel" au sein de son parti, il "pense que c'est faux". Mme Baerbock a répondu aux questions de l'opposition que les Verts "ne voulaient plus être endormis". Ils sont prêts - à la différence de l'AfD - à adapter leurs exigences programmatiques "aux circonstances". Cela ressemblait à de l'auto-dénigrement, mais n'a pas vraiment irrité qui que ce soit. On sait que Mme Baerbock a une relation quelque peu légère et inconsistante avec la vérité.
L'entretien a été réalisé par Bernhard Tomaschitz.
11:09 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Entretiens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : thor kunkel, entretien, actualité, pacifisme, verts allemands, ukraine, politique internationale, allemagne, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
La revue de presse de CD - 05 juin 2022

La revue de presse de CD
05 juin 2022
EN VEDETTE
Harari et "l'homme numérique de demain" : les projets inquiétants du Forum de Davos
Certains le connaissent, d’autres pas. Pourtant, son rôle est majeur au sein du Forum économique mondial, puisqu’il en est le conseiller principal. Yuval Noah Harari est un écrivain et historien israélien, auteur du best-seller "Sapiens", ouvrage qui ajoute la science à l'histoire de notre humanité entière. En 2018 déjà, avant la pandémie mondiale, il évoquait les concepts de l’homme numérique de demain. Cet homme serait celui que l’on pourrait "pirater", pour lequel la vie n’aurait plus de sens réel. Les dirigeants devraient alors tout mettre en œuvre pour remédier à cela, notamment grâce aux jeux vidéos et aux médicaments. Le bras droit de Klaus Schwab s’est également fait connaître avec son second tome : "Homo Deus".
Francesoir.fr
https://www.francesoir.fr/societe-science-tech/yuval-hara...
DÉSINFORMATION/CORRUPTION/CENSURES
Revue de presse RT (Russia Today) du 22 au 28 mai
Au menu cette semaine, l’Europe et les Etats-Unis qui continuent, de façon totalement volontaire et assumée, leur chute économique ; l’Ukraine qui plus elle perd plus elle se fascise ; la Russie et la Chine qui prépare leurs défenses contre l’inévitable assaut final, et suicidaire, de l’Occident. La crise vue du côté russe…
Lesakerfrancophone.fr
https://lesakerfrancophone.fr/revue-de-presse-rt-du-22-au...
Rivarol privé d’aides à la presse
C’est une pétition signée d’historiens, de personnalités diverses que nous évoquerons plus loin qui a entraîné cette mesure. Une trentaine de personnes considéraient que cette « propagande salit le travail des historiens ». La pétition remarque pourtant que la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) réunie en 2018 avait accordé son imprimatur au journal et renouvelé les avantages qui résultent du numéro d’immatriculation : TVA à taux réduit (2,1 % au lieu de 20 %), tarifs postaux préférentiels et accès aux aides à la presse. Tout journal qui appartient à la catégorie des publications d’information politique et générale (IPG) et qui couvre en principe tout le champ de l’actualité y a droit. La pétition, qui demandait l’annulation de l’immatriculation du journal en tant qu’IPG, ajoute « pour autant que ces informations tendent à éclairer le jugement des citoyens ». Mais qui sera l’arbitre des élégances pour déterminer les « bonnes informations » qui vont « éclairer le jugement des citoyens » ? Les signataires de la pétition ?
Ojim.fr
https://www.ojim.fr/rivarol-aides-a-la-presse/?utm_source...
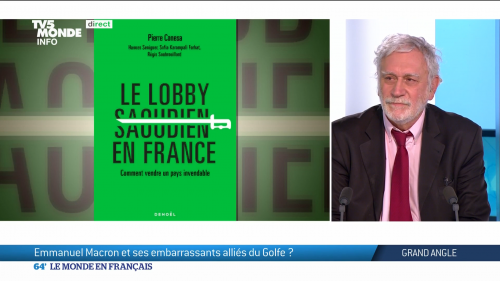
Arabie Saoudite, les rois de la communication ?
Parole d’expert réalisé avec notre partenaire Terra Bellum au sujet de l' « Arabie Saoudite, les rois de la communication » ? Pierre Conesa analyse les ressorts de l’influence du Royaume Wahabite dans les démocraties occidentales et les bénéfices qu’il cherche à tirer d’une communication bien huilée grassement financée par la pétro-monarchie. Vidéo.
httgeopragma.frps://geopragma.fr/parole-dexpert-arabie-saoudite-les-rois-de-la-communication-avec-pierre-conesa-membre-du-comite-dorientation-strategique-de-geopragma-2/
ÉCONOMIE
Le miroir aux alouettes de la réindustrialisation
Dès la fin de la guerre froide il devint intéressant de confier des tâches productives à des régions du monde devenues accessibles et qui disposaient d’une abondante main d’œuvre bon marché. Les pays occidentaux se transformèrent en économies de services, plus rémunérateurs, tout en pensant rester maître de leurs technologies. Si les tâches industrielles migrèrent vers l’Asie, elles furent accompagnées par les savoir-faire, sans que l’on veuille se rendre compte de cette dépossession. Trois décennies plus tard, les dépendances sont inversées : le confort matériel s’importe désormais de là-bas et la maîtrise technologique n’est plus une chasse gardée.
Le blog de Michel de Rougemont
https://blog.mr-int.ch/?p=8469&utm_source=mailpoet&am...
Alerte ! la dette de la France est structurelle
La dette du pays ayant maintenant dépassé le montant du PIB, il faut s’interroger pour savoir s’il va être possible de faire en sorte qu’elle n’augmente pas davantage encore dans les années à venir.
contrepoints.org
https://www.contrepoints.org/2022/05/31/428495-alerte-la-...
ÉNERGIES
Qui gagne la guerre de l’énergie ?
Nos dirigeants européens sont des irresponsables. En obéissant aveuglément aux Américains, ils ont mis en danger tout le volet des ressources énergétique dont l’Europe a besoin car nos économies reposent encore sur le gaz, le pétrole et le charbon dont la Russie nous fournit l’essentiel de nos besoins.
synthesenationale.hautetfort.com
http://synthesenationale.hautetfort.com/archive/2022/06/0...
ÉTATS-UNIS
L'Afrique, les pays BRICS et les républicains américains bloquent le traité mondial de l'OMS sur la pandémie !
Comme pour la lutte contre le diktat mondial de Corona, de nombreux pays du Sud, et en particulier ceux d'Afrique, sont à nouveau à la pointe de la résistance. En effet, le très controversé traité mondial de l'OMS sur les pandémies, qui vise à mettre en place une dictature mondiale de la santé au-dessus du statut constitutionnel des États-nations souverains, est rejeté dans ces pays. Au Brésil et dans d'autres parties du monde, on se défend également.
euro-synergies.hautetfort.com
http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2022/06/02/l...
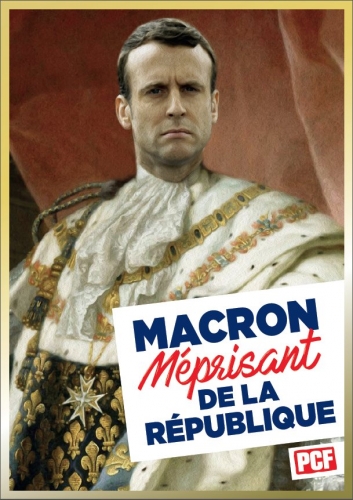
FRANCE
Renaissance démocratique : Macron dissimule son mépris de la démocratie
Si la majorité semble s’être effectivement entichée de cette idée de renaissance, son application à la question démocratique semble quelque peu paradoxale lorsqu’on se souvient du bilan d’Emmanuel Macron sur ce point.
Contrepoints.org
https://www.contrepoints.org/2022/05/31/429128-renaissanc...
Le fiasco de la Ligue des champions au Stade de France a un retentissement mondial
La Mondiovision a offert un spectacle navrant à quelque 400 millions de téléspectateurs sur la planète. Ils étaient pourtant privilégiés par rapport aux quelque 80.000 supporters qui avaient eu la mauvaise idée de se rendre au Stade de France. Attentes interminables, intrusions, vols, agressions y compris sexuelles (surtout à la sortie du stade), jets de gaz lacrymogènes d’une police débordée contre d’authentiques amateurs de football venus souvent de loin et en famille… un chaos inouï. Mais au lieu de reconnaître tout de suite le désastre et d’en demander pardon aux victimes, le ministre de l’Intérieur et la nouvelle ministre des Sports, témoins directs de ce fiasco, ont rejeté la faute sur les fans anglais en évoquant « une fraude massive, industrielle de faux billets », d’où « 30.000 à 40.000 supporters » sans billet ou munis de faux billets
laselectiondujour.com
https://www.laselectiondujour.com/le-fiasco-de-la-ligue-d...
GÉOPOLITIQUE
Ukraine/Russie : en Amérique latine et en Asie, des pays refusent de suivre les sanctions
Les Américains encouragent avec ardeur l’Ukraine dans une guerre qui, pour beaucoup, est une lutte décisive pour la liberté humaine. L’intensité de notre engouement fait qu’il est facile de supposer que tout le monde dans le monde le partage. Ce n’est pas le cas. La réaction passionnée des Américains n’a de pareil qu’en Europe, au Canada et chez la poignée d’alliés des États-Unis en Asie de l’Est. Pour de nombreuses personnes dans le reste du monde, le conflit Russie-Ukraine n’est qu’une autre guerre occidentale inutile dans laquelle ils n’ont aucun intérêt.
Les-crises.fr
https://www.les-crises.fr/ukraine-russie-en-amerique-lati...

La Russie, l'Iran et l'Inde créent un troisième pôle d'influence dans les relations internationales
Le ministre russe des Transports, Valery Savelyev, vient de reconnaître le rôle vital que joue aujourd'hui l'Iran pour la logistique de son pays grâce au corridor de transport Nord-Sud (NSTC - North South Transport Corridor). Selon lui, les sanctions occidentales sans précédent imposées par les États-Unis en réponse à l'opération militaire russe en cours en Ukraine "ont pratiquement brisé toute la logistique dans notre pays. Et nous sommes obligés de chercher de nouveaux couloirs logistiques".
euro-synergies.hautetfort.com
http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2022/05/27/l...
La dynamique de la puissance dans la région indo-pacifique est en pleine mutation
La patrouille aérienne conjointe, au-dessus des eaux de la mer du Japon et de la mer de Chine orientale, lundi, par une force opérationnelle aérienne composée de Tu-95MS russes capables de transporter des armes nucléaires et de bombardiers stratégiques H-6K chinois n’aurait pas pu être une réaction plus instinctive à la tournée du président américain Joe Biden en Asie, sans parler de ses remarques provocatrices évoquant une guerre apocalyptique entre les États-Unis et la Chine au sujet de Taïwan.
lesakerfrancophone.fr
https://lesakerfrancophone.fr/la-dynamique-de-la-puissanc...
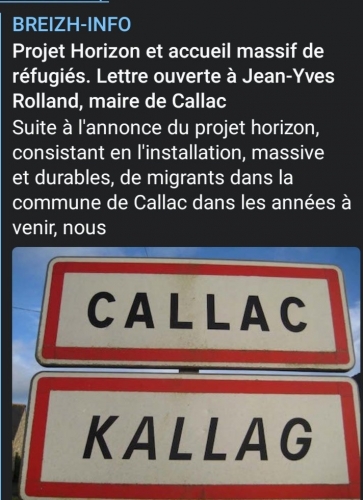
IMMIGRATION
Projet Horizon : des migrants dans nos campagnes
Le fond de dotation « Merci » qui appartient à la famille Cohen cherche à implanter des dizaines de familles de migrants dans la ville rurale de Callac en Bretagne. Yann Vallerie, habitant local et fondateur du site Breizh Info, s’inquiète d’un projet qui changerait la population et les mœurs de nos campagnes.
Lincorrect.org
https://lincorrect.org/projet-horizon-des-migrants-dans-n...
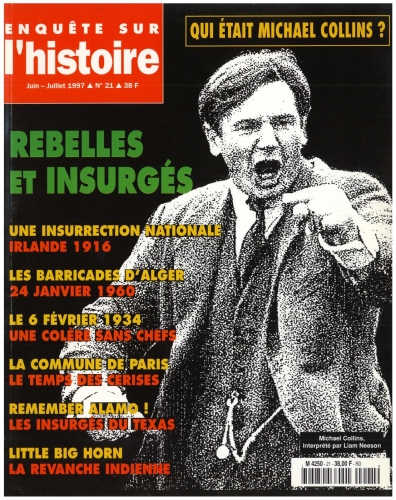
LECTURE
L’Institut Iliade met à disposition tous les numéros d’Enquête sur l’Histoire, magazine fondé par Dominique Venner, de 1992 à 1999
L’Institut Iliade vient de mettre à disposition tous les numéros d’Enquête sur l’Histoire, magazine fondé par Dominique Venner, de 1992 à 1999. Enquête sur l’histoire est une revue française qui traitait de sujets d’histoire. Fondée en 1991 par Dominique Venner, elle était liée à la mouvance de la Nouvelle Droite. Elle disparut en 1999. Comme l’explique Dominique Venner dans l’éditorial du premier numéro de cette revue : « Il est impossible de penser le présent et le futur sans éprouver derrière nous l’épaisseur de notre passé, sans le sentiment de nos origines. Il n’y a pas de futur pour qui ne sait d’où il vient, pour qui n’a pas la mémoire du passé qui l’a fait ce qu’il est. Mais sentir le passé, c’est le rendre présent. Le passé n’est pas derrière nous comme ce qui a été autrefois. Il se tient devant nous, toujours neuf et jeune ».
Les numéros sont désormais tous libres d’accès et de téléchargement
Breizh-info.com
https://www.breizh-info.com/2022/05/31/187382/linstitut-i...
MONDIALISME/BIOTERRORISME/DICTATURE
Forum économique mondial 2022 : le retour de l’homme de Davos
La réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF) à Davos est peut-être la conférence la plus impopulaire au monde, et son fondateur et président, Klaus Schwab, l’une des personnalités les plus méprisées au monde. Souvent comparé au Dr. Denfer, le personnage joué par Mike Meyers dans la série Austin Powers, et régulièrement comparé à un super-méchant de James Bond sur Internet, Schwab est considéré comme un mégalomane messianique dirigeant une infâme cabale de dirigeants mondiaux et de chefs d’entreprise vers un avenir dominé par une élite mondialiste.
Contrepoints.org
https://www.contrepoints.org/2022/06/02/431611-forum-econ...
Soros et la fermeture hermétique de la "société ouverte"
Lorsque nous évaluons les bouleversements qui se produisent dans notre société et qui sont devenus soudainement si évidents, nous nous retrouvons souvent à en tenir quelques noms pour responsables, toujours les mêmes. Bien que cela ne satisfasse pas entièrement notre désir de compréhension et se prête au risque de simplifier à l'excès la réalité, il ne fait aucun doute que l'action visible par laquelle les individus exercent leur pouvoir est le miroir à travers lequel nous pouvons tenter d'identifier les lieux où nous mènent les forces mystérieuses qui guident le cours des événements.
euro-synergies.hautetfort.com
http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2022/06/03/s...
RÉFLEXIONS
Au-delà du "gauchisme" : le fléau "trotskyste" dans les mouvements contre-hégémoniques
C'est surtout au sein des mouvements communistes qu'ont émergé les "trotskystes". Léon Trotsky était un marxiste révolutionnaire qui, entre autres contributions théoriques au marxisme, a représenté la première opposition majeure au sein du parti bolchevik dans la période post-Lénine. Léon Trotsky a mis en avant une ligne "plus marxiste" au détriment d'une ligne "plus nationale" adoptée par Josef Staline. C'était une façon de chercher à préserver les acquis de la révolution russe, de fortifier son propre État plutôt que d'appliquer la vision marxiste d'une soi-disant révolution mondiale.
euro-synergies.hautetfort.com
http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2022/05/28/a...

Grand espace et idée d'empire - contre-projet à l'UE
L'État-Nation : pour certains, c'est un modèle dépassé, pour d'autres, c'est la possibilité de revenir au "bon vieux temps". Mais le problème soulevé par l'Etat-Nation réside dans le fait qu'il est d'une part trop faible pour contrer la menace de la mondialisation, l'espace qu'il domine n'étant tout simplement pas assez vaste, et d'autre part trop fort lorsqu'il s'agit de restreindre les libertés de son propre peuple, puisqu'il tente de rendre tous les citoyens "égaux" à partir d'un centre, au-delà des frontières des régions, des tribus et des états qui se sont développés au fil du temps.
euro-synergies.hautetfort.com
http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2022/05/29/g...
SANTÉ/INTERDICTIONS/LIBERTÉS
Documents Pfizer : trop gros pour être vrai ?
Les documents Pfizer ont du mal à sortir. Il est vrai que plusieurs centaines de milliers de pages n’est pas évident à éplucher. Rien qu’un dossier de patient fait 250 pages, il y en a plus de 40 000, et il faut vérifier que ses éléments ont bien été retranscrits, et le résultat non déformé. Un travail de fous, que même la FDA, l’EMA, l’ANSM n’ont pas fait. Personne n’ayant réellement les moyens de le faire, l’industrie pharmaceutique a le champ libre pour faire ce qu’elle veut. Même pour des dossiers plus petits, comme le Paxlovid, du même menteur, personne n’a vu les rebonds.
Covid-factuel.fr
https://www.covid-factuel.fr/2022/06/01/documents-%c2%a8p...
UNION EUROPÉENNE
Char à laver
Sur un site peu connu mais très atlantiste, un plumitif résume un article du Washington Post. Selon le Wapo, citant la secrétaire étasunienne au commerce Gina Raimondo, les chars russes ne fonctionnent que par la grâce de circuits électroniques pris à des lave-linges et des frigos. Il y a donc cinq programmes, dont un pour obus délicats, et la rotation de la tourelle est déterminée par la vitesse d’essorage. C’est pour fabriquer de nouveaux chars, ou réparer les quelques-uns restants, que les Russes pillent les maisons en Ukraine et envoient à l’arrière les précieuses machines à laver.
Lesakerfrancophone.fr
https://lesakerfrancophone.fr/char-a-laver
D’un rapport l’autre, le Conseil de l’Europe n’en finit donc pas son autoflagellation !
fdesouche.com
10:39 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, presse, médias, france, journaux, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 04 juin 2022
La malédiction de l'hypocrisie de gauche - Comment les pacifistes sont devenus des bellicistes

La malédiction de l'hypocrisie de gauche
Comment les pacifistes sont devenus des bellicistes
Andreas Mölzer
Source: https://andreasmoelzer.wordpress.com/2022/06/02/vom-fluch-der-linken-heuchelei/
Si l'on analyse le débat actuel sur la guerre en Ukraine, on ne peut tirer qu'une seule conclusion: les plus grands bellicistes sont actuellement issus des rangs de la gauche européenne. Ces dernières semaines, les appels à la livraison d'armes lourdes, à un engagement toujours plus fort en faveur de Kiev et, dans certains cas, à une intervention active dans le conflit, ont été les plus virulents, voire les plus hystériques, de la part des représentants de la gauche de l'échiquier politique.
Si vous écoutez les Verts allemands, de la plus grande ministre des Affaires étrangères de tous les temps au président des Verts bavarois aux cheveux hirsutes, vous savez qu'un parti de véritables bellicistes s'est formé, abandonnant derrière lui l'ancien pacifisme de la révolte de 68 et de la Nouvelle Gauche. A l'époque, on disait "Des socs plutôt que des épées" et "Faire la paix sans armes" et on manifestait contre la guerre du Vietnam et contre le réarmement de l'OTAN. Aujourd'hui, ce sont les épigones de cette ancienne Nouvelle Gauche qui critiquent massivement le chancelier allemand Olaf Scholz parce qu'il n'est pas prêt à livrer des armes lourdes offensives à l'Ukraine.
Il convient d'analyser plus en détail comment peut s'expliquer un changement aussi radical dans l'attitude fondamentale de la gauche vis-à-vis de la guerre et de la paix. D'une part, cela tient bien sûr à l'adversaire actuel dans cette guerre en cours. Vladimir Poutine est depuis longtemps l'ennemi idéal de la gauche, car il incarne tout ce que la gauche déteste et rejette avec ses positions conservatrices en matière de patriotisme, de famille et d'attitude envers les homosexuels. Vladimir Poutine est alors rapidement comparé à Adolf Hitler, et les spécialistes en sciences politiques affirment plus facilement que le régime actuel du Kremlin est bien sûr un fascisme bien réel. Ils ignorent les voix modérées qui font remarquer que Poutine ne menace d'extermination aucun groupe ethnique ou social et que le fascisme implique la pénétration organisationnelle de la population et de tous les secteurs de la société. L'image de l'ennemi Poutine et du méchant impérialisme russe suffit à motiver le nouvel enthousiasme de la gauche pour la guerre.

Une autre cause de ce changement de paradigme idéologique au sein de la gauche est sans doute l'hypocrisie que ces messieurs-dames ont depuis longtemps intériorisée, hypocrisie à laquelle on s'est concrètement habitué dans ce domaine et dans la fonction de bien-pensant attitré. Cette bien-pensance de gauche, qui s'est notamment développée sur la question de l'immigration de masse au cours de ces dernières années, est naturellement capable de porter des jugements en matière de guerre et de paix en toute décontraction, dans une pose complaisante de supériorité morale. Les Ukrainiens et leur président Zelenski, considérés auparavant comme l'un des pays les plus corrompus avec un président, lui, extrêmement corrompu, sont soudain ceux qui mènent une guerre juste, à savoir une guerre défensive, alors que Poutine est présenté comme un tyran fou et sanguinaire à la tête d'un régime tout aussi sanguinaire et d'une armée non moins sanguinaire. Et contre cela, l'utilisation d'armes lourdes est alors la moindre des choses.
Dans le paysage politique et médiatique allemand, la gauche belliciste rejoint curieusement les chrétiens-démocrates de Friedrich Merz et le style journalistique et polémique du "Bild-Zeitung". Alors que les sociaux-démocrates d'Olaf Scholz freinent des quatre fers et se montrent réticents à l'idée de livrer des armes lourdes, ce sont ces deux secteurs politiques-là qui se profilent carrément comme des bellicistes. Et quiconque adopte une attitude prudente en ce qui concerne la prise de position dans la guerre en Ukraine est aussitôt diffamé parce qu'il "comprend Poutine" (est un "Putin-Versteher").
Bien que de plus en plus de voix s'élèvent dans les médias pour reconnaître qu'une défaite militaire totale des Russes est tout simplement impensable et que toute nouvelle escalade et extension de la guerre vers un conflit européen, voire mondial, doit être évitée à tout prix, la seule conséquence logique de cette reconnaissance, à savoir la recherche d'une paix négociée, semble encore lointaine. Ces dernières semaines, les discussions entre Moscou et Kiev se sont révélées fausses négociations et ont échoué sans donner le moindre résultat.

Les tentatives de médiation, comme celles du Turc Erdogan ou d'Israël, sont restées lettre morte jusqu'à présent, et les contacts téléphoniques réels ou supposés entre Macron et Poutine ou entre Scholz et Poutine n'ont guère donné de résultats. Sans parler des tentatives plutôt ridicules du chancelier autrichien de communiquer avec le maître du Kremlin. Il n'en reste pas moins que des négociations sérieuses devront avoir lieu un jour. Et celles-ci devront partir du principe qu'un éventuel compromis de paix devra naturellement tenir compte de la partie russe, c'est-à-dire que les gains de terrain russes dans l'est et le sud-est de l'Ukraine devront probablement être maintenus à long terme. Les bellicistes de gauche en Occident ne veulent pas en entendre parler. De même, les francs-tireurs du 10 Downing Street et de la Maison Blanche à Washington tentent encore aujourd'hui de nous faire croire que seule une défaite totale des Russes pourrait mettre fin à la guerre. Mais tout cela est illusoire et ne fait qu'accroître le risque d'une escalade généralisée jusqu'à la guerre nucléaire mondiale.
C'est ainsi que les va-t-en-guerre de gauche, tout comme les anglo-américains qui haïssent les Russes, s'avèrent être la véritable grande menace pour la paix mondiale. Bien entendu, cela ne change rien au fait que Vladimir Poutine et la Russie ont déclenché une guerre d'agression que rien ne justifie au regard du droit international. Néanmoins, les négociations restent le seul moyen d'y mettre fin. Et pour cela, il faudra offrir à Poutine un scénario de sortie. La soif de guerre, hypocritement déguisée en défense des "valeurs occidentales", comme le fait actuellement la gauche, rendra impossible la fin de la guerre et une solution pacifique.
12:29 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andreas mölzer, autriche, allemagne, verts, pacifistes, bellicistes, gauche allemande, europe, affaires européennes, russie, ukraine, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
La politique face à l'apocalypse
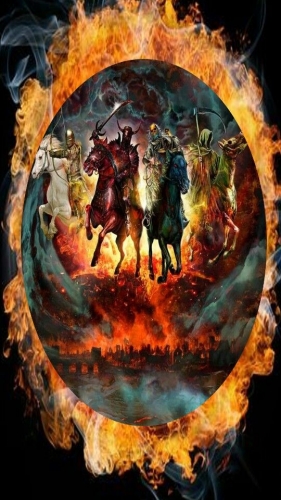
La politique face à l'apocalypse
Source: https://www.tradicionviva.es/2022/04/28/politica-ante-el-apocalipsis/
Dans un essai publié dans le Frankfurter Allgemeine Zeitung, le politologue Comte Peter von Kielmansegg (photo) critique le fait que les élites politiques allemandes ne sont pas à la hauteur des défis stratégiques auxquels le pays est confronté. Face au risque d'utilisation d'armes nucléaires en Europe, les décideurs doivent être en mesure de faire face au "danger d'une catastrophe apocalyptique". Pour cela, ils auraient besoin de vertus classiques, comme le "courage prudent". La "classe politique" allemande, quant à elle, a démontré à plusieurs reprises sa "cécité" stratégique et ne sera probablement pas en mesure de prendre les décisions sages et courageuses nécessaires pour éviter les dommages à la communauté.
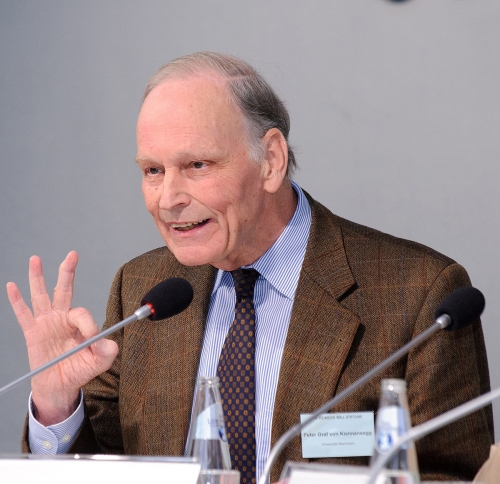
L'Allemagne est "un cas d'instabilité particulière". Les élites politiques du pays ont eu tendance à idéaliser la faiblesse et le manque de sagesse. La "classe politique" est "convaincue que son évitement habituel de l'urgence" est "la preuve d'une moralité supérieure, laquelle est le propre d'une communauté purifiée par l'expérience historique".
L'"aveuglement avec lequel cette classe politique a délibérément conduit son pays dans la dépendance énergétique de la Russie de Poutine jusqu'à la toute dernière seconde et a géré la Bundeswehr presque jusqu'à l'effondrement silencieux" "ne les qualifie pas exactement pour prendre l'initiative dans la direction opposée".
Dans la situation actuelle, il est particulièrement important de trouver des solutions éthiques qui ne doivent pas être interprétées comme un signe de faiblesse du côté russe, car cela pourrait conduire à une escalade, par exemple sous la forme d'une invasion russe des anciennes républiques soviétiques que sont les États baltes. Il s'agit avant tout d'éviter une guerre avec la Russie, car cela pourrait "se terminer en apocalypse".
D'un point de vue européen, le moyen le plus favorable d'éviter une escalade militaire est l'échec de l'invasion russe, car il pourrait en résulter une disposition à un cessez-le-feu chez les dirigeants politiques de la Russie, qui n'est pas encore perceptible. Quoi qu'il en soit, la situation en Europe centrale restera probablement instable sur le long terme. La "naïveté politique des dix ou vingt dernières années" ne pourra donc "plus se reproduire" en Europe occidentale (1).
Nous avons évoqué ici le manque de sagesse de la culture stratégique de l'Allemagne, qui devient maintenant évident. Il y a quelques semaines, le général de brigade à la retraite Erich Vad, ancien conseiller militaro-politique de la chancelière Angela Merkel, a critiqué dans ce contexte la "rhétorique de guerre" qui prévaut en Allemagne et qui est présentée "hors de toute bonne intention éthique". Cependant, la "route de l'enfer" est "toujours pavée de bonnes intentions". Il faut "penser à la guerre en cours entre la Russie et l'Ukraine depuis la fin février" et, surtout, s'efforcer de prévenir une nouvelle escalade et éviter une éventuelle troisième guerre mondiale (2). (sur la réaction d'Erich Vad, voir: http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2022/04/28/le-general-de-brigade-a-la-retraite-erich-vad-il-regle-maintenant-ses-compt.html#more ).
Il y a quelques mois, l'ancien ministre allemand des Affaires étrangères Sigmar Gabriel et Urban Rid, ancien chef de service à la Chancellerie fédérale, ont diagnostiqué un déclin des élites étatiques en Allemagne. Cependant, les auteurs n'ont pas abordé les causes culturelles de ce problème et les réponses possibles à celui-ci. Les réponses possibles ont été décrites par l'historien israélien Shalom Salomon Wald dans son ouvrage sur les conditions préalables à l'existence à long terme des nations, où il a identifié un certain nombre de caractéristiques intellectuelles et culturelles dont doivent faire montrer les élites étatiques qui ont réussi en temps de crise (3).
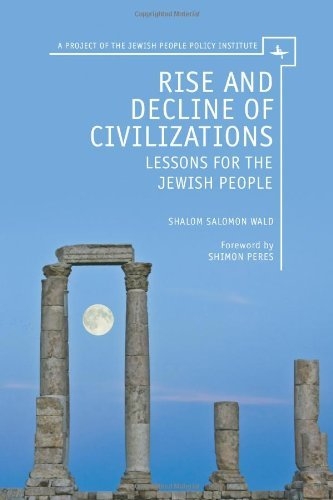
Du point de vue de la doctrine sociale chrétienne, le pape Pie XII avait décrit l'essence de l'idée d'élite dans la tradition occidentale, qui comprend également les éléments spirituels énumérés par Wald. Ainsi, les États fonctionnels reposent sur une élite de personnes qui "se distinguent par leur esprit et leur force de caractère". Seules les personnes "à la doctrine claire et saine, à la volonté ferme et droite" sont capables "d'être des dirigeants et des responsables de leurs concitoyens" (4 ). Dans ce contexte, le pape Pie XI avait décrit la doctrine sociale chrétienne comme "l'école de l'élite dans la vie sociale et politique" (5). Cependant, en dehors d'initiatives privées individuelles, il n'existe actuellement aucune institution en Allemagne qui poursuit une formation d'élite dans ce sens. La suggestion de Werner Weidenfeld de créer une "école de pensée stratégique" n'a pas non plus reçu de réponse pertinente.
Cet article a été initialement publié en allemand sur renovatio.org.
Sources:
1) Peter Graf Kielmansegg : "La guerre de Poutine", Frankfurter Allgemeine Zeitung, 19.04.2022, p. 7.
2) Christoph Driessen : "Das Dilemma des deutschen Pazifismus", Aachener Zeitung, 14.04.2022, p. 2.
3) Shalom Salomon Wald : Rise and Decline of Civilizations : Lessons for the Jewish People, Boston/Jerusalem 2014, pp. 220-241.
4) Benignitas et humanitas 20.
11:55 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, allemagne, europe, affaires européennes, élites, élites dirigeantes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Contre l'"optimisme scientifique". De l'"homo sapiens" à l'"homo deus"

Contre l'"optimisme scientifique". De l'"homo sapiens" à l'"homo deus"
Ernesto Mila
Source: http://info-krisis.blogspot.com/2022/05/cronicas-desde-mi-retrete-contra-el.html
L'un des mirages de notre époque est l'"optimisme scientifique" que l'on retrouve dans les médias. "Quoi, il y a un virus qui efface tout ? Relax, il ne se passe rien ici ! Le vaccin qui résoudra le problème sera bientôt prêt. Le VIH, qui était mortel dans les années 1980, n'est-il pas devenu aujourd'hui une maladie chronique ? C'est l'un des derniers arguments que nous entendons partout dans les médias depuis février-mars 2020. La science peut tout faire, elle résout tous les problèmes, ceux qui existent aujourd'hui et ceux qui apparaîtront demain. Quiconque ne fait pas confiance à la science a un problème. La science d'aujourd'hui est la définition la plus courte du "progrès". Puis il s'avère que les choses ne sont pas tout à fait comme ça.
Dans les années 1960, il y a eu un débat épistémologique sur la science et sa neutralité. Certains ont affirmé qu'il existait une "science" au service du capitalisme et que, par conséquent, la science n'était pas neutre, mais une extension du capitalisme pour mieux atteindre ses fins ultimes, plus rapidement et de manière plus rentable. Les autres disaient que la science était neutre car une invention comme la bombe atomique pouvait servir à la fois aux "capitalistes" et aux "communistes". Finalement, la chose la plus raisonnable - après la fièvre de Mai 68 - était que la science était neutre dans ses principes, mais que son application ne l'était pas. La science médico-légale, diffusée avec pédanterie depuis 20 ans par la franchise "CSI", peut être appliquée aussi bien par les enquêteurs de la police pour résoudre des crimes que par les criminels qui ne veulent pas laisser de traces (la série Dexter, par exemple, est basée sur cette idée).
Ainsi, à la conclusion sur la neutralité de la science, mais pas de ses applications, nous pouvons en ajouter une autre : la science peut être utilisée aussi bien dans son aspect "clair", bénéfique à l'humanité, que dans son aspect "sombre". Et, à partir de là, nous avons même une troisième conclusion à portée de main: les "optimistes scientifiques" ne font référence qu'aux aspects positifs des nouvelles découvertes et possibilités qui s'ouvrent dans les différents domaines, mais jamais, absolument jamais, à leur "côté sombre". Car tout progrès scientifique et toute avancée technique comportent inévitablement un aspect problématique.
Bien que nous reconnaissions que l'énergie nucléaire est le moyen le moins cher de garantir l'approvisionnement énergétique, du moins en Europe, et que les centrales nucléaires du 21e siècle n'ont rien à voir avec celles de la seconde moitié du 20e siècle, et sont donc plus sûres, il y aura toujours la possibilité d'une défaillance technique ou humaine ou d'une attaque. Mais toutes les formes de production d'énergie ont leur côté sombre: l'énergie éolienne, par exemple, génère des problèmes acoustiques qui empêchent la vie humaine à proximité des parcs éoliens. Quiconque a visité un parc éolien sait exactement de quoi nous parlons. Et, d'autre part, tout dépend du vent qui souffle, tout comme l'énergie solaire fonctionne tant qu'il n'y a pas de nuages qui s'amoncellent...
Il n'existe pas de solution qui soit sûre à 100 % et qui, en même temps, n'implique pas une forme de dommage, de nuisance, de risque ou de gaspillage.
Passons à un autre domaine. Celui des sciences de la santé. L'important capital excédentaire des entreprises technologiques investit dans ce domaine. Personne ne veut mourir. Personne ne veut être malade. Certains veulent même vivre éternellement. Et la science fait des recherches dans ce sens. Ce n'est pas de la science-fiction, ce sont des réalités qui ont déjà été réalisées: il a été possible de prolonger la vie de rats de laboratoire en multipliant par quatre leur durée de vie normale, en prolongeant les télomères qui garantissent la bonne reproduction de leurs cellules. Cela signifierait, dans la vie humaine, la possibilité d'atteindre 320 ans, sans aller plus loin. De même, ils expérimentent la technologie dite "CRISPR", qui consiste essentiellement à couper et coller les gènes endommagés dans les chaînes d'ADN et à les remplacer par d'autres gènes "sains". En d'autres termes, l'"édition de l'ADN" a été rendue possible. C'est très bien de pouvoir vivre un peu plus de trois siècles... mais le problème n'est pas seulement de vivre, mais quelle sera notre qualité de vie, et comment notre esprit réagira-t-il à un monde qui n'a rien à voir avec celui que nous avons connu dans notre enfance, pas même lorsque nous aurons atteint nos 100 premières années ; nous aurons atteint la "maturité" vers 150 ans... Qu'y a-t-il de mal à prolonger la vie au-delà de trois siècles ? Pouvons-nous imaginer ce que ce serait de naître en Espagne en 1700 et de mourir en 2022 ? Le cerveau pourrait-il stocker et traiter autant de souvenirs ? Pourrait-il résister à autant de changements ? Quelle serait notre qualité de vie ? La question de la "superlongévité" - techniquement possible aujourd'hui encore - génère de nouveaux problèmes très difficiles à résoudre... et aucun des scientifiques travaillant sur ces projets n'en parle.
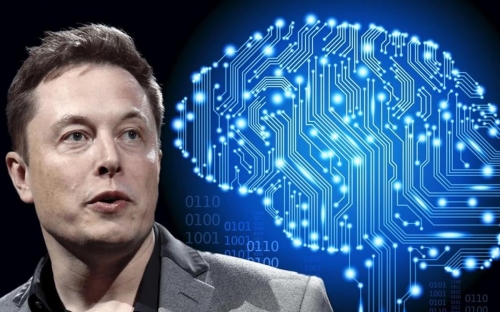
L'ineffable Elon Musk finance le projet "Neurolink", qui consiste à connecter directement cerveau et ordinateur. Malgré le secret qui entoure ce projet, il a été rendu public: à une date indéterminée, en tout cas avant les 25 prochaines années, il sera possible de créer une interface permettant de "télécharger" tout ce que contient notre cerveau dans le "nuage" (le "cloud"). L'idée est que ce projet progresse parallèlement à d'autres nouvelles technologies. La robotique, par exemple. Si nous devons être en Australie, il ne sera pas nécessaire, dit Musk, que nous nous y rendions. Il suffira de charger un robot avec le contenu de notre partition dans le "nuage", pour que "nous" y soyons, sans y être... Science-fiction ? Pour le moment, oui, mais n'oublions pas que des milliards de dollars sont investis dans la recherche dans cette direction.
Beaucoup plus réaliste et à portée de main est l'abandon des transplantations d'organes. L'Espagne est réputée être un leader en matière de "dons" d'organes. Elle ne sera guère utile dans cinq ans, lorsque des organes artificiels pourront être "imprimés" dans des imprimantes 3D, en utilisant des cellules souches comme "encre". Ce sera une percée, car il n'y aura pas de "rejet" et le corps ne sera pas saturé après quelques années par les résidus chimiques des médicaments anti-rejet. La question fondamentale, une fois de plus, n'est pas technique, mais de savoir si la sécurité sociale couvrira les coûts de ce type d'opération ou si la technique ne sera qu'à la seule portée de quelques privilégiés. Les inégalités sociales risquent de se traduire en temps de vie: les plus fortunés pourront se payer un "étirement" des télomères, ils pourront remplacer tout organe qui se dégrade par une réplique imprimée en 3D et, à la limite, si tout échoue et qu'il n'y a pas de remède, ils pourront toujours souscrire une police auprès d'ALCOR, une entreprise qui opère depuis un quart de siècle, avec une succursale en Espagne, qui garantit la conservation cryogénique du corps physique en cas de décès dû à une maladie incurable, et la "dé-cryogénisation" au moment où l'on trouve un remède à cette maladie. L'assurance-vie couvre les frais de conservation. Et si l'on n'a pas une fortune pour payer les frais de cryogénie et de conservation du corps entier, ce qui sera conservé - ce qui est d'ores et déjà conservé aujourd'hui - c'est la tête dont le cerveau sera transplanté dans un robot à la première occasion.
À la limite de cet "optimisme scientifique" se trouvent les gourous du posthumanisme (à ne pas confondre avec le transhumanisme). Alors que le transhumanisme soutient qu'il est possible d'améliorer les capacités humaines grâce aux nouvelles technologies, les posthumanistes affirment qu'une fois le stade transhumaniste dépassé, il faudra atteindre une situation dans laquelle les êtres humains pourront s'émanciper complètement de la biologie qui les limite, se réfugier dans le "nuage", y créer une sorte de "conscience globale", qu'ils considèrent comme la limite de l'évolution darwinienne: nous aurons ainsi parcouru le chemin entre le ver et l'homme, comme disait Nietzsche... pour finalement nous transformer en un seul être global, avec une seule conscience d'espèce, presque comme celle qui gouverne une fourmilière ou une ruche.
Cette dernière perspective, défendue non pas dans le domaine de la science-fiction, mais dans celui des "sciences d'avant-garde", constitue la limite extrême d'une tendance très marquée de notre époque: la considération de la science comme la mère de toutes les solutions et du progrès comme la tendance inéluctable à laquelle elle nous conduit. Pourquoi s'interroger encore ? La science fait progresser l'humanité et il importe peu que nous vivions 320 ans, éternellement, ou que nous dépassions le "stade biologique" et parvenions à nous émanciper de ses limites. Le reste n'a pas d'importance. L'idée de "progrès" l'emporte toujours et nous devons toujours aller plus loin dans la direction qu'elle nous indique.
Au début du 20e siècle, les progrès scientifiques et techniques ont suscité un débat sur la science. Je crois me souvenir que c'est Henri Poincaré qui a inventé l'expression "science sans conscience" dans sa critique de la science positiviste. L'idée était que, s'il est vrai que la science peut explorer dans toutes les directions, elle doit le faire avec une éthique, une conscience, des critères moraux et raisonnables de sécurité et de prudence.
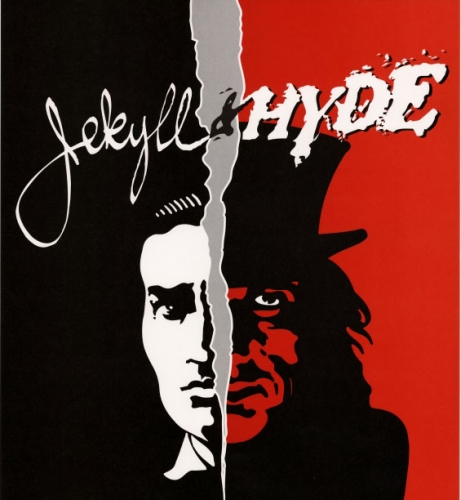
L'"ère informatique", créée par des personnes émotionnellement immatures (de Gates à Musk en passant par Jobs) préfigure les échecs titanesques évoqués dans la mythologie et dans la grande littérature : Icare qui voulait atteindre le soleil (très directement lié à Elon Musk avec son SpaceX), Faust qui a vendu son âme au diable en échange de la "connaissance" et, à partir de là, tout a mal tourné pour lui (la "science sans conscience" de Poincaré), Prométhée qui a volé le feu sacré de la connaissance et on sait comment il a fini (périphrase symbolique du transhumanisme), le Dr Frankenstein qui a voulu créer "l'homme parfait" et en est sorti une monstruosité (autre variante symbolique du sort qui attend les délires transhumanistes), le duo Jekyll et Hyde de Stevenson, qui croyait qu'un médicament pouvait améliorer les capacités humaines et a créé un monstre (ce qui renvoie directement aux "produits pharmaceutiques" et à leurs produits "miracles", notamment le vaccin anti-Covid ou le fentanyl, qui a dévasté les États-Unis plus que tout autre fléau biblique), et, comme tous les textes transhumanistes y font généralement référence, Gilgamesh lui-même, qui se plaignait que les dieux s'étaient réservé l'immortalité et voulait être comme les dieux.
Au fond, ce qui se cache derrière tous ces projets immatures et frustrés, c'est la transformation de l'"homo sapiens" en "homo Deus", ou encore le paradoxe selon lequel l'homme, qui a cessé de croire en Dieu, a fini par croire qu'il était un dieu et, par conséquent, ses projets consistent à réaliser les capacités de Dieu à travers la technologie.
C'est peut-être la raison pour laquelle, aujourd'hui plus que jamais, la phrase qui définissait le Diable comme "le singe de Dieu", le grand imitateur, est encore plus d'actualité qu'au Moyen Âge. Son inversion. En effet, nous vivons aujourd'hui une époque radicalement opposée à toute idée de "normalité". Pour "progresser" dans cette direction, la science de pointe, afin d'être acceptée et tolérée, s'abstient de faire allusion aux aspects négatifs qu'elle contient. Elle ne se concentre que sur ses réalisations positives, qui plaisent à tous. Mais toute avancée technique et scientifique comporte un risque. Jamais autant qu'aujourd'hui, les "optimistes technologiques", dans leur irresponsabilité la plus totale, n'ont évité de faire allusion aux risques des nouvelles technologies.
Le plus grave, c'est que nous vivons une époque de perte des identités : tout ce qui implique une référence, c'est-à-dire un système d'identités, est interdit ou tend à être estompé le plus possible : nous vivons une époque de perte des identités nationales, de perte des identités culturelles, voire de perte des identités sexuelles. Ce qui se passe avec les nouvelles technologies et dans leur arrière-plan est quelque chose d'encore plus grave et extrême : la perte de l'identité humaine.
11:16 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : ernesto milà, actualité, optimisme, optimisme scientifique, elon musk, transhumanisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook



