dimanche, 18 avril 2010
La Carta del Carnero - Une constituzione scomoda

La carta del Carnaro. Una costituzione scomoda |
| Scritto da Andrea Venanzoni |
| Uscita formalmente vincitrice dal primo conflitto mondiale, l’Italia si presenta in realtà come una nazione economicamente e socialmente allo sbando; un sistema produttivo prevalentemente a base rurale rimasto inerte e cristallizzato durante i lunghi anni del logoramento bellico, inflazione, disoccupazione, un certo tasso di arretratezza politica considerata dalla popolazione al pari di immobilismo e incapacità decisionale, i primi fermenti rivoluzionari portati dalla eco sempre più vicina della Rivoluzione d’Ottobre e dello spartachismo tedesco(1), danno un quadro desolato e raggelante di un paese sulla soglia della agitazione rivoluzionaria. In questa composita situazione, si leva alto al cielo il grido dannunziano della vittoria mutilata; fortemente ostile alla linea filo-alleati e alla politica estera di Orlando e del suo Ministro degli Esteri Sonnino (accusati di non saper gestire le delicate trattative di Versailles, soprattutto in tema di annessione della ricca città di Fiume), ancorata questa alle direttive del Presidente americano Wilson (col quale pure si registrano degli screzi , screzi originanti da una condotta scorretta del Wilson stesso che in sprezzante violazione dei principii elementari della politica internazionale si rivolge direttamente in un discorso al popolo italiano invitandolo ad accettare ciò che Orlando non sembra voler accettare, ovvero la rinuncia ai territori giuliani e dalmati), il Vate raduna una eterogenea pattuglia di militari, ex Arditi, sindacalisti rivoluzionari, artisti, anarchici e avventurieri e alla loro testa si insedia a Fiume per lavare quella che è vissuta a tutti gli effetti come una tragica onta. Siamo nel Settembre 1919(2). Fiume rappresenta all’epoca una realtà decisamente particolare; alla fine del secolo XVIII l'imperatrice Maria Teresa aveva concesso alla città lo status speciale di corpus separatum, garantendo una non indifferente autonomia amministrativa e finanziaria. La particolare posizione geografica poi e lo speciale statuto giuridico avevano favorito lo sviluppo di Fiume non solo come centro commerciale, ma pure come città cosmopolita, intellettualmente vivace. All’interno della città la componente etnica italiana era divenuta nel corso degli anni maggioritaria, tanto che la locale comunità italiana costituitasi in Consiglio Nazionale immediatamente dopo la vittoria nel primo conflitto mondiale aveva unilateralmente proclamato l’annessione all’Italia. Per quanto possa apparire paradossale, considerato lo stato d’assedio permanente(3) e la ristrettezza geomorfologica dell’enclave, l’area fiumana diventa subito uno straordinario laboratorio socio-giuridico; sul motivo o sui motivi che hanno reso possibile ciò si è scritto in abbondanza(4), quel che preme sottolineare è naturalmente la straordinaria capacità di mediazione operata da D’Annunzio, il quale riesce sin dall’inizio in forza del suo indubitabile carisma a ricomporre le disarmonie e le fratture intellettuali registratesi tra l’anima anarco-libertaria e quella più prettamente nazionalistica. Il primo problema da affrontare è la denominazione stessa della enclave; lungi dal rivestire solo una importanza nominalistica, la questione è invece prettamente e squisitamente politica. Mentre i nazionalisti e gli Arditi spingono affinchè Fiume divenga Reggenza e quindi estensione sulla costa giuliano-dalmata del territorio italiano, sposando quindi in pieno le tesi degli Irredentisti confluiti nel Consiglio Nazionale, i sindacalisti rivoluzionari, gli anarchici e l’anima operaista preferiscono di gran lunga sancire un’autonomia formale e sostanziale dall’Italia utilizzando la denominazione di Repubblica. A quanto sembra, su questo punto si consuma uno degli scontri intellettuali più intensi tra il Vate e Alceste de Ambris(5); il sindacalista rivoluzionario italiano, amico fraterno di Filippo Corridoni(6), nominato Capo di Gabinetto nel Comando Fiumano dal gennaio 1920 avrebbe senza dubbio alcuno preferito lasciare sullo sfondo le istanze meramente irredentiste e annessioniste per concentrarsi maggiormente sulla riorganizzazione amministrativa e sociale dello Stato fiumano (o della “città libera di Fiume” come si diceva ricorrendo a suggestioni anarchiche). Di questa larvata tensione dialettica tra D’Annunzio e De Ambris sarà dato trovare traccia lungo tutto il testo della Carta. Ad ogni modo, in considerazione del non secondario fatto che l’ala militare dei Fiumani è decisamente schierata su posizioni nazionaliste e che del Consiglio Nazionale ormai fanno parte anche iscritti ai Fasci di Combattimento mussoliniani, De Ambris accetta la denominazione di Reggenza, preferendo ottenere riconoscimenti di stampo sociale nella normazione dedicata al lavoro e al sistema rappresentativo. La stesura della Carta nasce da un imperativo eminentemente organizzativo; vi è necessità di sottoporre l’enclave ad una sia pur minimale forma di controllo e di governo, nella speranza che l’Italia nittiana smetta di temporeggiare e proceda alla tanto aspirata annessione. Quindi più che una vera e propria Costituzione, uno Statuto amministrativo legato in modo specifico alla amministrazione delle Finanze e al reperimento dei fondi di cui la eterogenea pattuglia dannunziana abbisogna(7). Per capire lungo quale tortuoso percorso logico, giuridico e culturale quello che sarebbe dovuto essere un mero Statuto di carattere effimero si trasforma in una vera e propria Costituzione diventa imprescindibile analizzare lo staff chiamato alla operazione di studio e di redazione della Carta stessa. Operazione che tra l’altro presenta il non secondario merito di spazzare via alcune ombre di mero folklore che aleggiano ancora oggi sulla impresa, sulla Reggenza e sulla Carta fiumana. Quando infatti ci si riferisce alla Carta del Carnaro si è soliti ritenerla frutto del genio estemporaneo del Vate e si tende a mettere in risalto solo gli aspetti più prettamente letterari (come ad esempio l’incardinamento della Musica in un testo normativo) e si dimenticano tutti quei tecnici, giuristi, economisti, sindacalisti che misero il loro impegno al servizio della redazione di uno dei testi costituzionali più innovativi dell’epoca (e che conserva notevoli accenti di modernità ancor oggi). D’Annunzio, come detto, deve reperire dei fondi e far gestire il Ministero dell’Economia da un tecnico; inizia una ricognizione di personalità accademiche ed istituzionali che lo possano aiutare sia nella gestione delle finanze sia nell’affrontare i problemi concettuali legati alla sfera delle imposizioni fiscali. Per dirigere l’economia fiumana il Vate quindi cerca, nel marzo del 1920, di attirare a Fiume anzitutto Giuseppe Toeplitz, consigliere delegato della Banca Commerciale, che però rifiuta. Risposta negativa il Comandante riceve anche da Giuseppe Volpi, altro grande finanziere(8). Inaspettatamente ad accettare è una personalità che, in apparenza, non potrebbe esser più distante dai governanti fiumani; il grande economista Maffeo Pantaleoni. Sulle motivazioni che spingono Pantaleoni ad accettare l’incarico sembra prevalere il nazionalismo dello studioso, ammesso da lui stesso nel carteggio intercorso con D’Annunzio(9). L’esponente di punta, assieme a Vilfredo Pareto, del filone italico della corrente teorica denominata marginalismo ebbe modo di percorrere durante la sua esistenza una parabola non solo teorica e di studio ma anche esistenziale che lo condusse da una acceso liberalismo individualista ad una fiducia assoluta nella forza e nel potere di equilibrio espletato dallo Stato. Tanto che Pantaleoni, nella introduzione di un suo volume, arriverà a scrivere “il più grande, il più perfetto, il più splendido nazionalista che la guerra abbia rivelato presso di noi è Gabriele D’Annunzio. Molto l’Italia deve a quest’uomo, il più straordinario per intensità di sentimento e ricchezza di pensiero”(10). In realtà l’idillio non dura molto; quando Pantaleoni arriva a Fiume, oltre alla tenuta del Ministero a cui è stato preposto viene chiamato a collaborare al documento costituzionale ed iniziano allora feroci scontri con le anime più libertarie ed intransigenti dell’Impresa. Effettivamente conciliare la posizione rigidamente statualista (quasi statolatrica) dell’economista con quelle autonomiste, microfederaliste dei vari De Ambris e Keller o con quelle eroico-futuriste di altri personaggi diventa un gioco di ardimento equilibristico. Lo scontro più violento, ed insanabile, però si consuma con i fautori del corporativismo, dottrina questa che Pantaleoni non può e non vuole culturalmente accettare. Il corporativismo, come noto, non conosce una sua intrinseca univocità strutturale; ne è esistita una corrente di stampo cattolico(11), una più prettamente anarco-socialista (slegata quindi, in ottica di puro mutualismo proudhoniano, da ogni intervento dello Stato(12)) ed un corporativismo statualista che sfocerà poi in quello di stampo fascista. Per i fautori di questa corrente e per la sua immissione nella carta costituzionale il corporativismo deve essere inteso come la collaborazione delle forze economiche di una Nazione, coordinate dallo Stato, secondo principi produttivistici, al fine di proteggere le economie nazionali dai tentativi egemonici di carattere monetario e politico operati da varie consorterie internazionali. In realtà mentre per lo stesso De Ambris l’intervento statuale può essere in qualche misura limitato, per altri Fiumani, esso deve comunque essere presente. Per Pantaleoni, il corporativismo rischia di portare con sé il germe del particolarismo economico, fenomeni di lobbying, stratificazioni sociali non più controllabili dallo Stato. Una disarmonia generalizzata ai limiti dell’anarchia. Dopo incontri, gruppi di studio, proposte accettate, cassate, smussate e lavorate più o meno finemente di cesello, si giunge l’8 Settembre del 1920 alla Promulgazione della Carta. Un testo certamente particolare, sia per alcuni profili di radicale innovazione dell’assetto statuale sia per l’inserimento, del tutto inusuale per un testo giuridico, di licenze poetiche, passi letterari (soprattutto nella considerazione della musica come cardine dello Stato) e palesi contraddizioni di cui si darà conto successivamente, avvertendo sin da ora che aporie e contraddizioni non sarebbero mai potute mancare stante la diversità culturale (ai limiti della irriducibilità ad unità) dei contributi proposti. Il testo della Carta viene fatto precedere da un preambolo dal sapore puramente storico-letterario, ai limiti della mitopoiesi, significativamente titolato “Della perpetua volontà popolare”, in cui si ricostruisce il valore simbolico della città libera e si fa promessa di consegnarne la gloria imperitura all’Italia (a cui tuttavia non si manca di muovere critica per l’immobilismo, con le parole “la trista Italia, che lascia disconoscere e annientare la sua propria vittoria” tipizzando in certa misura lo spettro della vittoria mutilata); già da questa parte della Carta si comprende chiaramente la sua differenza formale con un qualunque testo costituzionale, poiché D’Annunzio afferma ex professo di voler andare oltre il mero status di corpus separatum e di voler far entrare in vigore la Costituzione come forma di controllo temporaneo sull’area in attesa dell’annessione. Con l’art I si radica la sovranità (non a caso gli articoli dal I al XIV vanno sotto la rubrica di “dei fondamenti”), sia a livello rappresentativo sia a livello geografico (nel testo del medesimo articolo, sempre il I si assiste al passaggio di livello logico tra radicamento della sovranità nella libera audoterminazione del popolo e dato morfologico del confine orientale da difendere...). Particolarmente significativo il disposto dell’art IV(13); si sancisce in modo inequivoco un criterio di uguaglianza sostanziale, mirandosi a superare ogni forma di discriminazione per motivi di sesso, razza, convincimento ideologico, ceto, per poi passare ad una elevazione del diritto del produttore sopra ogni altro diritto, con frasi che echeggiano i principii proudhoniani. Principii proudhoniani che tornano, sia pure giocati sul delicato crinale di libertà individuale e mantenimento dell’ordine sociale, nell’articolo V laddove si fa riferimento alla tensione verso la giustizia e alla liberazione dai vincoli e dalla soggezione. Anche l’elencazione dei cd diritti civili e politici lascia sbalorditi per l’assoluta modernità; dopo aver stabilito in modo chiaro l’uguaglianza tra i sessi, la Carta si premura di eliminare in radice qualunque ipotesi di coartazione delle libertà individuali, soprattutto quando queste investono la delicata sfera della credenza religiosa. Unico limite, lascia chiaramente intendere l’art. VII, la contrarietà al bene comune e alla stabilità, limite che verrà normativizzato in apposite leggi (le quali comunque non potranno essere equivoche, fumose, in tanto delicata materia). Dopo aver stabilito il diritto all’educazione come diritto imprescindibile della persona umana, si arriva ad uno degli articoli certo più significativi dell’impalcatura normativa; il IX, che recita “lo Stato non riconosce la proprietà come il dominio assoluto della persona sopra la cosa, ma la considera come la piú utile delle funzioni sociali. Nessuna proprietà può essere riservata alla persona quasi fosse una sua parte; né può esser lecito che tal proprietario infingardo la lasci inerte o ne disponga malamente, ad esclusione di ogni altro. Unico titolo legittimo di dominio su qualsiasi mezzo di produzione e di scambio è il lavoro. Solo il lavoro è padrone della sostanza resa massimamente fruttuosa e massimamente profittevole all'economia generale.” Si tratta di una innovazione lungimirante e sociologicamente parlando di grande brillantezza; la funzionalizzazione sociale della proprietà (che avrà vasta eco nei lavori del Costituente repubblicano, tanto poi da finire ad esempio nel secondo comma dell’art 41) e la sua riconduzione nell’alveo del lavoro individuale sono frutto di una visione analitica estremamente precisa, proiettata nel futuro e senza dubbio disancorata dal dato sociale di una Italia in cui la proprietà è all’epoca quasi esclusivamente fondiaria ed in cui l’occupazione della terra costituisce risorsa primaria. Questa concezione della proprietà rappresenta una evidente rottura con schemi ottocenteschi, che consideravano in senso deteriore qualunque intervento statale in materia di traffici interprivatistici; si pensi alla notissima frase del giurista francese Portalis, uno dei massimi ispiratori del Code Civil del 1804, secondo cui ai privati compete la proprietà, al Sovrano l’impero, sancendo concettualmente l’esistenza di due sfere che avrebbero fatto meglio ad ignorarsi a vicenda. L’eco della impostazione borghese e napoleonica si era pesantemente riverberata nel codice civile italiano del 1865; si pensi all’articolo 436 che definiva la proprietà come “diritto di godere e disporre della cosa nella maniera più assoluta purchè non se ne faccia un uso vietato dalle leggi o dai regolamenti”, si tratta in tutta evidenza di una norma ispirata da profondo egoismo mercantilistico, in cui l’unica accezione negativa di cui può connotarsi la proprietà è quando essa arriva a minacciare l’ordine pubblico o la struttura del consesso, non rilevando quindi la mera speculazione o la distonia sociale che essa dovesse determinare. Piuttosto curioso che, nonostante come detto gli articoli 41 e 42 della costituzione repubblicana tendano ad affermare (più su carta che non nella sostanza) una funzione sociale della proprietà poi sopravvivano norme come quella dell’art 841 del codice civile, norma che ancora oggi sancisce una assolutezza dei diritti del proprietario (nel caso di specie, del proprietario del fondo). Allo stesso modo rileva l’art. XIII in cui per la prima volta nel testo compaiono le Corporazioni, qui al pari di Cittadini e Comuni considerate forze che concorrono al moto e alla formazione universitaria e sociale. Il lavoro torna in quella che è una delle norme più singolari dell’intera Carta, l’art. XIV; formalmente dedicato ai principii religiosi, di sapore estetizzante e con una smaccata aura nietzschana (soprattutto nella definizione dell’ “uomo intiero”) vede comparire ancora una volta il lavoro, vero motore non tanto invisibile della compagine statuale fiumana. Con l’art XVIII si entra nel delicato ambito della organizzazione corporativa; ambito delicato perché la struttura corporativa può sottendere tanto ad una ricerca esasperata della democrazia diretta, tesa alla rappresentatività cetuale e dei produttori, quanto ad un controllo capillare di schietta ispirazione organicistica o totalitaria da parte dello Stato. Detto articolo viene a prevedere le corporazioni in numero di dieci, con simbologia presa dal Comune (quindi ricorrendo direttamente ai mitemi medievali) e con proprio Statuto regolamentare interno. Il successivo articolo XIX passa in rassegna la morfologia e le caratteristiche delle varie corporazioni; merita accennare la più particolare di queste, la decima, chiamata a dare rappresentanza “ alle forze misteriose del popolo in travaglio e in ascendimento. E' quasi una figura votiva consacrata al genio ignoto, all'apparizione dell'uomo novissimo, alle trasfigurazioni ideali delle opere e dei giorni, alla compiuta liberazione dello spirito sopra l'ànsito penoso e il sudore di sangue. E' rappresentata, nel santuario civico, da una lampada ardente che porta inscritta un'antica parola toscana dell'epoca dei Comuni, stupenda allusione a una forma spiritualizzata del lavoro umano: "Fatica senza fatica ".”(14) Non a caso l’ultima corporazione è innominata ed eminentemente priva di fisiologia; essa finisce con l’incarnare lo spirito costruttore che deve informare l’azione delle precedenti nove corporazioni(15). D’altronde uno spirito-guida finisce con l’essere indispensabile se si pensa che alle Corporazioni la Carta assegna un altissimo grado di autonomia decisionale e funzionale; esse svolgono fini di mutualità sociale, mettono in piedi strutture assicurative e previdenziali, si autogovernano, impongono ai loro aderenti dei tributi per l’autofinanziamento. Vedono riconosciuta la personalità giuridica di diritto pubblico. Il raccordo con il potere centrale, la Reggenza, è determinato dall’articolo XXI secondo un criterio di autonomia e di collaborazione, in previsione del fine ultimo; non a caso si fa esplicito parallelismo con il riconoscimento delle autonomie locali, i Comuni. E proprio il dettato normativo concernente i Comuni (articoli da XXII a XXVI) rappresenta una delle innovazioni più radicali, riconoscimento pieno ed esplicito dell’autonomia locale al massimo grado. Si pensi invece alla situazione italiana, dall’entrata in vigore dello Statuto albertino (che tra l’altro riconosce gli enti locali ma li normativizza in modo incidentale e limitato) sino agli anni venti; gli enti locali sono organizzati secondo il modello di accentramento francese, con dei Prefetti scelti dal potere centrale e dipendenti dal Ministero degli Interni operanti nella provincia e chiamati a rappresentare il Governo e ad essere al tempo stesso organi di vertice dell’amministrazione locale, coi Comuni governati da un Sindaco scelto dal Governo (tra i consiglieri comunali) e con una serie di controlli pervasivi esperiti dal Governo stesso, controlli che non investono solo la sfera della legittimità ma anche quella del merito(16). Ai Comuni si riconosce il potere di stipulare trattati e accordi, di comporre le fratture sociali che si dovessero riscontrare al loro interno (a meno che queste non si facciano insanabili e non debba intervenire il potere centrale della Reggenza), in caso di contrasto tra le finalità perseguite dal Comune e la Reggenza una valutazione sarà data dalla Corte della Ragione (giudice delle leggi, sorta di Corte Costituzionale antesignana) attraverso un giudizio di conflitto di attribuzioni. Per quel che invece concerne il potere legislativo, anche qui si riscontrano delle novità significative e delle concettualizzazioni ardite e moderne; aldilà dell’aspetto nominalistico, per cui si prevedono due Camere, il Consiglio degli Ottimi e quello dei Provvisori, bisogna mettere in luce il riconoscimento del suffragio universale tout- court con estensione dell’elettorato attivo (e passivo; posto che per essere eletti nel Consiglio degli Ottimi è sufficiente il requisito del poter votare, mentre nel caso del Consiglio dei Provvisori, che è espressione delle Corporazioni, si deve appartenere alla Corporazione di riferimento) anche alle donne. L’età per votare è fissata a venti anni. Anche qui si colgono chiaramente delle nette differenze con la normativa costituzionale italiana dell’epoca; pur rimanendo anche nel caso fiumano la legge elettorale fuori dall’alveo costituzionale (pur se l’articolo XXXI, limitatamente al Consiglio dei Provvisori, parla esplicitamente di criterio della rappresentanza proporzionale), le età per essere eletti divergono in modo inequivoco (trenta anni in Italia, venti a Fiume; si veda l’art 40 dello Statuto albertino a tale proposito). Inoltre in Italia si prevedevano requisiti censitari sconosciuti alla Carta del Carnaro. Le due Camere, o Consigli, hanno attribuzioni radicalmente differenziate, in forza della loro diversa composizione; il potere legislativo compete al Consiglio degli Ottimi che lo esercita nella stesura del Codice penale e civile, nella organizzazione della Polizia, della Difesa nazionale, della Istruzione pubblica secondaria, delle Arti belle, dei Rapporti fra lo Stato e i Comuni. Al contrario il Consiglio dei Provvisori, espressione delle categorie corporative, ha potestà legislativa in materia di diritto commerciale, diritto della navigazione, diritto del lavoro e quelle che oggi potremmo definire relazioni industriali, diritto tributario e bancario. Le decisioni più rilevanti, come ad esempio i trattati internazionali e la riforma del testo costituzionale, competono al cd Arengo del Carnaro (anche noto come Consiglio Nazionale), ovvero i due Consigli di cui si è detto sopra, riuniti in seduta comune. Il potere esecutivo conosce la sua sistemazione in due articoli, il XXXV e il XXXVI; si tratta di due norme eminentemente descrittive, che passano in rassegna la struttura dei Rettori, equivalenti dei Ministri. Essi sono raccolti in un ufficio, un organo collegiale assimilabile in qualche misura al Consiglio dei Ministri in cui il primo Rettore svolge la sua funzione di coordinamento e di apertura del dibattito, come “primus inter pares”. Una delle novità più rilevanti è situata anche nell’ordinamento giudiziario cui la Carta dedica una cospicua mole di norme; esercizio migliore non potrebbe esservi di una lettura sinottica di queste norme e delle corrispondenti che lo Statuto albertino dedica all’argomento. Salta subito all’occhio quanto scarne siano le norme previste dalla costituzione italiana vigente in quegli anni, gli articoli dal 68 al 73; articoli che rimandano prevalentemente alla legge settoriale occupandosi poco della morfologia giudiziaria e del processo. Al contrario la Carta del Carnaro all’articolo XXXVII delinea una lunga serie di organi giudiziari, alcuni dei quali di sorprendente modernità; essi sono i Buoni uomini, i Giudici del Lavoro, i Giudici togati, i Giudici del Maleficio, la Corte della Ragione. Gli articoli successivi si dilungano in maniera organica a delineare la funzione peculiare e specifica di questi giudici. I buoni uomini potrebbero essere considerati antesignani dei nostri giudici di pace, con competenza esclusivamente su materie civili aventi un valore non superiore alle cinquemila lire, ed una residuale competenza in sede penale per quei reati che potremmo definire bagattellari, con pena non superiore all’anno di reclusione. L’articolo XXXIX si dilunga in maniera articolata per delineare le caratteristiche della magistratura del Lavoro, e non potrebbe essere altrimenti se si pensa l’importanza che il lavoro riveste nella Carta. Si tratta di una norma di grandissima finezza giuridica, in cui al giudice del lavoro sono rimesse le cause lavorative e legate alle dinamiche corporative, materie tecniche e come tali ben conoscibili da esperti del settore che saranno appunto nominati giudici dalle varie Corporazioni; non solo, il Costituente fiumano prevede anche, per garantire celerità e speditezza nel rendere giustizia, la creazione di sezioni specializzate, le quali saranno chiamate a riunirsi nel caso di proposizione di appello. Vi sono poi giudici togati, giurisperiti chiamati in via residuale a decidere sulle cause che non appartengano alla giurisdizione di buoni uomini o tribunale del lavoro. Questi giudici, in organo collegiale definito Tribunale, costituiscono giudice d’appello per quel che concerne le cause proposte davanti ai Buoni Uomini. L’articolo XLI prevede l’istituzione del cd Tribunale del Maleficio, composto da sette cittadini-giurati e da un giudice togato con funzioni di presidente. Si tratta di una sorta di Corte d’Assise penale, competente inoltre a decidere sui reati a sfondo politico. Vi è poi l’istituzione della Corte della Ragione, supremo giudice delle leggi (e dei provvedimenti dell’esecutivo), organo chiamato a giudicare anche dei conflitti di attribuzione tra legislatore ed enti locali(17). Si tratta in tutta evidenza di una costituzionalizzazione della funzione giudiziaria eminentemente diversificata rispetto a quella accolta dalle carti costituzionali ispirate ai criteri francesi, in cui la magistratura è un ordine con garanzie formali e sostanziali di indipendenza rispetto agli altri poteri; certamente permane grado di autonomia, in quanto non vi è soggezione del giusdicente rispetto agli altri poteri dello Stato però allo stesso tempo non esiste nemmeno una magistratura in senso tecnico.Anzi, gran parte dei cittadini chiamati a far valere la funzione giudiziaria sono diretta emanazione di interessi corporativi, con l’eccezione dei togati e dei dottori in legge nominati a comporre la Corte della Ragione. D’altronde basta scorrere la normativa italiana, pre e post-unitaria, in tema di ordinamento giudiziario per comprendere come la magistratura di carriera, costituita in autonoma classe specializzata, fosse divenuta a tutti gli effetti un corpo più o meno separato dall’esecutivo (più o meno perché ad esempio la legge Cortese, r.d. 2626/1865 ancorava in modo abbastanza netto la nomina dei magistrati a seguito di concorso indetto dall’esecutivo e soprattutto ne delineava lo status in termini non prettamente di indipendenza; nemmeno le modifiche intervenute successivamente, fino al 1890, andavano nel senso di una autonomizzazione, autonomizzazione che si palesò al’orizzonte solo con la legge organica Zanardelli, la l. 6878/1890 e con la legge Orlando, l. 438/1908...tuttavia nel 1920, quando la Carta del Carnaro viene promulgata la magistratura italiana gode di una piena autonomia, con tanto dell’avvenuta creazione del CSM e inamovibilità dei pretori, ed una sempre più evidente tecnicizzazione della funzione.). Nella Reggenza di Fiume a rigore non esiste una vera magistratura, non si prevedono contrappesi e bilanciamenti tra le funzioni, tanto che le Corporazioni, che appartengono a tutti gli effetti al novero dei corpi sociali e che esprimono anche una loro funzione legislativa (a mezzo di nomina di cittadini che finiranno nel Consiglio dei Provvisori), sono anche chiamate ad esprimere dei “magistrati” tecnici per il processo del Lavoro e per altre Corti. Questa curiosa commistione di differenti livelli logici troverà una sua peculiare eco nell’ordinamento Grandi; per fare un esempio che sia chiarificatore basta leggere il paragrafo ventinovesimo della Relazione del Guardasigilli al Re, paragrafo in cui si esprime chiaramente una visione etica dello Stato e della funzione giudiziaria che deve permanere indipendente solo per non vedere turbare il giudizio del magistrato (nonostante poi il magistrato stesso debba essere “responsabilizzato” verso il raggiungimento del bene supremo della comunità statuale). Certo una nozione curiosa di indipendenza. Consci della effimera consistenza della Reggenza, o quantomeno del suo essere minacciata dall’esercito italiano, i costituenti decidono tuttavia di costituzionalizzare la figura del Comandante, ricalcata palesemente sulla figura del “dittatore” del diritto pubblico romano; figura necessariamente transitoria, chiamata a risolvere casi di eccezionale gravità, il Comandante assomma tutti i poteri. La durata del suo incarico è stabilita dal Consiglio Nazionale, che è pure competente alla sua nomina. La difesa nazionale, strettamente interrelata alla figura del Comandante, viene affidata al “popolo in armi”, e tanto gli uomini quanto le donne devono prendere parte alle attività militari, i primi come combattenti le seconde come ausiliarie. L’art XLIX contiene una disposizione piuttosto oscura, prevedendo che “in tempo di pace e di sicurezza, la Reggenza non mantiene l'esercito armato; ma tutta la nazione resta armata, nei modi prescritti dall'apposita legge, e allena con sagace sobrietà le sue forze di terra e di mare”. Si tratta indubbiamente del tentativo di configurare una vera e propria milizia di popolo, sulla scia di suggestioni rivoluzionarie riprese dalla esperienza sovietica. Una conferma a questa impostazione ci arriva da uno scritto di De Ambris(18), in cui si mette in luce l’analogia intercorrente tra bolscevismo e fascismo (almeno il primo fascismo, quello cui lo stesso De Ambris aveva inizialmente abbracciato); non a caso nella temperie fiumana si tenterà la sintesi tra nazionalismo e istanze rivoluzionarie sociali, attingendo al patrimonio culturale dei cd teorici della violenza rivoluzionaria, come Blanqui e Sorel, che come noto furono tra le letture di formazione pure del giovane Mussolini. L’oscurità della norma adombra in realtà una contraddizione; il non mantenimento dell’esercito in armi cozza decisamente con il concetto di una nazione che resta comunque armata. E per quanto, come tenta di precisare il resto della disposizione, si operi una differenza tra servizio militare attivo e istruzione militare vi è da dire che la norma non si chiarifica, se non nel senso di una enunciazione di principio che vuole appunto la determinazione di una milizia popolare. Per rimanere in tema di spirito popolare e di democrazia diretta, alcune norme si premurano di garantire al cittadino la possibilità di partecipare, sia pur in modo limitato e mediato, al processo legislativo. A norma dell’art LV “ogni sette anni il grande Consiglio nazionale si aduna in assemblea straordinaria per la riforma della Costituzione. Ma la Costituzione può essere riformata in ogni tempo quando sia chiesta dal terzo dei cittadini in diritto di voto. Hanno facoltà di proporre emendamenti al testo della Costituzione i membri del Consiglio nazionale le rappresentanze dei Comuni la Corte della Ragione le Corporazion.”. Invece per l’art LVI, “tutti i cittadini appartenenti ai corpi elettorali hanno il diritto d'iniziare proposte di leggi che riguardino le materie riservate all'opera dell'uno o dell'altro Consiglio, rispettivamente. Ma l'iniziativa non è valida se almeno il quarto degli elettori, per l'uno o per l'altro Consiglio, non la promuova e non la sostenga.”. La carta costituzionale disciplina anche l’istituto della riprova, ovvero un referendum da leggersi sia in chiave propositiva quanto abrogativa. Estremamente moderno, e attuale, l’art LIX, il quale stabilisce che “nessun cittadino può esercitare piú di un potere né partecipare di due corpi legislativi nel tempo medesimo”. Abbiamo visto come la Carta sia un testo estremamente moderno, persino ardito in alcune parti; non mancano, come si accennava più sopra, delle contraddizioni e delle aporie soprattutto dettate dal tono generale di enunciazione solenne, persino meta- letteraria. E così, se da un lato sono comprensibili il mancato raccordo concettuale tra istanze socialisteggianti e quelle più smaccatamente nazionalistiche e statolatriche, diventa invece più arduo comprendere come in tema culturale la Carta si affretti a sancire l’uguaglianza di tutte le lingue salvo poi specificare che la lingua superiore a tutte, per retaggio storico e missione universale è quella italiana. Partizione comprensibile in termini di opportunità politica, meno in una prospettiva giuridica e costituzionale. La Carta tuttavia non ha modo di essere messa alla prova; promulgata l’8 Settembre del 1920, quindi al crepuscolo dell’esperienza fiumana (che sarebbe definitivamente finita col cd Natale di sangue in quello stesso anno), essa si appresta quindi a passare alla storia come uno di quei documenti di altissimo valore simbolico, come la Costituzione della Repubblica romana, priva però di una reale messa in pratica. Al Fascismo quel documento risulterà pressocchè inservibile(19) dal punto di vista pratico-organizzativo (ma non certamente da quello culturale); gli unici studiosi fascisti che si interesseranno ad essa saranno gli analisti del pensiero corporativo, come Menegazzi, Peteani, Ugo Spirito(20) ma la loro visione del corporativismo sarà decisamente differenziata rispetto a quella sussunta nel dato normativo della Carta. Piuttosto il Fascismo riprenderà la visione del lavoro fiumana e la tipizzerà nella Carta del Lavoro, cercando di dare un seguito, mediante il Ministero delle Corporazioni, alla piena collaborazione armonica tra le classi per il superiore bene della Nazione. Ma ciò che soprattutto il Fascismo riprenderà sarà il sostrato culturale sotteso alla esperienza fiumana, anche se la funzionalizzazione sociale della proprietà sarà raggiunta soltanto nel sudario di sangue e fuoco della Repubblica Sociale. Note
|
00:10 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, droit, constitution, politique, théorie politique, sciences politiques, italie, politologie, d'annunzio |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Tsarigrad ou le rêve brisé

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 2003
Trouvé sur : http://www.polemia.com/campagne.php?cat_id=31&iddoc=664
[Visitez souvent le site de l’association “Polemia” de Jean-Yves Le Gallou!!]
Fabien de STENAY :
Tsarigrad ou le rêve brisé
"Je me répète lentement, pour bien m'en pénétrer, cette phrase mélancolique d'un vieux prince Bibesco : « La chute de Constantinople est un malheur personnel qui nous est arrivé la semaine dernière »." Comme le montre la fin amère du fameux roman de Jean Raspail « Le Camp des Saints », la chute de Constantinople reste dans l'imaginaire européen symbole de fatalité, de perte irréversible et d'autant plus douloureuse. Pourtant, avec le reflux de l'Empire ottoman à partir du XVIIIe siècle, il s'en fallut de peu pour que la Seconde Rome revînt aux mains des Européens. Mais, comme souvent, ce fut la division de ceux-ci qui ruina tous les espoirs.
Dans l'Europe restaurée du Congrès de Vienne et de la Sainte Alliance, la Russie s'était assignée la mission de garantir l'ordre sur le continent.
Dès le début de son règne, le tsar Nicolas Ier (1825-1855) fit du contrôle des détroits - « les clefs de la maison » - le second objectif de sa diplomatie pour des raisons au moins autant mystiques que stratégiques. La politique de grande fermeté qui suivit vis-à-vis de la Sublime Porte déboucha en 1828 sur une guerre. L'armée russe fut victorieuse, et l'avantageux traité d'Andrinople fut conclu le 14 septembre 1829 : la Russie obtenait les bouches du Danube, des territoires caucasiens, ainsi que le libre passage à travers les détroits pour ses navires marchands. Enfin, les provinces de Moldavie et de Valachie obtenaient leur autonomie et leur placement sous protectorat russe (tout en restant officiellement rattachées à l'Empire ottoman). Les armées du tsar approchaient des Balkans.
Toutefois, les principes arrêtés par Alexandre Ier restaient de vigueur : on se contentait d'affaiblir l'Empire ottoman, tout en maintenant son intégrité territoriale. Dès le début des années 1830, cette politique relativement modérée porta ses fruits : le sultan demanda en 1833 l'aide russe contre le soulèvement du pacha d'Egypte Mehmet Ali. En retour, un traité d'assistance mutuelle fut signé entre les deux Empires; une clause secrète interdisait à l'Empire ottoman d'ouvrir les Dardanelles aux bâtiments de guerre étrangers.
Les grandes puissances européennes, en premier lieu l'Angleterre, contestèrent le privilège accordé aux Russes, et un nouveau conflit turco-égyptien donna l'occasion d'un nouveau traité : la convention des Détroits, entre l'Autriche, la France, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie, par laquelle les Britanniques obtinrent que les détroits soient interdits, en temps de paix, à tout navire autre que turc.
La Russie conservait toutefois des droits sur les populations chrétiennes de l'Empire ottoman, en particulier dans les Balkans.
Aussi, quand, en 1852, Napoléon III obtint la restitution de douze lieux saints de Palestine à l'Eglise catholique qui les avait perdus en 1808 au profit de l'Eglise orthodoxe, la diplomatie russe perçut le succès français comme une menace. Au début de l'année suivante, le tsar proposa donc au gouvernement britannique un plan de partage de l'Empire ottoman excluant Napoléon III : l'Egypte reviendrait à l'Angleterre tandis que la Russie obtiendrait les Principautés roumaines, la Serbie, la Bulgarie ainsi que le contrôle des détroits. Mais le projet ne pouvait qu'échouer : le tsar négligeait la force des ambitions françaises, et surtout l'hostilité des Anglais comme des Autrichiens à l'avancée russe dans les Balkans. Après une nouvelle guerre russo-turque et la destruction de la flotte ottomane le 30 novembre 1853 à Sinope, la France et l'Angleterre entrèrent en guerre contre le tsar. La guerre de Crimée se poursuivit pendant plus de deux ans et aboutit à une débâcle russe. Le nouveau tsar Alexandre II, à la tête d'une Russie en net recul, consacra alors une bonne partie de son énergie à réformer son Empire, et renonça pour le moment à son expansion balkanique.
Le climat des années 1870 renoua en partie avec celui qui suivit le Congrès de Vienne : en 1873, une alliance des trois empereurs (Allemagne, Autriche-Hongrie, Russie) ayant pour but de préserver l'équilibre européen semblait rejouer la Sainte-Alliance.
Mais pour le tsar, cette place qui lui était donnée devait servir de tremplin à une nouvelle politique balkanique conforme à la poussée du nationalisme et du panslavisme dans l'opinion russe. Celle-ci avait en effet commencé à s'engager passionnément dans la « question d'Orient » au nom de la cause panslave. Moscou, « troisième Rome », devait non seulement défendre les intérêts des minorités slaves et orthodoxes de l'Empire ottoman, mais aussi libérer ceux-ci du joug turc et reprendre pied à Constantinople. De plus en plus, la cité du Bosphore était désignée dans la langue russe sous le nom fortement connoté de Tsarigrad, « la ville des empereurs ». Des comités panslaves se formèrent dans les grandes villes (Moscou, Saint-Pétersbourg, Kiev, Odessa…), et nourrissaient leur idéologie par les écrits de plumes prestigieuses, comme Danilevski ou Dostoïevski. Ce dernier écrivait par exemple dans le « Journal d'un écrivain » : « Le chemin du salut exige que la Russie, et pour son propre compte, s'empare de Constantinople, car la Russie seule a le droit de dire qu'elle est à la hauteur de la tâche ». Certes, le gouvernement russe se méfiait de cette surenchère, mais elle contribua néanmoins au renforcement de l'engagement russe dans les Balkans, au moment même où les minorités orthodoxes de l'Empire ottoman se révoltèrent.
Le mouvement lancé en juillet 1875 par les paysans orthodoxes de Bosnie contre leurs seigneurs musulmans se généralisa en effet à l'ensemble des Balkans.
Devant la féroce répression turque et l'entrée en guerre de la Serbie et du Monténégro, la Russie tint naturellement à intervenir. Prudente, elle attendit la garantie de la neutralité autrichienne pour déclarer la guerre aux Ottomans, en avril 1877. L'engagement russe fut massif et, malgré la vive résistance turque, les troupes du Tsar entrèrent dans Andrinople, à 200 Km de Constantinople, en janvier 1878. Le 3 mars suivant, le traité de San Stefano entérinait la victoire de la Russie, qui obtenait de plus des territoires arméniens et roumains. L'Empire ottoman dut reconnaître formellement l'indépendance de la Serbie, du Monténégro, de la Roumanie, et accepter l'autonomie d'une grande Bulgarie englobant la Macédoine.
Toutefois, ce traité bilatéral russo-turc, bien qu'il témoignât du dynamisme retrouvé de la politique balkanique russe, se heurta à l'hostilité des diplomaties autrichienne et anglaise qui voyaient d'un mauvais œil cette grande Bulgarie, vaste Etat slave client de la Russie. Les autorités russes durent bientôt accepter le principe d'une conférence internationale; celle-ci se déroula à Berlin en juin et juillet 1878, sous l'égide du chancelier Bismarck et en présence des dirigeants européens de tout premier plan. La Russie dut renoncer à l'autonomie de la Grande Bulgarie et accepter que la Bosnie-Herzégovine fût occupée par l'Autriche-Hongrie. Malgré le dynamisme de la politique balkanique d'Alexandre II, la fin de son règne fut donc marquée par l'opposition virulente des Autrichiens et des Anglais, bientôt rejoints par l'Allemagne : en 1879, une nouvelle alliance, la Duplice, réunissait les Empires autrichien et allemand face à la Russie.
Le combat pour Tsarigrad restait toutefois une préoccupation au moins inconsciente de l'impérialisme russe. « Ce damné mirage de Constantinople », comme fait dire Soljénitsyne à l'un des personnages de «Novembre Seize», allait jouer un rôle dans les négociations qui menèrent à la Première Guerre Mondiale et qui la rythmèrent.
En 1912, lors des guerres menées contre la Turquie par les Etats balkaniques, la Russie soutint ces derniers en faisant bien comprendre à tous que la question constantinopolitaine était un domaine réservé du Tsar. Mais surtout, la mise en place de la Triple Entente impliquait un accord entre Saint-Pétersbourg et Londres : en 1905, la France avait en effet refusé de suivre les cousins Guillaume II et Nicolas II dans leur projet de grande alliance continentale, concocté à Björkö. Après cet échec, le réarmement naval de l'Allemagne inquiéta la Russie, qui, en 1907, n'eut d'autre choix que de suivre la France dans son alliance avec l'Angleterre, bien que cette dernière eût soutenu le Japon dans la guerre de 1904-1905. Mais malgré l'accord tacite de ses alliés à l'enlèvement de Constantinople aux Turcs, la Russie savait qu'elle ne pourrait faire admettre celui-ci aux Autrichiens qu'à la faveur d'une guerre victorieuse.
C'est donc après le déclenchement du conflit européen en août 1914 (la Russie ne déclara la guerre à la Turquie qu'en novembre) que commencèrent les manœuvres, militaires comme diplomatiques, autour de la Ville de Constantin.
En 1915, Anglais et Français montèrent l'opération des Dardanelles, en vue d'occuper Constantinople et de négocier sa remise à la Russie. Mais devant la résistance menée par Mustafa Kemal et le général allemand Liman von Sanders, l'offensive fut abandonnée après plusieurs mois meurtriers, et ce malgré l'épuisement imminent de l'armement turc: le retrait de l'amiral anglais De Robeck, commandant en chef de l'opération, stupéfia les Turcs qui ne pensaient pas pouvoir tenir plus longtemps ; il n'est pas impossible que la victoire ait été délibérément évitée. Mais ce n'est pas la dernière occasion manquée dans cette affaire.
À partir de la fin de 1916, des négociations secrètes furent ouvertes entre Vienne et Paris, par l'intermédiaire des princes de Bourbon-Parme, frères de l'impératrice Zita et officiers dans l'armée belge. En février 1917, Charles Ier d'Autriche fit savoir qu'il était prêt à accepter, non seulement la restitution à la France de l'Alsace-Moselle (et même des places enlevées au second traité de Paris en 1815), au sujet de laquelle il fallait encore convaincre Guillaume II, ignorant tout de ces tractations, mais aussi la souveraineté russe sur Constantinople : sans le soutien autrichien dans les Balkans, il était impossible aux Turcs de résister à une offensive de la Russie et de ses alliés. Le 24 mars, Charles Ier mit ses propositions par écrit, celles-ci restant toutefois encore secrètes.
Mais le 31 mars 1917, Clemenceau convainquit le nouveau ministre des Affaires étrangères Ribot de rompre les pourparlers engagés par son prédécesseur Briand. Entre-temps, la révolution avait éclaté en Russie, et celle-ci allait bientôt se retirer du conflit ; pendant que Lénine et Trotsky s'activaient en secret, Ribot trahissait les engagements de la France en révélant, aux Italiens d'abord, puis à tous, les propositions autrichiennes. Les révolutionnaires de Petrograd et les radicaux de Paris mettaient fin à un vieux rêve en passe de s'accomplir.
Seuls de rares rêveurs espèrent encore que la Seconde Rome et Sainte-Sophie seront un jour libérées. Encore cet espoir n'est-il souvent guère plus qu'une illusion romantique.
Toutefois, il n'est pas exclu qu'un jour, peut-être plus proche qu'on ne l'imagine, l'Europe enfin unie ou tout du moins solidaire puisse récupérer l'antique cité fondée au VIIe siècle A.C. par les Grecs de Mégare, élevée au rang de capitale impériale par Constantin le Grand et phare de l'Europe orientale pendant un millénaire. Car si Nietzsche nous apprend que la volonté de puissance est un moteur de l'histoire, n'oublions pas pour autant combien peut être grande la puissance de la volonté.
Fabien de STENAY,
(10/10/2003 - © POLEMIA).
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, turquie, russie, géopolitique, orthodoxie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 16 avril 2010
Le Général Sikorski: un "trouble-fête têtu" selon ses alliés anglo-saxons
Alfred SCHICKEL:
Le Général polonais Wladyslaw Sikorski: “un trouble-fête têtu” selon ses “alliés” anglo-saxons
Une conversation téléphonique entre Churchill et Roosevelt révèle les causes véritables de la mort « accidentelle » du Premier Ministre polonais en exil pendant la seconde guerre mondiale
 Le 25 novembre 2008, on a ouvert la crypte de la Cathédrale de Cracovie qui servait de tombeau à Wladyslaw Sikorski, premier ministre du gouvernement polonais en exil (de 1939 à 1943). Le procureur de la République de Pologne a ordonné d’exhumer le corps de Sikorski pour faire définitivement la lumière, à l’aide des méthodes techniques les plus modernes employées actuellement par la criminologie, sur les causes véritables de la mort du général et homme politique polonais, ôté à la vie, il y a plus de soixante-cinq ans lors de la chute de son avion dans la mer au large de Gibraltar. La nouvelle de la mort « accidentelle » du chef du gouvernement polonais Sikorski avait à peine été divulguée, le 4 juillet 1943, que les premiers doutes quant à la vérité de cette nouvelle étaient émis. Les experts en aéronautique et les observateurs critiques, à l’époque, ont jugé peu crédible, pour diverses raisons, la version d’un « accident d’avion ayant entrainé la mort ». La première chose qui les a frappés, c’est que lors de la chute de l’appareil utilisé par Sikorski tous les passagers n’ont pas trouvé la mort mais seulement une partie de ceux-ci, comme si certains d’entre eux avaient été « ciblés ». Par ailleurs, personne n’a pu dissimuler que le premier ministre polonais était tombé en disgrâce profonde chez Staline.
Le 25 novembre 2008, on a ouvert la crypte de la Cathédrale de Cracovie qui servait de tombeau à Wladyslaw Sikorski, premier ministre du gouvernement polonais en exil (de 1939 à 1943). Le procureur de la République de Pologne a ordonné d’exhumer le corps de Sikorski pour faire définitivement la lumière, à l’aide des méthodes techniques les plus modernes employées actuellement par la criminologie, sur les causes véritables de la mort du général et homme politique polonais, ôté à la vie, il y a plus de soixante-cinq ans lors de la chute de son avion dans la mer au large de Gibraltar. La nouvelle de la mort « accidentelle » du chef du gouvernement polonais Sikorski avait à peine été divulguée, le 4 juillet 1943, que les premiers doutes quant à la vérité de cette nouvelle étaient émis. Les experts en aéronautique et les observateurs critiques, à l’époque, ont jugé peu crédible, pour diverses raisons, la version d’un « accident d’avion ayant entrainé la mort ». La première chose qui les a frappés, c’est que lors de la chute de l’appareil utilisé par Sikorski tous les passagers n’ont pas trouvé la mort mais seulement une partie de ceux-ci, comme si certains d’entre eux avaient été « ciblés ». Par ailleurs, personne n’a pu dissimuler que le premier ministre polonais était tombé en disgrâce profonde chez Staline.
La peur de l’imprévisibilité d’Uncle Joe
On sait que Sikorski considérait que les officiers polonais assassinés, et dont les corps furent découverts par les Allemands à Katyn en avril 1943, avaient été les victimes des services secrets soviétiques. Staline a feint l’indignation face au soupçon qu’émettait Sikorski et s’en est servi comme prétexte pour rompre avec le gouvernement polonais en exil à Londres et pour répandre la rumeur que Sikorski était « un collaborateur d’Hitler ». Le président des Etats-Unis, Franklin D. Roosevelt, et le premier ministre britannique Winston Churchill, qui partageaient en secret les présomptions de Sikorski, ont fini par considérer les soupçons contre Staline, émis et réitérés par le premier ministre polonais, comme une entrave à la bonne entente au sein de l’alliance forgée entre les puissances anglo-saxonnes et le bolchevisme soviétique. Roosevelt et Churchill ont donc cherché une « solution », d’autant plus qu’ils étaient tous deux entrés en conflit avec Sikorski sur le tracé futur de la frontière polono-soviétique. Dans ce contexte, Roosevelt et Churchill soutenaient les revendications soviétiques qui réclamaient le retour à l’URSS des régions d’Ukraine et de Biélorussie occidentales, annexées par la Pologne en 1921, ce qui impliquait automatiquement de reconnaître la « Ligne Curzon » comme future frontière orientale de la Pologne. Sikorski, en revanche, voulait que ces régions demeurassent polonaises et qu’on ne tint aucun compte de la « Ligne Ribbentrop-Molotov ». Si Sikorski disparaissait de la scène politique, raisonnait-on à Londres, à Washington et à Moscou, la coalition antihitlérienne gardait toutes ses chances de survivre et de se renforcer.
A Londres et à Washington, on craignait par dessus tout que l’URSS sorte de cette coalition et ne fasse plus cause commune contre l’Allemagne ; c’est ce que prouve un extrait de conversation téléphonique entre Churchill et Roosevelt, daté du 29 juillet 1943, qui se trouve aujourd’hui dans les archives du « Centre de Recherches en Histoire Contemporaine » d’Ingolstadt (« Zeitgeschichtliche Forschungsstelle Ingolstadt »). Au cours de cette conversation, le premier ministre britannique dit au président des Etats-Unis « qu’Uncle Joe (le surnom donné à Staline) a entrepris des rapprochements inopportuns avec les Nazis dans le but d’un règlement négocié ». Prendre parti pour Sikorski aurait dès lors contribué à renforcer cette tendance chez Staline à vouloir s’arranger séparément avec Hitler et créer ainsi la surprise comme le Pacte Hitler/Staline d’août 1939 avait créé, lui aussi, la surprise. Roosevelt pensait également que Sikorski était un « trouble-fête têtu » qu’il fallait éliminer.
Finalement, Churchill s’est également exprimé expressis verbis en faveur d’une « élimination de Sikorski » : « Ces choses-là, aussi désagréables soient-elles, doivent être pourtant faites, tout simplement dans l’intérêt de la cause commune » et, dans la foulée, Churchill entraine Roosevelt avec lui dans la responsabilité de la « mort accidentelle » du premier ministre du gouvernement polonais en exil : « Je ne peux pas m’imaginer que vous ayez oublié nos entretiens personnels justement sur ce sujet-là, lors de mon dernier séjour à Washington. Cela s’est passé il y a juste deux mois. Vos vues sur la question correspondaient presque exactement aux miennes ».
Churchill a même durci sa position, à propos du soupçon qui pesait sur les seuls Britanniques, en répondant, piqué au vif, à Roosevelt qui cherchait à se dégager de toute responsabilité dans la mort de Sikorski parce qu’il devait tenir compte des électeurs américains d’origine polonaise. Churchill, dans la conversation téléphonique que nous évoquons, déclare sans détours à Roosevelt : « Vous savez très bien que nous avons discuté du cas Sikorski jusque dans les moindres détails et vous savez aussi que vous étiez entièrement d’accord avec la solution que je proposais. Vous ne pouvez nullement contester le fait que vous saviez et que vous êtes coresponsable. Je ne pourrai pas l’accepter ». Roosevelt a alors répondu sur un ton abrupt : « Vous devrez pourtant l’accepter. Je répète que je n’ai eu aucune connaissance préalable » ; ensuite, dur, il a adressé les paroles suivantes à Churchill : « L’un de mes plus fidèles conseillers m’a dit, quand il a appris l’accident, que trop de gens, qui n’étaient pas d’accord avec vous, avaient des accidents d’avion mortels ».
Roosevelt, en poursuivant la conversation avec son allié, met ensuite l’accent sur l’importance capitale de sa présidence et fait la leçon au Britannique : « Si je ne suis pas nominé, je ne pourrai pas être élu. Comprenez-vous cela ? Et si je ne suis pas élu, mon adversaire probable, que tiennent les réactionnaires et les cercles d’affaires, ne sera pas aussi coopératif et amical à l’égard de vous tous, et surtout pas à l’égard d’Uncle Joe. Si je tombe, l’alliance pourrait bien vaciller et vous aussi vous vacillerez. L’Uncle Joe pourrait alors conclure une paix séparée avec Hitler, et qu’arrivera-t-il alors à l’Angleterre ? Hitler pourrait dans ce cas tourner toute sa colère et toute son aviation contre vous pour se venger de certaines de vos actions comme le dernier raid contre Hambourg » ; Roosevelt faisant ici une allusion directe à l’ « Opération Gomorrhe » lancée deux jours auparavant par la RAF et qui a coûté la vie à 35.000 civils.
Révélations compromettantes sur le comportement des alliés occidentaux
L’incident démontre en toute clarté que les Etats-Unis ont délibérément étalé leur puissance et humilié simultanément, et de manière assez cruelle, l’Empire britannique, jadis si puissant et dont Churchill prétendait être l’intendant, responsable de son destin présent et futur. Apparemment sans en avoir eu l’intention, le président Roosevelt a contribué, par cette conversation téléphonique vespérale du 29 juillet 1943, à nous éclairer sur bon nombre d’événements peu élucidés de notre histoire contemporaine. De même, cette querelle au téléphone entre l’ « Amiral Q » et le « Colonel Warden » —selon les pseudonymes qu’utilisaient toujours Churchill et Roosevelt à fins de camouflage, lorsqu’ils s’annonçaient sur la ligne spéciale qui les reliait et qui était mise à leur disposition par l’ « American Telephone & Telegraph » de New York et la « British Post » de Londres— révèle quels ont été, pendant l’été 1943, les rapports réels entre les puissances occidentales et l’Union Soviétique. En tant que source concrète de notre histoire contemporaine, cette conversation téléphonique peut se révéler explosive par son contenu, vu le débat qui secoue aujourd’hui la Pologne pour savoir quelles ont été les véritables circonstances de la mort de Wladyslaw Sikorski.
Prof. Alfred SCHICKEL.
(article paru dans « Junge Freiheit », Berlin, n°51/2008 ; trad.. franc. : Robert Steuckers).
00:15 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, pologne, europe, seconde guerre mondiale, deuxième guerre mondiale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 11 avril 2010
La Légion Nationale / Het Nationaal Legioen
La Légion Nationale / Het Nationaal Legioen
 De eerste Derde Weg-beweging in België was het zeer radicale Nationaal Legioen of Légion Nationale, dat in mei 1922 ontstond uit de Fraternelles (oudstrijdersbonden) en vanaf midden 1924 opbloeide onder impuls van de Luikse ex-christen-democraat, advocaat, oorlogsvrijwilliger en voormalig officier Paul Hoornaert (1888-1944). Vanaf 1927 werd het Legioen geleid door hem en zijn compagnon Breughelmans.
De eerste Derde Weg-beweging in België was het zeer radicale Nationaal Legioen of Légion Nationale, dat in mei 1922 ontstond uit de Fraternelles (oudstrijdersbonden) en vanaf midden 1924 opbloeide onder impuls van de Luikse ex-christen-democraat, advocaat, oorlogsvrijwilliger en voormalig officier Paul Hoornaert (1888-1944). Vanaf 1927 werd het Legioen geleid door hem en zijn compagnon Breughelmans.
Voornoemde Fraternelles verenigden voormalige soldaten van het IJzerfront en zagen de opgang van socialisme, algemeen stemrecht en flamingantisme met lede ogen aan. In de jaren 1920 evolueerden de Belgisch-nationalistische kringen in de richting van Derde Weg-ideologieën. Zo ontstonden naast het Nationaal Legioen/Légion Nationale ook de Action Nationale van de katholieke senator Pierre Nothomb, het Légion Patriotique en de Faiseau Belge. Allen werden daarbij aanvankelijk sterk geïnspireerd door de Franse Action Française van Charles Maurras en later door de machtsovername van Derde Weg-bewegingen in Italië en Portugal. De meeste leden van Nothombs Action Nationale liepen over naar het Legioen.
Het Nationaal Legioen/Légion Nationale was met 5.000 leden en afdelingen in heel België een sterke organisatie. Aanvankelijk was het ideologisch en organisatorisch sterk beïnvloed door het Italiaanse fascisme. Het Legioen wou een nationale revolutie om in België een Nieuwe Orde te installeren, waarbij de politieke partijen en het parlement zouden vervangen worden door een krachtdadige regering onder leiding van de koning. Verder was het Legioen antimarxistisch, antiparlementair, antisemitisch, Belgisch-nationalistisch, royalistisch en wees iedere deelname aan verkiezingen af. Echte toenadering tot Degrelles Vlaams-Waalse partij Rex was dan ook onmogelijk.
Hoornaert richtte de gedisciplineerde en op Italiaanse leest geschoeide militie Services de Protection op, met helmen, knuppels en donkerblauwe uniformen en geleid door ‘commandanten’. Dit was de éérste militie in België en ze schuwde gewelddadige confrontaties met flaminganten, socialisten en communisten niet. De militie veranderde later haar naam in Groupes Mobiles en vanaf 1934 in Nationalistische Jonge Wacht/Jeunes Gardes Nationalistes.
 Het Nationaal Legioen/Légion Nationale was onderverdeeld in centuriën en gebruikte de Romeinse groet en de fasces. Naast een eigen militie had het ook ‘sportafdelingen’ (die de facto voor paramilitaire training zorgden). Dit laatste werd door de Wet op de Privé-milities van 1934 aan banden gelegd, hoewel dit geenszins de verdere groei van het Legioen hinderde. De leden legden de eed van trouw af aan Vorst, Volk en Vaderland en droegen ook een ring van het Nationaal Legioen.
Het Nationaal Legioen/Légion Nationale was onderverdeeld in centuriën en gebruikte de Romeinse groet en de fasces. Naast een eigen militie had het ook ‘sportafdelingen’ (die de facto voor paramilitaire training zorgden). Dit laatste werd door de Wet op de Privé-milities van 1934 aan banden gelegd, hoewel dit geenszins de verdere groei van het Legioen hinderde. De leden legden de eed van trouw af aan Vorst, Volk en Vaderland en droegen ook een ring van het Nationaal Legioen.
Verder had het Nationaal Legioen/Légion Nationale veel invloed in het Belgische leger, waarin het opereerde onder de naam MDS (Le Mot du Soldat). Tijdens de Tweede Wereldoorlog vormde MDS zich om tot een geheime postdienst voor het verzet (cfr. infra). De beweging was ook betrokken bij de mislukte staatsgreep van Rex-leider Léon Degrelle op 25 oktober 1936 en onderhield nauwe banden met vermoedelijk zowel de Belgische als Franse inlichtingendiensten.
Hoewel het Legioen vooral sterk stond in Franstalig België, had het toch ook in Vlaanderen enige aanhang. Zo had het Nationaal Legioen in Gent een secretariaat aan de Nederkouter 32 en werd reeds in 1924 een afdeling in Antwerpen opgericht, die vanaf 1929 opbloeide toen het Nederlandstalige ledenblad Het Belgisch Nationaal Legioen verscheen. Deze periodiek kende een aantal naamsveranderingen: Het Nationaal Legioen (1934), Het Legioen (1935) en Storm (1939). De verantwoordelijke voor dit blad was de Deurnse uitgever-publicist Raymond Gilbert. Onder de leiders van de Antwerpse Legioen-afdeling vinden we Melchior Peeters en H.C. Frederiks als propagandaleiders en de ex-flamingant Arthur Rotsaert, die overgestapt was van de Action Nationale. Ook sommige andere Antwerpse Legioen-leiders, zoals de advocaten René Lambrichts, Edouard Van Lil en Ferdinand Van de Vorst, waren afkomstig uit de kringen rond Pierre Nothomb. Bij de gewone leden van het Antwerpse Legioen was er een sterke katholieke inslag.
De Antwerpse afdeling was gevestigd in het Nationaal Huis in de Lange Gasthuisstraat 42, waarin ook een andere Antwerpse Belgisch-nationalistische organisatie, de Jonge Belgen/Jeunes Belges, gevestigd was. De Jonge Belgen gingen in de eerste helft van de jaren 1930 grotendeels op in het Legioen. Zo was Antwerps Legioen-gouwleider André Van Meel afkomstig uit de Jonge Belgen, evenals de Franstalige edelman Charles Decallone en de Belgisch-nationalistische militante Yvonne Mabesoone.
Na de Duitse bezetting van België in 1940 weigerde het virulent anti-Duitse Nationaal Legioen/Légion Nationale te collaboreren, maar ging daarentegen in het verzet. De Duitsers lieten het Legioen aanvankelijk met rust. Vergaderingen en oefenkampen, zelfs in uniform, bleven mogelijk. Toen de bezetters merkten dat ze het Legioen niet in een knechtenrol zoals de Eenheidsbeweging-VNV of Rex konden duwen, werd in augustus 1941 een compleet activiteitsverbod opgelegd. Vanaf dat ogenblik zat het Legioen in de clandestiniteit. In september 1941 ondernamen de Duitsers een enorme razzia in heel het land, waarbij ruim 200 Legioen-leiders werden gearresteerd. Velen daarvan belandden definitief in concentratiekampen. Leider Paul Hoornaert werd in 1941 door de Gestapo opgepakt en stierf in 1944 in het Duitse concentratiekamp Sonnenburg. Het volledige Legioen werd in juni 1941 onder de naam Groep Hoornaert-Dirix in het vanuit Londen gedirigeerde Geheim Leger opgenomen en verspreidde onder andere illegale pamfletten, pleegde sabotage en bespioneerde Duitse troepenbewegingen.
Het getuigt dan ook zonder meer van een gebrek aan historische kennis dat toenmalig Minister van Defensie André Flahaut tijdens een plechtigheid van de Koninklijke Verbroederingen van het Geheim Leger op 28 april 2002 de voormalige verzetstrijders loofde om hun “toewijding aan de democratische zaak” en hen tevens waarschuwde voor de volgens hem opkomende antidemocratische tendenzen. En wel om de simpele reden dat de kern van het Belgische verzet zo zwart als de nacht was, iets wat na de oorlog ‘vergeten’ werd omdat dit soort clichés politiek bruikbaar was. Het Belgische verzet ontstond immers vooral uit Belgisch-nationalistische motieven en was antidemocratisch …
00:10 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : belgique, belgicana, flandre, wallonie, années 20, années 30, nationalisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 08 avril 2010
L'expédition allemande au Tibet de 1938-39
Synergies européennes – Bruxelles/Munich/Tübingen – Novembre 2006
Detlev ROSE :
L’expédition allemande au Tibet de 1938-39
Voyage scientifique ou quête de traces à motivation idéologique ?
 Le 20 avril 1938 cinq jeunes scientifiques allemands montent à bord, dans le port de Gènes, sur le « Gneisenau », un navire rapide qui fait la liaison avec l’Extrême-Orient. Le but de leur voyage : le haut plateau du Tibet, entouré d’une nuée de mystères, le « Toit du monde ». Sous la direction du biologiste Ernst Schäfer, s’embarquent pour une aventure hors du commun pour les critères de l’époque, Bruno Beger (anthropologue et géographe), Karl Wienert (géophysicien et météorologue), Edmund Geer (en charge de la logistique et directeur technique de l’expédition) et Ernst Krause (entomologiste, cameraman et photographe).
Le 20 avril 1938 cinq jeunes scientifiques allemands montent à bord, dans le port de Gènes, sur le « Gneisenau », un navire rapide qui fait la liaison avec l’Extrême-Orient. Le but de leur voyage : le haut plateau du Tibet, entouré d’une nuée de mystères, le « Toit du monde ». Sous la direction du biologiste Ernst Schäfer, s’embarquent pour une aventure hors du commun pour les critères de l’époque, Bruno Beger (anthropologue et géographe), Karl Wienert (géophysicien et météorologue), Edmund Geer (en charge de la logistique et directeur technique de l’expédition) et Ernst Krause (entomologiste, cameraman et photographe).
Tous les participants à cette expédition étaient membres des « échelons de protection » (SS), mais ce fait justifie-t-il d’étiqueter cette expédition d’ « expédition SS », comme on le lit trop souvent dans maints ouvrages ? Cette étiquette fait penser qu’il s’agissait d’une expédition officielle du Troisième Reich. Est-ce exact ? Les SS avaient-il vraiment quelque chose à voir avec ce voyage de recherche vers cette lointaine contrée de l’Asie ? Quel intérêt les dirigeants nationaux-socialistes pouvaient-ils bien avoir au Tibet ? Comment cette expédition a-t-elle été montée ; quels étaient ses objectifs, ses motifs ? A quoi a-t-elle finalement abouti ? Beaucoup de questions, qui ont conduit à des études sérieuses mais aussi à l’éclosion de mythomanies, de légendes.
Des sources non encore étudiées…
« On a raconté et écrit beaucoup de sottises sur cette expédition au Tibet après la guerre », disait le dernier survivant Bruno Beger (1). Cela s’explique surtout par la rareté des sources, qui rend l’accès à ce thème fort malaisé. Il existe certes des travaux à prétention scientifique sur ce sujet, mais, jusqu’il y a peu de temps, nous ne disposions d’aucune analyse complète et détaillée sur les recherches tibétaines entreprises sous le Troisième Reich. Cette lacune est désormais comblée, grâce à une thèse de doctorat de Peter Mierau, un historien issu de l’Université de Würzburg (2). Le thème de ses recherches était la « politique nationale socialiste des expéditions ». Dans le cadre de cette recherche générale, il aborde de manière fort complète cette expédition allemande au Tibet de 1938-39. Mierau a découvert des sources qui n’avaient pas encore été étudiées (ou à peine) jusqu’ici. Certes, ce travail ne répond pas encore à toutes les questions mais, quoi qu’il en soit, les connaissances actuellement disponibles sur cette mystérieuse expédition se sont considérablement élargies.
Cette remarque vaut surtout pour les prolégomènes de cette entreprise aventureuse. Le biologiste et ornithologue Ernst Schäfer s’était taillé une bonne réputation en Allemagne, comme spécialiste du Tibet. Deux fois déjà, il avait participé, en 1931-32 et de 1934 à 1936, aux expéditions américaines de Brooke Dolan au Tibet oriental et central. En 1937, Himmler, Reichsführer SS, avait remarqué ce jeune scientifique prometteur et dynamique. Il prit contact avec lui. Schäfer était en train de préparer une nouvelle expédition. Himmler voulait simplement profiter du prestige acquis par le jeune savant. Il voulait inclure l’expédition dans le cadre de l’ « Ahnenerbe », la structure « Héritage des Ancêtres » qu’il avait créée en 1935, et, ainsi, placer l’expédition sous patronage SS (3). Le spécialiste du Tibet était certes déjà membre des SS à ce moment-là, mais il aurait préféré placer son expédition sous le patronage du département culturel des affaires étrangères ou de la très officielle DFG (« Communauté scientifique allemande ») et avait effectué des démarches en ce sens (4).
En l’état actuel des connaissances, il n’est donc pas possible d’affirmer ou d’infirmer clairement que les préparatifs de l’expédition aient été entièrement effectués sous la houlette des SS ou de l’Ahnenerbe (5). Le nom officiel de l’expédition était le suivant : « Expédition allemande Ernst Schäfer au Tibet » (= « Deutsche Tibetexpedition Ernst Schäfer »). Himmler eut droit au titre de « patron » de l’expédition et avait tenu à connaître personnellement tous les participants avant qu’ils ne partent et de donner le titre de SS à deux des scientifiques qui ne l’avaient pas encore (Krause et Wienert). Dans les articles des journaux, l’entreprise était souvent citée comme « Expédition SS ». Schäfer lui-même a utilisé cette dénomination à plusieurs reprises (6).
Le rôle très restreint de l’Ahnenerbe
Il a été question de faire de l’Ahnenerbe, la communauté scientifique fondée par les SS, l’un des commanditaires de cette expédition. On peut le prouver par l’existence d’un programme de travail provisoire intitulé « Ziele und Pläne der unter Leitung des SS-Obersturmführer Dr. Schäfer stehenden Tibet-Expedition der Gemeinschaft « Das Ahnenerbe » (Erster Kurator : Der Reichsführer SS)“ (= Objectifs et plans de l’expédition au Tibet de la Communauté „Héritage des Ancêtres » sous la direction du Dr. Schäfer, Obersturmführer des SS (Premier curateur : le Reichsführer SS) ». Muni de ce document, le département d’aide économique de l’état-major personnel du Reichsführer SS a appuyé le dossier de Schäfer auprès de la DFG (7). Après cette démarche, l’Ahnenerbe n’a plus joué aucun rôle officiel dans les préparatifs et la tenue de l’expédition. L’historien canadien Michael H. Kater, dans son ouvrage de référence sur la question, note que cette « vague institution », aux contours flous, a causé bien des tensions entre Schäfer et les dirigeants de l’Ahnenerbe Wolfram Sievers et Walter Wüst. De plus, l’Ahnenerbe ne semblait pas en mesure de financer quoi que ce soit relevant de l’expédition (8).
Ce qui est certain, en revanche, c’est que l’expédition a été financée par des cercles ou initiatives privées. Bruno Beger dit qu’Ernst Schäfer a été en mesure de rassembler quelque 70.000 Reichsmark, dont 30.000 provenaient du « conseil publicitaire » des cercles économiques allemands ; 20.000 RM de la DFG (qui s’appelait jusqu’en 1935 : « Notgemeinschaft Deutscher Wissenschaft ») ; 15.000 RM sont entrés dans les caisses grâce à l’entremise du père de Schäfer, qui était à l’époque le directeur de la fabrique de produits de caoutchouc Phoenix à Hambourg-Harburg ; les 5.000 RM restants ont été offerts par le « Frankfurter Zeitung » (9). Ces donateurs enthousiastes et généreux avaient été séduits par la passion et l’engagement des participants, surtout d’Ernst Schäfer. Beger se souvient encore : « Les instruments scientifiques, les appareils, les équipements photographiques, cinématographiques, sanitaires, presque tout nous a été prêté et même donné » (10).
Himmler, pour sa part, s’adressa à Göring pour que celui-ci mette 30.000 RM en devises à la disposition des explorateurs. Il fit verser cette somme à l’avance. Ce n’était pas une maigre somme car il fallait que l’expédition puisse disposer de toutes les sommes nécessaires en devises, pour qu’elle soit tout simplement possible (11).
Les premiers Allemands dans la « Cité interdite »
Ernst Schäfer s’occupa seul des préparatifs politiques et diplomatiques du voyage scientifique. Vu la situation internationale à l’époque, le chemin vers le Tibet ne pouvait se faire qu’au départ de l’Inde sous domination britannique : il fallait donc obtenir l’autorisation de la Grande-Bretagne. L’adhésion au projet de Britanniques en vue, Schäfer l’obtint grâce à son habilité diplomatique. Il s’embarqua lui-même pour l’Angleterre et en revint avec bon nombre de lettres de recommandation. Les participants à l’expédition ne savaient pas s’il allait être possible d’entrer dans le Tibet, alors indépendant, ni au début de leur voyage ni pendant les premiers mois de leur séjour, qu’ils passèrent pour l’essentiel dans la province septentrionale de l’Inde britannique, le Sikkim. Ce n’est qu’en novembre 1938, après de longues négociations et grâce aux bons travaux préparatoires, que leur parvint une invitation du gouvernement tibétain, comprenant également une autorisation à séjourner dans la « Cité interdite » de Lhassa. Au départ, cette autorisation de séjourner à Lhassa ne devait durer que deux semaines, mais elle a sans cesse été prolongée, si bien que les chercheurs allemands finirent par y rester deux mois. Ils étaient en outre les premiers Allemands à avoir pu pénétrer dans Lhassa.
Ce résultat, impressionnant vu les difficultés de l’époque, est dû principalement au travail et à la persévérance personnelle d’Ernst Schäfer et de ses compagnons plutôt qu’à l’action hypothétique des SS et de l’Ahnenerbe. Ernst Schäfer, quand il a organisé cette expédition, a toujours mis l’accent sur son indépendance, sur ses initiatives personnelles ; il a toujours voulu mettre cette entreprise en branle de ses propres forces, pour autant que cela ait été possible. Dans ces démarches, il jouait aussi, bien sûr, la carte de ses contacts SS, les utilisait et les mobilisaient, tant que cela pouvait lui être utile ou se révélait nécessaire (12). Mais en ce qui concerne les préparatifs et le financement (mis à part l’octroi des 30.000 RM en devises), le rôle des SS est finalement fort limité, d’après les nouvelles sources découvertes et exploitées par nos nouveaux historiens.
Mais cette modestie s’avère-t-elle pertinente aussi quand il s’est agi de déterminer les buts de l’expédition ? Quels étaient en fait les objectifs que s’était assignés Schäfer en préparant sa troisième expédition au Tibet ? Et que voulait Himmler ? Cette dernière question est bien évidemment la plus captivante, mais aussi celle à laquelle il est le plus difficile d’apporter une réponse précise ; les sources ne nous révèlent rien de bien substantiel. Il n’y a aucune déclaration ni aucun commentaire écrit du Reichsführer SS à propos de cette expédition. Seuls quelques indices existent. Ainsi, Schäfer rapporte, dans ses mémoires non encore publiées, une conversation qu’il a eue avec Himmler et quelques-uns de ses intimes. Himmler lui aurait demandé, lors de cette rencontre, « s’il avait vu au Tibet des hommes aux cheveux blonds et aux yeux bleus ». Schäfer aurait répondu non puis aurait explicité, à l’assemblée réduite des intimes de Himmler, tout son savoir sur l’histoire phylogénétique des hommes de là-bas. Himmler se serait révélé à l’explorateur, ce jour-là, comme un adepte de la « doctrine des âges de glace de Hanns Hörbiger ». Il aurait également fait part à Schäfer qu’il supposait qu’au Tibet « l’on pourrait trouver les vestiges de la haute culture de l’Atlantide immergée » (13). Ernst Schäfer n’a pas cédé : son expédition avait des buts essentiellement scientifiques et aucun autre. Schäfer n’a pas accepté l’exigence première de Himmler d’adjoindre à l’équipe un « runologue », un préhistorien et un chercheur ès-questions religieuses. Il n’a pas davantage accepté de rencontrer l’éminence grise de Himmler, Karl Maria Wiligut pour que celui-ci fasse part de ses théories aux membres de l’expédition (14). Schäfer ne voulait apparemment rien entendre des théories et doctrines occultistes et mythologisantes de Himmler et n’a jamais omis de le faire entendre et savoir (15).
Les thèses de Christopher Hale
Pourtant, on n’hésite pas à affirmer encore et toujours que cette expédition allemande au Tibet avait un but idéologique. Ainsi, dans un film documentaire de 2004, intitulé « Die Expeditionen der Nazis. Abenteuer und Rassenwahn » (= Les expéditions des nazis. Aventure et folie racialiste) (16), cette rengaine est réitérée. Le témoignage magistral que sortent les producteurs de ce documentaire de leur chapeau est un certain Christopher Hale, journaliste britannique de son état, qui venait de publier un livre sur la question et s’était par conséquent recommandé comme « expert » (17). La voix off commence par dire dans l’introduction : « Déjà vers la moitié des années 30, les chercheurs SS recherchaient dans le monde entier les traces d’une race des seigneurs évanouie ». Cette recherche aurait été motivée par la « doctrine des âges de glace », déjà évoquée ici, et théorisée par l’Autrichien Hanns Hörbiger. Hale ajoute alors qu’il est parfaitement absurde d’aller chercher des lointains parents des « Aryens » en Asie, sur le « Toit du monde ». Or, c’est ce que voulait, affirme Hale, l’expédition allemande au Tibet. La raison, pour Hale, réside tout entière dans les théories qui veulent que, dans une période très éloignée dans le temps, une civilisation nordique ou aryenne, supérieure à toutes les autres, ait existé et régné sur un gigantesque empire s’étendant de l’Europe au Japon. Cet empire se serait ensuite effondré à cause du mélange entre ses porteurs nordiques et les « races inférieures ». Il aurait cependant laissé des traces, même dans les coins les plus reculés de la Terre. Au Tibet, auraient affirmé ces théories selon l’expert Hale, de telles traces se retrouveraient dans l’aristocratie. Voilà en gros ce que ce Hale a tenté de démontrer. En même temps, il a essayé implicitement de prouver que les SS et l’Ahnenerbe auraient eu un grand rôle dans la préparation et l’exécution de l’expédition.
Cette interprétation, proposée par Hale, cadre sans doute fort bien avec les théories occultistes du Reichsführer SS, telles que les décrit Schäfer dans ses souvenirs. La « doctrine des âges de glace », la « doctrine secrète » de Madame Blavatsky et le livre paru en 1923 de l’occultiste russe Ferdinand Ossendowski (« Bêtes, hommes et dieux ») auraient donc été les principales sources d’inspiration de Himmler. La conception qu’évoque Christopher Hale d’un « grand empire aryen » remontant à la nuit des temps nous rappelle aussi les doctrines dualistes et racialistes de ceux que l’on nommait les « Ariosophes ». C’est plus particulièrement Jörg Lanz von Liebenfels qui présentait l’effondrement des anciens aryens comme la conséquence d’un mélange interracial. Les adeptes de ces théories, que l’on pose un peu arbitrairement comme les précurseurs occultes du national socialisme (18), ne voulaient absolument rien entendre d’une raciologie et d’une anthropologie scientifiques, comme celles de E. von Eickstedt et de H. F. K. Günther.
Une démarche rigoureusement scientifique
Le documentaire « Les expéditions des nazis » suggère donc que les vues bizarres de Himmler, qui sont sans aucun doute attestées, ont influencé les objectifs de l’expédition au Tibet. Ce serait aussi vrai que deux et deux font quatre, alors que les documents préparatoires de l’expédition ne prouvent rien qui aille dans ce sens (19) ! Himmler aurait certes aimé convaincre Schäfer d’aller rechercher au Tibet les traces d’une antique haute culture aryenne disparue. Mais il n’y est pas parvenu. Les membres de l’expédition se posaient tous comme des scientifiques et comme rien d’autre. Ainsi, par exemple, quand Bruno Beger a photographié et pris les mesures anthropomorphiques, crânologiques et chirologiques, ainsi que les empreintes digitales, de sujets appartenant à divers peuples du Sikkim ou du Tibet, quand il a examiné leurs yeux et leurs cheveux, quand il a procédé à une quantité d’interviews, il a toujours agi en scientifique, en respectant les critères médicaux et biologiques de l’époque, appliqués à l’anthropologie et à la raciologie, sans jamais faire intervenir des considérations fumeuses ou des spéculations farfelues.
Nous pouvons parfaitement étayer cela en nous référant à un essai de Beger, sur l’imagerie raciale des Tibétains, parue en 1944 dans la revue « Asienberichte » (20). Dans cet essai, Beger nous révèle les connaissances scientifiques gagnées lors de l’expédition. D’après le résultat de ses recherches, les Tibétains sont le produit d’un mélange entre diverses races de la grande race mongoloïde (ou race centre-asiatique ou « sinide »). On peut certes repérer quelques rares éléments de races europoïdes. Ce sont surtout celles-ci, écrit Beger : « Haute stature, couplée à un crâne long (ndt : dolichocéphalie), à un visage étroit, avec retrait des maxillaires, avec nez plus proéminent, plus droit ou légèrement plus incurvé avec dos plus élevé ; les cheveux sont lisses ; l’attitude et le maintien sont dominateurs, indice d’une forte conscience de soi » (21). Il explique la présence de ces éléments europoïdes, qu’il a découverts, par des migrations et des mélanges ; il évoque ensuite plusieurs hypothèses possibles pour expliquer « les rapports culturels et interraciaux entre éléments mongoloïdes et races europoïdes, surtout celles présentes au Proche-Orient ». Il a remarqué, à sa surprise, la présence « de plusieurs personnes aux yeux bleus, des enfants aux cheveux blonds foncés et quelques types aux traits europoïdes marqués » (22) (ndt : cette présence est sans doute due aux reflux des civilisations et royaumes indo-européens d’Asie centrale et de culture bouddhiste après les invasions turco-mongoles, quand les polities tokhariennes ont cessé d’exister ; cette présence est actuellement attestée par les recherches autour des fameuses momies du Tarim). Les remarques formulées par Beger s’inscrivent entièrement dans le cadre de l’anthropologie de son époque ; son essai ne contient aucune de ces allusions ou conclusions « mythologiques », contraire aux critères scientifiques ; Beger n’emploie jamais les vocables typiques de l’ère nationale socialiste tels « Aryens », « nordique » ou « race supérieure » ou « race des seigneurs » (23).
Ernst Schäfer a explicité les buts de son expédition
Dans le même numéro d’ « Asienberichte », Ernst Schäfer publie, lui aussi, un essai, sous le titre de « Forschungsraum Innerasien » (= « Espace de recherche : Asie intérieure) (24), dans lequel il explique quelles ont été les motifs de son expédition. Après les recherches pionnières effectuées dans le cœur du continent asiatique, lors des premières expéditions qui y furent menées, il a voulu procéder à des recherches plus systématiques en certains domaines et fournir par là même une synthèse des résultats obtenus en diverses disciplines. « Tel était l’objectif de ma dernière expédition au Tibet en 1938-39 ; … elle visait à obtenir une vue d’ensemble, après avoir tâté la réalité sur le terrain à l’aide de diverses disciplines scientifiques, ce qui constitue la condition première et factuelle pour que des spécialistes en divers domaines puissent travailler main dans la main, en s’explicitant les uns aux autres les matières traitées, de façon à compléter leurs savoirs respectifs ; toujours dans le but de faire apparaître plus clairement les tenants et aboutissants de toutes choses ». La tâche principale, qu’il s’agissait de réaliser, était la suivante : « Saisir de manière holiste l’espace écologique exploré », raison pour laquelle « la géologie, la flore, la faune et les hommes ont constitué les objets de nos recherches » (25).
Obtenir une synthèse globale et scientifique de ce qu’est le Tibet dans sa totalité, tel a donc été le but de l’expédition allemande au Tibet en 1938-39. Il n’existe aucun indice quant à d’autres motivations ou objectifs dans les rapports rédigés par les membres de l’expédition, qui décrivent leurs faits et gestes au Tibet de manière exhaustive et détaillée (26). L’image qu’ils donnent du Tibet se termine par un résumé des résultats obtenus par leurs recherches, accompagné d’une liste méticuleuse de toutes leurs activités et des échantillons prélevés, ainsi que le texte d’un exposé, prononcé par Schäfer à Calcutta. Parmi les résultats, nous trouvons des rapports sur le magnétisme tellurique, sur les températures, sur la salinité des lacs, sur les plans des bâtiments visités, sur la cartographie relative aux structures géologiques, sur les échantillons de pierres et de minéraux, sur les fossiles découverts, sur les squelettes d’animaux, sur les reptiles, les papillons et les oiseaux, sur les plantes séchées, les graines de fleurs, de céréales et de fruits, auxquels s’ajoutent divers objets à l’attention des ethnologues tels des outils et des pièces d’étoffe. A tout cela s’ajoutent 20.000 photographies en noir et blanc et 2000 photographies en couleurs, ainsi que 18.000 mètres de films (27), dont les explorateurs ont tiré, après leur retour, un documentaire officiel (28).
Aucun indice pour justifier les hypothèses occultistes
Le livre de Hale ne résiste pas, comme nous venons de le démontrer, à une analyse critique sérieuse. Cette faiblesse s’avère encore plus patente quand il s’agit d’analyser les thèses aberrantes de l’auteur, qui cherche à expliquer l’avènement du Troisième Reich par les effets directs ou indirects de toutes sortes de thèses et théories occultistes ou conspirationnistes. L’historien Peter Mierau l’explique fort bien dans sa thèse de doctorat : « Dans les années qui viennent de s’écouler, la double thématique du national socialisme et du Tibet a été dans le vent dans plusieurs types de cénacles. Les activités de chercheur de Schäfer, dans l’entourage de Heinrich Himmler, sont mises en rapport avec des théories occultistes, ésotéristes de droite, sur l’émergence du monde, avec des mythes germaniques et des conceptions bouddhistes ou lamaïstes de l’au-delà. Pour étayer ces thèses, on ne trouve aucun indice ou argument dans les sources écrites disponibles » (29).
Les occultistes endurcis ne se sentent nullement dérangés par ce constat scientifique. Ils affirment alors, tout simplement, que le caractère officiel d’une telle entreprise n’est que façade, pour dissimuler la nature de la « mission secrète » et les « motifs véritables ». Quand on sort ce type d’argument (?), inutile d’insister : ces spéculations ne sont ni prouvables ni réfutables.
Tant les tenants des thèses occultistes les plus hasardeuses que les dénonciateurs inscrits dans le cadre de la « correction politique » contemporaine, ne trouveront, dans les sources disponibles sur l’expédition allemande au Tibet de 1938-39, aucun élément pour renforcer leurs positions. Même si les explorateurs ont appartenu aux SS et s’ils ont eu des rapports étroits, dès leur retour en août 1939, avec l’Ahnenerbe (dans le département des recherches sur l’Asie intérieure), l’expédition proprement dite ne poursuivait aucun objectif d’ordre idéologique, comme l’ont affirmé les participants eux-mêmes. Bruno Beger, dans son rapport (30), écrit : « Tous les objectifs et toutes les tâches effectuées dans le cadre de nos recherches ont été déterminés et fixés par les participants à l’expédition, sous la direction de Schäfer. Objectifs et tâches à accomplir avaient tous un caractère scientifique sur base des connaissances acquises dans les années 30 ». Certes, les SS espéraient que les résultats scientifiques de l’expédition permettraient une exploitation d’ordre idéologique, mais cela, c’est une autre histoire ; Himmler espérait sans nul doute que les explorateurs découvrissent au Tibet des preuves capables d’étayer ses théories. Par conséquent, la leçon à tirer de cette expédition allemande au Tibet en 1938-39 est la suivante : elle constitue un exemple évident que même dans un Etat totalitaire, comme voulait l’être l’appareil national socialiste et le « Führerstaat », où le parti et la volonté du chef auraient compénétré ou oblitéré l’ensemble des activités des citoyens, le doigté et l’habilité personnelles, chez un homme comme Schäfer, permettaient malgré tout de se donner une marge de manœuvre autonome et des espaces de liberté.
Detlev ROSE.
(Article tiré de la revue « Deutschland in Geschichte und Gegenwart », n°3/2006).
Notes:
(1) Bruno BEGER, Mit der deutschen Tibetexpedition Ernst Schäfer 1938/39 nach Lhasa, Wiesbaden, 1998, page 6. Ce livre récapitule les notes du journal de voyage de Beger, réadaptées pour publication. Il n’a été tiré qu’à une cinquantaine d’exemplaires.
(2) Peter MIERAU, Nationalsozialistische Expeditionspolitik. Deutsche Asien-Expeditionen 1933-1945, Munich, 2006 (cet ouvrage est également une thèse de doctorat de l’Université de Munich, présentée en 2003). On y trouve une vue synoptique des sources et de l’état des recherches en ce domaine aux pages 27 à 34. Les expéditions de Schäfer sont décrites de la page 311 à la page 363.
(3) Michael H. KATER, Das Ahnenerbe der SS 1935-45. Ein Beitrag zur Kulturpolitik im Nationalsozialismus, Stuttgart, 1974, page 79.
(4) MIERAU, op. cit., p. 327, note 2.
(5) Ibidem, p. 329.
(6) Ibidem. Les participants auraient marqué leur désaccord quant à la qualification de leur expédition. Cette révélation a été faite à l’auteur de ces lignes par Bruno Beger, via une lettre à son fils Friedrich (6 août 2006).
(7) MIERAU, op. cit., p. 332, note 2.
(8) KATER, op. cit., p. 79, note 3.
(9) Communication de Bruno Beger dans une lettre de Friedrich Beger à l’auteur (27 mars 2006). Kater estime que la totalité des frais s’élève à 60.000 RM (p. 79 et ss.). Dans le documentaire « Die Expeditionen der Nazis. Abenteuer und Rassenwahn » (MDR, ZDF Enterprises & Polarfilm, 2004), on prétend que les frais totaux se seraient élevés à plus de 112.000 RM. Le documentaire produit un document, mais le narrateur du film n’en dit pas davantage. Pour en savoir plus sur le financement, cf. MIERAU, op. cit., p. 329 et ss., note 2.
(10) Bruno BEGER, op. cit., p. 8, note 1.
(11) MIERAU, p. 330, note 2. On trouve également un indice dans un discours tenu par Schäfer, peu avant le vol de retour, le 25 juillet 1939, à la tribune de l’Himalaya Club de Calcutta, une association de tourisme et d’alpinisme. Dans ce discours, Schäfer dit avoir reçu le soutien d’Himmler et de Goering ; cf. « Lecture to be given on the 25.7.39 by Dr. Ernst Schäfer at the Himalaya Club », page 4, Bundesarchiv R135/30, 12). Bruno Beger souligne lui aussi l’importance des devises (voir note 6).
(12) MIERAU, ibidem, p. 331.
(13) Ernst SCHÄFER, Aus meinem Forscherleben (autobiographie non publiée), 1994, p. 168 et ss. Voir également MIERAU, op. cit., p. 334 et ss. Cf. Rüdiger SÜNNER, Schwarze Sonne. Entfesselung und Missbrauch der Mythen in Nationalsozialismus und rechter Esoterik, Fribourg, 1999, p. 48.
(14) SÜNNER, ibidem, pp. 49 à 53. MIERAU, pp. 335-342; l’auteur y évoque de manière exhaustive les idées que se faisait Himmler sur le Tibet et leurs sources.
(15) KATER, op. cit., p. 79. SÜNNER, ibidem, p. 49 et ss. BEGER (voir note 9): « Le caractère de Schäfer était tel, qu’il ne permettait pas qu’on lui donne des instructions pour organiser ses voyages et pour lui en dicter les missions ; cela valait aussi pour Himmler ».
(16) Documentaire sur DVD, Die Expeditionen der Nazis. Abenteuer und Rassenwahn, MDR, ZDF Enterprises & Polarfilm, 2004.
(17) Christopher HALE, Himmler’s Crusade. The True Story of the 1938 Nazi Expedition into Tibet, Londres, 2003.
(18) Pour comprendre cet univers complexe, voir Nicholas GOODRICK-CLARKE, Die okkulten Wurzeln des Nationalsozialismus, Graz, 1997.
(19) MIERAU, p. 342, note 2, note en bas de page 1120.
(20) Bruno BEGER, « Das Rassenbild des Tibeters in seiner Stellung zum mongoliden und europiden Rassenkreis », in : Asienberichte. Vierteljahresschrift für asiatische Geschichte und Kultur, n°21, Avril 1944, pp. 29-53.
(21) Ibid., p. 45.
(22) Ibidem, p. 47.
(23) Rüdiger SÜNNER, op. cit. (note 13). R. Sünner se trompe lui aussi, lorsqu’il écrit que Beger “est allé indirectement à l’encontre des fantaisies himmlériennes sur l’Atlantide » (p. 51). « J’avais reçu une invitation pour participer à un débat sur la doctrine des âges de glace en 1937. Je n’ai pu que secouer la tête devant le caractère abscons des opinions qui y ont été exprimées. Mes camarades de l’expédition, y compris Schäfer, riaient bien fort des thèmes qui y avaient été débattus » : c’est en ces mots que Friedrich Beger reprend les paroles de son père (lettre à l’auteur en date du 22 juin 2006).
(24) Ernst SCHÄFER, « Forschungsraum Innerasien », in : Asienberichte. Vierteljahresschrift für asiatische Geschichte und Kultur, n°21, avril 1944, pages 3 à 6.
(25) Ibidem, page 4. Cette présentation correspond à la teneur de la conférence tenue par Schäfer à Calcutta, voir note 11, pages 3 et ss.
(26) Ernst SCHÄFER, Geheimnis Tibet. Erster Bericht der Deutschen Tibet-Expedition Ernst Schäfer 1938-39, Schirmherr: Reichsführer SS, München 1943. En outre, se référer aux notes de Bruno Beger, voir note 1.
(27) Cf. Lecture…. (voir note 11), page 6 et ss.
(28) Ce film est actuellement disponible grâce aux efforts de Marco Dolcetta qui l’a réédité en 1994. A ce propos, cf. H. T. HAKL, « Nationalsozialismus und Okkultismus », in : N. GOODRICK-CLARKE (voir note 18), pp. 194-217, ici p. 204. Hakl, lui aussi, souligne le caractère strictement scientifique de l’expédition, en s’appuyant notamment sur l’essai de Reinhard Greve, „Tibetforschung im SS-Ahnenerbe“, paru dans l’ouvrage collectif, édité par Thomas HAUSCHILD, Lebenslust und Fremdenfurcht. Ethnologie im Dritten Reich, Francfort sur le Main, 1995, pp. 168-209.
(29) MIERAU, op. cit., p.28. L’auteur vise ici tout particulièrement le roman de Russell McCloud, intitulé, dans sa version allemande, Die Schwarze Sonne von Tashi Lhunpo, paru à Vilsbiburg en 1991. Dans ce roman, un ancien SS explique à l’un des protagonistes que l’histoire mondiale est le produit d’une lutte entre deux puissances occultes (pp. 144 à 173).
(30) BEGER, op. cit., p. 278 (voir note 1). Je remercie du fond du coeur monsieur Bruno Beger et son fils Friedrich Beger pour m’avoir permis de consulter notes et documents, pour avoir répondu avec patience à mes nombreuses questions, pour avoir mis à ma dispositions les photographies qui illustrent mon article. A ce propos, je remercie également Monsieur Dieter Schwarz.
00:10 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, allemagne, tibet, asie, himalaya, explorations, expéditions, ernst schäfer, années 30, eurasie, eurasisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 04 avril 2010
Quand le Togo et le Cameroun étaient des protectorats allemands
Erich KÖRNER-LAKATOS :
Quand le Togo et le Cameroun étaient des protectorats allemands
 Pendant longtemps le Grand Electeur Frédéric-Guillaume de Prusse n’a connu aucun succès dans ses ambitions d’outre-mer. L’entreprise, qui a consisté à mettre sur pied une société à l’image de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, a échoué face aux réticences anglaises.
Pendant longtemps le Grand Electeur Frédéric-Guillaume de Prusse n’a connu aucun succès dans ses ambitions d’outre-mer. L’entreprise, qui a consisté à mettre sur pied une société à l’image de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, a échoué face aux réticences anglaises.
En 1682, Frédéric-Guillaume fonde dans le port maritime d’Emden la « Compagnie commerciale brandebourgeoise et africaine » (= « Brandeburgisch-afrikanische Handelskompagnie »). Une fort modeste expédition prend alors la mer, composée de deux navires avec, à leurs bords, à peine une centaine de matelots, quelques scientifiques et trois douzaines de fantassins.
Le jour du Nouvel An de 1683, les Prussiens débarquent au Cap des Trois Pointes sur la Côte d’Or de l’Afrique occidentale, dans le Ghana actuel. Von der Gröben hisse alors le drapeau frappé de l’aigle rouge sur fond blanc, pose la première pierre de la toute première colonie du Prince Electeur, qui est baptisée Gross-Friedrichsburg. Un traité de protection est signé, le « Tractat zwischen Seiner Churfürstlichen Durchlaut von Brandenburg Afrikanischer Compagnie und den Cabusiers von Capo tris Puntas », soit le « Traité entre la Compagnie africaine de son Excellence le Prince Electeur de Brandebourg et les Cabusiers du Cap des Trois Pointes ». Il règle les rapports entre les représentants du Prince Electeur et les chefs indigènes. Le commerce des esclaves, de l’or et de l’ivoire s’avère tout de suite florissant.
Mais des pirates français et des expéditions anglaises, venues de l’intérieur du pays, harcèlent les Prussiens qui, de surcroît, sont minés par les fièvres propres au climat des lieux et par la maladie du sommeil, transmise par la mouche tsétsé.
En 1708, le fortin n’est plus occupé que par sept Européens et quelques indigènes. Berlin en a assez des tracas que lui procure sa base africaine et le Roi Frédéric I (la Prusse est devenue un royaume en 1701) négocie pendant plusieurs années avec les Hollandais. En 1720, tout est réglé : ceux-ci reprennent à leur compte, pour la modique somme de 7200 ducats et pour quelques douzaines d’esclaves, les misérables reliquats de la première possession prussienne d’outre-mer.
Il faudra attendre plus d’un siècle et demi pour que quelques maisons de commerce allemandes se fixent à nouveau dans la région, sur la côte de la Guinée. Les Hanséatiques, qui cultivent l’honneur commercial et entendent baser leurs activités sur le principe de la parole donnée, sont confrontés à une concurrence anglaise, qui ne cesse d’évoquer le libre-échange et la « fairness » mais tisse des intrigues et brandit sans cesse la menace. En 1884, les marchands allemands demandent la protection de leur nouvel Empire et le Chancelier Bismarck envoie en Afrique le Consul Gustav Nachtigal, avec le titre de plénipotentionnaire, à bord du SMS Möve.

Drapeau du Togo à l'époque du protectorat allemand
Lorsque Nachtigal aborde les côtes du Togo, le roi local Mlapa demande un accord de protection au Reich, en songeant bien entendu à se protéger contre ses rivaux de l’arrière-pays. Aussitôt dit, aussitôt fait. A partir du 5 juillet 1884, le Togo est un protectorat allemand et, à Lomé (aujourd’hui capitale du pays), on hisse le drapeau du nouveau Reich en ponctuant la cérémonie de salves d’honneur. Une semaine plus tard, Nachtigal jette l’ancre devant les côtes du Cameroun et signe un traité de protection au cours de la deuxième semaine de juillet avec les chefs King Bell et King Aqua. C’est une malchance pour les envoyés de Londres qui n’arrivent que quelques jours après la conclusion de cet accord et ne peuvent donc plus revendiquer la région pour l’Empire britannique.
Dans les décennies qui précédèrent la première guerre mondiale, ce sera surtout le Togo qui deviendra la colonie modèle de l’Allemagne wilhelminienne. Ses principales denrées d’exportation sont le cacao, le coton, les oléagineux, les cacahuètes et le mais. La présence allemande se limite à quelques factoreries et missions sur le littoral togolais ; en 1913, seuls trois cents Allemands vivent au Togo, dont quatre-vingt fonctionnaires coloniaux et cela pour un pays de la taille de l’Autriche actuelle. Les communications avec le Reich sont assurées par la grande station de radio de Kamina, construite en 1914.
Pendant l’été 1914, le Togo sera le théâtre d’une lutte brève mais acharnée. 560 soldats de la police indigène et deux cents volontaires européens tenteront de défendre le Togo allemand coincé entre les Anglais qui avancent à partir de l’Ouest, c’est-à-dire à partir du Ghana actuel, et les Français qui progressent en venant de l’Est, du Dahomey, c’est-à-dire du Bénin d’aujourd’hui. Sur la rivière Chra, les soldats de la police indigène togolaise se lancent contre une colonne franco-anglaise et contraignent les attaquants à se replier : les pertes sont lourdes toutefois dans les deux camps. Le sacrifice des Togolais a été inutile : l’ennemi est très supérieur en nombre. Les Allemands font sauter la station radio de Kamina et le gouverneur, le Duc Adolf Friedrich de Mecklembourg, capitule le 26 août. Anglais et Français se partagent le pays.
La situation est différente au Cameroun, dix fois plus vaste. Au Nord, le Cameroun est une savane herbeuse et, au Sud, une forêt vierge impénétrable. Les denrées d’exportation sont la banane, le cacao, le tabac, le caoutchouc et les métaux précieux. En 1913, le pays compte quatre millions d’indigènes et seulement 2000 Allemands. L’administration est assurée par quatre cents fonctionnaires. Le nombre de femmes et d’enfants européens est insignifiant, vu le climat très difficile à supporter pour les Blancs, si bien qu’il n’y avait pas une seule école pour les enfants d’Européens.

Drapeau du Cameroun à l'époque du protectorat allemand
Dans ce Cameroun alors fort inhospitalier, les Alliés occidentaux auront de grosses difficultés à maîtriser la situation. La troupe de protection de la colonie comprend 43 compagnies, avec 1460 Allemands et 6550 indigènes. Les puissances de l’Entente leur opposaient, au début de la première guerre mondiale, un millier de soldats blancs et 15.000 colorés, parmi lesquels un régiment disciplinaire indien. Les défenseurs de la colonie allemande durent lutter sur trois fronts : au Sud, les Français entendent gagner du terrain au départ du Gabon, au Nord, les Britanniques pénètrent au Cameroun en partant de leur colonie du Nigéria. Plus tard, les Belges enverront une force de trois mille hommes, venus du Congo à l’Est.
 La troupe de protection allemande fut rapidement coupée de toute voie d’approvisionnement et, devant des forces ennemies supérieures en nombre, est obligée de se replier progressivement sur les hauts plateaux du pays, autour de l’actuelle capitale Yaoundé. Les combats acharnés durent jusqu’au début de l’année 1916. A ce moment-là, Allemands et Camerounais n’ont plus de munitions. Les Askaris de l’Empereur Guillaume II engagent le combat contre l’ennemi uniquement avec leurs baïonnettes. A la mi-février, le gros de la troupe de protection gagne un territoire neutre, la colonie espagnole de Rio Muni au Sud du Cameroun. Des dizaines de milliers d’indigènes, fidèles au Reich allemand, les suivent dans cet exil. Dans le Nord du protectorat du Cameroun, à proximité du Lac Tchad, la forteresse de montagne de Maroua tient sans fléchir sous les ordres du capitaine von Raben, grièvement blessé.
La troupe de protection allemande fut rapidement coupée de toute voie d’approvisionnement et, devant des forces ennemies supérieures en nombre, est obligée de se replier progressivement sur les hauts plateaux du pays, autour de l’actuelle capitale Yaoundé. Les combats acharnés durent jusqu’au début de l’année 1916. A ce moment-là, Allemands et Camerounais n’ont plus de munitions. Les Askaris de l’Empereur Guillaume II engagent le combat contre l’ennemi uniquement avec leurs baïonnettes. A la mi-février, le gros de la troupe de protection gagne un territoire neutre, la colonie espagnole de Rio Muni au Sud du Cameroun. Des dizaines de milliers d’indigènes, fidèles au Reich allemand, les suivent dans cet exil. Dans le Nord du protectorat du Cameroun, à proximité du Lac Tchad, la forteresse de montagne de Maroua tient sans fléchir sous les ordres du capitaine von Raben, grièvement blessé.
Il ne rendra les armes —mais ses soldats n’ont plus une seule cartouche !— que lorsqu’il apprendra que le gros de la troupe de protection, invaincue, était en sécurité sur territoire espagnol. La dernière citadelle allemande du Cameroun était tombée. La présence allemande dans ce pays africain appartenait désormais au passé.
Erich KÖRNER-LAKATOS.
(article paru dans « zur Zeit », Vienne, n°50/2005 ; trad.. franc. : Robert Steuckers).
00:10 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, allemagne, afrique, histoire africaine, africanologie, colonisation, impérialisme, première guerre mondiale, affaires africaines |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
The Germanization of Early Medieval Christianity
 EUROPEAN SYNERGIES – MANAGERS’ SCHOOL / BRUSSELS/LIEGE –
EUROPEAN SYNERGIES – MANAGERS’ SCHOOL / BRUSSELS/LIEGE –
OCTOBER 2004 – BIBLIOGRAPHICAL INFORMATION
The Germanization of Early Medieval Christianity: A Sociohistorical Approach to Religious Transformation
by James C. Russell
Price: US$25.00
Product Details
* Paperback: 272 pages ; Dimensions (in inches): 0.72 x 9.16 x 6.08
* Publisher: Oxford University Press; Reprint edition (June 1, 1996)
* ISBN: 0195104668
Editorial Reviews
Synopsis
While historians of Christianity have generally acknowledged some degree of Germanic influence in the development of early medieval Christianity, this work argues for a fundamental Germanic reinterpretation of Christianity. This treatment of the subject follows an interdisciplinary approach, applying to the early medieval period a sociohistorical method similar to that which has already proven fruitful in explicating the history of Early Christianity and Late Antiquity. The encounter of the Germanic peoples with Christianity is studied from within the larger context of the encounter of a predominantly "world-accepting" Indo-European folk-religiosity with predominantly "world-rejecting" religious movements. While the first part of the book develops a general model of religious transformation for such encounters, the second part applies this model to the Germano-Christian scenario. Russell shows how a Christian missionary policy of temporary accommodation inadvertently contributed to a reciprocal Germanization of Christianity.
Ingram
While historians of Christianity have generally acknowledged some degree of Germanic influence in the development of early medieval Christianity, Russell goes further, arguing for a fundamental Germanic reinterpretation of Christianity. He utilizes recent developments in sociobiology, anthropology, and psychology to help explain this pivotal transformation of the West. This book will interest all who wish to further their understanding of Christianity and Western civilization.
Reviewer: Elliot Bougis "coxson" (Taichung, Taiwan)
I stumbled upon this book while researching for a study of the conjoined paganization/Christianization of Medieval literature. What a find! As the reviewer above mentioned, Russell's strength lies in the amazing range of his scholarship. This intellectual breadth, however, does not detract from Russell's more focused, balanced, and lucid examination of key points (e.g., anomie as a factor in social religious conversion, fundamental worldview clashes between Christianity and Germanic converts, etc.). Russell covers a lot of ground in a mere 200+ pages. Moreover, his final assertions are modest enough to be credible, and yet daring enough to remain highly interesting. Plus, from a research perspective, the bibliography alone is worth a handful of other books. This book has been normative in my decisions about the contours of any future scholarship I pursue. Alas, I was left hungering for a continuation of many of the themes, to which Russell often just alludes (e.g, the imbibed Germanic ethos as the animus for the "Christian" Crusades, the contemporary implications of urban anomie for our globalizing world, etc.). Of course, such stellar scholarship cannot be rushed. Surely Russell's next inquiry is worth the wait!
Brilliant and innovative study of Germanic religiosity, September 2, 1999
Reviewer: A reader
Scholar James Russell has given us an important work with this detailed study. Subtitled "A sociohistorical approach to religious transformation," it is an exceedingly well-researched and documented analysis of the conversion of the Germanic tribes to the imported and fundamentally alien religion of Christianity during the period of 376-754 of the Common Era. Russell's work is all the more dynamic as he does not limit his inquiry simply to one field of study, but rather utilizes insights from sources as varied as modern sociobiological understanding of kinship behaviors, theological models on the nature of religious conversion, and comparative Indo-European religious research. Dexterously culling relevant evidence from such disparate disciplines, he then interprets a vast array of documentary material from the period of European history in question. The end result is a convincing book that offers a wealth of food for thought-not just in regards to historical conceptions of the past, but with far-reaching implications which relate directly to the tide of spiritual malaise currently at a high water mark in the collective European psyche. The first half of Russell's work provides an in-depth examination of various aspects of conversion, Christianization and Germanization, allowing him to arrive at a functional definition of religious transformation which he then applies to the more straightforward historical research material in the latter sections of the book. Along the way he presents a lucid exploration of ancient Germanic religiosity and social structure, placed appropriately in the wider context of a much older Indo-European religious tradition. Russell completes the study by tracing the parallel events of Germanization and Christianization in the central European tribal territories. He marshals a convincing array of historical, linguistic and other evidence to demonstrate his major thesis, asserting that during the process of the large European conversions Christianity was significantly "Germanicized" as a consequence of its adoption by the tribal peoples, while at the same time the latter were often "Christianized" only in a quite perfunctory and tenuous sense. Contrary to simplistic models put forth by some past historians, this book illustrates that conversion was not any sort of linear "one-way street"; a testament to the fundamental power of indigenous Indo-European and Germanic religiosity lies in the evidence that it was never fully or substantially eradicated by the faith which succeeded it. As Russell shows, a more accurate scenario was that of native spirituality and folk-tradition sublimated into a Christian framework, which in this altered form then became the predominant spiritual system for Europe. Russell's Germanization of Early Medieval Christianity is wide-ranging yet commanding in its contentions, and academia could do well with encouraging more scholars of this calibre and fortitude who are able to avoid the pitfall of over-specialization and produce works of great scope and lasting relevance. Make no doubt about it, this is a demanding and complex book, but for those willing to invest the effort, the benefits of understanding its content will be amply rewarding, and of imperative relevance for anyone who wishes to apprehend the past, present and future of genuine European religiosity.
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christianisme, christianisation, allemagne, germanie, europe centrale, missions, histoire, moyen âge, période médiévale, époque médiévale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 23 mars 2010
Seconde moitié du 17ème: les Pays-Bas royaux entre Cromwell et Mazarin
 XVII° siècle: les Pays-Bas Royaux entre Cromwell et Mazarin
XVII° siècle: les Pays-Bas Royaux entre Cromwell et Mazarin
23 mars 1657: Mazarin s’allie à Cromwell contre les Pays-Bas Royaux ou Pays-Bas espagnols. L’état de guerre entre Londres et Bruxelles date de septembre 1655, quand les relations diplomatiques ont été rompues entre les deux capitales. Le motif de cette rupture est le fameux “Acte de Navigation”, énoncé par Cromwell le 9 octobre 1651: cet “Acte” réservait l’exclusivité du commerce avec les îles britanniques aux seuls navires anglais, à l’exclusion de tous les autres. Cette décision entraîne une guerre entre les deux puissances protestantes que sont les Provinces-Unies et l’Angleterre. Ipso facto, la lutte entre les Provinces-Unies et l’Angleterre va rapprocher les Pays-Bas Royaux, demeurés catholiques, de leurs frères séparés du Nord, sans que ce rapprochement n’ait été exploité politiquement, métapolitiquement et culturellement par les avocats contemporains de l’idée de Benelux ou de la fusion Flandre/Pays-Bas. La lutte connaîtra son maximum d’intensité en 1652, année où l’espace mosan des Pays-Bas Royaux est ravagé par les combats entre Condé, passé au service de la Couronne d’Espagne, et le Duc de Lorraine, d’une part, contre le Prince-Evêque de Liège, allié à Mazarin.
Il faudra attendre la « Paix de Tirlemont » (17 mars 1654) pour sanctionner la fin des hostilités contre la Principauté ecclésiastique de Liège, dirigée par un évêque bavarois, Maximilien-Henri de Bavière, accusé d’avoir voulu ouvrir la vallée mosane aux armées françaises. Par la « Paix de Tirlemont », la Principauté de Liège acquiert un statut de neutralité, accepté par l’Espagne. Le gouverneur espagnol de Bruxelles, Léopold-Guillaume, fils de l’Empereur germanique Ferdinand II, peut tourner ses forces contre Cromwell. L’état de guerre est proclamé en septembre 1655. Le futur Charles II, prétendant au trône d’Angleterre, forcé à l’exil par les puritains de Cromwell, est contraint de quitter la France, où il s’était réfugié, pour les Pays-Bas Royaux. Ce deuxième exil du roi déchu se précipite à l’instigation de Mazarin qui, en dépit de sa pourpre cardinalice, va s’allier aux pires ennemis des catholiques. Au même moment, Pieter Stockmans, docteur en droit de l’Université de Louvain, rédige un traité contestant aux légats pontificaux le droit d’intervenir dans les affaires politiques des Pays-Bas Royaux ! Au 17ème siècle, la césure catholiques/protestants n’est plus aussi nette qu’au siècle précédent.
Les Pays-Bas Royaux sont dès lors coincés entre la puissance maritime anglaise et la puissance continentale française, sans qu’interviennent les Provinces-Unies, ennemies de l’Angleterre cromwellienne. Henri de Turenne, en 1655, harcèle les Pays-Bas Royaux sur leur frontière méridionale et pénètre en force dans la « trouée de l’Oise », où il se heurte, victorieusement, aux commandants espagnols, Condé et Fuensaldana, assistés de troupes lorraines. Turenne grignote les franges méridionales du Hainaut mais ne parvient pas à atteindre Bruxelles. Entretemps, Charles II s’installe à Bruges, où il tient sa cour, directement face aux côtes anglaises. En 1656, la guerre se porte également sur mer : les bâtiments flamands d’Ostende et de Dunkerque, au service de l’Espagne, se heurtent aux Anglais en Mer du Nord, à proximité des côtes anglaises (Goodwind Sands). Le Capitaine ostendais Erasme de Brauwer couvre la retraite des bâtiments flamands dunkerquois et ostendais et soutient, avec 27 canons contre 36 canons anglais, le feu ennemi pendant treize heures, avant de couler. Don Juan, fils naturel de Philippe IV d’Espagne, devient gouverneur des Pays-Bas Royaux et réorganise l’armée, dont les effectifs, surtout la cavalerie, sont sérieusement étoffés. Cela n’empêchera pas les Français de prendre, le 5 août 1657, la forteresse de Montmédy, qui faisait alors partie du Duché du Luxembourg. Le commandant de la place, Jean de Malandry, refusera de se rendre et tiendra tête, avec 800 hommes, aux 20.000 soldats du Maréchal de la Ferté. Il faudra attendre la mort au combat de ce courageux capitaine, après six semaines de siège, pour que tombe la forteresse (qu’on peut visiter aujourd’hui).
Turenne qui assiège Dunkerque depuis 1656, prend la ville en 1658, après avoir battu aux Dunes l’armée de secours, commandée par Don Juan et Condé. Les Anglais entrent dans le port flamand et les Français prennent successivement Bergues, Furnes, Dixmude, Gravelines, Audenarde et Ypres. Don Juan est rappelé à Madrid. Son successeur est Don Luis de Benavides, Marquis de Caracena, général de cavalerie à la brillante carrière militaire. La mort de Cromwell, le 3 septembre 1658 met un terme aux hostilités. Sous l’impulsion de Jan De Witt, les Provinces-Unies suggèrent une Union entre elles et les Pays-Bas Royaux sur le modèle cantonal suisse. La guerre franco-espagnole s’achève par le Traité de Pyrénées, le 7 novembre 1659. En 1660, Charles II récupère la Couronne d’Angleterre. Le Prince de Ligne tentera bientôt de rappeler au nouveau monarque anglais l’hospitalité que lui avaient octroyée les Pays-Bas Royaux, dans l’espoir de lui faire renoncer à toute alliance qui leur serait hostile et écornerait leur intégrité territoriale. Les résultats de ses démarches diplomatiques ont été assez mitigés.
00:10 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pays-bas, belgique, histoire, belgicana, 17ème siècle |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 20 mars 2010
La CIA mato y enveneno a franceses en los anos 50
La CIA mató y envenenó a franceses en los años 50
Un investigador implica a la CIA en el misterio del “pan maldito”
 Un investigador estadounidense afirma que la CIA está detrás del misterioso caso del “pan maldito”, aparente intoxicación alimentaria con síntomas de desorientación mental que afectó en agosto de 1951 a los vecinos de la localidad francesa Pont-Saint-Esprit, con un balance de cinco muertos y 300 afectados, 30 de los cuales fueron recluidos por largos años en centros psiquiátricos.
Un investigador estadounidense afirma que la CIA está detrás del misterioso caso del “pan maldito”, aparente intoxicación alimentaria con síntomas de desorientación mental que afectó en agosto de 1951 a los vecinos de la localidad francesa Pont-Saint-Esprit, con un balance de cinco muertos y 300 afectados, 30 de los cuales fueron recluidos por largos años en centros psiquiátricos.
El periodista estadounidense Hank Albarelli publicó en 2009 un libro que recoge los resultados de su investigación sobre experimentos secretos que la CIA llevó a cabo en el período de la Guerra Fría. Según el periodista, ampliamente citado por la prensa francesa, el “pan maldito” de Pont-Saint-Esprit contenía dietilamida de ácido lisérgico, o LSD, que la CIA pretendía examinar sus efectos.
Supuestamente, la CIA quiso primero esparcir el LSD sobre Pont-Saint-Esprit desde el aire, pero el método no funcionó, así que la sustancia fue agregada finalmente a la harina de pan. Ciertos colaboradores de la farmacéutica suiza Sandoz, que inventó el LSD en 1938, hacen referencia al “secreto de Pont-Saint-Esprit” y a “dietilamida” en una conversación con agentes de la CIA que Albarelli reproduce en su libro.
Los testigos describen como “apocalíptica” aquella noche de agosto de 1951. Además de náuseas, vómitos, diarreas y otros síntomas típicos de una intoxicación alimentaria, los afectados tenían comportamiento anormal, hasta violento.
Un niño de 11 años intentó estrangular a su abuela. Otro hombre gritaba: “Soy un avión”, poco antes de saltar por la ventana de un segundo piso, por lo que se rompió las piernas. Después, se levantó y continuó unos 50 metros. Otra persona vio a su corazón escapar por sus pies y le pidió a un médico que se lo colocara de nuevo. Muchos de los afectados fueron ingresados con camisas de fuerza.
Sin embargo, la versión de Albarelli no convence a todos. El historiador estadounidense Steven Kaplan la calificó de “clínicamente incoherente”. “El LSD empieza a surtir efecto en cuestión de horas contadas mientras que en Pont-Saint-Esprit los síntomas se manifestaron sólo 36 horas después o incluso más tarde”, declaró él en una entrevista con la cadena France 24.
Extraído de La Radio del Sur.
00:20 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cia, etats-unis, france, années 50, services secrets, opérations secrètes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 19 mars 2010
"British" link to Beslan child massacre

Archives: Oct./8/2004 – http://ca.altermedia.info/
“British” link to Beslan child massacre
A terrorist amongst the group responsible for the Beslan school massacre last month, in which 300 people, half of them children, died turns out to be a British citizen who attended the infamous Finsbury Park mosque in north London where Abu Hamza used to preach.
Two other members of the group, loyal to Chechen warlord and terrorist Shamil Basayev, are also believed to have been active at the mosque until less than three years ago.
Algerians
Russian security sources described Kamel Rabat Bouralha, 46 years old, as an aide of Basayev. The three men, all Algerian-born immigrants given asylum in Britain, travelled to Chechnya from London to take part in fighting there in 2001.
Russian authorities have identified most of the 33 men who occupied the school in Beslan last month and they include two Algerians in their mid-30s called Osman Larussi and Yacine Benalia, both based in London until recently. Like Bouralha, they too attended Finsbury Park mosque and joined the network of groups loyal to Basayev on arrival in Chechnya.
Firing range uncovered
Former associates in London confirmed that Bouralha had been a frequent visitor at Finsbury Park mosque where Abu Hamza preached from around 2000. This is the same mosque where the Metropolitan Police discovered a firing range and ammunition beneath the floors in a cellar.
According to Russian security sources, there are up to 300 Arab mercenaries operating with rebel formations in Chechnya. This fact defeats the lie used by the ‘ apologists for terror ‘ like Vanessa Redgrave, a celebrity Marxist and leading light in the Islamo-Soviet front in Britain, who insists that the war in Chechnya is a “defensive” one by Chechens against Russia and not part of a global jihad (or holy war). Vanessa Redgrave in her role as an apologist for terror guaranteed the £50,000 bail of Akhmed Zakayev, an Chechen warlord wanted by Russia, until he was given asylum in Britain by Jack Straw even though he was implicated in scores of murders in Russia and Chechnya.
London’s role as centre of terror web
It is to Britain’s shame that thousands of Afghanistan trained ex-Taliban, Algerian terrorists, Chechen warlords and other various murderous bandits from around the world have turned London into “Londonistan"; the centre of terror-recruiting and now the terror-exporting capital of the world.
Under both Labour and Tory governments the open borders of Britain and the insane asylum system have been used to wage war against the innocent of the world. Britain’s MI5 and MI6 estimate that at least seven to ten thousand Afghanistan trained Islamic terrorists are resident in Britain. These are the many thousand “ticking bombs” in our towns and cities waiting for the right time to wage war upon us in our own homes and streets.
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, russie, ossétie, tchétchénie, tchétchènes, beslan, massacre, terrorisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 18 mars 2010
Une analyse dissonante de la décennie postsoviétique
Une analyse dissonante de la décennie postsoviétique
00:20 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, urss, union soviétique, russie, cei, eurasie, eurasisme, économie, finances |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 10 mars 2010
Les Germains contre Rome: cinq siècles de lutte ininterrompue
Les Germains contre Rome: cinq siècles de lutte ininterrompue
par Konrad HÖFINGER
 Les sources écrites majeures du monde antique sont romaines, rédigées en latin. Les textes nous livrent donc une vision romaine des cinq siècles de lutte qui ont opposé le long du Rhin, des limes et du Danube, les tribus germaniques à Rome. Konrad Höfinger, archéologue de l'école de Kossina, interroge les vestiges archéologiques pour tenter de voir l'histoire avec l'oeil de ces Germains, qui ont fini par vaincre. Ses conclusions: les tribus germaniques connaissaient une forme d'unité confédérale et ont toutes participé à la lutte, en fournissant hommes ou matériel. La stratégie de guerilla, de guerre d'usure, le long des frontières était planifiée en bonne et due forme, au départ d'un centre, située au milieu de la partie septentrionale de la Germanie libre. Nous reproduisons ci-dessus une première traduction française des conclusions que tire Konrad Höfinger après son enquête minutieuse.
Les sources écrites majeures du monde antique sont romaines, rédigées en latin. Les textes nous livrent donc une vision romaine des cinq siècles de lutte qui ont opposé le long du Rhin, des limes et du Danube, les tribus germaniques à Rome. Konrad Höfinger, archéologue de l'école de Kossina, interroge les vestiges archéologiques pour tenter de voir l'histoire avec l'oeil de ces Germains, qui ont fini par vaincre. Ses conclusions: les tribus germaniques connaissaient une forme d'unité confédérale et ont toutes participé à la lutte, en fournissant hommes ou matériel. La stratégie de guerilla, de guerre d'usure, le long des frontières était planifiée en bonne et due forme, au départ d'un centre, située au milieu de la partie septentrionale de la Germanie libre. Nous reproduisons ci-dessus une première traduction française des conclusions que tire Konrad Höfinger après son enquête minutieuse.
Si nous résumons tous les faits et gestes du temps des Völkerwanderungen (migrations des peuples), nous constatons l'existence, sous des formes spécifiques, d'un Etat germanique, d'une culture germanique, renforcée par une conscience populaire cohérente.
1. Dès l'époque de César, c'est-à-dire dès leur première manifestation dans l'histoire, les Germains ont représenté une unité cohérente, opposée aux Romains; ceux-ci connaissaient les frontières germaniques non seulement celles de l'Ouest, le long du Rhin, mais aussi celles de l'Est.
2. La défense organisée par les Germains contre les attaques romaines au temps d'Auguste s'est déployée selon des plans cohérents, demeurés identiques pendant deux générations.
3. Après avoir repoussé les attaques romaines, les Germains ont fortifié la rive droite du Rhin et la rive gauche du Danube selon une stratégie cohérente et une tactique identique en tous points. Les appuis logistiques pour les troupes appelées à défendre cette ligne provenaient de toutes les régions de la Germanie antique.
4. Quand les Daces, sous la conduite de Decebalus, attaquent les Romains en l'an 100 de notre ère, les Quades passent à l'offensive sur le cours moyen du Danube et les Chattes attaquent le long du Rhin.
5. L'assaut lancé par les Quades et la Marcomans vers 160 a été entrepris simultanément aux tentatives des Alamans sur les bords du Rhin et des Goths sur le cours inférieur du Danube. Les troupes qui ont participé à ses manœuvres venaient de l'ensemble des pays germaniques.
6. A l'époque où se déclenche l'invasion gothique dans la région du Danube inférieur vers 250, les Alamans passent également à l'attaque et s'emparent des bastions romains entre Rhin et Danube.
7. A partir des premières années du IVième siècle, Rome s'arme de l'intérieur en vue d'emporter la décision finale contre les Germains. A partir de 350, les fortifications le long du Rhin et du Danube sont remises à neuf et des troupes, venues de tout l'Empire, y sont installées. Simultanément, sur le front germanique, on renforce aussi ses fortifications en tous points: ravitaillement, appuis, matériel et troupes proviennent, une nouvelle fois, de toute la Germanie, ce qu'attestent les sources historiques.
8. Sur aucun point du front, on ne trouve qu'une et une seule «tribu» (Stamm) ou un et un seul peuple (Volk), mais partout des représentants de toutes les régions germaniques.
9. Les attaques lancées par les Germains en 375 et 376 ne se sont pas seulement déclenchées avec une parfaite synchronisation, mais constituaient un ensemble de manœuvres militaires tactiquement justifiées, qui se complétaient les unes les autres, en chaque point du front. Le succès des Alamans en Alsace a ainsi conditionné la victoire gothique en Bessarabie.
10. La grande attaque, le long d'un front de plusieurs milliers de kilomètres, ne s'est pas effectuée en un coup mais à la suite de combats rudes et constants, qui ont parfois duré des années, ce qui implique une logistique et un apport en hommes rigoureusement planifiés.
11. Les combats isolés n'étaient pas engagés sans plan préalable, mais étaient mené avec une grande précision stratégique et avec clairvoyance, tant en ce qui concerne l'avance des troupes, la sécurisation des points enlevés et la chronométrie des manœuvres. Les sources romaines confirment ces faits par ailleurs.
12. Les événements qui se sont déroulés après la bataille d'Andrinople, entre 378 et 400, ont obligé l'Empereur Théodose à accepter un compromis avec l'ensemble des Germains. Ce compromis permettait à toutes les tribus germaniques, et non pas à une seule de ces tribus, d'occuper des territoires ayant été soumis à Rome.
13. La campagne menée par le Roi Alaric en Italie et la prise de Rome en 410, contrairement à l'acception encore courante, ne sont pas pensables comme des entreprises de pillage, perpétrées au gré des circonstances par une horde de barbares, mais bien plutôt comme un mouvement planifié de l'armée d'une grande puissance en territoire ennemi.
14. Ce ne sont pas seulement des Wisigoths qui ont marché sur Rome, mais, sous les ordres du «Général» Alaric, des représentants de toutes les régions de la Germanie.
15. L'occupation de l'Empire d'Occident s'est déroulée selon un plan d'ensemble unitaire; les diverses armées se sont mutuellement aidées au cours de l'opération.
16. L'armement et les manières de combattre de tous les Germains, le long du Rhin à l'Ouest, sur les rives de la Mer Noire à l'extrémité orientale du front, en Bretagne au Nord, ont été similaires et sont demeurées quasi identiques pendant tous les siècles qu'a duré cette longue guerre. Ils sont d'ailleurs restés les mêmes au cours des siècles suivants.
17. Enfin, la guerre qui a opposé Rome aux Germains a duré pendant quatre siècles complets, ce qui ne peut être possible qu'entre deux grandes unités politiques, égales en puissance. Cette longue guerre n'a pas été une suite d'escarmouches fortuites mais a provoqué, lentement, de façon constante, un renversement du jeu des forces: un accroissement de la puissance germanique et un déclin de la puissance romaine. Cette constance n'a été possible que parce qu'il existait une ferme volonté d'emporter la victoire chez les Germains; et cette volonté indique la présence implicite d'une forme d'unité et de conscience politiques.
Après la victoire germanique, à la fin du IVième siècle, se créent partout en Europe et en Afrique des Etats germaniques, qui, tous, furent édifiés selon les mêmes principes. Que ce soit en Bretagne avec les Angles, en Espagne avec les Alains, en Afrique avec les Vandales, en Gaule avec les Francs, en Italie avec les Goths ou les Lombards, toutes ces constructions étaient, sur les plans politique, économique et militaire, avec leurs avantages et leurs faiblesses, leur destin heureux ou malheureux, le produit d'une identité qu'on ne saurait méconnaître. Il saute aux yeux qu'il existait une spécificité propre à tous les Germains, comme on en rencontre que chez les peuples qui ont reçu une éducation solide au sein d'une culture bien typée, aux assises fermes et homogènes, si bien que leurs formes d'éducation politique et éthique accèdent à l'état de conscience selon un même mode, ciselé par les siècles. Nous avons toujours admiré, à juste titre d'ailleurs, l'homogénéité intérieure de la spécificité romaine, laquelle, en l'espace d'un millénaire, en tous les points du monde connu de l'époque et malgré les vicissitudes politiques mouvantes, est demeurée inchangée et, même, est restée inébranlable dans le déclin. Le monde germanique n'est pas moins admirable pour ce qui concerne l'unité, l'homogénéité et le caractère inébranlable de sa constance: dès qu'il est apparu sur la scène de l'histoire romaine, au Ier siècle avant notre ère, il est resté fidèle à lui-même et constant jusqu'à la fin de la «longue guerre».
Konrad HÖFINGER.
Konrad HÖFINGER, Germanen gegen Rom. Ein europäischer Schicksalskampf, Grabert-Verlag, Tübingen, 1986, 352 S., 32 Abb., DM 45.
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, archéologie, rome, rome antique, antiquité romaine, antiquité, germains, germanie, allemagne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 07 mars 2010
Mai 68: du col Mao au Rotary?
Archives de "Synergies Européennes" - 1986
Mai 68: du col Mao au Rotary?
 On n'a pas fini de parler de Mai 68, même s'il ne reste plus grand'chose de l'effervescence des campus de Berkeley, Berlin ou Paris. Le soixante-huitardisme s'est enlisé dans ses contradictions, s'est épuisé en discours stériles, malgré les fantastiques potentialités qu'il recelait. Examinons le phénomène de plus près, de concert avec quelques analystes français: d'une part Luc FERRY et Alain RENAUT, auteurs de La pensée 68, essai sur l'anti-humanisme contemporain (Gallimard, 1986) et, d'autre part, Guy HOCQUENGHEM, qui vient de sortir un petit bijou de satire: sa Lettre ouverte à ceux qui sont passés du col Mao au Rotary (Albin Michel, 1986). Pour RENAUT et FERRY, la pensée 68 comportait deux orientations possibles: la première était "humaniste"; la seconde était "anti-humaniste". L'humanisme soixante-huitard était anti-techniciste, anti-totalitaire, pour l'autonomie de l'individu, pour l'Eros marcusien contre la civilisation, pour le pansexualisme, pour l'effacement du politique, etc. Pour FERRY et RENAUT, ces valeurs-là sont positives; elles forment le meilleur de l'aventure soixante-huitarde. Pour nous, ce sont au contraire ces idéologèmes-là qui ont conduit aux farces actuelles des "nouveaux philosophes", à leur valorisation infra-philosophique des "droits de l'homme", au retour du fétichisme du "sujet", à la régression du dis-cours philosophique, à l'intérêt porté aux scandaleuses niaiseries d'un Yves MONTAND qui se prend pour un oracle parce qu'il est bon acteur... Ces farces, ces amu-sements stériles, ces assertions pareilles à des slogans publicitaires pour margarine ou yaourts ont permis le retour d'une praxis libérale, le néo-libéralisme, auquel ne croyait plus qu'une poignée d'aimables plaisantins presqu'octogénai-res. Ou encore, Madame Thatcher qui, selon les paroles officieuses de la Reine Elizabeth II, serait bel et bien restée "fille d'épicier" malgré son fard oxfordien. Ipso facto, le petit gauchisme de la pansexualité éroto-marcusienne, le baba-coolisme à la Club Med', le néo-obscurantisme talmudiste de BHL, les éloges tonitruants du cosmopolitisme à la SCARPETTA ou à la KONOPNICKI acquièrent une dimension "géopolitique": ils renforcent la main-mise américaine sur l'Europe occidentale et avalisent, avec une bienveillance très suspecte, les crimes de la machine de guerre sioniste. Décadentistes d'hier et traîneurs de sabre sans cervelle, illuminés moonistes et vieux défenseurs d'un "Occident chrétien", se retrouvent curieusement derrière les mêmes micros, prêchent les mêmes guerres: il n'y a que le vocabulaire de base qui change. L'effondrement du soixante-huitardisme dans ce que RENAUT et FERRY appellent "l'humanisme" s'est également exprimé à l'intérieur des partis de gauche: de l'Eurocommunisme à la trahison atlantiste du PSOE, au révisionnisme du PCI et au mittérandisme atlantiste: le cercle des rénégats est bouclé. HOCQUENGHEM trouve les mots durs qu'il faut: Montand? Un "loufiat râleur géostratège mégalo" (p.73); Simone Veil? Un "tas de suif" (p.73); Serge July? Un "parvenu" (pp. 108 et 109); Jack Lang? Il a la "fu-tilité des girouettes" (p.134); Régis De-bray? Un "ex-tiers-mondiste à revolver à bouchons" (p.129); BHL, alias, sous la plume d'HOCQUENGHEM, Sa Transcendance Béachelle? Un "aimable Torquemada d'une inquisition de théâtre" (p.159) qui ne tient qu'à l'applaudimètre (p.164); Glucksmann? "Tortueux" (p.179), "So-phiste et fier de l'être" (p.185), etc. HOCQUENGHEM fustige avec une délectable méchanceté et une adorable insolence tous les gourous mielleux, à fureurs atlantistes récurrentes, pourfendeurs de "pacifistes allemands gauchistes", que l'ère Mitterand a vomis sur nos écrans et dans les colonnes de nos gazettes. HOCQUENGHEM, comme presque personne en France, défend le pacifisme allemand que BHL et GLUCKSMANN abreuvent de leurs insultes de néo-théocrates et de leurs sarcasmes fielleux, parce que ce paci-fisme exprime la volonté d'un peuple de se maintenir hors de la tutelle yankee, de s'épanouir en dehors de l'hollywoodisme cher à SCARPETTA et à KONOPNICKI, par-ce que ce pacifisme est, malgré ses insuf-fisances, la seule idéologie d'Europe puis-samment hostile au duopole yaltaïque.
On n'a pas fini de parler de Mai 68, même s'il ne reste plus grand'chose de l'effervescence des campus de Berkeley, Berlin ou Paris. Le soixante-huitardisme s'est enlisé dans ses contradictions, s'est épuisé en discours stériles, malgré les fantastiques potentialités qu'il recelait. Examinons le phénomène de plus près, de concert avec quelques analystes français: d'une part Luc FERRY et Alain RENAUT, auteurs de La pensée 68, essai sur l'anti-humanisme contemporain (Gallimard, 1986) et, d'autre part, Guy HOCQUENGHEM, qui vient de sortir un petit bijou de satire: sa Lettre ouverte à ceux qui sont passés du col Mao au Rotary (Albin Michel, 1986). Pour RENAUT et FERRY, la pensée 68 comportait deux orientations possibles: la première était "humaniste"; la seconde était "anti-humaniste". L'humanisme soixante-huitard était anti-techniciste, anti-totalitaire, pour l'autonomie de l'individu, pour l'Eros marcusien contre la civilisation, pour le pansexualisme, pour l'effacement du politique, etc. Pour FERRY et RENAUT, ces valeurs-là sont positives; elles forment le meilleur de l'aventure soixante-huitarde. Pour nous, ce sont au contraire ces idéologèmes-là qui ont conduit aux farces actuelles des "nouveaux philosophes", à leur valorisation infra-philosophique des "droits de l'homme", au retour du fétichisme du "sujet", à la régression du dis-cours philosophique, à l'intérêt porté aux scandaleuses niaiseries d'un Yves MONTAND qui se prend pour un oracle parce qu'il est bon acteur... Ces farces, ces amu-sements stériles, ces assertions pareilles à des slogans publicitaires pour margarine ou yaourts ont permis le retour d'une praxis libérale, le néo-libéralisme, auquel ne croyait plus qu'une poignée d'aimables plaisantins presqu'octogénai-res. Ou encore, Madame Thatcher qui, selon les paroles officieuses de la Reine Elizabeth II, serait bel et bien restée "fille d'épicier" malgré son fard oxfordien. Ipso facto, le petit gauchisme de la pansexualité éroto-marcusienne, le baba-coolisme à la Club Med', le néo-obscurantisme talmudiste de BHL, les éloges tonitruants du cosmopolitisme à la SCARPETTA ou à la KONOPNICKI acquièrent une dimension "géopolitique": ils renforcent la main-mise américaine sur l'Europe occidentale et avalisent, avec une bienveillance très suspecte, les crimes de la machine de guerre sioniste. Décadentistes d'hier et traîneurs de sabre sans cervelle, illuminés moonistes et vieux défenseurs d'un "Occident chrétien", se retrouvent curieusement derrière les mêmes micros, prêchent les mêmes guerres: il n'y a que le vocabulaire de base qui change. L'effondrement du soixante-huitardisme dans ce que RENAUT et FERRY appellent "l'humanisme" s'est également exprimé à l'intérieur des partis de gauche: de l'Eurocommunisme à la trahison atlantiste du PSOE, au révisionnisme du PCI et au mittérandisme atlantiste: le cercle des rénégats est bouclé. HOCQUENGHEM trouve les mots durs qu'il faut: Montand? Un "loufiat râleur géostratège mégalo" (p.73); Simone Veil? Un "tas de suif" (p.73); Serge July? Un "parvenu" (pp. 108 et 109); Jack Lang? Il a la "fu-tilité des girouettes" (p.134); Régis De-bray? Un "ex-tiers-mondiste à revolver à bouchons" (p.129); BHL, alias, sous la plume d'HOCQUENGHEM, Sa Transcendance Béachelle? Un "aimable Torquemada d'une inquisition de théâtre" (p.159) qui ne tient qu'à l'applaudimètre (p.164); Glucksmann? "Tortueux" (p.179), "So-phiste et fier de l'être" (p.185), etc. HOCQUENGHEM fustige avec une délectable méchanceté et une adorable insolence tous les gourous mielleux, à fureurs atlantistes récurrentes, pourfendeurs de "pacifistes allemands gauchistes", que l'ère Mitterand a vomis sur nos écrans et dans les colonnes de nos gazettes. HOCQUENGHEM, comme presque personne en France, défend le pacifisme allemand que BHL et GLUCKSMANN abreuvent de leurs insultes de néo-théocrates et de leurs sarcasmes fielleux, parce que ce paci-fisme exprime la volonté d'un peuple de se maintenir hors de la tutelle yankee, de s'épanouir en dehors de l'hollywoodisme cher à SCARPETTA et à KONOPNICKI, par-ce que ce pacifisme est, malgré ses insuf-fisances, la seule idéologie d'Europe puis-samment hostile au duopole yaltaïque.
Voilà où mène l'humanisme post-soixante-huitard: aux reniements successifs, au vedettariat sans scrupules, comme si l'humanisme devait nécessairement me-ner à cette indulgence vis-à-vis des histrions, des pitres et bateleurs de la rive gauche. L'humanisme ainsi (mal) compris ne serait que tolérance à l'égard de ces ouistitis débraillés alors qu'un humanisme sainement compris exigerait la rigueur des autorités morales et poli-tiques (mais où sont-elles?) à l'encontre de ce ramassis d'incorrigibles saltimban-ques.
Heureusement pour la postérité, Mai 68 a aussi été autre chose: un anti-humanisme conséquent, une rénovation d'un héritage philosophique, un esprit pionnier dont on n'a pas fini d'exploiter les potentialités. RENAUT et FERRY, qui chantent le retour du "sujet" donc de la farce prétendument humaniste, signalent les œuvres d'ALTHUSSER, de FOUCAULT, de LACAN et de DERRIDA. Ils voient en eux les géniaux mais "dangereux" continuateurs des traditions hegelienne (Althusser) et nietzschéo-heidegerienne (Foucault, Derrida). Pour ces philosophes français dans la tradition allemande, le "sujet" est vidé, dépouillé de son autonomie. Cette auto-nomie est illusion, mystification. L'hom-me est "agi", disent-ils. Par quoi? Par les structures socio-économiques, diront les marxistes. Par des "appartenances" di-verses, dont l'appartenance au peuple historique qui l'a produit, dirions-nous. L'homme est ainsi "agi" par l'histoire de sa communauté et par les institutions que cette histoire a généré spontanément (il y a alors "harmonie") ou imposé par la force (il y alors "disharmonie").
Certes le langage de la "pensée 68" a été assez hermétique. C'est ce qui explique son isolement dans quelques cénacles universitaires, sa non-pénétration dans le peuple et aussi son échec politique, échec qui explique le retour d'un huma-nisme à slogans faciles qui détient la for-ce redoutable de se faire comprendre par un assez large public, fatigué des dis-cours compliqués.
Si l'avénement du fétiche "sujet" est récent (le XIXème dit FOUCAULT), il est contemporain de l'avènement du libéralisme économique dont les tares et les erreurs n'ont cessé d'être dénoncées. Et si la "pensée 68" s'est heurtée au "sujet", elle a également rejeté, au nom des spé-culations sur l'aliénation, la massification des collectivismes. La juxtaposition de ces deux rejets ne signifie par nécessairement l'existence de deux traditions, l'une "humaniste" et l'autre "anti-huma-niste". Une voie médiane était possible: celle de la valorisation des peuples, valo-risation qui aurait respecté simultané-ment la critique fondée des dangers re-présentés par le "sujet" (l'individu atomisé, isolé, improductif sur le plan historique) et les personnalités populaires. Aux "grands récits" abstraits, comme ce-lui de la raison (dénoncé par Foucault) à prétention universaliste, se seraient sub-stitués une multitude de récits, expri-mant chacun des potentialités particu-lières, des façons d'être originales. Quand les étudiants berlinois ou parisiens pre-naient fait et cause pour le peuple viet-namien, ils étaient très conséquents: cette lutte titanesque qui se jouait au Vietnam était la lutte d'un peuple particulier (cela aurait pu être un autre peuple) contre la puissance qui incarnait précisément l'idolâtrie du sujet, le chris-tianisme stérilisant, la non-productivité philosophique, le vide libéral, la vulgarité de l'ignorance et des loisirs de masse.
La "pensée 68" a oscillé entre le libé-ralisme à visage gauchiste (ce que RE-NAUT et FERRY appellent "l'humanisme") et l'innovation révolutionnaire (ce qu'ils appellent "l'anti-humanisme"). Elle a ou-blié un grand penseur de la fin du XVIIIème: HERDER. L'humanisme de ce dernier est un humanisme des peuples, non des individus. Le vocable "huma-nisme" est trop souvent utilisé pour dé-signer l'individualisme non pour désigner les créativités collectives et populaires. Or tous les anthropologues sérieux seront d'accord pour nous dire que l'homme n'est jamais seul, qu'il s'inscrit toujours dans une communauté familiale, villa-geoise, clanique, ethnique, etc. La "pensée 68", notamment celle de FOUCAULT, et la pensée d'un LEVY-STRAUSS nous ont dévoilé une "autre histoire", une histoire qui n'est plus celle du "grand récit de la raison". La raison, en tant qu'instance universelle, est une apostasie du réel. Le réel se déploie au départ d'instances multiples, sans ordre rationnel. FOUCAULT et LEVY-STRAUSS s'inscrivent ipso facto dans le sillage de HERDER qui estimait que l'historicité de l'homme se déployait au départ de sa faculté de par-ler une langue bien précise (Sprachlich-keit), donc au départ d'une spécificité inaliénable. Au "grand récit" abstrait de la raison, se substituait dès lors les merveilleux "petits récits" des peuples poètes. Ce sont ces récits-là que la "pen-sée 68", pour son malheur, n'a pas su re-découvrir; pourtant, avec Mircea ELIADE, Gilbert DURAND, Louis DUMONT, etc. les occasions ne manquaient pas.
Le philosophe allemand contemporain Walter FALK (Université de Marburg) a résolu le problème, sans encore avoir ac-quis la réputation qu'il mérite: si le "grand récit" rationaliste n'est plus cré-dible, si le structuralisme d'un LEVY-STRAUSS nous conduit à désespérer de l'histoire, parce que nous serions invo-lontairement "agis" par des "structures fixes et immobiles", le modèle de l'histoire ne sera plus "téléologique" (comme le christiano-rationalisme occidental et son dérivé marxiste) ni "structuralo-fixiste" (comme lorsque LEVY-STRAUSS chantait les vertus des "sociétés froides"). Le modèle de l'histoire sera "potentialiste", au-delà du néo-fixisme du "réarmement théologique" de BHL et au-delà des résidus de téléologie progressiste. Pour FALK, le potentialisme équivaut, en som-me, à deux pensées, que l'on ne met ja-mais en parallèle: celle des fulgurations phylogénétiques de Konrad LORENZ et celle de la pensée anticipative d'Ernst BLOCH. Comme chez FOUCAULT, les struc-tures qui agissent les hommes ne sont plus simplement stables mais aussi va-riables. FALK développe là une vision réellement tragique de l'histoire: l'huma-nité ne marche pas vers un télos para-disiaque ni ne vit au jour le jour, bercée par l'éternel retour du même, agie sans cesse par les mêmes structures échap-pant à son contrôle.
L'histoire est le théâtre où font irruption des potentialités diverses que le poète interprète selon ses sensibilités propres. Là réside ses libertés, ses libertés d'a-jouter quelques chose au capital de créa-tivité de son peuple. La "pensée 68" est entrée dans une double impasse: celle d'un "anti-humanisme", très riche en po-tentialités, enlisée dans un vocabulaire inaccessible au public cultivé moyen et celle d'un "humanisme" sans teneur phi-losophique. Le potentialisme de FALK et le retour des récits historiques des peu-ples ainsi que des récits mythologiques constitueront les axes d'une "troisième voie" politique, impliquant la libération de notre continent.
Vincent GOETHALS.
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, france, philosophie, mai 68, idéologie, années 60 |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 06 mars 2010
Réflexions sur les Accords Rex-VNV
DOCUMENT pour servir à une meilleure compréhension de notre histoire
Réflexions sur les Accords Rex-VNV
par José Streel (1941)
Il n'est pas trop tard pour parler encore de l'accord conclu la semaine dernière entre les organisations de Rex, du VNV et du Verdinaso et portant création du parti unique en Flandre et en Wallonie. Il en va de cet accord comme de tous les contrats: sa valeur réelle dépendra plus de l'application qui en sera faite que de ses clauses. C'est pourquoi plutôt qu'à un texte court et assez banal, il faut s'attacher à l'esprit dans lequel il a été négocié et signé. Dans la mesure où il est possible de définir des probabilités pour l'avenir, c'est dans l'atmosphère de l'accord et dans ses principes de base qu'on peut essayer de deviner les fruits qu'il portera.
Le patriotisme s'attache au peuple et non à l'Etat
Ce qui a triomphé et ne pourra être remis en question, c'est le principe de la primauté du peuple par rapport à l'Etat.Une des plus grave parmi les erreurs de l'ancien régime a consisté à considérer la formule étatique existante comme immuable et à identifier le patriotisme avec l'attachement à cette formule. En général, cette assimilation de l'Etat au peuple est utile à la paix publique et au développement de la communauté nationale. Seulement lorsque les fondements de la nationalité ne s'imposent pas avec la rigueur inéluctable d'une évidence, il est fatal que les périodes révolutionnaires remettent en question la forme et les limites de l'Etat. S'il en sort un Etat plus étroitement adapté à la réalité populaire, on regagnera dans l'avenir en stabilité et en harmonie les perturbations inséparables d'un aménagement.
 L'histoire récente de notre pays montrait que telle était notre situation. Le jour où sous la pression d'événements intérieurs ou extérieurs l'Etat libéral unitaire créé en 1830 par la bourgeoisie d'expression française s'écroulerait, l'organisation étatique appelée à lui succéder devrait non seulement posséder une nouvelle structure institutionnelle, mais intégrer le courant qui au cours d'un siècle a créé une conscience flamande nationale. Considérer la question flamande comme une simple "question linguistique" était l'expédient dont la démocratie pouvait se contenter, mais qui était depuis longtemps dépassé. Le phénomène flamand avait atteint un degré de complexité tel qu'il ne pouvait trouver sa place dans les cadres de l'Etat unitaire; s'il n'avait été qu'une simple querelle linguistique, il aurait été résorbé assez rapidement par la voie d'une législation assez satisfaisante sur l'emploi des langues. La surenchère électorale ne l'aurait pas empêché d'aller tout doucement en s'atténuant; il aurait perdu sinon en ampleur, au moins en virulence. Or, il n'en était rien. Chaque "concession" de l'Etat unitaire au mouvement flamand ne faisait que renforcer celui-ci au lieu de l'apaiser. Manifestement, on se trouvait en face d'un phénomène d'un dynamisme historique incoercible qui ne pouvait prendre place dans les limites d'une formule étatique conçue en d'autres temps et pour d'autres temps; fatalement, il devait faire craquer ces limites et créer une nouvelle forme d'Etat, conforme à son contenu populaire. Ceux qui, dès 1936, ou même avant, avaient reconnu la nature réelle de ce phénomène voyaient combien il était dangereux de solidariser le patriotisme ou le fait politique belge avec des formes étatiques désuètes et condamnées par l'évolution. De cette solidarité, il ne pouvait naître que des équivoques effroyables et lourdes de périls, que les efforts de quelques esprits lucides et authentiquement patriotes ne pouvaient réussir à conjurer.
L'histoire récente de notre pays montrait que telle était notre situation. Le jour où sous la pression d'événements intérieurs ou extérieurs l'Etat libéral unitaire créé en 1830 par la bourgeoisie d'expression française s'écroulerait, l'organisation étatique appelée à lui succéder devrait non seulement posséder une nouvelle structure institutionnelle, mais intégrer le courant qui au cours d'un siècle a créé une conscience flamande nationale. Considérer la question flamande comme une simple "question linguistique" était l'expédient dont la démocratie pouvait se contenter, mais qui était depuis longtemps dépassé. Le phénomène flamand avait atteint un degré de complexité tel qu'il ne pouvait trouver sa place dans les cadres de l'Etat unitaire; s'il n'avait été qu'une simple querelle linguistique, il aurait été résorbé assez rapidement par la voie d'une législation assez satisfaisante sur l'emploi des langues. La surenchère électorale ne l'aurait pas empêché d'aller tout doucement en s'atténuant; il aurait perdu sinon en ampleur, au moins en virulence. Or, il n'en était rien. Chaque "concession" de l'Etat unitaire au mouvement flamand ne faisait que renforcer celui-ci au lieu de l'apaiser. Manifestement, on se trouvait en face d'un phénomène d'un dynamisme historique incoercible qui ne pouvait prendre place dans les limites d'une formule étatique conçue en d'autres temps et pour d'autres temps; fatalement, il devait faire craquer ces limites et créer une nouvelle forme d'Etat, conforme à son contenu populaire. Ceux qui, dès 1936, ou même avant, avaient reconnu la nature réelle de ce phénomène voyaient combien il était dangereux de solidariser le patriotisme ou le fait politique belge avec des formes étatiques désuètes et condamnées par l'évolution. De cette solidarité, il ne pouvait naître que des équivoques effroyables et lourdes de périls, que les efforts de quelques esprits lucides et authentiquement patriotes ne pouvaient réussir à conjurer.
Le patriotisme ne consiste pas dans la fidélité à une formule politique qui a fait son temps, mais dans l'amour concret et vivant du peuple au milieu duquel on est né et auquel on est lié par la communauté de destin; la patrie, ce n'est pas une création juridique plus ou moins arbitraire, c'est un ensemble d'hommes dont on partage le sort dans les bons comme dans les mauvais jours, et dont on défend le patrimoine spirituel, moral et matériel. La bourgeoisie dénationalisée de Flandre a cherché, comme il était naturel, à confondre la construction politique de 1830 avec la patrie; dans la partie romane du pays et à Bruxelles, l'électoralisme a joué dans le même sens. On n'a manqué aucune occasion d'exploiter les sentiments de la population ni de mettre en ligne les anciens combattants de 1914-1918, comme si la formule étatique ancienne était sacrée et comme si c'était pour elle que des hommes avaient affronté la mort pendant cinquante-deux mois. Ces manœuvres n'ont que trop bien réussi -d'autant plus facilement qu'elles étaient liées à l'action pour maintenir notre politique extérieure dans une ligne favorable non pas aux Belges, mais à nos anciens alliés. Un régime perméable comme la démocratie aux influences étrangères ne pouvait manquer de commettre cette monstrueuse confusion.
Il est caractéristique que lors de la proclamation de la politique d'indépendance en octobre 1936, puis après la capitulation du 28 mai 1940, la presse française, dont l'ignorance des réalités belges est proverbiale, n'ait rien trouvé de plus fort ni, à son sens, de plus décisif que de parler du Roi "flamingant" ou de "l'entourage flamingant" de notre Souverain. Après cela, tout paraissait dit.
En Wallonie, nombreux étaient ceux qui, avec une candide bonne foi, ne discernaient dans le mouvement flamand, même dans sa forme la plus minimaliste, que de sombres machinations plus ou moins inspirées par une volonté de "trahison". Trahison envers qui et envers quoi? Envers le peuple? Non. Mais envers une forme de l'Etat dont les services rendus sont contestables et qui, de toute façon, se trouvait depuis longtemps dépassée par l'évolution de la réalité populaire. On ne trahit aucune valeur essentielle quand on se propose d'aménager autrement, fût-ce au détriment de quelques minorités fort peu soucieuses de leur propre peuple, les rapports entre les communautés culturelles dans un pays ayant une situation aussi complexe que le nôtre. L'Etat unitaire n'a rien de sacré, sauf pour ceux à qui son existence profitait.
Sacrifier l'unitarisme pour sauver l'unité
Il y a quelque chose qui, à notre sentiment, est sinon sacré -ce mot n'ayant aucune signification politique- au moins politiquement utile, nécessaire et donc désirable: c'est l'unité. Mais cette unité ne se confond nullement avec l'unitarisme: depuis longtemps déjà, il était évident pour les bons esprits, que le second devait être sacrifié à la première. Même ceux qui sont le moins suspects de sympathie personnelle envers M. Degrelle et qui naguère considéraient comme intangible l'édifice unitaire de 1830, ont reconnu la haute pertinence du passage de la communication du Chef de Rex exposant qu'il ne peut plus être question d'imposer une forme quelconque d'unité au peuple flamand, mais qu'il faut le laisser venir spontanément à cette unité que recommandent à la fois l'histoire, la géographie et l'économie. Ou bien on estime que cette unité, ayant subi les aménagements indispensables, répond vraiment aux exigences profondes de la vie politique de nos populations et dans ce cas, il faut faire confiance aux évidences: elles ne manqueront pas d'imposer cette unité. Les réalités sont toujours plus puissantes que la volonté bonne ou mauvaise des hommes. Ou bien -ce que nous ne croyons pas- cette unité n'a aucun fondement dans le réel et son désir ne procède que d'une sentimentalité assez vaine: dans cette hypothèse, il ne faudrait pas pleurer sa disparition, celle-ci apparaissant alors comme un bienfait libérant les forces populaires et orientant vers des voies nouvelles et plus sûres leur épanouissement.
Nous ne recommandons pas un fatalisme apathique: il faut aider la vérité politique à se manifester de la meilleure façon et avec le plus grand profit pour le peuple. Mais on se prépare de cruels déboires quand on prétend la violenter, soit dans un sens soit dans l'autre. Il faut maintenir le maximum de conditions favorables à une unité belge revue, corrigée et exprimée politiquement par un Etat de structure nouvelle. Cela non par fétichisme de l'unité ou de "l'idée belge" ni pour toute autre sentimentalité plus ou moins respectable, mais parce qu'on estime que nos provinces, celles du nord comme celles du sud, seraient condamnées à de pénibles vicissitudes historiques si l'on commettait l'erreur -l'erreur politique insistons-y- de les séparer.
Seulement, la meilleur façon de sauver cette unité, qui venant d'une libre adhésion, sera durable, c'est de la désolidariser très nettement d'avec l'ancien unitarisme.
L'accord et la stratégie révolutionnaire
C'est d'ailleurs là un des aspects inéluctables de la révolution du XXème siècle dans le coin d'Europe que nous habitons. Il était absurde d'imaginer que le régime ancien pourrait s'écrouler comme démocratie parlementaire, comme système ploutocratique, comme économie libérale, comme domination de l'argent sur le travail et que miraculeusement il resterait debout comme Etat unitaire. Dans ce domaine, comme dans les autres, la révolution ne pouvait être que totale. Il existait des forces jeunes, vigoureuses, populaires, dégagées par le seul développement historique des forces qui menaçaient la structure du vieil Etat. Elles étaient même beaucoup plus clairement manifestées et moins latentes que celles dont l'effort principal se portait contre la forme d'organisation politique ou contre la structure sociale de la société bourgeoise. Il fallait de toute manière leur faire une place dans la révolution. Tout est dans tout.
Le fameux accord Rex-VNV de 1936, tant critiqué, cible de tant de sottises et de tant de vilenies, répondait à une conception totalitaire et remarquablement réaliste de la stratégie révolutionnaire. Les rexistes savaient ou devinaient d'instinct que, pour écraser le système des partis et la puissance ploutocratique, dont ce système était le support, il fallait tout remettre en question, y compris la forme unitaire de l'Etat; les nationalistes flamands se rendaient compte, d'autre part, que l'Etat unitaire résisterait à leurs assauts aussi longtemps qu'il aurait son armature démocratique, économique et sociale.
Nous plaignons ceux qui n'ont vu dans cette opération qu'une banale coalition des oppositions; quant à ceux qui y voyaient nous ne savons quelle machination ténébreuse ou quelle "trahison" plus ou moins inspirée par l'Allemagne, leur cas relève soit de la vénalité, soit de l'ignorance la plus invincible des réalités populaires et politiques. En portant leur effort principal contre l'accord Rex-VNV, la bourgeoisie libérale, la caste politicienne et la maffia ploutocratique, galvanisées par le sourire doucereux de M. Van Zeeland, savaient ce qu'elles faisaient: elles sabotaient la conjonction des forces révolutionnaires dont la communauté d'action mettait en péril leur domination.
Par la fusion des diverses organisations politiques en Flandre, par la reconnaissance du nouveau parti comme parti unique flamand et de Rex -d'un Rex ouvert à tous et extensible en tous sens- comme parti unique dans le sud du pays, la nouvelle convention réédite ce regroupement des forces révolutionnaires organisées, à défaut duquel on voyait depuis un an les forces d'ancien régime consolider leurs positions, reconquérir celles qu'elles avaient perdues et renforcer une domination ploutocratique qui devenait plus lourde et plus menaçante que jamais.
L'ancien accord et le nouveau
Le nouvel accord se distingue cependant assez nettement de l'ancien par son contenu. En 1936, les parties contractantes énonçaient un programme commun d'aménagement de l'Etat; c'était le temps où l'on faisait encore des programmes et où chaque candidat disposait, au gré des préférences de ses électeurs, de l'avenir du pays.
Aujourd'hui, il s'agit de tout autre chose. Le nouveau pacte va plus loin, en ce sens par exemple que Rex renonce à toute action directe en Flandre, ce que M. Degrelle avait refusé de consentir il y a cinq ans, malgré le désir de ses alliés; c'est qu'aujourd'hui l'unification organique des forces politiques prime tout. La vieille anarchie libérale est éliminée, aussi bien en politique que dans l'économie.
Il était donc indispensable non pas de sacrifier les organisations flamandes de Rex, mais de les intégrer avec honneur et surtout avec efficacité dans le nouveau parti unique flamand.
En ce sens, l'accord de 1936 est dépassé. Par contre, le nouveau pacte ne dispose pas -et n'a pas à disposer- de l'avenir. Il ne trace pas de programme pour les constructions futures. Le moment n'est plus aux alignements de paragraphes et d'aliénas, puisque la guerre n'est pas terminée sur le plan juridique et que le Chef naturel du pays est réduit au silence. Ce qui est possible et ce qui a été fait, c'est une délimitation des sphères d'influence de chaque groupement. Faut-il dire que cette délimitation laisse prévoir l'avenir et que son principal intérêt à nos yeux est de sauvegarder "in spe" les intérêts des Wallons, menacés par l'impérialisme flamand et d'assurer l'intégrité romane de leurs provinces?
Mais ces aménagements sont l'œuvre de l'avenir. Pour l'instant, les organisations politiques n'ont qu'à renforcer leurs cadres, préparer les esprits et procéder au lent investissement de l'appareil étatique.
L'accord concerne donc principalement la stratégie révolutionnaire et non ses objectifs. Son seul contenu politique est le principe, que nous avons tenté de dégager plus haut, de la primauté du peuple sur l'Etat.
José STREEL.
in: Le Soir, jeudi 15 mai 1941.
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : histoire, rexisme, belgique, belgicana, deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale, flandre, mouvement flamand, documents historiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 05 mars 2010
Gamal Abdel Nasser, el republicano egipcio
Gamal Abdel Nasser, el republicano egipcio
Líder político más influyente en el mundo árabe de su época. Fue militar, estadista egipcio y Presidente de Egipto de 1956 a 1970.
 De origen humilde, nacido en 1918 en la provincia de Asiut, Egipto, Gamal Abdel Nasser ingresó en la Academia Militar en 1938, en plena guerra de resistencia.
De origen humilde, nacido en 1918 en la provincia de Asiut, Egipto, Gamal Abdel Nasser ingresó en la Academia Militar en 1938, en plena guerra de resistencia.
El atractivo que significaba el canal de Suez, el hecho de ser la bisagra entre oriente y occidente, y las riquezas naturales de este país, no tardarían en hacerlo presa del imperio británico, la primera potencia mundial para 1882… los ingleses usaron la humillante estrategia de convertir el gran Egipto de las escrituras en un protectorado inglés. Años de guerra de resistencia, ocasionaría el ultraje imperial.
En 1949 Nasser funda la organización de militares libres, con la cual daría el golpe de estado que derrocó al Rey Faruq I, súbdito de Gran Bretaña.
La organización de los militares estaba constituida por jóvenes oficiales nacionalistas de la academia militar que compartían la preocupación de su país y por el saqueo al cual era sometido por el imperio británico.
Los militares libres poseían su propio medio de comunicación: un periódico donde exponían claramente su ideología política y la razón de su lucha. Voz de los oficiales libres:”nacionalismo árabe, lucha contra cualquier potencia colonial y en especial contra los británicos, instauración de una república laica y defensa de los principios del socialismo”.
Nasser llega al poder el 23 de junio de 1956 y constituye el consejo directivo de la revolución. Su primera acción fue la nacionalización del canal de Suez lo que desencadenó la movilización militar de Francia, Gran Bretaña e Israel, países que planearon recuperar el canal, invadir el Cairo y destituir a Nasser.
A finales de 1956 Nasser aceleró el proceso de nacionalización, liquidó los bienes británicos y franceses, acepto la ayuda soviética, e impulsó la distribución de tierras y lideraba la construcción de un nuevo partido: la unión nacional organización de masas que debía cimentar la nueva sociedad socialista egipcia.
Nasser se convirtió en un panarabista, abogaba por la unidad regional, por la unidad de los países árabes,…por los países del sur, de allí su militancia en el movimiento de los no alineados.
En enero de 1958 materializó su sueño con la creación de la Republica Árabe Unida producto de la unión de Egipto y Siria…la arremetida imperial terminó con este sueño aunque la liga de estados árabes continúa como testimonio de lo que pudo haber sido.
“Podéis matar a Gamal! El pueblo egipcio cuenta con cientos de gamales que se alzarán y os mostrarán que más vale una revolución roja que una revolución muerta”.
Gamal Nasser murió de apenas 52 años de edad, de un repentino infarto al corazón en el año 1970.
Reinaldo Bolívar
Extraído de Radio del Sur.
00:10 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, politique internationale, arabisme, monde arabe, nationalisme arabe, afrique, egypte, nationalisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 04 mars 2010
Il Master Enrico Mattei in Vicino e Medio Oriente
Il Master Enrico Mattei in Vicino e Medio Oriente
Fra grandi attese, ottimi docenti e qualche immancabile boicottaggio, il tradizionale corso di studi all’Università di Teramo
Filippo Ghira
 Riparte all’Università di Teramo il “Master Enrico Mattei in Vicino e Medio Oriente”. Nel 2007 era stato chiuso per la nota vicenda Faurisson, per due anni è continuato a Roma sotto l’egida dello Iemasvo, Istituto Enrico Mattei in Vicino e Medio Oriente”, e adesso è di nuovo nell’Ateneo dove era stato inaugurato nel febbraio 2006 con una prolusione di Giulio Andreotti su Enrico Mattei.
Riparte all’Università di Teramo il “Master Enrico Mattei in Vicino e Medio Oriente”. Nel 2007 era stato chiuso per la nota vicenda Faurisson, per due anni è continuato a Roma sotto l’egida dello Iemasvo, Istituto Enrico Mattei in Vicino e Medio Oriente”, e adesso è di nuovo nell’Ateneo dove era stato inaugurato nel febbraio 2006 con una prolusione di Giulio Andreotti su Enrico Mattei.
E’ cambiato qualcosa? “E’ cambiato il regolamento di Facoltà - risponde il professor Claudio Moffa, coordinatore del corso di studi, le cui domande scadranno il 28 febbraio prossimo – adesso la lista dei docenti deve essere approvata dal Consiglio di Facoltà ma comunque l’impianto generale non cambia. Anzi nella fase romana è stata allargata la rosa dei conferenzieri, per fare due nomi Ilan Pappè e Clementina Forleo, e quest’anno proponiamo nuovi argomenti interessanti”. Come il convegno di economia su “Monete, acqua, oleodotti: le guerre economiche del Medio Oriente” e quello su: “Finanza, usura e signoraggio”, con economisti quali Bruno Amoroso, Gianfranco Lagrassa e Eugenio Benetazzo. O il seminario su: “L’assedio dei cristiani in Medio Oriente”, un panorama radicalmente diverso da quello dei tempi di La Pira.
Un corso dunque allo stesso tempo altamente professionale ma anche poco omologato alla lettura dominante degli eventi mediorientali.
Nessun problema dunque? “I problemi ci sono – risponde Moffa – e vengono per ora soprattutto da internet che ci impedisce di fatto una adeguata pubblicizzazione: improvvisi blocchi della posta in uscita, scomparsa dai siti di nomi e notizie importanti che poi magicamente ricompaiono poco dopo. Ma chiunque tratta argomenti politicamente non corretti conosce questo tipo di ostacoli. Per il resto ci stiamo avvicinando al traguardo delle iscrizioni, ancora possibili. Il termine ultimo per iscriversi al Master è il 28 febbraio. L’impressione quindi è che si voglia giocare sul fattore tempo per impedire che gli incontri del Master che vedrà l’avvicendarsi di docenti di chiara fama, abbia il successo e il riscontro già avuti in passato.
Una battaglia che riguarda tutti: basta andare sul sito www.masteruniteramo.it, ascoltare le presentazioni video del corso di studi e il già nutrito programma articolato in convegni e temi molto interessanti e spesso controcorrente per capire. La lista dei relatori, Franco Cardini, Maurizio Blondet, ma anche Agostino Cilardo, Ferdinando Pellegrini e Israel Shamir, basterebbe da sola a rassicurare che quella offerta agli iscritti e agli uditori, sarà un’analisi obiettiva degli argomenti trattati. Ci saranno anche alcuni ambasciatori, come quello venezuelano, entro un quadro di pluralismo tipico di un Ateneo pubblico”.
Enrico Mattei: in nome dell’Italia
Problemi per un Master intitolato a Mattei? La verità è che la figura e l’opera di Enrico Mattei sono ancora in grado di dare fastidio per tutti gli interrogativi che esse pongono oggi in materia di approvvigionamento energetico, indipendenza nazionale, colonialismo e rapporti internazionali. Della figura di Enrico Mattei si tende oggi a ricordare l’atteggiamento spregiudicato, i finanziamenti versati ai vari partiti per non dover incontrare ostacoli sul suo cammino. Ma ben pochi ricordano che il suo “utilizzare i partiti come taxi” era finalizzato a rendere l’Italia indipendente dal punto di vista energetico e non dipendente quindi dalle forniture delle Sette Sorelle statunitensi e anglo-olandesi. Basti pensare che nell’immediato dopoguerra, Enrico Mattei, nominato commissario liquidatore dell’Agip, dimostrando una notevole lungimiranza, riuscì a convincere il governo dell’epoca a rinunciare a quella idea e di investire invece in un Ente pubblico, l’Eni appunto, che si occupasse di garantire al nostro Paese l’approvvigionamento energetico di petrolio e di gas, che fu più che determinante per sostenere il nostro boom economico. La stampa italiana, specie quella del Nord, legata agli ambienti industriali e finanziari nazionali, e con saldi legami con analoghi ambienti europei e americani, non si fece sfuggire l’occasione per attaccare la politica dell’Eni che si muoveva con estrema autonomia sugli scenari internazionali, avendo per prima preoccupazione l’interesse nazionale.
L’aspetto che determinò il successo dell’Eni nei Paesi produttori di petrolio fu l’approccio “non colonialista” con cui Mattei lo caratterizzò. Tanto per cominciare, Mattei innovò radicalmente nella percentuale che l’Eni ritagliò per se stesso nello sfruttamento dei giacimenti di petrolio scoperti. Appena un 25% per il gruppo italiano contro il 75% riservato alla compagnia petrolifera di Stato locale. Laddove le Sette Sorelle pretendevano come minimo il 50%. Secondo aspetto, fu la clausola secondo la quale se le ricerche di uno specifico giacimento non avessero avuto buon fine, l’Eni non avrebbe chiesto niente allo Stato estero a mo’ di indennizzo. Un metodo a dir poco rivoluzionario che contribuì in maniera determinante a creare una corrente di enorme simpatia verso il gruppo italiano. Terzo e non meno importante innovazione fu la scelta di Mattei di fare addestrare le maestranze locali nella scuola aziendale dell’Eni a San Donato Milanese. Il disegno era di per sé ovvio. L’Eni, voleva far capire Mattei, non vuole limitarsi a rapporti economici ma vuole far crescere professionalmente una folta schiera di tecnici che una volta formati saranno in grado di fare da soli o affiancare al meglio le società petrolifere straniere, senza quindi dover dipendere totalmente da esse. Un approccio che è ancora vivo nella memoria delle classi dirigenti di quel Paese. Un ricordo che fa sì che l’Eni possa ancora oggi vivere di rendita in quei Paesi godendo di una simpatia che non è mai venuta meno.
La politica autonoma dell’Eni si indirizzò soprattutto verso i Paesi del Vicino Oriente e del Nord Africa. Se fu l’Iran l’esempio più eclatante di un irrompere del gruppo italiano in un Paese che era considerato territorio esclusivo di caccia della British Petroleum, fu però l’Egitto di Nasser il primo Paese con il quale Mattei nel 1956 iniziò rapporti stabili e duraturi. Per non parlare dell’appoggio finanziario dato dall’imprenditore marchigiano al Fronte di liberazione nazionale algerino, un fatto che non poteva che irritare non poco la Francia la cui classe dirigente si stava ormai rassegnando all’idea di perdere i suoi territori di oltremare. Una vicinanza all’Fnl che fu rafforzata dalla disponibilità di un appartamento a Roma per il capo politico del movimento indipendentista, Mohamed Ben Bella.
L’Eni si poneva quindi come una realtà autonoma che, in nome degli interessi superiori dell’Italia, vista come un naturale prolungamento dell’Europa verso i Paesi della sponda sud del Mediterraneo, voleva rompere gli equilibri consolidati in tutta l’area. L’attivismo di Mattei dava particolare fastidio ad Israele che male sopportava il fatto che l’Eni tendesse a far crescere economicamente e autonomamente Paesi come Algeria ed Egitto. L’origine dell’attentato del 27 ottobre 1962 con la bomba piazzata nel suo aereo ed esplosa nel cielo di Bascapè deve probabilmente essere inserita in questa contrapposizione con lo Stato nato appena quindici anni prima. Una ostilità che ebbe conseguenze all’interno della stessa Eni quando Mattei, qualche mese prima della sua morte, obbligò Eugenio Cefis, vicepresidente dell’Eni e presidente dell’Anic, a lasciare il gruppo dove costituiva il capo di una corrente giudicata troppo “vicina” agli interessi atlantici ed israeliani. Lo stesso Cefis, ex braccio destro di Mattei nella guerra civile come partigiano cattolico, che fu chiamato a guidare l’Eni subito dopo la morte di Mattei. Le altre ipotesi sul’attentato sono infatti poco credibili. Da un intervento delle Sette Sorelle, con le quali in settembre aveva raggiunto una sorta di “gentlemen agreement”, all’ipotesi della Cia che giudicava Mattei destabilizzante, proprio nei giorni in cui infuriava la crisi dei missili sovietici a Cuba. Lo stesso scetticismo vale per un possibile ruolo avuto dalle compagnie petrolifere francesi, che avevano vasti interessi in Algeria, o per l’intervento della Mafia siciliana o di Cosa Nostra Usa che agirono per conto terzi. Tutte ipotesi che hanno il demerito di vedere solamente la punta dell’iceberg e di non voler leggere quella che è la sostanza del problema. L’attentato di Bascapè mise comunque fine all’esistenza di una personalità unica, un uomo che era stato capace di intravedere realtà e potenzialità che altri nemmeno si immaginavano.
Per informazioni e per iscriversi al Master:
www.masteruniteramo.iit
info@mastermatteimedioriente.it;
claudio.moffa@fastwebnet.it;
mastermattei.unite@tiscali.it;
377-1520283; 347-7777.071
23 Febbraio 2010 12:00:00 - http://rinascita.eu/index.php?action=news&id=832
00:10 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, hommage, italie, pétrole, politique internationale, eni, hydrocarbures, proche orient, moyen orient |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
La nationalité canadienne

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1987
La nationalité canadienne
par Mario Gagné
L'histoire est faite d'événements passés dont les effets continuent de manifester aujourd'hui leur présence. Ceux-ci, parce qu'ils sont chargés de sens, parlent à la psychè collective. De la même façon que les territoires, l'âme des peuples est aussi le champ du politique (1). La conscience de cette réalité nous permet d'abord de comprendre une situation historique et, peut-être, de modifier par la suite le cours des événements.
Parce que nos sociétés sont encarcannées dans cet Occident qui a pour centre les Etats-Unis d'Amérique, il est nécessaire de comprendre les représentations qui nous révèlent l'Amérique. Toutefois, gardons-nous bien de confondre cette dernière avec les Etats-Unis. En effet, il existe des américanités plus anciennes et plus authentiques que celle-ci: entre autres, la nationalité canadienne.
Les récits de fondation
Dans la tradition politique et culturelle européenne, les nationalités apparaissent à la suite d'une alliance conclue entre deux ou plusieurs ethnies. Afin d'expliquer le sens de cet événement fondateur, les générations subséquentes mettront très souvent au point une interprétation fabuleuse et légendaire.
Ainsi la France est née à la suite du Baptême de Clovis. Le rite conféré par Saint Rémi dans cette Rome liturgique qu'est Reims a non seulement permis l'union politique des Gallo-Romains et des Francs mais il a aussi été perçu comme le moment où l'imperium romain et la culture gréco-latine, principes spirituels dont l'Eglise s'était instituée le fiduciaire à l'époque de la migration des peuples (2), ont été remis en héritage à la France.
Le mythe fondateur de la Suisse célèbre à la fois le serment de Rütli prononcé par les représentants des Trois Cantons et l'établissement de la société helvétique sur le modèle des ordres indo-européens (3). Celui de l'Angleterre doit être recherché dans le couronnement de Guillaume le Conquérant à Westminster à la suite de la bataille de Hastings; il rappelle à la fois l'alliance (plus ou moins volontaire) des Normands et des Saxons et l'avènement définitif de la romanité dans l'île britannique. On pourrait multiplier ainsi de semblables exemples.
Le Canada comme américanité
Transportons-nous le 19 juillet 1603 à Tadoussac, lieu où se jette le fleuve Saguené dans l'estuaire maritime du Canada. A cet endroit, les représentants des tribus etchemine, montagnaise et algonquine se sont réunis afin de souhaiter la bienvenue à Champlain et aux colons français qui vont s'établir à sa suite dans le pays (4).
Grâce à l'habile politique de Champlain, les Français furent les seuls Européens, parmi ceux qui sont venus en Amérique, à ne pas avoir acheté ou acquis par la force les territoires sur lesquels ils se sont installés; seuls, ils furent expressément conviés par les autochtones. A l'occasion du Paoua de Tadoussac, Champlain dit à peu près ceci aux chefs des tribus indiennes: "Nos fils épouseront vos filles et ils deviendront une seule nation". Ceux-ci lui répondirent: "Les enfants de vos fils apprendront de leur mère à devenir des hommes valeureux (5)".
Le métissage est l'événement fondateur du Canada, pays dont les racines plongent à la fois dans le passé européen et dans le passé immémorial de l'Amérique autochtone. Une telle hybridation ne fut pas seulement somatique mais aussi et surtout culturelle.
En adoptant maints aspects du mode de vie indien, les colons français ont d'abord pu survivre malgré les rigueurs du climat canadien. En voyageant tantôt dans des canots d'écorce, tantôt sur des chevaux indiens appelés "cayouche", les descendants de ces mêmes colons ont pu explorer la Nord-Amérique à partir de la vallée du Saint-Laurent jusqu'aux Montagnes Rocheuses et même au-delà, de l'Océan Arctique jusqu'au Golfe du Mexique. Ayant fait l'apprentissage des langues indiennes, les Canadiens ont pu rallier à la France un immense continent. En assimilant les techniques de guerre indiennes, les Canadiens ont encore forcé les Anglo-Saxons à demeurer sur le rivage de l'Océan Atlantique.
La nationalité canadienne, création européenne en terre d'Amérique, possède donc un caractère véritablement autochtonien (6). Le Canada se présente ainsi, avec le Mexique, la Caraïbe et le Brésil, comme une authentique construction américaine. A cet égard, il est intéressant de constater que le mythe de la fondation du Mexique prend aussi la forme d'une métaphore conjugale, c'est-à-dire celle de l'union de Guadeloupe et de Quetzalcoatl (7).
L'acculturation étatsunienne
Tout autre est le mythe de fondation des Etats-Unis d'Amérique. Revivifié aujourd'hui par le pasteur Falwell, allié politique du président Reagan, un tel mythe raconte la venue en Nord-Amérique des Pères pélerins à bord du Fleur-de-mai (Mayflower). Chassés d'Europe parce qu'ils poursuivaient le rêve du paradis puritain, les Pères pélerins continuèrent d'y être fidèles dans le Nouveau Monde, notamment en choisissant de demeurer à l'écart de l'Amérique autochtone. De cette attitude découleront les guerres d'extermination, qu'eux et leurs héritiers vont entreprendre contre les Indiens, et la création de réserves pour y enfermer les survivants.
Les Etats-Unis d'Amérique ne sont donc pas nés d'une alliance entre deux peuples mais bien plutôt d'un double refus: à la fois celui de l'Europe originelle et celui de l'Amérique primordiale. Ce pays qui ne voulait pas avoir de racines, ni en Amérique, ni en Europe, ne forma donc jamais un véritable peuple. Conformément aux fantasmes des Pères pélerins, cette entité étrangère à la fois à la terre d'origine et à la terre d'accueil, s'efforcera de ne devenir rien d'autre qu'«une bonne et solide prospérité étalée au grand jour» (8).
Afin de se donner un semblant de légitimité politique et historique, les E.U.A. se sont désespérément mis en quête d'une identité nationale. D'abord, comme leur nom l'indique, ils se sont octroyés le monopole de l'américanité; ensuite, ils ont usurpé l'identité des peuples véritables, en particulier celle des Canadiens.
Derrière la silhouette des personnages de Fennimore Cooper, que l'auteur a créés afin de donner aux Yanquis une familiarité qu'ils n'ont jamais eu avec la terre d'Amérique, se profile l'image à peine transposée du coureur-de-bois canadien. Sans la geste du cavalier métis, dont Hollywood s'est abondamment inspiré pour fabriquer en série ses héros de plateau de tournage, la figure du gardien de vaches, symbole de l'Amérique yanquie, apparaîtrait clairement pour ce qu'elle est, c'est-à-dire bien misérable.
Tout aussi significatif est le travestissement effectué par cette autre formation politique, voisine des E.U.A., qu'est l'Amérique du Nord Britannique. Comme en témoigne sa toponymie où se rencontrent des Kingston, des Windsor, des London, etc., l'A.N.B. fut créée sur le modèle de la Grande-Bretagne. Désirant n'avoir de racines qu'en Europe, l'A.N.B. choisit, comme les E.U.A., de demeurer étrangère à l'Amérique autochtone.
Comme les E.U.A., l'A.N.B. se retrouva bientôt devant le même vide identitaire. Comme les E.U.A., l'A.N.B. essayera de le combler en usurpant l'identité des Canadiens. Mais cette fois-ci, ce sera de manière plus profonde: alors que l'A.N.B. refuse précisément au Canada le droit à l'existence, elle s'attribuera le nom du Canada et voudra se faire reconnaître pour tel à la face du monde. Une telle opération, il va sans dire, aura aussi pour but de minoriser les Canadiens dans leur identité et de vider de toute substance leur nationalité.
Le refus français de l'Amérique
Alors que les Canadiens avaient, au-delà de l'Océan Atlantique, ouvert à la France un espace illimité et plein de possibilités pour son expansion territoriale et démographique, celle-ci ne comprit jamais l'importance de ses possessions nord-américaines. Au contraire, elle s'entêta dans sa traditionnelle politique d'expansion vers l'Est. Vu l'exigüité et le peuplement déjà dense du territoire européen, une telle politique allait non seulement faire perdre à la France son rôle de grande puissance de l'avenir mais aussi entraîner jusqu'à nos jours l'Europe dans de nombreux conflits, causes premières de son actuel déclin (9).
La France s'est volontairement départie de ses territoires nord-américains, d'abord en empêchant les Canadiens d'utiliser les techniques de guerre adaptées au Nouveau Monde -ce qui allait conduire à la chute de Québec en 1759- et, ensuite, en vendant la Louisiane aux Etats-Unis d'Amérique. Construite sur le refus de l'aventure américaine, la France moderne chassera de sa mémoire historique le Canada en intériorisant systématiquement le point de vue yanqui sur l'Amérique (10). Pour pouvoir agir autrement, il aurait fallu reconnaître explicitement l'erreur de jugement historique qui lui a valu la perte de son imperium.
Les Etats-Unis étant surtout pour la France l'"Amérique", il est significatif de constater que sa littérature romanesque ira jusqu'à affubler, pour faire plus "américain" des noms anglais aux Indiens -lesquels ont très souvent des ascendants français- et à les faire évoluer dans une toponymie non moins anglo-saxonne. Tout aussi significativement, elle mesurera désormais à l'aune yanquie les différentes manifestations de la "modernité" et de la "démocratie". Dans cette perspective, constater que le refus français de l'Amérique a entraîné l'asservissement aux Etats-Unis est le moindre des paradoxes.
Seule l'attitude du Général de Gaulle, qui a permis à la France de redécouvrir l'Amérique, représente une exception (11). Ce n'est pas par hasard si l'homme d'Etat qui fut à l'origine du rapprochement franco-allemand, c'est-à-dire de la mise en cause de la traditionnelle politique étrangère française, fut aussi celui qui appuya le mouvement indépendantiste du Canada français. Cet appui, rappelons-le ici, avait pour but d'annuler dans une certaine mesure les effets du désastreux traité de Paris (1763).
Le nationalisme de l'Eglise canadienne
Après la cession du Canada à la Grande-Bretagne, différents mouvements de résistance à la présence anglaise surgirent. Le plus important de ceux-ci fut l'Insurrection des Patriotes qui eut lieu en 1837 et en 1838. Influencés par les meilleures idées de la Révolution française (12), les Patriotes élaborèrent une légitimité en vertu de laquelle l'autochtonité du peuple canadien fondait son droit à la liberté et à la souveraineté politiques. Ils l'utilisèrent afin de l'opposer au droit de domination que le pouvoir britannique s'était arrogé.
La défaite de l'Insurrection fut le moment qui permit à l'Eglise de s'accaparer, avec la complicité de l'occupant, le pouvoir culturel; notamment, sa présence se fit sentir dans le domaine de l'enseignement public et dans celui de la formation des élites professionnelles et politique. En gros, cette mainmise allait durer de 1840 à 1960.
Pendant toute cette période, l'Eglise s'acquitta fidèlement de son pacte de collaboration. Afin d'empêcher à l'avance d'autres tentatives d'émancipation politique, elle mit au point un nationalisme qui, tout en faisant appel au sentiment national des Canadiens, allait aussi et surtout le neutraliser. Centré autour de la Province of Quebec, nom que le conquérant avait donné au Canada dès la Proclamation royale de 1763, ce nationalisme s'opposa résolument au caractère autochtonien de la nationalité canadienne.
Au moins deux raisons amenèrent l'Eglise à collaborer avec l'occupant. D'abord, elle se faisait du pouvoir politique une conception théocratique et déracinée. Puisque le Canada avait été cédé à la Grande-Bretagne en vertu d'un accord passé entre deux monarques, qui étaient l'un et l'autre les représentants de Dieu sur terre, on devait alors au roi d'Angleterre la même obéissance que l'on avait accordé au roi de France. Ensuite, la nationalité canadienne, qui avait émergé à la suite d'un contact prolongé avec la Grande Sauvagerie, représentait pour les Français qui venaient s'établir en Nord-Amérique et leurs descendants une façon de couper les ponts avec la Rome catholique. A l'exemple de Marie de l'Incarnation, le clergé se plaignait amèrement: "Un Français devient plutôt sauvage qu'un Sauvage ne devient Français."
L'Eglise favorisa donc la construction d'une histoire et d'une sociologie fictives dont les principaux axes furent la francité et la catholicité. On s'en doute bien, l'intériorisation du point de vue français ne pouvait manquer d'être aliénante. C'est ainsi que progressivement l'élite politique et culturelle canadienne évacua, comme le fit la France, le Canada de sa mémoire historique.
La fausse nationalité québécoise
Au début des années 1960, apparut un nationalisme qui, tout en se voulant nouveau, alla porter cent vingt années d'influence cléricale à son ultime conséquence. Bien loin de s'inspirer de l'Insurrection des Patriotes ou de la Relève des Métis (1869 et 1885), qui furent des moments d'affirmation de la nationalité canadienne, les néo-nationalistes fabriquèrent de toute pièce une nationalité québécoise qui serait exclusive de la nationalité canadienne et qui, de ce fait, entérinerait l'usurpation faite par l'A.N.B. Bien qu'ils proclamaient bien haut la nécessité de l'indépendance politique, les néo-nationalistes la niaient dans les faits puisqu'ils interdisaient le recours à la nationalité canadienne qui parle à la psychè collective et qui seule peut fonder un tel droit.
Sans le savoir, les néo-nationalistes, qui étaient souvent des anticléricaux virulents, reprirent l'essentiel de l'ancien nationalisme clérical. Les modifications apportées à celui-ci furent mineures. Ainsi, le terme "Québec" se substitua à celui de "Province" et le "corporatisme social" des années 1930 devient la "sociale démocratie" des années 1970 (13). Si l'Eglise disparut du domaine de l'éducation et des affaires sociales ce fut au profit d'une instance toute aussi maternante: l'Etat technocratique pourvoyeur de services. Pour le reste, les néo-nationalistes continuèrent d'agiter le drapeau à fleurs de lys blanches du clergé, véritable symbole d'abdication nationale.
Si la fausse nationalité québécoise a pu exercer un attrait durant un certain moment, c'est justement parce qu'elle promettait de faire accéder un peuple à la souveraineté politique sans avoir à soutenir de combat contre un adversaire identifiable. Après s'être donné une nouvelle identité qui l'exorciserait de tout un passé jugé colonial, il lui suffirait, aux dires du Parti québécois, de pratiquer la "démocratie" et de devenir "moderne" à la manière dont les Anglo-Saxons l'entendent. A leurs yeux, il lui aurait été enfin possible de mériter l'indépendance.
Une telle vue de l'esprit soutend une démarche semblable à celle que doit suivre le catéchumène chrétien: on se purifie d'un passé jugé inacceptable en abandonnant le nom de sa lignée et en pratiquant certaines vertus dans le but de se mériter le salut éternel devant Dieu.
Les néo-nationalistes ont donc conduit le mouvement indépendantiste du peuple canadien dans l'impasse. Ils n'ont pas voulu comprendre qu'un mouvement de libération nationale est d'abord et avant tout une révolution. Révolution, parce qu'à l'exemple de la conduite d'actions inscrites dans l'histoire, elle exige du courage, au moins celui qui permet de mettre en cause les schémas intellectuels étriqués.
Révolution aussi, parce qu'une action inscrite dans l'histoire est toujours -comme l'indique l'étymologie du terme, revolvere- un retour aux origines. Or, un peuple ne se maintient dans le monde que parce qu'il actualise constamment son mythe de fondation et sa tradition de lutte nationale.
Mario GAGNE.
NOTES
(1) C'est l'opinion du géopoliticien Jordis von Lohausen telle que rapportée dans le "Dossier géopolitique" de la revue Orientations, octobre 1980, p. 4.
(2) Voir à ce sujet Louis Rougier dans La France en marbre blanc, Bourquin, éd., Genève, 1947, p. 73.
(3) Voir Pierre Maugué dans "Les origines de la Suisse et la Tradition celtique", Etudes et recherches, n°3, automne 1984, p. 3.
(4) Voir Jean-Marc Soyez, Quand l'Amérique s'appelait Nouvelle-France, Fayard, Paris, 1981, p.84.
(5) Voir le texte en exergue du livre de Hugh Broody, The People's Land Eskimos and Whites in the Eastern Arctic, Penguin Books Ltd., Harmondsworth, 1975.
(6) Voir Alain de Benoist, Démocratie, le problème, éd. Le Labyrinthe, Paris, 1985; en particulier les pp. 13, 14 et 15.
(7) Voir Jacques Lafaye, Quetzalcoatl et Guadeloupe, la formation de la conscience nationale au Mexique, 1531-1813, Gallimard, 1974.
(8) L'expression est de Hawthorne et elle a été citée par Jean Morisset dans son livre L'Identité usurpée, tome I, éd. Nouvelle Optique, 1985, p. 58. Jean Morisset, dont les analyses sont une source d'inspiration féconde, est, avec Raoul Roy, l'un des rares intellectuels canadiens à défendre la nationalité canadienne contre la méprise que constitue la fausse identité québécoise.
(9) voir Jordis von Lohausen, op. cit., p. 15.
(10) L'Atlas mondial de la découverte préparé par Gérard Chaliand et Jean-Pierre Rageau (Fayard, Paris, 1984) est caractéristique de l'attitude déconcertante des Français envers le Canada. Alors qu'ils décrivent avec soin les explorations effectuées par les Espagnols, les Portugais et les Anglais en Amérique, aucune allusion n'est faite quant aux pérégrinations des explorateurs français et canadiens dans le nouveau monde. Même les voyages de Jacques Cartier sont ignorés. Ces deux géopoliticiens, qui ne peuvent avoir pour eux l'excuse de l'ignorance, se sont donc conformés aux vœux des Anglo-Saxons qui ont toujours combattu la présence de la France en Nord-Amérique.
(11) Le très beau livre de Jean-Marc Soyez (op. cit.), qui se lit comme un roman, est l'un des rares ouvrages français qui présente l'Amérique à la France et à l'Europe; il y a tout lieu de croire qu'il n'a pu être écrit que dans le contexte de la présidence du Général de Gaulle.
(12) Les dirigeants du mouvement des Patriotes étaient fascinés par les tentatives de "retour à l'antiquité" effectuées par la Révolution française. Un Ludger Duvernay, fondateur et directeur du journal La Minerve, puisait ses modèles politiques dans la démocratie athénienne ou dans la République romaine.
(13) Sur les liens de parenté existant entre les deux nationalismes, voir Clinton Archibald, Un Québec corporatiste?, éd. Asticou, Hull, 1983.
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : histoire, canada, amériques, amérique du nord, atlantique, pacifique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 03 mars 2010
L'idée de Mitteleuropa
 Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1987
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1987
L'idée de "Mitteleuropa": elle refait surface
par Karlheinz Weissmann
Lors du dernier Congrès de la SPD, le parti social-démocrate allemand, qui s'est tenu cette année à Nuremberg, Peter Glotz profita d'un forum sur le thème "Europe occidentale - Europe centrale - Europe totale" pour ranimer l'idée de "Mitteleuropa" (Europe centrale). Si cette initiative fut rejetée par la plupart des participants, un détail, cependant, mérite attention: parmi les quelques rares personnalités qui approuvèrent Peter Glotz, se trouvait Zdenek Mlynar, haut fonctionnaire du PC tchèque pendant l'ère Dubcek. Cela n'a rien d'étonnant: le débat "néogauchiste" sur la Mitteleuropa fut lancé et animé essentiellement par des intellectuels socialistes dissidents des pays d'Europe centrale et orientale. En septembre 1985 déjà, la revue Kursbuch, organe toujours influent de la gauche libertaire, la fameuse "undogmatische Linke" de RFA, avait publié dans ses colonnes la proposition du Hongrois György Dalos qui souhaitait une "Confédération centreuropéenne" et plusieurs autres publications théoriques s'ouvrirent à des débats sur ce thème. Le rejet de la proposition de Glotz illustre de façon typique l'attitude de la classe politique allemande à l'égard de thèses tendant à surmonter le statu quo des blocs; mais il s'explique surtout par le fait que Glotz avait aussi mis en avant l'idée de Reich, d'Empire, comme puissance tutélaire traditionnelle en Europe centrale et avait même évoqué, dans la foulée, les conceptions de Friedrich Naumann.
l'héritage de Naumann
Ceux qui s'intéressent à l'histoire savent que le nom de Friedrich Naumann est intimement lié à l'idée de Mitteleuropa. En 1915, Naumann publia un livre intitutlé précisément Mittteleuropa, où l'on trouve la formulation sans doute la plus prégnante de cette notion politique. Ses réflexions se ressentaient essentiellement de la situation créée par la Première Guerre mondiale, en particulier par l'économie de guerre. Naumann présageait l'avènement d'une époque où seuls les grands espaces autarciques pourraient économiquement, et donc politiquement, survivre. Son but était la fusion de l'Allemagne et de la monarchie danubienne, futur "noyau cristallisateur" d'une Europe centrale qui serait plus tard étendue à la France (1) ainsi qu'aux territoires limitrophes du Reich, à l'Est comme à l'Ouest. En cette "période historique d'avènement des groupements d'Etats et des Etats-masse", le nouvel espace ainsi créé serait capable de soutenir la concurrence des empires britanniques, nord-américain et russe. Bien que d'origine libérale, Naumann avait la conviction que la structure interne de ces grandes puissances serait toujours marquée par l'Etat organisateur mais que, dans une Europe centrale sous direction allemande, cette structure porterait le sceau du "socialisme d'Etat" ou du "socialisme national".
Pour étayer son argumentaire, Naumann se réfère volontiers à la politique de Bismarck et à sa Duplice (Zweibund). D'abord, parce que la figure du fondateur du Reich garde une force émotionnelle, et donc légitimante, considérable; ensuite, parce que cette évocation répondait sans doute aux convictions intimes de Naumann. Pourtant, celui-ci est victime d'une erreur de jugement historique: certes, Bismarck accordait une grande importance à une alliance avec l'Autriche-Hongrie, mais il n'excluait pas, si l'urgence de la situation politique l'exigeait, une entente avec la Russie aux dépens des Habsbourg! Plutôt que chez Bismarck, c'est dans les projets "grossdeutsch" du Parlement de Francfort, dans la vision d'un "Empire de 70 millions d'âmes", chère à Schwarzenberg et à Bruck, qu'il faut rechercher les précurseurs de la "Mitteleuropa". Quant à ses prophètes, il vaut mieux les chercher du côté des critiques de l'Etat national "petit-allemand", chez un Constantin Frantz ou un Paul de Lagarde par exemple.
le contexte de la première guerre mondiale
Toujours est-il que l'idée acquit une certaine faveur à la veille de la Première Guerre mondiale. Mais il faudra le conflit armé pour qu'elle acquière des chances réelles de réalisation: très tôt, la perte des colonies montra aux responsables politiques allemands que l'Allemagne devait rechercher ailleurs l'assise d'une grande puissance. Après les premières victoires des Empires centraux, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et la Bulgarie signèrent le 6 septembre 1915 une convention militaire à laquelle l'Empire Ottoman adhéra peu après. Sur la base de cette alliance, Falkenhayn, chef d'Etat-Major allemand, adresse au chancelier Bethmann-Hollweg (peu avant la parution de l'ouvrage de Naumann) un mémoire sur la "fondation d'une confédératon d'Etats du centre de l'Europe", un Mitteleuropäischer Staatenbund. Ce projet, comme tant d'autres, échoua devant la résistance de l'Autriche-Hongrie. Si la notion de "Mitteleuropa" est restée, dans les esprits, synonyme d'"agressions" et de "conquêtes territoriales" par l'Allemagne, cela tient à ce que les thèses bellicistes de l'extrême-droite allemande ont été débattues sous ce nom-là et que cette extrême-droite, surtout après la paix de Brest-Litovsk, envisageait d'étendre démesurément la sphère d'influence allemande en Europe centrale et orientale.
L'effondrement du Reich et de la monarchie des Habsbourg réduisit tous ces projets à néant. Les petits Etats-nations nouvellement créés entre l'Allemagne et l'Union Soviétique étaient étroitement contrôlés par la France. Le concept de "Mitteleuropa" n'avait pas disparu pour autant, tout au moins au niveau du débat politique. L'idée fut relancée à des titres divers. Ainsi, Giselher Wirsing, issu de la mouvance de la revue Die Tat lança l'idée de Zwischeneuropa, Europe médiane ou Europe d'entre-deux, dans laquelle l'Allemagne, si elle se redressait, aurait un rôle à jouer. Le "front anti-impérialiste des peuples jeunes" y instaurerait un espace d'autarcie économique. On reconnait là une parenté avec les thèses de Naumann mais on note un glissement dans la désignation de l'adversaire: non plus Londres et Saint-Petersbourg, mais Paris et Moscou. L'analyse sociologique, souvent très aride, de Wirsing concernant les présupposés politico-économiques, contraste étrangement avec les idéaux, souvent très romantiques, de "reconstruction du Reich" auxquels adhéraient nombre de théoriciens jungkonservativ de l'époque de Weimar. En toile de fond de leur analyse, il y avait la situation des populations d'ethnie allemande, dont il s'agissait de tirer les leçons. Le Reich réaliserait en Europe centrale un ordre fédérateur reposant non sur une conception centraliste de la nation, legs de la Révolution française, mais sur le principe de l'égalité des droits entre tous les peuples. Jung écrit à ce sujet: "C'est l'idée d'un Reich structuré, accordant à chacune de ses composantes un degré de liberté capable d'extirper à jamais de l'âme européenne les idées poussiéreuses d'annexion, d'exploitation et de génocide". Cette conception associait volontiers à la signification proprement politique du terme "Mitteleuropa" l'idée d'une "position médiane de l'esprit", une geistige Mittellage qui était au coeur de la pensée nationale traditionnelle et que, dès 1818, Arndt formulait ainsi: "Dieu nous a placés au centre de l'Europe; nous sommes le coeur de notre partie du monde". Quoi qu'il en soit, cette idée de Reich fut l'un des ferments intellectuels les plus féconds de la période de Weimar. Or, si l'on songe que la République de Weimar avait une liberté d'action plutôt limitée en politique étrangère, il n'est guère étonnant qu'aucune idée politique plus ambitieuse n'ait eu une chance quelconque de se réaliser: la propositon Briand-Stresemann sur l'unification européenne resta lettre morte tout comme cette fameuse union douanière austro-allemande dans le cadre d'une politique "centre-européenne", plutôt traditionnelle celle-là, pour laquelle militait le chancelier Brüning et dont l'échec (en 1931) inspira largement à Wirsing le sujet de son livre.
du nazisme au deuxième après-guerre
Le débat sur la "Mitteleuropa" se poursuivit sous les nationaux-socialistes. Il semble même, au cours des années 30, que ce débat épousait les contours de la stratégie hitlérienne en politique extérieure. Jusqu'à la conclusion de l'accord commercial germano-roumain, en effet, on pouvait encore affirmer que le Troisième Reich reprenait à son compte l'héritage de la monarchie habsbourgeoise dans l'espace mitteleuropäisch. Parmi ceux qui eurent tendance à confondre les intentions du régime national-socialiste avec leurs convictions personnelles, il faut citer l'interprétation de l'idéologie nazie par Heinrich von Srbik. Celui-ci persistait à croire que l'enjeu de la guerre mondiale était "un nouvel ordre plus viable en Europe centrale et sur notre continent". Or, les nationaux-socialistes ont toujours perçu l'idée de "Mitteleuropa" comme étrangère à leur mentalité, ne fut-ce qu'en raison de l'autonomie relative que cette idée accordait aux "petits peuples". Dans leur logique à eux, l'idée de "grand espace" était dictée par des impératifs tout à fait différents.
La deuxième guerre mondiale et ses prolongements firent litière des conditions fondamentales qui avaient sous-tendu les réflexions de naguère sur la Mitteleuropa. L'extermination des Juifs, l'expulsion des Allemands des territoires orientaux du Reich et de la plupart des pays d'Europe centrale et orientale, détruisirent une structure ethnique multiséculaire. L'Allemagne, puissance tutélaire potentielle de l'Europe centrale, disparut de la scène comme acteur politique, et ce pour une durée indéterminée. L'émiettement géographique en Etats se doubla d'une partition de l'Europe selon les lois du nouvel antagonisme mondial. Ce n'est qu'à la fin des années 40 que l'on vit apparaître, en République fédérale et dans les zones d'occupation occidentales, une amorce de réflexion allant à l'encontre d'une allégeance occidentale sans faille de la RFA et susceptible de trouver quelque résonance. La SBZ (Sowjetische Besatzungszone, future RDA), puis la RDA, n'avaient aucune liberté d'action et tous les projets fédéralistes développés en Europe centrale et orientale se heurtèrent invariablement au niet de l'Union Soviétique, peu encline à tolérer le moindre mouvement dans son glacis. C'est pourquoi les projets d'un Gerhard Schröder, par exemple, qui voulait établir des contacts directs avec ce groupe d'Etats, sans en référer à l'URSS, étaient voués à l'échec.
l'idée de "Mitteleuropa" renaît dans les années 80
Le nouveau débat sur la Mitteleuropa prend sa source dans les années 80. Cette source est en fait plurielle. En République Fédérale, le regain des argumentaires "géopolitiques" avait préparé le terrain. Aux Etats-Unis, la distinction entre géopolitique "vraie" et "fausse" n'avait jamais été abandonnée et ce type de réflexion alla jusqu'à influencer la stratégie américaine en politique étrangère. Henry Kissinger lui-même, qui orienta longtemps cette stratégie, avait eu recours, dans ses travaux historiques, à des facteurs géopolitiques pour analyser et expliquer l'histoire allemande. Il n'est guère surprenant, dès lors, que ce soit un autre Américain, David P. Calleo, qui ait interprété toute l'évolution de l'Etat national allemand sous l'angle de sa "situation centrale". Calleo conclut son livre The German Problem Reconsidered, paru en 1978, par ces lignes remarquables: "La géographie et l'histoire s'étaient jointes pour permettre à l'Allemagne une ascension tardive; mais rapide, contestable et contestée. Le reste du monde a réagi en écrasant le parvenu". Plus prudents, les historiens ouest-allemands sont néanmoins d'accord sur le fond: Michael Stürmer diagnostique un "traumatisme de puissance médiane menacée" et évoque les "contraintes d'une position centrale". Dans son Die gescheiterte Großmacht. Eine Skizze des deutschen Reiches 1871-1945 (paru en 1980), Andreas Hillgruber, dont les travaux antérieurs faisaient déjà appel à des considérations géopolitiques, fait de la "situation géostratégique centrale" un élément d'explication majeur. Et il ne faut pas oublier à quel point les déclarations de Richard von Weizsäcker sur les conséquences de "notre situation géopolitique" ont pu contribuer à légitimer et à vulgariser ces thèses. Tout cela annonce une "valse des paradigmes" dans l'historiographie officielle de la RFA, comme l'atteste l'émoi avec lequel certains représentants de l'opinion (jusqu'alors) dominante -qui ne voient dans l'histoire allemande que la sanction d'erreurs intrinsèques à l'Allemagne (le fameux Sonderweg!)- ont réagi devant ce qu'ils appellent "l'absurdité des constantes géostratégiques".
En marge de ces constructions historiques, la politique renoua spontanément, à la fin des années 70, avec la notion de Mitteleuropa. A Trieste, l'ancien port méditerranéen de la monarchie danubienne, germa la nostalgie d'une "Civiltà Mitteleuropa" (Viktor Meier). Il faut dire que les frustrations nées de la crise économique endémique qui secoue l'Italie n'étaient pas étrangères à cet état d'esprit. On ne peut pas dire, cependant, que cette étincelle se soit propagée à d'autres territoires anciennement austro-hongrois.
la "Mitteleuropa" correspond à la zone dénucléarisée envisagée par Olof Palme
Le concept de "Mitteleuropa" refit surface dans le sillage du débat sur la paix. Parmi les dissidents, notamment hongrois et tchécoslovaques, se développa l'idée d'une association des satellites ci-devant soviétiques en une confédération d'Etats indépendants, plus conforme aux traditions culturelles et politiques de ces peuples. Parallèlement, des contacts étaient noués entre la SED est-allemande et les sociaux-démocrates d'Allemagne occidentale en vue de la constitution d'une "zone soustraite aux armes chimiques", à rapprocher du projet, lancé par Olof Palme, d'une "zone dénucléarisée" en Europe.
La boucle est bouclée: le Congrès de Nuremberg de la SPD ouest-allemande a repris dans son programme la création d'un "corridor dénucléarisé". Certes, la sociale-démocratie ne conteste pas l'intégration de la RFA dans l'OTAN, mais il y a là un indice qui, à la suite d'autres, traduit la volonté de se démarquer toujours davantage de l'Alliance atlantique. Du coup, le conflit Est-Ouest, jusque là considéré comme une évidence naturelle, s'émousse au contact du débat sur la paix. Et cette érosion est devenue irrémédiable.
Il était inévitable, compte tenu de sa domination intellectuelle, que la gauche fût la première à produire un discours tendant à désamorcer les antagonismes en Europe. Et si les idées sur la neutralisation de la RFA, de l'Allemagne ou de l'Europe divergent encore quant à la stratégie, elles convergent en fin de compte vers un consensus quant aux objectifs fondamentaux.
Glotz, social-démocrate, reste dans le vague
Le projet proposé par Glotz pour la Mitteleuropa se singularise par un souci de transcender l'idée, plutôt prosaïque, d'une zone dénucléarisée sur 150 km de part et d'autre du Rideau de fer par une vision plus ambitieuse à laquelle Glotz prête apparemment quelque pouvoir mobilisateur. Malheureusement, on décèle chez lui un certain essoufflement des idées: Glotz semble être sans cesse demandeur d'idées nouvelles mais ses propres projets ne parviennent pas à le captiver très longtemps (par exemple, son dernier "Manifeste" pour des idées novatrices dans la politique européenne de la gauche). Cela peut, certes, s'expliquer par la grande mobilité intellectuelle du personnage mais on peut y voir aussi un signe de perplexité, et il n'est pas sûr que sa tentativce de renouer avec les idées de Mitteleuropa et de "Reich" soit d'un grand secours. Outre qu'il manque totalement de réalisme devant le fait de la puissance, il reste que les idées politiques ne sont pas des recettes de cuisine. Traditionnellement, la gauche allemande a toujours opposé le front du refus aux idées de "Mitteleuropa" et de "Reich" alors que les idées nationalistes ont pu, organiquement, faire bon ménage avec le socialisme ou la social-démocratie. Quoi qu'il en soit, le "Reich" est impensable sans référents résolument conservateurs; le contraire n'est pas concevable. Le fait que la gauche se cherche aujourd'hui des attaches de ce côté-là a valeur de symptôme mais de symptôme seulement: symptôme de son exaspération, ce qui semble donner raison à D.P. Calleo qui écrivait: "Après la deuxième Guerre mondiale, les Allemands ont en quelque sorte pris en congé de leurs problèmes traditionnels (...). Gageons que le conte allemand n'est pas encore fini...".
Aucun mouvement politique ne peut percer sans une dimenson visionnaire, un mouvement conservateur, ou national, moins que tout autre. Croire que le cynisme de la puissance géopolitique brute suffise à produire ses effets mobilisateurs, ou que l'idée "européenne" (en réalité ouest-européenne!) soit encore une idée d'avenir, est une erreur. En allemand, le mot "Reich" a gardé une résonnance particulière. Il pourrait donner une nouvelle impulsion à la question nationale et l'histoire de tous les peuples d'Europe centrale pourrait être unifiée, même si cette unité reste lourde (donc riche) de tensions Certes, la voie est ingrate et ne promet rien dans l'immédiat. Mais le jeu en vaut la chandelle et l'effort intellectuel, lui, ne décevra point.
Karlheinz WEISSMANN.
(texte tiré de Criticón n°97, septembre-octobre 1986; traduction française de Jean-Louis Pesteil)
N.B. Il est bien évident qu'entre cette idéologie et les solutions offertes par Naumann et Renner au problème de la Mitteleuropa , il n'y a aucun point commun. D'ailleurs les auteurs nationaux-socialistes n'avaient pas ménagé leurs critiques à l'encontre des idées naumaniennes, qualifiées de "pseudo-socialisme", marquées d'esprit judaïque. La plupart des collaborateurs et des amis de Naumann, l'ensemble des rédacteurs de la Hilfe se sont exilés ou ont subi la persécution nazie; seul P. Rohrbach, qui se trouvait en 1939 à la tête de la Deutsche Akademie de Munich avait accepté de subir la loi du régime, sans toutefois capituler devant toutes ses exigences. Le national-socialisme ne doit rien à Naumann et à son école.
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, géopolitique, mitteleuropa, allemagne, autriche, années 80 |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 02 mars 2010
Le fondamentalisme islamiste en Iran: négation de l'identité iranienne et création anglo-américaine
Robert STEUCKERS :
Le fondamentalisme islamiste en Iran : négation de l’identité iranienne et création anglo-américaine
Extrait d’une conférence prononcée par Robert Steuckers à la tribune de la « Gesellschaft für freie Publizistik » (Bayreuth, avril 2006), de l’association « Terre & Peuple / Flandre-Hainaut-Artois » (région lilloise, mars 2009), du « Cercle Proudhon (Genève, avril 2009)
 Ceux qui écoutent et ingurgitent, béats, sans émettre la moindre critique, les discours médiatiques, généralement fabriqués de toutes pièces outre-Atlantique, imagineront sans doute que l’identité iranienne correspond au fondamentalisme islamique qui y règne depuis 1979. Rien n’est plus faux. L’identité iranienne est une identité impériale, indo-européenne et perse. En effet, tous les historiens de l’Iran s’accordent à dire que, dès les dynasties bouyides et samanides (du 9ème au 11ème siècle), l’islamisation a dû composer avec de multiples recours au passé impérial irano-perse. L’identité iranienne se situe entièrement dans l’œuvre du poète Ferdowsi et du philosophe mystique Sohrawardi. Il faudra la catastrophe des invasions mongoles d’un Tamerlan pour réduire cette merveilleuse synthèse civilisationnelle à néant, pour précipiter l’Iran dans le déclin, du moins jusqu’à l’avènement des Séfévides. Les iranologues contemporains se divisent quant à savoir si la reprise en main de l’impérialité perse par les Séfévides a été ou non un bienfait pour l’Iran : les uns affirment que cet avènement dégage l’Iran de la cangue islamique sunnite, de la double emprise arabe et ottomane ; les autres disent qu’en privilégiant le chiisme, en en faisant une religion d’Etat, les Séfévides ont réduit à la marginalité le zoroastrisme, expression identitaire iranienne plurimillénaire qui avait survécu vaille que vaille sous l’islam pré-séfévide. Trancher dans cette querelle d’historiens n’est pas notre propos ici, mais d’examiner comment le fondamentalisme de l’Ayatollah Khomeiny s’est imposé dans un Etat impérial qui entendait s’inscrire dans d’autres traditions, dans des traditions de plus grande profondeur temporelle.
Ceux qui écoutent et ingurgitent, béats, sans émettre la moindre critique, les discours médiatiques, généralement fabriqués de toutes pièces outre-Atlantique, imagineront sans doute que l’identité iranienne correspond au fondamentalisme islamique qui y règne depuis 1979. Rien n’est plus faux. L’identité iranienne est une identité impériale, indo-européenne et perse. En effet, tous les historiens de l’Iran s’accordent à dire que, dès les dynasties bouyides et samanides (du 9ème au 11ème siècle), l’islamisation a dû composer avec de multiples recours au passé impérial irano-perse. L’identité iranienne se situe entièrement dans l’œuvre du poète Ferdowsi et du philosophe mystique Sohrawardi. Il faudra la catastrophe des invasions mongoles d’un Tamerlan pour réduire cette merveilleuse synthèse civilisationnelle à néant, pour précipiter l’Iran dans le déclin, du moins jusqu’à l’avènement des Séfévides. Les iranologues contemporains se divisent quant à savoir si la reprise en main de l’impérialité perse par les Séfévides a été ou non un bienfait pour l’Iran : les uns affirment que cet avènement dégage l’Iran de la cangue islamique sunnite, de la double emprise arabe et ottomane ; les autres disent qu’en privilégiant le chiisme, en en faisant une religion d’Etat, les Séfévides ont réduit à la marginalité le zoroastrisme, expression identitaire iranienne plurimillénaire qui avait survécu vaille que vaille sous l’islam pré-séfévide. Trancher dans cette querelle d’historiens n’est pas notre propos ici, mais d’examiner comment le fondamentalisme de l’Ayatollah Khomeiny s’est imposé dans un Etat impérial qui entendait s’inscrire dans d’autres traditions, dans des traditions de plus grande profondeur temporelle.
Evaluation positive du rôle des Séfévides en Europe
L’avènement des Séfévides est généralement vu d’un bon œil dans l’historiographie traditionnelle européenne, pour plusieurs raisons :
◊ L’empereur séfévide avait épousé une princesse byzantine de Trébizonde et va dès lors tenter de venger Byzance contre les Ottomans sunnites, qui reprennent à leur compte le vaste territoire où s’était préalablement exercée la souveraineté romaine/byzantine. De cette manière, le conflit séculaire entre la Romania orientale et les empires perses reprenait mais sous d’autres signes.
◊ L’empereur séfévide se pose ainsi comme le principal ennemi à l’est de l’empire ottoman qui assiège l’Europe sur le Danube et en Méditerranée. Il est ainsi l’allié de revers de Charles Quint. L’œuvre politique des Séfévides et leur action militaire ont donc contribué à alléger la pression ottomane en Europe. En 1529, le Sultan doit lever le siège de Vienne parce que les Perses attaquent à l’est. Cette guerre se soldera par une défaite perse et par l’émergence d’une frontière qui existe toujours aujourd’hui : en effet, la frontière entre l’Irak (à l’époque conquête récente de Soliman le Magnifique) et l’Iran, d’une part, entre la Turquie et l’Iran, d’autre part, demeure quasiment celle qui a résulté de cette guerre perso-ottomane du 16ème siècle. Elle sanctionne également la division des peuples kurde, azéri et arménien, partagés entre les deux empires.
Les empereurs séfévides vont donc privilégier le chiisme, en faire l’islam de leur empire, contre les sunnites, accusés de collusion avec les Ottomans, et contre les zoroastriens, dont le nombre se réduira au minimum dans l’empire perse. Une bonne partie d’entre ceux-ci va émigrer vers l’Inde, où ils constituent toujours la minorité des Parsi. Les Séfévides s’opposeront aussi aux fraternités soufies. En ce sens, les Séfévides commettent une série d’entorses à l’identité iranienne, car les synthèses lumineuses qui voyaient le jour dans l’Iran d’avant Tamerlan et s’y succédaient par transition plus ou moins douce étaient bien plus fécondes que le sera le futur chiisme d’Etat des Séfévides. Les historiens critiques à l’endroit du chiisme d’Etat, imposé par les Séfévides, accusent ceux-ci d’avoir utilisé deux instruments non iraniens pour faire triompher leur cause : les Qizilbakh turkmènes et les théologiens chiites arabes, deux forces religieuses qui ne puisaient pas dans le vieux fond iranien/persan. Le chiisme restera religion d’Etat jusqu’aux Pahlevi. Khomeiny s’inscrit dans cette tradition tout en rompant aussi avec elle, comme nous allons le voir.
Les mollahs, clergé chiite
La principale caractéristique du chiisme perse est la présence d’un clergé, celui des mollahs. Le jargon médiatique a parlé, depuis l’avènement de Khomeiny, de « mollahcratie ». La présence de ce clergé chiite fait de l’empire perse séfévide et post-séfévide un Etat fort différent de l’empire ottoman sunnite, qui est, lui, dépourvu de clergé organisé. En ce sens, on a parfois qualifié l’empire séfévide de « césaropapiste ». Le système est en tout cas dual, comme à Byzance et en Occident au temps des Othoniens dans le Saint Empire, avant la querelle des investitures. L’empire perse séfévide présente donc deux sphères autonomes, celle du « politique », apanage du Shah, et celle de la religion, apanage du clergé chiite. La sphère de la religion reçoit tour à tour deux interprétations :
◊ celle des Akhbaris, mystiques, qui fondent la légitimité religieuse sur le charisme du mollah ou de l’Imam ;
◊ celle des Ouzoulis, interprètes plus rationnels du droit qui demandent simplement de se soumettre au jugement de l’homme cultivé, du clerc, sans déployer d’incantations qualifiables de « mystiques ».
Le chiisme d’Etat encourage également les pèlerinages, non pas vers La Mecque, comme dans la tradition sunnite arabe et ottomane, mais vers le tombeau des Imams, des grands hommes ou des poètes, tradition qui s’est perpétuée jusqu’à nos jours. Les wahhabites saoudiens perçoivent dans cette pratique chiite et persane des pèlerinages une hérésie, une déviance inacceptable.
Le chiisme d’Etat repose sur un messianisme particulier : celui qui attend le Mahdi, le retour de l’Imam caché. Cette attente messianique postule, pour le croyant, d’agir toujours pour cet Imam caché. Dans l’histoire perse, depuis l’avènement des Séfévides, le messianisme a adopté une attitude essentiellement quiétiste : le croyant devait attendre la fin des temps pour agir réellement, dans la concrétude mondaine, sous la direction mystique et avisée du Mahdi. Khomeiny va bousculer cette tradition quiétiste : il va vouloir combattre tout de suite pour créer un Etat chiite-islamique pur pour pouvoir saluer l’avènement du Mahdi, pour être présent et en armes lors de son arrivée.
Avant Khomeiny : le quiétisme
Quelle fut l’attitude face au Shah avant Khomeiny ? Le quiétisme religieux de l’ère séfévide percevait le Shah comme une personne sacrée, comme l’ombre de Dieu sur la Terre. Seul prélude à l’attitude hostile d’un souverain iranien au clergé des mollahs, attitude qui caractérisera ultérieurement le règne des deux Shahs Pahlevi : le puissant Nadir Shah, au 18ème siècle, s’opposera à la hiérocratie chiite en lui coupant les vivres. Avec les Shahs de la nouvelle dynastie Qadjar, on assiste à une réconciliation avec le clergé mais sous l’influence accentuée des Ouzoulis. Shahs Qadjar et Ouzoulis jettent les bases d’un nouveau partage du pouvoir. Les Ouzoulis récupèrent les dotations au clergé, auparavant ôtées par Nadir Shah, et raffermissent du même coup leurs positions dans les domaines de la justice et de la conciliation juridique. Les effets de cette nouvelle donne politico-religieuse font que le Shah se voit petit à petit dépouillé de ses attributs « divins ». La position du Shah est désacralisée mais non pour autant délégitimée. Le Shah et le clergé chiite demeurent donc tous deux des représentants de l’Imam caché. Le Shah doit assurer dans la concrétude politique et quotidienne l’ordre réclamé par la religion, notamment doit garantir dans le pays le règne de la justice (sociale). Les clercs, dans ce partage des tâches, détiennent le savoir religieux et le leadership spirituel, posé comme intangible et incontestable. Les clercs disent la justice et deviennent les protecteurs du peuple contre les abus des propriétaires terriens, des gendarmes et de l’Etat. On percevra en Europe catholique des attitudes similaires : en Irlande contre le pouvoir britannique, en Flandre contre les institutions de l’Etat belge (notamment dans les rangs du bas clergé rural), en Croatie contre le pouvoir royal serbe, en France rurale contre les inventaires de la première décennie du 20ème siècle, etc.
Deux événements vont bouleverser les équilibres de la société iranienne à la fin du 19ème siècle : la régie des tabacs, entreprise lucrative, devient un monopole anglais et prive du coup l’Etat perse d’une formidable source de revenu. De plus, cette disposition installe une forme de semi-colonialisme dans la plus ancienne aire impériale de l’histoire des peuples de souche indo-européenne. Second événement : l’établissement d’une constitution, calquée sur la loi fondamentale belge, en 1906-1907. En 1906, les clercs refusent cette constitution parce qu’elle est un élément étranger et ne correspond en rien aux traditions chiites. En 1907, le clergé fait volte-face et l’accepte parce que cette constitution, finalement, contient bon nombre de clauses qui les favorisent. Malgré cette acceptation initiale, les réactions ne tardent pas : le Shaykh Fazlullah Nouri proclame que la constitution et le parlementarisme sont contraires à l’esprit de l’islam et réduisent finalement le pouvoir du clergé chiite organisé (on peut tracer un parallèle avec les réactions diverses des catholiques belges : depuis les ultramontains, engagés socialement, jusqu’aux daensistes soucieux de la condition ouvrière, aux étudiants louvanistes de l’ACJB, à bon nombre d’éléments du mouvement flamand catholique et aux rexistes d’avant-guerre, ils auront, face à cette constitution et au parlementarisme, des réactions similaires).
Critique de la Constitution à la belge, proposée par les Britanniques et leurs alliés
Quels arguments avance le Shaykh Fazlullah Nouri ? Le Parlement, qui est légiférant, implique, dit-il, un système où c’est la majorité qui décide en fin de compte. Or une telle majorité met tout le monde sur pied d’égalité (chrétiens, arméniens, juifs, zoroastriens, forces para-maçonniques, etc.), y compris, au-delà de tous clivages religieux, les « ignorants ». De telles majorités, composées d’éléments disparates et inégaux, bat en brèche les prérogatives du clergé, représentant de l’Imam caché. Le Shaykh Fazlullah Nouri reproche aussi au constitutionalisme de mouture belge, que les Anglais imposent indirectement à la Perse des derniers Qadjar, de fixer d’avance et pour l’éternité des « droits » et des « devoirs », sans qu’il ne soit plus possible de les adapter au gré des circonstances réelles de la société ou des conjonctures politiques (on retrouve ce reproche chez Max Weber et Carl Schmitt, critique particulièrement pertinent de la « nomocratie », vecteur d’immobilisme ou d’intransigeance abstraite). Dans le contexte d’un Iran devenu monarchie constitutionnelle à la belge, le clergé devient une institution parmi d’autres, ruinant du même coup la dualité traditionnelle héritée des empereurs séfévides et reposant sur la personne du Shah et sur le clergé. L’avènement de la constitution et du parlementarisme entraine l’émergence d’une administration moderne, qui empiète automatiquement sur les prérogatives traditionnelles du clergé. Les critiques du Shaykh Fazlullah Nouri ressemblent, mutatis mutandis, à celle d’un Max Weber : si les fonctionnaires sont bons, intègres, formés à bonne école et recrutés par examens, ils constitueront un bienfait pour l’Etat. Au contraire, si les fonctionnaires sont nommés au pro rata des voix accordées à des pochards, des politiciens de café de commerce, des corrompus véreux, des prostituées recyclées, des déments narcissiques ou des imbéciles finis, le fonctionnariat, devenu ainsi pléthorique, deviendra rapidement une calamité, comme on le constate dans bon nombre de pays européens, Belgique en tête.
Le système constitutionnaliste perse survivra à peine à la première guerre mondiale. Reza Khan, devenu Reza Shah en 1926, s’opposera tant aux corrompus du parlementarisme qu’au clergé ; dans son opposition à la religion islamique, on peut voir une imitation de son homologue turc Mustafa Kemal Atatürk. L’attitude que les deux Shahs Pahlevi imposent au clergé est celle du quiétisme. Son fils, qui monte sur le trône en 1941, organise, avec l’Ayatollah Boruyerdi, la conférence de Qom en 1949, où le clergé promet de ne pas s’immiscer dans les affaires politiques de l’empire. Tout clerc qui désobéirait à l’esprit de la conférence de Qom se verrait immédiatement exclu de la classe des clercs.
L’Iran pendant la seconde guerre mondiale et l’option pro-américaine
Comment, dans un tel contexte, va naître le fondamentalisme chiite de Khomeiny ? D’abord un rappel historique : Britanniques et Soviétiques violent la neutralité iranienne en 1941. Le pays est occupé, divisé en deux zones, avec les Soviétiques au nord et les Britanniques au sud. Reza Shah est éliminé, envoyé en exil aux Seychelles puis en Afrique du Sud, où on le laisse mourir d’un cancer qu’on ne soigne pas. Son fils Mohammed Reza Pahlavi est intronisé empereur à la place de son père. Les Américains envoient des équipes d’ingénieurs civils pour réorganiser les chemins de fer iraniens et parfaire une logistique qui mène du Golfe Persique à la Caspienne et de la Caspienne à la Volga pour alimenter en matériels américains l’armée soviétique aux abois depuis les coups de butoir qu’elle a pris en 1941 et pendant l’été 1942. La logistique transiranienne, organisée par les Américains, permettra de bloquer l’avance allemande en direction du Caucase méridional et des puits de pétrole azerbaïdjanais et en direction de Stalingrad, Astrakhan et la Caspienne. Mohammed Reza Shah va parier sur les Américains. Pourquoi ? Quel est son raisonnement en 1944-45 ? Les Américains ne sont pas des occupants militaires, contrairement aux Soviétiques et aux Britanniques. Ils n’ont pas de frontières communes avec l’Iran. Le jeune Shah craint surtout une annexion des provinces azerbaïdjanaises de l’Iran à l’Azerbaïdjan soviétique. Il craint aussi que les troupes soviétiques refuseront d’évacuer les rives caspiennes de l’Iran. Ensuite, il a peur de voir les Britanniques absorber le Baloutchistan iranien, le joindre à la province du même nom dans le Pakistan actuel, qui faisait partie, à l’époque, des possessions indiennes de la Couronne britannique.
L’Iran, en dépit de son occupation, connaît un boom économique pendant la seconde guerre mondiale, assorti d’un exode important de ruraux vers les villes. En 1942, Téhéran est secoué par des émeutes de la faim. Après la guerre, et avec la chute des productions militaires destinées aux Soviétiques et aux Alliés occidentaux, l’Iran doit affronter les problèmes posés par le trop-plein démographique urbain. Il le règle en distribuant à ces foules des grandes villes les dividendes du pétrole. En 1953, le Dr. Mossadegh, un nationaliste laïque, entend nationaliser les pétroles, toujours sous contrôle anglais, et rejeter l’inféodation de l’Iran aux Etats-Unis. Le Shah craint une alliance entre nationalistes et communistes, qui serait appuyée par l’URSS. Mais le clergé et les bazaris, les commerçants du Bazar de Téhéran, ne soutiennent pas le Dr. Mossadegh. Celui-ci est renversé par un putsch, soutenu par Washington et Londres. Toutefois, les questions soulevées par le Dr. Mossadegh en 1953, surtout la nécessité de nationaliser les pétroles et d’acquérir une autonomie énergétique, demeurent depuis lors les questions cruciales de la politique iranienne : elles seront au centre de la polémique contre le Shah ; elles sont au centre de la polémique entre l’américanosphère et Ahmadinedjad aujourd’hui.
La réforme agraire
Après le départ de Mossadegh, le Shah prend conscience de la nécessité d’une révolution sociale en Iran, une révolution qu’il voudra « blanche », c’est-à-dire téléguidée d’en haut, depuis l’empyrée du pouvoir impérial. Elle vise trois réformes essentielles : l’organisation d’un système éducatif moderne et performant (y compris pour les filles), détaché du clergé ; le droit de vote pour les femmes ; la réforme agraire. C’est la réforme agraire qui freinera le succès de la « révolution blanche ». La difficulté d’organiser une réforme agraire dans un pays comme l’Iran relève d’une donnée géographique incontournable : seulement 11% du sol iranien est cultivable ; or 22% de la population active (encore aujourd’hui) l’est dans l’agriculture. Avant la révolution blanche, lancée par le Shah, le système était latifundiste, constitué de grandes propriétés terriennes. Chacun, sur son lopin, produit pour sa famille, avec, éventuellement, un petit surplus. Ce système s’avère insuffisant pour nourrir correctement les masses urbaines : il faut importer des céréales américaines donc consentir à la dépendance alimentaire. Avec la réforme agraire, chaque paysan reçoit son lopin en pleine propriété. Les grands propriétaires sont dédommagés. Mais, à chacun de ces paysans devenu propriétaire, se pose un problème crucial : comment va-t-il financer l’achat de machines pour mettre en valeur ses nouvelles terres ? Pour beaucoup, c’est impossible. Un grand nombre de ces nouveaux petits propriétaires sont contraints à l’exode vers les villes, après avoir abandonné leur lopin. Une partie de cette masse est absorbée par l’industrie. Une autre partie reste sur le carreau. Les masses urbaines sont gonflées par ce nouvel afflux de population. Du coup, les dividendes pétroliers ne suffisent plus pour les nourrir. Le Shah aurait pu sortir de cette impasse en 1973, quand l’OPEP décida d’augmenter le prix du brut pour assurer le financement d’infrastructures dans les pays exportateurs de pétrole. C’est la raison pour laquelle il apporta son soutien à l’OPEP, majoritairement arabe, en dépit de la solidarité inflexible qu’il manifestait à l’égard des Etats-Unis. Cette option de l’empereur pour une solidarité entre pays producteurs de pétrole va définitivement lui aliéner Washington. Les relations n’étaient déjà plus au beau fixe depuis Kennedy, qui se méfiait des développements de l’armée iranienne, capable de devenir l’instrument d’une puissance régionale indélogeable et incontournable, surtout à proximité des puits de la péninsule arabique et à hauteur du Détroit d’Ormuz.
L’Axe énergétique Paris/Bonn/Téhéran
Pour le spécialiste suédois de la géopolitique pétrolière, William Engdahl, la colère américaine contre le Shah vient de la volonté du monarque 1) de doter son pays d’un programme nucléaire destiné non pas à l’Iran seul mais à tout l’espace circum-iranien, 2) de diversifier la dépendance iranienne vis-à-vis du pétrole et 3) de coopérer avec la France (l’uranium de Tricastin) et avec l’Allemagne (la compagnie KWU est appelée à construire deux réacteurs, avec, en sus, un financement complémentaire de 19 milliards de DM, consenti en 1977 pour la construction d’autres infrastructures). Cette coopération euro-iranienne n’allait pas en sens unique : les Iraniens investissaient en Allemagne (25% du capital de Krupp) et en France dans les entreprises gérant les technologies du nucléaire. Une Axe énergétique Paris-Bonn-Téhéran se mettait en place : voilà pourquoi il fallait éliminer le Shah, après avoir éliminé, par l’intermédiaire de la Bande à Baader, le président de la Dresdner Bank, Jürgen Ponto (assassiné le 31 juillet 1977), et le patron des patrons allemand, Hanns-Martin Schleyer, tous deux avocats d’une modification complète du système économique international, après que Nixon ait déclaré la non convertibilité du dollar en or. Ce double assassinat en Allemagne, faut-il le préciser, suit celui du Roi Fayçal d’Arabie, perpétré le 25 mars 1975 ; le monarque saoudien avait tenté de réorganiser l’OPEP, de concert avec le Shah, prouvant par là même que le système que préconisaient les deux hommes n’était pas belligène en dépit de l’hostilité ancestrale entre Arabes sunnites/wahhabites et Perses chiites. Washington, affolé face à la redistribution des cartes qui s’opérait sur la scène internationale, applique, via Kissinger, une politique intransigeante à l’endroit de ses alliés officiels, quasi une politique de collision frontale, prouvant que les « bonnes intentions » affichées par les Américains depuis la fin des années quarante n’étaient que des leurres propagandistes ; les alliés, qu’ils fussent d’anciens alliés ou d’anciens vaincus, demeuraient, dans le fond, des concurrents des Etats-Unis, donc des ennemis à abattre au moment opportun et non des alliés qu’une bienveillance américaine perpétuelle était toujours prompte à protéger, au nom de principes désintéressés.
La CIA parie sur Khomeiny
Pour recréer, au moins artificiellement, la confiance perdue dans les opinions publiques « alliées », pour retoucher ce tableau pessimiste, tissé de conflictualités réelles et résurgentes, en dépit des alliances officielles, il fallait inventer une nouvelle idéologie édulcorante : ce sera l’idéologie des « droits de l’homme », portée par le nouveau président des Etats-Unis, promu dans les médias en 1975 et intronisé en 1976 : Jimmy Carter, ancien cultivateur de cacahuètes en Géorgie. La diplomatie américaine évolue très rapidement dans les années 60 et 70 : elle est marquée par le passage de la diplomatie classique de Kissinger au temps de Nixon, à une diplomatie modifiée et axée sur la confrontation directe ou indirecte avec les alliés officiels de Washington puis à la diplomatie cartérienne des « droits de l’homme ». Dans ce contexte bouillonnant et tourbillonnant, la CIA est appelée à agir rapidement, avant que les alliés ne comprennent réellement ce qui arrive et se mettent au diapason. Elle va parier sur les mollahs iraniens parce qu’ils ne suggèrent aucun projet « moderniste », contrairement au Shah (ou au Roi Fayçal, en dépit des blocages potentiels de l’idéologie wahhabite). Le calcul des services américains est le suivant : si les mollahs n’ont pas de grands projets de modernisation, les dividendes pétroliers suffiront pour apaiser le pays et ses masses déclassées à la suite de l’échec (relatif) de la réforme agraire. Il n’y aura pas de programme nucléaire, donc aucune coopération future de réelle importance avec les puissances économiques européennes, qui demeureront dès lors inféodées aux Etats-Unis, sans risquer de faire cavaliers seuls. La CIA va donc créer le personnage de Khomeiny, le choisir comme figure privilégiée du bouleversement appelé à neutraliser l’Iran, à le plonger dans un marasme de longue durée, l’empêchant ainsi de devenir une puissance régionale qui compte.
Le programme de la « Révolution Blanche »
Qui est Khomeiny ? Avant toutes choses, il est un contestataire du quiétisme traditionnel adopté par les chiites depuis l’avènement des Qadjar et depuis la Conférence de Qom de 1949. Ce quiétisme va perdurer sans heurts jusqu’à la mort de l’Ayatollah Boruyerdi en 1961. Le quiétisme a été une période faste pour le clergé chiite : son autonomie était garantie par le principe de dualité et ses écoles, comme du reste tout le système scolaire iranien, vont se redresser dans les années 50. En 1959, quand le Shah annonce qu’il va introduire le vote des femmes et amorcer la réforme agraire, le clergé n’appelle nullement à manifester, alors que les thèmes étaient sensibles, susceptibles de provoquer une vigoureuse contestation de nature religieuse. En 1961, une fois l’Ayatollah Boruyerdi disparu, le Shah annonce le programme entier de sa « révolution blanche », que le peuple pourra accepter après référendum, prévu pour le 26 janvier 1963. Ce programme comprenait :
◊ La réforme agraire ;
◊ La nationalisation des forêts ;
◊ La privatisation des entreprises nationales ;
◊ La participation et l’intéressement des travailleurs (projet calqué sur les projets gaulliens) ;
◊ La réforme électorale ;
◊ La création d’un « corps d’alphabétisation ».
Mais simultanément à l’annonce de cet ambitieux programme de modernisation de l’Iran, le Shah traite les clercs de « parasites », de « réactionnaires noirs » et d’ « animaux impurs ». En substance, il déclare : « Nous en avons assez des parasites sociaux et politiques ; j’abhorre la ‘réaction noire’ encore plus que la ‘destruction rouge’ ». Ces paroles fortes sanctionnent la rupture entre le pouvoir royal/impérial et le clergé.
L’engrenage
En 1962, Khomeiny avait déjà tenu quelques discours incendiaires contre le droit de vote des femmes. En janvier 1963, à la veille du référendum qui doit légitimer le programme de la « révolution blanche », il déclare s’opposer à la réforme agraire, alors que le clergé ne l’avait jamais rejetée auparavant. Pourquoi cette nouvelle hostilité ? Parce que Khomeiny estime que cette réforme touche aussi les terres détenues par les fondations religieuses. En mars 1963, les étudiants en théologie manifestent à Qom, à l’instigation de Khomeiny. La répression est dure. Le 3 juin 1963, c’est le jour de l’Achura dans la tradition chiite. C’est une fête de première importance chez les chiites duodécimains ; elle consiste en une procession en souvenir de l’assassinat du troisième Imam Hussain sur ordre du Calife sunnite Yazid, en 680 à Kerbala (Irak actuel). Pour expliquer de manière succincte l’importance à la fois religieuse et politique de l’Achura, disons que chaque croyant doit promettre, ce jour-là, de « prendre la place d’Hussain, de voler à son secours », contre l’injustice commise par Yazid. Sont des « Yazids » tous ceux qui enfreignent les lois de l’islam et commettent l’injustice. Dans un tel contexte religieux, le Shah était devenu un « Yazid ». Le 3 juin 1963, donc, jour de l’Achura, Khomeiny tonne un discours incendiaire qui conduit immédiatement à son arrestation. Celle-ci déclenche des manifestations dans toutes les villes d’Iran, orchestrées par les « bazaris », les commerçants des bazars. Troubles et répression s’ensuivent, contraignant Khomeiny à prendre le chemin de l’exil en 1964. Ce chemin le conduira d’abord en Turquie, puis en Irak, où il s’installera à Najaf, près du tombeau d’Ali. Enfin, à Neauphle-le-Château en France, quand le pouvoir baathiste irakien, laïque et républicain, l’expulse par crainte d’une contagion en Irak même, au sein de la forte minorité chiite du Sud.
La « renaissance théologique » de Khomeiny
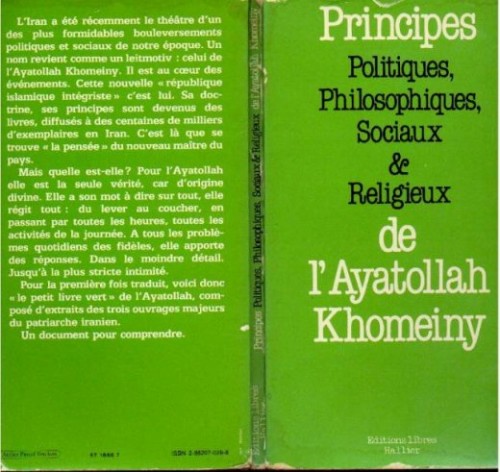 A Najaf, la pensée de Khomeiny va prendre les contours précis que nous lui connaissons depuis 1978. On parle à son propos d’une « renaissance théologique ». L’Ayatollah en exil va briser d’abord la dualité Shah/clergé qui avait caractérisé l’Iran chiite depuis les Séfévides. Il déclare en effet que la monarchie est incompatible avec l’islam ; cela implique que tant que l’Iman ou le Mahdi restent cachés, seuls les clercs ont droit au pouvoir (« velayet-e faqih »). Il réhabilite le culte du martyr, refoulé par le quiétisme dominant avant sa « renaissance théologique » : si l’on meurt en combattant le Shah, désormais totalement délégitimé et ramené à la figure négative d’un « Yazid », on acquiert automatiquement le statut de martyr. Les théologiens parlent à ce propos d’ « Entwerdung in Gott », de quitter volontairement le monde du devenir, d’abandonner son devenir individuel pour s’évanouir en Dieu, selon la notion soufie de « fana ». En résumé, c’est un appel aux suicidaires, dont on va faire des kamikazes dans les champs de mines ou des preneurs de tranchées (pendant la longue guerre Iran/Irak de 1980-88). Sur le plan plus strictement politique, Khomeiny avance pendant son exil irakien deux leitmotive : 1) il faut en finir avec l’immunité dont jouissent tous les citoyens américains actifs sur le territoire iranien (immunité dont ils jouissaient aussi par ailleurs en Grande-Bretagne depuis 1942 et en Allemagne depuis l’occupation de 1945) ; 2) il fustige l’endettement de l’Iran, argument plus concret que le Shah retiendra comme valable, dans la mesure où tous ses propres efforts pour conduire à l’autarcie énergétique de l’Iran, notamment sur le plan nucléaire, furent simultanément des efforts pour le dégager de l’endettement. Pendant son exil, Khomeiny soulèvera d’autres polémiques, comme, en 1967, contre le train de lois sur la protection de la famille ou, en 1971, contre les dépenses entrainées par les fêtes de Persépolis, destinées à donner un lustre inégalé au principe monarchique achéménide, revendiqué par les deux Shahs de la dynastie Pahlevi. En 1976, Khomeiny s’insurge contre l’introduction du calendrier achéménide, perçue comme une atteinte directe à l’islam, à la liturgie duquel il oppose une autre liturgie, se référant à un passé préislamique, donc relevant de la « jalilliyah », aux yeux des islamistes.
A Najaf, la pensée de Khomeiny va prendre les contours précis que nous lui connaissons depuis 1978. On parle à son propos d’une « renaissance théologique ». L’Ayatollah en exil va briser d’abord la dualité Shah/clergé qui avait caractérisé l’Iran chiite depuis les Séfévides. Il déclare en effet que la monarchie est incompatible avec l’islam ; cela implique que tant que l’Iman ou le Mahdi restent cachés, seuls les clercs ont droit au pouvoir (« velayet-e faqih »). Il réhabilite le culte du martyr, refoulé par le quiétisme dominant avant sa « renaissance théologique » : si l’on meurt en combattant le Shah, désormais totalement délégitimé et ramené à la figure négative d’un « Yazid », on acquiert automatiquement le statut de martyr. Les théologiens parlent à ce propos d’ « Entwerdung in Gott », de quitter volontairement le monde du devenir, d’abandonner son devenir individuel pour s’évanouir en Dieu, selon la notion soufie de « fana ». En résumé, c’est un appel aux suicidaires, dont on va faire des kamikazes dans les champs de mines ou des preneurs de tranchées (pendant la longue guerre Iran/Irak de 1980-88). Sur le plan plus strictement politique, Khomeiny avance pendant son exil irakien deux leitmotive : 1) il faut en finir avec l’immunité dont jouissent tous les citoyens américains actifs sur le territoire iranien (immunité dont ils jouissaient aussi par ailleurs en Grande-Bretagne depuis 1942 et en Allemagne depuis l’occupation de 1945) ; 2) il fustige l’endettement de l’Iran, argument plus concret que le Shah retiendra comme valable, dans la mesure où tous ses propres efforts pour conduire à l’autarcie énergétique de l’Iran, notamment sur le plan nucléaire, furent simultanément des efforts pour le dégager de l’endettement. Pendant son exil, Khomeiny soulèvera d’autres polémiques, comme, en 1967, contre le train de lois sur la protection de la famille ou, en 1971, contre les dépenses entrainées par les fêtes de Persépolis, destinées à donner un lustre inégalé au principe monarchique achéménide, revendiqué par les deux Shahs de la dynastie Pahlevi. En 1976, Khomeiny s’insurge contre l’introduction du calendrier achéménide, perçue comme une atteinte directe à l’islam, à la liturgie duquel il oppose une autre liturgie, se référant à un passé préislamique, donc relevant de la « jalilliyah », aux yeux des islamistes.
Dans les années 70, les clercs réussissent à organiser les masses issues de l’exode rural et concentrées dans les grandes villes iraniennes. Dans les années 50 et 60, cela n’avait pas été possible parce que l’industrie, en phase de croissance rapide, absorbait aisément cette frange de la population. A la veille du premier choc pétrolier, consécutif à la guerre du Yom Kippour de 1973, cette absorption du boom démographique iranien n’est plus possible et le rente pétrolière, aussi fabuleuse soit-elle, ne parvient pas à satisfaire les besoins des déclassés. Les parties couraient à la confrontation directe, malgré le quiétisme encore en vigueur sous l’Ayatollah Shariat Madari. A partir de 1975, la tension monte dans le pays. Il ne faut plus qu’une étincelle pour mettre le feu aux poudres. Il faudra attendre deux ans environ pour que le pays explose véritablement : le 3 novembre 1977, le fils de Khomeiny meurt dans des circonstances mystérieuses. Aussitôt, des manifestations violentes de grande ampleur éclatent à Téhéran, juste avant la période de l’Achura. Or la tradition chiite veut que s’il y a un mort par violence pendant le temps sacré de l’Achura, on doit le commémorer par des processions quarante jours après. Ce sera l’enchaînement fatal qui aura raison du pouvoir impérial : les processions ont lieu, elles tournent à la manifestation ou à l’émeute ; les forces de l’ordre réagissent : il y a des morts. Qu’il faut commémorer quarante jours plus tard, par d’autres processions/manifestations qui seront réprimées tout aussi durement par la police, avec mort d’hommes. Le scénario s’est répété inlassablement.
La presse vitupère contre Khomeiny, les étudiants en théologie manifestent à Qom
En janvier 1978, la presse officielle publie un article virulent et caustique contre Khomeiny où le dignitaire religieux est campé comme la tête des « réactionnaires noirs alliés aux communistes » ; on l’accuse d’être un étranger, un Pakistanais et non un Iranien de souche, dont les ancêtres s’appelaient Hindi, c’est-à-dire les « Indiens » ou « ceux venus d’Inde ». Ils ont changé de nom en s’établissant dans la petite de ville de Khomein, où ils étaient « épiciers ». L’article accuse encore Khomeiny d’être un « espion britannique », de mener une vie dispendieuse, de luxe et de luxure, et d’être un « érotomane pathologique » (sous prétexte qu’il avait commenté certains poèmes soufis à connotations érotiques). A la suite de cet article, de nouvelles émeutes éclatent à Qom, menées, une fois de plus, par les étudiants en théologie. Ils réclament le retour de Khomeiny, le rétablissement de la constitution de 1906-1907. Ils ne réclament pas encore l’avènement d’une république islamique. Omission qui laisse subodorer en filigrane, derrière le discours islamiste véhément et apparemment anti-occidental, une volonté américaine, puisque l’idée d’une constitution de type belge, importation britannique, avait déjà suscité le scepticisme de tous les partis perses de l’époque, sauf ceux qui cherchaient délibérément la protection britannique. Les émeutes déclenchées à Qom par les étudiants en théologie enclenchent un nouvel engrenage fatidique.
L’opposition est encore composite au début de l’année 1978. L’Ayatollah Shariat Madari veut simplement la constitution sans abolir la monarchie. Le théoricien Ali Shariati se revendique d’un chiisme socialiste, séduisant pour tous les sociaux révolutionnaires du pays qui se disent religieux mais anti-cléricaux. Il y a ensuite les partisans de Khomeiny qui veulent un retour aux principes purs de l’islam, à la façon des hanbalistes dans le monde sunnite mais en conservant l’idée d’un clergé dominant, propre au chiisme et conforme aux principes de sa propre « renaissance théologique », élaborée lors de son exil irakien. Il y a ensuite la masse des contestataires laïques du pouvoir impérial : les anciens du « Front National » du Dr. Mossadegh et les communistes du « Tudeh », flanqués de leurs milices, les « Mudjahiddins du Peuple » (qui deviendront ultérieurement, après leur éviction par les khomeinystes, le noyau dur de la Garde Républicaine de Saddam Hussein, y compris lors de la guerre Iran/Irak). Khomeiny, qui sortira vainqueur du lot, radicalise donc un mouvement, né dans les années 60 et demeuré jusqu’alors fort modeste, qui poursuivait quatre objectifs principaux :
◊ Rejeter définitivement le quiétisme conventionnel des dignitaires du clergé chiite iranien depuis les Shahs de la dynastie Qadjar et depuis la Conférence de Qom (1949), sanctionnée par l’Ayatollah Boruyerdi, décédé en 1961. L’abolition de l’attitude quiétiste implique une re-politisation de l’islam, de renouer avec des principes d’action.
◊ Réorganiser le clergé, en faire une instance combattante dans l’arène politique iranienne.
◊ Rationaliser et centraliser les finances du clergé, afin de le doter d’une autonomie permanente au sein de la société iranienne.
◊ Améliorer la formation du clergé.
Au départ, la volonté de traduire ces quatre objectifs ne s’oppose pas nécessairement à la personne du Shah ni à la modernisation de la société.
Le chiisme socialiste d’Ali Shariati
 Ali Shariati, théoricien d’une « révolution socialiste chiite », formule une idéologie contestatrice plus « moderne », que l’on peut classer parmi les « messianismes du tiers-monde », comme on les désignait à l’époque où la décolonisation venait de se dérouler à grande échelle sur le globe. Il appelle 1) à rejeter le quiétisme, à l’instar des religieux adeptes de Khomeiny ; 2) il réclame le droit à la parole pour les intellectuels non cléricaux qui s’inscrivent dans le cadre du chiisme (il élargit ainsi la notion de « clercs » et flanque ipso facto le clergé d’une caste militante d’intellectuels et d’écrivains chiites non affectés par le quiétisme et animés par la volonté de faire triompher la justice sur la Terre) ; 3) il opère une distinction entre le « chiisme des Séfévides » (et des Pahlevi), qu’il campe comme « corrompu » et le « chiisme d’Ali », chiisme pur des origines, impliquant tout à la fois un retour au prophète et à l’Imam Ali, tout en réclamant l’avènement permanent de la justice sociale, à l’instar des messies zoroastriens, manichéens ou mazdéens de l’histoire iranienne préislamique. Cette distinction postule une imitation active d’Ali, dans le quotidien politique, dans l’effervescence mondaine. La femme a un rôle primordial à jouer dans ce contexte : elle doit se montrer active sur le plan politique et religieux ; l’idéal qu’elle doit incarner rejette tout à la fois le modèle occidental de la femme émancipée et le modèle de la femme musulmane recluse. Ali Shariati développe là une idéologie contestatrice typiquement chiite et iranienne. Son anti-occidentalisme rejoint sur quelques points celui de Khomeiny ou d’autres militants islamistes (y compris sunnites). Ses sources d’inspiration sont : 1) l’écrivain Jalal Al-e Ahmad (1923-1969) qui avait théorisé la notion de « pays infecté » (« Gharb-zadegi »), infecté par l’Occident s’entend. Via les cercles de Shariati, l’idée d’un « empoisonnement occidental » ou d’une « infection occidentale » se répand dans les esprits ; 2) Shariati s’inspire de Franz Fanon, poète du tiers-monde, très en vogue dans les milieux contestataires de la planète dans les années 60. Fanon déclare qu’il est licite de « tuer les vecteurs de l’infection ». De là, l’idée d’une « violence désinfectante ». Ali Shariati s’inscrit dans le cadre de la gauche planétaire de son époque, dans la mesure où il véhicule une anthropologie optimiste de type rousseauiste : l’ « infection » ne vient pas de l’homme lui-même, comme le diraient les tenants de l’anthropologie pessimiste (Joseph de Maistre, Donoso Cortès, Carl Schmitt), elle vient de l’extérieur. L’homme est donc bon ; par la grâce de cette bonté, il peut commettre toutes les « violences désinfectantes » imaginables, y compris celles qui pourraient être clairement interprétées comme des crimes purs et simples, et peut donc tuer les « vecteurs d’infection » qu’il juge tels, indépendamment du fait que la personne ainsi visée soit « infectante » ou non, soit un ennemi conscient ou un quidam sans intention de nuire. Toute anthropologie optimiste peut ainsi conduire au carnage universel.
Ali Shariati, théoricien d’une « révolution socialiste chiite », formule une idéologie contestatrice plus « moderne », que l’on peut classer parmi les « messianismes du tiers-monde », comme on les désignait à l’époque où la décolonisation venait de se dérouler à grande échelle sur le globe. Il appelle 1) à rejeter le quiétisme, à l’instar des religieux adeptes de Khomeiny ; 2) il réclame le droit à la parole pour les intellectuels non cléricaux qui s’inscrivent dans le cadre du chiisme (il élargit ainsi la notion de « clercs » et flanque ipso facto le clergé d’une caste militante d’intellectuels et d’écrivains chiites non affectés par le quiétisme et animés par la volonté de faire triompher la justice sur la Terre) ; 3) il opère une distinction entre le « chiisme des Séfévides » (et des Pahlevi), qu’il campe comme « corrompu » et le « chiisme d’Ali », chiisme pur des origines, impliquant tout à la fois un retour au prophète et à l’Imam Ali, tout en réclamant l’avènement permanent de la justice sociale, à l’instar des messies zoroastriens, manichéens ou mazdéens de l’histoire iranienne préislamique. Cette distinction postule une imitation active d’Ali, dans le quotidien politique, dans l’effervescence mondaine. La femme a un rôle primordial à jouer dans ce contexte : elle doit se montrer active sur le plan politique et religieux ; l’idéal qu’elle doit incarner rejette tout à la fois le modèle occidental de la femme émancipée et le modèle de la femme musulmane recluse. Ali Shariati développe là une idéologie contestatrice typiquement chiite et iranienne. Son anti-occidentalisme rejoint sur quelques points celui de Khomeiny ou d’autres militants islamistes (y compris sunnites). Ses sources d’inspiration sont : 1) l’écrivain Jalal Al-e Ahmad (1923-1969) qui avait théorisé la notion de « pays infecté » (« Gharb-zadegi »), infecté par l’Occident s’entend. Via les cercles de Shariati, l’idée d’un « empoisonnement occidental » ou d’une « infection occidentale » se répand dans les esprits ; 2) Shariati s’inspire de Franz Fanon, poète du tiers-monde, très en vogue dans les milieux contestataires de la planète dans les années 60. Fanon déclare qu’il est licite de « tuer les vecteurs de l’infection ». De là, l’idée d’une « violence désinfectante ». Ali Shariati s’inscrit dans le cadre de la gauche planétaire de son époque, dans la mesure où il véhicule une anthropologie optimiste de type rousseauiste : l’ « infection » ne vient pas de l’homme lui-même, comme le diraient les tenants de l’anthropologie pessimiste (Joseph de Maistre, Donoso Cortès, Carl Schmitt), elle vient de l’extérieur. L’homme est donc bon ; par la grâce de cette bonté, il peut commettre toutes les « violences désinfectantes » imaginables, y compris celles qui pourraient être clairement interprétées comme des crimes purs et simples, et peut donc tuer les « vecteurs d’infection » qu’il juge tels, indépendamment du fait que la personne ainsi visée soit « infectante » ou non, soit un ennemi conscient ou un quidam sans intention de nuire. Toute anthropologie optimiste peut ainsi conduire au carnage universel.
En 1979, après le départ du Shah pour un exil dont il ne reviendra jamais, ces forces composites arrivent toutes au pouvoir mais, au cours de l’année, les partisans de Khomeiny, regroupés autour des Pasdarans de la révolution islamiste, prennent tout le pouvoir pour eux, contraignent bon nombre d’opposants laïques à prendre la fuite à l’étranger ou les assassinent. Les Américains sont désillusionnés : la disparition d’une masse de manœuvre politique composite les laisse dans le désarroi, masse que des fondations, instituts ou autres instances, issues du « soft power », auraient pu manipuler à loisir car toute pluralité composite ne sert pas le peuple qu’elle est censée gouverner mais sert l’étranger hégémonique qui peut la manœuvrer à son gré, en favorisant tantôt l’une faction tantôt l’autre et en fomentant crises et troubles civils. La prise du pouvoir par les Pasdarans de Khomeiny va induire les Américains à parier sur Saddam Hussein, à en faire l’instrument d’une guerre d’usure contre l’Iran (et simultanément contre l’Irak lui-même), qui durera huit longues années, où les Etats-Unis fourniront directement ou indirectement des armes aux deux belligérants. Cette guerre éliminera le « Youth Bulge » (le trop-plein de jeunes mâles de quinze à trente ans), qui constituait un potentiel révolutionnaire dans les zones urbaines et péri-urbaines d’Iran, ôtant du même coup aux Américains cet instrument dont ils s’étaient servi pour abattre le Shah. Le « Youth Bulge » ne pourra pas s’utiliser contre Khomeiny et ses successeurs. D’où l’hostilité permanente contre l’Iran.
Robert STEUCKERS.
(rédaction finale : mai 2009)
(à suivre – « Le fondamentalisme islamique en Afghanistan et au Pakistan »)
Bibliographie :
- Voir notre chapitre précédent, « Définir le fondamentalisme islamique dans le monde arabe » (sur http://euro-synergies.hautetfort.com/) et notre longue étude «L’encerclement de l’Iran à la lumière de l’histoire du « Grand Moyen Orient » (sur : http://vouloir.hautetfort.com/ et sur http://euro-synergies.hautetfort.com/ ).
00:10 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, iran, chiisme, islam, moyen orient, fondamentalisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Les Cosaques de la liberté: l'expérience de l'anarchisme de Nestor Makhno en Ukraine
 Archives de SYNERGIES EUROPENNES - 1987
Archives de SYNERGIES EUROPENNES - 1987
Les Cosaques de la liberté : l'expérience de l'anarchisme de Nestor Makhno en Ukraine
par Ange Sampieru
Présenter en 475 pages la vie et l'action de Nestor lvanovitch Makhno (1889/1934), inspirateur et réalisateur de la seule expérience de communisme libertaire pendant la période de la révolution russe (entre 1917 et 1921) est un pari réussi par A. Skirda. Spécialiste de la Russie Soviétique, l'auteur exprime sans aucun doute sa sympathie politique pour l'anarchisme makhnoviste au travers d'une étude aussi complète que variée.
Un travail d'apologie
En dépit de tout l'intérêt des analyses historiques de l'expérience originale accomplie par Makhno et ses partisans, le plan choisi par Skirda nous apparaît peu significatif. Après avoir étudié son sujet d'un point de vue chronologique et événementiel (de l'enfance de Makhno à sa mort en exil à Paris en 1934), il revient sur une recherche plus psycho-historique dans un second temps, achevant son ouvrage par une revue très critique des livres consacrés à l'anarchisme ukrainien et à son fondateur. On suit alors assez péniblement ces mouvements assez "anarchiques". Au fond, on lit ici trois ouvrages différents : l'un est un livre d'histoire, fort brillant au demeurant, consacré à l'histoire de l'expérience anarchiste en Ukraine dans ses rapports avec le phénomène global de la Révolution russe. Le second est une monographie de N. Makhno, fondateur et "Batko" ("petit père" en quelque sorte) de ce mouvement de "communisme libertaire". Le troisième enfin est une recension critique des textes (brochures, articles de presse, romans, etc.), ayant pour thème principal ou quelquefois secondaire l'expérience makhnoviste. C'est cet "éclatement" qui. sans remettre en cause la richesse et le sérieux de ce travail historique, rend peut-être mal à l'aise le lecteur que je suis. Un dernier point de forme enfin : la sympathie presque "religieuse" de l'auteur pour son héros et ses idées l'amènent, dans tous les cas, à une défense quasi militante de ses décisions et de ses choix politiques et militaires. Ainsi l'exécution, aussi barbare qu'inutile, d'émissaires des "gardes blancs" de Dénikine lui proposant une alliance face aux divisions de l'armée rouge n'appelle de sa part aucun commentaire. Commentaires qui, tout au contraire, abondent quand il s'agit d'actes de trahison commis par les responsables politiques ou militaires léninistes. Où fut alors la grandeur d'âme du héros qui fit pendre, le long d'un chemin, des porteurs de missives protégés par leur statut d'émissaires. Par ailleurs, dans ce que nous avons convenu de nommer le "second livre" il n'y a, chez Skirda, aucun aspect critique dans son analyse du personnage de Makhno. Nous regrettons cette vision toute théorique, l'auteur réservant ses critiques, souvent fondées, aux adversaires de Makhno et à ceux de ses partisans ou amis qui ont eu le malheur de ne pas le suivre en tous points dans son existence mouvementée.
Les deux visages du makhnovisme : identitaire ukrainien et anarchiste
intellectuel
Ceci étant, il nous apparaît que le mouvement anarchiste, fondé en Ukraine par Nestor Makhno, connait deux visages. L'un est celui du discours anarchiste, que nous comprenons comme idéologie cohérente, inscrit dans une filiation intellectuelle proprement occidentale. L'anarchie est ici une forme assez radicale de contestation du pouvoir d'État et, au-delà même, de toute structure politique et administrative centrale de direction. L'État confisquant à son profit le pouvoir politique, il confisque aussi la démocratie comprise comme forme autonome et locale de représentation et de gestion. On trouve ces critiques tant dans le mutualisme proudhonien, inquiet des empiétements grandissants de l'État post-révolutionnaire en France, que dans l'anarcho-syndicalisme sorélien, partisan d'une révolution spontanée prolétarienne contre la conception républicaine et bourgeoise du pouvoir politique. Dans tous les cas, on assiste à une renaissance de l'idéologie ancienne et traditionnelle des "libertés communautaires" qui structurent la démocratie européenne. Chez Makhno, l'anarchie inscrit ses références dans une même problématique. Une problématique nationale et sociale, puisque apparaissent en filigrane la revendication "nationale" ukrainienne, face au pouvoir central moscovite russe, et la revendication sociale paysanne, face à l'administration politique urbaine. L'anarchie répond alors à cette double revendication. Réponse "voilée" puisqu'aussi bien dominée par les "grands thèmes" occidentaux de l'idéologie moderne. Ainsi ni la revendication nationale (comprise comme désir explicite d identité culturelle et linguistique traduit en termes de pouvoir politique) ni la revendication paysanne (l'autonomie maximale face à la philosophie occidentale de la ville) ne sont reconnues à part entière. Ce refus résulte d'une présence souveraine des valeurs de l'anarchie comprise comme idéologie sociale occidentale.
Plus proche encore d'une revendication ethno-culturelle, l'auteur souligne la présence majoritaire au sein des troupes makhnovistes des descendants des cosaques zaporogues. Il est indubitable, à la lecture de ce livre, que le mouvement anarchiste dans les steppes de l'Ukraine résulte beaucoup plus d'un sentiment culturel, plus ou moins enfoui dans sa mémoire des paysans cosaques, que dans l'adhésion aux valeurs globales de la révolution anarchiste, au sens des intellectuels de l'anarchie formés à l'école citadine et théorique de Bakounine et Kropotkine.
Et les explications de Skirda sur cette adhésion toute théorique aux réflexions et aux valeurs de l'Anarchie (avec un grand A) sont non seulement peu convaincantes mais aussi et surtout constamment démenties par les descriptions du premier livre. Les paysans et les quelques ouvriers qui suivirent Makhno sont-ils des militants anarchistes ou plus simplement des Ukrainiens opposés non seulement à la restauration de l'ancien régime social des grands propriétaires (régime fondé sur un mélange détonnant de féodalisme et de valeurs socio-économiques bourgeoises) mais aussi à la perpétuation du pouvoir moscovite, que celui-ci se présente sous une couleur blanche ou rouge. L'Anarchie serait alors une "béquille théorique", une superstructure dans le langage marxiste, qui serait bien loin du concret historique. Le véritable ressort résiderait dans la volonté consciente, chez la masse paysanne de descendance zaporogue ou non (bien que les premiers aient été les inspirateurs et les vrais décideurs du mouvement), de restaurer une communauté sociale et politique en accord avec leur propre vue du monde. Skirda, militant anarchiste formé à l'école occidentale, refuse de souligner cette présence. C'est une erreur et elle révèle un point de vue très théorique que l'on regrettera.
Les raisons de l'hostilité des makhnovistes à l'égard des bolchéviques
 A contrario, nous découvrons avec beaucoup d'intérêt, chez Skirda, les rapports conflictuels entretenus par cette armée libertaire et paysanne avec les autorités léninistes-bolchéviques. Lénine et Trotsky, intellectuels et citadins, n'avaient que mépris et incompréhension, quelquefois mués en haine, à l'égard des masses paysannes. D'autant plus si ces dernières étaient opposées à leur autorité et non-russes ! La politique de répression, la NEP, la lutte contre les moyens propriétaires (les fameux Koulaks), bref la guerre civile à outrance menée contre les ruraux non russes et russes, résulte de ces sentiments développés et théorisés dans l'idéologie prolétarienne ouvrière des émules de Marx (bourgeois finalement conservateur et citadin). La misère des sociétés industrielles de l'Ouest fut élevée au rang de péché suprême que la Révolution devait effacer. Dans ce cadre, le paysannat était aussi, même si des nuances étaient introduites, complice et soutien du système bourgeois. Ce qui était un raccourci fulgurant dans la pensée et l'analyse chez Marx, devenait un dogme idéologique d'État chez Lénine. Dans ce schéma, l'anarchisme makhnovien, appuyé sur la multiplication des "soviets libres" en Ukraine, pouvait structurer les réactions spontanées d'autodéfense des paysans locaux.
A contrario, nous découvrons avec beaucoup d'intérêt, chez Skirda, les rapports conflictuels entretenus par cette armée libertaire et paysanne avec les autorités léninistes-bolchéviques. Lénine et Trotsky, intellectuels et citadins, n'avaient que mépris et incompréhension, quelquefois mués en haine, à l'égard des masses paysannes. D'autant plus si ces dernières étaient opposées à leur autorité et non-russes ! La politique de répression, la NEP, la lutte contre les moyens propriétaires (les fameux Koulaks), bref la guerre civile à outrance menée contre les ruraux non russes et russes, résulte de ces sentiments développés et théorisés dans l'idéologie prolétarienne ouvrière des émules de Marx (bourgeois finalement conservateur et citadin). La misère des sociétés industrielles de l'Ouest fut élevée au rang de péché suprême que la Révolution devait effacer. Dans ce cadre, le paysannat était aussi, même si des nuances étaient introduites, complice et soutien du système bourgeois. Ce qui était un raccourci fulgurant dans la pensée et l'analyse chez Marx, devenait un dogme idéologique d'État chez Lénine. Dans ce schéma, l'anarchisme makhnovien, appuyé sur la multiplication des "soviets libres" en Ukraine, pouvait structurer les réactions spontanées d'autodéfense des paysans locaux.
Le prélèvement autoritaire et violent de la production paysanne au profit des villes, la substitution du marché d'État à l'ancien marché des propriétaires féodaux, enfin le statisme des lieux (Moscou reste le centre du pouvoir) et des méthodes de pouvoir (utilisation normale de la force policière et militaire dans les opérations de prélèvement) confirmait les sentiments latents des producteurs locaux. En fait, il y eut politique de pillage des productions rurales au profit des centres urbains, politique justifiée par un discours révolutionnaire et appliquée par des forces répressives similaires aux forces de l'ancien régime tsariste (Tchéka au lieu de l'Okhrana). Les anarchistes eurent alors beau jeu d'identifier la politique autoritaire de Lénine avec l'ancienne pratique tsariste. Après la première révolution (renversement du tsarisme et création d'un État constitutionnel de type occidental) et la seconde révolution (coup d'État bolchévique), la "troisième révolution" consistait à établir un communisme social égalitaire sans autorité d'en haut. C'était du moins le programme de militants anarchistes. Le spontanéisme plus ou moins dirigé des révoltes populaires en Ukraine face à la politique de l'autorité moscovite-bolchévique se brise pourtant contre la puissance de l'armée rouge et des méthodes de répression de masse utilisées. Cet échec constitue une leçon historique. L'État bolchévique, en dépit de sa rhétorique communiste (atteindre l'utopie vivante de la société sans état et sans classes), appliqua les règles strictes du pouvoir moderne, issues de l'expérience révolutionnaire française (notamment en Vendée).
Un modèle applicable au monde entier
La seule issue aurait peut-être été de réaliser la synthèse entre les deux forces motrices de toute l'histoire : celle qui unit la force de la volonté d'existence identitaire (qui est une force nationale mais non nationaliste) et la construction d'une communauté démocratique et sociale, basée sur les valeurs de justice et d'égalité civique. C'est cette fusion, modifiée par les circonstances locales, qui assura la puissance révolutionnaire dans diverses régions du monde : révolution nassérienne, idéologie de la nation arabe chez le chef de l'État libyen, révolution populaire vietnamienne, sandinisme nicaraguayen, révolution du capitaine Sankara au Burkina-Faso. etc. Mais il eut fallu pour cela que l'anarchie ne fut pas une des nombreuses facettes de l'idéologie dominante moderne, mais l'expression réelle et locale de la volonté d'indépendance d'un peuple. À ce titre, l'auteur reste dans un schéma idéologique bien éloigné de la véritable voie de l'indépendance, qui pourrait tout aussi bien se nommer "anarchie" que trouver une autre étiquette.
Ange SAMPIERU.
Alexandre SKIRDA, Les Cosaques de la liberté, Jean-Claude Lattès, Paris, 1986, 475 p.
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cosaques, histoire, russie, anarchisme, liberté, libertaires, nestor makhno, ukraine, guerre civile russe, révolution russe |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 27 février 2010
Chile y la formacion de su Esrtado-Nacion
 Chile y la formación de su Estado-nación
Chile y la formación de su Estado-nación
Alberto Buela (*)
Luego de la derrota española en la definitiva batalla de Maipú el 5 de abril de 1818, los vencedores, las fuerza criollas, se enfrentaron con el problema de la organización del territorio que tenía un sistema colonial de gobierno. Había que establecer un modelo político nuevo, una organización administrativa que lograse reemplazar la antigua administración. De modo tal que se produjo un doble quiebre, como sucedió en toda Nuestra América: a) un quiebre político, el reemplazo de una administración y un régimen, el de la monarquía por la república. Y b) un quiebre de la identidad subjetiva de la nación, no más españoles americanos sino simplemente americanos (ideal de Bolivar y San Martín) o chilenos, paraguayos, argentinos, etc. (ideal del nacionalismo de patria chica) que fue lo que realmente sucedió.
La función de construir un Estado-nación propio va a ir emparejada a la importancia que adquieren las armas, así se va cumplir aquí el adagio de Clausewich: la guerra es la continuación de la política por otros medios. En el caso de Chile, a la guerra de la Independencia continuarán Portales y la batalla de Lircay, la guerra contra la confederación peruano-boliviana y la guerra civil de 1851.
Es que a partir de 1818 la unidad política alrededor del Estado-nación se va a tornar confusa e inestable y así lo que establecía O´Higgins, lo derribaba Freire y aquello que sostenía éste, lo volteaba Pinto. En realidad, ellos eran obstáculos a la integración en un orden nacional. Es que el caudillismo y los intereses locales eran divergentes. Así O´Higgins se enfrenta a los terratenientes, quienes eran representados por Freire. Fracasa en Chile el proyecto federalista. Y se impone luego de la derrota de Freire en la batalla de Lircay en 1830, el unitarismo del régimen portaliano, que no fue otra cosa que la síntesis entre la espada y la civilidad. Los dos autores más significativos en esta tema; el ensayista e historiador Alberto Edwards Bello (1874-1932) en su libro La Fronda aristocrática y el historiador Mario Góngora (1915-1985) en su libro Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglo XIX y XX van a respaldar con sus investigaciones esta tesis.
A partir de 1830 surge un gobierno fuerte pero extraño al militarismo de los tiempos de la independencia, que proclama la Constitución de 1833 sosteniendo que Chile es una república democrática y representativa, pero que al carecer de tradición republicana debe ser gobernada autoritariamente. Y Diego Portales es el principal resorte de ese régimen aun cuando no sea el presidente.
Aparece entonces en el horizonte político chileno la Confederación peruano-boliviana que “siempre serán más que Chile en todo orden ” Y que “debemos dominar para siempre el Pacífico” según Portales, por lo tanto, “guerra a la Confederación que debe desaparecer”.
Sin embargo, Portales es asesinado en Cerro Barón y el propósito de los conspiradores, detener la guerra contra el cholo Santa Cruz no sólo no se cumplió sino que de impopular, la guerra se transformó en una causa nacional.
Con el triunfo del general Bulnes triunfador de Yungay en 1841 y su posterior asunción a la presidencia de la República se consolida definitivamente el Estado-nación chileno en donde la “institucionalidad portaliana” reemplazó definitivamente al antiguo “caudillaje”.
(*) arkegueta, aprendiz constante, mejor que filósofo
alberto.buela@gmail.com
Casilla 3198 (1000) Buenos Aires
00:10 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, géopolitique, amérique latine, amérique du sud, chili, amériques, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 25 février 2010
Réflexions sur le voyage de Guillaume II en Palestine

Alois PRESSLER :
Réflexions sur le voyage de Guillaume II en Palestine
Lorsque l’on prononce les mots « Palestine » et « Proche Orient », on songe immédiatement à l’Intifada, à une guerre perpétuelle, surtout pour l’enjeu pétrolier. Le pétrole, en effet, fut l’un des motifs principaux du voyage en Palestine de l’Empereur d’Allemagne Guillaume II du 11 octobre au 26 novembre 1898.
Inauguration de la Basilique Saint Sauveur
Au cours de ce voyage, l’Empereur visita également Constantinople, Haïfa, Jérusalem, Jaffa et Beyrouth. La visite visait plusieurs objectifs : elle entendait consolider la position du Sultan turc Abdoul Hamid II et renforcer le poids de l’église protestante, évangélique et luthérienne au Proche Orient (car, à cette époque, quasi la moitié des chrétiens vivant en Palestine venaient d’Allemagne). Enfin, l’Empereur voulait inaugurer la Basilique Saint Sauveur à Jérusalem.
Scepticisme des Français
Dans l’opinion publique française, ce fut un tollé : on s’est très vite imaginé que Guillaume II voulait, par son voyage, miner la protection traditionnelle qu’offrait la France aux catholiques de Palestine. Ce reproche était dénué de tout fondement, de même que l’allusion à une éventuelle volonté allemande de s’approprier la Palestine.
Un sermon plein de reproches aux églises…
Le 25 octobre 1898, Guillaume II arrive en Palestine, premier Empereur du Reich allemand à y remettre les pieds depuis 670 ans (quand Frédéric II avait débarqué à Saint Jean d’Acre). Après avoir reproché amèrement aux représentants du clergé dans un sermon plein de reproche à Bethléem, où l’Empereur morigénait la désunion entre chrétiens (à maintes reprises, des soldats turcs avaient dû intervenir pour apaiser les querelles entre les diverses confessions chrétiennes).
Le rejet de l’idée d’un Etat juif
Le 31 octobre, enfin, eut lieu l’événement majeur du voyage de Guillaume II : l’inauguration de la Basilique Saint Sauveur à Jérusalem. Le 2 novembre, une délégation sioniste rend visite à l’Empereur dans le camp militaire, composés de tentes, qu’il occupe : elle est présidée par Theodor Herzl. L’Empereur spécifie clairement à la délégation qu’il est prêt à soutenir toute initiative visant à augmenter le niveau de vie en Palestine et à y consolider les infrastructures mais que la souveraineté du Sultan dans la région est à ses yeux intangible. L’Empereur, en toute clarté, n’a donc pas soutenu le rêve de Theodor Herzl, de créer un Etat juif en Palestine, rêve qui ne deviendra réalité qu’en 1948.
En grande pompe…
Le 4 novembre, Guillaume II embarque à Jaffa pour revenir finalement le 26 novembre à Berlin et s’y faire fêter triomphalement, ce qui ne se fit pas sans certaines contestations (sa propre sœur n’approuva pas l’ampleur des festivités).
Sur le plan politique, cette visite ne fut pas un succès
Le voyage de Guillaume II en Palestine ne fut pas un grand succès politique. Certes, les rapports avec le Sultan furent améliorés, condition essentielle pour la réalisation du chemin de fer vers Bagdad et pour la future alliance avec l’Empire ottoman lors de la première guerre mondiale. Cependant, l’Empereur n’a pas pu assurer à l’Allemagne l’octroi de bases ou de zones d’influence. De même, les Allemands et les Juifs allemands installés en Palestine ont certes reçu un appui indirect par la construction de routes et de ponts, de façon à avantager les initiatives des sociétés touristiques mais tout cela ne constituait pas un appui politique direct, que l’Empereur n’accorda pas. En Europe, ce voyagea se heurta à bon nombre de contestations. En Allemagne même, ce voyage, sans résultats à la clef, n’a pas bénéficié de soutiens inconditionnels.
Sur le voyage : rapports positifs
L’Empereur d’Allemagne a toutefois réussi à présenter son voyage de manière attrayante et populaire, en diffusant au sein de la population des rapports positifs et flatteurs sur son voyage au Proche Orient. Il y a 120 ans, toute politique proche orientale faisait déjà l’objet d’un travail médiatique et n’était pas assurée de succès durables.
Alois PRESSLER.
(article paru dans « Der Eckhart », Vienne, octobre 2007 ; trad.. franc. : Robert Steuckers, février 2010).
00:10 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, palestine, proche-orient, méditerranée, allemagne, turquie, empire ottoman, jérusalem |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 24 février 2010
Contre le capitalisme: du terrorisme rouge à d'Annunzio
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1995
Contre le capitalisme: du terrorisme rouge à d'Annunzio
Entretien avec Enrico Galmozzi
 Enrico Galmozzi est l'un des fondateurs du mouvement d'extrême-gauche “Prima Linea” (= Première Ligne), et aussi l'une des principales victimes des “années de plomb” en Italie. Son engagement lui a coûté treize années de prison. Dans les geôles de l'Etat italien, il a étudié la sociologie et obtenu son doctorat. Aujourd'hui, la passion du politique continue à l'animer, ce qui l'amène à une intense activité intellectuelle et à dépasser les limites de l'idéologie à laquelle il a spontanément adhérer dans ses plus jeunes années: il fréquente désormais des auteurs inhabituels pour un ancien “communiste combattant”. En effet, Enrico Galmozzi vient de publier un essai sur Gabriele d'Annunzio, Il soggetto senza limite, auprès de la Società Editrice Barbarossa à Milan en 1994. Ensuite, il a dirigé le dossier Pareto de la revue Origini, éditée par Synergies Européennes en Italie. Ce passage de l'extrême-gauche au dannunzisme réputé d'extrême-droite est effectivement une curiosité. C'est pourquoi nous sommes allés nous entretenir avec Enrico Galmozzi.
Enrico Galmozzi est l'un des fondateurs du mouvement d'extrême-gauche “Prima Linea” (= Première Ligne), et aussi l'une des principales victimes des “années de plomb” en Italie. Son engagement lui a coûté treize années de prison. Dans les geôles de l'Etat italien, il a étudié la sociologie et obtenu son doctorat. Aujourd'hui, la passion du politique continue à l'animer, ce qui l'amène à une intense activité intellectuelle et à dépasser les limites de l'idéologie à laquelle il a spontanément adhérer dans ses plus jeunes années: il fréquente désormais des auteurs inhabituels pour un ancien “communiste combattant”. En effet, Enrico Galmozzi vient de publier un essai sur Gabriele d'Annunzio, Il soggetto senza limite, auprès de la Società Editrice Barbarossa à Milan en 1994. Ensuite, il a dirigé le dossier Pareto de la revue Origini, éditée par Synergies Européennes en Italie. Ce passage de l'extrême-gauche au dannunzisme réputé d'extrême-droite est effectivement une curiosité. C'est pourquoi nous sommes allés nous entretenir avec Enrico Galmozzi.
Comment peut-on se rapprocher à ce point de Gabriele d'Annunzio quand on a une base idéologique marxiste-léniniste?
La majorité de mes contemporains qui sont devenus communistes ont été mus par deux options essentiellement: la critique du capitalisme, comme modèle économique fondé sur l'exploitation mais aussi comme modèle culturel, c'est-à-dire comme consumérisme exaspéré. C'est ce consumérisme que combattait le mouvement de 68. Ensuite, deuxième motif: notre aversion profonde à l'égard des Etats-Unis. L'impérialisme américain, nous le percevions comme la représentation emblématique de ce modèle économique et culturel, mais aussi comme le gendarme de la planète, le garant de ce modèle et le véhicule de sa pénétration dans tous les pays du monde. L'effondrement des pays où dominait le socialisme réel et la crise du marxisme en Occident ont conditionné l'abandon de toutes ces problématiques qui furent les nôtres. Aujourd'hui, la gauche, notamment en Italie, ne représente plus qu'une option réformiste parfaitement compatible avec le modèle capitaliste. Veltroni est le plus philo-américain de tous nos politiciens. Tous ceux qui veulent continuer à refuser absolument le capitalisme comme modèle culturel américanomorphe se trouvent aujourd'hui face à un problème de références et de paradigmes: il faut revoir les théorèmes et les éléments traditionnels de la gauche. En récapitulant toute ma propre pensée, j'en viens à croire que le marxisme n'a jamais représenté une alternative authentique et vraiment radicale (qui va aux racines des choses) au positivisme et aux Lumières qui sont les prémisses théoriques et idéologiques de la bourgeoisie.
En fait, dans votre livre, vous procédez à une critique incessante du matérialisme marxiste, tout en faisant l'éloge des dimensions héroïques et vitalistes présentes chez d'Annunzio, que vous percevez comme un chef charismatique “qui affirme et choisit la vie” quand il passe de l'extrême-droite à l'extrême-gauche. Dans un passage de votre livre, vous soulignez explicitement une apologie de la guerre qui rappelle certains accents de la “Révolution Conservatrice” allemande, plus spécialement le “nationalisme soldatique”...
Quand il devient impossible de comprendre la réalité et de la changer avec les instruments qu'on a toujours employés, il faut procéder à une introspection. D'abord, premier constat, la gauche n'est pas la seule à avoir été inadéquate dans ses réalisations pratiques. Nous devons passer en revue toute l'histoire du XIXième siècle afin de réexaminer critiquement et transversalement tous les territoires idéologiques sans aucun schématisme, sans manichéisme et sans passéisme idéologique. Par exemple, nous devons admettre, à gauche, que la “droite radicale” n'a jamais produit une critique scientifique du capitalisme et qu'elle s'est toujours mobilisée sur base de catégories morales, sans réussir à dégager véritablement une vision scientifique de la société...
Mais Werner Sombart, lui, a développé une analyse fondamentalement scientifique de l'évolution du capitalisme en Europe, certes sur base d'un héritage résolument marxiste, mais en débouchant finalement sur une noologie qui n'a rien de matérialiste et qui n'est de ce fait pas attribuable à la “gauche”...
 C'est vrai, mais Sombart est bien le seul. Au fond, c'est Evola qui devrait faire son auto-critique car il a mené le discours de la droite radicale dans une optique plus morale et plus spirituelle que scientifique. Par ailleurs, on ne peut plus prendre l'analyse économique du marxisme telle qu'elle a été; on ne peut plus reprendre tel quel son déterminisme économique, où il n'y a pas de place pour d'autres valeurs en dehors de celles qui sont exclusivement relatives à l'économie. Voilà pourquoi il est utile de procéder à cette analyse critique transversale dont je viens de vous parler. Il y a des périodes et des moments historiques qui doivent être complètement réévalués et revus car, jusqu'à nos jours, la critique dominante et surtout la critique de gauche n'ont montré que leur myopie et leur caractère manipulatoire. Par exemple, à Fiume, le subjectivisme volontariste de d'Annunzio convenait parfaitement aux sensibilités et aux revendications sociales émanant des syndicalistes révolutionnaires, en particulier de De Ambris. Cela les a conduit à rédiger une constitution comme la Carta del Carnaro, qui est absolument exemplaire. L'interventionnisme italien pendant la première guerre mondiale est également un phénomène sur lequel il faudra jetter un regard nouveau parce qu'il a été un mouvement absolument transversal qui est passé à travers toutes les formations politiques et qui est très riche en motivations de toutes provenances: du centre, de la droite et de la gauche, des milieux impérialistes et nationalistes comme des milieux socialistes et révolutionnaires. C'est le même cocktail d'éléments que l'on retrouvera quelques années plus tard dans l'arditisme et dans l'organisation des Fasci jusqu'au second congrès.
C'est vrai, mais Sombart est bien le seul. Au fond, c'est Evola qui devrait faire son auto-critique car il a mené le discours de la droite radicale dans une optique plus morale et plus spirituelle que scientifique. Par ailleurs, on ne peut plus prendre l'analyse économique du marxisme telle qu'elle a été; on ne peut plus reprendre tel quel son déterminisme économique, où il n'y a pas de place pour d'autres valeurs en dehors de celles qui sont exclusivement relatives à l'économie. Voilà pourquoi il est utile de procéder à cette analyse critique transversale dont je viens de vous parler. Il y a des périodes et des moments historiques qui doivent être complètement réévalués et revus car, jusqu'à nos jours, la critique dominante et surtout la critique de gauche n'ont montré que leur myopie et leur caractère manipulatoire. Par exemple, à Fiume, le subjectivisme volontariste de d'Annunzio convenait parfaitement aux sensibilités et aux revendications sociales émanant des syndicalistes révolutionnaires, en particulier de De Ambris. Cela les a conduit à rédiger une constitution comme la Carta del Carnaro, qui est absolument exemplaire. L'interventionnisme italien pendant la première guerre mondiale est également un phénomène sur lequel il faudra jetter un regard nouveau parce qu'il a été un mouvement absolument transversal qui est passé à travers toutes les formations politiques et qui est très riche en motivations de toutes provenances: du centre, de la droite et de la gauche, des milieux impérialistes et nationalistes comme des milieux socialistes et révolutionnaires. C'est le même cocktail d'éléments que l'on retrouvera quelques années plus tard dans l'arditisme et dans l'organisation des Fasci jusqu'au second congrès.
Dans votre livre, vous n'avez guère mis en exergue le concept de nation qui fut pourtant le mythe qui unifia tous ces courants hétérogènes...
La réalité est un petit peu plus complexe, mais si ce que vous dites est vrai: c'est sûr, un des aspects les plus obsolètes de la pensée de Marx, c'est la thèse que “le prolétariat n'a pas de nation”. Le prolétariat appartient toujours à une nation, comme l'histoire l'a démontré. L'une des principales limites du marxisme est de n'offrir au prolétariat qu'un seul type abstrait d'identité, calque du processus de production capitaliste, c'est-à-dire une identité générale qui le pose définitivement comme travailleur, alors qu'en réalité personne n'est seulement travailleur. Tout prolétaire, en tant que personne, possède une identité intime beaucoup plus profonde qui plonge dans les legs de la tradition que véhicule chaque homme, dans la mémoire spécifique, dans une histoire particulière: autant de rapports complexes qui constituent une existentialité humaine et dont l'anthropologie marxiste n'a pas tenu compte. Ensuite, on peut aisément constater que ni l'interventionnisme de d'Annunzio ni celui de Marinetti se limitent au concept de “nation”. Ils souhaitent tous deux l'intervention parce qu'ils ont un projet de civilisation, un projet culturel qui s'inscrira dans un espace européen.
Autre aspect important de votre livre: vous accordez une très grande importance au culte des morts —d'aucuns prétendront que c'est typique d'une “tradition fasciste”— et vous insistez tout particulièrement sur le serment des Arditi qui jurent de combattre au nom de leurs camarades tombés au combat.
Au sein de la gauche, on trouve également une tradition “hérétique” représentée par Ernst Bloch, où ce culte des morts est également fondamental. Bloch nous parle d'un processus révolutionnaire qui est pure continuité depuis les guerres paysannes dans l'Allemagne du XVIième siècle, depuis Thomas Müntzer. Cette continuité est un puissant filon de mysticisme où les révolutionnaires communient et participent à une cause commune, qui a des assises spirituelles. Dans le marxisme classique, au contraire, nous débouchons rapidement dans le cursus théorique sur un point de non retour et nous basculons dans l'ultra-rationalisme, où plus aucune valeur n'a droit de cité, où tout réflexe irrationnel est banni et éradiqué. Alors que le communisme, au fond, n'est jamais qu'une étape dans un processus qui a commencé avec les gnoses et les mouvements utopistes, puis a passé par le filtre des sectes hérétiques, pour aboutir, en fin de course, dans la Première Internationale, où Marx a viré les blanquistes et les anarchistes. En imposant le déterminisme économique, Marx a jeté par dessus bord le culte des morts et celui du passé, sous prétexte que tout cela était “condamné par l'Histoire”.
Vous faites carrément l'éloge de la Carta del Carnaro. Et vous dites qu'elle est “embarrassante pour la droite et pour la gauche” et qu'elle ne pourra jamais plus se répéter. Que voulez-vous dire?
Je l'ai dit, effectivement. Et j'espère que je me trompe, parce que ce document contient des intuitions très en avance sur leur temps, des aspects qui sont encore parfaitement actuels, comme la définition qu'elle donne des rapports entre l'Etat et la société et l'Etat et le monde du travail. Le corporatisme que développe la Carta del Carnaro est très différent de celui qu'a proposé le fascisme —sauf celui de la dernière période, de la République Sociale Italienne. Dans la Carta, les corporations sont des articulations de l'Etat dans la société civile. Elles sont des institutions qui travaillent sans cesse pour qu'advienne l'extinction même de l'Etat. L'Etat, dans cette Charte de Fiume, doit être dépassé, il faut mobiliser les efforts des meilleurs voire de tous pour qu'il laisse le champ libre aux organisations communautaires spontanées. Cette charte présente ces intentions avec une pléthore de références historiques et culturelles surprenante, en rappelant les structures de fonctionnement des communes médiévales et l'organisation des Soviets. La conception du travail chez d'Annunzio et De Ambris est très en avance sur son temps, car ils ne conçoivent pas le travail seulement comme travail manuel et productif mais aussi comme travail intellectuel, artistique et artisanal, ce qu'il s'agit pour eux de valoriser et de sauvegarder face aux productions sérielles. Ils perçoivent enfin le peuple dans son intégrité et non pas au sens classiste, comme l'ont toujours fait les marxistes.
Plus récemment vous vous êtes penché sur l'œuvre de l'économiste et sociologue italien Vilfredo Pareto. Comment avez-vous découvert son œuvre? Comment êtes-vous arrivé à lui?
Pareto, Mosca et Michels sont des figures de format international. Ils constituent à eux trois l'unique école sociologique italienne et, bien évidemment, elle est méconnue chez nous! Pareto est au fond une figure scandaleuse qui examine —comme Machiavel— méticuleusement et jusqu'au tréfond des choses les mécanismes de la politique. En étudiant son œuvre, j'ai trouvé que ce qu'il nous démontrait gardait une incroyable actualité: il a prévu beaucoup d'éléments de la théorie de la communication, il en a dévoilé les mécanismes conscients et inconscients. Dans ses rapports avec le marxisme, enfin, il refuse le déterminisme historique mais il récupère la lutte des classes, en l'expliquant et en la faisant fonctionner mieux que ne le firent jamais les marxistes: c'est sa fameuse théorie de la circulation des élites.
En tant qu'intellectuel, comme voyez-vous l'avenir?
Je suis optimiste, j'espère que les nouvelles générations pourront enfin mettre au rencart les idéologies dépassées et rechercheront de nouvelles synthèses et ouvriront de nouvelles possibilités.
(propos recueillis par Pietro Negri et parus dans la revue romaine Pagine Libere, septembre 1995).
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, années 70, italie, terrorisme, prima linea, idéologie, extrême gauche, gauche, gauchisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 22 février 2010
Hiroshima and Nagasaki: Worst single terror attacks in history
Hiroshima and Nagasaki: Worst single terror attacks in history
Three days after Hiroshima's destruction, the US dropped an A-bomb on Nagasaki, resulting in the deaths of at least 70,000 people before the year was out.
Since 1945, tens of thousands more residents of the two cities have continued to suffer and die from radiation-induced cancers, birth defects and still births.
A tiny group of US rulers met secretly in Washington and callously ordered this indiscriminate annihilation of civilian populations. They gave no explicit warnings. They rejected all alternatives, preferring to inflict the most extreme human carnage possible. They ordered and had carried out the two worst single terror acts in human history.
Hiroshima and Nagasaki anniversaries are inevitably marked by countless mass media commentaries and US politicians' speeches that repeat the 64-year-old mantra that there was no other choice but to use A-bombs in order to avoid a bitter, prolonged invasion of Japan.
On July 21, 2005, the British New Scientist magazine undermined this chorus when it reported that two historians had uncovered further evidence revealing that “the US decision to drop atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki ... was meant to kick-start the Cold War [against the Soviet Union, Washington's war-time ally] rather than end the Second World War”. Peter Kuznick, director of the Nuclear Studies Institute at the American University in Washington, stated that US President Harry Truman's decision to blast the cities “was not just a war crime, it was a crime against humanity”.
With Mark Selden, a historian from Cornell University in New York, Kuznick studied the diplomatic archives of the US, Japan and the USSR. They found that three days before Hiroshima, Truman agreed at a meeting that Japan was “looking for peace”. His senior generals and political advisers told him there was no need to use the A-bomb. But the bombs were dropped anyway. “Impressing Russia was more important than ending the war”, Selden told the New Scientist.
While the capitalist media immediately dubbed the historians' “theory” “controversial”, it accords with the testimony of many central US political and military players at the time, including General Dwight Eisenhower, who stated bluntly in a 1963 Newsweek interview that “the Japanese were ready to surrender and it wasn't necessary to hit them with that awful thing”.
Truman's chief of staff, Admiral William Leahy, stated in his memoirs that “the use of this barbarous weapon at Hiroshima and Nagasaki was of no material assistance in our war against Japan. The Japanese were already defeated and ready to surrender.”
At the time though, Washington cold-bloodedly decided to obliterate the lives of hundreds of thousands of men, women and children to show off the terrible power of its new super weapon and underline the US rulers' ruthless preparedness to use it.
These terrible acts were intended to warn the leaders of the Soviet Union that their cities would suffer the same fate if the USSR attempted to stand in the way of Washington's plans to create an “American Century” of US global domination. Nuclear scientist Leo Szilard recounted to his biographers how Truman's secretary of state, James Byrnes, told him before the Hiroshima attack that “Russia might be more manageable if impressed by American military might and that a demonstration of the bomb may impress Russia”.
Drunk from the success of its nuclear bloodletting in Japan, Washington planned and threatened the use of nuclear weapons on at least 20 occasions in the 1950s and 1960s, only being restrained when the USSR developed enough nuclear-armed rockets to usher in the era of “mutually assured destruction”, and the US rulers' fear that their use again of nuclear weapons would led to a massive anti-US political revolt by ordinary people around the world.
Washington's policy of nuclear terror remains intact. The US refuses to rule out the first use of nuclear weapons in a conflict. Its latest Nuclear Posture Review envisages the use of nuclear weapons against non-nuclear “rogue states” and it is developing a new generation of ‘battlefield” nuclear weapons.
Fear of the political backlash that would be caused in the US and around the globe by the use of nuclear weapons remains the main restraint upon the atomaniacs in Washington. On this 64rd anniversary year of history's worst acts of terror, the most effective thing that peace-loving people around the world can do to keep that fear alive in the minds of the US rulers is to recommit ourselves to defeating Washington's current “local” wars of terror in Afghanistan and Iraq.
This article was first published in Links - international journal of socialist renewal
00:10 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : japon, extreme orient, deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale, armes atomiques, armes nucléaires, nucléaire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 21 février 2010
Lawrence of Arabia - the conflicted colonialist
Lawrence of Arabia - the conflicted colonialist
No wonder Lawrence is regarded with suspicion by the contemporary Arab world.
Lawrence was born in 1888 and went to Oxford. His boyish enthusiasm for medieval knights led him to walk across Syria and the Middle East in 1909, studying crusader castles for his university thesis, the fortresses that formed a chain of foreign, Christian domination over the local population.
Lawrence’s first job was as an archaeologist in a remote area of Syria, managing a huge native workforce for the Palestine Exploration Fund, an archaeological society whose survey of the region served as cover for British intelligence-gathering during the build-up to war with the Ottoman empire and Germany. Lawrence, with his excellent Arabic and local knowledge, drew up an ethnic map that detailed the many different tribal and religious areas.
During the First World War the Ottomans called for a jihad against the British. In response, Lawrence promised the Emir of Mecca, leader of the 1916 anti-Ottoman Arab revolt, support for a pan-Arab empire after the war if he launched a counter jihad against the Turks. It was this ability to “walk into the crowd” and harness Arab nationalism that marked him out as a first rate colonial soldier, according to leading British Arabist and former MI6 officer Sir Mark Allen.
Understanding the Ottomans’ difficulties in effectively patrolling the vast expanse of their desert territories, Lawrence used highly mobile Bedouin troops to ambush the enemy in a new form of guerilla warfare, targeting the Damascus-Medina railway, the sole supply line to the Ottoman garrison of Medina in Arabia. Using locals to do the bulk of the fighting, he went on to capture the strategically important Red Sea port of Aqaba, an exploit that shot him to fame and set the template for future special forces operations.
When British general Allenby marched as a modern crusader into Jerusalem in 1917, with Lawrence by his side as a Major, it was through the symbolically important Jaffa Gate, the ‘Conquerors’ Gate, and on foot rather than horseback because Christ had walked not ridden. This was for Lawrence “the supreme moment of his career.”
Yet when he learned of the secret British and French deal to divide the Arabian kingdom into two imperial possessions after the war, Lawrence wrote to his commanding officer: “We’ve asked them to fight on a lie, and I can’t stand it.”
Lawrence rushed his Arab fighters, who were loyal to the Emir and his son Faisal Hussein, to Damascus with the aim of taking it from the Ottomans before the British army arrived, gambling that once Faisal was established as king in this capital of the Arab world, it would be hard for Britain to topple him.
On October 1st 1918, wearing Arab clothes and riding in a Rolls Royce, Lawrence was cheered by a Damascus crowd of up to 150,000 people, having “inspired and ignited” their revolutionary fervour, according to Syrian historian Sami Moubayed. Faisal Hussein, a hero of the Arab revolt, followed two days later. But Lawrence had underestimated his own imperialism.
Under the infamous Sykes-Picot agreement the Middle East was divided “from the E of Acre to the last K of Kirkuk” in a straight, diagonal line across the map. France got Syria, Britain oil-rich Mosul and Palestine. It was a moment that “still rankles in the Arab psyche”, says Jordan’s foreign minister, a moment when “the western countries succeeded in … demolishing the hopes of the Arabs.” Bin Laden’s description of the deal as one which “dissected the Islamic world into fragments” underlines its contemporary resonance.
The Damascus meeting in 1918, at which Faisal was read out the Foreign Office telegram outlining the betrayal by France and Britain, marked “the start of the next 90 years of antagonism between the West and the Arab world. Lawrence left Damascus immediately, a failure, having delivered the Arabs to his British masters,” says Stewart.
Lawrence tried to break the Sykes-Picot agreement at Versailles in 1919, acting as Faisal’s adviser, but he merely became an embarrassment to the establishment. Defeated, he returned to England, where over a million people went to see a show at Covent Garden featuring ‘Lawrence of Arabia’.
When the British occupied Iraq, dropping bombs and gas to quell the insurgency, Lawrence wrote to the Times in 1920: “The people of England have been led into a trap in Iraq… it’s a disgrace to our imperial record”. Then in 1921, with the occupation failing, he was called on to advise Churchill, the Colonial Secretary, and Faisal was installed as a puppet ‘king’. The “last relic of Lawrence’s vision” lives on today in the shape of the pro-British kingdom of Jordan, still ruled by Faisal’s family.
What should we make of Lawrence today? Sami Moubayed describes him as “a British officer serving his nation’s interests. He was one of the many foreigners… who definitely does not deserve the homage you see nowadays.”
Stewart takes a different view, seeing Lawrence as a prophetic figure for our times. Stewart himself was deputy governor of two Iraqi provinces in 2003, where he initially “thought we could do some good”. He tried to “bring some semblance of order and prepare the country for independence,” but in the face of the insurgency he came to share Lawrence’s disillusionment with colonial rule.
Similarly disillusioned is Carne Ross, Britain’s former key negotiator at the UN, who resigned over the WMD issue. He tells Stewart: “I found it a deeply embittering experience… I think I was naïve about it…Ultimately my conclusion is one of deep skepticism of the state system and indeed of this place [the UN].”
These men’s disappointment is revealing. Stewart believes that “if generals and politicians now could see what Lawrence saw we would not be in the mess today”. He condemns the American misuse of Lawrence – troops shown David Lean’s swashbuckling film and made to read Lawrence’s 27-point guide to “try to… enter the Arab mindset”. He exposes the hollowness of General Patraeus’ new counter-insurgency manual enjoining troops “to work with local forces” by walking round Baghdad in the company of a US officer who speaks no Arabic and is ignorant of local politics.
Stewart, like Lawrence, rejects foreign occupation of the Middle East as unsustainable. “However much you do to overcome these cultural divides, in the end you don’t have the consent of the people; it’s not your country,” he says, echoing Lawrence, who called for “every single British soldier” to leave, creating “our first brown dominion, not our last brown colony.”
But unlike the hero of Avatar, (see Going traitor: Avatar versus imperialism) Lawrence never fully broke with his own imperialist masters. Caught between the demands of colonial rule and his admiration for the ‘natives’, he could never resolve the contradiction and died a broken man.
Stewart, following in Lawrence’s footsteps, walked across Asia as a young man and found in the dignity of the locals “a great deal about how to live a meaningful life.” But though admiring the people and recognizing the failings of colonial rule, he remains wedded to the power of which he is part. A prospective Tory candidate, ex-Etonian, diplomat’s son, he has set up a school in Kabul to teach Afghan craftsmen skills to restore old buildings, a pet project of Hamid Karzai’s. Though he calls for troops out of Iraq and Afghanistan, he implicitly believes imperialism capable of arranging the world in gentlemanly fashion, if only it would take on board Lawrence’s “political vision”. Lawrence didn’t question imperialism itself, and Stewart’s Orientalist vision suffers from the same limited horizon.
00:10 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, proche orient, palestine, monde arabe, première guerre mondiale, impérialisme, empire britannique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook







 August 6 and August 9 2009 marked the 64th anniversaries of the US atomic-bomb attacks on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki. In Hiroshima, an estimated 80,000 people were killed in a split second. Some 13 square kilometres of the city were obliterated. By December, at least another 70,000 people had died from radiation and injuries.
August 6 and August 9 2009 marked the 64th anniversaries of the US atomic-bomb attacks on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki. In Hiroshima, an estimated 80,000 people were killed in a split second. Some 13 square kilometres of the city were obliterated. By December, at least another 70,000 people had died from radiation and injuries. T.E. Lawrence’s book Seven Pillars of Wisdom is on the syllabus at the elite US army training college at Fort Leavenworth, Kansas. Seen as the man who “cracked fighting in the Middle East”, Lawrence is a “kind of poster boy” of how to do colonial rule, according to writer-presenter Rory Stewart, in The Legacy of Lawrence of Arabia (BBC2, Jan 16 and 23 2010).
T.E. Lawrence’s book Seven Pillars of Wisdom is on the syllabus at the elite US army training college at Fort Leavenworth, Kansas. Seen as the man who “cracked fighting in the Middle East”, Lawrence is a “kind of poster boy” of how to do colonial rule, according to writer-presenter Rory Stewart, in The Legacy of Lawrence of Arabia (BBC2, Jan 16 and 23 2010).