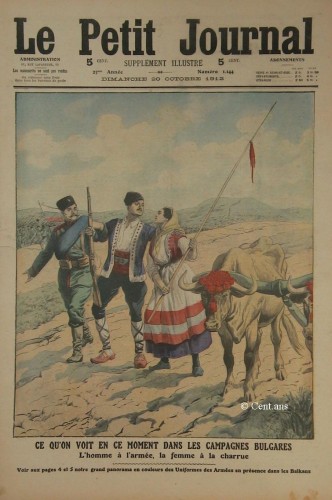vendredi, 15 janvier 2010
15 janvier 1821: les Anglais au Yémen
 15 janvier 1821 : Depuis l’expédition de Bonaparte en Egypte et ses tentatives de prendre pied en Palestine et en Syrie en 1798-99, l’Angleterre s’est faite la protectrice de l’Empire ottoman; elle réitérera cette protection contre l’Egypte de Mehmet Ali en 1839 et contre la Russie, lors de la guerre de Crimée et lors de l’offensive russe vers la Bulgarie et la Thrace en 1877-78, où les armées orthodoxes ont campé aux portes de Constantinople. L’Empire ottoman se situait sur la route des Indes, était bien présent en Méditerranée orientale, d’où la Sainte Ligue n’avait pu le déloger après la bataille de Lépante (1571) ni libérer Chypre; au 17ème siècle, les Ottomans, malgré leur ressac, avaient même pu conquérir la Crète, dernier bastion vénitien. Aucune puissance, aux yeux de l’Angleterre ne peut donc subjuguer cet Empire ottoman en pleine déliquescence ni acquérir des zones stratégiques lui appartenant. Si ces zones demeurent ottomanes, elles sont en quelque sorte neutralisées et ne servent pas de têtes de pont à une puissance européenne capable de rompre les communications entre la Grande-Bretagne et les Indes. Seule l’Angleterre, bien entendu, qui donne sa garantie à la Sublime Porte, mais tente de grignoter les côtes de son empire moribond ou d’occuper les points stratégiques éloignés de Constantinople, difficilement contrôlables et gérés par des potentats locaux, dont la fidélité est assez aléatoire. En 1821, avant que ne se consolide le pouvoir de Mehmet Ali en Egypte et avant que ne se déclenche la révolte grecque que soutiendront finalement, après bien des hésitations, Anglais, Français et Russes, la Royal Navy bombarde le port de Mokka au Yémen du 4 au 20 décembre 1820, afin de faire fléchir l’Imam local. Le 15 janvier 1821, celui-ci accepte les “capitulations” qui lui sont imposées: il doit respecter les “droits du résident anglais” et reconnaître la juridiction britannique sur tous les sujets de Sa Majesté vivant ou circulant au Yémen. En outre, il doit limiter les droits d’entrée de toutes les marchandises anglaises qui arrivent sur son territoire: c’est une application claire et nette des principes de l’ “impérialisme libre-échangiste”, pratiqué par l’Angleterre au 19ème siècle qui vise à lui assurer des débouchés, à briser les résistances locales et les barrières douanières et à garder les monopoles qu’elle a acquis en tant que première puissance industrielle. Quelques mois plus tard, les Anglais placent sous la protection de leur flotte l’Emir de Bahrein. La thalassocratie britannique est dorénavant présente à l’entrée de la Mer Rouge et dans le Golfe; elle en verrouille les accès. Petit à petit, elle se rend maîtresse de l’Océan Indien, océan du milieu, garant, pour qui le contrôle, de la maîtrise du globe. La logique de cet impérialisme, et les pratiques destinées à en assurer la longue durée, seront théorisées tout au début du 20ème siècle par deux géopolitologues: Halford John Mackinder et Homer Lea. Mutatis mutandis, ces règles servent encore pour étayer la stratégie américaine au Moyen Orient, en Afghanistan et au Pakistan, cette fois, sans la maîtrise directe de l’Inde, mais avec la maîtrise d’une île minuscule, celle de Diego Garcia, où se concentrent un arsenal moderne de bombardiers lourds à long rayon d’action et une flotte, épaulée par des porte-avions, véritables îles mobiles capables de frapper l’intérieur des terres sans donner prise à un ennemi dépourvu d’armes de ce genre.
15 janvier 1821 : Depuis l’expédition de Bonaparte en Egypte et ses tentatives de prendre pied en Palestine et en Syrie en 1798-99, l’Angleterre s’est faite la protectrice de l’Empire ottoman; elle réitérera cette protection contre l’Egypte de Mehmet Ali en 1839 et contre la Russie, lors de la guerre de Crimée et lors de l’offensive russe vers la Bulgarie et la Thrace en 1877-78, où les armées orthodoxes ont campé aux portes de Constantinople. L’Empire ottoman se situait sur la route des Indes, était bien présent en Méditerranée orientale, d’où la Sainte Ligue n’avait pu le déloger après la bataille de Lépante (1571) ni libérer Chypre; au 17ème siècle, les Ottomans, malgré leur ressac, avaient même pu conquérir la Crète, dernier bastion vénitien. Aucune puissance, aux yeux de l’Angleterre ne peut donc subjuguer cet Empire ottoman en pleine déliquescence ni acquérir des zones stratégiques lui appartenant. Si ces zones demeurent ottomanes, elles sont en quelque sorte neutralisées et ne servent pas de têtes de pont à une puissance européenne capable de rompre les communications entre la Grande-Bretagne et les Indes. Seule l’Angleterre, bien entendu, qui donne sa garantie à la Sublime Porte, mais tente de grignoter les côtes de son empire moribond ou d’occuper les points stratégiques éloignés de Constantinople, difficilement contrôlables et gérés par des potentats locaux, dont la fidélité est assez aléatoire. En 1821, avant que ne se consolide le pouvoir de Mehmet Ali en Egypte et avant que ne se déclenche la révolte grecque que soutiendront finalement, après bien des hésitations, Anglais, Français et Russes, la Royal Navy bombarde le port de Mokka au Yémen du 4 au 20 décembre 1820, afin de faire fléchir l’Imam local. Le 15 janvier 1821, celui-ci accepte les “capitulations” qui lui sont imposées: il doit respecter les “droits du résident anglais” et reconnaître la juridiction britannique sur tous les sujets de Sa Majesté vivant ou circulant au Yémen. En outre, il doit limiter les droits d’entrée de toutes les marchandises anglaises qui arrivent sur son territoire: c’est une application claire et nette des principes de l’ “impérialisme libre-échangiste”, pratiqué par l’Angleterre au 19ème siècle qui vise à lui assurer des débouchés, à briser les résistances locales et les barrières douanières et à garder les monopoles qu’elle a acquis en tant que première puissance industrielle. Quelques mois plus tard, les Anglais placent sous la protection de leur flotte l’Emir de Bahrein. La thalassocratie britannique est dorénavant présente à l’entrée de la Mer Rouge et dans le Golfe; elle en verrouille les accès. Petit à petit, elle se rend maîtresse de l’Océan Indien, océan du milieu, garant, pour qui le contrôle, de la maîtrise du globe. La logique de cet impérialisme, et les pratiques destinées à en assurer la longue durée, seront théorisées tout au début du 20ème siècle par deux géopolitologues: Halford John Mackinder et Homer Lea. Mutatis mutandis, ces règles servent encore pour étayer la stratégie américaine au Moyen Orient, en Afghanistan et au Pakistan, cette fois, sans la maîtrise directe de l’Inde, mais avec la maîtrise d’une île minuscule, celle de Diego Garcia, où se concentrent un arsenal moderne de bombardiers lourds à long rayon d’action et une flotte, épaulée par des porte-avions, véritables îles mobiles capables de frapper l’intérieur des terres sans donner prise à un ennemi dépourvu d’armes de ce genre.
00:10 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yémen, angleterre, empire britannique, géopolitique, histoire, péninsule arabique, 19ème siècle |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 13 janvier 2010
L'insegnamento della Costituzione di Fiume

| L'insegnamento della Costituzione di Fiume |
|
|
| Scritto da Giorgio Emili |
| La politica si spezza il cuore a forza di predicozzi e buoni sentimenti, nell’era del conflitto sociale. La Costituzione italiana – serve parlar chiaro - in molte parti nasconde questa realtà. |
00:15 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fiume, italie, littérature italienne, lettres italiennes, lettres, littérature, droit, constitution, droit constitutionnel, histoire, méditerranée |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 12 janvier 2010
Quis contra nos? Gabriele d'Annunzio et la Marche sur Fiume
 Peter VERHEYEN:
Peter VERHEYEN:
Quis contra nos?
Gabriele d’Annunzio et la Marche sur Fiume
Dans l’histoire, nous trouvons bon nombre de figures difficilement classables dans une catégorie proprette et bien définie. Elles nous apprennent que les clivages entre la gauche et la droite, entre le conservatisme et le progressisme ne sont finalement que des clivages entre « concepts conteneurs » aux contours médiocrement balisés, que l’on peut sans doute appliquer aux politicards sans intérêt qui sévissent de nos jours mais qui n’ont aucune pertinence dans la réalité, en dehors des tristes et inutiles baraques à parlottes que sont devenus les parlements. Gabriele d’Annunzio est l’exemple d’un penseur original, de la trempe de ceux que l’on ne rencontre pas tous les jours. Ce poète excentrique, cet aviateur et ce révolutionnaire demeure, encore de nos jours, une personnalité dont on peut s’inspirer ; ce n’est donc pas un hasard si son portrait orne un certain mur de la « Casa Pound » de Rome, le magnifique squat occupé aujourd’hui par des nationaux révolutionnaires dans la capitale italienne. Sa Marche sur Fiume en septembre 1919 et l’occupation de la ville qui s’ensuivit et dura quinze mois, n’a pas seulement été une entreprise toute d’ardeur et de témérité : elle a donné le ton pour d’autres générations de nationalistes révolutionnaires, d’anarchistes et d’autres esprits libres de l’entre-deux-guerres et, même, d’époques ultérieures. Le concept de « Zone Temporaire Autonome », telle que décrite dans les travaux de l’anarchiste Hakim Bey, a finalement été traduit dans le réel, et pour la première fois, à Fiume. La ville est ainsi devenue un microcosme où les rêves les plus radicaux, quels qu’ils soient, ont reçu la chance de se développer. Il serait dès lors dommage de dénigrer la Marche sur Fiume comme un simple précédant de la Marche sur Rome de 1922.
Dès son plus jeune âge, d’Annunzio avait lu Shakespeare et Baudelaire et ses premiers pas de poète, il les a faits dans le sillage du poète italien Giosué Carducci. L’influence de Nietzsche fut grande chez lui et le leitmotiv du « surhomme » devint rapidement central dans son œuvre. Il en déduisit un rôle important à accorder à l’héroïsme. Il hissa le culte éthique de la beauté, propre de l’héritage latin antique, au-dessus des fausses valeurs de l’industrialisme et du matérialisme. Il se dressa contre le positivisme et proclama qu’il ne voulait plus entendre de « vérité » mais voulait, plus simplement, posséder un rêve. C’est en ces années de maturation que l’influence de Nietzsche se fit fortement sentir sur d’Annunzio : il en vint à prêcher l’avènement d’une aristocratie spirituelle, arme contre la morale bourgeoise, et à concentrer ses efforts pour faire advenir une ère nouvelle. Avant la première guerre mondiale, sa pensée avait influencé le mouvement futuriste mais le fondateur du futurisme, Tomaso Marinetti, considérait que d’Annunzio était un personnage appartenant au passé. Après avoir séjourné un certain temps en France, il revint en Italie en 1915, en suscitant un énorme intérêt et pour participer aux combats de la guerre. Il avait déjà 52 ans au moment où elle éclata mais cela ne l’empêcha pas de se porter volontaire pour commander une division de cavalerie et la mener au feu, contre les puissances centrales. Il acquis bien vite le statut de héros, notamment en lançant une attaque contre les tranchées ennemies, vêtu d’une longue cape flottante jetée sur ses épaules et armé seulement d’un pistolet. Autre geste héroïque qu’il convient de rappeler : il s’envola un jour, à bord d’un avion, pour lancer des tracts sur Vienne, ce qui lui permit d’obtenir la « médaille d’or », la plus haute décoration honorifique d’Italie.
Lors de la conférence préludant au Traité de Versailles en 1919, l’Italie exigea le port de Fiume. Mais le sort de la ville était scellé, semble-t-il. En Italie, un sentiment général prenait le dessus : celui de subir une « victoire mutilée », concept forgé par d’Annunzio lui-même. La situation était devenue explosive, d’autant plus que l’état de l’économie se détériorait considérablement, avec son cortège de millions de chômeurs et l’atmosphère prérévolutionnaire que cette misère impliquait.
Les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France voulaient que Fiume fasse partie du nouvel Etat, né de Versailles : la Yougoslavie unitaire. Les alliés occidentaux occupent le port pour concrétiser leur volonté. En août 1919, les troupes italiennes sont contraintes de quitter la ville après quelques fusillades échangées avec des soldats français. Un petit groupe d’officiers, qui avaient dû quitter le port adriatique, s’est alors adressé à d’Annunzio, pour lui dire : « Nous l’avons juré : ou nous reprenons Fiume ou nous mourrons. Et que faites-vous pour Fiume ? ». Le 12 septembre 1919, pour répondre à ce défi, d’Annunzio, gravement malade, marche sur Fiume à la tête de deux mille légionnaires italiens, qui avaient déserté et s’étaient affublés de chemises noires ; leurs colonnes avancèrent en chantant « Giovinezza » et prirent la ville. Fiume était soudainement devenue le symbole de la liberté qui se dressait contre la lâcheté du temps. En fait, Fiume était devenue non seulement le symbole de la « victoire mutilée », qu’on essayait de réhabiliter, mais aussi le symbole de la « latinité ». En dehors de la ville, d’Annunzio rencontre le général italien Vittorio Emanuele Pittaluga, qui commandait les forces italiennes présentes devant la cité. Il donna l’ordre à d’Annunzio de faire demi-tour, mais le poète-soldat sortit son atout et lui montra fièrement ses médailles. Le général Pittaluga n’eut pas le cœur de faire tirer sur le héros. Ils entrèrent tous deux dans la ville sans qu’un seul coup de feu n’ait été tiré. Les alliés, abasourdis, furent contraints de quitter les lieux et d’Annunzio annonça qu’il avait l’intention d’occuper la ville jusqu’à ce qu’elle soit annexée à l’Italie. Il prit le titre de « Commandante » et, quelques semaines plus tard, sept mille légionnaires supplémentaires et quatre cent marins vinrent renforcer ses effectifs.
Les légionnaires de d’Annunzio se prononçaient en faveur de la liberté des peuples opprimés et tournaient leurs regards vers les expériences du tout jeune régime soviétique. D’Annunzio entra également en contact avec Sean O’Kelly, le futur président de l’Irlande, qui représentait le « Sinn Fein » à Paris ; ensuite, avec des nationalistes égyptiens et avec les autorités soviétiques. Le 28 avril 1920, il met sur pied une « Ligue de Fiume » pour faire contrepoids à la « Société des Nations ». Vladimir Lénine citait d’Annunzio comme « l’un des rares révolutionnaires d’Italie », un compliment qu’il avait préalablement adressé à Mussolini. Ces faits nous montrent que les extrêmes se touchent effectivement, même si d’actuels bourgeois trotskisants ne l’admettront jamais.
La « Carta del Carnaro » : base de l’Etat Libre de Fiume
L’Etat Libre de Fiume reposait sur des idées proto-fascistes, sur des idées républicaines et démocratiques antiques et sur quelques formes d’anarcho-syndicalisme : en ce sens, il exprimait un éventail bigarré mais intéressant d’idées fortes, issues de trois sphères intellectuelles fort différentes. D’Annunzio et l’anarchiste national-syndicaliste Alceste de Ambris rédigèrent le 27 août 1920 la constitution de Fiume, intitulée « Carta del Carnero » ; elle hissait la musique au rang de principe cardinal de l’Etat. D’après Gabriele d’Annunzio, la musique est un langage rituel, disposant du pouvoir d’exalter les objectifs de l’humanité. Les idées développées dans cette « Carta del Carnero » étaient inspirées du syndicalisme, surtout de ses éléments corporatifs. Les principes d’autonomie, de production, de communauté et de corporatisme y étaient tous importants. Inspirés par l’antiquité, les libérateurs de Fiume firent de la Cité une république, avec un régent comme chef d’Etat, qui, comme sous la république romaine, devait diriger la Cité avec des pouvoirs dictatoriaux si l’époque était soumise à un danger particulièrement extraordinaire. Autre élément important : la décentralisation complète, afin de dégager le politique autant que possible du parlement et de le ramener sur la « piazza », sur la place publique, sur le forum, de façon à ce que les simples citoyens soient tous impliqués dans le fonctionnement de la politique de la cité.
Les méchantes langues diront que c’est là du populisme mais, en fait, cette disposition rappelait la démocratie antique où un droit civil positif incitait les citoyens à participer aux débats politiques. Le parlement ne recevait dans cette « Carta » qu’un rôle peu signifiant, tandis que neuf corporations, qui accueillaient l’ensemble des citoyens et étaient basées sur leurs activités économiques, étaient destinées à gouverner véritablement. On créa même une dixième corporation, pour souligner l’importance du facteur spirituel : « … elle sera réservée aux forces mystérieuses du progrès et de l’aventure. Elle sera une sorte d’offrande votive au génie de l’inconnu, à l’homme du futur, à l’idéalisation espérée du travail quotidien, à la libération de l’esprit de l’homme au-delà des efforts astreignants et de la sueur sanglante que nous connaissons aujourd’hui. Elle sera représentée dans le sanctuaire civique par une lampe allumée portant une ancienne inscription en toscan, datant de l’époque des communes, qui appelle à une vision idéale du travail humain ; « Fatica senza fatica » » (article 9, Carta del Carnero).
A côté de ces corporations, les citoyens et la commune se voient octroyer, eux aussi, un rôle important. Les citoyens obtiennent leurs droits politiques et civiques dès l’âge de 20 ans. Tous, hommes et femmes, reçoivent le droit de vote (1) et peuvent, par l’intermédiaire d’institutions législatives, lever l’impôt dans le but de mettre un terme à la lutte entre le travail et le capital. La commune, elle, était basée sur le « potere normativo », le « pouvoir normatif », c’est-à-dire le pouvoir de soumettre le législatif aux lois coutumières.
La marine de Fiume se nommait « les Uscocchi », d’après le nom de pirates disparus depuis longtemps et qui avaient vécu jadis dans les îles de l’Adriatique, pas très éloignées de Fiume, et prenaient pour proies les bateaux marchands vénitiens et ottomans. Les Uscocchi modernes ont permis ainsi à Fiume de s’emparer de quelques navires bien chargés et de s’assurer de la sorte une plus longue vie. Artistes, figures issues de la bohème littéraire, homosexuels, anarchistes, fuyards, dandies militaires et autres personnages hors du commun se rendirent par essaims entiers à Fiume.
Fiume fut une république bizarre et excentrique, que l’on peut aussi qualifier de « décadente ». Chaque matin, d’Annunzio y lisait ses poésies du haut de son balcon et, chaque soir, il organisait un concert, suivi d’un feu d’artifice. Dans la constitution, l’enseignement se voyait attribuer un grand rôle, avec usage fréquent de poésie, de littérature et de musique dans les classes (articles 50 à 54 de la « Carta del Carnero »). Cette légèreté et cette superficialité apparentes exprimaient surtout l’autonomie et la liberté, n’étaient pas signes de décadence. Cependant, les problèmes ne tardèrent pas à survenir : ils se sont manifestés par des divergences idéologiques. Au départ, d’Annunzio voulait rendre Fiume à l’Italie, avait agi pour que Rome annexe la ville portuaire adriatique mais ses compagnons légionnaires ne voyaient pas l’avenir de cette façon. D’Annunzio, tourmenté par le doute, a fini par renoncer, lui aussi, à son idée initiale. L’un des corédacteurs de la constitution de Fiume, l’anarcho-syndicaliste Alceste de Ambris, plaidait pour une alliance entre les éléments fascistes de gauche et les révolutionnaires de gauche, mais elle ne se concrétisa jamais. L’objectif d’Alceste de Ambris était d’exporter la révolution de Fiume vers l’Italie toute entière mais, comme on le verra par la suite, Mussolini s’y opposait, tout en glissant petit à petit vers des options de droite. Cette mutation dans l’esprit de Mussolini, dira de Ambris, fera de lui « un instrument antirévolutionnaire aux mains de l’établissement bourgeois ».
La fin rapide de l’expérience insolite et originale que fut l’Etat Libre de Fiume vint au moment où Giolitti succéda à Nitti au poste de premier ministre en Italie. En novembre 1920, Giolitti signe à Rapallo un traité avec le nouvel Etat yougoslave. Ce traité fixe les frontières définitives entre les royaumes de Yougoslavie et d’Italie. Ce traité était à l’avantage de l’Italie : elle recevait l’Istrie, la région située à l’Est de la Vénétie ; Fiume devenait une ville-Etat indépendante. D’Annunzio, pour sa part, refusait de se retirer de Fiume ; Giolitti décida de faire donner l’armée pour le déloger. L’armée régulière prend la ville. Mussolini déclare : « maintenant l’épine enfoncée dans le flanc de Fiume est ôtée ; la rage de détruire, le feu de la destruction qui avait pris à Fiume n’a pas incendié l’Italie ni même le monde ». Lors des combats, commencés le 24 décembre 1920, il y eu 52 morts. Les trois mille hommes de d’Annunzio, après quatre jours de combat, se rendirent à l’armée régulière, forte de 20.000 hommes. L’Etat Libre de Fiume, qui fut éphémère, représente une révolte héroïque et passionnée contre la modération, incarnée par les autorités officielles de l’Italie. Même si l’on peut considérer que l’expérience de d’Annunzio était dès le départ condamnée à une fin prématurée, il faut dire que le souvenir de Fiume demeurera, comme un espoir général et comme source d’inspiration du futur fascisme.
D’Annunzio, effectivement, inspira Mussolini qui reprendra certains de ses emblèmes comme les chemises noires, oripeaux des combattants « arditi » de la première guerre mondiale, ces troupes de choc et d’élite de l’armée italienne ; Mussolini reprendra aussi une bonne part des us et de la terminologie de d’Annunzio. Mais tout cela n’était pas vraiment nouveau. Giuseppe Garibaldi, fondateur de l’Italie moderne, avait déclaré, en insistant, que les Italiens devaient s’habituer à l’idée de porter des chemises de couleur, car elles étaient le symbole de toutes les causes visant l’émancipation. Même le terme « fascio », d’où dérive le mot « fascisme » et qui signifie « groupe » ou « ligue », avait une longue tradition déjà dans la terminologie de la gauche italienne. En 1872, Garibaldi avait fondé un « fascio operaio », un « faisceau ouvrier », et, en 1891, apparaît un groupe d’extrême gauche qui a pour nom « Fascio dei Lavoratori », le « faisceau des travailleurs ». En dehors d’Italie, le mot « fascio » existe et exprime une idée de force, reprise par toutes sortes d’organisations politiques. A l’instar du futur fascisme, d’Annunzio exalte la violence et l’action héroïques et méprise le socialisme et le mode de vie bourgeois. Les marches de masse, dont la Marche sur Fiume fut le modèle initial, étaient considérées par les contemporains comme une réaction disciplinée, héroïque et collective contre le grand anonymat qu’imposait l’idéologie bourgeoise. La rébellion des jeunes hommes de gauche contre un socialisme perçu comme bourgeois et oppresseur, comme mou et antirévolutionnaire, était un trait commun aux légionnaires de Fiume et aux miliciens fascistes. Tous se réclamaient d’une puissance italienne, qui devait s’exprimer sur les plans militaire, culturel et sexuel.
Quelle leçon devons-nous tirer aujourd’hui de la Marche sur Fiume ? Tout d’abord, et c’est indubitablement la leçon principale qu’elle nous donne, c’est que la pensée politique ne peut pas, ne peut plus, se limiter aux concepts conteneurs conventionnels que sont le conservatisme, le progressisme, la gauche et la droite, etc. Toute pensée révolutionnaire s’exprime par la parole et par l’action, et ne met jamais d’eau dans son vin. Les compromis sont de simples instruments de la politique politicienne, axée sur les comptabilités électorales ; ils sont toutefois autant de coups de poignard dans les idéaux révolutionnaires. La prise de Fiume et la constitution qui s’ensuivit ont constitué le premier exemple de ville-Etat de facture utopique et poétique dans l’histoire contemporaine. Gabriele d’Annunzio était tout à la fois révolutionnaire, poète, guerrier, chef et philosophe. Fiume nous apprend a élargir notre propre horizon philosophique, lequel ne doit jamais se laisser aveugler par les compromis ni chavirer dans la médiocrité. Dans un régime où ont cohabité l’anarcho-syndicalisme, le proto-fascisme et l’idéal de la démocratie et de la république antiques, il n’y avait pas de place pour le bourgeoisisme passif, celui qui aime tant se laisser enchaîner par le conformisme moral et social et refuse d’emprunter une voie propre et héroïque :
Tutto fu ambito
e tutto fu tentato.
Ah perchè non è infinito
Come il desiderio, il potere umano ?
Cosi è finito il sogno fiumano.
NON DVCOR, DVCO !
Gridiamo ancora Noi,
per ricordare e per agire !
(Nous avons tout voulu,
nous avons tout tenté.
Et pourquoi donc le pouvoir humain
n’est-il pas aussi infini que le désir ?
C’est ainsi que finit le rêve de Fiume.
NON DVCOR, DVCO !
crions-nous encore,
pour nous souvenir et pour agir !) (2)
Peter VERHEYEN v/o Pjotr,
Scriptor NSV !’09-’10,
Stud. rer. hist..
( branding@nsv.be ).
Notes :
(1) Deux instances constituent le pouvoir exécutif : un Conseil de Sénateurs auquel peuvent appartenir tous les citoyens qui disposent de leurs droits politiques. la deuxième instance est le Conseil des « Provisori », composé de soixante délégués, élus au suffrage universel et selon une représentation proportionnelle. Y siègent des ouvriers, des marins, des patrons d’entreprise, des techniciens, des enseignants, des étudiants et des représentants d’autres groupes professionnels.
(2) Texte d’une chanson intitulée « NON DVCOR, DVCO » du groupe italien « Spite Extreme Wing ».
00:15 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : histoire, lettres, littérature, lettres italiennes, littérature italienne, italie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 11 janvier 2010
1941: les Soviétiques préparaient la guerre
 Archives de Synergies Européennes - 1991
Archives de Synergies Européennes - 1991
1941: les Soviétiques préparaient la guerre!
par le Dr. Heinz MAGENHEIMER
Professeur à l'Université de Salzbourg,
Membre de l'Académie de la Défense de Vienne
Pendant des décennies, l'attaque allemande contre l'Union Soviétique, commencée le 22 juin 1941, a été considérée comme l'exemple par excellence d'une guerre d'extermination, préparée depuis longtemps et justifiée par des arguments raciaux. L'historiographie soviétique qualifiait en outre cette guerre de «guerre de pillage» et ajoutait que l'Allemagne avait trahi ses promesses, avait rompu la parole donnée. Jusqu'en 1989, le Pacte Hitler/Staline des 23 et 24 août 1939 avait été interprété de cette façon dans l'apologétique soviétique. L'observateur des événements était littéralement noyé sous un flot d'arguments qui visaient à étayer au moins deux thèses: 1) La signature du traité a empêché Moscou d'être impliqué dans les premiers événements de la guerre européenne, qui aura ultérieurement comme victime principale l'URSS; 2) Le pouvoir soviétique a vu d'avance le plan des «impérialistes» et l'a contrecarré; il visait à détourner l'armée allemande vers l'Est. L'Union Soviétique aurait ainsi été la victime, à l'été 1941, de sa fidélité à la lettre du pacte et de sa volonté de paix. Cette loyauté, l'URSS l'a payée cher et a failli être complètement détruite sur le plan militaire.
Des experts soviétiques réfutent l'interprétation officielle
Depuis 1989, cette vision de l'histoire contemporaine a été largement réfutée. Des experts soviétiques, dont V. Dachitchev, estiment désormais que le Pacte des 23 et 24 août 1939 a constitué une lourde erreur de la politique étrangère soviétique (cf. Hans-Henning Schröder, Der Zweite Weltkrieg, Piper, München, 1989). Bien sûr, on parle encore et toujours de la guerre germano-russe comme d'une «guerre d'anéantissement justifiée par une idéologie racialiste», notamment dans les écrits, y compris les derniers, de l'historien Andreas Hillgruber (cf. Zweifacher Untergang, 1986). Mais les préoccupations qui dominent, actuellement, chez les spécialistes de l'histoire contemporaine, sont celles qui concernent les multiples facettes du processus de décision: outre la volonté d'expansion de Hitler, on examine désormais la logique, certes subjective, qui a fait que l'Allemagne a choisi la solution militaire pour règler le problème que constituait l'URSS dans le contexte stratégique du printemps 1941. On étudie ensuite ce qui opposait de façon irréconciliable les idéologies au pouvoir en URSS et dans le Troisième Reich, tout en essayant de comprendre quelles étaient les arrière-pensées de Staline en ce qui concerne l'Europe. Résultat de ces investigations: on se demande si l'attaque allemande n'a pas été finalement une attaque préventive, vu ce qui s'annonçait à moyen ou long terme. Ernst Topitsch est de cet avis depuis longtemps et a étayé solidement sa thèse dans Stalins Krieg (2ième éd., 1986). Quant à Viktor Souvorov, dans Le brise-glace (Olivier Orban, Paris, 1990), il a illustré cette thèse à grand renfort de preuves.
Staline avait le temps pour lui
Cela n'aurait guère de sens de revenir sur la vieille querelle quant à savoir si l'attaque de la Wehrmacht a été dictée essentiellement par des considérations d'ordre stratégique et politique ou par des motivations d'ordre idéologique. Il me semble plus utile, d'un point de vue historique, de chercher à cerner la raison première et fondamentale qui a fait que l'état-major allemand s'est décidé à passer à l'attaque. Cet état-major s'est dit, me semble-t-il, qu'attendre passivement rendait jour après jour le Reich plus dépendant de la politique de Staline; une telle dépendance aurait finalement créé des conditions défavorables pour l'Allemagne dans sa guerre à l'Ouest et en Afrique. Hitler était bien conscient du risque énorme qu'il y avait à ouvrir un second front, à parier pour l'offensive: il l'a clairement fait savoir à ses généraux, dont la plupart étaient trop optimistes.
Les papiers de Joukov
Les historiens qui affirment que les motivations idéologiques à connotations racistes ont été les plus déterminantes, sous-estiment trop souvent les préoccupations stratégiques; en effet, dès le début de l'automne 1940, la situation, pour l'Allemagne, était alarmante; l'état-major devait le reconnaître, si bien que son chef, le Général Halder craignait, dès avril 1941, une attaque préventive des Soviétiques. Aujourd'hui, après qu'on ait publié les papiers du Maréchal Georgy Joukov et qu'on y ait découvert des documents d'une importance capitale, non seulement on sait que l'Armée Rouge s'était mise en branle, que ses manœuvres avaient un caractère offensif, surtout dans les quatre districts militaires de l'Ouest mais on sait également, d'après des sources attestées, que les autorités militaires soviétiques prévoyaient dès la mi-mai 1941 une attaque préventive limitée, au moins contre la Pologne centrale et la Haute-Silésie.
Staline a certes refusé ce plan, mais son existence explique néanmoins pourquoi les Soviétiques ont massé six corps mécanisés sur des positions en saillie du front (le premier échelon opérationnel soviétique comptait en tout et pour tout treize corps mécanisés), ont aligné cinq corps aéroportés, ont réaménagé les installations d'un grand nombre de terrains d'aviation pour bombardiers et pour chasseurs à proximité de la frontière et ont renoncé à renforcer la Ligne Staline, alors qu'elle aurait été excellente pour une bonne défense stratégique du territoire soviétique. Les papiers de Joukov nous permettent de comprendre pourquoi les grandes unités stationnées dans les régions frontalières n'ont pas reçu l'ordre de construire un système défensif en profondeur mais, au contraire, ont été utilisées pour améliorer les réseaux routiers menant à la frontière. Ces indices, ainsi que bien d'autres, ont été mis en exergue récemment par des historiens ou des publicistes soviétiques, dont Vladimir Karpov. Sur base de ces plans d'opération, le chef de l'état-major général soviétique, Joukov, en accord avec le Ministre de la Défense, Timochenko, voulait atteindre en trente jours la ligne Ostrolenka, Rive de la Narev, Lowicz, Lodz, Oppeln, Olmütz. Ensuite, Joukov prévoyait de retourner ses forces vers le Nord et d'attaquer et de défaire le centre des forces allemandes, ainsi que le groupe Nord des armées du Reich, massé en Prusse Orientale.
Je souligne ici que ce plan d'opérations ne signifie pas que les Soviétiques avaient définitivement décidé de passer à l'offensive. L'existence de ce plan ne constitue donc pas une preuve irréfutable des intentions offensives de Staline à l'été 1941. Mais ce plan nous permet d'expliquer bon nombre de petits événements annexes: on sait, par exemple, que Staline a refusé de prendre en considération les informations sérieuses qu'on lui communiquait quant à l'imminence d'une attaque de la Wehrmacht au printemps 1941. Or il y a eu au moins 84 avertissements en ce sens (cf. Gordievski/Andrew, KGB, 1990). Comme le prouvent les événements de la nuit du 22 juin, Staline voulait éviter toute provocation; peu de temps avant que le feu des canons allemands ne se mette à tonner au-dessus de la frontière soviétique, il a donné instruction à l'ambassadeur d'URSS à Berlin, de s'enquérir des conditions qu'il fallait respecter pour que les Allemands se tiennent tranquilles (cf. Erich E. Sommer, Das Memorandum, 1981).
Staline estime que
l'Armée Rouge n'est pas prête
Ce qui nous autorise à conclure que Staline cherchait à gagner du temps, du moins jusqu'au moment où le deuxième échelon stratégique, composé de six armées (77 divisions), puisse quitter l'intérieur des terres russes. Ce qui étaye également la thèse qui veut que Staline estimait que ses préparatifs offensifs, destinés à réaliser ses projets, n'étaient pas encore suffisants. Quoi qu'il en soit, au début de la campagne, les Soviétiques alignaient à l'Ouest, réserves comprises, 177 divisions, renforcées par au moins 14.000 chars de combat, environ 34.000 canons et obusiers et à peu près 5.450 avions d'attaque (61 divisions aériennes). Face à ces forces impressionnantes, la Wehrmacht n'alignait que 148 divisions, trois brigades, 3.580 chars de combat, 7.150 canons et environ 2.700 avions d'attaque.
Cette faiblesse des forces allemandes et l'improvisation dans l'équipement et l'organisation, permettent de soutenir la thèse que la décision d'ouvrir un front à l'Est ne découlait pas d'un «programme» concocté depuis longtemps (cf. Hartmut Schustereit, Vabanque, 1988). Beaucoup d'indices semblent prouver que Staline estimait que le conflit ouvert avec l'Allemagne était inéluctable. En effet, les avantages incontestables que le Pacte germano-soviétique offrait à Berlin (cf. Rolf Ahmann, Hitler-Stalin-Pakt 1939, 1989) n'avaient de valeur qu'aussi longtemps qu'ils facilitaient les opérations allemandes à l'Ouest.
C'est alors qu'un facteur a commencé à prendre du poids: en l'occurrence le fait que les deux camps percevaient une menace qui ne pouvait être éliminée que par des moyens militaires. Les ordres qui lancent déploiements ou opérations ne reflètent —c'est connu— que des jugements d'ordre politique. C'est pourquoi l'observateur se trouve face à une situation historique où les deux protagonistes ne réfléchissent plus qu'au moment opportun qui se présentera à eux pour déclencher l'attaque. Mais comme dans l'histoire, il n'existe pas d'«inéluctabilité en soi», la clef pour comprendre le déclenchement de l'«Opération Barbarossa» se trouve dans une bonne connaissance de la façon dont les adversaires ont perçu et évalué la situation. De cette façon seulement, l'historien peut «vivre rétrospectivement et comprendre» (comme le disait Max Weber), le processus de décision. On peut ainsi acquérir un instrument pour évaluer et juger les options politiques et stratégiques qui se sont présentées à Berlin et à Moscou au cours des années 1940 et 1941. L'Allemagne tentait, en prestant un effort immense qu'elle voulait unique et définitif, de créer un imperium continental inattaquable; l'URSS tentait de défendre à tout prix le rôle d'arbitre qu'elle jouait secrètement, officieusement, en Europe.
Dr. Heinz MAGENHEIMER.
(texte issu de Junge Freiheit, juin 1991; adresse: JF, Postfach 147, D-7801 Stegen/Freiburg).
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, seconde guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, urss, union soviétique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 10 janvier 2010
La "Bulle d'or" est proclamée...

10 janvier 1356: L’Empereur du Saint Empire Romain de la Nation Germanique, Charles IV, proclame la “Bulle d’Or”, un édit impérial qui fixe les règles déterminant l’élection des rois germaniques et les droits des princes électeurs (Kurfürsten), sans prévoir un quelconque assentiment du Pape. Les électeurs sont au nombre de huit: les archevêques de Cologne, de Mayence et de Trêves, le roi de Bohème, le comte palatin du Rhin, le Duc de Saxe-Wittemberg, le margrave de Brandebourg.
00:13 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, allemagne, moyen âge, époque médiévale, saint empire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 08 janvier 2010
Catherine II prend la Crimée

8 janvier 1784 : Le Sultan ottoman est contraint de céder la Crimée à la Tsarine Catherine II. Celle-ci avait pour politique principale d’étendre la Russie vers le Sud, vers la Mer Noire et le monde grec. Elle avait tourné le dos à la politique russe antérieure, qui était de prendre la Baltique toute entière et d’affronter, pour y parvenir, le royaume de Suède et la Pologne. Catherine II tourne donc toutes ses forces vers le Sud. L’année précédente, elle avait protégé le khan de Crimée contre ses sujets révoltés, alors que ce khan était vassal de la Sublime Porte. Celle-ci est trop affaiblie pour réagir, et l’ambassadeur de France, Vergennes, dissuade le Sultan de riposter. Vergennes participe à une grande politique continentale : la France n’est plus l’ennemie de l’Autriche, car Louis XVI a épousé Marie-Antoinette ; et Joseph II, Empereur d’Autriche, qui a succédé en 1780 à sa mère Marie-Thérèse, souhaite la paix avec la France et avec la Russie. Implicitement, il existe à l’époque un Axe Paris/Vienne/Saint-Pétersbourg, donc une sorte de bloc eurasiatique ou eurosibérien avant la lettre. Quand Catherine II prend la Crimée, en rêvant d’y réaliser une synthèse russo-germano-grecque, l’Empereur Joseph II gagne pour l’Autriche le droit de faire circuler ses navires dans les Détroits. Contrairement à ce qui va se passer à la fin du 19ème siècle, après l’occupation de la Bosnie par les Autrichiens en 1878, il n’y avait pas, au départ, d’animosité russo-autrichienne, mais un franc partage des tâches, dans une harmonie européenne, que la révolution française, invention des services de Pitt le Jeune, va ruiner.
00:15 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, russie, turquie, europe, crimée, mer noire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
8 janvier 1792: Traité de Jassy
 8 janvier 1792: Comme les souverains de Prusse et d’Autriche souhaitent mobiliser tous les efforts militaires de l’Europe pour vider le chancre de la révolution française, pure fabrication des services secrets de Pitt le Jeune et non soulèvement populaire et “démocratique” comme le veulent les légendes colportées depuis lors, les Autrichiens sont contraints d’abandonner toutes les conquêtes récentes qu’ils venaient de faire dans les Balkans. A cause des voyous parisiens stipendiés par l’Angleterre, la Russie se retrouve seule face aux Ottomans de Sélim III qui tentent de profiter de l’aubaine pour réaffirmer leur présence en Serbie. Le peuple serbe est l’une des premières victimes collectives du chancre sans-culottes, on l’oublie trop souvent, car les Autrichiens, pour faire face à une France dévoyée ont dû suspendre leur protection et ramener une bonne partie de leurs troupes à l’Ouest, où l’alliance implicite de la France et de l’Autriche, sous Louis XVI et Joseph II, les avait rendues inutiles. Néanmoins, l’armée de la Tsarine Catherine II parvient à écraser les troupes ottomanes à Mashin, le 4 avril 1791. Le Sultan ne peut plus formuler d’exigences. Il devra entériner le Traité de Jassy, signé le 8 janvier 1792.
8 janvier 1792: Comme les souverains de Prusse et d’Autriche souhaitent mobiliser tous les efforts militaires de l’Europe pour vider le chancre de la révolution française, pure fabrication des services secrets de Pitt le Jeune et non soulèvement populaire et “démocratique” comme le veulent les légendes colportées depuis lors, les Autrichiens sont contraints d’abandonner toutes les conquêtes récentes qu’ils venaient de faire dans les Balkans. A cause des voyous parisiens stipendiés par l’Angleterre, la Russie se retrouve seule face aux Ottomans de Sélim III qui tentent de profiter de l’aubaine pour réaffirmer leur présence en Serbie. Le peuple serbe est l’une des premières victimes collectives du chancre sans-culottes, on l’oublie trop souvent, car les Autrichiens, pour faire face à une France dévoyée ont dû suspendre leur protection et ramener une bonne partie de leurs troupes à l’Ouest, où l’alliance implicite de la France et de l’Autriche, sous Louis XVI et Joseph II, les avait rendues inutiles. Néanmoins, l’armée de la Tsarine Catherine II parvient à écraser les troupes ottomanes à Mashin, le 4 avril 1791. Le Sultan ne peut plus formuler d’exigences. Il devra entériner le Traité de Jassy, signé le 8 janvier 1792.
Dans les clauses de ce Traité, les Ottomans acceptent l’annexion de la Crimée à la Russie et la suzerainté russe sur la Géorgie othodoxe, libérée du joug musulman. Le Dniestr devient la frontière entre les empires russe et ottoman. Cette extension russe permet aux Tsars de dominer la Mer Noire, ce qui leur vaudra l’inimitié tenace de l’Angleterre, une inimitié qui se concrétisera lors de la fameuse Guerre de Crimée (1853-1856), où la France sera entraînée. Ensuite, la présence russe sur le Dniestr pèse sur les “Principautés” danubiennes, la Moldavie et la Valachie, que Vienne entendait dominer afin de contrôler l’ensemble du cours du Danube, jusqu’à son delta et d’obtenir ainsi une fenêtre sur la Mer Noire. Le Traité de Jassy jette donc aussi les bases de l’inimitié entre la Russie et l’Autriche, qui compliquera considérablement la diplomatie du 19ème siècle et constituera l’un des motifs de la première guerre mondiale.
Si l’on jette un coup d’oeil sur la situation actuelle dans la région, nous constatons que les Etats-Unis ont repris en quelque sorte le rôle de la thalassocratie anglaise: ils sont les protecteurs de la Turquie, en dépit d’une mise en scène où celle-ci fait semblant de branler dans le manche et d’adopter, avec Davutolgu, une diplomatie autonome; en tant qu’héritiers de la politique pro-ottomane de l’Angleterre du 19ème siècle, ils veillent aussi à détacher la Crimée de la sphère d’influence moscovite, en pariant sur le contentieux russo-ukrainien et, aussi, à arracher la Géorgie orthodoxe à l’influence russe. Les Etats-Unis ont pour objectif de défaire les acquis du Traité de Jassy de 1792. Nous constatons également que la frontière sur le Dniestr constitue aujourd’hui aussi un enjeu, avec la proclamation de la république pro-russe de Transnistrie, face à une Moldavie qui pourrait se joindre à la Roumanie et, ainsi, se voir inféodée à l’OTAN et à l’UE.
00:15 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, russie, turquie, balkans, autriche, danube |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 03 janvier 2010
Les Finlandais bloquent l'Armée Rouge
 3 janvier 1940: Après avoir bloqué l’offensive soviétique, les Finlandais constatent que l’Armée Rouge s’enterre le long de la frontière russo-finlandaise et la fortifie, manifestement en vue d’une future offensive, après les grands froids. Le 3 janvier, l’aviation finlandaise lance trois millions de tracts sur Leningrad, afin de démoraliser la population soviétique et de l’informer sur la situation réelle sur le front. Deux jours plus tard, les troupes du Maréchal finlandais Mannerheim encerclent la 18ème Division soviétique au nord du Lac Ladoga. Le 8 janvier, la 9ème Division finlandaise du Général Siilasvuo écrase deux divisions soviétiques, dont elle avait préalablement coupé les approvisionnements. La tactique des Finlandais est “de laisser la faim et le froid affaiblir l’ennemi”.
3 janvier 1940: Après avoir bloqué l’offensive soviétique, les Finlandais constatent que l’Armée Rouge s’enterre le long de la frontière russo-finlandaise et la fortifie, manifestement en vue d’une future offensive, après les grands froids. Le 3 janvier, l’aviation finlandaise lance trois millions de tracts sur Leningrad, afin de démoraliser la population soviétique et de l’informer sur la situation réelle sur le front. Deux jours plus tard, les troupes du Maréchal finlandais Mannerheim encerclent la 18ème Division soviétique au nord du Lac Ladoga. Le 8 janvier, la 9ème Division finlandaise du Général Siilasvuo écrase deux divisions soviétiques, dont elle avait préalablement coupé les approvisionnements. La tactique des Finlandais est “de laisser la faim et le froid affaiblir l’ennemi”.
00:15 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, finlande, urss, deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale, armée rouge |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 02 janvier 2010
Joseph II abolit la torture
 2 janvier 1776 : L’Empereur Joseph II d’Autriche, despote éclairé, décide d’abolir la torture dans tous ses Etats. Joseph II entend modeler son système de pouvoir sur les idées nouvelles du 18ème siècle et “se débarrasser des fardeaux inutiles du passé”. Cette volonté de se débarrasser de toutes les bonnes vieilles habitudes de la tradition lui jouera des tours, notamment aux Pays-Bas où ses réformes seront mal accueillies et considérées comme tatillonnes, si bien qu’il récoltera le sobriquet de « roi sacristain » car il avait demandé de légiférer sur la longueur et l’épaisseur des bougies et cierges destinés au culte. De même, il vexera profondément les Hongrois, en ramenant à Vienne la Couronne de Saint-Etienne, qu’il portait au titre de Roi de Hongrie. Quant au palais royal de Prague, il le transformera en caserne de cavalerie, fasciné qu’il était par tout ce qui était « utile ». Joseph II introduit dans ses Etats disparates et composites un centralisme qui ne sera guère apprécié. Cet Empereur d’ancien régime, adepte du despotisme éclairé, a néanmoins « humanisé » les pratiques judiciaires, bien avant le triomphe des idées de 1789, qui, elles, feront un usage zélé de la guillotine.
2 janvier 1776 : L’Empereur Joseph II d’Autriche, despote éclairé, décide d’abolir la torture dans tous ses Etats. Joseph II entend modeler son système de pouvoir sur les idées nouvelles du 18ème siècle et “se débarrasser des fardeaux inutiles du passé”. Cette volonté de se débarrasser de toutes les bonnes vieilles habitudes de la tradition lui jouera des tours, notamment aux Pays-Bas où ses réformes seront mal accueillies et considérées comme tatillonnes, si bien qu’il récoltera le sobriquet de « roi sacristain » car il avait demandé de légiférer sur la longueur et l’épaisseur des bougies et cierges destinés au culte. De même, il vexera profondément les Hongrois, en ramenant à Vienne la Couronne de Saint-Etienne, qu’il portait au titre de Roi de Hongrie. Quant au palais royal de Prague, il le transformera en caserne de cavalerie, fasciné qu’il était par tout ce qui était « utile ». Joseph II introduit dans ses Etats disparates et composites un centralisme qui ne sera guère apprécié. Cet Empereur d’ancien régime, adepte du despotisme éclairé, a néanmoins « humanisé » les pratiques judiciaires, bien avant le triomphe des idées de 1789, qui, elles, feront un usage zélé de la guillotine.
00:10 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, autriche, saint empire, torture |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Le destin de Beppo Römer: des Corps Francs au Parti Communiste Allemand
 Holger SZYMANSKI :
Holger SZYMANSKI :
Le destin de Beppo Römer : des Corps Francs au Parti Communiste Allemand
Josef Römer, « Beppo » pour ses amis, était un ancien chef des Corps Francs allemands après 1918. Indubitablement, cette personnalité illustre est typique de ces destins troublés qui ont traversé le 20ème siècle.
Ceux qui s’intéressent à l’histoire allemande de la première moitié du 20ème siècle connaissent Römer : il fut l’un des initiateurs de l’assaut contre l’Annaberg en Silésie, une hauteur stratégique qui avait été occupée par des francs-tireurs polonais en mai 1921 ; ensuite, il fut un résistant à l’hitlérisme, exécuté en 1944. Entre l’héroïsme de l’Annaberg et la mort tragique de 1944, s’étend une période moins bien connue, celle où notre Capitaine mis à la retraite s’est d’abord engagé dans les rangs nationalistes puis, par le détour du national-bolchevisme, a fini par devenir un compagnon de route du communisme allemand. Pourtant ceux qui s’intéressent aux phénomènes de la « révolution conservatrice » et du national-bolchevisme ignorent une chose : Römer était déjà dans les années 20 un agent du service de renseignement de la KPD communiste allemande. Il y a déjà une quinzaine d’années, la maison d’édition Dietz de Berlin, inféodée à la SED, le parti unique de l’ex-Allemagne de l’Est, avait fait paraître un livre intitulé « Der Nachrichtendienst der KPD 1919-1937 » (= «Le service de renseignement du parti Communiste Allemande – 1919-1937 ») ; cet ouvrage est passé presque totalement inaperçu dans les milieux généralement intéressés à la « révolution conservatrice » et aux nationalismes allemands, sans doute à cause de sa provenance est-allemande et communiste.
Les auteurs de ce livre ont sans nul doute suscité des hauts le cœur chez les conservateurs et les nationaux : tous étaient jadis enseignants auprès de la « Hauptverwaltung Aufklärung » (« Administration Principale du Renseignement ») du Ministère de la Sécurité de l’Etat (la « Stasi »). Parmi eux, il y avait également le chef d’un département spécialisé « dans les recherches sur les problèmes spécifiques de lutte et de résistance antifascistes » ; lui aussi relevait du ministère du fameux Général Mielke. Pourtant, ces auteurs, contrairement à beaucoup d’autres historiens, avaient accès aux archives est-allemandes et toutes les références qu’ils citent dans leur livre sont vérifiables dans la mesure où leurs sources sont dûment citées. Pour l’essentiel, nos ex-officiers est-allemands se basent sur les archives de la SED et sur celles du « Département IX/11 » de la Stasi. Aujourd’hui, tous ces documents ont été transférés aux Archives Fédérales (« Bundesarchiv »). A l’époque de la RDA, les résultats des recherches de nos auteurs étaient considérés comme « top secrets » et tenus sous le boisseau. La Stasi se voulait l’héritière du « service de renseignement » de la KPD.
D’après les travaux de nos historiens membres de la Stasi, les contacts de Beppo Römer avec les communistes remontaient à 1921 déjà et auraient été rendus possibles par l’entremise d’un député communiste du Landtag de Bavière, Otto Graf. Le service de renseignement du parti finit par prendre contact avec Römer à l’automne 1923. Römer revêtait une grande importance pour les communistes, car il était l’un des dirigeants de la Ligue Oberland (= « Bund Oberland »), issue du Corps Francs du même nom, qui avait joué un rôle important dans les combats de l’immédiat après-guerre. A ce titre, cette Ligue exerçait une grande influence dans le camp nationaliste. Nos auteurs est-allemands en arrivent dès lors à la conclusion suivante, après avoir dépouillé un grand nombre de documents archivés : « Römer fut l’un des informateurs les plus prolixes de la KPD sur le camp des radicaux de droite en Bavière ». La direction de la KPD était donc très bien informée sur la préparation, l’exécution et l’échec du putsch perpétré par Hitler les 8 et 9 novembre 1923.
Cependant, le travail des informateurs ne servait pas seulement à informer la direction de la KPD mais aussi et surtout à travailler à la dislocation des troupes d’auto-défense et de toutes les autres organisations de droite. Le domaine dans lequel ce travail de dislocation devait s’effectuer s’appelait tout simplement celui des « Fascistes » dans le langage des communistes. Travaillant sous la houlette de son chef, Otto Thomas, Beppo Römer, qui avait achevé des études, obtenu un diplôme et trouvé un emploi civil dans le domaine de l’économie, fonde, avec Ludwig Oestreicher, issu comme lui de la Ligue Oberland, et quelques autres amis, la revue « Die neue Front » (= « Le Front nouveau ») dont l’objectif était de promouvoir des volontés activistes d’orientation nationale-bolchevique parmi les anciens des Corps Francs ; remarquons que, dans le chef de Römer, c’est avec le concours de l’appareil de subversion de la KPD que de telles vocations doivent éclore. La revue ne suscite finalement pas grand intérêt et cesse bien vite de paraître.
Römer, libéré de ses tâches de publiciste, s’adonne alors plus intensément à l’espionnage économique et militaire auquel se livrent les communistes allemands pour le bénéfice de leurs camarades soviétiques. Dans ce contexte, Römer est arrêté le 30 septembre 1926 à Berlin. Grâce à une amnistie générale, il ne sera pas jugé. Römer se serait surtout intéressé à la production de gaz toxiques et à fournir des échantillons de produits finis.
Beppo Römer ne réapparaît sur la scène de la politique allemande qu’en 1931, lorsqu’apparaissent les groupes de travail « Aufbruch ». Ces cercles politiques voient le jour au moment où l’ancien lieutenant de la Reichswehr, Richard Scheringer, passe de la NSDAP hitlérienne à la KPD communiste. Scheringer, avec ses camarades Hanns Ludin (plus tard ambassadeur du Reich en Slovaquie pendant la seconde guerre mondiale et, à ce titre, exécuté en 1947) et Hans Friedrich Wendt, avait fait de la propagande pour la NSDAP au sein des forces armées. Les trois hommes avaient voulu mettre sur pied des « cellules NSDAP » dans l’armée. Lors du procès de la Reichswehr, qui s’est tenu à Ulm à l’automne 1931, Hitler a été appelé à la barre comme témoin et c’est là qu’il a prononcé son fameux « serment de légalité », par lequel il proclama que la NSDAP ne cherchait à atteindre le pouvoir que par des moyens légaux.
Scheringer purgea sa peine à Gollnow où, sous l’influence d’un détenu communiste, Rudolf Schwarz, il finit par adhérer à l’idéologie des Rouges. Rudolf Schwarz n’était pas le premier communiste venu mais avait été le responsable du département « Reichswehr » de l’appareil politico-militaire du parti. Le dirigeant actif, à l’époque, de cet appareil « M », Hans Kippenberger, fit sensation le 19 mars 1931 lorsqu’il annonça pendant un débat au Reichstag l’adhésion de Scheringer à la KPD. La démarche de Scheringer a permis à la KPD de pénétrer des strates sociales qui avaient été jusqu’alors sceptiques à son égard.
Pour consolider ces nouveaux contacts, Kippenberger décida de fonder une nouvelle revue, « Aufbruch - Kampfblatt im Sinne des Leutnants a. D. Scheringer » (= « Aufbruch – Feuille de combat selon les idées du Lieutenant e.r. Scheringer »). Dans un premier temps, les éditeurs de la publication furent l’ancien Premier Lieutenant de police Gerhard Giesecke et l’ancien représentant du Gauleiter NSDAP du Brandebourg, Rudolf Rehm. A partir de 1932, le Capitaine e.r. Dr. Beppo Römer prend en mains la rédaction de la revue. On ne peut affirmer avec certitude si Römer avait adhéré de facto à la KPD à cette époque. Il l’a nié plus tard en dépit d’une note émise par le journal communiste « Die Rote Fahne » en date du 22 avril 1932. Autour de la revue naissent les cercles « Aufbruch » : en 1933, il y en avait vingt-cinq, avec quelque 200 à 300 membres. Leur objectif était de recruter dans les cercles d’officiers des combattants contre le national-socialisme. A la tête de ces cercles se trouvait une « Commission dirigeante », composée de « camarades travaillant sur le mode de la conspiration ». Outre Römer, il y avait, parmi ces « camarades », un certain Dr. Karl-Günther Heimsoth, devenu célèbre par des lettres de sa main, très compromettantes pour son ami intime Ernst Röhm et relatives à l’homosexualité de ce dernier. Pour la KPD, l’existence des cercles « Aufbruch » constituait une formidable aubaine : celle de glaner quantité d’informations et de recruter de nouveaux agents. Après la prise du pouvoir par les nationaux-socialistes en 1933, « Aufbruch » et les cercles qui gravitaient autour de la revue sont interdits. Bon nombre de leurs activistes, y compris Beppo Römer, sont placés en garde à vue ou fuient vers l’étranger. Plus tard, Beppo Römer se joindra à divers mouvements de résistance ; le dernier auquel il adhéra fut d’obédience communiste et sous la direction de Robert Uhrig. Cette adhésion constitua le motif de son arrestation au début de l’année 1942, de sa condamnation à mort et de son exécution, le 25 septembre 1944 à Brandenburg-Görden.
Au vu de toutes ces activités au profit du service de renseignement de la KPD, Römer apparaît plutôt aujourd’hui comme un véritable agent communiste et non pas comme un visionnaire rêvant de forger un Axe Berlin-Moscou, comme on l’a cru pendant très longtemps.
Holger SZYMANSKI.
(article paru dans la revue « Deutsche Stimme », février 2008 et sur http://www.deutsche-stimme.de/ - trad.. franc. : Robert Steuckers).
Bibliographie :
Bernd KAUFMANN et al., « Der Nachrichtendienst der KPD – 1919-1937 », Dietz Verlag, Berlin, 1993, 462 pages.
Pour tous les éléments biographiques relatifs à la personnalité de Beppo Römer, se référer au « Taschenkalender des nationalen Widerstandes 2007 », où ses activités d’agent communiste ne sont toutefois pas évoquées.
00:10 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, nationalisme révolutionnaire, allemagne, communisme, parti communiste allemand, weimar, années 20, années 30 |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 30 décembre 2009
Wang Tsing-wei s'engage pour le "nouvel ordre asiatique"
 30 décembre 1939: Les Japonais trouvent des alliés en Chine parmi les dissidents du Kuo-Min-Tang (KMT) nationaliste. Leur chef de file est Wang Tsing-wei, ancien ministre des affaires étrangères du KMT, donc une figure de proue et non un militant subalterne de cette formation nationaliste et républicaine chinoise. Wang Tsing-wei avait été l’un des principaux concurrents de Tchang Kai-chek dans la lutte pour la direction du KMT. Evincé, il se met au service d’une politique japonaise prônant la paix et invitant tous les Asiatiques à construire le “nouvel ordre asiatique” ou la “sphère de coprospérité d’Asie orientale”. Il s’était réfugié d’abord à Hanoï en Indochine française et, de là, avait appelé à cette paix voulue par les Japonais.
30 décembre 1939: Les Japonais trouvent des alliés en Chine parmi les dissidents du Kuo-Min-Tang (KMT) nationaliste. Leur chef de file est Wang Tsing-wei, ancien ministre des affaires étrangères du KMT, donc une figure de proue et non un militant subalterne de cette formation nationaliste et républicaine chinoise. Wang Tsing-wei avait été l’un des principaux concurrents de Tchang Kai-chek dans la lutte pour la direction du KMT. Evincé, il se met au service d’une politique japonaise prônant la paix et invitant tous les Asiatiques à construire le “nouvel ordre asiatique” ou la “sphère de coprospérité d’Asie orientale”. Il s’était réfugié d’abord à Hanoï en Indochine française et, de là, avait appelé à cette paix voulue par les Japonais.
00:10 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : chine, japon, asie, extreme orient, histoire, seconde guerre mondiale, deuxième guerre mondiale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 29 décembre 2009
Chine: l'impact psychologique de la révolte "Taiping" (1851-1864)

« Moestasjrik » : ‘t Pallieterke :
Chine : l’impact psychologique de la révolte « Taiping » (1851-1864).
Quand on se demande pourquoi les autorités politiques séculières ont si peur des mouvements religieux sectaires, comme, par exemple, l’actuel régime chinois, dont le communisme est devenu « soft », craint la secte Falungong, il faut étudier l’histoire de la révolte Taiping qui, entre 1851 et 1864, a ravagé la Chine centrale et méridionale en faisant près de vingt millions de morts, plus encore que la première guerre mondiale en Europe.
La révolte a été dirigée par une figure prophétique typique, Hong Xiuquan, qui s’était converti au protestantisme et imaginait être le frère de Jésus Christ. Conséquence des traductions lacunaires de la Bible en chinois, sa théologie chrétienne était largement « déviationniste ». Il n’acceptait que Dieu le Père, rejetait la Sainte Trinité et, bien sûr aussi, le précepte de la foi qui veut que Jésus ait été « le seul et unique fils de Dieu », puisqu’il y en avait deux : Jésus et lui-même ! Le compagnon de Hong, Yang Xiuqing imaginait qu’il était, lui aussi, un prophète mandaté par Dieu.
L’aventure commença par une révolte dans une ville de Chine du Sud, Jintian, en janvier 1851, soulèvement populaire qui parvint à mettre en déroute les troupes impériales. En 1851, Hong proclame dans cette ville le « Taiping Tianguo », c’est-à-dire « le royaume céleste de la paix suprême ». Dans les masses déshéritées, il parvient à recruter un grand nombre d’adeptes, surtout au sein de la minorité non chinoise des Zhuang et dans la strate sociale des migrants intérieurs de Chine, les Keija ou Hakka. Son armée compta bien vite un bon million de combattants. Elle conquit la grande métropole de la Chine du Sud, Nanjing (« la capitale du Sud ») et en fit la capitale de Hong, après l’avoir débaptisée et renommée « Tianjing » (« la capitale céleste »). La moitié supérieure de l’uniforme des combattants Taiping était rouge et la partie inférieure, bleue. Ces combattants portaient les cheveux longs, d’où leur surnom de « changmao » (= les hommes aux longs cheveux »).
Les partisans Taiping ne se sont pas donné la peine d’intéresser les classes supérieures à leur cause. Hong appelait systématiquement l’empereur le « roi de l’enfer ». Il expropriait les grands propriétaires terriens et, souvent, les exécutait. Pour sélectionner ses fonctionnaires, il avait supprimé les examens portant sur les auteurs classiques du confucianisme, dont les livres étaient accusés de répandre de la « sorcellerie », pour les remplacer par des examens portant sur la Bible. Des milliers de temples de la religion autochtone chinoise ont été détruits. Les Taiping professaient l’égalité de tous les hommes, sous la forme d’un néo-illuminisme protestant, né pendant les campagnes contre l’esclavage, en allant même plus loin, dans l’optique traditionnelle chinoise, en prêchant l’égalité de l’homme et de la femme. Son armée comptait dès lors quelques bataillons féminins. Hong avait adopté le principe monogamique chrétien mais, à l’instar de bon nombre de chefs de secte, il avait fait une exception pour lui et conservé son harem.
Le mouvement finit par contrôler une grande partie de la Chine, sans être sérieusement défié avant 1861. Entre 1856 et 1860, l’armée impériale avait d’autres soucis : elle devait affronter la France et l’Angleterre à l’occasion de la deuxième guerre de l’opium. Dans le cadre de ce conflit, en 1859, le capitaine américain Josiah Tattnall, sans avoir reçu aucun ordre de sa hiérarchie, était venu en aide au commandant en chef de l’armée britannique, Sir James Hope, quand ce dernier affrontait une armée chinoise. Plus tard, Tattnall justifia cette entorse à la neutralité américaine par les mots célèbres d’un vieux poème écossais : « Blood is thicker than water » (= le sang est plus épais que l’eau), ce qui signifiait que la solidarité raciale de deux officiers blancs perdus dans un océan de Chinois était plus importante que tout le reste. Cette guerre s’est terminée par la destruction du palais d’été de l’empereur, situé en dehors de Beijing, et par l’acceptation, par les Chinois, d’une nouvelle série de « droits spéciaux » et de privilèges pour les puissances occidentales, leurs diplomates et leurs commerçants.
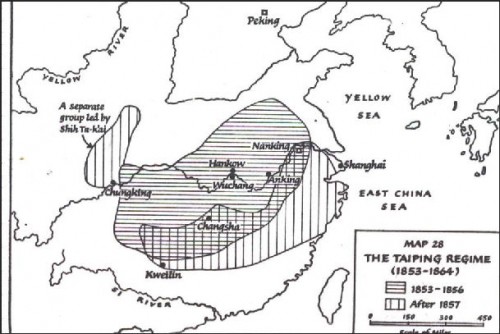
Le modèle de Mao
Immédiatement après la signature du traité de paix, les Britanniques sont venus en aide à l’empereur pour mater définitivement la révolte (à laquelle participaient quelques aventuriers occidentaux et quelques zélotes protestants). C’est alors que la fortune changea de camp. Lorsque les Taiping menacèrent Shanghai en 1862, où habitait une importante communauté d’Occidentaux, une armée britannique, sous les ordres du Général William Staveley, vint dégager la ville de l’étau des révoltés. Visant le même objectif, l’Américain Frederick Townsend Ward, de son côté, avait organisé une armée de soldats chinois commandés par des officiers occidentaux, mettant en œuvre les méthodes techniques les plus modernes de l’époque. Frederick Townsend Ward tomba au combat en 1863 et, à la demande du gouverneur local, Sir Staveley détacha son homme de confiance, Charles George Gordon, pour commander cette armée nouvelle et expérimentale. Après toute une série de succès impressionnants, l’empereur de Chine donna à cette armée le titre de « Changjiejun » (= « Armée toujours victorieuse »).
Gordon parvint à conquérir un point nodal dans le dispositif des Taiping, Chanchufu, et brisa de la sorte l’épine dorsale des révoltés. Il licencia son armée et laissa aux troupes impériales le soin de terminer le travail. En 1864, les Impériaux chinois prirent Nanjing et passèrent au fil de l’épée non seulement tous les combattants Taiping qui leur tombèrent sous la main mais aussi une bonne partie de la population civile. Hong était décédé depuis quelques mois ; son fils avait pris sa succession mais il n’avait ni le charisme ni le talent militaire de son géniteur pour pouvoir maintenir intact son Etat de nature sotériologique. Ses lieutenants, du moins les survivants, s’enfuirent dans tous les coins de l’empire. Au cours des décennies suivantes, quelques-uns d’entre eux organiseront encore des révoltes locales, notamment celle des musulmans des provinces occidentales.
L’historiographie maoïste s’était montré très positive à l’égard de la révolte Taiping : pour elle, c’était une prise du pouvoir bien organisé de la classe travailleuse, animée par les bons idéaux mais qui devait finalement échouer parce qu’elle n’avait aucun plan ni aucun mode d’organisation à « fondements scientifiques ». D’autres révoltes paysannes avaient déjà échoué parce qu’elles souffraient du même mal, sauf celles qui avaient été détournées par des aristocrates locaux qui surent bien souvent gérer les masses populaires pour les faire œuvrer au bénéfice de leurs propres ambitions. Pour les maoïstes, ces lacunes des révoltes populaires antérieures à Mao ne seront comblées que par l’adoption du marxisme-léninisme ; celui-ci impliquait une organisation rationnelle (avec un parti prolétarien d’avant-garde soumis à la centralisation démocratique) et une analyse scientifique de la situation ; ces deux atouts ont donné la victoire finale au peuple. Une étude maoïste sur les mérites de la révolte Taiping reprend les mots de Lénine : « Parfois, une lutte des masses, même pour une cause sans espoir, se révèle utile pour éduquer finalement ces masses et pour les préparer à la lutte finale ».
« Moestasjrik » / « ‘t Pallieterke ».
(article paru dans « ‘t Pallieterke », 16 mai 2007 ; trad.. franç. : Robert Steuckers, déc. 2009).
00:10 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, asie, chine, révoltes, 19ème siècle, religion, christianisme, protestantisme, messianisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 26 décembre 2009
Renseignement et espionnage dans la Rome antique
 Renseignement et espionnage dans la Rome antique
Renseignement et espionnage dans la Rome antique
Les activités de renseignement font partie intégrante de l’art de gouverner et, sans elles, les Romains n’auraient pas pu édifier et protéger leur empire.
Même s’ils ne séparaient pas les différentes fonctions du renseignement entre activités civiles et militaires, il n’en demeure pas moins qu’une grande partie de leurs activités de renseignement ressemblaient aux nôtres et qu’il est possible d’utiliser le concept moderne de cycle du renseignement pour les décrire. L’éventail des activités concernées est assez large : collecte de renseignements, contre-espionnage, infiltration, opérations clandestines, utilisation de codes et de chiffres, et diverses techniques d’espionnage. Toutes ont laissé des traces littéraires, épigraphiques et archéologiques qu’il est possible de suivre en partie.
Rose Mary Sheldon retrace le développement des méthodes de renseignement romaines des débuts de la République jusqu’au règne de Dioclétien (284-305 après J.-C.), d’une forme embryonnaire et souvent entachée d’amateurisme jusqu’au système très élaboré d’Auguste et de ses successeurs. L’ouvrage est rythmé tant par des chapitres consacrés à l’étude de certains des échecs romains que par l’examen des réseaux de communication, des signaux de transmission, des activités d’espionnage, des opérations militaires et de la politique frontalière.
C’est pourquoi les questions plus larges soulevées dans ce livre sont d’une pertinence immédiate pour le présent : bien que les méthodes de renseignement aient radicalement changé avec l’avènement de la technologie moderne, les principes restent étonnamment similaires. Les questions politiques essentielles portant sur la place des services de renseignement dans une démocratie et une république plongent leurs racines dans le monde gréco-romain.
Publication : novembre 2009, 528 pages,35
Via Theatrum Belli [1]
Disponible sur Amazon [2]
Article printed from :: Novopress Québec: http://qc.novopress.info
URL to article: http://qc.novopress.info/7371/renseignement-et-espionnage-dans-la-rome-antique/
URLs in this post:
[1] Theatrum Belli: http://www.theatrum-belli.com/archive/2009/12/14/renseignement-et-espionnage-dans-la-rome-antique.html
[2] Amazon: http://www.amazon.fr/Renseignement-espionnage-dans-Rome-antique/dp/2251381023?&camp=2498&linkCode=wsw&tag=tb0f6-21&creative=9162
00:25 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, antiquité, antiquité romaine, rome, antiquité classique, espionnage, renseignement, stratégie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 13 décembre 2009
Tiberio Graziani: Afghanistan 1979
 Afghanistan 1979
Afghanistan 1979
Déstabilisation du Proche et du Moyen Orient et origine du collapsus soviétique dans la géopolitique étasunienne
par Tiberio Graziani *
1979, l’année de la déstabilisation
Parmi les divers évènements de la politique internationale de l’année 1979, il y en a deux qui sont particulièrement importants à souligner, pour avoir contribué au bouleversement de la géopolitique mondiale basée à l’époque sur la confrontation entre les USA et l'URSS.
Il s’agit de la révolution islamique d'Iran et de l'aventure soviétique en Afghanistan.
Comme on le sait, la prise du pouvoir par l'ayatollah Khomeiny élimina un des piliers fondamentaux sur lesquels reposait l'architecture géopolitique occidentale, édifiée par les États-Unis à partir de la fin de la seconde guerre mondiale.
L'Iran de Reza Pahlavi représentait, dans les relations de pouvoir entre les États-Unis et l'URSS, en particulier au niveau géostratégique, un pion très important dont la disparition poussa le Pentagone et Washington à une révision profonde de la géopolitique des États-Unis dans la région.
En fait, un Iran autonome et hors de contrôle introduisait, sur l'échiquier géopolitique régional, une variable qui compromettait potentiellement toute la cohérence du système bipolaire.
En outre, le nouvel Iran, comme puissance régionale anti-étatsunienne et anti-israélienne, possédait également toutes les caractéristiques (en particulier, l’étendue et la centralité géographiques, ainsi que l'homogénéité politico-religieuse) pour prétendre à l'hégémonie sur une partie au moins du Moyen-Orient, en opposition ouverte avec les aspirations analogues et les intérêts d'Ankara et de Tel-Aviv - les deux solides piliers de la stratégie régionale de Washington - et d’Islamabad.
Pour ces raisons, les stratèges de Washington, conformément à leur « géopolitique du chaos » bicentenaire, poussèrent immédiatement l'Irak de Saddam Hussein à déclencher une guerre contre l'Iran.
La déstabilisation de toute la région permettait à Washington et à l'Occident de se donner du temps pour mettre au point une stratégie à long terme, et de « harceler sur ses flancs », en toute tranquillité, l'ours soviétique.
Comme l’a révélé, il y a onze ans, Zbigniew Brzezinski, conseiller à la sécurité nationale du président Jimmy Carter, lors d'une interview donnée à l'hebdomadaire français Le Nouvel Observateur (15-21 janvier 1998, p. 76), la CIA avait pénétré en Afghanistan, en vue de déstabiliser le gouvernement de Kaboul, en juillet 1979 déjà, soit cinq mois avant l'intervention de l’armée soviétique.
La première directive par laquelle Carter autorisait l'action clandestine pour aider secrètement les adversaires du gouvernement pro-soviétique date, en fait, du 3 juillet 1979.
Le même jour, le stratège étatsunien d'origine polonaise écrivit une note au président Carter, dans laquelle il expliquait que sa directive conduirait Moscou à intervenir militairement.
Cela se réalisa parfaitement à la fin de décembre de la même année.
Toujours dans la même interview, Brzezinski rappelle que, lorsque les Soviétiques entrèrent en Afghanistan, il écrivit une autre note à Carter, exprimant l'opinion que les USA avaient finalement l’occasion de donner à l'Union soviétique « sa guerre du Vietnam ».
Le conflit, insoutenable pour Moscou, devait conduire, selon Brzezinski, à l'effondrement de l'empire soviétique.
Le long engagement militaire des Soviétiques en faveur du gouvernement communiste de Kaboul contribua, en effet, à affaiblir encore davantage l'Union soviétique, déjà en proie à une importante crise interne, aussi bien sur le plan politique que socio-économique.
Comme nous le savons aujourd'hui, le retrait des troupes de Moscou du théâtre afghan laissa toute la région dans une situation d'extrême fragilité politique, économique, et surtout géostratégique. En effet, dix ans seulement après la révolution iranienne, la région tout entière avait été complètement déstabilisée au profit exclusif du système occidental. Le déclin, contemporain et inéluctable, de l'Union soviétique, accéléré par son aventure en Afghanistan et, ultérieurement, le démembrement de la Fédération yougoslave (une sorte d'État tampon entre les blocs occidental et soviétique) dans les années 90, ouvrirent la voie à l’expansion des États-Unis - de l'hyper-puissance, selon la définition du ministre français Hubert Védrine - dans l'espace eurasien.
Succédant au système bipolaire, une nouvelle saison géopolitique allait s’ouvrir: celle du «moment unipolaire».
Le nouveau système unipolaire aura, toutefois, une vie très courte, qui se terminera – à l'aube du XXIe siècle, - avec la réaffirmation de la Russie en tant qu'acteur mondial et l’émergence concomitante, économique et géopolitique, de la Chine et de l’Inde, les deux États-continents de l’Asie.
Les cycles géopolitique de l'Afghanistan
L'Afghanistan, en raison de ses spécificités, relatives, en premier lieu à sa position par rapport à l'espace soviétique (frontières avec les Républiques - à l’époque soviétiques - du Turkménistan, d’Ouzbékistan et du Tadjikistan), à ses caractéristiques géographiques, et aussi à son hétérogénéité ethnique, culturelle et confessionnelle, représentait, aux yeux de Washington, une grande partie de l’ « arc de crise», c'est à dire de cette portion de territoire qui s'étend des frontières sud de l'URSS à l'océan Indien. Le choix, comme piège pour l'Union soviétique, était donc tombé sur l'Afghanistan pour d’évidentes raisons géopolitiques et géostratégiques.
Du point de vue de l’analyse géopolitique, l'Afghanistan représente en fait un excellent exemple d'une zone de crise, où les tensions entre les grandes puissances se manifestent depuis des temps immémoriaux.
Le territoire actuellement dénommé République islamique d'Afghanistan, où le pouvoir politique a toujours été structuré autour de la domination des tribus pachtounes sur les autres groupes ethniques (Tadjiks, Hazaras Ouzbeks, Turkmènes, Baloutches), s’est constitué à la frontière de trois grands dispositifs géopolitiques: l'Empire mongol, le khanat ouzbek et l'Empire perse. Et ce sont les différends entre ces trois entités géopolitiques limitrophes qui détermineront son histoire.
Pendant les XVIIIe et XIXe siècles, lorsque l’État se consolidera en tant que royaume d’Afghanistan, la région deviendra l'objet de différends entre deux autres entités géopolitiques majeures: l'Empire de Russie et la Grande-Bretagne. Dans le cadre du «grand jeu », la Russie, puissance continentale, dans sa poussée vers les mers chaudes (océan Indien), l'Inde et la Chine, se heurte à la puissance maritime britannique, qui tente, à son tour, d’encercler et pénétrer la masse de l'Eurasie, vers l'est en direction de la Birmanie, de la Chine, du Tibet et du bassin du Yangtze, en s'appuyant sur l'Inde, et vers l'ouest en direction de l'actuel Pakistan, de l'Afghanistan et de l'Iran jusqu’au Caucase, à la mer Noire, à la Mésopotamie et au Golfe Persique.
Dans le système bipolaire, à la fin du XXe siècle, comme on l’a vu plus haut, l'Afghanistan est une fois de plus le théâtre de la compétition entre une puissance maritime, les USA, et une puissance continentale, l’URSS.
Aujourd'hui, après l'invasion étatsunienne de 2001, ce que Brzezinski avait, de façon présomptueuse, appelé le piège afghan des Soviétiques, est devenu le cauchemar et le bourbier des États-Unis.
* Directeur de Eurasia. Rivista di studi geopolitici – www.eurasia-rivista.org - direzione@eurasia-rivista.org
00:25 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, géopolitique, stratégie, déstabilisation, urss, union soviétique, afghanistan, moyen orient, asie, affaires asiatiques, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 10 décembre 2009
Une vie pour l'Irlande: Patrick Pearse
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1994
Une vie pour l'Irlande: Padraig Mac Piarais
 Poète, éducateur et soldat, tel fut Patrick Pearse (1879-1916), l'un des pères de l'Irlande libre. Jean Mabire, défenseur opiniâtre des patries charnelles et l'un des vrais inspirateur du renouveau révolutionnaire-conservateur en Europe, nous offre un élégant petit livre vert que tous les activistes des profondeurs serreront dans leur besace. Patrick Pearse, une vie pour l'Irlande est édité par l'association identitaire “Terre et Peuple”; c'est d'ailleurs son président, Pierre Vial, professeur d'histoire du Moyen Age à l'Université de Lyon, qui préface ce précieux bréviaire dédié à Michel Déon, autre amoureux de la Verte Erin et bel éveilleur lui aussi. Je tiens en effet La Carotte et le bâton (Table ronde) et Les Poneys sauvages (Gallimard) pour des livres essentiels à la formation d'une sensibilité antimoderne, que tous nos amis doivent avoir lu, au même titre qu'Henri Vincenot ou Jean Raspail (Le Camp des Saints, qui serait aujourd'hui interdit!). P. Vial souligne la principale qualité de Pearse: il fut un intellectuel organique dans le meilleur sens du terme, un homme dévoué à sa patrie jusqu'à la mort, et qui mit en accord ses pensées les plus profondes et ses actes les plus risqués. Comme Grundtvig ou Petöfi, Pearse voua sa vie à la cause des peuples, la plus noble qui soit. Aujourd'hui comme hier, Pearse demeure un modèle pour nous autres, patriotes continentaux, puisqu'il avait compris que le combat culturel précède toujours l'action politique et que celle-ci peut, quand l'état d'urgence (Ernstfall) l'exige, se transformer en révolution armée. Jean Mabire dresse un portrait complet et attachant du poète, initiateur de la Renaissance gaélique (des vers aux fusils, la route est parfois moins longue que prévu), car il avait compris que la langue, comme la géographie, cela sert aussi à faire la guerre! Pearse fut aussi éducateur de son peuple en créant le Collège où seront formés spirituellement (« Si l'Irlande spirituelle disparaît, alors l'Irlande réelle mourra aussi » aime à répéter Padraig Mac Piarais, forme gaélique de Patrick Pearse) et intellectuellement les Volunteers dont l'Irlande a tant besoin. Enfin, il assumera au moment voulu l'écrasante responsabilité de déclencher une révolte armée, la sixième en trois siècles, l'Uprising de Pâques 1916, écrasé dans le sang... par des bataillons de volontaires irlandais portant l'uniforme britannique. Pendant cette semaine folle et magnifique malgré le sang versé (une majorité de civils tués par les bombardements anglais: la tactique sera appliquée ailleurs, de Dresde à Bagdad), Pearse proclamera Poblacht na h Eireann, la République d'Irlande... même s'il fut un moment question de monarchie, avec un prince allemand comme Roi d'Irlande, ce qui aurait sans doute évité bien des drames. Au détour des pages, le.lecteur croisera d'autres géants de l'histoire irlandaise: Michael Collins et James Connolly le socialiste, qui fut l'ami du nationaliste Pearse. Tous deux furent fusillés par les Britanniques. L'émotion suscitée par ce meurtre, un crime, mais surtout une faute politique, devait faire passer la population dublinoise au départ hostile aux insurgés dans le camp de la résistance nationale. Du sacrifice de Pearse naquit l'Etat d'Irlande, encore mutilé à ce jour de ses comtés du nord.
Poète, éducateur et soldat, tel fut Patrick Pearse (1879-1916), l'un des pères de l'Irlande libre. Jean Mabire, défenseur opiniâtre des patries charnelles et l'un des vrais inspirateur du renouveau révolutionnaire-conservateur en Europe, nous offre un élégant petit livre vert que tous les activistes des profondeurs serreront dans leur besace. Patrick Pearse, une vie pour l'Irlande est édité par l'association identitaire “Terre et Peuple”; c'est d'ailleurs son président, Pierre Vial, professeur d'histoire du Moyen Age à l'Université de Lyon, qui préface ce précieux bréviaire dédié à Michel Déon, autre amoureux de la Verte Erin et bel éveilleur lui aussi. Je tiens en effet La Carotte et le bâton (Table ronde) et Les Poneys sauvages (Gallimard) pour des livres essentiels à la formation d'une sensibilité antimoderne, que tous nos amis doivent avoir lu, au même titre qu'Henri Vincenot ou Jean Raspail (Le Camp des Saints, qui serait aujourd'hui interdit!). P. Vial souligne la principale qualité de Pearse: il fut un intellectuel organique dans le meilleur sens du terme, un homme dévoué à sa patrie jusqu'à la mort, et qui mit en accord ses pensées les plus profondes et ses actes les plus risqués. Comme Grundtvig ou Petöfi, Pearse voua sa vie à la cause des peuples, la plus noble qui soit. Aujourd'hui comme hier, Pearse demeure un modèle pour nous autres, patriotes continentaux, puisqu'il avait compris que le combat culturel précède toujours l'action politique et que celle-ci peut, quand l'état d'urgence (Ernstfall) l'exige, se transformer en révolution armée. Jean Mabire dresse un portrait complet et attachant du poète, initiateur de la Renaissance gaélique (des vers aux fusils, la route est parfois moins longue que prévu), car il avait compris que la langue, comme la géographie, cela sert aussi à faire la guerre! Pearse fut aussi éducateur de son peuple en créant le Collège où seront formés spirituellement (« Si l'Irlande spirituelle disparaît, alors l'Irlande réelle mourra aussi » aime à répéter Padraig Mac Piarais, forme gaélique de Patrick Pearse) et intellectuellement les Volunteers dont l'Irlande a tant besoin. Enfin, il assumera au moment voulu l'écrasante responsabilité de déclencher une révolte armée, la sixième en trois siècles, l'Uprising de Pâques 1916, écrasé dans le sang... par des bataillons de volontaires irlandais portant l'uniforme britannique. Pendant cette semaine folle et magnifique malgré le sang versé (une majorité de civils tués par les bombardements anglais: la tactique sera appliquée ailleurs, de Dresde à Bagdad), Pearse proclamera Poblacht na h Eireann, la République d'Irlande... même s'il fut un moment question de monarchie, avec un prince allemand comme Roi d'Irlande, ce qui aurait sans doute évité bien des drames. Au détour des pages, le.lecteur croisera d'autres géants de l'histoire irlandaise: Michael Collins et James Connolly le socialiste, qui fut l'ami du nationaliste Pearse. Tous deux furent fusillés par les Britanniques. L'émotion suscitée par ce meurtre, un crime, mais surtout une faute politique, devait faire passer la population dublinoise au départ hostile aux insurgés dans le camp de la résistance nationale. Du sacrifice de Pearse naquit l'Etat d'Irlande, encore mutilé à ce jour de ses comtés du nord.
Padraig CANAVAN.
Jean MABIRE, Patrick Pearse. une vie pour l'Irlande, Editions Terre et Peuple, BP 1095, F-69612 Villeurbanne cedex, tél: 04.72.12.29.92. Prix: 85 FF. Sur l'Irlande, lire aussi, de Pierre Joannon, Michaël Collins (Table ronde) et Le Rêve irlandais (Artus), deux évocations passionnantes.
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, irlande, nationalisme irlandais, celtes, celtitude, monde celtique, pays celtiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 03 décembre 2009
Israël, le Likoud et le rêve sioniste
 Archives de Synergies Européennes - 1998
Archives de Synergies Européennes - 1998
Israël, le Likoud et le rêve sioniste
Le terme “sioniste”, en devenant un concept polémique voire une injure politique, ne désigne plus clairement une réalité politique, idéologique et historique. En entendant le terme “sioniste” dans la seule acception polémique qu’a inaugurée le conflit de Palestine, nos contemporains ne parviennent plus à saisir ce qu’a été cette idéologie avant la création de l’Etat d’Israël, dans les mouvements clandestins, et quelles ont été ses évolutions et ses mutations au cours de l’histoire israëlienne. A l’occasion du 50ième anniversaire de l’Etat d’Israël, il nous a semblé bon de conseiller la lecture d’un ouvrage de Colin Shindler, Israel, Likud and the Zionist Dream. Power, Politics and Ideology from Begin to Netanyahu (réf. infra). L’étude de Shindler commence en 1931, l’année où Zeev Vladimir Jabotinsky et ses camarades s’imposent lors du 17ième Congrès sioniste et lancent le “sionisme révisionniste” (qui obtient 21% des votes, contre 29% pour le Mapai modéré de Ben Gourion). En apprenant ces résultats, Chaim Weizmann, président de l’OSM (“Organisation Sioniste Mondiale”), est amer et ne mâche pas ses mots: pour lui, le “révisionnisme” est une gesticulation haineuse, de type hitlérien. Le clivage entre la gauche et la droite sionistes s’approfondit: le Mapai travailliste (fusion de l’Achdut Ha’avoda et de Hapoel Hatzair) s’oppose à la droite dont le noyau dur est le Betar de Jabotinsky, qui rejette le socialisme, “idéologie faible qui induit l’homme à ne plus déployer d’efforts, à cesser de combattre, de chercher le meilleur”. Et il ajoute: «[Dans le socialisme] la position de chacun serait régulée automatiquement, rien ne pourrait plus être changé, on cesserait de rêver, l’esprit ne se projetterait plus en avant et toutes les impulsions constructives de l’individu disparaîtraient». De même, Jabotinsky rejette injustement l’humanisme “dialogique” de Martin Buber, qu’il a verbalement agressé à plusieurs reprises: “ce provincial typique dans ses allures, un soi-disant penseur de troisième zone, qui énonce neuf dixièmes de phrases tordues pour une seule véhiculant une idée, qui n’est pas la sienne et n’a pas de valeur”. Jabotinsky reproche à Buber de “rêver” et de ne suggérer à la jeunesse juive que le rêve, sans concrétude aucune. Accusé de fascisme par les socialistes, Jabotinsky, toutefois, n’adhère pas à la formule italienne du fascisme et n’accepte pas, a fortiori, l’antisémitisme national-socialiste. Seuls quelques groupes, tel le Brit Ha’Biryonim, ont cultivé une certaine admiration pour Mussolini et même Hitler, tout en admirant les sicarii du Ier siècle de notre ère, qui assassinaient les collaborateurs juifs de Rome.
Le sionisme israëlien futur, dont celui du Likoud, sera un dérivé de ce “sionisme révisionniste” explique Shindler. Première étape dans l’évolution du “révisionnisme” sioniste: celle de la constitution de la “New Zionist Organization” (fondée en 1935) qui donne ensuite naissance à deux groupes armés, qui adopteront des politiques quelque peu différentes: l’Irgoun et le Groupe Stern. La différence entre les deux groupes de la “nouvelle organisation sioniste” repose surtout la façon de combattre la présence britannique en Palestine. Faut-il chasser les Anglais par la force ou composer avec eux? L’Irgoun s’était fait l’avocat d’une révolte immédiate contre les Britanniques en Palestine sous l’impulsion de Begin, apôtre de la désobéissance civile sur le modèle gandhiste. Après l’épisode de la “Nuit de cristal” en novembre 1938 et quand éclate la seconde guerre mondiale, Jabotinsky place sa confiance dans la diplomatie britannique et dans la personnalité de Churchill. Cette nouvelle option pro-britannique provoque d’âpres débats au sein de l’Irgoun. David Raziel, commandant militaire de l’Irgoun, opte également pour l’alliance avec Londres contre l’Axe et veut attendre la fin de la seconde guerre mondiale et l’élimination du national-socialisme en Europe, tandis que le Groupe Stern (plus tard le “Lehi”) veut démarrer la révolte juive avant la fin de la seconde guerre mondiale. Il avait fait des propositions à Mussolini à la fin des années 30: selon ce plan, les sionistes devaient s’allier avec l’Italie pour chasser les Anglais de Palestine, former un Etat hébreu de facture corporatiste et satellite de l’Axe et placer les lieux saints de Jérusalem sous la protection du Vatican. Cette proposition n’eut pas de lendemains, de même que l’offre faite à Hitler de recruter 40.000 soldats juifs d’Europe orientale pour chasser les Britanniques de Palestine. Hitler a préféré jouer la carte arabe. Néanmoins, Stern sabote le recrutement de soldats juifs de Palestine pour l’armée britannique. La police britannique abat Stern le 12 février 1942, éliminant le plus radical des sionistes anti-britanniques, ce qui laisse le champ libre à la politique pro-alliée de Jabotinsky et Raziel (qui meurt à la suite d’un raid aérien). Ya’akov Meridor prend sa succession à la tête de l’Irgoun et opte également pour la carte alliée et l’“armistice” avec les Britanniques.
Avraham Stern était un homme qui ne faisait pas confiance en Londres et s’inspirait de plusieurs sources: surtout l’IRA irlandaise, mais aussi l’action de Garibaldi en Italie, les sociaux-révolutionnaires russes et, sur le plan de la tradition juive, les animateurs de la révolte contre Rome. Stern s’est successivement adressé à Pilsudski en Pologne, à Mussolini et à Hitler pour demander leur appui contre les Britanniques, sous prétexte que ceux-ci sont les ennemis n°1 du rêve sioniste et que “les ennemis de nos ennemis sont nos amis”. Dès 1944, Begin, sûr de la défaite de l’Axe, donne l’ordre de commencer “la Révolte” contre l’administration britannique et de mettre un terme à l’“armistice”. Après 1945, les successeurs de Stern, c’est-à-dire le triumvirat Eldad, Yellin-Mor et Yitzhak Shamir, s’inspirent des terroristes russes du XIXième siècle, de Netchaïev et de Narodnaïa Volnia, demeurent anti-occidentaux et anti-britanniques et cherchent l’appui de l’URSS de Staline. Idéologiquement, explique Shindler, en dépit de la lutte commune contre l’administration britannique, l’Irgoun et le Lehi (= Groupe Stern) ne pouvaient pas fusionner: le Lehi était très jaloux de son indépendance et refusait tout contrôle par Begin. La carte soviétique du Lehi renouait avec la tradition de Stern (“les ennemis de nos ennemis sont nos amis”). Le Lehi considérait que Staline était le nouvel adversaire principal de l’Empire britannique, après la double disparition de Mussolini et de Hitler. A ce titre, le Vojd soviétique pouvait être considéré comme un allié du futur Israël. Yellin-Mor joue une carte plus bolchevique que ses compagnons: il garde une ligne anti-impérialiste radicale et appelle les sionistes à se joindre à tous les mouvements arabes anti-britanniques de la région. Begin, qui a été interné en URSS dans le goulag, est réticent. Shamir, lui, prend pour modèle Michael Collins, chef militaire de l’IRA, au point de prendre, en souvenir du chef irlandais, le nom de code de “Michael” dans la clandestinité. Il prône une lutte sans compromis contre Londres et entend déployer une propagande pro-sioniste en Amérique, pour créer un mouvement favorable à la création d’Israël comme De Valera et Connolly l’avaient fait pour l’Irlande. La littérature sur l’IRA devient lecture obligatoire pour les militants du Lehi. Shindler rappelle que David Raziel connaissait l’histoire de l’IRA par cœur et qu’Avraham Stern avait traduit en hébreu en 1941 le livre de P. S. O’Hegarty, The Victory of Sinn Fein.
Avec l’assassinat de Lord Moyne, ami personnel de Churchill, la Haganah de Ben-Gourion coopère avec les Britanniques et contribue à démanteler partiellement l’Irgoun. Le Lehi, plus clandestin, est relativement épargné. Begin est horrifié au spectacle de l’Haganah tuant des Juifs pour le service d’une puissance tierce. En novembre 1945, seulement, après le refus du nouveau gouvernement travailliste britannique de mener une politique pro-sioniste inconditionnelle, les trois forces (Haganah, Irgoun, Lehi) acceptent un armistice et cessent de se combattre mutuellement. Cette trêve durera jusqu’en août 1946, où Ben Gourion dénoncera les campagnes sanglantes de l’Irgoun (Hôtel King David, Deïr Yassin, etc.).
Après 1948, Begin initie un processus d’alliances et de fusions avec les divers éléments de droite et les factions dissidentes des milieux travaillistes: ainsi son mouvement Herout devient le Gahal en 1965 et le Likoud en 1973. Bien qu’ayant dû accepter l’armistice avec les Britanniques pendant le seconde guerre mondiale, Begin n’a jamais admis leur politique de donner la rive occidentale du Jourdain à l’Emir Abdoullah de Jordanie dans les années 20 ni celle des Nations-Unies de donner ce même territoire aux Palestiniens en 1947. Dans cette revendication, Begin est demeuré fidèle à Jabotinsky qui réclamait pour les Juifs tous les territoires à l’Ouest du Jourdain (la Judée et la Samarie). S’il a redonné le Sinaï à l’Egypte de Sadat, Begin n’a jamais lâché la Cisjordanie, qu’il percevait comme un glacis pour protéger le peuplement juif de Palestine, refuge ultime en cas de nouvelles persécutions en Europe. La conquête du Sud-Liban par Sharon est dans la logique de cette idéologie d’Israël-camp-retranché.
Yitzhak Shamir prend le relais dans le Likoud, bien qu’il soit issu du Groupe Stern anti-britannique. Shamir est un pragmatique, pour qui les pages de la seconde guerre mondiale et de l’opposition des Juifs au mandat britannique sont définitivement tournées, même si la saga du combat sioniste armé et clandestin doit toujours être donnée en exemple aux jeunes générations de “sabras”. Le salut de la droite israëlienne ne réside à ses yeux que dans le Likoud, les autres partis étant trop modestes numériquement. Shamir refuse de rester dans les cercles et petits partis issus du nationalisme anti-britannique, c’est-à-dire du Lehi et de ses satellites. Shamir s’allie donc aux pragmatiques du Likoud, rassemblés autour de Moshe Arens.
Avraham Stern a toutefois légué à Shamir l’idée d’un “Très Grand Israël”, du Nil à l’Euphrate. Raison pour laquelle, en dépit de son pragmatisme et de son refus de s’enfermer dans les petits partis dérivés du Lehi, Shamir est resté un adversaire des accords de Camp David. L’idéologie et la pratique de Shamir a donc sans cesse oscillé entre le maximalisme de Stern et le pragmatisme de Ben Gourion, dont il ne partageait pourtant pas la théorie d’une fédération de deux Etats, l’un palestinien, l’autre juif. Shindler rappelle que les actions du Groupe Stern et du Lehi ont toujours été mûrement réfléchies et n’ont jamais été des gestes spectaculaires et irréfléchis. Face à Begin, qui aimait “mélodramatiser” ses interventions et rappelait sans cesse le sort tragique des Juifs d’Europe, Shamir demeurait plus austère dans ses propos mais pratiquait dans le dialogue avec les Palestiniens une “approche immobile”, disant de lui-même qu’il aurait pu faire traîner les négociations pendant dix ans s’il l’avait fallu.
Netanyahu est aujourd’hui l’héritier de cette idéologie complexe, qui a pour point commun de faire vivre et survivre coûte que coûte l’Etat d’Israël dans un environnement hostile, mais où des inimitiés anciennes sont bien présentes, focalisées autour des concepts de “Petit Israël” (avec la Cisjordanie) ou de “Très Grand Israël” (du Nil à l’Euphrate).
L’ouvrage de Shindler est important, pour connaître tous les méandres de l’histoire du sionisme et d’Israël, pour prendre acte de la complexité de la question palestinienne.
Benoît DUCARME.
Colin SHINDLER, Israel, Likud and the Zionist Dream. Power, Politics and Ideology from Begin to Netanyahu, I. B. Tauris, London/New York, 1995, 324 p., $39.50, ISBN 0-85043-969-9.
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, sionisme, israël, judaica, judaïsme, terrorisme, années 20, années 30, années 40, palestine, proche orient |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 01 décembre 2009
Fascismo, Nazionalsocialismo, gli Arabi e l'Islam
| Fascismo, Nazionalsocialismo, gli Arabi e l’Islam
| |
|
|
| |
| Giovanna Canzano ha incontrato per Rinascita lo scrittore e storico Stefano Fabei Nei primi otto anni di potere Mussolini non portò avanti un’autonoma politica araba per diverse ragioni: la politica estera italiana aveva come punto di riferimento quella inglese e dall’andamento dei rapporti con la Gran Bretagna dipendeva l’atteggiamento di Roma verso gli arabi; inoltre gli impulsi a una politica estera rivoluzionaria, verso questa parte del mondo, sostenuta dai fascisti più dinamici, erano soffocati dall’influenza esercitata sul regime da nazionalisti e cattolici conservatori. |
00:10 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : monde arabe, islam, italie, allemagne, années 30, années 40, deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale, méditerranée |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Yukio Mishima et le Jieitai

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998
Yukio Mishima et le Jieitai
«Quand le tonnerre gronde dans le lointain, le temps qui passe à travers la lumière de la lampe, qui frappe à travers la fenêtre, et le son sourd qui s’ensuit paraissent incroyablement long. Dans mon cas particulier, il a duré vingt ans. La voix des héros disparus est la voix de la lampe. Dans un futur proche, la rumeur nostalgique du tonnere fera vibrer nos ventres virils et avec la promesse de fécondités sauvages fera vibrer aussi le cœur du Japon».
Cette phrase, Mishima l’a écrite dans la préface à Vie et mort de Hasuda Zenmei de la Kodakane Jirô. Il m’apparait superflu de souligner que Hasuda Zenmei a contribué durablement à la formation spirituelle et idéologique de l’adolescent Mishima. On le sait aujourd’hui: Hasuda, le 19 août 1945, peu de jours avant la défaite du Japon, servait encore l’Empire au titre de commandant de compagnie dans une base proche de Singapour. Hasuda apprend que le commadant du régiment avait lu lui-même à la troupe la déclaration de reddition de l’Empereur et avait demandé à ses hommes de donner le drapeau à l’ennemi. Hasuda le tue à coups de revolver et puis se suicide.
La signification de la mort de Hasuda est restée longtemps obscure, y compris pour Mishima: «Quand j’ai compris son geste, j’étais proche de la quarantaine: un âge peu éloigné de celui du Disparu... La signification d’une telle façon de mourir, comme une fulguration improvisée, a soudain éclairé les ténèbres épais qui assombrissaient mon propre long cheminement...». Cette fameuse préface nous explique quels sont les rapports entre Hasuda et Mishima, mais elle nous livre aussi, pour la première fois, explicitement, la clef de voûte qui explique le propre suicide de Mishima et révèle l’arrière-plan politique, historique et culturel qui l’a justifié.
Cependant, si l’on jette un regard plus attentif, derrière les allégories de la “lampe” et du “tonnerre”, on repère, cachées, les étapes de l’iter spiritualis de Mishima. Pour beaucoup de citoyens dont les années d’adolescence et de jeunesse se sont passées pendant la guerre, l’expérience guerrière est devenue a posteriori un point de référence existentiel et politique indépassable. En particulier, pour tous les Japonais, qu’ils soient de droite ou de gauche, la défaite de 1945 est une expérience communément partagée et le turning point le plus significatif du siècle. Yukio Mishima se souvient de cette expérience comme d’un sentiment de bonheur indicible, désormais perdu: «... Mis à part toute autre considération, il n’était pas étrange, à cette époque, pour les pilotes kamikaze, d’écrire: Tenno Heika Banzai (= Vive l’Empereur!). Admettons que cette époque puisse revenir, ou revenir sous une autre forme ou ne jamais revenir. Et pourtant, moi, cette époque où il n’était pas étrange d’écrire [cette parole], je l’ai connue, et le fait de l’avoir connue, en y pensant, me donne une incroyable sensation de bonheur. Mais quelle fut cette expérience? Quelle fut cette sensation de bonheur?» (Débats sur les Japonais).
Plus tard, cependant, cette “sensation de bonheur”, ressentie par l’adolescent Mishima, qui avait entrevu la guerre sous la forme de la “lumière d’une lampe”, chavire misérablement avec la défaite. La “sensation du tonnerre”, qui s’ensuivit, et qui aurait apporté ce bonheur, n’a plus jamais été ressentie. Yukio Mishima va vivre le temps de l’après-guerre (“une époque faite de fictions”, “un veillissement en toute harmonie”), pendant vingt-cinq années “terriblement longues” pour se retrouver lui-même transformé en “lampe”, pour faire vibrer par son propre “tonnerre”, d’acier et de sang, le cœur des hommes, le flux de l’histoire.
Les banderoles qu’il a fait claquer au vent sur la terrasse du Quartier Général d’Ichigaya le 25 novembre 1970 proclamaient: «Nous, les hommes du TATE-NO-KAI (= Secte des Boucliers/“Shield Society” selon la propre traduction anglaise de Mishima) avons été élevé par le Jieitai (le “Corps d’Auto-Défense”, soit l’actuelle armée japonaise, ndlr). En d’autres morts, le Jieitai a été pour nous un père, un frère aîné. Alors pourquoi avons-nous été poussés à commettre une telle action? Moi, depuis quatre ans, les autres membres étudiants de notre société, depuis trois ans, avons été acceptés dans le Jieitai à titre de quasi-officiers, nous avons reçu une instruction sans autre fin. Par ailleurs, nous aimons le Jieitai profondément, nous avons rêvé du véritable Japon, de ce Japon qui n’existe plus désormais en dehors de ces murs d’enceinte. C’est justement ce Japon que nous avons pleuré pour la première fois, nous, hommes nés après la guerre. La sueur que nous avons dépensée est pure. Tous ensemble, nous avons couru et marché à travers les champs aux pieds du Fukuyama, nous étions des camarades unis par l’esprit de la patrie. Nous n’avons aucun doute. Pour nous, le Jieitai est comme un pays natal. Dans la sordidité du Japon actuel, nous avons réussi à respirer seulement en ce lieu, où l’air est excitant. L’esprit qui nous a été communiqué par les officiers et les instructeurs est indépassable. Alors pourquoi avons-nous posé un acte aussi extrême? Cela peut paraître un paradoxe, mais j’affirme que nous l’avons posé parce que nous aimions le Jieitai» .
Vingt-sept ans se sont écoulés depuis le suicide de Mishima et le Jieitai, qu’il avait tant aimé, a changé lentement. Il avait été une sorte de “Cendrillon” des institutions japonaises; il s’est transformé en une armée quasi normale et respectée. Dernièrement, il a participé (ironie de l’histoire!) pour la première fois aux activités de “pacification” sous la bannière de l’ONU au Cambodge, à Madagascar et au Liban. Désormais, le Parti Socialiste (social-démocrate) japonais le “reconnaît”. Deux occasions ont permis au Jieitai de se placer sous les feux de la rampe: l’action humanitaire menée à la suite du tremblement de terre de Kobe et l’aide technique apportée aux forces de police lors de l’attaque au gaz neurotoxique perpétré par la secte Aum Shinri-kio, il y a deux ans.
Le problème fondamental pour le Japon demeure toutefois la constitution pacifiste imposée par les Alliés après 1945. L’article 9 de cette constitution interdit au pays de façon unilatérale l’usage de la force (militaire). C’est le plus gros obstacle à la restauration complète des droits de l’Etat japonais. Mishima, dans un bref essai intitulé Le Tate-no-kai, publié dans la revue anglaise Queen, écrivait à propos de la constitution pacifiste: «Je suis las de l’hypocrisie de l’après-guerre japonais: par là, je ne veux pas dire que le pacifisme est une hypocrisie, mais vu que la Constitution pacifiste est utilisée comme excuse politique tant par la gauche que par la droite, je ne crois pas qu’il existe un pays au monde, mis à part le Japon, où le pacifisme est autant synonyme d’hypocrisie. Dans notre pays, le mode de vie que tous honorent est celui d’une existence définitivement soustraite à tout danger, un mode de vie tout compénétré de sinistrose, celui des pacifistes et des adeptes de la non-violence. En soi, cette chose n’est pas criticable, mais le conformisme exagéré des faux intellectuels m’a convaincu que tous les conformismes sont une calamité et que les intellectuels, au contraire, devraient mener une vie dangereuse. D’autre part, l’influence des intellectuels et des salons socialistes s’est développée de manière absurde et ridicule. Ils conseillent aux mères de ne pas donner à leurs garçons des jouets imitant des armes à feu et considèrent que c’est du militarisme d’aligner les enfants sur des files à l’école et de leur demander de se nommer et d’énoncer leur numéro... ce qui a pour résultat que les enfants se rassemblent de manière éparpillée et mollement comme une bande de députés».
L’action de Mishima, de Morita et des autres membres du Tate-no-kai au Quartier Général d’Ichigaya fut pour l’essentiel un acte symbolique, destiné à donner le coup d’envoi à une révision de la constitution et à la transformation du Jieitai en une armée nationale légitime. Dans un certain sens, l’échec apparent de cette tentative a toutefois été le point de césure entre les deux droites japonaises: la droite contre-révolutionnaire des années 60 et la nouvelle droite radicale des années 70 (Shin-Uyoku).
Giuseppe FINO.
(article issu de Marginali, n°22, avril 1998).
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : mishima, japon, extreme orient, littérature, lettres, lettres japonaises, littérature japonaise |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 30 novembre 2009
Une biographie du Maréchal Mannerheim
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998
 Une biographie du Maréchal Mannerheim
Une biographie du Maréchal Mannerheim
Heureuse initiative des éditions M. La Maule que de traduire du suédois la biographie du Maréchal Mannerheim (1867-1951), le De Gaulle finlandais. Officier de l'armée impériale russe, aide de camp du Tsar Nicolas II en 1912, Gustaf Mannerheim prend la tête des troupes blanches qui pulvériseront les Bolchéviks sur le Front de Finlande, garantissant l'indépendance du pays des mille lacs. La Finlande, comme la Pologne d'un autre grand maréchal, donne ainsi l'exemple d'une résistance victorieuse au communisme, parce qu'ancrée dans une conscience populaire et ethnique clairement profilée: une réalité charnelle, même numériquement inférieure, triomphe toujours d'une abstraction, fût-elle colossale. Mannerheim, comme plus tard en Espagne ou au Chili, aura sauvé son pays de la terreur léniniste. Dans les années 30, Mannerheim fait tout pour préparer son pays à l'inévitable affrontement avec Staline. Et en 1939, il prend à nouveau la tête des armées finlandaises lors de la Guerre d'Hiver, modèle de guérilla bien menée et occasionnant un maximum de pertes à l'Armée rouge. Parmi les Gardiens de la Démocratie et du Droit, lisez la City de Londres et la calamiteuse IIIième République, nul ne s'opposa concrètement à cette invasion d'un pays neutre: les Finlandais mobilisent tous leurs hommes de 15 à 70 ans, et aussi leurs femmes, les formidables Lotta qui épauleront leurs compagnons, leurs fils et leurs maris, avec une détermination qui nous laisse encore pantois. Les mêmes démocrates français et britanniques, idolâtres de principes ronflants et de monnaies sonnantes et trébuchantes, précipiteront le continent dans une guerre suicidaire pour “défendre la Pologne” (sauf la partie envahie par les Russes): 120.000 soldats français mourront pour Dantzig, mais non pour Katyn. Episode peu connu de la IIième Guerre civile européenne, l'auteur de cette passionnante biographie rappelle la complexe partie de cache-cache de l'armée finlandaise avec les troupes allemandes durant le Guerre de Continuation, qui verra leur pays amputé de la Carélie et de Vyborg, vidées de leur population et soviétisées, c'est-à-dire sinistrées. L'ouvrage du professeur S. Jagerskiold, diplomate et juriste, constitue une excellente introduction à l'histoire contemporaine —et à l'esprit— de la Finlande, qui présidera bientôt l'Union Européenne.
Patrick CANAVAN.
S. JAGERSKIOLD, Gustaf Mannerheim, M. de Maule (27 rue Montorgueil, F-75.001 Paris), 148 FF. Une seule critique: peu de cartes et aucune photo, contrairement à l'édition allemande recensée dans Orientations n°9/1987.
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : finlande, histoire, deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale, biographie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 26 novembre 2009
L'art et la guerre: de Céline à H. G. Wells
Paul MODAVE :
L’art et la guerre : de Céline à H. G. Wells
Article paru dans « Le Soir », Bruxelles, le 18 juillet 1944
Au moment où l’invasion et les bombardements aériens dévastent les cités d’art de l’Occident, l’hebdomadaire français « la gerbe » vient d’ouvrir une enquête auprès des personnalités représentatives des lettres françaises afin d’offrir à celles-ci l’occasion de manifester leur réaction devant le saccage du pays.
 Ce qui frappe dans beaucoup de ces réponses, c’est leur réticence. Ainsi M. de Montherlant ne voit dans cette enquête qu’une « recherche académique ». M. Georges Ripert, doyen de la Faculté de Droit de Paris, regrette que « dirigeant une maison où il y a beaucoup de jeunes gens, il lui soit impossible d’accorder d’interview » ; quant à Ferdinand Céline, il répond sans ambages « qu’il donnerait toutes les cathédrales du monde pour arrêter la tuerie », ce qui est une plaisante façon de ne rien dire.
Ce qui frappe dans beaucoup de ces réponses, c’est leur réticence. Ainsi M. de Montherlant ne voit dans cette enquête qu’une « recherche académique ». M. Georges Ripert, doyen de la Faculté de Droit de Paris, regrette que « dirigeant une maison où il y a beaucoup de jeunes gens, il lui soit impossible d’accorder d’interview » ; quant à Ferdinand Céline, il répond sans ambages « qu’il donnerait toutes les cathédrales du monde pour arrêter la tuerie », ce qui est une plaisante façon de ne rien dire.
Commentant cette enquête dans « L’Echo de la France », M. Robert Brasillach s’exprime en ces termes : « Les professionnels de l’art savent bien, Céline aussi bien entendu, que la destruction des cathédrales ou des palais n’arrêtera pas pour cela la tuerie. Mais voilà, dire qu’on désapprouve —ce serait bien timide cependant— la destruction inutile de la beauté du monde, c’est donner des gages à l’Allemagne, paraît-il ! On a passé trente, quarante ans à discuter sur l’art et à plaindre nos civilisations mortelles, mais lorsque les trésors de cet art sont renversés par le souffle des machines à détruire, on se tait. On dira ce que l’on pense après la guerre, bien sûr, nuancé à la couleur du vainqueur, s’il y a un vainqueur et s’il y a une après-guerre ».
Et après avoir constaté que le dernier témoignage de liberté d’esprit aura été fourni par les cardinaux de France et de Belgique, M. Brasillach conclut par ses mots : « Aujourd’hui, la parole est aux forces et à leurs rapports. Tout s’est simplifié. Mais on pense seulement que la beauté du monde est chaque jour assassinée, et qu’un univers où risquent de manquer demain, Rouen, Caen, Pérouse, Sienne, Florence, n’est pas un univers dont les artistes, fût-ce par leur silence, aient le droit de se dire fiers. Si le « saint Augustin bouclé », de Benozzo Gozzoli, est détruit, dans ses fresques dorées de San-Gimignano, si la « Charité » ne rayonne plus sur les murailles d’Assise, si, de même qu’on ne peut plus errer au pied des plus nobles façades médiévales de Rostock ou de Hambourg, demain c’est le quai aux Herbes de Gand, qui s’effondre dans le néant où sont déjà les rues rouennaises et les églises de Caen ; et si l’on trouve cela tout naturel et si l’on ne souffre pas dans son cœur de civilisé, alors il me semble qu’on perd le droit de parler de culture et de barbarie, qu’on perd le droit, dans l’avenir, d’affirmer que l’on aime l’Italie, l’art roman, la sculpture française si tendre et si virile, il me semble que le silence qui sert aujourd’hui d’alibi devrait être le silence de toute une vie ».
On ne peut pas mieux dire. Mais dans le même moment où les artistes français se montrent si discrets ou si réticents, l’écrivain anglais H.-G. Wells, dans un article paru dans « Sunday Dispatch », bientôt repris dans le périodique « World Review », exprime ainsi son opinion sur la destruction des monuments d’art de l’Italie : « Dans tout ce territoire, il n’y a pas une seule œuvre d’art, à l’exception peut-être de manuscrits pouvant être mis facilement à l’abri, qui ne puisse être entièrement détruite, et l’héritage de l’humanité n’en éprouvera pas la moindre perte en beauté. Nous possédons notamment les maquettes de toutes ces statues qui peuvent être copiées, y compris leur patine ».

J’espère que nos lecteurs auront savouré comme il convient l’humour —hélas ! inconscient— de M. H.-G. Wells. Mais il ne s’agit pas d’une boutade. Pour l’auteur, auteur particulièrement sérieux mais aussi évidemment privé du sens de l’art que l’aveugle du sens des couleurs, ne comptent que les statues cataloguées dont on possède les maquettes ! La qualité originale d’une œuvre, le milieu spirituel dont elle fait partie intégrante, lui échappe avec une certitude indiscutable. Et il le prouve bien lorsqu’il déclare plus loin, avec autant de pédantisme béat que de solennelle bêtise : « L’art et le goût de l’art sont de suprêmes offenses au charme inépuisable des créations de la nature ».
Alors qu’il n’est que trop évident que l’art est exactement le contraire, c’est-à-dire une action de grâce, un cri d’amour et de reconnaissance devant la beauté de la vie !
Au pays basque, au déclin d’une belle journée, il n’est pas rare que des couples de paysans se mettent, en pleine campagne, à danser et à chanter, pour rien, pour personne, pour la joie de vivre. L’art n’est pas autre chose, à l’origine, que ce chant et cette danse. Mais revenons à M. Wells, qui se hâte d’ajouter : « L’œil embrasse plus de beauté en contemplant un oiseau qui plane, un poisson qui s’ébat dans l’eau, les reflets dans une chute d’eau ou toutes les ombres qui se dessinent sous les branches d’un arbre éclairé par le soleil que nous, misérables gâcheurs, puissions espérer imaginer ou imiter ».
Certes. Mais selon le mot de Debussy : « Les gens n’admettent jamais que la plupart d’entre eux n’entendent ni ne voient » et c’est le rôle de l’artiste de leur ouvrir les oreilles et les yeux à la beauté du monde. Il est trop facile, presque élémentaire, d’énumérer ici ce que chaque artiste nous enseigne au premier coup d’œil : Rubens, la joie triomphante de vivre ; Renoir, la beauté rayonnante de la créature humaine ; Vermeer de Delft, le charme profond des intérieurs où se jouent les lumières et les ombres ; Chardin, la secrète poésie qui vit au cœur des plus humbles objets, des plus usuels. Tout cela et bien davantage encore…
Je sais, hélas ! qu’il n’en est plus ainsi : que ces échanges permanents entre la vie et l’art ne nous sont plus sensibles ; que l’art, né spontanément de la vie, a cessé de nous y ramener avec des facultés plus vives et plus aigües. Les esthètes restent confinés dans un étouffant esthétisme qui n’a d’autre fin que lui-même. Les « viveurs », si je puis les appeler ainsi, ceux qui « vivent leur vie » comme ils disent, m’apparaissent aussi peu soucieux de la beauté des oiseaux qui planent que de la grâce des poissons qui s’ébattent, n’en déplaise à M. Wells. Qu’est-ce que cela veut dire sinon que l’homme a cessé de mettre en jeu toutes ses facultés, de vivre pleinement ? C’est là une des raisons les plus profondes de notre décadence.
Céline, contempteur du monde moderne, pas plus que Wells qui s’en fait l’apologiste, n’y ont trouvé de remède. C’est que l’un et l’autre appartiennent à différents égards, à cette décadence que le Docteur Carrel a si bien diagnostiquée : « Nous cherchons à développer en nous l’intelligence. Quant aux activités non intellectuelles de l’esprit, telles que le sens moral, le sens du beau et surtout le sens du sacré, elles sont négligées de façon presque complète. L’atrophie de ces qualités fondamentales fait de l’homme moderne un être spirituellement aveugle ».
Et, pour revenir au sujet de cet article, cela explique bien des erreurs de jugement, bien des réticences, bien des silence…
Paul Modave.
00:15 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale, céline, littérature française, lettres françaises, lettres, littérature, histoire, brasillach, 1944, années 40 |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 25 novembre 2009
Les mémoires de Jaruzelski
 Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1996
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1996
Les mémoires de Jaruzelski: notes sur le rôle de l'homme d'Etat
Au début de l'été 1992, le général polonais Wojciech Jaruzelski publiait un livre de mémoires politiques. Il y décrivait les événements politiques qui ont secoué la Pologne à partir du 13 décembre 1981, jour où l'état de siège a été proclamé. Moscou craignait qu'une Pologne déstabilisée ferait vaciller le système de domination soviétique. Raison pour laquelle l'ordre communiste fidèle à Moscou devait être promptement rétabli. Jaruzelski a donc reçu pour mission de maintenir son pays dans l'orbite soviétique, même en faisant usage de la violence, si cela s'avérait nécessaire. Les chapitres de son livre dévoilent des réalités peu connues de l'histoire polonaise des années 1980-85. Bien que “socialiste” et adepte du “socialisme réellement existant” de l'époque et du système soviétique, le militaire Jaruzelski nous apparaît toutefois, après les événements tumultueux du début des années 80, comme une sorte de “katechon” conservateur, c'est-à-dire, pour reprendre la définition de Carl Schmitt, comme un homme d'Etat qui se donne pour tâche de rétablir l'ordre et de préserver les institutions de son pays du chaos et du déclin. Bien entendu, pour nous, le communisme reste un corps étranger à la nation polonaise et le mouvement “Solidarité” de Walesa une expression spontanée de la colère populaire. Néanmoins, tout observateur neutre, aujourd'hui, admettra que des services spéciaux étrangers ont manipulé “Solidarnosc”, dans le but évident de faire sauter le système soviétique, déjà sérieusement gangréné. Cette opération de déstabilisation ne pouvait évidemment s'effectuer que là où le système était le plus faible, entre le grand espace soviétique et le territoire de l'ex-RDA (qui, disposant du balcon thuringien, servait de base au fer de lance du Pacte de Varsovie).
Les forces consrvatrices et les militaires de l'orbite soviétique ne pouvaient pas tolérer un développement, certes démocratique, mais néanmoins “aventureux” dans le rapport de forces de l'époque. Jaruzelski a été chargé de sauver la situation: en tant que militaire, il a obéi aux ordres de ses supérieurs du monde politique. L'état d'esprit de Jaruzelski se révèle clairement dans le livre. On peut le qualifier de conservateur-mainteneur, de “katechonique”, au sens où l'entendait Carl Schmitt. Plusieurs extraits de l'ouvrage en attestent: «On ne choisit pas l'espace historique et géographique dans lequel on nait. Parmi les hommes de ma génération, on en trouve très peu qui soient taillés d'un seul morceau de bois. La vie nous a formé avec les copeaux du destin et sur les croisées des chemins. Nous étions les enfants de notre époque, de notre milieu, de notre système. Chacun, à sa façon, est sorti de ce cadre. Mais tous ceux qui en sont rapidement sortis ne méritent pas notre respect. Et ceux qui n'en sont sortis que fort tard ne méritent pas tous notre mépris. Le plus important, c'est de savoir par quoi ces hommes se sont laissé guider individuellement, comment ils se sont comportés, ce qu'ils ont fait et ce qu'ils sont devenus aujourd'hui en tant qu'hommes» (p. 8). «En tant que soldat, je sais qu'un chef militaire, que tout supérieur hiérarchique est responsable pour tout et pour tous. Le mot “excuse” peut ne rien signifier, mais je ne trouve pourtant pas d'autres mots. Je voudrais ne demander qu'une seule chose: s'il y a des hommes pour qui le temps n'a pas guéri les blessures, n'a pas apaisé la colère, alors qu'ils tournent cette colère surtout contre moi, mais non pas contre ceux qui, dans des circonstances données, honnêtement et de bonne foi, ont sacrifié de nombreuses années de leur vie et donné toute leur capacité de travail pour la reconstruction de notre patrie» (p. 9).
Dans sa conclusion, Jaruzelski s'exprime dans un style clairement “katechonique”: «Des situations et des mesures exceptionnelles conduisent souvent à des flots de sang. Nous savons que dans de nombreux pays, l'état d'exception a coûté la vie à des milliers et des milliers d'hommes. Nous, en revanche, avons pris cette décision dramatique, afin, justement, de ne pas déboucher sur une telle tragédie. En grande partie, nous avons réussi ce coup de poker. Malheureusement, pas à 100%. Dans la mine de Wujek, on a dû faire usage d'armes à feu et neuf mineurs sont morts. Cet événement douloureux jette encore aujourd'hui une ombre sur l'ensemble des décisions prises à cette époque» (p. 465). Sa prise en compte objective et froide des forces humaines en présence sur l'échiquier politique révèle une proximité de pensée entre Jaruzelski et les conservateurs “katechoniques” comme Donoso Cortés, Joseph de Maistre ou Constantin Frantz: «Dans l'appareil du pouvoir, il y avait beaucoup d'hommes réfléchis, cultivés et expérimentés. Malheureusement, une somme de têtes intelligentes ne donne pas automatiquement un surplus d'intelligence. Souvent, on est tiré vers le bas par les idiots qui, par fanatisme, démagogie et arrogance, font en sorte que même les meilleures intentions sont exprimées en un langage faux et inacceptable. Tant pour des raisons objectives que pour des raisons subjectives, l'assise gouvernementale n'a pas été substantiellement élargie. Beaucoup d'hommes de valeur, qui ne voulaient s'engager ni d'un côté ni de l'autre, ont été poussés dans la marginalité» (p. 466).
Le général polonais perçoit parfaitement la différence entre mythologie et pragmatisme sur l'échiquier politique: «La mythologie est une composante ineffaçable de la vie de toute société. Le concept d'“éthique de la solidarité (Solidarnosc)” n'échappe pas à cette coloration mythologique, même s'il perd considérablement de son tonus aujourd'hui. C'est sans doute Pilsudski qui a dit, un jour, que les Polonais “ne pensaient pas en termes de faits, mais de symboles”. Le pragmatisme a d'incontestables avantages en politique et devrait en fait servir de guide pour toutes les équipes dirigeantes. Mais le pragmatisme seul ne suffit pas. Il demeure sec et gris si ses représentants n'en appellent pas en même temps aux fondements émotionnels de la conscience collective et individuelle» (p. 469). Jaruzelski reste sceptique lorsqu'il observe l'emprise totale du libéralisme économique dans les anciens pays du bloc de l'Est: «Je crains que diverses paroles vengeresses qui appellent à la “dé-communisation” ne détournent notre attention des objectifs essentiels; elles pourraient conduire à un éparpillement des efforts de notre société. Ce serait mortel pour la Pologne, au véritable sens du mot. Cela ne peut que nuire aux intérêts de notre pays, si l'on cherche des objectifs de remplacement dans ce monde marqué par la rivalité, la compétition et la concurrence et qu'on gaspille dans une telle démarche les énergies de la société» (p. 470).
Jaruzelski a donc défendu et sauvé un Etat imprégné de soviétisme, sans, semble-t-il, être un adepte de l'idéologie communiste. Pourquoi a-t-il alors agit de la sorte? Le chapitre 28 de son livre nous donne une réponse très détaillée et fort intéressante. Le principal, pour le Général, était de sauver la souveraineté de la Pologne: «Y avait-il une chance pour la Pologne, après la seconde guerre mondiale, d'exister en tant qu'Etat pleinement indépendant sans influence soviétique? (...) Les conférences de Téhéran, Yalta et Potsdam déterminent l'histoire contemporaine et les historiens en discutent à l'infini (...). La majorité des politiciens de cette époque ont dû, bon gré mal gré, accepter les accords de Yalta, les considérer comme le réel donné (...). L'ordre existant forçait aussi la Pologne à accepter ses règles et déterminait la marge de manœuvre du pays. En tant que militaire, je ne pouvais pas agir comme si je ne le savais pas» (pp. 302-303).
Jaruzelski rappelle ensuite à ses lecteurs une lettre qu'il a écrite en 1945 à sa mère et à sa sœur: «Je suis obligé de servir la Pologne et de travailler pour elle, peu importe les contours qu'elle prendra et les sacrifices qui seront exigés de nous» (p. 304). Le jeune officier polonais de l'époque voulait servir son pays sous la forme d'un Etat réellement existant, servir une Pologne “peu importe les contours" qu'elle aurait pris; le jeune Jaruzelski voulait se donner ce devoir et le hisser au-dessus de toutes les autres considérations. Les patriotes allemands estimeront sans doute que cette profession de foi est peu pertinente et intenable, mais, pour le meilleur et pour le pire, elle est bel et bien une attitude typique dans le corps des officiers polonais, où le service et le devoir semblent être plus importants que les facteurs ethniques et historiques ou que les constructions idéologiques. Jaruzelski esquisse, dans ce 28ième chapitre, la teneur des querelles qui ont opposés les Polonais de Londres, rassemblés autour du Général Anders, et les Polonais de Moscou. Les puissances occidentales n'ont jamais garanti les frontières occidentales de la Pologne, au contraire de l'URSS. Aux yeux de Jaruzelski, l'Union Soviétique apparaissait dès lors comme un garant fiable et un allié solide. Seule l'URSS, à l'époque, garantissait l'existence d'un Etat polonais dans des frontières fixées une fois pour toutes et clairement tracées. Les Polonais de Londres voulaient restaurer les frontières de 1939, ce que les Soviétiques n'auraient jamais accepté, parce que la Pologne avait annexée en 1921 de larges portions des territoires biélorusse et ukrainien. Comme les Soviétiques avançaient vers l'Ouest et disposaient de la plus puissante armée, la Pologne risquait d'être réduite aux dimensions qu'elle avait après le Congrès de Vienne en 1815, c'est-à-dire les dimensions et la configuration géographique d'un pays très réduit, aux frontières démembrées, impossibles à défendre. Cette prépondérance militaire soviétique et le refus de Moscou de rendre les territoires pris en 1921 par les armées polonaises victorieuses, a scellé le destin tragique des populations allemandes de Poméranie, de Prusse Orientale, de Dantzig, de Silésie et de Posnanie: une Pologne alliée à l'Union Soviétique devait nécessairement rendre les territoires biélorusses et ukrainiens et être élargie à l'Ouest, aux dépens des Allemands.
Les ennemis de Jaruzelski soulignent que la Pologne a été asservie dans le cadre du Pacte de Varsovie. A ce reproche, le Général répond qu'il existe deux formes de souveraineté limitée: 1) La limitation volontaire dans l'intérêt de l'Etat ou d'un groupe d'Etats alliés; 2) La limitation qui a les caractéristiques d'un protectorat. Jaruzelski admet que la Pologne a été un protectorat jusqu'en 1956, ensuite, elle a “bénéficié” d'une souverainté limitée dans le cadre du Pacte de Varsovie. Dans un tel cadre, Jaruzelski, en tant qu'officier, s'est fixé deux tâches principales: garder un Etat capable de fonctionner et éviter le chaos social et économique.
Jaruzelski cite encore les appels lancés à l'époque par les Chanceliers Kreisky (Autriche) et Schmidt (RFA) pour sauver l'ordre en Pologne, afin que le pays puisse remplir ses obligations vis-à-vis d'autres Etats et afin que la raison et la mesure demeurent maîtresses du terrain. Ensuite, ces mémoires de Jaruzelski contiennent le texte complet d'un rapport du ministre polonais des affaires étrangères Jozef Czyrek sur sa vistie au Saint-Siège (pp. 353-354) et également le rapport du Général Kiszczak sur les manœuvres des troupes soviétiques, est-allemandes et tchèques le long des frontières polonaises pendant l'automne 1981 et sur les actions des agents des services secrets à l'intérieur du pays. Si Jaruzelski n'avait pas proclamé l'état de siège le 13 décembre 1981, les troupes du Pacte de Varsovie seraient entrées en Pologne le 16, afin de sauver le peuple polonais du “garot de la contre-révolution”. Exactement selon le même schéma qu'à Prague en 1968.
L'action de Jaruzelski a constitué, selon le “faucon anti-communiste” américain, Zbigniew Brzezinski, le passage de l'“autoritarisme communiste” à l'“autoritarisme post-communiste”. Solidarnosc n'a pas été interdit, comme l'avait demandé le Pape à Czyrek, mais a été dompté avant de préserver la Pologne d'une invasion, du chaos et de la faillite. A la lecture de ces mémoires, on pourra rester sceptique, mais la teneur de ce livre est extrêmement intéressante, non pas parce qu'il nous révèle les idées d'un général polonais soviétophile, mais parce qu'il nous dévoile très précisément comment fonctionne la conscience du devoir chez un militaire, contraint par les événements à intervenir directement dans la politique. L'esprit militaire, le catholicisme, la russophilie et le communisme se mêlent étroitement, de façon très étonnante, dans les mémoires de Jaruzelski. Tous ces ingrédients forment en dernière instance un mélange instable, correspondant à l'identité polonaise réellement existante.
Robert STEUCKERS.
Wojciech JARUZELSKI, Hinter den Türen der Macht. Der Anfang vom Ende einer Herrschaft, Militzke Verlag, Leipzig, 1996, 479 p., ISBN 3-86189-089-5.
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mémoires, histoire, pologne, mitteleuropa, europe centrale, affaires européennes, europe, communisme, solidarnosc |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 13 novembre 2009
Plan Morgenthau et Plan Marshall

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1996
Plan Morgenthau et Plan Marshall
A l'occasion du cinquantième anniversaire du Plan Marshall, l'historien allemand Wilfried Mausbach a publié un ouvrage de recherches minutieuses, prenant sous la loupe les plans Morgenthau (“agrarisation et désindustrialisation totale de l'Allemagne”) et Marshall (“redressement de l'Europe et de l'Allemagne après la catastrophe de la seconde guerre mondiale”). Mausbach explique que les deux plans ont un point commun: intervenir sur les structures de l'industrie et de l'économie allemandes pour empêcher la nation centrale de notre continent de menacer la paix imposée par les Alliés occidentaux, en redevenant un géant économique soucieux de trouver des débouchés, fût-ce au prix de la guerre. Deux types de politique étaient dès lors possibles à partir de 1945: l'une, répressive, qui aurait maintenu l'économie allemande à un stade pré-industriel ou dans des domaines non concurrentiels vis-à-vis des économies voisines; l'autre, subtilement régulatrice et visant une imbrication des économies européennes, permettait à terme un contrôle permanent, tout en ne concurrençant pas les Etats-Unis. Pour des besoins de la propagande nationaliste, dit Mausbach, le Plan Morgenthau a été démonisé, considéré comme la solution la plus brutale au problème allemand. A ce plan, s'attache la légende d'une agrarisation de l'Allemagne. Mausbach, après avoir analysé les documents officiels américains, constate que ce plan Morgenthau entendait plutôt promouvoir une “mutation structurelle” de l'économie allemande au profit de l'industrie légère de la consommation, en prévoyant un démontage partiel des grands centres industriels. Cette politique s'est heurtée aux pragmatiques actifs au sein des autorités militaires d'occupation, dont les priorités étaient d'alimenter la population et de lui procurer du travail afin d'éviter toutes révoltes, désordres et subversions soviétiques. D'où l'option Marshall, qui n'est pourtant pas exempte d'arrière-pensées “géo-économiques”, mais qui était plus séduisante que le projet de Morgenthau, risquant de faire basculer la classe ouvrière allemande, privée d'outil industriel, dans le camp soviétique. Simultanément, l'application du Plan Marshall permettait à la propagande américaine d'affirmer que Washington avait écarté ses “faucons” et que les “modérés” avaient pris le contrôle de la politique de redressement en Europe (BD).
Wilfried MAUSBACH, Zwischen Morgenthau und Marshall. Das wirschaftspolitische Deutschlandkonzept der USA 1944-1947, Droste Verlag, Düsseldorf, 1996, 438 p., DM 78.
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, etats-unis, deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 10 novembre 2009
Stosstrupp einer neuen Wirklichkeit - Die Gruppe Sozialrevolutionäre Nationalisten 1930-1935
 Stoßtrupp einer neuen Wirklichkeit – Die Gruppe Sozialrevolutionärer Nationalisten 1930 - 1935
Stoßtrupp einer neuen Wirklichkeit – Die Gruppe Sozialrevolutionärer Nationalisten 1930 - 1935
Richard Schapke, im Februar 2002
Gegenstand dieses Aufsatzes sind die Aktivitäten des Publizisten Karl O. Paetel und der sich um ihn scharenden Gruppe Sozialrevolutionärer Nationalisten. Bei der GSRN handelte es sich um die sicherlich radikalste und konsequenteste Gruppierung der Weimarer Nationalrevolutionäre. Als einzige Organisation bezeichnete die GSRN sich offen als "nationalbolschewistisch" – und versuchte sich mit entsprechender Energie am Brückenschlag zwischen Nationalsozialismus und Kommunismus.
1. Karl Otto Paetel
Der nach dem Zweiten Weltkrieg als Verfasser von Arbeiten über Ernst Jünger und die Jugendbewegung zu einiger Bekanntheit gelangte Karl O. Paetel wurde am 23. November 1906 in Berlin geboren. Schon als Gymnasiast betätigte Paetel sich aktiv in der sogenannten Bündischen Jugend, die jedoch letztendlich nur die Rolle eines Durchlauferhitzers spielen sollte. Als wichtige politische Einflüsse sind zunächst der völkische Indologe Professor Hauer und Ernst Jüngers Soldatischer Nationalismus zu nennen. Als Student der Germanistik, Geschichtswissenschaften und der Philosophie schloss Paetel sich 1926 der Deutschen Freischar an, einem Versuch, die zersplitterten Gruppen der gegen das westlich-materialistische System revoltierenden Bündischen Jugend zu sammeln. Ab 1927 arbeitete der verkrachte Student beim "Deutschen Tageblatt", einem Organ der Deutschvölkischen Freiheitspartei. Mit dieser bürgerlich-reaktionären Gruppe kam es sehr bald zum Bruch.
Paetel hatte nicht zuletzt durch das Gemeinschaftsgefühl der Jugendbewegung bereits zu einem diffusen "Sozialismus" gefunden. Eine Möglichkeit zur Verwirklichung desselben sah er in der Altsozialdemokratischen Partei ASP, die sich 1926 von der SPD getrennt hatte. Unter dem Einfluss von Männern wie August Winnig und Ernst Niekisch hatte die ASP sich zum Ziel gesetzt, die unzufriedene Arbeiterschaft durch soziale, wirtschaftliche und politische Reformen für den deutschen Staat zu gewinnen, auf dass Deutschland unter Führung des unverbrauchten "Arbeitertums" die Ketten des Liberalismus und des Versailler Diktats zerbreche. Den Ultrareaktionären im deutschvölkischen Lager (interessanterweise ist die DVFP die indirekte Vorläuferorganisation der NPD) waren Zugeständnisse an die Arbeiterklasse jedoch verdächtig, und so führte Paetels Engagement für die ASP zu seinem Hinauswurf aus der Redaktion des "Deutschen Tageblatttes". Dem altsozialdemokratischen Intermezzo fiel ebenfalls das ehrgeizige Projekt zum Opfer, gemeinsam mit Reinhold Quaatz, dem Propagandachef der Deutschnationalen Volkspartei, die "Preußischen Jahrbücher" herauszugeben. Wichtig erscheint uns in diesem Zusammenhang die halbjüdische Herkunft von Quaatz – Paetel hatte wenig Berührungsängste, und nachmalige antisemitische Fehltritte sind wohl eher als Verbeugung vor dem Zeitgeist zu deuten.
Ernüchtert und von jeglichen Illusionen über die politischen Absichten der Deutschvölkischen und Deutschnationalen kuriert, übernahm Karl O. Paetel im Oktober 1928 aus der Hand eines Berliner ASP-Kameraden die Chefredaktion der Zeitschrift "Das Junge Volk" in Plauen. Zu dieser Zeit vollzog sich ein Gärungsprozess in den Reihen der Bündischen Jugend. Die Fragestellung innerhalb der zerstrittenen Bünde hieß nicht mehr "Nation oder Sozialismus", sondern "Nation und Sozialismus". Diese Synthese sollte durch die "Neue Front" der von gefühlsmäßigem Antikapitalismus und unklaren Sozialismusbegriffen erfassten Jugendverbände geschaffen werden. Paetel und andere wie Hans Ebeling oder Ernst Jüngers Juniorpartner Werner Lass schlugen einen bewusst "nationalbolschewistischen" Kurs ein.
Man ging deutlich über Moeller van den Brucks Definition Deutschlands als proletarischer Nation hinaus. Innerhalb Deutschlands wurden durch die inkompetente Wirtschafts- und Erfüllungspolitik der Weimarer Regierungen Millionen proletarisiert, so dass der Kampf gegen den Versailler Friedensvertrag und der Kampf gegen das liberalkapitalistische Weimarer System zusammenwuchsen. Zugleich bedeutete diese Radikalisierung aber auch eine Kampfansage an den "kleinbürgerlichen Naturidealismus" der herkömmlichen Jugendbewegung. Hierbei befand Paetel sich in engster Nachbarschaft zur im Aufbau befindlichen Hitler-Jugend, deren Reichsleitung nicht von ungefähr ebenfalls in Plauen angesiedelt war. In seiner Bedeutung für Paetels politische Entwicklung gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann der politische Einfluss des späteren Marburger Professors Wolfgang Abendroth, damals Aktivist der jugendbewegten Freisozialisten. Abendroth machte den völkischen Renegaten nachhaltig mit dem Klassenkampfgedanken vertraut, und Paetel schlussfolgerte, es bedürfe des Klassenkampfes, um die nationale Befreiung Deutschlands zu erreichen – eine Radikalisierung auch über die Thesen der ASP hinaus.
Nachdem der zusehends extremere Kurs des "Jungen Volkes" von paramilitärischen Wehrverbänden wie Oberland beifällig aufgenommen wurde, erkannte in der Februar-Ausgabe 1929 Artur Grosse den proletarischen Klassenkampf erstmals öffentlich an. Zwei Monate später formulierte Gunter Orsoleck, vor einigen Jahren Anführer einer HJ-Revolte gegen Hitlers reaktionäre Reichsleitung in München: "Volksgemeinschaft oder Klassenkampf? Sollte das ernstlich auch heute noch für die Bündischen zweifelhaft sein? Der Kampf um die nationalen Ziele, um die Freiheit des politischen Lebens, ist heute ein Kampf gegen die herrschenden Wirtschaftsmächte. Dieser Kampf ist nur zu gewinnen, wenn eine gemeinsame Front aller aktiven Kräfte im Volke da ist."
2. Arbeitsring Junge Front
Da die Tätigkeit als Chefredakteur den irrlichternden Paetel nicht zufriedenstellte, legte er diese im Frühjahr 1929 nieder. Publizistisch blieb er mit Aufsätzen im "Jungen Kämpfer", der Herausgabe der "Jungpolitischen Rundbriefe" und natürlich durch weitere Mitarbeit im "Jungen Volk" aktiv. Die "Jungpolitischen Rundbriefe" stellten eine Presseschau dar, die ihre Ansichten aus dem linkssozialdemokratischen "Klassenkampf", den "Nationalsozialistischen Briefen", dem "Widerstand", dem "Vormarsch", dem "Dritten Reich" oder der "Standarte" bezog. Durch diese Tätigkeit gelang es Paetel naturgemäß, eine Reihe wichtiger Kontakte zu knüpfen.
Wie unter den Weimarer Nationalrevolutionären üblich, widmete sich auch Paetel dem Aufbau eines Zirkels, des Arbeitsringes Junge Front. Der in Berlin-Charlottenburg ansässige Arbeitsring ging davon aus, dass ohne die soziale Befreiung der werktätigen Massen die Freiheit der Nation undenkbar sei. Durch die soziale Befreiung sollten die Proletarier in die Volksgemeinschaft eingegliedert werden, also bejahte die Gruppe den Klassenkampf der Arbeit gegen das Kapital. Im Gegensatz zu den meisten anderen NR-Gruppen zeigten Paetels Kameraden ein reges Interesse an ideologischer Untermauerung ihrer Ansichten und formierten die Fachgruppen Nationale Fragen, Sozialismus, Kapitalismus, Imperialismus und Fürsorgeerziehung. An den teilweise gut besuchten Veranstaltungen des Arbeitsringes beteiligten sich auch Vertreter des kommunistischen Jugendverbandes KVJD und der HJ. Auf einer dieser Veranstaltungen, am 4. Juli 1929, propagierte Paetel die Bildung der antikapitalistischen Jugendfront und den Nichtangriffspakt aller antikapitalistisch orientierten Organisationen von KVJD bis HJ. Allerdings erschienen die eingeladenen Kommunisten nicht, und die Nationalsozialisten verließen den Saal. Anschließend beteiligten die Teilnehmer sich vor der französischen Botschaft an einer wüsten Straßenschlacht gegen die preußische Polizei.
Zu diesem Zeitpunkt rückte die Entwicklung innerhalb der NSDAP in Paetels Blickfeld. Am 1. August 1929 hatte Otto Strasser seine "14 Thesen der Deutschen Revolution" veröffentlicht, die sich mit den Kernpunkten Kampf gegen Versailles, zentralistisches Großdeutschland, Korporativstaat und völkische Erneuerung im Vergleich mit der ultradikalen Linie eines Joseph Goebbels ziemlich harmlos ausnahmen. Der Arbeitsring erkannte, dass es innerhalb der NSDAP einen starken linken Flügel gab, der ideologische Verwandtschaften mit den Nationalrevolutionären aufwies und gegen Hitlers bürgerlich-reaktionären Kurs opponierte. Durch die Entwicklung extremistischer Positionen sollte dieses Potential innerhalb der NSDAP genutzt und radikalisiert werden. Den Anfang machte Paetel, als er Mitte August 1929 in Strassers "Nationalsozialistischen Briefen" seine These vom nationalen Klassenkampf wiederholte und offen erklärte, sozialistische Politik könne sowohl durch Mitarbeit in der NSDAP als auch in den NR-Gruppen oder der KPD betrieben werden.
Am 1. Oktober 1929 legte "Das Junge Volk" eine aufsehenerregende Skandalnummer nach. Paetel verkündete: "Wir wollen die Zusammenarbeit der nationalistischen Aktivisten, die sozialistisch sind um der Nation willen, mit den Aktivisten, die sozialistisch sind um des Proletariats willen." Rolf Becker verlangte den bewaffneten Klassenkampf und forderte den Bürgerkrieg nach bolschewistischem Beispiel, um die Internationale des Nationalismus und des Sozialismus zu schaffen. In der gleichen Ausgabe erschien ein entweder von Paetel oder dem in Schleswig-Holstein agitierenden NS-Linksaußen Bodo Uhse verfasstes Alternativprogramm für die NSDAP. "Die NSDAP ist eine nationalistische Partei. Ihr Ziel ist die Freie Deutsche Nation. Die NSDAP ist eine sozialistische Partei. Sie weiß, dass die Freie Deutsche Nation erst durch die Befreiung der werktätigen Massen Deutschlands von jeder Form der Ausbeutung und Unterdrückung erstehen kann. Die NSDAP ist eine Arbeiterpartei. Sie bekennt sich zum Klassenkampf der Schaffenden gegen die Schmarotzer aller Rassen und Bekenntnisse." Konkrete Forderungen waren Bildung des Großdeutschen Reiches, Annullierung aller außenpolitischen Verpflichtungen und Verträge der Weimarer Republik, Rätesystem auf Betriebsebene, Zerschlagung von Parlamentarismus und Parteienstaat, Verstaatlichung aller Wirtschaftsmittel, Enteignung des Mittel- und Großgrundbesitzes sowie Bildungs- und Sozialreformen zugunsten der armen Bevölkerungsschichten. Als Verbeugung vor dem antisemitisch-rassistischen Zeitgeist müssen die Ausweisung aller zugewanderten Ostjuden und ein strikt biologisch determinierter Staatsbürgerschaftsbegriff gewertet werden. "Die NSDAP ist sich bewusst, dass die in diesen Leitsätzen niedergelegten Gedanken sich nicht verwirklichen lassen ohne eine grundsätzliche Umstellung der bestehenden Machtverhältnisse. Da die volle Kontrolle über die gesamten deutschen Wirtschaftsmittel heute in den Händen von Organen des internationalen Finanzkapitals liegt, richtet sich die nationale Revolution unmittelbar gegen das internationale Finanzkapital. Hieraus ergibt sich, dass jede in Deutschland vollzogene Umwälzung sofort alle Machtmittel des Völkerbundes und Amerikas gegen den Deutschen Arbeiter- und Bauernstaat auf den Plan ruft. Erste Aufgabe der nationalsozialistischen Außenpolitik ist deshalb die Organisation der revolutionären Verteidigung gegen die imperialistischen Mächte, Bündnis mit der Sowjetunion und Unterstützung der revolutionären Bewegungen in allen Ländern der Welt, die sich gegen das internationale Finanzkapital richten."
Das erregte Aufsehen war beachtlich, die bürgerliche und die sozialistische Presse erschauerten vor der herannahenden 3. Welle des Nationalbolschewismus. Strassers Presseorgane winkten übrigens ab und kritisierten den übersteigerten Rassismus sowie die außenpolitische Anlehnung an die Sowjetunion und koloniale Befreiungsbewegungen. Immerhin gelang es Paetel, die Aufmerksamkeit der sogenannten Hamburger Nationalkommunisten auf sich zu lenken. Diese spielten in der direkten Nachkriegszeit unter Heinrich Laufenberg und Fritz Wolffheim eine bedeutende Rolle beim Aufbau der KPD, spalteten sich dann mit der KAPD ab und wurden innerhalb dieser von ultralinken Gruppen marginalisiert und verdrängt. Fritz Wolffheim dachte im "Jungen Volk" vom November 1929 über "Anfang oder Ende der deutschen Revolution" nach.
Ende 1929 wurde auch die Kommunistische Internationale auf die Gruppe um Paetel aufmerksam. Die deutschsprachige "Moskauer Rundschau" konstatierte, die nationalrevolutionäre Rechte habe sich zusehends den sozialistischen Vorstellungen der KPD angenähert. Nicht zuletzt der von einem China-Einsatz zurückgekehrte Berufsrevolutionär und linke Ruhrkämpfer Heinz Neumann sprach sich für eine partielle Zusammenarbeit der KPD mit den Nationalrevolutionären aus, was noch bedeutsame Folgen haben sollte.
3. Im nationalsozialistischen Minenfeld
Am 3. Januar 1930 trat das publizistische Schaffen Karl O. Paetels in ein neues Stadium. An diesem Tag übernahmen mit Ernst Jünger und Werner Lass zwei der wohl profiliertesten Nationalrevolutionäre die Herausgeberschaft der Zeitschrift "Die Kommenden" und delegierten die Chefredaktion an Paetel. Das Mitte der 20er Jahre entstandene Blatt sah sich als überbündisches Sprachrohr der Jugendbewegung und geriet im Lauf der Jahre zusehends in ein nationalrevolutionär-nationalsozialistisches Fahrwasser. Mit einer Auflage von bis zu 15.000 Exemplaren hatten "Die Kommenden" eine erhebliche Breitenwirkung – nicht zuletzt bei den Jugendgruppen der deutschnationalen Angestelltengewerkschaft DHV und bei der Hitlerjugend, für deren Führerkorps die Zeitschrift seit Sommer 1929 Pflichtblatt war.
Paetel öffnete die Spalten der "Kommenden" seinem nationalbolschewistischen Umfeld und schlug einen deutlichen Annäherungskurs an die NS-Linke ein. Endziel war die Bildung einer Einheitsfront aus revolutionären Nationalsozialisten, Proletariat, Bündischer Jugend und Frontsoldaten. Schon nach wenigen Wochen zeigte sich jedoch, dass die "Kommenden" eine weitaus radikale Richtung einschlugen als die Strasseristen. Bereits Mitte Februar attackierte man Otto Strassers Weigerung, Verstaatlichungen und Planwirtschaft anzuerkennen. Einen Monat darauf pflichtete die Redaktion der These bei, für den Wiederaufstieg Deutschlands sei auch das barbarischste Mittel gerechtfertigt. In den NS-Briefen formulierte Paetel zu dieser Zeit: "Gewehr bei Fuß und tätige Bereitschaft für den Augenblick, wo wir dann die Aktion der Unterjochten zu der unseren machen, die Bonzokratie der Moskauer hinwegfegen und das Steuer zum deutschen Sozialismus herumreißen." Die nationalrevolutionäre Avantgarde sollte also nicht nur die Führung der vom Hitlerismus, sondern auch der vom Stalinismus verblendeten Massen übernehmen.
Die orthodoxe Rechte, verkörpert nicht zuletzt durch den Frontsoldatenbund Stahlhelm und die Deutschnationalen, also Hitlers politische Wunschpartner, reagierte mit einer heftigen Kampagne gegen die NS-Linke. Man stellte die Skandalnummer des "Jungen Volkes" als Produkt der Parteilinken dar und setzte den apathischen Hitler immer massiver unter Druck, seinen innerparteilichen Gegnern das Handwerk zu legen. Paetel zog am 28. März 1930 zufrieden seine Zwischenbilanz: Die Trennung zwischen nationaler Boureoisie und revolutionärem Nationalismus zeige sich immer deutlicher. Offen erklärte er die nationale Bourgeoisie zum Hauptfeind der Nationalrevolutionäre. Nur zwei Tage später wurde der Chefredakteur als Antwort auf einen scharfen Angriff gegen die nationale Ikone Hindenburg aus der Deutschen Freischar ausgeschlossen. Anfang Mai warnte Reichswehrminister Groener per Geheimbefehl die Reichswehr vor den sich radikalisierenden linksnationalistischen Tendenzen innerhalb der Bündischen Jugend und namentlich vor der Zeitschrift "Die Kommenden".
Am 10. Mai 1930 setzten im Berliner Büro des Strasserschen Kampfverlages hektische Besprechungen der NS-Linken ein, wie man dem zusehends reaktionäreren Kurs der Münchener Reichsleitung begegnen solle. Hierbei spielten auch Paetels Einheitsfrontpläne eine gewisse Rolle, auch wenn der sich letztlich als der bessere Hitler definierende Otto Strasser hierbei eigennützige Pläne verfolgte. Anlass zur Sprengung der NSDAP von innen heraus sollte der Zeitungskrieg zwischen dem Berliner Gauleiter Goebbels und dem Kampfverlag dienen. Im Gegensatz zu Strassers späterer Darstellung ging es hier weniger um ideologische Differenzen mit Goebbels, dessen "Angriff" durchaus weiter links stand als die Kampfverlagspresse, sondern um einen reinen Machtkampf um die Vorherrschaft im Gau Berlin. Die Lage war nicht aussichtslos, denn auf der Abschlussbesprechung hatten sich mindestens drei Gauleiter, zahlreiche NS-Publizisten und mehrere SA-Führer hinter Otto Strasser gestellt. Dieser wollte nach dem ersten Parteiausschlussverfahren gegen einen seiner Mitarbeiter handeln und die Abspaltung der norddeutschen NSDAP-Gaue provozieren. Kristallisationspunkt dieser Unabhängigen Nationalsozialistischen Partei sollten die Kampfverlags-Presse und "Die Kommenden" werden. Paetel stimmte einer Zusammenarbeit nur unter der Voraussetzung zu, dass die Abspaltung unter sozialistischen Vorzeichen zu erfolgen hatte.
n den "Kommenden" und den NS-Briefen attackierte Paetel unter seinem Pseudonym Wolf Lerson die Intellektuellenfeindlichkeit der Münchener Reichsleitung. "Die französische Revolution brach aus, als die Ideen der Enzyklopädisten die alte Gesellschaft sturmreif gemacht und die Bourgeoisie mit neuen Forderungen erfüllt hatten. Rousseau und Voltaire sind ebenso ihre Väter wie Robespierre und Danton. Und die Väter der russischen Revolution haben nicht nur Bomben geworfen, sondern fast ein Jahrzehnt in den Schweizer Emigrantencafés diskutiert und Flugschrift über Flugschrift geschrieben. Ist es ein Zufall, dass die russische Revolution schließlich von einem Schriftsteller wie Lenin, die faschistische von einem Journalisten wie Mussolini durchgeführt wurde?" Genauso wichtig die die Schaffung des Dritten Reiches seien die geistige Klärung und „der Marschtritt der Formationen“.
4. GSRN und KGRNS
Mittlerweile schienen sich bei Paetel die ersten Zweifel eingeschlichen haben, ob Strasser wirklich der richtige Partner war. Am Pfingstwochenende 1930 hob er zusammen mit den Weggefährten des Arbeitsringes und den Überresten des Hamburger Bundes der Kommunisten die Gruppe Sozialrevolutionärer Nationalisten (GSRN) aus der Taufe. Als maßgebliche Mitglieder der Frühzeit sind die Nationalsozialisten Artur Grosse und Max Wehling und die bündischen Aktivisten Heinz Gruber und Heinz Gollong zu nennen. Die GSRN-Begründer wurden aus eigenem Entschluss aktiv, da sie die NSDAP-Hauptlinie ablehnten und ihnen andererseits die Strasseristen in puncto Sozialismus und Klassenkampf als zu halbherzig erschienen. Sich als Arbeitsgruppe zur national-sozialistischen Durchdringung der Jugendbünde und Nationalrevolutionäre verstehend, unterhielt die höchstens 500 Mitglieder zählende Gruppe dennoch ein weitgespanntes Netz von Vertrauensleuten in den urbanen Ballungszentren.
Die "Thesen der GSRN" lauteten zunächst:
"Wir erkennen die Notwendigkeit der Deutschen Revolution. Sie ist die geistige Umgestaltung, die wirtschaftlich, politisch und kulturell das Gesicht unserer Zeit bestimmt.
Wir bekennen uns zur Nation, sie ist uns letzter politischer Wert als schicksalsmäßiger Ausdruck volkhafter Gemeinschaft.
Wir bekennen uns zum Volk, also der artgemäßen Kulturgemeinschaft im Gegensatz zur volkszersetzenden westlerischen Zivilisation.
Wir bekennen uns zum Sozialismus, der nach Brechung der kapitalistischen Ordnung Volk und Nation in organischer Wirtschaftsgliederung bindet.
Die Verwirklichung unserer Ziele ist der großdeutsche Volksrätestaat als Ausdruck der Selbstverwaltung des schaffenden Volkes. Die Wirtschaftsmittel werden in den Gemeinbesitz der Nation überführt und das grundsätzliche Eigentum der Nation an Grund und Boden erklärt.
Daraus folgt: Nationalisierung aller Groß- und Mittelbetriebe, sofortige großzügige Besiedlung des Ostens, Vergebung von Kleinbauernstellen als Reichserblehen, Ersatz des römischen Privat-Rechtes durch das deutsche Gemeinrecht.
Der heutige Zustand fordert: Rücksichtslosen Kampf gegen alle außenpolitischen Versklavungsverträge von Versailles bis Young. Kampf gegen das die äußere Unfreiheit sanktionierende System von Weimar. Bündnispolitik mit der Sowjetunion. Unterstützung der revolutionären Bewegungen zur Schaffung der Einheitsfront aller unterdrückten Klassen und Nationen.
Der heutige Zustand erfordert die schärfste Durchführung des Klassenkampfes der Unterdrückten gegen alle, die das privatkapitalistische Dogma von der Heiligkeit des Eigentums vertreten. Das ist der einzige Weg zur deutschen Volksrevolution.
Zur Sicherung der Revolution gegen den Zugriff des internationalen Kapitals und gegen konterrevolutionäre Bestrebungen tritt an die Stelle des Söldnerheeres das revolutionäre Volksheer.“
Unter der Hand erklärte man sich jedoch bereit, Strassers 14 Thesen zumindest vorübergehend als gemeinsame Programmplattform anzuerkennen. Der Lagebericht der Polizeidirektion Nürnberg-Fürth von Ende Mai konstatierte bereits, Hitler ringe derzeit um die Einheit der NSDAP. "Die Kommenden" gossen reichlich Öl ins Feuer. Die Gründungstagung von Rosenbergs "Kampfbund für deutsche Kultur" wurde scharf ablehnend kommentiert: "Machen wir uns nichts weis darüber - der 'Kampfbund für deutsche Kultur' ist ein nationalsozialistisches Gewächs, und so war denn diese Tagung ein mehr oder weniger geschickt verschleierter Versuch, die deutsche Kultur nebst bündischer Jugendbewegung für die NSDAP einzufangen...Es war bezeichnend, dass ausgerechnet auf einer Kulturtagung von Religion überhaupt nicht die Rede war. Ersatz: nordischer Rassenfanatismus, der in seinen Auswüchsen zu einer dünkelhaften Verstiegenheit führt, die einen um die deutsche Kultur besorgten Menschen peinlich stimmen kann."
Am 27. Juni 1930 verkündete an gleicher Stelle der südwestdeutsche HJ-Führer Karl Baumann: "Es gibt für uns kein Vaterland mehr, das Deutschland heißt, in dem das Besitzbürgertum herrscht. Deutschland, das ist heute nichts weiter als der Begriff des Besitzes und Wohlstandes für die kapitalistische Bourgeoisie...Wir sehen unsere Aufgabe: Die Überwindung der Bourgeoisie im revolutionären Klassenkampf. (...) Es gibt für das deutsche Proletariat nur eine Lösung: Für ein sozialistisches freies Vaterland! Für ein Deutschland der Arbeiter und Bauern! Alle Macht den Räten! (...) Zerschlagt die Götzen des 19. Jahrhunderts! Zertrümmert mit uns die Ordnung, die nicht gottgewollt sein kann! Für Volk und Gemeinschaft! Für Freiheit und Sozialismus! Für ein Leben in Würde und Freiheit!“ Die entsprechende Ausgabe der "Kommenden" enthielt die Referate der GSRN-Gründungstagung und wurde bald als Broschüre mit einer Auflage von 4000 Exemplaren verbreitet.
 Zur gleichen Zeit wurde Otto Strasser von Hitler und Goebbels ausmanövriert und aus der NSDAP herausgedrängt. Dem pompösen Aufruf "Die Sozialisten verlassen die Partei" zum Trotz trennte sich nur eine Minderheit der NS-Linken als Kampfgemeinschaft Revolutionärer Nationalsozialisten (KGRNS) von der Mutterpartei – die meisten Gesinnungsgenossen der Sezessionisten verblieben innerhalb der Partei, wo sie auch weiterhin wichtige Funktionen bekleideten. Die Machtfrage wurde im Sommer 1934 von Hitler gestellt und mit der "Nacht der langen Messer" beantwortet. Als Vertreter der GSRN waren Artur Grosse, bislang Gauschulungsleiter für Berlin und Brandenburg sowie Mitglied der HJ-Reichsführung in Plauen, und Karl Baumann in der KGRNS untergebracht. Am 8. Juli gab die GSRN eine Kameradschaftserklärung für die KGRNS an: „Als faschistische Partei hat die NSDAP für uns jeden Anspruch verspielt, Sachwalter der Deutschen Revolution zu sein...Wir stehen nun da, wo man mit der Tat, nicht mit der Phrase das sozialistische Vaterland der Bauern und Arbeiter, die freie Nation in der Durchführung des Klassenkampfes der Arbeit gegen das internationale und das deutsche Kapital als Ausdruck der Weltanschauung unseres Jahrhunderts erkämpft.“
Zur gleichen Zeit wurde Otto Strasser von Hitler und Goebbels ausmanövriert und aus der NSDAP herausgedrängt. Dem pompösen Aufruf "Die Sozialisten verlassen die Partei" zum Trotz trennte sich nur eine Minderheit der NS-Linken als Kampfgemeinschaft Revolutionärer Nationalsozialisten (KGRNS) von der Mutterpartei – die meisten Gesinnungsgenossen der Sezessionisten verblieben innerhalb der Partei, wo sie auch weiterhin wichtige Funktionen bekleideten. Die Machtfrage wurde im Sommer 1934 von Hitler gestellt und mit der "Nacht der langen Messer" beantwortet. Als Vertreter der GSRN waren Artur Grosse, bislang Gauschulungsleiter für Berlin und Brandenburg sowie Mitglied der HJ-Reichsführung in Plauen, und Karl Baumann in der KGRNS untergebracht. Am 8. Juli gab die GSRN eine Kameradschaftserklärung für die KGRNS an: „Als faschistische Partei hat die NSDAP für uns jeden Anspruch verspielt, Sachwalter der Deutschen Revolution zu sein...Wir stehen nun da, wo man mit der Tat, nicht mit der Phrase das sozialistische Vaterland der Bauern und Arbeiter, die freie Nation in der Durchführung des Klassenkampfes der Arbeit gegen das internationale und das deutsche Kapital als Ausdruck der Weltanschauung unseres Jahrhunderts erkämpft.“
Sowohl KGRNS als auch GSRN scheiterten in ihrem Bestreben, sich als Auffangorganisationen für frustrierte Nationalsozialisten vor allem aus HJ und Studentenbund anzubieten. Die Reichsleitung der HJ erklärte "Die Kommenden" zum Feindblatt und untersagte ihren Bezug. Abschluss des Fiaskos war der Hinauswurf Paetels aus der Redaktion der "Kommenden", deren Verleger unter erheblichen wirtschaftlichen Druck geriet. Am 1. August 1930 veröffentlichte Paetel den Versuch einer Standortbestimmung: „Wo wir stehen? Überall da, wo die roten Fahnen der sozialistischen Revolution und die schwarzen Fahnen der deutschen Befreiung aufgepflanzt werden! Wir sind nicht ‚rechts‘ und nicht ‚links‘. Jeder gehört zu uns, von beiden Flügeln her, dem es um Deutschland und den Sozialismus geht. (...) Wir wissen, dass in der NSDAP, bei den ‚Revolutionären Nationalsozialisten‘, und in kommunistischen Kreisen Menschen unserer Haltung stehen, wissen, dass eine ganze Reihe kleinerer nationalistischer Bünde und Gruppen gleichen Losungen folgt, wissen sogar, dass mancher, den sein Schicksal in die politische ‚Mitte‘ verschlug, zu uns gehört - jenseits aller Parlamentsgeographie: mit ihnen stehen wir zusammen.
Wir stehen in der neuen deutschen Front, die sich formiert zum Aufstand der verproletarisierten Nation.
Von ‚links‘ und ‚rechts‘ stoßen Kameraden zu uns - eines Tages wird sich das Kader schließen. (...)
Bereit sein ist alles!
Bereit zu werden, unsere Aufgabe.“
Am 25. August 1930 veröffentlichte die KPD ihr nicht zuletzt auf die Initiative des oben erwähnten Heinz Neumann zurückzuführendes "Programm zur nationalen und sozialen Befreiung des deutschen Volkes". Die Kommunisten rückten nationale Belange in den Vordergrund, um der NSDAP den nationalistischen Schneid abzukaufen und sie zugleich als scheinsozialistisch zu entlarven. Als Ziele wurden die Zertrümmerung der Versailler Nachkriegsordnung, die Annullierung der Auslandsschulden und Reparationen, die Sozialisierung von Banken, Großbetrieben und Großgrundbesitz sowie die Schaffung Sowjetdeutschlands als Alternative zu Faschismus, Kapitalismus, Feudalismus und Sozialdemokratie genannt. Ein wichtiger Angriffspunkt war selbstredend die reaktionäre Tendenz der Münchener NS-Zentrale, deren Rattenfängerei in den proletarisierten Gesellschaftsschichten gegeißelt wurde. Um die Haltung gegenüber dem neuen Kurs der KPD kam es nun zum offenen Bruch zwischen Paetel und Strasser.
Nachdem zuvor 2000 Kommunisten eine Versammlung der KGRNS in Berlin-Neukölln sprengten, wandte Paetel sich Anfang Oktober 1930 in den NS-Briefen an die KPD ("Meine Herren, worum geht es Ihnen?"). Die KPD-Führung wurde aufgefordert, die Nationalrevolutionäre als Verbündete zu akzeptieren. Ihre kurzsichtige Parteitaktik spiele lediglich die revolutionären Kräfte gegeneinander aus, anstatt gemeinsam das kapitalistische System zu stürzen. Im gleichen Atemzug kritisierte der GSRN-Wortführer jedoch Internationalismus und Materialismus der Kommunisten. Strasser wiederum distanzierte sich in der gleichen Ausgabe der NS-Briefe von Paetels Ansichten. Er stellte die KPD-Programmerklärung als taktischen Schritt hin und stilisierte ausgerechnet sich selbst zum einzigen "bolschewistischen Deutschen" empor. Nur der Revolutionäre Nationalsozialismus verkörpere den Nationalbolschewismus.
Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Bruno von Salomon propagierte offen Sabotage, Terrorismus und passiven Widerstand als Kampfmittel gegen den Weimarer Staat (um sich kurz darauf zusammen mit Bodo Uhse an die Gründung kommunistischer Bauernkomitees zu machen), und mit Strassers Kaderchef Wilhelm Korn verabschiedete sich ein Schlüsselmann der KGRNS zu den Kommunisten. Die Dissidenten machten zudem publik, dass Strasser Gelder aus dem preußischen Innenministerium kassierte, welches so eine Radikalisierung der Revolutionären Nationalsozialisten zu verhindern suchte. In der "Roten Fahne" kritisierte Korn Strassers letztlich auf Gewinnbeteiligungen beschränkten Sozialismusbegriff und seine Leugnung des Klassenkampfes. Der ehemalige Nationalsozialist sollte es noch bis zum Reichsinspekteur des Kampfbundes gegen den Faschismus, also der Nachfolgeorganisation des Roten Frontkämpferbundes, bringen.
5. "Die sozialistische Nation"
Anfang Januar 1931 begann Paetel die Herausgabe der Zeitschrift "Die sozialistische Nation" als neues Sprachrohr der GSRN. In personeller Hinsicht hatte es abgesehen von den Wortführern der Gründungszeit erhebliche Veränderungen gegeben – Jugendbewegte und frustrierte Nationalsozialisten wurden zumindest in Berlin von ehemaligen KPD-Mitgliedern in die Minderheit gedrängt. Die Auflage der neuen Zeitschrift schwankte zwischen 300 und 600 Exemplaren. Der Preis für finanzielle und damit politische Unabhängigkeit bestand in einer mehr als schlechten Aufmachung und eben geringer Auflagenhöhe. Im Gegensatz zu den zwischen national-sozialistischem Verbalradikalismus und völkischen Thesen hin- und herschwankenden meisten NR-Gruppen zeichnete "Die sozialistische Nation" sich durch ein ausgeprägtes theoretisches Verständnis der Dinge aus. Man forderte nicht nur die äußerste Konsequenz, sondern wollte diese auch ideologisch untermauern.
Nachdem die KPD Paetel und Strasser am 6. Januar 1931 auf eine Versammlung eingeladen hatte und dem GSRN-Leiter im Gegensatz zu letzterem einen freundlichen Empfang bereitete, erschien im Februar eine deutliche Ausgabe der "Sozialistischen Nation". Paetel propagierte den "Volkskampf" gegen den prokapitalistischen und reaktionären Faschismus, beharrte aber auf der ideologischen Unabhängigkeit der Nationalbolschewisten. Artur Grosse, aufsässiger Leiter der Strasserschen Jugendorganisation, erklärte: "Nationalbolschewismus heißt zuerst revolutionäre Praxis". Schulter an Schulter mit dem durch die KPD organisierten revolutionären Proletariat sollten die Nationalbolschewisten "die erforderlichen Schritte" unternehmen. Der republikanisch-kapitalistische Klassenstaat zersetze die deutsche Nation, die als verproletarisiertes Volk der Arbeiter, Bauern und Kleinbürger aufgefasst wurde. Marxens These von der universalen Verproletarisierung wurde angesichts von Weltwirtschaftskrise und Massenelend als zutreffend erachtet. Nationalbolschewismus bedeutete für Grosse die Ausrottung der bürgerlichen Klassenordnung. Wenige Tage später erwarb er das Parteibuch der KPD. Zur gleichen Zeit machte das 1. Reichstreffen der GSRN den Mitgliedern eine enge Zusammenarbeit mit der KPD und den ihr angeschlossenen Organisationen zur Auflage, womit vor allem die Mitarbeit im Kampfbund gegen den Faschismus gemeint war.
 Unübersehbar gewann die KPD an Anziehungskraft auf die entschlossensten Elemente der Grauzone zwischen Nationalsozialismus und Kommunismus. Zu nennen ist hier vor allem die Hinwendung des wegen illegaler NS-Zellenbildung in der Reichswehr inhaftierten Richard Scheringer zur KPD. Die GSRN gab eine Ehrenerklärung für Scheringer ab, obwohl Paetel ihn von einer völligen Hinwendung zum Kommunismus abzuhalten suchte. Im März 1931 hieß es in der "Sozialistischen Nation": "Will Deutschland sein eigenes Gesicht wahren, bzw. wiedergewinnen, kann es das nur unter konsequentester Ausscheidung aller westlerischen Einflüsse. Gerät es dabei vorübergehend unter den starken Einfluss des Ostens, so ist das in Kauf zu nehmen angesichts der Tatsache, dass dieser Osten der natürliche Gegner auch unserer Feinde, der Westmächte ist. Das Schlagwort des Bolschewismus schreckt uns nicht – denn wir wissen, dass man den Westen nur mit seiner krassesten Antithese überwinden kann." Deutschland werde einst den "Mut zum Chaos" aufbringen müssen – der erwartete westliche Interventionskrieg gegen den einzigen sozialistischen Staat der Welt sollte das Signal zur sozialen Revolution im Reich sein, für den proletarischen Aufstand gegen die Versailler Ordnung. KPD und GSRN führten hier erstmals eine parallele Propagandakampagne durch.
Unübersehbar gewann die KPD an Anziehungskraft auf die entschlossensten Elemente der Grauzone zwischen Nationalsozialismus und Kommunismus. Zu nennen ist hier vor allem die Hinwendung des wegen illegaler NS-Zellenbildung in der Reichswehr inhaftierten Richard Scheringer zur KPD. Die GSRN gab eine Ehrenerklärung für Scheringer ab, obwohl Paetel ihn von einer völligen Hinwendung zum Kommunismus abzuhalten suchte. Im März 1931 hieß es in der "Sozialistischen Nation": "Will Deutschland sein eigenes Gesicht wahren, bzw. wiedergewinnen, kann es das nur unter konsequentester Ausscheidung aller westlerischen Einflüsse. Gerät es dabei vorübergehend unter den starken Einfluss des Ostens, so ist das in Kauf zu nehmen angesichts der Tatsache, dass dieser Osten der natürliche Gegner auch unserer Feinde, der Westmächte ist. Das Schlagwort des Bolschewismus schreckt uns nicht – denn wir wissen, dass man den Westen nur mit seiner krassesten Antithese überwinden kann." Deutschland werde einst den "Mut zum Chaos" aufbringen müssen – der erwartete westliche Interventionskrieg gegen den einzigen sozialistischen Staat der Welt sollte das Signal zur sozialen Revolution im Reich sein, für den proletarischen Aufstand gegen die Versailler Ordnung. KPD und GSRN führten hier erstmals eine parallele Propagandakampagne durch.
Im Frühjahr 1931 griff die GSRN auch erstmals wieder in die internen Machtkämpfe innerhalb der NSDAP ein. Offenbar hatte die Gruppe ihre Hände bei den bis heute nicht geklärten Vorgängen um die sogenannte 2. Stennes-Revolte der SA gegen die Münchener Reichsleitung im Spiel. In jedem Fall traten Paetel, Gollong und Grosse in Verhandlungen mit den SA-Rebellen ein, um sie zur Zusammenarbeit mit dem Kampfbund gegen den Faschismus zu überreden. Infolge des würdelosen Verhaltens der Kommunisten bei der Beisetzung Horst Wessels lehnte ein Führerrat der Rebellen ein Zusammengehen ab – man einigte sich stattdessen mit Otto Strasser.
Durch den im Juni 1931 in der "Sozialistischen Nation" veröffentlichten Aufsatz "Revolutionäre Wehrpolitik" handelte Scheringer sich eine weitere Haftstrafe wegen "literarischen Hochverrates" ein. Der NS-Renegat erteilte Weimars prowestlicher Verständigungspolitik auf Kosten der Sowjetunion eine klare Absage. Ihm erschien die Reichswehr nur noch als entpolitisierte Polizeitruppe zur Niederhaltung der unruhigen Massen im vom internationalen Kapital kolonisierten Deutschland. Die NSDAP habe den revolutionären Weg des bewaffneten Aufstandes gegen Versailles bereits verlassen. Sie werde die Massen niemals für sich gewinnen, weil sie auf ihre sozialistischen Programmpunkte verzichtete. Hitler wolle den deutschen Kapitalismus retten, und die deutschen Kapitalisten würden niemals einen revolutionären Befreiungskrieg zulassen. "Wir erkennen, dass jedes Wort von nationaler Befreiung unter Beibehaltung des kapitalistischen Systems eine Lüge ist...Jeder Soldat, der das kapitalistische System im eigenen Lande stützt, kämpft infolgedessen gegen die Befreiung des deutschen Volkes....Der entpolitisierte Soldat ist eine Kreatur, ein willenloses Werkzeug in der Hand der herrschenden Klasse."
Als KPD-nahes Schwesterblatt der "Sozialistischen Nation" konnte der ab dem 1. Juli 1931 erscheinende "Aufbruch" angesehen werden. Zur Beeinflussung unorthodoxer Nationalisten schlug diese Zeitschrift unter der Herausgeberschaft Wilhelm Korns einen nationalkommunistischen Kurs ein. Nicht zuletzt auf Anregung Scheringers bemühte sich nun Hans Kippenberger als Leiter des illegalen M-Apparates der KPD um eine engere Zusammenarbeit mit den Nationalrevolutionären. Von dieser Öffnung des Kommunismus nach "rechts" sollte auch Paetel profitieren. Obwohl er die Zusammenlegung des "Aufbruchs" und der "Sozialistischen Nation" und die Chefredaktion des nationalkommunistischen Gesamtorgans ablehnte, orderte der Kampfbund gegen den Faschismus dennoch einige Hundert Abonnements des GSRN-Organs. Nach heftigen Auseinandersetzungen innerhalb der GSRN stellte man sich jedoch gegen die kommunistische Bevormundung, und eine nach einem qualitativ hochwertigeren Intermezzo verschlechterte Aufmachung wies auf Ende der Finanzhilfe hin.
Als weiterer Vorteil erwies sich ein Machtkampf unter den Revolutionären Nationalsozialisten, der zahlreiche Aktivisten in die Reihen der GSRN hineintrieb. Paetel witterte hier Morgenluft, und im Herbst richtete die "Sozialistische Nation" heftige Angriffe gegen den als "Adolf II." charakterisierten Otto Strasser. Dessen Schwarze Front befinde sich durch ihre Ablehnung des Klassenkampfes und ihr kleinbürgerliches Zaudern vor dem "bolschewistischen Schritt in das Chaos" in einer "halbfaschistischen Reservestellung" verharrend. Strasser zeige sich ein weiteres Mal als nationalsozialistisch kompromittiert und verhindere die nationalbolschewistische Einheitsfront.
Diese wurde von der GSRN auch weiterhin angestrebt. Ab Ende 1931 arbeitete die Gruppe eng mit dem um die Zeitschrift "Der Gegner" entstehenden Kreis Harro Schulze-Boysens zusammen. Im Januar organisierte Paetel eine nationalbolschewistische Konferenz, an der Persönlichkeiten wie Ernst Niekisch vom "Widerstand", Werner Lass vom "Umsturz", Alexander Graf Stenbock-Fermor vom "Aufbruch" oder Bodo Uhse von den kommunistischen Bauernkomitees teilnahmen. Die weitere Hinwendung zur KPD wurde auch durch die vor den Reichspräsidentschaftswahlen vom Frühjahr 1932 ausgesprochene Empfehlung für den Kandidaten Ernst Thälmann dokumentiert. In einer im bewussten Gegensatz zu den Strasseristen und der Konservativen Revolution radikalisierten Fassung der Thesen der GSRN hieß es nunmehr: "Um der Nation willen, Rätedeutschland!"
Im Sommer 1932 übte Paetel sich vergebens in der Organisierung eines Kampfkomitees gegen Versailles mit kommunistischer Beteiligung – Heinz Neumanns Stern war bereits im Sinken begriffen. Den Beitritt des legendären Oberland-Kommandeurs Beppo Römer und anderer zur KPD kommentierte die "Sozialistische Nation" mit dem Wunsch, sie möchten ihre Weltanschauung nicht völlig umkrempeln. "Im Lager des konsequenten Sozialismus haben die nationalistischen Aktivisten die Aufgabe, Meldegänger der Nation zu sein, die Gewissheit der Unzerstörbarkeit des ewigen Deutschland als heimliches Losungswort weiterzugeben, (...) dem Aufstand gegen Versailles...die historische Legitimation zu geben." Der Klassenkampf wurde als organischer Führungsumbruch verstanden (wir erinnern hier an die Theorie Paretos von der Elitenzirkulation), der eine überalterte Führungsschicht durch neue unverbrauchte Kräfte ersetzte. Die mittlerweile beinahe geheimbündlerisch operierende GSRN betrieb die Zellenbildung in den Großstädten, um die von Hitler verratenen Kader des Jungnationalismus und des Nationalsozialismus, also den "deutschen Nationalkommunismus", dem revolutionären Proletariat an die Seite zu stellen.
Ein Beispiel dieser Zellenbildung ist die Beteiligung an einer vom Wedding ausgehenden Parteirevolte innerhalb des NS-Gaues Berlin. Das NSDAP- und GSRN-Doppelmitglied Heinz Gruber spaltete Teile der Berliner HJ angesichts einer einsetzenden Säuberung als Schwarze Jungmannschaft ab. Zu diesem Zeitpunkt stellten die "Hammerschläge", die Schulungsblätter der Berliner HJ, bereits ein Tarnorgan der GSRN dar. Mit Doppelmitgliedschaften wie im Fall Gruber übte die Paetel-Gruppe starken Einfluss auf beinahe ein Drittel der Berliner HJ aus. Paetels Bekanntheitsgrad nahm seit April 1932 kontinuierlich zu: Wie vor einigen Jahren Ernst Jünger, so öffneten ihm bürgerliche Blätter wie die "Literarische Woche", die "Weltbühne" und "Das Tagebuch" ihre Spalten und suchten die offene Diskussion mit dem als NR-Chefideologen angesehenen Publizisten.
6. Widerstand gegen Hitler und Adenauer
Die Zeichen der Zeit wurden von der GSRN schon ab Spätherbst 1932 erkannt. Die Umstellung auf Doppelmitgliedschaften und Unterwanderung war ein erstes Signal der Vorbereitung auf eine Hitler-Diktatur. Neben der GSRN stellten sich nur die Kommunisten bereits auf eine Phase illegaler Tätigkeit um. Die Sozialrevolutionären Nationalisten setzten auf die Selbstentlarvung des in die Reichskanzlei einziehenden Hitler und agitierten vor allem unter dem unzufriedenen linken Parteiflügel. Diese Propaganda wurde durch seit Herbst 1932 einsetzende Zerfallstendenzen der NSDAP und der SA erleichtert – Hitler hatte im Dezember Gregor Strasser aus der Partei hinausgedrängt und mit der Reichsorganisationsleitung das zentrale Steuerungsorgan der NS-Organisationen zerschlagen.
Ungeachtet einer Warnung der mit den Nationalbolschewisten sympathisierenden SA-Legende Hans Maikowski eröffnete die GSRN ihre Kundgebungswelle am 5. Februar 1933 in Berlin-Charlottenburg. Mitte des Monats erklärten sich rund 20 Führungskader der Berliner HJ zum Bruch mit der NSDAP bereit, aber Paetel legte seinen Sympathisanten weiterhin die Unterwanderung der Parteigliederungen nahe. Nach kommunistischem Vorbild dezentralisierte sich die GSRN in Fünfergruppen, und alle nicht öffentlich bekannten Aktivisten traten als Doppelmitglieder NS-Organisationen bei. Trotz einer einsetzenden Verfolgung durch Hitleristen und staatlichen Repressionsapparat ging die Kopfstärke der GSRN nicht zurück, sondern steigerte sich (wie auch diejenige der Revolutionären Nationalsozialisten) sogar. Paetel war auch an verzweifelten Versuchen beteiligt, für die Reichstagswahlen des 5. März 1933 eine nationalrevolutionäre Liste unter Ernst Niekisch und dem Bauernführer Claus Heim zustandezubringen. Grubers Schwarze Jungmannschaft als de facto-Jugendorganisation der GSRN vereinbarte mit Sozialistischer Arbeiterjugend, dem kommunistischen KJVD und linksbündischen Gruppen wie der legendären d.j. 1.11. gegenseitige Achtung und Zusammenarbeit gegen Hitler.
Am 25. Februar 1933 beschlagnahmte die Polizei Paetels "Nationalbolschewistisches Manifest" größtenteils in der Druckerei: "In den Umrissen proklamiert der deutsche Nationalkommunismus: Wir erkennen die Notwendigkeit der deutschen sozialistischen Revolution. Sie ist die geistige Umgestaltung, die wirtschaftlich, politisch und kulturell das Gesicht unserer Zeit bestimmt, sie ist praktisch die Revolution der Arbeiter, Bauern und verproletarisierten Mittelschichten." Die GSRN bekannte sich zur Nation als Kulturgemeinschaft im Gegensatz zur westlichen Zivilisation. "Wir bekennen uns zum planwirtschaftlichen Sozialismus, der nach Brechung der kapitalistischen Ordnung Volk und Nation und organischer Wirtschaftsgliederung bindet und als Gemeinwirtschaft die Grundlage der staatlichen Souveränität bildet. Die Verwirklichung unserer Ziele ist der freie großdeutsche Volksrätestaat als Ausdruck der Selbstverwaltung des schaffenden Volkes." Gefordert wurden im krassen Gegensatz zur prokapitalistischen Wirtschaftspolitik Hitlers die Sozialisierung aller industriellen Groß- und Mittelbetriebe, die Enteignung des Großgrundbesitzes, eine Agrarreform durch Ansiedlung von Kleinbauern und Errichtung sozialisierter Staatsgüter, das staatliche Außenhandelsmonopol, die Verstaatlichung des Bankensektors, engste wirtschaftliche, politische und militärische Zusammenarbeit mit der Sowjetunion, die Unterstützung auch ausländischer revolutionärer Bewegungen und die Schaffung der Einheitsfront aller unterdrückten Klassen und Nationen. "Kampf gegen das die äußere Unfreiheit sanktionierende System von Weimar, reichend von Hilferding zu Hitler, bis zu seiner Vernichtung...Der heutige Zustand erfordert: Die schärfste Durchführung des Klassenkampfes der Unterdrückten gegen alle, die das privatkapitalistische Dogma von der Heiligkeit des Eigentums vertreten. Das ist der einzige Weg zur deutschen souveränen sozialistischen Nation...Zur Erreichung dieser Ziele ist heute notwendig: Kampfgemeinschaft mit der Partei des revolutionären Proletariats, der KPD."
Die Verfolgungsmaßnahmen des sich konsolidierenden NS-Regimes gegen den sozialistischen Widerstand inner- und außerhalb der Parteigliederungen griffen ab dem Spätsommer 1933 zusehends. Karl O. Paetel wurde noch vor Jahresende aus der Reichsschrifttumskammer ausgeschlossen und verlor somit das Recht, in Deutschland zu publizieren. Der mit seiner Schwarzen Jungmannschaft mittlerweile innerhalb der Deutschen Arbeitsfront untergetauchte Gruber wurde im Januar 1934 zusammen mit einer Reihe von Aktivisten der d.j. 1.11. verhaftet. Im Zusammenhang mit der brutalen Vernichtung unruhiger Elemente innerhalb der SA, die sich auch auf andere Organisationen und Widerstandsgruppen ausweitete, tauchte Paetel im Sommer 1934 vorübergehend in Mecklenburg unter. Als offizielle Fortsetzung der "Kommenden" und getarntes Organ der GSRN und den "Gegner"-Kreises erschien ab dem 15. Juli 1934 die Zeitschrift "Wille zum Reich". Hier konnte Paetel unter seinem Pseudonym Wolf Lerson bis zum Verbot des Blattes 1935 eine Reihe von den real existierenden Nationalsozialismus kritisierenden Aufsätzen zur Typologie des internationalen Faschismus veröffentlichen und an das von Gestalten wie Schirach vergewaltigte politische Erbe der nationalrevolutionären Jugend erinnern.
Nach einer vorübergehenden Verhaftung im Januar 1935 setzte Karl O. Paetel sich auf der Stelle in die Tschechoslowakei ab, wo sich Prag zu einem Zentrum nationalrevolutionärer Exilanten entwickelt hatte. Die Reste der GSRN führten die Zusammenarbeit mit Harro Schulze-Boysens "Gegner"-Kreis weiter, mit dessen Hilfe Paetel sich im Sommer 1935 nach einem illegalen Aufenthalt in Deutschland nach Skandinavien absetzen konnte. Auf deutschen Druck (nach Veröffentlichung eines Aufrufes zur Unterstützung der spanischen Volksfront) aus Schweden ausgewiesen, reiste der nationalrevolutionäre Emigrant im Oktober 1936 via Polen erneut nach Prag, um Anfang 1937 eine Aufenthaltsgenehmigung für Frankreich zu erhalten. Hier arbeitete er an Willi Münzenbergs "Deutschem Freiheitssender" mit. Von Stockholm, Paris und Brüssel aus gaben Paetel und einige Mitarbeiter als Auslandsbüro der GSRN nun die "Blätter der sozialistischen Nation. Rundbriefe für sozialistische und nationalsozialistische deutsche Politik" heraus.
Durch Kontakte zu Vertretern der linksbündischen Untergrundorganisation d.j. 1.11. konnte wieder eine engere Verbindung zum innerdeutschen Widerstand hergestellt werden. Gemeinsam mit dem d.j.-Vordenker Eberhard Koebel (tusk) wies Paetel die Forderung der Kommunistischen Jugendinternationale nach politischer Unterordnung des gesamten Jugendwiderstandes unter die Parteidoktrin zurück. Ein nicht zuletzt von Paetel organisiertes größeres Treffen bündischer Widerstandskämpfer am Rande der Pariser Weltausstellung im August 1937 brachte die Gestapo auf die Fährte des bündischen Untergrundnetzes und hatte zahlreiche Verhaftungen und Terrorurteile zur Folge.
Im April 1939 entzog das Reichsinnenministerium Karl O. Paetel die deutsche Staatsangehörigkeit, und kurz darauf wurde er als Hochverräter in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Nachdem die Wehrmacht im Sommer 1940 Westeuropa überrannt hatte, übergab die Reichsregierung den französischen Behörden eine Auslieferungsliste mit gefährlichen Regimegegnern. Unter den 101 Namen stand Otto Strasser an 1. Stelle, Paetel bekleidete immerhin den 5. Rang. Über Spanien und Portugal gelang dem Gesuchten wie seinem Rivalen Strasser die Flucht nach Nordamerika.
Bevor Paetel sich endgültig von der politischen Bühne verabschiedete, erfolgte nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches ein neuer Versuch, den Traum von einer "Dritten Front" der Jugend zu verwirklichen. Im November 1947 trafen im Haus Altenberg bei Köln die Vertreter von Jugendverbänden aus allen Teilen des besetzten und zerstückelten Deutschland zusammen, um die Möglichkeit einer interzonalen Zusammenarbeit zu besprechen. Heinz Gruber als Paetels Vertreter versuchte vergebens, die sich öffnenden Gräben zwischen den kirchlichen und sozialdemokratischen Jugendverbänden einerseits und der durch Erich Honecker vertretenen FDJ andererseits zu überbrücken.
Auch nach dem Scheitern der Konferenz setzten sich Paetel, Gruber und Grosse weiterhin für die Schaffung eines deutschen Europäertums zwischen dem kapitalistischen Westen und dem stalinistischen Osten ein. Ein letztes Aufbäumen vor dem endgültigen Verzicht auf die Ziele eines 30jährigen Kampfes war die Konferenz auf Burg Ludwigstein vom Januar 1954. Hier trafen Veteranen aus Bündischer Jugend, Nationalsozialismus und Widerstand zusammen und beschlossen ein gemeinsames Engagement im neutralistischen Widerstand gegen die Wiederaufrüstung und Westintegration der separatistischen BRD. Mit dem Parteiverbot gegen die KPD und der systematischen Kriminalisierung außerparlamentarischer Bewegungen durch das reaktionäre Adenauer-Regime scheiterte auch dieser letzte Versuch, ein unabhängiges und sozialistisches Deutschland zu schaffen.
00:10 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, années 30, socialisme, nationalisme, nationalisme révolutionnaire, histoire, politique, théorie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 09 novembre 2009
Bulgaria, la guardiana eslava del Danubio
|
por José Luis Orella / http://www.arbil.org/ Bulgaria es un país bastante desconocido en sus orígenes y que se encuentra en la actualidad entre los países deseosos de aprovechar su entrada en la Unión Europea para elevar su nivel de vida. Pero, ¿quiénes son los búlgaros? | |
| Este pueblo nómada procedente de las estepas del Asia Central de origen turco-mongólico se integró entre las masas eslavas que habían pasado el siglo VII el Danubio. En el IX, bajo el reinado de Borís I los discípulos de Matodio convierten a los búlgaros al cristianismo. La nación búlgara no conoció la paz, creció en lucha con los bizantinos, magiares, pechenegos y las controversias interiores promovidas por los heréjes bogomilos. Aunque tuvo momentos de gran esplendor, como con Simeón entre el 893 y el 927, y un segundo período de grandeza con Juan Hasen entre 1218 y 1241. A pesar de todo, las estepas siguieron aportando oleadas de pueblos nómadas y en el siglo XIII los tártaros se adueñaron de la región balcánica. Pero cuando los turcos derrotaron a los cristianos en Kosovo, Bulgaria pasó al dominio otomano. No será hasta la segunda mitad del siglo XVIII cuando los búlgaros tengan un renacimiento cultural recuperando del olvido su identidad perdida. Este hecho tendrá como consecuencia la sprimeras revueltas contra el dominio turco que producirá tremendas persecuciones. Sin embargo, el imperio ruso siempre intercederá en protección de los cristianos ortodoxos de los territorios balcánicos. En el siglo XX Bulgaria alcanzará la independencia y en 1908 Fernando Sajonia Coburgo Ghota se convertirá en su monarca. Pero la independencia no significa la paz, Bulgaria entra en guerra contra los turcos, consiguiendo una gran expansión. No obstante, esto motivará la envidia de sus vecinos, servios, griegos y rumanos quienes unidos a los otomanos reducirán a Bulgaria a los límites actuales. Esto causará que en la Primera Guerra Mundial entre del lado de los Imperios centrales, siendo derrotada y perdiendo el trono el monarca Fernando, quien abdicó en favor de su hijo Boris III.
En la postguerra, el líder campesino Alejandro Stambulijsski estableció una dictadura que repartió las tierras y organizando las guardias naranjas. Sin embargo, en 1923, el ejército, derechistas y el rey derrocaron al gobierno campesino que derivaba hacia una peligrosa amistad con la Unión Soviética. Durante la Segunda Guerra Mundial, Bulgaria cooperó con las potencias del Eje en la región de los Balcanes, recibiendo en compensación Macedonia, la salida al Egeo y revancha ante Grecia y Yugoslavia. Pero la muerte prematura del rey en 1944, causó el ascenso de una regencia que pactó la entrada de los soviéticos y la deserción del bando alemán, que produjo el abandono alemán de la mayor parte de la región balcánica. El ejército soviético apoyó a los comunistas que subieron al poder liderados por Dimitrov, quien había sido presidente de la Internacional comunista. Después de la instauración de la república, la represión se avalanzó sobre todos los partícipes en el régimen monárquico, los escasos católicos y los musulmanes. Estos últimos son el 10% de la población y mantienen la cultura otomana a pesar de los intentos de eslavización de las autoridades búlgaras. Durante la guerra fria Bulgaria fue el satélite más obediente a las directrices rusas bajo Dimitrov y después con Todor Zikov, siendo su servicio de espionaje, quien llevó la mayor parte de los servicios que la KGB no quería realizar, como el atentado al actual Pontífice de la Iglesia Católica.
La Perestroika finalmente derrumbó en Bulgaria al comunismo, los antiguos dirigentes se transformaron en socialistas, aún con una gran poder y la oposición permaneció unida en una alianza que consiguió la máxima representación del Estado. Durante la transición, la unión de fuerzas democráticas tuvo un fuerte protagonismo, y los excomunistas fueron evolucionando a la socialdemocracia; mientras el partido de defensa de los derechos del hombre, reunía a la minoría turca del país, y en la capital a la importante minoría gitana. El papel bisagra de este último partido impidió a los partidos nacionales una política mayor en la intensificación de la eslavización del país. En cuanto a su política exterior, mantiene una gran amistad con Macedonia, país hermano y factible de integración, lo que provoca la enemistad con Grecia. Sin embargo, su situación es no quedar marginada del desarrollo europeo, situados en una esquina en el mar Negro. Sin embargo, la pobreza y la corrupción son los grandes protagonistas del país. Desde el 2005, socialistas, turcos y monárquicos de Simeón II, comparten las labores de gobierno en una coalición. No obstante, la emigración ha sido la única respuesta a la población joven. La consecuencia inmediata es la continua movilidad del mapa político búlgaro. En la actualidad, las encuestas otorgan su favor a los socialistas, como nostálgico recuerdo del orden; el partido de defensa de los derechos, basado en la minoría turca; el nuevo GERB, liderado por el alcalde de Sofía, Boiko Borisov, quien ha absorbido el apoyo social de los partidos de derechas como los históricos UFD e incluso a los monárquicos del pretendiente Simeón II, que obtendrían unos resultados ridículos. El cuarto protagonista sería el partido nacionalista Ataca, basado en desarrollar la eslavización y el nacionalismo búlgaro frente a los turcos, y que ejerce una ferrea oposición contra los excomunistas. Con respecto al campo económico, Rusia, la antigua protectora de Bulgaria, la introduce en el recorrido de su oleoducto hacia Austria. Un modo de mantener su influencia en los Balcanes, y de apoyar al pequeño hermano eslavo, que siempre ha demostrado su fideliadad a Rusia, incluso copiando parte de su bandera. ·- ·-· -······-· |
00:10 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, géopolitique, danube, bulgarie, balkans, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 08 novembre 2009
Bodo Uhse - im Spannungsfeld von Nationalem Sozialismus und sozialistischem Patriotismus
 Bodo Uhse – im Spannungsfeld von Nationalem Sozialismus und sozialistischem Patriotismus
Bodo Uhse – im Spannungsfeld von Nationalem Sozialismus und sozialistischem Patriotismus
Verfasser: Richard Schapke, Juni 2002
"Eine Eigenschaft vor allem ist nötig, Mut, Mut zur Eroberung wie zum Verzicht, Mut zur Erkenntnis, sei sie auch noch so schmerzlich, peinigend und bitter. Du musst es wagen, mit dem Herzen zu denken und mit dem Kopf zu fühlen. Von den Deutschen haben das nur wenige gekonnt."
- Bodo Uhse
Gegenstand dieses Aufsatzes ist die Person des Schriftstellers und Publizisten Bodo Uhse. Im Verlaufe seiner höchst bemerkenswerten Vita gelang es Uhse, seinen Lebensweg vom Teilnehmer des Kapp-Putsches bis hin zu einem der führenden Kulturpolitiker der Deutschen Demokratischen Republik zu gehen. Unsere Darstellung beruht auf Bodo Uhses romanartiger Autobiographie "Söldner und Soldat", auf Klaus Walthers dem Protagonisten gewidmeten Bändchen der DDR-Reihe "Schriftsteller der Gegenwart", zeitgenössischen Quellen aus Weimarer Zeiten und nicht zuletzt diversen Publikationen zum Nationalbolschewismus der 20er und 30er Jahre. Die kursiv gesetzten Zitate stammen, sofern nicht anders angegeben, aus der Feder Bodo Uhses
1. Jugendzeit im Bund Oberland
Bodo Uhse wurde am 12. März 1904 als Sohn eines preußischen Berufsoffiziers in der Garnisonstadt Rastatt geboren. Infolge der zahlreichen Versetzungen des Vaters verlief seine Kindheit in relativ unregelmäßigen Bahnen, wozu auch die Trennung der Eltern ihr Scherflein beigetragen haben mag. Nach jahrelangem Unterricht durch Privatlehrer kam Uhse erst 1914 in den fragwürdigen Genuss eines regulären Schulbesuches, und zwar in Braunschweig. Hier lebte er bei seinen Großeltern, und hier schloss er sich wie so viele seiner Altersgenossen der Wandervogelbewegung an, um der familiären Enge zu entkommen.
Die gehegten Hoffnungen auf eine Offizierslaufbahn nach des Vaters Vorbild – genährt durch den Ersten Weltkrieg und die Vision eines klassenübergreifenden nationalen Aufbruches hin zu besseren Zeiten – fanden durch den Zusammenbruch des morschen Kaiserreiches im November 1918 ein jähes Ende. Frustriert musste Uhse zu seinem Vater nach Berlin übersiedeln, wo er fortan die Oberrealschule besuchte. In diese Zeit fielen die ersten Kontakte zu paramilitärischen Verbänden der radikalen Rechten (für einen preußischen Offizierssohn und Wandervogel wahrlich nichts Ungewöhnliches), und im März 1920 beteiligte er sich, kaum 16 Jahre alt, als Zeitfreiwilliger und Meldegänger am Kapp-Putsch gegen die ungeliebte Republik.
Im Frühjahr 1921 brach Uhse mit der ungeliebten Familie und verließ Berlin, um fortan seinen eigenen Weg zu gehen. Der talentierte junge Mann wurde auf Vermittlung des rechtsradikalen Agitators Karl von Gebsattel als Volontär in die Redaktion des "Bamberger Tageblattes" aufgenommen. Das Blatt war trotz einer Auflage von 20.000 Exemplaren stark von den Wünschen des Tabakindustriellen Baron Michel-Raulinos abhängig, was der journalistischen Betätigung nicht nur Uhses so manche Schranken setzte. Bereits jetzt zeichnete er sich durch einen unruhigen Geist aus, was nicht zuletzt durch einen spontanen Redeauftritt auf einer Versammlung des Deutschvölkischen Schutz- und Trutzbundes dokumentiert wurde. "Wo sollte die nationale Sache hinkommen, wenn sie ängstlich vor Demokraten und Katholiken auswich?"
Stammtischreden und Vereinsmeierei der Deutschnationalen, Alldeutschen und Völkischen lagen dem aktivistischen Uhse nicht, also trat er Ende 1921 dem paramilitärischen Bund Oberland bei. "Wer auf diese Fahne schwört, hat nichts mehr, was ihm selbst gehört." Die Flucht aus der Vereinsamung in die entschlossene Gemeinschaft stellte hierbei neben politischen Aspekten einen wichtigen Faktor dar. Der Bund Oberland war aus dem gleichnamigen Freikorps hervorgegangen, das zwar einerseits gegen die Münchener Räterepublik und gegen die polnischen Insurgenten in Oberschlesien kämpfte, aber andererseits im Gegensatz zum Gros der anderen rechtsextremen Landsknechte den Einsatz gegen streikende Arbeiter verweigerte. Nach der Umwandlung in den Bund betrieb Oberland mit Hilfe der Reichswehr weiterhin intensive paramilitärische Ausbildung.
Bei Oberland lernte Uhse Persönlichkeiten der völkisch-nationalsozialistischen Szenerie bis hin zum Radauantisemiten Julius Streicher kennen. Einen gewissen Eindruck machte Gottfried Feders Theorie von der Brechung der Zinsknechtschaft – schon früh entwickelte sich ein diffuser antikapitalistischer Affekt. Kommandeur der Bamberger Oberländer war der "rote Leutnant" Audax, der während der Revolution als einziger Offizier auf Seiten der Sozialisten stand. Erscheinungen wie Audax waren bei Oberland keine Seltenheit: Auch der ehemalige Kommandeur Beppo Römer tat sich schon früh durch ausgesprochen "nationalbolschewistische" Tendenzen hervor. Auf der anderen Seite nahm Uhse selbstredend an Aufmärschen und Zusammenstössen mit Kommunisten und Sozialdemokraten teil, wobei er einmal erhebliche Verletzungen davontrug. "Viele hundert gebückte Gestalten sah ich vor mir, die suchten etwas. Ich hörte meine Stimme sie fragen: 'Was?' – 'Deutschland', antworteten sie, und ich empfand den Zwang, ihnen zu sagen, wo sie es fänden. Aber es war so, dass ich es selbst nicht wusste."
Im Laufe der Zeit kamen Rivalitäten mit den von den militärisch ungleich professionelleren Oberländern belächelten Nationalsozialisten auf, die unsinnige antisemitische Propaganda des Hitler-Intimus Hermann Esser führte im Frühjahr 1923 sogar zu einer Saalschlacht zwischen Oberland und der SA. Esser lehnte den Kampf gegen die französische Besatzungsmacht an der Ruhr strikt ab und erhob die Vernichtung des "jüdischen Weltparasiten" zum alleinseligmachenden Ausweg. Oberland nahm bekanntermaßen mit zahlreichen Aktivisten am Ruhrkampf teil und reagierte entsprechend gereizt auf die nationalsozialistischen Wahnvorstellungen. Dennoch verbündeten sich die Rivalen bald darauf im Kampfbund gegen die republikanische Ordnung.
Der einsetzende Massenzulauf zu Oberland warf erhebliche Probleme auf und sorgte für Unbehagen: "Der alte Ton persönlicher Kameradschaft verschwand aus dem Bunde...Der Bund konnte sie nicht mehr seiner Gemeinschaft voll einordnen. Die wohlausgewogene Mischung von Romantik und Sachlichkeit, von rebellischem Wandervogeltum und politischer Reaktion, von Aufrührertum und Disziplin wurde getrübt. Die Leute im Bund waren erst einmal Studenten oder Rechtsanwälte, Kaufleute oder Angestellte und erst lange nachher das, was wir ganz und gar sein wollten. Der selbstverständliche Grundsatz, dass, wer dem Bunde angehöre, nur ihm verpflichtet sein dürfe, wurde nicht mehr respektiert." Im Dienst wurden die mittleren und höheren Angestellten bevorzugt, die Korpsstudenten führten ohnehin ein striktes Eigenleben.
Im November 1923 wurde Bamberg im Zusammenhang mit dem Hitler-Ludendorff-Putsch in München von tagelangen Krawallen erschüttert, an denen auch Bodo Uhse und seine Oberland-Kameraden teilnahmen. Nachdem die SA sich zuvor widerstandslos entwaffnen ließ, wurden die Oberländer von ihrem neuen Kommandeur Apfelstedt kurzerhand nach Hause geschickt. Die Wut entlud sich in dreitägigen Straßenschlachten mit der Polizei und wüsten Radauszenen. Im Anschluss lieferten sich Bambergs Oberländer einen regelrechten Privatkrieg mit der örtlichen SA, namentlich der provozierend "Adolf" getaufte Mischlingshund der Uhse-Kumpanen sorgte stets für Zündstoff.
Der Bund Oberland erstickte langsam im provinziellen Treiben der einzelnen Gruppen, das Gros der alten Mitglieder verlief sich. Uhse und seine Freunde suchten nach tieferen Inhalten. Man "spottete über die, die mit weltanschaulichen Belichtungstabellen durchs Leben zogen und für jede Situation dort die richtige Einstellung gewannen. Für diese Leute gab es nichts Neues mehr. Das Überraschungsmoment war für sie ausgeschaltet, sie hatten für alles eine Formel, von allem eine fertige Meinung. Es war gewiss bequem, sich auf solche Weise mit dem Leben auseinanderzusetzen, denn es gab keine Auseinandersetzung mehr. An Stationen, die im Weltanschauungsfahrplan nicht vermerkt waren, fuhr man vorüber, ohne aus dem Fenster zu sehen. Es war angenehm und bequem, mit breitem Arsch auf seinen Überzeugungen zu sitzen und nicht das Leben vor sich zu haben, sondern seine Weltanschauung, nicht die Dinge, sondern seine Meinung von den Dingen. Weltanschauung verpflichtete nicht, sondern pflichtete bei."
2. Anschluss an die nationalsozialistische Linke
Wie das "Bamberger Tageblatt", so fungierte auch Oberland letztlich nur als Durchlauferhitzer für Bodo Uhses weitere Radikalisierung. Am 1. Mai 1927 erschien im Bundesorgan "Das Dritte Reich" erstmals ein Aufsatz aus der Feder Uhses, der eine deutliche Hinwendung zu den Positionen des linken Flügels der NSDAP und des Neuen Nationalismus eines Ernst Jünger erkennen ließ. Im gleichen Monat erfolgte auch der Eintritt in die Redaktion des Ingolstädter "Donauboten", mithin eine der ersten nationalsozialistischen Zeitungen überhaupt. Nach dem Parteieintritt im Spätsommer 1927 reihte Uhse sich in die Phalanx der NS-Linken um die Gebrüder Strasser ein, die bemüht waren, der kleinbürgerlich-reaktionären Fraktion um Hitler ein national-sozialistisches Gegengewicht entgegenzustellen. Gemeinsam wollten die NS-Linken der Partei einen sozialrevolutionären Geist einhauchen, der "an Stelle des Kehrrichthaufens aus Bierkellerromantik, Kleinbürgersehnsucht und einer Winzigkeit echten, aber irrenden Gefühls treten, den die fünfundzwanzig Punkte des offiziellen Parteiprogramms darstellten".
Aufschlussreich über den politischen Standort Uhses ist der im Dezember 1927 im "Dritten Reich" erschienene Aufsatz "Die neue Front. Saboteure an der Arbeit": "Brennend geworden in jener Stunde, da das Gewaltdiktat der kapitalistischen Siegermächte nicht das alte Deutschland, sondern das arbeitende, deutsche Volk mit vernichtendem Schlage traf. Damals verriet die Sozialdemokratie die sozialistische deutsche Revolution und streckte die Waffen. Der deutsche Arbeiter wurde zum Kuli. Er bekam die durch die Machtdiktate (die Reparationen des Versailler Diktats, d. Verf.) veranlasste Sozialreaktion zu spüren und empörte sich dagegen in blutigen Aufständen. Damit wurde zum zweiten Male die Frage der Verbundenheit von Arbeitern und Frontkämpfern brennend. Wenn die Frontkämpfer - statt vom Unternehmertum sich zur Niederwerfung der sozialrevolutionären Bewegung ausnutzen zu lassen - in den revolutionierenden Arbeitern ihre natürlichen Bundesgenossen erkannt hätten, so wäre damals schon die nationalrevolutionäre Front gegen Versailles entstanden. Die besitzenden Kreise wehrten sich gegen den neuen Nationalismus, der sich mit der sozialistischen Revolution um der nationalen Freiheit willen verbünden wollte, nicht aus taktischen Gründen sondern grundsätzlich um durch die sozialistische Organisation der Nation die Widerstandsfähigkeit auch für die Zukunft aufs Höchste zu steigern. So musste das Unternehmertum - nach einem halben Versuch im Ruhrkampfe - sich der Herrschaft der Finanzbourgeoisie ergeben und den Gedanken des nationalen Widerstandes mit dem Einschwenken in die Locarnofront (Sicherheitspakt mit den Westmächten statt Bündnis mit der antiwestlichen Sowjetunion, d. Verf.) verraten. Nachdem die Sozialdemokratie ihre Büttelrolle erfüllt hat, hat das deutsche Unternehmertum die Rolle des Fronvogtes der Finanzbourgeoisie übernommen. Die bittere aber eindeutige Lehre ist, dass man als Nationalist Sozialist sein muss, denn der Sozialismus ist unser Schicksal."
Als Protegé der vor allem in Norddeutschland einflussreichen Strasser-Brüder machte Uhse Karriere und übernahm noch vor Jahresende die Chefredaktion des "Donauboten". In dieser Funktion arbeitete er eng mit Otto Strasser und Herbert Blank zusammen und wurde praktisch das dritte Sprachrohr der NS-Linken. In Süddeutschland dominierte jedoch der rechte Parteiflügel, und als Uhse im Frühjahr 1928 öffentlich gegen die Kandidatur des reaktionären Generals von Epp auf der NS-Liste protestierte, warf man ihn aus der Redaktion hinaus. Seiner Agitation für einen nationalen Sozialismus tat das keinerlei Abbruch. Im August 1928 veröffentlichte er wiederum im "Dritten Reich" den Aufsatz "Der proletarische Deutsche", der deutliche Einflüsse der SPD-Renegaten August Winnig und Ernst Niekisch verriet. Diese sahen in der Arbeiterschaft die zur Machtausübung im kommenden neuen Staat bestimmte Klasse, propagierten die Mobilisierung des bolschewistischen Chaos gegen den Westen und standen damit in deutlichem Gegensatz zum herkömmlichen Nationalismus oder zur nationalsozialistischen Volksgemeinschaft:
"Außerdem aber verrät die Ansicht, dass das sachliche und persönliche Bekenntnis zum deutschen Arbeitertum ein Verrat am ‚Ideale‘ der Volksgemeinschaft sei, eine solche Unkenntnis zum deutschen Proletariat, das - wie man doch wird zugeben müssen - ein sehr beachtenswerter Teil der deutschen Volksgemeinschaft ist, dass es besser ist für die Träger diese Ansicht, sie geben die Beschäftigung mit der Politik auf (...) Wer um die deutsche Freiheit sinnt, der kann am deutschen Proletarier nicht mit blinden Augen vorbeigehen. Er ist im Gegenteil gezwungen, seine Augen auf ihn zu richten und wenn sein Freiheitswille ehrlich ist, d.h. wenn es ihm gleichgültig und unbeachtenswert ist, unter welchen Formen und Fahnen die Freiheit gewonnen werden soll, wenn er also alle Vorurteile und Gedankenhemmnisse überkommener Begriffe wegwirft, dann wird er den deutschen Proletarier sehen, achten und lieben lernen. Zunächst ist es nötig, sich einmal des durchaus bürgerlichen Begriffes der ‚Klasse‘ zu entledigen. (...) Nicht Bürger, sondern wahrhaft marxistischer Bourgeois ist, wer den Unterschied zwischen den Begriffen der Klasse und der Schicht nicht zu sehen vermag. Der materialistische Begriff der Klasse erfasst ja nur einen Teil, nur eine Seite des deutschen Arbeitertums, während die Schicht das deutsche Arbeitertum auch in seinen immateriellen Kräften umfasst. Nicht dialektische Schablone, sondern lebendige Kraft, das ist der Unterschied zwischen Klasse und Schicht. Wer aber diesen Unterschied kennt - und der Weg zu dieser Erkenntnis ist offen für alle, die guten Willens sind - der wird nicht ‚hinabsinken in die Masse‘, sondern er wird die lebendige Kraft des deutschen Arbeitertums aufsuchen."
3. Die "Schleswig-Holsteinische Tageszeitung"
Im September 1928 empfahl Gregor Strasser seinen Protegé als politischen Redakteur für die geplante "Schleswig-Holsteinische Tageszeitung" mit Sitz in Itzehoe. An der Besprechung im preußischen Landtag nahmen u.a. Parteiprominente wie Erich Koch, Karl Kaufmann, Robert Ley und Wilhelm Kube teil. Strassers Vertrauen in diese Truppe wurde von Uhse mitnichten geteilt: "Selbstlose Vorkämpfer eines deutschen Sozialismus waren diese erfahrenen und gewiegten Draufgänger wohl nicht." Dennoch ergriff er die neue Gelegenheit am Schopfe, war ihm die sich steigernde Unruhe im Deutschland der späten 20er Jahre doch durchaus bewusst: "Wenn sie scharf hinhören, werden sie das Ticken der Würmer im Gebälk vernehmen. Sehen sie nachts über das Land, am Horizont stehen Flammen. Unruhe und Ungewissheit liegen in der schwülen Luft." Die SHTZ sollte die erste norddeutsche Tageszeitung der NSDAP werden und die bisher kümmerliche Propagandaarbeit in der Nordmark vorantreiben. Das Terrain war günstig: Bei den Reichstagswahlen von 1928 erzielte die NSDAP in Schleswig-Holstein überdurchschnittliche Ergebnisse, und Strasser witterte hier Möglichkeiten, seine Basis zu verbreitern.
Im Oktober attackierte Uhse in den strasseristischen "NS-Briefen" noch einmal den parteioffiziellen Antimarxismus, bevor er nach Itzehoe übersiedelte. Die Itzehoer Parteibasis bestand zumeist aus Landwirten und Handwerkern und forderte, die SHTZ dürfe nicht nur ein Parteiblatt, sondern auch und gerade ein Blatt für die unter der Agrarkrise mit Preisverfall, Verschuldung und steigenden Steuern leidenden Bauern sein. "Ein Blatt also gegen die Regierung, ein Blatt des Umsturzes, ein Blatt der Revolution." Zu dieser Zeit entwickelte sich gerade die militante Landvolkbewegung, die sich durch Widerstandsaktionen gegen Gerichtsvollzieher und Polizeibeamte hervortat. Uhse nahm prompt an einer Protestkundgebung des Landvolks teil und zeigte sich beeindruckt: "Diese Bauernhaufen hatten eine rücksichtslose Entschlossenheit in ihren Gesichtern gezeigt. Ihre Methoden waren überraschend in der Unmittelbarkeit, mit der sie sich gegen den Staat wandten. Es gab kein spießbürgerliches Für und Wider, keine biedere Vereinsmeierei, keine Satzungen und keine Statuten, Abzeichen und Fahnen, wie sie sonst bei allem, was in Deutschland geschah, das Wichtigste und Vordringlichste schienen. Hier war wirklich Bewegung, gefährdet allerdings durch ihre fehlende Reglementierung, durch die anarchischen Formen ihres Ablaufes und durch die drängende Ungeduld. Man musste einen Weg finden, mit der unbändig rebellierenden Kraft der Bauern zusammenzuarbeiten."
Am 3. Januar 1929 erschien die erste reguläre Ausgabe der SHTZ, wenn auch anfangs nur als Wochenblatt. Uhse legte sich prompt mit Gauleiter Hinrich Lohse an, als er den Abdruck eines gegen das Landvolk gerichteten Artikels verweigerte, und drohte sogar mit seinem Rücktritt als Chefredakteur. Er traf auch mit dem Landvolkführer Claus Heim zusammen, der die bedingungslose Unterordnung der NSDAP unter die schwarze Fahne der Bauernnot und der Rebellion verlangte. Der NS-Agitator erkannte, dass die Abneigung der Parteibürokratie gegen das Landvolk und gegen Heim vor allem auf die Angst des Funktionärs vor der Persönlichkeit zurückzuführen war. Obwohl er sich eher zu den Landvolkaktivisten wie Herbert Volck, Walther Muthmann oder Bruno von Salomon hingezogen fühlte, übernahm er bald die Führung der NSDAP-Ortsgruppe Itzehoe. Die bislang vor sich hindümpelnde Parteiarbeit belebte sich unter Uhses Leitung sprunghaft. In den alle 14 Tage abgehaltenen Versammlungen agitierte er unter den Bauern und den Absolventen paramilitärischer Kurse und wetterte gegen den platten Antisemitismus der reaktionären Parteigeneralstäbler in München. "Die Revolution von 1918 hat nur den alten Bau vernichtet. Wir sitzen ohne Dach über dem Kopf im Wetter. (...) Das deutsche Volk ist ausgebeutet und unterdrückt. Im deutschen Volk aber stehen auf der untersten Stufe Arbeiter und Bauern. Auf sie werden alle Lasten abgewälzt. Ihre Not ist die Not des ganzen Volkes, ihnen gebührt die Führung." Zu Uhses Entsetzen erkannte Hitler jedoch im Interview mit einer amerikanischen Zeitung und auch im "Völkischen Beobachter" die Auslandsverpflichtungen Deutschlands und damit die Versailler Kriegstribute an.
Die Antwort bestand in einem prononcierten Radikalismus, der auch vor Saalschlachten mit anderen rechtsgerichteten Organisationen nicht haltmachte. In Husum provozierte Uhse eine aufsehenerregende Saalschlacht auf einer Versammlung des Jungdeutschen Ordens: "Ihr werft uns Terror vor? Wenn wir nur so terrorisieren könnten, wie wir wollen! Aber der Tag kommt. Nicht mit der klügelnden Vernunft – mit der vom eisernen Willen geführten Faust werden Revolutionen gemacht. Wir glauben an die Gewalt, wir lieben die Gewalt und wir üben Gewalt." Die SA ließ sich das nicht zweimal sagen, geriet völlig außer Rand und Band und schlug alles kurz und klein. Hitlers Privatkanzlei schickte prompt einen Beschwerdebrief an Lohse und verwies auf das Legalitätsprinzip der NSDAP.
Geradezu traumatisch wirkte sich kurz danach ein schwerer Zusammenstoß mit den Kommunisten in Wöhrden bei Heide aus, bei dem die Nationalsozialisten Otto Streibel und Hermann Schmidt sowie der Kommunist Johannes Stürzebecher den Tod fanden. "Ich konnte diesen Toten nicht hassen und nicht die, die seine Gefährten gewesen waren in dieser blutigen Nacht...Dieser Stürzebecher da hatte ehrlich für seine Sache gekämpft und für die seiner Kameraden. (...) "Ich erschrak, da ich fühlte, wie ich die beiden Toten vor mir verleugnete und mein Herz sich vor dem dritten beugte, vor der anklagenden und hassenden Grimasse des Kommunisten, der dem Namen des alten Seeräubers und Rebellen, den er trug, mit seinem Tode Ehre gemacht hatte. Leben und Tod waren bei ihm eine gerade Linie und sinnvoll einfach durch ihr Dasein. Er war arm und unterdrückt und ausgebeutet, daran hatte ich nicht zu zweifeln, und er hatte – wer wollte das in Frage stellen? – gegen das ihm und Tausenden der Seinen aufgezwungene Geschick gekämpft...Die schmerzverzogenen Züge formten für mich das Gesicht seiner Kameraden, seiner Klasse, an deren Kraft ich doch glaubte. Ich hatte nicht kämpfen wollen gegen diese Klasse, das war doch der simple Sinn meines Handelns gewesen, darum auch war ich National-Sozialist geworden."
Nach dem Wöhrdener Zwischenfall befürchtete Gauleiter Lohse anfänglich ein Parteiverbot, fing sich jedoch rasch wieder in schlachtete den Tod der zwei SA-Männer propagandistisch aus. Zur Trauerfeier am 13. März 1929 stattete auch Hitler Schleswig-Holstein seinen ersten Besuch aus. Im Anschluss an die Beisetzung tauchte er in der Redaktion der SHTZ auf und verlieh seinem Unmut über Uhses radikalen Kurs Ausdruck. Zwar lese er das Blatt täglich, aber die Umstände würden zur Zurückhaltung mahnen. Der Kritisierte konterte, der Radikalismus des Landvolkes zwinge ihn zu einer anderen Sprache. Bald darauf wurde die SHTZ für 4 Wochen verboten, und im Zwangsurlaub freundete Uhse sich mit der Redaktionsmannschaft der Konkurrenzzeitung "Das Landvolk" um Bruno von Salomon an.
Am 23. Mai 1929 eröffnete die Landvolkbewegung ihren Terrorfeldzug gegen die Republik mit einem Bombenanschlag auf das Itzehoer Landratsamt. In weiten Teilen Schleswig-Holsteins übernahmen revolutionäre Bauernkomitees die faktische Kontrolle und errichteten eine Parallelverwaltung. Für Wirbel sorgte die Beteiligung des Uhse-Kumpans Hein Hansen am Sturm auf ein Gefängnis, wo ein in Beugehaft befindlicher Bauer befreit werden sollte. Die Systempresse konstruierte einen Zusammenhang zwischen der NSDAP und den Terroristen, und um ein etwaiges Parteiverbot abzuwenden, bot Hitler eine Belohnung von 10.000 Reichsmark für denjenigen, der die Urheber der Anschläge namhaft macht. Damit machte die NS-Parteiführung sich bei den Landvolkextremisten und anderen Nationalrevolutionären geradezu zum Gespött. Es bildete sich eine Art informeller Zirkel aus Uhse, den beiden Landvolkterroristen John Johnson und Bruno von Salomon sowie dem Kommunisten Kreuding. Lohse ermahnte Uhse nachdrücklich, die Finger von den Terroristen zu lassen.
4. Bruch mit Hitler
Wasser auf die Mühlen der NS-Linken war der am 7. Juni 1929 von der Pariser Sachverständigenkonferenz verabschiedete Young-Plan zur Regelung der Reparationsfrage. Das Reich sollte bis 1988 116 Milliarden Reichsmark Reparationen in mit fortschreitender wirtschaftlicher Erholung ansteigenden Raten zahlen.
"Die Staatsmänner, beunruhigt von den drohend sich erhebenden ersten Wellen der Krisenspringflut, übergaben die Sache, von der sie bisher den Völkern erzählt hatten, es handele sich um die heiligsten Güter der Nationen, um das eben, wofür Millionen Soldaten einen harten Tod gestorben waren, den Geschäftsleuten, den Händlern, den Industriellen und Bankiers. Die traten nun bescheiden als Sachverständige aus den Kulissen heraus, hinter denen sie bisher die Regie geführt hatten, und unternahmen es, auf einer Konferenz in Paris...mit dem Geschick der Völker zu spielen. Es war das erste Mal, dass sich Vertreter Deutschlands in ihrer eigenen Sache als gleichberechtigt an den Tisch setzen durften; es war kein Zufall, dass dies in einem Kreis geschah, von dem man sagen könnte, dass hier Kapitalisten unter sich seien." Hintergrund des Youngplans waren die horrenden Kriegsschulden Großbritanniens und Frankreichs bei den USA, die durch deutsche Reparationen beglichen werden sollten. "Die Bourgeoisie dieser Länder fand es recht und billig, die Rückzahlung der Milliardensummen, die aus den Feuerschlünden der Kanonen mordbringend in die Luft gespien worden waren, auf die deutsche Bourgeoisie abzuwälzen, als 'Wiedergutmachung' eben. Der sachliche Ton der Pariser Verhandlungen der in diesen Dingen wahrhaft Sachverständigen war nicht zum letzten durch das Bewusstsein bedingt, dass die Bourgeoisie Deutschlands sich keineswegs an diesen Lasten übernehmen, sondern sie ihrerseits wieder auf die Massen des deutschen Volkes abwälzen werde. Von der Tüchtigkeit und Zuverlässigkeit des deutschen Volkes, von seinem Fleiß und seiner Arbeitskraft wussten nicht nur die ausländischen, sondern auch die deutschen Vertreter auf der Konferenz mit jener schäbigen Anerkennung zu sprechen, mit der etwa jemand das Geschick und den Fleiß seines Haustieres rühmend erwähnt. Die 'deutschen Kapitalisten' – der Ausdruck wirkt störend, denn der Kapitalismus zieht es vor, sich als Zivilisation, als Grundlage moderner Kultur, als Wahrer christlicher Güter, als Prinzip des wohlerworbenen Eigentums bezeichnen zu lassen..."
Das deutsche Kapital überwand die Deklassierung der ersten Nachkriegsjahre, indem es über den Rücken der Volksmasse stieg. Der Young-Plan stellte ein ausgezeichnetes Agitationsobjekt gegen die Weimarer Republik dar. Nicht die Alliierten hatten den Krieg gewonnen, sondern das internationale Finanzkapital. "Die deutschen Staatsmänner repräsentierten nicht den Willen des Volkes, sondern die Mächte der Ausbeutung. Die deutschen Kapitalisten hatten Frieden geschlossen mit den Kapitalisten der Feindstaaten. Der Widerstand gegen den Young-Plan musste dem Inhalt nach proletarisch und in seinen Formen revolutionär sein." Eine kalte Dusche für die revolutionären Hoffnungen war jedoch Hitlers Pakt mit DNVP und Stahlhelm zum Volksbegehren gegen den Young-Plan. "Wir hatten uns bisher mit Leidenschaft und Heftigkeit von diesen Gruppen distanziert. Wir hatten sie tagtäglich als Vertreter der Reaktion in der Presse und in Versammlungen angeprangert, und es war ein Hauptstück unserer Propaganda gewesen, dass wir ihnen den ehrlichen nationalen Willen ebenso abgesprochen hatten wie den Sozialdemokraten und Kommunisten den Willen zum Sozialismus. Nun brach Hitler mit dieser Linie unserer Politik und schlug nach rechts hin eine Brücke, auf der Bein brechen musste, wer mit der sozialen Lüge darüberschreiten wollte. Wir hatten bisher die abgetakelten Generale, die breitbeinigen Wirtschaftsführer mit ätzendem Spott übergossen und mussten nun Hitler in der Gesellschaft dieses gepflegten Pöbels sehen."
Die Redaktion der SHTZ reagierte mit Entsetzen und Empörung: "Hitler hat uns verkauft!...Mit denen, die wir täglich leidenschaftlich anklagten, denn sie schändeten mit ihrer Profitgier den Namen der Nation, mit den krebsfüßigen Rückwärtslern voll ekelhaften Standesdünkels hatte Hitler die jungen Armeen der Braunhemden verkoppelt. Er hatte in der entscheidenden Stunde, da der Kampf außerhalb der Gesetze dieses Staates geführt werden musste, seinen Weg in die friedlichen Gehege der Weimarer Demokratie gerichtet, hatte in Gemeinschaft durchschauter Scharfmacher, denen die Nation niemals mehr gewesen war als ein Deckmantel für ihre Geschäfte, an das Volk eine Frage gestellt, die nicht ehrlich gemeint, die ein Betrug war. In dem Augenblick, da Gefährliches zu tun notwendig schien, spielte Hitler ein sicheres Spiel. Er verband sich mit der Reaktion und dem unzufriedenen Kapital." Gegen diese Linie wollte Uhse Widerstand leisten, blitzte allerdings bei Lohse ab und auch bei Otto Strasser, der das Volksbegehren als seinen eigenen Erfolg feierte. Vergeblich warnte der NS-Linksausleger seinen bisherigen Mentor, dass so nur die Münchener Richtung gestärkt werden würde.
Am 16. Juni 1929 marschierten in Itzehoe 1000 Mann SA auf. Hauptredner Joseph Goebbels traf anschließend mit Bodo Uhse zusammen und notierte im Tagebuch: „Ein junger, sehr klarer Kopf. Er weiß, was er will. Dazu ein konsequenter Sozialist.“ Auf dem Nürnberger Parteitag kam es zu einem Zusammenstoss Uhses mit Rosenberg, der eine Zusammenarbeit mit den unterdrückten Kolonialvölkern aus rassischen Gründen strikt ablehnte. Der Antiimperialismus laufe lediglich hinter der Linie der KPD her. Gegenstand der Kritik wurde auch das Eintreten der Parteilinken für ein Bündnis mit der Sowjetunion gegen den kapitalistischen Westen. Der Parteitag verwarf zudem eine stärkere Orientierung hin zu gewerkschaftlichen Fragen und hin zur Arbeiterpropaganda.
Als die Polizei sich an die Zerschlagung der Landvolkbewegung machte, wurde auch die Redaktion der SHTZ am 12. September 1929 verhaftet. In der U-Haft in Altona hatte der NS-Journalist Zeit zum Nachdenken: "Gewiss, man konnte Nationalsozialist sein, die Masse umschmeicheln und verachten, den Krieg vergotten und die Legalität beschwören, für die Auslese sich begeistern und selber die Stufen der Hierarchie hinaufklettern, den Arbeiter achten und ihm schlechtere Löhne zahlen, nach Freiheit rufen und die Unterdrückung vorbereiten. Man konnte Faschist sein, ich war es nicht, das begriff ich jetzt. Und jenes faschistische Jakobinertum, das die Gewaltsamkeit gutmütig handhaben, die Freiheit rationell anwenden und die Revolution konservativ durchführen wollte, es war zum Kotzen." Die letzten Sätze bezogen sich auf Otto Strasser und seine Parteigänger, bei denen die meisten auf halbem Weg zum Sozialismus stehen blieben. Derweil vermuteten Goebbels und Lohse in Berlin, Strasser habe die Querverbindungen zwischen Landvolk und NS-Linker zustande gebracht, und der schleswig-holsteinische Gauleiter war seitdem alles andere als gut auf Bodo Uhse zu sprechen.
Nach seiner Entlassung aus der U-Haft kandidierte Uhse bei den preußischen Kommunalwahlen und wurde im November 1929 in den Itzehoer Stadtrat gewählt. Hier konkurrierte die NS-Fraktion mit der KPD, weil Uhse sich verstärkt um die Interessen der Arbeitslosen und der Arbeiter bemühte. Er freundete sich mit dem Kommunisten Waldemar Vogeley an. Dieser sagt ihm auf den Kopf zu, er werde nicht lange bei den Nazis bleiben, erkannte aber Uhses aufrichtiges Wollen an. In der Tat zeigte der neu gewählte Stadtrat sich beunruhigt über gleichgültige Haltung der Parteiführung gegenüber den Bauern und der Not des Proletariats sowie über Hitlers Legalitätskurs. Wohl nicht zuletzt unter Vogeleys Einfluss wurde Uhse zum Besucher in der örtlichen Buchstelle der KPD, wo er sich gründlich mit den Werken Lenins vertraut machte. Ab Januar 1930 richtete die SHTZ die Beilage "Der Proletarier" ein und opponierte offen gegen Hitlers probürgerlichen Kurs.
Am 10. Februar 1930 organisierte die Itzehoer NSDAP eine Kundgebung zum Hungermarsch der kommunistischen Arbeitslosen ("Hungermarsch oder Freiheitskampf"), die zum Schlüsselerlebnis werden sollte. Zwar sprach mit Johannes Engel einer der Begründer der im Entstehen begriffenen Nationalsozialistischen Betriebszellen-Organisation, aber Uhse zeigte sich eher von den Ausführungen des kommunistischen Diskussionsredners Karl Olbrysch aus Hamburg beeindruckt: "Ist denn der Kampf für die Freiheit eure Sache? Wieso kämpft ihr und wieso für die Freiheit? Ihr schleicht euch über die Hintertreppen der ratlos gewordenen Demokratie...Auf der Parlamentstribüne nennt ihr euch Revolutionäre, vor dem Richterstuhl aber beschwört ihr die Legalität. Und es ist euch ernst damit, denn ihr seid die missratenen Kinder des Liberalismus und treibt dessen doppelte Moral demagogisch auf den Gipfel. Er sagt: Gleichheit, und lässt für den Profit von einem halben Tausend Mächtiger sechs Millionen ohne Arbeit in Elend und Hunger. Ihr seid nicht so duldsam, ihr ruft mit kühner Stirn zum Kampf gegen das Kapital, und mit gleicher Stimme lockt ihr, in eurer Volksgemeinschaft habe der Arbeiter wie der Trustbesitzer, der Handwerker wie der Sohn des davongelaufenen Verbrechers von Doorn seinen Platz. Nationaler Sozialismus, ruft ihr grimmig, aber eurer Sozialismus endet, bevor er anfängt, denn das Privateigentum erklärte Hitler für heilig...Wenn ihr auf die Demokratie schimpft, um sie zu betrügen – auf den Kapitalismus schimpft ihr, um ihm besser dienen zu können. Das nennt ihr Kampf, wenn ihr mit den mächtigsten Mächten im Land verbündet seid? Das nennt ihr Revolution, wenn ihr das Grundgesetz der alten Ordnung von vornherein heilig sprecht?... Ihr Narren, wir eifern nicht mit eurem Patriotismus. Aber wer ist denn Deutschland? Die Millionen Arbeiter, die Millionen kleiner Bauern! Wie kann Deutschland frei sein, wenn sie, sein Volk, unterdrückt sind? Die Freiheit der Nation liegt außerhalb der Kraft des Nationalsozialismus... Deutschland, das Deutschland der Arbeiter und Bauern, gilt uns viel. Darum wollen wir es davor bewahren, dass sich die Bourgeoisie, die zu feige war, achtundvierzig im Sturm sich zu erheben, als dieses Deutschland ihre Sache war, sich jetzt aus diesem Deutschland ihr Sterbebett macht."
Folgerichtig war Bodo Uhse auch in die Bestrebungen der Parteilinken verwickelt, eine Parteispaltung herbeizuführen und zusammen mit den norddeutschen NSDAP-Gliederungen, Nationalrevolutionären wie Ernst Niekisch und dem Landvolk eine neue nationalsozialistische Partei aufzubauen. Es ging um nichts weniger als um die Sprengung der NSDAP von innen heraus, um den Pressekonflikt zwischen Goebbels und dem Strasserschen Kampfverlag auszunutzen. Kurz vor dem Parteiaustritt der Revolutionären Nationalsozialisten um Otto Strasser suchte Uhse diesen in Berlin auf. Strasser wollte jedoch Hitler lediglich den "wahren Nationalsozialismus" streitig machen und keinesfalls auf Linkskurs gehen. Der Parteirebell warnte Strasser vergebens, man brauche eine andere Idee, um erfolgreich gegen Hitler anzutreten. Folgerichtig entwickelten sich die Revolutionären Nationalsozialisten zu einer lautstarken, aber unbedeutenden Splittergruppe, die für viele Renegaten lediglich als Durchlauferhitzer für den Wechsel zur KPD oder zu nationalbolschewistischen Gruppen fungierte. Bei seiner Rückkehr nach Itzehoe fand Uhse ein Ultimatum Lohses vor: Bedingungslose Unterordnung unter die Münchener Richtung oder Ende der Redaktionstätigkeit. Der Chefredakteur der SHTZ lehnte ab und wurde am 16. Juli 1930 mit Wirkung zum 1. August aus der NSDAP ausgeschlossen.
5. Hinwendung zum Kommunismus
Nach dem Hinauswurf aus SHTZ und NSDAP bewegte Bodo Uhse sich zunächst im Dunstkreis der Revolutionären Nationalsozialisten – vollständig wollte auch er nicht mit dem nationalen Sozialismus brechen. Am 15. August feierte er als neuer Chefredakteur der strasseristischen "NS-Briefe" den terroristischen Kampf der Landvolkbewegung. Seine rechte Hand war der Landvolkagitator Bruno von Salomon. Bereits im November reihte Uhse sich in den nationalbolschewistischen Widerstands-Kreis Ernst Niekischs ein, um gleichzeitig unter dem Pseudonym Christian Klee weiterhin die NS-Briefe herauszugeben. Für den "Widerstand" referierte Uhse auf zahlreichen Veranstaltungen über die Landvolkbewegung, wobei er vor allem unter den Überresten des Bundes Oberland regen Zuspruch fand.
Am 21. März 1931 fanden die Aktivitäten für Niekisch ein Ende. Uhse verließ Itzehoe, um antifaschistische Bauernkomitees im Raum München zu organisieren. Endgültig überzeugt wurde er durch Gespräche mit den Kommunisten Christian Heuck und Karl Olbrysch: "Während wir sprachen, begriff ich..., dass die Sehnsucht meines Lebens sich erfüllte, dass etwas Neues begann und alles Bisherige nur mit Platzpatronen geschossen war. Es wurde Ernst, da der Krampf eines Jahrzehnts sich löste und der Zwiespalt, der bisher mein Leben zerrissen hatte, jener Zwiespalt, entstanden aus dem Bewusstsein von der Kraft der Arbeiterklasse und aus dem ständigen Kampf mit ihr und gegen sie, dass dieser Zwiespalt sein Ende fand dadurch, dass ich mich der großen Kraft ergab...Die große Kraft, mit der ich mich herumgeschlagen hatte, seit wir ausmarschiert waren unter der Edelweißfahne, die ich hatte mit kleinen Mitteln betrügen wollen unter dem Hakenkreuz, sie beschenkte mich, da ich mich ihr unterwarf, in dieser Nacht mit dem kostbarsten Gut. Das Leben bekam wieder einen Sinn."
Bedeutsam dürfte sich hierbei ausgewirkt haben, dass die KPD seit ihrem Programm zur nationalen und sozialen Befreiung Deutschlands vom August 1930 eine ausgesprochen nationalistische Haltung einnahm – die sozialistische Volksrevolution der unterdrückten Klassen sollte der Auftakt zur nationalen Befreiung sein. Im Frühjahr 1931 veröffentlichte die KPD als weiteren Teil ihres nationalistischen Kurses das Bauernhilfsprogramm mit der Forderung nach Zerschlagung des Großgrundbesitzes, das nicht zuletzt von Uhse und Salomon auf einem antifaschistischen Bauernkongress in Fulda der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Die Motive der sogenannten Komiteebewegung legte Uhse unter seinem Pseudonym Christian Klee in der Erstlingsnummer des "Aufbruch" nahe. Mit diesem Blatt wollte die KPD unzufriedene Nationalsozialisten und frustrierte Nationalrevolutionäre für sich gewinnen. Zur Redaktionsmannschaft gehörten neben bekannten KPD-Funktionären prominente "Nationalkommunisten" wie Ludwig Renn und Alexander Graf Stenbock-Fermor oder NS-Renegaten wie Wilhelm Korn und Rudolf Rehm, denen sich bald auch der ehemalige Oberland-Führer Beppo Römer hinzugesellen sollte.
"Darum ist jetzt die Stunde da, in der die revolutionäre Arbeiterschaft die historische Wendung zum Bauern tun musste. Die Kommunisten haben durch die Proklamation ihres Bauernhilfsprogramms alle vor die Entscheidung gestellt...An diesem Bauernhilfsprogramm der Kommunisten scheiden sich die Wege. Die Kampfgenossin der verarmten Bauernmillionen, die revolutionäre Arbeiterschaft, wird für dieses Programm kämpfen. Wer gegen die schaffenden Bauern ist, wird dieses Programm ablehnen, und das tun sie alle, von SPD bis zu den Nazis! Die revolutionäre Arbeiterschaft aber wird dieses Programm ins Dorf hinaus tragen. Sie hat begriffen, dass es in der kommenden Volksrevolution keine Vendée, keinen weißen Ring um die Städte geben darf. Der Arbeiter geht zum Bauern, ihm geht es nicht um Taktik oder Stimmenfang, ihm geht es um die Revolution. Die Revolution ohne den Bauern ist nur eine halbe Revolution, und eine halbe Revolution ist keine Revolution. (...) Wir sagen dir, Bauer: Du und der Arbeiter in der Stadt, ihr leidet die gleiche Not. Euch richtet derselbe Ausbeuter zugrunde, gleichgültig ob es der jüdische Wucherer oder der christliche Regierungsmann, der semitische Bankier oder der arische Junker ist. Ihr habt beide den gleichen Todfeind: das kapitalistische System. Dieses System muss sterben, wenn das Volk leben will. Darum Bauer Ahoi! Her in die revolutionäre Front!"
In diesem Sinne setzte Uhse seine Agitation unter der Bauernschaft fort. Auf der Tagung der Widerstands-Bewegung auf der Leuchtenburg bei Jena gehörte er zu den Hauptreferenten, weitere Auftritte gab es auf Veranstaltungen der Gruppe Sozialrevolutionärer Nationalisten. Schon im Januar avancierte der Agitator zum Sekretär des Reichsbauernkomitees der KPD. Im Frühjahr verhinderte Uhse in dieser Funktion die Kandidatur des zu einer langjährigen Zuchthausstrafe verurteilten Landvolkführers Claus Heim bei den Reichspräsidentschaftswahlen – die Komiteebewegung und der "Aufbruch" unterstützten die Kandidatur des KPD-Vorsitzenden Ernst Thälmann gegen Hitler und Hindenburg. Der Winter des Jahres 1932 sah Uhse in der Rhön, wo er den aktiven Widerstand des Landproletariats gegen den lohndrückerischen Freiwilligen Arbeitsdienst organisierte.
Nach dem Reichstagsbrand musste Bodo Uhse untertauchen, um einer Verhaftung zu entgehen. Einer Mitte April unter dem Vorwand einer Mordverschwörung gegen Hitler eröffnete Razzia unter prominenten Nationalrevolutionären entging er nur knapp und setzte sich nach Paris ab, wo er Bruno von Salomon wiedertraf. Nach anfänglichem Misstrauen etablierte Uhse sich sehr schnell in der Exilpublizistik und in der Propagandaarbeit der KPD gegen das Dritte Reich. Von Paris aus unterhielt er Verbindungen zu der im Untergrund aktiven Widerstands-Bewegung Niekischs. 1934 erfolgte mit einem offenen Brief an den nunmehrigen Chefredakteur bei der SHTZ die literarische Kampfansage an den real existierenden Nationalsozialismus. "Heute sitzen Sie an meinem Platz. Ich beneide Sie nicht darum. Die Schweigsamkeit ist ja Ihr vornehmstes Amt geworden...Wo Sie nicht schweigen, da müssen Sie lügen...Es lässt sich auch vom Standpunkt der nationalen Politik nichts Schlimmeres denken, als Eure nationalsozialistische Politik." Das Regime antwortete mit der Ausbürgerung am 3. November 1934.
Etwa gleichzeitig konnte Uhse mit Hilfe des Journalisten und Publizisten Egon Erwin Kisch seine ersten eigenen schriftstellerischen Arbeiten veröffentlichen. Im Jahr 1935 erfolgte der Beitritt zur Exil-KPD, für die er im Juni neben Johannes R. Becher und Bertolt Brecht am Ersten Internationalen Schriftstellerkongress in Paris teilnahm. Nach dem Ausbruch des Spanischen Bürgerkrieges meldete der bei Oberland ausgebildete Uhse sich zu den Internationalen Brigaden. In Spanien kämpfte er in den Reihen des französischen Bataillons "Edgar André" und war ab April 1937 als Politkommissar im Stab der 17. Division unter Hans Kahle tätig. Gemeinsam mit Ludwig Renn betätigte Uhse sich in der Propaganda unter den Truppen der Legion Condor, so im Rundfunk: "Kameraden! Ihr seid die Träger einer ruhmreichen Tradition – so sagt man euch, und ihr seid es wirklich. Der deutsche Soldat hat sich zu allen Zeiten tapfer geschlagen. Meist für andere, häufig gegen den eigenen Bruder, nie für sich, nie für sein Glück, nie für das Wohl von Vater und Mutter, von Bruder und Schwester." Anfang 1938 kehrte Uhse erkrankt nach Frankreich zurück. Im April 1939 ging er in die USA, um dort unter den deutschen Emigranten für die KPD tätig zu werden. In gleicher Funktion siedelte Uhse 1940 nach Mexiko über, wo er zusammen mit Ludwig Renn für die Bewegung Freies Deutschland tätig war.
5. Kulturpolitik in der DDR
Im Sommer 1948 kehrte Bodo Uhse nach Paßschwierigkeiten in die Sowjetische Besatzungszone zurück. Hier wurde er im Januar 1949 Chefredakteur der kulturpolitischen Monatszeitschrift "Aufbau". Bis zur Einstellung des Blattes im Jahr 1958 war er in dieser Funktion maßgeblich an der Ausformung des kulturpolitischen Lebens der frühen DDR beteiligt. Von 1950 bis 1954 gab es zudem ein Intermezzo als Volkskammerabgeordneter der SED. Im Tagebuch notierte Uhse zu dieser Zeit: "Ja, ich glaube, man kann mit Worten etwas ausrichten. Man hat es immer gekonnt und kann es auch jetzt – auch jetzt noch. Nicht mit dem Wort allein – aber mit dem Wort, das wahr und richtig die Wirklichkeit erkennt und schon genug wiegt, um Teil der Wirklichkeit zu werden, und als solches die Menschen beeinflusst. Ich fühle, dass ich nun wieder da bin, wo ich angefangen habe, nämlich bei der beklemmenden Schwere meiner Aufgabe. Aber wie sie zu lösen ist, darüber bin ich mir nicht klargeworden."
Von 1950 bis 1952 bekleidete Uhse die Posten eines Präsidialrates des Deutschen Kulturbundes und des Vorsitzenden des DDR-Schriftstellerverbandes. Selbstverständlich widmete er sich auch der Agitation gegen die separatistische BRD und Adenauers rücksichtslose Westintegration: Schon Ende der 20er Jahre und in den frühen 30er Jahren hatte man in Deutschland die nationale Frage unter dem Schlagwort der bolschewistischen Gefahr im Sinne der Großbourgeoisie gelöst. Der Uhse-Biograph Klaus Walther formulierte treffend: "Als 1948 durch die separate Währungsreform und 1949 durch die Errichtung eines Westzonenstaates die staatliche Einheit Deutschlands zerstört wurde, hatte der Klassenkampf übernationale Dimensionen gewonnen; auf deutschem Boden wurde er als Kampf um die deutsche Einheit ausgetragen."
Der Kampf um die nationale Einheit Deutschlands und für den Frieden sollte Sache einer breiten Einheitsfront sein. Schon in der ersten von Uhse zu verantwortenden Nummer des "Aufbruch" kamen so unterschiedliche Autoren wie Arnold Zweig, Rudolf Alexander Schröder oder Wolfgang Weyrauch zu Wort. Neben der kulturpolitischen Arbeit, die stets mit aktuellen Fragen verknüpft war, widmete die Zeitschrift sich auch der Förderung von Nachwuchstalenten. "Wir müssen überall dort anknüpfen, wo sich die deutsche Literatur gegen die Misere erhob oder sie gar überwand, wo sie wahrhaft humanistische Züge trägt und also im tiefsten Sinne national und fortschrittlich ist." Im Wechselverhältnis mit der "Beachtung, Prüfung, Durchsicht und Wertung" des literarischen Erbes sollte eine neue deutsche Literatur geschaffen werden.
1956 avancierte Uhse zum Sekretär der Sektion Dichtkunst und Sprachpflege der Akademie der Künste. Er nahm für die DDR am PEN-Kongress in London und an der antiimperialistischen Schriftstellerkonferenz in Neu-Delhi teil. Nach einem Kuba-Aufenthalt im Jahr 1961 setzte eine schwere Erkrankung seinen Aktivitäten ein Ende - Bodo Uhse starb am 2. Juli 1963 in Berlin.
"Wenige Stunden vor seinem Tod saßen wir lange in seinem Arbeitszimmer über dem Strausberger Platz zusammen. Er war heiter, aufgeschlossen, wie ich ihn seit langem nicht gesehen hatte...Er sprach so leise, zögernd, tastend wie immer. Und wie immer spürte ich, was sich hinter dieser leisen Stimme verbarg: dass es in ihm brannte, in ihm schrie." (Kurt Stern)
00:10 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : histoire, nationalisme révolutionnaire, socialisme national, socialisme, allemagne, années 20, années 30, révolution conservatrice |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook




 L’area su cui l’Italia mirava a esercitare il controllo comprendeva la penisola araba, l’Iraq, la Siria, la Palestina, l’Egitto, il Maghreb e la costa orientale africana fino al Tanganica, tutti Paesi alla ricerca dell’indipendenza. I movimenti anticolonialisti in lotta contro la Francia e l’Inghilterra non arrivavano, allora, ad azioni unitarie di vaste proporzioni: la rivoluzione del Partito Wafd in Egitto (1919-1920), il movimento Destour in Tunisia (1922-1929), o anche i fermenti antisionistici in Palestina (1922-1929), permettono di concludere che le intenzioni italiane potevano realizzarsi solo contro la resistenza araba e franco-britannica.
L’area su cui l’Italia mirava a esercitare il controllo comprendeva la penisola araba, l’Iraq, la Siria, la Palestina, l’Egitto, il Maghreb e la costa orientale africana fino al Tanganica, tutti Paesi alla ricerca dell’indipendenza. I movimenti anticolonialisti in lotta contro la Francia e l’Inghilterra non arrivavano, allora, ad azioni unitarie di vaste proporzioni: la rivoluzione del Partito Wafd in Egitto (1919-1920), il movimento Destour in Tunisia (1922-1929), o anche i fermenti antisionistici in Palestina (1922-1929), permettono di concludere che le intenzioni italiane potevano realizzarsi solo contro la resistenza araba e franco-britannica.  Bulgaria, la guardiana eslava del Danubio
Bulgaria, la guardiana eslava del Danubio