La democrazia come forma di dominio borghese
 Il giovane De Man è ancora fedele al marxismo ortodosso, in linea con la Seconda Internazionale, ma già si delineano alcuni temi che saranno centrali nel suo pensiero. In particolare, in “L’era della democrazia” (1907) emergono tre punti fondamentali. In primo luogo, il suo socialismo ha una base volontaristica, secondo cui lotta di classe e istinto di sopravvivenza – “volontà di potenza” per usare un termine nietzscheano” – coincidono. In secondo luogo – e qui viene ribadita la sua linea radicale e non riformista –, il proletariato dovrà essere attento a non cedere agli inganni della borghesia, bensì mantenersi puro e intransigente per conquistare il potere. Egli, infatti, riconosce il carattere precedentemente rivoluzionario della borghesia, ma ammonisce a non confondere la rivoluzione borghese con quella proletaria.
Il giovane De Man è ancora fedele al marxismo ortodosso, in linea con la Seconda Internazionale, ma già si delineano alcuni temi che saranno centrali nel suo pensiero. In particolare, in “L’era della democrazia” (1907) emergono tre punti fondamentali. In primo luogo, il suo socialismo ha una base volontaristica, secondo cui lotta di classe e istinto di sopravvivenza – “volontà di potenza” per usare un termine nietzscheano” – coincidono. In secondo luogo – e qui viene ribadita la sua linea radicale e non riformista –, il proletariato dovrà essere attento a non cedere agli inganni della borghesia, bensì mantenersi puro e intransigente per conquistare il potere. Egli, infatti, riconosce il carattere precedentemente rivoluzionario della borghesia, ma ammonisce a non confondere la rivoluzione borghese con quella proletaria.
1. La crescita parallela dei movimenti socialisti dei lavoratori e del movimento democratico di parte della borghesia, come abbiamo visto negli ultimi anni, in particolare da noi in Francia, Inghilterra, Olanda e Belgio, ha portato molti membri del nostro partito alla conclusione che, siccome entrambi i fenomeni sono portati avanti dalla medesima causa e per lo stesso scopo (la “democrazia” che infine diverrà “socialista”), così il progresso della democrazia e quello del movimento dei lavoratori sarà simile, combinato, inseparabile. Bene, questa conclusione è erronea, questa conclusione è falsa, questa conclusione è pericolosa.
In terzo luogo, però, il proletariato, man mano che acquisterà coscienza di classe, sarà in grado di vincere la borghesia con le proprie forze, sfruttando le stesse condizioni della democrazia borghese.
2. Sarebbe il peggior tipo di pessimismo concludere che non dobbiamo aspettarci immediati miglioramenti politici, che dobbiamo fermarci e riporre tutta la nostra speranza nel sovvertimento rivoluzionario della società capitalista. No; la democrazia politica – cioè, un minimo di diritti politici e legalità – è la condizione assolutamente indispensabile per il successo della rivoluzione sociale […]. Ma il proletariato sarà sempre più l’unica forza a sostenere tutte le battaglie per la democrazia e dovrà dipendere sulle sue risorse per la realizzazione della democrazia. Man mano che la democrazia diventa più indispensabile per il proletariato, diviene più pericolosa per la borghesia, e man mano che la lotta per ogni frammento di libertà e legalità diventa più difficile, sempre più s’avvicina a quella lotta finale in cui non ci sarà quartiere, dove la posta sarà il controllo del potere politico, la stessa esistenza dello sfruttamento capitalistico e della democrazia a uno e a un medesimo tempo.
Fin dall’inizio, quindi, il rapporto con la democrazia borghese, in quanto sistema politico reale e quotidiano in cui ci si trova ad operare e che occorre affrontare, risulta fondamentale nell’opera di De Man, il quale però ammonisce che la democrazia può spianare la strada al proletariato ma non è in sé una condizione sufficiente, tale da condurre automaticamente al socialismo.
3. Dunque, nella nostra lotta, non lasciamo che illusioni sulla misericordia della borghesia, né fiducia nella sincerità delle loro convinzioni democratiche, confondano la consapevolezza di classe del proletariato. La posta della battaglia è ben maggiore che un po’ di legalità o solo una riforma, ben più grande di quanto una rivoluzione borghese abbia mai tentato. E il proletariato ha un’arma molto più forte e formidabile di quanto la borghesia ne abbia mai usate. Non l’ha forgiata a partire dall’idea democratica – e dal fraseggio di un impotente classe in declino. Come il giovane eroe nel Sigfrido di Wagner, vede ciò con distacco […]. E forgerà la sua spada per salvare il mondo a partire dalla forte organizzazione di classe e con eroica coscienza di classe.
Infatti, approfondendo la sua preparazione teoretica e la sua conoscenza della democrazia liberale, De Man sarà sempre più cauto e guardingo relativamente all’attrazione del liberalismo e del riformismo sul proletariato. Particolarmente interessanti sono le sue lettere da London, pubblicate nel 1910 sul “Leipziger Vokszeitung” come “Lettere di viaggio socialiste”, laddove egli descrive come il partito laburista sia del tutto integrato in quello liberale e, perciò, funzionale agli stessi interessi borghesi, mentre invece quelli dei proletari sono ignorati o calpestati.
4. È del tutto ovvio che la natura della competizione elettorale tra i due grandi partiti borghesi, che almeno a Londra monopolizza quasi il campo di battaglia, è una competizione per catturare i voti del lavoratore attraverso trucchi pubblicitari da poco, così che il partito che ha meno scrupoli e più denaro vincerà. Perché alla fine, l’essenza del senso politico nel sistema elettorale inglese è questo: trasformare il potere finanziario delle classi proprietarie in potere politico in modo che il diritto di voto dei lavoratori sia reso un modo di preservare la loro dipendenza intellettuale e politica dai partiti borghesi.
L’analisi e la critica del sistema democratico inglese prosegue toccando altri punti fondamentali, quali la legge elettorale in sé, la quale esclude il voto femminile, riduce l’elettorato ai soli possidenti o affittuari benestanti, garantisce il voto plurale a laureati e proprietari terrieri, ed è basata su un sistema maggioritario, per cui in ogni collegio è eletto solo il singolo candidato che ottiene la maggioranza relativa. Inoltre, egli descrive la conduzione della campagna elettorale presso i lavoratori con distribuzione gratuita di alcoolici, propaganda di massa e addirittura l’organizzazione delle masse stesse al voto. Il termine che meglio descrive l’atteggiamento delle classi dominanti verso la classe operaia è “condiscendenza”.
5. Il movimento socialista operaio è trattato dalla classe dominante in Inghilterra in completo contrasto con il socialismo e con il movimento operaio. Mi esprimerò più chiaramente: il socialismo come teoria sociale e filosofica non appare come minaccioso per il corpo della borghesia, finché esso non trova sostenitori nei circoli intellettuali borghesi […]. In breve, il socialismo qui è ancora socialmente accettabile, come non lo è stato per lungo tempo in Germania. La borghesia inglese molto tempo fa ha fatto pace con il movimento dei lavoratori a patto che non fosse socialista, cioè, con il movimento sindacale di vecchio stampo.
Tuttavia, come fa notare De Man, alla “carota” viene affiancato il “bastone”: i metodi repressivi non sono meno assenti nella democrazia liberale, semplicemente essi sono usati con maggiore parsimonia e oculatezza. Questo è particolarmente evidente nel modus operandi della polizia inglese, in realtà non molto dissimile da quella prussiana, nonostante la differenza di regime, in linea teorica.
6. Alla fine il parallelo tra i “bobbies” e i “Bleus” riflette fondamentalmente quello tra le due forme di governo, il borghese liberale e lo Junker reazionario, in generale. Queste sono le due forme democratiche di oppressione politica del proletariato nell’era capitalista; la prima è la più ragionevole, la seconda la più brutale. Questo non significa che la polizia di Londra non possa e non si sia comportata in modo brutale. Ma questo ha luogo non regolarmente ma solo in circostanze straordinarie, cioè, quando è considerato davvero indispensabile.
In sintesi, il giovane De Man prende una posizione molto dura verso la democrazia borghese, liberale o autoritaria che sia. Se da una parte, infatti, riconosce che all’interno di essa è possibile trovare gli strumenti per portare avanti la lotta di classe, pure è consapevole che a un certo punto sarebbe risultata inevitabile la rivoluzione.
La democrazia come tappa intermedia
Nel 1914, con l’invasione del Belgio da parte tedesca, questa visione secondo cui non c’era differenza tra i vari regimi borghesi e imperialisti doveva cambiare radicalmente. Le democrazie occidentali parevano, infatti, garantire maggiori possibilità ai movimenti operai rispetto agli imperi centrali. Altrettanto importanti furono le sue esperienze di viaggio in Unione Sovietica e negli Stati Uniti, che lo convinsero della necessità di un ordinamento democratico come tappa intermedia tra il capitalismo e il socialismo. In quest’ottica egli arrivò a contrapporre all’URSS, che egli accusava di eccessiva furia nel tentare d’imporre le conquiste del socialismo a un proletariato ancora impreparato, gli Stati Uniti, dove invece vedeva quasi compiute le basi democratiche del socialismo.
Henri De Man, ne traccia una sintesi nell’articolo “La lezione della guerra”, comparso su “Le Peuple” nel 1919. Egli è però attento a sottolineare come la sua posizione non fosse stata immediatamente interventista come molti altri socialdemocratici e socialisti europei, bensì meditata alla luce degli eventi da lui vissuti tra il 1915 e il 1918, e frutto di una coscienza tormentata dalla consapevolezza delle contraddizioni.
7. Al fine di evitare ogni incomprensione, devo dichiarare che, anche se io ero un ufficiale associato all’azione del governo durante la guerra con due missioni ufficiali all’estero – in Russia nel 1917 e negli Stati Uniti nel 1918 – non sono mai stato tra quelli che hanno perso la loro autonomia morale per l’intossicazione del patriottismo ufficiale e dello sciovinismo militarista. Io ero un socialista antimilitarista e internazionalista prima della guerra. Credo di esserlo ancora di più ora. Forse lo sono in modo differente, ma certamente non in misura meno profonda o meno sentita. È precisamente perché io considero il socialismo una realtà urgente e ancora più ineluttabile che mai che esso mi appare da una prospettiva differente dalle mie opinioni del 1914. La revisione delle mie idee è dovuta soprattutto al fatto che per tre anni sono state letteralmente sottoposte alla prova del fuoco.
De Man propone in queste pagine però una svolta di entità non indifferente, anzi una vera e propria revisione del marxismo, dovuta ad esperienze che traspaiono come traumatiche. Egli trasvaluta tutti i valori, alla ricerca di una dottrina politica che gli consenta di comprendere davvero gli eventi.
8. Non penso più che possiamo capire i nuovi fatti della vita sociale con l’aiuto di una dottrina stabilita sulla base di fatti precedenti e differenti. Non penso più che la toeria che vede le guerre contemporanee unicamente come il risultato di conflitti economici tra governi imperialisti sia giusta. Non penso più che i soli fenomeni economici possano fornirci la trama di tutta l’evoluzione storica. Non penso più che il socialismo possa essere realizzato indipendentemente dallo sviluppo della democrazia politica. Non penso più che al socialismo basti fare appello agli interessi di classe del proletariato industriale, disdegnando il supporto che certi interessi e ideali comuni all’intera nazione o a tutta l’umanità possono darci. Non penso più che la lotta di classe proletaria, che rimane il mezzo principale per la realizzazione del socialismo, possa condurre ad esso senza ammettere certe forme di collaborazione di classe e di partito. Non credo più che il socialismo possa consistere semplicemente nell’esproprio dei mezzi di produzione di base da parte dello Stato, senza una profonda trasformazione dei processi amministrativi per portare allo sviluppo illimitato della produttività sociale. Non penso più che una società socialista possa essere sostenuta domani se rinuncia allo stimolante che oggi è fornito dalla competizione d’imprese private e di un ineguale frutto del lavoro, proporzionato alla sua produttività sociale. Credo in un socialismo più a portata di mano, più pragmatico, più organico – in una parola, più umano.
Egli spiega poi le sue motivazioni di contro al marxismo internazionalista, adducendo come tappa necessaria sul cammino verso il socialismo l’autonomia nazionale e la democrazia politica, entrambe ancora da raggiungere nelle due grandi nazioni europee dove era stata tentata la rivoluzione bolscevica, ovvero Russia e Germania, in quanto nazioni ancora rette da una monarchia di diritto divino. In quest’ottica, la guerra delle potenze dell’Intesa era giustificata anche da un punto di vista socialista proprio perché portava a termine quella rivoluzione borghese di cui parlava Marx. De Man continua a fare riferimento al filosofo di Treviri, anche se ne critica l’economicismo.
9. Il metodo del materialismo storico fondato da Marx ci ha abituati troppo a vedere solo il lato economico dei fatti della vita sociale. D’altra parte, il marxismo è stato represso troppo fortemente dal socialismo di Germania e Russia, due Paesi dove la mancanza d’istituzioni democratiche e, quel che è peggio, di tradizioni democratiche ha necessariamente avuto ripercussioni sul punto di vista dei lavoratori.
Egli ha ben presente che non è stata una guerra rivoluzionaria socialista, ma nondimeno è stata una guerra rivoluzionaria democratica. Passando poi a confrontare Stati Uniti e Russia, sottolinea le migliori condizioni del primo Paese, in confronto al secondo dove il proletariato, mancando di un’educazione democratica, non è stato in grado di gestire il potere conquistato.
10. In Russia, ho visto socialismo senza democrazia. In America, ho visto democrazia senza socialismo. La mia conclusione è che, per parte mia, preferirei, se dovessi scegliere, vivere in una democrazia senza socialismo che in un regime socialista senza democrazia. Questo non significa che io sia più democratico che socialista. Molto semplicemente significa che la democrazia senza socialismo è pur sempre democrazia, mentre il socialismo senza democrazia non è nemmeno socialismo. La democrazia, essendo il governo della maggioranza, può condurre al socialismo, se la maggioranza è a favore di esso; il socialismo, se non è basato sul governo della maggioranza, è un regime dispotico, il che significa o guerra civile o stagnazione.
Per risolvere questo problema, il proletariato dovrebbe includere non solamente gli operai, ma anche i tecnici e gli intellettuali, i quali vendono anch’essi la loro forza lavoro, sia pure più specializzata, il che fa di loro dei proletari.
11. Non sarei un socialista se non credessi che questa capacità si può trovare in nuce nel proletariato – a condizione che l’espressione includa oltre ai lavoratori manuali coloro, come i tecnici, i colletti bianchi, gli ingegneri, gli studiosi e gli artisti, che oggi vendono la loro forza lavoro intellettuale sul mercato del mondo capitalista. Ma poiché questo nucleo possa svilupparsi e rendere più che non solo vantaggi temporanei, un lungo periodo di adattamento della classe lavoratrice ai nuovi compiti di gestione sociale deve aver luogo.
Questa collaborazione tra le classi inferiori, sostiene De Man, ha già in realtà visto in parte la luce nelle trincee, laddove la maggioranza dei combattenti erano appunto proletari (in questo senso allargato). Qui sono state poste le basi sociali per un socialismo democratico, del tutto differente dal socialismo dittatoriale del bolscevismo sovietico.
Riguardo agli Stati Uniti, troviamo interesse nella “Lettera d’America” comparsa, sempre su “Le Peuple”, l’anno successivo. Ciò che l’autore sottolinea, sono le ottime condizioni materiali dei lavoratori americani, in particolare i contadini, rispetto a quelli europei. E a queste si accompagna una superiore istruzione e dunque una vera e propria coscienza di classe, che porrebbe le basi per un movimento socialista di successo.
12. Questo è un Paese che dimostra che non è la povertà che crea la più vigorosa coscienza di classe, e che un regime di sfruttamento capitalistico è più minacciato dove la gente comune ha acquisito il più alto grado di benessere materiale ed istruzione, come nel Far West americano. Tutto questo Paese è proprio ora lo sfondo di una grande rinascita della coscienza di classe, sia tra la popolazione rurale, sia tra i lavoratori urbani. È un fenomeno sorprendente, specialmente per un periodo immediatamente successivo a una guerra. La sua espressione più caratteristica è l’alleanza dei sindacati e delle organizzazioni agrarie per sostenere un programma esplicitamente collettivista.
La democrazia nel planismo
 Il successivo percorso di studio di De Man lo portò a toccare e ad approfondire ben altri argomenti, in particolare relativamente alla critica e al superamento del marxismo da un punto di vista psicologico, come espresso in “Psicologia del socialismo” (1926). La sua critica del marxismo è funzionale però a una radicalizzazione del movimento socialista. Secondo l’autore, infatti, è nella dottrina di Marx che devono essere rintracciati quei tratti filosofici positivisti come il meccanicismo, il razionalismo, l’edonismo materialista, che favoriscono l’imborghesimento dei movimenti marxisti. Un altro problema è la tendenza alla divisione, specie nei partiti di stampo bolscevico, tra dirigenti attivi e masse passive (“Masse e capi”, 1932). Il lato più propriamente psicologico è poi approfondito in “La lotta per la gioia del lavoro” (1927), laddove esamina i moventi psicologici che influenzano positivamente il lavoratore, ovvero principalmente l’utilità sociale, l’interesse personale, e il senso dell’obbligazione sociale; e quelli che lo influenzano negativamente, come l’insicurezza e la precarietà delle condizioni di vita e di lavoro o l’impossibilità di promozione sociale.
Il successivo percorso di studio di De Man lo portò a toccare e ad approfondire ben altri argomenti, in particolare relativamente alla critica e al superamento del marxismo da un punto di vista psicologico, come espresso in “Psicologia del socialismo” (1926). La sua critica del marxismo è funzionale però a una radicalizzazione del movimento socialista. Secondo l’autore, infatti, è nella dottrina di Marx che devono essere rintracciati quei tratti filosofici positivisti come il meccanicismo, il razionalismo, l’edonismo materialista, che favoriscono l’imborghesimento dei movimenti marxisti. Un altro problema è la tendenza alla divisione, specie nei partiti di stampo bolscevico, tra dirigenti attivi e masse passive (“Masse e capi”, 1932). Il lato più propriamente psicologico è poi approfondito in “La lotta per la gioia del lavoro” (1927), laddove esamina i moventi psicologici che influenzano positivamente il lavoratore, ovvero principalmente l’utilità sociale, l’interesse personale, e il senso dell’obbligazione sociale; e quelli che lo influenzano negativamente, come l’insicurezza e la precarietà delle condizioni di vita e di lavoro o l’impossibilità di promozione sociale.
Con “L’idea socialistica” (1933) viene finalmente approfondito un altro tema cruciale, quello dell’imborghesimento del proletario. De Man ricostruisce prima storicamente il passaggio da una borghesia lavoratrice a una borghesia proprietaria e sfruttatrice e poi osserva il processo analogo nel proletariato contemporaneo. Secondo lui, indubbiamente, ha un forte peso il miglioramento delle condizioni di vita, ma il fattore cruciale, che mina a suo parere il marxismo alla base, è il materialismo: la classe operaia lotta non per il bene dell’umanità, ma egoisticamente per il proprio benessere, mirando essenzialmente a rovesciare il dominio borghese e sostituirvisi. In questo senso, riprendendo il pensiero di Spengler e Sombart, il marxismo non è tanto un movimento opposto al capitalismo, quanto interno ad esso. Il socialismo invece doveva prescindere dagli interessi specifici della classe operaia, che a suo parere avrebbero potuto anche essere soddisfatti dal capitalismo, come negli Stati Uniti.
È proprio su queste premesse, che De Man scriverà il “Piano del lavoro” nel 1933, come programma pragmatico di riforma dello Stato dal punto di vista tanto sociale quanto economico.
13. L’obiettivo di questo piano è una trasformazione economica e politica del Paese, consistente in: 1) L’istituzione di un sistema economico misto che includa, oltre a un settore privato, un settore nazionalizzato che comprenda il controllo del credito e delle principali industrie che sono già monopolizzate di fatto; 2) La sottomissione dell’economia nazionale così riorganizzata a lle direttive del benessere comune mirante all’allargamento del mercato interno così da ridurre la disoccupazione e da creare condizioni che portino a un’accresciuta prosperità economica; 3) La realizzazione all’interno della sfera politica di una riforma dello Stato e del sistema parlamentare tale da creare le basi per una vera democrazia sociale ed economica.
Scendendo in maggiori dettagli riguardanti quest’ultimo punto, che delineino come sia mutata la concezione della democrazia propugnata da De Man, occorre consultare la settima e ultima parte del piano.
14. Per rinforzare le basi della democrazia e per preparare istituzioni parlamentari per la realizzazione delle trasformazioni economiche che sono delineate, la riforma dello Stato e del sistema parlamentare deve soddisfare le seguenti condizioni: 1) Tutti i poteri derivano dal suffragio universale non adulterato; 2) L’esercizio delle libertà costituzionali è pienamente garantito a tutti i cittadini; 3) Il sistema politico ed economico assicurerà l’indipendenza e l’autorità dello Stato e del potere pubblico rispetto al potere finanziario; 4) il potere legislativo sarà esercitato da una singola camera, di cui tutti i membri siano eletti con suffragio universale; 5) questa camera, i cui metodi di lavoro saranno semplificati e adattati alle necessità della moderna organizzazione sociale, saranno assistiti nell’elaborare leggi da consigli consultativi, i cui membri saranno scelti in parte fuori dal Parlamento, sulla base della loro riconosciuta competenza; 6) per evitare i pericoli dello statalismo, il Parlamento darà alle agenzie responsabili per legge della gestione dell’economia quei poteri d’implementazione indispensabili alla rapidità d’azione e alla focalizzazione delle responsabilità.
Nelle successive tesi di Pontigny del 1934, stabilirà il ruolo del partito all’interno della pianificazione qui delineata, ovvero la piena partecipazione, all’interno del sistema legale e politico democratico alla riforma dello Stato. Questo interventismo, unito alla delusione per l’inerzia del regime borghese e democratico sarà alla base della sua scelta, nel 1940, di appoggiare il fascismo, sperando che potesse compiere quella riorganizzazione dello Stato che né il socialismo né la democrazia erano stati in grado di intraprendere.





 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg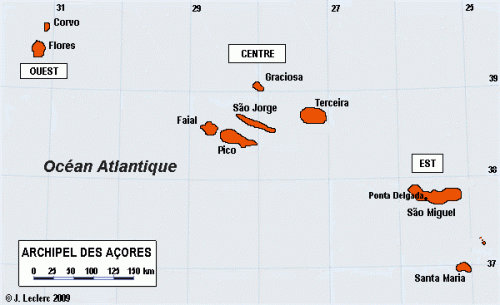




 Outre Haushofer, une approche du savoir géopolitique, tel qu'il sera déployé à Berlin dans les années 20, 30 et 40, ne peut omettre d'étudier la figure du Chevalier Oskar von Niedermayer, celui que l'on avait surnommé, le "Lawrence d'Arabie" allemand. Né en 1885, Oskar von Niedermayer embrasse la carrière d'officier, mais ne se contente pas des simples servitudes militaires. Il étudie à l'université les sciences naturelles physiques, la géographie et les langues iraniennes (ce qui lui permettra d'avoir des contacts suivis avec la Communauté religieuse Ba'hai, qui, à l'époque, était quasiment la seule porte ouverte de l'Iran sur l'Occident). De 1912 à 1914, il effectue un long voyage en Perse et en Inde. Il sera ainsi le premier Européen à traverser de part en part le désert de sable du Lout (Dacht-i-Lout). En 1914, quand éclate la première guerre mondiale, Oskar von Niedermayer, accompagné par Werner Otto von Henting, sillonne les montagnes d'Afghanistan pour inciter les tribus afghanes à se soulever contre les Anglais et les Russes, afin de créer un "abcès de fixation", obligeant les deux puissances ennemies de l'Allemagne à dégarnir partiellement
Outre Haushofer, une approche du savoir géopolitique, tel qu'il sera déployé à Berlin dans les années 20, 30 et 40, ne peut omettre d'étudier la figure du Chevalier Oskar von Niedermayer, celui que l'on avait surnommé, le "Lawrence d'Arabie" allemand. Né en 1885, Oskar von Niedermayer embrasse la carrière d'officier, mais ne se contente pas des simples servitudes militaires. Il étudie à l'université les sciences naturelles physiques, la géographie et les langues iraniennes (ce qui lui permettra d'avoir des contacts suivis avec la Communauté religieuse Ba'hai, qui, à l'époque, était quasiment la seule porte ouverte de l'Iran sur l'Occident). De 1912 à 1914, il effectue un long voyage en Perse et en Inde. Il sera ainsi le premier Européen à traverser de part en part le désert de sable du Lout (Dacht-i-Lout). En 1914, quand éclate la première guerre mondiale, Oskar von Niedermayer, accompagné par Werner Otto von Henting, sillonne les montagnes d'Afghanistan pour inciter les tribus afghanes à se soulever contre les Anglais et les Russes, afin de créer un "abcès de fixation", obligeant les deux puissances ennemies de l'Allemagne à dégarnir partiellement Le volet purement scientifique de cet engouement pour le Grand Est sera incarné à Berlin, de 1913 à 1946 par un professeur génial, autant que modeste: Otto Hoetzsch. Il a connu un destin particulièrement tragique. Après avoir accumulé dans son institut personnel une masse de documents et de travaux sur la Russie, pendant des décennies, les bombardements sur Berlin en 1945, à la veille de l'entrée des troupes soviétiques dans la capitale allemande, ont réduit sa colossale bibliothèque à néant. Cette tragédie explique partiellement le sort misérable de tout le savoir sur la Russie et l'Union Soviétique à l'Ouest. La majeure partie des documents les plus intéressants avait été accumulée à Berlin. La misère de la soviétologie occidentale est partiellement
Le volet purement scientifique de cet engouement pour le Grand Est sera incarné à Berlin, de 1913 à 1946 par un professeur génial, autant que modeste: Otto Hoetzsch. Il a connu un destin particulièrement tragique. Après avoir accumulé dans son institut personnel une masse de documents et de travaux sur la Russie, pendant des décennies, les bombardements sur Berlin en 1945, à la veille de l'entrée des troupes soviétiques dans la capitale allemande, ont réduit sa colossale bibliothèque à néant. Cette tragédie explique partiellement le sort misérable de tout le savoir sur la Russie et l'Union Soviétique à l'Ouest. La majeure partie des documents les plus intéressants avait été accumulée à Berlin. La misère de la soviétologie occidentale est partiellement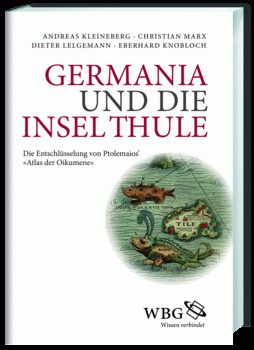 Après bien des tâtonnements, confinant à l’archéologie-fiction, l’itinéraire de l’expédition grecque de Pythéas en Mer du Nord, autour des Iles Britanniques et le long des côtes norvégiennes vient d’être reconstitué par une équipe de chercheurs de la « Technische Universität Berlin ». La tradition des hellénistes rapporte, en effet, que Pythéas a quitté Massalia (Marseille), vers 330 avant J. C., pour cingler vers le nord et atteindre, dit-on, la mystérieuse île de Thulé, que les Anciens considéraient comme l’extrémité septentrionale du monde. C’est ici que les spéculations allaient bon train : cette île de Thulé était-elle l’Islande, la Norvège (prise erronément pour une île), les Shetlands, les Orcades ou les Féroé ?
Après bien des tâtonnements, confinant à l’archéologie-fiction, l’itinéraire de l’expédition grecque de Pythéas en Mer du Nord, autour des Iles Britanniques et le long des côtes norvégiennes vient d’être reconstitué par une équipe de chercheurs de la « Technische Universität Berlin ». La tradition des hellénistes rapporte, en effet, que Pythéas a quitté Massalia (Marseille), vers 330 avant J. C., pour cingler vers le nord et atteindre, dit-on, la mystérieuse île de Thulé, que les Anciens considéraient comme l’extrémité septentrionale du monde. C’est ici que les spéculations allaient bon train : cette île de Thulé était-elle l’Islande, la Norvège (prise erronément pour une île), les Shetlands, les Orcades ou les Féroé ? 

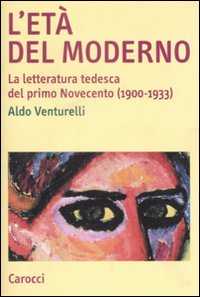
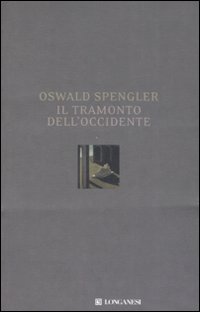




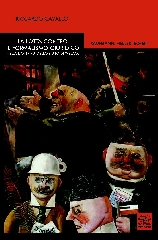
 Malgré les préparatifs fébriles en vue de commémorer le 200ème anniversaire de la Révolution Française, malgré l'unanimisme des partis politiques français autour des "acquis" de 1789, un certain nombre de travaux tentent encore et toujours de cerner l'histoire de cette révolution, non d'une point de vue républicain, partisan et politicien mais d'un point de vue analytique, objectif et historique. L'ouvrage d'Elie FOURNIER, que nous évoquons ici, tente de nous expliquer ce que fut réellement, sur le plan du vécu, la Révolution française, après les brèches ouvertes ces dernières années par des historiens comme François FURET ou Pierre CHAUNU. Il ne s'agit pas de la Révolution de Paris ni de celle des membres du Club des Jacobins ni celle des "représentants du peuple" à la Convention, mais celle des peuples qui constituaient alors l'ancien royaume de France, présentement transformé en "République une et indivisible".
Malgré les préparatifs fébriles en vue de commémorer le 200ème anniversaire de la Révolution Française, malgré l'unanimisme des partis politiques français autour des "acquis" de 1789, un certain nombre de travaux tentent encore et toujours de cerner l'histoire de cette révolution, non d'une point de vue républicain, partisan et politicien mais d'un point de vue analytique, objectif et historique. L'ouvrage d'Elie FOURNIER, que nous évoquons ici, tente de nous expliquer ce que fut réellement, sur le plan du vécu, la Révolution française, après les brèches ouvertes ces dernières années par des historiens comme François FURET ou Pierre CHAUNU. Il ne s'agit pas de la Révolution de Paris ni de celle des membres du Club des Jacobins ni celle des "représentants du peuple" à la Convention, mais celle des peuples qui constituaient alors l'ancien royaume de France, présentement transformé en "République une et indivisible". Une critique politique de la révolution et de l’esprit révolutionnaire est souvent à courte vue. Le phénomène de la révolution est multiforme. La révolution peut être violente comme celles de Robespierre ou de Lénine. Elle peut aussi se dérouler sans violence apparente mais bouleverser la société en profondeur. Les Canadiens parlent de « la révolution silencieuse » des années soixante où la pratique religieuse a diminué, le taux de natalité s’est effondré, la délinquance a augmenté, etc… On a bien eu dans les années 68 comme on dit en France, une sorte de révolution dans les mœurs (au sens large) qui a été reprise notamment par le parti socialiste et qui n’a pas fini d’avoir de l’influence, y compris sur la vie politique.
Une critique politique de la révolution et de l’esprit révolutionnaire est souvent à courte vue. Le phénomène de la révolution est multiforme. La révolution peut être violente comme celles de Robespierre ou de Lénine. Elle peut aussi se dérouler sans violence apparente mais bouleverser la société en profondeur. Les Canadiens parlent de « la révolution silencieuse » des années soixante où la pratique religieuse a diminué, le taux de natalité s’est effondré, la délinquance a augmenté, etc… On a bien eu dans les années 68 comme on dit en France, une sorte de révolution dans les mœurs (au sens large) qui a été reprise notamment par le parti socialiste et qui n’a pas fini d’avoir de l’influence, y compris sur la vie politique. 








 Walther BURGWEDEL :
Walther BURGWEDEL :

 Chi ha provocato la II guerra mondiale?
Chi ha provocato la II guerra mondiale? Les principales caractéristiques politiques du Japon avant son ouverture forcée en 1853 étaient:
Les principales caractéristiques politiques du Japon avant son ouverture forcée en 1853 étaient:



Mark Hackard
Mark Hackard has a a BA in Russian from Georgetown University and an MA in Russian, East European, and Eurasian Studies from Stanford University.