D. H. Lawrence on Men & Women
Derek HAWTHORNE
Ex: http://www.counter-currents.com/
1. Love and Strife
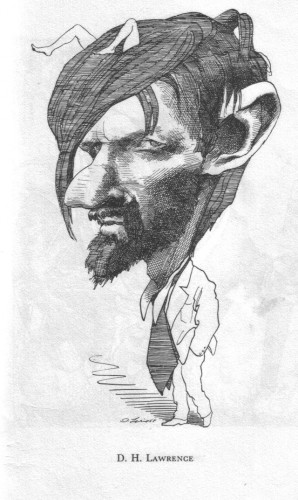 In a 1913 letter D. H. Lawrence writes that “it is the problem of to-day, the establishment of a new relation, or the readjustment of the old one, between men and women.” Lawrence’s views about relations between the sexes, and about sex differences are perhaps his most controversial – and they have frequently been misrepresented. But before we delve into those views, let us ask why it should be the case that establishing a new relation between men and women is “the problem of to-day.” The reason is fairly obvious. The species divides itself into male and female, reproduces itself thereby, and the overwhelming majority of human beings seek their fulfillment in a relationship to the opposite sex. If relations between the sexes have somehow been crippled—as Lawrence believes they have been—then this is a catastrophe. It is hard to imagine a greater, more pressing problem.
In a 1913 letter D. H. Lawrence writes that “it is the problem of to-day, the establishment of a new relation, or the readjustment of the old one, between men and women.” Lawrence’s views about relations between the sexes, and about sex differences are perhaps his most controversial – and they have frequently been misrepresented. But before we delve into those views, let us ask why it should be the case that establishing a new relation between men and women is “the problem of to-day.” The reason is fairly obvious. The species divides itself into male and female, reproduces itself thereby, and the overwhelming majority of human beings seek their fulfillment in a relationship to the opposite sex. If relations between the sexes have somehow been crippled—as Lawrence believes they have been—then this is a catastrophe. It is hard to imagine a greater, more pressing problem.
Lawrence came to relations with women bearing serious doubts about his own manhood, and with the conviction that his nature was fundamentally androgynous. Throughout his life, but especially as a boy, it was easier for him to relate to women and to form close bonds with them. Thus, when Lawrence discusses the nature of woman he draws not only upon his experiences with women, but also upon his understanding of his own nature. One of the questions we must examine is whether, in doing so, Lawrence was led astray. After all, Lawrence eventually came to repudiate the idea of any sort of fundamental androgyny and to claim that men and women are radically different. In Fantasia of the Unconscious he writes, “We are all wrong when we say there is no vital difference between the sexes.” Lawrence wrote this in 1921 intending it to be provocative, but it is surely much more controversial in today’s world, where it has become a dogma in some circles to insist that sex differences (now called “gender differences”) are “socially constructed.” Lawrence continues: “There is every difference. Every bit, every cell in a boy is male, every cell is female in a woman, and must remain so. Women can never feel or know as men do. And in the reverse, men can never feel and know, dynamically, as women do.”
Lawrence saw relations between the sexes as essentially a war. He tells us in his essay “Love” that all love between men and women is “dual, a love which is the motion of melting, fusing together into oneness, and a love which is the intense, frictional, and sensual gratification of being burnt down, burnt into separate clarity of being, unthinkable otherness and separateness.” The love between men and women is a fusing—or a will to fusing—but one that never fully takes place because the relation is also fundamentally frictional. Again and again Lawrence emphasizes the idea that men and women are metaphysically different. In other words, they have different, and even opposed ways of being in the world. They are not just anatomically different; they have different ways of thinking and feeling, and achieve satisfaction and fulfillment in life through different means.
Lawrence’s view of the difference between the sexes can be fruitfully compared to the Chinese theory of yin and yang. These concepts are of great antiquity, but the way in which they are generally understood today is the product of an ambitious intellectual synthesis that took place under the early Han dynasty (207 B.C.–9 A.D.). According to this philosophy, the universe is shot through with an ultimate principle or power known as the Tao. However, the Tao divides itself into two opposing principles, yin and yang. These oppose yet complement each other. Yang manifests itself in maleness, hardness, harshness, dominance, heat, light, and the sun, amongst other things. Yin manifests itself in femaleness, softness, gentleness, yielding, cold, darkness, the moon, etc.
Contrary to the impression these lists might give, however, yang is not regarded as “superior” to yin; hardness is not superior to softness, nor is dominance superior to yielding. Each requires the other and cannot exist without the other. In certain situations a yang approach or condition is to be preferred, in others a yin approach. On occasion, yang may predominate to the point where it becomes harmful, and it must be counterbalanced by yin, or vice versa. (These principles are of central importance, for example, in traditional Chinese medicine.) The Tao Te Ching, a work written by a man chiefly for men extols the virtues of yin, and continually advises one to choose yin ways over yang. Lao-Tzu tells us over and over that it is “best to be like water,” that “those who control, fail. Those who grasp, lose,” and that “soft and weak overcome stiff and strong.”
Like the Taoists, Lawrence regards maleness and femaleness as opposed, yet complementary. It is not the case that the male, or the male way of being, is superior to the female, or vice versa. In a sense the sexes are equal, yet equality does not mean sameness. The error of male chauvinism is in thinking that one way, the male way, is superior; that dominance and hardness are just “obviously” superior to their opposites.
Yet the same error is committed by some who call themselves feminists. Tacitly, they assume that the male or yang characteristics are superior, and enjoin women to seek fulfillment in life through cultivating those traits in themselves. To those who might wonder whether such a program is possible, to say nothing of desirable, the theory of the “social construction of gender” is today being offered as support. According to this view, the only inherent differences between men and women are anatomical, and all of the intellectual, emotional, and behavioral characteristics attributed to the sexes throughout history have actually been the product of culture and environment. (And so “yin and yang,” according to this view, is really a rather naïve philosophy which confuses nurture with nature.) Clearly, Lawrence would reject this theory. In doing so, he is on very solid ground.
It would, of course, be foolish not to recognize that some “masculine” and “feminine” traits are culturally conditioned. An obvious example would be the prevailing view in American culture that a truly “masculine” man is unable, without the help of women or gay men, to color-coordinate his wardrobe. However, when one sees certain traits in men and women displaying themselves consistently in all cultures and throughout all of human history it makes sense to speak of masculine and feminine natures. It is plausible to argue that a trait is culturally conditioned only if it shows up in some cultures but not in others. Unfortunately, the “social construction of gender” thesis has achieved the status of a dogma in academic circles. And, in truth, ultimately it has to be asserted as dogma since believing in it requires that we ignore the evidence of human history, profound philosophies such as Taoism, and most of the scientific research into sex differences that has taken place over the last one hundred years.
I said earlier that Lawrence believes men and women to be “metaphysically different,” and in his essay “A Study of Thomas Hardy” he does indeed write as if he believes they actually see the world with a different metaphysics in mind:
It were a male conception to see God with a manifold Being, even though He be One God. For man is ever keenly aware of the multiplicity of things, and their diversity. But woman, issuing from the other end of infinity, coming forth as the flesh, manifest in sensation, is obsessed by the oneness of things, the One Being, undifferentiated. Man, on the other hand, coming forth as the desire to single out one thing from another, to reduce each thing to its intrinsic self by process of elimination, cannot but be possessed by the infinite diversity and contrariety in life, by a passionate sense of isolation, and a poignant yearning to be at one.
So, men seek or are preoccupied with multiplicity, and women with unity. What are we to make of such a bizarre claim? First of all, it seems to run counter to the Greek tradition, especially that of the Pythagoreans, which tended to identify the One with the masculine, and the Many with the feminine. However, if one looks to Empedocles, a pre-Socratic philosopher Lawrence was particularly keen on, one finds a different story. Empedocles posits two fundamental forces which are responsible for all change in the universe: Love and Strife. Love, at the purely physical level, is a force of attraction. It draws things together, and without the intervention of Strife it would result in a monistic universe in which only one being existed. Strife breaks up and divides. It is a force of repulsion and separation. Now, Empedocles seems to identify Love with Aphrodite, and we may infer, though he does not say so, that Strife is Ares. In other words, he identifies his two forces with the archetypal female and male. This can offer us a clue as to what Lawrence is up to.
In Lawrence’s view, it is the female who wants to draw things, especially people, together. It is the female who yearns to heal divisions, to break down barriers. “Coming forth as the flesh, manifest in sensation” she seeks to overcome separateness through feeling, primarily through love. In the family situation, it is the female who tries to unite and overcome discord through love, whereas it is the male, typically, who frustrates this through the insistence on rules and distinctions. The ideal of universal love and an end to strife and division is fundamentally feminine—one which men, throughout history, have continually frustrated. It is characteristic of men to make war, and characteristic of women, no matter what cause or principle is involved, to object and to call for peace and unity.
Now the male, as Lawrence puts it, suffers from a sense of isolation, and a “yearning to be one.” He yearns for oneness, in fact, as the male yearns for the female. Yet his entire being disposes him to see the world in terms of its distinctness, and, indeed, to make a world rife with distinctions. Lawrence implies that polytheism is a “male” religion, and monotheism a “female” one. It is easy to see the logic involved in this. Polytheism sees the divine being that permeates the world as many because the world is itself many. Further, societies with polytheistic religions have always been keenly aware of ethnic and social differences, differences within the society (as in the Indian caste system), and between societies. Monotheism, on the other hand, tends toward universalism. Christianity especially, however it has actually been practiced, declares all men equal in the sight of God and calls for peace and unity in the world. (Lawrence, as we shall see later on, does indeed regard Christianity as a “feminine” religion, and blames it, in part, for feminizing Western men.)
This fundamental, metaphysical difference has the consequence that men and women do, in a real sense, live in different worlds. But perhaps such a formulation reflects a male bias towards differentiation. It is equally correct to say, in a more “feminine” formulation, that it is the same world seen in two, complementary ways. Indeed, it may be the case that it is difficult to see, from a male perspective, how the two sexes and their different ways of thinking and perceiving can achieve a rapprochement. Lawrence believes, of course, that they can live together, and that their opposite tendencies can be harmonized. In this way he is like Heraclitus, Lawrence’s favorite pre-Socratic, when he says “what is opposed brings together; the finest harmony is composed of things at variance, and everything comes to be in accordance with strife.” Heraclitus also tells us that “They do not understand how, though at variance with itself, it [the Logos] agrees with itself. It is a backwards-turning attunement like that of the bow and lyre.” In order to make a lyre or a bow, the two opposite ends of a piece of wood must be bent towards each other, never meeting, but held in tension. Their tension and opposition makes possible beautiful music, in the case of the lyre, and the propulsion of an arrow, in the case of the bow. Both involve a harmony through opposition.
In a 1923 newspaper interview Lawrence is quoted as saying “If men were left to themselves, they would rush off . . . into destruction. But women keep life back at its own center. They pull the men back. Women have enormous passive strength, the strength of inertia.” Here Lawrence uses an image he was very fond of: women are at the center, the hub. This is because they are closer to “the source” than men are.
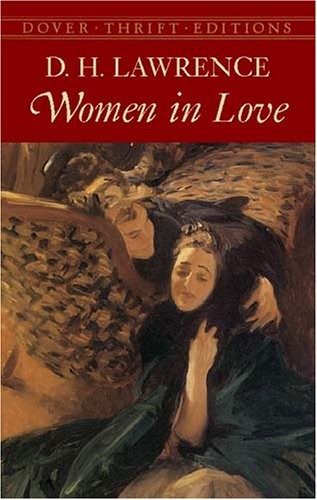 In Fantasia of the Unconscious, Lawrence tells us “The blood-consciousness and the blood-passion is the very source and origin of us. Not that we can stay at the source. Nor even make a goal of the source, as Freud does. The business of living is to travel away from the source. But you must start every single day fresh from the source. You must rise every day afresh out of the dark sea of the blood.” Lawrence believes that men yearn for purposive, creative activity, which involves moving away from the source. However, the energy and inspiration for purposive activity is drawn from the source, and so there is a complementary movement back towards it.
In Fantasia of the Unconscious, Lawrence tells us “The blood-consciousness and the blood-passion is the very source and origin of us. Not that we can stay at the source. Nor even make a goal of the source, as Freud does. The business of living is to travel away from the source. But you must start every single day fresh from the source. You must rise every day afresh out of the dark sea of the blood.” Lawrence believes that men yearn for purposive, creative activity, which involves moving away from the source. However, the energy and inspiration for purposive activity is drawn from the source, and so there is a complementary movement back towards it.
In The Rainbow, Lawrence describes how Tom Brangwen, besotted with his wife, seems to lose himself in a sensual obsession with her, and with knowing her sexually. But gradually,
Brangwen began to find himself free to attend to the outside life as well. His intimate life was so violently active, that it set another man in him free. And this new man turned with interest to public life, to see what part he could take in it. This would give him scope for new activity, activity of a kind for which he was now created and released. He wanted to be unanimous with the whole of purposive mankind.
Sex is one means of contacting the source. Men contact the source through women. This does not mean, of course, that blood-consciousness is in women but not in men. Rather, it means that in most men the blood-consciousness in them is “activated” primarily through their relationship to women. Second, in women blood-consciousness is more dominant than it is in men. Women are more intuitive than men; they operate more on the basis of feeling than intellect. It should not be necessary to point out that whereas such an observation might, in another author, be taken as a denigration of women, in Lawrence it is actually high praise. Women are also much more in tune with their bodies and bodily cycles than men are. Men tend to see their bodies as adversaries that must be whipped into shape.
When Lawrence continually tells us that we must find a way to reawaken the blood-consciousness in us, he is writing primarily for men. Women are already there—or, at least, they can get there with less effort. There is an old adage: “Women are, but men must become.” To be feminine is a constant state that a woman has as her birthright. Masculinity, on the other hand, is something men must achieve and prove. Rousseau in Emile states “The male is male only at certain moments, the female is female all of her life, or at least all her youth.” We exhort boys to “be a man,” but never does one hear girls told to “be a woman.” One can compliment a man simply by saying “he’s a man,” whereas “she’s a woman” seems mere statement of fact. The psychological difference between masculinity and femininity mirrors the biological fact that all fetuses begin as female; something must happen to them in order to make them male. It also articulates what is behind the strange conviction many men have had, including many great poets and artists, that woman is somehow the keeper of life’s mysteries; the one closest to the well-spring of nature.
In “A Study of Thomas Hardy,” Lawrence states that “in a man’s life, the female is the swivel and centre on which he turns closely, producing his movement.” Goethe tells us “Das ewig Weiblich zieht uns hinan” (“The Eternal Feminine draws us onwards”). The female, the male’s source of the source, stands at the center of his life. The woman as personification of the life mystery entices him to come together with her, and through their coupling the life mystery perpetuates itself. But he is not, ultimately, satisfied by this coupling. He goes forth into the world, his body renewed by his contact with the woman, but full of desire to know this mystery more adequately, and to be its vehicle through creative expression.
Without a woman, a man feels unmoored and ungrounded, for without a woman he has no center in his life. A man—a heterosexual man—can never feel fulfilled and can never reach his full potential without a woman to whom he can turn. As to homosexual men, it is a well-known fact that many cultivate in themselves characteristics that have been traditionally usually associated with woman: refined taste in clothing and decoration, cooking, gardening, etc. What these characteristics have in common is connectedness to the pleasures of the moment, and to the rhythms and necessities of life. Men are normally purpose-driven and future-oriented. They tend to overlook those aspects of life that please, but lack any greater purpose other than pleasing. They tend, therefore, to be somewhat insensitive to their surroundings, to color, to texture, to odor, to taste. They tend, in short, to be so focused upon doing, that they miss out on being. Heterosexual men look to women to ground them, and to provide these ingredients to life—ingredients which, in truth, make life livable. Homosexual men must make a woman within themselves, in order to be grounded. (This does not mean, however, that they must become effeminate – see my review essay of Jack Donovan’s Androphilia for more details.)
Homosexual men are, of course, the exception not the rule. Lawrence writes, of the typical man, “Let a man walk alone on the face of the earth, and he feels himself like a loose speck blown at random. Let him have a woman to whom he belongs, and he will feel as though he had a wall to back up against; even though the woman be mentally a fool.” And what of the woman? What does she desire? Lawrence tells us that “the vital desire of every woman is that she shall be clasped as axle to the hub of the man, that his motion shall portray her motionlessness, convey her static being into movement, complete and radiating out into infinity, starting from her stable eternality, and reaching eternity again, after having covered the whole of time.” Man is the “doer,” the actor, whereas woman need do nothing. Just by being woman she becomes the center of a man’s universe.
The dark side of this, in Lawrence’s view, is a tendency in women towards possessiveness, and towards wanting to make themselves not just the center of a man’s life but his sole concern. In Women in Love, Lawrence’s describes at length Rupert Birkin’s process of wrestling with this aspect of femininity:
But it seemed to him, woman was always so horrible and clutching, she had such a lust for possession, a greed of self-importance in love. She wanted to have, to own, to control, to be dominant. Everything must be referred back to her, to Woman, the Great Mother of everything, out of whom proceeded everything and to whom everything must finally be rendered up.
Birkin sees these qualities in Ursula, with whom he is in love. “She too was the awful, arrogant queen of life, as if she were a queen bee on whom all the rest depended.” He feels she wants, in a way, to worship him, but “to worship him as a woman worships her own infant, with a worship of perfect possession.”
Woman’s possessiveness is understandable given that the man is necessary to her well-being: she is only happy if she is center to the orbit and activity of some man. Again, for Lawrence, such a claim does not denigrate women, for he has already as much as said that a man is nothing without a woman. Nevertheless, some will see in this view of men and woman a sexism that places the man above the woman. From Lawrence’s perspective, this is illusory. It is true that the man is “doer,” but his perpetual need to act and to do stands in stark contrast to the woman, who need do nothing in order be who she is. It is true, further, that men’s ambition has given them power in the world, but it is a power that is nothing compared to that of the woman, who exercises her power without having to do anything. She reigns, without ruling. The man does what he does, but must return to the woman, and is “like a loose speck blown at random without her” – and he knows this. Much of misogyny may have to do with this. From the man’s perspective, the woman is all-powerful, and the source of her power a mystery.
Many modern feminists, however, conceive of power in an entirely male way, as the active power of doing. Lawrence recognized that in trying to cultivate this male power within themselves, women do not rise in the estimation of most men. Instead they are diminished, for men’s respect for and fascination with women springs entirely from the fact that unlike themselves women do not have to chase after an ideal of who they ought to be; they do not have to get caught up in the rat race in order to respect themselves. They can simply be; they can live, and take joy just in living.
One can make a rough distinction between two types of feminism. The most familiar type is what one might call the “woman on the street feminism,” which one encounters from average, working women, and which they imbibe from television, films, and magazines. This feminism essentially has as its aim claiming for women all that which formerly had been the province of men—including not only traditionally male jobs, but even male ways of speaking, moving, dressing, bonding, exercising, and displaying sexual interest. Ironically, this form of feminism is at root a form of masculinism, which makes traditionally masculine traits the hallmarks of the “liberated” or self-actualized human being.
The other type of feminism is usually to be found only in academia, though not all academic feminists subscribe to it. It insists that women have their own ways of thinking, feeling, and relating to others. Feminist philosophers have written of woman’s “ways of knowing” as distinct from men’s, and have even put forward the idea that women approach ethical decision-making in a markedly different way. It is this form of feminism to which Lawrence is closest. Lawrence’s writings are concerned with liberating both men and women from the tyranny of a modern civilization which cuts them off from their true natures. Liberation for modern women cannot mean becoming like modern men, for modern men are living in a condition of spiritual (as well as wage) slavery. In an essay on feminism, Wendell Berry writes
It is easy enough to see why women came to object to the role of [the comic strip character] Blondie, a mostly decorative custodian of a degraded, consumptive modern household, preoccupied with clothes, shopping, gossip, and outwitting her husband. But are we to assume that one may fittingly cease to be Blondie by becoming Dagwood? Is the life of a corporate underling—even acknowledging that corporate underlings are well paid—an acceptable end to our quest for human dignity and worth? . . . How, I am asking, can women improve themselves by submitting to the same specialization, degradation, trivialization, and tyrannization of work that men have submitted to? [Wendell Berry, “Feminism, the Body, and the Machine,” in The Art of the Commonplace: The Agrarian Essays of Wendell Berry, ed. Norman Wirzba (Washington, D.C.: Counterpoint, 2002), 69–70.]
I will return to this issue later.
Having now characterized, in broad strokes, Lawrence’s views on the differences between men and woman, I now turn to a more detailed discussion of each.
2. The Nature of Man
As we have seen, Lawrence believes that men (most men) need to have a woman in their lives. Their relationship to a woman serves to ground their lives, and to provide the man not only with a respite from the woes of the world, but with energy and inspiration. However, this is not the same thing as saying that the man makes the woman, or his relationship to her, the purpose of his life. In Fantasia of the Unconscious Lawrence writes, “When he makes the sexual consummation the supreme consummation, even in his secret soul, he falls into the beginnings of despair. When he makes woman, or the woman and child, the great centre of life and of life-significance, he falls into the beginnings of despair.” This is because Lawrence believes that true satisfaction for men can come only from some form of creative, purposive activity outside the family.
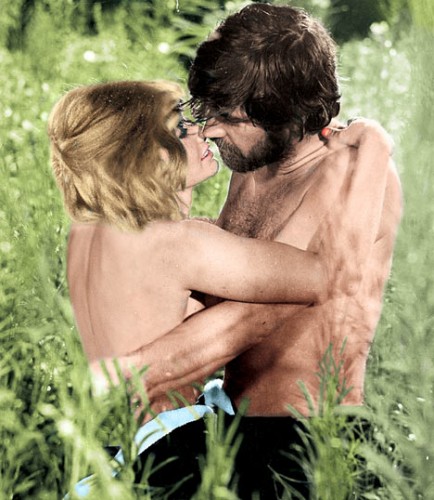 Having a woman is therefore a necessary but not a sufficient condition for male happiness. In addition to a woman, he must have a purpose. Women, on the other hand, do not require a purpose beyond the home and the family in order to be happy. This is another of those claims that will rankle some, so let us consider two important points about what Lawrence has said. First, he is speaking of what he believes the typical woman is like, just as he is speaking of the typical man. There are at least a few exceptions to just about every generalization. Second, we must ask an absolutely crucial question of those who regard such claims as demeaning women: why is being occupied with home and family lesser than having a purpose (e.g., a career) outside the home? The argument could be made—and I think Lawrence would be sympathetic to this—that the traditional female role of making a home and raising children is just as important and possibly more important than the male activities pursued outside the home. Again, much of contemporary feminism sees things from a typically male point of view, and denigrates women who choose motherhood rather than one of the many meaningless, ulcer-producing careers that have long been the province of men.
Having a woman is therefore a necessary but not a sufficient condition for male happiness. In addition to a woman, he must have a purpose. Women, on the other hand, do not require a purpose beyond the home and the family in order to be happy. This is another of those claims that will rankle some, so let us consider two important points about what Lawrence has said. First, he is speaking of what he believes the typical woman is like, just as he is speaking of the typical man. There are at least a few exceptions to just about every generalization. Second, we must ask an absolutely crucial question of those who regard such claims as demeaning women: why is being occupied with home and family lesser than having a purpose (e.g., a career) outside the home? The argument could be made—and I think Lawrence would be sympathetic to this—that the traditional female role of making a home and raising children is just as important and possibly more important than the male activities pursued outside the home. Again, much of contemporary feminism sees things from a typically male point of view, and denigrates women who choose motherhood rather than one of the many meaningless, ulcer-producing careers that have long been the province of men.
Lawrence writes, “Primarily and supremely man is always the pioneer of life, adventuring onward into the unknown, alone with his own temerarious, dauntless soul. Woman for him exists only in the twilight, by the camp fire, when day has departed. Evening and the night are hers.” Lawrence’s male bias creeps in here a bit, as he romanticizes the “dauntless” male soul. Men and women always believe, in their heart of hearts, that their ways are superior. Nevertheless, Lawrence is not here relegating women to an inferior position. Half of life is spent in the evening and night. Day belongs to the man, night to the woman. It is a division of labor. Lawrence is drawing here, as he frequently does, on traditional mythological themes: the man is solar, the woman lunar.
Lawrence characterizes the man’s pioneering activity as follows: “It is the desire of the human male to build a world: not ‘to build a world for you, dear’; but to build up out of his own self and his own belief and his own effort something wonderful. Not merely something useful. Something wonderful.” In other words, the man’s primary purpose is not having or doing any of the “practical” things that a wife and a family require. And when he acts on a larger scale—Lawrence gives building the Panama Canal as an example—it is not with the end in mind of making a world in which wives and babes can be more comfortable and secure (“a world for you, dear”). He seeks to make his mark on the world; to bring something glorious into existence. And so men create culture: games, religions, rituals, dances, artworks, poetry, music, and philosophy. Wars are fought, ultimately, for the same reason. It is probably true, as is often asserted, that every war has some kind of economic motivation. However, it is probably also true to assert that in the case of just about every actual war there was another, more cost-effective alternative. Men make war for the same reason they climb mountains, jump out of airplanes, race cars, and run with the bulls: for the challenge, and the fame and glory and exhilaration that goes with meeting the challenge. It is an aspect of male psychology that most women find baffling, and even contemptible.
Now, curiously, Lawrence refers to this “impractical,” purposive motive of the male as an “essentially religious or creative motive.” What can he mean by this? Specifically, why does he characterize it as a religious motive?
It is religious because it involves the pursuit of something that is beyond the ordinary and the familiar. It is a leap into the unknown. The man has to follow what Lawrence frequently calls the “Holy Ghost” within himself and to try to make something within the world. He yearns always for the yet-to-be, the yet-to-be-realized, and always has his eye on the future, on what is in process of coming to be. Yet there seems to be, at least on the surface, a strange inconsistency in Lawrence’s characterization of the man’s motive as religious. After all, for Lawrence the life mystery, the source of being is religious object—and women are closer to this source. Man is entranced by woman, and with her he helps to propagate this power in the world through sex, but his sense of “purpose” causes him to move away from the source. So why isn’t it the woman whose “motives” are religious, and the man who is, in effect, irreligious?
The answer is that religion is not being at the source: it is directedness toward the source. Religion is possible only because of a lack or an absence in the human soul. Religion is ultimately a desire to put oneself at-one with the source. But this is possible only if one is not, originally or most of the time, at one with it. In a way, the woman is not fundamentally religious because she is the goddess, the source herself. The sexual longing of the man for the woman, and his utter inability ever to fully satisfy his desire and to resolve the mystery that is woman, are a kind of small-scale allegory for man’s large-scale, religious relationship to the source of being itself. He is, as I have said, renewed by his relations with women and, for a time, satisfied. But then he goes forth into the world with a desire for something, something. He creates, and when he does he is acting to exalt the life mystery (religion and art), to understand it (philosophy and science), or to further it (invention and production).
Lawrence speaks of how a man must put his wife “under the spell of his fulfilled decision.” Woman, who rules over the night, draws man to her and they become one through sex. Man, who rules the day, draws woman into his purpose, his aim in life, and through this they become one in another fashion. The man’s purpose does not become the woman’s purpose. He pursues this alone. But if the woman simply believes in him and what he aims to do, she becomes a tremendous source of support for the man, and she gives herself a reason for being. The man needs the woman as center, as hub of his life, and the woman needs to play this role for some man. Without a mate, though a man may set all sorts of purposes before him, ultimately they seem meaningless. He feels a sense of hollow emptiness, and drifts into despair. He lets his appearance go, and lives in squalor. He may become an alcoholic and a misogynist. He dies much sooner than his married friends, often by his own hand. As to the woman, without a man who has set himself some purpose that she can believe in, she assumes the male role and tries to find fulfillment through some kind of busy activity in the world. But as she pursues this, she feels increasingly bitter and hard, and a terrific rage begins to seethe beneath her placid surface. She becomes a troublemaker and a prude. Increasingly angry at men, she makes a virtue of necessity and declares herself emancipated from them. She collects pets.
In Studies in Classic American Literature Lawrence writes:
As a matter of fact, unless a woman is held, by man, safe within the bounds of belief, she becomes inevitably a destructive force. She can’t help herself. A woman is almost always vulnerable to pity. She can’t bear to see anything physically hurt. But let a woman loose from the bounds and restraints of man’s fierce belief, in his gods and in himself, and she becomes a gentle devil.
If a woman is to be the hub in the life a man, and derive satisfaction from that, everything depends on the spirit of the man. A few lines later in the same text Lawrence states, “Unless a man believes in himself and his gods, genuinely: unless he fiercely obeys his own Holy Ghost; his woman will destroy him. Woman is the nemesis of doubting man.” In order for the woman to believe in a man, the man must believe in himself and his purpose. If he is filled with self-doubt, the woman will doubt him. If he lacks the strength to command himself, he cannot command her respect and devotion. And the trouble with modern men is that they are filled with self-doubt and lack the courage of their convictions.
Lawrence, following Nietzsche, in part blames Christianity for weakening modern, Western men. Men are potent—sexually and otherwise—to the extent they are in tune with the life force. But Christianity has “spiritualized” men. It has filled their heads with hatred of the body, and of strength, instinct, and vitality. It has infected them with what Lawrence calls the “love ideal,” which demands, counter to every natural impulse, that men love everyone and regard everyone as their equal.
Frequently in his fiction Lawrence depicts relationships in which the woman has turned against the man because he is, in effect, spiritually emasculated. The most dramatic and symbolically obvious example of this is the relationship of Clifford and Connie in Lady Chatterley’s Lover. Clifford returns from the First World War paralyzed from the waist down. But like the malady of the Grail King in Wolfram’s Parzival, this is only (literarily speaking) an outward, physical expression of an inward, psychic emasculation. Clifford is far too sensible a man to allow himself to be overcome by any great passion, so the loss of his sexual powers is not so dear. He has a keen, cynical wit and believes that he has seen through passion and found it not as great a thing as poets say that it is. It is his spiritual condition that drives Connie away from him, not so much his physical one. And so she wanders into the game preserve on their estate (representing the small space of “wildness” that still can rise up within civilization) and into the arms of Mellors, the gamekeeper. Their subsequent relationship becomes a hot, corporeal refutation of Clifford’s philosophy.
In Women in Love, Gerald Crich, the industrial magnate, is destroyed by Gudrun essentially because he does not believe in himself. Outwardly, he is “the God of the machine.” But his mastery of the material world is meaningless busywork, and he knows it. Gudrun is drawn to him because of this outward appearance of power, but when she finds that it is an illusion she hates him, and ultimately drives him to his death. For Lawrence, this is an allegory of the modern relationship between the sexes. Men today are masters of the material universe as they have never been before, but inside they are anxious and empty. The reason is that these “materialists” are profoundly afraid of and hostile to matter and nature, especially their own. Their intellect and “will to power” has cut them off from the life force and they are, in their deepest selves, impotent. The women know this, and scorn them.
In The Rainbow, Winifred Inger is Ursula’s teacher (with whom she has a brief affair), and an early feminist. She tells Ursula at one point,
The men will do no more,–they have lost the capacity for doing. . . . They fuss and talk, but they are really inane. They make everything fit into an old, inert idea. Love is a dead idea to them. They don’t come to one and love one, they come to an idea, and they say “You are my idea,” so they embrace themselves. As if I were any man’s idea! As if I exist because a man has an idea of me! As if I will be betrayed by him, lend him my body as an instrument for his idea, to be a mere apparatus of his dead theory. But they are too fussy to be able to act; they are all impotent, they can’t take a woman. They come to their own idea every time, and take that. They are like serpents trying to swallow themselves because they are hungry.”
In Fantasia of the Unconscious Lawrence writes, “If man will never accept his own ultimate being, his final aloneness, and his last responsibility for life, then he must expect woman to dash from disaster to disaster, rootless and uncontrolled.”
It is important to understand here that the issue is not one of power. Lawrence’s point not that men must dominate or control their wives. In fact, in a late essay entitled “Matriarchy” (originally published as “If Women Were Supreme”) Lawrence actually advocates rule by women, at least in the home, because he believes it would liberate men. He assumes the truth of the claim—now in disrepute—that early man had lived in matriarchal societies and writes, “the men seem to have been lively sorts, hunting and dancing and fighting, while the woman did the drudgery and minded the brats. . . . A woman deserves to possess her own children and have them called by her name. As to the household furniture and the bit of money in the bank, it seems naturally hers.” The man, in such a situation, is not the slave of the woman because the man is “first and foremost an active, religious member of the tribe.” The man’s real life is not in the household, but in creative activity, and religious activity:
The real life of the man is not spent in his own little home, daddy in the bosom of the family, wheeling the perambulator on Sundays. His life is passed mainly in the khiva, the great underground religious meeting-house where only the males assemble, where the sacred practices of the tribe are carried on; then also he is away hunting, or performing the sacred rites on the mountains, or he works in the fields.
Men, Lawrence tells us, have social and religious needs which can only be satisfied apart from women. The disaster of modern marriage is that men not only think they have to rule the roost, but they accept the woman’s insistence that he have no needs or desires that cannot be satisfied through his relationship to her. He becomes master of his household, and slave to it at the same time:
Now [man’s] activity is all of the domestic order and all his thought goes to proving that nothing matters except that birth shall continue and woman shall rock in the nest of this globe like a bird who covers her eggs in some tall tree. Man is the fetcher, the carrier, the sacrifice, and the reborn of woman. . . . Instead of being assertive and rather insentient, he becomes wavering and sensitive. He begins to have as many feelings—nay, more than a woman. His heroism is all in altruistic endurance. He worships pity and tenderness and weakness, even in himself. In short, he takes on very largely the original role of woman.
Ironically, in accepting such a situation without a fight, he only earns the woman’s contempt: “Almost invariably a [modern] married woman, as she passes the age of thirty, conceives a dislike, or a contempt, of her husband, or a pity which is near to contempt. Particularly if he is a good husband, a true modern.”
3. The Nature of Woman
In Fantasia of the Unconscious Lawrence writes, “Women will never understand the depth of the spirit of purpose in man, his deeper spirit. And man will never understand the sacredness of feeling to woman. Each will play at the other’s game, but they will remain apart.” But what is meant by “feeling” here? Lawrence is referring again to his belief that women live, to a greater extent than men, from the primal self. In the case of most men today, “mind-consciousness” and reason are dominant—to the point where they are frequently detached from “blood-consciousness” and feeling.
In describing the nature of woman Lawrence once again draws on perennial symbols: “Woman is really polarized downwards, towards the centre of the earth. Her deep positivity is in the downward flow, the moon-pull.” The sun represents man, and the moon woman. Day belongs to him, and night to her. However, another set of mythic images associates the earth with woman and the sky with man. The “pull” in women is towards the earth, and this means several things. First, the earth is the source of chthonic powers, and so, as poetic metaphor, it represents the primal, pre-mental, animal aspect in human beings. In a literal sense, however, Lawrence believes that women are more in tune than men with chthonic powers: with the rhythms of nature and the cycle of seasons. Further, the “downward flow” refers to Lawrence’s belief that the lower “centres” of the body are, in a sense, more primitive, more instinctual than the upper, and that women tend to live and act from these centers more than men do. Lawrence writes, “Her deepest consciousness is in the loins and belly. . . . The great flow of female consciousness is downwards, down to the weight of the loins and round the circuit of the feet.”
Finally, to be “polarized downwards, towards the centre of the earth” means to have one’s life, one’s vital being fixed in reference to a central point. If Lawrence intends us to assume that man is polarized upwards then we may ask, toward what? If woman is oriented towards the center of the earth, then–following the logic of the mythic categories–is man oriented toward the center of the sky? But the sky has no center. Man is less fixed than woman; he is a wanderer. He is a hunter, a seeker, a pioneer, an adventurer. Woman, on the other hand, lives from the axis of the world. Mircea Eliade writes that “the religious man sought to live as near as possible to the Center of the World.” Woman is at the center. Man begins there, then goes off. He returns again and again, the phallic power in him rising in response to the chthonic power of the woman. And his religious response is an ongoing effort to bring his daytime self into line with the life force he experiences when in the arms of the woman.
Woman, Lawrence tells us, “is a flow, a river of life,” and this flow is fundamentally different from the man’s river. However, “The woman is like an idol, or a marionette, always forced to play one role or another: sweetheart, mistress, wife, mother.” The mind of the male is built to analyze and categorize. But the nature of woman, like the nature of nature itself, defies categorization. Even before Bacon, man’s response to nature was to force it to yield up its secrets, to bend it to the human will, or to see it only within the narrow parameters of whatever theory was fashionable at the moment. The male mind attempts to do this to woman as well–and the woman, to a great extent, cooperates. She fits herself into the roles expected of her by authority figures, whether it is dutiful daughter-sister-wife-mother, or dutiful feminist and career-woman.
Lawrence writes, “The real trouble about women is that they must always go on trying to adapt themselves to men’s theories of women, as they always have done.” Two opposing wills exist in women, Lawrence believes: a will to conform or to submit, and a will to reject all boundaries and be free. In Women in Love, Birkin compares women to horses:
“And of course,” he said to Gerald, “horses haven’t got a complete will, like human beings. A horse has no one will. Every horse, strictly, has two wills. With one will, it wants to put itself in the human power completely—and with the other, it wants to be free, wild. The two wills sometimes lock—you know that, if ever you’ve felt a horse bolt, while you’ve been driving it. . . . And woman is the same as horses: two wills act in opposition inside her. With one will, she wants to subject herself utterly. With the other she wants to bolt, and pitch her rider to perdition.”
Ursula, who is present at this exchange, laughs and responds “Then I’m a bolter.” The trouble is that she is not.
Lawrence’s fiction is filled with vivid portrayals of women (arguably much more vivid and well-drawn than his portrayals of men). The central characters in several of his novels are women (The Rainbow, The Lost Girl, The Plumed Serpent, and Lady Chatterley’s Lover). All of Lawrence’s major female characters exhibit these two wills, but frequently he presents pairs of women each of whom represents one of the wills. This is the case in Women in Love. Ultimately, in Ursula’s character the will to surrender emerges as dominant. In her sister Gudrun the will to be free and wild dominates, with tragic results. In Lady Chatterley’s Lover, Connie Chatterley exhibits the will to surrender, and her sister Hilda the will to be free. The two lesbians in Lawrence’s novella The Fox are cut from the same cloth. Similar pairs of women also crop up in Lawrence’s short stories. In each case, one woman learns the joys of submitting, not to a man but to the earth, to nature, to the life mystery within her. The man is a means to this, however. The best example of this in Lawrence’s fiction is probably Connie Chatterley’s journey to awakening. In John Thomas and Lady Jane, an earlier version of Lady Chatterley’s Lover, Lawrence has Connie speak of the significance of her lover and of his penis: “I know it was the penis which really put the evening stars into my inside self. I used to look at the evening star, and think how lovely and wonderful it was. But now it’s in me as well as outside me, and I need hardly look at it. I am it. I don’t care what you say, it was penis gave it me.” As to the other woman in Lawrence’s fiction, she tends to be horrified by the primal self in her, and its call to surrender. She lives from the ego. She rages against anything in her nature that is unchosen, and against anything else that would hem her in, especially any man. She views herself as “realistic” and hardheaded, but the general impression she gives is of being hardhearted and sterile.
In his portrayals of the latter type of woman, Lawrence is partly depicting what he believes to be a perennial aspect of the female character, and partly depicting what he regards as the quintessential “modern” woman. It is in the nature of woman to counterbalance the will to submit with an opposing will that “bolts,” and kicks against all that which limits her, including her own nature. Lawrence believes that modern womanhood and all the problems of women today arise from the over-development of that will to freedom.
A “will to freedom” sounds like a good thing, so it is important to realize that essentially what Lawrence means by this is a negative will which tries either to control, or to destroy all that which it cannot control. Lawrence’s critique of modernity is a major topic in itself, but suffice it say that he believes that in the modern period a disavowal of the primal self takes place on a mass, cultural scale. The seeds of this disavowal were sown by Christianity, and reaped by modern scientism, which becomes the avowed enemy of the religion that helped foster it. Individuals live their lives from the standpoint of ego and mental-consciousness, and distrust the blood-consciousness. The negative will in women seizes upon reason and ego-dominance as a means to free herself from the influence of her dark, chthonic self, and from the influence of the men that this dark, chthonic self draws her to. The will to negate, using the mind as its tool, thus becomes the path to “liberation.”
Lawrence writes in Apocalypse:
Today, the best part of womanhood is wrapped tight and tense in the folds of the Logos, she is bodiless, abstract, and driven by a self-determination terrible to behold. A strange ‘spiritual’ creature is woman today, driven on and on by the evil demon of the old Logos, never for a moment allowed to escape and be herself.
And in an essay he writes, “Woman is truly less free today than ever she has been since time began, in the womanly sense of freedom.” This is, of course, exactly the opposite of what is asserted by most pundits today, when they speak of the progress made by woman in the modern era. Why does Lawrence believe that woman is now so unfree? The answer is implied in the quotation from Apocalypse: she is not allowed to be herself.
In Studies in Classic American Literature Lawrence tells us
Men are not free when they are doing just what they like. The moment you can do just what you like, there is nothing you care about doing. Men are only free when they are doing what the deepest self likes.
And there is getting down to the deepest self! It takes some diving.
Because the deepest self is way down, and the conscious self is an obstinate monkey. But of one thing we may be sure. If one wants to be free, one has to give up the illusion of doing what one likes, and seek what IT wishes done.
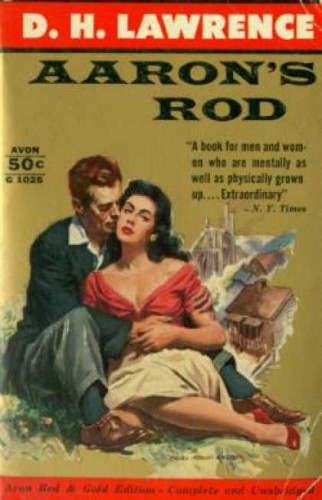 What Lawrence says here is applicable to both men and women. “To be oneself” in the true sense means to answer to the call of the deepest self. We can only achieve our “fullness of being” if we do so. The mind invents all manner of goals and projects and ideals to be pursued, but ultimately all that we do produces only frustration and emptiness if we act in a way that does not fundamentally satisfy the needs of our deepest, pre-mental, bodily nature.
What Lawrence says here is applicable to both men and women. “To be oneself” in the true sense means to answer to the call of the deepest self. We can only achieve our “fullness of being” if we do so. The mind invents all manner of goals and projects and ideals to be pursued, but ultimately all that we do produces only frustration and emptiness if we act in a way that does not fundamentally satisfy the needs of our deepest, pre-mental, bodily nature.
Lawrence writes further in Apocalypse: “The evil Logos says she must be ‘significant,’ she must ‘make something worth while’ of her life. So on and on she goes, making something worth while, piling up the evil forms of our civilization higher and higher, and never for a second escaping to be wrapped in the brilliant fluid folds of the new green dragon.” Earlier in the same text, Lawrence tells us that “The long green dragon with which we are so familiar on Chinese things is the dragon in his good aspect of life-bringer, life-giver, life-maker, vivifier.” In short, the “green dragon” represents the life force, the source of all, the Pan power. Lawrence is saying that modern woman, in search of something “significant” to do with her life, falls in with all the corrupt (largely, money-driven) pursuits that have brought men nothing but ulcers, emptiness, and early death. “All our present life-forms are evil,” he writes. “But with a persistence that would be angelic if it were not devilish woman insists on the best in life, by which she means the best of our evil life-forms, unable to realize that the best of evil life-forms are the most evil.” Like men, she loses touch with the natural both within herself and in the world surrounding her. Lawrence’s dragon symbolizes both of these: primal nature as such, and the primal nature within me. It is this dragon which Lawrence seeks to awake in himself, and in his readers. The tragedy of modern woman is that she has renounced the dragon, whereas she would be better off being devoured by it.
In John Thomas and Lady Jane Lawrence also links the ideal of fulfilled womanhood to the dragon. Following Connie Chatterley’s musings on the meaning of the phallus (which I quoted earlier), Lawrence writes:
The only thing which had taken her quite away from fear, if only for a night, was the strange gallant phallus looking round in its odd bright godhead, and now the arm of flesh around her, the socket of the hand against her breast, the slow, sleeping thud of the man’s heart against her body. It was all one thing—the mysterious phallic godhead. Now she knew that the worst had happened. This dragon had enfolded her, and its folds were pure gentleness and safety.
Make no mistake, Lawrence believes that women can adopt the ways of men; he believes that they can succeed at traditionally male work. But he believes that they do this at great cost to themselves. “Of all things, the most fatal to a woman is to have an aim,” Lawrence tells us. In general, he believes that the ultimate aim of life is simply living, and that we set a trap for ourselves when we declare that some goal or some ideal shall be the end of life, and believe that this will make life “meaningful.” This applies to men, but even more so to women. Why? Because, again, women are so much closer to the source that men tend to regard women as the life force embodied (“Mother Nature”). For a woman to live for something other than living is to pervert her nature, and her gift. Again, Lawrence’s position is not that a woman is incapable of doing the work of a man, but ultimately she will find it deadening: “The moment woman has got man’s ideals and tricks drilled into her, the moment she is competent in the manly world—there’s an end of it. She’s had enough. She’s had more than enough. She hates the thing she has embraced.”
In our age, many women who have forgone marriage and children in order to pursue a career are discovering this. The body has its own needs and ends, and the organism as a whole cannot flourish and achieve satisfaction unless these needs and ends are satisfied. With some exceptions, women who have chosen not to have children regret it, and suffer in other ways as well (for example, they are at higher risk for developing ovarian cancer than women who have given birth). The same goes for men, many of whom spend a great many “productive” years without feeling a need to reproduce–then are suddenly hit by that need and launch themselves on a frantic, sometimes worldwide search for a suitable mate able to father them a child. Lawrence wrote the following, prophetic words in one of his final essays:
It is all an attitude, and one day the attitude will become a weird cramp, a pain, and then it will collapse. And when it has collapsed, and she looks at the eggs she has laid, votes, or miles of typewriting, years of business efficiency—suddenly, because she is a hen and not a cock, all she has done will turn into pure nothingness to her. Suddenly it all falls out of relation to her basic henny self, and she realizes she has lost her life. The lovely henny surety, the hensureness which is the real bliss of every female, has been denied her: she had never had it. Having lived her life with such utmost strenuousness and cocksureness, she has missed her life altogether. Nothingness!
This quote suggests that Lawrence believes that the woman, the hen, ruins herself by taking up the ways appropriate and natural for the cock – but this is not exactly what he means. In Lawrence’s view, the modern ways of the cock are destroying the cock as well, but they are doubly bad for the hen. What’s bad for the gander is worse for the goose. Lawrence believes that in order to achieve satisfaction in life, we must get in touch with that primal self that the woman is fortunate enough always to be closer to.
4. A New Relation Between Man and Woman
So what is to be done? How are we to repair the damage that has been done in the modern world to the relation between the sexes? How are we to make men into men again, and women into women?
Lawrence has a great deal to say on this subject, but one of his oft-repeated recommendations essentially amounts to saying that relations between the sexes should be severed. By this he means that in order for men and women to come to each other as authentic men and women, they must stop trying to be “pals” with each other. In a 1925 letter he writes, “Friendship between a man and a woman, as a thing of first importance to either, is impossible: and I know it. We are creatures of two halves, spiritual and sensual—and each half is as important as the other. Any relation based on the one half—say the delicate spiritual half alone—inevitably brings revulsion and betrayal.”
In order for men and women to be friends, they must deliberately put aside or suppress their sexual identities and their very different natures. They must actively ignore the fact that they are men and women. They relate to each other, in effect, as neutered, sexless beings. They can never truly relax around each other, for they must continually monitor the way that they look at each other or (more problematic) touch each other. Sitting in too close proximity could awaken feelings that neither wants awakened. If, with respect to their “daytime selves,” men and women are forced to relate to each other in this way regularly, it has the potential of wrecking the ability of the “nighttime self” to relate to the opposite sex in a natural, sensual manner. Once accustomed to the daily routine of suppressing thoughts and feelings, and taking great care never to show a sexual side to their nature, these habits carry over into the realm of the romantic and sexual. Dating and courtship become fraught with tension, each party unsure of the “appropriateness” of this or that display of sexual interest or simple affection. The man, in short, becomes afraid to be a man, and the woman to be a woman. “On mixing with one another, in becoming familiar, in being ‘pals,’ they lose their own male and female integrity.” Writing of the modern marriage, Wendell Berry states
Marriage, in what is evidently its most popular version, is now on the one hand an intimate “relationship” involving (ideally) two successful careerists in the same bed, and on the other hand a sort of private political system in which rights and interests must be constantly asserted and defended. Marriage, in other words, has now taken the form of divorce: a prolonged and impassioned negotiation as to how things shall be divided. During their understandably temporary association, the “married” couple will typically consume a large quantity of merchandise and a large portion of each other.
If we must suppress our masculine and feminine natures in order to be friends with the opposite sex, in what way then do we actually relate to each other? We relate almost entirely through the intellect. Lawrence writes, “Nowadays, alas, we start off self-conscious, with sex in the head. We find a woman who is the same. We marry because we are ‘pals.’” And: “We have made the mistake of idealism again. We have thought that the woman who thinks and talks as we do will be the blood-answer.” Modern men and women begin their relationships as sexless things who relate through ideas and speech. The man looks for a woman, or the woman for a man who thinks and talks as they do; who “knows where they are coming from,” and has “similar values.” They might as well not have bodies at all, or conduct the initial stages of their relationships by telephone or email. Indeed, that is exactly the way many modern relationships are now beginning. But the primary way men and women are built to relate to each other is through the body and the signals of the body; through the subtle, sexual “vibrations” that each gives off, through the sexual gaze (different in the male and in the female), and through touch. No real, romantic relationship can be forged without these, and without feeling through these non-mental means that the two are “right” for each other. We cannot start with “mental agreement” and then construct a sexual relationship around it.
Lawrence, like Rousseau, had a good deal to say about education, and in fact much of what he says is Rousseauian. His ideas on the subject are expressed chiefly in Fantasia of the Unconscious and in a long essay, “The Education of the People.”
In Fantasia of the Unconscious, in a chapter entitled “First Steps in Education,” Lawrence lays out a new program for educating girls and boys: “All girls over ten years of age must attend at one domestic workshop. All girls over ten years of age may, in addition, attend at one workshop of skilled labour or of technical industry, or of art. . . . All boys over ten years of age must attend at one workshop of domestic crafts, and at one workshop of skilled labour, or of technical industry, or of art.” The difference between how boys and girls are to be educated (at least initially) is that whereas both are required to attend a “domestic workshop,” only boys are required to attend a “workshop of skilled labour or of technical industry, or of art.” Keep in mind that Lawrence is laying down the rules for education in his ideal society. He anticipates that whereas all males will work outside the home (in some fashion or other), not all females will. His system is not designed to force women into the role of homemakers, for he leaves it open that girls may, if they choose, learn the same skills as boys. As to higher education, Lawrence leaves this open: “Schools of mental culture are free to all individuals over fourteen years of age. Universities are free to all who obtain the first culture degree.” The system is designed in such a way that individuals are drawn to pursue certain avenues based on their personalities and natural temperaments. Unlike our present society, in Lawrence’s world there would be no universal pressure to attend university: only individuals with certain natural gifts and inclinations would go in that direction. Similarly, the system leaves open the possibility that some women will pursue the same path as men, but only if that is their natural inclination. The intent of Lawrence’s program is not to force individuals into certain roles, but to cultivate their natural, innate characteristics. And as we have seen, Lawrence believes that males and females are innately different.
Lawrence makes it clear elsewhere that in the early years education will be sex-segregated. This is intended to facilitate the development of each student’s character and talents. Males, especially early in life, relate more easily to other males and are better able to devote themselves to their studies in the absence of females. The same thing applies to females. Sex-segregated education in the early years also has the advantage, Lawrence believes, of promoting a healthier interaction between males and females later on. In Fantasia of the Unconscious he states, “boys and girls should be kept apart as much as possible, that they may have some sort of respect and fear for the gulf that lies between them in nature, and for the great strangeness which each has to offer the other, finally.” After all, “You don’t find the sun and moon playing at pals in the sky.”
But this is, of course, all in the realm of fantasy. Lawrence’s system would be practical, if modern society could be entirely restructured, and he is aware that this is not likely to occur anytime soon. So what are we to do in the meantime? Here we encounter some of Lawrence’s most controversial ideas, and most inflammatory prose. He writes, “men, drive your wives, beat them out of their self-consciousness and their soft smarminess and good, lovely idea of themselves. Absolutely tear their lovely opinion of themselves to tatters, and make them look a holy ridiculous sight in their own eyes.” It is this sort of thing that has made Lawrence a bête noire of feminists. Yet, in the next sentence, he adds “Wives, do the same to your husbands.” Lawrence’s intention, as always, is to destroy the ego-centredness in both husband and wife; to destroy the modern tendency for men and women to relate to each other, and to themselves, through ideas and ideals.
As a man and a husband, however, he writes primarily from that standpoint: “Fight your wife out of her own self-conscious preoccupation with herself. Batter her out of it till she’s stunned. Drive her back into her own true mode. Rip all her nice superimposed modern-woman and wonderful-creature garb off her, Reduce her once more to a naked Eve, and send the apple flying.” Does he mean any of this literally? Is he advocating that husbands beat their wives? Perhaps. Lawrence and Frieda were famous for their quarrels, which often came to blows, though the blows were struck by both. Lawrence states the purpose of such “beatings” (whether literal or figurative) as follows: “Make her yield to her own real unconscious self, and absolutely stamp on the self that she’s got in her head. Drive her forcibly back, back into her own true unconscious.”
As we have already seen, Lawrence believes that healthy relations between a man and a woman depend largely on the man’s ability to make the woman believe in him, and the purpose he has set for himself in life. Sex unites the “nighttime self” of men and women, but the daytime self can only be united, for Lawrence, through the man’s devotion to something outside the marriage, and the woman’s belief in the man. This is just the same thing as saying that what unites the lives of men and women (as opposed to their sexual natures) is the woman’s belief in the man and his purpose. And so Lawrence writes:
You’ve got to fight to make a woman believe in you as a real man, a pioneer. No man is a man unless to his woman he is a pioneer. You’ll have to fight still harder to make her yield her goal to yours: her night goal to your day goal. . . . She’ll never believe until you have your soul filled with a profound and absolutely inalterable purpose, that will yield to nothing, least of all to her. She’ll never believe until, in your soul, you are cut off and gone ahead, into the dark. . . . Ah, how good it is to come home to your wife when she believes in you and submits to your purpose that is beyond her. . . . And you feel an unfathomable gratitude to the woman who loves you and believes in your purpose and receives you into the magnificent dark gratification of her embrace. That’s what it is to have a wife.
Friends of Lawrence must have smiled when they read these words, for he was hardly giving an accurate description of his own marriage. As I have mentioned, Lawrence and Frieda frequently fell into violent quarrels, and she would often demean and humiliate him, and he her. Yet, ultimately, Frieda believed in Lawrence’s abilities and his mission in life; he knew it and derived strength from it. Those who may think that Lawrence’s prescriptions for marriage require an extraordinarily submissive and even unintelligent wife should take note of the sort of woman Lawrence himself chose.
Now, some might respond to Lawrence’s description of marriage by asking, understandably, “Where is love in all of this? What has become of love between man and wife?” Yet Lawrence speaks again and again, especially in Women in Love, of love between man and wife as a means to wholeness, as a way to transcend the false, ego-centered self. In a 1914 letter he tells a male correspondent:
You mustn’t think that your desire or your fundamental need is to make a good career, or to fill your life with activity, or even to provide for your family materially. It isn’t. Your most vital necessity in this life is that you shall love your wife completely and implicitly and in entire nakedness of body and spirit. Then you will have peace and inner security, no matter how many things go wrong. And this peace and security will leave you free to act and to produce your own work, a real independent workman.
Initially in these remarks Lawrence seems to be taking a position different from the one he expressed in the later Fantasia of the Unconscious, where he asserts that the man derives his chief fulfillment from purpose, not from the home and family. But Lawrence’s position is complex. He believes that the man requires a relationship to a woman in order to be strengthened in the pursuit of his purpose. Recall the lines I quoted earlier, “Let a man walk alone on the face of the earth, and he feels himself like a loose speck blown at random. Let him have a woman to whom he belongs, and he will feel as though he had a wall to back up against; even though the woman be mentally a fool.” Man fulfills himself through having a purpose beyond the home, but he must have a home and a wife to support him. Through romantic love (which always involves a strong sexual component) the man comes to his primal self, and emerges from the encounter with the strength to carry on in the world. Lawrence is telling his correspondent—and this becomes clear in the last lines of the passage quoted—that in order to accomplish anything meaningful he must first submerge himself, body and soul, into love for his wife.
Of course, this makes it sound as if Lawrence regards married love merely as a means to an end: merely as a means to pursuing a male “purpose.” Elsewhere, however, he speaks of it as if it were an end in itself. This is particularly the case in Women in Love. Early in the novel Birkin tells Gerald, “I find . . . that one needs some one really pure single activity—I should call love a single pure activity. . . . The old ideals are dead as nails—nothing there. It seems to me there remains only this perfect union with a woman—sort of ultimate marriage—and there isn’t anything else.” Again, Lawrence is seeking a way to get beyond idealism, and all the corrupt apparatus of modern, ego-driven life. To get beyond this, to what? To the true self, and to relationships based upon blood-consciousness and honest, uncorrupted sentiment. In Women in Love, Lawrence’s plan for achieving this involves a “perfect union” with a woman (and, as he states in the same novel, “the additional perfect relationship between man and man—additional to marriage”).
Birkin wants to achieve this with Ursula, but he keeps insisting over and over (much to her bewilderment and anger) that he means something more than mere “love.” The reason for this is that Birkin and Lawrence associate “love” with an ideal that is drummed into the heads of people in the modern, post-Christian world. We are issued with the baffling injunction to “love thy neighbor,” where thy neighbor means all of humanity. Any intelligent person can see that to love everyone means to love no one in particular. And any psychologically healthy person would find valueless the “love” of someone who claimed also to love all the rest of humanity. Lawrence is reacting also against the lovey-dovey, white lace, sanitized, billing and cooing sort of “love” that society encourages in married couples. Lawrence’s disgust for this sort of thing is expressed in his short story “In Love.” The main character, Hester, is repulsed by the “love” her fiancé, Joe, shows for her. They had been friends prior to their engagement and got on well
But now, alas, since she had promised to marry him, he had made the wretched mistake of falling “in love” with her. He had never been that way before. And if she had known he would get this way now, she would have said decidedly: Let us remain friends, Joe, for this sort of thing is a come-down. Once he started cuddling and petting, she couldn’t stand him. Yet she felt she ought to. She imagined she even ought to like it. Though where the ought came from, she could not see.
Birkin (like Lawrence) wants to avoid at all costs falling into this sort of scripted, stereotyped love relationship, but Ursula has a great deal of difficulty understanding what it is that he does want. He tries his best to explain it to her:
“There is,” he said, in a voice of pure abstraction, “a final me which is stark and impersonal and beyond responsibility. So there is a final you. And it is there I would want to meet you—not in the emotional, loving plane—but there beyond, where there is no speech and no terms of agreement. There we are two stark, unknown beings, two utterly strange creatures, I would want to approach you, and you me. And there could be no obligation, because there is no standard for action there, because no understanding has been reaped from that plane. It is quite inhuman—so there can be no calling to book, in any form whatsoever—because one is outside the pale of all that is accepted, and nothing known applies. One can only follow the impulse, taking that which lies in front, and responsible for nothing, giving nothing, only each taking according to the primal desire.”
The “final me and you” refers to the primal self. “The old ideals are dead as nails” and so is modern civilization. Birkin does not want his relationship to Ursula to “fit” into the modern social scheme, to become conventional or “safe.” He also fears and abhors the impress of society on his conscious, mental self. He does not want to come together with Ursula “though the ego,” as it were. He wants them to come together through their primal selves and to forge a relationship that is based on something deeper and far stronger than what the overly socialized creatures around him call “love.” Yet, at the same time, one could simply say that what he wants is a truer, deeper love, and that what passes for love with other people is usually not the genuine article. They are doing what one “ought” to do, even when in bed together.
In The Rainbow (to which Women in Love forms the “sequel”), Tom Brangwen offers his views on love and marriage in a famous passage:
“There’s very little else, on earth, but marriage. You can talk about making money, or saving souls. You can save your own soul seven times over, and you may have a mint of money, but your soul goes gnawin’, gnawin’, gnawin’, and it says there’s something it must have. In heaven there is no marriage. But on earth there is marriage, else heaven drops out, and there’s no bottom to it. . . . If we’ve got to be Angels . . . and if there is no such thing as a man or a woman among them, then it seems to me as a married couple makes one Angel. . . . [An] Angel can’t be less than a human being. And if it was only the soul of a man minus the man, then it would be less than a human being. . . . An Angel’s got to be more than a human being. . . . So I say, an Angel is the soul of a man and a woman in one: they rise united at the Judgment Day, as one angel. . . . If I am to become an Angel, it’ll be my married soul, and not my single soul.”
À la Aristophanes in Plato’s Symposium, men and women form two halves of a complete human being. Human nature divides itself into two, complementary aspects: masculinity and femininity. A complete human being is made when a man and a woman are joined together. But they cannot be joined—not really—through the mental, social self, but only through the unconscious, primal self.
In Women in Love, this view returns but in a modified form. Now Birkin tells us, “One must commit oneself to a conjunction with the other—for ever. But it is not selfless—it is a maintaining of the self in mystic balance and integrity—like a star balanced with another star.” And Lawrence tells us of Birkin, “he wanted a further conjunction, where man had being and woman had being, two pure beings, each constituting the freedom of the other, balancing each other like two poles of one force, like two angels, or two demons.” Tom Brangwen’s view implies that men and women, considered separately, do not have complete souls, and that a complete soul is made only when they join together in marriage. There is a suggestion in what he says that the “individuality” of single men and women is false, and that only a married couple constitutes a true individual. Birkin’s ideal, on the other hand, involves the man and the woman each preserving their selfhood and individuality and “balancing” each other.
Despite the fact that Birkin frequently, and transparently, speaks for Lawrence we cannot take him as speaking for Lawrence here. I believe that it is Brangwen’s position that is closest to Lawrence’s own. When Women in Love opens, Birkin is in a relationship with Hermione, who Lawrence portrays as a woman living entirely from out of her head, without any naturalness or spontaneity. Yet there is a bit of this in Birkin as well, which is perhaps why he reacts against it so violently when he sees it in Hermione. After the passage just quoted from Women in Love, Lawrence writes of Birkin, “He wanted so much to be free, not under the compulsion of any need for unification, or tortured by unsatisfied desire. . . . And he wanted to be with Ursula as free as with himself, single and clear and cool, yet balanced, polarised with her. The merging, the clutching, the mingling of love was become madly abhorrent to him.” Lawrence then goes on to describe Birkin’s fear and loathing of women’s “clutching.” Birkin is a conflicted character. He wants to lose himself in a relationship with a woman, but fears it at the same time. He wants Ursula, and talks on and on about spontaneity and the evil of ideals, yet he is continually preaching to Ursula about his ideal relationship which, conveniently, is one in which he can unite with her yet preserve his ego intact. This at first bewilders then infuriates Ursula, who never understands what it is that he wants. In the end, the problem resolves itself, probably just as it would in real life. Drawn to Ursula by a power stronger than his conscious ego, Birkin eventually drops all of his talk, surrenders his will, and settles into a married bliss that is marred only by his continued desire for the love of a man.
Ultimately, Lawrence believes that the “establishment of a new relation” between men and women depends upon a return to the oldest of relationships, and that this is possible only through a recovery of the oldest part of the self. We must, he believes, drop our ideal of the unisex society and be alive again to the fundamental, natural differences between men and women. Men and woman do not naturally desire to enjoy each other’s society at all times. We must not only educate men and women apart, but re-establish “spaces” within civilized society where men can be with men, and women with women. We must not force men and women together and command them to forget that they are men and women. Education and, indeed, much else in society must work to cultivate and to affirm the natural, masculine qualities and virtues in men, and the feminine qualities and virtues in women. Having become true men and women and having awakened, through their apartness, to the mystery and the allure that is the opposite sex, they will then come together and forge romantic alliances that are not based upon talk and “common values” but upon the “pull” between man and woman. Lawrence is not referring here simply to lust. A sexual element is, of course, involved, but what he means is the mysterious, ineffable attraction between an individual man and a woman, what we often call “chemistry,” which has nothing to do with the words they utter or the ideals they pay lip service to. And once this attraction is established, if the two desire to become bound to each other, then they must surrender themselves to the relationship. They must overcome their fear of the loss of ego boundaries. They must drop all talk of “rights” and not fall into the trap of treating the marriage as if it were a business partnership. For both, it is a leap into the unknown but in this case the unknown is the natural. When we plant a seed we must close the earth over it and go off and wait in anticipation. But we know that nature, being what it is, will produce as it has before. If all goes well, in that spot will grow the plant we were expecting. Similarly, marriage is not a human invention but something that grows naturally between a man and woman if its seed is planted in the fertile soil of the primal selves of each.
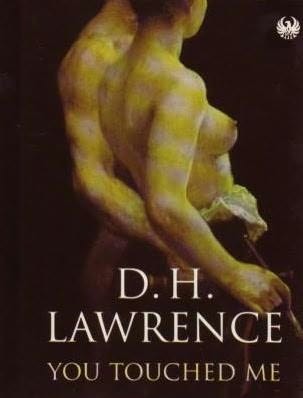 I have contributed several essays to Counter-Currents dealing with D. H. Lawrence’s critique of modernity. Those essays might lead the reader to believe that Lawrence treats modernity as a universal ideology or worldview that could be found anywhere.
I have contributed several essays to Counter-Currents dealing with D. H. Lawrence’s critique of modernity. Those essays might lead the reader to believe that Lawrence treats modernity as a universal ideology or worldview that could be found anywhere.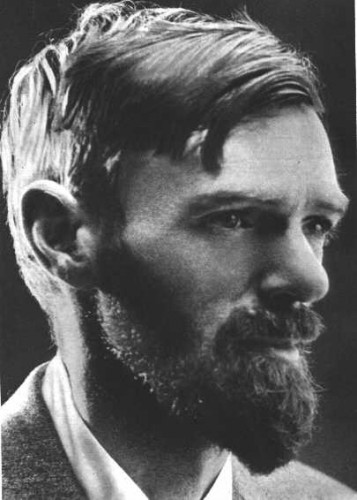 It is Lawrence’s analysis of Melville’s Moby Dick, however, that is perhaps his most incisive. He sees in this simple story an encapsulation of the American spirit, the American thanatos itself. Here is Lawrence summing up his interpretation:
It is Lawrence’s analysis of Melville’s Moby Dick, however, that is perhaps his most incisive. He sees in this simple story an encapsulation of the American spirit, the American thanatos itself. Here is Lawrence summing up his interpretation:


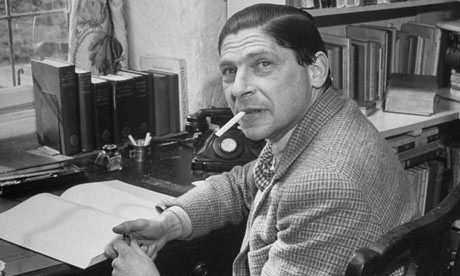
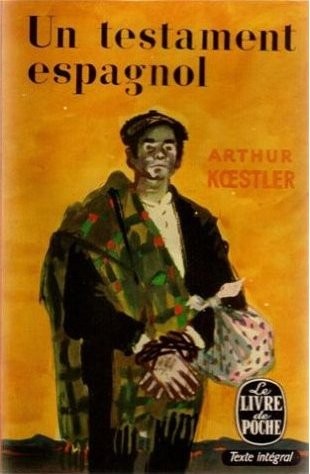 Le Testament espagnol de Koestler est un chef-d’oeuvre: la déréliction de l’homme, qui attend une exécution promise, les joies de lire dans cette geôle, espace exigu entre deux mondes (celui de la vie, qu’on va quitter, et celui, de l’“après”, inconnu et appréhendé), la fatalité de la mort dans un environnement ibérique, acceptée par les autres détenus, dont “le Poitrinaire”... A quinze ans, une littérature aussi forte laisse des traces. Pendant deux bonnes années, Koestler, pour moi, n’a été que ce prisonnier anglo-judéo-hongrois, pris dans la tourmente de la Guerre Civile espagnole, cet homme d’une gauche apparemment militante, dont on ne discernait plus tellement les contours quand s’évanouissait les vanités face à une mort qu’il pouvait croire imminente.
Le Testament espagnol de Koestler est un chef-d’oeuvre: la déréliction de l’homme, qui attend une exécution promise, les joies de lire dans cette geôle, espace exigu entre deux mondes (celui de la vie, qu’on va quitter, et celui, de l’“après”, inconnu et appréhendé), la fatalité de la mort dans un environnement ibérique, acceptée par les autres détenus, dont “le Poitrinaire”... A quinze ans, une littérature aussi forte laisse des traces. Pendant deux bonnes années, Koestler, pour moi, n’a été que ce prisonnier anglo-judéo-hongrois, pris dans la tourmente de la Guerre Civile espagnole, cet homme d’une gauche apparemment militante, dont on ne discernait plus tellement les contours quand s’évanouissait les vanités face à une mort qu’il pouvait croire imminente. 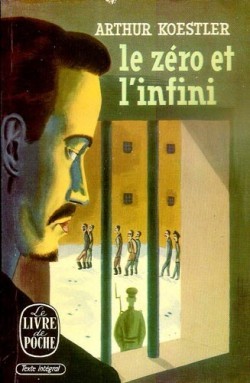 Ce n’est pas seulement par l’effet tonifiant du blanc-seing de Piron, dans le microcosme néo-droitiste bruxellois en gestation à l’époque, que Koestler revenait au premier plan de mes préoccupations. En première année de philologie germanique aux Facultés Universitaires Saint-Louis, il me fallait lire, dès le second trimestre, des romans anglais. Mon programme: Orwell, Huxley, Koestler et D. H. Lawrence. L’un des romans sélectionnés devait être présenté oralement: le sort a voulu que, pour moi, ce fut Darkness at Noon (Le zéro et l’infini), récit d’un procès politique dans le style des grandes purges staliniennes des années 30. Le roman, mettant en scène le “dissident” Roubachov face à ses inquisiteurs, est bien davantage qu’une simple dénonciation du stalinisme par un adepte de la dissidence boukharinienne, zinovievienne ou trotskiste. Toute personne qui entre en politique, entre obligatoirement au service d’un appareil, perclus de rigidités, même si ce n’est guère apparent au départ, pour le croyant, pour le militant, comme l’avoue d’ailleurs Koestler après avoir viré sa cuti. A parti d’un certain moment, le croyant se trouvera en porte-à-faux, tout à la fois face à la politique officielle du parti, face aux promesses faites aux militants de base mais non tenables, face à une réalité, sur laquelle le parti a projeté ses dogmes ou ses idées, mais qui n’en a cure. Le croyant connaîtra alors un profond malaise, il reculera et hésitera, devant les nouveaux ordres donnés, ou voudra mettre la charrue avant les boeufs en basculant dans le zèle révolutionnaire. Il sera soit exclu ou marginalisé, comme aujourd’hui dans les partis dits “démocratiques” ainsi que chez leurs challengeurs (car c’est kif-kif-bourricot!). Dans un parti révolutionnaire comme le parti bolchevique en Russie, la lenteur d’adaptation aux nouvelles directives de la centrale, la fidélité à de vieilles amitiés ou de vieilles traditions de l’époque héroïque de la révolution d’Octobre 1917 ou de la clandestinité pré-révolutionnaire, condamne le “lent” ou le nostalgique à être broyé par une machine en marche qui ne peut ni ralentir ni cesser d’aller de l’avant. La logique des procès communistes voulait que les accusés reconnaissent que leur lenteur et leur nostalgie entravaient le déploiement de la révolution dans le monde, mettait le socialisme construit dans un seul pays (l’URSS) en danger donc, ipso facto, que ces “vertus” de vieux révolutionnaires étaient forcément des “crimes” risquant de ruiner les acquis réellement existants des oeuvres du parti. En conséquence, ces “vertus” relevaient de la complicité avec les ennemis extérieurs de l’Union Soviétique (ou, lors des procès de Prague, de la nouvelle Tchécoslovaquie rouge). Lenteur et nostalgie étaient donc objectivement parlant des vices contre-révolutionnaires. Koestler a vécu de près, au sein des cellules du Komintern, ce type de situation. Pour lui, le pire a été l’entrée en dissidence, à son corps défendant, de Willi Münzenberg, communiste allemand chargé par le Komintern d’organiser depuis son exil parisien une résistance planétaire contre le fascisme et le nazisme. Pour y parvenir, Münzenberg avait reçu d’abord l’ordre de créer des “fronts populaires”, avec les socialistes et les sociaux-démocrates, comme en Espagne et en France. Mais la centrale moscovite change d’avis et pose trotskistes et socialistes comme des ennemis sournois de la révolution: Münzenberg entre en disgrâce, parce qu’il ne veut pas briser l’appareil qu’il a patiemment construit à Paris et tout recommencer à zéro; il refuse d’aller s’expliquer à Moscou, de crainte de subir le sort de son compatriote communiste allemand Neumann, épuré en Union Soviétique (sa veuve, Margarete Buber-Neumann, rejoindra Koestler dans son combat anti-communiste d’après guerre). Münzenberg a refusé d’obéir, de s’aligner sans pour autant passer au service de ses ennemis nationaux-socialistes. Dans le roman Darkness at Noon/Le zéro et l’infini, Roubachov n’est ni un désobéissant ni un traître: il proteste de sa fidélité à l’idéal révolutionnaire. Mais suite au travail de sape des inquisiteurs, il finit par admettre que ses positions, qu’il croit être de fidélité, sont une entorse à la bonne marche de la révolution mondiale en cours, qu’il est un complice objectif des ennemis de l’intérieur et de l’extérieur et que son élimination sauvera peut-être de l’échec final la révolution, à laquelle il a consacré toute sa vie et tous ses efforts. (Sur l’itinéraire de Willi Münzenberg, on se rapportera utilement aux pages que lui consacre François Furet dans Le passé d’une illusion – Essai sur l’idée communiste au XX° siècle, Laffont/Calmann-Lévy, 1995).
Ce n’est pas seulement par l’effet tonifiant du blanc-seing de Piron, dans le microcosme néo-droitiste bruxellois en gestation à l’époque, que Koestler revenait au premier plan de mes préoccupations. En première année de philologie germanique aux Facultés Universitaires Saint-Louis, il me fallait lire, dès le second trimestre, des romans anglais. Mon programme: Orwell, Huxley, Koestler et D. H. Lawrence. L’un des romans sélectionnés devait être présenté oralement: le sort a voulu que, pour moi, ce fut Darkness at Noon (Le zéro et l’infini), récit d’un procès politique dans le style des grandes purges staliniennes des années 30. Le roman, mettant en scène le “dissident” Roubachov face à ses inquisiteurs, est bien davantage qu’une simple dénonciation du stalinisme par un adepte de la dissidence boukharinienne, zinovievienne ou trotskiste. Toute personne qui entre en politique, entre obligatoirement au service d’un appareil, perclus de rigidités, même si ce n’est guère apparent au départ, pour le croyant, pour le militant, comme l’avoue d’ailleurs Koestler après avoir viré sa cuti. A parti d’un certain moment, le croyant se trouvera en porte-à-faux, tout à la fois face à la politique officielle du parti, face aux promesses faites aux militants de base mais non tenables, face à une réalité, sur laquelle le parti a projeté ses dogmes ou ses idées, mais qui n’en a cure. Le croyant connaîtra alors un profond malaise, il reculera et hésitera, devant les nouveaux ordres donnés, ou voudra mettre la charrue avant les boeufs en basculant dans le zèle révolutionnaire. Il sera soit exclu ou marginalisé, comme aujourd’hui dans les partis dits “démocratiques” ainsi que chez leurs challengeurs (car c’est kif-kif-bourricot!). Dans un parti révolutionnaire comme le parti bolchevique en Russie, la lenteur d’adaptation aux nouvelles directives de la centrale, la fidélité à de vieilles amitiés ou de vieilles traditions de l’époque héroïque de la révolution d’Octobre 1917 ou de la clandestinité pré-révolutionnaire, condamne le “lent” ou le nostalgique à être broyé par une machine en marche qui ne peut ni ralentir ni cesser d’aller de l’avant. La logique des procès communistes voulait que les accusés reconnaissent que leur lenteur et leur nostalgie entravaient le déploiement de la révolution dans le monde, mettait le socialisme construit dans un seul pays (l’URSS) en danger donc, ipso facto, que ces “vertus” de vieux révolutionnaires étaient forcément des “crimes” risquant de ruiner les acquis réellement existants des oeuvres du parti. En conséquence, ces “vertus” relevaient de la complicité avec les ennemis extérieurs de l’Union Soviétique (ou, lors des procès de Prague, de la nouvelle Tchécoslovaquie rouge). Lenteur et nostalgie étaient donc objectivement parlant des vices contre-révolutionnaires. Koestler a vécu de près, au sein des cellules du Komintern, ce type de situation. Pour lui, le pire a été l’entrée en dissidence, à son corps défendant, de Willi Münzenberg, communiste allemand chargé par le Komintern d’organiser depuis son exil parisien une résistance planétaire contre le fascisme et le nazisme. Pour y parvenir, Münzenberg avait reçu d’abord l’ordre de créer des “fronts populaires”, avec les socialistes et les sociaux-démocrates, comme en Espagne et en France. Mais la centrale moscovite change d’avis et pose trotskistes et socialistes comme des ennemis sournois de la révolution: Münzenberg entre en disgrâce, parce qu’il ne veut pas briser l’appareil qu’il a patiemment construit à Paris et tout recommencer à zéro; il refuse d’aller s’expliquer à Moscou, de crainte de subir le sort de son compatriote communiste allemand Neumann, épuré en Union Soviétique (sa veuve, Margarete Buber-Neumann, rejoindra Koestler dans son combat anti-communiste d’après guerre). Münzenberg a refusé d’obéir, de s’aligner sans pour autant passer au service de ses ennemis nationaux-socialistes. Dans le roman Darkness at Noon/Le zéro et l’infini, Roubachov n’est ni un désobéissant ni un traître: il proteste de sa fidélité à l’idéal révolutionnaire. Mais suite au travail de sape des inquisiteurs, il finit par admettre que ses positions, qu’il croit être de fidélité, sont une entorse à la bonne marche de la révolution mondiale en cours, qu’il est un complice objectif des ennemis de l’intérieur et de l’extérieur et que son élimination sauvera peut-être de l’échec final la révolution, à laquelle il a consacré toute sa vie et tous ses efforts. (Sur l’itinéraire de Willi Münzenberg, on se rapportera utilement aux pages que lui consacre François Furet dans Le passé d’une illusion – Essai sur l’idée communiste au XX° siècle, Laffont/Calmann-Lévy, 1995). 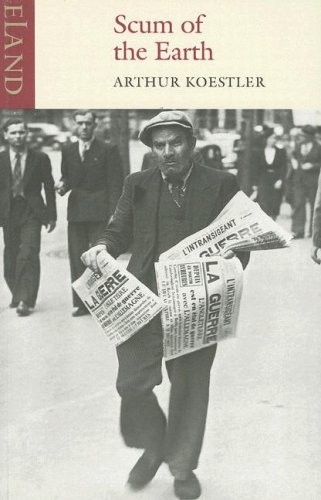 Reste à évoquer le rapport entre Koestler et la France. Ce pays est, dans l’entre-deux-guerres, le refuge idéal des antifascistes et antinazis de toutes obédiences. Koestler y pérègrine entre Paris et la Côte d’Azur. La France est la patrie de la révolution et Koestler se perçoit comme un révolutionnaire, qui poursuit l’idéal 150 ans après la prise de la Bastille, devant des ennemis tenaces, apparemment plus coriaces que les armées en dentelles de la Prusse et de l’Autriche à Valmy ou que les émigrés de Coblence. Cet engouement pour la France s’effondre en octobre 1939: considéré comme sujet hongrois et comme journaliste allemand, Koestler est arrêté et interné dans un camp de concentration en lisière des Pyrénées. Il y restera quatre mois. Cette mésaventure, ainsi que sa seconde arrestation en mai 1940, son évasion et son périple dans la France en débâcle, généreront un deuxième chef-d’oeuvre de littérature carcérale et autobiographique, Scum of the Earth (La lie de la Terre). Cet ouvrage est une dénonciation de l’inhumanité du système concentrationnaire de la Troisième République, de son absence totale d’hygiène et un témoignage poignant sur la mort et la déréliction de quelques antifascistes allemands, italiens et espagnols dans ces camps sordides. Avant 1945, la littérature carcérale/concentrationnaire dénonce, non pas le Troisième Reich, mais la Troisième République. Il y a Koestler, qui édite son livre en Angleterre et donne à l’allié français vaincu une très mauvaise presse, mais il y a, en Belgique, les souvenirs des internés du Vernet, arrêtés par la Sûreté belge en mai 1940 et livrés aux soudards français qui les accompagneront en les battant et en les humiliant jusqu’à la frontière espagnole. Eux aussi iront crever de faim, rongés par une abondante vermine, en bordure des Pyrénées. Ce scandale a été largement exploité en Belgique pendant les premiers mois de la deuxième occupation allemande, avec les témoignages de Léon Degrelle (Ma guerre en prison), du rexiste Serge Doring (L’école de la douleur – Souvenirs d’un déporté politique), des militants flamands René Lagrou (Wij Verdachten) et Ward Hermans. La description des lieux par Doring correspond bien à celle que nous livre Koestler. L’un de leurs compagnons d’infortune des trains fantômes partis de Bruxelles, le communiste saint-gillois Lucien Monami n’aura pas l’occasion de rédiger le récit de ses malheurs: il sera assassiné par des soldats français ivres à Abbeville, aux côtés des solidaristes Van Severen et Rijckoort. La lie de la terre rend Koestler impopulaire en France dans l’immédiat après-guerre. En effet, cet ouvrage prouve que le dérapage concentrationnaire n’est pas une exclusivité du Troisième Reich ou de l’URSS stalinienne, que les antifascistes et les rescapés des Brigades Internationales ou des milices anarchistes ibériques antifranquistes ont d’abord été victimes du système concentrationnaire français avant de l’être du système national-socialiste ou, éventuellement, stalinien, que la revendication d’humanisme de la “République” est donc un leurre, que la “saleté” et le manque total d’hygiène reprochés aux services policiers et pénitentiaires français sont attestés par un témoignage bien charpenté et largement lu chez les alliés d’Outre-Manche à l’époque. Les choses s’envenimeront dans les années chaudes et quasi insurrectionnelles de 1947-48, où Koestler évoque la possibilité d’une prise de pouvoir communiste en France et appelle à soutenir De Gaulle. Dans ses mémoires, il décrit Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, avec leur entourage, en des propos peu amènes, se gaussant grassement de leurs dogmatismes, de leurs manies, de leur laideur et de leur ivrognerie. La rupture a lieu définitivement en 1949, quand Koestler participe à un recueil collectif, Le Dieu des Ténèbres, publié dans une collection dirigée par Raymond Aron. La gauche française, communistes en tête, mène campagne contre le “rénégat” Koestler et surtout contre la publication en traduction française de Darkness at Noon (Le Zéro et l’Infini). Pire: l’impression du recueil d’articles de Koestler, intitulé Le Yogi et le commissaire, est suspendue sur ordre du gouvernement français pour “inopportunisme politique”! Une vengeance pour La lie de la Terre?
Reste à évoquer le rapport entre Koestler et la France. Ce pays est, dans l’entre-deux-guerres, le refuge idéal des antifascistes et antinazis de toutes obédiences. Koestler y pérègrine entre Paris et la Côte d’Azur. La France est la patrie de la révolution et Koestler se perçoit comme un révolutionnaire, qui poursuit l’idéal 150 ans après la prise de la Bastille, devant des ennemis tenaces, apparemment plus coriaces que les armées en dentelles de la Prusse et de l’Autriche à Valmy ou que les émigrés de Coblence. Cet engouement pour la France s’effondre en octobre 1939: considéré comme sujet hongrois et comme journaliste allemand, Koestler est arrêté et interné dans un camp de concentration en lisière des Pyrénées. Il y restera quatre mois. Cette mésaventure, ainsi que sa seconde arrestation en mai 1940, son évasion et son périple dans la France en débâcle, généreront un deuxième chef-d’oeuvre de littérature carcérale et autobiographique, Scum of the Earth (La lie de la Terre). Cet ouvrage est une dénonciation de l’inhumanité du système concentrationnaire de la Troisième République, de son absence totale d’hygiène et un témoignage poignant sur la mort et la déréliction de quelques antifascistes allemands, italiens et espagnols dans ces camps sordides. Avant 1945, la littérature carcérale/concentrationnaire dénonce, non pas le Troisième Reich, mais la Troisième République. Il y a Koestler, qui édite son livre en Angleterre et donne à l’allié français vaincu une très mauvaise presse, mais il y a, en Belgique, les souvenirs des internés du Vernet, arrêtés par la Sûreté belge en mai 1940 et livrés aux soudards français qui les accompagneront en les battant et en les humiliant jusqu’à la frontière espagnole. Eux aussi iront crever de faim, rongés par une abondante vermine, en bordure des Pyrénées. Ce scandale a été largement exploité en Belgique pendant les premiers mois de la deuxième occupation allemande, avec les témoignages de Léon Degrelle (Ma guerre en prison), du rexiste Serge Doring (L’école de la douleur – Souvenirs d’un déporté politique), des militants flamands René Lagrou (Wij Verdachten) et Ward Hermans. La description des lieux par Doring correspond bien à celle que nous livre Koestler. L’un de leurs compagnons d’infortune des trains fantômes partis de Bruxelles, le communiste saint-gillois Lucien Monami n’aura pas l’occasion de rédiger le récit de ses malheurs: il sera assassiné par des soldats français ivres à Abbeville, aux côtés des solidaristes Van Severen et Rijckoort. La lie de la terre rend Koestler impopulaire en France dans l’immédiat après-guerre. En effet, cet ouvrage prouve que le dérapage concentrationnaire n’est pas une exclusivité du Troisième Reich ou de l’URSS stalinienne, que les antifascistes et les rescapés des Brigades Internationales ou des milices anarchistes ibériques antifranquistes ont d’abord été victimes du système concentrationnaire français avant de l’être du système national-socialiste ou, éventuellement, stalinien, que la revendication d’humanisme de la “République” est donc un leurre, que la “saleté” et le manque total d’hygiène reprochés aux services policiers et pénitentiaires français sont attestés par un témoignage bien charpenté et largement lu chez les alliés d’Outre-Manche à l’époque. Les choses s’envenimeront dans les années chaudes et quasi insurrectionnelles de 1947-48, où Koestler évoque la possibilité d’une prise de pouvoir communiste en France et appelle à soutenir De Gaulle. Dans ses mémoires, il décrit Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, avec leur entourage, en des propos peu amènes, se gaussant grassement de leurs dogmatismes, de leurs manies, de leur laideur et de leur ivrognerie. La rupture a lieu définitivement en 1949, quand Koestler participe à un recueil collectif, Le Dieu des Ténèbres, publié dans une collection dirigée par Raymond Aron. La gauche française, communistes en tête, mène campagne contre le “rénégat” Koestler et surtout contre la publication en traduction française de Darkness at Noon (Le Zéro et l’Infini). Pire: l’impression du recueil d’articles de Koestler, intitulé Le Yogi et le commissaire, est suspendue sur ordre du gouvernement français pour “inopportunisme politique”! Une vengeance pour La lie de la Terre?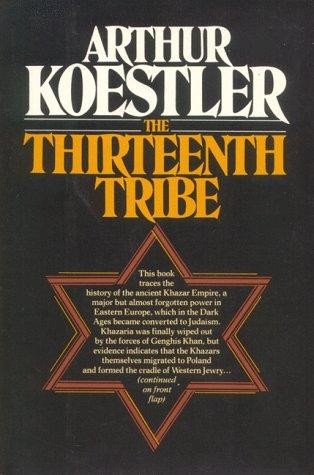 Aujourd’hui, il faut aussi relire Koestler quand on aborde la question judéo-israélienne. Les séjours de Koestler en Palestine, à l’époque du sionisme balbutiant, ont conduit, en gros, à une déception. Ce sionisme, idéologiquement séduisant dans les Burschenschaften juives de Vienne, où le niveau intellectuel était très élevé, s’avérait décevant et caricatural dans les kibboutzim des campagnes galiléennes ou judéennes et dans les nouvelles villes émergentes du Protectorat britannique de Palestine en voie de judaïsation. Même si Koestler fut le premier inventeur de mots croisés en hébreu pour une feuille juive locale, l’option en faveur de cette langue reconstituée lui déplaisait profondément: il estimait qu’ainsi, le futur citoyen palestinien de confession ou d’origine juive se détachait des vieilles cultures européennes, essentiellement celles de langues germaniques ou slaves, qui disposaient d’une riche littérature et d’une grande profondeur temporelle, tout en n’adoptant pas davantage l’arabe. Ce futur citoyen judéo-palestinien néo-hébraïsant adoptait une sorte d’esperanto largement incompris dans le reste du monde: selon le raisonnement de Koestler, le juif, en s’immergeant jusqu’à l’absurde dans l’idéologie sioniste, devenue caricaturale, cessait d’être un être passe-partout, un cosmopolite bon teint, à l’aise dans tous les milieux cultivés de la planète. L’hébraïsation transformait l’immigré juif, cherchant à échapper aux ghettos, aux pogroms ou aux persécutions, en un plouc baraguinant et marginalisé sur une planète dont il n’allait plus comprendre les ressorts. Plus tard, dans les années 70, Koestler rédigera La treizième tribu un ouvrage ruinant le mythe sioniste du “retour”, en affirmant que la masse des juifs russes et roumains n’avaient aucune racine en Palestine mais descendaient d’une tribu turco-tatar, les Khazars, convertie au judaïsme au haut moyen âge. Poser le mythe du “retour” comme fallacieux est l’axiome majeur de la nouvelle tradition “post-sioniste” en Israël aujourd’hui, sévèrement combattue par les droites israéliennes, dont elle ruine le mythe mobilisateur.
Aujourd’hui, il faut aussi relire Koestler quand on aborde la question judéo-israélienne. Les séjours de Koestler en Palestine, à l’époque du sionisme balbutiant, ont conduit, en gros, à une déception. Ce sionisme, idéologiquement séduisant dans les Burschenschaften juives de Vienne, où le niveau intellectuel était très élevé, s’avérait décevant et caricatural dans les kibboutzim des campagnes galiléennes ou judéennes et dans les nouvelles villes émergentes du Protectorat britannique de Palestine en voie de judaïsation. Même si Koestler fut le premier inventeur de mots croisés en hébreu pour une feuille juive locale, l’option en faveur de cette langue reconstituée lui déplaisait profondément: il estimait qu’ainsi, le futur citoyen palestinien de confession ou d’origine juive se détachait des vieilles cultures européennes, essentiellement celles de langues germaniques ou slaves, qui disposaient d’une riche littérature et d’une grande profondeur temporelle, tout en n’adoptant pas davantage l’arabe. Ce futur citoyen judéo-palestinien néo-hébraïsant adoptait une sorte d’esperanto largement incompris dans le reste du monde: selon le raisonnement de Koestler, le juif, en s’immergeant jusqu’à l’absurde dans l’idéologie sioniste, devenue caricaturale, cessait d’être un être passe-partout, un cosmopolite bon teint, à l’aise dans tous les milieux cultivés de la planète. L’hébraïsation transformait l’immigré juif, cherchant à échapper aux ghettos, aux pogroms ou aux persécutions, en un plouc baraguinant et marginalisé sur une planète dont il n’allait plus comprendre les ressorts. Plus tard, dans les années 70, Koestler rédigera La treizième tribu un ouvrage ruinant le mythe sioniste du “retour”, en affirmant que la masse des juifs russes et roumains n’avaient aucune racine en Palestine mais descendaient d’une tribu turco-tatar, les Khazars, convertie au judaïsme au haut moyen âge. Poser le mythe du “retour” comme fallacieux est l’axiome majeur de la nouvelle tradition “post-sioniste” en Israël aujourd’hui, sévèrement combattue par les droites israéliennes, dont elle ruine le mythe mobilisateur. 
 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg
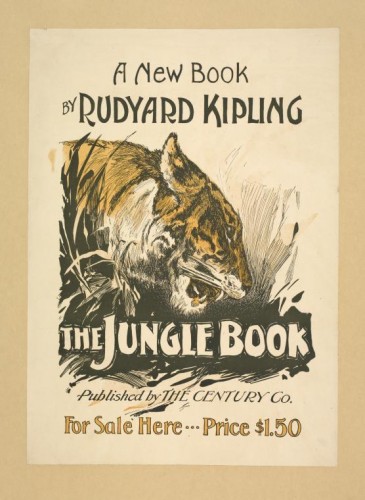 Every now and then the young subeditor, with his editor’s assent, would fill up a little left-over space in the newspaper with a poem of his own composition, much to the annoyance of the Indian typesetters, who did not like to use the special typefaces which Kipling deemed appropriate to distinguish his poems from the prose around them. In 1886 he gathered up all of these poems from the previous three years and republished them in a book, under the title Departmental Ditties. The book was an immediate hit with other British colonials, and the first printing sold out very quickly.
Every now and then the young subeditor, with his editor’s assent, would fill up a little left-over space in the newspaper with a poem of his own composition, much to the annoyance of the Indian typesetters, who did not like to use the special typefaces which Kipling deemed appropriate to distinguish his poems from the prose around them. In 1886 he gathered up all of these poems from the previous three years and republished them in a book, under the title Departmental Ditties. The book was an immediate hit with other British colonials, and the first printing sold out very quickly. Kipling chose as his symbol—his personal rune—the swastika, the ancient Aryan sign of the sun and of health and of good fortune. Most editions of his works published in the first decades of this century are adorned with this symbol. Beginning in 1933, however, Jewish pressure was brought to bear against the publishers, and the swastikas were dropped from subsequent printings.
Kipling chose as his symbol—his personal rune—the swastika, the ancient Aryan sign of the sun and of health and of good fortune. Most editions of his works published in the first decades of this century are adorned with this symbol. Beginning in 1933, however, Jewish pressure was brought to bear against the publishers, and the swastikas were dropped from subsequent printings.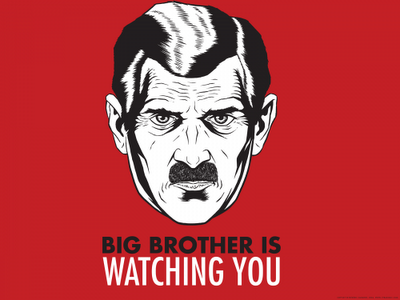







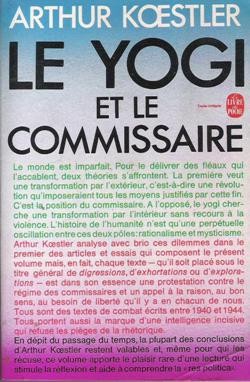 Futur auteur de Le zéro et l’infini, Arthur Koestler avait joué un rôle important dans la guerre d’Espagne comme agent du Komintern. Par ses écrits, il avait donné le ton d’une propagande antifranquiste qui a perduré. Plus tard, ses déceptions firent de lui un critique acéré du stalinisme. À l’été 1942, il publia un texte qui marquait sa rupture : Le yogi et le commissaire. Deux théories, écrivait-il, prétendent libérer le monde des maux qui l’accablent. La première, celle du commissaire (communiste) prône la transformation par l’extérieur. Elle professe que tous les maux de l’humanité, y compris la constipation, peuvent et doivent être guéris par la révolution, c’est-à-dire par la réorganisation du système de production. À l’opposé, la théorie du yogi pense qu’il n’y a de salut qu’intérieur et que seul l’effort spirituel de l’individu, les yeux sur les étoiles, peut sauver le monde. Mais l’histoire, concluait Koestler, avait consacré la faillite des deux théories. La première avait débouché sur les pires massacres de masse et la seconde conduisait à tout supporter passivement. C’était assez bien vu et totalement désespérant.
Futur auteur de Le zéro et l’infini, Arthur Koestler avait joué un rôle important dans la guerre d’Espagne comme agent du Komintern. Par ses écrits, il avait donné le ton d’une propagande antifranquiste qui a perduré. Plus tard, ses déceptions firent de lui un critique acéré du stalinisme. À l’été 1942, il publia un texte qui marquait sa rupture : Le yogi et le commissaire. Deux théories, écrivait-il, prétendent libérer le monde des maux qui l’accablent. La première, celle du commissaire (communiste) prône la transformation par l’extérieur. Elle professe que tous les maux de l’humanité, y compris la constipation, peuvent et doivent être guéris par la révolution, c’est-à-dire par la réorganisation du système de production. À l’opposé, la théorie du yogi pense qu’il n’y a de salut qu’intérieur et que seul l’effort spirituel de l’individu, les yeux sur les étoiles, peut sauver le monde. Mais l’histoire, concluait Koestler, avait consacré la faillite des deux théories. La première avait débouché sur les pires massacres de masse et la seconde conduisait à tout supporter passivement. C’était assez bien vu et totalement désespérant.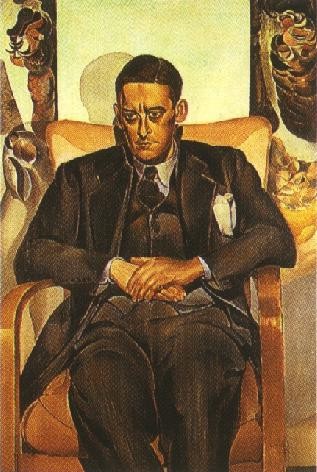
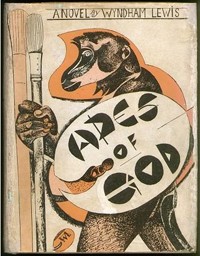 The Apes of God happens to be one of the most devastating satires to be published in the English language since the days of Dryden and Pope. It appeared in a
The Apes of God happens to be one of the most devastating satires to be published in the English language since the days of Dryden and Pope. It appeared in a 
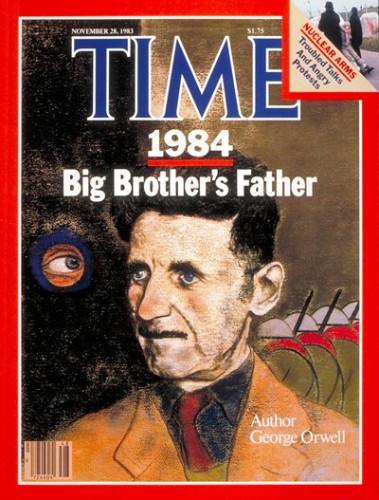
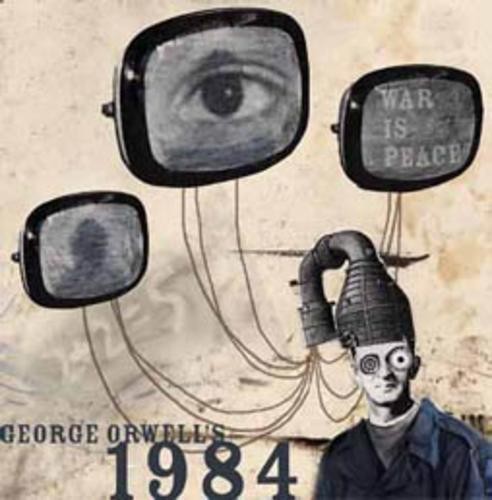
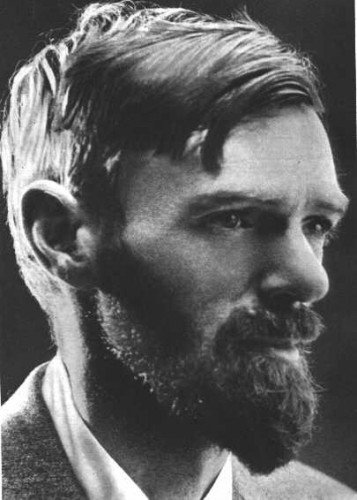 D. H. Lawrence’s greatest novel is also his most anti-modern. Written between April and October of 1916 in Cornwall, during some of the darkest days of the First World War,
D. H. Lawrence’s greatest novel is also his most anti-modern. Written between April and October of 1916 in Cornwall, during some of the darkest days of the First World War, 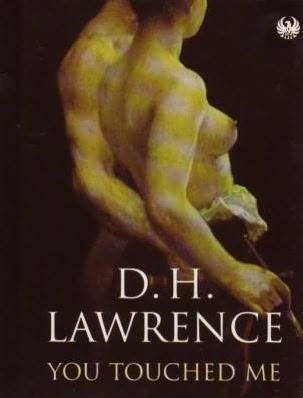 But why did Jane Austen’s England have the power to be something else? And what else did it have the power to be? For the answers to these questions we must, in essence, look back to The Rainbow. Jane Austen’s England still preserved some connection to the land—a sense of belonging to nature. What England then had the “power to be” was nothing grand and idealistic: it had the power simply to be its natural self. The people of Jane Austen’s England made and enjoyed beautiful objects—but these objects were an ornament to a life lived in relative closeness to the earth.
But why did Jane Austen’s England have the power to be something else? And what else did it have the power to be? For the answers to these questions we must, in essence, look back to The Rainbow. Jane Austen’s England still preserved some connection to the land—a sense of belonging to nature. What England then had the “power to be” was nothing grand and idealistic: it had the power simply to be its natural self. The people of Jane Austen’s England made and enjoyed beautiful objects—but these objects were an ornament to a life lived in relative closeness to the earth.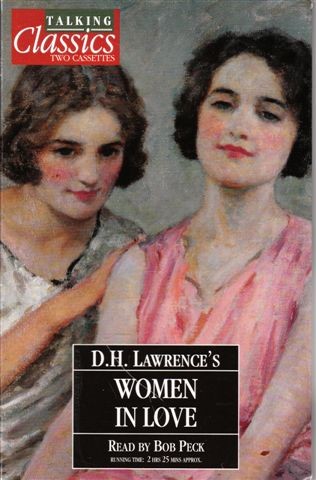 For Nietzsche, on the other hand, the end of history meant the death of everything that ennobles the human race. Without anything to struggle over or to believe in so strongly that one would be willing to fight and die for it, humanity would sink to the level of what Nietzsche called the Last Man, Homo economicus: the man whose aspirations do not rise above material comfort, safety, and security. The only hope was the arrival of the Overman, who would create new values, new systems of belief, and initiate new conflicts among human beings. In short, the Overman would re-start history. Nietzsche’s writings, in their trenchant critique of all Western beliefs and values, can be seen as an attempt to actually hasten the collapse of the modern world and usher in the Overman.
For Nietzsche, on the other hand, the end of history meant the death of everything that ennobles the human race. Without anything to struggle over or to believe in so strongly that one would be willing to fight and die for it, humanity would sink to the level of what Nietzsche called the Last Man, Homo economicus: the man whose aspirations do not rise above material comfort, safety, and security. The only hope was the arrival of the Overman, who would create new values, new systems of belief, and initiate new conflicts among human beings. In short, the Overman would re-start history. Nietzsche’s writings, in their trenchant critique of all Western beliefs and values, can be seen as an attempt to actually hasten the collapse of the modern world and usher in the Overman.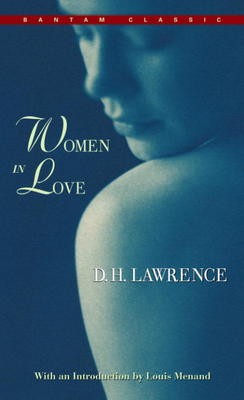 Spengler’s major work Der Untergang des Abendlandes (The Decline of the West) was published in 1918, two years after Lawrence first began working on Women in Love. According to Spengler, “Faustian man” creates a human world of artifacts and schemes not out of any economic motivation but rather out of a sheer desire for mastery.
Spengler’s major work Der Untergang des Abendlandes (The Decline of the West) was published in 1918, two years after Lawrence first began working on Women in Love. According to Spengler, “Faustian man” creates a human world of artifacts and schemes not out of any economic motivation but rather out of a sheer desire for mastery.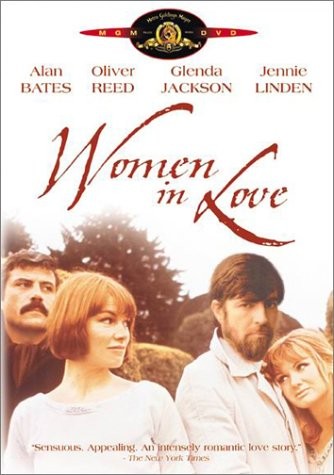 In the deleted “Prologue” to Women In Love (which is interesting for a good many other reasons), Lawrence describes Birkin in the early days of his affair with Hermione as “a youth of twenty-one, holding forth against Nietzsche.” Yet when Lawrence introduces us to Birkin’s own views they seem strikingly Nietzschean. First, however, Lawrence describes how Birkin had studied education (and become a school inspector) under the influence of what seems unmistakably like a warmed-over Hegelianism:
In the deleted “Prologue” to Women In Love (which is interesting for a good many other reasons), Lawrence describes Birkin in the early days of his affair with Hermione as “a youth of twenty-one, holding forth against Nietzsche.” Yet when Lawrence introduces us to Birkin’s own views they seem strikingly Nietzschean. First, however, Lawrence describes how Birkin had studied education (and become a school inspector) under the influence of what seems unmistakably like a warmed-over Hegelianism: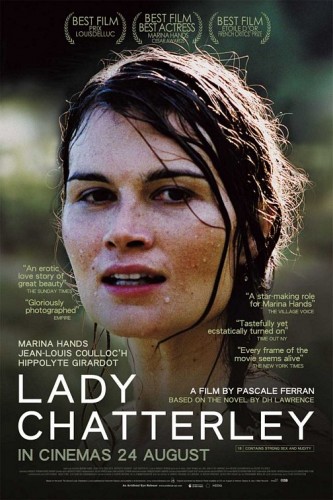 Lawrence is famous for characterizing relations between the sexes as a battle, or, more accurately, a struggle unto death. In Women in Love, the two couples battle each other continuously, but most of the fighting is done by the women against the men. (The famous nude wrestling match between Gerald and Birkin is a purely honest, physical contest, whose only psychological undertones are homoerotic.)
Lawrence is famous for characterizing relations between the sexes as a battle, or, more accurately, a struggle unto death. In Women in Love, the two couples battle each other continuously, but most of the fighting is done by the women against the men. (The famous nude wrestling match between Gerald and Birkin is a purely honest, physical contest, whose only psychological undertones are homoerotic.)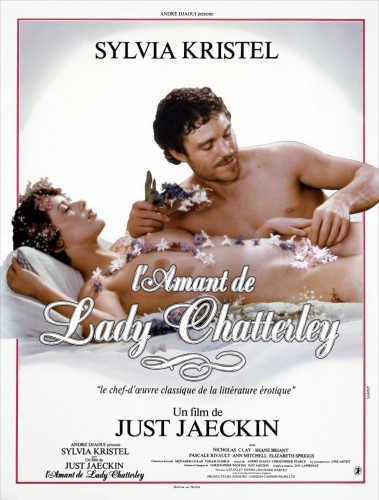 When Gudrun is asked the question wohin? (where to?) Lawrence tells us that “She never wanted it answered.”
When Gudrun is asked the question wohin? (where to?) Lawrence tells us that “She never wanted it answered.”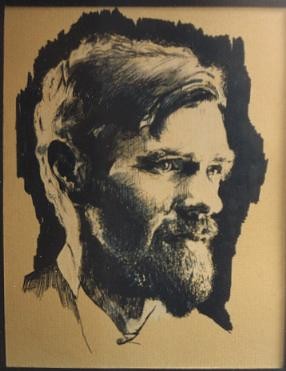 1. The Genealogy of Modernity
1. The Genealogy of Modernity Lawrence encountered the effects of modernity—especially the Industrial Revolution—directly in his native Midlands. He saw how if affected people, generally for the worse. Again and again he sets his stories against the backdrop of the collieries. He saw the miners become increasingly dehumanized. Working in the earth, they become cut off from it and from themselves. They lived, but they did not flourish. Lawrence’s remarks about the Industrial Revolution, capitalism, and the condition of the miners put him quite close to the thought of Marx and other socialist writers. In fact, it would not be at all unreasonable to claim Lawrence as a kind of socialist. However, as we shall see, few socialists would wish to do so!
Lawrence encountered the effects of modernity—especially the Industrial Revolution—directly in his native Midlands. He saw how if affected people, generally for the worse. Again and again he sets his stories against the backdrop of the collieries. He saw the miners become increasingly dehumanized. Working in the earth, they become cut off from it and from themselves. They lived, but they did not flourish. Lawrence’s remarks about the Industrial Revolution, capitalism, and the condition of the miners put him quite close to the thought of Marx and other socialist writers. In fact, it would not be at all unreasonable to claim Lawrence as a kind of socialist. However, as we shall see, few socialists would wish to do so!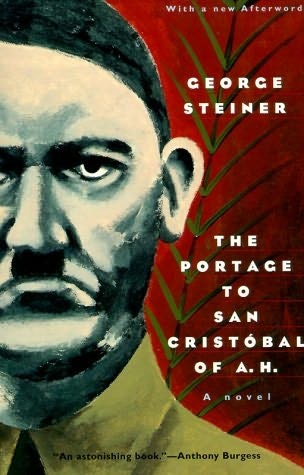 George Steiner’s novella, The Portage to San Cristobal of A. H., was published about three decades back and encodes a large number of the author’s non-fiction books which were released beforehand. This is especially pertinent to the analysis published in
George Steiner’s novella, The Portage to San Cristobal of A. H., was published about three decades back and encodes a large number of the author’s non-fiction books which were released beforehand. This is especially pertinent to the analysis published in 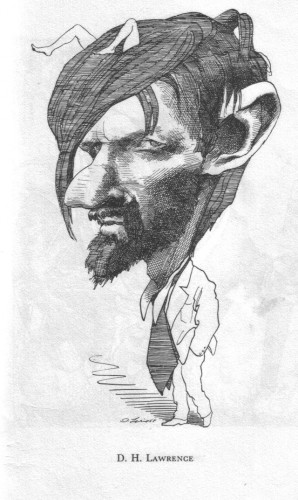 In a 1913 letter D. H. Lawrence writes that “it is the problem of to-day, the establishment of a new relation, or the readjustment of the old one, between men and women.” Lawrence’s views about relations between the sexes, and about sex differences are perhaps his most controversial – and they have frequently been misrepresented. But before we delve into those views, let us ask why it should be the case that establishing a new relation between men and women is “the problem of to-day.” The reason is fairly obvious. The species divides itself into male and female, reproduces itself thereby, and the overwhelming majority of human beings seek their fulfillment in a relationship to the opposite sex. If relations between the sexes have somehow been crippled—as Lawrence believes they have been—then this is a catastrophe. It is hard to imagine a greater, more pressing problem.
In a 1913 letter D. H. Lawrence writes that “it is the problem of to-day, the establishment of a new relation, or the readjustment of the old one, between men and women.” Lawrence’s views about relations between the sexes, and about sex differences are perhaps his most controversial – and they have frequently been misrepresented. But before we delve into those views, let us ask why it should be the case that establishing a new relation between men and women is “the problem of to-day.” The reason is fairly obvious. The species divides itself into male and female, reproduces itself thereby, and the overwhelming majority of human beings seek their fulfillment in a relationship to the opposite sex. If relations between the sexes have somehow been crippled—as Lawrence believes they have been—then this is a catastrophe. It is hard to imagine a greater, more pressing problem.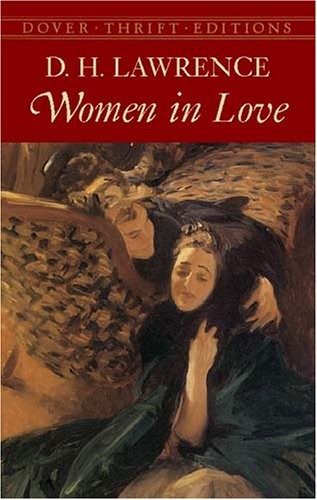 In Fantasia of the Unconscious, Lawrence tells us “The blood-consciousness and the blood-passion is the very source and origin of us. Not that we can stay at the source. Nor even make a goal of the source, as Freud does. The business of living is to travel away from the source. But you must start every single day fresh from the source. You must rise every day afresh out of the dark sea of the blood.” Lawrence believes that men yearn for purposive, creative activity, which involves moving away from the source. However, the energy and inspiration for purposive activity is drawn from the source, and so there is a complementary movement back towards it.
In Fantasia of the Unconscious, Lawrence tells us “The blood-consciousness and the blood-passion is the very source and origin of us. Not that we can stay at the source. Nor even make a goal of the source, as Freud does. The business of living is to travel away from the source. But you must start every single day fresh from the source. You must rise every day afresh out of the dark sea of the blood.” Lawrence believes that men yearn for purposive, creative activity, which involves moving away from the source. However, the energy and inspiration for purposive activity is drawn from the source, and so there is a complementary movement back towards it.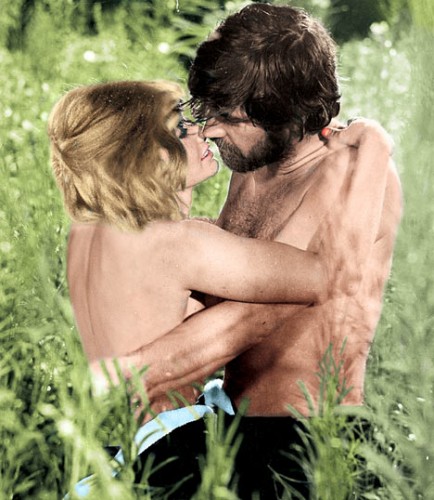 Having a woman is therefore a necessary but not a sufficient condition for male happiness. In addition to a woman, he must have a purpose. Women, on the other hand, do not require a purpose beyond the home and the family in order to be happy. This is another of those claims that will rankle some, so let us consider two important points about what Lawrence has said. First, he is speaking of what he believes the typical woman is like, just as he is speaking of the typical man. There are at least a few exceptions to just about every generalization. Second, we must ask an absolutely crucial question of those who regard such claims as demeaning women: why is being occupied with home and family lesser than having a purpose (e.g., a career) outside the home? The argument could be made—and I think Lawrence would be sympathetic to this—that the traditional female role of making a home and raising children is just as important and possibly more important than the male activities pursued outside the home. Again, much of contemporary feminism sees things from a typically male point of view, and denigrates women who choose motherhood rather than one of the many meaningless, ulcer-producing careers that have long been the province of men.
Having a woman is therefore a necessary but not a sufficient condition for male happiness. In addition to a woman, he must have a purpose. Women, on the other hand, do not require a purpose beyond the home and the family in order to be happy. This is another of those claims that will rankle some, so let us consider two important points about what Lawrence has said. First, he is speaking of what he believes the typical woman is like, just as he is speaking of the typical man. There are at least a few exceptions to just about every generalization. Second, we must ask an absolutely crucial question of those who regard such claims as demeaning women: why is being occupied with home and family lesser than having a purpose (e.g., a career) outside the home? The argument could be made—and I think Lawrence would be sympathetic to this—that the traditional female role of making a home and raising children is just as important and possibly more important than the male activities pursued outside the home. Again, much of contemporary feminism sees things from a typically male point of view, and denigrates women who choose motherhood rather than one of the many meaningless, ulcer-producing careers that have long been the province of men.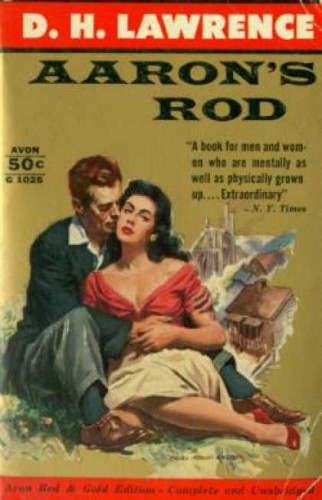 What Lawrence says here is applicable to both men and women. “To be oneself” in the true sense means to answer to the call of the deepest self. We can only achieve our “fullness of being” if we do so. The mind invents all manner of goals and projects and ideals to be pursued, but ultimately all that we do produces only frustration and emptiness if we act in a way that does not fundamentally satisfy the needs of our deepest, pre-mental, bodily nature.
What Lawrence says here is applicable to both men and women. “To be oneself” in the true sense means to answer to the call of the deepest self. We can only achieve our “fullness of being” if we do so. The mind invents all manner of goals and projects and ideals to be pursued, but ultimately all that we do produces only frustration and emptiness if we act in a way that does not fundamentally satisfy the needs of our deepest, pre-mental, bodily nature. Aanvankelijk was de in Trinidad geboren Naipaul als eregast uitgenodigd voor
Aanvankelijk was de in Trinidad geboren Naipaul als eregast uitgenodigd voor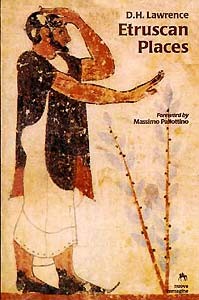 C’est à la fin du VIIe siècle avant la naissance du Christ qu’apparaît en Toscane une population que les Latins appelleront Tusci ou Etrusci, dont les origines continuent de rester énigmatiques. On suggère aujourd’hui que la culture étrusque est née d’un ancien substrat local qui s’est lentement modifié au cours des différentes vagues de population s’installant en Italie, tandis que l’hypothèse qui prévalait au début du siècle passé rejoignait le récit d’Hérodote, d’après lequel ce peuple serait venu par la mer de Lydie.
C’est à la fin du VIIe siècle avant la naissance du Christ qu’apparaît en Toscane une population que les Latins appelleront Tusci ou Etrusci, dont les origines continuent de rester énigmatiques. On suggère aujourd’hui que la culture étrusque est née d’un ancien substrat local qui s’est lentement modifié au cours des différentes vagues de population s’installant en Italie, tandis que l’hypothèse qui prévalait au début du siècle passé rejoignait le récit d’Hérodote, d’après lequel ce peuple serait venu par la mer de Lydie.  Lawrence, suivant en cela la leçon d’un nombre incalculable d’auteurs mais sans toutefois tomber dans le délire de certains qui, comme Keyserling, fonda à Darmstadt en 1920 une École de la Sagesse dénonçant les limites de la culture occidentale et puisant son enseignement de pacotille dans une Inde fantasmée, confère au monde ancien une vertu éminente : au contraire de ce que nous pouvons constater à notre époque de spécialistes qui poussent de grands cris dès qu’un esprit un peu audacieux essaie de créer des passerelles entre plusieurs domaines de savoir, le monde ancien ne craignait pas d’établir des parentés symboliques, donc réelles, entre les êtres vivants et les choses, reliés par un flux souterrain de sang (5). «Merveilleux monde, écrit ainsi Lawrence, qu’était sans doute ce monde ancien où toutes choses semblaient vivantes, luisantes dans l’ombre crépusculaire du contact qui les faisait se toucher, un monde où chaque chose n’était pas seulement une individualité isolée prise au piège de la lumière diurne; où chaque chose apparaissait en son clair contour, visuellement, mais qui du sein de sa clarté même était reliée par des affinités émotionnelles ou vitales à d’autres choses étranges, une chose surgissant d’une autre, mentalement contradictoires qui fusionnaient dans l’émotion, si bien qu’un lion pouvait au même instant être aussi une chèvre, et ne pas être une chèvre [Lawrence a évoqué précédemment la chimère en bronze d’Arezzo, conservée au musée de Florence et qui fut en partie restaurée par Benvenuto Cellini)» (p. 142).
Lawrence, suivant en cela la leçon d’un nombre incalculable d’auteurs mais sans toutefois tomber dans le délire de certains qui, comme Keyserling, fonda à Darmstadt en 1920 une École de la Sagesse dénonçant les limites de la culture occidentale et puisant son enseignement de pacotille dans une Inde fantasmée, confère au monde ancien une vertu éminente : au contraire de ce que nous pouvons constater à notre époque de spécialistes qui poussent de grands cris dès qu’un esprit un peu audacieux essaie de créer des passerelles entre plusieurs domaines de savoir, le monde ancien ne craignait pas d’établir des parentés symboliques, donc réelles, entre les êtres vivants et les choses, reliés par un flux souterrain de sang (5). «Merveilleux monde, écrit ainsi Lawrence, qu’était sans doute ce monde ancien où toutes choses semblaient vivantes, luisantes dans l’ombre crépusculaire du contact qui les faisait se toucher, un monde où chaque chose n’était pas seulement une individualité isolée prise au piège de la lumière diurne; où chaque chose apparaissait en son clair contour, visuellement, mais qui du sein de sa clarté même était reliée par des affinités émotionnelles ou vitales à d’autres choses étranges, une chose surgissant d’une autre, mentalement contradictoires qui fusionnaient dans l’émotion, si bien qu’un lion pouvait au même instant être aussi une chèvre, et ne pas être une chèvre [Lawrence a évoqué précédemment la chimère en bronze d’Arezzo, conservée au musée de Florence et qui fut en partie restaurée par Benvenuto Cellini)» (p. 142).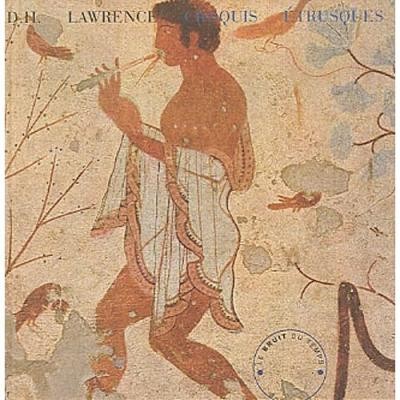 C’est dans un chapitre inachevé, resté à l’état de manuscrit et qui, peut-être, eût pu servir à Lawrence de conclusion pour ses Croquis étrusques, intitulé Le musée de Florence, que l’auteur va systématiser ses intuitions sur le thème d’une déperdition, au travers des siècles, d’une force rayonnante qui s’échappe désormais inéluctablement des œuvres des hommes. Ainsi, selon Lawrence, nous devons bien comprendre que les religions elles-mêmes de nos ancêtres les plus magnifiques, comme le sont, à ses yeux, les Étrusques, ne sont que des bribes d’un savoir immémorial ayant précédé les plus anciennes civilisations : «Ce qu’il nous faut saisir lorsque nous contemplons des œuvres étrusques, c’est que celles-ci nous révèlent les derniers feux d’une conscience cosmique humaine – disons, la tentative d’hommes aspirant à la conscience cosmique – différente de la nôtre. L’idée qui veut que notre histoire soit issue des cavernes ou de précaires habitats lacustres est puérile. Notre histoire prend corps à l’achèvement d’une phase précédente de l’histoire humaine, une phase prodigieuse et comparable à la nôtre. Il est bien plus vraisemblable que le singe descende de nous que nous du singe» (p. 225). Renversement de perspective qui a dû faire bondir les esprits scientistes ou chagrins, c’est tout un, qui lurent les Croquis étrusques lorsqu’ils furent publiés ! On se demande même comment l’auteur n’a semble-t-il pas été traité de réactionnaire. Il l’a peut-être été, à la réflexion, tout comme on n’a pas manqué de lui reprocher son manque de sérieux scientifique (cf. la réception du livre, pp. 272-278). Citons donc longuement ce très beau passage, toujours extrait du même texte qui ne fut pas recueilli en livre par Lawrence, où il semble sérieusement douter de la théorie de l’évolution, l’homme ayant toujours été un homme, l’homme ne provenant pas du singe comme nous l’avons vu mais l’homme, pourtant, depuis qu’il s’est coupé de ses plus profondes racines de savoir symbolique, paraissant en revanche devoir dégénérer, dévoluer : «Les civilisations apparaissent comme des vagues, et comme des vagues elles s’évanouissent. Tant que la science, ou l’art, n’aura pu saisir le sens dernier de ces symboles flottant sur l’ultime vague de la période préhistorique, c’est-à-dire cette période qui précède la nôtre, nous ne serons pas en mesure d’instituer la juste relation avec l’homme en ce qu’il est, en ce qu’il fut, en ce que toujours il sera.
C’est dans un chapitre inachevé, resté à l’état de manuscrit et qui, peut-être, eût pu servir à Lawrence de conclusion pour ses Croquis étrusques, intitulé Le musée de Florence, que l’auteur va systématiser ses intuitions sur le thème d’une déperdition, au travers des siècles, d’une force rayonnante qui s’échappe désormais inéluctablement des œuvres des hommes. Ainsi, selon Lawrence, nous devons bien comprendre que les religions elles-mêmes de nos ancêtres les plus magnifiques, comme le sont, à ses yeux, les Étrusques, ne sont que des bribes d’un savoir immémorial ayant précédé les plus anciennes civilisations : «Ce qu’il nous faut saisir lorsque nous contemplons des œuvres étrusques, c’est que celles-ci nous révèlent les derniers feux d’une conscience cosmique humaine – disons, la tentative d’hommes aspirant à la conscience cosmique – différente de la nôtre. L’idée qui veut que notre histoire soit issue des cavernes ou de précaires habitats lacustres est puérile. Notre histoire prend corps à l’achèvement d’une phase précédente de l’histoire humaine, une phase prodigieuse et comparable à la nôtre. Il est bien plus vraisemblable que le singe descende de nous que nous du singe» (p. 225). Renversement de perspective qui a dû faire bondir les esprits scientistes ou chagrins, c’est tout un, qui lurent les Croquis étrusques lorsqu’ils furent publiés ! On se demande même comment l’auteur n’a semble-t-il pas été traité de réactionnaire. Il l’a peut-être été, à la réflexion, tout comme on n’a pas manqué de lui reprocher son manque de sérieux scientifique (cf. la réception du livre, pp. 272-278). Citons donc longuement ce très beau passage, toujours extrait du même texte qui ne fut pas recueilli en livre par Lawrence, où il semble sérieusement douter de la théorie de l’évolution, l’homme ayant toujours été un homme, l’homme ne provenant pas du singe comme nous l’avons vu mais l’homme, pourtant, depuis qu’il s’est coupé de ses plus profondes racines de savoir symbolique, paraissant en revanche devoir dégénérer, dévoluer : «Les civilisations apparaissent comme des vagues, et comme des vagues elles s’évanouissent. Tant que la science, ou l’art, n’aura pu saisir le sens dernier de ces symboles flottant sur l’ultime vague de la période préhistorique, c’est-à-dire cette période qui précède la nôtre, nous ne serons pas en mesure d’instituer la juste relation avec l’homme en ce qu’il est, en ce qu’il fut, en ce que toujours il sera.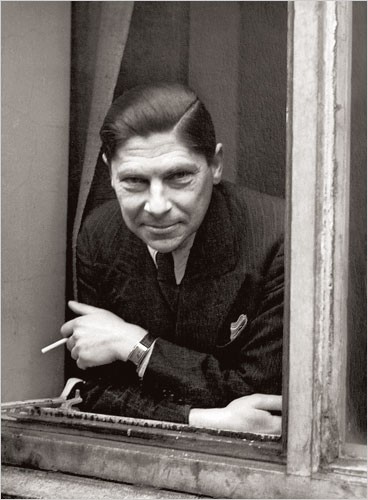 La vie d’Arthur Koestler fut loin d’être paisible et monotone. Après avoir abandonné ses études d’ingénieur à la « Haute Ecole Technique » de Vienne, il a émigré vers la Palestine où il a vécu de petits boulots occasionnels. Après ses mésaventures palestiniennes, les éditions Ullstein de Berlin lui offrent un poste de correspondant au Proche Orient, à Paris, puis un poste de journaliste scientifique à Berlin même. Cela durera de 1926 à 1931. Cette période est caractérisée par l’engagement passionné de Koestler pour la cause sioniste. En 1931, il change d’option : il s’engage dans le parti communiste allemand. Pendant la guerre civile espagnole, il écope d’une condamnation à mort et échappe de peu à l’exécution. Pendant la seconde guerre mondiale, il sert brièvement dans les armées française et britannique. Il finit par s’établir à Londres, où il écrira des ouvrages de vulgarisation scientifique. Le 3 mars 1983, il se suicide.
La vie d’Arthur Koestler fut loin d’être paisible et monotone. Après avoir abandonné ses études d’ingénieur à la « Haute Ecole Technique » de Vienne, il a émigré vers la Palestine où il a vécu de petits boulots occasionnels. Après ses mésaventures palestiniennes, les éditions Ullstein de Berlin lui offrent un poste de correspondant au Proche Orient, à Paris, puis un poste de journaliste scientifique à Berlin même. Cela durera de 1926 à 1931. Cette période est caractérisée par l’engagement passionné de Koestler pour la cause sioniste. En 1931, il change d’option : il s’engage dans le parti communiste allemand. Pendant la guerre civile espagnole, il écope d’une condamnation à mort et échappe de peu à l’exécution. Pendant la seconde guerre mondiale, il sert brièvement dans les armées française et britannique. Il finit par s’établir à Londres, où il écrira des ouvrages de vulgarisation scientifique. Le 3 mars 1983, il se suicide.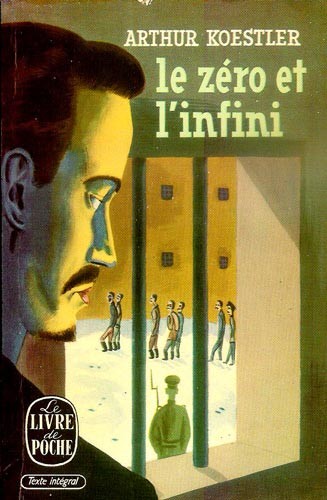 Pour Koestler, cette notion de « fiction grammaticale » doit nous expliquer cette part du moi que l’on ne définit pas comme « logique » mais comme « personnelle ». Or comme ce moi est inexistant pour le parti, mais que la grammaire réclame un substantif pour cette chose, Ivanov nomme cet aspect du « moi » celui de la « fiction grammaticale ». Roubachov, dans cette phase-là de sa détention, est tourmenté par des scrupules moraux, à cause de ses propres manières d’agir d’antan : celles-ci étaient déterminées exclusivement par un schéma de pensée rationnelle et acceptaient en toute conscience les pertes humaines qu’imposait cette rationalité. Ivanov réussit finalement à convaincre Roubachov que les idées, que celui-ci cultive et rumine, relèvent d’une « sentimentalité bourgeoise ». « On n’entendra aucun coq chanter », dit Ivanov, « si, objectivement parlant, des individus nuisibles sont liquidés ».
Pour Koestler, cette notion de « fiction grammaticale » doit nous expliquer cette part du moi que l’on ne définit pas comme « logique » mais comme « personnelle ». Or comme ce moi est inexistant pour le parti, mais que la grammaire réclame un substantif pour cette chose, Ivanov nomme cet aspect du « moi » celui de la « fiction grammaticale ». Roubachov, dans cette phase-là de sa détention, est tourmenté par des scrupules moraux, à cause de ses propres manières d’agir d’antan : celles-ci étaient déterminées exclusivement par un schéma de pensée rationnelle et acceptaient en toute conscience les pertes humaines qu’imposait cette rationalité. Ivanov réussit finalement à convaincre Roubachov que les idées, que celui-ci cultive et rumine, relèvent d’une « sentimentalité bourgeoise ». « On n’entendra aucun coq chanter », dit Ivanov, « si, objectivement parlant, des individus nuisibles sont liquidés ». 








 Les gens ordinaires, dans les pays occidentaux, n'ont pas encore accepté l'univers mental du "réalisme" et de la politique de la Force. Il se peut que cela se produise un jour ou l'autre, auquel cas Dickens sera aussi désuet que le cheval de fiacre. Mais s'il a été populaire en son temps, et s'il l'est encore, c'est principalement parce qu'il a su exprimer sous une forme comique, schématique et par là même mémorable, l'honnêteté innée de l'homme ordinaire. Et il est important que sous ce rapport des gens de toutes sortes puissent être considérés comme "ordinaires". Dans un pays tel que l'Angleterre, il existe, par delà la division des classes, une certaine unité de culture. Tout au long de l'ère chrétienne, et plus nettement encore après la Révolution française, le monde occidental a été hanté par les idées de liberté et d'égalité. Ce ne sont que des idées, mais elles ont pénétré toutes les couches de la société. On voit partout subsister les plus atroces injustices, cruautés, mensonges, snobismes, mais il est peu de gens qui puissent contempler tout cela aussi froidement qu'un propriétaire d'esclaves romain, par exemple. Le millionnaire lui-même éprouve un vague sentiment de culpabilité, comme un chien dévorant le gigot qu'il a dérobé. La quasi-totalité des gens, quelle que soit leur conduite réelle, réagit passionnellement à l'idée de la fraternité humaine. Dickens a énoncé un code auquel on accordait et on continue à accorder foi, même si on le transgresse. S'il en était autrement, on comprendrait mal comment il a pu à la fois être lu par des ouvriers (chose qui n'est arrivée à aucun autre romancier de son envergure), et être enterré à Westminster Abbey."
Les gens ordinaires, dans les pays occidentaux, n'ont pas encore accepté l'univers mental du "réalisme" et de la politique de la Force. Il se peut que cela se produise un jour ou l'autre, auquel cas Dickens sera aussi désuet que le cheval de fiacre. Mais s'il a été populaire en son temps, et s'il l'est encore, c'est principalement parce qu'il a su exprimer sous une forme comique, schématique et par là même mémorable, l'honnêteté innée de l'homme ordinaire. Et il est important que sous ce rapport des gens de toutes sortes puissent être considérés comme "ordinaires". Dans un pays tel que l'Angleterre, il existe, par delà la division des classes, une certaine unité de culture. Tout au long de l'ère chrétienne, et plus nettement encore après la Révolution française, le monde occidental a été hanté par les idées de liberté et d'égalité. Ce ne sont que des idées, mais elles ont pénétré toutes les couches de la société. On voit partout subsister les plus atroces injustices, cruautés, mensonges, snobismes, mais il est peu de gens qui puissent contempler tout cela aussi froidement qu'un propriétaire d'esclaves romain, par exemple. Le millionnaire lui-même éprouve un vague sentiment de culpabilité, comme un chien dévorant le gigot qu'il a dérobé. La quasi-totalité des gens, quelle que soit leur conduite réelle, réagit passionnellement à l'idée de la fraternité humaine. Dickens a énoncé un code auquel on accordait et on continue à accorder foi, même si on le transgresse. S'il en était autrement, on comprendrait mal comment il a pu à la fois être lu par des ouvriers (chose qui n'est arrivée à aucun autre romancier de son envergure), et être enterré à Westminster Abbey."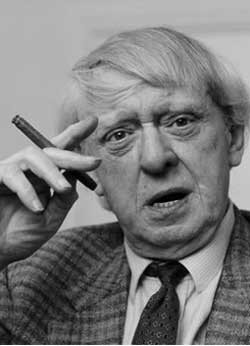 Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1985
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1985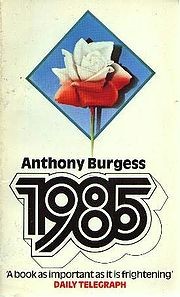 Burgess critique également la division du monde en trois blocs ou zones de puissance qui apparaît dans le 1984 d'Orwell. Il déclare cette vision irréaliste. Pour les lecteurs de Vouloir et Orientations habitués à l'argumentation géopolitique, bornons-nous à constater, ici, que George Orwell imaginait, à l'aube des années 50, qu'une superpuissance eurasiatique (le bloc imaginé par Haushofer, Niekisch et les signataires du Pacte germano-soviétique d'août 1939) allait se constituer pour défier le Nouveau Monde et l'Océania thalassocratique, c'est-à-dire les États-Unis avec leur arrière-cour sud-américaine et le Commonwealth.
Burgess critique également la division du monde en trois blocs ou zones de puissance qui apparaît dans le 1984 d'Orwell. Il déclare cette vision irréaliste. Pour les lecteurs de Vouloir et Orientations habitués à l'argumentation géopolitique, bornons-nous à constater, ici, que George Orwell imaginait, à l'aube des années 50, qu'une superpuissance eurasiatique (le bloc imaginé par Haushofer, Niekisch et les signataires du Pacte germano-soviétique d'août 1939) allait se constituer pour défier le Nouveau Monde et l'Océania thalassocratique, c'est-à-dire les États-Unis avec leur arrière-cour sud-américaine et le Commonwealth.