mercredi, 26 juillet 2023
La Russie archéofuturiste

La Russie archéofuturiste
par Paolo Mathlouthi
Source: https://www.centrostudilaruna.it/russia-archeofuturista.html
Qu'est-ce qu'un vrai voyage ? Quel est le ressort qui pousse l'homme depuis des temps immémoriaux à partir sur les routes du monde ? Il est difficile de donner une réponse univoque à cette question à la saveur ultime : la curiosité peut-être, le désir atavique de se mesurer à l'Inconnu, cette réalité située juste au-delà du seuil de la maison qui, comme l'explique Ernst Jünger dans Jeux africains, est à la fois "réglementée et sans loi", ou peut-être le besoin continuel de s'étonner, puisque pour les Grecs, le thaumazein est l'origine de la pensée, l'étincelle primordiale de l'illumination qui fait de nous des êtres sensibles. La connaissance présuppose nécessairement l'expérience directe des hommes et de leurs manières de faire.
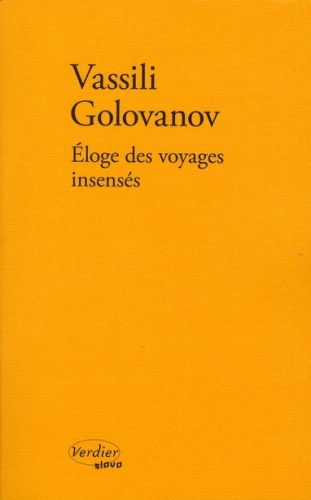
Si nous avions pu poser cette question hamlétique à Vassili Golovanov, l'écrivain russe récemment décédé dont Adelphi vient de publier le livre Verso le rovine de Cevengur (= Vers les ruines de Cevengur), l'une de ses proses itinérantes les plus significatives, il nous aurait probablement surpris en répondant que le voyage recèle en lui-même quelque chose d'archaïque qui a à voir avec le Mythe, une folie divine, une expérience initiatique avec une progression circulaire qui sert en fait à nous reconnecter à l'Origine, à retrouver le chemin perdu qui nous ramène à l'aube du Temps, à l'enfance du monde, là où reposent les certitudes ultimes et, en tant que telles, les fondements de notre être: la Vie, la Mort, l'inextricable et mystérieuse toile du Destin qui marque l'avenir de chacun d'entre nous. Partir pour revenir. Telle est, par définition, l'essence homérique de tout voyage.
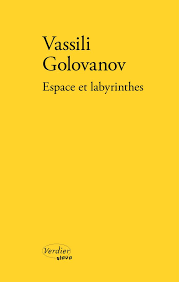 Golovanov est un écrivain au cœur ancien; en pessimiste actif qu'il est, le présent lui est étroit, tandis qu'il ne se soucie pas du tout de l'avenir, demain n'étant qu'un autre aujourd'hui. En revanche, il s'intéresse beaucoup au passé, à cet entrelacs dense de lieux et d'événements de l'Histoire qui est la marque la plus authentique de notre expérience terrestre ; il craint que sa mémoire ne se perde, dévorée par le tourbillon irrépressible de la Modernité. Comme Antoine de Saint-Exupéry, Sylvain Tesson, Paul Morand ou Patrick Leigh Fermor, écrivains vagabonds liés à lui par une profonde et intime consanguinité, Golovanov est atteint, peut-être malgré lui, par ce que Giuseppe Ungaretti aurait appelé le "sentiment du Temps" : une pulsion émotionnelle, irrationnelle et néanmoins puissante, qui se traduit par une nostalgie perçante des époques que nous n'avons pas vécues et nourrit le désir spasmodique de donner un corps et un sens à notre identité.
Golovanov est un écrivain au cœur ancien; en pessimiste actif qu'il est, le présent lui est étroit, tandis qu'il ne se soucie pas du tout de l'avenir, demain n'étant qu'un autre aujourd'hui. En revanche, il s'intéresse beaucoup au passé, à cet entrelacs dense de lieux et d'événements de l'Histoire qui est la marque la plus authentique de notre expérience terrestre ; il craint que sa mémoire ne se perde, dévorée par le tourbillon irrépressible de la Modernité. Comme Antoine de Saint-Exupéry, Sylvain Tesson, Paul Morand ou Patrick Leigh Fermor, écrivains vagabonds liés à lui par une profonde et intime consanguinité, Golovanov est atteint, peut-être malgré lui, par ce que Giuseppe Ungaretti aurait appelé le "sentiment du Temps" : une pulsion émotionnelle, irrationnelle et néanmoins puissante, qui se traduit par une nostalgie perçante des époques que nous n'avons pas vécues et nourrit le désir spasmodique de donner un corps et un sens à notre identité.
Connaître un lieu, en particulier son lieu de naissance, c'est donc le retracer. Entre le sentiment d'appartenance et le voyage, il existe une affinité élective inattendue. Si, comme dans le cas de Vassili Golovanov, le théâtre de cette initiation est la Russie, le voyage ne peut que commencer à Okov, dans une chapelle votive située près de la source de la Volga, le grand fleuve qui, dans la géographie sacrée de l'orthodoxie, s'identifie au Jourdain, puisqu'il représente symboliquement l'artère vitale du pays, sa source baptismale intarissable. "C'est ici le commencement", souligne l'auteur, "le calice caché, les forêts impénétrables et cachées. Toute la force à venir est dans cette fragilité". En d'autres termes, l'Omphalos.
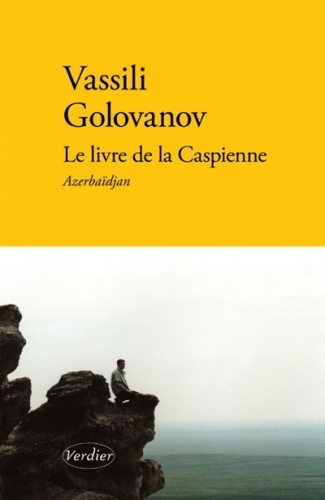
Sur ses rives, on ressent plus fortement qu'au-delà de l'Oural cette interpénétration entre l'Est et l'Ouest qui est le fondement même de l'identité multiple et kaléidoscopique de la Russie ainsi que son obsession culturelle la plus tourmentée. Suivant le cours du fleuve, des milliers de peuples différents se sont déversés au fil des siècles du cœur de l'Asie, du Moyen-Orient, de l'Inde et de la Scandinavie vers la Caspienne, comme autant de lignes de force convergeant vers un point focal unique, et chacun d'entre eux a apporté une pièce à cette mosaïque d'arabesques que nous appelons aujourd'hui Russkij mir. C'est un itinéraire secret qu'entreprend Golovanov, un chemin intérieur dessiné selon le tracé inextricable de ce que Bruce Chatwin appelait les "Routes of Songs" : une carte, un itinéraire dont seul le voyageur connaît les stations exactes. À l'horizon, une destination fabuleuse à atteindre, Cevengur (Tchevengour), le Shambala rouge, une ville mythique située au centre du continent eurasien où l'écrivain Andrej Platonov a préfiguré, dans les tons lugubres et apocalyptiques de la dystopie, l'accomplissement de l'utopie révolutionnaire, le rêve qui, lâché dans le futur et appliqué à la lettre, se transforme inévitablement en cauchemar.
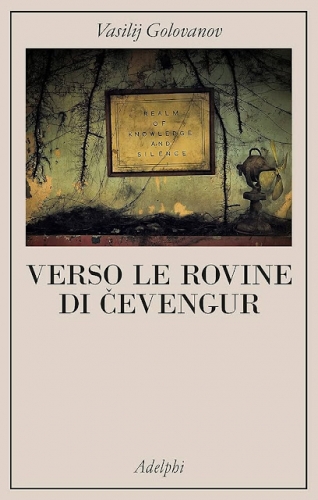
En chemin, il y a des étapes obligées comme le domaine princier de Prjamukhino, où naquit Michail Bakounine, l'apôtre de la Révolution qui inspira à Dostoïevski la figure de Stavroguine, l'archétype de la sodalité politique théorisée plus tard par Trotski et Goebbels, celui qui conçoit l'Idée comme le but ultime, même au prix de son propre anéantissement. Enfin, dans une sorte de contrapasso, les mystérieuses constructions mégalithiques de Touva, vieilles de plusieurs milliers d'années, à l'ombre desquelles les nomades évoquent la figure du baron Ungern Sternberg et racontent des histoires de chamans qui échappent au contrôle de la police soviétique en franchissant les murs des cellules et en prenant l'apparence de loups ou de hiboux. Commissaires politiques et sorciers, armes hyperbares et sortilèges... La Russie, c'est tout cela. Et tout le contraire.
Vasilij Golovanov, Verso le rovine di Cevengur, Adelphi, Milan 2023 ; p. 376 € 28.00 euro.
19:06 Publié dans Littérature, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, lettres, lettres russes, littérature russe, vassili golovanov |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 12 juillet 2023
Recension : l'Europe centrale et la multipolarité

Recension : l'Europe centrale et la multipolarité
Par Alexander Markovics
Dans son dernier livre "Mitteleuropa und Multipolarität" (Antaios, 2023), le journaliste Dimitrios Kisoudis (né en 1981) réunit un terme apparemment ancien, celui de "Mitteleuropa", et un terme apparemment nouveau, celui de multipolarité, pour les réconcilier tous deux avec le Sonderweg allemand. L'Allemagne - asservie par les Etats-Unis (voir Nordstream 2) et coupée de l'Est par l'Intermarium polonais - doit enfin se redonner une mission politique et proposer la Mitteleuropa au reste de l'Europe comme une alternative aux liens avec l'Ouest, l'UE et l'OTAN. Est-ce que ce projet peut réussir ou est-ce que nous attendons ici un mode d'emploi pour se faire un hara-kiri géopolitique dans une guerre sur deux fronts ?
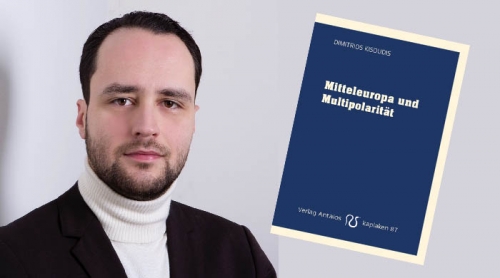
Héros contre marchands : une promenade à travers l'histoire intellectuelle allemande
Dans les pages de ce livre de petit format comptant à peine plus de 80 pages explicitant le capharnaüm de son essai antérieur de philosophie de l'histoire, Kisoudis nous livre une promenade à travers l'histoire des idées allemandes de l'ère moderne. Selon les critères du géographe et géopolitologue britannique Mackinder, Kisoudis, disciple de Carl Schmitt, identifie l'Allemagne à la puissance terrestre dans la guerre civile mondiale entre puissances terrestres et maritimes, alors qu'il considère les puissances maritimes anglo-saxonnes comme des partisans de la puissance maritime. Cela peut également être illustré par les différences dans le devenir des nations : alors que l'Allemagne a été façonnée par le pouvoir tenu par le second ordre de la trifonctionnalité traditionnelle, celui des guerriers, les Anglais ont été façonnés par le pouvoir de la bourgeoisie en proie à l'esprit de commerce et d'économie. Selon la classification suggérée par Werner Sombart, il s'agit donc également d'un duel entre des marchands et des héros.

Friedrich List, ancêtre de l'ordre du grand espace
Dans sa généalogie intellectuelle d'une voie (géo)politique particulière pour l'Allemagne, Kisoudis fait commencer le processus de conscientisation de l'Allemagne par Friedrich List (1789 - 1846), auquel il ne veut pas attribuer aujourd'hui le rôle d'un précurseur de l'État-nation allemand ou de l'Union européenne - il remarque ici avec pertinence que de tels rôles sont toujours liés à l'époque concernée - mais le rôle de l'architecte de la notion de Grand Espace (Grossraum). Alors que List voulait protéger l'Allemagne contre la grande puissance universaliste qu'était l'Angleterre avec son impérialisme en lui imposant des droits de douane, l'Allemagne doit aujourd'hui offrir à l'Europe une alternative à l'UE aujourd'hui téléguidée par les transatlantiques, afin qu'elle puisse s'affirmer face aux États-Unis, eux aussi universalistes.
La Mitteleuropa comme solution à la situation centrale de l'Allemagne
Cette orientation (centre)-européenne est notamment nécessaire parce que l'Allemagne ne dispose pas de frontières naturelles en raison de sa situation centrale. Kisoudis voit dans la Mitteleuropa la forme géopolitique de la voie particulière de l'Allemagne, qui peut s'opposer aussi bien à l'ancrage géopolitique à l'Ouest qu'à la rééducation libérale.
Au cours de son ouvrage, l'auteur montre cependant que les architectes du Sonderweg allemand se sont souvent écartés de la voie des héros et ont tenté de suivre celle des marchands: l'ère bismarckienne a été suivie en Allemagne par des idées impérialistes, comme par exemple dans l'Association navale allemande, la bourgeoisie allemande faisant désormais la promotion d'une grande flotte sous la forme d'une puissante marine de guerre qui se soumettrait le monde. Les causes de la "catastrophe allemande" se situent dans la promotion de ces idées impérialistes. L'Allgemeine Deutsche Verband (plus tard Alldeutscher Verband), fondée en 1891, lui sert d'exemple pour illustrer le conflit entre l'idée d'amitié entre les peuples et le chauvinisme.
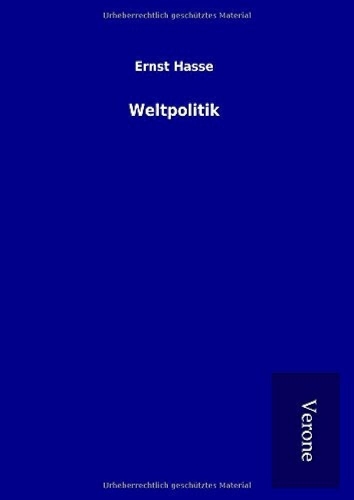
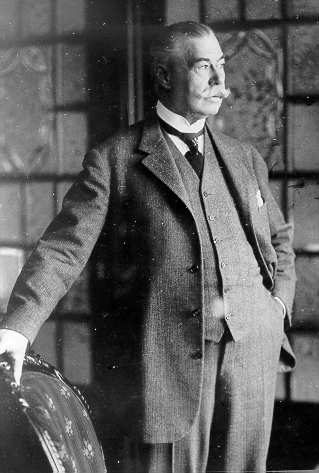
L'amitié entre les peuples contre le chauvinisme
Alors qu'Ernst Hasse, par exemple, défendait l'égalité des droits entre les puissances mondiales et se prononçait en faveur d'un Zollverein centre-européen, vecteur de la puissance mondiale allemande, Heinrich Claß (photo), arrivé à la tête de l'Alldeutscher Verband en 1908, défendait une politique fortement marquée par la théorie du darwinisme social et la théorie de la race. Kisoudis décrit les conflits et les recoupements entre les deux approches, notamment à travers le débat sur les buts de guerre pendant la Première Guerre mondiale. Alors que le premier courant culminait avec les plans du chemin de fer Berlin-Bagdad et les revendications pour la création d'une association économique centre-européenne, comme par exemple chez le représentant le plus connu de l'idée de la Mitteleuropa, Friedrich Naumann, le second courant ne voit la Mitteleuropa que comme une étape intermédiaire avant de s'étendre à l'Europe de l'Est selon une méthodologie impérialiste, comme l'ont fait les dirigeants allemands pendant la Première Guerre mondiale avec la région "Ober Ost" et pendant la Seconde Guerre mondiale dans le cadre du "Generalplan Ost". A ce stade, Kisoudis se range du côté de la politique de la Mitteleuropa dans le sens de l'entente entre les peuples et contre le chauvinisme. Si l'Allemagne veut reprendre sa voie particulière, elle doit montrer à l'Europe une alternative sous la forme de la Mitteleuropa, dans le sens d'un lien vers l'Est, également pour pouvoir surmonter la menace polonaise de l'Intermarium. La guerre actuelle autour de l'Ukraine prouve qu'un lien étroit avec l'Ouest, face à l'essor économique de l'Asie, ne peut que laisser l'Allemagne et l'Europe du côté des perdants.
La Mitteleuropa et la multipolarité - une introduction réussie au débat sur l'avenir de l'Allemagne
Enfin, Kisoudis fait remarquer avec pertinence que la multipolarité nécessite également un autre état d'esprit, axé sur des notions traditionnelles telles que l'honneur, la foi et la cohésion - des valeurs qui, selon lui, sont aujourd'hui vécues de manière plus convaincante en Hongrie et en Turquie que dans l'Ouest désormais contraint de vivre sous la bannière arc-en-ciel. Son livre est une introduction réussie à la thématique de la multipolarité et à la possibilité d'un Sonderweg allemand (= une voie particulière de l'Allemagne). Pour ceux qui souhaitent approfondir cette thématique, nous recommandons les ouvrages "Geopolitische Zeitwende" de Sascha Roßmüller, auteur de mensuel Deutsche Stimme, et "Konflikte der Zukunft" d'Alexander Douguine.
Commande: https://antaios.de/gesamtverzeichnis-antaios/reihe-kaplaken/176668/mitteleuropa-und-multipolaritaet?number=9783949041877
19:39 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dimitrios kisoudis, mitteleuropa, livre, europe, affaires européennes, politique internationale, allemagne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 03 juillet 2023
Friedrich Georg Jünger et les mythes grecs: Apollon, Pan et Dionysos
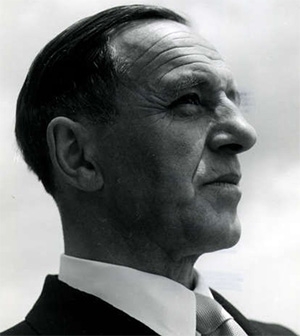
Friedrich Georg Jünger et les mythes grecs: Apollon, Pan et Dionysos
Giovanni Sessa
Source: https://www.paginefilosofali.it/friedrich-gerog-junger-e-i-miti-greci-apollo-pan-e-dioniso-giovanni-sessa/
Un texte vient de sortir en librairie qui non seulement nous permet de saisir la grandeur spéculative et littéraire d'une des figures "secrètes", apparemment marginales, de la culture du 20ème siècle, mais qui nous confronte aussi à la pauvreté de notre temps, au "désastre" de la modernité, à l'isolement atomistique de l'homme face au cosmos. Nous nous référons au volume de Friedrich Georg Jünger, frère d'Ernst, plus connu, Apollo, Pan, Dionisio, publié par les éditions Le Lettere et édité par Mario Bosincu, germaniste à l'Université de Sassari (pp. 283, euro 18.00). En 1943, un petit opuscule a été publié sous le même titre, que l'auteur a fait suivre d'un essai intitulé I Titani (= Les Titans) en 1944. En 1947, les deux livres, auxquels ont été ajoutés deux chapitres consacrés aux Héros et à Pindare, ont été rassemblés dans le volume Mythes grecs. L'édition italienne que nous présentons est une traduction de ce livre. On doit à Bosincu une rédaction impeccable.
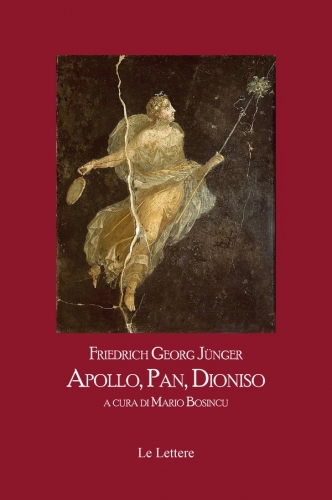
Ces pages représentent "l'un des trésors de ce continent submergé qu'est la littérature de l'émigration intérieure [...] dont les représentants sont restés dans l'Allemagne nazie, vivant comme des "exilés" dans leur patrie" (pp. 8-9). En effet, sous la République de Weimar, Friedrich Georg, avec son ouvrage Aufmarsch des Nationalismus, s'était fixé comme objectif de "faire de ses lecteurs [...] un nouveau sujet (de l'histoire) qui pourrait transformer la jeune république en une communitas totalitaire" (p. 110). Il participe ainsi au mouvement culturel hétérogène et vivant des intellectuels révolutionnaires-conservateurs, dont les idéaux ont été trahis par le national-socialisme au pouvoir. Dans l'essai introductif bien informé, vaste et organique, Bosincu présente les moments généalogiques de cette culture anti-moderne, une réponse à la crise induite par l'affirmation du Gestell, de l'implant techno-scientifique au service de la Forme-Capital. Il s'attarde notamment sur les figures de Schiller, Carlyle et Chateaubriand. Ce dernier, dans le Génie du Christianisme, en appelait, contre le présent historique dans lequel il était destiné à vivre, aux "intérêts du coeur" (p. 41).
Il fait appel, conformément à la sensibilité romane, à une connaissance autre que la raison calculatrice. Dans ses pages chargées d'émotion, se dessine : "après le sermo propheticus, le sermo mysticus et l'écriture ascétique [...] un style psychique alternatif à celui qui prévalait" (p. 41) à l'époque contemporaine, qui tendait à réaliser l'utile par la réduction de la nature à une res extensa à la disposition du maître de l'entité, l'homme. Les antimodernes, qui ont eu tant d'influence sur Friedrich Georg, n'ont pas cherché, sic et simpliciter, à explorer les traits d'une possible "autre subjectivité" que la moderne, mais ont visé à la réaliser en utilisant le trait démiurgique de leurs écrits.
Fondamentalement, explique Bosincu, en se référant à l'exégèse du gnosticisme par Eric Voegelin, ils étaient habités par une véritable horreur de l'existant et devenaient les porteurs d'un savoir sotériologique. Le gnostique : "connaît la matrice de la misère (temporaire) de l'homme [...] est en possession d'une sotériologie qui "donne à l'homme la conscience de sa déchéance et la certitude de la restauration de son être originel"" (p. 53). La fuite du moderne est centrée sur la "sotériologie de l'intériorité". Selon l'éditeur, Jünger a connu deux phases différentes de cette attitude néo-gnostique : dans sa jeunesse, il était proche du prométhéisme "wotaniste" du nazisme et de la "mobilisation totale".
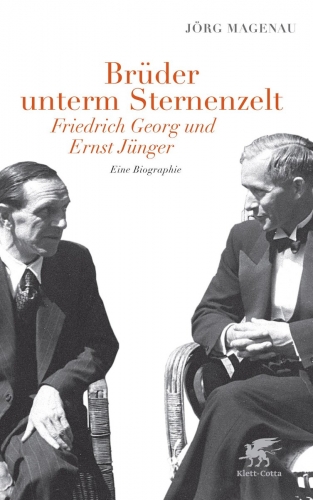
Cette référence visait à construire une subjectivité "active", animée par la volonté de puissance, destinée à dépasser l'individu bourgeois. Dans la phase d'"émigration intérieure", dont témoignent de façon paradigmatique Apollon, Pan, Dionysos, par l'influence du monde spirituel hellénique médiatisé par les lectures de Walter Friedrich Otto, et anticipant la psychologie des profondeurs de Hillman, Jünger devient le porteur de l'"homme total" schillérien, dans la psyché duquel la puissance titanesque revient se réconcilier avec les potestats des trois dieux en question. Cette métamorphose a amené notre homme à mûrir : "Le respect de la vie dans sa nature élémentaire", car il a pris conscience que : "le présupposé de la modernisation technologique est [...] la désanimation de la nature" (p. 99). La physis est vécue comme transcendant l'horizon humain : il y a un fossé évident entre le flux du devenir et de l'histoire, accumulateur de ruines, et les rythmes éternels et cycliques de la nature.
Le paganisme jüngerien est un "paganisme de l'esprit" qui s'adresse à une dimension inclusive profonde : "le noumène d'où jaillissent l'histoire et l'expérience empirique" (p. 111). L'auteur montre qu'il adhère à une perspective mythique : il croit que dans chaque entité, dans l'intériorité de l'homme et dans ses activités, un dieu agit. Le divin palpite, il s'expérimente. La technique elle-même n'est pas une simple expression de la raison instrumentale, mais a des racines mythiques, titanesques, prométhéennes.
Pour échapper à sa domination réifiante, l'homme doit retrouver la dimension imaginaire : ce n'est qu'en elle, et non dans les concepts qui statisent le réel, qu'il est possible de retrouver le souffle d'Apollon, de Pan et de Dionysos, l'éternelle métamorphose animique de la physis. Ces dieux sont dans une relation d'"antithèse fraternelle" (p. 244). Pour en retrouver le sens, il faut se pencher sur la coincidentia oppositorum, sur la logique du troisième inclus: "Apollon est exalté comme l'archétype à la base d'un style cognitif et existentiel qui privilégie la raison contemplative et le sens de la mesure" (p. 135), antithétique à l'hybris prométhéenne du nazisme et du capitalisme cognitif de nos jours. Pan incarne le "principe de plaisir" par opposition au "principe de performance", la légèreté de vivre que l'on peut éprouver en se plaçant dans la nature sauvage, perçue comme étrangère par l'homme moderne. La nature se suffit à elle-même, ce dont Karl Löwith était également conscient. Dionysos, enfin, est le dieu qui libère des fixités identitaires, de la dimension téléologique de la vie. Sa potestas met en échec la "folie enveloppée dans l'apparence de la raison" (p. 139).

Le Jünger de l'"émigration intérieure", à notre avis, est porteur d'un contre-mouvement gnostique non néognostique (Gian Franco Lami), capable de ramener l'homme à la physis, à la vie éternellement jaillissante du cosmos. Le cosmos, dans les pages d'Apollon, Pan, Dionysos, n'est pas amendable, comme le croyaient les gnostiques, et avec eux les chrétiens et leurs substituts modernes (positivistes, marxistes, etc.) car, comme l'affirme Héraclite (fr. 30) : "Il est identique pour toutes choses, aucun des dieux ou des hommes ne l'a fait, mais il a toujours été, il est et il sera un feu éternellement vivant, qui selon la mesure s'allume et selon la mesure s'éteint". Apollon, Pan, Dionysos montre, comme l'a affirmé Calasso, que les dieux anciens ont trouvé refuge dans la littérature. C'est l'extraordinaire modernité des anti-modernes, dont parlait Antoine Compagnon.
20:18 Publié dans Littérature, Livre, Livre, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : friedrich-georg jünger, livre, dieux grecs, paganisme, lettres, lettres allemandes, littérature, littérature allemande, révolution conservatrice, allemagne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 26 juin 2023
L'homme, la nature, la technologie: le nouveau livre de Giovanni Sessa éclaire les questions décisives de notre temps

L'homme, la nature, la technologie: le nouveau livre de Giovanni Sessa éclaire les questions décisives de notre temps
Par Giovanni Damiano
Source: https://www.ilprimatonazionale.it/cultura/uomo-natura-tecnica-libro-giovanni-sessa-icone-possibile-265250/
Rome, 25 juin - Avant-propos : le nouveau livre de Giovanni Sessa, très important et intitulé Icone del possibile: giardino, bosque, montagna (Oaks, 2023), se distingue par son originalité et la richesse de son argumentation. Plutôt qu'un compte-rendu, je tenterai ici d'indiquer, sous forme de notes, une série d'aspects qualificatifs du texte de Sessa, en y ajoutant quelques réflexions supplémentaires.

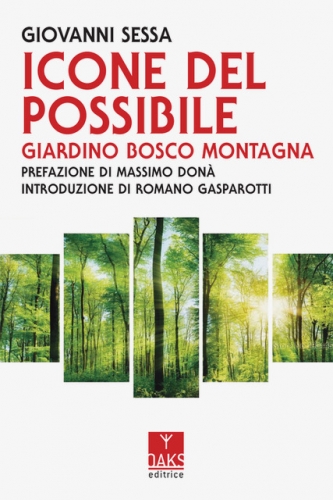
1) Tout d'abord, le livre de Giovanni Sessa aborde le sujet dans une perspective anti-dualiste très claire, à ne pas lire cependant dans le sens de l'et-et, bien sûr, où l'et-et se prête au malentendu de la synthèse conciliatrice. D'un autre côté, il ne faut pas non plus craindre l'aut-aut, à condition de ne pas l'interpréter comme une opposition rigide, ou pire, essentialisée, mais plutôt comme l'une des voies par lesquelles la physis se manifeste. L'et-et lui-même peut donc être admis, précisément comme l'un des modes de la physis. Mais il est tout aussi important de ne pas tomber dans le monisme, dont le risque suprême, traditionnellement, est le triomphe de l'indéterminé, de la dissolution des différences. En bref, il faut comprendre la physis comme un champ de tension dans lequel tout peut entrer en relation, mais de manière tensionnelle, ce qui est précisément aussi la position de Sessa.

Giovanni Sessa et la redécouverte de la grécité archaïque
2) Parler de physis, plutôt que de nature, comme le fait Sessa, c'est vouloir récupérer la pensée grecque archaïque, en vue d'une tentative de donner naissance à un nouveau commencement d'origine. Une tentative de regarder la nature précisément à partir de la perspective originelle de la pensée grecque archaïque, en essayant donc, et en même temps, de la rendre à nouveau pensable dans le présent. Une physis qui ne doit donc pas être comprise comme une relique érudite d'époques irréversiblement révolues ou comme une référence stérilement "cultivée" ou intellectualiste, mais plutôt comme une mémoire vivante dans le présent.

3) Sessa lit à juste titre physis comme dynamis, faisant ainsi allusion à l'extraordinaire puissance de la nature, à son immense réservoir de possibles. D'où précisément le titre du livre de Sessa, placé entièrement sous le signe du possible. L'icône, en revanche, renvoie à l'œuvre louable de Ludwig Klages qui, à propos de l'objet, dans lequel la vie se raidit, perdant sa mutation continue, voyait précisément dans l'image ce qui perpétue le devenir de la physis. Les icônes du possible sont donc les images toujours changeantes de la puissance de la physis, autre aussi de l'écologie, dans laquelle, dès son nom, le logos résonne comme une puissance qui divise de façon dualiste l'essence (la réduction de la physis à un simple concept) de l'existence (la manifestation concrète de la physis), finissant ainsi par commettre un physiocide (voir la préface de Romano Gasparotti à l'ouvrage de Sessa).
4) Dans le sous-titre de son livre, comme un nouveau rejet de tout dualisme rigide, qui nierait le dynamisme, le renouvellement de la nature dans son immanence, Sessa juxtapose la forêt et la montagne au jardin, ou plutôt à l'artificialité technique. Nature et culture, nature et technique sont ainsi placées dans un rapport qui n'est pas seulement contrastif, qui ne s'exclut pas mutuellement, aussi parce que nature et culture, certes pas de manière harmonieuse et pacifiée, mais plutôt souvent problématique, "coexistent" néanmoins, cohabitent. On pense à Arnold Gehlen, qui notait que la culture était précisément un concept anthropo-biologique, selon lequel la culture de l'homme n'est pas détachée de la nature, elle n'est pas une sphère autonome, complètement détachée de la nature, mais elle est structurellement imbriquée avec elle. L'homme est donc un être en devenir, pleinement impliqué dans le devenir de la physis. Si ce lien était rompu, nous serions confrontés à un tournant ontologique radical, c'est-à-dire à la naissance d'une nouvelle ontologie, d'un nouveau statut ontologique de la nature et de l'homme.
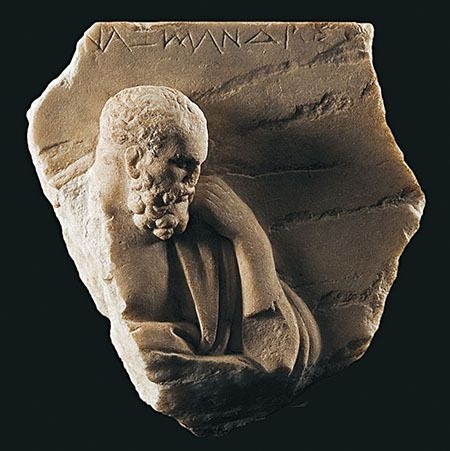
Socrate, Platon et Aristote
5) Pour la pensée originelle de la physis, l'homme en faisait pleinement partie. En reconstituant, de manière évidemment très sommaire, cette généalogie, on peut commencer par Anaximandre, qui pensait que les hommes provenaient de poissons ou d'autres animaux ressemblant à des poissons (voir DK 12 A 11 et 30). Et en effet, chez tous les autres soi-disant présocratiques, l'homme est toujours immergé dans la physis, sans occuper une place particulièrement privilégiée par rapport à elle.
Et même le soi-disant "tournant anthropocentrique" des Sophistes est plus un lieu commun historiographique qu'autre chose; par exemple, Mauro Bonazzi note qu'avec les Sophistes, c'est la perspective qui change, et non les sujets traités, en ce sens que l'homme n'est pas, pour ainsi dire, retiré de la physis pour être étudié en toute autonomie, à tel point que Bonazzi va jusqu'à affirmer que "la physis en tant que telle demeure, c'est le point de départ de toute recherche".
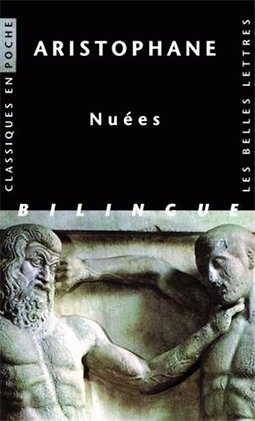 Socrate lui-même, on le sait, s'est intéressé à la philosophie d'Anaxagore ; outre les célèbres passages dans les Nuées d'Aristophane, où les nuages semblent se référer - comme le note Maria Michela Sassi - aux "implications athées de l'étude des phénomènes naturels", il y a les non moins célèbres passages du Phédon (96a-99c), où Socrate rappelle s'être intéressé dans sa jeunesse aux "recherches sur la nature" (historia perì physeos) et en particulier, précisément, à la philosophie d'Anaxagore.
Socrate lui-même, on le sait, s'est intéressé à la philosophie d'Anaxagore ; outre les célèbres passages dans les Nuées d'Aristophane, où les nuages semblent se référer - comme le note Maria Michela Sassi - aux "implications athées de l'étude des phénomènes naturels", il y a les non moins célèbres passages du Phédon (96a-99c), où Socrate rappelle s'être intéressé dans sa jeunesse aux "recherches sur la nature" (historia perì physeos) et en particulier, précisément, à la philosophie d'Anaxagore.
Il en va tout autrement avec Platon. Les idées platoniciennes, selon Mario Vegetti, naissent principalement dans la sphère des "valeurs éthiques" (beau, juste, bon) ou dans la sphère épistémique des mathématiques (égal, etc.). Il est donc très difficile d'étendre la relation idée-chose au monde des objets naturels, y compris l'homme. Cela expliquerait le recours au programme cosmogonique exposé dans le Timée, avec l'intervention, non fortuite, d'un véritable artisan (le Démiurge) qui, s'il ne crée pas à partir de rien, donne néanmoins lieu, précisément parce qu'il est artisan, à un artificialisme technique évident. Et c'est pourquoi le Platon médiéval, grâce au célèbre Commentaire sur le Timée de Chalcis, était surtout celui du Timée, qui se prêtait facilement à une relecture - Vegetti ne cesse de l'affirmer - dans le cadre de la théologie chrétienne créationniste.
Au contraire, il ne me semble pas exagéré de rappeler comment la pensée biologique d'Aristote s'enracine dans la tradition naturaliste présocratique, dont le Timée tire la conception de la physis comme une réalité dotée d'un ordre et d'une existence autonomes. Ce n'est pas un hasard si la définition de l'homme chez Aristote se réfère au zoologique et non à l'anthropologique. L'être humain est traité comme l'un des animaux; en bref, il n'est pas au centre du processus naturel, mais simplement l'une de ses parties. L'homme naît dans la zoosphère et s'en distingue ensuite, mais à la base se trouve, comme chez Anaximandre, l'idée d'une continuité entre l'homme et l'animal. Si bien que l'homme, même en tant qu'animal politique, partage précisément la politisation avec les autres animaux, comme l'explique un passage fondamental de l'Historia animalium (I 1, 488a), où il est dit qu'il y a des animaux qui vivent seuls et d'autres en communauté, et d'autres qui peuvent vivre les deux à la fois. L'homme peut vivre les deux, et dans son aspect communautaire, il est comparé aux abeilles, aux guêpes, aux fourmis, aux grues. Par conséquent, puisque seul le logos est ce qui différencie réellement l'homme de tous les autres animaux, la véritable anthropogenèse est donc le logos lui-même (voir Politique, 1253a 9-18). Seul le logos représente le facteur véritablement dirimant/discriminant qui marque le "détachement" décisif de l'homme de la zoosphère.

L'ambiguïté de Prométhée et le dilemme de la technologie
6) Je termine ces brèves notes par un addendum, tout aussi schématique, sur le Prométhée platonicien, en partant toutefois de l'hypothèse, partagée par Sessa, que le Titan ne doit pas être isolé, ni valorisé unilatéralement, du moins si l'on veut rester fidèle à sa matrice grecque d'origine, mais plutôt inscrit dans une perspective beaucoup plus large dans laquelle, par exemple, il entrerait dans une relation, certes jamais linéaire et pacifiée, même avec Orphée, à l'encontre des thèses bien connues de Pierre Hadot. Et cela parce que le monde grec, dans son clair-obscur, laisse la place aux contraires, dans leur relation toujours précaire, fragile.
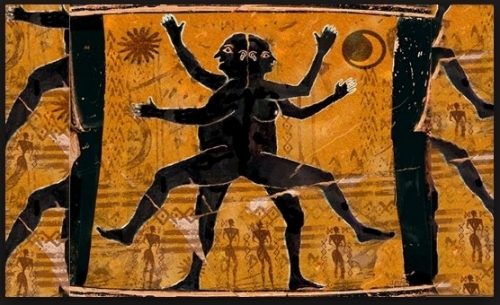
Or, en rappelant au passage qu'en réalité même le mythe de l'Androgyne, raconté par Aristophane dans le Symposium, raconte la condition, je dirais ontologique et en même temps existentielle, de l'homme, ou plutôt sa parabole d'une plénitude et d'une unité perdues, au manque et au désir actuels (impossibles?) de revenir à cette plénitude originelle, sur Prométhée, il faut dire tout de suite, dans le sillage de Jean-Pierre Vernant, qu'il y a une ambiguïté, une duplicité constitutive du Titan déjà mise en évidence par Hésiode, où Prométhée est à la fois le "vaillant fils de Japet", bienfaiteur de l'humanité, et l'être "aux pensées rusées", à l'origine des malheurs de l'homme. Il faut d'ailleurs rappeler que Pandore est aussi un produit technique, l'œuvre d'un démiurge qui la fabrique à partir de la terre et qui, dans les variantes, est tantôt Héphaïstos, tantôt Epiménide, tantôt Prométhée lui-même. Pandore est également inséparable de Prométhée, dans le sens où - comme le dit Umberto Curi - ce n'est pas l'inconscience de l'insipide Epiméthée qui est la cause des maux de l'homme, mais la philanthropie de Prométhée, car sans le sacrilège de ce dernier, l'humanité n'aurait jamais connu les "afflictions douloureuses" dont Pandore a été l'intermédiaire.
Pour en revenir à Platon, Prométhée apparaît dans les passages du Polyptyque 274c-d, où, le règne de Kronos ayant pris fin, ce qui leur permettait de mener une vie bienheureuse, exempte de douleur et de chagrin, les hommes, restés faibles et en proie aux animaux, privés de moyens et d'art (techne), sont aidés précisément par Prométhée, Héphaïstos, Athéna et "d'autres". Cela signifie que A) la techne est l'enfant d'un état d'indigence, de faiblesse chronique, de manque, et B) qu'en effet les technai de Prométhée (le feu), d'Héphaïstos et d'Athéna (la métallurgie) et des "autres" (les techniques de l'agriculture) ne suffisent pas, car l'art vraiment nécessaire, vraiment fondamental, la techne basilikè, l'art de la royauté, c'est la politique. Par conséquent, même le don de Prométhée est non seulement insuffisant en soi, minimisant ainsi clairement la capacité "sotériologique" supposée du feu, mais aussi subordonné à l'art de la royauté.
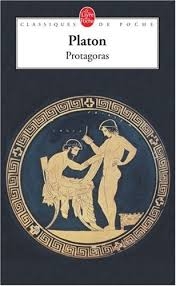 Dans le Protagoras, l'histoire est bien connue: les dieux confient aux deux frères la distribution des biens aux vivants; les deux frères se mettent d'accord pour qu'Epiméthée soit chargé de la distribution, qui, cependant, échoue, laissant l'homme dépourvu de tout moyen propre à sa survie, de sorte que Prométhée est conduit à voler le feu pour le donner aux hommes, avec une singulière inversion des rôles, de l'exécuteur des ordres de Zeus à son violateur. De là, comme le note Curi, émerge "une sorte de théorie du progrès", avec le passage de l'homme de la condition dans laquelle il se trouvait avec Épiméthée à celle dans laquelle il se trouve avec Prométhée, renversant ainsi le cadre régressif hésiodique, dans lequel c'est Épiméthée qui succède à son frère.
Dans le Protagoras, l'histoire est bien connue: les dieux confient aux deux frères la distribution des biens aux vivants; les deux frères se mettent d'accord pour qu'Epiméthée soit chargé de la distribution, qui, cependant, échoue, laissant l'homme dépourvu de tout moyen propre à sa survie, de sorte que Prométhée est conduit à voler le feu pour le donner aux hommes, avec une singulière inversion des rôles, de l'exécuteur des ordres de Zeus à son violateur. De là, comme le note Curi, émerge "une sorte de théorie du progrès", avec le passage de l'homme de la condition dans laquelle il se trouvait avec Épiméthée à celle dans laquelle il se trouve avec Prométhée, renversant ainsi le cadre régressif hésiodique, dans lequel c'est Épiméthée qui succède à son frère.
Mais le fait est que les dons des dieux ne suffisent pas à l'homme qui, une fois de plus, a besoin de l'art de la politique, de la politikè techne, pour laquelle Zeus envoie Hermès avec la tâche d'apporter à l'homme la modestie et la justice aptes à fonctionner comme poleis kosmoi, comme l'ordonnancement des cités des hommes (Protagoras 322b-c). Ainsi, une fois encore, les dons de la technologie ne suffisent pas à sauver une humanité intrinsèquement déficiente et manquante. Au contraire, c'est précisément la technologie qui nous fait prendre conscience de cette inaptitude de l'homme à survivre. Et comme le souligne encore Curi, dans cette version du mythe prométhéen, c'est donc Zeus qui apparaît véritablement philanthropos, dans la mesure où ce sont ses dons qui permettent la survie de l'homme.

Enfin, le rôle et la fonction des techniques, toujours dans ce cas, en sortent drastiquement réduits, car d'une part elles sont inférieures à la physis, dont elles ne peuvent égaler le potentiel, et d'autre part elles sont complètement subordonnées à la politique. En somme, la technique se révèle être un doron-dolon, un don trompeur, annonciateur de maux, car elle nous fait croire à un salut qu'elle ne peut finalement pas nous accorder. En synthèse extrême, nous avons d'un côté la nécessité de la technique, de l'autre le désenchantement lucide de celle-ci; de cette relation, pourtant difficile à démêler et peut-être même contradictoire, il est indispensable de partir, sous peine de se réfugier soit dans des archéologies anhistoriques, soit dans des aventurismes utopiques " futuristes ".
13:37 Publié dans Livre, Livre, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : giovanni sessa, philosophie, grèce antique, humanités gréco-latines, livre |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 24 juin 2023
Le grand hospice occidental: le "déclin de l'Occident" selon Eduard Limonov
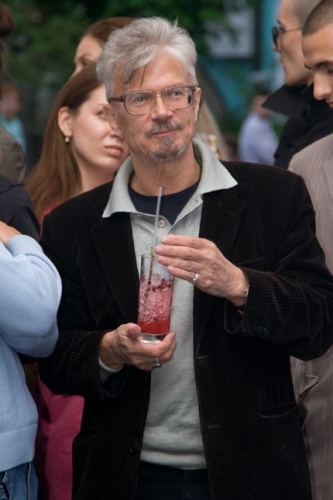
Le grand hospice occidental: le "déclin de l'Occident" selon Eduard Limonov
Giovanni Sessa
Source: https://www.paginefilosofali.it/grande-ospizio-occidentale-il-tramonto-delloccidente-secondo-eduard-limonov-giovanni-sessa/
Depuis des décennies, la scène littéraire, en Italie, connaît le succès d'auteurs et de textes en phase avec l'"intellectuellement correct". Rares sont les écrivains et les penseurs qui ont réussi à s'imposer avec des œuvres clairement dissidentes par rapport à la culture dominante. Cette fois-ci, nous pensons qu'Edouard Limonov y parviendra avec un livre publié par Bietti, Grande ospizio occidentale, édité par Andrea Lombardi (pp. 233, 21,00 euros). Il s'agit de pages qui, tant du point de vue littéraire que du point de vue du contenu, dégagent une grande puissance. La prose de Limonov est caustique, elle s'en prend aux idoles du présent post-moderne, mais elle est aussi captivante, capable d'engager le lecteur. Le volume se lit d'une traite. Mais qui était Limonov, mort d'un cancer en 2020, au milieu des restrictions causées par la pandémie de Cov id-19 ? Le journaliste parisien Alain de Benoist le précise dans l'introduction: "Poète et voyou, vagabond et majordome, milicien pro-serbe pendant la guerre de Bosnie [...] opposant dans l'âme, fou de littérature, amateur de femmes et de bagarres, opposant puis partisan de Poutine" (p. 11).
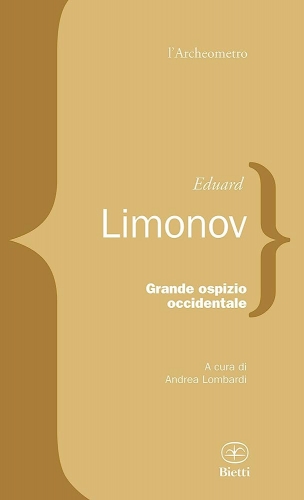

Limonov, après l'effondrement de l'URSS, a fondé le Parti national-bolchevique avec Douguine (les destins des deux hommes prendront plus tard des chemins différents). Né en Russie, mais ayant longtemps vécu en Ukraine, l'écrivain connaissait parfaitement la réalité du monde occidental, ayant séjourné assez longuement à New York et, à partir du début des années 1980, à Paris. La biographie fictive que lui a consacrée Emmanuel Carrère, publiée en Italie par Adelphi, l'a fait connaître il y a quelques années. L'édition italienne du Grand hospice occidental est une traduction de l'édition française de 2016. En réalité, le volume a été écrit par Limonov entre 1988 et 1989. La thèse centrale est illustrée par le titre. Vivre dans les sociétés occidentales (notons que pour Limonov, la Russie et la Chine font également partie de leur groupe), c'est comme séjourner dans une maison de retraite. L'Occident est une maison pour les personnes âgées "malades", réduites à un état pré-comateux par le capitalisme cognitif (pour l'auteur, la France de la fin des années 1980 est un paradigme exemplaire), qui ont perdu depuis longtemps l'élan faustien, l'énergie vitale qui leur permettait de se présenter au monde comme des créateurs de civilisation : "Un hospice géré par les autorités publiques (appelées ici "administrateurs") et peuplé de patients vivant sous sédatifs" (p. 13). Tout est sénescent, privé de vie réelle.

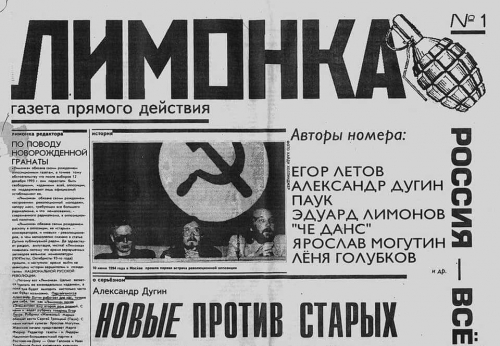
Limonov s'éloigne des pages de 1984 d'Orwell, un ouvrage lu non pas comme une prophétie politique, mais comme un simple enregistrement et une description de la violence explicite que les totalitarismes du 20ème siècle ont utilisée pour opprimer ou éliminer les minorités dissidentes. Au contraire, le pouvoir exercé par les "administrateurs" de l'Hospice a un côté doux : il passe par le contrôle psychologique-imaginal des masses, et est encore plus envahissant et dangereux que le pouvoir totalitaire du passé. En effet, "aujourd'hui [...] la télévision contrôle la population. Mais elle le fait à travers ce qu'elle montre, pas en l'observant" (p. 23). La violence douce repose sur l'exploitation des faiblesses des asservis qui sont poussés à considérer comme seul horizon existentiel possible la réalisation du bien-être matériel comme une fin en soi. Les masses contemporaines sont amenées à penser la pauvreté comme quelque chose de honteux, elles sont terrifiées par la crise économique, projetée comme imminente, et le chômage qui en découle. L'habitant de l'Hospice : "Assommé par le jonglage des blaireaux, au rythme des statistiques, [...] immergé dans le bourdonnement d'une musique pop de plus en plus vulgaire [...] l'habitant [...] des villes industrialisées prospères fait une course accélérée de la naissance à la retraite" (p. 28). Cette humanité bornée est terrifiée par la liberté, les choix individuels et divergents, l'esprit critique. En effet, le principal précepte en vigueur à l'Hospice identifie l'"Agité", sujet extrêmement dangereux, à marginaliser et à isoler.
Afin d'endormir les masses et de les forcer à embrasser inextricablement la simple réalité matérielle du monde, on leur rappelle souvent le résultat que la pensée de l'"Agité" a eu et pourrait avoir. En ce sens, les images d'Auschwitz ou du Goulag jouent un rôle "éducatif" et sédatif, ou celles qui proviennent de l'extérieur de l'hospice, du tiers-monde où les gens meurent de faim, sont utilisées à cette fin. Le patient modèle est celui qui adhère pleinement à la "vie assurée" que l'hospice dispense généreusement. Parmi les "Agités", les plus dangereux sont ceux qui, dans un monde qui a en fait oublié le sens de la virilité et du risque, du gâchis, se remettent à regarder le Héros comme la figure de référence d'un avenir possible. Leurs ambitions sont étouffées dans l'œuf: c'est le fait du révisionnisme historique, qui met en œuvre l'habituelle reductio ad Hitlerum contre les "Agités" émergents. Un nouveau modèle anthropologique se trouve, au contraire, dans la Victime. Dans l'hospice, le "dernier homme" nietzschéen vit à l'aise, sa vie est faite de "demi-passions du jour et de demi-passions de la nuit". Un homme qui a oublié le sens du destin.

Ses seules préoccupations sont la recherche du plaisir, de plus en plus dégradé, et la prospérité, pour laquelle il s'est livré à la dévastation de la nature. Il vit une éternelle adolescence ludique : "Portant des couleurs puériles et criardes, comme s'il était un clown, l'homo hospitius transforme son existence en roman-photo" (p. 153). Une photo-histoire mise sous protection par les pourcentages, par la société numérisée, par ceux qui créent l'information qui est ensuite propagée au Peuple, une sorte de divinité intouchable seulement en paroles, mais en fait violée chaque jour dans sa dignité. Un dogme prévaut sur tous : "Ne jamais, au grand jamais, troubler la paix du monde télévisuel, miroir de l'harmonie immaculée de l'Hospice" (p. 171). La musique pop devenue incontournable contribue à détourner les jeunes : "de leur tâche ancestrale, un instinct purement biologique qui les pousse à arracher le pouvoir aux vieux" (p. 179), tout comme la sexualité "libre" qui : " enlève de l'énergie à une [...] pulsion intrinsèquement plus forte, l'instinct de domination " (p. 188).
Limonov estime que pour sortir de la stagnation dans laquelle se trouve l'hospice, il est nécessaire de rouvrir les portes à la vie, aux passions, à la douleur, à la nature. Retrouver le sens et la signification de se dépenser pour soi et pour la communauté. Heureux donc le monde capable d'honorer les Héros !
18:53 Publié dans Littérature, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : édouard limonov, russie, lettres, lettres russes, littérature, littérature russe, livre |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 15 juin 2023
Nietzsche et les Grecs : une compilation de l'Institut italien d'études philosophiques
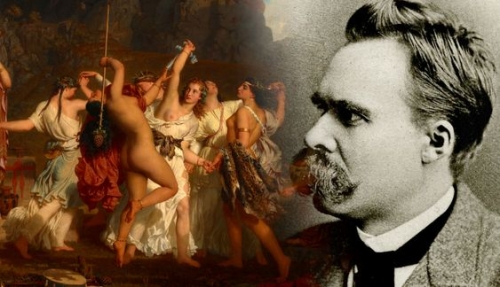
Nietzsche et les Grecs: une compilation de l'Institut italien d'études philosophiques
Giovanni Sessa
Source: https://www.paginefilosofali.it/nietzsche-e-i-greci-una-silloge-dellistituto-italiano-per-gli-studi-filosofici-giovanni-sessa/
L'expérience spéculative et existentielle de Friedrich Nietzsche représente un tournant dans l'histoire de la pensée européenne, distinguant deux époques différentes de la philosophie : avant Nietzsche et après lui. Cette affirmation est confirmée dans l'ouvrage Nietzsche e i Greci. Tra mito e disincanto (Nietzsche et les Grecs. Entre mythe et désenchantement), actuellement dans les librairies d'Italie grâce aux presses de l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici-Scuola di Pitagora (pp. 175, euro 18.00), édité par Ludovica Boi. Le volume rassemble une série de contributions sur le thème "Nietzsche et les Grecs", élaborées au cours de deux journées d'étude qui se sont tenues les 21 et 22 octobre 2019 dans les locaux de l'Institut au Palazzo Serra di Cassano à Naples. Il s'agissait de réunions et de séminaires organisées dans le cadre du projet "Les Grecs au miroir des Modernes". Le livre se compose de deux parties, chacune contenant trois essais. La préface est signée par Francesco Fronterotta, tandis que l'introduction est signée par l'éditeur.

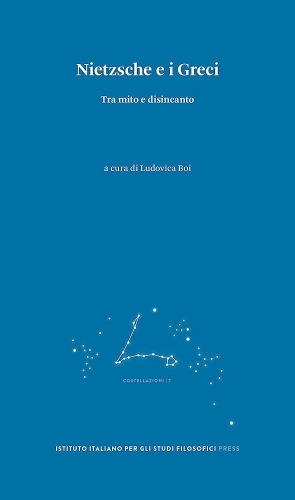
L'idée centrale, qui traverse tous les essais, est l'existence d'une continuité philologique-philosophique substantielle dans le parcours du penseur de Röcken. Ludovica Boi note que "s'il est indéniable que Nietzsche n'a jamais fait l'éloge de la méthode historiciste [...], il est tout aussi vrai que l'habitus philologique s'est enraciné en lui dès ses jeunes années et ne l'a jamais abandonné" (p. 13). La philologie fut en effet l'instrument avec lequel le penseur de l'éternel retour donna de l'ordre à sa propre nature intuitive et géniale. Nietzsche l'a transformée en : "un savoir-faire d'orfèvre qui contrecarre l'accélération de la modernité tardive [...] avec ses lectures superficielles et hâtives" (p. 13). D'un point de vue général, la civilisation grecque s'est révélée être, pour le philosophe, un marqueur indispensable de sa propre recherche, un engagement intellectuel intensément vécu. Ces deux éléments doivent donc être dûment pris en compte par quiconque entreprend l'exégèse du parcours théorique de l'Allemand, qui ne peut être distingué en "phases" rigidement opposées, puisqu'il met en évidence des traits unitaires. Nietzsche, tout en voulant reproposer le modus vivendi hellénique, reste un moderne, où l'instance épistrophique se conjugue avec le désir de démythification. C'est autour de cette ambiguïté que les auteurs ont développé leur travail herméneutique.
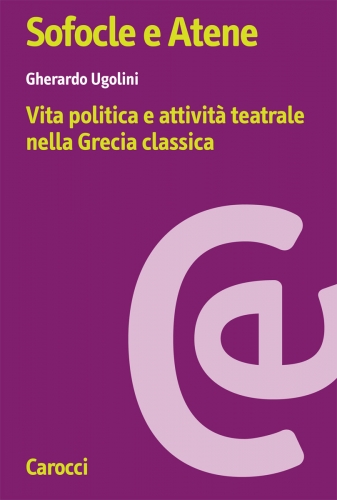
Gherardo Ugolini lit La naissance de la tragédie dans une perspective anti-aristotélicienne, en se concentrant notamment sur le décryptage de la "catharsis tragique". À ce sujet, les lectures de Lessing, Goethe et Bernays étaient pertinentes à l'époque. Le premier était porteur d'une exégèse "morale" de la catharsis, le second l'interprétait à la lumière de l'autonomie de l'esthétique, le troisième dans une clé "médico-pathologique". Nietzsche n'est pas convaincu de l'existence dans les représentations tragiques d'une libération "morale" et, reprenant le langage de Bernays, "ne croit pas du tout au potentiel thérapeutique inhérent à la tragédie" (p. 38). Il nie qu'il puisse y avoir une résolution "positive" de la condition tragique, la tragédie reproduisant l'extase dionysiaque. Dans la tragédie attique, le déchargement du dionysiaque, dont le chœur est témoin, dans le monde des images apolliniennes était évident. La seule catharsis possible était donc dans le dionysiaque : "compris comme la dissolution de l'identité et des catégories spatio-temporelles" (p. 43). Il est resté fidèle à cette conception jusqu'aux œuvres de sa maturité.
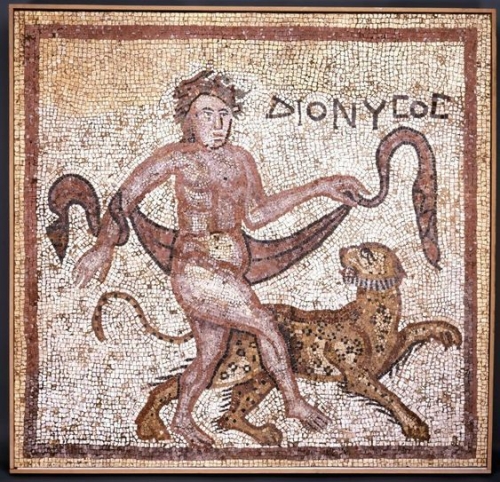
Dionysos, tel que saisi par Ludovica Boi, est le fil rouge omniprésent chez Nietzsche. Dans ses premiers écrits, il fait allusion à l'"unité essentielle" (Ur-eine), qui peut être expérimentée par le dépassement du principuum individiationis dans l'expérience extatique. Il la conçoit, en vertu de l'influence schopenhauerienne, en termes transcendantaux. Par la suite, grâce à la leçon tirée du préplatonisme et en particulier d'Héraclite, il s'approche de la coïncidentia oppositorum. Dans les écrits ultérieurs, ce sera précisément la réflexion sur le pouvoir de Dionysos qui déterminera dans sa vision la "dissolution de l'opposition du devenir et de la mort": "dissolution de l'opposition du devenir et de l'être, du moment et de l'éternité, du "monde vrai" et du "monde apparent"" (p. 50). À ce stade, l'"unité essentielle" sera expérimentée en termes de pure immanence, au-delà de tout dualisme ontologique et métaphysique. En conclusion, "Nietzsche radicalise les hypothèses déjà présentes dans la Geburt, en affirmant [...] une divinisation du devenir" (p. 51). Plus précisément, Dionysos symbolise la totalité de l'être ; il enseigne à l'humanité que la mort est liée à la vie. Pour l'auteur, ce dépassement du dualisme représente l'héritage le plus significatif du philosophe, qui réapparaîtra au 20ème siècle dans l'idéalisme magique de Deleuze, Klossowski et Evola.
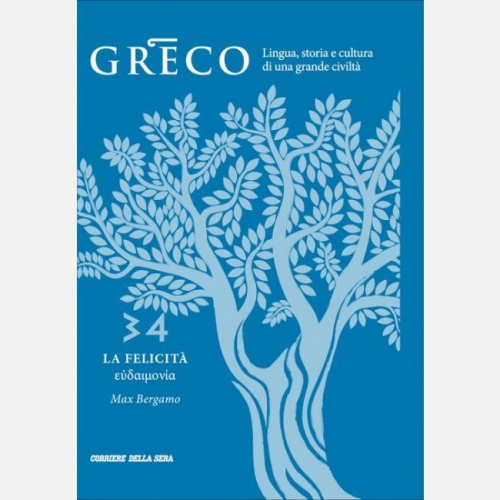
Max Bergamo traite du "caractère mixte" de Platon. Pour l'exégèse, il utilise des sources inédites telles que les notes du brillant élève de Nietzsche, Jakob Wackernagel. Par "caractère mixte", Nietzsche entend se référer à Platon, le lisant comme un philosophe chez qui l'écho de la sagesse hellénique archaïque pythagorico-heraclitéenne-socratique peut encore être entendu, présent même dans son choix de dialogue, par rapport auquel, en même temps, la spéculation de l'Athénien marque une rupture claire avec l'introduction du dualisme onto-gnoséologique. Le caractère "non original" de Platon aurait été déduit par Nietzsche à la lecture d'un passage de Diogène Laertius. Valeria Castagnini évoque la vie de l'érudit dans sa jeunesse : "exposant le lien entre le choix de la profession académique [...] et le tempérament du jeune Nietzsche" (p.16). On comprend comment, de cette manière, l'universitaire a fait sien un élément qualificatif de l'enseignement de Nietzsche, à savoir le rapport incontournable entre la vie et la pensée, l'existence et la science.
Edmondo Lisena aborde le rapport du philosophe avec les Grecs autour de l'"admirable année" 1875. À cette époque, le penseur était fermement convaincu que seule une pensée "impure" était capable de réagir face à l'illogisme de la réalité, à la dimension chaotique de la vie. Enfin, Andrea Orsucci exerce son analyse des pages de Umano, troppo umano (Humain, trop humain), en tenant compte de la crise des fondements de la connaissance qui se manifeste à la fin du 19ème siècle. La généalogie de l'esprit libre naîtra d'une confrontation étroite avec les développements de la science.
Un recueil extrêmement intéressant qui entre dans le cœur vital de la philosophie de Nietzsche : la potestas dionysiaque.
Giovanni Sessa
16:22 Publié dans Livre, Livre, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, philosophie, nietzsche, friedrich nietzsche, hellénisme, dionysos |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 08 juin 2023
Comment tuer le monstre libéral et renaître politiquement?

Comment tuer le monstre libéral et renaître politiquement?
par Iurie Rosca
Préface de l’édition roumaine du livre «Les raisons cachées du désordre mondiale» [1]
Ce livre est écrit par l’une des personnalités les plus remarquables de la très brillante constellation de la dissidence intellectuelle française, qui mènent une bataille exemplaire avec le régime tyrannique qui a usurpé le pouvoir politique en Occident, en particulier après la Seconde Guerre Mondiale. Nous, les ex-communistes d’Europe de l’Est, nous perdons la plupart du temps de vue le fait que les véritables bénéficiaires des résultats de cette guerre n’étaient pas les peuples d’Europe de l’Ouest, qui ont réussi à échapper à l’expansion du communisme soviétique, mais les dirigeants Grande-Bretagne et Etats-Unis. Autrement dit, les vainqueurs ont divisé leurs butin, les Soviétiques ont conquis le centre et l’est du continent, pendant que les Anglo-Saxons ont colonisé la partie occidentale de l’Europe. C’est pourquoi l’effort éditorial de l’Université populaire de Chisinau, sur une période de plusieurs années, est dirigé principalement vers la traduction et la publication, pour le lecteur roumain, de certains auteurs de l’élite intellectuelle française authentique. Le but est de contribuerait à dépasser les clichés de propagande imposés par les maîtres du discours dominant, fondés sur la sacralisation de l’Occident collectif comme expression de la dernière étape du développement civilisationnel.

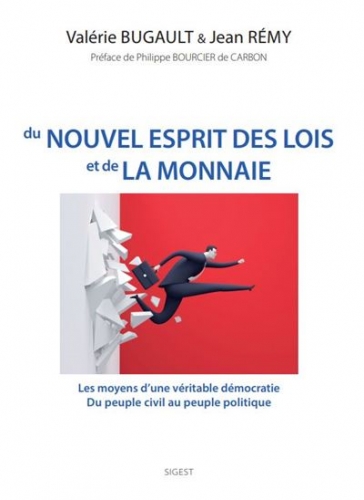
L’auteur de ce livre, qui allie une érudition très spéciale et une rigueur scientifique exemplaire, apparaît devant nous dans la stature d’un penseur politique qui fait partie de l’admirable tradition européenne des grands critiques du système qui a d’abord triomphé en France. Et le point de départ de cette destruction méthodique de la civilisation européenne millénaire est la soi-disant révolution française de 1789, qui a marqué le début de la colonisation de l’Europe continentale par les élites financières britanniques. Le déicide et le régicide, figures à la base de la République française, constituaient la couche sociale la plus détestée de tous les temps et de tous les peuples – celle des usuriers et des marchands. La nouvelle forme de gouvernement, nous rappelle Valérie Bugault, qui proclame la fin de la tyrannie et le triomphe de la liberté (en établissant le républicanisme et la démocratie, ainsi que d’autres éléments de la théorie politique et économique libérale), établissait en réalité la forme la plus perfide de la tyrannie. Il s’agit, pour la ploutocratie apatride, de mettre en oeuvre l’usurpation de tout pouvoir politique et de transformer l’État en simple outil, paravent marketing pour donner à des gens anonymes et irresponsables des bénéfices illimités.

Pour aider le lecteur à comprendre les origines du monde et l’envergure de la nouvelle caste qui s’est approprié la plupart des richesses du monde, l’auteur nous présente une vaste exposition historique de la montée et du triomphe de l’hyperclasse mondiale et de sa domination graduelle sur les États et les peuples. Valérie Bugault démontre les procédures politiques, juridiques, économiques et financières qui sous-tendent la stratégie à long terme des « maîtres de l’argent » pour établir une domination absolue. La formule qui illustre cette nouvelle réalité, qui a façonné les sociétés modernes, est présente comme un fil rouge tout au long du livre. Le « fait économique » a subordonné le « fait politique », en transformant les États en coquilles vides ou, pour reprendre une expression de la langue roumaine, en formes sans fond.

En d’autres termes, les pays qui étaient autrefois gouvernés par des hommes d’Etat à vocation politique, qui assumaient la mission de garantir le bien commun et la sécurité des gouvernés, ont été mis au service de groupes de type mafieux. Ils conservent leur honorabilité uniquement parce qu’ils ont réussi à imposer leur propre volonté à ceux qui font les lois et gèrent les institutions publiques. Ainsi, l’ensemble de l’appareil d’État est mis au service d’intérêts privés, diamétralement opposés à l’intérêt national et à chaque citoyen. Toute la politique législative, budgétaire, fiscale, douanière, de crédit, ainsi que les relations extérieures et la coopération avec les organes internationaux d’un pays comme la France ou tout autre pays vassalisé par les gangsters du capitalisme corporatif, ne représente que l’expression de leurs intérêts pécuniaires.
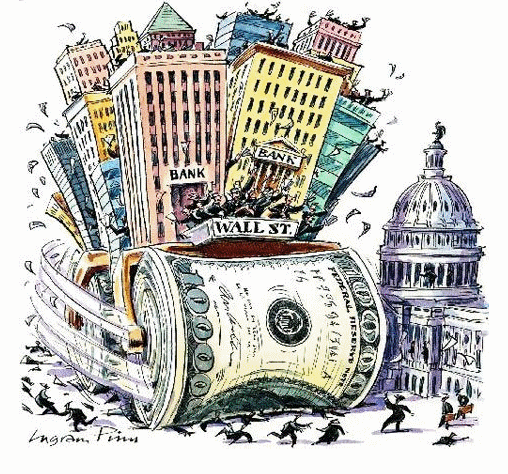
Valérie Bugault montre comment la mafia des prêteurs et des marchands est venue subjuguer les États. Parmi les méthodes d’asservissement politique et social des peuples, notre auteur révèle, entre autres, la transformation de la terre en marchandise à la suite du coup d’État de 1789, l’établissement du système de banques centrales qui prive les États de leur attribution royale pour émettre la monnaie, l’imposition du libre-échange comme une forme de colonisation économique de tous les États du monde, la création de systèmes juridiques qui permettent l’anonymat du capital (conglomérats économiques et zones offshore), etc.
L’auteur nous montre que nous assistons à l’annulation du phénomène politique et sa transformation en farce pour les foules; auxquelles le rôle assigné à l’électorat est celui du dindon de la farce. Les partis politiques et les élections servent en réalité à valider aveuglément décisions prises par les tenanciers économiques dans la plus grande opacité. La démocratie de masse n’est qu’un théâtre de marionnettes, derrière lequel se cachent les décideurs économiques qui instrumentalisent toute la farce politique en finançant les partis et leurs représentants aux postes d’État. C’est-à-dire que si les véritables maîtres de la politique sont les barons de l’économie de marché, ils n’ont aucune responsabilité envers le public. L’entière responsabilité repose sur les pitres qui, après avoir joué le rôle de valets du « facteur économique » et perdu toute crédibilité, sont remplacés par d'autres marionnettes, au service des mêmes maîtres, dans de nouvelles farces électorales.

Mais le mérite principal de Mme Valérie Bugault, qui mérite tous nos éloges, ne se limite pas à une critique approfondie du système politico-juridique et institutionnel actuel, qui s’est répandu dans le monde entier à la suite de la mondialisation. Elle est l’auteur d’une conception très solide de la réforme qui vise à réorganiser toute la société sur des principes fondés sur l'intérêt national et le bien commun, mettant fin à la domination d’une élite mondialiste. C’est la vision vraiment révolutionnaire de l’éminente scientifique française. Elle plaide ouvertement et avec des arguments imbattables pour l’abolition du système parlementaire fondé sur le parti, ainsi que pour la liquidation des partis en tant que tels, pour la renonciation au principe de séparation des pouvoirs dans l’État, mais aussi à la cyclicité électorale. L’auteur démontre l’inutilité « des constitutions » qui imposent tous ces principes.

C’est-à-dire que l’auteur est engagé dans une guerre totale et déterminée avec la classe dirigeante qui impose la doxa commune comme des vérités axiomatiques et donc le « politiquement correct » qui constitue une véritable religion laïque en Occident. C’est pourquoi l’auteur mérite de profonds encouragements pour son honnêteté professionnelle, son intégrité morale et son courage civique.
Assumer un tel discours public à l’heure actuelle équivaut à accepter des persécutions sans fin et la marginalisation dans le milieu universitaire et la presse dominante. L’approche de Mme Valérie Bugault est la preuve d’une mission plus élevée, étant le résultat d’une vocation à affirmer la vérité à tout prix. Aujourd’hui, ne pas être le confesseur bienveillant de l’hérésie libérale (avec tout son échafaudage théorique qui est la clé de l’endoctrinement des masses, auxquelles on inculque une « pensée unique », totalitaire), cela signifie défier le pouvoir réel et affirmer la verticalité comme une vertu civique majeure.
Tout au long de son œuvre, Valérie Bugault apparaît comme une figure éminente de la « troisième voie » en économie, au-delà du communisme et du libéralisme, deux systèmes tout aussi pernicieux pour la société. Ou, pour recourir à la formule utilisée par l’auteur elle-même, sa vision est une contribution précieuse au développement de la quatrième théorie économique (formule utilisée dans le Forum de Chisinau, édition 2019).
Le travail et la cause que plaide Valérie Bugault n’offrent ni chaires universitaires ni lauriers académiques ni avancées administratives. Cela offre plutôt l’exemple d’un dévouement total pour la France actuellement dévastée par la kleptocratie extraterritoriale, mais aussi pour d’autres pays. Le modèle de réorganisation radicale de tout le système politique et juridique international, développé par Valérie Bugault, pourrait servir de référence et d’action. La création de l’auteur de ce livre me fait penser aux grands auteurs de la Révolution conservatrice, d’un Carl Schmitt, ainsi qu’au grand penseur politique roumain Mihaïl Manoïlesco (voir en ce sens son œuvre « Le siècle du corporatisme »).
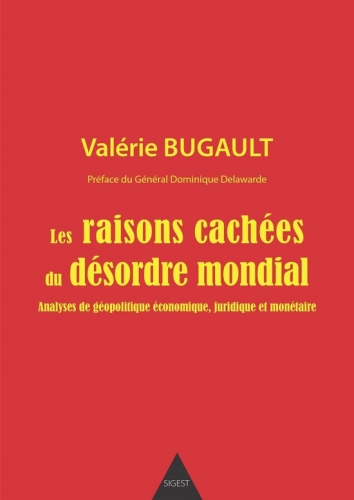
Nous rappelons au lecteur roumain que le premier ouvrage en roumain du même auteur porte le titre « Tuer la ploutocratie. Guide pratique pour le démontage du système»[2], ouvrage rédigé en collaboration avec Jean Remy, maison d’édition de l’Université populaire, 2017.
Iurie Roșca,
Moldavie
+ 373 79 77 44 44 (Telegram, Signal)
e-mail: roscaiurieppcd@gmail.com
chaîne Telegram: https://t.me/iurierosca
[1] Les deux volumes de notre auteur paraîtront bientôt dans la version roumaine à l’Université populaire de Chisinau, République de Moldavie
[2] Le titre original de l’édition française est Du nouvel esprit des lois et de la monnaie - Valérie Bugault, Jean Rémy. Ed. SIGEST, 2017
13:18 Publié dans Actualité, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : valérie bugault, livre, finance, histoire économique, dissidence, iurie rosca |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 28 mai 2023
Fils d'Homère
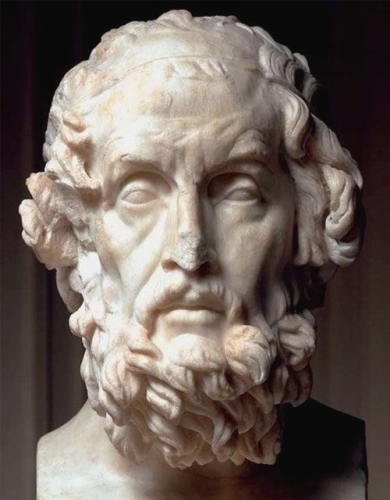
Fils d'Homère
Recension: Hijos de Homero. Un viaje personal por el alba de Occidente, Alianza Editorial, Madrid, 2006.
Carlos X. Blanco
Bernardo Souvirón nous a laissé une belle introduction au monde grec, écrite avec clarté, affection et élégance. A aucun moment ce philologue ne nous accable de citations et de notes de bas de page. Il ne nous en offre que pour éclaircir ou étendre l'information. J'ai tendance à penser qu'étant professeur de lycée, le désir de se faire comprendre clairement à un public non spécialiste transparait du début à la fin du livre.

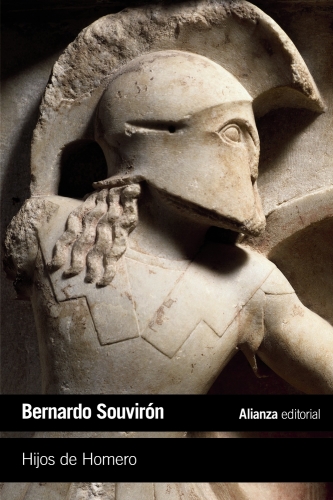
Souvirón nous raconte l'origine même de l'Europe, l'aube d'une culture, la nôtre. Une culture qui, littéralement, a son propre nom: Homère. Ce personnage, "l'éducateur de la Grèce", continue d'être aujourd'hui le symbole du poète dont le moi se cache dans les ténèbres, ne parlant jamais de lui-même, mais qui veut raconter quelle mémoire orale est passée de bouche en bouche pour former un Peuple. Homère est à la charnière entre un passé épique, purement oral, légendaire, et une Histoire déjà écrite. Une Histoire dans laquelle il a été le premier à mettre en caractères alphabétiques ce qu'il a peut-être lui-même chanté (aedo) ou récité (rhapsode). Mais Homère, le mystérieux père de l'Europe, fut aussi un créateur, un « humanisateur » de ces histoires si lointaines de héros et de dieux, et aussi d'hommes qui souffrent et meurent à la guerre, dans un monde cruel, dur et violent comme était le monde mycénien. Un monde pas si différent de celui d'aujourd'hui, aussi cruel, dur et violent. De ce sol pousse la plante de la Poésie, mais une Poésie qui est aussi Histoire (Homère est assez exact dans son récit des événements, selon l'auteur) et même le teint spirituel de l'homme européen.
Ces Mycéniens dont parle Homère étaient des peuples indo-européens qui, dans la partie la plus substantielle, ont façonné l'Europe que nous avons aujourd'hui et, à partir d'elle, le monde dans son ensemble. Les traits que l'auteur met le plus en évidence sont a) la mort légale des femmes et leur accaparement social dans tous les domaines, repris par l'homme comme machine de reproduction et b) la guerre comme mode de vie répandu dans certaines peuples qui ont besoin de butin, des esclaves et du sang pour survivre. Il n'est pas difficile d'observer ces traits essentiels dans le monde d'aujourd'hui, même si l'auteur ne pointe pas la dévirilisation actuelle de l'Européen et sa chute dans la bestialité. Au fil des siècles, au-delà de l'héritage hellénique, et surtout à la fin du Moyen Âge, grâce à l'esprit chevaleresque et aux influences celto-germaniques, les femmes européennes prennent le devant de la scène et parviennent à une réelle égalité avec les hommes. L'islamisation actuelle de l'Europe, jointe à l'inertie « lunaire » du sous-sol méditerranéen, va tout changer : la dignité spécifiquement européenne des femmes est mise en péril.
L'autre trait qui nous vient du fond indo-européen, avec lequel nous restons essentiellement mycéniens, est le bellicisme. La guerre n'a pas disparu comme moyen de résoudre les conflits. L'usage de la guerre pour transformer les peuples et les nations en animaux de proie, en bêtes qui vivent de leur proie, n'a nullement disparu et son abandon semble aujourd'hui bien plus éloigné que le premier trait, la culture patriarcale.

Il y a dans Los Hijos de Homero une série de thèses audacieuses, plutôt des hypothèses qui ont besoin d'être corroborées, qui attendent que l'Histoire, l'Archéologie et la Philologie les approuvent dans les années à venir. L'auteur propose d'effacer d'un trait de plume 300 ou 400 ans de la Chronologie standard, qui correspondent à ce qu'on appelle l'Age des Ténèbres, qui du XIIe au VIIIe siècle av. C. continue de nous présenter des énigmes. Nous ne savons rien de ces siècles, si ce n'est qu'il y a une continuité culturelle et qu'il n'y a pas de témoignages de catastrophes, d'invasions violentes, etc. Ce Dark Age s'achève avec un Homère, peut-être un Mycénien du VIIIe siècle, qui connaît presque parfaitement les événements de la guerre à Troie, malgré quelques anachronismes présents dans ses chansons. Peut-être, dit Souvirón, il y a des erreurs dans la datation chronologique dans l'établissement des synchronies. Nous laissons ici cette question, qui concerne le débat entre spécialistes, à l'avenir pour en décider.

En lisant l'excellent livre de Souvirón, nous pouvons nous souvenir de la situation dans laquelle les études classiques étaient enseignées dans l'État espagnol. Didactiquement, nous avons tous subi la difficulté actuelle de présenter la Philosophie comme une institution aux racines helléniques, et de montrer aux jeunes que la Civilisation dans laquelle nous vivons est fille de la Grèce. Enseigner le passage "du Mythe au Logos", la naissance de la Philosophie en Ionie, la prédisposition hellénique à la pensée rationnelle est une tâche énorme aujourd'hui compte tenu de l'analphabétisme en latin, en grec et, en général, dans la culture classique de la plupart de nos étudiants. Et ils ne sont pas coupables, ce sont nos législateurs, ministres et "comités d'experts" qui, par calcul politique, ont soutenu ces politiques démissionnaires. Des gens comme le professeur Adrados et bien d'autres dans la presse et dans tous les autres forums publics ont réclamé en vain contre cette déchéance. Pour certains intérêts fallacieux, il a semblé plus commode pour les politiciens et leurs "experts" (à mon avis, eux aussi des politiciens), d'inculquer aux jeunes esprits des matières supposées "pratiques", telles que l'économie, la numérisation (sic) et l'administration des entreprises, au détriment de la formation classique, clé de voûte de la compréhension de la Philosophie, des Sciences et, in fine, de l'identité des Européens. J'ose dire qu'il n'y a jamais eu autant d'étudiants dans ces matières économiques et financières au lycée et à l'université en Espagne et en Europe, et la situation économique n'a jamais été aussi mauvaise, justement.
Ils voulaient faire de nos élèves de nouveaux barbares. Ces programmes y sont parvenu de manière profonde et irréversible. Ne rien savoir d'Homère, c'est ne rien savoir de sa propre culture, de la culture européenne. Il sera très difficile de saisir le message que nous ont transmis les Présocratiques, Platon ou Aristote sans connaître les piliers sur lesquels repose notre civilisation. Ce n'est qu'avec cet analphabétisme planifié depuis la soumission de nos gouvernants à l'UNESCO et à l'Agenda 2030, et perpétué avec la loi actuelle, qu'il peut être qu'incompris dans le relativisme et le multiculturalisme crus d'aujourd'hui. Toute tradition, respectable en soi mais étrangère à notre substance culturelle, est placée dans l'esprit de nos concitoyens sur un pied d'égalité avec la tradition hellénique, et très peu d'étudiants sont aujourd'hui capables de reconnaître la leur, la nôtre, dans cette tradition hellénique. Cette situation malheureuse permet d'ouvrir toutes grandes les portes à la colonisation de l'Europe, à son aliénation aux mains d'une technocratie, qui idolâtre le nouveau ou lebizarre. Ne pas connaître les Grecs va supposer, pour l'Europe, un oubli d'elle-même. L'Europe s'africanise, s'américanise, devient une salade de traditions, mais coupe -avec elle- ses racines.
Des livres aussi instructifs, aussi bien écrits que celui de Bernardo Souvirón, servent à comprendre le bien et le moins bien de notre propre patrimoine culturel. Un conglomérat historique qui comprend la guerre et le patriarcat, oui, mais aussi la démocratie et la rationalité. Si nous ne sommes pas capables de comprendre ces racines, nous ne pourrons pas grandir ou continuer à avoir une nouvelle sève.
11:36 Publié dans Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : homère, grèce antique, livre, hellénisme, antiquité grecque, antiquité gréco-latine |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Criminalité monétaire et économie circulaire

Criminalité monétaire et économie circulaire
par Giovanni Sessa
Source: https://www.centrostudilaruna.it/crimini-monetari-ed-economia-circolare.html
Deux publications récemment parues en librairie attirent notre attention sur des questions économiques urgentes, sur l'"argent équitable" et la nécessité de surmonter le capitalisme dans le cadre d'une économie circulaire. Le premier sujet est largement abordé dans le livre d'Alexander Del Mar, Storia dei crimini monetari, publié par Mimesis et édité par Luca Gallesi (pour commande : 02/21100089, mimesis@mimesisedizioni.it, pp.134, euro 12.00). La seconde est la pierre angulaire des réflexions qu'Antonino Galloni, économiste et élève de Federico Caffè, développe dans I nuovi Spartani. Superamento del capitalismo, moneta non a debito, economia circolare, publié par Oaks (sur commande: info@oakseditrice.it, pp. 223, euro 18.00), avec une introduction de Giacomo Maria Prati. Commençons par le premier de ces volumes.
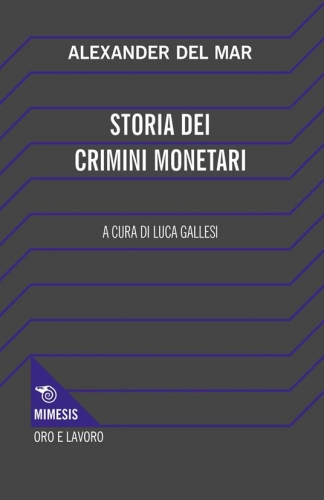
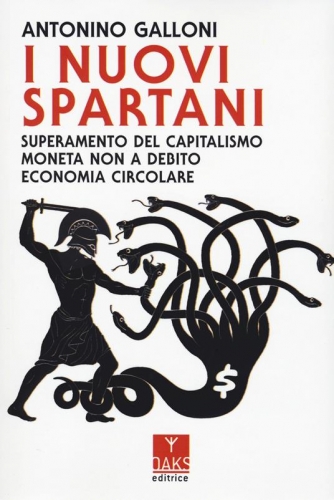
Comme le rappelle l'éditeur dans son introduction très complète, Alexander Del Mar, ingénieur des mines né à New York en 1836, a suivi une formation académique en Grande-Bretagne puis à Madrid. Il a noué une série de relations avec le monde de l'édition américaine qui lui ont permis, à son retour, de fonder un prestigieux périodique d'études économiques, The New York Social Science Review. Il occupe des postes gouvernementaux importants: il représente son pays au Congrès international de Turin en 1866 et, plus tard, au Congrès international de statistique de Saint-Pétersbourg. Économiste "hérétique", ses thèses sont tardivement acceptées par l'académie "économiquement correcte", notamment en ce qui concerne les politiques monétaires. Sa production livresque, véritablement inépuisable, alimente néanmoins un monde idéal de personnalités culturelles de premier plan, parmi lesquelles le poète, également "hérétique" dans la sphère économico-politique, Ezra Pound.
Del Mar ne partageait pas la conception typiquement libérale de la monnaie: "dont la valeur, déterminée par la quantité de métal précieux qui la compose, devait [...] être liée au mécanisme de l'offre et de la demande", rappelle Gallesi (p. 8). Une thèse erronée, car elle ne tient pas compte du fait que la monnaie a, certes, une valeur en soi, mais qu'elle détermine la valeur d'autres marchandises. De plus, après l'introduction du papier-monnaie, sans parler de la monnaie électronique, "on ne peut plus attribuer de valeur intrinsèque à la monnaie" (p. 9). Del Mar est fermement convaincu que seule l'autorité politique a pour tâche d'établir la valeur de la monnaie et de garantir sa circulation. Cette position apparaît très clairement dans l'ouvrage que nous examinons ici. L'argumentation de l'universitaire commence par la présentation de la figure de Barbara Villiers, maîtresse de Charles II, le roi appelé à restaurer la monarchie anglaise après la république de Cromwell. A cette femme, le souverain concède des rentes seigneuriales: d'elle, les nouveaux puissants, orfèvres et banquiers, obtiennent le privilège d'émettre de la monnaie, ce qui, jusqu'alors, était l'apanage de la couronne.
L'économiste présente la longue et terrible histoire des "crimes monétaires" dus à la privatisation du pouvoir de battre monnaie. Pound estimait que le moment décisif de cette évolution avait été la création de la Banque d'Angleterre (en 1694), Del Mar, comme nous l'avons vu, la fait remonter aux années qui séparent la dictature puritaine de Cromwell de la restauration monarchique.
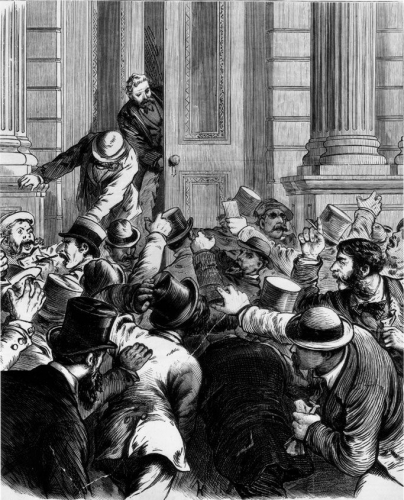
Avec Storia dei crimini monetari, Del Mar a contribué à fournir une base théorique au mouvement politique populiste américain. En effet, à l'origine de la révolte anti-anglaise des citoyens des colonies américaines à la fin du 18ème siècle, il y a la protestation contre le fait que la Pennsylvanie a été forcée de ne pas imprimer son propre papier-monnaie. La lutte politique pour une "monnaie équitable" a connu une impasse avec le "crime de 1873", c'est-à-dire avec l'introduction de la "loi suspendant officiellement la frappe du dollar en argent" (p. 14). Plus tard, lors de la crise aux États-Unis en 1893, la situation dans ce pays est apparue clairement : "D'un côté, il y a les intérêts [...] de l'argent, de la richesse concentrée et du capital arrogant et impitoyable [...] de l'autre côté, il y a les multitudes", paroles du candidat à la présidence Bryan. Ce contexte n'a pas changé depuis lors; au contraire, il est devenu le paradigme sur lequel le monde occidental s'est construit !
Le livre de Del Mar fournit des outils pour comprendre le présent et penser à un avenir alternatif, dans lequel l'élément Travail l'emportera finalement sur la domination incontestée de l'Or.
Une perspective assez semblable anime les pages de I nuovi Spartani de Galloni, un chercheur qui, dans le cadre de l'économie "hérétique", en est l'un des plus grands interprètes actuels. Dans la première partie du volume, l'auteur décrit les causes qui, à partir des années 1920, ont déclenché une transformation progressive du capitalisme. Il s'attarde en particulier sur ce qui s'est passé dans la sphère économico-productive, des années 1940 aux années 1970. Il trace, dans les processus métamorphiques qui ont conduit à l'affirmation du capitalisme cognitif, une donnée sans équivoque : "les contours d'une perspective qui ne peut plus être éludée, concernant le dépassement du capitalisme" (p. 15). Dans cette perspective, il discute du rôle joué par les écologismes "systémiques" dans l'actuelle remise à zéro du monde, avant d'aborder, dans la deuxième partie du livre, des questions telles que l'inflation, la dette publique et privée et le déséquilibre économique induit par ces facteurs. Enfin, dans la troisième partie de l'essai, il s'interroge sur un éventuel modèle économique alternatif, essentiellement axé sur la circularité.
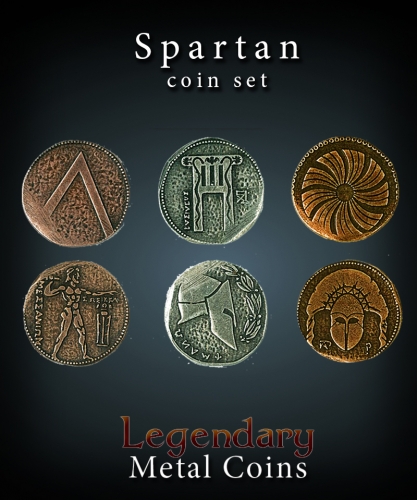
Comme le reconnaît Prati dans l'introduction: "La première "durabilité", nous enseigne notre auteur, est donnée par une économie qui n'est pas seulement fondée sur la valeur du gain facile [...] et sur l'idée de la finance/argent comme fin en soi, artificielle, aliénante" (p. 13). C'est ce qui explique la référence à Sparte. Dans la cité grecque, la monnaie était constituée de simples pièces de fer : "pour que l'argent ne prenne pas trop d'importance [...] pour réduire le risque de son accumulation pathologique" (p. 11). La monnaie devait avoir une circularité exclusivement sociale, communautaire, irriguer la cité comme le sang irrigue le corps et, pour cette raison, la frappe de monnaie était la prérogative de l'État, une prérogative politique. Sparte était un État-communauté centré sur l'éducation, dans lequel les femmes jouaient également un rôle important. Les Spartiates savaient que l'économie est l'expression d'une culture, d'une vision du monde, et c'est pour cette raison qu'ils étaient conscients que "l'économie ne peut pas être basée sur l'économie" : "L'économie ne peut pas être basée sur l'économie" (p. 13). Des pages d'une grande pertinence, à méditer.
11:12 Publié dans Economie, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : monnaie, économie, économie circulaire, livre |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 27 mai 2023
Dimitrios Kisoudis : Europe centrale et multipolarité

Dimitrios Kisoudis: Europe centrale et multipolarité
Bron: https://www.pi-news.net/2023/05/dimitrios-kisoudis-mittel...
Le volume de la collection Kaplaken "Mitteleuropa und Multipolarität" de Dimitrios Kisoudis est paru aux éditions Antaios à Schnellroda (cf. infra).
L'Allemagne n'est pas l'Occident ou l'Est, mais les deux à la fois et surtout, elle est un pont. C'est la conviction de Dimitrios Kisoudis, journaliste et conseiller politique du porte-parole de l'AfD Tino Chrupalla au Bundestag allemand, et c'est dans ce petit volume concis et précis qu'il raconte la courte histoire de l'idée de Mitteleuropa.
La Mitteleuropa est la figure géopolitique du tristement célèbre "Sonderweg allemand" (la "voie particulièrement de l'Allemagne"). L'Allemagne appartient au centre - ni géographiquement ni politiquement, l'Allemagne n'a jamais été "l'Ouest" : elle a été forcée de prendre le chemin de l'Ouest.
Aujourd'hui, il apparaît que ce chemin n'est pas un chemin de salut. Qu'est-ce que les puissances victorieuses avaient identifié comme défauts allemands après 1945 ? Le militarisme et l'obéissance à l'autorité. Le "Pflichtethos" allemand originel a été réinterprété en "Kadavergehorsam" (obéissance perinde ac cadaver). La "rééducation" est passée par là !
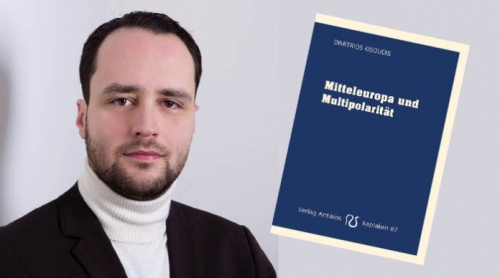
Pour échapper au danger de la "Wokeness" occidentale, l'Allemagne doit désormais reprendre son "Sonderweg". Sur cette "voie spéciale", l'Allemagne avait déjà découvert la multipolarité - qu'elle doit faire revivre.
- L'économiste Friedrich List a conçu l'Union douanière allemande comme une grande région d'Europe centrale.
- L'homme politique Friedrich Naumann voulait transférer l'idée de Saint Empire romain de la nation germanique à l'idée de Mitteleuropa dans l'ordre moderne des grandes régions.
- Pendant plus d'un siècle, l'idée d'une Mitteleuropa dirigée par l'Allemagne a marqué la politique. Elle a trouvé son apogée dans l'idée d'un bloc continental allant de l'Europe centrale à l'Asie de l'Est.
Parmi beaucoup d'autres, Kisoudis cite ici le père de la gymnastique, Turnvater Jahn : "L'Allemagne, si elle est unie avec elle-même, pourra un jour être la fondatrice de la paix perpétuelle en Europe, l'ange gardien de l'humanité".
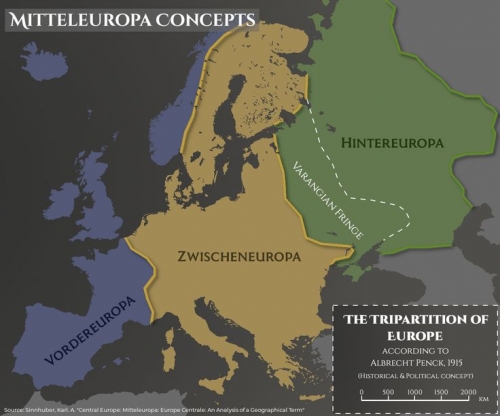
Oui, c'était à l'évidence du pathos ! Et pourtant, ce n'est pas du tout faux. Il y a des siècles déjà, l'idée de la Mitteleuropa a fait entrer le Saint Empire romain de la nation germanique dans l'ère moderne. Aujourd'hui, une véritable conception de la Mitteleuropa pourrait être plus attrayante que jamais.
Car nous sommes entrés dans l'ère de la multipolarité. L'idée d'un monde de grands espaces égaux revient d'Asie en Allemagne. Alors que la Pologne enfonce un coin dans le continent avec son initiative des Trois Mers, l'Allemagne, elle, devrait au contraire construire un pont entre l'Ouest et l'Est.
Kisoudis appelle à une initiative d'Europe centrale, au-delà de l'UE et de l'OTAN. Un petit ouvrage de base très intéressant.
" Dimitrios Kisoudis : Mitteleuropa und Multipolarität, Schnellroda : Antaios 2023, 86 p., 10 € - à commander ici: https://antaios.de/gesamtverzeichnis-antaios/reihe-kaplaken/176668/mitteleuropa-und-multipolaritaet
20:40 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dimitrios kisoudis, europe centrale, allemagne, mitteleuropa, géopolitique, europe, affaires européennes, livre |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 21 mai 2023
De la diversité des frontières

De la diversité des frontières
par Georges FELTIN-TRACOL
Quand l’histoire rencontre le droit, la géographie trinque ! En particulier si cela concerne les frontières, ces délimitations politiques conclues entre États voisins ou bien ces bornages administratifs opérés entre régions, provinces ou pays fédérés au sein d’un même État. En fonction de l’échelle pratiquée, on peut remarquer que le tracé frontalier peut ne pas être rationnel.
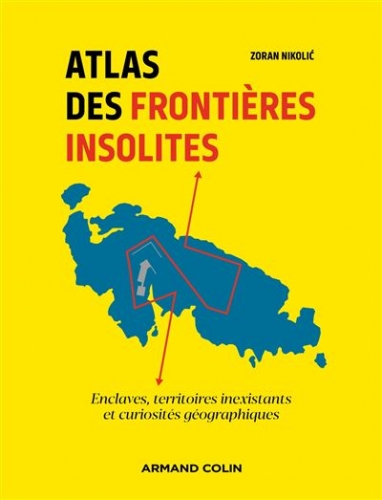 C’est le thème principal de l’Atlas des frontières insolites de Zoran Nikolić (Armand Colin, 2022, 210 p., 22,90 €) traduit de l’anglais par Philip Essertin. En lisant son sous-titre, on comprend que l’ouvrage aborde « Enclaves, territoires inexistants et curiosités géographiques ». Sous cette dernière appellation, l’auteur y intègre la principauté d’Andorre avec ses deux co-princes (l’évêque d’Urgell en Espagne et le chef d’État français) et la république monastique autonome du Mont-Athos dont l’accès est toujours interdit aux femmes en dépit des hurlements hystériques fréquents des prétendantes au matriarcat wokiste.
C’est le thème principal de l’Atlas des frontières insolites de Zoran Nikolić (Armand Colin, 2022, 210 p., 22,90 €) traduit de l’anglais par Philip Essertin. En lisant son sous-titre, on comprend que l’ouvrage aborde « Enclaves, territoires inexistants et curiosités géographiques ». Sous cette dernière appellation, l’auteur y intègre la principauté d’Andorre avec ses deux co-princes (l’évêque d’Urgell en Espagne et le chef d’État français) et la république monastique autonome du Mont-Athos dont l’accès est toujours interdit aux femmes en dépit des hurlements hystériques fréquents des prétendantes au matriarcat wokiste.
Zoran Nikolić explique qu’une enclave est un « territoire entièrement entouré par le territoire d’un autre pays ». Les cas ne manquent pas selon une démarche multiscalaire. Dans les Pyrénées françaises se trouve l’enclave espagnole de Llívia (12 km² et 1 500 habitants) qui relève de la Généralité de Catalogne. Au bord du lac de Lugano, Campione d’Italia est une ville italienne de 1,6 km² en Suisse. « Bien qu’elle soit localisée à moins d’un kilomètre du reste de l’Italie, de hautes montagnes empêchent un accès direct à son pays d’origine. Les habitants de Campione sont contraints de parcourir près de quinze kilomètres pour atteindre la ville italienne la plus proche. »
Büsingen am Hochrhein est la seule commune allemande à ne pas appartenir à l’Union dite européenne et à voir son club de football évoluer dans le championnat helvétique. En effet, c’« est une ville […] entourée de territoires suisses, c’est-à-dire les cantons de Schaffhouse, de Thurgovie et de Zürich. […] Elle est séparée du reste de l’Allemagne par une bande de terre qui n’a que 700 m de large dans sa partie la plus étroite ».
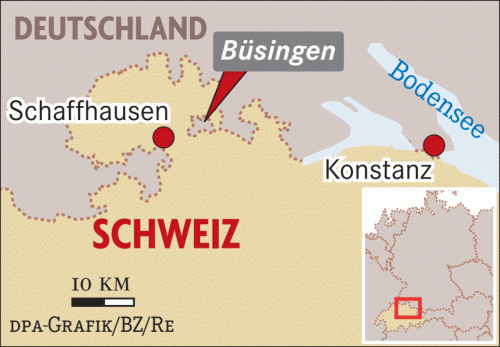
L’auteur aurait pu donner d’autres exemples d’enclaves à l’échelle infra-étatique. En dehors du cas assez connu de Valréas, parcelle du Vaucluse située en Drôme méridionale, il existe les deux enclaves bigourdanes des Hautes-Pyrénées dans les Pyrénées-Atlantiques ou trois communes du département du Nord enclavées dans le département du Pas-de-Calais. Il aurait pu évoquer l’enclave genevoise de Céligny dans le canton de Vaud, de trois enclaves du canton de Fribourg dans le canton de Vaud toujours et une dans le canton de Berne. Il mentionne bien le Land allemand de Brême et de ses deux portions territoriales (Bremerhaven et Fehrmoor) situées à une trentaine de kilomètres plus au nord de la ville à l’embouchure de la Weser. Il oublie l’enclave angolaise du Cabinda.
Zoran Nikolić tient à distinguer l’enclave de la « semi-enclave », ce « territoire physiquement séparé de son pays d’origine, mais qui n’est pas complètement encerclé par le territoire d’un autre pays ». On peut ainsi arriver en Alaska par la voie maritime en partant de l’État étatsunien de Washington sans jamais traverser le Canada. Dépendances des États-Unis enchâssées au Canada, Points Robert se trouve au Nord de la Baie de Boundary tandis que l’« Angle nord-ouest » situé dans le Manitoba est relié au Minnesota à travers le lac des Bois. À la différence de la République de Saint-Marin, Gibraltar et la principauté de Monaco sont aussi des semi-enclaves, car accessibles depuis les eaux internationales.
L’auteur se penche sur la « contre-enclave », à savoir une « enclave à l’intérieur d’une enclave ». Outre la présence militaire turque occupant le Nord de Chypre depuis 1974, l’île natale d’Aphrodite compte deux enclaves britanniques que sont les bases d’Akrotiri et de Dhekelia. Or, dans ce dernier territoire, existent quatre contre-enclaves chypriotes dont une centrale électrique. La situation est plus complexe encore avec la ville de Baerle. Il y a Baerle-Nassau aux Pays Bas et Baerle-Duc en Belgique. Mais « la partie néerlandaise accueille vingt enclaves belges à l’intérieur desquelles nous comptons environ dix contre-enclaves
L’auteur se penche sur la « contre-enclave », à savoir une « enclave à l’intérieur d’une enclave ». Outre la présence militaire turque occupant le Nord de Chypre depuis 1974, l’île natale d’Aphrodite compte deux enclaves britanniques que sont les bases d’Akrotiri et de Dhekelia. Or, dans ce dernier territoire, existent quatre contre-enclaves chypriotes dont une centrale électrique. La situation est plus complexe encore avec la ville de Baerle. Il y a Baerle-Nassau aux Pays Bas et Baerle-Duc (Baarle-Hertog) en Belgique. Mais « la partie néerlandaise accueille vingt enclaves belges à l’intérieur desquelles nous comptons environ dix contre-enclaves néerlandaises ». Par conséquent, « lorsque la frontière traverse une maison, sa “ citoyenneté “ est déterminée par la position géographique de sa porte d’entrée » qui peut parfois changer selon le goût fiscal du propriétaire…
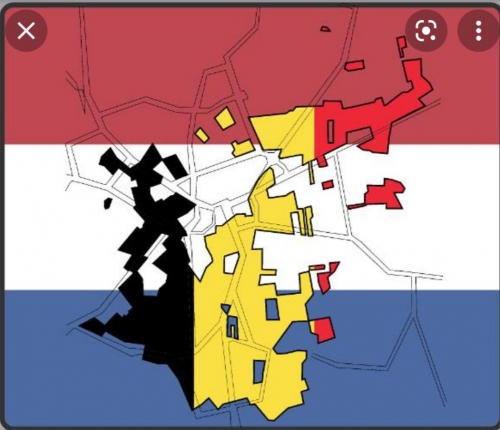


L’atlas s’intéresse par ailleurs aux exclaves. Il s’agit d’une « partie d’un territoire d’un État dont l’accès à son territoire d’origine ne peut se faire qu’en passant par un autre territoire ou État ». Non loin de sa frontière, la Russie possède au Bélarus une exclave de 4,5 km² inhabitée depuis l’accident nucléaire de Tchernobyl en 1986 nommée Sankovo et Medvezhe. Moscou détient au moins trois exclaves en Estonie avec Dubki près du lac Peïpous, le triangle de Lutepää et la zone de Santse Boot. Les Occidentaux surveillent avec attention ces trois portions territoriales russes à l’heure de fortes tensions géopolitiques. L’oblast russe de Kaliningrad et la Crimée annexée ne sont que des « semi-exclaves » puisque le premier reste en contact avec la Russie via la mer Baltique alors qu’un pont routier et ferroviaire long d’une vingtaine de kilomètres franchit le détroit de Kertch et relie la seconde au reste de la Fédération de Russie. La France des communes connaît elle aussi des exclaves. Par exemple, en Haute-Loire, la commune d’Aiguilhe en comprend deux séparées par Le Puy-en-Velay, Polignac et Espaly-Saint-Marcel.
Jusqu’en 2015, le long de la frontière entre l’Inde et le Bangladesh se répartissaient au moins une centaine d’enclaves bangladaises et plus de cent trente enclaves indiennes dont plusieurs se caractérisaient par leur statut d’exclaves et de contre-enclaves. Ce phénomène frontalier singulier était appelé « Miettes de terre ». Un traité a mis un terme à ces anomalies géopolitiques. Mais perdure encore l’enclave bangladaise de Dahagram-Angarpota...
Outil intéressant pour mieux connaître les incongruités géographiques, mais sans être exhaustif, cet Atlas des frontières insolites offre des cas pertinents dont l’étude confirme que les territoires se plient, s’il le faut aux contraintes, de l’histoire, de la politique et des traditions, n’en déplaise aux No Border détraqués...
GF-T
- « Vigie d’un monde en ébullition », n° 74, mise en ligne le 16 mai 2023 sur Radio Méridien Zéro.
18:27 Publié dans Définitions, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : définitions, frontières, enclaves, exclaves, géographie politique, livre |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 11 mai 2023
René Baert: esthétique et éthique

René Baert : esthétique et éthique
C’est la réédition d’une rare pépite des éditions nationales-socialistes belges de La Roue solaire que nous annonce également le Cercle. L’épreuve du feu, à la recherche d’une éthique fut publié en mars 1944 par René Baert, critique littéraire et artistique du Pays réel, aux éditions qu’il cofonda, un an plus tôt.
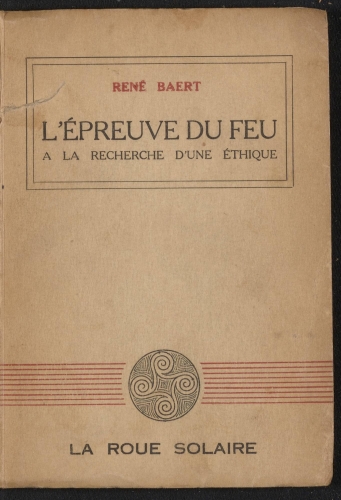
A sa sortie, ce livre fut présenté élogieusement dans la presse d’Ordre Nouveau, notamment par Le Nouveau Journal dont Robert Poulet fut le rédacteur en chef : « C’est à [la révolution nationale et sociale] que se consacre René Baert dans son livre L’épreuve du feu, qui porte en sous-titre : à la recherche d’une éthique.
Il s’agit d’une suite de courts essais dont le lien et l’unité sont évidents. Livre un peu aride, sans doute, –mais la facilité n’est plus de mise en ces temps de fer, et puisque, justement, c’est contre l’esprit de facilité qu’il faut d’abord lutter. Livre d’utile mise au point. L’essentiel de notre combat sur le plan de la pensée et de l’éthique, se trouve condensé dans de brefs chapitres qui s’intitulent notamment : La mesure du monde, Liberté chérie, Apprendre à servir, Le salut est en soi, Mystique de l’action, L’homme totalitaire, Le sens révolutionnaire.
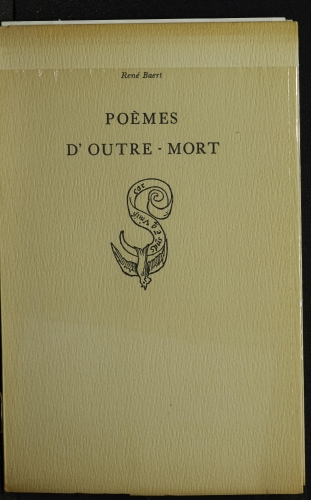
On n’entreprendra pas ici de résumer un message qui se trouve déjà fortement condensé dans ces pages, et dont la signification essentielle tient peut-être dans ces quelques lignes :
“Le révolutionnaire est celui qui lutte pour que nous ne connaissions plus jamais un temps comme celui que nous avons connu avant cette guerre… Ah ! combien à ce temps exécrable préférons-nous celui que nous vivons aujourd’hui ! Ce n’est pas que nous soyons heureux d’avoir fait les frais d’une aventure qui ne nous concernait pas, ce n’est pas que nous bénissions l’épreuve qui nous condamne à étaler toutes nos misères aux yeux d’autrui, –mais ce qui nous enchante, c’est d’être entrés de plain-pied dans la lutte, c’est de participer dans la faible mesure de nos moyens au gigantesque travail de l’avènement de l’Europe… Le sens révolutionnaire de notre époque extraordinaire se traduit précisément dans l’immense besoin de quelques-uns de sauver leur patrie malgré elle… La tâche, plus que jamais, doit appartenir aux révolutionnaires. C’est toujours à la minorité combattante qu’appartient l’initiative de la lutte. Mais qu’on n’oublie pas que seuls pourront y participer ceux qui n’auront pas préféré leurs petites aises au risque qui fait l’homme.”
Cette tâche, elle est politique et sociale, mais elle est aussi spirituelle, éthique. Aussi bien est-ce à la recherche d’une éthique révolutionnaire que s’applique l’auteur de L’épreuve du feu. Il ne le fait pas sans se référer à de hauts maîtres, tels que Nietzsche ou, plus près de nous, l’Allemand Ernst Jünger (dont René Baert analyse lucidement l’œuvre et l’enseignement dans un chapitre intitulé Le travailleur), les Français Drieu la Rochelle ou Montherlant (entre lesquels il établit un remarquable parallèle). » (Le Nouveau Journal, 6 avril 1944).
René Baert, réfugié en Allemagne en 1945 où il tentait de se préserver des générosités assassines de la Libération, est arrêté et fusillé sans autre forme de procès par des militaires belges. On ne dispose que de peu d’éléments biographiques sur lui bien qu’il existe un site modeste qui lui est consacré (cliquez ici: https://renebaert.wordpress.com/biographie/).
L’épreuve du feu, de René Baert, est ressorti aux éditions du Lore et est disponible directement chez l'éditeur: http://www.ladiffusiondulore.fr/index.php?id_product=1031&controller=product
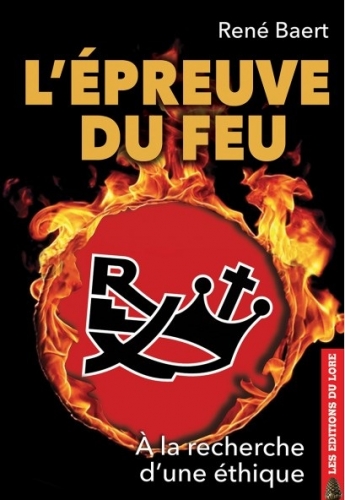
22:06 Publié dans Belgicana, Histoire, Littérature, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, belgique, belgicana, lettres, littérature, lettres belges, littérature belge, deuxième guerre mondiale, livre, rené baert |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Steuckers et une certaine Russie: sur les traces du phylum russe

Steuckers et une certaine Russie: sur les traces du phylum russe
Georges FELTIN-TRACOL
Source: http://leslansquenetsdeurope.hautetfort.com/archive/2023/05/08/steuckers-et-une-certaine-russie-6442067.html
Le conflit entre la Russie et l’Ukraine fait rage aux confins de l’Europe. Les belligérants produisent une désinformation massive qui brouille la réalité et corrompt les faits. Esprit libre à la polyglossie avertie d’où des lectures riches, variées et pertinentes, Robert Steuckers étudie depuis des décennies sur une généalogie intellectuelle de la pensée russe.
On trouve une part non négligeable de ce travail permanent dans un recueil passionnant intitulé Pages russes. D’aucuns l’accuseront de soutenir de manière implicite, par des sous-entendus convenus et des arrières-pensées inavouables le Kremlin. Ils ne comprendront pas que l’auteur n’est pas un enfant de la Rus’ médiévale, mais un féal du Lothier impérial. Neutre, il peut se permettre d’aller aux sources philosophiques d’une « russicité » constante dans ses moments tsariste, soviétique et russe.
Contre l’Occident US !
Il est en revanche avéré que Robert Steuckers n’apprécie pas l’OTAN, ce bras armé de l’Occident planétaire américanomorphe, grand pourvoyeuse de drogues. Cette organisation poursuit depuis 1949 - 1950 les tristement célèbres Guerres de l’opium (1839 – 1856) contre l’Empire chinois. «"Internationaliste" dans son essence, elle prend le relais d’un internationalisme inégalitaire, né de l’idéologie interventionniste du One World sous égide américaine, défendue par Roosevelt lors de la deuxième guerre mondiale. » Il souligne dès 2003 qu’« être un État membre de l’OTAN […] signifie être dépendant, donc soumis à la volonté d’un autre qui ne poursuit évidemment que ses seuls intérêts; être membre de l’OTAN, c’est être le jouet d’une volonté autre, d’une volonté qui veut nous réduire à l’état de pion docile, sans volonté propre ». L’actualité récente confirme son assertion.

Vue de Vladikavkaz.
De retour de son voyage en Chine, le président français Emmanuel Macron qui tente par ailleurs de trouver un terrain d’entente viable entre Russes et Ukrainiens, a récusé toute confrontation entre l’Occident et la Chine. Cette remarque de bon sens a suscité la colère de Donald Trump. L’ancien président étatsunien a accusé le locataire de l’Élysée de « lécher le cul de la Chine ». Sans être aussi grossiers, Polonais et Baltes ont eux aussi condamné la sortie présidentielle, montrant qu’ils adoraient bouffer le derrière de l’Oncle Sam. Quant à la Hongrie, elle a tenu au contraire à saluer les propos du dirigeant français.
L’actuelle agitation autour de la réforme adoptée des retraites et la forte impopularité que connaît Emmanuel Macron ne seraient-elles pas en partie attisées par des officines atlantistes ? Leur influence sur les syndicats de l’Hexagone, en particulier FO, est en effet indéniable…

La littérature russe, reflet d’une sociologie
Robert Steuckers examine avec précision non pas l’« âme russe », ce cliché pseudo-psychologisant éculé, mais le phylum d’un univers mental moins ordonné qu’on ne l’imagine. Ainsi s’intéresse-t-il à la nouvelle génération littéraire qui émerge à la fin de l’Union Soviétique. Chef de file d’une école qui promeut la paysannerie et l’écologie, Valentin Raspoutine combat le mirage libéral dans une œuvre guère connue en Occident. « Raspoutine et les ruralistes défendent le statut mythique de la nation, revalorisent la pensée archétypique, réhabilitent l’unité substantielle avec les générations passées. » En recensant l’essai prodigieux Le communisme comme réalité, il signale qu’Alexandre Zinoviev « a prouvé qu’il n’était pas seulement un grand homme de lettres mais un fin sociologue ». Il le décrit en parfait « conservateur individualiste ».
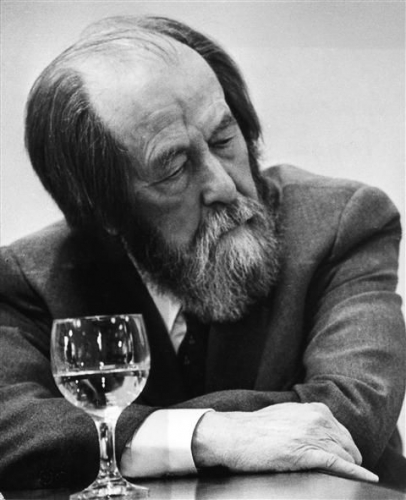
L’auteur revient sur la vie, le parcours et les écrits d’Alexandre Soljénitsyne. Ce dernier prononce, le 25 septembre 1993, un vibrant discours d’hommage à la Vendée martyrisée deux siècles plus tôt. Le dissident souligne que « les racines criminelles du communisme résident in nuce dans l’idéologie républicaine de la révolution française; les deux projets politiques, également criminels dans leurs intentions, sont caractérisés par une haine viscérale et insatiable dirigée contre les populations paysannes, accusées de ne pas être réceptives aux chimères et aux bricolages idéologiques d’une caste d’intellectuels détachés des réalités tangibles de l’histoire. […] Ce discours, très logique, présentant une généalogie sans faille des idéologies criminelles de la modernité occidentale, provoquera la fureur des cercles faisandés du “ républicanisme “ français, placés sans ménagement aucun par une haute sommité de la littérature mondiale devant leurs propres erreurs et devant leur passé nauséabond ». Ces nabots poursuivent le défunt auteur de L’archipel du goulag d’une incroyable hargne en réclamant le changement de nom d’un lycée des Pays-de-la-Loire sous prétexte qu’Alexandre Soljénitsyne était… russe.
Sur le plan intérieur, Robert Steuckers analyse l’œuvre exigeante de Dostoïevski, « idéologue génial de la “ slavophilie “ voire du panslavisme » à travers les idées de Chatov qui offrent au populisme russe (narodnikisme) une transcendance incarnée dans l’histoire. « Chatov affirme que le peuple est la plus haute des réalités, notamment le peuple russe qui, à l’époque où il pose ses affirmations, serait le seul peuple réellement vivant. En Europe occidentale, l’Église de Rome n’a pas résisté à “ la troisième tentation du Christ dans le désert “, c’est-à-dire à la “ tentation d’acquérir un maximum de puissance terrestre “. Cette cupidité a fait perdre à l’Occident son âme et a disloqué la cohésion des peuples qui l’habitent. En Russie, pays non affecté par les miasmes “ romains “, le peuple est toujours le “ corps de Dieu “ et Dieu est l’âme du peuple, l’esprit qui anime et valorise le corps-peuple. » La vision du peuple russe théophore n’est donc pas propre à Alexandre Douguine puisqu’elle s’inspire, par-delà Dostoïevski, de La Russie et l’Europe (1869) de Nicolas Danilevski. Il en résulte un messianisme civilisationnel et une eschatologie (géo)politique qu’on retrouve dans les méandres compliqués de la diplomatie soviétique.
Diplomatie manquée et impératif confédéral
Joseph Staline agit sur le plan international en dirigeant réaliste. Est-ce la raison qui l’incite à décliner à la fin de l’année 1940 le projet ambitieux de « quadripartite » avec les signataires du Pacte Tripartite (Allemagne, Italie et Japon) ? Cette grande alliance aurait modifié la donne géopolitique avec « une URSS qui aurait pris le relais de l’Angleterre en Perse, en Afghanistan, au Pakistan (voire aux Indes) et une Grande-Allemagne maîtresse du reste de l’Europe [qui] auraient, conjointement, mieux pu garantir la paix. Surtout au Moyen-Orient ».

Robert Steuckers insiste sur l’impossibilité en Europe centrale et orientale de faire coïncider le peuple et l’État. En décembre 1942, le gouvernement polonais en exil à Londres, dans le but de neutraliser les velléités expansionnistes allemandes et soviétiques, « propose la création de deux “ unions fédérales “ dans l’Est de l’Europe centrale. La première regrouperait la Tchécoslovaquie, la Pologne, la Lituanie, la Hongrie et la Roumanie et la seconde, la Yougoslavie, la Grèce, la Bulgarie et l’Albanie (voire la Turquie) ». Dès l’immédiat après-Seconde Guerre mondiale, le Yougoslave Tito cherchera pour sa part à créer une « fédération balkanique » autour de la Yougoslavie avec l’adhésion de l’Albanie, de la Bulgarie et de la Grèce. La défaite des communistes grecs et la rivalité entre le maréchal yougoslave et l’Albanais Enver Hodja ruineront ce plan qui aurait résolu les irrédentismes croate, bosniaque, albanais, musulman et macédonien…
Robert Steuckers fustige enfin qu’« en Occident, l’ignorance du mode “ ethniste “ de pratiquer la politique dans l’Est de l’Europe centrale demeure une triste constante. Personne ne se rend compte qu’on y raisonne en termes de “ peuples “ et non en termes juridiques et individualistes ». Cette méconnaissance crasse ne doit pas stériliser les initiatives. Au contraire, « l’idée d’une confédération doit mobiliser nos esprits. Une ou plusieurs confédérations regroupant les peuples d’Europe centrale en groupes d’État dégagés de Moscou et de Washington et s’étendant de la mer du Nord à la mer Noire, donnerait un essor nouveau à notre continent ». Déclinant, vilipendé et défaillant, l’État-nation n’était pas le modèle approprié à reproduire au lendemain de la chute du mur de Berlin.
D’une érudition exceptionnelle, Robert Steuckers va volontiers à l’encontre des bouffons du savoir, « les amateurs de terribles simplifications, les spécialistes de l’arasement programmé de tous les souvenirs et de tous les réflexes naturels des peuples ». En Européen convaincu, il prévient surtout que « construire la “ maison commune “, c’est se mettre à l’écoute de l’histoire et non pas rêver à un quelconque monde sans heurts, à un paradis artificiel de gadgets éphémères », surtout quand les bases initiales n’existent toujours pas.
• Robert Steuckers, Pages russes, Éditions du Lore, 2022, 398 p., 30 € (pour toute commande: http://www.ladiffusiondulore.fr/index.php?id_product=1007&controller=product ).
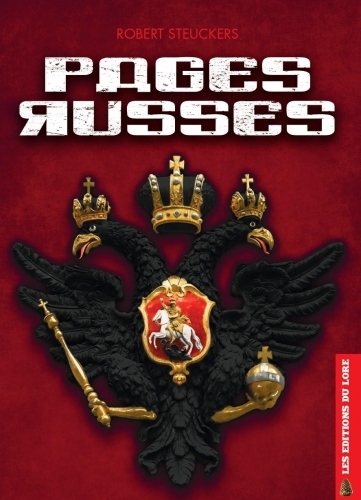
21:08 Publié dans Livre, Livre, Synergies européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, robert steuckers, russie, synergies européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 23 avril 2023
Vers l’implosion des États-Unis?
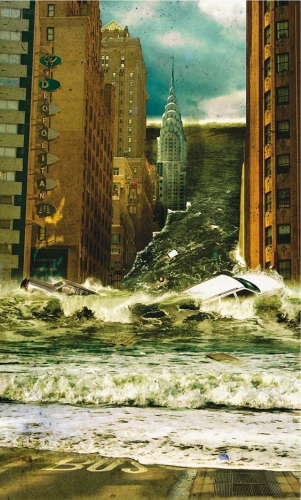
Vers l’implosion des États-Unis?
par Georges FELTIN-TRACOL
Le procureur démocrate de Manhattan, Alvin Bragg, a inculpé, le 30 mars dernier, l’ancien président Donald Trump sous trente-quatre chefs d’accusation pour des peccadilles. Un procès au civil s’ouvre par ailleurs à New York à propos d’un viol qu’il aurait commis sur une journaliste il y a plusieurs années. Candidat déclaré aux primaires présidentielles républicaines de l’an prochain, le 45e président crie au complot politique, à l’instrumentalisation judiciaire et à la manipulation médiatique.
Le 7 avril, un juge fédéral au Texas, Matthew Kacsmaryk, interdit la pillule abortive. Cette décision devrait normalement faire jurisprudence sur l’ensemble du territoire étatsunien. Quelques heures plus tard, dans l’État de Washington, un autre juge fédéral, Thomas Rice, nommé par Barack Obama, rend une décision contraire à la première. Bien que les deux sentences s’annulent, l’administration Biden fait aussitôt appel.
Le 27 mars, Audrey Hale, âgée de 28 ans, en pleine transition dysgenrée, commet une tuerie dans une école de Nashville dans le Tennessee : six morts dont trois enfants de 9 ans chacun. Elle (ou il, voire « iel » - sic !) a auparavant rédigé un manifeste dont le contenu reste inconnu. On peut déjà présumer que sa teneur cisphobe et hétérophobe n’indignera guère les plumitifs complaisants.
Une guerre culturelle bat son plein outre-Atlantique. Des États républicains tels la Floride chassent les bouquins wokistes et pornographiques des bibliothèques scolaires. Dans les États démocrates, ce sont les livres jugés sur des critères subjectifs et partiaux discriminants et attentatoires à la liberté des minorités qu’on retire d’autorité s’ils ne sont pas réécrits en novlangue inclusive.
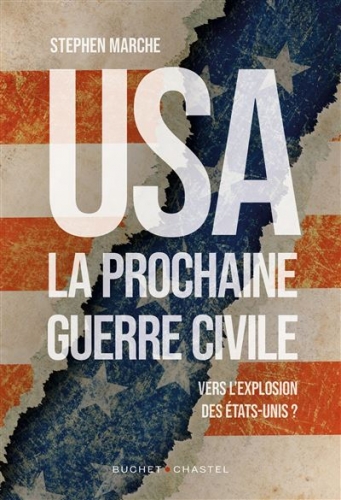

Ces quatre exemples montrent qu’Oncle Sam connaît de profondes divisions intestines. Cette situation conflictuelle est au cœur de l’essai de Stephen Marche au titre évocateur : USA : la prochaine guerre civile. Vers l’explosion des États-Unis ? (Buchet-Chastel, 2023, 306 p., 22,50 €).
Canadien vivant aux États-Unis, ce journaliste collabore à la presse du Système (New York Times, Wall Street Journal). Il observe les dissensions multiples qui fracturent la société étatsunienne. Il constate que cela ne concerne pas que le clivage républicains « rouges » - démocrates « bleus ». Les contentieux dépassent le cadre politique même si la géographie et la sociologie confirment d’indéniables correspondances. Les États progressistes côtiers de l’Est (New York) et de l’Ouest (Californie) font face aux États conservateurs de l’intérieur. Victimes d’un déclassement social et de la consommation affligeante d’opioïdes, les « petits Blancs » détestent une caste arrogante et incompétente, surprotégée. Appuyée par la doxa médiatique politiquement correcte, la communauté noire tente d’imposer son monopole culturel à travers l’activisme Black Lives Matter.
Stephen Marche estime que « les forces qui la déchirent sont à la fois radicalement modernes et aussi anciennes que le pays lui-même. […] La révolution sanglante et la menace de sécession sont des composantes intrinsèques de l’expérience américaine ». Les premiers colons puritains fuient l’Angleterre agacée par leur rigorisme. Au XIXe siècle, les mormons préfèrent s’installer au bord du Grand Lac Salé plutôt que de continuer à côtoyer des mécréants. Les immenses espaces de l’Amérique du Nord facilitent une existence côte à côte sans craindre la promiscuité. L’auteur objecte cependant que « les services de renseignement d’autres pays préparent des dossiers sur les scénarios éventuels d’un effondrement de l’Amérique ». Il se montre ainsi alarmiste.

À partir de sources ouvertes, d’entretiens, d’enquêtes et d’analyses de sondages, l’auteur pose cinq hypothèses de déflagration socio-politique. Une seule a une cause naturelle : un puissant ouragan ravage New York et contraint les citadins rescapés à se réfugier à l’intérieur des terres. Les quatre autres conjectures reposent sur une amplification des heurts d’autant qu’à ses yeux, « l’Amérique s’est toujours définie par la violence ».
Stephen Marche accuse une « extrême droite » aux mille facettes de préparer un « terrorisme de l’intérieur ». La mouvance patriote anti-gouvernementale serait le principal responsable de cette ambiance délétère dont le paroxysme se serait déroulé le 6 janvier 2021 au Capitole… Il remarque que « l’intensité de leur haine du gouvernement est leur façon d’exprimer leur amour pour leur pays. Ils croient que l’autorité fédérale détruit la véritable Amérique ». Il ajoute même que, selon eux, « l’Amérique n’est plus possible au sein des États-Unis d’Amérique ». Il ignore en revanche le pesant danger wokiste. Son approche verse dans le manichéisme grossier. Pis, il envisage le recours à des lois d’exception. « Pour survivre, prévient-il, le gouvernement devra suspendre les droits les plus emblématiques inhérents à son pouvoir, ceux du Bill of Rights ». Il avertit avec une gourmandise certaine que « le gouvernement américain n’aura pas d’autres choix que d’instaurer un contrôle des armes à feu, un contrôle des faits et gestes de ses citoyens et un contrôle des discours de haine ». Pas certain que l’habitant du Kentucky, du Colorado ou du Texas accepte calmement ces restrictions anti-constitutionnelles…
L’auteur mentionne les mouvements séparatistes, mais il ne développe pas assez. Il n’a rencontré que les indépendantistes texans et californiens. On n’a rien sur les souverainistes du Vermont, les tenants de l’autodétermination des tribus amérindiennes, les chantres d’un État afro-américain, les rêveries chicanos de reconstitution du Grand Mexique d’avant 1848 ou les nationalistes blancs qui investissent depuis plus d’une décennie dans le Nord-Ouest étatsunien. Fatigués de migrer vers un État politiquement à leur convenance, d’autres Étatsuniens suggèrent plutôt de déplacer les frontières administratives inter-étatiques.
Dans son édition du 5 avril 2023, le correspondant permanent du Figaro aux États-Unis, Lucien Jaulmes, s’intéresse à « Ces républicains de l’Oregon qui rêvent de faire sécession ». Le titre de l’article est à la fois excessif et racoleur. En effet, irrité par le confinement, l’hystérie covidiste, les limitations croissantes du port et de la détention d’armes, les projets sociétaux déviants, l’écologie punitive et la fiscalité confiscatoire, Mike McCarter (photo) fonde en 2021 le Mouvement des citoyens pour le plus grand Idaho.


Grâce aux zones urbaines du littoral Pacifique qui leur sont acquises, les démocrates contrôlent l’Oregon. À un fuseau horaire d’écart de Salem, une quinzaine de comtés, 400 000 habitants et 63 % de la superficie de l’État, se tournent vers l’Est, en direction de l’Idaho républicain. Mike McCarter et ses amis font pression sur les législatures des deux États afin que l’Oregon oriental, après des phases de négociations, de référendum et de ratifications, intègre l’Idaho. La procédure paraît plus simple que l’érection d’un nouvel État fédéré. La Virginie-Occidentale se sépare bien de la Virginie en 1862 à cause de l’esclavage. Les démocrates aimeraient éclater la Californie en cinq entités fédérées, élever le District de Colombia et la ville de New York en nouveaux États de l’Union. Pendant la Guerre de Sécession (1861 – 1865), des comtés officiellement dans des États nordistes soutenaient le Sud tandis que des comtés de la Confédération rebelle revendiquaient leur attachement aux États-Unis. La présidente de la minorité démocrate à la Chambre des représentants de l’Idaho, Ilana Rubel, rejette ce projet, sinon ce précédent signifierait pour elle que « nous allons droit à la guerre civile si nous continuons sur cette voie ».
Stephen Marche pense que « les États-Unis vont bientôt entrer dans une phase d’instabilité radicale à l’échelle du pays entier, quels que soient le ou la président(e) au pouvoir et la politique qu’il ou elle appliquera. L’avenir économique sera plus volatil. Le futur environnemental sera plus imprévisible. Les villes seront plus vulnérables. Le gouvernement sera incapable de mener des politiques et sera déconnecté de la conception qu’aura le peuple de sa volonté collective ». Ce pessimiste oublie bien vite que la première économie mondiale détient un imposant arsenal nucléaire, que sa monnaie continue sa domination financière, que son poids diplomatique demeure prédominant dans les institutions internationales, que les super-productions cinématographiques inondent la planète et formatent les esprits au mode de vie, de penser, d’agir et de parler américanomorphe.
Souvenons-nous que malgré les sanglantes guerres civiles du Ier siècle avant notre ère, Rome continuait ses conquêtes territoriales. Loin d’affaiblir le gouvernement, les rivalités internes le rendent plus expansionniste encore.
GF-T
- Vigie d’un monde en ébullition », n° 70, mise en ligne le 18 avril 2023 sur Radio Méridien Zéro.
11:09 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : états-unis, livre, actualité |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 20 avril 2023
"L'islam ennemi, une impasse" - Quelle est la voie à suivre?

"L'islam ennemi, une impasse" - Quelle est la voie à suivre?
Dans la quatrième contribution au débat sur le livre Feindbild Islam als Sackgasse, Peter Backfisch aborde en parallèle les thèses de Frederic Höfer et de Simon Kiessling (Das Neue Volk). Alors qu'il considère l'analyse de Kiessling comme contradictoire et erronée, il est beaucoup plus favorable à l'approche de Höfer. Backfisch lui-même voit des points de convergence potentiels avec les migrants musulmans, notamment dans le domaine des questions sociales et de la propagande LGBTQ, points de convergence qu'il convient d'exploiter.
Une contribution au débat de Peter Backfisch
Simon Kiessling, historien, philosophe et traducteur, a publié aux éditions Antaios un essai intitulé "Le nouveau peuple". Le titre de l'ouvrage suggère que le concept de peuple a besoin d'une nouvelle définition. Mais comment cela peut-il se faire ? Le point de départ de sa thèse est le constat que la droite et les conservateurs en Allemagne ont reculé petit à petit suite à la Révolution française. Ils abandonnent toutes les positions et traditions qui ont fait leurs preuves, ils perdent du terrain. C'est comme une digue qui retient l'eau avant de s'effondrer à nouveau. Tout ce qui mérite d'être protégé disparaît sous les flots. Pour Kiessling, le chemin est pavé de défaites. Les causes sont à rechercher dans la persistance d'une pensée dépassée du 20ème siècle. Comme personne ne peut trouver d'issue dans le spectre de la droite et des conservateurs, l'incapacité à mettre le changement en route reste enfouie. "Ils perdent parce qu'ils veulent restaurer quelque chose qui appartient à une époque révolue. Il est urgent de développer une vision d'avenir". Cela nous amène au cœur de ce constat d'échec permanent posé par Kiessling.
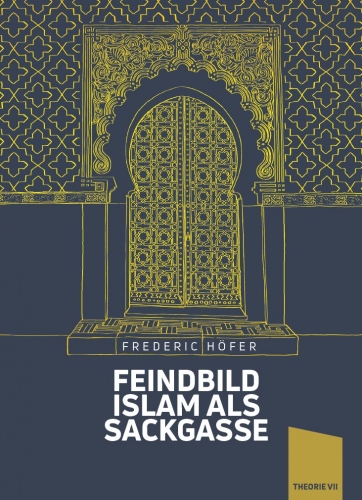
Récemment, les éditions Jungeuropa ont publié l'essai Feindbild Islam als Sackgasse de Frederic Höfer. Le livre cherche et montre les intersections et le potentiel pour une réorientation stratégique dans l'approche de l'Islam. Le point de départ est le fait que plus de 6 millions de musulmans vivent aujourd'hui en Allemagne et que leur foi en l'islam fait partie intégrante de leur vie pratique en Allemagne et dans presque tous les pays d'Europe occidentale, et qu'il en sera toujours ainsi. Il est donc nécessaire de repenser l'approche des musulmans et de l'islam. Le maintien de l'orientation anti-islam actuelle est contre-productif et mène à une impasse. Höfer demande à la droite de repenser et de définir de nouvelles stratégies.
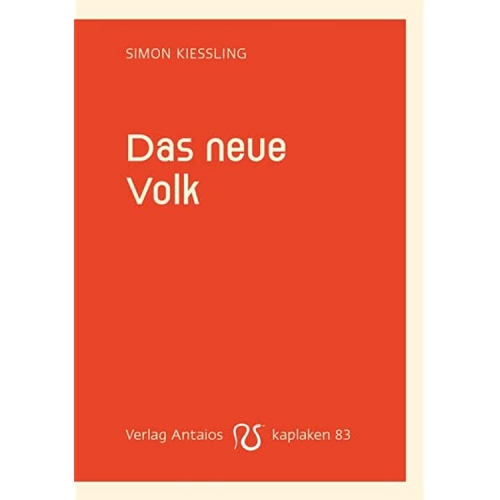
Dans la postface du livre, Thor von Waldstein voit Höfer en "compagnie créative" avec Simon Kiessling et son livre Das Neue Volk. Est-ce le cas ? Il est vrai que les deux approches de la pensée présentent de nombreux points communs, mais les deux essais sont néanmoins totalement différents dans le développement de stratégies concrètes. Ainsi, Kiessling veut créer quelque chose d'indéfiniment nouveau avec tous les nouveaux arrivants, il ne mentionne qu'une seule fois le plus grand groupe ethnoculturel au sein de la population immigrée, les musulmans, "le marquage de l'Islam comme ennemi par excellence représente tendanciellement une pensée ancienne" (80). C'est à peu près tout.
Comme le texte de ce travail sur le livre de Kiessling était déjà prêt, publié sous le titre Feindbild Islam als Sackgasse (L'Islam ennemi comme impasse), je vais insérer dans le texte original les contradictions et les développements de stratégie que je vois dans les réflexions de Höfer. Ainsi, je considère le livre de Höfer comme un correctif à l'essai déjà existant.
Krall, Sellner et Engels
Kiessling étaye ses conceptions par des évaluations des travaux de trois "protagonistes intellectuels" qui se sont penchés sur "l'identité interculturelle des peuples d'Europe et de la culture occidentale". Premièrement, la "révolte bourgeoise et ses prestataires bourgeois", représentée par l'écrivain Markus Krall, deuxièmement, la "Reconquista de l'Europe occidentale" par la remigration des segments de population immigrés, représentée par Martin Sellner, le chef du mouvement identitaire en Allemagne et en Autriche, et troisièmement la "Renovatio (nouvelle construction) de l'Occident", représentée par David Engels, historien de l'Antiquité, avec son concept patriotique culturel d'"hespérialisme", par lequel il veut faire naître un nouveau patriotisme chrétien occidental. Engels tire l'utilisation de ce terme de la désignation grecque antique de l'extrême ouest du monde connu, et le conçoit comme un concept opposé à l'"européanisation" de l'Union européenne.
Kiessling rejette ces trois penseurs. Il qualifie leurs "propositions" d'inaptes à "secouer la caste oppressive". Il rejette l'appel de Krall à revenir à la grande époque héroïque de la bourgeoisie, la jugeant déconnectée de la réalité. Les idéaux patriotiques, comme une bourgeoisie qui s'auto-discipline, ont cessé d'exister depuis longtemps. A la place, "l'ère de l'homme orienté vers la démocratie de masse et l'émancipation" est apparue, à laquelle le renoncement aux pulsions et à la consommation est étranger. Il veut que ses exigences d'émancipation soient satisfaites directement, sans effort et immédiatement. L'éthique du travail a également changé, on s'oriente aujourd'hui vers l'expérience immédiate et non plus vers des idéaux de travail dépassés. Il n'y a pas de retour en arrière possible. "Seuls ceux qui acceptent ce fait peuvent avoir une vision libre de la réalité, ce qui est nécessaire pour construire activement l'avenir".
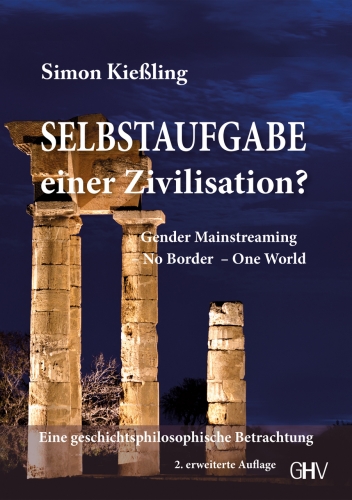
Il qualifie brièvement la demande identitaire de Sellner d'annuler l'immigration de masse et d'organiser la remigration des immigrés d'Europe occidentale de déconnectée de la réalité. Selon lui, c'est aussi illusoire que de dire "aux gens qui ont afflué dans la Rome antique qu'ils doivent retourner dans leurs marais".
Contrairement à Sellner, David Engels veut abandonner le niveau étatique, quitter les villes et établir, à l'écart du courant dominant, une nouvelle société civile culturellement conservatrice qui se réfère à des valeurs séculaires de l'Occident. Kiessling trouve un certain intérêt à cette approche, mais considère qu'elle ne va pas jusqu'au bout. Il reproche à Engels de répandre un espoir illusoire, car un retour à la grandeur occidentale n'est tout simplement plus possible. Dans l'outil formulé par Engels, à savoir l'établissement d'un césarisme, Kiessling voit un retour à l'a-historicité, "à la trappe primitive du temps". Kiessling ne semble pas savoir que Bismarck voyait lui aussi dans le césarisme la seule solution pour faire face au sentiment d'éternelles défaites.
Höfer fournit des scénarios d'action
L'exposé des idées de Krall, Sellner et Engels est court, incomplet, abstrait et contradictoire chez Kiessling. En revanche, l'analyse de Höfer, qui aborde de manière beaucoup plus complète deux des trois penseurs cités, a plus de substance, car elle montre quels autres scénarios sont possibles. Pour lui aussi, le "point de non-retour" a été dépassé et "la réalité multiethnique ne peut être inversée par des moyens humains ou inhumains". Sellner et Engels proposent, si c'est le cas, des alternatives, ils présentent pour ainsi dire un plan B. Sellner affirme qu'il n'y a pas d'alternative à la lutte pour la démocratie et l'État (Reconquista) et que, si celle-ci échoue en raison de la démographie, des stratégies de rassemblement des forces patriotiques devront être mises en œuvre. Des scénarios alternatifs similaires sont développés par Engels, qui rejette l'inversion dans la guerre civile, le génocide et autres solutions criminelles. Concernant Markus Krall, Kiessling est plein de contradictions. Dans un chapitre entier, il rejette sa "révolte bourgeoise", pour ensuite prôner dans la foulée "la préservation des classes moyennes", "la sauvegarde du niveau de vie", "un peuple qui se cristallise autour d'un noyau d'élites". Cela pourrait être l'originalité de Krall.
Il est maintenant clair que Höfer va plus loin que Kiessling, qui reste bloqué dans une analyse limitée, ne mentionne pas le "que faire?". En revanche, Höfer fournit des scénarios d'action concrets, au cœur desquels il faut trouver un allié compétent contre toutes les stratégies de destruction du peuple. Pour y parvenir, la droite et les conservateurs doivent bouger et changer d'attitude.
- Accepter le fait que des millions de musulmans sont devenus une réalité tangible.
- Abandonner l'amalgame entre migration et religion et entre politique intérieure et extérieure, héritage d'une logique de discours spécifique.
- Reconnaître que la poussée anti-islamique a un potentiel de guerre civile et que celle-ci mène à une impasse.
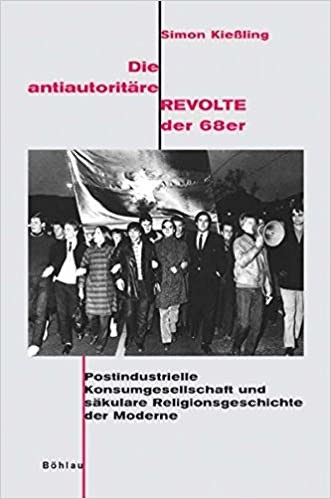
Kiessling : rejet et critique
Le livre de Kiessling suscite l'approbation des milieux de droite et conservateurs, mais aussi un vif rejet et des critiques. Lui-même se considère comme un conservateur et veut inviter l'ensemble du milieu à faire son autocritique et à surmonter sa propre paralysie intellectuelle. "Le passé exsangue ne sera pas récupérable", les regards doivent être tournés vers ce qui existe réellement. L'immigration d'étrangers issus d'autres cultures est une réalité et il invite la droite et les conservateurs à intégrer les nouvelles cultures étrangères par le processus d'assimilation et d'archaïsation, ce qui doit conduire à un nouveau concept de peuple. "Ce nouveau peuple ("proto-peuple"), ne sera plus seulement allemand ou seulement européen au sens strict, mais se composera de différentes origines ethnoculturelles". L'ancien peuple originel n'existera plus. Son destin est de "s'éteindre", comme cela a toujours été le cas pour les civilisations précédentes. A leur place, les populations immigrées forment de nouvelles associations que l'on doit appeler des peuples. Kiessling se réfère à la philosophie de l'histoire d'Oswald Spengler et de Julius Evola, qui voient venir la fin fatale des Allemands autochtones, tout comme cela s'est produit à Rome, Babylone et Tenochtitlán.
Le livre est controversé et n'est pas une grande réussite, il offre encore moins une vision de l'avenir. Il ne contribue pas à "ouvrir enfin les yeux des conservateurs". Une grande partie de l'ouvrage est juxtaposée de manière arbitraire. Pourquoi examine-t-il les trois penseurs cités et pas d'autres ? Pourquoi n'est-il pas fait mention de voix renommées de l'opposition catholique et musulmane ou/et d'autres communautés spirituelles ? C'est précisément là que l'on trouve des stratégies pour s'opposer à l'ordre mondial tyrannique, même pour le monde civilisé ! Et ce, non pas en faisant appel à des valeurs dépassées, mais à des valeurs intemporelles et éternelles, comme la foi, la langue, la morale, les mœurs et la liberté et la responsabilité personnelles. D'autres points restent obscurs: qui Kiessling compte-t-il parmi les conservateurs, Söder, Merz, Lindner, Weidel, Höcke ou d'autres ? Des personnes différentes qui utilisent toutes le terme conservateur pour se décrire.
Son analyse des soi-disant défaites permanentes est erronée, ce n'est pas la mauvaise attitude ou l'attachement à ce qui est dépassé, à ce qui n'est plus d'actualité qui en sont la cause, mais les rapports de force dominants qui permettent aux élites politiques de manipuler les gens par le biais des médias et de l'ensemble du secteur culturel. Cet aspect n'est pas mentionné. L'érudit Günter Maschke, décédé en 2022, est plus explicite dans son magnifique ouvrage Sterbender Konservatismus und Wiedergeburt der Nation (Conservatisme mourant et renaissance de la nation). Pour lui, les conservateurs sont "ceux qui comprennent sans doute le mieux la décadence de la société actuelle et qui ont les affects les plus forts à son égard". Ce qui manque, ce sont des réponses à ce qu'il faut faire pour s'opposer à la politique libérale de marché du mondialisme.
Pour pouvoir parer à l'avenir les prétendues "défaites permanentes", de telles réponses doivent être orientées vers les questions de l'écologie, qui était avant 1968 le thème propre du spectre conservateur, vers la question sociale, que l'on peut tout à fait considérer comme une "nouvelle question sociale", et finalement contre l'exclusion sociale, le recul des libertés et autres impositions. La question sociale est plus que jamais d'actualité, elle a un impact quotidien sur la vie de nombreuses personnes. Pourquoi, dans les sondages d'opinion, de nombreux électeurs de l'AfD répondent-ils qu'ils pourraient également s'imaginer voter pour un nouveau "parti Wagenknecht" à l'avenir ?
Les questions écologiques et sociales, ainsi que la réduction des droits ethnoculturels (famille, éducation des enfants, pratique religieuse) par des actes d'État paternalistes, constituent des interfaces pour le potentiel de résistance. Les communautés musulmanes ont également un besoin de sécurité sociale et matérielle. La pression fiscale, l'inflation, la pénurie de logements créent des situations problématiques réelles. La responsabilité sociale et l'équilibre social au sein de la communauté musulmane font partie de leurs principales valeurs. J'en ai terminé avec l'évaluation de l'essai de Kiessling et j'en viens pour finir aux suggestions formulées avec tant de pertinence par Höfer.
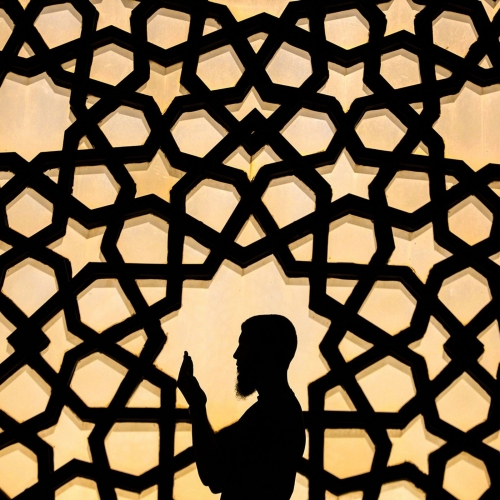
Höfer : la réalité multiethnique comme opportunité
Höfer intervient longuement contre l'image hostile de l'islam répandue en Europe occidentale, il traite des racines historiques, comment cela a pu se produire. "La caractéristique commune de ce courant était, entre autres, l'occultation complète des causes géopolitiques". A partir de la seconde moitié du 20ème siècle, l'extrémisme islamique était principalement motivé par la politique et non par la religion. On peut citer la domination néocoloniale américaine avec ses croisades, surtout dans les pays islamiques, le conflit traumatique en Palestine et la décadence corrosive de l'Occident en matière de politique et de culture. Dans la postface, Thor von Waldstein s'oppose donc au slogan politique qui en découle : "Dire "L'Islam n'appartient pas à l'Allemagne" est, au vu de cela, une phrase qui refuse manifestement la réalité".
Höfer voit dans les réalités multiethniques des opportunités de développer un "potentiel de résistance conservateur" commun, tout en exhortant à veiller à limiter les dégâts. A la page 107 et aux suivantes, il énumère en détail les points communs entre le camp patriotique allemand de droite et le "camp patriotique (des musulmans allemands)". Il convient de noter que l'auteur de ce texte voit également des points de convergence avec les musulmans non allemands. Ils découlent de toutes les contraintes de l'idéologie LGBTQ dominante auxquelles les deux "camps" sont confrontés quotidiennement et qui harcèlent leurs vies.
La droite et les conservateurs doivent déterminer avec quels musulmans ils peuvent coopérer et agir politiquement : Quelles alliances sont possibles ? Car l'islam comporte de nombreux courants qui ne peuvent être ignorés. Les musulmans vivant dans notre société sont également soumis aux mêmes divisions que la population allemande autochtone. Il y a les partisans de l'islam politique (militant). En règle générale, ils ne se contentent pas de mépriser le modèle de vie occidental et veulent généralement rester entre eux. Ils n'aspirent pas à coopérer dans des communautés de destin avec les Allemands. Il y a ceux qui ont décidé de passer leur existence dans le courant dominant occidental, soi-disant universel et idéal, et qui intériorisent et défendent avec sympathie et engagement les valeurs tyranniques qui y règnent (avec l'appui des politiciens et journalistes), et il y a ceux qui doivent supporter toutes les impositions mentionnées. Il existe avec eux des points communs qu'il convient d'exploiter. Il faut garder à l'esprit ces tensions et lutter contre les dérives extrémistes de l'islam.
Un livre courageux qui s'aventure sur un terrain miné et qui ne manquera pas de susciter des discussions controversées mais ouvertes.
Le livre Feindbild Islam als Sackgasse de l'auteur Frederic Höfer, récemment paru aux éditions Jungeuropa, fait actuellement couler beaucoup d'encre dans le camp de la droite. Afin de canaliser cette discussion, nous avons ouvert un forum de débat sur ce thème au Heimatkurier. Vous voulez participer au débat ? Envoyez-nous votre contribution au débat à l'adresse suivante : kontakt@heimat-kurier.at.
Commandes: https://www.jungeuropa.de/jungeuropa/309/feindbild-islam-...
et
https://antaios.de/gesamtverzeichnis-antaios/reihe-kaplak...
19:47 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, allemagne, société multiculturelle, multiculturalité, livre, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 17 avril 2023
L'option eurasienne - l'alternative d'Elsässer pour la paix

L'option eurasienne - l'alternative d'Elsässer pour la paix
Par Jürgen Elsässer
Source: https://www.compact-online.de/die-eurasische-option-elsaessers-alternative-fuer-frieden/
La coalition gouvernementale tricolore et la "politique étrangère féministe" d'Annalena Baerbock (Verts) entraînent l'Allemagne dans une guerre contre la Russie, la soumettent aux plans mondialistes des États-Unis et détruisent ses relations économiques avec la Chine. Face à ce pandémonium, Jürgen Elsässer a défendu dès 2009 l'importance de l'État-nation et d'une alternative eurasienne à l'impérialisme américain dans son livre Nationalstaat und Globalisierung. Voici des extraits de ce livre, qui est enfin à nouveau disponible, mais uniquement dans la boutique de la revue COMPACT.
Toutes les mesures prises en Europe ne suffiront pas à compenser l'effondrement des marchés d'exportation nord-américains. L'économie allemande est trop productive, elle ne peut pas écouler tous ses produits sur notre continent. Mais pourquoi toujours regarder vers l'ouest - et non vers l'est - lorsqu'il s'agit de trouver des clients ? Il y a là une demande solvable accumulée sans précédent.
Ainsi, la République populaire de Chine a accumulé 1,8 billion de dollars de réserves de change, la Russie en a environ 400 milliards. Avec l'effondrement prévisible du billet vert, ces petits papiers ne vaudront bientôt plus rien. Pourquoi les Allemands et les autres Européens de l'Ouest ne forment-ils pas un grand marché avec les Chinois et les Russes: nous vous échangeons vos réserves de dollars inutiles contre des euros et vous achetez des produits européens en échange. Les quelque deux mille milliards d'euros nécessaires à cette opération correspondraient à peu près à la somme que les pays de l'UE ont mise à disposition de leurs banques fin 2008 à titre de garantie.
On pourrait objecter, en prenant l'exemple du secteur automobile, que l'Empire du Milieu construit plus de cinq millions de véhicules par an et n'a donc pas besoin des Allemands. Mais la production propre aux États-Unis a récemment doublé, et pourtant les véhicules made in Germany y ont été un succès commercial. Volkswagen pour la République populaire - ce serait un marché de plusieurs milliards. La Russie aussi voudra en premier lieu développer ses propres capacités de production.
Mais si les exportations allemandes vers la Russie pouvaient être payées par des exportations de gaz supplémentaires, les deux parties auraient un avantage. Quoi qu'il en soit, la Russie s'efforcera d'apporter sa contribution à la nécessaire transformation de l'économie mondiale.
Comme l'a déclaré le président Dmitri Medvedev en novembre 2008 : "La crise financière a montré qu'il était nécessaire de réformer le système politique et économique. Le pivot de cette réforme est de briser la domination des États-Unis sur la politique et l'économie".

Liaison Paris-Berlin-Moscou
Gerhard Schröder a testé un contre-modèle au printemps 2003, lorsqu'il a coordonné son opposition à la guerre en Irak avec Jacques Chirac et Vladimir Poutine. A l'Elysée, Sarkozy a poursuivi la politique orientale équilibrante de son prédécesseur, comme le montre sa médiation après la guerre en Géorgie en août 2008.
Malheureusement, la politique allemande sous Angela Merkel n'est pas aussi engagée en ce sens, bien que notre industrie apprécie la Russie comme un partenaire fiable. A ce stade, l'opposition ne pourrait-elle pas se présenter comme une véritable alternative ? Willy Brandt avait déjà fait des concessions à Moscou en pratiquant une politique de détente et en négociant en contrepartie des livraisons de gaz stables - et ce mélange lui avait permis de gagner des élections.
Quoi qu'il en soit, une liaison Paris-Berlin-Moscou pourrait avoir un impact considérable sur d'autres pays. Non seulement pour des raisons économiques, mais aussi comme symbole de paix : des États qui se faisaient la guerre en tant qu'ennemis héréditaires il n'y a pas si longtemps s'allient en bonne intelligence. Les trois gouvernements seraient bien inspirés de ne pas se considérer comme le noyau d'un axe militaire, mais comme le nœud d'un réseau de paix eurasien: pas de relance de l'armement, mais une démilitarisation poussée. Pas d'intervention mondiale, mais un retrait des troupes. Les dividendes de la paix sont utilisés pour l'économie civile, l'éducation et la culture.
Une zone de paix de Brest à Vladivostok. Une confédération de républiques souveraines, tout comme la Grèce antique était une confédération de cités libres - la vieille Europe dans sa plus belle forme. Personne ne verserait une larme sur l'UE et l'OTAN. Le Conseil de la Fédération se réunit à Saint-Pétersbourg, carrefour historique de l'Est et de l'Ouest. Personne ne serait menacé par cette fédération. Même l'Amérique n'aurait pas à se sentir défiée et pourrait se rappeler ses vertus isolationnistes. Athènes et Rome se réconcilieraient (...)
Si l'Allemagne et d'autres Etats européens se libéraient de leur subordination aux Etats-Unis et donc de leur politique belliciste, ce serait déjà un grand gain. Cela ne sera d'ailleurs pas une promenade de santé. L'histoire connaît de nombreux exemples où non seulement Moscou, mais aussi Washington, ont su empêcher la dérive de satellites en leur prodiguant une "aide fraternelle".
Le rétablissement d'une économie sociale de marché comme dans l'ancienne République fédérale d'Allemagne est un objectif pour lequel des majorités pourraient s'enthousiasmer dans notre pays. Une fois cette étape franchie, la gauche pourrait promouvoir ses utopies à des niveaux plus larges. Nous devrions toutefois préciser que celles-ci ne seraient réalisées que si la population donnait son accord dans le cadre de procédures démocratiques irréprochables.
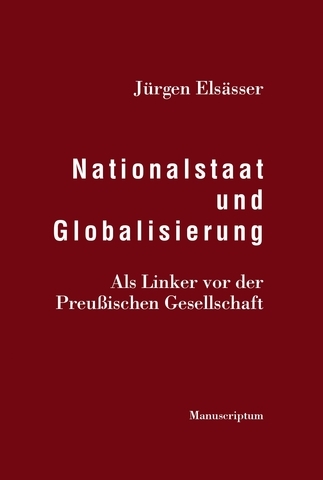
Enfin à nouveau disponible - mais uniquement dans la boutique de la revue COMPACT : Le classique de Jürgen Elsässer Nationalstaat und Globalisierung (= "État-nation et mondialisation"). Pourquoi il ne s'agit plus de la gauche contre la droite, mais de la base contre le sommet. Un plaidoyer pour un patriotisme social. A commander ici:
https://www.compact-shop.de/shop/buecher/juergen-elsaesser-nationalstaat-und-globalisierung/
19:27 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Eurasisme | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jürgen elsässer, eurasisme, allemagne, livre, géopolitique, actualité, politique internationale, europe, affaires européennes, axe paris-berlin-moscou |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 05 avril 2023
Entretien avec Thorvald Ross, auteur d'un remarquable roman initiatique

Entretien avec Thorvald Ross, auteur d'un remarquable roman initiatique
A propos d'une quête religieuse et philosophique de plus de quarante ans
Propos recueillis par Robert Steuckers
1.
Je vous connaissais déjà lorsque vous publiez la revue Mjöllnir. Vous vouliez découvrir les racines nordiques (scandinaves) présentes de manière diffuse dans la culture néerlandaise (Nord et Sud confondus). Votre livre De laatsten heiden (= Les derniers païens) est-il le témoignage de cette quête ? Et qu'en est-il de cet héritage nordique aujourd'hui ?
Mon expérience "païenne" ne s'est pas faite du jour au lendemain. Il s'agit d'une quête sans fin qui a mis du temps à arriver à maturité. Avant la publication de Mjöllnir, j'avais pris contact avec des organisations "païennes" à l'étranger et j'avais lu avec avidité leurs revues, principalement des publications allemandes, anglaises, irlandaises, françaises et scandinaves. Ces publications étaient fortement teintées de romantisme, d'occultisme et de libre-pensée, mais elles cherchaient aussi parfois à revendiquer politiquement l'héritage "païen". On pourrait donc dire qu'il ne s'agissait pas vraiment d'études scientifiques, mais plutôt de visions nostalgiques qui cherchaient une certaine légitimité dans ce "paganisme". Néanmoins, cela m'a donné envie de creuser davantage. La revue Mjöllnir a suivi à la fin des années 1980. Il s'agissait d'un mélange d'occultisme, d'une certaine forme d'ésotérisme, des premiers balbutiements de la recherche de sources et d'une étude plus large de la symbolologie.
Cela correspondait parfaitement à la phase suivante de mon itinéraire, à savoir la fondation de la Société Herman Wirth. Le travail de pionnier effectué par cette société était basé sur les écrits de Herman Wirth Roeper Bosch (1885-1985): j'en possédais déjà un grand nombre à l'époque. Der Aufgang der Menschheit et Die Heilige Urschrift der Menschheit ont été pour moi des ouvrages révolutionnaires. Ils m'ont encouragé à partir à la recherche des vestiges de notre héritage préchrétien dans les Pays-Bas, c'est-à-dire à travailler sur le terrain. Muni de mon appareil photo, je suis parti de village en village, dans les cimetières, sur les maisons, dans l'art populaire, les coutumes, les chansons, etc. pour redécouvrir le symbolisme ancien, l'enregistrer pour la postérité et l'interpréter de manière adéquate.
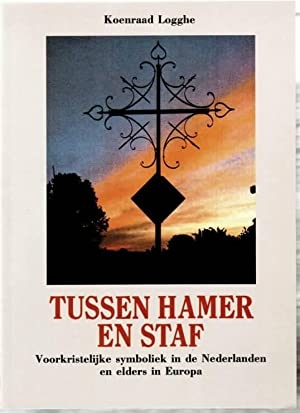
Le résultat: la publication de mon premier livre: Tussen Hamer en Staf - Voorchristelijke symboliek in de Nederlanden en elders in Europa (= Entre le Marteau et la Crosse - Symbolisme pré-chrétiendans les Bas Pays et ailleurs en Europe). Entre-temps, j'étais entré en contact avec des personnes en Flandre qui cherchaient une interprétation spirituelle et une véritable expérience de nos propres traditions.
C'est ainsi qu'est né, dans les années 1990, le Werkgroep Traditie, toujours actif aujourd'hui. La différence avec toutes les initiatives "païennes" précédentes était que la nouvelle organisation ne se basait pas sur l'interprétation völkisch du mot tradition, mais sur le concept établi par Julius Evola dans Les Hommes au milieu des Ruines, à savoir : "Dans sa véritable essence, la Tradition ne représente pas un conformisme passif à l'égard de ce qui a existé, ni la continuation inerte du passé dans le présent. La Tradition est, par essence, une réalité à la fois métahistorique et dynamique : elle est une force générale d'ordonnancement, obéissant à des principes qui visent une légitimité supérieure. On pourrait également dire qu'elle s'aligne sur les principes d'en haut. C'est une force qui est une dans l'esprit et dans l'inspiration - une force qui exerce son influence à travers les générations en servant les institutions, les lois et les organisations dans la plus grande variété. Cependant, ce serait un malentendu d'identifier certaines de ces formes, appartenant à un passé plus ou moins lointain, avec la Tradition en tant que telle".
Mon souci était de commencer à voir notre Tradition non plus comme une simple transmission horizontale (dans le temps), mais de la voir, en plus, comme une force verticale (transcendante) ordonnatrice, métaphysique. Cela était nécessaire pour se libérer de l'amateurisme et s'élever à un niveau véritablement spirituel. Ce n'est qu'alors que notre tradition (avec un petit t) deviendrait viable et ferait véritablement partie de la Tradition (avec un grand T). Sinon, elle ne serait qu'un saupoudrage incohérent de vestiges d'un passé plus ou moins lointain, tout au plus bon à exposer dans un musée.
Cette vision traditionaliste était également notre approche en tant que cofondateurs du Congrès mondial des religions ethniques (fondé par Jonas Trinkunas, avec des réunions à Vilnius, Athènes, Delhi, Anvers et Rome). Nous avons ainsi pu établir des liens avec des formes encore vivantes de "paganisme" indo-européen.
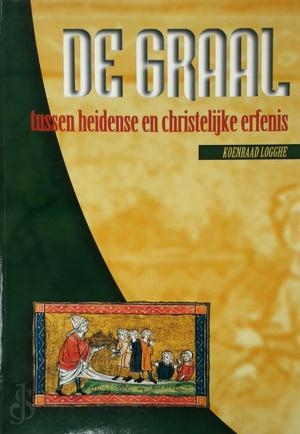
J'ai quitté ce groupe de travail sur la tradition au début des années 2000, en partie parce que certains membres trouvaient difficile de s'engager dans cette vision métaphysique fondamentale. À cette époque, j'avais déjà publié un certain nombre d'ouvrages, dont De Graal - tussen heidense en christelijke erfenis (= Le Graal - Entre héritage païen et chrétien) sera probablement considéré comme l'un des plus importants. Des articles pour les revues Vers la Tradition, Ars Macionica, Tradition,... indiquent clairement où battait mon cœur. Je me suis plongé de plus en plus profondément dans les auteurs traditionalistes tels que René Guénon, Julius Evola, Ananda K. Coomaraswamy, Frithjof Shuon, Titus Burkhardt, Christophe Levalois, j'ai parcouru des ouvrages savants de Dumézil, De Vries, Guyonvarc'h, Widengren, Gimbutas... et je suis retourné aux sources pour vérifier les choses.
En outre, j'étais particulièrement actif dans la franc-maçonnerie traditionnelle depuis le début des années 1990. Par conséquent, ma connaissance des mystères n'était pas purement académique, mais reposait sur une expérience concrète. Dans l'Ordre, je m'étais consacré à l'enseignement des Frères : exposés sur les principes métaphysiques, recherche de symboles, techniques pratiques, instructions, aphorismes, poèmes et, enfin, pièces littéraires. J'ai pris conscience que la manière dont les choses sont mises en place contribue à déterminer l'impact du contenu. C'est pourquoi, des années plus tard, je me suis aventuré dans la littérature, d'abord la poésie, puis le roman. Le roman est un excellent outil pour faire connaître la pensée traditionnelle au grand public. C'est ainsi qu'est né De laatste heiden (= Les derniers païens). Bien que cette histoire soit basée sur la mythologie nordique, le drame a été complètement transposé à notre époque. Il a constitué la base de mon réalisme magique.
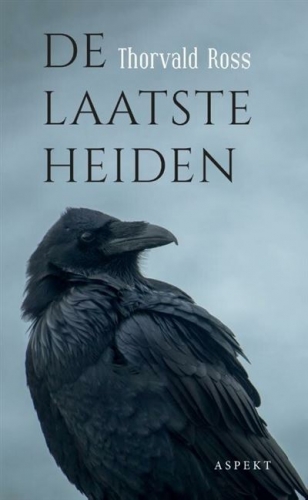
Certains se demandent si, avec De Zwerver, j'ai dit adieu à la pensée nordique. À cela, je réponds résolument : non ! Je place maintenant mon expérience dans un contexte indo-européen plus large, car je pense que les points de vue nordique et indien sont très similaires. Ce n'est que dans la forme qu'elles sont relativement différentes. En fait, l'imagerie nordique reste bien présente dans De Zwerver : par exemple, le pont à la fin du livre (cf. Bifröst), l'entrelacement des mondes (cf. Nevelland), les trois classes (cf. Scuola Sapientia),... Ces thèmes ne sont pas typiquement nordiques, ils sont indo-européens. Ce sont ces grandes lignes indo-européennes que je veux mettre en évidence dans le patrimoine matériel et immatériel de nos Pays-Bas. Soyez assurés que sous la surface, beaucoup de choses sont encore présentes dans nos régions: dans l'étymologie, dans diverses expressions, dans des chansons, dans les coutumes populaires, dans les symboles, dans les structures, dans la législation.
2.
On a dit que votre nouvelle œuvre était d'inspiration néoplatonicienne. Après la mort tragique de Darja Douguina qui, après des études en Russie et en France, défendait une vision traditionaliste marquée par le néo-platonisme, vous semblez vous aussi emprunter la voie du néo-platonisme dans un contexte plus apaisé ? Quel est donc le néo-platonisme de votre héros et comment le néo-platonisme s'inscrit-il dans le paysage intellectuel néerlandais d'hier et d'aujourd'hui ?
C'est effectivement ce que l'ondit. Il existe en effet d'autres systèmes qui présentent une certaine parenté avec le platonisme: l'hermétisme, la kabbale, le gnosticisme, l'advaitisme,... Cependant, cette perception n'est que partiellement vraie. Certes, j'accorde une grande importance à Platon, mais ma vision du monde n'est pas statique. Elle est dynamique, presque taoïste ou héraclitéenne. Tout s'enchaîne dans une sorte de dynamisme tourbillonnant. Cela n'est possible que s'il existe un pivot qui maintient cette confluence. C'est là que réside la tension entre Vishnu et Maya (Mahadêvi/Shakti), qui permet à la manifestation dynamique de prendre forme.
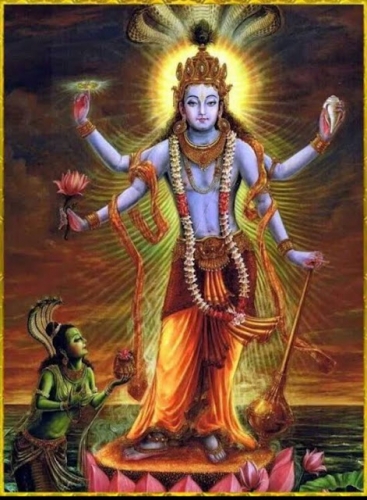
Il est clair que la contemplation est primordiale pour moi, mais cela n'exclut pas l'action (tragique). Je préconise une manière d'être quasi stoïcienne, en gardant toujours à l'esprit les principes métaphysiques et en essayant d'agir en accord avec l'être humain authentique. Concrètement, il s'agit d'abandonner toute forme de morale et de culpabilité. Il s'agit d'une attitude "Jenseits von Gute und Böse". Tout est ce qu'il est. Pour beaucoup, cela semble être une voie sans cœur (on m'en fait parfois le reproche). De l'extérieur, c'est le cas. Mais pour l'essentiel, cette voie est beaucoup plus humaine et élevée. C'est une vision sobre qui perçoit le monde avec détachement. C'est précisément par ce biais que se réalise l'être humain le plus proche (homogène), physiquement, psychiquement et métaphysiquement. Donc pas de rejet de la matière, pas de mépris du corps, pas de mépris du terrestre, mais une acceptation totale de celui-ci, quelles qu'en soient les conséquences. En ce sens, je ne suis guère platonicien - ou du moins pas de la manière dont certains modernistes pensent qu'il faut expliquer Platon. Ma vision est l'extension radicale de ce que Ruusbroec appelle la "sur-image". Il désigne par là une attitude de base qui se situe au-delà des images, mais qui est néanmoins ancrée dans l'ici et le maintenant. Une attitude qui ne se laisse pas emporter par le tourbillon du monde, mais qui s'enracine dans l'origine de toute chose.
La voie active de Daria Douguina et de son père Alexander Douguine, je peux la suivre et la défendre dans une certaine mesure. L'objectif ultime est d'élever le niveau local en un royaume global, c'est-à-dire non seulement dans le cadre d'un ordre administratif, mais aussi dans une structure dotée d'une cohérence spirituelle. Au sein du royaume spirituel, tout groupe organique - de toute culture, religion, ethnie - est assuré d'être lui-même et d'être inclus dans un récit supérieur. Ainsi, la composante populaire est transcendée et liée à un niveau d'être au niveau de l'État - un niveau greffé sur des valeurs spirituelles. Il me semble que c'est là la véritable signification de l'idée d'État, telle que nous l'avons vue s'établir autour de la chrétienté au Moyen-Âge, entre autres.
Là où je m'écarte de l'idée russe, c'est dans la méthode. L'empire n'est pas contraignant. Il doit agir comme un aimant organisationnel qui attire les peuples à lui en faisant rayonner l'autorité. L'autorité (auctoritas) n'est pas la même chose que la force. Cette dernière est l'exercice forcé du pouvoir par la force. Une telle chose ne peut jamais conduire à la stabilité. L'auctoritas représente la dignité, le prestige, l'influence, l'élévation. C'est ce qu'une personne "regarde vers le haut".
Le paysage intellectuel néerlandais actuel est celui du nihilisme, du relativisme, du je m'en foutisme. Peut-être un peu court sur le plan de la substance, il est vrai. Mais c'est bien de cela qu'il s'agit. Tout est remis en question, il ne nous reste que la trivialité, la banalité de notre existence. Pourtant, il existe des écrivains qui parviennent à transcender cette situation et qui jouissent d'une certaine notoriété dans le paysage culturel néerlandais: il suffit de penser à Albert Verwey, Martinus Nijhoff, Pieter Cornelis Boutens, Hubert Lampo, Harry Mulish, Pol le Roy. Il convient toutefois de faire preuve de prudence dans ce domaine également. Dès qu'une interprétation spirituelle est repérée, les gens pensent qu'ils doivent immédiatement invoquer Platon.
Quoi qu'il en soit, j'ai l'intention d'initier une nouvelle profondeur et un nouveau dynamisme dans cette vie, en partant des valeurs traditionnelles qui forment la communauté (horizontalement), mais qui construisent également le pont vers une ouverture transcendante. Dans cette optique, le séculier est intégré dans une histoire plus vaste, une histoire de pouvoirs et de forces cosmiques à l'œuvre ici et maintenant.

3.
Le Zwerver est un personnage "qui part en quête". La quête n'est-elle pas l'essence même de l'homme ? Et en quoi la quête de l'Errant est-elle caractérisée par la Tradition au sens le plus élevé du terme ?
Il est logique que la queste, la quête, le pèlerinage, l'imramma,... soit le fondement de l'existence. C'est aussi vieux que le monde. Nous sommes ici en transit à la recherche de quelque chose que nous avons perdu: notre origine, notre être, notre essence, notre patrie, une petite perle, un mot, une félicité... La quête renvoie à l'aliénation, à un état dégénéré. Mais ne vous y trompez pas: la plupart des gens - malgré le parcours de leur vie - ne s'y attardent pas. Ils se contentent de flotter sur les eaux et, parfois, ils sont engloutis par les eaux, engloutis tout entiers. Ils sont habités par la dynamique de l'agitation. Ils ne contrôlent pas la vie, ou plutôt: ils ne la vivent pas ! C'est là que réside le problème. Mon personnage principal, en revanche, fait tout ce qu'il peut pour échapper à ce qui conditionne les humains. Il va même jusqu'à se sacrifier - encore et encore - pour échapper à la mort par la mort. Cela lui permet d'atteindre les limites du concevable. Même si tout s'y effondre, tout y repart à zéro. Finalement, le chemin devient le but.
4.
Le Zwerver se retrouve dans une ville idéale. N'est-ce pas une utopie ? Quelle est la différence entre cette petite ville idéale italienne et l'Utopie de Thomas More ou entre cette ville et les utopies modernes qui veulent effacer le passé ?
Sans aucun doute, Civitas Ludum est une utopie au sens propre du terme: un non-lieu (ou-topos). Elle constitue une sorte de société juste dans laquelle le jeu joue un rôle crucial. Le maire, et ce n'est pas une coïncidence, est Prospero, le magicien philosophe de La Tempête de Shakespeare. Et oui, il existe des similitudes (involontaires) entre l'Utopie de Thomas More et la Civitas Ludum dans mon roman De Zwerver. Les deux représentent une société inspirée par la philosophie. Pourtant, dans Civitas Ludum, aucun jugement n'est porté sur la propriété, ni sur l'esclavage, aucun État-providence n'est mis en place, aucune nouvelle forme de socialisme n'est introduite, aucune idée sur la fonction de la religion n'est proposée.
Civitas Ludum fait référence au stade de l'enfance dans la vie humaine. Elle est utilisée pour réfléchir à l'importance du jeu, à l'enthousiasme avec lequel on s'absorbe dans le jeu, en se perdant dans le rôle que l'on joue. En ce sens, le jeu est une métaphore de la vie elle-même : "All the world's a stage, And all the men and women merely players" (As You Like It, Shakespeare, II, scène 7). Mais il y a plus: dans Civitas Ludum, chacun a des cartes à jouer différentes, et ces cartes déterminent le caractère, les forces et les faiblesses, les sensibilités... C'est avec cela que l'on joue la vie. Non pas une perfection idéale, mais une perfection dans les limites imparties. De plus, dans cette vision, l'individualité n'est pas détruite, mais embrassée. Il ne s'agit pas d'un effacement de ce que l'on a été, ni d'une incompréhension de toute la culture, mais d'une acceptation totale de ce qui est imparfait et de ce qui est prometteur. En jouant, l'homme authentique prend vie, sans affectation, sans mentalité factice, mais tel qu'il est vraiment. Et par le jeu, l'homme s'élève dans cette authenticité. Il apprend à découvrir les qualités qui lui permettent de se réaliser. Le jeu est donc à la base de la civilisation, du rituel, de la danse, du développement. Sa discussion critique ébranle la vision moderne du travail. Si le travail était vécu comme un enthousiasme intact, comme l'est le jeu, alors la vie, le jeu et le travail coïncideraient et engendreraient une expérience totalement différente : une expérience de bonheur.
5.
Existe-t-il une analogie entre cette petite ville magnifique et le labyrinthe du monde de Jan Amos Comenius ? Pouvez-vous l'expliquer ?
Bien sûr, on ne peut pas l'éviter. Chez Comenius, il s'agit d'un lieu en forme de labyrinthe où le personnage - le pèlerin - part à la recherche de la profession qui lui convient le mieux. Chez moi, il s'agit d'une ville à triple enceinte où, dans chacun des quatre quartiers (qui relèvent d'une sorte de jeu de cartes), tel ou tel personnage coïncide avec un état spécifique. Le bord extérieur est dominé par la danse itinérante. La foule y est presque magiquement forcée de danser la roue de Fortuna. Elle subit simplement la vie. Entre les deux se trouve le champ de travail, le lieu où l'homme lutte avec lui-même pour s'affiner et coïncider avec l'homme authentique. L'homme authentique devient rempli d'un Amour supérieur. Tout ce qu'il fait sert un but plus élevé. Tout ce que l'homme fait sien remonte à la surface dans la ville. Ainsi, mon personnage principal est particulièrement enclin à la vanité, qui est induite par l'ego et renforcée par l'orgueil.
6.
Le Zwerver, dans les faubourgs de cette ville où se trouve une école de pensée, avoue ses erreurs. S'agit-il de vos propres erreurs de jeunesse que vous confessez là, à l'âge où vous entrez dans le "troisième âge" ?
Oh, vous savez, un roman est toujours en partie autobiographique. J'ai certainement commis des erreurs dans ma vie. Il est important de le reconnaître. Mais - et les gens l'oublient trop souvent - ce n'est pas une raison pour commencer à se plaindre et à s'en vouloir. Ce genre de culpabilité et de moralisation du comportement m'est étranger. J'accepte tout, mais vraiment tout, ce que j'ai fait ou n'ai pas fait dans le passé. C'est précisément ce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je n'ai plus 20 ans. Chaque âge a ses charmes et ses défis. Mais l'enthousiasme de la jeunesse m'a conféré une maturité somptueuse que je chéris aujourd'hui. La folie téméraire (et je le dis expressément ici en faisant référence à der reine Tor de Parzifal) avec laquelle j'ai longtemps lutté s'est finalement avérée être l'atout qui m'a permis de gagner la bataille. Sans cette folie, sans ce coin perdu, sans cette naïveté, le processus d'apprentissage aurait été complètement différent. Peut-être n'aurais-je pas écrit de livres, peut-être serais-je devenu un grand industriel ne pensant qu'au profit. Mais je me suis engagé dans cette voie sans plan sophistiqué. J'ai suivi cette voie avec honnêteté et constance, et voilà que des miracles apparaissent parfois sur votre chemin.
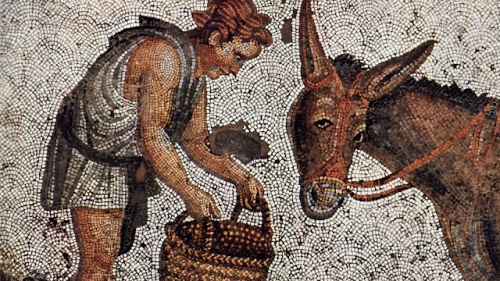
7.
La promotion de votre livre parle d'une influence secrète d'Apulée et de Dante. Que devrait retenir le traditionaliste anticonformiste contemporain de ces auteurs anciens et médiévaux ?
Ceux qui me connaissent savent à quel point l'Antiquité et le Moyen Âge sont importants pour moi. Dans mon œuvre, Pythagore, Platon, Origène, Apulée, Dante, Shakespeare, Rabelais, ... sont imbriqués dans des noms, des formes de pensée, des symboles, .... En ce sens, mon livre peut également être lu comme un voyage à travers les penseurs qui ont contribué à façonner mes pensées et que j'ai englobés dans la toile du roman. Apulée fait partie de ces grands qui ont su faire passer le message des mystères de manière magistrale - avec l'humour nécessaire - sans en trahir aucun aspect. Logique que j'exploite son âne. Il y a tant à dire sur Dante qu'il est presque impossible d'exposer son influence en toute finesse. En tant que Gibelin, il a conservé la finesse du discours spirituel en s'engageant avec les Fidele d'Amore. La façon dont il joue si subtilement des aspects de l'imagerie secrète entourant la Dame dans La Vita Nuova est tout simplement grandiose. En outre, il est l'un des écrivains médiévaux qui ont joué un rôle politique important en transmettant l'héritage spirituel des chevaliers du Temple. Mais ce que j'admire par-dessus tout, c'est l'image globale qu'il donne des affaires du monde en relation avec le plus haut niveau. C'est tout simplement grandiose. Je suis envieux quand je vois à quels géants nous avions affaire. Ce que nous, écrivains contemporains, pouvons encore faire, c'est bricoler dans les marges. Nous ne pouvons plus créer une image globale, une image plus grande, une vision cosmique. C'est donc là que commence le travail du traditionaliste, c'est là qu'il doit restaurer, c'est là qu'est sa tâche.
17:31 Publié dans Entretiens, Littérature, Livre, Livre, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : thorval ross, lettres, lettres néerlandaises, littérature, littérature néerlandaise, livre, quête, entretien, traditions, traditionalisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 01 avril 2023
La géopolitique anglo-américaine et la mer

La géopolitique anglo-américaine et la mer
"Talassocrazia" est un essai intéressant de Marco Ghisetti sur les relations de pouvoir mondiales liées à la terre, à l'eau et à l'air.
par Andrea Scarano
Source: https://www.barbadillo.it/108636-la-geopolitica-anglo-americana-e-il-mare/
Géopolitique
Les descriptions méthodiques des espaces, des équilibres et de la répartition du pouvoir entre les États figurent parmi les principales modalités de l'approche géopolitique des relations internationales. Marco Ghisetti (auteur de Talassocracia - I fondamenti della geopolitica anglo-statutitense, publié en 2021 par Anteo edizioni) se demande si ce type d'analyse conserve sa validité face aux profondes transformations économiques, technologiques et militaires de notre époque. Il compare la pensée des "pionniers" et des classiques du sujet - Mahan, Mackinder et Spykman - qui ont vécu au tournant des 19ème et 20ème siècles, sans pour autant négliger les développements les plus récents.
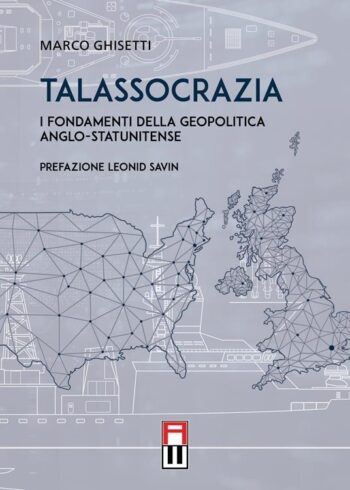
L'essai de Ghisetti sur la thalassocratie chez Anteo Edizioni
Puissances maritimes et puissances terrestres
Le fait que la réflexion ne concerne pas exclusivement les cercles académiques est évident au cours d'un récit largement fondé sur la centralité de la domination de la mer et du contrôle de ses centres névralgiques, sur le contraste entre les puissances navales et terrestres, sur l'éternelle nécessité pour les États-Unis - une puissance "insulaire" de facto, héritière de l'Empire britannique - de s'étendre à la recherche de nouveaux marchés et de se doter, en temps de paix comme en temps de guerre, d'une flotte efficace, y compris pour des raisons de défense nationale.
La pertinence de facteurs tels que la géographie comme élément permanent, le caractère illusoire de l'idée que les conflits d'intérêts entre nations "civilisées" ne peuvent conduire à des guerres et le poids décisif de l'action humaine introduisent le débat sur des catégories imperceptiblement mobiles telles que le "cœur de la terre", zone charnière du continent asiatique qui peut en fait être étendue à l'Allemagne, zone enclavée et point d'appui de la puissance terrestre, réserve inépuisable de matières premières, terre d'où proviennent les menaces récurrentes à la suprématie de Washington.
La connaissance des relations privilégiées entre cette dernière et Londres permet de réfléchir au choix presque apriorique de l'Angleterre (géographiquement "partie intégrante de l'Europe") de boycotter systématiquement l'idée d'un continent unifié, notamment parce que - comme l'a rappelé Jean Thiriart il y a quelques années - cela aurait provoqué la création d'une force capable de l'envahir. C'est dans ce sens que l'on peut interpréter la mise en garde de Mackinder, partisan convaincu en 1943 d'une alliance élargie à l'Union soviétique et à la France en tant que "tête de pont", selon laquelle les États-Unis devaient participer activement aux politiques d'équilibre soutenues par le Royaume de Sa Majesté, qui visaient à s'opposer à l'ennemi terrestre allemand sous la forme de puissances amphibies.

L'antinomie entre les peuples maritimes, démocratiques et idéalistes d'une part, et les peuples terrestres, autoritaires et organisateurs d'autre part, ne masque cependant pas certaines faiblesses, qui sont soulignées lorsque Mahan soutient, par exemple, que les embargos économiques et alimentaires entraînent un faible coût en vie et en souffrance et que l'ouverture globale au commerce et aux processus de vie européens génère automatiquement des bénéfices pour l'ensemble de l'humanité ; ou lorsque Mackinder fait l'éloge de la tendance des Britanniques à conclure des alliances avec des pays plus faibles tout en omettant de préciser leurs intentions de diviser pour régner et, pire encore, d'évoquer les massacres perpétrés contre les Irlandais.
L'introduction du terme Eurasie - grand ensemble géographique formé d'un centre, d'un croissant intérieur (péninsule européenne, Asie du Sud-Ouest, Inde et Chine) et d'un croissant extérieur (États-Unis, Grande-Bretagne, Japon et Australie) - comme conception du monde intimement liée à l'idéalisation de l'homme "continental" s'accompagne du déploiement de trois enjeux cruciaux, de la division en deux moitiés physiquement très inégales, la délimitation de l'Europe selon une ligne de partage - celle de l'Oural - considérée par beaucoup comme insatisfaisante, et la dispute complexe autour de l'identité de la Russie, essentiellement suspendue entre un substrat européen et un élément tartare-asiatique.
Le postulat de l'appartenance à une civilisation eurasiatique a été récemment revisité et en partie idéologisé par le courant de pensée néo-eurasiste qui, au nom de la coopération économique, politique et militaire de deux acteurs "obligés" par l'histoire et la géographie de partager un destin commun, s'oppose vigoureusement au "glissement" du vieux continent dans un état de subalternité par rapport aux Etats-Unis et à l'OTAN ; une perspective exactement identique à celle qui prône, de l'autre côté de l'océan, l'expansion vers l'est de l'Europe et de l'Alliance atlantique, utilisées comme avant-postes "démocratiques".
La nouvelle hégémonie américaine
La nature profondément anarchique de la communauté internationale et la lutte constante pour le pouvoir comme boussole de la politique étrangère des nations sont les pierres angulaires qui guident l'élaboration par Spykman de la stratégie d'"endiguement" de l'URSS suite à la Seconde Guerre mondiale ; une vision extrêmement réaliste attribue aux différents pays des priorités divergentes, à l'équilibre planétaire (susceptible d'évoluer comme un champ magnétique soumis à des changements de force relative ou à l'émergence de nouveaux pôles) les traits de l'instabilité et aux États-Unis, facilités par une situation géographique enviable, un rôle dominant.
L'insuffisance de la domination maritime pour garantir une position hégémonique est, en revanche, la principale justification de la théorisation du "droit" de l'administration étoilée à s'implanter militairement et durablement à la fois dans les territoires d'outre-mer et dans la zone frontalière euro-asiatique, exerçant une fonction d'"overseas balancer" où le choc des puissances menace cycliquement de s'intensifier.

L'identification d'une ligne de fracture entre l'ancien et le nouveau monde est aussi pertinente pour l'inclusion du Royaume-Uni dans le premier que pour l'hypothèse - considérée comme tout sauf lointaine - d'une alliance entre le Japon, l'Allemagne, l'Italie et l'URSS, accréditée par les intentions de Staline de travailler à un armistice avec les Allemands après la bataille de Stalingrad et par des précédents symptomatiques, tels que les accords Molotov - Ribbentrop et le pacte de non-agression nippo-soviétique.
La promotion par les deux superpuissances de l'indépendance des colonies vis-à-vis des empires européens après 1945 est interprétée par l'auteur comme une politique visant à la remplacer par une forme plus sophistiquée de domination, visant des États formellement libres mais fortement dépendants économiquement.
Dans cette perspective, la reconstitution de certains passages historiques cruciaux - des caractéristiques de la doctrine Wilson au besoin de dominer les marchés européens, besoin manifesté depuis la crise de 1929, de l'obstination pour obtenir la capitulation inconditionnelle des puissances de l'Axe à la nécessité de lier à soi le processus de reconstruction d'après-guerre à travers le Plan Marshall et la division de l'Europe en deux - constitue le cadre dans lequel les États-Unis ont poursuivi d'abord l'objectif de détruire définitivement la suprématie de cette dernière et ensuite celui de l'intégrer dans le système capitaliste de marché, dans un état de subalternité qui était également flagrant d'un point de vue militaire.
Il est significatif de rappeler comment, minimisant les justifications idéologiques courantes utilisées pour démêler le sens des guerres menées au 20ème siècle par les États-Unis en Corée et au Viêt Nam, Henry Kissinger s'est précisément référé à des raisons géopolitiques dans la crainte plus générale que le Japon ne se lie politiquement à l'URSS, glissant dans les sables mouvants préconçus par la "théorie des dominos".
Enfin, la dimension culturelle de la primauté de la thalassocratie, fondée sur un concept problématique comme celui d'"Occident", géographiquement incertain, instrument des projets d'incorporation méditerranéenne et de la stabilisation des rapports de force consolidés depuis l'aube de la guerre froide, sur la base de l'acceptation sans critique de l'américanisme comme destin par les Européens, n'est certainement pas la moindre.

La force du yen et l'économie de la concurrence chinoise sont des facteurs qui ont joué un rôle important dans le développement de la région.
Concurrence chinoise
Si, après l'effondrement du communisme, l'élargissement de l'OTAN à l'Est a sans doute eu pour fonction de dévitaliser les mécanismes de fonctionnement de l'UE, la capacité des Etats-Unis à s'ériger en seul hégémon régional et à entraver les autres acteurs désireux d'en faire autant a trouvé une nouvelle confirmation dans la représentation des "trois Méditerranées" identifiées par Yves Lacoste : l'américaine, avant-poste de l'expansionnisme dans l'Atlantique et le Pacifique ; l'européenne, facilitée par l'aplatissement des oligarchies continentales et la pénétration de la politique du "diviser pour régner" sur ses rives méridionales ; l'asiatique, où les Etats-Unis se sont imposés dans le passé aux dépens du Japon et sont aujourd'hui concurrencés par la Chine. Dans ce dernier cas, la collaboration avec les pays de second rang de la région (qui ne veulent pas se retrouver dans l'orbite d'influence de Pékin) est configurée comme une tentative de réponse aux itinéraires de la nouvelle route de la soie, un signe significatif non seulement d'ouverture au capital et au commerce international, mais aussi d'un changement radical de perspective en ce qui concerne l'attention portée à l'importance de la mer.
Conclusions
L'ouvrage de Ghisetti, qui n'est pas toujours lisse sur le plan stylistique, est enrichi par l'analyse des documents stratégiques anglo-américains rédigés en 2020-21, qui laissent présager une remise en question de l'effort d'intégration continentale et de coopération entre la Russie, la Chine et (à l'arrière-plan) l'Iran, le tout assorti du renforcement express des forces militaires ukrainiennes, comme autant de " prolongements " naturels d'un processus de déstabilisation initié à la fin de la guerre froide dans l'espace eurasiatique et dans le Caucase, " cœur de la terre " potentiellement menaçant pour les équilibres existants.
Accusée de déterminisme et parfois même de cautionner des " pulsions " autoritaires, la géopolitique apparaît à l'heure de la mondialisation comme une discipline plus à même - comme l'affirme également l'auteur - de fournir des outils appréciables de compréhension et de prévision des actions des acteurs politiques, en partie encore conditionnées par l'influence des classiques.
16:34 Publié dans Actualité, Géopolitique, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, thalassocratie, livre |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 09 mars 2023
Changer l'image du monde - Réflexions sur le dernier livre de Carlo Rovelli

Changer l'image du monde
Réflexions sur le dernier livre de Carlo Rovelli
par Pierluigi Fagan
Source : Pierluigi Fagan & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/cambiamento-dell-immagine-del-mondo
Dans son livre Buchi bianchi - Dentro l'orizzonte, qui vient de paraître chez Adelphi, Carlo Rovelli réfléchit, entre autres, à la dynamique de la connaissance. Sur l'aspect spécifique de l'image changeante du monde, il note que nous devons d'abord aller aux confins de nos connaissances. La connaissance est, par analogie, comme une sphère au centre de laquelle nous savons et à la périphérie de laquelle nous savons moins, jusqu'à ce qu'au lieu de nous retourner vers ce que nous savons, nous défions ce qui est au-delà, ce que nous ne savons pas.
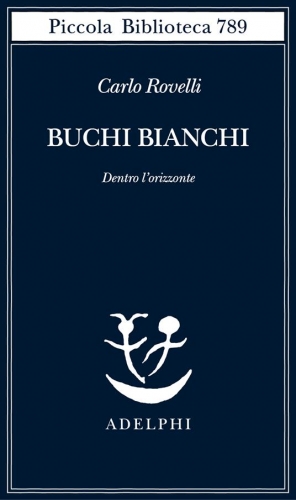
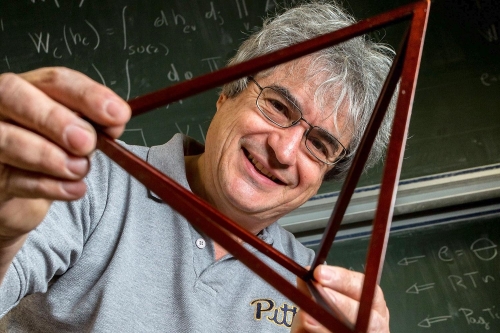
Ce faisant, nous ne pouvons nous empêcher d'utiliser les connaissances que nous avons, mais pas complètement. C'est un équilibre délicat qu'il faut rechercher. Au 12ème siècle déjà, Bernard de Chartres utilisait l'expression "nous sommes comme des nains sur les épaules de géants", pour dire que la connaissance des géants nous élève un peu plus haut, là où, cependant, même les géants que nous utilisons pour élever notre regard ne pourraient pas voir. L'équilibre consiste donc à trouver le bon dosage entre les connaissances dont nous héritons et que nous faisons nôtres et le pari, par essais et erreurs, de produire de nouvelles connaissances. Si nous essayons uniquement d'utiliser de nouvelles pensées, nous ne saurons même pas où les trouver, car nous pensons en réorganisant continuellement d'anciennes connaissances. À l'inverse, si nous n'utilisons que des connaissances anciennes, nous resterons au centre confortable de notre savoir qui, cependant, ne sait pas ce qui se trouve au-delà de lui-même.
Selon Rovelli, cette utilisation partielle des connaissances connues pour défier l'inconnu est le pouvoir de l'analogie, qui consiste à utiliser des concepts placés dans certains contextes et à les déplacer dans d'autres contextes. Puisque la signification émerge de la relation entre le concept et son contexte, le changement de son contexte devrait produire de nouvelles significations. Cela devrait correspondre, en termes neuronaux, à l'activation de nouvelles voies, c'est-à-dire de nouvelles dendrites et de nouveaux axones entre les neurones ou les groupes de neurones. Autrement dit, il s'agit de réorganiser l'architecture mentale.
Aujourd'hui, de nombreuses personnes s'efforcent de trouver de nouveaux concepts, mais il semble que le principal problème de nombreuses images du monde réside dans leur architecture.
Pour mener à bien cette réorganisation du mental, un changement de point de vue peut aider, de même que la mise en évidence de ce qui ne correspondait pas tout à fait à l'usage de nos anciennes connaissances. Mais c'est ici qu'intervient une véritable psychologie de la connaissance. Il existe des personnes qui, au cours de leur vie, se construisent une image du monde basée sur certaines connaissances et versions de ces connaissances (théories). Elles passent ensuite toute leur vie au centre de leur domaine cognitif, convaincues que dans l'image du monde, l'image est plus importante que le monde. L'image devient le monde. Si on leur présentait des faits hors de la théorie, comme ils ne vont certainement pas les chercher, ils les balaient sous le tapis.
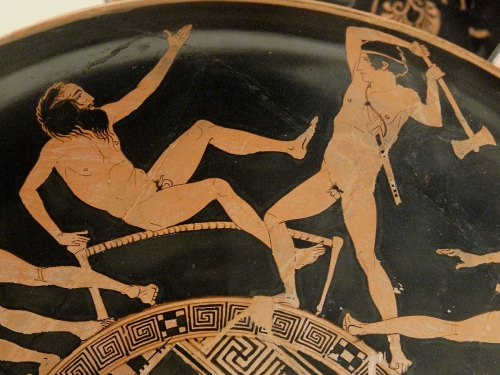
Il existe également une forme active appelée le "lit de Procuste". La métaphore grecque antique raconte l'histoire d'un homme qui garde un col de montagne. Ayant construit un lit de pierre, il ne laissera passer le voyageur imprudent que si ce dernier a exactement la longueur du lit. Aux petits voyageurs, il tendra les membres à l'aide de cordes et d'engins, aux plus grands, il sciera les jambes jusqu'à ce qu'elles correspondent à la taille du lit. Ainsi, certains brouilleront les faits pour les faire correspondre à leur propre mentalité. L'image, c'est-à-dire le lit, c'est-à-dire la forme de sa mentalité, est plus importante que le monde, c'est-à-dire le voyageur, ce dernier doit correspondre au premier. La première dislocation du point de vue pour s'ouvrir à un changement de l'image du monde consiste à s'accrocher fermement à la conviction que toute image est sous-déterminée par rapport au monde qu'elle est censée refléter.
Il existe des frictions, des lacets et des conditionnements considérables qui ralentissent ou empêchent tout à fait le changement d'image du monde.
Premièrement, le fait que nous soyons notre image du monde, l'image du monde est l'essence mentale de notre identité. L'identité comportementale en dépend. L'identité est une construction qui sert à être dans le monde, difficile de mettre en péril sa vigueur dans des processus de révision dont nous ne ressentons souvent pas le besoin. De plus, être ouvert à l'image changeante du monde n'est qu'une "ouverture", ce n'est pas comme une robe que l'on change en peu de temps, c'est se mettre en mode "travail en cours" et cela implique des états d'incertitude. S'il y a une chose que les identités détestent, c'est l'état d'incertitude.
Deuxièmement, nous avons certainement une image personnelle du monde, mais il s'agit surtout d'une déclinaison particulière d'une image collective et partagée du monde. Ce peut être l'image du monde moyenne ou celle d'un groupe particulier, même un petit groupe, une secte. Plus le groupe qui partage une image du monde est petit, plus sa défense est dogmatique ; tout réviseur de l'image du monde partagée est un sécessionniste potentiel du groupe, une menace d'hérésie. S'ouvrir à la révision de l'image du monde, c'est courir le risque de la solitude et du détachement de notre groupe social.
Troisièmement, il faut noter que l'image du monde est une construction très complexe ; pratiquement personne n'a une connaissance précise de l'ampleur et de la complexité de sa structure. Même si l'on était sérieusement déterminé à y mettre la main en acceptant le prix psychologique de l'incertitude et de la solitude, il est fort douteux qu'un individu puisse y parvenir en termes de capacité. De plus, comme il ne s'agit pas d'un système régi par un interrupteur qui mène de l'état A à l'état B, s'ouvrir à la révision, c'est s'ouvrir à une période plus ou moins longue d'incertitude et de solitude, ainsi qu'à la frustration des erreurs résultant des diverses tentatives. Parfois, c'est la stabilité psychique et la fonctionnalité même qui entrent en jeu.

Quatrièmement, il existe des mécanismes mentaux qui ont été sélectionnés par notre histoire adaptative en tant qu'espèce, afin de défendre l'image du monde dominante, quelle qu'elle soit, même dans ses formes les plus déconcertantes et paradoxales. Une fois qu'il est établi que l'image est plus importante que le monde qu'elle est censée refléter, tout est possible. La collecte des croyances de divers peuples, à diverses époques historiques, croyances conduisant aux comportements les plus bizarres, nous indique comment il existe des mécanismes internes de l'esprit, conçus pour défendre à tout prix la structure existante de l'image du monde.
L'un de ces mécanismes est la cohérence interne, une sorte de principe de non-contradiction requis par la logique même qui régit le mental. Plus l'image-monde s'est détachée du monde, plus elle se consacre à la guérison de ses contradictions internes d'une manière purement formelle. Dans la théorie de la dissonance cognitive de Festinger, la dissonance se soigne de trois manières. Deux options d'abord: à savoir changer la partie du monde qui génère des contradictions et changer notre comportement pour surmonter les contradictions, présupposent une forte présence du monde en tant que tel. La troisième option consiste à changer l'image du monde, mais nous savons que les images du monde, le plus souvent, remplacent le monde réel par un monde mental dont nous sommes, ou peut-être pensons-nous seulement être, le démiurge. Le plus souvent, nous traitons la dissonance cognitive de l'image du monde par des dénis, des aveuglements partiels, des lits de Procuste, de fausses analogies et des illusions, plutôt que de la changer, de changer de comportement ou de changer le monde.
Le moteur des illusions est né lorsque, dans le long temps de notre adaptation en tant qu'espèce ou peut-être en tant que genre, une cognition et une auto-cognition accomplies nous ont apporté le fruit amer de savoir que nous allons mourir. L'ensemble de notre complexion biologique, comme toutes les autres dans le vivant, a évolué pour nous faire être. C'est à partir de cette complexion que notre genre ou espèce a vu évoluer la cognition, notre arme adaptative la plus importante. Mais malheureusement, c'est là qu'apparaît la première contradiction, à savoir savoir que malgré tout, tôt ou tard, nous ne serons plus. De cette première contradiction naît le premier produit du moteur illusionniste : nous ne mourrons jamais ou complètement. A partir de là, le moteur illusionniste a produit toutes les idées folles pour nous donner l'impression que notre image du monde n'est pas contradictoire, que la cognition n'est pas dissonante. Sa cohérence interne est plus importante que sa pertinence par rapport au monde, et c'est souvent la défense obstinée de cette cohérence qui nous conduit à détacher notre esprit du monde pour ce qu'il est.

À propos de la cohérence interne, il convient de noter que l'intérieur mental comporte le rationnel conscient autant que le non-rationnel dont nous sommes souvent inconscients. La première cohérence requise est entre ces deux niveaux où, cependant, le niveau non rationnel et inconscient dicte les métriques, les "émotions" sont les formes les plus anciennes du mental que nous possédons, sélectionnées le long de la ligne qui a conduit des vertébrés aux mammifères, puis de ceux-ci aux singes et enfin aux différents types d'hominidés qui sont finalement arrivés jusqu'à nous. Ce niveau est donc inatteignable mais aussi, de façon purement théorique, inchangeable. Pour résoudre les dissonances cognitives, nous n'avons donc pas d'autre choix que de bourrer d'illusions les images du monde et, pour ne pas les révéler comme telles, de les détacher autant que possible du monde.
Dans les périodes de profonde transition historique, tout ce que nous avons brièvement évoqué ici montre sa phénoménologie la plus intense, car lorsque le monde change et qu'il faut au contraire défendre la vigueur des images du monde qui reflétaient en quelque sorte le monde passé, tout le système se met en défaut, de façon répétée.
19:58 Publié dans Livre, Livre, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, philosophie, carlo rovelli |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Irlande. L'histoire de l'I.R.A. des origines à 1970

Irlande. L'histoire de l'I.R.A. des origines à 1970
Le livre de Tim Pat Coogan retrace un pan de l'histoire de l'irrédentisme irlandais entre documents et témoignages de militants
par Giovanni Sessa
Source: https://www.barbadillo.it/108308-irlanda-la-storia-dellira-dalle-origini-al-1970/
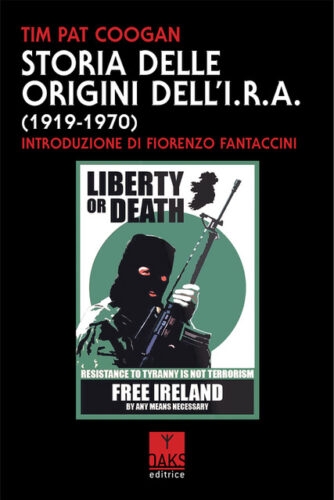
Recension: Storia delle origini de l'I.R.A. (1917-1970) (= Histoire des origines de l'Ira (1917-1970)).
L'histoire de l'indépendance irlandaise a été marquée par des gestes héroïques, des sacrifices extrêmes et le recours à la violence dans certaines circonstances. Au centre de ce conglomérat historique se trouve l'I.R.A., l'armée républicaine d'indépendance, dont l'origine et les vicissitudes internes sont éclaircies dans les pages d'un intéressant volume de Tim Pat Coogan, History of the origins of the I.R.A. (1919-1970), en librairie en Italie, grâce aux éditions Oaks, avec une préface de Fiorenzo Fantaccini (sur commande : info@oakseditrice.it, pp. 317, euro 24,00).

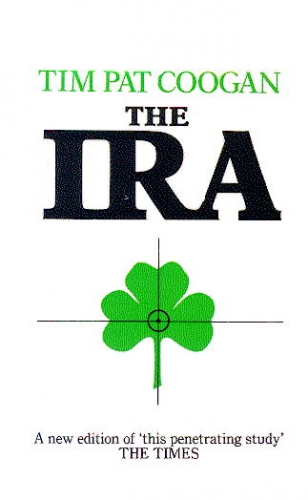
L'auteur est né dans une famille marquée par le nationalisme. Son père a contribué, nous rappelle la préface, à la création du système judiciaire irlandais, né pour remplacer le système anglais. Dans les années 1940, il était secrétaire du Fine Gael, un groupe politique modéré issu de la scission qui a divisé le Sinn Féin. Sa mère, actrice et journaliste, a publié un roman historique à grand succès, The Big Wind. À peine plus qu'un adolescent, Coogan a commencé à écrire pour l'Evening Press, devenant plus tard rédacteur en chef de l'Irish Press pendant une vingtaine d'années.
En 1966, un de ses livres est publié sur l'histoire de l'Irlande après la révolte de 1916. Jusqu'alors, l'indépendance avait eu, comme références culturelles, l'histoire ancienne de l'île d'émeraude, la mythologie celtique et les suggestions littéraires qui y étaient liées. Il était nécessaire, selon notre auteur, d'attirer l'attention sur les événements contemporains. À cette fin, le livre contenait un chapitre consacré à l'I.R.A. Au vu du succès de ce premier texte, on demanda à Coogan d'écrire un livre pionnier consacré uniquement à l'histoire de l'I.R.A. Il accepta et commença à travailler sur ce nouvel ouvrage en 1967. Dans ces années-là, l'armée républicaine semblait "endormie", une sorte de "volcan éteint" : "mais juste avant la publication du volume, en 1970, des émeutes interconfessionnelles avaient eu lieu en Ulster, marquant le début des [...] Troubles et remettant au premier plan le conflit entre les communautés catholique et protestante" (p. III). En 1969, en outre, l'I.R.A. provisoire avait vu le jour en raison de divisions internes. Certains ministres irlandais ont été accusés, mais plus tard acquittés, d'avoir fourni des armes à cette fraction révolutionnaire.

L'Histoire des origines de l'I.R.A. a un mérite fondamental. Non seulement elle fait appel à une vaste documentation sur le sujet étudié, mais elle se réfère également aux expériences directes de nombreux militants, interrogés par l'auteur. Les cadres de l'armée républicaine ont d'abord fait preuve de méfiance à l'égard de Coogan. Le chef d'état-major de l'I.R.A., Cathal Goulding, a donné pour instruction à ses subordonnés de ne faire aucune déclaration d'aucune sorte. Coogan, lors de la première approche avec eux, a tenté de les rassurer sur ses intentions et, lors du deuxième entretien, a obtenu des informations significatives. Grâce à cette méthode, il a recueilli plus de cinq cents témoignages, qui constituent le cœur du volume que nous présentons. L'édition italienne reproduit la première version du livre, qui a été un best-seller en Irlande. Par la suite, jusqu'en 2002, le texte a été édité plusieurs fois et mis à jour. La reconstruction-narration historique commence dans les années 1920 et va jusqu'au début des années 1970. L'exégèse de la "question irlandaise" remonte loin dans le temps. Elle va de la colonisation des six comtés d'Ulster en 1609 par Jacques Ier à la création des Irlandais unis par Wolfe Tone [...] (en passant par) la grande famine et les conséquences de l'Acte d'Union de l'Angleterre et de l'Irlande en 1800" (p. VI).
Le livre reconstitue minutieusement l'histoire de l'I.R.A., qui s'est levée pour défendre le Home Rule et pour réaliser l'unité irlandaise, qui devait inclure les comtés du nord. Les statuts de l'Armée républicaine ont été rédigés en 1923. Depuis lors, l'organisation a connu des phases de développement alternées. Les chapitres que l'auteur consacre aux relations de l'I.R.A. avec les Etats-Unis, compte tenu de la présence d'un nombre important de patriotes irlandais dans ce pays, avec la Russie et avec l'Allemagne nazie sont particulièrement pertinents. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands avaient intérêt à affaiblir la Grande-Bretagne en fomentant des actes de sabotage qui devaient être réalisés par des membres de l'Armée républicaine irlandaise. La position de neutralité, adoptée par le gouvernement irlandais de De Valera, a empêché que cela ne se produise. Les chapitres consacrés à la campagne terroriste menée en Angleterre entre 1939 et 1940, le récit de l'internement des républicains pendant la Seconde Guerre mondiale et les "Border Campaigns" des années 1950, à l'origine du conflit ethnico-religieux des décennies suivantes, sont importants pour l'histoire.

Les entretiens, qui sont bien reliés à la documentation fournie par l'auteur, montrent l'hétérogénéité idéologique de l'I.R.A. Coogan, par moments, s'attarde sur la description d'événements dramatiques impliquant des militants de l'Armée républicaine. D'une part, il condamne fermement le recours à la violence et précise que le livre n'a pas pour objectif de faire du prosélytisme en faveur de la lutte armée ; d'autre part, ses pages révèlent le courage et l'idéalisme des membres de l'I.R.A. Comme paradigme des intentions de Coogan, on pourrait choisir la figure de Dan Breen qui, en 1919, avec un groupe de camarades, a tué deux policiers anglais. Il s'est ensuite converti à la praxis politique du constitutionnalisme, dont les objectifs sont symbolisés par le drapeau irlandais : "Je suis profondément convaincu que l'unité irlandaise sera réalisée [...] non par la force, mais par un accord semblable à celui du drapeau irlandais : vert pour le Sud catholique, orange pour le Nord protestant, et blanc pour la paix entre les deux parties" (p. 13).
Malgré cela, Coogan reconnaît avoir tiré une leçon essentielle de ses rencontres avec les hommes de l'I.R.A. : l'histoire est le produit de l'action humaine. Aussi, dans les pages où il raconte le dur emprisonnement auquel ils ont été soumis ou rappelle leurs exécutions sommaires, il honore leur courage, leur esprit de sacrifice et leur mémoire.
19:31 Publié dans Affaires européennes, Histoire, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : irlande, histoire, ira, livre, tom pat coogan, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 03 mars 2023
La guerre de deux cents ans : une tenaille et un blocus sur l'Europe
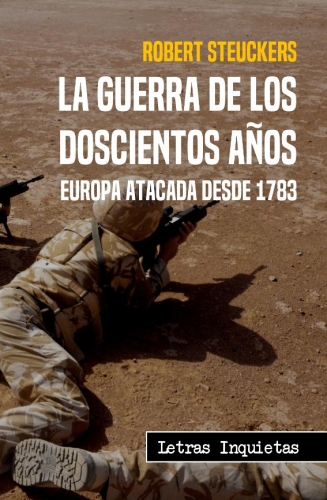
La guerre de deux cents ans : une tenaille et un blocus sur l'Europe
Carlos X. Blanco
Source: https://elrelector.ntvespana.com/la-guerra-de-los-doscientos-anos-una-tenaza-y-un-bloqueo-sobre-europa/
Les textes de Robert Steuckers sont imprégnés d'érudition géopolitique. En même temps, cette érudition géopolitique n'est pas celle que l'on retrouve habituellement chez les "experts". On connaît la manie statistique et anhistorique de tant d'"experts en géopolitique", une discipline devenue à la mode. Ils commencent généralement leurs conférences en disant : "Je vais vous donner un fait". Et ainsi de suite : "un fait, un autre fait...".
Dans le cas de Steuckers, ce n'est pas le cas. Son approche de la géopolitique est essentiellement historique. Je vois, derrière ses réflexions parfois hâtives et fulgurantes, une logique directrice : l'histoire se répète. Dans l'histoire, il y a des ondes sismiques qui s'étendent dans le temps et l'espace, et, comme pour les tremblements de terre, il n'y a pas de secousse sérieuse sans répliques.
C'est le cas de la "logique" qui sous-tend les mouvements conquérants ou migratoires des Indo-Européens, qui remontent à la préhistoire de la masse continentale eurasienne. Ces mouvements de peuples ne suivent pas un schéma aléatoire et expansif. Les schémas sont d'origine géophysique : ils suivent des accidents "formidables", au sens latin du terme. Des accidents qui la "façonnent" et la montrent aux acteurs qui s'y adaptent et jouent avec elle : chaînes de montagnes, bassins et plaines, accès aux mers, recherche de "sorties"...
Ainsi, la "logique" de nos ancêtres tend à se répéter, car l'ébranlement de la masse eurasienne au cours de son histoire doit refléter une double impulsion. C'est la pulsion des peuples qui prennent l'initiative, dépositaires qu'ils sont d'un héritage ancestral, d'une mémoire de groupe qui les a façonnés. Cette sorte de pulsion est phylogénétique, d'une part. Mais d'autre part, il y a une deuxième force : la force structurante des espaces "formidables". Ces systèmes d'accidents géophysiques qui canalisent les forces des peuples qui s'étalent, qui cherchent la "sortie" non seulement au sens adaptatif, dans la recherche de la survie (volonté de vivre) mais aussi au sens de "l'affirmation de soi" (volonté de puissance). Je trouve admirable ce livre, La guerre de deux cents ans : l'Europe assaillie depuis 1783, même s'il est vrai qu'il se présente sous la forme d'"éclairs", selon la façon dont le penseur belge parle de telles répétitions de secousses et d'impulsions historiques.
Les peuples européens ont très mal tourné depuis 1783, et le livre explique pourquoi cette date et ce qui a conduit à l'échec auquel nous sommes arrivés aujourd'hui. Je ne le révélerai pas ici, car je souhaite que le lecteur se procure le livre. Mais il y a un précédent, le 16ème siècle : depuis que François Ier de France a trahi la chrétienté (l'Europe, en somme) et fait une sale guerre au champion impérial de la chrétienté, Charles Quint, en alliant les Français aux Turcs. Un échec que nous subissons aujourd'hui, puisque l'Angleterre a pris le relais de cette grande trahison turcophile, freinant deux aspirations légitimes, a) celles des empires centraux (à base germanophone) aspirant à s'étendre à l'Est, et b) celles de l'Empire russe (chrétien orthodoxe), qui avait besoin de regarder dans deux directions, vers la Méditerranée autrefois byzantine et vers la masse continentale indienne.
Après la défaite de l'Axe en 1945, la soumission de l'Europe à la thalassocratie, cette fois principalement américaine, mais très largement étayée par l'Empire britannique résiduel, a préservé le "kyste" de la puissance turque. C'est une constante : l'anglosphère alliée aux Turcs. Une puissance néo-ottomane qui sera toujours un foyer de troubles pour l'Europe : le kyste est une source d'instabilité et de pourrissement futur. Par l'action de la Turquie, l'islamisation d'une partie des Balkans se perpétue, infiltrant toutes sortes de terroristes et de criminels de droit commun dans une Europe envahie par des étrangers fanatiques qui peuvent leur offrir couverture et abri. Le rôle ambigu et dangereux de la Turquie en tant que bélier pour l'islamisation de l'Europe et en tant que membre puissant de l'OTAN est l'un des arguments de Steuckers. Le même rôle négatif que l'Empire ottoman a joué dans le passé est joué aujourd'hui par cette puissance militaire et prosélyte, dirigée aujourd'hui par un Erdogan autoritaire et féroce.
Les secousses de notre continent, qui ont été fortement agitées par le conflit en Ukraine, peuvent être mieux comprises si l'on tient compte de ces "constantes" historiques. Le rôle des Britanniques et des Turcs est fondamentalement le même depuis des siècles : empêcher l'intégration impériale eurasienne.
Le détroit de Gibraltar, tout le nord du Maghreb, l'Andalousie, les Canaries, le Levant... Si c'est un échec pour l'Europe de ne pas intégrer l'Eurasie, de renoncer aux Balkans, à Chypre, à la Thrace sous domination turque, etc., ce sera un échec encore plus grand de poursuivre la politique faible et lâche de l'Espagne à l'égard du sultan marocain. Allié fidèle des États-Unis et d'Israël, le roi du Maroc a infiltré ses agents en Espagne : dans de nombreuses ONG et partis politiques, ainsi que dans les universités et les organisations pro-immigration. Actuellement, l'État espagnol se comporte comme une véritable colonie de ce pays d'Afrique et du tiers monde, ce qui constitue un cas unique dans l'histoire. Avec l'argent public espagnol, une grande partie de l'éducation de ses sujets (à l'intérieur et à l'extérieur du royaume alaouite) est payée, et toutes sortes d'initiatives sont encouragées pour réislamiser l'Espagne et réinterpréter la Reconquista en accord avec le rêve alaouite de construire un "Grand Maroc". L'argent des impôts de millions d'Espagnols est investi dans le but de réaliser leur africanisation. Le livre serait très complet s'il analysait cette tenaille sur l'Europe : le Maghreb et la Turquie.
Letras Inquietas est, comme son nom l'indique, une maison d'édition dynamique. Elle ne cesse de publier des livres dérangeants qui stimulent l'esprit du lecteur hispanophone, en luttant contre le conformisme. En tant qu'Européens, nous ne devons pas accepter cette tenaille et ce blocus auxquels nous sommes soumis. La plume de Steuckers est bien nécessaire pour sortir de cette stupeur.
16:59 Publié dans Géopolitique, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, livre, robert steuckers |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 14 février 2023
Kurt Vonnegut à Dresde
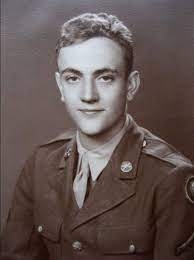
Kurt Vonnegut à Dresde
Constantin von Hoffmeister
Source: https://eurosiberia.substack.com/p/kurt-vonnegut-in-dresden?utm_source=post-email-title&publication_id=1305515&post_id=102496009&isFreemail=true&utm_medium=email
Abattoir-Cinq (1969) est considéré comme l'une des œuvres les plus importantes de la littérature américaine du 20ème siècle. Kurt Vonnegut prend comme point de départ le brasier provoqué par plus d'un millier de bombardiers américains et britanniques à Dresde les 13 et 14 février 1945. Cependant, Slaughterhouse-Five ne traite pas des morts en masse dans une ville surpeuplée de réfugiés de l'Est. Il s'agit plutôt de la destruction psychologique d'une seule personne. Bien que le bombardement ait coûté la vie à 200.000 personnes, il était autrefois considéré comme une note de bas de page, comme un fait historique quelconque très brièvement évoqué, inclus dans un récit beaucoup plus vaste. Après tout, il a eu lieu vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, une guerre déjà marquée par des crimes bestiaux et des atrocités génocidaires.
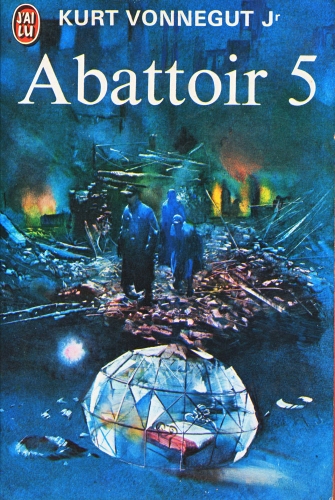
Dans une sorte de métafiction, Vonnegut fait voyager son alter ego à Dresde en 1967 pour traiter son traumatisme. Billy Pilgrim, qui fait des sauts dans le temps, fuit les souvenirs horribles qui le hantent continuellement dans un monde de science-fiction.
Vonnegut était un soldat américain pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été capturé pendant la bataille des Ardennes. Lui et ses compagnons d'armes ont été transportés à Dresde, où une série d'abattoirs avaient été convertis en baraquements de fortune pour les prisonniers. Une douzaine de bâtiments constituaient le quartier des boucheries de la ville. Lorsque les Alliés ont largué près de 4000 tonnes d'explosifs sur Dresde, Kurt Vonnegut s'est réfugié dans la cave de l'abattoir numéro 5.
Au-dessus de lui, il entendait les impacts sourds, comme les pas de géants qui n'en finissaient pas de marteler le sol. La cave à viande était un excellent abri contre les raids aériens. Il n'y avait personne en bas, à part les prisonniers de guerre américains, quatre gardes allemands et quelques carcasses d'animaux éventrés. Les autres gardes, qui s'étaient éclipsés avant l'attaque pour profiter du confort de leurs maisons de Dresde, ont tous été tués avec leurs familles. Lorsque Vonnegut a refait surface après le bombardement, il a vu un carnage inimaginable. Les prisonniers de guerre avaient été chargés de rassembler tous les corps pour un enterrement collectif, mais il y avait trop de corps à enterrer. Alors les Allemands ont envoyé des gens avec des lance-flammes.
Le roman est devenu l'œuvre la plus réussie de Vonnegut. Il s'est vendu à plus de 800.000 exemplaires aux États-Unis et a été traduit dans de nombreuses langues. Il a été lu comme une retentissante proclamation sur les horreurs de la guerre - particulièrement pertinente lorsque les protestations contre la guerre d'agression impérialiste contre le peuple vietnamien étaient à leur apogée.
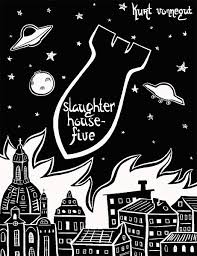
Vonnegut lui-même a un jour fait remarquer de manière sombre que le bombardement de Dresde était si insignifiant qu'il était peut-être le seul à avoir pu en bénéficier. Il a dit qu'il recevait en gros deux ou trois dollars pour chaque personne tuée - pour lui, le bombardement était sans aucun doute une affaire lucrative.
Aujourd'hui, l'actuel abattoir 5 est le hall 1 dans le complexe d'immeubles sur le site de la foire commerciale de Dresde (adresse : Messering 6), un lieu de réunions et de conférences. Bien que le bâtiment ait été entièrement remodelé, de nombreux éléments architecturaux originaux de l'extérieur subsistent. De l'extérieur, seul un simple panneau bleu et gris portant l'ancien nom indique l'histoire du bâtiment. Il est fermé aux visiteurs, mais lorsque j'ai demandé au gardien du service de sécurité, il m'a laissé entrer sur le terrain pour prendre une photo.
Merci de lire Eurosiberia ! Abonnez-vous gratuitement pour recevoir les nouveaux articles et soutenir mon travail.
18:10 Publié dans Littérature, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : kurt vonnegut, lettres, lettres américaines, littérature, littérature américaine, livre, dresde |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 09 février 2023
Guénon et la révision du traditionalisme selon Silvano Panunzio
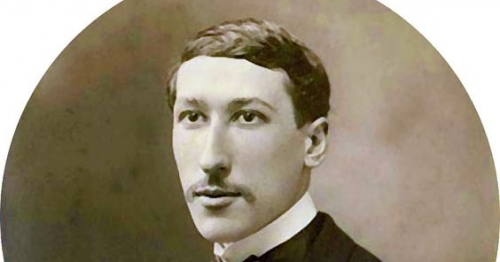
Guénon et la révision du traditionalisme selon Silvano Panunzio
Giovanni Sessa
Source: https://www.paginefilosofali.it/guenon-e-la-revisione-del...
Les éditions Iduna proposent aux lecteurs un important recueil d'écrits de Silvano Panunzio, introduit par Aldo la Fata, qui est le plus grand exégète de ce penseur chrétien. Il s'agit du volume René Guénon e la crisi del mondo moderno ("René Guénon et la crise du monde moderne"), dans lequel sont rassemblés des essais consacrés par l'auteur à l'exégèse de la pensée de l'ésotériste français et de son école, parus dans des livres ou dans la revue Metapolitica, qu'il a lui-même fondée. Les textes sont accompagnés d'une série de lettres adressées à des chercheurs de différents horizons, intéressés par le 'traditionalisme intégral' (pour toute commande : associazione.iduna@gmail.com, pp. 188, euro 20.00). La Fata note la différence de ton que l'on peut déduire en comparant les écrits publics et privés : les premiers caractérisés par un plus grand calme, les seconds plus "libres" et caractérisés par des tons plus polémiques ou apologétiques.
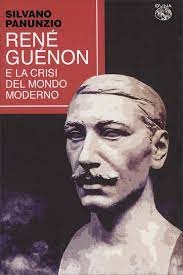
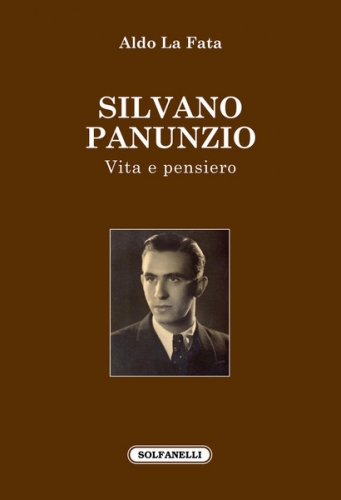
D'un point de vue général, Panunzio reconnaît le rôle important de Guénon dans la culture métaphysique et religieuse du vingtième siècle, mais considère que son enseignement n'est pas sans limites ni contradictions. Panunzio vise à démontrer "aux 'traditionalistes ésotériques' que le christianisme est une tradition complète à tous égards" (p. 9). Parmi les essais, certains révèlent explicitement l'intention qui anime et traverse l'exégèse du "traditionalisme intégral" de Panunzio: parvenir à une révision du guénonisme. Prenant comme point de départ une critique de l'écrivain Vintilă Horia de 1982, consacrée à La crise du monde moderne, l'universitaire italien montre qu'il partage la thèse critique du Roumain. Horia a relevé des ambiguïtés dans le livre en question. Si, d'une part, Guénon "revendique [...] au christianisme latin et à l'Église le privilège d'être la seule organisation authentiquement "traditionnelle"" (p. 65), d'autre part, il accorde à la franc-maçonnerie le même rôle. En outre, les "ouvertures" à l'Orient hindou et à l'islamisme, une religion à laquelle le Français s'est ensuite converti en s'installant en Égypte, ont en fait contribué au "démantèlement" de l'Europe de sa patrie spirituelle. De telles attitudes théoriques pourraient trouver une justification dans l'idée guénonienne de la Tradition unique, dont toutes les "traditions" descendent.

Silvano Panunzio jeune.
À cette thèse, Panunzio répond que les Révélations ne se valent pas et ne sont pas interchangeables: "Le christianisme est, en ce sens, la "dernière" religion, celle qui offre uniquement à l'homme la possibilité du salut [...] par l'intercession du Fils de Dieu lui-même" (p. 67). Compte tenu de l'accélération des processus de décadence qui se sont manifestés après la seconde moitié du siècle dernier, pour Panunzio il aurait été diriment de mettre en œuvre une révision du "traditionalisme intégral". Une révision aussi radicale que celle qui avait ébranlé les certitudes dogmatiques du marxisme à la fin du 19ème siècle. La limite du guénonisme est identifiée, comme on peut le voir dans Les multiples états de l'être, d'où descend tout le système de l'ésotériste, d'être une proposition centrée sur le monisme de Plotin et de ramener, par conséquent, le débat : "à la rencontre et au choc, jamais complètement résolu, entre le néoplatonisme extrême et le christianisme" (p. 70). Cette attitude intellectuelle a, en outre, conduit Guénon à vivre l'Inde à la lumière de la seule perspective shankarienne, sous-estimant le "mystère vivant", saisi par Pannikar, relatif à l'existence d'une "Inde intérieure" qui reconnaît la fonction salvatrice du Christ.
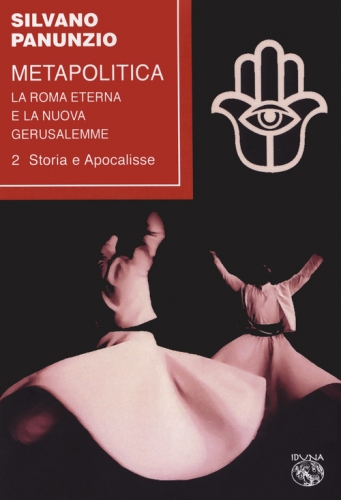
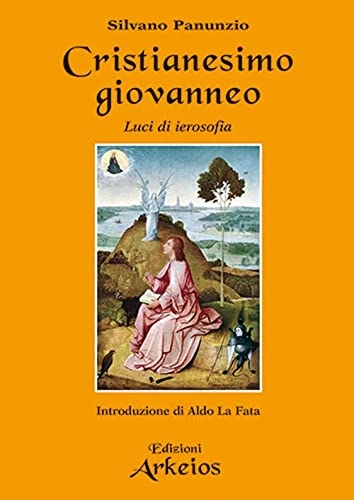
En conclusion, pour Panunzio, le guénonisme est une forme moderne de l'averroïsme "qui se présente aux chrétiens du vingtième siècle avec les mêmes problèmes choquants qu'au treizième siècle ! Il faut dire, précise notre auteur, que Guénon lui-même attendait beaucoup, en termes d'amendement de son propre système, de la nouvelle vague d'études traditionnelles qui s'affirmait en Italie et qui était menée par le spécialiste de l'économie Giuseppe Palomba et par Panunzio lui-même. Il était censé favoriser, non pas simplement la réunion horizontale de l'Est et de l'Ouest, mais "l'échange vertical entre le Ciel et la Terre" (p. 73). Des remarques critiques similaires émergent à la lecture de l'essai consacré à Guido De Giorgio, dont le plus grand mérite est de "ne pas avoir risqué (sic !) de mettre la Tradition à la place de Dieu" (p. 43). C'est précisément par l'analyse de l'apport de cet Adepte que l'on peut comprendre l'échec du traditionalisme des 19ème et 20ème siècles, oublieux des enseignements de De Maistre, qui était conscient que la Tradition avait été préservée non seulement par le catholicisme mais aussi par l'orthodoxie, dont seul Sédir avait une idée. Sur la voie tracée par le guénonisme: "L'Europe intérieure a été abandonnée, laissée à la merci des forces chthoniennes [...] Un glissement de terrain : que la métaphysique pure, sans l'aide de la métapolitique, s'est révélée impuissante à arrêter" (p. 45). Guénon, rappelle Panunzio, a rencontré le Père Tacchi Venturi (photo) : l'échange entre les deux n'a pas été fructueux pour rectifier les positions du Français, et il a continué à poursuivre la voie de l'"externalisation" du patrimoine ésotérique.
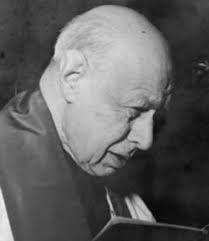 Le penseur transalpin n'a pas pleinement compris l'héritage "traditionnel" présent chez Leibniz. Ce dernier, non seulement était un véritable initié, mais avait une connaissance profonde de la scolastique mystique: "cette dernière est, par contre, inconnue de Guénon" (pg. 34). Leibniz, pour cela, n'a pas reculé devant la conception audacieuse de la "pars totale", qui a tant fasciné Goethe, philosophe de la nature. Ceux qui sont présentés ne sont que quelques-uns des thèmes abordés dans le volume. Ils reviennent également dans l'intéressante correspondance privée qui clôt cette précieuse collection. Nous sommes d'accord sur la nécessité de réviser le traditionalisme. Panunzio aurait voulu y parvenir en faisant référence à un "christianisme ésotérique", "johannique". Dans certains passages du volume, un jugement excessivement peu généreux envers l'"hérésie évolienne", considérée comme "luciférienne", est évident.
Le penseur transalpin n'a pas pleinement compris l'héritage "traditionnel" présent chez Leibniz. Ce dernier, non seulement était un véritable initié, mais avait une connaissance profonde de la scolastique mystique: "cette dernière est, par contre, inconnue de Guénon" (pg. 34). Leibniz, pour cela, n'a pas reculé devant la conception audacieuse de la "pars totale", qui a tant fasciné Goethe, philosophe de la nature. Ceux qui sont présentés ne sont que quelques-uns des thèmes abordés dans le volume. Ils reviennent également dans l'intéressante correspondance privée qui clôt cette précieuse collection. Nous sommes d'accord sur la nécessité de réviser le traditionalisme. Panunzio aurait voulu y parvenir en faisant référence à un "christianisme ésotérique", "johannique". Dans certains passages du volume, un jugement excessivement peu généreux envers l'"hérésie évolienne", considérée comme "luciférienne", est évident.
L'écrivain pense certainement que "l'esprit géométrique" et l'esprit systémique de Guénon doivent être vitalisés par "l'esprit de finesse". Cette qualité était vivante et présente dans la tradition mystique grecque, en particulier dans le dionysisme, qui n'a jamais, dans l'acte aristotélicien, pensé à normaliser et à faire taire la dynamis, la puissance-liberté du principe. L'un, pour moi, n'est donné que dans le multiple, il est infranaturel. Physis est le temple de dynamis. Par conséquent, s'il devait y avoir un ésotérisme chrétien, centré sur l'idée d'un dieu qui meurt et renaît, "puissant" et "souffrant", il serait redevable et successeur des anciens Mystères, auxquels il faut revenir pour dépasser la scolastique traditionaliste.
Giovanni Sessa
18:00 Publié dans Livre, Livre, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, tradition, silvano panunzio, rené guénon, traditionalisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 05 février 2023
Le Dictionnaire de l'Europe d'Yves Tissier: une source inépuisable d’érudition
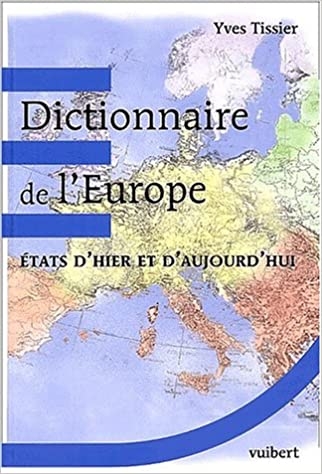
Le Dictionnaire de l'Europe d'Yves Tissier: une source inépuisable d’érudition
par Georges FELTIN-TRACOL
Il faut parfois savoir prendre du recul par rapport aux cadences chaotiques de l’actualité et évoquer les outils avec lesquels il importe de comprendre le monde et son temps. En 2008, les éditions Vuibert réimprimaient pour la troisième fois un travail original d’Yves Tissier. Ce lexicographe et historien est l’auteur d’un fantastique Dictionnaire de l’Europe, sous-titré États d’hier et d’aujourd’hui de 1789 à nos jours (716 p., hélas indisponible sauf erreur peut-être chez les bouquinistes en ligne).
Cette gigantesque somme se révèle être pour les chercheurs, les curieux et les érudits une formidable source de renseignements aux confins de l’histoire, du droit, de la géographie et de la diplomatie. L’auteur explique volontiers que « l’étude historique de l’évolution territoriale des États, que l’on nommait autrefois géographie politique, permet d’éclairer les données géopolitiques du monde d’aujourd’hui (p. 3) ».
D’un maniement aisé, ce dictionnaire se divise en quatre parties de taille inégale. La première présente une « Chronologie territoriale de l’Europe (1789 à nos jours) ». La deuxième est la plus longue puisqu’elle étudie « les États existants », de l’Albanie au Vatican en n’oubliant pas Andorre, Monaco et même l’Ordre de Malte. La troisième partie aborde « les États disparus ». Il faut comprendre des « États [qui] ont eu une existence, brève ou longue, entre 1789 et 2008 (p. 551) ». On pense bien sûr à la Tchécoslovaquie, à l’URSS et à la Yougoslavie, mais aussi à la République rauracienne dans le Jura suisse à la fin du XVIIIe siècle ou à la Régence italienne du Quarnero à Fiume. La quatrième et dernière partie regroupe différentes annexes. Il faut en outre mentionner quarante-deux magnifiques cartes en couleurs.
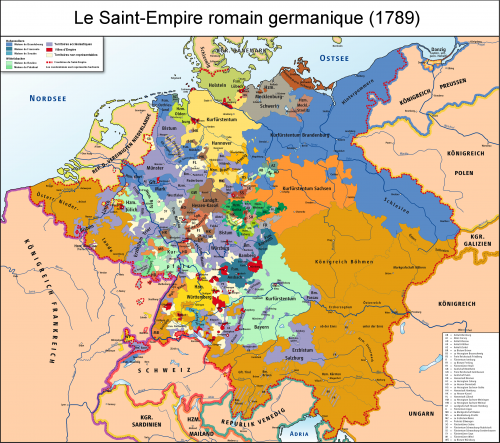
Cartes et annexes offrent aux curieux francophones des informations complètes habituellement disponibles qu’en anglais, en allemand et en néerlandais. Plusieurs cartes représentent à la veille de la Révolution française la localisation exacte des États héréditaires, des États ecclésiastiques et autres villes libres du Saint-Empire romain germanique. Leur visualisation cartographique confirme le caractère mosaïque de l’ensemble avec des espaces politiques fragmentés, disséminés et enclavés. Les annexes évoquent « les pays réservés de Napoléon Ier » tels le margraviat de Bayreuth « avec son enclave de Caulsdorf en Thuringe » ou les présides de Toscane, « cinq places fortes napolitaines sur le littoral toscan (p. 598) »; le fonctionnement de la Confédération du Rhin (1806 - 1813), puis de la Confédération germanique (1815 – 1866) et de la Confédération de l’Allemagne du Nord (1867 – 1871).

L’ouvrage comporte une analyse serrée de la notion de « frontières naturelles » à travers des cas de cours d’eau, de montagnes et de mers. D’autres annexes attirent une attention immédiate. « Étrangetés, particularismes et anecdotes en tout genre » rapporte le cas de l’enclave espagnole de Llivia dans le département français des Pyrénées-Orientales ou d’autres incongruités géopolitiques surgies de l’histoire. L’auteur décrit les nombreuses « républiques-sœurs » du Directoire à la fin de la Révolution. Se souvient-on encore de la République ligurienne à Gènes, de la République cisalpine à Bologne, de la République parthénopéenne à Naples ? Il y a un « répertoire de concordance des noms de lieux ». La ville ukrainienne de Lviv s’appelle au cours des âges Lemberg, Leopol, Lwow et Lvov.
La première annexe examine avec maints détails le fonctionnement complexe du Saint-Empire. À côté du Collège électoral de huit membres en 1777 se tiennent le Collège des princes détenteur de cent voix réparties entre le banc ecclésiastique, soit trente-trois voix viriles (individuelles) et deux voix curiales (collectives), et le banc laïque (soixante-et-une voix viriles et quatre voix curiales), et le Collège des villes libres (cinquante-et-une voix) se divisant en « banc rhénan (quatorze voix) » et en « banc souabe (trente-sept voix) ». À cet agencement institutionnel s’ajoutent les dix cercles créés par Charles Quint dont le Cercle de Bourgogne qui correspond à peu près aux pays thiois.
Ouvrage de référence, le Dictionnaire de l’Europe examine la cohérence territoriale des États et la pertinence du tracé de leurs frontières. Ainsi les frontières du Portugal n’ont-elles pas changé depuis son indépendance regagnée en 1640. Mais, en 1801, l’Espagne reçoit le district d’Olivence (Olivença en portugais et Olivenza en espagnol) en Estrémadure sur la rive gauche du Guadiana. Au Congrès de Vienne en 1814 – 1815, Madrid refuse avec vigueur toute rétrocession. Lisbonne continue à en revendiquer la souveraineté. Des responsables politiques portugais considèrent toujours qu’il s’agit de leur Gibraltar.

On pense que la délimitation du territoire français s’achève en 1860 avec l’annexion de la Savoie et de Nice, nonobstant la particularité de l’Alsace – Moselle entre 1871 et 1945. On oublie que le traité de Paris du 10 octobre 1946 oblige l’Italie à céder à la France « un fragment de territoire au col du Petit-Saint-Bernard, le plateau du Mont-Cenis, le village de Clavière, au-delà du col du Montgenèvre et Tende, La Brigue et les crêtes de Vésubie et de Tinée » entérinée, pour ces quatre derniers lieux, par un plébiscite du 12 octobre 1947. Et dire que la République française avait déclaré la guerre le 3 septembre 1939 pour le maintien de l’intégrité de la Pologne...
Il ne fait aucun doute que la lecture, parfois aléatoire, du Dictionnaire de l’Europe est un véritable régal.
GF-T
- « Vigie d’un monde en ébullition », n° 59, mise en ligne le 31 janvier 2023 sur Radio Méridien Zéro.
16:38 Publié dans Histoire, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, livre, cartographie, géographie, géographie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 22 janvier 2023
Présentation de Multipolarité au XXIème siècle et de L'Europe, la multipolarité et le système international

Présentation de Multipolarité au XXIème siècle et de L'Europe, la multipolarité et le système international
Age planétaire et nouvel ordre mondial
par Irnerio Seminatore
INSTITUT ROYAL D'ETUDES STRATEGIQUES de RABAT
8 Décembre 2022
TABLE DES MATIERES
Une vue d'ensemble
Alliance Anti-Hegemonique et nouveau Rimland
Crise de l'atlantisme et transition du système
Les issues du conflit ukrainien
L'hégémonie et le remodelage du système
Stabilité et sécurité. Alternance Hégémonique ou alternative systémique ?
Le conflits USA-Russie et la rupture de la continuité géopolitique Europe-Asie
Encerclement, politique des alliances et leçons de la crise
***
Une vue d'ensemble
L'ambition de ces deux publications sur la multipolarité, le tome 1 au titre La Multipolarité au XXIème siècle et le tome 2: L'Europe, la Multipolarité et le Système international. Age planétaire et nouvel ordre mondial, a été d'avoir essayé de dresser une vue d'ensemble sur la politique mondiale à l'époque où nous vivons.
Et cela, sous l'angle d'une pluralité de structures de souverainetés et donc d'équilibre des forces, mais également et surtout de l'antagonisme historique entre puissances hégémoniques et puissances montantes et donc d'un certain ordre politique et moral. On y repère ainsi les deux aspects principaux de tout narratif historique, l'acteur et le système, qui se projettent sur la toile de fond de l'action historique.
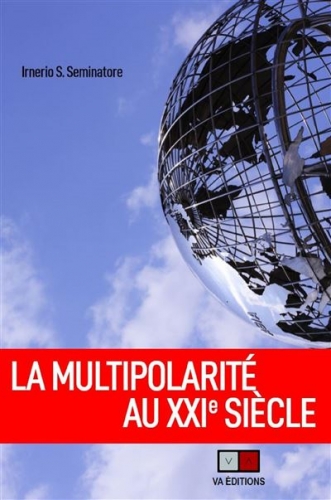
L'acteur, ou la figure de l'Hégémon, y apparaît comme le signifiant universel d'une époque et le système, comme englobant général de tous les antagonismes et de toutes les rivalités, en est le décor.
Ces deux ouvrages couvrent la transition qui va de la fin du système bipolaire à l'unipolarisme américain qui lui a succédé, puis au multipolarisme actuel, en voie de reconfiguration.
Parmi les changements des structures de pouvoir et des ordres internationaux, trois thèmes constituent le fil conducteur de l'antagonisme qui secoue le système, des débats qui animent ses rivalités et ses conflits et, comme tels, l'axe directeur de mes deux ouvrages
- la triade des puissances établies, qui se disputent l'hégémonie de la scène planétaire (Etats-Unis, Russie et Chine), scène devenue durablement instable;
- l'environnement stratégique mondial, comme cadre historique, cumulant les trois dimensions de l’action, d’influence, de subversion ou de contrainte;
- l'Europe, comme acteur géopolitique inachevé et à autonomie incomplète.
Dans ce contexte, l’interprétation des stratégies de politique étrangère prises en considération, obéit aux critères, jadis dominants de la Realpolitik, remis à l’ordre du jour par le World Politics anglo-saxon.
L'option réaliste en politique internationale est adoptée non pas pour garantir l'idéal de la puissance ou de l'Etat-puissance, comme au XIXème siècle, ou encore pour justifier la matrice classique de la discipline, l'anarchie internationale, à la manière de R. Niebuhr, mais pour comprendre les mutations des idées et des rapports de forces, intervenues dans la politique mondiale depuis 1945.
C'est uniquement par l'approche systémique et par conséquent par une vue générale et exhaustive, que l'on peut saisir les conditions idéologiques et structurelles de la remise en cause de la souveraineté des Etats et des Nations et l'apparition d'un univers d'unités politiques interdépendantes et toutefois subalternes à une hégémonie impériale dominante.
Ainsi l'ensemble des essais ici réunis, prétend conférer à ces deux tomes un statut d'éclairage conceptuel pour la compréhension de l'évolution globale de notre conjoncture et pour l'analyse du "Grand Jeu" entre pôles de puissances établies, défiant la stabilité antérieure.
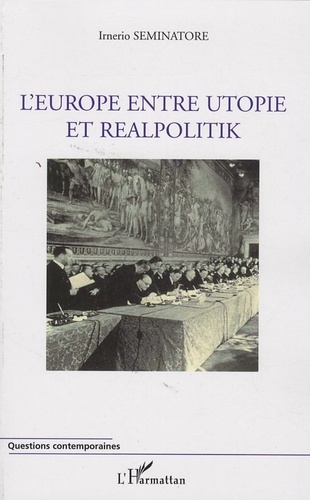
Alliance Anti-Hégémonique et nouveau Rimland
Sont mises en exergue, dès lors :
- l'alliance anti-hégémonique du pivot géographique de l'histoire, le Heartland, par la Russie, l'Iran et la Chine et, en position d'arbitrage la Turquie,
- la chaîne politico-diplomatique du "containement" de la masse eurasienne, par la ceinture péninsulaire extérieure du "Rimland"mondial, constituée par la Grande Ile de l'Amérique, le Japon, l'Australie, l'Inde, les pays du Golfe et l'Europe, ou, pour simplifier, l'alliance nouvelle des puissances de la terre contre les puissances de la mer.
Dans cet antagonisme entre acteurs étatiques, l'enjeu est historique, le pari existentiel et l'affrontement est planétaire.
En soulignant le déplacement de l'axe de gravité du monde vers
l'Asie-Pacifique, provoqué par l'émergence surprenante de l'Empire du Milieu, ce livre s'interroge sur le rôle de l'Amérique et de la Russie, ennemies ou partenaires stratégiques de l'Europe de l'Ouest, justifiant par là le deuil définitif de "l'ère atlantiste" qui s'était imposée depuis 1945.
Crise de l'atlantisme et transition du système
La crise de l'atlantisme, ou du principe de vassalité est aujourd'hui aggravée par deux phénomènes:
- la démission stratégique du continent européen, en voie de régression vers un sous-système dépendant;
- les tentatives de resserrement des alliances militaires permanentes en Europe et en Asie-Pacifique (Otan, Aukus) prélude d'un conflit de grandes dimensions.
Ouvrages didactiques, ces deux tomes prétendent se situer dans la postérité des auteurs classiques du système international, R. Aron, Kaplan, Rosenau, H. Kissinger, K. Waltz, Allison, Brzezinski, Strausz-Hupé, et plus loin, Machiavel et Hobbes, tout aussi bien dans la lecture des changements des équilibres globaux et dans la transition d'un système international à l'autre, que dans la lecture philosophique sur la nature de l'homme, la morphologie du pouvoir et les caractéristiques intellectuelles de la période post-moderne. Ce qui est en cause dans toute transition est le concept de hiérarchie.
Sous ce regard de changement et de mouvement, le retour de la guerre en Europe représente le premier moment d'un remodelage géopolitique de l'ensemble planétaire et une rupture des relations globales entre deux sous-systèmes, euro-atlantique et euro-asiatique.
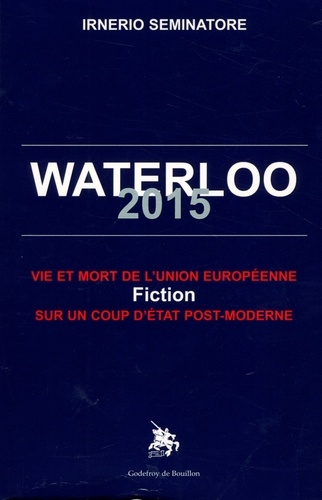
Au sein de ce retournement, l'Europe y perd son rôle d'équilibre entre l'Amérique et la Russie et le grand vide de puissance, qui s'instaure dans la partie occidentale du continent, est aggravé par l'absence de perspective stratégique, par le particularisme des options diplomatiques des Etats-Membres de l'Union Européenne, par le flottement des relations franco-allemandes jadis structurantes et, in fine, par la difficile recherche d'un Leadership commun.
Les issues du conflit ukrainien
L'issue du conflit ukrainien, comme guerre par procuration mené par l'Amérique contre la Russie, a été présenté au Forum sur la sécurité internationale de Halifax, au Canada, par Lloyd Austin, Secrétaire américain à la défense, comme déterminant de la sécurité et de l'ordre mondial du XXIème siècle fondé, sur des règles. Ce conflit prouve la difficulté de l'Union européenne à assurer une architecture européenne de sécurité "égale et indivisible" car il intervient comme modèle de rupture dans les relations de coopération internationales et préfigure en Asie-Pacifique une relation d'interdépendance stratégique et d'alliances militaires opposées, entre puissances du "Rimland" et puissances du "Heartland", face à l'ouverture prévisible, d'une crise, concernant le "statut" de Taiwan.
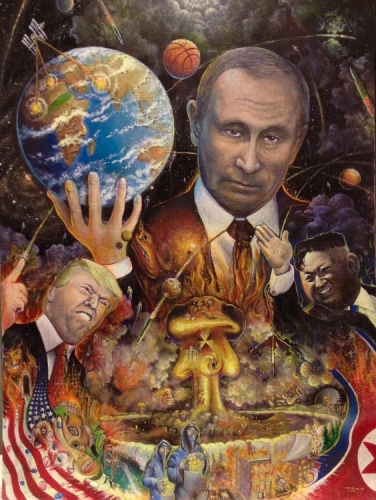
Dans la perspective d'une invasion de celle-ci par la Chine s'ouvriraient les portes de la géopolitique planétaire vers le Pacifique et l'Australie et changerait immédiatement le sens du conflit entre Moscou et l'Occident. Seraient particulièrement brouillés les calculs de Washington sur le rôle de la Russie en Europe, en Asie-centrale et en Asie-Pacifique, d'où le jeu ambigu de la Turquie et la recherche d'une profondeur stratégique pour l'emporter, qui demeure sans précédent.
Aujourd'hui, l'affrontement Orient et Occident est tout autant géopolitique et stratégique, qu'idéologique et systémique et concerne tous les domaines, bien qu'il soit interprété, dans la plupart des cas, sous le profil de la relation entre économie et politique.
Sous cet angle, en particulier, l'unipolarisme de l'Occident fait jouer à la finance, disjointe de l'économie, un rôle autonome pour contrôler, à travers les institutions multilatérales, le FMI et la Banque Mondiale, l'industrie, la production d'énergie, l'alimentation, les ressources minières et les infrastructures vitales de plusieurs pays.
Dans ce cadre les Etats qui soutiennent la multipolarité sont aussi des Etats à gouvernement autocratique, qui résistent au modèle culturel de l'Occident et affirment le respect de vies autonomes de développement, une opposition visant la financiarisation et la privatisation des économies , subordonnant la finance à la production de biens publics.

L'hégémonie et le remodelage du système
Or le remodelage du système international pose le problème de l'hégémonie comme nœud capital de notre époque et inscrit ce problème comme la principale question du pouvoir dans le monde. En effet nous allons vers une extension sans limites des conflits régionaux, une politique de resserrement des alliances militaires, occidentales, euro-asiatiques et orientales, qui donnent plausibilité à l'hypothèse d'une réorganisation planétaire de l'ordre global, par le biais d'un conflit mondial de haute intensité.
La plausibilité d'un conflit majeur entre pôles insulaires et pôles continentaux crée une incertitude complémentaire sur les scénarios de belligérance multipolaire dans un contexte de bipolarisme sous-jacent (Chine-Etats-Unis)
C'est l'une des préoccupations, d'ordre historique, évoquées dans ces deux tomes sur la multipolarité.
A ce propos, le théâtre européen élargi (en y incluant les crises en chaîne qui vont des zones contestées des pays baltes au Bélarus et à l'Ukraine, jusqu'au Golfe et à l'Iran, en passant par la Syrie et le conflit israélo-palestinien), peut devenir soudainement l'activateur d'un conflit général, à l'épicentre initial dans l'Est du continent.
Ce scénario, qui apparaît comme une crise du politique dans la dimension de l'ordre inter-étatique, peut être appelé transition hégémonique dans l'ordre de l'histoire en devenir.
Bon nombre d'analystes expriment la conviction que le système international actuel vit une alternance et peut être même une alternative hégémonique et ils identifient les facteurs de ce changement, porteurs de guerres, dans une série de besoins insatisfaits , principalement dans l'exigence de sécurité et dans la transgression déclamatoire du tabou nucléaire, sur le terrain tactique et dans les zones d'influence disputées (en Ukraine, dans les pays baltes, en Biélorussie, ainsi que dans d'autres points de crises parsemées).
L'énumération de ces besoins va de l'instabilité politique interne, sujette à l'intervention de puissances extérieures, à l'usure des systèmes démocratiques, gangrenés en Eurasie par l'inefficacité et par la corruption et en Afrique, par le sous-développement, l'absence d'infrastructures modernes, la santé publique et une démographie sans contrôle.
En effet, sans la capacité d'imposer la stabilité ou la défendre, Hégémon ne peut exercer la suprématie du pouvoir international par la seule diplomatie, l'économie, le multilatéralisme, ou l'appel aux valeurs.
Il lui faut préserver un aspect essentiel du pouvoir international (supériorité militaire, organisation efficace, avancées technologiques, innovation permanente, etc).
Hégémon doit tenir compte de l'échiquier mondial, de la Balance of Power, de la cohésion et homogénéité des alliances, mais aussi de l'intensité et de la durée de l'effort de guerre. C'est pourquoi les guerres majeures relèvent essentiellement de décisions systémiques (R. Gilpin).

Stabilité et sécurité. Alternance Hégémonique ou alternative systémique ?
La question qui émerge du débat actuel sur le rôle des Etats-Unis dans la conjoncture actuelle est de savoir si la "Stabilité stratégique" assurée pendant 60 par l'Amérique (R. Gilpin) est en train de disparaître, entrainant le déclin d'Hégémon et de la civilisation occidentale, ou bien, si nous sommes confrontés à une alternative hégémonique et à un monde post-impérial.
L'interrogation qui s'accompagne au déclin supposé des Etats-Unis et à la transition vers un monde multipolaire articulée, est également centrale et peut être formulée ainsi; "quelle forme prendra cette transition ?".
La forme déjà connue, d'une série de conflits en chaîne, selon le modèle de R. Aron, calqué sur le XXème siècle, ou la forme plus profonde d'un changement de la civilisation, de l'idée de société et de la figure de l'homme selon le modèle des "révolutions systémiques" de Strausz-Hupé, couvrant l'univers des relations socio-politiques du monde occidental et les grandes aires de civilisations connues?
Du point de vue des interrogations connexes, les tensions entretenues entre les Occidentaux et la Russie en Ukraine, sont susceptibles de provoquer une escalade aux incertitudes multiples, y compris nucléaires et des clivages d'instabilités, de crises ouvertes et de conflits gelés, allant des Pays baltes à la mer Noire et du Caucase à la Turquie. Ces tensions remettent à l'ordre du jour l'hypothèse d'un affrontement général, comme issue difficilement évitable de formes permanentes d'instabilité régionales, aux foyers multiples, internes et internationaux.
Cette hypothèse alimente une culture de défense hégémonique des Etats-Unis, dont la projection de puissance manifeste sa dangerosité et sa provocation en Europe, au Moyen Orient et en Asie.

Le conflits USA-Russie et la rupture de la continuité géopolitique Europe-Asie
En ce sens le conflit avec la Russie, par Ukraine interposée, peut être interprété comme une tentative de désarticulation de la continuité géopolitique de l'Europe vers l'Asie (Brzezinski) et de la Chine vers la région de l'Indopacifique. C'est sous l'angle de fracturation et de la vassalité, que s'aggravent les facteurs d'incertitudes et les motifs de préoccupation sur les tendances stratégiques des Etats-Unis.
En effet la différenciation vis à vis du Leader de bloc distingue en Europe les pays d'obédience et d'influence atlantique stricte (GB, pays nordiques, Hollande, Belgique, Pays baltes et Pologne) des pays du doute et de la résistance (France, Italie et Allemagne).
Au niveau planétaire font partie des zones à hégémonie disputée et demeurent sujettes à l'influence grandissante de la Realpolitik chinoise la région des Balkans, de la mer Noire, de la Caspienne, du plateau turc, du Golfe, de l'Inde, d'Indonésie, du Japon et d'Australie.
Pariant, sans vraiment y croire sur la "victoire" de Kiev", face à Moscou, l'Amérique entend clairement faire saigner la Russie, en éloignant le plus possible la perspective d'un compromis et d'une sortie de crise.
Par ailleurs la vassalité de l'Europe centrale vis à vis de l'Amérique deviendra une nécessité politique et militaire, afin de décourager l'Allemagne, réarmée, de vouloir réunifier demain le continent. Une vassalité semblable pourrait opposer les pays asiatiques à la Chine dans la volonté de restituer de manière unilatérale, l'Asie aux Asiatiques.
Encerclement, politique des alliances et leçons de la crise
Du point de vue des leçons à tirer et de ses répercussions, la crise ukrainienne a mis à l'ordre du jour la réflexion sur la morphologie des systèmes internationaux, stables, instables ou révolutionnaires, et, en particulier la politique des alliances, qui ont fait grands les empires et inéluctables les guerres.
Comme l'Empire allemand avant 1914, la Fédération de Russie a pu se sentir encerclée par l'Otan et a choisi, en pleine conscience du danger, de passer d'un mode défensif à un mode préventif et offensif, au nom de ses intérêts de sécurité et de la conception commune et incontestable de la "sécurité égale et indivisible" pour tous les membres de la communauté internationale. Une sécurité égale qui était justifiée, avant la première guerre mondiale, par une équivalence morale entre les ennemis, comme l'a bien montré Carl Schmitt, contre la diabolisation de l'Allemagne.
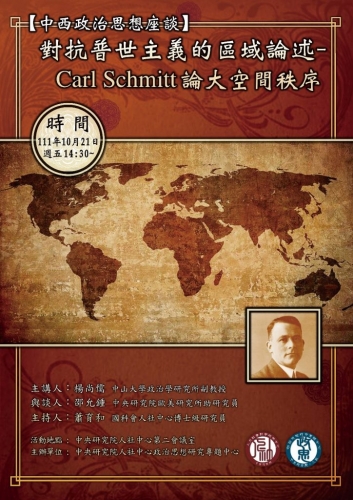
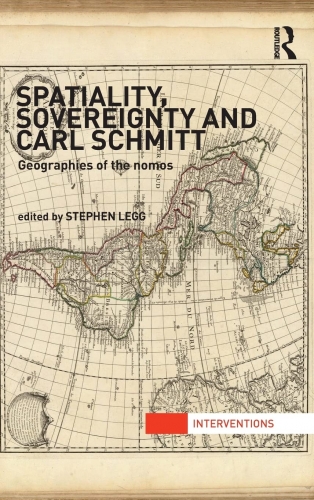
Telle est, à mes yeux, la vue d'ensemble de la conjoncture que nous vivons, si profonde et si grave, que j'ai essayé d'en décrire les formes et les enjeux et de la soumettre au jugement de nos contemporains, pour qu'en témoigne l'Histoire et pour qu'en tire profit la décision politique. Et cela dans le but de décrypter les dilemmes de la paix et de la guerre et de percevoir dans la détérioration des systèmes internationaux, un espoir de compatibilité civilisationnelle et stratégique entre acteurs principaux, portant sur la stabilité ou le retour à la stabilité
Pour rendre moins aléatoire cette recherche j'ai adoptée tour à tour cinq niveaux de compréhension :
- théorique (attributs systémiques, système et sous-systèmes, homogénéité- hétérogénéité, stabilité et sécurité);
- historique (la scène planétaire et sa morphologie ,les acteurs et les constellations diplomatiques);
- géopolitique (enjeux globaux, géopolitique continentale et géopolitique mondiale océanique);
- stratégique (la triade, le condominium USA-Chine ou le duel du siècle, hégémonie et compétition hégémonique);
- institutionnel (la crise de l’unipolarisme et de l’atlantisme, l’Europe et la multipolarité);
et j'en ai conclu à et opté pour un indéterminisme probabiliste, qui gouverne le sort de l'homme et des sociétés, dans le sens de la liberté ou de celui de la tyrannie, de la vie ou de la mort.
Ce travail, qui m'a demandé quarante ans, ne m'a consenti aucune certitude et aucune sentence définitive et m'a toujours rappelé que l'histoire reste ouverte au choix du bien ou du mal et à celui de la volonté la plus déterminée, soit-elle terrifiante.
Ce qui se prépare aujourd'hui et qui est conforme à la théorie des grands cycles et à la situation du monde actuel, demeure le duel du siècle entre les Etats-Unis et la Chine. Mais "quid" alors de la Russie et avec autant d'inquiétude de l’Europe ?
Les interrogations proposent à l'action les grandes options de demain, mais ne donnent que l'image approximative du possible et jamais la solution accomplie. Celle-ci appartient à l'imprévu, qui est l'enfant naturel du risque et l'appétit le plus cruel de l'aventure humaine.
Bruxelles le 8 Décembre 2022
19:56 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique, Livre, Livre, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, affaires européennes, hégémonisme, géopolitique, politique internationale, relations internationales, livre, irnerio seminatore, théorie politique, sciences politiques, politologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook


