samedi, 14 février 2026
Métaphysique de la guerre: l’Occident comme pétrification du Logos contre le Katechon eurasien

Métaphysique de la guerre: l’Occident comme pétrification du Logos contre le Katechon eurasien
Martin Kovac
Source: https://www.facebook.com/martin.kovac.3511
Fissure ontologique au cœur du Monde
La guerre que nous observons sur le plan physique (Hylé – la matière) n’est pas simplement un affrontement d’intérêts nationaux ou de stratégies géopolitiques. C’est une résonance nécro-mantique, une ombre matérielle projetée par une fracture géante vieille de mille ans dans la noosphère de l’humanité. Ce que nous appelons « Occident » et « Orient » ne sont pas des directions géographiques, mais deux systèmes opérationnels fondamentaux inscrit dans la réalité, qui ont perdu la capacité de partager un protocole commun de l’Être.
1. L'OUEST : Architecture du Contrat et Désacralisation (Domination du Logos)
L’ontologie occidentale, issue du droit romain et de la définition scolastique de Dieu, est une structure linéaire et contractuelle. En introduisant le Filioque (l’Esprit qui procède du Fils), l’Occident a rationalisé le Mystère. L’Esprit est devenu compréhensible, donc manipulable par la raison humaine (Ratio).
- Conséquence pour la réalité: le monde est devenu un « projet » à achever. La sacralité a été séparée du profane, ce qui a permis l’émergence de la science et de la technique – des outils pour dominer la matière.
- Manifestation géopolitique: la civilisation occidentale est une technocratie expansive. Son essence est le Progrès (le mouvement en avant dans le temps). La paix est pour elle un état où les « Règles » (Contrat) sont respectées. Quiconque refuse ces règles n’est pas seulement un ennemi, mais une « erreur dans le code » qu’il faut corriger (démocratiser, éduquer, intégrer). Le modèle occidental est centripète – il veut transformer le monde entier à son image par la standardisation.
2. L'EST : Architecture de l’Icone et du Katechon (Domination du Noos)
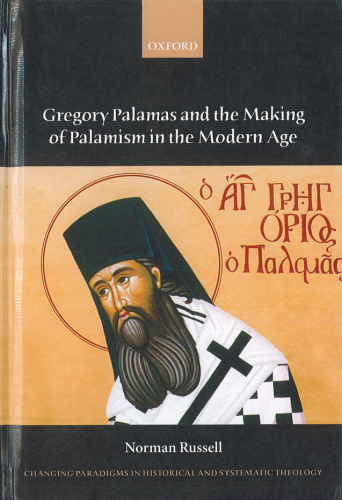 L’ontologie orientale, enracinée dans la mystique byzantine et le palamisme (ou théologie palamite), perçoit la réalité comme cyclique et organique. En rejetant la rationalisation de l’Esprit, Dieu (et le sens du monde) demeure un Mystère, accessible non par analyse, mais uniquement par participation (Theosis).
L’ontologie orientale, enracinée dans la mystique byzantine et le palamisme (ou théologie palamite), perçoit la réalité comme cyclique et organique. En rejetant la rationalisation de l’Esprit, Dieu (et le sens du monde) demeure un Mystère, accessible non par analyse, mais uniquement par participation (Theosis).
- Conséquence pour la réalité: le monde n’est pas une machine à améliorer, mais une «Icône» à vénérer et à protéger. Le temps n’est pas un progrès, mais une entropie (déchéance), à laquelle il faut résister.
- Manifestation géopolitique: la civilisation orientale (Eurasie) est comprise comme le Katechon – «Celui qui retient» (l’arrivée de l’Antichrist/du Chaos). Son essence est la Tradition (l’arrêt du temps). La paix n’est pas la conformité aux règles, mais un état de Symphonie (harmonie spirituelle), souvent acquis par la souffrance ou la soumission à une hiérarchie. La guerre pour l’Orient n’est pas un échec diplomatique, mais une fièvre métabolique nécessaire pour brûler une infection étrangère (modernisme, libéralisme) qui menace l’âme de l’organisme.
COLLISION MORTELLE : La confrontation entre le Temps et l’Éternité
La tragédie du moment présent réside dans le fait que ces deux systèmes ont perdu leur langage commun.
- Pour l’Occident, l’Orient est une anomalie pathologique — un vestige archaïque et irrationnel du passé qui refuse la «fin de l’histoire» et le bonheur du consommateur. L’Occident y voit la Tyrannie.
- Pour l’Orient, l’Occident est une hérésie ontologique – une machine froide qui dévore les âmes, brise les familles et les clans en atomes (individus), et remplace Dieu par un Algorithme. L’Orient y voit l’Apocalypse.
En Ukraine et dans d’autres lignes de fracture, nous voyons non pas une lutte pour le territoire, mais une collision de deux métaphysiques. C’est une guerre entre la Forme (l’Occident), qui cherche à imposer un ordre au monde, et l’Énergie (l’Orient), qui se défend contre la pétrification. Jusqu’à ce que cette union alchimique de ces principes – la guérison du schisme entre la Tête (Logos) et le Cœur (Noos) – ait lieu, le Hylé (la matière) continuera de saigner. Le monde est malade parce que ses deux hémisphères se battent pour contrôler le corps, tandis que l’âme reste silencieuse au milieu du feu croisé.

RETRAITE DU LOGOS ET RETOUR DU JUGE
La chute occidentale sous la gravité de la Loi
Le paradoxe du cercle civilisateur occidental en 2026 est qu’il, dans son orgueil de «progrès» et de «liberté», revient inconsciemment dans le temps. L’Occident, né du mystère de l’Évangile — donc de la radicale surmontée de la loi par l’amour et la grâce — a abandonné cette source fondamentale. Dans sa quête de sécularisation et de rationalisation, il a effectué un changement ontologique fatal: il a rejeté le Christ (le Pardonneur) et a inconsciemment réinstallé l’archétype de l’Ancien Testament dans sa forme la plus rigide et pharisienne.
a) Hypertrophie de la Loi et atrophie de la Grâce
La société occidentale est devenue une Communauté du Contrat, pas du Spiritus.
- Diagnostic: l’Évangile a apporté au monde le concept de Metanoia (changement de mentalité) et de Pardon. Le pardon est la seule force capable de briser la chaîne causale de la culpabilité et de la punition (karma). Cependant, avec la «mort de Dieu», l’Occident a perdu la verticale d’où vient la grâce.
- Manifestation: ce qui reste, c’est la Loi horizontale. Le libéralisme moderne, la correction politique et la «cancel culture» ne sont pas des expressions de tolérance, mais de nouveaux Lévitiques séculiers. Ce sont des codes de pureté. Quiconque touche à la «propreté» (mauvaise opinion, péché historique) est rituellement exclu de la société. Il n’y a pas de pénitence, seulement une élimination ou une ostracisation sociale. L’Occident est devenu un Grand Inquisiteur, tenant dans sa main l’épée des lois et des droits de l’homme, mais sans Caritas (Amour) dans le cœur.
b) Mécanisation de la Justice: Œil pour œil, sanction pour sanction
La perte de l’aspect évangélique a replongé l’Occident dans la causalité.
- Piège ontologique: sans le principe de la Grâce, la réalité devient un mécanisme impitoyable de «flux et reflux». La géopolitique et la politique intérieure occidentale fonctionnent selon le principe de la rétribution. C’est un retour à la Lex Talionis archaïque, mais sophistiqué par le langage bureaucratique des tribunaux internationaux.
- Conséquence: l’Occident ne sait plus guérir, il ne sait que juger. Face à l’Orient (et au reste du monde), il agit comme un Procureur qui lit une liste d’infractions et réclame satisfaction. En cela, il se prive de la possibilité d’être le «Sel de la Terre». Le sel conserve et donne du goût; l’Occident est devenu une acide qui veut tout ronger jusqu’à ce que tout corresponde à la norme.

c) La cristallisation du Cœur: la fin de l’histoire du Salut
En absolutisant les «Règles» (rules-based order), l’Occident s’est enfermé lui-même dans l'Hylé (la matière) et le Logos (la raison), mais s’est coupé du Pneuma (l’Esprit).
- Effondrement: une société qui a remplacé l’Amour du prochain par l’obligation envers le système tend inévitablement vers le totalitarisme. Il s’agit d’un totalitarisme du «Bien», mais défini par des juristes et des technocrates, pas par des saints. L’Occident construit un «Palais de Cristal» — parfaitement transparent, hygiénique, sûr, mais froid et sans vie.
- Diagnostic final: l’Occident meurt par sous-nutrition spirituelle. Il a échangé la liberté inconfortable et risquée de l’Évangile contre la cage sécurisante mais étouffante de la Loi. Il devient ce contre quoi Christ a autrefois lutté: un temple où l’on marchandise la culpabilité, où la lettre de la loi tue l’Esprit. Et tant que l’Occident ne retrouvera pas la force de la Grâce — c’est-à-dire la capacité de voir, au-delà des contrats et des normes, le vivant — sa construction civilisationnelle s’effondrera sous le poids de sa propre justice impitoyable.
17:42 Publié dans Philosophie, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : orient, occident, philosophie, tradition |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Maître et esclave : l'erreur fatale de Marx - Pourquoi Marx a mal compris Hegel
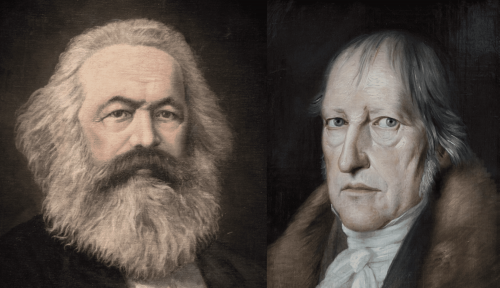
Maître et esclave : l'erreur fatale de Marx
Pourquoi Marx a mal compris Hegel
Alexander Douguine
Alexander Douguine soutient que Marx a mal interprété Hegel, confondant une structure éternelle de la conscience avec un problème historique qui pouvait être aboli.
Le modèle de la relation entre le maître et l'esclave a été examiné en détail par Hegel. Il comporte un aspect intéressant. En fait, Marx a construit sa doctrine de la révolution sur ce passage précis. Le maître lutte, préférant la mort et la liberté (c'est-à-dire que pour lui, la liberté et la mort ne font qu'un), tandis que l'esclave choisit non pas la liberté, mais l'esclavage et la vie. Celui qui choisit la vie choisit l'esclavage ; celui qui choisit la mort choisit la liberté. Ainsi, la mort, la liberté et la maîtrise forment un côté, tandis que la vie, la survie, la production matérielle, le traitement des êtres et l'esclavage forment l'autre.
De cette manière, deux types philosophiques émergent. Notez que nous parlons de types philosophiques. Bien sûr, la tentation est immédiate d'appliquer cela à la sociologie, à l'anthropologie, à l'ethnologie, à la structure de la société et aux classes. C'est exactement ce qu'a fait Marx : il a posé l'existence de maîtres et d'esclaves et l'idée d'un soulèvement des esclaves. Le marxisme repose sur le postulat que l'esclave n'a pas de conscience propre et que, par conséquent, les masses exploitées de la société féodale (ou d'une société encore plus ancienne) ne vivent pas selon leur propre conscience, mais selon celle de la classe dominante. Elles ne se connaissent pas elles-mêmes et ne prennent conscience d'elles-mêmes qu'à travers la conscience des maîtres. Elles manquent de conscience de soi, tandis que les maîtres en sont dotés.
Hegel poursuit en disant que dans la lutte contre la mort, et dans les luttes de la mort elle-même avec ses reflets et ses échos, le maître n'atteint pas l'immortalité au sens plein du terme, bien que ce soit précisément ce qu'il recherche. Au lieu de cela, il acquiert l'esclave. Celui qui s'est enfui loin de lui, qui n'a pas pu supporter son vide et son regard, devient sa proie. Et l'esclave, devenu esclave, a la possibilité de ne pas regarder son maître dans les yeux, de baisser le regard, c'est-à-dire de ne pas regarder la mort en face, et il gagne ainsi la vie, bien qu'il ne soit plus libre. Et que signifie la liberté ? Pour Hegel, la liberté est la conscience de soi, et seule la conscience de soi est liberté. Celui qui est libre est conscient de sa propre conscience — Selbstbewußtsein. Celui qui n'est pas libre ne reconnaît pas son individualité: c'est précisément cela, le manque de liberté. La liberté n'a pas d'autres paramètres. La position sociale, par exemple celle des classes dépendantes exploitées ou des classes dominantes, n'est que la conséquence de la réalisation de certaines orientations et mouvements philosophiques qui se produisent au sein du sujet. Le sujet qui insiste jusqu'au bout sur sa conscience de soi périt ou devient dominant. Le sujet qui échappe à cette résistance, qui s'en retire, grossit les masses, comme le croyaient les Sarmates polonais ou les adeptes hongrois de l'idéologie scythe.
En philosophie, en particulier dans la philosophie hégélienne, tout cela est irréprochable. Bien sûr, en histoire, en sociologie et en anthropologie, on peut trouver des exemples qui confirment ou réfutent cette théorie. Il n'y a pas de projection directe de ces principes sur l'histoire des sociétés humaines. Pourtant, ces observations profondes nécessitent une réflexion approfondie ; elles ne doivent pas être appliquées immédiatement. Marx a tenté de les appliquer, mais dès qu'il s'est légèrement trompé dans les subtilités des modèles philosophiques, ne parvenant pas à mener à bien la réflexion de Hegel, nombre de ses notions sur la nature sociale des processus qui se déroulent dans la société humaine à travers l'histoire se sont révélées incorrectes et erronées.
La dialectique hégélienne de l'esclave et du maître concerne avant tout les structures de l'Esprit subjectif. On peut en tirer
- les conclusions tirées par Marx,
- les conclusions tirées par Gentile,
- et les conclusions tirées par Heidegger.

Si la topographie philosophique est correcte, elle possède un nombre illimité d'applications, de versions, de nuances, de réfutations et de confirmations. En même temps, elle est entièrement indépendante de ses aspects appliqués. La vérité de la philosophie n'est pas vérifiée par l'expérience, mais par une immersion totale dans ses structures et par l'habileté à les naviguer librement, en les corrélant prudemment avec d'autres systèmes métaphysiques.
En tout état de cause, quiconque renonce à la liberté renonce à la conscience de soi. Et quiconque renonce à la conscience de soi est immédiatement placé à la périphérie de la société, ce qui est logique. La conscience de l'esclave est dirigée vers l'extérieur, vers le monde sensoriel, vers les sensations, vers cette apparence (Schein) qui se fait passer pour l'être. Pas vers les phénomènes eux-mêmes, car les phénomènes résident dans le maître, et pour les atteindre, il faut d'abord briser l'immense pouvoir du négatif.
En général, la phénoménologie est l'affaire des maîtres, car affronter le mouvement de la pensée – en particulier la réflexion, le mouvement de la conscience vers elle-même – signifie, pour Hegel, acquérir l'expérience du contact avec la sphère du premier monde suprasensible, où le phénomène se révèle comme phénomène : Erscheinung als Erscheinung. Seul le maître peut se permettre cela, car il évolue vers sa propre maîtrise en lui-même. Puisque l'Erscheinung en tant que phénomène est l'affaire du sujet, la phénoménologie elle-même est l'affaire des maîtres, et non des esclaves. L'affaire des esclaves est la perception sensorielle, la conscience sans conscience de soi. L'esclave philosophique est destiné à être un instrument, une zone intermédiaire au sein de la culture humaine, un territoire frontalier entre le centre magistral et le monde de l'extériorité, une zone d'objectivité négative qui se désintègre et se disperse à mesure qu'elle s'éloigne du centre de la subjectivité radicale, le long des rayons dispersés des essences en déclin.

Ainsi, le maître, ayant acquis l'esclave, se concentre sur le contenu intérieur de la conscience, sur l'aperception, sur la réduction phénoménologique, sur le problème de la culture du sujet radical et royal. L'esclave, en revanche, est envoyé à la périphérie de la conscience afin d'organiser l'expérience sensorielle. Là, il passe à une interaction directe (pour parler en termes kantiens) avec les formes a priori de la sensibilité, avec l'espace et le temps, avec les aspects les plus externes de l'être. L'Esclave produit des choses parce qu'il les cultive. Bien sûr, il est le porteur d'une conscience importante et rationnelle. Il arrange et ordonne les choses ; il les produit, tandis que le Maître se contente de les consommer ou de les détruire. L'Esclave fournit la chose au Maître afin qu'elle cesse d'exister. Le Maître dit : « Apportez-moi ceci ou cela ; je vais maintenant le consommer ou le détruire. » Le maître consomme tout ce qu'il souhaite, puisqu'il apparaît effectivement comme le destructeur de tout ce qui existe et qu'il ne crée pas lui-même. L'esclave crée tout ; le maître ne fait qu'anéantir. Que ce soit dans la guerre, vers laquelle il est naturellement attiré, ou en dehors de la guerre, le maître est engagé dans la destruction. L'idée naïve selon laquelle le maître doit être gentil, aider ses ouvriers (ou ses travailleurs) à peindre les murs, par exemple, est peu réaliste. Le maître ne doit se préoccuper de rien ; il doit être absolument libre de toute prescription, et surtout des prescriptions de ce que pensent les esclaves, car les esclaves doivent faire ce que le maître leur dit, plutôt que de s'adresser à lui avec leurs propres considérations.
Telle est la dialectique de l'esclave et du maître. On peut également observer leur relation différente à la production : ce que le maître détruit ou consomme, l'esclave le crée. Cela a impressionné Marx, qui a décidé qu'à un moment donné, le maître rassemblerait de nombreux esclaves (une classe entière), les assujettirait et ne consommerait que ce qu'ils produisaient. En conséquence, à un moment donné, le maître deviendrait dépendant des esclaves, car s'il n'avait rien à détruire – c'est-à-dire à consommer –, il disparaîtrait, périrait. Il s'avérerait alors que les esclaves, inutiles en eux-mêmes, étaient devenus indispensables à sa survie.
Pourtant, même si nous admettons que cela ne se produira pas (contrairement à Marx) et que la conscience de soi du maître devienne une conscience de soi absolue, ne dépendant de rien, y compris de la classe des esclaves qui lui fournit son contenu ontique, elle deviendrait une concentration de négativité noire, une négation radicale anéantissant tout ce qui existe. Même l'illusion du nicht-Ich ne subsisterait plus, et par conséquent, il n'y aurait plus de monde subordonné, servile, soumis à la destruction par la conscience, c'est-à-dire à la compréhension ou à la connaissance.

Chez Hegel, la discussion porte sur la structure de la conscience qui nous est donnée de manière synchronique. Les phases de la bataille entre deux consciences de soi – la lutte héroïque avec la mort et la désertion qui transforme le guerrier en esclave, la préférence pour la vie au prix du renoncement à la conscience de soi – sont décrites comme séquentielles. Pourtant, dans la structure de Hegel, elles sont synchrones. Il s'agit de moments structurels dans le domaine de la conscience. Il serait tout à fait erroné d'interpréter cela du point de vue de la succession temporelle. Ce qui est présent ici est une séquence logique, et non chronologique ou diachronique. Supposer, comme l'a fait Marx, qu'un moment viendra où le maître deviendra trop dépendant de l'esclave, que la conscience de soi de l'esclave s'éveillera et qu'il se rendra compte que le maître ne peut ni manger ni boire sans lui, et que l'esclave, entrant dans sa conscience, détruira le maître et sa volonté nihiliste, mettra fin à ses efforts pour consommer et anéantir, et créera un monde magnifique pour les travailleurs du socialisme et du communisme, est théoriquement possible. Le libéral hégélien Kojève voyait la résolution de la dialectique maître-esclave dans la société civile, bien que Hegel lui-même ne la considérait possible que dans un État pleinement réalisé du futur, dans une monarchie constitutionnelle.
Néanmoins, sans une analyse structurelle minutieuse de la conscience et une compréhension claire de la nature de la conscience de soi, nous risquons d'obtenir non pas un hégélianisme authentique, mais un hégélianisme inversé, un hégélianisme renversé. L'idée de Marx selon laquelle la conscience prolétarienne reconnaîtra la dépendance du maître vis-à-vis des travailleurs, rejettera la conscience de soi empruntée au maître, renversera le pouvoir des classes exploiteuses et construira une société sans négation, sans conscience négative, fondée sur la pure constructivité et la sensibilité, sans ce sujet maître terrifiant qui constituait l'essence du problème fondamental dans la relation entre l'esclave et le maître, découle d'une compréhension profondément erronée (voire d'un rejet pur et simple) de l'Esprit subjectif et de ses structures, sans parler du Sujet radical.
En fin de compte, si nous adoptons la position de Marx et prenons le parti de l'esclave qui cherche à se libérer du maître, cela revient à reconnaître que la conscience ne peut exister que comme sa propre périphérie sans centre — qu'il n'y a pas de centre du tout et qu'il n'en faut pas, puisqu'il n'en émane que diverses impulsions terribles, dont la principale est la mort. La logique des marxistes est la suivante : si l'on ignore le contenu intérieur de la conscience et que l'on s'accroche à l'être extérieur — ou même plus loin encore, dans le domaine de « l'attitude naturelle » de Husserl, au-delà des limites de la conscience —, alors seulement le bonheur, l'immortalité et l'égalité peuvent être atteints, et le Moyen Âge, l'exploitation et la domination peuvent prendre fin pour toujours. En poussant cette logique jusqu'à sa conclusion, nous arrivons à la conclusion que dans un tel cas, il ne resterait non seulement aucune philosophie et aucun sujet radical, mais finalement aucun être humain.

Il est donc extrêmement important de concevoir toutes les phases et étapes de la formation du couple Maître (en tant que sujet et porteur de conscience de soi) et Esclave (en tant que porteur de conscience subordonnée) comme une configuration immuable – en un certain sens « éternelle » – de la structure anthropologique. En ce sens, un Hegel compris (lu) de manière synchronique peut s'appliquer aussi bien aux sociétés anciennes, médiévales que modernes. Parfois, cela apparaît de manière évidente, parfois sous une forme voilée (par exemple, à travers diverses procédures de la société civile, où l'on ne rencontre plus de revendication directe de maîtrise absolue), mais la domination elle-même – et Marx a tout à fait raison sur ce point ! – ne disparaît pas dans la démocratie et la société civile, dans le capitalisme ; au contraire, elle ne fait que devenir plus totale. En tout état de cause, si l'on examine de près ces sociétés, l'axe maître/esclave se révèle inévitablement. Derrière toutes les revendications d'égalité de la démocratie moderne – que les esclaves ont enfin pris le pouvoir et aboli les hiérarchies, qu'il n'y a plus de maîtres au-dessus d'eux et que, par conséquent, les esclaves ne sont plus des esclaves mais des membres respectés de la « société civile » – se cache une réalité tout autre, beaucoup plus proche du couple hégélien. Les élites dirigeantes de la démocratie – en particulier dans le contexte de la mondialisation – s'efforcent plus que jamais d'exercer un contrôle total sur la conscience des masses, en y projetant leur volonté, en la chargeant de faux substituts et en « annulant » sans pitié toute tentative des masses de s'éveiller et de remettre en question l'idéologie dominante (le plus souvent libérale ou libérale de gauche). Dans la société libérale, une autre édition du Maître remplace la classe dirigeante : il porte un nom différent, a une apparence différente, est d'un style nouveau. Pourtant, la domination ne peut être abolie sans abolir l'être humain, sans détruire la société, sans annuler la pensée et la philosophie. L'absence de domination nécessiterait l'absence de l'humain.
Le postmodernisme, ou le courant posthumaniste dans la culture, arrive progressivement à une conclusion aussi radicalement égalitaire. La libération de la hiérarchie est possible en même temps que la libération de l'humain. Là où il y a un être humain, la différenciation entre l'esclavage et la maîtrise apparaîtra inévitablement à un certain niveau, même au sein d'une seule et même entité. D'où la verticalité de l'humain ; d'où la domination de l'esprit (la tête) sur les autres organes. En effet, tout ce qui touche à l'humain est l'histoire de la dialectique de l'esclave et du maître, qui, en principe, n'a pas subi de changements majeurs tout au long de l'existence de l'humanité. Oui, elle se déploie sous différentes formes et combinaisons, mais les maîtres et les esclaves — sous diverses formes, combinaisons, sous différents masques, avec différents modèles d'institutionnalisation — existent toujours, qu'ils le sachent ou non, qu'ils le reconnaissent ou non. Les esclaves peuvent ne pas se douter qu'ils sont esclaves, mais les maîtres agissent toujours avec une image plus responsable, même s'ils la dissimulent souvent, la déforment ou même nient son existence.
A. G. Douguine, La phénoménologie de Hegel — Une expérience d'interprétations transversales, Projet académique, Moscou, 2024.
15:55 Publié dans Nouvelle Droite, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : philosophie, hegel, karl marx, alexandre douguine |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 12 février 2026
La dictature des libéraux

La dictature des libéraux
par Diego Fusaro
Source: https://socialismomultipolaridad.blogspot.com/2026/02/la-dictadura-de-los-liberales.html
Argent créé à partir de rien et exploitation: la dictature financière des seigneurs apatrides de la notation
Sur la base de la nouvelle alchimie bancaire, qui transforme le papier imprimé en or et, en outre, en chaînes inoxydables de l'endettement, la classe liquide-financière des seigneurs de la globocratie sans frontières a acquis le monopole de la creatio ex nihilo de la monnaie et de la notation (c'est-à-dire du montant que les entités publiques ou privées paient pour obtenir de l'argent). Le monde entier est endetté envers la classe dominante pour la simple raison que l'on progresse en accumulant des intérêts. La virtualisation luciférienne de la turbofinance a en effet conduit à la création, ex nihilo, d'immenses valeurs comptables, mais sans fondement réel, ainsi qu'à des bulles immobilières et boursières, à des effondrements et à des récessions. Ainsi, profitant des actifs toxiques et de la fraude financière évidente, le Seigneur mondial-élitiste renforce de plus en plus sa domination sur le Serviteur national-populaire appauvri : grâce à son propre pouvoir, il impose aux gouvernements ses propres choix, en finançant certaines politiques spécifiques et en en définissant d'autres.
Plus précisément, la classe usurière au pouvoir épuise et dirige l'État à l'aide des leviers de la dette et des notations : ainsi, les politiques sont dictées par les marchés spéculatifs. Elle hégémonise également progressivement la recherche scientifique, l'éducation et la juridiction.
Le mystère du grand commerce bancaire réside dans le fait que les banques perçoivent des intérêts sur de l'argent qui n'est pas réellement disponible et prétendent le prêter en ouvrant des crédits comptables à un coût qui, en fait, est nul pour elles. La classe turbo-financière des mondialisateurs et des banquiers, qui apparaissent et agissent de plus en plus comme les détenteurs du monopole planétaire de l'argent, génère de l'argent ex nihilo et, à travers lui, retire le pouvoir d'achat de la société sans rien donner en échange : elle le rectifie, le prête avec intérêts, puis se le fait rembourser avec de l'argent produit par le travail de la classe dominée par le peuple national.

Dans cette perspective, où les mauvaises entreprises transfèrent les coûts vers la communauté et déversent les actifs de l'entreprise dans de nouvelles entreprises qui sont rapidement privatisées, il est clair comme le jour que les banques ne se limitent pas à servir d'intermédiaires dans l'épargne et à exercer le crédit. Elles créent également de l'argent. Ce que l'on appelle la « seigneurie » consiste en un tel geste de prise de pouvoir d'achat de la richesse réelle en l'absence d'une valeur réelle donnée en échange. Il s'agit, en d'autres termes, du pouvoir d'émettre de la monnaie dont le pouvoir d'achat est indépendant de sa propre valeur.
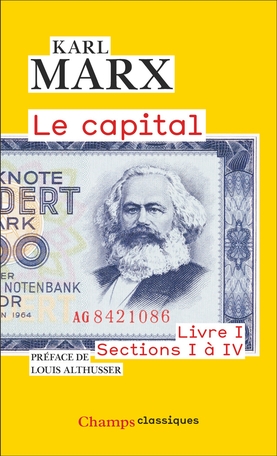 Comme nous le savons, à ses débuts, le capital s'est constitué sur la base de « l'accumulation primitive », décrite dans le chapitre XXIV du premier livre du Capital. Le nouveau capitalisme totalitaire absolu connaît aujourd'hui une sorte de seconde accumulation primitive, d'origine financière.
Comme nous le savons, à ses débuts, le capital s'est constitué sur la base de « l'accumulation primitive », décrite dans le chapitre XXIV du premier livre du Capital. Le nouveau capitalisme totalitaire absolu connaît aujourd'hui une sorte de seconde accumulation primitive, d'origine financière.
Il ne se concentre plus sur l'expropriation forcée des terres communales, mais sur l'émission de nouvelle monnaie ex nihilo par les seigneurs de la bancocratie et du core business [activité principale] et, de cette manière, ils acquièrent unilatéralement pour eux-mêmes un pouvoir d'achat de biens et de services sur le marché, à partir duquel ils exercent leur pouvoir. Si la première accumulation a été violente, celle-ci est silencieuse et anonyme, mais non moins tragique dans ses effets. C'est la seule façon d'expliquer la crise américaine de 2007, ainsi que - pour nous limiter à l'Italie - la perte d'environ 40% du pouvoir d'achat du peuple italien avec le passage de la lire à la monnaie unique, l'euro. Cet aspect révèle en outre que la mondialisation est aussi – et non pas secondairement – un processus par lequel la production de biens et de services se traduit par une dépendance monétaire et créditrice envers un système bancaire privé de plus en plus post-national.
La prophétie (néfaste) de Karl Marx sur le capitalisme financier actuel
Dans le troisième livre du Capital, le philosophe allemand avait anticipé l'établissement d'une nouvelle aristocratie financière composée d'usuriers et de parasites vivant grâce à des escroqueries bancaires et à des vols légalisés.
Le troisième livre du Capital de Karl Marx anticipe ce qui a été réalisé dans le cadre du nouvel ordre mondial après 1989, à savoir la mise en place d'une nouvelle aristocratie financière composée d'usuriers et de parasites qui vivent grâce à des escroqueries bancaires et à des vols légalisés. C'est ainsi que Marx écrit à propos de la création financière du capital :
« Elle reproduit une nouvelle aristocratie financière (neue Finanzaristokratie), une nouvelle catégorie de parasites sous la forme de concepteurs de projets, de fondateurs et de simples directeurs nominaux ; tout un système de fraude et de tromperie lié aux fondations, aux émissions d'actions et au commerce des actions. »
Marx suit en effet comment le passage de la société industrielle à la société financière se caractérise également par le passage de la richesse productive et entrepreneuriale à la richesse parasitaire et au vol propres au « capitalisme financier », comme l'appelait Luciano Gallino. Chassée par la Révolution française et la bourgeoisie industrielle, l'aristocratie féodale s'est relevée sous la forme sans précédent de l'aristocratie financière évoquée par Marx, désormais installée au pouvoir dans le cadre du capitalisme absolu et financier après 1989. Claudio Tuozzolo l'a souligné dans son essai « République : travail, décroissance ou finance ? Marx et le capitalisme des revenus financiers » (2013), auquel nous faisons référence ici.
Il n'y a plus de travail, mais le revenu redevient l'axe du mode de production néo-féodal du capitalisme flexible. Selon les termes de Marx à propos de l'aristocratie financière, « le profit se présente exclusivement sous forme de rente » et « le profit total est empoché uniquement sous forme d'intérêts, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une simple compensation pour la propriété du capital ». La différence entre le capitalisme industriel et le capitalisme financier, qui ne s'est concrétisée que récemment, est déjà clairement soulignée par Marx, qui montre comment, avec le capitalisme financier, la classe moyenne et le monde des affaires finissent par se dissoudre.
Si, en effet, dans le capitalisme entrepreneurial, le capital est « la propriété privée des producteurs individuels », avec l'avènement de l'économie financiarisée, il se produit une séparation entre la propriété et les producteurs : la conséquence paradoxale est que, selon les termes de Marx, au sein même de la production capitaliste, on assiste à « l'annulation de l'industrie capitaliste privée ». Le producteur capitaliste est désormais remplacé par le spéculateur financier : si le premier risquait son propre capital accumulé, le second risque une propriété qui ne lui appartient pas et affirme que « d'autres épargneront pour lui ».
Au sommet de la dynamique d'absolutisation et d'autonomie de l'économie en tant que processus autoréférentiel, le capitalisme financier de la phase absolue ne repose plus, comme l'écrit, sur « les individus réellement actifs dans la production, du gestionnaire au dernier journalier ». Ces derniers sont utilisés par l'économie financière comme ses outils, comme des fonctionnaires de la croissance infinie de la valeur : ils se contrôlent mutuellement et sont soumis à des sanctions inflexibles, articulées contre quiconque ne remplit pas au mieux sa fonction d'agent de valorisation. Le capital dévore ses propres agents.
Le capital gagne parce qu'il nous demande d'être le pire de nous-mêmes
La réalité dépasse souvent la fantaisie. À partir de 1989, la classe dominée et surexploitée s'est mise à lutter pour défendre un monde socio-économique auquel, après une analyse minutieuse du schéma des relations de pouvoir, elle devrait résolument tourner le dos en vue d'obtenir sa libération. D'autre part, tout le monde peut le voir : le sophisme de la « main invisible », le mythe de la coïncidence entre les intérêts privés et le bien-être public, a révélé sa véritable nature illusoire. Une fois son voile trompeur disparu, le capital s'est révélé dans toute sa cruauté : il a clairement montré, selon les termes de l'Introduction à la métaphysique de Heidegger, « la fuite des dieux, la destruction de la terre, la massification de l'homme, la prévalence de la médiocrité », c'est-à-dire ses véritables fondements. Et pourtant, même en marge des tragédies sociales qu'il produit constamment, le capital reste l'objet d'une foi inébranlable et omniprésente, enracinée également chez ceux qui, en le combattant, ne feraient que perdre leurs chaînes.
 Comme je l'ai dit dans Minima Mercatalia. Philosophie et capitalisme (2012), chaque ventre vide continue de représenter un argument non négligeable contre cet ordre de production « sensiblement suprasensible » (Marx), qui a fait de la vie elle-même une lutte cannibale pour la survie. Et pourtant, les ventres vides, chaque jour plus nombreux, continuent d'attester le credo quia absurdum de la religion du libre marché et des homélies des thaumaturges du néolibéralisme. S'ils se soulèvent – ce qui n'arrive en réalité que très sporadiquement –, ils ont tendance à le faire contre ce qui pourrait mettre en danger le contrôle systémique de l'ordre désordonné du fanatisme économique.
Comme je l'ai dit dans Minima Mercatalia. Philosophie et capitalisme (2012), chaque ventre vide continue de représenter un argument non négligeable contre cet ordre de production « sensiblement suprasensible » (Marx), qui a fait de la vie elle-même une lutte cannibale pour la survie. Et pourtant, les ventres vides, chaque jour plus nombreux, continuent d'attester le credo quia absurdum de la religion du libre marché et des homélies des thaumaturges du néolibéralisme. S'ils se soulèvent – ce qui n'arrive en réalité que très sporadiquement –, ils ont tendance à le faire contre ce qui pourrait mettre en danger le contrôle systémique de l'ordre désordonné du fanatisme économique.
Cet aspect doit bien sûr être mis en relation avec l'anthropologie persuasive généralisée par le capital, une anthropologie centrée sur le profil de l'individu sans gravité et sans limites, de sorte que tout désir coïncide avec un droit qui doit être satisfait par le consumérisme et sans délai : la vie, c'est maintenant, comme le répète sans cesse l'affirmation salutaire de la société du spectacle permanent.
Et même sans la discrimination de classe sur laquelle repose l'ordre globocratique – dans sa lutte perpétuelle contre toutes les formes de discrimination qui ne coïncident pas avec l'ordre économique de plus en plus oppressif –, les défaites de la mondialisation continuent d'adhérer avec enthousiasme au projet du capital.
Elles le font parce qu'au final, il ne nous demande que d'être indifférents et de montrer sans inhibition le pire de nous-mêmes. Le cynisme, la cupidité, l'avarice, la débauche, l'égoïsme et toutes les autres prérogatives que les religions et la morale du passé avaient unanimement diabolisées comme des vices pernicieux sont, dans un mouvement inverse, élevées par l'anthropologie capitaliste au rang de qualités favorables à l'individu déraciné, dont le soulagement de la responsabilité pour tout ce qui l'entoure est loué comme le fondement même de sa réussite entrepreneuriale et de l'affirmation de son propre moi.
La civilisation, dans son ensemble, peut également être comprise comme une tentative ardue d'élever l'animal humain au-dessus de sa condition purement animale, en l'éduquant et en l'incitant à développer les déterminations qui le distinguent proprement des autres animaux. Pour sa part, l'anthropologie inhérente au capital est régressive : elle sacrifie l'humain sur l'autel de la bête et transforme en impératif catégorique la simple observance du principe d'animalité, les pulsions immédiates et la satisfaction anormale de son propre plaisir individuel sans report ni règles. C'est là que réside sa force magnétique attractive de religion d'immanence et d'égoïsme.
La politique a perdu. Le marché a donc tué les idéologies
S'appuyant sur la mystique libérale de l'intervention thaumaturgique des marchés autorégulés, la dérégulation libérale correspond à la dépolitisation de l'économie soustraite à la gestion démocratique possible par le peuple souverain. Cela marque, comme on l'a dit, l'apogée de la dés-éthisation, dans la mesure où, suivant les traces de Hegel, l'État s'érige en idée vivante de la réalité éthique et, plus généralement, en garant des « racines éthiques » qui imprègnent le monde de la vie et les connexions communautaires intersubjectives. On ne peut pas dire que le rêve néolibéral se soit réalisé tant que les « dentelles et les broderies » de l'État sont le dernier bastion survivant de la primauté du politique sur l'économique, du choix démocratique sur la volonté oligarchique incontrôlée, des communautés sur l'élite néo-féodale et ploutocratique pour empêcher l'avènement du laissez-faire planétaire et de l'anarchie commerciale.
 Selon la grammaire de Carl Schmitt, c'est le moment où les processus convergents de « dépolitisation » (Entpolitisierung) et de « neutralisation » (Neutralisierung) deviennent réalité. Tout « centre de référence » symbolique autre que celui de l'économie élevée au rang de seule source de sens est neutralisé ; et, dans cette voie, nous avançons vers une dépolitisation complète. La capacité résiduelle de la force politique à contenir et à gouverner l'économie - de plus en plus déconnectée - est désarticulée. La dépolitisation de l'économie est déterminée par la dé-souverainisation, c'est-à-dire par l'anéantissement de l'espace réel d'action des politiques des États nationaux souverains en tant qu'instances éthiques capables de contenir et d'orienter l'économie en fonction des intérêts de la communauté.
Selon la grammaire de Carl Schmitt, c'est le moment où les processus convergents de « dépolitisation » (Entpolitisierung) et de « neutralisation » (Neutralisierung) deviennent réalité. Tout « centre de référence » symbolique autre que celui de l'économie élevée au rang de seule source de sens est neutralisé ; et, dans cette voie, nous avançons vers une dépolitisation complète. La capacité résiduelle de la force politique à contenir et à gouverner l'économie - de plus en plus déconnectée - est désarticulée. La dépolitisation de l'économie est déterminée par la dé-souverainisation, c'est-à-dire par l'anéantissement de l'espace réel d'action des politiques des États nationaux souverains en tant qu'instances éthiques capables de contenir et d'orienter l'économie en fonction des intérêts de la communauté.
Ainsi, la « tendance à séparer le pouvoir de la politique » apparaît comme la raison d'être du nouveau système du marché absolu. Cela réfute en outre la célèbre thèse de Ferguson dans son Essai sur l'histoire de la société civile (1767), selon laquelle « les arts du commerce et de la politique ont progressé ensemble, tout en se préservant »: en admettant, avec Ferguson, qu'il y a eu dans le passé un entrelacement aussi progressif, celui-ci semble aujourd'hui manifestement dissous ; avec pour conséquence que les nouveaux arts du commerce et de l'économie numérique sans frontières progressent en anéantissant les espaces de la politique. À travers la dépolitisation de l'économie et l'anéantissement de l'État souverain démocratique, s'établit la « domination de l'économie sur la société » et la souveraineté absolue du capital financier, selon les termes de Lukács. Ce dernier décompose le droit du travail, les contrats nationaux, le droit constitutionnel et les acquis sociaux en défense des subordonnés.
Les processus mutuellement innervés de Neutralisierung et d'Entpolitisierung se projettent clairement dans un fait nouveau, qui marque également une rupture par rapport au « petit siècle » : pour la première fois, la société dans son ensemble ne représente plus sa propre dynamique globale à travers la politique, ni n'est considérée comme susceptible d'être transformée par des projets politiques visant à remodeler l'existant. Dans le triomphe de la période post-politique, la dimension antérieure de la politique et ses passions fortes sont remplacées par l'épanouissement de formations idéologiques micro-sectorielles de faible ou nulle importance. Il s'agit, entre autres, du féminisme et de l'écologisme, du fondamentalisme religieux et du nationalisme tribal.
Ces formations idéologiques fragmentent de manière prismatique l'ensemble de la société en dichotomies partisanes sur lesquelles elles reposent. Elles sont donc intrinsèquement inadaptées à tout projet politique visant à reconstituer la société aliénée sur de nouvelles bases. C'est également en vertu de cela que les idéologies post-politiques susmentionnées sont finalement fortement conditionnées et limitées, dans leurs applications pratiques, par l'idéologie omniprésente du marché, qui agit comme un fond idéologique constant, souvent inconscient. Le politicien, quant à lui, est lié à la dimension du choix et de la décision, dans un espace où s'affrontent de manière dialogique différentes idées sur l'orientation générale et globale de la vie associative et l'organisation collective de l'existence : or, cet espace, abandonné par la politique, a été livré au marché lui-même et donc réabsorbé par l'économie.
L'entreprise sanitaire et la marchandisation du langage
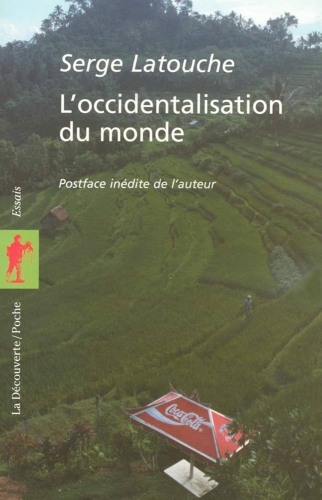 Tout devient marchandise, avait prévenu Marx en 1847. Marx ne pouvait peut-être pas prévoir que même le ventre des femmes et l'école le deviendraient aussi. Cependant, son diagnostic était clair et, après tout, s'il était bien compris, il permettait de prédire la marchandisation totale qui a lieu aujourd'hui. De l'économie de marché dans laquelle Marx a vécu, nous sommes passés indifféremment à la société de marché, dans laquelle il n'existe aucun paramètre qui résiste à la «marchandisation omniprésente» (Latouche). Même les écoles, les hôpitaux et les utérus des femmes.
Tout devient marchandise, avait prévenu Marx en 1847. Marx ne pouvait peut-être pas prévoir que même le ventre des femmes et l'école le deviendraient aussi. Cependant, son diagnostic était clair et, après tout, s'il était bien compris, il permettait de prédire la marchandisation totale qui a lieu aujourd'hui. De l'économie de marché dans laquelle Marx a vécu, nous sommes passés indifféremment à la société de marché, dans laquelle il n'existe aucun paramètre qui résiste à la «marchandisation omniprésente» (Latouche). Même les écoles, les hôpitaux et les utérus des femmes.
Selon Foucault, le lien avec le marché est devenu un « a priori historique », c'est-à-dire une condition de réalité pour chaque affirmation et chaque représentation de la signification de la pensée. Tout ce que nous disons et pensons est dit et pensé sur la base de la forme des biens comme condition inéluctable de la possibilité d'énoncer et de penser le réel.
Avec Heidegger, nous sommes parlés par le langage : c'est en lui que se cristallise l'esprit du temps. Notre lexique, parfois sans que nous nous en rendions compte, est colonisé par la forme des biens. Même la sphère sentimentale, qui semble être la plus hétérogène par rapport à la forme de la marchandise, en est profondément imprégnée : ne parle-t-on pas depuis quelque temps d'« investissement affectif » ?
À l'instar du « Je pense » kantien, les biens doivent pouvoir accompagner toutes mes représentations. Jamais auparavant la forme des biens n'avait été élevée au rang de moyen de communication total d'une culture. Jamais auparavant le réel et le symbolique n'avaient été complètement marchandisés.
Dans les limites du capitalisme totalitaire, monde dont nous sommes les habitants, l'individu est soumis au capital non seulement en tant que vendeur de main-d'œuvre (qui est, de surcroît, précaire et flexible à notre époque). Son incorporation est en soi absolument totalitaire, puisqu'elle se produit tant dans la culture que dans les loisirs, dans l'éducation comme dans la maladie, et même dans la mort. Il n'y a aujourd'hui aucun domaine de la vie nue qui puisse échapper aux griffes mortelles du capital.
Dans le passé, le capital s'arrêtait aux portes de l'usine. Aujourd'hui, il les a franchies et s'est emparé de toute la vie, de la pensée et de l'imagination.
Ainsi, le modèle de l'entreprise totale prévaut : tout devient entreprise, même les écoles. En raison de cette dynamique entrepreneuriale initiale, les hôpitaux ont désormais laissé place à des « agences de santé », selon la logique de la marchandisation de la santé et des soins de santé eux-mêmes. La santé n'est plus un droit social incontournable, mais est devenue une marchandise parmi tant d'autres.
Le cannibalisme libéral. Comment les citoyens sont devenus des consommateurs
 Le pouvoir apolitique de l'économie peut aujourd'hui s'exercer sans entrave dans l'arène mondialisée et dénationalisée, hors de portée de la politique. L'« anarchie commerciale » dénoncée par Fichte correspond à la déréglementation actuelle du laissez-faire mondial du code néolibéral. Le capitalisme réglementé ne peut exister, car son essence est la désobéissance, l'entropie efficace qui dépasse toute norme visant à freiner et à limiter les dynamiques autoréférentielles de la croissance infinie.
Le pouvoir apolitique de l'économie peut aujourd'hui s'exercer sans entrave dans l'arène mondialisée et dénationalisée, hors de portée de la politique. L'« anarchie commerciale » dénoncée par Fichte correspond à la déréglementation actuelle du laissez-faire mondial du code néolibéral. Le capitalisme réglementé ne peut exister, car son essence est la désobéissance, l'entropie efficace qui dépasse toute norme visant à freiner et à limiter les dynamiques autoréférentielles de la croissance infinie.
Présentée à travers l'utilisation autorisée et liturgique de la langue anglaise comme un nouveau latin, la déréglementation n'est finalement rien d'autre que la dynamique de libération des formes et des réglementations qui entravent l'innovation techno-capitaliste, garantissant en échange des protections juridiques pour les travailleurs et la communauté humaine, les démocraties et les droits. Pour que cette déréglementation soit pleinement possible, il est bien sûr nécessaire de déconstruire la conscience oppositionnelle de la masse nationale-populaire (ce qui a été fait avec succès), mais aussi de dés-souverainiser les États, en éliminant les conditions de toutes les manœuvres possibles de leur gestion de l'économie.
La gestion de l'économie est rendue impossible par l'annulation de l'espace politique des États souverains et, symboliquement, par la diabolisation a priori de tout projet de gouvernement politique de l'économie elle-même, déjà qualifié de totalitaire.
Cela est également possible, et ce n'est pas secondaire, par le fait que le libéralisme, d'une manière totalement non vérifiée, a été pacifiquement accepté comme le nec plus ultra de la philosophie politique et comme la cour suprême devant laquelle tous les régimes politiques qui ne s'appuient pas sans réserve sur lui sont convoqués et appelés à se disculper.
La politique elle-même, après 1989, réduite presque entièrement à une continuation de l'économie par d'autres moyens, n'accepte pas les mouvements, les factions et les partis qui n'ont pas juré fidélité éternelle au discours libéral : avec pour conséquence évidente que, dans le triomphe du faux pluralisme qui cache la véritable nature du totalitarisme glamour, seuls le libéralisme de droite, le libéralisme centriste et le libéralisme de gauche s'affrontent toujours. Quel que soit le camp victorieux, c'est le libéralisme qui l'emporte, mais avec une intensité et des couleurs changeantes.
C'est également grâce à la déréglementation que la condition néolibérale peut être caractérisée, non sans raison, par la privatisation complète de ce qui, même avant 1989, était considéré comme des biens communautaires indisponibles (de la santé au logement, en passant par l'éducation). Le cœur secret du capital et son élan atavique d'acquisition fondé sur l'asymétrie du lien entre seigneurie et servitude, l'esprit individualiste du profit illimité, continuent sans relâche à recourir à la pratique de la clôture, privatisant le public et transformant les biens et droits communs en biens achetables.
Le cannibalisme libre, typique de la norme de compétitivité antagoniste, occupe à nouveau les espaces de solidarité communautaire ; il redéfinit comme des objets de consommation accessibles à partir de la valeur d'échange ce qui était auparavant des droits inaliénables. Les figures interconnectées de citoyenneté et de citoyen fondées sur l'éthique de l'État national souverain sont éclipsées, remplacées par de nouveaux profils de clientèle et de consommation, avec au centre la forme des biens et la valeur d'échange réparties différemment. Avec la grammaire de l'essai marxiste Sur la question juive, le profil de l'individu privatisé s'est mondialisé, non pas celui du citoyen, qui est en réalité en train de s'éclipser, mais celui du bourgeois, qui construit ses relations sur la base du théorème de la sociabilité malheureuse.
20:15 Publié dans Actualité, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, diego fusaro, libéralisme, néolibéralisme, turbocapitalisme, bancocratie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 03 février 2026
Les néoréactionnaires sont-ils solubles dans la pensée?

Les néoréactionnaires sont-ils solubles dans la pensée?
par Claude Bourrinet
La galaxie Gutenberg et l’humanisme européen
On se souvient peut-être de la thèse que Marshall McLuhan, en 1962, avait soutenue dans un essai brillant: The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man. La cybernétique n’en était alors qu’à ses balbutiements. Elle venait de fêter ses vingt ans, et promettait un bel avenir.
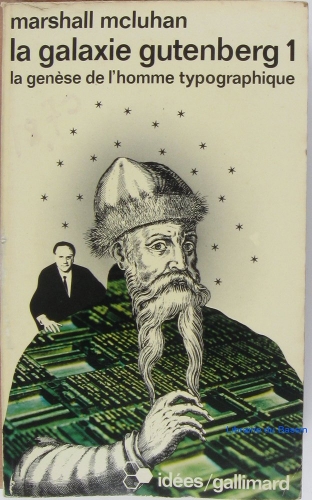 McLuhan avait d’abord analysé la formation d’un nouvel homme, d’une nouvelle conscience, d’une civilisation inédite générée par l’invention de l'imprimerie à caractères mobiles par Gutenberg (vers 1450). La diffusion du livre imprimé à une échelle inimaginable alors avait instauré la suprématie de la vision et de la linéarité au détriment des autres sens.
McLuhan avait d’abord analysé la formation d’un nouvel homme, d’une nouvelle conscience, d’une civilisation inédite générée par l’invention de l'imprimerie à caractères mobiles par Gutenberg (vers 1450). La diffusion du livre imprimé à une échelle inimaginable alors avait instauré la suprématie de la vision et de la linéarité au détriment des autres sens.
Sa vision anthropologique repose sur un postulat : l’homme est un être protéique, modulable, dont la nature est d’être sans nature fixe, en tout cas d’un point de vue psychologique, social, politique. Toutefois, en 1937, à l’âge de 26 ans, il s’était converti au catholicisme romain. Et il est resté un catholique fervent et pratiquant jusqu’à sa mort. On ne peut donc affirmer que, pour lui, la personne n’existait pas, contrairement, par exemple, à la thèse déconstructiviste d’un Foucault, pour qui le moi, l’individu, est un concept vide susceptible d’emprunter tous les oripeaux sociaux et psychiques en fonction des jeux de pouvoirs. «L’homme s’effacera comme à la limite de la mer un visage de sable», affirmait-il. Pour lui, le concept moderne d’individu/de sujet est un produit historique récent et transitoire des savoirs (épistémè) des XVIIIᵉ-XIXᵉ siècles, pas du tout comme une réalité éternelle ou substantielle.
C’est justement à cette période, précédée tout de même par un XVIIe siècle, phase problématique, de crise, de transition, où les certitudes s’ébranlent, que fait référence McLuhan lorsqu’il décrit les effets produit par la « galaxie Gutenberg ».
Si l’homme (socialisé, l’homme de «culture») est un être modulable, il l’est surtout par le médium (en l’occurrence, le livre imprimé), qui est un prolongement de nos sens (surtout la vue), et découpe, transforme, structure le monde perçu et interprété. Le lien dialectique entre le mot, le signe, et le lecteur, induit l’émergence d’un individu coupé du réel sensoriellement présent (le livre du monde), individualiste et analytique (d’où le succès de la Réforme dans certaines régions européennes, et de la science moderne), et donnant naissance à un humanisme érudit, aux « collèges » où un corpus livresque est livré à la mémoire et à la répétition, et où ces trésors de culture permettent la spécialisation. La personne humaine est considérée alors comme le faisait le cicéronisme : c’est un être éducable, dont on favorise les bons penchants par l’étude, la discipline intellectuelle, et la construction commune, encouragée par les échanges (circulation des livres, « académies », cercles etc.) humains et savants.
Les cultures orales antérieures étayaient la diffusion du savoir sur l’oralité. Le livre manuscrit – d’abord le papyrus, le rouleau (volumen), puis le parchemin, notamment le codex, était rare, cher, et particulièrement périssable. La lecture silencieuse ne s’est imposée dans l’ensemble des «lettrés» qu’à la fin du moyen-âge (bien qu’il y eût parfois des pratiques isolées de cette sorte). Une lecture était une «performance» (au sens théâtral). Elle engageait physiquement le lecteur (et l’auditoire), qui devait régler sa voix, son souffle, son regard en fonction de son public. En outre, elle se pratiquait au sein d’un groupe bien caractérisé, singulier, qu’il fût une assemblée de croyants, dans le cadre d’un office religieux, ou un groupe d’étudiants écoutant le maître ou l’un des leurs, lors d’une leçon universitaire, ou bien, de manière plus intime, dans un lieu privé, comme le manoir d’un noble, ou la maison d’un bourgeois, quand on donnait vie aux romans de la Quête du Graal, par exemple, ou à des Fabliaux. Cet exercice renforçait les liens identitaires des participants, et donnait vie à une relation autant sociale que culturelle (les auditeurs pouvaient réagir au fil de la lecture, par exemple). Ajoutons que cette oralité concernait aussi la transmission, l’élaboration de contes, de légendes, de mythes, dont la multiplicité et la richesse des variantes (tant à l’oral que dans les productions manuscrites) délivraient d’une uniformisation et d’une universalisation de la pensée, dont le livre imprimé, puis les mass media modernes, se feront les vecteurs trop souvent. Le monde était considéré comme un enchâssement de fidélités, et chacun y avait sa place, pourvu qu’il appartînt à un groupe social, à ce qu’on appellera au XVIIe siècle, une « condition ».

L’âge cybernétique
En 1962, l’âge électrique/électronique est en train d’envahir le monde occidental. A la radio a succédé la télévision, et, dans les années 70/80, internet s’est imposé. L’oralité et l’image semblent de nouveau supplanter l’écrit, le livre, et la simultanéité de l’échange de messages envoyés à partir d’un clavier ou d’un micro rend vaine la macération, la lente digestion intellectuelle et émotionnelle que prodiguait l’usage du livre. Le tempo du véhicule charriant « informations », « connaissances », « affects » etc. s’est accéléré, voire emballé. Le savoir s’est fragmenté, émietté, et simplifié, formatant des cerveaux et des estomacs à sa mesure. Dans le même temps, des connivences, des solidarités, souvent fluctuantes, éphémères, fondées sur des goûts ou des répulsions communs, créent des « réseaux », et même des groupes de pression. La planète leur sert d’espace d’expression, mais le monde, le « village global » ainsi suscité double le monde réel : il est devenu une bulle où des simulacres, des créations électroniques, ont plus de présence, souvent fantasmée, que la réalité.
 Cette schizophrénie est devenue un mode d’existence, et les geeks sont une espèce nouvelle. Plus généralement, l’outil informatique est devenu un instrument d’arraisonnement du monde. Il organise de plus en plus le travail, et modèle la représentation de la vie. On a pu assimiler le cerveau à un ordinateur. Qui contrôle internet contrôle le monde. Une nouvelle caste, aussi assurée de sa supériorité présumée que l’était la classe érudite de l’ancien monde, avance sa maîtrise technique, les connexions qu’elle entretient avec les intérêts d’argent, les besoins économiques, et avec les nouveaux lieux de pouvoir, comme la Silicon Valley, pour s’ériger en nouvelle upper class.
Cette schizophrénie est devenue un mode d’existence, et les geeks sont une espèce nouvelle. Plus généralement, l’outil informatique est devenu un instrument d’arraisonnement du monde. Il organise de plus en plus le travail, et modèle la représentation de la vie. On a pu assimiler le cerveau à un ordinateur. Qui contrôle internet contrôle le monde. Une nouvelle caste, aussi assurée de sa supériorité présumée que l’était la classe érudite de l’ancien monde, avance sa maîtrise technique, les connexions qu’elle entretient avec les intérêts d’argent, les besoins économiques, et avec les nouveaux lieux de pouvoir, comme la Silicon Valley, pour s’ériger en nouvelle upper class.
« Le medium est le message »
Quelle est la langue de la cybernétique ? Le langage usité dans des contextes de communication extérieurs à son univers est constitué de phrases, de lexèmes, de morphèmes, qui produisent des sèmes, des unités de sens. Ces éléments structurels sont unis par une syntaxe modulable, complexe, capable de réaliser une pensée élaborée, ou de suggérer finement un ensemble de sensations ou d’émotions. Plus un individu est doté d’un bagage riche en quantité et en qualité de ce genre de briques langagières, idiomatiques, plus il approfondit sa dimension intérieure, et varie ses relations avec son entourage.
Le « mème » (mot valise construit à partir de « gène » ( unité de transmission biologique (ADN)) et de « mimeme », inspiré du grec mimêsis ( imitation) est une unité de transmission culturelle. Un mème, dans ce sens large, est n'importe quelle idée, comportement, style, mélodie, croyance, mode, expression ou rituel qui se réplique d’un cerveau à un autre par imitation, ou plutôt, dans le cas d’internet, par contagion. Comme dans le monde des espèces décrit par Darwin, il s’adapte, peut muter, ou phagocyter d’autres mèmes. L’internaute n’est, somme toute, qu’un truchement, un transmetteur. Ce phénomène d’inondation, de propagation sémiotique, encourage l’uniformisation des réactions et des idées, voire des comportements. Si la cybernétique crée des tribus, elles se reconnaissent par des signes partagés et reconnaissables. Des réactions similaires rompent avec d’autres monomanies tribales, mais soudent de manière holistique les membres du groupe.
Les signes et stimuli sont loin d’appartenir au domaine de la langue. La consommation du Web est surtout celle de l’image et du son. D’une certaine manière, on retrouve la civilisation de l’oralité antérieure à l’avènement de l’imprimé, mais sans cette incorporation sociale, culturelle, civilisationnelle, dont nous avions souligné la mise en œuvre dans de véritables singularités humaines, dans une société qui privilégiait la confiance et la fidélité. En revanche, le monde cybernétique, bien générateur de fusion, est un univers atomisé. Chacun est seul devant son écran. Et son usage, au lieu de ménager un équilibre entre le moi et la collectivité, invite à déverser, les inhibitions de la sociabilité abolies, des fantasmes, des pulsions, des affects violents, des lubies délirantes, des vulgarités, qu’on n’oserait pas exprimer dans un cadre inter-relationnel normal et codifié (par la pudeur, la morale, l’éducation…).

La néoréaction, ou la fin de l’Occident
Les Etats-Unis d’Amérique ont toujours une certaine avance dans la course vers l’abîme de notre dégénérescence. Le phénomène de la néoréaction, qui se fixe pour objectif de ré-accélérer le capitalisme en Occident, a la réputation d’inspirer le pouvoir trumpien. Son influence dépasse le cadre politique, et touche les décideurs véritables, ceux qui détiennent le pouvoir véritable, et particulièrement les cadres de la Silicon Valley.
Elle se présente comme une contre-culture de droite, mais cette étiquette n’est qu’un enfantillage, car son ambition dépasse les limites de la dichotomie droite/gauche. Certes, l’ennemi affiché est l’égalitarisme progressiste, mais sa portée est plus large, et plus dangereuse qu’une simple posture droitière. Du reste, elle s’oppose à la droite conservatrice, et se présente comme transgressive. Il ne faut pas la placer dans la filiation de Joseph de Maistre, Thomas Carlyle, Louis de Bonald, Donoso Cortés, Nicolás Gómez Dávila ou Karl Ludwig von Haller, bien qu’on puisse trouver dans sa/ses discours des citations des uns et des autres.

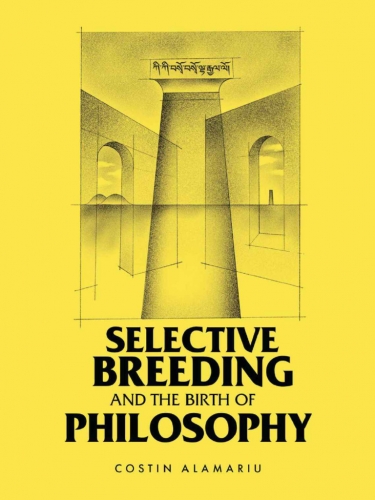
Son émergence est assez récente. Elle est née dans ce bain de culture pullulant de toutes sortes de bacilles douteux qu’est internet. A partir de blogs, de forums, de réseaux, dès 2010, des producteurs d’idées (comme aurait dit Céline) ont surgi hors du bocal, comme Curtis Yarvin, Nick Land, Costin Vlad Alamariu (photo). Les auteurs sont des ingénieurs, des blogueurs, des informaticiens, des start-uppers autodidactes, un milieu inculte et prétentieux assez proliférant, et qui se prend pour une élite.
Sa « culture » reflète le milieu où elle évolue : importance de la science-fiction, ou du fantastique d’épouvante, chez HP Lovecraft, par exemple.
Elle est volontiers provocatrice, mais fuit, comme il est normal, toute pensée structurée et cohérente.
Si on y trouve des références « élaborées », elles se présentent sous une forme légère et adaptée à des intelligences rétives à l’effort cognitif, et la patiente et longue lecture évocatrice de la rumination des vaches, image que Gracq aimait beaucoup. Ses productions sont farcies de citations, d’aphorismes, de condensés, de reader’s digest, bric-à-brac qui peut donner l’illusion d’en savoir beaucoup à peu de frais. La répétition ad nauseam des mèmes, qui crépitent comme une mitrailleuse électronique, s’impose aux consciences et aux cervelles.
Il n’est pas question ici d’analyser en détail la « pensée » que ce courant véhicule, mais qui, idéologiquement, n’est pas si insolite qu’il le dit de lui-même. On y retrouve le culte de l’inégalité, sociale et raciale, l’idéologie libertarienne ultra-libérale, individualiste, une technophilie débridée, et s’y mêlent aussi, aussi étrange que cela puisse paraître aux yeux d’un Français, des délires théologiques, eschatologiques, traditionalistes, un messianisme qui se concilie très bien avec un productivisme conquérant, un projet de conquérir l’ensemble de la nature, de Mars aux abîmes marins, avec l’aide de l’IA.
Mais ce qui frappe surtout, c’est l’abandon complet des inhibitions, des pudeurs, des tabous qui pouvaient freiner les appétits capitalistes du Vieux monde, ou, du moins, susciter une mauvaise conscience parmi ses membres. L’humanisme soucieux des démunis, des misères de la terre, et le souci de la nature, tout cela vole en éclat avec jubilation. L’idée d’instituer un pouvoir féroce, d’écraser le faible sans barguigner, de conquérir les terres d’autrui, d’écraser l’adversaire au nom de la raison du plus fort, de piller, de s’enrichir sans vergogne, n’est associée à aucune honte ni scrupules, et se trouve même considérée comme l’expression d’une certaine excellence.
La technique ne pense pas, comme dit Heidegger. Elle fonctionne. L’homme est un rouage du fonctionnement. On lui demande d’être efficace, techniquement, bien sûr, mais aussi économiquement. Il ne s’agit pas de se polluer la vie avec de la poésie et de l’art, des rêves ou les délices de la contemplation. Le mot d’ordre, c’est l’action, et le succès. Un succès illimité. Comme l’affirmait Spengler, le prométhéisme et le faustisme, qui caractérisent le déclin de l’Occident, s’affichent comme un mouvement continu et sans bornes. Tous les moyens sont bons pour y parvenir, y compris les régimes les plus autoritaires.
On retrouve là les thèses de Johann Chapoutot, qui a fait un lien entre le management et les théories nazies.
Pour Heidegger, la technique est la phase ultime de la métaphysique, dans sa version nihiliste.

Les néoréactionnaires en Europe
Bien entendu, les « accélérationnistes » sont nombreux en Grande Bretagne. Le techno-libertarianisme est un capitalisme ultra, et l’Angleterre est la patrie du capitalisme.
La néoréaction a aussi été favorisé par le déconstructivisme du structuralisme français, et c’est pourquoi elle est présente dans certains mouvements de la gauche radicale. Mais c’est un mouvement très minoritaire, même à l’extrême droite où, pourtant, on a vu une catholique conservatrice comme Chantal Delsol inviter Peter Thiel à l’Institut de France. Le niveau lamentable de la «pensée» de cet «intellectuel» américain situe l’étiage très bas de certains chantres français du conservatisme. Car on peut déceler, parfois, des champions de ce technocapitalisme furieux, par exemple dans la revue Eléments, un Rochedy, par exemple.
Mais, en général, tant en France qu’en Italie, sans doute moins en Allemagne, les résistances à cette idéologie fumeuse et dangereuse sont assez fortes, et sa pénétration est faible. Sans doute s’y méfie-t-on de la technique, et l’Amérique n’est-elle pas perçue comme une amie. Mais il se peut aussi que, comme le dit Emmanuel Todd, certaines valeurs traditionnelles, issue d’un vieux fonds humaniste, chrétien, antique, subsiste-t-il, pour renforcer cette méfiance. La philosophie européenne, contrairement à l’empirisme logique et aux théories analytiques anglo-saxonnes, qui privilégient le « comment » sur le « pourquoi », se souvient que son souci est ontologique, c’est celui de l’être, et sa longue mémoire laisse ressurgir des souvenirs littéraires, artistiques, culturelles, où la pure contemplation et le plaisir gratuit de vivre et d’être heureux étaient le sommet de l’existence (sans oublier l’attention à la dignité de l’homme, quelle que soit son origine).
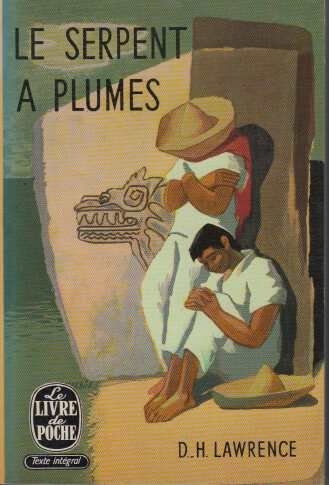 L’idéologie néoréactionnaire apparaît comme le dernier cri de rage d’une civilisation qui est en train de périr. Rappelons ce qu’écrivait D.H. Lawrence, dans son roman Le Serpent à plumes :
L’idéologie néoréactionnaire apparaît comme le dernier cri de rage d’une civilisation qui est en train de périr. Rappelons ce qu’écrivait D.H. Lawrence, dans son roman Le Serpent à plumes :
« Était-ce l’Amérique le grand continent de la mort, le grand Non! opposé au Oui! de l’Europe, de l’Asie et même de l’Afrique? Était-ce le grand creuset où les hommes venus des continents créateurs étaient refondus, non pour une création nouvelle, mais pour être réduits à l’homogénéité de la mort? Les grands continents-États étaient-ils les agents de la destruction mystique ! Arrachant, arrachant l’âme créée en l’homme, jusqu’à ce qu’enfin ils arrachent le germe en croissance, et le laissent créature de mécanisme et de réaction automatique, avec une seule inspiration, le désir d’arracher le vif de toute créature vivante spontanée. Était-ce là la clé de l’Amérique : le désir de détruire la connexion organique humaine en chaque homme ? Arracher, arracher, arracher à chaque âme individuelle jusqu’à ce qu’elle soit sans racines, frémissante, arrachée. Et au-delà, le désir que chaque homme détruise dans sa propre âme les racines de toute affection et même de la passion physique et du désir, si bien que l’humanité devienne enfin un arbre d’individus innombrables et isolés, tous frémissants et s’affirmant eux-mêmes, mais sans racines ni au ciel ni sur la terre, seulement l’éternel frémissement de l’auto-affirmation et du mécanisme. Était-ce cela, l’Amérique?»
19:09 Publié dans Actualité, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualmité, philosophie, néoréactionnaires, accélérationnistes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 02 février 2026
La Caverne de Platon et l’Empire

La Caverne de Platon et l’Empire
Alexandre Douguine
Alexandre Douguine sur le Philosophe-Roi et le retour de l’Empire de l’Esprit.
Dans le septième livre du dialogue La République, Platon décrit le processus de devenir un philosophe-roi comme suit.
Il compare le monde à une caverne (c’est-à-dire un territoire situé dans une matière dense, dans une montagne ou sous la terre), et l’humanité à des prisonniers enchaînés, incapables de tourner la tête, forcés de regarder des ombres qui se déplacent le long du mur de la caverne. Cela correspond au Royaume inférieur — le monde des corps. La destinée de l’homme ordinaire est de vivre en observant les ombres sur le mur, en les prenant pour la réalité véritable. En vérité, cependant, cela n’est qu’une copie la plus distante et la plus vague, pas même de l’original, mais d’une autre copie. En raison de leur ignorance, les prisonniers ne soupçonnent ni leur véritable condition ni la nature de ce qui leur apparaît comme étant réel. En effet, Platon décrit l’enfer, le royaume des ombres.
Platon ne pose pas la question de savoir qui a enchaîné les prisonniers et les a condamnés à une existence aussi misérable. Comme nous l’avons vu, les Grecs ne connaissaient pas la figure du diable ni son homologue iranien, Ahriman, et pour eux, une telle formulation du problème aurait peu de sens. Puisque la manifestation suppose nécessairement un éloignement du Premier Principe et, par conséquent, une densification de l’être, il doit exister des régions où les ombres s’épaississent et où la vérité disparaît derrière un horizon lointain. Cela n’est en soi ni mal ni bien, mais plutôt une douloureuse conséquence du processus même de la manifestation — le coût de la manifestation cosmique. Quiconque se contente de cela en assume la responsabilité.

Pourtant, selon Platon, parmi les prisonniers, existent aussi ceux qui refusent de se satisfaire. Quoi qu’il leur en coûte, ils tournent la tête en arrière pour voir quels objets projettent les ombres qu’ils observent sur le mur. Alors ils découvrent ce que Platon appelle la «voie supérieure».
«Imaginez des gens comme s’ils étaient dans une habitation souterraine semblable à une caverne, avec une entrée ouverte vers la lumière tout le long de sa longueur. Depuis leur enfance, ils ont des chaînes aux jambes et au cou, de sorte qu’ils doivent rester à la même place et ne voir que ce qui est directement devant eux, car ils ne peuvent pas tourner la tête à cause de ces liens. Derrière eux, tout en haut, brûle la lumière d’un feu, et entre le feu et les prisonniers court une voie supérieure, sur laquelle, imaginez, une faible muraille a été construite, comme le paravent placé devant les spectateurs de merveilles, derrière lequel ils exhibent leurs prodiges».
La voie supérieure est le domaine des objets eux-mêmes plutôt que de leurs ombres. Ceux qui portent ces objets, comme lors des processions dionysiaques, conversent entre eux, et leurs voix résonnent dans les murs de la caverne, donnant l’impression que les sons proviennent des ombres sur le mur.
La philosophie commence avec cette inversion, avec la distinction claire entre ce qui se passe sur la «voie supérieure» — la vision et l’écoute de véritables images et discours.

Platon continue en décrivant comment une personne réveillée de l’illusion partagée par la majorité ne se trouve pas dans une position active; elle devient plutôt la proie passive d’une force qui agit contre ses souhaits. Ainsi, Platon veut souligner que dans l’homme ordinaire, tout résiste à devenir philosophe et à saisir la vérité. D’où le langage de la contrainte.
«Lorsqu’un d’eux est libéré de ses liens et est soudainement contraint de se lever, de tourner le cou, de marcher, et de regarder vers la lumière en haut, cela lui fera mal, et il ne pourra pas regarder les choses lumineuses dont il voyait les ombres auparavant.(….)
Et s’il est forcé de regarder directement la lumière elle-même, ses yeux ne feront-ils pas mal ? Ne se détournera-t-il pas rapidement vers les choses qu’il peut voir, croyant qu’elles sont plus claires que ce qui lui est maintenant montré ? (….) »
« Si quelqu’un le traînait de force par la montée escarpée, jusqu’au sommet de la montagne, et ne le lâchait pas avant de l’avoir tiré dans la lumière du soleil, ne souffrirait-il pas et ne protesterait-il pas contre cette violence? Et une fois dans la lumière, ses yeux, saturés de son éclat, ne seraient-ils pas incapables de discerner une seule des choses dont la vérité lui est maintenant révélée? (….)».

Il aurait besoin de temps pour s’habituer, s’il veut voir ce qui est en haut. Il doit commencer par ce qui est le plus facile: regarder d’abord les ombres, puis les reflets dans l’eau des êtres humains et des objets divers, et seulement après cela, les choses elles-mêmes. Ensuite, il trouverait plus facile de regarder ce qui se trouve dans le ciel et le ciel lui-même la nuit — c’est-à-dire contempler la lumière des étoiles et de la lune plutôt que celle du soleil et de sa lumière.
En tout cas, celui qui, de sa propre volonté ou sous l’influence d’une force supérieure, a parcouru ce chemin vers la sortie de la caverne, a non seulement appris la différence entre ombres, images, choses elles-mêmes, et la source de leur lumière, mais aussi quitté le monde même de la caverne, montant vers un autre monde — cette fois le vrai, inondé de la lumière du Nous. Ainsi, le philosophe s’élève du monde des corps vers le monde de l’Esprit. Là, il contemple les objets mêmes dont les objets de la «voie supérieure» ne sont que des copies, ainsi que la vraie lumière qui se trouve en dehors de la caverne. C’est le monde des idées, des paradigmes, des prototypes, des originaux. Et celui qui a réussi à s’échapper de la caverne et à contempler le monde tel qu’il est — et les idées, selon Platon, sont précisément ce qui est (elles existent éternellement et antérieurement à toutes leurs copies) — celui-là est le philosophe.

Ici, la définition de la philosophie converge avec le thème du pouvoir et, par conséquent, avec la politique. Le philosophe qui connaît la vérité retourne aux prisonniers pour diverses raisons et travaille à leur libération. Il sait, à l’avance, plusieurs couches de l’être plus qu'ils n'en savent eux, et cela lui donne le droit de gouverner les ignorants. Ainsi, la dignité du vrai souverain ne réside ni dans la compétence, ni dans l’efficacité, ni dans l’origine dynastique, ni dans la force de volonté. Elle découle de la transmutation ontologique de son âme, de la capacité à sortir du fond de la caverne, à dépasser ses limites, et à entrer dans le monde divin où la vérité se donne dans une contemplation immédiate.
Ainsi apparaît la figure du Philosophe-Roi. En lui, le droit au pouvoir est précisément déterminé par l’esprit éveillé, par la capacité de dépasser les frontières du monde inférieur. Or, c’est aussi la caractéristique distinctive du Roi du Monde et de son Empire Spirituel. Le Roi du Monde et son domaine se situent dans la zone de l’éternité, hors de la grotte des corps. Par conséquent, le voyage du philosophe vers la sortie du monde souterrain est identique à une visite au Royaume du Graal, un retour au paradis. C’est là que se déroule l’investiture du droit de gouverner. Le royaume du Roi du Monde se trouve hors de la caverne. C’est le modèle de tout royaume authentique et réel — non seulement un plan, mais une réalité à vivre, à voir, à entendre et à ressentir comme nous vivons les choses du monde terrestre, seulement avec un degré de intensité, de netteté et de clarté bien supérieur.

Le Philosophe-Roi de Platon est un avatar du Roi du Monde. Sur lui repose ce pouvoir. Il consiste en l’esprit, en la transfiguration de la conscience, en le noyau intérieur de l’âme qui accède à la contemplation directe du Logos, du Nous. Par conséquent, pour le philosophe, l’autorité sur les prisonniers de la caverne n’est pas une élévation, mais une descente — un chemin vers le bas, une immersion sacrificielle jusqu’au fond de la caverne, et la courageuse disposition à vivre pour la libération des captifs, pour leur donner accès à la lumière, et pour la construction d’un ordre politique et religieux qui inciterait aussi les meilleurs à suivre le chemin de la philosophie, en montant vers la sortie de la caverne.
L’état dont parle Platon dans le dialogue portant ce nom est une structure terrestre destinée à l’ascension vers le ciel. De là découle sa fonction religieuse et initiatique. Un tel état n’est pas simplement le meilleur; il est sacré, saint, et, dans une limite ultime, divin. Plus le royaume terrestre ressemble au Royaume Céleste, plus il se rapproche de l’Empire de l’Esprit, et son souverain — du statut du Roi du Monde.
21:49 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : alexandre douguine, philosophie, philosophe-roi, platon, platonisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Du christianisme européen de la raison faustienne - Forme, infini et architecture de la croyance

Du christianisme européen de la raison faustienne
Forme, infini et architecture de la croyance
Constantin von Hoffmeister
Le divin se révèle à travers la proportion, l’harmonie et la connaissance de soi qui se déploient dans le temps, par le biais de structures qui croissent, mûrissent et atteignent une forme dans l’histoire plutôt que de se tenir en dehors d’elle. Dans cette vision faustienne, la théologie devient une discipline d’intuition façonnée par une nécessité intérieure, attentive à l’ordre, à la mesure et au destin, tandis que la raison sert de vase à travers lequel le christianisme européen articule sa volonté historique vers l’infini, l’espace et la pression silencieuse de l’émergence qui pousse les civilisations vers leur forme désignée.
Ces réflexions découlent de la théologie spéculative de Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781) (illustration), dont le christianisme de raison cherche la structure, la proportion et une nécessité intérieure. Lessing commence par une vision de l’éternité façonnée par la contemplation plutôt que par le mouvement. L’être parfait réside dans le regard de la perfection elle-même. L’éternité apparaît comme une plénitude rassemblée dans la conscience. La divinité se révèle comme une attention concentrée, comme une intensité calme dirigée vers la réalité la plus haute concevable. En ce début, raison et foi convergent. La pensée reçoit un poids ontologique. La théologie acquiert la posture de la métaphysique. Le divin se tient comme une intériorité absolue dont la richesse s’exprime à travers un ordre intelligible.
Lessing avance par la gravité logique plutôt que par la force rhétorique. L’objet le plus parfait équivaut à Dieu lui-même. La pensée divine se tourne vers l’intérieur, embrassant sa propre plénitude. Dans cet acte, penser, vouloir et créer forment un seul mouvement. Chaque idée divine porte une puissance génératrice. La création coule comme une expression plutôt qu’une interruption. La réalité se déploie comme une pensée étendue en forme. Le cosmos émerge comme une intelligibilité rendue visible. Être et sens partagent une seule origine. Le monde apparaît comme la raison rendue spatiale, temporelle et relationnelle.
De cette auto-conscience éternelle naît la figure que l’Écriture nomme le Fils. Lessing décrit cet être comme une plénitude divine saisie comme une totalité. Chaque perfection présente en Dieu apparaît rassemblée dans une unité vivante. Le Fils-Dieu exprime une identité plutôt qu’une division. L’essence reste entière. La distinction n’intervient qu’à travers la séquence implicite de la compréhension humaine. La pensée semble antérieure à son image, bien que la substance reste partagée. La théologie parle ici avec une clarté philosophique. La génération apparaît comme un déploiement logique plutôt qu’un événement temporel. Le divin se révèle à travers une connaissance de soi manifestée.

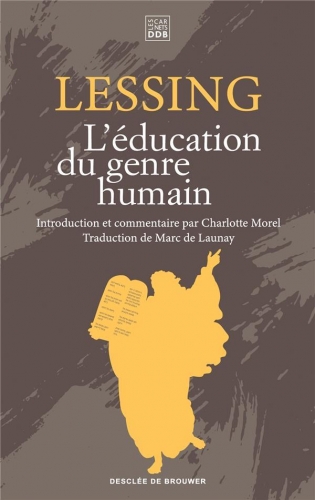
Ce Fils-Dieu se tient comme l’image identique de Dieu. Ici, l’image signifie une correspondance parfaite plutôt qu’une imitation. Penser Dieu implique de penser cette image au même moment. L’harmonie découle d’une essence partagée. Là où les attributs coïncident pleinement, la consonance atteint son sommet. Lessing définit l’harmonie comme un accord total de l’être. L’identité et la relation s’entrelacent dans une structure unique. Le christianisme acquiert ainsi une architecture intérieure marquée par la symétrie, l’équilibre et une profondeur intelligible.

De l’unité vivante de Dieu et du Fils-Dieu provient l’Esprit, décrit comme l’harmonie qui les lie. Cette harmonie contient la plénitude de la vie divine. Père, Fils et Esprit expriment une seule réalité à travers la relation et la présence mutuelle. Chacun dépend des autres comme expressions de la même essence. Lessing présente la Trinité comme une articulation nécessaire de la conscience divine. La théologie y gagne en stabilité par la cohérence. Le mystère se transforme en profondeur accessible à la raison disciplinée.
La raison se tourne ensuite vers l’extérieur, vers la création. Dieu pense ses perfections sous une forme divisée, et chaque pensée se déploie en étant. Les créatures surgissent, chacune portant une part des attributs divins. Ensemble, elles forment le monde en tant que totalité d’expressions différenciées. La création apparaît comme un déploiement gradué plutôt qu’un acte abrupt. Dieu choisit la manière la plus parfaite de division, organisant les êtres le long d’une échelle continue. Les degrés se succèdent sans discontinuité. Chaque niveau rassemble les qualités inférieures et en ajoute d’autres. L’ordre gouverne la multiplicité par la proportion.
Cette échelle s’étend indéfiniment, formant une série infinie. La vastitude du monde découle de la logique de la perfection elle-même. L’infini apparaît comme une nécessité structurelle plutôt que comme un excès poétique. Les êtres simples forment la fondation de la réalité. Les formes composites surgissent des relations entre simples. L’harmonie relie ces éléments, fournissant la clé aux processus naturels. La nature se révèle comme un système lisible façonné par la correspondance, la résonance et une puissance graduée.
Lessing envisage un christianisme futur guidé par la connaissance mûrie sur plusieurs siècles. La recherche avance avec patience. L’observation s’approfondit. Les apparences livrent leurs lois intérieures. La pensée remonte aux premiers principes des phénomènes. La théologie et la philosophie naturelle convergent vers un horizon unifié. La raison s’étend à tout le champ de l’existence. La foi mûrit en insight. La création se révèle comme un tout cohérent, illuminé de l’intérieur par un ordre intelligible.
Dans ce monde ordonné, les êtres reflètent selon leur degré les attributs divins. La conscience apparaît dans une intensité graduée. La capacité d’action augmente avec la conscience. Les êtres moraux émergent lorsque l’intuition rejoint le pouvoir. La loi naît de la structure intérieure plutôt que du décret. La vie éthique se déploie comme un alignement avec sa propre forme. L’action exprime une nature accomplie. La liberté apparaît comme un harmonie avec la mesure intérieure.
À travers la vision historique d’Oswald Spengler (1880-1936), le christianisme de la raison de Lessing gagne une échelle civilisatrice. Spengler décrit les cultures comme des formes vivantes gouvernées par une nécessité intérieure. Lessing fournit la grammaire métaphysique sous-jacente à ces formes. Son univers gradué reflète la montée ordonnée des civilisations, chacune exprimant un style total à travers des étapes successives. Cette théologie appartient à l’âme faustienne, attirée par l’infini, la structure et le destin qui se déploient dans le temps. Lessing propose un christianisme européen façonné pour une civilisation en quête de clarté, de cohérence et de forme comme expressions de sa volonté historique.
21:15 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, raison faustienne, civilisation faustienne, christianisme faustien, gotthold ephraïm lessing |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 30 janvier 2026
L'Iran et le seuil du temps - La transition de paradigme dans l’intellectualisme

L'Iran et le seuil du temps
La transition de paradigme dans l’intellectualisme
Ashkan Baladi
«Ce que nous appelons valeurs traditionnelles n’est pas la même chose que les valeurs de la bourgeoisie : nos valeurs leur sont précisément opposées».
«Ni le désir ni la douleur ne doivent jamais être la norme ou la fondation de l’action».
— (Julius Evola)
Il fut un temps où l’intellectuel se limitait à un seul geste, finalement ridicule: l'« opposition au pouvoir»! Ce récit prédominant et tragique a tout plongé dans la ruine pendant des décennies. La pensée était exilée. Le modèle de cette forme d’éclairage était un modèle dévoyé, que l’on pourrait, avec indulgence, qualifier de « sartresque » et désigner comme l’héritage de l’École de Francfort: un équilibre qui manipulait tout système théorique ou toute question historique en faveur de ce qu’il appelait le «faible». Pour l’intellectuel, le chat, l’enfant, l’ethnie, etc., n’avaient pas de différence catégorielle en soi ; leur signification ne découlait que de leur position laquelle était en opposition à «celui qui était capable de fonder», c’est-à-dire à la puissance dominante.
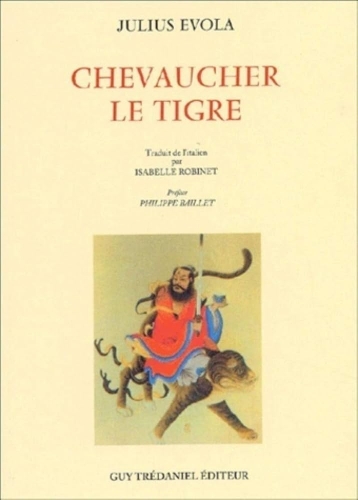 Evola aborde ce problème dans le treizième chapitre de son ouvrage Cavalcare la tigre («Chevaucher le tigre»), sous le titre «Sartre : prison sans murs». Cette forme de « négation » – la négation du pouvoir –, tout comme la liberté, le choix et la responsabilité, se révèlent être des symptômes d’une ère nihiliste, dans laquelle la liberté se réduit au soi et à sa subjectivité. Comme l’homme est condamné à cette seule liberté d’être, la liberté elle-même lui inspire la peur. En fin de compte, cette pseudo-responsabilité se transforme en conscience de «l’absurdité». La liberté moderne en soi est ce qui trouble le sujet; pour y échapper, le sujet moderne se réfugie dans le consumérisme.
Evola aborde ce problème dans le treizième chapitre de son ouvrage Cavalcare la tigre («Chevaucher le tigre»), sous le titre «Sartre : prison sans murs». Cette forme de « négation » – la négation du pouvoir –, tout comme la liberté, le choix et la responsabilité, se révèlent être des symptômes d’une ère nihiliste, dans laquelle la liberté se réduit au soi et à sa subjectivité. Comme l’homme est condamné à cette seule liberté d’être, la liberté elle-même lui inspire la peur. En fin de compte, cette pseudo-responsabilité se transforme en conscience de «l’absurdité». La liberté moderne en soi est ce qui trouble le sujet; pour y échapper, le sujet moderne se réfugie dans le consumérisme.
Cette forme d’hégémonie intellectuelle a montré ses limites et s’est déformée en un vide, une psychologisation et, en fin de compte, une façade absurde, répétée à l’infini. L’Occident moderne lui-même est envoûté par ce discours auto-créé, et ne fait que retarder le moment de sa mort, qui est indissociable de l’appareil occidental.
L’un des signes les plus évidents de cet effondrement et du changement de paradigme qui l’accompagne fut le remplacement des penseurs qui autrefois travaillaient pour l’État par des journalistes, des acteurs et des célébrités en politique. Les structures sont en déclin. Les économies occidentales en faillite promettent à leurs citoyens, pour une année, une courte période de vacances en bord de mer, dans des économies encore davantage en faillite. Le système théorique de l’Occident est tombé dans sa propre cage. Aucune réorientation de gauche ou de droite ne peut plus le sauver.
Mais le vrai penseur ne craint pas la proximité du pouvoir. C’est précisément à ce point que se manifestent ici la «volonté nationale» et la «vraie histoire». Ici, il n’y a plus de différence entre penser et héroïsme. Le penseur est le guerrier qui lutte non pas sur la base d’une auto-justification théorique, mais pour la préservation de la patrie et du peuple – contre les forces de pillage déchaînée par le diable. Cela garantit la continuité et le renforcement du pouvoir du pays – c’est la tâche de la pensée. En Iran – et auparavant en Russie et en Chine – des conditions favorables se sont créées pour l’émergence de ce type de penseurs, et il semble que ce processus gagne en dynamique.
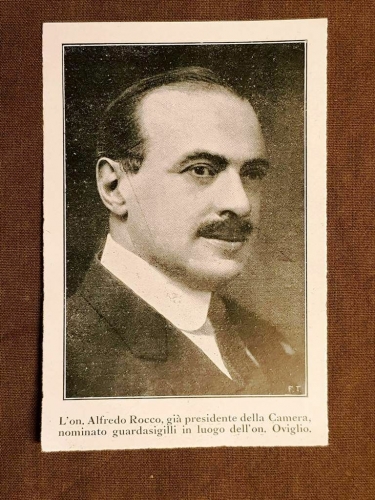 Pendant plus d’un demi-siècle, l’histoire des sciences humaines a été manipulée dans le sens de ce qu’on appelle l’esprit moderne. Pendant cette période, les voix les plus authentiques du continent européen ont été houspillées dans l’exil intellectuel: des penseurs comme Julius Evola, Giovanni Gentile, Alfredo Rocco (photo) en Italie, ou – en République de Weimar et au-delà – Carl Schmitt, Ernst Jünger et Martin Heidegger en Allemagne. Tous avaient développé une conscience du «vrai vouloir national» et n’hésitaient pas à s’approcher de ce pouvoir qui, selon eux, incarnait cette volonté.
Pendant plus d’un demi-siècle, l’histoire des sciences humaines a été manipulée dans le sens de ce qu’on appelle l’esprit moderne. Pendant cette période, les voix les plus authentiques du continent européen ont été houspillées dans l’exil intellectuel: des penseurs comme Julius Evola, Giovanni Gentile, Alfredo Rocco (photo) en Italie, ou – en République de Weimar et au-delà – Carl Schmitt, Ernst Jünger et Martin Heidegger en Allemagne. Tous avaient développé une conscience du «vrai vouloir national» et n’hésitaient pas à s’approcher de ce pouvoir qui, selon eux, incarnait cette volonté.
Cette proximité avec le pouvoir ne doit pas être comprise comme un lobbying de type libéral-démocratique, c’est-à-dire comme la promotion d’intérêts économiques ou partisans. Il s’agit plutôt d’une conscience historique, d’un rapprochement avec des forces originelles oubliées, d’une compréhension du « début » et de la réconciliation avec la force créatrice de la « nation ».
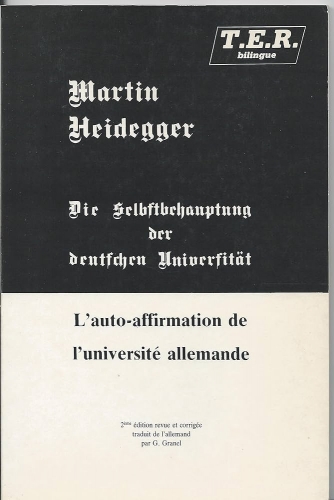 Heidegger s’est approché de cette aspiration du côté des nationaux-socialistes, et dans son discours de 1933, «La défense de l’université allemande», il évoque explicitement cette possibilité. Pour Heidegger, le «Führer» était l’expression de cette volonté et de cette défense du «peuple allemand», et l’université, en tant que lieu d’émergence et de possibilité du savoir, devait mûrir, participer sans doute à cette «direction» et lier sa volonté à cette «direction». Cette essence devient sérieusement claire, de rang et de pouvoir, lorsque en premier lieu et à tout moment, ce sont les guides eux-mêmes qui sont guidés – guidés par l’intransigeance de la mission spirituelle, qui impose le destin du peuple allemand dans le façonnement de son histoire.
Heidegger s’est approché de cette aspiration du côté des nationaux-socialistes, et dans son discours de 1933, «La défense de l’université allemande», il évoque explicitement cette possibilité. Pour Heidegger, le «Führer» était l’expression de cette volonté et de cette défense du «peuple allemand», et l’université, en tant que lieu d’émergence et de possibilité du savoir, devait mûrir, participer sans doute à cette «direction» et lier sa volonté à cette «direction». Cette essence devient sérieusement claire, de rang et de pouvoir, lorsque en premier lieu et à tout moment, ce sont les guides eux-mêmes qui sont guidés – guidés par l’intransigeance de la mission spirituelle, qui impose le destin du peuple allemand dans le façonnement de son histoire.
Dans notre position décisive, nous nous rappelons encore une fois ce que Carl Schmitt appelle «l’aspect spatial», et la façon dont il le décrit :
«Indépendamment de la bonne ou mauvaise volonté des hommes, des objectifs pacifiques ou belliqueux, chaque augmentation de la technique humaine crée de nouveaux espaces et des changements imprévisibles dans les structures spatiales héritées».
Ce changement de la structure spatiale procède aujourd’hui plus que jamais – en résumé – de l’opposition entre «puissances terrestres» et «puissances maritimes». Les puissances terrestres incarnent l’ordre et la légalité, des frontières fixes et cette souveraineté qui découle de la délimitation et de la stabilité. À l’opposé, la puissance maritime est la représentante du commerce libre, des déplacements continus de frontières, ainsi que des modes de vie et des qualités changeantes: la permanence du législateur contre la fluidité et la dissolution des frontières.
Je n’ai pas l’intention ici de réduire la notion de Schmitt à l’empire "du dedans et dehors" ou de me l’approprier. Mais le changement structurel de l’espace se manifeste tout aussi résolument dans le monde de «l’esprit». L’esprit enraciné dans la terre et le sol s’oppose à la vague du mondialisme. Les changements structurels de l’espace subissent – selon le progrès technologique – des modifications correspondantes dans la manière de résister.
L’Iran – tout comme la Chine et la Russie, ainsi que de nombreux pays d’Amérique latine – constitue un modèle parfait pour cette confrontation entre les «forces terrestres»/Est et les «forces maritimes»/Occident. C’est précisément dans cette question que le penseur iranien est parvenu par diverses voies à un consensus et à une «conscience», et poursuit maintenant une stratégie pleine d’espoir.
Oui, l’Iran va gagner, parce qu’il a initié la transition du paradigme de l’intellectualisme.
19:28 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, intellectualisme, iran |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Axel Matthes: "Je me permets la révolte"
Axel Matthes: "Je me permets la révolte"
Bernard Lindekens
Source: Knooppunt Delta, Nieuwsbrief, Nr. 206, Januari 2026
Si tout va bien, il fêtera cette année, le 18 mai, ses quatre-vingt-dix ans: Axel Matthes. Un âge qui impose non seulement le respect, mais il est aussi un homme, devenu quasiment un symbole pendant toute la longue période durant laquelle il a mis au défi, secoué, et parfois carrément irrité le monde de l’édition allemande. Dans cet univers éditorial, son nom apparaît comme un murmure, comme quelque chose que l’on ne prononce pas toujours à haute voix mais que tout le monde connaît. Ce n’est pas un éditeur du genre à vouloir se mettre en avant. Il n’a jamais été l’homme des conférences, des tapis rouges ou des stratégies de best-sellers prévisibles. Axel Matthes considérait une maison d’édition comme un laboratoire de la pensée, pas comme une entreprise avec des objectifs matériels et mensuels. Et c’est précisément pour cela qu’il a laissé une empreinte durable sur la culture littéraire européenne.
Matthes est né en 1936 à Berlin, une ville où l’histoire n’était jamais loin. Il y étudia le droit et la sociologie à l’Université libre de Berlin. Ceux qui l’ont rencontré plus tard ont vite compris que son véritable domaine n’était pas la salle de cours ou le tribunal, mais la zone d’ombre entre littérature, philosophie et l’indicible. L’endroit où la plupart des éditeurs évitent de se rendre.
Il travailla d’abord comme antiquaire, libraire et éditeur avant de fonder, en 1968 à Munich, avec Klaus P. Rogner et Marianne Bernhard, la maison d’édition Rogner & Bernhard. Il y fut responsable du fonds jusqu’en 1976, mais dut quitter à la fin de cette année-là suite à une décision de la directrice, Antje Ellermann.


Mais la véritable naissance de Matthes en tant qu’éditeur avec sa propre signature eut lieu en 1977, lorsqu’il fonda, avec l’imprimeur Claus Seitz, ce qui allait devenir la légendaire maison d'édition Matthes & Seitz à Munich. Pour Matthes, cela ne signifiait pas simplement créer une nouvelle maison. C’était aussi prononcer un manifeste. Une déclaration que les livres n'existent pas d'abord pour le marché, mais pour cette fine couche de lecteurs prêts à mobiliser leur esprit. Le programme qu’il élaborait n’était pas une simple collection de titres, mais un défi intellectuel. Georges Bataille, Antonin Artaud, Michel Leiris, les surréalistes, les mystiques, les malheureux, les visionnaires — tous trouvaient refuge chez lui. Non pas forcément parce que c’était commercialement judicieux, mais parce que c’était nécessaire. Parce qu’il existe des voix qui sont dangereuses pour le bon goût, pour les orthodoxies politiques de gauche comme de droite, pour la tranquillité de l’âme bourgeoise. Et il fallait que quelqu'un protége ces voix.
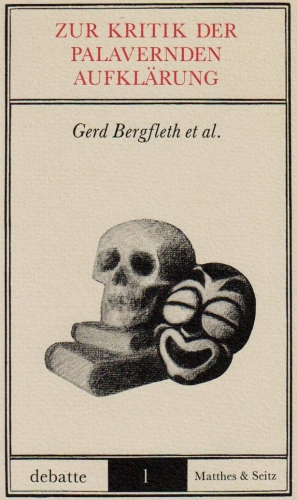
A lire pour cerner la personnalité de Gerd Bergfleth:
http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2010/09/24/l...
http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2010/09/24/g... &
http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2023/03/17/g...
Surtout la série Debatte deviendrait légendaire. En particulier le petit ouvrage de Gerd Bergfleth Zur Kritik der palavernden Aufklärung. Il s’agit d’une petite anthologie où, aux côtés de textes de Bergfleth lui-même, figurent notamment des contributions de Jean Baudrillard (« La fatalité de la modernité ») et de Georges Bataille (« Nietzsche »). Elle provoqua immédiatement un petit scandale lorsque Bergfleth fit lentement basculer la pensée de Walter Benjamin et y chercha la clé dans la judéité de la théorie critique. L’accusation d’antisémitisme ne tarda pas. Mais Axel Matthes défendit son auteur avec ferveur. D’ailleurs, la maison d’édition jouerait un rôle clé dans tout le débat sur le postmodernisme en Allemagne.
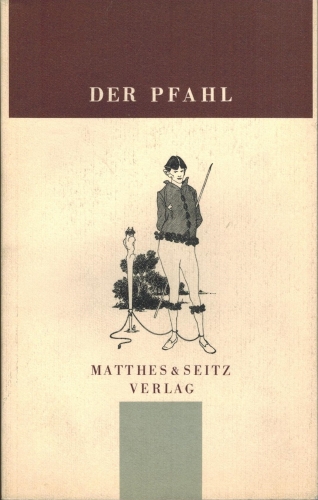
Sa maison d’édition n’était pas seulement un lieu pour découvrir des livres provocateurs et pertinents, mais un lieu pour débattre sur des idées qui dérangeaient. Dans cette perspective, il créa aussi la revue annuelle Der Pfahl, qu’il décrivait comme une exploration du « no man’s land entre art et science ». Ce no man’s land était précisément l’endroit où Matthes se sentait chez lui. Pas dans les disciplines établies, pas au centre, mais toujours en marge — là où tout est encore possible et rien n’est évident. Botho Strauss, l’un des dramaturges les plus importants de l’ex-République fédérale, devint collaborateur de Der Pfahl. Il proposa à Axel Matthes le texte original de l’essai Anschwellender Bocksgesang pour publication. Sur la recommandation de ce dernier, Strauss (photo, ci-dessous) envoya une version abrégée de son texte à Der Spiegel. Ce fut l’un des textes les plus discutés des années 1990 en Allemagne, marquant le passage de Strauss de dramaturge renommé à intellectuel public critiquant le climat politique et culturel dominant (1).

A lire à propos de Botho Strauss:
http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2023/03/03/i...
À partir de 1991, Axel Matthes contribua régulièrement à la revue conservatrice Etappe et à la revue Criticon, éditée par Caspar von Schrenck-Notzing. En 1997, il fut nommé Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres pour ses mérites envers la littérature française.
Mais chaque idéalisme a ses limites. À partir des années 1990, les difficultés financières s’accumulèrent. Le marché — cette énorme machine indifférente à toute notion de qualité et de réelle pertinence — avait de moins en moins de patience pour une maison d’édition qui refusait de suivre une logique mercantile. Finalement, en 2004, Matthes dut vendre le nom, les droits et le stock. Ainsi naquit Matthes & Seitz Berlin — une nouvelle maison qui poursuit l’esprit de l’ancien, mais avec d’autres moyens et une nouvelle génération à sa tête.
Ce qui reste, c’est l’héritage de Matthes, et celui-ci est plus grand que ce que son ancien chiffre d’affaires annuel aurait jamais pu devenir. Pendant des décennies, il a maintenu un espace où la littérature et la philosophie les plus rebelles pouvaient exister. Non pas parce que c’était possible, mais parce qu’il croyait que c’était nécessaire. Il a montré ce que le métier d’éditeur signifie: prendre des risques, choisir à contre-courant, rester fidèle à l’idée que la culture ne se mesure pas en chiffres de vente.
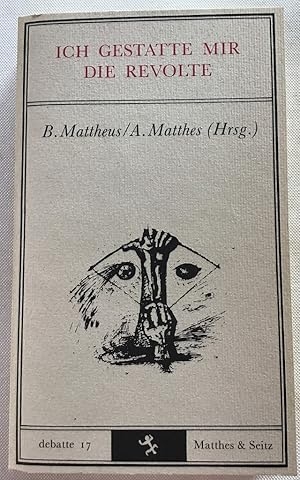
A lire pour comprendre le contexte:
http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2011/09/20/r...
Axel Matthes est donc une figure rare dans le monde du livre: un éditeur qui ne se contentait pas de publier des livres, mais incarnait aussi une certaine attitude intellectuelle. Il est la preuve vivante que la littérature est propulsée en avant par des personnes assez têtues pour ignorer ce qu'un monde médiocre exige d’elles. Quiconque a travaillé avec Matthes rappelle toujours son acuité, sa fidélité obstinée à ses auteurs, sa capacité quasi instinctive à sentir quand un texte était une nécessité, pas une option. Et peut-être est-ce cela précisément qui fait qu’un éditeur est un éditeur: connaître la différence entre un livre qui veut exister et un livre qui doit exister.
Peut-être sa plus grande héritage est-il celui qui nous rappelle que la vraie culture commence toujours par quelqu’un qui dit, doucement ou fort : « Je me permets la révolte. » (2)
Bernard Lindekens
Notes:
(1) Le texte original est également paru dans Der Pfahl après sa publication dans Der Spiegel
(2) Librement inspiré par la sélection que Axel Matthes a lui-même constituée : Bernd Mattheus, Axel Matthes, Ich gestatte mir die Revolte, Matthes & Seitz, Munich, 1985, 400 p. ISBN: 978-3-88221-361-4
17:27 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, axel matthes, éditeurs, édition, matthes & seitz, non-conformisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 16 janvier 2026
Ce n'est pas Dieu qui est mort. Seulement l'Occident!

Ce n'est pas Dieu qui est mort. Seulement l'Occident!
Cristi Pantelimon
Source: https://www.facebook.com/profile.php?id=100005135564621
Dans la tradition de l'Église orientale, le problème du nihilisme est l'un des plus graves. Et cela parce que le nihilisme ne peut être «anéanti» selon les termes de la théologie rationaliste occidentale, qui a joué dans l'Église le rôle du libéralisme par rapport à la tradition politique orientale, c'est-à-dire celui de la subjugation et de l'asphyxie ontologique.
Le plus grand philosophe de l'Occident moderne, Martin Heidegger, a dû lutter à armes égales contre le nihilisme. Et il l'a fait. Lui seul pouvait le vaincre, mais il n'y est pas parvenu totalement. Heidegger est remonté jusqu'aux présocratiques et, de là, il pouvait certes voir l'erreur nihiliste, mais il ne pouvait pas la réparer.

La réparation vient de l'affirmation claire que Dieu n'est pas mort, ce que Heidegger ne dit PAS. Il dit que le Dieu des chrétiens occidentaux est mort, le Dieu de la scolastique médiévale. Mais Heidegger ne peut lui-même concevoir le christianisme autrement que comme égaré sur les chemins de l'Occident, car le Christ lui apparaît comme une égarement juif, issu de Philon le Juif, un mesitis, un médiateur et rien de plus. Mais le mot ne dit rien si nous ne comprenons pas plus que le mot.

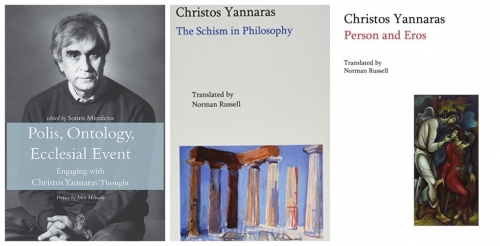
Voici que, par Denys l'Aréopagite, Christos Yannaras nous montre comment Heidegger aurait pu sauver sa philosophie et ainsi accomplir sa destinée dans un Occident spirituellement mort. Mort dans le sens où, sans la foi chrétienne selon laquelle la mort est vaincue, il n'y a aucune possibilité de philosopher librement ! Tout mène au nihilisme.
Par rapport à l'approche de Yannaras, qui se réfère aux écrits des premiers Pères et, en particulier, à Denys et à Maxime le Confesseur (qui, dans ses Écoles sur le premier, reprend et explique de manière plus compréhensible le mystère définitif et pourtant communicable comme participation personnelle à la divinité), tout ce que pense la théologie occidentale reste lettre morte.
La pensée occidentale elle-même est frappée par l'esprit de la mort, car la racine commune de la scolastique et de la philosophie universitaire ultérieure est la même.
Chez nous, en Roumanie, de temps en temps, un écrivain apporte un peu de vie dans ses livres. Mais c'est très rare.

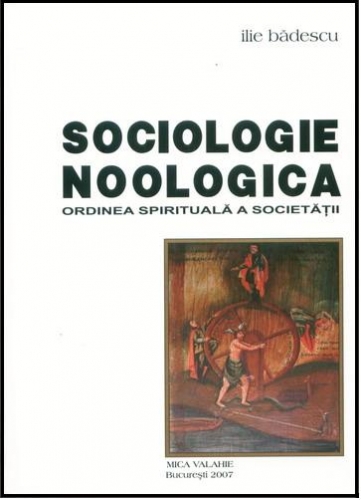
En sociologie, personne n'a tenté de dépasser le nihilisme jusqu'à la Noologie d'Ilie Bădescu (photo, ci-dessus). C'est-à-dire que personne n'a tenté de dépasser la sémantique vide des concepts pour permettre à la Vérité de prendre possession d'un domaine.
Du point de vue de Denys l'Aréopagite, la connaissance occidentale est, selon Yannaras, un jardin d'enfants.
Et nous, qui refusons de nous nourrir de notre propre sève et faisons appel à ce qui est là, nous devenons une sorte de vieux enfants qui ne croient même plus aux paroles inutiles qu'ils prononcent. Là où Dieu n'est pas, il n'y a pas de vie !
14:55 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, théologie, occident |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 13 janvier 2026
La relation vacillante de Walter Benjamin avec le marxisme et le judaïsme
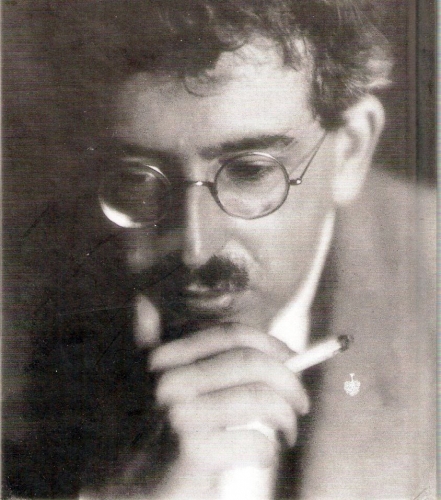
La relation vacillante de Walter Benjamin avec le marxisme et le judaïsme
Troy Southgate
Source: https://troysouthgate.substack.com/p/walter-benjamins-wav...
Au cours de ses premières années, Walter Benjamin a développé des idées très originales et le torrent de lettres qu'il a envoyées entre les deux guerres à son grand ami et éminent théologien Gershom Scholem (photo) révèle qu'il n'a jamais pu s'engager pleinement ni dans le judaïsme ni dans le marxisme. Il n'a jamais cédé aux arguments persuasifs du sionisme libéral de Scholem, par exemple, ni mis les pieds en Palestine, et il n'a pas non plus renoncé à son individualité littéraire en acceptant de rejoindre les comités de rédaction du Parti communiste, qui comptaient souvent parmi leurs membres plusieurs de ses amis les plus proches.
 Cependant, bien que le désir de Benjamin de conserver son indépendance entre les piliers envahissants de la religion millénariste et de la politique douteuse soit quelque peu louable, dans une lettre à Scholem, il a fait une très mauvaise tentative pour comparer sa nouvelle tendance vers le matérialisme dialectique avec les enseignements judaïques. Ce lien entre le matérialisme et la théologie, affirmait-il, était basé sur l'idée que
Cependant, bien que le désir de Benjamin de conserver son indépendance entre les piliers envahissants de la religion millénariste et de la politique douteuse soit quelque peu louable, dans une lettre à Scholem, il a fait une très mauvaise tentative pour comparer sa nouvelle tendance vers le matérialisme dialectique avec les enseignements judaïques. Ce lien entre le matérialisme et la théologie, affirmait-il, était basé sur l'idée que
« je n'ai jamais été capable de faire des recherches et de penser autrement que, si vous voulez, d'une manière théologique, c'est-à-dire conformément à l'enseignement talmudique sur les quarante-neuf niveaux de sens dans chaque passage de la Torah ».
Tentant d'apaiser les craintes croissantes de Scholem qui le voyait devenir un athée convaincu, Benjamin ajouta :
« Et d'après mon expérience, la platitude communiste la plus banale possède plus de hiérarchies de sens que la profondeur bourgeoise contemporaine. »
Plus important encore, alors que Benjamin cherchait à justifier ses tendances marxistes, il n'a absolument pas perçu, au cours de cette correspondance, le lien inextricable qui existe entre la théologie juive et le communisme lui-même. Un lien qui, bien sûr, n'a rien à voir avec des hiérarchies de sens, mais qui, pour le meilleur ou pour le pire, est spécifiquement lié au caractère unique du peuple juif. Benjamin, malgré tous ses défauts, était toujours trop imprégné de sa culture allemande natale pour passer complètement du côté obscur.
19:02 Publié dans Judaica, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, walter benjamin, gershom scholem, judaica |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 12 janvier 2026
Nietzsche et son temps: pour une contextualisation de son oeuvre
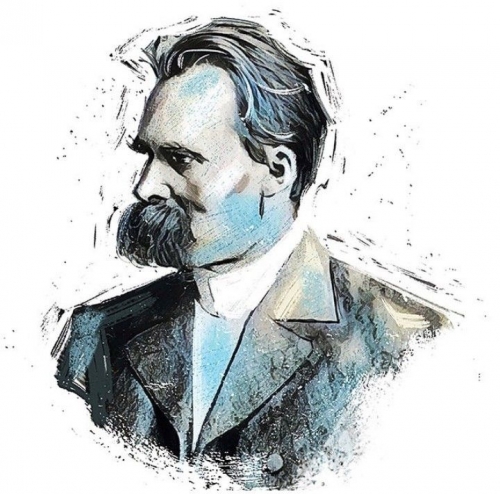
Nietzsche et son temps: pour une contextualisation de son oeuvre
Robert Steuckers
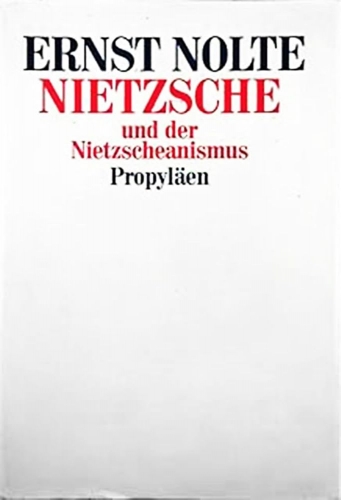 L’ouvrage d’Ernst Nolte, Nietzsche und der Nietzscheanismus, n’a pas retenu l’attention qu’il méritait dans une mouvance où, pourtant, la référence à Nietzsche semble omniprésente et où une figure de proue comme Dominique Venner vouait une admiration réelle à cet historien allemand des idées et des mouvements politiques du 20ème siècle. L’ouvrage que Nolte consacre à Nietzsche est vaste, explore tous les aspects du 19ème siècle qui ont influé sur la maturation de la pensée de Nietzsche. Partons toutefois, pour ne pas nous disperser, de la notion, cardinale aujourd’hui dans la pensée dominante, d’Aufklärung, des Lumières, principal mouvement d'idées né au 18ème siècle. Nolte souligne à très juste titre que la notion d’Aufklärung repose d’emblée sur un paradoxe de taille: elle induit la vision somme toute poétique, d’une forte luminosité diurne qui chasse les ténèbres de la nuit mais force est de constater qu’une telle luminosité ne s’inscrit que dans la durée d’une seule journée. Aucune luminosité de cette nature ne dure éternellement. Croire qu’elle durera éternellement, dès qu’elle se manifeste à l’aurore, est l’illusion ridicule des adeptes naïfs, véhéments et finalement totalitaires et hystériques des Lumières, tels sont qui sont aujourd’hui, en nos états occidentaux, au pouvoir.
L’ouvrage d’Ernst Nolte, Nietzsche und der Nietzscheanismus, n’a pas retenu l’attention qu’il méritait dans une mouvance où, pourtant, la référence à Nietzsche semble omniprésente et où une figure de proue comme Dominique Venner vouait une admiration réelle à cet historien allemand des idées et des mouvements politiques du 20ème siècle. L’ouvrage que Nolte consacre à Nietzsche est vaste, explore tous les aspects du 19ème siècle qui ont influé sur la maturation de la pensée de Nietzsche. Partons toutefois, pour ne pas nous disperser, de la notion, cardinale aujourd’hui dans la pensée dominante, d’Aufklärung, des Lumières, principal mouvement d'idées né au 18ème siècle. Nolte souligne à très juste titre que la notion d’Aufklärung repose d’emblée sur un paradoxe de taille: elle induit la vision somme toute poétique, d’une forte luminosité diurne qui chasse les ténèbres de la nuit mais force est de constater qu’une telle luminosité ne s’inscrit que dans la durée d’une seule journée. Aucune luminosité de cette nature ne dure éternellement. Croire qu’elle durera éternellement, dès qu’elle se manifeste à l’aurore, est l’illusion ridicule des adeptes naïfs, véhéments et finalement totalitaires et hystériques des Lumières, tels sont qui sont aujourd’hui, en nos états occidentaux, au pouvoir.
 Leurs Lumières ont débouché sur un nouvel âge sombre, ce qu’avait d’ailleurs prévu une figure emblématique des Lumières françaises, Condorcet (illustration), dès 1794: les Lumières, pensait-il, vont générer une inégalité pire que celle des âges dits «sombres» et conduire à des crimes bien plus retentissants que ceux commis en ces anciennes périodes dites de «ténèbres» (et Condorcet finira guillotiné…).
Leurs Lumières ont débouché sur un nouvel âge sombre, ce qu’avait d’ailleurs prévu une figure emblématique des Lumières françaises, Condorcet (illustration), dès 1794: les Lumières, pensait-il, vont générer une inégalité pire que celle des âges dits «sombres» et conduire à des crimes bien plus retentissants que ceux commis en ces anciennes périodes dites de «ténèbres» (et Condorcet finira guillotiné…).
 Kant, autre figure emblématique des Lumières en Europe, malgré la précision extrême de son œuvre, véhicule, lui aussi, des contradictions, indices d’une certaine naïveté; Rousseau est le chantre d’un primitivisme qui, sous bon nombre d’aspects, est l’antithèse des Lumières; Adolf von Knigge (ci-contre), lui aussi adepte des Lumières, compile dans ses écrits de nombreuses contradictions qui induisent Nolte à lui poser, à titre posthume, les questions suivantes: l’adepte des Lumières ne doit-il pas craindre par-dessus tout l’ultime conséquence de la philosophie des Lumières: la complète neutralisation de la raison générale par les pulsions de l’individu, lesquelles se posent comme expressions de la «raison» (individualiste) et engendrent ainsi l’anarchie ?
Kant, autre figure emblématique des Lumières en Europe, malgré la précision extrême de son œuvre, véhicule, lui aussi, des contradictions, indices d’une certaine naïveté; Rousseau est le chantre d’un primitivisme qui, sous bon nombre d’aspects, est l’antithèse des Lumières; Adolf von Knigge (ci-contre), lui aussi adepte des Lumières, compile dans ses écrits de nombreuses contradictions qui induisent Nolte à lui poser, à titre posthume, les questions suivantes: l’adepte des Lumières ne doit-il pas craindre par-dessus tout l’ultime conséquence de la philosophie des Lumières: la complète neutralisation de la raison générale par les pulsions de l’individu, lesquelles se posent comme expressions de la «raison» (individualiste) et engendrent ainsi l’anarchie ?
Conclusion de Nolte: les Lumières sont un corpus bourré des contradictions qui a été mis entre parenthèse pendant quelques décennies en Europe mais qui est revenu au grand galop à partir des années 1970 (après les engouements existentialistes des années 1950-1960 et l’effervescence soixante-huitarde.
Ces contradictions, Nietzsche les mettra en exergue de manières différentes, en se passionnant pour la musique de Wagner pour s’en désolidariser ensuite, en explorant l’œuvre des dramaturges grecs de l’antiquité, etc. Nietzsche ne rejette pas toutes les Lumières: il restaure, dans une phase de son œuvre, entre son wagnérisme et sa philosophie finale, une pratique des Lumières, soustraite aux pesanteurs métaphysiques (Nietzsche se veut «physiologue» et «Freigeist», «esprit libre»). Ce pragmatisme activiste entend se débarrasser du «ballast catagogique de la civilisation» (comme nous devrions nous débarrasser aujourd’hui des ballasts de ce qui s’affiche comme adepte ou héritier ou bétonneur des Lumières du 18ème siècle, tout en prétendant détenir les seuls atouts porteurs d’un pouvoir politiques et métapolitique/médiatique parfait et jugé indépassable et inamovible).
Le Nietzsche proche des Lumières semble préconiser une sphère politique rationalisée, équilibrante mais, en dépit de cette apparence, ses positions recèlent un rejet assez radical du message des Lumières (et surtout de ce qu’elles vont devenir au fil du temps pour aboutir au pandémonium qu’elles sont aujourd’hui en Europe occidentale). Nietzsche, en effet, constate, dans cette phase «rationnelle» (en apparence) de son œuvre, que le monde, en son holicité (en sa totalité), n’est nullement rationnel et que la raison elle-même n’est jamais qu’un phénomène surgissant par hasard dans un monde soumis à un hasard général.
Nietzsche emprunte la voie qui le mène à formuler sa philosophie finale. Il démasque ceux qui veulent faire des hommes les porteurs exclusifs de leur rationalité imaginaire (et de pacotille); les vertus, chantées par les «illuministes» (pour parler comme les philosophes italiens) ne sont que des oripeaux camouflant un égoïsme fondamental que les moralistes français avaient déjà, avant les Lumières, bien mis en exergue. Dès lors, Nietzsche voudra léguer aux lucides du futur un «double cerveau »: l’une moitié vouée à la science pratique et philologique; l’autre capable de faire face au «socle fondamental de toutes choses, lequel est dépourvu de toute logique».
 Dans Aurore, Nietzsche brocarde cruellement l’adepte des Lumières qui veut faire de «belles choses» (der schöntuerische Aufklärer). C’est là le moment de basculement dans l’œuvre de Nietzsche, aux répercussions politiques, métapolitiques et philosophiques de grande ampleur, dont les ondes de choc nous ébranlent aujourd’hui encore. Il évoque, dès ces aphorismes d’Aurore, une équivalence entre le christianisme et les Lumières, une équivalence qui apparaît dès le moment où le philosophe perçoit qu’il y a, chez les deux piliers philosophiques de son 19ème siècle, la marotte infertile de la «Schöntuerei» (de vouloir fabriquer du bien et du beau au départ de bonnes intentions, reposant sur une forme de négation du réel tel qu’il est, sur des raisonnements qui ne prennent pas acte de ce que le réel est mais se référant à un réel imaginaire qui est, en fait, un «voudrait-être»: on ne peut pas être plus actuel! ).
Dans Aurore, Nietzsche brocarde cruellement l’adepte des Lumières qui veut faire de «belles choses» (der schöntuerische Aufklärer). C’est là le moment de basculement dans l’œuvre de Nietzsche, aux répercussions politiques, métapolitiques et philosophiques de grande ampleur, dont les ondes de choc nous ébranlent aujourd’hui encore. Il évoque, dès ces aphorismes d’Aurore, une équivalence entre le christianisme et les Lumières, une équivalence qui apparaît dès le moment où le philosophe perçoit qu’il y a, chez les deux piliers philosophiques de son 19ème siècle, la marotte infertile de la «Schöntuerei» (de vouloir fabriquer du bien et du beau au départ de bonnes intentions, reposant sur une forme de négation du réel tel qu’il est, sur des raisonnements qui ne prennent pas acte de ce que le réel est mais se référant à un réel imaginaire qui est, en fait, un «voudrait-être»: on ne peut pas être plus actuel! ).
D’autres termes témoignent également de ce basculement: les Lumières à la Rousseau, notamment, sont «à moitié folles», «théâtrales», «d’une cruauté bestiale», «sentimentales» et «auto-enivrantes», toutes tares qui donnent sa substance à l’idéologie de la «Révolution française» et, nous empresserons-nous d’ajouter, au fatras comique et hargneux de l’actuelle idéologie républicaine, telle qu’elle se manifeste dans les discours insipides de Macron et dans les vitupérations hystériques de Mélanchon, sans parler des piaillements de la piétaille qui claudique derrière ces deux bonshommes, une piétaille qui serait toute prête à porter à son paroxysme la «cruauté bestiale» (tierisch-grausam) exposée par Nietzsche.
Les Lumières affichées par ce ramassis d’abjects politicards ne sont donc pas les «Lumières libératrices», annoncées avec fracas par la propagande régimiste/néolibérale et par celle d’une fausse opposition, dûment contrôlée, juste bonne à dégoiser des slogans qui ne débouchent sur rien de concret. Nous avons affaire à un «révolutionnisme» dangereux, sous tous ses aspects, qui est solidement en place mais qu’il aurait fallu, dixit Nietzsche à son époque, étouffer dans l’œuf (in der Geburt zu ersticken).
Deux positionnements peuvent se déduire de ce Nietzsche du «moment de basculement»: 1) être un adepte pragmatique des Lumières qui expurge l’espace politique de tout «révolutionnisme bestial»; 2) dénoncer le «jésuitisme» des «Lumières démocratiques» (ou relevant de la «bestialité révolutionnaire») qui s’oppose, par ressentiment ou pas pure et simple bassesse, au «splendide effort» que constitue le fait européen. Les «esprits libres» de ces Lumières-là ne sont plus des Freigeister, dont Nietzsche espérait l’avènement mais des «niveleurs» stupides, véhicules d’un phénomène de dégénérescence, de déclin, de décadence.
Cette morale de l’amélioration constante (Besserungs-Moral) est une sinistre farce. La luminosité diurne la plus aveuglante, la petite rationalité à tout prix, la vie éclairée, froide, prudente, consciente, sans instinct, résistant en permanence contre les instincts, n’est qu’une pathologie, une autre pathologie (que le christianisme) et, de ce fait, n’est nullement un retour à la «vertu» (de romaine mémoire), à la «santé», au «bonheur». «Vouloir combattre les instincts, telle est la manie qui conduit à la décadence».

Nietzsche et la révolution française
Des clivages politiques émergent au fur et à mesure que les événements de Paris bouleversent la France de l’intérieur ou interpellent les observateurs sympathisants ou hostiles à l’extérieur, ailleurs en Europe. En Allemagne, les enthousiastes de la révolution, assez nombreux au départ, surtout suite à la chute de la place de Mayence, feront place à des tenants du scepticisme puis à d’ex-révolutionnaires devenus totalement hostiles à l’entreprise napoléonienne. Les excès des jacobins refroidissent les ardeurs des révolutionnaires allemands; l’exécution de Louis XVI et de la Reine Marie-Antoinette entraîne d’autres désaffections et la prise du pouvoir par Bonaparte, perçu comme un «despote militaire», réduit quasi à néant les rangs déjà éclaircis des adeptes allemands des idées révolutionnaires.
 L’auto-couronnement de Napoléon en 1804 est vu comme un scandale inacceptable: même Beethoven, auteur de la symphonie Eroica, retire son soutien. Schiller et Klopstock avait tourné le dos aux idéaux de la Révolution dès la Terreur. Goethe avait exprimé son scepticisme dès le départ. Seuls Kant et Hegel gardent des sentiments positifs. Fichte restera fidèle aux idéaux de la Révolution jusqu’en 1813. Les libéraux allemands d’avant 1789, qui envisageaient un glissement progressif vers un Etat idéal selon les critères des Lumières –Brandes, Rehberg, Gentz- sont très rapidement devenus des adversaires résolus du «Synode despotique de Paris» et du régime napoléonien.
L’auto-couronnement de Napoléon en 1804 est vu comme un scandale inacceptable: même Beethoven, auteur de la symphonie Eroica, retire son soutien. Schiller et Klopstock avait tourné le dos aux idéaux de la Révolution dès la Terreur. Goethe avait exprimé son scepticisme dès le départ. Seuls Kant et Hegel gardent des sentiments positifs. Fichte restera fidèle aux idéaux de la Révolution jusqu’en 1813. Les libéraux allemands d’avant 1789, qui envisageaient un glissement progressif vers un Etat idéal selon les critères des Lumières –Brandes, Rehberg, Gentz- sont très rapidement devenus des adversaires résolus du «Synode despotique de Paris» et du régime napoléonien.
Au 19ème siècle, période où ont mûri tous les filons idéologiques de l’histoire européenne contemporaine, un «parti de la réaction» s’est opposé à un «parti du mouvement» (antinomie entre «Beharrung» et «Bewegung»). C’est là une terminologie qui est récurrente et dont les échos sont encore parfaitement audibles de nos jours. Nietzsche, politiquement parlant, nous explique Ernst Nolte (p. 147), n’est pas une figure qui s’inscrit pourtant dans le sillage conservateur traditionnel d’Edmund Burke ou de Joseph de Maistre. Dès La naissance de la tragédie, Nietzsche rejette les idéaux modernes/illuministes comme étant des «platitudes», diamétralement opposées à l’esprit hellénique/germanique.
 Dans Le gai savoir (aphorisme 350), il écrit: «Déjà le protestantisme est une révolte du vulgaire au profit de ce qui est médiocrement bourgeois (bieder), ingénu et superficiel… mais il faudra attendre la révolution française pour donner le sceptre, sans retenue et festivement, aux «hommes bons» (au mouton, à l’âne, à l’oie et à tout ce qui est incurablement plat et braillard et mûr pour la maison des fous, celle où règnent les idéaux modernes».
Dans Le gai savoir (aphorisme 350), il écrit: «Déjà le protestantisme est une révolte du vulgaire au profit de ce qui est médiocrement bourgeois (bieder), ingénu et superficiel… mais il faudra attendre la révolution française pour donner le sceptre, sans retenue et festivement, aux «hommes bons» (au mouton, à l’âne, à l’oie et à tout ce qui est incurablement plat et braillard et mûr pour la maison des fous, celle où règnent les idéaux modernes».
Nietzsche, le 19ème et le socialisme
Dans le sillage des idées révolutionnaires émerge le mouvement socialiste, lequel, avant d’être largement «marxisé», était franchement utopique : on rêvait de phalanstères égalitaires, telles celles qu’imaginaient Robert Owen en Angleterre ou Charles Fourier en France.
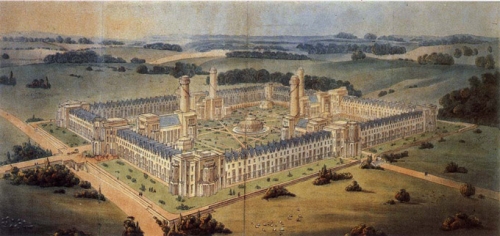
Des villages communautaires voient le jour et se nomment Orbiston, New Lanark (illustration) et Queenswood. Hélas pour les utopistes, ces expériences, séduisantes sur le papier, seront de très courte durée: l’impossibilité pratique de les faire fonctionner provenant du fait que la valeur d’une heure de travail de tel artisan n’équivalait pas à l’heure de travail de tel autre métier; ensuite, les assemblées communes, appelées régulièrement à débattre de tous les problèmes du village égalitaire et à prendre des décisions, durent trop longtemps pour pouvoir régler, en des délais raisonnables, toutes les questions qui réclament une solution plus ou moins rapide.
Le démocratisme outrancier de ces expériences utopiques butait contre les différences qualitatives existant de facto dans les œuvres et prestations diverses des hommes, lesquels sont peut-être égaux en droit mais très différents les uns des autres vu les capacités diverses qu’ils peuvent faire valoir. Ce démocratisme caricatural bute enfin sur la nécessité pour toute communauté ou organisation de limiter les débats stériles, trop longs, et de prendre rapidement des décisions d’importance vitale. Ces pierres d’achoppement du démocratisme utopique et caricatural demeurent bien présentes dans nos sociétés actuelles (d’où la nécessité de décider avant de débattre, nécessité perçue au 19ème par Donoso Cortés en Espagne, au 20ème par Carl Schmitt dans l’Allemagne de Weimar).
Le socialisme, ensuite, a besoin de planification: cette planification en elle-même ou le degré de son extension dans la gestion d’une commune ou d’un Etat demeure une question politique ouverte mais le problème politique majeur reste en ce domaine permanent: il faut de la planification (un Bureau du Plan), indubitablement, car l’absence de planification est le propre de l’idéologie libérale, elle aussi issue des Lumières (et avec un droit d’aînesse!) et conduit à l’impasse.
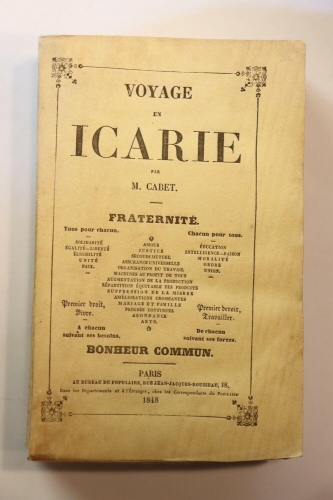 Cependant, l’utopisme et les faillites des phalanstères anglo-saxonnes d’Owen conduisent à une radicalisation théorique chez Etienne Cabet, auteur de Voyage en Icarie. Cabet théorise une utopie très coercitive: le travail y est un devoir auquel personne ne peut se soustraire. Tout y est standardisé, tout est partout pareil. Et on y décèle déjà du wokisme avant la lettre: les langues anciennes ne sont plus enseignées dans les écoles car elles sont inutiles (point de vue partagé aujourd’hui par les néolibéraux, les soixante-huitards, les gauchistes de tous poils et les tenants de la cancel culture). Les mauvais livres, en Icarie, sont brûlés en place publique. On ne parle pas de transhumanisme ou de transgendérisme mais la «race humaine» doit être améliorée par l’étude de la phénologie et en observant les lois de l’eugénisme.
Cependant, l’utopisme et les faillites des phalanstères anglo-saxonnes d’Owen conduisent à une radicalisation théorique chez Etienne Cabet, auteur de Voyage en Icarie. Cabet théorise une utopie très coercitive: le travail y est un devoir auquel personne ne peut se soustraire. Tout y est standardisé, tout est partout pareil. Et on y décèle déjà du wokisme avant la lettre: les langues anciennes ne sont plus enseignées dans les écoles car elles sont inutiles (point de vue partagé aujourd’hui par les néolibéraux, les soixante-huitards, les gauchistes de tous poils et les tenants de la cancel culture). Les mauvais livres, en Icarie, sont brûlés en place publique. On ne parle pas de transhumanisme ou de transgendérisme mais la «race humaine» doit être améliorée par l’étude de la phénologie et en observant les lois de l’eugénisme.
 Mieux et très contemporain: on a, en Icarie, le souci du passé; on y a institué un «tribunal pour les morts», où des «historiens» jugent le passé du point de vue du bonheur (atteint) en ce moment (icarien) de fin de l’histoire. Dans la vision de Cabet (illustration), l’Icarie n’est pas isolée sur elle-même: elle sort de sa coquille pour lancer des croisades au profit des opprimés dans le monde entier… Cet utopisme du début du 19ème est, rappelle Nolte, l’écho laïcisé de visions chrétiennes, exprimées dans certains formes de monachisme (à la différence près que le monachisme, contrairement à l’Icarie de Cabet, se veut retranché du monde et s’organise exclusivement intra muros). On retrouve des visions comparables chez Maître Eckhart, chez les bégards qu’il fréquentait ou chez Joachim de Flore (et son «Troisième Empire») ou encore chez les Taborites, les Anabaptistes et dans les écrits qui ont accompagné les révoltes paysannes anglaises (Wycliff).
Mieux et très contemporain: on a, en Icarie, le souci du passé; on y a institué un «tribunal pour les morts», où des «historiens» jugent le passé du point de vue du bonheur (atteint) en ce moment (icarien) de fin de l’histoire. Dans la vision de Cabet (illustration), l’Icarie n’est pas isolée sur elle-même: elle sort de sa coquille pour lancer des croisades au profit des opprimés dans le monde entier… Cet utopisme du début du 19ème est, rappelle Nolte, l’écho laïcisé de visions chrétiennes, exprimées dans certains formes de monachisme (à la différence près que le monachisme, contrairement à l’Icarie de Cabet, se veut retranché du monde et s’organise exclusivement intra muros). On retrouve des visions comparables chez Maître Eckhart, chez les bégards qu’il fréquentait ou chez Joachim de Flore (et son «Troisième Empire») ou encore chez les Taborites, les Anabaptistes et dans les écrits qui ont accompagné les révoltes paysannes anglaises (Wycliff).
 Nolte ne pense pas que Nietzsche ait lu Marx, bien qu'il aurait lu son adversaire socialiste Dühring (photo) et s’est, à certains moments, intéressé à la littérature socialiste de son temps. Nolte constate cependant qu’il y a des rapprochements possibles à faire entre l’œuvre de Nietzsche et celle de Marx. Ces rapprochements seraient les suivants: commune hostilité à l’idée figée, mièvre et déconnectée de «civilisation» (au sens que donnent les Lumières à ce terme); même intérêt pour la «résurrection de la nature» (le retour au dionysiaque chez Nietzsche), oblitérée par les ratiocinations éthérées des juristes et par les raisonnements mécaniques, seuls posés comme «rationnels»; commune hostilité au principe de la division du travail et à la politique économique du «laisser faire»; même valorisation de l’homme comme membre de sa propre espèce (Gattungsmensch) contre l’individu détaché et sans plus aucun lien; dans ce sens, Nietzsche écrit: «La fabrique règne; l’homme devient rouage»; comme Engels, Nietzsche déplore amèrement la massification par l’urbanisation, laquelle entraîne l’apathie généralisée et pousse les foules dans une hâte qui ne s’interrompt jamais.
Nolte ne pense pas que Nietzsche ait lu Marx, bien qu'il aurait lu son adversaire socialiste Dühring (photo) et s’est, à certains moments, intéressé à la littérature socialiste de son temps. Nolte constate cependant qu’il y a des rapprochements possibles à faire entre l’œuvre de Nietzsche et celle de Marx. Ces rapprochements seraient les suivants: commune hostilité à l’idée figée, mièvre et déconnectée de «civilisation» (au sens que donnent les Lumières à ce terme); même intérêt pour la «résurrection de la nature» (le retour au dionysiaque chez Nietzsche), oblitérée par les ratiocinations éthérées des juristes et par les raisonnements mécaniques, seuls posés comme «rationnels»; commune hostilité au principe de la division du travail et à la politique économique du «laisser faire»; même valorisation de l’homme comme membre de sa propre espèce (Gattungsmensch) contre l’individu détaché et sans plus aucun lien; dans ce sens, Nietzsche écrit: «La fabrique règne; l’homme devient rouage»; comme Engels, Nietzsche déplore amèrement la massification par l’urbanisation, laquelle entraîne l’apathie généralisée et pousse les foules dans une hâte qui ne s’interrompt jamais.
Ces convergences partielles entre Nietzsche et Marx n’autorisent toutefois pas de ne retenir que celles-ci pour fabriquer une idéologie superficielle qui serait «rouge-brune», «social-dionysiaque» ou quelque chose du même genre. Nietzsche reste critique face aux travers possibles de tout socialisme politique et semble percevoir le danger que représente une volonté d’abolir les legs du passé ou de les reléguer au niveau de simples pièces de musée.
Nietzsche ne partage pas la vision hegelo-marxiste d’une « réalisation » finale de l’essence de l’humanité. Les convergences demeurent donc partielles, bien qu’importantes, et partagent la critique du «travail déshumanisant», de «la dépersonalisation du travailleur», de la «monstrueuse machinerie» qui s’impose aux sociétés modernes. La Kulturkritik et le rejet de toute « aliénation » (Entfremdung) ne sont donc pas des apanages des seules écoles marxistes ou post-marxistes.
 Face aux manifestations patentes d’un déclin général de l’Europe et de l’humanité toute entière, Nietzsche exprime une certaine confiance, critique toutefois, dans le Reich bismarckien car il est devenu, après 1871, la principale puissance militaire européenne, qui a mis en place des lois antisocialistes (avant de créer un socialisme solide au sein de l’Obrigkeitsstaat prusso-allemand ce qui ne fut réalisé qu’après que Nietzsche ait sombré dans l’inconscience) et qui pratique une politique hostile aux ingérences vaticanes au sein d’un Reich, pour une bonne part luthérien; Rome souhaitait le faire imploser pour que se constitue une moitié catholique et une autre moitié protestante (le mouvement «Los von Rom»).
Face aux manifestations patentes d’un déclin général de l’Europe et de l’humanité toute entière, Nietzsche exprime une certaine confiance, critique toutefois, dans le Reich bismarckien car il est devenu, après 1871, la principale puissance militaire européenne, qui a mis en place des lois antisocialistes (avant de créer un socialisme solide au sein de l’Obrigkeitsstaat prusso-allemand ce qui ne fut réalisé qu’après que Nietzsche ait sombré dans l’inconscience) et qui pratique une politique hostile aux ingérences vaticanes au sein d’un Reich, pour une bonne part luthérien; Rome souhaitait le faire imploser pour que se constitue une moitié catholique et une autre moitié protestante (le mouvement «Los von Rom»).
Nietzsche n’est toutefois que partiellement satisfait: dans l’avenir, ce Reich bismarckien devrait se donner tous les moyens adéquats de mettre un terme à tous les phénomènes de déclin, bien que ceux-ci relèvent de la «dégénérescence générale de l’humanité». Si Nietzsche se félicite que le Reich bismarckien soit devenu la principale puissance militaire européenne, il déplore toutefois le militarisme caricatural, que Frédéric III, le père de Guillaume II, avait voulu corriger («l’inoubliable Frédéric III» écrit-il). Cet empereur n’eut qu’un règne des plus éphémères.
 L’anti-militarisme allemand, anarchisant, satirique, socialiste et conservateur tout à la fois, de l’ère bismarckienne puis wilhelminienne, s’est exprimé dans la riche tradition des cabarets et des revues satiriques. Il n’est pas anti-patriotique ni même pacifiste: il veut une armée plus professionnelle, des officiers mieux formés même au niveau académique (ce à quoi s’emploiera le Général Hans von Seeckt après 1918); ces auteurs de satires et animateurs de cabarets politisés s’opposent plutôt à une armée et à un corps d’officiers (insuffisamment formés) qui est caricaturale. Ils doivent plus à Nietzsche qu’à d’autres auteurs, hostiles par pacifisme ou par impolitisme à la chose militaire.
L’anti-militarisme allemand, anarchisant, satirique, socialiste et conservateur tout à la fois, de l’ère bismarckienne puis wilhelminienne, s’est exprimé dans la riche tradition des cabarets et des revues satiriques. Il n’est pas anti-patriotique ni même pacifiste: il veut une armée plus professionnelle, des officiers mieux formés même au niveau académique (ce à quoi s’emploiera le Général Hans von Seeckt après 1918); ces auteurs de satires et animateurs de cabarets politisés s’opposent plutôt à une armée et à un corps d’officiers (insuffisamment formés) qui est caricaturale. Ils doivent plus à Nietzsche qu’à d’autres auteurs, hostiles par pacifisme ou par impolitisme à la chose militaire.
Les convergences ténues entre l’œuvre de Nietzsche et certains aspects de la pensée de Marx (qui réfute l’utopisme gauchiste comme le fera aussi plus tard Lénine) et la critique du militarisme caricatural de l’ère wilhelminienne font que Nietzsche sera reçu et lu, dès la fin du 19ème siècle, par un public de gauche plutôt que par un public de droite. L’orthodoxie, qui se voulait marxiste (sans l’être en fait) au sein de la social-démocratie allemande, posait, avec un certain Franz Mehring et sous l’impulsion de Bebel, Nietzsche comme un «ennemi du prolétariat». La «correction politique» avant la lettre, veillait comme elle veille toujours en Allemagne, à l’heure où Sahra Wagenknecht et son époux Oskar Lafontaine cherchent à échapper à l’impolitisme de la SPD et de Die Linke.
Cette inquisition, sans dire son nom, impliquait entre 1890 et 1914, que toute pensée un tant soit peu virulente ou inclassable devait être condamnée: il fallait que les ouailles l’ignorent, il fallait l’effacer des horizons. Cependant, cet alignement des sociaux-démocrates allemands, qui se proclamaient marxistes et veillaient à ce qu’un conformisme figé serve de «pensée» aux intellectuels du parti, ne satisfait pas tous les contestataires du statu quo politique, qui votaient peut-être pour les socialistes mais n’avalaient pas toutes les couleuvres que les bonzes (dixit Roberto Michels) voulaient leur faire gober. Certaines tendances socialisantes, syndicalistes ou anarchisantes dans la vaste mouvance socialiste rejetaient les rigidités des bonzes qui craignaient, certainement à juste titre, d’être brocardés et moqués par tous ceux qui, à gauche, et partout en Europe, entendaient se donner des horizons plus vastes, où les orthodoxies étriquées n’avaient pas leur place, où un syndicalisme pugnace plus ancré dans le réel (notamment en Italie) déterminait un activisme plus en prise sur des réalités populaires, régionales ou sectorielles rétives à tout enfermement dogmatique et à toute orthodoxie théorisée par des philosophes abscons ou des avocaillons ergoteurs.
 La pensée plastique, mouvante, démasquante de Nietzsche pouvait, pour tous ces contestataires de la bonzification de la social-démocratie en Allemagne, en Italie ou en Belgique (les pays où Michels -photo- a vécu, participant aux initiatives socialistes), être bien plus utile et surtout plus galvanisante que le pilpoul des idéologues sans envergure ou des avocats marrons qui tentaient de compenser leur extrême médiocrité en se posant comme les défenseurs raisonnables (et donc stérilisateurs) d’un peuple qu’ils méprisaient profondément, qu’ils infantilisaient dans leur pâle imaginaire et auquel ils vendaient leurs salades insipides. A cette médiocrité, que constituait la bonzification des cadres socialistes d’avant 1914 (la Verbonzung de Michels), s’ajoutait l’élément utopique qu’était et est resté l’internationalisme (ou l’universalisme ou la panmixie de nos jours): cette lubie idéologique, indéracinable chez les bonzes, idéologues et avocats, conduisait à sacrifier les intérêts directs du peuple concret pour préserver des chimères sans ancrage temporel ou spatial. On ne peut créer un socialisme, qui soit réellement au service du peuple, que si l’on entend le réaliser dans un cadre précis, un cadre national ou régional ou autre, selon les circonstances réelles, en excluant la démesure des projets internationalistes qui ne pourront jamais mobiliser les moyens nécessaires pour établir cette utopie globale.
La pensée plastique, mouvante, démasquante de Nietzsche pouvait, pour tous ces contestataires de la bonzification de la social-démocratie en Allemagne, en Italie ou en Belgique (les pays où Michels -photo- a vécu, participant aux initiatives socialistes), être bien plus utile et surtout plus galvanisante que le pilpoul des idéologues sans envergure ou des avocats marrons qui tentaient de compenser leur extrême médiocrité en se posant comme les défenseurs raisonnables (et donc stérilisateurs) d’un peuple qu’ils méprisaient profondément, qu’ils infantilisaient dans leur pâle imaginaire et auquel ils vendaient leurs salades insipides. A cette médiocrité, que constituait la bonzification des cadres socialistes d’avant 1914 (la Verbonzung de Michels), s’ajoutait l’élément utopique qu’était et est resté l’internationalisme (ou l’universalisme ou la panmixie de nos jours): cette lubie idéologique, indéracinable chez les bonzes, idéologues et avocats, conduisait à sacrifier les intérêts directs du peuple concret pour préserver des chimères sans ancrage temporel ou spatial. On ne peut créer un socialisme, qui soit réellement au service du peuple, que si l’on entend le réaliser dans un cadre précis, un cadre national ou régional ou autre, selon les circonstances réelles, en excluant la démesure des projets internationalistes qui ne pourront jamais mobiliser les moyens nécessaires pour établir cette utopie globale.
Bruno Wille
 Le clivage au sein de la social-démocratie allemande peut s’expliquer, à nos contemporains des années 2020, en opposant deux figures aux positions diamétralement différentes : Franz Mehring et Bruno Wille (photo). Mehring a lutté dans les années 1890 pour que Nietzsche n’ait plus aucune influence sur les raisonnements des intellectuels socialistes. Bruno Wille dirigeait les jeunes du parti sous l’appellation de «Die Jungen». Ces derniers accusaient le parti d’être «accommodationniste» et de s’embourgeoiser (de s’aligner sur les avocats), de se contenter de faire du parlementarisme, de s’ossifier (la Verknochung de Michels), de tout miser sur le fonctionnement d’une bureaucratie qui s’éloignerait très rapidement des préoccupations des masses, qui, elles, sont toujours au bord de la pire des précarités. Wille et ses amis, dans leurs critiques, se sont toujours explicitement référés à Nietzsche, philosophe permettant, disaient-ils, de déployer en permanence une créativité qu’étouffait la bureaucratie.
Le clivage au sein de la social-démocratie allemande peut s’expliquer, à nos contemporains des années 2020, en opposant deux figures aux positions diamétralement différentes : Franz Mehring et Bruno Wille (photo). Mehring a lutté dans les années 1890 pour que Nietzsche n’ait plus aucune influence sur les raisonnements des intellectuels socialistes. Bruno Wille dirigeait les jeunes du parti sous l’appellation de «Die Jungen». Ces derniers accusaient le parti d’être «accommodationniste» et de s’embourgeoiser (de s’aligner sur les avocats), de se contenter de faire du parlementarisme, de s’ossifier (la Verknochung de Michels), de tout miser sur le fonctionnement d’une bureaucratie qui s’éloignerait très rapidement des préoccupations des masses, qui, elles, sont toujours au bord de la pire des précarités. Wille et ses amis, dans leurs critiques, se sont toujours explicitement référés à Nietzsche, philosophe permettant, disaient-ils, de déployer en permanence une créativité qu’étouffait la bureaucratie.
L’ouvrier, le prolétaire, avait potentiellement une personnalité, capable de déployer de la créativité. La bureaucratie socialiste condamnait, en imposant ses routines stéréotypées, le prolétaire à s’effacer au sein d’une masse amorphe, sevrée de tout élan révolutionnaire. Mehring et Bebel gagneront néanmoins l’épreuve de force: les militants de «Die Jungen» quitteront alors un à un le parti pour devenir des «socialistes indépendants», qui s’éparpilleront dans d’autres mouvances politiques, anarchistes, syndicalistes ou national-révolutionnaires.
Lily Braun
 Parmi les socialistes contestataires et nietzschéens au sein même du parti social-démocrate allemand avant 1914, il convient de citer Lily Braun (photo), qui fut aussi la théoricienne d’un féminisme de bon aloi. Elle avait, en dépit de sa position élevée dans la hiérarchie du parti, réfuté, dans de nombreux écrits, les fondements du socialisme des bonzes encartés (et non le socialisme du peuple), en déclarant, de manière récurrente, que le socialisme n’était pas viable à long terme s’il restait campé sur des bases kantiennes, hégéliennes ou chrétiennes. Il fallait tenir compte des foucades de Nietzsche contre ces débris idéologico-philosophiques vétustes, inféconds, hérités des Lumières. Ensuite, il fallait discipliner ces foucades pour évacuer les dogmes, contourner le contrôle bureaucratique.
Parmi les socialistes contestataires et nietzschéens au sein même du parti social-démocrate allemand avant 1914, il convient de citer Lily Braun (photo), qui fut aussi la théoricienne d’un féminisme de bon aloi. Elle avait, en dépit de sa position élevée dans la hiérarchie du parti, réfuté, dans de nombreux écrits, les fondements du socialisme des bonzes encartés (et non le socialisme du peuple), en déclarant, de manière récurrente, que le socialisme n’était pas viable à long terme s’il restait campé sur des bases kantiennes, hégéliennes ou chrétiennes. Il fallait tenir compte des foucades de Nietzsche contre ces débris idéologico-philosophiques vétustes, inféconds, hérités des Lumières. Ensuite, il fallait discipliner ces foucades pour évacuer les dogmes, contourner le contrôle bureaucratique.
Le socialiste vrai, ajoutait Lily Braun, est un révolutionnaire et, à ce titre, il vise l’héroïsme car la praxis du révolutionnaire est de se transcender personnellement dans le combat pour le peuple. Le combat, communautaire par nature, ne doit pas conduire, in fine, à se subordonner aux bureaucrates replets mais doit assurer le libre développement de la personnalité, laquelle est également vectrice d’une dimension esthétique (comportementale) que l’idéologie médiocre des bureaucrates étouffe et évacue hors du champ de tout socialisme bien compris.
 Lily Braun, curieusement, théorisera ce qu’elle appelait «l’esprit de négation» (Geist der Verneinung). Aujourd’hui, cette notion est attribuée aux théoriciens de l’Ecole de Francfort, précurseurs des dérives soixante-huitardes et du négativisme absolu et virulent de la «cancel culture» et du wokisme. Pour Lily Braun, toutefois, l’esprit de négation doit conduire à nier ce qui sclérose, ce qui est figé, ce qui ne recèle plus aucune potentialité et qui ne permet plus aucune «re-juvénilisation» du socialisme. Il s’agit donc, pour elle, de nier les dogmes inspirés du kantisme, qui structuraient l’idéologie de la social-démocratie allemande d’avant 1914 et qui structurent toujours, mutatis mutandis, le fatras hétéroclite des idéologies dominantes (et seules tolérées) d’aujourd’hui.
Lily Braun, curieusement, théorisera ce qu’elle appelait «l’esprit de négation» (Geist der Verneinung). Aujourd’hui, cette notion est attribuée aux théoriciens de l’Ecole de Francfort, précurseurs des dérives soixante-huitardes et du négativisme absolu et virulent de la «cancel culture» et du wokisme. Pour Lily Braun, toutefois, l’esprit de négation doit conduire à nier ce qui sclérose, ce qui est figé, ce qui ne recèle plus aucune potentialité et qui ne permet plus aucune «re-juvénilisation» du socialisme. Il s’agit donc, pour elle, de nier les dogmes inspirés du kantisme, qui structuraient l’idéologie de la social-démocratie allemande d’avant 1914 et qui structurent toujours, mutatis mutandis, le fatras hétéroclite des idéologies dominantes (et seules tolérées) d’aujourd’hui.
Nietzsche, avec ses démarches démasquantes, avec ses critiques incisives des poncifs de toutes natures, avec son idée cardinale de procéder à une «transvaluation de toutes les valeurs», est le philosophe qui doit nous apprendre à parfaire cette négation de ce qui nous nie (de ce qui nous niait hier et continue de nous nier aujourd’hui).
Lily Braun est même très explicite quand elle dit qu’il faut «dire oui à la Vie», tout en se débarrassant de cet «idéal du plus grand bonheur pour le plus grand nombre», idéal désuet qui nous amène «à ne créer qu’une société de petits bourgeois flegmatiques». L’esprit de négation, à condition qu’il n’ait que des références directement tirées de Nietzsche, sert à dire mieux «oui à la Vie» et à créer les conditions pour que les hommes ne sombrent pas dans un univers de «petits bourgeois flegmatiques».
 Le fils de Lily Braun, Otto Braun (1897-1918) (photo), frotté avant-guerre aux démarches polémiques de sa mère contre les bonzificateurs du socialisme allemand, rangés derrière Mehring et Bebel, s’engage très tôt dans l’armée impériale pour partir combattre en Russie et en France, où il trouvera la mort au front. Dans les lettres adressées à ses parents et à son amie Julia Vogelstein pendant la guerre, recueil de lettres qui constitue son unique livre d’une extraordinaire densité, eu égard à son jeune âge, Otto Braun résume les positions qu’il avait déjà exprimées entre sa dixième et sa douzième année dans des missives adressées à son père et à sa mère: il chante l’Eros et la liberté; il veut déjà voir la vie telle qu’elle est et non telle qu’elle doit être, passant ainsi, en toute conscience à la fin de son enfance et au tout début de son adolescence, de l’idéalisme (abstrait) au réalisme, laissant très tôt entrevoir un refus du moralisme social-démocrate (et autre), qui ne veut qu’amender et corriger le monde sans l’aimer pour ce qu’il est, sans l’accepter tel qu’il est. «Nous, jeunes d’aujourd’hui, avons besoin de gens qui s’immergent dans la vie pour accomplir quelque chose de nouveau, déjà que quelque chose de nouveau se rapproche de nous, je le sens!».
Le fils de Lily Braun, Otto Braun (1897-1918) (photo), frotté avant-guerre aux démarches polémiques de sa mère contre les bonzificateurs du socialisme allemand, rangés derrière Mehring et Bebel, s’engage très tôt dans l’armée impériale pour partir combattre en Russie et en France, où il trouvera la mort au front. Dans les lettres adressées à ses parents et à son amie Julia Vogelstein pendant la guerre, recueil de lettres qui constitue son unique livre d’une extraordinaire densité, eu égard à son jeune âge, Otto Braun résume les positions qu’il avait déjà exprimées entre sa dixième et sa douzième année dans des missives adressées à son père et à sa mère: il chante l’Eros et la liberté; il veut déjà voir la vie telle qu’elle est et non telle qu’elle doit être, passant ainsi, en toute conscience à la fin de son enfance et au tout début de son adolescence, de l’idéalisme (abstrait) au réalisme, laissant très tôt entrevoir un refus du moralisme social-démocrate (et autre), qui ne veut qu’amender et corriger le monde sans l’aimer pour ce qu’il est, sans l’accepter tel qu’il est. «Nous, jeunes d’aujourd’hui, avons besoin de gens qui s’immergent dans la vie pour accomplir quelque chose de nouveau, déjà que quelque chose de nouveau se rapproche de nous, je le sens!».
La mort précoce d’Otto Braun a privé l’Europe (et pas seulement l’Allemagne) d’un philosophe en devenir qui aurait peut-être égalé Ernst Jünger. Les positions de Lily Braun révèlent donc un socialisme aujourd’hui bien révolu, le «mehringisme bébélien» de la Belle Epoque ayant triomphé sur toute la ligne, oblitérant notre présent de ses avatars les plus dégénérés et les plus biscornus.
Impact sur les marxistes russes
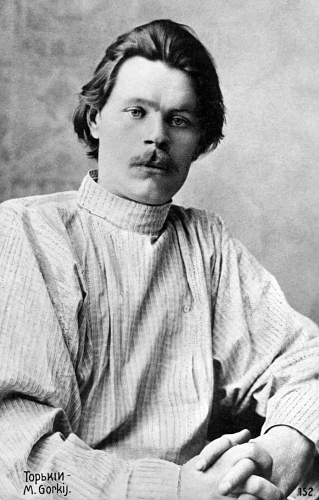 A la même époque, Nietzsche exerce une influence non négligeable sur les marxistes et les socialistes russes. Ainsi, Maxime Gorki (photo) a été un homme qui fut immergé, par déréliction familiale ou parfois volontairement, dans les misères du petit peuple russe sans partager les illusions des «populistes» sur l’hypothétique bonté intrinsèque du peuple buveur, batailleur, roublard. Son adhésion à la mouvance marxiste prérévolutionnaire puis au bolchévisme l’obligera à mettre en sourdine sa dette envers Nietzsche, qu’il ne reniera pas pour autant, ce qu’attestent clairement certains écrits datant de l’ère stalinienne. Lounatcharski et Bogdanov seront eux aussi les débiteurs de Nietzsche et l’impact du philosophe de Sils-Maria sur leur vision du monde et de la politique, sur leur manière d’interpréter le marxisme mériterait une étude en soi.
A la même époque, Nietzsche exerce une influence non négligeable sur les marxistes et les socialistes russes. Ainsi, Maxime Gorki (photo) a été un homme qui fut immergé, par déréliction familiale ou parfois volontairement, dans les misères du petit peuple russe sans partager les illusions des «populistes» sur l’hypothétique bonté intrinsèque du peuple buveur, batailleur, roublard. Son adhésion à la mouvance marxiste prérévolutionnaire puis au bolchévisme l’obligera à mettre en sourdine sa dette envers Nietzsche, qu’il ne reniera pas pour autant, ce qu’attestent clairement certains écrits datant de l’ère stalinienne. Lounatcharski et Bogdanov seront eux aussi les débiteurs de Nietzsche et l’impact du philosophe de Sils-Maria sur leur vision du monde et de la politique, sur leur manière d’interpréter le marxisme mériterait une étude en soi.
L’impact de Nietzsche sur les droites et, ensuite, sur le national-socialisme est plus mitigé, ce qui pourrait être vu comme un paradoxe, si l’on tient benoîtement compte des schématismes idéologico-médiatiques dominants de nos jours. Les droites n’ont pas toujours, loin s’en faut, accepté les critiques acerbes de Nietzsche sur le christianisme ou elles lui ont justement reproché d’avoir trop influencé certains socialistes, les plus turbulents voire les plus mécréants, et d’avoir eu un ascendant trop considérable «sur les artistes déjantés et les femmes hystériques».
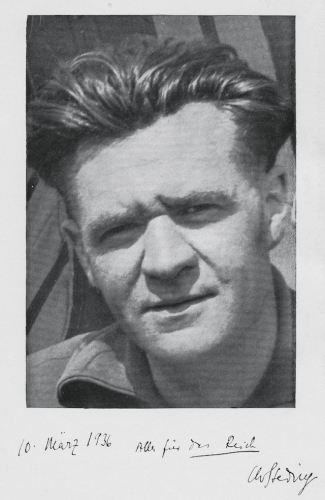 Sous le IIIème Reich, Christoph Steding (photo) lui reproche son a-politisme (bien réel, il faut en convenir) et l’influence qu’il a exercée sur les formes culturelles neutres et anti-impériales de Suisse, des Pays-Bas et des royaumes scandinaves, tandis qu’Alfred Bäumler, de très loin le plus pertinent de ses exégètes à l’époque national-socialiste, tire des conclusions qui méritent encore le détour aujourd’hui, qui sont analysées en profondeur et sans a priori en Italie actuellement. Rien de cela ne transparaît dans l’espace linguistique français.
Sous le IIIème Reich, Christoph Steding (photo) lui reproche son a-politisme (bien réel, il faut en convenir) et l’influence qu’il a exercée sur les formes culturelles neutres et anti-impériales de Suisse, des Pays-Bas et des royaumes scandinaves, tandis qu’Alfred Bäumler, de très loin le plus pertinent de ses exégètes à l’époque national-socialiste, tire des conclusions qui méritent encore le détour aujourd’hui, qui sont analysées en profondeur et sans a priori en Italie actuellement. Rien de cela ne transparaît dans l’espace linguistique français.
Le chantier est vaste quand on aborde Nietzsche et le nietzschéisme. Se pencher sur ce philosophe, sur les diverses facettes de son œuvre, sur la fascination que penseurs et écrivains de toute l’Europe ont ressenti en le lisant, est un travail herculéen. Mais il faudra s’y atteler.
Forest-Flotzenberg, juillet 2025.
15:00 Publié dans Histoire, Nouvelle Droite, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : friedrich nietzsche, histoire, philosophie, socialisme allemand, révolution conservatrice, robert steuckers, nouvelle droite |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 29 décembre 2025
Platonisme et spéculations philosophiques dans la Troisième Rome
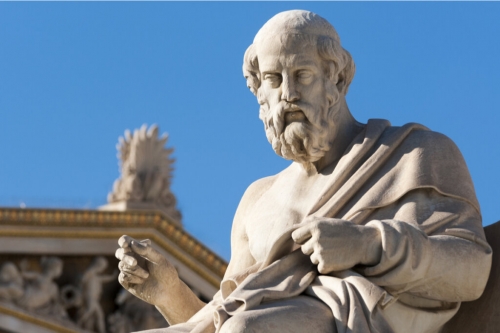
Platonisme et spéculations philosophiques dans la Troisième Rome
La philosophe russe Natalia Melentiëva publie chez Aga Éditeur l’essai Philosophie verticale, ouvrage en lien avec la Révolution conservatrice
par Luca Negri
Dans l’un de ses aphorismes les plus sages, Nicolás Gómez Dávila affirme que le monde moderne représente une révolte contre Platon. Il est difficile de lui donner tort, surtout si l’on considère le glissement supplémentaire vers le postmodernisme, où les ombres sur le mur de la caverne se sont multipliées, comme les opinions et revendications déconnectées de l’objectivité de la nature et du logos.

La véritable révolte contre Platon est plus précisément un nivellement sur la ligne horizontale des identités fermées, du bavardage alimenté par les médias. C’est l’oubli de l’Être, donc de la verticalité qui permet de sortir de la caverne, de se connecter au monde objectif de l’esprit.
Nous avons donc besoin d’une pensée verticale qui secoue la stagnante mare horizontale du postmodernisme, d’une philosophie tellurique capable de faire tomber les fausses et confortables certitudes pour faire surgir de nouvelles hauteurs.
Il existe néanmoins une communauté néoplatonicienne dispersée à travers le monde, capable de se révolter contre le postmodernisme. Et il y a en Russie la famille platonicienne des Douguine. Non seulement les livres du penseur moscovite, souvent cités accompagnés de tristes préjugés mais peu lus, sont précieux comme exemples de renouvellement du platonisme, mais aussi les écrits de sa fille Daria Douguina, qui a choisi très jeune le surnom de «Platonova», ressentant une affinité particulière avec le philosophe grec. On pourrait même penser que sa mort tragique par attentat en août 2022 pourrait représenter un équivalent (post)moderne de la condamnation à mort de Socrate, coupable d’avoir invité les jeunes à dépasser l’opinion pour accéder enfin à la Vérité.
Philosophie verticale
Le lecteur italien a toutefois maintenant la possibilité de lire en volume un recueil significatif d’écrits de la mère de Daria et épouse de Douguine: la philosophe Natalia Melentiëva. Tout récemment publiée par AGA Éditeur, Philosophie verticale suggère déjà, par son titre, un contenu capable de stimuler le mouvement tellurique que nous avons invoqué.
Il s’agit précisément d’une anthologie de textes abordant divers thèmes, d’abord philosophiques, avec des applications politiques d’une extrême actualité. Ce sont des contributions qui illustrent bien la fécondité de la pensée actuelle provenant de Russie, qui redevient en ce sens et véritablement une « Troisième Rome » comme le prophétise Paolo Borgognone dans sa préface précise.
 La lecture commence par une intervention qui se rattache au sentier interrompu de la «Révolution Conservatrice» allemande, analysant l’essai d’Armin Mohler sur le «style fasciste». Un texte à lire et méditer en ces jours où cet adjectif est surtout utilisé pour discréditer et effacer tout interlocuteur qui se place en dissidence par rapport à la narration libérale dominante et aux identifications fossilisées par la gauche du 20ème siècle.
La lecture commence par une intervention qui se rattache au sentier interrompu de la «Révolution Conservatrice» allemande, analysant l’essai d’Armin Mohler sur le «style fasciste». Un texte à lire et méditer en ces jours où cet adjectif est surtout utilisé pour discréditer et effacer tout interlocuteur qui se place en dissidence par rapport à la narration libérale dominante et aux identifications fossilisées par la gauche du 20ème siècle.
Suit une réflexion aiguë sur un penseur fondamental pour la pensée socialiste: Auguste Blanqui. Sa conception d’univers multiples peut devenir un stimulant puissant pour ne pas accepter la civilisation présente, pour devenir révolutionnaires en étant conscients que d’autres mondes sont toujours possibles et qu’il ne faut pas céder au fatalisme du fait accompli, simple organisation d’un seul univers.
La philosophe russe s’intéresse aussi au cinéma, trouvant dans les longs-métrages de David Fincher et Lars von Trier des éléments, parfois involontaires, de critique du système libéral.
Melentiëva invite également à découvrir le philosophe allemand Gerd Berfleth, décédé en 2023, spécialiste de Bataille et de Nietzsche, défenseur d’une pensée en révolte au diapason de l’idée jüngerienne de l’Anarque.
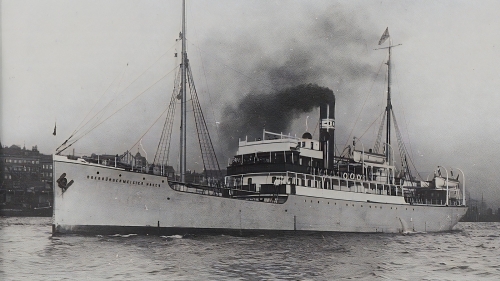
De grande importance, le souvenir du « navire des philosophes » (photo) qui a forcé à l’exil, aux débuts du bolchevisme, les penseurs russes les plus incisifs et les plus véritablement verticaux (comme Berdiaev et Merejkovski), appauvrissant énormément la civilisation soviétique et la conduisant vers l’échec.
Puis, des pages précieuses sur la déconstruction du paradigme mental libéral, où – en accord avec son mari Douguine – elle en tire les conséquences inévitables de la perte de contact avec les Idées platoniciennes et les «universaux» du thomisme. Lorsque le monde occidental a fini par céder au nominalisme, niant la réalité métaphysique des concepts, il ne restait que l’individu nu, qui n'était plus membre d’une société, d’une communauté ou d’une tradition plus grande que les parties elles-mêmes. La voie de la guerre de tous contre tous pour l’appropriation des biens, véritable filigrane du capitalisme, était déblayée. Dans un monde précisément aplati horizontalement.
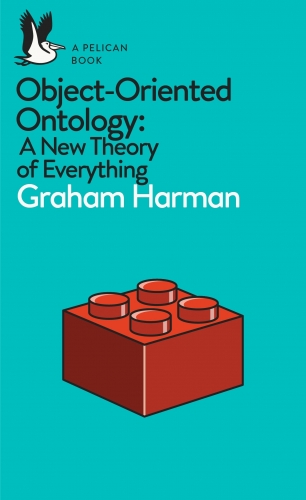 Et de l’horizon, on creuse même vers le sub-humain avec la philosophie de l’Ontologie Orientée Objet, d’origine anglo-saxonne, qui nie toute centralité et spécificité à l’être humain dans un horizon où chaque entité a les mêmes droits et la même dignité: animaux, plantes et même objets matériels. Cette philosophie postmoderne était un objet d’étude critique particulier pour Daria, dans ses derniers temps incarnés.
Et de l’horizon, on creuse même vers le sub-humain avec la philosophie de l’Ontologie Orientée Objet, d’origine anglo-saxonne, qui nie toute centralité et spécificité à l’être humain dans un horizon où chaque entité a les mêmes droits et la même dignité: animaux, plantes et même objets matériels. Cette philosophie postmoderne était un objet d’étude critique particulier pour Daria, dans ses derniers temps incarnés.
Et c’est précisément avec des souvenirs et hommages à sa fille que se clôt le volume de Melentiëva.
Daria est partie beaucoup trop tôt, à moins de trente ans, pour réaliser pleinement sa «philosophie verticale», notamment les concepts et pratiques de ce qu’elle appelait «l’optimisme escatologique» (à laquelle AGA avait déjà consacré un volume). En s’appuyant notamment sur Platon, Hegel, Nietzsche, Evola, Cioran et Jünger, Daria a proposé une vision du monde qui accepte courageusement l’illusion, les ombres projetées sur le mur de la caverne, et la condition tragique dans laquelle se trouve l’être humain emprisonné, mais qui réagit non avec un pessimisme fataliste, mais avec l’optimisme de ceux qui se battent aussi pour des causes apparemment désespérées, sortant de la caverne, passant dans la forêt, forçant la rupture pour accéder à un stade supérieur de conscience.
Le chemin laissé inachevé par la mort brutale de Daria, rappelle sa mère, attend des sujets courageux prêts à le reprendre, à redresser la colonne vertébrale, à redécouvrir la verticalité pour laquelle l’être humain existe sur la face de la Terre.
20:29 Publié dans Nouvelle Droite, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : daria douguina, natalia malentiëva, philosophie, russie, nouvelle droite |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 26 décembre 2025
La philosophie de l’histoire de Hegel - Sur la dialectique non linéaire de Hegel

La philosophie de l’histoire de Hegel
Sur la dialectique non linéaire de Hegel
Alexandre Douguine
Alexandre Douguine explique, dans ce bref article, que, pour Hegel, la fin de l’histoire correspond à un retour à l’origine.
L’Esprit Absolu n’est pas un début, mais le résultat du cycle complet de l’épanouissement de la subjectivité — c’est pourquoi Hegel n’est pas un idéaliste, mais un phénoménologue. Cependant, il est un phénoménologue du Sujet Radical. Si Hegel déclare que l’Absolu est un résultat, alors une immanence absolument radicale apparaît — semblable à celle de Fichte. Hegel écrit: «Il faut dire de l’Absolu qu’il est essentiellement un résultat, qu’il n’est ce qu’il est vraiment qu’à la fin» (1).
L’Absolu est ce qui doit encore devenir lui-même, non seulement en purgeant son côté sombre, comme chez Böhme (2), mais en passant par l'auto-aliénation de soi — du vide universel au concret catastrophique, puis en revenant du concret catastrophique à l’origine dans une nouvelle qualité. Autrement dit, l’Absolu se trouve devant nous comme un but, comme une fin. Cependant, ce n’est pas un mouvement linéaire, et cela est également crucial à comprendre: c’est un mouvement du centre vers la périphérie, puis, du périphérique, de retour vers le centre. Ce n’est pas le mouvement qui se déroule sur le cercle extérieur de la conscience, c’est-à-dire là où se produit une transformation constante (derrière l’éternité, dans l’élément du temps).
Pour Hegel, l’histoire n’est pas ce qui se déploie dans le temps; plutôt, c’est ce qui unit le départ de l’éternité dans le temps et le retour du temps dans l’éternité. L’histoire de Hegel, le temps de Hegel, est un mouvement du centre vers la périphérie, puis de la périphérie vers le centre. Cette histoire détermine à l’avance les structures et les moments du temps. Le temps lui-même n’a pas d’orientation, de sens ou de contenu; il ne porte aucun événement en lui. Tous les événements et contenus du temps proviennent de l’intérieur de la conscience (le temps en tant que processus linéaire est fondamentalement étranger à la pensée platonicienne, hégélienne et phénoménologique (3)). Tous les événements du temps proviennent de l’intérieur de la conscience. Si nous utilisons ses éléments situés à sa périphérie, ou encore plus à l’extérieur (dans le domaine hypothétique des «choses en soi»), ou si nous considérons l’histoire comme un processus linéaire, nous dévions au maximum de Hegel.

L’histoire selon Hegel est l’histoire de l’épanouissement de l’Esprit subjectif dans le temps et de son retour et de sa transformation en l’Esprit Absolu. L’histoire selon Hegel est transversale au processus temporel en soi. C’est-à-dire que l’histoire n’est pas simplement « non temps » — elle est perpendiculaire au temps. Les événements qui se produisent dans l’histoire ne sont pas ceux qui se produisent dans le temps, mais ceux qui ont lieu dans les structures de la conscience. Et c’est cette conscience qui marque le temps par ses événements. Par conséquent, lorsque nous parlons de «la fin de l’histoire», cela signifie atteindre le point originel dans une nouvelle qualité. Cependant, ce déploiement de la structure de l’Esprit et cette progression de la dialectique de l’actualité (Wirklichkeit) n’ont jamais eu de début dans le temps — elles existaient au point de l’éternité. Ce point est ce que nous identifions comme le Sujet Radical, comme Homo Intimus (4), ou comme νοῦς ποιητικός. À partir de là, comme à partir d’un état vide et non manifesté, la négation se déplace vers la périphérie, puis une retour se produit. Dans ce retour, le centre se révèle comme quelque chose d’absolu. C’est le résultat de l’histoire, mais il n’existe ni dans une dimension linéaire ni dans une dimension cyclique. Dans un cycle, comme le montre Aristote, il n’y a ni début ni fin. Le mouvement d’une planète est éternel; elle n’a jamais commencé à partir d’un seul point — elle a toujours existé. Son début est à la fois le début et la fin, deux relations d’un seul point autour duquel tournent les planètes, non un point situé sur l’orbite elle-même. Cela nécessite une perspective totalement différente sur la dialectique de Hegel, qui ne peut pas être interprétée du point de vue des processus se produisant à la périphérie de notre conscience, mais qui se présentent comme indépendants et autonomes.
Notes:
(1) Hegel. Phénoménologie de l'esprit.
(2) Dans les enseignements de Jakob Böhme, Dieu contient dans son fondement (Grund) un commencement obscur («la nature en Dieu»), dont il se purifie (s'absout) dans le processus de devenir-Esprit. Voir Alexander Douguine, Noomachie : Les guerres de l'esprit. Le Logos germanique. L'homme apophatique.
(3) Voir le cours magistral d'A. Douguine «Doxas et paradoxes du temps» (2021-2022).
(4) Homo intimus — « l'humain le plus intime », situé encore plus profondément que le simple «humain intérieur», homo interior. Une catégorie cruciale dans le système de Dietrich Freiberg et parmi les mystiques rhénans. Voir Douguine. Noomachie : Les guerres de l'esprit. Le Logos germanique. L'homme apophatique.
16:12 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hegel, philosophie, alexandre douguine |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 19 décembre 2025
Le Roi et l'Âme - Le char de l'âme selon Platon, comme image métaphysique de l'empire et de la politique sacrée

Le Roi et l'Âme
Le char de l'âme selon Platon, comme image métaphysique de l'empire et de la politique sacrée
Alexander Douguine
Alexander Douguine explique l'image platonicienne de l'âme et sa signification politique.
Platon part du principe fondamental d'une homologie directe entre le cosmos, l'État et la structure de l'âme.
Dans le dialogue Phèdre, il décrit cette structure tripartite de l'âme à travers les images suivantes:
- Comparons l'âme à la force combinée d'un couple de chevaux ailés et d’un conducteur de chars. Chez les dieux, les chevaux et les conducteurs sont tous nobles et issus des castes nobles, tandis que chez d’autres, ils ont une origine mixte.
- D’abord, notre souverain conduit l’attelage, et parmi les chevaux l’un est beau, noble et issu d’une race noble, tandis que l’autre est son opposé, avec des ancêtres d’une autre nature. Inévitablement, la tâche de gouverner est difficile et laborieuse.
Il est important ici que Platon compare la structure de l’âme humaine à celle des âmes des dieux: elles ne diffèrent l’une de l’autre que par la qualité et la noblesse de leurs parties.
Platon poursuit sa description :
- Au début de cette narration, nous avons divisé chaque âme en trois parties: deux parties que nous avons comparées, du point de vue de la forme, à des chevaux, et la troisième à un conducteur de chars. Que cette division demeure en vigueur également maintenant.
- Parmi les chevaux, nous disons que l’un est bon et l’autre mauvais. Nous n’avons pas encore expliqué en quoi consiste la bonté de l’un ou la méchanceté de l’autre, et cela doit maintenant être dit.
- L’un d’eux, alors, adopte une posture plus noble: droit et bien proportionné en forme, à haute tête, avec une courbure légèrement aquiline au niveau des naseaux, blanc, aux yeux noirs, aimant l’honneur associé à la modération et à la révérence; un compagnon de la vraie opinion, qui n’a pas besoin de fouet, guidé uniquement par l’ordre et la parole. L’autre est tordu, lourd, maladroit, au cou épais et court, aux naseaux retroussés, noir, aux yeux clairs, de sang chaud, compagnon de l’insolence et de la vantardise; hirsute autour des oreilles, sourd et à peine soumis au fouet et aux rênes.
Comme le souligne Platon, les deux chevaux sont inégaux: l’un est meilleur, l’autre pire; l’un est blanc (mais avec un œil noir — melanomatos), l’autre noir (avec un œil clair — glaukómmatos). Ainsi, une hiérarchie s’établit dans l’âme:
- le conducteur de chars (hēnióchos);
- le cheval blanc (to leukón — le bon);
- le cheval noir (to mélanon — le non-bon, le mauvais).
Dans le quatrième livre de La République, Platon approfondit ce thème en définissant les trois composantes de l’âme ainsi:
- le conducteur de chars représente l’intellect (noûs, lógos);
- le cheval blanc incarne le principe spiritualisé (thúmos);
- le cheval noir représente le désir (epithymía).
Platon relie directement ces trois éléments aux trois classes de sa cité:
- la partie supérieure de l’âme correspond aux philosophes-rois (les gardiens);
- le principe spiritualisé correspond aux guerriers (les auxiliaires des gardiens);
- le désir est la force dominante parmi les travailleurs et les paysans (la population de base).


Dans Phèdre, Platon décrit la cause de la chute de l’âme dans le corps comme une conséquence de la révolte du cheval noir. Alors que le cheval blanc obéit à la voix du conducteur, le cheval noir ne le fait pas, et cherche constamment à aller dans une direction opposée à celle de l’intellect. L’âme tombe dans le corps et perd ses ailes précisément à cause d’une impulsion centrifuge intrinsèque en elle-même, incarnée dans le cheval noir, dans la propriété du désir. Il n’y a pas de ligne de démarcation stricte entre le désir et le corps; le corps lui-même est le désir devenu pierre.
Mais d’un autre point de vue, le cheval noir est relié au blanc: tous deux sont des chevaux, bien que d’origine différente, comme le souligne Platon. Les deux qualités — thymos (θυμός) et éthymie (ἐπιθυμία) — dérivent d’une seule fondation, du mot thymos, qui pour les Grecs servait aussi de synonyme de l’âme. La racine indo-européenne de ce mot, dʰuh₂mós, signifiait à l’origine «fumée», une signification associée au feu et à l’air. Le désir, donc, est avant tout esprit; mais si la virilité (thymos), la plus haute vertu martiale, est le désir dans sa forme pure, alors le désir (epithymía) est le désir chargé, durci et condensé. La pure virilité mène à la destruction (vers la corporéité); d’où la vocation des guerriers à supporter la mort. La virilité chargée, ou le désir, mène à la création; d’où la vocation des paysans et des artisans à créer des produits et des choses, ainsi qu’à engendrer des enfants.
Le roi-philosophe est celui chez qui le conducteur de chars est pleinement capable de subordonner les deux chevaux et de diriger la course du char vers le haut, verticalement. C’est dans cette direction même que l’État est construit — le long de l’axe entre le Ciel et la Terre, vers le Ciel. L’Empire est une échelle menant vers le Ciel.
Selon Platon, la politique est une structure d’ascension anthropologique, correspondant à l’élévation de l’âme et à la purification de ses propriétés. C’est précisément cette connexion immédiate entre l’être et la politique qui rend la cité, dans la compréhension platonicienne, sacrée.
18:17 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre douguine, philosophie, platon |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Remettre la beauté dans la cité: une condition pour une société bonne

Remettre la beauté dans la cité: une condition pour une société bonne
Pierre Le Vigan
Etre conservateur ? Voire. Tout ne doit pas être conservé de notre monde. Il y a des choses contre lesquelles il nous faut réagir. Et des révolutions sont nécessaires, comme les non conformistes des années trente l’avaient déjà bien vu. Mais il serait fou de ne pas vouloir conserver ce qui fait que nous avons été un peuple grand et créateur. Une certaine conception de la beauté. Conserver : c’est prendre sous sa garde et c’est servir. Conserver intelligemment, c’est d’abord pérenniser.
Mais si le mot d’ordre « il faut conserver la beauté » parait simple, il ne l’est pas. Il suppose que la beauté soit un bien commun, donc partagé. Ce n‘est pas une évidence, ou plutôt, ce n’est plus une évidence. Nous sommes dans une époque de subjectivisme: de « tout à l’ego », dit Rémi Brague. Qui définit la beauté ? Et comment définir la beauté ? Ces questions touchent à ce qui nous unit, ou à ce qui devrait nous unir. Car nous sommes malheureusement dans une société de déliaison. La beauté est donc une notion à repenser. Il ne s’agit pas ici de philosopher une fois de plus avec la beauté, ou de « philosopher avec l’histoire de l’art » (Audrey Rieber) mais de clarifier cette notion de beauté et d’esquisser un programme de son bon usage. N’oublions pas que délibérer vient de « soupeser » et que la pensée est elle-même toujours une « pesée ». Que pèse la beauté et comment la soulever, la manipuler, en faire quelque chose ? Si l’Idée est dans le ciel, elle nous sert, comme une étoile, de point de repère quand nous marchons, et nous marchons sur la terre.
Levons tout d’abord une hypothèque. La beauté concerne l’art mais pas seulement. Peinture, architecture, musique: tout cela a à voir avec la beauté. Mais la nature aussi est concernée par la question de la beauté. C’est ce que l’on appelle la beauté naturelle. Elle nous est donnée. Encore faut-il que nous la voyons. C’est une montagne, un lac, un simple cheminement dans la nature, ou c’est une vieille ville dans laquelle, pourtant, la raison première des constructions n’a pas été de « faire du beau » mais de remplir des fonctions utiles. Tout cela peut relever de la beauté. Elle est donc question de perception. Mais quelles sont les raisons de cette perception ?
C’est là que les choses se compliquent.
Une théorie nous dit que des choses sont perçues comme relevant du beau pour des raisons internes à la chose. Et ce dans le domaine du regard (peinture, sculpture, architecture), comme dans celui de l’audition (musique). Ce sont des qualités intrinsèques à la chose qui la font paraitre belle : des proportions, une harmonie, un équilibre, etc. Le sculpteur grec Polyclète avait déjà dit que la beauté était question de proportion. L’harmonie comme critère du beau : c’est ce qu’avait dit aussi Pythagore. De son côté, Edmund Burke nous dit : « L’ordonnance des édifices religieux est fondée sur la “symétrie”, dont les architectes doivent respecter le principe avec le plus grand soin… Aucun temple ne peut effectivement présenter une ordonnance rationnelle sans la ‘’symétrie” ni la ‘‘proportion”, c’est-à-dire si les composantes n’ont pas entre elles une relation précisément définie, comme les membres d’un homme correctement conformé. » (Recherche philosophique sur l'origine de nos idées du sublime et du beau, 1757). Tout est question de proportion : « La proportion consiste en la commensurabilité des composantes en toutes les parties d’un ouvrage. », nous dit encore E. Burke. Bien avant Burke, à la Renaissance, Luça Pacioli, moine et géomètre, avait développé la théorie du nombre d’or: 1/1,618 (De divina proportione, 1509). La beauté vient donc de la chose même et d’abord des proportions. Telle est la première hypothèse sur le pourquoi de la beauté.

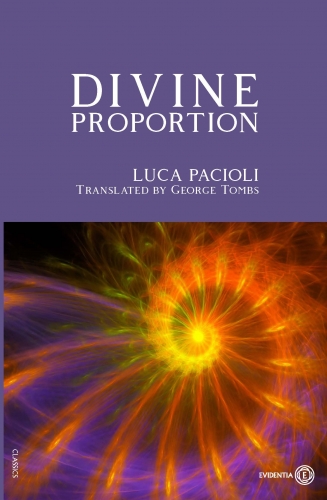
Mais tout le monde ne partage pas ce point de vue. Une deuxième théorie voit le beau dans un facteur externe à la chose même. Le beau relèverait de la subjectivité de chacun, de la perspective de chacun. Le regard, l’ouïe de chacun serait à l’origine du beau. C’est donc une affaire personnelle et surtout une affaire de perspective, une question de point de vue. A chacun son idée du beau: en peinture, en musique, en architecture, en danse, etc. En ce sens, dans cette théorie, il n’y a plus de beau en commun. Il peut être une simple affaire de statistique : nous sommes peut-être nombreux à trouver belle telle œuvre ou tel paysage, mais il n’y a pas pas de critère autre que subjectif.
La beauté vient-elle donc des choses mêmes ou de l’effet que nous font certaines choses en fonction de ce que nous sommes et de notre état d’esprit présent ? Ce sont les deux théories qui se confrontent.
* * *
Pendant très longtemps, la théorie du beau comme interne à la chose a été privilégiée. « De là, la raison se dirigea vers les œuvres des yeux et, embrassant la terre et le ciel, se rendit compte quelle n’aimait rien d’autre que la beauté, et dans la beauté les figures, dans les figures les proportions, dans les proportions les nombres », dit Saint Augustin. Dieu a créé le monde beau, et dans ce monde, il a créé les choses belles. La raison fait ce constat. La beauté est interne au monde car Dieu l’a mis dans le monde. Pour Alberti (1404-1472), nature, raison et beauté forme un ensemble. La beauté est une affaire de convenance, une « harmonie réglée par une proportion déterminée, qui règne entre l’ensemble des parties du tout auquel elles appartiennent » (L’Art d’édifier). La beauté est « l’accord et l’union des parties d’un tout auquel elles appartiennent ». On retrouve les mêmes règles pour la peinture, la sculpture et même l’éloquence. Quant à l’origine même des choses, elle est, comme le suggère le trytique évoqué plus haut, dans la nature même.

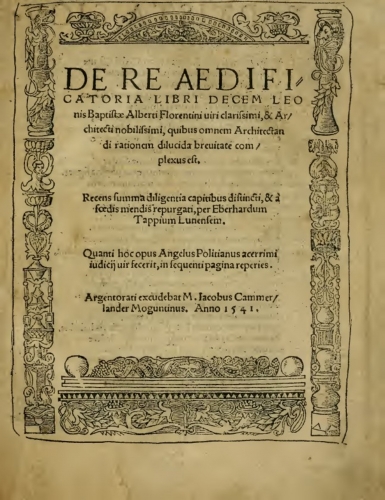
La vision d’Alberti est ici conforme à ce que dit Aristote : « en général les choses adviennent absolument, les unes par changement de forme, par exemple une statue, d’autres par addition, par exemple les choses qui croissent, d’autres par soustraction, par exemple l’Hermès à partir de la pierre, d’autres par composition, par exemple une maison, d’autres par altération, par exemple les choses qui changent du point de vue de la matière » (Physique, I, 7, 190 b trad. Pierre Pellegrin). Il en est de même pour les choses prétendant à l’art, c’est-à-dire, pour les Anciens, visant à la beauté. Pour Léonard de Vinci (Traité de la peinture, notes prises à partir de 1490), la peinture relève des proportions et est ainsi liée aux mathématiques. Là encore, nous sommes là dans une conception de la beauté comme intrinsèque aux choses. Les choses belles sont celles qui répondent à des critères internes de beauté. C’est une beauté objective. Un plafond peint est objectivement beau pour des raisons de proportion, d’harmonie, d’équilibre entre les masses, les couleurs, etc, et dans le mesure où il répond à ces exigences d’harmonie.
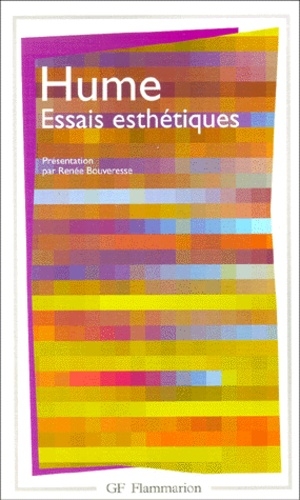 David Hume remet cela complètement en question. Selon lui, la beauté est subjective, elle relève du goût et de la jouissance que nous procure quelque chose : un tableau, un paysage, une musique. « La beauté n'est pas une qualité inhérente aux choses elles-mêmes, elle existe seulement dans l'esprit qui la contemple, et chaque esprit perçoit une beauté différente. » (De la norme du goût, 1757). Le beau est affaire de goût. Pour autant, ce goût, s’il est subjectif, n’est pas arbitraire. Il est façonné par des règles et celles-ci trouvent leur origine dans l’expérience. « Le fondement de ces règles est le même que celui de toutes les sciences pratiques, l’expérience. Elles ne sont que des observations générales sur ce qu’on a vu universellement plaire dans tous les pays et à toutes les époques. » (Essai sur la règle de goût, 1757). Chacun se dirigera vers ce qui lui procure du plaisir, mais il ne faut pas y voir un hédonisme primaire : ce qui procure du plaisir à un tel peut être la rigueur, l’exactitude, la vertu. On peut jouir de l’austérité des formes, des volumes, des couleurs.
David Hume remet cela complètement en question. Selon lui, la beauté est subjective, elle relève du goût et de la jouissance que nous procure quelque chose : un tableau, un paysage, une musique. « La beauté n'est pas une qualité inhérente aux choses elles-mêmes, elle existe seulement dans l'esprit qui la contemple, et chaque esprit perçoit une beauté différente. » (De la norme du goût, 1757). Le beau est affaire de goût. Pour autant, ce goût, s’il est subjectif, n’est pas arbitraire. Il est façonné par des règles et celles-ci trouvent leur origine dans l’expérience. « Le fondement de ces règles est le même que celui de toutes les sciences pratiques, l’expérience. Elles ne sont que des observations générales sur ce qu’on a vu universellement plaire dans tous les pays et à toutes les époques. » (Essai sur la règle de goût, 1757). Chacun se dirigera vers ce qui lui procure du plaisir, mais il ne faut pas y voir un hédonisme primaire : ce qui procure du plaisir à un tel peut être la rigueur, l’exactitude, la vertu. On peut jouir de l’austérité des formes, des volumes, des couleurs.
Kant propose une théorie qui tente la synthèse des deux premières : la beauté intrinsèque aux choses et la beauté comme relevant des goûts subjectifs. Pour Kant, la théorie des goûts subjectifs concerne l’agréable et non pas le beau. L’agréable est relatif à l’expérience de chacun, il est parfaitement subjectif, en matière de cuisine ou d’odeur. Mais le beau relève par contre d’une certaine objectivité. « Le beau est ce qui plait universellement sans concept. » (Critique de la faculté de juger, 1790). Universellement. Dés lors, il est peut-être subjectif mais il plait à tous, ce qui veut dire qu’il y a des critères universels au beau. « Ce qui est simplement subjectif dans la représentation d’un objet, c’est-à-dire ce qui constitue sa relation au sujet et non à l’objet, c’est sa nature esthétique » (Introduction à la Critique de la faculté de juger, 1790).
L’esthétique est, conformément à son étymologie grecque, ce que nos sens perçoivent, ou encore ce qui affecte nos sens. Pour Kant, le beau existe objectivement comme objet mais nous le percevons subjectivement. Bien que le jugement de goût, dont relève le beau, ne soit pas un jugement de connaissance (contrairement à un jugement tel que « le chat est un félin »), ce n’est pas pour autant un jugement purement subjectif. «Le beau est représenté sans concept comme objet d’une satisfaction universelle.» Cette satisfaction n’est pas exactement l’agréable, elle est le respect. En ce sens, si le beau ne relève pas de la raison pratique, c’est-à-dire du devoir-faire, il y a tout de même une notion de devoir qui intervient, qui est le devoir admirer. Une forme de convenance sociale, voire de décence sociale qui ne se réduit pas à la théorie de la distinction qui sera celle de Pierre Bourdieu. C’est le respect d’un en-commun et le respect d’une transmission.
Le beau ne se confond donc pas ce qui donne du plaisir, nous dit Kant. Il est par ailleurs strictement désintéressé, ce qui renvoie à sa distinction d’avec l’agréable. « La satisfaction qui détermine le jugement de goût est désintéressée » (Kant, Critique de la faculté de juger, 1790). On ne trouve pas beau un tableau parce que on va se l’offrir, et/ou parce que c’est un bon placement. Le beau n’a aucune utilité. Il doit « plaire sans intérêt ». En ce sens, le beau dans la nature est plus authentiquement beau que le beau humain, celui de l’art, car un tableau est fait pour être vu, pour obtenir au moins un succès d’estime, de même qu’une pièce de musique est faite pour être jouée, et si possible devant un public choisi, de qualité, de même qu’un discours est fait pour susciter les applaudissements, etc. On verra que c’est le contraire du point de vue de Hegel, pour qui le seul vrai beau et le produit de l’homme.
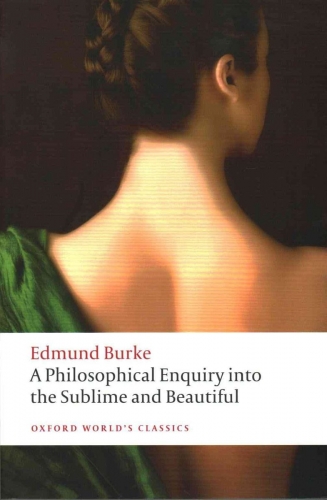 Le beau a aussi des limites hautes pour Kant : ce qui est au-delà. Ce qui est trop beau pour rester simplement beau. C’est le sublime – une notion qui a été développée avant Kant par Edmund Burke (Recherche philosophique sur l'origine de nos idées du sublime et du beau, 1757), et que l’on trouvait déjà chez différents auteurs, tel Nicolas Boileau. Or, le beau n’est pas le sublime, car le sublime excède l’entendement. Le beau et le sublime touchent, certes, tous deux l’âme, mais le sublime le fait avec violence. Il est « trop beau » pour être raisonnable. Le sublime est mélé d’effroi. Il est inévitablement violent. « (…) le beau et le sublime ne donnent-ils lieu qu'à des jugements particuliers, mais qui s'attribuent une valeur universelle, quoiqu'ils ne prétendent qu'au sentiment de plaisir, et non point à une connaissance de l'objet. Mais il y a entre l’un et l’autre des différences considérables. Le beau de la nature concerne la forme de l’objet, laquelle consiste dans la limitation ; le sublime, au contraire, doit être cherché dans un objet sans forme, en tant qu’on se représente dans cet objet ou, à son occasion, l’illimitation. » (Kant, Critique de la faculté de juger, II, 23). Le sublime ouvre sur un gouffre, à la différence du beau. Le sublime est ce qui déborde. « L'esprit se sent mis en mouvement dans la représentation du sublime dans la nature, en revanche, dans le jugement esthétique sur le beau dans la nature, il est dans une calme contemplation » (Critique de la faculté de juger). Kant dit encore : « Le sublime émeut, le beau charme » (Observations sur le sentiment du beau et du sublime, 1770).
Le beau a aussi des limites hautes pour Kant : ce qui est au-delà. Ce qui est trop beau pour rester simplement beau. C’est le sublime – une notion qui a été développée avant Kant par Edmund Burke (Recherche philosophique sur l'origine de nos idées du sublime et du beau, 1757), et que l’on trouvait déjà chez différents auteurs, tel Nicolas Boileau. Or, le beau n’est pas le sublime, car le sublime excède l’entendement. Le beau et le sublime touchent, certes, tous deux l’âme, mais le sublime le fait avec violence. Il est « trop beau » pour être raisonnable. Le sublime est mélé d’effroi. Il est inévitablement violent. « (…) le beau et le sublime ne donnent-ils lieu qu'à des jugements particuliers, mais qui s'attribuent une valeur universelle, quoiqu'ils ne prétendent qu'au sentiment de plaisir, et non point à une connaissance de l'objet. Mais il y a entre l’un et l’autre des différences considérables. Le beau de la nature concerne la forme de l’objet, laquelle consiste dans la limitation ; le sublime, au contraire, doit être cherché dans un objet sans forme, en tant qu’on se représente dans cet objet ou, à son occasion, l’illimitation. » (Kant, Critique de la faculté de juger, II, 23). Le sublime ouvre sur un gouffre, à la différence du beau. Le sublime est ce qui déborde. « L'esprit se sent mis en mouvement dans la représentation du sublime dans la nature, en revanche, dans le jugement esthétique sur le beau dans la nature, il est dans une calme contemplation » (Critique de la faculté de juger). Kant dit encore : « Le sublime émeut, le beau charme » (Observations sur le sentiment du beau et du sublime, 1770).
Le beau est par définition ce qui plait universellement (on peut toutefois se demander dans quelle mesure Kant prenait en compte l’existence de civilisations non européennes). Mais cet universel reste néanmoins subjectif à sa façon. Il n’est pas un jugement de connaissance comme « Un chat a des vibrisses ». Le beau qui croit parler d’une chose, - comme la phrase « Cette montagne est belle » - ne nous dit en fait rien de cette montagne (s’agit-il du Mont Blanc, du Puy de Sancy, du Ballon de Guebwiller?). Mais cette phrase dit quelque chose de celui qui est affecté par le spectacle de la montagne. Elle dit cela et seulement cela. Il (le sujet) a trouvé cela beau, que cela soit une grande montagne ou une petite montagne. Pour autant, ce subjectif, ce jugement personnel vise à une universalité. Quand l’un d’entre nous dit d’un paysage : « C’est beau », il pense que cette affirmation est non seulement audible par autrui, mais raisonnablement partageable. L’art, le beau et la sensibilité sont liés (Alexander G. Baumgarten, Esthétique, 1750).
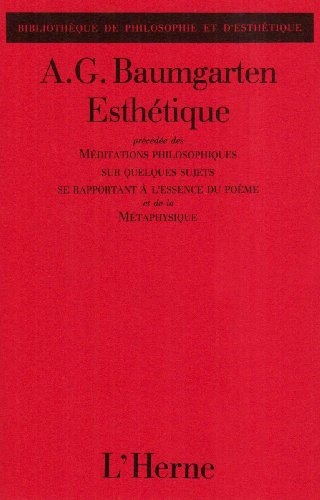 Il est entendu que ce serait rompre une sorte de pacte social implicite que ne pas trouver belle la vue du Pic du Midi, ou beau un tableau de Degas ou de Cézanne. En ce sens, il y a une universalité subjective que David Hume lui-même, pourtant subjectiviste et donc théoriquement individualiste, reconnaissait puisqu’il estimait que certaines œuvres sont amenées, en fonction de l’acquisition par chacun d’un « bon goût » esthétique à être appréciées par tous et à différentes époques. L’approche subjectiviste et nominaliste du beau trouve ses limites quand on affirme que par l’éducation, tout le monde doit se retrouver d’accord pour trouver belles certaines choses ou certaines œuvres.
Il est entendu que ce serait rompre une sorte de pacte social implicite que ne pas trouver belle la vue du Pic du Midi, ou beau un tableau de Degas ou de Cézanne. En ce sens, il y a une universalité subjective que David Hume lui-même, pourtant subjectiviste et donc théoriquement individualiste, reconnaissait puisqu’il estimait que certaines œuvres sont amenées, en fonction de l’acquisition par chacun d’un « bon goût » esthétique à être appréciées par tous et à différentes époques. L’approche subjectiviste et nominaliste du beau trouve ses limites quand on affirme que par l’éducation, tout le monde doit se retrouver d’accord pour trouver belles certaines choses ou certaines œuvres.
* * *
Dans toutes ses théories, il y a un manque, et c’est la théorie la plus originelle du beau. Il n’aurait rien à voir avec l’agréable ni avec la subjectivité. Il ne renverrait pas non plus à des qualités propres à l’objet, internes à celui-ci. Le beau, ce serait le vrai. Ce serait la vérité de la chose mais aussi la justesse de notre rapport à la chose. C’est la théorie de Platon. C’est aussi celle de Hegel : « Le beau c’est l’éclat du vrai ». C’est un point de vue que l’on trouvera aussi chez Jules Lequier pour qui le beau, c’est l’éclat de la raison, ce qui n’est pas très éloigné, et chez Jules Lachelier, pour qui la beauté est une expérience de l’esprit qui recherche le vrai. Nous sommes, là encore, dans la lignée de Platon. Il faut donc faire retour à lui.
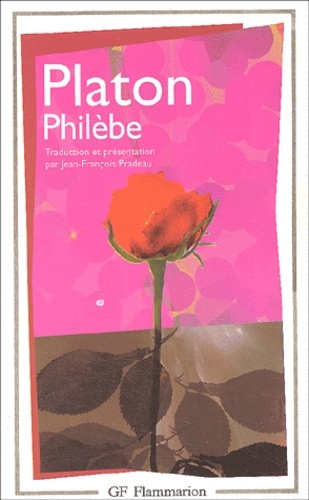 Pour Platon, le beau, c’est le vrai et c’est aussi le bien, ou au moins l’éclat du bien. Le beau n’est donc pas que l’apparence du beau, ni la belle représentation d’une belle chose. Il est le chemin vers le bien et le vrai. « La puissance du bien s’est réfugiée dans la nature du beau », dit Socrate (Platon, Philèbe ou Sur le plaisir, 64 e). La puissance du bien n’est pas tout à fait le bien, mais est le bien comme possibilité et potentialité. Mais précisément, comment saisir qu’il est possible ? « Si donc nous ne pouvons saisir le bien sous un seul caractère, saisissons le sous trois : beauté, proportion, vérité, et disons que par là comme s’il s’agissait d’un seul terme, nous pouvons indiquer avec certitude les causes des qualités du mélange et déclarer que si cela est bon, le mélange est tel lui aussi. » (Philèbe, 65 a). Par contre, le beau n’a rien à voir avec le plaisir et l’agréable. Il faut même prendre garde quand l’agréable est présent. Cela est signe de vulgarité. Le plaisir est en effet sans limite (illimité : apeiron). Or, seul ce qui est limité est beau pour les Grecs. Le beau ne peut être que limite et mesure. Il y a une clôture du beau.
Pour Platon, le beau, c’est le vrai et c’est aussi le bien, ou au moins l’éclat du bien. Le beau n’est donc pas que l’apparence du beau, ni la belle représentation d’une belle chose. Il est le chemin vers le bien et le vrai. « La puissance du bien s’est réfugiée dans la nature du beau », dit Socrate (Platon, Philèbe ou Sur le plaisir, 64 e). La puissance du bien n’est pas tout à fait le bien, mais est le bien comme possibilité et potentialité. Mais précisément, comment saisir qu’il est possible ? « Si donc nous ne pouvons saisir le bien sous un seul caractère, saisissons le sous trois : beauté, proportion, vérité, et disons que par là comme s’il s’agissait d’un seul terme, nous pouvons indiquer avec certitude les causes des qualités du mélange et déclarer que si cela est bon, le mélange est tel lui aussi. » (Philèbe, 65 a). Par contre, le beau n’a rien à voir avec le plaisir et l’agréable. Il faut même prendre garde quand l’agréable est présent. Cela est signe de vulgarité. Le plaisir est en effet sans limite (illimité : apeiron). Or, seul ce qui est limité est beau pour les Grecs. Le beau ne peut être que limite et mesure. Il y a une clôture du beau.
Un autre aspect du beau chez Platon est le refus de tout perspectivisme. Le beau n’est beau qu’en absolu, non quand il est conçu pour être vu d’un point de vue humain (Sophiste 235-237). Il faut, pour voir le beau, se déprendre de toute perspective (c’est l’opposé de ce que sera la position de Nietzsche). Pour Platon, il peut être nécessaire de prendre en compte une perspective et donc, par exemple, de déformer une statue pour séduire le goût commun, pour tenir compte du lieu à partir duquel on aura une vue sur elle, mais cela n’a aucun rapport avec la beauté véritable. C’est une apparence, et une apparence est du non-être. C’est du sophisme, c’est-à-dire non pas du savoir mais un mime du savoir. Une habileté sociale et langagière. C’est aussi de la rhétorique, c’est-à-dire une tentative de séduire, de convaincre d’une beauté qui n’est pas vraiment là. Cela relève donc de l’opinion (doxa) et non de la vérité. Or, la vraie beauté, la seule beauté doit se fonder sur la rectitude du jugement, sur le vrai (Les Lois, 667 c-669 b): «Aucune imitation ne doit se juger d’après le plaisir». Du reste, l’imitation est conforme à l’ordre naturel mais en dessous de l’ordre du vrai et du bien.
Le seul critère doit être le vrai. «(…) Préférer la beauté à la vertu, écrit encore Platon, ce n'est pas autre chose que déshonorer son âme réellement et entièrement ; c'est en effet dire, contre toute vérité, que le corps est plus estimable que l'âme» (Les Lois, livre V). Pour le dire autrement, il n’y a de vraie beauté que la vertu. Et la vertu consiste dans la rectitude de l’artiste, c’est-à-dire dans son sens exact des proportions, hors toute mise en perspective. C’est la proportion absolue – indépendante des perspectives humaines, par définition changeantes – ou encore l’harmonie dans l’absolu qui doit être sa règle de travail. La seule apparence des proportions, au prix d’artifices, serait une tromperie (ce qui renvoie à la condamnation de la séduction du goût commun évoquée plus haut). Pour trouver le vrai, les sciences sont nécessaires : la science des nombres, la géométrie, l’astronomie (La République, 491-494). De plus, l’harmonie est nécessaire pour trouver le bien et le vrai mais ne suffit pas. Il faut que le regard se lève des choses du bas pour aller vers les choses du haut, c’est-à-dire vers la science, c’est-à-dire les Idées ’’en soi’’ (par opposition au ’’pour soi’’ de toute perspective, pour le dire en langage post-platonicien, et en l’occurrence kantien).
Mesure, proportion, intellect : telles sont les trois étapes nécessaires pour accéder au bien et au vrai. Ecoutons Platon : « Socrate – Ainsi tu publieras partout, Protarque (…) que le plaisir n’est ni le premier, ni le second bien ; mais que le premier bien est la mesure, le juste milieu, l’à-propos, et toutes les autres qualités semblables, qu’on doit regarder comme ayant en partage une nature immuable. (…) Que le second bien est la proportion, le beau, le parfait, ce qui se suffit par soi-même, et tout ce qui est de ce genre. (…) Autant que je puis conjecturer, tu ne t’écarteras guère de la vérité en mettant pour le troisième bien l’intelligence et la sagesse. » Platon poursuit : « (…) N’assignerons-nous point la quatrième place à ce que nous avons dit appartenir à l’âme seule, aux sciences, aux arts, aux vraies connaissances, [66c] s’il est vrai que ces choses ont une liaison plus étroite avec le bien que le plaisir ? (…) Au cinquième rang, mettons les plaisirs que nous avons distingués des autres comme exempts de douleur, les nommant des perceptions pures de l’âme qui tiennent à la suite des sensations. (…) A la sixième génération, dit Orphée, mettez fin à vos chants. Il me semble pareillement que ce discours a pris fin au sixième jugement. Il [66d] ne nous reste plus qu’à couronner ce qui a été dit. » (Philèbe, 66 a-d, trad. Victor Cousin).
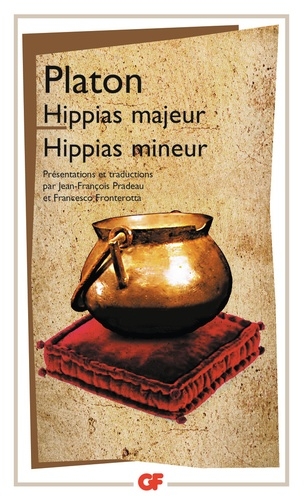 Voilà donc quels sont les biens qui mènent au Bien, au Beau, au Vrai. L’énoncé de ce chemin – mesure, proportion, sagesse, écoute de l’âme – répond à la question qui est débattue dans l’Hippias majeur ou De la beauté. Dans ce dialogue, Socrate interroge Hippias sur ce qu’est le beau. Hippias répond par un exemple: «une jeune vierge» c’est-à-dire «une belle jeune fille». Mais Socrate attend une réponse qui ne soit pas un exemple. Il voudrait savoir ce qui rend une chose belle. C’est pourquoi il émet l’hypothèse que le beau pourrait concerner des choses à laquelle on ne s’attend pas. Par exemple une marmite. Pour Socrate, une marmite peut être belle. Hippias ne voit pas les choses ainsi. Il voit de belles choses, mais ne voit pas comment des choses peuvent devenir belles. Il ne répond qu’à la question «Qu’est ce qui est beau?» et non à la question «Qu’est-ce que le beau?».
Voilà donc quels sont les biens qui mènent au Bien, au Beau, au Vrai. L’énoncé de ce chemin – mesure, proportion, sagesse, écoute de l’âme – répond à la question qui est débattue dans l’Hippias majeur ou De la beauté. Dans ce dialogue, Socrate interroge Hippias sur ce qu’est le beau. Hippias répond par un exemple: «une jeune vierge» c’est-à-dire «une belle jeune fille». Mais Socrate attend une réponse qui ne soit pas un exemple. Il voudrait savoir ce qui rend une chose belle. C’est pourquoi il émet l’hypothèse que le beau pourrait concerner des choses à laquelle on ne s’attend pas. Par exemple une marmite. Pour Socrate, une marmite peut être belle. Hippias ne voit pas les choses ainsi. Il voit de belles choses, mais ne voit pas comment des choses peuvent devenir belles. Il ne répond qu’à la question «Qu’est ce qui est beau?» et non à la question «Qu’est-ce que le beau?».
C’est ce que nous dit ce dialogue, dans lequel Socrate cherche des arguments pour convaincre non Hippias mais un supposé interlocuteur qui est absent. « Hippias – Tu sauras donc, puisqu'il faut te dire la vérité, que le beau, c'est une belle jeune fille. Socrate – Par le chien, Hippias, voilà une belle et brillante réponse. Si je réponds ainsi, aurai-je répondu, et répondu juste à la question, et n'aura-t-on rien à répliquer ? Hippias – Comment le ferait-on, Socrate, puisque tout le monde pense de même, et que ceux qui entendront ta réponse te rendront tous témoignage qu'elle est bonne ? Socrate – Admettons... Mais permets, Hippias, que je reprenne ce que tu viens de dire. Cet homme m'interrogera à peu près de cette manière : “Socrate, réponds-moi : toutes les choses que tu appelles belles ne sont-elles pas belles parce qu'il y a quelque chose de beau par soi-même?” Et moi, je lui répondrai que, si une jeune fille est belle, c'est qu'il existe quelque chose qui donne leur beauté aux belles choses. » (Hippias majeur, 287d-288 e). Les choses sont ainsi on ne peut plus claires : pour Socrate, il y a quelque chose qui peut rendre les choses belles, la jeune fille tout comme la marmite. Ce quelque chose, c’est l’Idée de la beauté. Et c’est en tant qu’une chose participe à cette idée de la beauté qu’elle peut devenir belle.
Participer à l’Idée de la beauté nécessite d’être dans le vrai et dans l’harmonie. On assimile souvent cela à être dans le bien. Cette interprétation est recevable, mais au sens où c’est être dans le bien qui est cause de l’harmonie, de la proportion et de la vérité, et donc au final de la beauté. Le bien est cause du beau, mais, en même temps, le beau est un repère : il fait signe vers le bien. Il nous indique où est la demeure du bien. Il aide à accoucher du bien, et c’est en cela qu’il est beau (osons dire : c’est en cela que le beau est beau). Le bien, qui est notamment le bien-faire, le bien travailler, permet le beau, qui se met lui-même au service du bien. On aurait tort de croire périmées les leçons de Platon. Faire coïncider le beau et le bien reste un objectif. Ajoutons y la force et la passion. Car il n’y a de beau et de bien que dans la force, l’énergie et la passion. Cette indispensable passion sans laquelle rien de grand ne se fait, avait remarqué Hegel.
* * *
Au terme de cette rapide enquête, il est possible de tirer quelques conclusions : que faire de la beauté ? Quelle place lui accorder? De la beauté, il faut faire une exigence - et non un pourcentage (le 1% artistique). De là, quelques points de repères s’imposent pour lui donner sa place.
1 – L’art n’est pas le beau. L’art peut certes être beau. Mais il peut aussi être autre chose. Il peut émouvoir, séduire, intéresser, voire déranger. Ce dernier aspect est très à la mode. L’art doit être « dérangeant ». Oublions cette coquetterie moderne. En tout état de cause, l’art tel qu’il est aujourd’hui ne relève ni du beau objectif – conçu selon des lois d’harmonie et de proportion – ni du beau universellement subjectif, perçu comme tel par tous. Le grand récit universel de l’art n’est que celui de l’Occident, et tout le monde l’a maintenant compris. Les arts ne suivent pas la pente du progrès comme le font les sciences, contrairement à ce que pensait Charles Perrault, à l’encontre de Nicolas Boileau, La Bruyère, La Fontaine.
2 – Le beau, non seulement ne se réduit pas à l’art, mais concerne bien des domaines. C’est le cas de la beauté dans la nature. C’est le cas de la beauté dans le quotidien, et notamment dans l’artisanat. C’est précisément dans ces domaines que la beauté manque le plus. Trop de technique répétitive, industrielle.

3 – Le beau est un enjeu social. Les bâtiments dans lesquels nous vivons, nous travaillons, nous consommons nous concernent tous. La production du beau n’est pas principalement une question d’artistes. Elle concerne les artisans et l’industrie, y compris bien entendu celle du bâtiment, qui a connu, comme l’a bien vu Françoise Choay, une révolution par l’industrialisation. Le beau a vocation à être dans la rue plus que dans les musées. Nous en sommes loin.
4 – Le beau est aussi une question qui concerne chacun. Il n’est pas raisonnable de demander du beau dans la rue quand on se promène en short dans une ville. C’est à chacun, à défaut de produire du beau, de ne pas ajouter à la laideur ambiante.
5 – Le beau est une question de civilisation. Le beau européen exclut ainsi la burqa, la djellaba, la casquette du rapeur, les robes d’indiennes, etc. Il y a d’autres « beau » que le beau européen, mais ils sont faits pour les pays non européens. En Europe, fais comme les Européens.
Pour la pensée progressiste, il n’y a pas de bien et de mal, il n’y a que du moderne, qui doit être remplacé par du toujours plus moderne. Il y a le progrès, qui est moderne, et la réaction, qui est toujours à proscrire, quand bien même estimerait-elle être une réaction contre le laid ou le mal. Pour la pensée conservatrice, celle qui veut conserver non pas tout ce qui est contemporain, mais ce qui le mérite, c’est-à-dire ce qui relève des permanences de notre civilisation, et pour tout dire de notre être, il y a du bien et du mal, du beau et du laid. Et non pas du moderne et du réactionnaire. C’était et c’est toujours la pensée des Anciens. Ce n’est pas la pensée d’avant, c’est la pensée de toujours.
De ce point de vue, qui refuse la dictature de la néophilie, le beau peut être du nouveau. Mais le nouveau n’est pas beau par le simple fait qu’il soit nouveau. L’enjeu du beau déborde aussi sur le sens de la vie. Konrad Lorenz écrit : « le sens esthétique et le sens moral sont manifestement étroitement liés » (Les huits péchés capitaux de notre civilisation, 1973). Vivre dans la laideur ne pousse pas à penser hautement. Ce qui pose la question fondamentale de la beauté nécessaire de notre « cadre de vie », de la qualité esthétique de notre environnement. La beauté est une question sociale. Elle est même souvent la forme que prend la question sociale.
* * *


Pierre Le Vigan est né en 1956. Il est urbaniste, essayiste et philosophe. Auteur de quelque 25 livres, il s’intéresse depuis des décennies au mouvement des idées et à l’évolution des sociétés. Ses derniers ouvrages porte sur Les démons de la déconstruction. Derrida, Lévinas, Sartre, éditions La barque d’or; Trop moche la ville. Comment nos villes sont devenues laides (et obèses), La barque d’or, 2025; Le Coma français, Perspectives Libres-Cercle Aristote, 2024; Clausewitz (PL, 2024).
15:30 Publié dans Architecture/Urbanisme, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art, philosophie, esthétique, beau, beauté |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 15 décembre 2025
Ontologie et eschatologie de l’ordre mondial

Ontologie et eschatologie de l’ordre mondial
Evgueni Vertlib
À une époque où la victoire de la vision du monde libérale semblait définitive et où l’on proclamait la « fin de l’histoire » comme un fait irréversible, le monde s’est retrouvé au bord d’une nouvelle réalité post-atomique, où les conflits idéologiques et civilisateurs ne disparaissaient pas, mais se transformaient en formes plus complexes et ontologiquement inconciliables. L’ordre mondial ne peut plus reposer sur l’illusion d’une homogénéité ou sur la stratégie de détruire l’adversaire, car les enjeux ont atteint une limite existentielle: la victoire, définie comme la maximisation des dégâts, entraîne aujourd’hui inévitablement une catastrophe globale. Ainsi, la seule issue réaliste du face-à-face n’est pas la capitulation de l’une ou l’autre partie, mais la reconnaissance ontologique et la fixation d’une nouvelle limite stratégique, dans la logique de laquelle la capacité à prévenir la guerre devient la valeur politique suprême. En conséquence, le monde n’atteindra pas l’utopie de l’homogénéité, mais trouvera la stabilité grâce à la « multiplicité florissante » (K. Leontiev), passant à un état de tension contrôlée et de coexistence structurale dans tous les hémisphères.

Les années de Mathusalem apportent une confrontation ontologique profonde entre deux principes civilisateurs : l’universalisme atlantique (Léviathan), qui aspire à l’unification du monde et à l’élimination de toutes les formes de différence, et le principe tellurique (Katechon), qui défend le droit des peuples à la souveraineté, à l’enracinement et à la multiplicité du sacré. L’essence de cette confrontation consiste en la lutte pour la structure même de l’être, pour l’essence humaine et la trajectoire du développement historique. Le principe atlantique (Léviathan) s’oppose au principe tellurique (Katechon) : le mobile (maritime, abstraction) contre le sédentaire (terre, ordre). Historiquement, chaque avancée de l’universalisme, depuis les réformes de Pierre Ier jusqu’aux théories révolutionnaires du début du XXe siècle, a été accompagnée d’une tentative de démanteler les systèmes qui maintiennent les différences nationales et culturelles. Le mondialisme contemporain n’a pas rejeté cette impulsion, mais l’a reconfigurée selon une clé technocratique. La chimère de la révolution permanente a été remplacée par le modèle d’intégration du Nouvel Ordre Mondial à travers la bureaucratie, la standardisation numérique et la gestion unifiée, où la supervision et la régulation remplacent fonctionnellement l’extrémisme antérieur. La dimension eschatologique du choix stratégique s’exprime dans un dilemme : soit l’universalisme technocratique, où le contrôle se dissimule derrière une unité symbolique, soit le rétablissement de la multipolarité tellurique, qui affirme le droit à la différence comme principe fondamental de l’ordre mondial.
Le bloc tellurique des États, dont le noyau est constitué par les centres de pouvoir de l’Eurasie — Russie, Chine et Iran —, applique une stratégie d'endiguement et de limitation de l’hégémonisme universaliste. La mission du Katechon, comprise comme la tâche de retenir le temps historique et d’entraver la triomphale victoire du mal eschatologique, vise à créer un ordre mondial autonome, basé sur une architecture duale, où coexistent deux systèmes qui se limitent mutuellement. Le maintien de l’autonomie stratégique exige une approche globale dans laquelle l’autosuffisance économique, technologique, militaire et culturelle s’intègre dans un système unique de durabilité.
La clé pour les États telluriques est d’assurer la continuité des chaînes de production et de technologie, le contrôle des ressources et des flux énergétiques, ainsi que la capacité de réponse autonome en matière de défense. La durabilité stratégique est assurée non seulement par la présence de forces armées, mais aussi par la structure organisationnelle de la société, le niveau de préparation technologique et la flexibilité de la mobilisation. L’interaction avec d’éventuels alliés du Sud global joue un rôle stratégique, renforçant les alliances macro-régionales et créant des plateformes pour un développement conjoint.

La dissuasion financière se réalise par le biais de systèmes monétaires et de paiement alternatifs, garantissant la liberté financière stratégique. La dissuasion économique repose sur le principe de la limitation stratégique des vulnérabilités, où les corridors logistiques deviennent un instrument de contrôle stratégique. L’autonomie technologique se construit par la création de plateformes numériques et informatiques indépendantes: l’infrastructure numérique est construite selon le principe d’une gestion segmentée mais intégrée, où les systèmes critiques sont protégés contre l’ingérence extérieure, permettant d’atteindre la souveraineté économique et technologique par la création de complexes macro-régionaux autonomes. La dissuasion militaire intègre l’autonomie des forces armées nationales avec la coordination macro-régionale, en utilisant le concept d’«attaque impossible». La dimension informationnelle et culturelle du Katechon constitue la base stratégique de la souveraineté: le contrôle des discours et des codes culturels permet de préserver l’intégrité de la société face à la pression universaliste.
Dans sa configuration ultime, le monde entre dans une ère où le changement anthropologique devient décisif: la formation d’un nouveau type de personne, séparée du territoire et de la tradition. Les futurologues ont prévu l’émergence du nomade global, un consommateur mobile, sans racines et vivant dans une culture de consommation jetable et dévaluée. Cette figure incarne le sujet idéal de l’Hyper-Empire technocratique: un être humain ayant perdu contact avec la terre et incapable de résister politiquement à tout ce qui vient de l’extérieur. La lutte pour la souveraineté se déplace dans l’espace intérieur de l’être humain: sa mémoire culturelle, ses fondements psychologiques et sa capacité à maintenir une identité stable. Une guerre des mentalités est menée pour la préservation du noyau humain. Les États doivent défendre leur propre code anthropologique pour éviter qu’il ne se dissolve dans le panier d’achat de la société hyper-modernisée. Ce projet de gestion technocratique est clairement annoncé par ses architectes. Klaus Schwab insiste sur le «Grand Reset» et son conseiller, Yuval Noah Harari, indique directement: «Nous n’avons simplement pas besoin de la majorité d’entre vous… Nous aurons l’opportunité de pirater les gens». Cette position, confirmée par des idéologues comme Jacques Attali, donne à la conception du nouveau camp de concentration numérique une objectif concret, dans lequel la supervision et la régulation remplacent fonctionnellement l’extrémisme antérieur.

La dimension financière de la confrontation est devenue le domaine où le projet atlantique a atteint sa plus grande maturité. La transition du contrôle territorial au contrôle informationnel et financier a permis de déplacer le centre du pouvoir vers le domaine de la surveillance algorithmique et de la dépendance monétaire. Ainsi apparaît l’eschatologie financière, un concept dans lequel l’argent se transforme d’instrument d’échange en mécanisme de contrôle total. L’unification de l’espace monétaire mondial par le biais des monnaies numériques ouvre la voie à la création d’un cadre financier supranational capable d’imposer des règles uniques. La formule historique «celui qui contrôle la masse monétaire d’un pays contrôle le pays» acquiert une dimension globale. Pour les forces telluriques, cela crée un impératif stratégique: la souveraineté monétaire devient un élément clé de l’indépendance politique, ce qui fait de la crypto-politique le front principal du XXIe siècle. À l’ère du capitalisme numérique, le principe atlantique obtient un avantage absolu dans la gestion de l’information. Le pouvoir algorithmique remplace le pouvoir des flottes, formant l’impérialisme des données, une forme de domination basée sur le contrôle de l’environnement numérique. La dimension eschatologique de ce projet se manifeste dans le désir de créer un état de paix où toute alternative serait techniquement impossible, transformant la fin de l’histoire en une eschatologie algorithmique.

La fracture entre les différents fronts du monde se déplace définitivement vers la sphère du contrôle de la signification. Un nouveau régime cognitif apparaît, dans lequel le contrôle s’exerce par la distribution de l’attention et la reconfiguration de la réalité, et où les algorithmes façonnent la perception de l’être humain. En réponse, le principe tellurique tente de rendre à la culture sa profondeur et sa sacralité. Le code culturel est une forme d’enracinement existentiel qui relie l’être humain à l’histoire et à l’espace. La confrontation entre dans le domaine de l’eschatologie culturelle: un projet cherche à créer un sujet universel pour l’économie en réseau (en utilisant la hyper-tolérance et la déconstruction postmoderne pour l’individualisation), tandis qu’un autre cherche à restaurer le sujet comme porteur de la tradition, dont l’existence transcende les prédictions et le contrôle des algorithmes.

La couche la plus profonde du conflit réside dans la question du corps et des limites. La civilisation atlantique propose l’idée de dissoudre la nature matérielle de l’être humain par le biais du posthumanisme, tandis que la logique tellurique insiste sur l’enracinement insurmontable de l’être humain dans la géographie charnelle de l’être. La terre implique le corps, et le corps implique des limites. Le projet atlantique construit un monde où les limites doivent disparaître, tandis que le projet tellurique construit un monde où les limites sont la base de l’ordre, et l’ordre la base de la liberté. Cela fait de la restauration des frontières une stratégie ontologique.
La structure du face-à-face mondial prend sa forme définitive lorsque l’on analyse le temps. Le projet atlantique cherche à priver l’humanité de sa profondeur historique, en réduisant le passé à des symboles déconstruits et l’avenir à une projection technocratique unique et rationnelle, ce qui constitue une confrontation entre deux théologies de l’histoire: la technocratique et la traditionnelle. Le système supra-humain que la civilisation atlantique souhaite créer est une technocratie sans technocrates, un pouvoir réparti entre machines et protocoles. Le projet tellurique, quant à lui, cherche à intégrer la technologie dans la structure du sens, plutôt que de remplacer le sens par la technologie, en générant l’idée de la souveraineté du sens.

Il est en jeu la propre possibilité d’existence des civilisations humaines en tant que formes de vie autosuffisantes, où la souveraineté commence par la liberté intérieure et le sens collectif. Le conflit entre les projets atlantique et tellurique n’est pas simplement une dispute sur la gouvernance du monde, mais une lutte sur ce qu’il faut considérer comme le monde. À ce niveau, le choix stratégique acquiert une profondeur eschatologique: accepter la dissolution dans un conglomérat nomade universel, ou construire un monde contre-eschatologique basé sur la sacralité de l’espace, la tradition et le droit à la différence, qui devient une nouvelle valeur politique suprême. La jonction de tous ces éléments forme un bloc macro-régional capable de maintenir l’équilibre stratégique avec le Léviathan. Le capital démographique devient alors un instrument de profondeur stratégique et une garantie de reproduction de la souveraineté nationale et culturelle, constituant un aspect fondamental dans cette lutte et, par conséquent, le pari final du conflit mondial.
Ainsi, nous avons exploré l’ontologie et l’eschatologie de l’ordre mondial, établissant que le conflit mondial a dépassé les limites de la géopolitique classique, devenant une confrontation antagoniste entre deux principes métaphysiques. Dans ce contexte, la victoire russe sur le théâtre des opérations ukrainien n’est pas seulement un succès militaire et politique, mais un acte existentiel de réalisation du potentiel des forces du Katechon pour contenir la victoire totale des intrigues antichristiques de l’euro-atlantisme. Étant donné l’inacceptabilité d’un affrontement militaire direct entre les pôles dans un contexte de dissuasion nucléaire entre des parties à potentiel de destruction mutuelle égal, la confrontation passe au plan de la stratégie d’épuisement: guerres de sanctions, blocus maritimes et technologiques, où la victoire ne se gagne pas tant par la destruction physique de l’ennemi que par la destruction de sa volonté de continuer la lutte. «Une façon efficace d’affaiblir un rival grand et armé d'un potentiel nucléaire est de le faire saigner de loin, ce qui constitue une version moderne et relativement sûre de la stratégie de l'anaconda. L’objectif de cette lutte n’est pas la défaite immédiate, mais l’épuisement prolongé et inexorable de ses ressources et de sa détermination politique», affirme le stratège américain de renom Stephen M. Walt (photo), professeur de Relations internationales à Harvard.

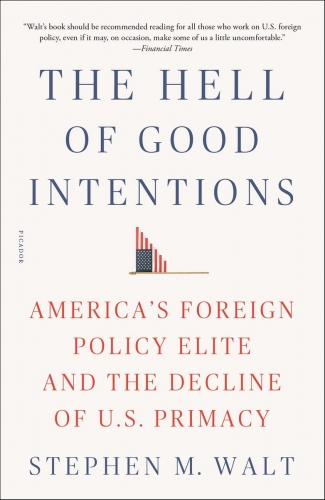

C’est précisément cette conscience d’un épuisement total, mais à distance, qui rend impossible la victoire totale du Léviathan et mène inévitablement à la nécessité d’établir une nouvelle limite de la sagesse stratégique. Cette limite conduit à la composition d’un compromis dual, que l’analyste Evgueni Vertlib a nommé l'«architecture de la survie» («La logique des compromis stratégiques», 2014 ; «Katechon et Léviathan. Duel global», 2025). L’auteur a formalisé la dichotomie Léviathan vs. Katechon non plus comme une confrontation entre États, mais comme une nécessité dans laquelle Léviathan et Katechon s’avèrent être des contrepoids indispensables dans l’unité dialectique des opposés, dictée par les limites de la destruction mutuelle. Le Katechon (l'Ours Russe), après avoir supporté la stratégie d’épuisement, oblige Léviathan à reconnaître les limites de son universalité: les limites du maintien de l’apparence de la victoire, la légitimation de la non-défaite comme victoire. La conclusion de cette confrontation ne sera pas la capitulation, mais la reconnaissance ontologique et la fixation d’une nouvelle limite stratégique. Selon cette logique, la victoire ne consiste pas à maximiser les dégâts, mais à maximiser la capacité à prévenir la guerre. En conséquence, le monde n’atteindra pas l’utopie de l’homogénéité, mais trouvera la stabilité dans sa multiplicité, ce qui est la seule issue réaliste à l’ère post-nucléaire et la garantie de la préservation de l’espace même de l’action historique, où la «multiplicité florissante» (K. Leontiev) devient la nouvelle valeur politique suprême.
Le monde entre dans une période de tension contrôlée et de coexistence structurée de deux hémisphères, ce qui, en essence, constitue une réincarnation pragmatique du principe de «coexistence pacifique», concept fondamental de la politique étrangère soviétique qui, malgré tout son arrière-plan idéologique, visait à prévenir un affrontement militaire direct et à fixer la compétition à long terme comme un processus contrôlé et non catastrophique. En ce sens, notre modèle de «coexistence structurée de deux hémisphères» occupe une position unique, démontrant un avantage significatif sur les deux autres paradigmes mondiaux majeurs.

Premièrement, il diffère de manière critique de la formule chinoise «Un pays, deux systèmes», un modèle développé par Deng Xiaoping pour préserver les enclaves capitalistes sous la souveraineté de l’État socialiste. Alors que cette formule atteint la paix par la subordination ontologique d’un système à la souveraineté étatique unifiée (comme le démontre l’interprétation officielle: «Un pays» est la prémisse et la base, les «deux systèmes» sont subordonnés à «un pays» et tous se basent dessus»), notre vision exclut la subordination hiérarchique. La «coexistence structurée de deux hémisphères» affirme l’équilibre, non la subordination, fixant la limite stratégique comme une frontière horizontale de reconnaissance mutuelle, où la « multiplicité florissante » se présente comme une valeur politique autosuffisante et une garantie de paix, et non comme une concession temporaire pour préserver l’unité de l’État.

Deuxièmement, notre conception se caractérise également par une plus grande rigidité politique et un réalisme accru par rapport à l’idée du «Dialogue des civilisations», promue notamment par le président iranien Mohammad Khatami, en réponse à la thèse du «Choc des civilisations». Alors que le «Dialogue des civilisations» vise à dépasser le conflit par un rapprochement éthique, culturel et de valeurs basé sur le respect mutuel et l’échange actif (en affirmant notamment qu’«il n’y a pas de choc des civilisations, mais un choc d’intérêts et d’ignorance»), il ne comporte pas de mécanismes pour contenir l’agression systémique. Notre conception, au contraire, est ontologiquement réaliste, puisqu’elle reconnaît et intègre la «tension contrôlée» comme partie intégrante du système, en fixant la limite stratégique précisément par la maximisation de la capacité à prévenir la guerre. De cette façon, elle ne se fonde pas uniquement sur la surmontée volontaire de l’«ignorance», mais utilise la force de dissuasion comme base de la stabilité structurelle. Par conséquent, la « coexistence de deux hémisphères » n’est pas seulement une question pragmatique pour éviter la guerre, mais aussi un mécanisme politique de premier ordre qui affirme l’égalité structurelle et fonde la paix sur une limite stratégique contrôlable.
Cette approche exige de renoncer aux prétentions universalistes, caractéristiques à la fois de l’idéologie de la Guerre froide et de l’hégémonisme post-bipolaire, où la victoire était conçue comme l’absorption totale ou la reformulation de l’adversaire. À la place, la nouvelle limite de l’action stratégique dicte la nécessité de développer des protocoles d’interaction complexes et multi-strates, capables d’intégrer l’antagonisme dans le tissu d’un ordre mondial durable. Dans ce système, la «tension contrôlée» devient un état permanent dans lequel les acteurs clés calibrent constamment leurs actions par rapport à la nouvelle limite stratégique, sans dépasser la ligne critique qui mène à la catastrophe. De cette manière, la différence ontologique des systèmes, en étant reconnue et institutionnalisée, cesse d’être une source de conflit incontrôlable et se transforme en une source d’équilibre dynamique, dans laquelle la stabilité est assurée, paradoxalement, précisément, par la coexistence compétitive.
Pour le Katechon, qui lutte seul contre la légion de l’Antéchrist, le rôle de la Russie en tant que Reteneur serait rempli. Cette mission, enracinée dans la Deuxième Épître de l’apôtre Paul aux Thessaloniciens (« Car le mystère de l’iniquité est déjà en action; il ne sera déployé que lorsque celui qui le retient sera enlevé… puis l’impie sera révélé»), se projette dans la tâche ontologique de stabiliser la limite stratégique globale.
Le calcul stratégique de la victoire russe dépasse la simple réussite des objectifs opérationnels et tactiques classiques et repose sur l’obligation d’amener l’ennemi à s’auto-limiter et à accepter l’irréductible multiplicité de l’architecture mondiale. La Russie n’aspire pas à la domination totale, mais à créer des faits irréversibles d’équilibre stratégique qui rendent toute escalade militaire ultérieure défavorable à l’existence même de l’ennemi. L’impératif clé est de maximiser sa propre stabilité et de minimiser l’espace opératoire pour l’expansionnisme mondialiste, ce qui se réalise par une formule triple: provoquer des dégâts inacceptables en cas de confrontation directe pour renforcer la limite stratégique; démontrer l’autonomie et l’autosuffisance de la civilisation, qui montre l’inutilité de la stratégie de «suffocation»; et former de nouveaux pôles d’attraction: coalitions d’États souverains pour lesquels le modèle dominant de «pluralité florissante» deviendra une alternative sûre à l’hégémonie centrée sur les États-Unis. Ainsi, la victoire russe n’est pas la capitulation de l’ennemi, mais la victoire du bon sens et de la nécessité historique, qui conduit à la reconnaissance ontologique par les deux hémisphères d’une nouvelle norme durable de l’ordre mondial: à l’humanité dans son ensemble, il est donné la possibilité d’exister «légalement» dans sa pluralité. L’objectif est de re-codifier la stratégie globale, passant de la logique du «celui qui gagne prend tout» à la raison pratique: «tous ceux qui reconnaissent la limite survivent». Telle est la fonction du Reteneur : non pas empêcher la fin du monde, mais la retarder autant que possible en établissant l’ordre et le droit au développement souverain dans des conditions de tension permanente contrôlée.

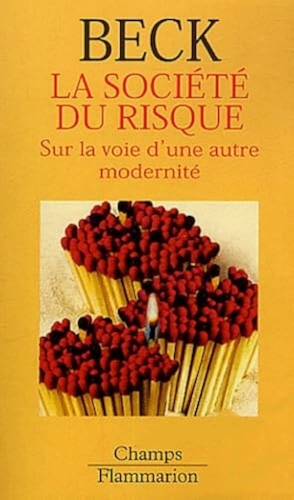
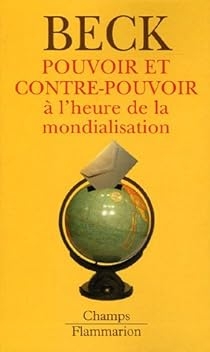
Cet impératif stratégique devient encore plus incontournable dans le contexte de la compréhension que l’histoire mondiale n’a pas seulement continué, comme l’a postulé Francis Fukuyama dans sa conception de « La fin de l’histoire » après la victoire de la démocratie libérale, mais qu’elle est revenue sous la forme d’un conflit entre des paradigmes ontologiques inconciliables, réfutant définitivement l’illusion de l’unification. Plus encore, cette nouvelle ère coïncide avec la formation de la «société du risque global» selon Ulrich Beck (1986), dans laquelle les menaces systémiques, invisibles et transfrontalières (du climat à l’atome) créent une nouvelle solidarité universelle face à une catastrophe commune provoquée par l’homme. «Les risques, comme les richesses, se distribuent selon un schéma de classes, sauf qu’ils le font en ordre inversé», affirmait Beck, soulignant que les menaces modernes dépassent toutes les frontières nationales, rendant toute tentative de victoire totale ontologiquement dénuée de sens. Ainsi, la Russie, agissant comme Reteneur, assume la fonction de stabilisateur mondial, dont la victoire ne consiste pas à imposer son ordre, mais à fixer une limite métaphysique infranchissable garantissant à toutes les civilisations leur propre existence par la «multiplicité florissante» et en annihilant toute prétention à une fin unique de l’histoire.
19:47 Publié dans Actualité, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : axtualité, philosophie, philosophie politique, théorie politique, sciences politiques, ontologie, eschatologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 11 décembre 2025
L'“Ère des troubles” de Toynbee dans une ère d'effondrement civilisationnel
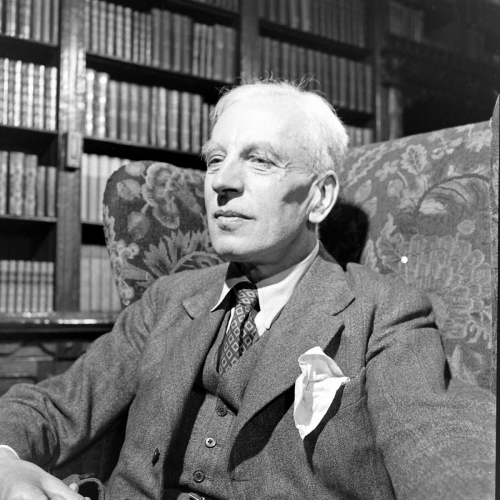
L'“Ère des troubles” de Toynbee dans une ère d'effondrement civilisationnel
Troy Southgate
Bron: https://troysouthgate.substack.com/p/toynbees-time-of-tro...
Selon le célèbre philosophe et historien anglais Arnold J. Toynbee (1889-1975), qui était également un anti-sioniste convaincu: «L’homme parvient à la civilisation, non pas en raison d’un don biologique supérieur ou d’un environnement géographique, mais en réponse à un défi dans une situation de difficulté particulière qui l’incite à faire un effort sans précédent jusqu’alors».
Dans son œuvre monumentale de 1934, A Study of History, Toynbee examine pas moins de vingt-six civilisations passées et conclut que leur effondrement dérive toujours de facteurs internes plutôt qu’externes. Une fois que les dirigeants d’une civilisation cessent d’agir de manière créative, en utilisant les forces dynamiques qui la portent en avant et vers le haut, la société descend peu à peu dans le nationalisme réactif, le militarisme et, finalement, arrive à l’extinction.
Contrairement à Oswald Spengler (1880-1936), qui croyait que « l’optimisme est lâcheté », Toynbee pensait que – dans la plupart des cas – le fait de relever les défis auxquels nous sommes confrontés fera ressortir le meilleur des gens. Cela est correct, du moins dans une certaine mesure, mais la limite de l’analyse de Toynbee est qu’il voit la civilisation comme la marque même du progrès humain et que nous devons être jugés en fonction de notre potentiel à résister aux facteurs qui cherchent à la déstabiliser. Toynbee qualifiait ce phénomène cyclique de « temps de troubles ».
Une analyse plus réaliste, à mon avis, impliquerait la capacité des gens à survivre au sein même de l’effondrement de la civilisation. En effet, Toynbee – qui était influencé par le philosophe français Henri Bergson (1859-1941) – croyait même qu’une « minorité créative » d’outsiders devait se retirer dans la nature sauvage pour régénérer leurs forces vitales et, une fois sortis de leur isolement volontaire, diffuser un message d’espoir à leurs compatriotes. Le salut adviendrait alors, si l'on veut, sous la contrainte. Ce retrait temporaire ressemble plutôt à l’idée chinoise antique de « chevaucher le tigre », et Toynbee était convaincu qu’une telle élite devait « s’accrocher et attendre » dans l’espoir que la civilisation puisse être sauvée.
Alors que certains, comme Julius Evola (1898-1974), nous ont proposé de vivre au milieu de la dégénérescence en tant qu’esprits libres et de maintenir notre dignité face au déclin, il est clair qu’il doit arriver un moment où une civilisation devient totalement irrécupérable, et que la soutenir comme on soutient un homme mourant n’est qu’une tentative futile de retarder sa fin inévitable. Je crois que nous avons beaucoup à apprendre de Toynbee, mais seulement si nous transférons ses pensées sur la civilisation à notre quête plus large de survivre à sa destruction ultime.
13:43 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : arnold joseph toynbee, philosophie, philosophie de l'histoire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 27 novembre 2025
Friedrich Nietzsche, Gilles Deleuze et l'éternel retour

Friedrich Nietzsche, Gilles Deleuze et l'éternel retour
Troy Southgate
Source: https://troysouthgate.substack.com/p/friedrich-nietzsche-...
Dans son ouvrage complexe publié en 1962, Nietzsche et la philosophie, le postmoderniste français Gilles Deleuze (1925-1995) cherche tellement à faire correspondre les idées de Nietzsche à sa propre vision matérialiste du monde que certains aspects de l'œuvre du penseur allemand sont complètement relégués au second plan. Lorsque Deleuze aborde la notion d'éternel retour, par exemple, à laquelle Nietzsche fait allusion dans Le Gai Savoir (1882) et Ainsi parlait Zarathoustra (1883-1891), il affirme que ce concept contient « les parties les plus obscures de la philosophie de Nietzsche et constitue un élément presque ésotérique de sa doctrine » (p. 69).
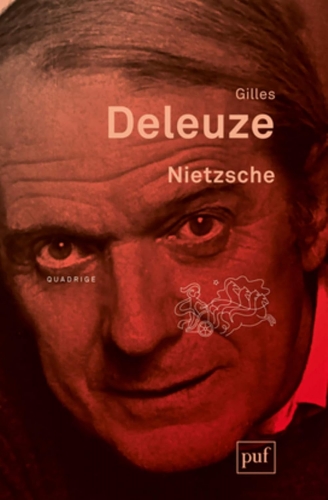
Ailleurs, Deleuze suggère que La généalogie de la morale (1887) de Nietzsche est une tentative flagrante de réécrire la Critique de la raison pure (1781) d'Emmanuel Kant, même si Nietzsche s'abstient de discuter des questions relatives à l'épistémologie dans cet ouvrage particulier et ne mentionne à aucun moment Kant lui-même.
Deleuze, comme Emma Goldman (1869-1940) avant lui, admirait beaucoup l'attitude intransigeante de Nietzsche et tentait de rehausser ses propres références révolutionnaires en créant une forme de nietzschéisme de gauche.
On peut débattre de la question de savoir s'il y parvint réellement, mais pour revenir à sa discussion sur l'éternel retour, je suis d'accord avec Deleuze pour dire que certaines remarques de Nietzsche sur la nature des tendances réactives s'expliquent par la relation entre la volonté de néant et l'éternel retour lui-même.
La volonté de néant, rappelons-le, est le nom que Nietzsche donne à la philosophie pessimiste d'Arthur Schopenhauer (1788-1860), selon laquelle la vie se détourne d'elle-même parce qu'elle ne trouve aucune valeur réelle dans le monde. Elle est similaire, à bien des égards, au bouddhisme. Cette tendance est bien sûr présentée comme la voie du nihiliste, décrite à titre posthume par Nietzsche dans La Volonté de puissance (1901) comme « un homme qui juge le monde tel qu'il est comme il ne devrait pas être, et le monde tel qu'il devrait être comme s'il n'existe pas ».
La volonté de néant est donc d'une importance vitale dans le schéma philosophique des choses car, comme le note Deleuze, en entrant en contact avec l'éternel retour, « elle rompt son alliance avec les forces réactives » et donc « l'éternel retour peut compléter le nihilisme car il fait de la négation une négation des forces réactives elles-mêmes » (p. 70).

En d'autres termes, bien que le nihilisme soit généralement perçu comme l'apanage des faibles, il devient ici l'instrument de leur propre autodestruction.
Avant cette association ironique entre la volonté de néant et l'éternel retour, la première était toujours présentée comme quelque chose qui s'alliait aux forces réactives et qui, par conséquent, cherchait inévitablement à nier ou à étouffer la force active. Nietzsche, en 1901, avait déjà observé que « la loi de conservation de l'énergie exige l'éternel retour ». La volonté de néant, en revanche, n'est qu'une forme incomplète de nihilisme et, comme le note Deleuze: « La négation active ou la destruction active est l'état des esprits forts qui détruisent le réactif en eux-mêmes, le soumettant à l'épreuve de l'éternel retour et se soumettant eux-mêmes à cette épreuve, même si cela implique de vouloir leur propre déclin » (Ibid.).
La négation est donc radicalement transformée en un état d'affirmation dans ce qui peut finalement être interprété comme une métamorphose dionysiaque.
18:11 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, gilles deleuze, friedrich nietzsche |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 24 novembre 2025
La philosophie de la modernité et sa réfraction en Russie

La philosophie de la modernité et sa réfraction en Russie
Le présent texte est un essai écrit pour l’un des cours de Daria Platonova Douguina à la Faculté de philosophie de l’Université d’État de Moscou.
par Alexandre Douguine
La philosophie occidentale est arrivée en Russie de manière plutôt étrange. Il n’y avait ni logique ni succession cohérente. Nous avons pris certaines choses de l’Occident, souvent par coïncidence, comme ce qui était populaire là-bas, tout en négligeant d’autres éléments plus importants. D’où l’étrangeté du dialogue philosophique russo-occidental. Par moments, ces fragments ont été réconciliés de manière absolument exotique. La logique a été détournée pour devenir morale, et la philosophie rationnelle sèche a inspiré des écrivains et des poètes à tirer des conclusions et des images complètement inattendues.
Malgré le fait que les penseurs et écrivains russes ont parfois interprété la philosophie occidentale de manière totalement arbitraire, voire déformée, ils ont saisi certains aspects de cette philosophie avec une profondeur telle qu’il en est même venu à l’Occident l’idée que les Russes avaient découvert quelque chose de nouveau et d’inattendu, qui leur avait échappé.
Dans l’ensemble, la corrélation entre la pensée européenne occidentale et sa lecture en Russie aux XVIIIe-XIXe siècles est un sujet à part entière. En partant de la nature chaotique de cette réception, on peut établir de nombreux parallèles et comparer à la fois des sources d’influence évidentes et moins apparentes.

Pourtant, les auteurs russes les plus profonds et les plus originaux ont compris ce qui est avant tout dans la culture occidentale de la modernité. Vladimir Soloviev (illustration) qualifiait cela d’atomisation de la culture, de désintégration individualiste en fragments, et il voyait dans cela le destin de la modernité européenne. Dès le début de son article programmatique « Trois forces », Soloviev parlait d’une culture d’unité forcée qu’il identifiait à l’Est, et d’une seconde force opposée, celle de l’Occident moderne. Soloviev écrivait à propos de la force culturelle occidentale :
"Elle cherche à briser le bastion de l’unité morte, à donner partout la liberté aux formes de vie individuelles, à la liberté de l’individu et de son activité ; sous son influence, les éléments individuels de l’humanité deviennent les points de départ de la vie, agissent exclusivement pour eux-mêmes et à partir d’eux-mêmes, et le commun perd la signification de l’être réel et essentiel, et se transforme en quelque chose d’abstrait, de vide, en une loi formelle, et est finalement complètement dépourvu de sens. L’égoïsme universel et l’anarchie, une multitude d’unités individuelles sans lien intérieur — c’est l’expression extrême de cette force. Si elle devait prendre, seule, le contrôle, alors l’humanité se désintégrerait en composants, la connexion de la vie serait déchirée, et l’histoire finirait dans une guerre de tous contre tous avec l’autodestruction de l’humanité" (1).
En effet, la civilisation européenne de la modernité a conduit à cet « égoïsme universel et cette anarchie » ainsi qu’à une « multitude d’individus sans aucun lien intérieur ». Malgré le fait que tout ait commencé avec un rationalisme totalement unificateur et universaliste — Descartes et encore plus Leibniz et ses disciples — l’Occident s’est dirigé vers la désintégration progressive et la décomposition de la société en atomes. Les Russes ont perçu ce processus dans toute son ampleur et ont posé la question: qui empêchera cela de se développer jusqu’à la dislocation de l’être humain en tant que tel ? Après tout, la force déchaînée de la civilisation dépasse les capacités de l’individu. Cela signifie qu’à partir de la monade universelle et de sa téléologie, nous arrivons non seulement à l’individu, mais à des phases encore plus avancées dans la fragmentation de l’être humain en parties individuelles.
Ces réflexions m’ont conduit à comparer deux figures totalement hétérogènes : le philosophe allemand précis et pédant Christian Wolff, disciple de Leibniz, et le génie de l’écrivain russe Nikolai Gogol.
Note:
(1) V. Solov’ev, “Tri sily” (1877) [ https://www.vehi.net/soloviev/trisily.html ].
Buy Eschatological Optimism now: https://pravpublishing.com/product/eschatological-optimism/
Follow the Prav Publishing on Telegram: https://t.me/PRAVPublishing
13:02 Publié dans Nouvelle Droite, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, nouvelle droite, nouvelle droite russe, alexandre douguine |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 21 novembre 2025
L’illusion divine de la vitesse – Critique du technocapitalisme chez Fabio Vighi

L’illusion divine de la vitesse – Critique du technocapitalisme chez Fabio Vighi
Markku Siira
Source: https://geopolarium.com/2025/11/18/kiihtyvyyden-jumalharh...
Fabio Vighi examine, à la lumière de la psychanalyse de Jacques Lacan, la structure de croyance dominante de l’ère technocapitaliste et applique le concept de « paranoïa réussie », qu’il décrit comme une illusion qui ne détruit pas le sujet mais, au contraire, le maintient cohérent et opérationnel.
Selon Vighi, nous sommes passés d’une compréhension cynique de la société et d’un déni fétichiste à une « illusion collective totale qui compense la décomposition inévitable de l’ordre symbolique et des liens sociaux » dans un contexte de déclin du capitalisme.
Lorsque l’ordre symbolique faiblit, l’identité ne se construit plus par l’interaction linguistique et les compromis. Elle est, à la place, installée dans des paquets prêts à l’emploi, fournis par les infrastructures numériques et le branding personnel commercialisé: « microcultures algorithmiques, étiquettes de diagnostic et modèles de personnalité téléchargeables ». Vighi insiste sur le fait que nous ne sommes pas seulement des victimes passives de la technologie, mais des « participants actifs à une illusion qui confère au technocapitalisme une autorité divine incontestée ».


Ce faux investissement lie les citoyens au système financier digitalisé et empêche qu’ils affrontent la machine automatique et dénuée de sens du capital. « Les promesses du progrès technologique et leurs contreparties symboliques » — politique identitaire, consommation éthique, greenwashing — « fonctionnent ensemble comme des illusions stabilisatrices » rendant presque impossible toute critique de la politique économique.
Aux extrêmes de cette illusion, Vighi distingue deux tendances miroir: l’accélérationnisme de droite, représenté par la pensée anglo-américaine des « Lumières obscures », et l’accélérationnisme de gauche, avec ses fantasmes nostalgiques d’humanisation.



Les deux s’appuient sur l’interprétation lacanienne de Daniel Paul Schreber—juriste allemand devenu un cas classique de psychiatrie en raison de sa schizophrénie paranoïde. Selon Lacan, la paranoïa de Schreber était contrôlable parce que « la société lui laissait de l’espace ». Cela s’est concrétisé dans le fait que Schreber a pu publier ses mémoires et que ses déclarations écrites ont été prises en compte dans le procès, donnant une légitimité sociale à son univers délirant. Par exemple, sa conviction qu’il devait se transformer en femme pour que Dieu puisse le féconder et sauver le monde a été traitée comme une revendication sérieuse au tribunal.
En appliquant cette analogie, les accélérationnistes de droite—notamment les partisans du manifeste technoptimiste de la Silicon Valley—« adoptent une posture messianique comme Schreber: ils se soumettent complètement à la puissance sacrée de la rationalité technocapitaliste ». Ils croient que l’automatisation technologique mènera à un ordre techno-féodal autoritaire, ce qui, dans leur imagination, sauvera le monde.
À l’opposé, l’accélérationnisme de gauche repose sur une illusion nostalgique selon laquelle « la force brute du capitalisme pourrait encore être domptée par des corrections éthiques » et conduirait à un paradis post-humain égalitaire. Selon Vighi, cette position refuse de faire face à la logique inéluctable de l’automatisation du capital. En pratique, les solutions proposées par l’accélération de gauche—planification algorithmique, inclusion et IA éthique—ne peuvent pas sauver le sujet humain.

Dans les deux cas, le sujet schreberien « se donne à voir à ‘l’éclat divin’—dans ce cas, aux algorithmes et au capital—et considère cette reddition comme une mission de libération et de salut ». Cette illusion repose sur un système de croyance anachronique qui ne correspond plus aux conditions objectives de l’accumulation accélérée du capital.
Vighi souligne surtout que la majorité des courants actuels de la gauche se sont retirés dans « des récits de salut technologique, de responsabilité des entreprises, de consommation éthique ou de luttes morales fragmentaires ». La critique de la politique économique a été remplacée par « des formes politiques centrées sur l’identité et des sujets individuels », où « l’opposition est construite autour du ‘faux’ ou du ‘mal’ de l’autre ». Cela laisse intacte la problématique centrale du capitalisme—« l’effondrement de la valorisation du travail de masse ».
Sur un plan concret, la bulle technologique se révèle être une bulle de dettes. Les entreprises technologiques américaines ont émis un nombre record d’obligations, et la dette totale des cinq grandes sociétés—Amazon, Microsoft, Apple, Meta et Alphabet—s’élève à 457 milliards de dollars. Les investissements dans l’IA, les centres de données et les services cloud sont majoritairement déficitaires—seulement environ 5% des applications d’IA déployées créent une véritable valeur—mais les prix des actions montent grâce à un optimisme spéculatif.
Par ailleurs, les fraudes sur les marchés du crédit privé se multiplient, comme les techniques de financement de dettes de type subprime récemment révélées, annonçant une nouvelle crise systémique. Ces pratiques rappellent fortement la période précédant la crise financière de 2008, lorsque des risques s’accumulaient dans des instruments financiers invisibles.

C’est précisément à cette intersection entre réalité économique et illusion psychique que l’analyse de Vighi révèle tout le mécanisme de la paranoïa. Le technocapitalisme n’est pas seulement un système économique, mais aussi un mécanisme psychologique profond: la bulle de dettes alimente l’illusion qui, à son tour, favorise la croissance de la bulle. Comme Vighi le dit: « Nous ne sommes pas tant gouvernés par le système techno-capitaliste lui-même que par la fantasme qu’il nous sauvera finalement. »
Vighi conclut avec une réflexion philosophique: seule la reconnaissance et la sortie de l’illusion peuvent ouvrir la voie à une véritable résistance. Comme dans la théorie critique, il reste ouvert aux possibles méthodes concrètes qui pourraient mener à cette prise de conscience. Le diagnostic est précis, mais le programme de traitement reste flou. Sommes-nous alors condamnés à rester fonctionnels et socialement intégrés—mais en même temps inévitablement illusoires, héritiers de Schreber dans le royaume du dieu du technocapitalisme?
19:35 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, fabio vighi, technocapitalisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 20 novembre 2025
Descartes, le "cogito" et la rupture de la modernité

Descartes, le "cogito" et la rupture de la modernité
par Daniele D’Innocenzio
Source : Giubbe rosse & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/cartesio-il-cogit...
Descartes n’a pas simplement commis une erreur philosophique, comme Antonio Damasio l’a justement souligné dans L’erreur de Descartes, mais a inauguré une rupture qui a condamné l’humanité, la nature et la vie elle-même à l’effondrement. En séparant l’esprit du corps et le sujet du monde, il a posé les bases métaphysiques d’une civilisation construite sur la domination, l’exploitation et la rationalité désincarnée.


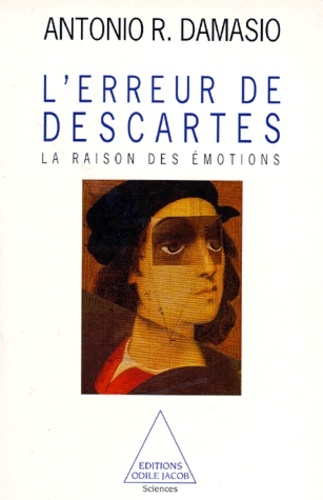
Le cogito cartésien, conçu comme une garantie de certitude, est devenu le germe de l’aliénation, déconnectant la moralité de la téléologie, la solidarité de la communauté et les êtres humains de la Terre vivante. Ce qui semblait être un triomphe de la raison fut, en réalité, l’acte d’ouverture d’un suicide lent de la civilisation. Ce n’était pas une simple erreur logique, mais un tremblement de terre. La secousse cartésienne continue encore aujourd’hui à se propager, sous forme de fissures dans la planète, de crises de sens, de corps anxieux qui ne comprennent plus où finissent et commencent les autres.
Au moment où “il” “partorise” le « cogito, ergo sum », Descartes déchire un voile qui ne sera plus recousu. Esprit et corps ne forment plus une seule trame de chair, désir et mémoire: ils deviennent deux substances. L’une, immatérielle, brillante, siège de la pensée claire et distincte; l’autre, lourde, mécanique, fiable comme une montre et tout aussi dépourvue d’intériorité. Le corps est désormais une «chose» parmi les choses, un morceau de nature à perforer, peser, vendre. La forêt devient une réserve de bois, le pétrole un fluide à pomper, les neurones des circuits à optimiser: le sujet, armé de raison, s’imagine hors du monde comme un ingénieur sur un pont de commandement. Mais personne ne lui a dit que le pont flotte sur l’océan qu’il prétend dominer.
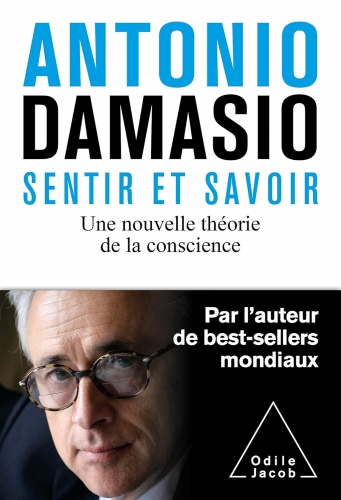
Damasio, trois siècles et demi plus tard, pense de manière simple mais efficace: retirez à la pensée le battement du coeur, l’intestin, la peau qui se ride, et ce qui reste est un désert cosmique laissant place à une abstraction stérile. Les neurosciences le démontrent: les patients avec des lésions au lobe préfrontal ont une logique intacte, une émotion nulle, une capacité de décision annihilée.
Sans corps, il n’y a pas d’évaluation possible, sans évaluation, il n’y a pas d’action, sans action, il n’y a pas d’histoire.
Pourtant, l’histoire raconte que notre civilisation a construit des temples, des universités, des économies entières sur l’hypothèse opposée. Le paradis cartésien est un lieu sans odeurs, sans sueur, sans horizon. Là, les choix se font avec des algorithmes, les marchés se régulent d’eux-mêmes, les données « parlent d’elles-mêmes ». Le reste – le goût des fraises, les pleurs des enfants, le bourdonnement des insectes – est « extérieur », un reste toléré tant qu’il ne nuit pas au profit.
Asseyons-nous au bord de l’eau et regardons la réalité: les démocraties sont narcotisées par des flux d’informations que personne ne contrôle; nos vies intérieures sont confiées à des plateformes conçues pour retenir l’attention. Chaque crise – climatique, politique, psychologique – est une note de retour de l’ancien morceau: un sujet séparé de l’objet, un esprit aliéné de la Terre. Maintenant, apparaît le paradoxe: plus nous repoussons le corps, plus il revient comme un fantôme. Les troubles alimentaires, l’anxiété généralisée, la dépression croissante chez les jeunes ne sont pas des « maladies mentales » au sens cartésien : ce sont des protestations de la “chair”, des tentatives de dire « je suis aussi » à un moi qui l’avait oublié. La psyché, privée de son humus biologique et social, tombe dans le vide.
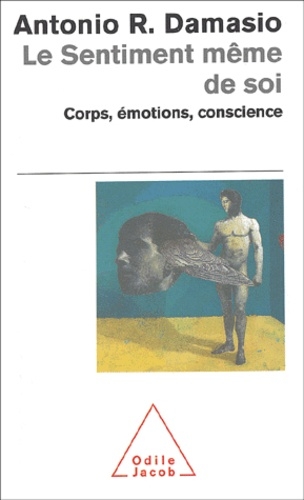
Reconnaître que penser c’est aussi respirer, que raisonner c’est aussi se nourrir, que connaître c’est aussi être touché, serait la semence d’une juste alternance alimentée par ce geste minimal. La science tant aimée, souvent évoquée lors de la crainte de la vague covi d, le confirme: les microbiotes intestinaux produisent de la sérotonine; les rayons ultraviolets modulent le système immunitaire; le cerveau «hors de la tête» s’étend à tout le corps, et au-delà – jusqu’à la toile de relations qui nous maintiennent en vie.
Changeons tout: ce n’est pas “je pense, donc je suis” mais “je suis entièrement, donc je comprends”. Un nous qui inclut bactéries, forêts, nuages, codes, mémoires d’ancêtres. Une subjectivité diffuse, symbiotique, imparfaite – mais au moins enracinée. La raison, alors, n’est plus une tour d’ivoire: c’est un jardin à cultiver, où l’intuition et la mesure, la poésie et les mathématiques, le sang et l’idée s’irriguent mutuellement.
Douter ne suffit plus, mais il faut accueillir. Accueillir la vulnérabilité de sa propre respiration. Seules un sujet qui se reconnaît dépendant peut concevoir une moralité qui ne soit pas aussi domination. C’est la fin de l’homme cartésien – et peut-être le début de l’émergence de l’humain.

Chaque fois que nous choisissons d’écouter le battement avant d’aborder un sujet, chaque fois que nous mesurons la valeur d’un arbre aussi pour ce qui est intangible (ombre, parfum, récit), nous détachons une brique du mur érigé en 1619 par Descartes: cette erreur ne restera pas une condamnation, mais deviendra – peut-être déjà – la cicatrice qui nous rappelle comment marcher quand on est à nouveau entier. En boitant, peut-être, mais avec la Terre sous nos pieds.
L’erreur de Descartes n’était pas seulement une erreur: c’était une blessure. Une blessure qui a façonné la modernité et qui saigne encore dans les crises de notre temps. La reconnaître, c’est comprendre que la tâche de la philosophie n’est plus de fonder des certitudes abstraites, mais de recoudre les liens brisés.
14:01 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rené descartes, antonio damasio, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 16 novembre 2025
Une Proto-Noomachie douguinienne dans «Les Racines Métaphysiques des Idéologies Politiques»

Une Proto-Noomachie douguinienne dans «Les Racines Métaphysiques des Idéologies Politiques»
Raphael Machado
Les plus attentifs d'entre les observateurs politiques savent que l’« opus magnum » du philosophe russe Alexandre Douguine est la série en 25 volumes intitulée « Noomakhia » (littéralement «guerre des intellects/mentes»), regroupant plus de 15.000 pages consacrées à l’étude des structures noétiques des cultures humaines.

Les outils théorico-méthodologiques de l’œuvre — expliqués dans les deux premiers volumes — peuvent être condensés dans la découverte du caractère constitutif de trois éléments, aspects ou orientations — appelés par Douguine les « logoi » — qui opèrent comme des paradigmes noétiques, et qui, dans leurs multiples combinaisons et conflits, façonnent la manière dont chaque culture ou civilisation se développe.
Dans la réinterprétation douguinienne de la dualité Apollon/Dionysos théorisée par Nietzsche, Douguine ajoute au Logos d’Apollon et au Logos de Dionysos le Logos de Cybèle.


Superficiellement, on peut caractériser le Logos d’Apollon par son caractère vertical, exclusif, hiérarchique, transcendant, lumineux, masculin, etc. ; le Logos de Dionysos par son caractère médiateur, dialectique, extatique, transcendant-immanent, sombre, androgynique, etc. ; et le Logos de Cybèle par son caractère horizontal, inclusif, démocratique, immanent, obscur, féminin, etc.
Il s’agit de trois manières distinctes d’appréhender le monde, qui façonnent ainsi toutes les œuvres humaines.
Mais, malgré la relative nouveauté de cette formulation douguinienne, il est possible de retrouver, de manière involontaire, des racines possibles de cette « science noologique » dans un texte écrit trente ans plus tôt, « Les Racines Métaphysiques des Idéologies Politiques », un article dans lequel Douguine cherche à proposer une « méta-théologie politique » comme fondement ultime des principales idéologies politiques.
Il ne s’agit pas simplement d’une « théologie politique » à la Carl Schmitt, car ici il ne s’agit pas simplement d’associer des perspectives religieuses explicites, comme le déisme, à leurs expressions politiques possibles, comme le libéralisme classique, mais de remonter jusqu’aux éléments structurants qui sous-tendent même les perspectives théologiques.
Douguine identifie trois principes fondamentaux des idéologies politiques, qu’il nomme « Paradis Polaire », « Créateur-Création » et « Matière Magique ».

Le principe paradisiaque-polaire est identifié par Douguine comme correspondant au caractère absolu et singulier de la nature divine, où tout est conçu comme le reflet de cette même nature divine. Il n’existe pas de distance ou d’intermédiation entre le Sacré et la politique, qui n’est qu’une des clairières où apparaît le Sacré. Par le propre caractère concentré d’absoluité, Douguine voit dans ce principe une tendance monarchique et structurellement impériale (c’est-à-dire une aspiration à l’intégration de vastes territoires sous la tutelle de l’empereur), ainsi qu’un impulsion révolutionnaire et eschatologique.
Le principe créationniste est identifié comme correspondant à une perspective dualiste-dialectique de la réalité, dans laquelle le sujet et l’objet, l’homme et le monde, sont clairement séparés, même si en relation permanente marquée par l’altérité. Le sujet est lancé en périphérie du monde, derrière laquelle se cache le Créateur, et le Sacré n’émerge que par l’intermédiaire du sacerdoce. La forme politique de l’État-nation démocratique et d’autres formulations conservatrices sont imprégnées de cette perspective, dont l’impulsion fondamentale est la stabilisation de la réalité donnée.

Le principe magique-matérialiste est identifié par Douguine comme correspondant essentiellement à une forme de panthéisme. Le sujet n’existe pas en tant que tel, étant simplement un miroir du monde et un objet parmi d’autres immergé dans le monde. La relation au monde est purement instrumentale et guidée par des forces impersonnelles, de sorte que le rôle de l’homme dans le monde est interprété de manière mécaniste. Le monde, en tant que système autonome, identifié à la Raison, ne connaît comme seul mouvement possible que l’évolution. Et c’est ici que résident les tendances politiques niveleuses, comme le communisme et la social-démocratie.
Le principe paradisiaque-polaire et le principe magique-matérialiste peuvent être facilement associés, respectivement, au Logos d’Apollon et au Logos de Cybèle, mais le principe créationniste semble un peu plus éloigné du Logos de Dionysos. Ils se rapprochent dans la perception dualiste-dialectique de la réalité, mais il semble manquer une clarté quant à la nature transcendante/immanente (c’est-à-dire, de « l’Esprit incarné ») propre à la perspective dionysiaque. En réalité, le créationnisme se voit attribuer un caractère purement ésotérique, où le Sacré apparaît toujours comme quelque chose de distant et de médiatisé, tandis que, dans le dionysiaque, le Sacré est toujours à la portée de l’expérience extatique de l’initié. Il est intéressant de noter, cependant, comment Douguine voit dans les deux une connexion, entre autres, avec l’idéalisme actualiste de Giovanni Gentile.
Cette distance entre l’article des années 80 et la Noomakhia peut s’expliquer par le fait que, dans le mûrissement intellectuel de l'auteur, la perception claire des distinctions entre le Logos de Dionysos et le Logos de Cybèle n’apparaît qu’au sein de l’œuvre « À la recherche du Logos Sombre », qui précède la Noomakhia.
Un autre aspect intéressant de cet article, qui est l’un des premiers publiés par Douguine, est que dans son analyse de ce qu’il appelle « matérialisme magique », il est possible de repérer des aperçus de ce qui serait éventuellement développé sous la forme d'une « ontologie orientée objet », notamment dans sa description de l’homme comme un objet pur immergé dans un monde de forces impersonnelles qui dictent le développement autonome de la rationalité du monde.
14:59 Publié dans Nouvelle Droite, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre douguine, nouvelle droite, nouvelle droite russe, noomachie, philosophie, traditionalisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 15 novembre 2025
Philosophes païens en des temps troublés

Philosophes païens en des temps troublés
Ralf Van den Haute
Le terme « néoplatonisme » est une invention de Thomas Taylor (1758-1835), qui s’est fait connaître comme l’auteur de la première traduction anglaise des œuvres complètes de Platon et d’Aristote. Il a également traduit les œuvres de plusieurs autres philosophes et poètes, dont Proclus et Porphyre, deux soi-disant néoplatoniciens.
À partir du IIe siècle de notre ère, Platon regagne en importance dans la philosophie. L’aristotélisme et le stoïcisme se fondent dans ce courant, qui subit aussi l’influence d’un mysticisme intégrant des éléments du pythagorisme, de l’hermétisme ou des oracles chaldéens.
Le terme « néoplatoniciens » est imprécis, car ces philosophes se considéraient eux-mêmes comme les disciples de Platon, une élite, une « race consacrée », et affirmaient clairement qu’ils n’apportaient rien de nouveau. Il s’agit plutôt d’une forme authentique de platonisme, bien que d’autres influences soient également présentes.
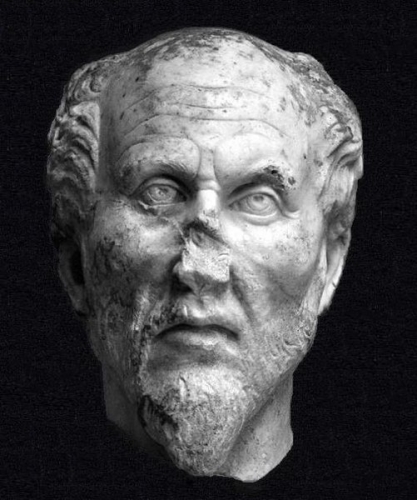
Le philosophe grec Plotin, né en Égypte (IIIe siècle), est considéré comme le fondateur de ce que l’on appellera bien plus tard le néoplatonisme.
Les néoplatoniciens tels que Ammonius Saccas, Plotin, Proclus, Julius Firmicus Maternus, Porphyre et Salluste vécurent à une époque de grands bouleversements culturels et religieux, à savoir la transition du paganisme au christianisme. À cette époque, aux IIIe et IVe siècles après J.-C., l’Empire romain était sous pression en raison de l’influence croissante du christianisme, et le polythéisme traditionnel était en déclin lorsque Constantin le Grand fit du christianisme la religion d’État et réprima sévèrement toute forme d’hérésie. C’est aussi l’époque où l’empereur Julien, après la mort de Constantin, rétablit le paganisme.
Bien que le néoplatonisme soit essentiellement un système philosophique issu des idées de Platon, avec une forte insistance sur l’unité de l’être (l’« Un »), il joue un rôle particulier dans le contexte du paganisme. Les néoplatoniciens considéraient le monde comme une structure hiérarchique remontant à une source ultime, l’« Un » ou le « Bien », et utilisaient cela comme base de leur vision du monde. Le panthéon traditionnel des dieux grecs et romains occupait également une place centrale chez les néoplatoniciens.
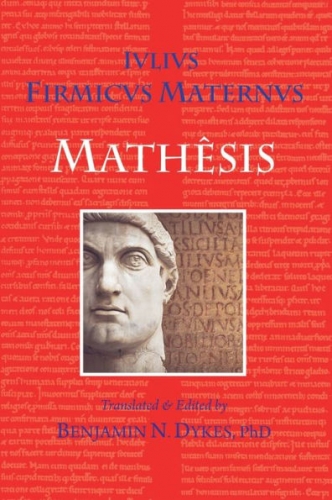
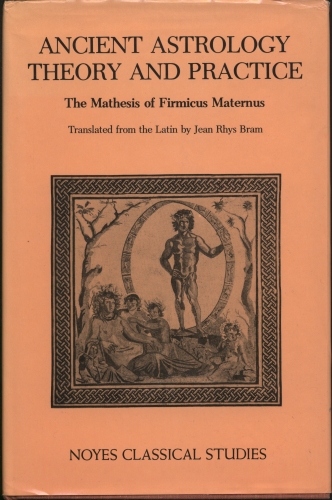
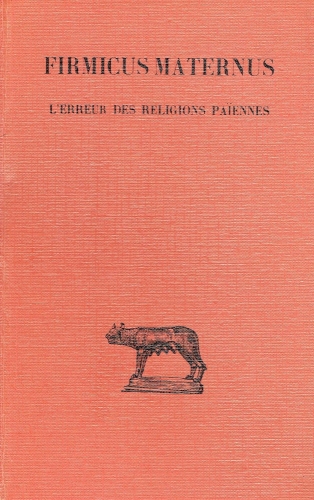
Que ces philosophes des IIIe et IVe siècles se trouvaient à un tournant de l’histoire se manifeste aussi dans leur attitude envers le christianisme. Julius Firmicus Maternus, avocat romain originaire de Syracuse en Sicile, s’est fait connaître avec les Matheseos Libri VIII, l’un des ouvrages les plus célèbres de l’astrologie classique, dans lequel il critique vivement les adversaires de l’astrologie. Il se convertit cependant au christianisme, renonça à l’astrologie et, vers 346, dans un autre ouvrage, De errore profanorum religionum, il présente le paganisme comme une erreur. Les convertis sont toujours les plus zélés : il appelle à la destruction de toutes les statues des dieux, à interdire toute activité dans les temples et à fondre les statues d’or et d’autres métaux pour en faire des pièces de monnaie. Il s’irritait surtout du fait que la plupart des Romains étaient encore païens – même si le christianisme était déjà la religion d’État depuis près de deux décennies. Cela contraste fortement avec ses opinions antérieures. Les autres néoplatoniciens étaient clairement hostiles à la religion révélée chrétienne.
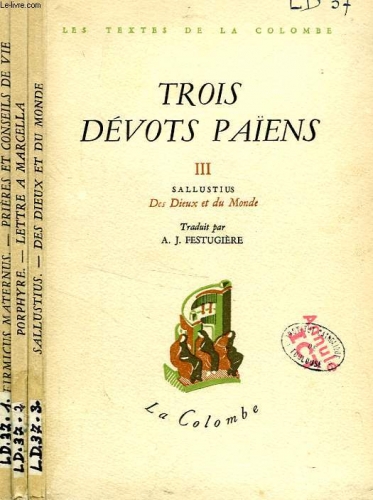
De l’astrologie au paganisme
Le lecteur sera peut-être surpris de voir l’astrologie et le paganisme mentionnés ensemble. A. J. Festugière, philologue classique qui a publié chez Arfuyen un recueil de textes de trois pieux païens – Firmicus, Porphyre et Salluste – souligne que l’astrologie dans l’Antiquité était davantage une religion qu’un art permettant de calculer, à partir de la position des astres, l’espérance de vie ou le succès d’une entreprise. Le ciel souvent clair du sud de l’Europe favorisait la contemplation et l’étude des corps célestes : la régularité des mouvements des étoiles et des planètes conduit naturellement à des réflexions sur l’ordre, la sagesse et l’infini. Festugière explique l’importance de l’astrologie antique pour les néoplatoniciens comme suit.
Les anciens Grecs ont probablement découvert l’astrologie et les oracles chaldéens via les Perses dans la seconde moitié du IVe siècle avant notre ère. La philosophie et les mathématiques grecques fusionnent alors en un ensemble particulier de science et de religion, que les Romains finiront aussi par connaître. Les étoiles se voient attribuer un statut similaire à celui des dieux. Le Soleil est une étoile particulière qui, par sa lumière et sa chaleur, est la source de toute vie. La Lune, autre astre proche, provoque les marées et influence le corps féminin. On percevait chez les planètes des correspondances subtiles avec le monde végétal et animal. Festugière : « Tout est Un. Le monde est un grand animal (l’auteur utilise le mot animal, qui signifie à l’origine “animé”), un être immortel et divin. »
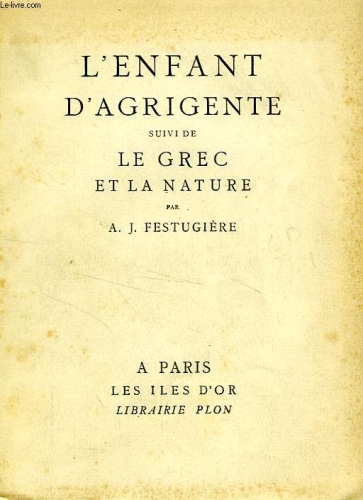
Au début de notre ère, cette religion astrale, fondée sur les étoiles, exerçait une influence bien plus grande qu’on ne l’imagine aujourd’hui. Elle était largement répandue parmi le peuple et les puissants de l’époque, à la campagne comme en ville. Sous les empereurs sévères (193-235 de notre ère), cette religion acquit un caractère officiel et donna un nouvel élan au paganisme déclinant. Il n’est donc pas surprenant que lorsque l’empereur Julien (IVe siècle de notre ère) voulut raviver la religion païenne, il le fit avec des hymnes dédiés au dieu Soleil, le Soleil invaincu, Sol Invictus.
Le culte des corps célestes provoqua aussi des conflits parmi les néoplatoniciens : un camp privilégiait une approche philosophique, l’autre se concentrait davantage sur les pratiques rituelles, et certains combinaient les deux aspects. Pendant des siècles, on a pu croire que les néoplatoniciens formaient une école cohérente, mais il ne faut pas oublier que tous ces philosophes n’ont pas vécu à la même époque et que leurs visions différaient donc.
Œuvres importantes
Les néoplatoniciens utilisaient divers textes et idées qui reflètent clairement leurs convictions païennes :
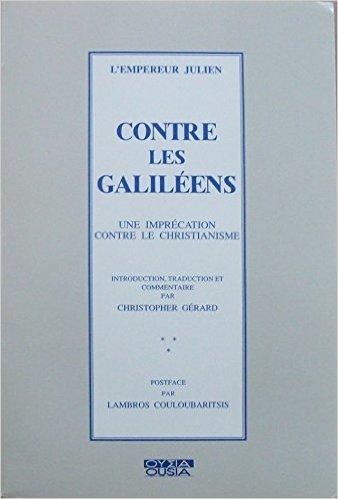
- Contre les Galiléens de l’empereur Julien. Un réquisitoire contre la secte des Galiléens, qu’il considère comme une simple tromperie humaine, sans dimension divine, séduisant les esprits faibles et transformant une fiction incroyable en vérité. Cette œuvre est fondamentale car elle va bien au-delà d’une accusation : Julien approfondit aussi l’essence du divin. Il se réfère à la définition du divin chez Platon et compare la vision platonicienne grecque à l’hébraïque.

- Les Ennéades de Plotin. Un recueil de traités philosophiques, notamment sur la structure hiérarchique de la réalité. La philosophie de Plotin est fortement centrée sur l’Un (qu’il appelle aussi le Bien), qui est la réalité suprême (par opposition à la matérialité). Remarquable : Plotin considère le mal comme un manque de Bien, et donc non comme une réalité absolue. Il est intéressant de noter que Plotin, élève d’Ammonius Saccas, s’intéressait aux mages perses et aux brahmanes indiens. Il n’a cependant pas pu réaliser son projet, car la campagne contre la Perse de l’empereur Gordien III, à laquelle il s’était joint, échoua et il dut rentrer bredouille.
- Le rôle des rituels : Des néoplatoniciens comme Porphyre et Salluste croyaient fermement au pouvoir des rituels, des sacrifices et de la vénération des dieux. Cela contraste avec le christianisme, qui s’opposait résolument aux rituels païens et cherchait à détruire les temples païens.
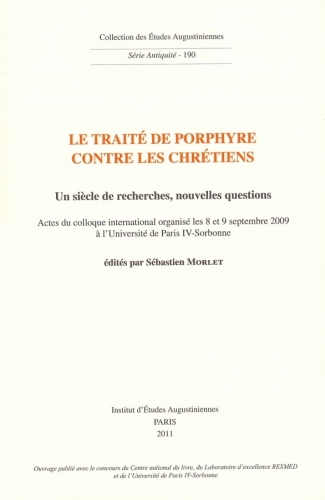
- Contre les chrétiens de Porphyre : Dans cette œuvre, le christianisme est critiqué comme incompatible avec la sagesse philosophique du paganisme. Porphyre soutenait que la théologie chrétienne n’était pas compatible avec la philosophie platonicienne, et que les chrétiens méprisaient à tort les temples et rituels traditionnels de l’Antiquité. Porphyre, élève de Plotin, fut l’un des plus éminents philosophes néoplatoniciens de son temps. Il était un adversaire déterminé du christianisme et écrivit plusieurs ouvrages sur ce sujet. Il défendait aussi les rituels païens et les pratiques des temples comme essentiels pour l’âme.
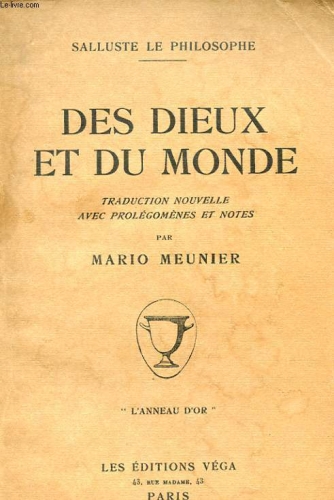
- Des dieux et du monde de Salluste : Cette œuvre offre une défense approfondie des anciennes religions grecques et romaines. Elle met en avant la conception platonicienne du divin comme source de tout, tout en restant fidèle aux conceptions païennes des dieux. Il discute de la relation entre le monde et les dieux, et de la façon dont la nature elle-même peut être vue comme une manifestation du divin. Ses idées sont proches de la vision néoplatonicienne de l’« Un » comme source de tout et insistent sur les rituels, les sacrifices et la nécessité de l’observance religieuse. Salluste n’était d’ailleurs pas opposé à l’idée pythagoricienne de la réincarnation, largement répandue dans le Bas-Empire romain.
Bien que les philosophes néoplatoniciens fussent essentiellement païens, on peut dire que leur paganisme ne correspond pas exactement aux anciennes religions polythéistes de l’Antiquité classique. Ils interprétaient l’ancienne religion et les rituels grecs à travers un prisme philosophique, fortement influencé par les idées de Platon sur la hiérarchie de la réalité et le rôle de l’« Un ». Leurs œuvres reflètent leur confiance dans le paganisme, la philosophie platonicienne et la nécessité des rituels, mais ils s’opposaient aussi au christianisme naissant et aux changements qu’il apportait. Les néoplatoniciens étaient très conscients de leur rôle de maillon dans une « chaîne d’or ».
Des néoplatoniciens comme Porphyre et Salluste croyaient fermement au pouvoir des rituels, des sacrifices et de la vénération des dieux. Cela contraste avec le christianisme, qui s’opposait résolument aux rituels païens. La pensée païenne fut combattue par tous les moyens par le gnosticisme puis par le christianisme. Parmi l’élite, il n’y avait pas seulement un scepticisme croissant. Salluste déplore le grand nombre d’athées, c’est-à-dire ceux qui ne reconnaissent pas les dieux grecs. Il comptait probablement aussi les chrétiens parmi eux. Beaucoup, dans le Bas-Empire romain, n’adhéraient à aucune religion. Sur ce point, rien de nouveau sous le soleil.
Les néoplatoniciens restent un phénomène remarquable en ce qu’ils se trouvent à la frontière de deux époques. Ils font encore partie de la fin de l’Antiquité, mais le début du Moyen Âge est déjà à la porte. Leurs textes païens, issus de la période où le paganisme, après quelques derniers sursauts, fut supplanté par le christianisme dans une grande partie de l’Europe, sont aussi importants pour cette raison : leur quête d’une piété polythéiste est une quête éternelle qui ne nous est pas étrangère à notre époque.

Hymne polythéiste
Pour conclure cette brève introduction à l’univers des néoplatoniciens, j’avais d’abord pensé à un hymne de Proclus, mais j’ai finalement choisi un hymne à Hécate et Janus du même auteur. Hécate, déesse grecque associée aux mystères, protectrice des femmes enceintes et de la jeunesse, est aussi liée à la frontière entre le monde des vivants et celui des morts.

Janus est un dieu romain, dont le temple sur le forum romain était rituellement ouvert en temps de guerre et fermé en temps de paix, et qui a donné son nom au mois de janvier. Il est lié au passage du temps. Il est le dieu romain des commencements et des fins, des choix et des portes. Ovide écrit à son sujet : « Je veille, avec la bienveillante troupe des Heures (horae, dont le mot français “heure” est dérivé, signifie saisons, donc le temps), sur les portes du ciel, et Jupiter ne peut entrer ni sortir sans moi. » Janus, également connu sous le nom de Januspater, occupe une place importante dans la hiérarchie religieuse romaine et, avec Mars – Marspiter – et Jupiter, il est le seul à porter le titre de dieu père. Hécate et Janus sont tous deux des divinités des frontières, et plus précisément de la frontière entre l’humain et le divin, et peuvent protéger les hommes de tout danger. Proclus leur demande dans cet hymne protection contre la maladie, et de l’aider dans sa quête de lumière et de piété. La forme de cet hymne est particulière, car l’invocation des dieux au début est répétée à la fin.
Salut, Mère des dieux aux noms multiples, aux beaux enfants
Salut, Hécate, gardienne des portes, à l’immense force.
Mais, à toi aussi, salut, Janus, premier Aïeul, Zeus impérissable, salut, Zeus, Dieu Suprême.
Rendez la course de mon existence radieuse, chargée de biens; chasse de mes membres les funestes maladies, et mon âme perdue de folie pour le séjour terrestre, tirez-la, après l’avoir purifiée par les mystères qui éveillent l’intellect.
Oui, je vous en supplie, donnez-moi la main, montrez-moi, c’est mon désir, les chemins indiqués par les dieux ; et que je voie la très précieuse lumière, qui permet de fuir la misère du monde de la génération sombre comme la mer.
Oui, je vous en supplie, donnez-moi la main, et pour me faire aborder, recru de fatigues, dans le port de la piété, pousse-moi par vos venst.
Salut, Mère des dieux aux noms multiples, aux beaux enfants
Salut, Hécate, gardienne des portes, à l’immense force.
Mais, à toi aussi, salut, Janus, premier Aïeul, Zeus impérissable, salut, Zeus, Dieu Suprême.
Bibliographie:
- Proclus, Hymnes et prières. Traduction Henri D. Saffrey. Arfuyen, Paris, 1994.
- Trois dévots païens. Traduction A.J. Festugière. Arfuyen, Paris, 1994.
Source : Traduction d’un texte paru dans Traditie, Jaarboek voor traditionele erfgoedbeleving in de lage landen, Brasschaat 2025. ISBN 9789491436260
18:14 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, néo-platoniciens, antiquité grecque, antiquité romaine, philosophie grecque, paganisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 13 novembre 2025
Douguine et la Kabbale - Les racines sacrées que le libéralisme veut oublier

Douguine et la Kabbale
Les racines sacrées que le libéralisme veut oublier
Constantin von Hoffmeister
Constantin von Hoffmeister examine comment un débat mal cité montre un Alexandre Douguine invoquant la Kabbale pour tenter d'expliciter le rejet du sacré par la modernité libérale.
Peu de penseurs contemporains ont été aussi systématiquement mal interprétés qu’Alexandre Douguine. Ses détracteurs n’abordent que rarement ses véritables propos. Au lieu de cela, ils se basent sur des fragments extraits d’échanges plus longs, présentés isolément pour donner l’illusion qu'il répand de l'irrationalité ou du fanatisme. Un exemple récent concerne son supposé « éloge de la Kabbale ». En réalité, cette phrase provient d’un débat de 2017 entre Douguine et l’intellectuel juif américain libéral Leon Wieseltier, et lorsqu’on l'examine dans son contexte complet, la signification s'avère tout autre.
Voici la vidéo :
Le débat a eu lieu devant un public d’universitaires occidentaux, dont plusieurs penseurs juifs libéraux, parmi lesquels le futur secrétaire d’État américain Antony Blinken. La tâche de Douguine dans ce cadre était d'ampleur formidable: défendre l’idée de Tradition, d’ordre métaphysique, et de dignité spirituelle des peuples face à un public profondément emberlificoté dans l’universalisme des Lumières.
Wieseltier commence par déclarer l’obsolescence de toute sagesse traditionnelle:
"Il n’y a absolument rien de nouveau dans le populisme, et il n’y a absolument rien de nouveau dans la foi mystique et la sagesse du peuple. Ce sont des idées très anciennes et, à mon avis, de très vieilles erreurs, parce qu’une des choses que montre l’histoire…". Etc.
Dans cette introduction, Wieseltier rejette à la fois le populisme et la tradition mystique comme des erreurs dépassées, des reliques d’une époque pré-rationnelle. Son argumentation implique que tous les appels à « la sagesse du peuple » ou à l’héritage sacré doivent en fin de compte conduire à la tyrannie ou à la folie. C’est la thèse libérale classique: que la liberté est sauvegardée par le scepticisme, par la raison procédurale, et par la neutralisation délibérée de l’âme collective.
Douguine l’interrompt avec une déclaration provocante, qui touche aux racines de la civilisation même de son adversaire:
"La tradition de la Kabbale est la plus grande réalisation de l’esprit humain".
La phrase, si souvent citée contre lui, n’était pas un sermon mais un défi. Douguine invoquait la tradition cabalistique — si profondément ancrée dans la métaphysique juive — comme l'exemple d’un héritage spirituel vivant. Ce faisant, il forçait Wieseltier à faire face à un paradoxe: comment peut-on nier la valeur de la Tradition tout en appartenant à un peuple dont le système mystique a inspiré des siècles de vie intellectuelle et religieuse?
Wieseltier répond en insistant, avec l’autorité calme d’un rationaliste libéral:
"Mon ami, j’ai étudié la Kabbale toute ma vie en hébreu, et je dois vous dire que cela n’a absolument rien à voir avec la sagesse du peuple. Ce que montre l’histoire, c’est que la sagesse du peuple devient souvent une justification pour des crimes terribles. Et que ce qui est présenté comme la sagesse du peuple peut conduire directement au mal. Et si nous nous référons au système américain, assurément, lorsque les Pères fondateurs ont écrit notre Constitution, ils ont pris le populisme en considération. Ils l’ont appelé démocratie directe. Et ils l’ont rejeté au profit de la démocratie représentative, précisément pour permettre la délibération et la prise en considération rationnelle des questions auxquelles le pays est confronté".

Cette réponse est révélatrice. Wieseltier (photo) rejette explicitement toute association entre la sagesse kabbalistique et l’esprit collectif d’un peuple. Il met en garde que ce qu’on appelle « la sagesse du peuple » peut devenir «une panoplie de justifications pour des crimes terribles». Pour lui, les pères fondateurs de la démocratie (américaine) avaient raison de supprimer la participation directe au profit d’un ordre médiatisé et technocratique: un ordre de raison oblitérant l’âme, un ordre de délibération dominant toute passion, et un ordre universaliste bridant tout réflexe identitaire.
L’intervention brève de Douguine, lorsqu’elle est replacée dans son contexte, prend toute sa portée philosophique. Il ne « promeut pas la Kabbale » pour les Russes orthodoxes ni ne loue le mysticisme juif. Il confronte son adversaire avec son propre héritage sacré, en l’utilisant comme un prisme pour révéler ce que le libéralisme moderne a perdu. La remarque de Douguine, « La tradition de la Kabbale est la plus grande réussite de l’esprit humain », est un appel ironique mais sérieux à la réalité de la transcendance—un appel à l’idée que l’humanité a un jour cherché à comprendre la structure divine de l’être, et que cette aspiration est supérieure au pragmatisme gestionnaire de la modernité.

Pourtant, isolée, cette seule ligne, extraite du flot de ses paroles, a été instrumentalisée pour dépeindre Douguine comme un crypto-mystique prêchant déraisonnablement des doctrines ésotériques aux masses. La vidéo complète réfute cela. Elle montre un philosophe rigoureux utilisant la rhétorique stratégiquement, poussant son adversaire à reconnaître qu’au sein même de la tradition juive, il y eut autrefois une hiérarchie de sens et une conception de l’ordre cosmique totalement étrangère à l’égalitarisme libéral.
Nous avons là l’essence de la confrontation de Douguine avec la pensée occidentale: la défense de la Tradition contre la réduction de toutes les valeurs à une neutralité procédurale. Dans le même débat, il parle de Trump, du retour de l’histoire, du besoin de pluralité civilisationnelle, et on peut percevoir un réel malaise dans le public. Les intellectuels libéraux, habitués à parler depuis le sommet moral du « progrès », rencontrent soudain un homme qui rejette totalement leur cadre conceptuel.
Le débat de 2017 reste l’une des rencontres les plus illustratives entre deux visions du monde: l’une qui vénère le sacré, et l’autre qui idolâtre l’autosuffisance de la raison. Lorsqu’il parle de la Kabbale, Douguine n’abandonne pas l’orthodoxie ou la Russie. Au contraire, il rappelle à ses auditeurs et critiques que même leurs propres traditions religieuses ont autrefois aspiré à l’Absolu. Ce geste — philosophique, rhétorique et civilisationnel — reste entièrement fidèle à son projet plus large: ressusciter un monde où l’esprit, et non l’abstraction, détermine le destin des peuples.
Le populisme, dans son sens le plus profond, transcende la division conventionnelle gauche/droite. C’est le pouls de la volonté collective: le cri d’un peuple en quête de sens contre la stérilité corporatiste. Qu’il soit habillé de couleurs socialistes ou nationalistes, le populisme affirme que la politique n’est pas une simple gestion, mais une destinée, la renaissance de l’esprit dans l’histoire.
La Kabbale est une manière ancienne du judaïsme de voir le monde comme une chaîne vivante entre Dieu et l’homme. Des fragments tombent, des lettres se réagencent, et la lumière perce le code. La Kabbale enseigne que toute la création coule à travers dix étapes d’énergie divine, reliant le ciel et la terre. Des griffonnages dans les marges, des circuits de souffle, le courant divin reconfiguré. Chaque partie de la vie reflète ce motif, des mouvements des étoiles aux pensées d’une personne. Un nom se plie en un autre, des étincelles tombent à travers l’alphabet. Étudier la Kabbale, c’est rechercher comment l’esprit se déplace à travers le monde et en soi, donnant ordre, sens et direction à l’existence. Tout se connecte, se disperse et revient, tout se réécrit dans la lumière.
12:12 Publié dans Nouvelle Droite, Philosophie, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre douguine, nouvelle droite, nouvelle droite russe, tradition, traditionalisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 03 novembre 2025
Il faut relire les oeuvres d'Arnold J. Toynbee
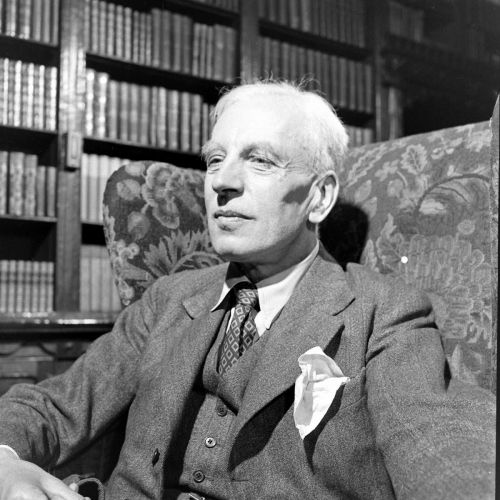
Il faut relire les oeuvres d'Arnold J. Toynbee
Rodolfo S. Souza
Source: https://www.facebook.com/rodolfo.souza.7
Arnold J. Toynbee, qui est aujourd'hui malheureusement tombé dans l'oubli, fut l'un des plus grands historiens du 20ème siècle. Son ouvrage « A Study of History » (publié en 12 volumes entre 1934 et 1961) est l'un des plus grands traités théoriques d'histoire comparée, au même titre que des ouvrages tels que « Le Déclin de l'Occident » d'Oswald Spengler. « A Study of History » attire l'attention tant par son immense érudition que par l'ambition épistémologique et spirituelle de sa vision: formuler une métathéorie de l'histoire humaine qui ne se réduit à aucune science particulière, ni à une simple succession de faits — une histoire qui est à la fois philosophie, théologie et diagnostic civilisationnel.
Pour Toynbee, l'histoire ne doit pas être racontée à partir des États, des empires ou des individus, mais à partir des civilisations: de grandes totalités culturelles, spirituelles et sociales. Il a identifié environ 21 civilisations, des Sumériens et des Hellènes à l'Occident moderne, et a cherché à comprendre comment elles apparaissent, s'épanouissent et déclinent. Son originalité réside dans le fait qu'il ne considérait pas les civilisations comme des entités déterminées par la race ou la géographie, mais comme des organismes spirituels, façonnés par des réponses créatives aux défis de l'existence. Chaque civilisation naît d'un défi environnemental, social ou spirituel (famine, invasions, désordre moral, perte de sens) et ne survit que si une élite créative (une minorité inspirée) répond de manière adéquate à ce défi, en générant de nouvelles institutions, de nouvelles valeurs et de nouveaux modes de vie.

Lorsque cette élite perd son dynamisme, elle devient une minorité dominante (au lieu d'être créative), et la civilisation entre alors en déclin, remplacée par la passivité et la révolte des masses. Contrairement au biologisme d'Oswald Spengler, Toynbee rejette le déterminisme. Aucune civilisation n'est condamnée à mourir: sa mort survient lorsqu'elle perd le contact avec son élan spirituel originel, c'est-à-dire lorsque ses institutions cessent de servir la vocation créative et religieuse qui les a fondées. Le déclin est donc moral et spirituel, et pas seulement matériel ou politique.
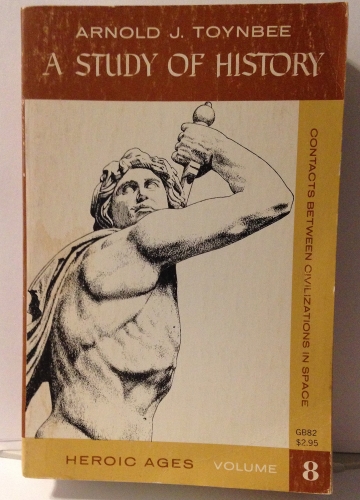
Toynbee réintroduit également l'élément religieux dans la philosophie de l'histoire, à une époque dominée par le matérialisme historique et la sociologie sécularisée. Il croyait que le sens de l'histoire réside dans un rapprochement progressif avec le divin, et que les religions universelles (en particulier le christianisme, le bouddhisme et l'hindouisme dans leurs dimensions mystiques) représentent des tentatives de transcender le cycle d'ascension et de chute des civilisations.
Dans ses derniers volumes, Toynbee en vient à parler d'une histoire dont le point culminant n'est pas politique, mais spirituel: la quête humaine de l'union avec l'Absolu. Ce tournant mystique situe sa pensée en dehors du positivisme, du libéralisme et du marxisme.
14:55 Publié dans Histoire, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : arnold j. toynbee, histoire, philosophie de l'histoire, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook





