mardi, 28 janvier 2025
Le triomphe de la stupidité

Le triomphe de la stupidité
Par Juan Manuel de Prada
Source: https://noticiasholisticas.com.ar/el-triunfo-de-la-estupi...
Dans son dernier essai, El triunfo de la estupidez (publié chez Plaza y Janés), Jano García aborde une question politique épineuse, à savoir l'intronisation par tout dirigeant malin de la stupidité humaine comme mortier sur lequel fonder son pouvoir. Cette intronisation de la stupidité atteint son paroxysme, selon l'auteur, dans la démocratie, où les masses sont flattées comme dans aucune autre forme d'organisation politique, car le dirigeant a besoin de leur soutien pour rester au pouvoir, et où les passions viles sont élevées au rang de vertus publiques, en particulier l'envie. En fait, en établissant ce lien entre l'envie et la démocratie, Jano García ne va pas plus loin que ce contre quoi de nombreux maîtres nous ont mis en garde ; souvenons-nous, par exemple, de ces vers d'Unamuno qui nous avertissaient que lorsque « l'envie déverse son fiel sur une foule vide/de reconnaissance à l'appel sourd/elle la quitte habituellement et la transforme en une horde/qu'elle est la mère de la démocratie ».
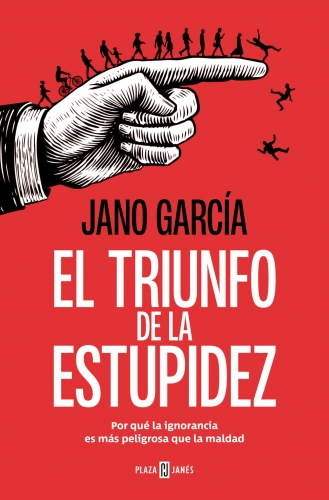
Bien sûr, cette « mère de la démocratie » doit se déguiser en justice sociale. Non seulement pour piller les riches, comme le souligne Jano García, mais en général pour dégrader et humilier tout ce qui est bon ou beau, car les envieux ont besoin de voir piétinées les vertus qu'ils ne peuvent atteindre. L'envieux, comme le souligne Jano García, « ne sera jamais assez satisfait du pillage dont souffre son prochain jusqu'à ce qu'il soit réduit au même niveau que lui ».
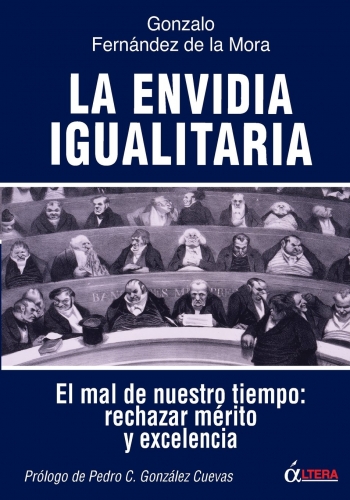
C'est en effet le cœur pourri de la démocratie qui, dans cette dernière phase de dégénérescence, atteint son paroxysme par l'intronisation de démagogues qui, en attisant les basses passions de la foule, réalisent leurs desseins les plus néfastes. Dans son essai, Jano García expose avec brio les ravages que cette « envie égalitaire » - pour reprendre l'expression de Gonzalo Fernández de la Mora - est en train de causer à la communauté politique.
Dans son ouvrage de référence La démocratie en Amérique, Alexis de Tocqueville avait déjà prévu ces ravages: « Les nations de notre temps ne peuvent éviter l'égalité des conditions dans leur sein, mais il dépend d'elles que cette égalité les conduise à la servitude ou à la liberté, à la civilisation ou à la barbarie, à la prospérité ou à la misère ». Tocqueville a averti que la démocratie favoriserait une nouvelle forme de despotisme, dans laquelle il suffirait au despote d'aimer l'égalité, ou même de faire semblant de l'aimer, pour que les masses rejettent toute atteinte à l'égalité, en renonçant en échange à leur liberté politique. C'est cette recette qu'utilise le Dr Sánchez, face à une société qui ne bronche pas et à une droite molle, enfermée dans la cage mentale de ses distorsions cognitives.
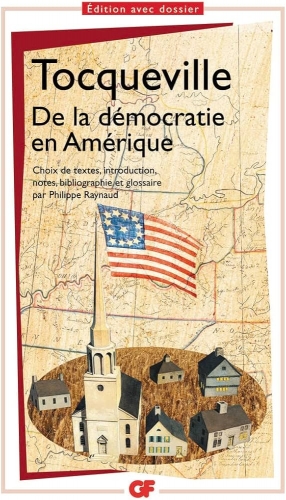
Jano Garcia nous montre comment l'égalité des chances, si nécessaire au maintien d'une société saine, s'est dégradée en un égalitarisme avilissant qui prétend que les ignorants peuvent réduire au silence les sages, que les paresseux peuvent vivre dans l'opulence aux dépens des travailleurs, que les vils peuvent mépriser et stigmatiser les nobles de manière olympique. Comme l'observait Tocqueville, l'égalité produit deux tendances: l'une conduit directement les hommes à l'indépendance, l'autre les conduit par une voie plus longue et plus secrète, mais plus sûre, au servage. Sans doute notre époque maudite a-t-elle choisi la voie de la servitude, qui aboutit à ce que Tocqueville lui-même appelle « la tyrannie de la majorité », où s'imposent un égalitarisme castrateur et une subversion de toutes les hiérarchies. Et cette passion égalitaire devient encore plus monstrueuse lorsqu'elle se mêle à l'obsession du bien-être, qui transforme l'être humain en victimaire avide de confort matériel et de « nouveaux droits ».
Dans un passage de son ouvrage, Jano García affirme que les stupides sont beaucoup plus dangereux que les méchants, « car un méchant, pour réaliser son plan diabolique, a toujours besoin de la participation des autres pour atteindre son but ». Un dirigeant malfaisant a en effet besoin de masses crétinisées pour se hisser et se maintenir au pouvoir. Mais si ce sont les méchants qui mobilisent les stupides, les méchants sont sans doute les plus dangereux, car ils sont à l'origine du mal, même si l'union des stupides est tragique. En effet, un noble souverain peut transformer les stupides en gens laborieux ; il peut stimuler chez eux les conduites les plus vertueuses et les plus bienfaisantes ; il peut susciter chez eux un désir d'émulation et les ennoblir, enfin, jusqu'à l'héroïsme ou à la sainteté. En revanche, un chef méchant, outre qu'il flatte les stupides, peut aussi les rendre méchants en suscitant en eux les passions les plus viles.
Un noble souverain s'efforce d'ordonner la société de façon hiérarchique, de telle sorte que les capacités de chacun, en prenant la place qui leur revient, agissent au profit des capacités des autres, en les renforçant. Le mauvais souverain, au contraire, ne fera rien d'autre que d'exciter l'envie de ceux qu'il gouverne, pour laquelle il a besoin de subvertir toutes les hiérarchies humaines, de détourner l'éducation, de frelater l'opposition, d'encourager les exigences les plus iniques et les pillages les plus sanglants. Et ainsi de suite, jusqu'à transformer la société qu'il gouverne en un pandémonium où triomphent les satans les plus bas. Mais il y a toujours des hommes bons qui parviennent, avec l'aide de Dieu, à vaincre le mal et la bêtise. Jano García en parle également dans son splendide essai ; mais il doit s'agir d'hommes prêts à être mis en pièces par la meute.
15:56 Publié dans Livre, Livre, Philosophie, Sociologie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : envie, stupidité, livre, philosophie, philosophie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 26 janvier 2025
Identité politico-civilisationnelle et période axiale chez l'égyptologue et philosophe allemand Jan Assmann
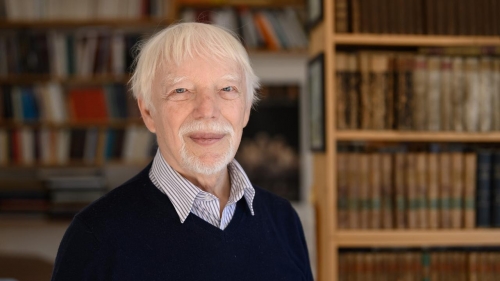
Identité politico-civilisationnelle et période axiale chez l'égyptologue et philosophe allemand Jan Assmann
NdlR: Soucieux d'approfondir les thèses énoncées par Jan Assmann, nous présentons ici un résumé succinct des deux thèmes majeurs de sa pensée, en attendant de nous immerger plus complètement dans les méandres de celle-ci. Aborder la notion de "période axiale" implique de se rappeler des thèses de Karl Jaspers et de Karen Armstrong. Les réponses ci-dessous sont "neutres" et ne révèlent pas notre approche critique de cette notion qui interpelle directement notre vision de l'histoire, Armin Mohler et Giorgio Locchi nous ayant légué également une interprétation rupturaliste de la notion de "période axiale".
Le philosophe allemand contemporain Jan Assmann a écrit des pages d'une grande profondeur sur "l'écriture, la mémoire et l'identité politique dans les hautes cultures de l'antiquité". De même, il a consacré un ouvrage à la "période axiale" de l'histoire, thème qu'avait inauguré le philosophe protestant Karl Jaspers. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste sa vision de l'identité politique des hautes civilisations de jadis et en quoi consiste son approche des "périodes axiales de l'histoire, et, accessoirement, quelle est la différence entre son approche et celle de Karl Jaspers?
1) La vision de Jan Assmann sur l'identité politique des hautes civilisations
Jan Assmann, égyptologue et spécialiste de la mémoire culturelle, explore comment les civilisations antiques ont construit leur identité politique autour de pratiques mémorielles, d'institutions religieuses et de formes spécifiques d'écriture. Sa réflexion repose sur plusieurs idées centrales :
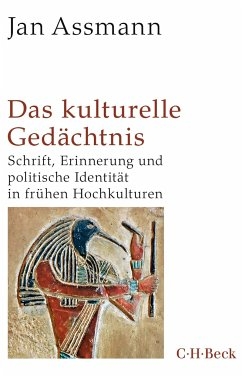
L’écriture et la mémoire culturelle
Assmann distingue la mémoire culturelle de la mémoire communicative.
La mémoire culturelle est le socle d’une identité collective, transmise sur plusieurs générations, souvent à travers des supports écrits, des mythes, des rituels et des monuments.
Les civilisations antiques, comme l'Égypte, ont utilisé l’écriture pour archiver leurs lois, rituels religieux et récits fondateurs, qui servaient à structurer et légitimer leur identité politique et culturelle.
L’écriture permet ainsi de figer le temps et de relier les générations présentes aux mythes fondateurs, en construisant une continuité historique et une légitimité politique.
Identité politique et théologie
Assmann souligne que, dans les hautes cultures, l'identité politique est souvent enracinée dans une conception théologique du pouvoir. Par exemple, en Égypte ancienne, le pharaon n’est pas simplement un dirigeant politique, mais l’intermédiaire entre les dieux et les hommes. Cette fusion du pouvoir divin et politique est un trait clé des premières civilisations complexes.
Il introduit également le concept de "distinction mosaïque", en opposition au polythéisme, pour analyser l’émergence du monothéisme (notamment dans le judaïsme) et son rôle dans la formation d’identités politiques exclusives, fondées sur des frontières entre le "vrai" et le "faux" dieu.
Le rôle des récits fondateurs
Les mythes, lois et rituels ne sont pas de simples traditions, mais des outils politiques puissants pour consolider le pouvoir, maintenir l’ordre social et justifier les institutions.
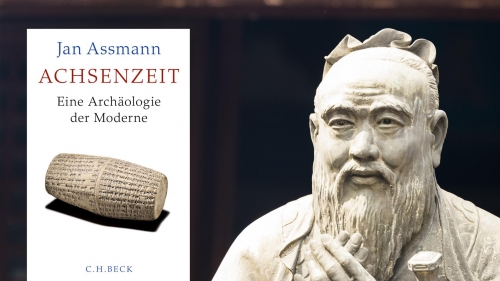
2) La "période axiale" chez Jan Assmann et Karl Jaspers
Le concept de "période axiale" selon Karl Jaspers
Karl Jaspers, philosophe protestant, a introduit le concept de période axiale dans son ouvrage Vom Ursprung und Ziel der Geschichte (1949). Il identifie une période historique charnière, située entre 800 et 200 avant notre ère, où plusieurs civilisations à travers le monde ont simultanément connu des révolutions spirituelles et intellectuelles majeures.
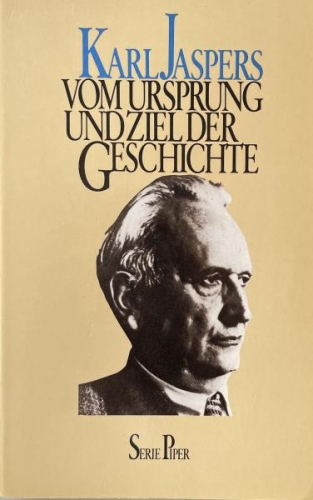
Cette période voit l'émergence de grandes figures fondatrices comme Confucius, Bouddha, Socrate, les prophètes hébraïques, et des textes fondamentaux tels que les Upanishads ou les dialogues platoniciens.
Pour Jaspers, cette période marque un tournant où l’humanité prend conscience de la transcendance, de l’individu et de l’éthique universelle.
La relecture de la période axiale par Jan Assmann
Jan Assmann reprend le concept, mais il y apporte une approche anthropologique et culturelle :
Il insiste sur le rôle des pratiques mémorielles et des textes écrits dans la transmission des idées de la période axiale. Selon lui, cette période est également marquée par une transition vers des formes d'identités collectives basées sur des textes fondateurs et des traditions mémorisées (ex. la Torah dans le judaïsme ou les Védas dans l’hindouisme).
Contrairement à Jaspers, qui met l’accent sur une évolution presque spirituelle et universelle de l’humanité, Assmann analyse les spécificités culturelles et historiques de chaque civilisation. Il soutient que les changements de la période axiale ne sont pas universels, mais fortement dépendants des contextes sociaux, politiques et religieux locaux.
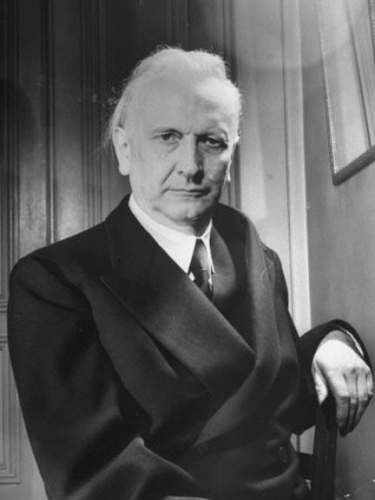
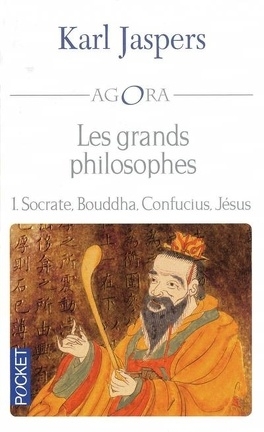
Différences entre Jaspers et Assmann
Approche universaliste vs particulariste :
Jaspers interprète la période axiale comme une évolution collective et presque simultanée de l’esprit humain vers des valeurs transcendantales.
Assmann, au contraire, insiste sur le rôle des systèmes de transmission culturelle et les diversités de chaque culture.
Centralité des textes et de la mémoire :
Jaspers met en avant les idées philosophiques et spirituelles universelles, tandis qu’Assmann insiste sur le rôle des textes écrits et des institutions mémorielles dans la formation des identités politiques et religieuses.
Émergence du monothéisme :
Assmann explore davantage les implications de la période axiale pour l'émergence du monothéisme, qu’il considère comme une révolution culturelle ayant des conséquences profondes sur les identités collectives.
3) En résumé
Jan Assmann apporte une profondeur anthropologique au concept de Jaspers, en examinant comment les textes, les pratiques mémorielles et les institutions ont contribué à structurer les identités politiques et religieuses des hautes civilisations. Là où Jaspers voit une évolution universelle de l'esprit humain, Assmann met en lumière la diversité des réponses culturelles et historiques, tout en montrant comment elles ont influencé la mémoire collective et l’organisation sociale.

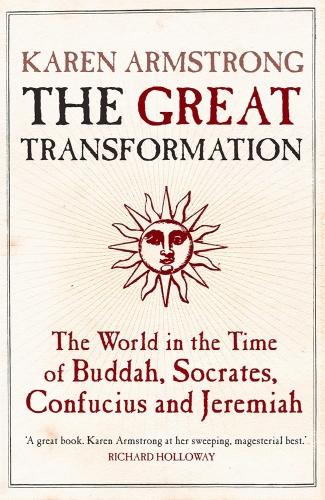
Et quel est le rapport entre ces deux philosophes allemands, qui ont planché sur la notion de "période axiale" et les travaux de Karen Armstrong dans l'anglosphère qui, elle aussi, réanime cette thématique philosophique qui avait été quelque peu oubliée?
Karen Armstrong, dans l’anglosphère, reprend et développe le concept de "période axiale" introduit par Karl Jaspers, en y apportant une perspective qui dialogue indirectement avec les travaux de Jan Assmann et enrichit l'approche en l'adaptant à des préoccupations contemporaines. Voici les liens et divergences entre ces trois penseurs :
1) Karl Jaspers et la conceptualisation initiale
Jaspers introduit l’idée d’une période axiale comme une époque historique entre 800 et 200 avant notre ère où les grandes civilisations du monde (Inde, Chine, Proche-Orient, Grèce) ont connu des transformations spirituelles et intellectuelles fondamentales.
Pour lui, cette époque marque la naissance des grands cadres de pensée universelle, comme la quête de transcendance, la réflexion éthique, et l’idée de l’individu en tant qu’agent moral.
Cette vision universaliste a marqué la réflexion philosophique et reste un socle théorique pour les travaux ultérieurs.
2) Jan Assmann et l’approche anthropologique
Assmann reprend l’idée de Jaspers, mais en s'intéressant aux mécanismes culturels qui ont permis la transmission des idées axiales.
Il met un accent particulier sur la mémoire culturelle et les textes fondateurs comme outils de transmission et de structuration des sociétés. Il explore notamment le rôle du monothéisme, qui émerge dans cette période, et ses implications sur l’identité collective et politique.
Là où Jaspers voyait une évolution presque simultanée et universelle de l’humanité, Assmann insiste sur les variations culturelles et les contextes historiques spécifiques des transformations de cette période.
3) Karen Armstrong et la réhabilitation de la période axiale
Dans son ouvrage The Great Transformation (2006), Karen Armstrong revisite le concept de période axiale avec un objectif clair: démontrer la pertinence contemporaine de cette époque fondatrice pour répondre aux crises éthiques, spirituelles et politiques actuelles.
Elle met en avant une lecture plus théologique et humaniste des figures et courants de cette période (Bouddha, Confucius, Socrate, les prophètes hébreux, etc.), en insistant sur leur quête commune: résoudre la souffrance humaine et instaurer une éthique universelle basée sur la compassion et la justice.
Elle partage avec Jaspers l’idée que ces transformations ont eu lieu simultanément dans des régions éloignées, mais elle souligne également leur intemporalité, en montrant comment elles peuvent inspirer le monde contemporain.
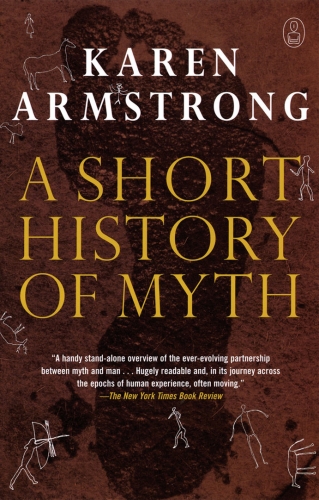
4) Points de convergence entre Armstrong, Jaspers et Assmann
Une humanité en quête de transcendance et d'éthique :
Tous trois voient la période axiale comme une étape cruciale où l’humanité a développé des outils pour penser la condition humaine, la souffrance et le sens de l’existence.
Importance des figures fondatrices :
Jaspers met l’accent sur les grands penseurs, Assmann sur leurs textes et contextes, tandis qu’Armstrong explore leur message moral et spirituel.
Relecture de cette période pour le présent :
Armstrong, comme Assmann, fait un lien explicite entre les enseignements de cette époque et les défis contemporains, qu’il s’agisse de violence religieuse, de crise de sens ou de conflits identitaires.
5) Différences entre Armstrong et les philosophes allemands
Avec Jaspers :
Armstrong dépasse la vision purement philosophique ou métaphysique de Jaspers en mettant l’accent sur les dynamiques sociales et pratiques des religions de la période axiale. Elle insiste notamment sur leur rôle dans la création d’une éthique universelle fondée sur la compassion, une dimension que Jaspers aborde moins directement.
Avec Assmann :
Là où Assmann explore la période axiale à travers le prisme de la mémoire culturelle et des textes, Armstrong adopte une approche plus narrative et accessible, centrée sur les enseignements moraux des grandes figures axiales.
Armstrong insiste davantage sur les éléments de continuité spirituelle entre cette période et les enjeux actuels. Assmann, pour sa part, est plus attentif aux ruptures qu’elle introduit, notamment avec la "distinction mosaïque" et les tensions qu’elle crée dans les conceptions religieuses.
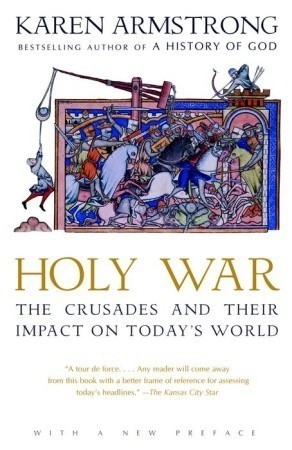
6) Une synthèse des trois approches
Karen Armstrong peut être vue comme un pont entre les travaux de Jaspers et Assmann :
Elle partage avec Jaspers une fascination pour les révolutions spirituelles universelles et leurs implications philosophiques.
Elle s’aligne avec Assmann dans son intérêt pour les contextes historiques et culturels spécifiques, mais sans adopter son analyse érudite des textes ou son insistance sur les institutions mémorielles.
Sa vision, plus pratique et centrée sur l’éthique contemporaine, cherche à rendre la période axiale pertinente pour un large public, en tant qu’inspiration pour résoudre les crises modernes.
Conclusion
Les trois auteurs enrichissent le concept de période axiale de manières complémentaires : Jaspers offre une vision philosophique et universaliste, Assmann une lecture anthropologique et contextuelle, tandis qu’Armstrong donne une interprétation théologique et humaniste, axée sur les enjeux contemporains. Ensemble, leurs approches forment une constellation d’idées qui approfondissent notre compréhension de cette période fondamentale de l’histoire humaine.
21:13 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, jan assmann, karl jaspers, karen armstrong, période axiale de l'histoire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Le Progrès, une idée de paresseux (Baudelaire)

Le Progrès, une idée de paresseux (Baudelaire)
par Claude Bourrinet
L’idée que l’homme puisse être perfectible est, du point de vue chrétien, une hérésie. Si l’on accepte le postulat biblique du Péché originel, il n’est pas envisageable qu’il existe un quelconque progrès véritable. L’art de la table est susceptible de jouir d’améliorations succulentes, l’électricité a pu être appliquée à des machines, et aboutir à voiler les étoiles du ciel, les armes devenir plus performantes et témoigner du génie humain, les transports voués à la vélocité la plus vertigineuse, de façon que l’on se rend plus vite à son poste d’ennui, les divertissements démultipliés et à la portée de toutes les consciences, de tous les rêves, et la société arrimée au port démocratique, si bien que l’on rend grâce aux urnes d’être arrivé à bon port, la clé du bonheur ayant enfin été trouvée, il n’en demeure pas moins que, égrugée la mince pellicule de civilité laborieusement enduite sur la peau du citoyen satisfait, se découvre encore la chair du Vieil homme éternel.
Il n’y a guère de différence entre un Tatar de la Volga, brave guerrier de l’empire Mongol, et un client bedonnant de McDo, excepté que le premier aura été plus leste pour sauter à cheval. Mais la même soif de sang gît au fond de leurs cœur. Et il en est ainsi pour tous les hommes du présent, du passé, et de l’avenir. Seule l’occasion diffère, pour manifester sa puissance de haine, et son talent de tuer.
Le monde moderne est donc, depuis plusieurs siècles, fondé sur un sophisme. Et, en passant, l'Eglise moderne s'adonne au pélagianisme. La prétention des adeptes du progrès à avoir rendu l’homme meilleur, je ne dis pas seulement moralement, mais aussi dans son aspiration à la beauté, est une escroquerie, qui ne rencontre de succès que grâce à la fatuité de ceux qui entendent ce discours, et qui s'estimeront toujours supérieur à Marc-Aurèle, qui ne connaissait pas le rasoir électrique. En vérité, si, du point de vue de la morale, toutes choses étant égales par ailleurs, un Français du XXIe siècle est aussi vicieux qu’un Hellène du Ve siècle av. J.C., il n’est pas certain que sa capacité à exister sous le soleil soit plus intense.

Au contraire. A ce niveau-là, nous avons régressé. L’homme rapetisse. Il aura bientôt atteint la taille du nain. Le monde est devenu une foire à la monstruosité la plus répugnante, parce que le crime, universel, se pare sans vergogne des oripeaux du Bien. Jadis, quand on trucidait son prochain selon la loi de la nature, on avait le meurtre franc et pour tout dire, honnête. Maintenant, il faut tortiller du croupion sur la chaise d’un Conseil de sécurité quelconque, pour débarrasser la terre de millions de coquins qui la polluaient.
20:07 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : progrès, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 22 janvier 2025
Il n'y a pas d'histoire sans philosophie

Il n'y a pas d'histoire sans philosophie
Alexandre Douguine
L'histoire est une séquence de blocs sémantiques appelés « événements ». Ceux-ci comprennent des personnalités, des processus, des changements, des oppositions, des catastrophes, des réalisations, des paysages sur lesquels tout cela se déroule et, en fin de compte, tout ce riche bloc de réalité à plusieurs niveaux s'élève jusqu'à sa signification. Et la signification d'un événement, à son tour, est inextricablement liée à la signification d'autres événements. C'est ainsi que se tisse la trame de l'histoire. En même temps, le sens d'un événement inclut la richesse infinie de ce qui constitue sa nature, son fondement.
L'histoire est donc quelque chose de spirituel, qui ne se révèle qu'à l'esprit philosophique rompu à la pratique de la contemplation des idées. L'histoire est un concept philosophique et même théologique; ce n'est pas par hasard que l'on parle d'histoire sacrée, où le sens des événements est révélé par des dogmes et des axiomes religieux, qui à leur tour révèlent ces dogmes et ces axiomes de manière détaillée et riche.
Toute l'histoire est structurée comme l'histoire sainte. Seules les versions séculières ont des dogmes et des axiomes différents - athées et matérialistes. Ici, à la place de Dieu, de l'Alliance, de l'Incarnation, du Salut, de la Providence, de l'eschatologie, se trouvent les lois immanentes de la terre, de la société, de la bio- et physio-logie, de la lutte inter- et intra-espèces, du destin, du climat, de la technologie, de la volonté de puissance, des formations historiques, etc.
L'histoire n'existe pas en dehors d'un système religieux ou idéologique
L'histoire n'existe pas en dehors d'un système religieux ou idéologique. Nous sommes aujourd'hui sur la voie des Lumières historiques. Il y a tout un décret présidentiel à ce propos. Mais nous n'avons pas de décret sur l'idée russe et la philosophie russe. Cela reste facultatif. De même, l'histoire reste suspendue dans un vide dogmatique et axiomatique. Pour l'un, cet événement signifie une chose, pour l'autre une autre, un troisième nie la signification même de cet événement, un quatrième en nie la réalité. Et il est impossible de réduire de force ce chaos et cet arbitraire en quelque chose d'unifié par un décret portant sur la seule histoire. Dans le meilleur des cas, un modèle artificiel superficiel sera formé, qui ne vivra de toute façon pas, même s'il est imposé à tous.
Nous devons nous engager à fond dans la philosophie
Jusqu'à présent, les autorités n'y prêtent aucune attention et la société ne s'y intéresse pas. Or, la philosophie, c'est le travail sur le code de programmation de la société. C'est le travail des programmateurs spéciaux de l'Esprit. Si nous n'avons pas de programmateurs souverains de l'Esprit, toutes nos disciplines historiques, sociales et humanitaires seront créées en dehors de la Russie, ce qui signifie que nous ne pouvons pas parler de souveraineté. Si l'État-Civilisation n'a pas de philosophie souveraine, cette souveraineté n'est finalement qu'une fiction.
Les philosophes sont en charge du sens des événements. Cela signifie qu'ils gèrent aussi les événements eux-mêmes. Il n'y a d'histoire à part entière que dans la société où il y a une philosophie à part entière. Sinon, la société et le pays vivent à la périphérie d'une autre civilisation, extérieure, dont les codes sont définis à l'extérieur et restent incompréhensibles. L'absence de souveraineté fait d'une société sans philosophie, et sans histoire, une société contrôlée de l'extérieur.

C'est pourquoi nous, Russes, n'avons pas de consensus sur les débuts de la Rus - sur les Slaves, Rurik, la tradition pré-chrétienne, l'acceptation du christianisme.
Nous n'avons pas de consensus sur l'État kiévien, ni sur sa fragmentation, ni sur les conquêtes mongoles et l'existence de la Russie en tant que partie de l'empire de Gengis Khan et de la Horde d'or.
Nous n'avons pas de consensus sur Ivan le Terrible, la zemshchina, l'oprichnina et la théorie de Moscou-Troisième Rome. L'interprétation de la relation de notre Église avec le Phanar n'est pas claire.
Nous n'avons pas de consensus sur les premiers Romanov, et nous comprenons encore moins le schisme russe.
Nous avons une divergence d'opinion totale sur le 18ème siècle pétrinien.
Nous n'avons pas de vision commune du 19ème siècle et de son tournant conservateur. La querelle entre slavophiles et occidentaux est réduite à peu de choses, elle est abandonnée, bien qu'elle ne soit pas terminée.
Il n'est pas surprenant que nous n'ayons pas de consensus sur les événements de 1917. Aujourd'hui, nous ne comprenons apparemment pas la signification de ces événements et sommes enclins à croire qu'ils n'ont pas eu lieu du tout.
Nous ne comprenons pas du tout pourquoi l'URSS a pris fin et comment il se fait que les années 90 ont commencé et que le pays s'est effondré et a perdu sa souveraineté, se transformant en une colonie de l'Occident.
Nous ne comprenons pas comment et d'où vient Poutine en tant que phénomène historique. Nous comptons beaucoup sur lui, mais nous ne sommes pas en mesure de l'expliquer ou de l'interpréter, ni de comprendre les conditions qui ont conduit à son règne. Je veux dire dans le contexte historique où la philosophie fonctionne.
Nous ne comprenons pas la raison d'être de Medvedev, ni ce qu'il fait aujourd'hui sur son canal Telegram.
Nous ne comprenons pas bien pourquoi nous avons commencé l'Opération militaire spéciale en 2022 et pourquoi nous ne l'avons pas fait en 2014. Il n'y a pas de consensus. Chacun à sa manière de voir et d'interpréter l'événement.
Personne n'est déconcerté par le fait qu'au cours des 40 dernières années, presque la même élite russe a changé à plusieurs reprises d'idéologie pour en adopter une autre, mais avec une apparence intelligente et importante, aujourd'hui grise et décrépite, elle continue à enseigner au peuple aveugle quelque chose qui lui est propre et que l'on ne comprend guère. Nous ne pouvons expliquer à personne, et d'abord à nous-mêmes, comment un membre du Komsomol devient un libéral, et un libéral devient un anti-libéral et un patriote, et ensuite, très probablement, un libéral et un anti-patriote à nouveau. La seule clé d'interprétation dont nous disposons est la célèbre chanson de la popstar Instasamka (photo).

Mais à partir de tout cela, il est tout simplement impossible de tresser le tissu spirituel de l'histoire russe. Et une nation qui n'a pas d'histoire n'a pas d'avenir. Or, l'avenir est aussi l'histoire, sa dimension nécessaire.
Dans un récit de Yuri Mamleyev, il y avait un personnage, une femme victime de violence, qui, lorsque le juge lui demandait s'il y avait eu violence ou non, bégayait soudain et répondait une seule phrase étrange : « C'est tombé tout seul ». C'est à cela que ressemble notre histoire: quelque chose est tombé tout seul. On ne sait pas très bien quoi, quand, où, qui l'a poussé, pourquoi... Mais ce n'est pas ce qu'est l'histoire. Ce n'est pas du tout cela.
18:47 Publié dans Actualité, Histoire, Nouvelle Droite, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : actualité, russie, alexandre douguine, hisoire, philosophie, nouvelle droite, nouvelle droite russe |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 20 janvier 2025
Hegel et le saut platonicien

Hegel et le saut platonicien
La philosophie politique de Hegel est très complexe. Elle s'appuie sur l'ensemble de son tableau philosophique. Comme nous l'avons vu, toute philosophie a toujours la possibilité de susciter une dimension politique.
Alexandre Douguine
Le 14 novembre 1831, le plus grand philosophe romantique de l'histoire mondiale de la pensée, Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), est mort. Heidegger, tout comme Nietzsche, considérait Hegel comme celui qui avait achevé l'histoire de la philosophie du Logos occidental et comme celui qui incarnait l'apogée de l'histoire de la philosophie et de la philosophie en général. Si Platon était le philosophe du début, Hegel et Nietzsche étaient les philosophes de la fin. En ce sens, Hegel est le philosophe de la fin.
Tout est altérité de l'Autre
La philosophie politique de Hegel est très complexe. Elle s'appuie sur l'ensemble de son tableau philosophique. Comme nous l'avons vu, toute philosophie a toujours la possibilité de susciter une dimension politique. Comme Platon, Hegel, dans sa philosophie du droit, fait ce geste, prend toute sa philosophie et l'applique à la politique, c'est-à-dire qu'il situe explicitement la place de la philosophie politique dans le contexte de l'ensemble de sa philosophie. Par la philosophie, il explique la philosophie politique, en même temps qu'il clarifie la politique par sa dimension métaphysique.
À cet égard, Hegel est un philosophe classique qui inclut implicitement la philosophie politique. En ce sens, Heidegger avait parfaitement raison lorsqu'il disait que si l'on comprenait la Phénoménologie de l'Esprit, on pouvait en déduire tout le reste. En ce qui concerne la lecture, deux ouvrages fondamentaux de Hegel sont habituellement proposés : La Phénoménologie de l'Esprit et La Philosophie du Droit.
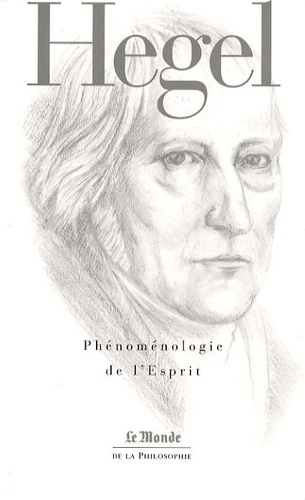
L'idée fondamentale de Hegel est qu'existe l'Esprit subjectif primordial, l'« esprit pour soi » (en allemand: der subjektive Geist). Ce point coïncide avec la thèse théologique sur l'existence de Dieu - l'Esprit subjectif est Dieu pour lui-même. Afin de s'employer pour l'Autre, cet Esprit subjectif se projette dans l'Esprit objectif (en allemand: der objektive Geist) dans lequel il devient nature et matière, c'est-à-dire que le sujet se projette dans l'objet.
On notera ici la différence fondamentale avec la topologie cartésienne qui a prédéterminé la structure de la modernité. Pour Descartes, il existe un dualisme entre le sujet et l'objet, alors que Hegel tente de supprimer ce dualisme et de surmonter le pessimisme épistémologique de Kant en distinguant la matière ou l'objet de l'Esprit. En fait, il ne s'agit que d'un développement du modèle kantien du « je suis » absolu, mais pris dans un modèle dynamique et dialectique. Si Fichte était une réaction à Kant, Hegel est une réaction à Fichte, mais en dialogue constant avec Kant et le cartésianisme.
Ainsi, Hegel soutient qu'il existe un esprit subjectif qui se révèle à travers l'esprit objectif par le biais de l'aliénation dialectique. La Thèse est l'Esprit subjectif et l'Antithèse est l'Esprit objectif, c'est-à-dire la nature. La nature n'est donc pas la nature puisque, selon Hegel, rien n'est identique à soi, mais tout est altérité de l'Autre, d'où le terme de « dialectique ».

Le cycle du départ et du retour : l'esprit absolu
En d'autres termes, il y a l'Esprit subjectif en tant que tel qui se projette comme Antithèse. C'est ainsi que commence l'histoire. Pour Hegel, la philosophie de l'histoire est d'une importance fondamentale car l'histoire n'est rien d'autre que le processus de déploiement de l'Esprit objectif qui acquiert à chaque nouvelle étape sa composante spirituelle qui constitue son essence. Mais le premier acte de l'Esprit objectif est de cacher son caractère spirituel, de s'incarner dans la matière ou la nature, et ensuite, tout au long de l'histoire, cette altérité de l'Esprit subjectif revient, par l'homme et l'histoire humaine, à son essence.
Mais il s'agit alors d'une nouvelle essence ; ce n'est plus l'Esprit Subjectif (l'« esprit pour soi ») ni un « esprit pour un autre », mais un « esprit en soi ». En d'autres termes, l'esprit revient à lui-même par sa propre aliénation. C'est ainsi qu'apparaît le cycle du départ et du retour, ce dernier étant plus important pour Hegel que le départ. Ce dernier crée les conditions préalables au retour, et le retour, passant le cycle entier, revient à l'esprit subjectif lui-même, devenant le troisième esprit - l'esprit absolu (en allemand: der absolute Geist). Autrement dit, il y a d'abord l'esprit subjectif, puis l'esprit objectif et enfin l'esprit absolu.
L'Esprit absolu, selon Hegel, se déploie au cours de l'histoire humaine et se dirige vers la fin de l'histoire.
Le sens de l'histoire est la réalisation de l'Esprit à travers la matière. D'abord, l'Esprit est lui-même, mais n'est pas conscient de lui-même, puis il commence à se réaliser, mais n'a pas de "lui-même". La nature abrite en elle-même les conditions préalables de l'histoire parce qu'elle est un élément de l'histoire. D'où l'histoire des religions, l'histoire des sociétés, et comme résultat du déploiement de l'Esprit à travers l'histoire, elle atteint son apogée à la fin de l'histoire, quand l'Esprit est pleinement conscient et est alors lui-même. Thèse, Antithèse, Synthèse. Ainsi, l'histoire est terminée.
Il s'agit là d'une image générale de la philosophie de Hegel, qui comporte de nombreuses nuances et complexités. Ainsi, selon Hegel, l'histoire évolue positivement, mais il s'agit d'un positivisme différent de celui de la philosophie de la Grande Mère. Le commencement titanesque implique qu'au début il y avait du moins et ensuite du plus. Dans sa lecture de Hegel, Marx a supprimé l'esprit subjectif et dit qu'il existe une nature qui se perfectionne elle-même. Il rétablit ainsi la philosophie de la Grande Mère selon laquelle tout croît à partir de la matière et de la nature.
Mais Hegel n'est pas Marx. Chez Hegel, cette croissance, ce processus, ce mouvement du bas vers le haut est basé sur le fait qu'au début, il y a eu un saut vers le bas. D'abord l'Esprit saute et tombe dans la nature, et donc la nature commence à croître, et la nature n'est pas tant autre qu'elle est l'altérité de l'Esprit. L'antithèse de l'Esprit n'est pas simplement son opposé, car il est lui-même sous une forme retirée. Le concept de « retrait » chez Hegel est très important, car l'Antithèse ne détruit pas la Thèse, mais la retire, l'absorbe et la démontre ensuite à travers la Synthèse.
Par conséquent, la thèse n'est pas absolue et l'antithèse n'est pas absolue. Elles sont toutes dialectiquement dépendantes. Seule leur synthèse est absolue, ce qui permet d'éliminer la thèse et l'antithèse. En ce sens, la compréhension hégélienne de l'histoire comme déploiement de l'Esprit se fait par phases: il y a l'Esprit subjectif (préhistorique), l'Esprit objectif, qui se manifeste à travers l'histoire, et enfin l'Esprit absolu, qui se manifeste à travers la tension supérieure de l'histoire, à travers la création d'une sorte de sommet culturel et sociopolitique, la pyramide de l'Esprit, qui est finalement devenu l'Absolu.
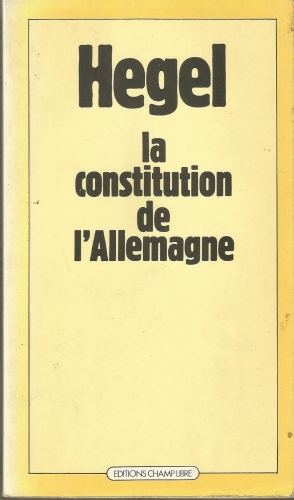
Hegel et l'idée de l'État allemand
Quelle est la place de la philosophie politique dans ce contexte ? Il est clair que, dans un certain sens, l'histoire devient politique. C'est pourquoi Hegel conçoit l'évolution des systèmes, des modèles et des régimes politiques comme des moments de devenir de l'Esprit absolu. La politique est la cristallisation de la synthèse. L'histoire politique est le mouvement de l'Esprit vers le devenir absolu. La politique est l'histoire de l'absolutisation de l'Esprit.
Hegel établit une hiérarchie entre les différentes formes politiques. D'une part, il s'agit d'une hiérarchie évolutive puisque chaque régime est meilleur que le précédent. Mais, contrairement aux idées de Marx, cette évolution n'est pas seulement le reflet de l'Antithèse, elle n'est pas le développement de la matière ou de la nature. Il s'agit de la distinction de l'Esprit qui était à l'origine inhérent à la matière et à la nature. Il n'y a donc pas de matérialisme ici. Il s'agit d'un schéma complexe qui combine l'option platonicienne (au début, il y avait l'Esprit et non la matière) et le modèle évolutionniste (dans lequel nous commençons à considérer l'histoire à partir de l'Antithèse, ce qui rappelle l'idée de la Grande Mère). Marx a évacué la partie platonicienne, d'où sa réinterprétation de Hegel dans un sens exclusivement matérialiste. Mais Hegel est plus complexe.
Un autre point important chez Hegel est la façon dont il définit la fin politique de l'histoire, le sommet du devenir de l'histoire politique et l'expression de l'Esprit absolu. Hegel dit ici quelque chose d'intéressant à propos de la Prusse et de l'État allemand. Les Allemands n'avaient pas d'État, donc historiquement il n'y avait pas d'expression de ce type. Ainsi, les Allemands absorbent la logique du mouvement mondial, et l'État prusso-allemand est l'expression de l'Esprit absolu. Toute l'histoire est donc un prélude à la formation de l'Allemagne au 19ème siècle. Hegel disait que les grands peuples sont ceux qui ont soit un grand État, soit une grande philosophie. Selon lui, les Russes ont un grand État, alors qu'au 19ème siècle, les Allemands n'avaient aucun État. Il s'ensuit que les Allemands doivent avoir une grande philosophie, puis un grand État.
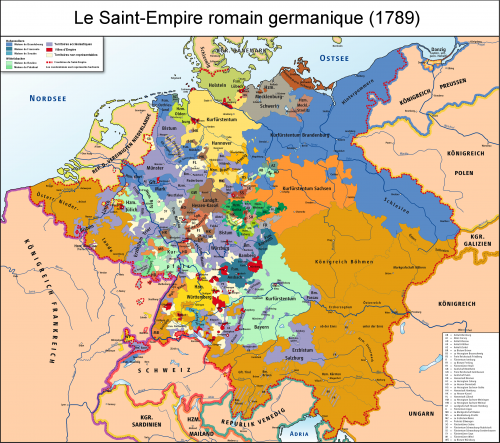
Le plus frappant est que Hegel a formulé la philosophie d'un grand État allemand avant que l'Allemagne n'apparaisse sur l'échiquier européen. Il a forgé cette théorie alors qu'il vivait lui-même dans une Allemagne fragmentée en principautés qui n'avait rien d'un État puissant et fort. Hegel a rassemblé l'Allemagne, l'a dotée d'une mission intellectuelle et a créé, avec Fichte et Schelling, le concept idéaliste et romantique de l'État allemand en tant qu'expression de l'Esprit devenant absolu. L'apogée et la fin de l'histoire, selon Hegel, est donc l'État allemand.
De plus, Hegel pensait que le système politique le plus optimal était une monarchie éclairée dominée par des philosophes politiques hégéliens, porteurs de la synthèse de l'esprit du monde entier, qui reconnaissent la logique de l'histoire mondiale. Hegel se considérait comme un prophète de la philosophie, de l'humanité et de l'Allemagne et, dans un certain sens, comme un mystique. Sur le plan méthodologique, la philosophie de Hegel était absolument rationnelle, mais elle était irrationnelle dans ses prémisses. Il a étayé l'idée que la société civile, la Révolution française et l'époque des Lumières constituaient un autre moment dialectique dans la formation de la monarchie éclairée. La société civile est ce qui permet à la monarchie de se développer et que la monarchie abolit ensuite. Hegel était donc un monarchiste mystique qui considérait que la logique de l'histoire était le chemin des différentes formes politiques vers la monarchie à la façon russe.
Il n'est pas surprenant que cette idée ait été reprise par les fascistes italiens, en particulier dans la théorie de l'État italien de Giovanni Gentile, qui était un hégélien. Paradoxalement, ni le fascisme ni le nazisme ne peuvent être considérés comme des représentants du nationalisme classique. Dans ces deux visions du monde, certains éléments ne se prêtent pas à être considérés comme des formes classiques ou même radicales du nationalisme bourgeois européen, car dans ce cas, l'ajout de l'instance hégélienne sous la forme de l'Esprit subjectif et toute la métaphysique de l'histoire que Gentile a posée dans les fondements de la théorie du fascisme italien n'étaient que de l'hégélianisme appliqué à l'Italie.
Bien qu'il soit considéré comme un classique de la philosophie politique, Hegel est un cas plutôt complexe, composite. Sa philosophie politique ne reflète pas l'idéologie de la troisième voie, et la théorie marxiste a été construite sur un hégélianisme métaphysiquement tronqué. En d'autres termes, l'hégélianisme « de gauche » est devenu la base de la deuxième théorie politique, et l'hégélianisme « de droite » a influencé certaines des particularités de la troisième théorie politique. Par ailleurs, l'idée hégélienne de la fin de l'histoire a été reprise et appliquée au modèle libéral par son élève Alexandre Kojève [1], son disciple Francis Fukuyama et d'autres philosophes. Marx a appliqué la « fin de l'histoire » au communisme, Gentile à l'État et certains philosophes hégéliens au triomphe de l'ordre mondial libéral. Selon ces derniers, la société civile n'est donc pas un prolégomène à la monarchie (comme le pensait Hegel lui-même), mais l'apogée du développement de la civilisation humaine.
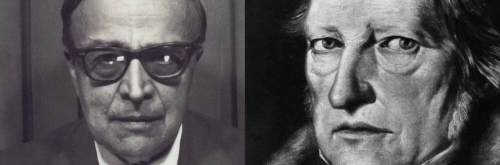
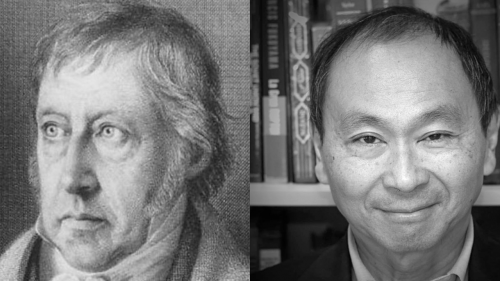
Cette idée a été reprise comme prémisse par Francis Fukuyama, qui a employé le terme de « fin de l'histoire ». Ce terme était d'une importance fondamentale pour Hegel dans la mesure où il marquait le moment final de l'accomplissement par l'Esprit de sa phase absolue à travers l'histoire, le moment dialectique du retour de l'Esprit à lui-même, en lui-même et pour lui-même - la Synthèse.
Ainsi, nous pouvons trouver dans l'hégélianisme les trois idéologies classiques de la modernité, mais cela ne signifie pas que l'hégélianisme puisse être qualifié du point de vue de l'une ou l'autre d'entre elles. Hegel est plus large que toutes les théories politiques de la modernité et ne tombe donc en aucune d'entre elles. Il y a donc dans l'hégélianisme ce qui a été volé par fragments par les trois idéologies politiques de la modernité, ainsi que ce qui n'a pas été pris, comme l'idée de l'Esprit subjectif primordial qui précède tout mouvement descendant. Cet élément du saut platonicien primordial, le néoplatonisme, qui transite ensuite dans des topologies plus ou moins progressives-évolutives, nous permet de ne pas classer Hegel parmi les philosophes ou philosophes politiques de la modernité, car, comme nous l'avons vu, le paradigme de la modernité ne présume aucune composante matérielle préalable.
Une lecture non libérale, non marxiste et non fasciste de Hegel nous permet de révéler ses composantes pour une alternative à la modernité et de l'intégrer dans la Quatrième Théorie Politique. Par cette opération, nous déplaçons Hegel de l'époque de la modernité dans laquelle il a vécu et pensé vers un autre contexte. Il s'agit d'un autre Hegel, d'une autre philosophie politique de Hegel dans laquelle l'accent est mis sur le saut platonicien vers le bas. Cette partie de sa philosophie n'a pas reçu, et ne pouvait pas recevoir, d'incarnation politique dans le cadre du paradigme de la modernité. Néanmoins, elle peut trouver son expression dans le contexte de la Quatrième théorie politique.
Note :
[1] Le philosophe russe Alexandre Kozhevnikov a changé son nom en Alexandre Kojève après avoir émigré.
17:53 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : hegel, hegélianisme, philosophie, alexandre douguine |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 19 janvier 2025
L’Anti-Système: le concept de Lev Goumilev s’applique de manière étonnamment pertinente à l’Occident d’aujourd’hui
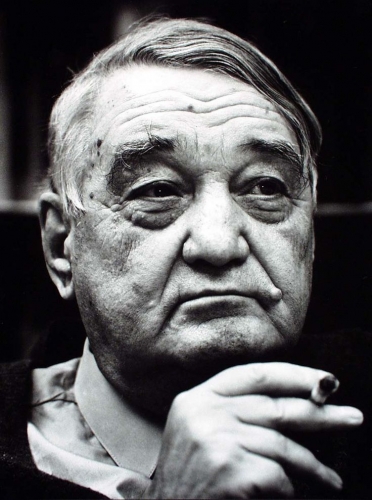
L’Anti-Système: le concept de Lev Goumilev s’applique de manière étonnamment pertinente à l’Occident d’aujourd’hui
Brecht Jonkers
Source: https://brechtjonkers.substack.com/p/the-anti-system?publ...
« Essentiellement, les anti-systèmes sont des visions négatives du monde : des ensembles cohérents d’enseignements qui organisent et rationalisent les pulsions prédatrices déterminant le comportement d’un groupe ethnique ou sous-ethnique. Goumilev les qualifiait de "concepts vampires", incarnant un sens profond et diabolique du dessein ».
Dans leurs spécificités, les anti-systèmes varient grandement d’un groupe à l’autre et selon les périodes historiques, mais ils partagent certaines convictions et orientations fondamentales. Ils se caractérisent toujours par une "vision négative du monde", considérant l’univers matériel et les domaines de la vie quotidienne comme un lieu de souffrance et la source de tous les maux. En conséquence, tous les anti-systèmes prônent le rejet du monde matériel (mirootritsanie ou zhizneotritsanie) dans toute sa complexité et diversité, au profit de principes abstraits simplifiés et d’idéaux absolus et inflexibles.
En effet, le zhizneotritsanie est le principal sentiment motivationnel de l’anti-système, exprimé généralement soit par un appel à remodeler le monde, soit plus simplement à le détruire.
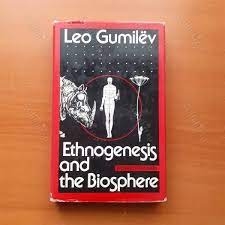
Cette hostilité générale envers le monde est liée à une hostilité plus spécifique envers les réalités écologiques de la biosphère. Dans un anti-système, « l’homme s’oppose à la nature, qu’il considère comme un domaine de souffrance. Pourtant, il est contraint d’inclure son propre corps dans la biosphère qu’il rejette, et dont il devient nécessaire de "libérer son âme", c’est-à-dire sa conscience. »
De nombreuses méthodes ont été proposées pour accomplir cela, mais le principe sous-jacent reste toujours le même : le rejet du monde [naturel] comme source du mal.
En fin de compte, bien sûr, cette lutte ne peut être que vaine, car aucun anti-système chimérique n’est capable d’extraire complètement un groupe ethnique de son emplacement écologique, qu'il occupe dans le monde naturel. Ainsi, plutôt qu’une véritable libération de l’environnement naturel, l’anti-système convoque ses adeptes à une lutte qui ne peut conduire qu’à la profanation et à la destruction écologiques.
Un anti-système viole toutes les qualités naturelles positives de la vie ethnique. La vénération de l’héritage et de la tradition qui, dans des ethnies saines, opère à travers la structure familiale par l’héritage signalétique et contribue à maintenir l’intégrité et la continuité ethniques, est rejetée. Au contraire, un anti-système se tourne obsessionnellement vers l’avenir plutôt que de regarder avec révérence vers le passé, et il est dominé par des individus ayant un "sens du temps futuriste". Les valeurs et attitudes antisystémiques sont codifiées et formalisées à travers des textes écrits stylisés, qui ne peuvent être absorbés spontanément mais doivent être expliqués et enseignés de manière formaliste.
« Et la différence entre les traditions "vivantes", absorbées par les enfants au cours de leur éducation, et les traditions "fabriquées" (sdelannye), c’est-à-dire celles basées sur des livres, est la même que celle entre les organismes vivants et les objets inanimés. Les premières, lorsqu’elles périssent [naturellement], renaissent sous forme de leur postérité. Les secondes, en revanche, sont progressivement détruites, sans espoir de résurrection. » (Mark Bassin, The Gumilev Mystique).
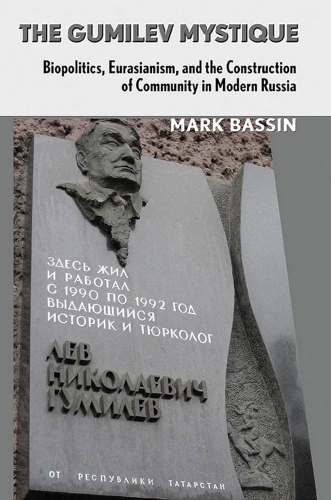
18:32 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, lev goumilev, biopolitique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 12 janvier 2025
L'importance de Giorgio Locchi aujourd'hui
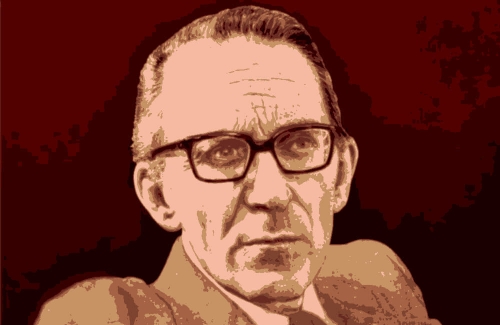
L'importance de Giorgio Locchi aujourd'hui
par Alexander Raynor
Source: https://www.arktosjournal.com/p/why-giorgio-locchi-matter...
« Je n'ai eu que deux maîtres: Friedrich Nietzsche et Giorgio Locchi. Je n'ai jamais rencontré le premier, j'ai rencontré le second », a écrit l'influent philosophe français Guillaume Faye. « Je pèse mes mots: sans Giorgio Locchi et son œuvre, la véritable chaîne de défense de l'identité européenne se serait probablement brisée ».
Giorgio Locchi (1923-1992) était un philosophe, journaliste et intellectuel italien qui, malgré une reconnaissance relativement limitée de son vivant, a exercé une profonde influence sur la pensée culturelle et politique européenne dans la seconde moitié du 20ème siècle. Travaillant principalement depuis Paris en tant que correspondant à l'étranger pour le journal italien Il Tempo, Locchi a développé un système philosophique sophistiqué qui intègre des idées de Friedrich Nietzsche, Richard Wagner et Martin Heidegger, tout en apportant des contributions originales à notre compréhension de l'histoire, du temps et de l'identité culturelle.
Il existe plusieurs raisons impérieuses de lire Locchi aujourd'hui :
Premièrement, il fournit l'une des analyses les plus rigoureuses, soit une analyse philosophiquement sophistiquée, sur la manière dont les différentes conceptions du temps et de l'histoire façonnent les civilisations. S'inspirant des innovations musicales de Wagner et du concept d'éternel retour de Nietzsche, Locchi a formulé une vision « sphérique » du temps historique qui s'oppose aux conceptions linéaires, progressives et cycliques. Pour Locchi, chaque moment historique contient simultanément les dimensions du passé, du présent et du futur, de la même manière qu'un morceau de musique conserve sa cohérence grâce à l'interaction entre la mémoire, les notes actuelles et l'anticipation. Cela permet de mieux comprendre la manière dont les cultures se comprennent elles-mêmes et leurs trajectoires.
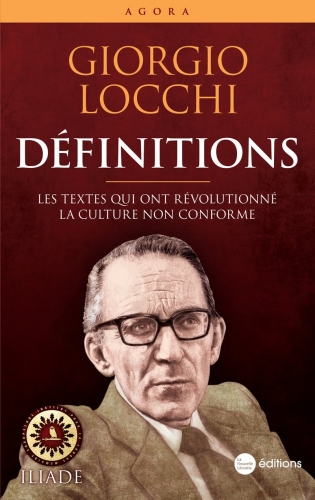
Deuxièmement, Locchi offre une perspective unique sur la relation entre la musique, le mythe et l'identité culturelle. Son analyse des opéras de Wagner va au-delà des interprétations standard pour révéler comment la musique peut exprimer des visions du monde fondamentales et façonner la conscience historique. Il voit dans l'utilisation innovante par Wagner de leitmotivs et de mélodies sans fin un moyen de représenter la nature multidimensionnelle du temps historique. Cela rejoint son argument plus large sur la façon dont les mythes et les récits culturels structurent la façon dont les sociétés se comprennent elles-mêmes et leur destin.
Troisièmement, Locchi a développé une théorie originale sur la façon dont les tendances historiques émergent et évoluent à travers des phases mythiques, idéologiques et synthétiques distinctes. Cette théorie fournit un cadre utile pour comprendre les mouvements culturels et politiques. Selon lui, les nouvelles tendances historiques apparaissent d'abord sous une forme mythique, puis se divisent en idéologies concurrentes, avant d'aboutir éventuellement à une résolution synthétique. Cela permet d'expliquer les modèles que nous observons dans la manière dont les mouvements se développent et se transforment au fil du temps.
Le cœur de la pensée de Locchi porte sur la manière dont les sociétés et les cultures conservent leur cohérence et leur identité au fil du temps. Il a constaté que les différentes civilisations sont façonnées par des « tendances » distinctes - des schémas profonds de pensée et de sentiment qui structurent la façon dont elles perçoivent le monde et leur place dans l'histoire. Ces tendances ne sont pas seulement des idées abstraites, mais s'expriment à travers l'art, le rituel, la politique et l'organisation sociale.
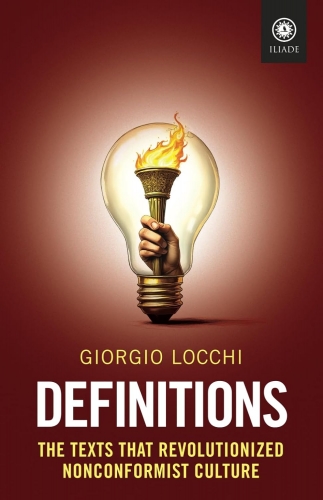
L'une de ses principales idées a été de reconnaître que les tendances passent par des phases distinctes. Dans la phase mythique, une tendance s'exprime à travers des symboles et des récits puissants qui unissent les opposés dans une vision originale. Dans la phase idéologique, cette unité se brise en interprétations concurrentes. Dans la phase synthétique, ces conflits peuvent être résolus dans une nouvelle unité, mais cela n'est pas garanti.
Locchi s'intéressait particulièrement à la manière dont la civilisation européenne contenait des tendances concurrentes - l'une s'exprimant dans le christianisme et l'égalitarisme moderne, l'autre dans les diverses tentatives de faire revivre les traditions et les valeurs européennes plus anciennes. Il voyait en Wagner une figure cruciale qui avait atteint une nouvelle expression mythique susceptible de régénérer la culture européenne - le mythe surhumaniste (1).
Cela rejoint un autre aspect important de la pensée de Locchi : son analyse de la manière dont les sociétés maintiennent une continuité culturelle tout en évoluant et en se transformant. Il a souligné que les cultures saines ont besoin à la fois de la mémoire des origines et de l'ouverture sur l'avenir. Son concept de temps sphérique permet d'expliquer comment cela est possible - le passé n'a pas simplement disparu mais reste actif dans la façon dont nous nous comprenons et dont nous envisageons nos possibilités.
L'œuvre de Locchi mérite d'être étudiée attentivement, car elle allie rigueur philosophique et sensibilité à l'art, au mythe et à la culture. Bien que ses écrits soient parfois denses et difficiles, il met en lumière des questions fondamentales sur la manière dont les sociétés maintiennent leur cohérence et leur identité à travers le temps. Ses idées sur la relation entre la musique, le mythe et la conscience historique restent très pertinentes.
La compréhension de Locchi sur la manière dont les nouveaux mouvements culturels et politiques émergent et se développent est particulièrement précieuse. Son analyse du schéma mythique-idéologique-synthétique permet d'expliquer à la fois comment les mouvements prennent leur élan initial grâce à des visions fondatrices puissantes, et comment ils peuvent ensuite se fragmenter et potentiellement se transformer. Ce cadre reste utile pour comprendre les dynamiques culturelles et politiques contemporaines.
Locchi apporte également des éclaircissements importants sur le rôle de l'art et de la culture dans la formation de la conscience historique. Son analyse de Wagner montre comment les innovations artistiques peuvent exprimer et contribuer à créer de nouvelles façons de comprendre le temps et l'histoire. Cela suggère l'importance continue de l'art et de la culture dans la façon dont les sociétés se perçoivent et perçoivent leurs possibilités.
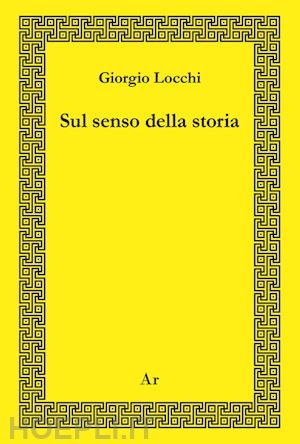
La lecture de Locchi aujourd'hui est précieuse car il aborde des questions fondamentales sur l'identité culturelle et la conscience historique qui demeurent pressantes. Comment les sociétés maintiennent-elles la continuité tout en évoluant ? Comment les différentes conceptions du temps façonnent-elles la manière dont les cultures se comprennent elles-mêmes ? Quel rôle l'art et les mythes jouent-ils dans la structuration de la compréhension historique ? Le traitement sophistiqué de ces questions fournit des ressources conceptuelles pour relever les défis contemporains.
Bien que certains aspects de la pensée de Locchi soient le produit de son contexte historique, ses idées fondamentales sur la relation entre le temps, l'identité et la culture restent très pertinentes. Son analyse de l'émergence et de l'évolution des tendances permet d'éclairer les dynamiques culturelles et politiques actuelles. Son insistance sur l'importance de l'enracinement et de l'ouverture sur l'avenir s'inscrit dans les débats actuels sur la tradition et le changement.
L'œuvre de Locchi est également précieuse parce qu'elle réunit de manière originale de multiples traditions intellectuelles. Sa synthèse des idées issues de la musique, de la philosophie et de l'analyse culturelle démontre la valeur de la pensée interdisciplinaire. Bien que son écriture puisse être exigeante, la profondeur et la sophistication de sa pensée méritent d'être étudiées attentivement.
Pour comprendre Locchi, il est utile de commencer par ses œuvres les plus accessibles, comme Définitions, avant de s'attaquer à ses textes philosophiques plus denses. Son analyse de Wagner constitue un bon point de départ pour aborder ses idées plus générales sur le temps, le mythe et l'identité culturelle. Bien que tous les lecteurs ne soient pas d'accord avec ses conclusions, son traitement rigoureux des questions fondamentales sur la manière dont les sociétés maintiennent leur cohérence à travers le temps reste précieux.
En conclusion, Giorgio Locchi mérite une attention renouvelée en tant que penseur profond qui éclaire des questions cruciales sur l'identité culturelle, la conscience historique et la transformation sociale. Son analyse sophistiquée du temps, des mythes et des tendances offre des ressources conceptuelles pour comprendre le passé et le présent. Bien que son travail puisse être difficile, il mérite d'être étudié attentivement par toute personne intéressée par les questions de continuité et de changement culturels. Ses idées sur la façon dont les sociétés maintiennent leur cohérence tout en évoluant restent très pertinentes pour les débats contemporains.
Commandez les Définitions de Giorgio Locchi ici:
En langue française: https://boutique.institut-iliade.com/product/definitions-...
En langue anglaise: https://www.amazon.com/dp/1917646046
Note:
(1) L'idée du mythe surhumaniste est explorée dans l'autre ouvrage majeur de Locchi : Nietzsche, Wagner e il mito sovrumanista (Nietzsche, Wagner et le mythe surhumaniste). Pour mieux comprendre ce concept, vous pouvez consulter l'entretien qu'Éléments a réalisé avec le fils de Giorgio, Pierluigi Locchi. La traduction anglaise de cet entretien est disponible ici:
https://www.thepostil.com/giorgio-locchi-and-the-suprahumanist-myth/
17:37 Publié dans Nouvelle Droite, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : philosophie, surhumanisme, giorgio locchi, nouvelle droite |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 10 janvier 2025
De la xénophobie, du nationalisme, de la noblesse



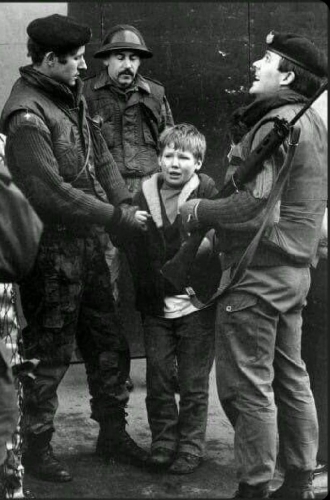
15:18 Publié dans Philosophie, Réflexions personnelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : noblesse, nationalisme, xénophobie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Chesterton et Borges
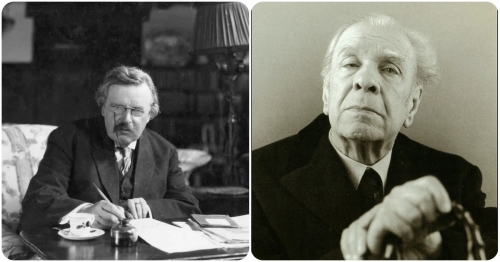
Chesterton et Borges
Par Juan Manuel de Prada
Source: https://noticiasholisticas.com.ar/chesterton-y-borges-por...
Un siècle et demi après sa naissance, les œuvres de Gilbert Keith Chesterton sont encore régulièrement réimprimées et sa figure fait l'objet d'un « culte » croissant. Il est en effet paradoxal (mais un écrivain aussi doué pour le paradoxe que Chesterton ne pouvait avoir d'autre destin) qu'une époque qui s'acharne à ne pas croire tout ce en quoi Chesterton croyait avec ferveur s'acharne également à vénérer Chesterton. Car le scepticisme terminal et putrescent de notre époque n'a pu venir à bout du talent foisonnant du créateur du Père Brown, avec sa tonne de bon sens, avec la bonne santé rugissante de son argumentation et la splendeur de son style, qui débordait sur tous les genres.
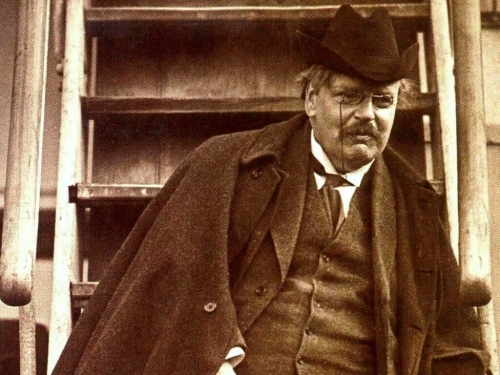
Chesterton, qui dans ses dernières années était un auteur de plus en plus vilipendé par ses compatriotes, a néanmoins joui en Espagne et dans d'autres pays catholiques d'une popularité qui s'est prolongée tout au long des années 1940 et 1950. Mais dans la seconde moitié du siècle dernier (alors que les pays catholiques devenaient « protestants »), un manteau d'opprobre s'est abattu sur Chesterton, en raison de ses opinions « réactionnaires » (c'est-à-dire clairvoyantes et très sages) sur la démocratie, le progressisme, l'évolutionnisme, le féminisme et les autres « ismes » émétiques en circulation. Même son plus fervent et prestigieux défenseur, Jorge Luis Borges, n'échappe pas au rejet général de la pensée de Chesterton dans le progressisme environnemental ; et déjà, lorsqu'il écrit sa nécrologie dans la revue « Sur », il prend ses distances avec les positions de son maître (« Aucun des attraits du christianisme ne peut rivaliser avec son invraisemblance débridée »), affirmant que Chesterton est ce qu'il est en dépit de son catholicisme, et non grâce à lui.
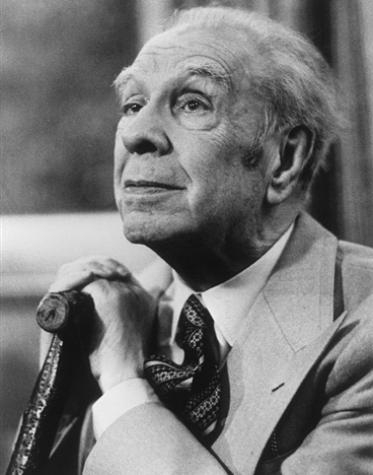
Borges affirmera également que « l'intérêt qu'elles [les croyances de Chesterton] suscitent est limité ; supposer qu'elles l'épuisent, c'est oublier qu'un credo est l'aboutissement ultime d'une série de processus mentaux et émotionnels ». Mais il s'avère que pour Chesterton, le credo était quelque chose de bien plus important qu'une « série de processus mentaux et émotionnels ». Il était le carburant de toute sa littérature, qui s'attachait à éclairer les mystères de la foi, non pas à la manière sèche de tant d'apologistes étouffants, mais à la manière jonglée d'un artiste de cirque, de sorte que les dogmes sont mis sous nos yeux pour faire des sauts périlleux et faire semblant d'être ivres, nous faisant rire presque sans que nous nous en apercevions, comme le ferait un gentleman en pyjama et en chapeau melon. Borges n'a jamais compris quelque chose d'aussi élémentaire, et il a eu beau lire, citer et traduire Chesterton, imiter son humour polémique et la belle « clarté latine » de son style paradoxal, il a toujours insisté pour construire un Chesterton à sa mesure, allégé ou « purifié » des aspects de sa pensée qu'il jugeait inintelligibles ou qu'il rejetait (n'oublions pas que, pour Borges, « l'idée d'un être parfait, omnipotent, tout-puissant est l'ultime création de la littérature fantastique »).
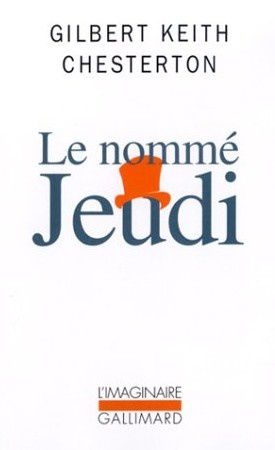
Ainsi, toutes les lectures de Chesterton par Borges sont boiteuses, hémiplégiques, souvent grotesques, quand elles ne sont pas carrément idiotes. C'est le cas, par exemple, lorsqu'il présente « Le nommé Jeudi » comme une fantaisie à mi-chemin entre Lewis Carroll et Franz Kafka, en ignorant la thèse théologique que le livre cache dans ses pages. Car « Le nommé Jeudi » est avant tout une très belle fable sur les mystères de la souffrance, le libre arbitre et le problème du mal, qui sont après tout les mêmes questions que celles que l'on trouve dans le Livre de Job ; seul le traitement chestertonien est totalement nouveau. Pour un lecteur non averti, « Le nommé Jeudi » peut sembler être une diatribe contre l'anarchisme ; mais Chesterton ne dirige pas ses fléchettes contre la désobéissance aux gouvernements, mais contre le « non serviam » transformé en un « vaste mouvement philosophique qui annonce toujours un âge futur de béatitude ».
En fin de compte, Borges faisait partie de ce vaste mouvement philosophique ; c'est pourquoi, bien qu'il ait toujours écrit sous l'« influence notoire » de Chesterton, il n'a jamais pu pénétrer l'homme qui palpitait dans l'éclat de son écriture, en qui s'amalgamaient - comme l'a écrit Leonardo Castellani - « la sagesse du vieillard, la raison de l'homme, la combativité du jeune homme, la pétulance du garçon, le rire de l'enfant et le regard étonné et sérieux du nourrisson ». Et tous ces vêtements apparaissent dans ses écrits, qui exercent une influence vitale sur ses lecteurs. Car l'influence de Chesterton n'est pas seulement (contrairement à celle de Borges) intellectuelle ou esthétique ; Chesterton est aussi un « maître à penser » qui façonne notre pensée et nous apprend à vivre.
Je crois que c'est finalement la raison ultime de la pertinence de Chesterton, un siècle et demi après sa naissance ; une pertinence de la même nature que celle d'autres auteurs comme Cervantès ou Dostoïevski qui, en plus de nous donner un plaisir littéraire, nous façonnent intérieurement ; une pertinence que Borges ne pourra jamais avoir, même s'il est l'écrivain espagnol le plus techniquement parfait de tout le vingtième siècle. C'est sans doute une magnifique ironie que Dieu ait choisi Borges comme sauveur de Chesterton, sans lui permettre de pénétrer la raison ultime de sa valeur, tout comme il a choisi Moïse comme guide vers la terre promise, sans lui permettre d'y mettre les pieds. Car Dieu est un ironiste aussi paradoxal et éblouissant que Chesterton lui-même.
11:44 Publié dans Littérature, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : g. k. chesterton, chesterton, jorge luis borges, lettres, littérature, littérature anglaise, littérature argentine, lettres argentines, lettres anglaises |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 05 janvier 2025
La fin du "quatrième tournant"

La fin du "quatrième tournant"
Alexandre Douguine
La théorie générationnelle de Strauss-Howe, ou théorie du « quatrième tournant », postule que l'histoire suit des schémas cycliques en passant par quatre tournants, chacun durant environ 20 à 25 ans :
1) Haute période (premier tournant) - C'est une ère d'institutions fortes et de conformisme. La confiance collective est élevée et l'individualisme est faible.
2) Période d'Éveil (deuxième tournant) - Un bouleversement culturel au cours duquel la jeune génération se rebelle contre les normes établies, ce qui conduit à un renouveau spirituel et culturel.
3) La période d'effritement (troisième tournant) - Les institutions s'affaiblissent, l'individualisme s'accroît et la confiance du public dans les institutions diminue. La société se fragmente.
4) La période de Crise (quatrième tournant) - Période de bouleversements majeurs où une action collective est nécessaire pour résoudre des problèmes cruciaux, impliquant souvent une guerre, un effondrement économique ou un changement social majeur. Cela conduit à un nouvel apogée, qui redémarre le cycle.
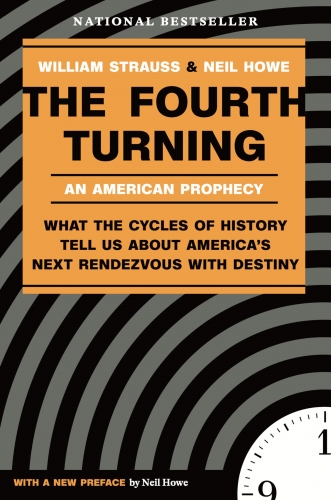
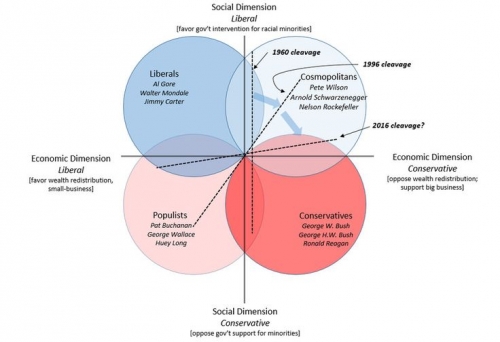
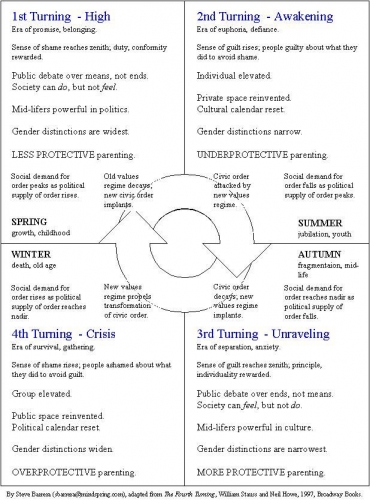
Ces cycles sont façonnés par la psychologie collective des différentes générations (Prophète, Nomade, Héros et Artiste), chacune ayant des traits distincts influencés par l'époque dans laquelle elle est née. La théorie suggère que la compréhension de ces cycles peut aider à prédire les changements sociétaux à venir et à s'y préparer.
La théorie générationnelle de Strauss-Howe marque la transition d'un cycle historique à un autre, un passage symbolisé aujourd'hui par Donald Trump. Le néoconservatisme et le sionisme chrétien sont considérés comme des parties intégrantes de la phase de crise, ce qui représente un défi important.
La théorie de Strauss-Howe est particulièrement pertinente lorsqu'elle aborde la dynamique entre la socialité (holisme) et l'individualisme. Cela s'apparente au célèbre dilemme de L. Dumont, où la socialité représente l'apogée, le début et le printemps, tandis que l'individualisme signifie la crise, la fin et l'hiver, l'individu étant dépeint comme Krampus.
La modernité occidentale, dans ce contexte, est la crise, le déclin (Untergang). Le nominalisme et l'individualisme occidentaux sont emblématiques de l'hiver de l'histoire, marquant la transition de la culture à la civilisation (selon Spengler) et l'oubli de l'être (Heidegger). La théorie générationnelle peut être étendue à des cycles historiques plus larges.
En juxtaposant des cycles relativement courts comme le saeculum et les Turnings aux vastes saisons de l'histoire (comme la Tradition, la Modernité, la Postmodernité), nous concluons que Trump signifie la fin d'une époque majeure - la fin du monde moderne.
Cela marque également la fin de la modernité occidentale. Le postmodernisme sert de fondement philosophique à la culture woke et au mondialisme libéral, révélant le nihilisme inhérent à la modernité occidentale. C'est le point culminant des fins, la fin de l'histoire occidentale.
Trump finalise cette fin, symbolisant la fin de la fin. Cependant, la question demeure: est-il conscient de sa mission ? Peut-il initier un nouveau départ ? Le prochain sommet (haute période, hauts temps) ne peut être quelque chose de relatif, de limité ou de local. Le prochain tournant doit être une révolution conservatrice globale à l'échelle mondiale.
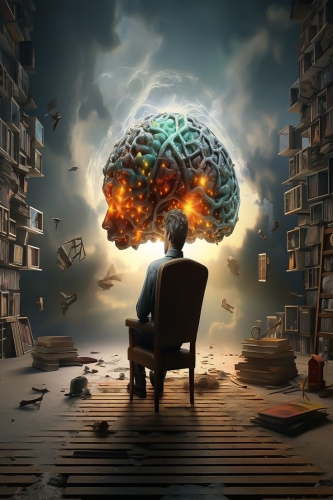
Le prochain sommet (hauts temps, haute période) doit signifier le dépassement de la modernité, c'est-à-dire de l'individualisme occidental, de l'atomisme, du libéralisme et du capitalisme. L'Occident doit se transcender. C'est pourquoi les œuvres de Weaver et le platonisme politique sont si importants. Le prochain Grand Réveil devrait être un Grand Réveil, mais pas au sens de Strauss-Howe.
La modernité occidentale était fondamentalement défectueuse, conduisant à une dégénérescence totale et à un désastre, culminant avec le règne de l'Antéchrist. La culture woke est la culture de l'Antéchrist.
Le prochain sommet (hauts temps) ne peut être que le grand retour au Christ. Le Christ est le roi du monde. Son autorité a été temporairement usurpée par le prince de ce monde, mais le règne de Satan prend fin. Les libéraux sont considérés comme possédés par Satan et la modernité elle-même est satanique. En termes hindous, ce cycle est connu sous le nom de Kali-Yuga, l'âge des ténèbres.
Trump est bien plus qu'un simple Trump, c'est un signe.
17:55 Publié dans Actualité, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, théorie générationnelle strauss-howe, strauss-howe, alexandre douguine |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 30 décembre 2024
Raâga Blanda, les compositions poétiques d'Evola 1916-1922
Raâga Blanda, les compositions poétiques d'Evola 1916-1922
L'éditeur évoque, avec une évidente participation émotionnelle, sa rencontre avec Evola, un auteur qui a joué un rôle important dans l'histoire de la courageuse maison d'édition romaine.
par Giovanni Sessa
Source: https://www.barbadillo.it/117475-libri-strenne-di-natale-...
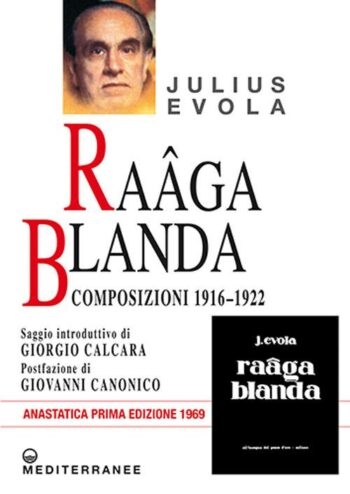 Raâga Blanda, un recueil de poèmes de Julius Evola pour les éditions Mediterranee
Raâga Blanda, un recueil de poèmes de Julius Evola pour les éditions Mediterranee
À l'occasion du 50ème anniversaire de la mort de Julius Evola, un nombre considérable d'œuvres du philosophe ou qui lui sont dédiées ont été imprimées. Nous abordons ici le recueil de compositions poétiques d'Evola, Raâga Blanda, récemment sorti en librairie grâce aux Edizioni Mediterranee (pour les commandes : 06/3235433, ordinipvdizionimediterranee.net, pp.79, 14,50 euros). Le livre, qui comprend un essai introductif de Giorgio Calcara, se termine par une postface de Giovanni Canonico, patron des Edizioni Mediterranee, ainsi que par une brève biographie du penseur. L'éditeur évoque, avec une évidente participation émotionnelle, sa rencontre avec Evola, un auteur qui a joué un rôle important dans l'histoire de la courageuse maison d'édition romaine. Il s'attarde en particulier sur l'histoire de la couverture du volume que nous présentons, reproposée dans cette nouvelle édition anastatique, exactement telle qu'elle a été conçue et souhaitée par le philosophe.
Calcara, dans l'essai introductif, présente, de manière organique et avec des accents persuasifs, le sens et la signification de la production poétique d'Evola. Il s'agit d'un moment central dans la production artistique futuriste-dadaïste du traditionaliste et d'une grande importance. La première édition de Raâga Blanda est parue en 1969, grâce à l'extraordinaire sensibilité éditoriale de Vanni Scheiwiller.
La saison poétique d'Evola, contemporaine de sa saison picturale, s'est en effet achevée vers 1922. Ses lueurs poétiques ont attendu cinquante ans pour être éditées dans leur intégralité, grâce à l'insistance de l'auteur qui considérait ces expériences « de jeunesse » comme centrales dans son processus de réalisation spéculative. Les compositions de Raâga Blanda témoignent, comme l'indique la Note préparée par la Fondation, de « l'unité profonde d'un philosophe encore capable de penser en artiste et d'un artiste qui [...] n'a jamais cessé de faire de la philosophie » (p. X). Le terme Raâga apparaît pour la première fois chez Evola en 1920, dans le poème I sogni (Rêves), inclus dans Arte astratta (Art abstrait), texte capital de la théorie abstractionniste européenne. Calcara affirme qu'il évoque : « une présence mystérieuse qui se manifeste sous la forme d'une expression phonique abstraite » (p. XIV). Ce lemme prend une forme définitive dans le poème La parole obscure, devenant l'un des quatre « élémentaires » de cette composition, Monsieur Raâga.
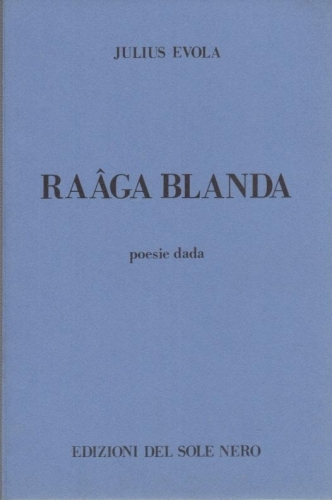 Ce dernier exerce une fonction d'enregistrement, en transcrivant : « les mécanismes du paysage intérieur activés par les trois élémentaires précédents » (p. XIV), Lilian, Ngara, Hhah. Grâce à l'étude d'Elisabetta Valento de 1989, centrée sur la relation épistolaire que l'artiste-philosophe entretenait avec le dadaïste Tzara, nous savons que, dès 1919, Evola pensait à son livre poétique, probablement achevé à la fin de l'année 1920. Le livre ne vit pas le jour à ce moment-là en raison de désaccords avec Marinetti et les futuristes et, par conséquent, certaines des compositions furent intégrées à l'essai théorique L'art abstrait, un texte qui, à bien des égards, était déjà dadaïste. Franco Crispolti, éminent critique d'art, a redécouvert le caractère crucial de la production artistique d'Evola à la fin des années 1950 et a organisé une exposition de ses peintures à la galerie de Claudio Bruni à Rome en 1963. Comme nous l'avons dit, Scheiwiller a adhéré avec enthousiasme à la proposition d'Evola, comme en témoigne la correspondance entre les deux hommes, conservée dans le Fonds Apice de l'Université de Milan.
Ce dernier exerce une fonction d'enregistrement, en transcrivant : « les mécanismes du paysage intérieur activés par les trois élémentaires précédents » (p. XIV), Lilian, Ngara, Hhah. Grâce à l'étude d'Elisabetta Valento de 1989, centrée sur la relation épistolaire que l'artiste-philosophe entretenait avec le dadaïste Tzara, nous savons que, dès 1919, Evola pensait à son livre poétique, probablement achevé à la fin de l'année 1920. Le livre ne vit pas le jour à ce moment-là en raison de désaccords avec Marinetti et les futuristes et, par conséquent, certaines des compositions furent intégrées à l'essai théorique L'art abstrait, un texte qui, à bien des égards, était déjà dadaïste. Franco Crispolti, éminent critique d'art, a redécouvert le caractère crucial de la production artistique d'Evola à la fin des années 1950 et a organisé une exposition de ses peintures à la galerie de Claudio Bruni à Rome en 1963. Comme nous l'avons dit, Scheiwiller a adhéré avec enthousiasme à la proposition d'Evola, comme en témoigne la correspondance entre les deux hommes, conservée dans le Fonds Apice de l'Université de Milan.
Pour saisir le sens de ces poèmes, il est nécessaire de se référer à la signification que le terme raâga avait dans le bouddhisme primitif. Il peut être traduit par « attachement », « désir » et fait allusion à ce qui pèse sur l'esprit, le reléguant à la seule dimension « causale », « sensorielle ». En sanskrit, ce mot peut être traduit par « couleur », « tache sombre », signe de l'impureté de la condition humaine générant « la souffrance et l'impossibilité d'atteindre l'état final de la grande libération » (p. XVII). L'adjectif blanda (doux) vise, quant à lui, à adoucir cette condition de stase existentielle, en faisant allusion à son possible dépassement. Les poèmes d'Evola ont donc des traits de « mystérieuses abstractions verbales, ils décrivent des paysages intérieurs [...] qui tantôt chantent des territoires doux et acides et des galops féroces, tantôt descendent soudain dans de sombres profondeurs abyssales pour finir projetés sur des orbites stellaires glacées » (p. XIX). À travers l'expérience du vide, les poèmes d'Evola font allusion au dépassement de la limite qui nous caractérise encore, en découvrant, alchimiquement, notre nature divine.
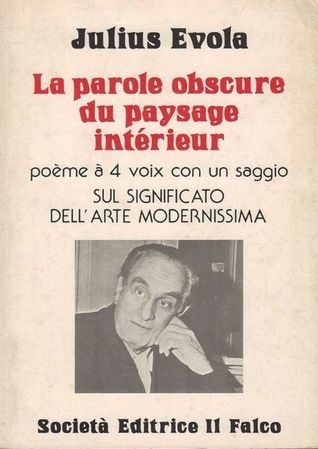 La parole poétique évolienne est mantra, rébus phonologique, qui libère le dire de la dimension de la signification, c'est une parole magique qui porte en elle l'incipit vita nova, tant à l'égard du moi que du monde, comme dans les accords de la perspective philosophique de l'idéalisme magique. Raâga blanda témoigne de l'irruption du spirituel dans l'art. L'art authentique, en effet, est orphique, acte dé-déterminant, mettant en évidence l'être toujours à l'œuvre au commencement.
La parole poétique évolienne est mantra, rébus phonologique, qui libère le dire de la dimension de la signification, c'est une parole magique qui porte en elle l'incipit vita nova, tant à l'égard du moi que du monde, comme dans les accords de la perspective philosophique de l'idéalisme magique. Raâga blanda témoigne de l'irruption du spirituel dans l'art. L'art authentique, en effet, est orphique, acte dé-déterminant, mettant en évidence l'être toujours à l'œuvre au commencement.
Pour ce faire, le mot doit se libérer de son rapport univoque aux choses, mais aussi de son propre usage métaphorique : ce n'est que dans ce cas qu'il devient une porte royale grande ouverte sur le divin. Sur les trente compositions rassemblées dans le volume, huit sont tirées de L'art abstrait, bien que révisées. Certains textes sont explicitement dadaïstes. Parmi eux, « A » dit : Lumière dans lequel est évoqué le serpent Ea, typique de l'imagerie hermétique évolienne. Les poèmes de la première période se réfèrent, à partir de 1916, à la phase picturale de l'« idéalisme sensoriel » : « ce qui frappe [...], c'est le recours obsessionnel à l'addition des couleurs » (p. XXII). Ceci est particulièrement évident dans les Esquisses (Schizzi). Les poèmes composés pendant la période où Evola a participé à la Première Guerre mondiale sont également dignes d'intérêt. Dans ces poèmes, « ce qui est représenté, c'est la conséquence de l'action : la visée, le tir [...] et l'explosion » (p. XXII).
Il convient de noter que, transversalement, dans de nombreux poèmes, il y a une valorisation évidente du « féminin », on pense surtout à la Ballade en rouge (Ballata in rosso). La nouvelle édition de Raâga blanda permet au lecteur de saisir pleinement la valeur de la poésie d'Evola, moment saillant de son parcours idéal et de sa réalisation.
20:13 Publié dans Littérature, Livre, Livre, Philosophie, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julius evola, poésie, dadaïsme, art abtrait, lettres, lettres italiennes, littérature, littérature italienne, tradition, traditionalisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Vers une théorie générale de l'horreur

Vers une théorie générale de l'horreur
Alexander Douguine
Peu à peu, les travaux avancent dans une nouvelle direction : une théorie générale de l'horreur. Heidegger oppose l'horreur (Angst, angoisse) à la peur (Furcht, crainte). La peur nous fait fuir, alors que l'horreur nous fige sur place. En psychiatrie, la distinction entre le trouble anxieux et la peur est quelque peu différente mais complète le dualisme de Heidegger. L'horreur naît de l'intérieur, face à quelque chose d'indéfini et d'inexprimable. La peur vient toujours de l'extérieur et a - même si ce n'est qu'un phantasme - une cause, une forme et une explication.
Les films de David Lynch traduisent admirablement l'angoisse, mais celle-ci est tout à fait différente du genre de l'horreur. Une horreur intérieure intense rend une personne intrépide. À l'inverse, l'immersion dans une peur mesquine et tremblante (la « créature tremblante ») protège contre l'impact de l'horreur intérieure.
La perspective de la déshumanisation de l'homme, de plus en plus aiguë et proche, peut générer à la fois la peur et l'horreur. La peur nous fait esquiver, l'horreur nous pousse au face-à-face. L'horreur est plus proche de l'éternité. La peur est inhérente au temps.

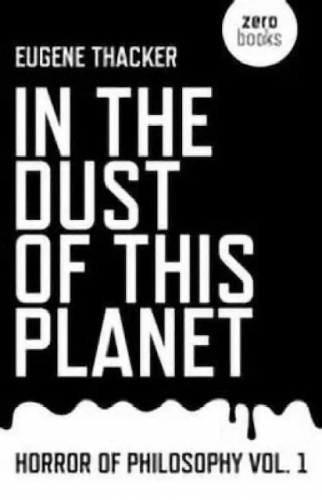
Eugene Thacker dans « Horror of Philosophy » explique l'horreur par trois types de « monde » dans l'esprit du réalisme critique (OOO - Object-Oriented Ontology) :
Le monde avec nous, c'est-à-dire le monde en tant qu'existentiel de Heidegger (in-der-Welt-sein). Ce thème est développé par Eugen Fink, ami de Heidegger et élève de Husserl - kosmologische Differenz - la différence entre les choses du monde et le monde dans son ensemble. Fink l'interprète dans l'esprit de la distinction de Heidegger entre l'être et les êtres (Le jeu comme image du monde).
Le monde en soi. La théorie matérialiste de l'objet.
Le monde sans nous. Selon Thacker, c'est ce qui suscite l'horreur, car il se situe entre le monde-avec-nous et le monde-en-soi. Cette dimension intermédiaire est l'expérience du contact avec quelque chose qui abolit activement et concrètement notre nature même. C'est la zone de l'horreur pure, et non de la peur. Le contact avec le monde-sans-nous est bien plus aigu que la mort personnelle. Lorsque nous périssons, notre espèce demeure. Mais l'expérience de l'extinction de l'espèce est véritablement horrifiante. Elon Musk y a récemment réfléchi.
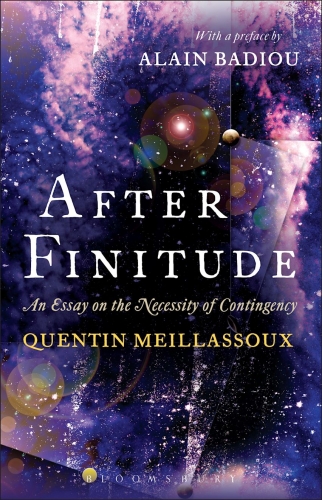
Ce thème apparaît chez d'autres réalistes spéculatifs comme Meillassoux et Harman dans un contexte similaire. Construisant une ontologie des objets, ils modélisent la fin du sujet (et de tout corrélationnisme) et en viennent à l'hypothèse de l'être se profilant de l'autre côté des choses, où se concentre l'horreur absolue. Ils illustrent cela par des motifs et des intrigues lovecraftiennes, en intégrant à la philosophie ses images et ses idées sur les dieux idiots et les civilisations sous-marines.
Heidegger lui-même y fait allusion, l'horreur (Angst) étant pour lui l'expérience du néant ou de l'être pur (« Qu'est-ce que la métaphysique ? »). Cependant, les réalistes critiques adaptent Heidegger à leur obsession des objets et au démantèlement de la vie, du sujet et du Dasein, alors que pour Heidegger, le Dasein est central.
Bien sûr, une théorie générale de l'horreur devrait commencer par la nature du sacré et la peur de Dieu (ici, clairement, nous parlons d'horreur, d'Angst - Dieu n'effraie pas, il horrifie). Ensuite, explorer Boehme, Pascal, Hegel, Kierkegaard. Et seulement ensuite, Heidegger et la pensée post-heideggérienne - de Sartre et Camus à Deleuze et OOO.
D'ailleurs, pour Pascal et Kierkegaard, l'horreur est évoquée par l'Univers très autonome ouvert par la physique des temps modernes - froide et infinie. C'est peut-être ce qui explique les descriptions grotesques de la nature sombre de Dieu dans la théosophie de Boehme.
La pensée de Plotin et de Denys l'Aréopagite sur le pré-être qu'est l'Un, sur la théologie apophatique, a préparé le terrain pour un autre type d'horreur - transformatrice, élévatrice, déifiante.
La crainte du Seigneur est l'axe vertical de l'être.
Quel pourrait être le phénomène ou le concept russe le plus proche de l'horreur? Comment les Russes vivent-ils et interprètent-ils l'horreur?
À première vue, un Russe ne connaît pas l'horreur avant le monde parce que, pour nous, le monde est une continuation organique de soi-même - les racines des mots « мир » (monde) et « милый » (cher) ne font qu'un, selon Kolesov. Le cher n'inspire pas l'horreur. Pas plus que le monde en tant que communauté.
Ainsi, les Russes ne connaissent pas la nature en tant que telle (en soi, en tant qu'objet). Les Russes ont tendance à l'animer et à la spiritualiser (d'où le techno-animisme d'Andrei Platonov, son bolchevisme magique). Et bien sûr, Fedorov, pour qui la matière est la danse des particules des cendres de nos pères. Les atomes de Tsiolkovski, qui ont goûté à la douceur de vivre.
Notre science n'est pas matérialiste mais panthéiste.
Ce qui horrifie un Russe, ce n'est pas tant l'absence et l'aliénation de la vie que ses excès et ses aberrations. D'où le thème essentiellement slave du vampire. Le vampire est un excès de vie. Il devrait être mort, mais d'une manière ou d'une autre, il ne l'est pas.
Il semble que l'amour obstiné de la vie chez un Russe déplace l'horreur trop profondément à l'intérieur - si profondément que nous ne le remarquons pas nous-mêmes. Mais les autres la remarquent.
L'horreur est ce que nous inspirons.
19:33 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, horreur, alexandre douguine |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 28 décembre 2024
L'Approche Unique de Kierkegaard sur le 'Péché'
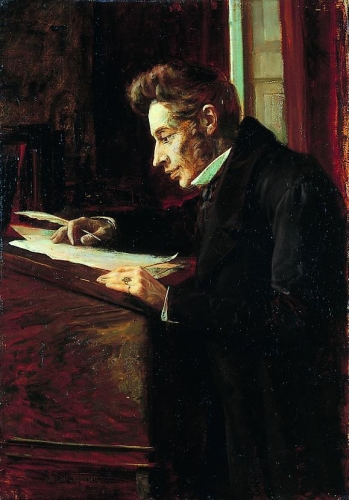
L'Approche Unique de Kierkegaard sur le 'Péché'
Troy Southgate
Source: https://troysouthgate.substack.com/p/kierkegaards-unique-...
Bien que nous soyons habitués à entendre des chrétiens décrire des comportements tels que la fornication ou l'hédonisme comme des manifestations de comportements « pécheurs », il existe une manière légèrement différente d'aborder la question, qui pourrait même intéresser les non-chrétiens.
Søren Kierkegaard, ayant grandi dans un environnement profondément religieux, où lui et ses compagnons luthériens étaient constamment rappelés à la nécessité d’examiner leur conscience à la recherche de traces persistantes de « péché », a adopté une perspective différente dans ses propres travaux. Plutôt que de prendre un ton moralisateur, il envisageait la déviance humaine de manière analogue à celle de Saint Augustin d'Hippone, qui parlait de désorientation spirituelle. Pour Kierkegaard, le « péché » naît dès que les êtres humains, face à la liberté, deviennent anxieux et échouent à faire le bon choix. La vie est pleine de moments difficiles, mais c’est la manière dont nous les affrontons qui compte.
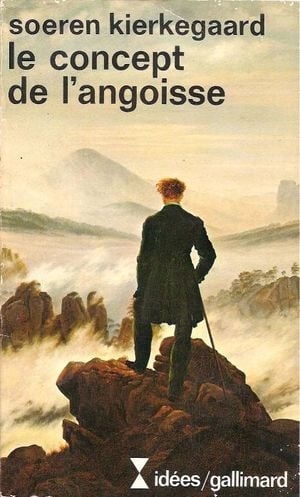 Dans son ouvrage de 1844, Le Concept de l'angoisse, Kierkegaard explique que nous devons laisser passer en nous les préoccupations et l’incertitude, et qu’en utilisant notre force intérieure, nous pouvons tenir face à la tempête comme un homme condamné à mort refuse de plier devant ses ennemis. En embrassant la liberté qui nous est donnée et en « passant à travers l’anxiété du possible », nous nous purifions de tout ce qui est mesquin et inférieur. Plutôt que de décrire le « péché » comme une tentation à éviter, Kierkegaard insiste sur le fait que nous devons accueillir ces moments de crise personnelle, car ils nous offrent une véritable libération et peuvent enseigner à l'individu :
Dans son ouvrage de 1844, Le Concept de l'angoisse, Kierkegaard explique que nous devons laisser passer en nous les préoccupations et l’incertitude, et qu’en utilisant notre force intérieure, nous pouvons tenir face à la tempête comme un homme condamné à mort refuse de plier devant ses ennemis. En embrassant la liberté qui nous est donnée et en « passant à travers l’anxiété du possible », nous nous purifions de tout ce qui est mesquin et inférieur. Plutôt que de décrire le « péché » comme une tentation à éviter, Kierkegaard insiste sur le fait que nous devons accueillir ces moments de crise personnelle, car ils nous offrent une véritable libération et peuvent enseigner à l'individu :
« À ne pas avoir d'anxiété, non pas parce qu'il peut échapper aux terribles épreuves de la vie, mais parce que celles-ci deviennent toujours faibles en comparaison avec celles du possible ».
Ainsi, comme Augustin avant lui, Kierkegaard croyait que bien que la notion de péché originel soit tirée du récit de la désobéissance d'Adam et Ève dans le Jardin d'Éden, les humains vivent encore et encore la Chute tout au long de leur vie, ce qui explique l’apparition récurrente de ces moments d’anxiété.
Compte tenu du syndrome de Stockholm qui a conduit les populations de l'Europe et de l'Amérique du Nord contemporaines à développer une affinité psychologique avec leurs geôliers financiers, il est évident que la plupart des gens ne prennent pas au sérieux les conseils de Kierkegaard sur la saisie de la liberté. Ils choisissent plutôt l'option plus « pécheresse » qui leur permet de réprimer leur anxiété à l'aide des artifices synthétiques de la vie moderne. Bien que Kierkegaard accepte que notre chemin à travers ce royaume terrestre soit difficile, il n'y a vraiment aucune excuse pour rejeter la liberté dès qu'elle se présente à nous.
23:14 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, sören kierkegaard, angoisse |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 22 décembre 2024
La défense de la dialectique hégélienne par Bataille
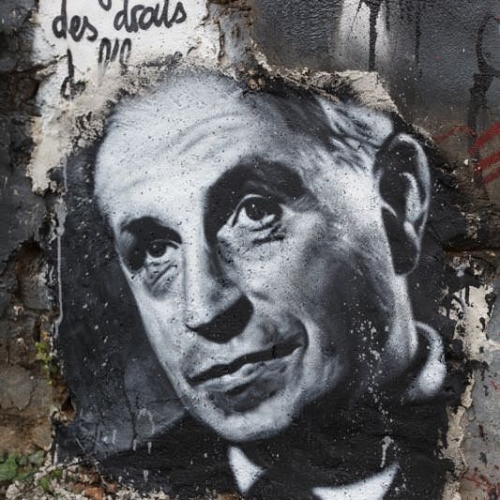
La défense de la dialectique hégélienne par Bataille
Troy Southgate
Source: https://troysouthgate.substack.com/p/batailles-defence-of...
Les premiers écrits de Georges Bataille révèlent, en particulier, une profonde aversion pour la manière dont la dialectique hégélienne s’était de plus en plus imbriquée dans l’idéologie marxiste. Du moins en ce qui concerne l’interprétation ordinaire de Hegel, car pour Bataille, la réconciliation des contraires aboutit à quelque chose de progressiste et est donc en contradiction flagrante avec sa propre glorification de la matière vile.
Prenant la matière comme point de départ, Bataille rejette le matérialisme plus pragmatique qui s’était infiltré dans la théorie marxiste, en raison de sa tendance à construire un édifice scientifique. Le matérialisme bas de Bataille, en revanche, ne peut être réduit à des systèmes scientifiques ou politiques parce que, selon lui, ces techniques structurelles trouvent profondément inconfortables les questions relatives à la saleté, à la dégénérescence et à la décomposition. Marx, malgré la transformation ultérieure de ses idées en stalinisme et en maoïsme, entretenait une vision distinctement utopique et peut-être même idéaliste de l’avenir, vision qui a peu de points communs avec la fascination étrange de Bataille pour la fange, les excréments et la putréfaction.
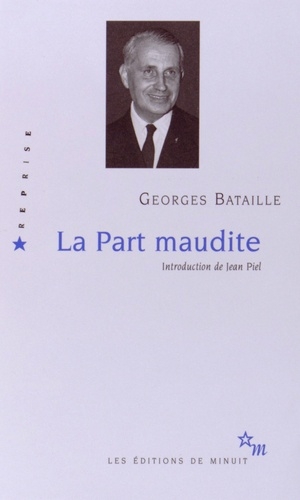
Pour revenir à la question de la dialectique hégélienne, si le couplage d’un négatif (thèse) avec un positif (antithèse) mène simplement à quelque chose de progressiste (synthèse), la notion batailleenne de matière vile est complètement perdue. En d’autres termes, bien que le marxisme insiste sur l’importance du matérialisme et le revendique comme sien, sa forte dépendance à Hegel conduit inévitablement, selon Bataille, à une dilution de ce qui est négatif. Cela se traduit par une pâle imitation du matérialisme lui-même. Bataille soutient que le marxisme, sans les réalités brutales des mouches, des excréments et des fornications, déraille du processus d’hétérodoxie et échoue ainsi à débarrasser la société capitaliste de ses valeurs bourgeoises.
C’est peut-être ici que la philosophie de Bataille commence à s’approcher de l’extrémité plus « radicale » du primitivisme. Bien qu’il semble logique de suggérer que l’effondrement de la civilisation moderne entraînerait une régression technologique, Bataille aurait sans doute considéré les tentatives de conserver un semblant de mécanisation dans un contexte primitiviste de la même manière qu’il voyait la dialectique communiste: comme une trahison du matérialisme, forçant un pacte impardonnable avec le diable hégélien. Même l’interprétation matérialiste de l’histoire, aurait-il soutenu, échoue en fin de compte à surmonter l’idée même d’histoire.
On peut détecter une perspective similaire dans la proposition économique de Bataille, selon laquelle l’idée marxiste absurde de « libération » par le travail devrait être remplacée par l’événement « orgiaque » du potlatch tribal et, par conséquent, par la destruction de la richesse en tant que telle. En même temps, on peut se demander si la réalisation d’un négatif batailleen réussi ne finit pas par se contredire en devenant un positif aux yeux de ses protagonistes.
21:33 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : hegel, georges bataille, philosophie, dialectique, matérialisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
De la théologie négative

De la théologie négative
(Pettersson, Cacciari, Heidegger, Hölderlin, Maître Eckhart, Malévitch)
par Gérard Conio
On a établi un rapport entre la musique et les mathématiques, mais la musique peut aussi exprimer des aspirations théogoniques, comme cela m’est apparu en écoutant la sixième symphonie d’Allan Pettersson, dont j’ai trouvé le commentaire dans les réflexions de Massimo Cacciari sur « Le problème du sacré chez Heidegger ».
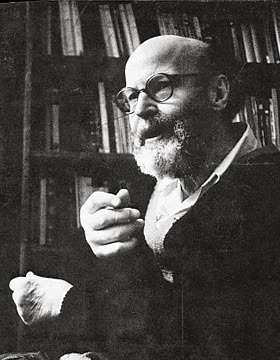
Parmi les symphonies d’Allan Pettersson (photo), la sixième est certainement la plus violente, la plus survoltée, la plus convulsive, la plus déchirante, la plus spasmodique, la plus tendue vers une harmonie inaccessible. Allan Pettersson a dit qu’elle n’était pas tragique, mais solaire. Le soleil, qui engendra Dionysos peut être, il est vrai, une source du tragique, comme chez les Grecs. Faut-il y voir la source de la force émotionnelle de Pettersson? Le tragique n’est pas incompatible avec l’extase, il en est même la face noire. Cette exaltation insatiable et incompressible concorde avec le Chaos sacré chanté par Hölderlin dans ses hymnes. Et la symphonie de Pettersson est elle-même un hymne au « chaos sacré », celui que Bakst a évoqué dans « Terror antiquus », mais aussi le « Heilig » décanté par Heidegger dans « Comme au jour de fête... » de Hölderlin:
« Quel est le sens de « Heilig », s’interroge Cacciari, comment ce sens revit-il chez Hölderlin ? Dans « heil » résonne cette idée de vigueur, de vitalité, d’impulsion, qui caractérise le terme védique isirah et le hiéron grec. C’est l’attribut des vents, des chevaux, des hommes et des villes (« Ilion sacrée »), mais aussi des choses saisies à leur acmé, à l’instant culminant de leur puissance. Dans ce sens, en un passage d’une prodigieuse violence, Homère (Illiade, XVI, 407) qualifie de hiéron le poisson qui se débat hors de l’eau, à l’extrémité de la ligne - et cette image lui est suggérée par le spectacle terrible de Thestor harponné à la mâchoire par la lance de Patrocle qui lui transperce la tête de part en part et le soulève ainsi par-dessus la rampe de son char où il avait cherché refuge. Cet éclair de vie (fa-villa !) est si puissant et inoubliable, jusque dans son instantanéité, qu’il semble parfait, accompli, inéluctable. Par ailleurs, la foudre gouverne toutes choses – et Aiôn est pour Plotin esklampon, éclair...

Heilige conserve intact ce sens chez Hölderlin; il s’oppose donc étymologiquement à toute idée de sacralité (sacer: ce qui est séparé, éloigné, et préservé justement du fait qu’il est séparé: arkeo, arcanum). L’heilig surgit devant nous, vif et « sauf » dans sa présence (gothique: hails, d’où heilen = guérir; et il faut noter la correspondance avec l’anglais holy, équivalent de heilig, et whole = entier, intègre), quand bien même cette présence serait le spasme de Thestor. Hiéron, dirait le chrétien, primordialement, est le cri du Christ sur la croix. »
Ce cri, ce spasme, retentissent dans la sixième symphonie d’Allan Pettersson.
C’est le spasme d’un accouchement, le spasme d’un commencement qui n’aura pas de fin et qui embrasse la terre et les hommes.
« Il ne faut pas croire, a dit Pettersson, que j’ai pitié de moi-même, j’ai voulu exprimer ma compassion pour la souffrance des hommes. »
Les hommes sont les enfants de la terre qu’ils ont sacrifiée et leur souffrance, née du chaos originel, c’est la souffrance de la terre.
Dans les sonorités proprement inouïes qu’il tire de cette souffrance, Pettersson nous fait entendre ce que Carl Schmitt a appelé « le Nomos de la Terre ». C’est la terre qui se soulève pour prendre la parole, la terre blessée à mort par les hommes.

Cette énergie tellurique naît du chaos originel, du chaos sacré, du Heilig, elle se fond à ce grondement indistinct avant de prendre forme, avant de « se nommer », elle se lamente comme la terre humaine, et pourtant s’irradie toujours de plus en plus, monte comme un désir inassouvi et nous transporte dans des gradations qui culminent toujours sur la première note du premier motif et elle ne trouvera jamais sa résolution car elle se tord sur elle-même comme un serpent qui se mord la queue. En dépit du gigantisme d’une polyphonie pléthorique, cet éternel commencement, ce martèlement lancinant du même motif matriciel, de la même note aiguë, lancée très haut, dans une répétition obsédante, se rapproche davantage des compositeurs minimalistes que de Gustav Mahler auquel on a souvent comparé Pettersson.
Le chaos sacré n’est pas seulement l’attente du Nomos, un appel vers le Nomos, il a besoin du Nomos pour exister, il est déjà le Nomos en puissance: « L’immédiat, écrit Cacciari, ne devient pas médiat, contrairement à ce qu’affirme Heidegger, mais n’est rien d’autre et depuis toujours que le fondement même de la médiation qui, dans la médiation, se révèle et se réalise », sans jamais « vaciller ». »

C’est ainsi que Pettersson articule le mouvement de sa symphonie dans une simultanéité des contraires, non comme Héraclite dans le changement et dans l’absorption dans le processus, mais dans l’affirmation du fondement de l’être, comme Malévitch. C’est l’abîme qui nous parle.
« Et il est inévitable que cela soit, poursuit Cacciari, si je pense le Commencement sous la forme grecque du Chaos, de l’Ouvert (et cela seul, je le nomme « das Heilige »): Chaos reste toujours une puissance théo-gonique. Et donc, dans ce cadre, le Commencement n’est pas autrement pensable sinon comme ce qui donne-commencement, ce qui est source et origine, et donc lié en lui-même, dans son être le plus intime, à la physis: commencement-de-la-nature, Ouvert qui est depuis toujours hymne de (génitif absolu) la nature. Ainsi le rapport entre Chaos et Nomos n’est pas problématique, le Chaos étant depuis toujours pré-compris comme origine du Nomos, au sens radical qu’il en est le présupposé. Mais le présupposé est pose, il est une position : la pensée pose le Chaos comme origine essentielle des lois qui ordonnent son propre langage»
Dans une intuition de la pensée sensible, Pettersson nous apporte la même révélation.
Et dans son hymne « Comme au jour de fête… » Hölderlin ne nous dit rien d’autre :
« Mais voici le jour ! Je l’espérais, je le vis venir
Et ce que je vis, que le Sacré soit ma Parole
Car elle, elle-même, plus ancienne que les temps
Et au-dessus des dieux du soir et de l’orient,
La Nature maintenant s’est éveillée avec tumulte,
et haut de l’Ether jusqu’à l’abîme en-bas
Selon un ferme statut, comme jadis, tiré du Chaos sacré
L’Esprit se sent à nouveau créateur. »
Cacciari constate le dilemme dans lequel la position de Hölderlin a enfermé Heidegger en le retournant contre lui-même. Et son commentaire pourrait parfaitement s’appliquer à la musique de Pettersson qui suit inexorablement la voie indiquée par Hölderlin en produisant « le tumulte avec lequel la Nature s’est éveillée quand, du haut de l’Ether jusqu’à l’abîme en-bas, tiré du Chaos sacré, l’Esprit se sent à nouveau créateur » :
« Dans les limites de la compréhension grecque de l’origine, que Heidegger fait sienne, Chaos est fondamentalement et de manière constante disposé au Nomos, et la parole du Nomos disposée à l’écoute du Chaos qui en est à l’origine. Ainsi, le chant commence par le Chaos. Mais le Commencement, ainsi nommé et posé, n’est autre sinon « quod debet esse » - ce qui doit être – fondement qui ne peut être scindé de l’advenir, immédiat qui n’est autre que le domaine propre des médiations. Que le Commencement devienne, qu’il s’articule et procède, qu’il pâtisse de la « décision » du rayonnement, qu’il soit dit et pris en garde dans l’hymne, est pur destin. Est sacré le destin même de la manifestation du sacré. Mais ne devient sacrée, ainsi, finalement, que la pure dé-latence, dans laquelle se nie toute léthé.

Précisément la conclusion à laquelle Heidegger voudrait éviter d’arriver, qu’il croyait même éviter en pensant l’immédiateté de l’Ouvert. Heidegger est mu essentiellement par l’exigence de « sauver » l’immédiate omniprésence de l’Ouvert, du Commencement, de la « voracité » du processus, mais il ne peut satisfaire une telle exigence, justement parce qu’il la conçoit dans les termes théo-goniques de la tradition classique (revécue par Hölderlin) d’une part, et dans les termes idéalistes du rapport (qui reste inexorablement dialectique) entre immédiat et médiat d’autre part. Et cette pensée qu’il voulait montrer « en elle-même intacte et sauve (heilig), das Heilige finit par appartenir, en réalité, à l’horizon historique de la dé-sacralisation (dans tous les sens du terme: non seulement dans celui de l’anéantissement du sacer, processus qui est déjà la quintessence du christianisme, mais dans le sens aussi de l’élimination de toute différence essentielle entre le Sacré et sa parole). La méditation sur « das Heilige » apparaît véritablement décisive pour Heidegger, en tant que d’elle dépend l’instance fondamentalement anti-idéaliste de toute sa pensée et, en même temps, du naufrage qui la menace depuis toujours. »
Si on rapporte cette conclusion à la menace qui hante la pensée musicale de Pettersson, on trouvera la même résistance à « la voracité du processus », puisque le minimalisme latent que nous avons constaté s’inscrit contre le développement qui, dans la symphonie classique, détruit le fondement sur lequel il est posé.
Mais Pettersson est radicalement opposé à toute altération, toute aliénation du Commencement, de l’Ouvert, du « Heilige », et il reste indéfectiblement arrimé à un embarcadère d’où ne partira aucun « bateau ivre », vers aucun naufrage à « l’horizon historique de la dé-sacralisation ».

Et la déshérence du Sacré séparé de sa parole, du Chaos privé de son Nomos, a été conjurée par les prophètes du « logos apophantique » qui ont prôné le relâchement de la volonté de puissance, une abstention, un vouloir-non vouloir, un retrait de la décision créatrice, et c’est la Gelassenheit de maître Eckhart, celle des pauvres d’esprit, c’est le zéro des formes et le rien libéré de Malévitch qui apparaissent comme le seul moyen possible d’empêcher la catastrophe annoncée.
Et même si cet horizon historique constitue notre présent, nous pouvons puiser chez ces grands déconstructeurs du progrès, de la modernité, le courage nécessaire pour nous sauver.
Le salut est dans la superssentialis divinitas, la Gottheit de Maître Eckhart qui, écrit Cacciari, « semble indiquer cet infiniment Ultérieur, cet Ouvert qui donne lieu aux choses, que Heidegger nommait « das Heilige », à la suite de Hölderlin, Gottheit n’est ni terre, ni ciel, ni dieu ni homme. […..] La Gottheit comme « das Heilige », se montre dans l’instant même de son retrait et, se retirant, en cela se révèle. Le penser - non pas le calcul proportionné à des fins spécifiques, non le rechnen, mais le denken, - est ouvert à ce jeu originaire de l’Etre, qui ne peut avoir d’explication-détermination théologique, qui doit être médité dans son « ohne Warum ».
Le problème d’une pensée non-représentative-calculante, qui se constitue comme ouverture à une telle écoute, et donc en analogie avec l’Ouvert (responsable, en tant qu’elle « prend soin » de l’Ouvert) domine le Heidegger postérieur au Kant. Cette ouverture de la pensée est, à la fin, nommée Gelassenheit, terme eckhartien. La pensée se relâche, sich-ein-lassen, ne-voulant-rien, n’attendant-rien, se libère, se désenchaîne du sé-duisant des représentations, s’intériorise au fond du Soi, s’abandonne au jeu sans pourquoi de l’Etre, et s’abandonne devant les choses elles-mêmes pour saisir, dans leur réveil, « das Heilige ». Elle s’abandonne pour s’ouvrir au mystère.
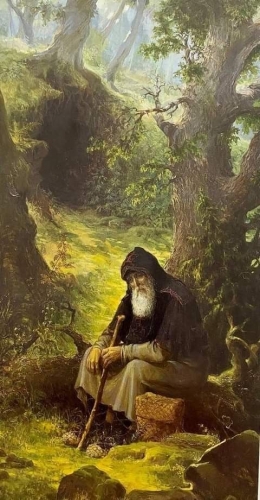
Ce mystère meut le « vouloir-non vouloir » de la dé-liaison entre les phrases tonales et atonales qui s’interpénètrent chez Pettersson, dans les renversements du même thème où le retrait, le relâchement des îlots lyriques répond aux climax des tutti orchestraux qui sonnent comme des tremblements de terre. La succession des marches et des transes est sans cesse transcendée par la Gottheit, la superssentialis divinitas qui surplombe la souffrance de la terre et des hommes.
« A travers Maître Eckhart, écrit Cacciari, Heidegger tente de désenchaîner l’Ouvert de la nécessité du donner-commencement: au sens de la nécessité de la manifestation. L’abandon est une libération de la représentation vers le mystère d’un tel Commencement; une révocation de la volonté en tant que volonté-à dessein, un vouloir-non vouloir, pour « insister » uniquement dans l’attente de l’abandon. Vouloir le non vouloir est une aporie typique du « pauvre eckhartien »: c’est de là aussi qu’elle est reprise par Schopenhauer (et par Michelstaedter bien avant Heidegger). On peut l’imaginer comme un rester dans l’attente sans attendre, sans préfigurer quelque chose d’attendu. Et, en vérité, c’est le rien qui est ici attendu, puisque le rien c’est l’Ouvert. Gelassenheit c’est se re-laisser-aller à l’Ouvert, qui n’est pas. La « quiète » dynamique de l’abandon ferait signe pourtant au néant du Commencement-Ouvert-Heilige et donc, en libérerait l’idée de toute nécessité épiphanique, révélatrice. »
Pettersson nous donne à entendre cet en-soi qui résorbe les tensions d’une âme souffrante et coïncide avec le rien libéré de Malévitch en réalisant la fusion des contraires dans l’attente de la Gottheit, au-dessus de toutes les manifestations pour s’ouvrir à l’Etre pauvre et nu.
19:32 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, hölderlin, martin heidegger, maître eckhart |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 20 décembre 2024
Les systèmes trifonctionnels chez Dumézil, Steiner et Stirner

Les systèmes trifonctionnels chez Dumézil, Steiner et Stirner
Troy Southgate
Source: https://troysouthgate.substack.com/p/threefold-systems-in...
La représentation du paradis médiéval par Pieter Bruegel l'Ancien, Le pays de Cockaigne (1567), met en scène un clerc, un paysan et un guerrier et représente ainsi les trois « fonctions » de la société indo-européenne. Autour d'un arbre, qui fait office de moyeu central, les personnages de la gravure représentent les rayons d'une roue, bien que la quatrième position - celle du noble - ait été occupée par une volaille rôtie.

Un critique a suggéré que Bruegel avait l'intention de dénoncer l'autosatisfaction bourgeoise des Pays-Bas du troisième quart du 16ème siècle. La composition tripartite de la société indo-européenne a été longuement discutée par le philologue français Georges Dumézil (1898-1986), bien que son affirmation de toujours, selon laquelle un système trifonctionnel est une marque fondamentale de la société indo-européenne, ait été critiquée par J. P. Mallory (né en 1945) dans son ouvrage de 1989, In Search of the Indo-Europeans : Language, Archaeology, and Myth. Contrairement à Dumezil qui insiste sur le fait qu'il représente une partie unique de notre identité sociale, Mallory pense qu'il s'agit d'un concept plus universel et qu'il n'est donc pas du tout confiné aux Indo-Européens.

Rudolf Steiner (1861-1925), qui a commencé à formuler sa théorie trifonctionnelle des « trois plis » sociaux peu après la fin de la Première Guerre mondiale, croyait, lui aussi en des solutions universelles, mais son approche était quelque peu différente. Partant du principe biologique que l'organisme humain est composé de trois systèmes indépendants qui coopèrent les uns avec les autres - à savoir notre « activité nerveuse et sensorielle », les « processus rythmiques » et le « système métabolique » - il explique ensuite comment cela peut servir de schéma directeur pour ce qu'il décrit comme la « vie économique », la « vie des droits » et la « vie culturelle » de l'humanité. Plutôt que de diviser les gens selon une sorte de pyramide des classes, Steiner souhaitait une forme d'autogestion dans laquelle nous participons à chacune des trois sphères tout en conservant notre indépendance.

Dans la nouvelle édition traduite de son texte de 1991, The Threefolding Movement, 1919 : A History, Albert Schmelzer explique que Steiner « s'est donc expressément défini par rapport à l'ancienne conception de Platon d'un État-statut. Alors que dans la société platonicienne, les êtres humains devaient être divisés en trois classes, les savants, les soldats et les paysans, la société trifonctionnelle à trois plis est elle-même articulée en fonctions d'une manière qui permet à chaque individu de collaborer de manière autodéterminée à la vie des trois domaines » (p.53).
La carte de l'organisme humain est transposée à la société humaine parce qu'elle est composée de trois systèmes qui coopèrent tout en conservant leur autonomie. Steiner, fortement influencé par son prédécesseur anarcho-individualiste, Max Stirner (1806-1856), applique essentiellement la méthode dite de « l'union des égoïstes » que ce dernier avait exposée dans L'Unique et sa propriété (1844). Selon les propres termes de Stirner: "Seuls les individus peuvent s'unir les uns aux autres, et toutes les alliances et ligues de peuples sont et restent des combinaisons mécaniques, car ceux qui s'unissent, du moins dans la mesure où les « peuples » sont considérés comme ceux qui se sont unis, sont dépourvus de volonté. Ce n'est qu'avec la dernière séparation que la séparation elle-même prend fin et se transforme en unification".
Comme je l'ai expliqué dans mon livre, The Self Unleashed : Max Stirner and the Politics of the Ego (2017) :
« Plutôt que d'accepter l'abstraction de la « communauté », l'égoïste ne voit que l'inégalité et le potentiel d'utiliser ou d'ignorer ses homologues. Cette relation ne doit cependant pas être une exploitation, car les égoïstes sont capables de former des unions pour atteindre leurs objectifs mutuels. Ces unions ne sont pas fondées sur la ferveur religieuse ou les valeurs libérales, par lesquelles les individus eux-mêmes sont liés à un idéal, et elles n'ont pas non plus besoin d'être centrées sur une famille ou une tribu, car l'union elle-même appartient à l'individu et devient sa propriété dans la poursuite de ce dont il a besoin. Ni Dieu, ni l'humanité, ni l'État, ni la nation, ni la famille, ni la communauté ne permettent une telle liberté individuelle. (pp.103-4).
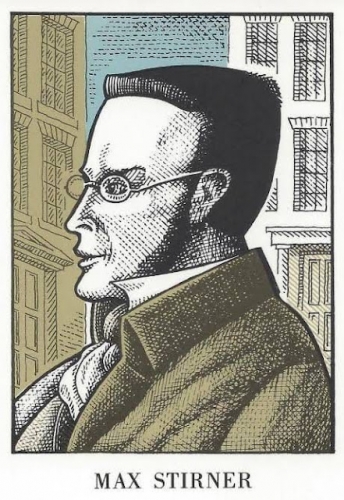
Stirner poursuit en disant que:
Dans une société, on est employé, avec sa force de travail ; dans la première, on vit égoïstement, dans la seconde, humainement, c'est-à-dire religieusement, en tant que « membre du corps de ce Seigneur » ; on doit à une société ce que l'on a, on est lié à elle par le devoir, on est possédé par des « devoirs sociaux » ; on utilise une union, et on l'abandonne consciencieusement et infidèlement lorsqu'on ne voit plus comment l'utiliser davantage.
Si une société est plus que vous, alors elle est plus pour vous que vous-même ; une union n'est que votre instrument, ou l'épée avec laquelle vous aiguisez et augmentez votre force naturelle ; l'union existe pour vous et par vous, la société, à l'inverse, vous réclame pour elle-même et existe même sans vous ; en bref, la société est sacrée, l'union vous appartient ; la société vous consomme.
Comme Steiner, l'importance des systèmes trifonctionnels faisait partie de la philosophie de Stirner et son œuvre était divisée en un trio de stades de développement, tous importants: non intellectuel (enfant), intellectuel (jeune) et égoïste (homme).
16:27 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, georges dumézil, rudolf steiner, max stirner |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 19 décembre 2024
Quelle sera donc la religion du futur ?
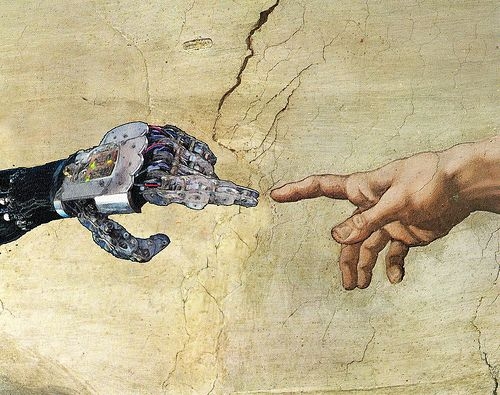
Quelle sera donc la religion du futur?
Claude Bourrinet
Le fonctionnement intellectuel et imaginaire humain est tel qu'il lui est nécessaire de s'appuyer sur des comparaisons. Un exercice scolaire itératif consiste à établir des parallèles entre des périodes de l'histoire. Cette paresseuse tentation, malgré parfois les séductions de l'apparence, a le défaut d'oublier un facteur important: la réalité. Si le cycle de la naissance, du développement, et de la mort, loi naturelle, se retrouve en permanence dans la longue marche de l'humanité - encore est-ce là une perception distanciée, car quand on y regarde de près, les limites imparties à chaque phase ne sont pas si tranchées, et, en tenant compte des différents domaines des réalisations humaines, on est contraint de constater qu'il y a, au fil du temps, d'innombrables naissances, et autant de développements et de morts, ce qui rend fort problématique les découpages auxquels les historiens se sont tenus à un certain niveau - pour le reste, c'est-à-dire les hypothétiques similitudes entre certaines époques, il faut bien en rabattre: l'homme, être plastique, modulable, protéique, change à tel point de nature, qu'il n'est plus le même à mesure qu'il évolue. Un Romain du 1er siècle est complètement dissemblable d'un Romain du 4ème, et ne parlons pas des hommes de moyen âge, ou de l'époque contemporaine. L'hétérogénéité n'est pas seulement de degré, mais elle est radicale. Lorsqu'on pense "comprendre" un texte de Cicéron, par exemple, nous l'appréhendons en fonction de ce que nous sommes. Il est impossible de le saisir comme un citoyen romain de la République romaine. On ne peut que s'en approcher, prudemment, à l'aide d'un appareil critique conséquent.
Il en va de même de toutes les productions humaines. L'histoire ne repasse pas les plats, où il s'agit alors de parodie, de singerie. Les Révolutionnaires français ont mimé Sparte, Rome etc., mais la Révolution est la source de la modernité, non de l'Antiquité renaissante. La tranchée est immense entre un Brutus, et un Robespierre. Ce sont deux espèces différentes.
Aussi a-t-on tenté de prévoir la "spiritualité" de l'avenir, et certains se sont essayés à dessiner les contours de la religion qui succédera à un christianisme moribond. Les nationalistes identitaires occidentaux craignent l'islam, sans se demander de quel islam ils parlent, et si celui-ci ne subira pas le sort du christianisme, et pour les mêmes causes (société de consommation, nihilisme techniciste etc.). Il faudrait aussi analyser les causes d'un soi-disant revival musulman, dans une région qui subit de plein fouet l'effet destructeur de l'Occident. L'islam actuel n'est peut-être que la réaction moderne, voire moderniste (l'utilisation pointue de la technique, par exemple) d'une société qui craint de mourir.

Il est courant de prévoir que l'extinction du christianisme, sous toutes ses formes, amènera l'avènement d'une nouvelle religion, éclectique, inspirée d'un New age, qui est déjà installé dans les pays occidentaux depuis près d'un siècle, mais qui ne touche que les classes moyennes. Ce courant n'est structuré qu'en une multitude de sectes, et il règne comme atmosphère mentale, inspirant par exemple la publicité, la production d'objets, et des pratiques tenant de très près aux finalités hygiénistes ou thérapeutiques de bien-être et d'adaptabilité à une société sous tension. Il est difficile de parler à son sujet de religion, ni même de spiritualité. Mais il est indéniable que des millions d'individus en sont adeptes, même si la profondeur de leur engagement n'est pas très convaincants, malgré les prédictions d'un Jünger, qui pensait qu'une sorte de shintoïsme, de bouddhisme cool, de paganisme éthéré, suivrait l'avènement de l'Etat universel, ou, plus sérieusement, une nouvelle poésie de l'être, comme l'espérait Heidegger, sans trop y croire.
A ce sujet, celui de la palingénésie, c'est-à-dire de la transformation d'un ensemble religieux en un autre - songeons au remplacement du paganisme du haut-empire néoplatonicien par le christianisme de l'Antiquité tardive - nous avons certes des points apparents de comparaison. Mais la Weltanschauung d'un disciple de Plotin était en gros similaire à celle d'un saint Ambroise, par exemple. Saint Augustin a glissé du néoplatonisme au catholicisme sans véritable heurt. Les racines épistémologiques, philosophiques, théologiques, relativement parentes entre ces traditions, ont été consolidées dans la terre civilisationnelle de la vieille Europe durant plusieurs siècles.
Rien de tel à notre époque, qui est inédite dans l'histoire. Pour la première fois, le passé est renié, considéré comme inutile pour fonder la société du présent et du futur, l'homme est, de même, aboli, perçu comme construit selon un tas de critères, la dimension suprahumaine, qui fondait le politique et les liens sociaux depuis toujours, a disparu, même à l'état de reste, plus aucun repère ne subsiste des temps anciens. On ne peut se fonder sur ce vide absolu pour imaginer une suite qui ressemblerait à ce qui s'était passé il y a des millénaires. Nous sommes dans un temps impensable. On ne peut le penser, car, pour penser, il faut comparer.
Mais que l'on ne tombe pas dans la caricature ! Les phénomènes historiques sont rarement scindés brutalement. Il subsiste toujours des terreaux antiques, même ténus, ou, le plus souvent, contaminés. Il existera encore des chrétiens, et sans doute plus solides que maintenant, mais ils seront ultra-minoritaires. Car il ne faut pas s'imaginer qu'il puisse exister un avenir fiable pour les Eglises. Poutine peut bien se rendre à l'office, il n'en demeure pas moins qu'en la sainte Russie, comme chez nous, il n'y a plus que 2% de pratiquants. Certes, comme dit Emmanuel Todd, il se peut qu'à l'Est, on ait encore des croyants "zombies", mais arrivera le temps du degré 0 de la croyance et de la pratique, les mêmes causes créant les mêmes effets (l'occidentalisation a conquis la planète, avec son nihilisme, latent ou actif).
Aux Etats-Unis, non seulement le nombre de ceux qui ne croient pas dépasse désormais celui des croyants en Dieu, mais, comme le faisait remarquer Rod Dreher, la pratique (ce à quoi il est indispensable de prêter attention, plutôt qu'aux déclarations de principe) le recentrement individuel, le genre de vie hédoniste et individualiste, voire narcissique, contredisent violemment les "valeurs" chrétiennes, certains "fondamentaux" évangéliques, comme la chasteté, le rejet de l'homosexualité, de l'avortement, le mépris de l'argent, de la réussite sociale impérative, l'inculture religieuse rendant parfois ce négationnisme sociétal invisible, ou acceptable. L'évangélisme, du reste, était déjà une accommodation crue et matérialiste aux séductions de l'American way of life, de son système codifié lié au travail, au commerce, au spectacle, au show business. Si de nombreux Africains ou Moyen Orientaux se laissent prendre à ce puritanisme made in USA, c'est parce qu'il permet d'échapper à l'emprise de la société traditionnelle, avec ses contraintes claniques et familiales, et délivre des liens psychologiques afin de permettre des activités plus proches de ce que le monde moderne, individualiste, utilitariste, promeut.

L'hypothèse d'une nouvelle "religiosité" doit tenir compte de la réalité du monde de la technoscience. L'humanisme, qui était à l'origine solidaire du christianisme, est devenu une religion séculaire à partir du XVIIIe siècle. L'homme est devenu le centre de l'existence, de la civilisation, et le porteur du sens de la vie. Nous assistons maintenant à sa métamorphose. La vraie foi qui semble mouvoir les esprits, les coeurs et les corps, et susciter un véritable enthousiasme, maintenant, c'est la démultiplication des pouvoirs de l'humain, et le rêve d'un homme éternellement jeune, voire immortel. C'est un projet faustien (tout-à-fait compatible avec ce "supplément d'âme" qu'est le New Age, du reste), entreprise méphistophélique que Goethe a dépeinte dans son fameux drame, et qui est l'un des rares mythes à être encore virulent dans notre univers nihiliste. A mon sens, voilà la religion du futur, prévue, somme toute par la Bible : "Et nous serons comme des dieux".
Je prophétise en pleurant.
14:00 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : religion, futur, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 16 décembre 2024
Le progressisme est aussi un libéralisme (et c'est pourquoi il n'a pas de critiques fondamentales à formuler à l'encontre de Milei)

Le progressisme est aussi un libéralisme (et c'est pourquoi il n'a pas de critiques fondamentales à formuler à l'encontre de Milei)
Andrés Berazategui, diplômé en relations internationales et analyste géopolitique, a analysé dans POLITICAR les implications du progressisme dans le libéralisme et le rôle qu'il joue dans l'opposition au gouvernement de Javier Milei.
Andrés Berazategui
Source: https://politicar.com.ar/contenido/344/el-progresismo-tam...
Le progressisme est aussi un libéralisme
Lorsque l'on examine les critiques formulées par les progressistes à l'encontre du président Javier Milei, on constate que les questions qu'ils posent à son gouvernement sont peu approfondies. En général, au-delà de la polémique relatives à des mesures concrètes, comme cela se produit dans tous les systèmes politiques où il y a une opposition, il n'y a pas de jugements contre les piliers idéologiques du libertarisme, c'est-à-dire les fondements philosophiques sur lesquels Milei agit et qui expliquent ses prises de décisions - qui ne sont pas aussi irrationnelles que le croient ses ennemis les plus acharnés -.
Les critiques formulées par les progressistes se limitent aux manières et aux expressions habituelles du président dans ses déclarations publiques, le qualifiant d'autoritaire, d'agressif, de dérangé, etc. C'est peut-être tout cela et même pire, mais ce qui doit nous importer, pour une critique féconde qui permette de démonter les erreurs et les faussetés libertaires, c'est d'analyser la rationalité qui guide Milei et la structure mentale qui sert de cadre à l'émergence de cette rationalité. Et là, le progressisme n'a pas grand-chose à dire.
Il se trouve que le progressisme est aussi une sorte de libéralisme. C'est la raison principale qui explique l'incapacité d'une grande partie de la gauche à mener une critique radicale du libertarisme. Nous entendons par là la gauche postmoderne en général et la gauche qui vit dans et de l'appareil culturel en particulier. Cela ne veut pas dire que le libertarianisme et le progressisme sont exactement les mêmes, mais en tant que deux variantes du libéralisme, ils ont plus en commun que ce qu'ils veulent bien reconnaître.
Certes, ils sont différents dans leurs stratégies respectives de croissance politique et dans les sujets sociaux qu'ils cherchent à « interpeller », comme ils le disent aujourd'hui. Ils ont donc des revendications et des symboles différents. Néanmoins, nous pouvons constater qu'il s'agit dans les deux cas de différentes manières de participer au jeu à partirdu même point de départ: l'individualisme anthropologique, un aspect crucial qui conduit les libéraux de droite et de gauche à partager les dynamiques qui sont le produit de l'intronisation de l'autonomie individuelle, de la confiance aveugle dans le progrès et d'une rationalité calculatrice orientée vers la maximisation des profits, que ceux-ci naissent de l'appât du gain, comme dans le cas des néolibéraux et des libertariens, ou de la recherche de la reconnaissance, comme dans le cas des progressistes.
Pour revenir aux différences, la droite libérale - dans sa variante néolibérale ou libertaire plus radicale - recherche un Etat minimal, la maximisation du profit et une vision punitive de la sécurité. Ce dernier point est logique: une croissance économique sans répartition équitable des richesses et un État faible ou absent pour garantir l'accès aux biens et services fondamentaux génèrent nécessairement une inégalité irritante; une inégalité qui produit non pas un monde où certains ont beaucoup et d'autres moins, mais un monde où peu ont presque tout et où beaucoup n'ont même pas accès aux biens, aliments et services de base qui leur permettent de vivre dignement.
Qu'est-ce qui peut en résulter, sinon des zones de forte tension interpersonnelle, de marginalité et de surpeuplement ? Un scénario idéal pour la propagation de la violence nuisible et de la criminalité dans ses pires manifestations. Dans ce contexte, il est logique que les libéraux de droite réclament plus de police et de prisons. Ils ne sont pas prêts à s'atteler à la tâche pour mettre fin au terreau social dans lequel la violence se manifeste sous son plus mauvais jour. La droite libérale a souvent aussi une branche conservatrice, ce qui est absurde puisque le conservatisme, en promouvant aussi le libéralisme, défend un système qui sape les fondements communs (c'est-à-dire collectifs) des valeurs qu'il prétend défendre. Le conservatisme est donc impuissant, préoccupé par sa morale de pacotille de défense d'une identité nationale faite de poncho et de matelot, et indigné par ce qu'il perçoit comme des atteintes à des « traditions » qu'il ne définit jamais.
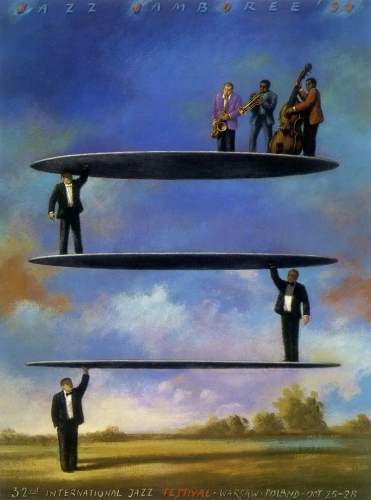
Le progressisme, quant à lui, interroge l'exclusion sociale en faisant appel à la construction de sujets qui expriment des singularités identitaires, c'est-à-dire à une multiplicité de minorités où c'est précisément l'individualité qui s'exprime. La gauche postmoderne défend autant de minorités et de diversités que possible, c'est-à-dire toutes les exclusions qui existent, et pas seulement (ni même principalement) celles qui sont le produit de la détérioration du travail et de l'économie.
Ainsi, ce qui a commencé comme la lutte des LGBT en référence à la diversité des genres, par exemple, est aujourd'hui désigné par l'acronyme LGBTIQ+ et, de temps à autre, une nouvelle lettre est ajoutée en guise de revendication. Les personnes qui intègrent des identités diverses ne manquent pas, puis apparaissent les trans afro-mapuches, les gros bruns ou autres.
Mais comme l'émergence de singularités fondées sur l'expression individuelle n'en finit pas, les minorités sont finalement prises au piège de la dynamique logique de ceux qui cherchent à maximiser les bénéfices: la dynamique de la concurrence. En l'occurrence, il s'agit de savoir qui est le plus singulier, le plus exclu ou le plus opprimé. En d'autres termes, la gauche post-progressiste est en compétition pour la visibilité et la reconnaissance, raison pour laquelle toute une stratégie de victimisation est née de ces secteurs: plus je suis exclu, plus j'ai besoin de me rendre visible et plus j'exige des demandes d'« extension des droits ».
Ainsi, il est récurrent de voir dans cette gauche un certain anti-ouvriérisme qui étonne les marxistes d'antan, puisque les travailleurs s'intéressent encore à la défense de communautés éthiques comme la famille, les groupes d'amis ou leurs syndicats, et n'ont apparemment pas encore parmi leurs priorités le multiculturalisme et les débats sur la déconstruction du genre.

Il semble que l'on se moque de l'histoire. Les Grecs anciens enseignaient que les hommes sont motivés par trois finalités: l'intérêt personnel, la reconnaissance et la survie. Dans le monde contemporain, les libéraux de droite mettent l'accent sur la recherche de l'intérêt personnel et les libéraux de gauche sur la recherche de la reconnaissance, tandis que des foules immenses luttent pour survivre. Cependant, il est clair pour nous que l'autonomie individuelle est l'alpha et l'oméga de la vision libérale du monde, et cela est partagé par tous les libéralismes occidentaux, qu'ils soient conservateurs, néolibéraux, libertaires, progressistes, postmodernes, défenseurs des minorités, etc. Le philosophe russe Alexandre Douguine a raison: en Occident, on peut être tout sauf que l'on reste libéral. On peut être de gauche, de droite, du centre, mais tous, dans le statu quo des systèmes politiques occidentaux, sont libéraux.
La critique fondamentale à l'encontre du gouvernement de La Libertad Avanza ne peut donc pas venir des secteurs progressistes parce qu'ils partagent avec Javier Milei les fondements anthropologiques individualistes du libéralisme. Comme si cela ne suffisait pas, la gauche post-moderne, au-delà de quelques questions purement esthétiques, a même laissé de côté le vieux marxisme. Certes, le communisme était lui aussi une idéologie issue des Lumières, mais cela leur aurait au moins permis de se rendre compte que les idéologies dominantes sont les idéologies des classes dominantes.
Et le progressisme préfère ignorer cette vérité fondamentale, si bien que loin de remettre en cause le système actuel et ses piliers - primauté de l'autonomie individuelle, maximisation rationaliste, confiance dans le progrès - il se consacre à essayer de construire des sujets qui lui permettront de se mouvoir dans ce système, qu'il reconnaît au fond comme triomphant. Pour la gauche déconstruite, la lutte pour le prolétariat, la classe ou même le peuple, sujets d'un passé tissé de « grands récits » qu'elle a fini par abandonner, a été jetée aux orties. Le progressisme interpelle de nouveaux acteurs fondés sur la reconnaissance et l'identité, des collectifs qui expriment des singularités et revendiquent une visibilité, s'inscrivant parfaitement dans le monde de la concurrence et du profit. Le monde que le capitalisme a construit et façonné.
17:35 Publié dans Actualité, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gauces, progressisme, argentine, javier miléi, libéralisme, actualité, philosopie, philosophie politique, théorie politique, sciences politiques, politologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 04 décembre 2024
L'École de Francfort: la pensée néocommuniste qui a changé l'Occident

L'École de Francfort: la pensée néocommuniste qui a changé l'Occident
par Sara (Blocco Studentesco)
Source: https://www.bloccostudentesco.org/2024/11/21/bs-scuola-di...
L'école de Francfort est une école de pensée qui a vu le jour dans les années 1920 dans la République de Weimar. Les philosophes adhérant à cette école ont opéré une synthèse entre la psychanalyse freudienne et l'idéologie marxiste, conduisant à faire émerger ce que l'on pourrait appeler le « néo-communisme psychanalytique ». Les membres de cette école ont réussi, surtout après la Seconde Guerre mondiale, à infiltrer les écoles publiques, le gouvernement et à influencer l'ensemble de la société occidentale. Leurs idées sont d'ailleurs toujours à l'ordre du jour.
Theodor Adorno, le penseur le plus important de l'École, estimait que les conceptions traditionnelles de la société, telles que les vérités universelles, cachaient souvent des contradictions et des problèmes. Pour lui, la tâche de la théorie sociale et de la pensée critique était précisément de mettre au jour ces contradictions. Dans son livre intitulé « Dialectique négative », Adorno a critiqué la philosophie traditionnelle pour sa tentative de créer des systèmes logiques et ordonnés pour expliquer le monde, allant même jusqu'à affirmer qu'elle servait à justifier l'oppression sociale. Sa critique s'étendait également à l'art qui, selon lui, perpétuait l'oppression sociale en présentant des visions d'harmonie, de beauté et de vérité. Dans une déclaration célèbre, il a écrit : « Écrire de la poésie après Auschwitz est barbare », ce qui signifie que l'art qui véhicule des idéaux de beauté et de vérité renforce les idéologies oppressives. Selon Adorno, ce qui paraît beau ou harmonieux exclut et opprime ce qui n'est pas conforme à cet idéal, et doit donc être déconstruit.

Cette critique de la beauté et des valeurs traditionnelles a alimenté une approche sceptique qui a encouragé la résistance à ce qu'Adorno a appelé la « coercition spiritualisée ». Les idées d'Adorno ont laissé un héritage durable sur la pensée critique contemporaine. Les critiques d'aujourd'hui se méfient souvent de la beauté, de l'harmonie et des récits moraux. Ce regard critique a conduit à la perception que toute forme d'art traditionnelle ou belle est « fasciste » parce qu'elle implique une hiérarchie : si quelque chose est beau, quelque chose d'autre doit être laid ; si quelque chose est vrai, quelque chose d'autre doit être faux. Cette attitude peut être observée dans la critique culturelle moderne, où la beauté est souvent déconstruite. Cette critique accuse souvent l'art traditionnel, les récits et même la morale d'incorporer des systèmes cachés de violence et de conformité.
Le rejet de l'esthétique traditionnelle par Adorno présente des similitudes avec l'activisme moderne « woke », qui cherche à démanteler les institutions et les structures sociales jugées oppressives, y compris les normes de beauté et de moralité. Ce type d'activisme célèbre souvent des figures qui remettent en question les hiérarchies traditionnelles, comme les « filles patronnesses » ou les mouvements de sexualité alternative, comme une forme de résistance contre le patriarcat et les normes conservatrices. Ces attitudes se reflètent en fait dans les théories de l'école de Francfort, qui considérait l'opposition à la tradition comme un acte libérateur.
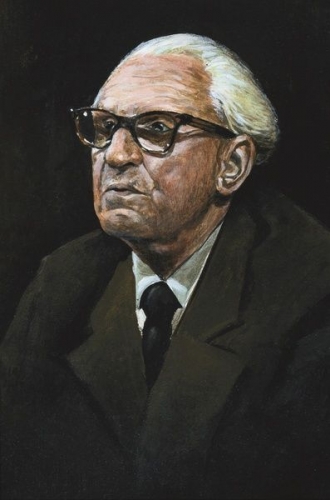
Herbert Marcuse, un autre membre influent de cette école, a élargi la critique d'Adorno en y intégrant les idées de Freud sur la sexualité. Dans son livre Eros et Civilisation, Marcuse affirme que les systèmes économiques capitalistes répriment la sexualité pour maintenir le contrôle sur la main-d'œuvre. Dans ce contexte, les relations hétérosexuelles et reproductives étaient considérées comme fonctionnelles pour la production capitaliste. Avec le communisme, cependant, cette répression disparaîtrait, permettant à la sexualité de s'exprimer librement. Bien que Marcuse se soit inspiré de Freud, il s'en est éloigné en rejetant l'idée que la répression était nécessaire à la civilisation. Il imagine une « civilisation non répressive » dans laquelle le travail deviendrait un jeu et l'énergie érotique s'exprimerait librement. Marcuse voit dans le mythe de Narcisse, qui tombe amoureux de son propre reflet, une métaphore du rejet des normes sociales et de l'adhésion à l'individualisme. Selon lui, le dépassement des distinctions traditionnelles de genre et de sexualité conduirait à une nouvelle culture libérée, dans laquelle le retour à un état pré-répressif dissoudrait les structures sociales traditionnelles.
Après tout, l'école de Francfort nous a laissé un héritage précieux: l'art de la critique perpétuelle, qui ne manque jamais une occasion de démonter, de déconstruire et finalement de détruire tout ce qui représentait autrefois la beauté, l'ordre et la vérité. Aujourd'hui, son influence se reflète dans une société qui célèbre la désintégration des valeurs traditionnelles, qui considère l'harmonie comme un acte d'oppression et l'individualisme comme un signe de libération. En associant Marx et Freud, l'École a créé un cocktail mortel d'idéologie et de psychanalyse qui continue à renforcer la croyance que toute hiérarchie, toute norme, toute structure sociale est une forme déguisée de domination. Et, bien sûr, ce qui reste à célébrer, ce sont les petites victoires contre la beauté et l'ordre: les nouveaux héros sont les « meilleurs » ennemis de la beauté, les champions de l'idéologie, les adversaires de l'harmonie qui luttent courageusement contre les vestiges d'une société qui ose encore apprécier le classicisme et l'élégance. Car, comme l'enseigne l'École de Francfort, tout ce qui est trop beau, trop soigné, trop traditionnel, est assurément fasciste, oppressif et digne d'être balayé. Finalement, pour ceux qui ont appris à mépriser tout ce qui représente la vérité et la beauté, il y a toujours un combat à mener contre une civilisation qui n'a jamais pris la peine de perdre. Mais au milieu de cette tempête idéologique, il y a encore de la place pour ceux qui croient que la beauté et l'ordre peuvent être des forces libératrices. C'est en redécouvrant la beauté et en embrassant les valeurs qui ont résisté à l'épreuve du temps que nous pourrons véritablement construire une société qui non seulement existe, mais prospère.
19:04 Publié dans Philosophie, Sociologie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : philosophie, sociologie, école de francfort, theodor w. adorno, herbert marcuse |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 02 décembre 2024
Alexandre Douguine: "Le moment libéral"
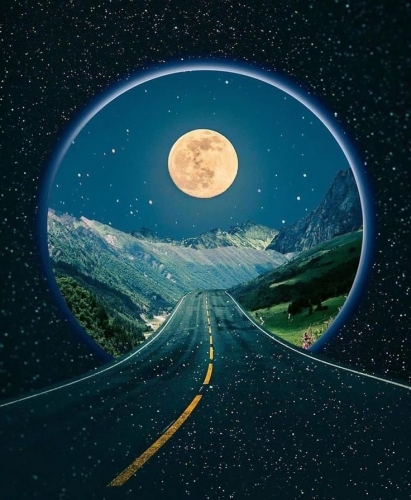
Le moment libéral
par Alexandre Douguine
Alexandre Douguine affirme que l'effondrement du monde unipolaire marque le début d'une grande métamorphose, la lumière déclinante du libéralisme occidental cédant la place à l'éveil d'anciennes traditions, de profondes identités civilisationnelles et à la promesse d'une ère multipolaire dynamique aux possibilités illimitées.
Dans un numéro de 1990/1991 de la prestigieuse revue mondialiste Foreign Affairs, l'expert américain Charles Krauthammer avait publié un article programmatique intitulé « The Unipolar Moment » (= Le moment unipolaire) (1). Dans cet essai, il proposait une explication à la fin du monde bipolaire. Après l'effondrement des pays du Pacte de Varsovie et la désintégration de l'Union soviétique (qui n'avait pas encore eu lieu au moment de la publication de l'article), un nouvel ordre mondial émergerait dans lequel les États-Unis et l'Occident collectif (OTAN) resteraient le seul pôle de pouvoir, régissant le monde en établissant des règles, des normes et des lois, tout en assimilant leurs propres intérêts et valeurs à des normes universelles, globales et obligatoires. Krauthammer a qualifié cette hégémonie mondiale de facto de l'Occident de « moment unipolaire ».

Peu après, un autre expert américain, Francis Fukuyama, a publié un manifeste similaire intitulé La fin de l'histoire (2). Contrairement à Fukuyama, qui a déclaré prématurément que la victoire de l'Occident sur le reste de l'humanité était complète et que toutes les nations adopteraient désormais l'idéologie libérale et accepteraient la domination des États-Unis et de l'Occident, Krauthammer a fait preuve de plus de retenue et de prudence. Il a choisi de parler d'un « moment », se référant à une situation de facto dans l'équilibre du pouvoir mondial, sans tirer de conclusions hâtives sur la durabilité ou la durée de l'ordre unipolaire. Les signes de l'unipolarité sont évidents: l'adoption quasi universelle du capitalisme, de la démocratie parlementaire, des valeurs libérales, des variantes de l'idéologie des droits de l'homme, de la technocratie, de la mondialisation et du leadership américain. Cependant, Krauthammer a reconnu la possibilité que cet état de fait ne soit pas permanent mais simplement une phase - une phase qui pourrait évoluer vers un modèle à long terme (validant la thèse de Fukuyama) ou qui pourrait au contraire s'achever, laissant place à un ordre mondial différent.
En 2002/2003, Krauthammer est revenu sur sa thèse dans un article intitulé « The Unipolar Moment Revisited » (3), publié dans la revue réaliste (plutôt que mondialiste) National Interest. Cette fois, il affirme, une décennie plus tard, que l'unipolarité s'est avérée être un moment, et non un ordre mondial stable. Il a suggéré que des modèles alternatifs allaient bientôt émerger, alimentés par des tendances anti-occidentales croissantes à l'échelle mondiale - en particulier dans les pays islamiques, en Chine et dans une Russie renaissante sous la direction de Vladimir Poutine. Les événements qui ont suivi ont confirmé la conviction de Krauthammer selon laquelle le moment unipolaire était révolu. Les États-Unis n'ont pas réussi à consolider le leadership mondial qu'ils détenaient réellement dans les années 1990, et la domination occidentale est entrée dans une phase de déclin. L'opportunité d'une hégémonie mondiale, que les élites occidentales avaient pratiquement tenue entre leurs mains, a été gâchée. Désormais, au mieux, l'Occident devrait participer à la construction d'un monde multipolaire à un autre titre, sans viser l'hégémonie, afin d'éviter d'être laissé en marge de l'histoire.
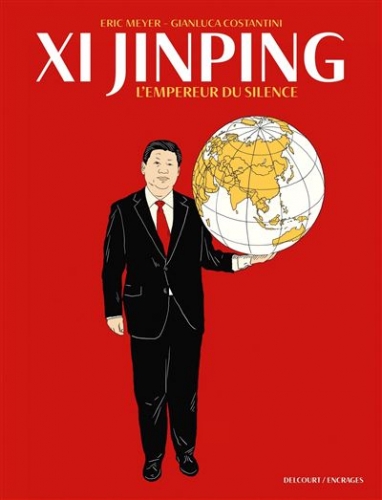
Le discours de Poutine à Munich en 2007, l'ascension de Xi Jinping en Chine et la croissance économique rapide du pays, les événements de 2008 en Géorgie, la révolution de Maïdan en Ukraine et la réunification de la Russie avec la Crimée, l'opération militaire spéciale de 2022 et la guerre à grande échelle au Moyen-Orient commencée en 2023 - tout cela a confirmé dans la pratique que les penseurs prudents, Krauthammer et Samuel Huntington, qui prévoyaient une ère de « choc des civilisations » (4), étaient bien plus proches de la vérité que la vision trop optimiste de Fukuyama (optimiste pour l'Occident libéral, cela va de soi). Aujourd'hui, il est clair pour tout observateur raisonnable que l'unipolarité n'était qu'un « moment », qui cède maintenant la place à un nouveau paradigme - la multipolarité ou, plus prudemment, un « moment multipolaire » (5).
Nous revenons sur cette discussion pour souligner l'importance du concept de « moment » dans l'analyse de la politique mondiale. Ce concept restera un point central dans la suite de notre analyse.
Est-ce un moment ou non ?
Le débat sur la question de savoir si un système international, politique ou idéologique particulier représente quelque chose d'irréversible ou, à l'inverse, quelque chose de temporaire, de transitoire ou d'instable, ne date pas d'hier. Les défenseurs de théories spécifiques affirment souvent avec véhémence le caractère inévitable des régimes sociaux ou des transformations qu'ils privilégient. En revanche, les sceptiques et les observateurs critiques proposent d'autres points de vue, considérant ces systèmes comme de simples moments.
Cette dynamique est clairement visible dans l'exemple du marxisme. Pour la théorie libérale, le capitalisme et l'ordre bourgeois représentent le destin de l'humanité - un état permanent dans lequel le monde devient uniformément libéral-capitaliste et où tous les individus finissent par rejoindre la classe moyenne, devenant ainsi des bourgeois. Les marxistes, cependant, considèrent le capitalisme comme un moment historique du développement. Il était nécessaire pour surmonter le moment féodal précédent, mais il serait lui-même supplanté par le socialisme et le communisme. Le prolétariat remplacera la bourgeoisie, la propriété privée sera abolie et l'humanité ne sera plus composée que de travailleurs. Pour les marxistes, le communisme n'est pas un moment mais, essentiellement, la « fin de l'histoire ».
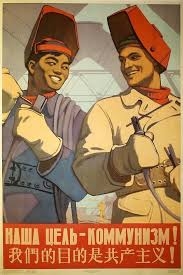
Les révolutions socialistes du 20ème siècle - en Russie, en Chine, au Viêt Nam, en Corée, à Cuba et ailleurs - semblaient valider le marxisme. Cependant, il n'y a pas eu de révolution mondiale et un monde bipolaire a émergé. De 1945 (après la victoire commune des communistes et des capitalistes sur l'Allemagne nazie) à 1991, deux systèmes idéologiques ont coexisté. Chaque camp affirmait que l'autre n'était qu'un moment - une phase dialectique plutôt que la fin de l'histoire. Les communistes affirmaient que le capitalisme s'effondrerait et que le socialisme triompherait, tandis que les idéologues libéraux soutenaient que le communisme était une déviation de la voie bourgeoise et que le capitalisme perdurerait à jamais. La thèse de la fin de l'histoire de Fukuyama faisait écho à cette croyance. En 1991, il s'est avéré qu'il avait raison: le système socialiste s'est effondré et les États post-soviétiques ainsi que la Chine maoïste sont passés à l'économie de marché, confirmant ainsi les prédictions libérales.
Certains marxistes gardent l'espoir que le capitalisme s'effondrera, ouvrant la voie à une révolution prolétarienne, mais cela n'est pas certain. Le prolétariat mondial se réduit et l'humanité semble prendre une toute autre direction.
Les penseurs libéraux ont toutefois adopté le point de vue de Fukuyama, assimilant le communisme à un moment et proclamant un « capitalisme sans fin ». Les postmodernes ont exploré les contours de cette nouvelle société, proposant des approches radicales pour résister au capitalisme de l'intérieur, allant de la transformation individuelle à des stratégies technologiques subversives. Ces idées ont trouvé un écho parmi les élites de gauche aux États-Unis, influençant les politiques relatives à la culture de l'homosexualité, à la culture de l'annulation (cancel culture), aux programmes écologiques et au transhumanisme. Pourtant, les partisans et les détracteurs du capitalisme victorieux s'accordent à dire qu'il représente la dernière étape de l'humanité, au-delà de laquelle se trouve la post-humanité, comme le prévoient les futurologues parlant de la « Singularité », où la mortalité humaine est remplacée par l'immortalité de la machine. Bienvenue dans la Matrice.
Ainsi, dans l'affrontement idéologique, la bourgeoisie a triomphé, façonnant le paradigme dominant de la « fin de l'histoire ».
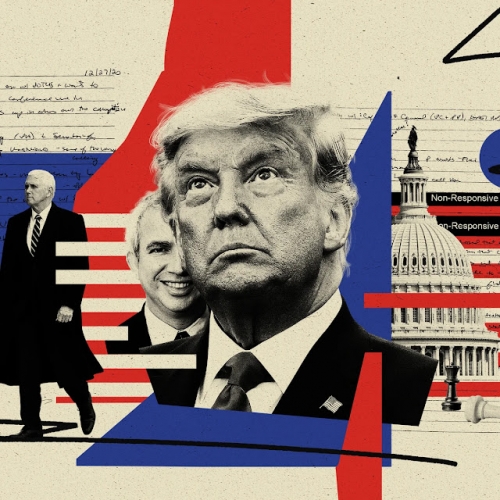
Trump comme facteur de l'histoire mondiale
La possibilité même d'appliquer le terme « moment » à l'ère du triomphe mondial du capitalisme, même au sein de la sphère intellectuelle occidentale (comme l'a fait Krauthammer), ouvre une perspective unique qui n'a pas encore été pleinement explorée et comprise. L'effondrement actuel et évident du leadership occidental et l'incapacité de l'Occident à servir d'arbitre universel de l'autorité légitime pourraient-ils également comporter une dimension idéologique ? La fin de l'unipolarité et de l'hégémonie occidentale pourrait-elle signifier la fin du libéralisme lui-même ?
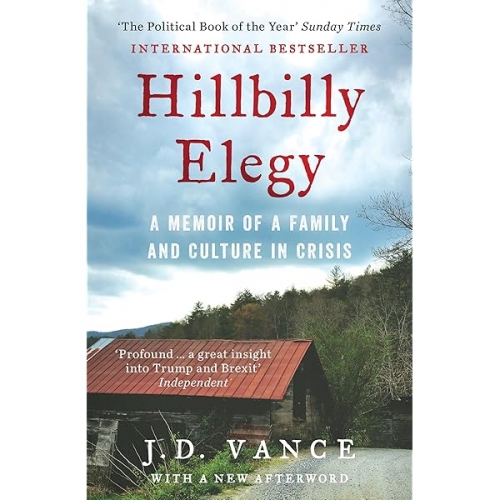
Cette idée est étayée par un événement politique crucial: l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis pour deux mandats. La présidence de Trump a représenté une répudiation frappante du mondialisme et du libéralisme, reflétant l'émergence d'une masse critique de mécontentement à l'égard de la direction idéologique et géopolitique des élites libérales, même au cœur de l'unipolarité. D'ailleurs, le vice-président choisi par Trump pour son second mandat, J. D. Vance, s'identifie ouvertement comme un partisan du « conservatisme post-libéral ». Pendant la campagne de Trump, le libéralisme a été constamment invoqué comme un terme négatif, visant spécifiquement le « libéralisme de gauche » du parti démocrate. Cependant, dans les cercles plus larges de partisans de Trump, le libéralisme est devenu un synonyme de dégénérescence, de décadence et de corruption morale au sein de l'élite dirigeante.
Pour la deuxième fois dans l'histoire récente, une personnalité politique ouvertement critique à l'égard du libéralisme a triomphé dans la citadelle même de l'idéologie libérale, les États-Unis. Parmi les partisans de Trump, le libéralisme en est venu à être carrément diabolisé, reflétant son association avec le déclin moral et politique. Il est donc de plus en plus plausible de parler de la fin du « moment libéral ». Le libéralisme, autrefois considéré comme le vainqueur ultime de la progression historique, apparaît aujourd'hui comme une simple étape dans le cours plus large de l'histoire, une étape avec un début et une fin, limitée par son contexte géographique et historique.
Le déclin du libéralisme signale l'émergence d'une idéologie alternative, d'un nouvel ordre mondial et d'un ensemble de valeurs différent. Le libéralisme s'est avéré ne pas être un destin, ni la fin de l'histoire, ni un paradigme irréversible et universel, mais simplement un épisode - une ère avec des limites temporelles et spatiales claires. Le libéralisme est intrinsèquement lié au modèle occidental de la modernité. S'il a gagné des batailles idéologiques contre d'autres formes de modernité - le nationalisme et le communisme - il a finalement atteint sa conclusion. Avec lui, le « moment unipolaire » décrit par Krauthammer et le cycle plus large de la domination coloniale singulière de l'Occident sur le globe, qui a commencé à l'époque des grandes découvertes géographiques, ont également pris fin.
L'ère post-libérale
L'humanité entre maintenant dans une ère post-libérale. Cependant, cette ère diverge fortement des attentes marxistes-communistes du passé. Premièrement, le mouvement socialiste mondial s'est largement estompé et ses principaux bastions - l'Union soviétique et la Chine - ont abandonné leurs formes orthodoxes, adoptant des aspects du modèle libéral à des degrés divers. Deuxièmement, les principales forces responsables de l'effondrement du libéralisme sont les valeurs traditionnelles et les identités civilisationnelles profondes.

L'humanité surmontera le libéralisme non pas par une phase socialiste, matérialiste ou technologique, mais en faisant revivre des couches culturelles et civilisationnelles que la modernité occidentale a jugées obsolètes et éradiquées. Ce retour au pré-moderne, plutôt que la poursuite de la trajectoire postmoderne ancrée dans la modernité occidentale, définit l'essence du post-libéralisme. Contrairement aux attentes de la pensée progressiste de gauche, le post-libéralisme émerge comme un rejet des prétentions universelles de l'ordre moderne occidental. Il considère plutôt l'ère moderne comme un phénomène temporaire, un épisode dû à la dépendance d'une culture spécifique à l'égard de la force brute et de l'exploitation technologique agressive.
Le monde post-libéral n'envisage pas la poursuite de l'hégémonie occidentale, mais un retour à la diversité des civilisations, comme à l'époque qui a précédé la montée en flèche de l'Occident. Le libéralisme, en tant que dernière forme d'impérialisme mondial occidental, a absorbé tous les principes clés de la modernité européenne et les a poussés à leurs extrêmes logiques : la politique du genre, la culture woke, la "culture de l'annulation", la théorie critique de la race, le transhumanisme et les cadres postmodernistes. La fin du moment libéral marque non seulement l'effondrement du libéralisme, mais aussi la conclusion de la domination singulière de l'Occident dans l'histoire du monde. C'est la fin de l'Occident.
Le moment libéral chez Hegel
Le concept de « fin de l'histoire » est apparu à plusieurs reprises dans cette discussion. Il est maintenant nécessaire de revenir sur la théorie elle-même. L'expression trouve son origine chez Hegel, et sa signification est enracinée dans la philosophie de Hegel. Marx et Fukuyama ont tous deux adopté ce concept (ce dernier par l'intermédiaire de l'hégélien russo-français Alexandre Kojève), mais ils l'ont dépouillé de ses fondements théologiques et métaphysiques.

Dans le modèle de Hegel, la fin de l'histoire est inséparable de son commencement. Au début de l'histoire se trouve Dieu, caché en lui-même. Par la négation de soi, Dieu se transforme en Nature. Dans la Nature, la présence de Dieu est latente mais active, et cette présence latente est à l'origine de l'émergence de l'histoire. L'histoire, à son tour, représente le déploiement de l'Esprit. Des sociétés de différents types émergent au fil du temps: monarchies traditionnelles, démocraties et sociétés civiles. Enfin, l'histoire culmine dans le grand Empire de l'Esprit, où Dieu se manifeste le plus pleinement dans l'État - pas n'importe quel État, mais un État philosophique guidé par l'Esprit.
Dans ce cadre, le libéralisme n'est qu'un moment. Il suit la dissolution d'États plus anciens et précède l'établissement d'un nouvel État véritable qui marque l'apogée de l'histoire. Les marxistes et les libéraux, rejetant la base théologique de Hegel, ont réduit sa théorie à des termes matérialistes. Ils sont partis de la nature, sans tenir compte de la conception de Dieu de Hegel, pour aboutir à la société civile - le libéralisme - comme point culminant de l'histoire. Pour les libéraux comme Fukuyama, l'histoire s'achève lorsque l'humanité tout entière devient une société civile mondiale. Les marxistes, quant à eux, envisagent la fin de l'histoire avec une société communiste sans classes, bien qu'elle reste dans le cadre de la société civile.
En rétablissant le modèle philosophique complet de Hegel, il devient évident que le libéralisme n'est qu'une phase transitoire - ce que Hegel appellerait un « moment ». Sa conclusion ouvre la voie à la réalisation ultime de l'Esprit, que Hegel envisageait comme un Empire de l'Esprit.
Le postmodernisme et la monarchie
Dans ce contexte, l'idée de monarchie acquiert une signification nouvelle - non pas comme une relique du passé, mais comme un modèle potentiel pour l'avenir. L'ère mondiale de la démocratie libérale et du républicanisme s'est épuisée. Les efforts visant à établir une république mondiale ont échoué. En janvier 2025, cet échec sera définitivement reconnu.
Que se passera-t-il ensuite ? Les paramètres de l'ère post-libérale restent indéfinis. Cependant, la reconnaissance du fait que toute la modernité européenne - sa science, sa culture, sa politique, sa technologie, sa société et ses valeurs - n'était qu'un épisode, culminant dans une conclusion lugubre et peu glorieuse, suggère que l'avenir post-libéral sera radicalement inattendu.
Hegel nous donne un indice : l'ère post-libérale sera une ère de monarchies. La Russie contemporaine, bien qu'elle soit encore formellement une démocratie libérale, présente déjà les caractéristiques d'une monarchie: un dirigeant populaire, la permanence de l'autorité suprême et l'accent mis sur les valeurs spirituelles, l'identité et la tradition. Ce sont là les fondements d'une transition monarchique - non pas dans la forme, mais dans l'essence.
D'autres civilisations évoluent dans une direction similaire. L'Inde de Narendra Modi reflète de plus en plus l'archétype d'un monarque sacré, un chakravartin, proche du dixième avatar Kalki, qui inaugure la fin d'un âge sombre. La Chine de Xi Jinping présente les traits d'un empire confucéen, Xi incarnant l'archétype de l'empereur jaune. Même le monde islamique pourrait s'intégrer grâce à un califat modernisé.
Dans ce monde post-libéral, même les États-Unis pourraient connaître un tournant monarchique. Des penseurs influents comme Curtis Yarvin préconisent depuis longtemps la monarchie en Amérique. Des personnalités comme Donald Trump, avec ses liens dynastiques, pourraient symboliser ce changement.

Un avenir ouvert
Le terme « moment libéral » a des implications révolutionnaires pour la pensée politique. Ce qui était autrefois considéré comme un destin inéluctable se révèle n'être qu'un motif éphémère dans la vaste tapisserie de l'histoire. Cette prise de conscience ouvre la voie à une imagination politique sans limites. Le monde post-libéral est un monde de possibilités infinies, où le passé, l'avenir et même les traditions oubliées peuvent être redécouverts ou réimaginés.
Ainsi, les dictats déterministes de l'histoire sont renversés, annonçant une ère de temporalités plurielles. Au-delà du moment libéral s'ouvre une nouvelle liberté, où des civilisations diverses tracent leur chemin vers les horizons inconnus d'un avenir post-libéral.
Notes:
1) Krauthammer, Charles. “The Unipolar Moment”, Foreign Affairs, 70.1, 1990/1991, pp. 23-33.
2) Fukuyama, Francis. The End of History and the Last Man. NY: Free Press, 1992.
3) Krauthammer, Charles. “The Unipolar Moment Revisited”, National Interest, 70, 2002/2003, pp. 5-17.
4) Huntington, Samuel. “The Clash of Civilizations?”, Foreign Affairs, summer 1993, pp. 22-47.
5) Савин Л., Многополярный момент.
17:39 Publié dans Actualité, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : alexandre douguine, libéralisme, unipolarité, multipolarité, définition, philosophie, philosophie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 27 novembre 2024
Friedrich Nietzsche, Gilles Deleuze et l'éternel retour
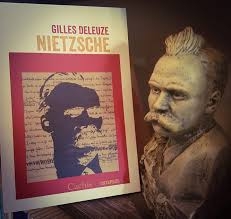
Friedrich Nietzsche, Gilles Deleuze et l'éternel retour
Troy Southgate
Source: https://troysouthgate.substack.com/p/friedrich-nietzsche-...
Dans son ouvrage complexe de 1962, Nietzsche et la philosophie, le postmoderniste français Gilles Deleuze (1925-1995) cherche si désespérément à faire concorder les idées de Nietzsche avec sa propre vision matérialiste du monde que certains aspects de l'œuvre du penseur allemand sont complètement relégués à l'arrière-plan. Ainsi, lorsque Deleuze aborde la notion d'éternel retour, à laquelle Nietzsche fait allusion dans Le Gai Savoir (1882) et dans Ainsi parlait Zarathoustra (1883-1891), il est dit que ce concept contient « les parties les plus obscures de la philosophie de Nietzsche et constitue un élément presque ésotérique de la doctrine » (p.69).
Ailleurs, Deleuze suggère que la Généalogie de la morale (1887) de Nietzsche est une tentative flagrante de réécrire la Critique de la raison pure (1781) d'Emmanuel Kant, bien que Nietzsche s'abstienne de discuter des questions relatives à l'épistémologie dans cet ouvrage particulier et qu'à aucun moment il ne mentionne Kant lui-même.
Deleuze, comme Emma Goldman (1869-1940) avant lui, admire beaucoup l'attitude intransigeante de Nietzsche et tente d'améliorer ses propres références révolutionnaires en créant une forme de nietzschéisme de gauche. On peut se demander s'il y est parvenu, mais pour en revenir - comme on le fait - à sa discussion sur l'Éternel Retour, je suis d'accord avec Deleuze pour dire que certaines des remarques de Nietzsche sur la nature des tendances réactives s'expliquent par la relation entre la volonté de néant et l'Éternel Retour lui-même.
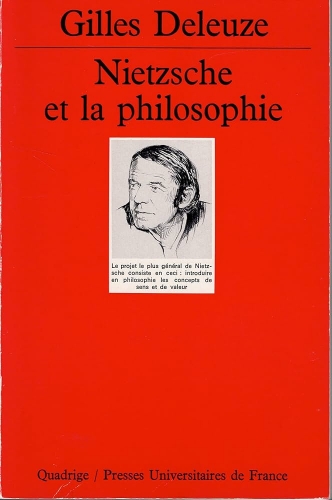
La volonté de néant, rappelons-le, est le nom que Nietzsche donne à la philosophie pessimiste d'Arthur Schopenhauer (1788-1860) et qui implique que la vie se détourne d'elle-même parce qu'elle ne trouve aucune valeur réelle dans le monde. Cette philosophie s'apparente, à bien des égards, au bouddhisme. Cette tendance est bien sûr présentée comme la voie du nihiliste, décrite à titre posthume par Nietzsche dans La volonté de puissance (1901) comme « un homme qui juge du monde tel qu'il est qu'il ne devrait pas être, et du monde tel qu'il devrait être qu'il n'existe pas ».
La volonté de néant est donc d'une importance vitale dans le schéma philosophique car, comme le note Deleuze, en entrant en contact avec l'Éternel Retour « elle rompt son alliance avec les forces réactives » et donc « l'Éternel Retour peut achever le nihilisme parce qu'il fait de la négation une négation des forces réactives elles-mêmes » (p.70).
En d'autres termes, alors que le nihilisme est généralement perçu comme l'apanage des faibles, il devient ici l'instrument de leur propre autodestruction. Avant cette association ironique entre la volonté de néant et l'Éternel Retour, la première était toujours présentée comme quelque chose qui s'alliait aux forces réactives et, par conséquent, cherchait inévitablement à nier ou à étouffer la force active. Nietzsche, en 1901, avait déjà observé que la « loi de conservation de l'énergie exige l'éternel retour ». La volonté de néant, quant à elle, n'est qu'une forme incomplète de nihilisme et, comme le note Deleuze : « La négation active ou destruction active est l'état des esprits forts qui détruisent le réactif en eux-mêmes, le soumettant à l'épreuve de l'Éternel Retour et se soumettant à cette épreuve même s'il s'agit de vouloir sa propre déchéance » (Ibid.).
La négation est donc radicalement transformée en un état d'affirmation dans ce qui peut finalement être interprété comme une métamorphose dionysiaque.
13:41 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, gilles deleuze, friedrich nietzsche |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 19 novembre 2024
Trois grands penseurs du monde indien

Trois grands penseurs du monde indien
Troy Southgate
Source: https://troysouthgate.substack.com/p/three-great-thinkers...
L'approche de certains aspects de l'idéalisme absolu qui a vu le jour dans la philosophie allemande à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle est similaire à celle du Vedanta que l'on trouve dans l'hindouisme. Les trois principaux textes traitant de l'approche védique de la réalité ultime sont les Upanishads, la Bhagavad-gita et le Brahma-sutra, tandis que trois des principaux penseurs ayant examiné la relation entre Brahman (la réalité ultime) et Atman (le soi) sont originaires du sud de l'Inde : Shankara (788-820 CE), Ramanuja (1017-1137 CE) et Madhvacharya (1238-1317 CE).

Le premier d'entre eux, Shankara, s'est inspiré d'un vieux conte hindou dans lequel un père place un cube de sel dans une casserole d'eau pour montrer à son fils que sa dissolution éventuelle est un exemple de la manière dont le moi est absorbé par la réalité ultime. Cela a conduit Shankara à développer un système connu sous le nom d'Advaita (non-dualisme), qui cherche à illustrer comment le soi n'est pas une entité séparée qui peut être reliée à diverses parties du corps, mais indissociable du principe universel de Brahman. En supprimant l'identité entre les deux, Shankara a prouvé qu'il était possible d'atteindre la libération. La connaissance de la vraie réalité est donc une forme de liberté, de la même manière que le penseur idéaliste allemand Friedrich Schelling insistera plus tard sur le fait que le sujet et l'objet ne font qu'un en fin de compte.

Notre deuxième philosophe indien, Ramanuja, est arrivé deux siècles après Shankara et n'a pas eu à relever le défi du bouddhisme comme l'avait fait son prédécesseur. La stratégie de Ramanuja était plutôt différente dans le sens où il opérait dans le domaine des Vaishnavas, ou adeptes de Vishnu, et utilisait cette dimension particulière de la religion pour accentuer la relation entre Brahman et Atman par le biais de récits épiques tels que le Mahabharata et les textes mythologiques des Puranas.
Le principal argument de Ramanuja est que les humains ne sont ni différents de Dieu, ni eux-mêmes, et que nos sens sont donc illusoires. Cela ne signifie pas que la réalité ultime est impersonnelle, comme le décrit Shankara, mais seulement que tout est une manifestation du Seigneur (Ishvara), ou du puissant. Dieu contrôle donc à la fois le moi intérieur et le monde.

On pourrait penser qu'il y a encore peu de place pour l'identité, mais les choses changent rapidement avec l'apparition de Madhvacharya au XIIIe siècle. En effet, bien qu'il ait imité Ramanuja en rejoignant le culte de Vishnu, il rejette la non-dualité de ses homologues et promeut une forme de dualisme. Pour Madhvacharya, il doit y avoir une distinction entre la réalité ultime et le moi et ils ne doivent pas être considérés comme identiques. Tous les phénomènes, conformément à la volonté du Divin, sont clairs et définis, mais avec une particularité fondamentale qui exige que l'on vénère le Seigneur Krishna comme quelque chose qui se trouve à l'extérieur du soi. C'est ce qu'il appelle le « témoin intérieur ».

Néanmoins, malgré ces interprétations subtiles entre une réalité impersonnelle et un Dieu personnel, les trois traditions continuent de prospérer sous la forme de l'Ordre Ramakrishna et de la Société Vedanta de Shankara, du mouvement Shri-Vaishnava et Gujarati Swaminarayan de Ramanuja, et du Gaudiya Math et de la Société internationale pour la conscience de Krishna. En ce qui concerne les idéalistes allemands comme Schelling, il est allé au-delà du dualisme que l'on trouve dans le cartésianisme et a formulé une « identité absolue » qui unit la singularité de la réalité ultime à la multiplicité qui découle de la réalité ultime. Comme il l'explique à propos de l'erreur cartésienne elle-même :
« Le "je pense donc je suis", est, depuis Descartes, l'erreur fondamentale de toute connaissance ; la pensée n'est pas ma pensée, et l'être n'est pas mon être, car tout n'est que de Dieu ou de la totalité ».
19:10 Publié dans Philosophie, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tradition, tradition indienne, inde, hindouïsme, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 05 novembre 2024
Révolte contre le monde postmoderne
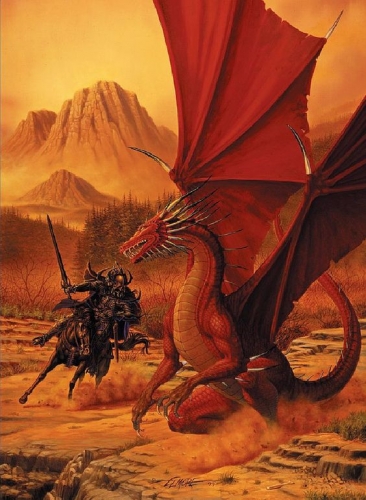
Archives Nicolas Bonnal, 2009
Révolte contre le monde postmoderne
Nicolas Bonnal
Extrait personnel du recueil collectif : Julius Evola envers et contre tous (Orientations/Avatar, 2009).
En titrant d'une manière provocante "Révolte contre le monde post-moderne", je suppose qu'il y a quelque chose de pire que ce monde moderne contre quoi se révolter... Sommes-nous descendus plus bas qu'à l'époque où Julius Evola tonnait contre son monde moderne ?
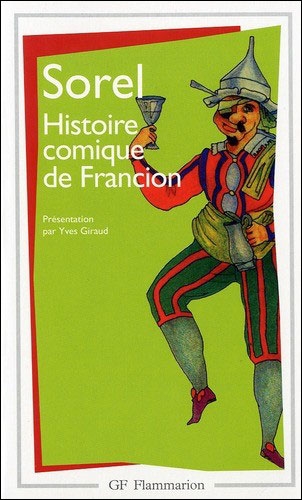 Et d'ailleurs cela fait beaucoup de temps que l'on tonne contre ce monde. Montesquieu s'en moque fort dans ses Lettres persanes, et de l'inflation, et de la mode, et de la crise démographique (comme déjà l'historien grec Polybe qui se navre du dépeuplement et du vieillissement de la Grèce impériale !), et du désir mimétique, et de la vanité des sujets du roi, et du pape, et du reste... Au 19ème siècle, que pourtant moi, Européen, je contemple avec nostalgie, Poe, Tocqueville, Maupassant, Baudelaire et tant d'autres contemplent avec mépris le « stupide dix-neuvième siècle » de Daudet. Pour en revenir à Montesquieu, il modernise une critique acerbe du siècle du « roi-machine » (Apostolides) que l'on pressent à travers les œuvres de Furetière, la Bruyère, la Fontaine ou même Sorel, auteur de l’étonnante histoire de Francion. Bref, la Fin des Temps est dans l’air du Temps, et on relira avec stupéfaction la fin des Mémoires de Saint-Simon pour s'en convaincre.
Et d'ailleurs cela fait beaucoup de temps que l'on tonne contre ce monde. Montesquieu s'en moque fort dans ses Lettres persanes, et de l'inflation, et de la mode, et de la crise démographique (comme déjà l'historien grec Polybe qui se navre du dépeuplement et du vieillissement de la Grèce impériale !), et du désir mimétique, et de la vanité des sujets du roi, et du pape, et du reste... Au 19ème siècle, que pourtant moi, Européen, je contemple avec nostalgie, Poe, Tocqueville, Maupassant, Baudelaire et tant d'autres contemplent avec mépris le « stupide dix-neuvième siècle » de Daudet. Pour en revenir à Montesquieu, il modernise une critique acerbe du siècle du « roi-machine » (Apostolides) que l'on pressent à travers les œuvres de Furetière, la Bruyère, la Fontaine ou même Sorel, auteur de l’étonnante histoire de Francion. Bref, la Fin des Temps est dans l’air du Temps, et on relira avec stupéfaction la fin des Mémoires de Saint-Simon pour s'en convaincre.
De quoi donc se plaint Evola et de quoi pouvons-nous nous plaindre nous, trente-cinq ans après sa disparition ? L’esprit traditionnel n'est-il pas lié à je ne sais quelle hypocondrie qui fait tout voir en noir, une mélancolie plutôt, comme celle du nain grincheux, symbole de Saturne et du plomb et qui toujours se plaint, surtout lorsque, comme Evola, il a affaire aux femmes ? Du reste Blanche-Neige, la reine alchimique, trouble, et bien, l'existence des sept nains chercheurs de trésors...
J'insiste, quitte à paraître un peu lourd; car tout de même l'esprit traditionnel aura bien entaché ma jeunesse, en lui faisant voir tout en noir ; et l'on ne vit qu'une fois, contrairement aux chats: « On est forcé d'écrire pour soi, de penser pour soi et d'espérer la fin de tout. Demain ce sera pis encore », écrit dans son prodigieux journal un Léon Bloy plus inspiré que lorsqu'il attend le retour des cosaques, comme d'autres attendaient de l'Orient du capital communiste et des supermarchés un réveil spirituel qui ramènerait l'Occident dans le droit chemin…
C'est d'ailleurs à mon sens une des qualités d'Evola: il n'attendait pas de grand réveil, il a pensé en kshatriya au sauvetage individuel sur un champ de bataille ruiné et abandonné.
Il n’a pas vraiment donné de recettes, mais il a plutôt cru à un salut très personnel, de type nietzschéen si l’on veut.

Cinquante ans après ses grands manuels de résistance (arc et massue, tigre), on ne peut que confirmer l'effondrement de tout : des états, des nations, des Occidentaux, de la famille, des paysages, la pollution du monde qui a atteint un stade ontologique (mais dont parlent déjà les transcendantalistes américains !). On n'en est même plus à l'époque des conflits idéologiques qui opposaient le communisme et l'Occident libéral. L'islam rentre dans le rang à Dubaï ou à Médine et l'Orient goberge comme on sait. Tout le monde se fout de tout, se désintéresse du politique et du reste, les Français subissent sans broncher le gouvernement le plus incapable de leur histoire (mais c'est aussi ce que disaient Bloy ou Toussenel, lui du temps de la monarchie de juillet...).
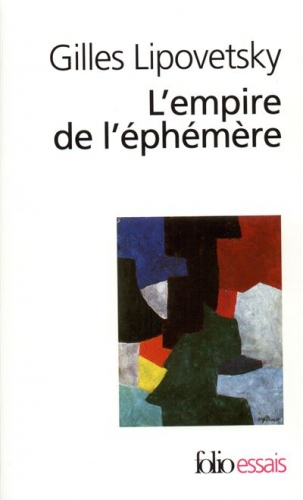 Nous sommes entrés dans la société post-moderne décrite au début des années 80 par Gilles Lipovetsky dans son Empire de l'éphémère, où il présente un individu cool et désabusé, humoristique et nihiliste. La différence est qu'à l’époque il avait encore un peu de réaction. Il n’y a plus rien aujourd'hui, et cette disparition de toute réaction, qui nous remplit d'angoisse et tremblement, est à mon sens apparue (sic) au milieu des années 2000; quand avec les horreurs de la bourse et de l'Irak, du bric et du broc, de la mondialisation et du néant, tout le monde s'est laissé aller au vide éternel.
Nous sommes entrés dans la société post-moderne décrite au début des années 80 par Gilles Lipovetsky dans son Empire de l'éphémère, où il présente un individu cool et désabusé, humoristique et nihiliste. La différence est qu'à l’époque il avait encore un peu de réaction. Il n’y a plus rien aujourd'hui, et cette disparition de toute réaction, qui nous remplit d'angoisse et tremblement, est à mon sens apparue (sic) au milieu des années 2000; quand avec les horreurs de la bourse et de l'Irak, du bric et du broc, de la mondialisation et du néant, tout le monde s'est laissé aller au vide éternel.
L'époque est opaque, les temps sont mous. Mais comme dit déjà Zarathoustra repris par Charles de Gaulle (lire Tournoux), « Tout est vain, tout est mort, tout a été »... Il dit aussi : « le désert croît... malheur à qui recèle des déserts ! ». C'est d'ailleurs pour cela que l'on a accru la consommation d'anxiolytiques, d'antidépresseurs et de somnifères de toute sorte. Dans les années 70, la figure du militant ou du rebelle laisse la place à celle du dépressif (il culpabilise pour son chômage, sa technophobie, ou son absence de convivialité...); et l'on voit aussi le degré d'abrutissement atteint par le cinéma, que l'on compare aux grands films contestataires du début des Seventies : je pense au Grand Secret d'Enrico, à Soleil vert ou Rollerball.
Mais Guénon évoque déjà cette crise psychologique dans la Crise du monde moderne ; auquel je répondrai en citant Sénèque ou même les Sumériens qui se plaignaient du fisc (cf. Samuel Noah Kramer) : le monde n’est-il pas toujours en crise, le monde n'est-il pas une éternelle crise moderne ? Après on pourra toujours m’objecter que du temps de l'âge d'or les choses allaient mieux, il y a 65.000 ans, et que les hommes étaient dorés, comme le dit Hésiode: mais cela m'est difficile à vérifier, surtout que l'histoire, la géographie (ma formation...) ou l'archéologie ne valent rien pour les traditionnels... Quant à Evola qui encense l'empire romain, je peux lui donner à lire ou relire bien des textes, notamment de Sénèque, qui se désespère de l'état de son empire romain, de son pain et de ses jeux du cirque, lui qui avait été le précepteur d'un des monstres les plus renommés de l'Histoire. Il est facile de citer Caton quand on néglige de lire Pétrone ou Tacite, ou bien sûr Juvénal qui comme Montesquieu ou Boileau semble avoir écrit hier matin.
J'en ai fini avec mon introduction qui sert non pas à noyer le sujet, on l'aura compris, mais à le nier: à quel moment peut-on parler de temps traditionnel, d'âge d'or, de société parfaite sinon dans les rêves, ou sinon même de mauvaise foi ?... Et pourtant, je n'y peux mais : de la même manière que Delenda est Carthago, Delendum est monstruum modernum.

Il faut détruire le monde moderne, il faut encore plus détruire le monde post-moderne, et si on ne peut le faire, il faut lui résister de toutes nos forces, à peine de sombrer dans la dépression, « l'angoisse métaphysique » dont se moquait Guénon, et tout le reste. Mais il ne faut pas le mésestimer, car, on l'a vu, les murailles de Jéricho n'ont jamais survécu longtemps au passage du buccin capitaliste. Marx nous avait prévenus dans son Manifeste. La Chine, l'Inde, le Japon, tout a été balayé par l'avarice, la gourmandise (15% d'ados chinois obèses..) et la cyber-luxure, quand ce n'est par la paresse spirituelle et intellectuelle, celle qui enrichit les laboratoires pharmaceutiques...
Car j'en viens à un autre obstacle, beaucoup plus concret maintenant: le temps. Pas le Temps avec un grand « T », celui de l'eschatologie, mais le mien, le vôtre, celui de notre vieillissement organique auquel Houellebecq a consacré des pages dit-on définitives. Le philosophe australien Pearson parle de ce fardeau de la personnalité vers 1890 déjà.
Je me promenais l'autre jour à cap d’Ail et je longeais mes plages et mes roches préférées, comme un promeneur romantique. Soudain je vis un voilier rempli de plaisanciers.
Je pensais aussitôt à Evola : le monde moderne, c'est cela.
Un tas de gens à poil qui « profitent de la mer, « qui profitent de leur vie », « qui profitent de leur temps libre ».
Bloy dénonce déjà cette obsession du Jouir qui est la marque de la vie sous le Second Empire.
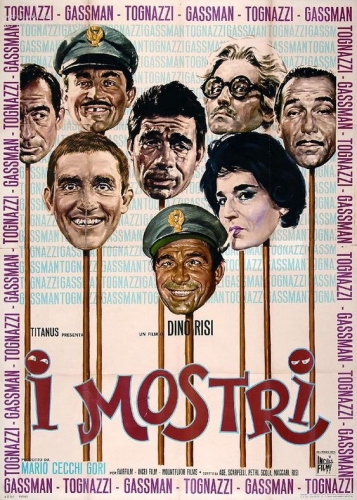
Mais... mais il y a en 2010 une petite différence avec l’époque de la rébellion d'Evola (les Sixties). Lui était contemporain d'une jeunesse gauchiste, stripteaseuse, marginale, contestataire, luxurieuse... Celle décrite par Godard, dans les films « existentialistes » d'Antonioni ou caricaturée dans les films de Dino Risi (Les Monstres, magnifique parabole sur les Rigolus de la société de consommation toute neuve à l'époque).
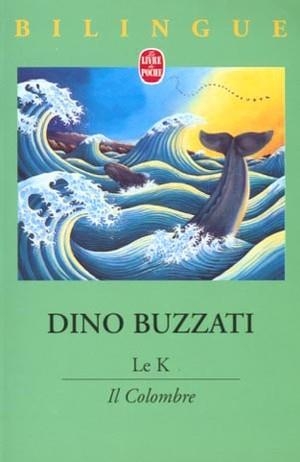 Mais là c'était différent : sur mon voilier d'ailleurs modeste de quarante pieds il n'y avait que des vieux à bord. Oh, pas des vieux paralytiques, pas des cacochymes. De bons retraités bien nourris au viagra et aux farines animales, un bon troupeau festif de « grosses bêtes bien dociles, bien habituées à s’ennuyer » (Céline). Le troupeau post-moderne est en effet postmoderne au sens littéral, il vient après les modernes, il a donc vingt ou trente ans de plus. Je vois 30% de sexagénaires où que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord, et même en Amérique du sud, dans les zones principalement peuplées de blancs (Uruguay, sud du Brésil, province de Buenos Aires). Je sais que la population du Brésil va passer d'une moyenne d'âge de 25 à 41 ans d'ici quinze ans, et que la Chine, qui ne sait déjà pas quoi faire de sa jeunesse, va compter 500 millions de retraités (ou présumés tels) en 2050. La population russe va disparaître, comme l'allemande, la coréenne, l’italienne, etc. il ne restera que les noirs et les robots. Sur ces bonnes nouvelles, on se demande contre quoi on va se révolter ? Peut-être que les Folamour qui nous gouvernent vont nous concocter un plan de survie cannibale, en tout cas il est certain que ce ne sont pas des septuagénaires remariés, dont nous ferons bientôt tous partie, qui vont nous tirer de l'ornière. Buzzati, le peu évolien, nous avait prévenus dix bonnes fois dans Le K.
Mais là c'était différent : sur mon voilier d'ailleurs modeste de quarante pieds il n'y avait que des vieux à bord. Oh, pas des vieux paralytiques, pas des cacochymes. De bons retraités bien nourris au viagra et aux farines animales, un bon troupeau festif de « grosses bêtes bien dociles, bien habituées à s’ennuyer » (Céline). Le troupeau post-moderne est en effet postmoderne au sens littéral, il vient après les modernes, il a donc vingt ou trente ans de plus. Je vois 30% de sexagénaires où que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord, et même en Amérique du sud, dans les zones principalement peuplées de blancs (Uruguay, sud du Brésil, province de Buenos Aires). Je sais que la population du Brésil va passer d'une moyenne d'âge de 25 à 41 ans d'ici quinze ans, et que la Chine, qui ne sait déjà pas quoi faire de sa jeunesse, va compter 500 millions de retraités (ou présumés tels) en 2050. La population russe va disparaître, comme l'allemande, la coréenne, l’italienne, etc. il ne restera que les noirs et les robots. Sur ces bonnes nouvelles, on se demande contre quoi on va se révolter ? Peut-être que les Folamour qui nous gouvernent vont nous concocter un plan de survie cannibale, en tout cas il est certain que ce ne sont pas des septuagénaires remariés, dont nous ferons bientôt tous partie, qui vont nous tirer de l'ornière. Buzzati, le peu évolien, nous avait prévenus dix bonnes fois dans Le K.
De même, Julius Evola se plaint des Beatles ou de la littérature existentialiste ou du jazz : mais que cette sous-culture nous paraît grande aujourd'hui ! La nullité abyssale de l'époque, que mêmes les ados que je croise reconnaissent, n'est plus mise en doute par personne. Il suffit d'ouvrir sa page Yahoo pour se rendre compte du niveau ahurissant de nullité que recèlent les préoccupations des gens : je copie ce que j'ai sous les yeux (nous sommes le 6 octobre 2009, à 11 heures du matin).
Valérie Payet, Karim Benzema, Spencer Tunick, Rugby fédéral, Chantal Goya, Rallye de Catalogne, Lindsay Lohan, Peugeot 3008, Loi Hadopi, Brigitte Bardot...
Voilà ce qui passionne mes contemporains, qui ont tous ou presque bac+5, et qui sont tous plus cons que la cuisinière de Flaubert. Il me semble bien délicat tout d'un coup, Evola, de se plaindre de Sartre ou Pasolini, de Louis Armstrong ou des jeux olympiques de Rome... Nous sommes bien plus bas.
Nous sommes plus vieux, nous sommes plus bêtes. C'est la première observation. Nous sommes plus vieux ; donc plus radins, plus luxurieux (tout en étant post-sexuels, car les filles d'aujourd'hui préfèrent boire entre elles que faire l'amour, et plus un jeune ne se risque à « draguer », à la façon des idiots du film Les Valseuses). Nous n'avons plus un seul idéal politique, juste la volonté de nuire à notre prochain par le biais juridique dont l'écologie exterminatrice n'est qu'une des ramifications (et pas l'inverse).
 On nous a interdit d'interdire, eh bien maintenant tout va nous être interdit: conduire, boire, respirer, fumer, monter dans un avion, cracher par terre, parler même... On aura droit au doigt dans le cul puisque Ben Laden a inventé le suppositoire explosif... Le monde postmoderne s'annonce comme le mauvais film dont parlait Deleuze. Depuis les attentats gluants de 2001, et ce Ground Zero qui n’a pas été reconstruit (Les Hommes au milieu des ruines – des ruines ou des tuiles ?), nous sommes dans un espace-temps gelé, circulaire, clos, une ronde de nuit infernale et ennuyeuse, gâteuse et interminable. Je me réfugie moi dans la vieille musique classique de Pollini ou Karajan, dans les westerns des années 50, décennie diabolisée par Evola, mais où l'on peut encore admirer du Walsh, du Donen ou du Ford. Et j’essaie de ne même plus regarder les nouvelles, de savoir ce qui se passe, ou ne se passe plus. Il devient difficile de se faire des amis, les gens devenant trop cons (le mot est juste). Ceux qui ne le sont pas souffrent, culpabilisent, prennent des produits toxiques (je parle des drogues autorisées bien sûr), deviennent timides....
On nous a interdit d'interdire, eh bien maintenant tout va nous être interdit: conduire, boire, respirer, fumer, monter dans un avion, cracher par terre, parler même... On aura droit au doigt dans le cul puisque Ben Laden a inventé le suppositoire explosif... Le monde postmoderne s'annonce comme le mauvais film dont parlait Deleuze. Depuis les attentats gluants de 2001, et ce Ground Zero qui n’a pas été reconstruit (Les Hommes au milieu des ruines – des ruines ou des tuiles ?), nous sommes dans un espace-temps gelé, circulaire, clos, une ronde de nuit infernale et ennuyeuse, gâteuse et interminable. Je me réfugie moi dans la vieille musique classique de Pollini ou Karajan, dans les westerns des années 50, décennie diabolisée par Evola, mais où l'on peut encore admirer du Walsh, du Donen ou du Ford. Et j’essaie de ne même plus regarder les nouvelles, de savoir ce qui se passe, ou ne se passe plus. Il devient difficile de se faire des amis, les gens devenant trop cons (le mot est juste). Ceux qui ne le sont pas souffrent, culpabilisent, prennent des produits toxiques (je parle des drogues autorisées bien sûr), deviennent timides....
On n'ose plus, de peur de se faire traiter d'aigris, ou plus simplement traîner devant les tribunaux. Il y a cinquante ans les clivages étaient politiques ou spirituels, aujourd'hui ils sont purement existentiels. On se fond dans la masse ou pas, avec peu de perspectives de futur. Car si l’étranger (pas si étranger d’ailleurs) de Camus commence par la visite au cadavre de la mère à l'hospice, il faut savoir que c'est à l'hospice que se terminera pour tous la chanson de geste post-moderne, d'ici cinquante ou cent ans. On nous promet une durée de vie de 120 ans, et comme le disait le docteur Alexis Carrel, la société augmentera notre durée de vieillissement bien plus que notre durée de vie. Cela doit d'ailleurs correspondre à une logique infernale : une épouvantable salle d'attente où l'on ne peut rien faire. Je me vois actuellement environné par mes vieilles tantes qui voudraient bien mourir et ne le peuvent plus (Exorciste III, le meilleur). Elles ont cent ans, elles redoutent d’en tirer encore pour vingt ou trente. Quant aux enfants, ils vieillissent en même temps que leurs parents. On héritera à 80 ou 90 ans, si l'on a des parents. Le monde nouveau est avancé.
J'aurais 80 ans dans une France qui n'aura plus rien de français, ou je serai ailleurs, dans un monde qui n'aura plus rien de monde; je ne sais pas de quoi je vivrai, si même je survivrai, car on me fera comprendre comme à quelques autres milliards de vieillards que je suis de trop sur cette terre.
Des sexagénaires friqués iront faire des croisières minables sur des mers polluées ou bien assisteront à des concerts de rock-stars grabataires... et l'on réélira des politiciens liftés, botoxés et chevronnés promettant à un vieux public de trouillards de nettoyer au karcher des banlieues qu'ils ont eux-mêmes peuplées, avec les compagnies aériennes et le patronat, de populations allogènes inassimilables mais tenues par la drogue et la médiocrité de la vie ordinaire. Yeaaaah !
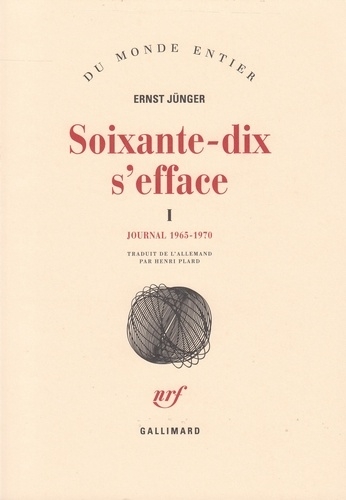 Cette espèce d'horreur ordinaire que je viens de décrire sommairement n'est même pas neuve : elle est tout entière présente dans le Voyage au bout de la nuit. Relisez ces pages inoubliables, et cette « petite musique de la vie que l'on n'a plus envie de faire danser », et ce troupeau soumis, et « ce commerce partout, ce chancre du monde ». Car c'est bien le commerce qui aura eu raison de tout cela. Ah, l’Angleterre et son bonheur matériel qu'elle aura partout imposé... Un des intérêts du reste d'Evola est qu'il s'était intéressé physiquement à son siècle: il aimait le sport, l'alpinisme, la guerre, l’héroïsme, il avait le culte des valeurs chevaleresques contemporaines, il admirait Jünger ou Drieu. Mais on sait comment a terminé Drieu, et on relira Soixante-dix s’efface de Jünger pour comprendre comment a terminé le grand homme. Dans ce livre admirable, on sent comment peu à peu Jünger, avec toute sa culture, sa bonne santé, son équilibre romain, son goût pour la bonne vie, est progressivement envahi, déprimé, possédé par l'horreur de ce monde de consommateurs impersonnels.
Cette espèce d'horreur ordinaire que je viens de décrire sommairement n'est même pas neuve : elle est tout entière présente dans le Voyage au bout de la nuit. Relisez ces pages inoubliables, et cette « petite musique de la vie que l'on n'a plus envie de faire danser », et ce troupeau soumis, et « ce commerce partout, ce chancre du monde ». Car c'est bien le commerce qui aura eu raison de tout cela. Ah, l’Angleterre et son bonheur matériel qu'elle aura partout imposé... Un des intérêts du reste d'Evola est qu'il s'était intéressé physiquement à son siècle: il aimait le sport, l'alpinisme, la guerre, l’héroïsme, il avait le culte des valeurs chevaleresques contemporaines, il admirait Jünger ou Drieu. Mais on sait comment a terminé Drieu, et on relira Soixante-dix s’efface de Jünger pour comprendre comment a terminé le grand homme. Dans ce livre admirable, on sent comment peu à peu Jünger, avec toute sa culture, sa bonne santé, son équilibre romain, son goût pour la bonne vie, est progressivement envahi, déprimé, possédé par l'horreur de ce monde de consommateurs impersonnels.
Il se rend au Maghreb, où je suis né, et progressivement il voit le monde de Guénon et de Titus Burckhardt se déliter devant lui, avec sa médiocrité, sa sexualité, ses constructions, son horreur économique et tout le reste. Et c'est Jünger, que même Evola admirait... Alors, où en sommes-nous, camarades ? Plus bas que l'enfer ! Nous avons touché le fond, mais le fond est vaseux, et nous nous enfonçons encore. Un monde sans prêtres, sans guerriers, sans grands hommes, sans visionnaires, sans conscience, sans jugements, un monde en outre sans corps et sans jeunesse, sans valeurs et sans mémoire.
Le sauvetage ne peut être qu'individuel, dit-on. Peut-être familial, si l'on a rencontré la belle âme-sœur adéquate. Le plus dur est alors de transmettre à l'enfant la lucidité sans le malheur.
De révolte, mieux vaut n'en pas parler. On nous drogue, on nous ment, on nous disperse maintenant comme à Pittsburgh à coups de canon à son. Les foules n'existent plus, les sociétés secrètes non plus, les ordres solaires ou religieux encore moins. La nature, c'est ce qui me peine le plus d'ailleurs, paraît de moins en moins réelle, naturelle. Elle est un parc national cartographié par Google Earth dans le meilleur des cas, et pour le reste... Nous savons que nous avons six fois plus de temps à partager avec un conjoint, quinze fois plus de temps libre qu'il y a deux siècles, et qu'il n'y a plus de religion qui tienne vraiment la route (mais Nietzsche le disait déjà). Chacun peut se soumettre à son filet d'illusions personnelles ou collectives, mais le filet est de plus en plus troué. Nous ne sommes même plus dans le profil d'une attente eschatologique.
Bien orgueilleusement, les prédictions se sont succédé pour rien, où Guénon nous annonçait la fin du monde moderne qui serait celle d'une illusion (ah bon ?). Pour l'instant, c'est notre propre fin, précédée de notre pénible vieillissement, qui nous guette. Comme l'autre dans sa tour, nous n'avons rien vu venir. Ceux qui attendaient trop se sont trompés ou en ont trompé d'autres. Peut-être que Debord a raison et que « le destin du Spectacle n'est pas de finir en despotisme éclairé » ; mais nous n'en sommes même pas certains. Peut-être que tout va s'éteindre lentement, minablement, puisque, comme le dit mon ami Jean Parvulesco, qui participe à ce recueil sur Evola, « la race humaine est fatiguée ». En 1941, les Allemands lancent 170 divisions pour attaquer la Russie et ils se heurtent à la résistance de toute une nation de 160 millions d'habitants. Les deux pays n'ont pas aujourd'hui le dixième de cette frappe militaire d'alors, et les deux nations sont aujourd'hui en voie de disparition démographique. L'histoire est terminée, merci monsieur Fukuyama.
Si j'en reste à ma notion personnelle, que je n'impose à personne, de révolte évolienne contre ce monde du néant absolu et relatif, je vois les contenus suivants : continuer d'écrire ; continuer de lire, d'écouter (ou de jouer) de la musique ; danser, faire du sport, continuer de fréquenter les têtes conscientes, même si l'on se fait un peu de mal à force – et qu’elles se raréfient dangereusement) ; aller vers ce qui reste de nature ; pratiquer la révolution froide de Houellebecq en refusant par exemple de consommer; fuir, là-bas fuir, autant que je le peux. Et mépriser, aussi mépriser mais jusqu'à l'ignorance de l'infra-humanité coprophage qui m'entoure. Car je n'ai plus de temps à perdre. Jamais le mens sana in corpore sano ne m'aura semblé si vrai, à une époque de vide intellectuel et d'obésité corporelle. A une époque où l'on n’a plus d'hommes au milieu des ruines, mais des touristes au milieu des ruines. Nous n'avons d'autre choix alors : les temps sont mous, devenons durs.
« Pourquoi si dur ? », demande le morceau de charbon dans le Zarathoustra. Parce qu'on n'a pas le choix, justement. C'est cela ou y passer tout de suite. On attendra que les touristes soient partis et l'on se promènera entre nous dans les ruines. En relisant les Œuvres du baron Evola.
https://www.amazon.fr/Evola-Envers-contre-tous-Collectif/...
19:58 Publié dans Philosophie, Réflexions personnelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julius evola, réflexions personnelles, nicolas bonnal, philosophie, monde moderne, monde postmoderne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 04 novembre 2024
Hugo Fischer: le maître caché d'Ernst Jünger
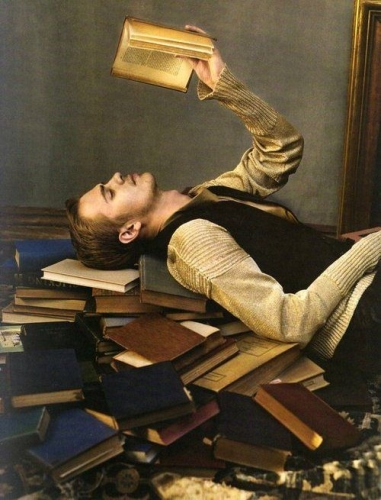
Hugo Fischer: le maître caché d'Ernst Jünger
par Manuel Fernández Espinosa
Source: https://culturatransversal.wordpress.com/2016/01/12/hugo-...
Le magister Nigromontanus
Lors de la préparation de l'excursus à l'« Élucidation de la tradition », consacré en deux parties (Partie I et Partie II [L'ouvrage complet peut être consulté dans Página Transversal]) à la réflexion sur la notion de « tradition » chez Ernst Jünger, nous avons été frappés par un sujet qui nous préoccupait depuis un certain temps: la figure de l'un des maîtres qui a le plus influencé la pensée d'Ernst Jünger et qui, dans la bibliographie espagnole sur Jünger, n'a pratiquement pas été abordée. Il s'agit d'Ernst Hugo Fischer.
Jünger s'y réfère abondamment, mais de manière dispersée. Dans ses journaux, il le désigne presque toujours sous le pseudonyme de «Magister», bien qu'il le mentionne également par son prénom et son nom. Dans les romans « Sur les falaises de marbre » et « Héliopolis », il le désigne par le surnom de « Nigromontanus », dans « Visite à Godenholm », Jünger germanise « Nigromontanus », et on peut l'identifier au personnage de «Schwarzenberg» (Montenegro, comme on dirait en espagnol). Il y a autour de Hugo Fischer un halo de mystère que Jünger lui-même contribue à créer et qui plane sur toute l'œuvre de Jünger dans la figure du maître (bien que tous les personnages ne soient pas identifiables à lui en chair et en os) qui nous initie aux secrets d'une sagesse capable de vaincre le nihilisme.
Ernst Hugo Fischer est né à Halle an der Saale le 17 octobre 1897. La Première Guerre mondiale l'a rendu infirme et, après avoir obtenu son diplôme d'invalidité, il s'est consacré à partir de 1918 à des études consciencieuses et pluridisciplinaires à l'université de Leipzig, où Jünger le rencontrera des années plus tard. Les intérêts « scientifiques » de Fischer sont multiples: il étudie l'histoire, la philosophie, la sociologie, la psychologie et devient un orientaliste renommé. Il obtient son doctorat en 1921 avec une thèse intitulée « Das Prinzip der bei Gegensätzlichkeit Jakob Böhme » (Le principe d'opposition chez Jakob Böhme).
Il est curieux qu'Ernst Jünger, qui avait quelques années de plus que Fischer (Jünger est né en 1895 et Fischer en 1897), l'ait appelé « Maître » jusqu'à la fin de ses jours, mais il faut garder à l'esprit que Jünger est arrivé à l'université alors que Fischer avait quelques années d'avance sur lui. Lorsque Jünger arrive à Leipzig, Fischer est déjà l'un des polygraphes les plus importants d'Europe, mais toujours dans l'ombre, avec une discrétion proche du secret, étudiant et voyageant sans cesse et exerçant son magistère à la manière d'un maître occulte du type de ceux dont parlent les traditions orientales comme le taoïsme.

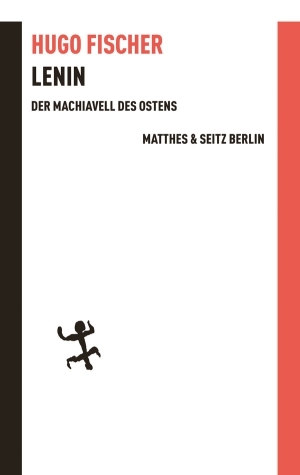
En 1921, il se rend en Inde, en 1923 en Espagne. De 1925 à 1938, il enseigne à la faculté de philosophie de l'université de Leipzig, où il est associé à Arnold Gehlen. Son nationalisme allemand est une constante dans sa vie et il est actif dans les cercles nationaux-révolutionnaires, y compris dans ceux animés par le national-bolchevique Ernst Niekisch, un ami de Jünger. Il émigre d'Allemagne en 1938, car les nazis le trouvent suspect pour ses analyses philosophiques du marxisme, exprimées dans « Karl Marx und sein Verhältnis zum Staat » (Karl Marx et son rapport à l'État) et « Lénine : Machiavel de l'Est », et il finit par s'installer en Norvège, où il devient directeur de l'Institut de recherche pour la sociologie et l'enseignement d'Oslo. Il s'installe ensuite en Angleterre. Il continue à voyager en Inde, où il donne notamment des cours à l'université de Varanasi, et retourne en Allemagne en 1956, où il occupe la chaire de philosophie de la civilisation à l'université de Munich. Il continue d'étudier, d'écrire et de publier, sans toutefois connaître un succès retentissant qui placerait sa figure philosophique au premier plan dans le monde. Son dernier livre est publié en 1971 sous le titre « Vernunft und Zivilisation » (Raison et civilisation) et il meurt le 11 mai 1975 à Ohlstadt (Bavière).
Sa pensée a évolué, mais il est toujours resté hypercritique à l'égard de la modernité et anticapitaliste, étant l'un des maîtres d'œuvre de la révolution conservatrice allemande et testant tous les moyens possibles de combattre ce qu'il considérait comme le mal absolu: la modernité et le capitalisme, afin d'instaurer un nouvel ordre. L'un de ceux qui ont le plus contribué à le faire connaître est, comme on l'a vu plus haut, Ernst Jünger.
Plus qu'une traque exhaustive des abondantes citations que Jünger consacre à Fischer tout au long de son œuvre, il convient de noter le caractère nettement métaphysique (on pourrait même dire mystique) qu'il a imprimé à la vision du monde de Jünger. Dans « Héliopolis », le protagoniste révèle que l'un des enseignements qu'il a reçus de son maître « Nigromontanus » était « que la nature intérieure de l'homme doit devenir visible à la surface, comme la fleur qui jaillit du germe ». Cette idée est répétée à la fin du roman : « Nous croyons que son intention [celle de Nigromontanus/Fischer] est de saturer la surface de profondeur, de sorte que les choses soient à la fois symboliques et réelles ».
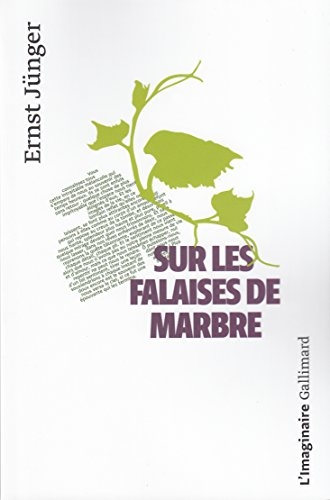 Dans « Sur les falaises de marbre », il est question d'un mystérieux appareil que Nigromontanus aurait offert aux frères du roman: « Pour nous consoler, cependant, nous possédions le miroir de Nigromontanus, dont la contemplation (...) nous calmait toujours ». Ce miroir aurait eu la propriété de « concentrer les rayons du soleil sur un point où un grand feu se produisait immédiatement. Les choses qui, touchées par ce feu, s'enflammaient, entraient dans l'éternité d'une manière qui, selon Nigromontanus, ne pouvait être comparée même à la plus fine distillation. Nigromontanus avait appris cet art dans les couvents d'Extrême-Orient, où les trésors des défunts sont détruits par les flammes, afin qu'ils puissent entrer dans l'éternité en compagnie du défunt.
Dans « Sur les falaises de marbre », il est question d'un mystérieux appareil que Nigromontanus aurait offert aux frères du roman: « Pour nous consoler, cependant, nous possédions le miroir de Nigromontanus, dont la contemplation (...) nous calmait toujours ». Ce miroir aurait eu la propriété de « concentrer les rayons du soleil sur un point où un grand feu se produisait immédiatement. Les choses qui, touchées par ce feu, s'enflammaient, entraient dans l'éternité d'une manière qui, selon Nigromontanus, ne pouvait être comparée même à la plus fine distillation. Nigromontanus avait appris cet art dans les couvents d'Extrême-Orient, où les trésors des défunts sont détruits par les flammes, afin qu'ils puissent entrer dans l'éternité en compagnie du défunt.
Etant donné que « Sur les falaises de marbre » est un roman que l'on pourrait bien qualifier de « réalisme magique », sans pour autant lui dénier son statut de « dystopie », on serait en droit de penser que plutôt qu'un artefact, le « miroir de Nigromontanus » serait quelque chose comme une possible technique de méditation inspirée des connaissances occultes de l'Extrême-Orient (je me demande, non sans prévenir que je risque de me tromper : s'agirait-il d'un mandala?).
Dans cette optique, il convient de rappeler les mots énigmatiques que Jünger écrit dans « Le cœur aventureux. Figures et caprices »: "Parmi les arcanes que m'a révélés Nigromontanus, il y a la certitude qu'il y a parmi nous une troupe choisie qui s'est retirée depuis longtemps des bibliothèques et de la poussière des sables pour se consacrer à son travail dans le monastère le plus intime et dans le Tibet le plus sombre. Il parlait d'hommes assis solitairement dans des chambres nocturnes, imperturbables comme des rochers, dans les cavités desquels scintille le courant qui, à l'extérieur, fait tourner toutes les roues des moulins et maintient en mouvement l'armée des machines ; mais l'énergie de ces hommes reste étrangère à toute fin et est rassemblée dans leur cœur qui, en tant que matrice chaude et vibrante de toute force et de tout pouvoir, est à jamais soustrait à toute lumière extérieure".
Quoi qu'il en soit, la relation entre Ernst Jünger et ce philosophe inconnu était très étroite, et Jünger fait même allusion à des voyages qu'ils ont effectués ensemble, par exemple en traversant le golfe de Gascogne sur le bateau « Iris ». Nous savons, grâce aux journaux de Jünger, que le philosophe Fischer s'est encore rendu à Majorque en 1968, mais nous aimerions connaître les lieux qu'il a visités lors de son voyage en Espagne en 1923 ou lors d'autres visites. Nous sommes convaincus qu'en Hugo Fischer, cet inconnu de la philosophie et de la culture espagnoles, nous avons affaire à un maître caché dont l'œuvre scientifique n'a pas encore, pour quelque raison que ce soit, été suffisamment diffusée.
BIBLIOGRAPHIE :
Jünger, Ernst, «Visite à Godenholm».
Jünger, Ernst, «Heliopolis».
Jünger, Ernst, Diarios: Radiaciones I y II, Pasados los Setenta I, II, III, IV, V.
Jünger, Ernst, «Sobre los acantilados de mármol».
Jünger, Ernst, «El corazón aventurero».
Liens intéressants:
Berger, Tiana, «Hugo Fischer: le maître-à-penser d’Ernst Jünger»
Gajek, Bernhard, «Magister-Nigromontan-Schwarzenberg: Ernst Jünger und Hugo Fischer». Revue de littérature comparée. 1997.
13:18 Publié dans Littérature, Philosophie, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hugo fischer, ernst jünger, lettres, lettres allemandes, littérature, littérature allemande, révolution conservatrice |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 20 octobre 2024
Sur Nietzsche et sa russophilie paradoxale
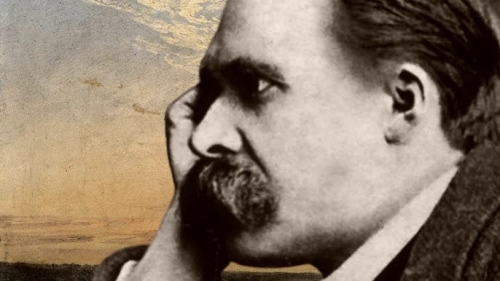
Sur Nietzsche et sa russophilie paradoxale
Nicolas Bonnal
Peut-on admirer les Russes sans les aimer ? C’est ce que fait Nietzsche, et plus d’une fois. En feuilletant pour la millième fois de ma vie le Crépuscule des idoles, je tombe sur des phrases qui marquent une certaine admiration de Nietzsche pour la Russie, et qui rejoint le fondamental § 251 de Par-delà le bien et le mal ; et ça donne (§ 22) :
« Les hommes méchants n’ont point de chants ». D’où vient que les Russes aient des chants ? ».
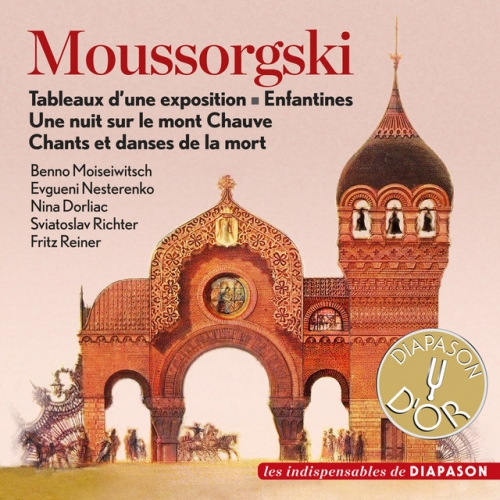
C’est en plus la grande époque de la musique russe avec Moussorgski, Borodine, Rimski-Korsakov qui ont du reste inspiré avec Wagner toute la grande musique de film hollywoodienne – celle de l’âge d’or s’entend (cela vaudrait un essai). Russophile paradoxal, Nietzsche qui préfère de loin les Français ou les italiens, admire cette « race » plus solide et tellurique que le reste du troupeau indo-européen.
L’idée implicite de Nietzsche est que les Russes sont des durs et des méchants, qu’ils ne sont pas comme les autres Occidentaux qui se croient bons. Nietzsche semble aussi penser qu’ils le resteront, qu’il y a une exception russe, et il va expliquer pourquoi: la Russie n’est pas une nation (Nietzsche méprise cette notion), mais un empire. Et Nietzsche qui méprise l’empire allemand (ses raisons ne me semblent pas toujours convaincantes, il avait une certaine grandeur et un certain mérite cet empire) admire l’empire russe.
Mais revenons à Par-delà le bien et le mal (le prodigieux § 251 donc), quand notre génie explique le futur champ de forces :
« Or, les juifs sont incontestablement la race la plus énergique, la plus tenace et la plus pure qu’il y ait dans l’Europe actuelle ; ils savent tirer parti des pires conditions — mieux peut-être que des plus favorables, — et ils le doivent à quelqu’une de ces vertus dont on voudrait aujourd’hui faire des vices, ils le doivent surtout à une foi robuste qui n’a pas de raison de rougir devant les « idées modernes » ; ils se transforment, quand ils se transforment, comme l’empire russe conquiert : la Russie étend ses conquêtes en empire qui a du temps devant lui et qui ne date pas d’hier, — eux se transforment suivant la maxime : « Aussi lentement que possible ! » Le penseur que préoccupe l’avenir de l’Europe doit, dans toutes ses spéculations sur cet avenir, compter avec les juifs et les Russes comme avec les facteurs les plus certains et les plus probables du jeu et du conflit des forces. »
L’empire russe rêve toujours de terre et de conquête. Custine a dit la même chose (cf. notre texte) : l’Occident fait des guerres de propagande, la Russie des guerres de conquête.
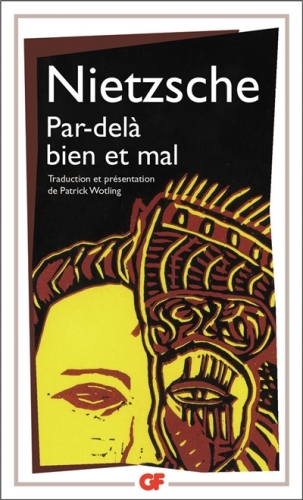
Comme Marshall Macluhan plus tard (on y reviendra), Nietzsche constate que la nation est une « chose fabriquée »:
« Ce que, dans l’Europe d’aujourd’hui, on appelle une « nation » est chose fabriquée plutôt que chose de nature, et a bien souvent tout l’air d’être une chose artificielle et fictive ; mais, à coup sûr, les « nations » actuelles sont choses qui deviennent, choses jeunes et aisément modifiables, ne sont pas encore des « races », et n’ont à aucun degré ce caractère d’éternité, qui est le propre des juifs (§ 251)…
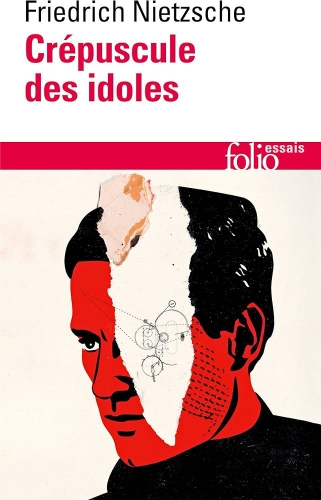
Retour au Crépuscule des idoles. Nietzsche y dénonce comme on sait notre décadence, thème parfois incertain qu’on retrouve alors chez Maupassant, Tolstoï ou Max Nordau (cf. texte encore). Il voit la sensibilité humanitaire et néo-chrétienne tout bousiller dans cet Occident :
SOMMES-NOUS DEVENUS PLUS MORAUX ? — Contre ma notion « par-delà le bien et le mal », il fallait s’y attendre, toute la férocité de l’abêtissement moral, qui, comme on sait, passe en Allemagne pour la morale même — s’est ruée à l’assaut : j’aurais de jolies histoires à conter là-dessus. Avant tout on a voulu me faire comprendre « l’indéniable supériorité » de notre temps en matière d’opinion morale, notre véritable progrès sur ce domaine : impossible d’accepter qu’un César Borgia, comparé avec nous, puisse être présenté, ainsi que je l’ai fait, comme un « homme supérieur », comme une espèce de surhumain... »
Nietzsche aime l’homme dur et cruel, celui qu’il a célébré dans Zarathoustra : Borgia, Napoléon, le forçat russe (on y revient)… et il comprend que cet humanitarisme occidental est la source de la criminelle arrogance et des guerres humanitaires à venir (« faire un monde un lieu sûr pour la démocratie » comme en Palestine). L’Occident se croit supérieur moralement, et cela lui vient de son judéo-christianisme chevronné : il peut donc tout exterminer. L’excellent John Hobson parlait d’une certaine inconsistance dans son chef-d’œuvre sur l’impérialisme, livre de chevet de Lénine (une myriade de citations orne l’Impérialisme stade suprême du capitalisme) :
« Nous autres hommes modernes, très délicats, très susceptibles, obéissant à cent considérations différentes, nous nous figurons en effet que ces tendres sentiments d’humanité que nous représentons, cette unanimité acquise dans l’indulgence, dans la disposition à secourir, dans la confiance réciproque est un progrès réel et que nous sommes par-là bien au-dessus des hommes de la Renaissance (§ 37 toujours). »
Ce faisant nous devenons des… comiques :
« Ne doutons pas, d’autre part, que nous autres modernes, avec notre humanitarisme épais et ouaté qui craindrait même de se heurter à une pierre, nous offririons aux contemporains de César Borgia une comédie qui les ferait mourir de rire. En effet, avec nos « vertus » modernes, nous sommes ridicules au-delà de toute mesure... »

La vertu du gentil c’est une vertu de faible, de décadent (on a la même intuition chez Schiller, cf. lien).
« La diminution des instincts hostiles et qui tiennent la défiance en éveil — et ce serait là notre « progrès » — ne représente qu’une des conséquences de la diminution générale de la vitalité : cela coûte cent fois plus de peine, plus de précautions de faire aboutir une existence si dépendante et si tardive. »
Plus nûment le maître écrit :
« Notre adoucissement des mœurs — c’est là mon idée, c’est là si l’on veut mon innovation — est une conséquence de notre affaiblissement ; la dureté et l’atrocité des mœurs peuvent être, au contraire, la suite d’une surabondance de vie. »
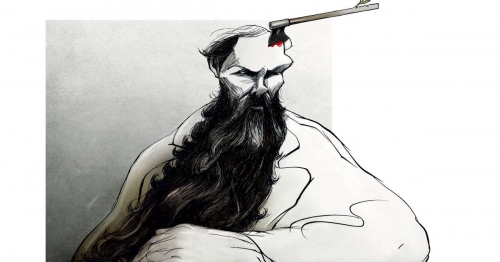
Puis Nietzsche revient à sa Russie pure et dure et cite Dostoïevski, le seul comme on sait qui lui ait « appris quelque chose en psychologie » (il y en eut un autre, c’est notre Stendhal) :
« Cet homme profond, qui a eu dix fois raison de faire peu de cas de ce peuple superficiel que sont les Allemands, a vécu longtemps parmi les forçats de Sibérie, et il a reçu de ces vrais criminels, pour lesquels il n’y avait pas de retour possible dans la société, une impression toute différente de celle qu’il attendait; — ils lui sont apparus taillés dans le meilleur bois que porte peut-être la terre russe, dans le bois le plus dur et le plus précieux. »
C’est presque du Pinocchio ce passage : l’important c’est le bois, la matière brute. Et Dostoïevski qui dénonce régulièrement l’homoncule dégénéré de Saint-Pétersbourg célèbre son homme dur des bois. On le cite sur sa Sibérie presque natale (Souvenirs de la maison des morts, p. 29) :
« Ceux qui savent résoudre le problème de la vie restent presque toujours en Sibérie et s’y fixent définitivement. Les fruits abondants et savoureux qu’ils récoltent plus tard les dédommagent amplement ; quant aux autres, gens légers et qui ne savent pas résoudre ce problème, ils s’ennuient bientôt en Sibérie et se demandent avec regret pourquoi ils ont fait la bêtise d’y venir. C’est avec impatience qu’ils tuent les trois ans, – terme légal de leur séjour ; – une fois leur engagement expiré, ils sollicitent leur retour et reviennent chez eux en dénigrant la Sibérie et en s’en moquant. Ils ont tort, car c’est un pays de béatitude, non seulement en ce qui concerne le service public, mais encore à bien d’autres points de vue. Le climat est excellent ; les marchands sont riches et hospitaliers ; les Européens aisés y sont nombreux. Quant aux jeunes filles, elles ressemblent à des roses fleuries ; leur moralité est irréprochable. Le gibier court dans les rues et vient se jeter contre le chasseur… »
C’est humoristique bien sûr, mais quel dommage que les Russes n’aient pas bravé cet excellent climat pour peupler et développer ces déserts sibériens !

J’ai expliqué dans mon libre toute la critique occidentale de Dostoïevski. Il a tout vu venir notamment dans le Crocodile, pièce géniale et comique et prophétique à la fois.
Revenons à Nietzsche qui attaque l’empire (le pire) allemand :
CRITIQUE DE LA MODERNITÉ. — Nos institutions ne valent plus rien : là-dessus tout le monde est d’accord. Pourtant la faute n’en est pas à elles, mais à nous. Tous les instincts d’où sont sorties les institutions s’étant égarés, celles-ci à leur tour nous échappent, parce que nous ne nous y adaptons plus. De tous temps le démocratisme a été la forme de décomposition de la force organisatrice : dans Humain, trop humain, 1, 318, j’ai déjà caractérisé, comme une forme de décadence de la force organisatrice, la démocratie moderne ainsi que ses palliatifs, tel « l’Empire allemand » ».
Sous des dehors guerriers et militaristes la brave Allemagne bismarckienne cache une belle dégénérescence :
« Pour qu’il y ait des institutions, il faut qu’il y ait une sorte de volonté, d’instinct, d’impératif, antilibéral jusqu’à la méchanceté : une volonté de tradition, d’autorité, de responsabilité, établie sur des siècles, de solidarité enchaînée à travers des siècles, dans le passé et dans l’avenir, in infinitum. Lorsque cette volonté existe, il se fonde quelque chose comme l’imperium Romanum : ou comme la Russie, la seule puissance qui ait aujourd’hui l’espoir de quelque durée, qui puisse attendre, qui puisse encore promettre quelque chose, — la Russie, l’idée contraire de la misérable manie des petits États européens, de la nervosité européenne que la fondation de l’Empire allemand a fait entrer dans sa période critique... »
On en est toujours là remarquez : la Russie contre les misérables petits états européens qui n’ont pu trouver que le pauvre ukrainien-ex-russe pour lui faire la guerre.
L’Occident en un mot c’est la fin des instincts (les migrants, l’antiracisme, le féminisme, l’anti-carbonisme, tout ce qu’on voudra) :
« Tout l’Occident n’a plus ces instincts d’où naissent les institutions, d’où naît l’avenir : rien n’est peut-être en opposition plus absolue à son « esprit moderne ». On vit pour aujourd’hui, on vit très vite, — on vit sans aucune responsabilité : c’est précisément ce que l’on appelle « liberté ». Tout ce qui fait que les institutions sont des institutions est méprisé, haï, écarté : on se croit de nouveau en danger d’esclavage dès que le mot « autorité » se fait seulement entendre. »
Remarquons que Nietzsche inspire ou annonce un autre génie dont j’ai aussi évoqué les mérites. Je cite mon texte sur Freud politiquement incorrect :
« Et voici ce que j’ajoute : depuis des temps immémoriaux, l’humanité subit le phénomène du développement de la culture (d’aucuns préfèrent, je le sais, user ici du terme de civilisation). C’est à ce phénomène que nous devons le meilleur de ce dont nous sommes faits et une bonne part de ce dont nous souffrons. Ses causes et ses origines sont obscures, son aboutissement est incertain, et quelques-uns de ses caractères sont aisément discernables. »
Voici les conséquences de ce développement culturel si nocif à certains égards, et auxquelles nos élites actuelles se consacrent grandement :
« Peut-être conduit-il à l’extinction du genre humain, car il nuit par plus d’un côté à la fonction sexuelle, et actuellement déjà les races incultes et les couches arriérées de la population s’accroissent dans de plus fortes proportions que les catégories raffinées. »
Cette extinction prend un certain temps c’est vrai mais comme elle se précise enfin on va pouvoir respirer.
Sources :
https://fr.wikisource.org/wiki/Par_del%C3%A0_le_bien_et_l...
https://ekladata.com/zAQyX0zvTMx50y-0sJwlAhBZ-vI/Nietzsch...
https://www.dedefensa.org/article/sigmund-freud-politique...
https://www.dedefensa.org/article/frederic-schiller-et-la...
https://lesakerfrancophone.fr/la-russophobie-pourquoi-com...
https://www.amazon.fr/NIETZSCHE-GUERRE-SEXES-Nicolas-Bonn...
https://www.dedefensa.org/article/max-nordau-et-lart-dege...
18:01 Publié dans Actualité, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : freidrich nietzsche, nicolas bonnal, philosophie, russie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook



