Jornadas
Actualidad de Carl Schmitt a 30 años de su muerte.
18, 19 y 20 de noviembre de 2015, Santiago del Estero 1029, CABA.
Facultad de Ciencias Sociales, UBA.
Para consultar el programa, hacé click aquí:
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Oswald Spengler and the Soul of Russia

 The hatred of the ‘West’ and of ‘Europe’ is the hatred for a Civilisation that had already reached an advanced state of decay into materialism and sought to impose its primacy by cultural subversion rather than by combat, with its City-based and money-based outlook, ‘poisoning the unborn culture in the womb of the land’. (Spengler, 1971, II, 194). Russia was still a land where there were no bourgeoisie and no true class system but only lord and peasant, a view confirmed by Berdyaev, writing:
The hatred of the ‘West’ and of ‘Europe’ is the hatred for a Civilisation that had already reached an advanced state of decay into materialism and sought to impose its primacy by cultural subversion rather than by combat, with its City-based and money-based outlook, ‘poisoning the unborn culture in the womb of the land’. (Spengler, 1971, II, 194). Russia was still a land where there were no bourgeoisie and no true class system but only lord and peasant, a view confirmed by Berdyaev, writing:  Spengler states above that the Russians do not ‘fight’ capital. (Ibid., 495). Yet their young soul brings them into conflict with money, as both oligarchy from inside and plutocracy from outside contend with the Russian soul for supremacy. It was something observed by both Gogol and Dostoyevski. The anti-capitalism and ‘world revolution’ of Stalinism took on features that were drawn more from Russian messianism than from Marxism, reflected in the struggle between Trotsky and Stalin. The revival of the Czarist and Orthodox icons, martyrs and heroes and of Russian folk-culture in conjunction with a campaign against ‘ rootless cosmopolitanism’, reflected the emergence of primal Russian soul amidst Petrine Marxism. (Brandenberger, 2002). Today the conflict between two world-views can be seen in the conflicts between Putin and certain ‘oligarchs’ and the uneasiness Putin causes among the West.
Spengler states above that the Russians do not ‘fight’ capital. (Ibid., 495). Yet their young soul brings them into conflict with money, as both oligarchy from inside and plutocracy from outside contend with the Russian soul for supremacy. It was something observed by both Gogol and Dostoyevski. The anti-capitalism and ‘world revolution’ of Stalinism took on features that were drawn more from Russian messianism than from Marxism, reflected in the struggle between Trotsky and Stalin. The revival of the Czarist and Orthodox icons, martyrs and heroes and of Russian folk-culture in conjunction with a campaign against ‘ rootless cosmopolitanism’, reflected the emergence of primal Russian soul amidst Petrine Marxism. (Brandenberger, 2002). Today the conflict between two world-views can be seen in the conflicts between Putin and certain ‘oligarchs’ and the uneasiness Putin causes among the West.
00:05 Publié dans Philosophie, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : russie, oswald spengler, allemagne, révolution conservatrice, philosophie, philosophie de l'histoire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Jornadas
Actualidad de Carl Schmitt a 30 años de su muerte.
18, 19 y 20 de noviembre de 2015, Santiago del Estero 1029, CABA.
Facultad de Ciencias Sociales, UBA.
Para consultar el programa, hacé click aquí:
12:34 Publié dans Evénement, Révolution conservatrice, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : carl schmitt, théorie politique, politologie, sciences politiques, révolution conservatrice, allemagne, philosophie, théologie politique, philosophie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Once upon a time, a dental or medical exam was an opportunity to read a book. No more. The TV blares. It was talking heads discussing whether a football player had been sufficiently punished. The offense was unclear. The question was whether the lashes were sufficient.
It brought to mind that punishment has become a primary feature of American, indeed Western, society. A baker in Colorado was punished because he would not bake a wedding cake for a homosexual marriage. A county or state clerk was punished because she would not issue a marriage license for a homosexual marriage. University professors are punished because they criticize Israel’s inhumane treatment of Palestinians. Whistleblowers are punished—despite their protection under federal law—for revealing crimes of the US government. And children are punished for being children.
But not by their parents. Police can slam children around and seriously injure them. But parents must not lay a hand on a child. If a child gets spanked, as everyone in my generation was, in comes the Child Protective Services Gestapo. The child is seized, put into “protective custody,” and the parents are arrested. The CPS Gestapo receives a federal bonus for every child that they seize, and they want the money.
About all parents can do today is to restrict TV or video game playing time. Even this is dicey, because the kids are taught at school to report abusive behavior of parents. For many kids being told what to do by parents is abusive behavior. Kids have learned that they can pay back parents for disciplining them by reporting the parents to teachers or by themselves calling CPS. Kids who retaliate in this socially approved manner do not realize that they run a high risk of ruining the lives of their parents as well as their own and ending up in foster care where the risk of sexual abuse is present.
As society has made it possible for kids to prevail over parents, the kids think this right also applies to teachers, school administrators, and School Resource Officers, psychopaths with police badges who maintain discipline with force and violence. The kids quickly discover,as Shakara discovered in her encounter with Ben Fields, that whereas parents are constrained from using corporal punishment, School Resource Officers are not. Shakara’s desk was overturned as she sat in it. She was slammed onto the floor, dragged across the floor and handcuffed. Any parent who did that would be facing jail time.
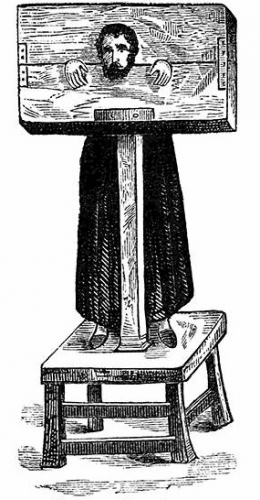 Schools are no longer places of learning. They are places of punishment. Kids are punished for the most absurd reasons. Nothing more than behaving as a child brings on punishment. As Henry Giroux has written, schools have become places of control, repression, and punishment.
Schools are no longer places of learning. They are places of punishment. Kids are punished for the most absurd reasons. Nothing more than behaving as a child brings on punishment. As Henry Giroux has written, schools have become places of control, repression, and punishment.
17,000 American public schools have a police presence. All common sense has long departed.Five and six year-olds who get into a shoving match are arrested and carried off in handcuffs. Police issue tickets and fines to students for what was ordinary behavior in my school days. Suspensions result as do police records that hamper a child’s prospect of success.
The violence that Ben Fields used against Shakara is routine. Mother Jones reports that a Louisville goon thug, Jonathan Hardin punched a 13-year old in the face for cutting into the cafeteria line and of holding another 13-year old in a chokehold until the student became unconscious. A dispute over cell phone use resulted in a Houston student being hit 18 times with a police weapon.
The police violence extends beyond the schools. Any American unfortunate enough to have a police encounter risks being tasered, beaten, arrested, and even murdered.
Protesters, war and otherwise, are beaten, tear gassed, arrested. The American police state is working hard to criminalize all criticism of itself. Violence has become the defining hallmark of the United States. It is even the basis of US foreign policy. In the 21st century millions of peoples have been killed and displaced by American violence against the world.
With our public schools and police forces working overtime to teach the children who will comprise the future generations that violence is the solution and submission is the only alternative, expect the United States to be unliveable at home and an even worse danger to the rest of the world.
00:05 Publié dans Actualité, Sociologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, société répressive, répression, états-unis, philosophie, sociologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Prendre la parole était l’un des slogans de 68 et il m’est resté cher. A cette époque, il fallait prendre la parole comme sujet libre, autonome, indépendant. Ça me fascinait, j’allais me libérer et j’applaudissais la liberté d’expression. Je ne savais pas que le désir de liberté peut conduire dans le néant, le terrorisme, le désespoir. Je n’avais pas lu Dostoïevski, celui qui a inspiré Svetlana Alexievitch, cette année prix Nobel de la paix.
Ce désir de libérer la parole, comme on dit encore aujourd’hui, n’était pas vraiment nouveau : c’était déjà celui de la psychanalyse avec un patient qui, au début, balbutie mais en vient progressivement à s’exprimer comme sujet et non comme le réceptacle des discours qui l’entourent, celui du père surtout. C’était si peu nouveau que déjà les prophètes de l’Ancien Testament s’efforçaient de prendre la parole indépendamment de tout ce qui enchainait Israël. La différence était que les prophètes s’appuyaient sur la parole d’un Autre, l’Eternel, et qu’eux, contrairement aux soixante-huitards, ne visaient pas à se poser comme sujets émancipés. Au contraire ! L’Eternel était tout-puissant et eux ne l’étaient pas. En outre, ils avouaient qu’ils comprenaient mal ce que le tout-puissant leur disait, « ses pensées n’étant pas leurs pensées » (Esaïe, 55 : 8).
Sommes-nous aujourd’hui, suite à mai 68, dans un monde où chacun prend la parole en son nom propre ? Poser la question, c’est y répondre. Les êtres que nous côtoyons sont souvent des perroquets, et nous aussi le sommes parfois. Ne répétons-nous pas quotidiennement un discours sur les droits de l’homme, la nécessaire émancipation de tel ou tel groupe opprimé, les processus de paix. Ce n’est pas nous qui parlons alors, mais ce qu’on appelait en Grèce antique la « doxa », et que nous appelons aujourd’hui le politiquement correct.
Se demander si c’est vraiment un individu libre qui parle est une question importante. On se l’est posée à Jérusalem. La parole des prophètes était-elle libre ? La réponse fut parfois négative, comme aujourd’hui elle l’est pour la plupart de nos contemporains. Pour eux, ce n’est d’ailleurs même pas une réponse, parce qu’ils sont en pilotage automatique contre toute religion. A Athènes, les choses se sont passées différemment. On a cherché une parole libre en songeant à Socrate. Mais il ne « prenait » pas la parole, il dialoguait.
Je ne crois pas que nous pourrons jamais développer une parole libre. En même temps, je suis convaincu qu’il faut s’efforcer de le faire. Position inconfortable mais dont je ne vois pas qu’on puisse lui échapper.
Ce qui me frappe beaucoup aujourd’hui est que ceux qui parlent dans l’espace public prétendent toujours parler librement grâce à la liberté d’expression, mais qu’en réalité ils parlent au nom de quelqu’un ou quelque chose d’autre : la science, le progrès et surtout les faits, dont on nous dit qu’ils parlent d’eux-mêmes. Devant des faits, pas question de prendre la parole. On oublie qu’un fait doit être dit, doit passer par la parole, pour parvenir à la conscience. Il n’y a pas d’individus libres et autonomes devant des faits qui parlent d’eux-mêmes.
Tout se passe comme si nous n’arrivions pas à parler par nous-mêmes et que nous devions placer nos propos sous l’autorité de quelque « père », (pour parler en termes psychanalytiques ou théologiques). Parfois, pour nous faire entendre, nous nous réclamons d’une entité toute-puissante dans une vaine tentative d’imposer ces propos d’en-haut. C’est surtout une rationalité étroite qui, aujourd’hui, est devenue notre « père tout-puissant ». La soi-disant extrême droite et aussi la gauche extrême sont sévèrement tancés pour ne pas respecter les chiffres, les statistiques et donner dans des émotions, respectivement la peur et un enthousiasme délirant. Les gardiens de la rationalité n’ouvrent les portes du temple qu’à des individus lisses et corrects, les pharisiens de la modernité. Au côté des politiciens locaux qui aiment s’appuyer sur l’autorité indiscutable des chiffres, comme le parti libéral-radical en Suisse, il y a encore des pouvoirs supranationaux, des pères presque célestes. La cour européenne des droits de l’homme ou, tout récemment, l’OMS qui, sur la base d’impitoyables calculs nous a dit comment nous devons nous comporter devant notre assiette. Les risques de cancer sont plus élevés chez ceux qui mangent de la viande rouge d’où un commandement : « tu ne mangeras pas ou peu de viande rouge ». Le « père » a parlé. Des experts ou chercheurs de L’OMS récitent ce commandement, mais sans prendre du tout la parole. Plus les propos s’adossent à un « père » terrestre et tout-puissant, moins ils proviennent d’un individu libre et autonome. Le père tout-puissant de la Bible fait horreur, mais pas l’OMS.
En nous débarrassant du père tout-puissant de la Bible, nous ne nous sommes pas libérés. Nous en avons seulement choisi un autre ou plusieurs autres. Saint Paul l’a senti qui restait perplexe devant la loi, allant même jusqu’à dire qu’elle conduisait à la mort. Effectivement, un individu dont le comportement et les propos sont calqués sur une loi devant laquelle il n’a rien à dire, ne peut exister, est mort, comme le savent bien les psychanalystes.
Seul le Christ me semble avoir parlé pleinement à partir de lui, de sa chair. Mais ce que je viens de dire est faux, puisqu’il déclare : « les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même » (Jean : 14).
Ce passage de Jean signale une voie de salut hors du dilemme stérile entre parler comme sujet libre ou « être parlé », conditionné, par divers « pères » terrestres qui courent les rues comme autant de petits diables vendant leur marchandise médiatique à la criée. De quoi s’agit-il ?
Dans nos misérables existences, n’avons-nous pas senti, parfois, que nous ne parlions pas à partir de nous-mêmes et que pourtant, nous étions miraculeusement libres ? Que nos paroles étaient transportées par un souffle venu d’ailleurs ? La manière dont nous nous sommes alors exprimés, ne révélait-elle pas que nos paroles ne provenaient pas de nous et que pourtant nous n’étions pas asservis à une parole morte comme l’est la parole médiatique aujourd’hui ? Conclusion : parler à partir de soi-même est peut-être un principe régulateur au sens de Kant (un objectif inatteignable), mais au fond, nous cherchons surtout à être portés par l’esprit plutôt que par les tristes ruminations de notre petit moi ou les glaciales déductions de notre intellect.
Depuis la « belle époque » (mai 68) des aspirations à une parole libre et autonome, la situation a basculé. A force de vouloir parler comme sujet libre, on en vient à se faire le porte-parole de préjugés ou d’idées toute faites. Pas seulement un porte-parole mais un esclave pavlovien. A force de se vouloir libre, on est tombé dans la servitude. Normal ! Le moi souverain à partir duquel on veut prendre la parole est une chimère, une coquille vide. Dès lors, pour continuer à dire quelque chose, il faut meubler ce vide avec des chiffres ou quelque autre entité toute-puissante et intimer à tout le monde de suivre sans broncher.
Des discours politiques nous sont ainsi assénés comme s’ils provenaient d’un Autre irréfutable, des commandements d’un « père » qu’on ne discute pas. Tandis que la notion de père céleste dans la Bible provoque aujourd’hui des ricanements, les esprits sont asservis à une toute-puissance de la science ou des faits, autrement plus tyrannique que le discours d’un leader charismatique.
A chacun de choisir son asservissement. Comme me l’a dit une fois un commentateur sur ce site, notre seule liberté est de choisir nos chaînes. Il y a des chaînes qui asservissent au point d’abrutir, d’autres non. A chacun de choisir.
Jan Marejko, 3 novembre 2015
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, liberté d'expression |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Entrevista a Francisco José Fernández-Cruz Sequera realizada en el programa "Una hora en libertad" de Radio Inter el 10-10-2015, con motivo de la publicación de los libros "Ayn Rand y Leo Strauss. El capitalismo, sus tiranos y sus dioses" y "Crónicas del austericidio"
Pour commander le livre/To order the book: http://editorialeas.com/shop/
00:05 Publié dans Entretiens, Philosophie, Synergies européennes, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, philosophie politique, ayn rand, leo strauss, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Caffeina d'Europa
Scuotere l’Italia “a suon di schiaffi e dinamite”, scrive Giordano Bruno Guerri nella biografia dedicata a Marinetti, era la missione del padre del Futurismo e di tutte le sue declinazioni. Lo schiaffo, la dinamite: la rinascita artistica che comincia da una particella elementare, il suono, una rifondazione che parte dal segno, dalla radice, per sconvolgere le fondamenta di un’intera cultura.
«Col preannunzio sciroccale del Hamsin e dei suoi 50 giorni taglienti di sanguigne scottature desertiche nacqui il 22 dicembre 1876 in una casa sul mare ad Alessandria d’Egitto». Secondogenito di una giovane coppia milanese, F.T. nasce in terra africana per volere del padre Enrico, avvocato, convinto al trasferimento dalle buone prospettive di lavoro offerte dall’apertura del Canale di Suez. Insieme al fratello Leone viene educato al Collegio Internazionale San Francesco Saverio, un istituto gesuitico dove incontrerà un altro illustre innovatore della poesia italiana del Novecento, Giuseppe Ungaretti. Grazie alle ingenti somme guadagnate dagli affari del padre, perfeziona gli studi con un baccalaureato a Parigi nel 1894. Dopo il soggiorno parigino, eccolo in territorio italiano, a Pavia, dove raggiunge il fratello per studiare legge, facoltà che abbandonerà presto a causa della morte di Leone. Conclude gli studi universitari a Genova e vince nel frattempo il concorso parigino Samedis populaires con il poemetto Les vieux marins. Il componimento è il taglio del nastro agli ambienti intellettuali francesi: in breve tempo viene pubblicata la sua prima raccolta di poesie, La Conquete des Étoiles, la carriera giuridica definitivamente accantonata. Continua a comporre versi in stile liberty e simbolista, guardando a Mallarmé e D’Annunzio – stimato rivale quest’ultimo, amato e odiato, lui stesso si definì “figlio di una turbina e di D’Annunzio, da cui sarà definito “cretino fosforescente”. Nel 1905 fonda la rivista Poesia, la nuova palestra del verso parolibero firmato F.T. Nel 1908 eccolo tirato fuori da un fossato a Milano, nella sua automobile, uscito fuori strada per evitare due ciclisti; l’episodio si farà aneddoto – come poi molti altri – e diventerà per Marinetti la chiave di lettura della rivoluzione culturale programmata per il prossimo anno: l’uomo estratto dall’automobile è l’uomo nuovo futurista che dopo aver vinto l’inferno della tradizione ed aver accantonato lo stile liberty e decadentista rappresentato dai due «noiosi» ciclisti, può volgersi all’istituzione di un’arte nuova, rivoluzionaria.

Il febbraio 1909 è arrivato. Tutto è pronto per il lancio della bomba. F.T. ha sedotto Rose Fatine, 20 anni, figlia di Mohamed el Rachi Pascià, un vecchio egiziano, ricco azionista de LeFigaro. Grazie alla buona intesa dei giovani amanti, l’uomo asseconda la bizzarra richiesta dell’italiano, ignaro del privilegio di partecipare ad un evento storico mondiale: pubblicare sul giornale il suo Manifesto. Il 20 febbraio 1909 sul quotidiano nazionale francese viene lanciata la bomba: esce il Manifesto del Futurismo, undici punti, con appendice. Il Futurismo è fondato. Sintetizzerà Marinetti: «E’ un movimento anticulturale, antifilosofico, di idee, di intuiti, di istinti, di schiaffi, pugni purificatori e velocizzatori. I futuristi combattono la prudenza diplomatica, il tradizionalismo, il neutralismo, i musei, il culto del libro.» La parola d’ordine è “Velocità”. Come dinamismo, come simultaneità, come meccanicismo e libertà. Marinetti stravolge ogni dogma della poesia e delle arti e ne ritaglia un vestito nuovo, “moderno”, diremmo oggi, come il secolo XX. Protagonista di quest’ultimo, annuncia F.T., sarà la Macchina, metafora dell’impeto prometeico dell’uomo nuovo. Per evitare una volta per tutte l’associazioni del poeta Marinetti e del futurismo all’idea infantile e brutale dell’adorazione della macchina e della modernolatria, ecco un passo del discorso che F.T. stesso tenne nel 1924 alla Sorbona:« Io intendo per macchina tutto ciò ch’essa significa come ritmo e come avvenire; la macchina dà lezioni di ordine, disciplina, di forza, di precisione, d’ottimismo e di continuità. […] Per macchina, io intendo uscire da tutto ciò che è languore, chiaroscuro, fumoso, indeciso, mal riuscito, trascuratezza, triste, malinconico per rientrare nell’ordine, nella precisione, la volontà, lo stretto necessario, l’essenziale, la sintesi». Il Manifesto è discusso in tutta Europa, i giornali lo chiamano “Caffeina d’Europa”. Intanto Marinetti continua a scrivere poesie, romanzi e testi teatrali, tra cui si ricordano “ Gl’Indomabili”, il censuratissimo “Mafarka il futurista” e la sceneggiatura “ Re Baldoria”. La fama di Marinetti si diffonde per tutto il Vecchio Continente, legata soprattutto alle esuberanze e ai modi “futuristi” di F.T. & Co. In particolar modo diventano celebri le serate-futuriste: spettacoli teatrali in cui vengono fuse performance di vario genere, dalla declamazione alla piéce teatrale, durante cui il futurismo fa da protagonista e le bagarre e gli scontri con il pubblico sono la norma, e ne alimentano la curiosità. Il 1911 inaugura la stagione dei viaggi del poeta e della maggiore sperimentazioni linguista e letteraria. Scoppiata la guerra con la Libia, parte al fronte come reporter per un quotidiano d’oltralpe. Poi è a Mosca e San Pietroburgo, invitato dai futuristi russi a fare propaganda. Nel frattempo in Lacerba, la rivista fiorentina diretta da Papini e Soffici, il futurismo trova il miglior canale di diffusione in Italia parallelamente alla pubblicazione di Zang Tumb Tumb, un reportage bellico scritto in parole in libertà. La prima guerra mondiale fa esplodere il cuore di Marinetti, che, in seguito all’attentato di Sarajevo, si arruola volontario: è a Caporetto ma anche a Vittorio Veneto. Tornato dal conflitto si interessa alla politica cui lo spirito rivoluzionario affascina Mussolini che si avvarrà di molti futuristi nel giorno della proclamazione dei fasci di combattimento, nel 1919 al San Sepolcro. Giudicate passatiste e reazionarie le idee di Mussolini, se ne allontanerà, pur sempre rimanendo rispettato e considerato dal Duce. Si lega nel frattempo a Benedetta Cappa, pittrice e poetessa che accompagnerà Marinetti fino alla fine dei suoi giorni, sua «eguale, non discepola». Nel ’35 parte volontario in Africa Orientale, nel ’42 si arruola per la campagna di Russia. Marinetti viene rimpatriato con l’arrivo dell’autunno, spossato e in precario stato fisico. La morte lo coglie il 2 dicembre 1944, a Bellagio sul Lago di Como, all’alba dopo una notte di lavoro poetico consacrato al Quarto d’ora di poesia della X mas, complice il cuore.
Tentare di definire Filippo Tommaso Marinetti a più di 70 anni dalla morte è un esperimento difficile, che richiede capacità di sintesi ben collaudate; sicuramente possiamo definirlo un “rivoluzionario”, nonostante le ideologie e i numerosi detrattori che F.T. ha avuto. Sicuramente possiamo definirlo un “cortocircuito” della storia culturale europea, ma fu soprattutto un profetico anticipatore, ai limiti dell’incredibile. Dalla propaganda allo scandalo all’editoria, Marinetti è stato il protoideatore dei fenomeni di comunicazione di massa che oggi caratterizzano le nostre vite; nei suoi scritti compaiono descrizioni fantascientifiche di nuove tecnologie e abitudini, pienamente rintracciabili oggi in computer e social networks. Nonostante le ortodosse e insipide categorizzazioni a cui è stato sottoposto, Marinetti resta nella sua natura contraddittoria un personaggio tanto affascinante quanto enigmatico. Intellettuale rivoluzionario, dissidente, fervente agitatore aderì al fascismo cui si allontanò disprezzando leggi marziali e reazionarismo; libertino, don Giovanni, promotore del libero amore e del tradimento e fautore dell’emancipazione totale e disinibita delle donne, fu padre modello di tre figlie e marito presente; anticlericale al fulmicotone, accesissimo nemico della Chiesa, si sposò cristianamente, fece battezzare e cresimare le figlie, e non si privò né dell’estrema unzione né dei funerali religiosi.
Se è vero che ognuno è figlio del suo secolo, sarà vero in questo caso anche il contrario. Il secolo delle contraddizioni e dello stravolgimento totale che il Novecento rappresenta ha un padre illustre. Permettendoci di citare Bontempelli diremmo: le parole gridate da Marinetti sono quelle che partoriscono un nuovo secolo.
00:05 Publié dans art, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art, avant-gardes, futurisme, philosophie, marinetti, italie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Entretiens, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, suisse, oskar freysinger, affaires européennes, philosophie, philosophie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

La servitude est volontaire
Ex: http://www.lesobservateurs.ch
La « pensée correcte » ou le conformisme, autrement dit « bienpensance », est l’un des fruits de la normalisation, c’est-à-dire du pouvoir des normes invisibles et non juridiques. Nul ne rédige une norme : elle s’impose à travers un réseau de pouvoirs et d’oppressions psychologiques où s’exerce moins le pouvoir d’un seul que la servitude de tous. La norme asservit les intelligences, et leur est tellement présente qu’elle est les bornes immanentes de la créativité, de la raison et de la lucidité. Toute cette oppression ne sert qu’à une chose : rendre volontaire la servitude.
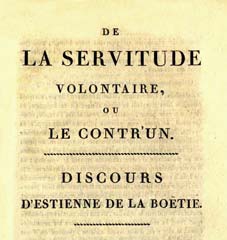 Comment cette tyrannie diffuse opère-t-elle, et nous coupe de toute possibilité d’exercer une quelconque liberté ? Etienne de la Boétie, dans De la servitude volontaire, montre que la liberté est très simple à obtenir : le tyran et ses amis ne pèsent rien face au peuple tout entier. Seulement, pour désirer quelque chose, il faut l’avoir connu. C’est pourquoi le tyran et ses amis tentent par-dessus tout de supprimer la mémoire de la liberté pour asseoir sa tyrannie. Pour cela, pas besoin de prendre la peine de supprimer la mémoire de la masse : l’abrutir suffit largement. Du pain et des jeux, disaient déjà les romains : nous avons les séries télévisuelles de masse, qui servent à saturer l’intelligence avec le non sens et l’affect primaire. Ce qui permet, par exemple, de faire passer tranquillement l'acceptation d'une arithmétique électorale étrange, comme en Suisse récemment. Une tyrannie bien entretenue s’enracine dans l’ignorance et se perpétue par l’oubli de la liberté.
Comment cette tyrannie diffuse opère-t-elle, et nous coupe de toute possibilité d’exercer une quelconque liberté ? Etienne de la Boétie, dans De la servitude volontaire, montre que la liberté est très simple à obtenir : le tyran et ses amis ne pèsent rien face au peuple tout entier. Seulement, pour désirer quelque chose, il faut l’avoir connu. C’est pourquoi le tyran et ses amis tentent par-dessus tout de supprimer la mémoire de la liberté pour asseoir sa tyrannie. Pour cela, pas besoin de prendre la peine de supprimer la mémoire de la masse : l’abrutir suffit largement. Du pain et des jeux, disaient déjà les romains : nous avons les séries télévisuelles de masse, qui servent à saturer l’intelligence avec le non sens et l’affect primaire. Ce qui permet, par exemple, de faire passer tranquillement l'acceptation d'une arithmétique électorale étrange, comme en Suisse récemment. Une tyrannie bien entretenue s’enracine dans l’ignorance et se perpétue par l’oubli de la liberté.
Un autre thème obsédant du discours sur la servitude d’Étienne de la Boétie, c’est celui des masques derrière lesquels se cachent le tyran et ses amis afin de tromper le peuple. Quel est le masque de nos tyrans ? C’est celui de la révolte. Nos tyrans mettent en exergue les cas-limites (insistance sur les différentes indignations dialectiques, mise en avant du monde LGBT, accueil de la « différence » étrangère et le financement des officines d’extrême-gauche mobilisées contre les « oppressions » « patriarcales », « colonialistes », « raciales », ect.), pour asseoir leur domination idéologique. La normalisation de la « révolte » ne cache en fait qu’un horrible conformisme à une pensée unique, qui vise à rendre invisibles les libertés. « L’époque qui ose se dire la plus révoltée n’offre à choisir que des conformismes. », écrivait Albert Camus.
Peu de périodes ont eu aussi peur de la liberté. Tâchons de ne pas l’oublier.
Vivien Hoch, 23 octobre 2015
00:05 Publié dans Actualité, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, philosophie, servitude |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, philosophie de l'histoire, philippe jumel, crise |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Crise syrienne, paysage intellectuel français et «Grand Remplacement»
Entretien avec Robert Steuckers
Propos recueillis par Adriano Scianca pour « Primato nazionale »
1. Que pensez-vous de la manière dont l'Europe a géré la crise de l'immigration suite à la crise syrienne?
L’Europe est inexistante en tant que puissance politique qui compte dans la région hautement stratégique qu’est le Levant. Elle n’a su ni impulser une politique de stabilité qui aurait joué dans son intérêt le plus légitime ni faire face aux catastrophes que l’intervention des Etats-Unis et de leurs alliés dans la région ont entraînées. Parmi ces catastrophes, la plus visible aujourd’hui en Europe, de la Grèce à l’Allemagne en passant par tous les pays des Balkans, est bien sûr cet afflux massif de réfugiés que les Etats européens ne sont pas capables d’intégrer à l’heure d’un certain ressac de l’économie européenne, perceptible même en Allemagne. L’intérêt de l’Europe aurait été de maintenir la stabilité au Levant et en Irak. C’était le point de vue du fameux « Axe Paris-Berlin-Moscou » qui s’était insurgé contre l’intervention de Bush en Irak en 2003. Les Etats-Unis, qui ne sont pas une puissance romaine au sens classique du terme et au sens où l’entendait Carl Schmitt, ne font donc pas comme Rome, ils n’apportent ni « pax romana » ni « pax americana » mais génèrent le chaos, auquel les populations essaient tout naturellement d’échapper, au bout d’une douzaine d’années voire d’un quart de siècle si l’on tient compte de la première intervention en Irak en 1990. Ces pays, jadis structurés selon les principes de l’idéologie baathiste (personnaliste, transconfessionnelle et étatiste), avaient le mérite de la stabilité et faisaient l’admiration d’un grand diplomate néerlandais, Nikolaos Van Dam, docteur en langue et civilisation arabes, qui a consacré un ouvrage en anglais à la Syrie baathiste qui mériterait bien d’être traduit en toutes les grandes langues d’Europe. Cette stabilité, maintenue parfois avec rudesse et sévérité, a été brisée : on a cassé la forme d’Etat qui finissait vaille que vaille par s’imposer dans une région, soulignait aussi Van Dam, marquée par le tribalisme et allergique à cette forme étatique et européenne de gestion des « res publicae ». L’Europe a fait du « suivisme », selon la formule d’un observateur flamand des relations internationales, le Prof. Rik Coolsaet. Elle a benoîtement acquiescé aux menées dangereuses et sciemment destructrices de Washington, puissance étrangère à l’espace européen et à l’espace du Levant et de la Méditerranée orientale. Elle paie donc aujourd’hui les pots cassés car elle est la voisine immédiate des régions où l’hegemon-ennemi a semé le chaos. Celui-ci cherche à éviter ce que j’appellerais la « perspective Marco Polo », la cohésion en marche des puissances d’Eurasie (Europe, Russie, Inde, Chine), par le truchement des télécommunications, des nouvelles voies maritimes et ferroviaires en construction ou en projet, du commerce, etc. Par voie de conséquence, l’hegemon hostile doit mener plusieurs actions destructrices, « chaotogènes » dans les régions les plus sensibles que les géopolitologues nomment les « gateway regions », soit les régions qui sont des « passages stratégiques » incontournables, permettant, s’ils sont dominés, de dynamiser de vastes espaces ou, s’ils sont neutralisés par des forces belligènes, par un chaos fabriqué, de juguler ces mêmes dynamismes potentiels. La Syrie et le Nord de l’Irak sont une de ces « gateway regions » et l’étaient déjà au moyen-âge car ce Levant, avec sa projection vers l’hinterland mésopotamien, donnait accès à l’une des routes de la soie, menant, via Bagdad, à l’Inde et la Chine. L’Ukraine est une autre de ces « gateway regions ». L’abcès de fixation du Donbass est un verrou sur la route du nord, celle empruntée, avant la première croisade d’Urbain II, par les Coumans turcs, tandis que leurs cousins seldjouks occupaient justement les points-clefs du Levant, dont on reparle aujourd’hui : cette tenaille turque, païenne au nord et musulmane au sud, barrait la route de la soie, la voie vers l’Inde et la Chine, enclavait l’Europe à l’Est et risquait de la provincialiser définitivement.
Par ailleurs, dans un avenir très proche, d’autres zones de turbulences pourront éclore autour de l’Afghanistan, non pacifié, dans le Sinkiang chinois, base de départ d’une récente vague d’attentats terroristes en Chine, en Transnistrie/Moldavie ou ailleurs. L’Europe, dans cette perspective, doit être cernée par des zones de turbulence ingérables, afin qu’elle ne puisse plus se projeter ni vers l’Afrique ni vers le Levant ni vers l’Asie centrale au-delà de l’Ukraine. L’Europe a la mémoire courte et ses établissements d’enseignement ne se souviennent plus ni de Carl Schmitt (surtout le théoricien du « grand espace » et le critique des faux traités pacifistes dictés par les Américains) ni surtout du géopolitologue Robert Strausz-Hupé (1903-2002) qui, pour le compte de Roosevelt et de Truman, percevait très clairement les atouts de la puissance européenne (allemande à son époque), que toute politique américaine se devait de détruire. Ces atouts étaient, entre bien d’autres choses, l’excellence des systèmes universitaires européens, la cohésion sociale due à l’homogénéité des populations et la qualité des produits industriels. Le système universitaire a été détruit par les nouvelles pédagogies aberrantes depuis les années 60 et par ce que Philippe Muray appelait en France l’idéologie « festiviste » ; l’homogénéité des populations est sapée par des politiques migratoires désordonnées et irréfléchies, dont l’afflux massif de ces dernières semaines constitue l’apothéose, une apothéose qui détruira les systèmes sociaux exemplaires de notre Europe, qui seront bientôt incapables de s’auto-financer. Les Européens seront dès lors dans l’impossibilité de consacrer des budgets (d’ailleurs déjà insuffisants ou inexistants) à l’insertion de telles quantités de nouveaux venus. L’Europe s’effondre, perd l’atout de son excellent système social et ne peut plus distraire des fonds pour une défense continentale efficace ou pour la « recherche & développement » en technologies de pointe. Avec le scandale Volkswagen, qui verra le marché américain lui échapper, un coup fatal est porté à l’industrie lourde européenne. La boucle est bouclée.
2. Partout en Europe des mouvements hostiles à l'immigration ont beaucoup de succès. Dans bon nombre de ces cas, cependant, ces partis n'ont pas très clairement compris qu’attaquer l'immigration sans se battre contre la vision du monde libérale et les mécanismes du capitalisme est une bataille qui ne touche pas les racines du Système. Que pensez-vous?
Votre question pointe du doigt le problème le plus grave qui soit : effectivement, les succès récents de partis ou mouvements hostiles à cette nouvelle vague migratoire, considérée comme ingérable, sont dus à un facteur bien évident : les masses devinent inconsciemment que les acquis sociaux des combats socialistes, démocrates-chrétiens, nationalistes, communistes et autres, menés depuis la fin du 19ème siècle, vont être balayés et détruits. Le paradoxe que nous avons sous les yeux est le suivant : depuis 1979 (année de l’accession au pouvoir de Thatcher en Grande-Bretagne), la vogue contestatrice de l’Etat keynésien, jugé trop rigide et mal géré par les socialistes « bonzifiés » (Roberto Michels), a été la vogue néolibérale, mêlant, en un cocktail particulièrement pernicieux, divers linéaments de l’idéologie libérale anti-étatique et anti-politique. Une recomposition mentale erronée s’est opérée : elle a injecté dans toutes les contestations des déviances et errements politiques régimistes une dose de néolibéralisme, dorénavant difficilement éradicable. Quand ces partis et mouvements anti-immigration acquièrent quelque pouvoir, même à des niveaux assez modestes, ils s’empressent de réaliser une partie du vaste programme déconstructiviste des écoles néolibérales, préparant de la sorte l’avènement d’horreurs comme le Traité transatlantique qui effacera toute trace des Etats nationaux et tout résidu d’identité populaire et nationale. On combat l’immigration parce qu’on l’accuse de porter atteinte à l’identité mais on pratique des politiques néolibérales qui vont bientôt tuer définitivement toute forme d’identité. Le combat contre le néolibéralisme et ses effets délétères doit être un combat socialiste et syndicaliste musclé (retour à Sorel et Corridoni), pétri, non plus des idées édulcorées et dévoyées des pseudo-socialistes actuels, mais des théories économiques dites « hétérodoxes », dérivées de Friedrich List, des écoles historiques allemandes et de l’institutionnalisme américain (Thorstein Veblen). Parce que ces écoles hétérodoxes ne sont pas universalistes mais tiennent compte des contextes religieux, nationaux, civilisationnels, culturels, etc. Elles ne théorisent pas un homme, un producteur ou un consommateur abstrait mais un citoyen ancré dans une réalité léguée par l’histoire. Etre en rébellion contre le système, négateur des réalités concrètes, postule d’être un hétérodoxe économique, qui veut les sauver, les réhabiliter, les respecter.
3. Que pensez-vous des positions actuelles, plus ou moins «identitaires» des intellectuels comme Zemmour, Onfray, Houellebecq, Finkielkraut, Debray?
Tous les hommes que vous citez ici sont bien différents les uns des autres : seuls les praticiens sourcilleux de la médiacratie contrôlante et du « politiquement correct » amalgament ces penseurs en une sorte de nouvel « axe du mal » au sein du « paysage intellectuel français » (PIF). Zemmour dresse un bilan intéressant de la déconstruction de la France au cours des quatre dernières décennies, déconstruction qui est un démantèlement progressif de l’Etat gaullien. En ce sens, Zemmour n’est pas un « libéral » mais une sorte de personnaliste gaullien qui estime qu’aucune société ne peut bien fonctionner sans une épine dorsale politique.

Onfray a toujours été pour moi un philosophe plaisant à lire, au ton badin, qui esquissait de manière bien agréable ce qu’était la « raison gourmande », par exemple, et insistait sur l’homme comme être de goût et non pas seulement être pensant à la façon de Descartes. Onfray esquissait une histoire alternative de la philosophie en ressuscitant des filons qu’une pensée française trop rationaliste avait refoulés ou qui ne cadraient plus avec la bien-pensance totalitaire inaugurée par Bernard-Henry Lévy à la fin des années 70, période où émerge le « politiquement correct » à la française. Plus récemment, Onfray a sorti un ouvrage toujours aussi agréable à lire, intitulé « Cosmos », où il apparaît bien pour ce qu’il est, soit un anarchiste cosmique, doublé d’un nietzschéen libertaire, d’un avatar actuel des « Frères du Libre Esprit ». Certaines de ses options le rapprochent des prémisses organicistes, dionysiaques et nietzschéennes de la fameuse « révolution conservatrice » allemande, du moins dans les aspects non soldatiques qu’elle a revêtus avant la catastrophe de 1914. D’où un certain rapprochement avec la nouvelle droite historique, observable depuis quelques jours seulement.

Houellebecq exprime, mieux que personne en Europe occidentale aujourd’hui, l’effondrement moral de nos populations, leur dé-virilisation sous les coups de butoir d’un féminisme exacerbé et délirant, ce qui explique, notamment, le succès retentissant de son ouvrage Soumission aux Etats-Unis. Houellebecq se déclare affecté lui-même par la maladie de la déchéance, qui, qu’on le veuille ou non, fait l’identité européenne actuelle, radical contraire de ce que furent les fulgurances héroïques et constructives de l’Europe d’antan. L’homo europaeus actuel est un effondré moral, une loque infra-humaine qui cherche quelques petits plaisirs furtifs et éphémères pour compenser le vide effroyable qu’est devenue son existence. Pour retrouver une certaine dignité, notamment face à ce féminisme castrateur, cet homo europaeus pourrait, pense Houellebecq, se soumettre à l’islam, le terme « islam » signifiant d’ailleurs soumission à la volonté de Dieu et aux lois de sa création. Ce passage à la « soumission », c’est-à-dire à l’islam, balaierait le féminisme castrateur et redonnerait quelque lustre aux mâles frustrés, où ceux-ci pourraient reprendre du poil de la bête dans une Oumma planétaire, agrandie de l’Europe.
Le parcours de Finkielkraut est plus étonnant, dans la mesure où il a bel et bien fait partie de ces « nouveaux philosophes » de la place de Paris, en lutte contre un totalitarisme qu’ils jugeaient ubiquitaire et dont ils étaient chargé par la « Providence » ou par « Yahvé » (Lévy !) de traquer les moindres manifestations ou les résurgences les plus ténues. Ce totalitarisme se percevait partout, surtout dans les structures de l’Etat gaullien, subtilement assimilé, surtout chez Bernard-Henri Lévy, à des formes françaises d’une sorte de nazisme omniprésent, omni-compénétrant, toujours prêt à resurgir de manière caricaturale. Ces diabolisations faisaient le jeu du néolibéralisme thatchéro-reaganien et datent d’ailleurs de l’avènement de celui-ci sur les scènes politiques britannique et américaine. Finkielkraut a été emblématique de ces démarches, surtout, rappelons-le, lors de la guerre de l’OTAN contre la Serbie. Finkielkraut avait exhumé des penseurs libéraux serbes du 19ème siècle inspirés par le philosophe différentialiste allemand Herder, pour démontrer de manière boiteuse, en sollicitant les faits de manière pernicieuse et malhonnête, que deux de ces braves philologues serbes, espérant se débarrasser du joug ottoman, étaient en réalité des précurseurs du nazisme (encore !). Ce travail de Finkielkraut était d’autant plus ridicule qu’au même moment, à Vienne, un journaliste très connu, Wolfgang Libal, également israélite mais, lui, spécialiste insigne du « Sud-Est européen », écrivait un ouvrage à grand tirage pour démontrer le caractère éminemment démocratique (national-libéral) des deux philologues, posés comme pionniers de la modernité dans les Balkans !!
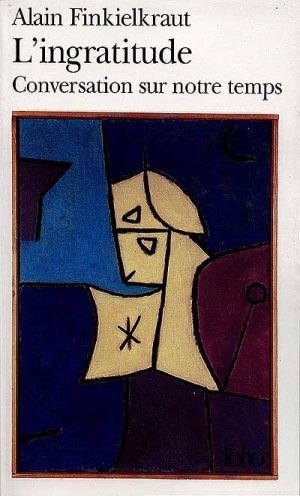 Après son hystérie anti-serbe, Finkielkraut, sans doute parce qu’il prend de l’âge, s’est « bonifié » comme disent les œnologues. Son ouvrage sur la notion d’ingratitude, qui est constitué des réponses à un très long entretien accordé au journal québécois Le Devoir, est intéressant car il y explique que les malheurs de notre époque viennent du fait que l’homme actuel se montre « ingrat » par rapport aux legs du passé. J’ai lu cet entretien avec grand intérêt et beaucoup de plaisir, y retrouvant d’ailleurs une facette de l’antique querelle des anciens et des modernes. Je dois l’avouer même si le Finkielkraut serbophobe m’avait particulièrement horripilé. A partir de cette réflexion sur l’ingratitude, Finkielkraut va, peut-être inconsciemment, sans doute à son corps défendant, adopter les réflexes intellectuels des deux Serbes herdériens qu’il fustigeait avec tant de fureur dans les années 90. Il va découvrir l’« identité » et, par une sorte de tour de passe-passe qui me laisse toujours pantois, défendre une identité française que Lévy avait posée comme une matrice particulièrement répugnante du nazisme !
Après son hystérie anti-serbe, Finkielkraut, sans doute parce qu’il prend de l’âge, s’est « bonifié » comme disent les œnologues. Son ouvrage sur la notion d’ingratitude, qui est constitué des réponses à un très long entretien accordé au journal québécois Le Devoir, est intéressant car il y explique que les malheurs de notre époque viennent du fait que l’homme actuel se montre « ingrat » par rapport aux legs du passé. J’ai lu cet entretien avec grand intérêt et beaucoup de plaisir, y retrouvant d’ailleurs une facette de l’antique querelle des anciens et des modernes. Je dois l’avouer même si le Finkielkraut serbophobe m’avait particulièrement horripilé. A partir de cette réflexion sur l’ingratitude, Finkielkraut va, peut-être inconsciemment, sans doute à son corps défendant, adopter les réflexes intellectuels des deux Serbes herdériens qu’il fustigeait avec tant de fureur dans les années 90. Il va découvrir l’« identité » et, par une sorte de tour de passe-passe qui me laisse toujours pantois, défendre une identité française que Lévy avait posée comme une matrice particulièrement répugnante du nazisme !
Debray est un penseur plus profond à mes yeux. Le début de sa carrière dans le paysage intellectuel français date des années 60, où il avait rencontré et accompagné Che Guevara en Bolivie. Cet aspect suscite toutes les nostalgies d’une époque où l’aventure était encore possible. Jean Cau, ancien secrétaire de Sartre (entre 1947 et 1956) qui, ultérieurement, ne ménagera pas ses sarcasmes à l’encontre des gauches parisiennes, consacrera en 1979 un ouvrage au Che, intitulé Une passion pour Che Guevara ; en résumé, nous avons là l’hommage d’un ancien militant de gauche, passé à « droite » (pour autant que cela veuille dire quelque chose…), qui ne renie pas la dimension véritablement existentielle de l’aventure et de l’engagement pour ses idées, fussent-elles celles qu’il vient explicitement de rejeter. Debray a donc mis, dans une première phase de sa carrière, sa peau au bout de ces idées. Peu ont eu ce courage même si d’aucuns ont cherché plus tard à minimiser son rôle en Bolivie.
 Dans les années 80, Debray, devenu, plutôt à son corps défendant, faire-valoir du mitterrandisme ascendant, participera à toutes les mascarades de la gauche officielle, en voie de « festivisation » et d’embourgeoisement, où les cocottes et les bobos se piquent d’eudémonisme et se posent en « belles âmes » (on sait ce que Hegel en pensait…). Les actions qu’il mène, je préfère les oublier aujourd’hui, tant elles ont participé des bouffonneries pariso-parisiennes. Mais entre l’épisode du militant guevariste et celle du néo-national-gaulliste d’aujourd’hui, il n’y a pas eu que cette participation à la lèpre républicano-mitterrandiste, il y a eu le passage du Debray militant et idéologue au Debray philosophe et « médiologue » (une science visant à cerner l’impact des « médiations », des images, dont éventuellement celles des médias, sur la formation ou la transformation des mentalités et des aspirations politiques). C’est dans le cadre de ce statut de « médiologue », qui commence en 1993, que Debray va glisser progressivement vers des positions différentes de celles imposées par le ronron médiatique ou le « politiquement correct » des « nouveaux philosophes » (Lévy, etc.) « qui », dit-il, « produisent de l’indignation au rythme de l’actualité ». Debray, comme l’indique alors le titre d’un de ses ouvrages récents, Dégagements, se « dégage » de ses engagements antérieurs, l’espace de la gauche, de sa gauche, ayant été phagocyté par de nouveaux venus qui se disent « occidentaux » et participent à la pratique perverse de la table rase, notamment en Amérique latine : leur travail de sape serait entièrement parachevé si des hommes comme Evo Morales, qu’il qualifie positivement d’« indigéniste », ne s’étaient pas dressés contre son vieil ennemi l’impérialisme américain, appuyé par les bourgeoisies compradores.
Dans les années 80, Debray, devenu, plutôt à son corps défendant, faire-valoir du mitterrandisme ascendant, participera à toutes les mascarades de la gauche officielle, en voie de « festivisation » et d’embourgeoisement, où les cocottes et les bobos se piquent d’eudémonisme et se posent en « belles âmes » (on sait ce que Hegel en pensait…). Les actions qu’il mène, je préfère les oublier aujourd’hui, tant elles ont participé des bouffonneries pariso-parisiennes. Mais entre l’épisode du militant guevariste et celle du néo-national-gaulliste d’aujourd’hui, il n’y a pas eu que cette participation à la lèpre républicano-mitterrandiste, il y a eu le passage du Debray militant et idéologue au Debray philosophe et « médiologue » (une science visant à cerner l’impact des « médiations », des images, dont éventuellement celles des médias, sur la formation ou la transformation des mentalités et des aspirations politiques). C’est dans le cadre de ce statut de « médiologue », qui commence en 1993, que Debray va glisser progressivement vers des positions différentes de celles imposées par le ronron médiatique ou le « politiquement correct » des « nouveaux philosophes » (Lévy, etc.) « qui », dit-il, « produisent de l’indignation au rythme de l’actualité ». Debray, comme l’indique alors le titre d’un de ses ouvrages récents, Dégagements, se « dégage » de ses engagements antérieurs, l’espace de la gauche, de sa gauche, ayant été phagocyté par de nouveaux venus qui se disent « occidentaux » et participent à la pratique perverse de la table rase, notamment en Amérique latine : leur travail de sape serait entièrement parachevé si des hommes comme Evo Morales, qu’il qualifie positivement d’« indigéniste », ne s’étaient pas dressés contre son vieil ennemi l’impérialisme américain, appuyé par les bourgeoisies compradores.
Enfin, les révolutions socialistes (et communistes) sont d’abord des nationalismes, écrit-il en 2010 : en dépit de l’omniprésence du Front National dans la vie politique de l’Hexagone, Debray ne craint plus le mot, à l’heure où les nouvelles gauches « néo-philosophiques » perdent et ruinent tout sens historique et basculent dans la moraline répétitive et incantatoire, dans le compassionnel et l’indignation programmée. Debray se déclare aussi « vieux jeu » : ce n’est pas le reproche que je lui ferai ; cependant, l’abus, dans ses œuvres polémiques récentes, est d’utiliser trop abondamment le vocable (également incantatoire) de « République » qui, pour tout observateur non parisien, est un véhicule d’éléments délétères de modernité donc d’ignorance du véritable tissu historique et populaire. De même, sa vision de l’« Etat » est trop marquée par l’idéologie jacobine, figée au fil des décennies depuis le début du 19ème siècle. Ceci dit, ses remarques et ses critiques (à l’adresse de son ancien camp) permettent de réamorcer un combat, non pas pour rétablir la « République » à la française avec son cortège de figements et d’archaïsmes ou un Etat trop rigide, mais pour restaurer ce que Julien Freund, à la suite de Carl Schmitt, nommait « le politique ». Combat qui pourrait d’ailleurs partir des remarques excellentes de Debray sur la « représentation », sur le « decorum », nécessaire à toute machine politique qui se respecte et force le respect : Carl Schmitt insistait, lui aussi, sur les splendeurs et les fastes du catholicisme, à reproduire dans tout Etat, sur la visibilité du pouvoir, antidote aux « potestates indirectae », aux pouvoirs occultes qui produisent les oligarchies dénoncées par Roberto Michels, celles qui se mettent sciemment en marge, se dérobent en des coulisses cachées, pour se soustraire au regard du peuple ou même de leurs propres militants. Schmitt hier, Debray aujourd’hui, veulent restaurer la parfaite visibilité du pouvoir : nous trouvons là une thématique métapolitique offensive qu’il serait bon, pour tous, d’articuler en nouveaux instruments de combat. Debray est sans nul doute une sorte d’enfant prodigue, qui a erré en des lieux de perdition pour revenir dans un espace à l’air rare et vif. L’histoire des idées se souviendra de son itinéraire : nous jetterons dès lors un œil narquois sur les agitations qu’il a commises dans les années 80 dans les allées du pouvoir mitterrandien et vouerons une admiration pour l’itinéraire du « médiologue » qui nous aura fourni des arguments pour opérer une critique de la dictature médiatique et pour rendre au pouvoir sa visibilité, partageable entre tous les citoyens et donc véritablement « démocratique » ou plutôt réellement populiste. Derrière cela, les quelques « franzouseries » statolâtriques et « républicagnanates », qu’il traine encore à ses basques, seront à mettre au rayon du folklore, là où il rangeait lui-même le vieux et caduc « clivage gauche/droite », dans quelques phrases bien ciselées de Dégagements.
4. Êtes-vous d'accord avec la thèse du Grand Remplacement?
 Je ne considère pas la notion de « Grand Remplacement » comme une thèse mais comme un terme-choc impulsant une réflexion antagoniste par rapport au fatras dominant, comme une figure de rhétorique, destinée à dénoncer la situation actuelle où le compassionnel, introduit dans les pratiques politiques par les nouveaux philosophes, évacue toute éthique de la responsabilité. Vous avez vous-même, en langue italienne, défini et explicité la notion de « Grand Remplacement » (http://www.ilprimatonazionale.it/cultura/grande-sostituzione-32682/ ). Vous l’avez fait avec brio. Et démontré que Marine Le Pen comme Matteo Salvini l’avaient incluse dans le langage politico-polémique qui anime les marges dites « droitières » ou « populistes » des spectres politiques européens d’aujourd’hui. Renaud Camus, père du concept, a le sens des formules, du discours (selon une bonne tradition française remontant au moins à Bossuet). Il est aussi le créateur de deux autres notions qui mériteraient de connaître la même bonne fortune : la notion de « nocence », contraire de l’« in-nocence », puis la notion de « dé-civilisation ». Renaud Camus se pose comme « in-nocent », comme un être qui ne cherche pas à nuire (« nocere » en latin). Les régimes politiques en place, eux, cherchent toujours à nuire à leurs citoyens ou sujets, qu’il haïssent au point de vouloir justement les remplacer par des êtres humains perdus, venus de partout et de nulle part, attirés par les promesses fallacieuses d’un paradis économique, où l’on touche des subsides sans avoir à fournir des efforts ni à respecter des devoirs sociaux ou citoyens. Les établis forment donc le parti de la « nocence », de la nuisance, auquel il faut opposer l’idéal, peut-être un peu irénique, de l’« in-nocence », sorte d’ascèse qui me rappelle tout à la fois le bouddhisme de Schopenhauer, le quiétisme de Gustav Landauer, but de son idéal révolutionnaire à Munich en 1919, et l’économie empathique de Serge-Christophe Kolm, inspiré par les pratiques bouddhistes (efficaces) qu’il a observées en Asie du Sud-est (cf. notre dossier : http://www.archiveseroe.eu/kolm-a118861530 ). Si la « nocence » triomphe et s’établit sur la longue durée, la civilisation, après la culture et l’éducation, s’effiloche, se détricote et disparait. C’est l’ère de la « dé-civilisation », du « refus névrotique de l’héritage ancestral », commente l’écrivain belge Christopher Gérard. Ce pessimisme n’est pas une idée neuve mais, à notre époque, elle constitue un retour du réalisme, après une parenthèse trop longue de rejet systématique et pathologique de nos héritages.
Je ne considère pas la notion de « Grand Remplacement » comme une thèse mais comme un terme-choc impulsant une réflexion antagoniste par rapport au fatras dominant, comme une figure de rhétorique, destinée à dénoncer la situation actuelle où le compassionnel, introduit dans les pratiques politiques par les nouveaux philosophes, évacue toute éthique de la responsabilité. Vous avez vous-même, en langue italienne, défini et explicité la notion de « Grand Remplacement » (http://www.ilprimatonazionale.it/cultura/grande-sostituzione-32682/ ). Vous l’avez fait avec brio. Et démontré que Marine Le Pen comme Matteo Salvini l’avaient incluse dans le langage politico-polémique qui anime les marges dites « droitières » ou « populistes » des spectres politiques européens d’aujourd’hui. Renaud Camus, père du concept, a le sens des formules, du discours (selon une bonne tradition française remontant au moins à Bossuet). Il est aussi le créateur de deux autres notions qui mériteraient de connaître la même bonne fortune : la notion de « nocence », contraire de l’« in-nocence », puis la notion de « dé-civilisation ». Renaud Camus se pose comme « in-nocent », comme un être qui ne cherche pas à nuire (« nocere » en latin). Les régimes politiques en place, eux, cherchent toujours à nuire à leurs citoyens ou sujets, qu’il haïssent au point de vouloir justement les remplacer par des êtres humains perdus, venus de partout et de nulle part, attirés par les promesses fallacieuses d’un paradis économique, où l’on touche des subsides sans avoir à fournir des efforts ni à respecter des devoirs sociaux ou citoyens. Les établis forment donc le parti de la « nocence », de la nuisance, auquel il faut opposer l’idéal, peut-être un peu irénique, de l’« in-nocence », sorte d’ascèse qui me rappelle tout à la fois le bouddhisme de Schopenhauer, le quiétisme de Gustav Landauer, but de son idéal révolutionnaire à Munich en 1919, et l’économie empathique de Serge-Christophe Kolm, inspiré par les pratiques bouddhistes (efficaces) qu’il a observées en Asie du Sud-est (cf. notre dossier : http://www.archiveseroe.eu/kolm-a118861530 ). Si la « nocence » triomphe et s’établit sur la longue durée, la civilisation, après la culture et l’éducation, s’effiloche, se détricote et disparait. C’est l’ère de la « dé-civilisation », du « refus névrotique de l’héritage ancestral », commente l’écrivain belge Christopher Gérard. Ce pessimisme n’est pas une idée neuve mais, à notre époque, elle constitue un retour du réalisme, après une parenthèse trop longue de rejet systématique et pathologique de nos héritages.
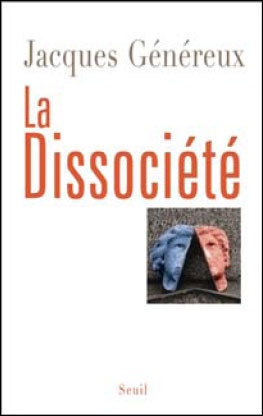 Je mettrais en parallèle la double idée de Renaud Camus d’une « dé-culturation » et d’une « dé-civilisation » avec l’idée de « dissociété », forgée par le philosophe Marcel De Corte au début des années 50. Pour De Corte, monarchiste belge et catholique thomiste, l’imposition des élucubrations libérales de la révolution française aux peuples d’Europe a conduit à la dislocation du tissu social, si bien que nous n’avons plus affaire à une « société » harmonieuse, au sens traditionnel du terme comme l’entendait Louis de Bonald, mais à une « dissociété ». L’idée, en dépit de son origine très conservatrice, est reprise aujourd’hui par quelques théoriciens d’une gauche non-conformiste, dont le Prof. Jacques Généreux qui constate amèrement que les pathologies de la dissociété moderne sont une « maladie sociale dégénérative qui altère les consciences en leur inculquant une culture fausse ». Généreux, socialiste au départ et rêvant à l’avènement d’un nouveau socialisme capable de gommer définitivement les affres de la « dissociété », quitte, déçu, le PS français en 2008 pour aller militer au « Parti de Gauche » et pour figurer sur la liste « Front de Gauche pour changer l’Europe », candidate aux élections européennes de 2009. En mars 2013, les idées, pourtant pertinentes, de Généreux ne séduisent plus ses compagnons de route et ses co-listiers : il n’est pas réélu au Bureau politique ! Preuve que la pertinence ne peut aller se nicher et prospérer au sein des gauches françaises non socialistes, bornées dans leurs analyses, sclérosées dans des marottes jacobines et résistancialistes qui ne sont qu’anachronismes ou tourneboulées par les délires immigrationnistes dont l’irréalisme foncier est plus virulent et plus maladivement agressif en France qu’ailleurs en Europe.
Je mettrais en parallèle la double idée de Renaud Camus d’une « dé-culturation » et d’une « dé-civilisation » avec l’idée de « dissociété », forgée par le philosophe Marcel De Corte au début des années 50. Pour De Corte, monarchiste belge et catholique thomiste, l’imposition des élucubrations libérales de la révolution française aux peuples d’Europe a conduit à la dislocation du tissu social, si bien que nous n’avons plus affaire à une « société » harmonieuse, au sens traditionnel du terme comme l’entendait Louis de Bonald, mais à une « dissociété ». L’idée, en dépit de son origine très conservatrice, est reprise aujourd’hui par quelques théoriciens d’une gauche non-conformiste, dont le Prof. Jacques Généreux qui constate amèrement que les pathologies de la dissociété moderne sont une « maladie sociale dégénérative qui altère les consciences en leur inculquant une culture fausse ». Généreux, socialiste au départ et rêvant à l’avènement d’un nouveau socialisme capable de gommer définitivement les affres de la « dissociété », quitte, déçu, le PS français en 2008 pour aller militer au « Parti de Gauche » et pour figurer sur la liste « Front de Gauche pour changer l’Europe », candidate aux élections européennes de 2009. En mars 2013, les idées, pourtant pertinentes, de Généreux ne séduisent plus ses compagnons de route et ses co-listiers : il n’est pas réélu au Bureau politique ! Preuve que la pertinence ne peut aller se nicher et prospérer au sein des gauches françaises non socialistes, bornées dans leurs analyses, sclérosées dans des marottes jacobines et résistancialistes qui ne sont qu’anachronismes ou tourneboulées par les délires immigrationnistes dont l’irréalisme foncier est plus virulent et plus maladivement agressif en France qu’ailleurs en Europe.
Ceci dit, l’idée de « Grand Remplacement » est à mes yeux un des avatars actuels d’un ouvrage écrit en 1973, le fameux récit Le Camp des Saints de Jean Raspail, où l’Europe est envahie par des millions d’hères faméliques cherchant à s’y installer. Les grandes banlieues des principales villes de France étaient déjà occupées par d’autres populations, complètement coupées des Français de souche. Dorénavant on voit la bigarrure ethnique émerger, à forte ou à moyenne dose, dans de petites villes comme Etampes, Vierzon ou Orléans, où elle semble effectivement « remplacer » les départs antérieurs, ceux de l’exode rural, ceux du départ vers les grandes mégapoles où dominent les emplois du secteur tertiaire. La France donne l’impression de juxtaposer sur son territoire deux ou plusieurs sociétés (ou dissociétés) parallèles, étanches les unes par rapport aux autres. Personne n’est satisfait ; d’abord les « remplacés », bien évidemment, dont les modes de vie et surtout les habitudes alimentaires sont dénigrées et jugées « impures » (ce qui fâche tout particulièrement les Français, très fiers de leurs traditions gastronomiques) mais aussi les « remplaçants » qui ne peuvent pas reproduire leur mode de vie et manifestent dès lors un mal de vivre destructeur. Le plan satanique du libéralisme se réalise dans cette bigarrure : la société est disloquée, livrée à la « cash flow mentality », déjà décriée par Thomas Carlyle au début du 19ème siècle. Le néolibéralisme, amplification monstrueuse de cette « mentality », étendue à la planète entière, ne peut survivre que dans des sociétés brisées, de même que les « économies diasporiques » ou les réseaux mafieux, pourfendus par les gauches intellectuelles non conformistes mais non combattus sur le terrain, dans le concret de la dissociété réellement existante.
5. Dans le parlement italien, on est en train de changer les lois sur la citoyenneté, en introduisant le principe de la citoyenneté par le lieu de naissance (jus soli) à la place de celui fondé sur la nationalité des parents (jus sanguinis). Selon vous quelles conséquences cela aura sur le tissu social de notre pays?
Le débat opposant le jus sanguinis au jus soli est ancien. Il remonte à l’époque napoléonienne. Napoléon voulait accorder automatiquement la nationalité française à toute personne vivant en France et ayant bénéficié d’une éducation (scolaire) française. Le but était aussi de recruter des soldats pour les campagnes militaires qu’il menait partout en Europe. Les rédacteurs du Code civil optent toutefois pour le jus sanguinis. Ces dispositions seront modifiées en 1889, vu l’afflux massif d’immigrés dans la France du 19ème siècle, essentiellement belges et italiens, dans une moindre mesure allemands et espagnols. Même visée que celle de Napoléon : la France de souche connait un ressac démographique, encore léger toutefois, face à une Allemagne qui, elle, connaît un véritablement boom démographique, en dépit des émigrations massives vers les Etats-Unis (plus de 50 millions de citoyens américains sont aujourd’hui d’origine allemande). Il faut à cette France angoissée devant son voisin de l’Est une masse impressionnante de soldats. De même, il faut envoyer des troupes dans un Outre-Mer souvent en révolte où les effectifs de la « Légion étrangère » ne suffisent pas. Dans Paris, sur les monuments aux morts de la première guerre mondiale, on lit plus de 10% de noms germaniques, allemands, suisses ou flamands, quelques noms italiens (ou corses ?), ce qui ne mentionne rien sur les immigrés romans de Suisse ou de Wallonie, parfois de Catalogne, dont les patronymes sont gallo-romans, comme ceux des Français de souche. La France s’est voulue multiethnique dès la fin du 19ème siècle, forçant parfois les immigrés européens, notamment en Afrique du Nord, à acquérir la nationalité française. Tant que cet apport volontaire ou forcé était le fait de peuples immédiatement périphériques, l’intégration et la fusion s’opéraient aisément. Après l’horrible saignée de 1914-18, quand les villages de la France profonde sont exsangues, une immigration plus exotique prend le relais de celle des peuples voisins. La départementalisation de l’Algérie et l’entrée, d’abord timide, de travailleurs algériens, puis subsahariens, colore la nouvelle immigration. Rien à signaler dans un premier temps. Ou rien que des broutilles. A partir du moment où certaines banlieues deviennent à 90% exotiques, le projet d’intégration et d’assimilation cafouille : pourquoi s’intégrer puisque l’environnement de l’immigré n’est en rien « Français de souche » ? Il lui est désormais possible de vivre en complète autarcie par rapport à la population d’origine. La société devient « composite » comme le déplorent les théoriciens indiens du RSS et du BJP qui estiment aussi que de telles sociétés n’ont pas d’avenir constructif, sont condamnées au chaos et à l’implosion. Pour les sociétés européennes, l’avenir nous dira si ces prophéties des théoriciens indiens s’avèreront exactes ou fausses. En attendant, l’introduction du jus soli, au détriment de tout jus sanguinis, en Italie comme ailleurs en Europe, est le signe d’un abandon volontaire de toute idée de continuité, d’héritage. Avec les théories du genre (le « gendérisme ») et les pratiques du néolibéralisme -dont la délocalisation et la titrisation soit l’abandon de toute économie patrimoniale et industrielle au profit d’une économie de la spéculation boursière- ce glissement annonce l’éclosion d’une société nouvelle, éclatée, amnésique, jetant aux orties l’éthique wébérienne de la responsabilité, pour la remplacer par des monstrations indécentes de toutes sortes d’éthiques de la conviction, prononcée sur le mode de l’hystérie « politiquement correcte » et travestie d’oripeaux festivistes et compassionnels. Bref, un Halloween planétaire et permanent.
Forest-Flotzenberg, octobre 2015.
00:10 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Entretiens, Synergies européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : robert steuckers, entretien, synergies européennes, crise syrienne, syrie, géopolitique, politique internationale, france, paysage intellectuel français, eric zemmour, michel onfray, régis debray, renaud camus, michel houellbecq, philosophie, jus soli, jus sanguinis, italie, adriano scianca |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Ex: http://cerclearistote.com
Alain Finkielkraut, La Seule Exactitude, Stock, 2015
 Ce livre s’inscrit dans la lignée des grands livres d’Alain Finkielkraut, La Défaite de la pensée, le Mécontemporain, Nous autres Modernes, Un Cœur intelligent, L’Identité malheureuse, L’Imparfait du présent, et comme ces livres, il se lit d’un trait. Alain Finkielkraut a été et reste un brillant élève qui maîtrise à merveille l’art de la dissertation, tel qu’il était enseigné naguère (jadis ?) dans les lycées : clarté, sûreté du jugement, équilibre, précision des références, fermeté de l’expression, élégance. Il est, comme Chateaubriand, un enchanteur. Ce qu’il déploie, ce ne sont pas seulement les artifices rhétoriques du « bien dire », c’est surtout la pensée, l’intelligence, la haute culture. L’atteste l’usage qu’il fait des citations, non pas pour éblouir les pharisiens, mais pour dialoguer avec les morts, avec les grands ancêtres, avec ceux qui ont pensé avant soi ou qui ont pensé eux aussi la question que l’on traite.
Ce livre s’inscrit dans la lignée des grands livres d’Alain Finkielkraut, La Défaite de la pensée, le Mécontemporain, Nous autres Modernes, Un Cœur intelligent, L’Identité malheureuse, L’Imparfait du présent, et comme ces livres, il se lit d’un trait. Alain Finkielkraut a été et reste un brillant élève qui maîtrise à merveille l’art de la dissertation, tel qu’il était enseigné naguère (jadis ?) dans les lycées : clarté, sûreté du jugement, équilibre, précision des références, fermeté de l’expression, élégance. Il est, comme Chateaubriand, un enchanteur. Ce qu’il déploie, ce ne sont pas seulement les artifices rhétoriques du « bien dire », c’est surtout la pensée, l’intelligence, la haute culture. L’atteste l’usage qu’il fait des citations, non pas pour éblouir les pharisiens, mais pour dialoguer avec les morts, avec les grands ancêtres, avec ceux qui ont pensé avant soi ou qui ont pensé eux aussi la question que l’on traite.
La thèse d’Alain Finkielkraut peut se résumer ainsi : la gauche n’est plus la (ou à) gauche. En un mot, il ne reconnaît pas sa gauche dans les positions que prennent les hommes dits « de gauche » sur des sujets importants (école, culture, morale, France, société, histoire, connaissance, état du monde, institutions publiques, conflits). Elles n’ont plus rien en commun avec les grands principes qui ont – ou auraient – été établis par la gauche. Le présent n’est pas saisi, analysé, pensé pour ce qu’il est ; il n’est qu’un passé qui se répète, les années trente et les heures sombres de « notre » histoire. Oubliés les 40 heures et les congés payés, qui sont les conquêtes sociales des années trente ; vouées aux gémonies la France Libre et la résistance qui sont la lumière des heures « sombres ». Pour les hommes de « gauche », l’amélioration de la condition ouvrière, le respect des travailleurs, la dignité des gens de peu n’ont plus de sens et le peuple français s’est massivement prosterné devant l’occupant. Si les choses sont ce qu’ils en disent, on ne comprend pas pourquoi ils adulent des « penseurs » qui n’ont jamais éclairé les « heures sombres », Sartre, Beauvoir, Blanchot, Grass, etc., pourquoi ils ont porté au pouvoir un pilier de Vichy qui a été un ardent partisan des guerres coloniales et approuvé un ancien du PPF, pourquoi ils ont soutenu par le vote des fils et filles de collabos, Jospin, Tasca, Védrine, Rebsamen, Royal, Hollande, etc. Cette histoire qu’ils prétendent être « nôtre » est leur. La haine de leur propre passé alimente la croyance en un progrès illimité vers plus d’égalité, plus de fraternité, plus d’indifférenciation (qu’elle soit sexuelle, culturelle, religieuse, etc.), plus de métissage, plus de culturel (inter ou multi). En un mot, la gauche réelle fait « table rase » du passé pour faire advenir « les lendemains qui chantent ». Ce programme se nourrit de la détestation de tout ce qui n’est pas soi, c’est-à-dire de tout ce qui n’est ni bobo, ni multi, ni homo, ni islamique, et de l’assurance que le monde sera meilleur, si celui-ci est façonné suivant leurs plans. De ce point de vue, le « retournement » qu’Alain Finkielkraut vit dans sa propre pensée n’est pas fondamentalement différent de celui qu’ont connu avant lui Péguy, Vargas Llosa, Jean Cau, Aron, Souvarine, Soustelle, Flaubert, Soljenitsyne, Malraux, Jacques Rossi, Leroy-Ladurie, Gallo, et des millions d’autres, dont Onfray et Brighelli…
Le problème, car il y en a un, est que la gauche idéale, au nom de laquelle Alain Finkielkraut se détourne de la gauche réelle, n’a jamais existé. Il n’y a que la gauche réelle, comme les seuls communisme et socialisme sont le communisme et le socialisme réels, et non le communisme démocratique et le socialisme à visage humain, ou inversement, dont se sont gargarisés pendant un siècle les hommes de gauche, bien que ces oxymores n’aient de réalité que dans le verbiage… La gauche réelle avance masquée. Elle s’approprie tout et surtout ce qu’elle n’a pas créé : les droits de l’homme déclarés universels en août 1789, l’abolition des privilèges, la fin des trois ordres, la sécurité sociale, l’Etat-providence, le progrès social, le progrès économique, la fin des colonies, la résistance… En revanche, elle occulte soigneusement les horreurs qu’elle a commises ou incité à commettre : les massacres de septembre 1792, le populicide de l’Ouest de la France, la guerre contre tous les peuples d’Europe, puis du monde, la République impériale, les manifestations réprimées à la baïonnette et au canon (1795, 1848, 1871, Algérie de 1956 à 1958) ou par la « troupe » (Fourmies, 6 février 1934, Isly), les conquêtes coloniales, la ruée à Vichy, les guerres dans les colonies, etc. Alain Finkielkraut forge une gauche idéale à son image. Il est persuadé qu’elle est, comme lui, attachée aux humanités, à la littérature, aux grands textes, à la pensée. Rien n’est plus faux. Déjà au début du siècle dernier, les hommes de la gauche réelle, soucieux de développement industriel, ont voulu renforcer l’enseignement technique et les écoles formant ingénieurs, ouvriers qualifiés et techniciens. Pourquoi pas ? Mais ils n’ont envisagé cela qu’en remplacement des humanités, le latin étant tenu pour la langue des curés honnis et la littérature pour un divertissement de mondaines oisives. La laïcité, à laquelle Alain Finkielkraut est attaché, est, elle aussi, morte et enterrée.
 Alain Finkielkraut consacre une courte réflexion à la disparition possible de la gauche, ce qu’a prédit Manuel Valls. Non, la gauche n’est pas mortelle, elle est éternelle, comme le sont les mensonges, les falsifications, les déformations, les censures, les doubles ou triples discours, les promesses, la démagogie, le cynisme, la soif de pouvoir. En décembre 1965, Mitterrand accorde un long entretien à deux journalistes du Nouvel Observateur et pas des moindres, Daniel et Galard. Il se présente comme un résistant. Vingt ans après la fin de la guerre, il ne lui est posé aucune question sur ses engagements avant 1939 et en 1942-44 à Vichy. Il se présente comme le défenseur du tiers-monde, parce qu’il critique les généraux brésiliens qui ont pris un pouvoir que des civils élus n’ont pas voulu exercer. Il ne lui est pas rappelé ses engagements contre les tiers-mondistes d’Algérie à partir du 1er novembre 1954 ; le soutien qu’il a apporté à l’intervention militaire en Egypte, pays du tiers-monde, en 1956 ; les pleins pouvoirs que le gouvernement auquel il participait a donnés à l’armée pour rétablir par la torture et les exécutions sommaires l’ordre « républicain » à Alger. Il ne lui a même pas été objecté les 61 condamnés à mort exécutés pendant 15 mois, le garde des sceaux qu’il était alors ayant refusé que soient transmises au président Coty, pour signature, des demandes de grâce. La gauche a réécrit l’histoire pour fabriquer un politicien. Les communistes ont procédé de la même manière quand ils ont falsifié la « biographie » de Marchais, leur Premier secrétaire. Que M. Valls ne s’inquiète pas sur le sort de la gauche : dans dix ou vingt ans, un nouveau leader apparaîtra qui pourra redonner le pouvoir à la gauche. Et la machine à mensonges fabriquera les mêmes fables.
Alain Finkielkraut consacre une courte réflexion à la disparition possible de la gauche, ce qu’a prédit Manuel Valls. Non, la gauche n’est pas mortelle, elle est éternelle, comme le sont les mensonges, les falsifications, les déformations, les censures, les doubles ou triples discours, les promesses, la démagogie, le cynisme, la soif de pouvoir. En décembre 1965, Mitterrand accorde un long entretien à deux journalistes du Nouvel Observateur et pas des moindres, Daniel et Galard. Il se présente comme un résistant. Vingt ans après la fin de la guerre, il ne lui est posé aucune question sur ses engagements avant 1939 et en 1942-44 à Vichy. Il se présente comme le défenseur du tiers-monde, parce qu’il critique les généraux brésiliens qui ont pris un pouvoir que des civils élus n’ont pas voulu exercer. Il ne lui est pas rappelé ses engagements contre les tiers-mondistes d’Algérie à partir du 1er novembre 1954 ; le soutien qu’il a apporté à l’intervention militaire en Egypte, pays du tiers-monde, en 1956 ; les pleins pouvoirs que le gouvernement auquel il participait a donnés à l’armée pour rétablir par la torture et les exécutions sommaires l’ordre « républicain » à Alger. Il ne lui a même pas été objecté les 61 condamnés à mort exécutés pendant 15 mois, le garde des sceaux qu’il était alors ayant refusé que soient transmises au président Coty, pour signature, des demandes de grâce. La gauche a réécrit l’histoire pour fabriquer un politicien. Les communistes ont procédé de la même manière quand ils ont falsifié la « biographie » de Marchais, leur Premier secrétaire. Que M. Valls ne s’inquiète pas sur le sort de la gauche : dans dix ou vingt ans, un nouveau leader apparaîtra qui pourra redonner le pouvoir à la gauche. Et la machine à mensonges fabriquera les mêmes fables.
Contrairement à ce que pense Alain Finkielkraut, ce n’est pas l’idéologie, de gauche ou non, qui importe. L’idéologie est plastique, malléable, fluctuante ; elle se retourne aussi facilement qu’un gant ; elle peut dire blanc à midi et noir à minuit ; oui à 12 h 47 et non dans la minute qui suit. Ce qui importe, c’est le lieu d’où « ça parle » ou le statut de la voix qui discourt. Ces lieux sont les palais du pouvoir et les forteresses de l’autorité, des privilèges et des avantages acquis. La gauche exerce le pouvoir, que ce soit celui de la politique, des idées, de l’université ou du savoir, des médias et de la communication, de Canal + ou du Monde. La gauche n’aspire qu’à étendre et accroître son emprise sur la culture, sur les idées, sur l’art et sur tout ce qui est : pensées individuelles, expression publique, émotion, langages. Ils sont les dominants, fussent-ils sociologues. Nous sommes leurs dominés. Ce qui fait l’essence de la gauche – sa « nature » en quelque sorte -, c’est la cupidité, la soif de pouvoir, les bas instincts, tout cela étant masqué par les beaux discours. Les adversaires d’Alain Finkielkraut sont fonctionnaires ou assimilés ou, s’ils ne le sont pas, ils vivent – et fort bien – de prébendes. Comme tous les fonctionnaires, ils ne rêvent que promotions, gratifications, crédits, avancements, subventions. Ils défendent donc bec et ongles les positions dont ils jouissent dans les médias, l’édition, la politique, le showbiz. L’enjeu, ce sont des milliards d’euros d’argent public. Les lieux d’où parle la gauche cachent des coffres-forts. Gomez Davila disait : « L’intelligence n’aspire pas à se libérer, mais à se soumettre ». En réalité, elle n’aspire qu’à soumettre les autres à son ordre.
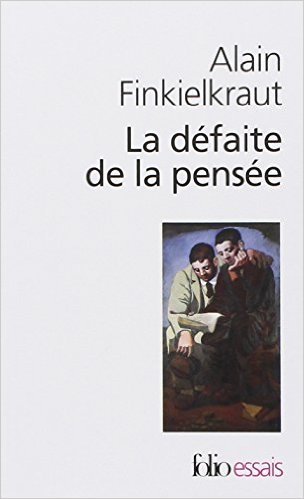 Sur quelques points, Alain Finkielkraut reste « de gauche », comme en témoigne la critique qu’il fait du Suicide français. A Zemmour, il prête des simulacres de thèses, le transformant sinon un négationniste, du moins un complice des négationnistes. L’antienne est banale. Zemmour étudie 40 années, de 1970 à 2010, qui ont défait la France. En 1981, l’historien américain Paxton accuse Vichy d’avoir participé à l’extermination des Juifs. Cette thèse rend caduque celle de l’historien français Aron, qui tenait Vichy pour un « bouclier », certes peu protecteur, des juifs français. C’est ce fait-là, à savoir le basculement de l’historiographie, que Zemmour analyse, le livre de Paxton mettant fin aussi à la thèse gaulliste sur les années 1940. Pour les Français libres, la France était à Londres. Paxton a replacé la France à Vichy et il l’a rendue responsable des crimes commis sur son territoire. Autre exemple : Alain Finkielkraut a été enthousiasmé par le 11 janvier. Ce jour-là, le chef de l’Etat a organisé une manifestation monstre avec tous les moyens dont dispose l’Etat et le soutien de tous les médias, qu’ils soient d’Etat ou privés. Dans de nombreux pays au monde, de semblables manifestations « officielles » ou étatiques sont propres aux Etats despotiques ou totalitaires. Le 11 janvier a eu pour mot d’ordre la « liberté d’expression » Or, seul l’Etat et ses institutions, dont la « justice », ou les associations lucratives sans but, la menacent. Ce n’est pas la liberté d’expression qui a été attaquée les 7, 8, 9 janvier ; ce sont des crimes racistes qui ont été commis. Des juifs ont été tués parce qu’ils étaient juifs et des dessinateurs ont été exécutés au nom de la loi islamique, parce que les infidèles n’ont pas le droit de représenter le rasoul, ou « messager », d’Allah. Or, le 11 janvier, personne n’a protesté et surtout pas l’Etat contre l’application sur le territoire de la République d’une loi, décidée par on ne sait qui et qui n’a force de loi qu’en Arabie saoudite ou en Afghanistan ou dans les territoires contrôlés par Boko Haram ou par l’Etat islamique. Il n’est pas étonnant que, les choses étant ce qu’elles sont, Alain Finkielkraut ait été dépité par l’après-11 janvier.
Sur quelques points, Alain Finkielkraut reste « de gauche », comme en témoigne la critique qu’il fait du Suicide français. A Zemmour, il prête des simulacres de thèses, le transformant sinon un négationniste, du moins un complice des négationnistes. L’antienne est banale. Zemmour étudie 40 années, de 1970 à 2010, qui ont défait la France. En 1981, l’historien américain Paxton accuse Vichy d’avoir participé à l’extermination des Juifs. Cette thèse rend caduque celle de l’historien français Aron, qui tenait Vichy pour un « bouclier », certes peu protecteur, des juifs français. C’est ce fait-là, à savoir le basculement de l’historiographie, que Zemmour analyse, le livre de Paxton mettant fin aussi à la thèse gaulliste sur les années 1940. Pour les Français libres, la France était à Londres. Paxton a replacé la France à Vichy et il l’a rendue responsable des crimes commis sur son territoire. Autre exemple : Alain Finkielkraut a été enthousiasmé par le 11 janvier. Ce jour-là, le chef de l’Etat a organisé une manifestation monstre avec tous les moyens dont dispose l’Etat et le soutien de tous les médias, qu’ils soient d’Etat ou privés. Dans de nombreux pays au monde, de semblables manifestations « officielles » ou étatiques sont propres aux Etats despotiques ou totalitaires. Le 11 janvier a eu pour mot d’ordre la « liberté d’expression » Or, seul l’Etat et ses institutions, dont la « justice », ou les associations lucratives sans but, la menacent. Ce n’est pas la liberté d’expression qui a été attaquée les 7, 8, 9 janvier ; ce sont des crimes racistes qui ont été commis. Des juifs ont été tués parce qu’ils étaient juifs et des dessinateurs ont été exécutés au nom de la loi islamique, parce que les infidèles n’ont pas le droit de représenter le rasoul, ou « messager », d’Allah. Or, le 11 janvier, personne n’a protesté et surtout pas l’Etat contre l’application sur le territoire de la République d’une loi, décidée par on ne sait qui et qui n’a force de loi qu’en Arabie saoudite ou en Afghanistan ou dans les territoires contrôlés par Boko Haram ou par l’Etat islamique. Il n’est pas étonnant que, les choses étant ce qu’elles sont, Alain Finkielkraut ait été dépité par l’après-11 janvier.
Alain Finkielkraut n’est pas encore tombé dans l’hérésie. Pour cela, il faudrait qu’il marche sur les brisées de Soljenitsyne, qui, en 1974, dans sa Lettre ouverte aux dirigeants de l’Union Soviétique, s’est adressé à la gauche réelle en ces termes : « Qu’importe si le mensonge recouvre tout, s’il devient maître de tout, mais soyons intraitables au moins sur ce point : qu’il ne le devienne pas PAR MOI ! ».
Jean-Gérard Lapacherie
00:05 Publié dans Livre, Livre, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alain finkielkraut, livre, philosophie, france |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Les progrès de la médecine, est-ce fini ? C’est peut-être pire encore
Anne-Laure Boch est une pasionaria de la vie de l’esprit mais aussi de la vie du corps. Elle a d’abord étudié la médecine, ce qui l’a conduite à devenir neurochirurgienne à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Ensuite elle a obtenu un doctorat en philosophie. Elle voulait comprendre ce qu’elle faisait comme médecin, et pourquoi. C’est cette méditation sur le sens de la médecine qu’elle a partagé avec les étudiants de l’institut Philanthropos à Fribourg. Devant eux, elle a posé la question de savoir si l’on pouvait encore attendre des progrès en médecine. Elle en doute et craint que la médecine ne produise désormais plus de méfaits que de bienfaits.
Elle n’a évidemment pas nié que la médecine occidentale a fait d’énormes progrès dans les trois derniers siècles. Mais rien ne nous garantit que des progrès passés engendrent des progrès pour l’avenir. Les communistes croyaient dur comme fer aux progrès de la science et ils ont bien placé Gagarine en orbite. Mais au-delà, plus rien ou presque. Ce n’est pas seulement que le progrès peut s’arrêter mais que, sur sa lancée, il peut produire du déclin, l’accélérer même. Une fusée, en retombant, peut faire des dégâts. La fusée de la médecine et des recherches qui lui sont associées est-elle en train de retomber ? On peut le craindre et c’est à repérer les raisons de cette crainte qu’Anne-Laure Boch s’est attachée.
La vocation de la médecine est de guérir. A-t-elle guéri le cancer par exemple ? Non, elle a fait de lui une maladie chronique, mais de guérison, point ! Si le but de la médecine est de faire survivre à n’importe quel prix, alors, oui, elle parvient effectivement à faire vivre plus longtemps les malades du cancer ? Mais le but de la médecine est la guérison du malade, pas son maintien en vie avec acharnement thérapeutique. Là, c’est l’échec, malgré les milliards investis dans la recherche depuis 50 ans. Faut-il se résigner à voir dans la médecine ce qui nous amène aux chaises roulantes, au semainier avec ingestion quotidienne de pilules, à un cheminement de plus en plus chevrotant avant la tombe ? Anne-Laure Boch ne s’y est jamais résignée. Pourquoi ?
Parce que, pour elle, l’être humain n’est pas un « tas de molécules » dont il faudrait comprendre le fonctionnement pour les rendre plus performantes. Elle a noté en passant que si nous ne sommes qu’un tas de molécules, l’amour se réduit à un frottement de chairs suivis de l’émission d’un liquide gluant. Pouvons-nous encore aimer si nous sommes un tas de molécules ?
La science ne connaît que des choses, et la technique « désanime » les êtres. De plus en plus dominée par la science, la médecine est devenue une « grande découpeuse » qui coupe le corps en tranches de plus en plus fines, comme le font d’ailleurs les images produites par un scanner médical. Plus encore, ce découpage conduit aujourd’hui à des greffes d’organes qui, à terme et selon certains, devraient nous permettre de vivre des centaines d’années (pour peu que les banques d’organes s’enrichissent…) Le philosophe Jean-Luc Nancy a témoigné de son expérience de greffé du cœur et du sentiment qu’il a eu d’être devenu « autre » après son opération. Or devenir autre, c’est se sentir aliéné. La médecine moderne s’est engagée sur un chemin qui, si elle le poursuit, pourrait non seulement faire de nous des assistés en chaise roulante, mais aussi des êtres qui se sentiraient étrangers à eux-mêmes. J’entends déjà caqueter les vautours de la vie à tout prix : « Au moins ils seraient vivants ! » Une vie mortelle, peu importe comment ! Étrange caquetage, puisque cette vie, nous devrons la quitter. Anne-Laure Boch n’est pas allée aussi loin mais je crois qu’elle me pardonnera de le faire. Je ne résiste pas toujours au plaisir d’extrapoler.
Nous ne sommes pas des choses dont la destination ultime serait de fonctionner le mieux possible dans le temps et dans l’espace. Si tel était le cas, alors oui, il faudrait tout faire pour nous rendre plus performants, plus propres, plus sains. Qui serait cet homme performant dont la figure transparaît en filigrane dans toutes les injonctions à ne pas fumer, à ne pas manger de viande, à ne pas boire le gras du lait, pour… éviter le cancer, les maladies cardiovasculaires, le diabète ou même la grippe lorsqu’arrive l’automne ? Cet homme, a souligné Anne-Laure Boch, serait un « homme nouveau ». Il serait si propre, si fonctionnel que, dans l’imaginaire des peuples modernes, il échapperait à la mort. Il suffit de se tourner vers les propositions du transhumanisme pour voir se dessiner le visage de cet homme nouveau ou surhomme. Pas tout à fait un visage encore, puisqu’il est question, dans ce transhumanisme, d’utérus artificiel ou de cerveau agrandi, mais le visage apparaîtra bien un jour. Il y a des chances pour que ce soit celui de Frankenstein, couturé de cicatrices en raison des greffes subies, le regard perdu en raison des pilules absorbées.
Voilà ce qui inquiète Anne-Laure Boch : l’image presque toute-puissante d’un homme nouveau qui a échappé à la condition humaine, à sa condition d’homme mortel. C’est cette image qui guide, oriente, soutient la médecine moderne qui a oublié sa vocation première, guérir, pour participer à une grande marche vers une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Chacun connaît la formule prononcée aux enterrements : « tu es né de la poussière et tu redeviendras poussière ». Eh bien, pas du tout pour la médecine d’aujourd’hui qui promeut un homme nouveau ! Elle n’est pas consciente, ajouterai-je, de s’être faite le promoteur de cet homme, mais elle n’en est pas moins orientée par lui. Était-il conscient de ce qu’il promouvait, cet expert de l’OMS qui expliquait récemment que la viande rouge augmente les risques de cancer du côlon ? Il est probable qu’interrogé, il aurait nié vouloir promouvoir un homme que la mort ne limiterait plus. Pour autant, le rapport de L’OMS sur la viande rouge tueuse n’en suggérait pas moins qu’à long terme, la mort pourrait être éradiquée non seulement par les greffes d’organes mais aussi par une prévention systématique dont on devinait que, une fois mise en place, elle nous conduirait vers d’enchantés pâturages où broutent déjà les adeptes du « véganisme ».
Les gardiens ou gargouilles d’une médecine orientée par pilotage automatique vers un homme nouveau abondent. Mais il n’y a pas que cela. Anne-Laure Boch nous a rendus attentifs au fait que différentes infrastructures se sont mises en place autour de la promotion de l’homme nouveau : structures d’accueil pour la fin de vie, personnel soignant pour ces structures, industrie pharmaceutique qui renforce le mythe d’une nouvelle vie grâce au viagra et autres pilules roses.
Notre époque n’aime pas les dogmes religieux, mais elle avale tout cru le dogme du progrès en général, le dogme du progrès de la médecine en particulier. C’est contre lui qu’Anne-Laure Boch s’est élevée avec, comme bélier pour enfoncer les portes de cette nouvelle citadelle dogmatique, Ivan Illich. Ce prêtre philosophe a en effet montré combien le dogme du progrès conduit à penser que, quoi qu’il arrive, on va vers le mieux, plus de bien-être, plus de bonheur. Staline déclarait en 1936 que les Russes étaient de plus en plus heureux, juste après avoir fait mourir de faim des millions d’Ukrainiens et juste avant d’organiser des grandes purges avec des centaines de milliers d’assassinats. Mais les gens l’ont cru, tant la soif de bonheur et d’immortalité est grande en nous.
Est-ce que, parmi des déambulateurs, des chaises roulantes, des drogués au Prozac, nous continuerons à bêler notre credo sur les bienfaits de la médecine et de la recherche ?
Pour Anne-Laure Boch ce n’est pas sûr. Nous voyons grandir la proportion des gens qui préfèrent mourir plutôt que d’être pris en charge par une médecine qui risque de faire d’eux des morts-vivants. Rejoindre le cortège des chevrotants ne les tente guère. Un autre facteur est que la schizophrénie s’aggrave chez les soignants : d’un côté ils sont encouragés à manifester de la bienveillance envers les malades – d’un autre côté, on leur dit que ces mêmes malades sont un « tas de molécules ». Viendra un jour où soigner des patients « molécularisés » n’aura plus de sens. Ce jour-là, il sera peut-être possible de retrouver une médecine qui se contente de guérir plutôt que de s’acharner à faire survivre à n’importe quel prix.
Jan Marejko, 28 ocotobre 2015
00:05 Publié dans Philosophie, Science, Sciences | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : science, sciences, médecine, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Le fascisme: un «étymon spirituel» à découvrir?
Sur le dernier ouvrage de Philippe Baillet
par Daniel COLOGNE
Note de la rédaction: Daniel Cologne rend ici hommage à Philippe Baillet qu'il a côtoyé notamment au "Cercle Culture & Liberté", structure qui a précédé la création de la revue évolienne "Totalité" (1977), dirigée ultérieurement par Georges Gondinet. Philippe Baillet, traducteur de Julius Evola, a été par la suite secrétaire de rédaction de "Nouvelle école", avant d'être évincé par le directeur de cette publication, qui pratiquait là son sport favori. L'intérêt du nouveau livre de Baillet réside surtout dans le fait qu'il rend hommage à Giorgio Locchi et poursuit la quête de ce dernier qui a donné à la "nouvelle droite" ses impulsions majeures avant d'être évincé de manière particulièrement inélégante par ce même directeur.
* * *
Parmi les rencontres que j’ai faites durant ma période parisienne (1977 – 1983), celle de Philippe Baillet fut pour moi une des plus enrichissantes.
Co-fondateur de la revue Totalité, Baillet est l’un des principales artisans de la réception de l’œuvre de Julius Evola dans les pays francophones.
Sa maîtrise de l’italien lui permet de lire dans le texte original et de traduire avec fidélité de nombreux auteurs transalpins, dont l’énumération impressionne au chapitre 2 de la première partie de l’ouvrage ici recensé : Le Parti de la Vie. Clercs et guerriers d’Europe et d’Asie.
Il s’agit d’un recueil de textes initialement parus dans divers périodiques, dont Rivarol et Écrits de Paris, où j’ai moi-même collaboré entre 1977 et 1979.
Je reste reconnaissant à Philippe Baillet de m’avoir accordé son amical soutien, non exempt de critique toujours courtoisie, lors d’une conférence que j’ai prononcé en février 1979 au Cercle Péguy de Lyon. Dans la salle, il y avait une charmante et prometteuse étudiante nommée Chantal Delsol. Cette soirée rhodanienne demeure parmi les plus beaux souvenirs de mon séjour dans l’Hexagone.
L’émotion nostalgique s’efface devant la rigueur comptable de l’index, où Evola est cité douze fois, Guénon apparaît à trois reprises et Coomaraswamy ne récolte qu’une seule mention, en note infra-paginale.
Revenu à Nietzsche « comme référence essentielle » après « un très long détour (p. 15) » par le « traditionalisme intégral » des trois penseurs susdits, Baillet semble toutefois toujours considérer Evola comme inspirateur incontournable dans la perspective de La Désintégration du Système.
L’ouvrage de Giorgio Freda était abondamment commenté vers 1975 dans les milieux nationalistes-révolutionnaires. Il ne contenait rien d’original. Tout y était originel. Présents dans la préface du livre de Freda, les deux adjectifs s’opposent aussi dans la conclusion du recueil de Baillet.
Celui-ci évoque la haute figure de Lao-tseu : « Le vrai taoïste, lui, est insouciant de sa propre insouciance, qu’il ne donne pas en spectacle pour paraître “ original ”. Il est bien plutôt tourné vers l’originel (p. 233, c’est Baillet qui souligne). »
Quand on se rappelle que Révolte contre le monde moderne s’ouvre sur un extrait du Tao tö king, on peut conclure que l’ombre d’Evola plane sur ce florilège divisé en deux parties inégales, la première (six chapitres) relevant de la littérature et de l’histoire des idées, la seconde (deux chapitres) d’orientation plus nettement philosophique.
Le cloisonnement n’est toutefois pas étanche. L’auteur nous remet en mémoire l’œuvre littéraire de Mishima, extraordinaire en regard de sa courte existence : « Près de quarante romans, vingt recueils de nouvelles, dix-huit pièces de théâtre et quelques essais (p. 183). »
Parallèlement, quelques-uns des écrivains français analysés dans la première partie ont été attirés par l’Extrême-Orient. Même André Malraux, « un cabotin qui rêvait de s’inscrire dans la lignée des grands esthètes armés (p. 112) », connut une période japonisante, controversée, il est vrai. Rappelons aussi que La Condition humaine se passe en Chine.
En Chine : tel est précisément le titre d’un « ouvrage remarquable et devenu très rare (p. 79) » d’Abel Bonnard, dont Philippe Baillet se plaît à exhumer quelques brillantes phrases aux allures de maximes. « La Mort nous cache le regret de quitter le monde dans le bonheur de quitter les hommes (p. 108). »
Pierre Drieu connut aussi ce que le Belge Firmin Vandenbosch appelle « la tentation de l’Orient ». À l’auteur du Feu Follet, qui dirigea la Nouvelle revue Française sous l’Occupation, Baillet concède « l’élégance et l’honnêteté du désespoir ». Elles « forcent l’estime, voire l’admiration, que ne mérite sans doute pas l’œuvre, avec son ton trop souvent sentencieux, son style parfois médiocre, ses essais très inégaux, dans lesquels les meilleures intuitions s’arrêtent la plupart du temps au stade de l’esquisse (p. 111) ».
Étendues à Gabriele d’Annunzio et Ezra Pound, sommairement négatives en ce qui concerne Louis Aragon, les considérations d’ordre littéraire ne constituent pas l’essentiel du message délivré par Philippe Baillet.
Les amateurs de rapprochements inattendus goûteront celui effectué entre Nietzsche et Lao-tseu partageant « une vision biocentrique du monde (p. 202) ». Dans le cadre de cette étonnante parenté entre « deux univers de pensée » et en dépit de leur « éloignement racial, temporel, spatial et civilisationnel (p. 216) », Philippe Baillet redéfinit l’idée tant débattue de « volonté de puissance », « catégorie ontologique suprême (p. 218) », « sens originaire (p. 225) » non réductible au simple vitalisme bergsonien.
La « volonté de puissance » est synonyme de la « persévérance dans l’être ». Une filiation philosophique directe relie dès lors Nietzsche et Heidegger, et peut-être, en amont de l’histoire de la pensée européenne, le Wille zur Macht de Nietzsche et le conatus de Spinoza. En tout cas, la « volonté de puissance » s’affranchit de tout rapetissement tel que voudrait lui faire subir une certaine critique guénonienne en la confondant avec le jaillissement de « l’élan vital », avec « la création incessante d’imprévisible nouveauté », avec un vitalisme priapique et éjaculatoire.
Ailleurs dans l’ouvrage, certains guénoniens sont implicitement ciblés dans la mesure où ils jugent toute révolution anti-moderne impossible en raison des conditions cosmiques défavorables. Ce point de vue revient à catamorphoser le « traditionalisme intégral » en un mythe démobilisateur. L’Histoire n’est pas un progrès linéaire, mais elle n’est pas davantage une décadence unidirectionnelle. Comme le répétait souvent notre regretté ami Dominique Venner, elle a sa part d’imprévu, même si une véritable « astrologie mondiale », apte à saisir la respiration du mouvement historique, pourrait y introduire une frange de prévisibilité.
En l’occurrence, l’important est de ne pas « déserter la lutte pour la défense de la cité en raison du dégoût que celle-ci nous inspire (p. 104) ». Il ne faut pas « attendre que tout s’arrange grâce à la divine Providence (p. 105) », par une sorte de retournement automatique inscrit dans la marbre de la fatalité, par une espèce de choc en retour ou d’effet boomerang contre la pesanteur plurimillénaire de l’Âge Sombre (Kali Yuga).
À défaut de compter sur une improbable metanoïa de ce type, vers où convient-il de tourner le regard d’une espérance en une « régénération de l’Histoire (p. 133) », face au « mouvement irréversible » (François Hollande) que veut lui imprimer le finalisme égalitaire ?
Ce n’est ni du Front national ni des divers partis « populistes » européens qu’il faut attendre une salutaire réaction contre ceux qui souhaitent suspendre le vol du temps, non pas comme Lamartine sur les rives romantiques du lac du Bourget, mais au bord du bourbier social-démocrate perçu comme « horizon indépassable ».
Je partage totalement le point de vue qu’exprime Baillet dans les lignes qui suivent et dans son jugement sur le parti lepéniste.
« Je tiens évidemment pour acquis que les lecteurs auxquels je m’adresse ne nourrissent pas l’illusion de penser que les différents mouvements “ populistes ” qui engrangent des succès électoraux dans l’Europe d’aujourd’hui sont une résurgence du phénomène fasciste (p. 161). »
Quant au Front national, il « entretient désormais le comble de la confusion » en se présentant comme « le défenseur par excellence du républicanisme et du laïcisme (p. 101) ».
Philippe Baillet nous invite à rechercher « l’essence du fascisme », selon l’expression de Giorgio Locchi, dont une conférence est retranscrite (pp. 164 à 182) entre les deux parties du livre. Il s’agit en quelque sorte de trouver pour le fascisme l’équivalent de ce que le grand critique littéraire allemand Leo Spitzer, fondateur de la stylistique, veut faire surgir dans sa lecture des écrivains : un « étymon spirituel ».
Philippe Baillet s’interroge à propos d’un « nouveau regard (p. 21) » que la science et la recherche universitaires semblent porter, depuis quelque temps, sur le national-socialisme.
Johann Chapoutot affirme que le national-socialisme est porteur d’une Kulturkritik « prolixe et plus argumentée qu’on ne le dit (p. 22) ».
Plusieurs expéditions scientifiques en Amazonie, au Libéria et au Tibet, la reconversion de Leni Riefenstahl comme cinéaste du Sud-Soudan : voilà autant de faits avérés qui plaident en faveur d’une ouverture du nazisme au monde non européen. Ces réalités « sont encore largement méconnues dans nos propres rangs, quand elles ne sont pas purement et simplement ignorées (p. 247) ».
En revanche, on ne peut que constater l’hostilité de « beaucoup de hauts responsables nationaux-socialistes […] à la postérité d’Abraham, aux serviteurs de la Loi, de la Croix et du Livre, bref à tout l’univers mental du “ sémitisme ” au sens le plus large (p. 29) ».
Dans le sillage de Giorgio Locchi, Philippe Baillet diagnostique une « tendance époquale (p. 136) » dont nous subissons les effets pernicieux depuis deux millénaires : un sémitisme lato sensu, un judéo-christiano-islamisme, auquel doit s’opposer une « tendance époquale » surhumaniste.
 Respectivement consacrés à Renzo de Felice et Giorgio Locchi, les chapitres 1 et 6 de la première partie posent les questions les plus fondamentales pour notre famille de pensée. Jusqu’où faire remonter la recherche de notre « moment zéro » (François Bousquet) ? Les étapes de la « tendance époquale » surhumaniste se succèdent-elles de manière continue ? Le fascisme lato sensu (dont le national-socialisme est provisoirement la forme la plus achevée) a-t-il été « prématuré (p. 142) », comme le laissent supposer certains passagers de Nietzsche prophétisant un interrègne nihiliste de deux siècles ?
Respectivement consacrés à Renzo de Felice et Giorgio Locchi, les chapitres 1 et 6 de la première partie posent les questions les plus fondamentales pour notre famille de pensée. Jusqu’où faire remonter la recherche de notre « moment zéro » (François Bousquet) ? Les étapes de la « tendance époquale » surhumaniste se succèdent-elles de manière continue ? Le fascisme lato sensu (dont le national-socialisme est provisoirement la forme la plus achevée) a-t-il été « prématuré (p. 142) », comme le laissent supposer certains passagers de Nietzsche prophétisant un interrègne nihiliste de deux siècles ?
Selon Locchi et Baillet, le « phénomène fasciste » de nature « transnationale et transpolitique (p. 136) » prend racine dans « la seconde moitié du XIXe siècle (p. 137) ». Baillet précise dès sa préface : « la grande réaction antirationaliste de la fin du XIXe siècle (p. 12) » marque l’origine du fascisme en tant qu’essence apte à « détrôner le cogito (p. 221) », cette formule finale soulignant la remarquable cohérence de l’auteur.
Mais pourquoi ne pas remonter encore plus loin, par exemple jusqu’à cet équivoque XVIIIe siècle qui préoccupe Renzo De Felice avant qu’il se spécialise dans la période mussolinienne ?
Car le siècle des prétendues « Lumières » et de l’Aufklarung ne fut pas seulement celui des philosophes néo-cartésiens instaurant « pour la première fois une culture de masse (p. 146) ». Il fut aussi celui des « illuminés » dont le « mysticisme révolutionnaire (p. 44) » fournit à l’historien l’occasion de réhabiliter « la dignité historiographique de l’irrationnel (p. 47) ». Le propos de De Felice est « d’insérer le “ fait mystique ” dans l’histoire, alors même que, selon lui, des tentatives dans ce sens n’ont été faites que par l’histoire littéraire à propos du Sturm und Drang et du romantisme (p. 44) ». Je rejoins Philippe Baillet dans son appel à compulser plus systématiquement les revues culturelles gravitant dans l’orbite du fascisme (allemand en l’occurrence) pour dévoiler certaines facettes d’un “ sens originaire ” ou d’un “ étymon spirituel ” chez Klinger, Lenz, Schiller, Herder, Hölderlin et Novalis, disait un jour Robert Steuckers cité en page 155. À titre anecdotique, je signale qu’un des plus brillants germanistes que j’ai croisés à l’Université libre de Bruxelles était d’origine togolaise et faisait une thèse de doctorat sur le Sturm und Drang.
Sur la « Révolution conservatrice », c’est bien entendu le travail de rassemblement d’Alain de Benoist (cité pages 134 et 155) qu’il faut saluer, tout en insistant sur un thème commun à Locchi et Baillet : la parfaite continuité de ce mouvement et du national-socialisme, même si certains « révolutionnaires-conservateurs (comme Armin Mohler, par exemple) ont « tenté de tourner les difficultés liées à cet incommode voisinage (p. 149) ».
Sous la forme du national-socialisme, la « tendance époquale surhumaniste » a-t-elle émergé trop tôt ? On peut le penser dans la mesure où la « tendance époquale » opposée, de nature « sémitique », n’était pas encore en état d’épuisement. Elle refait surface aujourd’hui dans « le panislamisme radicalisé », ses « formes exacerbées de ressentiment culturel » et sa « haine raciale patente (p. 161) ».
Le seul passage du livre de Baillet qui puisse laisser le lecteur sur sa faim est celui où l’islamisme est ainsi réduit à l’influence de facteurs psychologiques. Je conseille la lecture de l’analyse plus fine de François Bousquet, cité plus haut, dans la revue Éléments (n° 156, pp. 22 à 24).
Selon Bousquet, toute religion est coextensive d’un devenir historico-culturel et un exemple éloquent en est fourni par le Christianisme, qui peut être « interprété comme une métamorphose complexe de l’ancestrale religion païenne (p. 137) ». En l’occurrence, Baillet fait écho aux idées de Wagner, l’un des pôles de la « tendance époquale surhumaniste » (l’autre pôle étant évidemment Nietzsche).
Mais la mondialisation post-moderne favorise, par une sorte de mutation génétique, l’émergence de religions d’un type nouveau qui, à l’instar des « frères ennemis » de l’évangélisme et du salafisme, aspirent à renouer avec leur « moment zéro », leur origine immaculée, leur paléo-tradition non encore entachée par les vicissitudes de l’Histoire et les contraintes de ce que Charles Péguy appelle la nécessaire « racination » du spirituel dans le charnel.
À la lumière de l’article de Bousquet, le « panislamisme radicalisé » apparaît motivé par quelque chose de bien plus essentiel que la « haine » et le « ressentiment ».
Par ailleurs, une question mérite d’être posée : la recherche d’une essence fasciste « transpolitique » et « transnationale » (adjectif également utilisé par Bousquet dans son examen des « religions mutantes ») n’est-elle pas assimilable à la quête du « moment zéro », hors sol, hors temps et antérieur à toute « racination » ?
Rechercher l’essence du fascisme revient à découvrir son arché (le principe, l’origine) sans perdre de vue sa coextensivité à une genosis (le devenir).
C’est à dessein que j’emploie les termes inauguraux de l’Ancien Testament, car je ne suis convaincu, ni de la corrélation du « sémitisme » et de l’égalitarisme, ni de la désignation des monothéismes sémitiques comme ennemi global et principal.
Le mépris des Juifs pour les goyim, l’hostilité des Chrétiens envers les mécréants, l’aversion de l’Islam pour les infidèles sont analogues au dédain que peuvent ressentir les disciples de Nietzsche face aux « derniers hommes » qui se regardent en clignant de l’œil et se flattent d’avoir inventé le bonheur.
D’autre part, plutôt que « désigner l’ennemi », ne faut-il pas prioritairement identifier celui qui nous désigne comme ennemi ? À mes yeux, il ne fait pas de doute que c’est le laïcisme stupidement revendiqué par le Front national.
Quelle que soit l’étymologie basse-latine (laicus, commun, ordinaire) ou grecque (laos, le peuple, dont le pluriel laoi signifie « les soldats »), le laïcisme est à la fois égalitaire et profanateur.
D’un côté, il réduit les êtres humains à ce qu’ils ont de plus ordinaire en commun. De l’autre, il déclare une guerre permanente à tout ce qui relève du spirituel, du métaphysique, du cosmologique et du sacré.
René Guénon a très bien vu que l’égalitarisme ne serait qu’une première étape de la modernité. Dans un second temps sont appelées à émerger une « contre-hiérarchie » et une « parodie » de spiritualité. S’il faut éviter les pièges de l’apolitisme et du fatalisme tendus par certains guénoniens, il convient tout autant de garder en mémoire le message d’un maître à penser dont le diagnostic de « chaos social », entre autres analyses prémonitoires, se révèle d’une brûlante actualité.
Le mérite de Philippe Baillet est de dire clairement les choses : une révolution anti-moderne ne peut qu’être synonyme de rétablissement des valeurs d’ordre, d’hiérarchie et d’autorité. Je demeure réservé quant à l’adjectif « surhumaniste », trop nettement corollaire de la référence nietzschéenne, alors que la quête du « sens originaire » de la contre-modernité peut nous faire remonter au moins jusqu’au pré-romantisme, pour nous en tenir à l’aire culturelle allemande.
Nous autres révoltés contre le monde moderne devons poursuivre le combat contre la « tendance époquale » égalitaire qui est loin d’être épuisée. Mais il nous incombe aussi de nous préparer à l’affrontement décisif entre, d’une part l’élite « transnationale » de clercs et de guerriers tels que nous les présente Philippe Baillet, et d’autres part « l’hyper-classe mondialiste » (Pierre Le Vigan), dont il est encore aujourd’hui difficile de cerner les contours, mais qui incarnera davantage l’aspect profanateur du laïcisme que sa facette égalitaire, si tant est qu’il faille diviser l’action anti-traditionnelle en deux étapes successives. Égalitarisme et « contre-hiérarchie » apparaissent plutôt comme des phénomènes simultanés, dès qu’on y regarde d’un peu plus près.
Cet enchevêtrement complexe d’influences négatives rend d’autant plus urgente la tâche de redéfinir un fascisme essentialisé, capable de riposter aux formules lapidaires et diffamatoires – comme « l’islamo-fascisme » de Manuel Valls – qui visent à confondre dans la même brutalité tous les ennemis du Nouvel Ordre Mondial.
Mais une essence ne persévère dans l’Être que sous les conditions historiques, culturelles, géographiques, voire ethniques d’une substance qui, dans le livre de Philippe Baillet, hormis les pénétrantes ouvertures vers l’Extrême-Asie, épouse un vaste courant germanique continu : le Sturm und Drang, Nietzsche, Wagner, la « Révolution conservatrice » et le national-socialisme.
L’« étymon spirituel » de Leo Spitzer ne perdure qu’en s’incarnant dans « une race, un milieu, un moment », selon la formule d’Hippolyte Taine, qui fut également un grand critique littéraire.
À notre époque de désinformation calomnieuse, Philippe Baillet a le courage d’écrire que le national-socialisme est « la seule forme historique de révolte anti-égalitariste que le monde moderne ait connue (p. 15) ».
Le cadre limité de la présente recension ne permet pas de mettre au jour toute la richesse du livre de Philippe Baillet.
Il faudrait s’attarder davantage sur le chapitre consacré à Bernard Faÿ, dont l’itinéraire « conduit de l’avant-garde artistique et littéraire au pétainisme, des sympathies initiales pour Roosevelt à la collaboration avec des responsables de la SS dans le cadre du combat anti-maçonnique, d’un cosmopolitisme snob à la passion du redressement national (p. 116) ».
Il conviendrait de commenter plus en détail les pages remarquables qu’inspire à Philippe Baillet la lecture d’Abel Bonnard, pour qui « l’ordre est le nom social de la beauté (p. 92) ».
« Face à l’uniformisation croissante des modes de vie et des cultures, face à la laideur moderne qui s’étend partout, le clerc authentique est appelé à témoigner pour les valeurs de l’esprit, d’abord en se faisant le chantre de l’ordre et de la civilisation (p. 78) ».
Baillet décèle chez Bonnard un « penchant pour la poésie de l’ordre, que résumait si bien, au Japon, l’alliance du tranchant du sabre et de la pureté du chrysanthème dans l’âme du guerrier (p. 93) ».
La « ligne de force générale » que l’auteur a vu émerger, au fur et à mesure de la relecture et de la ré-écriture augmentée de ses articles initiaux, mériterait d’être approfondie.
Cette « ligne de force » ne renvoie « jamais, fondamentalement, à un discours, une spéculation, des concepts, des idéologies, une dialectique, mais à leurs opposés : un mythe, une vision du monde, des images, une esthétique (p. 12) ».
Ce culte de la Beauté, qui n’est pas sans rappeler la poésie d’Émile Verhaeren, pourtant compagnon de route du socialisme, cette nécessité de percevoir le Beau même « dans ce qui peut être tragique (p. 19) », cet esthétisme se combine à un « conservatisme vital (p. 199) », à une vigoureuse dénonciation du « caractère absolument suicidaire de toutes les idéologies prétendant faire abstraction des lois de la vie au profit d’un monde artificiel entièrement recomposé dans une perspective où l’homme est la mesure de toutes choses (p. 20) ».
La célèbre proposition de Protagoras fut vivement critiquée par Platon, dont La République et Les Lois figurent, comme le De Monarchia de Dante ou l’Arthashâstra indien, parmi les grands textes « qui ignorent superbement les anti-principes démocratiques (p. 85) ».
C’est également à ces sources antiques et médiévales que doivent s’abreuver tous les non-conformistes désireux de penser « par delà les clichés (p. 117) », de dépasser les clivages manichéens et de partir en quête d’une fascisme essentialisé, coextensif d’un mouvement historique bien plus ample que celui amorcé par les prétendues « Lumières ».
Philippe Baillet nous offre une chatoyante galerie de portraits de clercs et de guerriers dans un livre réunissant la cohésion de la pensée, la brillance de l’écriture et la magistrale organisation du savoir.
L’auteur a choisi de nous dévoiler le « versant ensoleillé (p. 24) » de la montagne au sommet de laquelle, sur un équivoque et périlleux chemin de crête, le fascisme a proposé un parcours politique et un itinéraire métapolitique.
Les voyageurs de haute altitude s’exposent fatalement à des chutes au fond du précipice, dans l’abîme de l’autre versant.
Philippe Baillet ne se voile pas la face lorsqu’il stigmatise, par exemple, « le traitement réservé aux prisonniers russes (p. 28) » par les nazis dans les territoires de l’Est occupés.
La caste médiatique aujourd’hui dominante aurait certes préféré d’autres illustrations des excès meurtriers où le fascisme allemand a basculé.
Mais ce livre ne s’adresse pas à cette caste experte en victimisation préférentielle.
Il interpelle plutôt tous les membres de notre famille de pensée conscients de ne pouvoir se permettre l’économie d’une étape intellectuelle en compagnie des régimes et mouvements anti-égalitaires du XXe siècle.
Daniel Cologne
• Philippe Baillet, Le Parti de la Vie. Clercs et guerriers d’Europe et d’Asie, Akribeia, Saint-Genis-Laval, 2015, 243 p., 22 € (à commander à Akribeia, 45/3, route de Vourles, 69230 Saint-Genis-Laval).
Article printed from Europe Maxima: http://www.europemaxima.com
URL to article: http://www.europemaxima.com/?p=4563
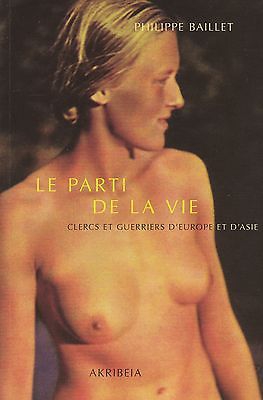 Le Parti de la vie
Le Parti de la vie
Clercs et guerriers d’Europe et d’Asie
Philippe Baillet
Le « parti de la vie » est constitué de tous ceux en qui sont encore présents et actifs les éléments originaires du réel occultés par la modernité : la voix de la race et du sang, les instincts élémentaires de légitime défense et de protection des siens, la solidarité ethnoraciale, la grande sagesse impersonnelle du corps, le sens de la beauté conforme aux types. Qu’il s’agisse de réalités méconnues du régime national-socialiste ou de l’anti-intellectualisme fasciste, de l’ordre en tant que « nom social de la beauté » chez Abel Bonnard ou de Giorgio Locchi insistant sur le caractère nécessairement « mythique » du discours surhumaniste, de l’intimité possible de la chair avec les idées selon Mishima ou de la nature « biocentrique » de la vision taoïste du monde, etc. – tout ici renvoie à une esthétique incarnée, radicalement étrangère à la postérité d’Abraham, aux serviteurs de la Loi, de la Croix et du Livre, aux « Trois Imposteurs » (Moïse, Jésus, Mahomet). Apparemment inactuel, ce livre explore donc avec rigueur le « versant ensoleillé » d’une Cause diffamée, enracinant ainsi les convictions dans la dynamique même des lois de la vie.
Contient un texte inédit en français de Giorgio Locchi.
Index.
248 p.
Pour commander:
http://www.akribeia.fr/akribeia/1712-le-parti-de-la-vie.html
00:05 Publié dans Livre, Livre, Nouvelle Droite, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fascisme, philippe baillet, livre, philosophie, philosophie politique, giorgio locchi, nouvelle droite, tradition, julius evola |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

von Carlos Wefers Verástegui
Ex: http://www.blauenarzisse.de
Der Geschichtstheoretiker und Kulturphilosoph Giambattista Vico (1668−1744) ist, wenn überhaupt, nur als „Vorläufer Spenglers“ bekannt.
Zu Unrecht, denn der Neapolitaner Vico ist Spengler in Sachen Eingebungskraft, Selbständigkeit und Reichhaltigkeit des Denkens überlegen. Er verdient es, als Bildungsmacht neben den ganzen Deutschen Idealismus gestellt zu werden, aber auch Wilhelm Dilthey, Friedrich Nietzsche – vor allem der geniale Nietzsche von „Lüge und Wahrheit im außermoralischen Sinne“ – und Ferdinand Tönnies sind Vico ebenbürtig. Vicos leidenschaftliche, aber dennoch den Tatsachen auf den Grund gehende Beschäftigung mit der Geschichte lassen ihn vorteilhafter als Spengler erscheinen. Anders als die herkömmlichen Geschichtsphilosophen neigt Vico nicht zu Ideologie und politischer Auswertung der Vergangenheit.
Dass Vico immer noch so wenig bekannt ist, liegt vor allem daran, dass er im Gegensatz zu Spengler keinen durch Zeitumstände bedingten Erfolg hatte. Sein Hauptwerk, die „Neue Wissenschaft“ (Scienza Nuova), war seiner Zeit derart voraus, dass es über ein Jahrhundert lang einsam dastand und auch später meist unverstanden blieb.
Erst die Arbeiten des italienischen Philosophen Benedetto Croce sowie die Forschungen Deutscher, wie Richard Peters, aber auch Karl Löwith, haben die Viquianische Methode der historischen Einsicht in ihrem Wert wiedererkannt. Auch konservative Gelehrte, wie Werner Sombart und Carl Schmitt, haben Vico durchaus die Wertschätzung zuteil kommen lassen, die er verdient. Der ehemalige Spann-Schüler Eric Voegelin hat in ausdrücklicher Anlehnung an Vico seinem Hauptwerk den Titel „Die neue Wissenschaft der Politik“ gegeben.
Gemäß ihrem Schöpfer ist die neue Wissenschaft eine teologia civile e ragionata della provvidenza divina, frei übersetzt: eine „auf Vernunftbelege gegründete politische Theologie der göttlichen Vorsehung“. Hinter dem barocken Ausdruck verbirgt sich eine Philosophie des Geistes, ähnlich imposant wie die Hegelsche. Dazu gesellen sich noch eine empirische Geschichte oder, wie Croce präzisiert, „eine Gruppe von verschiedenen Geschichten“, sowie eine Gesellschaftswissenschaft. Obwohl Vico den Begriff nicht gebraucht, ist sein Werk als eine umfassende Kulturphilosophie zu bezeichnen, die sich bereits im Übergang zu einer konservativen Soziologie befindet.
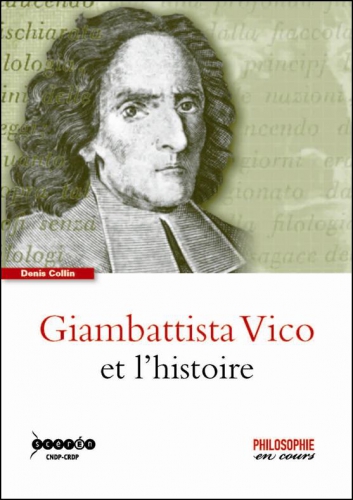
Nach Vico bezeichnet seine Wissenschaft eine „ideale ewige Geschichte“. Dieser idealistische Begriff geht auf zwei Gegenstände Viquianischer Eingebung zurück: durch die Erfassung des Heroenzeitalter Homers ist er im Mythos verankert, die römische Geschichte hat ihm als Vorlage für alles Weitere gedient – sie stand geradezu Modell für Vicos geschichtliche Zyklenlehre der corsi und recorsi. Vicos Geschichtsbild gemäß dieser „idealen ewigen Geschichte“ ist aufs innigste verwand mit romantischen Naturgeschichtsvorstellungen, wie denen Heinrich Leos oder Wilhelm Roschers, aber auch Othmar Spanns universalistische Geschichtstheorie gehört hier her.
Wie leicht es ist, Vico mißzuverstehen, beleuchtet Spanns Fehlurteil über Vico als eines „naturalistischen Geschichtsphilosophen“. Der Ernst von Vicos System ist, wie bei Spann, „objektiver Idealismus“. Auch führte Vico konsequent die fundamentale Unterscheidung zwischen Natur und Kultur, zwischen physischer Welt und Welt des Geistes als erkenntnistheoretischer Grundlage einer von den Naturwissenschaften geschiedenen und, im Gegensatz zu diesen, wahren Wissenschaft – der vom menschlichen Geist nämlich – ein.
Dadurch, dass Vico seinen Gottesglauben gedanklich ausführte, kam er zu der Feststellung: In Gott sind Einsicht, Erkennen und Schaffen eins. Nur Gott, als dem Schöpfer, gebührt vollkommene Einsicht in sein Werk, nur er besitzt wahres Wissen über alles. Der Mensch aber findet sich in einer natürlichen Welt zurecht, die er nicht geschaffen hat, und über die er deshalb nur „Gewissheit“, niemals aber „wahres Wissen“ erlangen kann. Nur was der Mensch selbst schafft, vermag er auch vollkommen zu erkennen, wahres Wissen erlangt er nur über seine eigenen Erzeugnisse.
Vico stützt sich in seinen Untersuchungen auf die Fähigkeit des menschlichen Geistes, Erkenntnis über sich selbst zu erlangen, auf die Einheit des Menschengeschlechtes sowie die (relative) Unveränderlichkeit der Menschennatur. Relativ unveränderlich ist die Menschennatur deshalb, weil Vico sich der Geschichtlichkeit des Menschen sowie seiner individuellen Abhängigkeit vom geschichtlichen Schicksal der „Völker und Nationen“ sicher ist.
Diese dogmatische Erkenntnisvoraussetzung nimmt bei Vico die Gestalt einer Kritik des Rationalismus sowie der utilitaristischen Naturrechtslehren, vor allem von Hobbes und Spinozas, an. Am Ende dieser Kritik steht bei Vico eine entschieden fromme Philosophie der Autorität, die für sich beansprucht, die gesamte Überlieferung, den Mythos, die Phantasie und überhaupt die Intuition wieder in ihr angestammtes Recht eingesetzt zu haben. Überhaupt ist die Frömmigkeit bei Vico erster und letzter Begriff.
Erst der Fromme besitzt den Schlüssel zum wahren, nämlich einfühlsamen Verständnis der gesellschaftlich-geschichtlichen Welt. Gegenüber dem Frommen und seiner wahren Einsicht nehmen sich die Naturrechtler und Rationalisten toll und hochmütig aus; die Wahrheit bleibt ihnen auf immer verschlossen, und sie merken es nicht einmal. Derselbe tolle Hochmut macht für Vico auch die Atheisten so hassenswert. Über hundert Jahre später übernimmt der spanische Reaktionär Juan Donoso Cortés dieses Viquianischen Argument in seinem Kampf gegen die politischen Nachfahren der Rationalisten und Naturrechtler, die Liberalen und Sozialisten.
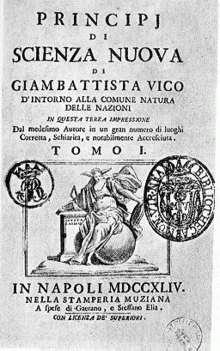 Als strenger Theist ist Vico der Ansicht, dass die Geschichte, die ihm immer eine Geschichte der „Völker und Nationen“, niemals von Individuen ist, zwar von Menschen gemacht ist, dass aber hinter den Menschen und selbst durch die Menschen hindurch unentwegt die göttliche Vorsehung wirkt. Die Selbsterkenntnisfähigkeit des menschlichen Geistes ist ein Beweis für dieses Wirken der Vorsehung, ja, sie nähert den Menschen selbst in gewisser Weise an Gott an.
Als strenger Theist ist Vico der Ansicht, dass die Geschichte, die ihm immer eine Geschichte der „Völker und Nationen“, niemals von Individuen ist, zwar von Menschen gemacht ist, dass aber hinter den Menschen und selbst durch die Menschen hindurch unentwegt die göttliche Vorsehung wirkt. Die Selbsterkenntnisfähigkeit des menschlichen Geistes ist ein Beweis für dieses Wirken der Vorsehung, ja, sie nähert den Menschen selbst in gewisser Weise an Gott an.
Dieses Vergnügen in der Gewissheit, in der Erkenntnis der menschlichen Dinge über sich selbst als Menschen herausgewachsen zu sein, macht Vico zu einem würdigen Nachfahren und Geistesverwandten Machiavellis, der für sich – und für intelligente Leser ebenfalls – stillschweigend beanspruchte, die politischen Dinge sowohl von der Ebene als auch zugleich von der Anhöhe aus zu betrachten. Was aber bei Machiavelli verhohlener Stolz und eine kleine Eitelkeit gegenüber den Fürsten ist, ist bei Vico freudige Demut ob der errungenen wahren Einsicht im Angesicht Gottes.
Gott besitzt die vollkommene Einsicht, nur er besitzt die ganze Wahrheit, und sich ein wenig zu ihm emporgerungen zu haben, ist keine Kleinigkeit für den menschlichen Geist. Darauf ist Vico stolz. Die Menschen spielen sich nämlich dauernd selbst Streiche, sie irren über die wahren Beweggründe ihres Handelns. Sie meinen, etwas zu wollen oder zu tun, erreichen aber etwas ganz anderes, was ihnen nicht aufgeht – es ist die Vorsehung, die die Selbstsucht, die Triebe, den Ehrgeiz, die Laster, die Leidenschaften, die Irrtümer und überhaupt alles Streben der Menschen dazu benutzt, das Allgemeinwohl hinter dem Rücken der Akteure und über ihre Köpfe hinweg zustande zu bringen.
Vicos „Vorsehung“ hat zwar auf den ersten Blick etwas von Adam Smiths „unsichtbarer Hand“, die gerade da die allgemeine Wohlfahrt befördert, wo jeder seinem eigenen Vorteil nachgeht. Ihre genaue Entsprechung ist jedoch Hegels List der Vernunft: dadurch, dass die Menschen sich in ihren wesentlichen Überzeugungen, Glaubensartikeln, Ansichten und Zwecksetzungen täuschen bzw. sich grundsätzlich irren, machen sie sich letzen Endes selbst, nämlich freiwillig und ohne dass sie irgendetwas davon ahnten, zu Werkzeugen der Vorsehung.
Diese eigentümliche dialektische Spannung zwischen Existenz, Bewusstsein und Handeln des Individuums und dessen eigentlicher, ungeahnter Bewandtnis innerhalb von Gottes Vorsehung, sagt trotz ihrer, für heutiges Empfinden mythologischen Einkleidung, tatsächlich etwas über die Struktur der menschlichen Wirklichkeit aus. Sie tut es auf die gleiche Weise, wie es Machiavelli mit dem Hinweis getan hat, dass der Fürst sich auch darauf verstehen müsse, nach Notwendigkeit böse zu handeln. Nur ist bei Vico das Aktivistische von Machiavellis individualistischer Handlungstheorie eben zum überindividuellen Prozess der Vorsehung ausgeweitet, der so zur geschichtlichen Dialektik wird. Die Vorsehung ist gerade deshalb, weil sie göttlichem Ratschluss, Gottes Vernunft und Autorität in einem, entsprungen ist, gut und gerecht; in der Notwendigkeit des geschichtlichen Verlaufs rechtfertigt, d.h. reinigt, heilt und korrigiert sie diesen.
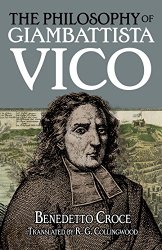 Als tief einem in der Tradition verwurzelten Katholiken fehlte Vico jeder Begriff von „Fortschritt“. Trotzdem beinhaltet seine „Neue Wissenschaft“ eine intensive Auseinandersetzung mit dem Aufstieg und Verfall der Völker und Nationen. Nach Vico liegt der Anfang der Völker in einem dunklen Heroenzeitalter. Dies ist gekennzeichnet durch barbarische Gefühlsausbrüche und körperliche Sinnlichkeit. Doch gerade dieses unmenschliche Zeitalter der rohen Gewalt und Barbarei ist ganz im Sinn der Vorsehung, und zwar zum Besten der Menschen: sie sind der Urkeim eines wahrhaft geselligen Zustandes, der erst ein menschenwürdiges Zusammenleben möglich macht. Obwohl Vico nicht mit groben Bezeichnungen für seine barbarischen Helden spart, behandelt er diese Vorzeit mit Liebe und Verständnis, ja sogar mit Sympathie für die „Riesen und Polypheme“, wie er die Barbaren nennt. Ihr Zeitalter ist das einer unschuldigen Jugend, reichlich ausgestattet mit Phantasie und ursprünglicher Schaffenskraft.
Als tief einem in der Tradition verwurzelten Katholiken fehlte Vico jeder Begriff von „Fortschritt“. Trotzdem beinhaltet seine „Neue Wissenschaft“ eine intensive Auseinandersetzung mit dem Aufstieg und Verfall der Völker und Nationen. Nach Vico liegt der Anfang der Völker in einem dunklen Heroenzeitalter. Dies ist gekennzeichnet durch barbarische Gefühlsausbrüche und körperliche Sinnlichkeit. Doch gerade dieses unmenschliche Zeitalter der rohen Gewalt und Barbarei ist ganz im Sinn der Vorsehung, und zwar zum Besten der Menschen: sie sind der Urkeim eines wahrhaft geselligen Zustandes, der erst ein menschenwürdiges Zusammenleben möglich macht. Obwohl Vico nicht mit groben Bezeichnungen für seine barbarischen Helden spart, behandelt er diese Vorzeit mit Liebe und Verständnis, ja sogar mit Sympathie für die „Riesen und Polypheme“, wie er die Barbaren nennt. Ihr Zeitalter ist das einer unschuldigen Jugend, reichlich ausgestattet mit Phantasie und ursprünglicher Schaffenskraft.
Sind es auch Barbaren, so sind sie doch edelmütig und aufrichtig bei aller Gewalttätigkeit. Indem sie ihr zyklopisches Heroenrecht gegenüber anderen Barbaren und, vor allem, den nichtheroischen Schwachen durchsetzten, wurden sie zu Stiftern der Zivilisation. Die Schwachen machten sie sich unterwürfig, nahmen sie in ihre Obhut und gewährten ihnen so ein erträgliches Dasein.
Den weiteren Fortschritt der Kultur zeichnet Vico, hauptsächlich anhand der römischen Geschichte, als eine Folge von Kämpfen, Klassenkämpfen und Bürgerkriegen, zwischen Adligen und Niedriggeborenen, einheimischen Patriziat und fremdstämmigen Plebejern. Nach jedem dieser Kämpfe kommt es zu einem Ausgleich, der immer mehr diese „Gemeinen“, die für Vico die eigentliche Menschheit ausmachen, begünstigt. Dadurch, dass die Plebejer in der Geschichte gegenüber den sich immer mehr weibischen Adligen an Boden gewinnen, wird die mildeste und den Schwachen gemäße Zeit eingeläutet: das „menschliche Zeitalter“. In diesem sichert ein rechtlicher Zustand den Schwachen das Dasein, die „Gesellschaft“ – im Gegensatz zur Gemeinschaft. Auch die Regierungsformen ändern sich während dieses Prozesses: die Aristokratenrepublik, bestehend aus Heroennachkommen, weicht dem demokratischen „Volksstaat“, welcher am Ende in einen Cäsarismus bei bloß „sozialer“ Demokratie ausläuft.
Die gesellschaftliche Entwicklung geht dabei vom Notwendigen zum Nützlichen. Darauf folgen nacheinander das Bequeme, das Gefällige und, schließlich, der völkerverderbende Luxus. Die „humanen Zeiten“ sind nicht dazu bestimmt, eine den Leuten zuträgliche demokratische Staatsform zu stabilisieren. Nach Vico wissen die „Menschen“ mit ihrer Sicherheit und ihrem Wohlsein nichts Besseres anzufangen, als sich immer mehr in ihrem Eigennutz und ihrer Genussucht gehen zu lassen.
Auch ihren hochentwickelten Verstand benutzen sie nur zu Falschheiten – zur Gemeinheit und Niedertracht. Entgegen den Behauptungen eines Forschers zeigt Vico überhaupt kein besonderes Interesse an der „Demokratie“, sondern sieht diese nur in ihrer geschichtlichen Notwendigkeit und Bestimmung in Egoismus und Unrecht umzuschlagen. Auf sie folgt wieder der ungesellige Zustand, es wird unerträglich für alle. Wegen dieser unerträglichen Ungerechtigkeit des Daseins legt nun die Vorsehung bei der idealen ewigen Geschichte als einem obersten Weltgericht „Berufung“ – ricorso – ein.
Drei Möglichkeiten sind es nun, die sich dabei auftun: 1. Der Retter kommt, gleich Oktavian-Kaiser Augustus, aus den eigenen Reihen. Es ist die cäsarische Lösung. 2. Es kommt ein fremder Eroberer, der über die erwiesenermaßen sich selbst zu regierenden Unfähigen herrscht – zu ihrem eigenen Besten. 3. Es ist zu spät, die zivilisatorisch überfeinerte Gemeinheit und die Barbarei des Verstandes gehen so lange weiter, bis die Völker sich total heruntergebracht haben. Hier greift nun die Vorsehung rettend ein und gewährt der Menschheit nach all dem Schmerz und Unrecht eine zweite Chance – ein neues Mittelalter bricht an. Nur dieser völlige Rückfall in eine ganz ursprüngliche und gewalttätige Barbarei, wie die, die das Mittelalter ermöglichte, ist in der Lage, die zivilisierte Menschheit zu läutern und von sich selbst, als einem leidigen Übel, zu kurieren.
00:05 Publié dans Philosophie, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : giambattista vico, oswald spengler, philosophie, révolution conservatrice, italie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

 J.R. - Je tiens Nietzsche pour une paire de lunettes. Il est, pour moi, avant tout une façon de regarder le monde. Une grille de lecture. Un filtre d'exactitude et, surtout, de sincérité. C'est s’entraîner à percevoir ce qui se mue et s'agite autour de soi en se débarrassant des grilles de lectures morales (le bien et le mal) ou idéalistes (au sens de la primauté de l'Idée). C'est donc regarder les choses et les hommes par delà bien et mal, par le prisme des valeurs aristocratiques ou des esclaves (le sain et le malade, le bon et le mauvais), en s'attardant plutôt sur la psychologie, et en fin de compte, la physiologie (l'importance du corps comme heuristique de l'esprit) pour comprendre les idées d'un homme, au lieu de se mentir sur la capacité « raisonnante » et abstraite des humains. Et c'est aussi sentir profondément ce qui appartient au nihilisme, au déclin, au mensonge vénéneux, à la maladie et à la mort, plutôt qu'à la vie, à la grande vie et l'immense « oui » qui va avec.
J.R. - Je tiens Nietzsche pour une paire de lunettes. Il est, pour moi, avant tout une façon de regarder le monde. Une grille de lecture. Un filtre d'exactitude et, surtout, de sincérité. C'est s’entraîner à percevoir ce qui se mue et s'agite autour de soi en se débarrassant des grilles de lectures morales (le bien et le mal) ou idéalistes (au sens de la primauté de l'Idée). C'est donc regarder les choses et les hommes par delà bien et mal, par le prisme des valeurs aristocratiques ou des esclaves (le sain et le malade, le bon et le mauvais), en s'attardant plutôt sur la psychologie, et en fin de compte, la physiologie (l'importance du corps comme heuristique de l'esprit) pour comprendre les idées d'un homme, au lieu de se mentir sur la capacité « raisonnante » et abstraite des humains. Et c'est aussi sentir profondément ce qui appartient au nihilisme, au déclin, au mensonge vénéneux, à la maladie et à la mort, plutôt qu'à la vie, à la grande vie et l'immense « oui » qui va avec.
00:05 Publié dans Entretiens, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : entretien, philosophie, nietzsche, julien rochedy |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Tous les esprits obsessionnels et/ou enthousiastes (l’un ne va pas forcément de pair avec l’autre) sont d’essence manichéenne. Ils se différentient très fortement de ceux qui ne partagent pas leur conviction, intensément vécue, assimilée à La Vérité. La distinction entre « eux » et « nous » tourne très facilement à l’alternative « eux » ou « nous ». C’est l’essence même du phénomène totalitaire, vieux comme l’humanité, infiniment plus répandu qu’on ne le croit. Tout le monde l’aura compris : le suffixe « - isme » indique l’exposé d’une doctrine, qu’elle soit d’inspiration (ou « d’essence ») religieuse, politique, scientifique ou artistique.
A – Le Totalitarisme n’a rien de spécifiquement moderne !
C’est, par définition, un État où le détenteur de l’autorité exige l’obéissance absolue de ses ouailles, en « totalité », c’est-à-dire non seulement dans leur corps (travail, service armé, participation à la vie sociale), mais aussi de leur esprit (par une idéologie officielle imposée au peuple sous la forme d’une pensée unique)… voire de leur « âme » pour ceux qui croient en une ou plusieurs divinités. Toutes les théocraties anciennes (soit les civilisations où le monarque était réputé « de droit divin » ou était lui-même souverain pontife du culte officiel) ont été des totalitarismes au même titre que le communisme, le fascisme ou le nazisme, et si les musulmans sunnites parviennent à s’accorder sur la personne d’un nouveau calife, celui-ci deviendra un potentat de droit divin, absolu s’il cumule les fonctions de sultan (chef politico-militaire).
Le totalitarisme est une manière d’envisager la domination des êtres humains. Il est indépendant du type de régime politique : le Pouvoir peut appartenir à un seul homme, dictateur omnipotent, à deux hommes ou à un consortium d’hyper-capitalistes. Il peut être fondé sur une foi, sur le culte de l’État ou de la race, sur un dogme économique et/ou social.
Le dictateur (si l’on préfère : l’autocrate) dirige lui-même :
- l’Exécutif, soit le pouvoir qui fait respecter les lois et la puissance de l’État : administration, fiscalité, polices généralement nombreuses et très puissantes, armée, prisons, relations étrangères
- le Législatif, en décidant seul des lois, avec ou sans la fiction d’un parlement à sa botte ; il n’existe en totalitarisme moderne qu’un parti unique, ce qui procure au despote des élections sans surprise
- le Judiciaire (même remarque que pour le parlement : des magistrats vautrés devant le maître ou convaincus sincèrement de son génie)
- l’Économie, étatisée, dans le cas du marxisme, ou plus ou moins fermement dirigée, dans les régimes populistes
- la Propagande, soit l’information domestiquée : les médias, qui vont du ministre de l’Information aux « réseaux sociaux », en passant par la presse, la radio, le cinéma et la télévision, les organismes culturels et les « sociétés dépensées », voire un clergé aux ordres ; la jeunesse est l’objet d’un endoctrinement spécifique dans un espoir, assez rarement vérifié, d’assurer la pérennité du régime
- le Spirituel, enfin. C’est un peu plus rare, mais cela fut le cas sous l’Empire romain préchrétien où l’Imperator était aussi Pontifex Maximus et dans les États pontificaux jusqu’en 1871 où le pape était souverain au temporel comme au spirituel. Dans les dictatures communistes, ce pouvoir était soit serf – ce fut le cas, en URSS, sous Staline et successeurs à partir de 1941 – soit hors la loi, au Mexique dans les années 1925-35, ou en Chine maoïste.
Un totalitarisme à deux dirigeants peut exister si le souverain temporel et le souverain spirituel s’entendent. Ce fut le cas, au Japon, des Shogun (maîtres militaires et politiques) et des Mikado (empereurs et chefs du culte shintoïste), jusqu’à la révolte de l’empereur Meïji en 1867, ainsi qu’au Tibet, où coexistaient le pouvoir politico-militaire du Panchen Lama et le pouvoir spirituel et intellectuel du Dalaï Lama jusqu’à l’invasion chinoise de 1950.
Une démocratie, parlementaire ou présidentielle, peut devenir un totalitarisme en cas de guerre : ce fut le cas de la France de 1914 à 1918, des USA et de la Grande-Bretagne durant la Seconde Guerre mondiale (suspension des libertés individuelles ; économie dirigée ; justice sommaire et enfermement des suspects ; information transformée en « bourrage de crânes »).
D’une manière générale, il est difficile d’instaurer un totalitarisme quand le ou les maîtres de l’Économie, des médias et de la politique doivent coexister avec un maître spirituel. On n’y parvient qu’en domestiquant l’un ou l’autre. Ce fut l’origine des querelles médiévales entre les papes et les rois ou empereurs ; la coexistence n’était pacifique que si le pape était faible ou si les rois tremblaient devant l’éventualité d’une excommunication personnelle ou de la mise en interdit du royaume. De nos jours, les chefs spirituels pratiquent généralement une grande souplesse, largement rétribuée, face au vrai pouvoir : l’économique. Notre société mondialiste, dans laquelle tous les médias officiels racontent la même histoire sous des apparences un peu diversifiées, sont des totalitarismes de fait, où seule la fantaisie de l’électeur peut se manifester, à échéances fixes, en hissant à l’apparence du pouvoir le groupe de pantins à la mode du jour, qui ne sera probablement pas celle de la prochaine élection. Que les polichinelles soient de droite, du centre ou de gauche, ils font tous la même politique, quelle que soient leur propagande électorale : tous obéissent aux vrais potentats.
Ceux-ci, qui sont les patrons de l’Économie, subventionnent tous les partis susceptibles d’obtenir une majorité ou de former une coalition gouvernementale. La mondialisation est l’uniformisation de la politique et de l’information dans les États où règne l’économie globale (délocalisations des entreprises et des services vers des régions de bas salaires et de minime protection sociale, sauf pour les productions qui exigent des salariés hautement intellectualisés)… donc États dinosaures marxistes et fantaisistes islamistes exclus. Les maîtres de notre monde monnaient la complaisance des chefs spirituels (ou font déposer les réfractaires : le cas de Benoît XVI, opposé à l’accueil généreux par la Banque vaticane de l’argent mafieux, fera peut-être école). Leur unique souci actuel est représenté par le Net qui demeure difficile à censurer.
Le risque de cette mondialisation-globalisation est le retour du marxisme, par désarroi de peuples exploités, paresseux et abrutis par la propagande et l’alcoolisme : le marxisme est « soluble dans l’alcool », on le sait depuis fort longtemps, mais les Occidentaux ne l’ont découvert qu’en 1968. Le cas grec risque, lui aussi, de faire école, où un peuple se refuse à régler ses dettes extérieures, accumulées par un régime de démagogues, conseillés par des requins d’affaires… c’est le commencement, non de la sagesse, mais du populisme.
Les doctes universitaires (presque tous issus de la riche bourgeoisie) qui ont savamment disserté sur le « phénomène totalitaire » sont tous passés à côté de l’essentiel, ayant insisté lourdement sur la répression policière (très inégale, en fait, selon les États) et omis l’enthousiasme populaire, généralement né du charisme du chef de l’État (ce fut évident pour Mussolini, Hitler, Kemal Atatürk ou Perón, voire Mao Tsé-toung). Cet enthousiasme était le meilleur soutien de ces régimes, jusqu’à la déréliction finale, liée à une guerre perdue (fascisme, nazisme), à une catastrophe économique (communisme), à l’intervention massive des services secrets US (pour le Péronisme) ou au retour en force de l’islam, dans son fanatisme premier. Il ne s’agit nullement d’un « délire collectif », mais d’un rêve : bâtir un monde nouveau, fonder de nouvelles relations sociales, redonner vie à un Empire. Ce ne peut être qu’un mouvement de jeunes, non encore désillusionnés !

B – Le modernisme est une doctrine très floue
Il est née durant la Grande Guerre (un peu avant pour sa part artistique, qui, seule, fut durable, mais a passé initialement pour accessoire), au contact de l’effarante guerre de matériel, au cours de laquelle l’homme avait perdu sa position d’étalon de mesure. De 1914 à 1918, on fit la guerre avec du « million d’hommes » et des tonnes d’explosifs, avec des chars d’assaut, des avions de combat volant à 100 voire 200 km/h, des sous-marins. Et tout cela parut neuf, provoquant chez les survivants un engouement pour la modernité.
Le culte de la vitesse et de la masse naquit de façon parallèle à la reconnaissance de la fin de l’efficacité de l’individu (sauf position exceptionnelle, mais même un pilote de chasse, prototype du guerrier solitaire moderne, a besoin d’une énorme logistique pour effectuer ses exploits).
Le modernisme, c’est aller plus vite et plus haut, frapper plus fort, construire davantage, produire plus et différemment, grâce à une rationalisation du travail. Le pétrole et l’électricité – déjà bien utilisés avant 1914 – deviennent des matières premières essentielles, à obtenir en énormes quantités et le moins cher possible, au besoin par des guerres à motif économique. Débute également le règne des produits artificiels, nés du génie chimique. Commence surtout la société de consommation envisagée comme le nec plus ultra (la « course au standing de vie » et au confort pour tous) chez les Nord-Américains et les Occidentaux à leur traîne. C’est l’aspect du modernisme qui est renié par les idéalistes nationalistes qui veulent adapter le monde industriel au culte de l’État, né en France au XVIIe siècle (sous Louis XIV) et rationalisé en Prusse aux XVIIIe (Frédéric II) et XIXe (Fichte, Hegel) siècles… et, pour certains, le culte de la race (nazisme ; mouvements panslave, panarabe, pantouranien, de « la plus grande Asie » etc.).
Les populistes y ajoutent une idée de justice sociale : minimum de protection sociale (l’application est également prussienne, mais date des années 1880-90, grâce à Bismarck, puis à Guillaume II – pourtant présentés comme des « réactionnaires » par les universitaires, alors qu’ils furent d’assez performants « despotes éclairés »), et meilleurs salaires (ce fut la grande idée de l’entrepreneur populiste des USA Henry Ford, judéophobe acharné jusqu’à ce qu’il fasse sa soumission, en 1926, à la finance omnipotente).
Le modernisme, c’est aussi libérer les êtres de la tutelle du clergé, lorsqu’il est jugé rétrograde, mais ce n’est nullement bafouer la morale universelle, que l’on peut nommer l’éthique : ne pas voler ni violer ; ne pas tuer, sauf cas de légitime défense ; aider et protéger les faibles qui le méritent ; s’occuper de sa famille ; faire honnêtement son travail etc. Le travail féminin entraîne une diminution de la fécondité, un accroissement des divorces et des avortements de complaisance, chez les femmes insatisfaites pour toutes sortes de raisons qui ne sont pas exclusivement d’ordre sexuel ; la psychanalyse, l’une des plaies du XXe siècle, a fait errer un nombre ahurissant de « penseurs » sociaux. Les régimes modernistes vont s’opposer sur ces points, selon qu’ils sont populistes (favorables au boom démographique, donc luttant contre les avortements et limitant les divorces aux seuls cas de force majeure) ou marxistes (très permissifs, voire partisans de « l’amour libre »…
On peut affirmer, sans trop de risque de se tromper, que le modernisme est la réactualisation, grâce à l’industrie et aux moyens nouveaux de communication des êtres et des idées, du « despotisme éclairé » du siècle (autoproclamé en toute modestie) des Lumières… « Il n’est rien de nouveau sous le soleil », soupirait, trois siècles avant notre ère, le rédacteur de l’Ecclésiaste.
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, philosophie politique, théorie politique, modernité, totalitarisme, sciences politiques, politologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

When socialism finally collapsed all around the world in the late ‘80s/early ‘90s the academic Marxists did not just throw in the towel and face reality. Indeed, not one of them has ever apologized for providing intellectual support for some of the worst mass murderers in world history – Stalin, Mao, Castro, and the rest of the communist/socialist gangsters. Instead, they reinvented themselves in several different ways, including posing as “environmentalists,” and as “cultural Marxists.”
Taking their cue from socialist economist Robert Heilbroner in a September 10, 1990 New Yorker article entitled “After Communism,” many Marxists began promoting socialist central planning of the economy and of society as a whole (a.k.a. totalitarianism) in the name of “saving the planet” from capitalism. The old Marxism was sold in the name of “the people”; the new Marxism said “to hell with people, we’re for the ants, the lizards, snakes, rocks, trees, etc. – Mother Earth. People Schmeople. Hence the “watermelons” were born: green on the outside, red on the inside.
The cultural Marxists take a different approach. They replaced the Marxist theory of class confict between the capitalist “class” and the working class with a new set of classes. Now the supposed eternal conflict is between an “oppressor” class and an “oppressed” class. In essence, the oppressor class consists of white heterosexual males. The oppressed class is everyone else. Armed with this new totalitarian ideology, egalitarianism is still the secular religion of the academic Marxists, with “diversity” being the mating call of the modern academic administrator.
Now that the cultural Marxists are in charge of so many colleges and universities, they no longer even pretend to defend academic freedom and free speech. Silencing dissenting opinions (to Marxist totalitarian ideology) is now taught to students as the only moral position. One of their gurus is the Marxist intellectual Herbert Marcuse, who has been called “the evangelist of cultural Marxism.” He is of course a “celebrated intellectual” who has taught at Harvard, Yale, and Columbia Universities. Marcuse first became famous among academics in the 1950s with his book, Eros and Civilization, in which he advised young people to “don’t work, have sex.” (It apparently never occurred to him that the two things are not necessarily mutually exclusive). This was in keeping with the hoary Marxian theme that all work is slavery.
Marcuse also taught that science and the scientific method is “the enemy” for it “denies the reality of utopia,” by which he meant communism. In today’s world, we see this same idea expressed by the watermelon socialists when they use the quintessentially unscientific language of “settled science” in reference to the global warming hoax. Science is never “settled.” If it were, it would still be “settled science” that the world is flat. Settled science watermelons like Al Gore are the new flat earthers.
Marcuse also opposed freedom of speech, which he said was a tool of “the oppressors” since it was responsible for too many criticisms of communism. “There is no need for logic, debate and free exchange of ideas,” he said, for communism supposedly “provides all the answers.” Certainly libertarian or conservative views should not be permitted on campuses since they support “the status quo.”
Only the “oppressed classes,” as defined by the cultural Marxists, deserve tolerance, preached Marcuse; all others deserve intolerance, and students must be indoctrinated in this thinking, he said. All of these things are now, and have been for a long time, common features of academe.

In addition to Marcuse, the work of law professor Catharine McKinnon, the high priestess of cultural Marxism, also inform today’s university administrators and their cultural Marxist faculty. Dissenting views (to their verision of totalitarian Marxism) threaten to create a “hostile work environment,” she says. And if the work environment becomes so hostile that it interferes with work effort, the source of the “hostility” should be fired. Thus, if a libertarian or conservative academic should somehow sneak by the university interviewing committee and become employed, and then reveal himself to be a dissenter, he can always be fired – even if he has tenure – under the guise of having created a “hostile work environment” with his dissenting views about free speech, the Constitution, free-market exchange, or Heaven forbid, gun ownership.
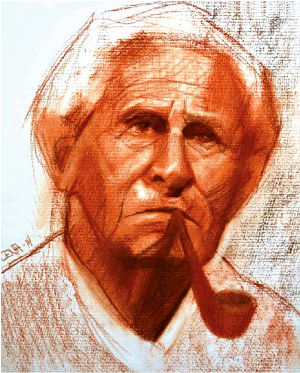 According to Catharine McKinnon, the new mantra that should be taught to children is: “Sticks and stones may break my bones, but words are infinitely worse.”
According to Catharine McKinnon, the new mantra that should be taught to children is: “Sticks and stones may break my bones, but words are infinitely worse.”
Cultural Marxist academic administrators lie through their teeth when they make speeches or write articles in the university alumni magazine praising academic freedom. They are lying because they supervise a strict censorship of dissenting views at the same time. One method that is used to achieve this is to declare that “insensitivity” and “hurt feelings” are caused by dissenting campus speakers. For example, when Dr. Walter Block was maliciously libeled by the president of Loyola University Maryland, one Brian Linnane, several years ago, the mechanism of libel was textbook cultural Marxism: the Marxists on campus sent one student to Dr. Block’s invited economics lecture with instructions to complain to them later that something he said was “insensitive.” Brian Linnane then sent an email to all students, staff, faculty, and alumni apologizing for the “insensitive” remark while never mentioning what the remark was. In fact, what Dr. Block said was a very mainstream idea in economics –that wage discrimination based on gender or race penalizes discriminating employers in a free-market economy. It does so by providing a profit opportunity for the discriminating employer’s competitors. For example, if in my accounting firm I discriminate against a woman who generates say, $100,000/year in revenue for me by paying her $50,000/year while paying equally-productive male employees $90,000/year, a competitor can hire her away for say, $60,000 and make $40,000 in profit. Eventually, I will be left with all higher-paid male empoyees which will reduce my profitability. The same story goes for employer discrimination based on race.
The cultural Marxist mantra, on the other hand, is that capitalist America is such a hopelessly racist and sexist society, that only the “legacy of slavery” and the white male “war on women” are permissible on college campuses as the one and only causes of male/female or black/white wage differences. Anyone who shows up on a college campus who says otherwise is not to be debated with logic and facts, as Marcuse said, but libeled, smeared, and called a racist and a sexist.
Most American colleges and universities take their cues from the Ivy League schools, such as Brown University. According to a March 21, 2015 article in the New York Times, the cultural Marxists at Brown set up a “safe room” whenever a renegade student organization invites a non-Marxist speaker to campus. These rooms are filled with cookies, coloring books, Play-Do, calming music, pillows, blankets, videos of frolicking puppies, and “trauma experts” according to the Times. This is the business that most American colleges and universities are in these days: the infantilization of college students. Faculty are instructed to place “trigger warnings” on their course syllabi warning students that a disseting (to cultural Marxism) opinion may be found there. Safe rooms are set aside just in case. Students are routinely taught to boycott or disrupt any campus speakers who dissent from cultural Marxist orthodoxy, and to participate in vicious, malicious campaigns of character assassination orchestrated by faculty and administrators.
Cultural Marxism may be bred in academe, but it has spread throughout society. When Rush Limbaugh attempted to become part owner of an NFL team the cultural Marxists lied, as they routinely do, by spreading the false rumor that he “defended slavery” on his radio program! When the American Enterprise Institute in Washington, D.C. sponsored a public debate on immigration policy, something Americans have been doing since the Louisiana Purchase, inviting both sides to air their views, the hardcore left-wing hate group, the Southern Poverty Law Center (SPLC), accused AEI of “mainstreaming hate.” The SPLC routinely conflates mainstream organizations like AEI with say, the KKK, by using the same language of “hate” and “hate group” to describe all of them.
When Rand Paul first ran for the U.S. Senate the SPLC issued a “report” on “dangerous characters” running for state and local political office. Next to a photo of a genuinely crazy-looking neo-Nazi from the mountains of Idaho was, naturally, a photo of Rand Paul. When a group of military, police, and firefighters pledged their devotion to the U.S. Constitution by creating the group, Oathkeepers, the SPLC also branded them as a “hate group.” And when Ron Paul was running for president the SPLC talked the Department of Homeland Security into issuing a public warning that people with “Ron Paul for President” bumper stickers were potential “terrorist threats.”
The heavy-handed, totalitarian censorship that now exists on most American college campuses is so ingrained that comedians Chris Rock and Jerry Seinfeld no longer perform on college campuses. Too many students have been turned into dour, humorless, left-wing cultural Marxist scolds in the image of their professors and university administrators. One thoroughly-brainwashed twenty-year-old even wrote a letter to Seinfeld, whose comedy television show was the most successful in all of television history, on the “proper” way to perform a comedy routine.
In his famous book, The Road to Serfdom, F.A. Hayek presciently described the effects of this kind of censorship under totalitarianism in a chapter (11) entitled “The End of Truth.” Such propaganda in a totalitarian society is “destructive of all morals,” wrote Hayek, because “it undermines one of the foundations of all morals; the sense of and the respect for the truth” (emphasis added). Moreover, “in the disciplines dealing directly with human affairs and therefore most immediately affecting political views, such as history, law, or economics, the disinterested search for truth cannot be allowed in a totalitarian system . . . . These disciplines have . . . in all totalitarian countries become the most fertile factories for the official myths which the rulers use to guide the minds and wills of their subjects.” This of course is what cultural Marxism and political correctness are all about: spreading Official Myths to promote a totalitarian, socialist society.
“The word truth itself ceases to have its old meaning” in such a society, wrote Hayek, for “It describes no longer something to be found, with the individual conscience as the sole arbiter of whether in any particular instance the evidence warrants a belief; it becomes something to be laid down by authority. . .” and “intolerance is openly extolled.” Herbert Marcuse could not have said it better.
This article is based on a speech delivered at the Mises Circle in Ft. Worth on October 3, 2015.
00:05 Publié dans Actualité, Ecole/Education | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : école, éducation, université, étudiants, marxisme culturel, théorie politique, sociologie, philosophie politique, philosophie, école de francfort, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

por Manuel Fernández Espinosa
Ex: http://culturatransversal.wordpress.com
La insustancialidad del pacifismo rebañego
El pacifismo viene definido por el diccionario de la RAE como: “Conjunto de doctrinas encaminadas a mantener la paz entre las naciones”. Pero esas doctrinas de las que se nutre el pacifismo son muy variadas y es por ello que me propongo hacer una inspección sobre este asunto.
Aunque se pueden traer a colación muchos antecedentes del pacifismo diremos que el pacifismo tiene una médula religiosa, como vamos a tener ocasión de ver abajo. Sin embargo, en un occidente desacralizado, el pacifismo que se estila prescinde de esta dimensión religiosa, ofreciéndose una versión apta para todos los públicos, sin que comporte mayor compromiso que la escenificación más o menos patética de un deseo de paz evanescente.
A falta de un compromiso real que sí puede encontrarse de forma plena en lo religioso hasta el “heroísmo pacifista” (sea la religión que sea), el “pacifismo” occidentalista no deja de ser una ideología que sirve como instrumento de dominio de masas. Su funcionalidad está desnaturalizada y no deja de ser un recurso que el poder económico y político emplea a su conveniencia. Y el mecanismo que este “pacifismo rebañego” sigue es tan simple como lo podemos ver en no pocas de sus manifestaciones de la historia más reciente.
Image: Gandhi en Italie dans les années 20, conversant avec des jeunes garçons du mouvement "Balilla"
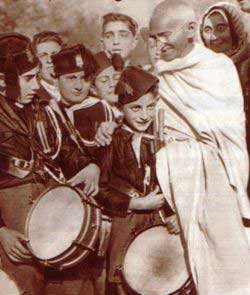 Un suceso trágico de índole bélica impacta en la opinión pública, mediante los medios de intoxicación de masas (llamarle “medios de comunicación” sería convertirse en cómplices de las conspiraciones del poder), inmediatamente se desencadena un efecto sobre las masas, recogiéndose lo que se había calculado recoger: lo mismo la adhesión masiva a una intervención militar que la recepción de “refugiados”. El pacifismo fue empleado magistralmente por el comunismo soviético que, durante la Guerra Fría, lo exportó a sus sucursales en todos los países que permanecían bajo la férula estadounidense: se minaba así la combatividad de la opinión pública de los países capitalistas y se neutralizaba cualquier esfuerzo bélico procedente de los gobiernos. Dábase el caso paradójico de que, mientras en occidente los comunistas reclamaban la “paz”, los países comunistas seguían rearmándose. La lección ha sido aprendida por las demás potencias, independientemente de su signo político.
Un suceso trágico de índole bélica impacta en la opinión pública, mediante los medios de intoxicación de masas (llamarle “medios de comunicación” sería convertirse en cómplices de las conspiraciones del poder), inmediatamente se desencadena un efecto sobre las masas, recogiéndose lo que se había calculado recoger: lo mismo la adhesión masiva a una intervención militar que la recepción de “refugiados”. El pacifismo fue empleado magistralmente por el comunismo soviético que, durante la Guerra Fría, lo exportó a sus sucursales en todos los países que permanecían bajo la férula estadounidense: se minaba así la combatividad de la opinión pública de los países capitalistas y se neutralizaba cualquier esfuerzo bélico procedente de los gobiernos. Dábase el caso paradójico de que, mientras en occidente los comunistas reclamaban la “paz”, los países comunistas seguían rearmándose. La lección ha sido aprendida por las demás potencias, independientemente de su signo político.
El pacifismo de las religiones de extremo oriente
Prevalece una enorme ignorancia en cuanto a las religiones y no parece que nadie quiera remediarla. Es por ello que se tiende a generalizaciones totalmente equivocadas. Se ha llegado a admitir una clasificación de las religiones en:
Religiones violentas.
Religiones pacifistas.
Entre las religiones violentas, el Islam y el Cristianismo cargan con la peor de las famas: el Islam por su “yihad” y el Cristianismo por sus “Cruzadas” de antaño. Y esto se hace con el máximo desdén intelectual hacia la complejidad que podemos hallar tanto en el Islam (sunnitas y chiítas) como en el cristianismo (protestantes, ortodoxos y católicos). Por ser enormente problemático, este tema lo dejamos a un lado, para centrarnos en el “pacifismo religioso” que es el que nutre al “pacifismo rebañego”. Éste, el rebañego, tiene una imagen parcial de la realidad de las religiones consideradas como “pacifistas”, las de Extremo Oriente y, como es de esperar, no actúa en consecuencia como sí que actuaron los grandes ejemplos del “pacifismo religioso”, el mismo ejemplo que -sin “religión” y degradado a icono o eslogan publicitario- reclama para sí.
Las religiones del Extremo Oriente son conceptuadas como “pacifistas”, lo que muestra el abrumador desconocimiento que el occidental tiene de las mismas.
He dicho más arriba que el pacifismo, en efecto, es de índole religiosa. Puede verse en sus dos figuras mundialmente más representativas: Lev Tolstoi y Mahatma Gandhi. Gandhi ha sido convertido en un icono del pacifismo rebañego, prescindiéndose de sus motivaciones y, por supuesto, sin animar a nadie a reproducir el ejemplo de su determinación.

Gandhi y la “Ahimsa”
Mahatma Gandhi (1869-1948) empleó el pacifismo por razones estrictamente religiosas, sin dejar por ello de perseguir una finalidad política: luchar incruentamente por expulsar a Gran Bretaña de la India y alcanzar la independencia de su nación. Y este pacifismo gandhiano nunca fue obstáculo para que Gandhi admirara a Benito Mussolini y al fascismo italiano (algo que ignora la mayoría de pacifistas de rebaño). Es cierto que Tolstoi ejerció una formidable influencia sobre el pensamiento de Gandhi, pero la inspiración de Gandhi no hay que encontrarla en el “El Reino de Dios está en Vosotros” de Tolstoi, sino en el concepto religioso y filosófico de la tradición india: la “Ahimsa”. Y aquí debemos aclarar un poco la procedencia de este término sánscrito.
La “Ahimsa” suele traducirse como “no-violencia”, pero sería más apropiado traducirlo como “no hacer daño”. Puede encontrarse en los textos de la “Upanishads”, pero la “Ahimsa” fue asimilada por algunas modalidades del hinduísmo, del budismo y del jainismo. Sin embargo, es tal el desconocimiento de las diversas tradiciones de Extremo Oriente que se considera que todo el hinduísmo, todo el budismo y todo el jainismo la acepta con el mismo rigor. Eso ha dado una imagen de “benevolencia” (muy buen rollo) a estas religiones que está muy lejos de hacerles justicia.
Ahimsa en el hinduísmo
Estas tres religiones son tan antiguas como para haberse ido complicando en su despliegue y su complejidad es más de la que puede sospechar el necio occidental, ese que se apresura a identificar hinduísmo y budismo con la “no-violencia”.
El hinduísmo fue el suelo sobre el que surgieron tanto el budismo como el jainismo. Pero en el hinduísmo la “Ahimsa” no puede entenderse como un concepto permanente en el tiempo ni tampoco generalizado socialmente, dado que la doctrina de las “varnas” (las castas) establece con claridad meridiana que la sociedad hindú se halla estratificada en cuatro órdenes sociales con obligaciones y derechos muy distintos: los brahmanes, los ksatryas (guerreros), los vaisyas (mercaderes) y los siervos (sudras). Atendiendo a la segunda de las castas hindúes vemos que esta religión antiquísima admite la función militar como algo necesario para la defensa de la sociedad. A lo largo de su historia, el hinduísmo ha manifestado que, si bien es cierto que existe una tendencia por el “no hacer daño”, la violencia es algo necesario. Lo vemos clamorosamente en el “Bhagavad Gita” (perteneciente al Mahabharata, aproximadamente siglo III a. C.) En el “Bhagavad Gita”, Krisna (avatar de Visnú) le dice a Arjuna (que duda si combatir a sus parientes):
“¿De dónde este decaimiento
te ha invadido en el riesgo,
impropio de un noble, que aleja del cielo,
que no trae gloria, oh Arjuna?
No vayas a caer en cobardía, hijo de Prtha.
Es algo que no es propio de ti.
La vil debilidad del corazón
arrojando lejos, yérguete, Destructor de enemigos”.
Krisna termina convenciendo a Arjuna de la necesidad de entrar en batalla y aniquilar físicamente a sus adversarios mediante la guerra, en la persuasión de que los muertos que siembre sobre el campo de batalla, bien mirado por encima del mundo de las apariencias, no mueren, puesto que se reencarnarán.
Según el cómputo de las edades que rigen para el hinduísmo, estamos (en nuestros presentes días) en el llamado “Kali Yuga” (la edad oscura) en que abunda la contienda, la ignorancia, la irreligión y el vicio y se vaticina en el hinduísmo que para dar fin al colmo de este exceso del mal vendrá otro avatar de Visnú, Kalki, que destruirá a los demonios para abrir la siguiente edad llamada “Satya Yuga”. Es interesante reparar en el asombroso parecido que muestra la iconografía del Kalki hindú con nuestro Santiago Matamoros.

Ahimsa en el budismo
El budismo que goza en occidente de tantas simpatías y una proyección considerable no puede tampoco decirse que sea pacifista en bloque. Si bien es cierto que la “Ahimsa” es el primero de los diez preceptos y el primer elemento de la disciplina moral, sería imposible comprender el fenómeno de los samuráis japoneses (budistas) si la “Ahimsa” fuese un precepto practicado en toda su radicalidad. Esto se debe al mismo despliegue del budismo que tan diversos frutos ha dado dependiendo del terreno sobre el que ha florecido, hasta tal punto que no puede decirse que el budismo zen o el budismo tibetano sean lo mismo, por mucho que participen de una base común. La tendencia occidental de considerar el budismo como algo “puro” es un error de enfoque. El budismo tuvo sus propios sincretismos allí donde aterrizó, como ocurrió con el Bön (chamanismo prebudista) tibetano y el shintoísmo japonés.
Ahimsa en el jainismo
Si hinduísmo y budismo son bastante desconocidos en occidente (ver una fotografía del Dalai Lama no es comprender el budismo tibetano, p. ej.), mucho más se ignora el jainismo, cuyo fundador Mahavira (llamado Jina, el Conquistador) fue contemporáneo de Buda. Los jainas están divididos desde el año 79 d. C. en “svetambaras” (tradición más relajada) y los “dighambaras” ´(los más estrictos) que practican el nudismo. Los jainas tienen, a modo de mandamientos, los Grandes Votos (mahavratas) para los religiosos y los Pequeños Votos (anuvratas) para los laicos y aquí la “Ahimsa” se estipula para ambos.
Gandhi encontró en su propia tradición la inspiración para su “Ahimsa”, elemento fundamental del “pacifismo” religioso de Extremo Oriente, pero -como podemos ver- se trata de una de las muchas vías que se proponen en el abigarrado y complejo mundo donde tienen arraigo aquellas religiones. Y, lejos de ser una actitud ampliamente generalizada, el pacifismo religioso es una vía muy particular, abrazada por algunos singulares personajes, no por la sociedad en su conjunto; lo que nunca se les ha ocurrido a los hindúes y budistas es practicar a rajatabla el “pacifisimo religioso”, pues ello, ante la amenaza de un enemigo violento, significaría el exterminio de sus feligresías.
Conclusión
El pacifismo puede dividirse, a nuestro juicio, en dos grandes clases:
-El Pacifismo religioso que nos merece todo el respeto en sus grandes figuras, algunas veces heroicas, pero que es un fenómeno bastante extraño incluso en las religiones que son consideradas como sustancialmente “pacifistas”.
-El Pacifismo rebañego que no es más que la occidentalización del pacifismo religioso, desustanciado y convertido en ideología que sirve a intereses políticos, sobre todo para dominar y debilitar a las masas. Y que no nos merece ningún respeto, como no nos lo merece cualquier cosa que ha dado esa perversión de la Cristiandad que se llama “occidente”.
Fuente: Raigambre
00:05 Publié dans Théorie politique, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : traditions, théorie politique, politologie, sciences politiques, philosophie, philosophie politique, politique internationale, pacifisme, bouddhisme, hindouisme, gandhi, gandhisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

par Jean-François Gautier
Ex: http://www.institut-iliade.com
La musique savante européenne est d’essence polyphonique. Cela signifie qu’elle conjugue au cours d’une même durée – d’exposition, ou d’écoute – plusieurs états sensibles superposés. Elle est la seule, dans l’ensemble des traditions musicales de la planète, à être ainsi construite. Elle retrouve en cela l’esprit du polythéisme antique, ressaisi à partir du XIII° siècle, et secondé par la mise au net d’une écriture solfégique des sons très précise.
L’antiquité hellénique distinguait neuf muses, autant de manières d’inspirer ou de styliser la profération des textes selon la matière traitée. Clio, avant de devenir la muse de l’Histoire, était celle qui inspirait l’épopée, narrée selon un certain type de mélodie et un certain type de rythme ; Érato inspirait la poésie amoureuse ; Euterpe prônait un autre type de poésie, à danser celle-là, avec d’autres mélodies et d’autres rythmes ; le domaine de Calliope était celui du « bien dire » ; celui de Thalie, le pastoral ; etc. Mais en ces temps-là, il n’était pas question de polyphonie.
On trouve un peu partout sur la planète des formes d’expression à deux ou trois voix, que l’on pourrait qualifier de polyphonies naïves, mais que la musicologie préfère qualifier d’hétérophonies. Il y a des hétérophonies corses, ou sardes ; il en existe aussi en Islande, en Géorgie, et dans le fond celtique qui, avec les cornemuses, superpose une basse constante et des variations mélodiques dans les aigus. Dans tous les cas, il s’agit de voix parallèles, sans guère d’autonomie et, d’une séquence à l’autre de la musique, elles sont reprises à l’identique comme dans les cantiques ou les chansons à versets et refrains : les différentes voix superposées y reviennent inchangées, répétées à l’infini, selon la quantité de paroles à chanter.
La polyphonie qui naît dans le chantier de Notre-Dame de Paris à la fin du XIIe siècle et au début du XIIIe siècle est d’essence toute différente. Elle suppose qu’ait été au préalable résolu un problème technique autour duquel tournent les pratiques monastiques depuis la fin du IXe siècle, et que l’on peut résumer ainsi : tout son est caractérisé par sa hauteur, sa durée, son timbre et son intensité ; mais comment écrire – c’est-à-dire comment transmettre – les deux premières caractéristiques, hauteur et durée, pour qu’elles puissent être reprises par d’autres que soi, à la seule lecture, autrement qu’en faisant travailler la mémoire ?
Deux chantres en activité dans Notre-Dame en construction, Léonin et Pérotin, résolvent progressivement ce double problème, en utilisant des lignes superposées (les futures portées) pour repérer des hauteurs de sons, et différentes formes de notes (les futures rondes, blanches, noires, croches, etc.) pour indiquer leurs durées. Ce faisant, ils libèrent la mémoire de l’apprentissage par cœur du répertoire ecclésiastique ; mais ils se donnent surtout les moyens d’écrire des chants à plusieurs voix étagées. La rénovation de la musique européenne est là, dans la capacité qu’elle acquiert de rédiger des architectures à plusieurs parties, exactement comme la peinture pouvait réaliser des scènes à plusieurs éléments, paysages, personnages, animaux, etc.
Il est à noter que ce souci d’écrire plusieurs voix superposées anime les musiciens au moment où, dans une civilisation encore marquée par des féodalités individualistes, jalouses de leurs indépendances, apparaît une idéologie politique qui va permettre d’unifier celles-ci. C’est le retour du vieux modèle trifonctionnel indo-européen, qui vise à faire coexister pacifiquement les fonctions sociales de ceux qui prient (oratores), qui se battent (bellatores) ou qui travaillent et produisent (laboratores). Un monde rénové apparaît, qui adopte la polyphonie comme sa manière propre de se réunir et de chanter.
A partir de cette époque, deux types de musiques vont être pratiqués. Dans les monastères, ceux des réseaux de Cluny et de Cîteaux, la musique est celle de la cantillation grégorienne à une voix, ou à deux voix parallèles. Cette musique-là ne vise pas une émotion esthétique comprise pour elle-même. Il s’agit plutôt d’une forme d’exercice spirituel, de travail du souffle et de la voix, permettant de progresser, de note d’appui (arsis) en note de repos (thésis), vers la contemplation du mystère théologal (incarnation, ou rédemption) qui est la vérité non de la musique mais du texte chanté.
Dans le chantier de Notre-Dame de Paris, la musique à plusieurs voix devient quant à elle autonome par rapport au texte. Plus que servir une vérité préalable, le compositeur est surtout préoccupé par la compatibilité mélodique et rythmique des chants proférés ensemble, qui participent de la même architecture. Les polyphonies nouvelles s’accordent en effet à l’agencement du vaisseau basilical, avec des montées et des descentes de voix, parallèles ou non, articulées autour de notes-pivots équivalant à des clefs de voûte, tandis que d’autres voix dessinent des arcades, des transepts, des claires-voies et toute autre figure magnifiant la nef en construction tout autant que la communauté diverse réunie à l’office.
Les travaux de Pérotin et de Léonin forment la matière d’un Magnus Liber Organi (« Grand Livre de chants ») dont des copies circulent à partir de 1215-1220 dans tous les grands chantiers gothiques de France et de Flandres (Senlis, Laon, Soissons, Amiens, Mons, Louvain, Beauvais, etc.). L’école franco-flamande prospère ainsi, puis exporte ses techniques en Europe centrale et du Nord. Celles-ci présentent le double avantage de libérer la mémoire d’un apprentissage difficile, surtout dans les chants à plusieurs voix, et conséquemment d’étendre indéfiniment le répertoire, au moins auprès de ceux qui, d’une part, auront appris à écrire les notes, et d’autre part à les lire.
L’école va ensuite essaimer vers l’Italie, restée à l’écart du mouvement gothique. Johannes Ciconia (v.1340-1411), un temps chanoine à Liège où il naquit, adapte les rigueurs de l’ars nova à la courbe mélodique italienne, tant à Padoue qu’à Florence ou à Venise. Son successeur Guillaume Dufay (v.1400-1474), né dans le Cambrésis, voyage lui aussi en Italie, attaché à la chapelle papale de Rome, puis à Florence et à Bologne avant de revenir à Cambrai. Il laisse une douzaine de Messes à trois ou quatre voix, dont une sur un thème de chanson profane, l’Homme armé, grand succès du XVe siècle, qui resservira dans toute l’Europe pour une quarantaine de Messes après la sienne, jusqu’au XVIIe siècle.
 Jean de Vaerwere, dit Johannes Tinctoris, né en 1435 à Nivelles, dans le Brabant wallon, affine en 1477 le règles de l’écriture à plusieurs voix dans un remarquable traité de contrepoint, Liber de arte contrapuncti, suivi de trois autres traités tous publiés en Italie, qui vont servir de référence. Son successeur picard Josquin des Prés, qui mourra à Condé-sur-l’Escault en 1541, passera lui aussi par Milan, la Sixtine romaine et Ferrare. La délocalisation franco-flamande est totale. D’Andrea Gabrieli (Venise) à Palestrina (Rome) en passant par Ingenieri (Crémone) ou Monteverdi (Mantoue), tous les grands maîtres italiens sont formés par des Nordiques.
Jean de Vaerwere, dit Johannes Tinctoris, né en 1435 à Nivelles, dans le Brabant wallon, affine en 1477 le règles de l’écriture à plusieurs voix dans un remarquable traité de contrepoint, Liber de arte contrapuncti, suivi de trois autres traités tous publiés en Italie, qui vont servir de référence. Son successeur picard Josquin des Prés, qui mourra à Condé-sur-l’Escault en 1541, passera lui aussi par Milan, la Sixtine romaine et Ferrare. La délocalisation franco-flamande est totale. D’Andrea Gabrieli (Venise) à Palestrina (Rome) en passant par Ingenieri (Crémone) ou Monteverdi (Mantoue), tous les grands maîtres italiens sont formés par des Nordiques.
L’art polyphonique construit avec eux, et pour l’oreille, un espace de pluralités audibles ensemble, même si l’auditeur ne les perçoit pas les unes les autres comme distinctement différentes. L’apport de cet art nouveau est décisif dans l’esthétique continentale. En même temps que des érudits comme Pic de la Mirandole ou Marcile Ficin diffusent par des traductions et des adaptations les grands écrits de l’antiquité polythéiste, les musiciens s’apprennent à bâtir des partitions dans lesquelles, comme sur l’Olympe, les voix divergentes ne sont pas tenues pour contradictoires mais, au contraire, conjuguées avec plaisir.
Cet art des voix combinées se double en Italie d’un art instrumental autonome, qui acquiert une liberté que l’école franco-flamande n’avait pas connue. Bientôt, ce sont les maîtres italiens qui vont initier leurs confrères européens aux nouvelles formes instrumentales et vocales développées dans la péninsule. Notamment l’opéra, un nouvel art théâtral et chanté (Orfeo, 1607) qui va parler en italien deux siècles durant dans toute l’Europe, même sur les scènes londoniennes.
L’art des pluriels conjugués ne cesse de plaire. L’Orfeo de Monteverdi (1607) dit en même temps bios et thanatos, la vie et la mort. La cantate BWV 60 de Bach (1723) chante de concert les deux motifs opposés de la crainte (Fucht) et de l’espérance (Hoffnung). La Symphonie Fantastique (1830) de Berlioz dit dans le même mouvement un Dies Irae et une ronde de Sabbat de sorcières. Désir (Eros) et Discorde (Eris) dominent le Tristan (1865) de Wagner. Dans la Mer (1905), Debussy combine des rythmes de houles, de vagues, de crêtes et d’écumes qui semblaient incompatibles. Tout ce polythématisme musical porte vers les sens l’émotion jamais résolue de la même énigme antique, celle de l’essentialité des contraires. Quelque chose comme Dionysos et Apollon racontés ensemble, tant ils sont inséparables. Ou Clio, Euterpe, Érato et Calliope conversant en chœur, sans tomber dans la cacophonie.
Le XXe siècle, après Ravel et Poulenc, inaugure une césure brutale d’avec cette tradition. La technique dite « dodécaphonique » prônée par nombre d’écoles modernes vise la maîtrise dogmatique de l’écriture plus que l’art des sensations sollicitées chez l’auditeur. Comme pour les installations en peinture ou les performances en sculpture, ou pour la mise en fonction d’une machine à laver, il devient bientôt indispensable de disposer au concert d’un mode d’emploi des œuvres. D’où le recours des mélomanes à une muséographie insensée, qui réactualise sans fin les œuvres du passé faute de disposer d’une actualité continuatrice de la vocation historique et artistique de l’Europe musicale.
Jean-François Gautier
00:05 Publié dans Musique, Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, musique polyphonique, polyphonie, philosophie, philosophie de la musique, musicologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Hervé Juvin : Le mur de l'Ouest n'est pas tombé
par webtele-libre
Hervé Juvin en conférence au Cercle Aristote le 15 juin 2015 pour la sortie de son ouvrage : Le mur de l'Ouest n'est pas tombé.
Retrouvez-nous sur www.cerclearistote.com
00:05 Publié dans Actualité, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hervé juvin, livre, philosophie, théorie politique, sciences politiques, politologie, philosophie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

par François-Bernard Huyghe
Ex: http://metapoinfos.hautetfort.com
Vous pouvez découvrir ci-dessous un point de vue de François-Bernard Huyghe, cueilli sur son blog, Huyghe.fr, et consacré à l'assaut des intellectuels dits "réacs" contre la doxa politico-médiatique et son refus du réel...
Réac attaque
Les intellectuels reviennent et par la droite. Ou plus exactement, pendant que la gendarmerie de la pensée (Libé, télé & co.) s'épuise à constater les dérapages et franchissements de ligne rouge, quiconque a le malheur de commettre un livre d'un peu de portée se voit aussitôt soupçonné de faire partie du complot réac. Comme si penser c'était désormais regretter. Dès 2002, la première alarme fut tirée par le livre de Lindenberg "Le rappel à l'ordre" : il s'inquiétait du succès d'une intelligentsia odieuse à ses yeux - Gauchet, Finkielkraut, Besançon, Houellebecq, Ferry, Muray, Lévy, Taguieff, Nora et d'autres. Il étaient coupables de nostalgie identitaire, de déclinisme. Ils présentaient les symptôme contagieux des phobies qui nous ont fait tant de mal - refus de l'évolution des mœurs, des droits de l'homme, du métissage, etc..
Treize ans plus tard, il suffit d'ouvrir n'importe quel hebdomadaire pour voir combien font débat chaque nouveau livre ou nouvelle déclaration des inévitables Debray, Onfray, Houellebecq, Finkielkraut, Michéa, Zemmour, sans oublier Renaud Camus, Elisabeth Lévy, Richard Millet, Olivier Todd, Christophe Guilluy, etc. ( gens dont nous convenons volontiers qu'ils ne pensent pas la même chose). Ils risquent le tribunal, du type ONPC où l'on commence par vous dire que vous êtes partout, que vous dominez le débat et que vous ne cessez de vous exprimer avant de vous reprocher la moindre ligne et de vous intimer de vous repentir. Et si possible de vous taire. Ou alors pour votre salut et repentance, vous devriez faire quelque opuscule propre à édifier les masses, tenir des propos antiracistes et pro-européens, exalter la mondialisation et la modernité, chanter l'Autre et le changement. Nous expliquer en somme que le monde tel qu'il est est le moins mauvais possible, employer votre énergie à une cause enfin courageuse et anticonformiste comme lutter contre le réchauffement climatique, Poutine, le Front National, la France crispée et le populisme, devenir de vrais rebelles, quoi!
Pour ne prendre qu'un exemple, au cours des deux dernières semaines Onfray, Debray, Finkielkraut ont chacun fait la couverture d'un des principaux hebdomadaires. Ce sont de longs dossiers qui aideront le lecteur cadre à décider s'il doit croquer dans la pomme : d'un côté ces gens là disent des choses que l'on comprend. Leurs fulminations contre la bien-pensance ont un côté Bad Boys bien séduisant. De l'autre, il ne faudrait quand même pas faire le jeu de l'innommable et la blonde est en embuscade... On a moins hésité avant de goûter son premier joint.
À chaque époque l'évolution des idées dominantes, montée et le déclin des représentations hégémoniques - se développe dans un rapport complexe. Il se joue entre la situation des producteurs d'idées, leurs organisations collectives, la forme des moyens de transmission, les groupes d'influence ou les détenteurs d'autorité, la doxa populaire et -il faut quand même le rappeler- la situation objective. Nous n'avons pas la place d'en traiter ici, mais il nous semble qu'il y a au moins deux phénomènes majeurs sur lesquels nous reviendrons:
L'alliance qui s'esquisse entre la haute intelligentsia (producteur de thèses et idées générales) et le peuple ou du moins les tendances de l'opinion populaire. Elle se constitue autour d'un accord pour nommer un réel que refusent les politiquement corrects (basse intelligentsia, commentateurs médiatiques, classes urbaines assez matériellement protégées pour être soucieuses des "valeurs"). En clair, le conflit oppose ceux qui osent et ceux qui refusent d'aborder les sujets tabous - identité, effondrement de l'éducation, danger islamiste, existence d'ennemis, souveraineté, nation, peuple, culture et mœurs, continuité historique - autrement que comme des fantasmes répugnants nés des "peurs". Ceux qui s'inquiètent d'une permanence du tragique contre les partisans de ce qu'il faut bien nommer l'orde établi. Selon eux, ses principes seraient excellents, le triomphe historique inéluctable et il conviendrait seulement de corriger les excès et dérives avec un peu plus du même : plus de libéralisme, de gestion, de tolérance et d'ouverture, de gouvernance, d'Europe, de technologie et de vivre ensemble. À certains égards, cette bataille se fait à flancs renversés. Les positions entre pessimistes critiques s'attaquant aux élites et aux dominations idéologiques d'une part et, d'autre part universalistes moraux et bons gestionnaires ont été comme échangées entre "réacs" et "progressistes".
Le retrait des seconds sur des positions purement défensives voire répressives (on n'a pas le droit de dire que..., on sait où cela nous mène). Une hégémonie idéologique peut-elle survivre en n'expliquant rien, en ne promettant rien, mais en se contentant de dire que ses ennemis sont méchants ? La criminalisation de la critique et le recours au tabou nous semblent plutôt être les armes du suicide idéologique. C'est, en tout, cas une question sur laquelle nous reviendrons ici.
François-Bernard Huyghe (Huyghe.fr, 8 octobre 2015)
00:05 Publié dans Actualité, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, france, paysage intellectuel français, théorie politique, sciences politiques, politologie, philosophie, philosophie politique, droite |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Marcel Gauchet : Deux choses dans votre question : le pourquoi de l’abstention et la grille d’explication que vous évoquez. Elle ne convainc pas sur le fond, même si elle touche à quelque chose de juste. Pourquoi voter quand l’offre ne propose plus d’opposition tranchée ? “Tous pareils”. L’Union européenne limite fortement la gamme des choix. Elle accentue l’effet de la mondialisation, en créant le sentiment que les gouvernants, de toute façon, ne peuvent pas grand-chose. “Ils causent, mais ils ne peuvent rien faire.” Enfin, cerise sur le gâteau, la politique est faite pour les gagnants de la mondialisation. Pourquoi les perdants iraient-ils approuver le fait qu’ils sont sacrifiés sur l’autel de la bonne cause? “Ils se foutent des gens comme nous.” La mondialisation, c’est l’alliance des riches des pays riches avec les pauvres des pays pauvres contre les pauvres des pays riches. Voilà les trois faits qui me semblent largement expliquer la montée de l’abstention, en particulier dans les milieux populaires. Il y a d’autres facteurs, plus diffus, comme la dépolitisation générale.
Quant au rôle du système représentatif lui-même, en le qualifiant d’“aristocratique”, vous faites sans doute allusion à l’analyse de mon ami Bernard Manin. Je ne crois pas que ce soit le mot le plus approprié. La représentation, c’est effectivement un processus de sélection de gens supposément pourvus de qualités spéciales, dont celle de la représentativité. Mais cette représentativité peut très bien s’exercer contre les privilégiés. C’était le grand argument contre le suffrage universel pendant longtemps. Il était présenté comme le moyen pour les masses de faire fonctionner le pouvoir à leur profit grâce à de dangereux démagogues. Le système représentatif a été, de fait, le moyen pour réformer socialement nos régimes en d’autres temps. Il faut se demander comment il s’est retourné sur lui-même. Le problème est ailleurs, en un mot. Il ne faut pas confondre l’instrument et les conditions de son usage.
Pas du tout. Il y a une nation de droite et une nation de gauche. Il y a une anti-nation de droite, libérale, et une anti-nation de gauche, libertaire. Il y a la nation d’hier et la nation d’aujourd’hui. La nation de 2015 n’est pas, et ne peut pas être, celle de 1915. Et puis, il y a l’Europe : nation de substitution ou autre chose, mais quoi exactement ? La vérité est que le brouillage est complet. Tout est à redéfinir.
Aucun retour d’aucune sorte ne nous sera d’une quelconque utilité – il faudrait d’ailleurs qu’ils soient possibles, ce qui, en l’état, n’est pas le cas. Nous sommes condamnés à inventer. Cela commence par nous mettre en position de comprendre ce qui nous est arrivé pour nous retrouver dans cette impasse, sans anathèmes, exorcismes et autres “dénonciations”. Qu’est devenu le politique, par exemple, et pourquoi ? C’est le genre de travail auquel l’individu “total”, comme vous dites, n’est pas spontanément très disposé. Pourtant, il va falloir qu’il s’y mette, et il s’y mettra ! Les cures de désintoxication, c’est dur. Christianisme et paganisme sont des sujets très intéressants en soi, ce n’est pas moi qui dirai le contraire, mais ils ne nous aideront pas beaucoup pour ce travail, si ce n’est indirectement, pour nous aider à mesurer ce qui nous sépare de leurs univers. C’est là qu’est le sujet principal.
« S’il n’y a que des individus et leurs droits, alors toutes les expressions culturelles émanées de ces individus se valent. »
Je ne critique pas les droits de l’Homme, je critique les applications qui en sont faites et les conséquences qu’on prétend en tirer, ce qui est fort différent. Il n’y a pas grand sens à critiquer les droits de l’Homme si on y réfléchit un peu sérieusement : ils sont la seule base sur laquelle nous pouvons établir cette chose essentielle dans une société qu’est la légitimité. Que pourrions-nous mettre d’autre à la place pour définir la norme des rapports entre les gens ou la juste source du pouvoir ? La seule alternative valable, ce sont les droits de Dieu. C’est d’ailleurs ce qu’ont bien compris les fondamentalistes. Il faut donc faire avec les droits de l’Homme. La question est de savoir s’ils ont réponse à tout. C’est là qu’est l’égarement actuel. Ils ne rendent pas compte de la nature des communautés politiques dans lesquelles ils s’appliquent. Ils doivent composer avec elles. Le politique ne se dissout pas dans le droit. Ils ne nous disent pas ce que nous avons à faire en matière économique, etc. La démocratie libérale, bien comprise, consiste précisément dans ce bon usage des droits de l’Homme qui leur reconnait leur place, mais qui se soucie de les articuler avec ce qui leur échappe et ne peut que leur échapper. C’est en ce sens qu’elle est le remède au droit-de-l’hommisme démagogique.
De la même façon, cette vision de l’équilibre à respecter entre droit et politique permet d’échapper au relativisme culturel, qui fait d’ailleurs système avec le droit-de-l’hommisme. S’il n’y a que des individus et leurs droits, alors toutes les expressions culturelles émanées de ces individus se valent. Mais s’il existe des communautés historiques qui ont leur consistance par elles-mêmes, alors il est possible de les comprendre pour ce qu’elles sont, d’abord, en faisant aux cultures singulières la place qu’elles méritent et, ensuite, en les distinguant au sein d’une histoire où nous pouvons introduire des critères de jugement. C’est, de nouveau, une affaire de composition entre des exigences à la fois contradictoires et solidaires. La chose la plus difficile qui soit dans notre monde, apparemment. La conférence de l’Unesco, qui a adopté la Convention sur la protection et la promotion des expressions culturelles en 2005, souligne expressément, selon ses mots, « l’importance de la diversité culturelle pour la pleine réalisation des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ».
Ne tirons pas de conclusions définitives sur l’essence des droits de l’Homme depuis ce que nous en observons aujourd’hui. Il est vrai que beaucoup de gens de par le monde trouvent grotesques les prétentions occidentales à l’universalisation des droits de l’Homme – non sans raison, étant donné les contextes sociaux où ils sont supposés s’appliquer. D’un autre côté, la débilité de nos droits-de-l’hommistes n’est plus à démontrer. Mais cela ne prouve rien sur le fond. Il a fallu deux siècles en Occident pour qu’on prenne la mesure opératoire du principe. Il est permis de penser qu’il faudra un peu de temps pour que leur enracinement s’opère à l’échelle planétaire. De la même façon, le mésusage de ce principe tel que nous le pratiquons actuellement dans nos démocraties peut fort bien n’être qu’une pathologie transitoire. C’est ce que je crois.
Je pense que les droits de l’Homme ont une portée universelle en tant que principe de légitimité. Ils représentent la seule manière de concevoir, en dernier ressort, le fondement d’un pouvoir qui ne tombe pas d’en haut et ne s’impose pas par sa seule force, à l’instar, par exemple, des dictatures arabes. Ils sont également le seul étalon dont nous disposons pour concevoir la manière dont peuvent se former des liens juste entre les personnes dès lors qu’ils sont déterminés par leur seule volonté réciproque et non par leurs situations acquises. De ce point de vue, je suis convaincu qu’ils sont voués à se répandre au fur et à mesure que la sortie de la religion, telle que je l’entends, se diffusera à l’échelle du globe – c’est en cours, c’est cela la mondialisation.
Maintenant, ce qui légitime ne peut pas se substituer à ce qui est à légitimer : l’ordre politique ou l’action historique. En Europe, c’est la folie du moment que d’être tombé dans ce panneau. C’est ce qui produit ce dévoiement que vous résumez très bien : la réduction du processus politique à la coexistence procédurale des libertés individuelles. Mais ce n’est pas le dernier mot de l’histoire, juste une phase de délire comme on en a connu d’autres. Elle est en train de révéler ses limites. Il y a un autre emploi des droits de l’Homme à définir. Ils n’ont pas réponse à tout mais ils sont un élément indispensable de la société que nous avons le droit d’appeler de nos vœux.
« Non seulement la place du politique demeure, mais plus le rôle du marché s’amplifie, plus sa nécessité s’accroît, en profondeur. »
C’est quoi au juste “libéral” ? C’est quoi “capitalisme” ? Il serait peut-être temps de se poser sérieusement la question avant de brailler en toute ignorance de cause.
Libéraux, nous le sommes en fait à peu près tous, que nous le voulions ou non, parce que nous voulons que tous soient libres de parler, de se réunir, mais aussi de créer des journaux, des radios, des entreprises pour faire fructifier leurs idées. La raison de fond de ce libéralisme qui nous embrigade, c’est que le monde moderne est tourné vers sa propre invention et que cela passe par les libres initiatives des individus dans tous les domaines. Et capitalistes, du coup, nous sommes amenés à l’accepter inexorablement parce que pour faire un journal, une radio, une entreprise, il faut des capitaux, des investissements, des emprunts, des bénéfices pour les rembourser, et ainsi de suite. Préférons-nous demander à l’État, à ses bureaucrates, et à ses réseaux clientélistes ?
Ce sont les données de base. Après, vient la question de la manière dont tout cela s’organise. Et sous cet angle, nous ne sommes qu’au début de l’histoire. Nous avons tellement été obsédés par l’idée d’abolir le libéralisme et le capitalisme que nous n’avons pas vraiment réfléchi à la bonne manière d’aménager des faits premiers pour leur donner une tournure vraiment acceptable. Voilà le vrai sujet. Il me semble que nous pouvons imaginer un capitalisme avec des administrateurs du capital qui ne seraient pas des capitalistes tournés vers l’accumulation de leur capital personnel. De la même manière, nous avons à concevoir un statut des entreprises qui rendrait la subordination salariale mieux vivable. Après tout, chacun a envie de travailler dans un collectif qui a du sens et qui marche. Mais il faut bien que quelqu’un prenne l’initiative de le créer et de définir sa direction. Arrêtons de rêvasser d’un monde où tout cela aurait disparu et occupons-nous vraiment de le penser.
« Foucault voit le pouvoir partout, Bourdieu détecte la domination dans tous les coins. Voilà du grain à moudre pour la “critique” à bon marché. »
Autonomisation de l’économie, soit. Mais jusqu’où ? Il ne faut surtout pas se laisser prendre au piège du discours libéral et de son fantasme de l’autosuffisance du marché autorégulateur. La réalité est que ce marché est permis par un certain état du politique, qu’il repose sur le socle que celui-ci lui fournit. Il en a besoin, même s’il tend à l’ignorer. Sa logique le pousse en effet à vouloir aller toujours plus loin dans son émancipation du cadre politique, mais cette démarche est autodestructrice et bute sur une limite. Elle suscite en tout cas inévitablement un conflit avec les acteurs sociaux à peu près conscients de la dynamique destructrice à l’œuvre. Nous y sommes. C’est en fonction de cette bataille inévitable qu’il faut raisonner, en rappelant aux tenants frénétiques du marché ses conditions même de possibilité. Non seulement la place du politique demeure, mais plus le rôle du marché s’amplifie, plus sa nécessité s’accroît, en profondeur. Nous ne sommes pas à la fin de l’histoire !
La réponse est dans la question ! Évidemment que les roquets qui m’ont aboyé dessus représentent la quintessence du néo-conformisme actuel, qui prétend combiner les prestiges de la rebellitude avec le confort de la pensée en troupeau. Les commissaires politiques “foucaldo-bourdivins” d’aujourd’hui sont l’exact équivalent des procureurs et des chaisières qui s’indignaient hier des outrages aux bonnes mœurs. Par conséquent, le non-conformisme, dans cette ambiance, est globalement passé du côté conservateur, vous avez raison. C’est un fait, mais ce n’est qu’un fait. Car le conservatisme n’est pas exempt pour autant de pensées toutes faites, de schémas préfabriqués et de suivisme. Le vrai non-conformisme est dans la liberté d’esprit et l’indépendance de jugement, aujourd’hui comme hier. Il n’est d’aucun camp.
« Si j’apprécie la part critique de l’idée de l’institution imaginaire de la société, je suis pourtant peu convaincu par la philosophie de l’imaginaire radical que développe Castoriadis, ce qui ne m’empêche pas d’admirer l’entreprise. »
N’exagérons pas les proportions du phénomène. Comme vous le remarquez vous-même, il reste confiné à la sphère universitaire. Contrairement au marxisme, il n’a pas le mouvement ouvrier derrière lui. Mais il a, en revanche, un relais public assez important avec la complicité de l’extrême gauche présente dans le système médiatique. Il fournit au journalisme de dénonciation une vulgate commode. Foucault voit le pouvoir partout, Bourdieu détecte la domination dans tous les coins. Voilà du grain à moudre pour la “critique” à bon marché. C’est d’une facilité à la portée des débiles, mais avec une griffe haute couture. Que demander de mieux ?
 Il y a, depuis quelques années, un retour sur la scène publique des idées de Cornélius Castoriadis avec, notamment, la publication d’actes de colloque ou la grande biographie de François Dosse. Quel est votre rapport à l’œuvre de ce « titan de la pensée », comme le qualifiait Edgar Morin ?
Il y a, depuis quelques années, un retour sur la scène publique des idées de Cornélius Castoriadis avec, notamment, la publication d’actes de colloque ou la grande biographie de François Dosse. Quel est votre rapport à l’œuvre de ce « titan de la pensée », comme le qualifiait Edgar Morin ?J’espère que vous avez raison sur le constat et que la pensée de Castoriadis est en train de trouver l’attention qu’elle mérite. Elle est autrement consistante que les foutaises qui occupent le devant de la scène. Cela voudrait dire que les vraies questions sont peut-être en train de faire leur chemin dans les esprits, en dépit des apparences. Je ne peux que m’en réjouir. Je dirais que nous étions fondamentalement d’accord sur la question, justement, et en désaccord sur la réponse à lui apporter. Nous étions d’accord, d’abord, sur le brouillage intellectuel et politique dans lequel nos sociétés évoluent à l’aveugle. Et au-delà de ce constat critique, nous étions unanimes sur la voie pour en sortir : il faut ré-élaborer une pensée de la société et de l’histoire – seule à même de permettre de nous orienter efficacement – en mesure de prendre la relève du fourvoiement hegelo-marxiste. De ce que les pensées antérieures en ce domaine ont erré, il ne suit pas que toute pensée en la matière est impossible, comme nous le serinent les insanités postmodernes. C’est sur le contenu de cette pensée que nous divergeons. Si j’apprécie la part critique de l’idée de l’institution imaginaire de la société, je suis pourtant peu convaincu par la philosophie de l’imaginaire radical que développe Castoriadis, ce qui ne m’empêche pas d’admirer l’entreprise. Elle ne me semble pas éclairer l’histoire moderne et ses prolongements possibles. C’est pourquoi je me suis lancé dans une autre direction en élaborant l’idée de sortie de la religion. Le but est précisément d’élucider la nature de ce qui s’est passé en Occident depuis cinq siècles comme chemin vers l’autonomie et les difficultés présentes sur lesquelles butent nos sociétés. Pour tout dire, j’ai le sentiment que l’idée d’imaginaire radical est avant tout faite pour sauver la possibilité d’un projet révolutionnaire, plus que pour comprendre la réalité de nos sociétés. Elle empêche Castoriadis de mesurer la dimension structurelle de l’autonomie qui rend possible la visée d’autonomie.
Cela dit, ces divergences de vue se situent à l’intérieur d’un même espace de questionnement et c’est pour moi ce qui compte au premier chef. La discussion a du sens, elle n’est pas une dispute avec du non-sens. C’est l’essentiel.
Entretien réalisé avec l’aide de Galaad Wilgos
Notes :
[i] « Le paradoxe impliqué par la perte des droits de l’Homme, écrit-elle, c’est que celle-ci survient au moment où une personne devient un être humain en général […] ne représentant rien d’autre que sa propre et absolument unique individualité qui, en l’absence d’un monde commun où elle puisse s’exprimer et sur lequel elle puisse intervenir, perd toute signification. » Hannah Arendt, L’impérialisme, Fayard, 1982.
[ii] « Aucun des prétendus droits de l’Homme ne s’étend au-delà de l’homme égoïste, au-delà de l’homme comme membre de la société civile, à savoir un individu replié sur lui-même, sur son intérêt privé et son caprice privé, l’homme séparé de la communauté. » Karl Marx, À propos de la question juive, 1843.
00:05 Publié dans Entretiens, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : conservatisme, entretien, marcel gauchet, philosophie, philosophie politique, france |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Dans le cadre de la VIème Conférence Internationale "Lire Alexandre Zinoviev", avec pour thème : "Alexandre Zinoviev et les idéologies contemporaines" qui se tiendra à Moscou fin octobre 2015, plusieurs articles, dont celui-ci, seront publiés et de nombreux chercheurs interviendront. Faire connaître les thèses du sociologue russe : tel est l'objectif que se sont fixé tous les participants à cette conférence. Fabrice Fassio.
Á ma connaissance, Alexandre Alexandrovitch Zinoviev est le seul philosophe au monde qui ait créé une théorie englobant tous les aspects du phénomène idéologique. Il est regrettable que peu de gens aient prêté attention aux idées radicalement nouvelles que le logicien russe a développées dans ses ouvrages, qu'ils soient littéraires ou sociologiques. Dans le cadre de cet article, nous vous proposons un très bref aperçu de cette théorie.
Passion de jeunesse
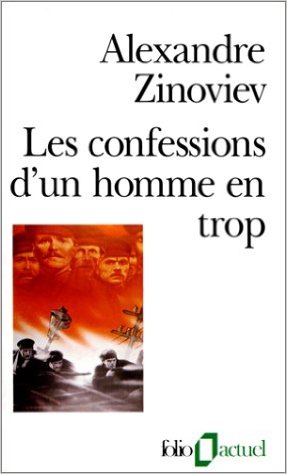 Passionné dès son adolescence par les problèmes politiques et sociaux, Alexandre Zinoviev raconte dans ses mémoires, Les Confessions d'un Homme en Trop, qu'il a commencé très jeune à se familiariser avec l'idéologie marxiste, lisant entre autres des ouvrages de Marx, d'Engels ou de Staline. Devenu bien plus tard un logicien de renommée mondiale, le philosophe affirmera que le marxisme, idéologie d'État de l'ancienne Union soviétique, est le phénomène idéologique le plus important du vingtième siècle. Il affirmera aussi que le marxisme n'est pas une science, bien qu'il contienne des éléments scientifiques en son sein. Quelle est donc la frontière entre science et idéologie selon le philosophe?
Passionné dès son adolescence par les problèmes politiques et sociaux, Alexandre Zinoviev raconte dans ses mémoires, Les Confessions d'un Homme en Trop, qu'il a commencé très jeune à se familiariser avec l'idéologie marxiste, lisant entre autres des ouvrages de Marx, d'Engels ou de Staline. Devenu bien plus tard un logicien de renommée mondiale, le philosophe affirmera que le marxisme, idéologie d'État de l'ancienne Union soviétique, est le phénomène idéologique le plus important du vingtième siècle. Il affirmera aussi que le marxisme n'est pas une science, bien qu'il contienne des éléments scientifiques en son sein. Quelle est donc la frontière entre science et idéologie selon le philosophe?
Cerner le phénomène idéologique
Selon le logicien russe, les propositions scientifiques sont vérifiables ou réfutables, à moins que l'on ne puisse prouver leur caractère insoluble. Quant aux affirmations idéologiques, elles sont impossibles à prouver ou à réfuter; en outre, elles peuvent être interprétées de différentes façons, alors que les termes utilisés par la science ont un sens précis. Enfin, et ce point me paraît essentiel, les résultats d'une idéologie (qu'elle soit laïque ou religieuse) se mesurent par l'efficacité de son action sur la conscience des gens. Dans ses ouvrages sociologiques, le philosophe explique que, dans l'Union soviétique des années 1980-1990, l'influence du marxisme sur la conscience des Soviétiques s'est révélée trop faible pour arrêter l'action de l'idéologie occidentale. Ce fut l'un des facteurs qui contribuèrent à l'effondrement de l'Union soviétique.
La sphère idéologique
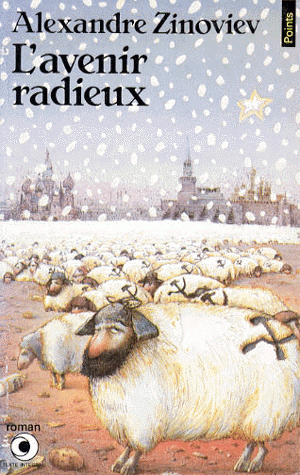 Dans ses œuvres, Le Facteur de la Compréhension en particulier*, Alexandre Zinoviev note que la sphère idéologique comprend un grand nombre d'hommes et d'organismes dont la tâche consiste à conditionner l'esprit des citoyens dans un sens favorable à la survie de la société tout entière.
Dans ses œuvres, Le Facteur de la Compréhension en particulier*, Alexandre Zinoviev note que la sphère idéologique comprend un grand nombre d'hommes et d'organismes dont la tâche consiste à conditionner l'esprit des citoyens dans un sens favorable à la survie de la société tout entière.
Journalistes, politiciens, sociologues, professeurs, membres du clergé, effectuent au quotidien cette tâche indispensable à la préservation de l'organisme social. Les modes d'organisation de cette sphère sont très divers et forment un large éventail allant de l'organisation unique et toute-puissante (une "Eglise") jusqu'à un grand nombre d'institutions plus ou moins autonomes. L'ancienne Union soviétique où certains pays musulmans contemporains sont des exemples de sociétés dans lesquelles existait ou existe encore une organisation unique chargée de diffuser une idéologie d'État laïque ou religieuse. A l'inverse, les nations occidentales contemporaines comptent de nombreuses institutions plus ou moins autonomes (maisons d'édition, médias, cercles de réflexion, etc.) qui exercent une action idéologique sur les populations. Dans ses mémoires, Alexandre Zinoviev note qu'il existe un mode de pensée commun à tous les Occidentaux. Bien qu'elle se compose de nombreuses institutions, la sphère idéologique occidentale joue donc son rôle.
Le champ idéologique
L'action de la sphère idéologique a comme résultat la création d'un champ de forces dans lequel "baignent" en permanence tous les membres de la société. Mots, slogans, images, constituent la "nourriture mentale" quotidienne des citoyens d'un pays. De nos jours, des institutions telles que les médias jouent un rôle énorme en matière d'éducation idéologique de la population. Les individus sociaux sont informés dans l'esprit de l'idéologie de l'actualité politique nationale et internationale, des nouveautés en matière de science et de technique, etc. Cette éducation a pour objectif non seulement d'imprégner les esprits d'une certaine vision de l'être humain, de la société et du monde, mais aussi d'entraîner les cerveaux de telle sorte qu'ils ne soient pas capables d'élaborer une autre vision des choses. C'est la raison pour laquelle, au sein d'un même groupe humain, beaucoup de personnes adoptent une attitude identique face à des événements sociaux, politiques ou culturels nouveaux.
Si les gens perdent l'idéologie à laquelle ils sont habitués, ils sombrent dans un état de chaos et de confusion idéologique, note Alexandre Zinoviev dans le Facteur de la Compréhension. C'est ce qui s'est produit, ajoute le philosophe, en Union soviétique après le rejet du marxisme-léninisme comme idéologie d'Etat.
Un ensemble mouvant
En tant que doctrine (ensemble d'idées), l'idéologie n'est pas un ensemble figé, constitué une fois pour toutes. Certaines idées apparaissent alors que d'autres se modifient ou disparaissent tout simplement. Après l'effondrement de l'Union soviétique par exemple, l'idéologie occidentale a intégré de nouveaux concepts : révolution globale, gouvernance mondiale, village planétaire, culture globale, etc. Ces concepts se sont agrégés à des idées plus anciennes (éloges de l'économie de marché ou de la démocratie parlementaire, par exemple). Née aux Etats-Unis, l'idéologie contemporaine de la globalisation est destinée à servir les intérêts des Occidentaux en général et des Américains en premier lieu. Cependant, les idées occidentales ne sont pas les seules à exister sur cette terre. Idéologie religieuse, l'islam exerce aujourd'hui une action puissante sur l'esprit de millions d'hommes. En plein essor, il s'affirme comme un redoutable concurrent des autres idéologies qui fleurissent de nos jours sur notre planète.
*Le Facteur de la Compréhension (Faktor Ponimania) ; ce livre n'est toujours pas édité dans notre pays alors que sont publiés chaque année des centaines de livres dénués d'intérêt. France, que devient ta tradition d'intellectualisme ?
**spécialiste de l'oeuvre du logicien et sociologue russe : Alexandre Zinoviev.
00:05 Publié dans Littérature, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, littérature russe, lettres, lettres russes, alexandre zinoviev, idéologie, philosophie, philosophie politique, théorie politique, sciences politiques, politologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
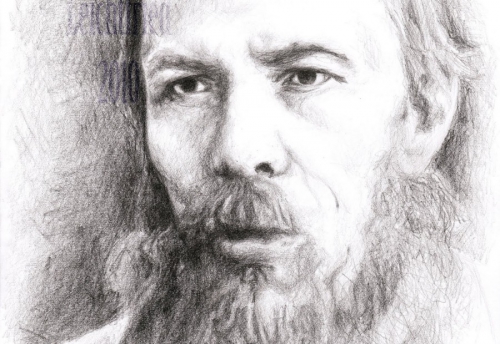
In his work Dostoevsky and the Metaphysics of Crime, sociologist Dr. Vladislav Arkadyevich Bachinin analyzes the only seemingly contradictory correlation between Enlightenment rationalism and the rise of infernal forces in Fyodor Dostoevsky’s work Demons. Translated by Mark Hackard.
Ex: http://souloftheeast.org
The Immoral Reason of a Living Automaton
Pyotr Verkhovensky, the cold-blooded cynic who easily transgresses any moral obstacles, represents a special type of criminal, to whom is applicable the philosophical metaphor of “man the machine.”
In 1748 France, Lematrie’s book under that title was released. Its author cast man as a self-winding machine moving along perpendicular lines. In Lametrie’s conception a human being was the direct likeness of a watch or harpsichord, and at the same time subordinated to natural necessity. But possessing instincts, feelings, and passions, he is deprived of a soul. Lametrie assumed that the soul was a term lacking any essential substance whatsoever.
The world in which the machine-man dwells is anthropocentric; there is no place for God. Reality is arranged in accordance with the principles of Newtonian mechanics, and the world presents a mechanical conglomerate of soulless elements. Natural and social processes are moved by one and the same mechanical forces.
The philosophy of machine rationality unfolds as the unique result of the evolution of classical rationalism. The elimination of all metaphysical content prepares the ground both for the arrival of positivism and for the realization of plans for building the future strictly rationalized society with calculated parameters wholly under the control of a directing will. The machine-man and machine-state, which need each other, arise as something resembling Aristotle’s telic reasons, and will directly and gradually determine the development of positivist anthropocentric schematics.
In accordance with the mechanistic picture of the world, there always exists the threat of intentional deformations in the structures of the cosmic order. Objectively there exist possibilities for the violation of measure and harmony, the destruction of order, and the ascent of chaos. A murderer can realize the objective possibility of death that exists for his victim. A thief or robber is capable of realizing the objective possibility of shifting material values in the social space from one set of hands to the other, etc. That is, it stands only for man to apply certain efforts for the possibility of disintegration of existing structures, its movement into reality. At times purely mechanical forces were sufficient for this. Moreover, the higher the degree of mechanism of such enterprises, the less that spiritual, ethical, religious, and similar components are in the mix, and the more effective destructive actions will prove.
Dostoevsky has the philosophy of the machine-man applicable first and foremost to characters who represent practical businessmen smacking of commercial types of the Western model, i.e., to such men as Luzhin, Rakitin, Epanchin, Totsky, Ferdyshchenko, etc. Indifferent to metaphysical reality, they subscribe to Rousseau’s “Geneva ideals” allowing the possibility of “virtue without Christ.” Immersed in the vanity of a graceless, prosaic-pragmatic existence, “having ears, they do not hear, and having eyes, they do not see.” All that comes from on high, from the spheres of metaphysical reality, does not reach their souls, and therefore they are immersed in the darkness of ignorance and incomprehension of the most important meanings of life. The thoughts and feelings of these “Bernards” carry an earthly character and are not directed toward the beyond. They do not like abstract reasoning, considering it an idle pastime. For them as for Lametrie, God and the soul are false moral magnitudes. For them the entire world dwells in the “disenchanted” state of a gigantic conglomerate of soulless elements. Not in one of them does God’s spark gleam. All these men are spiritually impoverished living machines, wound up, however, by a mysterious hand, but as Lev Shestov would say about them, they are not conscious that their life is not life, but death.
In his portrayals Dostoevsky expounds his criticism of the far-from-clean, wholly filthy immoral mind, more precisely the banal and base “Euclidian” reason that is deaf to the metaphysics of moral absolutes, the mind that sees in the soul “only vapor;” that is governed by cold reason alone and views the entire world as a set of tools for the achievement of its vapid objectives.
Among the specimens of the machine-man replicated by Dostoevsky, Pyotr Verkhovensky represents the most odious exemplar. He is calculating, ruthless, and is ready to go the full distance for the achievement of his goals, not stopping at the most vile infamies and crimes.
Criminal reality, inside of which exists Verkhovensky’s true “I,” is distinguished by characteristics such as a harsh aloofness from other evaluative worlds, and most of all from the world of religious, moral, and natural-law absolutes. Second, inherent to it is an acute tension in relations with official-normative evaluative reality. And its third particularity is a faint vulnerability, explained by the fact that for all its antagonistic position, it aspires to copy the structures of legal realities in its own fashion. Just as the devil parodies God, trying to imitate him, the criminal world seeks, for all the caricatured nature of its efforts, to reproduce normative-evaluative stereotypes of the legitimate and sacral worlds, attempting to acquire additional vitatlity at their cost.
It is not accidental that Shatov’s murder in Demons bears the marks of a ritual sacrifice. Along with that it takes the form of a monstrous parody of ancient ritual: instead of the solemnity of a holy rite, there is the filthy lowness of the whole scene; instead of open officiality, there is the cowardly, concealed secret act; instead of calling upon the favor of higher forces, there is a wager on the dark elements of evil, a commiseration of all the participants of the murder through the spilled blood of the victim and mutual fear before one another.
The Normative Space of the Criminal-Political Association
Verkhovensky deliberately forms an enclosed normative-evaluative space of criminal-corporate “morality” with harsh principles of self-organization and self-preservation. He requires that association members’ attitude to their tasks and objectives be extremely serious, not allowing for skepticism, self-irony, or criticism. Violators are immediately punished. Applied violence fulfills a protective function, acting as a means of welding and self-defense for this artificial micro-world.
Aside from similarity in the structure and forms of activity of criminal-political and purely criminal organizations, between the two there are essential distinctions. And so, if a criminal group’s ultimate goals are limited to the resolution of self-interested mercantile tasks, then the goals of criminal-political associations reach far beyond the boundaries of mercantile interests and are oriented toward the achievement of political dominance, by which members of the association cross over into the position of a ruling elite.
If associated criminals, as a rule, do not issue a challenge to the state and the state system but prefer to deal with individual citizens, a criminal-political association boldly steps into antagonism with state power and its institutions.
If a criminal group represents a unique form of a “thing-for-itself” and doesn’t conceal its corporate egoism, then a criminal-political association masks its just-as-base interests with a smokescreen of lies about the interests of the people that supposedly concern it.
The latter circumstance, noted Dostoevsky, allowed such men as Verkhovensky to recruit supporters not only from the spectrum of little-educated “losers” and fanatics with an unhealthy lust for intrigue and power, but also to involve young people with a good heart, even if with a “shakiness” in their views. The fate of the latter proved genuinely tragic, since these confidence tricksters, who studied the magnanimous side of the human heart and were able to play on its strings as on a musical instrument, ultimately transformed these youth into criminals.
Dostoevsky lamented that contemporary youth was undefended against “demonism” through maturity of firm convictions and moral hardiness. Among many material drives dominate a higher idea, and a genuine education is replaced with stereotypes of impudent negation through another’s voice, dissatisfaction, and impatience. As a result “even an honest and guileless boy, even one who studied well, could occasionally turn out to be a Nechaevite…that is, again, if he’d come across Nechaev…” (21, 133). To such boys, Nechaevs and Verkhovenskys paint criminal acts as feats of policy.
The fateful transformations that took place in the souls of many “Russian boys” were facilitated by a “time of troubles” itself, which forced Russian civilization at first slowly, and then ever more quickly, to slide down a sloping surface leading from order to chaos.
“In my novel Demons,” wrote Dostoevsky, “I attempted to attempted to express those various and diverse motives by which even the purest of heart and the most guileless people can be drawn to commit the most monstrous villainy. Therein is the horror, that here one can do the most infamous and abhorrent deed, sometimes completely not being a scoundrel! And that’s not among us only, but across the whole world it is so, always and from the beginning of the ages, during times of transition, in times of dislocation in people’s lives, of doubts and negation, skepticism and unsteadiness in basic social convictions. But we have it more than it’s possible anywhere, and namely in our time, and this feature is the most painful and sad feature of our present time. In the possibility of seeing oneself, and even sometimes almost, as a matter of fact, as not a scoundrel, while working clear and inarguable abomination – herein is our contemporary tragedy!” (21, 131)
“Machine” Rationality of a Political Program
Verkhovensky, possessing a strong, mechanical will seeking power, found a just as machine-like political program that corresponded to his nature. Its basic positions amount to the following points:
Two vectors have united in this criminal-political program – the “machine” rationality of soulless villains with the demonic irrationality of maniacs run amok.
One of the most impressive paradoxes of Verkhovensky’s personality is just that surprising combination of “machine likeness” with a maniacal enthusiasm for destruction. It accords the figure of the political fiend an especially sinister character. With the direct participation of this unfeeling “machine” for producing disorder, events in the novel take the form of an oncoming squall, chaos enthroned, when a dozen murders and suicides are committed, along with several bouts of madness and a grandiose fire from arson. As a result the world enclosed in the novel’s textual frame begins to resemble a monstrous bestiary, where there is an absence of love and mercy, where there is only ruthless struggle of all against all.
Dostoevsky saw one of the sources of this chaos in the philosophical mindsets of rationalistic, materialistic, and atheistic content that penetrated from the West. Falling on Russian soil, the doctrines of Darwin, Mill, Strauss, and other representatives of European “progressive” thought, as a rule were taken in the Slavic consciousness, untried by many centuries of philosophical schooling, as adamantine philosophical axioms. Moreover, practical conclusions were often drawn from them, conclusions the possibility of which Western teachers had not suspected.
Of course, positive knowledge did not directly teach anyone villainy. And if Strauss, Dostoevsky notes with unconcealed irony, denied and mocked Christ, alongside that for man and humanity he demonstrated the most earnest love and desired their most radiant future.
But then here is what seems to me indubitable – give all these contemporary higher teachers the full opportunity to destroy the old society and build a new one – then there will come such darkness, such chaos, something so crude, blind, and inhuman, that the whole construction would collapse under the curses of humanity before it could be completed. Once it has rejected Christ, the human mind can reach the most astounding results. That is an axiom. Europe, at least in the higher representations of its thought, rejects Christ, and as is known, we are obligated to imitate Europe. (21, 132-133)
For Dostoevsky the evaluative-orienting and practical-transforming activity of moral, legal, and political consciousness must be founded on the principles of Theo-centrism. He disseminates the spirit of Theodicy on all spheres of spheres of social and spiritual life without exception. The Western legal consciousness is predominantly anthropocentric, and as a rule does not accept either religious or metaphysical normative-evaluative bases.
These bases are unneeded by machine-man, who discovers by his actions that open immorality, crime, and political Machiavellianism all have one and the same nature. They all begin with the denial of higher principles of being, absolute values, and norms.
00:05 Publié dans Littérature, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, russie, dostoïevski, littérature, lettres, lettres russes, littérature russe |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
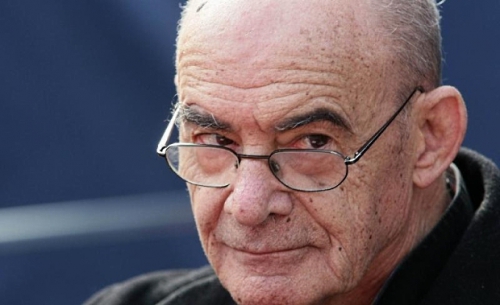
L'affaire Michel Onfray déchaîne les journalistes, c'est normal. Michel Onfray s'est sans doute depuis trop longtemps prêté aux jeux mais qu'elle enrage les métaphysiciens du silence est beaucoup plus surprenant pour ne pas dire proprement indécent.
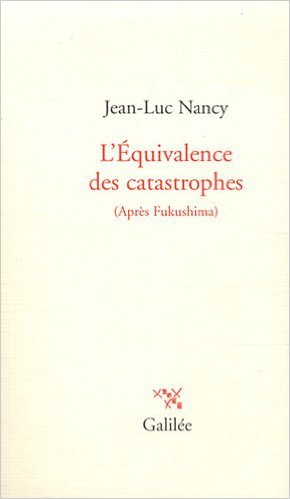 L'éloge du « silence des intellectuels » vantés par un des plus bavards - pour ne pas dire le plus baveux - d'entre eux prête à rire. Si Jean-Luc Nancy ne fréquente pas les plateaux de la télévision, il ne s'est en réalité jamais tu. La masse importante de ses publications, sans grande signification d'avenir et qui se vendent d'ailleurs déjà au kilo, en atteste largement. Effectivement, il est peu intervenu dans le débat public mais c'est que si Jean-Luc Nancy s'est tu depuis des années sur les affaires du monde, c'est qu'il a toujours consenti. Il a beau nous la jouer grand intellectuel dans son bureau au-dessus de la mêlée avec le leitmotiv d'Adorno au plafond, "plus de poésie après Auschwitz", il a en réalité toujours trouvé le temps d'écrire pour soutenir les pouvoirs en place.
L'éloge du « silence des intellectuels » vantés par un des plus bavards - pour ne pas dire le plus baveux - d'entre eux prête à rire. Si Jean-Luc Nancy ne fréquente pas les plateaux de la télévision, il ne s'est en réalité jamais tu. La masse importante de ses publications, sans grande signification d'avenir et qui se vendent d'ailleurs déjà au kilo, en atteste largement. Effectivement, il est peu intervenu dans le débat public mais c'est que si Jean-Luc Nancy s'est tu depuis des années sur les affaires du monde, c'est qu'il a toujours consenti. Il a beau nous la jouer grand intellectuel dans son bureau au-dessus de la mêlée avec le leitmotiv d'Adorno au plafond, "plus de poésie après Auschwitz", il a en réalité toujours trouvé le temps d'écrire pour soutenir les pouvoirs en place.
Jean-Luc Nancy n'est pas tout à fait l'ascète ou le vieux sage qu'il voudrait nous faire croire. Mais imbu de son travail pour ne pas dire de sa personne, il se croit occupé à des choses plus sérieuses, en effet il déconstruit, il arrache la tradition et c'est en ce sens là que précisément il n'a cessé de collaborer à ce qui nous arrive, ce désastre que lui-même pressent. Incapable de la moindre analyse géopolitique autre que celle des maîtres - c'est-à-dire en gros le journal de 20 heures ou le 20 minutes de Canal Plus -, sans courage par carriérisme, il a toujours suivi le courant, il est donc dans le vent compassionnel et il adhère à toutes les manipulations. Jean-Luc Nancy, c'est en quelque sorte le summum de la pensée adhérente, de la pensée qui colle au manche mais qui est fière d'elle-même puisqu'elle a la certitude d'être dans le bien. .Il nous sert donc politiquement un brouet relativiste et cosmopolite, un humanisme de pacotille fondé sur l'émotion directe et la dialectique du fluide ou du nomade. Il joue la pleureuse philosophique, qui a d'ailleurs le toupet de déclarer que les mots, surtout les mots du politique, n'ont plus de sens intelligible. Justement, les mots conservent leur sens intelligible à mesure que croît le décalage entre ce que les Français voient ou lisent et la réalité qu’ils perçoivent et vivent au quotidien. Il n'empêche selon cette grande âme du Bien par procuration, il s'agit évidemment d’accueillir avec enthousiasme l’Autre, celui venu d’ailleurs, nimbé de toutes les vertus et paré de toutes les supériorités dont pourraient et même devraient se réjouir des peuples vieillissants et fatigués qu’ils auraient peut-être - mais Nancy n'ose le dire, cela aurait été trop « osé » - pour mission de régénérer. Avouons que le conte philosophique est très mièvre et qu'il ne ferait même pas sourire Voltaire mais il est destiné aux esprits les plus fragiles. Il flatte surtout le Prince qui vous paie. C'est sa fonction première, ce « sens qui fait sens », « cet horizon », cette « ligne de fuite » pour paraphraser les inepties du style post moderniste de la fin de la métaphysique. Avec Nancy, nous n'aurons donc pas un autre son de cloche que celui des « petites chances » Mais encore, il va plus loin. Lui qui déconseillait sûrement à ses élèves de lire Spengler, devient en quelque sorte un décadentiste, un converti néo darwinien à la Jared Diamond, un apocalyptique mais sans Katechon, cédant aux sirènes de la disparition et voyant dans les réfugiés les « messagers de la fin ».
L’épisode migratoire intensif subi par la France et un certain nombre de nations européennes et son aggravation subite depuis le mois d’août dernier ne doivent évidemment rien au hasard, pas plus que le glissement sémantique de « clandestins » à « réfugiés ». Déjà, nous sommes biens pantois devant un philosophe grand manitou du silence, qui cède sans sourciller, à la novlangue sans avoir l'honnêteté de relever la dérive sémantique du terme « migrants » en « réfugiés » ou de reconnaître au moins qu'il assume ce détournement politique qui n’a rien à voir avec un tic langagier mais qui est imposé par les médias relevant de la propagande. En fait, Jean-Luc Nancy s'est fait ici le porte-parole de la classe philosophique universitaire et des professeurs de philosophie du secondaire. Ce sont des milieux libéraux particulièrement aliénés qui entonnent en chœur les refrains connus du déficit démographique qu’il convient de combler au plus vite, d’un système social qu’il nous faudrait consolider en accueillant la misère du monde, de la nécessaire solidarité à mettre en œuvre et du grand cœur qu’il convient de porter en bandoulière tout en affichant une exaltation bienveillante devant un fléau de grande ampleur qu’il faudrait feindre de prendre pour une inégalable opportunité. C’est un festival de bons sentiments, de passions désordonnées avec pour fond d'écran la paix universelle de Kant ou un regain de spinozisme anachronique. La philosophie universitaire, fidèle et docile à ses commanditaires aura ici une fois de plus joué son rôle, collaborant, pilonnant sans répit les valeurs, confondant éthique personnelle et éthique politique, serment d'Hippocrate et raison d'Etat sans le moindre sens de la nuance et surtout du bien commun mais aussi encore plus grave sans la moindre parcelle de rationalité. Jean-Luc Nancy qui en bon masochiste aura passé toute sa vie à cracher sur la Raison se mobilise donc pour le lavage de cerveau et le bourrage de crâne avant le grand conflit. On saura le retenir comme le fait que quelles que soient les approximations de Michel Onfray, ce dernier se sera tenu au contraire debout et non couché. « Accueillez-les », « Le grand défi de l’Europe », les silences bavards de l'intellectuel Nancy sont peut-être les silences de l'attendrissement mais c'est un attendrissement qui, en pleine cavale et inquisition intellectuelle contre Onfray, a choisi son camp. Déjà, cela ne se fait pas entre collègues.
Quant à soutenir l'accueil inconditionnel des immigrés illégaux, Nancy qui a travaillé toute sa vie à la mort de la métaphysique finit pourtant en parfait métaphysicien par occulter délibérément la réalité tangible du politique. C'est bien le bon laquais, déférent du cosmopolitisme philosophique et qui ne peut s'empêcher aussi de nous mettre en demeure d’ouvrir grandes les frontières et de profiter de cet horizon indépassable de félicité que représentent la submersion migratoire et la disparition de nos peuples autochtones mais néanmoins dans une vision décadentiste de la fin. L'apôtre du suicide collectif semble ainsi tout émoustillé et ragaillardi par le déferlement massif de la misère du monde aux quatre coins de l’Europe parce qu'il y voit la fin d'un monde.
On croirait lire du Cioran pour les nuls mais c'est très tristement ce qu'il appelle « penser au présent », sur fond de messagers itinérants qui hélas, ne seront pas des extraterrestres. La pensée a des devoirs et des droits. En tout domaine étudié, la pensée doit se faire l'humble auxiliaire des conditions qu'elle rassemble, pour être libre juge des conséquences qu'elle tire. La pensée fait et défait nos idées. Si les idées exercent l'intelligence, il reste pour chaque vie, à n'être pas intelligent pour rien.
(*) Philosophe. A paraître: "L'Equivalence des catastrophes. Après Fukushima" (Galilée).
00:05 Publié dans Livre, Livre, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, philosophie, jean-luc nancy |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook