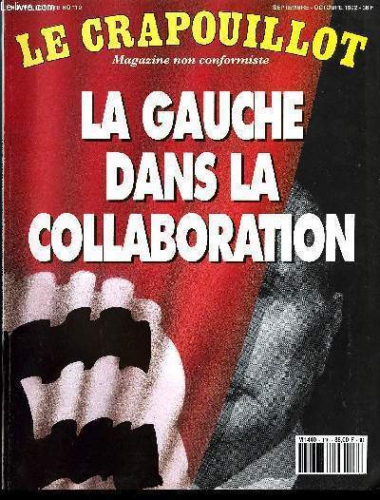Pierre Daye, un esthète dans la tourmente
par Christophe Dolbeau
Lorsque le 28 février 1960, le très discret Pierre Daye s’est éteint à Buenos-Aires, très peu de Belges se souvenaient probablement de lui. Et pourtant ce Porteño d’adoption avait été l’un des journalistes européens les plus brillants de la première moitié du XXe siècle, ainsi qu’un protagoniste majeur de la vie politique bruxelloise d’avant-guerre. Grand reporter à la façon d’un Albert Londres, d’un Paul Morand ou d’un Henri Béraud, brillant causeur et plaisant conférencier, il avait également été député et avait même occupé des fonctions gouvernementales sous l’Occupation. Effacé de la mémoire collective comme des annales littéraires belges, ce personnage aux multiples facettes mérite amplement, 60 ans après sa disparition, de sortir du purgatoire.
Un globe-trotter
C’est dans une famille très bourgeoise de Schaerbeek, l’une des communes de Bruxelles, que Pierre Daye vient au monde le 24 juin 1892. Scolarisé chez les pères jésuites du Collège Saint-Michel, il se voit offrir, dès l’enfance, la possibilité de faire plusieurs beaux voyages. À une époque où l’on circule bien moins qu’aujourd’hui, le jeune Pierre découvre Venise (août 1901), la Bretagne et les pistes de ski de Kandersteg (1904). Il assiste même à une audience du Pape Saint Pie X. À 17 ans, il passe des vacances à Tanger (1909) puis intègre l’Institut Saint-Louis où il va suivre deux années de droit. Appelé ensuite sous les drapeaux, il se trouve donc fin prêt, en juillet 1914, pour répondre à la mobilisation générale. Le jeune homme prend part aux batailles de Namur, d’Anvers et de l’Yser, puis son goût pour l’exotisme le conduit à se porter volontaire pour rejoindre, en Afrique, les troupes du général Charles Tombeur (1867-1947). Ces unités (la Force publique congolaise) se battent contre le célèbre général allemand Paul Emil von Lettow-Vorbeck (1870-1964). Mitrailleur, Pierre Daye participe à la prise de Tabora (19 septembre 1916), le principal fait d’armes des bataillons belges. Il consacrera plus tard un livre à cette épopée tropicale (1). Promu officier mais sévèrement atteint par la malaria, il est alors rapatrié en Europe. Au terme de sa convalescence, le conflit n’est pas achevé, ce qui lui vaut d’effectuer encore une dernière mission, nettement moins périlleuse celle-là : assurer, à Washington, la promotion de la Belgique, en qualité d’attaché militaire adjoint. C’est à ce titre qu’il est reçu, en décembre 1918, par le président cubain García Menocal (1866-1941). De son séjour américain, il tirera matière à un livre, Sam ou le voyage dans l’optimiste Amérique, qui paraîtra en 1922.

Pierre Daye, officier de la "Force publique" congolaise.
Rendu à la vie civile en 1919, Pierre Daye s’intéresse dès lors aux joutes politiques. Membre de la Ligue de la Renaissance nationale, où il côtoie Pierre Nothomb (2), l’aviateur Edmond Thieffry (3) et le peintre Delville (4), il en est candidat suppléant lors des élections de novembre 1919. On le trouve ensuite au Comité de politique nationale, un groupe qui milite, sous la houlette de Pierre Nothomb, pour « la plus grande Belgique », et il collabore à l’hebdomadaire La Politique (1921). Très sédentaire, cette activité n’est toutefois pas à même de le retenir bien longtemps car, au fond, sa véritable passion, ce sont les voyages. Dès 1922, il embarque donc sur l’Élisabethville et repart pour l’Afrique : durant plusieurs mois, il sillonne le Congo, en voiture, en train, à pied ou en « typoï » (chaise à porteurs), et navigue sur le lac Tanganyika. Puis, avant de rentrer en métropole, il fait un crochet par l’Union sud-africaine où il s’entretient avec le Premier ministre Jan Smuts.
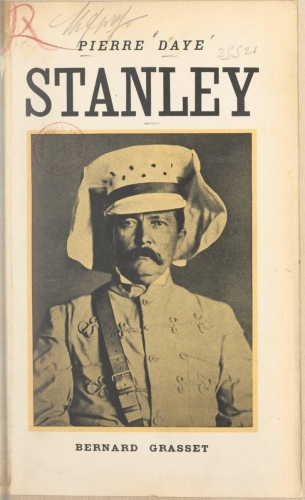 Embauché comme reporter par le grand quotidien Le Soir, il va désormais multiplier les expéditions les plus lointaines et les entrevues exclusives. En une quinzaine d’années, ses pérégrinations vont l’emmener aux quatre coins de l’univers et lui permettre de rencontrer un nombre incroyable de personnalités de premier plan. Après le Congo (où il retournera plusieurs fois), Pierre Daye visite ainsi le Maroc, où il s’entretient avec le sultan Moulay Youssef (1881-1927), les Balkans, où il est reçu par le Premier ministre bulgare Alexandre Tsankov (1879-1959), et l’Argentine, où il se rend, en 1925, en faisant le subrécargue sur un modeste cargo. Après Buenos-Aires, où il se lie avec l’écrivain nationaliste Leopoldo Lugones (1874-1938), il traverse la Cordillière des Andes et découvre le Chili, puis se rend en Uruguay et au Brésil. En 1926, il est à Moscou, approche Léon Trotsky, Leonid Krassine (5) et Maxime Litvinov (6), puis passe par la Pologne et s’y entretient avec Sikorski (7), avant de regagner Bruxelles pour y faire rapport au roi Albert Ier. D’autres expéditions le conduisent en Angola, en Nubie mais aussi au Maroc espagnol, où il rencontre le général Primo de Rivera, et en Asie qu’il visite en qualité de chargé de mission. Après une escale à Ceylan, il passe par les Indes britanniques, la Malaisie, Sumatra, le Japon, la Chine et la Mandchourie. Dans l’Empire du Milieu, il va voir les tombes des Mings, rencontre Pou-yi (8) et obtient une entrevue avec le président Tchang Tso-lin (9). D’une curiosité insatiable, Pierre Daye effectue ensuite un tour du monde par les îles, périple original qui le conduit au Cap Vert, aux Antilles, à Panama, à Tahiti, aux îles Fidji, aux Nouvelles-Hébrides, en Nouvelle-Calédonie, en Australie et à Java. Il va sans dire que toutes ces étapes donnent naissance à autant d’articles ou de livres captivants (10). Notre impénitent voyageur connaît également bien Constantinople et le Moyen-Orient. Passé par la Syrie, la Palestine et Jérusalem, il séjourne assez longuement en Égypte (1931), ce qui lui permet de visiter Memphis (avec le peintre Herman Richir), Thèbes, Abou Simbel et le temple d’Edfou.
Embauché comme reporter par le grand quotidien Le Soir, il va désormais multiplier les expéditions les plus lointaines et les entrevues exclusives. En une quinzaine d’années, ses pérégrinations vont l’emmener aux quatre coins de l’univers et lui permettre de rencontrer un nombre incroyable de personnalités de premier plan. Après le Congo (où il retournera plusieurs fois), Pierre Daye visite ainsi le Maroc, où il s’entretient avec le sultan Moulay Youssef (1881-1927), les Balkans, où il est reçu par le Premier ministre bulgare Alexandre Tsankov (1879-1959), et l’Argentine, où il se rend, en 1925, en faisant le subrécargue sur un modeste cargo. Après Buenos-Aires, où il se lie avec l’écrivain nationaliste Leopoldo Lugones (1874-1938), il traverse la Cordillière des Andes et découvre le Chili, puis se rend en Uruguay et au Brésil. En 1926, il est à Moscou, approche Léon Trotsky, Leonid Krassine (5) et Maxime Litvinov (6), puis passe par la Pologne et s’y entretient avec Sikorski (7), avant de regagner Bruxelles pour y faire rapport au roi Albert Ier. D’autres expéditions le conduisent en Angola, en Nubie mais aussi au Maroc espagnol, où il rencontre le général Primo de Rivera, et en Asie qu’il visite en qualité de chargé de mission. Après une escale à Ceylan, il passe par les Indes britanniques, la Malaisie, Sumatra, le Japon, la Chine et la Mandchourie. Dans l’Empire du Milieu, il va voir les tombes des Mings, rencontre Pou-yi (8) et obtient une entrevue avec le président Tchang Tso-lin (9). D’une curiosité insatiable, Pierre Daye effectue ensuite un tour du monde par les îles, périple original qui le conduit au Cap Vert, aux Antilles, à Panama, à Tahiti, aux îles Fidji, aux Nouvelles-Hébrides, en Nouvelle-Calédonie, en Australie et à Java. Il va sans dire que toutes ces étapes donnent naissance à autant d’articles ou de livres captivants (10). Notre impénitent voyageur connaît également bien Constantinople et le Moyen-Orient. Passé par la Syrie, la Palestine et Jérusalem, il séjourne assez longuement en Égypte (1931), ce qui lui permet de visiter Memphis (avec le peintre Herman Richir), Thèbes, Abou Simbel et le temple d’Edfou.
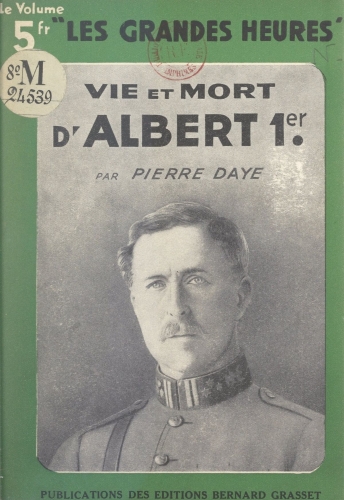 Ajoutons encore à la liste de ses voyages mémorables, la traversée de la Sibérie par 30° au-dessous de zéro, et un séjour en Perse qui lui offre l’occasion de converser avec Reza Chah Pahlavi. Son goût affirmé pour les contrées lointaines ne l’empêche pas d’apprécier aussi les découvertes européennes. Angleterre, Portugal, Italie, Autriche, Hongrie et pays scandinaves n’ont guère de secrets pour lui ; en août 1932, il est même en Lituanie, à Nida, où l’a invité Thomas Mann, tandis qu’en 1935, il visite les Pays-Bas et l’Allemagne en compagnie de Pierre Gaxotte. À Berlin, les deux hommes auront l’occasion d’échanger quelques propos avec Ribbentrop et Otto Abetz. Aventurier dans l’âme, Pierre Daye ne se contente pas de flâner nonchalamment mais il n’hésite pas, le cas échéant, à se rendre sur le théâtre de certains conflits : on le verra par exemple, en pleine guerre civile espagnole, faire la tournée des lignes de front avec Gaxotte et José Félix de Lequerica (11).
Ajoutons encore à la liste de ses voyages mémorables, la traversée de la Sibérie par 30° au-dessous de zéro, et un séjour en Perse qui lui offre l’occasion de converser avec Reza Chah Pahlavi. Son goût affirmé pour les contrées lointaines ne l’empêche pas d’apprécier aussi les découvertes européennes. Angleterre, Portugal, Italie, Autriche, Hongrie et pays scandinaves n’ont guère de secrets pour lui ; en août 1932, il est même en Lituanie, à Nida, où l’a invité Thomas Mann, tandis qu’en 1935, il visite les Pays-Bas et l’Allemagne en compagnie de Pierre Gaxotte. À Berlin, les deux hommes auront l’occasion d’échanger quelques propos avec Ribbentrop et Otto Abetz. Aventurier dans l’âme, Pierre Daye ne se contente pas de flâner nonchalamment mais il n’hésite pas, le cas échéant, à se rendre sur le théâtre de certains conflits : on le verra par exemple, en pleine guerre civile espagnole, faire la tournée des lignes de front avec Gaxotte et José Félix de Lequerica (11).
Un homme du monde
Chroniqueur réputé et homme du monde, Pierre Daye est également un habitué des dîners en ville où ses commensaux sont généralement des personnes de qualité. On l’apercevra ainsi à la table du maréchal Joffre ou à celle de Raymond Poincaré. Ami de Pierre Gaxotte (qui le fera bientôt entrer à Je suis partout), il est également lié au poète Éric de Haulleville, à Pierre Drieu la Rochelle, Maurice Mæterlinck et Georges Remi (Hergé). Sa popularité de journaliste et ses talents de causeur en font par ailleurs l’un des hôtes les plus réguliers des salons à la mode de la capitale belge. Membre assidu du très chic Cercle Gaulois, que fréquentent André Tardieu, Paul Claudel ou Pierre Benoit, il est aussi l’un des convives attitrés des dîners que donne Isabelle Errera (Goldschmidt), des soirées de prestige qu’organise Madame Jules Destrée, ou encore des réunions qu’orchestre la belle Lucienne Didier (Bauwens). Très éclectiques, ces rendez-vous accueillent aussi bien des notables de gauche, comme Henri De Man (12) et Paul-Henri Spaak (13), que des intellectuels de droite, comme Louis Carette (le futur Félicien Marceau), Brasillach, Montherlant et Fabre-Luce, ou des penseurs indépendants, comme Emmanuel Mounier (14). Dans les années 1930, il n’est pas excessif de dire que Daye est un homme arrivé. Un peu sarcastique, Jean-Léo le présente ainsi : « Grand bourgeois catholique, un peu précieux, toujours habillé avec recherche (sauf quand il pratique le nudisme), il affectionne les cravates club et ne fume que des ‘Abdalla’ à bout doré » (15). « Gentleman globe-trotter », précise-t-il encore, « habitué des sleepings, des paquebots, des palaces et des restaurants quatre étoiles (…) il est un peu boudé par la bonne société qui lui reproche ‘des mœurs dissolues’ (L’expression, à une époque où l’on ne s’éclate pas encore dans les Gay pride, désigne son homosexualité que Marcel Antoine, dans ses caricatures, suggère en le représentant jouant du bilboquet » (16). Confirmant ce portrait, l’historien Jean-Michel Etienne ajoute que l’homme est sans conteste intelligent et bon connaisseur des milieux diplomatiques belges et étrangers (17).
Disons aussi que si Pierre Daye est effectivement familier de la haute société, il ne succombe jamais à ce miroir aux alouettes qu’il observe un peu comme une sorte d’entomologiste. Parlant des « gens du monde », voici d’ailleurs ce qu’il en dit : « … vains, souvent paresseux, certains ont pour excuse sinon leur fortune, tout au moins leur culture ou leur goût, qui sont parfois réels. Snobs, comme on dit, ils se nourrissent néanmoins d’idées toutes faites, à condition qu’elles soient à la mode (…) On trouve chez eux, souvent, de l’élégance extérieure, du brillant, du charme, ce que l’on a appelé la douceur de vivre, et parfois du comique involontaire. C’est pourquoi je les ai beaucoup fréquentés, et ils m’ont beaucoup amusé. À condition de les juger pour ce qu’ils sont et de ne rien leur demander, les gens du monde apparaissent d’un utile et agréable commerce pour un célibataire qui se pique d’être en même temps un observateur professionnel » (18)
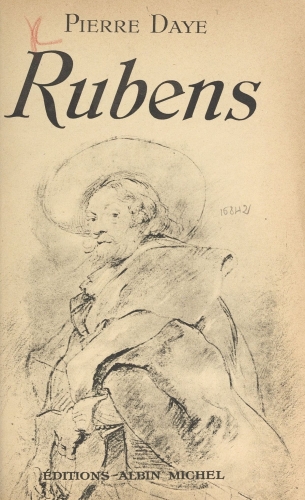 Au demeurant, il serait injuste et inexact de ne voir en Pierre Daye qu’un voyageur nanti et un mondain frivole : il s’agit aussi et surtout d’un écrivain talentueux dont les nombreux livres se vendent très bien. Auteur de multiples récits de voyage (19), il a également consacré plusieurs ouvrages aux souverains belges (20), ainsi que plusieurs essais à l’Afrique (21). Dans la première partie de sa vie, il a, en revanche, peu abordé la politique dans ses livres, et lorsqu’il l’a fait, ce fut plutôt sous l’angle de la politique étrangère (22). Il s’est par ailleurs peu intéressé à la fiction, sinon sous la forme de quelques nouvelles et contes. L’un de ceux-ci, Daïnah, la métisse (1932), sera même adapté au cinéma par Jean Grémillon (avec Charles Vanel dans l’un des rôles principaux).
Au demeurant, il serait injuste et inexact de ne voir en Pierre Daye qu’un voyageur nanti et un mondain frivole : il s’agit aussi et surtout d’un écrivain talentueux dont les nombreux livres se vendent très bien. Auteur de multiples récits de voyage (19), il a également consacré plusieurs ouvrages aux souverains belges (20), ainsi que plusieurs essais à l’Afrique (21). Dans la première partie de sa vie, il a, en revanche, peu abordé la politique dans ses livres, et lorsqu’il l’a fait, ce fut plutôt sous l’angle de la politique étrangère (22). Il s’est par ailleurs peu intéressé à la fiction, sinon sous la forme de quelques nouvelles et contes. L’un de ceux-ci, Daïnah, la métisse (1932), sera même adapté au cinéma par Jean Grémillon (avec Charles Vanel dans l’un des rôles principaux).
Député rexiste
Dans les années 1930, la politique, qu’il avait autrefois délaissée au profit des voyages, l’attire de nouveau. Secrétaire du socialiste Jules Destrée, Daye se refuse toutefois à rallier le Parti Ouvrier Belge (POB). En fait, il se range parmi les conservateurs « éclairés » : membre (depuis 1926) de l’Union paneuropéenne, il se montre sensible aux questions sociales, mais à la façon des catholiques, et reste très fidèle au roi comme à l’unité nationale. Partisan de la colonisation et hostile à une émancipation rapide du Congo, il n’est cependant absolument pas raciste et ne témoigne d’aucune hostilité de principe à l’égard des Noirs. Dès 1921 et dans un article consacré au mouvement « pan-nègre » (23), il souligne qu’ « il serait vain de croire que la suprématie de la race blanche pourra se maintenir intacte », proclame que « les préjugés de race sont absurdes » et s’affirme partisan « des généreuses idées de collaboration des races ». À propos des Africains, il déclare : « Nous sommes les premiers à vouloir que le sort de la race noire soit amélioré ; que là où des abus existent, ils soient redressés ; que l’on s’occupe de l’éducation, de la formation intellectuelle et – par après – de la liberté des nègres. Mais il faut procéder avec ordre ». Car, ajoute-t-il, « il nous faut veiller à ce qu’au nom de principes sentimentaux, on n’aille pas saper notre autorité en Afrique ». Si nous insistons quelque peu sur ces opinions, disons paternalistes, de Pierre Daye, c’est afin de mieux souligner toute l’absurdité qu’il y a à le qualifier de « nazi » comme d’aucuns le feront un jour…
 Désireux de descendre dans l’arène pour y défendre ses idées catholiques, sociales et nationales, Pierre Daye découvre en 1935 le nouveau phénomène politique qu’est Léon Degrelle. Le 24 janvier, il le voit, pour la première fois, à Louvain où le jeune orateur l’impressionne beaucoup. « J’attendais depuis plusieurs années », racontera-t-il, « que se manifestât dans mon pays un effet de ce grand mouvement européen dont j’avais découvert en tant de nations les signes tangibles » (24). Séduit, l’écrivain n’est pas long à rejoindre les rangs de Rex où il siège d’emblée au Conseil politique (mais pas au Bureau exécutif). Aux élections du 24 mai 1936, le mouvement, qui a le vent en poupe, obtient du premier coup 33 élus (21 députés et 12 sénateurs). « Nous étions partis, nous pouvons bien le dire », se souvient-il, « sans aucun moyen ; nous n’avions pas d’argent, aucune expérience, très peu d’hommes, pas de journaux. Mais nous avions la foi. Et la jeunesse aussi… » (25). Et le 27 mai, dans les colonnes du Pays réel, le nouveau député bruxellois se montre plus laudatif encore, affirmant entre autres que « Léon Degrelle est devenu l’interprète de tout ce qui, dans la nation, est jeune, vivant, audacieux, tourné vers l’avenir » (26). L’Assemblée que découvre Pierre Daye n’a rien de bien attrayant : selon lui, « les trucs, les combinaisons, l’intérêt personnel, la stérilité, la suffisance, la vulgarité, tels étaient quelques-uns des traits que révélait l’examen de l’institution parlementaire » (27). Il semble néanmoins tout à fait décidé à jouer le jeu et à faire sérieusement son travail de député. Placé à la tête du groupe parlementaire, il s’efforce donc, en premier lieu, de discipliner ses collègues rexistes qui font souvent preuve d’une nonchalance et d’un amateurisme consternants. Auteur d’un projet de loi réduisant la durée du service militaire, il s’exprime aussi au sein de la Commission des Colonies et de celle des Affaires Étrangères où il plaide fougueusement pour l’Espagne nationaliste. Assez proche du chef, il est souvent associé aux grandes manœuvres de ce dernier. En septembre 1936, par exemple, il est aux côtés de Degrelle lorsque celui-ci est reçu par Hitler (invité par Rudolf Hess, il profite du déplacement pour assister au 8e congrès de Nuremberg). C’est par ailleurs autour de la table de Pierre Daye que se nouent certains contacts discrets entre des gens comme Gustave Sap (28), Hendrik Borginon (29), Gérard Romsée (30), Joris van Severen (31), Charles-Albert d’Aspremont-Lynden (32), et Léon Degrelle. Plus tard, et au grand dam du Quai d’Orsay, il demandera la dénonciation de l’accord militaire franco-belge, ainsi que des accords de Locarno (33).
Désireux de descendre dans l’arène pour y défendre ses idées catholiques, sociales et nationales, Pierre Daye découvre en 1935 le nouveau phénomène politique qu’est Léon Degrelle. Le 24 janvier, il le voit, pour la première fois, à Louvain où le jeune orateur l’impressionne beaucoup. « J’attendais depuis plusieurs années », racontera-t-il, « que se manifestât dans mon pays un effet de ce grand mouvement européen dont j’avais découvert en tant de nations les signes tangibles » (24). Séduit, l’écrivain n’est pas long à rejoindre les rangs de Rex où il siège d’emblée au Conseil politique (mais pas au Bureau exécutif). Aux élections du 24 mai 1936, le mouvement, qui a le vent en poupe, obtient du premier coup 33 élus (21 députés et 12 sénateurs). « Nous étions partis, nous pouvons bien le dire », se souvient-il, « sans aucun moyen ; nous n’avions pas d’argent, aucune expérience, très peu d’hommes, pas de journaux. Mais nous avions la foi. Et la jeunesse aussi… » (25). Et le 27 mai, dans les colonnes du Pays réel, le nouveau député bruxellois se montre plus laudatif encore, affirmant entre autres que « Léon Degrelle est devenu l’interprète de tout ce qui, dans la nation, est jeune, vivant, audacieux, tourné vers l’avenir » (26). L’Assemblée que découvre Pierre Daye n’a rien de bien attrayant : selon lui, « les trucs, les combinaisons, l’intérêt personnel, la stérilité, la suffisance, la vulgarité, tels étaient quelques-uns des traits que révélait l’examen de l’institution parlementaire » (27). Il semble néanmoins tout à fait décidé à jouer le jeu et à faire sérieusement son travail de député. Placé à la tête du groupe parlementaire, il s’efforce donc, en premier lieu, de discipliner ses collègues rexistes qui font souvent preuve d’une nonchalance et d’un amateurisme consternants. Auteur d’un projet de loi réduisant la durée du service militaire, il s’exprime aussi au sein de la Commission des Colonies et de celle des Affaires Étrangères où il plaide fougueusement pour l’Espagne nationaliste. Assez proche du chef, il est souvent associé aux grandes manœuvres de ce dernier. En septembre 1936, par exemple, il est aux côtés de Degrelle lorsque celui-ci est reçu par Hitler (invité par Rudolf Hess, il profite du déplacement pour assister au 8e congrès de Nuremberg). C’est par ailleurs autour de la table de Pierre Daye que se nouent certains contacts discrets entre des gens comme Gustave Sap (28), Hendrik Borginon (29), Gérard Romsée (30), Joris van Severen (31), Charles-Albert d’Aspremont-Lynden (32), et Léon Degrelle. Plus tard, et au grand dam du Quai d’Orsay, il demandera la dénonciation de l’accord militaire franco-belge, ainsi que des accords de Locarno (33).
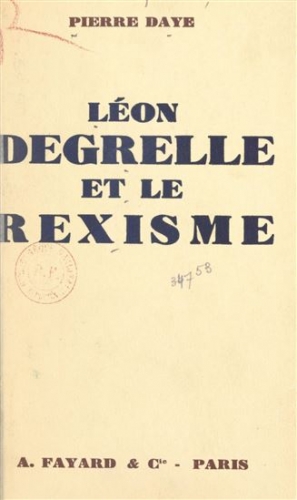 Dévoué mais exigeant, Pierre Daye va vite se lasser des carences profondes du groupe parlementaire rexiste dont il abandonne d’ailleurs la présidence dès juin 1937. Cela ne l’empêche cependant pas de continuer son travail à la Chambre. Dans le même temps, il poursuit son activité de chroniqueur et d’essayiste. En octobre 1936, il joue un rôle clef dans la parution d’un numéro spécial de Je suis partout entièrement consacré à Rex, avec une « Lettre aux Français » de Léon Degrelle et des articles de Serge Doring, Carlos Leruitte et Lucien Rebatet [La même année, Robert Brasillach fait paraître Léon Degrelle et l’avenir de Rex (Plon) et l’année suivante (3 novembre 1937), il dédiera toute une page de Je suis partout au mouvement belge]. Régulièrement présent dans les colonnes de l’hebdomadaire parisien, Pierre Daye signe également, en 1937, un livre sur Léon Degrelle et le rexisme (Fayard), suivi en 1938 d’une Petite histoire parlementaire belge. Malgré cet engagement sans faille, les erreurs répétées de Rex et de son chef finissent toutefois par user sa patience. Ce désenchantement le conduit même, en 1939, à refuser de se représenter aux élections et à quitter le mouvement. Le 10 mars, il prend donc définitivement congé du groupe parlementaire et se tourne dès lors vers le parti catholique où il a conservé nombre d’amis. Il s’en va, certes, mais demeure en excellents termes avec Degrelle, ce que la suite des événements ne va pas tarder à démontrer.
Dévoué mais exigeant, Pierre Daye va vite se lasser des carences profondes du groupe parlementaire rexiste dont il abandonne d’ailleurs la présidence dès juin 1937. Cela ne l’empêche cependant pas de continuer son travail à la Chambre. Dans le même temps, il poursuit son activité de chroniqueur et d’essayiste. En octobre 1936, il joue un rôle clef dans la parution d’un numéro spécial de Je suis partout entièrement consacré à Rex, avec une « Lettre aux Français » de Léon Degrelle et des articles de Serge Doring, Carlos Leruitte et Lucien Rebatet [La même année, Robert Brasillach fait paraître Léon Degrelle et l’avenir de Rex (Plon) et l’année suivante (3 novembre 1937), il dédiera toute une page de Je suis partout au mouvement belge]. Régulièrement présent dans les colonnes de l’hebdomadaire parisien, Pierre Daye signe également, en 1937, un livre sur Léon Degrelle et le rexisme (Fayard), suivi en 1938 d’une Petite histoire parlementaire belge. Malgré cet engagement sans faille, les erreurs répétées de Rex et de son chef finissent toutefois par user sa patience. Ce désenchantement le conduit même, en 1939, à refuser de se représenter aux élections et à quitter le mouvement. Le 10 mars, il prend donc définitivement congé du groupe parlementaire et se tourne dès lors vers le parti catholique où il a conservé nombre d’amis. Il s’en va, certes, mais demeure en excellents termes avec Degrelle, ce que la suite des événements ne va pas tarder à démontrer.
La catastrophe de 1940
À nouveau libre de ses initiatives et très hostile à l’idée d’un nouveau conflit avec l’Allemagne, Pierre Daye s’associe, le 23 septembre 1939, au manifeste des intellectuels (34) « pour la neutralité belge, contre l’éternisation de la guerre européenne et pour la défense des valeurs de l’esprit ». Le texte paraît le 29 septembre dans la Revue catholique des idées et des faits, puis dans Cassandre, le Pays réel, les Cahiers franco-allemands, et ses treize signataires se voient aussitôt interdire l’accès au territoire français. En décembre, Daye rejoint Robert Poulet, Hergé, Gaston Derijcke (Claude Elsen) et Raymond De Becker, au nouvel hebdomadaire L’Ouest qui se veut le prolongement du manifeste. La France, la Grande-Bretagne et l’Allemagne étant entrées en guerre le 3 septembre, la situation devient dès lors chaotique en Belgique où partis politiques et ministres ne parviennent pas à faire des choix clairs et consensuels.
Et puis survient soudain le cataclysme, avec l’attaque allemande du 10 mai 1940 et la débandade quasi immédiate du gouvernement belge. Avant de filer vers Paris, Poitiers, Limoges ou Vichy, les autorités ont tout de même fait appréhender tous ceux qu’elles soupçonnent – à tort le plus souvent – d’appartenir à la cinquième colonne. Averti de l’arrestation de nombre de ses amis mais épargné par la première rafle, Pierre Daye juge dès lors prudent de s’éloigner au plus vite de Bruxelles. Accompagné de son neveu, Jacques Lesigne, il part donc, le 12 mai, pour La Panne, dans le but de trouver asile en France. Refoulé car il ne possède pas les visas nécessaires, il parvient cependant, le 14 mai, à franchir la frontière à Poperinghe et à filer vers Eu. Après une étape de cinq jours à Lisieux, il reprend la route, le 20 mai, traverse Nantes et atteint La Rochelle où son ami Pierre Bonardi (35) lui offre le vivre et le couvert. Le 24 mai, il pousse encore jusqu’à la périphérie de Bordeaux, laisse son neveu à Libourne, puis rebrousse chemin et regagne La Rochelle où les Bonardi le dirigent vers l’île de Ré où ils possèdent un moulin.
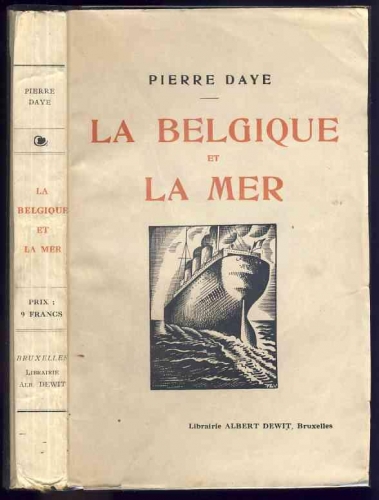 Daye va donc séjourner plusieurs semaines à Saint-Clément-des-Baleines. Loin des combats, il fait de la bicyclette, se balade avec Henri Béraud et aperçoit de temps en temps Suzy Solidor ou le peintre Paul Colin. Cette paisible villégiature s’achève toutefois vers la fin juin car avec l’armistice, le journaliste souhaite désormais rentrer chez lui. Le 8 juillet 1940, il remonte donc sur Paris, s’y arrête le temps de voir Jean Chiappe, puis regagne Bruxelles. Informé du massacre d’Abbeville (36) et du décès de Léon Degrelle, le journaliste ne tarde pas à réapparaître à Paris où l’ambassadeur Abetz, une vieille connaissance, lui apprend incidemment que Degrelle n’est absolument pas mort, mais probablement interné dans un camp du sud de la France. En dépit des divergences politiques qui ont pu opposer les deux hommes, Daye estime alors de son devoir de se porter au secours du chef de Rex et part aussitôt à sa recherche. Accompagné de Jacques Crokaert et Carl Doutreligne, il file à Vichy, rencontre Adrien Marquet mais aussi plusieurs ministres belges en déréliction… L’administration française n’ayant pas mis longtemps à localiser Degrelle qui se trouve dans l’Ariège, au camp du Vernet, le trio de sauveteurs (« mes trois mousquetaires » dira Degrelle dans La cohue de 40) s’empresse de reprendre la route. Quelques heures plus tard, ils sont à Carcassonne où ils retrouvent enfin Léon Degrelle, « sale, amaigri, méconnaissable » (37), ainsi que l’ex-député rexiste Gustave Wyns.
Daye va donc séjourner plusieurs semaines à Saint-Clément-des-Baleines. Loin des combats, il fait de la bicyclette, se balade avec Henri Béraud et aperçoit de temps en temps Suzy Solidor ou le peintre Paul Colin. Cette paisible villégiature s’achève toutefois vers la fin juin car avec l’armistice, le journaliste souhaite désormais rentrer chez lui. Le 8 juillet 1940, il remonte donc sur Paris, s’y arrête le temps de voir Jean Chiappe, puis regagne Bruxelles. Informé du massacre d’Abbeville (36) et du décès de Léon Degrelle, le journaliste ne tarde pas à réapparaître à Paris où l’ambassadeur Abetz, une vieille connaissance, lui apprend incidemment que Degrelle n’est absolument pas mort, mais probablement interné dans un camp du sud de la France. En dépit des divergences politiques qui ont pu opposer les deux hommes, Daye estime alors de son devoir de se porter au secours du chef de Rex et part aussitôt à sa recherche. Accompagné de Jacques Crokaert et Carl Doutreligne, il file à Vichy, rencontre Adrien Marquet mais aussi plusieurs ministres belges en déréliction… L’administration française n’ayant pas mis longtemps à localiser Degrelle qui se trouve dans l’Ariège, au camp du Vernet, le trio de sauveteurs (« mes trois mousquetaires » dira Degrelle dans La cohue de 40) s’empresse de reprendre la route. Quelques heures plus tard, ils sont à Carcassonne où ils retrouvent enfin Léon Degrelle, « sale, amaigri, méconnaissable » (37), ainsi que l’ex-député rexiste Gustave Wyns.
Au cœur des intrigues
La petite troupe ne s’attarde pas dans l’Aude et remonte aussitôt vers Paris où une brève escale permet à Degrelle de remercier Abetz et de s’entretenir avec Fernand de Brinon. De retour à Bruxelles le 30 août, Pierre Daye reçoit bientôt la visite du comte Robert Capelle auquel il relate la triste épopée de Degrelle. À cette occasion, le secrétaire du roi lui fait part de la position circonspecte et réservée du souverain, et lui conseille de collaborer à la presse. « Le patriotisme », énonce-t-il, « commande que les patriotes s’emparent des journaux, au lieu de les laisser à d’autres » (38). Là-dessus, Daye effectue un nouveau séjour à Paris, sa terre d’élection. Le 7 août 1940, il présente Degrelle à Pierre Laval, puis déjeune avec Bertrand de Jouvenel, et dîne un soir avec Abetz, Degrelle et Henri de Man. Le 12 août, enfin, il est chez le comte de Beaumont où il passe la soirée en compagnie de Pierre Drieu la Rochelle, avant de regagner Bruxelles.
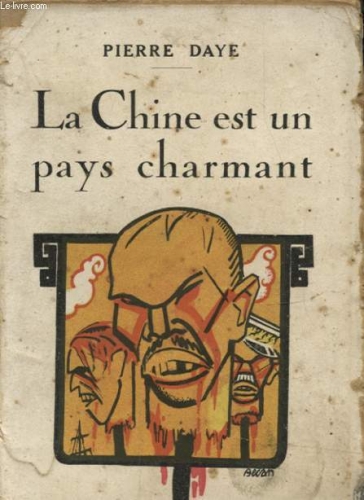 Loin d’être le pestiféré qu’il deviendra bientôt, Pierre Daye conserve en cette époque troublée de nombreuses relations mondaines : il organise, chez lui, une rencontre entre le comte Capelle et le chef de Rex, dîne avec les frères Heymans (dont l’un, Corneille, est prix Nobel) et séjourne au Zoute, chez le banquier Wauters. Invité chez le vicomte Jacques Duvignon, ancien ambassadeur à Berlin, il revoit également Mme Destrée et Robert Poulet, tandis que lors d’un enième séjour à Paris, il croise Alphonse de Chateaubriant (qui l’accueille dans les locaux de La Gerbe), Bernard Grasset, l’historien Pierre Bessand-Massenet et Stanislas de la Rochefoucauld. Si, en dépit des circonstances, Pierre Daye est quelqu’un qui demeure attaché aux petits plaisirs de la vie et aux relations sociales, il serait erroné de ne voir en lui qu’un second couteau falot et superficiel. En fait, il sert de passerelle entre beaucoup d’acteurs importants du jeu politico-diplomatique et maintient notamment d’étroits contacts avec les proches du roi. En relation avec les secrétaires du souverain, il voit aussi, très régulièrement, les anciens ministres Maurice Lippens et Henri De Man, ainsi que le général Van Overstræten, aide-de-camp de Léopold III. Pour le palais royal, Daye est donc une précieuse source de renseignements : « Je servis bien souvent d’informateur au souverain », écrit-il, « et le bloc-notes en main, le comte Capelle prenait des indications ‘pour sa Majesté’ durant la plupart de nos entretiens » (39). Il facilite par ailleurs certains contacts improbables comme cette entrevue, chez lui, le 22 mai 1943, entre Capelle et l’abbé Louis Fierens, l’aumônier (non rexiste) de la Légion Wallonie… Aucun reproche, explicite ou implicite, ne lui ayant jamais été exprimé, le journaliste s’étonnera plus tard des accusations de félonie formulées à son encontre : « Pouvais-je n’être pas convaincu », demande-t-il dans ses mémoires, « après tous mes rapports plus ou moins directs avec lui (le roi), par l’intermédiaire de son entourage, que ma conduite était approuvée ? Ou que tout au moins, elle n’était pas blamée ? » (40). Et pour être encore plus clair, il ajoute : « Si des ‘collaborationnistes’ sincères se trompaient, Léopold III aurait dû les avertir, ou les faire avertir, même au risque de déplaire aux Allemands » (41).
Loin d’être le pestiféré qu’il deviendra bientôt, Pierre Daye conserve en cette époque troublée de nombreuses relations mondaines : il organise, chez lui, une rencontre entre le comte Capelle et le chef de Rex, dîne avec les frères Heymans (dont l’un, Corneille, est prix Nobel) et séjourne au Zoute, chez le banquier Wauters. Invité chez le vicomte Jacques Duvignon, ancien ambassadeur à Berlin, il revoit également Mme Destrée et Robert Poulet, tandis que lors d’un enième séjour à Paris, il croise Alphonse de Chateaubriant (qui l’accueille dans les locaux de La Gerbe), Bernard Grasset, l’historien Pierre Bessand-Massenet et Stanislas de la Rochefoucauld. Si, en dépit des circonstances, Pierre Daye est quelqu’un qui demeure attaché aux petits plaisirs de la vie et aux relations sociales, il serait erroné de ne voir en lui qu’un second couteau falot et superficiel. En fait, il sert de passerelle entre beaucoup d’acteurs importants du jeu politico-diplomatique et maintient notamment d’étroits contacts avec les proches du roi. En relation avec les secrétaires du souverain, il voit aussi, très régulièrement, les anciens ministres Maurice Lippens et Henri De Man, ainsi que le général Van Overstræten, aide-de-camp de Léopold III. Pour le palais royal, Daye est donc une précieuse source de renseignements : « Je servis bien souvent d’informateur au souverain », écrit-il, « et le bloc-notes en main, le comte Capelle prenait des indications ‘pour sa Majesté’ durant la plupart de nos entretiens » (39). Il facilite par ailleurs certains contacts improbables comme cette entrevue, chez lui, le 22 mai 1943, entre Capelle et l’abbé Louis Fierens, l’aumônier (non rexiste) de la Légion Wallonie… Aucun reproche, explicite ou implicite, ne lui ayant jamais été exprimé, le journaliste s’étonnera plus tard des accusations de félonie formulées à son encontre : « Pouvais-je n’être pas convaincu », demande-t-il dans ses mémoires, « après tous mes rapports plus ou moins directs avec lui (le roi), par l’intermédiaire de son entourage, que ma conduite était approuvée ? Ou que tout au moins, elle n’était pas blamée ? » (40). Et pour être encore plus clair, il ajoute : « Si des ‘collaborationnistes’ sincères se trompaient, Léopold III aurait dû les avertir, ou les faire avertir, même au risque de déplaire aux Allemands » (41).
Engagé mais avec raison
Il faut dire que conformément aux conseils de Capelle, Pierre Daye s’engage assez nettement dans la « politique de présence » en rejoignant, à l’automne 1940, la rédaction du Nouveau Journal que lance Paul Colin, son ancien condisciple de l’Institut Saint-Louis. Déjà patron de l’hebdomadaire Cassandre, ce dernier est, selon Jean-Léo, un véritable « Frégoli polygraphe, merveilleusement à l’aise une plume à la main » (42). Rescapé du camp du Vernet, il a réuni autour de lui une équipe brillante où figurent entre autres Robert Poulet, le rédacteur en chef, Nicolas Barthélémy, Guido Eeckels, Paul Herten, Joseph Jumeau (alias Pierre Hubermont) et Paul Werrie (43). Son quotidien revendique « un esprit nouveau » et veut « montrer aux Belges que leur pays doit réclamer et prendre sa place dans l’économie continentale à l’érection de laquelle le Reich allemand – c’est un fait – consacre aujourd’hui une grande partie de son effort » (44). Partisan d’une collaboration digne et relativement modérée, il s’agit néanmoins, aux yeux des résistants et des Belges de Londres, d’un journal « emboché ».
 Chargé de la rubrique de politique étrangère, Pierre Daye en sera l’un des principaux chroniqueurs jusqu’en avril 1943. Le Nouveau Journal n’est pas le seul organe de presse à accueillir sa prose puisque l’on trouve également sa signature dans Junges Europa, Das Neue Europa, Europäische Revue, Signal, Actu, le Petit Parisien, Je suis partout, et qu’il s’exprime de temps à autres au micro de Radio-Bruxelles. Quoique très dense, cette activité journalistique ne l’empêche pas de publier aussi quelques nouveaux livres. En 1941, il fait ainsi paraître un essai politique, Guerre et révolution, lettre d’un Belge à un ami français, suivi d’un Rubens, puis de Par le monde qui change, un ouvrage où il évoque quelques-uns des pays qu’il a visités, décerne au passage quelques compliments au Reich pour avoir encouragé la jeunesse et amélioré la race, et décrit Adolf Hitler comme « un homme simple, très différend des hobereaux allemands d’autrefois » (45). Si l’homme de lettres ne fait pas mystère de ses sympathies, il s’abstient toutefois de franchir certaines limites : il garde notamment ses distances avec la Légion Wallonie et fait même publiquement savoir qu’il n’est jamais intervenu en sa faveur auprès du palais royal. Il admire, dit-il, le courage des volontaires mais ne comprend pas vraiment leur démarche. Très attaché à l’unité et à l’intégrité de la Belgique comme à la personne du roi, il prend grand soin de ne jamais cautionner une autre ligne que celle-là. Hostile à la persécution des Juifs comme à tout démembrement du royaume, Pierre Daye considère globalement les affaires politiques d’un œil sévère : « Trop de gens aux dents longues, trop de bonshommes intéressés. Trop de tripotages. Trop de fortunes aussi gigantesques que rapides » (46). Désireux de voir la Belgique se réorganiser sur un schéma centralisateur, monarchique et corporatif, il regroupe autour de lui un « Bureau politique », auquel prennent part ses amis Gustave Wyns et Jacques Crokaert, puis s’associe, en mai 1941, à la tentative de créer un Parti des Provinces Romanes. Ce dernier doit soutenir l’Ordre Nouveau européen, protéger la race et favoriser la fondation d’un État autoritaire, corporatif et chrétien (47). Le projet fera long feu car le 5 août 1941, les autorités allemandes y opposent leur veto. Autre geste politique de Pierre Daye : le 1er février 1943, il adhère à la Société Européenne des Écrivains (48) et plus précisément à l’une de ses deux sections belges, la Communauté Culturelle Wallonne (49). Cet engagement sans détour ne fait cependant pas de lui un fanatique ou un ultra, et c’est assez souvent, il faut le dire, qu’il intervient en faveur de certains Israélites ou de résistants (dont le communiste Albert Marteaux et le socialiste Victor Larock).
Chargé de la rubrique de politique étrangère, Pierre Daye en sera l’un des principaux chroniqueurs jusqu’en avril 1943. Le Nouveau Journal n’est pas le seul organe de presse à accueillir sa prose puisque l’on trouve également sa signature dans Junges Europa, Das Neue Europa, Europäische Revue, Signal, Actu, le Petit Parisien, Je suis partout, et qu’il s’exprime de temps à autres au micro de Radio-Bruxelles. Quoique très dense, cette activité journalistique ne l’empêche pas de publier aussi quelques nouveaux livres. En 1941, il fait ainsi paraître un essai politique, Guerre et révolution, lettre d’un Belge à un ami français, suivi d’un Rubens, puis de Par le monde qui change, un ouvrage où il évoque quelques-uns des pays qu’il a visités, décerne au passage quelques compliments au Reich pour avoir encouragé la jeunesse et amélioré la race, et décrit Adolf Hitler comme « un homme simple, très différend des hobereaux allemands d’autrefois » (45). Si l’homme de lettres ne fait pas mystère de ses sympathies, il s’abstient toutefois de franchir certaines limites : il garde notamment ses distances avec la Légion Wallonie et fait même publiquement savoir qu’il n’est jamais intervenu en sa faveur auprès du palais royal. Il admire, dit-il, le courage des volontaires mais ne comprend pas vraiment leur démarche. Très attaché à l’unité et à l’intégrité de la Belgique comme à la personne du roi, il prend grand soin de ne jamais cautionner une autre ligne que celle-là. Hostile à la persécution des Juifs comme à tout démembrement du royaume, Pierre Daye considère globalement les affaires politiques d’un œil sévère : « Trop de gens aux dents longues, trop de bonshommes intéressés. Trop de tripotages. Trop de fortunes aussi gigantesques que rapides » (46). Désireux de voir la Belgique se réorganiser sur un schéma centralisateur, monarchique et corporatif, il regroupe autour de lui un « Bureau politique », auquel prennent part ses amis Gustave Wyns et Jacques Crokaert, puis s’associe, en mai 1941, à la tentative de créer un Parti des Provinces Romanes. Ce dernier doit soutenir l’Ordre Nouveau européen, protéger la race et favoriser la fondation d’un État autoritaire, corporatif et chrétien (47). Le projet fera long feu car le 5 août 1941, les autorités allemandes y opposent leur veto. Autre geste politique de Pierre Daye : le 1er février 1943, il adhère à la Société Européenne des Écrivains (48) et plus précisément à l’une de ses deux sections belges, la Communauté Culturelle Wallonne (49). Cet engagement sans détour ne fait cependant pas de lui un fanatique ou un ultra, et c’est assez souvent, il faut le dire, qu’il intervient en faveur de certains Israélites ou de résistants (dont le communiste Albert Marteaux et le socialiste Victor Larock).
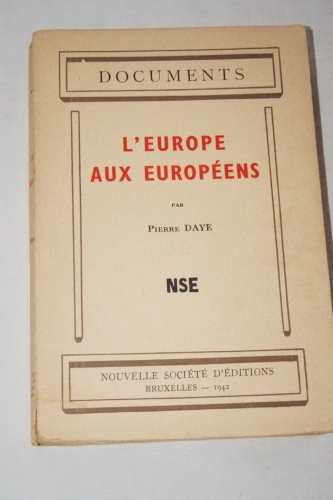 La guerre n’a pas émoussé le goût pour les voyages de Pierre Daye qui continue, dans la mesure où les événements le permettent, à se déplacer en Europe. Début 1942, il est par exemple au Portugal, puis en août en Hongrie, et séjourne, en fin d’année, à Rome. Dans la ville éternelle, il renoue avec de vieux amis, comme la duchesse de Villarosa ou le sénateur Aldobrandini Rangoni, tous très anglophiles, et s’entretient, le 10 janvier 1943, avec le prince Umberto. Quatre jours auparavant, il a pu être reçu par le Souverain Pontife, ce qui revêt pour lui une importance toute particulière. Grâce à un proche du Pape, le père jésuite Tacchi-Venturi, il a en effet obtenu de voir brièvement Sa Sainteté Pie XII qui l’a interrogé sur la situation belge et lui a donné sa bénédiction. « Ce qui m’avait le plus ému durant cette entrevue », rapporte-t-il, « c’est la grande allure du Saint-Père, son air de seigneur, la beauté de son visage ascétique et blême, avec ses yeux d’un noir brillant, sa longue bouche volontaire, son nez en bec d’aigle, la noblesse de ses gestes » (50). Peu de temps après cette promenade italienne, en février-mars 1943, Pierre Daye se rend à Madrid. N’étant inféodé à aucune faction politique, il profite de ce passage dans un pays non-belligérant pour adresser, de son propre chef, un courrier à Paul van Zeeland : « Il faut souhaiter », lui écrit-il, « que des éléments provenant des deux clans entre lesquels se divise aujourd’hui la Belgique, celui des “gens de Londres“ et celui de ceux que vous appelez, je crois, les “collaborationnistes“ (je suis pour ma part convaincu que tous deux comptent des patriotes sincères) puissent bientôt, à l’issue des hostilités, se comprendre et collaborer, autour du Roi, dans l’intérêt même de notre pays » (51). Par le biais de l’armateur Pierre Grisar, il envoie une missive du même genre à Hubert Pierlot, le chef du gouvernement belge en exil. Faut-il préciser qu’il n’obtiendra aucune réponse…
La guerre n’a pas émoussé le goût pour les voyages de Pierre Daye qui continue, dans la mesure où les événements le permettent, à se déplacer en Europe. Début 1942, il est par exemple au Portugal, puis en août en Hongrie, et séjourne, en fin d’année, à Rome. Dans la ville éternelle, il renoue avec de vieux amis, comme la duchesse de Villarosa ou le sénateur Aldobrandini Rangoni, tous très anglophiles, et s’entretient, le 10 janvier 1943, avec le prince Umberto. Quatre jours auparavant, il a pu être reçu par le Souverain Pontife, ce qui revêt pour lui une importance toute particulière. Grâce à un proche du Pape, le père jésuite Tacchi-Venturi, il a en effet obtenu de voir brièvement Sa Sainteté Pie XII qui l’a interrogé sur la situation belge et lui a donné sa bénédiction. « Ce qui m’avait le plus ému durant cette entrevue », rapporte-t-il, « c’est la grande allure du Saint-Père, son air de seigneur, la beauté de son visage ascétique et blême, avec ses yeux d’un noir brillant, sa longue bouche volontaire, son nez en bec d’aigle, la noblesse de ses gestes » (50). Peu de temps après cette promenade italienne, en février-mars 1943, Pierre Daye se rend à Madrid. N’étant inféodé à aucune faction politique, il profite de ce passage dans un pays non-belligérant pour adresser, de son propre chef, un courrier à Paul van Zeeland : « Il faut souhaiter », lui écrit-il, « que des éléments provenant des deux clans entre lesquels se divise aujourd’hui la Belgique, celui des “gens de Londres“ et celui de ceux que vous appelez, je crois, les “collaborationnistes“ (je suis pour ma part convaincu que tous deux comptent des patriotes sincères) puissent bientôt, à l’issue des hostilités, se comprendre et collaborer, autour du Roi, dans l’intérêt même de notre pays » (51). Par le biais de l’armateur Pierre Grisar, il envoie une missive du même genre à Hubert Pierlot, le chef du gouvernement belge en exil. Faut-il préciser qu’il n’obtiendra aucune réponse…
Face à l’orage
La destination préférée de Pierre Daye reste la France où le Belge a ses habitudes depuis des lustres et où il compte de nombreux amis. À Paris, il rencontre bien sûr les gens de Je suis partout : Lucien Rebatet (« bouillant, grinçant, belliqueux, rageur »), Brasillach, Lesca (« serein, définitif et magnifique »), Georges Blond, Pierre-Antoine Cousteau, Claude Jeantet et Alain Laubreaux (« féroce, débordant d’esprit, d’érudition théâtrale »). À La Gerbe, il rend visite à Alphonse de Chateaubriant qu’il invitera bientôt à Bruxelles. Toujours friand de distractions, il retrouve aussi son complice Carl Doutreligne et dîne parfois avec lui chez Maxim’s où les deux compères coudoient Cécile Sorel et Maurice Chevalier, mais aussi Fernand de Brinon, Alice Cocéa, Serge Lifar et l’ambassadeur Scapini. Sans parler de quelques Belges comme les barons Jean Empain et de Becker-Remy… Doué pour les croquis, Pierre Daye en parsème les articles qu’il donne alors au Nouveau Journal et au Petit Parisien. On y voit défiler Fernand de Brinon, « la taille moyenne, le profil aquilin, la voix un peu haute », Pierre Laval, « l’œil plein d’ironie » et presque « asiatique », Jean Chiappe, avec « ses souliers vernis à tiges de drap mastic et ses hauts talons, son melon un peu penché sur l’oreille, sa canne à bague d’or », ou encore Robert Brasillach, « le regard toujours ingénu derrière ses grosses lunettes à monture d’écaille ». De cette galerie, le chroniqueur n’omet pas le maréchal, « figure ferme, au teint mat et sain », ni Jacques Doriot, « grand, de visage plus martelé que sur les photos, agile, quoique puissant (…), l’œil très noir derrière les verres ronds, le geste sobre » (52).
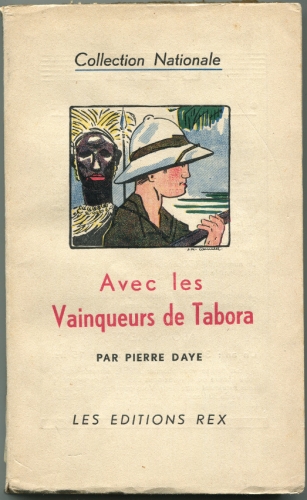 Présent dans les gazettes, Pierre Daye l’est tout autant aux devantures des librairies : en 1942, il fait paraître deux essais politiques (L ‘Europe aux Européens et Trente-deux mois chez les députés), puis en 1943, un texte sur l’Afrique (Problèmes congolais), et en 1944, un recueil de contes (D’ombre et de lumière). À compter de 1943, son engagement se concrétise aussi par son accession à un poste officiel dans l’administration belge. Sur recommandation du Flamand Gérard Romsée, il est en effet nommé, le 25 juin 1943, au poste un peu inattendu de … commissaire général à l’Éducation Physique et aux Sports. En soi, il s’agit d’une fonction peu compromettante et qui fournit à son titulaire d’excellentes justifications pour voyager. Reste qu’elle fait de Pierre Daye un fonctionnaire officiel de la collaboration, ce qui peut se révéler extrêmement dangereux. De fait, loin d’aller vers l’apaisement qu’il souhaitait, la situation se dégrade et les rivalités belges se muent désormais en sanglants règlements de compte. « Les hitlériens de nationalité belge [sont] plus abjects encore que leurs maîtres allemands », proclame un journal clandestin communiste. « Cette vermine immonde doit être écrasée (…) Les Partisans belges se sont juré de liquider ces bêtes puantes » (53) L’année 1942 est ponctuée d’au moins 67 attentats et l’année 1943 connaît une recrudescence vertigineuse des actes violents, au point que le chef de l’administration allemande, Eggert Reeder, parle carrément d’une vague de meurtres ou Mordwelle. « Dans la rue et les campagnes, surtout à partir de 1943 », écrit une historienne belge, « règne une atmosphère de guerre civile : rexistes et nationalistes flamands, ainsi que les membres de leurs familles, sont abattus, sans autre forme de procès, sans distinction d’âge ou de sexe » (54).
Présent dans les gazettes, Pierre Daye l’est tout autant aux devantures des librairies : en 1942, il fait paraître deux essais politiques (L ‘Europe aux Européens et Trente-deux mois chez les députés), puis en 1943, un texte sur l’Afrique (Problèmes congolais), et en 1944, un recueil de contes (D’ombre et de lumière). À compter de 1943, son engagement se concrétise aussi par son accession à un poste officiel dans l’administration belge. Sur recommandation du Flamand Gérard Romsée, il est en effet nommé, le 25 juin 1943, au poste un peu inattendu de … commissaire général à l’Éducation Physique et aux Sports. En soi, il s’agit d’une fonction peu compromettante et qui fournit à son titulaire d’excellentes justifications pour voyager. Reste qu’elle fait de Pierre Daye un fonctionnaire officiel de la collaboration, ce qui peut se révéler extrêmement dangereux. De fait, loin d’aller vers l’apaisement qu’il souhaitait, la situation se dégrade et les rivalités belges se muent désormais en sanglants règlements de compte. « Les hitlériens de nationalité belge [sont] plus abjects encore que leurs maîtres allemands », proclame un journal clandestin communiste. « Cette vermine immonde doit être écrasée (…) Les Partisans belges se sont juré de liquider ces bêtes puantes » (53) L’année 1942 est ponctuée d’au moins 67 attentats et l’année 1943 connaît une recrudescence vertigineuse des actes violents, au point que le chef de l’administration allemande, Eggert Reeder, parle carrément d’une vague de meurtres ou Mordwelle. « Dans la rue et les campagnes, surtout à partir de 1943 », écrit une historienne belge, « règne une atmosphère de guerre civile : rexistes et nationalistes flamands, ainsi que les membres de leurs familles, sont abattus, sans autre forme de procès, sans distinction d’âge ou de sexe » (54).
Le 14 avril 1943, Paul Colin, le patron et l’ami de Pierre Daye, est abattu dans sa librairie. L’un de ses employés, Gaston Bekeman, tombe sous les balles du même assassin. Le meurtrier, Arnaud Fraiteur, un étudiant de 22 ans (55), et ses deux complices, André Bertulot et Maurice Raskin, seront condamnés à mort et pendus. « Paul Colin », écrit Pierre Daye, « n’était pas seulement le premier critique d’art de Belgique (…) l’auteur de tant d’essais littéraires, artistiques, politiques, l’historien profond des ducs de Bourgogne, l’éditeur, le directeur du Nouveau Journal et de Cassandre, le chroniqueur et le pamphlétaire, le fondateur et le président de l’Association des journalistes belges, mais un amateur éclairé, un homme de goût et surtout un être terriblement intelligent, un des plus intelligents que j’ai rencontrés dans cette partie agitée de ma carrière » (56) « Il était détesté, naturellement », ajoute-t-il, « car il haïssait la médiocrité et ne se privait pas de le montrer, avec une verve, un éclat terribles. Il avait la dent dure et adorait se faire des ennemis » (57).
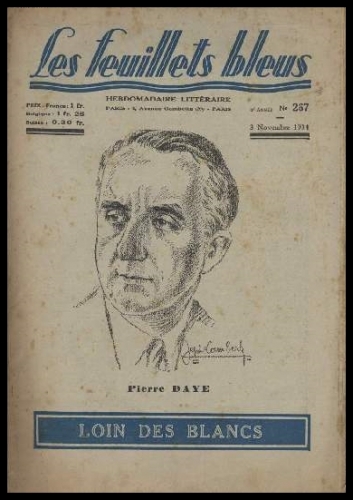 Profondément choqué par le déferlement de violence auquel il assiste, Pierre Daye en juge sévèrement les inspirateurs : « Il fallait », constate-t-il amèrement, « par la provocation, empoisonner une atmosphère trop paisible, donc trop favorable à l’occupant. Il fallait susciter des vengeances, allumer l’esprit de représailles » (58). Et confronté à cet engrenage fatal (59), il en décrit tristement le mécanisme : « De braves gens, mûs uniquement par le sentiment patriotique, ne se doutaient point du vrai rôle qu’on leur faisait ainsi jouer. Et des canailles trouvaient, en se glissant parmi eux, le moyen de commettre les plus bas crimes (…) Se sentant sans protection, d’autres braves gens, de l’autre idéologie, se dirent alors qu’il fallait se défendre soi-même ; non pas se venger, mais si l’on voulait vivre, répondre à la terreur par la terreur » (60).
Profondément choqué par le déferlement de violence auquel il assiste, Pierre Daye en juge sévèrement les inspirateurs : « Il fallait », constate-t-il amèrement, « par la provocation, empoisonner une atmosphère trop paisible, donc trop favorable à l’occupant. Il fallait susciter des vengeances, allumer l’esprit de représailles » (58). Et confronté à cet engrenage fatal (59), il en décrit tristement le mécanisme : « De braves gens, mûs uniquement par le sentiment patriotique, ne se doutaient point du vrai rôle qu’on leur faisait ainsi jouer. Et des canailles trouvaient, en se glissant parmi eux, le moyen de commettre les plus bas crimes (…) Se sentant sans protection, d’autres braves gens, de l’autre idéologie, se dirent alors qu’il fallait se défendre soi-même ; non pas se venger, mais si l’on voulait vivre, répondre à la terreur par la terreur » (60).
Sa charge administrative facilitant les déplacements, Pierre Daye ne se prive pas de revenir en France autant qu’il le souhaite. Le 29 novembre 1943, il est à Vichy où il déjeune avec Pierre Laval, « la mèche napoléonienne sur la lippe fatiguée (…) Ironique, sans illusion, finaud » (61). Le soir, il dîne au Chantecler avec Stanislas de la Rochefoucauld, l’ambassadeur Gaston Bergery (« toujours l’air d’un jeune père jésuite, sec, précis et désabusé, strictement vêtu de drap sombre ») et son épouse, Bettina Jones, ancienne égérie de Schiaparelli. Au retour, le Belge s’arrête bien sûr à Paris où il rend visite à Drieu, avenue de Breteuil. « Il m’effraye », note-t-il, « par sa lucidité triste : la guerre, la décadence des possédants, la lourdeur des Allemands, l’incompréhension des femmes, le préoccupent. Son scepticisme me désespère et me séduit à la fois » (62). De retour chez lui, avenue de Tervueren, à Etterbeek, Pierre Daye n’est pas rasséréné par l’atmosphère ambiante. Les attentats se multiplient et les positions des uns et des autres se crispent jusqu’à l’absurde. Même les nuits ne laissent désormais plus aucun répit : « Qui n’a pas connu », raconte-t-il, « l’angoisse causée par des centaines d’avions passant sur les têtes, tandis que roulait à travers les nuages un bruit sourd, dominant tous les autres, et la sensation de la mort qui pouvait vous atteindre à chaque seconde, alors que l’on se sentait accablé d’impuissance, hors de toute possibilité de fuite ou de recours quelconque, ne sait pas ce que furent pour les nerfs ces heures démoralisantes » (63).
Loin des épurateurs
Dans ces conditions, et compte tenu de l’avenir immédiat de la Belgique tel qu’il l’anticipe, Daye songe de plus en plus à mettre quelque distance entre les futurs libérateurs du royaume et lui-même. En mai 1944, l’occasion s’offre à lui d’effectuer une tournée officielle en Espagne en qualité de commissaire aux sports, déplacement qui possède l’immense avantage de le mettre à l’abri des pistoleros du Front de l’Indépendance, comme des bombes de la RAF et de l’US Air Force. Le 19 mai, le quotidien madrilène ABC rapporte que le Belge a donné une conférence de presse dans la capitale ibérique, et quant à l’intéressé lui-même, il signale qu’il passe ensuite quelques jours à Barcelone afin de s’entretenir avec le général Moscardo (1878-1956), délégué national aux sports. Peu pressé de rentrer en Belgique, Pierre Daye se trouve encore à Madrid le 6 juin lorsque tombe la nouvelle du débarquement allié en Normandie. Ses supérieurs le pressent de rentrer au pays, mais l’écrivain n’en a cure : « J’étais venu librement comme les autres fois », commente-t-il. « Nul ne m’avait donné d’ordres, et je ne me sentais pas d’humeur à commencer à en recevoir » (64). D’ailleurs, un retour impliquerait de traverser une France en pleine insurrection et comme il le souligne : « Je possédais les meilleures raisons du monde pour ne pas tomber entre les mains d’excités pris de folie sanguinaire » (65). À cette époque commence donc pour Pierre Daye une seconde existence, celle d’un émigré politique. Elle va durer un peu plus de quinze ans.
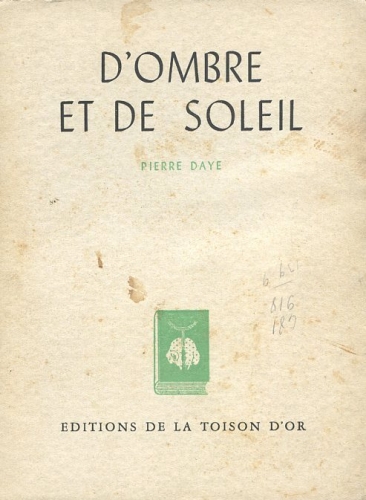 Les premiers temps d’exil ne sont pas trop durs car l’expatrié possède encore quelques relations : il est reçu chez le phalangiste Eugenio d’Ors (66) ou chez le général Eugenio Espinosa de los Monteros, ancien ambassadeur à Berlin, et dîne même parfois avec Walter Starkie (67), le directeur de l’Institut Britannique de Madrid. Plus tard, il verra de temps en temps François Piétri et l’académicien Abel Bonnard. Quelles que soient les difficultés qu’il rencontre et la peine qu’il éprouve, cet exil lui épargne à tout le moins un sort funeste. L’épuration belge se veut en effet particulièrement vindicative puisque, si l’on en croit Paul Sérant, un certain Marcel Houtman exige par exemple que soient exécutés tous les Belges ayant combattu sur le front de l’Est, tous les écrivains et journalistes de la collaboration et tous les fonctionnaires ayant servi les desseins de l’occupant ! (68) Les intellectuels ne peuvent donc guère espérer de mansuétude. Le poète René Baert a été sommairement abattu au coin d’un bois, quelque part en Allemagne, plusieurs journalistes sont condamnés à la peine capitale et fusillés (Paul Herten, José Sreel, Jules Lhoste, Victor Meulenyser, Charles Nisolles, Paul Lespagnard), d’autres échappent de très peu au poteau (Robert Poulet, Paul Jamin), et quelques-uns, comme Pierre Hubermont et Gabriel Figeys, écopent de lourdes peines de détention. Le peintre Marc Eemans est frappé d’une peine de huit ans de prison, tandis que le dramaturge Michel de Ghelderode se fait copieusement insulter et chasser de son emploi. Beaucoup ne retrouveront un peu de tranquillité qu’à l’étranger : Simenon, Hergé et Henri de Man en Suisse, Paul Werrie en Espagne puis en France, Raymond de Becker (condamné à mort puis à la détention perpétuelle), Claude Elsen (condamné à mort par contumace) et Louis Carette (condamné par contumace à 15 ans de travaux forcés) en France. Certains feront malgré tout, hors de Belgique, de brillantes carrières : émigré à Paris, Oscar Van Godtsenhoven, alias Jan Van Dorp, y remportera un prix (1948) pour son Flamand des vagues ; Louis Carette, alias Félicien Marceau, sera élu à l’Académie française (1975), tandis que Jean Libert et Gaston Vandenpanhuyse vendront des milliers de livres sous les noms d’emprunt de Paul Kenny et Jean-Gaston Vandel. « La répression contre les intellectuels », note Elsa Van Brusseghem-Loorne, « surtout en Wallonie (69), prendra (…) une tournure dramatique et particulièrement cruelle, comme si le pouvoir, détenu par des classes en déclin, voulait éliminer par tous les moyens ceux qui, par leurs efforts, étaient la preuve vivante de son infériorité culturelle » (70)…
Les premiers temps d’exil ne sont pas trop durs car l’expatrié possède encore quelques relations : il est reçu chez le phalangiste Eugenio d’Ors (66) ou chez le général Eugenio Espinosa de los Monteros, ancien ambassadeur à Berlin, et dîne même parfois avec Walter Starkie (67), le directeur de l’Institut Britannique de Madrid. Plus tard, il verra de temps en temps François Piétri et l’académicien Abel Bonnard. Quelles que soient les difficultés qu’il rencontre et la peine qu’il éprouve, cet exil lui épargne à tout le moins un sort funeste. L’épuration belge se veut en effet particulièrement vindicative puisque, si l’on en croit Paul Sérant, un certain Marcel Houtman exige par exemple que soient exécutés tous les Belges ayant combattu sur le front de l’Est, tous les écrivains et journalistes de la collaboration et tous les fonctionnaires ayant servi les desseins de l’occupant ! (68) Les intellectuels ne peuvent donc guère espérer de mansuétude. Le poète René Baert a été sommairement abattu au coin d’un bois, quelque part en Allemagne, plusieurs journalistes sont condamnés à la peine capitale et fusillés (Paul Herten, José Sreel, Jules Lhoste, Victor Meulenyser, Charles Nisolles, Paul Lespagnard), d’autres échappent de très peu au poteau (Robert Poulet, Paul Jamin), et quelques-uns, comme Pierre Hubermont et Gabriel Figeys, écopent de lourdes peines de détention. Le peintre Marc Eemans est frappé d’une peine de huit ans de prison, tandis que le dramaturge Michel de Ghelderode se fait copieusement insulter et chasser de son emploi. Beaucoup ne retrouveront un peu de tranquillité qu’à l’étranger : Simenon, Hergé et Henri de Man en Suisse, Paul Werrie en Espagne puis en France, Raymond de Becker (condamné à mort puis à la détention perpétuelle), Claude Elsen (condamné à mort par contumace) et Louis Carette (condamné par contumace à 15 ans de travaux forcés) en France. Certains feront malgré tout, hors de Belgique, de brillantes carrières : émigré à Paris, Oscar Van Godtsenhoven, alias Jan Van Dorp, y remportera un prix (1948) pour son Flamand des vagues ; Louis Carette, alias Félicien Marceau, sera élu à l’Académie française (1975), tandis que Jean Libert et Gaston Vandenpanhuyse vendront des milliers de livres sous les noms d’emprunt de Paul Kenny et Jean-Gaston Vandel. « La répression contre les intellectuels », note Elsa Van Brusseghem-Loorne, « surtout en Wallonie (69), prendra (…) une tournure dramatique et particulièrement cruelle, comme si le pouvoir, détenu par des classes en déclin, voulait éliminer par tous les moyens ceux qui, par leurs efforts, étaient la preuve vivante de son infériorité culturelle » (70)…
Au pays de Martin Fierro
Faute d’avoir pu épingler Pierre Daye à leur tableau de chasse, les nouvelles autorités belges se penchent néanmoins sur son cas, et la 4e Chambre du Conseil de Guerre n’éprouve aucun scrupule à le condamner par contumace, le 18 décembre 1946, à la peine de mort. Des pressions sont exercées sur l’Espagne qui ne peut décemment, sous le nez des Alliés, offrir l’hospitalité à tous les proscrits d’Europe et se voit donc contrainte d’effectuer des choix. Si le Caudillo a accordé l’asile politique à Léon Degrelle, Jean Bichelone ou Abel Bonnard, il n’a pas gardé Pierre Laval qui a fini devant un peloton d’exécution… Malgré le soutien de quelques dignitaires franquistes, comme José Félix de Lequerica, Manuel Aznar et José María de Areilza, Pierre Daye fait lui aussi partie des gens que l’on incite vivement à quitter l’Espagne. Muni d’un passeport espagnol libellé au nom de Pedro Adán, l’ancien commissaire aux sports s’envole donc pour Buenos Aires où il arrive le 21 mai 1947. En Argentine, le nouveau venu n’est pas livré à lui-même car plusieurs amis et connaissances l’ont précédé et sont là pour l’accueillir. Au nombre de ces fidèles, citons Charles Lesca (71), alias Carlos Levray ou Pedro Vignau, ancien directeur de Je suis partout, Georges Guilbaud (72), alias Jorge Degay, et Robert Pincemin (73), alias Rives ; dans le comité d’accueil figure également Mario Octavio Amadeo (74), l’un des proches conseillers du Président Perón. À peu près à la même époque, Buenos Aires voit aussi arriver Jean-Jules Lecomte, alias Jean Degraaf Verhegen, ancien bourgmestre rexiste de Chimay ; plus tard, en 1949, débarquera encore Henri Collard-Bovy, un avocat bruxellois d’un certain renom. Avisée de l’arrivée de Pierre Daye, Bruxelles se manifeste aussitôt auprès du gouvernement argentin et réclame son extradition (17 juin 1947). Cette demande ayant été rejetée, l’écrivain est alors tout simplement déchu de sa nationalité. À compter du 24 décembre 1947, l’ancien combattant de 1914-18, vétéran de Tabora et ex-député, n’est donc plus citoyen belge, il est apatride.
 Âgé de 55 ans et plutôt combatif, l’homme est cependant loin d’avoir dit son dernier mot. Le 29 juin 1948, il prend part, avec quelques autres expatriés (75), à la création de la Société Argentine pour l’Accueil des Européens ou Sociedad Argentina para la Recepción de Europeos (SARE). Jouissant de la discrète protection de l’anthropologue Santiago Peralta, patron des services d’immigration, et bénéficiant des encouragements du cardinal Santiago Luis Copello (1880-1967), cette société s’efforce d’aider les « maudits » qui continuent d’affluer sur les rives du Rio de la Plata. Pierre Daye reprend aussi son métier de journaliste et participe au lancement de plusieurs publications dont Hebdo (1947), Europe-Argentine (1948), Argentina 49, Paroles françaises et Nouvelles d’Argentine. Naturalisé argentin en 1949, il collabore également aux revues Criterio et Itinerarium, à El Economista, le journal que fonde l’ancien Premier ministre yougoslave Milan Stojadinović (1888-1961), ainsi qu’à Dinámica Social, le mensuel que lance, en 1952, l’ancien hiérarque fasciste Carló Scorza (alias Camillo Sirtori)-(76). Organe officiel du Centre d’Études Économiques et Sociales, cette revue regroupe de nombreuses plumes de talent dont celles du philosophe roumain Georges Uscatescu, d’Ante Pavelić (alias A. S. Mrzlodolski), du père Juan Ramon Sepich, de Julio Irazusta, ou encore de Jean Pleyber, André Thérive, Jacques de Mahieu et Jacques Ploncard (alias Jacques de Sainte-Marie). Pierre Daye ne délaisse pas non plus le terrain politique où il parvient, avec son entregent habituel, à rester en bons termes à la fois avec les traditionalistes catholiques et les péronistes. Durant l’été 1949, il a quelques contacts avec le Centre des Forces Nationalistes, mais s’intéresse aussi à la Troisième Position de Juan Perón. Avec Radu Ghenea, Georges Guilbaud, René Lagrou (77) et Victor de la Serna, il signe d’ailleurs à ce sujet une note qui sera remise au chef de l’État. En septembre 1950, l’écrivain a le plaisir de renouer avec le ministre belge Marcel Henri Jaspar (1901-1982) qui est de passage dans le cône sud. Autre contact important, Sir Oswald Mosley, qu’il rencontre en novembre 1950, lors de la visite que l’ancien chef de la British Union of Fascists fait en Argentine (78). Venu s’entretenir avec Hans Ulrich Rudel, l’Anglais sera reçu par Juan Perón. Installé à Buenos Aires, dans le quartier de Palermo, et nommé professeur à l’Université de La Plata (sur recommandation de son ami le ministre des Affaires Étrangères Hipólito Jesús Paz), Pierre Daye entretient d’autre part une abondante correspondance.
Âgé de 55 ans et plutôt combatif, l’homme est cependant loin d’avoir dit son dernier mot. Le 29 juin 1948, il prend part, avec quelques autres expatriés (75), à la création de la Société Argentine pour l’Accueil des Européens ou Sociedad Argentina para la Recepción de Europeos (SARE). Jouissant de la discrète protection de l’anthropologue Santiago Peralta, patron des services d’immigration, et bénéficiant des encouragements du cardinal Santiago Luis Copello (1880-1967), cette société s’efforce d’aider les « maudits » qui continuent d’affluer sur les rives du Rio de la Plata. Pierre Daye reprend aussi son métier de journaliste et participe au lancement de plusieurs publications dont Hebdo (1947), Europe-Argentine (1948), Argentina 49, Paroles françaises et Nouvelles d’Argentine. Naturalisé argentin en 1949, il collabore également aux revues Criterio et Itinerarium, à El Economista, le journal que fonde l’ancien Premier ministre yougoslave Milan Stojadinović (1888-1961), ainsi qu’à Dinámica Social, le mensuel que lance, en 1952, l’ancien hiérarque fasciste Carló Scorza (alias Camillo Sirtori)-(76). Organe officiel du Centre d’Études Économiques et Sociales, cette revue regroupe de nombreuses plumes de talent dont celles du philosophe roumain Georges Uscatescu, d’Ante Pavelić (alias A. S. Mrzlodolski), du père Juan Ramon Sepich, de Julio Irazusta, ou encore de Jean Pleyber, André Thérive, Jacques de Mahieu et Jacques Ploncard (alias Jacques de Sainte-Marie). Pierre Daye ne délaisse pas non plus le terrain politique où il parvient, avec son entregent habituel, à rester en bons termes à la fois avec les traditionalistes catholiques et les péronistes. Durant l’été 1949, il a quelques contacts avec le Centre des Forces Nationalistes, mais s’intéresse aussi à la Troisième Position de Juan Perón. Avec Radu Ghenea, Georges Guilbaud, René Lagrou (77) et Victor de la Serna, il signe d’ailleurs à ce sujet une note qui sera remise au chef de l’État. En septembre 1950, l’écrivain a le plaisir de renouer avec le ministre belge Marcel Henri Jaspar (1901-1982) qui est de passage dans le cône sud. Autre contact important, Sir Oswald Mosley, qu’il rencontre en novembre 1950, lors de la visite que l’ancien chef de la British Union of Fascists fait en Argentine (78). Venu s’entretenir avec Hans Ulrich Rudel, l’Anglais sera reçu par Juan Perón. Installé à Buenos Aires, dans le quartier de Palermo, et nommé professeur à l’Université de La Plata (sur recommandation de son ami le ministre des Affaires Étrangères Hipólito Jesús Paz), Pierre Daye entretient d’autre part une abondante correspondance.
On sait notamment qu’il a de fréquents échanges épistolaires avec des gens comme Jean Azéma, Maurice Bardèche, Henri de Man, Georges Remi (Hergé), Christian du Jonchay (alias Della Torre), le père Omer Englebert, Simon Arbellot, Henri Poulain ou l’éditeur genevois Constant Bourquin. Au plan des relations sociales, il est probable qu’il rencontre assez souvent quelques collègues d’autrefois comme Henri Lèbre (alias Enrique Winter), un ancien du Cri du Peuple, Henri Janières, vétéran de Paris-Soir (et futur correspondant local du Monde) et Pierre Villette-Dorsay, ancien chroniqueur parlementaire à Je suis partout et rescapé de Radio-Patrie (79), qui tous résident dans la capitale fédérale. Il possède également d’excellents amis argentins, comme Juan Carlos Goyeneche (1913-1982), l’attaché de presse de la présidence de la République. En août 1951, il assiste sans doute, à la cathédrale de Buenos Aires, à la messe qui est célébrée, devant des milliers de fidèles, pour le repos de l’âme du maréchal Pétain, et fin 1952 à celle qui est dite pour Charles Maurras. Séparé de son lectorat habituel et résidant dans un pays hispanophone, Pierre Daye ne publie quasiment plus de livres : seul paraîtra, en 1952, un essai politique, El suicidio de la burguesía (Le suicide de la bourgeoisie). Cela ne l’empêche bien évidemment pas d’écrire et il laissera à la postérité de nombreux inédits. Parmi ceux-ci et outre divers essais (Le voyageur de la guerre, 1940-1945 ; Panorama espagnol ; En Argentine ; Pris aux autres), son long exil lui permet de rédiger d’imposants mémoires. Intitulés D’un monde à l’autre et ne comptant pas moins de 63 chapitres ou 1600 pages dactylographiées, ces mémoires sont, hélas, encore inédits et dorment toujours dans les bibliothèques bruxelloises…
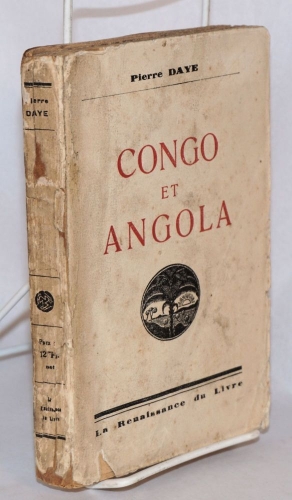 La chute de Juan Perón, en septembre 1955, n’entraîne pas d’inconvénients majeurs pour Pierre Daye qui n’est pas vraiment un acteur de la vie politique locale. Tenu pour proche du péronisme, il se retrouve néanmoins marginalisé et éloigné des nouveaux cercles dirigeants. Plus que le changement de régime, c’est plutôt l’isolement et l’oubli qui le menacent désormais. Le temps fait lentement son œuvre et la plupart des Belges l’ont d’ores et déjà oublié. Pas mal d’émigrés ont regagné l’Europe, on lui demande de moins en moins d’articles et la solitude le guette. C’est dans ce contexte un peu maussade que le 20 février 1960, à un peu moins de 68 ans, une hémorragie cérébrale vient brutalement mettre un terme à son existence. Cultivé, discret et fort modéré, on se demande encore ce que cet homme avait bien pu faire pour que la Belgique d’après-guerre lui témoigne d’une vindicte aussi tenace. Se pourrait-il tout simplement que l’on ait jugé, en haut lieu, qu’il en savait beaucoup trop long sur les arcanes (et les drôles de combines) de l’Occupation et qu’il fallait le discréditer à jamais ?
La chute de Juan Perón, en septembre 1955, n’entraîne pas d’inconvénients majeurs pour Pierre Daye qui n’est pas vraiment un acteur de la vie politique locale. Tenu pour proche du péronisme, il se retrouve néanmoins marginalisé et éloigné des nouveaux cercles dirigeants. Plus que le changement de régime, c’est plutôt l’isolement et l’oubli qui le menacent désormais. Le temps fait lentement son œuvre et la plupart des Belges l’ont d’ores et déjà oublié. Pas mal d’émigrés ont regagné l’Europe, on lui demande de moins en moins d’articles et la solitude le guette. C’est dans ce contexte un peu maussade que le 20 février 1960, à un peu moins de 68 ans, une hémorragie cérébrale vient brutalement mettre un terme à son existence. Cultivé, discret et fort modéré, on se demande encore ce que cet homme avait bien pu faire pour que la Belgique d’après-guerre lui témoigne d’une vindicte aussi tenace. Se pourrait-il tout simplement que l’on ait jugé, en haut lieu, qu’il en savait beaucoup trop long sur les arcanes (et les drôles de combines) de l’Occupation et qu’il fallait le discréditer à jamais ?
Christophe Dolbeau
———————————————
(1) Avec les vainqueurs de Tabora, Paris, Perrin et Cie, 1918.
(2) Le baron Pierre Nothomb (1887-1966) fut avocat mais surtout écrivain et homme politique. Leader des nationalistes belges, il sera plus tard sénateur du Parti catholique puis du Parti social-chrétien. Voy. Lionel Baland, Pierre Nothomb, Qui suis-je, Grez-sur-Loing, Pardès, 2019.
(3) Edmond Thieffry (1892-1929) était un as de l’aviation belge. En 1925, il accomplit l’exploit de rallier Léopoldville (Kinshasa) depuis Bruxelles, à bord d’un avion Handley Page W8.
(4) Jean Delville (1867-1953) était un poète et un peintre symboliste. Il enseigna son art à l’Académie royale des beaux-arts de Bruxelles entre 1907 et 1937.
(5) L’ingénieur Leonid Krassine (1870-1926) était un dirigeant bolchevik qui fut commissaire du peuple au commerce extérieur, puis ambassadeur soviétique à Paris et Londres.
(6) Fils de banquier, Maxime Litvinov ou Meir Henoch Wallach-Finkelstein (1876-1951) fut commissaire du peuple aux Affaires Étrangères et ambassadeur soviétique à Londres, puis auprès de la SDN.
(7) Le général Wladyslaw Sikorski (1881-1943) avait été, en 1920, l’un des artisans de la défaite des bolcheviks devant Varsovie. Il sera successivement chef d’état-major, Président du Conseil et ministre des affaires militaires.
(8) Pou-yi (1906-1967) fut le dernier empereur de Chine. Destitué en 1912 puis réfugié à Tianjin, il sera placé par les Japonais à la tête du « Grand État mandchou de Chine » ou Mandchoukouo (1932).
(9) Seigneur de guerre et généralissime, Tchang Tso-lin (1875-1928) sera brièvement président de la République de Chine (juin 1927-juin 1928) après avoir été longtemps le maître de la Mandchourie.
(10) Par exemple Le Maroc s’éveille (1924), Moscou dans le souffle de l’Asie (1926), La Chine est un pays charmant (1927), Le Japon et son destin (1928), La clef anglaise (1929), Beaux jours du Pacifique (1931) et Aspects du monde (1934).
(11) José Félix de Lequerica (1891-1963) fut maire de Bilbao (1938-39), puis ambassadeur d’Espagne en France, ministre des Affaires Étrangères (1944-45) et ambassadeur aux Etats-Unis (1951-54).
(12) Président du Parti Ouvrier Belge, Henri de Man (1885-1953) sera ministre des Travaux publics (1934-35) et ministre des Finances (1936-38). Condamné en 1946 à 20 ans de détention et dix millions d’amende pour avoir « servi les desseins de l’ennemi », il finira ses jours en Suisse (écrasé par un train sur une voie de chemin de fer où sa voiture s’était immobilisée).
(13) Militant socialiste, Paul-Henri Spaak (1899-1972) sera ministre des Transports et des PTT, ministre des Affaires Étrangères et Premier ministre. Il est considéré comme l’un des « pères de l’Europe ».
(14) Voy. Bernard Delcord, « À propos de quelques ‘chapelles’ politico-littéraires en Belgique (1919-1945 », Cahiers d’Histoire de la IIe Guerre mondiale, Bruxelles, Centre de Recherches et d’Études historiques de la IIe Guerre mondiale, n° 10, octobre 1986, p. 165-168.
(15) Voy. Jean-Léo, La Collaboration au quotidien – Paul Colin et le Nouveau Journal 1940-1944, Bruxelles, Racine, 2002, p. 107.
(16) Ibid, p. 109.
(17) Voy. Jean-Michel Etienne, Le mouvement rexiste jusqu’en 1940, Paris, Armand Colin, 1968, p. 73.
(18) Voy. Le Dossier du Mois, n° 12 (décembre 1963), Bruxelles, Editions du Ponant, p. 35 – extrait du chapitre XLVII des mémoires de Pierre Daye.
(19) Voy. supra, note 10.
(20) À savoir La politique coloniale de Léopold II (1918), Léopold II (1934), Vie et mort d’Albert Ier (1934), La jeunesse et l’avènement de Léopold III (1934).
(21) Par exemple Les conquêtes africaines des Belges (1918), L’Empire colonial belge (1923), Le Congo belge (1927), Congo et Angola (1929), Stanley (1936), Livingstone retrouvé par Stanley (1936),
(22) Voy. En Espagne, sous la Dictature (1925), La Belgique et la mer (1926), La Belgique maritime (1930) et L’Europe en morceaux (1932).
(23) « Le mouvement pan-nègre », Le Flambeau, 4e année, n° 7, juillet 1921, pp. 360-375 (consultable en ligne).
(24) Pierre Daye, Léon Degrelle et le rexisme, Paris, Fayard, 1937, p. 10.
(25) Le Dossier du Mois, n° 12, p. 2 – chapitre XLII des mémoires de Pierre Daye.
(26) Voy. Jean-Michel Etienne, op.cit., p. 36.
(27) Le Dossier du Mois, n° 12, p. 4 – chapitre XXXV des mémoires de Pierre Daye.
(28) Le Flamand Gustave Sap (1886-1940) était le propriétaire du journal catholique De Standaard. Député du Parti catholique, il sera ministre des Travaux publics, de l’Agriculture et du Commerce (1932-34), ministre des Finances (1934), puis de l’Économie et du Commerce (1939-40). Ses sympathies pour la droite et le rexisme entraîneront son exclusion du Parti catholique…
(29) L’avocat Hendrik Borginon (1890-1985) était l’un des dirigeants du parti nationaliste flamand VNV.
(30) Député du Parti catholique populaire flamand, Gérard Romsée (1901-1975) fut ensuite l’une des figures de proue du parti nationaliste flamand VNV. En avril 1941, il sera nommé secrétaire général à l’Intérieur et la Santé, ce qui lui vaudra d’être condamné à mort puis à la réclusion perpétuelle en 1945.
(31) Nationaliste flamand, Joris van Severen (1894-1940) fut le fondateur du mouvement solidariste thiois Verdinaso. Arrêté en 1940 sur soupçon (totalement infondé) d’appartenance à la 5e colonne, il sera sommairement abattu par des militaires français, le 20 mai, à Abbeville.
(32) Charles-Albert d’Aspremont-Lynden (1888-1967) était un sénateur du Parti catholique. Il sera ministre de l’Agriculture en 1939-40 et ministre sans portefeuille dans le gouvernement belge en exil à Londres (1940-44).
(33) « On ne comprit pas », écrit Pierre Daye, « ou plutôt on ne voulut pas comprendre, qu’en politique, les sentiments et le réalisme sont deux choses et que si mon affection pour la culture et pour le peuple de France n’a jamais varié, je ne pouvais pas rester aveugle devant la folie de sa politique guerrière… » – Le Dossier du Mois, n° 12, p. 8 – chapitre XXXV des mémoires de Pierre Daye.
(34) Voy. Bernard Delcord, op. cit., pp. 177-179.
(35) Autonomiste corse, Pierre Bonardi (1887-1964) était un journaliste et un écrivain. Longtemps proche du Parti radical-socialiste et de la Ligue contre l’antisémitisme (LICA), il adhèra ensuite au PPF et soutint Pierre Laval durant l’Occupation.
(36) Le 20 mai 1940, 21 personnes arrêtées en Belgique et soupçonnées d’appartenir à la 5e colonne sont assassinées sans jugement, à Abbeville, par une compagnie de l’armée française aux ordres du capitaine Marcel Dingeon et du lieutenant René Caron. Disparaissent (entre autres) dans ce massacre le leader flamand Joris Van Severen et son adjoint Jan Ryckoort, le rexiste René Wery, le hockeyeur canadien Robert Bell, deux communistes et deux Juifs. Léon Degrelle échappe de justesse à la mort. Voy. Léon Degrelle, La guerre en prison, in Relectures Léon Degrelle, Lyon, Irminsul Éditions, s.d. ; Carlos Vlaeminck, Dossier Abbeville, Louvain, Davidsfonds, 1977.
(37) Le Dossier du Mois, n° 12, p. 15 – chapitre XLII des mémoires de Pierre Daye.
(38) Ibid, p. 16 – chapitre XLII des mémoires de Pierre Daye.
(39) Ibid, p. 22 – chapitre XLV des mémoires de Pierre Daye.
(40) Ibid, p. 24 – chapitre XLV des mémoires de Pierre Daye.
(41) Ibid, p. 24 – chapitre XLV des mémoires de Pierre Daye.
(42) Voy. Jean-Léo, op.cit., p. 28.
(43) Ibid, pp. 41-48.
(44) Voy. Jean-Léo, op. cit., p. 56.
(45) cité par Roland Roudil, Jean-François Durand et Guillaume Bridet, in Le reportage colonial, Pondicherry, Kailash, 2016, p. 462.
(46) Le Choc du Mois, n° 12, p. 36 – chapitre XLVII des mémoires de Pierre Daye.
(47) Voy. Bernard Delcord, op. cit., p. 183.
(48) Voy. C. Dolbeau, « Weimar 1941-1942 : la Société Européenne des Écrivains », Tabou, vol. 25, Saint-Genis-Laval, Akribeia, 2019, 160-183.
(49) Voy. Bernard Delcord, op. cit., p. 182.
(50) Le Dossier du Mois, n° 12, p. 27 – chapitre XLVI des mémoires de Pierre Daye.
(51) Ibid, p. 27-28 – chapitre XLVI des mémoires de Pierre Daye.
(52) Ibid, pp. 31-32 – chapitre XLVII des mémoires de Pierre Daye.
(53) Voy. Jacques Willequet, La Belgique sous la botte, Paris, Éditions universitaires, 1986, p. 279.
(54) Voy. Elsa Van Brusseghem-Loorne, « La libération et l’épuration en Belgique », Le Crapouillot, n° 120 (juillet-août 1994), p. 62.
(55) petit-cousin de Robert Poulet (1893-1989), le rédacteur en chef du Nouveau Journal.
(56) Le Dossier du Mois, n° 12, pp. 28-29 – chapitre XLVI des mémoires de Pierre Daye.
(57) Ibid, p. 29 – chapitre XLVI des mémoires de Pierre Daye.
(58) Ibid, p. 35 – chapitre XLVII des mémoires de Pierre Daye.
(59) Les Partisans communistes se vantent d’avoir « exécuté » 962 soldats ennemis et 1137 collaborateurs (voy. J. Willequet, op. cit., p. 300) et l’on parle de 700 rexistes assassinés. En face, des commandos ripostent, en abattant le banquier Alexandre Galopin et l’ancien gouverneur François Bovesse ou en massacrant 27 otages à Courcelles-Charleroi.
(60) Le Dossier du Mois, n° 12, p. 35 – chapitre XLVII des mémoires de Pierre Daye.
(61) Ibid, p. 34 – chapitre XLVII des mémoires de Pierre Daye.
(62) Ibid, p. 34 – chapitre XLVII des mémoires de Pierre Daye.
(63) Ibid, p. 36 – chapitre XLVII des mémoires de Pierre Daye.
(64) Ibid, p. 36 – chapitre XLIX des mémoires de Pierre Daye.
(65) Ibid, p. 36 – chapitre XLIX des mémoires de Pierre Daye.
(66) Célèbre écrivain et critique d’art catalan, Eugenio d’Ors i Rovira (1881-1954) fut ministre des Beaux-Arts du gouvernement nationaliste durant la Guerre Civile. Membre de l’Association des amis de l’Allemagne, il siégeait aussi à l’Académie royale espagnole.
(67) Universitaire et musicien, Walter Starkie (1894-1976) était un grand spécialiste de la culture rom. Il avait appartenu, dans les années 1920, au Centre International d’Études sur le Fascisme (CINEF) avec Giovanni Gentile, James S. Barnes et Herman de Vries de Heekelingen.
(68) Voy. Paul Sérant, Les vaincus de la Libération, Paris, Robert Laffont, 1964, p. 136.
(69) Il ne faut toutefois pas sous-estimer les effets de la répression du côté flamand, avec notamment l’exécution d’Auguste Borms et Karel de Feyter, la condamnation à mort puis à la détention perpétuelle de Ward Hermans, Johannes Timmermans, Gérard Romsée et Josephus Van De Wiele, la condamnation à mort de Jozef François, la condamnation à mort par contumace du père Cyriel Verschaeve, de Wies Moens, Hendrik Elias, Frans Daels et Edgar Delvo, la peine de 20 ans de détention infligée à Hendrik Borginon (avec une amende de 10 millions), celle de 12 ans de prison infligée à Jules Callewaert ou celle de 10 ans infligée à Filip de Pillecijn – Voy. Franz W. Seidler, Die Kollaboration 1939-1945, Munich-Berlin, Herbig, 1999.
(70) Elsa Van Brusseghem-Loorne, op. cit., p. 62.
(71) Charles Lesca (1887-1948) était né en Argentine et s’appelait en fait Carlos Hipólito Saralegui Lesca. Ami personnel de Charles Maurras, il succéda à Robert Brasillach à la direction de Je suis partout, ce qui lui valut, en mai 1947, d’être condamné à mort par contumace. Voy. Dominique Venner, Histoire de la Collaboration, Paris, Pygmalion, 2000, p. 620-621 ; Philippe Randa, Dictionnaire commenté de la Collaboration française, Paris, Jean Picollec, 1987, pp. 560-562.
(72) Ancien fort des Halles mais aussi docteur en droit, Georges Guilbaud (1914) était un ex-communiste qui avait rejoint le PPF de Jacques Doriot. Directeur du journal L’Écho de la France, il fut également plénipotentiaire français auprès de la République Sociale Italienne. Voy. Dominique Venner, op. cit., p. 600.
(73) Ancien ingénieur de l’École Centrale, Robert Pincemin avait dirigé la Milice française dans les départements de l’Ariège et de la Haute-Garonne. Il fondera en Argentine une branche locale de la Cité catholique et publiera plusieurs ouvrages de politique et d’économie.
(74) Philosophe et diplomate, Mario Octavio Amadeo (1911-1983) était l’un des fondateurs de l’Action catholique en Argentine. Proche un temps de Juan Perón, il s’en écartera par la suite et sera brièvement ministre des Affaires Étrangères en 1955. Chef de la délégation argentine aux Nations Unies, il en présidera même le Conseil de Sécurité en 1959.
(75) En l’occurrence le Roumain Radu Ghenea (1907-1973), ex-ambassadeur de Roumanie à Madrid et ancien avocat de Corneliu Zelea Codreanu, Ferdinand Durčansky (1906-1974), ancien ministre slovaque de l’Intérieur et des Affaires Étrangères, Mgr Ferenc Luttor (1886-1953), protonotaire apostolique hongrois, Eugenio Morreale, ex-ambassadeur d’Italie à Madrid, et Robert Pincemin (voy. note 73).
(76) Plusieurs fois élu député, Carló Scorza (1897-1988) fut, en 1943, le dernier secrétaire du Parti national fasciste.
(77) L’avocat flamand René Lagrou (1904-1969) fut le premier chef de l’Algemeene-SS Vlaanderen puis il rejoignit la Waffen-SS en qualité de correspondant de guerre et obtint le grade de Sturmbannführer dans la division Langemarck.
(78) Il voyage alors sous l’amusant pseudonyme de Harry Morley.
(79) Voy. C. Dolbeau, « Des Français chez Perón », Écrits de Paris, n° 727, janvier 2010, 47-53.
——————————————————
Bibliographie
– Le Dossier du Mois, n° 12 (décembre 1963), Bruxelles, Éditions du Ponant (« Les Mémoires de Pierre Daye »).
– Elsa Van Brusseghem-Loorne, « La libération et l’épuration en Belgique », Le Crapouillot, n° 120 (juillet-août 1994), 61-63.
– Pierre Daye, Léon Degrelle et le rexisme, Paris, Fayard, 1937.
– Pierre Daye, « Le mouvement pan-nègre », Le Flambeau, 4e année, n° 7, juillet 1921, 360-375.
– Léon Degrelle, La cohue de 40, Lausanne, Robert Crauzaz, 1949.
– Léon Degrelle, La guerre en prison, in Relectures Léon Degrelle, Lyon, Irminsul Éditions, s.d.
– Paul Sérant, Les vaincus de la Libération, Paris, Robert Laffont, 1964.
– Jean-Michel Etienne, Le mouvement rexiste jusqu’en 1940, Paris, Armand Colin, 1968.
– Jacques Willequet, La Belgique sous la botte. Résistances et collaborations 1940-1945, Paris, Éditions universitaires, 1986.
– Bernard Delcord, « À propos de quelques ‘chapelles’ politico-littéraires en Belgique (1919-1945) », Cahiers d’Histoire de la IIe Guerre mondiale, Bruxelles, Centre de recherches et d’études historiques de la IIe Guerre mondiale, n° 10, octobre 1986, 153-205.
– Bernard Delcord et José Gotovitch, Papiers Pierre Daye, Inventaires 22, Bruxelles, Centre de recherches et d’études historiques de la IIe Guerre mondiale, 1989.
– Jean-Léo, La collaboration au quotidien – Paul Colin et le Nouveau Journal 1940-1944, Bruxelles, Racine, 2002.
– Louis Fierens, 39-45 Carnets de Guerre – Prêtre chez les SS, Waterloo, Éditions Jourdan, 2012.
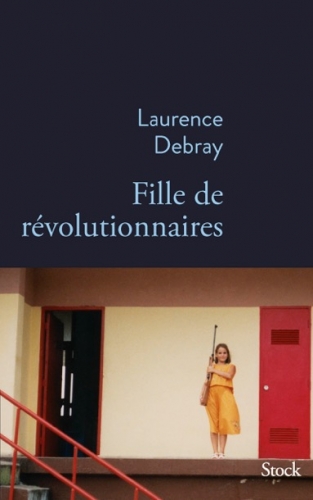 Il n’y a pas de grand homme pour son valet de chambre. Il n’y a pas non plus de grand penseur pour sa fille aînée. Avec Fille de révolutionnaires, la journaliste macronienne Laurence Debray a ravi tous les détracteurs de son père, Régis Debray. La photographie du bandeau de la couverture attire déjà l’attention. On la voit presque au garde-à-vous devant une porte tenant un fusil. À l’âge de dix ans, elle séjourne en juillet dans un camp des Jeunesses communistes à Cuba où elle apprend entre autres à manipuler des armes. Un mois plus tard, elle participe à un camp de jeunes aux États-Unis. En accord avec sa mère d’origine vénézuélienne, Elizabeth Burgos, son père veut qu’elle prenne enfin partie. À Cuba, la jeune fille découvre que chaque matin commence par la cérémonie des couleurs cubaines et des autres nationalités présentes. Elle observe que « si le communisme prêche l’égalité, un bon communiste est meilleur que les autres et doit sans cesse le prouver (p. 246) ». Entre le modèle castriste et l’exemple yankee, elle choisit finalement « la vieille Europe, assez modérée et confortable : on y mange bien, lit bien, dort bien (p. 253) ».
Il n’y a pas de grand homme pour son valet de chambre. Il n’y a pas non plus de grand penseur pour sa fille aînée. Avec Fille de révolutionnaires, la journaliste macronienne Laurence Debray a ravi tous les détracteurs de son père, Régis Debray. La photographie du bandeau de la couverture attire déjà l’attention. On la voit presque au garde-à-vous devant une porte tenant un fusil. À l’âge de dix ans, elle séjourne en juillet dans un camp des Jeunesses communistes à Cuba où elle apprend entre autres à manipuler des armes. Un mois plus tard, elle participe à un camp de jeunes aux États-Unis. En accord avec sa mère d’origine vénézuélienne, Elizabeth Burgos, son père veut qu’elle prenne enfin partie. À Cuba, la jeune fille découvre que chaque matin commence par la cérémonie des couleurs cubaines et des autres nationalités présentes. Elle observe que « si le communisme prêche l’égalité, un bon communiste est meilleur que les autres et doit sans cesse le prouver (p. 246) ». Entre le modèle castriste et l’exemple yankee, elle choisit finalement « la vieille Europe, assez modérée et confortable : on y mange bien, lit bien, dort bien (p. 253) ». Elle dépeint des parents entièrement préoccupés par la politique au point qu’ils ne s’en occupent guère. Ses jeunes années sont surtout marquées par l’incessante traque parentale de Klaus Barbie dont le procès télévisé va marquer le début de l’ère de l’hypermnésie victimaire. Elle insiste en outre longuement sur les années de son père passées à La Havane aux côtés de Fidel Castro et du Che ainsi que sur sa période de guérillero en Bolivie et sur les conditions éprouvantes de détention. Ambassadeur de France à La Paz, l’ancienne barbouze en chef anti-OAS, Dominique Ponchardier, aidera beaucoup le détenu et ses parents.
Elle dépeint des parents entièrement préoccupés par la politique au point qu’ils ne s’en occupent guère. Ses jeunes années sont surtout marquées par l’incessante traque parentale de Klaus Barbie dont le procès télévisé va marquer le début de l’ère de l’hypermnésie victimaire. Elle insiste en outre longuement sur les années de son père passées à La Havane aux côtés de Fidel Castro et du Che ainsi que sur sa période de guérillero en Bolivie et sur les conditions éprouvantes de détention. Ambassadeur de France à La Paz, l’ancienne barbouze en chef anti-OAS, Dominique Ponchardier, aidera beaucoup le détenu et ses parents.





 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg
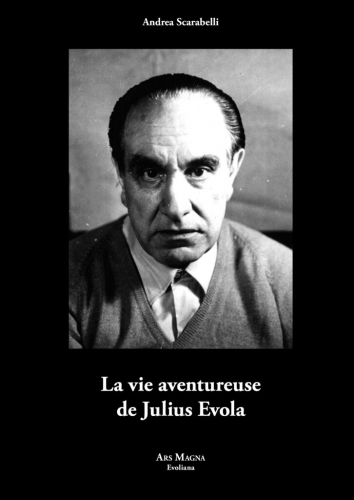 Ce travail colossal revient à Andrea Scarabelli. Vice-secrétaire de la Fondation Julius-Evola, il offre au public francophone une édition revue, corrigée et augmentée par rapport à l’édition initiale. Traduit par Istvàn Leszno et préfacé par Alian de Bneoist, le livre contient plusieurs cahiers photographiques, un appareil critique de notes sur quatre-vingt-deux pages, la liste intégrale des livres originaux d’Evola, une bibliographie exhaustive de dix-huit pages suivie de la bibliographie française des ouvrages évoliens parus dans l’Hexagone réalisée par le préfacier, soit quinze pages, et un index de noms propres mentionnés. Très impressionnant !
Ce travail colossal revient à Andrea Scarabelli. Vice-secrétaire de la Fondation Julius-Evola, il offre au public francophone une édition revue, corrigée et augmentée par rapport à l’édition initiale. Traduit par Istvàn Leszno et préfacé par Alian de Bneoist, le livre contient plusieurs cahiers photographiques, un appareil critique de notes sur quatre-vingt-deux pages, la liste intégrale des livres originaux d’Evola, une bibliographie exhaustive de dix-huit pages suivie de la bibliographie française des ouvrages évoliens parus dans l’Hexagone réalisée par le préfacier, soit quinze pages, et un index de noms propres mentionnés. Très impressionnant ! Toute sa vie, Julius Evola exècre la bourgeoisie. Outre la promotion de la Droite spirituelle hostile à la modernité, il critique la morale commune des communistes et des catholiques qui plombe les années 1950. Il déplore l’interdiction des maisons closes. Il considère les prostituées plus honorables que les bourgeoises et se gausse de la bigoterie gouvernementale. À propos de la prostitution, à travers divers articles, il «propose […] l’institution de structures syndicales visant à protéger et à défendre les prostituées». Il défend aussi les filles–mères célibataires. Ce supposé misogyne tance les hommes qui se défilent de leurs responsabilités paternelles.
Toute sa vie, Julius Evola exècre la bourgeoisie. Outre la promotion de la Droite spirituelle hostile à la modernité, il critique la morale commune des communistes et des catholiques qui plombe les années 1950. Il déplore l’interdiction des maisons closes. Il considère les prostituées plus honorables que les bourgeoises et se gausse de la bigoterie gouvernementale. À propos de la prostitution, à travers divers articles, il «propose […] l’institution de structures syndicales visant à protéger et à défendre les prostituées». Il défend aussi les filles–mères célibataires. Ce supposé misogyne tance les hommes qui se défilent de leurs responsabilités paternelles.  Les relations sont loin d’être au beau fixe avec ses correspondants réguliers. René Guénon ne cache pas son scepticisme envers l’Italien qui s’investit un peu trop à son avis dans le fracas du monde moderne. Il oublie cependant que Julius Evola a participé à la Grande Guerre (1915 – 1918) en tant qu’officier d’artillerie. Il recevra au nom de ce passé en 1969 le titre de « chevalier de Vittorio Veneto » signé par le président de la République italienne…
Les relations sont loin d’être au beau fixe avec ses correspondants réguliers. René Guénon ne cache pas son scepticisme envers l’Italien qui s’investit un peu trop à son avis dans le fracas du monde moderne. Il oublie cependant que Julius Evola a participé à la Grande Guerre (1915 – 1918) en tant qu’officier d’artillerie. Il recevra au nom de ce passé en 1969 le titre de « chevalier de Vittorio Veneto » signé par le président de la République italienne…


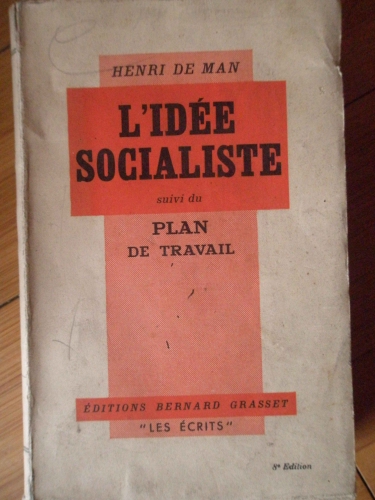
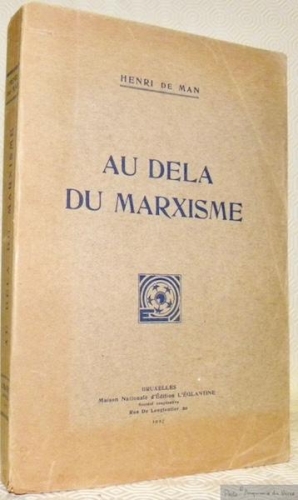
 Après l'arrivée au pouvoir des nationaux-socialistes en Allemagne, De Man perdit sa chaire. Il dut nécessairement retourner dans notre pays, où il œuvra à l'élargissement du mouvement ouvrier et tenta de concevoir un nouveau cadre de réflexion pour le socialisme. Son livre De Socialistische Idee (L'idée socialiste, 1933) fut publié dans de nombreuses langues et fit quelque bruit. Avec le Plan du Travail qu'il avait conçu, il tenta à partir de 1933 de faire barrage aux conséquences de la crise économique. À ses yeux, c'était la meilleure réponse à l'influence croissante du fascisme et du communisme. Hendrik de Man devint vice-président du BWP en 1934 et, après la mort d'Emile Vandervelde en 1938, il lui succéda à la présidence. À cette époque, une profonde méfiance régnait déjà à l'égard de De Man. De plus, connu pour son caractère difficile, de Man avait eu pendant des décennies des conflits violents avec des personnalités importantes au sein et en dehors du BWP, ce qui n'avait pas vraiment contribué à accroître sa popularité.
Après l'arrivée au pouvoir des nationaux-socialistes en Allemagne, De Man perdit sa chaire. Il dut nécessairement retourner dans notre pays, où il œuvra à l'élargissement du mouvement ouvrier et tenta de concevoir un nouveau cadre de réflexion pour le socialisme. Son livre De Socialistische Idee (L'idée socialiste, 1933) fut publié dans de nombreuses langues et fit quelque bruit. Avec le Plan du Travail qu'il avait conçu, il tenta à partir de 1933 de faire barrage aux conséquences de la crise économique. À ses yeux, c'était la meilleure réponse à l'influence croissante du fascisme et du communisme. Hendrik de Man devint vice-président du BWP en 1934 et, après la mort d'Emile Vandervelde en 1938, il lui succéda à la présidence. À cette époque, une profonde méfiance régnait déjà à l'égard de De Man. De plus, connu pour son caractère difficile, de Man avait eu pendant des décennies des conflits violents avec des personnalités importantes au sein et en dehors du BWP, ce qui n'avait pas vraiment contribué à accroître sa popularité.


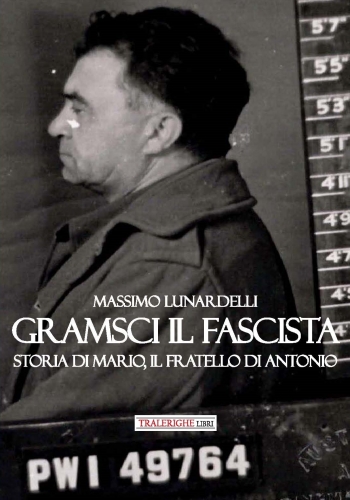



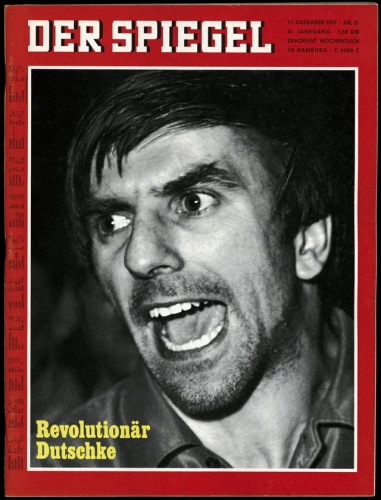
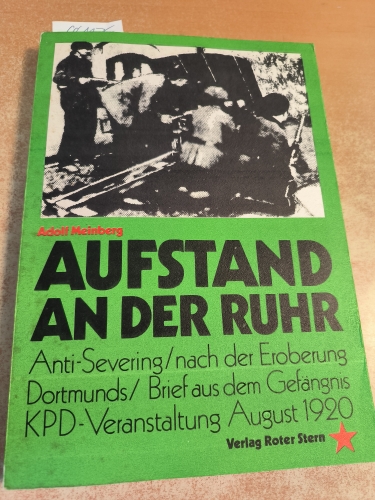



 Julius Evola est mort il y a cinquante ans. Son nom continue d'être accablé de préjugés aprioristiques récemment ravivés par le battage journalistique mainstream visant à promouvoir un volume mal informé dans lequel le penseur traditionaliste est présenté, rien de moins, comme l'"instigateur moral" du "viol de Circeo". Le philosophe Piero di Vona, l'un des plus fins exégètes de la vision du monde d'Evola, avait en effet raison de souligner l'urgence, pour sauver Evola d'un dénigrement préconçu ou d'une exaltation hagiographique tout aussi stérile, d'écrire une biographie objective et équilibrée de cet intellectuel qui a traversé le "petit siècle" en tant que l'un de ses protagonistes. Andrea Scarabelli a répondu à ce besoin de clarification historique avec sa Vita avventurosa di Julius Evola (Vie aventureuse de Julius Evola), désormais en librairie grâce aux éditions Bietti (pour les commandes : 02/29528929, pp. 830, 39,00 euros).
Julius Evola est mort il y a cinquante ans. Son nom continue d'être accablé de préjugés aprioristiques récemment ravivés par le battage journalistique mainstream visant à promouvoir un volume mal informé dans lequel le penseur traditionaliste est présenté, rien de moins, comme l'"instigateur moral" du "viol de Circeo". Le philosophe Piero di Vona, l'un des plus fins exégètes de la vision du monde d'Evola, avait en effet raison de souligner l'urgence, pour sauver Evola d'un dénigrement préconçu ou d'une exaltation hagiographique tout aussi stérile, d'écrire une biographie objective et équilibrée de cet intellectuel qui a traversé le "petit siècle" en tant que l'un de ses protagonistes. Andrea Scarabelli a répondu à ce besoin de clarification historique avec sa Vita avventurosa di Julius Evola (Vie aventureuse de Julius Evola), désormais en librairie grâce aux éditions Bietti (pour les commandes : 02/29528929, pp. 830, 39,00 euros). Scarabelli (photo) a utilisé une vaste documentation d'archives, a parcouru (pour la première fois) tout le matériel conservé par la Fondation, a consulté des lettres épistolaires (parfois inédites), a recueilli de nouveaux témoignages, a suivi les traces laissées par Evola en Italie et en Europe. Grâce à la vaste documentation produite, on peut parler, et pas seulement pour le volume que constitue l'ouvrage, d'un livre monumental, d'une œuvre charnière dans la bibliographie critique concernant le penseur traditionaliste. Le personnage d'Evola fait ici l'objet d'une étude approfondie, ses points positifs et sa grandeur sont notés, mais aussi ses limites et ses traits "humains, trop humains". Il en ressort un portrait équilibré: un Evola face au miroir. Dans l'incipit, l'environnement familial est reconstitué dans son intégralité (dans la mesure où les documents le permettent), révélant la nature tout sauf aristocratique de la famille (le surnom de "baron", par lequel Evola est souvent désigné, est en fait un surnom qui lui a été donné à l'époque du dadaïsme).
Scarabelli (photo) a utilisé une vaste documentation d'archives, a parcouru (pour la première fois) tout le matériel conservé par la Fondation, a consulté des lettres épistolaires (parfois inédites), a recueilli de nouveaux témoignages, a suivi les traces laissées par Evola en Italie et en Europe. Grâce à la vaste documentation produite, on peut parler, et pas seulement pour le volume que constitue l'ouvrage, d'un livre monumental, d'une œuvre charnière dans la bibliographie critique concernant le penseur traditionaliste. Le personnage d'Evola fait ici l'objet d'une étude approfondie, ses points positifs et sa grandeur sont notés, mais aussi ses limites et ses traits "humains, trop humains". Il en ressort un portrait équilibré: un Evola face au miroir. Dans l'incipit, l'environnement familial est reconstitué dans son intégralité (dans la mesure où les documents le permettent), révélant la nature tout sauf aristocratique de la famille (le surnom de "baron", par lequel Evola est souvent désigné, est en fait un surnom qui lui a été donné à l'époque du dadaïsme). 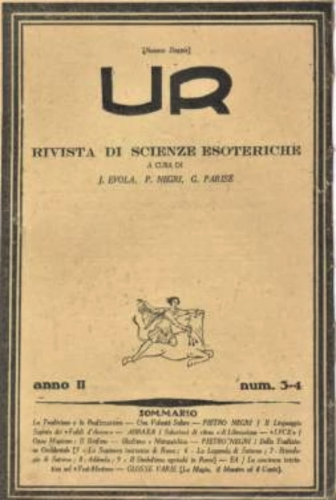





 2) l'analyse du racisme d'Evola. Le "racisme spirituel" proposé par le philosophe n'était pas seulement impraticable à la lumière des contingences historiques et donc politiquement inutile, mais il était aussi combattu, comme "anti-allemand", non seulement par les nazis, mais aussi par des cercles appartenant à la Compagnie de Jésus, le père Agostino Gemelli (photo) et Pietro Tacchi-Venturi. Même Giorgio Almirante (qui décrira plus tard Evola comme "notre Marcuse") et Giulio Cogni ont contribué à l'isolement d'Evola.
2) l'analyse du racisme d'Evola. Le "racisme spirituel" proposé par le philosophe n'était pas seulement impraticable à la lumière des contingences historiques et donc politiquement inutile, mais il était aussi combattu, comme "anti-allemand", non seulement par les nazis, mais aussi par des cercles appartenant à la Compagnie de Jésus, le père Agostino Gemelli (photo) et Pietro Tacchi-Venturi. Même Giorgio Almirante (qui décrira plus tard Evola comme "notre Marcuse") et Giulio Cogni ont contribué à l'isolement d'Evola.




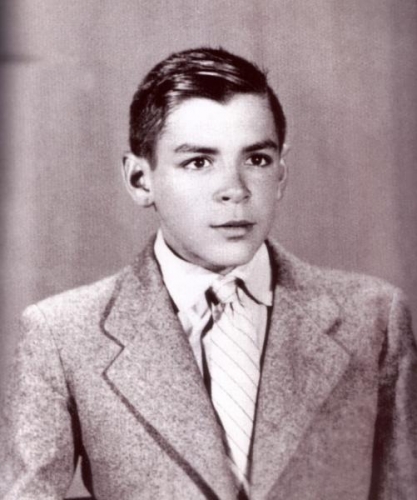
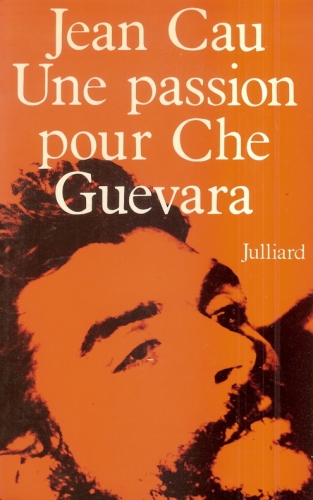
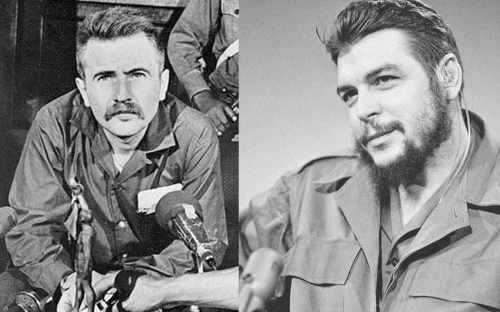








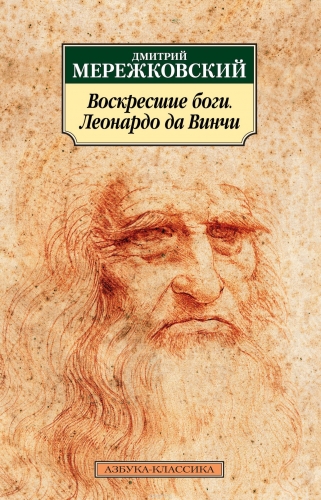
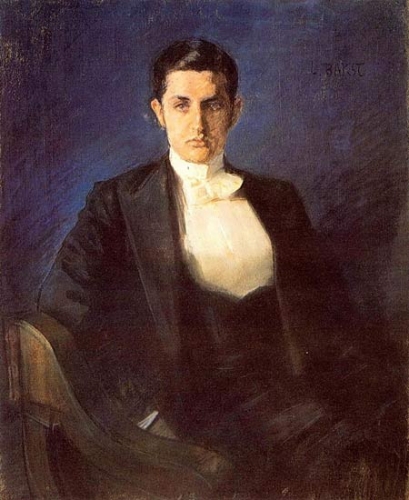

 En 1900, l'immense empire russe s'était industrialisé grâce à des emprunts financiers étrangers au moyen de prêts monétaires, sans aucune modernisation de sa structure sociale. Aucune perspective n'était donnée à l'indicible misère de sa population paysanne, soit sans terre à la merci des propriétaires, soit indépendante mais écrasée par les gigantesques taxes destinées à pourvoir au paiement de l'endettement russe (les propriétaires ne payaient pas d'impôts). L'immense sous-classe prolétarienne, qui vit dans des conditions misérables, afflue dans les villes et les centres industriels. L'énorme croissance de la population a permis de compenser les soldats dans l'armée, les ouvriers dans l'industrie, les travailleurs coloniaux sibériens et dans les campagnes. L'Empire est secoué par une politique désordonnée. Des grèves, des manifestations et des affrontements avec la police ont eu lieu dans plusieurs villes. Les radicaux de gauche ont repris le terrorisme politique. Les structures autoritaires rigides de l'autocratie semblaient incapables de réagir ou de saisir ce qui se passait.
En 1900, l'immense empire russe s'était industrialisé grâce à des emprunts financiers étrangers au moyen de prêts monétaires, sans aucune modernisation de sa structure sociale. Aucune perspective n'était donnée à l'indicible misère de sa population paysanne, soit sans terre à la merci des propriétaires, soit indépendante mais écrasée par les gigantesques taxes destinées à pourvoir au paiement de l'endettement russe (les propriétaires ne payaient pas d'impôts). L'immense sous-classe prolétarienne, qui vit dans des conditions misérables, afflue dans les villes et les centres industriels. L'énorme croissance de la population a permis de compenser les soldats dans l'armée, les ouvriers dans l'industrie, les travailleurs coloniaux sibériens et dans les campagnes. L'Empire est secoué par une politique désordonnée. Des grèves, des manifestations et des affrontements avec la police ont eu lieu dans plusieurs villes. Les radicaux de gauche ont repris le terrorisme politique. Les structures autoritaires rigides de l'autocratie semblaient incapables de réagir ou de saisir ce qui se passait. En 1901, Merezhkovsky et son ami Dmitri V. Filosofov, sont devenus les animateurs d'un mouvement philosophique religieux, dont le but était de promouvoir une ''nouvelle conscience religieuse'' en Russie, en fondant la Société philosophico-religieuse, dont l'instrument de diffusion était la revue ''Novyi put'' (La nouvelle voie), qui reflétait leurs idées métaphysiques. Ces réunions régulières étaient connues sous le nom d'Assemblées religieuses de Saint-Pétersbourg et ont duré de 1901 à 1903. Penseur religieux et mystique, il envisage l'avènement d'un nouveau monde de liberté et d'épanouissement chrétien qui s'accomplirait avec la réalisation du Royaume de l'Esprit, invoqué par Joachim de Fiore. L'attente du Troisième Royaume lui impose la nécessité de mener une action concrète, qu'il tente à plusieurs reprises, lors de conférences religieuses et philosophiques en 1901 qui sont mémorables dans l'histoire de la culture russe contemporaine.
En 1901, Merezhkovsky et son ami Dmitri V. Filosofov, sont devenus les animateurs d'un mouvement philosophique religieux, dont le but était de promouvoir une ''nouvelle conscience religieuse'' en Russie, en fondant la Société philosophico-religieuse, dont l'instrument de diffusion était la revue ''Novyi put'' (La nouvelle voie), qui reflétait leurs idées métaphysiques. Ces réunions régulières étaient connues sous le nom d'Assemblées religieuses de Saint-Pétersbourg et ont duré de 1901 à 1903. Penseur religieux et mystique, il envisage l'avènement d'un nouveau monde de liberté et d'épanouissement chrétien qui s'accomplirait avec la réalisation du Royaume de l'Esprit, invoqué par Joachim de Fiore. L'attente du Troisième Royaume lui impose la nécessité de mener une action concrète, qu'il tente à plusieurs reprises, lors de conférences religieuses et philosophiques en 1901 qui sont mémorables dans l'histoire de la culture russe contemporaine. 
 Merezhkovsky soutient la monarchie russe, à laquelle il attribue une institution divine. Il a résisté aux critiques sévères des écrivains progressistes. Il a fait l'objet de moqueries dans un article imprimé dans ''Osvobozhdenie'' en 1902, un périodique clandestin publié à l'étranger, en rapport avec sa comparaison de l'autocratie russe à un ordre mystique dans son livre sur Dostoïevski, signalant que le département de la police, les règlements sur les contrôles étaient intensifiés ; dans ''Moskovskie vedomosti'', ''Grazhdanin'', ''Cossack'', des sarcasmes ont été faits sur les convocations et les potences et autres attributs de protection : étaient-ils également des objets de l'ordre mystique ? Ils contenaient le secret indescriptible de Dieu. Mysticisme oblige. Si l'idée de la monarchie n'est que mystique et qu'elle est promue, non pas comme un son de cloche, mais avec respect et crainte, une telle conviction oblige à lutter furieusement contre l'ordre policier russe. L'autocratie est une idée religieuse, mais la défense d'une telle idée est un argument pour Dieu, et non pour le service de police. Quelles que soient les souffrances et la misère du peuple, le régime tsariste a maintenu son prestige grâce à l'expansion de l'empire russe. Le Caucase, l'Asie centrale et l'Extrême-Orient, des provinces absorbées au XIXe siècle. Au début du 20e siècle, la situation a brutalement changé. Dans la guerre de l'Est, l'impérialisme russe et le Japon modernisé s'affrontent.
Merezhkovsky soutient la monarchie russe, à laquelle il attribue une institution divine. Il a résisté aux critiques sévères des écrivains progressistes. Il a fait l'objet de moqueries dans un article imprimé dans ''Osvobozhdenie'' en 1902, un périodique clandestin publié à l'étranger, en rapport avec sa comparaison de l'autocratie russe à un ordre mystique dans son livre sur Dostoïevski, signalant que le département de la police, les règlements sur les contrôles étaient intensifiés ; dans ''Moskovskie vedomosti'', ''Grazhdanin'', ''Cossack'', des sarcasmes ont été faits sur les convocations et les potences et autres attributs de protection : étaient-ils également des objets de l'ordre mystique ? Ils contenaient le secret indescriptible de Dieu. Mysticisme oblige. Si l'idée de la monarchie n'est que mystique et qu'elle est promue, non pas comme un son de cloche, mais avec respect et crainte, une telle conviction oblige à lutter furieusement contre l'ordre policier russe. L'autocratie est une idée religieuse, mais la défense d'une telle idée est un argument pour Dieu, et non pour le service de police. Quelles que soient les souffrances et la misère du peuple, le régime tsariste a maintenu son prestige grâce à l'expansion de l'empire russe. Le Caucase, l'Asie centrale et l'Extrême-Orient, des provinces absorbées au XIXe siècle. Au début du 20e siècle, la situation a brutalement changé. Dans la guerre de l'Est, l'impérialisme russe et le Japon modernisé s'affrontent.


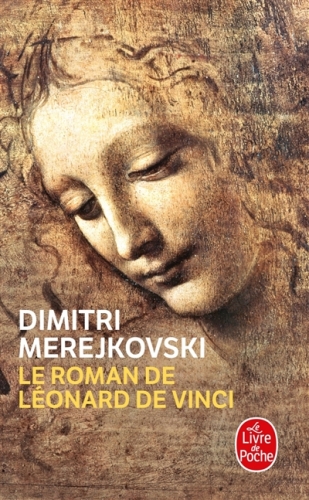
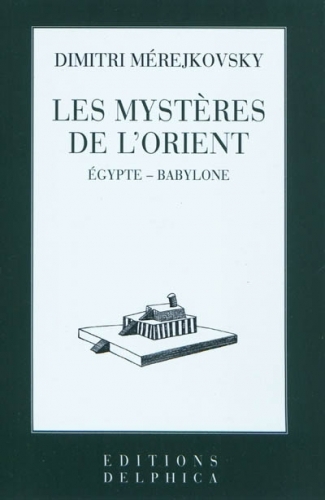
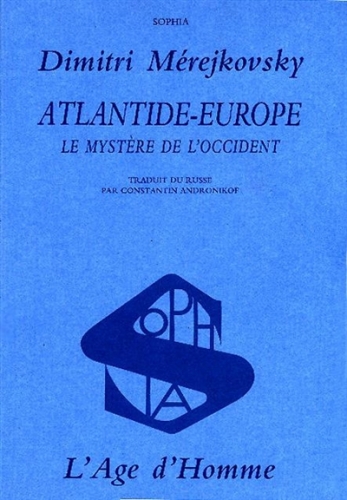


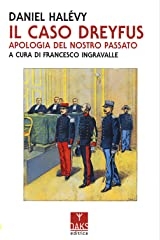
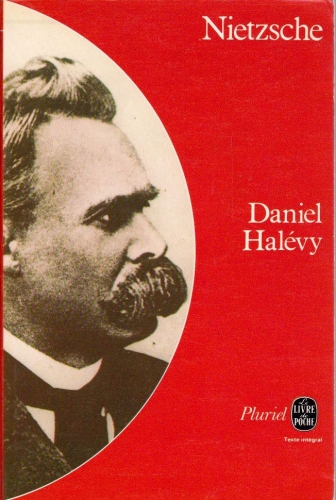
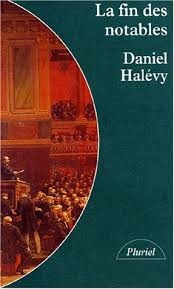 Ses ouvrages sur l'histoire de France sont également très importants, notamment La fin des notables, Paris, Grasset, 1930, rééd. Paris, Sauret, 1972 ; tr. anglaise, The End of Notables, Conn. Wesleyan University Press, Middletown, 1974 ; tr. italienne, La fine dei notabili, Milano, Longanesi, 1954).
Ses ouvrages sur l'histoire de France sont également très importants, notamment La fin des notables, Paris, Grasset, 1930, rééd. Paris, Sauret, 1972 ; tr. anglaise, The End of Notables, Conn. Wesleyan University Press, Middletown, 1974 ; tr. italienne, La fine dei notabili, Milano, Longanesi, 1954).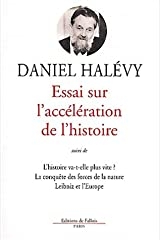 Parler, aujourd'hui, comme il le faisait en 1948, de " l'accélération de l'histoire " (Essai sur l'accélération de l'histoire, tr. it L'accelerazione della storia, Milano, Oaks, 2019), c'est voir concrètement comment un siècle peut être plus " comprimé " qu'un autre, une œuvre d'art, de perspectives, restreinte et dilatée ; un auteur qui a vécu le temps de manière artistique, en utilisant, précisément, la perspective comme critère pour voir l'événement. La stabilité de l'expérience sociale a été perdue en raison du progrès technologique et nos vies sont devenues, comme le dira Zygmunt Bauman au XXIe siècle, des "vies pressées". C'est pourquoi Halévy est pertinent pour le lecteur d'aujourd'hui, c'est pourquoi il est un classique.
Parler, aujourd'hui, comme il le faisait en 1948, de " l'accélération de l'histoire " (Essai sur l'accélération de l'histoire, tr. it L'accelerazione della storia, Milano, Oaks, 2019), c'est voir concrètement comment un siècle peut être plus " comprimé " qu'un autre, une œuvre d'art, de perspectives, restreinte et dilatée ; un auteur qui a vécu le temps de manière artistique, en utilisant, précisément, la perspective comme critère pour voir l'événement. La stabilité de l'expérience sociale a été perdue en raison du progrès technologique et nos vies sont devenues, comme le dira Zygmunt Bauman au XXIe siècle, des "vies pressées". C'est pourquoi Halévy est pertinent pour le lecteur d'aujourd'hui, c'est pourquoi il est un classique.


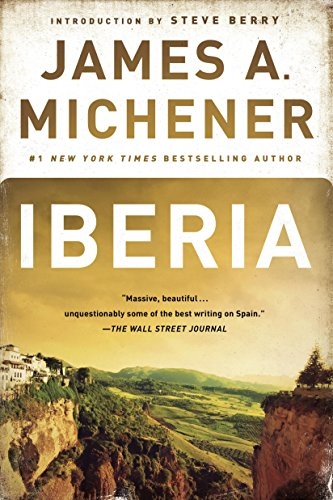 Louant les prouesses de ces hommes féroces venus de l'une des régions les plus pauvres de la péninsule ibérique, Michener affirme que le bien le plus précieux que les galions espagnols ont apporté au Nouveau Monde était "leur courage d'Estrémadure". "L'Estrémadure était mon Espagne". Debout dans l'ancienne Pax Augusta, voyant autour de moi "les Extremadurans austères, têtus et méfiants, dont les ancêtres ont conquis non pas des villes mais des nations et des continents entiers, j'ai senti que j'étais arrivé dans ma vraie patrie". Il a également affirmé que la meilleure façon de connaître le mystère de l'espagnol (ou de l'hispanique) est de connaître la capitale de l'Estrémadure, "cette ville maladroite et négligée" ; "si l'on comprend Badajoz, on comprendra l'Espagne".
Louant les prouesses de ces hommes féroces venus de l'une des régions les plus pauvres de la péninsule ibérique, Michener affirme que le bien le plus précieux que les galions espagnols ont apporté au Nouveau Monde était "leur courage d'Estrémadure". "L'Estrémadure était mon Espagne". Debout dans l'ancienne Pax Augusta, voyant autour de moi "les Extremadurans austères, têtus et méfiants, dont les ancêtres ont conquis non pas des villes mais des nations et des continents entiers, j'ai senti que j'étais arrivé dans ma vraie patrie". Il a également affirmé que la meilleure façon de connaître le mystère de l'espagnol (ou de l'hispanique) est de connaître la capitale de l'Estrémadure, "cette ville maladroite et négligée" ; "si l'on comprend Badajoz, on comprendra l'Espagne". 
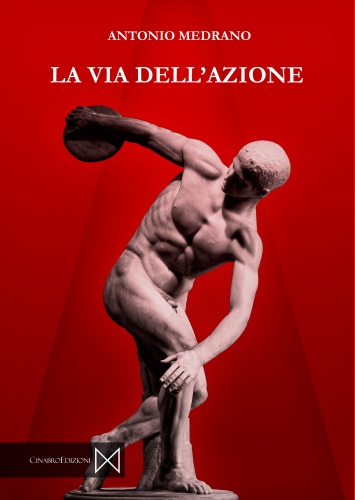
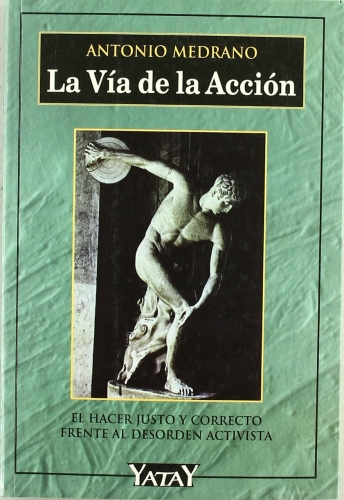
 Diplômé en sciences de l'entreprise de l'ICADE (Instituto Católico de Dirección de Empresas), il a travaillé dans l'industrie (dans des rôles techniques et de gestion), principalement dans le contrôle de gestion, la planification stratégique, le conseil, la motivation du personnel, l'assistance et la coopération avec la direction, et dans des associations publiques et privées pendant plus de 20 ans. Il a derrière lui un long militantisme politique et culturel, qui l'a amené à vivre diverses expériences en Espagne en tant que protagoniste, ayant été le promoteur d'initiatives (groupes, publications, maisons d'édition : Centro Librario Aztlán, Circolo Culturale Imperium, revue Traditio, Maison d'édition YATAY) qui ont contribué de manière décisive à la diffusion de la pensée traditionnelle dans la péninsule ibérique. Il a également une grande expérience en tant que traducteur de livres, d'articles et de documents officiels, avec une connaissance de plusieurs langues. Il a eu des contacts et des relations avec d'éminentes personnalités internationales : hommes politiques et hommes de culture, artistes et sportifs, soldats et hommes d'affaires, autorités religieuses et maîtres spirituels.
Diplômé en sciences de l'entreprise de l'ICADE (Instituto Católico de Dirección de Empresas), il a travaillé dans l'industrie (dans des rôles techniques et de gestion), principalement dans le contrôle de gestion, la planification stratégique, le conseil, la motivation du personnel, l'assistance et la coopération avec la direction, et dans des associations publiques et privées pendant plus de 20 ans. Il a derrière lui un long militantisme politique et culturel, qui l'a amené à vivre diverses expériences en Espagne en tant que protagoniste, ayant été le promoteur d'initiatives (groupes, publications, maisons d'édition : Centro Librario Aztlán, Circolo Culturale Imperium, revue Traditio, Maison d'édition YATAY) qui ont contribué de manière décisive à la diffusion de la pensée traditionnelle dans la péninsule ibérique. Il a également une grande expérience en tant que traducteur de livres, d'articles et de documents officiels, avec une connaissance de plusieurs langues. Il a eu des contacts et des relations avec d'éminentes personnalités internationales : hommes politiques et hommes de culture, artistes et sportifs, soldats et hommes d'affaires, autorités religieuses et maîtres spirituels. 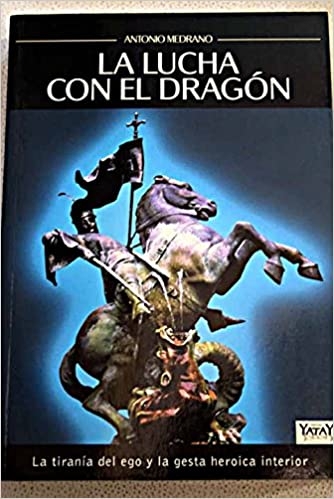 Un exemple de l'esprit, mêlé d'insouciance et de courage, qui animait le jeune Medrano se trouve dans un épisode raconté par sa femme. Le 23 février 1981, alors que la tentative de coup d'État menée par le colonel Tejero - qui avait occupé le Parlement espagnol avec ses hommes et tenait en joue le gouvernement et les parlementaires - était en cours, Medrano et Maria Antonia tentaient de se rendre à leur travail, traversant le centre de Madrid complètement isolé par les forces de police. Il était impossible de passer, une garde civile lourdement armée les empêchant d'accéder à leur lieu de travail. Antonio l'a affrontée, lui disant qu'ils devaient entrer coûte que coûte, même s'ils devaient marcher sur son cadavre, et que s'il avait un devoir à accomplir, ils avaient un devoir à accomplir et n'étaient pas prêts à rentrer chez eux comme des idiots après s'être levés tôt et avoir parcouru plusieurs kilomètres pour aller travailler. À la surprise de sa femme, le garde les laisse passer sans sourciller.
Un exemple de l'esprit, mêlé d'insouciance et de courage, qui animait le jeune Medrano se trouve dans un épisode raconté par sa femme. Le 23 février 1981, alors que la tentative de coup d'État menée par le colonel Tejero - qui avait occupé le Parlement espagnol avec ses hommes et tenait en joue le gouvernement et les parlementaires - était en cours, Medrano et Maria Antonia tentaient de se rendre à leur travail, traversant le centre de Madrid complètement isolé par les forces de police. Il était impossible de passer, une garde civile lourdement armée les empêchant d'accéder à leur lieu de travail. Antonio l'a affrontée, lui disant qu'ils devaient entrer coûte que coûte, même s'ils devaient marcher sur son cadavre, et que s'il avait un devoir à accomplir, ils avaient un devoir à accomplir et n'étaient pas prêts à rentrer chez eux comme des idiots après s'être levés tôt et avoir parcouru plusieurs kilomètres pour aller travailler. À la surprise de sa femme, le garde les laisse passer sans sourciller.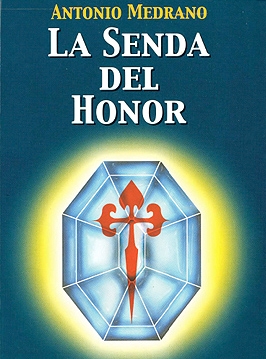 Deux courants fondamentaux convergent dans sa pensée et son œuvre : la tradition occidentale, tant dans sa version chrétienne que pré-chrétienne (grecque, romaine, celtique et germanique), et les traditions orientales (hindouisme, bouddhisme, taoïsme, shintoïsme), auxquelles il convient d'ajouter d'autres doctrines et courants traditionnels, tels que le zoroastrisme, la spiritualité amérindienne, le soufisme islamique ou la kabbale et l'hassidisme (mystique et ésotérisme juifs). Bon connaisseur des trois branches du christianisme (catholique, protestant et orthodoxe), on retrouve dans ses écrits des phrases de mystiques, saints, théologiens, penseurs et poètes chrétiens de tous âges et de toutes nationalités. En même temps, les enseignements des maîtres de l'Inde, de la Chine, du Japon, du Tibet, de la Birmanie, de la Thaïlande, du Sri Lanka, de la Corée et du Vietnam s'y rencontrent. Cette fusion de l'Orient et de l'Occident, notamment du christianisme et du bouddhisme-hindouisme, très similaire à celle que l'on retrouve dans l'œuvre de Coomaraswamy, a conduit certains à le surnommer "le Coomaraswamy espagnol". Et il a d'autres points communs avec Coomaraswamy : l'importance accordée à la beauté et à l'art ; l'attention portée aux symboles et aux mythes ; la citation d'auteurs qui ne sont pas strictement traditionnels (ou pas du tout) ; l'abondance de citations ; l'impact de certains auteurs anglo-saxons qui ont influencé les deux (comme William Blake ou Eric Gill).
Deux courants fondamentaux convergent dans sa pensée et son œuvre : la tradition occidentale, tant dans sa version chrétienne que pré-chrétienne (grecque, romaine, celtique et germanique), et les traditions orientales (hindouisme, bouddhisme, taoïsme, shintoïsme), auxquelles il convient d'ajouter d'autres doctrines et courants traditionnels, tels que le zoroastrisme, la spiritualité amérindienne, le soufisme islamique ou la kabbale et l'hassidisme (mystique et ésotérisme juifs). Bon connaisseur des trois branches du christianisme (catholique, protestant et orthodoxe), on retrouve dans ses écrits des phrases de mystiques, saints, théologiens, penseurs et poètes chrétiens de tous âges et de toutes nationalités. En même temps, les enseignements des maîtres de l'Inde, de la Chine, du Japon, du Tibet, de la Birmanie, de la Thaïlande, du Sri Lanka, de la Corée et du Vietnam s'y rencontrent. Cette fusion de l'Orient et de l'Occident, notamment du christianisme et du bouddhisme-hindouisme, très similaire à celle que l'on retrouve dans l'œuvre de Coomaraswamy, a conduit certains à le surnommer "le Coomaraswamy espagnol". Et il a d'autres points communs avec Coomaraswamy : l'importance accordée à la beauté et à l'art ; l'attention portée aux symboles et aux mythes ; la citation d'auteurs qui ne sont pas strictement traditionnels (ou pas du tout) ; l'abondance de citations ; l'impact de certains auteurs anglo-saxons qui ont influencé les deux (comme William Blake ou Eric Gill). 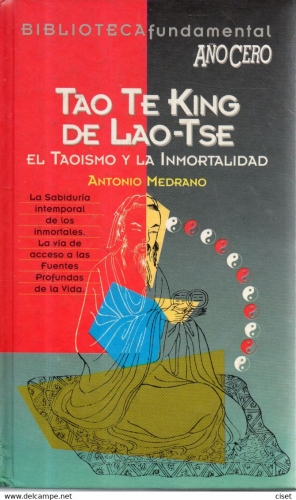 Et voici ce que Medrano lui-même dit du rôle de la beauté : "En ce qui concerne la beauté, je suis chaque jour davantage convaincu de l'importance de la beauté pour la vie humaine, je découvre chaque jour de nouveaux aspects de la beauté de la réalité, reflet et manifestation de la Beauté suprême. Je suis fasciné, étonné et émerveillé par la beauté sous toutes ses formes : la beauté de la Création, la beauté de la nature, la beauté des animaux et des plantes, la beauté de chaque lever de soleil, la beauté de la lumière, la beauté des femmes, la beauté des différentes langues et de ce que l'on dit avec elles, la beauté morale des personnes bonnes et nobles qui m'entourent, la beauté des grandes œuvres d'art, la beauté des grandes œuvres d'art, la beauté des symboles et des rites sacrés, la beauté des idées bien présentées et de celles qui nous transmettent la vérité, la beauté de tant de pages bien écrites qui nous instruisent et illuminent nos vies, la beauté des bonnes actions, la beauté de l'amitié, la beauté du sport, la beauté de l'esprit athlétique et olympique. Face à une telle beauté, on ne peut s'empêcher d'adorer, de vénérer et de se soumettre respectueusement à Celui qui l'a conçue et créée".
Et voici ce que Medrano lui-même dit du rôle de la beauté : "En ce qui concerne la beauté, je suis chaque jour davantage convaincu de l'importance de la beauté pour la vie humaine, je découvre chaque jour de nouveaux aspects de la beauté de la réalité, reflet et manifestation de la Beauté suprême. Je suis fasciné, étonné et émerveillé par la beauté sous toutes ses formes : la beauté de la Création, la beauté de la nature, la beauté des animaux et des plantes, la beauté de chaque lever de soleil, la beauté de la lumière, la beauté des femmes, la beauté des différentes langues et de ce que l'on dit avec elles, la beauté morale des personnes bonnes et nobles qui m'entourent, la beauté des grandes œuvres d'art, la beauté des grandes œuvres d'art, la beauté des symboles et des rites sacrés, la beauté des idées bien présentées et de celles qui nous transmettent la vérité, la beauté de tant de pages bien écrites qui nous instruisent et illuminent nos vies, la beauté des bonnes actions, la beauté de l'amitié, la beauté du sport, la beauté de l'esprit athlétique et olympique. Face à une telle beauté, on ne peut s'empêcher d'adorer, de vénérer et de se soumettre respectueusement à Celui qui l'a conçue et créée".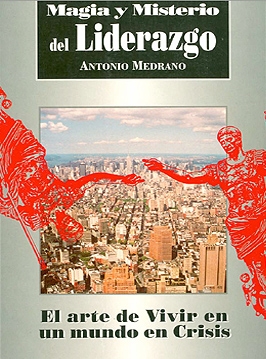 Le résultat de ce choix courageux (qu'il considère comme "inévitable" : "Le destin m'avait fermé toutes les autres portes. Je me suis limité à accepter la seule voie qui m'était offerte et qui semblait être celle que je devais suivre, celle que la "société" attendait de moi") de se consacrer totalement et exclusivement à sa "vocation" est représentée par les œuvres déjà réalisées et celles en préparation. En plus de La voie de l'action, enfin disponible dans sa traduction italienne, Medrano a déjà publié en Espagne : Sabiduría Activa (deuxième volume consacré à l'action) ; La Lucha con el Dragón (le symbolisme du dragon vu, avant tout, comme une représentation de l'ego qui nous domine et nous opprime) ; Magia y Misterio del Liderazgo - El arte de vivir en un mundo en crisis (la figure du leader comme être humain intégral et complet, comme idéal de noblesse et comme objectif auquel nous devons tous aspirer) ; La Luz del Tao (le Tao-Te-King de Lao-Tse traduit et commenté dans un exposé vaste et approfondi) ; La Senda del Honor ("Le chemin de l'honneur", présentation de l'une des valeurs fondamentales de toute société traditionnelle).
Le résultat de ce choix courageux (qu'il considère comme "inévitable" : "Le destin m'avait fermé toutes les autres portes. Je me suis limité à accepter la seule voie qui m'était offerte et qui semblait être celle que je devais suivre, celle que la "société" attendait de moi") de se consacrer totalement et exclusivement à sa "vocation" est représentée par les œuvres déjà réalisées et celles en préparation. En plus de La voie de l'action, enfin disponible dans sa traduction italienne, Medrano a déjà publié en Espagne : Sabiduría Activa (deuxième volume consacré à l'action) ; La Lucha con el Dragón (le symbolisme du dragon vu, avant tout, comme une représentation de l'ego qui nous domine et nous opprime) ; Magia y Misterio del Liderazgo - El arte de vivir en un mundo en crisis (la figure du leader comme être humain intégral et complet, comme idéal de noblesse et comme objectif auquel nous devons tous aspirer) ; La Luz del Tao (le Tao-Te-King de Lao-Tse traduit et commenté dans un exposé vaste et approfondi) ; La Senda del Honor ("Le chemin de l'honneur", présentation de l'une des valeurs fondamentales de toute société traditionnelle).
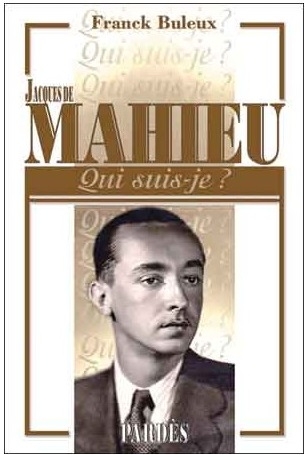
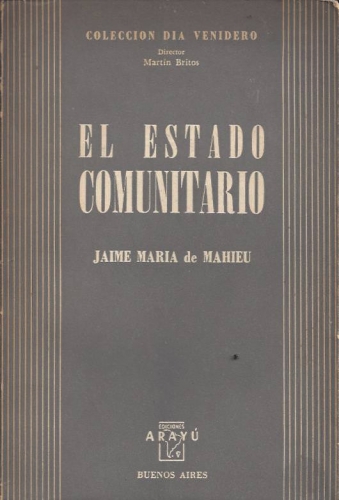
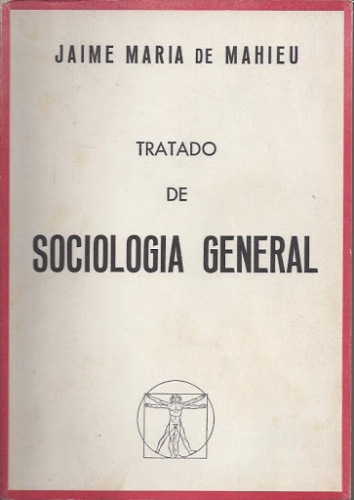
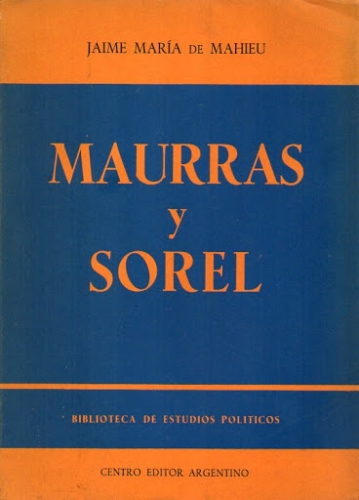


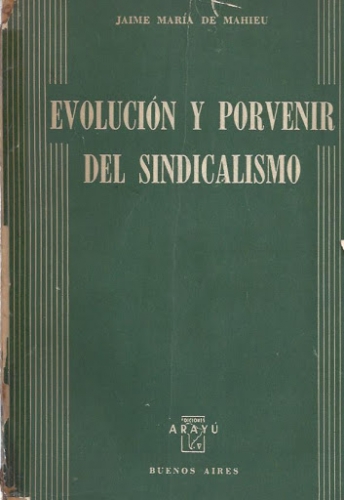
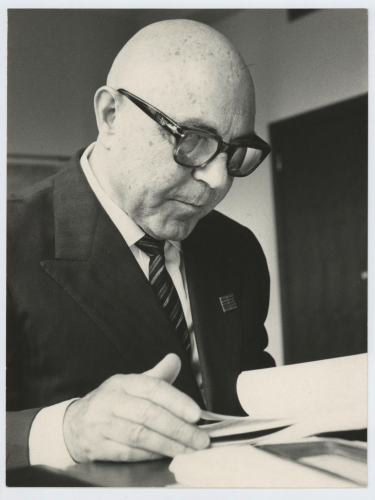
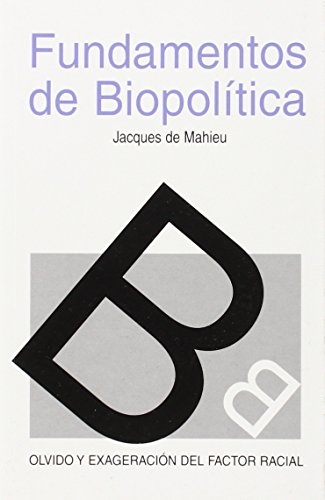
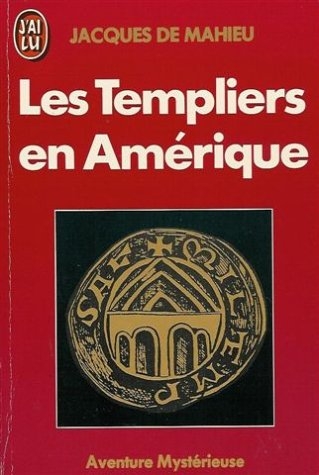
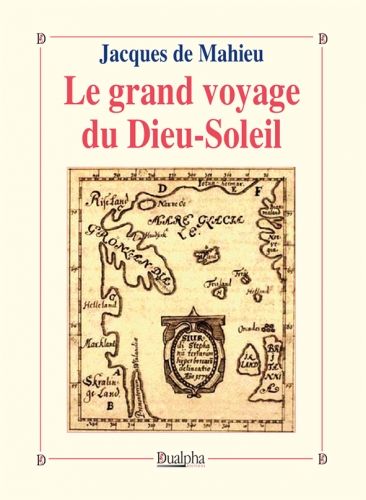
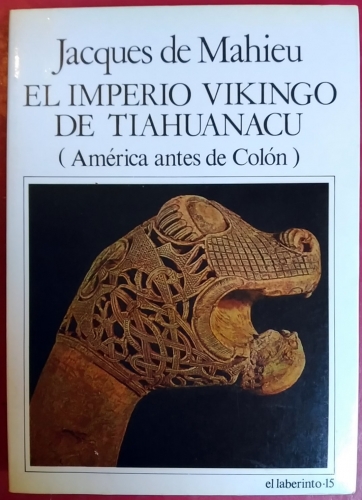

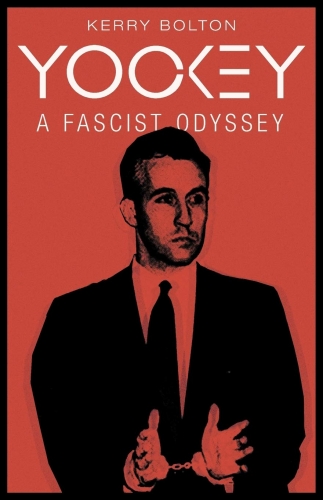

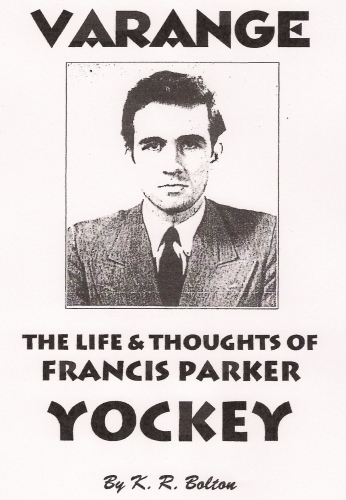
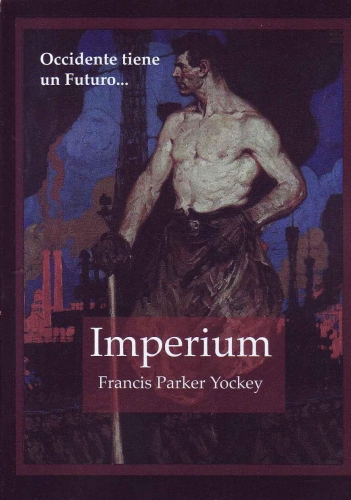
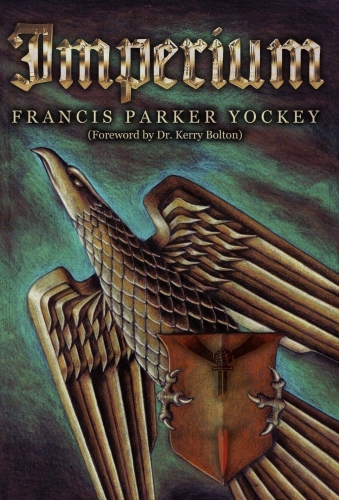


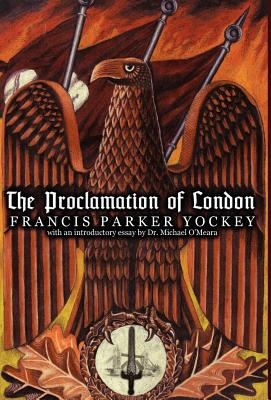 Je note aussi la haute opinion du Dr. Revilo Oliver concernant Yockey et Imperium (un livre dont Oliver pensait qu’il pouvait servir de fondement à un mouvement gagnant ; Oliver était aussi enthousiasmé par TRUD, soit dit au passage) ; je note aussi l’idée d’Oliver selon laquelle nous devons promouvoir des mèmes pour tous les niveaux de compréhension, pour les masses aussi bien que pour l’élite (ce que j’ai recommandé pour le concept d’EGI). L’enthousiasme d’Oliver pour le yockisme est en opposition avec l’ignorance de Yockey de la part de la faction Pierce/Strom/NA, mais nous en connaissons la raison (voir les commentaires sur « Robertson » ci-dessous) ; apparemment, Pierce ne lut jamais Imperium (je suis choqué, choqué). Le Dr. Oliver est un parfait exemple de la manière dont quelqu’un qui est un « matérialiste racial » obsédé par les gènes peut malgré tout être un partisan convaincu de Yockey et d’Imperium. En fait je dirais que la génétique moderne des populations, en analysant le génome autosomal, soutient en fait certaines des idées de Yockey ; par exemple, cet extrait d’Imperium :
Je note aussi la haute opinion du Dr. Revilo Oliver concernant Yockey et Imperium (un livre dont Oliver pensait qu’il pouvait servir de fondement à un mouvement gagnant ; Oliver était aussi enthousiasmé par TRUD, soit dit au passage) ; je note aussi l’idée d’Oliver selon laquelle nous devons promouvoir des mèmes pour tous les niveaux de compréhension, pour les masses aussi bien que pour l’élite (ce que j’ai recommandé pour le concept d’EGI). L’enthousiasme d’Oliver pour le yockisme est en opposition avec l’ignorance de Yockey de la part de la faction Pierce/Strom/NA, mais nous en connaissons la raison (voir les commentaires sur « Robertson » ci-dessous) ; apparemment, Pierce ne lut jamais Imperium (je suis choqué, choqué). Le Dr. Oliver est un parfait exemple de la manière dont quelqu’un qui est un « matérialiste racial » obsédé par les gènes peut malgré tout être un partisan convaincu de Yockey et d’Imperium. En fait je dirais que la génétique moderne des populations, en analysant le génome autosomal, soutient en fait certaines des idées de Yockey ; par exemple, cet extrait d’Imperium :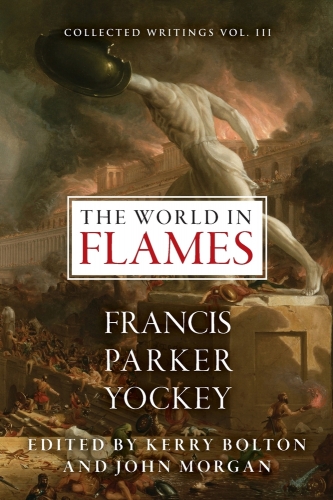
 Concernant la relation de Carto (photo) avec le yockisme, celle-ci est bien couverte par Bolton, et discutée par d’autres ailleurs, donc je ne vais pas m’attarder là-dessus, bien que je croie que Gannon était bien trop critique de Carto (bien sûr la critique de Carto par Gannon s’appliquerait aussi à mes propres vues, donc je ne suis pas objectif ici). Bolton décrit d’autres interprétations de Yockey, incluant celle des odinistes ; je ne peux pas discuter de tout cela par manque de temps.
Concernant la relation de Carto (photo) avec le yockisme, celle-ci est bien couverte par Bolton, et discutée par d’autres ailleurs, donc je ne vais pas m’attarder là-dessus, bien que je croie que Gannon était bien trop critique de Carto (bien sûr la critique de Carto par Gannon s’appliquerait aussi à mes propres vues, donc je ne suis pas objectif ici). Bolton décrit d’autres interprétations de Yockey, incluant celle des odinistes ; je ne peux pas discuter de tout cela par manque de temps. Concernant la terminologie, une analyse plus complète du yockisme requerra des définitions plus précises de termes comme « race horizontale », « race verticale », « verticalisme » et tout le reste, incluant le « pessimisme spenglerien » aussi bien que les diverses « maladies de la culture » de Yockey. En parlant de terminologie, Yockey s’illusionnait peut-être un peu en pensant que « Impérialisme » est plus convenable que « Fascisme », mais encore une fois, dans la période de l’après-guerre immédiat peut-être que c’était vrai. Mais certainement plus maintenant.
Concernant la terminologie, une analyse plus complète du yockisme requerra des définitions plus précises de termes comme « race horizontale », « race verticale », « verticalisme » et tout le reste, incluant le « pessimisme spenglerien » aussi bien que les diverses « maladies de la culture » de Yockey. En parlant de terminologie, Yockey s’illusionnait peut-être un peu en pensant que « Impérialisme » est plus convenable que « Fascisme », mais encore une fois, dans la période de l’après-guerre immédiat peut-être que c’était vrai. Mais certainement plus maintenant.

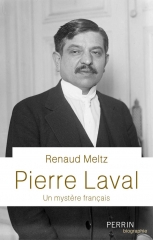 Renaud Meltz vient de livrer, avec les Éditions Perrin, une monumentale et phénoménale biographie de Pierre Laval, l'homme le plus détesté de l'histoire de France. Pacifiste forcené, partant de l’extrême gauche, maire d'Aubervilliers, sénateur, président du Conseil, il bascule vers le centre droit tout en s'enrichissant de façon troublante. Acteur clé de la mort de la République en juillet 40, il invente la Collaboration avec l'Allemagne nazie pensant qu'il "roulera Hitler" et qu'il sera la sauveur de la France. Il finira par céder à tout, à aider au pillage du pays, et à livrer les juifs à la déportation. Renaud Meltz grâce à des archives neuves ou peu exploitées renouvelle profondément la vision que nous avions de Pierre Laval dans ce livre remarquablement écrit et subtilement construit par un mariage réussi de chapitres thématiques et chronologiques. Abonnez vous aux Voix de l'histoire et partagez si vous avez aimé. Merci.
Renaud Meltz vient de livrer, avec les Éditions Perrin, une monumentale et phénoménale biographie de Pierre Laval, l'homme le plus détesté de l'histoire de France. Pacifiste forcené, partant de l’extrême gauche, maire d'Aubervilliers, sénateur, président du Conseil, il bascule vers le centre droit tout en s'enrichissant de façon troublante. Acteur clé de la mort de la République en juillet 40, il invente la Collaboration avec l'Allemagne nazie pensant qu'il "roulera Hitler" et qu'il sera la sauveur de la France. Il finira par céder à tout, à aider au pillage du pays, et à livrer les juifs à la déportation. Renaud Meltz grâce à des archives neuves ou peu exploitées renouvelle profondément la vision que nous avions de Pierre Laval dans ce livre remarquablement écrit et subtilement construit par un mariage réussi de chapitres thématiques et chronologiques. Abonnez vous aux Voix de l'histoire et partagez si vous avez aimé. Merci.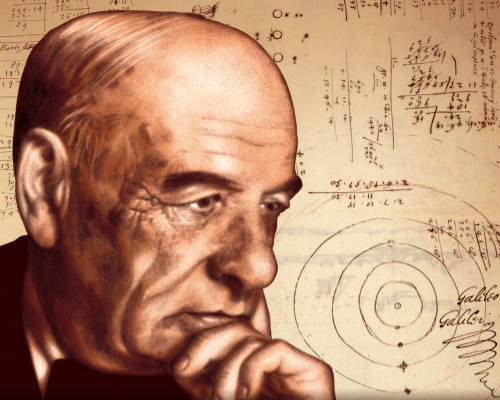
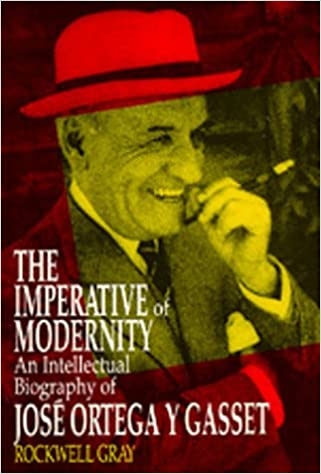 La littérature sur Ortega y Gasset est extraordinairement abondante. Longtemps, elle s’est limitée à la présentation et l’étude de ses idées philosophiques, sociologiques, politiques et esthétiques. Ce n’est qu’assez récemment que sont apparues les premières biographies en bonne et due forme. Deux des plus fouillées, par Rockwell Gray et Javier Zamora Bonilla, coordinateur de la nouvelle édition des œuvres complètes d’Ortega en dix volumes, sont essentiellement, pour reprendre l’expression utilisée par le premier de ces deux auteurs à propos de son livre, des biographies « intellectuelles ». En filigrane de l’exposé des idées d’Ortega et de leur évolution, un certain nombre d’aspects de sa vie personnelle et de son caractère y étaient toutefois évoqués. Jordi Gracia va plus loin encore dans cette direction, en s’appliquant à mettre en évidence, grâce à l’exploitation de nombreux documents dont certains inédits (notes privées, correspondance), le jeu serré des interactions entre la personnalité d’Ortega, ses idées et les péripéties de sa vie. Dense, touffue, farcie de citations et rédigée sur un ton souvent subjectif, personnel et passionné, épousant les reliefs et les sinuosités de la vie intellectuelle et émotionnelle d’Ortega plutôt que de présenter de manière linéaire, distante et méthodique les événements de son existence et le contenu de ses œuvres, cette biographie, dont la lecture profitera surtout à ceux qui sont déjà un peu familiers des théories du philosophe et de sa trajectoire, jette sur le personnage une lumière nouvelle.
La littérature sur Ortega y Gasset est extraordinairement abondante. Longtemps, elle s’est limitée à la présentation et l’étude de ses idées philosophiques, sociologiques, politiques et esthétiques. Ce n’est qu’assez récemment que sont apparues les premières biographies en bonne et due forme. Deux des plus fouillées, par Rockwell Gray et Javier Zamora Bonilla, coordinateur de la nouvelle édition des œuvres complètes d’Ortega en dix volumes, sont essentiellement, pour reprendre l’expression utilisée par le premier de ces deux auteurs à propos de son livre, des biographies « intellectuelles ». En filigrane de l’exposé des idées d’Ortega et de leur évolution, un certain nombre d’aspects de sa vie personnelle et de son caractère y étaient toutefois évoqués. Jordi Gracia va plus loin encore dans cette direction, en s’appliquant à mettre en évidence, grâce à l’exploitation de nombreux documents dont certains inédits (notes privées, correspondance), le jeu serré des interactions entre la personnalité d’Ortega, ses idées et les péripéties de sa vie. Dense, touffue, farcie de citations et rédigée sur un ton souvent subjectif, personnel et passionné, épousant les reliefs et les sinuosités de la vie intellectuelle et émotionnelle d’Ortega plutôt que de présenter de manière linéaire, distante et méthodique les événements de son existence et le contenu de ses œuvres, cette biographie, dont la lecture profitera surtout à ceux qui sont déjà un peu familiers des théories du philosophe et de sa trajectoire, jette sur le personnage une lumière nouvelle.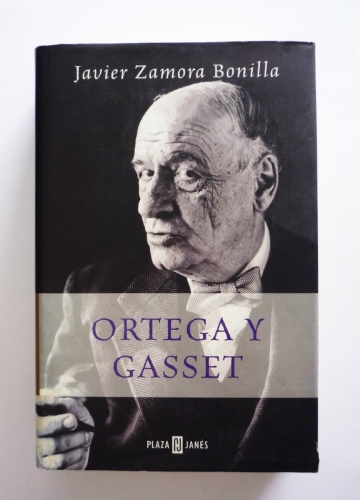 L’image qui ressort de ce portrait est nuancée et complexe. C’est celle d’un homme « d’une intelligence insolente […] impérialement sûr de lui et souriant, plaisantin, jovial, fanfaron et séducteur », d’un travailleur forcené et infatigable doté d’une imagination puissante, mais aussi d’un homme anxieux, tourmenté et non sans contradictions, s’efforçant avec opiniâtreté de surmonter des faiblesses dont il était en partie conscient, vulnérable au découragement et qui a traversé plusieurs épisodes de dépression psychologique paralysante. Comme l’indique sans équivoque la première phrase du livre, c’est aussi l’image d’un homme pouvant penser que sa vie avait été, au moins partiellement, un échec. Pour quelles raisons ?
L’image qui ressort de ce portrait est nuancée et complexe. C’est celle d’un homme « d’une intelligence insolente […] impérialement sûr de lui et souriant, plaisantin, jovial, fanfaron et séducteur », d’un travailleur forcené et infatigable doté d’une imagination puissante, mais aussi d’un homme anxieux, tourmenté et non sans contradictions, s’efforçant avec opiniâtreté de surmonter des faiblesses dont il était en partie conscient, vulnérable au découragement et qui a traversé plusieurs épisodes de dépression psychologique paralysante. Comme l’indique sans équivoque la première phrase du livre, c’est aussi l’image d’un homme pouvant penser que sa vie avait été, au moins partiellement, un échec. Pour quelles raisons ? Ces années furent les plus pénibles de l’existence d’Ortega. À Paris, où s’était également réfugié Gregorio Marañon, il souffrit de graves problèmes de santé qui mirent ses jours en danger. En Argentine, la fréquentation de milieux conservateurs lui valut l’opprobre des intellectuels progressistes, avec pour effet de le placer dans une situation de terrible isolement. L’étrange théorie du penseur comme prophète condamné à la solitude qu’il développa à ce moment dans plusieurs articles, à rebours de sa vision de toujours du rôle de l’intellectuel, pourrait être interprétée, suggère judicieusement Eve Giustiniani, comme une tentative d’auto-légitimation de cette solitude forcée – preuve supplémentaire, s’il était nécessaire, de l’impact permanent des épisodes de sa vie sur sa pensée.
Ces années furent les plus pénibles de l’existence d’Ortega. À Paris, où s’était également réfugié Gregorio Marañon, il souffrit de graves problèmes de santé qui mirent ses jours en danger. En Argentine, la fréquentation de milieux conservateurs lui valut l’opprobre des intellectuels progressistes, avec pour effet de le placer dans une situation de terrible isolement. L’étrange théorie du penseur comme prophète condamné à la solitude qu’il développa à ce moment dans plusieurs articles, à rebours de sa vision de toujours du rôle de l’intellectuel, pourrait être interprétée, suggère judicieusement Eve Giustiniani, comme une tentative d’auto-légitimation de cette solitude forcée – preuve supplémentaire, s’il était nécessaire, de l’impact permanent des épisodes de sa vie sur sa pensée. À l’évidence, Ortega n’avait en effet aucune sympathie intellectuelle pour l’idéologie franquiste. Résolument agnostique (par fidélité avec ses convictions sur ce plan, sa famille, à sa mort, refusa les funérailles religieuses qu’envisageaient les autorités), il se sentait à des années-lumière du conservatisme clérical et religieux du parti de Franco. Il est incontestable qu’une partie des phalangistes au pouvoir se sont emparés de certaines de ses idées dans le but de fournir au régime une légitimité intellectuelle. Mais de cela on ne peut le tenir responsable. On ne peut pas non plus vraiment lui reprocher d’avoir naïvement pensé que le régime franquiste pouvait évoluer dans le sens de la démocratie. On peut par contre lui faire grief de s’être laissé aller, par manque de courage ou par opportunisme, à tenir des propos et à prendre des initiatives qu’il aurait pu éviter, ainsi que d’avoir continuellement maintenu autour de sa position politique une ambiguïté troublante. Il la paiera lourdement : regardé avec méfiance par les opposants au régime comme par les responsables de celui-ci, il passera les vingt dernières années de sa vie dans une situation peu claire et inconfortable en Espagne, ne bénéficiant d’une réelle reconnaissance sans réserve et sans arrière-pensées qu’en dehors des frontières du pays.
À l’évidence, Ortega n’avait en effet aucune sympathie intellectuelle pour l’idéologie franquiste. Résolument agnostique (par fidélité avec ses convictions sur ce plan, sa famille, à sa mort, refusa les funérailles religieuses qu’envisageaient les autorités), il se sentait à des années-lumière du conservatisme clérical et religieux du parti de Franco. Il est incontestable qu’une partie des phalangistes au pouvoir se sont emparés de certaines de ses idées dans le but de fournir au régime une légitimité intellectuelle. Mais de cela on ne peut le tenir responsable. On ne peut pas non plus vraiment lui reprocher d’avoir naïvement pensé que le régime franquiste pouvait évoluer dans le sens de la démocratie. On peut par contre lui faire grief de s’être laissé aller, par manque de courage ou par opportunisme, à tenir des propos et à prendre des initiatives qu’il aurait pu éviter, ainsi que d’avoir continuellement maintenu autour de sa position politique une ambiguïté troublante. Il la paiera lourdement : regardé avec méfiance par les opposants au régime comme par les responsables de celui-ci, il passera les vingt dernières années de sa vie dans une situation peu claire et inconfortable en Espagne, ne bénéficiant d’une réelle reconnaissance sans réserve et sans arrière-pensées qu’en dehors des frontières du pays.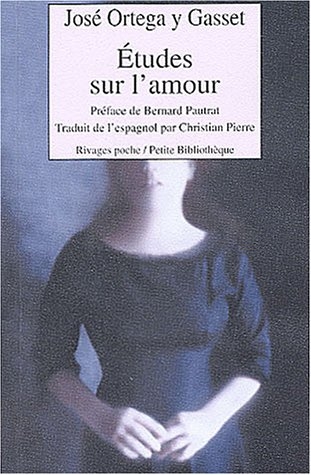 Esprit curieux et lecteur vorace, Ortega a emprunté des idées ou des concepts à de nombreux penseurs, pour les mettre au service d’une intuition centrale : « le socle de toutes mes idées philosophiques, écrira-t-il, est l’intuition du phénomène de la vie humaine ». L’idée que l’objet de la philosophie ne peut être que l’existence humaine dans ce qui fait sa singularité – le fait qu’elle ne se réduit pas à sa réalité biologique et possède une dimension historique au plan individuel et collectif – Ortega l’a trouvée dans la lecture de penseurs comme Nietzsche, Bergson et surtout Wilhelm Dilthey, psychologue et philosophe allemand qu’il considérait comme « le philosophe le plus important de la seconde moitié du XIXe siècle ».
Esprit curieux et lecteur vorace, Ortega a emprunté des idées ou des concepts à de nombreux penseurs, pour les mettre au service d’une intuition centrale : « le socle de toutes mes idées philosophiques, écrira-t-il, est l’intuition du phénomène de la vie humaine ». L’idée que l’objet de la philosophie ne peut être que l’existence humaine dans ce qui fait sa singularité – le fait qu’elle ne se réduit pas à sa réalité biologique et possède une dimension historique au plan individuel et collectif – Ortega l’a trouvée dans la lecture de penseurs comme Nietzsche, Bergson et surtout Wilhelm Dilthey, psychologue et philosophe allemand qu’il considérait comme « le philosophe le plus important de la seconde moitié du XIXe siècle ».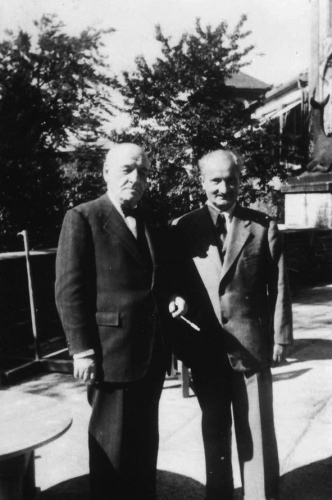 Un choc considérable à cet égard a été la parution, en 1927, de L’Être et le Temps, l’ouvrage qui a fait connaître Martin Heidegger. À plusieurs endroits de son livre, Jordi Gracia évoque le bouleversement qu’a engendré chez Ortega la découverte de la philosophie de Heidegger, dont la proximité apparente des idées avec les siennes ne pouvait manquer de le perturber. Conformément à son habitude, Ortega prit soin de se distancer de Heidegger en pointant du doigt ce qu’il critiquait comme les faiblesses de sa pensée : dans un premier temps ce qu’il appelait son pessimisme, bien illustré dans son esprit par le rôle dévolu dans L’Être et le Temps à l’angoisse comme révélateur de la condition humaine ; plus tard ce qu’il présentait à juste titre comme la dérive de la pensée de Heidegger vers des considérations de caractère religieux et théologique, lorsque ses préoccupations ont évolué d’une philosophie de l’existence à des réflexions ontologiques (sur la nature de l’être en général).
Un choc considérable à cet égard a été la parution, en 1927, de L’Être et le Temps, l’ouvrage qui a fait connaître Martin Heidegger. À plusieurs endroits de son livre, Jordi Gracia évoque le bouleversement qu’a engendré chez Ortega la découverte de la philosophie de Heidegger, dont la proximité apparente des idées avec les siennes ne pouvait manquer de le perturber. Conformément à son habitude, Ortega prit soin de se distancer de Heidegger en pointant du doigt ce qu’il critiquait comme les faiblesses de sa pensée : dans un premier temps ce qu’il appelait son pessimisme, bien illustré dans son esprit par le rôle dévolu dans L’Être et le Temps à l’angoisse comme révélateur de la condition humaine ; plus tard ce qu’il présentait à juste titre comme la dérive de la pensée de Heidegger vers des considérations de caractère religieux et théologique, lorsque ses préoccupations ont évolué d’une philosophie de l’existence à des réflexions ontologiques (sur la nature de l’être en général).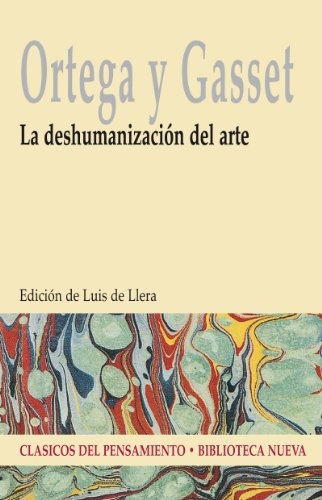 Le parallèle pourrait être poussé plus loin encore, jusqu’à inclure un trait psychologique particulier des deux hommes, leur attitude face aux penseurs et aux artistes dont ils traitaient. Ortega analysait la vie de Goethe, Velasquez ou Goya à la lumière de leur « vocation fondamentale » exactement comme Sartre lisait celle des écrivains dont il parlait en référence à leur « projet existentiel ». Mais l’un et l’autre tendaient de surcroît à se projeter dans la vie et la personnalité des créateurs sur qui ils écrivaient, d’une façon qui conférait aux portraits qu’ils livraient d’eux le caractère d’autoportraits implicites et déformés. Comme Sartre, Ortega était rempli de lui-même, même si c’est d’une manière très différente, la forme particulière d’orgueil de Sartre lui interdisant cette vantardise dans laquelle le philosophe espagnol tombait volontiers. Mais, comme lui, il a réussi à faire de cette caractéristique psychologique une force, en développant une vision de la vie qui, tout en nous parlant ostensiblement de lui-même, possède à l’évidence une portée universelle.
Le parallèle pourrait être poussé plus loin encore, jusqu’à inclure un trait psychologique particulier des deux hommes, leur attitude face aux penseurs et aux artistes dont ils traitaient. Ortega analysait la vie de Goethe, Velasquez ou Goya à la lumière de leur « vocation fondamentale » exactement comme Sartre lisait celle des écrivains dont il parlait en référence à leur « projet existentiel ». Mais l’un et l’autre tendaient de surcroît à se projeter dans la vie et la personnalité des créateurs sur qui ils écrivaient, d’une façon qui conférait aux portraits qu’ils livraient d’eux le caractère d’autoportraits implicites et déformés. Comme Sartre, Ortega était rempli de lui-même, même si c’est d’une manière très différente, la forme particulière d’orgueil de Sartre lui interdisant cette vantardise dans laquelle le philosophe espagnol tombait volontiers. Mais, comme lui, il a réussi à faire de cette caractéristique psychologique une force, en développant une vision de la vie qui, tout en nous parlant ostensiblement de lui-même, possède à l’évidence une portée universelle. Si Ortega a choisi de s’exprimer presque exclusivement de la sorte, c’est certainement pour pouvoir toucher un large public, en conformité avec ce qu’il voyait comme son rôle d’éducateur de l’élite. Mais c’est aussi pour des raisons liées à son caractère et sa personnalité, justement soulignées par son disciple Julian Marias : « Écrire un livre requiert un tempérament bien plus ascétique que celui d’Ortega. […] Le caractère voluptueux des sujets [qu’il traitait], qu’Ortega ressentait intensément d’une manière qui faisait de lui non seulement un intellectuel, mais un écrivain au sens plein du terme, le distrayait très fréquemment et l’entraînait vers des questions secondaires et, surtout, vers de nouveaux sujets […]».
Si Ortega a choisi de s’exprimer presque exclusivement de la sorte, c’est certainement pour pouvoir toucher un large public, en conformité avec ce qu’il voyait comme son rôle d’éducateur de l’élite. Mais c’est aussi pour des raisons liées à son caractère et sa personnalité, justement soulignées par son disciple Julian Marias : « Écrire un livre requiert un tempérament bien plus ascétique que celui d’Ortega. […] Le caractère voluptueux des sujets [qu’il traitait], qu’Ortega ressentait intensément d’une manière qui faisait de lui non seulement un intellectuel, mais un écrivain au sens plein du terme, le distrayait très fréquemment et l’entraînait vers des questions secondaires et, surtout, vers de nouveaux sujets […]». Au titre de ceux-ci, l’écrivain Javier Cercas énumère ainsi « [la] pédanterie d’Ortega, son snobisme, sa tendance aux jugements arbitraires, son nationalisme mal dissimulé, son autoritarisme de salon [et] son goût pour les gens prétentieux », caractéristiques dont Jordi Gracia, tout en soulignant à l’envi ses qualités (sa générosité intellectuelle, son courage dans l’adversité, son tempérament combatif et passionné), ne tente pas de faire davantage mystère que des traits physiques et de comportement qui leur sont liés et sont autant de composantes de l’image qu’il voulait donner (et que nous avons) de lui : l’élégance vestimentaire extrême, le canotier et les voitures décapotables décapotées même en hiver, habitude dont la combinaison avec l’assuétude à la cigarette, a-t-on dit, a pu contribuer aux problèmes respiratoires dont il a souffert durant toute sa vie.
Au titre de ceux-ci, l’écrivain Javier Cercas énumère ainsi « [la] pédanterie d’Ortega, son snobisme, sa tendance aux jugements arbitraires, son nationalisme mal dissimulé, son autoritarisme de salon [et] son goût pour les gens prétentieux », caractéristiques dont Jordi Gracia, tout en soulignant à l’envi ses qualités (sa générosité intellectuelle, son courage dans l’adversité, son tempérament combatif et passionné), ne tente pas de faire davantage mystère que des traits physiques et de comportement qui leur sont liés et sont autant de composantes de l’image qu’il voulait donner (et que nous avons) de lui : l’élégance vestimentaire extrême, le canotier et les voitures décapotables décapotées même en hiver, habitude dont la combinaison avec l’assuétude à la cigarette, a-t-on dit, a pu contribuer aux problèmes respiratoires dont il a souffert durant toute sa vie.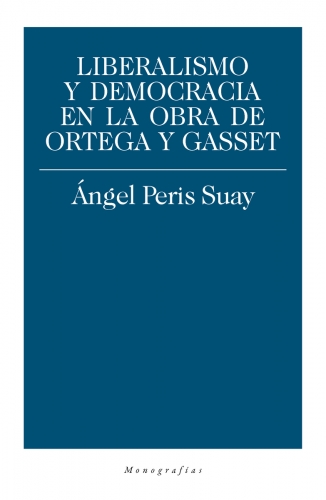 Une pépinière d’idées
Une pépinière d’idées


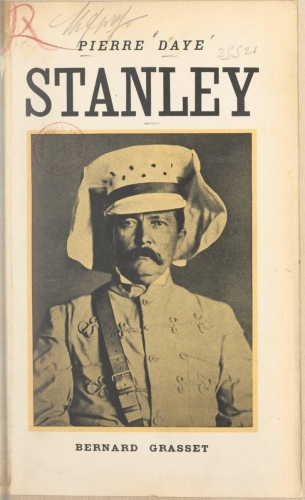 Embauché comme reporter par le grand quotidien Le Soir, il va désormais multiplier les expéditions les plus lointaines et les entrevues exclusives. En une quinzaine d’années, ses pérégrinations vont l’emmener aux quatre coins de l’univers et lui permettre de rencontrer un nombre incroyable de personnalités de premier plan. Après le Congo (où il retournera plusieurs fois), Pierre Daye visite ainsi le Maroc, où il s’entretient avec le sultan Moulay Youssef (1881-1927), les Balkans, où il est reçu par le Premier ministre bulgare Alexandre Tsankov (1879-1959), et l’Argentine, où il se rend, en 1925, en faisant le subrécargue sur un modeste cargo. Après Buenos-Aires, où il se lie avec l’écrivain nationaliste Leopoldo Lugones (1874-1938), il traverse la Cordillière des Andes et découvre le Chili, puis se rend en Uruguay et au Brésil. En 1926, il est à Moscou, approche Léon Trotsky, Leonid Krassine (5) et Maxime Litvinov (6), puis passe par la Pologne et s’y entretient avec Sikorski (7), avant de regagner Bruxelles pour y faire rapport au roi Albert Ier. D’autres expéditions le conduisent en Angola, en Nubie mais aussi au Maroc espagnol, où il rencontre le général Primo de Rivera, et en Asie qu’il visite en qualité de chargé de mission. Après une escale à Ceylan, il passe par les Indes britanniques, la Malaisie, Sumatra, le Japon, la Chine et la Mandchourie. Dans l’Empire du Milieu, il va voir les tombes des Mings, rencontre Pou-yi (8) et obtient une entrevue avec le président Tchang Tso-lin (9). D’une curiosité insatiable, Pierre Daye effectue ensuite un tour du monde par les îles, périple original qui le conduit au Cap Vert, aux Antilles, à Panama, à Tahiti, aux îles Fidji, aux Nouvelles-Hébrides, en Nouvelle-Calédonie, en Australie et à Java. Il va sans dire que toutes ces étapes donnent naissance à autant d’articles ou de livres captivants (10). Notre impénitent voyageur connaît également bien Constantinople et le Moyen-Orient. Passé par la Syrie, la Palestine et Jérusalem, il séjourne assez longuement en Égypte (1931), ce qui lui permet de visiter Memphis (avec le peintre Herman Richir), Thèbes, Abou Simbel et le temple d’Edfou.
Embauché comme reporter par le grand quotidien Le Soir, il va désormais multiplier les expéditions les plus lointaines et les entrevues exclusives. En une quinzaine d’années, ses pérégrinations vont l’emmener aux quatre coins de l’univers et lui permettre de rencontrer un nombre incroyable de personnalités de premier plan. Après le Congo (où il retournera plusieurs fois), Pierre Daye visite ainsi le Maroc, où il s’entretient avec le sultan Moulay Youssef (1881-1927), les Balkans, où il est reçu par le Premier ministre bulgare Alexandre Tsankov (1879-1959), et l’Argentine, où il se rend, en 1925, en faisant le subrécargue sur un modeste cargo. Après Buenos-Aires, où il se lie avec l’écrivain nationaliste Leopoldo Lugones (1874-1938), il traverse la Cordillière des Andes et découvre le Chili, puis se rend en Uruguay et au Brésil. En 1926, il est à Moscou, approche Léon Trotsky, Leonid Krassine (5) et Maxime Litvinov (6), puis passe par la Pologne et s’y entretient avec Sikorski (7), avant de regagner Bruxelles pour y faire rapport au roi Albert Ier. D’autres expéditions le conduisent en Angola, en Nubie mais aussi au Maroc espagnol, où il rencontre le général Primo de Rivera, et en Asie qu’il visite en qualité de chargé de mission. Après une escale à Ceylan, il passe par les Indes britanniques, la Malaisie, Sumatra, le Japon, la Chine et la Mandchourie. Dans l’Empire du Milieu, il va voir les tombes des Mings, rencontre Pou-yi (8) et obtient une entrevue avec le président Tchang Tso-lin (9). D’une curiosité insatiable, Pierre Daye effectue ensuite un tour du monde par les îles, périple original qui le conduit au Cap Vert, aux Antilles, à Panama, à Tahiti, aux îles Fidji, aux Nouvelles-Hébrides, en Nouvelle-Calédonie, en Australie et à Java. Il va sans dire que toutes ces étapes donnent naissance à autant d’articles ou de livres captivants (10). Notre impénitent voyageur connaît également bien Constantinople et le Moyen-Orient. Passé par la Syrie, la Palestine et Jérusalem, il séjourne assez longuement en Égypte (1931), ce qui lui permet de visiter Memphis (avec le peintre Herman Richir), Thèbes, Abou Simbel et le temple d’Edfou. 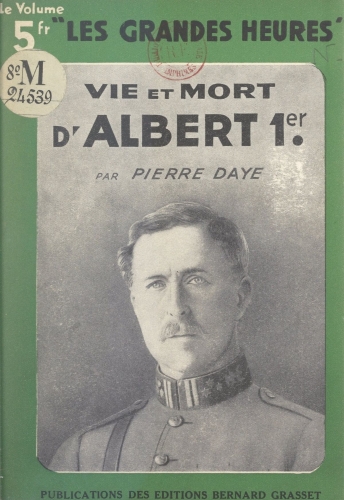 Ajoutons encore à la liste de ses voyages mémorables, la traversée de la Sibérie par 30° au-dessous de zéro, et un séjour en Perse qui lui offre l’occasion de converser avec Reza Chah Pahlavi. Son goût affirmé pour les contrées lointaines ne l’empêche pas d’apprécier aussi les découvertes européennes. Angleterre, Portugal, Italie, Autriche, Hongrie et pays scandinaves n’ont guère de secrets pour lui ; en août 1932, il est même en Lituanie, à Nida, où l’a invité Thomas Mann, tandis qu’en 1935, il visite les Pays-Bas et l’Allemagne en compagnie de Pierre Gaxotte. À Berlin, les deux hommes auront l’occasion d’échanger quelques propos avec Ribbentrop et Otto Abetz. Aventurier dans l’âme, Pierre Daye ne se contente pas de flâner nonchalamment mais il n’hésite pas, le cas échéant, à se rendre sur le théâtre de certains conflits : on le verra par exemple, en pleine guerre civile espagnole, faire la tournée des lignes de front avec Gaxotte et José Félix de Lequerica (11).
Ajoutons encore à la liste de ses voyages mémorables, la traversée de la Sibérie par 30° au-dessous de zéro, et un séjour en Perse qui lui offre l’occasion de converser avec Reza Chah Pahlavi. Son goût affirmé pour les contrées lointaines ne l’empêche pas d’apprécier aussi les découvertes européennes. Angleterre, Portugal, Italie, Autriche, Hongrie et pays scandinaves n’ont guère de secrets pour lui ; en août 1932, il est même en Lituanie, à Nida, où l’a invité Thomas Mann, tandis qu’en 1935, il visite les Pays-Bas et l’Allemagne en compagnie de Pierre Gaxotte. À Berlin, les deux hommes auront l’occasion d’échanger quelques propos avec Ribbentrop et Otto Abetz. Aventurier dans l’âme, Pierre Daye ne se contente pas de flâner nonchalamment mais il n’hésite pas, le cas échéant, à se rendre sur le théâtre de certains conflits : on le verra par exemple, en pleine guerre civile espagnole, faire la tournée des lignes de front avec Gaxotte et José Félix de Lequerica (11).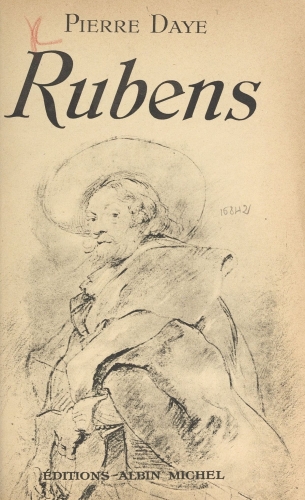 Au demeurant, il serait injuste et inexact de ne voir en Pierre Daye qu’un voyageur nanti et un mondain frivole : il s’agit aussi et surtout d’un écrivain talentueux dont les nombreux livres se vendent très bien. Auteur de multiples récits de voyage (19), il a également consacré plusieurs ouvrages aux souverains belges (20), ainsi que plusieurs essais à l’Afrique (21). Dans la première partie de sa vie, il a, en revanche, peu abordé la politique dans ses livres, et lorsqu’il l’a fait, ce fut plutôt sous l’angle de la politique étrangère (22). Il s’est par ailleurs peu intéressé à la fiction, sinon sous la forme de quelques nouvelles et contes. L’un de ceux-ci, Daïnah, la métisse (1932), sera même adapté au cinéma par Jean Grémillon (avec Charles Vanel dans l’un des rôles principaux).
Au demeurant, il serait injuste et inexact de ne voir en Pierre Daye qu’un voyageur nanti et un mondain frivole : il s’agit aussi et surtout d’un écrivain talentueux dont les nombreux livres se vendent très bien. Auteur de multiples récits de voyage (19), il a également consacré plusieurs ouvrages aux souverains belges (20), ainsi que plusieurs essais à l’Afrique (21). Dans la première partie de sa vie, il a, en revanche, peu abordé la politique dans ses livres, et lorsqu’il l’a fait, ce fut plutôt sous l’angle de la politique étrangère (22). Il s’est par ailleurs peu intéressé à la fiction, sinon sous la forme de quelques nouvelles et contes. L’un de ceux-ci, Daïnah, la métisse (1932), sera même adapté au cinéma par Jean Grémillon (avec Charles Vanel dans l’un des rôles principaux). Désireux de descendre dans l’arène pour y défendre ses idées catholiques, sociales et nationales, Pierre Daye découvre en 1935 le nouveau phénomène politique qu’est Léon Degrelle. Le 24 janvier, il le voit, pour la première fois, à Louvain où le jeune orateur l’impressionne beaucoup. « J’attendais depuis plusieurs années », racontera-t-il, « que se manifestât dans mon pays un effet de ce grand mouvement européen dont j’avais découvert en tant de nations les signes tangibles » (24). Séduit, l’écrivain n’est pas long à rejoindre les rangs de Rex où il siège d’emblée au Conseil politique (mais pas au Bureau exécutif). Aux élections du 24 mai 1936, le mouvement, qui a le vent en poupe, obtient du premier coup 33 élus (21 députés et 12 sénateurs). « Nous étions partis, nous pouvons bien le dire », se souvient-il, « sans aucun moyen ; nous n’avions pas d’argent, aucune expérience, très peu d’hommes, pas de journaux. Mais nous avions la foi. Et la jeunesse aussi… » (25). Et le 27 mai, dans les colonnes du Pays réel, le nouveau député bruxellois se montre plus laudatif encore, affirmant entre autres que « Léon Degrelle est devenu l’interprète de tout ce qui, dans la nation, est jeune, vivant, audacieux, tourné vers l’avenir » (26). L’Assemblée que découvre Pierre Daye n’a rien de bien attrayant : selon lui, « les trucs, les combinaisons, l’intérêt personnel, la stérilité, la suffisance, la vulgarité, tels étaient quelques-uns des traits que révélait l’examen de l’institution parlementaire » (27). Il semble néanmoins tout à fait décidé à jouer le jeu et à faire sérieusement son travail de député. Placé à la tête du groupe parlementaire, il s’efforce donc, en premier lieu, de discipliner ses collègues rexistes qui font souvent preuve d’une nonchalance et d’un amateurisme consternants. Auteur d’un projet de loi réduisant la durée du service militaire, il s’exprime aussi au sein de la Commission des Colonies et de celle des Affaires Étrangères où il plaide fougueusement pour l’Espagne nationaliste. Assez proche du chef, il est souvent associé aux grandes manœuvres de ce dernier. En septembre 1936, par exemple, il est aux côtés de Degrelle lorsque celui-ci est reçu par Hitler (invité par Rudolf Hess, il profite du déplacement pour assister au 8e congrès de Nuremberg). C’est par ailleurs autour de la table de Pierre Daye que se nouent certains contacts discrets entre des gens comme Gustave Sap (28), Hendrik Borginon (29), Gérard Romsée (30), Joris van Severen (31), Charles-Albert d’Aspremont-Lynden (32), et Léon Degrelle. Plus tard, et au grand dam du Quai d’Orsay, il demandera la dénonciation de l’accord militaire franco-belge, ainsi que des accords de Locarno (33).
Désireux de descendre dans l’arène pour y défendre ses idées catholiques, sociales et nationales, Pierre Daye découvre en 1935 le nouveau phénomène politique qu’est Léon Degrelle. Le 24 janvier, il le voit, pour la première fois, à Louvain où le jeune orateur l’impressionne beaucoup. « J’attendais depuis plusieurs années », racontera-t-il, « que se manifestât dans mon pays un effet de ce grand mouvement européen dont j’avais découvert en tant de nations les signes tangibles » (24). Séduit, l’écrivain n’est pas long à rejoindre les rangs de Rex où il siège d’emblée au Conseil politique (mais pas au Bureau exécutif). Aux élections du 24 mai 1936, le mouvement, qui a le vent en poupe, obtient du premier coup 33 élus (21 députés et 12 sénateurs). « Nous étions partis, nous pouvons bien le dire », se souvient-il, « sans aucun moyen ; nous n’avions pas d’argent, aucune expérience, très peu d’hommes, pas de journaux. Mais nous avions la foi. Et la jeunesse aussi… » (25). Et le 27 mai, dans les colonnes du Pays réel, le nouveau député bruxellois se montre plus laudatif encore, affirmant entre autres que « Léon Degrelle est devenu l’interprète de tout ce qui, dans la nation, est jeune, vivant, audacieux, tourné vers l’avenir » (26). L’Assemblée que découvre Pierre Daye n’a rien de bien attrayant : selon lui, « les trucs, les combinaisons, l’intérêt personnel, la stérilité, la suffisance, la vulgarité, tels étaient quelques-uns des traits que révélait l’examen de l’institution parlementaire » (27). Il semble néanmoins tout à fait décidé à jouer le jeu et à faire sérieusement son travail de député. Placé à la tête du groupe parlementaire, il s’efforce donc, en premier lieu, de discipliner ses collègues rexistes qui font souvent preuve d’une nonchalance et d’un amateurisme consternants. Auteur d’un projet de loi réduisant la durée du service militaire, il s’exprime aussi au sein de la Commission des Colonies et de celle des Affaires Étrangères où il plaide fougueusement pour l’Espagne nationaliste. Assez proche du chef, il est souvent associé aux grandes manœuvres de ce dernier. En septembre 1936, par exemple, il est aux côtés de Degrelle lorsque celui-ci est reçu par Hitler (invité par Rudolf Hess, il profite du déplacement pour assister au 8e congrès de Nuremberg). C’est par ailleurs autour de la table de Pierre Daye que se nouent certains contacts discrets entre des gens comme Gustave Sap (28), Hendrik Borginon (29), Gérard Romsée (30), Joris van Severen (31), Charles-Albert d’Aspremont-Lynden (32), et Léon Degrelle. Plus tard, et au grand dam du Quai d’Orsay, il demandera la dénonciation de l’accord militaire franco-belge, ainsi que des accords de Locarno (33).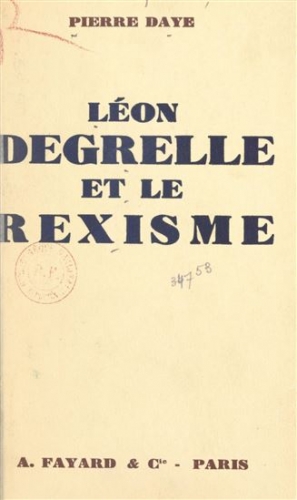 Dévoué mais exigeant, Pierre Daye va vite se lasser des carences profondes du groupe parlementaire rexiste dont il abandonne d’ailleurs la présidence dès juin 1937. Cela ne l’empêche cependant pas de continuer son travail à la Chambre. Dans le même temps, il poursuit son activité de chroniqueur et d’essayiste. En octobre 1936, il joue un rôle clef dans la parution d’un numéro spécial de Je suis partout entièrement consacré à Rex, avec une « Lettre aux Français » de Léon Degrelle et des articles de Serge Doring, Carlos Leruitte et Lucien Rebatet [La même année, Robert Brasillach fait paraître Léon Degrelle et l’avenir de Rex (Plon) et l’année suivante (3 novembre 1937), il dédiera toute une page de Je suis partout au mouvement belge]. Régulièrement présent dans les colonnes de l’hebdomadaire parisien, Pierre Daye signe également, en 1937, un livre sur Léon Degrelle et le rexisme (Fayard), suivi en 1938 d’une Petite histoire parlementaire belge. Malgré cet engagement sans faille, les erreurs répétées de Rex et de son chef finissent toutefois par user sa patience. Ce désenchantement le conduit même, en 1939, à refuser de se représenter aux élections et à quitter le mouvement. Le 10 mars, il prend donc définitivement congé du groupe parlementaire et se tourne dès lors vers le parti catholique où il a conservé nombre d’amis. Il s’en va, certes, mais demeure en excellents termes avec Degrelle, ce que la suite des événements ne va pas tarder à démontrer.
Dévoué mais exigeant, Pierre Daye va vite se lasser des carences profondes du groupe parlementaire rexiste dont il abandonne d’ailleurs la présidence dès juin 1937. Cela ne l’empêche cependant pas de continuer son travail à la Chambre. Dans le même temps, il poursuit son activité de chroniqueur et d’essayiste. En octobre 1936, il joue un rôle clef dans la parution d’un numéro spécial de Je suis partout entièrement consacré à Rex, avec une « Lettre aux Français » de Léon Degrelle et des articles de Serge Doring, Carlos Leruitte et Lucien Rebatet [La même année, Robert Brasillach fait paraître Léon Degrelle et l’avenir de Rex (Plon) et l’année suivante (3 novembre 1937), il dédiera toute une page de Je suis partout au mouvement belge]. Régulièrement présent dans les colonnes de l’hebdomadaire parisien, Pierre Daye signe également, en 1937, un livre sur Léon Degrelle et le rexisme (Fayard), suivi en 1938 d’une Petite histoire parlementaire belge. Malgré cet engagement sans faille, les erreurs répétées de Rex et de son chef finissent toutefois par user sa patience. Ce désenchantement le conduit même, en 1939, à refuser de se représenter aux élections et à quitter le mouvement. Le 10 mars, il prend donc définitivement congé du groupe parlementaire et se tourne dès lors vers le parti catholique où il a conservé nombre d’amis. Il s’en va, certes, mais demeure en excellents termes avec Degrelle, ce que la suite des événements ne va pas tarder à démontrer.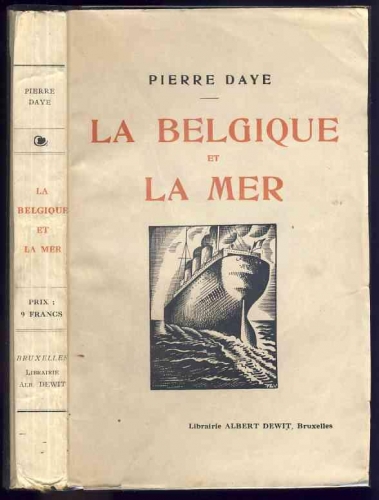 Daye va donc séjourner plusieurs semaines à Saint-Clément-des-Baleines. Loin des combats, il fait de la bicyclette, se balade avec Henri Béraud et aperçoit de temps en temps Suzy Solidor ou le peintre Paul Colin. Cette paisible villégiature s’achève toutefois vers la fin juin car avec l’armistice, le journaliste souhaite désormais rentrer chez lui. Le 8 juillet 1940, il remonte donc sur Paris, s’y arrête le temps de voir Jean Chiappe, puis regagne Bruxelles. Informé du massacre d’Abbeville (36) et du décès de Léon Degrelle, le journaliste ne tarde pas à réapparaître à Paris où l’ambassadeur Abetz, une vieille connaissance, lui apprend incidemment que Degrelle n’est absolument pas mort, mais probablement interné dans un camp du sud de la France. En dépit des divergences politiques qui ont pu opposer les deux hommes, Daye estime alors de son devoir de se porter au secours du chef de Rex et part aussitôt à sa recherche. Accompagné de Jacques Crokaert et Carl Doutreligne, il file à Vichy, rencontre Adrien Marquet mais aussi plusieurs ministres belges en déréliction… L’administration française n’ayant pas mis longtemps à localiser Degrelle qui se trouve dans l’Ariège, au camp du Vernet, le trio de sauveteurs (« mes trois mousquetaires » dira Degrelle dans La cohue de 40) s’empresse de reprendre la route. Quelques heures plus tard, ils sont à Carcassonne où ils retrouvent enfin Léon Degrelle, « sale, amaigri, méconnaissable » (37), ainsi que l’ex-député rexiste Gustave Wyns.
Daye va donc séjourner plusieurs semaines à Saint-Clément-des-Baleines. Loin des combats, il fait de la bicyclette, se balade avec Henri Béraud et aperçoit de temps en temps Suzy Solidor ou le peintre Paul Colin. Cette paisible villégiature s’achève toutefois vers la fin juin car avec l’armistice, le journaliste souhaite désormais rentrer chez lui. Le 8 juillet 1940, il remonte donc sur Paris, s’y arrête le temps de voir Jean Chiappe, puis regagne Bruxelles. Informé du massacre d’Abbeville (36) et du décès de Léon Degrelle, le journaliste ne tarde pas à réapparaître à Paris où l’ambassadeur Abetz, une vieille connaissance, lui apprend incidemment que Degrelle n’est absolument pas mort, mais probablement interné dans un camp du sud de la France. En dépit des divergences politiques qui ont pu opposer les deux hommes, Daye estime alors de son devoir de se porter au secours du chef de Rex et part aussitôt à sa recherche. Accompagné de Jacques Crokaert et Carl Doutreligne, il file à Vichy, rencontre Adrien Marquet mais aussi plusieurs ministres belges en déréliction… L’administration française n’ayant pas mis longtemps à localiser Degrelle qui se trouve dans l’Ariège, au camp du Vernet, le trio de sauveteurs (« mes trois mousquetaires » dira Degrelle dans La cohue de 40) s’empresse de reprendre la route. Quelques heures plus tard, ils sont à Carcassonne où ils retrouvent enfin Léon Degrelle, « sale, amaigri, méconnaissable » (37), ainsi que l’ex-député rexiste Gustave Wyns.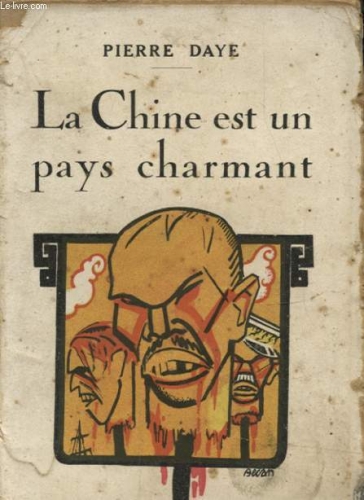 Loin d’être le pestiféré qu’il deviendra bientôt, Pierre Daye conserve en cette époque troublée de nombreuses relations mondaines : il organise, chez lui, une rencontre entre le comte Capelle et le chef de Rex, dîne avec les frères Heymans (dont l’un, Corneille, est prix Nobel) et séjourne au Zoute, chez le banquier Wauters. Invité chez le vicomte Jacques Duvignon, ancien ambassadeur à Berlin, il revoit également Mme Destrée et Robert Poulet, tandis que lors d’un enième séjour à Paris, il croise Alphonse de Chateaubriant (qui l’accueille dans les locaux de La Gerbe), Bernard Grasset, l’historien Pierre Bessand-Massenet et Stanislas de la Rochefoucauld. Si, en dépit des circonstances, Pierre Daye est quelqu’un qui demeure attaché aux petits plaisirs de la vie et aux relations sociales, il serait erroné de ne voir en lui qu’un second couteau falot et superficiel. En fait, il sert de passerelle entre beaucoup d’acteurs importants du jeu politico-diplomatique et maintient notamment d’étroits contacts avec les proches du roi. En relation avec les secrétaires du souverain, il voit aussi, très régulièrement, les anciens ministres Maurice Lippens et Henri De Man, ainsi que le général Van Overstræten, aide-de-camp de Léopold III. Pour le palais royal, Daye est donc une précieuse source de renseignements : « Je servis bien souvent d’informateur au souverain », écrit-il, « et le bloc-notes en main, le comte Capelle prenait des indications ‘pour sa Majesté’ durant la plupart de nos entretiens » (39). Il facilite par ailleurs certains contacts improbables comme cette entrevue, chez lui, le 22 mai 1943, entre Capelle et l’abbé Louis Fierens, l’aumônier (non rexiste) de la Légion Wallonie… Aucun reproche, explicite ou implicite, ne lui ayant jamais été exprimé, le journaliste s’étonnera plus tard des accusations de félonie formulées à son encontre : « Pouvais-je n’être pas convaincu », demande-t-il dans ses mémoires, « après tous mes rapports plus ou moins directs avec lui (le roi), par l’intermédiaire de son entourage, que ma conduite était approuvée ? Ou que tout au moins, elle n’était pas blamée ? » (40). Et pour être encore plus clair, il ajoute : « Si des ‘collaborationnistes’ sincères se trompaient, Léopold III aurait dû les avertir, ou les faire avertir, même au risque de déplaire aux Allemands » (41).
Loin d’être le pestiféré qu’il deviendra bientôt, Pierre Daye conserve en cette époque troublée de nombreuses relations mondaines : il organise, chez lui, une rencontre entre le comte Capelle et le chef de Rex, dîne avec les frères Heymans (dont l’un, Corneille, est prix Nobel) et séjourne au Zoute, chez le banquier Wauters. Invité chez le vicomte Jacques Duvignon, ancien ambassadeur à Berlin, il revoit également Mme Destrée et Robert Poulet, tandis que lors d’un enième séjour à Paris, il croise Alphonse de Chateaubriant (qui l’accueille dans les locaux de La Gerbe), Bernard Grasset, l’historien Pierre Bessand-Massenet et Stanislas de la Rochefoucauld. Si, en dépit des circonstances, Pierre Daye est quelqu’un qui demeure attaché aux petits plaisirs de la vie et aux relations sociales, il serait erroné de ne voir en lui qu’un second couteau falot et superficiel. En fait, il sert de passerelle entre beaucoup d’acteurs importants du jeu politico-diplomatique et maintient notamment d’étroits contacts avec les proches du roi. En relation avec les secrétaires du souverain, il voit aussi, très régulièrement, les anciens ministres Maurice Lippens et Henri De Man, ainsi que le général Van Overstræten, aide-de-camp de Léopold III. Pour le palais royal, Daye est donc une précieuse source de renseignements : « Je servis bien souvent d’informateur au souverain », écrit-il, « et le bloc-notes en main, le comte Capelle prenait des indications ‘pour sa Majesté’ durant la plupart de nos entretiens » (39). Il facilite par ailleurs certains contacts improbables comme cette entrevue, chez lui, le 22 mai 1943, entre Capelle et l’abbé Louis Fierens, l’aumônier (non rexiste) de la Légion Wallonie… Aucun reproche, explicite ou implicite, ne lui ayant jamais été exprimé, le journaliste s’étonnera plus tard des accusations de félonie formulées à son encontre : « Pouvais-je n’être pas convaincu », demande-t-il dans ses mémoires, « après tous mes rapports plus ou moins directs avec lui (le roi), par l’intermédiaire de son entourage, que ma conduite était approuvée ? Ou que tout au moins, elle n’était pas blamée ? » (40). Et pour être encore plus clair, il ajoute : « Si des ‘collaborationnistes’ sincères se trompaient, Léopold III aurait dû les avertir, ou les faire avertir, même au risque de déplaire aux Allemands » (41). Chargé de la rubrique de politique étrangère, Pierre Daye en sera l’un des principaux chroniqueurs jusqu’en avril 1943. Le Nouveau Journal n’est pas le seul organe de presse à accueillir sa prose puisque l’on trouve également sa signature dans Junges Europa, Das Neue Europa, Europäische Revue, Signal, Actu, le Petit Parisien, Je suis partout, et qu’il s’exprime de temps à autres au micro de Radio-Bruxelles. Quoique très dense, cette activité journalistique ne l’empêche pas de publier aussi quelques nouveaux livres. En 1941, il fait ainsi paraître un essai politique, Guerre et révolution, lettre d’un Belge à un ami français, suivi d’un Rubens, puis de Par le monde qui change, un ouvrage où il évoque quelques-uns des pays qu’il a visités, décerne au passage quelques compliments au Reich pour avoir encouragé la jeunesse et amélioré la race, et décrit Adolf Hitler comme « un homme simple, très différend des hobereaux allemands d’autrefois » (45). Si l’homme de lettres ne fait pas mystère de ses sympathies, il s’abstient toutefois de franchir certaines limites : il garde notamment ses distances avec la Légion Wallonie et fait même publiquement savoir qu’il n’est jamais intervenu en sa faveur auprès du palais royal. Il admire, dit-il, le courage des volontaires mais ne comprend pas vraiment leur démarche. Très attaché à l’unité et à l’intégrité de la Belgique comme à la personne du roi, il prend grand soin de ne jamais cautionner une autre ligne que celle-là. Hostile à la persécution des Juifs comme à tout démembrement du royaume, Pierre Daye considère globalement les affaires politiques d’un œil sévère : « Trop de gens aux dents longues, trop de bonshommes intéressés. Trop de tripotages. Trop de fortunes aussi gigantesques que rapides » (46). Désireux de voir la Belgique se réorganiser sur un schéma centralisateur, monarchique et corporatif, il regroupe autour de lui un « Bureau politique », auquel prennent part ses amis Gustave Wyns et Jacques Crokaert, puis s’associe, en mai 1941, à la tentative de créer un Parti des Provinces Romanes. Ce dernier doit soutenir l’Ordre Nouveau européen, protéger la race et favoriser la fondation d’un État autoritaire, corporatif et chrétien (47). Le projet fera long feu car le 5 août 1941, les autorités allemandes y opposent leur veto. Autre geste politique de Pierre Daye : le 1er février 1943, il adhère à la Société Européenne des Écrivains (48) et plus précisément à l’une de ses deux sections belges, la Communauté Culturelle Wallonne (49). Cet engagement sans détour ne fait cependant pas de lui un fanatique ou un ultra, et c’est assez souvent, il faut le dire, qu’il intervient en faveur de certains Israélites ou de résistants (dont le communiste Albert Marteaux et le socialiste Victor Larock).
Chargé de la rubrique de politique étrangère, Pierre Daye en sera l’un des principaux chroniqueurs jusqu’en avril 1943. Le Nouveau Journal n’est pas le seul organe de presse à accueillir sa prose puisque l’on trouve également sa signature dans Junges Europa, Das Neue Europa, Europäische Revue, Signal, Actu, le Petit Parisien, Je suis partout, et qu’il s’exprime de temps à autres au micro de Radio-Bruxelles. Quoique très dense, cette activité journalistique ne l’empêche pas de publier aussi quelques nouveaux livres. En 1941, il fait ainsi paraître un essai politique, Guerre et révolution, lettre d’un Belge à un ami français, suivi d’un Rubens, puis de Par le monde qui change, un ouvrage où il évoque quelques-uns des pays qu’il a visités, décerne au passage quelques compliments au Reich pour avoir encouragé la jeunesse et amélioré la race, et décrit Adolf Hitler comme « un homme simple, très différend des hobereaux allemands d’autrefois » (45). Si l’homme de lettres ne fait pas mystère de ses sympathies, il s’abstient toutefois de franchir certaines limites : il garde notamment ses distances avec la Légion Wallonie et fait même publiquement savoir qu’il n’est jamais intervenu en sa faveur auprès du palais royal. Il admire, dit-il, le courage des volontaires mais ne comprend pas vraiment leur démarche. Très attaché à l’unité et à l’intégrité de la Belgique comme à la personne du roi, il prend grand soin de ne jamais cautionner une autre ligne que celle-là. Hostile à la persécution des Juifs comme à tout démembrement du royaume, Pierre Daye considère globalement les affaires politiques d’un œil sévère : « Trop de gens aux dents longues, trop de bonshommes intéressés. Trop de tripotages. Trop de fortunes aussi gigantesques que rapides » (46). Désireux de voir la Belgique se réorganiser sur un schéma centralisateur, monarchique et corporatif, il regroupe autour de lui un « Bureau politique », auquel prennent part ses amis Gustave Wyns et Jacques Crokaert, puis s’associe, en mai 1941, à la tentative de créer un Parti des Provinces Romanes. Ce dernier doit soutenir l’Ordre Nouveau européen, protéger la race et favoriser la fondation d’un État autoritaire, corporatif et chrétien (47). Le projet fera long feu car le 5 août 1941, les autorités allemandes y opposent leur veto. Autre geste politique de Pierre Daye : le 1er février 1943, il adhère à la Société Européenne des Écrivains (48) et plus précisément à l’une de ses deux sections belges, la Communauté Culturelle Wallonne (49). Cet engagement sans détour ne fait cependant pas de lui un fanatique ou un ultra, et c’est assez souvent, il faut le dire, qu’il intervient en faveur de certains Israélites ou de résistants (dont le communiste Albert Marteaux et le socialiste Victor Larock).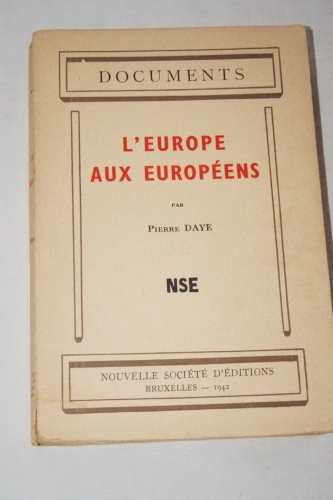 La guerre n’a pas émoussé le goût pour les voyages de Pierre Daye qui continue, dans la mesure où les événements le permettent, à se déplacer en Europe. Début 1942, il est par exemple au Portugal, puis en août en Hongrie, et séjourne, en fin d’année, à Rome. Dans la ville éternelle, il renoue avec de vieux amis, comme la duchesse de Villarosa ou le sénateur Aldobrandini Rangoni, tous très anglophiles, et s’entretient, le 10 janvier 1943, avec le prince Umberto. Quatre jours auparavant, il a pu être reçu par le Souverain Pontife, ce qui revêt pour lui une importance toute particulière. Grâce à un proche du Pape, le père jésuite Tacchi-Venturi, il a en effet obtenu de voir brièvement Sa Sainteté Pie XII qui l’a interrogé sur la situation belge et lui a donné sa bénédiction. « Ce qui m’avait le plus ému durant cette entrevue », rapporte-t-il, « c’est la grande allure du Saint-Père, son air de seigneur, la beauté de son visage ascétique et blême, avec ses yeux d’un noir brillant, sa longue bouche volontaire, son nez en bec d’aigle, la noblesse de ses gestes » (50). Peu de temps après cette promenade italienne, en février-mars 1943, Pierre Daye se rend à Madrid. N’étant inféodé à aucune faction politique, il profite de ce passage dans un pays non-belligérant pour adresser, de son propre chef, un courrier à Paul van Zeeland : « Il faut souhaiter », lui écrit-il, « que des éléments provenant des deux clans entre lesquels se divise aujourd’hui la Belgique, celui des “gens de Londres“ et celui de ceux que vous appelez, je crois, les “collaborationnistes“ (je suis pour ma part convaincu que tous deux comptent des patriotes sincères) puissent bientôt, à l’issue des hostilités, se comprendre et collaborer, autour du Roi, dans l’intérêt même de notre pays » (51). Par le biais de l’armateur Pierre Grisar, il envoie une missive du même genre à Hubert Pierlot, le chef du gouvernement belge en exil. Faut-il préciser qu’il n’obtiendra aucune réponse…
La guerre n’a pas émoussé le goût pour les voyages de Pierre Daye qui continue, dans la mesure où les événements le permettent, à se déplacer en Europe. Début 1942, il est par exemple au Portugal, puis en août en Hongrie, et séjourne, en fin d’année, à Rome. Dans la ville éternelle, il renoue avec de vieux amis, comme la duchesse de Villarosa ou le sénateur Aldobrandini Rangoni, tous très anglophiles, et s’entretient, le 10 janvier 1943, avec le prince Umberto. Quatre jours auparavant, il a pu être reçu par le Souverain Pontife, ce qui revêt pour lui une importance toute particulière. Grâce à un proche du Pape, le père jésuite Tacchi-Venturi, il a en effet obtenu de voir brièvement Sa Sainteté Pie XII qui l’a interrogé sur la situation belge et lui a donné sa bénédiction. « Ce qui m’avait le plus ému durant cette entrevue », rapporte-t-il, « c’est la grande allure du Saint-Père, son air de seigneur, la beauté de son visage ascétique et blême, avec ses yeux d’un noir brillant, sa longue bouche volontaire, son nez en bec d’aigle, la noblesse de ses gestes » (50). Peu de temps après cette promenade italienne, en février-mars 1943, Pierre Daye se rend à Madrid. N’étant inféodé à aucune faction politique, il profite de ce passage dans un pays non-belligérant pour adresser, de son propre chef, un courrier à Paul van Zeeland : « Il faut souhaiter », lui écrit-il, « que des éléments provenant des deux clans entre lesquels se divise aujourd’hui la Belgique, celui des “gens de Londres“ et celui de ceux que vous appelez, je crois, les “collaborationnistes“ (je suis pour ma part convaincu que tous deux comptent des patriotes sincères) puissent bientôt, à l’issue des hostilités, se comprendre et collaborer, autour du Roi, dans l’intérêt même de notre pays » (51). Par le biais de l’armateur Pierre Grisar, il envoie une missive du même genre à Hubert Pierlot, le chef du gouvernement belge en exil. Faut-il préciser qu’il n’obtiendra aucune réponse…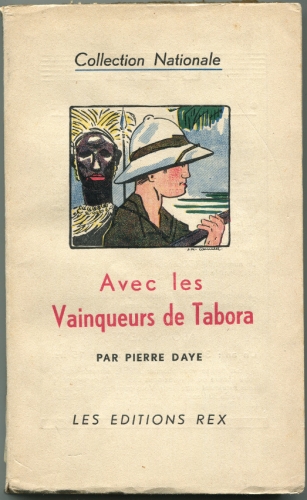 Présent dans les gazettes, Pierre Daye l’est tout autant aux devantures des librairies : en 1942, il fait paraître deux essais politiques (L ‘Europe aux Européens et Trente-deux mois chez les députés), puis en 1943, un texte sur l’Afrique (Problèmes congolais), et en 1944, un recueil de contes (D’ombre et de lumière). À compter de 1943, son engagement se concrétise aussi par son accession à un poste officiel dans l’administration belge. Sur recommandation du Flamand Gérard Romsée, il est en effet nommé, le 25 juin 1943, au poste un peu inattendu de … commissaire général à l’Éducation Physique et aux Sports. En soi, il s’agit d’une fonction peu compromettante et qui fournit à son titulaire d’excellentes justifications pour voyager. Reste qu’elle fait de Pierre Daye un fonctionnaire officiel de la collaboration, ce qui peut se révéler extrêmement dangereux. De fait, loin d’aller vers l’apaisement qu’il souhaitait, la situation se dégrade et les rivalités belges se muent désormais en sanglants règlements de compte. « Les hitlériens de nationalité belge [sont] plus abjects encore que leurs maîtres allemands », proclame un journal clandestin communiste. « Cette vermine immonde doit être écrasée (…) Les Partisans belges se sont juré de liquider ces bêtes puantes » (53) L’année 1942 est ponctuée d’au moins 67 attentats et l’année 1943 connaît une recrudescence vertigineuse des actes violents, au point que le chef de l’administration allemande, Eggert Reeder, parle carrément d’une vague de meurtres ou Mordwelle. « Dans la rue et les campagnes, surtout à partir de 1943 », écrit une historienne belge, « règne une atmosphère de guerre civile : rexistes et nationalistes flamands, ainsi que les membres de leurs familles, sont abattus, sans autre forme de procès, sans distinction d’âge ou de sexe » (54).
Présent dans les gazettes, Pierre Daye l’est tout autant aux devantures des librairies : en 1942, il fait paraître deux essais politiques (L ‘Europe aux Européens et Trente-deux mois chez les députés), puis en 1943, un texte sur l’Afrique (Problèmes congolais), et en 1944, un recueil de contes (D’ombre et de lumière). À compter de 1943, son engagement se concrétise aussi par son accession à un poste officiel dans l’administration belge. Sur recommandation du Flamand Gérard Romsée, il est en effet nommé, le 25 juin 1943, au poste un peu inattendu de … commissaire général à l’Éducation Physique et aux Sports. En soi, il s’agit d’une fonction peu compromettante et qui fournit à son titulaire d’excellentes justifications pour voyager. Reste qu’elle fait de Pierre Daye un fonctionnaire officiel de la collaboration, ce qui peut se révéler extrêmement dangereux. De fait, loin d’aller vers l’apaisement qu’il souhaitait, la situation se dégrade et les rivalités belges se muent désormais en sanglants règlements de compte. « Les hitlériens de nationalité belge [sont] plus abjects encore que leurs maîtres allemands », proclame un journal clandestin communiste. « Cette vermine immonde doit être écrasée (…) Les Partisans belges se sont juré de liquider ces bêtes puantes » (53) L’année 1942 est ponctuée d’au moins 67 attentats et l’année 1943 connaît une recrudescence vertigineuse des actes violents, au point que le chef de l’administration allemande, Eggert Reeder, parle carrément d’une vague de meurtres ou Mordwelle. « Dans la rue et les campagnes, surtout à partir de 1943 », écrit une historienne belge, « règne une atmosphère de guerre civile : rexistes et nationalistes flamands, ainsi que les membres de leurs familles, sont abattus, sans autre forme de procès, sans distinction d’âge ou de sexe » (54).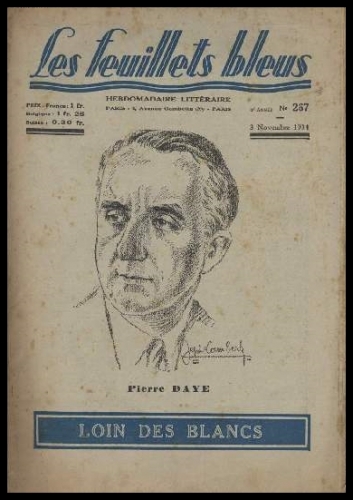 Profondément choqué par le déferlement de violence auquel il assiste, Pierre Daye en juge sévèrement les inspirateurs : « Il fallait », constate-t-il amèrement, « par la provocation, empoisonner une atmosphère trop paisible, donc trop favorable à l’occupant. Il fallait susciter des vengeances, allumer l’esprit de représailles » (58). Et confronté à cet engrenage fatal (59), il en décrit tristement le mécanisme : « De braves gens, mûs uniquement par le sentiment patriotique, ne se doutaient point du vrai rôle qu’on leur faisait ainsi jouer. Et des canailles trouvaient, en se glissant parmi eux, le moyen de commettre les plus bas crimes (…) Se sentant sans protection, d’autres braves gens, de l’autre idéologie, se dirent alors qu’il fallait se défendre soi-même ; non pas se venger, mais si l’on voulait vivre, répondre à la terreur par la terreur » (60).
Profondément choqué par le déferlement de violence auquel il assiste, Pierre Daye en juge sévèrement les inspirateurs : « Il fallait », constate-t-il amèrement, « par la provocation, empoisonner une atmosphère trop paisible, donc trop favorable à l’occupant. Il fallait susciter des vengeances, allumer l’esprit de représailles » (58). Et confronté à cet engrenage fatal (59), il en décrit tristement le mécanisme : « De braves gens, mûs uniquement par le sentiment patriotique, ne se doutaient point du vrai rôle qu’on leur faisait ainsi jouer. Et des canailles trouvaient, en se glissant parmi eux, le moyen de commettre les plus bas crimes (…) Se sentant sans protection, d’autres braves gens, de l’autre idéologie, se dirent alors qu’il fallait se défendre soi-même ; non pas se venger, mais si l’on voulait vivre, répondre à la terreur par la terreur » (60).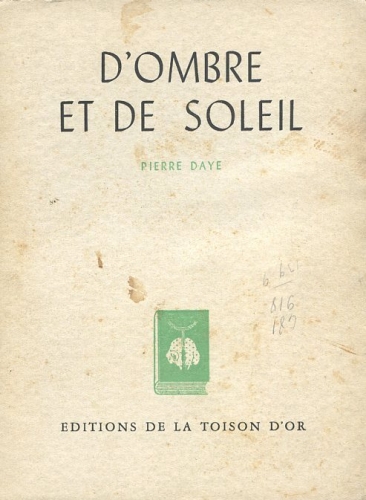 Les premiers temps d’exil ne sont pas trop durs car l’expatrié possède encore quelques relations : il est reçu chez le phalangiste Eugenio d’Ors (66) ou chez le général Eugenio Espinosa de los Monteros, ancien ambassadeur à Berlin, et dîne même parfois avec Walter Starkie (67), le directeur de l’Institut Britannique de Madrid. Plus tard, il verra de temps en temps François Piétri et l’académicien Abel Bonnard. Quelles que soient les difficultés qu’il rencontre et la peine qu’il éprouve, cet exil lui épargne à tout le moins un sort funeste. L’épuration belge se veut en effet particulièrement vindicative puisque, si l’on en croit Paul Sérant, un certain Marcel Houtman exige par exemple que soient exécutés tous les Belges ayant combattu sur le front de l’Est, tous les écrivains et journalistes de la collaboration et tous les fonctionnaires ayant servi les desseins de l’occupant ! (68) Les intellectuels ne peuvent donc guère espérer de mansuétude. Le poète René Baert a été sommairement abattu au coin d’un bois, quelque part en Allemagne, plusieurs journalistes sont condamnés à la peine capitale et fusillés (Paul Herten, José Sreel, Jules Lhoste, Victor Meulenyser, Charles Nisolles, Paul Lespagnard), d’autres échappent de très peu au poteau (Robert Poulet, Paul Jamin), et quelques-uns, comme Pierre Hubermont et Gabriel Figeys, écopent de lourdes peines de détention. Le peintre Marc Eemans est frappé d’une peine de huit ans de prison, tandis que le dramaturge Michel de Ghelderode se fait copieusement insulter et chasser de son emploi. Beaucoup ne retrouveront un peu de tranquillité qu’à l’étranger : Simenon, Hergé et Henri de Man en Suisse, Paul Werrie en Espagne puis en France, Raymond de Becker (condamné à mort puis à la détention perpétuelle), Claude Elsen (condamné à mort par contumace) et Louis Carette (condamné par contumace à 15 ans de travaux forcés) en France. Certains feront malgré tout, hors de Belgique, de brillantes carrières : émigré à Paris, Oscar Van Godtsenhoven, alias Jan Van Dorp, y remportera un prix (1948) pour son Flamand des vagues ; Louis Carette, alias Félicien Marceau, sera élu à l’Académie française (1975), tandis que Jean Libert et Gaston Vandenpanhuyse vendront des milliers de livres sous les noms d’emprunt de Paul Kenny et Jean-Gaston Vandel. « La répression contre les intellectuels », note Elsa Van Brusseghem-Loorne, « surtout en Wallonie (69), prendra (…) une tournure dramatique et particulièrement cruelle, comme si le pouvoir, détenu par des classes en déclin, voulait éliminer par tous les moyens ceux qui, par leurs efforts, étaient la preuve vivante de son infériorité culturelle » (70)…
Les premiers temps d’exil ne sont pas trop durs car l’expatrié possède encore quelques relations : il est reçu chez le phalangiste Eugenio d’Ors (66) ou chez le général Eugenio Espinosa de los Monteros, ancien ambassadeur à Berlin, et dîne même parfois avec Walter Starkie (67), le directeur de l’Institut Britannique de Madrid. Plus tard, il verra de temps en temps François Piétri et l’académicien Abel Bonnard. Quelles que soient les difficultés qu’il rencontre et la peine qu’il éprouve, cet exil lui épargne à tout le moins un sort funeste. L’épuration belge se veut en effet particulièrement vindicative puisque, si l’on en croit Paul Sérant, un certain Marcel Houtman exige par exemple que soient exécutés tous les Belges ayant combattu sur le front de l’Est, tous les écrivains et journalistes de la collaboration et tous les fonctionnaires ayant servi les desseins de l’occupant ! (68) Les intellectuels ne peuvent donc guère espérer de mansuétude. Le poète René Baert a été sommairement abattu au coin d’un bois, quelque part en Allemagne, plusieurs journalistes sont condamnés à la peine capitale et fusillés (Paul Herten, José Sreel, Jules Lhoste, Victor Meulenyser, Charles Nisolles, Paul Lespagnard), d’autres échappent de très peu au poteau (Robert Poulet, Paul Jamin), et quelques-uns, comme Pierre Hubermont et Gabriel Figeys, écopent de lourdes peines de détention. Le peintre Marc Eemans est frappé d’une peine de huit ans de prison, tandis que le dramaturge Michel de Ghelderode se fait copieusement insulter et chasser de son emploi. Beaucoup ne retrouveront un peu de tranquillité qu’à l’étranger : Simenon, Hergé et Henri de Man en Suisse, Paul Werrie en Espagne puis en France, Raymond de Becker (condamné à mort puis à la détention perpétuelle), Claude Elsen (condamné à mort par contumace) et Louis Carette (condamné par contumace à 15 ans de travaux forcés) en France. Certains feront malgré tout, hors de Belgique, de brillantes carrières : émigré à Paris, Oscar Van Godtsenhoven, alias Jan Van Dorp, y remportera un prix (1948) pour son Flamand des vagues ; Louis Carette, alias Félicien Marceau, sera élu à l’Académie française (1975), tandis que Jean Libert et Gaston Vandenpanhuyse vendront des milliers de livres sous les noms d’emprunt de Paul Kenny et Jean-Gaston Vandel. « La répression contre les intellectuels », note Elsa Van Brusseghem-Loorne, « surtout en Wallonie (69), prendra (…) une tournure dramatique et particulièrement cruelle, comme si le pouvoir, détenu par des classes en déclin, voulait éliminer par tous les moyens ceux qui, par leurs efforts, étaient la preuve vivante de son infériorité culturelle » (70)… Âgé de 55 ans et plutôt combatif, l’homme est cependant loin d’avoir dit son dernier mot. Le 29 juin 1948, il prend part, avec quelques autres expatriés (75), à la création de la Société Argentine pour l’Accueil des Européens ou Sociedad Argentina para la Recepción de Europeos (SARE). Jouissant de la discrète protection de l’anthropologue Santiago Peralta, patron des services d’immigration, et bénéficiant des encouragements du cardinal Santiago Luis Copello (1880-1967), cette société s’efforce d’aider les « maudits » qui continuent d’affluer sur les rives du Rio de la Plata. Pierre Daye reprend aussi son métier de journaliste et participe au lancement de plusieurs publications dont Hebdo (1947), Europe-Argentine (1948), Argentina 49, Paroles françaises et Nouvelles d’Argentine. Naturalisé argentin en 1949, il collabore également aux revues Criterio et Itinerarium, à El Economista, le journal que fonde l’ancien Premier ministre yougoslave Milan Stojadinović (1888-1961), ainsi qu’à Dinámica Social, le mensuel que lance, en 1952, l’ancien hiérarque fasciste Carló Scorza (alias Camillo Sirtori)-(76). Organe officiel du Centre d’Études Économiques et Sociales, cette revue regroupe de nombreuses plumes de talent dont celles du philosophe roumain Georges Uscatescu, d’Ante Pavelić (alias A. S. Mrzlodolski), du père Juan Ramon Sepich, de Julio Irazusta, ou encore de Jean Pleyber, André Thérive, Jacques de Mahieu et Jacques Ploncard (alias Jacques de Sainte-Marie). Pierre Daye ne délaisse pas non plus le terrain politique où il parvient, avec son entregent habituel, à rester en bons termes à la fois avec les traditionalistes catholiques et les péronistes. Durant l’été 1949, il a quelques contacts avec le Centre des Forces Nationalistes, mais s’intéresse aussi à la Troisième Position de Juan Perón. Avec Radu Ghenea, Georges Guilbaud, René Lagrou (77) et Victor de la Serna, il signe d’ailleurs à ce sujet une note qui sera remise au chef de l’État. En septembre 1950, l’écrivain a le plaisir de renouer avec le ministre belge Marcel Henri Jaspar (1901-1982) qui est de passage dans le cône sud. Autre contact important, Sir Oswald Mosley, qu’il rencontre en novembre 1950, lors de la visite que l’ancien chef de la British Union of Fascists fait en Argentine (78). Venu s’entretenir avec Hans Ulrich Rudel, l’Anglais sera reçu par Juan Perón. Installé à Buenos Aires, dans le quartier de Palermo, et nommé professeur à l’Université de La Plata (sur recommandation de son ami le ministre des Affaires Étrangères Hipólito Jesús Paz), Pierre Daye entretient d’autre part une abondante correspondance.
Âgé de 55 ans et plutôt combatif, l’homme est cependant loin d’avoir dit son dernier mot. Le 29 juin 1948, il prend part, avec quelques autres expatriés (75), à la création de la Société Argentine pour l’Accueil des Européens ou Sociedad Argentina para la Recepción de Europeos (SARE). Jouissant de la discrète protection de l’anthropologue Santiago Peralta, patron des services d’immigration, et bénéficiant des encouragements du cardinal Santiago Luis Copello (1880-1967), cette société s’efforce d’aider les « maudits » qui continuent d’affluer sur les rives du Rio de la Plata. Pierre Daye reprend aussi son métier de journaliste et participe au lancement de plusieurs publications dont Hebdo (1947), Europe-Argentine (1948), Argentina 49, Paroles françaises et Nouvelles d’Argentine. Naturalisé argentin en 1949, il collabore également aux revues Criterio et Itinerarium, à El Economista, le journal que fonde l’ancien Premier ministre yougoslave Milan Stojadinović (1888-1961), ainsi qu’à Dinámica Social, le mensuel que lance, en 1952, l’ancien hiérarque fasciste Carló Scorza (alias Camillo Sirtori)-(76). Organe officiel du Centre d’Études Économiques et Sociales, cette revue regroupe de nombreuses plumes de talent dont celles du philosophe roumain Georges Uscatescu, d’Ante Pavelić (alias A. S. Mrzlodolski), du père Juan Ramon Sepich, de Julio Irazusta, ou encore de Jean Pleyber, André Thérive, Jacques de Mahieu et Jacques Ploncard (alias Jacques de Sainte-Marie). Pierre Daye ne délaisse pas non plus le terrain politique où il parvient, avec son entregent habituel, à rester en bons termes à la fois avec les traditionalistes catholiques et les péronistes. Durant l’été 1949, il a quelques contacts avec le Centre des Forces Nationalistes, mais s’intéresse aussi à la Troisième Position de Juan Perón. Avec Radu Ghenea, Georges Guilbaud, René Lagrou (77) et Victor de la Serna, il signe d’ailleurs à ce sujet une note qui sera remise au chef de l’État. En septembre 1950, l’écrivain a le plaisir de renouer avec le ministre belge Marcel Henri Jaspar (1901-1982) qui est de passage dans le cône sud. Autre contact important, Sir Oswald Mosley, qu’il rencontre en novembre 1950, lors de la visite que l’ancien chef de la British Union of Fascists fait en Argentine (78). Venu s’entretenir avec Hans Ulrich Rudel, l’Anglais sera reçu par Juan Perón. Installé à Buenos Aires, dans le quartier de Palermo, et nommé professeur à l’Université de La Plata (sur recommandation de son ami le ministre des Affaires Étrangères Hipólito Jesús Paz), Pierre Daye entretient d’autre part une abondante correspondance. 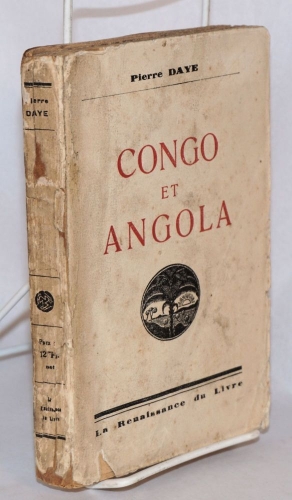 La chute de Juan Perón, en septembre 1955, n’entraîne pas d’inconvénients majeurs pour Pierre Daye qui n’est pas vraiment un acteur de la vie politique locale. Tenu pour proche du péronisme, il se retrouve néanmoins marginalisé et éloigné des nouveaux cercles dirigeants. Plus que le changement de régime, c’est plutôt l’isolement et l’oubli qui le menacent désormais. Le temps fait lentement son œuvre et la plupart des Belges l’ont d’ores et déjà oublié. Pas mal d’émigrés ont regagné l’Europe, on lui demande de moins en moins d’articles et la solitude le guette. C’est dans ce contexte un peu maussade que le 20 février 1960, à un peu moins de 68 ans, une hémorragie cérébrale vient brutalement mettre un terme à son existence. Cultivé, discret et fort modéré, on se demande encore ce que cet homme avait bien pu faire pour que la Belgique d’après-guerre lui témoigne d’une vindicte aussi tenace. Se pourrait-il tout simplement que l’on ait jugé, en haut lieu, qu’il en savait beaucoup trop long sur les arcanes (et les drôles de combines) de l’Occupation et qu’il fallait le discréditer à jamais ?
La chute de Juan Perón, en septembre 1955, n’entraîne pas d’inconvénients majeurs pour Pierre Daye qui n’est pas vraiment un acteur de la vie politique locale. Tenu pour proche du péronisme, il se retrouve néanmoins marginalisé et éloigné des nouveaux cercles dirigeants. Plus que le changement de régime, c’est plutôt l’isolement et l’oubli qui le menacent désormais. Le temps fait lentement son œuvre et la plupart des Belges l’ont d’ores et déjà oublié. Pas mal d’émigrés ont regagné l’Europe, on lui demande de moins en moins d’articles et la solitude le guette. C’est dans ce contexte un peu maussade que le 20 février 1960, à un peu moins de 68 ans, une hémorragie cérébrale vient brutalement mettre un terme à son existence. Cultivé, discret et fort modéré, on se demande encore ce que cet homme avait bien pu faire pour que la Belgique d’après-guerre lui témoigne d’une vindicte aussi tenace. Se pourrait-il tout simplement que l’on ait jugé, en haut lieu, qu’il en savait beaucoup trop long sur les arcanes (et les drôles de combines) de l’Occupation et qu’il fallait le discréditer à jamais ?
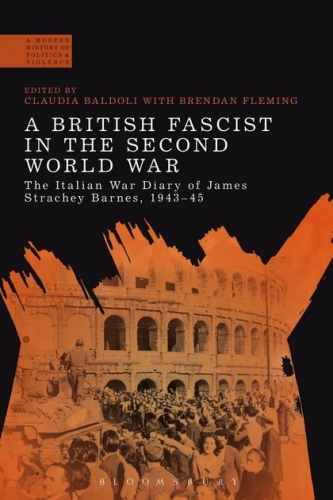 Le 27 septembre 1930, Jim Barnes, qui a tout de même quarante ans, épouse Buona Pia Felice Guidotti, la fille d’un général italien ; le couple (qui a reçu les félicitations de Mussolini et du Pape) aura un fils, Adriano, dit « Job », qui naît l’année suivante (27). Les activités du CINEF étant sur le déclin, Jim travaille désormais comme directeur des ventes chez Vickers Aviation, ce qui ne l’empêche aucunement de poursuivre son activité éditoriale. Toujours soucieux de mieux faire connaître au public anglophone la doctrine mussolinienne, il publie, en 1931, Fascism (Londres, Thornton Buttersworth Ltd), un petit livre qui connaîtra plusieurs rééditions. Fidèle à ses convictions spirituelles, c’est une interprétation très chrétienne du fascisme que Jim offre à ses lecteurs. Pour lui, le saint-patron du fascisme n’est autre que François d’Assise, et quant à son modèle absolu, c’est Ignace de Loyola : « Jamais peut-être n’a existé un homme associant aussi parfaitement, et en un seul individu, la pensée et l’action », affirme-t-il. « Il fut à la fois un philosophe, un soldat et un mystique. Il connaissait la valeur de la discipline et de l’autorité » (p. 76). Le fascisme, précise-t-il aussi, est « une force positive dont le but est de promouvoir la vertu » ; ce « n’est pas seulement un système politique ou social (…) mais une philosophie globale de la vie, une religion » (p. 18). Pour Jim, le fascisme « est une vigoureuse révolte contre le matérialisme, c’est à dire contre toutes les façons d’interpréter le monde d’un point de vue purement naturaliste et individualiste » (p. 43). Et « un gouvernement fondé sur le principe [autoritaire fasciste] », tranche-t-il, « serait en parfaite symbiose avec la tradition romaine » (p. 113). Le fascisme, c’est également un mouvement qui « fait tout ce qu’il peut pour éduquer les gens, pas seulement dans la perspective d’augmenter leurs connaissances, mais bien dans celle de forger les caractères, de promouvoir le jugement intuitif (jusqu’alors très négligé) et de développer le civisme et le sens moral » (p. 114). « Le fascisme », proclame-t-il enfin, « est décidé à faire des jeunes une génération d’individus qui croient à la Providence Divine, les hérauts d’un âge de foi ; à faire des jeunes une génération qui, grâce à sa foi, ne connaît pas la peur, va galvaniser l’esprit de sacrifice, affronter gaiement tous les dangers, soutenir la bonne cause, et subir le martyre avec le sourire » (p. 50). On voit que le disciple anglais du Duce ne manque pas de ferveur !
Le 27 septembre 1930, Jim Barnes, qui a tout de même quarante ans, épouse Buona Pia Felice Guidotti, la fille d’un général italien ; le couple (qui a reçu les félicitations de Mussolini et du Pape) aura un fils, Adriano, dit « Job », qui naît l’année suivante (27). Les activités du CINEF étant sur le déclin, Jim travaille désormais comme directeur des ventes chez Vickers Aviation, ce qui ne l’empêche aucunement de poursuivre son activité éditoriale. Toujours soucieux de mieux faire connaître au public anglophone la doctrine mussolinienne, il publie, en 1931, Fascism (Londres, Thornton Buttersworth Ltd), un petit livre qui connaîtra plusieurs rééditions. Fidèle à ses convictions spirituelles, c’est une interprétation très chrétienne du fascisme que Jim offre à ses lecteurs. Pour lui, le saint-patron du fascisme n’est autre que François d’Assise, et quant à son modèle absolu, c’est Ignace de Loyola : « Jamais peut-être n’a existé un homme associant aussi parfaitement, et en un seul individu, la pensée et l’action », affirme-t-il. « Il fut à la fois un philosophe, un soldat et un mystique. Il connaissait la valeur de la discipline et de l’autorité » (p. 76). Le fascisme, précise-t-il aussi, est « une force positive dont le but est de promouvoir la vertu » ; ce « n’est pas seulement un système politique ou social (…) mais une philosophie globale de la vie, une religion » (p. 18). Pour Jim, le fascisme « est une vigoureuse révolte contre le matérialisme, c’est à dire contre toutes les façons d’interpréter le monde d’un point de vue purement naturaliste et individualiste » (p. 43). Et « un gouvernement fondé sur le principe [autoritaire fasciste] », tranche-t-il, « serait en parfaite symbiose avec la tradition romaine » (p. 113). Le fascisme, c’est également un mouvement qui « fait tout ce qu’il peut pour éduquer les gens, pas seulement dans la perspective d’augmenter leurs connaissances, mais bien dans celle de forger les caractères, de promouvoir le jugement intuitif (jusqu’alors très négligé) et de développer le civisme et le sens moral » (p. 114). « Le fascisme », proclame-t-il enfin, « est décidé à faire des jeunes une génération d’individus qui croient à la Providence Divine, les hérauts d’un âge de foi ; à faire des jeunes une génération qui, grâce à sa foi, ne connaît pas la peur, va galvaniser l’esprit de sacrifice, affronter gaiement tous les dangers, soutenir la bonne cause, et subir le martyre avec le sourire » (p. 50). On voit que le disciple anglais du Duce ne manque pas de ferveur !
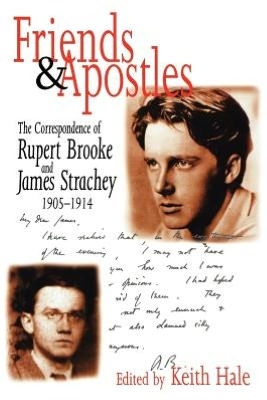 C’est donc au Tyrol du Sud qu’il apprend la mort du Duce (28 avril 1945), un drame qu’il n’hésite pas à qualifier de « plus grand crime depuis la crucifixion ». Activement recherché par les services secrets et la police militaire britanniques, Jim plonge dès lors dans la clandestinité la plus stricte. Son épouse demeure à Mérano, sans se cacher, mais lui-même disparaît totalement de la circulation. On le croit au Vatican, hébergé au Collège Pontifical Saint-Bede que l’on surveille en vain durant plusieurs mois. En fait, le fugitif est parti pour Bergame puis a trouvé refuge dans un couvent sicilien où il va séjourner jusqu’en août 1947. Pour quelqu’un d’aussi pieux que lui, cette réclusion monacale n’est pas un problème. À la fin de l’occupation britannique, il prolonge d’ailleurs sa retraite – on n’est jamais trop prudent – et continue à bénéficier de l’hospitalité de divers monastères, dans le Latium et le Piémont. Ce n’est qu’en septembre 1949 qu’il réapparaît au grand jour et retrouve les siens à Rome. Quatre ans ont passé, on est en pleine guerre froide et Londres ne s’intéresse plus du tout à lui. Barnes n’a renoncé à aucune de ses convictions mais la page du fascisme semble désormais tournée. Employé par une compagnie pétrolière, il garde le contact avec quelques vétérans de l’épopée mussolinienne mais n’a plus vraiment d’activité politique. Il correspond toutefois, de temps en temps, avec Ezra Pound et adresse même une lettre à Churchill pour lui demander d’intercéder en faveur du poète qui se morfond toujours à l’hôpital St Elizabeths, à Washington. En 1953 et avec dix ans de retard, Jim connaît enfin l’immense satisfaction d’être officiellement naturalisé italien. Il devient définitivement Giacomo Barnes, identité sous laquelle il succombe le 25 août 1955, et qui figure sur sa tombe au cimetière romain du Verano. « Aucun Italien digne de ce nom » affirmera l’historien et diplomate Luigi Villari (1876-1959), « n’oubliera jamais ce cher Jim, ses sacrifices pour la cause italienne, et les risques qu’il a courus pour la servir ».
C’est donc au Tyrol du Sud qu’il apprend la mort du Duce (28 avril 1945), un drame qu’il n’hésite pas à qualifier de « plus grand crime depuis la crucifixion ». Activement recherché par les services secrets et la police militaire britanniques, Jim plonge dès lors dans la clandestinité la plus stricte. Son épouse demeure à Mérano, sans se cacher, mais lui-même disparaît totalement de la circulation. On le croit au Vatican, hébergé au Collège Pontifical Saint-Bede que l’on surveille en vain durant plusieurs mois. En fait, le fugitif est parti pour Bergame puis a trouvé refuge dans un couvent sicilien où il va séjourner jusqu’en août 1947. Pour quelqu’un d’aussi pieux que lui, cette réclusion monacale n’est pas un problème. À la fin de l’occupation britannique, il prolonge d’ailleurs sa retraite – on n’est jamais trop prudent – et continue à bénéficier de l’hospitalité de divers monastères, dans le Latium et le Piémont. Ce n’est qu’en septembre 1949 qu’il réapparaît au grand jour et retrouve les siens à Rome. Quatre ans ont passé, on est en pleine guerre froide et Londres ne s’intéresse plus du tout à lui. Barnes n’a renoncé à aucune de ses convictions mais la page du fascisme semble désormais tournée. Employé par une compagnie pétrolière, il garde le contact avec quelques vétérans de l’épopée mussolinienne mais n’a plus vraiment d’activité politique. Il correspond toutefois, de temps en temps, avec Ezra Pound et adresse même une lettre à Churchill pour lui demander d’intercéder en faveur du poète qui se morfond toujours à l’hôpital St Elizabeths, à Washington. En 1953 et avec dix ans de retard, Jim connaît enfin l’immense satisfaction d’être officiellement naturalisé italien. Il devient définitivement Giacomo Barnes, identité sous laquelle il succombe le 25 août 1955, et qui figure sur sa tombe au cimetière romain du Verano. « Aucun Italien digne de ce nom » affirmera l’historien et diplomate Luigi Villari (1876-1959), « n’oubliera jamais ce cher Jim, ses sacrifices pour la cause italienne, et les risques qu’il a courus pour la servir ».
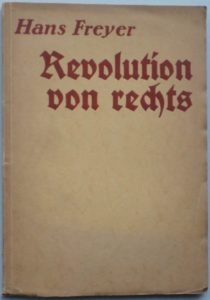 Der Sohn eines sächsischen Postdirektors erhielt seine Gymnasialausbildung am königlichen Elitegymnasium zu Dresden-Neustadt, studierte von 1907 bis 1911 in Leipzig Philosophie, Psychologie, Nationalökonomie und Geschichte, u.a. bei Wilhelm Wundt und Karl Lamprecht, in deren universalhistorischer Tradition er seine ersten Arbeiten zur Geschichtsauffassung der Aufklärung (Diss. 1911) und zur Bewertung der Wirtschaft in der deutschen Philosophie des 19. Jahrhunderts (Habilitation 1921) verfaßte. Nach zusätzlichen Studien in Berlin mit engen Kontakten zu Georg Simmel und Lehrtätigkeit an der Reformschule der Freien Schulgemeinde Wickersdorf kämpfte F. mit dem Militär-St.-Heinrichs-Orden ausgezeichnet im Ersten Weltkrieg. Als Mitglied des von Eugen Diederichs initiierten Serakreises der Jugendbewegungverfaßte F. an die Aufbruchsgeneration gerichtete philosophischen Schriften: Antäus (1918), Prometheus (1923), Pallas Athene (1935). Von 1922 bis 1925 lehrte er als Ordinarius hauptsächlich Kulturphilosophie an der Universität Kiel, erhielt 1925 den ersten deutschen Lehrstuhl für Soziologie ohne Beiordnung eines anderen Faches in Leipzig und widmete sich von nun an der logischen und historisch-philosophischen Grundlegung dieser neuen Disziplin. In Auseinandersetzung mit dem Positivismus seiner Lehrer und mit der Philosophie Hegels sollten typische gesellschaftliche Grundstrukturen herausgearbeitet und ihre historischen Entwicklungsgesetze gefunden werden. Darüber hinaus ist für F. die Soziologie als konkrete historische Erscheinung, erst durch die abendländische Aufklärung möglich geworden, Äußerung einer vorher nie dagewesenen gesellschaftlichen Emanzipation zur wissenschaftlichen Selbstreflexion, drückt deshalb als "Wirklichkeitswissenschaft" in der Erfassung des gegenwärtigen gesellschaftlichen Wandels auch den kollektiven Willen aus, ist also als Wissenschaft zugleich politische Ethik, die die Richtung des gesellschaftlichen Wandels zu bestimmen hat.
Der Sohn eines sächsischen Postdirektors erhielt seine Gymnasialausbildung am königlichen Elitegymnasium zu Dresden-Neustadt, studierte von 1907 bis 1911 in Leipzig Philosophie, Psychologie, Nationalökonomie und Geschichte, u.a. bei Wilhelm Wundt und Karl Lamprecht, in deren universalhistorischer Tradition er seine ersten Arbeiten zur Geschichtsauffassung der Aufklärung (Diss. 1911) und zur Bewertung der Wirtschaft in der deutschen Philosophie des 19. Jahrhunderts (Habilitation 1921) verfaßte. Nach zusätzlichen Studien in Berlin mit engen Kontakten zu Georg Simmel und Lehrtätigkeit an der Reformschule der Freien Schulgemeinde Wickersdorf kämpfte F. mit dem Militär-St.-Heinrichs-Orden ausgezeichnet im Ersten Weltkrieg. Als Mitglied des von Eugen Diederichs initiierten Serakreises der Jugendbewegungverfaßte F. an die Aufbruchsgeneration gerichtete philosophischen Schriften: Antäus (1918), Prometheus (1923), Pallas Athene (1935). Von 1922 bis 1925 lehrte er als Ordinarius hauptsächlich Kulturphilosophie an der Universität Kiel, erhielt 1925 den ersten deutschen Lehrstuhl für Soziologie ohne Beiordnung eines anderen Faches in Leipzig und widmete sich von nun an der logischen und historisch-philosophischen Grundlegung dieser neuen Disziplin. In Auseinandersetzung mit dem Positivismus seiner Lehrer und mit der Philosophie Hegels sollten typische gesellschaftliche Grundstrukturen herausgearbeitet und ihre historischen Entwicklungsgesetze gefunden werden. Darüber hinaus ist für F. die Soziologie als konkrete historische Erscheinung, erst durch die abendländische Aufklärung möglich geworden, Äußerung einer vorher nie dagewesenen gesellschaftlichen Emanzipation zur wissenschaftlichen Selbstreflexion, drückt deshalb als "Wirklichkeitswissenschaft" in der Erfassung des gegenwärtigen gesellschaftlichen Wandels auch den kollektiven Willen aus, ist also als Wissenschaft zugleich politische Ethik, die die Richtung des gesellschaftlichen Wandels zu bestimmen hat.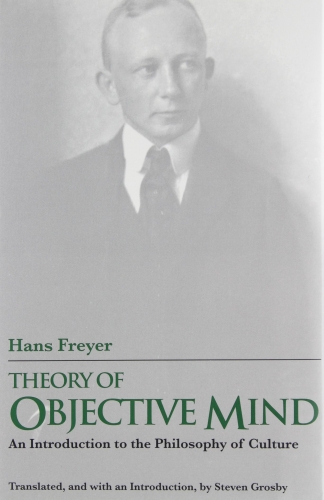 F. war ab 1933 Direktor des Instituts für Kultur- und Universalgeschichte an der Leipziger Universität. Als neu gewählter Präsident der Deutschen Gesellschaft für Soziologie legte er diese 1933 still, um eine politische "Gleichschaltung" zu verhindern. Den damaligen europäischen politischen Umbrüchen brachte F. als Theoretiker des Wandels zunächst offenes Interesse entgegen, fühlte sich der theoretischen Erfassung dieser Entwicklungen verpflichtet und war deshalb nie aktives Mitglied einer politischen Partei oder Bewegung; er wurde später der "konservativen Revolution" der zwanziger Jahre als "jungkonservativer Einzelgänger" (Mohler) zugeordnet. Die vor 1933 noch idealistisch formulierte Konzeption des Staates als höchste Form der Kultur (1925) hat F. im Lauf der bedrohlichen politischen Entwicklung revidiert in seinen Studien über Machiavelli (1936) und Friedrich den Großen (Preußentum und Aufklärung 1944) durch einen realistischen Staatsbegriff, der ausschließlich durch Gemeinwohl, langfristige gesellschaftliche Entwicklungsperspektiven und durch prozessuale Kriterien der Legitimität gerechtfertigt ist: durch den Dienst am Staat, der aber den Menschen keinesfalls total vereinnahmen darf, sowie die Prägekraft des Staates, der dem Kollektiv ein gemeinsames Ziel gibt, aber dennoch die Freiheit und Menschenwürde seiner Bürger bewahrt. Insbesondere gelang F. in der Darstellung der Legitimität als generellem Gesetz jeder Politik eine dialektische Verknüpfung des naturrechtlichen Herrschaftsgedankens mit der klassischen bürgerlich-humanitären Aufklärung: Nur die Herrschaft ist legitim, die dem Sinn ihres Ursprungs entspricht - es muß das erfüllt werden, was das Volk mit der Einsetzung der Herrschaft gewollt hat.
F. war ab 1933 Direktor des Instituts für Kultur- und Universalgeschichte an der Leipziger Universität. Als neu gewählter Präsident der Deutschen Gesellschaft für Soziologie legte er diese 1933 still, um eine politische "Gleichschaltung" zu verhindern. Den damaligen europäischen politischen Umbrüchen brachte F. als Theoretiker des Wandels zunächst offenes Interesse entgegen, fühlte sich der theoretischen Erfassung dieser Entwicklungen verpflichtet und war deshalb nie aktives Mitglied einer politischen Partei oder Bewegung; er wurde später der "konservativen Revolution" der zwanziger Jahre als "jungkonservativer Einzelgänger" (Mohler) zugeordnet. Die vor 1933 noch idealistisch formulierte Konzeption des Staates als höchste Form der Kultur (1925) hat F. im Lauf der bedrohlichen politischen Entwicklung revidiert in seinen Studien über Machiavelli (1936) und Friedrich den Großen (Preußentum und Aufklärung 1944) durch einen realistischen Staatsbegriff, der ausschließlich durch Gemeinwohl, langfristige gesellschaftliche Entwicklungsperspektiven und durch prozessuale Kriterien der Legitimität gerechtfertigt ist: durch den Dienst am Staat, der aber den Menschen keinesfalls total vereinnahmen darf, sowie die Prägekraft des Staates, der dem Kollektiv ein gemeinsames Ziel gibt, aber dennoch die Freiheit und Menschenwürde seiner Bürger bewahrt. Insbesondere gelang F. in der Darstellung der Legitimität als generellem Gesetz jeder Politik eine dialektische Verknüpfung des naturrechtlichen Herrschaftsgedankens mit der klassischen bürgerlich-humanitären Aufklärung: Nur die Herrschaft ist legitim, die dem Sinn ihres Ursprungs entspricht - es muß das erfüllt werden, was das Volk mit der Einsetzung der Herrschaft gewollt hat.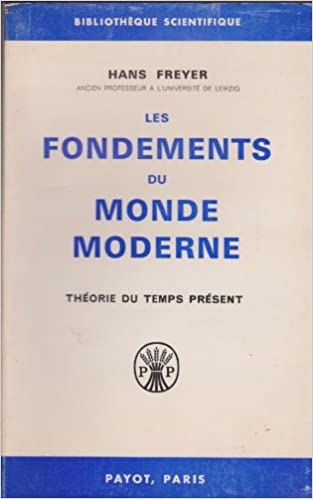 Zentraler Gesichtspunkt seiner Nachkriegsschriften war die gegenwärtige Epochenschwelle, der Übergang der modernen Industriegesellschaft zur weltweit ausgreifenden wissenschaftlich-technischen Rationalität, deren "sekundäre Systeme" alle naturhaft gewachsenen Lebensformen erfassen. F. weist nach, wie diese Fortschrittsordnung zum tragenden Kulturfaktor wird in allen Teilentwicklungen: der Technik, Siedlungsformen, Arbeit und Wertungen. Seine frühere integrative Perspektive einer Kultursynthese wird ersetzt durch den Konflikt von eigengesetzlichen, künstlichen Sachwelten einerseits und den "haltenden Mächte" des sozialen Lebens andererseits, die im "Katarakt des Fortschritts" auf wenige, die private Lebenswelt beherrschende Gemeinschaftsformen beschränkt sind. Jedoch bleibt die Synthese von "Leben" und "Form", von Menschlichkeit und technischer Zivilisation für F. weiterhin unerläßlich für den Fortbestand jeder Kultur, im krisenhaften Übergang noch nicht erreicht, aber durchaus denkbar jenseits der Schwelle, wenn sich die neue geschichtliche Epoche der weltumspannenden Industriekultur konsolidieren wird. F.s Theorie der Industriekultur, kurz vor seinem Tode begonnen, ist unvollendet geblieben. Sein strukturhistorisches Konzept der Epochenschwelle hat in der deutschen Nachkriegssoziologie weniger Aufnahme gefunden, während es in der deutschen Geschichtswissenschaft wesentlich zur Überwindung einer evolutionären Entwicklungsgeschichte beigetragen hat und eine sozialwissenschaftlich orientierte Strukturgeschichtsschreibung einleitete, wofür F.s Konzept der Eigendynamik der sekundären Systeme ebenso ausschlaggebend war.
Zentraler Gesichtspunkt seiner Nachkriegsschriften war die gegenwärtige Epochenschwelle, der Übergang der modernen Industriegesellschaft zur weltweit ausgreifenden wissenschaftlich-technischen Rationalität, deren "sekundäre Systeme" alle naturhaft gewachsenen Lebensformen erfassen. F. weist nach, wie diese Fortschrittsordnung zum tragenden Kulturfaktor wird in allen Teilentwicklungen: der Technik, Siedlungsformen, Arbeit und Wertungen. Seine frühere integrative Perspektive einer Kultursynthese wird ersetzt durch den Konflikt von eigengesetzlichen, künstlichen Sachwelten einerseits und den "haltenden Mächte" des sozialen Lebens andererseits, die im "Katarakt des Fortschritts" auf wenige, die private Lebenswelt beherrschende Gemeinschaftsformen beschränkt sind. Jedoch bleibt die Synthese von "Leben" und "Form", von Menschlichkeit und technischer Zivilisation für F. weiterhin unerläßlich für den Fortbestand jeder Kultur, im krisenhaften Übergang noch nicht erreicht, aber durchaus denkbar jenseits der Schwelle, wenn sich die neue geschichtliche Epoche der weltumspannenden Industriekultur konsolidieren wird. F.s Theorie der Industriekultur, kurz vor seinem Tode begonnen, ist unvollendet geblieben. Sein strukturhistorisches Konzept der Epochenschwelle hat in der deutschen Nachkriegssoziologie weniger Aufnahme gefunden, während es in der deutschen Geschichtswissenschaft wesentlich zur Überwindung einer evolutionären Entwicklungsgeschichte beigetragen hat und eine sozialwissenschaftlich orientierte Strukturgeschichtsschreibung einleitete, wofür F.s Konzept der Eigendynamik der sekundären Systeme ebenso ausschlaggebend war.


 Il anime dans les années trente, un courant de jeunes architectes d’esprit nationaliste (il possède le magasin art déco Ty Kodaks de Quimper) et tente de créer un style breton moderne. En 1932, François Debauvais et Olier Mordrel fondent le PNB 2 (Parti national breton), lequel sera dissous sous le gouvernement Daladier (octobre 1939) en raison de son engagement séparatiste et de ses amitiés avec de hauts dignitaires allemands prompts à affaiblir par tout moyen la France. Olier Mordrel est un des deux dirigeants majeurs de la mouvance autonomiste, mais si François Debauvais s'attache plus à l'organisation, lui accorde plus de temps aux spéculations idéologiques et aux prises de positions politiques notamment par l'intermédiaire du journal autonomiste puis nationaliste "Breiz Atao". Sa sensibilité radicale voire extrémiste qui le pousse vers un romantisme néo-païen et une fascination pour le fascisme reste cependant toujours relativement marginale et il devra créer sa propre revue afin d'exprimer un ensemble d'opinions que "Breiz Atao" ne peut formuler sans risquer de heurter d'autres sensibilités, notamment catholiques.
Il anime dans les années trente, un courant de jeunes architectes d’esprit nationaliste (il possède le magasin art déco Ty Kodaks de Quimper) et tente de créer un style breton moderne. En 1932, François Debauvais et Olier Mordrel fondent le PNB 2 (Parti national breton), lequel sera dissous sous le gouvernement Daladier (octobre 1939) en raison de son engagement séparatiste et de ses amitiés avec de hauts dignitaires allemands prompts à affaiblir par tout moyen la France. Olier Mordrel est un des deux dirigeants majeurs de la mouvance autonomiste, mais si François Debauvais s'attache plus à l'organisation, lui accorde plus de temps aux spéculations idéologiques et aux prises de positions politiques notamment par l'intermédiaire du journal autonomiste puis nationaliste "Breiz Atao". Sa sensibilité radicale voire extrémiste qui le pousse vers un romantisme néo-païen et une fascination pour le fascisme reste cependant toujours relativement marginale et il devra créer sa propre revue afin d'exprimer un ensemble d'opinions que "Breiz Atao" ne peut formuler sans risquer de heurter d'autres sensibilités, notamment catholiques. Dans Breiz Atao (n° 164, 11 décembre 1932) il déclare, signant de son pseudonyme J. La B / Jean La Bénelais : Jacobin rime avec Youppin. (...) " Notre Juif " à nous, en Bretagne, c’est donc surtout le théoricien de l’Une et Indivisible, avant que Breiz Atao ne reprenne la swastika, symbole utilisé également par les nazis, le 29 janvier 1933. Le 14 décembre 1938, Mordrel est condamné, avec François Debauvais, à un an de prison avec sursis pour « atteinte à l'unité de la nation ». De juillet 1938 à juillet 1939, il est secrétaire général et rédacteur de Breiz Atao. Avant la déclaration de la guerre entre la France et l'Allemagne, et afin s'échapper à une arrestation imminente, il part en Allemagne nazie avec sa femme, François Debauvais et Anna Debauvais qui décrit leur voyage (Mémoires du chef breton : Fransez Debauvais, tome 3, p. 29-38). Depuis la Belgique, il rejoint Berlin. Publiés depuis Amsterdam, Mordrel et Debauvais adressent un manifeste aux Bretons, condamnant la guerre entreprise par la France le 25 octobre 1939.
Dans Breiz Atao (n° 164, 11 décembre 1932) il déclare, signant de son pseudonyme J. La B / Jean La Bénelais : Jacobin rime avec Youppin. (...) " Notre Juif " à nous, en Bretagne, c’est donc surtout le théoricien de l’Une et Indivisible, avant que Breiz Atao ne reprenne la swastika, symbole utilisé également par les nazis, le 29 janvier 1933. Le 14 décembre 1938, Mordrel est condamné, avec François Debauvais, à un an de prison avec sursis pour « atteinte à l'unité de la nation ». De juillet 1938 à juillet 1939, il est secrétaire général et rédacteur de Breiz Atao. Avant la déclaration de la guerre entre la France et l'Allemagne, et afin s'échapper à une arrestation imminente, il part en Allemagne nazie avec sa femme, François Debauvais et Anna Debauvais qui décrit leur voyage (Mémoires du chef breton : Fransez Debauvais, tome 3, p. 29-38). Depuis la Belgique, il rejoint Berlin. Publiés depuis Amsterdam, Mordrel et Debauvais adressent un manifeste aux Bretons, condamnant la guerre entreprise par la France le 25 octobre 1939. Sa ligne politique irrite Vichy et ne correspond plus aux besoins de Berlin, qui s’appuie désormais sur Vichy et constate l’isolement relatif du PNB dans la population; cet état de fait sera à l'origine de "la révolution de palais" du parti de décembre 1940. Qui plus est, Raymond Delaporte appuyé de Célestin Lainé, lequel ambitionne depuis longtemps de remplacer Olier Mordrel, profite du désir allemand d'étouffer l'autonomisme breton rendu inutile pour l'écarter de la direction alors qu'il lance une réorganisation du parti visant à le rendre totalement indépendant des Allemands et hostile à Vichy. La doctrine du PNB perdra en rigueur et en ardeur pour nourrir un séparatisme convenu. En novembre 1940, il affirme : "Notre force est en nous. elle n'est ni dans les autres ni dans les circonstances. ce n'est ni Vichy ni Berlin qui rendront au peuple breton la force de caractère nécessaire pour s'affranchir, se regrouper et se frayer une route. Notre sort se joue dans nos fibres... N'attendons rien que de nous. Alors, nous passerons au travers du gros temps, si gros temps il y a, comme une bonne étrave, et nos enfants seront Bretons".
Sa ligne politique irrite Vichy et ne correspond plus aux besoins de Berlin, qui s’appuie désormais sur Vichy et constate l’isolement relatif du PNB dans la population; cet état de fait sera à l'origine de "la révolution de palais" du parti de décembre 1940. Qui plus est, Raymond Delaporte appuyé de Célestin Lainé, lequel ambitionne depuis longtemps de remplacer Olier Mordrel, profite du désir allemand d'étouffer l'autonomisme breton rendu inutile pour l'écarter de la direction alors qu'il lance une réorganisation du parti visant à le rendre totalement indépendant des Allemands et hostile à Vichy. La doctrine du PNB perdra en rigueur et en ardeur pour nourrir un séparatisme convenu. En novembre 1940, il affirme : "Notre force est en nous. elle n'est ni dans les autres ni dans les circonstances. ce n'est ni Vichy ni Berlin qui rendront au peuple breton la force de caractère nécessaire pour s'affranchir, se regrouper et se frayer une route. Notre sort se joue dans nos fibres... N'attendons rien que de nous. Alors, nous passerons au travers du gros temps, si gros temps il y a, comme une bonne étrave, et nos enfants seront Bretons".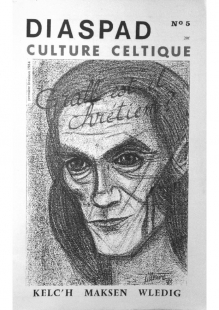 Il part d'abord pour le Brésil, puis l'Argentine, avant de trouver refuge en Espagne. Il est condamné à mort par contumace à la Libération, en juin 1946. Il écrit dans la revue Ar Vro, sous le pseudonyme de Brython. Il revient en France, en 1972, collabore à La Bretagne réelle, sous le pseudonyme d'Otto Mohr (son pseudonyme de 1940) et édite divers livres, dont Waffen SS d'Occident. Il a co-fondé dans les années 1980 un cercle nationaliste, le Kelc'h Maksen Wledig (Du nom de l'Empereur Maxime, "descendu" de Bretagne insulaire en compagnie de Conan Meriadec, le premier roi de Bretagne ), avec, entre autres, Yann-Ber Tillenon, et qui se place dans la continuité de l'extrême-droite bretonne ; et Georges Pinault, alias Goulven Pennaod. En 1981, il soutient François Mitterrand, tout en étant attentif aux travaux du GRECE, cercle de réflexion animé par Alain de Benoist, considéré comme proche de l'extrême-droite. Il meurt en 1985. (Voir Camus et Monzat, Les Droites nationales et radicales en France, Presses universitaires de Lyon, 1992).
Il part d'abord pour le Brésil, puis l'Argentine, avant de trouver refuge en Espagne. Il est condamné à mort par contumace à la Libération, en juin 1946. Il écrit dans la revue Ar Vro, sous le pseudonyme de Brython. Il revient en France, en 1972, collabore à La Bretagne réelle, sous le pseudonyme d'Otto Mohr (son pseudonyme de 1940) et édite divers livres, dont Waffen SS d'Occident. Il a co-fondé dans les années 1980 un cercle nationaliste, le Kelc'h Maksen Wledig (Du nom de l'Empereur Maxime, "descendu" de Bretagne insulaire en compagnie de Conan Meriadec, le premier roi de Bretagne ), avec, entre autres, Yann-Ber Tillenon, et qui se place dans la continuité de l'extrême-droite bretonne ; et Georges Pinault, alias Goulven Pennaod. En 1981, il soutient François Mitterrand, tout en étant attentif aux travaux du GRECE, cercle de réflexion animé par Alain de Benoist, considéré comme proche de l'extrême-droite. Il meurt en 1985. (Voir Camus et Monzat, Les Droites nationales et radicales en France, Presses universitaires de Lyon, 1992).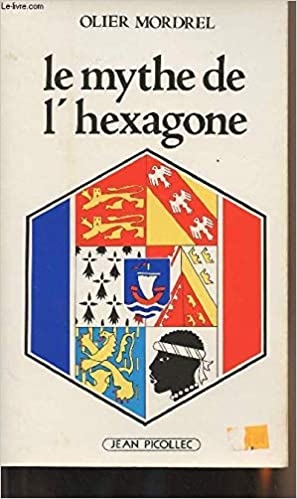 Le portrait des relations entre Mordrel et Debeauvais laissant entrevoir des rapports de plus en plus exécrables à mesure que la possibilité de réaliser l'indépendance avec l'aide allemande se concrétise. Reste que Olier Mordrel explique dans le détail son parcours et fournit son propre point de vue sur son engagement. Olier Mordrel cependant se garde d'expliquer les raisons plus intimes de ses sympathies pour l'idéologie nationale socialiste. Il avance au demeurant des motivations comme l'opportunisme, les circonstances exceptionnelles, une certaine communauté d'esprit. Il prend soin de démarquer la démarche du PNB de celle des fascismes par une sensibilité bretonne originale éloignée des stato-nationalismes allemand et italien et rejette l'idée d'une "copie bretonne" de modèles étrangers.
Le portrait des relations entre Mordrel et Debeauvais laissant entrevoir des rapports de plus en plus exécrables à mesure que la possibilité de réaliser l'indépendance avec l'aide allemande se concrétise. Reste que Olier Mordrel explique dans le détail son parcours et fournit son propre point de vue sur son engagement. Olier Mordrel cependant se garde d'expliquer les raisons plus intimes de ses sympathies pour l'idéologie nationale socialiste. Il avance au demeurant des motivations comme l'opportunisme, les circonstances exceptionnelles, une certaine communauté d'esprit. Il prend soin de démarquer la démarche du PNB de celle des fascismes par une sensibilité bretonne originale éloignée des stato-nationalismes allemand et italien et rejette l'idée d'une "copie bretonne" de modèles étrangers.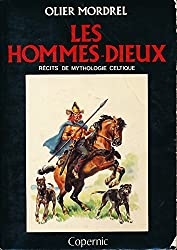 En 2005, Adsav organisera une cérémonie sur la tombe de Mordrel pour les 20 ans de sa disparition. Plus généralement on peut dire qu'avec Adsav, les conceptions mordrelliennes du nationalisme breton que l'on trouvait déjà dans Breiz Atao à l'état embryonnaire, sont devenues les éléments constitutifs d'un nouveau courant à part entière de l'Emsav. Un courant d'extrême droite ou très proche de l'extrême droite mais doté d'une perspective propre et différente de l'extrême droite française. Une réalité qu'a dénoncé Mona Bras, porte parole de l'UDB suite à une interview du président d'Adsav ou ce dernier souligne les apports d'Olier Mordrel au nationalisme breton. La porte parole y dénonçait la dérive "mordrellienne" d'une frange de l'Emsav.
En 2005, Adsav organisera une cérémonie sur la tombe de Mordrel pour les 20 ans de sa disparition. Plus généralement on peut dire qu'avec Adsav, les conceptions mordrelliennes du nationalisme breton que l'on trouvait déjà dans Breiz Atao à l'état embryonnaire, sont devenues les éléments constitutifs d'un nouveau courant à part entière de l'Emsav. Un courant d'extrême droite ou très proche de l'extrême droite mais doté d'une perspective propre et différente de l'extrême droite française. Une réalité qu'a dénoncé Mona Bras, porte parole de l'UDB suite à une interview du président d'Adsav ou ce dernier souligne les apports d'Olier Mordrel au nationalisme breton. La porte parole y dénonçait la dérive "mordrellienne" d'une frange de l'Emsav.
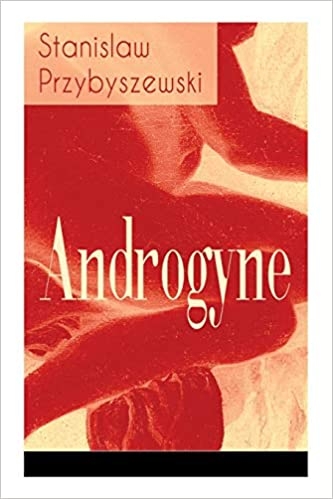 He earned fame in Berlin, where he became a hero of the international artistic community. It was in Berlin that he published his resonant essay "Zur Psychologie des Individuums. I - Chopin und Nietzsche. II - Ola Hansson" 1892 as well as poems Totenmesse, 1895 (Polish version: Requiem aeternam, 1904), Vigilien, 1895 (Polish version: Z cyklu wigilii, 1899), De profundis, 1895 (Polish version 1900), Androgyne, 1900. They introduced themes which would be central to all of his work: individualism, the metaphysical and social status of creative individuals, fate of geniuses, the sense of such attributes of genius as "degeneration" and "illness". He continued to present his philosophical views in essays published in a number of magazines and later collected in the volumes "Auf den Wegen der Seele" 1897 ("Na drogach duszy" [On the Paths of the Soul], 1900), "Szlakiem duszy polskiej" [On the Paths of the Polish Soul], 1917, "Ekspresjonizm, Słowacki i Genesis z ducha" [Expressionism, Slowacki and Genesis from the Spirit], 1918.
He earned fame in Berlin, where he became a hero of the international artistic community. It was in Berlin that he published his resonant essay "Zur Psychologie des Individuums. I - Chopin und Nietzsche. II - Ola Hansson" 1892 as well as poems Totenmesse, 1895 (Polish version: Requiem aeternam, 1904), Vigilien, 1895 (Polish version: Z cyklu wigilii, 1899), De profundis, 1895 (Polish version 1900), Androgyne, 1900. They introduced themes which would be central to all of his work: individualism, the metaphysical and social status of creative individuals, fate of geniuses, the sense of such attributes of genius as "degeneration" and "illness". He continued to present his philosophical views in essays published in a number of magazines and later collected in the volumes "Auf den Wegen der Seele" 1897 ("Na drogach duszy" [On the Paths of the Soul], 1900), "Szlakiem duszy polskiej" [On the Paths of the Polish Soul], 1917, "Ekspresjonizm, Słowacki i Genesis z ducha" [Expressionism, Slowacki and Genesis from the Spirit], 1918.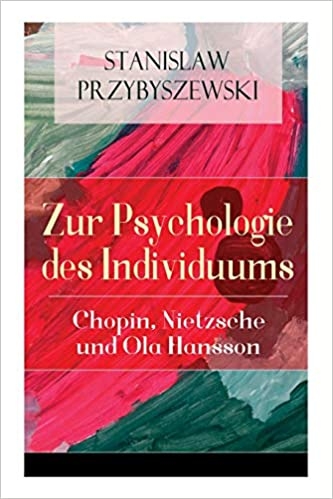 Przybyszewski translated the philosophical issues raised in his essays and narrative poems into the language of literary prose and drama. A very prolific writer, he published many novels, all of them trilogies, in German and Polish, notably Homo Sapiens, German edition 1895-96, Polish edition. 1901; Satans Kinder, 1897; Synowie ziemi [Sons of the Earth], 1904-11; Dzieci nędzy [Children of Poverty], 1913-14; Krzyk [The Cry], 1917; Il Regno Doloroso, 1924. All of his novels had basically the same type of protagonists, i.e. outstanding individuals destroyed by the social world and by their internal demons. These doomed characters were presented in extreme, frequently pathological, emotional states of alcoholism, jealousy, destructive love. The plots were weak and served as a pretext to analyze the characters' internal states. This new type of the protagonist required appropriate narration techniques that were different from those used in realistic novels. Przybyszewski made innovative use of (seemingly) indirect speech and of internal monologue.
Przybyszewski translated the philosophical issues raised in his essays and narrative poems into the language of literary prose and drama. A very prolific writer, he published many novels, all of them trilogies, in German and Polish, notably Homo Sapiens, German edition 1895-96, Polish edition. 1901; Satans Kinder, 1897; Synowie ziemi [Sons of the Earth], 1904-11; Dzieci nędzy [Children of Poverty], 1913-14; Krzyk [The Cry], 1917; Il Regno Doloroso, 1924. All of his novels had basically the same type of protagonists, i.e. outstanding individuals destroyed by the social world and by their internal demons. These doomed characters were presented in extreme, frequently pathological, emotional states of alcoholism, jealousy, destructive love. The plots were weak and served as a pretext to analyze the characters' internal states. This new type of the protagonist required appropriate narration techniques that were different from those used in realistic novels. Przybyszewski made innovative use of (seemingly) indirect speech and of internal monologue.

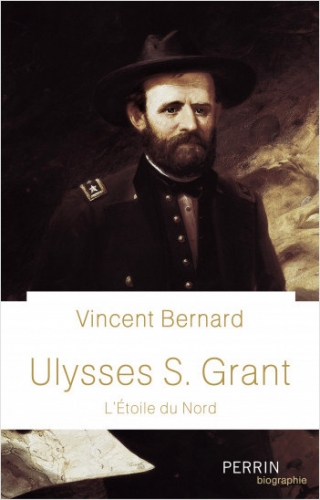 Ulysses S. Grant n’a pas eu une vie mais plusieurs. Vincent Bernard nous fait découvrir celui qui fut tour à tour, un enfant timide et effacé de l
Ulysses S. Grant n’a pas eu une vie mais plusieurs. Vincent Bernard nous fait découvrir celui qui fut tour à tour, un enfant timide et effacé de l

 Grant est lucide au sujet de cette Guerre Civile. Voici comment il la considère.
Grant est lucide au sujet de cette Guerre Civile. Voici comment il la considère.  De son vivant et après sa mort, d’aucuns opposeront le «
De son vivant et après sa mort, d’aucuns opposeront le « 
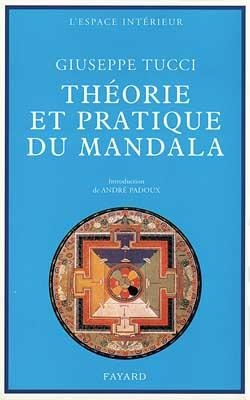 Era il 5 giugno del 1894 quando un bimbo dagli occhi curiosi e le mani sempre pronte ad afferrare ciò che incontrava sul suo cammino nasceva in un confortevole appartamento di Macerata. Oggi la targa che ricorda la sua persona si trova in corso Cavour ed è facilmente visibile, tuttavia sono in molti ad avere ricordi di un adolescente di via Crispi originale, poco avvezzo a far amicizia, sempre immerso in letture e passeggiate tra le rovine storiche, che aveva attirato l'attenzione su di sé poiché spesso, durante il freddo inverno dell'entroterra marchigiano, usciva in balcone a dorso nudo e si cimentava in difficilissimi esercizi di yoga. Nessuno poteva immaginare che la città di Macerata sarebbe arrivata in un futuro non troppo lontano a dedicargli persino una via e una sede didattica a
Era il 5 giugno del 1894 quando un bimbo dagli occhi curiosi e le mani sempre pronte ad afferrare ciò che incontrava sul suo cammino nasceva in un confortevole appartamento di Macerata. Oggi la targa che ricorda la sua persona si trova in corso Cavour ed è facilmente visibile, tuttavia sono in molti ad avere ricordi di un adolescente di via Crispi originale, poco avvezzo a far amicizia, sempre immerso in letture e passeggiate tra le rovine storiche, che aveva attirato l'attenzione su di sé poiché spesso, durante il freddo inverno dell'entroterra marchigiano, usciva in balcone a dorso nudo e si cimentava in difficilissimi esercizi di yoga. Nessuno poteva immaginare che la città di Macerata sarebbe arrivata in un futuro non troppo lontano a dedicargli persino una via e una sede didattica a 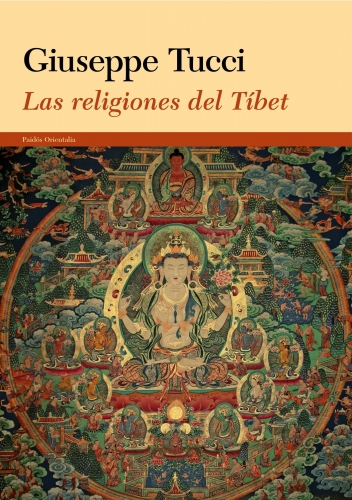 Giuseppe strinse la cinghia che teneva incollati tra loro gli antichi libri e sorrise compiaciuto. Era giunto il momento di lasciare Lhasa dopo che, non molto tempo prima, era davvero riuscito a farsi ammettere – unico uomo di tutta la spedizione – sfruttando una motivazione assai semplice: era buddista. Lo era diventato, in effetti, durante la precedente visita al Tibet nel 1935 grazie all'iniziazione dell'abate di Sakya Ngawang Thutob Wangdrag. Lo raccontò lui stesso nel libro Santi e briganti nel Tibet ignoto, esplicitando anche la convinzione di essere stato un tibetano e di essersi reincarnato nei panni di un esploratore per dare voce e lustro alla cultura di un popolo in continuo pericolo, ancora troppo ignoto al resto dell'umanità. Ed era proprio per questo motivo che Tucci, in quella soleggiata giornata dall'aria frizzantina proveniente dalle vette che si estendevano intorno a lui in lontananza, non aveva nessuna intenzione di restituire l'opera costituita da ben 108 volumi preziosi e di inestimabile valore che il Dalai Lama
Giuseppe strinse la cinghia che teneva incollati tra loro gli antichi libri e sorrise compiaciuto. Era giunto il momento di lasciare Lhasa dopo che, non molto tempo prima, era davvero riuscito a farsi ammettere – unico uomo di tutta la spedizione – sfruttando una motivazione assai semplice: era buddista. Lo era diventato, in effetti, durante la precedente visita al Tibet nel 1935 grazie all'iniziazione dell'abate di Sakya Ngawang Thutob Wangdrag. Lo raccontò lui stesso nel libro Santi e briganti nel Tibet ignoto, esplicitando anche la convinzione di essere stato un tibetano e di essersi reincarnato nei panni di un esploratore per dare voce e lustro alla cultura di un popolo in continuo pericolo, ancora troppo ignoto al resto dell'umanità. Ed era proprio per questo motivo che Tucci, in quella soleggiata giornata dall'aria frizzantina proveniente dalle vette che si estendevano intorno a lui in lontananza, non aveva nessuna intenzione di restituire l'opera costituita da ben 108 volumi preziosi e di inestimabile valore che il Dalai Lama 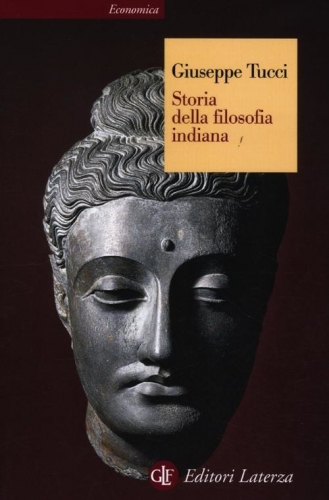 Sebbene Giuseppe Tucci sia oggi considerato unanimamente il più importante tibetologo del mondo e un esploratore, orientalista, professore e storico delle religioni di livello internazionale – contando le numerose università straniere e italiane in cui insegnò, o le prestigiose onorificenze ricevute – la sua figura resta tuttora avvolta nel mistero e nella discrezione. Acclamato nonché profondamente stimato all'estero, Tucci seppe sfruttare anche nel suo paese i legami politici e istituzionali che la sua immensa cultura gli aveva procurato; tuttavia, mai si piegò ai lustri del successo, ai salotti letterari e alla sete di visibilità, restando così un personaggio ben poco noto se si pensa all'estremo carisma che seppe emanare in vita, ma soprattutto alle incredibili missioni che svolse, degne di un'incomparabile genialità.
Sebbene Giuseppe Tucci sia oggi considerato unanimamente il più importante tibetologo del mondo e un esploratore, orientalista, professore e storico delle religioni di livello internazionale – contando le numerose università straniere e italiane in cui insegnò, o le prestigiose onorificenze ricevute – la sua figura resta tuttora avvolta nel mistero e nella discrezione. Acclamato nonché profondamente stimato all'estero, Tucci seppe sfruttare anche nel suo paese i legami politici e istituzionali che la sua immensa cultura gli aveva procurato; tuttavia, mai si piegò ai lustri del successo, ai salotti letterari e alla sete di visibilità, restando così un personaggio ben poco noto se si pensa all'estremo carisma che seppe emanare in vita, ma soprattutto alle incredibili missioni che svolse, degne di un'incomparabile genialità.
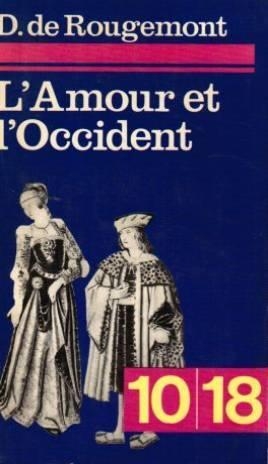 Anti-matérialiste, Denis de Rougemont le sera toujours. En contact épisodique avec les chefs de file de la « Jeune Droite », Jean de Fabrègue et Thierry Maulnier, il écrit aussi pour la revue Esprit d’Emmanuel Mounier. Ils sont d’ailleurs les premiers à parler de personnalisme. Cependant, Rougemont relie ce concept à une dimension plus ambitieuse, celle d’une Europe fédéraliste appliquant la subsidiarité intégrale. Il se détourne en tout cas de l’étatisme centralisateur républicain français dont il perçoit toute la malfaisance.
Anti-matérialiste, Denis de Rougemont le sera toujours. En contact épisodique avec les chefs de file de la « Jeune Droite », Jean de Fabrègue et Thierry Maulnier, il écrit aussi pour la revue Esprit d’Emmanuel Mounier. Ils sont d’ailleurs les premiers à parler de personnalisme. Cependant, Rougemont relie ce concept à une dimension plus ambitieuse, celle d’une Europe fédéraliste appliquant la subsidiarité intégrale. Il se détourne en tout cas de l’étatisme centralisateur républicain français dont il perçoit toute la malfaisance. Rentré en Europe dès 1946, il organise un an plus tard à Montreux en Suisse le 1er Congrès de l’Union européenne des fédéralistes. Un second congrès se tient à La Haye l’année suivante au cours duquel les tenants de l’économisme, Jean Monnet en tête, rompent avec les partisans de l’action culturelle prioritaire. Cette vive scission n’empêche pas Denis de Rougemont de créer le Centre européen de la culture et de militer au sein du Mouvement paneuropéen. Horrifié en août 1945 par les deux bombardements atomiques étatsuniens qu’il estime être l’apothéose du totalitarisme moderne, il soutient dès lors des positions pacifistes, régionalistes, fédéralistes et écologistes. Dans les années 1960 – 1970, aidé par l’intellectuel protestant français Jacques Ellul, il crée l’association Ecoropa.
Rentré en Europe dès 1946, il organise un an plus tard à Montreux en Suisse le 1er Congrès de l’Union européenne des fédéralistes. Un second congrès se tient à La Haye l’année suivante au cours duquel les tenants de l’économisme, Jean Monnet en tête, rompent avec les partisans de l’action culturelle prioritaire. Cette vive scission n’empêche pas Denis de Rougemont de créer le Centre européen de la culture et de militer au sein du Mouvement paneuropéen. Horrifié en août 1945 par les deux bombardements atomiques étatsuniens qu’il estime être l’apothéose du totalitarisme moderne, il soutient dès lors des positions pacifistes, régionalistes, fédéralistes et écologistes. Dans les années 1960 – 1970, aidé par l’intellectuel protestant français Jacques Ellul, il crée l’association Ecoropa. 
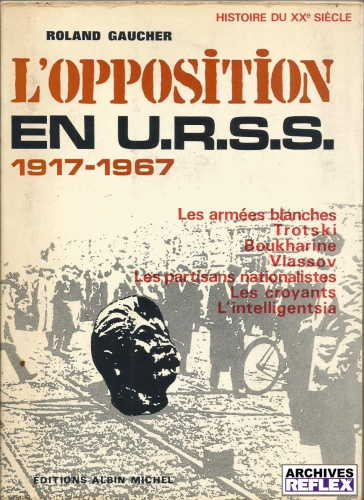 Après la guerre, il connut des moments difficiles. Il fut condamné à cinq années de prison, mais il fut libéré en 1948. Devenu journaliste professionnel, il collabora à plusieurs revues spécialisées parmi lesquelles l’Auto-journal. Mais le sens du devoir conduisit Roland Gaucher à reprendre le combat. Il travailla un temps pour l’Institut d’histoire sociale et pour la revue Est et Ouest, deux émanations de ce que l’on appelait alors pudiquement « les réseaux Albertini » (1). Il participa à la lutte en faveur de la défense de l’Algérie française. Après l’échec de ce « baroud pour l’honneur », il devint grand reporter à l’hebdomadaire Minute où il restera plus de vingt ans. Parallèlement à son engagement journalistique, il prit une part active, au cours des année 70, à l’action sur le terrain contre le Parti communiste qui représentait un véritable danger pour notre liberté. Il participa en 1972 à la création du Front national et, en 1974, il rejoignit le Parti des forces nouvelles dont il devint l’un des principaux dirigeants. La même année, il publia une monumentale Histoire secrète du Parti communiste français (chez Albin Michel) qui fit grand bruit et contribua, à n’en pas douter, à la déstabilisation et à la marginalisation de ce parti alors encore tout puissant.
Après la guerre, il connut des moments difficiles. Il fut condamné à cinq années de prison, mais il fut libéré en 1948. Devenu journaliste professionnel, il collabora à plusieurs revues spécialisées parmi lesquelles l’Auto-journal. Mais le sens du devoir conduisit Roland Gaucher à reprendre le combat. Il travailla un temps pour l’Institut d’histoire sociale et pour la revue Est et Ouest, deux émanations de ce que l’on appelait alors pudiquement « les réseaux Albertini » (1). Il participa à la lutte en faveur de la défense de l’Algérie française. Après l’échec de ce « baroud pour l’honneur », il devint grand reporter à l’hebdomadaire Minute où il restera plus de vingt ans. Parallèlement à son engagement journalistique, il prit une part active, au cours des année 70, à l’action sur le terrain contre le Parti communiste qui représentait un véritable danger pour notre liberté. Il participa en 1972 à la création du Front national et, en 1974, il rejoignit le Parti des forces nouvelles dont il devint l’un des principaux dirigeants. La même année, il publia une monumentale Histoire secrète du Parti communiste français (chez Albin Michel) qui fit grand bruit et contribua, à n’en pas douter, à la déstabilisation et à la marginalisation de ce parti alors encore tout puissant. Roland était devenu la bête noire des communistes. Dans Minute, chaque semaine, il ne manquait jamais une occasion de mener la vie dure au parti de Moscou. C’est ainsi qu’il fut le premier à rappeler l’engagement volontaire, alors que la France était occupée, de Georges Marchais dans les ateliers de la firme Messerschmitt, principal constructeur d’avions de l’Allemagne nationale-socialiste. Marchais fondit en larmes lorsqu’il perdit le procès qu’il avait engagé contre Gaucher. Ce fut le début de la fin de sa carrière. Dans un hommage publié dans le quotidien Présent du 11 août dernier, le journaliste Jean Cochet nous rappelle ce que Roland lui avait alors confié : « Ces larmes de Marchais, c’est ma Légion d’honneur à moi ».
Roland était devenu la bête noire des communistes. Dans Minute, chaque semaine, il ne manquait jamais une occasion de mener la vie dure au parti de Moscou. C’est ainsi qu’il fut le premier à rappeler l’engagement volontaire, alors que la France était occupée, de Georges Marchais dans les ateliers de la firme Messerschmitt, principal constructeur d’avions de l’Allemagne nationale-socialiste. Marchais fondit en larmes lorsqu’il perdit le procès qu’il avait engagé contre Gaucher. Ce fut le début de la fin de sa carrière. Dans un hommage publié dans le quotidien Présent du 11 août dernier, le journaliste Jean Cochet nous rappelle ce que Roland lui avait alors confié : « Ces larmes de Marchais, c’est ma Légion d’honneur à moi ». 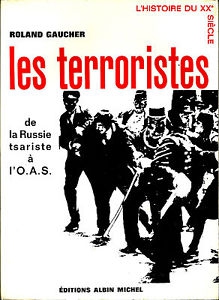 Toujours soucieux de voir un jour se réaliser le véritable rassemblement des forces nationales, Roland Gaucher fut aussi, ne l’oublions pas, au début des années 90, l’instigateur des Journées culturelles de National Hebdo qui rassemblèrent tout ce que le camp national comptait alors de mouvements, associations, journaux…
Toujours soucieux de voir un jour se réaliser le véritable rassemblement des forces nationales, Roland Gaucher fut aussi, ne l’oublions pas, au début des années 90, l’instigateur des Journées culturelles de National Hebdo qui rassemblèrent tout ce que le camp national comptait alors de mouvements, associations, journaux…