mardi, 27 janvier 2026
Davos 2026: Vers un nouveau désordre mondial

Davos 2026: Vers un nouveau désordre mondial
Leonid Savin
Le Forum économique mondial, également connu sous le nom de Forum de Davos, s’est tenu en Suisse du 19 au 23 janvier. Ce rassemblement annuel avait été initialement conçu comme une plateforme pour discuter et promouvoir les idées du mondialisme, puis les multinationales, les grandes banques et les élites politiques qui les servent dans différents pays se sont progressivement tournées vers le transhumanisme, le forum est alors devenu une sorte de rassemblement où certains venaient avec des revendications, d’autres se demandaient ce qui se passait et ce qu’il fallait faire ensuite, et d’autres arrivaient simplement comme des célébrités pour participer à une réunion politique importante.
Bien que, en raison de l’inertie des années précédentes, l’Ukraine, l’intelligence artificielle, le commerce mondial et le changement climatique soient encore à l’ordre du jour, l’attention principale s’est déplacée vers le Groenland et ce que le président américain Donald Trump a dit et proposé. Parallèlement, une des directives à l’ordre du jour était la suivante: «Relever les défis critiques: comprendre comment naviguer dans les tensions géopolitiques, affronter la pression inflationniste, la volatilité des chaînes d’approvisionnement et les transitions énergétiques en cours. Identifier de nouvelles opportunités sur les marchés émergents et adopter des stratégies qui aident votre entreprise à rester résiliente». En réalité, le contraire s’est produit. Les tensions géopolitiques se sont accrues, l’incertitude a augmenté, et la volatilité est entrée dans une nouvelle phase.
Trump a été la star du spectacle, dont il était intéressant d’écouter les propos, mais beaucoup n’ont pas aimé ce qu’il disait. Pour résumer son discours confus, le message peut être résumé par une phrase qui est déjà devenue un mème: «Nous voulons récupérer un morceau de glace pour protéger le monde, mais ils ne nous le donnent pas. Ils ont le choix: dire oui, et nous serons très reconnaissants. Ou dire non, et nous nous en souviendrons. Je n’ai pas besoin d’utiliser la force, je ne veux pas utiliser la force, je n’utiliserai pas la force. Je veux commencer immédiatement des négociations pour l’acquisition du Groenland», a déclaré Trump.
Bien que la décision militaire concernant l’annexion semble avoir été reportée, et qu’un nouveau cadre d’accord entre les États-Unis et le Danemark serait en préparation, selon lequel des bases américaines supplémentaires seraient construites au Groenland, la question reste non résolue. Cela signifie que toute la politique intra-européenne restera dans une tension terrible et que nous aurons une fracture transatlantique.
Même le plus proche et le plus ancien allié des États-Unis, la Grande-Bretagne, a condamné les revendications de Washington sur le Groenland. Et au Canada, ils se préparent maintenant à des actions de guérilla en cas d’invasion américaine. Le cas de Caracas a éclipsé l’idée de sécurité commune dans le système de l’OTAN.
Le discours du Premier ministre canadien Mark Carney a également été significatif. Il a calmement admis que «le narratif de l’ordre international basé sur des règles était en partie faux: les plus forts se sont libérés des règles quand cela leur convenait, et les règles commerciales étaient appliquées de manière asymétrique. Nous savions aussi que le droit international était appliqué avec des rigorismes variables selon que l’on était l’accusé ou la victime. Cette fiction était utile, et l’hégémonie américaine, en particulier, contribuait à assurer les biens publics». Pourquoi le Canada n’aime-t-il plus l’hégémonie des États-Unis maintenant? Probablement parce que leurs intérêts ont commencé à être enfreints. Les États-Unis ne considèrent plus qu’il est nécessaire de demander quoi que ce soit à leurs anciens partenaires et satellites.
Il est significatif que, du point de vue de la division géopolitique, peu de choses ont changé au sein de l’UE au cours des 25 dernières années – de nouveaux membres d’Europe de l’Est, comme la Pologne, représentée par son président, ont en fait justifié les actions de Donald Trump. Seule l’Europe ancienne a essayé de se rassembler autour de la menace de la prise du Groenland, tout en reconnaissant sa faiblesse et sa vulnérabilité.
Mais il y a deux autres phobies obsessionnelles: la Russie et la Chine. Un tel trilemme dépasse clairement la puissance de la mentalité collective européenne de l’UE, qui s’est elle-même piégée dans la dépendance aux États-Unis depuis de nombreuses années. Soutenir activement l’Ukraine depuis le coup d’État de février 2014 et en faire une anti-Russie a été une grave erreur politique et la première étape vers le désastre. Et l'abandon du pétrole et du gaz russes bon marché a gravement fragilisé les économies des principaux acteurs du bloc,: c'est bel et bien une continuation logique de l’aveuglement politique européen.
Aujourd’hui, le chancelier allemand Friedrich Merz déclare: «nous sommes entrés dans une époque de politique de grande puissance». La question est maintenant la suivante: quelles sortes de pays sont-ils ? L’Allemagne est définitivement exclue de ce club. Par conséquent, elle est condamnée à suivre les pas des autres ou à s’adapter aux tendances actuelles. Cependant, une autre crise de confiance de l’UE envers les États-Unis (encore une, puisque Washington a souvent agi sans tenir compte de ses alliés auparavant, tant lors de l’occupation de l’Irak en 2003 que durant le premier mandat de Donald Trump en tant que président) révèle aussi une image plus globale.
Il s’agit d’une nouvelle forme de mercantilisme. La politique tarifaire de Trump s’inscrivait dans cette direction, et aujourd’hui nous ne voyons qu’une nouvelle forme de sa manifestation. C’est simplement que les taxes sur un certain nombre de produits en provenance de nombreux pays étaient un prélude à des plans plus ambitieux qui semblaient se concrétiser. Les États-Unis ont commencé à intervenir non seulement dans la politique commerciale, mais tentent également d’établir des règles pour d’autres actifs.
Et si le libre-échange a toujours été une contre-attaque au mercantilisme, dans ce cas, il est peu probable qu’il puisse apporter une solution. Le paradoxe est que les États-Unis eux-mêmes défendaient le libre-échange (bien sûr, dans leur propre interprétation et selon leurs règles), et plusieurs multinationales enregistrées aux États-Unis suivent toujours cette logique. Mais l’instinct de survie des autres puissances, d’une manière ou d’une autre, les obligera à se tourner vers le protectionnisme et à chercher des moyens alternatifs pour établir des mécanismes économiques adéquats.

Donald Trump espérait probablement renforcer le système qu’il construisait sous l’égide du «Conseil de la paix», qui, selon lui, devrait devenir un substitut aux Nations unies pour traiter les enjeux mondiaux et sous sa propre direction (comme indiqué dans la charte soumise). L’idée est plutôt douteuse, il est difficile d’y croire sérieusement, et encore plus d’y participer. Outre les États-Unis, la cérémonie de signature comprenait l’Azerbaïdjan, l’Argentine, l’Arménie, Bahreïn, la Bulgarie, la Hongrie, l’Indonésie, la Jordanie, le Kazakhstan, le Qatar, le Maroc, la Mongolie, le Pakistan, le Paraguay, l’Arabie saoudite, la Turquie et l’Ouzbékistan, ainsi que le Kosovo, état autoproclamé. La Hongrie est probablement là uniquement parce que les États-Unis n’imposeront pas de sanctions pour l’achat de ressources énergétiques russes (c’était la raison du vote de la Hongrie à l’Assemblée générale de l’ONU contre Cuba à la fin de l’année dernière). La liste comprend aussi plusieurs satellites évidents de Washington. Les pays musulmans sont clairement présents en raison de l’objectif déclaré d’aider la Palestine. Mais, en général, cela ne donne pas l’impression d’une organisation sérieuse.
Cela crée cependant une nouvelle fragmentation géopolitique. Et avec une telle rupture des anciens liens politiques, on peut se demander si un forum de Davos aura lieu l’année prochaine.
21:24 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, davos, davos 2026, fem, donald trump, board of peace |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Mourir pour des idées: une synthèse du suicide européen

Mourir pour des idées: une synthèse du suicide européen
par Andrea Zhok
Source: https://telegra.ph/Morire-per-delle-idee-una-sintesi-del-...
Il fut un temps où l'Europe Unie était présentée comme:
- un bastion compétitif face aux États-Unis;
- la création d’un organisme supranational doté d’une masse critique capable de s’imposer sur la scène internationale.
Tout cela s’est avéré une farce.
Pourquoi ?
A) Le modèle idéologique:
Lorsque le traité de Maastricht a été élaboré, l’Occident était dominé par la légende de la victoire néolibérale sur l’ours soviétique, et donc le système néolibéral a défini tous les mécanismes juridiques principaux, le rôle de l’industrie publique, les relations avec la finance, selon ce modèle idéologique.
Ce modèle suppose que la liberté d’échange est une substitution idéale à la démocratie (en réalité une amélioration par rapport au mécanisme brut des élections démocratiques) et privilégie le rôle dynamique du grand capital, pour lequel la politique doit jouer un rôle subsidiaire, de facilitateur.
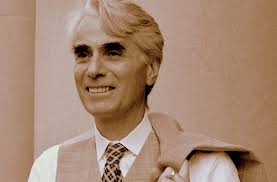
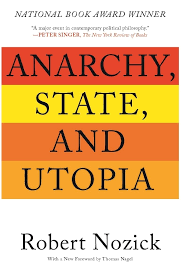
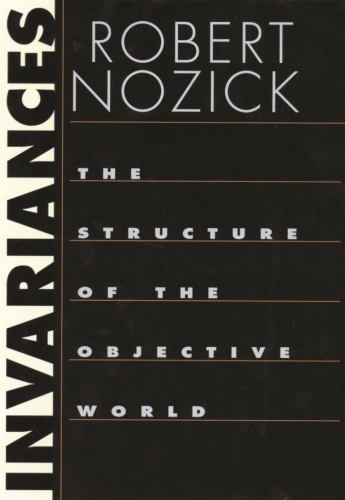
B) La souveraineté de l’économie financière:
Des théories outrageusement abstraites comme le modèle de Nozick sur la naissance de l’État à partir du libre-échange intéressé ont constitué l’épine dorsale d’un modèle inédit, où l’on imaginait qu’une entité politique (une union politique, un État fédéral, etc.) pourrait émerger comme résultat d’une interaction intense du marché. Le modèle européen est ainsi devenu la première expérience historique (et, vu les résultats, la dernière) où l’on pensait qu’un marché commun (c’est-à-dire un dispositif de compétition mutuelle entre États dans un cadre qui obligeait à la plus grande compétitivité) serait le prélude à une union politique.
Ce qui s’est produit en réalité, comme toujours dans des conditions de marché très concurrentielles sans filtres politiques (sans barrières douanières, sans ajustements monétaires, etc.), c’est qu’il y a eu des gagnants et des perdants, des pays qui ont obtenu des avantages et d’autres dont les ressources ont été vampirisées (l’Italie en fait partie).
L’idée obsolète de gouvernements démocratiques responsables devant les électeurs a été remplacée par celle d’une “gouvernance” comme système de règles pour la gestion économique, menant à l’idée d’une politique gérée par un “pilote automatique”.

C) La politique du “winner takes all”
Les systèmes financiers sont impersonnels, apolitiques et supranationaux, mais cela ne signifie pas qu’ils n’aient pas de centres de gravité. Le centre de gravité principal du système financier occidental est l’axe New York – Londres, où son bras politique principal a toujours été le gouvernement américain (quel que soit par ailleurs le gouvernement américain).
L’Europe de Maastricht, qui s’est lancée sur la scène internationale selon des règles néolibérales, est fatalement tombée dans l’orbite gravitationnelle des principaux gestionnaires de fonds financiers, incarnés par la politique américaine. Aux États-Unis, la politique de suprématie nationale et de profit financier sont indissociables: c’est la même chose avec de faibles variantes stylistiques. L’Europe de Maastricht est donc revenue intégralement sous l’aile hégémonique des États-Unis, précisément à l’époque où le développement économique d’après-guerre aurait pu permettre une autonomisation.
L’hégémonie des États-Unis depuis les années 90 a été financière, militaire, mais surtout culturelle, détruisant peu à peu toutes les capacités de résistance intérieure en Europe. Sur le plan culturel, les 30 dernières années ont représenté une américanisation idéologique totale de l’Europe, où ont été importés non seulement des produits cinématographiques et des styles musicaux, mais surtout des modèles institutionnels, des modèles de gestion de l’école, de l’université, des services publics, etc.
D) Le suicide géopolitique:
L’hégémonie culturelle a facilité une croissance de l’hégémonie politico-militaire américaine, qui, au lieu de se retirer après les résultats de la Seconde Guerre mondiale, s’est imposée dans une nouvelle dimension géopolitique.
L’Europe (UE) a commencé à soutenir systématiquement toutes les initiatives de restructuration géopolitique américaines, de l’Afghanistan à l’Irak, en passant par la Yougoslavie et la Libye.
Le cadre idéologique – la légende progressiste du système international basé sur les règles et le respect des droits de l’homme – a permis aux politiques américaines d’être acceptées sans résistance par l’opinion publique européenne. La citoyenneté européenne a englouti comme des oies engraissées pendant deux décennies tous les contes américains sur “l’émancipation des peuples opprimés”, “les interventions humanitaires”, “la police internationale”.
Pendant ce temps, alors que nos journaux échangeaient mutuellement des médailles sur notre civilisation et notre enlightenment, (nos "Lumières"), les États-Unis ont rompu toutes les chaînes d’approvisionnement vitales pour l’Europe. Ils ont déstabilisé tous ces producteurs de pétrole du Moyen-Orient qui n’étaient pas déjà vassaux des États-Unis (Arabie Saoudite, EAU, etc.). Ainsi, l’Irak et la Libye ont été transformés de fournisseurs indépendants en amas de ruines où seule la force militaire compte. Avec la naïve fable des droits de l’homme, l’Iran a été placé sous sanctions et isolé également de la possibilité de commercer ses ressources avec l’Europe. Enfin, les provocations répétées à la frontière ukrainienne ont réussi à produire la guerre encore en cours, qui a coupé le principal poumon d’approvisionnement énergétique de l’industrie européenne, la Russie.

Après avoir éliminé le Moyen-Orient et la Russie, les stratèges européens se sont appuyés à fond sur le GNL américain, faisant perdre dramatiquement en compétitivité l’industrie européenne. Et à ce stade, le pouvoir de négociation européen face aux États-Unis est évidemment nul. Si Trump veut le Groenland, nous lui donnerons le Groenland ; s’il veut le “ius primae noctis”, nous lui donnerons aussi (il lui suffit de couper le GNL pour mettre le continent à genoux).
E) Que faire ?
Une situation aussi compromise est vraiment difficile à récupérer. En fait, l’Union Européenne néolibérale et ses institutions ont scellé le plus grave effondrement historique que l’Europe ait subi dans son histoire, pire même que la Seconde Guerre mondiale, du point de vue du pouvoir comparatif.
La solution théorique, en principe simple (beaucoup moins en pratique), est que l’UE doit fermer boutique, afficher “faillite” et devenir une page sombre dans les livres d’histoire (restera alors la question technique de ce qu’on fait de l’euro).
À la place de l’UE, doivent naître immédiatement des alliances stratégiques entre États européens aux intérêts communs.
Tous les canaux diplomatiques et économiques doivent être rouvert immédiatement avec tous les pays que le soft power américain nous a présentés comme des monstres repoussants : Russie, Chine, Iran.
C’est seulement par cette voie que l’encerclement américain de l’Europe (et du reste du monde) pourra être brisé.
C’est seulement ainsi que l’Europe pourra ouvrir un avenir pour les prochaines générations.
Évidemment, dans l’atmosphère culturelle entretenue depuis des décennies, une telle perspective ne peut que rencontrer une résistance farouche. Et si tel est le cas, une fois de plus, l’Europe se sera sacrifiée pour des idées (stupides).
Mais, contrairement à la chanson de Georges Brassens, cette fois-ci, nous mourrons pour des idées, mais pas d’une mort lente.
15:04 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, affaires européennes, suicide européen |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Le plus grand problème de l'Europe est peut-être son incapacité à distinguer amis et ennemis

Le plus grand problème de l'Europe est peut-être son incapacité à distinguer amis et ennemis
par Giulio Chinappi
Source: https://telegra.ph/Il-problema-pi%C3%B9-grande-dellEuropa...
Qui aurait jamais imaginé qu’un conflit, inédit depuis des générations entre les États-Unis et l’Europe, finirait par éclater, avec le Groenland comme épicentre de cette tempête géopolitique?
Dimanche, heure locale, le secrétaire au Trésor Scott Bessent a déclaré sans détour: je crois que les Européens finiront par comprendre que le meilleur résultat sera que les États-Unis maintiennent ou reprennent le contrôle du Groenland». Le même jour, les ambassadeurs des 27 pays de l’UE se sont réunis à Bruxelles, évaluant l’imposition de droits de douane pour 93 milliards d’euros (108 milliards de dollars) ou des restrictions d’accès pour les entreprises américaines au marché de l'Union. Un jour plus tôt, les États-Unis avaient annoncé qu’ils appliqueraient une nouvelle taxe de 10% au Danemark et à sept autres pays européens à partir du 1er février, jusqu’à ce qu’un accord pour l’achat complet et total du Groenland soit conclu.
En apparence, la dernière réponse européenne semble indiquer qu’enfin, l’Europe pourrait passer de la défense passive à la riposte active. Cependant, la réalité est beaucoup plus complexe. Les droits de douane de 93 milliards d’euros en représailles n’ont pas encore été appliqués. Certains responsables ont noté que cette mesure, ainsi que le soi-disant instrument d'anti-coercition (Anti-Coercition Instrument, ACI), qui peut limiter l’accès des entreprises américaines au marché intérieur de l’UE, «est en cours d’élaboration pour donner aux dirigeants européens un levier dans les négociations cruciales avec le président des États-Unis lors du Forum économique mondial de Davos cette semaine». Mais, selon les rapports, ils attendront jusqu’au 1er février pour voir si Washington donnera suite à la menace tarifaire, avant de décider d’adopter des contre-mesures.
De plus, peu après l’annonce des droits de douane américains, l’équipe de reconnaissance allemande composée de 15 personnes a brusquement interrompu sa participation à l’Opération Arctic Endurance, un exercice militaire au Groenland dirigé par le Danemark pour 2026, et a quitté l’île arctique. Auparavant, sept pays européens, dont le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Suède, la France, la Norvège, les Pays-Bas et la Finlande, avaient déployé au total 37 militaires au Groenland. Au moment de la publication, Berlin n’a fourni aucune explication publique pour ce retrait, bien que les analystes l’attribuent largement à la pression tarifaire.
Les États-Unis ont transformé la plaisanterie sur l’«achat du Groenland» en une pression concrète et sérieuse, probablement parce qu’ils ont jugé à juste titre que l’Europe ne réagirait pas de manière énergique. Pendant des années, l’Europe a mal interprété ses propres opportunités de développement ainsi que les changements qui s'opéraient dans le paysage mondial, devenant excessivement dépendante de liens profonds avec les États-Unis et remettant à plus tard, sine die, la coopération avec des partenaires plus vastes, y compris la Chine et la Russie. En conséquence, l’Europe est devenue de plus en plus vulnérable au harcèlement américain, facilement pressurable et manipulable, avec une capacité de riposte limitée.
Par exemple, après l’éclatement du conflit entre la Russie et l’Ukraine, l’Europe a cessé, de manière tranchée, ses approvisionnements en gaz en provenance de Russie, sans faire montre de beaucoup de sagesse politique ou de capacité à évaluer les conséquences concrètes d'une telle décision, pour ensuite se retrouver à faire face à d’énormes coûts économiques et sociaux. Le même schéma s’applique à la Chine. Autrefois florissante grâce à la coopération économique, les relations entre la Chine et l’Europe ont changé lorsque l’Europe a suivi la ligne américaine, en regardant la Chine à travers un prisme idéologique plutôt que comme un partenaire pragmatique.
Dans ses relations avec les États-Unis, l’Europe choisit souvent le compromis, allant jusqu’à l’acquiescement. Lors de la guerre commerciale, l’Europe a pratiquement capitulé sans se battre, ce qui pourrait avoir ouvert la voie aux États-Unis qui peuvent, dès lors, viser ouvertement l'annexion d'une portion du territoire européen.
«Qui sont nos ennemis? Qui sont nos amis?»: c’est là une question de première importance pour toute révolution nécessaire, une phrase bien connue et familière à la majorité des Chinois. Aujourd’hui, apparemment, l’Europe a besoin de cette sagesse. Dans les relations internationales, il n’y a ni amis ni ennemis permanents: l’Europe doit donc faire face à la situation avec réalisme et lucidité.
L’Europe a longtemps cru que les États-Unis étaient ses amis, mais les États-Unis voient-ils l’Europe de la même façon?
Malgré la présence de bases militaires américaines au Groenland et des preuves qui réfutent les affirmations sur la présence de navires de guerre russes et chinois dans la région, les États-Unis auraient pu obtenir facilement ce qu’ils veulent, qu’il s’agisse de ressources minérales ou de routes maritimes arctiques, en renforçant leurs liens militaires avec le Groenland. Cependant, cette fois, Washington s'exprime clairement sur un point: les Américains ne recherchent plus seulement la coopération mais exigent la souveraineté pleine et entière sur le Groenland. Et ils estiment que l’Europe n'opposera probablement que peu de résistance sérieuse.
L’escalade des actions et de la rhétorique américaines montre au monde que, pour les États-Unis, le Groenland est une priorité incontournable. La vraie question est maintenant de savoir si l’Europe pourra faire comprendre à Washington qu’elle est, elle aussi, déterminée à défendre la souveraineté territoriale de ses États membres souverains.
14:25 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : états-unis, europe, groenland, affaires européennes, souveraineté, souveraineté européenne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 26 janvier 2026
Cinq raisons pour lesquelles la droite allemande doit se détourner du culte MAGA - Ainsi que toutes les droites et les gauches européennes...

Cinq raisons pour lesquelles la droite allemande doit se détourner du culte MAGA
Ainsi que toutes les droites et les gauches européennes...
par Bruno Wolters
Source: https://www.freilich-magazin.com/politik/fuenf-gruende-wa...
Le culte qui s'est créé autour du mouvement « MAGA » révèle, chez une partie de la droite allemande, moins une force qu’une dépendance stratégique, et menace de subordonner les intérêts européens à des jeux de pouvoir étrangers. Bruno Wolters met en garde contre le fait que la souveraineté politique ne peut naître que lorsque l’on maintient une distance vis-à-vis des cycles d’excitation médiatiques lancés par les services américains.
Il y a des moments où la proximité politique ne signifie pas la force mais la dépendance. L’enthousiasme actuel pour le fatras idéologique du mouvement MAGA chez une large partie de la droite européenne – en particulier en Allemagne – l'atteste. Ce qui a commencé comme une sympathie tactique s’est, dans certains cas, transformé en une soumission mentale.
L’une des tentations classiques des mouvements politiques est de considérer les succès étrangers comme des succès à soi. La fixation d’une partie de la droite allemande sur Donald Trump et le milieu MAGA est l’expression exacte de cette tentation: on projette ses propres désirs, conflits non résolus et blocages stratégiques sur un acteur étranger, en oubliant que ses actions ne sont ni destinées ni adaptées à l’Europe.
Ce n’est pas seulement imprudent sur le plan politique mais aussi stratégiquement dangereux – surtout maintenant que le président américain et ses conseillers veulent, après le Venezuela, aussi contrôler le Groenland. Il s’agit ici d'un territoire danois, donc de l'espace souverain d’un partenaire de l’OTAN, qui s’est montré au fil des décennies comme l’un des alliés américains les plus loyaux.
Conséquence: selon certains médias, Trump aurait ordonné à ses militaires d’élaborer des plans offensifs, tandis que les généraux tenteraient de le distraire en abordant d’autres sujets. La cupidité de Trump pour le Groenland ne doit pas nous apaiser – et que se passerait-il s’il déclarait que les bases américaines en Europe, comme Ramstein, deviendraient toutes territoire américain? Avec l’instabilité de Trump, tout doit être envisagé. Cela signifie que la droite allemande et européenne doit suivre une voie différente de celle du mouvement MAGA.
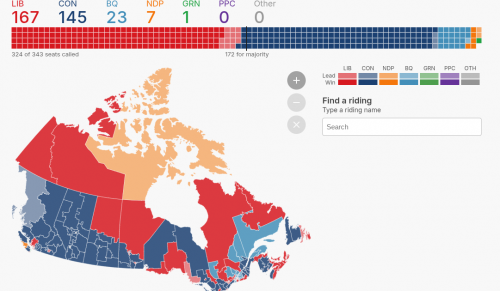
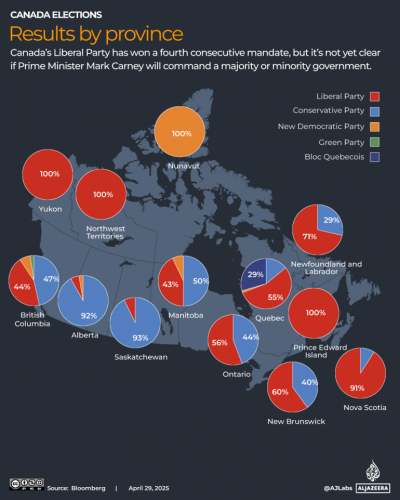
1. Le piège canadien: quand la souveraineté nationale devient soudain réalité
Au Canada, jusqu’à peu près avant les élections de l’été 2025, une victoire claire des conservateurs sur les libéraux au pouvoir était attendue, jusqu’à ce que Trump, avec ses fantasmes d’annexion ("51ème État") et ses taxes punitives, ne bouleverse la rhétorique de la campagne. Début 2025, selon des études, les conservateurs avaient près de 30 points de pourcentage d’avance sur leurs rivaux de gauche et libéraux. Mais ce qui a suivi n’a pas été une révolte de gauche ou une campagne morale, mais une réaction souverainiste des électeurs. Les sondages montraient que la majorité des Canadiens percevaient ces débordements comme une attaque contre leur souveraineté nationale, tandis que, contre toute attente, les supporters conservateurs de Trump au Canada étaient soudain considérés comme des collaborateurs potentiels du futur ennemi américain. Le parti conservateur, proche de Trump, a ainsi perdu son avantage.
C’est ici que cet exemple canadien devrait servir d'avertisseur pour la droite allemande. S’attacher de manière démonstrative à un président américain dont la rhétorique remet en question la souveraineté d’autres pays, voire la sienne propre, envoie un message à son propre peuple et lui dit que le destin de la nation dépend finalement des caprices d’un autre continent. Les sondages sur le gouvernement Trump montrent à quel point sa personne est polarisante: les républicains l’aiment, les démocrates le détestent, et les indépendants sont divisés. Pour la droite et la mouvance conservatrice allemandes, cela signifie: s’accrocher à une figure aussi divisive consiste aussi à importer une telle division en Europe, sans toutefois posséder les moyens de puissance correspondants.
Une dépendance trop étroite à l'endroit du mouvement MAGA comporte le danger d’être perçu non pas comme une force nationale indépendante mais comme une formation qui importe des conflits étrangers. Le message des électeurs canadiens est clair: faire de son pays un appendice des projets d'une puissance étrangère, c’est perdre sa légitimité. Nous, Européens, ne devons pas faire cette erreur à notre tour.
2. La souveraineté mentale comme condition d’efficacité politique
Trump et son mouvement MAGA mènent une politique selon le modèle de l'«escroquerie populiste de droite»: d’abord, la colère populaire contre l’immigration, le terrorisme et la désindustrialisation est attisée. Ensuite, les populistes de droite sont élus, qui font beaucoup de bruit, puis agissent de manière perturbatrice en politique étrangère en étant principalement au service des intérêts de l’élite politique et économique, sans changer fondamentalement la situation intérieure. Finalement, ils sont houspillés hors des allées du pouvoir, la gauche reprend alors celui-ci, aggravant la situation – et le cycle recommence. Ce mécanisme s’applique désormais au mouvement MAGA, presque comme un cas suggéré par un manuel. En Europe, on a aussi pu voir ce modèle dans le gouvernement de Wilders aux Pays-Bas.
Après un peu plus d’un an au pouvoir, l’administration MAGA semble politiquement épuisée: le bilan de la rémigration promise et annoncée est à peu près le même que celui des gouvernements démocratiques précédents, les chiffres des expulsions réelles restent dans la moyenne, tandis que des "expulsions spectaculaires" et symboliques sont médiatisées. L'inflation, la migration massive et les ruptures sociales ne sont pas résolues, voire empirent – et les premières analyses économiques indiquent que la politique douanière a détruit plus d’emplois qu’elle n'en a créés. Beaucoup de promesses et d'annonces n’ont pas été concrétisées jusqu’à présent. Trump s’en démarque même.

Cela signifie que MAGA remplit exactement la fonction systémique esquissée par l'effet «scam»: la colère populaire est canalisée, transformée en une politique de type affectif et en une mise en scène médiatique, mais pas en réformes structurelles véritables. Le système d’immigration reste essentiellement inchangé, les structures de soutien au combat anti-blancs ne sont pas remises en question, et l’administration libérale reste intacte. Pour la droite allemande, c’est une leçon: s’aligner sur un populisme de droite de ce type, c’est adopter un mécanisme qui génère de l’indignation pour la neutraliser politiquement.
Car l’Europe ne deviendra pas une grande puissance ou une puissance spatiale tant qu’elle restera mentalement dans la zone d’avant-garde des États-Unis. Cela concerne non seulement les gouvernements, mais aussi l’opposition. Un mouvement de droite qui tire son énergie politique des batailles culturelles américaines, des cycles électoraux et des rituels d’indignation made in USA, ne pense pas souverainement, mais réactivement: pure agitation sans effets réels.
Les études sur le soutien à Trump illustrent ce problème précis. MAGA n’est pas un projet qui intègre la nation, mais un phénomène de constitution de camps fortement polarisés. Même aux États-Unis, le mouvement MAGA ne subsiste que de manière fragmentaire. Le rejet massif par les indépendants, la division selon des lignes culturelles et sociales, ainsi que la diminution du soutien en dehors de la base dure, ne parlent pas en faveur d’un modèle à exporter.
La souveraineté mentale consiste à analyser la réalité politique de manière objective, plutôt que de s’enivrer d’images où force et dureté sont obscènement mises en exergue. Ceux qui réagissent constamment aux signaux venus d'Amérique perdent de vue leurs propres nécessités stratégiques.

3. Les intérêts des États-Unis ne sont pas les nôtres – et ne l’ont jamais été
L’une des erreurs les plus tenaces de la droite européenne est de supposer qu’un président «de droite» aux États-Unis serait un allié naturel. Cependant, cette supposition ignore des faits fondamentaux d’ordre géopolitique. Les États-Unis agissent comme un empire – indépendamment de celui qui siège à la Maison Blanche. Leurs intérêts sont structuraux et idéologiques.
Les États-Unis poursuivent – indépendamment de leur administration – la stabilisation de leur empire. Un sondage sur une intervention militaire américaine montre qu’au sein même de la population américaine, un équilibre existe entre les réponses «opposition», «soutien» et «indécision», alors que les camps politiques s’opposent. Mais que l’on lise 47% de rejet ou 33% d’approbation: pour Washington, ce qui compte, c’est que la machine de la politique étrangère continue de fonctionner, peu importe si l’Europe en bénéficie.
Mais: le conflit imminent avec la Chine est perçu par Washington comme existentiel. Pour l’Europe, la Chine est principalement un partenaire économique, moins une menace géopolitique ou idéologique. Pour l’Allemagne, la coopération avec la Chine est cruciale pour l’industrie et l’exportation. Une politique ignorant cette réalité nuit à ses propres bases.
Il en va de même pour la question énergétique. La dépendance croissante de l’approvisionnement énergétique européen à des intérêts américains crée de nouvelles dépendances. L’énergie devient un levier de pression politique – même sur les alliés. Ceux qui pensent pouvoir désamorcer cela par proximité idéologique se méprennent sur la logique de la politique de puissance.
L’Europe a d’autres intérêts fondamentaux: la coopération économique avec de nombreux autres pays, une fourniture d’énergie stable et l’évitement de guerres d’intervention coûteuses qui génèrent des flux migratoires. Si la droite allemande se laisse entraîner dans «les combats à mort» qui agitent l’imperium américain – cela va du changement de régime réclamé en Iran à la surveillance des champs pétrolifères vénézuéliens –, elle adopte un agenda qui déstabilise ses propres sociétés.
Ajoutez à cela la question énergétique et monétaire: avec la perte progressive du pouvoir du dollar américain, l’incitation pour Washington d’exercer une pression politique via des ressources énergétiques et des régimes de sanctions s’accroît. Une dépendance durable de l’approvisionnement énergétique allemand aux diktats américains signifierait que toute politique indépendante envers la Russie ou la Chine pourrait être indirectement sanctionnée. Ceux qui brandissent dans de telles conditions des drapeaux MAGA contribuent involontairement à fixer la République fédérale comme avant-poste industriel d’une grande puissance étrangère. Qui exige la souveraineté doit d’abord la penser. Et ceux qui prennent au sérieux l’indépendance européenne ne peuvent plus se laisser lier aux cycles d’excitation propagés par un empire étranger.

4. Dommages à la réputation: la menace MAGA comme hypothèque stratégique
Un problème central de la gouvernance MAGA actuelle réside moins dans ses échecs ouverts dans certains domaines politiques que dans la manière dont le pouvoir est désormais exercé de manière démonstrative: non comme une puissance étatique, mais comme un réseau personnel. Non plus comme un projet politique, mais comme un réseau familial et économique.
Ce que l’on observe actuellement aux États-Unis, ce n’est pas une renaissance nationale, mais un affaiblissement rapide des intérêts politiques qui y sont liés. L’entourage immédiat de Trump agit de plus en plus comme une structure parallèle d’entrepreneurs: projets cryptographiques non ironiques avec un caractère évident de scam, construction de marques personnelles utilisant la proximité politique, accès privilégié pour les grands donateurs et les oligarques technologiques, qui ne jouent plus le rôle d’alliés mais de co-gouvernants.
Ce n’est pas un argument moral mais un argument qui doit évoquer la réputation. Ceux qui se lient de manière démonstrative au mouvement MAGA ne s’attachent pas à «l’Amérique» ou à une transformation de l’État dans un sens idéologiquement conservateur, mais à un milieu de plus en plus étroit d’intérêts familiaux, de capital-risque, de monopoles technologiques et de patronage politique. La frontière entre pouvoir politique et avantage privé n’est plus dissimulée mais ostentatoirement acceptée.
Plutôt que d’être perçue comme une contre-force souveraine, une telle alliance, étiquetée nationaliste, populiste ou conservatrice, risque d’apparaître comme la branche provinciale d’un milieu oligarchique américain. Non comme une force sérieuse avec ses propres réponses mais comme spectatrice enthousiaste de jeux de pouvoir étrangers. Cela nuit non seulement à la crédibilité, mais aussi à toute stratégie à long terme.
Précisément parce que la confiance dans les institutions politiques s’effrite, la crédibilité devient la ressource la plus rare de toute opposition. Toute proximité visible avec un réseau de fraude cryptographique, de deals d’oligarques et de patronage familial affaiblit cette ressource – non seulement auprès des opposants mais aussi auprès des électeurs potentiels qui espèrent restaurer l’ordre, la transparence et la justice sociale. Une droite européenne souveraine doit donc maintenir ses distances: aussi bien vis-à-vis du culte MAGA en tant que figure cultuelle que vis-à-vis des réseaux environnants d’argent, de glamour et de spectacles numériques.
5. Solutions propres – la droite multipolaire plutôt que l’importation MAGA
Pour la droite européenne, un rare créneau temporel s’ouvre actuellement: celui de la possibilité de maintenir une distance dans la dignité. Ceux qui abandonnent maintenant leurs illusions gagnent du temps pour la théorie, l’organisation et la construction stratégique. Ceux qui persistent dans le culte du mouvement MAGA risquent une perte massive de crédibilité. Il est temps de formuler une stratégie européenne indépendante qui associe rémigration, souveraineté et rationalité économique, sans s’attacher aux cycles de la politique intérieure américaine.
De plus, l’usure intérieure du camp MAGA est manifeste: le «tournant» promis n’a pas eu lieu, des scandales majeurs n’ont pas été élucidés, et économiquement, ce sont surtout les grands donateurs, les réseaux néocon et l’entourage familial immédiat de la direction qui ont profité. La collusion apparente avec le grand capital et les intérêts lobbyistes n’est même plus dissimulée mais célébrée comme une expression de «puissance». Le prix en est la déconnexion avec les électeurs qui rêvent d’une véritable renaissance sociale ou nationale.
Le danger est réel que des acteurs américains tentent d’utiliser le populisme de droite européen comme le vecteur d'une vassalisation renouvelée. La dépendance énergétique, les exigences de loyauté géopolitique et la pression économique en seraient les conséquences. La démocratie chrétienne classique est aujourd'hui épuisée – une nouvelle mouvance porteuse doit être trouvée.
Une stratégie européenne indépendante devrait, en revanche, être sobre et orientée par ses propres intérêts. Elle n’éviterait pas des questions difficiles telles: la relation avec la Russie, la coopération économique avec la Chine, le rejet d’une politique extérieure uniquement basée sur le moralisme niais au profit de calculs politiques réalistes. Une démarcation consciente par rapport aux luttes simulées et mimétiques, le tout au profit d’une conquête silencieuse mais résolue des institutions nationales, voilà ce qui serait nécessaire.
Conclusion: contre le fallacieux populisme de droite
Le populisme de droite d’aujourd’hui n’a pas disparu mais s’est adapté. Il utilise un langage, des codes et des affects de droite sans en réaliser les objectifs. Il canalise l’énergie de la protestation, la neutralise, puis la ramène dans le système existant de façon contrôlée. Ceux qui veulent un changement réel doivent apprendre à reconnaître aussi le populisme de droite comme une impasse potentielle. MAGA en est l’exemple le plus visible. Pour la droite allemande, ce serait un signe de maturité de tourner froidement la page de ce culte – non pas par anti-américanisme, mais par simple conscience que les peuples qui ne se représentent pas eux-mêmes sont gérés par d’autres.
La droite allemande doit faire un choix : continuer à agir dans l’ombre de puissances étrangères – ou agir enfin de manière indépendante. La souveraineté n’est pas une pose. C’est une séparation délibérée.
À propos de l’auteur: Qui est Bruno Wolters?
Bruno Wolters est né en 1994 en Allemagne et a étudié la philosophie et l’histoire dans le nord de l’Allemagne. Depuis 2022, Wolters est rédacteur de la revue Freilich. Ses domaines d’intérêt sont l’histoire des idées et la philosophie politique.
22:25 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, allemagne, droite allemande, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Pourquoi la politique allemande est-elle si faible sur le plan stratégique?

Pourquoi la politique allemande est-elle si faible sur le plan stratégique?
Markus G. Bußmann, MBA
Source: https://www.linkedin.com/in/markusgbussmann/
C'est simple. Parce que la politique allemande est systématiquement conçue pour sa propre gestion, et non pour une stratégie bien précise. Il ne s'agit pas de l'échec personnel de certains politiciens mais d'un défaut de conception conforme à la norme DIN.
Voici 7 raisons qui expliquent pourquoi nous semblons si dépassés et pourquoi cette situation devrait perdurer:
1. La gestion plutôt que la pensée stratégique
L'Allemagne se considère comme le gardien moral du monde. Or, toute stratégie cohérente exige de penser explicitement en termes de pouvoir, d'intérêts et de conflits. À Berlin, on considère cela comme indécent. On préfère réagir "correctement" mais toujours trop tard. L'État fonctionne comme un service d'urbanisme obstiné avec une perception extérieure déplorable.
2. Les coalitions tuent la vision à long terme
Les cycles de quatre ans et les calculs cogités par toute coalition conduisent à une politique basée sur le principe suivant: ce qui ne suscite pas de controverse aujourd'hui est déjà stratégique.
Les grandes lignes ne survivent pas aux négociations de la coalition en cours. Elles sont édulcorées jusqu'à ce que plus personne ne s'y oppose, mais que plus personne ne les soutienne non plus. Nous avons affaire à un ragoût consensuel au lieu d'un changement de cap.
3. Le consensus comme substitut à la décision
En Allemagne, le consensus est considéré comme une catégorie morale. Mais la stratégie a besoin de dissensions et de priorités. Celui qui veut tout prendre en compte ne donne la priorité à rien. Celui qui ne donne la priorité à rien se voit imposer des priorités par d'autres.
4. Forte domination des juristes et de l'administration
L'élite allemande raisonne en termes de :
- compétences
- procédures
- risques constitutionnels
Et non en termes de :
- scénarios
- changements de pouvoir
- dépendances
Le droit remplace la réalité. D'un point de vue juridique, cela semble correct, conforme, à première vue, mais c'est complètement irréaliste.
5. L'économie est considérée à tort comme un secteur qui fonctionne tout seul
Pendant des décennies, on a cru que la puissance industrielle était une loi naturelle en Allemagne. Donc:
- pas de programme de recherche ambitieux
- pas de stratégie technologique
- pas de culture startup
Lorsque d'autres États ont commencé à subventionner, protéger et orienter stratégiquement, l'Allemagne a déclaré que c'était incorrect, puis qu'il n'y avait pas d'autre alternative.
6. Un frein historique
Après 1945, un profond malaise s'est développé à l'égard de tout ce qui ressemble à l'intérêt national. C'est compréhensible, mais cela a des conséquences :
- les intérêts sont dissimulés sous des considérations morales
- les questions de pouvoir sont externalisées
- le leadership est délégué à des règles
Les règles sont une bonne chose. Mais elles ne dirigent pas les pays.
7. Une politique sans prix à payer pour les erreurs
Les erreurs stratégiques n'ont pratiquement aucune conséquence sur les personnes dans ce pays. In fine, personne n'est responsable. Et personne ne démissionne à cause d'erreurs
- de dépendances
- de prévisions
- d'attentes en matière de risques
Sans responsabilité, pas de stratégie. La politique allemande n'est ni stupide ni incompétente. Elle est simplement optimisée structurellement pour la stabilité, et non pour un véritable changement. Cela fonctionne très bien en période calme.
Dans un monde marqué par la rivalité entre Xi, Poutine et Trump, par les guerres technologiques et la formation de blocs, cela revient à participer à une course automobile en respectant parfaitement le code de la route. Et ensuite, le conducteur vertueux demande avec un grand sérieux pourquoi les autres ont un comportement inconsidéré.
21:34 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, affaires européennes, allemagne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Israël favorise le séparatisme du Somaliland pour ouvrir des bases militaires dans la mer Rouge, attaquer le Yémen et déclencher une crise régionale

Israël favorise le séparatisme du Somaliland pour ouvrir des bases militaires dans la mer Rouge, attaquer le Yémen et déclencher une crise régionale
Davide Rossi
Source: https://telegra.ph/Israele-fomenta-il-separatismo-del-Som...
Le risque d’enflammer la Corne de l’Afrique par de nouvelles guerres est totalement évident, c'est peut-être même l’un des objectifs criminels subtilement poursuivis par Tel Aviv.
Femmes d’une beauté inhabituelle, sultanats somnolents, dunes de sable blanc entre palmiers luxuriants au bord d’une mer d’un bleu cristallin: à la fin du 19ème siècle, la Somalie n’est que cela, ou peu s’en faut, tandis que, devant la côte, les navires britanniques multiplient leurs passages: ce sont de puissants vaisseaux provenant des vastes territoires du vice-royaume des Indes, en direction de Bab el Mandeb, pour ensuite se diriger vers les côtes britanniques, traversant la mer Rouge et le canal de Suez.
Tout commence avec le retrait de la Corne de l’Afrique par le khedivat d’Égypte, une province ottomane oubliée par Istanbul, qui exerce pendant longtemps une autorité de plus en plus nominale sur les sultanats locaux. Les Italiens, grâce au commerce lancé par Raffaele Rubattino, achètent en 1869 la baie d’Assab, donnant naissance à la colonie d’Érythrée. En Somalie, ils ne mènent pas une guerre coloniale, mais signent plusieurs accords avec les souverains locaux, créent des échanges amicaux, autant de collaborations basées sur une protection mutuelle, qui devront aussi, par la suite, être menés avec les fusils de quelques contingents militaires, mais sont plutôt réalisés en entraînant des jeunes locaux par quelques officiers en quête d’exotisme, et surtout en envoyant des explorateurs et géographes qui laissent des journaux et des descriptions toutes empreintes de désirs sensuels.
Le jeune et très pauvre royaume d’Italie de l’époque, bien que bercé par l’esprit colonial de son temps, nécessaire pour entrer dans le cercle très convoité et restreint des grandes puissances, n’envoie pas tant de soldats que des islamologues et des arabisants, à la recherche d’une convergence espérée plutôt que d’une soumission explicite. Au début du 20ème siècle, se forme en arabe le terme Al-Sumal Al-Italiy et en somali Dhulka Talyaaniga ee Soomaaliya. Mogadiscio, qui deviendra le siège de la colonie puis la capitale de la nation indépendante à partir de 1960, est louée à la Société Commerciale Italienne par le sultanat de Zanzibar, disparu un quart de siècle plus tard à l’expiration du contrat, permettant ainsi aux Italiens de s’y établir définitivement en faisant disparaître le précédent propriétaire.
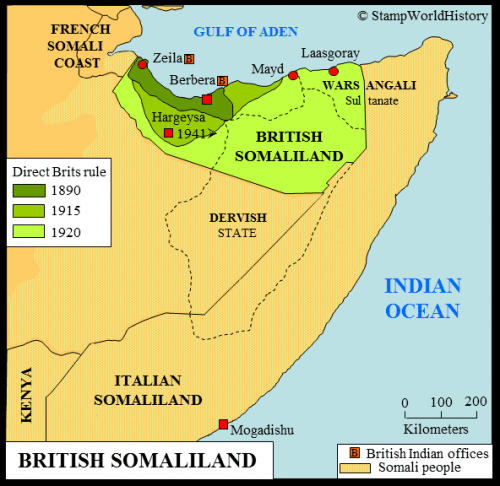
Pour la reine Victoria, cette pénétration des Italiens, d’abord en Érythrée puis en Somalie, à quelques milles marins de l’entrée de la mer Rouge, est très gênante, et en 1884, elle donne mandat et ordre à ses sujets stationnés à Aden, de l’autre côté du golfe, à la limite de la péninsule arabique, de procéder à une occupation effective et pleinement coloniale d’une partie considérable de la terre des Somali, ainsi naît la Somalie Britannique, qui restera telle jusqu’en 1960, pour ensuite rejoindre la nouvelle Somalie socialiste et indépendante, et retrouver une autonomie pleine – sinon formelle, du moins substantielle – jusqu’à ce que Washington, avec une superficialité encore plus inattendue, déclenche une guerre tribale d’une violence féroce. Le Somaliland, aujourd’hui reconnu officiellement par Israël seul, avide de protéger ses intérêts économiques et militaires en agissant comme un élément de déstabilisation régional, est le produit de cette histoire longue, complexe et embrouillée.
Les Anglais, bien sûr, n’oublient pas leurs alliés français. Ensemble, ils ont construit le canal de Suez, et jusqu’à leur expulsion en 1956 par la volonté de Gamal Abdel Nasser, ils gèrent ce canal et partagent les bénéfices qu'ils en tirent. Ils soutiennent la conquête des terres d’Afar et d’Issa, noms arabes de Jésus, qui deviendront plus tard la Somalie française et aujourd’hui Djibouti.

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, l’Italie est sévèrement battue en Afrique orientale en novembre 1941, et l’Érythrée ainsi que la Somalie passent sous contrôle britannique, tandis que l’Éthiopie redevient un royaume indépendant dirigé par le Negus Hailé Selassié. En 1952, les Nations unies unifient l’Érythrée à l’Éthiopie, tandis que, dès 1950, la Somalie est déjà confiée à une administration fiduciaire italienne, gouvernée par des démocrates-chrétiens durant une décennie, jusqu’à la reconnaissance de son indépendance le 1er juillet 1960. Cela suscite beaucoup d’espoirs, malgré une réalité modeste où 60% des exportations sont constituées de bananes. La Somalie emprunte alors, comme une grande partie des nations africaines, l’un des nombreux chemins créatifs vers le socialisme, mais cette expérience dure moins de trente ans, laissant place à une guerre civile, qui peut à tous égards être considérée comme le conflit le moins suivi par les médias occidentaux et le plus oublié par l’opinion publique mondiale.
Déclenchée en 1986, on ne peut encore dire, après quarante ans, qu’elle soit totalement terminée. Au cours des cinq premières années, l’Occident a fomenté des divisions tribales et, comme toujours, le séparatisme ethnique pour déstabiliser et renverser la République démocratique somalienne, dirigée depuis 1969 par Siad Barre (photo).
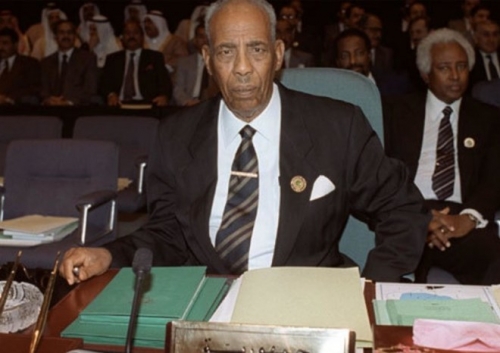
La situation empire avec le conflit entre la Somalie et l’Éthiopie, qui, depuis 1974, est devenue une République populaire démocratique, également de tendance socialiste, dirigée par Mengistu Hailé Mariam, et fortement soutenue par Cuba. En 1991, Siad Barre démissionne, révélant a posteriori l’ampleur de problèmes bien difficiles à surmonter par lui-même. Un gouvernement unitaire, représentant toutes les tribus et groupes claniques, est alors formé, probablement le seul dans l’histoire de l’humanité avec quatre-vingts ministres. Cela peut sembler ridicule, mais c’est en réalité très tragique: le gouvernement disparaît plus rapidement que la lenteur énorme qui a permis sa formation, et la Somalie sombre encore pendant cinq ans dans une guerre d’une violence et d'une cruauté inouïes, peut-être les années les plus terribles, où les forces armées tribales, notamment celles du général Aidid, prennent le pouvoir.

En 1992, les Américains imposent aux Nations unies une mission humanitaire armée, la première depuis 1945. Elle n’est pas menée avec des cahiers de charge, des écritures ou des distributions de semences, mais avec des armes, et malheureusement, d’autres suivront. La mission porte le nom pompeux et inapproprié de "Restore Hope" — "Restaurer l’Espoir" — et jamais un nom n’a été plus dramatiquement contredit, avec des milliers de morts et une interminable traînée de sang. Après la défaite de l’espoir, les Américains croient pouvoir instaurer la paix avec une opération encore plus militaire, cette fois dénommée "Gothic Serpent", pensant peut-être agir comme dans un jeu vidéo. Ce sera un échec total qui contribuera à rendre la guerre civile encore plus atroce. En fin de compte, les États-Unis compteront dix-neuf soldats morts et la chute de deux hélicoptères Black Hawk, dont les images font le tour du monde.
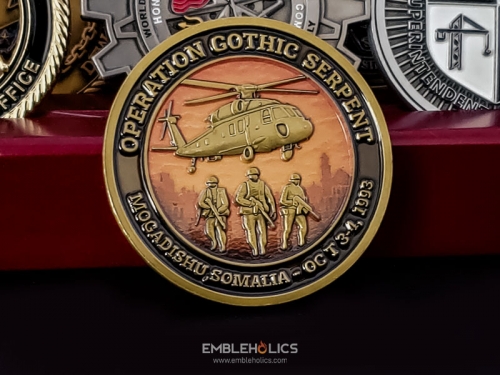

Le 20 mars 1994, à Mogadiscio, la journaliste de la RAI Ilaria Alpi (photo) et le caméraman slovène Miran Hrovatin (photo) de Trieste sont assassinés parce qu’ils ont découvert comment l’Italie abandonnait en Somalie, à ciel ouvert et en mer, une quantité indescriptible de bidons contenant des déchets radioactifs issus des centrales nucléaires italiennes de modestes dimensions et de certains déchets provenant des centrales françaises, en échange d’énergie que Paris fournit alors au Val d’Aoste et au Piémont.
Entre-temps, l’Occident et l’ONU abandonnent la Somalie au printemps 1995, constatant l’échec de la dernière mission organisée par le Conseil de sécurité, la mission "United Shield" — une tentative sobre mais inutile, sans assumer la responsabilité du chaos qu’ils ont précédemment causé, et sans se soucier de la tragédie humanitaire, avec des femmes, des hommes, des enfants et des personnes âgées mourant de faim et de maladies, tout en étant les victimes civiles d’un conflit sans règles, sauf celles de la survie et du tribalisme le plus sauvage —, tout cela sous influence de financements internationaux peu transparents, impliquant les États-Unis et l’OTAN, et avec la présence de groupes terroristes d’inspiration religieuse, d’abord les Tribunaux islamiques, puis le Hizb al-Shabaab (le Parti des Jeunes), et d’autres groupes qui revendiquent, on ne sait pas dans quelle mesure en vérité, une appartenance à l’État islamique.
Il est certain que les missions de l’ONU de 1992 à 1995 et les contingents américains n’ont rien résolu, ni soulagé la souffrance de la population, ni apporté un quelconque espoir. Au contraire, ils ont aggravé une situation déjà dramatique au départ.
Seule l’intervention de la Turquie, sous la direction de Recep Tayyip Erdoğan, au cours des cinq dernières années, a réussi à instaurer une paix relative entre les parties en conflit, en proposant un projet crédible de coopération et d’aide pour sortir la Somalie d’une saison de quarante ans de destructions dévastatrices, avec des répercussions énormes sur la population civile et un nombre incalculable de morts.
Dans tout cela, les habitants et les figures politiques du Somaliland, insatisfaits des impositions de l’État unitaire, ont exploité la guerre civile et le conflit tribal pour parvenir, avec le soutien de Washington et de Londres, toujours favorables au séparatisme ethnique, à la déclaration d’indépendance le 18 mai 1991. Le président, en fonction de 2017 à 2024, Muse Bihi Abdi, a accueilli dans la capitale Hargeisa et dans le port de Berbera des délégations du Royaume-Uni, de l’Union européenne et de Taïwan, avec qui il a signé un accord bilatéral de coopération et de reconnaissance mutuelle.

L’Éthiopie, qui cherche une sortie vers la mer Rouge, a signé en janvier 2024 un mémorandum d’accord avec le Somaliland, prévoyant l’accès éthiopien aux ports, provoquant des protestations évidentes du président somalien Hassan Sheikh Mohamud, qui dénonce à maintes reprises et avec raison les ambitions séparatistes du Puntland, région somalienne du nord limitrophe du Somaliland. Le Puntland s’est déclaré indépendant en 1998, durant la guerre civile, bien qu’au cours des dernières années, il ait accepté d’être considéré comme partie intégrante de l’État fédéral somalien, avec son propre président, Said Abdullahi Dani, en fonction depuis 2015. Grâce à la médiation turque, pour éviter de nouveaux conflits, l’accord Somaliland – Éthiopie est pour l’instant suspendu.
La situation s’est aggravée en décembre 2025 par la reconnaissance honteuse des séparatistes du Somaliland par l'Etat sioniste, intéressé à faire venir dans la Corne de l’Afrique une importante partie des Palestiniens que Benjamin Netanyahu, criminel internationalement reconnu comme tel, souhaite déporter, ainsi que par l’ouverture prévue d’une ou plusieurs bases militaires aériennes et navales israéliennes sur la côte de la mer Rouge, dans le but d’attaquer plus facilement les Houthis yéménites. Par ailleurs, l’adhésion programmée du Somaliland via la signature de l’accord d’Abraham par le président actuel Abdirahman Mohamed Abdillah représentera non seulement la reconnaissance de l’État sioniste, mais aussi et surtout le déclenchement d’une crise régionale très grave.
Le président somalien Hassan Sheikh Mohamud, élu en 2022, a déclaré, avec le soutien unanime de toute l’Union africaine, ainsi que celui de la Turquie et de la Chine, engagées depuis longtemps dans la reconstruction de la Somalie après les années dévastatrices d’abandon et de terrorisme promus par Washington, que le risque d’enflammer la Corne de l'Afrique par de nouvelles guerres est totalement évident, c'est peut-être même l’un des objectifs criminels poursuivis sournoisement par Tel Aviv.
13:49 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : somaliland, afrique, corne de l'afrique, somalie, affaires africaines, actualité, géopolitique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 24 janvier 2026
La scission interne et irréversible au sein de l’Occident - Une transformation fondamentale de toute l’architecture mondiale
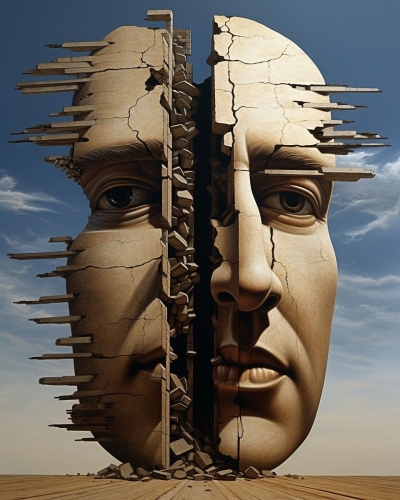
La scission interne et irréversible au sein de l’Occident
Une transformation fondamentale de toute l’architecture mondiale
Alexandre Douguine
Alexandre Douguine sur la fracture irréversible de l’Occident, les gambades impériales de Trump, et l’émergence de cinq pôles occidentaux concurrents.
Entretien avec Alexander Dugin pour l’émission « Escalation » de Sputnik TV.
Animateur: Les fêtes de début 2026 ont apporté une nouvelle qui évoque inévitablement les grands bouleversements du passé. La presse discute activement de l’initiative de Donald Trump concernant le Groenland, en la comparant à l’achat de l’Alaska. On dit que si Trump parvient à acquérir l’île, son nom sera associé à celui des plus grands présidents américains. Selon vous, l’acquisition du Groenland est-elle l’un des principaux objectifs de Trump pour les États-Unis, une manière pour lui d’entrer dans l’histoire ?
Alexandre Douguine: Je pense que Trump a certainement un tel objectif, mais ce n’est pas le principal. Devant nos yeux se déroule une transformation fondamentale de toute l’architecture mondiale. Dans l’histoire des États-Unis, aux côtés de l’achat de l’Alaska, il y a également l’achat de la Louisiane, qui appartenait à un régime totalement différent, ainsi que la guerre avec le Mexique, après laquelle les États-Unis ont annexé deux tiers de son territoire. L’expansion d’une sphère d’influence est une constante de la politique américaine.
Aujourd’hui, Trump a proclamé une «Doctrine Monroe» avec son propre «corollaire», c’est-à-dire l’affirmation des États-Unis comme le seul hégémon de l’Hémisphère occidental. Nous l’avons vu dans le cas du Venezuela: l’enlèvement de Maduro et la mise du pays à genoux, pratiquement sans un seul coup de feu. Désormais, les politiciens américains gouvernent là-bas comme si c’était leur propre arrière-pays, et Trump n’écrit pas par hasard sur les réseaux sociaux qu’il est le «président par intérim de l’Argentine». Dans cette logique, le Groenland est une extension géographique naturelle du continent nord-américain.
Cependant, Trump ne s’arrêtera pas là. Le Premier ministre actuel du Canada se prépare déjà, en fait, à une guerre contre les États-Unis — le Canada doit se préparer comme s'il allait être le toute prochaine cible. Je pense que Trump obtiendra gain de cause tant pour le Groenland que pour le Canada. Bien que des problèmes puissent encore apparaître avec l’Amérique du Sud, l’absorption du Canada sera simplement «avalée» par tout le monde. Certains diront que nous avons été malchanceux d’avoir eu un tel président; d’autres diront qu’il a vraiment rendu l’Amérique grande à nouveau.

La situation autour du Groenland révèle un fait crucial: il y a désormais une scission complète au sein de l’Occident. L’Occident uni n’existe plus. Il peut nous combattre, combattre l’Iran ou le Venezuela, mais il est désormais prêt à se livrer des combats aussi à l'intérieur de son propre camp. Nous avons vu les tentatives pitoyables de l’Union européenne d’envoyer quelques troupes au Groenland pour «le protéger» d’une menace fictive de la Russie et de la Chine. Mais dès que Trump a lancé un ultimatum sur les tarifs douaniers, Friedrich Merz a immédiatement retiré son petits groupe de soldats.
Trump dit ouvertement aux Européens: «Vous êtes mes vassaux, faites ce que je vous ordonne». Lorsqu’il leur dit de faire la paix avec les Russes — ils doivent faire la paix. Lorsqu’il leur dit de céder le Groenland — ils doivent le céder. Lorsqu’il leur dit de soutenir Netanyahu — ils doivent le soutenir. Pendant des décennies, la direction mondialiste des États-Unis a créé l’illusion que l’Europe était un partenaire avec une voix au chapitre. Maintenant, ces illusions se sont brisées. Trump leur dit sans détours: «Vous n’êtes personne, juste des bras armés, des livreurs de pizzas ou des travailleurs migrants. Si je prends le Groenland, vous devez répondre: ‘Oh, cher Papa Trump, prends-le vite, sauve-nous des méchants Russes et Chinois avec leurs sous-marins». Voilà le monde dans lequel nous vivons: Trump frappe du poing sur la table, et l’Europe — ayant brièvement tenté de prétendre qu’elle défendrait le Groenland contre l’Amérique — capitule rapidement.

Trump est prêt à démanteler l’OTAN, puisque l’alliance se compose déjà de 95% de ressources américaines. Ce qui se passe aujourd’hui n’est pas seulement une humiliation colossale pour l’Europe (les émotions passeront), c’est la fin de l’ancien Occident collectif. L’épisode du Groenland est devenu un test de référence, révélant une image unique: un monolithe autrefois uni, avec lequel nous nous battions encore il y a un an, s’est brisé en cinq pôles différents.
Le premier Occident, c’est Trump lui-même. Il déclare: «Je suis l’Occident, et tous les autres ne sont que des décors». Il se comporte comme un cow-boy prêt à «bombarder» tout le monde — ennemis et alliés — sans reconnaître personne comme un sujet souverain. Pour lui, seul le président américain existe; tous les autres ne sont personne.
Le second Occident, c’est l’Union européenne. Elle a soudain découvert qu’elle n’est même plus un «partenaire mineur». L’UE a été dépouillée de toute subjectivité solide, politiquement, elle est effectivement castrée. Pour les élites européennes habituées à une admission formelle dans le «club des hommes», cela a été un choc absolu. On leur a dit franchement: votre opinion sur l’Ukraine ou le Groenland n’intéresse personne.
Le troisième, c’est l’Angleterre. Elle se trouve dans une position étrange: apparemment proche des États-Unis, mais frappée par les tarifs de Trump à cause de ses critiques sur l’accord du Groenland. La Grande-Bretagne n’est plus le chef d’orchestre de l’UE (forcément, après le Brexit), mais ce n’est pas non plus une marionnette américaine. C’est un acteur autonome, à part entière.
Le quatrième groupe rassemble les restes du mondialisme. Il s’agit du «deep state» aux États-Unis, des démocrates, qui regardent Trump avec horreur, réalisant qu’ils sont les prochains sur la liste pour une purge. Leurs représentants restent puissants dans les structures européennes et britanniques, et ils continuent de parler de domination mondiale, même si le sol se dérobe sous leurs pieds. Même Macron parle déjà de quitter l’OTAN, et Merz envisage un rapprochement avec la Russie, ayant saisi l’ampleur des pertes.

Enfin, le cinquième Occident, c’est Israël: un petit pays qui se comporte comme s’il était le centre du monde. Avec une frénésie toute messianique, Netanyahu construit un «Grand Israël», utilisant des méthodes extrêmement brutales et forçant tout le monde à l’aider. Il s’avère qu’Israël n’est pas une avant-garde occidentale, mais une force qui, à bien des égards, contrôle l’Amérique elle-même à travers des réseaux pro-israéliens.
Au final, au lieu d’un seul ennemi, nous faisons face à cinq pôles occidentaux différents. Nos regards se tournent dans tous les sens: avec qui devrions-nous conclure des accords? Qui ici est réellement souverain, et qui ne fait que faire semblant? La stratification de l’Occident en ces cinq parties est la principale conséquence de la crise actuelle.
Animateur : Une question d’un auditeur : « Alexandre Geliévitch [Douguine], quelle est la raison pour laquelle Trump a si violemment changé de tactique après le Nouvel An? Venezuela, Groenland, saisies de pétroliers — pourquoi voyons-nous une telle accélération des actions du président américain ? »
Alexandre Douguine: Tout d’abord, je pense que Trump a rencontré une opposition intérieure extrêmement puissante aux États-Unis même, et il a besoin de consolider sa position par des succès sur la scène internationale. Il a été élu pour restaurer l’ordre chez lui, mais cela s’est avéré extraordinairement difficile. Il s’est avéré que pratiquement tout le système judiciaire américain est sous le contrôle de Soros: les soi-disant «juges militants», qui, au lieu d'être guidés par le sens de la loi et de la justice, le sont par une idéologie libérale et prononcent toujours des verdicts contre Trump.
Cette "justice" a commencé par bloquer tous les processus internes. Des protestations contre les agences fédérales chargées de faire respecter la frontière ont éclaté, aboutissant à des affrontements avec des victimes. De nombreux gouverneurs sabotent effectivement ses directives. Trump commence à s’enliser à l’intérieur du pays: la liste Epstein n’a toujours pas été publiée, et de nombreux griefs légitimes s’accumulent contre lui. Il a compris qu’il pourrait passer trois ans à lutter contre ces libéraux corrompus sans rien obtenir, alors que les élections de mi-mandat de 2026 approchent — élections qu’il a toutes les chances de perdre.
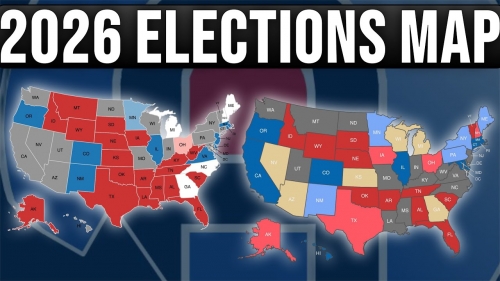
Je pense que les sondages et les conseillers en communication lui ont clairement dit: les ressources internes sont épuisées, il faut un nouvel argument. Il faut annexer quelque chose, kidnapper quelqu’un, le vaincre, l’effrayer ou l’humilier. Ensuite, il pourra obtenir un levier pour la politique intérieure. Trump comprend que le temps s’écoule rapidement — à la fois le temps biologique et le temps de sa présidence. Il a décidé que 2026 est la limite au-delà de laquelle le retard n’est plus possible.
L’annexion du Groenland, le début effectif d’une guerre avec le Canada, la dissolution de l’OTAN, et le démantèlement de l’ONU — tout cela fait partie d’un agenda de redéfinition mondiale. Sur ce fond, les ennemis intérieurs de Trump s’effacent: il est beaucoup plus difficile de démettre un président qui a acquis d’immenses territoires pour les États-Unis et qui a restauré leur statut de puissance redoutable. Après Biden, l’Amérique a commencé à être moquée par tous, mais Trump a rappelé au monde qu’il est un «despote enragé», capable de frapper n’importe où à tout moment.
L’humanité a frissonné. Nous, bien sûr, ne sommes pas des sots non plus et sommes prêts à relever des défis, mais il est important de comprendre: ce n’est plus, face à nous, Russes, l’ancien système mondialiste moribond; c’est autre chose. Trump utilise tous les moyens: des moyens totalement immoraux et illégaux. Il déclare ouvertement que le droit international n’existe plus, et qu’il décidera lui-même de ce qui est moral ou non.
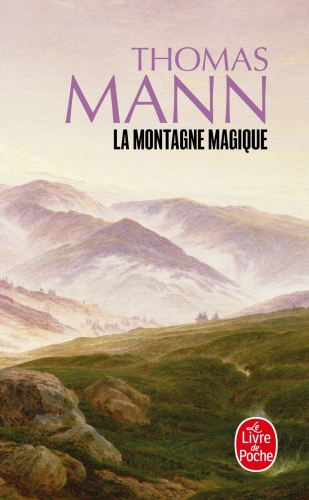 Le cow-boy l’a dit — le cow-boy l’a fait. Il a envahi la scène politique mondiale comme un caïd envahissait un saloon du Far West, tiré sur ses adversaires, et s’est autoproclamé shérif. Trump incarne ce «Far West», avec toutes ses traits répugnants et, pour certains, charmants. Si l’Europe aujourd’hui est une vieille «maison de retraite», rappelant La montagne magique de Thomas Mann, où des dégénérés vivent leurs jours au détriment de la main-d’œuvre migrante, alors Trump est une force jeune, agressive, prédatrice. Son passage à une politique étrangère active est tout à fait rationnel.
Le cow-boy l’a dit — le cow-boy l’a fait. Il a envahi la scène politique mondiale comme un caïd envahissait un saloon du Far West, tiré sur ses adversaires, et s’est autoproclamé shérif. Trump incarne ce «Far West», avec toutes ses traits répugnants et, pour certains, charmants. Si l’Europe aujourd’hui est une vieille «maison de retraite», rappelant La montagne magique de Thomas Mann, où des dégénérés vivent leurs jours au détriment de la main-d’œuvre migrante, alors Trump est une force jeune, agressive, prédatrice. Son passage à une politique étrangère active est tout à fait rationnel.
Animateur: Des prévisions importantes sont déjà évoquées officiellement. Le représentant spécial du président, Kirill Dmitriev, a souligné qu’au vu des actions plus dures de Trump, l’Europe pourrait commencer à pivoter vers un dialogue avec la Russie. Dans quelle mesure un tel scénario est-il réaliste sous les gouvernements actuels de cette «cinquième partie de l’Occident» dont vous parliez? Après tout, pour des raisons géopolitiques et géographiques, il est objectivement plus avantageux pour l’Europe d’entamer un tel tournant aujourd’hui.
Alexandre Douguine: Vous savez, il y a un an, un an et demi — voire quelques mois —, si nous avions commencé à parler sérieusement de la question que les États-Unis soulevaient au sujet de l’annexion du Groenland, cela aurait semblé si irréaliste que même les penseurs géopolitiques les plus avant-gardistes auraient qualifié cela d’impossible.
Imaginer que l’Europe se prépare d’abord à se battre contre l’Amérique pour le Groenland, puis que cette détermination ne durerait pas plus d’une semaine, se soldant par un recul — cela aurait été inconcevable l’automne dernier. Nous rêvions encore que l’Europe disposait d’au moins une certaine souveraineté.
Aujourd’hui, les Européens se trouvent dans des conditions totalement nouvelles, qui, à bien des égards, sont choquantes. Avant, ils pouvaient se disputer avec Trump sur des détails, comme l’ampleur du soutien à Kiev. Pour Trump lui-même, ce n’est pas particulièrement important: son image de «pacificateur» n’était qu’un écran de fumée, un brouillard. Il n’est pas un hasard s’il a effectivement rétabli le statut du Pentagone en tant que «ministère de la Guerre» — cela en dit long. Il ne se soucie pas d'une vraie paix, ni d’un cessez-le-feu en Ukraine. Il résout ses propres tâches, lesquelles sont purement américaines.
Trump leur a dit franchement: «Concluez rapidement un cessez-le-feu avec les Russes selon les termes que j’ai moi-même acceptés à Anchorage». L’Europe a d’abord répondu avec arrogance: «Nous sommes une coalition des volontaires, nous soutiendrons l’Ukraine et nous nous débrouillerons sans vous». Trump a répliqué: «Alors, gérez, mettez le Groenland sur la table et survivez comme vous pouvez». L’Europe s’est retrouvée dans cette situation soudainement, sans préparation. La panique y règne désormais.
Le fait que Macron ait commencé, dans la chaleur du moment, à parler de quitter l’OTAN, et que Friedrich Merz oscille entre la reconnaissance de l’effondrement de l’économie allemande dû à la rupture avec la Russie et des tentatives de se rapprocher de Washington — c’est de l'hystérie classique. L’Union européenne est en panique. Les dirigeants européens actuels sont des reliques de l’ancien système: des gens à Soros, au Forum de Davos, des adeptes du modèle de Fukuyama, qui a finalement sombré.
Dans cette agonie, ils peuvent proposer n’importe quel scénario, même les plus fantastiques. Y compris: «Pourquoi ne pas s’appuyer sur la Russie? Pourquoi ne pas reconsidérer les relations avec Poutine?». La gravité de ce qu’ils proposent reste une grande question. Pour l’instant, un tel tournant semble improbable, mais dans le contexte de la redéfinition mondiale que Trump a mise en marche, rien n’est à exclure.
Animateur: Restons au sujet que constitue Donald Trump. Cette fois, parlons de son initiative de créer un Conseil de la Paix pour gouverner la Bande de Gaza. Une nouvelle vient de tomber: le porte-parole du président russe a confirmé que Donald Trump aurait invité Vladimir Poutine à rejoindre ce conseil. Que va faire exactement cet organisme, et quelle en sera l’efficacité dans le contexte actuel?
Alexandre Douguine: Je pense que Trump, après s’être retroussé les manches, s’est lancé dans une refonte radicale de la carte politique mondiale. Le droit international, incarné par l’ONU, reflétait un équilibre des puissances vieux de près d’un siècle — un monde bipolaire dans lequel deux superpuissances dialoguaient, tandis que tous les autres pays ne servaient que de figurants. Lorsque l'URSS a commis un suicide géopolitique, ce système a effectivement dépassé sa date de validité. Les Américains ont à plusieurs reprises évoqué la dissolution de l’ONU et son remplacement par une sorte de «Ligue des démocraties», où au lieu du dialogue, il y aurait un monologue américain accompagné du silence approbateur de l’audience.
Aujourd’hui, l’Occident collectif s’est divisé en ces cinq blocs que nous venons d'évoquer. Chacun a son propre programme, mais le tandem Trump–Netanyahu se démarque en particulier. Ce dernier proclame de plus en plus ouvertement être le «roi des Juifs», mettant en œuvre le projet messianique d’un «Grand Israël». Les idées d’exterminer les Palestiniens et d’étendre les frontières d’une mer à l’autre, exposées dans des textes radicaux comme La Torah du roi, ne sont plus de simples théories du complot — elles se reflètent dans le symbolisme même de l’IDF.
Trump, en tant que chrétien sioniste particulier, est encombré par de vieilles institutions. Il a besoin de quelque chose de nouveau, et il commence à façonner des structures alternatives — comme le «Conseil de la paix» — autour de la région centrale de sa géopolitique eschatologique. Cette région, c’est Israël et Gaza. Trump veut créer une institution sans activistes mondialistes comme Greta Thunberg et ses flotilles, composée uniquement de ceux qui ne contrediront pas son ami Netanyahu. C’est aussi un modèle unipolaire, mais dans une nouvelle configuration « mystique ».

Quant à l’invitation à Vladimir Poutine pour rejoindre ce conseil : l’information doit encore être vérifiée. Si Trump a réellement fait un tel geste, alors il suppose à tort que notre position sur Israël est plus douce que celle des mondialistes occidentaux. En réalité, nous condamnons catégoriquement le génocide à Gaza et considérons les méthodes de Netanyahu comme absolument inacceptables. Trump espère s’entourer de ceux en qui il a confiance, mais sur la tragédie palestinienne, nos vues ne coïncident probablement pas avec sa vision d’un «nouvel ordre».
Animateur : Cela vient d’être confirmé par Dmitri Peskov, le secrétaire de presse du président. C’est une information officielle, confirmée par le Kremlin: l’invitation à Vladimir Poutine a bien été faite.
Alexandre Douguine: Alors, il est évident que Trump a confiance en nous, et qu’il pense que nous soutiendrons son initiative. Il est également convaincu que ceux qu’il n’a pas invités délibérément à ce «Conseil de la paix» s’y opposeront. Cet événement — l’invitation à Vladimir Poutine — s’inscrit dans la même veine que l’affaire du Groenland. Nous ne sommes pas ravis par le traité d’achat de l’île, mais, en fin de compte, le Groenland nous préoccupe bien moins que le Venezuela, l’Iran, et surtout l’Ukraine. Les Européens eux-mêmes comprennent parfaitement: si Trump absorbe le Groenland, l’Ukraine sera instantanément oubliée — il n’y aura tout simplement plus de temps pour elle.
L’image de Trump comme opposant aux interventions s’est révélée n’être qu’un brouillard politique. Il a promis d’être un «président de la paix», mais en pratique, il intervient calmement où il veut, menace tout le monde de guerre, et transforme efficacement le département de la Défense en un «ministère de l’Offense» ou un ministère de la Guerre. La paix pour lui n’est qu’une façade. Il n’y croit pas vraiment. Son vrai but est de renforcer l’hégémonie américaine aux dépens de tous — de nous, de la Chine, et, comme on le voit, de l’Europe.
Trump considère l’Europe comme un malentendu agaçant, comme une branche rebelle de sa propre chaîne de distribution qui décide de pousser ses propres marchandises dans sa boutique. Leur désobéissance l’irrite bien plus que notre position calme, souveraine et distanciée. Nous ne provoquons pas; nous agissons avec cohérence: tout ce que nous déclarons, nous le mettons en œuvre, et tout ce que nous faisons, nous l'articulons dans un langage qu’il comprend. Cela ne fait pas de Trump notre ami — il est un ami uniquement pour lui-même. Je ne suis même pas sûr qu’il soit un ami du peuple américain, puisque sa politique pourrait finir en catastrophe. Il risque tout, comme un hussard qui a hypothéqué ses domaines, sa famille, et son avenir en jouant aux cartes. Certains joueurs ont parfois de la chance, mais le plus souvent, ils perdent tout d’un seul coup.

Trump est une brute audacieuse qui a tout misé. Les enjeux dans ce Grand Jeu sont portés à leur paroxysme. Ses mouvements sont imprévisibles: l’invitation de la Russie au Conseil de la paix pour Gaza a probablement été faite pour narguer l’Union européenne, pour leur dire: «Regardez ce que je peux faire». Pour les mondialistes qui, lors du premier mandat de Trump, l’ont qualifié d’«agent du Kremlin», cette invitation ressemble à un cauchemar devenu réalité. L'«ami de Poutine» a invité son « ami » — pour eux, c’est la fin du monde connu.
Cependant, il est difficile d’attendre une paix véritable en Palestine: le destin du peuple longuement souffrant repose entre les mains de ceux qu’on peut appeler des bourreaux et des maniaques. La Russie n’a actuellement pas la capacité d’imposer ses conditions dans cette région sans risquer de provoquer la colère de Trump comme il a énervé l’Europe. Cette invitation est une offre que notre président examinera avec la plus grande responsabilité. Nous n’avons pas besoin de dons. Nous verrons si la Chine et d’autres pays des BRICS rejoignent ce conseil — c’est précisément notre conception multipolaire de l’ordre: une alternative, ni basée sur l’ONU, ni mondialiste.
Le monde d’aujourd’hui n’est pas une image en noir et blanc, mais une «philosophie de la complexité» dont le président a parlé lors du sommet de Valdai. Nous sommes dans une situation de mécanique quantique en politique internationale. La mécanique classique, avec son inertie et ses trajectoires calculables de têtes nucléaires en chute, appartient au passé. Ce sont désormais les lois des ondes qui s’appliquent. Des processus extrêmement complexes de superposition sont en cours, qui «s’effondrent» soudainement dans un État-nation particulier: pendant un instant, le premier ministre parle au nom du pays, l’instant d’après, tout redevient un réseau d’ondes où il est difficile de distinguer le début et la fin.
J’étudie quotidiennement les briefings des principaux centres analytiques mondiaux, et j’ai l’impression que personne n’a une compréhension claire de ce qui se passe. Chacun décrit son propre univers avec ses constantes gravitationnelles. Nous avons besoin d’une pensée totalement nouvelle en politique internationale.
Une invitation à un «Conseil de la paix» d’un pays avec lequel nous sommes effectivement en guerre en Ukraine, tout en condamnant l’agression de son allié, Israël, est un paradoxe qu’il faut replacer dans le contexte approprié.
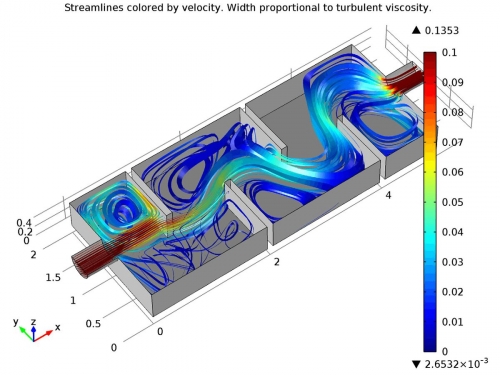
Les anciennes cartes avec des lignes rouges ne fonctionnent plus. Comme le note Sergueï Karaganov, même les armes nucléaires cessent d’être dissuasives dans le sens habituel — la question de leur utilisation directe se pose désormais. Nous sommes dans un état de transition vers une phase nouvelle: l’eau dans la casserole a déjà bouilli ou est sur le point de bouillir. Cette transition stochastique, décrite par les équations de Navier–Stokes et la théorie fractale, se transfère désormais pleinement dans la politique mondiale. Nos analystes doivent abandonner les anciens modèles humanitaires et se tourner vers la nouvelle physique et la théorie des superstructures.
Animateur : Vous avez évoqué la thématique ukrainienne, et sa place dans le contexte actuel est extrêmement intrigante. Selon les publications occidentales, les politiciens européens réécrivent littéralement leurs plans pour l’Ukraine en temps réel: les thèses qu’ils comptaient porter au forum de Davos sont jetées à la poubelle, et toute l’attention se porte désormais sur le Groenland. Pensez-vous qu’il est possible que, désormais, non seulement les États-Unis, mais aussi l’Europe, commencent à s’éloigner progressivement des événements en Ukraine, nous permettant en quelque sorte de mettre fin à ce conflit en tête-à-tête avec Kiev?
Alexandre Douguine: Ce serait l’option optimale, mais je crains que personne ne nous accordera un tel luxe. Bien que je sois convaincu que les jours de Zelensky sont comptés. Il sera certainement «annulé». Il n’est pas certain que Zaloujny le remplacera — quelqu’un d’autre pourrait être installé à sa place. Cependant, nous ne devons pas nous faire d’illusions: Trump lui-même n’est pas prêt à remettre l’Ukraine entre nos mains. De plus, l’existence d’un tel point chaud, terriblement conflictuel, sur notre propre territoire lui profite: c’est un levier classique, un outil pour nous gérer.
Trump ne cédera pas volontairement l’Ukraine. Le plan qu’il propose, prétendument selon nos termes, n’est qu’une tentative de geler le conflit. Ils comptent se regrouper et créer un centre de dissuasion contre nous «au cas où». Je ne pense pas que Trump considère que nous sommes des ennemis existentiels, mais il ne veut certainement pas notre renforcement. Il comprend que la Russie ne peut pas être vaincue, mais aider notre croissance ne fait pas partie de ses plans. Au contraire, son objectif est de nous affaiblir. Par conséquent, nous ne devons pas compter sur sa bonté.
Au contraire, Trump continuera à exercer une pression par des sanctions, et cela pourrait même conduire à des provocations militaires. Trump n’est pas notre ami. Et même si ses opposants le surnomment «ami de Poutine», en réalité, ce n’est pas le cas. Il agit seul, pour ses propres intérêts. Dans sa stratégie — même dans ses versions les plus audacieuses — il n’y a pas l’idée de transférer l’Ukraine à la Russie. Une victoire russe décisive ne fait pas partie de ses plans, ce qui signifie qu’il s’opposera à nous.
Malheureusement, nous devons compter uniquement sur nos propres forces. Nous devons utiliser tout moment favorable: les fluctuations accompagnant un changement de président aux États-Unis, les désaccords en Europe, les scandales de corruption secouant l’Ukraine, et le recentrage de l’Occident sur le Groenland. Tous ces facteurs doivent être pris en compte. Nous n’avons d’autre choix que d’agir en souverains, dans notre propre intérêt et selon notre propre stratégie.
Nous avons besoin d’une stratégie beaucoup plus audacieuse que celle que nous avons actuellement: souveraine, active, rapide et efficace. Si vous voulez, une stratégie à la russe «folle», car en ce moment, nous sommes trop rationnels et trop gentils.
19:50 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : alexandre douguine, donald trump, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Magistrale transition verte: l’Europe privilégie les dépenses militaires plutôt que les valeurs environnementales

Magistrale transition verte: l’Europe privilégie les dépenses militaires plutôt que les valeurs environnementales
Markku Siira
Source: https://substack.com/inbox/post/185439014?publication_id=...
Fabio Vighi analyse pourquoi l’agenda sécuritaire et militaire excessif de l’Europe n’est pas seulement une réaction aux opérations militaires de la Russie en Ukraine. Bien que ce récit soit présenté comme une explication émotionnelle et politiquement pratique, il masque un problème structurel plus profond du système capitaliste.
L’Europe oriente désormais sa capacité limitée d’emprunt vers le secteur militaire, loin de la transition écologique, secteur militaire où la demande garantie compense la faiblesse de la compétitivité. Selon Vighi, il ne s’agit pas simplement d’une réévaluation des priorités, mais d’une réponse désespérée à un problème que les politiciens n’osent pas reconnaître: le maintien du capitalisme ne repose plus sur un emploi productif.
Les avancées technologiques, de la microélectronique à l’intelligence artificielle, ont progressivement réduit la rôle du travail humain dans la production de biens et creusé le fossé entre les dettes financières croissantes — bulles — et la réalité sociale fragile. Ce problème n’est pas résolu, mais géré avec les mêmes moyens qui l’ont créé: en gonflant le financement, en élargissant le crédit, par des interventions étatiques et par la montée des dépenses militaires.
Vighi a observé que la transition « de la troisième guerre mondiale gonflée par la crise du coronavirus » à la menace russe en 2022 s’est faite de manière fluide. Une situation d’urgence a remplacé une autre sans rupture dans la logique politique ou la gestion économique. Ce n’était pas la nature de la menace qui importait, mais sa fonction: elle légitimait une impressionnante création monétaire pour sauver à court terme les marchés financiers.
Selon l'analyste italien, le récent plan de soutien de 90 milliards d’euros de l’UE pour les besoins militaires en Ukraine suit la même logique. La prolongation de l’état d’urgence géopolitique est transformée en un nouvel instrument de levée de dettes et de financements d’urgence.

Vighi décrit l'European Green Deal comme une opération brillante pour canaliser la logique de gestion de crise du capitalisme dans un projet économique présenté comme moralement supérieur. Il ne s’agissait pas tant de mesures réelles pour lutter contre le changement climatique que d’un ingénieux levier de financement, emballé comme une opportunité verte pour l’industrie.

Grâce à NextGenerationEU et aux obligations vertes de l’UE, l’objectif était de mobiliser la dette publique pour attirer le capital privé ESG. Bien que l’objectif nominal fût la modernisation de l’industrie au nom de la neutralité carbone, en réalité, il s’agissait d’un mécanisme d’urgence destiné à retarder temporairement l’effondrement structurel du capital financier.
L’industrie automobile, les batteries, la mobilité propre et les énergies renouvelables forment selon Vighi la colonne vertébrale de cette transition. Mais ces investissements sont désormais sous forte pression. La plus visible est dans l’industrie automobile, le pilier à long terme de l’industrie européenne. Les constructeurs européens peinent à passer aux véhicules électriques en raison des coûts élevés et des désavantages structurels.

Les fabricants chinois ont l’avantage: un soutien massif de l’État et une quasi-position monopolistique sur les matières premières critiques permettent de produire des voitures électriques moins chères et souvent technologiquement supérieures. Le programme de transition verte a été financé selon Vighi en partant du principe que les entreprises européennes domineraient les segments de marché à forte marge — c’est-à-dire en vendant les modèles les plus rentables et technologiquement avancés. Lorsque cette hypothèse s’est effondrée, la « discipline du capital » est revenue, et les investisseurs privés se sont retirés.
C’est précisément à ce stade que Vighi voit la rhétorique sécuritaire remonter au premier plan. La « verdeur » écologique cède la place au vert militaire: on passe des voitures électriques aux chars de combat. Selon l’analyse de Vighi, les dépenses militaires offrent une demande sûre, une protection contre la compétition mondiale et un récit moral qui rend politiquement impossible de résister aux coûts.

Contrairement aux voitures électriques, les systèmes d’armes européens ne font pas face à une concurrence chinoise. La réussite se mesure ici en dissuasion, non en profits de marché. L’industrie de l’armement est historiquement — comme le montrent les guerres mondiales du 20ème siècle — exceptionnellement compatible avec une économie basée sur la dette et la consommation.
Selon Vighi, les dépenses militaires consomment du capital sans augmenter la capacité productive de la société. C’est pourquoi la production militaire s’intègre parfaitement dans une économie de consommation financée par la dette, et l’armement justifie l’augmentation de la masse monétaire, au bénéfice du secteur financier. C’est un paradigme de «fausse accumulation»: l’argent circule sans créer de nouvelle valeur, uniquement pour prolonger la durée de vie du système.
Vighi rappelle que la politique environnementale et sécuritaire est présentée comme un choix, mais qu’en réalité, elles sont façonnées par les impératifs de la politique économique. Le Green Deal n’a pas été totalement rejeté, il a simplement été dévalorisé: le discours climatique continue, mais la menace géopolitique oriente désormais les flux de capitaux. L’investissement ESG, axé sur l’environnement, se révèle un cynique mécanisme de redistribution du capital.
Ce changement approfondit la soumission de l’Europe aux États-Unis. L’UE imite le modèle américain sans la même puissance industrielle ni la même capacité financière. La dette publique américaine dépasse 38.000 milliards de dollars, et la Réserve fédérale a relancé une phase d’assouplissement quantitatif inflationniste — achats massifs d’obligations pour créer de la nouvelle monnaie afin de relancer l’économie et maintenir la bulle de dettes.

L’Europe est en voie de récession, accélérée par le rejet brutal de l’énergie russe et du partenariat euro-asiatique. La guerre en Ukraine et le sabotage du réseau gazier ont, comme Vighi le met en évidence, « réalisé l’objectif stratégique des États-Unis de couper la dépendance de l’Europe à l’énergie russe ». Cette action a déplacé la pression sur le financement, passant du profond objectif de neutralité carbone à l’industrie de l’armement. Selon son analyse, « la militarisation européenne s’inscrit dans un système de dettes centré sur le dollar. »
Vighi prévoit que la militarisation occidentale ne fera que s’accélérer : le président Donald Trump a déjà demandé d’augmenter le budget militaire américain à près de 1,5 billion de dollars — un choc économique exceptionnel, probablement financé à nouveau par une loi d’urgence nationale justifiée par la sécurité nationale.
Son analyse aboutit à une conclusion révélatrice: la transition verte de l’Europe semblait politiquement réalisable uniquement tant qu’elle semblait augmenter la compétitivité. La course aux armements est une extension plus naturelle du capitalisme de crise — et peut-être a toujours été sa conséquence inévitable.
De manière plus générale, le système suit aveuglément ses impératifs internes, tout en sapant ses propres bases. Le progrès technologique détruit la société basée sur le travail, qui est aujourd’hui définie par une urgence perpétuelle, de plus en plus anti-libérale.
Dans cette optique, ce que les dirigeants européens qualifient de guerre hybride n’est pas une crise passagère. Selon Vighi, c’est «un état généralisé et permanent du capitalisme financier — une façon de mobiliser la dette qui prépare la population aux conflits, tout en normalisant la répression et la surveillance».
La priorité donnée à la politique de sécurité ne traduit pas une prise de conscience stratégique, mais n’est qu'«une rhétorique de la récession, qui entraîne la fuite inévitable du système vers sa propre autodestruction».
Dans cette perspective, la transition verte n’était pas un projet moral, mais une continuation opérationnelle de la même gestion de crise — une tentative de canaliser la crise dans des promesses d’avenir. Lorsqu’elle a échoué, le système est revenu à une solution plus sûre : la logique éternelle de l’économie de guerre.
16:42 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : transition verte, militarisation, militarisation de l'économie, europe, affaires européennes, green deal |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Le FEM sans Schwab: un tournant à peine sincère dans le temple du mondialisme? - L'agenda reste néanmoins le même...

Le FEM sans Schwab: un tournant à peine sincère dans le temple du mondialisme?
L'agenda reste néanmoins le même...
Source: https://derstatus.at/globalismus/wef-ohne-schwab-halbherz...
Il y a quelques jours commençait le sommet du FEM qui à duré cinq jours à Davos. Au cours des cinquante dernières années, cette réunion était réputée comme un rassemblement de mondialistes notoires. Politiciens, idéologues et dirigeants se retrouvaient chez l’architecte du "Grand Reset", Klaus Schwab, pour comploter. Mais cette année, le sommet est sous un autre signe : le fondateur du FEM a démissionné, il ne sera probablement même pas présent. En revanche, tout le monde a observé attentivement la prestation du président américain Donald Trump, compte tenu de la situation géopolitique. Pour le gouvernement autrichien, dit "Ömpel" et de composition noire-rouge-rose, c’est le chancelier de l’ÖVP démocrate-chrétienne, Christian Stocker, qui jouera le rôle de l’invité d’honneur.

Le grand sommet des mondialistes s'est tenu pour la première fois sans Schwab
La hiérarchie lors du sommet des mondialistes était claire depuis des décennies: des gouvernements du monde entier se rassemblaient pour donner des ordres et discuter de l’agenda mondialiste des élites. À plusieurs reprises, des déclarations à la fois éclairantes et choquantes étaient faites. De l’Ukraine en tant que centre de l’"énergie verte" à la surveillance de toutes les fonctions quotidiennes, du trafic financier à la manipulation mentale, en passant par la censure généralisée de toute critique jusqu’aux possibilités de contrôler l’accès aux comptes bancaires et à l’éducation via une identité numérique et des pass sanitaires, presque toutes les ruses en place ou à mettre en place étaient représentées.
Depuis 1971, la figure de proue était toujours Klaus Schwab, le fondateur du FEM, qui dictait l’agenda à sa guise. Le sommet était souvent le lieu où des réseaux mondiaux et des initiatives d’élite étaient créés. La controverse autour de l’alliance vaccinale de Gates, GAVI, a également vu le jour là. Mais le "patron des mondialistes" a connu une chute asses vertigineuse. Après des accusations portées contre lui, qui disaient qu'il faisait le "complexe de Dieu", des allégations de harcèlement sexuel et d’abus de pouvoir, l’Octogénaire a même été interdit de séjour dans sa propre maison à un moment donné. C’est d’abord l’ancien PDG de Nestlé et promoteur de la privatisation de l’eau, Peter Brabeck, qui a pris le relais, puis, après quatre mois, il a transféré la direction à Larry Fink, PDG de BlackRock, et à André Hoffmann, vice-président de Roche.
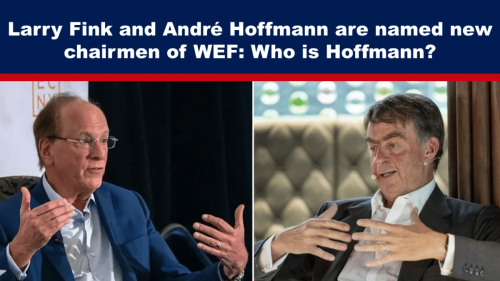
L’empereur est mort, vivent les rois ?
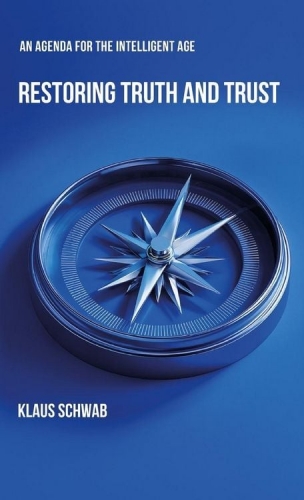 L’année suivante, le fondateur a été complètement ignoré. Il ne participe pas au sommet cette année, et il ne fait aucune apparition publique, et il manque même au tableau une reconnaissance en bonne et due forme pour son œuvre de toute une vie. Il tente actuellement de rester dans la conversation avec un livre intitulé (notez le titre absurde) "Restaurer la vérité et la confiance". Il y déplore la "désinformation" et l’échec institutionnel, loue les progrès technologiques vers une "ère intelligente" et plaide, comme d’habitude, pour une coopération mondiale des élites. Mais le conseiller de longue date est victime de sa propre logique mondialiste : tout est éphémère, et pour le bien de la cause, des têtes peuvent être remplacées si nécessaire.
L’année suivante, le fondateur a été complètement ignoré. Il ne participe pas au sommet cette année, et il ne fait aucune apparition publique, et il manque même au tableau une reconnaissance en bonne et due forme pour son œuvre de toute une vie. Il tente actuellement de rester dans la conversation avec un livre intitulé (notez le titre absurde) "Restaurer la vérité et la confiance". Il y déplore la "désinformation" et l’échec institutionnel, loue les progrès technologiques vers une "ère intelligente" et plaide, comme d’habitude, pour une coopération mondiale des élites. Mais le conseiller de longue date est victime de sa propre logique mondialiste : tout est éphémère, et pour le bien de la cause, des têtes peuvent être remplacées si nécessaire.
Cela se voit rien qu’avec les mots utilisés par le journal de Suisse alémanique Neue Zürcher Zeitung (NZZ), qui cite Thierry Malleret, ancien directeur du programme du FEM et co-auteur avec Schwab du livre intitulé "Grand Reset": "L’absence de Schwab ne fait pas une grande différence". Il a été utile et efficace pour construire les réseaux mondialistes, mais Fink et Hoffmann pourraient faire la même chose. Le premier a particulièrement beaucoup d’expérience pour rassembler des personnes influentes. Cependant, il met en garde contre la perte de signification du FEM, alors que les nouveaux co-responsables se réfèrent précisément à la vision de Schwab et présentent l’agenda élitiste comme incontournable: "La mondialisation ne s’arrête pas, elle continue de se développer."
Le Chancelier autrichien Christian Stocker au WEF
En réalité, malgré les bouleversements qu'il connait, le FEM ne peut se plaindr : ses revenus s’élèvent à 469 millions de francs suisses, ce qui le place dans une bonne situation économique, et la liste des invités est plus fournie que jamais. La NZZ le décrit ainsi: "Au sein du FEM, les employés sont inquiets pour l’avenir de celui-ci. Mais vu de l’extérieur, c’est toujours un grand succès. En réalité, avec 3000 participants, dont 64 chefs d’État et 850 PDG, il y a plus de 'leaders' que jamais". Parmi eux, figurent aussi le malheureux chancelier autrichien Christian Stocker (ÖVP) et le chancelier allemand Friedrich Merz, qui ne jouent plus qu'un rôle symbolique.
Bien que Stocker n’ait pas l’intention d’avoir un rôle majeur lors de cette visite au FEM, sa présence est importante pour les démocrates-chrétiens. Tellement que les détails concrets du maigre «paquet de relâchement» dans son pays doivent attendre. Son ami de parti et prédécesseur, Karl Nehammer, avait refusé de coopérer avec la FPÖ, qui a remporté la dernière élection du Parlement, en partie parce que son chef Herbert Kickl critique sévèrement les organisations mondialistes comme le FEM et l’OMS. La surveillance coûteuse de l’espace aérien par l’armée fédérale, qui n’était auparavant qu’un sujet dans les médias alternatifs, trouve maintenant aussi sa place dans les médias mainstream...
Les suspectés habituels jouent un rôle
Raison: on a trouvé une occasion de faire porter le chapeau à Trump pour un problème sur lequel on a longtemps fait silence. Car le président américain honorera Davos comme en 2018 et 2020, devenant ainsi, avec Bill Clinton, le seul chef d’État américain en fonction à honorer la réunion du FEM depuis le début de ce millénaire. Mais pour les États-Unis, comme pour d’autres superpuissances de la "première ligue", comme la Russie ou la Chine, il ne s’agit pas de supplier, mais de venir en position de force. Et cela signifie frapper fort: Trump arrive cette fois avec sa famille, ses cinq ministres et l’"Air Force One".
Cela incite le gouvernement danois à envisager de rester à l’écart du sommet, notamment à cause du conflit au Groenland. Le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, le chancelier allemand Merz et d’autres dirigeants européens veulent profiter de l’occasion pour engager la conversation avec Trump. Parmi eux, Macron (France) et Sánchez (Espagne) feront également un discours. D’autres habitués comme Ursula von der Leyen (UE), Kristalina Georgieva (FMI), Christine Lagarde ( BCE) et Bill Gates seront également présents, tout comme les PDG de grandes entreprises comme Microsoft, Palantir ou JP Morgan.
15:14 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, davos, klaus schwab, fem |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Que se passera-t-il après Davos? Des empires ou un empire?

Que se passera-t-il après Davos? Des empires ou un empire?
Cristi Pantelimon
Le discours du Premier ministre canadien à Davos était vraiment génial. Avec un seul bémol: parler de Vaclav Havel maintenant, c'est trop tard, beaucoup trop tard. Et ce n'est pas approprié. Voici pourquoi.
Vaclav Havel a été victime d'une grande illusion, et pas seulement celle du communisme. Mais SURTOUT de l'illusion de l'après-communisme, qui lui semblait être la délivrance après l'effondrement du communisme. Et cela parce que l'illusion communiste était déjà une illusion consommée, alors que l'autre, libérale, venait à peine de naître, bien qu'elle eût déjà été tuée une fois, pendant l'entre-deux-guerres.
Le libéralisme avait été tué par les Italiens et les Allemands pendant l'entre-deux-guerres. Il avait été asphyxié par la révolution corporatiste de Salazar au Portugal. Personne ne parle plus aujourd'hui du corporatisme de Vichy, car il a été de courte durée et associé à l'Allemagne nazie, mais lui aussi était antilibéral. Et la Roumanie s'était alors débarrassée, elle aussi, de l'illusion libérale.
La Seconde Guerre mondiale a toutefois voulu que le libéralisme revive une seconde fois, mais pas partout, seulement en Europe occidentale, avec l'aide des Américains. Un mourant en Europe, ressuscité par la fraîcheur américaine.
Après 1989, l'illusion communiste (qui, en fait, était également d'origine occidentale) s'étant évaporée, le libéralisme revient pour la deuxième fois, fantomatique, en URSS et sur l'ancien territoire du socialisme dépendant de Moscou. Havel était lui-même un homme dépassé dès l'instant où il a placé ses espoirs dans ce fantôme de seconde main qu'était le libéralisme.
Il a fallu que Trump vienne pour enterrer le fantôme aujourd'hui, alors qu'il était mort depuis les années 20. Nous avons donc eu cent ans de politique fantomatique.
Nous ne savons donc pas quelle illusion nous envahira dès demain; et c'est mieux ainsi, car sinon nous aurions certainement beaucoup de Vaclav Havel pour nous délivrer du libéralisme mondialiste afin de nous orienter vers la véritable illusion, celle qui vient de naître.
Les Chinois ne produisent pas d'illusions et c'est là leur grande qualité.
Les Américains et les Russes reviennent aux empires - là, nous pouvons nous entendre avec les uns et les autres. Mais l'époque des empires est-elle encore d'actualité ? C'est à cette question-là qu'il faut chercher une réponse.
N'est-il pas temps d'essayer la mondialisation sans illusions et un empire mondial unique et harmonieux, sans mensonges, comme celui des États-Unis, dénoncé aujourd'hui par le Premier ministre canadien ? Il semble que c'est ce à quoi nous appelle la Chine. Mais elle ne nous attire pas avec des illusions. C'est là le problème !
Ce n'est qu'après Davos que la recherche commence. Nous verrons ce que nous trouverons !
14:03 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, davos, fem |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 22 janvier 2026
Avis de recherche : l’Occident a été confisqué par deux psychopathes

Avis de recherche: l’Occident a été confisqué par deux psychopathes
Pierre-Emile Blairon
L’une des plus anciennes et des plus grandes civilisations du monde, la civilisation indo-européenne (1), a propagé son génie et a imposé son modèle sur une grande partie de la planète.
Cette civilisation indo-européenne s’est confondue, au fil des siècles, avec le socle géographique où elle s’est épanouie: l’Europe de l’Ouest, laquelle s’est confondue plus tard avec l’Occident.
On appelle Occident l’un des quatre points cardinaux, celui où le soleil se couche, à l’ouest. On l’appelle aussi le couchant.
L’un de ses plus grands historiens, Oswald Spengler, a raconté son épopée il y a un peu plus de cent ans et en a conclu qu’elle était sur son déclin (2).
Vous lirez ci-après les étapes qui ont conduit le monde à cette future catastrophe et vous saurez ensuite quels en sont les protagonistes, et les responsables.
Les métamorphoses de l’Occident
En réalité, l’Occident européen est mort quarante ans avant la prédiction de Spengler avec l’érection en 1884 du premier gratte-ciel américain; le génie européen, trop délicat, trop intelligent, trop élégant, trop aristocratique, s’est éteint, concurrencé par la force brute et la volonté de puissance primaire, vulgaire, mégalomaniaque, titanique, qui caractérisait déjà l’Amérique des cow-boys sans foi ni loi devenue celle des hommes d’affaires sans scrupules.

Les deux guerres mondiales ont été fatales à l’Europe: la première a vu mourir dans les tranchées la moitié de la paysannerie et de l’artisanat européens dans cette guerre fratricide fomentée par ceux qui avaient un intérêt à le faire, la deuxième a vu se mettre en place les stratagèmes américains qui allaient la déposséder de son avenir.
L’Occident, devenu l’Ordre mondial, s’acheminait vers le Meilleur des mondes.
Enfin, sa dernière métamorphose qui s’opère sous nos yeux ébahis sonne le glas d’un Occident respectueux, stabilisé par la lente élaboration des règles internationales dont l’application régulait encore, au moins en façade, les relations des peuples sur la planète. Il semble que, désormais, la loi du plus fort, la loi de la jungle, s’impose; ce processus apocalyptique ne peut s’arrêter que si les forces traditionnelles, celles représentées notamment par les BRICS, qui sont lentes à se réveiller, décident de le contrer.
« Capture » de l’Europe par les Etats-Unis
Je n’évoquerai pas plus avant l’histoire de l’Europe dont le destin prometteur semble s’être achevé brutalement, détourné, dès la fin de la deuxième guerre mondiale (3) par les manigances des Américains qui mirent en place à la tête de l’institution qu’ils projetaient de créer des traîtres d’origine européenne acquis à leur cause pour concevoir les bases de ce qui deviendra «L’Union européenne» (4) qui sera dès lors vassalisée, dans le but de couper tous les ponts entre l’Europe de l’Ouest et l’Europe de l’Est.

Je veux espérer que l’Europe des peuples qui ne s’est jamais faite a pris le maquis avec ses partisans et réapparaîtra lorsque le moment sera venu, comme ses grands prêtres, les druides, l’ont fait pour laisser place au christianisme en s’enfonçant dans l’obscurité des forêts en attendant le moment propice pour en ressortir.
Cette politique de séparation entre les deux blocs européens qui, en cas de jonction, auraient gravement mis en péril le statut économique prédominant des USA et le monopole mondial de leur monnaie, le dollar, connaîtra avec les bombardements de l’Otan sur la Serbie en 1999, une nouvelle atteinte aux libertés européennes et aux peuples européens.

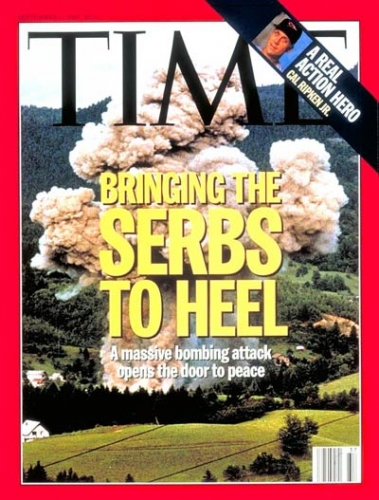
Ces bombardements, effectués avec la complicité de ces mêmes dirigeants félons européens, eurent pour conséquence la création d’un Etat islamique en plein cœur de l’Europe, le Kosovo, devenu une verrue mafieuse s’adonnant au trafic international d’organes en compagnie, notamment, de ressortissants israéliens (5). L’ancien ministre et ancien administrateur onusien du Kosovo (la MINUK), Bernard Kouchner, mis en cause par des journalistes serbes, a été questionné à ce sujet (6).
L’Europe a envahi le monde, l’Occident l’a standardisé
Tous les peuples des anciennes sociétés traditionnelles ont été des peuples conquérants.
Spengler disait que les hommes ont toujours voulu partir à la conquête de nouveaux territoires, de nouveaux paysages, et à la rencontre de nouveaux peuples, mus par ce qu’il a appelé le tact cosmique, ou racique; ces hommes intrépides n’aimaient rien plus que de plonger dans cette ivresse de l’aventure et de sentir la poussière de ces nouvelles terres se lever sous le pas de leurs chevaux.

Les Espagnols et les Portugais ont ainsi découvert l’Amérique du Sud, les Français, les Hollandais et les Anglais, l’Amérique du Nord (après les Vikings) et aussi les Indes. Les Arabes ont occupé l’Espagne et écumé les côtes africaines et européennes pour faire du trafic d’esclaves, l’Afrique a été colonisée, ainsi que l’Indochine dans sa plus grande partie au XIXe siècle, surtout par la France, Alexandre Le Grand est allé avec son armée jusqu’en Inde et Gengis Khan est arrivé aux portes de l’Europe en prenant le chemin inverse; quant à Napoléon et Hitler, ils se sont cassé les dents en voulant envahir la Russie.
Dès la fin du XVIIIe siècle et pendant tout le XIXe siècle, l’Europe a conquis le monde d’une autre façon mais en juxtaposition de son empire colonial: la technoscience et son corollaire le progrès, ont envahi les moindres recoins de Ouagadougou ou de Saïgon.

Le concept d’« Occident » non-européen est né à un moment précis, lorsqu’il a physiquement, matériellement, pris forme aux Etats-Unis avec le premier gratte-ciel construit pour une compagnie d’assurance à Chicago en 1884 (photo).
Symboliquement, on ne pouvait mieux faire: le gratte-ciel, son nom l’indique bien, est la représentation de l’esprit titanique, de l’Homme qui veut défier Dieu, voire le remplacer.
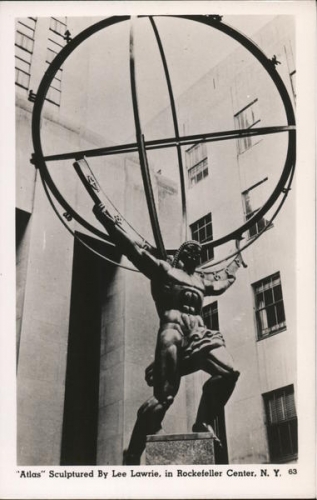
Il est d’ailleurs tout aussi symbolique que la statue en bronze du Titan Atlas créée par Lee Lawrie en 1936 soit érigée en plein cœur du Rockfeller Center; elle ne pouvait trouver meilleur emplacement.
L’Occident nouveau est donc un concept américain. La standardisation du monde commençait en même temps que son uniformisation.
Lorsque Spengler fit paraître son livre, Le Déclin de l’Occident en 1918 juste à la fin de la Première guerre mondiale, c’était en fait l’Occident européen qui mourait pour laisser place à l’Occident américain.
En même temps sont apparues tout au long du XIXe siècle quantité d’inventions scientifiques et techniques qui faisaient penser que le monde entrait dans une phase de bonheur et de prospérité matériels.
L’électricité, le cinéma, la photographie, le télégraphe, le téléphone, la machine à vapeur, le train, l’avion… un tourbillon d’inventions techniques qui ne pourront que tourner la tête des foules et les persuader qu’une ère nouvelle était en train de bouleverser leur vie, celle du progrès sans fin.

Les bonnes âmes européennes ont voulu faire profiter de leur immense savoir tous ces pauvres gens des pays qu’on n’appelait pas encore sous-développés, mais plutôt non-civilisés, restés si longtemps dans «l’ignorance»; des bataillons d’instituteurs socialistes en blouse grise sillonnaient les sentiers africains pour donner une instruction aux populations, des Dr Schweitzer, stéthoscope au cou, traquaient la malaria dans l’obscurité des huttes, des Pères Blancs attentionnés soignaient les populations africaines reconnaissantes, des ingénieurs en redingote creusaient le sol pour chercher une goutte d’eau devant des enfants rigolards, l’Europe qui était devenue l’Occident déversait la lumière sur le monde, oui, si le XVIIIe siècle était le Siècle des Lumières (les lumières de ces philosophes irresponsables qui ont amené la catastrophique Révolution française), le XIXe siècle était le Siècle de la Lumière, de la fée Electricité, de la technoscience, du progrès sans fin, on apprenait aux petits Africains qu’ils descendaient du singe, celui qu’ils voyaient descendre de l’arbre: la belle idée de Charles Darwin!
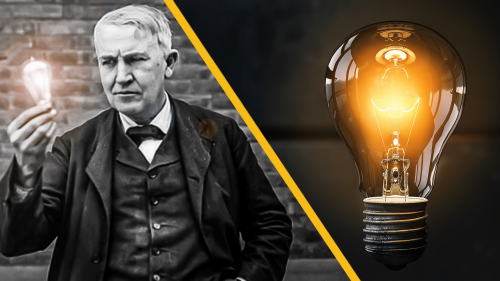
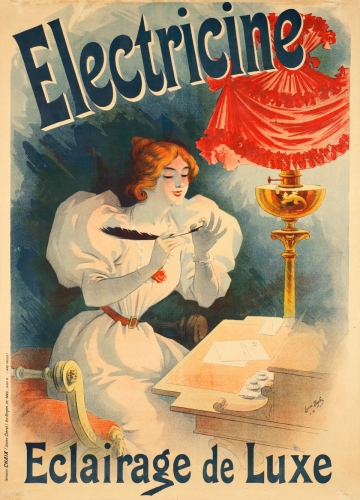
L’Occident américain
En 1620, La secte des Puritains, des personnages austères aux longues barbes et aux vêtements sombres, débarquaient du Mayflower à Cape Cod dans le Massachussetts en s’assurant que les mollets de leurs épouses n’excitent pas trop les indigènes qui regardaient le spectacle d’un air goguenard.
La colonisation de l’Amérique par ces biblistes fanatiques qui venaient d’être chassés d’Europe, plus précisément d’Angleterre puis de Hollande, ne s’est pas faite dans le même état d’esprit que la colonisation française par exemple, telle que je viens de l’évoquer; les Français s’établissaient dans un pays avec la conviction, à tort ou à raison, d’apporter les bienfaits de la «civilisation» aux peuples qu’ils colonisaient; la démarche des colons américains était inverse: ils étaient là pour prendre et non pas pour donner.

Pour preuve, en Algérie, la population indigène a été estimée à 2,5 millions d’habitants en 1830, 12 millions en 1962 et elle est évaluée à 47 millions en 2025.
En comparaison, il y avait environ 10 millions d’Amérindiens à l’arrivée des colons en Amérique du Nord et 250.000 en 1900; ce chiffre est remonté à 6 millions actuellement en incluant les métissages. De fait, nombre d’historiens concluent à l’existence d’un génocide (Moyenne des fourchettes données par l’I.A. Grok; il est très difficile, sinon impossible d’avoir d’autres sources fiables, notamment universitaires. Cependant, même ces fourchettes ne laissent pas de doute sur la réalité d’un génocide (7) perpétré par les Américains sur la population autochtone (8)).
Cortès voyait dans l’Amérique du Sud un Eldorado, un pays où l’on trouve de l’or à profusion.
Ceux qu’on appellera plus tard les Pères pèlerins, les Pilgrims, voient dans l’Amérique du Nord un Nouveau Monde (9), celui que Christophe Colomb n’a pas découvert, mais surtout une terre vierge qu’ils ont identifiée à la Terre promise d’Israël, à la lecture quotidienne de la Bible, le seul livre qu’ils connaissaient.

Ils reprenaient à leur compte ce mythe (10) qu’ils n’avaient pas créé mais qu’ils se persuadaient d’incarner physiquement, en quelque sorte par procuration; ils revivaient, par leur exil, l’épopée fantasmée des Hébreux dont tous leurs enfants portaient les prénoms. Les biblistes considérèrent dès lors la terre sur laquelle ils venaient de poser les pieds et dont ils ignoraient la vaste étendue, comme la leur, leur terre promise, Israël constituant la nouvelle «maison-mère» des nouveaux Américains, leur véritable patrie spirituelle.

Mais, pas plus que pour leur modèle, la terre que les Puritains venaient occuper ne leur appartenait. Elle n’était pas vierge. Elle appartenait aux innombrables tribus natives, aux autochtones qu’on appellera ensuite Amérindiens pour tenter de corriger l’erreur de Christophe Colomb, tout comme la « Terre promise » des Hébreux appartenait aux Palestiniens. Pour les uns et pour les autres, cette appropriation était abusive, fondée sur un malentendu. Américains et sionistes se sont persuadés que Dieu distribue les terres comme des bons points ; encore faut-il que les heureux bénéficiaires de Ses largesses soient méritants.
Les deux diables qui sortent de la boîte à malices : Trump et Netanyahou
Cet article raconte aussi, en parallèle, l’histoire de deux vies que rien ne destinait à se rencontrer, Trump et Netanyahou qui se sont avancés l’un vers l’autre comme deux frères siamois, une hydre à deux têtes, chacune des deux têtes s’appropriant le destin de l’Occident à sa façon, le confisquant jusqu’à le faire disparaître.
Chacun des deux a été influencé par des fanatiques religieux abrahamiques considérant Israël comme le socle sur lequel ils devaient s’appuyer.
Les deux frères jumeaux se connaissent pourtant bien, et de longue date: l’un s’appelle Titan et l’autre Satan; et ce n’est pas un hasard si l’équivalent des Titans chez les monothéistes sont les anges rebelles, et de ce fait déchus, dont le chef s’appelle évidemment Satan, dont la racine serait la même que celle de Titan, selon le chercheur historien Daniel E. Gershenson.

J’ai le sentiment qu’avec ces deux-là, le diable est bicéphale, l’un continue, en la poussant à son paroxysme, la longue litanie des massacres Etats-Uniens (11), l’autre, de juif intégriste qu’il était, se révèle un second Hitler.
Les deux usent des mêmes moyens: la brutalité, le mensonge, la manipulation, les massacres de masse, la duplicité, la trahison et tous les deux renforcent la satanisation du monde.
Ils ont tous les deux à leur disposition une multitude de petits démons qui leur sont soumis et qui leur ressemblent, représentés par les petits chefs d’Etat européens, entre autres (il y en a d’autres aussi timbrés dans le monde, comme l’homme à la tronçonneuse, le président argentin Javier Milei).
En fait, ces deux démons ont fabriqué une dystopie et ont fait de l’Occident un cauchemar orwellien qu’ils ont l’intention d’appliquer sur la totalité de la planète, si les sociétés traditionnelles n’y mettent pas le holà.
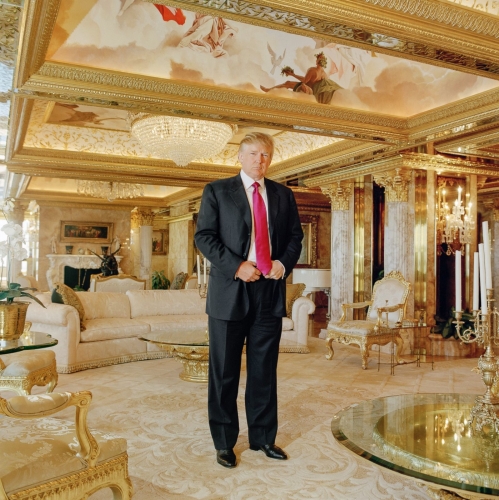
Qui est Donald Trump ?
Donald Trump est l’héritier, le pur produit de ces premiers Américains (Il préfèrera ce terme, «produit»: Trump ne comprend le terme d’«héritage» ou d’«héritier» qu’en espèces sonores et trébuchantes).
Donald Trump est issu d’un ancêtre allemand, son grand-père, qui a fait fortune en ouvrant des tripots mal famés pour accueillir les chercheurs d’or du Yukon en 1900. C’est l’origine de la saga des Trump.
C’est la grand-mère de Donald Trump qui, après la mort de son mari, a créé la société de promotion immobilière qui sera gérée par Fred, le père de Donald, qui en fera un empire, après maints déboires, procès et péripéties.
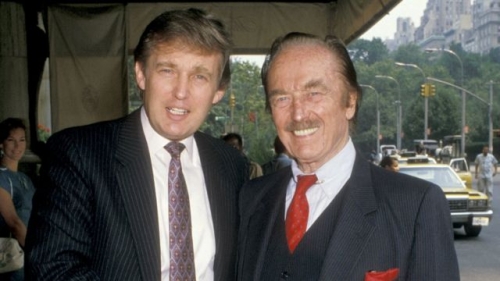
Donald Trump et son père, Fred Trump.
Détail à retenir: durant les années 1980, Fred Trump fait la connaissance de Benyamin Netanyahou, qui représente alors Israël auprès de l'Organisation des Nations unies à New York. Fred Trump devient ainsi un soutien important de la droite israélienne et achète des obligations d'État israéliennes.
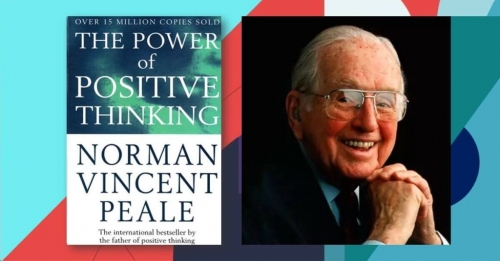
Sur le plan religieux, Trump a été formé par un pasteur nommé Norman Vincent Peale qui prêchait «l’optimisme et la réussite, matérielle autant que spirituelle. Supporter de Richard Nixon, très hostile à la candidature du catholique John Kennedy en 1960, il admirait les hommes d’affaires prospères et truffait ses sermons d’anecdotes sur les grands industriels qu’il connaissait (12)».
La formation et la «pensée» de Trump semblent donc pouvoir être facilement cadrées dans leurs grandes lignes, qui rejoignent celles de l’Américain moyen, même quand il n’est pas milliardaire, et qui se résument dans la devise nationale officielle des États-Unis: in God we trust.

Ray(mond) McGovern, ancien conseiller de la présidence américaine, définit le caractère de Trump comme de type «mercuriel», «c’est le mot qui décrit Trump», dit-il, «Mercure était le patron des escrocs, des voleurs, des tricheurs. […] Trump a un tempérament changeant, délirant, narcissique (13)».
Certains ont cru que les revirements, les gesticulations, la brutalité et les pirouettes de Trump pouvaient s’expliquer par le fait qu’il était «tenu» par l’Etat occulte qui sait ce qui est exploitable à son encontre dans le dossier concernant l’affaire Epstein.
En fait, si on analyse le portrait que je viens de tracer de ce personnage sur le plan de son éducation, de ses croyances, de son milieu, de son caractère, sa façon psychotique de se comporter n’a pas besoin de plus d’explication psychologique ou de pression: il est naturellement fruste et irréfléchi et ne peut pas être pris au sérieux, comme tous ses collègues présidents occidentaux qu’il critique mais auxquels il ressemble: il est mégalomane, perturbé, décadent, inconstant et inconsistant.
Ses dernières saillies sur le Groenland ne peuvent que confirmer ce portrait : «Sur la question du Groenland, comme sur sa mainmise sur le Venezuela, Trump explique que rien ne pourra l'arrêter, à part ʺsa propre moraleʺ. ʺJe n'ai pas besoin du droit internationalʺ, a-t-il expliqué au New York Times» (Les Echos, 9 janvier 2026).
Toujours sur la question du Groenland, «Le fait qu’ils aient débarqué là avec un bateau il y a 500 ans ne veut pas dire qu’ils possèdent le territoire», a assuré le président américain devant la presse à la Maison-Blanche ce vendredi 9 janvier 2026; le Groenland (2.166.086 km, la plus grande île du monde) a été découvert par Erik le Rouge en 982 après les… Amérindiens de la culture Saqqaq et n’a appartenu au Danemark qu’en 1814. Si l’on suit le raisonnement de Trump, ni les premiers Américains qui ont débarqué à Cape Cod en 1620 ni les suivants n’ont aucune légitimité à revendiquer l’Amérique.
Enfin, cerise sur le gâteau, la psychanalyste Élisabeth Roudinesco, dans un article publié le 16 janvier 2026 dans Le Grand Continent, intitulé: "Donald Trump est-il totalement fou?", a tracé un portrait pour le moins inquiétant de cet homme qui tient le monde entre ses mains (14); extrait de cet article passionnant: «Trump aime les médailles, le clinquant, les fausses dorures, et il croit que ces signes extérieurs sont l’équivalent d’un vrai titre: il a une passion pour les salles de bal et les signes de la vie monarchique. Il se rêve en roi — de style Louis XIV à Las Vegas — couvert de décorations et de breloques. Le signifiant ʺNobel de la Paixʺ est une obsession chez lui, alors même qu’il est un brutal faiseur de guerre ayant échappé par terreur au service militaire — quatre reports d’incorporation…
Cela en dit long sur ce qu’il est: il préfère être dupé que de risquer quoi que ce soit et il ne craint pas le ridicule. Là est son délire visible: un délire des grandeurs fondé sur le culte de son ego; un délire narcissique d’histrion qui devient d’autant plus dangereux que son entourage s’y soumet».
Lorsque je disais que tous ces dirigeants «occidentaux» se ressemblent dans leur délire psychotique, il suffit de remplacer le nom de Trump par celui de Macron et vous n’avez pas une seule dissonance entre les deux portraits.
Le portrait qui suit, celui de son compère Netanyahou n’est guère plus encourageant pour la paix du monde, puisque procédant du même registre psychotique.

Qui est Benyamin Netanyahou ?
Benyamin Netanyhaou, né en 1949, est le fils d’un historien juif sioniste d’origine polonaise, né Mileikowsky, parti s’installer en Israël en 1920 avec sa famille; Bension Netanyahou – c’est son nom de plume - étudia l'histoire médiévale à l'Université de Jérusalem et commença à fréquenter les mouvements sionistes; il devint co-éditeur du mensuel Betar (1934-1935) puis partit, toujours avec sa famille, aux Etats-Unis en 1940 pour devenir le secrétaire de Vladimir Jabotinsky, juif ukrainien d’Odessa qui créa le parti sioniste révisionniste.
Benjamin Netanyahou étudiera l’architecture et l’administration des affaires aux Etats-Unis avant de partir en Israël entre 1967 et 1973 pour servir dans l’armée israélienne. A son retour aux Etats-Unis, il travaillera à l’ambassade d’Israël à Washington et sera ambassadeur de l’État hébreu auprès des Nations unies à New York de 1984 à 1988, c’est à ce moment qu’il rencontrera le père de Donald Trump avec lequel il nouera des relations amicales.
Benyamin Netanyhaou s’engagera ensuite en politique en Israël: il sera six fois Premier ministre et une trentaine de fois ministre à partir de 1996, mandats au cours desquels il sera de nombreuses fois inculpé pour diverses malversations en Israël et de «crimes contre l’humanité et crimes de guerre» par la Cour Pénale Internationale pour ses crimes contre les Palestiniens de Gaza.
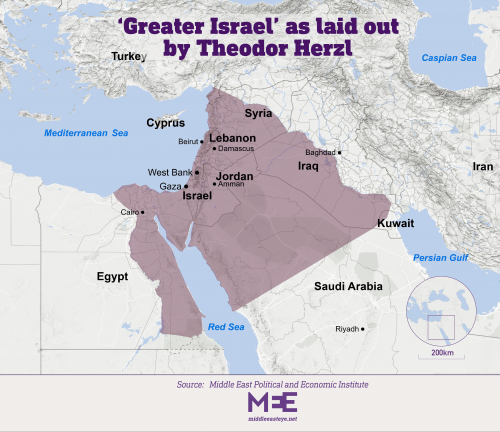
Le projet de Netanyhaou est d’arriver à constituer «Le Grand Israël» qui exige d’englober tous les pays autour d’Israël, tout ou en partie, et de les soumettre à l’Israël sioniste, le « peuple élu » de Dieu, ce qu’il a déjà commencé à faire.
Cette idéologie du «Grand Israël» trouve son origine dans les textes bibliques, qui définissent les frontières promises aux Hébreux allant «du Nil à l’Euphrate».
«Dans une interview récente donnée à la chaîne israélienne i24, le Premier ministre israélien a déclaré qu’il était en «mission historique et spirituelle» et ressentait un lien fort avec la vision d’un «Grand Israël». Selon plusieurs médias, il a même évoqué l’annexion de parties de territoires appartenant à des États arabes souverains (Cisjordanie et Gaza, mais aussi des parties du Liban, de la Syrie, de la Jordanie et même de l’Égypte) comme faisant partie de cette vision» (La Voix du Nord, 14 août 2025).
On a vu avec le traitement que son armée inflige à la bande de Gaza et à ses habitants, que Netanyahou, avec des méthodes inspirées des pratiques mafieuses, voire nazies, n’hésite devant aucune horreur ni aucun massacre de masse pour arriver à ses fins, bousculant ses propres concitoyens qui n’approuvent pas les méthodes du tyran; la plupart des Juifs sont arrivés en Israël pour y trouver un pays en acceptant d’y vivre avec le voisin palestinien qui leur concédait une (grande) place de leur terre ancestrale et non pas pour être en guerre de façon permanente.
L’Occident nouveau : le rêve dystopique de deux psychopathes
«L’Occident nouveau» n’a rien à voir avec le Beaujolais, il n’est pas tellement nouveau et, à vrai dire, il n’a plus rien à voir non plus avec l’Occident.
Il est américano-sioniste, issu de la diaspora juive qui commença lors de la prise de Jérusalem par Pompée en 63 av. J.-C. qui envoya en esclavage à Rome de nombreux prisonniers. C'est l'élément fondateur de la diaspora en Occident.
Une partie de cette diaspora, n’ayant de facto pas de pays d’attache, sinon virtuel, s’est tourné naturellement vers les concepts universalistes, puis mondialistes et globalistes, une idéologie mortifère qu’elle a répandue à travers le monde et qui a pris à son compte les rêves de grandeur de l’Israël sioniste.
« L’Occident » était constitué, depuis le rapt de l’Europe par les américano-sionistes, d’un triptyque: Israël, l’Amérique et «l’Union européenne». Israël dictait ses volontés à l’Amérique et l’Amérique dictait ses volontés à l’Europe de Bruxelles.
L’Occident nouveau est plus «technique», plus matérialiste et délibérément dédié à la conquête du monde, à la mise en place d’un Nouvel Ordre Mondial sans plus aucune attache géographique, historique, culturelle, morale et encore moins spirituelle; il s’appuie sans aucune gêne, et même au grand jour, sur ses services secrets qui, donc, ne le sont plus.
La coalition USA, CIA, MI6, U.E., Mossad et l'Israël sioniste pratiquent la manipulation intense et sont actuellement physiquement sur tous les fronts pour abattre les régimes qui sont un obstacle au déploiement du N.O.M. sur la planète sans, évidemment, aucun mandat international.
Les Iraniens ont clairement identifié ces jours-ci l’agression des américano-sionistes qui ont envoyé des centaines, voire des milliers d’agents armés pour fomenter les troubles qui ont perturbé l’Iran, mais ces agents ont lamentablement échoué et les américano-sionistes ont piteusement «reporté» le changement de régime qu’ils espéraient mettre en place; ils n’ont toujours pas compris qu’il ne faut pas se frotter à l’Iran.
Avant le «kidnapping» de Maduro au Venezuela, Trump avait mis de l’huile sur le feu des conflits en Ukraine et à Gaza et les Etats-Unis ont mené des frappes au Nigéria et en Syrie.
Depuis son retour à la Maison-Blanche en janvier 2025, Donald Trump, ʺprésident de la paixʺ, a ordonné presque autant de frappes aériennes que Joe Biden durant l’ensemble de son mandat, selon un décompte de l’ONG Acled. En un an, l’armée américaine a mené 672 frappes, principalement au Yémen et en Somalie, faisant plus de 1000 morts. Une stratégie militaire qui contraste avec l’image de « président de la paix » revendiquée par le chef de l’État. » (Ouest-France, 14 janvier 2026).
Ce monde en folie, sans repères et sans avenir que celui du chaos et de la guerre, est né de l’association de deux malfaiteurs qui ont impliqué dans leurs délires les deux Etats et les deux peuples dont ils sont les présidents, bafouant tous les deux les souhaits de leurs propres concitoyens qui n’aspiraient qu’à la paix; il ne fait aucun doute que Trump sera bientôt lâché par le mouvement Maga et Netanyahou par le peuple israélien, pour cause de trahison.
Cependant, tant que ces deux monstres n’auront pas été clairement identifiés comme des malades mentaux, et tant qu’ils ne seront pas dénoncés au plan mondial comme tels, la planète pétrifiée continuera à admirer leurs «exploits».
Pierre-Emile Blairon
Notes :
(1) Son aire géographique, linguistique et ethnique comprend les peuples grecs, italiques, albanais, indo-iraniens, celtiques, germaniques, nordiques, slaves, arméniens.
 (2) Oswald Spengler, Le Déclin de l’Occident, NRF Gallimard
(2) Oswald Spengler, Le Déclin de l’Occident, NRF Gallimard
L’œuvre monumentale de Spengler explique que les civilisations, tout comme les humains et tout ce qui vit sur Terre, traversent le temps de manière cyclique. Chaque civilisation naît, vit et meurt. Le cycle naissance-vie-mort pour un humain correspond au cycle préculture-culture-civilisation, dans la vision spenglérienne ; le terme même de « civilisation », dont se repaissent les progressistes, qu’ils assimilent à l’acmé, le point culminant, le paradis terrestre, n’est en fait que le stade de la décomposition et, in fine, de la mort d’un corps social parce que tout ce qui vit sur Terre est régi par la loi de l’involution et non pas de l’évolution et, donc, par analogie, un « être civilisé » est un être proche de sa fin.
On connaît le beau texte de Paul Valéry sur le sujet qui se rapproche de la conception de Spengler sur un mode plus romantique: «Nous autres, civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortelles. Nous avions entendu parler de mondes disparus tout entiers, d’empires coulés à pic avec tous leurs hommes et tous leurs engins ; descendus au fond inexplorable des siècles avec leurs dieux et leurs lois…».
(3) Et même avant : « C’est une page peu connue de l’histoire de la seconde guerre mondiale: dès 1941-1942, Washington avait prévu d’imposer à la France - comme aux futurs vaincus, Italie, Allemagne et Japon - un statut de protectorat, régi par un Allied Military Government of Occupied Territories (Amgot). Ce gouvernement militaire américain des territoires occupés aurait aboli toute souveraineté, y compris le droit de battre monnaie, sur le modèle fourni par les accords Darlan-Clark de novembre 1942. » Annie Lacroix-Riz, le Monde diplomatique, mai 2003.
(4) Nos dirigeants européens sont-ils des créatures façonnées par les derniers nazis survivants ?
(5) Kosovo/trafic d’organes: un Israélien arrêté à Chypre. https://www.la-croix.com/Monde/Kosovo-trafic-organes-Isra...
(6) https://www.rts.ch/play/tv/lactu-en-video/video/bernard-k...
(7) « D'abord, rappelons que le terme "génocide" a été défini par la Convention des Nations Unies de 1948 comme des actes commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Cela inclut non seulement les massacres directs, mais aussi les conditions de vie imposées pour entraîner la destruction physique ou culturelle du groupe. Raphael Lemkin, qui a inventé le terme en 1944, a lui-même considéré le déplacement des Amérindiens par les colons européens comme un exemple historique de génocide». (Grok)
(8) Le génocide des Amérindiens : https://www.youtube.com/watch?v=Ec4CrVDyGac
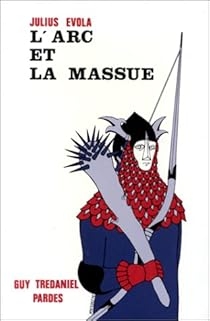 (9) Dans L’Arc et la Massue, Julius Evola écrivait qu’il est une bêtise que « l’on entend souvent répéter, à savoir que les Américains seraient une “race jeune”, avec pour corollaire tacite que c’est à eux qu’appartient l’avenir. […] En dépit des apparences, les peuples récemment formés doivent être considérés comme les peuples les plus vieux et, éventuellement comme des peuples crépusculaires, parce qu’ils sont venus en dernier justement, parce qu’ils sont encore plus éloignés des origines. »
(9) Dans L’Arc et la Massue, Julius Evola écrivait qu’il est une bêtise que « l’on entend souvent répéter, à savoir que les Américains seraient une “race jeune”, avec pour corollaire tacite que c’est à eux qu’appartient l’avenir. […] En dépit des apparences, les peuples récemment formés doivent être considérés comme les peuples les plus vieux et, éventuellement comme des peuples crépusculaires, parce qu’ils sont venus en dernier justement, parce qu’ils sont encore plus éloignés des origines. »
Il est vrai, en effet, que plus une civilisation est éloignée de la source originelle, et moins elle a de chances de s’y abreuver et de s’ancrer dans le monde spirituel parce qu’elle aura perdu les connaissances qui lui auraient permis de se raccrocher aux principes d’origine. Et Evola ajoutait: « « Les civilisations traditionnelles donnent le vertige par leur stabilité, leur identité, leur fermeté intangible et immuable au milieu du courant du temps et de l’histoire. »
(10) Pour l’historien des religions Mircea Eliade, tous les peuples naissent d’un mythe fondateur (voir Le Mythe de l’éternel retour et Le Sacré et le profane notamment), mythe qu’ils font perdurer par le rite.
(11) Voir quelques exemples de la folie meurtrière des Etats-Unis dans l’article de Georges Gourdin : "États-Unis : la culture du mensonge", https://nice-provence.info/2026/01/12/etats-unis-la-cultu...
(12) Voir mon article du 30 novembre 2025: "Trump veut-il vraiment finir la guerre en Ukraine?".
(13) Ibid.
(14) https://legrandcontinent.eu/fr/2026/01/16/donald-trump-es...
19:11 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, occident |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 21 janvier 2026
Seward, Trump et la tentation groenlandaise

Seward, Trump et la tentation groenlandaise
par Alessandro Mazzetti
Source: https://www.destra.it/home/seward-trump-e-la-tentazione-g...
Après les nombreux événements rocambolesques du Venezuela, qui, tous, demandent encore à être éclaircis, les déclarations de Trump concernant la nécessité pour les États-Unis d’acquérir le Groenland font écho. Ces affirmations de Washington ont suscité à la fois de l’indignation et de l’inquiétude, non seulement à Copenhague, mais dans toutes les capitales européennes.
Une surprise en partie injustifiée, car ce n’est certainement pas la première fois que Washington tente d’acheter l’île verte, découverte par Erik le Rouge. Nous allons essayer d’éclaircir un peu la situation en proposant une lecture différente de celles qui ont jusqu’à présent été publiées. Comme mentionné, le désir américain pour le Groenland est très ancien. Le premier à envisager son achat fut le secrétaire d’État de Lincoln, William Henry Seward (photo, ci-dessous), qui est devenu célèbre pour l’achat de l’Alaska par les États-Unis. Selon Seward, l’acquisition de la possession russe ne visait pas seulement à intégrer le Canada et à amorcer un processus d’américanisation de la domination anglaise, mais aussi à relancer la possibilité d’un autre achat potentiel: le Groenland.
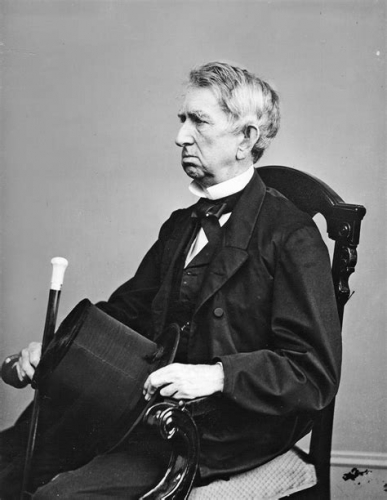
En résumé, la doctrine Monroe, ou plutôt l’intention derrière, était de créer un bloc politique-culturel anglo-saxon et germanique, qui pourrait également bénéficier de l’achat du Groenland et de l’Islande. L’offre fut rejetée par la monarchie danoise, et le projet de Seward fut interrompu. Le second cas remonte à la Seconde Guerre mondiale. Après avoir défendu l’île, installé des bases militaires et des centres d’observation météorologique, les Américains ont fait une proposition au gouvernement danois, qui la refusa poliment.
Ce n’est pas la première fois que Trump tente d’acheter l’île; cela remonte à août 2019. Pourquoi cet intérêt renouvelé ? Il est plausible d’en identifier deux raisons principales. La première est la nécessité de renforcer la doctrine Monroe, avec un projet qui, comme le démontrent les pressions exercées par la Chine et la Russie en Amérique du Sud, ainsi que le dynamisme du Mexique, date de plus de 150 ans. La seconde raison réside dans l’application des règles de Montego Bay 1982 (UNCLOS), permettant la création des Zones Économiques Exclusives, qui étendent jusqu’à 200 milles marins la souveraineté sur les eaux nationales.
Ce sujet met en évidence la nécessité pour les États-Unis de renforcer leur système de défense militaire, mais surtout d’accroître leur contrôle sur la route arctique, en raison de la guerre économique féroce en cours. Washington sait pertinemment que, depuis 2017, des navires chinois empruntent régulièrement ces routes, grâce à l’ouverture de l’Arctique. De plus, Pékin est actif dans ces zones depuis plus de vingt ans: les entreprises de l’ancien empire d'Extrême-Orient sont présentes depuis longtemps en Groenland, notamment à Kvanefjeld pour l’uranium, à Cittronen Fjord pour le zinc, à Illoqortormiut pour l’or, et à Isua pour le fer. La stratégie chinoise consiste à construire des infrastructures, ce qui leur confère un avantage stratégique considérable face à leurs concurrents. La Chine prévoit depuis des années de réaliser, à coûts très faibles et avec une main-d’œuvre locale, le réseau d’infrastructures indispensables pour relancer économiquement et commercialement l’île. En 2016, la proposition de Pékin pour réactiver l’ancienne base navale Blue West dans le fjord d’Arsuk a été rejetée délicatement par le gouvernement danois.
Les demandes chinoises pour la construction de pistes d’atterrissage et de nouveaux ports se sont intensifiées ces dernières années, tandis que le gouvernement de Copenhague a souvent repoussé ces offres pour ne pas heurter la sensibilité américaine. La tentative de Washington d’acheter économiquement le Groenland répond principalement à des besoins économiques et commerciaux, car dans un monde dominé par une économie maritime, celui qui contrôle les routes et les ports contrôle le cœur de l’économie. Bien que géographiquement et anthropologiquement le Groenland fasse partie du continent américain, l’île reste une possession européenne. Une acquisition pour des raisons non économiques serait impossible, car cela signifierait une rupture irrémédiable du monde occidental et la fin de l’Alliance atlantique.
22:10 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, histoire, william henry seward, états-unis, alaska, groenland |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Arndt Freytag von Loringhoven, vice-président des services de renseignement allemands (BND): «L’Europe est une colonie numérique des États-Unis»

Arndt Freytag von Loringhoven, vice-président des services de renseignement allemands (BND): «L’Europe est une colonie numérique des États-Unis»
L’ancien diplomate et agent de renseignement Arndt Freytag von Loringhoven voit la relation avec les États-Unis à un point historiquement bas – et, même, n’exclut pas la fin de l’OTAN.
par Manfred Ulex
Source: https://www.anonymousnews.org/deutschland/bnd-vize-europa...
Arndt Freytag von Loringhoven (photo, ci-dessous) a été vice-président des services de renseignement allemands, soit du Bundesnachrichtendienst (BND) de 2017 à 2020, et auparavant secrétaire général adjoint de l’OTAN pour le renseignement. Dans une interview avec la Berliner Zeitung, il a fait des déclarations remarquables. En regard de la relation transatlantique qui s'est détériorée entre l’Europe, ou l'UE, et les États-Unis, il a déclaré :
« Les relations transatlantiques sont à un point bas sous Donald Trump, il n’y a rien à enjoliver. Trump s’intéresse aux deals et aux affaires, pas à la préservation des valeurs, à la démocratie et au droit international. Dans son monde, les États autoritaires lui semblent souvent plus proches que l’Europe. Conséquence: l’Europe ne peut plus faire confiance aux États-Unis. »
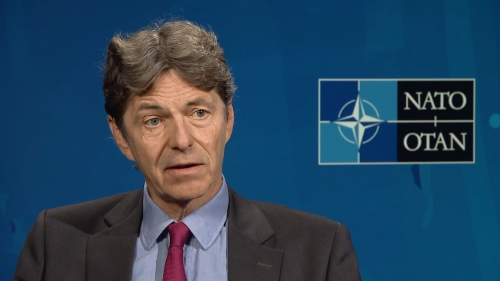
Il en a déduit que «l’Europe doit devenir plus souveraine» – tout en soulignant qu’elle n’aura plus l’influence mondiale qu’elle avait auparavant. Il réclame notamment que le gouvernement allemand fasse preuve de plus de fermeté – il ne suffit pas de souligner que «la situation est complexe», comme l’a fait le chancelier Friedrich Merz à propos de l’intervention militaire des États-Unis au Venezuela. La même règle s’applique à Groenland: «Une annexion du Groenland devrait être condamnée comme une violation claire du droit international».
En réponse à la question d’une éventuelle confrontation militaire au sein de l’OTAN sur cette grande île, il a répondu: «Trump veut le Groenland, je le vois de la même façon. Pour l’instant, je n’exclurais rien. Il existe bien sûr aussi l’option que les États-Unis n’iront pas aussi loin pour lancer une action militaire – mais tenteront de renégocier les relations, notamment en matière de sécurité, de ressources et de routes maritimes dans l’Arctique. Il est dans l’intérêt de tout l’Occident que la Russie et la Chine ne comblent pas cette lacune. Tant que cela se fera dans un processus de négociation ordonné et équitable, nous pourrons accompagner cela positivement. Mais une attaque militaire dans le but d’une annexion doit être clairement condamnée par l’Allemagne». Il a souligné :
« Une action militaire d’un partenaire contre un autre, surtout s’il s’agit du plus puissant allié – ici, la différence avec Chypre –, ébranlerait profondément la crédibilité de la promesse de solidarité. L’OTAN ne pourrait alors plus projeter de dissuasion. Même si elle ne se dissout pas formellement, comme cela semble être le cas actuellement, elle perdrait toute pertinence. »
En ce qui concerne Amazon, Google, Apple et autres, von Loringhoven a constaté une dépendance européenne énorme vis-à-vis des États-Unis: «L’Europe est une colonie numérique des États-Unis. Nous sommes devenus dépendants de l’Amérique d’une manière qui nous limite énormément sur le plan sécuritaire. L’Europe doit devenir souveraine – dans le numérique comme dans la défense».
Cela ne sera pas facile, a-t-il également souligné: «C’est évidemment un défi de taille, ce qui signifie: développer ses propres capacités en IA, infrastructures cloud, puces, réseaux – la guerre du futur sera numérique et menée avec des systèmes autonomes. La dépendance aux Américains est particulièrement grande, en plus du nucléaire, dans ce qu’on appelle les ‘strategic enablers’, c’est-à-dire dans la reconnaissance, les capteurs et les transports aériens à grande échelle».
21:44 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, états-unis, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Protéger l’Ukraine pour protéger le Groenland? Sur la logique du document de la DGAP allemande sur la «Doctrine Donroe»

Protéger l’Ukraine pour protéger le Groenland?
Sur la logique du document de la DGAP allemande sur la «Doctrine Donroe»
Elena Fritz
Source: https://t.me/global_affairs_byelena
La Société allemande pour la politique étrangère (DGAP) a publié début 2026 un mémo (https://dgap.org/en/research/publications/donroe-doctrine-requires-firm-calm-response-europe), qui, sous le mot-clé de «Doctrine Donroe», étudie la politique extérieure de la deuxième présidence de Donald Trump.
Ce document mérite l’attention – non pas parce qu’il convainc nécessairement, mais parce qu’il montre de manière exemplaire comment la politique étrangère allemande est actuellement pensée, encadrée et priorisée.
Tout d’abord, voyons l'argumentation du mémo.
L’autrice décrit la politique extérieure de Trump comme une rechute dans une pensée typique du 19ème siècle: nationaliste, imprégnée de christianisme, ouvertement orientée vers la puissance. Le terme «Doctrine Donroe» doit illustrer que Trump réinterprète la doctrine classique de Monroe – qui consiste à protéger l’hémisphère occidental – de façon renouvelée, plus débridée et plus explicite que les gouvernements américains précédents. Trois éléments la caractérisent: d’abord, un mépris ostentatoire pour les normes internationales; ensuite, un «mercantilisme musclé», où les gains économiques sont garantis et sécurisés par la puissance militaire; et enfin, une approche politique reposant expressément sur le court terme, qui relègue la stabilité, les alliances et les effets secondaires au second plan.

De cette analyse découle une mise en garde sur le plan de la sécurité pour l’Europe – notamment en ce qui concerne le Groenland. Même si une annexion est considérée comme peu probable, la région est interprétée comme un cas-test de la projection de puissance américaine. L’Europe doit donc agir de manière unie, souligner son autonomie et tenter de « faire comprendre » ses intérêts en matière de sécurité aux Américains.
Jusqu’ici, le document reste dans le cadre d’une analyse classique des risques. L'étape décisive intervient cependant ensuite – et c’est précisément là que commence le problème.
En effet, la DGAP conclut que l’Europe – et implicitement l’Allemagne – doit poursuivre résolument et approfondir son soutien à l’Ukraine pour contrer d’éventuelles ambitions expansionnistes américaines. La politique envers l’Ukraine devient ainsi une clé stratégique: preuve de la capacité d’action européenne, signal de fermeté face à Washington, et expression d’un réel sujet politique.
Ce lien stratégique constitue le point névralgique du mémo.
Car c’est ici que différents espaces conflictuels, intérêts et logiques de pouvoir sont connectés de manière fonctionnelle, sans qu’une causalité sécuritaire solide soit établie. Pourquoi des livraisons d’armes et un soutien financier durable à Kiev doivent-ils, en particulier, permettre d’atténuer les ambitions américaines dans l’Atlantique Nord, reste inexpliqué. L'Ukraine n’est pas traitée comme un problème de sécurité autonome, mais comme un instrument symbolique universel de la puissance européenne.
Cela nous amène à la question des intérêts.
Contrairement à certaines critiques, le mémo de la DGAP définit clairement les intérêts européens – et donc aussi les intérêts allemands. Selon lui, ils résident dans le maintien de l’ordre basé sur des règles, dans la cohésion européenne et dans une continuité politique crédible, incarnée principalement par la politique envers l’Ukraine. C’est cohérent – mais extrêmement réducteur.
Car les intérêts allemands ne sont pas formulés comme le résultat d’une priorisation ouverte, mais comme une déduction d’un postulat d’ordre. Divers champs politiques – Arctique, Europe de l’Est, relations transatlantiques – ne sont pas évalués séparément, mais regroupés normativement. Les coûts, risques et alternatives pour l’Allemagne elle-même restent peu analysés : c'est-à-dire les coûts politiques, énergétiques, économiques, fiscaux, sécuritaires.
La politique extérieure apparaît ainsi moins comme un instrument de défense des intérêts de l’État que comme une épreuve de fidélité à l’ordre. Toute déviation ne met pas en danger une position concrète mais toute la crédibilité européenne.
C’est précisément là que réside le danger de telles logiques issues de think tanks. Elles remplacent l’évaluation stratégique par des chaînes d’arguments moralement connotés. Elles relient les conflits, plutôt que de les désolidariser. Et elles définissent la capacité d’agir politique non pas par la réalisation d’objectifs, mais par la continuité d'une attitude.
Conclusion :
Le document de la DGAP est moins une analyse de la politique extérieure américaine qu’un miroir de l’auto-affirmation européenne. Il montre comment les intérêts allemands sont actuellement pensés: fortement liés à l’ordre en place, faiblement priorisés, très symboliques. Mais si l’on veut réellement orienter la politique extérieure allemande selon des intérêts nationaux, il faut précisément commencer ici – et reposer la question à laquelle le mémo répond trop vite :
Qu’est-ce qui sert concrètement l’Allemagne – et qu’est-ce qui sert surtout une certaine vision du monde en matière de politique extérieure ?
19:24 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, europe, affaires européennes, ukraine, groenland, allemagne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
De la souveraineté comme état d'urgence: la géopolitique à l'ère de Trump - Commentaire métaphysique sur les événements de 2025–2026

De la souveraineté comme état d'urgence: la géopolitique à l'ère de Trump
Commentaire métaphysique sur les événements de 2025–2026
Alexander Douguine
La mort du droit international et la triomphe de la « Power Politics »
Question : Alexandre Geliévič, tournons-nous vers les turbulences qui ont surgi au passage de l'année 2025 à l'année 2026. Nous assistons à une escalade synchrone: Venezuela, Groenland, la nouvelle rhétorique de Trump, instabilité autour de l’Iran. Pourquoi ce «projectile» géopolitique à têtes multiples est-il tombé de manière si rapidement à intervalles réduits?
A.D. : Nous sommes témoins d'un moment de vérité — la réalisation des plans que Donald Trump a déjà formulés lors de la campagne électorale de 2024–2025. Ce qui était alors perçu comme de l’extravagance, du vandalisme diplomatique ou du grotesque irréalisable — je veux parler des idées d’annexion du Groenland, de absorption du Canada ou d’invasion directe du Venezuela — prend aujourd’hui forme concrète. Trump n’a pas seulement déclaré la transition vers la Power Politics (politique de puissance), il a commencé à la mettre en œuvre de manière implacable.
Sa maxime récente — « international law doesn't exist » (le droit international n’existe pas), et la seule source de légitimité étant le soi de l’acteur — n’est rien d’autre qu’une définition pure et distillée de la souveraineté. Car selon Carl Schmitt, le souverain est celui qui prend une décision en situation d’exception (Ausnahmezustand). Toute guerre, toute rupture de l’équilibre mondial, constitue une situation d’exception par excellence. Et celui qui impose sa volonté dans ce chaos — est le souverain, peu importe s’il correspond ou non aux normes juridiques.
Il faut s'en rendre compte: le droit international n’est toujours que le produit du consensus des vainqueurs. Lorsque l’architecture juridique existante cesse de satisfaire la voracité des grandes puissances — comme ce fut le cas en Angleterre aux 16ème–17ème siècles, lorsqu’elle s’est arrogée le monopole des mers, provoquant un conflit avec le monde ibérique — la guerre commence. Trump a déclaré: ce moment est arrivé.
Le système a commencé à pourrir dès la dislocation de l’URSS, lorsque des traîtres dans notre direction ont commis un crime allant au-delà de la catastrophe — ils ont remis à l’ennemi les clés du «Grad» (armes et missiles) sur un plateau d’argent. Avec la disparition du camp socialiste, la structure du droit international s’est affaissée et a commencé à s’éroder. Et alors que les libéraux rêvaient d’un monde global, Trump a brutalement interrompu ces rêves: d’abord, renforcer l’hégémonie américaine et l’État-nation, promouvoir le mondialisme est dès lors remis à plus tard. Nous sommes au cœur de la Troisième Guerre mondiale, dans le processus de redéfinition de la carte du monde.
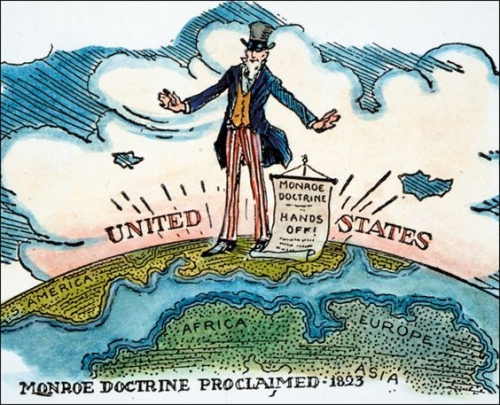
Néo-Monroïsme et fin des petites souverainetés
Trump a actualisé la fameuse «doctrine du dollar de Monroe». Si James Monroe, au 19ème siècle, postulait la libération de l’Amérique de toute influence européenne, Trump a inversé cette thèse: cela signifie désormais la gestion directe et totale de Washington sur tout l’hémisphère occidental. Comme Tucker Carlson l’a justement noté, il s’agit du passage de la République à l’Empire.
Dans cette situation, la Russie n’a pas d’autre choix ontologique que de se proclamer "Empire" à son tour et d’affirmer la Doctrine de Monroe eurasienne: « L’Eurasie — pour les Eurasiens. »
- Trump déclare: "L’hémisphère occidental appartient aux États-Unis".
- Nous devons répondre: "L’hémisphère oriental est la sphère de domination de la Russie et de la Chine (ainsi que de l’Inde)".
Nous entrons dans l’ère d’un monde tripolaire. Le destin de l’Europe dans cette configuration est désastreux et imprévisible — elle risque de devenir la victime de la prochaine guerre pour le Groenland entre les États-Unis et l’OTAN, et les élites bruxelloises, déjà totalement désemparées, sont prêtes à collecter des fonds pour la «défense du Danemark».
Pour nous, l’impératif est clair: devenir un pôle souverain de puissance. Dans cette nouvelle topologie mondiale dure, les petits États-nations appartiennent au passé. La notion de souveraineté pour les pays sans bouclier nucléaire est forcément annulée.
- L’Arménie, par exemple, n'a pas les moyens d'être souveraine.
- La Géorgie ou l’Azerbaïdjan, de la même façon, ne peuvent pas davantage être souverains.
- Le Kazakhstan, l’Ouzbékistan, le Tadjikistan ou le Kirghizistan ne peuvent pas être souverains.
Soit ils deviennent partie intégrante de notre Union, de notre "Grand Espace" (Grossraum), soit ils deviennent une plateforme du Front Occidental (ou de la Chine). Il n’y a pas d’autre alternative. L’époque des «Confédérations neutres» est terminée.
L’Étranglement Énergétique et la « Pensée après Gaza »
Question : Ne se met-il pas en place, contre nous, une stratégie d’étranglement énergétique par la chute des prix, compte tenu des réserves disponibles au Venezuela, en Iran et des ambitions arctiques des États-Unis?
A.D. : Les risques sont colossaux, de fait. Trump, en attaquant notre flotte fantôme et en imposant des sanctions, cherche à nous priver du «droit de respirer». L’énergie est une arme. L’attaque contre Maduro, la pression sur l’Iran, les revendications sur le Groenland — tous ces éléments forment une chaîne de blocages de nos perspectives arctiques, des perspectives arctiques qui nous ont été données par Dieu.
Mais répondre en « exprimant une préoccupation » ou faire appel au vieux droit international — c’est montrer une faiblesse que Washington et Bruxelles ne cessent de railler. Nous sommes déjà dans un monde où le «chant du prophète Jérémie» est inapproprié.
De plus, je suis convaincu: une prochaine opération de changement de régime se prépare contre la Russie.
- D’abord, ils ont, par le truchement d'Israël et des États-Unis, éliminé la direction du Hamas et du Hezbollah.
- Ensuite, ils ont tué des officiers de la Garde révolutionnaire iranienne (IRGC) et des scientifiques nucléaires iraniens.
- Maintenant — une attaque de drones contre la résidence de notre président et une attaque contre la triade nucléaire.
C’est une «marque noire». Il n’y a plus de lignes rouges. Notre réponse doit être un régime dans lequel chaque jour devient la «Journée de l'Orechnik». Les attaques doivent viser les centres de décision, la direction politique du régime terroriste ukrainien.

Nous devons maîtriser la philosophie terrifiante qui s'est instaurée — cette philosophie, c'est la pensée de l'après-Gaza. Comme Adorno a questionné la possibilité de la poésie après Auschwitz, nous devons comprendre: en 2026, la référence, qu'on le veuille ou non, c'est Gaza.
- Soit tu transformes l’ennemi en Gaza.
- Soit tu deviens toi-même Gaza.
C’est une conclusion anti-humaniste, véritablement immorale, mais nous n’avons pas d’autre choix, vu les circonstances. Les vainqueurs — Netanyahu, Trump, Zelensky — ne sont pas jugés. Nous, par humanité, ne considérions pas les Ukrainiens comme des ennemis, car nous croyions qu’ils faisaient partie de notre propre peuple. Mais en regardant Zelensky, Boudanov, Malyuk — je ne vois pas en eux des expressions de notre peuple. Ils relèvent d'une ontologie différente, qui nous est étrangère. Et si nous continuons à jouer à l’humanisme et à basculer dans des mièvreries à la «Tchebourachka», à célébrer des mariages au milieu de l’apocalypse — il n’y aura plus ni mariages ni Tchebourachka ni Russie.
Trump: Ennemi honnête et chance de victoire
Question: Il y a un an, vous avez qualifié Trump de «chance», car il n’est pas un maniaque du même type que les mondialistes fous. Votre opinion a-t-elle changé après un an de son mandat?
A.D.: Trump est à la fois un ennemi et une chance. Le fou, c’était Biden avec son mondialisme hypocrite, qui a déclenché la guerre en Ukraine. Trump, lui, incarne la volonté de puissance; il a abandonné «le langage du mensonge» parce qu’il n’en a plus besoin. Son monde — c’est celui de la formule «Je peux le faire et je le ferai».
Au cours de cette année, Trump a évidemment évolué — au départ de l'intéressant programme MAGA, il s'est malheureusement rapproché des néoconservateurs. En politique intérieure, il n’a rien fait — ni arrestations de corrompus, ni purges promises (où en est l’affaire Epstein?). Mais en politique étrangère, il s’est montré bien plus interventionniste que prévu.
Mais c’est cela, sa «sincérité». On ne peut pas jouer avec lui à la diplomatie truquée — car, dans ce cas, il sort simplement une arme. Il ne comprend que le langage de la force. Et c’est notre chance. Nous devons agir en miroir: ne pas expliquer, ne pas justifier, mais prendre ce qui nous revient. Trump ne respecte que ceux qui sont capables de réduire l’ennemi en ruines — comme Israël avec Gaza (que Trump, il faut le noter, a tacitement approuvé).
Phénoménologie du cynisme
Question : Mais qu’en est-il de ses tweets sur «l’esprit d’Anchorage» et de son amitié avec Poutine?
A.D.: C’est un cynisme absolu, cristallin. Trump loue avec le même pathos la «grande boisson diététique» qu’il boit à flots, et les négociations avec le leader d’un pays insulaire comme Vanuatu. Il ne tente même pas de mentir — il retransmet simplement le flot qui jaillit de sa conscience, où tout est «great».
Sa tentative de «sauver l’Ukraine» par une trêve a été pour nous un piège mortel, et, heureusement, son arrogance impériale a rapidement ramené tout à l’ordre — aux ultimatums que nous avons rejetés. Trump est transparent. Quand il ne dit pas directement «Je vais vous tuer», il le sous-entend. Nous avons appris à lire ces pensées. Il n’y a plus de place pour les illusions et les négociations. Il ne reste que la Volonté de la Victoire — la volonté de triomphe, laquelle sera exclusivement appuyée sur ses propres forces.
15:05 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, russie, états-unis, donald trump, alexandre douguine |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 20 janvier 2026
Quels droits humanitaires en Venezuela et en Iran? Les changements de régime servent à sauver le petrodollar

Quels droits humanitaires en Venezuela et en Iran?
Les changements de régime servent à sauver le petrodollar
De Glauco Benigni
Source: https://comedonchisciotte.org/ma-quali-diritti-umanitari-...
Il est très difficile de défendre pleinement à la fois le gouvernement de Maduro et celui des ayatollahs de Téhéran… Les raisons pour lesquelles les États-Unis cherchent à évincer le premier et planifient en ce moment même de réattaquer et d’éliminer le second sont multiples et de nature variée. Restons-en aux motifs « éthiques, humanitaires » et « économiques, géopolitiques ».
La narration dominante est que l’Occident, dirigé par son shérif affairiste, veut rétablir l’ordre et la Pax Americana dans ces nations pour des raisons humanitaires. Malheureusement, cette argumentation, même si elle est partiellement vraie, n’est qu’un prétexte et permet d’ouvrir un débat médiatique qui détourne de la véritable raison principale, à savoir le motif économique et géopolitique, basé sur la « crise du dollar américain et l’immense dette publique de l’empire ».
Tant que l’Occident considérera que 38 trillions de dollars de dette publique ne sont pas aussi scandaleux qu’un régime autoritaire, mais tolérables pour la planète, le focus restera uniquement sur le premier aspect : « intervenir pour redonner la liberté aux peuples opprimés », un mantra qui ne convainc plus personne sauf ceux qui animent les talk-shows et qui titrent dans les journaux.
La réalité est différente : la dette publique américaine doit, pour continuer à tenir debout, même avec des béquilles et en vacillant, avoir un dollar qui conserve sa caractéristique de « monnaie de réserve mondiale ». C’est seulement ainsi qu’il y aura encore quelqu’un qui achètera des obligations américaines, contribuant à justifier l’existence d’une dette publique monstrueuse. Mais pour rester « hégémonique », le dollar américain doit continuer à être utilisé comme monnaie privilégiée dans les échanges commerciaux mondiaux, notamment pour l’achat et la vente de matières premières et de ressources énergétiques, en premier lieu le pétrole. C’est ainsi depuis 50 ans !

Cette « pratique », appelée « la loi du petrodollar », imposée en 1973-74 aux pays de l’OPEP puis au reste du monde, suite à un accord entre Kissinger et le monarque saoudien de l’époque, a justifié l’émission à l’envi de dollars par la Fed parce que chaque trésorerie devait disposer de billets verts pour faire face aux urgences et aux achats énergétiques, acceptant ainsi d’acheter les «fiches dollar – monnaie imprimée».
Les deux premiers dirigeants qui ont tenté de briser cet accord, en proposant de vendre du pétrole dans d’autres monnaies, furent Saddam Hussein et Kadhafi. Vous vous souvenez de ce qu’il est advenu d’eux?
En 2012, l’Iran a commencé à vendre du pétrole en roubles et en yuans, et quelques analystes américains importants ont écrit «c’est la fin d’une ère». Par la suite, d’autres pays producteurs de pétrole, dont la Russie, ont commencé à vendre en monnaies différentes du dollar. Le Venezuela vend depuis des années en yuan à la Chine, et depuis 2024, l’Arabie saoudite, qui a refusé de renouveler le pacte du petrodollar après 50 ans, vend aujourd’hui du pétrole en diverses monnaies.
Il se trouve aussi que tous ces pays occupent des positions importantes dans la zone BRICS+ : le conglomérat géopolitique qui se révèle être l’Antagoniste du IIIe millénaire par rapport à l’Empire américain d’après la Seconde Guerre mondiale.
Faites le calcul : si le Venezuela et l’Iran, deux des plus grands producteurs de pétrole au monde, continuent à vendre leur «or noir» dans d’autres monnaies que le dollar, et si (comme actuellement) ils vendent via la Chine aux pays de la zone BRICS+, et si, de plus, la part du yuan dans le commerce mondial continue de croître… combien de temps l’hégémonie du dollar américain pourra-t-elle encore durer avant que Washington ne soit ensevelie sous la montagne de papier que seraient les dollars?

Voici donc la véritable raison qui oblige, littéralement « force », les États-Unis, à tenter un changement de régime, tant en Venezuela qu’en Iran, dans l’espoir d’enrayer l’hémorragie qui a frappé leur monnaie.
L’objectif était aussi de changer de régime en Russie en l’encercant, mais ils se sont enlisé avec toute l’OTAN. L’idée est : « Changer aussi de régime en Arabie saoudite ? » Je ne sais pas. Mais si cela continue ainsi, rien n’est exclu.
Bien entendu, si la situation évolue ainsi, la Chine et la Russie ne resteront pas à regarder. Nous pourrions être très proches de la fin. Jusqu’à la chute de Maduro, on aurait dit que les trois tsars avaient tracé les contours d’un nouveau Yalta. Aujourd’hui, on ne sait plus si Trump est contraint de faire ce qu’il fait, avec toutes les conséquences que cela implique. Attachez votre ceinture, car nous entrons dans une zone de fortes turbulences.
Espérons que tout ira bien.
20:22 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : regime change, iran, venezuela, petrodollar, actualité |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Joseph Stiglitz et le déclin de l’Europe

Joseph Stiglitz et le déclin de l’Europe
Andrea Marcigliano
Source: https://electomagazine.it/stiglitz-e-il-declino-delleuropa/
Joseph Stiglitz n’utilise pas de périphrases. Il ne tourne pas autour du sujet. Il va droit au cœur de la question.
L’euro a échoué dans sa seule et essentielle mission: favoriser l’unification, politique et économique, de l’Europe.
Et il a échoué parce qu’il a été totalement soumis aux intérêts particuliers des lobbies financiers et des pays individuels, totalement indifférents à l’intérêt commun.
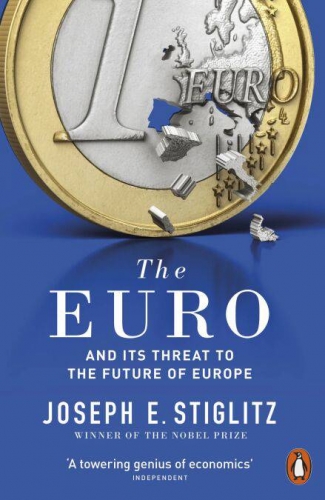
Au contraire, ils ont agi dans le sens opposé à celui de l’intégration européenne. Ils ont exploité l’euro sans jamais initier un processus d’intégration politique, pourtant nécessaire.
Une évaluation extrêmement sévère. Surtout parce qu’elle ne vient pas d’un quelconque idéologue, mais d’un Prix Nobel d’économie. De plus, d’origine démocratique, avec Keynes comme référence.
Bien sûr, Stiglitz a reçu le Nobel pour la microéconomie.
Mais, avec le temps, il a commencé à s’intéresser de plus en plus aux grands problèmes, économiques certes, mais aussi politiques et sociaux.
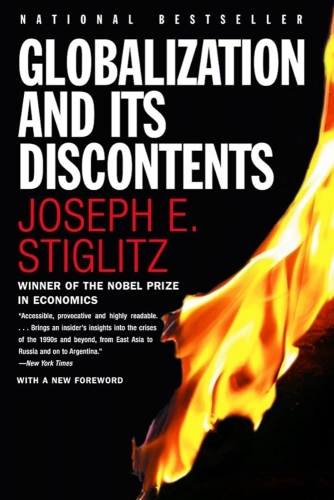
Il est devenu une référence pour tous ceux, notamment en Europe, qui contestent cette union… abstraite. Qui ne tient pas compte des peuples et des hommes réels.
Aujourd’hui, Stiglitz, qui est de formation démocrate, est considéré comme une référence aussi bien par les formations populistes/conservatrices européennes que par la gauche radicale. Autrement dit: par ceux qui ne sont pas du tout satisfaits de cette Europe.
Il n’a pas changé, cependant. Il reste, fondamentalement, un démocrate américain, influencé par la pensée de Keynes. Et totalement éloigné de ceux qui, d’un côté ou de l’autre, voudraient le pousser vers une dérive politique.
Après beaucoup d'errances et de réflexions, Stiglitz en est arrivé à une conclusion:
L’Europe, l’Union européenne, a échoué dans sa mission. Et trahi son destin.
Il ne reste donc que deux options.
La première est très improbable. Pour ne pas dire impossible. Réformer radicalement l’Union européenne. Lui donner une autre forme. Faire de l’euro un instrument d’unification politique.
Ce qui est empêché par la volonté des pays européens eux-mêmes. Trop liés à leurs intérêts particuliers. Un petit commerce fermé.
Surtout celle de l’Allemagne et des pays du Nord. Qui ne veulent pas la croissance économique et politique du Sud, des pays en développement.
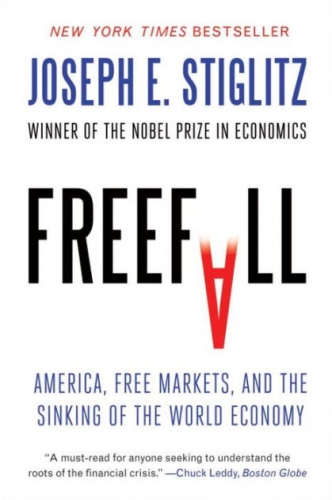
Et donc, à défaut de cette option, il ne reste que l’autre:
Renoncer à l’euro. Mettre fin à l’expérience de la monnaie commune. Qui s’est révélée pire qu’un échec. Qui s'est révélée néfaste.
Cette décision, selon Stiglitz, n’est ni facile ni indolore. Mais elle est possible, car l’euro n’a que vingt ans. Peu, mais suffisamment pour en constater l’échec.
Il faut donc mettre fin à cette expérience négative. En payant, certes, un prix élevé. Mais moins coûteux et douloureux que de continuer sur une voie erronée.
Abandonner l’euro, donc. Et repartir à zéro.
Vingt ans, dit-il, ce n’est pas grand-chose. Presque rien. Nous sommes encore à temps pour inverser cette tendance au déclin.
Avant qu’elle ne devienne un précipice.
19:54 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : joseph e. stiglitz, actualité, europe, euro, affaires européennes, économie, union européenne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
L’Inde propose d’interconnecter les monnaies numériques pour contourner le dollar

L’Inde propose d’interconnecter les monnaies numériques pour contourner le dollar
Source: https://mpr21.info/india-propone-interconectar-las-moneda...
La Reserve Bank of India a présenté une proposition au gouvernement de New Delhi pour relier les monnaies numériques des banques centrales des pays du BRICS, facilitant ainsi les transactions commerciales et touristiques entre ces économies émergentes. Cette initiative, qui pourrait figurer à l’ordre du jour du sommet des BRICS de cette année, qui se tiendra en Inde, représente une étape supplémentaire dans la quête du bloc pour une autonomie financière par rapport au système monétaire international dominé par le dollar.
La proposition de la banque centrale indienne intervient à un moment où les technologies financières numériques se positionnent comme des alternatives crédibles aux systèmes de paiement traditionnels. La banque recommande que ce sujet soit au centre du prochain sommet des BRICS, ce qui pourrait constituer la première fois qu’un tel projet est officiellement débattu au niveau des chefs d’État et de gouvernement du bloc.

L’interconnexion permettrait aux monnaies numériques émises par les banques centrales de chaque pays membre de communiquer entre elles, créant ainsi un réseau de paiement transfrontalier direct. Les secteurs du commerce bilatéral et du tourisme font partie des bénéficiaires potentiels immédiats de ce système, qui élimine les multiples conversions de devises et réduit les coûts de transaction pour les entreprises et les voyageurs se déplaçant entre ces pays.
L’initiative s’inscrit dans un mouvement plus large vers une plus grande indépendance vis-à-vis des mécanismes financiers établis. Depuis leur création, les pays membres du bloc partagent le désir commun de construire un ordre mondial distinct, défiant l’hégémonie des puissances occidentales dans les affaires internationales. Leur objectif principal est de rééquilibrer la dynamique de pouvoir au sein des institutions financières mondiales, en particulier le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, où leur poids économique et démographique réel n’est pas proportionnellement reflété dans les processus décisionnels.

Les pays du bloc défendent les principes de souveraineté et de non-ingérence, s’opposant notamment à l’utilisation des systèmes de paiement internationaux comme instruments de pression politique. Les sanctions économiques occidentales, qui dépendent en grande partie du contrôle des flux financiers en dollars, ont renforcé la détermination des BRICS à développer leur propre infrastructure. La création de la Nouvelle Banque de Développement en 2014 a déjà été une manifestation concrète de cette stratégie d’autonomie financière, permettant aux pays émergents de financer leurs projets de développement sans dépendre exclusivement des institutions occidentales.
Ce type de coopération dépasse les questions purement monétaires et vise à établir des plateformes alternatives pour l’échange économique et politique, réduisant progressivement la dépendance structurelle aux monnaies et systèmes de paiement traditionnellement dominants.
La proposition indienne se base sur les conclusions du sommet des BRICS de 2025 à Rio de Janeiro, où les pays ont explicitement demandé à renforcer l’interopérabilité entre les systèmes de paiement nationaux des États membres. Cette déclaration collective a posé les bases d’une coordination accrue dans le domaine de l’infrastructure financière numérique, en reconnaissant le potentiel transformateur des technologies de monnaies numériques.

Plusieurs pays du bloc ont déjà réalisé des avancées significatives dans le développement de leurs propres monnaies numériques émises par des banques centrales. La Chine expérimente depuis plusieurs années avec son yuan numérique, tandis que l’Inde a lancé son roupie numérique en phase pilote. Ces expérimentations créent les conditions techniques nécessaires pour envisager une intégration régionale des systèmes.
La Banque centrale indienne a déclaré publiquement que ces efforts ne visent pas à promouvoir la dédollarisation du commerce international, une déclaration très prudente qui contraste avec l’impact potentiel évident de ce système sur l’utilisation du dollar américain dans le commerce entre économies émergentes. Il s’agit d’une stratégie diplomatique visant à éviter une confrontation directe avec Washington.
19:35 Publié dans Actualité, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, économie, inde, dédollarisation, brics |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Asservie, dépouillée, déshonorée: comment l'Europe est devenue un jouet des États-Unis

Asservie, dépouillée, déshonorée: comment l'Europe est devenue un jouet des États-Unis
Günther Burbach
Source: https://overton-magazin.de/hintergrund/politik/erpressbar...
L'Europe se trouve en 2025 à un tournant géopolitique, et personne ne semble vraiment vouloir l'admettre. Le nouvel accord commercial avec les États-Unis, orchestré par la présidente de la Commission Ursula von der Leyen et ratifié par le chancelier Friedrich Merz, montre crûment ce qui est désormais une réalité : l'Europe n'est plus un partenaire, mais une suppliante.
Et Donald Trump ne le cache pas. Au contraire: il nous le montre en direct, sans aucune politesse diplomatique, sans souci de perdre la face. Et le pire dans tout ça: nos gouvernements applaudissent. Cela aurait pu être encore pire, pense-t-on, mais est-ce vraiment le cas? Il ne s'agit plus de tarifs douaniers, que certains messieurs à Washington annoncent à leur guise devant les caméras de télévision. Il s'agit de l'Europe, autrefois puissance économique majeure. Il s'agit du fait que cette ancienne puissance économique n'a rien d'autre à offrir qu'Ursula von der Leyen, qui vend une humiliation totale comme un bon accord.
1. Le nouvel accord : capitulation annoncée
Le 27 juillet 2025, Trump et von der Leyen ont présenté un traité commercial censé protéger l'UE de tarifs plus élevés. En réalité, il s'agit d'un traité unilatéral en faveur des États-Unis. Alors que l'Europe devra désormais importer du gaz de schiste américain pour une valeur de 750 milliards de dollars et s'engage à investir 600 milliards, les produits américains restent en grande partie sans droits de douane. En échange, l'UE accepte des droits de douane punitifs de 15 % sur ses principales exportations: voitures, machines, semi-conducteurs. Trump parle de «balance», mais en vérité, c'est un tribut. Il reste à voir comment notre industrie automobile déjà fragilisée pourra s'en sortir.
Ce « compromis » a été salué par les médias transatlantiques comme une concession. En réalité, c'est l'expression d'une soumission totale. L'Europe paie pour ne pas être punie, et elle vend encore cette situation comme un succès diplomatique.

2. La protection militaire comme arme – La menace du parapluie
Les États-Unis assurent la défense militaire de l'Europe, notamment nucléaire, ce qui constituait un consensus tacite depuis des décennies. Mais Trump a brisé ce consensus publiquement. Déjà en 2020, il mettait en doute l'OTAN, et en 2024, il exigeait que «les pays qui ne paient pas se débrouillent eux-mêmes». Aujourd'hui, il exige clairement: l'Europe doit payer, sinon le parapluie sera replié.
Que cela signifie-t-il?
- L'accès aux armes nucléaires américaines reste entièrement sous contrôle de Washington.
- Les garanties en matière de cybersécurité sont également politiquement conditionnées.
- La logistique militaire, les satellites, les systèmes d'alerte précoce, sans accès américain, sont pratiquement inaccessibles.
L'Europe dépend, sur le plan militaire, d'une pompe à essence. Et cette pompe est maintenant utilisée pour forcer une soumission politique et économique. Et cela va encore s'aggraver, car avec ces nouveaux accords d'armement, on deviendra encore plus dépendant des États-Unis. On se demande vraiment dans quelles têtes de telles affaires peuvent avoir un sens. Des logiciels américains contrôlent tout, et le grand frère est dans chaque PC, chaque caméra ou autre système en Europe. Ce que cela signifie, nous en avons un aperçu avec Trump. Mais tout cela semble sans effet, non, cela ne fait que rapprocher encore plus l'Europe du grand frère. L'Europe attend apparemment d'être punie par Trump par le biais de nouvelles escapades.
3. La séparation prévue : comment les États-Unis ont détaché l'Europe de la Russie
Ceux qui pensent que la guerre en Ukraine est une escalade accidentelle se méprennent sur les intérêts stratégiques de Washington. Depuis 2014, la politique étrangère américaine a travaillé à couper la Russie de l'Europe, en déployant des efforts colossaux.
- Après Maidan, plus de 5 milliards de dollars ont été investis dans la «promotion de la démocratie» en Ukraine (Victoria Nuland, 2014).
- Les États-Unis ont fourni des armes, formé l'armée ukrainienne selon des tactiques occidentales, et ancré la doctrine de l'OTAN dans le dispositif de sécurité du pays.
- De nombreuses ONG, think tanks et conseillers proches des États-Unis ont été systématiquement installés à Kiev. Le pays a été politiquement, économiquement et médiatiquement intégré à l'Occident, sans adhésion à l'OTAN, mais avec une orientation claire.
- Depuis 2016, des centaines de millions de dollars d'aide militaire ont été versés chaque année. Avec la guerre de 2022, cette aide a atteint des montants à deux chiffres en milliards, incluant des bombes à dispersion, des systèmes Patriot, des entraînements Black Hawk.
La Russie a été isolée, Nord Stream a été saboté, les canaux diplomatiques coupés, l'objectif étant de séparer durablement l'UE de Moscou. Gagnants: les États-Unis. Perdants: l'Europe, qui, depuis lors, achète du gaz de schiste américain à des prix exorbitants et perd sa base industrielle.

4. La classe politique : gestion d'une impuissance
Que font les principaux politiciens européens? Ils gèrent, dissimulent, masquent, mais ne contestent pas. Ursula von der Leyen, qui est très bien connectée transatlantiquement, agit comme une ambassadrice de Washington. Friedrich Merz, ancien de BlackRock, aujourd'hui chancelier, défend les tarifs de Trump comme une «impulsion de modernisation». Emmanuel Macron critique prudemment, mais reste finalement muet. Critique de l'OTAN, des sanctions américaines ou de la désindustrialisation par les prix de l'énergie? Nada.
Les élites européennes font ce qu'elles ont perfectionné depuis des années: afficher une posture, sans agir. Elles emploient un vocabulaire bienveillant, qui se brise face à la réalité. Et elles confondent loyauté transatlantique avec irresponsabilité envers leur propre population.
5. Dépendance totale dans tous les secteurs
- L'Europe utilise quasi systématiquement l'infrastructure logicielle américaine : Microsoft, Amazon Web Services, Palantir.
- Défense : F-35, systèmes de défense antimissile, avions de transport, tout est américain.
- Énergie : le gaz liquéfié américain domine les projets de construction à Wilhelmshaven, Brunsbüttel, et ailleurs.
- Finances : le dollar reste la monnaie de référence, tandis que SWIFT et les sanctions américaines dictent ce que les banques européennes peuvent faire.
Chacun de ces secteurs est une arme potentielle, et Trump le sait. Il ne menace même pas subtilement. Il le dit ouvertement. Et l'Europe? Elle reste silencieuse.
6. Et si tout s'arrêtait vraiment demain ?
Imaginons que Trump exige: «Deux mille milliards d'euros par an, sinon il n'y aura pas de protection». Pas d'accès à l'infrastructure militaire. Pas de dissuasion nucléaire. Pas de bouclier cybernétique. Pas de satellites. Pas d'accès aux plateformes économiques américaines. Pas de coopération avec les services de renseignement militaires.
Que reste-t-il à l'Europe? La dépendance pure et simple. Pas de plan B, pas d'autonomie stratégique, pas d'alliance en dehors du périmètre américain. La France? Seule. L'Allemagne? Désarmée sur le plan militaire. L'OTAN? Un corps creux sans noyau américain.

7. L'Europe doit agir maintenant – ou sombrer
Le temps de l'hésitation est terminé. Soit l'Europe comprend enfin qu'elle ne survivra qu'en tant qu'acteur indépendant, soit elle restera un protectorat. Les mesures :
- Construire une structure de défense souveraine avec la France, l'Italie, la Scandinavie.
- Créer un commandement européen cybernétique sans technologie américaine.
- Autonomie énergétique grâce à des partenariats stratégiques avec l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine.
- Souveraineté numérique avec ses propres clouds, puces, standards.
- Névrose diplomatique : rétablir des canaux diplomatiques avec la Russie, sans œillères idéologiques.
Conclusion : Trump n'est pas le problème. Il est le miroir. Le reflet d'une Europe qui a oublié comment fonctionne l'indépendance. Nous nous sommes dégradés en partenaire junior, par peur, par confort, par inertie idéologique. Il est désormais trop tard pour la politesse.
L'Europe doit sortir de sa dépendance, sinon elle deviendra une coquille vide sur le plan géopolitique. L'Europe ne doit rien à personne, sauf à ses citoyens.
Sources :
Victoria Nuland, 2014: https://2009-2017.state.gov/p/eur/rls/rm/2014/mar/222718....
RAND Corporation, 2019: „Extending Russia“ https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR3063.html
AP News, Juli 2025: https://apnews.com/article/cb323423c4317c89410c0dee3d389753
FT zu US-Zollpolitik: https://www.ft.com/content/11aa3964-5460-405f-981b-9d284f...
The Guardian, 28.07.2025: https://www.theguardian.com/commentisfree/2025/jul/28/eu-...
Günther Burbach, né en 1963, est informaticien, journaliste et auteur. Après avoir tenu sa propre chronique dans un hebdomadaire, il a travaillé à la rédaction du groupe Funke Mediengruppe. Il a publié quatre livres consacrés principalement à l'intelligence artificielle et à la politique intérieure et étrangère allemande. Dans ses textes, il allie une compréhension technique à une vision sociopolitique, toujours dans le but de susciter des débats et d'aiguiser le regard sur l'essentiel.
11:13 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 19 janvier 2026
Farce groenlandaise
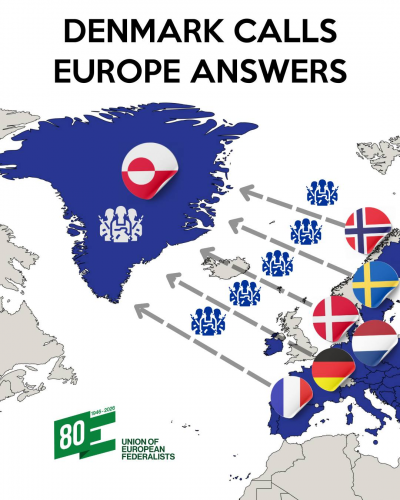
Farce groenlandaise
Andrea Marcigliano
Source: https://electomagazine.it/farsa-groenlandese/
Cela ressemble à une pochade. Une farce, même. Et de très mauvaise qualité.
Certains pays européens envoient des troupes au Groenland, après la volonté manifeste de Trump d'annexer cette île glaciale aux États-Unis.
Des troupes de quatre ou cinq pays européens, en mission sous le nom de «Artic Endurance». En réalité, une poignée d'hommes. Quelques dizaines.
Assez pour donner raison à l'ironie, à peine voilée, du ministre italien de la Défense, Guido Crosetto.
Et, en effet, le nombre de soldats européens engagés fait sourire. Une quinzaine de Français. Une poignée d'Allemands et de Britanniques. Quelques Néerlandais, quelques Norvégiens. Peut-être deux ou trois Finlandais...
Une bande de chasseurs de phoques serait plus nombreuse.
C'est un signal politique, dira-t-on... ou plutôt, on nous le dit déjà. Le poids de cette opération Arctic Endurance ne doit pas être évalué en fonction du nombre d'hommes engagés...
Peut-être... mais l'opération – si l'on peut l'appeler ainsi – des Européens semble complètement dépourvue d'un point d'ancrage fondamental.
Ce n'est pas une opération de l'OTAN. Autrement dit, l'OTAN ne prend pas position, elle n'adopte pas de position définie. Claire.
Elle ne pourrait d'ailleurs pas le faire. Car les États-Unis sont membres de l'OTAN. Et membres à large majorité.
Ainsi, l'OTAN, avec l'ineffable Rutte, se retire. Ou plutôt, elle noie le poisson dans le tonneau. Elle évite de prendre position. Elle se débrouille.
Démontrant ainsi, si besoin était, une vérité évidente.
L'OTAN est une création des États-Unis. Elle dépend d'eux en tout et pour tout. Les autres membres ne sont pas des partenaires à part entière. Ce sont des vassaux. Et Trump les traite comme tels.
Si le président américain le souhaite, il s'emparera donc du Groenland. En l'intégrant économiquement et militairement. En versant une maigre indemnité à la population locale.
Et les Européens, après cette comédie risible, ne pourront que se taire. Et accepter. Servilement. Car c'est ce qu'ils sont : des serviteurs, des subordonnés, des employés.
J'ai dit « s'il le souhaite ». Et, bien sûr, « s'il le peut ».
Les obstacles éventuels ne viendront toutefois pas de Copenhague, Berlin, Paris...
Les véritables obstacles ne peuvent venir que de Moscou et aussi de Pékin.
Pas de risibles alignements d'une poignée d'hommes. Les Russes et les Chinois, puissances réelles, peuvent ne pas vouloir d'un contrôle américain total sur le Groenland. Et décider de le freiner.
21:10 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, groenland, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
L’OTAN sous pression: l'alliance transatlantique s’effrite

L’OTAN sous pression: l'alliance transatlantique s’effrite
Bruxelles. Les fondations de l’alliance militaire occidentale tremblent. De Paris à Ankara, les développements actuels indiquent un processus d’érosion profonde qui menace de plonger l’OTAN dans l’une de ses crises les plus graves depuis sa création.
En France, le 9 janvier, la vice-présidente de l’Assemblée nationale, Clémence Guetté, du rassemblement de gauche «La France Insoumise», a déposé une proposition de résolution pour sortir de l’OTAN. Elle justifie cette démarche par la politique «agressive» des États-Unis sous Donald Trump, qui représenterait une menace pour la souveraineté française. «Les États-Unis enlèvent un chef d’État, ce qui montre que l’OTAN ne sert plus nos intérêts», indique la déclaration. Bien que cette étape soit pour l’instant symbolique, elle témoigne du mécontentement croissant des Français envers l'alliance occidentale. Même dans la droite, les voix se font de plus en plus entendre pour réclamer une sortie de l'OTAN.
Plus inquiétant encore est le retrait d’un partenaire clé de longue date à la frontière est. La Turquie, qui dispose, derrière les États-Unis, de la deuxième armée la plus puissante de l'alliance, négocie intensément son adhésion à un nouveau pacte de défense forgé entre l’Arabie Saoudite et le Pakistan. L’accord conclu en septembre 2025 prévoit une clause d’alliance selon le modèle de l’article 5 de l’OTAN. Des médias comme Bloomberg parlent d’une «OTAN islamique» en gestation. Une entrée de la Turquie dans ce pacte déplacerait fondamentalement l’orientation stratégique d’Ankara vers l’est et pourrait révéler une contradiction majeure avec les engagements de l’OTAN.
Les relations transatlantiques sont également fortement fragilisées. La Première ministre danoise, Mette Frederiksen, a récemment averti qu’une attaque américaine contre le membre de l’OTAN qu'est le Groenland, signifierait la fin de l’alliance. La destruction du gazoduc Nord Stream a déjà gravement endommagé la confiance — car en coulisses, les États-Unis seraient considérés comme le seul responsable plausible du sabotage sans précédent de septembre 2022.
Par ailleurs, l’Union européenne imagine, dans ses plans, une structure de défense plus autonome, ce que certains observateurs interprètent comme une préparation à une éventuelle «UE-OTAN» sans influence réelle des États-nations. Cependant, les plans pour une alliance de défense européenne sans les États-Unis existent presque depuis aussi longtemps que l’OTAN elle-même — mais n’ont jamais abouti.
Néanmoins, les fissures dans l’alliance deviennent de plus en plus visibles. La façade unitaire se fissure. L’ère de l’ordre mondial multipolaire pourrait effectivement annoncer la fin de l’OTAN. Surtout parce que Washington pourrait en tirer un avantage concret — les États-Unis pourraient soudainement économiser d’énormes dépenses et les faire supporter aux Européens, qui semblent déjà à bout de souffle. 2026 pourrait devenir l’année décisive (mü).
Source: Zu erst, Janvier 2026
20:52 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, affaires européennes, europe, otan, alliance atlantique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Toutes les manœuvres sont possibles en attendant les «midterm elections»

Toutes les manœuvres sont possibles en attendant les «midterm elections»
Nos politiciens et opinion-makers ont vécu une semaine mouvementée. Des rumeurs selon lesquelles le Groenland serait annexé à tout moment par les troupes américaines font haleter de nombreux analystes politiques.
Joachim Van Wing
Source: https://joachimvanwing.substack.com/p/alle-registers-open...
Pas seulement mouvementée, la semaine qui vient de s'écouler... Elle a aussi été éprouvante. «Après le Venezuela, voilà encore ça?!». Nos politiciens européens semblent encore ne pas avoir compris comment le président Trump négocie. La méthode Trump est pourtant très simple:
Le président Trump appelle ses partenaires à la table de négociation. Lorsqu’ils sont tous réunis, il se dirige vers la porte, jette une grenade dans la salle juste avant de la claquer derrière lui. Après le bruit, il revient dans la salle de réunion, ouvre une fenêtre et dit :
«Nous devons parler» (Pippa Malgren, 7 janvier 2026).
Une légère panique règne sur le continent européen. Et cela est d’autant plus surprenant compte tenu des traités et accords limpides conclus au cours des dernières décennies entre le Danemark et les États-Unis. D’où viennent alors toute cette hystérie, cette agitation et cette indignation? Peut-être que nos politiciens et journalistes ne sont guère conscients des traités internationaux qui définissent si précisément le statut du Groenland?
Oui, les troupes américaines sont présentes sur le Groenland. Et ce depuis 1951, lorsque la Guerre froide créait encore un état de bipolarité paralysante. Car, même à cette époque, le Danemark n’était pas une puissance maritime mondiale équipée de sous-marins, de cuirassés et de porte-avions pour fermer les mers du monde, ni de sous-marins soviétiques bloquant l’accès du passage GIUK (Greenland-Iceland-United Kingdom). Seul Washington pouvait assumer ce rôle.
« L’accord entre le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement du Royaume du Danemark, en vertu de la Charte de l’Atlantique Nord, concernant la défense du Groenland. »
— Copenhague, 27 avril 1951, Bibliothèque des traités de l’ONU
Après la dislocation de l’Union soviétique, il a fallu attendre jusqu’en 2007 pour que le Groenland ressurgisse de manière significative dans l’agenda géopolitique. À cette époque, le président Poutine expliquait au monde, lors du sommet de Munich, comment la Russie allait progressivement étendre sa présence dans l’Arctique.

Depuis 1951, des troupes américaines patrouillent le Groenland depuis une base aérienne à Thulé, surveillant la façade arctique de l’Atlantique Nord. En 2020, la base aérienne de Thulé a été officiellement transférée à la United States Space Force, et le 6 avril 2023, la base de Thulé a été rebaptisée: elle s'appelle désormais Pituffik. La base abrite une détection avancée de missiles pour le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD).
Washington a tenté à plusieurs reprises d’incorporer le Groenland par achat, échange ou annexion militaire.
1867-1868 : l’achat de l’Alaska
Après l’achat de l’Alaska à la Russie en 1867, le gouvernement américain montrait déjà de l’intérêt pour une expansion vers le nord. Le Groenland (ainsi que l’Islande) était considéré comme un territoire potentiellement annexable en raison de sa position stratégique. Les ressources groenlandaises ont été cartographiées, mais aucune offre officielle n’a été faite au Danemark.
1910 : proposition d’échange territorial
Au lieu d’un achat direct, des diplomates américains ont voulu organiser un échange complexe. En échange du Groenland, le Danemark aurait acquis le Schleswig allemand. L’Allemagne aurait été indemnisée par de nouveaux territoires aux Philippines. Ce deal n’a pas abouti.
1946 : offre formelle pendant la Guerre froide
Lorsque la Seconde Guerre mondiale s’est progressivement transformée en Guerre froide, l’administration Truman a proposé au Danemark 100 millions de dollars en lingots d’or pour acheter le Groenland. Le Danemark a refusé de vendre. Les États-Unis ont cependant conservé un droit d’usage militaire pour un ensemble de bases militaires.

1958 : tensions accrues
1958 fut une année particulièrement importante. Le Spoutnik a été lancé. Le Pentagone a rapidement installé le BMEWS (Ballistic Missile Early Warning System) au Groenland, en Alaska et en Écosse. Alarmé par les avancées technologiques démontrées par l’URSS, le Pentagone a élaboré des scénarios concrets où il invoquait le «droit d’urgence de l’OTAN» et où le Groenland aurait été annexé de façon permanente et immédiate. Mais ce scénario a également disparu dans les plis de l’histoire.
2026 : toutes les manœuvres sont possibles avant les «midterm elections»
L’intérêt accru et soudain des États-Unis pour le Groenland peut s’expliquer par quatre bonnes raisons :
- Les ressources: pour ceux qui en doutaient encore… une course mondiale a été lancée pour acquérir tous les minerais, roches et ressources qu'offre notre croûte terrestre. Le Groenland possède un potentiel formidable pour l’extraction d’argent, de cuivre, d'or, de zinc, de plomb, de nickel, de niobium, de tantale et d'uranium. Au cours des 25 dernières années, la Chine a quasiment pris le contrôle mondial de l’extraction minière, du raffinage, de la transformation et de la commercialisation des minerais, métaux et minerais. Washington prend conscience de cette vulnérabilité et des dangers qu’elle comporte. L’administration Trump intervient en fin de course en mobilisant tous les moyens possibles.

- Les routes maritimes arctiques: les brise-glaces nucléaires sud-coréens, chinois et russes maintiennent la route de l’Arctique libre de glace en permanence, évitant ainsi aux navires militaires et commerciaux de parcourir des milliers de miles en contournant le canal de Suez ou le cap. Avec des bases aériennes et navales en Norvège, en Finlande — et oui, aussi au Groenland —, Washington peut couper les lignes d’approvisionnement chinoises et russes vers l’Europe et l’Atlantique. Sans un point d’appui au Groenland, il ne peut imposer d’embargos ni de blocus.
- La course spatiale: le «space race» est notre première vraie «guerre spatiale». Sans les satellites de communication d’Elon Musk, les forces ukrainiennes devraient arrêter immédiatement leur combat. Starlink est l’unique infrastructure restante permettant aux forces ukrainiennes de communiquer entre elles et de cibler les objectifs russes. La valeur stratégique et opérationnelle de Starlink dans ce conflit ne peut être sous-estimée. Par conséquent, Pékin va très bientôt lancer sa propre alternative à «Starlink» qui aura la même capacité civile et militaire. Les bases de lancement dans la région polaire seront donc essentielles.
- Les midterm elections: le président Trump sait parfaitement ce qui l’attend si lui et les républicains perdent les élections de novembre 2026. Alors, tout son programme législatif sera bloqué, et Donald Trump n’obtiendra rien de validé. Pire encore, comme il le dit lui-même :
« Si nous ne gagnons pas les midterms, parce que si nous ne gagnons pas… ils trouveront une raison de m’infliger un Impeach. Je serai mis en accusation. »
— président Donald Trump, retraite du House GOP, 6 janvier 2026
Cette fois, Trump ne fait pas d’excès. Lui et son cabinet ont en un an éliminé tant de barrières, contourné tant de règles, violé tant de lois, qu’ils n’auront probablement jamais connu le repos. Si l’administration Trump perd sa majorité en novembre, elle sera la cible d’un combat judiciaire sans pitié, qui l’empêchera de fonctionner normalement. Si Trump remporte les midterms, cette chasse sera reportée après la fin de son mandat. Mais une chose est sûre: Trump continuera à être poursuivi sans relâche pour le reste de ses jours.
En conclusion
Il est tout à fait probable que cette administration utilise tous les moyens pour augmenter sa «cote de popularité». Mais les signaux sont sombres. Son intervention unilatérale au Venezuela semble n’avoir pas modifié l’opinion publique. La saisie de navires sous pavillon russe en eaux internationales n’est pas sans danger, et constitue une nouvelle violation. Pour les électeurs réclamant une politique migratoire beaucoup plus stricte, exécuter une jeune femme blanche a été considéré comme "un pont trop loin".
Et tout comme aujourd’hui en Iran, la classe moyenne américaine s’épuise quand les produits de base deviennent inabordables. La dévaluation incessante de la monnaie entraîne une érosion inévitable du pouvoir d’achat et frappe durement les ménages moyens. Beaucoup d’entre eux avaient imaginé cette seconde année de mandat très différemment, et se préparent à ce que les 10 prochains mois leur réservent.
Et pendant ce temps…
Alors que nous, Européens, regardons anxieusement vers le Venezuela, l’Iran ou le Groenland, la Commission européenne continue en toute discrétion à rédiger des textes pour un orwellien «Chat Control » et à signer sans entraves les accords du Mercosur avec l’Amérique du Sud.
13:16 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, groenland, europe, affaires européennes, donald trump, midterm elections 2026, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Métaphysique de la décadence: du héros Bourevestnik à la piètre petite figure de Tchébourachka

Métaphysique de la décadence: du héros Bourevestnik à la piètre petite figure de Tchébourachka
Expérience en culturologie existentielle
Alexandre Douguine
Herméneutique de l'ironie et érosion des codes culturels
Le phénomène de l’humour est tel que toute tentative d’expliquer une blague — c’est-à-dire de préciser quand exactement il faut rire ou quelles figures ironiques ont été employées — tue instantanément l’essence même du comique, en réduisant la trame vivante de la conversation à un ennui insupportable. Il faut littéralement marquer l’espace de la parole: «ici, mesdames et messieurs, voici l’ironie», «ici, messieurs, voilà la vanne».
Cependant, lorsque l’on m’interpelle pour expliciter mes propres métaphores ou que l’on exige un décryptage de ce que j’ai dit, je trouve cela profondément inapproprié. Car si nous perdons les derniers codes culturels à tel point que toute expression imagée ou métaphorique nécessite un commentaire en bas de page, nous nous trouvons dans l'espace d’une culture mentalement déficiente. Cultiver une telle invalidité de l’esprit me paraît inutile; au contraire, l’impératif d’un penseur est de faire deviner par soi-même.
Évolution et involution du mythe héroïque soviétique
Revenons à la diachronie de nos idéaux. Les recherches récentes de l’Académie de l’Éducation, notamment les résultats annoncés par la présidente Vasileva, montrent une dynamique étonnante des transformations archétypiques tout au long de l’histoire soviétique.
- Années 1920: L’ère du titanisme. Le héros, modèle à imiter, est le Bourevestnik de Gorki, avec ses personnages révolutionnaires comme «Mère», et les figures futuristes de Maïakovski. Ce sont des déconstructeurs, qui jettent la vieille humanité par-dessus bord du «navire de la modernité», construisant un horizon ontologique radicalement différent.

- Années 1930 à 1950: Le monumental stalinien. Le paradigme se déplace vers la construction d’un empire. L’archétype devient Pavka Kortchaguine — le héros du roman «Comment l’acier fut trempé». L’idéal de cette époque n’est pas tant le renversement, mais la construction sacrificielle du Grand État, avec une totale dévotion à la nation et à la société.
- Années 1970-1980: La chute fondamentale et l’entropie des idéaux. C’est précisément durant cette période de stagnation tardive, face à la désintégration des significations, qu’émerge la figure sinistre du «Wagon Bleu», de l'«Hélicoptère Bleu» et de leurs passagers.
Démonologie de la stagnation : Tchebourachka comme simulacre
 La déliquescence de l’idéal à la fin de l’époque soviétique est illustrée par des images qui, à y regarder de plus près, apparaissent métaphysiquement monstrueuses. On assiste à une «amitié» entre deux monstres. L’un d’eux est le Crocodile — une créature absente de nos régions et, dans la symbolique traditionnelle (souvenons-nous de l’Égypte ancienne), solidement associée au dieu Seth, dieu du mal, du chaos et du désert, incarnant une force destructrice et aquatique. L’autre est Tchebourachka — le démon de la Lune, une créature sans équivalent parmi les vivants, un simulacre pur. Le seul personnage anthropomorphe de cette compagnie infernale est la vieille Chapoklyak — délibérément représentée comme une entité abominable et malveillante.
La déliquescence de l’idéal à la fin de l’époque soviétique est illustrée par des images qui, à y regarder de plus près, apparaissent métaphysiquement monstrueuses. On assiste à une «amitié» entre deux monstres. L’un d’eux est le Crocodile — une créature absente de nos régions et, dans la symbolique traditionnelle (souvenons-nous de l’Égypte ancienne), solidement associée au dieu Seth, dieu du mal, du chaos et du désert, incarnant une force destructrice et aquatique. L’autre est Tchebourachka — le démon de la Lune, une créature sans équivalent parmi les vivants, un simulacre pur. Le seul personnage anthropomorphe de cette compagnie infernale est la vieille Chapoklyak — délibérément représentée comme une entité abominable et malveillante.
Il y a ici un programme de déconstruction des idéaux: du Révolutionnaire et du Constructeur, nous dégradons jusqu’à «la bête inconnue de la science». Quand les citoyens soviétiques, y compris le corps des officiers, commencent à chanter en chœur lors des réceptions que «soudain, un magicien arrivera dans un hélicoptère bleu», il devient évident que nous avons perdu notre repère existentiel.
La chronologie et la métaphysique de l’apparition de Tchebourachka coïncident avec la chute de l’Union soviétique, la dilution de la conscience, la transition vers des valeurs bourgeoises et infantilisantes. On peut affirmer que Tchebourachka a fait s’effondrer l’URSS — bien sûr, pas littéralement, mais en tant que figure archétypale incarnant l’inconscient d’une société mourante.
Brainrot et sabotage esthétique
Il semblerait que cette obscurité soit restée dans le passé, sous la période Brejnev. Mais aujourd’hui, face à une confrontation historique des plus aiguës, sans idéal mobilisateur, nous assistons à la Deuxième Venue de Tchebourachka. La société replonge dans la léthargie de la décadence soviétique tardive: tout le monde ricane, s’émerveille et acquiesce devant une créature sans visage ni sens. L’État, avant de s’effondrer, dégénère toujours, et cette dernière étape se manifeste dans le rétrécissement et la perversion des héros.
Nous nous sommes proclamés État-Civilisation. Nous menons une guerre existentielle contre l’Occident, en réalité contre le monde entier, défendant notre droit d’être bien ancrés dans l’Histoire. Et le moment de brandir le symbole d’une désintégration mentale totale — ce qu’on appelle aujourd’hui en argot le «brainrot» — est arrivé. Tchebourachka est la quintessence du brainrot soviétique tardif: une figure d’origine indéfinie, sans lignée ni tribu, incapable de répondre à une seule question ontologique sérieuse.
Où va ce «wagon bleu»? Quelle est la téléologie du chemin de ces deux étranges créatures? Leur avenir est une obscurité absolue. Et le fait que cet image devienne aujourd’hui presque le seul objet de notre fierté nationale m’inspire une inquiétude métaphysique et esthétique profonde.
Sur de fausses alternatives et de véritables archétypes
On me reproche la renaissance d’autres personnages, comme Buratino ou les héros de Prostokvachino. Mais ici, une différenciation est nécessaire. Buratino est l'adaptation charmante d'un conte italien par Alexandre Tolstoï, un héros accomplissant des exploits; il est au moins inoffensif. Prostokvachino est une esquisse de la vie d’une famille d’ingénieurs, portant déjà en elle les graines de la décomposition et d’une certaine immoralité, mais c’est une histoire secondaire. Tchebourachka est toxique précisément par son prétention à l’archétype universel.
Si nous rejetons cette voie, nous devons proposer une alternative. Et nous en avons une.
Il faut revenir aux profondeurs de l’inconscient populaire, à notre mythologie, notre hagiographie et notre histoire.
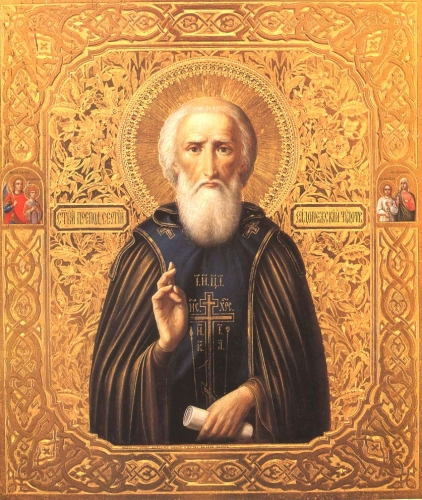
- Sainteté: L’image de l’abbé de la terre russe, le saint Serge Radonège (icône, ci-dessus). Sa vie, son rôle dans la politique et l’histoire — c’est une réserve de sens, le sommet de notre dimension spirituelle.
- Héroïsme: Nos bogatyrs, nos tsars, nos guerriers, et sans aucun doute, les héros actuels de l’opération spéciale.
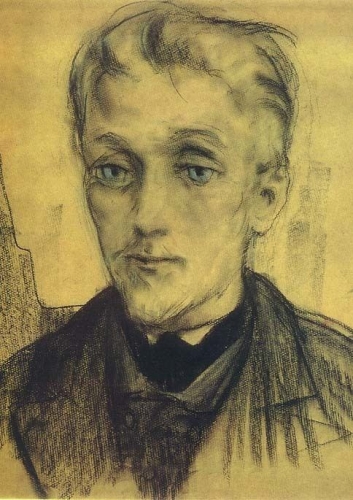
- Littérature russe: F. M. Dostoïevski a décrit l’âme russe à travers une galerie de personnages profondément souffrants, en quête de Dieu. Chacun d’eux — de Raskolnikov à Prince Mychkine (tableau, ci-dessus) — pourrait devenir un héros national.
Notre but n’est pas simplement de restaurer le passé, mais d’adapter ces sens au futur, en utilisant le potentiel créatif de nos artistes et cinéastes. Nous avons besoin d’un portrait de l’Homme Russe, qui ouvre un horizon, et non qui mène dans une impasse infantile.
L’entité démoniaque et la résonance japonaise
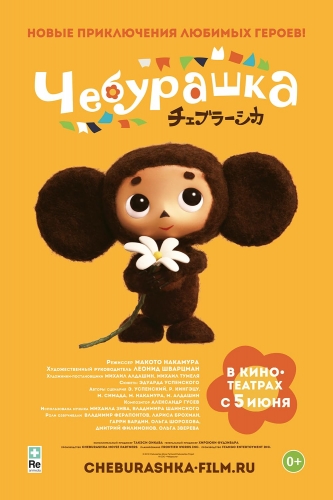 Il est curieux de constater que Tchebourachka a acquis une popularité incroyable au Japon. Et cela n’est pas du tout une coïncidence. Dans la culture japonaise, imprégnée d’animisme et de démonologie, cette image est perçue de façon totalement organique. Regardez son iconographie: deux oreilles semi-circulaires et une tête ronde — ce sont les phases de la Lune (nouvelle, pleine, décroissante). C’est un démon classique, un esprit comme ceux représentés dans le manga ou dans des films comme «La Guerre des Tanuki» (Heisei Tanuki Gassen Ponpoko). Pour le contexte religieux japonais, une telle figure démoniaque est acceptable, mais pour nous, en quête de notre Logos sacré, elle symbolise une impuissance créative.
Il est curieux de constater que Tchebourachka a acquis une popularité incroyable au Japon. Et cela n’est pas du tout une coïncidence. Dans la culture japonaise, imprégnée d’animisme et de démonologie, cette image est perçue de façon totalement organique. Regardez son iconographie: deux oreilles semi-circulaires et une tête ronde — ce sont les phases de la Lune (nouvelle, pleine, décroissante). C’est un démon classique, un esprit comme ceux représentés dans le manga ou dans des films comme «La Guerre des Tanuki» (Heisei Tanuki Gassen Ponpoko). Pour le contexte religieux japonais, une telle figure démoniaque est acceptable, mais pour nous, en quête de notre Logos sacré, elle symbolise une impuissance créative.
Finale eschatologique
La situation est extrêmement grave. Nous sommes au bord d’un Armageddon nucléaire, la Troisième Guerre mondiale est en cours, et il se produit une redistribution mondiale du pouvoir. Dans de telles circonstances, la culture ne peut pas être un «divertissement» ou des «vacances». La dégradation mentale nous a déjà conduits à la chute de l’Empire Rouge. Aujourd’hui, nous vivons dans l’inertie de cette décomposition et de cette trahison des années 90.
Le président Poutine parle de l’illumination historique et des valeurs traditionnelles. Mais lorsque les artisans de la culture répondent à cet appel en réinterprétant un vieux dessin animé soviétique axé sur «une créature inconnue », je considère cela comme un sabotage cynique du réveil historique de la Russie. Nous avons besoin de figures empreintes de sérieux, de figures tragiques, même si elles sont confuses, mais il faut qu'elles soient profondément russes.
Être fier des milliards de vues qu’une histoire sans sens suscite dans le public — c’est une chose terrible. C’est un rejet de la responsabilité historique. Si nous ne surmontons pas ce «brainrot», si nous ne mettons pas fin à cette initiative qui glorifie la désintégration, les conséquences seront fatales. Comme on dit, la différence entre un patriote et un cochon est que le patriote accepte tout, alors que le cochon, dans son obéissance, ne remarque pas la frontière. Nous devons non seulement voir cette frontière, mais aussi la tracer avec l’épée du sens.
12:34 Publié dans Actualité, Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, nouvelle droite, alexandre douguine, russie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 18 janvier 2026
Iran. Illusions et réalité

Iran. Illusions et réalité
Andrea Marcigliano
Source: https://electomagazine.it/iran-illusioni-e-realta/
Après tant de grondements d'orage, la pluie est finalement tombée.
Iran. Pendant plusieurs jours, le gouvernement a laissé s'exprimer dans les rues un certain mécontentement populaire, généralisé et profond. Ce mécontentement était essentiellement dû à des questions économiques, à la difficulté de commercer, qui a surtout touché les puissants Bazari.
Ces seigneurs qui dominent les grands marchés intérieurs et qui, à l'époque, étaient sans doute les principaux ennemis du Shah. Car Reza Pahlevi s'ouvrait aux multinationales, surtout américaines, menaçant de fait leur pouvoir traditionnel sur l'économie iranienne.
La tolérance du gouvernement permettait de dire que les Bazari, de Téhéran et des principales villes, étaient derrière les manifestations de rue.
En effet, Massoud Pezeshkian est un homme qui a toujours été lié aux puissants seigneurs du marché intérieur. C'est en grande partie à eux qu'il doit sa victoire électorale.
Cependant, des agents et des groupes manipulés depuis l'étranger s'étaient rapidement infiltrés dans les manifestations de rue. Des groupes armés, qui bénéficiaient du soutien de la CIA américaine et, surtout, du Mossad israélien. Ce dernier n'a pas caché son action, soutenant même ouvertement la thèse d'un changement de régime, c'est-à-dire d'un coup d'État, à Téhéran.
Un coup d'État visant à ramener au pouvoir l'héritier direct du dernier Shah, Rezha Ciro, exilé depuis plusieurs décennies aux États-Unis.
Que cet homme semble complètement détaché des réalités iranienne et étranger aux vicissitudes actuelles de l'Iran est évidemment un problème tout à fait secondaire et sans importance pour les partisans du changement de régime. À savoir le Mossad et la CIA.

Cependant, l'Iran n'est pas une petite république bananière. C'est un grand pays très peuplé. Où des peuples d'ethnies différentes sont essentiellement maintenus ensemble par un seul ciment. Social et religieux, qui trouve son apogée dans le système des ayatollahs et dans la figure, symbolique autant que réelle, d'Ali Khamenei.
Et ainsi, après les nombreuses hésitations du gouvernement, les superviseurs religieux du système iranien sont intervenus.
Dans deux directions distinctes mais convergentes.
L'une a été plus résolument répressive. En ordonnant aux milices pasdaran et basihi d'intervenir pour frapper durement, arrêter et éliminer les groupes de guérilleros infiltrés.
Et les exécutions publiques, plus ou moins sommaires, de ceux qui sont tombés entre leurs mains ont déjà commencé.
L'autre direction, cependant, a été celle de démontrer leur force à travers des manifestations de masse colossales. Dans tout le pays, de la capitale Téhéran au dernier des petits villages.
Des manifestations qui renforcent la cohésion interne et démontrent à l'extérieur la solidité du régime.
Ces deux opérations ont parfaitement réussi.
À ce stade, Washington et Tel-Aviv n'auraient d'autre choix que de mener une action militaire directe.
Un choix qui n'est toutefois pas facile à faire.
20:09 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, iran |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Venezuela, Iran, Groenland: l'embrasement du monde - Entretien avec Robert Steuckers

Venezuela, Iran, Groenland: l'embrasement du monde
Entretien avec Robert Steuckers
Propos recueillis par Arne Schimmer
Au début de l'année 2026, le monde semble être en feu si l'on regarde le Venezuela, le Groenland ou l'Iran. Y a-t-il un lien entre tous ces foyers de tension et une explication à cela ?
Le lien entre toutes ces zones de turbulence réside bien évidemment dans le fait que l’hegemon du monde unipolaire d’après la Guerre Froide voit sa domination contestée par un ensemble de glissements nouveaux, parmi lesquels le grand projet de connectivité continentale promu par la Chine de Xi Jinping qui consolide les communications terrestres sur le Heartland centre-asiatique et russe ; la séduction que ce projet suscite dans des territoires importants des Rimlands jadis dominés par les alliances militaires forgées par les Etats-Unis, surtout en Asie du Sud-Est et en Indonésie, ainsi qu’en Iran ; la dé-dollarisation des échanges et l’importance croissante du yuan chinois. Ce projet de grande envergure touche également l’Amérique ibérique, en premier lieu parce que le pétrole vénézuélien se déverse en Chine et que celle-ci organise également les connectivités intérieures de l’Amérique du sud : liaison ferroviaire entre le Pérou et le Brésil, creusement d’un canal transocéanique au Nicaragua, etc. L’hegemon, qui ne veut pas perdre complètement la partie, joue son va-tout : il tente de couper la Chine de ses approvisionnements en pétrole vénézuélien et tente de réanimer un projet technocratique qui existait aux Etats-Unis pendant l’entre-deux-guerres : la création d’un « Technate » nord- et centre-américain, centré sur les Etats-Unis qui aurait inclus le Canada (au détriment de l’Empire britannique), le Groenland (ce qui explique la volonté de Trump de l’englober totalement dans l’orbite américaine), le Mexique (déjà discrètement menacé aujourd’hui), tous les petits Etats d’Amérique centrale (dont Panama, autre revendication actuelle de Trump), la Colombie et le Venezuela. Si ce « Technate » des technocrates américains d’avant-guerre se réalisait avec l’appui des nouveaux grands magnats de la nouvelle technocratie (Musk, Thiel, Palantir), les Etats-Unis disposeraient d’un territoire et de ressources, dont le lithium, capables de les faire durer très longtemps en toute autarcie. En outre, le contrôle total du Groenland leur permettrait de contrôler les nouvelles voies maritimes de l’Arctique et de les bloquer au niveau de la ligne GIUK (Groenland-Iceland-United Kingdom) puis, dans une étape seconde, au niveau de la ligne Groenland, Svalbard/Spitzbergen, Kola au détriment de la Norvège (prochaine victime scandinave de ce projet technocratique qui devra alors céder l'archipel Svalbard ou archipel des Spitzbergen qu'elle possède depuis des siècles). Par ailleurs, l’utilisation du Groenland comme base de missiles à longue portée menace directement la concentration des forces russes autour de la Mer Blanche.

Que pensez-vous de la doctrine « Donroe » de Trump, selon laquelle les États-Unis veulent exercer un pouvoir illimité sur l'hémisphère occidental ?
« Donroe » est un jeu de mot, où l’on associe la Doctrine Monroe (« L’Amérique aux Américains ») de 1823 au prénom de Donald Trump. La Doctrine Monroe visait à exclure toute présence européenne sur les deux continents américains, dans la mesure où le Congrès de Vérone de 1822, convoqué par la Sainte Alliance, a envisagé de soutenir, par l’envoi de troupes françaises, les légitimistes espagnols contre les libéraux (soutenus par l’Angleterre) et, dans la foulée, d’aider l’Espagne re-légitimisée à maintenir son emprise sur l’Amérique ibérique. Cette politique pro-espagnole et a-libérale de la Quintuple Alliance (Angleterre non comprise), ou Sainte Alliance, provoque les premières lézardes dans le bel édifice diplomatique européen postérieur à la chute de Napoléon, édifice dont l’Empereur russe Alexandre I était le principal inspirateur avec Metternich. L’Angleterre faisait bande à part et continuera à le faire, soutenant implicitement les politiques anti-européennes des Etats-Unis, puissance émergente à l’époque.
L’Espagne n’est pas la seule nation visée par le jeune Etat américain: la Russie l’est également, car elle possède toujours l’Alaska et un comptoir en Californie (Fort Ross). Ensuite, plus tard, le soutien de Napoléon III à Maximilien de Habsbourg au Mexique se fera contre la volonté des Etats-Unis dès le lendemain de la Guerre Civile entre Nordistes et Sudistes, entre Unionistes et Confédérés. La guerre hispano-américaine de 1898 a permis aux Etats-Unis de s’emparer de Cuba et des Philippines, ce qui les sortaient ipso facto de la logique « hémisphérique » prétendument revendiquée par James Monroe, puisqu'ils s'ancraient en lisière de la masse continentale asiatique, en face de la Chine et à proximité du Japon émergent.
La Doctrine de Monroe sera complétée par le « corollaire Roosevelt » de 1904, énoncé suite à une tentative germano-britannique d’intervenir au Venezuela, Etat protégé par les Etats-Unis. Ce corollaire prévoyait l’intervention armée des Etats-Unis contre tout gouvernement latino-américain qui enfreindrait « les bonnes règles de la civilisation », corollaire qui reçut rapidement le surnom de « politique du gros bâton » (Big Stick Policy). Aujourd’hui, la Doctrine Donroe complète et la Doctrine du Président Monroe et le corollaire Roosevelt en réaffirmant l’hégémonisme américain dans les Caraïbes (Cuba est directement menacé) et en refusant toute collusion économique trop intense entre la Chine et un Etat situé dans l’espace du « Technate » imaginé par les technocrates d’hier et d’aujourd’hui.

Parmi les conflits mondiaux qui font rage actuellement, lequel est le plus dangereux et le plus lourd de conséquences ?
Pour contenir la Chine, non plus seulement sur les Rimlands de l’Asie du Sud-Est et/ou du sous-continent indien (Inde et Pakistan), mais le long de toutes les voies de connectivité que le projet chinois de « Belt and Road », de "Route de la Soie", a fait naître entre l’Europe et la Chine en Asie centrale et entre le Pacifique et l’Atlantique en Amérique du Sud. Il faut dès lors freiner l’approvisionnement en énergie de Pékin, que ce projet facilite. C’est une des raisons majeures de la brève intervention militaire américaine à Caracas le 3 janvier dernier et de la mainmise subséquente sur les pétroles vénézuéliens. Cependant, si la Chine était le meilleur client pour le pétrole vénézuélien, l’Iran demeure, pour Xi Jinping, le principal fournisseur d’hydrocarbures.

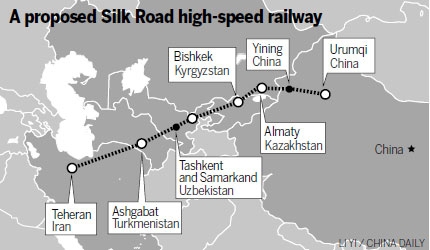
Le soutien américain à des protestations populaires en Iran, causées par les innombrables restrictions suite aux sanctions subies depuis des décennies par le pays, survient, et ce n’est pas un hasard, au moment où les liens ferroviaires de l'Iran avec la Chine sont devenus réalité depuis mai-juin 2025 et où le dernier tronçon de la voie de chemin de fer entre le port iranien de Bandar Abbas (sur l’Océan Indien) et la frontière azerbaïdjanaise (Astara) a été parachevé en décembre dernier.

La connectivité entre l’Inde et la Russie (jusqu’à la Mer Blanche) est désormais possible par l’INSTC (International North-South Transport Corridor) et par la liaison ferroviaire entre la Chine et la Turquie, via les petits pays d’Asie centrale et l’Iran. C’est cette double connectivité que les Etats-Unis, selon la logique géopolitique énoncée par des théoriciens comme Halford John Mackinder, Homer Lea et Nicholas Spykman, entendent détruire. Le maillon central, incontournable, de ces deux nouvelles connectivités, c’est l’Iran. Il faut dès lors qu’il devienne le site d’un chaos permanent comme le sont devenues la Libye et la Syrie. Vu la volatilité de la région, vu la proximité de l’Iran avec la Russie, l’Europe, l’Inde et la Chine, tout désordre organisé dans cette région, qui est une Drehscheibe, une plaque tournante, constituerait un danger mortel pour tous les Etats de la masse continentale eurasienne, surtout ceux qui sont enclavés.
Quel concept géopolitique, élaboré par quel penseur, est le plus pertinent pour notre époque ?
Tous les concepts géopolitiques sont pertinents et il convient d’en connaître un maximum pour pouvoir interpréter correctement les événements de l’actualité. On ne sort pas de la logique conflictuelle entre Heartland et Rimlands, entre puissances telluriques et puissances thalassocratiques, même avec l’avènement et les perfectionnements de l’arme aérienne et de la balistique des missiles et fusées. La réponse aux théoriciens anglo-saxons de la géopolitique (Mackinder, Lea) a été apportée par Karl Haushofer en Allemagne qui préconisait une quadruple alliance grande-continentale entre l’Allemagne, l’Italie, l’URSS et le Japon.
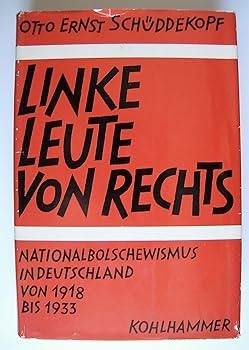 Cependant, certains ouvrages importants ont été oubliés dans les débats lancés par ceux qui contestent l’hégémonisme en place, sans sombrer dans la phraséologie insipide, bien qu’hystérique, des gauches établies. Je commencerai par l’idéal de la Triade parmi les nationaux-révolutionnaires du temps de la République de Weimar (Niekisch, Jünger, Hielscher, Scheringer, etc.). La Triade est l’alliance espérée entre un régime à advenir en Allemagne (mais qui n’adviendra jamais), l’URSS stalinienne et la Chine nationaliste du Kuo Min Tang (organisée notamment par les équipes de conseillers militaires mises sur pied par le Général von Seeckt). Otto-Ernst Schüddekopf a très bien analysé les vicissitudes de ce projet de Triade dans son ouvrage sur le « national-bolchevisme » allemand, hélas un peu oublié aujourd’hui. J’ai eu l’occasion d’en parler dans le deuxième volume de ma compilation de textes sur la "révolution conservatrice" allemande des années 1918-1932.
Cependant, certains ouvrages importants ont été oubliés dans les débats lancés par ceux qui contestent l’hégémonisme en place, sans sombrer dans la phraséologie insipide, bien qu’hystérique, des gauches établies. Je commencerai par l’idéal de la Triade parmi les nationaux-révolutionnaires du temps de la République de Weimar (Niekisch, Jünger, Hielscher, Scheringer, etc.). La Triade est l’alliance espérée entre un régime à advenir en Allemagne (mais qui n’adviendra jamais), l’URSS stalinienne et la Chine nationaliste du Kuo Min Tang (organisée notamment par les équipes de conseillers militaires mises sur pied par le Général von Seeckt). Otto-Ernst Schüddekopf a très bien analysé les vicissitudes de ce projet de Triade dans son ouvrage sur le « national-bolchevisme » allemand, hélas un peu oublié aujourd’hui. J’ai eu l’occasion d’en parler dans le deuxième volume de ma compilation de textes sur la "révolution conservatrice" allemande des années 1918-1932.
Ensuite, vu l’importance et le développement des connectivités dans le projet chinois, il conviendrait de redécouvrir un auteur qui est, lui, totalement oublié, Richard Henning, géopolitologue allemand de la Verkehrsgeographie, qui fit carrière en Argentine après 1945.
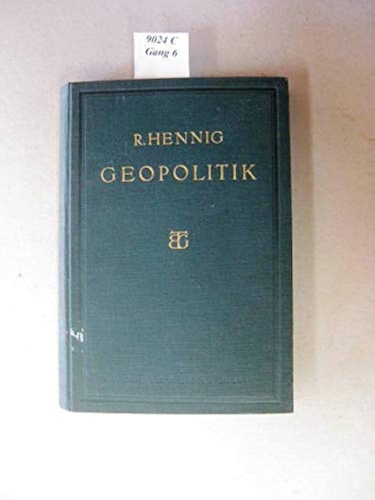 Ensuite, et c’est une tâche à laquelle je vais m’atteler, il conviendrait d’analyser la très pertinente réception des théories géopolitiques allemandes et européennes dans les écoles militaires d’Argentine, du Chili et du Brésil (en l’occurrence la réception de Friedrich Ratzel). Enfin, l’Italie est aujourd’hui, en Europe, le pays qui abrite le plus grand nombre d’instituts d’études géopolitiques, où l’on réédite les classiques allemands de cette discipline, tels Ratzel et Haushofer. En Espagne, nous avons le Colonel Pedro Banos qui ne cesse de produire des best-sellers en la matière. En Allemagne, il faudra inlassablement relire Scholl-Latour pour se doter d’une mémoire diplomatique.
Ensuite, et c’est une tâche à laquelle je vais m’atteler, il conviendrait d’analyser la très pertinente réception des théories géopolitiques allemandes et européennes dans les écoles militaires d’Argentine, du Chili et du Brésil (en l’occurrence la réception de Friedrich Ratzel). Enfin, l’Italie est aujourd’hui, en Europe, le pays qui abrite le plus grand nombre d’instituts d’études géopolitiques, où l’on réédite les classiques allemands de cette discipline, tels Ratzel et Haushofer. En Espagne, nous avons le Colonel Pedro Banos qui ne cesse de produire des best-sellers en la matière. En Allemagne, il faudra inlassablement relire Scholl-Latour pour se doter d’une mémoire diplomatique.
Dans quelle mesure l'axe Paris-Berlin-Moscou, que vous privilégiez, est-il encore réaliste aujourd'hui, et quelles mesures seraient nécessaires ?
Il n’y a plus lieu de parler d’un Axe Paris-Berlin-Moscou dont le théoricien principal fut indubitablement le Français Henri de Grossouvre. Ce dernier avait placé ses espoirs en une alliance entre Chirac, Schröder et Poutine en 2003 au moment où l’Europe avait manifesté un net scepticisme face à l’intervention anglo-américaine en Irak. La riposte fut immédiate: les néoconservateurs bellicistes américains ont accusé les Européens de lâcheté et Chirac a été rapidement remplacé par Sarkozy qui s’est empressé de rejoindre à nouveau le commandement unifié de l’OTAN, que De Gaulle avait quitté dans les années 1960. La France était le maillon faible de cet Axe malgré les rodomontades post-gaullistes: elle reste une puissance idéologiquement occidentale (au sens où l’entendaient Niekisch et ses lecteurs). Son logiciel mental demeure occidental envers et contre tout, ce qui empêche ses élites déconnectées de comprendre, même de façon élémentaire, les dynamiques de l'Europe centrale, des Balkans, de la Scandinavie ou du Proche-Orient, en dépit des excellentes productions des théoriciens de la géopolitique dans la France d'aujourd'hui. En Allemagne, le virus dissolvant qui a permis d'oublier d'activer et de réactiver cet Axe potentiel a été le mouvement des Verts, comme vous le savez mieux que moi. Seule la Russie et son président ont maintenu le cap.
Le sabotage des gazoducs Nord Stream a été le point culminant dans la volonté de destruction de cet Axe franco-germano-russe. Les prises de position de l’UE, de la France de Macron et de l’Allemagne de Scholz et de Merz dans le conflit russo-ukrainien ont créé l’irréparable et reconstitué de facto un rideau de fer de l’Arctique à la Mer Noire qui condamnera le centre et l’ouest du sous-continent européen à la stagnation puis au déclin irrémédiable dont se gausseront Arabes, Turcs, Iraniens et surtout Chinois, sans oublier les Africains.
Quelle priorité géopolitique les Européens devraient-ils se fixer pour les 10 à 15 prochaines années?
Les priorités que le personnel politique européen dominant se fixe aujourd’hui ne pourront que précipiter l’Europe dans un déclin pire que celui qu’a connu jadis l’Empire Romain. Nous allons au-devant d’un effondrement total de nos économies et de nos systèmes sociaux, le tout dans un hiver démographique autochtone et une submersion par vagues migratoires incontrôlées. Le pouvoir sera tenu par le système bancaire, par un capitalisme non plus patrimonial mais totalement et dangereusement financiarisé, et par des mafias en concurrence les unes avec les autres, comme l’avait d’ailleurs prévu Armin Mohler dans un célèbre article de la revue Criticon en 1982 (et qu’une de mes collaboratrices avait traduit avec maestro).
Les mouvements alternatifs, décriés et soumis à toutes sortes de vexations répressives, doivent énoncer une politique différente car telle est leur tâche: retour aux énergies bon marché, priorité de la diplomatie sur toutes les formes de bellicisme délirant, retour à une cohésion de la société, respect des régimes politiques non européens dans les régions du monde d’où nous viennent matières premières et denrées alimentaires (car nous ne sommes pas autarciques), rétablissement de la qualité de nos établissements d’enseignement, lutte contre les pouvoirs occultes et mafieux qui, dans nos rues, s’affrontent à coups de rafales de Kalachnikov, revalorisation de la magistrature dans cette lutte et congédiement des magistrats incompétents, comme on le réclame depuis longtemps en Italie.
17:04 Publié dans Actualité, Entretiens, Synergies européennes | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : robert steuckers, actualité, iran, groenland, venezuela, géopolitique, entretien, synergies européennes, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook


