
Le Livre noir non si presenta come una storia sistematica della Rivoluzione Francese. È diviso in tre parti. La prima – «I fatti» (pp. 7-441) – presenta in venticinque capitoli, ciascuno opera di un diverso autore, una serie di episodi salienti della Rivoluzione e alcune valutazioni critiche complessive. La seconda – «Il genio» (pp. 443-746) – offre venti ritratti di pensatori e letterati che hanno, a diverso titolo e da diversi punti di vista, criticato la Rivoluzione, senza che tutti possano essere definiti «contro-rivoluzionari». La terza – «Antologia» (pp.747-878) – completa l’opera con una serie di testi sia di protagonisti sia di critici della Rivoluzione Francese.
Le oltre quattrocento pagine della parte relativa ai fatti coprono sia gli eventi sia la loro valutazione in modo tendenzialmente esaustivo. Si tratta di un vasto affresco, che non a caso si apre con un capitolo (tratto, con l’autorizzazione dell’anziano storico che ha esplicitamente voluto collaborare al Livre noir, da una sua opera del 1984) di Pierre Chaunu sulla vendita dei beni ecclesiastici (pp. 9-19), dove già si annuncia una delle tesi fondamentali del volume. La Chiesa cattolica non fu coinvolta a causa dei suoi legami con la monarchia in una rivoluzione principalmente politica, ma era il vero obiettivo di rivoluzionari il cui scopo era scristianizzare la Francia. Esemplare è anche la ricostruzione da parte degli storici Jean Pierre e Isabelle Brancourt della giornata del 14 luglio 1789 (pp.21-51). La presa della Bastiglia emerge sia nella sua dimensione di mito, pensato addirittura prima degli avvenimenti e giunto sino ai giorni nostri, sia nella sua realtà di modesto episodio già però caratterizzato dalla manipolazione della folla da parte dei club e delle società segrete e da una ferocia che diventerà il marchio della Rivoluzione.
Dopo un capitolo di Gregory Woimbée sui simboli rivoluzionari e sulla loro decomposizione nella Francia multiculturalista del XXI secolo (pp.65-88), quattro capitoli (pp. 89-181) sono dedicati all’azione e al martirio di Luigi XVI (1754-1793) e della sua famiglia. L’ultimo re di Francia appare – anche prima del martirio, sopportato con esemplare e cristiana fermezza – come un uomo profondamente buono, pio e sinceramente preoccupato del bene comune del suo popolo, il cui regno non è affatto una sequela di fallimenti né in politica estera né in politica interna. Un uomo, però, tradito dalla sua stessa bontà che lo porta a chiedere di fronte alla Rivoluzione – senza mai smentirsi – che neppure una goccia di sangue francese sia versata dalle sue guardie, nemmeno per salvare la sua persona. La sua attitudine conciliante, che lo porterà perfino a indossare il berretto frigio, appare come l’aspetto più discutibile dell’azione del monarca, spiegata ma non giustificata dalla sua naturale mitezza e bontà d’animo. Maggiore fermezza – ma, anche in questo caso, non senza errori politici – è mostrata dalla consorte di Luigi XVI, Maria Antonietta d’Asburgo-Lorena (1755-1793): ma in questo caso la rivalutazione storica è già da tempo in corso, ed è stata a suo modo confermata dal tono e dal successo dell’esposizione dedicata alla regina martire dalle Gallerie Nazionali del Grand Palais di Parigi nello stesso anno 2008.
Il lungo capitolo consacrato dal professore di diritto pubblico dell’Université Paris V Frédéric Rouvillois al tema «Saint-Just fascista?» (pp. 183-211) è tra quelli che più hanno indotto i critici a stracciarsi le vesti. L’uso della parola «fascismo», a differenza di quanto spesso avviene, è tecnico: Rouvillois propone un parallelo fra le idee del tribuno della Rivoluzione Louis-Antoine de Saint-Just (1767-1794) e quelle di Benito Mussolini (1883-1945). Saint-Just, secondo l’autore, anticipa il Duce del fascismo nel culto dell’eroe, della virilità, della «virtù» che conferisce all’uomo politico che la incarna il diritto di giustificare qualunque eccesso. Rouvillois non ignora le critiche di Mussolini alla Rivoluzione Francese, ma distingue fra la fase del regime fascista e quelle rispettivamente della formazione del movimento fascista e della Repubblica di Salò, dove le idee del Duce appaiono assai più vicine a quelle di Saint-Just. I critici hanno trovato il parallelo offensivo per Saint-Just. Se si guarda però al numero di morti giustiziati per ordine del tribuno francese e all’autentica passione per il sangue e l’omicidio politico di Saint-Just, da una prospettiva italiana si potrebbe al contrario – provocatoriamente – concludere che forse il paragone è offensivo per Mussolini. Fascismo o no, il capitolo merita comunque di essere letto per la lucida disamina del personaggio Saint-Just, la cui ferocia non deriva semplicemente da un carattere sanguinario ma è una conseguenza necessaria dell’ideologia.
Il cuore del Livre noir è rappresentato dai due capitoli di Jean de Viguerie sulla persecuzione antireligiosa (pp. 213-225) e di Reynald Secher sul genocidio vandeano (pp. 227-248). Entrambi gli storici riassumono qui loro opere precedenti e ben note. E tuttavia costituisce un merito l’essere riusciti a sintetizzare in due articoli brevi l’essenziale della violenza anticristiana della Rivoluzione Francese, che colpisce anche gl’insorti vandeani con una furia genocida che richiede spiegazioni teologiche e non solo politiche. Secher, in particolare, distingue – rispondendo a obiezioni di storici filo-rivoluzionari – tre periodi. Il primo è quello della guerra civile (1793), caratterizzata da atrocità non dissimili da quelle di altre guerre civili. Il secondo è il tempo del genocidio (1794), perpetrato secondo gli ordini delle autorità rivoluzionarie – le quali invano cercheranno di attribuirne la responsabilità al solo delegato della Convenzione Nazionale in Vandea, Jean-Baptiste Carrier (1756-1794), che sarà processato e ghigliottinato – contro una popolazione inerme, dopo che l’insurrezione era già stata sconfitta sul piano militare. Nel terzo periodo va in scena un «memoricidio», iniziato dopo il processo Carrier e ancora in corso ai giorni nostri, con cui si cerca di far dimenticare la memoria del genocidio vandeano attraverso la falsificazione storica e la congiura del silenzio.
Altri tre capitoli fondamentali sono dedicati al vandalismo, cioè alla distruzione sistematica per ragioni ideologiche di elementi del patrimonio francese: opere d’architettura e d’arte di natura religiosa o collegate alla storia della monarchia (pp. 249-259); libri e biblioteche, particolarmente monastiche (pp. 261-282); e navi (pp. 283-299). Quanto a queste ultime, il capitolo dello storico Tancrède Josseran riassume una vicenda tanto decisiva quanto poco conosciuta. La Rivoluzione si accorge che la Marina militare francese, orgoglio del re Luigi XVI che l’ha portata per la prima volta a competere ad armi pari per il dominio del mare con quella inglese (e a batterla in occasione del sostegno della Francia alla Rivoluzione Americana), è fondata su uno spirito di corpo e su un sistema di relazioni rigorosamente gerarchico, con ufficiali che sono tutti nobili. Decide quindi coscientemente di distruggere la Marina in nome dell’egualitarismo: i suoi effettivi sono ridotti, gli ufficiali ghigliottinati o messi in fuga, e sostituiti da capitani della marina commerciale senza esperienza di guerra, molte navi smantellate per farne legna da costruzioni o da ardere, con comprensibile giubilo di ammiragli inglesi come Horatio Nelson (1758-1805). Questi ultimi sanno bene come la guerra della Francia rivoluzionaria all’Europa non possa essere vinta senza controllare i mari, il che diventa impossibile grazie alla miopia tutta ideologica che distrugge la Royale, il nome con cui i francesi designano la Regia Marina Militare e che mostra fin da subito il suo collegamento organico con l’istituzione monarchica.
Non poteva mancare nel Livre noir una parte consacrata agli aspetti istituzionali e giuridici della Rivoluzione: anzi, per la verità, questa è la porzione del volume che anche alcuni critici hanno lodato. Il professore emerito di diritto dell’Università di Angers Xavier Martin, nel suo capitolo sul diritto rivoluzionario (pp. 301-322), mette in evidenza soprattutto due punti. Il primo è la nozione ideologica di legge, che per i rivoluzionari non nasce dal basso, dalla realtà, ma dalla volontà astratta – ritenuta assoluta e onnipotente – della Nazione. Una volta assunto questo punto di partenza, ogni governo – e ogni governante – non resiste alla tentazione di emanare centinaia di nuove leggi. La Rivoluzione aveva promesso di diminuire il numero di leggi: ce n’erano in effetti troppe, per la proliferazione dei diritti regionali e locali. Ma il risultato è piuttosto il contrario. «Quindicimila leggi in quattro anni? La cifra corre agli inizi del Direttorio. Si arriverà a quarantamila quattro anni più tardi» (p. 319): una tendenza che continua ancora oggi, e che proprio nella Rivoluzione Francese ha le sue origini. Il secondo aspetto sottolineato da Martin è l’odio, ugualmente ideologico, che la Rivoluzione Francese ha per la famiglia. Se l’uomo nuovo che la Rivoluzione vuole creare, il cittadino, deve stare davanti allo Stato senza la mediazione dei corpi intermedi, il diritto rivoluzionario distruggerà certamente le corporazioni e i privilegi locali: ma il suo obiettivo ultimo è il primo corpo intermedio, il più vicino alla persona che è la famiglia.
Saint-Just, l’ex-prete e teorico della Rivoluzione Emmanuel Joseph Sieyès (1748-1836), Maximilien Robespierre (1758-1794): tutti sognano l’abolizione della famiglia e l’instaurazione di un regime di figli affidati in tenera età allo Stato che non ricordino neppure più chi siano i loro genitori. Cominciano ad abolire la patria potestà e a introdurre il divorzio, nel 1792. Ma succede ai rivoluzionari francesi quello che capiterà ai loro emuli sovietici nel XX secolo: quando si trovano in guerra, scoprono che ogni attacco alla famiglia sfibra la società e danneggia l’esercito. Fanno, dunque, rapidamente marcia indietro: anche se rimarranno il divorzio (fino alla Restaurazione) e l’ideologia. Il grande assalto alla famiglia, abbandonato dai rivoluzionari per ragioni tattiche, sarà ripreso alla fine del XIX secolo; il divorzio, abolito nel 1816, sarà reintrodotto in Francia nel 1884.
Rimarrà pure – è il tema del capitolo di un altro professore universitario di diritto, Christophe Boutin (pp. 323-333) – la riorganizzazione del territorio, che sopprime le antiche regioni e le loro autonomie e introduce i dipartimenti, spesso del tutto artificiali e i cui confini sono fissati in un’ottica dichiaratamente anti-regionale. Anche in questo caso si tratta di far prevalere, rispetto a regioni che hanno una cultura comune e che sono nate dalla storia, una divisione territoriale stabilita dall’alto e il cui fine non è promuovere ma reprimere le autonomie locali. I nomi dei dipartimenti, poi, vogliono evitare qualunque riferimento storico e culturale: e anche questo è rimasto fino ai nostri giorni, mentre si è tornati indietro dopo la Rivoluzione almeno rispetto allo «stadio ultimo del ridicolo» (p. 332) che aveva cambiato nome anche alle città, modificando per esempio il nome di Bourg-la-Reine («Borgo della Regina») in Bourg-Égalité («Borgo dell’Uguaglianza») e quello di Grenoble (che conteneva la parola «noble», «nobile») in Grelibre.
A ben vedere, va ricollegato a questi due capitoli sul diritto e l’amministrazione anche quello del filosofo Michaël Bar Zvi sugli ebrei e la Rivoluzione (pp. 403-413). Il capitolo, infatti, mostra come agli ebrei siano riconosciuti dai rivoluzionari tutti i diritti come individui ma nessun diritto come comunità: sono emancipati in quanto «cittadini» ma disprezzati in quanto ebrei, quando non esplicitamente – e neppure troppo cordialmente – invitati a rinunciare alla loro identità e alla loro religione. C’è qui, certo, il consueto odio rivoluzionario per ogni religione. Ma c’è anche il pregiudizio secondo cui il cittadino deve stare di fronte allo Stato senza la protezione di alcun corpo intermedio, sia questo di natura professionale, locale o religiosa. Lo Stato rivoluzionario conosce il citoyen ma non conosce l’avvocato, il membro della corporazione di mestiere, il bretone o appunto l’ebreo. Dal momento che l’identità ebraica è particolarmente tenace, è pure combattuta dalla Rivoluzione con toni specialmente accesi, che secondo Bar Zvi hanno avuto certamente un ruolo nel preparare l’antisemitismo del XIX e del XX secolo.
Due storici molto noti, anche al pubblico non specializzato, intervengono su temi particolari: Emmanuel Le Roy Ladurie sul rapporto tra meteorologia, economia e Rivoluzione (pp. 336-347), e Jean Tulard su Napoleone I Bonaparte (1769-1821: pp. 355-374). Le Roy Ladurie mostra che, contrariamente a un mito duro a morire, un inverno particolarmente duro seguito da un’estate particolarmente secca non caratterizzò il 1789 ma piuttosto il 1788. Del resto, perché il ciclo innescato dalle avverse condizioni meteorologiche potesse passare dal cattivo raccolto al rincaro dei prezzi e da questo alle sommosse occorreva un anno: dunque a danni creati dalla meteorologia nel 1788 corrispondono sommosse nel 1789. Tuttavia in passato c’erano stati raccolti – e rincari dei prezzi – peggiori, che non avevano dato luogo a rivoluzioni, il che mostra che il cattivo raccolto del 1788 e il conseguente carovita sono (contro un’interpretazione diffusa fra gli storici marxisti) solo alcune fra le molteplici cause dell’agitazione rivoluzionaria, ma non le uniche né le principali. Tulard – riassumendo brevemente quanto ha più diffusamente illustrato altrove – si chiede se davvero Napoleone I possa essere descritto come l’uomo che assume, diffonde e consolida la Rivoluzione. Lo stesso Napoleone I, osserva lo storico, ha diffuso questo mito negli scritti redatti negli ultimi anni della sua vita. Da giovane, tuttavia, aveva guardato con sospetto alla Rivoluzione in quanto ostile all’indipendenza e anche alla semplice autonomia della nativa Corsica, causa che gli era molto cara, mentre in seguito aveva sì usato a suo vantaggio la retorica rivoluzionaria, ma senza dare mai l’impressione di crederci veramente. Il bonapartismo, secondo Tulard, resta un’ideologia politica diversa da quella rivoluzionaria nella sostanza, anche se spesso non nella retorica.
Interessante, anche perché accompagnato da numerose tavole a colori fuori testo, è il capitolo dello storico Bruno Centorame sull’iconografia contro-rivoluzionaria (pp. 349-363). Abituato a vedersi presentare a scuola e altrove solo l’arte che inneggia alla Rivoluzione, il lettore – specie francese – scopre l’esistenza di tutto un filone ottocentesco, talora artisticamente assai pregevole, che mostra gli orrori giacobini o esalta gli eroi della Vandea, il cui tipo sono i ritratti dei capi vandeani di Pierre Narcisse Guérin (1774-1833), a lungo nascosti nei sotterranei dei musei perché «diseducativi» ma oggi giustamente apprezzati e rivalutati.
Gli ultimi sei capitoli della prima parte (pp. 375-441) – tranne quello, già citato, relativo al rapporto fra ebrei e Rivoluzione Francese – propongono un inventario dell’eredità della Rivoluzione Francese e una sua valutazione critica. I totalitarismi del XX secolo – il comunismo, ma anche il nazional-socialismo – e il terrorismo, fino a quello dei giorni nostri, sono ricondotti alla Rivoluzione Francese come alla loro matrice e alla loro origine. Certo, non sono negate le differenze: e da questo punto di vista appare invero patetico il tentativo dei critici del Livre noir di considerare così fondamentali da rendere illegittimo ogni parallelo le distinzioni fra terrore sanzionato dalla legge (come sarebbe quello della Rivoluzione Francese) e terrore illegale dei terroristi, o fra regimi spietati che criticano o negano la democrazia (il comunismo e il nazional-socialismo) e regimi, pure spietati (come quello del Terrore rivoluzionario), che però affermano di operare in nome della democrazia. Queste differenze sono reali, né il Livre noir le nega. E tuttavia lo spirito della Rivoluzione Francese, l’idea che la misura della politica non è il bene comune ma l’ideologia, la giustificazione della violenza e del Terrore in nome della stessa ideologia sono momenti cruciali di un processo che prepara i totalitarismi del XX secolo e la giustificazione del terrorismo nel XXI.
Questa parte del volume mette pure in conto, anticipatamente, un’obiezione che in effetti è stata rivolta al Livre noir: quella di non distinguere fra la Rivoluzione «buona» del 1789 e quella «cattiva» del 1793 e del Terrore. Se si limitasse a criticare il 1793, si afferma, il Livre noir s’inserirebbe in un filone di storiografia liberale che è accettato, anche se non è condiviso da tutti, nell’attuale clima culturale e politico della Repubblica Francese. Criticando anche il 1789, il Livre noir invece si pone fuori da un consenso nazionale che unisce destra e sinistra (e, hanno scritto in molti, anche buona parte dei cattolici, «integristi» esclusi). In effetti, anche Benedetto XVI nel suo importante Discorso ai Membri della Curia e della Prelatura Romana per la presentazione degli auguri natalizi, del 22 dicembre 2005, da molti definito una vera e propria «enciclica sulla modernità», ha difeso la condanna pronunciata dalla Chiesa del XIX secolo nei confronti delle «tendenze radicali emerse nella seconda fase della rivoluzione francese». Dunque – ci si potrebbe chiedere – perfino il Pontefice può essere arruolato fra quanti distinguono fra una fase buona (il 1789) e una cattiva (il 1793) della Rivoluzione? Tutto dipende da quello che s’intende per «prima fase». Anche gli autori del Livre noir sono consapevoli che non tutto andava per il meglio in Francia fino al 13 luglio 1789. La distruzione dei corpi intermedi non è stata ideata completamente ex novo dalla Rivoluzione ma è stata preparata da secoli di assolutismo regio. Molti di coloro che andavano a Parigi per partecipare agli Stati Generali non intendevano rovesciare in modo «radicale» lo stato di cose vigente, e meno ancora chiudere le chiese o ghigliottinare gli oppositori. Intendevano solo protestare contro l’assolutismo in nome delle libertà dei singoli e della società che lo Stato assolutista aveva negato. Una «prima fase» della Rivoluzione Francese, in questo senso, dovrebbe andare dal 5 maggio 1789 (se non, considerando i prodromi, addirittura dal 1788) al 9 luglio 1789, cioè dalla convocazione degli Stati Generali fino alla loro trasformazione in Assemblea Nazionale: ma non certo fino al 1792, e neppure fino al 1790. Si può dunque mantenere sia che – secondo la nota espressione dell’uomo politico radicale e anticlericale francese Georges Clemenceau (1841-1929), più volte citata nel Livre noir – «la Rivoluzione è un blocco», dal 14 luglio 1789 al Terrore e oltre, sia che l’iniziale protesta anti-assolutista (la «prima fase») di questo blocco a rigore non fa parte.
Padre Jean-Michel Potin, O.P., archivista della Provincia Domenicana di Francia (pp. 416-429), e il giornalista e storico Jean Sévillia (pp. 431-441) offrono adeguate conclusioni alla prima parte dell’opera. Se Sévillia – confrontando i festeggiamenti del primo centenario della Rivoluzione nel 1889 con quelli del secondo, nel 1989 – mostra come nella Francia multietnica e multiculturale della Rivoluzione resti molto poco, così che – osserva provocatoriamente – forse nel 2089 il terzo centenario non sarà neppure celebrato, Potin conclude indicando che una delle più nefaste eredità della Rivoluzione Francese è la confusione dei ruoli, profondamente sovversiva, fra l’eroe e il re. Contro questa confusione si è schierato, nota il religioso, John Ronald Reuel Tolkien (1892-1973) nel suo Il Signore degli Anelli: «Alla fine del romanzo, il figlio del re è incoronato perché il potere è suo di diritto, e l’eroe – che ha compiuto il suo compito – si ritira dal mondo degli uomini. Ciascuno è stato al suo ruolo, e al suo posto: l’eroe è eroe e non è re, ed è per questo che deve lasciare il mondo dove il re regna, per evitare che lì si sviluppi un culto dell’eroe. L’eroe Frodo non ha figli, ma è seguito da altri tre hobbit della sua stessa generazione che condividono il suo combattimento e le sue gioie. Il re invece, nel momento in cui cinge la corona, si sposa e si assicura una discendenza. L’eroe è generazionale, il re paterno. Rifondare la politica sull’amore non consiste nel rifiutare di amare gli eroi, ma nel saper discernere che l’eroe è colui che affida il potere alla persona che porta in sé la legittimità. Ogni autorità viene da Dio. Egli la dona, ed è questo dono che si deve amare» (p. 429).
La lettura della seconda parte, «Il genio», dedicata ai critici della Rivoluzione Francese, è molto più faticosa. Anche qui l’intento dichiarato non è quello di proporre una storia del pensiero contro-rivoluzionario. L’obiettivo, se fosse questo, sarebbe mancato. Lo sarebbe per eccesso, in quanto sono inclusi pensatori che di questa storia non fanno parte, come Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900: pp. 631-656). Ma lo sarebbe anche per difetto, perché mancano riferimenti al pensiero contro-rivoluzionario del XX secolo, soprattutto spagnolo e iberoamericano (uno per tutti: Plinio Corrêa de Oliveira, 1908-1995, da cui una storia della Contro-Rivoluzione nel XX secolo non può certamente prescindere) ma anche francese (Jean Ousset, 1914-1994). La scelta ha privilegiato gli autori francofoni – di cui uno non francese, il diplomatico del re di Sardegna Joseph de Maistre (1753-1821: pp. 471-482) – con tre sole eccezioni: oltre a Nietsche, lo spagnolo Juan Donoso Cortés de Valdemagas (1809-1853), in effetti un punto di riferimento imprescindibile per la Contro-Rivoluzione (pp. 529-545), e la tedesca (vissuta però negli Stati Uniti a partire dal 1941) Hannah Arendt (1906-1975). L’inclusione di quest’ultima si comprende: l’autorità di una delle maggiori studiose di scienza politica del XX secolo viene a confermare la tesi del Livre noir secondo cui i totalitarismi del Novecento sono figli della Rivoluzione Francese. Colpisce, però, la mancanza di un capitolo su Edmund Burke (1729-1797), il primo e più influente critico anglofono della Rivoluzione.
Alcuni capitoli di taglio letterario appaiono poi eccessivamente concentrati su questioni estetiche, e lontani dallo spirito generale del volume. Così l’analisi che la romanziera Sarah Vajda dedica a François-Remé de Chateaubriand (1768-1848: pp. 505-520), di taglio strutturalista e dove più che la critica della Rivoluzione all’autrice sembra stare a cuore il possibile paragone con il semiologo del XX secolo Roland Barthes (1915-1980). Un paragone giustificato da qualche spunto «antimoderno» del semiologo, ma qui giocato sui rispettivi atteggiamenti di fronte alla bellezza e all’erotismo – salvo che per Chateaubriand si tratta di belle donne e per l’omosessuale Barthes dei «begli occhi e lunghi capelli» del ragazzo di turno (p. 512). Quanto alla politica, otto pagine su Charles Maurras (1868-1952; pp. 696-706) non sembrano sufficienti ad approfondire – eventualmente in modo critico, mettendo in luce come egli abbia cercato di separare la Contro-Rivoluzione dalla sua essenziale dimensione teologica e religiosa – il ruolo che ha avuto nella storia della critica alla Rivoluzione Francese. C’è spazio appena per un cenno ai suoi complessi rapporti con il positivismo, e per una presa di distanza obbligatoria dai suoi spunti antisemiti.
Queste riserve non vogliono però dissuadere dal leggere anche la seconda parte del Livre noir. Fra i venti ritratti di critici della Rivoluzione si nascondono veri e propri gioielli. Forse il capitolo più notevole è quello consacrato da un dottorando dell’Università di Angers, Jonathan Ruiz de Chastenet, ad Antoine Blanc de Saint-Bonnet (1815-1880: pp. 547-572). Di questo filosofo francese emerge la capacità – oggi troppo spesso dimenticata – di sintetizzare il pensiero contro-rivoluzionario precedente, legato ai nomi di Joseph de Maistre e Louis de Bonald (1754-1840; interessante anche il capitolo che lo riguarda, principalmente inteso a smentire una certa vulgata secondo cui sarebbe stato un pensatore fideista e ostile alla ragione: pp. 483-504). La presentazione sistematica di Blanc de Saint-Bonnet contribuisce in modo decisivo al passaggio, per riprendere un’espressione di un esponente contemporaneo italiano della scuola contro-rivoluzionaria, Giovanni Cantoni, dalla patristica a quella scolastica della Contro-Rivoluzione che fiorirà nel XX secolo.
Pregevoli sono anche i ritratti dedicati a due storici critici della Rivoluzione. Il primo è Hyppolite Taine (1828-1893: pp. 665-677), positivista quanto a convinzioni filosofiche ma – come mostra l’uso ampio che ne fa anche la parte antologica del Livre noir – per molti aspetti ancora insuperato come studioso delle fonti, nonché a sua volta punto di riferimento per Augustin Cochin (1875-1916: pp. 679-689), il giovane studioso caduto nella Prima guerra mondiale oggi riscoperto grazie ai lavori di uno storico autorevole come François Furet. Cochin, alla scuola di Taine, si segnala per una rigorosa ricognizione delle fonti, da cui emerge il ruolo delle «società di pensiero» (non solo della massoneria: e sta qui, come si fa giustamente notare nel Livre noir, la sua differenza con il più «complottista» Augustin Barruel S.J., 1741-1820) nel preparare e orientare la Rivoluzione. Né, infine, va sottovalutato l’interesse di alcuni ritratti letterari come quelli, per alcuni versi paralleli, dedicati al repubblicano Charles Péguy (1873-1914: pp. 707-712) e al monarchico Georges Bernanos (1888-1948: pp. 713-732). Di entrambi si mostra, al di là di oscillazioni nei giudizi storici e politici, la fondamentale unità d’ispirazione radicata nella centralità della fede e nell’amore per la Chiesa cattolica. Quanto al loro comune maestro Léon Bloy (1846-1917: pp. 615-630), come spesso accade quando si parla di questo letterato le sue miserie umane e i suoi eccessi e le sue incoerenze di polemista hanno più spazio rispetto alle belle pagine cristiane che pure hanno ispirato, come si riconosce, un’ampia posterità letteraria e filosofica. Ma è vero che le questioni politiche non sono mai state davvero al centro delle preoccupazioni di Bloy, che ha anzi trasformato – secondo l’espressione dello storico delle idee «antimoderne» Jacques Compagnon, ripresa dal Livre noir - «una marginalità politica e un handicap ideologico in un atout estetico» (p. 630).
Una parte del Livre noir che, pervenuti a pagina 747, molti rischieranno davvero di non leggere è la terza, di natura antologica. Grave errore: perché, anzitutto, l’antologia consente di riscoprire pagine dimenticate di storici acuti e sempre attentissimi alle fonti come Hyppolite Taine, ma anche testi di autori come Barruel che – pure criticato nelle sezioni precedenti nell’opera – emerge qui come uno storico tutt’altro che sprovveduto quando, più che i vasti complotti internazionali degli Illuminati, ricostruisce con dovizia di prove i piccoli – ma non piccolissimi – complotti dei tribuni della Rivoluzione. Ma errore, soprattutto, perché l’antologia, curata con intelligenza e brio da padre Renaud Silly O.P., dà voce agli stessi rivoluzionari attraverso testi, discorsi e articoli di giornali e gazzette del tempo. Ne emerge un quadro francamente agghiacciante. dove tribuni senza pietà e senza cuore arringano le folle in nome dell’odio contro la religione, la monarchia e ogni forma di differenza che possa fare ostacolo a un’impresa che mira a trasformare i francesi in «cittadini» tutti uguali e tutti modellati dall’ideologia. L’uccisione – anche, e lo si dice esplicitamente, dell’innocente –, il sangue, la guerra di aggressione non sono semplicemente presentati come mali tragicamente necessari, ma esaltati come strumenti potenti per distruggere la vecchia Francia e far nascere dalle sue rovine sanguinanti l’uomo nuovo ideologico. La mole di documenti presentati esclude che si tratti di eccessi individuali. Emerge al contrario un vero e proprio sistema, di cui sono responsabili tutti i principali dirigenti rivoluzionari e, in ultimo, la Rivoluzione stessa.
Opera collettiva, il Livre noir ha tutti i pregi e qualche difetto del genere. Molti autori sono del resto giovani. Questo non è necessariamente un limite, anche se i critici hanno sottolineato che i titolari di cattedra non sono in maggioranza. Reynald Secher ha peraltro risposto che spesso le cattedre in Francia sono negate a chi si occupa di Rivoluzione Francese senza ripetere la versione ufficiale: il cane rivoluzionario, quindi, si morde la coda. Ma – ed è questa la buona notizia – la coda, per quanto lunga, è ormai quasi alla fine. Lo dimostra la stanchezza dei rituali con cui si celebra la Rivoluzione. Lo conferma l’atteggiamento dei tanti francesi che, sordi alla campagna ostile dei media, hanno votato con i piedi andando in libreria e comprandosi il libro. Lo leggeranno tutto? Il Livre noir, nonostante la mole, non è né vuole essere un’opera di consultazione. Assomiglia piuttosto a un buffet di qualità, dove ciascuno prende secondo i suoi gusti e il suo appetito ma che offre comunque il senso di una cucina e di una gastronomia. Così il volume trasmette a chi lo percorre il sapore aspro e l’odore di morte di una delle grandi tragedie della storia, strappata con opportuna violenza alle oleografie celebrative e riportata nella strada dove il sangue scorre, le croci sono spezzate, le opere d’arte sono date alle fiamme e le teste dei sacerdoti, delle religiose, degli oppositori e talora di semplici passanti che si sono trovati al posto sbagliato nel momento sbagliato sono portate in macabro trionfo issate sulle picche dei sanculotti. Non è certo un bello spettacolo: ma ha il pregio di essere vero.
Benedetto XVI nell’enciclica Spe salvi ha ricordato gli orrori della Rivoluzione Francese mostrando come, a proposito dei fatti di Francia, ebbe occasione di mutare parere il filosofo tedesco Immanuel Kant (1724-1804), inizialmente entusiasta e che del resto alla Rivoluzione con le sue idee aveva in qualche modo contribuito. Ma nell’opuscolo La fine di tutte le cose, del 1794, ogni maschera è caduta e di fronte alla Rivoluzione Francese il filosofo parla apertamente di un regno dell’«Anticristo», «fondato […] sulla paura e sull’egoismo»: «la fine (perversa) di tutte le cose» (così riassume il suo pensiero il Papa nel n. 19 dell’enciclica). Sì: l’Anticristo. Tra i tanti meriti del Livre noir c’è quello di mostrare come il motore dell’impresa rivoluzionaria – non, ancora, una sua conseguenza accessoria o seconda – sia l’odio per la Chiesa cattolica, per la religione, infine per Dio stesso, nel tentativo di inventare una Francia, un’Europa, una società senza Dio. Ma – come ricorda Giovanni Paolo II (1920-2005) in uno dei suoi discorsi più famosi, quello al congresso Evangelizzazione e ateismo del 10 ottobre 1980, facendo sue le parole del cardinale Henri de Lubac S.J. (1896-1991) – «non è vero che l’uomo non possa organizzare la terra senza Dio. Quel che è vero, è che, senza Dio, egli non può in fin dei conti che organizzarla contro l’uomo». Se questo è il problema, non c’è che una soluzione, quella indicata già agli albori della scuola contro-rivoluzionaria da de Bonald: «La rivoluzione è cominciata con la proclamazione dei diritti dell'uomo. Non sarà distrutta che dalla proclamazione dei diritti di Dio».





 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg

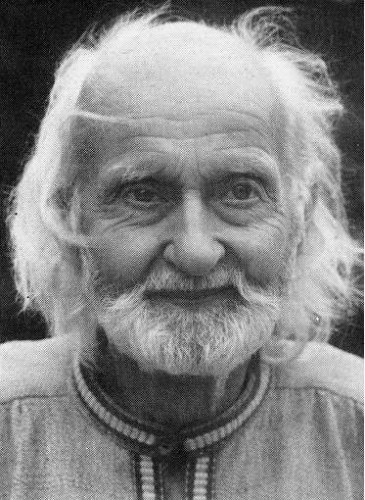
 Naar aanleiding van de recente afdankingen en besparingen bij de verschillende mediagroepen in dit land, waarbij tientallen redactiemedewerkers werden ontslagen, duikt de vraag bij de burgerij en haar linkse papegaaien op of onze media nog wel democratisch en onafhankelijk genoeg zijn. Voor ons kan die vraag gerust negatief worden beantwoord, want in dit land en in de rest van de ultraliberale wereld is er al lang geen sprake meer van zoiets als vrije of onafhankelijke pers, dat zijn al lang lege begrippen geworden hier. De TV-nieuwsberichten bijvoorbeeld zijn een loutere voordracht van de dagelijkse persknipsels die worden overgenomen van persgroepen die geconcentreerd zijn in de handen van de Belgische kapitaalselite. Zelfs op de door de staat gecontroleerde media zoals de VRT zijn de toon en de inhoud van het nieuws gekopieerd van die burgelijke mediagroepen, want daar moet het duidelijk zijn dat de politieke elite een verlengde van de kapitaalselite is en bijgevolg de inhoud van de berichtgeving als dusdanig controleert. Ze vullen elkaar aan als propagandamachine van privé-belangen. Bij de staatsmedia speelt niet zozeer de agenda van de reclameterreur een rol als wel de enorme impact van het ideologische denken van die politieke klasse die de vrijheid van mening en het brengen van alternatieve meningen tegenhoudt.
Naar aanleiding van de recente afdankingen en besparingen bij de verschillende mediagroepen in dit land, waarbij tientallen redactiemedewerkers werden ontslagen, duikt de vraag bij de burgerij en haar linkse papegaaien op of onze media nog wel democratisch en onafhankelijk genoeg zijn. Voor ons kan die vraag gerust negatief worden beantwoord, want in dit land en in de rest van de ultraliberale wereld is er al lang geen sprake meer van zoiets als vrije of onafhankelijke pers, dat zijn al lang lege begrippen geworden hier. De TV-nieuwsberichten bijvoorbeeld zijn een loutere voordracht van de dagelijkse persknipsels die worden overgenomen van persgroepen die geconcentreerd zijn in de handen van de Belgische kapitaalselite. Zelfs op de door de staat gecontroleerde media zoals de VRT zijn de toon en de inhoud van het nieuws gekopieerd van die burgelijke mediagroepen, want daar moet het duidelijk zijn dat de politieke elite een verlengde van de kapitaalselite is en bijgevolg de inhoud van de berichtgeving als dusdanig controleert. Ze vullen elkaar aan als propagandamachine van privé-belangen. Bij de staatsmedia speelt niet zozeer de agenda van de reclameterreur een rol als wel de enorme impact van het ideologische denken van die politieke klasse die de vrijheid van mening en het brengen van alternatieve meningen tegenhoudt. « Il y a eu le développement d'internet, l'accès facile à des scènes pornographiques, le fait que les jeunes peuvent se filmer avec des téléphones portables en train d'avoir des relations sexuelles reproduisant ces scénarios. Sans qu'aucun adulte ne leur dise que le porno, ce n'est pas la réalité, que l'acteur joue, qu'il est dopé.
« Il y a eu le développement d'internet, l'accès facile à des scènes pornographiques, le fait que les jeunes peuvent se filmer avec des téléphones portables en train d'avoir des relations sexuelles reproduisant ces scénarios. Sans qu'aucun adulte ne leur dise que le porno, ce n'est pas la réalité, que l'acteur joue, qu'il est dopé. 

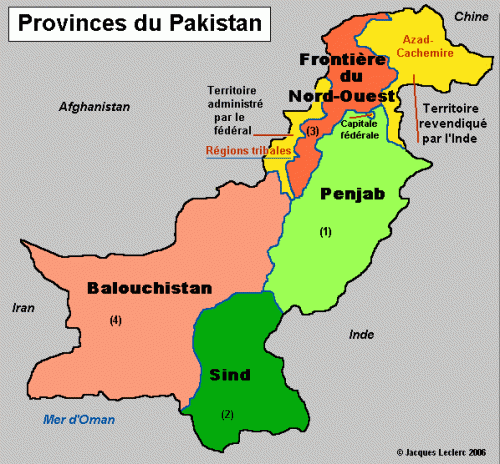





 Pétrole, une guerre d’un siècle : L’ordre mondial anglo-américain
Pétrole, une guerre d’un siècle : L’ordre mondial anglo-américain


 « "En 2025, les Etats-Unis constitueront sans doute encore l'acteur individuel le plus puissant de la planète, mais sa puissance relative, même militaire, aura décliné, et sa capacité de levier sur les affaires du monde sera fortement restreinte." Ce pronostic n'est pas le fait d'un groupuscule anti-américain : c'est l'une des conclusions les plus frappantes du rapport que vient de publier le Conseil national du renseignement (NIC), un centre d'études gouvernemental américain dépendant directement du directeur national du renseignement. C'est la 4e édition de ce rapport, élaboré tous les quatre ans par le NIC – anciennement par la CIA – destiné à éclairer les plus hautes instances américaines sur l'évolution prévisible de la planète. Nul doute qu'il tombe à pic pour le président élu Barack Obama, au moment où celui-ci s'apprête à prendre en main le gouvernail de la puissance américaine.
« "En 2025, les Etats-Unis constitueront sans doute encore l'acteur individuel le plus puissant de la planète, mais sa puissance relative, même militaire, aura décliné, et sa capacité de levier sur les affaires du monde sera fortement restreinte." Ce pronostic n'est pas le fait d'un groupuscule anti-américain : c'est l'une des conclusions les plus frappantes du rapport que vient de publier le Conseil national du renseignement (NIC), un centre d'études gouvernemental américain dépendant directement du directeur national du renseignement. C'est la 4e édition de ce rapport, élaboré tous les quatre ans par le NIC – anciennement par la CIA – destiné à éclairer les plus hautes instances américaines sur l'évolution prévisible de la planète. Nul doute qu'il tombe à pic pour le président élu Barack Obama, au moment où celui-ci s'apprête à prendre en main le gouvernail de la puissance américaine.



 « Parmi ceux que n’ont pas touchés les excès de l’Obamania, il y a les dirigeants chinois, les Turcs et – parmi d’autres – les Russes, qui se rallieraient certainement au commentaire du conseiller diplomatique du président français, Jean-David Levitte : le président américain élu “ne porte pas une vision différente du monde”, propos rapportés par Le Monde du 5 novembre. Le premier discours annuel adressé par le président russe à la Fédération témoigne de cette réserve : pas de trêve ni d’état de grâce accordés à celui qui a repris, au cours de sa campagne, le discours anti-russe habituel à son prédécesseur.
« Parmi ceux que n’ont pas touchés les excès de l’Obamania, il y a les dirigeants chinois, les Turcs et – parmi d’autres – les Russes, qui se rallieraient certainement au commentaire du conseiller diplomatique du président français, Jean-David Levitte : le président américain élu “ne porte pas une vision différente du monde”, propos rapportés par Le Monde du 5 novembre. Le premier discours annuel adressé par le président russe à la Fédération témoigne de cette réserve : pas de trêve ni d’état de grâce accordés à celui qui a repris, au cours de sa campagne, le discours anti-russe habituel à son prédécesseur.
