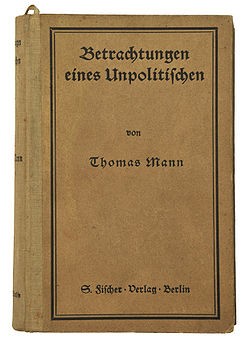vendredi, 29 avril 2011
La Cruz visigoda como labaro de la reconquista

Por E. Monsonis
Ex: http://idendidadytradicion.blogia.com/
De entre los símbolos más importantes utilizados durante los primeros tiempos de la Reconquista destaca la cruz de brazos trapeciales e iguales, llegada a nuestros días como principal emblema heráldico de Asturias, y primitivo lábaro de la reconquista, adoptado por los reyes asturianos como emblema de la monarquía junto a otros modos y costumbres visigóticas «pues en mostrarse heredera de estos visigodos residía su más prestigiosa razón de ser».(1)
Es conocida por los historiadores e investigadores de esta parte de la historia la aspiración por parte de los monarcas asturianos de restablecer la continuidad visigoda en el naciente enclave, cuna de los posteriores reinos de León y Castilla que finalizarían la reconquista europea del territorio de la península ibérica a los moros, iniciado por sus antepasados de estirpe goda desde la primera llegada de aquellos. Ya uno de los primeros monarcas asturianos, Alfonso I, que reinó entre el 739 y el 756, quien fuera yerno de Pelayo –a su vez de la estirpe real de Kindaswindus, y espatario del rey Egik–, primer rey neogodo elegido al estilo germánico, elevándolo sobre su propio escudo por sus más nobles guerreros, y que arrojó a los moros de Galicia y de León, se vanagloriaba de ser de «stirpe regis Recaredi et Ermenegildi». Por su parte, su nieto Alfonso II afirmaba en el Epítome Ovetense del año 883, también llamada CronicónAlbeldense«omnem gothorum ordinem sicuti Toleto fuerat, tam in ecclesiam quampalatio in Oveto, cuncta statuit» («todo el orden de los godos tal como existió en Toledo quedó instituido en la Iglesia y la corte de Oviedo»), y es en dicha crónica tal como apunta Hernández Sáez en Las Castillas y León, teoría de una nación, donde se califica también a la relación de monarcas astures como «Ordo Gothorum OvetensiumRegum» («relación de los reyes godos de Oviedo»), pues como apunta Gonzalo Menéndez Pidal en su artículo «El lábaro primitivo de la reconquista», «en mostrarse heredera de estos visigodos residía su más prestigiosa razón de ser»(2). Por ello, los modos, costumbres, textos refundidos de la época toledana, rituales y símbolos visigodos se perpetúan en Silos, Cardeña , San Millán y otros centros durante los primeros siglos de la reconquista hispánica. Por su parte, en los nacientes reinos peninsulares –en todos, no sólo en el asturiano–, el rito godo dentro de las costumbres religiosas continuó en vigor hasta el año 1071 fecha en la que el legado del papa Alejandro II, Hugo, fue a San Juan de la Peña y en presencia del rey Sancho Ramírez de Aragón y de toda su corte, obispos y abades, celebró la primera misa pascual conforme al rito romano, originando con ello toda una reforma en la que fue preciso copiar miles de códices para asegurar la difusión de la nueva liturgia, sustituyéndose la letra gótica, en vigor hasta esas fechas, por la carolina, y modificándose el calendario litúrgico y el santoral. También en el campo de la lingüística, la onomástica o el de la legislación, o bien en el mundo de la literatura de los nacientes reinos peninsulares permaneció un legado visigótico nada desdeñable. En definitiva, «la impronta visigoda está grabada en muchas instituciones medievales y en la epopeya castellana» (3). Y en esta campo, es la cruz cómo lábaro de la Reconquista, una importante seña de identidad de la monarquía visigótica que continuó como tal entre las aristocracias germánicas que iniciaron la reconquista tal como veremos a continuación.

Tan sólo unos años antes de la batalla de Covadonga, la península ibérica en su totalidad se hallaba bajo el poder del reino visigodo de Toledo, y destacando entre los símbolos godos se encontraba la cruz, antiguo símbolo visigótico representado en numerosas ocasiones de una forma particular, normalmente con brazos iguales, tal como consta en los templos visigóticos de los antiguos reinos de Tolosa y Toledo, y quedando dicha cruz para la posteridad en los emblemas heráldicos de los diversos reinos y condados que devinieron durante la Edad Media procedentes del de Toledo. En la península ibérica, entre las piezas visigodas halladas en los tesoros de Guarrazar y Torredonjimeno se cuentan nunerosas cruces votivas con inscripciones, presencia constatada también en el Liber Ordinum, o en importantes joyas artísticas como la corona de Recesvinto. García Volta, destaca en su obra El mundo perdido de los visigodos , la afición de este pueblo de depositar en los altares cruces junto a otros motivos artísticos (4). Sabemos además por otras fuentes documentales como dice Blanco Torviso, que junto a las representaciones geométricas, vegetales y zoomórficas –repetidas en el llamado «arte asturiano»– destacaban en los templos visigodos resplandecientes elementos suntuarios, «especialmente cruces y coronas votivas» (5). También Fernández Conde y Santos del Valle inciden en que «el mundo tardorromano y visigodo estaba mucho más cercano. Por eso, nada tiene de extraño que las grandes iglesias hispanogodas del siglo VII –San Juan de Baños de Cerrato, San Pedro de la Nave, Santa Comba de Bande, y hasta la misma Quintanilla de Viñas– presentan similitudes estilísticas notorias con la fundación de Silo en su corte asturiana» (6). Ya en tiempos del rey Don Favila, se levantó sobre un dolmen en Cangas de Onís, una de las primeras iglesias cristianas tras la invasión musulmana, llamándose precisamente de la Santa Cruz, observando con ello Besga Marroquín que «si la vinculación de la Santa Cruz con la monarquía asturiana es patente desde el reinado de Favila, no lo es menos con el pasado visigótico» (7), ya que según Menendez Pidal de Navascues, «de todos los pueblos germánicos, solo entre los visigodos se halla este uso de la cruz; (…).Tal signo o emblema de la monarquía visigoda se refuerza por su probable uso como enseña de las milicias reales, llevada la cruz de modo visible, sostenida por el asta, uso que veremos continuado por la monarquía asturiana» (8), añadiendo Besga Marroquín, que «éste debe ser tenido como un elemento más que vinculado al naciente poder en Asturias con el elemento visigodo» (9)

Por su parte el rey Alfonso II, «de quien el Epitome Ovetense dice que restauró los modos del Toledo visigótico, tanto en palacio como en la Iglesia», mandó labrar una extraordinaria cruz votiva con la forma usual entre los visigodos, es decir, brazos trapeciales e iguales, como los representados en Guarrazar, San Juan de Baños, el tablero de Alcaudete u otras muestras del arte visigótico. Es la conocida como Cruz de los Ángeles.
También Alfonso III ofreció a la recién construida basílica de Santiago otra cruz similar, ofrecimiento que se repite con sus descendientes Alfonso III y Ramiro II, ya en el 940.
Por ello, como indica Menéndez Pidal en el trabajo citado «…las cruces conservadas “de los ángeles”, de Santiago y de la Victoria –o la llamada «cruz del secreto» tal como aparece figurada en un pilar visigodo, similar a la de la victoria, con el alfa y el omega– «se nos ofrecen como supervivencias que testifican de qué manera aquella costumbre visigótica, según la cual los reyes ofrecían como dones cruces preciosas a sus iglesias, siguió siendo practicada por los reyes asturianos deseosos de persistir en los modos toledanos» (10), costumbre que pervivirá al menos hasta el siglo XIII. Por su parte, el Liber ordinum en sus diversas ediciones nos describe con todo detalle como el rey visigodo-asturiano era recibido por el obispo y el clero en la iglesia pretoriana, recepción en la que era protagonista la cruz como estandarte victorioso de combate, y en la que acabado el ceremonial los caballeros recibían de manos del sacerdote los estandartes. «De donde resulta que la cruz era lábaro de los reyes visigodos y lo siguió siendo de los asturianos, acorde con lo cual quedan bien justificadas las inscripciones de las cruces de Alfonso II y Alfonso III» (11).
Siguiendo a Menéndez Pidal conocemos que «La vieja tradición española parece haberse distinguido en ciertas peculiaridades: En Santa María de las Viñas un ángel y la figura central de un capitel, actualmente suelto, empuñan cruces de brazos trapeciales e iguales, en una de las cuales se ve claramente el mango que entesta con el pie de la cruz. Ambas van empuñadas con una sola mano y no con dos. En la miniatura de los Beatos, el Ángel de los Vientos marca a los elegidos con una cruz enmangada. Pero la más completa imagen de cómo este lábaro visigótico asturiano era llevado a la guerra, nos la da el estandarte de San Isidoro de León, que en pleno siglo XIII aún representa al santo de Sevilla galopando en corcel que monta con silla de guerra de altos borrenes llevando en la mano derecha una cruz gótica empuñada de igual modo a como lo hace el ángel visigodo de Santa María de Lara o el Angel de los Vientos en los Beatos mozárabes. Así se dice que apareció San Isidoro en el cerco de Baeza; así iría antes los reyes ovetenses o toledanos, el clérigo a quien el rey entregaba la cruz al partir para la guerra desde la Basílica pretoriana, centros ceremoniales donde el rey toma la cruz para partir a la guerra, , basílica en la cual se reunieron de 653 a 702 al menos seis de los grandes concilios toledanos, y en la cual fue ungido Wamba en el 672. Basílica pretoriana también se llamó en Toledo a la de Santa Leocadia. Llevarían título de pretorianas por ser las de la guardia real, por eso en ellas se celebraba la ceremonia de tomar el rey la cruz para la guerra .
Todavía de Alfonso III se refiere como encargó al conde Hermenegildo Gutierrez someter al rebelde Vitiza, y como le combatió con su gente y “cum omnibus militibuspalatii”. Esta militia palatii evidentemente ya no osaba llevar el titulo de pretoriana , pero sin duda quería heredar la tradición toledana, y por eso era tenida como nervio de ese ejército permanente que en tantas cosas se consideraba continuador de las tradiciones visigóticas. Esa basílica palatina tendría en Oviedo una basílica preferida para su ceremonial castrense», función no del todo reconocida, o bien semiocultada, en nuestros días por parte de la historiografía oficial, aunque la estructura y emplazamiento del monumento no deje de confundir a muchos historiadores y arqueológos. Sabemos por las crónicas del siglo IX que en Naranco construyó Ramiro I un edificio y una aula regia con baño, pero en ella además de la estancia que ha sido definida como baño existió un ara consagrada a Santa María en el 848 con uso circunstancial de lo que podríamos llamar basílica pretoriana o de la milicia palatina. Y es en el interior de la sala principal de este interesante monumento, donde se pueden apreciar, tal como incluimos en las ilustraciones de este trabajo, la cruz de la que estamos hablando junto a otros motivos que nos remiten a simbologías solares guerreras. Cuando la visitamos, pensamos que no es difícil imaginar el interior de Santa María del Naranco ocupado por guerreros visigodos asturianos junto a su rey. No hay más que estudiar sus detalles con detenimiento. Definitivamente ni es un palacio ni una iglesia.
Por otra parte, siguiendo con Asturias también podemos detectar esta continuidad visigótica en los símbolos de la comunidad de lucha con voluntad de reconquista surgida en el primitivo reino astur, en todo cuanto hace referencia a la continuidad familiar o de linaje, no sólo en el caso de la familia real sino entre los más antiguos linajes asturianos, la mayoría de estirpe goda. Los símbolos de la cruz junto a otros no menos visigóticos como el águila aparecen pintados en numerosas muestras heráldicas de entre las más hidalgas familias asturianas. Tirso de Avilés en su obra Armas y linajesy antigüedad del principado nos habla de apellidos como Fonfría del que recoge «de Recaredo, rey godo, es cierto que descendía el linaje de Fonfría», o de los Noriega «Los de este linaje y apellido son buenos hidalgos, y tan antiguos que se tiene por cierto que vienen del infante Pelayo y se llamaban Infanzones antiguamente teniendo su solar en el valle de Riva de Sella en las Asturias de Santillana. Traen por armas las que tomó dicho infante cuando comenzó a echar a los moros de Asturias que son en azur una cruz que llevó como estandarte y bandera» (12) . Y es que, como afirma Jesús Evaristo Casariego, «viene Oviedo a la historia para ser cabeza de una gran empresa, impregnada de neogoticismo germano hispano, y por tanto, de catolicismo, de germanismo y de romanismo, es decir, de la cristiandad europea que estaba naciendo. Por algo (curiosa coincidencia) Oviedo viene a la historia al mismo tiempo que el imperio carolingio, otro de los creadores de Europa»(13).
Pero no será , de entre los enclaves surgidos de la España visigoda, el reino asturiano, el único en usar como lábaro y emblema de combate de la reconquista el símbolo de la cruz patada, también en Aragón se repite un proceso restaurador semejante al asturiano, y además la imagen con que tradicionalmente se representa esa cruz en monedas y demás emblemas es de cruz griega con brazos trapeciales y enmanganado, un pequeño astil para empuñadura. Símbolo que se perpetúa en el actual escudo heráldico del reino de Aragón junto a cuatro cabezas de moro cercenadas y ensangrentadas, histórico emblema que cuando esto escribo, los representantes parlamentarios aragoneses trabajan por eliminar, siguiendo el ejemplo del cabildo de Santiago, que renegó publica y vergonzosamente hace unos años de su santo patrón, Sant Yago Matamoros, patrón de la caballería neovisigótica en su lucha contra el invasor musulmán quien según la leyenda también portaba una cruz de similares características, emblema de una importante Orden Militar castellana.
De igual forma es la cruz de Sobrarbe. «Todos ellos testimonios evidentes de lo enraizada que estuvo en toda la España cristiana la tradición visigoda, y como todos los focos de reconquista buscaban restablecer ese mismo lábaro que por una parte testimoniaba su fe ante el invasor y por otra justificaba su legalidad encadenándose a lo visigodo» (14).
Terminando con Gonzalo Menéndez Pidal recordemos que «La cruz como lábaro del ejército real fue adoptada por reyes de Asturias y Aragón (utilizada como emblema de León hasta el siglo XII y por Castilla hasta el XIII). Para ello hay que admitir una mínima continuidad, pues sólo los visigodos entre todos los pueblos germánicos, habían tenido la cruz por insignia; y el que las huestes asturianas se lanzasen al combate bajo el mismo estandarte de los ejércitos reales del Toledo visigótico, habla bien a las claras de cómo en Oviedo alentaba un ansia de continuidad. Las minuciosas rúbricas del Liber Ordinum seguían rigiendo las ceremonias con que en el aula regia del Naranco, a las afueras de Oviedo, se despedía al ejército reconquistador, igual que antes de la invasión musulmana habían regido la despedida del ejército hispanogodo en la basílica pretoriana de los arrabales toledanos.
Por eso Alfonso III traerá de su campaña toledana como preciado botín, una cruz con su lignum crucis; tal fue el lábaro de los reyes godos y tal reliquia había de constituir ahora el alma del regio lábaro alfonsí. Por eso, la cruz acabará figurando en Asturias (y por ende en León, Castilla, Aragón) como emblema real. Y por eso, según rúbrica visigótica se esculpirán protectoras cruces sobre regios palacios y fuentes. Porque en toda la vida de los renacientes reinos cristianos habrá constante deseo de mantener la peculiar tradición visigoda, y conforme prescribe el viejo Liber ordinum se seguirán ofreciendo coronas a los altares, y conforme a las mismas rúbricas se seguirá asistiendo a los moribundos. Y no acabaremos de comprender los marfiles de San Millán si olvidamos esto, porque aún la pintura y la literatura románica de los siglos XII y XIII seguían recordándolo.
Recordemos nosotros por tanto, ahora, como la Reconquista empezó siendo una empresa sentida como guerra visigótica, guerra con la que se deseaba restablecer la continuidad de una tradición toledana, y donde no se daba otra variante sino la de que antes del 711 los españoles impetraban de Dios» (15).
Los hijos del primitivo reino visigótico de Asturias, organizados luego en León y posteriormente en Castilla, como también los no menos originalmente visigodos de Aragón, Navarra y Cataluña, siguieron utilizando años después la cruz visigoda como lábaro en la Reconquista europea de la península ibérica, constatando orgullosamente con ello al modo germánico cuales eran sus gloriosos orígenes, y cuales sus objetivos. La cruz fue sustituida por leones y castillos, las ceremonias y escritura visigótica fueron tenazmente abolidas por las autoridades religiosas desgotizadas, aunque no muchos otros modos y costumbres bien arraigadas en la población hispano-goda, pero las viejas piedras de los templos, los antiguos estandartes y las armas de los guerreros que hicieron posible la recuperación de la tierra que había sido del reino de Toledo mantuvieron bien visible para el que quisiera verlo, cuales y de que origen fueron los símbolos que animaron la Reconquista. Símbolos que todavía hoy, ocultos entre la confusión y el olvido, nos muestran un legado y una herencia que algún día habrá que recuperar, para poder iniciar una cada vez más necesaria nueva Reconquista.
(1) Menéndez Pidal Gonzalo. El lábaro primitivo de la reconquista. En Varia Medievalia I. Real Academia de la Historia. Madrid 2003
(2) Menéndez Pidal. op.cit.
(3)La pesa, Rafael .Historia de la lengua española. Madrid 2001.
(4)García Volta, G. El mundo perdido de los visigodos. Ed.Bruguera. Barcelona 1977
(5)VV.AA. Historia del Arte. La Edad Media. Alianza Editorial. Madrid 2004.
(6) Citado por, José Ignacio Gracia Noriega en Don Pelayo, el rey de las montañas. La esfera de los libros. Madrid 2006
(7) Besga Marroquín A., Orígenes hispano-godos del reino de Asturias. Oviedo 2000
(8) ) Citado por, José Ignacio Gracia Noriega en Don Pelayo, el rey de las montañas
(9) Besga Marroquín, A. op.cit.
(10) Menéndez Pidal. op.cit.
(11) Menéndez Pidal. op.cit.
(12) Avilés, Tirso de. Armas y linajes de Asturias y antigüedades del principado.Grupo Editorial Asturiano. Oviedo 1991El águila como figura heráldica aparece en los blasones de los linajes Portal, Moran, junto con la cruz, Busto, Pedrera, Fonfría, Estrada, Junco, Moniz, Riaño etc. Mientras que la cruz es pintada en las armas deAlfonso, Somonte, Cifuentes,Ordóñez, Caso, Noriega, Hevia «que no tienen sangre mezclada» o Ribero.
(fuente: Tirso de Avilés).
(13) Citado por, José Ignacio Gracia Noriega en Don Pelayo, el rey de las montañas. La esfera de los libros. Madrid 2006
(14) Menéndez Pidal, G.
(15) Menéndez Pidal, G.
00:05 Publié dans Histoire, Terres d'Europe, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, tradition, wisigoths, espagne, symboles, moyen âge, reconquista |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 28 avril 2011
Reza Shah inaugure le chemin de fer transiranien
Reza Shah inaugure le chemin de fer transiranien
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, iran, moyen orient |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 26 avril 2011
Nicola Bombacci: de Lênin a Mussolini

Nicola Bombacci: de Lênin a Mussolini
Nicola Bombacci nasce no seio de uma família católica (o seu pai era agricultor, antigo soldado do Estado Pontifício) da Romagna, na província de Forli, a 24 de Outubro de 1879, a escassos quilómetros de Predappio, onde quatro anos mais tarde nascerá o futuro fundador do Fascismo. Trata-se de uma região marcada por duras lutas operárias e por um campesinato habituado à rebelião, terra de paixões extremas. Por imposição paterna ingressa no seminário mas rapidamente o abandona aquando da morte do seu progenitor. Em 1903 ingressa no anticlerical Partido Socialista (PSI) e decide tornar-se professor para poder assim servir as classes menos favorecidas na sua luta (novamente as semelhanças com o Duce são evidentes, tendo chegado a estudar na mesma escola superior) mas rapidamente passa a dedicar-se de corpo e alma à revolução socialista. A sua capacidade de trabalho e os seus dotes de organizador valem-lhe a direcção dos órgãos da imprensa socialista, o que lhe permitirá aumentar a sua influência no seio do movimento operário, chegando a ser Secretário do Comité Central do Partido, onde conhecerá um jovem uns anos mais novo: Benito Mussolini, que, não nos esqueçamos, foi a promessa do socialismo italiano antes de se tornar nacional-revolucionário. [1]
Opondo-se à linha moderada da social-democracia, Bombacci fundará juntamente com Gramsci o Partido Comunista de Itália após a cisão interna do PSI e viajará em princípios dos anos 20 para a URSS, para participar na revolução bolchevique, aonde já antes tinha estado como representante do Partido Socialista tendo sido conquistado pela causa dos sovietes. Aí trava amizade com o próprio Lenine que lhe dirá numa recepção no Kremlin estas famosas palavras sobre Mussolini: “Em Itália, companheiros, em Itália só há um socialista capaz de guiar o povo para a revolução: Benito Mussolini”, e pouco depois o Duce encabeçaria uma revolução, mas fascista… [2]
Como líder (António Gramsci era o teórico, Bombacci o organizador) do recém-criado PCI, torna-se no autêntico “inimigo público nº 1” da burguesia italiana, que o apoda de “O Papa Vermelho”. Revalidará brilhantemente o seu lugar de deputado, desta vez nas listas da nova formação, enquanto que as esquadras fascistas começam a tomar as ruas enfrentando as milícias comunistas em sangrentos combates. Bombacci empenhar-se-á em deter a marcha para o poder do fascismo mas fracassará, desde as páginas dos seus jornais lança invectivas contra o fascismo arengando a defesa da revolução comunista. É uma época em que os esquadristas de camisa negra cantam canções irreverentes como “Não tenho medo de Bombacci / Com a barba de Bombacci faremos spazzolini (escovas) / Para abrilhantar a careca de Benito Mussolini”. Etapa em que o comunismo se vê imerso em numerosas tensões internas e o próprio Bombacci entra em polémica com os seus companheiros de partido sendo um dos pontos de fricção a opção entre nacionalismo e internacionalismo. Já antes tinha demonstrado tendências nacionalistas, que faziam pressagiar a sua futura linha. Quando ainda estava no Partido Socialista e como consequência de um documento protestando contra a acção de Fiume levada a cabo por D’Annunzio que o Partido queria apresentar, Bombacci rebelou-se e escreveu sobre este que era “Perfeita e profundamente revolucionário; porque D’Annunzio é revolucionário. Disse-o Lenine no Congresso de Moscovo”. [3]
Em 1922 os fascistas marcham sobre a capital do Tibre; nada pode impedir que Mussolini assuma o poder, ainda que este não seja absoluto durante os primeiros anos do regime. Como deputado e membro do Comité Central do Partido, assim como encarregado das relações exteriores do mesmo, Bombacci viaja ao estrangeiro frequentemente. Participa no IV Congresso da Internacional Comunista representando a Itália, e, no Comité de Acção Antifascista, entrevista-se com dirigentes bolcheviques russos. Leva já metade da sua vida dedicada à causa do proletariado e não está disposto a desistir do seu empenho em levar à prática o seu sonho socialista. Torna-se fervente defensor da aproximação da Itália à URSS na Câmara e na imprensa comunista, falando seguramente em nome e por instigação dos dirigentes moscovitas, mas utilizando um discurso nacional-revolucionário que incomoda no seio do Partido, que por outro lado está em plena debandada após a vitória fascista. As relações com o revolucionário Estado soviético seriam uma vantagem para a Itália enquanto nação que também atravessa um processo revolucionário, ainda que fascista. É imediatamente acusado de herético e pedem-lhe que rectifique as suas posições. Não podem admitir que um comunista exija, como o faz Bombacci, “superar a Nação (sem) a destruir, queremo-la maior, porque queremos um governo de trabalhadores e agricultores”, socialista e sem negar a Pátria “direito incontestável e sacro de todo o homem e de todos os grupos de homens”. É a chamada “Terceira Via” onde o nacionalismo revolucionário do fascismo se encontra com o socialismo revolucionário comunista.
Bombacci é progressivamente marginalizado no seio do PCI e condenado ao ostracismo político, embora não deixe de manter contactos com alguns dirigentes russos e com a embaixada russa para a qual trabalha, além de que um dos seus filhos vivia na URSS. Acreditava sinceramente na revolução bolchevique e que, ao contrário dos camaradas italianos, os russos tinham um sentido nacional da revolução pelo que jamais renegará a sua amizade para com a URSS, nem sequer depois de aderir definitivamente ao fascismo.
Com a expulsão definitiva do partido em 1927, Bombacci entra numa etapa que podemos qualificar como os anos do silêncio que dura até 1936, altura em que lança a sua editorial e a revista homónima baptizada “La Veritá” e que culminará em 1943 numa progressiva conversão ao fascismo. No entanto é demasiado fácil considerar que Bombacci simplesmente se passou de armas e bagagens para o fascismo como pretendem os que o acusam de ser um “traidor”. Assistiremos a um processo lento de aproximação, não ao fascismo mas sim a Mussolini e à ala esquerdista do movimento fascista, onde Bombacci se sente aconchegado e em família, próximo das suas concepções revolucionárias, o corporativismo e as leis sociais deste fascismo de que “todo o postulado é um programa do socialismo”, segundo dirá em 1928 reconhecendo a sua identificação. [4]
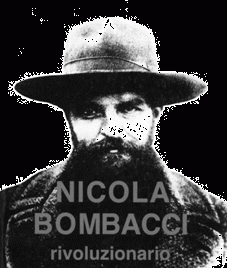 Comprovamos assim que Bombacci não é um fascista, mas defende as conquistas do regime e a figura de Mussolini. Não se aproximou do partido fascista – jamais se inscreveu no Partido Nacional Fascista – apesar da sua amizade reconhecida com Mussolini, não aceitou cargos que lhe poderiam oferecer nem renegou as suas origens comunistas. A sua independência valia mais. No entanto convenceu-se de que o Estado Corporativo proposto pelo fascismo era a realização mais perfeita, o socialismo levado à prática, um estado superior ao comunismo. Jamais camuflará os seus ideais, em 1936 escrevia na revista “La Veritá”, confessando a sua adesão ao fascismo mas também ao comunismo:
Comprovamos assim que Bombacci não é um fascista, mas defende as conquistas do regime e a figura de Mussolini. Não se aproximou do partido fascista – jamais se inscreveu no Partido Nacional Fascista – apesar da sua amizade reconhecida com Mussolini, não aceitou cargos que lhe poderiam oferecer nem renegou as suas origens comunistas. A sua independência valia mais. No entanto convenceu-se de que o Estado Corporativo proposto pelo fascismo era a realização mais perfeita, o socialismo levado à prática, um estado superior ao comunismo. Jamais camuflará os seus ideais, em 1936 escrevia na revista “La Veritá”, confessando a sua adesão ao fascismo mas também ao comunismo:“O fascismo fez uma grandiosa revolução social, Mussolini e Lenine. Soviete e Estado fascista corporativo, Roma e Moscovo. Muito tivemos que rectificar, nada de que nos fazer perdoar, pois hoje como ontem move-nos o mesmo ideal: o triunfo do trabalho”. [5]
Enquanto isto sucedia Bombacci tem um longo intercâmbio epistolar com o Duce tentando influenciar o antigo socialista na sua política social. O máximo historiador do fascismo, Renzo de Felice, escreveu a este respeito que Bombacci tem o mérito de ter sugerido a Mussolini mais do que uma das medidas adoptadas nesses anos 30. [6] Numa destas missivas, datada de Julho de 1934, propõe um programa de economia autárquica (que Mussolini aplicará) que, diz Bombacci ao Duce, é mostra da sua “vontade de trabalhar mais naquilo que agora concerne, no interesse e pelo triunfo do Estado Corporativo…”, como faz também desde as páginas da sua revista onde uma e outra vez batalha por uma autarcia que faça da Itália um país independente e capaz de enfrentar as potências plutocráticas (entenda-se os EUA, mas também a França e a Inglaterra). Por isso apoia decididamente a intervenção na Etiópia em 1935, mas não como campanha colonial senão como prelúdio da confrontação entre os países “proletários” (entre os quais estaria a Itália fascista) e os “capitalistas” que irremediavelmente chegaria, essa “revolução mundial (que) restabelecerá o equilíbrio mundial”. A acção italiana seria uma “típica e inconfundível conquista proletária”, destinada a derrotar as potências “capitalistas” e cuja experiência “deverá ser assumida… como um dado fundamental para a redenção das gentes de cor, ainda sob a opressão do capitalismo mais terrível”. [7]
Contra Estaline
Entre os anos de 1936 e 1943, difíceis para o fascismo pois iniciam-se os conflitos armados, prelúdio da derrota, Bombacci acrescenta a sua adesão ideológica a Mussolini. É um homem com quase 60 anos, viu como muitos dos seus sonhos socialistas não se realizaram, mas é um eterno idealista e não está disposto a abandonar a luta pelo socialismo, por “essa obra de redenção económica e de elevação espiritual do proletariado italiano que os socialistas da primeira hora tínhamos iniciado”. A sua editorial é uma ruína económica, os seus biógrafos deixaram constância das dificuldades e penúrias que sofre. Ter-lhe-ia bastado um passo oportunista e integrar-se no fascismo oficial e teria disposto de todas as ajudas do aparato do Estado mas não quer perder a sua independência ainda que em ocasiões deva aceitar subvenções do Ministério de Cultura Popular.
Esta etapa coincide com uma profunda reflexão sobre os seus erros passados e uma série de ataques ao comunismo russo que se tinha vendido às potências capitalistas traindo os postulados de Lenine. Assim, escreve Bombacci em Novembro de 1937, as relações entre a URSS e os países democráticos só tinha uma explicação que revelaria tudo o resto: “a razão é só uma, frívola, vulgar, mas real: o interesse, o dinheiro, o negócio”, pelo que este antigo comunista podia declarar abertamente que “nós proclamamos com a consciência limpa que a Rússia bolchevique de Estaline se tornou uma colónia do capitalismo maçónico-hebraico-internacional…”. A alusão anti-semita não é nova em Bombacci, nem nos teóricos socialistas do início do século, pois não devemos esquecer que o anti-semitismo moderno teve os seus mais ferventes defensores precisamente entre os doutrinários revolucionários de finais do século XIX, quando o judeu encarnava a figura do odiado capitalista. Em Bombacci não encontramos um anti-semitismo racialista mas sim social, de acordo com os posicionamentos mediterrânicos do problema judeu diferentemente do anti-judaismo alemão ou gaulês.
Quando estala a II Guerra Mundial, e especialmente ao estalar na frente Leste, Bombacci participa em pleno nas campanhas anticomunistas do regime. Como dirigente comunista conhecedor da URSS a sua voz faz-se ouvir. No entanto não renega os seus ideais, pelo contrário aprofunda a tese de que Estaline e os seus acólitos traíram a revolução. Escreve numerosos artigos contra Estaline, sobre as condições reais de vida no chamado “paraíso comunista”, as medidas adoptadas por este para destruir todos os sucessos do socialismo leninista. Em 1943, pouco antes da queda do Fascismo, concluía Bombacci resumindo a sua posição num folheto de propaganda:
“Qual das duas revoluções, a fascista ou a bolchevique, fará história no século XX e ficará na história como criadora de uma ordem nova de valores sociais e mundiais?
Qual das duas revoluções resolveu o problema agrário interpretando verdadeiramente os desejos e aspirações dos camponeses e os interesses económicos e sociais da colectividade nacional?
Roma venceu!
Moscovo materialista e semi-bárbara, com um capitalismo totalitário de Estado-Patrão quer juntar-se à força (planos quinquenais), levando à miséria mais negra os seus cidadãos, à industrialização existente nos países que durante o século XIX seguiram um processo de regime capitalista burguês. Moscovo completa a fase capitalista.
Roma é outra coisa.
Moscovo, com a reforma de Estaline, retrata-se institucionalmente ao nível de qualquer Estado burguês parlamentar. Economicamente há uma diferença substancial, porque, enquanto que nos Estados burgueses o governo é formado por delegados da classe capitalista, aqui o governo está nas mãos da burocracia bolchevique, uma nova classe que na realidade é pior que essa classe capitalista porque dispõe sem qualquer controlo do trabalho, da produção e da vida dos cidadãos”. [8]
A República Social Italiana
 Quando Mussolini é deposto em Julho de 1943 e resgatado pelos alemães uns meses depois, o Partido Nacional Fascista já se desagregou. A estrutura orgânica desapareceu, os dirigentes do partido, provenientes das camadas privilegiadas da sociedade passaram-se em massa para o governo de Badoglio e a Itália encontra-se dividida em dois (ao sul de Roma os Aliados avançam em direcção ao norte). Mussolini reagrupa os seus mais fiéis, todos eles velhos camaradas da primeira hora ou jovens entusiastas, quase nenhum dirigente de alto nível, que ainda acreditam na revolução fascista e proclama a República Social Italiana. Imediatamente o fascismo parece voltar às suas origens revolucionárias e Nicola Bombacci adere à república proclamada e presta a Mussolini todo o seu apoio. O seu sonho é poder levar a cabo a construção dessa “República dos trabalhadores” pela qual tanto ele como Mussolini se bateram juntos no início do século. Tal como Bombacci, outros conhecidos intelectuais de esquerda juntam-se ao novo governo: Carlo Silvestri (deputado socialista, depois da guerra defensor da memória do Duce), Edmondo Cione (filosofo socialista que será autorizado a criar um partido socialista aparte do Partido Fascista Republicano), etc.
Quando Mussolini é deposto em Julho de 1943 e resgatado pelos alemães uns meses depois, o Partido Nacional Fascista já se desagregou. A estrutura orgânica desapareceu, os dirigentes do partido, provenientes das camadas privilegiadas da sociedade passaram-se em massa para o governo de Badoglio e a Itália encontra-se dividida em dois (ao sul de Roma os Aliados avançam em direcção ao norte). Mussolini reagrupa os seus mais fiéis, todos eles velhos camaradas da primeira hora ou jovens entusiastas, quase nenhum dirigente de alto nível, que ainda acreditam na revolução fascista e proclama a República Social Italiana. Imediatamente o fascismo parece voltar às suas origens revolucionárias e Nicola Bombacci adere à república proclamada e presta a Mussolini todo o seu apoio. O seu sonho é poder levar a cabo a construção dessa “República dos trabalhadores” pela qual tanto ele como Mussolini se bateram juntos no início do século. Tal como Bombacci, outros conhecidos intelectuais de esquerda juntam-se ao novo governo: Carlo Silvestri (deputado socialista, depois da guerra defensor da memória do Duce), Edmondo Cione (filosofo socialista que será autorizado a criar um partido socialista aparte do Partido Fascista Republicano), etc.O primeiro contacto com Mussolini ocorre a 11 de Outubro, apenas um mês depois da proclamação da RSI, e é epistolar. Bombacci escreve a Mussolini a partir de Roma, cidade onde o fascismo ruiu estrepitosamente (os romanos destruíram todos os símbolos do anterior regime nas ruas), mas onde ainda existem muitos fascistas de coração, e é este o momento que escolhe para declarar a Mussolini que está consigo. Não quando tudo corria bem, mas sim nos momentos difíceis como tão-só o fazem os verdadeiros camaradas:
“Estou hoje mais que ontem totalmente consigo” – confessa Bombacci – “a vil traição do rei-Badoglio trouxe por todos os lados a ruína e a desonra de Itália mas libertou-a de todos os compromissos pluto-monárquicos de 22.
Hoje o caminho está livre e em minha opinião só se pode recorrer ao abrigo socialista. Acima de tudo: a vitória das armas.
Mas para assegurar a vitória deve ter a adesão da massa operária. Como? Com feitos decisivos e radicais no sector económico-produtivo e sindical…
Sempre às suas ordens com o grande afecto já de trinta anos.”
Se para muitos o último Mussolini era um homem acabado, títere dos alemães, não deixa de surpreender a adesão que recebe de homens como Bombacci, um verdadeiro idealista, de estatura imponente, com a barba crescida e uma oratória atraente, alérgico a tudo o que pudesse significar acomodar-se ou aburguesar-se, que tão-pouco agora aceitará salário ou prebendas (apenas em princípios de 1945 aparecerá o seu nome numa lista de propostas de salários do ministério da Economia ou como Chefe da Confederação Única do Trabalho e da Técnica). Bombacci tornar-se-á assessor pessoal e confidente de Mussolini, para atrair de novo às bases do partido os trabalhadores. Propõe a criação de comités sindicais, abertos a não militantes fascistas, eleições sindicais livres, viajará pelas fábricas do norte industrializado (Milão-Turim) explicando a revolução social do novo regime e o porquê da sua adesão. O velho combatente revolucionário parece de novo rejuvenescer, após um comício em Verona e várias visitas a empresas socializadas escreve ao Duce a 22 de Dezembro de 1944: “Falei durante uma hora e trinta minutos num teatro entregue e entusiasta… a plateia, composta na maior parte por operários vibrou gritando: sim, queremos combater por Itália, pela república, pela socialização… pela manhã visitei a Mondadori, já socializada, e falei com os operários que constituem o Conselho de Gestão que achei cheio de entusiasmo e compreensão por esta nossa missão”. Enquanto a situação militar se deteriorava, os grupos terroristas comunistas (os tragicamente famosos GAP) já tinham decidido eliminá-lo pelo perigo que a sua actividade representava para os seus objectivos. [9]
Mas a guerra está a chegar ao fim. Benito Mussolini, aconselhado pelo deputado ex-socialista Carlo Silvestri e Bombacci, propõe entregar o poder aos socialistas, integrados no Comité Nacional de Libertação. [10] Em Abril de 1945 as autoridades militares alemãs rendem-se aos Aliados, sem informar os italianos, é o fim. Abandonados e sós.
Durante os últimos meses da RSI Bombbaci continuou a campanha para recuperar as massas populares e evitar que se decantassem pelo bolchevismo. Em finais de 1944 publicava um opúsculo intitulado «Isto é o Bolchevismo», reproduzido no jornal católico «Crociata Italica» em Março de 1945. Bombacci insiste nas críticas aos desvios estalinistas do comunismo real que destruiu o verdadeiro sindicalismo revolucionário na Europa com as ingerências russas. Nestas últimas semanas de vida da experiência republicana, Bombacci está ao lado dos que ainda acreditam numa solução de compromisso com o inimigo para assim evitar a ruína do país. Leal até ao fim, ficará com Mussolini mesmo quando tudo já está definitivamente perdido. Profeticamente fala disso aos seus operários numa das suas últimas aparições públicas, em Março de 1945:
“Irmãos de fé e de luta… não reneguei aos meus ideais pelos quais lutei e pelos quais, se Deus me deixar viver mais, lutarei sempre. Mas agora encontro-me nas fileiras das cores que militam na República Social Italiana, e vim outra vez porque agora sim é a sério e é verdadeiramente decisivo reivindicar os direitos dos operários…”
Nicola Bombacci, sempre fiel, sempre sereno, acompanhará Mussolini na sua última e dramática viagem até à morte. A 25 de Abril está em Milão. O relato de Vittorio Mussolini, filho do Duce, sobre o seu último encontro com o seu pai, acompanhado por Bombacci, mostra-nos a inteireza deste:
“Pensei no destino deste homem, um verdadeiro apóstolo do proletariado, em certa altura inimigo acérrimo do fascismo e agora ao lado do meu pai, sem nenhum cargo nem prebenda, fiel a dois chefes diferentes até à morte. A sua calma serviu-me de consolo”. [11]
Pouco depois, após Mussolini se separar da coluna dos seus últimos fiéis para os poupar ao seu destino, Bombacci é detido por um grupo de guerrilheiros comunistas junto com um grupo de hierarcas fascistas. Na manhã de 28 de Abril era colocado contra o paredão em Dongo, no norte do país, ao lado de Barracu, valoroso ex-combatente, mutilado de guerra, de Pavolini, o poeta-secretário do partido, de Valério Zerbino, um intelectual e Coppola, outro pensador. Todos gritam, perante o pelotão que os assassina, “Viva Itália!”. Bombacci, enquanto tomba crivado pelas balas dos comunistas, grita: “Viva o Socialismo!”.
_____________
Notas:
1. Em português, sobre o movimento revolucionário do pré-fascismo veja-se o excelente trabalho do professor israelita Zeev Sternhell e dos seus colaboradores, «Nascimento da ideologia fascista», onde curiosamente quase não se menciona Bombacci.
2. Sobre a trajectória revolucionária de Bombacci há um excelente trabalho de Gugliemo Salotti intitulado «Nicola Bombacci, da Mosca a Saló».
3. Referimo-nos à tomada da cidade dálmata em 1919 pelo poeta-soldado Gabrielle D’Annunzio, que é considerada por muitos autores como o primeiro capítulo da revolução fascista. Veja-se Carlos Caballero, “La fascinante historia D’Annunzio en Fiume”, em Revisión, Alicante, ano I, 2, vol. IV, Outubro de 1990.
4. Sobre a ala esquerdista do fascismo: Luca Leonello Rimbotti, «Il fascismo di sinistra. Da Piazza San Sepolcro al congresso di Verona», Roma, Settimo Sigillo, 1989. Ver também: Giuseppe Parlato, “La Sinistra fascista. Storia de un progetto mancato”, Bolinia, Il Mulino, 2000.
5. Cit. Arrigo Petacco, «Il comunista in camicia nera. Nicola Bombacci tra Lenin e Mussolini», Milão, Mondadori Editori, 1996, p. 115.
6. «Mussolini il Duce. II. Lo Stato totalitario 1936-1940», Turim, Einaudi, 1981 (2a, 1996), p. 331 n.
7. A correspondência de Bombacci para Mussolini (mas não a do Duce para este) está conservada em parte no Arquivo Central do Estado Italiano.
8. Nicola Bombacci, «I contadini nell’Italia di Mussolini», Roma, 1943, pp. 34 e ss.
9. Mais de 50 mil fascistas serão executados por estes grupos terroristas durante estes dois anos, e mais 50 mil na trágica Primavera-Verão de 1945. Foram especialmente visados os dirigentes fascistas que possuíssem uma certa aura de popularidade e que pudessem encarnar uma face mais populista do fascismo. O caso mais chamativo foi o do filósofo Giovanni Gentile, que deu lugar inclusivamente a protestos no seio da resistência antifascista. Existe uma ampla bibliografia sobre o assunto, embora na actualidade se tente reduzir as cifras e o impacto desta sangrenta guerra civil.
10. É curioso comprovar como em vários países da Europa, com o aproximar do final da guerra, os únicos elementos fieis à nova ordem são as chamadas alas “proletárias” dos movimentos nacional-revolucionários e que se negoceie a entrega do poder aos grupos socialistas da resistência por oposição aos comunistas e aos burgueses. Assim sucederá na Noruega onde os sectores sindicais propõe um governo de coligação à resistência social-democrata em Abril de 1945, ou em França onde após a queda do governo de Petain no Outono de 1944 Marcel Deat e Jacques Doriot pugnam por instaurar um governo socialista.
11. «La vida con mi padre», Madrid, Ediciones Cid, 1958, p. 267.
00:05 Publié dans Biographie, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, italie, fascisme, communisme, années 20, années 30, années 40, deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale, politique, théorie politique, sciences politiques, politologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 25 avril 2011
La spedizione algerina in Islanda del 1627
La spedizione algerina in Islanda del 1627
 Nel diciassettessimo secolo gli Stati costieri del Maghreb – Marocco, Algeri, Tunisi, Tripoli -, nominalmente infeudati all’Impero Ottomano, erano in piena fioritura economica e politica. Una parte notevolissima del loro benessere proveniva dalla pirateria, esercitata in maniera diretta o indiretta, cioè esigendo il pagamento di un tributo dagli Stati cristiani che volevano vivere tranquilli. Altro denaro affluiva nelle casse dei pascià maghrebini sotto forma di riscatto per gli schiavi cristiani che i parenti volevano far liberare; anche il grande scrittore Miguel de Cervantes conobbe questa dolorosa vicissitudine, dal 1575 al 1580. (1) Si calcola che nella prima metà del 1600 vi fossero, nella sola Algeria, più di 20.000 schiavi cristiani. (2) L’intera struttura economico-sociale di Tunisi e di Algeri, che in quell’epoca avevano riunito le loro forze, poggiava sulla guerra di corsa.
Nel diciassettessimo secolo gli Stati costieri del Maghreb – Marocco, Algeri, Tunisi, Tripoli -, nominalmente infeudati all’Impero Ottomano, erano in piena fioritura economica e politica. Una parte notevolissima del loro benessere proveniva dalla pirateria, esercitata in maniera diretta o indiretta, cioè esigendo il pagamento di un tributo dagli Stati cristiani che volevano vivere tranquilli. Altro denaro affluiva nelle casse dei pascià maghrebini sotto forma di riscatto per gli schiavi cristiani che i parenti volevano far liberare; anche il grande scrittore Miguel de Cervantes conobbe questa dolorosa vicissitudine, dal 1575 al 1580. (1) Si calcola che nella prima metà del 1600 vi fossero, nella sola Algeria, più di 20.000 schiavi cristiani. (2) L’intera struttura economico-sociale di Tunisi e di Algeri, che in quell’epoca avevano riunito le loro forze, poggiava sulla guerra di corsa.
La cornice storica
A partire dal 1618 l’Europa fu travolta dalla Guerra dei Trent’Anni, in un crescendo di distruzioni e carestie. Le forze navali dei maggiori Stati europei furono distratte dalle esigenze della difesa contro i barbareschi, prime fra tutte quelle del colosso spagnolo, che già si avviava a una inarrestabile decadenza economica, politica e, infine, militare (quest’ultimo fattore si rivelerà solo nel 1643, con la disfatta nella decisiva battaglia di Rocroi contro i Francesi del Condé). Di tale situazione profittarono i veloci e leggeri vascelli moreschi per spingere le loro audaci imprese sempre più lontano, anche fuori del Mediterraneo. Le isole Canarie furono uno dei loro obiettivi, sporadici ma fruttuosi e quasi senza rischi (3). Nel terzo decennio del secolo giunsero ad Algeri notizie allettanti sulla remota isola del nord, l’Islanda. Essa era a quel tempo una terra particolarmente isolata: dal 1602 il il Governo danese aveva concesso alla Compagnia d’Islanda, gestita da mercanti di Copenhagen, il monopolio su tutto il commercio estero dell’isola (4). Inoltre, sembra che già allora fosse iniziato nel nord Atlantico quel movimento di espansione neoglaciale che condusse, nei secoli XVIII e XIX, il limite meridionale dei ghiacci galleggianti a sud dell’Islanda (mentre dal 1920 è tornato stabilmente a nord di essa) (5).
Il raffreddamento complessivo del clima e l’assolutismo dei re danesi non erano però riusciti ancora a distruggere le basi economiche della società islandese, poggianti soprattutto su una fiorente attività peschereccia. In particolare, la costa sud-orientale (oggi pressoché disabitata, e divenuta tale per l’eruzione del vulcano Lakagigar nel 1738) (6), godeva di un certo benessere, dovuto alla pescosità di quelle acque. Sopravviveva anche una certa vivacità culturale: tanto che nel 1643 il vescovo Brynjólf Sveinsson scopriva la raccolta di antichi carmi norreni denominata Edda.
Ce n’era abbastanza per invogliare all’impresa gli audaci pirati barbareschi. Essi sapevano che le nebbie e il pack dei mari artici sarebbero stati, più che dei nemici, dei preziosi alleati per sfuggire a una peraltro improbabile sorveglianza delle flotte cristiane. Il re di Danimarca, Cristiano IV, s’era lasciato coinvolgere, nel 1625, nella Guerra dei Trent’Anni, e col Wallenstein che minacciava l’invasione dello Jutland, aveva ben altro cui pensare che la difesa del lontano possedimento islandese. Quanto al bottino che si sperava di fare nell’impresa, le bionde donne nordiche dagli occhi azzurri costituivano un articolo quanto mai pregiato per gli harem del Nord Africa; e, per rivendere i beni materiali che si sarebbero razziati, c’erano sempre i mercanti ebrei di Algeri (ma anche quelli di Livorno, se del caso), pronti alla bisogna.
Una straordinaria impresa marinara
Dal punto di vista nautico, la spedizione moresca in Islanda si presentava come una grossa impresa. È necessario porsi davanti a un globo geografico di una certa scala, per esempio 1:25.000.000, per afferrarne tutta la grandiosità. Si trattava di compiere un balzo di ventotto gradi di meridiano (dai 36° lat. N dello Stretto di Gibilterra ai 64° della costa meridionale islandese) navigando in pieno Atlantico, lontano da qualsiasi costa amica. Coprire qualcosa come 3.100 chilometri in linea d’aria nel solo viaggio di andata, e senza contare la navigazione costiera da Algeri a Céuta e dallo Stretto di Gibilterra al Cabo de São Vicente, estrema punta sud-occidentale del Portogallo (allora sottomesso alla corona spagnola di Filippo IV). In totale, fra andata e ritorno, più di 8.000 chilometri di navigazione, pari – per farsi un’idea concreta – ad oltre un quinto della circonferenza terrestre!
 C’erano, è pur vero, alcuni elementi che giocavano a vantaggio della flotta barbaresca. In primo luogo, i Turchi – e quindi i loro alleati nordafricani – disponevano di ottime carte nautiche relative a tutti i mari del mondo, delle quali la famosa carta di Piri Reis, conservata nel Museo Topkapi di Istanbul, è solo un esempio. Poi, a partire dal 45° parallelo Nord circa, la flotta moresca nel viaggio di andata (ma solo in quello di andata!) avrebbe potuto sfruttare in pieno il ramo principale della Corrente del Golfo, che l’avrebbe sospinta di poppa dritta dritta fino all’Islanda (7). Gli icebergs, però, nell’ultima fase del viaggio, avrebbero costituito un pericolo temibile, specialmente di notte. (E si badi che lo sarebbero stati, praticamente, fino all’introduzione del radar, come dimostrerà l’immane tragedia del grandioso transatlantico Titanic in piena belle époque: nel 1912!). Senza contare che le caratteristiche tecniche del naviglio moresco – la leggerezza e l’esilità dello scafo e delle strutture di coperta – se costituivano un vantaggio nel Mediterraneo, poiché consentivano di sviluppare una velocità superiore a quella dei grossi vascelli europei, ponevano tuttavia un’incognita nelle violente tempeste dell’Atlantico settentrionale.
C’erano, è pur vero, alcuni elementi che giocavano a vantaggio della flotta barbaresca. In primo luogo, i Turchi – e quindi i loro alleati nordafricani – disponevano di ottime carte nautiche relative a tutti i mari del mondo, delle quali la famosa carta di Piri Reis, conservata nel Museo Topkapi di Istanbul, è solo un esempio. Poi, a partire dal 45° parallelo Nord circa, la flotta moresca nel viaggio di andata (ma solo in quello di andata!) avrebbe potuto sfruttare in pieno il ramo principale della Corrente del Golfo, che l’avrebbe sospinta di poppa dritta dritta fino all’Islanda (7). Gli icebergs, però, nell’ultima fase del viaggio, avrebbero costituito un pericolo temibile, specialmente di notte. (E si badi che lo sarebbero stati, praticamente, fino all’introduzione del radar, come dimostrerà l’immane tragedia del grandioso transatlantico Titanic in piena belle époque: nel 1912!). Senza contare che le caratteristiche tecniche del naviglio moresco – la leggerezza e l’esilità dello scafo e delle strutture di coperta – se costituivano un vantaggio nel Mediterraneo, poiché consentivano di sviluppare una velocità superiore a quella dei grossi vascelli europei, ponevano tuttavia un’incognita nelle violente tempeste dell’Atlantico settentrionale.
L’incognita principale, comunque, era data dalla novità stessa dell’impresa. Fino a quel momento le navi di Algeri, come quelle di tutte le potenze rivierasche maghrebine, non avevano mai intrapreso delle spedizioni verso obiettivi così lontani. E, pur essendo dotate, da prima delle cristiane, di bussola magnetica, le navi musulmane preferivano senz’altro la navigazione costiera a quella d’altura. Fuori del Mediterraneo, non avevano molta esperienza: le stesse Canarie, obiettivo di alcune precedenti scorrerie, non distano che un centinaio di chilometri dal litorale marocchino – all’altezza della più orientale di essa, Lanzarote: tanto che, nelle giornate in cui l’aria è limpida, si possono vedere reciprocamente le due opposte sponde.
È pur vero che alcuni audaci ra’is (così si chiamavano i comandanti delle navi corsare) avevano vòlto la prua anche più lontano, fino alle Azzorre (1.400 km. a ovest del Portogallo) e perfino alle Isole del Capo Verde (500 km. a ovest della costa africana). Altri avevano compiuto scorrerie ai danni dei pescherecci europei sui Grandi Banchi, al largo delle coste occidentali iberiche e irlandesi (8). Nessuna però di queste imprese può essere paragonata a quella contro l’Islanda, almeno dal punto di vista nautico. Tanto le isole di Capo Verde quanto i Banchi di pesca della Penisola Iberica e delle Isole Britanniche erano indubbiamente degli obiettivi lontani, ma potevano essere raggiunti navigando, per lo più, in vista delle coste; e le Azzorre, benché poste in pieno Oceano, sono molto più vicine allo Stretto di Gibilterra che non l’Islanda, e circondate da acque assai più miti.
La spedizione contro l’Islanda del 1627 aveva, dunque, tutti i caratteri della eccezionalità e presentava rischi non indifferenti. Dovettero essere approntati vascelli più solidi dell’usuale, e raccolti equipaggi capaci di tenere il mare per parecchie settimane consecutive. Le spese per armare una tale flotta furono considerevoli, e i preparativi più complessi del solito. A quell’epoca, del resto, e per lungo tempo ancora – dal 1587 al 1659 – Algeri era governata direttamente da un pascià nominato dal sultano di Costantinopoli; questi, nel 1627, era l’energico e capace Murad IV. Fu quindi con l’approvazione e l’appoggio dell’Impero Ottomano, una delle massime potenze navali del Mediterraneo, che venne varata la spedizione algerina nel Nord Atlantico.
I Turchi, da parte loro, non avevano esperienza diretta di navigazione sulle rotte oceaniche (9), e tutti gli aspetti tecnici dell’impresa ricaddero sulla flotta di Algeri. Al Governo della Sublime Porta sarebbero andati, comunque, secondo l’uso della pirateria barbaresca, un quinto del bottino e tutte le navi cristiane eventualmente catturate. Il resto spettava ai proprietari delle navi, agli equipaggi e ad alcuni funzionari (10).
Il fattore sorpresa
Quando giunsero in vista della costa meridionale islandese, quei vascelli corsari, usciti come per incantesimo dall’orizzonte, provocarono una sorpresa totale. Se pure ai pacifici abitanti dell’isola era giunta notizia delle incursioni moresche al largo della Manica, mai avrebbero pensato di vedersi un giorno assalire da quel nemico sconosciuto, partito dalle lontanissime coste dell’Africa.
Tutto fu quindi facile, dopo le fatiche e i pericoli della traversata, per i corsari algerini. Guidati dalla vetta del Hvannadalshnúkur (2.119 metri sul livello del mare, corrispondenti, però, da un punto di vista climatico, botanico e alpinistico a un 5.000 delle nostre Alpi) e dal bianco scintillante del grandioso ghiacciaio Vatnajökull, allora ancor più esteso di oggi (12), essi diressero le prore verso la costa, animati in pari misura dal sacro zelo della Gihad, la guerra santa contro gli infedeli, e dalla prospettiva di un ricco e facile bottino.
Le prime vittime dell’attacco furono le navi della flotta peschereccia; poi vi fu lo sbarco nel consueto stile corsaro: la cattura degli schiavi, il saccheggio delle abitazioni, l’incendio. Quel po’ di benessere accumulato dagli abitanti con la faticosa pesca del merluzzo e delle aringhe, non ancora del tutto eroso dalla rapacità del monopolio danese, andò distrutto in poche ore. Accadde tutto così in fretta e così imprevedibilmente, che gli scampati faticavano ancora a capacitarsene, quando già era tutto finito. Essi vedevano bruciare le case e le barche, loro sola fonte di sopravvivenza; allontanarsi su quelle navi misteriose i loro cari, rapiti per sempre (e che sarebbero morti ben presto in gran numero nel clima africano), e non potevano pensare che a un’opera del demonio. In tempi in cui la società islandese viveva ancora – come del resto altri paesi d’Europa e d’America – nel clima della superstizione e della caccia alle streghe (13), era quella l’unica, istintiva, possibile spiegazione.
“Quei pirati che giungevano dal nulla, esportando morte e una lingua incomprensibile – è stato giustamente scritto -, sono rimasti nei secoli, emblematicamente, cifra del Male, popolando saghe e racconti imperniati fin allora su Zeus-Odino” (14).
Conclusioni
È stata a lungo opinione degli studiosi che la navigazione e l’esplorazione delle regioni polari sia un capitolo esclusivo della storia occidentale. Nessuno, a quel che ci risulta, ha tentato di porre in luce il contributo dei popoli extraeuropei. Una rara eccezione è data da Silvio Zavatti, che nel suo Dizionario degli Esploratori e delle scoperte geografiche ricordava anche episodi quali la traversata del Pacifico da parte del cinese Hui-Sien, nel 499 d.C., o la navigazione antartica del polinesiano Hui-Te-rangi-Ora, nel secolo VII o VIII (15). A proposito della quale ultima, il celebre etnologo Peter Buck si esprimeva in termini negativi, giudicando poco credibile che dei Polinesiani succintamente vestiti possano aver navigato fra ghiacci e icebergs, tanto più che essi – a suo avviso – non sarebbero comunque disposti ad avventurarsi in mari freddi e grigi (16).
Ebbene, un tale argomento “psicologico” deve essere scartato, non solo perché i popoli della fascia climatica tropicale possono aver navigato alle alte latitudini per cause accidentali, trascinati dalle tempeste – e di fatto così avvenne nella maggior parte dei casi -, ma anche perché non pertinente. Ancora nel 1800 i Maori della Nuova Zelanda si spingevano, con le loro piroghe, fino alle isole subantartiche di Auckland, 500 km. a sud dell’isola meridionale (o, più precisamente, dell’Isola Stewart, da essi chiamata Rakiura o “Terra dai Cieli Ardenti”, forse per via delle aurore polari) (17). E la spedizione corsara algerina in Islanda del 1627 conferma che navigatori non europei, originari di Paesi caldi, erano in gradi di affrontare con successo le rotte polari, anche al tempo della navigazione a vela.
Certo, non si trattava di spedizioni a carattere scientifico, volte ad ampliare il patrimonio nautico e geografico: ma lo stesso si può dire per gran parte delle navigazioni polari degli Europei fino al XIX secolo. Furono i cacciatori di foche e di balene che diedero un contributo decisivo alla conoscenza delle terre e dei mari artici e antartici (al prezzo assai elevato, questo è un fatto, di terribili distruzioni della fauna e, indirettamente, della flora di quelle regioni, fino alll’estinzione totale di un gran numero di specie viventi). E se la spedizione algerina del 1627 non andò oltre le rotte già note agli Europei, tuttavia dimostra che il freddo, gli icebergs e l’impatto psicologico con situazioni climatiche e ambientali tanto diverse da quelle a loro abituali, non bastavano a fermare dei navigatori africani. La circostanza, triste invero, che quegli audaci navigatori fossero dei corsari spietati, non modifica questa realtà. Né dovremmo dimenticare che un corsaro spietato fu pure sir Francis Drake, il primo circumnavigatore inglese della Terra (e il secondo in assoluto dopo Magellano); e tali furono molti altri esploratori europei.
Una storia delle navigazioni polari compiute dai popoli così detti “di colore” aspetta ancora d’essere scritta. Essa dovrebbe prendere in considerazione le imprese dimenticate degli Eschimesi o Inuit, dei Siberiani, dei Polinesiani, dei Maori, dei popoli canoeros della costa americana sud-occidentale (Chonos, Alakaluf, Yahgan o Yàmana) nonché, forse, quelle accidentali dei Tasmaniani (che però, a quanto ci è noto, non erano in grado di raggiungere nemmeno la vicina costa del continente australiano). Molte difficoltà presenterebbe la sua stesura, trattandosi di eventi attestati, per lo più, da semplici tradizioni orali, e perciò sospesi nel Limbo fra lo storico e il leggendario.
La prima e più grave difficoltà, tuttavia, speriamo d’averla rimossa: ed era la tipica ripugnanza dello studioso occidentale ad ammettere che, anche in questo campo, non fu vanto esclusivo dell’uomo bianco quello d’aver valicato gli orizzonti di Ulisse.
Note
1) Carlo Boselli – Cesco Vian, Storia della letteratura spagnola, Firenze, 1946, p. 95.
2) Henry Louis Etienne Terrasse, Barbary Pirates, in Encyclopedia Britannica, ed. 1946, vol. 3, p. 147.
3) Robert Percy Beckinsale, Canary Islands, in Enc. Brit., ed. 1964, vol. 4, p. 767.
4) Islanda, storia, voce della Enciclopedia Europea, vol. 6, 1978, p. 298.
5) George H. Denton – Stephen C. Porter, Neoglaciazione, su Le Scienze, sett. 1970.
6) Haroun Tazieff, E l’Inferno venne a galla, su Atlante, ott. 1970, pag. 31.
7) Cfr. ad es. il World Atlas della Enc. Brit., 1963, vol. 24, tav. 19, Drainage Regions & Ocean Currents.
8) J. P. Cooper, in Storia del mondo moderno della Cambridge University press, tr. it. Milano, 1971, vol. IV, pag. 264.
9) B. L. Montgomery, Storia delle guerre, Milano, 1970, pag. 263.
10) Francesco Beguinot, Barbareschi, Stati, voce della Enciclopedia Italiana, ed. 1949, vol. VI, pp. 121-122.
11) J. P. Cooper, c. s.
12) Lo stesso fenomeno di espansione riguardò, oltre quelli islandesi, i ghiacciai svizzeri. Cfr. F. C. Spooner, in Storia del mondo moderno di Cambridge, cit., vol. IV, pp. 76-77.
13) Vermund G. Lausten, Islanda, storia, voce della Enc. Ital., ed. 1949, XIX, p. 629.
14) Enrico Devalle – Maurizio Gily, La grande sfida alla natura, su Geodes, marzo 1986, p. 31.
15) Silvio Zavatti, Dizionario degli Esploratori e delle scoperte geografiche, Milano, 1967, p. 150.
16) Peter Buck, I Vichinghi d’Oriente. Le migrazioni dei Polinesiani, Milano, 1961, pp. 122-124.
17) Elsdon Best, Map showing the Routes and some recorded Voyages of the Polynesians in the Pacific Ocean, in The Geographical Review, nr. 3, marzo 1918.
* * *
(Articolo pubblicato sul numero 3, anno XLIII, settembre 1987 de “Il Polo. Rivista trimestrale fondata dal prof. Silvio Zavatti”, pp. 35-39; e, con il titolo La spedizione moresca in Islanda, nel volume miscellaneo edito dal Museo Nazionale della Montagna Terra di ghiaccio. Arte e civiltà dell’Islanda, Torino, 1989, pp. 167-170).
Francesco Lamendola
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : algérie, islande, piraterie, piraterie barbaresque, barbaresques, méditerranée, atlantique, histoire, histoire maritime, histoire navale, esclavage |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 24 avril 2011
Léon Daudet, sa vie, son oeuvre et ses astralités
par Daniel Cologne
Ex: http://geminilitteraire.wordpress.com/
Dans la riche banlieue Est de Bruxelles, à l’angle des avenues de l’Yser et de Tervueren, on découvre aujourd’hui un immeuble moderne abritant, entre autres locataires, une chemiserie de luxe et une agence bancaire. Là s’élevait jadis l’hôtel particulier de la marquise de Radigues, où Léon Daudet séjourna durant son exil belge de vingt-neuf mois (1927 – 1929). L’entrée du Parc du Cinquantenaire est à quelques mètres et, sur une photographie reproduite dans le livre de Francis Bergeron en page 122, à l’arrière-plan de Léon Daudet et de son fils Philippe, on aperçoit les arcades édifiées à l’initiative du roi-bâtisseur Léopold II pour les cinquante ans de la Belgique en 1880. Au sommet de cet arc de triomphe, Le char de Phébus est emporté par des chevaux qui galopent vers Le Soleil Levant.
Léon Daudet arrive en Belgique après s’être évadé de la prison de la Santé, où il purgeait une peine de cinq mois pour diffamation. Il est toujours marqué par le suicide de son fils Philippe en 1923. Il soupçonnait un assassinat politique maquillé en suicide, mais Francis Bergeron pense que l’adolescent fugueur et épileptique a vraiment mis fin à ses jours. Publié en annexe par Marin de Charette, l’horoscope de Philippe Daudet né à Paris, Le 7 janvier 1909 à 4 h 00, semble confirmer la thèse de l’auteur.
En dépit de ce deuil encore récent et de cette blessure non cicatrisée, Léon Daudet déborde d’activité à Bruxelles : conférences, réceptions, rédaction d’une vingtaine de volumes. C’est le rythme de travail habituel de Daudet : une « déferlante effroyable » (p. 43) au détriment de la qualité, du moins en ce qui concerne l’œuvre romanesque. En revanche, le critique littéraire et artistique mérite de passer à la postérité avec ses surprenants éloges de Proust, Gide, Kessel et Picasso. « La patrie [ou la France, selon les versions], je lui dis merde quand il s’agit de littérature » (p. 90). Ainsi parlait celui qu’Éric Vatré qualifie judicieusement de « libre réactionnaire » (cité p. 116).
Léon Daudet naît à Paris Le 16 novembre 1867 à 23 h 00. Il est le fils d’Alphonse Daudet (1840 – 1897). Moins prolixe que son père dans la veine provençale héritée du Félibrige (Fièvres de Camargue, roman publié en 1938), il en partage jusqu’en 1900 les convictions politiques de républicain antisémite.
D’Alphonse Daudet, Francis Bergeron écrit : « Il déjeune chez Zola et dîne chez Drumont » (p. 45). Le moindre mérite de son livre n’est certes pas de rappeler que l’origine de l’antisémitisme se situe à gauche.
Entre autres influences, celle de sa cousine Marthe Allard, qui devient sa seconde épouse, et « dont les idées catholiques et monarchistes sont bien arrêtées » (p. 48), fait basculer Léon Daudet dans l’orbite de l’Action française.
Au lendemain de la Première Guerre mondiale, Léon Daudet est élu député d’une « Chambre bleu-horizon ». Il joue un rôle important dans la décision de la France d’occuper la Ruhr. Farouche adversaire d’Aristide Briand, Léon Daudet est apprécié par André Tardieu qui, devenu président du Conseil en 1929, lui accorde sa grâce. Après deux ans et demi de bannissement, Léon Daudet rentre à Paris non sans avoir une ultime réception dans son hôtel bruxellois, le 30 décembre.
« Léon fut un redoutable polygraphe » (p. 109). À ses cent vingt-sept œuvres (romans, essais, pamphlets, recueils d’articles), il faut ajouter plus de quarante préfaces et contributions à des ouvrages collectifs. Parmi les livres qui emportent l’enthousiaste préférence de Francis Bergeron, citons : Paris vécu (deux tomes paradoxalement écrits à Bruxelles), l’incontournable Stupide XIXe siècle (1922), La vie orageuse de Clémenceau (1938), car Léon Daudet vénérait Le « Tigre », Panorama de la IIIe République (1936), Charles Maurras et son temps (1928), les romans historiques de 1896 et 1933 mettant en scène les personnages de Shakespeare et Rabelais.
Le 1er juillet 1942, Léon Daudet s’éteint à Saint-Rémy-de-Provence, dans cette région inspiratrice de son père, dans ce Midi dont on a chanté les marchés (Gilbert Bécaud), les fifres et les tambourins (Robert Ripa), Le « mistral qui décoiffe les marchandes, jouant au Tout-Puissant » (Mireille Mathieu).
Léon Daudet meurt là où naquit Nostradamus. Le point commun de « l’enfant terrible de la IIIe République » (Louis Guitard, cité p. 114) et du faux prophète du XVIe siècle est Le cursus universitaire médical, inachevé chez l’un, accompli chez l’autre.
Dans notre famille de pensée, l’on demeure volontiers sceptique, voire méfiant, envers l’astrologie. D’autant plus nécessaires sont les études qui terminent tous les ouvrages de la collection « Qui suis-je ? ». Marin de Charette interprète l’horoscope de Léon Daudet (pages 123 à 126).
Son analyse est convaincante. De Léon Daudet, l’astrologue écrit : « Dans son ciel de naissance, aucune planète n’est faible : elles sont toutes puissamment reliées entre elles » (p. 125). Sur le plan personnel, le trigone Lune – Mercure (angle de 120 °) incline à la sur-activité littéraire et à la toute particulière prédisposition à la critique. Le romancier « solaire » produit, le critique « lunaire » reproduit, à l’instar du luminaire nocturne qui reproduit la lumière du Soleil en la reflétant.
« Né, en outre, au moment d’un carré exact et croissant d’Uranus à Neptune (dont l’axe mitoyen passe par Saturne !) – aspect générationnel -, Daudet incarne comme une sorte de déchirement entre l’ancien et le nouveau, et, aussi, un pont » (p. 126).
Mis en perspective dans les statistiques de Michel Gauquelin, cet horoscope se caractérise par l’occupation des quatre « zones d’intensité maximale » : la Lune vient de se lever, Jupiter se couche, Pluton culmine et cinq planètes sont amassées au nadir. Parmi cette quintuple conjonction, relevons le couple Soleil – Saturne (deux degrés d’orbe). Saturne « ensoleillé » indique la quête du Vrai sachant s’affranchir des a priori (le « libre réactionnaire »). mais Saturne « brûlé » (« combuste », disent les astrologues traditionalistes), peut expliquer « l’extrême violence de ton avec laquelle il a toujours défendu ses idées, ses convictions, ses goûts » (p. 94).
Cela ne fait pas pour autant de Léon Daudet un « extrémiste ». Même les actuels et pernicieux censeurs de la plus sournoise des polices de la pensée ne s’y trompent pas et lui laissent le bénéfice d’une « relative indulgence ».
Note
• Francis Bergeron, Léon Daudet, Éditions Pardès, coll. «Qui suis-je ?», 2007, 128 p
00:05 Publié dans Biographie, Histoire, Littérature, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : léon daudet, histoire, littérature, france, années 20, années 30, littérature française, lettres, lettres françaises, action française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 20 avril 2011
Bataglione S. Marco - X-Mas
Battaglione S. Marco & X-MAS
00:05 Publié dans Histoire, Militaria, Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, histoire, italie, militaria |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Wandervögel: révolte contre l'esprit bourgeois
 Wandervögel, révolte contre l’esprit bourgeois
Wandervögel, révolte contre l’esprit bourgeois
Ex: http://tpalsace.wordpress.com/
« C’est que le bivouac dérange l’état car il est manière de ne jamais être là où celui-ci nous attend »
Sylvain Tesson
Voila un sujet tellement vaste que nous ne savions par quel bout l’aborder. Nous oublierons donc la liste des nombreux protagonistes, instigateurs de l’aventure Wandervögel, et les différents courants de ce mouvement pour nous intéresser principalement à son éthique. Libre au lecteur de peaufiner le sujet en consultant les quelques livres ou sites internet qui lui sont consacrés.
Le mouvement Wandervögel, qui signifie « Les Oiseaux Migrateurs », est né en 1896 dans la banlieue berlinoise d’une révolte générale de jeunes étudiants contre les effets sociaux et esthétiques de l’industrialisation outrancière qui eut lieu en Europe à la fin du XIXème siècle. Ils avaient pour leitmotiv la volonté de redonner la priorité aux choses de l’esprit, à l’âme simple des gens du peuple, refusant l’esprit marchand et industriel et les calculs de la bourgeoisie. Partant du principe que la jeunesse ne peut pas rester prisonnière des cités enfumées de l’ère industrielle, le mouvement Wandervögel va, au fur et à mesure, prendre son essor dans toute l’Allemagne, faire sortir la jeunesse de sa cangue en l’emmenant en randonnée.
Même si les débuts de ce mouvement connurent une résistance de la part des autorités scolaires contre les excursions proposées, cette dernière fut vite balayée par les parents et des pédagogues moins classiques, conscients, grâce à leur lecture de Nietzsche et de Langbehn, que l’éducation doit quitter le trop théorique pour prendre la vie et le réel à bras le corps.
Très vite, les petites randonnées se transforment en véritables excursions de plusieurs semaines à travers l’Allemagne wilhelmienne et cette pédagogie non conventionnelle, ces expéditions, deviennent les symboles d’une révolte générale contre l’ordre établi (école, industrie, administration, etc.) Peu à peu, une discipline plus militaire s’instaure et des excursions plus aventureuses s’organisent, le mouvement commence également à critiquer l’ordre établi au nom d’une éthique de l’austérité (anti-consumériste) et veut renouer avec la tradition médiévale des « escholiers pérégrinant ».
Au programme des activités Wandervögels : soirées autour de feux de camp, visite de châteaux en ruines et de vestiges médiévaux, fêtes solsticiales, randonnées en montagne dans un esprit de romantisme, d’ enracinement dans l’histoire nationale et de culte des Lansquenets. Ces grandes idées ont été véhiculées par tous les mouvements de jeunesse idéalistes jusqu’à nos jours, y compris en France (cf Europe Jeunesse).
Dès lors, le mouvement va se diffuser dans toute l’Allemagne puis dans les Sudètes, à Prague et à Vienne et devient l’expression d’une jeunesse joyeuse, allègre, aimant la musique et créant ses propres chansons et mélodies (le chansonnier du mouvement, le Zupfgeigerhansl, créé par Hans Breuer, est toujours d’actualité.) En 1906, les premières sections féminines (Mädchenwandern) sont mises sur pied. Désormais, deux modes cohabiteront : la mixité et la masculinité exclusive.
Mais comment un mouvement, au départ groupusculaire et très localisé, a-t-il pu ainsi se propager et enflammer toute une jeunesse ? La raison est à la fois culturelle et métapolitique, déviant de la culture alternative qui se répandait en Allemagne à la même époque avec, en point d’orgue, les objectifs suivants : donner priorité à la vie et au dynamisme, recourir aux patrimoines germaniques (Edda), redécouvrir le romantisme en littérature; revaloriser les liens légués par le sang et le passé, penser écologisme (avant la lettre !), forger un socialisme dynamique, anti-bourgeois, éthique, susciter sans relâche la créativité chez les adolescents (des artistes et musiciens viennent ainsi animer les débats), enfin la notion de communauté (communauté de travail, de combat, d’étude, de survie, de loisirs…) est opposée à l’individualisme et au collectivisme.
L’apogée de l’aventure Wandervögel sera le grand rassemblement de la jeunesse allemande, tous groupes confondus, sur le sommet du Hoher Meissner en 1913. A partir de ce rassemblement, de nombreuses initiatives locales, étudiantes, lycéennes ou ouvrières se regroupent dans une structure souple et informelle qui reçoit le nom de Freideutsche Jugend.
En 1914, la jeunesse se porte volontaire en masse pour la Grande Randonnée (Die Große Fahrt) c’est-à-dire la Grande Guerre, qui se terminera tragiquement pour la plupart: des 12 000 Wandervögel d’avant-guerre, 7000 ne reviendront jamais des champs de bataille. Trois valeurs éthiques fondamentales animaient alors ces jeunes volontaires: l’absence d’intérêts (matériels et personnels), l’altruisme et la camaraderie. Mais après 1918, le mouvement connaît des scissions : il y a une incompréhension entre les jeunes soldats revenus du front, pleins de désillusions, d’amertume et de lassitude face aux discours trop idéalistes, et l’esprit de la nouvelle génération qui n’a pas eu le temps de connaître le front et l’idéalise outrancièrement et hors de propos.
Les différents leaders qui s’ensuivront après la Grande Guerre n’auront de cesse de préserver les valeurs et l’esprit du mouvement initial et maintiendront l’effectif de 10 000 à 12 000 membres, (dont les trois quarts avaient moins de 18 ans), au sein de différents courants.
Le mouvement Wandervögel sera finalement interdit par le régime hitlérien en 1933, jugé trop marginal et trop autonome. Il renaîtra péniblement après la Seconde Guerre mondiale, pour essaimer ensuite, lentement, dans différents pays dont la France (il existe en effet une ramification Wandervögel en Normandie).
L’Allemagne abrite aujourd’hui encore la branche la plus importante en nombre de membres du mouvement (environ 5 000) dont le devise demeure « devenir mûr et rester pur ». Ces jeunes ont pour impératif la redécouverte du terroir régional/national et le ré-enracinement, bel objectif quand on sait que, de nos jours, la majorité d’entre eux aspire uniquement à faire de l’argent, se vautrer dans un confort petit bourgeois tout en se noyant dans la masse par l’uniformisation tant vestimentaire que du mode de pensée. L’instruction ? Très peu pour la nouvelle jeunesse qui est par contre experte dans l’art de manier le joystick et ne rêve que de voyages de masse où tout est prémâché (vive le Club Me(r)d !). … O Tempora, O Mores…
Source : Robert Steuckers – Synergies Européennes – 1998 & Wikipédia
Pour en savoir plus, nous vous recommandons la lecture de :
« Wandervögel, Révolte contre l’Esprit Bourgeois » de Karl Hoffkes, paru aux éditions ACE en 2001
« Pèlerin entre deux Mondes » de Walter Flex, également aux éditions ACE
« Une Histoire des Mouvements de Jeunesse Allemands (1896-1933) : du Wandervögel à la Dissolution des Ligues par le Régime National-Socialiste » de Michel Froissart
« Une Fille qui voulait Vivre Autrement » de Norgard Kohlhagen, aux éditions ACE
« Croyez-en mon expérience, vous trouverez quelque chose de plus au milieu des bois que dans les livres. Les arbres et les rochers vous enseigneront ce que vous ne pourrez apprendre d’aucun maître »
Bernard de Clairvaux
00:05 Publié dans Histoire, Mouvements de jeunesse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, mouvements de jeunesse, jeunesse, wandervogel, allemagne, weimar |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 18 avril 2011
Clefs pour comprendre Katyn
Clefs pour comprendre Katyn
par Jean-Gilles MALLIARAKIS
 On projette donc le très beau film "Katyn" ce 14 avril (1) sur la chaîne franco-allemande Arte. Au-delà de l'œuvre de Wajda elle-même (2), de son scénario, tiré d'un roman mais aussi de l'expérience personnelle du cinéaste dans la Pologne communiste d'après-guerre, il faut considérer l'Histoire. Celle-ci accable non seulement Staline personnellement mais, d'une manière plus générale, le communisme international. Au premier rang en occident le parti le plus servile, le parti français, le parti de Maurice Thorez et de Jacques Duclos partage 100 % de la culpabilité de son maître. Et il faut y ajouter une circonstance aggravante. Car, après la Pologne en 1939, abandonnée par les radicaux-socialistes en charge à Paris de la conduite de la guerre, le sort de la France suivit en 1940.
On projette donc le très beau film "Katyn" ce 14 avril (1) sur la chaîne franco-allemande Arte. Au-delà de l'œuvre de Wajda elle-même (2), de son scénario, tiré d'un roman mais aussi de l'expérience personnelle du cinéaste dans la Pologne communiste d'après-guerre, il faut considérer l'Histoire. Celle-ci accable non seulement Staline personnellement mais, d'une manière plus générale, le communisme international. Au premier rang en occident le parti le plus servile, le parti français, le parti de Maurice Thorez et de Jacques Duclos partage 100 % de la culpabilité de son maître. Et il faut y ajouter une circonstance aggravante. Car, après la Pologne en 1939, abandonnée par les radicaux-socialistes en charge à Paris de la conduite de la guerre, le sort de la France suivit en 1940.
Et si le débarquement anglo-américain, épaulé par 14 autres nations alliées, a permis en 1944 la libération territoriale de l'Hexagone, au contraire, l'Europe orientale dans son ensemble demeura jusqu'en 1991 contre son gré sous la botte de l'URSS copartageante, en vertu d'accords dont Moscou fut l'initiatrice.
Doit-on dire qu'il ne faut "jamais l'oublier" ?
Hélas, pour garder un événement en mémoire encore faut-il en avoir eu connaissance. Or l'Histoire officiellement enseignée dans le contexte de la république jacobine reste sur ce sujet très discrète. Embargo jusqu'à la chute du communisme, modestie depuis.
Rappelons donc que le 23 août 1939 fut signé à Moscou un prétendu pacte de non-agression. Il était signé par Joachim von Ribbentrop, qui sera pendu à Nuremberg en 1946 et le commissaire du peuple Viatcheslav Mikhaïlovitch Molotov. Celui-ci dirigera encore la diplomatie de son pays après la guerre et mourra dans son lit en 1986. Il se nouait alors une véritable alliance officielle entre Hitler et Staline. Le premier était resté à Berlin, alors que le second se congratulait avec le ministre des affaires étrangères du Reich. Elle ne fut aucunement rompue par Moscou mais par l'Allemagne. Staline le soulignera encore dans son discours du 3 juillet 1941. Le "génial" dictateur communiste figure hilare sur la photo de famille prise à Moscou pendant que son ministre paraphe le traité. Pendant la nuit était convenu un protocole (alors] secret, précisant le partage non seulement de la Pologne mais de toute l'Europe à l'est de la Vistule.

Or ce document sera complété et aggravé par l'entrée en guerre effective de la l'URSS contre sa malheureuse voisine le 17 septembre et la chute de Varsovie le 19. Le film de Wajda commence donc par cette jonction historique de la Wehrmacht et de l'Armée rouge, "scellant dans le sang", l'expression est de Staline lui-même, la complicité des deux agresseurs.
Mais pour comprendre Katyn, c'est-à-dire le massacre des élites polonaises par la barbarie communiste, il faut aussi comprendre la marque spécifique que celle-ci donna à son ensemble de crimes.
C'est l'URSS en effet qui chercha et imposa la disparition de l'État polonais. Le 28 septembre elle finalisera son projet en faisant signer à Ribbentrop un avenant déplaçant la ligne de démarcation entre les deux empires, bloquant, pour ce qui allait devenir le 8 octobre 1939, le "Gouvernement général" de Pologne, toute perspective d'accès à la mer. Ceci permit à l'empire stalinien naissant de compléter sa propre mainmise sur les pays baltes, en rétrocédant au Reich une portion de territoire.
"L'alliance Staline Hitler" (3) avait été pensée, théorisée et appliquée à Moscou avec beaucoup de méthode, jusqu'à sa rupture en juin 1941 du seul fait de l'Allemagne.
La prophétie de Toukhatchevski de 1920 : "la révolution mondiale passera sur le cadavre de la Pologne" se réalisa donc 20 ans plus tard avec la collaboration des nazis. Vaincue sur la Vistule, l'Armée rouge obtenait sa revanche sur le tapis vert.
Pendant toute la période 1940-1990 Moscou œuvra pour conserver ses acquis.
Soulignons que la conférence de Yalta de février 1945 aboutit à cet égard à une "déclaration sur l'Europe libérée" permettant à l'URSS de conserver tous les avantages territoriaux de la période 1939-1941, et donc de déplacer à son profit les frontières de 1938 – au nom desquelles l'occident était entré en guerre. Prétendre qu'il ne se serait rien passé en cette occasion relève de la désinformation : les Alliés se sont accordés pour entériner la "situation politique nouvelle" résultant de la "libération par l'Armée rouge". Les accords de Potsdam d'août 1945, entre Truman, Bevin et Staline ont consolidé ce principe, après la disparition de Roosevelt et la victoire des travaillistes aux élections britanniques.
Dans ce cadre un gouvernement communiste fut imposé au peuple-martyr. On appelle cette formule la "Pologne nouvelle", appuyée par la canaille, précisément contrôlée par les organes dits "de sécurité" du système soviétique. Ceux-ci ont travaillé soigneusement à l'éradication de la "Mémoire" : celle du peuple polonais s'est maintenue, en dépit d'une répression abominable à l'encontre des récalcitrants.
Hélas en Europe occidentale, et singulièrement en France, les mêmes réseaux ont rencontré beaucoup plus de complaisances auprès des beaux esprits bien connus.
JG Malliarakis
Apostilles
- le 14 avril à 20h40 Rediffusion le 19 avril à 01h30.
http://www.arte.tv/fr/semaine/244,broadcastingNum=1260026,day=6,week=15,year=2011.html - à la sortie de laquelle en France nous avons consacré deux articles → L'Insolent du 8 avril 2009 "Katyn un film magnifique de Wajda" Je voulais ce matin évoquer Katyn en commençant par le film de Wajda projeté cette semaine encore dans 13 salles seulement de notre hexagone. → et L'Insolent du 9 avril 2009 "Katyn le poids historique du mensonge et du crime" Le film de Wajda évoqué hier s'inscrit dans un certain contexte mémoriel et politique. Comme le déclare le cinéaste lui-même : "il ne pouvait être réalisé plus tôt, tant que la 'Pologne populaire' existait".
Sous ce titre paraîtra un ouvrage de l'auteur de ces lignes retraçant le contexte de la politique soviétique pendant toute l'entre deux guerres. Il comprend en annexe, et expliquant, plus de 80 documents diplomatiques, caractéristiques de cette alliance. Il sera en vente à partir du 15 mai au prix de 29 euros. Les lecteurs de L'Insolent peuvent y souscrire jusqu'au 30 avril au prix de 20 euros, soit en passant par la page spéciale sur le site des Éditions du Trident, soit en adressant directement un chèque de 20 euros aux Éditions du Trident 39 rue du Cherche Midi 75006 Paris. Tel 06 72 87 31 59.
Puisque vous avez aimé l'Insolent
00:10 Publié dans Film, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : wajda, film, cinéma, katyn, pologne, urss, union soviétique, deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Serbian Volunteers Song
Serbian Volunteers Song
00:05 Publié dans Histoire, Militaria, Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : serbie, militaria, musique, histoire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 17 avril 2011
Thomas Mann: Betrachtungen eines Unpolitischen - über die Wiedersprüche der demokratischen Gesinnungsethik
|
Thomas Mann: Betrachtungen eines Unpolitischen - Über die Wiedersprüche der demokratischen Gesinnungsethik Geschrieben von: Prof. Dr. Paul Gottfried (Gastautor) |
|
Als Universitätsstudent wurde mir eingehämmert, dass beides dieselbe antidemokratische Streitlust bloßlegt, die den Krieg angestossen hatte. Obendrein ist ein gradliniger Verbindungsgang vermeintlich aufzuspüren, der von Manns Empfehlung des „deutschen Sonderwegs“ in den Betrachtungen bis auf die Nazi-Gewaltherrschaft hinüberleitet. Das wurde in den relativ beschaulichen und unparteiischen USA im Jahre 1963 gelehrt. Man kann sich vorstellen, wie dröhnend dieselbe Mahnung im heutigen antifaschistischen Deutschland ertönen muss. |
00:05 Publié dans Histoire, Philosophie, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : allemagne, weimar, histoire, philosophie, révolution conservatrice, thomas mann |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 15 avril 2011
L'Empire hittite aux origines de la défaite égyptiee de Qadesh
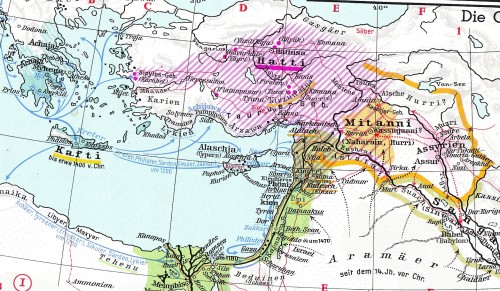
L’Empire hittite aux origines de la défaite égyptienne de Qadesh
La capitale de l’Empire hittite, Hattusa, fut l’équivalente de Babylone et de Thèbes, non pas, sans doute, sur le plan de la civilisation, mais pour la puissance qui émanait d’elle et pour son importance politique très particulière
Gianluca PADOVAN
Aux origines
Question générale : qui est venu en premier lieu en un endroit donné? Ce n’est pas tant une question qu’une affirmation, dans le sens où, avant nous, il y a forcément eu quelqu’un sur cette Terre. L’exception, nous la trouvons dans les profondeurs: sous la surface des eaux ou sous celle du sol, ou encore au fond des lacs, des mers, des océans, ou dans les grottes. Chacun d’entre nous aimerait appartenir à ceux qui étaient là les premiers, à une date donnée, et ne peut en acquérir la certitude que si nous fouillons les “Chambres de la Terre”, en nous plongeant verticalement dans ses entrailles et dans ses creux que les spéléologues appellent les “abysses”.
Si ce n’est pas le cas —en fait, c’est quasiment toujours le contraire qui est vrai— nous cherchons à repérer les lieux que nos ancêtres ont parcouru, lieux où il y avait aussi toujours quelqu’un, où une civilisation a brillé, et une autre s’est éclipsée dans la poussière des millénaires, où des hommes se sont déplacés, ont combattu, ont écrit, ont produit des objets que nous cherchons aujourd’hui à expliciter, à interpréter. En creusant, nous trouvons toujours nos racines, parfois sous la colline à côté de notre maison. Il faut mieux préserver les vestiges que de les détruire, découvrir une cave plutôt que d’enterrer tout sous une aire de parking.
Un “tell”, pour les archéologues, est une structure apparemment naturelle, qui, en langue arabe, désigne un monticule, une colline. En paléo-ethnologie, le terme indique les monticules artificiels qui se sont formés par l’accumulation de structures et résidus divers provenant d’habitats au cours de longues périodes. Quand on creuse ces “tells”, on dépouille et on dévoile souvent une mémoire pluriséculaire, dissimulée dans les restes d’habitations construites les unes sur les ruines des autres. Les excavations entreprises sur le tell de Çatal Hüyük nous ont révélé l’existence de plus de dix strates de structures habitées entre le VIIe et le Ve millénaire avant notre ère. A côté de ce tell fort ancien, se trouve un second tell, tout aussi intéressant du point de vue archéologique. Il se trouve dans la partie méridionale de la Turquie d’aujourd’hui, sur un territoire qui avait jadis, en ces temps lointains, un aspect différent de celui d’aujourd’hui. Elles nous ont également révélé l’existence de peuples appelés Hatti ou Khatti ou Hittite, qui sont arrivés en Anatolie par vagues successives, tout en n’étant ni les premiers ni les derniers.
Les Hittites blonds
Les Hittites sont généralement définis comme un peuple antique d’Asie Mineure, qui ont revêtu une grande importance des points de vue politique, militaire et culturel entre le 18ème et le 12ème siècles avant notre ère. Certains soutiennent la thèse que les premiers groupes de futurs Hittites sont arrivés sur le territoire du futur empire, déjà à la moitié du IIIe millénaire, en se basant sur l’interprétation de quelques tablettes d’argile assyriennes qui évoquent l’arrivée de “nouveaux peuples”. Selon d’autres archéologues, il convient de fixer la date de l’arrivée des Hittites soit à la fin du IIIe millénaire soit au début du IIe. Quoi qu’il en soit, voici comment Lehman voit l’arrivée de ces tribus: “Une chose est sûre: ces peuples n’ont pas fait irruption à l’improviste, de manière inattendue, en Anatolie en venant de quelque part sur la Terre. Ces troupes de cavaliers sauvages ne se sont pas déversés brutalement sur le pays ni ne se sont constitués en hordes promptes à saccager et à piller mais en sont venus graduellement à peupler villes et villages; ils n’étaient pas des barbares détruisant les civilisations étrangères, massacrant les hommes et violant les femmes. Ces images stéréotypées des peuples envahisseurs à la recherche de terres ne conviennent pas dans le cas qui nous préoccupe” (J. Lehman, Gli Ittiti, Garzanti, Milano, 1997, p. 171).
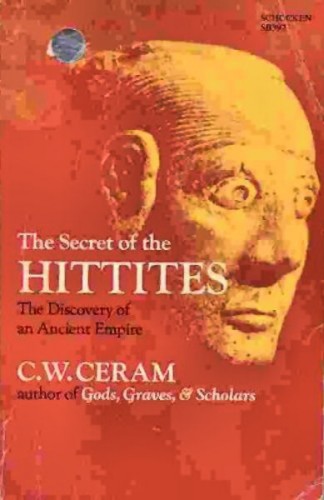
L’un de ces groupes s’est installé au centre de l’Anatolie, dans une terre qui finira par s’appeler “Terre des Hatti”, avec pour capitale Hattusa. Leur royaume, conjointement aux états vassalisés, s’étendait des rives du Bosphore et des Dardanelles jusqu’au lac de Van à l’est. Ils parlaient une langue indo-européenne ou, mieux, plusieurs langues de cette famille, qu’ils écrivaient sur des modes variés, selon les influences des populations locales et selon les degrés de développement atteints: cunéiforme en langue accadienne, cunéiforme en langue hittite, idéographique, etc. Dans tous les cas de figures, la majeure partie des documents cunéiformes sur tablettes d’argile sont en “hittite”, selon la terminologie utilisée pour désigner la langue officielle de l’Empire. Ils s’autodésignaient sous le nom de “Hari”, les “blonds”. Sur une tablette, on parle du trône royal, qui est en fer, tandis que sur d’autres, on évoque des conquêtes, des négoces, des querelles. Il s’agissait d’un Etat fédéral avec un gouvernement central, avec un ordre social subdivisé en classes mais non de manière rigide. Il semble que les croyances et rites religieux aient été variés et se juxtaposaient dans une sorte de tolérance tranquille. Il y avait deux divinités amies, un dieu solaire et un dieu de la tempête, représentés dans l’acte de gouverner, avec la hache en une main et la foudre en l’autre.
La race blanche en Orient
Il semble qu’une autre population soit arrivée sur le territoire: les Egyptiens les appelaient Heka-Kasut, ce qui signifie “chefs des pays étrangers”. Nous les connaissons communément sous le nom de “Hyksos”. Cette population est généralement définie comme “asiatique” mais elle présente pourtant des indices typiquement europoïdes, avec des caractéristiques nettement xantho-croïques (haute taille, peau claire, yeux également clairs et cheveux blonds, roux ou châtain). Ils ont dominé l’Egypte de la fin du XVIIIe jusqu’au début du XVIe siècle avant notre ère. Ils se sont d’abord stabilisés aux environs d’Avaris, leur capitale. Puis ont étendu leur pouvoir sur l’ensemble de l’Egypte. Les rois des deux dynasties hyksos, la quinzième et la seizième (1730-1570 environ), ont adopté les us et coutumes égyptiens et se sont proclamés pharaons, tout en retranscrivant leurs noms en hiéroglyphes et en prenant des noms égyptiens. Aux débuts du XVIème siècle, les rois de Thèbes ripostent: ils s’organisent et chassent les Hyksos d’Egypte. Ahmose, futur fondateur de la dix-huitième dynastie, conquiert Avaris et poursuit les Hyksos jusqu’en Syrie.
Par la suite, entre 1650 et 1600 avant notre ère, les souverains hittites Khattushili I et Murshilli I pénètrent en Syrie et en Mésopotamie et mettent un terme à la première dynastie amoréenne de Babylonie. Les Cassites (ou “Kassites” ou “’Kosséi”), un peuple à fortes caractéristiques europoïdes, utilisant également le cheval et le char de guerre, en profitent pour s’emparer du pays et pour le gouverner jusqu’à la moitié du XIIe siècle. Ces Cassites, arrivés par une migration pacifique, se sont installés en Mésopotamie comme agriculteurs, artisans et guerriers mercenaires, en venant de l’Elam, territoire de l’aire iranienne. Le temps passe et les Hittites conquièrent le pays des Mittani, un Etat hourrite à cheval sur les territoires actuels de la Syrie et de la Turquie et s’étendant sur le cours supérieur des fleuves Tigre et Euphrate. L’Etat est gouverné par une monarchie héréditaire, probablement de souche indo-iranienne, avec une classe dominante écrivant dans une langue que l’on qualifie, peut-être un peu abusivement, d’indo-européenne ou d’européenne (selon que la migration soit partie de l’Europe vers l’Inde et non le contraire), et que l’on décrit comme ressemblant au sanskrit et au perse le plus ancien. Les Hourrites font acte de soumission au roi hittite Suppiluliuma vers 1365 avant notre ère. Comme les Hittites avancent, en obtenant du consensus, leurs voisins égyptiens ne vont pas attendre passivement le choc.
Soldats égyptiens et guerriers “sardana”
Environ un demi-siècle plus tard, le roi hittite Muwatalli n’est pas battu à Qadesh par le pharaon Ramsès II, même si, dans le temple de Luxor, les Egyptiens évoquent une magnifique victoire. Mais ce n’est là que pure propagande, destinée à dissimuler au peuple la défaite réelle de son souverain. Qadesh est un site se situant dans l’intérieur des terres aujourd’hui syriennes, à un peu plus de cent kilomètres au nord de Damas, à proximité du Lac d’Homos. Vers la fin du mois de mai de 1300 avant notre ère (d’autres sources mentionnent d’autres dates), le pharaon Ramsès II mène personnellement son armée égyptienne, répartie en quatre divisions distinctes d’environ 50.000 hommes chacune, dont mille soldats constituant l’équipage des chars. Nous avons donc deux soldats par char et donc 250 chars par division. On peut calculer qu’il y avait donc un total de 16.000 fantassins et archers, deux mille chars avec quatre mille hommes pour les monter. Il y avait en plus les hommes affectés à l’approvisionnement, dont on ne peut estimer le nombre. Une cinquième division égyptienne rejoindra cette armée au cours de la bataille en venant d’Amarru. Une partie de la garde royale est formée par des guerriers “sardanes” (ou “chardanes” ou “sardes” ou “peuples de la mer”), étrangers et armés de longues épées, de boucliers de forme ronde et de casques en corne, venus, dit-on, de l’espace méditerranéen (cf. M. Healy, Qades 1300 a. C. – Lo scontro dei re guerrieri, Osprey Military, Ediciones del Prado, Madrid, 1999, p. 43). Si nous observons certaines statuettes en bronze des IXe et VIIIe siècles avant notre ère, découvertes sur les sites nuraghi, nous nous rendons compte que ces guerriers au service du Pharaon auraient très bien pu provenir de cette population, les Nurs. Les habitants de la Corse avaient déjà eu le désagrément de les connaître et avaient érigé des menhirs anthropomorphes, pourvus de leurs traits, de leurs épées, de leurs poignards et de leurs casques en corne (cf. J. Grosjean, F. L. Virili, Guide des sites torréens de l’âge du bronze – Corse, Ed. Vigros, Paris, 1979, pp. 15-17). Les textes égyptiens les nomment “guerriers de la mer, « Cherdens sans maîtres », que personne n’avait pu victorieusement affronter; ils sont venus courageusement de la mer sur leurs navires de guerre à voiles, et personne ne put les arrêter, mais Sa Majesté les a dispersés par la force de son bras valeureux et les a amenés prisonniers en Egypte” (cf. F. Cimmino, Ramesses II il Grande, Rusconi, Milano, 1984, pp. 95-96).
L’adversaire qu’affronte Ramsès II en Syrie est le Roi hittite Muwatalli, qui commande une armée plus nombreuse que la sienne. Une différence marque les deux armées: les chars de combat hittites sont montés par trois hommes, et non par deux comme pour leurs homologues égyptiens, ainsi que l’attestent les indices épigraphiques. D’après Healy, le scénario de la bataille fut le suivant: le fleuve Oronte coulait du Sud vers le Nord et peu avant le Lac d’Homs, il recevait comme affluent, sur sa rive gauche, les eaux de l’Al-Mukadiyah. Dans le lambeau de terre formant le confluent se trouvait la nouvelle ville de Qadesh, occupée par les Hittites; au Nord-Est et donc sur la rive droite se trouvait la vieille ville de Qadesh, elle aussi occupée par l’armée des Hittites, tandis qu’au Nord-Ouest, le Pharaon installait son campement avec la Division Amon et sa suite, apparemment sans savoir qu’il plantait ses tentes sous l’oeil et le contrôle des Hittites. Ramsès II ne s’en aperçut pas et fit appeler d’urgence le reste de l’armée (M. Healy, op. cit., pp. 47 & 59).
Ramsès II, battu à Qadesh
Nous possédons deux comptes-rendus égyptiens de la bataille: le Bulletin et le Poème de Pentaur. Les interprétations du déroulement exact de l’affrontement divergent: on suppose qu’une unité n’a pas fait son devoir en matière de reconnaissance ou que d’autres n’ont pas exécuté les ordres correctement: rien de nouveau dans l’histoire... La Division Ra traversa rapidement la plaine sur la rive gauche de l’Oronte, suivie à distance par les Divisions Pthah et Sutekh. L’objectif était de rejoindre le camp retranché de la Division Amon.
Les divisions hittites, avec leurs chars de guerre en tête, déboulèrent à l’improviste de l’autre côté de l’Al-Mukadiyah, en tombant sur le flanc droit de la Division Ra, scindant les formations de celles-ci en deux et la mettant en fuite. Beaucoup de Hittites se mettent alors à piller les colonnes d’approvisionnement égyptiennes, et “oublièrent” de prêter main forte lors de l’attaque contre la Division Amon. Mais le gros des Hittites poursuivit la course et attaqua le camp retranché ; mais ces soldats rompirent leurs formations et s’éparpillèrent, tout en pillant tout ce qu’ils pouvaient trouver dans les riches tentes des Egyptiens. Ramsès II réussit tout de même à rassembler sa garde en bon ordre et les Sardanes se montrèrent à la hauteur de la situation: ils se comportèrent héroïquement et firent mur, bloquant l’assaut avec toute la vigueur voulue. Dès qu’il put réorganiser ses chars de combat, en les ralliant aux restes de la Division Ra, qui venaient d’arriver, Ramsès II contre-attaqua. La colonne hittite dut alors se retirer sous la pression de la réaction adverse; c’est alors qu’une seconde vague de chars hittites arriva sur le terrain pour prêter main forte aux siens, mais avec un certain retard. Le résultat de ce retard fut que l’armée hittite se trouva coincée entre les chars de Ramsès II et la cinquième division égyptienne, la Ne’Arin, arrivée, inattendue, du Nord avec ses cavaliers lancés au galop. La journée se termina dans un nuage de poussière où tous se combattaient sans ordre ni coordination, sans plus aucun plan de combat, où les uns doivent avancer tandis que d’autres doivent se retirer; d’autres, dans ce désordre, cherchent à obtenir leur part du butin. En fin de compte, les divisions hittites se retirent, non sans difficultés, de la rive droite de l’Oronte, et rejoignent leurs campements, tandis que les Divisions Amon et Ne’Arin, malmenées, se rassemblent avec les restes de la Division Ra. Pour certains historiens, le combat reprit le lendemain, dès l’arrivée des Divisions Pthah et Sutekh. D’autres estiment que non. D’autres interprétations encore postulent que le Pharaon a passé cette journée à juger quelques survivants de la Division Ra, qui avaient fui, afin de faire des exemples et de rappeler que la lâcheté est punie de mort. L’armée égyptienne s’est ensuite retirée et est rentrée au pays. L’armée hittite l’a suivie sur une partie du trajet: cela signifie en fait que les Egyptiens ont été battus, bien que dans une mesure réduite (ibidem, pp. 44-82). Ces reconstructions, qu’elles soient appropriées ou non, ne changent rien à l’issue même du conflit: la signature d’un traité de paix entre Egyptiens et Hittites. Ce traité stipule une reconnaissance réciproque des territoires sur lesquels les uns et les autres gouvernent, avec une frontière proche de Qadesh, au nord de laquelle Ramsès II n’avait pas réussi à pousser ses armées. Il n’a pas obtenu la victoire en rase campagne. Quatre versions intéressantes peuvent se lire dans les ouvrages de Bibby, Ceram, Cimmino et Healy (G. Bibby, 4000 anni fa, Enaudi Editore, Torino, 1966, pp. 260-262; Ceram, Il libro delle rupi. Alla scoperta dell’impero degli Ittiti, Einaudi Editore, Torino, 1955, pp. 192-208; F. Cimmino, op. cit., pp. 94-112; M. Healy, op. cit., pp. 44-82).
Le traité de paix sera renforcé par la suite grâce au mariage entre Ramsès II et la fille de Hattushilish III, successeur de Muwatalli. Dans le cadre de cette époque, le contenu d’une lettre envoyée par le Roi des Hatti à Ramsès II mérite d’être rappelé: “Quant au fer à propos duquel tu m’écris, je n’ai pas de fer pur pour le moment à Kizzuwatna dans mes réserves. Ce n’est pas une période favorable pour faire le fer; toutefois, j’ai demandé que l’on me fasse du fer pur; pour l’instant, ce n’est pas fini, mais dès qu’il sera prêt, je te l’enverrai. Pour l’instant, je ne peux que t’envoyer une seule épée en fer” (F. Cimmino, op. cit., p. 130).
L’importance de l’Empire hittite
A la fin du IIe millénaire avant notre ère, commence l’expansion assyrienne sous Tiglatpileser I (1112-1074): les rois d’Assyrie, avides de conquêtes, s’approchent des frontières hittites. Par ailleurs, un des plus fidèles vassaux des régions occidentales, Madduwattas, se présente à l’improviste à la cour hittite et explique qu’une nouvelle puissance est en train d’émerger. La région d’Arzawa accroît son influence de manière préoccupante et les Ahhiyawa (ou les Achéens ou Grecs primitifs) avancent leurs pions et forment désormais une puissance menaçante sur les confins occidentaux. Le grand empire que Suppiluliumas avait construit et qu’il avait tenu pendant près d’un siècle, disparaît en deux générations, car il était aux mains du faible Tudhaliyas IV (1250-1220) puis d’un roi encore plus débile, Arnuwandas IV (1220-1190). Ni l’un ni l’autre ne furent en mesure de maintenir la politique constructive et pacifique de Hattusilis, ni de reprendre par l’épée ce qu’il avaient perdu par la voie diplomatique. Sur la disparition soudaine de ce grand empire, on a avancé maintes conjonctures. Mais les choses sont pourtant simples: une nouvelle migration de peuples se préparait. Il ne suffit donc pas d’expliquer la “rapidité” de l’effondrement d’un empire: rappelons-nous tout de même que dans notre propre histoire occidentale, il y a eu bon nombre de flux et de reflux au cours de ces 150 dernières années; songeons à Kant et à ses concepts de « temps » et d’ « espace »; dans ce contexte philosophique, les concepts propres à l’espace historique n’ont pas encore été étudiés dans leur valeur relative (Ceram, op. cit., pp. 217-219).
C’est alors qu’arrivent les Louviens et les Phrygiens, que certains identifient aux peuples de la mer; Hattusas est prise, brûlée et pillée. La culture hittite survit encore cinq siècles dans les régions du Sud-est. Puis elle disparaît sans laisser de traces, sinon sur quelques tablettes d’argile et sur quelques indices épigraphiques. Kurt W. Marek, alias Ceram, conclut, dans son livre Il libro delle rupi – Alla scoperta dell’impero ittita, écrit en 1955: “Il y a 70 ans, les Hittites et leur empire étaient encore ignorés. Aujourd’hui encore, on enseigne dans nos écoles qu’il n’y a eu que les empires mésopotamiens et le Royaume d’Egypte pour déterminer, des points de vue politique et militaire, le destin de l’Asie Mineure et du Proche Orient. Mais à côté de ces empires et de ce royaume, il y a eu, pendant un certain temps, le grand empire hittite, égal aux autres en tant que ‘tierce puissance’ et dont la capitale Hattusa fut l’équivalente de Babylone et de Thèbes, non pas sans doute du point de vue de la civilisation, mais parce qu’elle revêtait une grande importance politique” (Ibidem, p. 274).
Gianluca PADOVAN.
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, protohistoire, proche orient, asie mineure, indo-européens, hittites, empire hittite, egypte, egypte antique, ramsès ii, syrie, qadesch |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 11 avril 2011
El viente divino o la muerte voluntaria
El viento divino o la muerte voluntaria
[Artículo de Isidro Juan Palacios]
Ex: http://antecedentes.wordpress.com/
 “Nuestra sombría discusión fue interrumpida por la llegada de un automóvil negro que venía por la carretera, rodeado de las primeras sombras del crepúsculo”.
“Nuestra sombría discusión fue interrumpida por la llegada de un automóvil negro que venía por la carretera, rodeado de las primeras sombras del crepúsculo”.
Rikihei Inoguchi, oficial del estado mayor y asesor del grupo Aéreo 201 japonés, charlaba con el comandante Tamai sobre el giro adverso que había tomado la guerra. Aquel día, 19 de octubre de 1944, había brillado el Sol en Malacabat, un pequeño pueblo de la isla de Luzón, en unas Filipinas todavía ocupadas por los ejércitos de Su Majestad Imperial, Hiro-Hito. “Pronto -recuerda Inoguchi- reconocimos en el interior del coche al almirante Takijiro Ohnishi…” Era el nuevo comandante de la fuerzas aeronavales japonesas en aquel archipiélago. “He venido aquí -dijo Ohnishi- para discutir con ustedes algo de suma importancia. ¿Podemos ir al Cuartel General?”
El almirante, antes de comenzar a hablar, miró en silencio al rostro de los seis oficiales que se habían sentado alrededor de la mesa. “Como ustedes saben, la situación de la guerra es muy grave. La aparición de la escuadra americana en el Golfo de Leyte ha sido confirmada (…) Para frenarla -continuó Ohnishi- debemos alcanzar a los portaviones enemigos y mantenerlos neutralizados durante al menos una semana”. Sin una mueca, sentados con la espalda recta, los militares de las fuerzas combinandas seguían el curso de las palabras del almirante. Y entones vino la sorpresa.
“En mi opinión, sólo hay una manera de asegurar la máxima eficiencia de nuestras escasas fuerzas: organizar unidades de ataque suicidas compuestas por cazas Zero armados con bombas de 250 kilogramos. Cada avión tendría que lanzarse en picado contra un portaviones enemigo… Espero su opinión al respecto”.
Tamai tuvo que tomar la decisión. Fue así como el Grupo Aéreo 201 de las Filipinas se puso al frente de todo un contingente de pilotos que enseguida le seguirían, extendiéndose el gesto de Manila a las Marianas, de Borneo a Formosa, de Okinawa al resto de las islas del Imperio del Sol Naciente, el Dai Nippon, sin detenerse hasta el día de la rendición.
Tras celebrar una reunión con todos los jefes de escuadrilla, Tamai habló al resto de los hombres del Grupo Aéreo 201; veintitrés brazos jóvenes, adolescentes, “se alzaron al unísono anunciando un total acuerdo en un frenesí de emoción y de alegría”. Eran los primeros de la muerte voluntaria. Pero, ¿quién les mandaría e iría con ellos a la cabeza, por el cielo, y caer sobre los objetivos en el mar? El teniente Yukio Seki, el más destacado, se ofreció al comandante Tamai para reclamar el honor. Aquel grupo inicial se dividiría en cuatro secciones bautizadas con nombres evocadores: “Shikishima” (apelación poética del Japón), “Yamato” (antigua designación del país), “Asahi” (Sol naciente) y “Yamazukura” (cerezo en flor de las montañas).
Configurado de este modo el Cuerpo de Ataque Especial, sólo restaba buscarle una identidad también muy especial, como indicó oportunamente Inoguchi; y fue así como se bautizó a la “Unidad Shimpu”. Shimpu, una palabra repleta de la filosofía del Zen. En realidad no tiene ningún sentido, es una mera onomatopeya, pero es otra de las formas de leer los ideogramas que forman la palabra KAMIKAZE, “Viento de los Dioses”.
“Está bien -asintió Tamai-. Después de todo, tenemos que poner en acción un Kamikaze”. El comandante Tamai dio el nombre a las unidades suicidas japonesas, llamando a sus componentes los “pilotos del Viento Divino”.
La escuadrilla Shikishima, al frente de la cual se hallaba el teniente Seki, salió, para ya no regresar, el 25 de octubre de 1944, desde Malacabat, a las siete y veinticinco de la mañana. Sobre las once del día, los cinco aparatos destinados divisaron al enemigo en las aguas de las Filipinas. El primero en entrar en picado y romperse súbitamente, como un cristal, fue el teniente Seki, seguido de otro kamikaze a corta distancia, hundiendo el portaviones “St.Lo”, de la armada norteamericana. Ante los ojos incrédulos de los yanquis, los restantes tres pilotos se lanzaron a toda velocidad en su último vuelo, a 325 kilómetros por hora en un ángulo de 65 grados, hundiendo el portaviones “Kalinin Bay” y dejando fuera de combate los destructores “Kitkun” y “White Plains”. Siguiendo su ejemplo, la unidad Yamato emprendió vuelo un día después, el 26 de octubre, al encuentro certero con la muerte, después de brindar con sake y entonar una canción guerrera por aquel entonces muy popular entre los soldados:
“Si voy al mar, volveré cadáver sobre las olas.
Si mi deber me llama a las montañas,
la hierba verde será mi mortaja .
Por mi emperador no quiero morir en la paz del hogar”.
Tras el primer asombro, un soplo gélido de terror sacudió las almas del enemigo, los soldados de la Tierra del Dólar.
Lo asombroso del Cuerpo Kamikaze de Ataque Especial no fue su novedad, ni siquiera durante la Segunda Guerra Mundial. Fue su especial espíritu y sus numerosísimos voluntarios lo que les distinguió de otras actitudes heroicas semejantes, de igual o superior valor. La invocación del nombre del Kamikaze despertaba en los japoneses la vieja alma del Shinto, los milenarios mitos inmortales anclados en la suprahistoria, y recordaba que cada hombre podía convertirse en un “Kami”, un dios viviente, por la asunción enérgica de la muerte voluntaria como sacrificio, y alcanzar así la “vida que es más que la vida”.
De hecho, la táctica del bombardeo suicida (”tai-atari”) ya había sido utilizada por las escuadrillas navales en sus combates de impacto aéreo contra los grandes bombarderos norteamericanos. Pero aisladamente. Asímismo, otros casos singulares de enorme heroísmo encarando una muerte segura tuvieron lugar durante esa guerra. Yukio Mishima, en sus “Lecciones espirituales para los jóvenes samurai“, nos narra una anécdota entre un millón que, por su particular belleza, merece ser aquí recordada. Y dice de este modo: “Se ha contado que durante la guerra uno de nuestros submarinos emergió frente a la costa australiana y se arrojó contra una nave enemiga desafiando el fuego de sus cañones. Mientras la Luna brillaba en la noche serena, se abrió la escotilla y apareció un oficial blandiendo su espada catana y que murió acribillado a balazos mientras se enfrentaba de este modo al poderoso enemigo“.
Más lejos y mucho antes, también entre nosotros, tan acostumbrados a la tragedia de antaño, de siempre, en la España medieval, se produjo un caso parecido a este del Kamikaze, salvando, claro está, las distancias. Con los musulmanes dominando el sur de la Península, surgieron entre los cristianos mozárabes, sometidos al poder del Islam, unos que comenzaron a llamarse a sí mismos los “Iactatio Martirii”, los “lanzados”, los “arrojados al martirio”, es decir, a la muerte. Los guiaba e inspiraba el santo Eulogio de Córdoba, y actuaron durante ocho años bajo el mandato de los califas, entre el año 851 y el 859. Su modo de proceder era el siguiente: penetraban en la mezquita de manera insolente, siempre de uno en uno, y entonces, a sabiendas de que con ello se granjeaban una muerte sin paliativos, abominaban del Islam e insultaban a Mahoma. No tardaban en morir por degollamiento. Hubo por este camino cuarenta y nueve muertes voluntarias. El sello lo puso Eulogio con la suya propia el último año.
Tampoco se encuentra exenta la Naturaleza de brindarnos algún que otro ejemplo claro de lo que es un kamikaze. De ello, el símbolo concluyente es el de la abeja, ese insecto solar y regio que vive en y por las flores, las únicas que saben caer gloriosas y radiantes, jóvenes, en el esplendor de su belleza, apenas han comenzado a vivir por primavera. Igual que la abeja, que liba el néctar más dulce y está siempre dispuesta para morir, así actúa también el kamikaze, cayendo en a una muerte segura frente al intruso que pretende hollar las tierras del Dai Nippon. El marco tiene todos los ingredientes para encarnar el misterio litúrgico o el acto del sacrificio, del oficio sacro.
En “El pabellón de oro“, Yukio Mishima describe una misión simbólica. Una abeja vela en torno a la rueda amarilla de un crisantemo de verano (el crisantemo, la flor simbólica del Imperio Japonés); en un determinado instante -escribe Mishima- “la abeja se arrojó a lo más profundo del corazón de la flor y se embadurnó de su polen, ahogándose en la embriaguez, y el crisantemo, que en su seno había acogido al insecto, se transformó, asimismo, en una abeja amarilla de suntuosa armadura, en la que pude contemplar frenéticos sobresaltos, como si ella intentase echarse a volar, lejos de su tallo“. ¿Hay una imagen más perfecta para adivinar la creencia shintoísta de la transformación del guerrero, del artesano, del príncipe, del que se ofrenda en el seno del Emperador, a su vez fortalecido por el sacrificio de sus servidores? Desde hace más de dos mil seiscientos años, el Trono del Crisantemo (una línea jamás ininterrumpida) es de naturaleza divina: ellos son descendientes directos de la diosa del Sol, Amaterasu-omi-Kami; los “Tennos”, los emperadores japoneses, son las primeras manifestaciones vivientes de los dioses invisibles creadores, en los orígenes, de las islas del Japón. No son los representantes de Dios, son dioses… por ello, Mishima, en su obra “Caballos desbocados“, define así, con absoluta fidelidad a la moral shintoísta, el principio de la lealtad a la Vía Imperial (el “Kodo”): “Lealtad es abandono brusco de la vida en un acto de reverencia ante la Voluntad Imperial. Es el precipitarse en pleno núcleo de la Voluntad Imperial“.
Corría el siglo XIII, segunda mitad. El budismo no había conseguido todavía apaciguar a los mongoles, cosa de lo que más tarde se ha ufanado. Kublai-Khan, el nieto de Temujin, conocido entre los suyos como Gengis-Khan, acababa de sumar el reino de Corea al Imperio del Medio. Sus planes incluían el Japón como próxima conquista. Por dos veces, una en 1274 y otra en 1281, Kublai-Khan intentó llegar a las tierras del Dai Nippon con poderosos navíos y extraordinarios efectos psíquicos y materiales; y por dos veces fue rechazado por fuerzas misteriosas sobrehumanas. Primero, una tempestad y después un tifón desencadenados por los kami deshicieron los planes del Emperador de los mongoles. Ningún japonés olvidaría en adelante aquel portentoso milagro, que fue recordado en la memoria colectiva con su propio nombre: “Kamikaze”, viento de los kami, Viento Divino.
El descubrimiento del país de Yamato, al que Cristobal Colón llamaba Cipango, y que fue conocido así también por los portugueses y después por los jesuitas españoles, por los holandeses e ingleses que les siguieron en el siglo XVI, no fue del todo mal recibido por los shogunes del Japón. Sin embargo, un poco antes de mediados de la siguiente centuria, el shogunado de Tokugawa Ieyashu había empezado a desconfiar de los “bárbaros” occidentales, por lo que decide la expulsión de los extranjeros, impide las nuevas entradas y prohibe la salida de las islas a todos los súbditos del Japón. En 1647 se promulga el “Decreto de Reclusión”, por el cual el Dai Nippon se convertiría de nuevo en un mundo interiorizado, en un país anacoreta. Japón se cerró al comercio exterior y a las influencias ideológicas de Occidente, ya tocado irreversiblemente por el espíritu de la modernidad. De esta forma es como se vivió en aquellas tierras hasta bien entrado el siglo XIX, de espaldas a los llamados “progresos”. Japón ignorará también el nacimiento de una nueva nación que para su desgracia no tardará en ser, con el tiempo, la expresión más cabal de su destino fatídico, como le sucedería igualmente a otros pueblos de formación tradicional. La nueva nación se autodenominará “América”, pretendiendo asumir para sí el destino de todo un continente. Intolerable le resultará al Congreso y al presidente Filemore la existencia de un pueblo insolente, fiel a sí mismo, obstinado en seguir cerrado por propia voluntad al comercio y a las “buenas relaciones”. Japón debía ser abierto, y, si fuera preciso, a fuerza de cañonazos. Todo muy democráticamente. Todavía hoy, en el Japón moderno y americanizado, los barcos negros del almirante Perry son de infausta memoria.
Los estruendos de la pólvora y el hierro hicieron despertar bruscamente a muchos japoneses, para quienes la presencia norteamericana indicaba con claridad que la Tierra del Sol Naciente había descendido a los mismos niveles que las naciones decadentes, de los que antes estuvieron preservados. Muchos pensaron que la causa de tal desgracia le venía al Dai Nippon por haberse olvidado de los descendientes de Amaterasu, del Emperador, recluido desde hacía centurias en su palacio de Kioto. Por ello se alzó enseguida una revuelta a los gritos de “¡Joy, joy!” (¡fuera, fuera!, referido a los extranjeros) y de “¡Sonno Tenno!” (¡venerad al Emperador!). La restauración Meiji de 1868 se apuntaló bajo el lema del “fukko”, el retorno al pasado. Pero la tierra de Yamato tuvo que aceptar por la fuerza la nueva situación y ponerse a rivalizar con el mundo moderno, pero sin perder de vista su espíritu invisible, al que siguió siendo fiel. Cuando Yukio Mishima escribe sobre esa época, piensa lo que otros también pensaron como él. Y, así, anota: “Si los hombres fuesen puros, reverenciarían al Emperador por encima de todo. El Viento Divino (el Kamikaze) se levantaría de inmediato, como ocurrió durante la invasión mongola, y los bárbaros serían expulsados“.
Año de 1944. Mes de octubre. El Japón se encuentra en guerra frente a las potencias anglonorteamericanas. La escuadra yanqui está cercando las islas Filipinas, y en sus aguas orientales se aproxima, golpe tras golpe, hacia el mismo corazón del Imperio… El almirante Onhisi concibe la idea de lanzar a los pilotos kamikaze…
El mismo día en que el Emperador Hiro-Hito decide anunciar la rendición incondicional de las armas japonesas y se lo comunica al pueblo entero por radio (¡era la primera vez que un Tenno hablaba directamente!), el comandante supremo de la flota, vicealmirante Matome Ugaki, había ordenado preparar los aviones bombarderos de Oita con el fin de lanzarse en vuelo kamikaze sobre el enemigo anclado en Okinawa. Era el 15 de agosto de 1945. En su último informe, incluyó sus reflexiones finales…: “Sólo yo, Majestad, soy responsable de nuestro fracaso en defender la Patria y destruir al ensoberbecido enemigo. He decidido lanzarme en ataque sobre Okinawa, donde mis valerosos muchachos han caído como cerezos en flor. Allí embestiré y destruiré al engreído enemigo. Soy un bushi, mi alma es el reflejo del Bushido. Me lanzaré portando el kamikaze con firme convicción y fe en la eternidad del Japón Imperial. ¡Banzai!”. Veintidós aviadores voluntarios salieron con él, sólo por seguirle en el ejemplo de su última ofrenda. No estaban obligados. La guerra había concluido. Pero… no obstante, tampoco podían desobedecer las órdenes del Emperador, que mandaba no golpear más al adversario. Se estrellaron en las mismas narices de los norteamericanos, que contemplaron atónitos un espectáculo que no podían comprender… Ugaki hablaba del Bushido -el código de honor de los guerreros japoneses-. ¿Acaso no es el kamikaze, por esencia y por sentencia, un samurai?
En los botones de sus uniformes, los aviadores suicidas llevaban impresas flores de cerezo de tres pétalos, conforme al sentido del viejo haiku (poema japonés de dieciséis sílabas) del poeta Karumatu:
“La flor por excelencia es la del cerezo,
el hombre perfecto es el caballero”
El cerezo es una flor simbólica en las tierras japonesas, nace antes que ninguna otra, antes de iniciarse la primavera, para, en la plenitud de su gloria, caer radiante; es la flor de más corta juventud, que muere en el frescor de su belleza. Siempre fue el distintivo de los samurai.
Al encenderse los motores, los pilotos kamikaze se ajustaban el “hashimaki”, la banda de tela blanca que rodea la cabeza con el disco rojo del Sol Naciente impreso junto a algunas palabras caligrafiadas con pincel y tinta negra, al modo como antaño lo usaron los samurai antes de entrar en batalla, al modo como cayeron los últimos guerreros japoneses del siglo XIX con sus espadas catana siguiendo al caudillo Saigo Takamori frente a los “marines” del almirante Perry. En la mente fresca y clara, iluminada por el Sol, no había sitio para las turbulencias. Sobre todos, unos ideogramas se repetían hasta la saciedad: “Shichisei Hokoku” (”Siete vidas quisiera tener para darlas a la Patria“). Eran los mismos ideogramas que por primera vez puso sobre su frente Masashige Kusonoki cuando se lanzó a morir a caballo, en un combate sin esperanzas, allá por el siglo XIV; los mismos ideogramas que se colocó alrededor de la cabeza Yukio Mishima en el día de su muerte ritual.
Yukio Mishima, obsesionado por la muerte ya desde su niñez y adolescencia, estuvo a punto de ser enrolado en el Cuerpo Kamikaze de Ataque Especial. Se deleitaba pensando románticamente que si un día se le diera la oportunidad se ser un soldado, pronto tendría una ocasión segura para morir. Sin embargo, cuando fue llamado a filas y se vio libre de ser incorporado al tomársele erróneamente por un enfermo de tuberculosis, el mejor escritor japonés de los tiempos modernos no hizo nada por deshacer el engaño del oficial médico, saliendo a la carrera de la oficina de reclutamiento. Aquello, pese a todo, le pareció a Mishima un acto de infamante cobardía, como lo confesará más tarde en repetidas ocasiones. El desprecio de su propia actitud fue uno de los factores de menor importancia en el día de su “seppuku” (el “hara-kiri”, el suicidio ritual), pero que le llevó a meditar durante años sobre la condición interior del kamikaze. Para Mishima no cabía la menor duda: aquellos pilotos que hicieron ofrenda de sus vidas, con sus aparatos, eran verdaderos samurai. En “El loco morir”, afirma que el kamikaze se encuentra religado al Hagakure, un texto escrito entre los siglos XVII y XVIII por Yocho Yamamoto, legendario samurai que tras la muerte de su señor se hizo ermitaño. El Hagakure llegó a ser el libro de cabecera de los samurai, el texto que sintetizó la esencia del Bushido. En cinco puntos finales, venía a decir:
- El Bushido es la muerte.
- Entre dos caminos, el samurai debe siempre elegir aquél en el que se
muere más deprisa.
- Desde el momento en que se ha elegido morir, no importa si la muerte
se produce o no en vano. La muerte nunca se produce en vano.
- La muerte sin causa y sin objeto llega a ser la más pura y segura,
porque si para morir necesitamos una causa poderosa, al lado
encontraremos otra tan fuerte y atractiva como ésta que nos impulse a vivir.
- La profesión del samurai es el misterio del morir.
Para el hombre que guarda la semilla de lo sagrado, la muerte es siempre el rito de paso hacia la trascendencia, hacia lo absoluto, hacia la Divinidad; por esa razón suenan, incluso hoy, sin extrañezas, las primeras palabras del almirante Ohnisi en su discurso de despedida al primer grupo de pilotos kamikaze constituido por el teniente Seki:
“Vosotros ya sois kami (dioses), sin deseos terrenales…”
Ya eran dioses vivientes, y como tales se les veneraba, aunque todavía “no hubieran muerto”; porque, sencillamente, “ya estaban muertos”. Los resultados de sus acciones pasaban al último plano de las consideraciones a evaluar. No importaban demasiado… Aunque realmente los hubo: durante el año y medio que duraron los ataques kamikaze, fueron hundidos un total de 322 barcos aliados, entre portaviones, acorazados, destructores, cruceros, cargueros, torpederos, remolcadores, e, incluso, barcazas de desembarco; ¡la mitad de todos los barcos hundidos en la guerra!
Para Mishima, el caza Zero era semejante a una espada catana que descendía como un rayo desde el cielo azul, desde lo alto de las nubes blancas, desde el mismo corazón del Sol, todos ellos símbolos inequívocos de la muerte donde el hombre terreno, que respira, no puede vivir, y por los que paradójicamente todos esos hombres suspiran en ansias de vida inmortal, eterna. “Hi-Ri-Ho-Ken-Ten” fue la insignia de una unidad kamikaze de la base de Konoya. Era la forma abreviada de cuatro lemas engarzados: “La Injusticia no puede vencer al Principio. El Principio no puede vencer a la Ley. La Ley no puede vencer al Poder. El Poder no puede vencer al Cielo“.
Aquel 15 de agosto de 1945, cuando el Japón se rendía al invasor, el almirante Takijiro Ohnishi se reunió por última vez con varios oficiales del Estado mayor, a quienes había invitado a su residencia oficial. ¿Una despedida? Los oficiales se retiraron hacia la medianoche. Ya a solas, en silencio, el inspirador principal del Cuerpo Kamikaze de Ataque Especial se dirigió a su despacho, situado en el segundo piso de la casa. Allí se abrió el vientre conforme al ritual sagrado del seppuku. No tuvo a su lado un kaishakunin, el asistente encargado de dar el corte de gracia separándole la cabeza del cuerpo cuando el dolor se hace ya extremadamente insoportable… Al amanecer fue descubierto por su secretario, quien le encontró todavía con vida, sentado en la postura tradicional de la meditación Zen. Una sola mirada bastó para que el oficial permaneciera quieto y no hiciera nada para aliviar o aligerar su sufrimiento. Ohnishi permaneció, por propia voluntad, muriendo durante dieciocho horas de atroz agonía. Igonaki, Inoguchi y otros militares que le conocían que el almirante, desde el mismo instante en que concibiera la idea de los ataques kamikaze, había decidido darse la muerte voluntaria por sacrificio al estilo de los antiguos samurai, incluso aunque las fuerzas del Japón hubieses alcanzado finalmente la victoria. En la pared, colgaba un viejo haiku anónimo:
“La vida se asemeja a una flor de cerezo.
Su fragancia no puede perdurar en la eternidad”.
Poco antes de la partida, los jóvenes kamikaze componían sus tradicionales poemas de abandono del mundo, emulando con ello a los antiguos guerreros samurai de las epopeyas tradicionales. La inmensa mayoría de ellos también enviaron cartas a sus padres, novias, familiares o amigos, despidiéndose pocas horas antes de la partida sin retorno. Ichiro Omi se dedicó, después de la guerra, a peregrinar de casa en casa, pidiendo leer aquellas cartas. su intención era publicar un libro que recogiese todo aquel material atesorado por las familias y los camaradas, y fue así como muchas de aquellas cartas salieron a la luz. Bastantes de éstas y otras fueron a parar a la base naval japonesa de Etaji. Allí también peregrinó Yukio Mishima, poco antes de practicarse el seppuku, releyéndolas y meditándolas. Una, sobre las otras, le conmovió, actuando en su interior como un verdadero koan (el “koan” es, en la práctica del budismo Zen, la meditación sobre una frase que logra desatar el “satori”, la iluminación espiritual). Mishima tuvo la tentación de escribir una obra sobre los pilotos del Viento Divino, y así apareció su obra “Sol y Acero“. Un breve párrafo de estas cartas y algunos otros de las tomadas por Omi son las fuentes de esta antología:
“En este momento estoy lleno de vida. Todo mi cuerpo desborda juventud y fuerza. Parece imposible que dentro de unas horas deba morir (…) La forma de vivir japonesa es realmente bella y de ello me siento orgullo, como también de la historia y de la mitología japonesas, que reflejan la pureza de nuestros antepasados y su creencia en el pasado, sea o no cierta esa creencia (…) Es un honor indescriptible el poder dar mi vida en defensa de todo en lo creo, de todas estas cosas tan bellas y eminentes. Padre, elevo mis plegarias para que tenga usted una larga y feliz vida. Estoy seguro que el Japón surgirá de nuevo“.
Teruo Yamaguchi.
“Queridos padres: Les escribo desde Manila. Este es el último día de mi vida. Deben felicitarme. Seré un escudo para Su Majestad el Emperador y moriré limpiamente, junto con mis camaradas de escuadrilla. Volveré en espíritu. Espero con ansias sus visitas al santuario de Kishenai, donde coloquen una estela en mi memoria “.
Isao Matsuo.
“Elevándonos hacia los cielos de los Mares del Sur, nuestra gloriosa misión es morir como escudos de Su Majestad. Las flores del cerezo se abren, resplandecen y caen (…) Uno de los cadetes fue eliminado de la lista de los asignados para la salida del no-retorno. Siento mucha lástima por él. Esta es una situación donde se encuentran distintas emociones. El hombre es sólo mortal; la muerte, como la vida, es cuestión de probabilidad. Pero el destino también juega su papel. Estoy seguro de mi valor para la acción que debo realizar mañana, donde haré todo lo posible por estrellarme contra un barco de guerra enemigo, para así cumplir mi destino en defensa de la Patria. Ikao, querida mía, mi querida amante, recuérdame, tal como estoy ahora, en tus oraciones“.
Yuso Nakanishi
“Ha llegado la hora de que mi amigo Nakanishi y yo partamos. No hay remordimiento. Cada hombre debe seguir su camino individualmente (…) En sus últimas instrucciones, el oficial de comando nos advirtió de no ser imprudentes a la hora de morir. Todo depende del Cielo. Estoy resuelto a perseguir la meta que el destino me ha trazado. Ustedes siempre han sido muy buenos conmigo y les estoy muy agradecido. Quince años de escuela y adiestramiento están a punto de rendir frutos. Siento una gran alegría por haber nacido en el Japón. No hay nada especial digno de mención, pero quiero que sepan que disfruto de buena salud en estos momentos. Los primeros aviones de mi grupo ya están en el aire. Espero que este último gesto de descargar un golpe sobre el enemigo sirva para compensar, en muy reducida medida, todo lo que ustedes han hecho por mí. La primavera ha llegado adelantada al sur de Kyushu. Aquí los capullos de las flores son muy bellos. Hay paz y tranquilidad en la base, en pleno campo de batalla incluso. Les suplico que se acuerden de mí cuando vayan al templo de Kyoto, donde reposan nuestros antepasados“.
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, japon, deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale, kamikazes, années 40 |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 09 avril 2011
La tragedia armena: il primo "olocausto" dell'epoca contemporanea
 Con l’espressione “genocidio armeno” (in lingua armena Medz Yeghern, Grande Male) (1) ci si riferisce a due eventi distinti ma legati fra loro: il primo, quello relativo alla campagna contro gli armeni condotta negli anni 1894-1896 dal sultano Abdul Hamid II; il secondo, quello collegato alla deportazione ed eliminazione degli armeni compiute nel corso del Primo Conflitto Mondiale dal nuovo governo della Sublime Porta controllato dai Giovani Turchi. In questa sede ci limiteremo a ricostruire i fatti salienti di quest’ultima persecuzione, soprattutto in virtù delle sue peculiari finalità e metodologie e per il fatto che essa viene ancora negata o contestata – nonostante l’enorme mole di documenti e testimonianze – dall’attuale governo turco. Il sostanziale rifiuto da parte dell’attuale governo di Ankara di riconoscere le responsabilità storiche della Sublime Porta rappresenta non soltanto un chiaro esempio di ‘negazionismo’, ma anche un ingombrante ostacolo all’ingresso nel consesso europeo di questo Paese retto sì da un regime laico ma ancora fortemente permeato di religiosità e di esasperato e malinteso spirito nazionalista.
Con l’espressione “genocidio armeno” (in lingua armena Medz Yeghern, Grande Male) (1) ci si riferisce a due eventi distinti ma legati fra loro: il primo, quello relativo alla campagna contro gli armeni condotta negli anni 1894-1896 dal sultano Abdul Hamid II; il secondo, quello collegato alla deportazione ed eliminazione degli armeni compiute nel corso del Primo Conflitto Mondiale dal nuovo governo della Sublime Porta controllato dai Giovani Turchi. In questa sede ci limiteremo a ricostruire i fatti salienti di quest’ultima persecuzione, soprattutto in virtù delle sue peculiari finalità e metodologie e per il fatto che essa viene ancora negata o contestata – nonostante l’enorme mole di documenti e testimonianze – dall’attuale governo turco. Il sostanziale rifiuto da parte dell’attuale governo di Ankara di riconoscere le responsabilità storiche della Sublime Porta rappresenta non soltanto un chiaro esempio di ‘negazionismo’, ma anche un ingombrante ostacolo all’ingresso nel consesso europeo di questo Paese retto sì da un regime laico ma ancora fortemente permeato di religiosità e di esasperato e malinteso spirito nazionalista.***
Verso la fine del XIX secolo, la crisi politica, economica e sociale dell’impero ottomano si fece sempre più grave, sfociando in sedizioni e sommosse. A Salonicco un gruppo di ufficiali dell’esercito, affiancato da alcuni esiliati politici turchi confluiti nella Ittihad ve Terakki (il partito Unione e Progresso), iniziò a tramare contro l’incapace e retrogrado governo centrale di Costantinopoli, con l’obiettivo di intraprendere, anche con la forza, un necessario quanto urgente processo di modernizzazione dell’impero ormai sull’orlo del collasso.
Il 24 luglio del 1908, il Comitato Centrale di Unione e Progresso detronizzò il sultano Abdul Hamid II sostituendolo con il più malleabile fratello Muhammad. Seguì un breve periodo di euforia da parte delle minoranze etniche e religiose della Sublime Porta, tra cui quella armena, che confidavano nell’inizio di una nuova era caratterizzata da maggiori libertà. Si trattò però di una semplice speranza destinata a svanire di fronte ai reali e non dichiarati intenti che in segreto animavano i cuori degli appartenenti ad un nuovo partito ‘progressista’, il Movimento dei Giovani Turchi, intenzionati sì a modernizzare economicamente e socialmente il loro agonizzante impero, ma anche ad unificarlo etnicamente e religiosamente, espandendone nuovamente i confini non ad occidente, come avevano quasi sempre fatto i sultani del passato, bensì ad oriente, in direzione della Persia, del Caucaso e delle immense regioni asiatiche centrali, abitate da popoli (tartari, azerbaigiani, ceceni, kazachi, uzbechi, kirghisi e tagiki) linguisticamente ed etnicamente affini al popolo anatolico. La teoria geopolitica intorno alla quale ruotava questo piano si basava sull’ideologia panturanica. Secondo il padre di quest’ultima – l’orientalista, linguista ed esploratore ungherese Arminius Vambery (1832-1913) – l’impero ottomano avrebbe infatti potuto e dovuto allargare i suoi confini all’intera area caucasica e asiatico-centrale in virtù della già citata uniformità etnico-religiosa che caratterizzava l’intero “popolo” turco. Fu per questa ragione che, il 26 gennaio 1913, un triumvirato di Giovani Turchi firmato da Enver Pascià, Taalat Pascià e Ahmed Jemal – nonostante i precedenti proclami inneggianti l’eguaglianza di tutti i sudditi della Sublime Porta – iniziarono ad organizzare un piano di persecuzione nei confronti di tutte le minoranze, prima fra tutte quella armena, mettendo in piedi un’efficiente struttura paramilitare, l’Organizzazione Speciale (O.S.), coordinata da due medici, Nazim e Shaker, e dipendente dal Ministero della Guerra e da quello degli Interni e della Giustizia. Nel 1914, con l’entrata in guerra della Turchia a fianco degli Imperi Centrali, i Giovani Turchi poterono finalmente rendere più che palesi le loro intime convinzioni e dare il via ad una sistematica e scientifica persecuzione destinata a protrarsi per quasi tutta la durata del Primo Conflitto Mondiale. Tra l’aprile e il maggio 1915, i turchi concentrarono i loro sforzi nell’eliminazione dell’élite economico-culturale e dei militari armeni. Il 24 aprile 1915 (che verrà in seguito ricordata come la data commemorativa del ‘genocidio’), a Costantinopoli, circa 500 armeni furono incarcerati e poi eliminati. Tra le vittime vi era anche il deputato Krikor Zohrab che pensava di godere dell’amicizia personale di Talaat Pascià, molti intellettuali, come il poeta Daniel Varujan, giornalisti e sacerdoti. Tra gli uomini di chiesa, Soghomon Gevorki Soghomonyan (più noto come il monaco Komitas), padre della etnomusicologia armena. Komitas fu deportato assieme ad altri 180 intellettuali armeni a Çankırı in Anatolia centro settentrionale. Egli sopravvisse alla prigionia e alla guerra grazie all’intervento del poeta nazionalista turco Emin Yurdakul, della scrittrice turca Halide Edip Adıvar e dell’ambasciatore americano Henry Morgenthau. Trasferitosi nel 1919 a Parigi, Komitas, sulla scorta degli orrori patiti, impazzì finendo i suoi giorni in un manicomio, nel 1935.
Tra il maggio e il luglio del 1915, gli ottomani, spalleggiati da bande curde (2) e da reparti formati da ex detenuti, setacciarono le comunità delle province di Erzerum, Bitlis, Van, Diyarbakir, Trebisonda, Sivas e Kharput, dove soprattutto i reparti curdi depredarono e massacrarono migliaia tra donne, vecchi e bambini e decine di sacerdoti a molti dei quali, prima dell’esecuzione, furono strappati gli occhi, le unghie e i denti. Gevdet Bey, vali (governatore) della città di Van e cognato del ministro della Difesa Enver Pascià, era solito fare inchiodare ai piedi dei prelati ferri di cavallo arroventati. Stando ad un rapporto del console statunitense ad Ankara, nel luglio 1915, diverse migliaia di soldati armeni inquadrati nell’esercito ottomano e reduci dalla disastrosa campagna del Caucaso (scatenata nel dicembre del 1914 da Enver Pascià contro le forze zariste al comando del generale Nikolai Yudenich ) furono improvvisamente disarmati dai turchi e spediti nelle zone di Kharput e Diyarbakir con il pretesto di utilizzarli nella costruzione di una strada. Ma una volta giunti sul posto essi vennero tutti fucilati. Solitamente, i turchi organizzavano le deportazioni di massa trasferendo i loro prigionieri in località piuttosto remote. Una delle destinazioni prescelte fu la desolata regione siriana di Deir al-Zor, dove centinaia di intere famiglie armene furono ammassate e lasciate morire di stenti in primordiali lager privi di baracche e servizi igienici.. In terra siriana vennero anche spediti migliaia di giovani ragazze e ragazzi armeni che riuscirono però a scampare alla morte in parte perché venduti a gestori arabi di bordelli per etero e omosessuali, e in parte perché rinchiusi negli speciali orfanotrofi per cristiani gestiti da Halidé Edib Adivart, una sadica virago incaricata da Costantinopoli di ‘rieducare’ I piccoli armeni.
“Le deportazioni – annotò in questo periodo il diplomatico tedesco Max Erwin von Scheubner-Richter -furono giustificate dal governo turco con la scusa di un necessario spostamento delle comunità armene dalle zone interessate dalle operazioni militari (Anatolia orientale e nord orientale, n.d.a) (…) Non escludo che gran parte dei deportati furono massacrati durante la loro marcia. (…) Una volta abbandonati i loro villaggi, le bande curde e i gendarmi turchi si impadronivano di tutte le abitazioni e i beni degli armeni, grazie anche ad una legge del 10.6.1915 ed altre a seguire che stabiliva che tutte le proprietà appartenenti agli armeni deportati fossero dichiarate “beni abbandonati” (emvali metruke) e quindi soggetti alla confisca da parte dello Stato turco”. E a testimonianza dei risvolti economici della strage, basti pensare che “i profitti derivati all’oligarchia dei Giovani Turchi e ai suoi lacchè dai beni rapinati agli armeni arrivarono a toccare la cifra astronomica di un miliardo di marchi”. Nell’inverno del ‘15, il conte Wolff-Metternich decise di riferire al ministero degli Esteri tedesco il protrarsi “di questi inutili e crudeli eccidi”, chiedendo un intervento ufficiale presso la Sacra Porta Venuti al corrente della protesta, Enver Pascià e Taalat Pascià chiesero a Berlino la sostituzione di Wolff-Metternich che nel 1916 dovette infatti rientrare in Germania.
 Va comunque detto che non tutti i governatori turchi accettarono di eseguire per filo e per segno gli ordini di Costantinopoli. Nel luglio 1915, ad esempio, il vali di Ankara si oppose allo sterminio indiscriminato di giovani e vecchi, venendo rimosso e sostituito da un funzionario più zelante, tale Gevdet, che nell’estate del ‘15 a Siirt fece massacrare oltre 10.000 tra armeni ortodossi, cristiani nestoriani, giacobini e greci del Ponto. Resoconti sui molteplici eccidi sono registrati anche nelle memorie di altri addetti diplomatici francesi, bulgari, svedesi e italiani (come il console di Trebisonda, Giovanni Gorrini) presenti all’epoca in Turchia. Nonostante tutto, il governo turco non si reputava ancora soddisfatto di come stava procedendo la risoluzione del “problema armeno”. “In base alle relazioni da noi raccolte – annotò il 10 e il 20 gennaio del 1916, il notabile Abdullahad Nouri Bey – mi risulta che soltanto il 10 per cento degli armeni soggetti a deportazione generale abbia raggiunto i luoghi ad essi destinati; il resto è morto di cause naturali, come fame e malattie. Vi informiamo che stiamo lavorando per avere lo stesso risultato riguardo quelli ancora vivi, indicando e utilizzando misure ancora più severe (…) Il numero settimanale dei morti non è ancora da considerarsi soddisfacente”. Nel 1916, Enver Pascià, Taalat Pascià e Ahmed Jemal diedero quindi un ulteriore giro di vite, intimando ai loro governatori e ai capi di polizia di “eliminare con le armi, ma se possibile con mezzi più economici, tutti i sopravvissuti dei campi siriani e anatolici”. In questa fase del massacro ebbe modo di distinguersi per efficienza il governatore del già citato distretto di Deir al-Azor, Zeki Bey, che – secondo quanto riportano James Bryce e Arnold Toynbee in The Treatment of Armenians in the Ottoman Empire, 1915–1916 – “rinchiuse 500 armeni all’interno di una stretta palizzata, costruita su una piana desertica, e li fece morire di fame e di sete”. Durante l’estate del 1916, gli uomini di Zeki eliminarono complessivamente oltre 20.000 armeni. A dimostrazione della criminale sfacciataggine dei leader turchi, basti pensare che Taalat Pascià arrivò a vantarsi dell’efficienza del suo governatore con l’ambasciatore americano Morgenthau, al quale egli ebbe anche il coraggio di chiedere “l’elenco delle polizze assicurazioni sulla vita che gli armeni più ricchi (deceduti nei campi di sterminio) avevano precedentemente stipulato con compagnie americane, in modo da consentire al governo di incassare gli utili delle polizze”. Altrettanto crudele ed anche beffardo risultò il destino delle comunità armene dell’Anatolia orientale che, grazie anche all’intervento dell’armata zarista, erano riuscite a trovare momentaneo rifugio nelle valli del Caucaso. In seguito alla rivoluzione bolscevica del 1917, l’esercito russo si era infatti ritirato dall’Anatolia orientale e dalla Ciscaucasia, abbandonando gli armeni al loro destino. Rioccupata l’importante città-fortezza di Kars, le forze ottomane iniziarono una vera e propria caccia all’uomo, eliminando circa 19.000 cristiani. Identica sorte toccò a quei profughi armeni che, rifugiatisi in Azerbaigian, furono massacrati dalle locali minoranze mussulmane tartare e cecene che, nel 1918, nella sola area di Baku, ne eliminarono 30.000.
Va comunque detto che non tutti i governatori turchi accettarono di eseguire per filo e per segno gli ordini di Costantinopoli. Nel luglio 1915, ad esempio, il vali di Ankara si oppose allo sterminio indiscriminato di giovani e vecchi, venendo rimosso e sostituito da un funzionario più zelante, tale Gevdet, che nell’estate del ‘15 a Siirt fece massacrare oltre 10.000 tra armeni ortodossi, cristiani nestoriani, giacobini e greci del Ponto. Resoconti sui molteplici eccidi sono registrati anche nelle memorie di altri addetti diplomatici francesi, bulgari, svedesi e italiani (come il console di Trebisonda, Giovanni Gorrini) presenti all’epoca in Turchia. Nonostante tutto, il governo turco non si reputava ancora soddisfatto di come stava procedendo la risoluzione del “problema armeno”. “In base alle relazioni da noi raccolte – annotò il 10 e il 20 gennaio del 1916, il notabile Abdullahad Nouri Bey – mi risulta che soltanto il 10 per cento degli armeni soggetti a deportazione generale abbia raggiunto i luoghi ad essi destinati; il resto è morto di cause naturali, come fame e malattie. Vi informiamo che stiamo lavorando per avere lo stesso risultato riguardo quelli ancora vivi, indicando e utilizzando misure ancora più severe (…) Il numero settimanale dei morti non è ancora da considerarsi soddisfacente”. Nel 1916, Enver Pascià, Taalat Pascià e Ahmed Jemal diedero quindi un ulteriore giro di vite, intimando ai loro governatori e ai capi di polizia di “eliminare con le armi, ma se possibile con mezzi più economici, tutti i sopravvissuti dei campi siriani e anatolici”. In questa fase del massacro ebbe modo di distinguersi per efficienza il governatore del già citato distretto di Deir al-Azor, Zeki Bey, che – secondo quanto riportano James Bryce e Arnold Toynbee in The Treatment of Armenians in the Ottoman Empire, 1915–1916 – “rinchiuse 500 armeni all’interno di una stretta palizzata, costruita su una piana desertica, e li fece morire di fame e di sete”. Durante l’estate del 1916, gli uomini di Zeki eliminarono complessivamente oltre 20.000 armeni. A dimostrazione della criminale sfacciataggine dei leader turchi, basti pensare che Taalat Pascià arrivò a vantarsi dell’efficienza del suo governatore con l’ambasciatore americano Morgenthau, al quale egli ebbe anche il coraggio di chiedere “l’elenco delle polizze assicurazioni sulla vita che gli armeni più ricchi (deceduti nei campi di sterminio) avevano precedentemente stipulato con compagnie americane, in modo da consentire al governo di incassare gli utili delle polizze”. Altrettanto crudele ed anche beffardo risultò il destino delle comunità armene dell’Anatolia orientale che, grazie anche all’intervento dell’armata zarista, erano riuscite a trovare momentaneo rifugio nelle valli del Caucaso. In seguito alla rivoluzione bolscevica del 1917, l’esercito russo si era infatti ritirato dall’Anatolia orientale e dalla Ciscaucasia, abbandonando gli armeni al loro destino. Rioccupata l’importante città-fortezza di Kars, le forze ottomane iniziarono una vera e propria caccia all’uomo, eliminando circa 19.000 cristiani. Identica sorte toccò a quei profughi armeni che, rifugiatisi in Azerbaigian, furono massacrati dalle locali minoranze mussulmane tartare e cecene che, nel 1918, nella sola area di Baku, ne eliminarono 30.000.
Ma la guerra stava ormai volgendo al termine e nell’imminenza del crollo della Sublime Porta, i responsabili delle stragi iniziarono a dileguarsi. Quando, nell’ottobre 1918, la Turchia si arrese alle forze dell’Intesa, i principali dirigenti del partito dei Giovani Turchi vennero arrestati dai britannici ed internati a Malta per un breve periodo. A carico dei fautori e degli esecutori dei massacri fu intentato un processo svoltosi nel 1919 a Costantinopoli sotto la supervisione del nuovo primo ministro Damad Ferid Pascià che alla Conferenza di pace di Parigi, il 17 luglio 1919 aveva ammesso i crimini perpetrati ai danni degli armeni. Lo scopo del processo di Costantinopoli non era in realtà quello di rendere giustizia al popolo armeno e di chiarire le colpe pregresse dell’amministrazione ottomana (cioè quelle di prima della Grande Guerra), bensì quello di scaricare tutte le colpe sui leader dei Giovani Turchi, sicuramente responsabili, ma che avevano potuto portare a compimento il loro piano di sterminio, grazie alla connivenza di larghi strati della burocrazia civile e militare. Il processo si risolse quindi in una farsa, senza considerare che nei confronti dei molti imputati condannati in contumacia (nell’autunno del 1918 quasi tutti erano riusciti ad abbandonare al Turchia), non furono mai presentate richieste di estradizione. Non solo. In una fase successiva anche i verdetti della corte vennero in gran parte annullati ed archiviati. Nell’ottobre del 1919, a Yerevan, i vertici del partito armeno Dashnak, più che mai decisi a farsi giustizia, misero a punto un piano (l’Operazione Nemesis) per eliminare di circa 200 tra uomini politici, funzionari turchi e ‘collaborazionisti’ armeni ritenuti direttamente o indirettamente responsabili del genocidio. Il 15 marzo del 1921, a Berlino, l’ex ministro degli Interni Talaat Pascià, il principale artefice dell’olocausto armeno, venne ucciso da Solomon Tehlirian che, tuttavia, dopo essere stato arrestato e processato, nel mese di giugno dello stesso anno sarà graziato da un tribunale tedesco. Il 18 luglio 1921, fu la volta di Pipit Jivanshir Khan, coordinatore del massacro di Baku, assassinato a Constantinopoli, da Misak Torlakian. Il killer fu arrestato, ma rilasciato dalla polizia inglese. Il 5 dicembre, a Berlino, l’agente Arshavir Shiragian eliminò l’ex primo ministro turco Said Halim Pascià. Shiragian scampò all’arresto, rientrando poi a Constantinopoli. Il 17 aprile 1922, sempre a Berlino, Aram Yerganian, spalleggiato probabilmente da un altro sicario (il misterioso “agente T”) da lui ingaggiato, freddò Behaeddin Shakir Bey, coordinatore dello speciale Comitato ittihadista e Jemal Azmi, il ‘mostro’ di Trebisonda, responsabile della morte di 15.000 armeni, e già condannato, nel 1919, alla pena capitale da un tribunale militare turco che tuttavia non aveva ritenuto opportuno rendere esecutiva la sentenza. Il 25 luglio 1922, fu la volta dell’ex ministro della Difesa Jemal Pascià che a Tbilisi cadde sotto i colpi di Stepan Dzaghigian e Bedros D. Boghosian. Curiosa, ma decisamente consona al personaggio fu invece la fine di Enver Pascià, probabilmente il più ambizioso e idealista dei triumviri turchi, il “piccolo Napoleone” dell’impero e il più tenace propugnatore del movimento “internazionalista” turco. Rifugiatosi tra le tribù dell’Asia Centrale, dove pensava di realizzare il suo antico sogno panturanico, cioè la creazione di una Grande Nazione Turca, agli inizi degli anni Venti Enver scatenò una rivolta mussulmana contro il potere sovietico. Ma il 4 agosto 1922, nei pressi di Baldzhuan, località del Turkestan meridionale (oggi inclusa del territorio del Tagikistan) egli venne sconfitto e ucciso con pochi suoi seguaci da preponderanti forze bolsceviche.
Alberto Rosselli
NOTE:
1) Il termine “genocidio” fu coniato negli anni Quaranta dal giurista americano di origine ebraico-polacca Raphael Lemkin proprio in riferimento alla repressione armena.
2) A proposito della collaborazione fornita dai curdi al governo centrale, va ricordata l’istituzione da parte del sultano dei reggimenti Hamidye, reparti paramilitari dipendenti dall’esercito e dalla gendarmeria turchi, che vennero largamente utilizzate per depredare o incendiare le comunità armene “ribelli”).
BIBLIOGRAFIA:
B. H. Liddell Hart, La Prima Guerra Mondiale 1914-18, Rizzoli Editore, Milano 1972.
D. Fromkin, Una pace senza pace, Rizzoli Libri, Milano 1992.
M. Gilbert, La grande storia della Prima Guerra Mondiale, Arnoldo Mondatori Editore, Milano 1998.
A.Emin (Yalman), Turkey in the World War, Newhaven, 1930.
H.Kaiser, Imperialism, Racism and Development Theories: The Construction of a Dominant Paradigm on Ottoman Armenians, Gomidas Institute Books, Princeton, 1998.
H.Kaiser, The Baghdad Railway and the Armenian Genocide, 1915-1916: A Case Study in German Resistance and Complicity, in Remembrance and Denial: the Case of the Armenian Genocide, Wayne State University Press, 1999.
R. Kevorkian, L’extermination des deportés arméniens ottomans dans les camps de concentration de Syrie-Mésopotamie (1915-1916), Revue d’Histoire Arménienne Contemporaine, Tome II, Paris, 1998.
Y. Ternon, Gli armeni. 1915-1916: il genocidio dimenticato, Rizzoli, Milano, 2003.
D. M. Thomas, Ararat, Frassinelli, Milano, 1984.
D.Varujan, Il canto del pane, Guerini, Milano, 1992.
D.Varujan, Mari di grano e altre poesie armene, Paoline, Milano, 1995, a cura di Antonia Arslan.
C. Mutafian, Metz Yeghérn Breve storia del genocidio degli armeni, Angelo Guerrini & Associati, Milano 1998.
A. Rosselli, Sulla Turchia e l’Europa, Solfanelli Editore, Chieti, 2006.
A. Rosselli, L’olocausto armeno, Sito web Nuovi Orizzonti, http://www.storico.org.
H. M. Sukru, “The Political Ideas of the Young Turks”, in idem, The Young Turks in Opposition, Oxford University Press, 1995
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, arménie, génocide, génocide arménien, caucase, turquie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 08 avril 2011
Per il popolo, con il popolo - Il messagio di Evita e l'Argentina peronista
 Eva Maria Ibarguren nacque il 7 maggio 1919 a Los Toldos, ultima di cinque figli illegittimi (Elisa, Blanca, Juan Ramòn, Erminda ed Eva) di, Juana Ibarguren, figlia di un carrettiere basco, e di un fattore di Chivilcoy (cittadina situata trecento chilometri a ovest di Buenos Aires), Juan Duarte. Eva scoprì con sofferta stupefazione la prima grande umiliazione della sua vita a sette anni. Quando, nel 1926, il padre (ormai vedovo, la moglie legittima, Estela Grisolia, era morta nel 1922) morì in un incidente d’auto e la famiglia legittima volle impedire a Juana e ai suoi figli di seguire il corteo funebre. Eva scriverà nella Razòn de mi vida: “Ho scoperto nel mio cuore un sentimento fondamentale che mi domina completamente lo spirito e la volontà: questo sentimento è l’indignazione dinanzi all’ingiustizia”.
Eva Maria Ibarguren nacque il 7 maggio 1919 a Los Toldos, ultima di cinque figli illegittimi (Elisa, Blanca, Juan Ramòn, Erminda ed Eva) di, Juana Ibarguren, figlia di un carrettiere basco, e di un fattore di Chivilcoy (cittadina situata trecento chilometri a ovest di Buenos Aires), Juan Duarte. Eva scoprì con sofferta stupefazione la prima grande umiliazione della sua vita a sette anni. Quando, nel 1926, il padre (ormai vedovo, la moglie legittima, Estela Grisolia, era morta nel 1922) morì in un incidente d’auto e la famiglia legittima volle impedire a Juana e ai suoi figli di seguire il corteo funebre. Eva scriverà nella Razòn de mi vida: “Ho scoperto nel mio cuore un sentimento fondamentale che mi domina completamente lo spirito e la volontà: questo sentimento è l’indignazione dinanzi all’ingiustizia”.“Da che io lo ricordi, ogni ingiustizia mi fa dolere l’anima come se mi conficcassero dentro qualcosa. Di ogni età conservo il ricordo di qualche ingiustizia che mi fece indignare, dilaniando il mio intimo”.
Sua sorella Erminda sottolineò queste emozioni del cuore di Eva e disse: “Tu, Eva, vedevi il cielo proprio perché non smettevi di guardare negli occhi dei poveri … Il fatto è che gli avvenimenti dell’infanzia sono come radici, che non si vedono ma che continuano ad alimentarci …”. Eva stessa scriverà, ancora, nella Razòn de mi vida: “la ricchezza della nostra terra non è che una vecchia menzogna per i suoi figli. Durante un secolo nelle campagne e nelle città argentine sono state seminate la miseria e la povertà. Il grano argentino non serviva che ad appagare i desideri di pochi privilegiati … ma i peones che seminavano e raccoglievano questo grano non avevano pane per i loro figli”. Eva, a scuola, era la prima in recitazione e, nel 1933, a quattordici anni, ebbe l’ispirazione definitiva, recitando per la prima volta in pubblico, in un lavoro, preparato dalla scuola, intitolato Viva gli studenti. Un giorno offrirono a Eva la possibilità di fare un saggio a Radio Belgrano, a Buenos Aires, e, sebbene non precisato nelle date, il racconto dell’impressione che le produsse la metropoli, la Reina del Plata, si trova riflesso nel suo libro La Razòn de mi vida: “Un giorno visitai la città per la prima volta. Arrivando scoprii che non era come io l’avevo immaginata. Improvvisamente vidi i suoi quartieri miseri e capii dalle strade e dalle case che anche in città vi erano poveri e ricchi. Quella constatazione doveva colpirmi nel profondo, perché ogni volta che rientro in città da uno dei miei viaggi all’interno del Paese, mi ritorna quel primo impatto con la sua grandezza e la sua miseria: e provo la stessa sensazione di profonda tristezza che provai allora”. All’età di 15 anni (ritornata, nel frattempo, a Junin, la città in cui Juana Ibarguren e i suoi figli erano andati ad abitare fin dal 1931), il 2 gennaio 1935, dopo essere rimasta in attesa della chiamata da Radio Belgrano che non arrivò, Eva, che non era persona da aspettare a lungo, lasciò la madre, le sorelle e prende il treno per Buenos Aires, dicendo alla sua maestra, Palmira Repetti: “Vado lo stesso a Buenos Aires. In un modo o nell’altro mi sistemerò”. Dopo quattro mesi dal suo arrivo, Eva ottenne la parte di una delle sorelle di Napoleone, in Madame Sans-Gene, di Moreau e Sardou. Nel 1937, Eva ottenne una parte in un film, Seguendos afuera, una sua foto fu pubblicata sulla rivista “Sintonia” e ebbe un ruolo in No hay su egra como la mìa. (Mia suocera è unica), trasmessa anche da Radio Splendid. Si trattava, tuttavia, ancora di briciole di teatro, di frammenti di personaggi che non consentirono a Eva di uscire dall’anonimato, di affrancarsi dallo stato di bisogno, né dalla sensazione di insicurezza e di incertezza del futuro. Il 4 giugno 1943, un colpo di stato, fomentato dal generale Arturo Rawson, destituì il presidente Ramòn J. Castillo e lo sostituì con il generale Pedro Pablo Ramirez. Questa rivoluzione si opponeva alla candidatura, patrocinata dal presidente Castillo, di Robustiano Patron Costas, che significava la continuità del potere oligarchico e del feudalesimo dei proprietari terrieri. Il colonnello Juan Domingo Peròn ( che era uno dei giovani ufficiali del Gou, ovvero Grupo Obra de Unificacìon, una di quelle conventicole militari, la cui politica era fondata principalmente sull’obiettivo di liberare l’Argentina dalla dipendenza economica inglese) assunse la direzione, con l’incarico di trasformarla in una Segreteria, del Lavoro e della Previdenza sociale. Le idee politiche di Peròn non volevano limitarsi a conseguire l’indipendenza economica dall’Inghilterra. Peròn voleva trasformare l’Argentina in una nazione “economicamente libera, socialmente giusta e politicamente sovrana”. Riunì al suo fianco, alla Segreteria, uomini come Cipriano Reyes, un sindacalista, capo della C.G.T. (Confederacion General de Trabajo); José Figuerola, che gli avrebbe redatto tutto quanto si riferiva alla riforma sociale e ai piani quinquennali; Miguel Miranda, abile economista, che Jaruteche definì “grande argentino” per il magnifico programma di riforme economiche; Atilio Bramuglia, ministro degli Affari Esteri durante la prima presidenza Peròn, il colonnello Mercante, uno dei suoi collaboratori più fedeli che nei primi anni di governo poté essere considerato il delfino di Peròn, Cereijo, presidente della Banca Centrale, che diventò ministro delle Finanze, Borlenghi, ministro degli Interni; e infine il dottor Carrillo, ministro della Sanità, gabinetto che prima non esisteva e dal quale vennero promosse importanti campagne che sfociarono in un sensibile miglioramento dell’igiene e della salute degli argentini. Durante questi primi mesi d’attività alla Segreteria, Peròn adotta così una serie di misure che faranno fare all’Argentina spettacolari balzi in avanti nel settore della sicurezza sociale. Venne stabilito il principio del salario minimo, venne data la pensione dello stato a circa due milioni di lavoratori, si crearono i tribunali del Lavoro che garantivano parità di diritti tra datori di lavoro e lavoratori nei conflitti sociali, vennero istituite le commissioni paritetiche, con lo Stato cioè in qualità di mediatore. Inoltre fu emanata un’apposita legislazione per gli incidenti sul lavoro, le malattie professionali, la tredicesima mensilità, le ferie retribuite (già da allora di quattro settimane) e la durata della settimana lavorativa. A completamento del “pacchetto” venne poi formalmente riconosciuto lo stato giuridico dei sindacati, la cui costituzione era fortemente incoraggiata, i cui mezzi e le cui strutture furono notevolmente ampliati, consolidando definitivamente la natura riformista del sindacalismo argentino, dopo le precedenti tendenze anarchiche e nichiliste. Il 15 gennaio del 1944, la città di San Juan venne quasi totalmente distrutta da un terremoto. Città già povera, subì danni per un valore di 300 milioni di pesos e fu necessario evacuare i 50.000 abitanti sopravvissuti. Peròn, attraverso la sua Segreteria, organizzò tutti i soccorsi, l’evacuazione della popolazione e la riparazione dei danni. Peròn convocò una riunione di artisti del cinema, del teatro e della radio nella sede del Consejio Deliberante, allo scopo di organizzare uno spettacolo, la celebre festa del Luna Park, per raccogliere fondi destinati ai terremotati. Eva partecipò al grande avvenimento del Luna Park, nel quale vennero raccolti 21 mila pesos e Peròn dirà che “Il mondo si evolve verso i valori spirituali che trovano un baluardo negli artisti ai quali il popolo argentino deve il suo costante progresso”. Eva incontrò Peròn a questa festa, dove i biografi dicono che abbia avuto inizio la loro storia d’amore. Peròn la ricordò così: “Aveva la pelle bianca ma, quando parlava, il volto le si infiammava. Le mani diventavano rosse a forza d’intrecciarsi le dita. Quella donna aveva del nerbo”. Peròn schierandosi dalla parte dei lavoratori, fece avanzare quell’incendio, intraprese quel “cammino nuovo”, quel “percorso difficile”, quella “rivoluzione” di cui parlava Evita. Quella Rivoluzione Nazionale, i cui punti fondamentali erano: nazionalizzazione dei servizi pubblici, previdenza sociale, sovranità popolare, riforma agraria e organizzazione del lavoro. Sfidando così gli “uomini comuni” dell’oligarchia, gli “eterni nemici di tutto ciò che è nuovo, di ogni progresso, di ogni idea straordinaria”. Già il 16 giugno 1945 gli industriali avevano inviato un esposto al governo con il quale esigevano la rettifica della sua politica sociale. Naturalmente i sindacati reagirono in difesa della Segreteria. Nello scontro, le due forze si misurarono sullo steso terreno: la piazza. Cominciarono gli industriali con la Marcia della Costituzione e della Libertà che ebbe luogo il 17 settembre 1945. il governo dichiarò lo stato d’assedio e, per reazione, gli studenti occuparono numerose facoltà. Peròn affermò che era “naturale” che contro le riforme si fossero “sollevate “le forze vive” che altri chiamano “i pesi morti”. Ma chi erano queste “forze vive”? “La Borsa: cinquecento persone che vivono trafficando su quanto producono gli altri; o l’Unione degli Industriali: dodici signori che, come ben si sa, vivono imponendo la loro dittatura al Paese”. L’8 ottobre, un gruppo di allievi della Scuola Superiore di Guerra chiese al generale di brigata Eduardo Jorge Avalos, comandante della guarnigione di Campo de Mayo, di togliere a Peròn qualsiasi incarico. La richiesta arrivò al presidente Farrell, il quale si rese conto che, non accogliendola, avrebbe provocato inevitabilmente un sollevamento militare. Gli Stati Uniti, tramite l’ambasciatore Spruille Braden, diedero il loro appoggio a questa coalizione di industriali, studenti e militari. Ai loro occhi Però rappresentava un militare troppo rivoluzionario che esasperava l’atteggiamento dell’oligarchia. Peròn presentò, dunque, le proprie dimissioni scrivendo poche parole al presidente Farrell per comunicargli che si dimetteva “dalle cariche conferitegli di Vice – Presidente, di Ministro della Guerra e di Segretario di Stato al Lavoro e alla Previdenza sociale”. Il 10 ottobre Peròn rivolse un saluto d’addio ai 50.000 operai che lo acclamavano dinanzi alla sede della Segreteria: “Se la rivoluzione si fosse limitata a permettere comizi liberi avrebbe favorito esclusivamente un partito politico. Questo non poté, non può e non potrà essere mai il fine esclusivo della rivoluzione. E’ quanto avrebbero voluto alcuni politici per poter tornare; ma la rivoluzione incarna le riforme fondamentali che si è proposta di realizzare a livello economico, politico e sociale. Questa trilogia rappresenta la conquista della rivoluzione, che è ancora in marcia, e quali che siano gli avvenimenti, essa non potrà mai essere svilita nel suo significato più profondo. L’opera compiuta sinora è di una consistenza tale che non cederà di fronte a nulla, e viene riconosciuta non da quanti la denigrano, ma dagli operai che la sentono. Quest’opera sociale che soltanto i lavoratori apprezzano nel suo vero valore, dev’essere difesa da essi in tutti i campi. Ho approvato anche in decreto di straordinaria importanza per i lavoratori, riguardante gli aumenti salariali, l’instaurazione del salario mobile, cosa vitale e basilare, e la partecipazione ai profitti. Chiedo a tutti voli che portate nel cuore la bandiera delle rivendicazioni, di pensare ogni giorno della vostra vita che dobbiamo continuare a lottare ininterrottamente per quelle conquiste che sono gli obiettivi che porteranno la nostra repubblica alla testa delle nazioni del mondo. Ricordate e tenete ben impresso questo motto: “da casa al lavoro e dal lavoro a casa”, perché con esso vinceremo. Concludendo, non vi dico addio. Vi dico invece hasta siempre perché da oggi in poi starò con voi, adesso più che mai. E, infine, accettate questa raccomandazione che vi fa la Segreteria del “Lavoro e Previdenza”: unitevi e difendetela perché è la vostra e la nostra opera”. Quando un gruppo di ufficiali della Marina arrestò il colonnello e lo condusse a bordo della cannoniera Independencia, Eva si rivolse alla piazza e questa fu la sua prima importante azione politica. Il momento era storico ed Eva si lanciò nella lotta (“Bussai di porta in porta. In quel doloroso e interminabile peregrinare, sentivo ardere nel mio cuore la fiamma di un incendio, che annullava la mia assoluta piccolezza”), percorse in macchina i quartieri popolari chiamando gli operai allo sciopero (“A mano a mano che scendevo dai quartieri orgogliosi e ricchi verso quelli poveri e umili le porte si aprivano generosamente, con più cordialità”), partecipando ai preparativi del movimento – guidato da capi sindacali come Cipriano Reyes, Luis Gay e Luis Monzalvo – e al presidente Farrell non rimase che far rientrare Peròn dal confino nell’isola di Martin Garcia. Peròn apparve al balcone della Casa Rosada alle 11,10 di sera del 17 ottobre 1945 e nella moltitudine di operai, che aveva atteso per l’intera giornata scoppiò un’oceanica e interminabile ovazione, un solo grido si innalzò all’unisono dalle trecentomila bocche dei descamisados: “Peròn Presidente!”, “Peròn Presidente!”. Solo due mesi dopo Peròn ed Eva si sposarono con il matrimonio sia civile (il 22 ottobre 1945 a Junin) che religioso (il 10 dicembre a La Plata). Per Evita (così amava essere chiamata dal popolo) “descamisados” sarà la definizione – cito La Razòn de mi vida – che più si addice al peronista militante: “Sono descamisados tutti coloro che si trovavano nella Plaza de Mayo il 17 ottobre 1945; quelli che hanno attraversato a nuoto il Riachuelo provenienti da Avellaneda, dalla Boca e dalla provincia di Buenos Aires, quelli che in colonne allegre, ma disposti a tutto, anche alla morte, quel giorno indimenticabile sono sfilati per l’Avenida de Mayo”. “Ciò che spinse le masse verso Peròn – scrisse Jaruteche – non fu il risentimento, fu la speranza”. La situazione, nell’ottobre 1945, era perciò allarmante per l’oligarchia che costituiva un gruppo di enorme influenza economica, che dirigeva la vita politica del paese, erigendo barriere insuperabili a livello di comunicazione sociale. Venne costituito un fronte unico chiamato Uniòn Democratica (fronte vasto ed eterogeneo che comprendeva radicali, socialisti, comunisti, demo – progressisti e contava sull’appoggio dell’unione industriali), sotto la protezione dell’allora ambasciatore americano Spruille Braden, il quale era all’origine del Libro blu, pubblicato dal Dipartimento di Stato, che denunciava il nazismo di Peròn. Manovra particolarmente infelice per un diplomatico, la cui prima regola di condotta dovrebbe essere quella di non ingerirsi negli affari interni del paese di accreditamento. Peròn seppe, infatti, sfruttare questa gaffe e riuscì a porre il nazionalismo dei suoi compatrioti di fronte all’alternativa efficacemente espressa dalla formula “Braden o Peròn”.
Peròn, d’accordo con Cipriano Reyes, capo della C.G.T., creò il Partito Laburista Argentino, che consisteva in un “raggruppamento di lavoratori urbani e rurali il scopo è di battersi per l’emancipazione politica e sociale delle classi lavoratrici, migliorandone le condizioni di lavoro, elevandone il tenore di vita e per l’instaurazione nel paese della democrazia integrale”, cioè una “democrazia sociale”, derivante dal superamento di quella “democrazia liberale” che, in realtà, era espressione di élite e di potentati economici. Non a caso uno dei presidenti che successero a Peròn, Arturo Frondizi, sottolineò che l’unica forza reale e concreta che abbia cambiato il volto dell’Argentina è stato il peronismo e che “appartiene ad una distorsione europea l’idea che il peronismo non sia stata una forma democratica”. Nel programma vennero riprese le tematiche sui cui Peròn aveva già basato la sua azione di Segretario del Lavoro e della Previdenza sociale, e, in particolare, partecipazione degli operai agli utili dell’impresa, lotta alla speculazione, salario minimo garantito e indicizzato, indennità di disoccupazione, riduzione dell’orario di lavoro, lotta contro il caro – vita, nazionalizzazione dei mezzi di produzione, ridimensionamento del grande latifondo, con distribuzione della terra a piccole cooperative, controllo della grandi holding inglesi e americane presenti nel paese. Venne aggiunto, infine, su intelligente ispirazione di Evita, un ulteriore obiettivo, d realizzare in tempi brevi: l’estensione dei diritti politici alle donne, una misura che del rivoluzionario in un paese dove tradizionalmente l’elemento femminile viene tenuto ben lontano dalla politica e dalle grandi questioni economiche e sociali. Se gli uomini delusero Peròn, sua moglie e il suo Paese, l’Argentina, gli furono fedeli in modo difficilmente superabile. E per l’Argentina, per arricchirla, propose la creazione di grandi capitali che fossero frutto del lavoro e non della speculazione. E gli argentini scelsero naturalmente Peròn, il quale, il 24 febbraio 1946, con il fedele e scaltro Hortensio Quijano (un membro del partito radicale, che era stato ministro degli Interni e aveva avuto un ruolo decisivo negli avvenimenti del settembre e ottobre 1945) in qualità di candidato alla vicepresidenza, ottenne 1.479.511 voti contro 1.201.822 di Tamborini e di Mosca, notabili appartenenti all’ Uniòn Democratica, dando come risultato la vittoria peronista. Il trionfo ottenuto nelle elezioni aprì le porte della Presidenza a Peròn che assunse il potere il 4 giugno 1946. Evita, da allora, assunse un ruolo fondamentale. Non volle seguire “l’antico modello della moglie del presidente”. E’ chiaro, insomma, che Evita non si lasciò rinserrare dall’oligarchia nel ruolo di consorte del presidente della repubblica. Disse chiaramente nel suo libro La Razòn de mi vida: “Alcuni giorni dell’anno ero Eva Peròn [la moglie cioè del Presidente] e lo facevo molto bene. Tutto il resto del tempo ero Evita, l’ambasciatrice del popolo presso Peròn. Compito difficilissimo e richiedente sforzi continui … Se mi domandaste che cosa preferisco, la mia risposta sarebbe immediata e spontanea: mi piace di più il nome che mi dà il popolo. Quando un bambino mi dice Evita, mi sento madre di tutti i bambini, di tutti deboli e i diseredati della terra. Quando un operaio mi dice Evita mi sento compagna di tutti gli uomini che lavorano nel mio paese e nel mondo intero. Quando una donna della mia patria mi dice Evita mi sembra di essere sorella di quella e di tutte le donne dell’umanità …”. Evita, pur erssendo una donna di temperamento, che non si fermava né davanti alle parole, né davanti ai fatti, conosceva, tuttavia, i limiti della sua sfera d’azione che sapeva di non dover superare, e l’armonia fra i due fu, grazie al tatto di lei, costante fino alla fine. Peròn mantenne per sé il comando delle Forze Armate, la direzione della diplomazia, la direzione dell’economia e lasciò ad Evita la Segreteria del Lavoro, dove sbrigava le questioni coi dirigenti sindacali e incontrava i descamisados; faceva numerose visite e presenziava a inaugurazioni. Dell’equipe di Evita facevano parte Oscar Nicolini, nominato nel 1945 ministro delle Comunicazioni, e José Espejo, diventato, nel 1948, segretario della C.G.T., dopo l’uscita di scena di Luis Gay e di Aurelio Hernàndez. Nel 1947 venne intrapresa l’impresa più spettacolare: il viaggio in Europa di Evita. Il 6 giugno 1947 un quadrimotore Douglas DC4 dell’Iberia, messo a disposizione dalle autorità spagnole, decollò dall’aeroporto di Buenos Aires per portare in Spagna Evita Peròn. Il viaggio in Europa fu l’opportunità di presentare Evita a livello internazionale: con il fascino, la sua giovinezza, la vitalità, sarebbe stata certamente in grado di conquistare le simpatie e i cuori della vecchia classe dirigente europea, facendo uscire il suo paese dallo stato d’emarginazione nel quale l’Argentina si trovava a causa della volontà di liberarsi dalla dipendenza, sia economica che politica, dalla Gran Bretagna e degli Stati Uniti, nazionalizzando la rete ferroviaria (posseduta, fin dal 1907, da società britanniche) e quella telefonica (detenuta fin dagli anni ’20 dalla multinazionale americana ITT). Peròn volle mantenere fede alle promesse elettorali, realizzando queste prime riforme, approfittando di una congiuntura internazionale favorevole all’Argentina. Gli indicatori macro – economici prospettavano, infatti, un futuro di benessere e di sviluppo: la ricomposizione degli equilibri internazionali nel dopoguerra favoriva la collocazione delle esportazioni argentine nel mercato mondiale; la bilancia commerciale era in forte attivo ed il paese disponeva di ingenti risorse d’oro e di valuta estera; la situazione occupazione era buona; inoltre la scelta di una crescita basata sui comparti leggeri dell’industria, puntando cioè su un settore che produceva beni per il mercato anziché capitali, s’intendeva non penalizzare i consumi e, soprattutto, utilizzare il settore industriale come strumento di assorbimento della disoccupazione (se nel 1943 le persone occupate nell’industria erano 488.700, nel 1949 raggiungevano la cifra di 955.900, cioè i posti di lavoro erano aumentati di circa il 96%) e di redistribuzione del reddito in favore delle classi lavoratrici urbane. Infatti, il soli tre anni dal 1946 al 1949, il reddito reale aumentò di più del 40%, trainando i consumi interni. Evita arrivò in Spagna domenica 8 giugno, alle sette del pomeriggio, accolta dal generalissimo Franco, affiancato da sua moglie, dona Carmen Polo de Franco e da sua figlia, Carmen Franco Polo. All’aeroporto c’erano trecentomila madrileni in delirio che gridavano il suo nome. Un po’ più in là, un gruppo di ragazze della Falange agitava i fazzoletti. Dappertutto fiori e bandiere spagnole, rosso – giallo – rosso, e argentina azzurro – bianco – azzurro. Ricevuta dalla mani del generalissimo Franco la Grande Croce d’Isabella la Cattolica, che metterà in occasione del colloquio con Pio XII., Evita pronunziò, lunedì 9 giugno, nella piazza d’Oriente, un discorso breve ma efficace, in cui parlò solo di questioni sociali e di lavoratori, dicendo ciò che sentivano nella nuova Argentina, cercando di trasmettere la profonda aspirazione a una società nuova, nella quale “non vi siano né troppi ricchi né troppi poveri”, e la preoccupazione di rendere ogni giorno più concreta e reale, per ogni uomo e per ogni famiglia , la sicurezza della vita e la speranza di un costante miglioramento. Evita disse di essere venuta in Spagna non per formare “assi”, ma per tendere “arcobaleni di pace”, a portare un messaggio di speranza al Vecchio Mondo e anche un messaggio d’amore a tutti gli spagnoli da parte dei descamisados argentini. Più tardi la stessa Evita definirà questo ruolo con un’immagine altrettanto forte: “Sono il ponte che collega Peròn con il popolo. Attraversatemi!”. Il suo amore per i bisognosi la portò a voler visitare misere catapecchie dove vivevano donne malate e uomini senza lavoro. Evita, recandosi nelle principali località del paese, tenne una serie impressionante di interventi (a Madrid, in una scuola di orientamento professionale, a Granata, in una fabbrica, a Vigo, nella Casa del Pescatore) per esaltare l’instaurazione di “un ordine basato sulla giustizia sociale secondo i principi proclamati dal presidente Peròn, dove tutti possano godere di una giusta retribuzione; dove l’operaio possa vivere in condizioni di lavoro dignitose e possa conservare la sua salute, godere di benessere fisico e spirituale, proteggere la propria famiglia, innalzare il suo livello economico” affinché “nessuno soffra e nessuno si veda assediato da una terribile miseria”. Il 26 giugno 1947 lasciò la Spagna esclamando “Addio Spagna mia”. Purtroppo non altrettanto bene andarono le cose in Italia, Francia, Svizzera e Inghilterra: a Roma, l’ambasciata argentina era situata in piazza dell’Esquilino, di fronte alla sede di un sindacato italiano di ispirazione comunista e l’arrivo di Evita venne accolto da urla, parolacce e insulti terribili; a Parigi, la visita, pur essendo caratterizzata dalla migliore accoglienza ufficiale (sia da parte del presidente della Repubblica Vincent Auriol, che dal ministro degli Affari Esteri Georges Bidault), venne ridimensionata da numerosi ricevimenti privati, che mostrarono, come le autorità francesi si sforzassero di togliere ogni significato politico di “avvicinamento” tra i due paesi; a Berna un giovane svizzero aggredì Evita, lanciando dei sassi contro la sua macchina, rompendo il parabrezza e ferendo l’autista; la visita a Londra, fu annullata, perché la corte britannica si rifiutò di riceverla, proponendo, invece, che la visita avesse carattere privato. Proprio durante il viaggio di sua moglie in Europa, Peròn lanciò un messaggio di pace al mondo, affermando la sua teoria politica della “terza posizione”, elemento di stabilità, all’interno, tra lo sfruttamento capitalista e la disumanizzazione marxista e fattore di equilibrio, all’esterno, tra i due blocchi emersi dalla logica di Yalta: “… in questo momento è in corso una lotta tra il comunismo e il capitalismo … noi non vogliamo essere né contro l’uno né contro l’altro. Noi realizziamo nel nostro paese la dottrina dell’equilibrio e dell’armonia tra l’individuo e la collettività attraverso la giustizia sociale che rende dignità al lavoro, che armonizza il capitale, che eleva la cultura sociale … di modo che il noi sociale si realizza e si perfeziona attraverso l’io dell’individuo considerato come un essere umano …”. Infatti, un paese come la nuova Argentina era in grado di sfamare, con carne e grano, l’intero continente europeo lacerato e disorientato dalla recente guerra: “L’unico rischio che correrà il mondo in futuro è la fame ma noi abbiamo il cibo dei nostri campi”, ripeteva spesso Peròn. La fornitura di prodotti alimentari ai paesi belligeranti aveva consentito di accumulare già durante la guerra ingenti riserve in moneta estera. Inoltre le difficoltà di pagamento e di trasferimento delle valute intervenute nel periodo bellico, fecero sì che l’Argentina vantasse crediti non incassati nei confronti di diverse nazioni. Tra le quali c’era proprio la Gran Bretagna, che ancora nel 1946 non aveva saldato un debito di 150 milioni di sterline.
Deciso a portare avanti il proprio programma sociale e politico, Peròn adottò misure tipicamente keynesiane: : sussidio al credito, politica dei redditi, espansione della spesa pubblica e, di conseguenza, del deficit statale. Peròn giustificò, nell’ottobre del 1951, tale strategia con queste parole: “L’Argentina giustizialista dirige tutti i suoi sforzi verso al’affermazione della sovranità nazionale, cercando le basi per il sostenimento in una volontà popolare nitida ed internamente inattaccabile”. Infatti, la politica economica peronista aveva tra i propri obiettivi prioritari un rapido recupero di risorse che consentisse di realizzare una decisa redistribuzione del reddito in favore dei ceti urbani. Le cifre si riferivano al totale delle ore lavorative di un operaio nel 1949 che, messe a confronto con quelle del 1943, rivelavano un aumento del 16,6% mentre la retribuzione era superiore, rispetto a quella del 1943, del 388,5%. Peròn rafforzò la politica d’intervento diretto dello stato in economia con la costruzione di centrali idroelettriche e gasdotti, con l’ammodernamento delle reti di trasporto urbano ed extra – urbano, con l’istituzione della compagnia aerea di bandiera (le “Aerolìneas Argentinas”) e della flotta mercantile nazionale. Inoltre lo stato diventò anche produttore, gestendo con funzionari propri (spesso ufficiali e tecnici delle forze armate) l’industria bellica e le imprese del gruppo DINIE, costituito da società confiscate ai proprietari tedeschi all’indomani dell’entrata in guerra argentina, dichiarata il 27 marzo 1945, al fianco degli Alleati. Ma l’intervento che più d’ogni altro sancì la volontà innovatrice del nuovo governo fu la nazionalizzazione del Banco Central, che diventò la chiave di volta della politica economica di Peròn, tramite il controllo del Banco Industrial e dell’Instituto Argentino de Promocìon del Intercambio (IAPI). Quest’ultimo, cui venne assegnato il monpolio del commercio con l’estero, acquistava direttamente dai produttori a prezzo amministrato i beni destinati all’esportazione – tipicamente cereali e prodotti di macellazione – , rivendendoli a prezzo di mercato sulle piazze internazionali e trasferendo i profitti ottenuti al Banco Industrial, che li avrebbe trasformati in capitali da assegnare in prestito a tassi iper – vantaggiosi al settore industriale per approvvigionarsi di materie prime, quali combustibile, macchinari e pezzi di ricambio. Tra il 1945 e il 1948 il Pil aumentò del 29%, trainato dalla crescita dell’industria leggera (tessile e alimentare in primis, impoverendo però il settore agricolo, cioè quello che fu il motore stesso dello sviluppo), che fece registrare un picco del 12,1% nel 1947.
Una delle riforme più importanti e popolari intraprese da Peròn fu la concessione alle donne del diritto di voto. La legge 13010 venne approvata il 9 settembre da una storica seduta del Parlamento, davanti al quale Peròn spiegò che “il riconoscimento dei diritti politici della donna costituisce un atto di giustizia in quanto la donna coopera con i suoi sforzi e con la stessa energia dell’uomo alla difesa degli interessi e dei diritti collettivi sacrificando spesso anche la vita, la famiglia e la serenità; sarebbe quindi inconcepibile che rimanesse esclusa dalla difesa dei suoi stessi diritti e interessi”. Da parte sua Evita , il 23 settembre 1947, giorno della promulgazione della legge, completò così il pensiero del marito: “Mi tremano le mani al contatto dell’alloro che sancisce la vittoria, perché qui, sorelle mie, in pochi articoli concentrati è riassunta una lunga storia di lotte, di scontri e di speranze …”.
“Noi donne siamo le missionarie della pace. I sacrifici e le lotte sono riusciti finora solo a raddoppiare la nostra fede. Innalziamo, tutte assieme, questa fede e con essa illuminiamo il sentiero del nostro destino. E’un destino grande, appassionato e felice. Per farlo nostro e meritarlo, disponiamo di tre elementi incorruttibili e inalterabili: una fiducia illimitata in dio e nella sua infinita giustizia; una Patria incomparabile da amare con passione e un leader che il destino ha forgiato per affrontare vittoriosamente i problemi: il generale Peròn. Col voto e con lui contribuiremo alla perfezione della democrazia argentina”.
L’8 luglio 1949 fu creata ufficialmente la Fondazione di Aiuto Sociale Maria Eva Duarte de Peròn, istituzione la cui responsabilità “compete unicamente e esclusivamente alla sua fondatrice”, che rappresentò un concetto di giustizia sociale molto lontano dal modo d’intendere la carità a parte delle dame dell’oligarchia: era regolata da uno statuto in accordo con le norme stabilite dal Ministero della Giustizia. Erano membri fissi del suo Consiglio Direttivo il Ministro delle Finanze e il segretario generale della C.G.T. i consiglieri erano nominati per metà dalla fondazione, e i restanti da rappresentanti operai del sindacato. Mille scuole e diciotto pensionati furono costruiti in provincia. Gli alunni, circa tremila, venivano da famiglie che vivevano nei ranchos de adobe e dormivano per terra. Evita fece costruire anche dei quartieri per studenti a Còrdoba e a Mendoza. Ma le sue grandi passioni erano il Quartiere degli studenti di Buenos Aires, che occupava cinque blocchi di case, e la Città dei bambini Amanda Allen (un’infermiera della fondazione, morta in un incidente aereo mentre rientrava in Argentina dopo essere andata in soccorso delle vittime di un terremoto che aveva scosso l’Ecuador), inaugurata il 14 luglio 1949. Oltre alle colonie di vacanza create a Ezeiza, vicino a Buenos Aires, Evita fece costruire delle “unità turistiche” a Chapadmalal (non lontano da Mar del Plata), a Uspallata (Mendoza) e a Embalse Rìo Tersero (Còrdoba). Ognuna di queste comprendeva un centro alberghiero che poteva ospitare da tremila a quattromila persone, operai, pensionati, studenti. Soltanto a Buenos Aires la fondazione aveva costruito quattro policlinici. Altri centri simili furono inaugurati in nove province. A Termas de Reyes (Jujuy, nel Nord – ovest del paese) e a Ramos Mejia (nella periferia di Buenos Aires) furono costruite delle cliniche pediatriche. Purtroppo l’ospedale dei bambini di Buenos Aires e un altro a Corrientes, sul litorale argentino, furono abbandonati dopo la caduta del peronismo. Nell’agosto 1948 il ministero del Lavoro proclamò solennemente la Dichiarazione dei diritti degli anziani. Nel luglio 1950, al teatro Colòn, Evita pianse per la gioia di poter assicurare una vecchiaia serena agli anziani argenti argentini quando diede le prime mille pensioni ad altrettanti anziani. La casa di riposo di Burzaco, vicino a Buenos Aires si sviluppava su due ettari e poteva accogliere duecento persone in un ambiente caloroso, tanto che Evita in La Razòn de mi vida: (che pure scrisse quando la sua malattia era ormai una realtà) sognava del giorno in cui, forse, lei stessa avrebbe potuto abitarvi. E, ancora, furono creati altri centri che accoglievano donne senza lavoro e senza domicilio, finché non si fossero trovati loro l’uno e l’altro. Ma il fiore all’occhiello di Evita era il Pensionato dell’impiegata, sull’Avenida de Mayo, che accolse cinquecento donne venute a lavorare nella capitale. Tutte opere necessarie per accrescere il legame comunitario e solidaristico della gente. Questo fu un merito fondamentale della politica di Evita. La sua opera non era soltanto un impegno a favore dei più deboli, dei suoi descamisados , ma la volontà precisa di radicare nel profondo del suo popolo un legame molto forte, un senso di appartenenza che travalicasse ogni rivendicazione sociale, uno spirito di unione talmente forte da trasformare la popolazione argentina in un popolo unito: “Siamo un popolo che ha in mano il timone del proprio destino”, disse Evita “che è grande perché è popolare, che è degno perché è giustizialista , he è nobile perché è argentino e che è sublime perché c’è Peròn. E’ stato un miracolo che ha avuto conseguenze enormi a livello economico, politico e sociale. In primo luogo ha creato una giustizia sociale che ha riordinato i criteri distributivi, mobilitando le masse a favore delle grandi battaglie per l’indipendenza economica nazionale … Questa rinascita del nostro spirito che l’oligarchia non ha potuto vendere come ha venduto le nostre fonti di ricchezza, ha portato con sé la suprema dignità del lavoro e la definitiva liberazione dell’uomo. Abbiamo abbattuto con gioia i cupi orfanotrofi per innalzare le pareti chiare ed allegre della “Città dell’Infanzia”, dei convitti, dei policlinici, delle case – parcheggio, della casa dell’impiegata e dell’anziano, della “Città dello Studente”, delle città universitarie, delle colonie per le vacanze, delle case per la madre, delle scuole e delle mense popolari. On l scopa giustizialista abbiamo fatto piazza pulita delle capanne e delle baracche e abbiamo costruito quartieri operai, necessari per la dignità sociale delle nostre masse lavoratrici. Abbiamo esiliato l’elemosina per esaltare la solidarietà come criterio di giustizia. E continuiamo gioiosamente nella lotta perché il repmio è troppo grande e troppo bello per rinunciarvi. Questo premio è la felicità, il benessere e l’avvenire del nostro amato popolo descamisado”.
Il 26 luglio del 1949, mille donne si radunarono al Teatro Nazionale Cervantes di Buenos Aires dove si tenne il Primo Congresso del Movimento Peronista Femminile. Con la fondazione di questo movimento riemerse con forza la volontà di occuparsi delle donne, dei loro problemi, di seguirle da vicino. Questo rapporto, però, si è evoluta, è diventato politico. Evita volle rivoluzionare anche il ruolo delle donne nella vita politica argentina. Disse Evita a quel pubblico femminile: “le donne sono state doppiamente vittime di tutte le ingiustizie. In famiglia soffrivano più d’ogni altro membro perché si assumevano tutta la miseria, la desolazione e sacrifici per evitarli ai propri cari. Portate in fabbrica, subivano tutta la prepotenza padronale. Tormentate dalla sofferenza, stroncate dai bisogni, stordite dalle giornate estenuanti e dalle pochissime ore destinate al riposo, distrutte dai lavori domestici, le nostre compagne di allora – che in molti paesi del mondo sono le nostre compagne di oggi, anche se è vergognoso ricordarlo – non trovarono altra soluzione se non rassegnarsi di fronte all’accumulazione sempre maggiore degli insensibili e bastardi capitalisti. Come se non bastasse, il destino riservava loro un’altra sofferenza. Scoperte dall’industriale come forza – lavoro meno cara, le donne che lavorano diventano le concorrenti dei fratelli lavoratori, compiendo – costrette dalle circostanze e dal bisogno di mandare avanti la famiglia – i loro stessi lavori pur ricevendo un salario inferiore”. Nel 1949, quando le ingenti risorse valutarie accumulate durante la guerra andarono esaurendosi, la favorevole congiuntura esterna in cui mosse i suoi primi passi lo stato peronista cominciò ad invertirsi. La bilancia commerciale, dopo quattro anni consecutivi di surplus, fece registrare un deficit di 160 milioni di dollari, dovuto principalmente al ritorno alla normalità dei prezzi agricoli e della carne; lo sviluppo dell’industria leggera, inoltre, rese il paese sempre più dipendente da materie prime e semi – lavorati esteri, cosa che comportò l’ascesa dei costi di produzione e dei prezzi al consumo dei prodotti. La conseguenze ultime di questo processo fu il riaccendersi dell’inflazione, dal 13% del 1947 al 29% nel 1949. Per spiegare che il governo aveva la possibilità d’inaugurare una politica di austerità, davanti ad un comitato di 300 persone, in maggioranza donne, che, il 29 settembre 1950, fece visita a Peròn protestando contro il carovita e chiedendo misure contro gli speculatori, Peròn, ricorrendo a un’immagine forte, disse: “Se il governo volesse deflazionare lo otterrebbe in una settimana. Con le ferrovie abbiamo comprato 23.000 proprietà. Basterebbe venderle, raccogliere il denaro, portarlo alla Caja de la Conversiòn e bruciarlo, in tal modo la circolazione diminuirebbe di circa il 39, 40 e 50%. Ma dopo, chi vedrebbe più un peso? Chi troverebbe più un peso dopo aver rarefatto in questo modo i mezzi di pagamento?”.
Il 2 agosto 1951, una folla di duecento sindacalisti della C.G.T. chiesero a Peròn di accettare la candidatura alla rielezione presidenziale ed espressero il “vivo desiderio” che Evita fosse candidata alla vicepresidenza. Il 22 agosto fu la data fissata per annunciare la candidatura di Evita. Ma ciò non avvenne, l’esercito si oppose perché se Evita fosse stata eletta vicepresidente e se Peròn fosse morto prima di lei, Evita avrebbe preso il suo posto alla presidenza dell’Argentina e, dunque, al comando delle forze armate, come fece vent’anni dopo Isabelita Peròn. Il 31 agosto, Evita rinunciò alla candidatura alla vicepresidenza: “Ho solo un’ambizione personale, che il giorno in cui si scriverà il capitolo meraviglioso della storia di Peròn, di me si dica questo: c’era, al fianco di Peròn, una donna che si era dedicata a trasmettergli le speranze del popolo. Di questa donna si sa soltanto che il popolo la chiamava con amore Evita”. E un mese dopo questo messaggio radiofonico, Evita si mise a letto e comiciò a morire. E il paese stava morendo assieme a lei. il 1952 fu l’anno in cui la crisi raggiunse il suo culmine, anche per effetto delle avverse condizioni climatiche: la produzione agricola risultò del 15% inferiore all’anno precedente, il Pil calò del 6%, il tasso di inflazione sfiorò il 50%, mentre il salario reale diminuì tra il 1948 ed il ’52 di circa il 20%. Il 28 settembre 1951, proprio mentre stavano facendo a Evita una trasfusione di sangue data la sua estrema debolezza, il generale Benjamìn Menéndez si mise alla testa di un’insurrezione, che sarà facilmente domata. tesa a far crollare il governo peronista, ma le cui conseguenze matureranno nel 1955, il 16 settembre, con la Revoluciòn libertadora, diretta dal generale Lonardi, che pose fine al governo di Peròn. Le elezioni dell’11 novembre 1951 segnarono per il Partito Peronista (frutto della fusione tra il Partido Laburista, la Unión Cívica Radical Junta Renovadora e il Partido Independiente di Alberto Tessaire, che raggruppava i conservatori che appoggiavano Peròn) un vero trionfo. Peròn venne eletto per la seconda volta con 4.652.000 voti contro i 2.358.000 del suo avversario, Ricardo Balbin della Unión Cívica Radical. Un margine notevolmente superiore a quello della prima elezione che consentì ai peronisti di conquistare tutti i seggi del Senato e centrotrentacinque dei centoquarantanove seggi della Camera. Non bisogna poi dimenticare che, per la prima volta, votarono anche 3.816.654 donne, i cui suffragi andarono all’unico partito, cioè a quello peronista, che inserì delle donne nelle sue liste. Alla fine risultarono elette ventitre deputate e sei senatrici.
Il 3 novembre 1951 Evita fu ricoverata al policlinico Presidente Peròn, dove il ginecologo Humberto Dionisi le diagnosticò un carcinoma. All’inizio di novembre, il chirurgo George Pack, specialista del Memorial Cancer Hospital di New York, procedette a un’isterectomia totale. La vita di Evita si stava spegnendo, le restavano solo alcune gocce di vita e le offrì il 1° maggio, in un discorso carico di accenti di incredibile bellezza, l’ultima volta che Evita parlò in pubblico, sorretta dal marito sul balcone della Casa Rosada. “Miei cari descamisados. Ancora una volta siamo qui riuniti, lavoratori e donne del popolo; ancora una volta ci ritroviamo, noi descamisados, in questa storica piazza del 17 ottobre 1945 per dare la risposta al leader del popolo che questa mattina, a conclusione del suo messaggio, ha detto: “Chi vuole ascoltare, ascolti; chi vuole seguire, segua”. Ed è questa la risposta, o mio generale. E’ il popolo lavoratore, è il popolo umile della Patria che qui e in tutto il Paese si è levato in piedi ed è pronto a seguire Peròn, il leader del popolo, il leader dell’umanità, che ha innalzato la bandiera della redenzione e della giustizia delle masse lavoratrici; esso lo seguirà contro l’oppressione dei traditori interni ed esterni, che, nell’oscurità della notte, vogliono iniettare il loro veleno di vipere nell’anima nel corpo di Peròn, che è l’anima e il corpo stesso della Patria. Ma non ci riusciranno, così come l’invidia dei rospi non è riuscita a far tacere il canto del usignoli e le vipere non hanno impedito il volo dei condor”.
“Io chiedo a Dio di non permettere che degli insensati alzino la mano contro Peròn, perché guai a quel giorno! Quel giorno, mio generale, io marcerò alla testa dei descamisados per non lasciare interno nemmeno un sasso che non sia peronista. Noi non ci lasceremo schiacciare dallo stivale oligarca e traditore dei “vendipatria” che hanno sfruttato la classe lavoratrice. Noi non ci lasceremo più sfruttare da quelli che, vendutisi per quattro soldi, servono i padroni stranieri e consegnano il popolo della loro Patria con la stessa tranquillità con cui hanno venduto il loro Paese e le loro coscienze”.
“Ma noi siamo il popolo, e io so che il popolo sta all’erta, siamo invincibili, perché noi siamo la Patria”.
E’ una dichiarazione di guerra, ma Evita, la grande lottatrice era colpita a morte.
Evita si spense dolcemente, respirando appena. Poi emise un sospiro e il suo cuore si fermò. La sua morte fu annunciata ufficialmente il 26 luglio 1952 alle 8,30 di sera. Una terribile solitudine avvolse l’Argentina. Una solitudine che non si dissipò nemmeno al ritorno di Peròn in patria, dopo vent’anni di esilio. Evita presagì bene l’avvenire del suo Paese quando gridava e piangeva nell’agonia: “Chi, ma chi si prenderà cura dei mie poveri?”.
GINO SALVI
BIBLIOGRAFIA
Evita, un mito del nostro secolo, di Alicia Dujovne Ortiz, 1995, Mondatori.
Chiamatemi Evita, di Carmen Llorca, 1984, Mursia.
Evita Peròn, la madonna dei descamisados, di Domenico Vecchioni, 1995, Eura Press.
La ragione della mia vita, introdotto da Vanni Blengino, 1996, Editori Riuniti.
Evita, il mio messaggio, introdotto da Joseph A. Page, 1996, Fazi.
L’Argentina da Peròn a Cavallo (1945-2002), di Francesco Silvestri, 2003, Clueb
00:05 Publié dans Histoire, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, argentine, amérique latine, amérique du sud, evita peron, péronisme, populisme, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 07 avril 2011
La visione "corporativa" di Ugo Spirito
 Nel 1935, il filosofo Ugo Spirito (Arezzo, 1896 – Roma, 1979) presentava al Convegno di studi corporativi di Roma la sua relazione – intitolata Corporativismo e libertà – con la quale esprimeva la convinzione che la sfida al capitalismo dovesse essere vinta tanto sul piano tecnico quanto su quello spirituale, marcando una superiorità di tipo gerarchico-totalitario “in cui i valori umani si differenzino al massimo”. La concezione corporativistica di Spirito è infatti una visione, poiché non si derubrica a semplice metodologia, a insieme di processi di funzionalità tecnica, ma si eleva a momento spirituale nel quale la vita sociale si unifica moralmente “nella gioia del dare e del sacrificarsi”; in buona sostanza nel rifiuto di ogni fine privato dell’esistenza. In uno scritto del 1934, significativamente intitolato Il corporativismo come negazione dell’economia, Spirito afferma chiaramente che il corporativismo “non è economia, ma politica, morale, religione, essenza unica della rivoluzione fascista”. E proprio per questa ragione egli parlò di “comunismo gerarchico”, dove il primo termine va inteso in un senso assai distante da qualsiasi dogmatismo marxista-bolscevico; mentre il secondo rimanda alla libertà caratterizzata dal diritto al lavoro che seleziona un’èlite umana in grado di accedere ai vertici della comunità. Il comunismo inteso da Spirito è stile di vita più che sistema politico. Come scriverà nel 1947 in Filosofia del comunismo: “…Il comunismo può dare luogo ad istituzioni sociali e giuridiche…Può tendere ad una vita collettiva in cui il criterio di distribuzione dei beni sia fissato in funzione della produttività di ognuno; può eliminare le sperequazioni più gravi della vita attuale e le forme più chiare di sfruttamento. Ma detto questo risulta altresì è evidente che il comunismo può realizzarsi prima e senza la trasfigurazione della società, [può realizzarsi] in quella più profonda società che è in ognuno di noi – la societas in interiore homine – e che da noi soltanto acquista valore”. Il comunismo di Spirito è quindi più platonico che marxista, nell’affermazione che questo può realizzarsi prima e senza la rivoluzione delle strutture socio-economiche, in quanto rivoluzione interiore delle coscienze. Ma a questo proposito, Ugo Spirito chiarisce ulteriormente il suo punto di vista “Quando spontaneamente e gioiosamente rinuncio al di più, so di avere realizzato, anche nel mezzo del più anticomunistico regime politico, l’ideale del comunismo. Ideale che può sussistere non soltanto in un solo Paese…ma anche e soprattutto in un solo uomo, vale a dire nella coscienza del singolo; là dove può rivelarsi nella pura spiritualità”. Di qui l’apparentemente paradossale affermazione che non è il proletariato a costituire la forza realizzante l’avvento della società comunista – dato che esso aspira in fondo solo al comfort borghese. Soltanto il borghese che ha preso coscienza della metafisica comunista –cioè di una coscienza anticonsumistica – può rappresentare la forza trainante della Rivoluzione.
Nel 1935, il filosofo Ugo Spirito (Arezzo, 1896 – Roma, 1979) presentava al Convegno di studi corporativi di Roma la sua relazione – intitolata Corporativismo e libertà – con la quale esprimeva la convinzione che la sfida al capitalismo dovesse essere vinta tanto sul piano tecnico quanto su quello spirituale, marcando una superiorità di tipo gerarchico-totalitario “in cui i valori umani si differenzino al massimo”. La concezione corporativistica di Spirito è infatti una visione, poiché non si derubrica a semplice metodologia, a insieme di processi di funzionalità tecnica, ma si eleva a momento spirituale nel quale la vita sociale si unifica moralmente “nella gioia del dare e del sacrificarsi”; in buona sostanza nel rifiuto di ogni fine privato dell’esistenza. In uno scritto del 1934, significativamente intitolato Il corporativismo come negazione dell’economia, Spirito afferma chiaramente che il corporativismo “non è economia, ma politica, morale, religione, essenza unica della rivoluzione fascista”. E proprio per questa ragione egli parlò di “comunismo gerarchico”, dove il primo termine va inteso in un senso assai distante da qualsiasi dogmatismo marxista-bolscevico; mentre il secondo rimanda alla libertà caratterizzata dal diritto al lavoro che seleziona un’èlite umana in grado di accedere ai vertici della comunità. Il comunismo inteso da Spirito è stile di vita più che sistema politico. Come scriverà nel 1947 in Filosofia del comunismo: “…Il comunismo può dare luogo ad istituzioni sociali e giuridiche…Può tendere ad una vita collettiva in cui il criterio di distribuzione dei beni sia fissato in funzione della produttività di ognuno; può eliminare le sperequazioni più gravi della vita attuale e le forme più chiare di sfruttamento. Ma detto questo risulta altresì è evidente che il comunismo può realizzarsi prima e senza la trasfigurazione della società, [può realizzarsi] in quella più profonda società che è in ognuno di noi – la societas in interiore homine – e che da noi soltanto acquista valore”. Il comunismo di Spirito è quindi più platonico che marxista, nell’affermazione che questo può realizzarsi prima e senza la rivoluzione delle strutture socio-economiche, in quanto rivoluzione interiore delle coscienze. Ma a questo proposito, Ugo Spirito chiarisce ulteriormente il suo punto di vista “Quando spontaneamente e gioiosamente rinuncio al di più, so di avere realizzato, anche nel mezzo del più anticomunistico regime politico, l’ideale del comunismo. Ideale che può sussistere non soltanto in un solo Paese…ma anche e soprattutto in un solo uomo, vale a dire nella coscienza del singolo; là dove può rivelarsi nella pura spiritualità”. Di qui l’apparentemente paradossale affermazione che non è il proletariato a costituire la forza realizzante l’avvento della società comunista – dato che esso aspira in fondo solo al comfort borghese. Soltanto il borghese che ha preso coscienza della metafisica comunista –cioè di una coscienza anticonsumistica – può rappresentare la forza trainante della Rivoluzione.
Spirito contro la ‘Carta del Lavoro’ del 1927
Per questo Ugo Spirito percepì come insufficiente la ‘Carta del Lavoro’ del 1927 che conservava gli aspetti di quel mondo borghese-capitalistico contro cui il fascismo, ispirandosi ad un’altra Carta, quella del Carnaro, era sorto. Il fascismo nasceva infatti per contrapporsi all’’individuocrazia’ liberale, affermando l’immanenza dello Stato nelle singole parti che lo compongono. Tuttavia, tentando di conciliare la proprietà privata con il dovere di metterla al servizio della collettività – al di là della reale capacità e volontà politica di trovare la giusta sintesi a tutto ciò – di fatto cedeva alla superiorità della prima, il cui diritto rimaneva intangibile. Nel Convegno di Ferrara del 1932, Spirito propose di tagliare il nodo di Gordio con la spada della “corporazione proprietaria”: tesi con la quale si affermava che la proprietà privata dei mezzi di produzione doveva passare alla corporazione intesa come corpo sociale intermedio tra individuo e Stato. In questo modo la Rivoluzione fascista avrebbe superato quella francese e la sua egoistica rivendicazione della proprietà privata, con un concetto di proprietà non più volto a fare di essa un inalienabile e assoluto diritto dell’individuo, ma una funzione utile all’interesse della Nazione. Concezione che in parte il fascismo faceva propria se pensiamo che la legge sulla Bonifica integrale autorizzava la revoca della proprietà qualora questa fosse stata lasciata inattiva. In ogni caso, se la ‘Carta del Lavoro’ aveva giustapposto l’interesse pubblico e quello privato, la tesi di Spirito tendeva a fonderli nell’identità di capitale e lavoro, di sindacalismo e proprietà. Con la corporazione “proprietaria”, il capitale sarebbe infatti passato dagli azionisti ai lavoratori, i quali avrebbero acquisito la proprietà in base a meriti gerarchici determinati da competenza e impegno.
L’’eresia’ di Ugo Spirito venne immediatamente tacciata di bolscevismo. Reazione abbastanza scontata, anche perché lo stesso filosofo chiuse la sua relazione ferrarese dichiarò che la proposta da lui fatta andava verso un certo tipo di ‘socialismo nazionale’. Se l’oggi vedeva contrapposti Fascismo e Bolscevismo, il domani sarebbe stato di quel sistema che avrebbe saputo non negare l’altro, ma incorporarlo e superarlo in una forma più elevata. Ragione per cui “il Fascismo ha il dovere di fare sentire che esso rappresenta una forza costruttrice storicamente all’avanguardia, capace di lasciarsi alle spalle, dopo averli riassorbiti, Socialismo e Bolscevismo”. Chiuse il convegno il ministro Giuseppe Bottai (1895 –1959) che difese l’autonomia di corporazione, sindacato, impresa e Stato che Spirito voleva fondere nella già citata ‘corporazione proprietaria’; ma che nel contempo prese le distanze da quelli che, indossata la “maschera di cartone” del liberalismo, consideravano conclusa la sperimentazione corporativa.
Il periodo della ‘rielaborazione’
Negli anni successivi, Ugo Spirito abbandonò la tesi ‘eretica’ sostenuta a Ferrara, pur riaffermando costantemente il carattere pubblicistico della proprietà e dichiarando un controsenso il concepirla privatisticamente. Tanto più che la fondazione dell’IRI sembrò a tutti gli effetti un passo avanti verso il riconoscimento della proprietà come res pubblica, attraverso un deciso intervento dello Stato in economia. Ancora nel 1941, Spirito scriveva in Guerra rivoluzionaria (rimasto inedito fino al 1989) che la Rivoluzione fascista non avrebbe mai condotto ad un comunismo ‘livellatore’, figlio diretto delle democrazie liberali: “Non aristocrazia ereditaria e neppure il suo astratto opposto segnato dalla democrazia maggioritaria, bensì la gerarchia di tutti continuamente formantesi e rinnovantesi nell’assolvimento delle funzioni sociali, dalle più elevate e complesse alle più umili e semplici. Non comunismo, dunque, fondato sul peso della massa come numero, ma ‘comunismo gerarchico’, ossia collaborazione di tutti all’opera comune, determinata in ogni suo aspetto con il solo criterio della competenza”. Proprio in quell’anno, tuttavia, il nuovo Codice civile stabiliva sì la funzione sociale della proprietà, ma ne tutelava comunque il carattere privatistico. La necessità di conseguire scopi sociali veniva affidata dunque all’impulso individuale e all’iniziativa del proprietario secondo la nota favola liberale, stando alla quale dall’interesse privato di alcuni nascerebbe l’utile per tutti. Nulla di strano però, se consideriamo i mille compromessi con le forze borghesi e clericali, con i grandi gruppi finanziari che certamente trovavano sponda e sostegno nella monarchia “borghese” dei Savoia, ai quali era ormai costretto il fascismo. Quando però la trahison des clercs – cioè il vero o presunto abbandono del fascismo da parte della borghesia – e il tradimento del re fecero venire meno la ragione stessa dei compromessi, fu però possibile un’accelerazione dell’evoluzione del sistema corporativo in direzione delle tesi di Spirito. Ma ciò avvenne troppo tardi, soprattutto in quanto il regime aveva ormai di fronte un ostacolo nuovo, oltre che poco disposto a compromessi: la Germania. La necessità da parte di quest’ultima di trasferire in patria lavoratori italiani e di utilizzare pure le industrie ubicate in Nord Italia per le proprie necessità, comportò l’opposizione del generale Hans Leyers, capo della Commissione Guerra e Armamenti del Nord d’Italia, al processo di socializzazione.
Fu comunque significativo che il ‘Manifesto’ di Verona venne redatto dal segretario del partito Alessandro Pavolini insieme con Nicola Bombacci, e rivisto infine dal duce. Nel documento si parlò di socializzazione, ovvero della cooperazione delle forze del lavoro nella gestione delle imprese, eliminando così il dualismo tra lavoratori e datori di lavoro. Nella sostanza, l’obiettivo era certo quello di un miglioramento delle condizioni di vita degli operai delle industrie – il cui appoggio risultava fondamentale anche per la Repubblica Sociale Italiana – anche se attraverso la ‘socializzazione’ si riproponeva di realizzare una nuova concezione del lavoro, capace di sviluppare un senso di appartenenza, di solidarietà, di responsabilità. Un ethos capace di rivoluzionare il rapporto tra cittadini e quello tra popolo e Stato. Il lavoro si sarebbe ‘spiritualizzato’ poiché il peso fondamentale non sarebbe stato più attribuito alla semplice materialità del possesso dei mezzi di produzione. Ed era poi il senso di quanto il filosofo Giovanni Gentile, maestro di Spirito ebbe a dire in Genesi e struttura della società a proposito dell’Umanesimo del lavoro. Detto ciò, occorre riconoscere che la “corporazione proprietaria” di Spirito si spinse oltre la stessa socializzazione che, in ogni caso, avrebbe conservato il principio della proprietà privata intesa come beneficio esclusivo del capitalista.
Il ruolo sociale ed etico della Corporazione
Spirito attribuiva infatti la proprietà dei mezzi di produzione alla corporazione, affermando che la stessa produzione, avendo un ruolo sociale, non avrebbe potuto di conseguenza essere abbandonata all’arbitrio individuale del proprietario. La tesi di Spirito eliminava dunque ogni rischio; ma la socializzazione lasciò però uno spiraglio di cui i capitalisti del Nord seppero approfittare. Essa ebbe comunque il merito di introdurre principi di quel ‘socialismo nazionale’ auspicato da Spirito, riconsegnando dignità spirituale al lavoro e al lavoratore, nel rifiuto di ogni materialismo marxistico, di ogni determinismo storico e della lotta di classe. A guerra conclusa, il CNLAI dominato dai comunisti decretò l’abrogazione della legge sulla socializzazione delle imprese. E mentre il bolscevismo non abolì il capitalismo, la ‘socializzazione’ ebbe il merito di sapere ipotizzare un ‘socialismo nazionale’ assai prossimo alla Volksgemeinschaft, la Comunità di popolo tedesca. Un organismo in grado di eliminare ogni antagonismo di classe e capace di realizzare nelle aziende un modello di Stato nazionalsocialista. Ma la fine del Secondo Conflitto fece naufragare anche questo tentativo rivoluzionario, consentendo al mondo borghese-capitalistico si riappropriarsi dei suoi privilegi. Tuttavia, pochi anni dopo in Filosofia del comunismo, Spirito scriveva ancora: “…la civiltà liberale e borghese ha potuto fare della libertà il monopolio di una classe solo a patto che i molti non liberi ne pagassero il prezzo; ma se oggi la stessa libertà vuole essere rivendicata da tutti, sì che nessuno resti a condizionarne il privilegio, la lotta di classe si muta in lotta di gruppi e di individui, tutti al privilegio anelanti e tutti impegnati nella corsa degli egoismi più sfrenati. La presunta libertà diventa il principio della disgregazione, dell’atomismo e del conseguente caos, del quale già si avvertono i segni premonitori. Perché a questa logica sia dato sottrarsi, occorre vivere di un’altra fede, credere in un nuovo mondo sociale, che vada al di là del liberalismo e realizzi nella comunità degli uomini un ideale che non sia quello del tornaconto del singolo e del calcolo economico di chi guarda alla propria persona come centro del mondo”. Negli anni successivi, questa fede prese per Spirito sempre più il nome di comunismo; ma nonostante una sua certa ammirazione per il mondo sovietico (che ebbe modo di visitare in un viaggio di appena un mese), il comunismo di Spirito si identificava pur sempre in una forma di ‘corporativismo antindividualistico’ e antimaterialistico che con il realismo sovietico non aveva proprio nulla da spartire.
Rielaborazioni. La ‘nuova religione’
Nello scritto del 1958, Cristianesimo e comunismo, Spirito vide nel socialismo e nel comunismo addirittura i veri continuatori della ‘rivoluzione cristiana’ in virtù della rivendicazione della dignità del lavoro nelle sue forme più umili e per la definitiva negazione della proprietà privata, caposaldo della rivoluzione borghese. Il comunismo avrebbe realizzato ciò non con la lotta di partito e con le sue rivendicazioni – che Spirito giudicava mere continuazioni del mondo borghese – ma trasformandosi in ‘nuova metafisica’ e ‘nuova religione’ fondata sul rifiuto dello stesso principio individualistico. Un ideale compiuto che avrebbe consegnato alle coscienze un programma che “nasce dalla collaborazione di tutti, come ragione d’essere di una vita comune” in cui la volontà di ognuno si risolve nella volontà sociale. “Nessuno appartiene più a se stesso perché ognuno diventa soltanto parte di un organismo e dell’organismo acquista il carattere superiore, la forza, la coscienza e la finalità”. Ora, agli inizi del XXI secolo, dove il principio individualistico e il privilegio borghese sembrano avere trionfato ovunque, al di là del nome che ognuno di noi attribuisce alla ‘nuova fede’ di cui parla Spirito, non si può tralasciare di realizzarla dentro di noi, affinché la civiltà europea possa ancora guardare al futuro con un briciolo di speranza.
Rodolfo Sideri
00:05 Publié dans Histoire, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, philosophie, théorie politique, sciences politiques, politologie, italie, corporations, corporatisme, sociologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 04 avril 2011
Un texte prophétique de 1925
Un texte prophétique de 1925
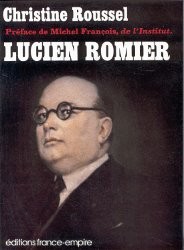 « Pour son idéal comme pour son bien-être, c’est donc en soi que l’Europe doit chercher le salut.
« Pour son idéal comme pour son bien-être, c’est donc en soi que l’Europe doit chercher le salut.
Voudra-t-elle se sauver ? Une telle volonté exigerait de sa part de grands redressements. Car l’Europe glisse aujourd’hui avec complaisance sur la pente d’un général abandon.
Elle y glisse, entrainée par la double loi de l’égoïsme individuel et du moindre effort. Elle y glisse, croyant poursuivre un idéal nouveau qu’elle appelle « démocratique ». En réalité, elle vit de ses restes, aussi incapable d’adopter les dures lois de la morale païenne et naturelle que de revenir à la morale chrétienne. Rien de plus frappant que son égale impuissance à pratiquer la solidarité ou la fraternité entre les hommes et à y substituer une véritable lutte des classes. L’Européen est aujourd’hui trop détaché de la charité chrétienne pour faire du bien à son semblable, mais il n’a pas atteint ce degré de logique naturelle qui commande la suppression de l’individu dangereux ou des bouches inutiles. Par quoi il laisse périr le faible ou le juste, il supporte le méchant et il entretient le paresseux. L’ancienne Europe avait fait un compromis de la morale de l’amour et de la morale du glaive. L’Europe actuelle a perdu l’amour et n’ose se servir du glaive.
Or les peuples nouveaux auxquels nous avons fourni les moyens techniques de devenir forts et, partant, de propager ou d’imposer leurs façons de vivre, n’ont jamais connu, eux, la morale de l’amour telle que nous l’avons connue. Ils n’ont donc pas les timidités que nous avons gardées. Ils ne connaissent, sous des inspirations diverses, que la morale de la force ou du glaive. Quelle leçon nous donne, à cet égard, le mépris des Russes, mi-Européens mi-Asiatiques, pour la Démocratie ! Chez eux, la Révolution ne fut pas une revanche d’individus, mais une revanche de classes. Ailleurs, par exemple au Japon, les techniques modernes servent une féodalité. Les seigneurs de l’Atlas marocain voyagent en automobile, mais assistés d’esclaves… Quelque estime que nous portions aux Américains, nous devons bien constater qu’ils lynchent les noirs.
Voilà qui procurerait à l’Europe d’étranges surprises si, demain ou après-demain, la vie de ses habitants dépendait du gré d’un autre continent ».
Lucien ROMIER.
(extrait du livre : Explication de notre temps, Grasset, Les Cahiers Verts (sous la direction de Daniel Halévy), n°48, Paris, 1925).
00:05 Publié dans Histoire, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, histoire, idée européenne, europe, france |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 01 avril 2011
La Bandera Irlandesa del Tercio - 1936-1937

La Bandera Irlandesa del Tercio, 1936-1937
por José Luis de Mesa, 1999
Autor de, entre otras obras, Los otros internacionales. Voluntarios extranjeros desconocidos en el Bando Nacional durante la Guerra Civil (1936-39), Barbarroja, Madrid, 1998.
Antecedentes
La sublevación del 17 de julio de 1936 y los acontecimiento que se producen en nuestro país en los meses siguientes sobre todo en la zona denominada republicana y que muchas veces se concretan en la persecución y muerte de sacerdotes, monjas y fieles católicos por el simple hecho de serlo y en la destrucción de iglesias e imágenes tienen honda repercusión entre los habitantes de un pequeño país europeo, que había alcanzado hacía poco su independencia y que se encontraba unido al nuestro por relaciones multiseculares. Me refiero al Estado Libre de Irlanda.
La población irlandesa, en su gran mayoría católica se conmociona a medida que se va enterando de lo que sucede en España y se vuelca en ayudas destinadas al ejército que para ellos defiende la fe y la religión católicas. Así, el 22 de agosto la prensa da la noticia de que “Los Camisas Verdes de Irlanda han enviado la primera expedición de elementos de la Cruz Roja para España. Forman la expedición médicos, enfermeras y abundante material sanitario” [1] y para el 24 de octubre se recibe en el bando nacional el dinero obtenido en una colecta llevada a cabo en la isla en favor de la Iglesia Católica de España, que recauda un millón y medio de pesetas de la época y que enviada al cardenal Gomá, destinó éste a la compra de material sanitario para el Ejército Nacional.
Mientras tanto en la isla un político que a la vez había sido general, Eoin O’Duffy, aprovechando que lidera un partido político de cierta importancia de corte neofascista, y de que goza de prestigio entre sus conciudadanos también por haber sido jefe de la Policía primero y más tarde de la Guardia Nacional irlandesas, concibe el proyecto de ayudar también con hombres a los nacionales y para ello se dirige a nuestro país, al que llega el 26 de septiembre de 1936 y tras entrevistarse en Pamplona con la Junta de Guerra Carlista y con la Diputación Foral, al día siguiente marcha a Burgos donde se entrevista con el general Mola sin llegar a alcanzar resultado práctico alguno. [2] Incluso antes de venir a España O’Duffy había dirigido una circular a sus partidarios, distribuida antes del 16 de septiembre entre los mismos, en la que se decía a los que se habían ofrecido para luchar en nuestro país que estuviesen preparados para ello. [3]
Pese a su inicial fracaso y mientras prosigue en su país la actividad reclutadora de voluntarios, el irlandés vuelve al nuestro y tras varias entrevistas con Franco, ambos generales el 28 de noviembre llegan a un acuerdo mediante el cual se formarían varias banderas del Tercio con voluntarios irlandeses, [4] las cuales podrían alcanzar el número de ocho con un total de 5.000 hombres. Contarían con su propio personal médico, enfermeras, capellanes y cocineros. Los mandos serían hispano-irlandeses, si bien en cada bandera para encuadrar a los voluntarios habría oficiales, suboficiales, cabos y soldados españoles que hablasen inglés.
En el acuerdo se hace especial hincapié en el hecho de que los irlandeses son católicos fervientes y practicantes que no serían empleados contra los nacionalistas vascos por ser éstos también católicos. Incluso se llega a plantear que el número de voluntarios fuese tan elevado que se pudiese constituir una columna con predominio irlandés que sería mandada por un jefe de dicha nacionalidad: y se apuntala posibilidad de que O´Duffy pudiese traer varios miles de voluntarios irlandeses. Finalmente las banderas dependerían del coronel inspector del Tercio si bien al general irlandés se le reconoce una inspección especial con el grado de general de brigada.
Concluido el acuerdo la Inspección del Tercio planifica el organigrama de la bandera que se compondría de un comandante-jefe, 10 capitanes, 7 tenientes, 14 alféreces, un médico, 53 sargentos, un maestro-armero, 2 cabos y 590 voluntarios. De ellos, 2 capitanes, 2 tenientes, 6 alféreces, 7 sargentos, un maestro-armero, 2 cabos y 3 legionarios serían españoles o procedentes del Ejército Nacional pues en el existían extranjeros que podían ser destinados a aquella por su origen o dominio del inglés.
Las expediciones
Los irlandeses empezaron a salir hacia España en pequeños grupos a partir del 13 de noviembre, antes de que se formalizasen los acuerdos pues O´Duffy quiso obligar a los mandos nacionales a aceptar sus propuestas valiéndose de hechos consumados. En la primera de ellas, que salió del puerto inglés de Liverpool, parten diez voluntarios, en su mayor parte antiguos oficiales del I.R.A (Ejército Republicano Irlandés) que constituirán los cuadros de mando de la unidad. A la semana siguiente sale la segunda expedición a cuyo frente figura el coronel Patrick Dalton, que fue el primero en mandar la bandera irlandesa en nuestro país y con él parten doce oficiales, el oficial médico Peter O´Higgins y el capellán S. Gillan. El viaje se realiza en barco hasta Lisboa, después en autobús hasta Badajoz para terminar en Cáceres, que serviría de base para formar la unidad.
El 27 de noviembre parte la tercera expedición desde Liverpool con 84 voluntarios entre los que figuraban al menos tres oficiales, el capellán-capitán Seamus Mulream; cuando llegaron a la capital extremeña a principios de diciembre el número total de irlandeses que había en ella asciende a 21 oficiales y 123 soldados, [5] número que no se corresponde con los fragmentariamente citados basados en los números facilitados por O´Duffy en su libro y que ascendían a 109 hombres en total, por lo que hay un exceso de 35 que podrían haber llegado en alguna otra expedición no computada o ser irlandeses que ya luchaban en unidades españolas con anterioridad y que fuesen remitidos a Cáceres para encuadrar como veteranos a sus compatriotas lo cual no sería de extrañar pues voluntarios de Eire había desde el principio de la guerra en unidades como la Columna Sagardía en la divisoria de Burgos y Santander, o en la que en principio se denominó Tercio Sanjurjo en tierras aragonesas o en unidades del Requeté como el capitán O’Farrill.
La última expedición, esta vez multitudinaria, salió del puerto irlandés de Galway en un buque alemán, que según la documentación oficial transportó un oficial y 520 voluntarios, aunque autores como el inglés Peter Kemp aumentan, su número a 650. [6] El viaje, con independencia del número exacto de voluntarios, no fue nada cómodo ni agradable para los voluntarios ya que el barco carecía de elementos como agua y los hombres viajaron hacinados y casi sin recibir alimentación. Al llegar a El Ferrol se les desembarcó trasladó a Cáceres en tren, previa parada en Salamanca, pero el viaje tampoco fue satisfactorio y se produjeron leves incidentes con cierto carácter cómico pero que presagiaron que la aventura de los irlandeses en España no iba a terminar con felicidad. El hecho de que este último transporte se hubiese llevado a efecto en un buque alemán provocó las protestas del gobierno irlandés, opuesto políticamente a O´Duffy, porque se había admitido a un gran número de jóvenes irlandeses que eran menores de edad, que carecían de pasaporte y porque en los barcos alemanes que entraban en puertos irlandeses y que luego se dirigían a España se admitía a los irlandeses que querían dirigirse a nuestro país sin permiso de su gobierno.
Consecuencia de todo ello fue que ya no hubo más expediciones masivas de irlandeses hacia España que partiesen de puertos de su país, en las que por cierto colaboraban las embajadas alemana e italiana en Dublín captando voluntarios. Así, el 11 de enero de 1937 fracasó el envío de un nuevo contingente de voluntarios a nuestro país porque el barco que debía transportarlos no apareció en el puerto designado para el embarque y los que se presentaron en él con el fin de embarcar tuvieron que volver a sus casas y el gobierno irlandés, ayudado por el inglés tomó medidas para que ya no se enviasen más voluntarios masivamente.
La bandera
Reunidos en Cáceres todos los irlandeses se procedió a iniciar su instrucción y como muchos habían sido antiguos combatientes en la I Guerra Mundial o en la guerra de independencia de Irlanda, el coronel Yagüe, inspector del Tercio, el de enero comunicaba a Franco que para el día 10 podrían ser utilizados en campo abierto, opinión que no era compartida por O’Duffy, quien se dirigió al Cuartel General del Generalísimo diciendo que la mayoría de sus voluntarios solo llevaba una semana de instrucción, habiéndoseles entregado los fusiles el 30 del mes anterior, sin que hubiesen recibido granadas de mano ni se les hubiese instruido en el manejo de las ametralladoras y morteros asignados a la bandera.
Para contribuir al entrenamiento de la unidad se envió a una serie de oficiales y suboficiales españoles que hablaban correctamente el inglés, provenientes del Tercio la mayor parte y entre los que figuraban dos tenientes ingleses que combatían en sus filas desde el mes de agosto del año anterior: Noel Fitzpatrick y William Neagle, pero el número total no sobrepasó el de doce. A ellos se unieron una serie de intérpretes británicos o irlandeses que residían en España o españoles descendientes de matrimonios mixtos hispano-británicos, a los que se otorgó el grado de sargentos mientras estuviesen adscritos a la unidad, su número fue de 14 ó 15.
La bandera la constituyen tres compañías de fusiles y una de ametralladoras y su mando se da a los siguientes oficiales irlandeses: el de la bandera al ya citado Dalton con el grado de comandante (se rebajaron los grados que los irlandeses decían ostentar en su país), la Compañía A (se siguió la tradición anglosajona de darles letras y no número como se hacía en España) al capitán D. O´Sullivan, la B al capitán T. F. Smith, la C al del mismo empleo P. Quinon y finalmente la de Ametralladoras al también capitán S. Cunningham.
Al llegar a España los voluntarios lucían camisas verdes con el arpa irlandesa al cuello, uniforme que luego fue cambiado por el del Tercio si bien en las camisas siguieron ostentando el arpa. La primera bandera de la que dispusieron fue una verde esmeralda con una cruz roja, en el centro que a su alrededor lucía el lema In Hoc Signo Vinces, pero durante el periodo de instrucción y para lo sucesivo fue cambiada por otra también con fondo verde en la que aparecía un perro-lobo irlandés. Cada compañía fue provista de un banderín que representaba a las provincias irlandesas irredentas. [7]
Durante el periodo de instrucción los irlandeses, dado su carácter, protagonizaron varios incidentes serios pues con frecuencia, en sus horas libres, reñían con españoles y marroquíes y se produjeron casos de deserciones o detenciones, como, la de tres ingleses incorporados a la bandera, en la que hubo un cierto número de ellos a los que se acusó de espionaje, si bien luego se demostró que dicha acusación no era cierta. El incidente se resolvió expulsando a Gibraltar a los tres. Otro problema que se presentó y que tuvo mucha repercusión en la eficacia combativa de la unidad fue la falta de oficiales y suboficiales irlandeses capacitados para el mando de la tropa, pues O´Duffy había rechazado a muchos irlandeses y británicos experimentados que se la habían ofrecido por no militar en su Partido Nacional Corporativo y concedió grados militares a quienes le eran devotos políticamente pero que estaban en ayunas en cuestiones de milicia, sin que por ello los instructores españoles pudiesen realizar grandes avances en este sentido pues en la unidad no ejercían funciones de mando. Terminado el periodo de instrucción, el 6 de febrero, la bandera fue revistada por Franco y tras unos días de descanso, el 15 del mismo mes se dio por finalizada la estancia en retaguardia de los voluntarios irlandeses.
En el frente
Al día siguiente parten hacia él en tren los componentes de la bandera: el comandante, 25 oficiales, 45 sargentos, dos maestros-armeros y 570 hombres de tropa, pero el viaje se hace interminable ya que tardan 26 horas en hacer un trayecto en el que normalmente se invertían seis. Cuando tras pasar Navalmoral de la Mata, que acababa de ser bombardeada por la aviación enemiga, llegan a Torrejón, desembarcan y andando se dirigen a Valdemoro que dista doce kilómetros, empleando en hacer el recorrido dos horas. Descansan y comen en dicha población y se dirigen hacia Ciempozuelos, pero durante el trayecto se produce otro hecho que marcará indeleblemente a los irlandeses.
Se observa que frente a ellos marcha una tropa española, que los oficiales españoles adscritos a los irlandeses identifican como nacional, pero cuando se dan a conocer como Bandera Irlandesa del Tercio los que están enfrente empiezan a disparar O´Sullivan, que manda la vanguardia, ordena a su vez hacer fuego y cuando al cabo de cinco minutos cesa el mismo y tras la retirada de la tropa que les ha atacado en el suelo, muertos, están los cuerpos del teniente Bonet y del sargento Calvo, españoles y de los irlandeses teniente Hyde y legionario Chute. También herido el voluntario Hoey. Cuando se despeja la situación se llega a la conclusión de que la unidad que les ha atacado es una bandera de la Falange canaria que al oírles hablar en inglés (eran escasos los irlandeses que hablaban nuestro idioma) se creyeron víctimas de una trampa y empezaron a disparar. Por su parte los canarios sufrieron la pérdida de su comandante y del segundo jefe de la unidad. O’Duffy, en su libro culpa del hecho a los canarios y dice que el mando nacional felicitó a su unidad, pero fuentes nacionales, Peter Kemp entre ellos, dicen que la culpa fue de los irlandeses y sobre todo de O´Sullivan que no era militar profesional, y que se puso nervioso y sin más, a los primeros disparos de advertencia ordenó a los suyos responder de igual forma en vez de esperar a que la situación se arreglase incruentamente.
Solventado el incidente, la bandera se acantona en Ciempozuelos, donde se ve sometida al fuego enemigo lo que le causa algunas bajas de momento no mortales. Se dedica a reforzar a las fuerzas del sector e incluso llega a prestar servicios de protección a una sección de ingenieros alemanes. Pero su permanencia en las trincheras, debido al estado de las mismas y las continuas lluvias que padecen hacen que más de cien irlandeses contraigan diversas enfermedades, por lo que tienen que ser evacuados a los hospitales de retaguardia. Entre los enfermos se encuentra el mayor (como le designaban sus subordinados que no empleaban el equivalente español de comandante) Dalton, que entrega el mando a O´Sullivan, que asciende al grado superior. A su vez Quinon es nombrado segundo comandante de la bandera y Fitzpatrick pasa a mandar la unidad del nuevo jefe de los irlandeses.
Hasta el 13 de marzo no entra en combate, el cual según el Diario de Operaciones de la Columna Asensio es ”una demostración ofensiva sobre Titulcia". [8] Para O´Duffy se trata de un verdadero combate mientras que para otro voluntario irlandés Seamus McKee sólo se trató de un ataque contra posiciones enemigas que se convirtió finalmente en una desbandada. Sea cual fuese la verdad y el desarrollo de la acción, como consecuencia de la misma mueren el sargento Lawlor y otros cuatro legionarios que son evacuados primero a Grijón y luego a Cáceres donde se encuentran los servicios médicos de la bandera encabezados por el coronel McCabe, el doctor Connor Martin y las enfermeras McGorisk y Mulvaney. En la citada ciudad se encontraba también la unidad de depósito mandada por el capitán Patrick Hughes a la que se habían incorporado algunos irlandeses llegados a España por sus propios medios después de la partida hacia el frente de la bandera. Los muertos fueron enterrados en el cementerio cacereño. De Ciempozuelos los irlandeses pasaron a La Marañosa, donde no intervienen en combates pero pierden algunos hombres por heridas accidentales y donde tiene lugar algunos incidentes que preludian la disolución de la unidad.
El desenlace
Mientras la Bandera Irlandesa se encuentra en el frente se presentan una serie de problemas que hacen que finalmente se llegue al acuerdo de disolver la unidad. En ella había más de 100 voluntarios menores de 21 años cuya repatriación pidió el gobierno irlandés parece ser que presionado por el británico, a lo que accedió el de Burgos para evitar incidentes diplomáticos. Se presentan quejas contra O´Duffy por haber instaurado la censura en la correspondencia, pero lo más grave era la indisciplina que reinaba entre los irlandeses. Estos se emborrachaban con frecuencia, se agredían entre ellos e incluso llegaron a hacerlo tanto con sus oficiales como con los españoles agregados a la bandera para intentar cohesionarla y convertirla en una unidad eficaz y combativa. Incluso los propios oficiales irlandeses llegaron a las manos entre ellos y para rematar la sucesión de hechos una noche un oficial irlandés no identificado llegó disparar contra dos oficiales españoles. [9]
Por ello Yagüe, el 28 de marzo de 1937 solicita la disolución en base a la indisciplina reinante en la unidad por la falta de mandos profesionales irlandeses, por la mala alimentación que se proporcionaba a los irlandeses por su propia intendencia y porque su eficacia militar era nula. Ahora bien, proponía que los voluntarios que quisieran permanecer en España fuesen repartidos entre las diversas banderas del Tercio y que los qué no quisieran seguir en nuestro país fuesen repatriados al suyo. O´Duffy se opone a ello y echa las culpas de lo ocurrido a los oficiales españoles, a algunos irlandeses y sobre todo a los de origen inglés. El 12 de abril, tras un incidente entre O´Sullivan y el alférez español Silva, Yagüe destituye a aquel del mando y le envía a Cáceres. Franco autoriza la disolución de la bandera permitiendo la permanencia en España de los oficiales y suboficiales irlandeses profesionales que quisieran quedarse respetándoles el rango militar que ostentasen. También podían quedarse los voluntarios que lo solicitasen con los que se formaría una unidad irlandesa si su número lo permitía la cual sería suplementada con legionarios españoles y puesta al mando de un oficial español. Incluso se permitiría la permanencia de un médico y de un capellán irlandeses si el número de los que se quedasen era alto.
Las compañías van siendo conducidas a Cáceres donde votan si se quedan en España o vuelven a su país. Según O’Duffy 654 hombres decidieron volver a Irlanda y solo nueve pidieron, permanecer en España, si bien al final su número se elevó a trece, pero muy pronto por unos u otros motivos cinco de ellos volvieron a su país o a lnglaterra según su origen. [10] Los que se quedaron fueron los capitanes O´Farrill y Gunning, los tenientes Fitzpatrick y Neagle, el alférez Lawler, tres sargentos, un cabo y cuatro legionarios, pero para final de 1937 no permanecen en España ninguno de los oficiales mencionados y al menos uno de los sargentos, Michael Weymes, había muerto en combate.
El capitán de estado mayor González Caminero es nombrado organizador de la repatriación que cuenta con el apoyo del gobierno británico que les concede pasaportes mientras que el nacional les proporciona vestido y calzado civiles. El 12 de junio salen de Cáceres para Lisboa quince oficiales y 632 suboficiales y soldados irlandeses que embarcan en el buque portugués Mozambique que el 22 de junio los desembarcó en el puerto de Dublín donde fueron recibidos en triunfo con bandas de música que les acompañaron hasta el Ayuntamiento donde se les dirigieron discursos en los que se les calificó de “defensores de la fe" y “combatientes por la gloria de Dios y el honor de Irlanda". [11]
Pero en España aún permanecía un grupo de heridos y enfermos que de momento no pudieron repatriarse. Cuando recibieron el alta médica eran cuatro que tras algunas dificultades puestas por el cónsul británico en Lisboa, volvieron a su país donde por causa de las enfermedades contraídas en España en fechas posteriores, murieron otros tres o cuatro voluntarios irlandeses con lo que el número de bajas mortales de irlandeses pertenecientes a la unidad reclutada por O´Duffy alcanzó la cifra de ocho, con independencia de los que habiendo formando parte de la unidad se quedaron en nuestro país y murieron con posterioridad.
Notas
1. Diario Región, Oviedo.
2. Jaime del Burgo, Conspiración y Guerra Civil, pp. 249-250.
3. The Morning Post, 17 de septiembre de 1936.
4. Servicio Histórico Militar (SHM), Armario 2, Legajo 156, Carpeta 14, Documento 23.
5. Eoin O´Duffy, Crusade in Spain, pp. 96 y ss.
6. Peter Kemp, Legionario en España, pp. 96 y ss.
7. E. O´Duffy, op. cit., p. 108.
8. SHM, A. 10, L. 452, Cpt. 4.
9. SHM, A. 2, L. 156, Cpt. 24, Dt. 32
10. E. O´Duffy, op. cit., p. 236
11. E. O´Duffy, op. cit., pp. 236 y ss.
Más información
por Carlos A. Pérez
Según datos recogidos en el Archivo de la Guerra Civil Española del Archivo General Militar de Ávila*, esta bandera irlandesa fue, mientras duró, la 15ª Bandera de la Legión y su repatriación se decidió el 13 de abril de 1937 como consecuencia de los desfavorables informes elaborados por los mandos del Ejército Nacional acerca del estado de la misma. En los mismos se recogía la gran indisciplina existente, con unos mandos no profesionales incapaces de imponer su autoridad sobre una tropa, en muchas ocasiones borracha. En concreto, se cita un caso de agresión a un oficial por parte de otro oficial y un soldado. La comida y el vestuario tampoco eran los adecuados. Todo esto se tradujo en un mal comportamiento en las escasas operaciones militares en que participaron. La decisión del Parlamento irlandés de no permitir la recluta de más voluntarios condenaba, a la larga, a la bandera irlandesa. En el momento de su marcha, se ofreció a los voluntarios que lo deseasen permanecer en la Legión encuadrados en compañías irlandesas.
* Los documentos en Cuartel General del Generalísimo (CGG), Armario 2, Legajo 156, Carpetas 19-27 "Banderas Irlandesas".
Bibliografía:
Para estos voluntarios irlandeses véase:
- Eoin O´Duffy: Crusade in Spain. Robert Hale, Londres, 1938.
- Francis McCullagh: In Franco´s Spain. Burns, Oates and Washbourne, Londres, 1987.
- M. Manning: The Blueshirts. Gill and Macmillan, Dublín, 1987.
- Robert A. Stradling: The Irish and the Spanish Civil War. Manchester University Press, 1999.
- J. Bowyer Bell: "Ireland and the Spanish Civil War", Studia Hibernia, vol. 9, 1969.
Enlace recomendado:
O´Duffy´s Bandera en Ireland and the Spanish Civil War
00:09 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, irlande, espagne, guerre civile espagnole, guerre d'espagne, années 30 |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 31 mars 2011
Eoin O'Duffy... his life and legacy
![blueshirts[1].gif](http://euro-synergies.hautetfort.com/media/02/02/2177461570.gif)
Eoin O'Duffy ... his life and legacy
Ex: http://www.irishidentity.com/
Probably one of the most controversial Irishmen of all time was born at Cargaghdoo, near Lough Egish, in the parish of Aughnamullen East, on 30th October 1892. He was Eoin O¹Duffy, later better known as general Eoin O¹Duffy, and he would become one of the most prominent figures in the history of the GAA, not just in Co. Monaghan, but throughout Ulster, and also the Leading Light¹ in the Struggle for Independence¹ of the 1919-21 period in his native Co. Monaghan.
By Seamus McCluskey.
Completing his primary, secondary and third level education, O’Duffy became an engineer and worked as a surveyor for Monaghan County Council in the Clones area. Following the formation of the Volunteers and the 1916 Rising, he became one of the movement’s most active members, and his organisational abilities were soon to become very evident during the ensuing War of Independence. By September 1918 he was already a Brigade Officer in the IRA and became the foremost organiser in the county. Jailed in 1918, he was released in 1919, and soon threw himself completely and wholeheartedly into the work of gaining independence for his country.
He had already been very active in GAA circles and he would now use that organisation as a recruiting ground for his Volunteers.
Starting with his GAA activities, Eoin O’Duffy became secretary of the Monaghan Co. Board in 1912, when he was a mere youth of twenty, and his organisational abilities here led to his then being elected Secretary of the Ulster GAA Council the following year. He would remain as Ulster Secretary right up until 1923, and would then become Treasurer from 1925 until 1934.
During all this period his GAA and Volunteer activities went hand-in-hand.
One of his most unusual exploits in 1918 was on the occasion of ‘Gaelic Sunday’, 4th August of that year. The 1918 Ulster Final on 7th July had had to be cancelled when British soldiers occupied the Cootehill venue and banned the playing of Gaelic Games. To defy the ‘ban’, all nine counties organised challenge matches for Sunday 4th August, and the GAA Central Council followed suit. No permits were applied for anywhere. It would be called ‘Gaelic Sunday’ and over 100,000 took part, leaving the authorities totally helpless.
The ‘proclaimed’ game at Cootehill on 7th July had a unique sequel. Ulster secretary O’Duffy, along with Dan Hogan of Clones, who was to have refereed the Final, and about thirty others, all cycled home from Cootehill towards Newbliss, but were followed by a party of RIC men on their heavy bicycles. O’Duffy knew they were being followed and led the unfortunate RIC men on a fifteen miles wild-goose chase over the by-roads around Newbliss. The sweltering heat and the heavy official uniforms, made matters extremely unpleasant for the pursuers, who must have lost a lot of sweat trying to push their cumbersome machines in such conditions.
The first major event of the War of Independence in the county, in which O’Duffy was involved, was the ‘Siege of Ballytrain’ RIC barracks on 13th February 1920. O’Duffy himself led the attack, in which thirty Volunteers formed the assault party, drawn from companies in Monaghan, Donagh, Clones, Wattlebridge and Corcaghan. The other companies of the county were involved in blocking roads and dismantling telephone wires. The RIC garrison eventually surrendered and O’Duffy’s pattern of attack was soon imitated in later attacks on several other RIC barracks throughout the country.
On the following 17th March (1920) the Ulster GAA Convention was held in Conlon’s Hotel in Clones and O’Duffy, now very much a ‘wanted man’ by the British Authorities, had to enter the meeting in disguise, as RIC spies were waiting outside to arrest him. However, O’Duffy had already departed when the police eventually raided the hotel. The ‘Adjourned Convention’ was held in Armagh on 17th April 1920 and O’Duffy, now even more wanted by the police, again attended, but this time without a disguise. Quickly arrested, it became obvious that O’Duffy actually wanted to be arrested on this occasion as it was his intention to organise a hunger-strike among the Monaghan Prisoners then being held in Crumlin Road jail in Belfast. This he duly did, and very successfully too, and all the Monaghan prisoners were later released.
O’Duffy realised the importance of getting arms for his Volunteers and, consequently, he organised a major raid on several Unionist houses throughout North Monaghan to obtain them. Many guns were captured in these raids but four Volunteers lost their lives that same night, while several others were wounded when stiff resistance was offered. The ‘Night of the Raids’, as it became known, took place on 31st August 1920 and was the brainchild of O’Duffy.
Because of these activities and the continuing ’Troubles’, as they were called, all GAA competitions in Ulster fell very much into arrears. The 1921 Ulster Final was not played until October 1923, as several of the Monaghan players had been arrested by ‘B Specials’ at Dromore, Co. Tyrone, when on their way to play Derry, in Derry, for the original fixture. All of them were ‘O’Duffy Men’, and O’Duffy was instrumental in obtaining the later release of all ten. The 1922 Final was not played until April 1923, and the 1923 Final on 2nd September. The 1923 Ulster Convention had been held in Clones on 17th March, when O’Duffy was replaced as secretary.
One of the great memories of that same year, however, was the Official Opening of Breifne Park in Cavan on 22nd July, the name having been suggested by Eoin O’Duffy.
Following the cessation of hostilities and the Treaty of 1921, O’Duffy rose in the ranks of the Irish Free State army, becoming chief-of-staff in 1922. Fortunately, there was very little activity in Co. Monaghan during the unfortunate Civil War that then ensued and lasted for ten months in 1922-23. Now O’Duffy could concentrate more on his GAA activities but, unfortunately, he was unavoidably absent from the 1929 Ulster Convention held in March 1929.
With the setting up of the new Irish Free State and the establishment of the Garda Siochana in 1922, O’Duffy was put in charge with the rank of Commissioner. Here he again showed remarkable ability in the establishment of our first national police force, and was Chief Marshall at the Catholic Emancipation Centenary celebrations in 1929 and again at the Eucharist Congress of 1932. However, he then incurred the disfavour of the new Taoiseach, Eamon DeValera, and was dismissed from his post on 22nd February 1933.
The Army Comrades Association was founded in 1933 and was basically a welfare organisation for former members of the Irish Free Stage army.
Political meetings of Cumann na nGaedheal, the pro-Treaty party, were frequently disrupted by IRA and the Association adopted the role of protecting these meetings from interference. Members wore a blue shirt and black beret, and became known as ‘The Blueshirts’. Eoin O’Duffy joined the Blueshirts in 1933 and was soon promoted to the post of Leader of the movement, which then became known as the ‘National Guard’. A proposed ‘March on Dublin’, however, was banned by the Government of the day, and the name was duly changed again, this time to ‘Young Ireland Association’. Rallies were held throughout Ireland, one of the largest taking place in Monaghan town on 20th August 1933.
O’Duffy’s recruiting abilities continued and the ranks of the Blueshirts duly swelled. He held a parade of over two hundred in Ballybay in November 1933 and another two hundred in Newbliss three months later. His greatest show-of-strength, however, was in Monaghan on 18th February 1934. O’Duffy had come to Monaghan as President of Fine Gael on 19th November 1933, and the aforementioned rallies and parades then followed. O’Duffy’s unquestionable popularity in the county since his Sinn Fein days, and the fact that he was a native of the county, probably accounted for the remarkable rise of the Blueshirts throughout the county.
Despite his absence from Ulster Convention in February 1934, O’Duffy was still the central figure. He had been the most tireless worker for the GAA in Ulster for the previous twenty-two years, first as secretary, and later as Ulster Delegate on the Central Council, where he proved himself a fearless fighter for the Ulster cause, particularly since the National Games were so vehemently opposed by a majority in the northern province. However, when he became embroiled in party politics, and with his involvement as leader of the Blueshirts, this created a position where many of his former associates now became his enemies. GAA rules also make it quite clear that involvement in controversial politics would preclude him from membership. By 1933 it was generally accepted that O’Duffy had resigned, but by the time of the 1934 Convention, this resignation had still not yet been officially received. No wonder there was a record attendance, and there was a tense atmosphere throughout the entire proceedings.
A letter from O’Duffy proved somewhat ambiguous and did not clearly indicate that he was withdrawing from the post of Treasurer, so his name had to be allowed to go forward. Even Co. Monaghan had nominated an opponent to O’Duffy in the person of Michael Markey, while Gerry Arthurs of Armagh also allowed his name to go forward. Arthurs proved a decisive victor in the ensuing vote at this unique Convention, which heralded the end of O’Duffy’s official association with the GAA, and it was held in Dungannon on 28th February 1934.
In 1936 Eoin O’Duffy recruited and formed an ‘Irish Brigade’ to go to the assistance of General Franco in the Spanish Civil War. 700 strong, they contributed to the success of the Catholic leader of Spain and were even blessed by Irish bishops prior to their departure for what was a most unusual expedition, and which has been vividly described by O’Duffy’s himself in his ‘Crusade in Spain’.
Eoin O’Duffy was later elected President of the NACA, the body controlling Irish athletics, and held this post until his death on 30th November 1944. On the 2nd December 1944, Eoin O’Duffy was given a full military funeral and was then laid to rest in Glasnevin Cemetery, Dublin, alongside his friend and ally, Michael Collins.
Taken from Monaghan's Match
December 2004
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, irlande, fascisme, militaria |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 30 mars 2011
L'impero ittita dalle origini alla sconfitta egiziana di Kadesh

L’impero ittita dalle origini alla sconfitta egiziana di Kadesh
La sua capitale Hattusas fu alla pari di Babilonia e di Tebe, anche se non dal punto di vista della civiltà, tuttavia per una singolarissima forza e importanza “politica”
Gianluca Padovan
Ex: http://rinascita.eu/
Alle origini
Chi c’era prima. Non è una domanda, ma un’affermazione, nel senso che prima di noi c’è sempre stato qualcuno, su questa Terra. L’eccezione la troviamo nelle profondità: sotto il livello delle acque e sotto la superficie del suolo, ovvero nelle profondità di laghi, mari, oceani e nelle grotte. A taluni di noi piace essere i primi ad arrivare in un dato posto e la certezza la possiamo avere quando varchiamo i Cancelli della Terra, spingendoci nella verticalità di quei vuoti che gli speleologi chiamano abissi.
In caso contrario, ovvero quasi sempre, nel luogo che percorriamo c’è già stato qualcuno, una civiltà è fiorita, un’altra è rimasta eclissata nella polvere dei millenni e l’essere umano si è trasferito, ha combattuto, ha scritto e ha prodotto manufatti che noi oggi cerchiamo d’interpretare. Se scaviamo troviamo sempre le nostre radici, magari sotto la collina vicina a casa nostra. E forse è meglio preservarla che demolirla con l’apertura di una cava o ricavandovi sotto un parcheggio.
Il tell è una struttura apparentemente naturale, che in lingua araba identifica un monte, una collina. In paletnologia il termine indica le colline artificiali formatesi con la sovrapposizione di strutture abitative nel corso di lunghi periodi di tempo. Quando li si scava si ha la sorpresa di sfogliare secoli e secoli di abitazioni, diligentemente costruite una sulle ceneri dell’altra. L’indagine presso il tell di Çatal Hüyük ha rivelato l’esistenza di più di dieci livelli di strutture, abitate tra il VII e il VI millennio a. Accanto vi è un secondo tell, altrettanto interessante dal punto di vista archeologico. Si trovano nella parte meridionale della Turchia, in un territorio che un tempo aveva un aspetto diverso da oggi. E i popoli chiamati Hatti o Chatti o Ittiti che successivamente giungono in Anatolia non sono i primi e nemmeno gli ultimi.
I biondi Ittiti
Gli Ittiti sono definiti come un antico popolo dell’Asia Minore, che riveste una grande importanza dal punto di vista politico, militare e culturale tra il XVIII e il XII sec. a. Taluni sostengono che i primi gruppi giungono nel territorio già alla metà del III millennio a., secondo l’interpretazione di alcune tavolette d’argilla assire che parlano dell’arrivo di “nuove genti”. Secondo altri la data è da fissare o alla fine del III millennio oppure agli inizi del successivo, ma ecco l’invasione vista da Lehman: “Una cosa soltanto è sicura: non irruppero improvvise e inaspettate in Anatolia da una qualche parte della terra. Quindi bande di cavalieri selvaggi non si riversarono a schiere sul paese, né orde di saccheggiatori e di predoni occuparono città e villaggi, né giunsero barbari a distruggere civiltà straniere, massacrare gli uomini e rapire le donne. Queste immagini stereotipate di popoli invasori in cerca di terra non si adattano al nostro caso” (Lehman J., Gli Ittiti, Garzanti, Milano 1997, p. 171).
Uno dei “gruppi” si stanzia al centro dell’Anatolia, in quella che viene chiamata Terra di Hatti, con capitale Hattusa. Il loro regno, unitamente agli stati vassalli, si estende dagli stretti del Bosforo e dei Dardanelli fino all’orientale Lago di Van. Hanno una lingua europea, o meglio più lingue, che scrivono in vari modi appresi dalle popolazioni locali e sviluppati: cuneiforme in lingua accadica, cuneiforme in lingua ittita, ideografico, etc. In ogni caso la maggior parte dei documenti cuneiformi su tavolette d’argilla sono in “ittito”, termine che viene applicato alla lingua ufficiale dell’impero. Chiamano sé stessi hari, “i biondi”. In una tavoletta si parla del trono del re che è in ferro, mentre in altre si leggono di conquiste, commerci, dispute. Sono uno stato federativo, con un governo centrale, il cui ordinamento sociale è suddiviso in classi, ma non rigidamente. Pare che le religioni siano diverse, convivendo in una sorta di tranquilla tolleranza. Compaiono divinità solari e un dio della tempesta, rappresentato nell’atto di reggere la scure con una mano e la folgore con l’altra.
Le razze bianche in oriente
Intanto giunge sulla scena anche una nuova popolazione che gli egizi chiamano Heka-Kasut, ovvero “capi dei paesi stranieri”, comunemente conosciuti con il nome di Hyksos. Sono una popolazione definita asiatica, che in realtà presenta i tipici connotati europoidi, con caratteri marcatamente xantocroici (alti, chiari di pelle, con occhi anch’essi chiari e capelli biondi, rossi, castani); dominano l’Egitto dalla fine del XVIII secolo a. fino all’inizio del XVI secolo a. Stabilitisi inizialmente nei dintorni di Avaris, loro capitale, estendono il potere su tutto l’Egitto. I re delle due dinastie Hyksos, la XV e la XVI (1730-1570 circa a.), adottarono usi e costumi egizi e si proclamarono faraoni, trascrivendo i loro nomi in geroglifici e assumendo a volte nomi egizi. Agli inizi del XVI sec. i re di Tebe si organizzarono e scacciarono gli Hyksos dall’Egitto; Ahmose, futuro fondatore della XVIII dinastia, conquista Avaris e li insegue fino in Siria.
Successivamente, tra il 1650 e il 1600 a., i sovrani ittiti Khattushili I e Murshili I penetrano in Siria e in Mesopotamia e viene posto il termine alla prima dinastia amorrea di Babilonia. Ne approfittano i Cassiti (o Kassiti, o Cossèi), popolo con forti connotati europoidi, anche loro utilizzanti il cavallo e il carro da guerra, che s’appropriano del paese governandolo fino alla metà del XII sec. a. Tali Cassiti, pare con pacifica migrazione, si erano già insediati in Mesopotamia come agricoltori, artigiani e guerrieri mercenari, provenendo dall’Elam nell’area iranica. Il tempo passa e gli Ittiti conquistano il paese dei Mitanni, stato Hurrito che in una fascia compresa tra le odierne Siria e Turchia si spinge nell’area superiore dei fiumi Eufrate e Tigri. Lo stato è governato da una monarchia ereditaria, probabilmente di stirpe indo-iranica, con una classe dominante che scrive in una lingua definita acriticamente “indoeuropea”, ovvero europea (dal momento che le migrazioni sono avvenute dall’Europa all’India e non viceversa), simile al sanscrito e all’antico persiano. Gli Hurriti fanno atto di sottomissione al re ittita Suppiluliuma attorno al 1365 a. Come gli Ittiti avanzano, ottenendo consensi, i vicini egizi non fanno attendere l’attrito.
Soldati egizi e guerrieri Sciardana
Circa mezzo secolo più tardi il re ittita Muwatalli non è battuto a Kadesh dal faraone Ramesse II, anche se nel tempio di Luxor gli egiziani inneggiano ad una strepitosa vittoria, ma solo per mera propaganda, per celare al popolo la sconfitta del proprio re. Kadesh, o Qadesh, si trova nell’entroterra siriano, a poco più di cento chilometri a nord di Damasco, nei pressi del Lago di Homos. Verso la fine del mese di maggio del 1300 a. (alcune fonti riportano altre date) il faraone Ramesse II guida personalmente l’esercito egizio suddiviso in quattro divisioni da circa cinquemila uomini l’una, di cui mille costituenti gli equipaggi dei cocchi. Abbiamo quindi due soldati per cocchio e quindi duecentocinquanta cocchi per ogni divisione. Si calcolerebbe così un totale di circa sedicimila fanti e arcieri, duemila cocchi con quattromila uomini che li montano; vi sono inoltre le salmerie con un numero imprecisato di persone. Una quinta divisione egizia li raggiungerà nel corso della battaglia, provenendo da Amurru. Parte della guardia reale è formata da guerrieri Sciardana “stranieri” (Shardanes, Sardani, Sardi o semplicemente Popoli del Mare) armati con lunghe spade, scudi circolari ed elmi con le corna, provenienti indicativamente dal Mare Mediterraneo (Healy M., Qades 1300 a.C. Lo scontro dei re guerrieri, Osprey Military, Ediciones del Prado, Madrid 1999, p. 43). Se guardiamo alcune statuine in bronzo del IX-VIII sec. a. rinvenute in siti nuragici, ci rendiamo conto che possono tranquillamente essere loro, i Nur. Gli abitanti della Corsica devono averli già conosciuti con spiacevoli conseguenze e hanno eretto qualche menhir antropomorfo con le loro fattezze: spade, pugnali ed elmi con le corna (Grosjean J., Virili F. L., Guide des sites Torréens de l’Age du Bronze Corse, Éditions Vigros, Paris 1979, pp. 15-17). I testi egizi li chiamano: “i guerrieri del mare, gli Sherden senza padroni, che nessuno aveva potuto contrastare. Essi vennero coraggiosamente dal mare nelle loro navi da guerra con le vele, e nessuno era in grado di fermarli, ma Sua Maestà li disperse con la forza del suo braccio valoroso e li trascinò [prigionieri] in Egitto”, e che nei rilievi egizi sono rappresentati alti, robusti, di pelle chiara” (Cimmino F., Ramesses II il Grande, Rusconi, Milano 1984, p. 95-96).
L’avversario da affrontare è il re ittita Muwatalli, al comando di un esercito forse più numeroso. Una differenza è data dal cocchio, o carro da guerra: quello ittita è montato da tre uomini, stando alle deduzioni epigrafiche. Secondo Healy lo scenario è il seguente: il fiume Oronte scorre da sud a nord e poco prima del Lago di Homos riceve da sinistra le acque dell’Al-Mukadiyah. Internamente alla confluenza vi è la città di Kadesh nuova già occupata dagli Ittiti, a nord est e quindi alla destra idrografica sorge la Kadesh vecchia, anch’essa occupata dall’esercito ittita, mentre a nord ovest il faraone pone il proprio campo con la divisione Amon e il suo seguito, apparentemente ignaro del fatto che viene tenuto sotto controllo visivo dagli Ittiti. Ma poi se ne accorge e manda a chiamare con una certa urgenza il resto dell’esercito (Healy M., op. cit., pp. 47-59.).
Ramesse II sconfitto a Kadesh
Si hanno due resoconti egiziani della battaglia: il Bollettino e il Poema di Pentaur. Le interpretazioni sull’esatto svolgersi dei fatti sono contrastanti, si suppone che qualcuno non abbia fatto il proprio dovere nel corso delle ricognizioni, qualcun altro non avrà invece eseguito gli ordini fino in fondo; nulla di nuovo nella Storia, in ogni caso. La divisione Ra solca velocemente la pianura alla sinistra orografica dell’Oronte, seguita a distanza dalle divisioni Pthah e Sutekh. L’obiettivo è di raggiungere l’accampamento trincerato della divisione Amon.
Le divisioni ittite, con i carri da guerra in testa, sbucano improvvisamente al di là dell’Al-Mukadiyah, piombano sul fianco destro della divisione Ra, la tagliano in due e la mettono in fuga; molti si danno al saccheggio delle salmerie, “dimenticandosi” di dare man forte per attaccare la divisione Amon. Gli Ittiti proseguono la corsa e piombano sul campo trincerato, si scompaginano combattendo sparpagliati e predando quel che riescono tra le ricche tende. Ramesse II riesce comunque a schierare la sua guardia e gli Sciardana si mostrano all’altezza della situazione; personalmente credo si comportino con valore facendo muro e bloccando l’assalto con vigore. Appena organizza i suoi carri da guerra, unendoli ai sopraggiunti superstiti della Ra, Ramesse II contrattacca. Intanto che la colonna ittita si ritira sotto la spinta della reazione avversaria, sopraggiunge una seconda ondata di carri ittiti a dare man forte, ma in ritardo sui tempi. Il risultato è che questa si trova probabilmente presa tra i cocchi di Ramesse II e la quinta divisione, la Ne’arin, che quasi inaspettatamente arriva da nord con i cavalli lanciati al galoppo. La giornata si chiude in una coltre di polvere entro cui si combatte senza coordinamento, senza più schemi tra reparti che avanzano, altri che ripiegano, altri ancora che vogliono la loro parte di bottino. Infine le divisioni ittite si ritirano non senza difficoltà alla destra orografica dell’Oronte, sui loro accampamenti, mentre le malmesse divisioni Amon e Ne’arin si riuniscono a quello che rimane della Ra. Per alcuni storici il combattimento riprende il giorno seguente, appena giungono le divisioni Pthah e Sutek, per altri no. O meglio, secondo alcune interpretazioni, il faraone passa la giornata a giustiziare alcuni superstiti della Ra, che se la sono data a gambe, tanto per dare un esempio e ricordare che la vigliaccheria è punita con la morte. Poi l’esercito egizio ripiega, ovvero se ne torna a casa, e quello ittita lo segue per un tratto: questo vuole solo dire che gli egiziani sono stati comunque battuti, fosse anche solo di stretta misura (Ibidem, pp. 44-82). Calzante o meno, tale ricostruzione non muta l’esito conclusivo, ovvero la firma del trattato di pace tra Egiziani e Ittiti. Si stipula un equo riconoscimento delle terre su cui governare attorno a quel confine che Ramesse II non è riuscito a spostare più a nord di Kadesh, con la mancata vittoria campale. Quattro interessanti versioni della vicenda sono date da Bibby, Ceram, Cimmino e da Healy (Bibby G., 4000 anni fa, Einaudi, Torino 1966, pp. 260-262. Ceram, Il libro delle rupi. Alla scoperta dell’impero degli Ittiti, Einaudi Editore, Torino 1955,, pp. 192-208. Cimmino F., op. cit., pp. 94-112. Ealy M., op. cit., pp. 44-82).
Il trattato di pace è successivamente rafforzato con il matrimonio tra Ramesse II e figlia di Hattushilish III, successore di Muwatalli. Nel carteggio di questo periodo il contenuto di una lettera inviata dal re di Hatti a Ramesse II merita di essere ricordato: “Per il ferro del quale mi scrivi, io per ora non ho ferro puro a Kizzuwatna nelle mie riserve. Non è il periodo favorevole per fare il ferro; tuttavia ho chiesto di fare ferro puro; fino ad ora non è finito, ma non appena sarà pronto te lo manderò. Per ora posso mandarti soltanto una spada di ferro” (Cimmino F., op. cit., p. 130).
L’importanza dell’impero Ittita
Si arriva alla fine del II millennio a. e comincia l’espansione assira con Tiglatpileser I (1112-1074): Re assiri, avidi di conquiste, premevano ai confini. Uno dei più fedeli vassalli occidentali, Madduwattas, si staccò improvvisamente, presentendo il sorgere di una nuova potenza. La regione di Arzawa accrebbe la sua influenza in modo preoccupante, e gli Ahhiyawa (forse davvero Achei, cioè Greci primitivi) andavano creando a occidente una potenza minacciosa. Il grande impero che Suppiluliumas aveva costruito e che aveva retto per un secolo, scomparve in due generazioni, nelle deboli mani di Tudhaliyas IV (1250-1220 a.C.) e in quelle ancor più deboli di Arnuwandas IV (1220-1190 a.C.). L’uno e l’altro non furono in grado né di mantenere la costruttiva politica di pace di Hattusilis, né di riprendere con la spada ciò che perdevano per via diplomatica. Su questa repentina caduta di un grande impero, molte congetture sono state avanzate. Ma la soluzione è semplice: si annunziava una nuova migrazione di popoli. E qualora si obiettasse che questo non basta a spiegare la “rapidità” del crollo di un “Imperium”, ricordiamo che nel nostro Occidente si è molto riflettuto negli ultimi centocinquanta anni, da Kant in poi, sui concetti di spazio e di tempo, ma che i concetti di “spazio storico” non sono ancora stati studiati nel loro valore relativo (Ceram, op. cit., pp. 217-219).
Pare che arrivino Misi e Frigii, che qualcuno identifica come altri Popoli del Mare; in ogni caso Hattusas brucia dopo il saccheggio. La cultura ittita sopravvive ancora per cinque secoli nelle regioni sudorientali. Poi scompare senza lasciare alcuna traccia, se non nelle tavolette d’argilla e nelle epigrafi. Kurt W. Marek, alias Ceram, conclude così il suo lavoro Il libro delle rupi. Alla scoperta dell’impero Ittita, scritto nel 1955: “Settant’anni fa gli Ittiti e il loro impero erano ancora ignoti. Ancor’oggi si insegna nelle scuole che sono stati soltanto l’impero mesopotamico e il regno d’Egitto a determinare, dal punto di vista politico-militare, la sorte dell’Asia minore e dell’Asia anteriore. Ma accanto ad essi e fra di essi ci fu per un certo tempo il grande impero ittita, con pari diritti come “terza potenza” e la sua capitale Hattusas fu alla pari di Babilonia e di Tebe, anche se non dal punto di vista della civiltà, tuttavia per una singolarissima forza e importanza “politica” (Ibidem, p. 274).
26 Febbraio 2011 12:00:00 - http://rinascita.eu/index.php?action=news&id=6753
00:05 Publié dans archéologie, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : indo-européens, archéologie, histoire, protohistoire, hittites, egypte antique, anatolie antique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 29 mars 2011
La guerra anglo-boera
di Angelo Cani
Fonte: Conflitti e strategie [scheda fonte]  Due guerre, quella degli Stati Uniti del 1898 contro la Spagna, per la conquista di Cuba e delle Filippine, e quella intrapresa dall’Inghilterra, contro le due piccole repubbliche boere: il Transvaal e lo Stato libero d’Orange, segnarono l’inizio di una nuova epoca, l’epoca dell’imperialismo e del dominio del capitale finanziario.
Due guerre, quella degli Stati Uniti del 1898 contro la Spagna, per la conquista di Cuba e delle Filippine, e quella intrapresa dall’Inghilterra, contro le due piccole repubbliche boere: il Transvaal e lo Stato libero d’Orange, segnarono l’inizio di una nuova epoca, l’epoca dell’imperialismo e del dominio del capitale finanziario.
Nella storia del passato si erano combattute molte guerre, allo scopo di estendere il commercio e i possedimenti delle potenze imperialistiche, ma mai gli interessi del capitale monopolistico e finanziario avevano avuto un ruolo così decisivo e determinante.
La guerra anglo-boera, scoppiata nel 1899, è stata la prima guerra imperialistica.
La piccola repubblica del Transvaal, fondata nel 1837 dai discendenti dei contadini olandesi, che erano emigrati al Capo di Buona Speranza alla metà del XVII secolo, aveva goduto di una relativa pace fino al 1886, anno della scoperta dei giacimenti d’oro.
Dei 300 mila kg. d’oro, che a quei tempi si estraevano ogni mese in tutto il pianeta, 80 mila provenivano dalla piccola Repubblica. La sola Inghilterra, ogni mese, estraeva dalle proprie colonie 80 mila kg. e se si Fosse impadronita della repubblica boera, come era sua intenzione, sarebbe diventata padrona di più della metà della produzione mondiale di oro. Per questa ragione i dirigenti inglesi, subito dopo la scoperta del metallo prezioso, si attivarono per la conquista della Repubblica del Transvaal. L’impresa venne affidata a Cecil Rodes, fondatore e direttore della “Chartered Company”, capo del potente sindacato “de Beers”, che forniva il 90% della produzione diamantifera mondiale, primo ministro della Repubblica del Capo e padrone della Rhodesia. Egli preparò, molto accuratamente, un grandioso piano per creare un impero inglese che avrebbe dovuto estendersi da Città del Capo fino al Cairo. La conquista della Repubblica boera faceva parte di questo piano. I mezzi per raggiungere tale obiettivo furono i più svariati. In primo luogo, in base a un trattato imposto ai boeri nel 1884, l’Inghilterra aveva il diritto di esercitare il controllo sui rapporti di questa Repubblica con l’estero. In secondo luogo essi potevano esercitare una costante pressione sul governo boero agendo sugli immigrati inglesi che avevano ottenuto la cittadinanza della piccola Repubblica e speravano di prevalere sui boeri. In terzo luogo l’Inghilterra aveva cercato di accerchiare e isolare il Transvaal con i suoi possedimenti. Quest’ultimo tentativo fallì perché la Repubblica boera si era unita direttamente con una ferrovia con il porto portoghese Laurenco Marques situato sulla costa della baia di Delagoa. Il tentativo di conquistare, da parte del governo inglese, il controllo di questo porto e della ferrovia fallì per l’opposizione del governo portoghese dietro il quale agiva attivamente la diplomazia e il capitale tedesco che aveva già costruito la ferrovia che collegava Pretoria direttamente al mare. Inoltre per dimostrare il suo appoggio a Pretoria e per dissuadere gli inglesi il governo tedesco, nel gennaio del 1895, mandò dimostrativamente a Delagoa due navi da guerra. Sempre in questo periodo l’influenza economica, la penetrazione dei capitali e delle merci tedesche nella Repubblica boera si sviluppò considerevolmente. L’industria meccanica tedesca, i trusts elettrotecnici, le grandi ditte di costruzioni, la Società per l’industria dell’acciaio di Bochum, la fabbrica di vagoni Deutzer di Colonia, la Krupp e la Siemens trovarono in questo paese lo sbocco per la propria produzione.
 Le banche tedesche non si limitavano a partecipare alla banca del Transvaal, ma di fatto la controllavano. Nell’ottobre del 1895 la Dresdner Bank aprì a Pretoria una succursale e grande interesse mostrò anche la Deutsche Bank. Il capitale tedesco investito in Transvaal raggiungeva in questo periodo la somma di 500 milioni di marchi.
Le banche tedesche non si limitavano a partecipare alla banca del Transvaal, ma di fatto la controllavano. Nell’ottobre del 1895 la Dresdner Bank aprì a Pretoria una succursale e grande interesse mostrò anche la Deutsche Bank. Il capitale tedesco investito in Transvaal raggiungeva in questo periodo la somma di 500 milioni di marchi.
Attratti dai fantastici guadagni, accorsero nella Repubblica boera numerosi avventurieri, commercianti e industriali tedeschi. Solo nella città di Johannesburg i tedeschi immigrati erano 15000. Questi immigrati si consideravano il nucleo della nuova grande Germania nell’Africa meridionale. Il loro progetto era quello di instaurare sul Transvaal il protettorato della Germania e per questo era necessario eliminare il pericolo di un protettorato inglese. I circoli tedeschi dichiararono unanimi la loro disponibilità a difendere i boeri da un’eventuale attacco inglese.
Nell’aprile 1895 i tedeschi riuscirono, d’accordo con il Portogallo, a strappare agli inglesi il controllo sul servizio postale lungo la costa sudorientale dell’Africa. La reazione dell’Inghilterra non si fece attendere. Il 30 dicembre, con il benestare del governo, bande della “Chartered Company”, forti di oltre 800 uomini, armate di cannoni e mitragliatrici, al comando di Jamenson, stretto collaboratore di Rhodes, entrano nel territorio del Transvaal e marciano verso Johannesburg, dove si attendeva da un momento all’altro l’insurrezione organizzata da tempo sempre da Rhodes.
Il giorno dopo la notizia arriva a Berlino. Il governo reagisce: rompe le relazioni diplomatiche con l’Inghilterra, invia una unità militare a Pretoria, ordina al comandante dell’incrociatore “Seeadler”, dislocato nelle acque della baia di Delagoa, di sbarcare un reparto di fanteria marina e di inviarlo nel Transvaal. Ma quando la tensione tra Londra e Berlino sta ormai per raggiungere un punto di non ritorno sono gli avvenimenti del giorno dopo a far allentare la tensione.
Le bande di Jamenson vengono circondate dai boeri e catturate assieme al loro capo. Anche il complotto organizzato a Johannesburg Fallisce miseramente. L’incursione delle bande inglesi smascherano Rhodes di fronte alla popolazione e al governo del Transvaal che, pur contando sull’aiuto tedesco, comincia ad armarsi per potersi difendere autonomamente. Buona parte delle armi vengono acquistate in Germania. La ditta Krupp riceve, proprio in questo periodo, grandi ordinazioni di cannoni e la ditta berlinese Lewe trae grandi guadagni dalla vendita di un gran numero di fucili Mauser.
I boeri, con l’acquisto di armi belghe, fecero guadagnare molto denaro anche ad alcune ditte commerciali inglesi, le quali erano a conoscenza che tali armi sarebbero state usate contro i soldati inglesi. Ma furono soprattutto le ditte tedesche a trarre i massimi guadagni fornendo ai boeri armi per la guerra contro l’Inghilterra e contemporaneamente fornendo all’esercito inglese armi e munizioni per la guerra contro i boeri. Interesse di queste ditte era quindi quello di mantenere il più a lungo possibile lo stato di tensione nei rapporti tra inglesi e boeri.
Dopo la crisi del 1895-96 possiamo notare un graduale cambiamento del governo tedesco per quanto riguarda i rapporti anglo- boeri. Le ragioni del mutamento politico vanno ricercate nei diversi interessi del capitale tedesco.
Nella Repubblica boera oltre ai circoli della Deutsche Bank e della Darmstadt Bank, che deteneva un grosso pacco di azioni delle ferrovie del Transvaal, avevano grossi interessi anche le acciaierie Krupp, gli armatori di Amburgo e altri esportatori. Un ruolo importantissimo veniva svolto da uno dei più grandi gruppi del capitale finanziario tedesco: la Disconto – Gesellschaft. Soprattutto il capo di questa banca, il banchiere Hansemann, s’interessava proprio in questo momento della costruzione di una ferrovia che doveva collegare l’Africa orientale tedesca con l’Africa sud – occidentale tedesca. Il progetto prevedeva che la ferrovia attraversasse ilterritorio del Transvaal.
La Lega pangermanica, appoggiata dalla Disconto, si affrettò, attraverso la stampa, a sostenere tale progetto. Era però chiaro, fin dall’inizio, che questa banca da sola non avrebbe potuto assicurare il finanziamento di un’impresa così grandiosa. Il tentativo di avere l’appoggio della Deutsche Bank fallì, lo stesso avvenne con la City di Londra che era interessata alla realizzazione della linea ferroviaria, che da Città del Capo arrivava al Cairo, progettata da Rhodes.
Hansemann assieme ad una parte dei commercianti anseatici, della compagnia navale Werman e altri grandi circoli finanziari chiedeva al governo tedesco di svolgere una politica più attiva nell’Africa del sud e una lotta più incisiva per avere un peso più determinate nel Transvaal. Ma per quanto questo gruppo fosse influente, il governo tedesco doveva tener conto anche degli interessi di un altro gruppo finanziario alla cui testa si trovava la Deutsche Bank: anche questo gruppo chiedeva al governo un impegno maggiore e una politica più attiva nella Repubblica boera, ma i suoi dirigenti, molto informati sugli interessi dell’imperialismo inglese e sull’atteggiamento dei boeri, avevano cominciato ad elaborare vasti piani verso l’Impero ottomano, l’Asia sud-occidentale e la Cina. Al centro di questo grandioso piano espansionistico stava il progetto della costruzione della ferrovia, che partendo dal Bosforo passava per Bagdad e giungeva fino al Golfo Persico.
Questi circoli legati alla Deutsche Bank, dopo aver ottenuto la concessione dal governo turco per la costruzione della ferrovia, avevano incominciato, per l’impossibilità di fermare la crescente pressione dei capitalisti inglesi, a disinteressarsi degli affari del Transvaal. Infatti Siemens e gli altri dirigenti della Deutsche Bank si erano resi conto che sarebbe stato più conveniente, per il capitale tedesco, rinunciare alle mire
espansionistiche nel sud Africa e sfruttare le posizioni politiche ed economiche di cui disponevano in quella zona, per costringere l’Inghilterra a scendere a patti. Essi rivendicavano, in cambio di un loro disinteresse sulla piccola Repubblica del Transvaal, grossi compensi finanziari e coloniali. Fu così che in questi gruppi del capitale finanziario cominciò a prendere forma una linea di ritirata invece di una linea di politica attiva nella Repubblica boera. Questa politica coincideva con gli interessi delle classi dominanti: borghesia e junker.
Nella lotta tra i due gruppi del capitale finanziario tedesco, uno capeggiato dalla Deutsche e l’altro dalla Disconto, prevalse, grazie all’appoggio del governo, la tendenza che considerava più conveniente alimentare e accentuare la tensione nei rapporti tra l’imperialismo inglese e i boeri. Da un lato i circoli della lega pangermanica facevano credere ai boeri che la Germania non gli avrebbe mai abbandonati. Dall’altro lato, il Kaiser, il capo del governo von Bulow e l’ambasciatore tedesco a Londra, non rinunciavano a sondare il terreno presso il ministro inglese Salisbury , sui compensi per l’amicizia che la Germania avrebbe potuto concedere, a determinate condizioni, all’Inghilterra.
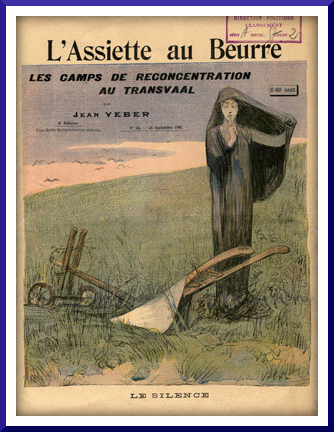 Nell’estate del 1898, la diplomazia tedesca venuta a conoscenza che il governo inglese si accingeva ad approfittare della difficile situazione finanziaria in cui era venuto a trovarsi il Portogallo per mettere le mani sui suoi possedimenti coloniali, pretese dall’Inghilterra la propria parte, cioè avere libero accesso alla spartizione delle colonie portoghesi. Per rendere più convincente la sua richiesta il governo tedesco minacciò di intervenire a fianco dei boeri, di allearsi con la Russia e altre potenze rivali dell’Inghilterra, ma in realtà questo era solo un ricatto per poter aumentare le proprie pretese.
Nell’estate del 1898, la diplomazia tedesca venuta a conoscenza che il governo inglese si accingeva ad approfittare della difficile situazione finanziaria in cui era venuto a trovarsi il Portogallo per mettere le mani sui suoi possedimenti coloniali, pretese dall’Inghilterra la propria parte, cioè avere libero accesso alla spartizione delle colonie portoghesi. Per rendere più convincente la sua richiesta il governo tedesco minacciò di intervenire a fianco dei boeri, di allearsi con la Russia e altre potenze rivali dell’Inghilterra, ma in realtà questo era solo un ricatto per poter aumentare le proprie pretese.
Alla fine, dopo lunghi contrasti e mercanteggiamenti, arrivano ad un accordo per la spartizione delle colonie portoghesi. Tutti i partiti dominanti accettarono tale accordo, eccezion fatta per la lega pangermanica, che aveva a cuore gli interessi della Disconto, che lo qualificò come tradimento a danno dei boeri.
Nel marzo 1899 Cecil Rhodes, per assicurarsi della neutralità dei circoli tedeschi in caso di guerra contro il Transvaal, si recò a Berlino e si impegnò: ad esercitare pressioni sulle alte sfere inglesi per strappare concessioni coloniali, particolarmente nelle isole Samoa, che i circoli della marina tedesca consideravano una importante base strategica nell’Oceania, favorire la Germania nella costruzione della linea telegrafica e della ferrovia transafricana e appoggiare la Deutsche Bank nell’Asia sud – occidentale.
La linea politica, del non intervento, del governo tedesco poggiava sul sostegno della Deutsche Bank perché vi vedeva la condizione per il successo per la sua espansione sia verso l’Asia sud-occidentale, sia verso la Cina. I circoli collegati con la Disconto -Gesellschaft non erano entusiasti, ma aspettavano anche loro i grossi vantaggi, promessi da Rhodes, per la costruzione della ferrovia africana. I Krupp e gli altri grandi magnati dell’industria bellica avevano già ottenuto grossi profitti prima della guerra e se ne aspettavano altri ancora maggiori in caso di inizio guerra .
Il 22 settembre il governo inglese, dopo essersi assicurato la neutralità della Germania, proclamò la mobilitazione di un corpo d’armata. Alcuni giorni dopo una parte considerevole venne mandata in Africa del sud.
Il 9 ottobre il presidente del Transvaal, Kruger, presentò l’ultimatum al governo inglese chiedendo di ritirare le truppe a ridosso della frontiera. Il governo inglese le respinse. Kruger, dopo aver avuto l’appoggio del presidente della Repubblica d’Orange, prese l’iniziativa e occupò il Natal. La guerra era cominciata.
La guerra inizialmente fù sfavorevole per gli inglesi. I boeri in tre distinte battaglie sconfissero le truppe britanniche. E per tre anni, prima di essere sconfitti dal potente esercito inglese nel 1902, inflissero dure perdite alle forze britanniche.
La fine della guerra anglo-boera non pose fine ai contrasti coloniali tra le potenze europee e la Germania, anzi, dopo l’accordo tra Francia e Inghilterra, firmato nel 1904, per la spartizione dell’Africa settentrionale, divennero irreversibili. Con questo accordo la Francia rinunciò alle pretese egemoniche nei confronti dell’Egitto e ne riconobbe l’influenza Inglese. l’Inghilterra si dichiarò a sua volta favorevole ad un ampliamento del dominio francese in Tunisia, Algeria e Marocco. Ma proprio in quest’ultimo paese le banche e le grosse imprese tedesche, già da tempo, avevano intrapreso una intensa e redditizia attività commerciale e non erano per niente disposte a farsi da parte. La Germania per superare i contrasti e far valere le proprie ragioni promosse una conferenza internazionale che si tenne nella città spagnola di Algesiras nel 1906.
L’incontro non eliminò nessun contrasto, anzi l’unico effetto che sortì fu l’isolamento politico e l’indebolimento economico dell’Impero tedesco. Ad esasperare ulteriormente i contrasti fu la crisi di sovrapproduzione industriale, incominciata 1907, che interessò tutti i paesi capitalistici, in particolar modo la Germania.
Nel luglio del 1911 le speranze tedesche di sfruttare i giacimenti di ferro, di piombo e manganese, in Marocco, vennero cancellate definitivamente con l’occupazione militare da parte della Francia. Venuta meno questa possibilità le industrie e le banche tedesche rivolsero l’attenzione all’area balcanica e al Medio Oriente. La Disconto fornì alla Romania, Grecia e Bulgaria prestiti per completare le loro reti ferroviarie ed elettriche mediante acquisti di materiale dalle industrie tedesche. Sempre la Disconto riescì ad ottenere la concessione per lo sfruttamento dei giacimenti di petrolio di Ploesti, vendendo in Germania tutto il petrolio estratto.
La Deutsche Bank portò avanti lo sfruttamento dei giacimenti di cromonell’Asia Minore e il collegamento ferroviario tra Istambul e Bagdad. L’ascesa al potere in Turchia dei “giovani Turchi” nel 1908 accentuò il legame con la Germania e le banche concessero grossi prestiti per rinnovare il suo armamentario con acquisti di materiale bellico dall’industria tedesca e in particolar modo dalla Krupp. Negli ambienti capitalistici tedeschi si fece strada l’idea di poter superare la crisi economica facendo di tutta l’area balcanica e medio-orientale un vasto mercato in grado di dare uno sbocco all’industria pesante tedesca e al contempo fornirle a basso costo le materie prime necessarie. Questo disegno del capitalismo tedesco creò però sempre più gravi tensioni internazionali.
L’Inghilterra premeva sul governo persiano per non permettere il passaggio della ferrovia nel suo territorio. La Francia cercava con tutti i mezzi di ridurre l’influenza tedesca in Serbia, Grecia, Bulgaria e Romania.
Le due guerre combattute nel 1912/13 che hanno interessato i paesi dell’area balcanica (passate alla storia come guerra balcaniche) avevano portato sull’orlo della bancarotta le nazioni che vi avevano partecipato.
Alla fine del conflitto la Serbia si rivolse per un grosso prestito alle banche tedesche, che non disponevano, per ragioni storiche, di capitali liquidi e quindi non erano in grado di concedere alcun prestito. La Serbia si rivolse allora alla Francia che, grazie alla disponibilità di capitali liquidi, non aveva difficoltà a concedere il prestito, ponendo, però, come condizione l’acquisto di merci francesi.
Anche la Romania chiese un prestito alle banche tedesche ottenendo, come la Serbia, lo stesso risultato negativo. L’unica strada percorribile, per la grande disponibilità di liquidità, era quella francese, che concesse il prestito, ma ponendo come condizione il controllo dei pozzi petroliferi già controllati dai tedeschi.
La stessa dinamica si svolse in Turchia che prima chiese alle banche tedesche il denaro per riarmare il proprio esercito e costruire le fortificazioni nei Dardanelli, ma non avendolo ottenuto si rivolse alla Francia che pone anche in questo caso come condizione l’acquisto di armi dalle proprie industrie. A questo punto l’unico sbocco alle incessanti
contraddizioni che la crisi capitalistica aveva generato, coinvolgendo tutte le potenze industrializzate, e in particolar modo la Germania che aveva l’esercito più potente del mondo, non poteva essere che la guerra.
Tante altre notizie su www.ariannaeditrice.it
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : afrique du sud, boers, guerre des boers, histoire, afrique, affaires africaines, afrique australe, grande-bretagne, angleterre |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Battle of Waterloo - Charge of the British Heavy Cavalry
Battle of Waterloo - Charge of the British Heavy Cavalry
00:05 Publié dans Cinéma, Histoire, Militaria | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : waterloo, armées, batailles, histoire, cinéma, film |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 26 mars 2011
Fürs Vaterland. L'epopea dei Corpi Franchi
Fürs Vaterland. L’epopea dei Corpi Franchi
Autore: Luca Leonello Rimbotti
Ex: http://www.centrostudilaruna.it/

Il Freikorps Roßbach. Uno dei Corpi Franchi più celebri, fu impegnato nella Prussia occidentale e sul Baltico.
Nella Germania devastata del primo dopoguerra, travolta dalla crisi economica, dalla guerra civile, dallo sfascio dello Stato, ci fu un nucleo di uomini che non rimasero a guardare: la Repubblica di Weimar, nata dal crollo del 1918 e scossa da una serie di insurrezioni comuniste, che dettero vita alle effimere “repubbliche dei consigli”, era anche attraversata da tentativi di contro-rivoluzione: un putsch dietro l’altro, ma nessuno di essi riuscì a rovesciare il pur fragile governo socialdemocratico. Questo, infatti, si resse praticamente soltanto grazie al paradossale aiuto che gli fornirono i Corpi Franchi, cioè quei gruppi nati spontaneamente fra giovani e soldati appena smobilitati, che si raccoglievano attorno a capi militari carismatici ed efficienti: una specie di compagnie di ventura, che sorsero qua e là in tutta la Germania.
 Non difendevano la Repubblica, che anzi disprezzavano. Difendevano la Germania. Contro le sollevazioni dei “rossi” e contro le infiltrazioni che, a Est come a Ovest, minacciavano i labili confini, non ancora stabiliti dalla pace di Versailles e completamente aperti. A Occidente, la Francia sobillava il separatismo renano; a Oriente la Polonia appena risorta voleva accaparrarsi più terra tedesca che poteva; e intanto l’Armata Rossa di Trotzkij spingeva verso la Germania. Lenin lo aveva detto: per fare la rivoluzione mondiale bisogna prendere in tutti i modi la Germania. Contro questa folla di nemici sorse un pugno di combattenti: bande irregolari, civili armati alla meglio, oltre a veterani delle trincee della Grande Guerra.
Non difendevano la Repubblica, che anzi disprezzavano. Difendevano la Germania. Contro le sollevazioni dei “rossi” e contro le infiltrazioni che, a Est come a Ovest, minacciavano i labili confini, non ancora stabiliti dalla pace di Versailles e completamente aperti. A Occidente, la Francia sobillava il separatismo renano; a Oriente la Polonia appena risorta voleva accaparrarsi più terra tedesca che poteva; e intanto l’Armata Rossa di Trotzkij spingeva verso la Germania. Lenin lo aveva detto: per fare la rivoluzione mondiale bisogna prendere in tutti i modi la Germania. Contro questa folla di nemici sorse un pugno di combattenti: bande irregolari, civili armati alla meglio, oltre a veterani delle trincee della Grande Guerra.
Nella zona baltica, in Curlandia, nella Pomerania e nell’Alta Slesia contese alla Polonia, nella Ruhr occupata dai Francesi, nella Renania, a Berlino: ovunque ci fosse da contrastare la sovversione si trovavano uomini disposti a morire. Questi “lanzichenecchi”, come li chiamò Jünger, erano nazionalisti radicali, alcuni rimpiangevano la Germania imperiale del Kaiser, ma molti altri vedevano invece in quella lotta l’occasione per fare una rivoluzione nazionale. Ma, ben più che ideologi, erano uomini d’azione. Con una sola idea in testa: difendere il Reich in ogni modo e in ogni luogo. Questo mondo di ribelli, di straordinari guerrieri moderni, trovò il suo realistico epos nel famoso romanzo I proscritti di Ernst von Salomon, pubblicato nel 1929 e presto divenuto il testo di riferimento per comprendere un’epoca e una serie di intricate vicende, che altrimenti – specialmente fuori dalla Germania – sarebbero state del tutto ignorate.
 Oggi le Edizioni Ritter ci propongono un eccezionale documento in materia: la prima traduzione italiana di un altro testo di von Salomon, Freikorps. Lo spirito dei Corpi Franchi, uscito in Germania nel 1936 col titolo Storia recente, un documento che si raccomanda sia per la scarsità della bibliografia sull’argomento, sia per la statura dell’autore. Von Salomon, coinvolto nell’omicidio politico del ministro degli Esteri Walther Rathenau, per il quale venne condannato nel 1922 a cinque anni, in precedenza, negli anni caldi dell’immediato primo dopoguerra, fu presente in molti teatri guerreschi, dalla repressione dei moti comunisti a Berlino alla lotta antibolscevica nelle regioni baltiche, a quella anti-polacca nella Slesia settentrionale.
Oggi le Edizioni Ritter ci propongono un eccezionale documento in materia: la prima traduzione italiana di un altro testo di von Salomon, Freikorps. Lo spirito dei Corpi Franchi, uscito in Germania nel 1936 col titolo Storia recente, un documento che si raccomanda sia per la scarsità della bibliografia sull’argomento, sia per la statura dell’autore. Von Salomon, coinvolto nell’omicidio politico del ministro degli Esteri Walther Rathenau, per il quale venne condannato nel 1922 a cinque anni, in precedenza, negli anni caldi dell’immediato primo dopoguerra, fu presente in molti teatri guerreschi, dalla repressione dei moti comunisti a Berlino alla lotta antibolscevica nelle regioni baltiche, a quella anti-polacca nella Slesia settentrionale.
Il libro, breve ma denso e trascinante, è un formidabile ritratto dell’epoca e degli uomini che si mossero in quegli scenari mutevoli e irti di incognite. Idealismo combattentistico, fedeltà al capo del proprio corpo e alla terra tedesca, coscienza di essere circondati dall’odio dei nemici e dall’incomprensione del governo centrale; il quale molto spesso, sotto le minacce dell’Intesa (Francia e Inghilterra), si piegava a intimare sgomberi di zone già riconquistate dai Freikorps dopo sanguinosi combattimenti. Ma la frustrante situazione non era tale da ingenerare scoramento in quegli uomini dall’eccezionale temperamento. Scrive von Salomon che «il “lanzichenecco” del dopoguerra tedesco non si vendeva. Si donava». I giovani che accorrevano in quelle file fondevano i loro ideali in un’unica forma: «i vari aspetti ideologici di ogni orientamento, in voga a quell’epoca, agirono insieme e non è un caso che molti concetti sorti dai movimenti giovanili si siano precipitati a trovare nei Corpi Franchi una nuova patria spirituale». Aggregazioni rapide sul campo, mobilità, capacità di impegnare anche battaglie con armi pesanti fornite di straforo dall’esercito, slancio e senso del sacrificio. Queste doti permisero a formazioni, come ad es. quella del Reggimento Reinhard, il primo a costituirsi a Berlino, o il Corpo Franco Rossbach, o la Brigata Ehrhardt, di fronteggiare situazioni catastrofiche, come quella orientale, dove si profilava «lo spaventoso pericolo dell’insurrezione dell’Asia alle porte dell’Europa», come scrive von Salomon.

Un reparto della Brigata Ehrhardt
Un’etica rigida, ma guidata da un «forte valore affettivo» per quelle terre tedesche da riconquistare al germanesimo e sulle quali non pochi combattenti speravano un giorno di radicarsi: l’ideale di acquisire una tenuta agricola nella Pomerania o nella Prussia Orientale redente, come asserisce von Salomon, era diffuso, al fine di «rafforzare l’elemento tedesco e conquistare così per il Reich un nuovo baluardo, se non una nuova provincia». L’universo dei Freikorps, destinato a scomparire all’improvviso così come era sorto, al momento della stabilizzazione dei confini e della situazione politica interna, rappresentò in ogni caso un momento alto della tenuta nazionale, in un momento tragico della storia tedesca. Qualcosa che, in Italia, può essere paragonato al legionarismo fiumano, ugualmente mobilitatosi per proteggere un fronte compromesso dai trattati di pace, e non a caso ricordato di passata da von Salomon come «prima espressione dello spirito fascista». Ed anche nella memoria storica tedesca la vicenda rimase esemplare del volontarismo spontaneo, tanto che – come ricorda nell’introduzione Maurizio Rossi, che svolge un’esauriente ricostruzione del quadro storico entro cui operarono i Freikorps - il Nazionalsocialismo si disse erede di quelle vicende e di quegli uomini, ben rappresentati dalla figura di Schlageter, l’ex-combattente dei Corpi Franchi e poi iscritto alla NSDAP: finendo fucilato dai Francesi nel 1923 per terrorismo nella zona della Ruhr, divenne una delle icone più celebrate dell’eroismo post-bellico.
 Difatti: «Il Nazionalsocialismo – sottolinea Rossi – aveva comprensibilmente tutto l’interesse di esaltare la logica continuità ideale tra lo spirito dei volontari dei Freikorps, rimarcandone l’immagine di comunità combattente rivoluzionaria e interclassista mobilitata contro i nemici esterni e interni del Reich, e il combattentismo delle SA, ponendo così in evidenza il ruolo svolto dal movimento nazionalsocialista come risolutore della questione nazionale e sociale ed unico artefice della rinascita spirituale della Germania».
Difatti: «Il Nazionalsocialismo – sottolinea Rossi – aveva comprensibilmente tutto l’interesse di esaltare la logica continuità ideale tra lo spirito dei volontari dei Freikorps, rimarcandone l’immagine di comunità combattente rivoluzionaria e interclassista mobilitata contro i nemici esterni e interni del Reich, e il combattentismo delle SA, ponendo così in evidenza il ruolo svolto dal movimento nazionalsocialista come risolutore della questione nazionale e sociale ed unico artefice della rinascita spirituale della Germania».
Estranei agli intrighi e ai compromessi con i quali il governo di Weimar si screditava davanti all’opinione pubblica, i membri dei reparti volontari accorrevano là, dove c’era un pericolo immediato: badando alla concretezza, e non alle convenienze politiche del momento, essi contribuirono spesso a creare dei fatti compiuti, per cui molte zone poterono rimanere al Reich (ad es. Memel) solo perché c’erano stati uomini disposti a morire per mantenerle tedesche: «Il soldato di quell’epoca – commentava von Salomon – non capiva più le tortuosità misteriose della strategia governativa, agiva secondo un impulso guerriero». Poi venne la smobilitazione: «I Corpi Franchi si difendevano isolatamente con battaglie sempre nuove contro l’avversario, che li inseguiva senza tregua. Fortemente decimati, laceri, mezzi morti di fame, vacillanti per la stanchezza, ma con una disciplina incrollabile, giunsero infine […] alla frontiera tedesca, dove le truppe del Reichswehr dovevano accoglierli e smistarli rapidamente in quartieri di riposo qua e là nel Reich, fino al loro completo smembramento».
Diversi di loro finiranno oppositori del Terzo Reich (come Edgar Jung), alcuni si defilarono ma vi convissero (come von Salomon). Molti altri confluirono nel Nazionalsocialismo, come ad es. Erich Koch, che divenne Gauleiter della Prussia Orientale.
* * *
Tratto da Linea del 5 febbraio 2011.
Luca Leonello Rimbotti
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, allemagne, weimar, années 20, corps francs, révolution conservatirce |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 25 mars 2011
Futurismo: Valentine de Saint-Point molto futurista, poco femminista
Futurismo: Valentine de Saint-Point molto futurista, poco femminista
Donna vera e genio puro, avanguardista e provocatrice fu autrice del “Manifesto delle Donne” e della “Lussuria”
Claudio Cabona
Ex: http://rinascita.eu/ Se non ora quando? La donna e la sua dignità, il suo ruolo sociale. La posizione da assumere all’interno e nei confronti del sistema Italia. Dibattiti su dibattiti, manifestazioni, mobilitazioni in nome di una rinascita in gonnella, appelli infuocati al popolo rosa. Costruzione di una nuova identità femminile o starnazzo di gallinelle? La donna paragonata all’uomo, divisione fra sessi al centro di battaglie e rivendicazioni che sanciscono nuove superiorità o inferiorità?
Se non ora quando? La donna e la sua dignità, il suo ruolo sociale. La posizione da assumere all’interno e nei confronti del sistema Italia. Dibattiti su dibattiti, manifestazioni, mobilitazioni in nome di una rinascita in gonnella, appelli infuocati al popolo rosa. Costruzione di una nuova identità femminile o starnazzo di gallinelle? La donna paragonata all’uomo, divisione fra sessi al centro di battaglie e rivendicazioni che sanciscono nuove superiorità o inferiorità?
“L’Umanità è mediocre. La maggioranza delle donne non è né superiore né inferiore alla maggioranza degli uomini. Sono uguali. Meritano entrambe lo stesso disprezzo. Nel suo insieme, l’umanità non è mai stata altro che il terreno di coltura donde sono scaturiti i geni e gli eroi dei due sessi. Ma vi sono nell’umanità, come nella natura, momenti più propizi a questa fioritura... E’ assurdo dividere l’umanità in donne e uomini. Essa è composta solo di femminilità e di mascolinità”.
La femminilità e la mascolinità sono due elementi che separano e caratterizzano i due sessi, ma che in quest’epoca moderna sembrano essersi in parte persi, lasciando spazio ad un indebolimento dell’individuo che è sempre più costruzione e non realtà.
“Un individuo esclusivamente virile non è che un bruto; un individuo esclusivamente femminile non è che una femmina.
Per le collettività, e per i diversi momenti della storia umana, vale ciò che vale per gli individui. Noi viviamo alla fine di uno di questi periodi. Ciò che più manca alle donne, come agli uomini, è la virilità. Ogni donna deve possedere non solo virtù femminili, ma qualità virili, senza le quali non è che una femmina. L’uomo che possiede solo la forza maschia, senza l’intuizione, è un bruto. Ma nella fase di femminilità in cui viviamo, soltanto l’eccesso contrario è salutare: è il bruto che va proposto a modello”.
Il rinnovamento? Una nuova donna non moralizzatrice, ma guerriera, scultrice del proprio futuro. Un cambiamento che passa attraverso una riscoperta del potenziale rivoluzionario della femminilità che non deve essere un artificio creato e voluto dall’uomo, ma una nuova alba. Non bisogna conservare, ma distruggere antiche concezioni.
”Basta le donne di cui i soldati devono temere le braccia come fiori intrecciati sulle ginocchia la mattina della partenza; basta con le donne-infermiere che prolungano all’infinito la debolezza e la vecchiezza, che addomesticano gli uomini per i loro piaceri personali o i loro bisogni materiali!... Basta con la donna piovra del focolare, i cui tentacoli dissanguano gli uomini e anemizzano i bambini; basta con le donne bestialmente innamorate, che svuotano il Desiderio fin della forza di rinnovarsi!. Le donne sono le Erinni, le Amazzoni; le Semiramidi, le Giovanne d’Arco, le Jeanne Hachette; le Giuditte e le Calotte Corday; le Cleopatre e le Messaline; le guerriere che combattono con più ferocia dei maschi, le amanti che incitano, le distruttrici che, spezzando i più deboli, agevolano la selezione attraverso l’orgoglio e la disperazione, la disperazione che dà al cuore tutto il suo rendimento”.
Non può e non deve esservi differenza fra la sensualità di una femmina, il suo essere provocante e la sua inclinazione a diventare madre, pura e cristallina. La demarcazione fra “donna angelo” e “donna lussuriosa” è puramente maschilista e priva di significato. Il passato e il futuro si incrociano nei due grandi ruoli che la donna ricopre all’interno della società: amante e procreatrice di vita. Figure diverse, ma al contempo tasselli di uno stesso mosaico.
“La lussuria è una forza, perché distrugge i deboli ed eccita i forti a spendere le energie, e quindi a rinnovarle. Ogni popolo eroico è sensuale. La donna è per lui la più esaltante dei trofei.
La donna deve essere o madre, o amante. Le vere madri saranno sempre amanti mediocri, e le amanti, madri inadeguate per eccesso. Uguali di fronte alla vita, questi due tipi di donna si completano. La madre che accoglie un bimbo, con il passato fabbrica il futuro; l’amante dispensa il desiderio, che trascina verso il futuro”.
Il sentimento e l’accondiscendenza non possono ergersi a valori centrali della vita. L’energia femminile non solo si manifesta come ostacolo, ma anche luce che illumina strade di conquista dell’umana voglia di esistere.
“La Donna che con le sue lacrime e con lo sfoggio dei sentimenti trattiene l’uomo ai suoi piedi è inferiore alla ragazza che, per vantarsene, spinge il suo uomo a mantenere, pistola in pugno, il suo arrogante dominio sui bassifondi della città; quest’ultima, per lo meno, coltiva un’energia che potrà anche servire a cause migliori”.
Queste parole, non moraliste né tanto meno prettamente femministe, non furono di una persona qualsiasi. Appartennero ad una donna sì, ma unica, che rigettò tutte le definizioni, stracciando etichette e pregiudizi. Il suo verbo, ancora oggi, nonostante la sua visione del mondo sia stata coniata nel 1912, è ancora attuale e può insegnare molto a chi si pone domande sul “mondo rosa” e non solo. Avanguardista, provocatrice e futurista. Lei fu Valentine de Saint-Point (1875-1953), autrice del “Manifesto delle Donne” e della “Lussuria”. Contribuì, come poche intellettuali nella storia, all’emancipazione della donna sia dal punto di vista dei diritti che del pensiero, partecipando anche a vari movimenti di rivendicazione. Odiava le masse, le certezze, i dettami borghesi, amava la libertà di pensiero, l’essere femmina, l’essere futuro. Concludo con l’ultima parte del manifesto, momento più alto della poetica di una delle grandi donne del ‘900. La speranza è che femmine come Valentine esistano ancora oggi, perchè l’Italia ha bisogno di loro, di voi.
”Donne, troppo a lungo sviate dai moralismi e dai pregiudizi, ritornate al vostro sublime istinto, alla violenza, alla crudeltà.
Per la fatale decima del sangue, mentre gli uomini si battono nelle guerre e nelle lotte, fate figli, e di essi, in eroico sacrificio, date al Destino la parte che gli spetta. Non allevateli per voi, cioè per sminuirli, ma nella più vasta libertà, perché il loro rigoglio sia completo.
Invece di ridurre l’uomo alla schiavitù degli squallidi bisogni sentimentali, spingete i vostri figli e i vostri uomini a superare sé stessi. Voi li avete fatti. Voi potete tutto su di loro.
All’umanità dovete degli eroi. Dateglieli”.
08 Marzo 2011 12:00:00 - http://rinascita.eu/index.php?action=news&id=6928
00:05 Publié dans art, Histoire, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : futurisme, avant-gardes, valentine de saint-point, littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, art, féminisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 24 mars 2011
Urheimat: alle origini del Popolo Europeo
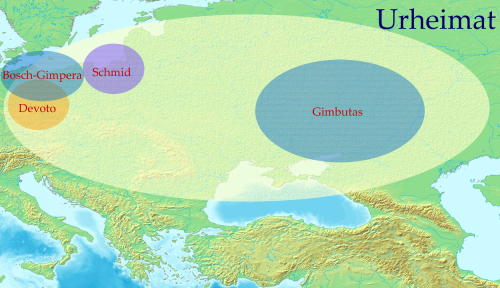
Urheimat: alle origini del Popolo Europeo
Molteplici le teorie sulle origini etniche, addirittura c’è chi sostiene che gli Ittiti provengano dal popolo dei Chatti, stanziati in Europa tra Reno e Weser
Gianluca Padovan
Ex: http://rinascita.eu/
L’improbabile origine asiatica
La questione più dibattuta tra archeologi e linguisti è la sede originaria (dal tedesco Urheimat) dei cosiddetti “Indoeuropei”, popolo che tra il IV millennio a. e il I millennio a. sembra comparire, oltre che in Europa, anche in Asia e in Africa. Ma, inizialmente, si pensa che tale popolazione provenga dall’India e approdi in Europa foriera di cultura e tradizione: cosa mai avvenuta. Così pure si desidera vedere la provenienza di genti, che fanno fiorire culture sul suolo europeo, dalle steppe e dalle tundre dell’est e dai deserti di sudest, basandosi più che altro sui testi biblici e sulla propria religione. A mio avviso il concetto espresso nella frase “ex Oriente lux” è da riconsiderare e soprattutto da evitarne la pedissequa e acritica applicazione.
Alcuni ritengono che la patria originaria sia da ricercarsi nell’Asia Centrale, in un territorio compreso tra il Turkestan e il Pamir, altri nella cosiddetta Russia Europea, ovvero ad ovest degli Urali. Ma vi è chi ritiene che l’ “Urheimat” sia l’Europa del Nord. Oggi i più tendono a considerare che essa sia da collocarsi tra la Germania del Nord e l’Elba e la Vistola, fino alle steppe che vanno dal Danubio agli Urali, quasi in una sorta di compromesso. In buona sostanza la provenienza della luce culturale e sociale è ancora da definirsi e, sostanzialmente, le idee al proposito rimangono varie anche e soprattutto in campo accademico.
Ad esempio, uno dei luoghi comuni dell’Antropologia è l’origine asiatica degli “Indoeuropei”. E a sostegno della tesi della provenienza asiatica vi è la questione del cavallo. Si afferma che esso è addomesticato e allevato nelle grandi pianure dell’est e del sudest asiatico e da qui introdotto in Europa. In realtà il cavallo è già noto almeno fino dal paleolitico superiore, con attestazioni, ad esempio, in Scania (Svezia meridionale). Ma sulla questione si potrebbero leggere fiumi di parole sia pro che contro.
Calvert Watkins scrive: “Molti studiosi ritengono che la zona della steppa siberiana a nord e a est del Mar Nero sia stata, se non la ‘culla’ originaria degli Indoeuropei, almeno un’importante area di sosta negli spostamenti verso ovest nei Balcani e oltre, verso l’Anatolia e verso il sud e poi verso l’est nell’Iran e in India, a cominciare dalla metà del quinto millennio a.C. Questa è quella che viene chiamata dagli archeologi cultura Kurgan, dalla parola russa per i suoi caratteristici monumenti o tumuli sepolcrali” (Watkins C., Il proto-indoeuropeo, in Campanile E., Comrie B., Watkins C., Introduzione alla lingua e alla cultura degli Indoeuropei, Il Mulino, Bologna 2005, p. 49). Tali teorie sono basate anche sugli scritti dell’archeologa americana di origini lituane Marija Gimbutas.
Innanzitutto è probabilmente da ricercare in Europa il fenomeno del megalitismo, che ha lasciato sul territorio monumenti a tumulo che si perpetuano nel tempo e anche all’esterno dei confini continentali. L’argomento è più che noto ed è superfluo riprenderlo, ma un passo è doveroso riportarlo: “L’architettura territoriale neolitica realizza i suoi capolavori nelle regioni europee che costeggiano l’Atlantico e il Mare del Nord - la facciata atlantica europea - dal Portogallo alla Svezia. Gordon Childe ha avuto l’intuizione di rilevare che in Europa i grandi centri dell’architettura megalitica corrispondono alle regioni in cui le sopravvivenze paleolitiche sono più numerose e meglio attestate. Perciò c’è forse un rapporto, sconosciuto e mediato dal tempo, di educazione, atteggiamento e cultura tra i pittori delle caverne paleolitiche e i costruttori di monumenti megalitici. È significativo ricordare il profondo cambiamento di opinione, nella comunità archeologica, sulle origini delle culture megalitiche europee. In passato si pensava che derivassero dalle grandi civiltà urbane del Vicino Oriente. Attraverso i sistemi moderni di datazione al radiocarbonio Colin Renfrew ha potuto dimostrare che i manufatti europei risalgono a prima del 4000 a.C. e sono “creazioni autonome, uniche nel loro genere: i più antichi monumenti di pietra eretti al mondo”. Molte costruzioni furono cominciate nel V millennio a.C. e modificate fino al I millennio a.C.” (Benevolo L., Albrecht B., Le origini dell’architettura, Editori Laterza, Bari 2002, p. 97).
La forza culturale Europea
Così ricorda Romualdi: “L’espansione della cultura nordica nella Russia centrale e meridionale si lascia seguire attraverso la cultura megalitica di Volinia, quella del medio Dnepr e quella di Fatyanovo: tutte queste culture sono caratterizzate da ceramica globulare o cordata e da asce da battaglia. Esse invadono il territorio dei cacciatori ugro-finnici della ceramica a pettine, e premono su quello degli agricoltori della ceramica dipinta di Tripolje. Queste invasioni sono state appassionatamente negate dalla scuola archeologica sovietica di Marr e compagni, pei quali l’esistenza di una Urheimat indoeuropea era “un pregiudizio borghese, esattamente come la fede nell’esistenza di Dio” e per i quali le invasioni indoeuropee facevan parte della mitologia capitalistica” (Romualdi A., Gli Indoeuropei, Edizioni di Ar, Padova 1978, p. 29).
E ancora Romualdi sottolinea l’improbabilità di forti migrazioni da est verso ovest, apportatrici di caratteri culturali: “Ci si trova sempre di fronte alla vaga suggestione delle ‘orde indoeuropee irrompenti nelle steppe euroasiatiche’, contro la quale già Hermann Hirt aveva obiettato che a nessun popolo delle steppe è mai riuscito di diffondere lingue in Europa” (Ivi).
Herman Hirt, nel suo Die Indogermanen, afferma: “L’agricoltura può nutrire su uno stesso territorio assai più uomini dei nomadi delle steppe. È in grado di produrre forze sempre nuove che rafforzano e vivificano la prima corrente. L’assalto dei popoli delle steppe può abbattersi straordinariamente violento, può distruggere come una fiumana di lava ma, poiché non ha nulla dietro di sé, si riassorbe ben presto nella sabbia” (Hirt H., Die Indogermanen I, S. 190; in Romualdi A., op. cit., p. 70). Se qualcuno nutre dei dubbi, guardi che cos’hanno lasciato, ad esempio, gli Unni in Europa: solo un ricordo e per giunta negativo.
Fin dagli albori della storia in Asia e nell’Africa del Nord si incontrano Europei in quanto minoranze che riescono a imprimere una propria impronta alla storia locale. La lingua che diffondono è quella di una aristocrazia conquistatrice, probabilmente poco rispecchiante i multiformi aspetti della vita quotidiana, ma in grado di perdurare nel tempo.
Ittiti, Hittiti, Hatti o Chatti
Rimanendo cauti su traduzioni, trascrizioni, vocalizzazioni più o meno azzeccate, e interpretazioni, parrebbe che la terra di Hatti o di Chatti sia quella occupata dagli Ittiti, che verrebbero così scritti: Hittites, Héthéens, Hetiter, etc. Il territorio, o patria di origine o di semplice sviluppo, è stato localizzato nella penisola anatolica, ad est dell’attuale città di Ankara, antica Angora, capitale della Turchia, ed è la regione detta Hatti. La città principale è Hattusa, o Chattusa, vecchia Boğhazköy (“villaggio nella gola”), odierna Boğazkale. Ma la domanda canonica rimane comunque la seguente: da dove provengono gli Ittiti? Anche qui le ipotesi, ognuna con i suoi bravi dati a sostegno, sono varie. All’occhio di un profano come me sono tutte ugualmente interessanti e valide. Ma una mi ha colpito per la sua originalità e, senza che la si prenda troppo sul serio, la riporto semplicemente perché mi piace, invitando le persone competenti a rifletterci sopra. C’è chi sostiene che gli Ittiti provengano dal popolo dei Chatti, stanziati in Europa tra Reno e Weser. Alcuni linguisti sostengono che varie parole ittite derivino da una forma di linguaggio “antico-alto-tedesco” (Lehman J., Gli Ittiti, Garzanti, Milano 1997, p. 61). Fermo restando che la lingua ittita appartiene alla “famiglia indoeuropea” (meglio identificabile come Famiglia Europea), non basta l’assonanza dei nomi a fornire dati probanti: “Tuttavia non ci basiamo solo su questo. Theodor Bossert, una delle autorità dell’ittitologia, ha pubblicato nel suo Alt-Anatolien (Anatolia antica) una mappa in cui sono registrate tutte le località archeologiche dove sono state rinvenute divinità raffigurate su un toro o nell’atto di cavalcarlo. È una traccia lineare che dalla Siria, oltrepassando Boğhazköy, corre lungo il Danubio fino al Reno, piegando per una sua parte anche verso l’Italia. Un bellissimo esemplare di epoca romana, raffigurante questa divinità ittita con tutti i suoi attributi (fascio di saette e doppia ascia) a cavallo del toro, è stato trovato all’inizio del secolo a Heddernheim, che oggi è un quartiere di Francoforte sul Meno. Werner Speiser forse esagera, quando nel suo Vorderasiatische Kunst (Arte dell’Asia Anteriore) del 1952 sostiene che gli ittiti, con le loro teste e i lunghi nasi vigorosi, avevano un aspetto addirittura “falico” (cioè vestfalico); ma se si accetta la tesi di fondo c’è da riflettere. In definitiva anche i Galati dell’Asia Minore, cui scriveva l’apostolo Paolo, sono parenti dei celti nordeuropei” (Ibidem, pp. 74-75).
Caratteri distintivi
Leggendo nei vari testi e osservando le testimonianze della loro cultura possiamo vedere che gli Ittiti hanno la fronte alta e arrotondata, il naso dritto è senza l’angolo di attaccatura e i capelli sono tendenzialmente sciolti, lunghi e diritti. Possiamo ravvisarvi dei connotati “greci” come per esempio il naso? Attenzione: riferendosi agli Ittiti le iscrizioni egizie li descrivono aventi capelli chiari o probabilmente castano-chiari; inoltre c’è chi ha la barba, tagliata in varie fogge, verosimilmente a seconda della moda del momento. Per curiosità andiamo a vedere che cosa ci dice Tacito a proposito dei germanici Chatti, i quali sono stanziati a nordest del fiume Reno: “abitano il territorio che comincia dalla selva Ercinia, in luoghi non così pianeggianti e palustri come le altre regioni nelle quali si estende la Germania; infatti vi continuano i colli, che a poco a poco si fanno più rari, e la selva Ercinia continua insieme ai suoi Chatti e alla fine li mette al sicuro. La conformazione fisica è più resistente, solide le membra, truce l’aspetto, maggiore la forza d’animo. Possiedono - per essere dei Germani - molto raziocinio e abilità: mettono a capo delle truppe condottieri scelti, ubbidiscono ai comandanti, mantengono il loro posto nelle file dell’esercito; sanno riconoscere l’opportunità favorevole, ritardare gli attacchi, distribuire opportunamente le occupazioni della giornata e fortificarsi di notte; ascrivono la fortuna alle cose dubbie, e invece il valore alle cose sicure, e, cosa ben rara e concessa soltanto alla disciplina romana, ripongono maggior fiducia nel comandante che nell’esercito. La loro forza militare risiede interamente nella fanteria, che oltre alle armi caricano anche di arnesi da lavoro e vettovaglie: gli altri li vedi andare in battaglia, i Chatti in campagna militare. Rare presso di loro le scorrerie e scaramucce. Ottenere rapidamente la vittoria e altrettanto rapidamente ritirarsi è tipico del combattimento a cavallo: la velocità è connessa al timore, la ponderatezza invece alla costanza” (Tacito C., Germania, Risari E. (a cura di), Mondadori Editore, Milano 1991, 30, 1-3).
Tacito sottolinea quindi la capacità dei Chatti di possedere due cose non comuni tra Germani e Celti, che sono la ponderatezza, la costanza, la disciplina e la logistica. Inoltre spiega che dalla tribù dei Chatti, nel 38 a., si staccano i Batavi per andarsi a stabilire alla sinistra orografica del fiume Reno, quindi nel territorio occupato dai Romani, ma da questi “non subiscono l’umiliazione di pagare tributi, né sono oppressi dagli esattori; sono esenti da oneri di imposte e da contribuzioni straordinarie e tenuti in serbo soltanto per il combattimento; li si destina alla guerra come fossero armi da offesa e da difesa” (Ibidem, 29, 1).
Arii o Ariani.
Con il nome di Arii o di Ariani si designano comunemente le genti di lingua “indoeuropea” che dilagarono nelle attuali regioni dell’Iran e dell’India del nord. Taluni hanno sostenuto che si tratta di genti provenienti da nord o da est del Mar Nero, altri da settori ad ovest che oggi portano il nome di Romania e Ucraina. Nel corso del XIX sec. altri studiosi indicano invece come ariani i popoli di lingua europea, di razza bianca e in particolare quelli provenienti dalle regioni del Nord Europa.
Ad ogni buon conto non si è stabilita, o non si è voluta stabilire, con esattezza la loro terra d’origine, andando a negare l’esistenza di una cosiddetta “razza ariana”. Dagli Anni Trenta in avanti, e soprattutto a conclusione della Seconda guerra mondiale, si tende ad assimilare il termine di ariano con le teorizzazioni sulla razza e le formulazioni e le applicazioni delle cosiddette “leggi razziali”. Pertanto l’argomento viene accantonato come scomodo e inopportuno.
Ecco un’altra curiosità che ci viene dal passato tramite Tacito e ancora sui Germani: “Io, personalmente, condivido l’opinione di chi ritiene che le popolazioni della Germania non si siano mescolate con altre genti tramite matrimoni, e che quindi siano una stirpe a sé stante e pura, con una conformazione fisica propria. Da ciò deriva un aspetto simile in tutti, nonostante il gran numero di individui: occhi azzurri e torvi, capelli biondo-rossastri, corpi saldi e robusti, in grado però di costituire una massa d’urto: la loro capacità di sopportare prestazioni faticose è di gran lunga inferiore, e non sono avvezzi a tollerare la sete e il caldo; il clima e la configurazione del territorio li abituano infatti ad adattarsi al freddo e alla fame” (Ibidem, 4, 3).
In particolare, Tacito parla della numerosa tribù dei Suebi, costituita da più tribù: “Attraversa e divide il paese dei Suebi una catena continua di montagne, al di là della quale abitano numerose genti; tra di esse è ampiamente diffuso il nome di Lugi, applicato a molte tribù. Basterà qui ricordare le più forti: Harii, Helveconi, Manimi, Helisi, Nahanarvali” (Ibidem, 43, 2). Stando ad alcuni studiosi la catena montuosa è stata individuata nei Carpazi occidentali e i territori nelle odierne Slesia e Polonia, dalla Vistola all’Oder; inoltre si esprime perplessità sul fatto che fossero della tribù dei Suebi, propendendo per quella degli Slavi.
Vediamo ora cosa ci dice Tacito di una tribù in particolare, quella degli Harii: “Per tornare agli Harii, alla forza per la quale superano le popolazioni sopra elencate aggiungono un’aria truce, e accrescono l’innata ferocia con artifici e con la scelta del momento opportuno: neri gli scudi, tinti di scuro i corpi, scelgono per l’attacco le notti più buie: un esercito di spettri che incute terrore col suo aspetto tenebroso. Non c’è nemico in grado di fronteggiare quella vista tremenda e quasi infernale. Infatti in qualsiasi combattimento i primi a essere sconfitti sono gli occhi” (Ibidem, 43, 4).
Gli studi delle nostre origini e quindi delle popolazioni che abitarono il continente europeo servono allo sviluppo delle conoscenze, nel senso più ampio del termine. Questo porrà probabilmente dei limiti a quello che fu propugnato fin dall’Ottocento come “pangermanesimo”, a cui Stalin oppose, nella prima metà del secolo successivo, il suo ideale di “panslavismo”, dimenticando come gli Slavi siano gente di stirpe europea e non già asiatica. È auspicabile che tutto ciò ponga fine all’equivoco ottocentesco e novecentesco di credere che da altrove sia pervenuta la nostra cultura, definendola “indoeuropea”. Sarebbe un po’ come dire (mi si conceda il paragone) a persone che vivono onestamente del proprio lavoro che gli asini volano ed è bello vederli volare: a furia di ripeterlo, decennio dopo decennio, qualcuno per creduloneria, qualcuno per problemi psichici, altri per piaggeria, affermeranno di vedere gli asini volare.
Noi siamo Europei e la nostra cultura è a tutti gli effetti europea. Non ci credete? La storia si ripete sempre e non sono certo io a dirlo: basti pensare, ad esempio, al filosofo napoletano Giambattista Vico e alla sua teoria riguardo corsi e ricorsi storici. Quindi è necessario e bastante vedere cos’hanno fatto, nel bene e nel male, le genti europee in questi ultimi duemilacinquecento anni e da dove sono partite, dove sono giunte, cos’hanno fondato, cos’hanno costruito, quale sia il contributo sociale, nazionale e culturale che hanno ovunque lasciato. Reimpariamo a pensare con la nostra testa... da veri Europei.
11 Marzo 2011 12:00:00 - http://rinascita.eu/index.php?action=news&id=7010
00:05 Publié dans anthropologie, archéologie, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : anthropologie, ethnologie, europe, histoire, préhistoire, protohistoire, indo-européens, urheimat, archéologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 22 mars 2011
Portrait: Gabriele d'Annunzio

Portrait: Gabriel d'Annunzio
Il avait le teint brouillé des grands nerveux, les yeux bleuâtres, d'un azur profond et embrumé, voilé de quelque lointain rêve, la cornée et l'iris légèrement en saillie entre les paupières glabres, comme les yeux des bustes antiques – déjà. Les lèvres d'un gris mauve, comme des lèvres de marbre – déjà – d'un marbre jadis teinté, dont la nuance purpurine se serait effacée. Les dents mauvaises. Mais qu'importaient ces couleurs de la face et de l'émail dentaire ! La couleur est la chose éphémère, comme l'était cette nuance roussâtre du poil sur l'arcade sourcilière, sous le nez, à la pointe du menton. Et qu'importait, de même, ce corps petit et musclé, avec son torse long, ses jambes courtes ! De ces proportions sans grâce le poète s'accommodait, sachant bien que sa gloire future concentrait tout l'intérêt de son humaine apparence dans le buste, promis – déjà – à l'éternité. Or, la tête était admirable par la forme et par les volumes, par tout ce qui ressortit à la statuaire. Il n'est pas jusqu'à cette complète calvitie qui ne parût par avance un dépouillement volontaire de toute simulation et de tout accident. « Ma clarté frontale », comme l'appelait le maître, avec ce mélange d'orgueil et de sarcasme qui, dans sa bouche, prenait le ton d'un défi, d'une raillerie adressée aux circonstances, aux bizarreries de la nature, aux défaillances d'un dieu distrait. Et la main aussi – la main qui caresse et qui tient la plume (et l'épée) – la main qui est volupté et qui est esprit (et fierté), la main était belle : petite, féminine, ciselée, impérieuse, ayant cette force de dédain que le plus hautain visage ne peut exprimer et que, seule, une belle main reflète avec tranquillité. Au petit doigt, deux bagues d'or, chacune ornée d'une émeraude cabochon. J'ai lu que, sur le lit funèbre, le doigt ne portait plus que deux minces anneaux nus, sans aucune pierre précieuse. Il y a tout un symbole de grandeur et de renoncement dans cette disparition des émeraudes.
Sur le ciel noir de l'époque, la mort de Gabriele d'Annunzio a jeté, durant quelques jours, les suprêmes clartés de la fusée qui s'éteint ou du météore qui rentre dans la nuit. Astre ou bouquet d'artifice ? Là est la question. Certes, la fin d'un tel homme ne pouvait passer inaperçue. Elle devait éblouir encore, les puissances du feu étant les caractéristiques mêmes de l'âme qui prenait congé de nous. Mais je ne puis m'empêcher de noter combien fut bref ce dernier éblouissement, combien la nécrologie (en maints articles où il faut voir un signe des temps et le reflet des modes changées) fut prompte à diminuer, à « minimiser », comme on dit dans un affreux jargon, l'importance de ce brusque départ,
Me trompé-je ? Mais il me semble que, en Italie même, c'est avec quelque précipitation que furent rendus à la haute renommée du défunt les honneurs qu'on lui devait, ou qu'on ne pouvait lui refuser. Dans quelques semaines, la «Voie triomphale » ouvrira sa vaste perspective devant le char de M. Hitler. Ses dalles toutes neuves retentiront sous les martèlements sourds de ce « pas romain » qui fait sa rentrée dans Rome après un bien long détour. Mais le char funèbre du poète n'aura pas suivi la nouvelle avenue. Sans doute parce qu'il y aurait eu antimonie à ce que les gloires du passé empruntassent les routes de l'avenir. Dans une petite église de campagne, un simple cercueil de noyer ciré a reçu l'absoute rituelle. Et la dépouille du héros fut inhumée dans la terre de cette même colline où il avait vécu retiré durant les seize ou dix-sept dernières années de sa vie.
Ainsi va le siècle, ainsi vont les destins des hommes et des États, et les cieux, un instant déchirés par le suprême éclair de la flamme que le vent a soufflée, les cieux sont redevenus ce qu'ils étaient : un amoncellement de nuages sombres.
Quel grand vide, pourtant, ce mort laisse après soi ! Ce vide, on ne le mesure pas encore. Ou bien disons, pour ceux qui pensent que la vie est un renouvellement incessant où nul vide ne se creuse qui ne soit aussitôt comblé, où ce qui s'en va est aussitôt remplacé (fût-ce par son contraire, ce qui est le cas le plus fréquent), disons pour ceux-là que la mort de Gabriele d'Annunzio constitue un grand événement, et point seulement dans l'Histoire de la Littérature universelle, mais dans l'Histoire universelle tout court, l'Histoire de l'Humanité.
C'est toute une conception du monde qui s'efface avec cette éclatante figure. Et j'entends bien que cette conception était depuis longtemps déjà dépassée, démodée, périmée (comme disent les générations nouvelles, avec ce luxe d'expressions méprisantes qu'elles ont toujours à l'égard des gens et des choses qui les ont précédées). Mais Gabriele d'Annunzio, jusqu'à ce soir du 1er mars où la mort l'a frappé à sa table de travail, était le plus illustre « survivant » d'une époque évanouie, le représentant le plus magnifique et le plus accompli d'un certain ordre de grandeur. Lui disparu, c'est tout un pan de la civilisation qui s'effondre ou, si l'on veut, c'est tout un décor qui disparaît comme dans une trappe.
Il a commencé par le culte de l'Amour et de la Beauté. Il ne s'agissait pas, dans son esprit, comprenez bien, de deux religions séparées, ayant chacune leur objet distinct, mais d'une religion unique ayant un double objet sur un seul autel. Les exigences des sens le tourmentaient, et ses aventures furent nombreuses, mais il n'eût point donné satisfaction à ses instincts s'il ne les eût associés – du moins en pensée, car l'imagination du poète supplée parfois aux réalités – à la poursuite d'une forme belle. D'autre part, la définition selon laquelle la beauté serait « une promesse de bonheur » correspond exactement à la manière de sentir qu'il eut dans sa jeunesse, et sa jeunesse se prolongea longtemps, comme on sait, jusque dans son vieil âge. Il ne distinguait point alors la Beauté de la Volupté. Certes, il ne ravalait pas son idole à n'être qu'un instrument du plaisir, mais il considérait l'extase amoureuse, les paradis physiques, comme un accroissement de la Beauté, laquelle ne pouvait, selon lui, atteindre son point de perfection et, si je puis dire, culminer que dans le délire sensuel.
Mais ici encore, gardez-vous d'une équivoque ! N'allez pas confondre cette chasse ardente avec la morne dépravation. Dès l'instant que l'amour est requis, ou que l'âme aspire à lui, le voluptueux cesse d'être enfermé dans le cercle de la débauche. Ce qu'il cherche dans les voies de la sensualité, c'est une évasion, un moyen de se surpasser soi-même, c'est une issue vers le sublime. La Beauté, aux yeux de Gabriele d'Annunzio, fut donc toujours une sorte de prêtresse qui a pour sacerdoce l'initiation aux mystères, et le plus grand mystère de la vie, peut-être son unique but, pense le poète à cette époque, c'est l'Amour.
De plus, comme cet artiste du verbe était en même temps très érudit en matière d'art, toutes les tentatives que les peintres, les sculpteurs, les orfèvres, les émailleurs, les tailleurs d'ivoire et autres servants de la Beauté avaient faites en tous les siècles et tous les pays pour saisir et fixer quelque aspect particulier, éphémère de l'éternelle idole, il les connaissait. Aux figures évoquées par sa propre imagination, laquelle ne cessait d'inventer des formes et des symboles, s'ajoutait un peuple de souvenirs. Il était environné d'images rêvées, mais aussi d'une multitude d'images rencontrées par lui dans tous les musées d'Europe. Entre les créatures de son esprit et les visages des portraits, des statues, des médailles, s'établissaient de perpétuels échanges. Il se créait, entre les deux plans, tout un jeu de références et d'allusions. Le danger eût été qu'une mémoire si fidèle n'étouffât, sous ses apports constants, le jaillissement spontané de l'imagination créatrice. Mais la Poésie, chez Gabriele d'Annunzio, n'avait rien à craindre de Mnémosyne. Combien de fois la Muse annunziesque n'a-t-elle pas prouvé, en souriant, à sa redoutable compagne, qu'elle aurait pu se passer d'elle ! Une flamme extraordinaire maintenait à la température voulue le creuset où s'opérait la fusion magique.
Dans le domaine du vers notamment, où il excella tout jeune, (son premier recueil, Primo vere, contient les poèmes écrits en 1879 et 1880, entre seize et dix-sept ans), Annunzio possède le double don sans lequel il n'est pas de grand poète : l'alliance de l'image neuve et de la sonorité ; il est plastique et musical. Romancier, il a, par les illustrations qu'il a données du culte « Amour et Beauté », imposé à toute une époque sa vue personnelle du monde, la mystique sensualiste d'un paganisme nouveau. Il est à l'origine d'un certain romanesque lyrique, tout à l'opposé de l'école naturaliste, qui, elle, a bien souvent caché, cultivé comme un vice, sous le couvert de la recherche du Vrai, un amour monstrueux, assidu, acharné de la Laideur. Il a créé une atmosphère d'enchantement qui n'appartient qu'à lui, détourné le XIXe siècle finissant des spectacles amers, des étalages complaisants de la bassesse humaine et de la platitude. Il nous a induits en des rêveries fastueuses ; il nous a rendu les clés des jardins ornés, des palais au fond des parcs ; il a peuplé nos songes de fascinantes figures de femmes, restauré les loisirs heureux ou ravagés par des passions aristocratiques.
Et sans doute, il a pu entrer quelque naïveté dans ces évocations, de même qu'il y eut quelque bric-à-brac dans l'existence de l'auteur lorsqu'il voulut, pour son propre compte, mettre sa vie en accord avec ce luxe imaginaire.
Mais on aurait tort de limiter au goût du pittoresque et du bibelot ce vœu profond d'un cœur fervent. N'oublions pas que, dans les romans de Gabriele d'Annunzio, la Mort est toujours présente, accoudée aux terrasses avec les amoureux ou, solitaire, jouant de la harpe, en attendant son heure, dans le boudoir voisin de la chambre à coucher. Le culte « Amour et Beauté » ne peut être sincère, pratiqué avec foi, et ne peut mener loin sans que s'y glissent l'odeur attristante des roses effeuillées, la saveur de la lie au fond du verre, tout ce qui présage, annonce, révèle les approches de la visiteuse voilée.
Ensuite il y a entre l'esthétique et l'éthique de secrets passages. Le culte du Beau ne suffirait point à faire accéder une âme à la sainteté. Le Beau ne se confond pas avec le Bon. Que de fois n'est-il pas son contraire ! Mais il est rare que quelqu'un de bien déterminé à faire du culte de la Beauté sa raison de vivre, ne soit pas porté vers ce qui est noble et vers ce qui est grand. Cette ascension est patente dans l'œuvre et le caractère de Gabriele d'Annunzio.
Comparée à son œuvre romanesque, son œuvre dramatique frappe déjà par un certain caractère d'austérité. Les passions y règnent encore en maîtresses, mais il ne s'agit plus uniquement ici de la passion amoureuse et de l'exaltation de la Beauté. Ce sont tous les tragiques de la vie qui se donnent rendez-vous en ces drames étranges. La volonté de transposer le réel dans le lyrisme, de l'intégrer à la poésie, voilà ce qui crée l'unité entre ces drames divers, ainsi que le lien entre ce théâtre et les romans qui l'ont précédé.
Les Lettres françaises garderont une reconnaissance particulière à ce grand poète italien, ce merveilleux génie bilingue, qui sut couler ses sentiments, ses rêves légendaires, la vibration de sa lyre épique et sacrée dans notre « doux parler ». Lui-même s'est dépeint tel qu'il fut en sa première jeunesse, attentif aux leçons de ceux qu'il nomme ses deux maîtres en matière de langage : l'Italien Ernesto Monaci et le Français Gaston Paris. Il a conté comment, à la veille de la Grande Guerre, exilé sur notre sol, entre le cap de Grave et l'Adour, il se plaisait à reconnaître, au cours de ses promenades à cheval, le long des grèves, dans le large déferlement de la houle atlantique, la grande chevelure glauque de la fée Morgane, divinité bienfaisante des Gaules. Or, « en cet automne lointain des Landes », le poète écrivait le Martyre de saint Sébastien, ce poème français, unique dans notre littérature, où les sources communes de notre langue et de la langue italienne retrouvent parfois leur surgeon primitif, comme deux sœurs jumelles, à certaines heures, et quoique depuis longtemps séparées, sentent palpiter encore au fond de leur subconscient le souvenir du tendre emmêlement qu'elles avaient dans le sein maternel.
Ce français poétique de Gabriele d'Annunzio est « en dehors de tout » peut-être, hors du courant, hors du temps écoulé. Mais quelle étonnante merveille ! Nourri aux allégories et symboles du Roman de la Rose, aux truculences et trivialités magnifiques de nos vieux fabliaux, il est, avec cela, aussi éloigné que possible de l'archaïsme pédantesque, aussi embaumé, aussi frais qu'un parterre de fleurs à l'aurore.
Vint la guerre. On sait ce que la France doit à Gabriele d'Annunzio. Dans la lettre fameuse que le poète écrivit à Maurice Barrès, le jour où l'Italie se rangea aux côtés des Alliés, il est une phrase superbe que je n’ai jamais pu relire sans être parcouru de ce frisson qui se transmet de l'âme au corps lorsque retentit dans l'air la voix de l'héroïsme : « ... le vert et le bleu de nos drapeaux confondent leurs couleurs dans le soir qui tombe ».
Une vie nouvelle commençait alors pour le grand écrivain. Elle devait être courte et flamboyante. Six années à peine, avant la retraite au bord du lac, sur la colline ! Mais, à partir de ce mois de mai 1915, où il quitta son appartement parisien pour regagner son pays, qu'il allait entraîner dans la guerre, quel changement chez cet homme qui, moins d'un an auparavant, souriait, au milieu d'un cercle de femmes, dans les théâtres et les salons de Paris.
Pourtant, du premier jour où son destin le requiert d'agir, il est prêt, armé chevalier en lui-même, et par lui-même, et sur l'heure ! De la religion « Amour et Beauté », sans transition apparente (mais les transitions, il les avait sans doute vécues dans son cœur, durant ses méditations solitaires sous les pins brûlants d'Arcachon), il passe, non seulement au culte des Héros, mais à la pratique de l'héroïsme, non seulement à la « chanson de geste », mais à la « geste » elle-même. Il n'est plus le troubadour qui s'exalte à célébrer les exploits des Roland, des Olivier, des Renaud. Il est l'égal des preux. Et un jour, il les surpasse. Il s'est élancé dans le ciel, suivi de ses compagnons montés sur des monstres ailés. Il libère Fiume, comme Persée délivra Andromède, et il la rend à sa patrie.
François PORCHE.
Extrait de La Revue Belge, 1920-1930.
00:05 Publié dans Histoire, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres italiennes, littérature italienne, italie, histoire, gabriele d'annunzio |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook