samedi, 27 janvier 2024
Les leçons du Belarus

Les leçons du Belarus
Carlos X. Blanco
Le professeur Fernández Riquelme est un auteur très connu dans le domaine des essais géopolitiques, de l'histoire sociale, de la pensée espagnole, etc. L'un de ses livres que j'ai le plus apprécié est le vaste traité El sueño de la democracia orgánica (SND, Madrid, 2021), un ouvrage fondamental pour comprendre la pensée démocratique conservatrice (et non libérale) dans l'Espagne du 20ème siècle, et en particulier sous le régime franquiste.
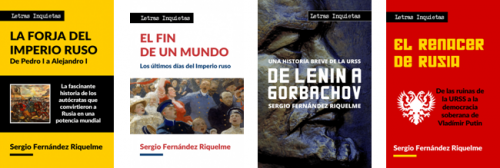
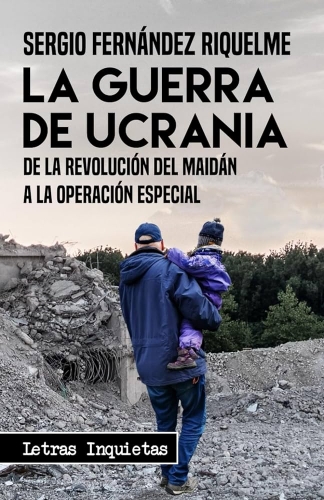
Dans le domaine qui nous intéresse ici, celui de la géopolitique actuelle, toujours étudiée avec les considérations nécessaires sur l'histoire récente, l'auteur s'est distingué sur la scène éditoriale avec ses ouvrages consacrés au monde slave et à l'Europe de l'Est. La maison d'édition Letras Inquietas, à travers sa collection "Visegrad", a servi de plateforme pour la diffusion d'une information rigoureuse de la situation de ces pays qui, malgré les politiques bellicistes et conflictuelles de l'OTAN, sont aussi les patries de nos frères et sœurs. Il s'agit de nations européennes qui partagent avec l'Espagne plus de choses qu'on ne le dit et qui offrent parfois des modèles de démocratie alternatifs au paradigme supposé unique de la partitocratie libérale et oligarchique, un système désastreux qui domine l'Espagne depuis 1978.
Numéro un du nouveau catalogue des Ediciones Ratzel, une maison d'édition consacrée aux questions géopolitiques, Don Sergio complète sa production de textes sur l'Europe de l'Est avec celui-ci qui s'intéresse à un État largement méconnu du public espagnol : la Biélorussie. La Russie blanche, la Biélorussie, est un pays intérieur et enclavé qui a toujours été étroitement lié à la Russie. Bien qu'il possède sa propre langue, comme l'Ukraine voisine, la grande majorité de la population parle russe et se sent culturellement identifiée à la Grande Russie.
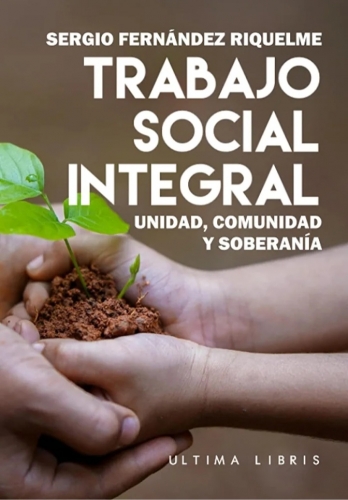
Le Belarus dirigé par Loukachenko (né en 1954) est un pays stable, doté d'un niveau élevé de protection sociale et d'une homogénéité ethnique enviable. Son existence indépendante est paradoxalement liée à l'"empire soviétique" qui, formellement, était une fédération. En tant que fédération de républiques socialistes, l'URSS a été la matrice de nouveaux États après sa démolition en 1991. Le passé de Loukachenko, et du Belarus lui-même, est soviétique et unitariste. Le "père" de ce "jeune frère russe" (comme le dit le sous-titre du livre que nous commentons) était le seul membre du Soviet suprême qui, en 1991, a voté contre la désintégration de l'URSS. Paradoxe de l'histoire de l'empire soviétique : le seul homme politique d'une institution aussi importante qui s'est opposé à la désintégration de l'URSS a été reconnu quatre ans plus tard (1994) comme président d'une nation jeune et nouvelle.
Le professeur Fernández Riquelme raconte comment les liens entre la Russie blanche et la Grande Russie ont connu des "hauts et des bas". L'équilibre entre le maintien de l'autonomie souveraine vis-à-vis du géant Moscou et la dépendance vis-à-vis de ce géant (en matière d'énergie, de commerce, de sécurité, etc.) a été judicieusement géré par Alexandre Loukachenko depuis Minsk. L'épreuve décisive pour ces régimes post-soviétiques est venue, comme en Ukraine, de l'ingérence des États-Unis et de leurs agents pro-occidentaux. L'ingérence qui a conduit à l'éviction du président légitime de l'Ukraine en 2014 (le fameux Euromaïdan) a également été tentée en Biélorussie : manifestations, expressions d'un nationalisme russophobe, voire nazi, et d'un "occidentalisme" exacerbés. Mais Loukachenko, finalement, est sorti vainqueur de la guerre hybride lancée par les États-Unis. Ses services secrets (KGB), son contrôle sans faille de l'appareil militaire et policier, ainsi que le degré élevé de satisfaction de la population à l'égard de son régime quasi-socialiste, ont fait de lui le père incontesté de la nation et ont scellé le destin du Belarus en tant que nation sœur de la Russie, intégrée avec elle dans les domaines les plus variés, même si, formellement, le Belarus est et restera un État souverain.
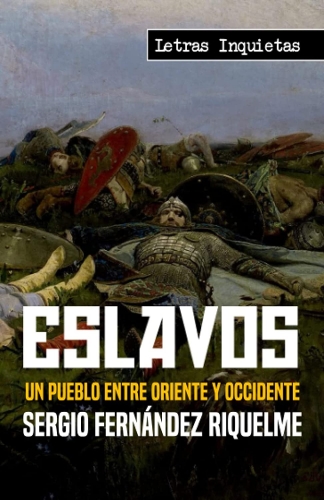
Loukachenko a garanti la sécurité et une croissance soutenue à son peuple pendant ses nombreux mandats, ce qui n'est pas une mince affaire dans une région d'Europe où le Pentagone a réussi à élever des clowns criminels comme Zelensky, des dirigeants sans scrupules qui sont prêts à offrir sur le bûcher funéraire de l'OTAN et de son prestige carbonisé "jusqu'au dernier Ukrainien". Alors que l'Ukraine disparaîtra probablement à jamais en tant que nation après une défaite des forces de l'OTAN qui éclipsera un jour pour toujours l'humiliation des États-Unis au Viêt Nam, Loukachenko, quant à lui, a jusqu'à présent déjà offert des preuves avérées de travail constructif.
Aux côtés du Chinois Xi et de son "grand frère" Poutine, le président biélorusse apporte sa pierre à l'édifice d'une Eurasie élargie. L'Eurasie qui dominera le cœur du monde ne sera pas une démocratie libérale, nous le savons. Ce sera une grande confédération d'États de taille impériale (Russie, Chine, Inde) et de petits et moyens États, comme celui qui est dirigé depuis Minsk, qui conserveront leur identité et leur autonomie tout en atteignant des niveaux élevés de couverture sociale, de développement technologique et de sécurité intérieure et extérieure.
Les "démocraties libérales" s'enfoncent dans le chaos que Guillaume Faye a qualifié de "convergence de catastrophes" : guerres civiles ethniques, criminalité généralisée, ghettos intégristes, invasion massive de migrants illégaux, effondrement économique, tensions centrifuges, drogue et prostitution, dégradation des institutions... Ceux que la propagande otanienne et pentagonale appelle "autocrates" à l'Est entreront dans l'histoire (en général) comme les derniers "hommes d'Etat". Car en Occident, il n'y a plus d'"hommes d'État", bons ou mauvais (Franco, De Gaulle, Perón, Castro). En Occident, il n'y a plus que des primates aveugles et arrogants qui se hissent au sommet lorsque l'OTAN civile le décide, et qui tomberont dans la fange lorsque cette même OTAN, corrompue et criminelle, décidera de leur sort. En Espagne, nous avons connu de nombreuses années de primaterie politique, et le dernier en date, le tyran qui veut amnistier Puigdemont, est le pire jusqu'à présent. Mais ne vous inquiétez pas: tant qu'il n'y aura pas de chaîne de bronze tendue reliant Madrid à Paris, Berlin et Moscou, nous aurons des tyrans de plus en plus mauvais, de plus en plus rampants et délétères. Il est difficile de les imaginer pires, mais ils le seront tant que l'Europe ne sera pas unie de Lisbonne à Vladivostok.
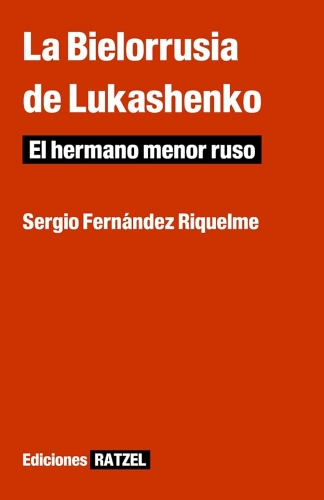
Le livre de Sergio est à recommander à cent pour cent. En quelques pages, le lecteur reçoit une leçon sur un pays et un dirigeant qu'il faut connaître, plus et mieux.
La Rusia de Lukashenko. El hermano menor de Rusia.
La Biélorussie de Loukachenko : le petit frère de la Russie (Sergio Fernández Riquelme)
Ediciones Ratzel.
Prix de vente conseillé : 8,99 euros, 43 pages
Disponible : Amazon | PayPal
19:06 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : belarus, biélorussie, europe orientale, europe, affaires européennes, politique internationale, histoire, sergio fernandez riquelme, monde slave |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 24 janvier 2024
Max Otte : "Les opposants politiques sont déshumanisés et persécutés"

Diario 16 Mediterráneo interviewe Max Otte, auteur de "Temps incertains"
Max Otte : "Les opposants politiques sont déshumanisés et persécutés"
Par Santiago Aparicio
Source: https://editorialeas.com/diario-16-mediterraneo-entrevista-a-max-otte-autor-de-tiempos-inciertos/
À l'occasion de la publication du livre Tiempos inciertos (Editorial EAS), nous avons l'opportunité d'interviewer l'ancien candidat à la chancellerie allemande Max Otte. Économiste et professeur dans plusieurs universités américaines et allemandes prestigieuses, il offre une vision pessimiste du chemin que prend l'économie allemande, en particulier, et l'économie européenne, en général. Si l'on ajoute à cela une profonde crise de civilisation, l'exposé se résume à une critique de la situation actuelle que l'on nous vend comme presque parfaite.
D16 : Après avoir lu le livre, on se demande si la situation de l'Allemagne est vraiment si mauvaise (parce qu'elle a beaucoup plus de petites et moyennes entreprises que l'Espagne, par exemple)?
L'Allemagne compte encore un certain nombre de petites et moyennes entreprises. Mais leur nombre diminue vite. L'éducation, la science et la technologie s'érodent rapidement. La plupart des Allemands ont vécu sur le passé - les industries de la deuxième et de la troisième vague d'industrialisation - et n'ont que peu d'industries d'avenir. Une politique économique suicidaire fait également grimper les prix de l'énergie au niveau le plus élevé du monde.
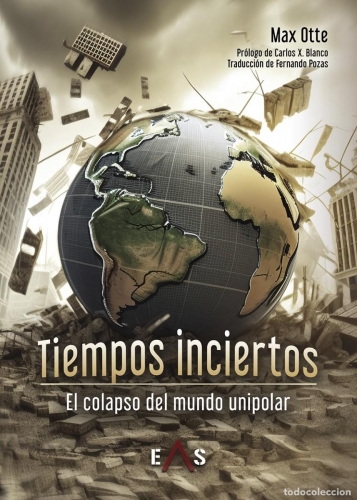
D16 : La classe dirigeante mondialiste divise-t-elle les fonctions économiques des différentes régions du monde ?
Il existe une classe mondialiste : milliardaires mondialistes, cadres et politiciens mondialistes. En même temps, les rivalités géopolitiques continuent d'exister et même de s'approfondir. Je vois le monde se diviser en un bloc dirigé par les Etats-Unis, un bloc chinois et quelques Etats plus ou moins indépendants.
D16 : Le capitalisme financier est-il la dernière phase du capitalisme ou la première phase d'un nouveau système ?
Il est certain que nous sommes à la fin du siècle américain et de l'ordre mondial concurrent. Le capitalisme financier est un système plutôt malsain, à plein régime, qui crée d'énormes revenus sans apporter de valeur à certains et une pauvreté relative à d'autres. Ce système social pourrait disparaître et être remplacé par un système beaucoup plus axé sur le contrôle, comme le prédisent Strauss et Howe dans The Fourth Turning (1996). Il est fort probable que le Green New Deal et la Religion climatique soient utilisés pour mettre en œuvre une économie dirigée par l'État.
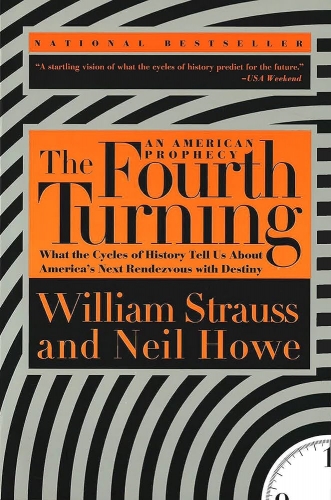
D16 : Que pensez-vous de l'intelligence artificielle et du transhumanisme ?
Avec la prévention de la troisième guerre mondiale (Elon Musk), les défis posés à l'humanité par l'intelligence artificielle constituent les questions les plus importantes de la prochaine décennie. L'IA se développe aujourd'hui à une vitesse fulgurante, et il n'est pas inconcevable que les humains soient remplacés par l'intelligence informatique. Le transhumanisme va de pair avec le développement de l'IA, et il n'est pas non plus inconcevable que l'homme et la machine fusionnent. Un cauchemar pour les humanistes.
D16 : Dans la lignée de Spengler, prévoyez-vous l'émergence d'une nouvelle culture qui dépasserait la civilisation occidentale ?
La Chine a fait preuve d'une stabilité étonnante, elle peut donc potentiellement amorcer un nouveau cycle civilisationnel. Pour Spengler, la Russie était le noyau d'une nouvelle civilisation potentielle. Mais Spengler lui-même admettait que, comparée à la civilisation occidentale, la plus puissante de toutes, elle serait plus faible. Mais aujourd'hui, bien sûr, un nouveau stade civilisationnel pourrait se développer grâce à l'IA.
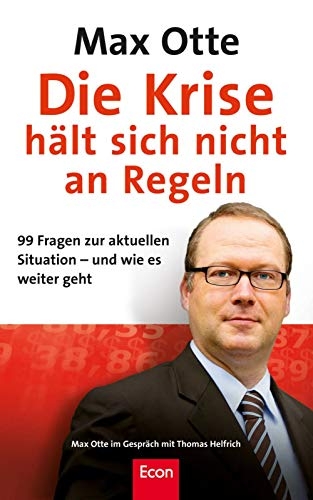
D16 : Les médias de l'establishment qualifient des partis comme l'AfD de néo-fascistes. Y a-t-il un retour à la criminalisation et à la déshumanisation de la différence/de l'ennemi ?
Oui, nous assistons aux dernières étapes d'un projet qui fut fondamental dans le système mondial, et les opposants politiques sont désormais déshumanisés et persécutés. Mais ils appartiennent aux partis dits "de droite" qui défendent la société civile et les droits civiques. La gauche et les partis verts défendent l'idéologie climatique à caractère religieux, le transhumanisme et l'ouverture des frontières.
D16 : L'Union européenne, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, est-elle le mal absolu ?
Je me méfie des termes comme "mal absolu". Mais l'UE est très dysfonctionnelle, a un programme autoritaire et est sujette au lobbying et à l'influence des Etats-Unis, de sorte qu'elle promeut souvent les intérêts des Etats-Unis plutôt que ceux de l'Europe.
D16 : Si seul le socialisme prussien est un socialisme possible, quel espoir reste-t-il aux peuples d'Europe ?
Appelez-le socialisme prussien, socialisme démocratique, économie sociale de marché ou capitalisme rhénan, ils diffèrent en degré, mais ils sont le modèle européen. Nous devons nous souvenir de nos racines.
D16 : Y a-t-il une solution venant des universités ou des écoles de commerce pour sauver cela ou la situation des universités est-elle aussi mauvaise qu'il n'y paraît ?
Les universités sont perdues. Nous devons repartir à zéro.
20:19 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Entretiens, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : max otte, entretien, allemagne, europe, affaires européennes, actualité, livre |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 18 janvier 2024
Emmanuel Todd et la défaite de l'Occident

Emmanuel Todd et la défaite de l'Occident
Markku Siira
Source: https://markkusiira.com/2024/01/12/emmanuel-todd-ja-lannen-tappio/
L'historien et sociologue français Emmanuel Todd, qui avait prédit dès 1976 la chute prochaine de l'Union soviétique, évalue dans son nouveau livre La Défaite de l'Occident la fin imminente de l'Occident.
Décrit comme un "conservateur de gauche", Todd estime que l'OTAN est déjà en train de perdre le conflit en Ukraine. Malgré la situation actuelle enflammée, il conclut également que la défaite finira par culminer avec la réconciliation de la Russie avec l'Europe et son rapprochement avec l'Allemagne, contre la volonté des États-Unis. Cette affirmation semble bien téméraire.
L'historien français condamne l'attitude brutale de l'Occident à l'égard de la Russie, affirmant que "la prévention du rapprochement entre l'Allemagne et la Russie était l'un des objectifs des États-Unis". Ce rapprochement aurait signifié l'éviction des États-Unis de la structure du pouvoir européen. Ainsi, les Américains "préférent détruire l'Europe plutôt que de sauver l'Occident".
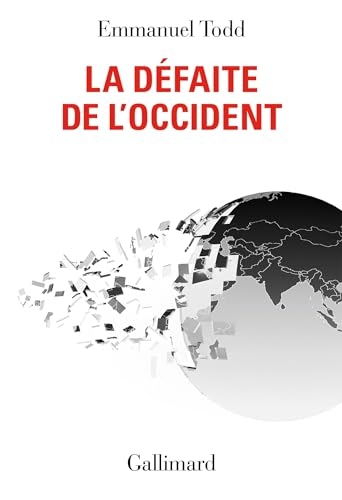
Dans sa nouvelle analyse, Todd souligne le déclin de "l'Amérique, plongée dans le nihilisme" en tant que superpuissance mondiale et l'affaiblissement de son industrie de guerre. Le penseur français cite également la perte d'influence de l'Europe, autrefois représentée par le partenariat franco-allemand.
Suite au conflit en Ukraine, l'Union européenne a pris ses distances avec la Russie, au détriment de ses propres intérêts commerciaux et énergétiques. Selon M. Todd, nous vivons désormais dans un "monde poutinophobe et russophobe" saturé par le discours occidental. Il n'est pas surprenant que ses opinions lui aient déjà valu l'étiquette de "poutiniste".
Mais Todd est un penseur ouvert et défend le pluralisme, qui reconnaît la valeur des différentes perspectives. Il souhaite que l'Occident reste pluraliste, même si, à l'heure actuelle, il semble qu'une seule version politisée de la réalité soit acceptée.
Todd ne pense pas que les prochaines élections présidentielles américaines changeront le cours du conflit actuel. Il pense que la Russie est fermement attachée à sa ligne de conduite. Le changement de leadership à la Maison Blanche n'a aucune importance pour le Kremlin, car "la Russie est en guerre contre les États-Unis".
L'historien considère que la situation en France est sombre. Pour Todd, "la France n'existe même plus parce qu'elle est alliée aux États-Unis et contrôlée par l'OTAN". La France de Macron ne semble de toute façon pas être une puissance très sérieuse: l'élite népotique vient d'élever un inexpérimenté de 34 ans, ouvertement homosexuel, Gabriel Attal, au poste de premier ministre.
D'un point de vue géopolitique, la dégradation de l'Europe ne se limite pas à la France. Les États existent grâce à leurs divers intérêts et à leur souveraineté nationale; dès lors qu'ils acceptent l'élément de vassalité volontaire, ils cessent d'exister. La guerre mondiale est loin, mais l'Europe vit toujours en territoire occupé par les Américains.
Selon Todd, la meilleure chose qui puisse arriver à l'Europe serait que les États-Unis se retirent de l'ensemble du continent. Alors que les euro-atlantistes habitués à l'hégémonie de Washington et souffrant du syndrome de Stockholm politique pourraient se demander "que nous arriverait-il alors?", Todd voit une paix s'étendre partout dans un espace européen libéré du joug américain.
Bien entendu, on peut se demander si le départ des États-Unis de l'Europe nécessite d'abord une guerre. La géopolitique est revenue au premier plan dans les relations internationales et la "gouvernance mondiale" est en pleine mutation. Qui déterminera finalement le nouvel ordre si et quand la domination de l'Occident, selon l'hypothèse de Todd, prendra fin ?
17:25 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, emmanuel todd, occident, europe, affaires européennes, livre |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 01 janvier 2024
L'européanisme de Drieu entre philosophie, littérature et politique

L'européanisme de Drieu entre philosophie, littérature et politique
Les éditions "Passaggio al Bosco" rééditent en Italie l'essai "Drieu La Rochelle : le mythe de l'Europe" avec des textes d'Adriano Romualdi
par Andrea Scarano
Source: https://www.barbadillo.it/95823-leuropeismo-di-drieu-tra-filosofia-letteratura-e-politica/
Le mythe de l'Europe par Drieu La Rochelle
Quelle vision du monde caractérise l'un des principaux littérateurs français du 20ème siècle, à la personnalité complexe et solitaire, incompris, mal à l'aise et dépassé, longtemps ignoré même par la droite, y compris la droite italienne? La maison d'édition "Passaggio al bosco" propose la réédition de l'essai "Drieu La Rochelle : le mythe de l'Europe", publié pour la première fois en 1965 avec des contributions d'Adriano Romualdi, Mario Prisco et Guido Giannettini.
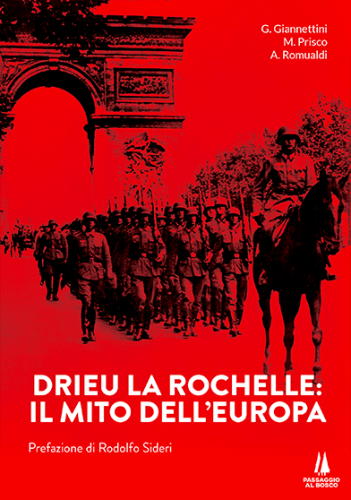 Les auteurs retracent les vicissitudes d'un écrivain "déchiré" entre spéculation philosophique et pensée politique, littérature et problèmes sociaux, religion et militantisme plus ou moins actif, tourmenté surtout par l'idée, clairement nietzschéenne, de la décadence, cause de la disparition de l'individualité dans l'anonymat et de la lente dissolution des classes et des hiérarchies, menace imminente tant pour la France que pour l'Occident tout entier, plongé dans le "bourbier putride" des sociétés modernes, bourgeoises et capitalistes.
Les auteurs retracent les vicissitudes d'un écrivain "déchiré" entre spéculation philosophique et pensée politique, littérature et problèmes sociaux, religion et militantisme plus ou moins actif, tourmenté surtout par l'idée, clairement nietzschéenne, de la décadence, cause de la disparition de l'individualité dans l'anonymat et de la lente dissolution des classes et des hiérarchies, menace imminente tant pour la France que pour l'Occident tout entier, plongé dans le "bourbier putride" des sociétés modernes, bourgeoises et capitalistes.
Aristocrate et attaché à ses origines normandes, Drieu participe activement à la Première Guerre mondiale, qu'il salue comme une véritable libération, dont il souligne à la fois les aspects mystiques et héroïques et l'ivresse d'un rêve de puissance capable de lui révéler l'unité absolue des binômes vie/mort et douleur/joie, lui faisant espérer des possibilités de renaissance, contrariées ensuite par le recul des Français, envers lesquels il ne cache pas son vif ressentiment; leur médiocrité face aux puissances émergentes était le signe que l'expérience républicaine commencée en 1789 pouvait être considérée comme irrémédiablement terminée.
L'objectif de détruire les mythes de la civilisation décadente, y compris les mythes éculés du conservatisme, l'amène à adhérer au mouvement Dada; la confluence de ses principaux animateurs dans le surréalisme et le communisme - dont l'écrivain a toujours reconnu les militants comme ayant une prédisposition au sacrifice et à la lutte - décrète bientôt son éloignement de ses anciens amis et le début de son engagement dans la construction de la patrie et de l'idée européenne. L'unité politique, le dépassement des nationalismes dans une forme de fédération d'États, alternative au capitalisme comme au communisme, auraient également évité le spectre de la subordination coloniale à la Russie ou aux États-Unis.
Sa prise de conscience progressive que seul le fascisme compris comme un phénomène européen pouvait s'imposer comme une révolution intégrale, une synthèse des intérêts politiques et spirituels, des valeurs de la liberté et de l'autorité, du travail et du capital, a commencé avec les émeutes parisiennes de février 1934; la chronique de ces événements, reprise dans le roman "Gilles", lui a fait croire pendant un court laps de temps que l'insurrection des fascistes et des communistes pourrait renverser le gouvernement radical-socialiste.
L'analyse de l'échec de l'action rénovatrice des partis de droite et de gauche contenue dans "Le socialisme fasciste" incite Drieu à appeler à la constitution d'un nouveau parti, plaçant l'espoir éphémère de l'instauration du socialisme - "pas celui des négateurs de l'esprit, un socialisme non fondé sur l'envie", précise Romualdi - et du fascisme dans le militantisme au sein des rangs du Parti populaire français, formation d'anciens communistes (dont son fondateur, Jacques Doriot), de radicaux et de fascistes.
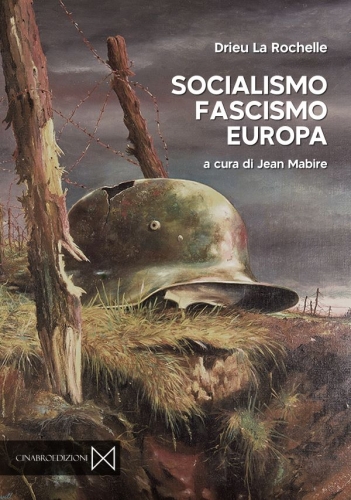 Dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, où l'Allemagne nationale-socialiste - symbole du fascisme européen le plus "abouti" - affirme progressivement son hégémonie comme un fait incontestable, Drieu justifie son adhésion au collaborationnisme non seulement comme le choix de l'intellectuel qui, n'ayant pas peur des choix impopulaires, prend ses responsabilités. L'attitude douce des Allemands à l'égard de la population et des militaires français, ainsi que la renonciation - après l'armistice et au moins jusqu'à la mi-1941 - aux revendications territoriales concernant les possessions coloniales et les régions (comme l'Alsace et la Lorraine) qui avaient appartenu à l'Allemagne jusqu'en 1919, lui ont fait croire qu'ils accepteraient la coopération loyale d'autres pays en position de "primi inter pares", satisfaisant ainsi les exigences de l'inclusion de la France dans le processus de formation du nouvel ordre européen, du retour aux mythiques âges d'or et à l'ancienne grandeur.
Dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, où l'Allemagne nationale-socialiste - symbole du fascisme européen le plus "abouti" - affirme progressivement son hégémonie comme un fait incontestable, Drieu justifie son adhésion au collaborationnisme non seulement comme le choix de l'intellectuel qui, n'ayant pas peur des choix impopulaires, prend ses responsabilités. L'attitude douce des Allemands à l'égard de la population et des militaires français, ainsi que la renonciation - après l'armistice et au moins jusqu'à la mi-1941 - aux revendications territoriales concernant les possessions coloniales et les régions (comme l'Alsace et la Lorraine) qui avaient appartenu à l'Allemagne jusqu'en 1919, lui ont fait croire qu'ils accepteraient la coopération loyale d'autres pays en position de "primi inter pares", satisfaisant ainsi les exigences de l'inclusion de la France dans le processus de formation du nouvel ordre européen, du retour aux mythiques âges d'or et à l'ancienne grandeur.
Une fois disparus les nationalismes traditionnels et les anciennes patries, l'échiquier international se composerait de trois empires: l'Amérique, la Russie et l'Europe unie - malgré la malheureuse guerre fratricide anglo-allemande - contre les francs-maçons et les jésuites, les progressistes et les radicaux, la bourgeoisie et le prolétariat. Partant d'une critique du concept de progrès et de civilisation qui impliquait également le catholicisme moderne et décadent, Drieu développa une éthique fasciste qui, poursuivant l'objectif de la "civilisation du héros", des mythes du sang et de l'homme nouveau, disciplinait l'âme - conçue comme éternelle - et le corps, en recourant à la fois aux vertus guerrières et monastiques; il attribue donc à la spiritualité non pas le sens respectable et sentimental de l'amour du prochain, mais celui de la force intérieure qui se traduit par la sévérité et l'âpreté de l'essentiel.
Sa conception religieuse tente de concilier le christianisme héroïque de la vision médiévale du Christ royal et viril et le paganisme, conçu comme une reprise des orientations métaphysiques préchrétiennes - qui admettent l'existence d'autres divinités en dessous de Dieu ("profondeurs du monde") - et comme la négation qu'un Dieu "personnel" exprime le sentiment authentique de la divinité.
Sens du sacrifice, sens de la résurrection, guerre perdue, rêve brisé de l'Europe sont des thèmes récurrents dans sa production littéraire, ainsi que celui de la mort. À la veille de l'invasion et des bombardements alliés, Constant - le protagoniste du roman "Chien de paille" - est le spectateur amer et détaché des événements, prêt à faire le geste extrême comme l'alter ego de Drieu qui - trahi par le choix des Allemands de répudier son rôle révolutionnaire pour poursuivre des politiques d'annexion déstabilisant l'unité du vieux continent - a planifié et consommé, en pleine cohérence et conscience, son suicide.
Andrea Scarano.
18:50 Publié dans Littérature, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, livre, littérature française, lettres, lettres françaises, pierre drieu la rochelle, deuxième guerre mondiale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 28 décembre 2023
Comment l'âme d'un peuple se détruit et se reconstruit

Comment l'âme d'un peuple se détruit et se reconstruit
Claudio Ozella
Source: https://electomagazine.it/come-si-distrugge-e-si-ricostruisce-lanima-di-un-popolo/
Caspar von Schrenck-Notzing (1923-2009) était un écrivain conservateur allemand issu d'une famille noble et ayant de vastes intérêts culturels. Lavaggio del carattere. Le conseguenze dell'occupazione americana de la Germania (€28.00 p. 378) republié en Italie par OAKS, édité par Francesco Coppellotti, qui a écrit un long essai introductif intitulé FIAT DEMOCRACY PEREAT GERMANY. Cet essai introductif, selon son auteur, a un double objectif: 1. démontrer l'importance absolue du livre de Caspar von Schrenck-Notzing, qui devrait être adopté par toutes les chaires de germanistique d'Italie. 2. Montrer comment la germanistique italienne de l'après-guerre peut être libérée de sa scandaleuse servitude au maître américain.
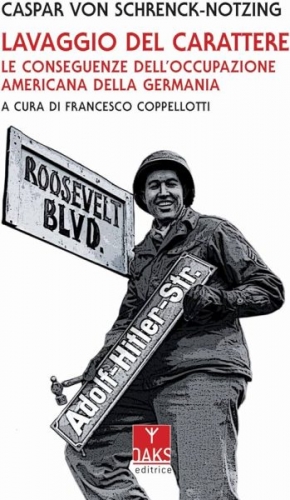

L'auteur, dans cet essai, sur la base d'une documentation originale, inédite et solidement étayée, analyse comment l'âme d'un peuple, en l'occurrence le peuple allemand, est détruite et reconstruite après la défaite de la Seconde Guerre mondiale par les États-Unis, par le biais du "lavage de caractère". Roosevelt et Staline se sont mis d'accord sur l'idée de neutraliser le peuple allemand, afin d'étouffer dans l'œuf toute idée future de revanchisme. Ce lavage de caractère n'a pas seulement touché les nazis, mais l'ensemble du peuple allemand.
Les bases pratiques ont été posées pendant l'occupation militaire américaine de l'Allemagne. Tous les Allemands ont été considérés comme coupables d'un crime, l'extermination des Juifs, qui ne pouvait être pardonné, excluant toute possibilité de rédemption, auquel s'ajoutait une théorie du complot contre la paix. L'Holocauste, le complot contre la paix et le nazisme lui-même sont considérés comme l'aboutissement de l'histoire, de la culture et de la philosophie allemandes - Frédéric le Grand, Adam Müller, Novalis, Fichte, jusqu'à Heidegger, Schmitt et Jünger, par exemple - et des courants de pensée qui s'y rattachent, et qu'il faut éradiquer.
Cette stérilisation de l'identité nationale allemande s'est faite de manière capillaire, avec tout d'abord la création d'un groupe d'experts pour la recherche scientifique, présidé par Max Horkheimer, qui a compilé deux volumes sur la personnalité autoritaire, destinés à servir d'outils pour la découverte de fascistes potentiels.
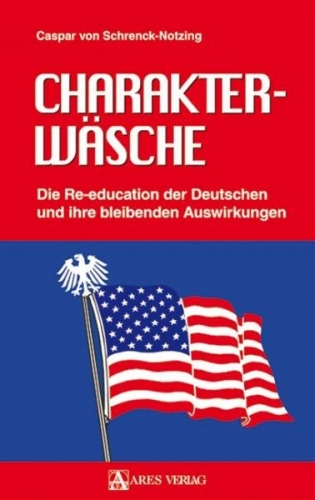
L'un des organes de l'occupation militaire américaine, l'Office of Public Affairs, a apporté des contributions financières considérables à l'École de Francfort afin que ses philosophes, s'appuyant sur Marx et Freud, façonnent les Allemands pour qu'ils adoptent le mode de vie américain, qui était déjà en train de conquérir le reste de l'Europe. Les écoles de tous niveaux et les universités ont adopté des textes dont le but était d'éduquer les nouvelles générations en tant que membres d'une communauté démocratique orientée vers le patriotisme constitutionnel et non celui qui émane de la nation, tandis que les interprétations historiques et philosophiques et les œuvres artistiques et littéraires qui ne suivaient pas le diktat officiel étaient diabolisées et attaquées par les médias.
L'intention initiale de Roosevelt de réduire l'Allemagne à un simple pays agraire a été abandonnée avec le début de la guerre froide et la césure en Europe que cette dernière impliquait. La République fédérale d'Allemagne est cependant devenue une démocratie qui, au lieu de favoriser la participation populaire, administrait ce qui existait et guidait le peuple de manière à ce qu'il ne s'écarte pas du droit chemin, discriminant et attaquant toute formation politique qui proposait une ligne différente de celle des partis qui alternaient au gouvernement et qui, bien qu'ayant des programmes différents, avaient en commun l'aversion pour toute renaissance d'une pensée nationale indépendante.
L'essai est sans aucun doute une mine de stimuli intellectuels, culturels, politiques et historiques, capable d'ouvrir des champs de recherche pluridisciplinaires, notamment sur la possibilité qu'un futur totalitarisme puisse procéder précisément de la démocratie libérale, dont il resterait la forme vidée de toute substance pluraliste et remplacée par une seule et unique façon de penser.
15:44 Publié dans Affaires européennes, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : caspar von schrenck notzing, allemagne, rééducation allemande, rééducation, europe, affaires européennes, livre, lavage de cerveau, histoire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 26 décembre 2023
A propos du livre Plus ultra: Géopolitique atlantique espagnole

A propos du livre Plus ultra: Géopolitique atlantique espagnole
(Ediciones Ratzel, 2023).
Entretien avec l'auteur Carlos X. Blanco
Pourquoi un livre sur la géopolitique nationale dans un pays comme l'Espagne d'aujourd'hui, qui n'a pas de géopolitique propre ?
L'Espagne est une nation en faillite depuis que son empire s'est effondré et que des puissances étrangères ont imposé une dynastie tout aussi étrangère au début du XVIIIe siècle. Avec les Bourbons, au cours de ce même XVIIIe siècle, il y a eu une récupération de l'Empire et nous avons même atteint un maximum territorial, mais sous la nécessaire subordination à la France. Depuis la guerre de succession, nous étions, pour ainsi dire, la franchise d'un Empire et non un Imperium proprement dit. Le reste de notre histoire a été un désastre. L'invasion napoléonienne aurait pu être un vrai début "nationaliste": le peuple de toute l'Espagne a pris conscience de lui-même et pour lui-même en 1808, et s'est battu pour la souveraineté contre ses propres élites, toujours traîtresses. Mais l'indépendance acquise a coûté très cher. Les oligarchies, qu'elles aient été francisées ou anglophiles, par le biais de la franc-maçonnerie, ont bien compris que les dépouilles de l'Empire devaient être vendues à l'étranger, comme des reliques que l'on solde au marché aux puces. Le peuple espagnol n'a pas réussi à former une nation espagnole. La nation historique n'a pas fonctionné comme nation politique, et le modèle libéral ou francisé ne pouvait que supprimer la nation historique elle-même, en éliminant même sa base, le peuple. Le même peuple s'est soulevé dans les Asturies en 1808, comme l'avait fait auparavant Pelayo en 718, un soulèvement qui a conduit les Madrilènes à se soulever immédiatement en suivant l'exemple de la Junte souveraine de la Principauté; ce peuple est mort dans les guerres dites "carlistes", véritables tentatives de résistance populaire. Depuis longtemps, nous n'avons plus de souveraineté. Les oligarchies nous ont vendus à bas prix aux Français, aux Anglais et aux Yankees. Et ce, pour toutes les étapes de notre histoire: la guerre illégale de 1898 et la trahison du Tribunal de Madrid, les manœuvres des puissances en 1936, l'attentat contre Carrero Blanco, l'invasion du Sahara "arrangée" par Juan Carlos, 23-F, les bombes d'Atocha, le coup d'Etat de Puigdemont... tous ces épisodes révèlent la désactivation progressive de la souveraineté nationale de l'Espagne. Face à ce "vol" de la Nation et du Peuple lui-même (le Peuple espagnol cesse d'exister), j'ai voulu écrire un livre qui rappelle les possibilités objectives de l'Espagne en tant que puissance géopolitique, potentiel donné par sa propre histoire et sa propre géographie. Mais ce potentiel ne peut être réalisé que s'il y a un changement énergique de mentalité, de régime et d'économie.
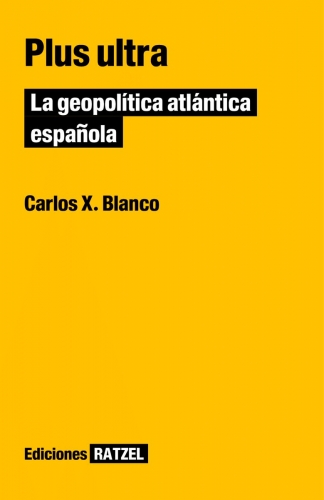
L'élite politique et dirigeante, ainsi que les milieux intellectuels, sont-ils conscients de l'importance de la géopolitique ?
Comme je l'ai déjà dit, notre élite politique et dirigeante est, depuis des temps immémoriaux, et pour faire une généralisation qui peut être injuste dans certains cas, elle est une bande de voleurs et d'indolents. Ils ont gagné leur propre statut en collaborant avec nos "partenaires et amis". Lorsque vous entendez un politicien, un économiste, un diplomate, un homme d'affaires, etc. parler de "partenaires et alliés", vous pensez tout de suite au Maroc, à la France, à l'Angleterre, aux États-Unis, à l'"Europe" (U.E.), etc. Nous devons alors faire une traduction immédiate: ce sont là les ennemis objectifs de l'Espagne. Cela s'est déjà traduit, au moment du changement dynastique, par une déformation de l'image de l'Espagne: l'Espagne maure, l'Espagne du flamenco, de la tauromachie, l'Espagne agitée, "méditerranéenne", qui est au goût des Français, la puissance dominante de l'époque, à laquelle nous étions subordonnés. Ils ont donné un visage et des vêtements à une nouvelle Espagne inventée, et l'Espagne plus authentique (celto-germanique) a été refoulée. Par la suite, l'aliénation (y compris l'aliénation culturelle et ethnique) a été gérée par les Anglos et les Yankees. Les puissances dominantes ont imposé leurs élites locales collaborationnistes et même les conceptions nationales qui leur plaisaient et leur convenaient.
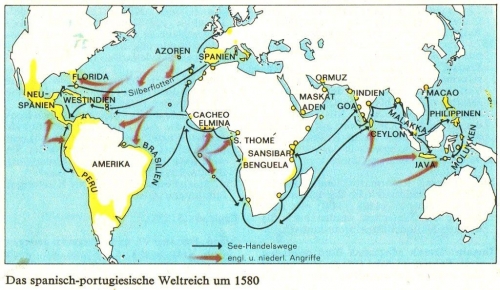
L'Espagne atlantique, l'Espagne des Caravelles et des "Plus Ultra" ne convient pas aux Anglos, aux Français, aux Yankees... C'est une Espagne aux fortes racines celtiques et indo-européennes, pas celle "où cent peuples se sont déversés en toi d'Algésiras à Istanbul", comme le dit la chanson de Serrat. Une Espagne maritime née pour être un empire: un empire territorial d'abord, chassant les Maures de l'autre côté du détroit de Gibraltar, puis un empire océanique et universel.
Plus ultra : la géopolitique atlantique de l'Espagne, pourquoi ce livre, et que proposez-vous dans ses pages ?
Je dirai d'abord ce qui est entre les lignes, ou à peine formulé en passant. Je propose un changement de régime, à court et moyen terme, quelque peu utopique à l'heure actuelle, dans lequel les peuples d'Espagne enterrent les différences idéologiques importées de la sphère "occidentale" (libéralisme, essentiellement, qu'il soit de gauche ou de droite) et constituent une Autorité populaire et énergique qui permette une "insubordination fondatrice", au sens de Marcelo Gullo (réindustrialisation, revitalisation des campagnes, programmes natalistes et protectionnisme graduel et prudent). Renaître démographiquement et productivement, consolider une armée au service de la défense des frontières et de la souveraineté nationale, et non une armée conçue pour des parades ou des "Erasmus" de l'OTAN, comme c'est le cas aujourd'hui. Mais surtout, relancer la projection maritime (civile et militaire) qui a fait notre grandeur à l'âge d'or, et ainsi embrasser à nouveau toute l'Ibéro-Amérique. Je propose de créer les bases d'un pôle hispanique atlantique. Ce pôle ne s'appelle pas "Amérique latine" comme le dit Douguine, mais Hispanidad, et il est appelé à dominer l'Atlantique quand l'OTAN et l'engeance yankee déclineront.
Pourquoi, alors que l'Espagne a développé sa géopolitique, nous sommes-nous concentrés sur le bassin méditerranéen et l'Afrique du Nord comme axes principaux ?
À la mort d'Isabelle la Catholique, ce dilemme s'est posé. La continuité de la Reconquête après la prise de Grenade, comment allait-elle se faire: se projeter vers l'Atlantique ou vers la Méditerranée? Hériter des intérêts de la couronne d'Aragon fut un fardeau pour l'Espagne. Le nid de frelons italien, les Berbères et les Ottomans ? Plus tard, dans cette même Couronne, la Catalogne a été (et continue d'être) un véritable fardeau parasitaire qu'il fallait supporter.
Le Maghreb aurait pu être une "Nouvelle Andalousie", mais l'entreprise était démesurée sans l'alliance effective (une "Croisade") des royaumes chrétiens. L'action des Français et des Anglais est déjà désastreuse : ils complotent avec les Berbères et les Ottomans, et profitent du commerce de la chair humaine, des esclaves blancs capturés dans tout le Levant. L'Espagne a plutôt poursuivi sa reconquête dans les Amériques. La Méditerranée était, et est toujours, un foyer d'invasion. L'Espagne ne fait pas encore partie de l'Afrique grâce à un effort héroïque qui a commencé avec Pelayo. Au sud, nous ne pouvons que faire un travail vigoureux d'endiguement. Il n'en sortira rien de bon.

Quels seraient les avantages de la géopolitique atlantique que vous proposez ?
Une construction navale intense, un chantier naval florissant, génèrent de nombreux emplois. Une marine prestigieuse peut être une école de discipline et de talent. Une organisation internationale hispanique qui permet aux forces armées ibéro-américaines de collaborer entre elles, une "OTAN" hispanique en dehors de l'OTAN proprement dite, qui s'efforcerait de se défaire du joug anglo-américain... n'aurait que des avantages: échanges éducatifs, technologiques, géostratégiques... La marine civile, quant à elle, serait un élément clé pour un véritable marché commun ibéro-américain, non soumis aux intérêts anglo-américains. Un grand marché et un grand pôle qui collabore sans entrave avec les Chinois, les Russes, les Arabes (distinguons bien sûr Arabes et Maghrébins)... Si l'Espagne se renforce sur sa côte atlantique, elle pourra aussi exercer son rôle de barrage, d'endiguement, en Méditerranée. Il s'agirait de se renforcer là où l'histoire et la géopolitique nous disent que nous l'avons toujours fait, soit dans l'Atlantique et dans le Golfe de Gascogne, pour résister là où nous ne pouvons que "tenir", sans jamais rien gagner de bon ni de nouveau (c'est-à-dire le Sud méditerranéen et le Levant).
C'est un fait que, géopolitiquement (et dans d'autres domaines), l'Espagne n'est pas une nation souveraine. Quelles mesures devrions-nous commencer à prendre pour récupérer notre souveraineté ?
Eh bien, l'ordre que je propose est le suivant : 1) Souveraineté économique dirigée par une force de "concentration nationale" (non partisane), et sans litiges démo-libéraux, 2) Insubordination fondatrice au sens de Gullo (protectionnisme graduel et sélectif, toujours croissant, réindustrialisation, recolonisation de l'agriculture), 3) Insubordination consolidée, politique atlantique (Iberosphère, marine puissante et marine civile, dominant l'Atlantique et se connectant avec la mer Boréale et les mers de Chine), 4) Consolidation du pôle ibérique, en bonnes relations avec les pôles eurasien, chinois, arabe, indien et africain. Surtout avec les trois premiers. 5) L'abandon progressif de l'"Occident collectif".
Ces derniers temps, le discours hispaniste récupéré et renouvelé est devenu un courant politique de plus en plus important. Est-il possible de récupérer l'idée d'hispanité, avec l'Espagne comme axe central ?
Il faut faire preuve de beaucoup de pédagogie. Tout d'abord, il ne faut pas y voir un projet "néo-impérial", nostalgique et phalangiste. L'Hispanidad n'est ni de gauche ni de droite, bien au contraire... C'est un pôle géopolitique nécessaire pour que les Eurasiens, les Chinois, les Arabes, etc. se libèrent du joug anglo-américain, et c'est un pôle qui garantit la survie non aliénée des peuples de langue portugaise et espagnole. C'est un pôle qui peut favoriser le développement autocentré d'une vaste région (au moins) bicontinentale. L'Espagne ne doit pas être considérée comme une "mère", mais comme un partenaire confédéré petit et/ou moyen: le potentiel démographique et naturel se trouve principalement en Argentine et au Brésil.


Dans votre livre, vous proposez l'union de l'Espagne et du Portugal: cette idée est-elle réalisable et quels en seraient les avantages pour les deux nations ?
Le Portugal est une nation sœur, fille directe de la reconquête espagnole, un exploit unique qui s'est déroulé dans les montagnes des Asturies au VIIIe siècle et qui a récupéré pour l'Europe les régions ou pays de Galice, de León, des Montagnes et aussi du Portugal. Le Portugal en tant que nation a les mêmes origines historico-politiques, culturelles et ethniques que le reste de l'Espagne et, bien entendu, le même ethnos y est préservé que dans tout le nord-ouest de l'Espagne.
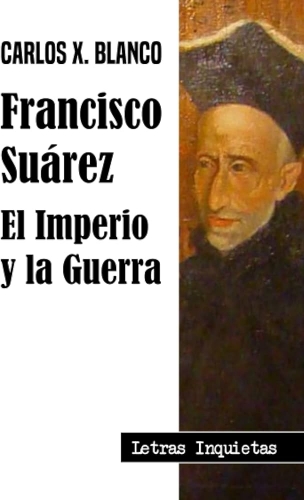
Comme je l'ai montré dans un livre récent, Francisco Suárez, le grand philosophe, juriste et théologien de Philippe II et Philippe III, a porté un jugement rigoureux sur la nécessité d'une politique atlantique (Portugal, Angleterre) et d'une annexion du royaume portugais avant qu'il ne tombe sous l'emprise de la Perfide Albion. Peut-être aurait-on pu faire mieux, et les puissances étrangères ont toujours conspiré pour empêcher cette unité ibérique qui, avec celle des nations américaines, produit une panique chez l'hégémon anglo-américain. Les Portugais ont été, en réalité, une colonie anglaise pendant des siècles. Un empire "franchisé" bien plus inféodé que celui des Espagnols. Le Nord-Ouest espagnol a besoin d'être repeuplé par une population autochtone : à bien des égards, c'est la partie la plus originale de l'Europe, moins torturée par le soi-disant "melting-pot" méditerranéen, "où l'on a déversé sur vous cent villages d'Algésiras à Istanbul". La chanson de Serrat, d'où je tire ces paroles, est très belle, mais je reconnais que je ne suis pas né en Méditerranée et que je vois cette mer (berceau de la culture classique, bien sûr) comme un cimetière aquatique et une honte pour l'humanité. Les forces hispaniques doivent se retrouver ailleurs. L'élément "phénicien" et afro-sémite (je parle ici du mythe légitimant le séparatisme, et non pas d'une réalité anthropologique) des Catalans ou des Andalous nostalgiques d'Al-Andalus, est totalement étranger, honteux et est à rejeter. Rejoindre le Portugal, c'est gagner en puissance démographique et maritime, et le substrat ethnique atlantico-celtique, très affaibli par le dépeuplement de l'ancien royaume de León, y gagnerait en poids.
Informations sur le livre :
Plus ultra : la géopolitica atlantica espanola (Carlos X. Blanco): https://edicionesratzel.com/plus-ultra-la-geopolitica-atlantica-espanola-de-carlos-x-blanco/
15:53 Publié dans Actualité, Entretiens, Histoire, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : carlos x. blanco, espagne, espagne atlantique, oceéan atlantique, hispanidad, hispanité, entretien, livre, géopolitique, histoire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 23 décembre 2023
L'essence initiatique de la connaissance chez Hegel (vue par Giandomenico Casalino)
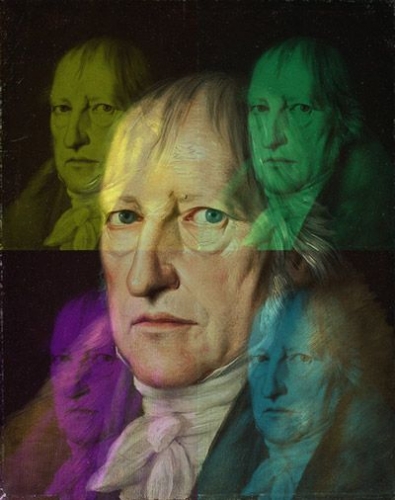
L'essence initiatique de la connaissance chez Hegel (vue par Giandomenico Casalino)
L'auteur salentin propose une exégèse non conventionnelle de la philosophie de l'auteur allemand, visant à soustraire le philosophe idéaliste aux lectures "modernes".
par Giovanni Sessa
Source: https://www.barbadillo.it/112190-lessenza-iniziatica-del-sapere-in-hegel-vista-da-giandomenico-casalino/
Giandomenico Casalino, spécialiste des choses traditionnelles, propose depuis longtemps dans ses essais une exégèse non conventionnelle de la philosophie de Hegel, visant à soustraire le philosophe idéaliste des lectures "modernes", visant à reléguer l'idéaliste dans la sphère de l'historicisme immanentiste. Ce travail analytique a, comme sa propre pars construens, le désir de restaurer l'hégélianisme dans la vénérable "tradition platonico-hermétique". C'est ce qui ressort de la lecture du dernier ouvrage de Casalino, L'essenza iniziatica del sapere in Hegel (L'essence initiatique de la connaissance chez Hegel), en librairie chez Arỹa edizioni (sur commande : arya.victoriasrl@gmail.com, pp. 80, euro 18.00). L'intention de l'auteur est explicite dès le début du volume : "Hegel appartient, de Proclus à travers tout le platonisme médiéval jusqu'à George Gemiste Plethon (Γεώργιος Γεμιστὸς Πλήθων) [...] à la véritable Tradition platonicienne, qui a certes conclu sa vie institutionnelle en 529 après J.-C. [...] mais n'a pas cessé sa vie spirituelle, en termes de transmission" (p. 12).
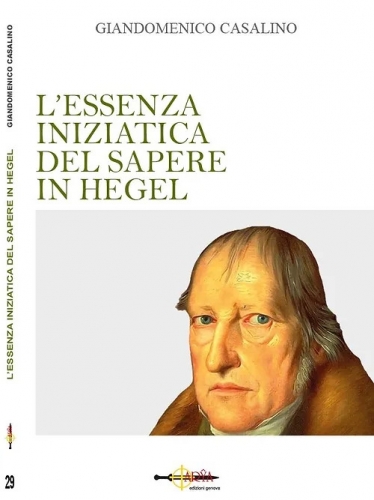

L'appartenance hégélienne à une telle séquence spéculative se manifesterait par le fait que le penseur concevait la philosophie comme "une considération ésotérique sur Dieu" (p. 13). Philosopher représenterait donc, selon ce point de vue, le moment le plus élevé sur le chemin qui mène à la Connaissance: "en vertu du fait qu'il n'est plus fondé sur la conviction fidéiste de l'existence de l'Autre et de son extranéité par rapport au Moi" (p. 13) comme cela se produit, au contraire, dans la représentation propre au moment religieux et ésotérique. Ce n'est qu'à travers la philosophie qu'il est possible de connaître l'Absolu, le Divin. Casalino note un trait théo-logique chez Hegel dans la mesure où la logique de l'idéaliste présente ce que Mario Dal Pra a défini comme la condition du dieu "incoato", du dieu avant la création, avant de sortir de lui-même. La logique hégélienne est en fait une ontologie, elle s'identifie à la métaphysique et à la physique, dans la mesure où: "L'essence de la Nature-Monde est la même essence conceptuelle, c'est-à-dire éternelle, de la Pensée, ou que les Dieux-Métaux, en tant que Puissances vivantes des choses, sont les mêmes Noumène-Astres-Métaux intérieurs, comme l'affirme la Tradition hermétique" (p. 14).
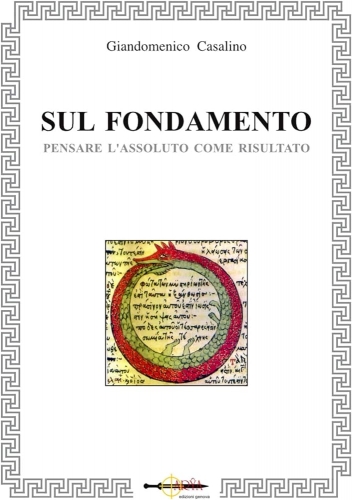
Essai de Casalino sur Hegel
Pour Hegel, à la lumière de ces affirmations : "La connaissance est et consiste dans la coïncidence identificatrice du connaissant et du connu, où le semblable est connu par le semblable; le connaissant est l'être du connu" (p. 15). En un mot, le panlogisme nous inviterait à prendre conscience de notre nature la plus vraie et la plus profonde, le divin, qui vit en nous depuis toujours. C'est pourquoi le résultat auquel parvient le système du philosophe de Stuttgart, l'Esprit, représente en réalité un retour à l'origine. Il s'agit d'un processus anamnestique qui induit l'"Éveil", un processus circulaire et ouroborique de connaissance de soi. En vertu de ce contexte conceptuel, Casalino voit une proximité évidente entre les positions hégéliennes et celles exprimées au 20ème siècle par Evola et Guénon, représentants du traditionalisme, qui visaient, de différentes manières, à dépasser le moment purement religieux, fidéiste et sentimental, centré sur le dualisme Homme/Dieu. L'auteur montre une préférence pour l'approche d'Evola, qu'il définit comme héroïque-apollinienne, de l'Absolu: Evola se serait placé, tout comme la Connaissance hégélienne, au-delà du même Mystère hellénique, qui, comme l'avait saisi Aristote dans le fr. 15 du Perì philosophias, transmis jusqu'à nous par Simplicius (ou Simplice ou encore Simplicios de Cilicie), n'est jamais allé jusqu'au mathèin, l'Intelligible, s'arrêtant à la dimension du pathèin, la dimension animique.
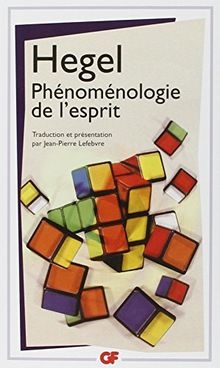 C'est notamment sur ce parcours que Hegel aurait eu connaissance d'un élément pertinent de l'enseignement de Plotin. Le néo-platonicien, soucieux de la vision classique de la vie et de la Connaissance, invitait en effet ses étudiants à se libérer de la "conscience", si chère à la gnoséologie moderne: "il n'y a de conscience vigilante, éveillée, intentionnelle, au sens moderne du terme, que lorsqu'il y a une diminutio du Nous, un mouvement vers le bas" (p. 44). La conscience, en tombant dans le corps, "remplace l'éternité de la pensée par une continuité dans le temps et l'espace [...] c'est un abaissement de la contemplation" (p. 45). La pensée est une chose, nous disent Plotin et Hegel, et la conscience de la pensée en est une autre : "tout ce qui est sous le gouvernement de la conscience, ce sont les choses qui nous sont les plus étrangères, les moins nobles, tandis que de ce qui est notre vraie nature [...] nous sommes inconscients" (p. 47). Dans l'ensemble de l'œuvre du grand idéaliste, la Phénoménologie de l'Esprit jouerait le même rôle que le Timée dans le parcours de Platon: "c'est le récit vraisemblable de l'"histoire" symbolique de la conscience qui aboutit au Savoir absolu" (p. 53).
C'est notamment sur ce parcours que Hegel aurait eu connaissance d'un élément pertinent de l'enseignement de Plotin. Le néo-platonicien, soucieux de la vision classique de la vie et de la Connaissance, invitait en effet ses étudiants à se libérer de la "conscience", si chère à la gnoséologie moderne: "il n'y a de conscience vigilante, éveillée, intentionnelle, au sens moderne du terme, que lorsqu'il y a une diminutio du Nous, un mouvement vers le bas" (p. 44). La conscience, en tombant dans le corps, "remplace l'éternité de la pensée par une continuité dans le temps et l'espace [...] c'est un abaissement de la contemplation" (p. 45). La pensée est une chose, nous disent Plotin et Hegel, et la conscience de la pensée en est une autre : "tout ce qui est sous le gouvernement de la conscience, ce sont les choses qui nous sont les plus étrangères, les moins nobles, tandis que de ce qui est notre vraie nature [...] nous sommes inconscients" (p. 47). Dans l'ensemble de l'œuvre du grand idéaliste, la Phénoménologie de l'Esprit jouerait le même rôle que le Timée dans le parcours de Platon: "c'est le récit vraisemblable de l'"histoire" symbolique de la conscience qui aboutit au Savoir absolu" (p. 53).
La science de la logique correspondrait, au contraire, au Parménide platonicien. L'affirmation hégélienne bien connue : "Le Vrai est le Tout" montre qu'une telle vision peut être atteinte, selon l'auteur, par une Connaissance intuitive et instantanée "qui n'exclut pas, précisément parce qu'elle lui est supérieure [...] la Logique moderne [...] de l'identité [...] cette dernière étant le mode légitime de connaissance de la dimension exotérique" (p. 19). Le cercle hégélien des cercles, selon Casalino, ne se réfère donc pas à un déjà-là qui doit être retrouvé, ni même à un futur, à un avant-nous, mais à ce toujours qui est donné dans les phénomènes comme le Tout présent. Hegel, dans cette perspective, dépasse le dualisme essence/existence, intérieur/extérieur et, libéré de la dimension du sentir et du vouloir, nous invite à nous élever vers "le suprasensible par la thèoria [...] la vision indicible de l'Idée qui est l'Intelligible " (p. 55).
Hegel conclut, pour l'auteur: "en parlant [...] du mouvement de l'Être dans lequel se réalise l'Essence qui est le Tout et qui est l'Absolu, celui-ci est présent dans le temps et dans l'espace mais il est ab aeterno en dehors d'eux" (p. 57). Il s'agit d'une connaissance à caractère hermétique, à réaliser dans l'Instant qui est l'Éternel, puisque nous vivons en lui même si nous n'en avons pas connaissance. L'identité du réel et du rationnel ne renvoie pas à l'acceptation de l'existant, car : "L'Idée est réelle, parce qu'elle est vraie, seulement dans la Nature [...] et à travers et au-delà d'elle pour être [...] Esprit ! Une analyse à méditer...
Giovanni Sessa
20:11 Publié dans Livre, Livre, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hegel, philosophie, giandomenico casalino, livre |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 17 décembre 2023
Propos d'avant-hier pour après-demain, les inédits de Gustave Thibon par Luc-Olivier d'Algange

Propos d'avant-hier pour après-demain, les inédits de Gustave Thibon
par Luc-Olivier d'Algange
Le livre d'inédits de Gustave Thibon, qui vient de paraître aux éditions Mame, est un événement. L'ouvrage rassemble des notes, des conférences, « feuilles volantes et pages hors champs », lesquelles, pour les lecteurs non encore familiers constitueront une introduction du meilleur aloi, et pour les autres, une vision panoramique des plus instructives. Presque tous les thèmes connus de l'oeuvre sont abordés, et d'autres encore, où l'on découvre un philosophe dont la vertu première est l'attention. Il y est question de la France, des « liens libérateurs », formule qui n'est paradoxale qu'en apparence, des « corps intermédiaires », de Nietzsche et de Simone Weil, du mystère du vin, de l'âme du Midi, du Portugal, de la vie et de la mort. Ces « pensées pour soi-même », nous donnent la chance de remonter vers l'amont, vers la source d'une pensée qui ne se contente pas d'être édifiante et sauvegarde l'inquiétude, ce corollaire de la Foi, qui est au principe de toute aventure intellectuelle digne d'être vécue.
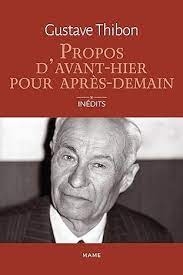 Encore qu'il eût, depuis plus d'un demi-siècle, des lecteurs fidèles, et, mieux encore, de ceux qui surent entrer en conversation avec lui et prolonger sa pensée et son œuvre, - tel Philippe Barthelet auteur d'un livre d'entretiens avec Gustave Thibon, et d'un magistral Dossier H consacré à l'auteur de L'Ignorance étoilée, aux éditions de L'Age d'Homme - il est à craindre que Gustave Thibon ne soit pas encore reconnu à sa juste valeur, et surtout, à sa juste audace. Une image s'interpose : celle du « philosophe-paysan » qui se contenterait de dispenser une sagesse traditionnelle appuyée sur le catholicisme et l'amour de la terre.
Encore qu'il eût, depuis plus d'un demi-siècle, des lecteurs fidèles, et, mieux encore, de ceux qui surent entrer en conversation avec lui et prolonger sa pensée et son œuvre, - tel Philippe Barthelet auteur d'un livre d'entretiens avec Gustave Thibon, et d'un magistral Dossier H consacré à l'auteur de L'Ignorance étoilée, aux éditions de L'Age d'Homme - il est à craindre que Gustave Thibon ne soit pas encore reconnu à sa juste valeur, et surtout, à sa juste audace. Une image s'interpose : celle du « philosophe-paysan » qui se contenterait de dispenser une sagesse traditionnelle appuyée sur le catholicisme et l'amour de la terre.
Forts de cette vision réductrice, sinon fausse, on se dispense de le lire, de confronter son œuvre à celles des philosophes, plus universitaires, de son temps, et l'on méconnaît ce qu'il y a de singulièrement affûté, et sans concession d'aucune sorte, dans sa pensée érudite, mais de ligne claire et précise, sans jargon. Gustave Thibon, dans ces pages « hors champs », adresse au lecteur, une mise-en-demeure radicale, non certes au sens actuel de radicalisme, mais, à l'inverse, par un recours aux profondeurs du temps, aux palimpsestes de la pensée, à cette archéologie, voire à cette géologie de l'âme, à cette géographie sacrée, celle de la France, qui est, par nature, la diversité même, qui se décline de la Bretagne à l'Occitanie, et n'en nécessite point d'autre, abstraite, importée ou forcée.
Certes, la terre est présente, et Gustave Thibon rejoint Simone Weil dans ses réflexions sur l'enracinement ; certes, il est catholique, sans avoir à passer son temps à le proclamer, - mais ces deux évidences sont, avant tout, l'expérience d'une transcendance véritable, qui ne cède jamais à la facilité revendicatrice, à ces représentations secondes qui nous poussent, sur une pente fatale parfois, à parler « en tant que ». Gardons-nous, dit Gustave Thibon, de nous reposer dans l'image que nous nous faisons de nous-mêmes ou dans le sentiment, d'être, par nos opinions et nos convictions, une incarnation du « Bien ».
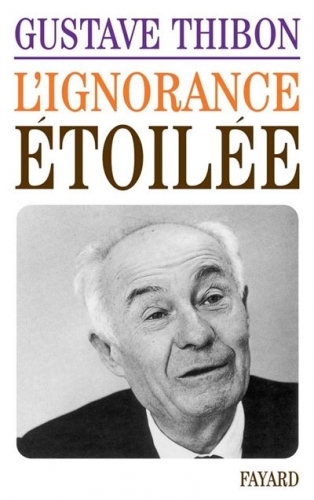
Il existe bien un narcissisme religieux, une satisfaction indue, une façon de s'y croire, au lieu de croire vraiment, une pseudo-morale de dévots, une « charité profanée » (selon l'expression de Jean Borella) que Gustave Thibon, dans ces inédits, n'épargne pas de ses flèches. On se souviendra, en ces temps hâtifs et planificateurs que nous vivons, de sa formule qui ne cesse de gagner en pertinence : « Il ne faut pas faire l'Un trop vite ». Contre la fiction d'un universalisme abstrait, Gustave Thibon propose un retour au réel , celui du monde, avec ses limites et ses frontières heureuses ; celui de l'homme qui défaille et parfois se dépasse. Il suivra Nietzsche, pas à pas, dans son « humain, trop humain », dénonçant les leurres, la morale comme masque du ressentiment et de la faiblesse, non pour « déconstruire », et se livrer au désastre dans « un vacarme silencieux comme la mort » ainsi que l'écrivait Nietzsche, - noble naufragé qui en fit la tragique expérience, - mais pour comprendre que le vide qui se dissimule derrière nos vanités est appel à une plénitude infiniment proche et lointaine.
La faiblesse exagère tout. Son mode est l'outrance. Elle conspue, elle maudit, elle excommunie avec la rage de ceux dont la Foi est incertaine. Ces Propos d'avant-hier pour après-demain, le sont aussi pour notre pauvre aujourd'hui. Nous avons nos Robespierre, nos Précieuses ridicules, nos propagandistes du chaos, sous l'habit policé des technocrates, perfusés d'argent public, et tous ont pour dessein de faire table rase de notre héritage pour y établir leurs fatras, leurs encombrements de laideurs, de fictions lamentables, autant d'écrans entre nous et le monde ; écrans entre nous et un « au-delà de nous-mêmes », vaste mais autrefois familier, comme le furent les Rameaux, Pâques, Noël. - ces temporalités qualifiées où les hommes se retrouvaient entre eux et en eux-mêmes à la recherche de « la juste balance de l'âme » : « Existence simultané des incompatibles, balance qui penche des deux côtés à la fois : c'est la sainteté » écrivait Simone Weil, citée, dans ces pages, par Gustave Thibon.
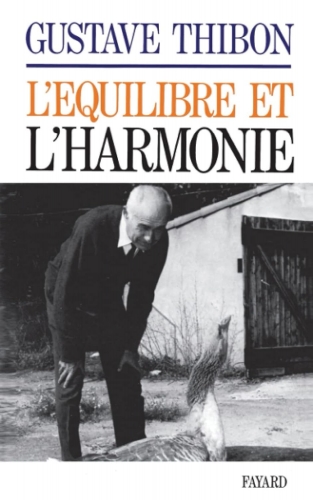
Philosophe-paysan, Gustave Thibon le serait alors au sens où il nous intime de nous désembourgeoiser, de cesser, par exemple, de considérer l'argent comme le socle des valeurs et de retrouver le « dépôt à transmettre » : le fief, la terre, la religion. « Le socle dévore la statue (…), avarice bourgeoise, aucune magnificence, pas de générosité ; abaissement des valeurs : pour le marchand tout se chiffre – et mépris des valeurs artistiques ; mentalité étriquée (…) ; règne du Quantitatif. Les « gros » ont replacé les « grands ».
Où demeurer alors ? Gustave Thibon nous le dit, en forme de devise héraldique : « Contre l'espoir dans l'espoir ».
Luc-Olivier d'Algange
15:35 Publié dans Littérature, Livre, Livre, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, gustave thibon, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 26 novembre 2023
« Babar » contre la pègre démocratique
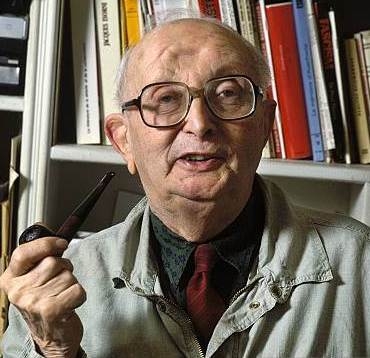
« Babar » contre la pègre démocratique
par Georges FELTIN-TRACOL
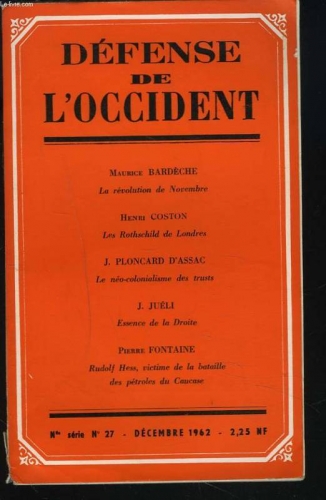 Pendant trente ans au gré d’une périodicité fluctuante sort Défense de l’Occident. Fondée et animée par Maurice Bardèche (1907 – 1998), cette revue accueille diverses sensibilités nationales, du nationaliste-révolutionnaire François Duprat au futur gréciste Jean-Claude Jacquard, du traditionaliste radical Georges Gondinet à l’euro-régionaliste Jean Mabire… Maurice Bardèche, affectueusement surnommé « Babar » par les contributeurs, en fait un carrefour obligé de la radicalité à droite.
Pendant trente ans au gré d’une périodicité fluctuante sort Défense de l’Occident. Fondée et animée par Maurice Bardèche (1907 – 1998), cette revue accueille diverses sensibilités nationales, du nationaliste-révolutionnaire François Duprat au futur gréciste Jean-Claude Jacquard, du traditionaliste radical Georges Gondinet à l’euro-régionaliste Jean Mabire… Maurice Bardèche, affectueusement surnommé « Babar » par les contributeurs, en fait un carrefour obligé de la radicalité à droite.
Outre ses articles, Maurice Bardèche signe dans chaque livraison un éditorial sur l’actualité du moment. Il aborde tous les sujets, de l’économie aux relations internationales en passant par la vie politique. Bien de ses éditoriaux sont de nos jours dépassés. Toutefois, certains gardent toute leur pertinence. C’est le cas avec La mafia des démocraties (2023, 212 p., 18,10 €), un recueil de vingt textes écrits entre 1953 et 1982 que viennent de publier les excellentes éditions dissidentes Kontre Kulture.
Il faut saluer le long et minutieux travail de recherche et de lecture attentive qui précède le choix crucial des éditoriaux. Certes, en cette période de Guerre froide, « Babar » dénonce volontiers l’Union Soviétique, le Pacte de Varsovie et les communistes. Il fustige néanmoins avec une énergie équivalente le Système occidental capitaliste – libéral. Maurice Bardèche tonne avec constance contre le régime victorieux en 1945. Force est de constater que certains textes rassemblés dans ce volume à la magnifique couverture sont visionnaires.
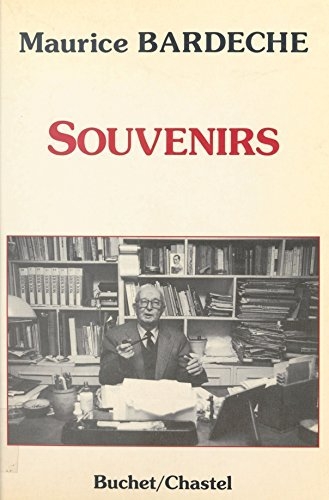 Par exemple, dans « Physiologie des démocraties libérales avancées » (1976), il prévient que « l’État ne nous protège plus. […] Les organisations marginales sont plus puissantes aujourd’hui que les gouvernements ». Il précise que l’impuissance croissante de l’État « n’empêche pas l’autoritarisme saugrenu. C’est un autre aspect des démocraties libérales avancées, c’est même la contrepartie de la violence et du terrorisme ». Cet avertissement prend un écho considérable après le covid et les attaques terroristes. Quelques lignes auparavant, il signale que « notre liberté politique est donc illusoire ». Persécuté politique pour ses écrits hostiles au résistancialisme triomphant, en particulier son Nuremberg ou la Terre promise, « Babar », incarcéré à la prison de Fresnes en 1954, rappelle que « nos libertés sont un leurre et la liberté de la presse pour commencer ». Il souligne que « l’opinion est donc dirigée dans les démocraties libérales tout comme dans les pays totalitaires ».
Par exemple, dans « Physiologie des démocraties libérales avancées » (1976), il prévient que « l’État ne nous protège plus. […] Les organisations marginales sont plus puissantes aujourd’hui que les gouvernements ». Il précise que l’impuissance croissante de l’État « n’empêche pas l’autoritarisme saugrenu. C’est un autre aspect des démocraties libérales avancées, c’est même la contrepartie de la violence et du terrorisme ». Cet avertissement prend un écho considérable après le covid et les attaques terroristes. Quelques lignes auparavant, il signale que « notre liberté politique est donc illusoire ». Persécuté politique pour ses écrits hostiles au résistancialisme triomphant, en particulier son Nuremberg ou la Terre promise, « Babar », incarcéré à la prison de Fresnes en 1954, rappelle que « nos libertés sont un leurre et la liberté de la presse pour commencer ». Il souligne que « l’opinion est donc dirigée dans les démocraties libérales tout comme dans les pays totalitaires ».
Brillant universitaire, spécialiste de la littérature française du XIXe siècle, mais marginalisé en raison de son engagement audacieux, Maurice Bardèche appartient au sérail enseignant. Son point de vue sur le système scolaire français peut surprendre. Sans aller jusqu’à la remise en cause de l’obligation scolaire, remise en cause plus que jamais essentielle et salutaire comme le préconisait d’ailleurs l’excellent programme présidentiel de Jean-Marie Le Pen en 2002, « Babar » estime que « le but de l’enseignement est un but pratique : l’enseignement doit permettre à un adolescent de gagner sa vie. Tout le reste est prétention et verbiage. Dès l’école, la sélection doit être la règle. C’est la meilleure et même la seule garantie de promotion pour les enfants des familles défavorisées ». Datant de 1981, cet article intitulé « Sur le chômage » s’élève par conséquent contre les premiers méfaits dévastateurs du pédagogisme et de la massification.
À propos de ce drame social qu’est la perte d’un emploi, il explique que « la cause fondamentale de tout chômage présent ou à venir est notre incapacité à maîtriser les conséquences du mécanisme industriel de la production, impuissance qui n’est pas particulière à la France, mais qu’on retrouve dans toutes les nations industrielles ». À l’époque, la France est encore une grand pays industriel. Maurice Bardèche devine les ravages considérables d’une mondialisation balbutiante alors contenue par le duopole planétaire USA – URSS.
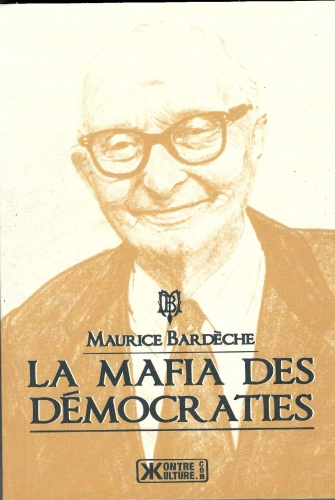 Sans avoir la fibre juridique, « Babar » condamne enfin l’intrusion lente du poison égalitaire dans le droit. « Notre Code pénal, note-t-il, établi sous l’influence de la Déclaration des Droits de l’homme qui proclamait l’égalité de tous les citoyens contenait par là une cause profonde d’injustice et d’inefficacité. Aussi bien dans le niveau que dans l’exécution de la peine, la valeur de la sanction, la simple intervention de la justice pénale, ont un poids très différent suivant les individus, leur passé, leur caractère, leur situation sociale. » Les tribunaux libèrent des immigrés clandestins pour mieux emprisonner des lanceurs d’alerte identitaires. La « justice » administrative entérine la dissolution scandaleuse d’associations de défense du peuple français et supprime celle des bandes éco-terroristes. C’est très bien vu par Bardèche !
Sans avoir la fibre juridique, « Babar » condamne enfin l’intrusion lente du poison égalitaire dans le droit. « Notre Code pénal, note-t-il, établi sous l’influence de la Déclaration des Droits de l’homme qui proclamait l’égalité de tous les citoyens contenait par là une cause profonde d’injustice et d’inefficacité. Aussi bien dans le niveau que dans l’exécution de la peine, la valeur de la sanction, la simple intervention de la justice pénale, ont un poids très différent suivant les individus, leur passé, leur caractère, leur situation sociale. » Les tribunaux libèrent des immigrés clandestins pour mieux emprisonner des lanceurs d’alerte identitaires. La « justice » administrative entérine la dissolution scandaleuse d’associations de défense du peuple français et supprime celle des bandes éco-terroristes. C’est très bien vu par Bardèche !
On comprend qu’il est impérieux de lire et de faire lire La mafia des démocraties. Le style de Maurice Bardèche y est exceptionnel. Il maîtrise tous les sujets qu’il traite avec brio, clarté et intelligence. Soucieux du sort des classes populaires autant que des classes moyennes, l’auteur de Sparte et les Sudistes combat donc l’égalitarisme et, plus largement, le mythe égalitaire qui sous-tend l’illusion démocratique. Un très grand merci aux courageuses éditions Kontre Kulture de remettre à l’honneur un immense monsieur de la pensée nationale et européenne !
GF-T
- « Vigie d’un monde en ébullition », n° 93, mise en ligne le 22 novembre 2023 sur Radio Méridien Zéro.
15:16 Publié dans Hommages, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : maurice bardèche, france, livre, hommage |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 21 octobre 2023
Sur les cycles cosmiques et les rythmes du temps en Inde: un nouvel essai de Nuccio D'Anna

Sur les cycles cosmiques et les rythmes du temps en Inde: un nouvel essai de Nuccio D'Anna
Giovanni Sessa
Source: https://www.paginefilosofali.it/sui-cicli-cosmici-e-ritmi-del-tempo-in-india-un-nuovo-saggio-di-nuccio-danna-giovanni-sessa/
Nuccio D'Anna a récemment ajouté un ouvrage important à sa production de livres. Il sera particulièrement utile aux lecteurs intéressés par les études historico-religieuses et traditionnelles. Il s'agit du volume I cicli cosmici. Le dottrine indiane sui ritmi del tempo (= Les doctrines indiennes sur les rythmes du temps), que l'on trouve désormais dans les librairies grâce aux éditions Arỹa (pour commander : arya.victoriasrl@mail.com, pp. 240, euro 26.00). Dans ces pages, l'auteur fait preuve d'une maîtrise peu commune de la vaste littérature critique, il accompagne aussi avec sagacité le lecteur dans l'exégèse des textes sacrés complexes centrés sur la temporalité cyclique. Cette tâche est accomplie en se référant à la méthode comparative, qui permet de déduire la valeur universelle des mythes et des symboles. Les contenus abordés sont si vastes qu'il est difficile de les résumer dans l'espace d'une revue. Nous ne nous attarderons donc que sur quelques plexus théoriques.
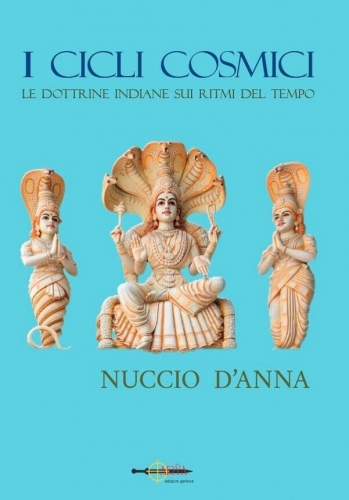
Nuccio D'Anna commence par présenter le sens et la signification du "Centre" dans le monde traditionnel. Pour ce faire, il s'attarde sur la valeur du mont Meru: "considéré comme le reflet du pôle céleste qui tient, gouverne et oriente tout le mouvement du quadrant cosmique" (p. 3). La structure axiale de la montagne incite à la considérer comme: "le véhicule des bénédictions divines dispensées sans cesse [...] le Meru apparaît comme l'"arbre du cosmos"" (p. 4). Selon la tradition védique, de ses branches sont descendus les rayons de Sūrya qui ont transmis à l'humanité la "loi de Varuṇa, le Ṛta, l'Ordre qui est la Vérité". Le Ṛta : "a une relation directe avec la stabilité de la constellation des sept étoiles de l'Ourse" (p. 5). La montagne sacrée est étroitement liée, d'une part, à Agni, le dieu du feu prototypique qui brûle avec éclat au centre du monde, et, d'autre part, à Brahma, la divinité formatrice qui peut être comparée au "rocher indestructible", d'où rayonnent les "qualités" divines. Le Meru se dresse au centre d'une île circulaire subdivisée en sept "régions", autour desquelles se trouvent sept océans en correspondance "avec l'ordre planétaire habituellement structuré sur sept niveaux" (p. 10). La dernière étendue de mer est appelée "Océan de lait".
L'auteur précise : "Au cours du déroulement cyclique dans chacune de ces "îles", la Tradition [...] devra nécessairement trouver son propre développement intégral, ce qui aboutira inévitablement à l'épuisement de toutes les possibilités spirituelles véhiculées dans le monde" (p. 13). C'est ainsi que se révèle le lien d'un tel symbolisme avec le développement cyclique. Dans une telle cosmosophie, chaque point de pivot est gardé par une divinité : le cosmos lui-même prend des traits maṇḍaliques. L'éon actuel, dans la liste des 30 kalpas, occupe la 26ème place (Varaha-Kalpa) et est précédé par le Padama-kalpa. Selon l'enseignement traditionnel, la manifestation a régressé à cause du "poids des hommes", qui ont manipulé le Dharma. Durant le kalpa précédant le nôtre, Viṣṇu "l'Endormi" a effectué "sa propre intervention cosmogonique sous la forme d'une fleur de lotus qui émergea de son propre nombril" (p. 20), ce qui a permis une parfaite continuité doctrinale et rituelle entre les sixième et septième manvantaras de notre kalpa.
Brahma a donné naissance à la "terre primordiale" : "l'archétype ou le modèle préformel d'une réalité encore immaculée" (p. 21). Chaque fois que le Principe descend dans le devenir, selon la perspective traditionnelle indienne, il donne lieu à un véritable "sacrifice universel". C'est un acte capable d'agir contre les "puissances des ténèbres". Un rôle essentiel, en ce sens, est attribué par D'Anna à Prajapati, qui a rejoint la Terre immaculée qui a émergé des Eaux. Il "symbolise l'Unité ineffable dont tous les autres dieux sont issus et à laquelle ils retourneront" (p. 28). Cette potestas s'étend dans toutes les directions de l'espace. Les eaux primordiales ne sont rien d'autre que la transcription symbolique du "murmure" du temps qui passe, puisque le Principe, à la lumière des études de Marius Schneider, citées à plusieurs reprises par l'auteur, n'est que son-lumière. Les chanteurs sacrés : "Ils haïssent l'essence sonore et présensible [...] qui se déverse "naturellement" dans la vie cosmique" (p. 31). Le chant solaire des sept Ṛṣi formait la tête de Prajapati qui, en harmonisant le son et le rythme, "rendait possible la formulation des phonèmes et des syllabes" (p. 33).
L'auteur rappelle que le septième Manvatara a commencé après le Déluge. L'époque actuelle est divisée en quatre yugas, dont le développement est ordonné autour du symbole de la décennie, qui marque l'appauvrissement spirituel progressif, induit par les pouvoirs catagogiques de Koka et Vikoka (Gog et Magog). Le premier âge est l'"âge de la vérité" et de la plénitude spirituelle. La couleur qui le connote est le blanc, révélant son essence sapientielle et celle de la caste des Haṃsa : "Dans le jeu de dés indien [...] ce premier âge [...] correspond au "jet" réussi" (p. 112). Dans le deuxième âge, la "dynastie solaire" agit, visant à préserver la tradition "non-humaine", en accomplissant une action conservatrice, similaire à celle attribuée en Occident à Saturne. La valeur rituelle du jeu de dés, bien connue à Rome (il pouvait être pratiqué pendant les Saturnales, à l'occasion du solstice d'hiver), était liée à des conjonctures astronomiques particulières. Les "points" gravés sur les faces des dés étaient appelés "yeux", car ils renvoyaient aux "luminaires" qui brillaient "dans le ciel du primordial védique" (p. 115).
Lorsque le lancer de dés était désordonné, on l'attribuait à la lourdeur spirituelle du cycle, correspondant au tourbillon frénétique du monde. Le lancer de dés, où le trois apparaissait, indiquait le deuxième âge, dans lequel le monde reposait sur les "trois quarts" du dharma. Sa couleur était le rouge. Le deux du jeu de dés faisait référence au troisième âge, dans lequel le monde se développe sur la relation lumière/obscurité, qui tend de plus en plus à cristalliser ces deux puissances dans un sens oppositionnel. Dans cet âge, sattva se retire, rajas et tamas prédominent. Sa couleur est le vert.
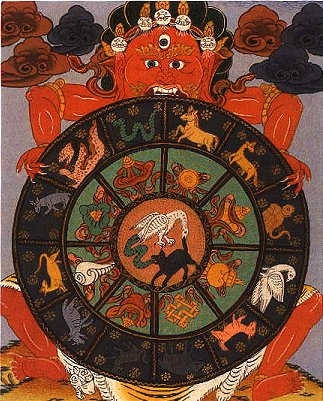
Enfin, le kali-yuga, dont le début : "a été fixé pour coïncider avec la conjoncture aurorale qui a commencé à 6 heures du matin le 18 février 3102 avant J.-C.". (p. 118). Ce yuga est également divisé en quatre sous-âges : c'est l'âge de la résurgence des forces magmatiques et chaotiques qui submergent la perfection de l'Origine. Śiva se retire également des apparences phénoménales. Pour comprendre le déroulement cyclique, il faut se référer à la précession des équinoxes, dans laquelle l'obliquité de l'écliptique et de l'équateur dessine une " toupie " cosmique. Cette précession : "continue à se déployer autour d'un véritable "chef" qui en dirige le cours : c'est Dhruva" (p. 131), le pôle fixe, garant du retour à l'ordre à la fin du kali-yuga. D'Anna enrichit la présentation des cycles indiens par de nombreuses références érudites aux traditions grecques, mésopotamiennes et taoïstes, dont il trouve des échos jusque dans l'astronomie de Kepler. Il aborde également le symbolisme complexe qui sous-tend la vision cyclique et clarifie, entre autres, la faiblesse de l'exégèse "naturaliste" du temps cyclique, même celle formulée par Eliade, basée sur la référence aux cycles lunaires : "Seule cette (la) dimension cosmique-triomphale peut faire contempler la profondeur, la hauteur et l'ampleur du substrat spirituel qui nourrit la relation intime existant entre les phonèmes, les sons, les couleurs, les langages animaux [...] les scansions célestes [...] les moments saisonniers" (p. 209), la relation entre le macrocosme et le microcosme. L'essai de D'Anna est véritablement exhaustif.
Giovanni Sessa
23:53 Publié dans Livre, Livre, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : traditions, traditionalisme, cycles cosmiques, nuccio d'anna, livre |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 12 octobre 2023
L'expansion russe au-delà de l'Oural et en Amérique
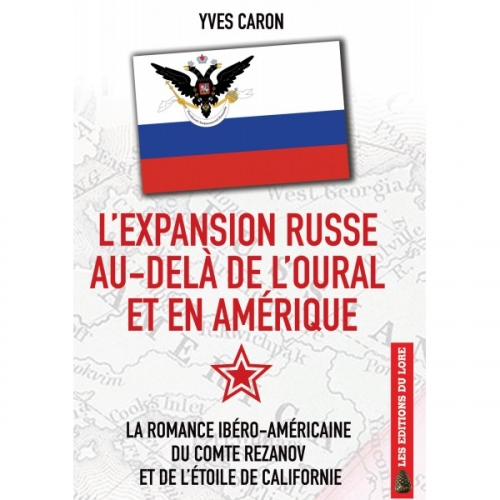
L'expansion russe au-delà de l'Oural et en Amérique
Un historien avait calculé naguère qu’entre la fin du XVe siècle et la fin du XIXe, l’Empire russe s’était accru au taux de 130 km2 par jour !
Bien évidemment, pour devenir le plus grand empire continental que le monde ait connu, l’Empire russe ne limita pas sa poussée à la partie septentrionale de la Sibérie. Il exista jusqu’au 30 mars 1867, date de la vente de l’Alaska aux Etats-Unis par les Russes, ce qu’il convient d’appeler une « Amérique russe ».
Cette Amérique russe dont le but fut de ranimer les échanges avec la Chine, mais par mer cette fois, conduisit à une extraordinaire aventure commerciale, la Compagnie russe d’Amérique créée le 8 juillet 1799 à Saint-Pétersbourg.

Cette étude du regretté professeur Yves Caron (photo), s’agrémentant d’un intermède nécessaire portant sur les plus audacieux navigateurs européens, nous fait parcourir plus de quatre siècles d’expansion russe avec une rigueur inégalée concernant l’exactitude des protagonistes, des lieux, des distances, mais aussi des chiffres commerciaux.
Si le professeur vous disait qu’une idylle ibéro-russe a failli faire passer la Californie à l’Empire des Romanov, que lui répondriez-vous ? Un livre passionnant.
Pour commander le livre:
http://www.ladiffusiondulore.fr/index.php?id_product=1385&controller=product
23:32 Publié dans Histoire, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, livre, russie, sibérie, alaska, yves caron |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 01 octobre 2023
Le temps des guerres écologiques

Le temps des guerres écologiques
par Georges FELTIN-TRACOL
La chronique n° 51 du 15 novembre 2022 intitulée « Vers la poliorcétique des cyborgs » recensait l’ouvrage collectif de Red Team (voir: http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2022/11/19/vers-la-poliorcetique-des-cyborgs.html), ce projet du ministère français des Armées qui réunit illustrateurs, auteurs de science-fiction, ingénieurs et militaires de carrière afin de réfléchir aux prochains conflits.
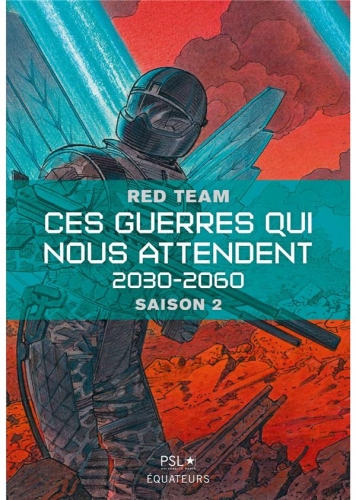
Toujours intitulé Ces guerres qui nous attendent 2030 – 2060. Saison 2 (éditions des Équateurs/PSL – Université Paris Sciences et Lettres, 2023, 210 p., 22 €), un nouvel ouvrage est paru sous la même signature qui rassemble Virginie Tournay, Laurent Genefort, Romain Lucazeau, Capitaine Numericus, François Schuiten et Saran Diakité Kaba avec une préface commune d’Alain Fuchs et de Cédric Denis-Rémis. Mais, à la différence du premier, on trouve aussi de courtes contributions de plusieurs spécialistes et un avant-propos des animateurs de ce programme, Nicolas Minvielle et Olivier Wathelet.

Ainsi apprend-on l’existence d’une Blue Team, un groupe de « militaires de différents corps » qui examine la véracité et la pertinence des hypothèses émises par Red Team. Il paraît évident que « l’initiative du collectif Red Team Défense, par sa dimension inédite et son engagement citoyen, est un nouvel outil d’anticipation qui contribue à l’orientation des efforts d’innovation et de défense ». Tout aussi ambitieux que le premier, ce nouveau livre explore deux facettes inattendues de la confrontation inter-étatique.

Le premier scénario part d’une uchronie un peu bancale. Dans ce monde perdure la Horde d’Or d’origine mongole qui contrôle les khanats de Königsberg et de Minsk et qui vient de s’emparer de la Ruthénie de Khief. Elle doit composer, à l’Est de l’Eurasie, avec l’Empire han et, à l’Ouest, avec la Ligue hanséatique qui regroupe entre autres la Francie occidentale, la Bretagne et la Bourgogne… La Horde et la Ligue traversent une ère de guerre froide. Or émerge « une cinquième révolution industrielle marquée par les biotechnologies ». Ces avancées techno-scientifiques concernent la « bio-ingénierie » et le travail sur l’ADN chez soi en utilisant un matériel perfectionné au coût assez faible. Au risque que l’homme perde toute maîtrise sur le vivant, il devient bientôt possible de fabriquer des chimères issues de manipulations génétiques audacieuses. À l’intersection de l’agronomie et de l’industrie militaire surgissent alors des armes nouvelles qui ne sont plus biologiques, mais « écosystémiques, c’est-à-dire capables de modifier un écosystème entier pour le rendre plus favorable à un camp dans un conflit ». Par exemple, la « surveillance basée sur des capteurs de mouvement constitués de filaments de mycélium ». L’historien militaire Michel Goya conclut que « la “ weaponization “ du vivant peut se jouer à la fois dans le microscopique, avec des virus et de l’ADN, et dans la macroscopique, avec des organismes animaux et végétaux ».
Le second scénario s’intéresse au déroulement d’une opération extérieure soumise aux contraintes de la sobriété énergétique et au respect absolu des réserves naturelles riches en biodiversité. En raison de la « décarbonation progressive de tous les systèmes militaires à tous les niveaux », les engins militaires roulent désormais au moteur électrique. Dans le même temps, « la carrière de chaque membre est indexée sur sa note énergétique ». Or les combattants portent une combinaison à camouflage actif et une série d’appareils très énergivores (casques à vision nocturne avec intelligence artificielle intégrée, sac de combat modulaire de 100 litres, chaussures de combat « intelligentes », etc.). Chaque soldat emploie en outre des drones-éclaireurs et des drones-batteries afin de réussir la mission.

La rareté des sources énergétiques disponibles oblige l’état-major à considérer un nouveau cadre opérationnel, surtout si « chaque opération est indexée sur un budget énergétique ». Dans ces conditions restrictives, « les armées se sont dotées de centrales électriques mobiles (flottantes ou terrestres) où les unités peuvent recharger leurs batteries ». Tant pour le port des tenues de combat que pour l’alimentation en énergie des troupes, le design prend dès lors une valeur cruciale. Qui aurait pensé que « le design, explique Édith Buser, directrice adjointe de la recherche de l’École nationale supérieure des arts décoratifs, est mobilisé sur des projets impliquant les sciences cognitives, l’IA, la chimie, la biologie, la médecine, la soft robotique mais aussi l’économie, le management, la sociologie, l’anthropologie ainsi que d’autres champs artistiques » ? Elle ajoute aussitôt que « chercheurs et doctorants sont impliqués dans des projets de recherche liés à la santé et au soin, au textile, à l’architecture, ou encore à la data visualisation de grandes masses de données ».
Ces supputations n’empêchent pas « le brouillard de la guerre » de perdurer, voire de s’épaissir, car l’application de la sobriété énergétique dépend en premier lieu de la volonté politique. On pourrait en effet croire que ce deuxième ouvrage contredit le premier qui met en avant les missiles hypervéloces et les forteresses à grand besoin d’énergie. La contradiction n’est qu’apparente. En fonction du déroulement des combats peuvent se succéder des phases d’intenses consommations énergétiques et d’autres à très basse consommation. L’art de la guerre prend vraiment des voies singulières.
GF-T
- « Vigie d’un monde en ébullition », n° 85, mise en ligne le 26 septembre 2023 sur Radio Méridien Zéro.
12:41 Publié dans Livre, Livre, Militaria | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, guerre écologique, polémologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 28 septembre 2023
Le livre noir de la nouvelle gauche

Le livre noir de la nouvelle gauche
par Michele Fabbri
Source: https://www.centrostudilaruna.it/marxismo-missione-compiuta.html
La première forme d'oppression qui se manifeste dans l'histoire est celle exercée par les hommes sur les femmes. Ce concept, évoqué par Marx et approfondi par son camarade Engels, est le fondement des démocraties "avancées" d'aujourd'hui, c'est-à-dire des sociétés fémino-centriques et homosexualisées du 21ème siècle. Nous pouvons donc constater aujourd'hui que les systèmes fondés sur la "politique du genre" sont ipso facto marxistes. Cette prise de conscience est nécessaire pour imaginer une alternative à l'état actuel des choses, et certaines avant-gardes intellectuelles commencent à attirer l'attention sur cette question. C'est le cas de deux jeunes et brillants universitaires hispanophones, Agustin Laje et Nicolás Márquez, qui ont publié une étude traduite en italien en 2023 : Le livre noir de la nouvelle gauche.
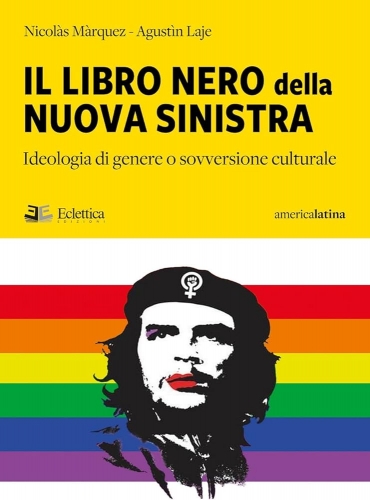
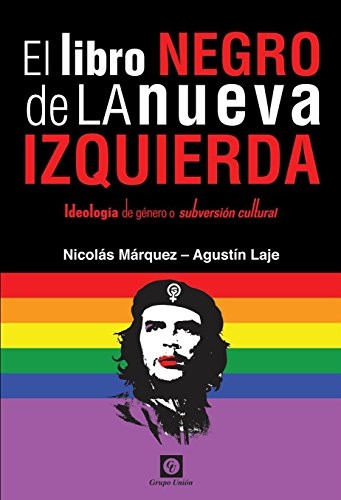
Cette étude, axée sur l'idéologie du genre, analyse la montée irrésistible du lobby gay et du pouvoir féministe dans le monde occidental. Il en ressort notamment que dans les pays où le socialisme réel a été mis en œuvre, le statut des femmes n'a pas particulièrement progressé: aucun pays du bloc communiste n'a connu de leadership féminin. Quant aux homosexuels, ils ont souvent été persécutés par la loi dans les régimes marxistes. Les auteurs du livre s'interrogent sur ces contradictions inconciliables dans le monde socialo-communiste et estiment que les marxistes ont en tête le vieil objectif de l'abolition de la propriété privée, qu'ils voudraient atteindre en s'appuyant sur la Sainte Alliance entre le féminisme et l'homosexualisme. Le monde homosexuel, bien que négligeable en nombre, jouit d'une puissance médiatique globale. L'homosexualisme servirait alors de bélier pour casser le capitalisme, dit hétéro-capitalisme, avec l'objectif habituel de détruire la famille.
Le livre fait particulièrement référence au monde latino-américain, que les auteurs connaissent très bien, où l'homosexualité est en général organisée au sein de groupes d'extrême gauche. Cependant, la réalité en Europe et en Amérique du Nord montre une image différente: le capitalisme avancé semble être le liquide amniotique de l'homosexualité, qui jouit souvent d'un consensus politique unanime. Fondamentalement, le système occidental est animé d'une haine viscérale à l'égard du mâle hétérosexuel, tenu pour responsable des maux du monde. La criminalisation du genre masculin est l'exercice quotidien des grands médias, et les frustrations de toutes sortes se coagulent dans la misandrie d'État, devenue aujourd'hui une religion civile interclassiste.
Quelle que soit l'interprétation que l'on souhaite donner aux pulsions qui se manifestent dans l'opinion publique, le livre de Màrquez et Laje regorge d'informations utiles et de citations mettant en lumière les piliers de l'idéologie arc-en-ciel, dans laquelle les invitations explicites à la pédophilie, à la coprophilie, à l'inceste, aux pratiques sexuelles extrêmes telles que la roulette russe du SIDA, et même la théorisation d'une démocratie sexuelle post-humaine basée sur l'orifice anal, ne manquent pas... Autant de sujets qui n'ont jamais été abordés par les médias généralistes et qu'il est juste de porter à la connaissance d'un public non averti qui se plie désormais à la rhétorique gay de manière inconsciente, presque par réflexe conditionné.
Les deux chercheurs, qui s'expriment avec une franchise très rare et vraiment louable de nos jours, sont des auteurs d'origine catholique, et de nombreux catholiques italiens, chloroformés par la rhétorique bien-pensante du pape Bergoglio, seront certainement choqués par un langage aussi explicite. C'est une autre raison pour laquelle il vaut la peine de s'attaquer à cette lecture, qui offre, parmi de nombreuses informations intéressantes, des statistiques indicatives pour une évaluation du phénomène LGBT. Les lecteurs trouveront des données sur la prévalence exceptionnelle des maladies vénériennes chez les homosexuels: ces informations sont soigneusement cachées au public et contrastent fortement avec les programmes de santé souvent mis en œuvre par les politiciens (pensez aux campagnes antitabac). On détourne les citoyens du vice de la cigarette, tout en les poussant à des formes de promiscuité sexuelle extrêmement dangereuses du point de vue de la santé !
Une partie du livre est consacrée à l'idéologie de l'avortement, qui est la question anthropologique la plus importante. En outre, l'ouvrage décrit des propositions politiques qui apparaissent dans les publications de la région et qui sont susceptibles d'être mises en œuvre dans un avenir proche: homosexualité obligatoire, hétérosexualité interdite, camps de concentration pour les hommes...

Mais au-delà des observations du livre, on peut dire que le marxisme a gagné avec l'effondrement du mur de Berlin. La haine sociale que le communisme prônait dans les années 1900 s'est transformée en un conflit permanent des sexes entre hommes et femmes ainsi qu'entre homosexuels et hétérosexuels. Le changement de mentalité s'est opéré grâce à l'endoctrinement généralisé des marxistes pendant la période de la guerre froide: sous l'égide de l'école de Francfort, ils ont commencé à comprendre que le capitalisme, tout en générant de grandes inégalités dans la répartition des richesses, réalisait en même temps l'émancipation des femmes, ce qui était évidemment pour les marxistes un objectif bien plus attrayant que la "justice sociale". Le capitalisme a favorisé le travail des femmes pour accroître la consommation, ce qui a également permis d'augmenter les revenus imposables: en bref, les capitalistes ont secoué l'arbre et les marxistes ont récolté les fruits... Après tout, ce n'est pas la première fois que les deux côtés de la modernité collaborent amoureusement !
À long terme, la disponibilité accrue de la main-d'œuvre a généré un chômage de masse et maintenu les salaires à un bas niveau, tandis que le relâchement des liens du sang a fragmenté les patrimoines familiaux. Sans parler du déclin démographique qui conduit les sociétés "avancées" au suicide... Un scénario d'appauvrissement généralisé s'est ainsi mis en place, rendant les travailleurs facilement accessibles au chantage. Ainsi, avec la dématérialisation progressive de l'institution familiale, tout sens de la communauté a été éliminé, ce qui a conduit à un individualisme radical et à la guerre de tous contre tous qui en découle. Le résultat est un modèle social qui tend vers le dystopisme, très proche du communisme puisqu'il vise à l'homologation des modes de vie : aujourd'hui, même les "conservateurs" autoproclamés ont intériorisé le langage arc-en-ciel et l'utilisent sans même s'en rendre compte
Le chef-d'œuvre des progressistes a donc été de féminiser la psychologie de masse. La mentalité de la société contemporaine reflète l'attitude typique des femmes : soumises, obéissantes, serviles... Ainsi, les velléités de rébellion sont facilement absorbées et la classe politique a beau jeu de conditionner des individus castrés, devenus incapables de réagir aux injustices dont ils sont eux-mêmes victimes !
Le livre de Laje et Màrquez se limite à l'aspect idéologique et propagandiste de la question, mais il serait intéressant d'approfondir les thèmes des manipulations biologiques qui ont permis d'établir le Gender; cependant, ces sujets nécessitent une expertise scientifique qui dépasse la formation des deux auteurs, formés en droit et en sociologie. Pour toutes ces raisons, la bataille politique se joue aujourd'hui sur le front du Gender, que l'on peut désormais définir comme le communisme du 21ème siècle. Les arguments ne manquent pas pour démontrer les contradictions du système. Les apories manifestées dans le socialisme réel suffisent déjà largement à discréditer le cadre conceptuel du progressisme, mais l'idéologie du genre est encore plus inconcevable. S'il est vrai, comme le disent les genderistes, que le genre sexuel est un choix psychologique et non un fait biologique, alors tout le monde peut se déclarer femme et tous les problèmes du monde seront résolus: il n'y aura plus de raison d'élaborer des politiques spécifiques pour les femmes ! Le fait que les oligarchies se renforcent au fur et à mesure que l'arc-en-ciel se lève ne fait que confirmer le caractère contre-initiatique du progressisme, historiquement soutenu et financé par des noms bien connus des "complotistes"...
Nicolas Màrquez, Agustin Laje, Il libro nero della nuova sinistra. Ideologia di genere o sovversione culturale, (= Le livre noir de la nouvelle gauche. Idéologie du genre ou subversion culturelle), Editions Eclectica 2023, p.284.
21:40 Publié dans Actualité, Livre, Livre, Sociologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sociologie, livre, actualité, problèmes contemporains, nouvelle gauche, gauche fuchsia |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 24 septembre 2023
Lucien Rebatet, révolutionnaire décadent
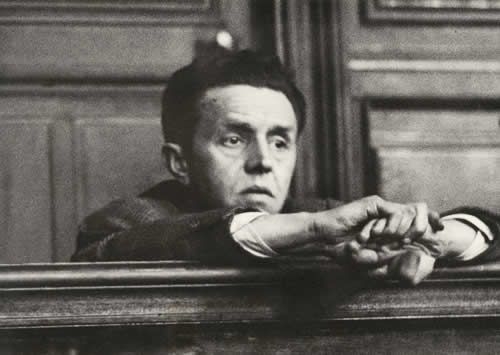
Lucien Rebatet, révolutionnaire décadent
Rebatet, selon l'essayiste Claudio Siniscalchi, est un véritable paradigme de cette large patrouille d'intellectuels qui lisent l'histoire de la France moderne en termes de décadence.
par Giovanni Sessa
Source: https://www.barbadillo.it/111174-lucien-rebatet-rivoluzio...
Ces dernières années, dans le paysage éditorial italien, il semble y avoir un regain d'intérêt pour le fascisme français. Claudio Siniscalchi fait partie des auteurs qui ont le plus contribué à cette résurgence d'études thématiques. Son dernier ouvrage, Un revoluzionario decadente. Vita maledetta di Lucien Rebatet, en librairie aux éditions Oaks (sur commande : info@oakseditrice.it, pp. 182, euro 20.00). Selon l'auteur, Rebatet est un véritable paradigme de cette vaste compagnie d'intellectuels qui ont lu l'histoire de la France moderne en termes de décadence, mais qui étaient en réalité profondément enracinés dans ce monde.
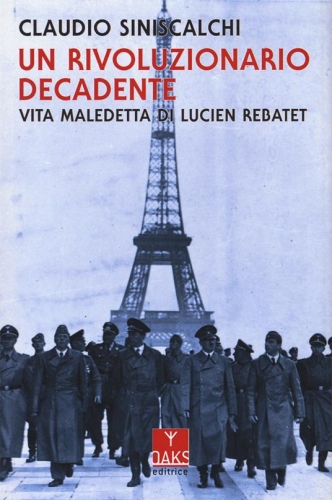
Rebatet est né en novembre 1903 dans l'ancien Dauphiné. Il est éduqué dans une école dirigée par des religieux, pour lesquels il éprouve un dégoût irrépressible. Son père, notaire d'obédience républicaine, et sa mère, catholique d'origine napolitaine, ne parviennent pas à l'attirer dans leurs univers idéaux respectifs. En 1923, le jeune Rebatet arrive à Paris. Dans la capitale, il étudie la littérature à la Sorbonne et fréquente assidûment Montparnasse, quartier excentrique où règne une vie nocturne intense et où se déroulent des manifestations culturelles et artistiques novatrices. C'est au cours de ces années que débute sa collaboration avec L'Action française de Maurras, d'abord en tant que critique musical, puis en tant que critique cinématographique. Contrairement à Maurras, Rebatet "n'est ni catholique ni anti-allemand" (p. 19). Doté d'un style mordant, ses articles connaissent un succès immédiat. Son ascension au sommet de l'intelligencija de la "droite" française commence en 1932. Cette année-là, ses contributions paraissent dans l'hebdomadaire Je suis partout. Dans ces colonnes, il passe de la critique cinématographique à la polémique politique. Ses écrits témoignent du dépassement progressif des positions de Maurras, dans le sens d'un soutien total à la cause "fasciste".
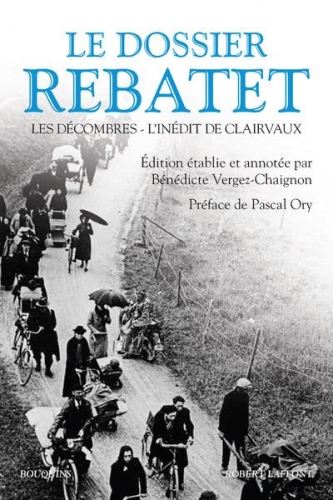 En présentant l'itinéraire intellectuel et politique de Rebatet, Siniscalchi dresse un tableau organique du monde intellectuel varié et vivant du "fascisme" français, en discutant des relations qui existaient entre les principaux interprètes de cette faction intellectuelle et politique. Il parvient ainsi à des jugements équilibrés, conformes aux exigences de la recherche historique. Il précise notamment comment le rapprochement de Rebatet avec l'Allemagne nationale-socialiste s'explique par la conviction profonde que les ennemis de la patrie sont "intérieurs" et se reconnaissent dans : "les Maghrébins, les Noirs, les Jaunes, les Russes anciens et nouveaux, les mineurs polonais, les Italiens" (p. 23), venus en France pour les raisons les plus disparates. Ces catégories seront bientôt remplacées par l'ennemi par excellence, le Juif. Les révolutionnaires et les juifs qui ont quitté l'Allemagne après 1933 ont rencontré les exilés antifascistes italiens et ont formé l'Internationale antifasciste. Celle-ci devait être combattue, selon l'auteur, par l'internationale fasciste.
En présentant l'itinéraire intellectuel et politique de Rebatet, Siniscalchi dresse un tableau organique du monde intellectuel varié et vivant du "fascisme" français, en discutant des relations qui existaient entre les principaux interprètes de cette faction intellectuelle et politique. Il parvient ainsi à des jugements équilibrés, conformes aux exigences de la recherche historique. Il précise notamment comment le rapprochement de Rebatet avec l'Allemagne nationale-socialiste s'explique par la conviction profonde que les ennemis de la patrie sont "intérieurs" et se reconnaissent dans : "les Maghrébins, les Noirs, les Jaunes, les Russes anciens et nouveaux, les mineurs polonais, les Italiens" (p. 23), venus en France pour les raisons les plus disparates. Ces catégories seront bientôt remplacées par l'ennemi par excellence, le Juif. Les révolutionnaires et les juifs qui ont quitté l'Allemagne après 1933 ont rencontré les exilés antifascistes italiens et ont formé l'Internationale antifasciste. Celle-ci devait être combattue, selon l'auteur, par l'internationale fasciste.
Ainsi, l'idée d'un fascisme européen comme seule réponse possible à la décadence de notre continent mûrit chez Rebatet, ainsi que chez Drieu La Rochelle. La fièvre antisémite se radicalise en France, avec la conquête du pouvoir par le Front populaire de Blum. Rebatet, nous dit Siniscalchi, reste un observateur attentif des phénomènes contemporains. Après la publication de l'Histoire du cinéma de Brasillach et Bardèche, il montre qu'il ne partage pas l'exégèse esthétique néoclassique de Maurras et qu'il voit dans le cinéma un art aux potentialités extraordinaires. Il n'est pas un critique de cinéma animé par des préjugés anti-américains : "Dans les films hollywoodiens [...] il trouve souvent des œuvres saines et spontanées, vitales et viriles [...] des œuvres dépourvues de superficialité et de fausseté" (p. 49). En 1937, il va même jusqu'à définir La grande illusione, un film critiqué en Italie par Luigi Chiarini, comme le meilleur produit de l'année. Il s'insurge également contre "le pessimisme moral typique des films les plus significatifs du "réalisme poétique" français" (p. 52). Rebatet devient le plus important critique de cinéma du pays pendant l'Occupation. Selon lui, les "Aryens" et les Français Lumière et Méliès sont responsables de la naissance du cinéma: "Les "Juifs" ont récolté les copieux fruits économiques de cette invention" (p. 73), tant en Europe qu'aux États-Unis.
Le collaborationniste ne fait qu'appliquer à l'histoire du cinéma le schéma développé par Wagner pour ses écrits sur le judaïsme musical. Le résultat, note Siniscalchi, est une "falsification" de l'histoire du cinéma français. L'activité d'écrivain de Rebatet trouve son apogée dans deux livres. Le premier, Les décombres, peut être considéré comme le véritable manifeste idéologique de la "tentation fasciste". Il connaît un succès inattendu et immédiat. Rebatet y "attaque avec une rare violence les institutions, les partis, les hommes politiques, les intellectuels, appelant à [...] la "déjudaïsation" du pays" (p. 100). Rebatet est convaincu de l'inanité de la tentative politique menée à Vichy: seul un authentique fascisme français aurait pu relever la France, sur la base du national-socialisme allemand. À la Libération de Paris, après une évasion audacieuse, Rebatet est arrêté et condamné à mort, mais la peine est bientôt commuée en détention à perpétuité. En fait, il est resté dans les prisons françaises pendant plusieurs années.
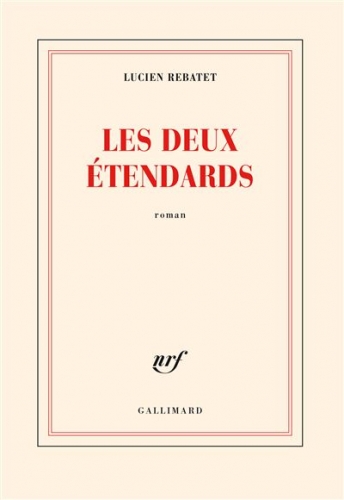
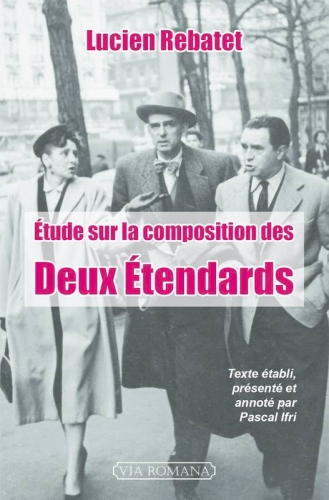
En 1951, il publie un nouveau roman, Les deux étendards. Sur le plan littéraire, il s'agit d'un retour à Proust, mais l'inspiration profonde est nietzschéenne et antichrétienne. Siniscalchi, se référant aux études de Del Noce et de Voegelin, inscrit les thèses exprimées dans ce volume dans les positions révolutionnaires modernes et néo-gnostiques des religions politiques. En ce qui nous concerne, ce qui est surprenant chez le Français, c'est que son adhésion à la vision "païenne" de la vie l'ait conduit à embrasser la cause nationale-socialiste. Au contraire, pour l'écrivain, attentif au thème de la leçon de Benoist, mais pas seulement, le nazisme est l'expression typique du monothéisme politique, "Un peuple, un Reich, un chef", rien de plus éloigné des conceptions issues d'une approche polythéiste du monde.
En tout cas, Rebatet, pendant la période dramatique de l'après-guerre, a vécu dans la solitude, marginalisé, sans abjurer, il est vrai, les idées qu'il avait défendues avec tant de véhémence dans les années précédentes. C'est le mérite de Siniscalchi d'avoir remis au centre du débat ces idées et les événements auxquels l'écrivain a participé.
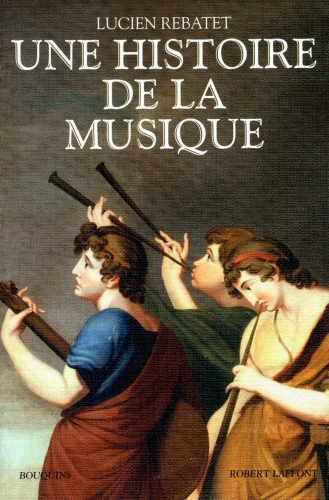
12:14 Publié dans Littérature, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lucien rebatet, livre, fascisme, fascisme français, france, histoire, collaboration, cinéma, années 30, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 20 septembre 2023
Lev Gumilëv: ethnos, superethnos et passionnalité. Un exemple tiré de la culture chinoise ancienne : Ming Tang

Lev Gumilëv: ethnos, superethnos et passionnalité. Un exemple tiré de la culture chinoise ancienne : Ming Tang
par Maria Morigi
Source: https://www.cese-m.eu/cesem/2023/09/lev-gumilev-ethnos-superethnos-e-passionarieta-un-esempio-dalla-cultura-cinese-antica-ming-tang/
J'ai lu avec grand intérêt l'essai de Luigi Zuccaro intitulé La geofilosofia con Lev Gumilëv (= La Géophilosophie avec Lev Gumilëv, Anteo ed., 2022). Le livre rend justice à un chercheur peu connu en Occident, Lev Gumilëv, anthropologue, ethnologue, géographe, sémioticien, iraniste et ouralo-altaïste (comme le définit Franco Cardini dans la préface) qui a été une figure fondamentale de l'eurasisme, un courant idéologique qui a développé une théorie de la Russie en tant que système historico-culturel et géopolitique, distinct à la fois de l'Europe et de l'Asie.
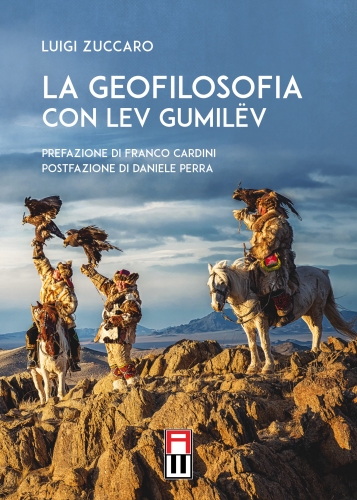
Le projet de "Grande Eurasie" qui en résulte joue un rôle prépondérant dans la vie culturelle de la Russie contemporaine et constitue aujourd'hui l'axe principal de la géopolitique moscovite en opposition à l'Occident.
Anti-léniniste, Gumilëv a été persécuté, emprisonné et soumis au travail forcé pendant la période stalinienne. Ce n'est qu'après 1956, à l'Institut d'études orientales de l'Académie des sciences de Leningrad et en travaillant comme bibliothécaire à l'Ermitage, qu'il a pu approfondir son analyse de l'origine des peuples par l'étude archéologique et anthropologique, en parvenant à une compréhension organique de l'économie, sans tomber dans la catégorie de la pensée économiste occidentale; une démarche, à y regarder de plus près, clairement anti-libérale et anti-occidentale, ce qui explique que le savant, décédé en 1991 peu après la dissolution de l'empire soviétique, se soit déclaré alarmé et extrêmement préoccupé précisément par la chute de l'URSS et opposé à toute alliance avec l'Occident.

L'intérêt pour les thèses de Gumilëv a été ravivé à l'ère post-soviétique : Alexandre Douguine le considère comme le lien entre l'eurasisme classique et le néo-eurasisme, et dans les républiques post-soviétiques d'Asie centrale, il a inspiré les projets eurasistes de rédemption nationale des présidents kazakh Noursoultan Nazarbaev (l'université d'État d'Astana porte le nom de Gumilëv) et kirghize Askar Akaïev.
La préface de Franco Cardini et la postface de Daniele Perra, tous deux spécialistes de la pensée philosophique et géopolitique russo-eurasienne, ont bien saisi et souligné les influences, les emprunts et les valeurs géopolitiques de la pensée de Gumilëv dans le cadre des savants, philosophes et scientifiques qui lui sont contemporains et qui l'ont précédé (le titre de l'essai contient un con, un "avec" Lev Gumilëv, ce qui est significatif). Pour moi, cette lecture constitue un défi théorique auquel j'ai du mal à faire face, car je ne connais que peu des nombreux auteurs cités et issus de l'espace russe; en même temps, elle représente la confirmation d'une évidence, à savoir que l'Histoire est déterminée par la Géographie et que la genèse, le développement et les migrations des groupes ethniques et sociaux sont déterminés par des facteurs tels que la morphologie du territoire, le climat, etc.
Dans l'interprétation de Gumilëv, les idées d'ethnos et d'ethnogenèse deviennent étrangères à l'anthropologie culturelle théorique, mais s'expriment dans la relation entre la biosphère et la géosphère, à l'instar de la biogénétique du physicien Kozyrev, qui a tenté de prouver le lien entre l'esprit, le corps et le cosmos et a émis l'hypothèse d'une énergie biosomatique. L'espace eurasien lui-même, correspondant aux frontières géopolitiques de la Russie tsariste, divisé en quatre ceintures pédologiques horizontales (toundra, taïga, steppe et désert) et deux ceintures climatiques verticales séparant l'Eurasie du climat de mousson asiatique, est une prémisse fonctionnelle de la théorie ethnogénétique.
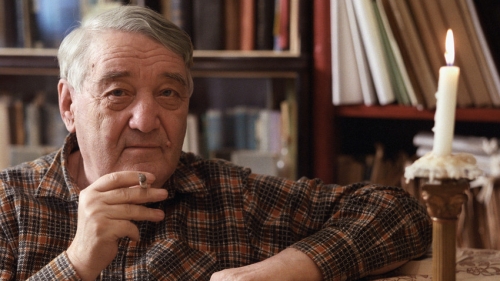
Dans ses études sur les peuples nomades de la steppe, dont l'histoire est souvent centrée sur la figure d'un chef charismatique, Gumilëv propose le concept de l'action réciproque de l'homme et de l'environnement - c'est-à-dire la "passionnalité", en russe la passionarnost - soit la capacité de l'organisme humain à absorber l'énergie de l'environnement et à la libérer sous forme de force d'action; la passionnalité est aussi la capacité, propre à certains hommes seulement, de se donner pour une cause qui dépasse l'intérêt individuel et stimule d'autres hommes à surmonter une condition d'inertie, initiant ainsi le processus de l'ethnogenèse. La passion s'exercerait selon la succession de cinq phases : ascendante, acmatique, de rupture, d'inertie (ou homéostatique en équilibre avec le milieu) et mémorielle (manquant désormais de force pour dépasser les limites de l'organisation et de l'espace). Le déclin de la passion se manifesterait par des comportements de plus en plus individualistes.
Selon Zuccaro, "la phase passionnelle elle-même est un produit de l'action systémique de l'environnement qui produit un saut qualitatif avec les pratiques produites par les peuples qui l'habitent". L'étude de Gumilëv sur la passionnarité représente une sorte de phénoménologie naturalisée de l'esprit qui part de l'environnement en tant que structure et non de catégories économiques comme pour Marx" (p. 52). Théorie récurrente dans la pensée philosophique russe en ce qu'elle considère l'espace comme transcendantal par rapport à l'Histoire, selon Pavel A. Florensky: "Toute la culture peut être représentée comme l'activité de l'organisation de l'espace" (P. A. Florensky, Lo spazio e il tempo nell'arte, Adelphi 1995).

Ayant une formation d'archéologue et de spécialiste des ethnies et des religions (surtout en ce qui concerne la Chine), j'en viens aux chapitres qui m'ont le plus interpellée, à savoir le chapitre IV, "Mythe et imaginaire" et le chapitre V, "De la Chine archaïque au passionnisme du siècle chinois". Ces chapitres illustrent les éléments constitutifs du superethnos, du grand ensemble ethnique (européen, russe, eurasien, islamique, chinois) et phénomène complexe qui prend forme à partir de la religion et de la mythologie, mais qui ne correspond pas toujours (et pas entièrement) à la civilisation ou à l'espace civilisationnel.
Je donne l'exemple de la Chine archaïque, une société agricole et sédentaire où les inondations et les famines étaient les principales catastrophes récurrentes. La recherche de la Voie (Tao) est basée sur le Qi (énergie vitale qui imprègne tous les aspects de l'action humaine et de la nature), sur l'alternance continue des deux polarités Yin et Yang, et sur la croyance que les Shen (Esprits) traversent continuellement l'espace entre le ciel et la terre. L'art géomantique du Feng Shui ("vent et eau", c'est-à-dire l'énergie latente dans la terre) détermine et oriente également la construction de la nécropole ou du palais; et le "Ne pas agir" ou Wu Wei (bien illustré dans l'essai de Zuccaro, p. 94 et suivantes) avec le concept essentiel du "ne pas agir" ou du "ne pas faire", est un principe de base de la culture de l'homme), en même temps que le concept essentiel du "Vide parfait"; tous deux témoignent du fait que la sagesse chinoise s'articule harmonieusement avec la Nature, suit l'inclinaison venant du Ciel et contribue à "ordonner" le monde, le cosmos et les relations humaines à travers les rituels (voir le "Livre des Rites" - Lǐjì - de Confucius) et la divination.
Le modèle de référence est l'édifice sacré par excellence, le Ming Tang (Salle Lumineuse, Maison du Calendrier ou Pavillon de Lumière), salle d'apparat du palais impérial et lieu où l'empereur et ses fonctionnaires s'asseyaient pour les consultations divinatoires et pour établir le calendrier agricole, prérogative et fonction indispensable de l'empereur dont la tâche était de nourrir tout le peuple de l'empire.
Le Ming Tang se compose d'une plate-forme carrée, représentant la Terre, divisée en 9 pièces, sur laquelle est élevé un toit circulaire, à l'image du Ciel. Le centre du carré est occupé par le chiffre 5, centre du cosmos, centre de la terre et premier point cardinal.
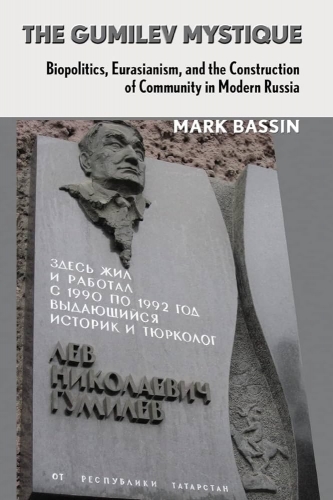
Les côtés représentent les 4 piliers correspondant aux 4 saisons; sur les côtés extérieurs des 9 pièces se trouvent 12 fenêtres représentant les mois de l'année rituelle. Les 12 fenêtres multipliées par les 9 chambres donnent 108, un chiffre cyclique qui revient dans de nombreuses traditions sacrées liées au temps. La tâche du responsable de la Maison du Calendrier était de s'assurer que les pièces étaient distribuées correctement afin qu'elles soient en corrélation avec les points cardinaux.
Le Ming Tang n'est pas seulement une représentation du cosmos et de la loi céleste, mais aussi une métaphore de l'empire qui, au troisième millénaire avant J.-C., était divisé en neuf provinces (Zhou) selon la mesure légendaire de la terre attribuée au roi chaman Fu Yu qui avait dompté les inondations (mentionné dans le Shǐjì ).
Les anciens Chinois ont ainsi déterminé les 24 phases de l'année solaire appelées chieh-ch'i et les phases de la lune. La disposition de la Maison du Calendrier est également associée à la tortue (Shu) qui représente l'élément eau, la saison hivernale, la couleur noire, le sous-sol, la polarité Yīn (ombre et côté féminin), le point cardinal Nord et les Ancêtres. Ce sont tous des éléments qui tournent cycliquement dans le temps et l'espace, mais qui doivent être respectés et exorcisés afin de donner la bonne inclinaison aux événements humains qui leur sont liés.
Pour conclure sur l'exemple chinois, je suis d'accord avec ce qu'écrit Zuccaro : "Au cours de son histoire millénaire, la Chine, plutôt que des transformations, a connu des changements au sein desquels la territorialité est néanmoins restée intacte. Le principe du Tao, entendu comme ordre et équilibre, et non comme structure, est un concept proche du concept grec de Dike. Le taoïsme... est la véritable religion civile de la Chine et l'est resté malgré les tentatives de déstructuration partielle des structures féodales et traditionnelles, même dans le contexte de la révolution maoïste. Mao a réalisé une révolution certes dans le cadre des Lumières et du marxisme..., mais dans le cadre d'une réforme économique et agricole liée aux critères de la tradition culturelle chinoise" (p. 98-99).
19:25 Publié dans Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, lev gumilëv, géophilosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 17 septembre 2023
Géopolitique de l'épée

Géopolitique de l’épée
par Georges FELTIN-TRACOL
En octobre 2022 paraissait en co-édition chez L’Artilleur et Bernard Giovanangeli Le déclin d’un monde. Géopolitique des affrontements et des rivalités en 2023 (278 p., 22 €) de Jean-Baptiste Noé, le rédacteur en chef de la revue Conflits qui appartient au même groupe de presse que le mensuel Causeur dont les numéros 111 d’avril et 112 de mai 2023 dénigraient la mémoire d’Emmanuel Ratier, grand ami de Radio Méridien Zéro, décédé en 2015.

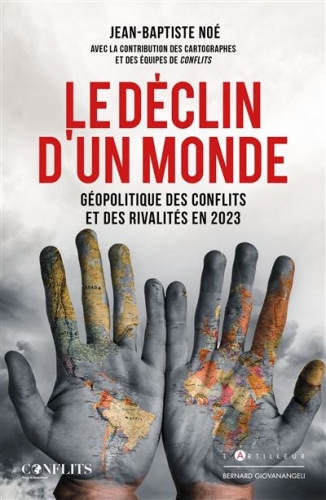
Jean-Baptiste Noé expose dans une excellente introduction sa vision géopolitique pragmatique et réaliste. Il explique avec raison que « l’épée, réalité la plus profonde de l’homme, est de nouveau sortie de son fourreau ». Par cette métaphore, il avertit le lecteur peut-être candide que le monde actuel se forge sur des rapports de forces redoutables et permanents. Au risque de choquer les tenants de l’éternel irénisme, il assure que « la géopolitique est au service d’une vision de la puissance ». Mais qu’est-ce que la puissance ? « Seule la puissance, affirme-t-il, maintient l’être, c’est-à-dire la vie. Être puissant, c’est être libre, indépendant, souverain et maître de son destin. La recherche de la puissance est un mobile fondamental des États sans quoi ils n’existent pas. »
L’auteur déplore bien sûr que la France et, plus généralement, les États européens ne la recherchent plus. C’est la raison pour laquelle bien des Occidentaux d’Europe s’en remettent à l’OTAN. « Le choix de l’OTAN, explique-t-il, est le choix logique et pertinent de pays qui n’ont pas les moyens matériels et humains de porter l’épée et qui s’en remettent donc à d’autres, via un tribut et une nouvelle forme de mercenariat, pour assurer leur sécurité. » Sur d’autres continents, des États ne partagent pas ce manque d’ambition d’autant que Jean-Baptiste Noé constate que « le monde du XXIe siècle, c’est le XIXe siècle, la technologie en plus ». La référence au XIXe siècle n’est pas anodine de la part de ce conservateur libéral, admirateur de Frédéric Bastiat, de François Guizot et d’Alexis de Tocqueville. Outre deux essais géopolitiques sur le Vatican et la diplomatie de l’Église catholique à l’heure du supposé « pape » Bergoglio, il a publié en 2018 La parenthèse libérale. Dix-huit années qui ont changé la France qui se veut une réévaluation positive de la Monarchie de Juillet (1830 – 1848) de l’usurpateur royal Louis-Philippe. Son prisme libéral se manifeste dans la troisième partie du livre quand il aborde la géo-économie et les interactions géopolitiques des entreprises et du monde des affaires.
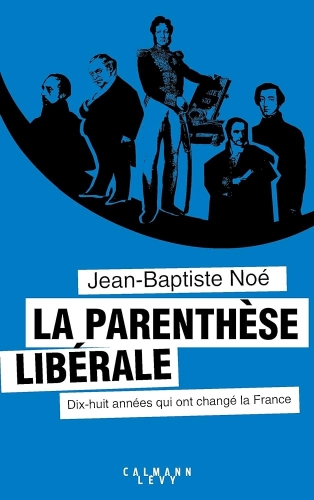
Jean-Baptiste Noé se place en outre sous la patronage du chroniqueur économiste libéral et maurrassien Jacques Bainville. Oui, « un État à l’économie déficitaire et bloquée ne peut pas être une grande puissance ». Mais faut-il pour autant recourir à l’illusion libérale, critiquer l’« État-Providence » et dénoncer le système de retraite par répartition ? Il enrage que « les Français adhèrent à un système d’économie semi-fermée » parce qu’ils font toujours « le choix du socialisme ». Certes, le système scolaire français va très mal. La privatisation serait-elle la solution ? Sans la refonte complète des programmes, de la maternelle jusqu’au lycée, et la révision intégrale des pratiques éducatives actuelles, on peut en douter. Même privatisée, l’école restera déplorable si ne se produit pas en parallèle dans le pays une vigoureuse révolution intellectuelle, morale et psychologique.
L’auteur se fourvoie donc quand il annonce l’avènement d’un nouveau XIXe siècle. En réalité, nous vivons l’équivalent du tournant anthropologique entre le Moyen Âge et la Renaissance à la charnière des XVe et XVIe siècles. Loin du XIXe siècle, nous entrons plutôt dans un nouvel âge médiéval tribalisé (ou communautarisé) hautement technicisé selon les avertissements précurseurs du sociologue Michel Maffesoli et du « dynamiteur de concepts » Guillaume Faye.
Jean-Baptiste Noé s’inquiète du retour du mythe, cette « démarche inverse de la logique où la parole sert à désigner la chose vue et éprouvée. Dans le logos, la parole décrit; dans le mythe, la parole crée ». C’est un point de vue biaisé. Le mythe n’est pas un idéalisme; il est au contraire le fondement des communautés organiques. L’auteur pourfend aussi une certaine écologie qui prend tantôt une tournure favorable à Gaïa, tantôt une tournure indigéniste. Il ne comprend pas que l’écologie politique peut être bio-conservatrice et même identitaire. Le retour à la terre peut suivre différentes modalités, car « local et global sont corrélés, l’intelligence territoriale va de pair avec la puissance internationale ». Mieux, « la puissance doit penser une vraie modernité », à moins qu’il ne s’agisse d’une post-modernité tragique très éloignée du post-modernisme ultra-libéral ambiant ou bien plus proche d’un impérieux archéofuturisme...
Non sans contradictions, ce libéral vitupère avec justesse « le mythe du développement » qui « repose sur une vision keynésienne de l’interventionnisme international selon laquelle il suffirait d’arroser d’argent public, via des banques, des associations ou des entreprises créées de toutes pièces, pour assurer le développement matériel de l’Afrique ». Or la logique développementaliste ne s’inscrit-elle pas dans la grande veine du libéralisme ?
Conscient que sa ferveur libérale risque d’indisposer le lecteur, Jean-Baptiste Noé invite les entreprises à « favoriser l’actionnariat salarial afin de conserver une partie des actions au sein des sociétés. La participation a été l’une des grandes idées du général de Gaulle, beaucoup moins étatiste qu’on ne le croit, qu’il a contribué à mettre en place au cours de ses mandats. Cela a en outre la vertu d’intégrer les salariés à la vie de leur entreprise et de leur permettre de se constituer un capital en vue de leur retraite ».
L’auteur se trouve finalement tiraillé entre son réalisme géopolitique et son idéalisme socio-économique. Oui, « la fin de l’universalisme signe la revanche des frontières, c’est-à-dire le réveil de l’histoire ». Il persiste toutefois sous l’influence de Hayek à écrire que « les universalistes ont cherché à construire un monde issu de leurs pensées et de leurs esprits. Cet ordre constructiviste ayant échoué reste l’ordre spontané de la culture et de la civilisation ». Or, il n’existe pas d’ordre spontané (ou catallaxie chez Hayek). Le monde est un chaos permanent. Il faut espérer – et travailler - que « la fin de l’universalisme oblige au renouveau de la culture européenne » à la stricte condition que ce renouveau repose, d’une part, sur des cultures vernaculaires enracinées dynamiques et, d’autre part, sur des Européens enfin libérés de toute culpabilité historico-morale. Le chemin est encore bien long, y compris pour ceux qui ont déjà saisi la poignée de l’épée.
GF-T
- « Vigie d’un monde en ébullition », n° 83, mise en ligne le 12 septembre 2023 sur Radio Méridien Zéro.
12:00 Publié dans Actualité, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, jean-baptiste noé, france, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
G. K. Chesterton et la conspiration ploutocratique (Le nommé Jeudi, 1908)

G. K. Chesterton et la conspiration ploutocratique (Le nommé Jeudi, 1908)
Nicolas Bonnal
On lit et on relit Chesterton, et son génial Nommé jeudi, publié en 1908, lisible sur Wikisource, qui décrit la situation que nous vivons, que nos anti-conspirateurs dénoncent :
« Vous partagez cette illusion idiote que le triomphe de l’anarchie, s’il s’accomplit, sera l’œuvre des pauvres. Pourquoi ? Les pauvres ont été, parfois, des rebelles ; des anarchistes, jamais. Ils sont plus intéressés que personne à l’existence d’un gouvernement régulier quelconque. Le sort du pauvre se confond avec le sort du pays. Le sort du riche n’y est pas lié. Le riche n’a qu’à monter sur son yacht et à se faire conduire dans la Nouvelle-Guinée. Les pauvres ont protesté parfois, quand on les gouvernait mal. Les riches ont toujours protesté contre le gouvernement, quel qu’il fût. Les aristocrates furent toujours des anarchistes ; les guerres féodales en témoignent. »
C’est qu’en effet les oligarques n’aiment guère obéir.
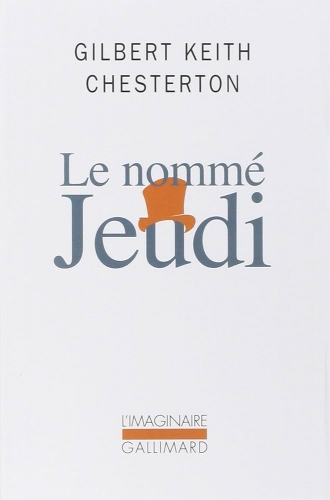
Dans son roman à clé sur la montée du communisme et de la mondialisation (tous aux mains d’une clique de banquiers), Chesterton, qui avait été révolté par la guerre des boers liée au diamant (Barnato, Rothschild, Cecil Rhodes et sa périlleuse Table Ronde), ajoute :
« Nous ne sommes pas des bouffons ; nous sommes des hommes qui luttons dans des conditions désespérées contre une vaste conspiration. Une société secrète d’anarchistes nous poursuit comme des lapins. Il ne s’agit pas de ces pauvres fous qui, poussés par la philosophie allemande ou par la faim, jettent de temps en temps une bombe ; il s’agit d’une riche, fanatique et puissante Église : l’Église du Pessimisme occidental, qui s’est proposé comme une tâche sacrée la destruction de l’humanité comme d’une vermine».
Chesterton ajoute avec humour et fantaisie cette allusion à Cecil Rhodes et à la Table ronde – dont reparlera Carroll Quigley dans ses classiques:
« Voici son application à ces circonstances : la plupart des lieutenants de Dimanche sont des millionnaires qui ont fait leur fortune en Afrique du Sud ou en Amérique. C’est ce qui lui a permis de mettre la main sur tous les moyens de communication, et c’est pourquoi les quatre derniers champions de la police anti-anarchiste fuient dans les bois, comme des lièvres. »
Et comme aujourd’hui on accuse le mondialisme et le transhumanisme des maîtres du réseau (Google, Amazon, Facebook, Apple, GAFA, etc.),
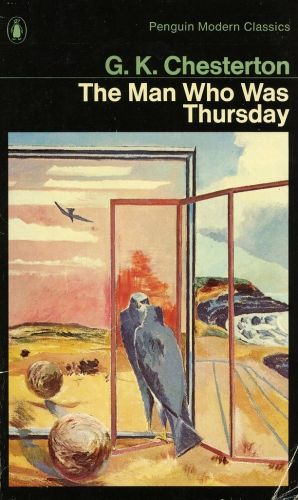
Chesterton dénonce les maîtres du rail :
« Mais permettez-moi de vous faire observer que la force de cette racaille est proportionnée à la nôtre et que nous ne sommes pas grand-chose, mon ami, dans l’univers soumis à Dimanche. Il s’est personnellement assuré de toutes les lignes télégraphiques, de tous les câbles. Quant à l’exécution des membres du Conseil suprême, ce n’est rien pour lui, ce n’est qu’une carte postale à mettre à la poste, et le secrétaire suffit à cette bagatelle. »
Bibliographie
Gilbert Keith Chesterton – Le nommé jeudi (wikisource)
Nicolas Bonnal – Littérature et conspiration (Amazon.fr, Dualpha.com)
11:39 Publié dans Littérature, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nicolas bonnal, g. k. chesterton, lettres, lettres anglaises, littérature, littérature anglaise |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 16 septembre 2023
Chine archéofuturiste

Chine archéofuturiste
Carlos X. Blanco
Peut-on réconcilier Confucius (qui serait né en 551 av. J.-C. et mort en 479 av. J.-C.) et Marx (1818-1883) ? En Chine, c'est possible. La République populaire de Chine au 21ème siècle les a miraculeusement et étonnamment réunis.
Est-il logique de combiner l'éthique de l'ordre, de la vertu, de la méritocratie et de la culture de l'inégalité naturelle de l'homme (au profit de l'homme et de la société) avec Marx ? C'est-à-dire combiner Confucius avec une praxis révolutionnaire visant à vaincre le capitalisme, avec le progrès techno-scientifique et le contrôle de l'usure. Dans la Chine d'aujourd'hui, c'est possible, et même nécessaire. Méritocratie, vertu, hiérarchie et pragmatisme, le tout au service d'un État impérial qui a surmonté la lutte des classes et promeut la prospérité socialiste à outrance.

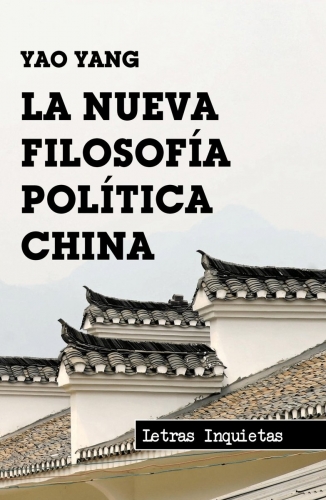
Ce livre de Yao Yang nous montre comment cette "synthèse" entre l'éthique confucéenne, fondatrice de la civilisation chinoise, et le socialisme marxiste-léniniste a été possible et essentielle. Le terme idéal serait certainement (pour paraphraser le regretté Guillaume Faye) : archéofuturisme. Les dirigeants communistes chinois ont su mener à bien une synthèse archéofuturiste. Le même genre de synthèse que, mutatis mutandis, les Européens devraient faire mais que, par lâcheté et colonisation américaine, ils sont totalement incapables de faire.
"L'archéo, l'ancien, oui, mais pas le vieux et le périclité, mais le classique et le fondateur. Ce qui nous relie aux racines, et celles-ci à la terre nourricière. Pour les Chinois, Confucius. Pour l'Europe, Aristote ou Saint Thomas. Et commun à tous les peuples: le respect et l'amour des traditions, des anciens, de l'identité. S'abreuver à leurs sources toujours limpides, les sources de la tradition, pour reprendre des forces et s'élancer vers de nouveaux horizons. Les sources du passé (le passé de chaque peuple) nous catapultent vers l'avenir.
Le "futurisme", le nouveau et l'avenir. Réveiller les identités ancestrales, ce qui n'est pas collectionner des momies dans des tombes sombres, mais susciter des modes d'éthique plus fondateurs que n'importe quel fragment d'ADN ou n'importe quelle mesure crânienne, plus efficaces que tous les discours doctrinaires et nostalgiques.
Les Chinois se sont occidentalisés au 20ème siècle. Ils le reconnaissent eux-mêmes, ils l'acceptent, ils ne le nient nullement. Qu'ils apprennent la leçon chinoise, typique des grands réalistes et pragmatiques, que ces indigénistes ridicules, dont beaucoup portent des noms de famille et des teints asturiens, montagnards et biscayens, prennent une leçon. Que les "réparateurs" noirs qui obligent leurs semblables à s'agenouiller devant eux à la moindre occasion prennent une leçon. Que les pleurnichards qui ne cessent de geindre et de dire "l'Espagne nous vole" prennent note. Les Chinois ont été occidentalisés sous la faucille et le marteau, le drapeau rouge et le livre - non moins rouge - de Mao. Les Chinois ont été occidentalisés par la dialectique hégélienne et les chiasmes tordus et alambiqués de Marx, des matérialistes et des "progressistes". Les révolutionnaires asiatiques ont apporté l'industrie, l'électricité, la science moderne, l'abolition des classes sociales et mille autres choses, toutes nées et conçues dans l'esprit des Européens. Ils se sont occidentalisés, mais n'ont semblé abjurer que momentanément leurs origines millénaires chinoises, totalement chinoises. Aujourd'hui, la puissance destinée à dépasser l'empire yankee est prête à s'abreuver à ses immenses sources indigènes. En d'autres termes, une leçon d'archéofuturisme.
Cette occidentalisation a-t-elle donné lieu à une réaction indigène, à un rejet de toute idéologie ou mentalité qui leur était étrangère ? Pas du tout. Le professeur Yao Yang, l'un des plus grands économistes et penseurs actuels de la puissance émergente, rallié à la "nouvelle gauche" chinoise autour de Xi Jinping, estime que la clé réside dans une sinisation du socialisme.
Marx sinisé - qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que l'on s'éloigne des approches doctrinaires. Il s'agit d'une sorte de mentalité pragmatique qui n'a rien à voir avec l'opportunisme ou le cynisme, comme la propagande sinophobe veut parfois le faire croire. Elle est liée à l'"archéo-éthique" propre à la Chine, si profondément enracinée dans le substrat collectif de cet immense peuple de milliards de citoyens. L'archéo-éthique confucéenne nous dit que les idées, en elles-mêmes, ne valent pas grand-chose si elles ne sont pas mises à l'épreuve de manière graduelle et mesurée. C'est l'archéo-éthique qui nous rappelle que les murs contre les barbares sont désormais construits grâce à la haute technologie et à la haute efficacité de chaque travailleur, soldat, entrepreneur ou fonctionnaire. Il s'agit de parvenir à une bonne répartition des richesses (rural-urbain, centre-périphérie, parti-populaire...) en supposant que la lutte des classes est aujourd'hui heureusement éteinte.
Les Chinois d'aujourd'hui sont eux-mêmes une leçon pour le monde. Ils ne financent pas de coups d'État ou de révolutions de couleur. Ils ne pensent qu'à faire de bonnes affaires entre eux. Contrairement aux transactions commerciales avec les Anglo-Américains, les Mahométans et les "partenaires" européens (c'est-à-dire les Francs et les Allemands), qui sont si minables, les transactions commerciales avec les Chinois ne sont pas toujours du type "l'un gagne, l'autre perd". Il s'agit souvent d'accords mutuellement avantageux. Pour l'un plus que pour l'autre, mais avantageux pour les deux parties dans de nombreux cas. Ils en savent déjà beaucoup à ce sujet en Afrique, en Amérique latine et ailleurs. Les Chinois négocient avec des dictateurs, et alors ? Ils ne jugent pas: si un peuple veut des dictateurs, c'est son choix. Un empire chinois n'est pas un empire anglo-saxon: supprimer des dictateurs et en installer d'autres, ce n'est pas de l'économie, c'est de la prédation et de l'ingérence. L'empire chinois, devenu un État socialiste de marché hautement technologique, est un empire civilisateur, pas un empire pirate. Son rôle géopolitique ne peut être que multipolaire et constructif: de nouvelles règles doivent être générées sur l'échiquier mondial. Celles-ci doivent inclure la non-ingérence dans les régimes et les traditions de chaque peuple.
Mais revenons à l'essai de Yao Yang. Le lecteur trouvera dans ces pages une auto-perception plus que curieuse de l'éthique fondatrice de la Chine. Une vision de son peuple, de son histoire et de sa projection dans l'avenir qui heurte de plein fouet la propagande raciste anglophone sur le civilisation chinoise. Cette propagande, si répandue dans le cinéma, présente les Chinois comme un peuple indolent, semi-civilisé, habitué à vivre sous le despotisme et, tendanciellement ou instinctivement, collectiviste. Selon les circonstances du moment, des traits similaires ont été utilisés pour qualifier les Hispaniques, les Russes, les Africains, etc., c'est-à-dire les peuples et les empires qui ont opposé une résistance à l'impérialisme anglo-saxon. Cela suffit à nous mettre sur nos gardes. Mais contre les clichés de la propagande anglo-yankee, contre la caricature du petit Chinois à nattes, servile mais rusé, robot indifférencié face à une masse égalitaire, captive des despotes, masse qui par son nombre représentait déjà le "péril jaune", notre auteur, Yao Yang, invoque un peuple individualiste (mais profondément enraciné dans la famille et la communauté locale). Un peuple raisonnable, pragmatique, éduqué à la vertu... La philosophie germanique, si puissante et profonde, est également tombée dans le piège des clichés "occidentaux": Nietzsche et Spengler, mais aussi notre Ortega (dans ce qu'il avait de germanique et d'"européiste") ont écrit des paragraphes lamentables sur les Chinois, qui nous ont éloignés de la vérité.


Le professeur Yang nous surprend avec un portrait du Chinois d'aujourd'hui, un véritable archéofuturiste, un type d'homme qui, au nom du progrès techno-scientifique que lui et son peuple sont les seuls à mener, se veut l'héritier de Confucius et le participant d'une "révolution" pacifique qui appelle à l'éducation et à la dignité matérielle de tous les hommes. Il réclame de nouvelles règles du jeu sur l'échiquier mondial, des règles qui bannissent définitivement la prédation anglo-saxonne. L'auteur nous surprend en parlant d'un Confucius qui était déjà, à l'époque axiale, au Vème siècle avant J.-C. !, un vrai libéral, un libéral plus libéral que l'esclavagiste et persécuteur des catholiques appelé Locke ! Si l'on entend par libéral celui qui revendique une éthique de la personne au service des autres par le biais du perfectionnement de soi, on commence à se comprendre...
Pendant que les universités de l'Occident collectif pourrissent et mijotent dans leur propre graillon (études de genre, pédagogie, mémoire historique et autres pseudo-sciences), les centres d'élite asiatiques lancent chaque année des millions de diplômés hautement qualifiés, comme les soldats d'une immense armée, des armées et des armées de cerveaux aptes à la transformation du monde.
L'Espagne prépare son autodestruction, qui passe par l'explosion de ce qui fut sa belle machine éducative de granit construite sous le régime franquiste, une machine éducative dont il ne reste plus rien. L'Espagne avait réussi à endiguer l'eau et à réserver les cerveaux pour les temps difficiles. Suite à l'avènement de la Constitution de 1978, les barrages qui contenaient l'idiotie ont été rompus et l'ont maintenue à distance. Aujourd'hui, l'idiotie nous submerge et nous étouffe. La Chine a pris la direction la plus opposée que nous puissions imaginer: la culture de l'excellence académique, professionnelle, de la fonction publique et techno-scientifique. Bien sûr, au lieu d'un tas de ferraille de partis politiques parasites et charognards, ils ont un Parti-Timonier. Le PCC dirige la nation et est lui-même une école de dirigeants.
L'essai récemment publié par les éditions Letras Inquietas, (La nouvelle philosophie politique chinoise de Yao Yang, https://www.letrasinquietas.com/la-nueva-filosofia-politica-china-de-yao-yang/) est une grande opportunité pour tous ceux d'entre nous qui aspirent à une certaine sinisation de l'Europe et de l'Espagne, aujourd'hui si exangues et misérables.
12:22 Publié dans Actualité, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : actualité, livre, chine, asie, affaires asiatiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 15 septembre 2023
Wang Hui : L'essor de l'économie chinoise

Wang Hui : L'essor de l'économie chinoise
(Letras Inquietas, Cenicero, Espagne, 2023)
Carlos X. Blanco
Le professeur Wang Hui (Yangzhou, 1959) est un spécialiste universitaire de la littérature chinoise et de l'histoire intellectuelle. Il est professeur à l'université Tsinghua de Pékin. Il a été professeur invité dans plusieurs universités étrangères et jouit d'un grand prestige en tant que principal représentant de ce que l'on appelle la "nouvelle gauche" en Chine.
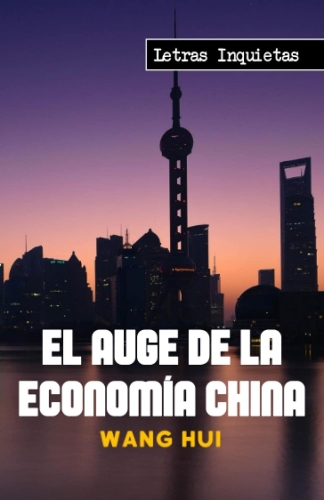
Il convient de clarifier la signification du terme "nouvelle gauche" dans le contexte du géant asiatique. Ce n'est pas une formule qui plaît à Wang Hui lui-même, pour diverses raisons. L'une d'entre elles, que je soulignerai ici, est qu'elle se confond avec les connotations occidentales qu'elle véhicule et qui ne coïncident pas avec les connotations chinoises. Nouvelle gauche signifie être contre le néolibéralisme, et implique également de ne pas être un marxiste-léniniste orthodoxe. La "vieille" gauche chinoise fait référence au régime communiste qui a dominé le pays sans partage pendant des décennies, et en particulier au maoïsme. Wang Hui n'a jamais été un représentant de la "vieille garde" : il aurait été lié aux célèbres manifestations de Tiananmen (1989), au cours desquelles une partie de la société chinoise a revendiqué la liberté et le changement. Libre, notre auteur a ensuite pris position contre le néolibéralisme rampant des années 1990, également en Chine.
Les années 1990 ont été une décennie au cours de laquelle le régime chinois a promu des mesures de libéralisation, des tendances capitalistes qui, de l'avis de plusieurs intellectuels chinois, signifiaient une réduction des droits et du niveau de vie des classes les plus défavorisées. A l'époque, se dire de "Nouvelle Gauche" signifiait donc se confronter à un gouvernement autoritaire qui, formellement communiste, faisait trop de concessions à un mode de production, le capitalisme, prédateur et contraire à l'idée d'égalité dans laquelle des millions de Chinois avaient été éduqués.
Avec le temps, Wang Hui et d'autres penseurs chinois de la nouvelle gauche se sont réconciliés avec les dirigeants de leur pays, observant que l'ouverture au marché impliquait, à tout moment, le contrôle par l'État des processus économiques capitalistes et un contrôle qui permettait de redistribuer et de distribuer la richesse entre les secteurs et les territoires, en augmentant constamment le niveau de productivité et de revenu. Ce contrôle de l'État (la politique soumettant l'économie, par l'intermédiaire du PCC, le parti communiste chinois) pourrait corriger les inévitables désalignements dans la transformation accélérée et drastique de la Chine :
a) désalignements entre les classes sociales (en particulier le peuple, d'une part, et les fonctionnaires et les nouveaux riches),
b) désalignements ou contradictions entre la ville et la campagne ;
c) désalignements entre le développement et l'ultra-modernisation du pays, d'une part, et la viabilité environnementale, d'autre part.
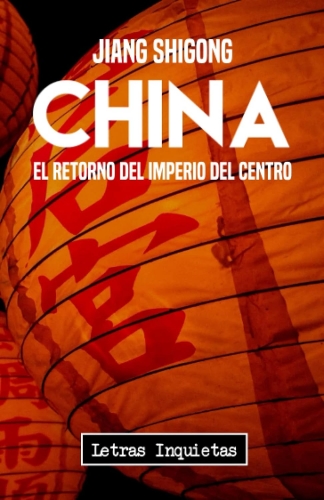
La Chine est en passe de devenir la grande puissance mondiale. La nouvelle gauche, menée par des personnalités telles que Jiang Shigong (dont le livre China. El retorno del imperio del centro a également été publié par Letras Inquietas) et Wang Hui lui-même, semble soutenir aujourd'hui le modèle de Xi Jinping, un modèle qui fera date: au lieu de l'impérialisme militariste et prédateur dont fait preuve l'anglosphère, c'est l'internationalisme qui est proposé, c'est-à-dire l'idéal des relations de solidarité qu'un pays socialiste devrait entretenir avec le reste des peuples du monde. Il s'agit d'un développement du Sud global (anciennement appelé "Tiers Monde") réalisé en termes d'investissements et de crédits bienveillants, où l'Empire du Centre (la Chine) en bénéficie, bien sûr, mais où, également, les pays en développement entrent en relation amicale avec ce nouveau Centre et peuvent atteindre des normes plus élevées en matière de santé, d'éducation, de finance, d'industrie, etc.
Les principaux intellectuels d'une nation-état-continent (la R.P. de Chine) appelée à devenir le moteur et le leader de la planète, une fois neutralisée la folie prédatrice de l'empire américain, sont des personnes qui ont une voix propre et un message digne d'être reçu par nous. Nous devons savoir d'où ils viennent, quelles sont leurs propositions, quelles sont les questions intérieures et internationales qui les préoccupent. Nous devons surtout nous intéresser à leur combinaison d'une vision impériale (mais non impérialiste) et d'une philosophie plus solidaire et égalitaire, en accord avec leur approche du "socialisme aux caractéristiques chinoises". Cette vision est comme un filet de lumière qui éclaire un avenir qui, sans les Chinois, est celui des nuages d'orage propagés par le Pentagone et son laquais Borrell. L'avenir peint par la folie américaine ne peut être plus noir, mais il y a d'autres pôles en devenir et d'autres modèles de relations internationales.
Chine : il y a toujours tant à apprendre de la Chine...
https://latribunadelpaisvasco.com/art/18612/el-auge-de-la...
20:26 Publié dans Actualité, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, chine, asie, affaires asiatiques, livre |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 01 septembre 2023
Zend-Avesta de Gustav Theodor Fechner: réflexions de Giovanni Sessa
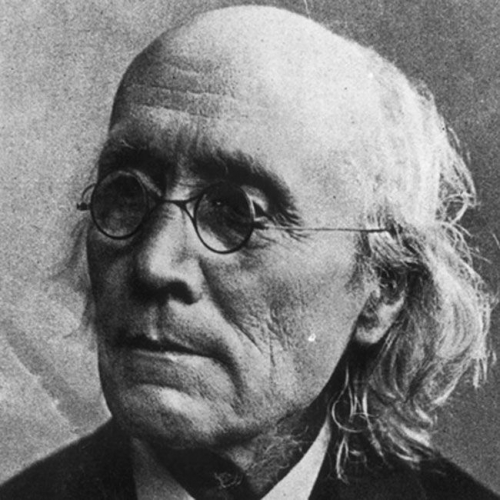
Zend-Avesta de Gustav Theodor Fechner: réflexions de Giovanni Sessa
Source: https://www.paginefilosofali.it/zend-avesta-di-gustav-theodor-fechner-riflessioni-di-giovanni-sessa/
Avis aux lecteurs ! Le livre Zend-Avesta. Pensieri sulle cose del cielo e dell'al di là de Gustav Theodor Fechner est un texte au caractère résolument désuet : de ses pages, en effet, on peut déduire une vision du monde, de la nature et de la vie humaine, totalement étrangère aux conceptions actuelles, tant religieuses que séculières. Dans ce volume, les thèses panpsychistes et panthéistes réapparaissent, soutenues par un cadre théorique remarquable.
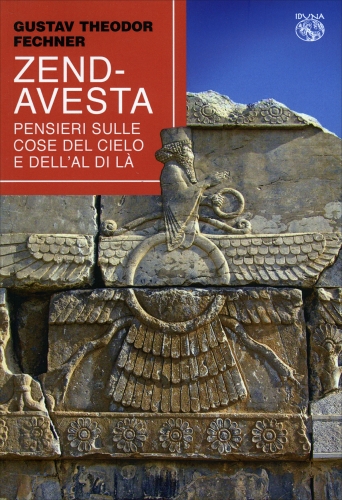
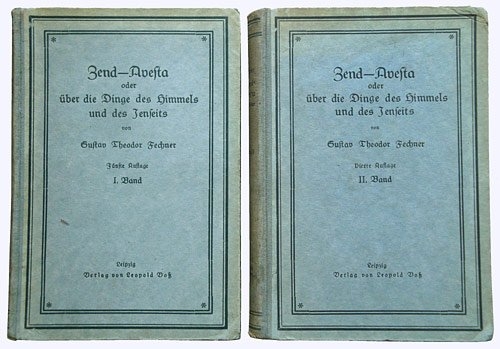
Les éditions Oaks reproposent ce livre dans la version italienne traduite et introduite par Remo Fedi, qui était parue en 1944. Compte tenu des idées en vigueur aujourd'hui au sujet de la nature et, surtout, de l'éloignement de l'idée de la mort hors du champ de la vie quotidienne dans les sociétés dominées par la techno-science, un livre comme le Zend-Avesta peut être lu comme une véritable provocation et conduire à un scandale intellectuel. Nous espérons sincèrement que cela se produira. En effet, nous avons grand besoin de remettre en question les fausses certitudes sur lesquelles notre monde s'est construit. Dans la société liquide ou hyperindustrielle, dominée par les appareils de gouvernance et de technologie, l'idée de la limite et de la fugacité de la vie, ainsi que la prise en compte du memento mori, ont été remplacées par un salutisme sanitaire qui, dans le sillage de la pandémie du Cov id 19, a pris des allures liberticides et paroissiales. Prolonger la vie, d'abord ! Tel est l'impératif actuel des sociétés capitalistes avancées.
Une guerre déclarée à la vieillesse est en cours, qui passe par le recours aux expédients thérapeutiques les plus divers, y compris la chirurgie plastique. C'est le mantra dominant d'une actualité privée de profondeur et de symbolique. Pour ces raisons, le livre de Fechner peut s'élever au rang de pierre jetée dans les eaux stagnantes de la culture hégémonique de notre temps. L'auteur, en effet, est porteur de la conception de l'animation universelle du cosmos, il affirme que tout vit, tout est animé, même le monde minéral est traversé de l'intérieur par le mouvement animique. De plus, il affronte le caractère problématique de la mort, en tentant (pas moins !) de décrire la vie dans l'au-delà, selon des canons bien différents de ceux de la religion devenue dominante en Occident [...]. Le lecteur doit également savoir que cette version du Zend-Avesta est une traduction du syllogue, édité en Allemagne par Max Fischer, que ce savant a repris des trois volumes de Fechner.
Dans la préface du Zend-Avesta, Fedi dit de ce livre : "Un hymne à la vie [...] écrit avec une profonde sincérité, sans se laisser égarer par les courants de pensée en vogue au moment de sa parution [...] et exprimant le vif désir de l'auteur de surmonter les grands [...] obstacles qui se dressent devant ceux qui entreprennent de briser [...] le voile épais qui sépare l'au-delà de l'ici-bas". Le lecteur ne doit pas s'y tromper : le choix de ce titre ne fait pas référence au livre sacré du zoroastrisme, mais au sens littéral de cette expression, "parole vivante ou parole de vie". Les qualités de l'homme Fechner ressortent de ces pages : amabilité, sincérité avant tout, mais aussi naïveté intellectuelle non dissimulée. Le volume est divisé en deux parties. Dans la première, le philosophe présente et discute la doctrine panpsychiste; dans la seconde, avec un trait mystique, mais accompagné d'une rationalité non superficielle, il affronte le thème insolite de la vie dans l'au-delà, sur la base des conclusions auxquelles il est parvenu dans la première partie de l'ouvrage.
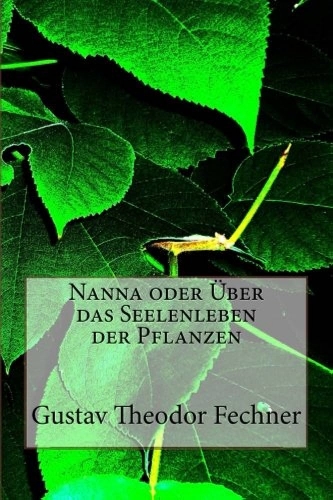
Nous sommes entièrement d'accord avec Fedi. Cette œuvre représente un moment important dans la résurgence de la philosophia perennis dans la pensée moderne. Fechner y remet en question l'analogie, qui a toujours été un instrument de connaissance dans la pensée de la Tradition, en tant que médium entre l'afflux mystique et la recherche rationnelle. Tout est Un: d'une telle affirmation, le penseur tire la complémentarité de la physique et de la psychologie, l'unité de l'âme et du corps. De plus, selon le savant: "La terre est un organisme vivant, animé comme celui des hommes, bien que l'animation du premier soit d'un ordre plus élevé que celle des seconds". Les hommes, en effet, dans une telle conception, ne sont que les organes de la sensibilité de la terre. Cela conduit, par conséquent, à considérer même les corps célestes comme des entités animées: "Cela revient à dire que la conscience humaine est un échelon sur l'échelle de la conscience divine". Il s'ensuit que le cosmos animé de Fechner se révèle être un organisme animé et hiérarchisé dans lequel l'inférieur participe au supérieur. Cette vision, dont le scientifique naïf était bien conscient, sera sévèrement critiquée et rejetée par les vestales du savoir hégémonique (positiviste) de l'Europe du milieu du 19ème siècle. Malgré cela, il est certain que "sa vision [...] laissera derrière elle un sillon de pensée que ses adversaires devront également prendre en compte". Dans la deuxième partie, Fechner tente de présenter le monde de l'au-delà à la lumière de la clairvoyance qu'il croyait partager avec Swedenborg. Puisque dans la vie nous ne sommes que des sensations de l'esprit de la terre, "nous survivons en tant que "souvenirs" dans le même esprit".
Il s'agit donc d'un post-mortem mnémotechnique. N'oublions pas à cet égard que, pour Notre Seigneur, l'esprit et la matière sont donnés en un seul. Tout est esprit mais, dans le monde des phénomènes "une partie de l'être [...] remplit une fonction instrumentale par rapport à l'autre". Fedi, avec une argumentation pertinente, note comment chez Fechner il est possible de saisir une anticipation de la conception de la matière comme fonction de l'énergie [...]. Le penseur commence par constater un fait incontestable: la science moderne, analytique et cloisonnante, a perdu de vue l'ensemble de la nature et, qui plus est, a expulsé le Principe des investigations naturalistes. Il constate également que cette attitude paraît tout à fait légitime au sens commun sans pour autant l'être. A cet état de fait, conclut Fechner, on ne peut répondre qu'en suscitant le doute, en indiquant d'autres voies d'investigation possibles. En ce qui concerne l'âme, nous ne pouvons connaître que la partie qui nous appartient individuellement. En revanche, aborder l'anima mundi, conditio sine qua non, c'est revenir sur la médiation que représente l'âme de la Terre. Le philosophe propose au lecteur de constater que tout est en mouvement sur Terre et que les mouvements individuels des entités sont le produit de l'énergie de l'ensemble.
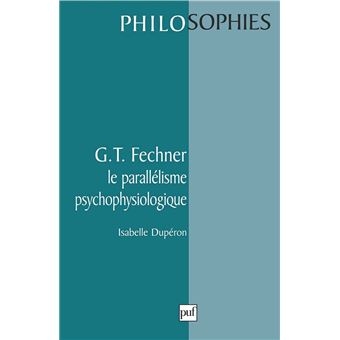
La motilité des entités nous indique que tout est vivant, orienté vers la métamorphose. L'approche analytique et moderne ne saisit qu'une partie de la vérité de la nature. Les premiers hommes, comme le note Vico, "sentaient" la nature et savaient : "que leur sang coulait sous l'influence de l'âme ; que leur respiration dépendait d'un quid animé". Le corps de la nature, disséqué en ses parties et examiné par les sciences dont la mission est d'étudier ce secteur donné de la réalité, est réduit au caractère statique du cadavre: "La principale erreur de cette manière de voir consiste à opposer [...] le domaine de l'organique à celui de l'inorganique". Au contraire, il faut savoir que: les hommes et les animaux sont [...] les membres de la Terre, dans laquelle se trouve la plus haute énergie de mélange et d'intégration de tous les matériaux terrestres et de leurs relations". Si les hommes, les animaux et les plantes pouvaient être retirés de la Terre, celle-ci prendrait l'aspect d'un tronc mort. La Terre et les êtres vivants sont étroitement liés, ils vont de pair: tout est dans tout.
La Terre pense donc ! Elle pense à travers les âmes qui l'habitent et nous, par une contrepartie supérieure à l'expérience sensible, provenant de l'esprit universel, nous ajoutons une ultériorité cognitive à chaque perception. L'homme collabore ainsi avec l'anima mundi à la croissance de la conscience mutuelle. L'intérêt et la volonté des hommes individuels se heurtent à la volonté de la "conscience de la terre". Toutes les entités sont liées à la terre par des relations de sympathie. Nous avons connaissance de l'âme par le corps et "de l'esprit divin [...] par ce qui se passe matériellement dans le monde". Tout nous est transmis et nous le comprenons par la lumière et le son: du Principe on ne peut dire "sinon qu'il est caractérisé par la capacité d'apparaître d'une double manière, c'est-à-dire comme une entité spirituelle quand il apparaît à lui-même et comme une entité corporelle quand il apparaît à un autre". Dieu et le monde sont une seule et même chose. L'universel ne vit que dans la particularité des entités: "C'est la vision panthéiste du monde. Notre vision est également panthéiste". Par conséquent: "La partie de l'entité divine que nous avons en commun avec Dieu, nous la saisissons comme esprit; tout ce qui reste nous apparaît corporellement, matériellement comme nature, comme monde. Il s'agit d'une philosophie du souvenir, capable de re-présenter un héritage sapientiel très ancien mais, en même temps, capable de nous parler en termes de philosophie future. C'est pourquoi ceux qui s'intéressent à l'élaboration d'une culture du "Nouveau Départ" trouveront chez Fechner des stimuli et des suggestions d'une grande pertinence.
[...] Dans ces pages, le philosophe affirme que la mort est un voyage, l'aboutissement d'un chemin inachevé. En elle, la vie s'élargit à une intensité supérieure à celle vécue avant de disparaître. La conscience associée à la sensibilité, entendue en termes néo-platoniciens et eckhartiens par Fechner, permet au penseur allemand de dépasser l'idée moderne de subjectivité et correspond à un besoin particulièrement ressenti à l'époque romantique. Dans le panpsychisme cosmique de Fechner, tout est interconnecté et donc rien de ce qui nous appartient n'est perdu : "ce que nous pensons ou ressentons [...] reste tissé dans la trame de l'existence individuelle et de la dynamique de la Terre dans son ensemble, selon des modalités [...] que nous comprendrons dans l'au-delà". Plus précisément, au moment de la mort, "l'homme prend soudain conscience de tout ce qui [...] continue d'agir et de vivre", révélant la force qui lie, dans la solidarité communautaire, les vivants aux défunts, le pouvoir de la tradition. Ceux-ci peuvent, comme en témoignent d'anciens rituels, avant tout romains, "sentir" et "rencontrer" autour du mundus également l'adventice, l'avenir.
[...] La nature enseigne que le permanent est toujours dans l'éphémère, l'un dans le multiple, l'Acte pur indique un divin qui vit en toutes choses: "Ce n'est pas un divin que nous aurions la tâche de chercher au-delà de la nature".
Héraclite, plus que tout autre, a montré la relation entre les opposés. Polemos et harmonie, chez lui et pour les Grecs, "renvoient à une seule et même réalité", au-delà de tout dualisme. C'est pourquoi revenir à l'animation de la nature avec Fechner est, selon l'écrivain, la seule façon de sortir de l'impasse spéculative et existentielle qui caractérise notre époque [...].
(extrait de la préface de Giovanni Sessa au volume de Gustav Theodor Fechner, Zend Avesta. Pensieri sulle cose del cielo e dell'al di là, Iduna editrice, pp. 262, euro 20.00).
18:38 Publié dans Livre, Livre, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : zend-avesta, gustav theodor fechner, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 28 août 2023
La relation Europe-Orient vue par le philosophe Schubart
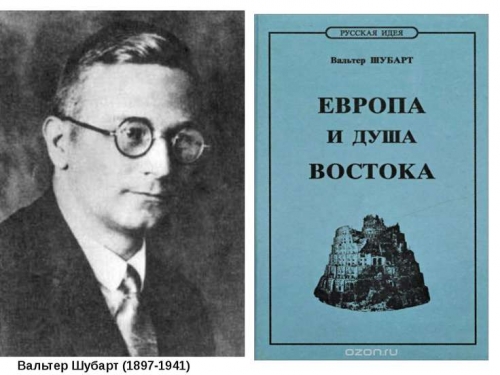
La relation Europe-Orient vue par le philosophe Schubart
La lecture du livre "L'Europe et l'âme de l'Orient" a marqué un lecteur exceptionnel, Ernst Jünger.
par Giovanni Sessa
Source: https://www.barbadillo.it/110840-il-rapporto-europa-oriente-visto-dal-filosofo-schubart/
Un livre important est désormais en librairie grâce aux éditions Oaks. Il s'agit de l'essai du philosophe allemand Walter Schubart, L'Europe et l'âme de l'Orient, qui a vu le jour en 1938 (sur commande: info@oakseditrice.it, pp. 399, euro 28,00). Schubart était un éminent spécialiste du "continent russe" et a su capter la profondeur de l'âme de la "mère Russie" dans ses écrits. Avec la prise du pouvoir par Hitler, il a quitté sa patrie en 1933 et, avec sa femme d'origine juive, s'est réfugié à Riga où, en 1942, après avoir été arrêté et déporté par les Soviétiques, il a trouvé la mort dans un goulag soviétique au Kazakhstan. Inutile de souligner que le thème abordé dans les pages de ce volume est d'une grande actualité: les relations entre l'Ouest et l'Est, entre l'Europe et la Russie. Le développement argumentatif de l'essai repose, d'une part, sur la prose narrative de l'écrivain, apte à captiver le lecteur, et, d'autre part, sur le caractère prophétique de ses pages. À la fin des années 1930, la situation spirituelle et géopolitique du monde présentait, selon Schubart, les caractéristiques suivantes : "Ce qui [...] s'approche, c'est la lutte de deux mondes, la composition finale entre l'Occident et l'Orient et la naissance d'une culture occidentalo-orientale à travers l'homme johannique, en tant que représentant d'un nouvel âge" (p. 5).
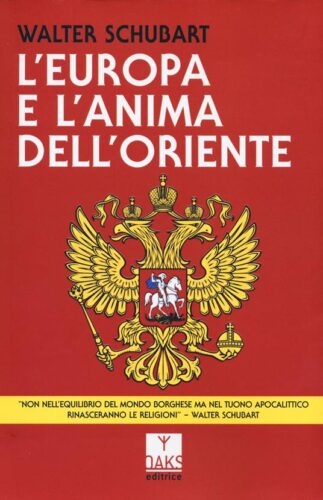
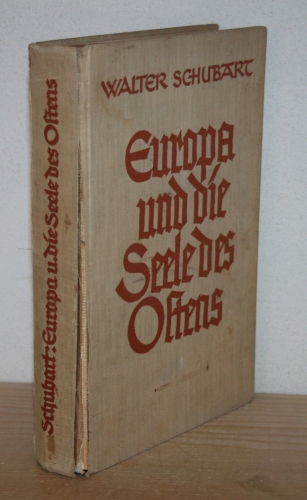
Avec le recul, il semble facile d'affirmer que la prémisse de cette affirmation était certainement vraie, alors que la conclusion entrevue par le penseur n'a pas été réalisée. La référence à l'homme johannique et à la régénération du monde dans une nouvelle ère montre clairement que le cadre herméneutique de l'auteur est certainement apocalyptique, puisque l'apocalyptique est l'animus russe. En Italie, des positions similaires se sont manifestées dans le catholicisme johannique et universaliste de Silvano Panunzio.
La lecture de l'ouvrage a beaucoup impressionné un lecteur exceptionnel, Ernst Jünger. Ce dernier, dans son livre Le Nœud gordien, a posé l'Orient et l'Occident comme des archétypes, des mythes éternels à travers la leçon de Schubart. Cela dit, le lecteur doit savoir que le philosophe déclare explicitement qu'il reprend la conception éonico-cyclique de l'histoire, articulée autour de quatre âges, chacun centré sur un type humain spécifique: l'homme harmonieux, héroïque, ascétique et messianique. À la fin des années 1930, le monde se trouverait dans une phase de transition, entre le monde ascétique et le monde messianique. Une époque de mutations et d'attentes naissantes, où l'on peut déceler la crise du monde bourgeois-industriel, mais où il est difficile de saisir les traits salutaires de l'ère nouvelle : "Nous vivons une époque de transition [...] elle est pleine de mélancolie, mais aussi d'espérance" (p. 15).
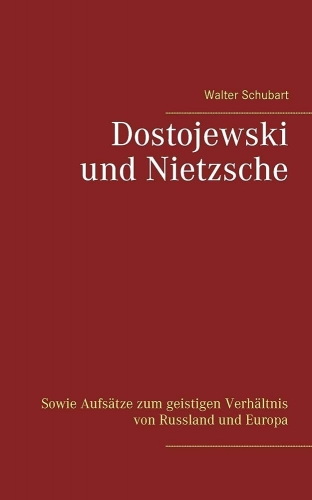
Au cours du dernier millénaire, l'Europe, rappelle l'auteur, a connu deux époques: la gothique et la prométhéenne. La première, qui se développe entre le 11ème et le 16ème siècle, incarne le prototype de l'homme harmonieux, parfaitement réconcilié avec le surnaturel et dont la vie a pour but la paix accordée par la Grâce. Entre 1450 et 1550, le passage au monde prométhéen s'opère, notamment avec la Réforme: "L'homme nouveau tourne son regard vers la terre, vers les lointains, vers le globe, et non plus vers les hauteurs infinies" (p. 16). L'homme nouveau veut posséder le monde, sa nature est la volonté de puissance, c'est un Titan qui s'est rebellé contre l'ordre divin des choses. L'ère prométhéenne du 20ème siècle touche à sa fin: "l'ère johannique est annoncée, dans laquelle le prototype messianique façonnera l'homme" (p. 16).
Schubart est convaincu que l'esprit du paysage est une constante de l'histoire, que le genius loci agit sur le sentiment animique des hommes. Les Russes ont été forgés par les plaines sans limites, dans lesquelles l'éternel les regarde majestueusement, les détachant de leur attachement au fini, à la terre comprise en termes de simple matérialité. La force du paysage agit dans l'histoire, tandis que les forces du sang, les forces purement biologiques sont soumises au vieillissement. Contrairement à la culture nationale socialiste: "Le sang et la terre désignent des éléments différents, qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre sur le plan conceptuel" (p. 20). Dans l'ère johannique, l'autre monde reviendra s'affirmer, c'est pourquoi un rôle de premier plan, selon le penseur, sera joué par les Russes, peuple métaphysique: "Le grand événement qui se prépare est l'accession du slavisme au pouvoir déterminant de la culture" (p. 27). Le problème des relations Est-Ouest n'est pas un problème historico-politique, il est de nature spirituelle et philosophique.
Revenant à cette espérance messianique, le message goethéen-leibnizien concernant l'avènement d'une future grande civilisation occidentalo-orientale. L'Europe pourra se retrouver elle-même, sa grandeur homérique et médiévale, à travers le choc avec la Russie. L'homme grec est pour l'Allemand la première apparition de l'homme harmonieux, alors que Rome et sa civilisation juridique annoncent l'ère prométhéenne. L'Occident "a donné à l'humanité les formes les plus perfectionnées de la technique, de l'État [...] mais il lui a volé son âme. C'est à la Russie qu'il incombe de la restituer à l'humanité. La Russie possède précisément les forces que l'Europe a perdues et détruites" (p. 41). En effet, les Russes possèdent "l'idée nationale la plus profonde et la plus universelle: la rédemption de l'humanité [...]. L'idée de la rédemption du monde est l'expression du sentiment de fraternité, de l'humanitarisme universel au niveau de la politique internationale" (p. 248). Schubart, en reconstituant les étapes historico-idéales de la formation de l'idée nationale russe, en confrontant les principaux représentants de la slavophilie et de l'eurasianisme, s'attarde sur Dostoïevski. Ses personnages témoignent, par leurs conflits intérieurs, de la lutte entre les valeurs prométhéennes de l'Occident, qui ont fait irruption dans le pays oriental avec Pierre Ier, et l'âme originelle.
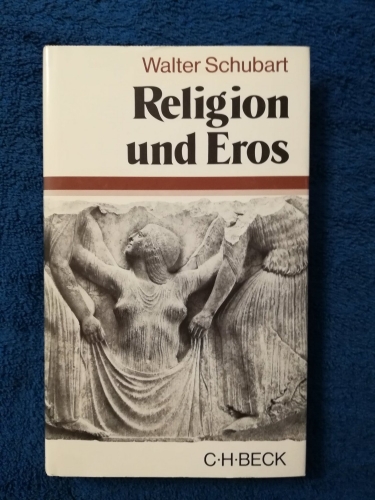
Dans Crime et Châtiment, l'issue du récit est un réquisitoire contre l'exaltation de la personnalité libre et forte affirmée en Occident avec la ligne spéculative Machiavel-Nietzsche, tandis que dans Démons, c'est l'État-Moloch qui montre ses limites. Le salut vient de la reconnaissance des limites humaines, il mûrit à travers un repentir intensément vécu. C'est ainsi que l'homme se rachète. Le salut du peuple russe est centré sur la récupération de la transcendance et de la tradition. Le bolchevisme lui-même a paradoxalement contribué, malgré l'athéisme d'État, à protéger la "Mère Russie" de la dissolution dans les eaux usées de la société post-moderne. La redécouverte stalinienne de l'idée nationale et de sa primauté le confirmera.
Dans le même ensemble historique, la crise de la culture prométhéenne et les signes de renaissance spirituelle en Occident ont convaincu Schubart de la proximité de la rencontre, sous le signe apocalyptique de Jean, de l'Europe et de la Russie. Il nous semble que les choses se sont passées et se passent autrement. La théologie johannique de l'histoire, qui soutient les thèses de Schubart, n'est pas proprement européenne. Seul un retour à la physis grecque peut ramener les Européens à leurs origines.
20:41 Publié dans Livre, Livre, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : orient, occident, europe, russie, walter schubart, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 23 août 2023
Les "icônes du possible", un retour à la pensée fondée sur la nature

Les "icônes du possible", un retour à la pensée fondée sur la nature
L'essai de Giovani Sessa sur le jardin, la forêt et la montagne révèle trois lieux archétypaux qui, expérimentés avec ouverture et dévouement, peuvent réactiver le sens perdu de la physis.
par Gabriele Sabetta
Source: https://www.barbadillo.it/110776-icone-del-possibile-come-ritorno-al-pensiero-basato-sulla-natura/
Giovanni Sessa (Milan, 1957) a enseigné la philosophie dans des lycées et a donné des cours dans plusieurs universités italiennes. Il est secrétaire de la Fondation Julius Evola. Il a consacré au philosophe et ésotériste romain une étude intitulée "Julius Evola et l'utopie de la tradition" (Oaks Editrice, 2019). Un autre essai important, sur la philosophie d'Andrea Emo, a été publié par notre auteur sous le titre 'La meraviglia del nulla' (Bietti, 2014). Un autre ouvrage pertinent pour comprendre son parcours intellectuel est "L'écho de l'Allemagne secrète" (Oaks Editrice, 2021). C'est de cette dernière étude que provient l'essai dont il est question ici, récemment publié par Oaks, intitulé "Icônes du possible. Jardin, forêt, montagne", préfacé par Massimo Donà et introduit par Romano Gasparotti (tous deux professeurs à l'Université Vita-Salute San Raffale de Milan avec lesquels le professeur Sessa est en profond accord depuis des années).
Penser à partir de la nature
La vision qui anime "Icônes du possible" consiste en un retour sur la scène philosophique du lógos physikós, la pensée fondée sur la nature - une réémergence puissante du sentiment des philosophes auroraux de la Grèce archaïque, qui, avant que Platon et Aristote ne sèment les graines de la décadence métaphysique, avaient conservé un contact direct et dialoguant avec la nature (entendue, précisément, comme physis). La nature en tant que vie palpitante, force qui pousse au changement, tentative éternelle - toujours inachevée - de donner une forme achevée à un principe éternel qui est au-delà des formes (tout en vivant dans chacune d'elles), force qui est la seule transcendance. Dans ce contexte, la nature n'est pas abordée comme un fonds exploitable de manière illimitée, remis à l'homme par le dieu de la Bible pour qu'il l'utilise à ses propres fins terrestres. D'où la nature comme objet, comme res extensa, désanimée, simple théâtre de l'action humaine - une vision que l'homme moderne ne rejettera pas ; au contraire, il parviendra à un physiocide complet, à un oubli total du sens originel de la physis, au-delà des formes qui apparaissent. Mais même si nous agissons continuellement sur elle, le plus souvent en la violant, nous n'avons en fait aucun pouvoir réel.
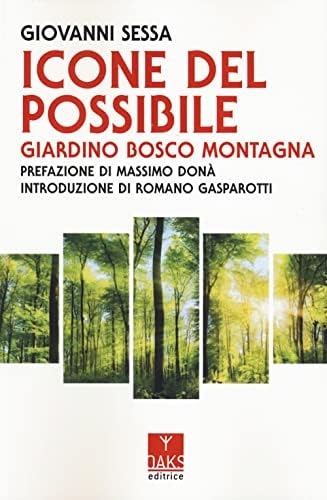

Dans le jardin, la forêt et la montagne, notre auteur, également par expérience personnelle, trouve trois lieux archétypaux qui, expérimentés avec ouverture et dévouement, peuvent réactiver le sens perdu de la physis.
Pouvoir destructeur et créateur à la fois - créateur "comme" destructeur et vice versa ; synthèse de la matière et de l'esprit, du ciel et de la terre, du chaos et de la forme, une pensée vertigineuse de l'unité qui, au cours des siècles, a eu des interprètes notables, ponctuellement mis en évidence dans le volume. L'un d'entre eux est Johann Wolfgang von Goethe. Il a su insuffler, en véritable homme "intégral", dans toutes ses activités - poète, romancier, scientifique, homme d'État - l'idée originelle de la nature, qui nous enveloppe et nous imprègne d'elle-même - nous qui sommes incapables de la quitter, mais aussi de la pénétrer plus profondément. Elle nous saisit continuellement dans le tourbillon de sa danse, nous poussant au changement ; mais nous, endormis dans nos formes ordinaires, nous nous laissons passivement submerger par ce processus, jusqu'à ce que peut-être un jour, lassés de notre condition servile et saisis d'un courage renouvelé, nous relâchions dans ses bras notre ego illusoire.
Il nous repropose sans cesse l'original sous des formes toujours nouvelles, éternel retour du principe de liberté qui nous parle sous toutes les coutures, sans jamais trahir son secret (et comment le pourrait-il ?). L'homme est d'abord plongé dans les ténèbres, cloué à la terre, mais il est ensuite continuellement poussé à gagner dans la lumière, à travers des entreprises toujours nouvelles. Éternel devenir, mouvement perpétuel, la nature semble pourtant ne pas avancer : chaque printemps est à la fois identique et différent des autres. Ses créatures, nées du néant, ne savent ni d'où elles viennent, ni où elles vont.

Retrouver les racines
Il revient donc à des philosophes comme Giovanni Sessa de ramener l'homme à ses racines, en réaffirmant la puissance du lógos physikós contre la logique immobilisante de la pensée métaphysique, qui place la vérité "ailleurs" et tend à fixer les entités, à les éloigner et à les différencier, en se fondant sur le principe d'identité et de non-contradiction. Selon cette approche, les entités sont donc réduites à ce qu'elles sont, à ce qui apparaît phénoménalement ; elles sont vécues comme une présence rigide et glacée, elles sont placées devant nous pour être utilisées et manipulées, sur le plan cognitif et pratique. Dans cette perspective, il est totalement exclu que les entités puissent également être ce qu'elles ne se montrent PAS, et que l'occulte et le voilé puissent avoir autant de valeur que ce qui est manifesté (si ce n'est plus).
Fixer l'attention sur l'entité en supprimant le sens de l'être était également la thèse de base de la philosophie occidentale qui a initié la réflexion de Martin Heidegger à partir de "L'Être et le temps"; une réflexion qui s'est ensuite poursuivie en se concentrant sur la question de la technologie moderne, qui a définitivement imposé à la planète un contact purement mécanique et homologué avec l'entité.
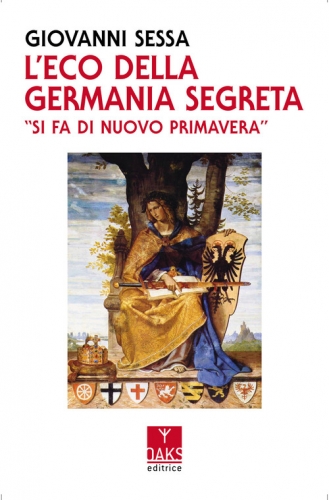
L'homme moderne conçoit les entités comme "réelles" et réduit le monde à un ensemble de choses indépendantes. Le processus cognitif commence lorsque ces choses se présentent à la conscience du sujet qui les observe et les représente. Cette façon de voir l'essence de l'entité, bien que valable pour la science moderne, ne peut comprimer les multiples façons dont les entités "se donnent". La "réalité", la présence stable, n'est qu'"un mode d'être" parmi d'autres. Cette réalité doit maintenant redevenir fluide : obéir à l'impulsion de la physis, témoigner de notre appartenance à celle-ci, donner une forme toujours plus accomplie et lumineuse à notre être ; dépasser la forme (méta-morphose), imprimer au devenir une forme supérieure, dans laquelle le mystère éternel de la physis transparaît et resplendit.
Le livre de Giovanni Sessa se veut une invitation à repenser le contact avec l'autre, à sortir de l'engourdissement ordinaire, à participer à l'appel de la physis de manière directe et initiale, en se libérant de l'uniformité et du mécanisme que la société de masse impose brutalement.
Gabriele Sabetta
19:16 Publié dans Livre, Livre, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nature, philosophie, giovanni sessa, livre |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 18 août 2023
Métapolitique, Silvano Panunzio et critique organique de la modernité

Métapolitique, Silvano Panunzio et critique organique de la modernité
par Giovanni Sessa
Source: https://www.barbadillo.it/110645-la-metapolitica-silvano-panunzio-e-una-critica-organica-della-modernita/
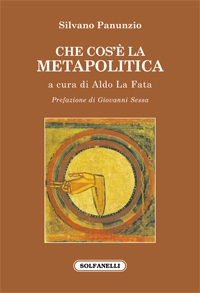 Nous publions un extrait de la préface de Giovanni Sessa, Metapolitica. Escatologia religiosa e civile in Silvano Panunzio, au volume de Silvano Panunzio, Che cos'è la Metapolitica, édité par Aldo la Fata, Solfanelli, Chieti 2023, pp. 208, euro 15.
Nous publions un extrait de la préface de Giovanni Sessa, Metapolitica. Escatologia religiosa e civile in Silvano Panunzio, au volume de Silvano Panunzio, Che cos'è la Metapolitica, édité par Aldo la Fata, Solfanelli, Chieti 2023, pp. 208, euro 15.
Fondamentalement, la métapolitique est une discipline qui précède et dépasse la politique. Depuis l'Allemagne et l'Europe centrale, un écho de ces positions est parvenu à De Maistre, qui les a interprétées comme une "métaphysique de la politique". Selon Panunzio, le sens du terme a circulé dans les œuvres de nombreux auteurs au cours des siècles: d'Augustin à Gioberti, de Berdiaev à Sturzo. Ceux qui ont compris correctement le contenu de la métapolitique étaient toutefois conscients qu'elle n'avait pas, sic et simpliciter, un caractère religieux, mais aussi une valeur civile.
Fondamentalement, la métapolitique est une discipline qui précède et dépasse la politique. Depuis l'Allemagne et l'Europe centrale, un écho de ces positions est parvenu à De Maistre, qui les a interprétées comme la "métaphysique de la politique". Selon Panunzio, le sens du terme a circulé dans les œuvres de nombreux auteurs au cours des siècles : d'Augustin à Gioberti, de Berdiaev à Sturzo. Ceux qui comprenaient correctement le contenu de la métapolitique étaient toutefois conscients qu'elle n'avait pas, sic et simpliciter, un caractère religieux, mais aussi une valeur civile.
C'est ce qu'avait compris Platon, véritable initiateur de cette discipline. L'Athénien, animé d'une vision métaphysique, pensait la réalité humaine comme articulée de bas en haut. C'est pourquoi il considérait que la dimension politique elle-même était anagogiquement transcendée. Comme l'a reconnu Werner Jaeger, il manquait à Platon "le ferment prophétique du christianisme". La Cité platonicienne d'Augustin est donc devenue le miroir de la Cité de Dieu : "Métaphysique et métapolitique sont [...] des jumelles".

Silvano Panunzio
La métapolitique vise l'archétype de la transcendance reflétée dans l'histoire, c'est la métaphysique en action. Panunzio la définit de manière lapidaire: "c'est le projet architectural que, avec la conception et la collaboration du Ciel, les hommes s'efforcent d'accomplir sur Terre en surmontant les résistances inférieures". L'idéal augustinien a été ravivé par l'eschatologie chrétienne, qui a trouvé un écho chez Campanella et, plus tard, chez Bossuet et Soloviev.
Panunzio, dans Qu'est-ce que la métapolitique, aborde le thème du bìos theoretikòs, qui, dans le monde antique, a été remis en question par Dicéarque avec la revalorisation de la phrònesis. Dans le monde romain, entre autres, Cicéron était proche de cette position, qui comprenait le philosopher comme un service : "pour une organisation active de la vie", tentant de rapprocher Platon de Lycurgue, au nom de la primauté du bìos politikòs. Pour Panunzio, l'authentique Metapolitica, au contraire, ne peut être saisie que dans la dimension prophétique capable, selon lui, de réaliser le "bìos sìnthetos qui n'est pas [...] un maigre compromis, mais une fusion originale [...] de sophia et de phrònesis [...] dans le nouveau génie de l'Homme universel". Cette affirmation précise que la vision du monde de Panunzio est éminemment une théologie de l'histoire.
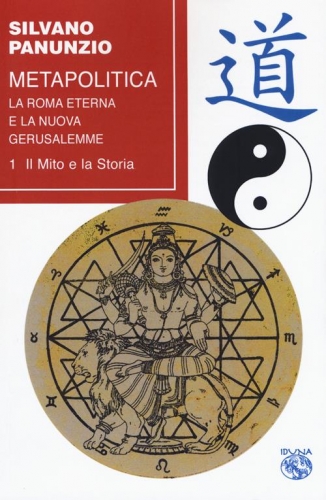
À ce stade, il convient de se demander quelle est la véritable fonction de la métapolitique selon Panunzio.
Il attribue deux tâches essentielles à la métapolitique. 1) Développer la critique de la modernité en termes organiques et analytiques ; 2) Reconstruire le plan divin sur la terre. Les hommes doivent d'abord reconnaître la nécessité de faire tabula rasa du présent, en vue d'une renaissance. En effet, Panunzio est fermement convaincu que ce sont les agents "de la main gauche de Dieu", les forces qui ont produit la lacération moderne, qui la feront imploser. (...) La vision de l'histoire de Panunzio vise une fin, elle est centrée sur un "optimisme final, mais transcendant".
Dans sa perspective, Dieu tolère les "démons", seulement en vue de leur action inconsciente, en vue de la catharsis finale. La structuration du parcours historique est centrée sur l'intersection de trois plans différents: terrestre, céleste et infernal. Les esprits qui agissent dans le monde sont à la fois catagogiques et anagogiques. Les premiers visent à dégrader la nature humaine jusqu'à la rendre sauvage (en cela, les "signes des temps" évidents semblent confirmer la thèse de Panunzio), tandis que les seconds poussent l'homme vers le haut, vers l'atteinte de la nature angélique. Ce duel entre les forces célestes et infernales est vieux de plusieurs milliers d'années. L'époque actuelle, cependant, est le dernier âge, nous sommes au moment "décisif et final" de la crise. Dans ce contexte, le seul but à atteindre est le salut des âmes, rien d'autre ne peut être fait. [...] La métapolitique est donc acquise à l'eschatologie, et cette dernière est une métapolitique inspirée par les prophètes qui l'ont révélée dans le symbole. [...] La métapolitique comprend la métaphysique, l'eschatologie et la politique en une seule: elle est quadridimensionnelle. [...) C'est pourquoi les thèmes centraux de la métapolitique sont les deux soleils, l'Empire et l'Église. La Romanitas, avec son héritage impérial, représente la perfection humaine, la christianitas vise à réaliser la perfection qui descend de Dieu. Le Christ, véritable homme et véritable Dieu, est authentiquement "romain".
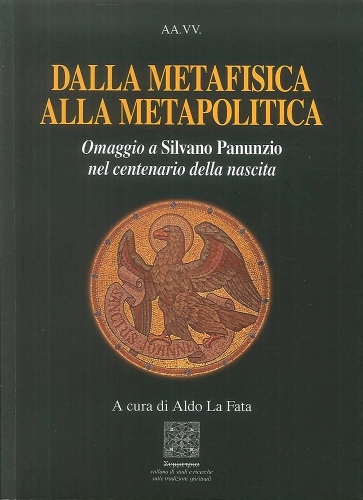
(...) Pour bien comprendre la leçon panunzienne, il convient de garder à l'esprit la distinction entre métapolitique et cryptopolitique. En ce sens, la politique doit être interprétée comme une première ligne que l'on peut atteindre d'en bas ou d'en haut, au service du monde souterrain ou du monde célecte. Dans l'Antiquité, l'initiation royale permettait d'accéder au plan proprement métapolitique. La sécularisation des organisations qui présidaient à l'initiation a donné lieu à l'essor des partis et des syndicats. C'est sur cette voie qu'est née la cryptopolitique. La véritable cryptopolitique se heurte "aux manœuvres de la guerre occulte et aux complots mondiaux de la subversion". Il y a ensuite la cryptopolitique élémentaire (appendice de la politique militante), qui est dirigée par la cryptopolitique officielle. La seule réponse sérieuse à cette condition est la référence à la métapolitique, dont le délai est long, bien que l'intervention du ciel, compte tenu de la situation générale, ne tardera pas à se manifester. Ceux qui, en entrant en politique, se tournent vers les forces du Ciel et se laissent guider par elles, feront preuve d'une conscience inhabituelle et seront même prêts à faire le sacrifice ultime. Dans la phase actuelle, ces hommes doivent nécessairement agir dans la dimension intellectuelle et s'enraciner dans la "Tradition universelle" : "Une véritable résurgence initiatique ne peut procéder d'en bas, de l'humain, même rectifié et réintégré.
(...) Alors que les prophètes de l'Ancien Testament désignaient le Messie, le nouveau prophétisme panunzien a un caractère michaélique. Michel l'Archange est le prophète du "Christ qui vient" et du "Christ qui revient". Au début des temps, c'était Melchizédek, à la fin, Mikaël. [...] Pour "se renouveler" dans la Tradition, il faut devenir Mikaël, participer à sa nature angélique, se transfigurer.
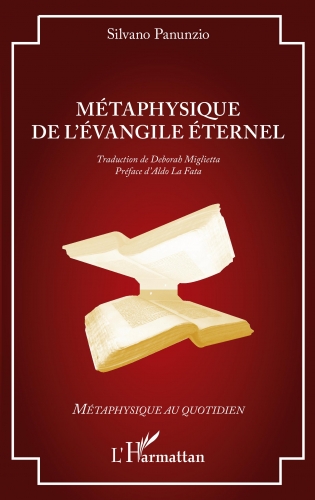
(...) Dans un autre ouvrage, Panunzio a parlé de la nécessité de réformer le "traditionalisme intégral" guénonien. Nous partageons pleinement son intention. Cependant, son idée de réformer le "traditionalisme intégral" dans un sens eschatologique et chrétien n'est pas la nôtre. [...] L'auteur croit certainement que l'"esprit géométrique" et l'esprit systémique de Guénon doivent être vivifiés par l'"esprit de finesse". Cette qualité était vivante et présente dans la tradition mystique grecque, en particulier dans le dionysisme, qui n'a jamais, dans l'acte aristotélicien, pensé à normaliser et à faire taire la dynamis, la puissance-liberté du principe. Par conséquent, s'il devait y avoir un ésotérisme chrétien, centré sur l'idée d'un dieu qui meurt et renaît, "puissant" et "souffrant", il serait redevable et successeur des anciens Mystères, auxquels il est nécessaire de revenir et de regarder au-delà de la scolastique traditionaliste. De plus, penser le Principe en termes de non, de négation, nous éloigne des perspectives de la philosophie de l'histoire et de la théologie de l'histoire, comme celle de Panunzio. Pour les tenants d'une vision tragico-dionysienne, le monde est suspendu au Principe de liberté-puissance. Dans l'histoire et dans le temps, l'origine est toujours possible (le pouvoir est possibilité) à condition que l'action humaine s'y adapte. Si tel n'est pas le cas, l'origine peut, selon nous, rencontrer son oubli définitif, sans que l'histoire ne s'achève pour autant. Il n'y a pas, selon nous, de fin prédéterminée à l'histoire. Nous sommes proches de la conception ouverte et non-nécessaire du temps. Une conception sphérique et non cyclique : elle a été réaffirmée dans les années 80 par Giorgio Locchi, compte tenu des leçons de Nietzsche et de Heidegger sur le sujet.
La réforme du traditionalisme de Panunzio a une finalité eschatologique, sotériologique, théologico-historique. Notre proposition, au contraire, se tourne vers le premier Evola (et le dernier, celui de Chevaucher le Tigre), pour suggérer la sortie possible de la pensée de la Tradition du nécessitarisme historico-temporel.
Quoi qu'il en soit, nous recommandons vivement les pages de Panunzio, élégantes dans leur style et stimulantes dans leur contenu. On sort toujours enrichi d'une confrontation avec un tel érudit, quelle que soit sa vision du monde.
Giovanni Sessa
18:35 Publié dans Livre, Livre, Philosophie, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, silvano panunzio, métaphysique, métapolitique, philosophie, tradition, traditionalisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 29 juillet 2023
Hegel, toutes voiles déployées

Hegel, toutes voiles déployées
Carlos X. Blanco
Préface de Ética y economía : Ensayos sobre Hegel de Diego Fusaro. Editorial Letras Inquietas (Cenicero, La Rioja, 2023). Édité par Carlos X. Blanco.
Hegel est aujourd'hui un objet de condamnation. Si l'on écoute les apôtres de la "société ouverte", il y aurait un démon philosophique à exorciser. À côté de Platon, et parmi les plus grands, il y a Hegel, le grand philosophe germanique de Stuttgart (1770-1831) : lui aussi est le monstre que les libéraux Karl Popper et George Soros auraient voulu transpercer, en le déversant sur le dépotoir d'un Marché-Monde totalitaire, aujourd'hui triomphant.
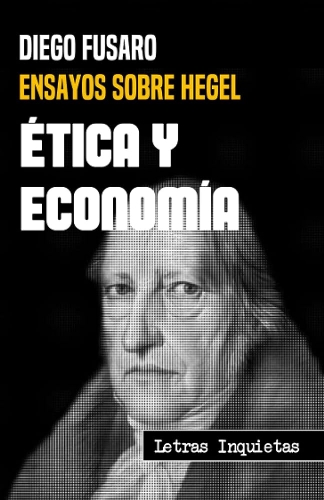 Totalitaire est le qualificatif donné à Hegel par ceux qui représentent aujourd'hui, en réalité, la quintessence du totalitarisme : les prédicateurs du mondialisme, c'est-à-dire du néolibéralisme, de la religion du marché, du monde sans frontières... Les dénigreurs de Hegel sont, en grand nombre, les véritables totalitaires d'aujourd'hui. Chacune de ces dénominations "globalitaires" - comme dirait Fusaro - rend parfaitement compte du totalitarisme réellement existant et actuel. Le terme "totalitaire" en vient à représenter l'idée d'un pouvoir global, sans fissures ni failles, qui étouffe ab initio toute plainte ou dissidence, qui annule la pluralité et élimine les espaces, les coins et les recoins de la libre vie privée.
Totalitaire est le qualificatif donné à Hegel par ceux qui représentent aujourd'hui, en réalité, la quintessence du totalitarisme : les prédicateurs du mondialisme, c'est-à-dire du néolibéralisme, de la religion du marché, du monde sans frontières... Les dénigreurs de Hegel sont, en grand nombre, les véritables totalitaires d'aujourd'hui. Chacune de ces dénominations "globalitaires" - comme dirait Fusaro - rend parfaitement compte du totalitarisme réellement existant et actuel. Le terme "totalitaire" en vient à représenter l'idée d'un pouvoir global, sans fissures ni failles, qui étouffe ab initio toute plainte ou dissidence, qui annule la pluralité et élimine les espaces, les coins et les recoins de la libre vie privée.
Les anathèmes poppériens et sorosiens sont lancés contre un État qu'ils comprennent comme un Léviathan totalitaire, une entité toute-puissante qui annule l'individu et le soumet. Mais le marché mondial, seigneur de la spéculation financière prédatrice, est, lui, bel et bien le nouveau Léviathan. Et il se trouve que l'éloge actuel de l'individu détaché de l'État cache l'étroite imbrication, la chaîne de fer de nature économique, qui lie son "libertarianisme" anti-hégélien dans une relation métallique et palpable avec le Marché mondial. C'est ce Marché mondial qu'ils ont projeté pour un 21ème siècle où "l'argent" n'aurait plus l'odeur des patries, et où les frontières - pour le Capital - n'existeraient pas. Il ne resterait aux peuples que le simulacre libertaire d'un dépassement de l'abolition des États. Les peuples deviendraient des serfs, sans législation protectrice, croyant bêtement que le capitalisme deviendrait - par sa propre dynamique - libertaire. Un capitalisme libertaire : quelle farce !
Mais ainsi, enterrant Hegel, le Seigneur deviendrait Seigneur Absolu, vendant de la fumée et de la camelote idéologique: car la fin des États signifierait l'avènement de la "gouvernance mondiale". Les entités mondialistes auto-légitimées - en commençant par l'ONU elle-même, et en terminant par le Forum de Davos, le FMI, la BM, etc. - agiraient comme de véritables Gouvernements planétaires qui, au plus tôt, mettraient tous les peuples de la Terre dans le même piège.
Il fallait en finir avec Platon et Hegel : c'est ce qu'ont décrété les néolibéraux Popper et Soros, idéologues de la "société ouverte". Bref, il était nécessaire, impératif, vital pour les seigneurs de l'argent de se débarrasser de la philosophie. Pourquoi ? Pour la simple raison que Platon et Hegel sont porteurs d'idées incompatibles avec le totalitarisme mercantile et néolibéral. Ils portent en eux le germe d'un possible sauvetage de l'Humanité bien comprise, c'est-à-dire comme un système de communautés organiques composées d'êtres rationnels et enracinés. Les deux géants du savoir philosophique, Platon et Hegel, nous enseignent (ainsi que leurs "fils" intellectuels respectifs, géants eux-mêmes, à savoir Aristote et Marx) ce qui est fondamental pour l'avènement de l'homme libre, c'est-à-dire la Communauté.
Qu'enseigne Hegel et que condamne le néolibéralisme ?
Premièrement. Hegel, ainsi que les autres géants et champions de la philosophie illibérale (toute vraie philosophie est illibérale) enseignent que l'homme est un animal communautaire (zoon politikon). Il n'est pas un atome isolé et discret. Ne perdons pas de temps à déguiser notre thèse, elle-même hégélienne : le courant dominant de la philosophie politique anglo-saxonne est un mensonge et une monstruosité. Le "loup-garou pour l'homme" (Hobbes) est un avant-goût de la jungle et de l'ère capitaliste sanglante: s'attaquer à son prochain, boire son sang, le violer, le voler et le réduire en esclavage... pour que la "richesse" puisse ensuite exister. Il n'est pas vrai que les vertus naissent des vices (Mandeville) ou des crimes les plus atroces. La tolérance lockienne a toujours été sélective, et son prétendu rejet de l'absolutisme impliquait la construction d'un absolutisme économique bourgeois plus subtil et plus écrasant. C'est alors que Hegel arrive et remet en question toutes ces balivernes libérales, y compris la "main invisible" d'Adam Smith. Fin connaisseur de l'économie politique anglaise, l'homme de Stuttgart nie la majeure. L'homme, comme le voyaient déjà les Grecs, est l'animal communautaire par excellence. L'humanité, c'est la vie rationnelle et l'épanouissement de l'esprit et de la vie éthique dans la communauté organique. Et le lien qui unit les individus, les rendant ontologiquement possibles, est un lien qui, dans la tradition chrétienne, peut être appelé amour. Il s'agit d'un lien éthique. La nature de l'homme est d'être communautaire. L'ontologie de l'être social a été découverte par cet "Aristote contemporain" qu'est Hegel. Dans le couple monogame et hétérosexuel lui-même, l'association organique - et non seulement ou surtout contractuelle - de deux personnes qui s'aiment, ce qui est spécifiquement humain transparaît déjà de manière aveuglante: le lien éthique-amoureux, le lien qui conduit naturellement à la procréation, un lien suprabiologique (parce que l'enfant implique l'éducation, l'affection et la culture) à partir duquel, dialectiquement, se déploient les institutions proprement humaines: la famille et la polis. Cet amour familial est l'antichambre éthique et logique de la cité.
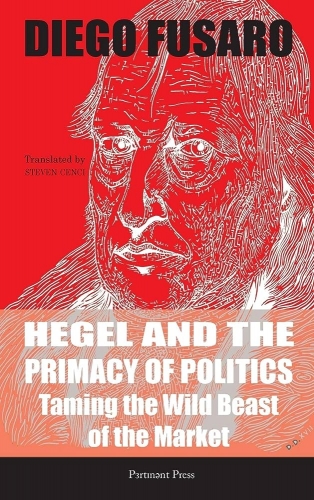
La terrible "Open Society" que nous prépare le mensonge libéral et anglo-saxon n'est pas une société: c'est un agrégat d'atomes discrets et égoïstes (sans amour) qui réduisent leurs "engagements" envers l'autre, envers leurs semblables (en remplaçant les enfants par des animaux domestiques, les conjoints par des amants occasionnels, les identités réelles par des "assignations culturelles" et des "autodéterminations de genre"), et ainsi de suite. Mais l'engagement fondamental reste intact dans ce monde terriblement "ouvert" : celui du nouveau serviteur ab-solu (qui signifie "lâche", détaché) d'un Autre: le Seigneur, qui n'est plus un homme riche fumant le cigare et portant le chapeau, l'ancien patron manchestérien, mais bien plus, quelque chose de plus terrible et de plus englobant. Loin de la figure de l'homme d'affaires, prosopon du Capital, ou du masque humain incarnant un rapport social (c'est-à-dire, à proprement parler, le Capital), le Seigneur est un tyran global, planétaire, un maître anonyme qui opère selon la vieille devise: divide et impera. Le Serviteur d'aujourd'hui, en revanche, est divisé en atomes discrets, ne sait plus fonder de familles ou de poleis, et est aujourd'hui, en ce 21ème siècle occidental, plus faible que jamais.
Deuxièmement. Les néolibéraux et les mondialistes, furieusement anti-hégéliens, enseignent que l'État est ultimement mauvais. Ils ne reconnaissent jamais que l'État, avec ses cadres législatifs potentiellement protecteurs des peuples, peut devenir un rempart contre ce sauvage "Monde sans frontières". Ils n'admettent jamais qu'un État populaire défende la production indigène et la classe ouvrière indigène. Son cadre législatif et sa discipline interne, en se dotant de moyens coercitifs pour la défense du peuple, peuvent empêcher la société de plonger dans une biocénose incontrôlable, où les capitalistes prédateurs gouvernent la planète, les corps et les esprits des hommes, en ruinant les conquêtes sociales (santé, culture, éducation, qualité de l'emploi, réseaux d'assistance et de solidarité...). Ils accusent Platon et Hegel d'"étatisme", et ce concept, pour leur part, ils l'associent ténébreusement aux totalitarismes du 20ème siècle : Hitler et Staline. Les philosophes de la lignée dialectique, de Platon à Hegel et Marx, seraient les pères intellectuels de la statolâtrie, c'est-à-dire du culte d'un État divinisé qui écrase l'individu. Foutaise, pure foutaise.
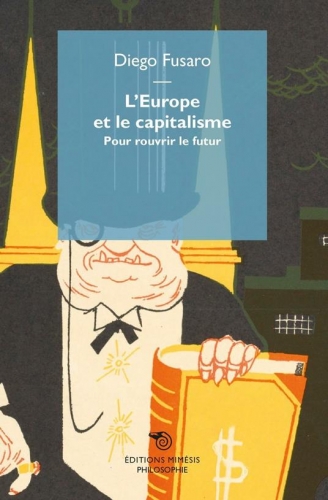
Hegel, bien étudié, parle de lui-même. Son langage n'est pas toujours simple, mais une fois acquis, le Tout est compris, et dans le Tout la vérité devient manifeste. Hegel, en partant de la dialectique découverte par Platon et en prenant au sérieux la définition aristotélicienne de l'homme comme zoon politikon, dissipe la fumée atomistique de Popper et de Soros.L'émergence même d'un monde multipolaire, où le Sud se défait du colonialisme occidental, où les pays émergents redécouvrent le rôle des États comme véhicules du peuple et pour le peuple, sera la preuve que Hegel avait raison. La raison qui, en termes hégéliens, n'est rien d'autre que la cohérence. Elle n'est que le déploiement de l'Esprit qui devient supérieur sur la base de luttes émancipatrices, de conquêtes, de résistances, d'avancées objectives au milieu de mille revers conjoncturels. Le Hegel de Fusaro, c'est le Marx d'avant Marx, le communautarisme d'aujourd'hui dans le langage métaphysique du 19ème siècle, mais aussi l'éclat de la philosophie au milieu de la nuit néolibérale, brutalement "libertaire" et atomiste.
Un maître du 21ème siècle pour comprendre un maître du 19ème. Je suis fier de placer ces quelques lignes devant la prose du Prof. Fusaro, lisse, virile et démolissante. Je ne m'attarderai pas plus longtemps sur la présentation de cet outil essentiel de libération qu'est le livre de Diego Fusaro sur G. W. F. Hegel. Sa parution en langue espagnole fait peut-être partie de la dialectique du monde lui-même. Si les vents soufflent dans une direction favorable, ils rencontreront des voiles déjà déployées.
Pour toute commande:
https://www.letrasinquietas.com/etica-y-economia-ensayos-...
21:20 Publié dans Livre, Livre, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : diego fusaro, hegel, g. w. f. hegel, livre, philosophie, philosophie politique, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Préface à "La destruction de la France au cinéma" de Nicolas Bonnal
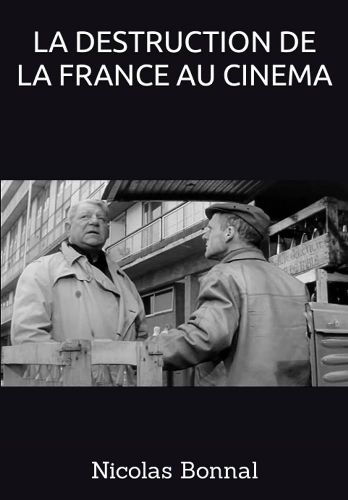
Pierre Le Vigan:
Préface à La destruction de la France au cinéma de Nicolas Bonnal
Disons-le d’emblée : « La destruction de la France au cinéma » est un livre épatant. Alacrité, rapidité de l’écriture, parfois célinienne. Comme « D’un château à l’autre » devenu « D’un château l’autre »… Livre furieux, joyeux, caustique, exaspéré par le monde moderne, mais pas haineux. Bonnal en long et en large. On ne s’en lasse pas. L’idée de départ est de montrer comment une certaine France a disparu. Une France prémoderne ? Traditionnelle ? Celle des vieux métiers ? Celle des vieilles librairies, des bouquins papier et non des e-books ? Celle des bistrots ? Un peu tout cela. Une chose est sûre. C’était la France que nous aimions.
La littérature peut montrer la disparition de cette France. Le cinéma tout autant, et sans doute de manière plus spectaculaire. Nicolas Bonnal s’y prend en deux temps. Tout d’abord, en quelques quatre-vingt pages, il combine littérature et cinéma pour aborder les grands aspects de l’effacement d’une certaine France. S’agit-il de la liquidation de la tradition par la modernité ? Ou de la liquidation de la modernité des années 60 par la postmodernité des années 80 et 90 ? Un peu les deux. En tout cas, le monde se déglingue. Un monde se déglingue. Un monde que l’on voit encore dans Flandres (2006), de Bruno Dumont, filmé comme un film de Robert Bresson. Un monde qui disparait pour laisser place à d’autres normes, à une autre vision. Le problème est que le monde qui se déglingue était le nôtre. Tout ce qui était encore enchâssé dans un mode de vie traditionnel, dans un habitus ancien, se désencastre et tourne en roue libre.
L’imbécillité gratuite triomphe, le non-sens s’installe, le bavardage inutile prolifère, le sens du beau se déglingue. Nicolas Bonnal nous le montre par des allers et retours entre la création cinématographique et les œuvres de grands littérateurs, voire de quelques politiques comme de Gaulle et Michel Debré. Les cinéastes ne sont pas les deniers à être lucides. Jean Renoir comparant notre temps et le Moyen-Age : « Notre religion, maintenant, c’est la banque, et notre latin, c’est la publicité ». Il pourrait ajouter le globish. « Choose France », comme dit McRond. Le monde devient uniforme. « Le monde ne présentait pas cette ennuyeuse unité vers laquelle nous marchons à grands pas » (toujours Jean Renoir). Alexis Carrel et la destruction du sens esthétique (on pense aussi à Konrad Lorenz) : « Si l’activité esthétique reste virtuelle chez la plupart des individus, c’est parce que la civilisation industrielle nous a entouré de spectacles laids, grossiers et vulgaires. » (Il n’avait pourtant pas vu le pire). L’industrialisme nous éloigne de la joie, poursuit Carrel. On croirait lire Péguy. « La civilisation moderne est incapable de produire une élite douée à la fois d’imagination, d’intelligence et de courage. » (Alexis Carrel).

Le cinéma de Jean-Luc Godard. A bout de souffle (1960). La guerre d’Algérie n’est même pas terminée (mal terminée) et pourtant, nous en sommes déjà si loin avec ce film. Déjà dans un temps pas seulement postnationaliste mais postnational. « La belle américaine mène notre voyou franchouillard à la mort », dit Bonnal. Les Carabiniers (1963) : film anarchiste de droite. Et comment ! Le Petit soldat, toujours en 63. Film d’extrême droite ? En tout cas vingt-quatre fois la vérité par seconde.
Sacha Guitry : le tableau de la vraie France qui avait déjà commencé à être remplacée. D’où le charme inoxydable de Guitry. Michel Audiard : la fin des maisons closes, du client du dimanche, du « furtif » (et s’il n’y avait que cela, la fermeture des ’’maisons’’ !). L’homme moderne « rêve de savoir s’il est devenu l’homme du vingtième siècle ». Il n’y a plus qu’à répéter avec conviction et en chœur « Merci Simca », comme le fait Charles Denner dans Le Voyou de Claude Lelouch (1970).
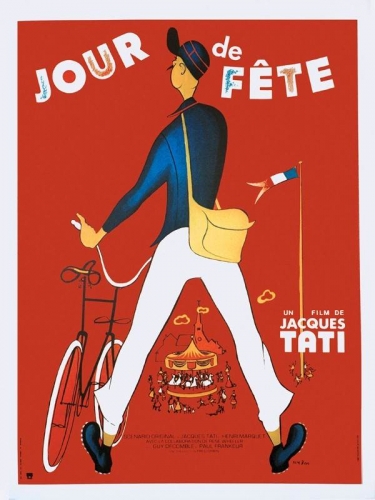
Jacques Tati, Jour de fête (1949). C’est « l’humiliation du facteur français à vélo » face aux méthodes américaines. On pense au film espagnol Bienvenue Mr Marshall (1953). Toujours Tati. Les vacances de Monsieur Hulot (1953) : le début du dévergondage touristique. Les congés payés comme dit joliment Brigitte Bardot. Mon Oncle (1958) : la folie du monde moderne et la résistance du monde ancien.
Michel Serres : comme Bonnal, je ne me suis rendu compte que très tardivement qu’il était génial (avant tout dans ses entretiens). Son optimisme était de façade (ou de courtoisie ?). Son constat était lucide. « L’américanisation générale de la culture et des entrées de ville, qui sont devenues abominables [provoque] un hurlement de laideur. » Et voilà qui remonte à la modernité gaulliste. Ses ’’villes nouvelles’’, sautant par-dessus les vieilles banlieues. Ses tours de bureaux, ses grands magasins. André Malraux et l’engouement pour l’art moderne. Et les MJC des « cultureux ». L’objectif de Malraux : battre l’Amérique sur son propre terrain. Marc Fumaroli explique que l’Amérique ne pouvait pas perdre le duel autour de l’art moderne. L’art moderne, déjà déconstruit, entre innocence (les arts premiers) et perversité (les arts premiers seront les derniers). Zemmour, qui aime pourtant les Trente Glorieuses, a bien vu que Malraux – et la culture – était son point faible. Quant à Nicolas Bonnal, qui n’aime pas les Trente Glorieuses, il voit la « sarcellisation » de nos villes, et il nous la montre à travers le cinéma (Mélodie en sous-sol, 1962, Henri Verneuil).

La Pauvreté. Il y avait une dignité du Pauvre. On lui demande maintenant d’entretenir « cette vertu de l’Envie, indispensable au Progrès » (Georges Bernanos), ’’vertu’’ par laquelle il devient un consommateur comme un autre. Dans quel monde ? Dans celui de « l’avènement triomphal de l’Argent » - toujours Bernanos – marqué par « la dépossession progressive des Etats au profit des forces anonymes de l’Industrie et de la Banque. » Notons que, entretemps, l’Industrie, du moins chez nous, a été liquidée par la Banque. Et l’Ouvrier a laissé la place au Bureaucrate.
Et peut-être le plus important : le lien entre sadisme et totalitarisme dégénéré, celui même du libéralisme-libertaire, ce lien compris et annoncé par Pier Paolo Pasolini, avant Dany-Robert Dufour. « Tu baiseras ton prochain », inversion de Marc 12 : 31 « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Tu le tortureras comme le système te torture par l’envie. Barbare est le système libéral. Barbare tu seras toi-même.*
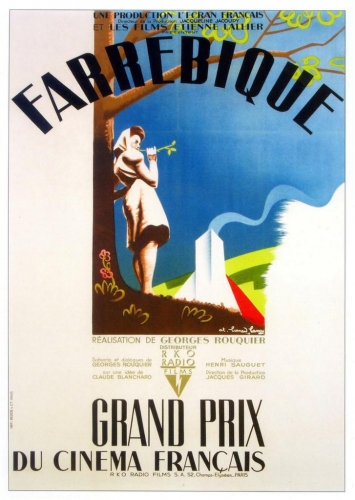
La seconde partie du livre de Nicolas Bonnal est une analyse critique de films. Ils seraient au nombre de 72 films, chiffre chinois que notre auteur nous dit aimer. Mais en fait, ils sont au nombre de soixante-quinze ! Nicolas Bonnal n’est pas toujours exact mais il est toujours VRAI. Sa vérité est comme celle de Céline, moins factuelle que métaphysique. Evocation de plus de soixante-dix films donc, de Farrebique, prodigieux (Georges Rouquier, 1943) aux Valseuses (Bertrand Blier, 1973), en passant par les Tati, les Godard, les Tontons flingueurs (Georges Lautner, 1963), L’Imprécateur (Jean-Louis Bertuccelli, 1977), le nécessaire mais accablant Biquefarre (G. Rouquier, 1983), qui montre que le monde de Farrebique est mort…
Ne nous y trompons pas. Tous les films évoqués sont à voir, mais pas parce qu’ils sont des chefs d’œuvre. Certains sont de très grands films. Mais beaucoup sont ratés, bien que parfois restant fort agréables à regarder (Le fruit défendu d’Henri Verneuil, 1952, par exemple). L’essentiel : tous sont significatifs d’un tournant dans les mœurs. Des symptômes, et parfois des fantômes… Le temps a tourné comme il arrive au lait.
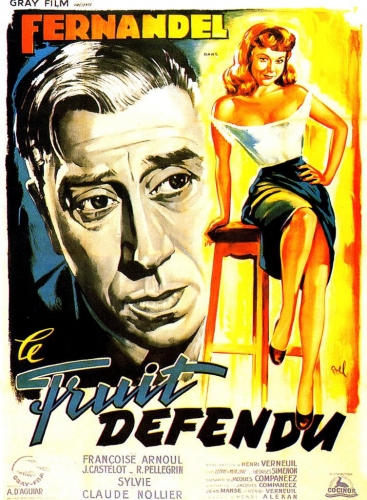
Bonnal parle du cinéma (et du reste), dans un style tout à fait personnel et inimitable. C’est Louis-Ferdinand Bonnal. Il est né en 1961, l’année de la mort de Céline. En un sens, il a pris le relais de la colère de Ferdine. Tatiana est sa Lucette. Almeria est son Meudon – ou son Danemark. Consultant en décomposition, il propose de bons remèdes : comédies musicales, natation, plongée, lectures de Léon Bloy, Maurice Joly, Michelet... Bonnal ne s’interdit pas des répétitions de citations quand elles lui paraissent tellement lumineuses qu’il veut les faire entrer dans la tête du lecteur (comme quoi il n’a pas tout à fait désespéré de l’espèce humaine…).
Ses propres formules sont souvent une synthèse qui vaut bien des livres. « De Gaulle et l’effondrement français : il œuvre en destructeur ET en fantôme ». A savoir qu’il détruisit le monde d’avant, avec l’urbanisation et la modernité des années 60, et fut en même temps le fantôme d’un monde encore traditionnel, celui des familles durables, celui de la littérature et non de la télévision et des écrans. Jugement sans doute injuste. Et problème qui n’a peut-être pas de solution. Comment vouloir la puissance sans être dans la massification, la normalisation, la répétition, sans mettre au pouvoir les hommes d’argent, sans désenchanter le monde.

Lisons Une enfance de Hans Carossa (1922, trad. 1943). Ce monde aurait-il résisté à la modernité technologique, fut-elle durablement nationale et socialiste ? Et le Regain de Jean Giono, illustré par un film de Pagnol (1937) ? Durable le regain ? Notons que le régime du maréchal Pétain, adulé par une certaine droite se voulant traditionaliste, voulait lui aussi faire construire des autoroutes (1942 : début des travaux de l’autoroute de l’Ouest). Mais il est vrai que ce n’était là que hors d’œuvres. Il est vrai que la modernité s’accélère avec de Gaulle dans les années 60, mais que partout ailleurs en Europe, elle s’accélère aussi sans avoir besoin d’un de Gaulle (même en Espagne avec Franco !).
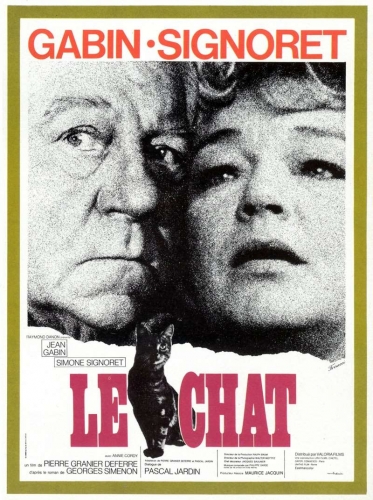
La modernisation continuera de changer notre monde, nos paysages et nos mœurs, et notre regard sur la vie et sur nous-mêmes, sous Pompidou et sous Giscard. Par exemple avec les premiers supermarchés, ou avec les rénovations urbaines (Le Chat, 1971, de Pierre Granier-Deferre). On peut dire que le boulot de destruction et de « mochisation » de la France sera fait quand Mitterrand arrivera au pouvoir. Il ne restera qu’à désindustrialiser le pays pour en faire un nouveau tiers monde. Le commerce : baromètre de la modernité, avec la bagnole. Le premier supermarché s’ouvre à Rueil-Malmaison en 1958, et surtout le premier hypermarché à Sainte Geneviève des bois en 1963. Je dis « surtout » car les grands magasins existaient depuis Napoléon III (Le Bon Marché, 1852) et le premier Prisunic est installé rue de Provence à Paris en 1931, mais, en 1963, on change vraiment d’échelle et les hypermarchés sont hors les villes, et contre les villes. Ils ne prétendent pas les embellir, ils en sont au contraire la négation. Ste Geneviève des bois, Seine et Oise 1963, dans ce qui sera l’Essonne après le redécoupage de la région parisienne (1964-68). Opération qui frappe la région parisienne, tout comme l’Algérie n’avait cessé, depuis 1955, d’être redécoupée en nouveaux départements. Grande banlieue et gigantisme. Grande banlieue pour permettre le gigantisme. Pierre Uri, disciple de François Perroux, avait regretté la disparition du département de la Seine ancienne formule. Paris ne devait pas se couper de sa proche banlieue. Il avait raison.

A Paris, ouverture de la FNAC Wagram en 1969, puis de la FNAC Montparnasse en 1974. Fédération nationale d’achat des cadres: c’est le monde de Jacques Tati. Ou plutôt, c’est le monde dans lequel Jacques Tati commence à se sentir bien mal. La FNAC, c’est le début de la fin pour les libraires traditionnelles, de quartier, et pour les disquaires (le correcteur d’orthographe ne comprend pas le mot « disquaire » : ben oui, l’intelligence artificielle n’a pas de mémoire). Tout cela se terminera par la fermeture en 2020 du Boulinier historique du boulevard Saint-Michel et, un an plus tard, par la fermeture des Gibert Jeune de la place St-Michel. Comme cela avait été dit et souhaité et promu en haut lieu, le Covid sera l’occasion d’aller plus loin dans la modernisation-numérisation-dématérialisation de notre économie (et infiniment plus loin dans le flicage). Tout cela après la disparition de nombre de cafés, comme la Rôtisserie Périgourdine et son piano-bar, 2 place St-Michel, fermée en 1997, cafés remplacés par des boutiques toutes plus abominables les unes que les autres.
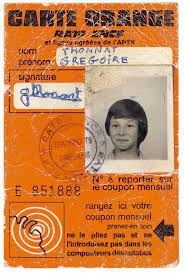 Création de la Carte Orange le 1er juillet 1975, ouverture du centre Pompidou en 1977. L’ambition d’un Paris pour tous ? Mais les prix de l’immobilier, de plus en plus délirants à partir des années 70-80, font que les candidats à l’accession à la propriété sont mis en situation d’acheter des surfaces de plus en plus petites. Et voilà Paris finalement sous-peuplé, mais sur-envahi de touristes, sur-construit en bureaux inutiles (pourquoi ne pas travailler dans des banlieues moches et rentrer le soir vivre dans une belle ville plutôt que le contraire ?). Et Paris lui-même devenu moche, – surtout après le départ de Chirac de la mairie, reconnaissons-le ! Et le regroupement familial de 1976 (décidément, Chirac aurait dû se borner à un mandat local), et la grande mutation ethnique qui s’ensuit de cette folie.
Création de la Carte Orange le 1er juillet 1975, ouverture du centre Pompidou en 1977. L’ambition d’un Paris pour tous ? Mais les prix de l’immobilier, de plus en plus délirants à partir des années 70-80, font que les candidats à l’accession à la propriété sont mis en situation d’acheter des surfaces de plus en plus petites. Et voilà Paris finalement sous-peuplé, mais sur-envahi de touristes, sur-construit en bureaux inutiles (pourquoi ne pas travailler dans des banlieues moches et rentrer le soir vivre dans une belle ville plutôt que le contraire ?). Et Paris lui-même devenu moche, – surtout après le départ de Chirac de la mairie, reconnaissons-le ! Et le regroupement familial de 1976 (décidément, Chirac aurait dû se borner à un mandat local), et la grande mutation ethnique qui s’ensuit de cette folie.
Un peuple de souche qui ne se reproduit plus guère biologiquement, mais qui ne veut pas non plus se reproduire culturellement et esthétiquement. Et si c’était un seul et même problème ? Ce qui nous ramène à Nicolas Bonnal. En s’occupant de cinéma, c’est-à-dire de la question esthétique, il va au coeur de l’essentiel.
PLV
Pour acquérir le livre: https://www.amazon.fr/DESTRUCTION-FRANCE-AU-CINEMA/dp/B0C9S8NWXX
20:38 Publié dans Cinéma, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinéma français, nicolas bonnal, france, histoire, déclin français |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook



