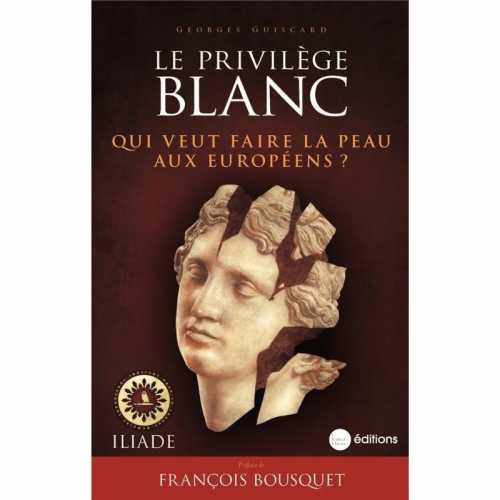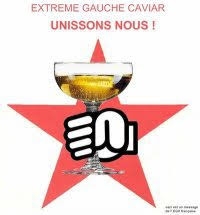lundi, 15 novembre 2021
L'idéologie du politiquement correct et la civilisation occidentale

L'idéologie du politiquement correct et la civilisation occidentale
Vojtěch Belling
Ex: https://deliandiver.org/2007/11/ideologie-politicke-korektnosti-a-zapadni-civilizace.html
Lorsque, au début des années 1930, le politologue et théoricien du droit allemand Carl Schmitt a tenté de prouver la présence cachée mais néanmoins évidente de tendances totalitaires dans l'État libéral-démocratique moderne, il a semblé à nombre de ses contemporains conservateurs qu'il s'agissait d'une exagération. Les années suivantes ont apparemment confirmé à leurs yeux l'absurdité de l'affirmation de Schmitt. Au contraire, le véritable totalitarisme était palpable dans les régimes qui positionnaient la démocratie libérale comme leur ennemi juré.
Les théories classiques du totalitarisme associées aux noms de Carl Joachim Friedrich, Zbigniew Brzezinski et Hannah Arendt, fondées sur les caractéristiques externes des régimes totalitaires (idéologie, parti, police secrète terroriste, monopole du renseignement, monopole des armes, économie planifiée), ont soutenu cette mise en opposition absolue du totalitarisme avec la démocratie libérale. Ni la conception de Voegelin et de Meier sur l'émergence des religions politiques en tant que substitut de la foi, ni la conception de Schelsky sur le totalitarisme pluraliste, n'ont changé quoi que ce soit à l'acception générale et exclusive du totalitarisme en tant que phénomène anti-libéral et anti-démocratique en contradiction avec les démocraties ordinaires de style occidental.
Pourtant, depuis que le monde a célébré le triomphe de l'establishment libéral-démocratique et que Francis Fukuyama a commencé à parler de la fin de l'histoire, certaines tendances totalitaires ont commencé à émerger très clairement au sein des États libéraux-démocratiques, ce qui peut nous amener à repenser les propositions de Schmitt et à les comprendre sous un jour nouveau. Je pense en particulier au phénomène multicouche du soi-disant politiquement correct qui imprègne toutes les réalités du discours politique, social et scientifique dans la civilisation occidentale actuelle. Dans l'article suivant, j'essaierai de démontrer comment ce politiquement correct, issu du régime libéral-démocratique développé, tend à détruire progressivement son essence (ndt: du moins l'essence qu'on lui attribue et/ou qu'il s'est auto-attribuée). En décrivant la nature de ce phénomène et ses formes dans les environnements nord-américain, européen et tchèque, j'essaierai de le placer dans le contexte du développement de la société moderne et de documenter la dérivation naturelle de son essence.

L'essence du politiquement correct
Le politiquement correct, dans le sens courant du terme, désigne un ensemble d'éléments nécessaires pour qu'une certaine action ou expression d'opinion soit considérée comme pertinente ou ne soit pas sanctionnée socialement. En d'autres termes, le politiquement correct est une sorte de cadre externe de communication que l'auteur et le lecteur ou l'auditeur doivent accepter s'ils veulent se comprendre. À cet égard, elle joue donc un rôle similaire à celui de la langue elle-même. Toutefois, contrairement à cette dernière, le politiquement correct n'est pas exigé par les caractéristiques biologiques de l'homme, mais par certaines normes sociales imposées aux deux sujets - l'auteur et le lecteur - par la société extérieure.
En un sens, le politiquement correct peut donc être assimilé à la politesse, qui est également une forme externe universelle de communication entre des personnes d'horizons différents. Contrairement à la politesse, cependant, le politiquement correct a un impact beaucoup plus important sur le contenu du discours lui-même, et pas seulement sur sa forme. En outre, les sanctions pour violation du politiquement correct sont beaucoup plus sévères et durables que celles pour violation de la politesse. Car, comme le note Gerard Radnitzky, ne pas suivre le politiquement correct revient à briser un tabou. Le politiquement correct, comme nous le verrons, tend en fait à étendre la gamme des tabous éthiques de l'ordre libéral classique, tels que le meurtre, le vol, etc. D'autre part, elle supprime de force certains des tabous traditionnels existants (meurtre de l'enfant à naître, fornication, etc.). Cela change fondamentalement le système de valeurs éthiques de la civilisation occidentale.
Le politiquement correct repose sur la conviction que les idées d'un courant de valeurs politiques particulier, essentiellement et exclusivement de gauche, peuvent prétendre à une validité universelle. Les défenseurs de ces idées, par une manipulation habile, en utilisant au maximum les possibilités de l'État et de ses instruments dans la sphère culturelle (les médias publics), parviennent à subordonner à ces idées les normes du langage humain, du comportement humain, de l'action politique et, en définitive, de la pensée humaine. Les unités idéologiques que le politiquement correct universalise de cette manière concernent le plus souvent les questions des minorités nationales, ethniques, sexuelles ou religieuses et de l'égalité des sexes. En même temps, le politiquement correct est une arme efficace qui aide les minorités défavorisées pour diverses raisons (parfois, étonnamment, elles sont justifiées) à atteindre facilement leurs objectifs. Cependant, le but ultime et l'élément omniprésent du politiquement correct est l'élimination d'une identité culturelle ou civilisationnelle qui joue encore un rôle de premier plan dans un domaine particulier. Le politiquement correct étant un phénomène spécifiquement occidental, la réalisation de son objectif constitue une élimination concomitante de l'identité occidentale.

Réglementer le langage : le premier domaine du politiquement correct
La modification des règles d'utilisation de la langue est l'un des symptômes les plus évidents du politiquement correct, partout dans le monde. Au lieu des termes traditionnels utilisés, le politiquement correct crée de nouvelles tournures de phrases ou des termes de substitution qui changent le sens de la chose nommée. Le terme existant est immédiatement tabou dès qu'il est remplacé. Un exemple classique est le développement des termes servant à désigner un membre du groupe ethnique noir aux États-Unis. Au lieu du terme "nègre", le politiquement correct a inventé dans le passé le terme "de couleur". Dès que la signification de ce terme est redevenue problématique, le politiquement correct l'a remplacé par "noir". Il n'a pas fallu longtemps pour que le terme soit à nouveau remplacé par "afro-américain". Un processus similaire peut être observé pour certains mots de la langue tchèque. Par exemple, le terme original "Gypsy" a été remplacé par "Roma", en dépit du fait que le terme "Roma" était auparavant utilisé pour se référer uniquement à un groupe spécifique de Gitans. C'est pourquoi les Allemands ont utilisé le double terme "Roma und Sinti" pour désigner un groupe plus important des tribus gitanes d'origine, mais pas toutes.
Lorsqu'il existe un risque de jugement négatif à l'égard des membres d'un groupe ethnique particulier, le politiquement correct refuse toute discussion sur l'ethnicité. Un exemple en est la couverture des crimes dans les programmes d'investigation de la télévision publique, dans lesquels le téléspectateur doit souvent déchiffrer littéralement l'origine ethnique de l'auteur sur la base de quelques références accessoires (peau brune, cheveux noirs, "mauvais Tchèque", etc.). Et ce, malgré le fait qu'une information directe sur cette affiliation faciliterait grandement la recherche. En bref, les règles du politiquement correct l'emportent sur l'objectif du message lui-même.
Les exigences linguistiques du politiquement correct visant à donner du pouvoir aux minorités discriminées sont souvent très absurdes. Aujourd'hui, par exemple, il est très dangereux de commander un café blanc à une serveuse noire aux États-Unis en utilisant le terme traditionnel "café blanc". Le terme a déjà été coulé et tabouisé en termes de politiquement correct. Il faut soit réfréner son envie de la boisson en question, soit faire preuve de beaucoup d'imagination pour trouver des formes descriptives.

Une raison très courante des transformations politiquement correctes du langage est le discours de l'égalité des sexes, qui cherche délibérément à s'emparer du langage comme de l'arme la plus puissante de l'homme postmoderne. Peut-être que toutes les langues subissent aujourd'hui des changements qui correspondent au désir des femmes d'avoir une part de pouvoir. Il n'y aurait rien d'étrange à cela si ces changements n'étaient pas effectués sans tenir compte de la logique interne de ces langues et de leurs règles. En français, ce problème a été soulevé dans le débat sur les équivalents féminins d'expressions traditionnellement masculinisées : monsieur le ministre - madame la/le ministre.
En allemand, en revanche, la question du pluriel commun des noms existant à la fois sous forme masculine et féminine a été abordée. Par exemple, le terme "étudiants" (Studenten) était traditionnellement utilisé au pluriel pour les étudiants et les étudiantes. Plus tard, les idéologues du politiquement correct ont jugé que cela était discriminatoire à l'égard des femmes, et ce sens a été redéfini en tant qu'étudiants (Studenten) et étudiantes (Studentinnen). Ici, cependant, le problème est que les femmes ne sont pas prises en compte. Enfin, une toute nouvelle forme de pluriel "unisexe" a été créée pour la plupart des noms en ajoutant la terminaison féminine "Innen" avec une lettre initiale majuscule pour prouver son égalité avec les pluriels masculins. Ainsi, "Studenten" est devenu le mot absurde "StudentInnen", qui viole toutes les règles de la logique grammaticale allemande en incluant une majuscule au milieu du mot. Pour l'instant, la langue tchèque du politiquement correct en matière de genre se contente de l'usage courant des pluriels féminins et masculins, les femmes venant généralement en premier (étudiantes et étudiants, citoyennes et citoyens, etc.).
Cependant, le règlement linguistique s'étend également à des domaines où l'on ne s'y attend pas. L'exemple le plus évident de la prétention du politiquement correct à une validité universelle est son empiètement sur le domaine de la religion dans le domaine du langage. L'apparition d'éditions politiquement correctes de la Bible ou de livres de prière en est la preuve. Ainsi, en plus de Dieu le Père, "Dieu la Mère" apparaît également dans ces versions, et des changements similaires se produisent dans d'autres concepts fondamentaux du langage religieux. Même dans la sphère sacrée, le politiquement correct est l'arbitre suprême de la qualité du contenu et de la forme du message.
Régulation du comportement
Au stade suivant, le politiquement correct passe de la régulation du langage à la régulation du comportement des individus, mais aussi de groupes entiers, de la société et de l'État dans son ensemble. Comme nous l'avons déjà mentionné, le but du politiquement correct est la destruction de l'identité. L'une des façons d'atteindre cet objectif est de souligner la position non seulement égale mais souvent privilégiée de toute minorité dans un environnement culturel donné. Cette promotion prend de nombreuses formes, parmi lesquelles le principe de la discrimination positive, l'affirmative action, mérite une mention spéciale. Son essence repose sur le principe d'égaliser, mais aussi de favoriser et de privilégier tout ce qui est considéré comme étant en dehors de la norme ou de la normalité dans la tradition occidentale. La discrimination positive vise les minorités ethniques, les groupes religieux et les personnes non hétérosexuelles (n'oublions pas que, selon le langage du politiquement correct, il n'y a pas deux, mais cinq genres).
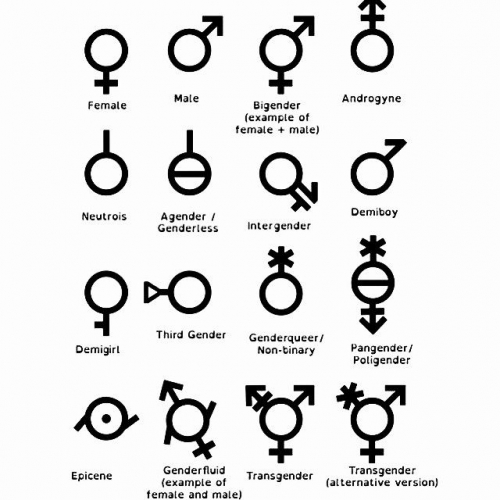
Aux extrêmes, la discrimination positive peut prendre des formes très curieuses : par exemple, certaines universités américaines favorisent les membres de minorités ethniques (mais seulement certaines, comme les Afro-Américains ou les Amérindiens), mais avec la preuve d'une ascendance biologique-raciale jusqu'au quatrième degré. En d'autres termes, un demandeur d'aide sociale ou de traitement spécial doit documenter l'ascendance biologique de ses grands-parents et autres ancêtres, y compris le pourcentage de "sang minoritaire". La méthodologie de l'affirmative action est donc très proche des pratiques raciales du régime nazi, dont les fameux "Ahnenpässe" - mais à la différence que l'objectif est de favoriser les minorités ethniques.
Dans tous ces cas, il s'agit d'une démarche rationnelle de la part des minorités. Dans son livre The Holocaust Industry, l'auteur juif américain Norman Finkelstein utilise l'exemple de l'utilisation de l'Holocauste à des fins qui n'ont rien à voir avec la commémoration et l'héritage de cette horrible tragédie du 20ème siècle pour critiquer l'approche utilitaire de nombre de ses collègues qui ont fait de l'Holocauste un concept industrialisé. Ce qui mérite d'être analysé, c'est donc plutôt le comportement de la majorité, qui est non seulement capable de s'accommoder des efforts rationnels des minorités, mais qui anticipe elle-même ces efforts. Après tout, la simple mention de l'existence d'une culture majoritaire est politiquement incorrecte, comme l'a montré, par exemple, la discussion sur le terme "Leitkultur" qui a eu lieu en Allemagne il y a quelques années à propos de l'intégration des étrangers dans l'environnement allemand. En réponse aux tentatives des politiciens conservateurs de créer une législation qui rendrait obligatoire l'initiation des immigrants aux principes culturels de l'espace d'Europe centrale, la gauche a répondu par le jugement surprenant qu'il n'y a aucune culture qui a une position privilégiée dans l'environnement allemand, et qu'il ne peut y en avoir.

Cela nous amène à la deuxième dimension de la réglementation politiquement correcte des comportements, qui ne vise pas à privilégier les minorités et les cultures minoritaires, mais à détruire la culture majoritaire. Bien sûr, toujours avec la conscience de la liquidation de l'identité comme ultima ratio. Cette lutte contre l'identité occidentale prend plusieurs formes. L'une d'entre elles est la tentative de supprimer ou de remettre en question les éléments distinctifs de la culture occidentale. Comme l'a écrit le théologien Henry van Til, "la culture est la religion incarnée". L'assaut du politiquement correct se concentre donc en premier lieu contre le christianisme. On peut trouver des exemples partout dans le monde de la civilisation occidentale. La première association qui vient à l'esprit est la destruction des symboles religieux : le retrait des croix dans les écoles bavaroises sur l'insistance des parents d'un seul élève d'une autre religion qui se sentait offensé par la présence de la croix dans les salles de classe, le retrait de la crèche dans les écoles du nord de l'Italie, ou encore le retrait des croix et des tablettes des dix commandements des palais de justice américains et d'autres espaces publics.
Cependant, si les efforts de neutralité religieuse dans la sphère publique sont plus anciens (en France, la laïcité est l'un des principes constitutionnels fondamentaux depuis le début du 20ème siècle), dans la sphère privée, cette ingérence a déjà lieu exclusivement sous la bannière du politiquement correct. Les Boy Scouts of America, par exemple, ont échappé de justesse à une modification de leur constitution, ordonnée par un tribunal, interdisant le recrutement d'homosexuels actifs comme chefs scouts. Ils ont payé leur victoire à la Cour suprême par le mépris d'un certain nombre d'organisations et d'institutions publiques activées par l'American Civil Liberties Union (ACLU) - la structure personnifiée du politiquement correct aux États-Unis. Par ailleurs, même les scouts n'ont pas résisté à la pression du politiquement correct, qui les a contraints à modifier la formulation du serment des nouveaux membres et à autoriser une version athée du serment scout.

Toutefois, l'influence du christianisme est également limitée par des moyens beaucoup plus radicaux : par exemple, la possibilité de désacraliser librement les symboles chrétiens dans l'art ou la littérature, ou l'attitude a priori négative de la plupart des médias, en particulier les médias publics, à l'égard des dénominations chrétiennes. Cependant, quiconque voudrait désacraliser de la même manière toute religion autre que celle qui constitue l'identité occidentale se heurterait au mal. Nous trouvons donc un paradoxe intéressant : le politiquement correct, qui lui-même nie officiellement l'existence de sources spécifiques de l'identité occidentale (par exemple, ses racines chrétiennes), dans ses activités visant à éliminer ces sources, confirme effectivement ce rôle, tout en prouvant qu'il en est en fait très conscient.
Outre la religion, le politiquement correct s'attaque également à d'autres symboles de la culture occidentale. Cela est évident, par exemple, dans les efforts acharnés pour remettre en question puis démanteler la famille en tant que principale forme de vie légitimée dans la société occidentale. La promotion de formes de vie alternatives (favorisant les minorités) et, à l'inverse, la discrimination de la famille traditionnelle et du mariage en tant qu'élément institutionnel central (désavantageant la majorité) dans les actions de nombreux États en sont la preuve.
Régulation de la pensée
Si la régulation du langage et la régulation des comportements sont des symptômes très évidents, et faciles à décrire, de la présence du discours du politiquement correct, son caractère totalitaire ne devient apparent que dans la troisième étape de sa progression : la régulation de la pensée. Pourtant, c'est précisément l'atteinte d'un état d'autorégulation totale de la pensée, la définition de nouveaux critères moraux et la prise de conscience de ce qui est ou n'est pas acceptable et approprié qui constituent le but ultime du politiquement correct. À cet égard, le politiquement correct a eu plus de succès que les régimes totalitaires classiques, qui se concentraient le plus souvent uniquement sur la réglementation du langage et du comportement.
Le stade de l'autorégulation ne nécessite plus d'intervention extérieure et le politiquement correct n'a plus besoin de soutien institutionnel extérieur (par exemple dans les médias publics, les partis politiques et les ONG). L'étendue du niveau d'autorégulation atteint est révélée par des enquêtes d'opinion publique comportant des questions choisies de manière appropriée. Lorsque l'opinion publique a été sondée en Allemagne après la récente affaire dite Hohmann (1), la majorité des personnes interrogées (80 %) ont exprimé leur profond désaccord avec les opinions de cet homme politique conservateur. Peu après, l'opinion publique a été sondée sur les opinions de Hohmann sans le nommer explicitement, et un groupe tout aussi important (80 %) les a approuvées. Cette enquête a donc démontré que la population avait déjà accepté les attitudes politiquement correctes médiatisées envers le porteur spécifique du message (Hohmann), mais pas envers le message lui-même, qui n'était pas encore dans la sphère du tabou autorégulateur.
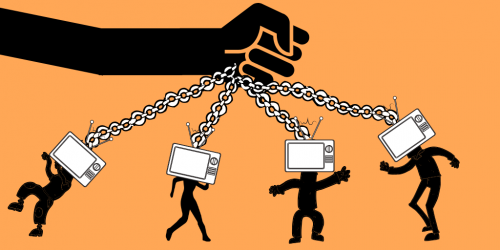
Dans la régulation de la pensée, les médias jouent un rôle central, et presque entièrement les médias publics, qui sont coordonnés par la sphère politique et en même temps ne sont pas liés par la loi de l'offre et de la demande. Au lieu de fournir un divertissement, leur objectif est d'éduquer et de former le public, bien sûr dans l'esprit des élites intellectuelles qui les influencent. Les médias de service public sont également les propagateurs de mythes et de stéréotypes modernes qui, contrairement aux stéréotypes culturels classiques, revendiquent une vérité universelle et incontestable.
Un exemple de ce "stéréotype à l'envers" est la thèse de la discrimination salariale présumée à l'encontre des femmes, qui atteint en République tchèque le niveau d'un écart salarial de vingt-cinq pour cent. En réalité, cette différence au sein d'une même profession (et c'est seulement là qu'elle peut être constatée) ne dépasse pas 4 %, selon les statistiques officielles du ministère du travail et des affaires sociales. La différence d'un quart de point souvent citée n'est due qu'à la répartition différente de la main-d'œuvre féminine et masculine dans les différentes professions (féminisation de certains secteurs, comme l'éducation, et masculinisation d'autres, comme la métallurgie et l'extraction de minéraux et de charbon). Néanmoins, l'allégation susmentionnée de discrimination salariale monstrueuse à l'encontre des femmes se retrouve dans les documents officiels et les présentations médiatiques et fonctionne selon les principes d'un stéréotype bien ancré. Cependant, il n'est pas permis de le nier - c'est politiquement incorrect, avec tout ce que cela comporte comme classification.
Un exemple similaire est celui des stéréotypes de la soi-disant correction historique - un symptôme classique de la correction politique en Allemagne. Ses règles rendent impossible la recherche historique sur certaines questions du passé. Certaines vérités sont considérées comme immuables et les recherches à leur sujet ne sont pas autorisées (par exemple, le sujet de certains crimes commis par l'Armée rouge sur le front de l'Est pendant la conquête de l'Allemagne nazie a longtemps été tabou et sa recherche même était "historiquement incorrecte").
Lorsqu'une exposition sur les crimes de la Wehrmacht a été organisée en Allemagne il y a quelques années, son intention et le matériel présenté étaient incontestables en Allemagne, même si de nombreux experts étaient conscients des difficultés fondamentales du concept. En raison de l'objectif de l'exposition - montrer la criminalité de l'armée allemande (encore considérée dans les années 1950 et 1960 comme une organisation non criminelle à la suite des conclusions du tribunal de Nuremberg) -, rien ne pouvait être contesté qui puisse nuire à sa réalisation. Seul l'historien polonais Bogdan Musial a perturbé le concept de l'exposition en soulignant le fait (connu de nombreux experts, mais pas officiellement déclaré) que, dans de nombreux cas, les images représentant des crimes brutaux ne mettaient pas en scène des soldats allemands, mais des membres de l'Armée rouge et du NKVD. Il est intéressant de noter qu'aucun des centaines de milliers de visiteurs allemands, souvent d'anciens soldats, n'a fait remarquer la différence évidente entre les uniformes sur les photos (ces uniformes n'étaient clairement pas allemands). L'institutionnalisation de la prétention à la vérité dans le régime du politiquement correct rend impossible la négation d'un mensonge flagrant si une telle négation compromet les objectifs du politiquement correct.
Conclusion : Le politiquement correct comme élément du totalitarisme pluraliste
À ce stade, nous pouvons revenir à la question initiale : est-il possible de voir dans le politiquement correct un élément de tendances totalitaires au sein de l'État démocratique libéral moderne ?
Comme je l'ai dit dans l'introduction, pour les théoriciens classiques du totalitarisme, Arendt, Friedrich et Brzezinski, l'ordre démocratique est absolument opposé au totalitarisme. Bien entendu, la définition structurelle-fonctionnelle du totalitarisme ne nous permet pas de considérer le régime du politiquement correct comme totalitaire, puisqu'il ne remplit que deux des six éléments nécessaires au totalitarisme : l'élément idéologique et le monopole de l'information.
Une perspective quelque peu différente est toutefois fournie par la conception du totalitarisme telle qu'elle a été exposée par les représentants de l'école de sociologie de Leipzig, qui voyaient dans le totalitarisme un produit logique de la société industrielle moderne. Selon Arnold Gehlen et Hans Freyer, l'ordre social industriel contient des éléments totalitaires immanents. Hans Freyer parle dans ce contexte de systèmes dits "secondaires". Alors que l'ordre social traditionnel des temps pré-modernes est construit "auf gewachsenem Grunde" (métaphore de la continuité avec la nature : "sur une base de développement organique"), la société moderne est basée sur des "systèmes secondaires". Freyer les considère comme des "types idéaux" qui permettent d'isoler et d'analyser certains des éléments individuels de l'ordre social moderne : avant tout, les systèmes de production, de consommation et d'administration.
La production est fondée sur la tentative d'organiser et de distribuer le travail, de rationaliser tous les facteurs de production et de transformer le travailleur en une machine à travailler. La consommation est basée sur le principe de tout offrir à tout le monde, selon le slogan: "le niveau de vie est le dieu de l'époque et la production est son prophète". Enfin, le système d'administration apporte un nouveau type d'autorité - l'administration bureaucratique remplaçant les autorités naturelles de l'ère pré-moderne. Les systèmes secondaires créent un nouveau type d'homme, sans valeurs traditionnelles et sans base naturelle. Le totalitarisme trouve un terrain fertile à ce stade, selon Freyer, car il fournit des réponses faciles aux complexités de l'ordre social actuel et trouve un coupable spécifique pour les maux de notre temps : le juif, le capitaliste, le koulak. Le système administratif moderne accroît la menace du totalitarisme et facilite l'application de mécanismes totalitaires dans toutes les sphères de la vie humaine.
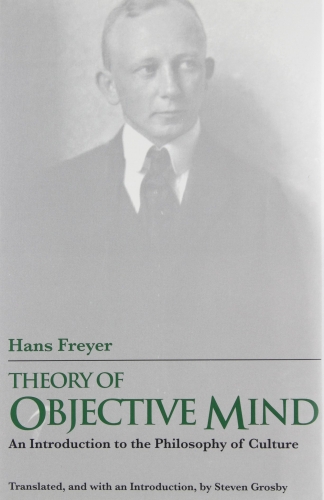
Freyer voit deux formes résultantes de l'État moderne : l'État totalitaire classique à l'Est, l'État providence à l'Ouest. Mais si Freyer considère que l'État-providence occidental est bénéfique dans le cadre des possibilités offertes par la modernité, Gehlen et Schelsky s'appuient sur ce concept en considérant que l'État-providence est également secrètement totalitaire. En effet, à la différence de l'État antérieur, l'État providence a pour objectif de fournir à l'homme la couverture de tous ses besoins sociaux et culturels, mais en même temps de contrôler ces besoins et les domaines correspondants. Cette idée est notamment développée par Roland Huntford, qui, sur la base d'une analyse du modèle suédois, conclut que le système de protection sociale constitue la base d'un nouveau totalitarisme conduisant à la croissance de la planification, de la bureaucratie et du conformisme des médias de masse.
Si le politiquement correct est analysé dans le contexte de cette théorie sociologique du totalitarisme de Leipzig, son essence apparaît sous un jour nouveau. Le politiquement correct est ici un produit spécifiquement occidental, issu des valeurs libérales classiques, mais qui les détruit en même temps. Le libéralisme classique, appliqué à la sphère des valeurs, a conduit à la relativisation de valeurs jusqu'alors considérées comme indiscutables et universelles. Le politiquement correct consiste dans le fait que cette relativisation revendique un caractère universel et s'absolutise (selon les termes du pape Benoît XVI, quand il été encore appelé cardinal Ratzinger).
C'est, après tout, le paradoxe bien connu de la philosophie post-structuraliste, qui élève sa thèse de la non-existence de la vérité au rang de révélation incontestable. Ce faisant, il se détourne du libéralisme classique et détruit même les libertés traditionnelles dont il dépend (liberté d'expression, liberté de pensée, liberté de religion). Dans le même temps, cependant, nous observons une ligne de développement cohérente depuis les Lumières et le libéralisme classique jusqu'au totalitarisme relativiste. Dans ce contexte, nombreux sont ceux qui se souviennent du célèbre dilemme de Böckenförde, selon lequel l'État laïque moderne est construit sur des principes qu'il ne peut garantir lui-même. En effet, ce dilemme peut être appliqué sans faille à la société moderne post-Lumières elle-même.
L'hypothèse selon laquelle le totalitarisme relativiste est peut-être plus modéré que le totalitarisme classique du passé est, bien sûr, erronée. Les principes des deux systèmes sont identiques. Le politiquement correct remet en question toutes les vérités, sauf celle qui prétend qu'il n'y a pas de vérité. Cette vérité, cependant, est universellement valable et sa négation est inacceptable. C'est également la base de l'application concrète des règles du politiquement correct à la vie de l'individu et de la société. Toutes les sources traditionnelles de la vérité et ses supports institutionnels doivent être détruits.
C'est la justification du fait que j'ai affirmé au début de cette étude sur la base d'une analyse empirique : le principal ennemi du politiquement correct est l'identité, en tant qu'élément institutionnalisant de la vérité. Sans identité, il n'y a pas de vérité. Et comme le politiquement correct est un phénomène occidental, l'ennemi est avant tout l'identité de l'Occident, c'est-à-dire la culture occidentale elle-même. Cet ennemi est certes désincarné, mais dans sa fonction de coupable systémique et d'ennemi universel, il remplit pour le politiquement correct la même fonction que le juif pour le nazisme ou le capitaliste pour le communisme. Par conséquent, il remplit pleinement les conditions de la conception du totalitarisme de Freyer.
La seule différence réside dans le fait que le politiquement correct est un élément qui découle de la tradition du système libéral-démocratique post-Lumières. Devenu la seule forme de gouvernement universellement légitime dans le monde après la fin de la guerre froide, et ayant ainsi perdu la raison de définir ses origines civilisationnelles contre un Orient dominé par le totalitarisme, ce système s'est en même temps livré au règne du politiquement correct, qui détruit les fondements sur lesquels repose le système libéral-démocratique, bien plus efficacement que n'importe quelle force armée extérieure.
Notes :
(1) L'acteur de cette affaire, un membre du Bundestag pour la région de Fulda, en Allemagne, a contesté il y a plusieurs années la thèse selon laquelle le peuple allemand est collectivement responsable de l'Holocauste et que cette culpabilité fait partie de l'identité allemande. Hohmann a étayé son affirmation en disant que défendre un tel point de vue revient à essayer de rendre les Juifs responsables de la révolution russe simplement parce que la plupart de ses dirigeants étaient juifs. Selon Hohmann, les deux approches sont tout aussi absurdes l'une que l'autre. Sur la base de ces déclarations, Hohmann a été exclu de la CDU et du Bundestag.
Conférence de Vojtěch Belling, PhD, au séminaire de l'Institut civique "Le monde 4 ans après le 11 septembre", 14 octobre 2005. Adapté du magazine Distance n° 3/2005.
11:39 Publié dans Actualité, Philosophie, Sociologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, sociologie, philosophie, philosophie politique, politiquement correct |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 14 novembre 2021
Le privilège blanc – entretien avec Georges Guiscard
19:52 Publié dans Actualité, Entretiens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges guiscard, actualité, privilège blanc, problèmes contemporains |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Tatarstan : la dernière démarche séparatiste

Tatarstan : la dernière démarche séparatiste
Alexandre Douguine
Ex: https://www.geopolitica.ru/article/tatarstan-posledniy-demarsh-separatizma
Six députés de la Douma du Tatarstan représentant le parti Russie Unie ont voté contre la loi sur le système unifié de l'autorité publique. L'élément principal de cette loi est qu'elle interdit aux chefs des entités régionales d'être appelés "présidents" et accorde au président russe le droit de les démettre de leurs fonctions. Le Tatarstan est actuellement la seule entité constitutive de la Fédération de Russie où le chef de l'État est encore appelé "le président".
Les députés nationalistes ont été soutenus par un certain nombre de médias du Tatarstan, menaçant de ne pas utiliser le nom officiel du chef de la République et de continuer à l'appeler "Président du Tatarstan".
Je suppose que c'est le dernier vestige de séparatisme dans l'histoire récente de la Russie. C'était une toute autre affaire, beaucoup plus alarmante et risquée pour le destin de la Russie.
Permettez-moi de vous rappeler qu'après l'effondrement de l'Union soviétique, le processus de désintégration de la Fédération de Russie a été lancé. Presque avec le consentement du centre fédéral, certains sujets ont commencé à réfléchir à leur souveraineté complète. Cela a d'abord touché la Tchétchénie, où une véritable guerre a éclaté, mais en même temps, la Yakoutie, le Tatarstan et la Bachkirie étaient sur la même voie. Il s'agissait de sujets qui revendiquaient non seulement le statut de républiques nationales mais aussi, en fait, d'États nationaux indépendants. D'où l'attention portée aux langues nationales, au statut du président et aux autres attributs de la souveraineté. La Yakoutie a même annoncé la création de sa propre armée et la délivrance de visas aux autres citoyens russes pour qu'ils puissent visiter la République.

En fait, le processus n'a été ralenti que par la guerre en Tchétchénie, lorsque Moscou, malgré les sympathies précoces du président Boris Eltsine pour le séparatisme au sein de la Fédération de Russie (la célèbre phrase d'agitation adressée aux sujets de la Fédération - "prenez autant de souveraineté que vous voulez"), s'est encore prononcé assez durement (bien que de manière incohérente) contre la tentative de sécession de la République tchétchène. Le Tatarstan, la Bachkirie et, dans une certaine mesure, la Yakoutie ont observé de près la manière dont l'intégrité territoriale de la Russie était préservée afin de choisir le moment et d'annoncer leur sécession de la Fédération de Russie. Mais voyant l'attitude dure de Moscou, ils ont préféré attendre et ne pas aggraver la situation.
Telle était la situation dans les années 1990.
Poutine, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, était vraiment occupé à démanteler ces sentiments séparatistes dans les régions. La deuxième campagne tchétchène s'est soldée par une victoire, qui a mis fin au problème du séparatisme en Tchétchénie et a fait des citoyens de la République tchétchène les patriotes les plus fidèles à Moscou. Elle a conduit à une modification de la loi concernant les républiques nationales, conformément à la reconnaissance de l'indivisibilité et de l'intégrité territoriale de la Fédération de Russie. En fait, les districts fédéraux ont été introduits à cette fin, le Conseil de la Fédération a été affaibli et le Conseil d'État a été créé. Poutine a constamment - étape par étape - éradiqué tout soupçon de souveraineté des entités constitutives de la Fédération.

Dans les années 2000, Poutine a poursuivi ces réformes et a proposé de supprimer toute allusion à la souveraineté afin d'éradiquer tout séparatisme résiduel, qui avait survécu au moins nominalement dans l'esprit de l'intelligentsia et des élites de certaines régions nationales, dont le Tatarstan. Dans le même ordre d'idées, l'idée de changer le statut du "président" d'une république ou d'une entité constitutive de la Fédération de Russie en celui de "leader". De cette manière, un autre nom symbolique a été aboli, qui aurait permis aux républiques nationales d'être considérées comme des États indépendants, ne serait-ce que dans un avenir lointain.
 Mais au Tatarstan, il y avait un front nationaliste très fort et même un sentiment islamique extrémiste. Sous le premier président de la république, Mintimer Shaimiev, il y avait le théoricien Rafael Khakimov (photo), que j'ai rencontré dans les années 1990 et au début des années 2000. Lui et beaucoup d'autres comme lui au Tatarstan étaient de fervents partisans de l'indépendance des Tatars. À l'époque, dans les années 90, le nationalisme tatar - ou plutôt tatarstanais - était en plein essor.
Mais au Tatarstan, il y avait un front nationaliste très fort et même un sentiment islamique extrémiste. Sous le premier président de la république, Mintimer Shaimiev, il y avait le théoricien Rafael Khakimov (photo), que j'ai rencontré dans les années 1990 et au début des années 2000. Lui et beaucoup d'autres comme lui au Tatarstan étaient de fervents partisans de l'indépendance des Tatars. À l'époque, dans les années 90, le nationalisme tatar - ou plutôt tatarstanais - était en plein essor.
Et au cours de ces 30 années, des élites politiques et économiques se sont formées dans la république. Aujourd'hui, tout le monde comprend à quel point Moscou, Poutine et les sentiments centripètes sont forts, mais les Tatars ne sont toujours pas prêts moralement à l'abolition du statut présidentiel.
C'est pathologique, à mon avis, parce que :
1) la moitié de la population du Tatarstan est russe,
2) plus de la moitié des Tatars vivent parfaitement bien dans d'autres régions de la Fédération de Russie et se sentent comme des citoyens à part entière.
Il n'y a aucune pression sur l'identité tatare nulle part, pas la moindre. Les Russes les considèrent comme des frères dans la création d'un État eurasien commun. Il existe peut-être un dialogue assez tendu entre les Tatars et les Bachkirs en Bachkirie, mais il s'agit d'une polémique interne entre les ressortissants de ces ethnies turques.
Les Tatars en général sont définitivement loyaux envers la Russie et les Russes, et vice versa.
Je crois que cette ligne d'abolition des oripeaux de la souveraineté doit certainement être poursuivie jusqu'au bout. Autrement dit, les députés et les journalistes tatars doivent être convaincus qu'ils sont guidés par une douleur fantôme et que l'ère de Shaimiev, de Khakimov et du nationalisme tatar est révolue et ne reviendra jamais. Et que s'ils veulent respecter les règles et être tournés vers le futur, ils doivent abandonner complètement leur entêtement pour toujours - même dans leurs rêves. La presse, qui continuera à désigner le chef du Tatarstan par le terme "président", devrait être reconnue comme un agent étranger.

Maintenant, il me semble que c'est la bonne situation pour que Moscou agisse un peu plus durement. Cela ne veut pas dire plus de manière plus grossière ou plus agressive. Nous devons tenir votre position calmement, avec dignité. Les Tatars russes (y compris les natifs du Tatarstan), quelle que soit la région où ils vivent, sont de bons citoyens, loyaux et patriotes. On ne cherche jamais le bon côté des choses et, dans un sens, je prendrais probablement des mesures disciplinaires contre certains des membres les plus agressifs du Parlement. Bien sûr, ils n'ont aucune chance d'arriver à leurs fins, mais tout de même, la démarche ressemble à de l'atavisme et à un front complètement inutile et superflu.
L'époque où il y avait de forts sentiments nationalistes, russophobes et séparatistes au Tatarstan (avec des éléments de l'islam extrémiste salafiste) est révolue depuis longtemps. Complètement, irrévocablement. Tout débordement de tels sentiments me semble inapproprié. Moscou devrait agir de manière très cohérente ici.
Le Tatarstan est une partie fière et merveilleuse de la Russie. Même s'il existe des vestiges de cercles nationalistes parmi les députés et les journalistes, cela ne signifie pas qu'il s'agit de toute la république. Nous parlons d'un segment très étroit qu'il est temps, à mon avis, d'encadrer.

12:14 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre douguine, actualité, tatarstan, russie, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Vaste mouchardage d’Est en Ouest

Vaste mouchardage d’Est en Ouest
par Georges FELTIN-TRACOL
Les journaux radio-télévisés ont confirmé l’information : le coupon papier de la RATP nécessaire pour prendre le bus, le métro ou le tram ne se vend déjà plus à l’unité dans de nombreuses stations. À terme, il doit disparaître définitivement et se faire remplacer par des équivalents dématérialisés. Le plus courant consiste dès à présent à régler depuis un téléphone portatif intelligent à l’instar du QR-code de l’Ausweis sanitaire.
Sous prétexte de combattre à la fois la fraude, le réchauffement climatique, les coûts d’impression et peut-être la nuit, cette mesure restreint encore plus la liberté de circulation déjà bien malmenée par le covidisme politique. Autorité de tutelle sur la RATP et les Transiliens de la SNCF, Île-de-France Mobilités qui dépend du conseil régional présidé par Valérie Pécresse alias Madame « deux tiers Merkel un tiers Thatcher », soit la quintessence de la droite libérale autoritaire atlantiste & globalitaire, ignore volontiers les usagers âgés qui ne disposent pas de smartphone ou qui ne sont que des voyageurs occasionnels.
La numérisation des titres de transport à l’heure de la hausse des prix du carburant automobile contribue au flicage généralisé de la population. Associé à la télé-surveillance qui scrute la voie publique, aux signaux émis au passage de chaque antenne-relais de la téléphonie mobile et aux billets de train sur longue distance nominatifs, le ticket virtuel va faciliter la reconstitution des déplacements de Monsieur Bidule, leurs durées, leurs fréquences, leurs arrêts, voire d’éventuelles rencontres.
Cette tendance inquiétante n’appartient pas au seul Hexagone. Londres infesté de milliers de caméras transforme le quotidien de ses habitants en une indécente émission de télé-réalité permanente. Quitte à indisposer les poutinolâtres les plus obtus, Moscou rivalise dans ce domaine avec la capitale britannique. Pire, depuis quelques semaines, le métro moscovite accepte une nouvelle manière d’emprunter ce moyen de transport. Finis le ticket-papier, la carte magnétique et le téléphone ! Bonjour la reconnaissance faciale ! L’utilisateur russe télécharge l’application, se prend en photographie et l’envoie à l’unité centrale. Quelques minutes plus tard, il se présente devant un portique spécial qui filme son visage, lui ouvre ensuite la porte et débite à l’instant sur son compte bancaire le montant prévu. Le suivi en direct de millions de personnes tous les jours alimente des bases de données gigantesques et aide les algorithmes de l’intelligence artificielle à cribler statistiquement les cas problématiques.
 Le groupe Auchan vient de commencer en banlieue parisienne une expérience inouïe au sein d’une école d’ingénieurs. Il a en effet inauguré un magasin d’alimentation ouvert vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept en libre-service sans aucune caisse enregistreuse. On entre dans le magasin. La reconnaissance faciale enregistre et comptabilise tout ce qu’on prend. On sort sans payer. Le total des achats est débité automatiquement du compte. Vantées comme des gages de rapidité, ces initiatives participent à la raréfaction volontaire des espèces monétaires. Pièces de monnaie et billets de banque circulent moins. La pandémie a favorisé le paiement sans contact et les achats en ligne. Les établissements bancaires ferment de nombreux distributeurs, officiellement pour des motifs de rentabilité, surtout dans les zones rurales et péri-urbaines. Jacques Attali préconise, pour sa part, la fin de l’argent liquide dans les cinq prochaines années. Pourquoi cet empressement suspect ? Ne faudrait-il pas que les candidats à l’élection présidentielle proposent d’inscrire dans la Constitution le droit inaliénable de payer en espèces ? Sinon il faut s’attendre à voir bientôt le banquier exiger qu’on lui justifie ses dons militants avec la menace réelle de fermer le compte bancaire sans donner la moindre justification…
Le groupe Auchan vient de commencer en banlieue parisienne une expérience inouïe au sein d’une école d’ingénieurs. Il a en effet inauguré un magasin d’alimentation ouvert vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept en libre-service sans aucune caisse enregistreuse. On entre dans le magasin. La reconnaissance faciale enregistre et comptabilise tout ce qu’on prend. On sort sans payer. Le total des achats est débité automatiquement du compte. Vantées comme des gages de rapidité, ces initiatives participent à la raréfaction volontaire des espèces monétaires. Pièces de monnaie et billets de banque circulent moins. La pandémie a favorisé le paiement sans contact et les achats en ligne. Les établissements bancaires ferment de nombreux distributeurs, officiellement pour des motifs de rentabilité, surtout dans les zones rurales et péri-urbaines. Jacques Attali préconise, pour sa part, la fin de l’argent liquide dans les cinq prochaines années. Pourquoi cet empressement suspect ? Ne faudrait-il pas que les candidats à l’élection présidentielle proposent d’inscrire dans la Constitution le droit inaliénable de payer en espèces ? Sinon il faut s’attendre à voir bientôt le banquier exiger qu’on lui justifie ses dons militants avec la menace réelle de fermer le compte bancaire sans donner la moindre justification…
Cependant, la fin des espèces ne sera pas complète en raison du trafic de drogue. Les toxicomanes préféreront toujours acheter leur dose en cash. Maints réseaux criminels financent sections locales de certains partis politiques, édiles et fonctionnaires municipaux. Il serait difficile aux clients d’utiliser des cryptomonnaies, fort volatiles du point de vue de la valeur, dont la conversion en monnaie légale nécessiterait d’expliquer la provenance des sommes. Le Système ne veut surtout pas scier la branche sur laquelle il est assis...

Oui, le constat avancé n’est guère optimiste. Le summum du contrôle cybernétique concerne la Chine. L’usage privilégié du code social permet l’impensable : domestiquer un milliard et demi d’habitants. Autrefois, on fuyait la campagne et son village pour trouver un doux et plaisant anonymat en ville. Aujourd’hui, c’est dans les métropoles que le Système surveille nos moindres faits et gestes en attendant d’écouter nos conversations. Des municipalités françaises ont tenté l’installation de « capteurs sonores » dans des quartiers dits « sensibles ». Il s’agit d’enregistrer tous les bruits jugés « anormaux » (carambolages automobiles, cris pendant une agression, klaxons lors d’un embouteillage). Ces capteurs peuvent aussi analyser les slogans qui fusent au cours d’une manifestation ainsi que des discussions tenues sur le trottoir entre particuliers. La justice administrative a néanmoins considéré ce procédé trop intrusif par rapport à la vie privée. Remarquons que les enceintes connectées à son domicile effectuent le même travail de compilation des données.
En Corée du Sud, dans les villes nouvelles à haute technicité, on entre dans son appartement, on conduit sa voiture, on paie ses commissions avec une seule et même carte qui transmet en permanence à l’ordinateur central des centaines d’actions amassées et répertoriées. L’ordinateur sait par exemple que le résident de l’appartement MZ du 10e étage est rentré à 20 h 15, qu’il a pris une douche de sept minutes trente-sept secondes, qu’il a regardé un épisode sur Netflix, qu’il a utilisé son micro-onde pour chauffer un produit surgelé acheté la vieille et qu’il s’est couché à 23 h 04.
À l’ère de l’hyper-(inter)connexion globale, la vidéo, le numérique et l’intelligence artificielle deviennent des mouchards zélés. En 1951, Ernst Jünger publiait son traité du rebelle intitulé Le recours aux forêts. Un tel recours intérieur est-il encore possible ?
GF-T
- « Vigie d’un monde en ébullition », n° 9, mise en ligne sur Radio Méridien Zéro, le 9 novembre 2021.
11:44 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, surveillance, problèmes contemporains |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
La revue de presse de CD 14 novembre 2021

La revue de presse de CD
14 novembre 2021
CHINE
La Chine continue de bénéficier de l'aide française au développement : un député LR proteste
Un bel exemple d’absurdité technocratique qui fait rire jaune ! Le député Les Républicains Marc Le Fur a exprimé son étonnement devant le fait que la Chine bénéficie encore de l’aide française au développement, alors qu'elle est en passe de devenir la première puissance économique mondiale.
rt.com
https://francais.rt.com/international/92552-chine-continu...
ÉTATS-UNIS
Julian Assange : Portrait d’un combattant de la liberté d’information
Avant Edward Snowden, avant Bradley Manning, il y avait Julian Assange. Ancien informaticien et hacker, fondateur de la plateforme WikiLeaks, Julian Assange s’est attiré les foudres du gouvernement américain lorsqu’il a mis en lumière les dessous de la guerre d’Irak. En 2010, il fait fuiter près de 400 000 documents classifiés de l’armée américaine, portant sur le conflit qui a débuté en mars 2003. Tortures, crimes de guerre, massacres sont révélés au grand public. Ces documents permettent aussi de chiffrer à 109 032 le nombre de morts irakiens causés par le conflit de 2004 à 2009, dont 60 % de civils, alors même que les États-Unis vendaient aux médias « les frappes chirurgicales » et affirmaient ne pas disposer d’un tel bilan chiffré. L’épée de Damoclès de la demande d’extradition américaine pèse sur l’activiste, à la santé désormais précaire, alors qu’il est incarcéré dans une prison de haute sécurité britannique depuis 2019, au grand dam de ses nombreux soutiens à travers le monde.
OJIM
https://www.ojim.fr/portraits/julian-assange-master-hacke...

GAFAM
Quand une lanceuse d’alerte se transforme en censeur, le cas Frances Haugen
Frances Haugen ? Une ancienne employée de Facebook – devenu “Meta” – qui se retourne contre son employeur ; non pas parce que celui-ci détricote savamment la liberté d’expression, mais parce qu’il ne censure pas assez bien.
OJIM
https://www.ojim.fr/lanceuse-dalerte-frances-haugen-faceb...
GÉOPOLITIQUE
L’empire de la haute finance avale les institutions supranationales et s’installe. Au nom du climat
Quand les PDG de BlackRock, de la Citi, de la Bank of America, de Banco Santander, de HSBC, du London Stock Exchange Group, Singapore Exchange, et du Fonds David Rockefeller se réunissent en 2021, ils s’entendent sur la nouvelle structure de Planète Finance post-Covid. Et idéalement, ils fusionnent avec les institutions supra gouvernementales qu’ils ont manipulées à l’envi depuis les Accords de Bretton Woods.
Le blog de Liliane Held Khawam
https://lilianeheldkhawam.com/2021/11/06/lempire-de-la-ha...
Grande-Bretagne
Liberté d’expression sur internet : le Royaume-Uni veut y mettre fin
Un projet de loi au Royaume-Uni prévoit de la prison pour certains propos. Une menace sérieuse pour la liberté d’expression sur internet.
Contrepoints
https://www.contrepoints.org/2021/11/08/411036-liberte-de...
RÉFLEXION
Comment les cercles économiques et financiers se laissent convaincre avec complaisance
Il est de plus en plus généralement allégué que notre civilisation court à sa perte après avoir molesté la Nature par négligence de l’environnement, du climat, des espèces animales et végétales, de la santé publique, et de la justice envers tous les opprimés. Que ce diagnostic soit majestueusement faux, donc mensonger, n’y change rien. La nouvelle doxa politique décrète l’urgence et, quoi qu’il en coûte, s’achemine vers un état d’exception permanent sans que, bien sûr, aucune volonté démocratique ne soit consultée puisque c’est prétendu « scientifique ».
Le blog de Michel de Rougemont
https://blog.mr-int.ch/?page_id=8023
Nous nous dirigeons vers la tyrannie mais ce n'est pas le fascisme, c'est l'hyperdémocratie
Et ainsi de suite. Des années de rhétorique démocratique ont déshabitué les esprits, surtout les plus jeunes et les plus influents, à l'esprit critique, au raisonnement dans son ensemble, à la lecture de la profondeur historique des faits, à toute conjecture qui ne soit pas purement subjective. Cela a créé une tache informe qui engloutit la démocratie elle-même. Mais ce qui nous sera recraché ne sera pas du tout le fascisme, qui n'a rien à voir avec lui et reste le "tout autre" par rapport à ce monde. Au contraire, nous aboutirons à une forme d'hyperdémocratie féroce, technocratique, policière, mais toujours considérée comme bonne, très, très bonne.
Euro-synergies
http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2021/11/05/n...

Complots, Fake news : défendre la pensée critique face au conformisme
La pensée critique est plus importante que jamais à une époque où le pouvoir établi accuse de théorie du complot les voix qui sont contraires à leurs intérêts.
Contrepoints
https://www.contrepoints.org/2021/11/10/411057-complots-f...
SANTÉ
OMS, ONU : la peur, fondement de l’intervention publique
Qu’il s’agisse des restrictions des libertés ou de l’accroissement de dépenses publiques à l’intérêt rarement prouvé, du niveau local, national ou mondial, la peur constitue toujours un moteur puissant d’accroissement de la sphère publique au détriment du bon sens et de nos libertés. L’ONU et l’OMS l’ont une nouvelle fois démontré. Explications.
Contrepoints
https://www.contrepoints.org/2021/11/09/411172-oms-onu-la...
Theresa Long, médecin de l’armée américaine, alerte sur la vaccination contre le Covid-19
"Je pense que le vaccin contre le COVID est une plus grande menace pour la santé des soldats que le virus lui-même", déclare le lieutenant-colonel Theresa Long, médecin de l'armée américaine.
francesoir.fr
https://www.francesoir.fr/politique-monde/lt-colonel-ther...
Fausse pandémie ! L’arnaque Covid est pire que ce que l’on a pu imaginer !
Covid = 2 % des hospitalisations en 2020. Étonnant, non ? Nous avons aujourd’hui, grâce à un rapport de la AITH, la preuve écrite de tous les mensonges que nos autorités, et leurs collaborateurs des médias de masse ainsi que les scientifiques financiarisés, nous ont servis depuis plus de 18 mois.
Le blog de Liliane Held Khawan
https://lilianeheldkhawam.com/2021/11/11/fausse-pandemie-...
TERRORISME
Attentats du 13 novembre : Bachar al-Assad dénonce le soutien de la France au terrorisme
Deux interviews - très révélatrices du climat de l’époque - de Bachar al-Assad et quelques vidéos pour mémoire juste après les massacres islamistes dans Paris…
Le Cri du Peuple
https://lecridespeuples.fr/2021/11/13/attentats-du-13-nov...

UNION EUROPÉENNE
L’e-Euro : outil de souveraineté européenne
Faut-il le rappeler, la monnaie est un instrument souverain émis par une autorité monétaire disposant, dans le meilleur des cas, d’une indépendance lui permettant de gérer la valeur de cette monnaie loin des contingences du politique. Cette souveraineté monétaire ne se limite pas au seul droit d’émettre, mais s’étend au droit de réglementer c’est-à-dire, entre autres, d’en contrôler la masse en circulation, sa valeur et d’avoir un droit de regard sur certains champs de son utilisation s’agissant notamment des flux externes pour lesquels des contreparties étrangères se voient dès lors opposer des lois monétaires nationales.
Geopragma
https://geopragma.fr/le-euro-outil-de-souverainete-europe...
11:31 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, france, affaires européennes, journaux, médias, presse |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 10 novembre 2021
Les appareils Atlantic français à Chypre : Paris renforce sa position en Méditerranée orientale

Les appareils Atlantic français à Chypre : Paris renforce sa position en Méditerranée orientale
par Paolo Mauri
Ex: https://it.insideover.com/difesa/atlantic-francesi-a-cipro-parigi-si-rafforza-nel-mediterraneo-orientale.html
Le ministère français de la défense a annoncé que deux avions de patrouille maritime Bréguet Atlantic 2 seront déployés à Chypre pour des opérations en Méditerranée orientale. Le Bréguet Br 1150 Atlantic est un avion de patrouille maritime à long rayon d'action conçu et fabriqué par Bréguet Aviation, qui est utilisé pour contrer les navires de surface et les sous-marins. Une version améliorée, l'Atlantic 2 ou Atl2, a été produite par Dassault Aviation pour la marine française dans les années 1980 et a également été proposée à l'Allemagne comme solution provisoire en attendant que le Maws, le nouvel avion de patrouille maritime construit conjointement avec Berlin, soit prêt, ce qui a ensuite été définitivement enterré par la décision allemande de s'appuyer sur le P-8 Poseidon de fabrication américaine. L'Atlantic est un monoplan bimoteur à aile moyenne doté d'un fuselage à " double bulle " : le lobe supérieur pressurisé abrite le compartiment de l'équipage tandis que le lobe inférieur abrite un compartiment d'armement de 9 mètres de long, avec des tubes de lancement pour des bouées acoustiques à l'arrière.

Les pièges de la Méditerranée orientale
Ce n'est pas la première fois que l'Elysée envoie ses moyens dans ce secteur de la Méditerranée : le Rafale avait déjà été vu à Chypre et en Crète, mais dans le cadre de l'opération Irini (la mission de l'UE pour le contrôle de la partie centrale de la Mare Nostrum pour assurer, entre autres, l'embargo sur les armes à destination de la Libye), un Atlantic 2 a atterri sur la base aérienne de Suda en novembre dernier. À cette occasion, la présence des avions de patrouille maritime sur l'île grecque a également permis de recueillir des informations sur la Méditerranée orientale, où la Turquie est très active, voire agressive.
Nous pensons que la tâche principale de ces deux avions est précisément de surveiller les mouvements navals turcs, ainsi que l'activité des unités russes qui sont de plus en plus fréquentes et nombreuses dans cette partie de la mer. La Russie a en effet renforcé sa présence dans le port de Tartus, qui est devenu de plus en plus "russe" après les accords de prolongation de son bail avec le gouvernement de Damas, et l'on voit de plus en plus de sous-marins battant pavillon moscovite, tels que la classe Kilo améliorée (ou projet 06363), traverser Mare Nostrum.
Les objectifs de la France
Mais l'Elysée a un autre objectif, purement diplomatique : resserrer encore les liens avec la Grèce et se poser en rempart à sa défense contre d'éventuelles intempérances turques. L'année dernière, en septembre, nous avions souligné que Paris avait débloqué la situation en se rangeant ouvertement du côté d'Athènes lorsqu'elle a décidé de fournir un lot de chasseurs Rafale à l'armée de l'air grecque. Après tout, Paris a ses propres petites "sphères d'influence" : le dossier libyen a pratiquement été généré par l'Élysée, qui a décidé presque unilatéralement d'écarter Kadhafi du pouvoir. Aujourd'hui encore, Paris est particulièrement attentif à ce qui se passe en Libye et les premiers désaccords ouverts avec la Turquie sont apparus précisément en mer lors de l'opération Irini. La France accorde également une attention particulière à ses anciennes colonies du Moyen-Orient : la Syrie et le Liban, qui ont été - et sont encore - ces dernières années le théâtre de l'expansionnisme turc.

Les liens entre Paris et Athènes se sont encore renforcés en septembre de cette année, lorsque le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis et le Président français Emmanuel Macron ont signé un accord qui a été défini comme le "Aukus de la Méditerranée". La France, en effet, livrera trois frégates de classe FTI à la Grèce, avec une option pour une quatrième. Ces unités pourront opérer conjointement avec le Rafale susmentionné. Le pacte, en plus de mettre fin aux possibilités italiennes d'entrer sur le marché grec, a également une valeur diplomatique très forte : en effet, une clause est prévue qui garantit une intervention armée en cas d'attaques de pays tiers, même s'ils font partie d'alliances dans lesquelles Athènes et Paris sont impliqués. Il s'agit d'un message peu subtil adressé à Ankara, réitéré par la présence des deux patrouilleurs Atlantic 2 qui partiront de Chypre pour contrôler cette partie de la Méditerranée.
Le rôle de l'Italie
Nous ne pouvons que tourner nos pensées, sur la base de ce qui s'est passé, vers notre pays. L'Italie, bien qu'elle ait récemment signé l'accord sur la ZEE (zone d'exclusivité économique) avec la Grèce, a manqué l'occasion d'ouvrir un nouveau et important front méditerranéen qui nous aurait projetés, après la cession de l'Égypte et de Fremm au Caire, dans un rôle plus actif dans la surveillance et la stabilisation de ce secteur en exploitant la carte grecque, étant donné également nos intérêts énergétiques qui se situent précisément entre l'offshore chypriote et égyptien.
On ne peut pas non plus oublier le type de moyens que la France a déployé à Chypre : les Atlantic 2 sont des patrouilleurs maritimes armés, capables d'être des plates-formes efficaces dans la lutte anti-sous-marine et de surface, alors que notre pays, de ce point de vue, n'est plus en mesure de disposer de cette capacité puisque les P-72 en service dans l'armée de l'air sont d'excellentes plates-formes Istar (intelligence, surveillance, target acquisition, and reconnaissance), mais ne sont pas armés.
Il s'agit d'une lacune intolérable compte tenu du nouvel équilibre en Méditerranée et au-delà. Une déficience qui doit être surmontée malgré le retard coupable. Il semble que les états-majors nationaux aient travaillé pour trouver une solution à ce problème : on parle de C-27J Asw armés de missiles Mars ER et de torpilles MU90, ou encore, mais cela semble n'être qu'un souhait, du P-8 Poseidon (qui allongerait considérablement notre armement anti-som/Asuw) et du P-1 japonais, qui d'ailleurs représenterait la meilleure solution également pour les questions de partenariat stratégique au niveau industriel, mais tout est encore en discussion, et il n'y a aucune trace dans les documents officiels de la Défense.
Nous sommes convaincus que le ministère italien de la défense (SMD) agira rapidement pour proposer une solution aussi locale que possible, mais de haut niveau, afin de disposer d'un avion pour les tâches Asw/Asuw qui puisse également faire face aux menaces navales "hors zone" et pas seulement dans notre "arrière-cour".
18:55 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, affaires européennes, france, italie, méditerranée, méditerranée orientale, grèce |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 09 novembre 2021
L'utilisation politique de l'immigration illégale

L'utilisation politique de l'immigration illégale
Sergio Fernández Riquelme
Ex: https://lanuevarazon.com/el-uso-politico-de-la-inmigracion-ilegal/
Sans migrations légales, stables et assimilées, il n'y a pas d'avenir, en général, ni pour les personnes qui se déplacent vers un plus grand bien-être ni pour les sociétés qui doivent les accueillir.
Les migrations peuvent être naturelles ou artificielles, spontanées ou dirigées, par la grâce d'événements imprévus ou comme conséquence de stratégies étudiées par des puissances de signatures différentes. Lorsque la nécessité se fait sentir, il est difficile de mettre des barrières sur le terrain; nous bougeons et bougerons toujours, pour apprendre ou pour survivre. Mais lorsque le besoin se fait sentir, les mouvements naturels de population peuvent devenir les mécanismes habituels de pression interne et externe dont personne ne veut parler. C'est pourquoi la presse et le monde universitaire post-moderne justifient presque toujours le caractère inévitable et désinvolte des flux illégaux, en ignorant la réalité fonctionnelle qu'ils semblent présenter, pour la plupart, dans leur genèse et leur développement. Parce que cette fonctionnalité stratégique est démontrée aujourd'hui et toujours, malgré le silence politique ou social sur les causes réelles des drames et des rêves de millions de personnes qui veulent quitter leurs sociétés d'origine, et les conséquences de l'utilisation intéressée et intentionnelle de ces flux qui atteignent les sociétés d'accueil.
Nous parlons donc d'un outil démontré dans l'étude documentaire du passé et vérifié dans l'analyse empirique du présent (comme l'a analysé Giovanni Sartori) : déplacer des populations pour homogénéiser ethniquement un territoire ou pour envahir progressivement son voisin, pour avoir moins de bouches à nourrir ou pour faire taire celles des dissidents, pour obtenir des électeurs ou pour les enlever à l'adversaire, pour obtenir des intérêts économiques juteux face à la menace ou à l'exploitation.

À l'heure de la mondialisation, une grande partie de cette réalité répond à des plans parfaitement conçus dans la création ou la gestion des flux migratoires illégaux. Alors que le bon sens impose des mécanismes réglementés et légaux de contrôle migratoire, en fonction de la demande de main-d'œuvre et des possibilités d'intégration des sociétés d'accueil, certains pouvoirs et institutions promeuvent ce que Kelly M. Greenhill a défini comme "l'armement de la migration" (ou "arme de la migration de masse") : c'est-à-dire l'utilisation stratégique et intentionnelle dans la naissance et le fonctionnement des flux migratoires illégaux avec des objectifs de profit économique, d'intérêt politique ou de déstabilisation sociale. Mais à la lumière d'événements plus récents ou proches, nous pouvons aller plus loin, en la considérant comme un possible outil de coercition de bien plus grande importance: à l'extérieur, pour imposer des changements politiques à l'adversaire, en obtenant de lui des concessions politiques ou économiques, en influençant ses décisions ou en altérant l'intégrité territoriale elle-même; et à l'intérieur, en ouvrant les frontières ou en cessant de les contrôler pour faire baisser les salaires et augmenter la concurrence, étendre la précarité au profit du système, modifier les identités traditionnelles ou créer des convulsions sociales dont on pourra extraire des ressources ou de la légitimité.
Dans les nations africaines ou asiatiques, encore définies par le carré et le carré ethnique, nous pourrions trouver une sorte de paradigme classique : le déplacement massif et brutal, entre les guerres et les famines, de milliers et de milliers de personnes loin de chez elles, même à l'intérieur de leur propre pays dans ce qu'on appelle les "réfugiés internes" (et que nous, en Europe, avons connu dans toute sa dureté au 20ème siècle). Nous pourrions également envisager cette singularité dans les pays soumis à la néo-colonisation mondialiste, qui semblent être témoins de pressions frontalières, de changements identitaires et de quotas migratoires permettant d'influencer de manière décisive leur parcours politique souverain (de l'Est du vieux continent aux steppes eurasiennes).
Mais dans nos limes, celles de l'Occident, nous pourrions aussi analyser cette utilisation, bien qu'avec des formes différentes ou des temps changés, à notre avantage ou à notre détriment (au-delà de la thèse polémique du "Grand Remplacement" ou de la "Grande Substitution"). Six grandes affaires récentes permettent d'éclairer cette interprétation.

La Turquie a profité, en tant qu'"État tampon", de la crise migratoire qui a débordé des frontières européennes au plus fort de la guerre syrienne. Après que des centaines de milliers de personnes ont traversé l'Europe en quête d'un avenir meilleur, l'UE a conclu un accord avec le gouvernement de Recep Erdogan. Le 18 mars 2016, la déclaration UE-Turquie (ou "accord UE-Turquie") a été signée, un pacte selon lequel toutes les arrivées irrégulières sur les îles de la mer Égée, y compris les demandeurs d'asile, seraient renvoyées en Turquie en échange de plusieurs milliards d'euros de contreparties (pour atteindre à terme un maximum de quatre millions de réfugiés dans les camps ou villes ottomanes).
Face à la crise susmentionnée, l'"Eurocratie" dénoncée à Bruxelles a imposé à ses différents États membres une série de quotas d'accueil d'immigrants, acceptés par les pays occidentaux qui ont besoin d'une main-d'œuvre bon marché (et qui, comme l'Allemagne d'Angela Merkel, l'ont encouragée dès le début du phénomène), et rejetés par les nations de l'Est parce qu'elles ont des frontières directes, présentent des données macroéconomiques moins bonnes ou défendent une vision plus nationaliste ou souveraine de leur propre réalité (comme la Pologne ou la Hongrie).
Le Mexique a également utilisé, comme avant Barack Obama et Donald Trump, cette utilisation par l'action (mais aussi par sa propre omission), en évitant de devoir accueillir des migrants de pays voisins plus pauvres ou en fournissant du travail à ses propres habitants, en recherchant de meilleurs accords bilatéraux sur les questions économico-industrielles (comme dans l'accord de libre-échange), ou des améliorations dans les processus de migration légale des travailleurs mexicains sur le territoire nord-américain. En conséquence, pendant des années, les "caravanes" de migrants en provenance d'Amérique centrale (Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua) ont été à peine contrôlées, ou l'exode des travailleurs mexicains vers le nord face à la crise ou aux inégalités (comme le montre l'emblématique train "La Bestia") n'a pas été arrêté, qui ont traversé le pays depuis la frontière sud bourrée d'immigrants clandestins), jusqu'à la signature des protocoles de protection des migrants (PPM, ou "Stay in Mexico") de 2019 entre les deux nations, face à la menace de Trump d'imposer des tarifs punitifs sur tous les produits mexicains importés.
Le Maroc exerce périodiquement des pressions sur l'Espagne en tant que "frontière méridionale" de l'UE, en agressant continuellement les migrants (aussi bien les Centrafricains adultes "de passage" que les mineurs patriotes "asociaux") et en les poussant vers les villes autonomes de Ceuta et Melilla, ou en fermant les yeux sur les pateras pleines de jeunes Maghrébins qui arrivent sur les côtes méditerranéennes, surtout en période de beau temps maritime. Malgré le traité d'amitié, de bonne volonté et de coopération entre les deux pays (Rabat, 1991) et divers accords, le Maroc autocratique a su jouer ses cartes, obtenant par ces pressions une augmentation des exportations vers l'Europe, plus d'investissements dans le pays, une carte blanche au Sahara occidental, ou une meilleure formation de la police, en contrôlant les flux migratoires africains (et en collaborant également à la lutte contre le terrorisme djihadiste international).
Aux États-Unis, on a dénoncé la façon dont les politiciens et les dirigeants démocrates se sont fait les champions de la défense de l'immigration illégale dans le pays, par exemple avec la déclaration des "villes sanctuaires", et pas seulement comme une aspiration éthique ou humanitaire : la population latino croissante, supposée sensible à ce problème, serait un corps électoral plus compact et mobilisé pour leurs intérêts, comme par exemple dans la campagne électorale et médiatique déclenchée à l'époque contre le président Trump.

Et même la Biélorussie, sous Alexandre Loukachenko, a répondu aux sanctions occidentales contre son pays (après les soubresauts des élections présidentielles de 2020) en permettant aux migrants asiatiques de transiter par le pays vers l'Europe, évitant ainsi d'être une zone de contrôle et un point de passage frontalier vers " le rêve européen ", et provoquant une grave crise diplomatique et politique à la frontière avec la Pologne et la Lituanie.
Sans une migration légale, stable et assimilée, il n'y a pas d'avenir, en général, ni pour les personnes qui se déplacent vers un plus grand bien-être ni pour les sociétés qui doivent les accueillir. C'est dans l'histoire, nous le voyons dans nos rues, et nous le savons dans les drames de ceux qui perdent parce qu'ils veulent ou peuvent se déplacer dans le monde. Et sans cette légalité, seuls les politiciens corrompus et inutiles qui exploitent leurs citoyens ici et là et les expulsent de presque toutes les manières, et toutes ces mafias économiques et sociales qui profitent des besoins des autres pour leurs affaires ou leurs projets, continueront à gagner.
Personne ne veut de morts sur les côtes, personne ne veut de ghettos dans ses villes, personne ne veut la misère des autres, personne ne veut l'exploitation du travail. Mais sans des politiques claires et légales de gestion des flux migratoires, consubstantiellement liées à la dénonciation de la violation des libertés fondamentales dans les centres de départ ou des atteintes aux identités nationales dans les centres d'arrivée, aucun slogan ou drapeau, aussi louables soient-ils, ne mettront fin aux drames subis par les uns ou les autres (en termes d'insécurité personnelle ou collective) causés par ce qui apparaît comme cet usage politique normalisé. Il n'y a pas de solutions faciles à des problèmes difficiles, comme le savent bien les sciences sociales, même s'il existe des politiques de contrôle public qui garantissent la légalité, des valeurs traditionnelles claires qui améliorent l'intégration, et des mesures d'assimilation éprouvées qui favorisent la coexistence. Et qui empêchent, ou délégitiment, l'utilisation politique et partisane habituelle de l'immigration illégale par des pouvoirs qui l'utilisent pour des objectifs très spécifiques sans vraiment se soucier des raisons pour lesquelles les migrants fuient et avec qui ils doivent partager.
Sergio Fernández Riquelme
Sergio Fernández Riquelme est historien, docteur en politique sociale et professeur d'université. Auteur de nombreux ouvrages et articles de recherche et de diffusion dans le domaine de l'histoire des idées et de la politique sociale, il est un spécialiste des phénomènes communautaires et identitaires passés et présents. Il est actuellement directeur de La Razón Histórica, une revue hispano-américaine sur l'histoire des idées.
16:59 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, immigration, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 08 novembre 2021
Un monde tripolaire : nouveaux horizons et Logos intemporels

Un monde tripolaire : nouveaux horizons et Logos intemporels
Alexandre Douguine
Ex: https://www.geopolitica.ru/article/trehpolyarnyy-mir-novye-gorizonty-i-vechnye-logosy
Un monde tripolaire s'est en fait construit sous nos yeux. Il n'importe plus de savoir quelle force politique prévaut en Amérique, les mondialistes (comme Biden aujourd'hui) ou les nationalistes (comme Trump hier). L'échec du maintien de l'hégémonie mondiale américaine ne dépend plus de l'orientation de l'élite dirigeante américaine. Les néocons et les ultra-libéraux de Biden vudraient revenir au modèle unipolaire qui prévalait dans les années 1990 après l'effondrement de l'URSS, mais ils ne le peuvent tout simplement plus. La Chine et la Russie, à partir d'un certain moment, sont devenues des entités géopolitiques et civilisationnelles si manifestement souveraines qu'il n'est plus possible de le nier.
Bien sûr, les libéraux en lutte contre Trump ont essayé de l'accuser d'être celui qui a contribué (et même tout à fait délibérément) à l'indépendance de la Russie de Poutine. C'était l'une des principales thématiques de l'élection américaine. Mais il est désormais clair qu'il s'agissait d'un pur coup politicien: il n'était pas question des sympathies de Trump pour Poutine ou de l'ingérence de la Russie dans les élections américaines. Le fait est que les États-Unis ne peuvent plus diriger le monde seuls. Et Biden est exactement dans la même position que Trump : la limite stratégique de l'unipolarité a été atteinte et il n'y a plus de ressources pour la maintenir et la renforcer. En dépit de Biden ou de Trump, nous sommes effectivement passés à un monde tripolaire.
Il existe trois centres de décision pleinement souverains dans ce monde.
- Les Etats-Unis, qui ne représentent plus l'Occident tout entier, mais l'axe anglo-saxon (d'où le lancement des alliances AUKUS et QUAD) + ses satellites régionaux ;
- La Russie, qui, malgré tout, ne fait que renforcer sa position sur la scène internationale, en essayant de trouver de nouveaux points d'application tant dans l'espace post-soviétique que dans d'autres régions ;
- La Chine qui supporte avec succès le poids de la confrontation économique et militaro-stratégique croissante avec les Anglo-Saxons, qui se sont sérieusement engagés dans un endiguement régional de la Chine en Asie du Sud-Est.
Entre ces centres complets de pouvoir oscillent
- L'Union européenne, désemparée, a été amenée au bord d'un désastre énergétique par les politiques ratées de Washington et s'est retrouvée pratiquement exclue du bloc anglo-saxon ;
- La Turquie, l'Iran et le Pakistan, qui renforcent systématiquement leurs capacités régionales ;
- Le Japon et l'Inde, qui cherchent à renforcer leur position en utilisant de manière pragmatique l'impasse entre les États-Unis et la Chine (tandis que l'Inde, de manière tout à fait rationnelle, continue de maintenir un partenariat stratégique avec la Russie) ;
- Les pays islamiques du Moyen-Orient et du Maghreb, qui se sont détachés des États-Unis et tentent désormais de résoudre les conflits locaux sans se tourner vers Washington ;
- Les régimes africains qui rejettent de plus en plus le néocolonialisme européen et, plus largement, occidental (incarné de manière très vivante par la nouvelle vague de panafricanisme anti-européen - comme les Urgences panafricanistes de Kemi Seba)
- Les pays d'Amérique latine, effectivement abandonnés par les États-Unis et cherchant une nouvelle place dans le système mondial sur le modèle du Sud global ;
- Les acteurs émergents d'Asie du Sud - Indonésie, Malaisie, Corée du Sud, etc.
Ainsi, entre les trois piliers de la tripolarité, qui ont désormais une supériorité incontestable, bien qu'asymétrique, commence un mouvement de pôles secondaires, un peu moins établis et encore incomplets. Néanmoins, certains d'entre eux - notamment l'Inde et certains pays d'Amérique latine - ont un potentiel très élevé et ne tarderont pas à atteindre la cour des grands.
Et c'est là que la partie amusante entre en jeu. Ce monde tripolaire, et demain un monde multipolaire au sens plein, a deux aspects.
D'une part, certains aspects technologiques de la civilisation - dans le système de communication, dans la sphère énergétique, dans les modèles de réseaux numériques et de développement de l'économie virtuelle - seront communs à tous les pôles, grands et petits, même si ce n'est que pour un court moment. Cela permettra de parvenir à une standardisation, même minime, des relations entre les pôles, et de justifier des algorithmes communs. Cela permettra d'établir un modèle spécifique sur le plan pratique, accepté par tous (ou presque), constitué de protocoles et de règles reflétant les nouvelles conditions. Oui, personne n'aura le monopole de la résolution des situations problématiques à lui seul. Toute solution peut être contestée par l'autre pôle ou par une alliance situationnelle de pôles. Dans une telle situation, personne n'aura le droit exclusif d'insister sur quoi que ce soit. Le pouvoir de l'un ne sera limité que par le pouvoir de l'autre. Le reste est une question de négociation.
Cela signifie, en fait, le début de la démocratie multipolaire ou "démocratie des normes". Une situation similaire existe d'ailleurs aux États-Unis, où chaque État a ses propres lois, qui se contredisent parfois directement. Dans un modèle international, la "démocratie des normes" peut être encore plus souple : certains pays proposent et acceptent leurs normes, d'autres acceptent les leurs, et ainsi de suite.
Bien sûr, il est dans l'intérêt de tous qu'il existe des algorithmes stables d'interaction internationale, mais les règles changeront constamment, chaque pôle cherchant à modifier la situation en sa faveur. Toutefois, un certain "universalisme" (de nature purement technique), bien que limité, sera manifestement exigé par tous.
Mais d'un autre côté, chaque pôle aura intérêt à renforcer son identité civilisationnelle. Et là, la situation sera encore plus intéressante.
Les trois pôles principaux déjà entièrement formés sont donc:
- Les Anglo-Saxons,
- La Russie et
- La Chine
On insistera clairement sur l'identité historique de chacun. Sur leur propre Logos. Et c'est là que les surprises nous attendent.
Il n'est pas du tout évident que les États-Unis, par exemple, bien que fortement liés à la Grande-Bretagne et à l'Australie, continueront sur la voie de l'ultra-libéralisme, du post-humanisme, de la dégénérescence LGBT+, etc. Ce modèle mondialiste est un échec total. Elle est de plus en plus rejetée, tant aux États-Unis qu'en Europe. Il ne faut donc pas écarter la possibilité d'un retour de Trump et du trumpisme (plus largement du populisme) aux États-Unis. Il est très révélateur que le symbole de la réussite mondiale, Elon Musk, se soit mis à lire Ernst Jünger. Le vent a tourné. L'élite des milliardaires prend un détour intellectuel intéressant - et résolument conservateur. Un autre milliardaire, Peter Thiel, lit depuis longtemps mes textes géopolitiques et les écrits de Carl Schmitt. Oui, il y a toujours Soros, Gates, méta-Zuckerberg, Bernard-Henri Lévy et Jeff Bezos avec les fous furieux de Google et Twitter, mais ils seront bientôt dans une impasse irrémédiable pour avoir tenté d'établir leurs monopoles. Et eux aussi chercheront à s'attaquer à la lecture de Jünger.
En Europe, la tendance montante du nouveau conservatisme est représentée par une figure comme Eric Zemmour, la star des prochaines élections présidentielles françaises. Zemmour rejette radicalement les LGBT+ et le libéralisme, appelle à l'arrêt complet des migrations, au retour à l'identité française, au gaullisme et à une alliance eurasienne avec la Russie.
La Hongrie et la Pologne, en Europe de l'Est, démontrent que le libéralisme commence à s'enliser aussi dans cette région.
Il n'est donc pas du tout certain que dans un monde tripolaire, les posthumanistes, les postmodernes, les maniaques de la technocratie et les pervers libéraux conserveront le monopole du Logos occidental. Un virage conservateur est également très probable. Et maintenant, ça pourrait devenir intéressant. Mais il n'en reste pas moins qu'un tel virage conservateur sera fondé sur les valeurs occidentales. Oui, ils ne seront pas aussi agressifs et intrusifs que la ligne totalitaire et déjà folle des mondialistes libéraux. Mais ce sera toujours une nouvelle affirmation de l'Occident - avec tout ce que cela implique.
La Chine, avec ses milliers d'années de civilisation et son système socio-politique tout à fait original, dispose là encore d'un énorme avantage. Ce n'est pas seulement l'économie et le contrôle politique étroit du PCC qui sont la clé du succès du Logos chinois. La société chinoise - tant l'État que le peuple lui-même - est un système de valeurs cohérent, avec une dimension impériale, une éthique et une sorte de métaphysique chinoise. Ce n'est pas seulement une question de pouvoir ; le fait est qu'entre le pouvoir du PCC et la société chinoise proprement dite se trouve un continent entier de culture traditionnelle chinoise - anthropologique, éthique, spirituelle. Et la Chine ne fera que se renforcer et étendre son influence dans les régions voisines.
Il est grand temps pour la Russie de réfléchir au Logos russe. Sur l'identité russe, sur la conscience de soi historique, sur notre système de valeurs, qui n'est pas moins original et distinctif que celui de l'Occident ou de la Chine. Hélas, nous y prêtons encore très peu d'attention. Mais il vaut la peine de se tourner vers l'histoire russe, vers les trésors inestimables de l'orthodoxie et de la tradition, vers notre littérature et notre art, vers notre philosophie religieuse, vers l'éthique russe de la justice et de la solidarité - et les grandes lignes de la civilisation russe s'ouvriront devant nous. Et là, il faut être décisif : même si ce n'est pas une vérité universelle, elle n'est pas universelle, mais c'est la nôtre, la russe. Qui est prêt à l'accepter, qu'il soit le bienvene. Pour ceux qui n'y sont pas prêts, eh bien, que le monde soit plus riche et plus complet grâce à la diversité et à l'identité.
Et encore les trois Logos...
...l'Occidental..,
... le chinois et...
le russe -
sont comme trois civilisations - et ils ne seront bientôt que les principaux pôles de la multipolarité. Les civilisations islamique ou indienne, africaine ou latino-américaine, avec toutes leurs particularités locales, auront l'occasion de multiplier leur Logos, de défendre et de développer leur identité, de construire leurs Etats, leurs cultures, leurs systèmes.
Bien sûr, il y aura des difficultés en cours de route. Mais il est parfois important de prêter d'abord attention aux nouveaux horizons, sans tout réduire à la concurrence, aux conflits, aux affrontements et au scepticisme geignard : "rien ne marchera pour l'humanité, comme rien n'a jamais marché". C'est un mensonge - cela a parfois fonctionné, et l'humanité a connu les plus grands succès, les plus grandes réalisations, les plus grands exploits et les plus hauts sommets, bien qu'il y ait eu aussi des chutes sévères et des catastrophes.
Il vaut la peine de se pencher sur un monde multipolaire - aujourd'hui tripolaire - avec responsabilité et animé de solides bonnes intentions. Après tout, c'est le monde dans lequel nous vivons que nous créons nous-mêmes. Concentrons-nous donc, nous les Russes, sur la recherche du Logos russe.
tg-Nezigar (@russica2)
18:37 Publié dans Actualité, Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, tripolarité, politique internationale, chine, russie, occident, alexandre douguine, nouvelle droite, nouvelle droite russe |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Droite et gauche, depuis 1989, les deux bras du rouleau compresseur néo-libéral

Droite et gauche, depuis 1989, les deux bras du rouleau compresseur néo-libéral
Les nouvelles gauches fuchsia et post-marxistes finiront par devenir l'emblème même, culturellement et politiquement, du turbo-capitalisme gagnant!
Par Diego Fusaro
Ex: https://www.tradicionviva.es/2021/11/07/derecha-e-izquierda-desde-1989-los-dos-brazos-del-monstruo-neoliberal/
Tant à droite qu'à gauche, les gens ont été incapables, par myopie ou par mauvaise foi, de saisir la véritable signification historique de 1989 comme le triomphe du capitalisme américain contre toutes les formes de résistance culturelle, politique et économique. Dans la seconde moitié du 20ème siècle, le soi-disant "néo-fascisme" a largement pris la forme d'une ressource de normalisation atlantiste et anti-soviétique servile, fonctionnelle parce qu'il abandonnait toute résistance anti-impérialiste et participait au reflux complet de la droite vers le capitalisme gagnant. Une dynamique convergente de domestication des intelligences critiques avait eu lieu à gauche ; une dynamique destinée à culminer dans l'actuelle reconfiguration globale de la gauche comme front avancé de la post-modernisation capitaliste, avec la centralité incontestable de la privatisation et de la libéralisation individualiste des coutumes et de la consommation.
Grâce à une métamorphose kafkaïenne, les nouvelles gauches fuchsia et post-marxistes finiront par devenir l'emblème même, sur le plan culturel et politique, du turbo-capitalisme gagnant. Preuve en est que la Nouvelle Gauche post-marxiste, qui - comme toute force libérale - est également anticommuniste et antifasciste, aurait repris toutes les batailles du cosmo-mercantilisme après 1989, adhérant pleinement au projet de libéralisation privée dans la sphère économique, d'impérialisme éthique made in USA en politique étrangère, de dé-souverainisation au profit de la Banque centrale européenne dans la sphère politique.
Les mots de Tacite s'inscrivent dans cette course générale vers la servitude: at Romae ruere in servitium consules, patres, eques... En ce sens, il est toujours bon de rappeler comment, aujourd'hui encore, le secteur de la gauche constitue le front le plus avancé pour la dé-souverainisation et la sanctification du projet de l'Union européenne. Sur ce plan incliné, qui les amènerait à se redéfinir comme ce que Gramsci a combattu tout au long de son existence, les gauches fuchsia et arc-en-ciel, traîtresses à Marx et au projet anticapitaliste, sont en fait devenues de manière cohérente des formes articulées pour se maintenir à bonne distance du peuple et antithétiques aux intérêts matériels des travailleurs.
De la lutte contre le capital, la gauche est passée à la lutte pour le capital, se redéfinissant comme un parti glamour et individualiste, culturellement libertaire, politiquement anti-étatiste et privatiste, économiquement libéral et compétitif, géopolitiquement atlantiste : "Je me sens plus en sécurité en restant de ce côté, sous le parapluie de l'OTAN", avait déjà improvisé Enrico Berlinguer en 1976, révélant l'adhésion déjà presque totale de la gauche démo-phobe - comme de la droite - à l'ordre de la mondialisation américano-centrique et, dans ce contexte, anti-soviétique. Cette déclaration, qui condense l'embryon de la reddition de la gauche à l'atlantisme, gauche qui était en train de se redéfinir comme post-marxiste, peut pratiquement être considérée comme un achèvement de la déclaration du secrétaire du parti Refondation communiste, Paolo Ferrero, dans le journal "Liberazione" du 9 novembre 2009 : la chute du mur de Berlin "était un fait positif et nécessaire, à célébrer" (sic !). Les paroles de Ferrero, dans ce contexte, auraient pu être les mêmes que celles de n'importe quel politicien de foi libérale ferme. Non seulement cela, mais, comme cela a souvent été souligné, le secteur de la gauche s'est révélé incapable d'offrir une réponse forte et plausible à la crise du paradigme keynésien, sans parler d'une véritable alternative à celui-ci. Qui plus est, il s'est retrouvé directement à "gérer la crise du capital pour le compte du capital" : et ce sur le plan incliné qui le conduira, après 1989, à se hisser au rôle insoupçonné d'espace politique privilégié pour la représentation des intérêts des classes dominantes.

La figure de Berlinguer constitue en effet un carrefour décisif dans le processus de métamorphose de la gauche marxiste et de sa normalisation libérale et atlantiste, tel qu'il finira par se réaliser après 1989 dans la nouvelle gauche malheureuse et sans conscience, celle des porte-drapeaux de l'Union européenne. Togliatti avait fait une revendication gramscienne de la souveraineté nationale comme base de l'internationalisme et de la "voie nationale vers le communisme" (s'opposant avec la même force à l'OTAN et aux projets d'intégration européenne). Il était aussi clairement conscient du conflit structurel entre le capital et le travail.

Pour sa part, Berlinguer abandonne la référence à la souveraineté nationale des communistes, optant pour la voie de l'eurocommunisme et de l'ouverture cosmopolite (plutôt qu'internationaliste), mais aussi pour la subordination de la nation italienne à la monarchie du dollar ("le parapluie de l'OTAN"). Berlinguer a ainsi posé les bases de la redéfinition ultérieure de la gauche comme force de soutien à l'Union européenne et à cette ouverture cosmopolite qui était, de facto, l'ordre symbolique de la classe dominante et qui, dans l'imaginaire de la nouvelle gauche, réoccuperait pleinement l'espace précédemment occupé par la lutte des classes et la question du travail.
De plus, Berlinguer a remplacé de manière perverse la question sociale du conflit entre le capital et le travail par la "question morale", qui non seulement n'a rien de marxiste (puisque le marxisme considère la société du capital comme intrinsèquement corrompue, quelle que soit la conduite morale des agents individuels). De plus, elle a fini par ouvrir la voie, à son grand regret, à la fois à l'anti-keynésianisme qui marquera plus tard le quadrant de gauche comme la nouvelle force privilégiée du libéralisme après 1989, et à la perte, de la part de la gauche, de toute référence à la question socio-économique et au conflit de classe associé.
Article publié en italien sur https://avig.mantepsei.it/single/destra-e-sinistra-dal-1989-sono-le-due-braccia-del-mostro-neoliberale
12:50 Publié dans Actualité, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : diego fusaro, droite, gauche, gauche fuschsia, italie, communistes italiens, actualité |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Le chercheur russe Artyom Lukin : trois options idéologiques à l'oeuvre dans le monde

Le chercheur russe Artyom Lukin : trois options idéologiques à l'oeuvre dans le monde
Markku Siira
Ex: https://markkusiira.com/2021/11/06/venalaistutkija-kolme-ideologista-vaihtoehtoa/
Le chercheur russe Artyom Lukin conteste l'argument selon lequel la compétition géopolitique actuelle ne peut être comparée à la guerre froide, car il ne s'agit plus d'un "choc des idéologies". Selon M. Lukin, les trois superpuissances actuelles - les États-Unis, la Chine et la Russie - représentent des "choix idéologiques différents".
Les États-Unis défendent "une idéologie libérale-progressiste, connue dans sa forme extrême [de pureté idéologique] sous le nom de wokeness". La Chine et la Russie remettent en question cette vision libérale américaine - et, par ailleurs, néo-gauchiste.
La Chine et la Russie sont souvent mises dans le même sac en tant qu'"amis autocratiques", note M. Lukin. Toutefois, le spécialiste de la Russie estime que Pékin et Moscou représentent "des modèles idéologiques très différents". Le modèle chinois est "une synthèse du socialisme marxiste-léniniste-maoïste et de la culture traditionnelle chinoise coutumière, renforcée par une technologie numérique avancée".
M. Lukin estime également que c'est une erreur de penser que M. Poutine veut faire revivre l'Union soviétique communiste. En fait, le président russe de longue date est très ambivalent à l'égard de l'ancien modèle soviétique. "Poutine n'est pas un communiste, mais plutôt un suzerain néo-féodal", dit Lukin.
La préférence de Poutine semble être pour la "vieille Russie tsariste": pour lui, la Russie ne doit pas être un empire idéologique universel, mais une "large autocratie continentale" qui s'appuie sur "les armes nucléaires, un conservatisme sain et des traditions éprouvées".
L'idéal russe de Poutine vient donc du passé ; en tant que telle, l'idéologie russe plaît à "certains conservateurs de droite en Europe et en Amérique du Nord". C'est pourquoi l'élite libérale occidentale considère Poutine comme son "adversaire idéologique".

Pourtant, le défi idéologique de la Russie à l'égard de l'Occident n'est rien comparé au défi posé par la Chine. "L'Occident a de plus en plus peur de la Chine, non seulement en raison de la puissance économique et militaire croissante de la Chine, mais aussi parce que le développement moderne et très réussi de la Chine renforce l'idéologie du parti communiste chinois", explique M. Lukin.
Il estime que "la pandémie du coronavirus a été un moment décisif qui a montré la supériorité du système chinois". "Alors que la plupart des pays occidentaux, ainsi que la Russie et l'Inde, ont échoué de manière désastreuse à protéger leurs populations, la Chine a gagné la bataille contre le virus", estime l'universitaire russe. Les lecteurs critiques peuvent, s'ils le souhaitent, débattre de la validité de ce point de vue dans le fil de discussion du compte Twitter de Lukin.
M. Lukin admet que le système chinois présente des "caractéristiques dystopiques", mais qu'il est actuellement "le système le plus efficace lorsqu'il s'agit de générer des richesses matérielles pour les masses et de protéger la vie humaine biologique". Au lieu d'arguments plus spécifiques, il invite les lecteurs à explorer le personnage du "grand inquisiteur" créé par l'écrivain Fyodor Dostoïevski.
Lukin n'oublie pas de mentionner qu'il existait également une quatrième idéologie concurrente, l'"islamisme radical", mais que l'"État islamique" qui la représentait a été détruit par l'action collective des grandes puissances. Il s'agit de la plus extraordinaire des affirmations de Lukin, car il existe des exemples plus réussis de groupes terroristes fondés sur le modèle de la civilisation islamique en Iran, en Arabie saoudite et, par exemple, en Turquie.
En résumé, Lukin conclut que "l'humanité a désormais le choix entre le wokéisme occidental, le néoféodalisme russe et le socialisme numérique quelque peu dystopique de la Chine". Y a-t-il vraiment un choix entre ces modèles, ou est-ce l'histoire, la géographie et les liens avec la politique étrangère et de sécurité qui déterminent à quelle superpuissance appartient chaque pays ? La deuxième question est la suivante : comment la crise mondiale actuelle affectera-t-elle les aspirations des grandes puissances ?
10:49 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, russie, chine, états-unis, politique internationale, idéologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 07 novembre 2021
Diego Fusaro : "Plus que Gramsci, nous vivons aujourd'hui dans une hégémonie subculturelle"

Diego Fusaro : "Plus que Gramsci, nous vivons aujourd'hui dans une hégémonie subculturelle"
Propos recueillis par Francesco Subiaco
Ex: https://culturaidentita.it/diego-fusaro-altro-che-gramsci-oggi-viviamo-unegemonia-subculturale/
Révolutionnaire, humaniste, national-populaire. Il s'agit d'Antonio Gramsci, l'un des plus grands penseurs du vingtième siècle qui, dans ses Cahiers de prison, a réalisé une réforme humaniste du marxisme, rompant avec tout déterminisme et tout mécanisme. Il a affirmé que l'histoire sans les hommes ne progresse pas. Retour à la culture humaniste, à la vision révolutionnaire de la culture et de l'école dans la formation d'un nouveau Léonard de Vinci, capable de dépasser l'atomisme et la spécialisation entomologique de l'homme contemporain. Une philosophie de la praxis qui poursuit le projet d'une hégémonie fondée sur le lien sentimental entre le peuple et l'élite, le national et le populaire, qui est bien représenté dans le nouveau livre de Diego Fusaro (Bentornato Gramsci, La nave di Teseo, pp. 362, 18 euros). Une grande exégèse du penseur sarde qui devient la clé de voûte pour interpréter notre société et décoder les relations de pouvoir inhérentes aux fictions de la société de consommation.
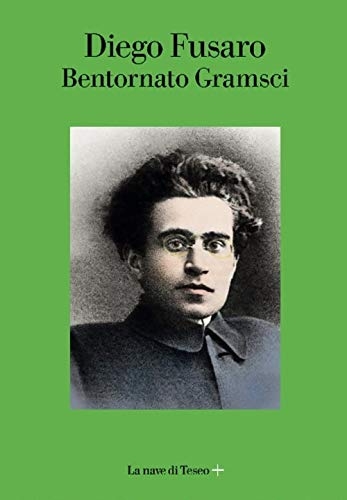
Qu'est-ce qui rend la pensée de Gramsci si actuelle à notre époque ?
À mon avis, il est particulièrement actuel pour diverses raisons, mais surtout sur le plan ontologique, car il déconstruit la mystique néolibérale de la nécessité, cette vision selon laquelle le monde est dépourvu d'alternatives, mais d'une positivité morte, qu'il faut accepter comme un rapport de force donné et indiscutable. Alors que pour Gramsci, toute vision est le produit d'un processus, d'une praxis, d'une histoire en cours. Défataliser l'existant et lui redonner la dimension du possible et de la volonté transformatrice.
Quelle est la principale différence entre la vision du monde libérale-progressiste, qui se développe à travers le politiquement correct, et la vision gramscienne ?
Gramsci a théorisé le concept d'hégémonie parmi de nombreux autres concepts fondamentaux dans les Cahiers de prison. L'hégémonie est la domination plus le consentement. C'est-à-dire une domination qui s'exerce par le biais du consentement et de la culture. Aujourd'hui, cependant, nous vivons dans une hégémonie subculturelle, qui n'utilise pas l'hégémonie culturelle comme celle de l'idéologie bourgeoise et libérale du début du vingtième siècle, mais une subculture faite de spectacle médiatique et d'annulation de la culture. Qui s'exerce en niant l'idée même de culture par le politiquement correct, ce qui se traduit par une culture éthiquement corrompue et annulée.
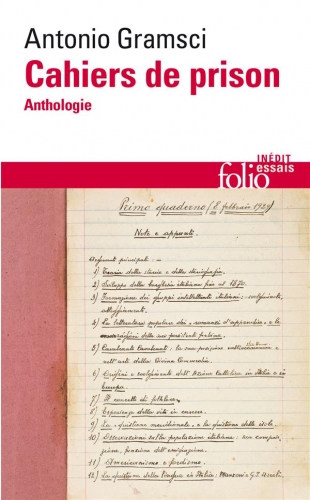
Le politiquement correct est-il la superstructure du monde néo-capitaliste global ?
Il se présente certainement comme la superstructure du monde global. Il procède à la sanctification idéologique des relations installées par le capitalisme financier. Il doit lutter contre toute souveraineté nationale, en la dénigrant jusqu'à la définir comme fascisme et ce, à ses propres fins, il doit ensuite détruire la famille en brisant tout lien social pour ne créer que des consommateurs, en délégitimisant la famille comme étant d'emblée homophobe, paternaliste et sexiste, tout cela se fait par le biais du politiquement correct. Qui devient ainsi le sanctificateur de l'immigration massive, ou de la déportation massive, qui par humanitarisme légitime le trafic de nouveaux esclaves qui deviennent des travailleurs très bon marché exploités par le capital.
Quelle est la relation entre Gramsci et Marx et quelle partie du marxisme le philosophe des Cahiers de prison examine-t-il ?
La grandeur de Gramsci dans sa lecture de Marx est de le libérer des scories du naturalisme, du fatalisme. Le montrant comme une ligne de faille sismique entre l'idéalisme allemand et le positivisme anglo-saxon. Gramsci développe chez Marx la composante de la praxis, celle des thèses de Feuerbach, de l'idéalisme. Qui abandonne le déterminisme au nom d'une vision de l'histoire faite par les hommes. Montrer la Révolution d'Octobre comme une révolution contre le capital, à la fois dans le sens d'une révolution anticapitaliste, et comme une révolution volontariste contre la vision capitaliste de Marx dans Das Kapital.
Gramsci a réformé Hegel, s'éloignant de l'actualisme pour se rapprocher d'une philosophie de la praxis. Qu'est-ce que Gramsci entend par une philosophie de la praxis et dans quelle mesure est-elle éloignée de la vision de Gentile ?
La thèse que j'ai développée dans mon livre est que le marxisme de Gramsci est un marxisme d'actualité. L'idée de l'essentiel comme praxis a un lien profond avec la philosophie de Gentile, car l'acte de penser est proprement réel. Il met en avant une philosophie de l'acte impur, par opposition à l'acte pur de la pensée du Gentile. Une vision qui ramène la philosophie dans le concret et le réel. Car, comme je le dis dans le livre, Gramsci est à Gentile ce que Marx est à Hegel.
14:22 Publié dans Entretiens, Livre, Livre, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, antonio gramsci, diego fusaro, italie, livre, marxisme, gramscisme, philosophie, philosophie politique, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Erdogan continue de jeter de l'huile sur le feu du conflit libyen

Erdogan continue de jeter de l'huile sur le feu du conflit libyen
par Alessandro Sansoni
Ex: https://www.lavocedelpatriota.it/erdogan-continua-a-gettare-benzina-sul-fuoco-del-conflitto-libico/?fbclid=IwAR1eql9a2imoe7z0Pg2UZdKtsmv0T4YC7N6wHrH2SHZB18VPSJavJUz4JSc
Les reportages triomphalistes des médias nous ont empêchés d'y prêter toute l'attention nécessaire, mais un développement dangereux a émergé du G20 à Rome. Au cours du sommet, en effet, le président turc Recep Erdogan a déclaré officiellement, et en termes non équivoques, qu'Ankara refuse de retirer ses troupes de Libye. Cette déclaration intervient alors que l'ONU s'est engagée à organiser et à mener à bien le retrait de toutes les troupes étrangères présentes dans le pays, condition préalable indispensable à la célébration des élections censées ramener la paix dans le pays.
Par sa position, la Turquie jette de l'huile sur le feu et menace de porter à un niveau très élevé le conflit entre les factions qui se disputent le pouvoir en Libye, mettant ainsi en péril le processus électoral. Une situation qui aurait des répercussions graves et dangereuses pour l'Italie et l'ensemble de l'Union européenne.
Premier problème : le retrait des mercenaires
La Libye devrait organiser ses élections présidentielles tant attendues le 24 décembre, tandis que les élections législatives sont prévues pour le début de 2022.
L'espoir est de mettre ainsi fin à la longue période d'anarchie et de guerre civile dans laquelle le pays a plongé depuis la fin du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, en sauvegardant éventuellement l'unité du territoire libyen, aujourd'hui effectivement divisé en une partie occidentale sous le contrôle du gouvernement de Tripoli et une partie orientale aux mains du général Khalifa Haftar et de son Armée nationale libyenne (ANL), engagés depuis des années dans un dur conflit non seulement avec les milices tripolitaines, mais aussi avec des groupes islamistes, alliés des Turcs. La situation est encore compliquée par le nombre élevé de mercenaires et de forces étrangères présents sur le terrain pour soutenir les deux prétendants.
C'est précisément pour cette raison que la feuille de route élaborée par les Nations unies prévoit, avant tout, l'élimination des groupes armés étrangers, qui doit être définie dans le cadre d'un format de négociation "5+5", dans lequel toutes les factions belligérantes sont présentes à la table des négociations, sous les auspices des Nations unies. Le 8 octobre, le Comité militaire conjoint "5+5" s'est réuni pendant trois jours au Palais des Nations à Genève et s'est conclu par la signature d'un plan d'action prévoyant un retrait progressif, équitable et coordonné de tous les mercenaires et forces étrangères de Libye.
La réunion de Genève s'est tenue conformément aux pistes définies dans l'accord de cessez-le-feu du 23 octobre 2020 et aux résolutions connexes émises par le Conseil de sécurité des Nations unies. La réunion faisait partie intégrante des diverses négociations intra-libyennes promues par l'ONU, ainsi que des efforts déployés par la communauté internationale à travers la conférence de Berlin.
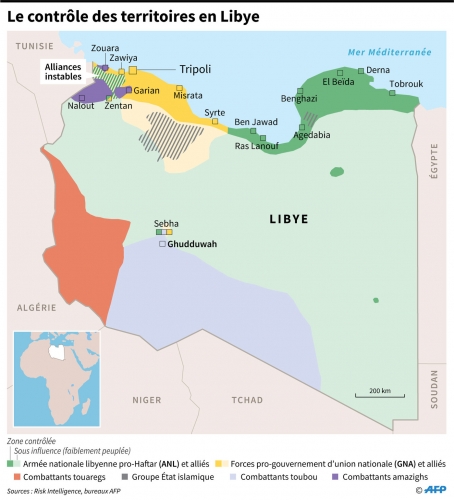
Début novembre, le Comité 5+5 a tenu une autre réunion, cette fois au Caire, toujours organisée par l'ONU, à laquelle ont également participé des représentants du Soudan, du Tchad et du Niger. À cette occasion, tous les pays voisins de la Libye ont exprimé leur volonté de coopérer au processus d'expulsion des combattants étrangers et des mercenaires, tandis que les délégués du Soudan, du Tchad et du Niger se sont engagés à coopérer pour assurer le retrait des hommes armés de leurs pays, en coordonnant leurs actions pour éviter qu'ils ne reviennent en Libye et ne déstabilisent les États voisins.
Cependant, le refus de la Turquie de s'aligner sur les accords généraux ouvre un problème gigantesque. En fait, près de la moitié des forces étrangères présentes en Libye sont liées à Ankara : selon le SOHR (Observatoire syrien des droits de l'homme), le nombre total de mercenaires syriens soutenus par la Turquie dans le pays d'Afrique du Nord est d'environ 7000, tandis que les Nations unies ont estimé la présence de 20.000 combattants étrangers sur le territoire libyen. Les sources de SOHR ont également confirmé qu'en dépit des tentatives de négociation de leur retrait début octobre, des miliciens islamistes vétérans du conflit syrien continuent d'être stationnés dans des bases turques en Libye, tandis qu'un nouveau contingent de 90 personnes en provenance de Syrie est arrivé en Libye transporté par des avions turcs.
G20 : la diplomatie à la turque
Lors du G20, Erdogan a non seulement confirmé son intention de ne pas démobiliser ses troupes en Libye, mais a également réaffirmé au président français Emmanuel Macron que la présence turque est légitimée par un accord de coopération militaire signé avec le gouvernement libyen.
"Nos soldats sont là en tant qu'instructeurs", a-t-il réitéré, niant que leurs activités puissent être assimilées à celles de mercenaires illégaux.
Or, ce n'est pas exactement le cas. Tout d'abord, ses propos peuvent s'appliquer au contingent militaire officiellement envoyé par l'armée turque début janvier 2020, et certainement pas aux mercenaires syriens qui continuent à être stationnés dans les bases militaires d'Ankara.
Par ailleurs, les accords conclus lors du sommet du 8 octobre à Genève font explicitement référence au retrait des "mercenaires, combattants étrangers et forces étrangères", les "forces étrangères" étant comprises comme incluant les troupes régulières et les instructeurs.
Enfin, les "instructeurs" turcs ont débarqué en Libye dans le cadre d'un accord signé par Ankara en novembre 2019 avec le gouvernement d'entente nationale (GNA) dirigé par Fayez al-Sarraj, un gouvernement intérimaire auquel a succédé en mars dernier le nouveau gouvernement d'union nationale dirigé par Abdul Hamid Dbeibah. Le point crucial, cependant, est qu'au moment où le traité a été signé, le mandat du GNA avait déjà expiré et donc, en tant que gouvernement intérimaire, il n'avait pas le droit de signer un tel traité de coopération militaire. C'est pour la même raison que tous les voisins de la Libye et de la Turquie ont désavoué le traité sur les frontières maritimes (et les zones économiques exclusives correspondantes) signé par Tripoli et Ankara au même moment. Ce dernier accord a considérablement étendu les revendications turques sur la Méditerranée et ses riches gisements de pétrole et de gaz.
C'est pour ces raisons que la présence militaire turque en Libye doit être considérée comme illégale au regard du droit international, car elle constitue un avant-poste des ambitions néo-impérialistes d'Erdogan. Ce n'est pas une coïncidence si Erdogan, pendant le G20, a annoncé son refus de participer au sommet sur la Libye à Paris (ce qui l'a fait couler), confirmant ainsi qu'il n'a aucune intention de soutenir les efforts internationaux visant à stabiliser le pays.
Nous avons notifié au président Macron, a déclaré Erdogan, notre refus de participer à une conférence à Paris à laquelle participent la Grèce, Israël et l'administration chypriote grecque. Pour nous, il s'agit d'une condition absolue. Si ces pays sont présents, cela n'a aucun sens pour nous d'envoyer des délégués".
À Rome, Erdogan a également eu une réunion séparée avec le Premier ministre Mario Draghi, mais celle-ci n'a donné aucun résultat concret. Aucun progrès n'a été enregistré dans les relations italo-turques, y compris en ce qui concerne le système de défense antimissile italo-français SAMP-T, pour lequel la Turquie avait précédemment manifesté son intérêt. Malgré l'annonce générale de développements futurs à cet égard, il est peu probable que la Turquie reprenne ce projet, à moins que ses relations avec Paris ne s'améliorent. Et Erdogan ne semble avoir aucune envie de poursuivre dans cette direction.
Tensions en Libye
Entre-temps, la situation politique en Libye devient de plus en plus précaire, surtout depuis que la Chambre des représentants (le parlement de Tobrouk) a remis en cause en septembre dernier, à l'instigation de Haftar, le gouvernement d'unité nationale.
D'un point de vue militaire, les tensions augmentent également, à tel point que ces derniers jours, les chefs de deux milices tripolines - Muammar Davi, chef de la Brigade 55, et Ahmad Sahab - ont été victimes d'attaques visant à les tuer.
À ce stade, il est difficile d'être sûr que les élections présidentielles auront lieu en décembre, tandis que les élections parlementaires ont déjà été reportées à 2022.
Le chantage d'Erdogan : géopolitique, énergie, flux migratoires
Si la Turquie a pu renforcer considérablement son influence en Libye, une part considérable de la responsabilité doit être attribuée aux gouvernements dirigés par Giuseppe Conte (surtout le second), caractérisés par un manque d'incisivité sur la question libyenne. Bénéficiant de facto d'une carte blanche, Ankara a pu, en quelques années seulement, débarquer des centaines de "conseillers militaires" dans le pays d'Afrique du Nord.
Avec le traité sur les frontières maritimes et la délimitation des zones économiques exclusives respectives, la Turquie a pris le contrôle du littoral de la Tripolitaine ainsi qu'une sorte de patronage sur les gisements de gaz et de pétrole de la Méditerranée centrale. Son influence politique sur le gouvernement d'accord national, puis sur le gouvernement d'unité nationale, est énorme.
La guerre civile entre Tripoli et Benghazi a permis à Ankara de fournir des troupes et des armes au camp ouest-libyen, de redéployer ses milices mercenaires précédemment actives en Syrie et d'obtenir la gestion du port et de l'aéroport de Misurata pour les 99 prochaines années.
Aujourd'hui, Erdogan, grâce à la forte influence qu'il est en mesure d'exercer sur l'un des plus grands producteurs de pétrole au monde, dispose d'une arme supplémentaire pour faire pression sur l'Europe, celle de l'approvisionnement énergétique, en plus de l'arme déjà largement utilisée du contrôle des flux migratoires, qu'il est désormais en mesure de réguler non seulement sur la route des Balkans, mais aussi sur celle de la Méditerranée centrale. La route la plus empruntée par les trafiquants d'êtres humains, selon les chiffres officiels, selon lesquels, au 22 octobre, 51.568 migrants sont déjà arrivés en Italie cette année, contre 26.683 en 2020.

Les demandes de Draghi à l'Union européenne d'allouer des fonds pour protéger "toutes les routes" sont du miel aux oreilles turques. Ils font en effet référence aux 6 milliards que Bruxelles a déjà versés à la Turquie pour gérer la route des Balkans et à ceux qu'elle versera encore. Il y a actuellement 3,7 millions de Syriens vivant sur le sol turc, auxquels il faut ajouter 300.000 Afghans. Une bombe à retardement qu'Ankara menace de faire exploser à tout moment si ses exigences ne sont pas satisfaites.
En bref, les crises humanitaires - de l'Afghanistan à la Syrie, auxquelles s'ajoute désormais la crise libyenne - sont devenues une occasion extraordinaire pour la Turquie d'obtenir des ressources de l'Europe et de la maintenir sous pression. C'est pourquoi le maintien d'un gouvernement pro-turc à Tripoli est si important pour Erdogan : il lui permet de jouer un jeu géopolitique complexe contre l'UE qui combine énergie et flux migratoires.
Reconstruire un équilibre en Méditerranée et redimensionner les ambitions turques en adoptant une attitude plus ferme à l'égard du nouveau sultan est le véritable défi que l'Italie doit relever, plutôt que de s'aventurer dans des aspirations improbables et irréalistes à diriger l'UE ou à renforcer les relations transatlantiques.
Alessandro Sansoni
Directeur du magazine mensuel CulturaIdentità
11:26 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, méditerranée, libye, turquie, erdogan, afrique du nord, afrique, affaires africaines, géopolitique, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 06 novembre 2021
"Grands Réveils" et "Enfants de Lumière"

"Grands Réveils" et "Enfants de Lumière"
Par Daniele Perra
Ex: https://www.eurasia-rivista.com/grandi-risvegli-e-figli-della-luce/
Dans un article publié dans le numéro 4/2021 d'Eurasia, l'universitaire Maria G. Buscema affirme que les historiens et les théologiens utilisent les termes de Grand Réveil ou Revivals pour désigner expressément les mouvements de renouveau spirituel caractéristiques du protestantisme. L'expression "Grand Réveil" a récemment été remise au goût du jour comme indicateur d'une révolte "spontanée" non spécifiée des masses (des peuples) contre la Grande Remise à zéro "mondialiste" imposée (aussi) par les mesures visant à contenir la crise pandémique, par la pandémie elle-même ou par le récit qui en est fait (ou préparé) en "Occident".
Ces aspects nécessitent naturellement une étude plus approfondie, que nous tenterons de fournir au cours de ce travail. Cependant, il semble presque un devoir de rappeler que l'"Occident" reste l'espace géographique-idéologique soumis à l'hégémonie culturelle et militaire des États-Unis d'Amérique. Par conséquent, il est assez rare qu'une expression idéologico-religieuse émanant du "centre impérial" vise de quelque manière que ce soit à sa destruction.
L'histoire nous enseigne que toute tentative de renouveau spirituel (qu'elle ait échoué ou non) conçue et guidée par les échelons supérieurs du pouvoir impérial a toujours eu pour objectif le renforcement de l'empire lui-même et non sa dissolution. Prenons l'exemple de la tentative de l'"impératrice philosophe" Julia Domna, tout en distinguant les aspects purement traditionnels de la modernité. Celle-ci, épouse de Septime Sévère et fille d'un prêtre du dieu syriaque El-Gabal, pensait à une uniformisation spirituelle renouvelée de l'Empire romain par l'imposition d'une sorte d'énothéisme solaire capable de surmonter les divisions entre les différentes croyances religieuses en son sein. Et son objectif était de donner vie à un modèle théologique qui légitimerait et sacraliserait à nouveau l'espace impérial après que la coïncidence originelle du droit, de la politique et de la religion se soit lentement estompée [1]. Son objectif, comme celui de Julien après elle, était donc de renforcer et non de détruire.

Pour en revenir à l'actualité, les pages d'Eurasia ont souvent traité de l'incohérence quasi absolue de la dichotomie mondialisme/souverainisme (deux faces d'une même pièce qui évoluent dans le paradigme géopolitique de l'atlantisme). Le discours est différent en ce qui concerne le Grand Réveil susmentionné.
L'observateur non averti de la réalité serait enclin à considérer et à accepter (pour le meilleur et pour le pire) ce "phénomène" comme quelque chose d'absolument original: comme une opposition naturelle au dessein de la "grande restauration" (théorisée au forum de Davos en 2020) selon ses plus ardents adeptes ; comme le résultat de fantasmes conspirationnistes selon ses détracteurs. Ces deux positions sont erronées.
Au tournant des XVIIIe et XXe siècles, comme le rapporte l'étude de Maria G. Buscema, il y a eu au moins trois ou quatre (selon l'interprétation) grands réveils différents (il y en aurait même cinq avec le réveil actuel). Toutes, bien qu'inspirées par des pratiques religieuses nées en Europe, sont originaires des États-Unis. Et toutes ont eu des répercussions dans les sphères religieuses et politiques. Ceux-ci, affirme la chercheuse de Syracuse, "ont en commun le fait de centrer leur enseignement sur la doctrine du péché et de la grâce que l'on trouve dans la Bible, mais lue à la lumière de la Réforme, c'est-à-dire en mettant le Christ au centre de la prédication, en éloignant les fidèles des rituels et des cérémonies et en rendant la religion intensément personnelle pour les fidèles ordinaires" [2].
De là, nous pouvons voir une première différence substantielle non seulement entre la doctrine catholique et protestante, mais aussi entre différents courants au sein même du protestantisme: c'est-à-dire entre les protestants traditionalistes, d'une part, centrés sur l'importance du rituel et, d'autre part, les nouvelles expressions religieuses visant à encourager une plus grande implication émotionnelle et un engagement personnel au nom de la spiritualité.
À cet égard, il convient de rappeler que le prosélytisme religieux, comme la propagande politique, recherche toujours l'implication émotionnelle directe de la personne. Par conséquent, le prosélytisme et la propagande doivent être réglementés en fonction du public auquel ils s'adressent.
Comme l'écrivait Lord Northbourne à l'époque: "De nos jours, les représentants de la religion n'osent rien faire d'autre que de paraître à la page. C'est pourquoi ils s'efforcent toujours de rendre les écritures et les doctrines de la religion intelligibles pour le commun des mortels en essayant de les définir en termes adaptés à ses capacités d'analyse mentale et de déduction [...] rien ne restreint mieux que la manie de la définition, qu'elle soit philosophique ou populaire. Une divinité définie n'est pas divine, mais humaine ; elle n'est pas Dieu, mais une idole" [3]. En fait, en paraphrasant René Guénon, en essayant d'amener Dieu dans les états inférieurs de l'être (une pratique répandue dans le protestantisme anglo-américain) on ne fait que développer un "satanisme inconscient" beaucoup plus pernicieux que le satanisme réel et conscient (un phénomène à peine répandu et plutôt grotesque).
Pour en revenir aux différents "grands réveils", il est utile de rappeler que les racines de ce phénomène peuvent être facilement identifiées dans le piétisme: courant protestant développé en Europe centrale aux 17ème et 18ème siècles en réaction au dogmatisme luthérien classique. Le piétisme s'opposait au rationalisme de la théologie luthérienne en mettant l'accent sur la dévotion intérieure, grâce à laquelle les adeptes étaient élevés au niveau des "éveillés" ou des "régénérés". Sur la base de cette idée de "réveil" ou de "renaissance" en Christ, les grands réveils nord-américains se sont développés à partir du 18ème siècle. Le premier de ceux-ci, dit Maria G. Buscema, remonte au méthodisme, qui a offert une substance et une force nouvelles à l'action des prédicateurs évangéliques, généralement d'origine calviniste et marqués par une forte rigueur morale.
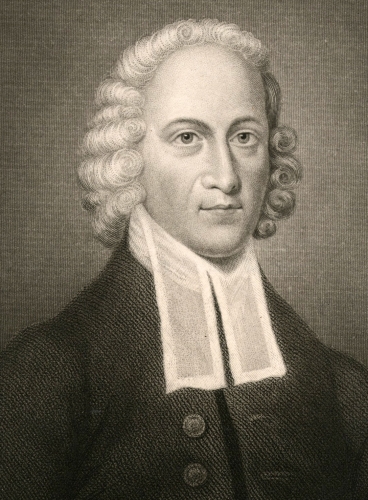
Jonathan Edwards.
Aux États-Unis, nous avons le prédicateur écossais Thomas Chalmers (1780-1847) [...] ou la prédication charismatique des pasteurs George Whitefield (1714-1770) et Jonathan Edwards (1703-1758) [...] La prédication de ce dernier s'accompagne d'une vague de fanatisme millénariste qui se répand du Connecticut à la Nouvelle-Angleterre. Ses prédications, appelant au "Nouvel Israël" américain et à l'alliance conclue avec Yahvé, suscitaient des foules extatiques à l'écoute des sermons des pasteurs itinérants [...] Il fut suivi du Second Grand Réveil (1800-1858), particulièrement fort dans le Nord-Est et le Midwest, qui impliqua les classes inférieures et moyennes et eut pour centre de prédication revivaliste le district dit "Burned over" dans l'ouest de l'État de New York, appelé ainsi en raison du thème constant des sermons: "la damnation éternelle dans les flammes de l'enfer" [5]. Le troisième Grand Réveil (1859-1900) est généralement associé à l'impulsion donnée à l'action missionnaire et à la naissance des Témoins de Jéhovah. Alors qu'avec le quatrième Grand Réveil (qui a commencé au tournant des années 60 du siècle dernier) on entre dans une dimension plus proprement politique et géopolitique. Elle se distingue par le succès de certains des acronymes les plus conservateurs du panorama religieux nord-américain qui se sont engagés, par exemple, dans des batailles "éthiques", dictées par une lecture littérale du texte biblique, contre l'évolutionnisme et en faveur du "créationnisme".
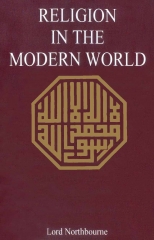 Il est ici nécessaire d'ouvrir une brève parenthèse, étant donné que les théories évolutionnistes et créationnistes ont toutes deux des origines modernes. "L'un et l'autre, dit Lord Northbourne déjà cité, cherchent à tout expliquer en termes d'avantages et d'inconvénients immédiats et tangibles" [6]. Ainsi, les deux courants, tout en étant en antithèse l'un avec l'autre (puisque le "créationnisme" part d'un présupposé religieux), sont régis par une tendance intrinsèquement matérialiste.
Il est ici nécessaire d'ouvrir une brève parenthèse, étant donné que les théories évolutionnistes et créationnistes ont toutes deux des origines modernes. "L'un et l'autre, dit Lord Northbourne déjà cité, cherchent à tout expliquer en termes d'avantages et d'inconvénients immédiats et tangibles" [6]. Ainsi, les deux courants, tout en étant en antithèse l'un avec l'autre (puisque le "créationnisme" part d'un présupposé religieux), sont régis par une tendance intrinsèquement matérialiste.
Le célèbre pasteur évangélique Bill Graham (1918-2018) est lié au quatrième Grand Réveil. Il a exercé son influence sur de nombreux locataires de la Maison Blanche, et plus généralement sur les dirigeants politiques américains, tout au long du milieu du 20e siècle et du début du 21e siècle, d'Eisenhower à Jimmy Carter et de Bill Clinton au vice-président de Donald J. Trump, Mike Pence.
Avec ce que nous pourrions appeler le cinquième grand réveil (dont la date de début pourrait coïncider avec l'élection de Donald J. Trump en 2016), la dimension géopolitique prend encore plus de valeur. Cependant, la traditionnelle "destinée manifeste" (la mission des États-Unis de construire un ordre mondial à leur image) est masquée par une lutte idéologique-eschatologique entre le bien (l'humanité en général) et le mal (les soi-disant élites libérales transnationales, présentées comme les "alliés" de la menace numéro un pour l'hégémonie mondiale des États-Unis: la Chine).

Cette nouvelle "théologie politico-apocalyptique" a pu surmonter le trumpisme lui-même (la défaite électorale de "l'homme que Dieu a envoyé pour débarrasser le monde du mal" selon les adeptes de QAnon) et les frontières du centre "impérial" pour s'étendre à la périphérie européenne (également grâce à des agitateurs politiques zélés, dont le penseur russe Alexandre Douguine, auteur d'un manifeste du Grand Réveil contre la Grande Restauration dans lequel sont chantées les louanges du trumpisme et de l'Amérique comme lieu du "crépuscule du libéralisme") [7]. Ce court pamphlet mérite qu'on s'y attarde, car il marque le passage définitif d'une perspective géopolitique quasi déterministe (les États-Unis sont poussés à la conquête du monde par leur nature thalassocratique intrinsèque) à une perspective purement politique, dans laquelle un "philosophe" (prétendument "évolien") fait ouvertement un clin d'œil à des éléments anti-traditionnels tels que le messianisme numérisé de la pseudo-religion QAnon susmentionnée [8]. Il importe peu que le trumpisme, en termes géopolitiques, ait évolué dans une continuité absolue avec les administrations précédentes, en appliquant la stratégie américaine habituelle: exacerber les tensions pour assurer des revenus au complexe industriel de guerre nord-américain et construire des blocs d'opposition entre l'Europe et le reste de l'Eurasie.
Or, la "théologie apocalyptique-politique" susmentionnée, profondément inspirée par les thèmes classiques de l'évangélisme et du sionisme chrétien, trouve sa référence théorique dans un tout aussi court pamphlet de 1944 écrit par le théologien réformé Reinhold Niebuhr et intitulé Les enfants de la lumière et les enfants des ténèbres. Le "travail" mérite une nouvelle parenthèse, car il exprime l'idée d'un véritable choc existentiel entre les États-Unis et l'Europe. À vrai dire, l'idée n'est pas particulièrement originale non plus. Déjà au cours du 19ème siècle, des thèses de conspiration ont été propagées aux États-Unis, selon lesquelles les empires européens, de concert avec le pape et les jésuites, tentaient de détruire le gouvernement démocratique de Washington.
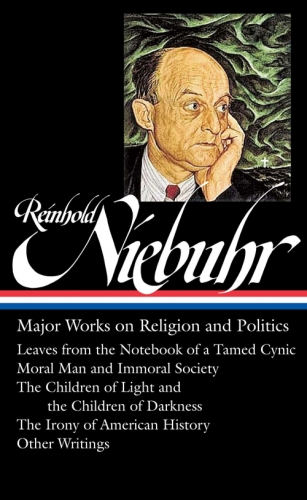
En fait, le pamphlet de Niebuhr se concentre sur la "civilisation démocratique moderne". Celle-ci, appuyée sur le "credo libéral", est l'expression des "enfants de la lumière", dont le seul péché est une approche sentimentale naïve des relations internationales. La "civilisation démocratique" est opposée à celle des "enfants des ténèbres", qui sont voués au cynisme moral (une caractéristique qui, selon Niebuhr, distingue aussi bien Mussolini, lié à Mazzini par une ligne directe, qu'Hitler); leur antidémocratisme serait influencé politiquement par Hobbes et religieusement par Luther. Ils sont mauvais mais très intelligents et ne connaissent aucune loi ni aucun droit autre que la simple force. L'ennemi des "enfants de la lumière" ne peut donc être que la "fureur démoniaque" du nazisme et du fascisme, qui ont mis les outils de la technologie moderne au service d'une idéologie antimoderne qui place la communauté avant l'individu [10].
Or, les affirmations de Niebuhr peuvent facilement être réfutées à plusieurs niveaux. Le théologien réformé, en premier lieu, semble être un piètre connaisseur de Hobbes, dont le "seul défaut", au mieux, serait de ne jamais dissimuler le pouvoir, son poids et sa position centrale dans tous les comportements humains, et de ne jamais l'exalter. Deuxièmement, il semble ignorer les multiples crimes du colonialisme libéral et le fait même que la soi-disant "Doctrine Monroe", loin d'être le produit d'une géopolitique isolationniste, était simplement la première expression de l'impérialisme nord-américain.

En outre, il semble ignorer le fait que l'absence de "droit", pour paraphraser Carl Schmitt, a principalement caractérisé les actions nord-américaines sur le continent européen. En diabolisant l'ennemi (qui mérite d'être anéanti), les États-Unis ont ramené la "loi de la jungle" en Europe. Surmontant le traditionnel ius publicum europaeum qui était à la base des relations entre les monarchies chrétiennes du continent, les États-Unis ont imposé une domination sur le continent qui aujourd'hui, à la seule exception de la Russie, est devenue totale.
Il n'est pas surprenant que l'agitateur et théoricien trumpiste Steve Bannon ait souvent fait référence à un "capitalisme éclairé" non spécifié, imprégné de "valeurs judéo-chrétiennes", qui a aidé à vaincre le nazisme et à renvoyer un "empire barbare" (la référence est à l'Union soviétique) à l'Est (11). Et il n'est pas surprenant que les partisans actuels du Grand Réveil aient alternativement recours à des comparaisons avec le communisme et le nazisme pour décrire les conditions restrictives actuelles.
Bannon lui-même a repris le thème (non sans références bibliques) des "enfants de la lumière contre les enfants des ténèbres" dans une interview désormais célèbre de l'ancien nonce apostolique aux États-Unis, Carlo Maria Viganò, connu pour ses positions pro-Trump et anti-Biggerhead [12]. Dans cette interview, il est fait explicitement référence à l'alliance impie entre "l'État profond mondialiste" et le "régime communiste brutal" (la référence est la Chine). Une théorie qui semble plutôt bizarre si l'on considère que l'homme de référence du mondialisme, George Soros, est considéré comme un terroriste en République populaire de Chine, et que l'actuelle administration Biden n'a fait qu'exagérer davantage les positions géopolitiques anti-chinoises de la précédente (on pense à la signature du pacte AUKUS et au renforcement militaire du gouvernement séparatiste de Taïwan, cheval de bataille de Steve Bannon).

À vrai dire, le prétendu État profond s'est désintéressé de la Chine au moment même où Bannon a compris que le grand pays asiatique représentait une menace réelle pour l'hégémonie mondiale nord-américaine. C'était déjà le cas lors du premier mandat présidentiel de Barack Obama. En ce qui concerne les soi-disant élites mondialistes, leur intérêt pour le marché chinois est inextricablement lié au renversement du gouvernement du PCC. Ce n'est pas un hasard si le spéculateur George Soros, déjà cité, a décrit à plusieurs reprises le président chinois Xi Jinping comme le plus grand ennemi de la société ouverte.
La crise pandémique n'a fait qu'exagérer davantage des positions qui restent toujours parfaitement dans le schéma géopolitique atlantiste (qu'elles soient progressistes ou réactionnaires). Il ne s'agit pas ici d'établir l'origine du virus, sujet sur lequel il n'y aura jamais de parole définitive (bien que l'auteur se soit fait sa propre idée sur la base de l'observation empirique que la recherche constante d'un ennemi est un présupposé fondamental pour la réaffirmation continuelle du schéma hégémonique nord-américain). Ce qui compte, ce sont ses effets.
Le premier effet, et le plus évident, de la crise pandémique a été l'accélération de certaines tendances et dynamiques qui se manifestaient en "Occident" depuis plusieurs décennies. L'évolution de la société occidentale vers une forme de "capitalisme de surveillance" ou de "totalitarisme libéral" a été "mal comprise" par les théoriciens du "grand réveil" comme une forme de "chinoisisation de la société". Pour être juste, son antécédent historique le plus immédiat peut facilement être trouvé dans le Patriot Act de l'administration Bush Jr, qui a donné à la NSA le champ libre pour espionner les citoyens américains eux-mêmes. En outre, des systèmes de contrôle et de suivi de la population étaient en place bien avant la crise pandémique grâce aux plateformes sociales et de recherche du réseau.
Les mêmes mesures pour contenir l'épidémie entre la Chine et l'"Occident" étaient complètement différentes. Dans le cas de la Chine, on a opté pour des fermetures localisées, une traçabilité rapide et le renforcement des soins de santé en tant qu'outil de sécurité nationale. Dans le cas de l'Occident (sauf dans de rares cas), en raison également des immenses dégâts générés par des décennies de néolibéralisme exaspéré, l'accent a été mis sur les confinements généralisés et prolongés, la lenteur ou l'absence de suivi, la mise en cause de la population et le cyberterrorisme. En outre, les vaccins (bien sûr, uniquement ceux produits par les multinationales pharmaceutiques occidentales) ont été considérés comme l'unique moyen de surmonter la crise, jusqu'au cas extrême de l'Italie (véritable laboratoire d'expériences politiques, du gouvernement jaune-vert au gouvernement hyper-atlantique du "bankster" [13] Mario Draghi), où une sorte d'obligation vaccinale fictive a été imposée par le biais du "certificat vert" : un outil qui discrimine ouvertement non seulement ceux qui ont choisi de ne pas se faire vacciner, mais aussi ceux qui l'ont fait avec des vaccins non occidentaux. Cette mesure, il faut le souligner, n'existe pas en Chine, où un état semi-normal a déjà été rétabli à l'été 2020 sans aucune obligation de vaccination, fictive ou non. On peut donc parler à juste titre d'une nouvelle "israélisation de la société".
Il n'en va pas différemment si la "chinoisisation de la société" signifie la réduction progressive des droits du travail, puisque nous avons affaire à deux formes de société complètement différentes. Concrètement, il est impossible d'établir des comparaisons entre une forme de socialisme national capable de sortir plus de 700 millions de personnes de la pauvreté et centré sur l'idée de "prospérité commune" et un modèle néolibéral, dont la seule aspiration est d'expérimenter de nouvelles techniques d'oppression (sans rien donner en retour à la population) afin de maintenir intact son système d'exploitation face aux crises structurelles cycliques de l'hypercapitalisme.
Une véritable opposition à l'évolution actuelle du système ne peut se limiter à un simple "non" au vaccin ou au "certificat vert". En laissant de côté le fait que se définir comme "éveillé" pour le simple fait d'avoir refusé une injection ferait rire même un débutant dans le domaine des études traditionnelles, penser que l'on peut créer une opposition au système uniquement et exclusivement sur ces bases, ou aspirer à un retour au passé qui a ouvert la voie à la situation actuelle, sans même gratter un pouce des dogmes atlantistes, c'est être absolument consubstantiel au système lui-même.
NOTES:
[1] Cf. C. Mutti, Introduzione alle Epistole di Apollonio di Tiana, Edizioni di Ar, Padova 2021, pp. 9-41.
[2] M. G. Buscema, Il “Grande Risveglio”. Una teologia politico-apocalittica?, “Eurasia. Rivista di studi geopolitici” 4/2021, P. 122.
[3] Lord Northbourne, Quale progresso?, Cinabro Edizioni, Roma 2021, p. 104.
[4] R. Guénon, Errore dello spiritismo, Luni Editrice, Milano 2014, p. 198.
[5] Il “Grande Risveglio”. Una teologia politico-apocalittica?, ivi cit., p. 124.
[6] Quale progresso?, ivi cit., p. 64.
[7] A. Dugin, Contre le great reset, le manifest du grand réveil, Ars Magna (2021), p. 47. Recension de Claudio Mutti in “Eurasia” 4/2021, pp. 221-222.
[8] Ibidem, p. 38.
[9] Cf. R. Hofstadter, The paranoid style in American politics, www.harpers.org.
[10] Cf. R. Niebuhr, The children of light and the children of darkness, Charles Scribners’s Son (1944).
[11] Cf. A. Braccio, Gli USA contro l’Eurasia: il caso Bannon, www.eurasia-rivista.com.
[12] La citation précédente de Lord Northbourne concernant la tentative de rendre Dieu définissable par tous, même par les esprits les moins préparés, s'applique parfaitement à la condition actuelle de l'Église catholique. Les deux positions, la "moderniste" de Bergoglio et la "conservatrice" de Viganò, sont profondément influencées par l'esprit protestant. Le premier s'est plié au style de propagande évangélique pour rendre l'image de Dieu accessible à tous. Le second a opté pour l'approche apocalyptique typique de l'évangélisme nord-américain. Il faut ajouter à cela que de nombreuses positions de Bergoglio sont souvent et volontairement déformées.
[13) Le terme a été utilisé par Léon Degrelle dans les années 1930 pour désigner les pratiques de gangsters employées par les grandes institutions de la finance pour maintenir leur contrôle sur les peuples.
11:49 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, protestantisme, états-unis, évangéliques, grands réveils |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Nous nous dirigeons vers la tyrannie mais ce n'est pas le fascisme, c'est l'hyperdémocratie

Nous nous dirigeons vers la tyrannie mais ce n'est pas le fascisme, c'est l'hyperdémocratie
Adriano Scianca
SOURCE : https://www.ilprimatonazionale.it/cultura/ci-avviamo-verso-tirannide-ma-non-fascismo-iperdemocrazia-213303/
Finalement, la gauche avait raison : les masses déculturées, abruties par des années de lavage de cerveau, nous mènent vers la tyrannie. Ils se sont seulement trompés dans l'identification du facteur de déculturation : ce n'est pas la chaîne de télévision Rete 4, les showgirls, les ballets, la télévision de l'après-midi qui ont fait de nous une masse prête à subir n'importe quelle brimade, et même à la revendiquer avec joie. C'était eux. C'était la gauche. Pas tant, et pas seulement, le PD socialiste italien, qui est maintenant une agence oligarchique froide, souvent un collecteur maladroit d'intérêts et de demandes supranationales, mais la gauche médiatique, la gauche sociale, celle qui fait une masse critique dans la communication et a la puissance de feu suffisante pour façonner une partie du discours dominant. Mais attention : l'autoritarisme auquel nous sommes confrontés n'est pas une trahison de la démocratie et de la Constitution, et encore moins un "retour du fascisme", mais plutôt une hyperdémocratie, une démocratie impatiente, qui, à la poursuite de ses propres fétiches, a commencé à considérer avec suspicion chaque obstacle procédural, chaque finesse formelle, même chaque subtilité de contenu. Examinons quelques-uns de ces fétiches.
L'hyperdémocratie et ses fétiches : la compétence
Fétichisme de la compétence : en partie pour plaire aux travailleurs précaires semi-culturés qui exorcisent leurs frustrations existentielles en corrigeant les subjonctifs sur les réseaux sociaux, et en partie pour répondre aux exigences du libéralisme technocratique, la compétence (compétence sur la base de quels paramètres ? sur la base de quelle grille de valeurs ?) est devenue ces dernières années l'alpha et l'oméga de la politique. Il se trouve que, face au super-compétent Draghi, tout droit réel piétiné est euphémisé sur un ton lyrique, et toute hypothèse qui évoque un coup d'État devient, dans la narration officielle, un ingénieux coup de théâtre à saveur institutionnelle.
Giancarlo Giorgetti peut donc spéculer sans risque et nous dire que "Draghi pourrait diriger le convoi de l'extérieur", c'est-à-dire depuis le palais du Quirinal, "il s'agirait d'un semi-présidentialisme de fait, dans lequel le président de la République élargit ses fonctions en profitant d'une politique faible". Et ainsi le dépassement du parlementarisme, de cauchemar nostalgique, devient un rêve de stabilité qui ne soulève plus aucune objection. Au contraire : sur Twitter, c'est l'ancien directeur de Repubblica Carlo Verdelli, qui, il y a quelques mois, a paralysé l'Italie parce qu'un fou l'a insulté sur les réseaux sociaux, qui a tweeté: "Tant de huées mais Giorgetti dit la vérité : il dirige Draghi partout où on le met, y compris au Quirinal". La Constitution dit-elle autre chose? Amen, au moins jusqu'à ce que l'Europe finance le redémarrage et que les partis sortent du coma. Nous avons le premier "premier ministre multilatéral". Et voici un cas typique dans lequel l'évolution autoritaire de la démocratie est justifiée par les arguments de la démocratie elle-même.
Le fétichisme des droits
Fétichisme des droits : tout le débat sur le projet de loi Zan a tourné autour de la pensée magique. À partir d'un certain moment, la réalité n'a plus d'importance, le contenu même du projet de loi devient un détail par rapport à la puissance évocatrice du simple mot "droits". Il y a effectivement eu un débat sur le fond du projet de loi, et les critiques du texte sont venues non seulement de toute la droite, y compris des franges libérales, mais aussi du Vatican et, surtout, d'une grande partie du monde féministe et LGBT. Mais ces critiques ont été noyées dans le bruit de fond des différents Fedez, dans le bavardage des commentateurs les plus exaltés, qui ont à leur tour soulevé des foules d'adolescents et de post-adolescents sans la moindre grammaire fondamentale de la politique, qui ont grandi sous la bannière d'un fondamentalisme dont le seul commandement est "tu n'auras pas de Dieu mais tes droits".


Face à cette masse à la puissance de feu impressionnante, toute discussion sur le fond a été anéantie et l'ensemble du débat est devenu une sorte de rituel bacchique centré sur l'évocation de mots magiques et d'actes de désespoir théâtralisés. Des hordes de jeunes militants étaient sincèrement convaincus qu'en rejetant le projet de loi, quelqu'un leur avait "retiré leurs droits", une phrase qui semble incompréhensible même si l'on apprécie le texte de Zan (rejeter un décret qui renforce les peines pour les "homophobes", en quoi cela retire-t-il les droits des homosexuels ?). Beaucoup se sont même indignés du simple fait qu'il y ait eu un débat, un vote sur le projet de loi, que cela n'aille pas de soi. À ceux qui craignaient des risques pour la liberté d'opinion, ils ont répondu que "la haine n'est pas une opinion", une phrase qui n'a évidemment aucun sens.
Le fétichisme de la sécurité
Fétichisme sécuritaire : l'interdiction de parole et d'action infligée à Stefano Puzzer, leader des dockers rebelles de Trieste, a été accueillie avec satisfaction et ironie par le même monde qui a pleuré les droits violés par le rejet du projet de loi Zan. Puisque Puzzer n'est pas aimé et qu'il dit des choses qui ne sont pas aimées, si l'État le punit de manière anormale et injustifiée, l'Etat a raison quoi qu'il en soit (personnellement, je suis loin de voir Puzzer comme une référence humaine ou politique, mais ce n'est pas le cœur du problème).

D'ailleurs, la pratique du daspo a déjà été expérimentée avec succès dans les stades, contre ces ultras qui tapent un peu sur les nerfs de tout le monde et pour lesquels, par conséquent, il n'était pas bien élevé de se battre. Que tous ces faits marquent des précédents inquiétants n'intéresse personne : ceux qui ont scandé à tout bout de champ "D'abord ils sont venus prendre...", nous font comprendre qu'avec cette rime ils n'affirmaient pas un principe général (défendre aussi les libertés de ceux que l'on n'aime pas, car de cette façon on se défend aussi soi-même), mais s'inquiétaient littéralement des catégories spécifiques mentionnées : s'ils viennent prendre les communistes, les tziganes etc. il y a de quoi s'inquiéter, tous les autres peuvent être expulsés aussi.
Le fétiche de l'antifascisme
Le fétiche de l'antifascisme : le premier et le plus important des fétiches est évidemment celui-ci, celui qui soutient tout l'échafaudage institutionnel et moral de l'esprit du temps. Oubliez le "nazipass", oubliez "Draghi comme Mussolini". En fait, à y regarder de plus près, le premier véritable précédent du laissez-passer vert - une certification qui concède certains droits réels à des personnes qui n'ont enfreint aucune loi - se trouve dans les diverses "déclarations d'antifascisme" exigées dans les municipalités dirigées par le parti démocrate. Comme si la pleine citoyenneté ne découlait pas de la loi, mais d'une superposition idéologique. Mais cela, bien que contraire à tout principe de droit, et aussi aux lois en vigueur, n'a pas suscité de critique, car le fond (la lutte contre le fascisme) rend inutile toute question de forme. Et, de la même manière, une forme abstraite, presque métaphysique, de protection de la santé de la part de Covid rend tout abus plausible. Et lorsque Facebook censure CPI ou, sur un autre plan, Trump, la plupart des commentateurs - ou du moins ceux qui font la masse critique, celle mentionnée plus haut - ne s'interrogent pas le moins du monde sur ce que cela signifie en termes structurels, juridiques, éthiques, politiques. Tout est ramené à d'autres mots fétiches, comme "haine". Et comment ne pas être contre la haine ?

Une tache informe
Et ainsi de suite. Des années de rhétorique démocratique ont déshabitué les esprits, surtout les plus jeunes et les plus influents, à l'esprit critique, au raisonnement dans son ensemble, à la lecture de la profondeur historique des faits, à toute conjecture qui ne soit pas purement subjective. Cela a créé une tache informe qui engloutit la démocratie elle-même. Mais ce qui nous sera recraché ne sera pas du tout le fascisme, qui n'a rien à voir avec lui et reste le "tout autre" par rapport à ce monde. Au contraire, nous aboutirons à une forme d'hyperdémocratie féroce, technocratique, policière, mais toujours considérée comme bonne, très, très bonne.
Adriano Scianca
10:52 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : actualité, haine, hyperdémocratie, tyrannie, politiquement correct |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 05 novembre 2021
Agenda vert et/ou retour au charbon: les contradictions "noires" et "vertes" de Biden
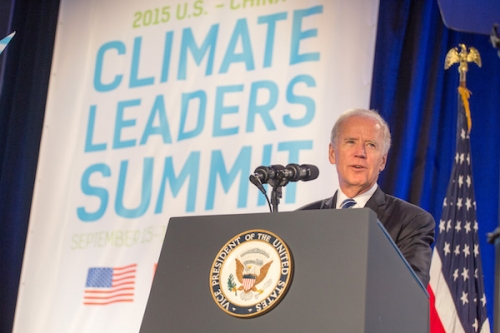
Agenda vert et/ou retour au charbon: les contradictions "noires" et "vertes" de Biden
Alfredo Jalife Rahme
Source: https://www.jornada.com.mx/2021/11/03/opinion/016o1pol & https://www.alfredojalife.com/2021/11/03/las-negras-contradicciones-verdes-de-biden/
Le grave problème que pose le prétendu "leadership mondial" des États-Unis, avec ses mesures de lutte contre le changement climatique depuis près d'un quart de siècle, est la géopolitisation de l'"agenda vert". Ainsi, le protocole de Kyoto, signé en 1997 par Clinton, avec son vice-président pharisien Al Gore - qui se prend pour l'écologiste suprême de la Voie Lactée - a été rejeté en bloc en mars 2001 par Baby Bush. Bill Clinton et Baby Bush se sont lancés la balle du rejet parce que sa mise en œuvre allait coûter 4000 milliards de dollars à leur pays.
De même, Trump, la main sur la ceinture, a rejeté l'Accord de Paris sur le climat de 2016 - signé par le duo Obama/Biden - et qui, dans une large mesure, constitue la matrice opérationnelle de la COP26 qui a connu 25 réunions anticipées avec une exagération cacophonique stridente, mais sans aucune concrétisation. Ni le sommet du G20 à Rome ni celui de la COP26 à Glasgow, en Écosse, n'ont bénéficié de la présence irremplaçable des deux autres superpuissances du "nouvel (dés)ordre tripolaire", la Chine et la Russie, ce qui délégitime toute résolution intrinsèquement non contraignante, même si le tsar Vlady Poutine (https://reut.rs/2Y8TKOw) et le mandarin Xi (https://bit.ly/3CFxsmL) ont tous deux participé à des téléconférences au cours desquelles ils ont fait preuve de souplesse pour atténuer, en fonction des circonstances de chaque nation, l'indéniable changement climatique.
Le problème de Biden n'est pas mondial, pas même dans son hostilité contre la Chine, la Russie et l'Arabie saoudite, mais national, où son propre coreligionnaire démocrate, le sénateur Joe Manchin - pour la Virginie occidentale, deuxième État producteur de charbon après le Wyoming, sans parler de ses ressources en gaz de schiste - entrave son programme vert idyllique qui est également pernicieux pour les États producteurs de pétrole du Texas et de l'Oklahoma. Il s'avère et met en évidence que Biden vante une chose, tout en faisant le contraire, comme c'est le cas avec l'augmentation "pour la première fois en sept ans" de la "quantité d'électricité aux États-Unis générée" par l'abominable charbon, selon le Daily Mail du Royaume-Uni (31/10/21), très proche du MI6, qui affirme que la crédibilité du président assiégé a été sérieusement érodée.

En raison de la montée en flèche du coût du gaz naturel - qui, soit dit en passant, touche le Mexique depuis l'inconcevable naïveté de López Portillo - "il (Biden) est revenu au charbon" (méga !), selon l'Energy Information Administration américaine.
Les initiés soulignent que l'émergence de l'utilisation du charbon aux États-Unis "est le résultat de politiques qui diabolisent le gaz naturel". Biden et Bill Gates sont tous deux connus pour mener une guerre géopolitique contre le gaz naturel afin de saper le leadership de la Russie, de l'Iran, du Qatar et du Turkménistan (https://bit.ly/3GNUb2b). Autre problème juxtaposé, le gaz naturel reste le premier producteur d'électricité aux États-Unis, devant le charbon, dont la production a augmenté de 22 % depuis le début de l'année, les centrales nucléaires (en tête de cette catégorie), bien avant l'énergie éolienne/solaire naissante et l'hydroélectricité (https://bit.ly/31kb701).
De manière surprenante, le journal mondialiste pro-"vert", le New York Times, expose la contradiction flagrante de Biden qui, tout en "poussant à l'énergie propre, cherche à accroître la production de pétrole" (mégassic !). Biden lui-même a fait remarquer qu'"il semble ironique qu'il appelle les pays riches en énergie à stimuler la production de pétrole" tout en "implorant le monde de juguler le changement climatique" (https://nyti.ms/3q1ZWDI).
Selon le New York Times, Darren Woods, directeur d'Exxon Mobil, a déclaré devant un panel de la Chambre des représentants que "nous ne disposons pas actuellement de sources d'énergie alternatives adéquates", de sorte que "le pétrole et le gaz continueront d'être nécessaires dans un avenir prévisible".
Les jeunes Européens qui adhèrent à l'agenda environnemental ne sont pas disposés à retarder et à envisager la décarbonisation de la planète alors que Biden a ses plus grands détracteurs dans son propre parti, sans parler de la majorité des républicains. La véritable feuille de route et le calendrier de la COP26 seront peut-être décidés lors de l'élection cruciale du gouverneur de Virginie, et non à Glasgow ou à Rome.
Comment lire Alfredo Jalife Rahme sur le net:
https://alfredojalife.com
Facebook : AlfredoJalife
Vk : alfredojalifeoficial
Télégramme : AJalife
https://www.youtube.com/channel/UClfxfOThZDPL_c0Ld7psDsw?view_as=subscriber
11:30 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : joe biden, états-unis, actualité, énergie, charbon, agenda vert |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 04 novembre 2021
Bonnal et la Gauche Caviar
10:29 Publié dans Actualité, Définitions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nicolas bonnal, gauche caviar, gauche, actualité, idéologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 01 novembre 2021
Pourquoi les médias occidentaux ont-ils commencé à parler d'Armageddon ?

Pourquoi les médias occidentaux ont-ils commencé à parler d'Armageddon?
Vladimir Malyshev
Ex: https://www.geopolitica.ru/es/article/por-que-los-medios-de-comunicacion-occidentales-han-comenzado-hablar-del-armagedon
Lior Ron, responsable de la division logistique d'Uber Technologies, a déclaré dans une interview accordée à CNBC que l'effondrement du secteur du transport automobile américain est un "véritable Armageddon" (1).
Ce qui se passe actuellement était inimaginable, il y a peu: les ports américains connaissent d'énormes embouteillages et des dizaines de navires font la queue, incapables de décharger tout ce qu'ils transportent. Il faut des travailleurs pour décharger les conteneurs et des chauffeurs de camion pour transporter leur contenu vers les entrepôts. Il a même été dit qu'il y aurait de graves pénuries de nourriture et d'autres produits de base. La Maison Blanche a averti ses citoyens que les prix des produits de base risquent d'augmenter et que les rayons seront vides d'ici Noël (2).

Selon CNBC, le coût du transport des marchandises a augmenté de 300 %. En outre, la pénurie de conteneurs a entraîné des retards dans l'arrivée des marchandises achetées en Chine, de sorte que l'augmentation du prix des marchandises affectera gravement les consommateurs. Un cadre supérieur d'Uber Technologies a déclaré que cette crise "affecte l'ensemble du secteur du transport routier, nous n'avons jamais rien vu de tel".
La chaîne de télévision CNBC a rapporté qu'il n'y a pas assez de chauffeurs de camions (3) en raison des restrictions imposées par le coronavirus. Les raisons de cette situation sont bien connues: licenciements massifs dus à l'inactivité et fermeture "temporaire" des écoles de conduite de camions. Selon le Bureau of Labour Statistics, le secteur du camionnage a perdu 6 % de ses travailleurs, plus une moyenne de 1,52 conducteur, soit au moins 90.000 travailleurs. Il y a maintenant une pénurie de près de 100.000 conducteurs.
Le quotidien italien Corriere della Sera accuse le "goulet d'étranglement" provoqué par les restrictions économiques volontaires dans le monde entier: "Celles-ci ont affecté tous les points de la chaîne logistique pour le transport des produits finis et semi-finis et des matières premières, provoquant un manque de conteneurs, de cargos, la congestion des ports, la pénurie de camions et de chauffeurs routiers, ainsi que la détérioration des capacités de stockage. Cette situation est aggravée par des pénuries de main-d'œuvre généralisées, qui se font de plus en plus sentir dans un large éventail de secteurs" (4).
Bloomberg affirme toutefois que la pénurie d'approvisionnement a d'autres causes: "À la suite des mesures restrictives imposées par la pandémie de coronavirus, les fabricants et les analystes ont prédit une baisse de la demande pour plusieurs produits. Cependant, la demande de nombreux produits s'est maintenue et a même augmenté, de sorte que de nombreuses industries n'étaient pas préparées à cela" (5).
Les entreprises n'ont pas non plus mesuré l'impact du passage du face-à-face au télétravail, d'autant plus que les gouvernements ont demandé aux consommateurs de rester chez eux et que beaucoup ont été contraints d'acheter des téléphones, des ordinateurs, des consoles de jeux vidéo, etc. en quantités jamais vues auparavant. Le marché des ordinateurs personnels a connu une croissance de 11 % en 2020, ce qui n'était pas arrivé depuis 10 ans.

En outre, il y a eu une réduction des importations de microprocesseurs en provenance d'Asie, ce qui a ralenti bon nombre des industries qui dépendent des microprocesseurs, comme les automobiles, les ordinateurs, les téléphones mobiles, les jeux vidéo, les appareils ménagers et les dispositifs médicaux..... Selon Bloomberg, "c'est un cauchemar non seulement pour les enfants qui s'attendaient à recevoir des consoles de jeux vidéo pour Noël, mais aussi pour les entreprises, puisque cette période de vacances leur procure la majeure partie de leurs revenus".
Joe Biden a dû rencontrer les représentants de plusieurs détaillants privés (Walmart, Target) et de compagnies maritimes, mais aussi les autorités portuaires de Los Angeles, de Long Beach et les syndicats de dockers pour obtenir qu'ils acceptent de travailler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour transporter 40 % des conteneurs qui arrivent chaque jour aux États-Unis. Apparemment, il n'y aura plus de fermetures !
Beaucoup affirment que les marchandises qui n'ont pas été expédiées d'Asie jusqu'à présent n'atteindront pas les magasins avant la mi-décembre, ce qui montre que les chaînes logistiques se sont brisées assez facilement. Au cours des 12 derniers mois, les marchandises traversant l'océan Pacifique ne prennent plus 13 heures mais 13 jours pour être déchargées, sans compter que les prix sont montés en flèche. Par exemple, il est désormais sept fois plus coûteux d'expédier un colis de Los Angeles à Shanghai qu'il y a un an. Sameera Fazil, directrice adjointe du Conseil économique de la Maison Blanche, a déclaré qu'un miracle était nécessaire pour résoudre ce problème. D'autre part, il est devenu très difficile de construire des conteneurs car la "pandémie" a touché l'industrie de l'acier et du bois.
En Europe, la situation n'est pas bonne non plus : en Allemagne, il manque 80 000 chauffeurs de camions, alors que les ventes et la production de voitures ont diminué d'environ 30 %. Selon le cabinet de conseil Alix Partners, 7,7 millions de voitures en moins seront produites cette année, ce qui équivaut à 10 % de la production mondiale.
La crise des transports a entraîné une hausse des prix des denrées alimentaires. Selon la FAO, le prix de l'huile végétale a battu tous les records. Parallèlement, les prix des produits laitiers, de la viande importée et des céréales ont augmenté de 20 à 30 % par rapport à 2019 (6).
Cela a mis en évidence la dépendance croissante des États-Unis et de l'Europe à l'égard des importations en provenance d'Asie, notamment de la Chine. Les États-Unis dépendent à 90% des approvisionnements chinois pour la fabrication de certains produits médicaux et ce chiffre atteint plus de 80% pour les terres rares (7).
Dans de telles circonstances, la meilleure chose à faire n'est pas de claironner l'Armageddon ou de rencontrer la Maison Blanche, mais de combattre la psychose que la pandémie a générée.
Notes :
1. https://www.cnbc.com/2021/10/14/head-of-uber-freight-says-the-us-is-in-a...
2. https://www.reuters.com/world/us/americans-may-not-get-some-christmas-tr...
3. https://news.ati.su/news/2021/10/14/nehvatka-voditeley-vedet-k-krizisu-g...
4. https://www.corriere.it/esteri/21_ottobre_14/usa-merci-scarse-collasso-p...
5. https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2021-03-31/prices-are-going-u...
6. https://www.fao.org/news/story/ru/item/1393201/icode/
7. https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Biden-s-Asia-policy/US-and-allies-to-build-China-free-tech-supply-chain
Source : https://www.fondsk.ru/news/2021/10/18/pochemu-zapadnye-smi-trubjat-ob-ar...
09:58 Publié dans Actualité, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, économie, crise, pandémie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
La revue de presse de CD - 31 octobre 2021

La revue de presse de CD
31 octobre 2021
AFRIQUE
Au Bénin, le développement urbain se nourrit d'expulsions
Au moment où la France "rend" 26 œuvres d'art au Bénin, il est intéressant de découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas ce pays africain, comment le président Talon (qui ne se prénomme pas Achille) s'occupe de son peuple et de l'urbanisation de son pays...
The Conversation
https://theconversation.com/au-benin-le-developpement-urb...
CHINE
La question taïwanaise peut-elle déclencher la troisième guerre mondiale ?
L’armée chinoise a condamné le dimanche 17 octobre les États-Unis et le Canada qui ont envoyé en fin de semaine des navires de guerre dans le détroit de Taïwan, estimant que ces initiatives représentaient une menace pour la paix et la stabilité dans la région. Le 19 octobre le correspondant du Figaro à Taïwan posait la question figurant ci-dessus dans le titre mais se bornait à rappeler l’origine historique du différend, la position de la communauté internationale d’« une seule Chine », l’effort d’armement chinois et citait pour conclure Bonnie Glasser du Center for Strategic Studies : « si Taïwan est attaquée , nous allons vers un conflit majeur entre les Etats-Unis et la Chine, qu’il sera difficile de contenir avec un risque d’escalade nucléaire. »
Geopragma
https://geopragma.fr/la-question-taiwanaise-peut-elle-dec...
DÉSINFORMATION
Contrôle de l’information : après la commission Bronner, Viginum
L’élection présidentielle approche et ce que l’on pourrait appeler une oligarchie macronienne met en place les conditions d’une bonne réélection du président sortant via une plus grande efficacité du contrôle de l’information, que celle-ci soit privée ou publique. Viginum est une parfaite illustration du second terme.
OJIM
https://www.ojim.fr/controle-de-linformation-viginum/
Déontologie : quand des journalistes revendiquent leur qualité de non-journalistes
La charte de Munich adoptée en novembre 1971 par la Fédération européenne des journalistes précise la déontologie de la profession, en dix devoirs et cinq droits. Cinq journalistes viennent pourtant de publier une tribune sur le blog Médiapart “Journalistes pas complices” où ils annoncent gentiment s’assoir sur ses principes, tribune à laquelle ont répondu plusieurs dizaines de leurs confrères.
OJIM
https://www.ojim.fr/deontologie-journalistes-mediapart-tr...

Les Corsaires à l’assaut des ennemis de la liberté d’expression
L’Observatoire du journalisme a consacré plusieurs articles aux Sleeping giants, ces ennemis de la liberté d’expression qui intimident les annonceurs de publicité. Les campagnes de pression de cette officine, organisées principalement sur Twitter, ont abouti à réduire très fortement les ressources publicitaires de médias comme Breitbart, Valeurs actuelles et Boulevard Voltaire. La riposte s’organise avec un collectif nouvellement apparu appelé « les Corsaires » (www.corsairesdefrance.com), qui propose aux citoyens de contrer les actions liberticides des Sleeping giants.
OJIM
https://www.ojim.fr/les-corsaires-vs-sleeping-giants/
ÉTATS-UNIS
La persécution d’Assange expose au grand jour la sauvagerie de l’Occident
Les pires atrocités de l’histoire ont toutes été légales. Tous les pires exemples de génocide, d’esclavage, de tyrannie et d’effusion de sang ont été autorisés ou activement facilités par l’État. La persécution d’Assange vise à faire entrer l’emprisonnement des journalistes dans cette catégorie.
Le Cri des Peuples
https://lecridespeuples.fr/2021/10/29/la-persecution-dass...
FRANCE
Blanquer à l’Éducation nationale, la dictature en marche
Le 19 octobre 2021, Jean-Michel Blanquer a déclaré sans ambages : « Les enseignants doivent transmettre les ‘valeurs de la république’ ou ‘sortir de ce métier’. » À cet effet, il prévoit un « vaste plan de formation sur 4 ans des personnels, à la laïcité et aux valeurs de la république », prenant appui sur les hommages rendus à Samuel Paty, assassiné pour avoir illustré la liberté d’expression – au programme – par la présentation d’une caricature de Mahomet. C’est précisément pour avoir appliqué la politique du gouvernement qu’il a été assassiné.
Polémia
https://www.polemia.com/blanquer-a-leducation-nationale-l...
Ces ministres macroniens qui prennent la plume et ne vendent pas
Lors du conseil des ministres du 13 octobre, Emmanuel Macron aurait manifesté son (vif) mécontentement. À force de les voir publier des livres, « les Français vont finir par se dire que les ministres ne foutent rien ». D’autant que personne ne les lit, ces livres…
Front populaire
https://frontpopulaire.fr/o/Content/co683076/ces-ministre...
« Affaire du siècle » : le sidérant double jeu de Cécile Duflot et Nicolas Hulot
« Élève des corbeaux et ils te crèveront les yeux ». Depuis jeudi 14 octobre, le célèbre dicton espagnol ne doit cesser de résonner dans la tête des responsables de l’État qui s’étaient associés avec certains écologistes patentés. Le tribunal administratif de Paris les a enjoint de « réparer le préjudice écologique » causé par le non-respect des engagements de la France en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. L’État a maintenant jusqu’au 31 décembre 2022 pour économiser les 15 millions de tonnes de CO2 qu’il a « indument » rejeté dans l’atmosphère pendant la période 2015-2018… À l’origine de cette condamnation, on trouve, entre autres, Cécile Duflot et Nicolas Hulot qui sont aujourd’hui les dirigeants de deux des quatre ONG qui ont attaqué l’État en justice (la fondation Nicolas Hulot et Oxfam France).
Causeur
https://www.causeur.fr/affaire-du-siecle-fessenheim-nicol...

La CIA et l’OTAN lorgnent sur les pépites technologiques françaises
La French Tech n’est pas à l’abri de la guerre économique. Les PME et les start-up sont aussi la cible de certaines prédations. Charles Degand, président d’Angelsquare, analyse la récente création de fonds dirigés par la CIA et l’OTAN.
Conflits
https://www.revueconflits.com/la-cia-et-lotan-lorgnent-su...
GAFAM
Trafic d’êtres humains, cartel de la drogue et appel au génocide: pas besoin d’aller sur le dark web, Facebook s’occupe de tout
Depuis plusieurs jours, un consortium de médias américains révèle des informations très embarrassantes (et c’est peu dire) au sujet de Facebook. Leur base de travail: des milliers de documents internes à l’entreprise divulgués par une lanceuse d’alerte, Frances Haugen. Voici trois des éléments les plus scandaleux qui ressortent de ces Facebook Papers.
Businessam.be
https://fr.businessam.be/trafic-detres-humains-cartel-de-...
Jeremy Fleming: l'homme qui sous-traite la souveraineté numérique britannique à Amazon
Les services de renseignement informatique du Royaume-Uni ont signé un contrat avec l'Américain Amazon Web Services pour stocker des données sensibles. Directeur de ce pilier de la sécurité britannique depuis 2017, Jeremy Fleming a préparé les esprits depuis des mois à ce partenariat aux contours flous.
L’Echo
https://www.lecho.be/dossier/portraits/Jeremy-Fleming-l-h...
Facebook va-t-il rémunérer (et aussi contrôler) une partie de la presse française ?
Un « accord » aurait été signé le 21 octobre 2021 entre Facebook et certains quotidiens pour rémunérer ces derniers, dont ni les termes financiers ni la liste des heureux bénéficiaires ne sont connus.
OJIM
https://www.ojim.fr/facebook-presse-francaise/
ITALIE
Trois commentaires amers sur les dernières élections italiennes
La défaite du centre-droit en Italie : personne ne démissionne et personne ne change les équipes d'incompétents
Euro-synergies
http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2021/10/21/d...
ONU

Qui était Dag Hammarskjöld ?
Dag Hammarskjöld a établi la norme d’intégrité et d’indépendance à laquelle tous les secrétaires généraux des Nations Unies sont jugés. Il a été le pionnier de la diplomatie directe grâce au secrétariat général pour désamorcer les crises, et a créé le maintien de la paix de l’ONU. Hammarskjöld a forgé une indépendance entre les puissances de la Guerre froide qui les a contrariées et qui a peut-être conduit à sa mort il y a 60 ans.
Les-crises.fr
https://www.les-crises.fr/qui-etait-dag-hammarskjold/
RUSSIE
Poutine croque le bloc occidental à la moulinette
Poutine a fait une longue apparition de trois heures devant le public de la session plénière de l’édition 2021 du “Davos russe”, ou de “l’anti-Davos” si l’on veut, – le “Valdaï Discussion Club”. Son intervention s’est faite dans le style de ses fameuses et très longues conférences de presse, avec questions du modérateur et du public, qu’il s’agisse de celui qui était présent physiquement ou par liaison vidéo.
Euro-synergies
http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2021/10/23/p...
SANTÉ
L’OMS entre lobbyings et scandales
Le chef de l’OMS a-t-il été un des acteurs-clés qui se seraient livrés à « des meurtres » et auraient autorisé « la détention arbitraire et la torture d’Éthiopiens »? La plainte qui le discrédite.
Le blog de Liliane Held Khawam
https://lilianeheldkhawam.com/2021/10/23/le-chef-de-loms-...
Un message à Fauci : Vous n’êtes pas en mesure de dicter le « plus grand bien »
Comment un fraudeur comme Anthony Fauci se retrouve-t-il au poste le mieux rémunéré de la bureaucratie américaine ? Eh bien, la carrière de Fauci est un témoignage plutôt choquant de la réalité de notre gouvernement et de notre époque. Plus vous êtes corrompu, plus vous recevrez de faveurs et de promotions.
Le Saker francophone
https://lesakerfrancophone.fr/un-message-a-fauci-vous-net...
Les dirigeants européens veulent une gouvernance mondiale de la santé
Les dirigeants européens viennent de tenir un conseil dont on retiendra en particulier que, s’agissant de la lutte contre le COVID et les pandémies en général, nos chefs d’Etat proposent d’abdiquer leurs pouvoirs au profit d’une agence européenne et de l’OMS, qui seraient toutes puissantes pour décider des mesures à appliquer sur les territoires nationaux. Ce projet terrifiant est désormais assumé politiquement de façon tout à fait officielle.
Les Moutons Enragés
https://lesmoutonsenrages.fr/2021/10/26/les-dirigeants-eu...
La culture victime de l’idiotie sanitaire ?
Depuis le 21 juillet, le pass sanitaire est obligatoire pour accéder aux lieux de loisirs et culturels. Ces lieux sont en grande partie, totalement ou partiellement, financés par le contribuable, c’est-à-dire tout le monde, mais ne sont désormais plus libres d’accès. Vous n’avez pas toujours besoin de pass pour travailler ou faire vos courses, enfin pour le moment, mais pour regarder un film, admirer une exposition, communier face à un spectacle vivant, si.
Contrepoints
https://www.contrepoints.org/2021/10/29/409894-la-culture...

UNION EUROPÉENNE
Cour constitutionnelle polonaise contre CJUE : la Pensée unique européiste se fissure
Même si la Pologne fait régulièrement parler d’elle depuis que les électeurs polonais se sont choisis une majorité conservatrice pour gouverner le pays (en 2015 et à nouveau en 2019), rarement un tel intérêt lui aura été porté que depuis la décision de son Tribunal constitutionnel, adoptée le 7 octobre, remettant en cause la primauté du droit européen. Revue de presse.
OJIM
https://www.ojim.fr/cour-constitutionnelle-polonaise-cont...
09:48 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, presse, journaux, médias, france, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 31 octobre 2021
Scénarios possibles du conflit RPC-Taiwan

Scénarios possibles du conflit RPC-Taiwan
Sergey Atamanov
Ex: https://www.geopolitica.ru/article/scenariy-konflikta-mezhdu-knr-i-tayvanem
Dans cet article, nous allons parler du conflit entre Taïwan et la Chine et de ses conséquences possibles.
Il est nécessaire de comprendre que la Chine a besoin de Taïwan, de ses usines de haute technologie et de ses spécialistes. Il ne faut donc pas s'attendre à une mer de feu et de sang. Sinon, une chaîne technologique et d'investissement très importante de la modernisation chinoise sera brisée.
Il n'y aura pas non plus l'introduction d'un contingent limité qui soutiendra la population locale désireuse de rejoindre la Chine, comme dans le cas de la Crimée. Il n'y en a pratiquement pas à Taiwan.
La population de Taïwan est d'environ 24 millions d'habitants. S'emparer du territoire signifierait devoir le conserver en permanence, y compris en réprimant l'agitation populaire. La Chine cherche à obtenir une réunification pacifique en espérant que les Taïwanais se rendront compte qu'ils font partie d'une grande nation et que, d'une manière ou d'une autre, que ce soit pacifiquement ou sous la pression, ils décideront de la rejoindre.
Cependant, un affrontement armé est toujours possible en raison de diverses circonstances, notamment des influences extérieures ou la volonté du hasard.

Il existe deux options possibles pour la confrontation armée: active et passive. Dans le premier cas, la marine et l'armée de l'air de l'APL imposeraient un blocus naval et aérien sévère à longue et courte portée à Taïwan, qui ne dispose pratiquement d'aucune ressource propre. Cela portera un coup monstrueux à l'économie et à la sphère sociale sans les détruire physiquement. La véritable famine sur l'île pourrait commencer assez tôt. Étant donné que, de nos jours, toutes les guerres ne sont pas seulement menées avec des hommes et des équipements, il y aura également un impact sur l'information. Les forces armées de Taïwan n'ont aucune chance de briser le blocus par leurs propres moyens. Le résultat est la capitulation de Taïwan.
La deuxième option est une option active. La Chine devra montrer le meilleur d'elle-même, tant sur le plan de l'armement que de la tactique. Qui sait ? La Chine possède un grand nombre de drones, y compris des drones militaires. La Chine a récemment testé un essaim de drones, notamment à partir d'un porte-avions ponté. Ils constitueront le premier échelon. Ensuite, grâce au travail actif de l'APL sur l'ISF et au soutien du groupe spatial, une frappe aérienne et de missiles sera lancée.
L'île sera attaquée depuis la direction de l'est, étirant les défenses taïwanaises. Les avions de pont des porte-avions les plus récents, le Liaoning et le Shandong, détruiront les principales défenses côtières de Taïwan en quelques heures.
Au même moment, un débarquement "hybride" maritime et aérien sur l'île commencera. Des centaines, voire des milliers, de petits avions légers tels que les avions à maïs Y-5 débarqueront des "moustiques" et des "pêcheurs hybrides" seront lancés depuis des navires. Ils ne seront pas, bien sûr, armés de cannes à pêche.
L'armée de l'air, la marine et les défenses côtières de Taïwan, qui subissent une pression énorme du fait des frappes aériennes et des missiles chinois, ne peuvent tout simplement pas faire face à autant de cibles.
Ainsi, un certain nombre de têtes de pont seront créées sur l'île pour les unités des forces terrestres de l'APL qui seront redéployées par les navires de débarquement polyvalents Qinchenshan, les navires d'assaut amphibies Type 075 et les aéroglisseurs Type 726. La largeur du détroit de Taiwan à son point le plus étroit n'est que de 150 kilomètres. Avec une portée maximale de 300 miles nautiques, l'aéroglisseur chinois Bison peut traverser le détroit en une heure.

Une guerre éclair chinoise ne laisserait pas la moindre chance de salut à Taïwan. Il sera inutile d'attendre l'aide des États-Unis et d'autres "alliés". Un effondrement rapide des défenses de Taïwan permettrait, à son tour, à la Chine de ne pas trop souffrir du ressac de l'économie de l'île.
Implications pour la Chine
Les conséquences d'une guerre éclair ou d'un blocus peuvent, de manière très classique, être divisées en "mauvaises" et "bonnes". Commençons par les "plus".
Avec la lutte politique interne en Chine, le blocus de l'Empire céleste par les États-Unis et la situation instable sur le marché boursier, il est nécessaire de consolider la société en suivant l'exemple de la Crimée. Dans ce cas, les ennemis internes et externes seront relégués au second plan pendant un certain temps.
En annexant Taïwan, la Chine deviendra une formidable puissance du Pacifique qui non seulement contrôlera les technologies avancées du monde, mais sera également en mesure de bloquer l'approvisionnement en pétrole du Japon et de la Corée du Sud pro-américains. Elle disposerait également d'un levier qui permettrait à Pékin d'exiger l'élimination des bases militaires américaines dans les deux pays.
L'avantage militaire n'est pas négligeable non plus. Outre l'élimination d'une plate-forme potentielle d'agression contre la Chine (une base aérienne ou navale ennemie située à cet endroit constitue une menace pour l'ensemble du centre industriel de la Chine situé le long de la côte orientale), la Chine obtiendra des échantillons d'équipements militaires des forces armées de Taïwan qu'elle pourra étudier à la suite de la guerre.
La Chine va déplacer son approvisionnement agricole de l'Australie et du Canada vers la Russie et les pays d'Asie centrale. Il en sera de même pour les ressources énergétiques. La Russie est non seulement un partenaire plus fiable, mais aussi une sorte de plaque tournante pour les transports.
Dans 3 à 5 ans, la Chine sera en mesure d'établir une production de micropuces à Taïwan, même si les usines seront partiellement fermées et qu'il y aura une pénurie de travailleurs qualifiés. Au cours de cette période, les produits de haute technologie requis seront achetés en Europe, en Russie, éventuellement au Japon et en Corée du Sud. Pékin deviendra par la suite un leader dans la production de micro-puces, ce qui était auparavant le cas de Taïwan. Le leadership incontesté de la Chine dans un autre domaine, l'extraction et le traitement des métaux des terres rares, dont les experts pensent qu'ils joueront un rôle essentiel dans le développement de l'économie mondiale, pourrait conduire à un leadership dans la fabrication de haute technologie.
Comme vous pouvez le constater, à moyen terme, les "plus" de l'adhésion de Taïwan à la Chine sont nombreux. Examinons maintenant les points négatifs.
Un conflit armé prolongé réduira considérablement la base de développement technologique et économique de Pékin, sans parler des pertes humaines réelles. En outre, cela activera le Japon, qui tentera d'accroître son influence dans la région en devenant un acteur indépendant.
Le détroit de Taïwan est un conduit stratégique pour l'approvisionnement énergétique de la Chine, faisant partie de la route commerciale golfe Persique-détroit de Malacca-Chine. En cas de blocage par un adversaire potentiel, le trafic entre la mer de Chine orientale et la mer de Chine méridionale serait bloqué, isolant la partie nord de la côte chinoise. Ainsi, les plus grands ports du pays, dont Shanghai, seraient bloqués. Cela causerait à son tour d'énormes dommages à l'ensemble de l'économie chinoise, si ce n'est sa chute pure et simple.
Les sanctions technologiques et personnelles seraient un lourd fardeau. La Chine devra chercher des substituts aux semi-conducteurs. La position du Japon, de la Corée du Sud et la capacité de la Chine à contrôler elle-même le marché des semi-conducteurs, qui se trouve à Taïwan, joueront ici un rôle majeur. Il y aura quelques perturbations. La Chine va attirer des semi-conducteurs du monde entier, y compris de Russie et d'Europe, afin de ne pas arrêter la production. Naturellement, cela aura une incidence sur le bien-être de tous en Chine.
Un embargo sur le pétrole ne manquera pas de suivre. La plupart du pétrole arrive en Chine par la mer. Cette route sera bloquée. Seuls la Russie, le Kazakhstan, le Turkménistan et l'Ouzbékistan ont accès à des voies terrestres. L'Asie centrale est extrêmement turbulente en ce moment.
L'émergence de nouvelles alliances et unions, qui ébranleront l'ordre mondial établi, sera également négative. Et comme nous le savons, tout changement est souvent douloureux.
Nous pouvons déjà dire que Taïwan est devenu un certain catalyseur de l'ordre mondial. Une nouvelle alliance militaire est devant nos yeux. AUKUS a uni les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Australie précisément contre la Chine. À ce triple traité s'ajoute le QUAD - Japon, Australie, Inde et États-Unis - qui prône une "région indo-pacifique libre et ouverte". Il y a aussi une coalition de fabricants de semi-conducteurs, qui inclut les États-Unis. Pays-Bas, Taiwan, Japon.
Il est très probable qu'une coalition de pays turcs dirigée par la Turquie (United Turan) émerge.
Une alliance entre l'éternel adversaire des États-Unis, l'Iran, et la Chine est possible.
Compte tenu de l'éloignement des États-Unis des intérêts européens, comme l'illustre l'AUKUS, une nouvelle alliance militaire européenne impliquant la France, l'Italie et l'Allemagne pourrait être créée.
Une alliance entre la Chine et la Russie est extrêmement probable. Ni Pékin ni Moscou ne peuvent rejoindre le camp occidental en tant qu'alliés, Washington en tête.
Dans le même temps, la pression stratégique exercée sur la Chine et la Russie en raison de la détérioration des relations sino-américaines et russo-américaines obligera ces dernières à unir leurs forces afin d'assurer leur propre sécurité. L'alliance ne s'étendra pas seulement à la sphère de la sécurité. Elle aura une incidence sur l'énergie, la sécurité alimentaire et le développement technologique.
En tout état de cause, la Chine sera en mesure de se redresser à moyen terme. Elle pourra ensuite, en fonction des partenaires qu'elle choisira, se développer mutuellement et accroître son influence dans la région, et dans le monde entier.
L'essentiel est que des hostilités actives à Taïwan sont peu probables. La Chine exercera toutes les pressions possibles sur Taïwan pour qu'elle parle d'adhésion de son propre chef. Si l'on compare les évolutions négatives et positives à moyen terme, les points positifs l'emportent sur les points négatifs. Par conséquent, il faut s'attendre à ce que la Chine intensifie ses efforts pour intégrer Taipei.
12:16 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, chine, taïwan, asie, affaires asiatiques, politique internationale, géopolitique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Russie: une menace appelée Turan

Russie: une menace appelée Turan
Pietro Emanueli
Ex: https://it.insideover.com/storia/russia-una-minaccia-chiamata-turan.html
Le Turan est ce lieu perdu, terre des loups et des chamans, qui aurait été le berceau d'une myriade de peuples et de tribus d'Eurasie, notamment les Turcs, les Magyars, les Mongols, les Bulgares, les Finlandais et les Japonais. Situé dans les steppes sauvages et magiques du cœur de la terre, l'Asie centrale, le Touran est un lieu mythologique dont la mémoire a survécu à travers les récits des sages et des conteurs, et dont le charme a résisté à l'érosion du temps et à la transformation de ces peuples nomades en nations.
Aujourd'hui, à l'ère de la fusion des identités où l'histoire s'est arrêtée - comme dans l'Occident sénile et stérile - et de la résurgence des identités où l'histoire ne s'est jamais arrêtée - tout le reste du monde -, cet espace géo-spirituel appelé Turan est revenu à la mode, manifestant sa puissance d'un côté à l'autre de l'Eurasie et devenant l'un des grands catalyseurs du phénomène historique qu'est la transition multipolaire.
Touran est la force motrice de l'agenda politique du Fidesz, qui dirige la Hongrie vers l'Anatolie, l'Asie centrale et l'Extrême-Orient. Touran est l'une des forces motrices du Conseil turc. Touran est l'un des piliers de l'Empire ottoman ressuscité. Et Touran est aussi une source historique de préoccupation pour la Russie. Car les Touraniens sont ceux qui ont pris Moscou en 1382 et 1571. Les Touraniens sont ceux qui se sont révoltés contre le Kremlin dans le Caucase et en Asie centrale pendant et après la Grande Guerre. Et les Touraniens sont ceux qui, aujourd'hui comme hier, contribuent à rendre vivante l'implosion cauchemardesque de la Fédération.
La longue histoire d'amour et de haine entre Moscou et Turan
Le Touran est le lieu situé entre le mythe et la réalité qui, aujourd'hui comme dans les siècles passés, sert de plateforme ancestrale à l'exceptionnalisme de la grande nation turque. Une nation qui, contrairement aux idées reçues, n'est pas née et ne se termine pas en Anatolie, mais traverse une grande partie de l'Eurasie, de la Gagaouzie à la Mongolie, et constitue le motif immatériel qui, depuis des temps immémoriaux, attise les pulsions identitaires des seize grands empires turcs et de leurs rejetons. Une nation qui, historiquement, voyait dans la Russie des tsars et des fous du Christ un ennemi à soumettre, et dont elle a réduit la capitale en cendres à deux reprises: en 1382 et en 1571.


Le passage du temps, des siècles, n'a pas changé la nature complexe des relations entre les peuples turcs et les héritiers de Rurik, pas plus qu'il n'a érodé le pouvoir préternaturel de Touran qui, au contraire et de façon (im)prévisible, au début de ce conflit mondial de civilisations qu'était la Grande Guerre, aurait balayé la Russie avec la force d'un tsunami. Une force qui prendra diverses formes, entre 1914 et l'immédiat après-guerre, dont la redoutable Armée islamique du Caucase dirigée par Enver Pacha et théorisée par Max von Oppenheim, l'insurrection d'Asie centrale de 1916 et la révolte des Basmachis au Turkestan (ci-dessous, Basmachis et drapeau de la révolte).

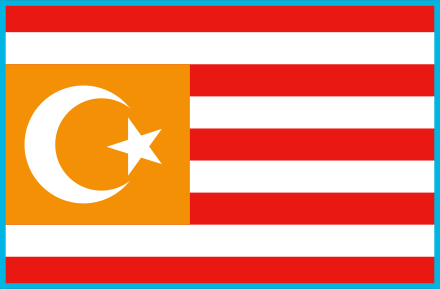
C'est dans le contexte des escarmouches intermittentes entre la Russie et le Turkménistan dans l'entre-deux-guerres, en particulier la révolte du Basmachi - un précurseur de ce qui se passera en Afghanistan dans les années 1980, étant donné la présence de fondamentalistes islamiques soutenus dans une logique antisoviétique par les Britanniques et les Turcs - que les dirigeants du Kremlin transformeront la lutte contre le spectre ancien et immuable en une obsession sans frontières, parfois irrationnelle, en essayant de réduire la charge explosive de la bombe par des goulags, des processus de russification et des transferts de population.
L'ombre de la croix gammée sur les terres de Touran
Dans l'Union soviétique de l'entre-deux-guerres, tous les citoyens étaient égaux, mais certains étaient plus égaux que d'autres. Et ceux dans les veines desquels coulait le sang des hommes-loups des vallées de Touran et d'Ergenekon, et qui étaient donc identifiés comme ethniquement turcs, étaient considérablement plus exposés à la surveillance du gouvernement et à l'accusation d'être des espions, des cinquièmes colonnes à la solde de puissances étrangères déterminées à fragmenter l'Empire par le séparatisme ethno-religieux.
La paranoïa anti-turque de Staline va faire la fortune du Kremlin à l'approche de la Seconde Guerre mondiale, car l'armée invisible d'agents secrets disséminés en Transcaucasie et en Sibérie va empêcher l'implosion de l'empire soviétique multiethnique, déjouer les conspirations et déjouer les graves atteintes à l'unité nationale. C'est dans ce contexte paranoïaque qu'a eu lieu, entre autres événements notables, la déportation fatidique des Tatars de Crimée, dont le dictateur soviétique craignait un soulèvement sous la direction des Turcs et des Allemands.
De l'autre côté de l'Europe, plus précisément à Berlin, Adolf Hitler voulait en fait utiliser la bombe turco-touranienne, en l'imprégnant de nationalisme islamique pour accroître sa puissance, car il était convaincu de son potentiel mortel et désirait ardemment détruire la Russie en tant qu'acteur historique au moyen d'un processus d'"indianisation induite" fondé sur les enseignements de la Compagnie des Indes orientales. Grâce à Touran, selon le Führer, l'empire pluraliste qu'était l'Union soviétique pourrait être transformé en un patchwork babélique de peuples, de croyances et de tribus à la merci d'un joueur habile à diviser pour mieux régner.
C'est dans le contexte des rêves turcs du Führer, dans lesquels la Russie était imaginée comme l'Inde de l'Allemagne, qu'une série d'événements ont eu lieu, dont les plus significatifs sont les suivants
- L'introduction de l'Oural dans le plan pour l'Europe de l'Est (Generalplan Ost), qui s'articule autour du concept de "mur vivant" (lebendige Mauer) pour séparer définitivement l'Europe de l'Asie.
- L'élaboration du projet de Reichkommissariat Turkestan par Alfred Rosenberg, à la suggestion d'un Ouzbek inconnu du nom de Veli Kayyun Han, dans le but de détacher l'Asie centrale de l'Union soviétique en alimentant les mouvements pan-turcs et pan-islamistes. Dans les plans initiaux, l'Altaï, le Tatarstan et la Bachkirie devaient également faire partie de l'entité.
- La conception du Reichkommissariat Kaukasus, dont Hitler aurait voulu déléguer l'administration à la Turquie en cas de victoire sur les Soviétiques.
- Les campagnes d'enrôlement destinées aux habitants turcs-turcophones de l'Union soviétique, qui aboutiront à la création d'innombrables régiments composés de volontaires d'Asie centrale (Osttürkischer Waffen-Verband der SS, Turkistanische Legion), de l'Azerbaïdjan (Légion Aserbaidschanische, SS-Waffengruppe Aserbaidschan, etc.) et du Caucase du Nord (Légion Kaukasisch-Mohammedanische, Kaukasischer-Waffen-Verband der SS, Légion Nordkaukasische, Kalmücken-Kavallerie-Korps, etc).
- Plus précisément, d'après le nombre de bataillons formés et leur taille, les campagnes de recrutement de l'Allemagne nazie ont été particulièrement fructueuses en Azerbaïdjan, en Tchétchénie, au Daghestan, en Ingouchie et même en Kalmoukie bouddhiste, où au moins cinq mille personnes ont prêté serment d'allégeance aux nazis.

Pas seulement Hitler, pas seulement un souvenir du passé
En cherchant à instrumentaliser la dimension ancestrale du touranisme, de préférence imprégné d'éléments panturquistes et islamistes, Hitler n'aurait rien inventé de nouveau. Il se serait contenté, tout au plus, de tirer les leçons de la brève mais intense épopée d'Enver Pacha et de reprendre le sceptre hérité des orientalistes pointus du Kaiser, dont von Oppenheim et Werner Otto von Hentig.
Werner Otto von Hentig, un diplomate, aurait entrepris, vers la fin de la Première Guerre mondiale, un long voyage à travers le Caucase, l'Iran, l'Afghanistan et le Turkestan russe afin d'évaluer la faisabilité d'une "ethno-insurrection" à grande échelle présentée à Berlin par le cheikh Abdureshid Ibrahim. Revenant chez lui avec un rapport rempli de noms, de chiffres et de détails de toutes sortes, inhérents à l'histoire, à la foi et à la géographie, le diplomate aurait soutenu la cause de l'extension du Jihad turco-allemand dans les dominions russes à majorité islamique.

Le sage von Hentig est écouté par le Kaiser, il reçoit également des représentants de la communauté tatare d'Allemagne prêts à organiser un régiment à envoyer à Kazan, mais le temps ne lui permet pas de compléter l'œuvre de son ami Oppenheim. En effet, le 11 novembre de la même année, l'empire épuisé met fin à la guerre par l'armistice signé à Compiègne.
Deux décennies après la fin de la Première Guerre mondiale, puis à l'aube de la Seconde, ce ne seront pas seulement les nazis qui récupéreront le programme islamo-turc du Kaiser, car les Japonais, eux aussi, consacreront effectivement des ressources humaines et économiques à un plan de renaissance du Touran. Un plan qui portait le nom de Kantokuen et dans le cadre duquel les agents secrets de la Société du Dragon Noir ont été envoyés dans les profondeurs de l'Asie centrale et de la Sibérie. La guerre concomitante avec les révolutionnaires chinois et l'ouverture du front du Pacifique auraient toutefois contraint les stratèges de l'empereur Hirohito à éliminer Touran des priorités de l'agenda extérieur japonais. Le reste appartient à l'histoire.

Écrire et parler de l'histoire d'amour-haine entre la Russie et la Turquie est plus qu'important - c'est indispensable -, parce que dans les salles de contrôle des États-Unis, de la Turquie (et même de la Chine) continuent de rôder des génies de la guerre secrète dans l'esprit desquels la Russie devra être indianisée - Zbigniew Brzezinski docet - et parce que le Kremlin n'a jamais cessé de regarder par-dessus son épaule ce "danger venant de l'Est", où par Est nous n'entendons pas (seulement) la Chine, mais ce microcosme turco-turc qui, s'étendant de la Crimée et du Tatarstan à la Yakoutie, n'a jamais été et ne sera jamais complètement apprivoisé. Et le nouveau printemps de l'ethno-séparatisme qui enveloppe la Russie, des terres tataro-transcaucasiennes à la Sibérie profonde, en est la preuve : quand Touran appelle, les loups répondent.
11:48 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : turquie, russie, europe, affaires européennes, asie, affaires asiatiques, géopolitique, pantouranisme, panturquisme, touran, actualité, politique internationale, histoire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Macron appelle la création d'une armée européenne... Et maintenant?

Macron appelle à la création d'une armée européenne... Et maintenant?
Enric Ravello Barber
Ex: https://www.enricravellobarber.eu/2021/10/macron-apela-un-ejercito-europeo-et.html#.YX0lNxw6-Uk
La signature du traité AUKUS et la perte de la vente de sous-marins français à l'Australie au profit de sous-marins américains ont provoqué des réactions de Macron qui rappellent les paroles de la chanson légendaire de Gilbert Bécaud et Pierre Delanoë ((Et maintenant /Que vais-je faire ?/ Maintenant/ Que tu es parti!).
Pour être juste, cependant, Macron est le seul dirigeant politique d'Europe occidentale (et, si vous voulez, de toute l'Europe, avec Vladimir Poutine) qui a mis en garde contre la divergence géopolitique croissante entre les États-Unis et l'Europe et la nécessité d'articuler l'Europe comme un acteur puissant sur la scène multipolaire du 21e siècle.
L'histoire remonte à loin. L'OTAN a été créée en 1949 et a reçu comme réponse la création du Pacte de Varsovie, c'est-à-dire que l'OTAN a été créé pour garantir la défense de l'Occident contre une éventuelle attaque du bloc de l'Est. De Gaulle avait compris que cette alliance signifiait aussi "de facto" que le parapluie militaire américain était suspendu au-dessus de toute l'Europe, avec les implications de soumission politique, économique et de politique étrangère que cela impliquait. La France était membre de l'OTAN mais en 1966, sous la présidence de Gaulle, elle a quitté le commandement militaire de l'OTAN. Ce n'est qu'en 2007 avec l'arrivée à l'Elysée du premier président ouvertement pro-américain de l'après-guerre, Nicolas Sarkozy, que la France a réintégré la structure militaire de l'Alliance atlantique en 2009.
La chute du mur et l'axe carolingien
La chute du mur et la réunification de l'Allemagne ont marqué un changement fondamental dans l'équilibre des forces en Europe. Le pays le plus puissant du continent s'est à nouveau perçu comme l'axe d'articulation du continent. Le chancelier qui a rendu cette réunification exemplaire, Helmut Kohl, avait aussi cette vision d'une Allemagne et d'une Europe moins soumises aux intérêts l'hegemon situé de l'autre côté de l'Atlantique. À la tête d'une Allemagne unifiée et forte, devenue la première puissance de l'UE, Kohl a renforcé l'axe dit carolingien (France-Allemagne) en tant que noyau d'une Europe puissante et autonome. Sa chancellerie a coïncidé avec la présidence de François Mitterrand en France - qui partageait pour l'essentiel cette vision européenne - qui a permis de réaliser un acte émouvant de réconciliation franco-allemande et de poser la première pierre de ce qui devait être une armée européenne, avec la création de l'Eurocorps. Curieusement, tous deux ont perdu les élections suivantes dans leurs pays respectifs, suite à des campagnes médiatiques contre eux.

La tentative de création d'une armée européenne a été avortée par les États-Unis, et aujourd'hui, il n'en reste qu'un pur témoignage, ridicule d'un point de vue militaire (1).
De l'Atlantique au Pacifique : la scène mondiale change
Les intérêts américains ont toujours été contraires à ceux de l'Europe occidentale depuis 1945, pour la simple raison que les États-Unis étaient la puissance colonisatrice et que l'Europe était le territoire colonisé et assujetti. Mais cette antithèse s'est accentuée avec la chute du Mur. L'Europe n'est plus sous la menace soviétique. La logique géopolitique appelle à une cohésion de l'Europe occidentale et à un rapprochement progressif avec la Russie, la menace de l'axe Paris-Berlin-Moscou redevenant le fléau de la diplomatie américaine. Toute tentative d'unification et d'émancipation européenne et de rapprochement euro-russe est toujours torpillée par les Etats-Unis.
Contrairement à ce qu'avait prédit l'idéologue mondialiste Francis Fukuyama, l'histoire ne s'arrête jamais. Au cours des dernières décennies, et surtout de la dernière, nous avons assisté au développement imparable d'une énorme puissance mondiale : la Chine. Dans le même temps, la principale scène mondiale se déplace de l'Atlantique au Pacifique.
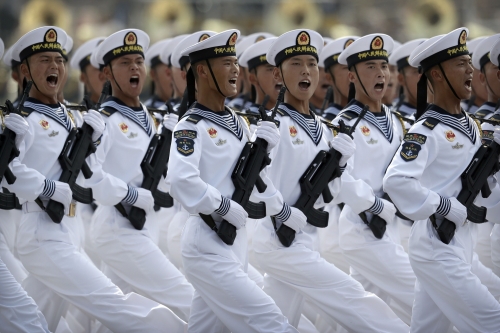
Les données de 2016 indiquaient déjà que dans le classement des 20 plus grands pays en termes de PIB mondial, 11 d'entre eux sont situés dans l'anneau du Pacifique. Ces 11 pays représentent environ 82 % du PIB mondial, mais ce pourcentage est aujourd'hui plus élevé. Les deux grandes superpuissances du moment (les États-Unis et la Chine) partagent un littoral avec cet océan, où se trouve également la Russie.
Les points de friction entre les deux parties (la Corée, Taïwan, le Vietnam, les îles Spratly et la "ligne en neuf points") se trouvent également dans le Pacifique. Les États-Unis ont depuis longtemps déplacé leur axe politique et militaire vers le Pacifique, et c'est Obama qui a initié ce changement stratégique majeur.
Les États-Unis n'ont plus le moindre intérêt dans la "défense" de l'Europe, la grande scène mondiale a changé. Le seul intérêt du Pentagone en Europe est de provoquer et d'acculer la Russie, mais le grand défi est de maintenir le contrôle du Pacifique et d'empêcher la Chine de projeter sa nouvelle route de la soie vers la mer, ce qui porterait un coup fatal à l'hégémonie mondiale des États-Unis. Les États-Unis ne sont plus disposés à payer pour la défense européenne ; ils ne sont plus intéressés. Et puis la réalité s'impose : nous sommes un continent fragmenté, divisé, faible et sans défense. Comme le dit Macron, le retrait progressif des États-Unis de l'OTAN est "de facto" la mort cérébrale de l'Alliance atlantique (2). Les États-Unis, qui ont soutenu le Brexit pour affaiblir l'UE et créer une nouvelle grande alliance anglo-saxonne, ont poussé au rapprochement avec leurs cousins britanniques et australiens - principal allié de Washington dans le Pacifique - dans une dynamique politico-militaire qui a pour but ultime la création d'une grande alliance anglo-saxonne et son désengagement de la défense européenne. Les pays anglo-saxons soutiennent clairement cette initiative menée par le cousin aîné de la famille (3).
Une armée européenne - comment, avec qui et dans quel but ?
La France, malmenée par la signature de l'alliance AUKUS, prend aujourd'hui conscience de la réalité précaire de la défense française et européenne. Macron appelle à la création d'une armée européenne "pour nous faire respecter" (4). Alors que son ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, un poids lourd du gouvernement français, déclare: "Nos partenaires européens doivent ouvrir les yeux, nous ne pouvons plus compter sur les États-Unis pour garantir notre protection stratégique. La première leçon est que l'Union européenne doit construire son indépendance stratégique. Si demain - a-t-il ajouté - il y a un problème massif d'immigration illégale, s'il y a un problème de terrorisme venant du continent africain, qui nous protégera? Seulement nous" (5). Sans aucun doute, il a tout à fait raison.
La France et son président sont conscients qu'aujourd'hui ils sont déjà une puissance de deuxième ou troisième ordre. Les lois de la géopolitique actuelle rendent impensable que la France soit à nouveau un acteur mondial majeur; il ne lui reste qu'une seule option: conduire un processus de convergence politique, diplomatique et militaire européenne. C'est l'un des points forts de la politique de Macron, qui a créé un think tank européen au nom révélateur: "Grand Continent". La nécessité d'une armée européenne est si évidente que la présidente de la Commission von der Leyen elle-même la partage (6). Macron a lancé cet appel, mais il y a des considérations nécessaires :
- Puissance nucléaire : Si nous parlons réellement d'une armée et pas seulement d'une politique visant à surveiller les frontières et à effectuer quelques "missions de paix" dans des pays lointains, l'armement nucléaire est nécessaire. Le seul pays de l'UE à posséder des ogives nucléaires est la France, et ce n'est guère plus qu'anecdotique comparé aux États-Unis, à la Russie et à une Chine montante dans ce domaine. La France possède 290 têtes nucléaires, les États-Unis en ont 5800, la Russie 6375, la Chine 350. C'est pourquoi elle refuse de signer tout traité de non-prolifération nucléaire tant que son désavantage ne sera pas réduit. En octobre dernier, la Chine a surpris avec son nouveau missile hypersonique (7). La croissance de l'armement nucléaire de Pékin est vertigineuse. C'est la logique de son accession à la puissance mondiale.

Si Macron est sérieux au sujet d'une armée européenne sérieuse, il doit renforcer la puissance nucléaire de la France et forcer le Conseil de sécurité de l'ONU à autoriser l'Allemagne à avoir des armes nucléaires, car il est impossible de construire une Europe forte sans une Allemagne militairement forte. S'il exerce cette pression diplomatique au sein du Conseil de sécurité des Nations unies, son appel à une armée européenne ne sera qu'une rhétorique vide. Il sera temps de voir réellement s'il est le leader européen qu'il prétend être, ou si sa rhétorique européenne n'est que de la poudre aux yeux et s'il ne pense qu'en termes d'Hexagone.
- Intégrer l'Europe centrale et orientale : une armée de l'UE ne peut se limiter à une armée dans sa partie occidentale. D'un point de vue militaire et stratégique, la participation des pays de l'Est de l'UE, principalement les pays du groupe dit de Visegrad, serait vitale. Sur le plan militaire, non seulement parce que l'armée polonaise est la 23e armée du monde et la cinquième de l'UE (8), mais aussi en raison de l'effort militaire important consenti par ces pays (9). Stratégiquement, parce que le projet d'armée européenne doit nécessairement associer les pays de Visegrad et les pays baltes à la défense européenne et ne pas leur permettre d'être les alliés privilégiés des Etats-Unis sur notre continent (10).
En ce sens, la pression exercée par l'UE sur les gouvernements légitimes de la Pologne et de la Hongrie n'est pas du tout une position intelligente. Mais quelqu'un dans l'UE est-il vraiment capable de penser en termes européens ? Nous avons peur que non.
- Rompre avec l'atlantisme, pour une logique européenne. L'Europe doit avoir une armée et une politique de défense propre, mais pour défendre ses intérêts et non ceux de la puissance dominante américaine (11).
L'escalade des tensions militaires entre l'Ukraine et la Russie obéit à la logique du Pentagone qui consiste à créer des tensions sur le territoire européen, à isoler la Russie et à empêcher tout rapprochement euro-russe (le cauchemar des stratèges de Washington). La logique européenne devrait être de désamorcer les tensions entre l'Ukraine et la Russie et de promouvoir une politique de rapprochement à Kiev entre l'UE et Moscou.
Bruxelles et Berlin ne l'ont pas compris, Moscou l'a à moitié compris, Washington l'a compris, et c'est pourquoi les Américains sont en train de gagner cette bataille géopolitique cruciale.
Notes:
1. ttps://www.elconfidencial.com/mundo/europa/2021-10-08/battlegroups-union-europea-fuerza-respuesta-rapida_3302008/
2. https://www.lavanguardia.com/internacional/20191107/471443349907/macron-otan-muerte-cerebral-retirada-eeuu.html
3. https://rebelioncontraelmundomoderno.wordpress.com/2021/10/19/la-creacion-de-aukus-y-quad-implica-que-los-anglosajones-estan-destruyendo-la-otan/
4. https://mundo.sputniknews.com/20210929/hagamonos-respetar-macron-llama-a-crear-un-ejercito-europeo-mientras-eeuu-se-enfoca-en-si-mismo-1116591497.html
5. https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/2021-09-23/francia-pide-a-los-europeos-dejar-de-confiar-en-eeuu-para-su-proteccion_3294548/
6. https://www.larazon.es/internacional/20210918/2uu23426zvgivogajqvtrbn7ke.html
7. https://mundo.sputniknews.com/20211017/china-sorprende-a-eeuu-con-un-misil-hipersonico-capaz-de-portar-ojivas-nucleares-1117210916.html
8. https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php
9. https://visegradpost.com/fr/2021/10/15/vers-un-renforcement-de-la-cooperation-militaire-au-sein-du-v4/
10. http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2021/10/16/la-lituanie-sentinelle-de-l-europe-ou-larbin-de-l-occident.html
11.
https://headtopics.com/es/la-ue-ultima-una-misi-n-militar-para-entrenar-a-oficiales-ucranianos-que-luchan-contra-rusia-22000931
11:04 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Défense | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europe, actualité, défense, défense européenne, armée européenne, affaires européennes, union européenne, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 30 octobre 2021
Le lithium deviendra-t-il une arme importante pour les talibans afghans ?

Le lithium deviendra-t-il une arme importante pour les talibans afghans?
Peter Logghe
Ex: Nieuwsbrief/Deltapers, n°162, octobre 2021
Vous l'aurez sans doute lu : la pénurie de matières premières rend difficile pour l'économie (notamment l'économie européenne) de suivre la demande de produits. Chaque fois que l'offre ne peut pas suivre la demande, les prix augmentent et nous en subirons les conséquences. Le coût de l'énergie devient progressivement inabordable pour de nombreux ménages dans notre société européenne. Cependant, il ne s'agit pas seulement d'énergie, mais aussi de produits primaires, de matières premières. L'un des pays les plus pauvres du monde, l'Afghanistan, semble également être l'un des pays potentiellement les plus riches grâce à ses minéraux et minerais. En 2010, par exemple, des experts militaires et des géologues américains ont estimé la valeur des réserves d'argent, de fer, de cobalt et de lithium en Afghanistan à environ un milliard de dollars US.
Jusqu'à présent, peu de choses ont été faites à ce sujet, malgré la concurrence croissante et féroce entre les fabricants dans le secteur technologique. La hausse de la demande a fait grimper la valeur des réserves de matières premières à tel point que le précédent gouvernement afghan a estimé en 2017 que la valeur de ces réserves était trois fois supérieure à celle estimée par les Américains en 2010.
Le lithium est une matière première nécessaire aux batteries. Il n'est pas vraiment rare en soi, mais seuls quelques pays disposent de réserves importantes - principalement des pays comme le Chili, la Chine, la Bolivie. L'Afghanistan pourrait rapidement prendre sa place parmi les trois premiers pays producteurs de lithium. Surtout quand on sait que, selon les spécialistes, la demande de lithium augmente d'environ 20 % par an et que, selon certaines estimations, le monde devra fournir quatre fois la production actuelle d'ici la fin de la décennie.
L'Afghanistan deviendra-t-il la nouvelle Arabie saoudite ?
Il n'y a pas que le lithium qui pourrait donner un coup de pouce économique à l'Afghanistan, d'ailleurs. Le cuivre, peut-être encore plus important dans la transition énergétique qui nous attend avec l'électrification à venir, est également plus que suffisamment présent dans ce pays asiatique: on estime que plus de 30 millions de tonnes sont présentes dans le riche sous-sol. L'importance du cuivre apparaît clairement lorsque l'on constate que les éoliennes et les infrastructures connexes nécessitent 2,5 tonnes de cuivre par mégawatt, et l'énergie solaire encore plus. Alors que la demande de cuivre continue d'augmenter, l'offre se réduit, en raison des conflits autour des mines, du coût croissant du développement de nouvelles mines et d'une offre potentiellement réduite.

Ensuite, il y a les minéraux dits "terres rares". L'Afghanistan pourrait en fournir un million de tonnes. La demande de minéraux terrestres a augmenté au cours des 15 dernières années pour atteindre 125.000 tonnes par an. Enfin, on pense que le sous-sol de l'Afghanistan contient du pétrole et des quantités importantes de gaz. Même si l'ère des combustibles fossiles touche à sa fin, il est impensable que les talibans ne s'emparent pas de cette importante source de devises et de financement.
Les États-Unis ont investi environ un demi-milliard de dollars dans la réglementation de l'industrie minière en Afghanistan. L'absence de résultats est due à l'attitude réticente du précédent gouvernement afghan : les régions concernées par les investissements ont été la proie de conflits, que nous connaissons tous. L'instabilité politique de la région afghane semble une fois de plus être la clé des années à venir. Si les talibans parviennent à installer un régime stable - bien que totalement répréhensible - en Afghanistan, cela pourrait poser un très grave dilemme à l'Europe occidentale, aux États-Unis et aux multinationales. Quelle entreprise veut avoir sur la conscience que sa production soutient et finance la lutte armée islamique ?
Un dilemme particulier à l'heure où toute grande entreprise digne de ce nom se sent moralement obligée de soutenir des associations comme Black Lives Matter. Qu'en est-il des Talibans, garçons et filles de l'économie mondiale internationale ? Qu'en est-il des "droits de l'homme" ?
Peter Logghe
12:33 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, géopolitique, lithium, afghanistan, terres rares |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 29 octobre 2021
Sur les alliances entre la gauche et les mouvements évangéliques en Amérique latine

Sur les alliances entre la gauche et les mouvements évangéliques en Amérique latine
Radha Sarkar
Ex: https://www.geopolitica.ru/es/article/sobre-las-alianzas-entre-la-izquierda-y-los-movimientos-evangelicos-en-america-latina
Traduction par Juan Gabriel Caro Rivera
Le politologue Javier Corrales est allé jusqu'à dire en 2018 que l'alliance entre les églises évangéliques et les partis conservateurs en Amérique latine était le "mariage parfait" (1). Cependant, il semble que le divorce soit pour bientôt, car un nouveau prétendant, intrigant, est entré en scène: la gauche.
Ces dernières années, de nombreux politiciens de gauche ont tenté de s'allier avec des églises, des dirigeants et des partis politiques évangéliques. Par exemple, Andrés Manuel Lopez Obrador (AMLO) et son parti MORENA se sont tous deux alliés au parti évangélique de la rencontre sociale (PES) pour arriver au pouvoir lors des élections mexicaines de 2018. Maduro a également courtisé plusieurs leaders évangéliques lors des élections vénézuéliennes de 2020, au point de leur promettre de commémorer la "Journée du pasteur", de créer une université évangélique et de faire don de milliers d'instruments de musique à leurs églises (2). C'est maintenant le tour de Gustavo Petro, candidat à la présidence de la Colombie et ancien guérillero, qui a reçu le soutien d'Alfredo Saade (un leader évangélique de la côte caraïbe) avec lequel il a conclu une alliance le 15 septembre (3). Le mouvement de Saade, Levántate, est composé de plus de 400 pasteurs évangéliques.
Si cela peut paraître surprenant, de telles alliances ont existé par le passé, surtout si l'on considère que les partis conservateurs d'Amérique latine ont toujours eu des liens étroits avec l'Église catholique. C'est pour cette raison qu'historiquement, les dirigeants protestants ont toujours été du côté des partis libéraux et ont même soutenu des gouvernements révolutionnaires, puisque l'objectif de tous ces mouvements a toujours été le même: diminuer l'influence sociale de l'Église catholique. Entre 1979 et 1990, la population évangélique est passée de 5 % à 15 % pendant le gouvernement sandiniste au Nicaragua, grâce aux tensions entre le gouvernement révolutionnaire et l'Église catholique au sujet des postes politiques que certains prêtres occuperaient (4). Les évangéliques étaient beaucoup plus enclins que les catholiques à voter pour la réélection de Daniel Ortega et, en fait, plusieurs de leurs dirigeants ont exprimé leur soutien à la direction du FSLN (5). En outre, les mouvements évangéliques ont soutenu la nouvelle constitution vénézuélienne promue par Hugo Chávez en 1999, car elle élargissait les libertés religieuses, tandis que les catholiques l'ont attaquée comme favorisant l'avortement (6).
Cependant, il y a eu des moments où les évangéliques ont trouvé plus commode de s'allier avec la droite. Par exemple, dans le Chili d'Augusto Pinochet, où l'Église catholique a participé activement à la résistance contre la dictature, les évangéliques se sont précipités pour la soutenir dans l'espoir de se voir accorder la pleine égalité religieuse avec les catholiques (7). Tous ces faits nous amènent à conclure que la participation évangélique à la politique latino-américaine se caractérise avant tout par le pragmatisme, s'alliant aussi bien avec la gauche qu'avec la droite selon le moment historique (8).

La croissance des églises évangéliques dans la région implique que leur participation à la politique augmentera avec le temps, bien que son intensité varie d'un pays à l'autre (9). Même en Colombie, où les groupes non catholiques ont toujours été marginalisés, on estime que 19,5% de la population nationale s'identifie comme évangélique ou pentecôtiste (10).
Toutefois, il est impossible de prétendre que les églises évangéliques sont unies dans leur ensemble, de sorte que le paysage politique actuel est le reflet du paysage religieux. Il existe de nombreux groupes, divisions et compétitions entre eux en raison de l'absence d'une structure unitaire plus large. Or, c'est précisément cette fragmentation qui explique la croissance rapide de leur foi, puisque toute personne ayant une vocation divine peut créer sa propre église, mais elle a pour contrepartie d'inhiber l'action politique commune. Par exemple, au début des années 1990, les évangéliques représentaient à peine 10 % de la population colombienne et, à l'époque, il y avait quatre partis évangéliques concurrents. Le parti politique de Saade est en concurrence avec deux autres : MIRA et Colombia Justa Libre.
Néanmoins, les églises évangéliques peuvent être de précieux alliés électoraux malgré leur incapacité à créer une plateforme unifiée. Ce dernier point est particulièrement vrai pour les méga-églises et les organisations religieuses ayant de multiples sites et des dizaines ou des centaines de milliers de fidèles, ainsi que l'accès à de nombreuses ressources et une utilisation intensive des médias. L'un des atouts qu'ils peuvent mettre à la disposition des campagnes politiques est leur immense salle, sans parler des chaînes de télévision et de radio. Tout cela peut facilement transformer le capital religieux en capital politique, bien que ces deux sphères ne se chevauchent pas toujours (11).
Néanmoins, cette transformation des fidèles en électeurs a un certain poids dans les urnes et a permis à plusieurs dirigeants évangéliques de remporter des sièges dans des conseils municipaux, des législatures d'État et des congrès nationaux. Lors des élections présidentielles, les évangéliques se sont davantage comportés comme des partenaires de coalition majeurs que comme des candidats autonomes, Fabricio Alvarado, du parti évangélique Restauration nationale, faisant exception : il est arrivé en deuxième position lors de l'élection présidentielle de 2018 au Costa Rica. Il est important de garder à l'esprit que les élections sont souvent décidées par des marges très étroites dans une grande partie de l'Amérique latine, et c'est pourquoi le capital politique que les méga-églises évangéliques et les organisations religieuses peuvent rassembler a un poids énorme lorsqu'il s'agit de faire ou de défaire des rois.
L'élection présidentielle de 2018 en Colombie a mis en évidence cette tendance, puisque le candidat du Centre démocratique, Iván Duque (photo, ci-dessous), a battu Petro de 2,3 millions de voix, remportant un total de 10,3 millions de voix. La clé de la victoire de Duque a été les partis évangéliques MIRA et Colombia Justa Libre, qui auraient apporté au moins un million de voix (12).

Il est très probable que M. Petro a tiré les leçons de cette défaite et c'est la raison pour laquelle il s'est empressé de rechercher le soutien des évangéliques pour sa candidature à la présidentielle de 2022. Petro a lancé sa campagne présidentielle dans la ville caribéenne de Barranquilla, en se référant à Jésus et aux saints et en accusant la droite de faire des "pactes avec le diable" (13). Peu après, on a appris que le leader évangélique Saade avait organisé l'événement dans l'intention de soutenir publiquement la candidature de Petro.
L'alliance de M. Petro avec les évangéliques de la côte caraïbe colombienne, densément peuplée, est très logique, car après la capitale et le département d'Antioquia, c'est la région la plus peuplée du pays. D'autre part, la région des Caraïbes présente la plus forte concentration d'évangéliques dans le pays, avec 25,4 % de la population se réclamant de cette dénomination, soit un total de 2,25 millions de citoyens, de sorte que les églises évangéliques de cette région pourraient fournir un nombre considérable de voix. La campagne de Saade vise 1,5 million d'entre eux.
De nombreux groupes évangéliques d'Amérique latine ont pu étendre leur influence sociale grâce à leur implication dans la politique. Un cas typique est celui du Brésil, où les évangéliques se sont présentés aux élections sous diverses candidatures, dont celle du Partido dos Trabalhadores (PT) de gauche (14), avec l'intention de légiférer sur des exonérations fiscales pour leurs églises respectives, ainsi que de modifier les lois sur la radiodiffusion afin d'atteindre un public plus large, d'obtenir un financement de l'État pour leurs services religieux en les faisant passer pour des événements culturels, et de prendre possession de certaines propriétés pour construire des églises. Les pasteurs brésiliens se présentent aux élections parce que c'est précisément le Congrès qui contrôle les droits de diffusion, donc être au Congrès garantit la "télévangélisation".
Cela s'applique également au PSE mexicain, qui a largement bénéficié de son alliance avec MORENA: il a cessé d'être un parti marginal et est devenu la quatrième faction la plus importante du corps législatif national (15). L'AMLO, contrairement aux autres présidents mexicains qui se sont appuyés sur des groupes catholiques, a ouvert les portes du pouvoir aux évangéliques en élargissant leur accès aux médias, aux affaires et à l'immobilier. Les organisations religieuses évangéliques se sont jointes au Secrétariat du gouvernement pour promouvoir la "Quatrième Transformation" (4T) (16) et viser à "réparer le tissu social du Mexique". AMLO a proposé d'accorder des concessions de diffusion à ces groupes religieux au motif de "renforcer les valeurs" et a recruté plusieurs de ces églises pour diffuser un livre publié par le gouvernement sur la moralité et la citoyenneté. De son côté, la National Fellowship of Evangelical Churches a annoncé en décembre 2020 qu'elle avait réussi à inscrire 7000 étudiants au programme fédéral de bourses d'études dans l'intention de leur fournir non seulement une formation technique et des emplois, mais aussi de les former aux préceptes de l'Évangile (17). Pour cela, les évangéliques ont recruté des étudiants dans toutes les régions du pays.
Ainsi, l'alliance entre Saade et Petro, qui est nouvelle pour la politique colombienne, ne fait que poursuivre un schéma régional. Saade a récemment retiré son soutien à la campagne de Petro, affirmant que le candidat présidentiel n'avait pas pris en compte nombre de ses points (18). Cependant, ce bref flirt politique est révélateur. Une source anonyme de la campagne de M. Petro a également déclaré que des alliances similaires avec d'autres groupes évangéliques pourraient être conclues à l'avenir.
Petro est le candidat présidentiel avec l'intention de vote la plus élevée pour les élections de 2022 selon les sondages (19) et ce malgré le fait que l'intention de vote pour sa candidature a chuté de 21% en juin à 17% en septembre, alors que les sondages montrent que l'intention de vote pour les candidats de droite, avec lesquels on pourrait s'attendre à ce que les évangéliques aient une plus grande affinité idéologique, est sensiblement plus faible.
Si Petro gagne, quelles seront les implications de sa victoire pour les évangéliques colombiens ? Il est probable qu'il suive la même voie qu'AMLO et qu'il renforce ses liens avec les groupes évangéliques, surtout compte tenu de l'hostilité ouverte de l'Église catholique à son égard (20). Le soutien des organisations évangéliques à la campagne de Petro pourrait se traduire par une plus grande influence sur les décisions du gouvernement et la mise en œuvre de certaines politiques sociales. Mais comme l'illustre le cas mexicain, cette alliance n'implique pas le triomphe de " l'agenda moral " des évangéliques, qui s'exprime avant tout dans l'interdiction de l'avortement et des droits LGBTQ (21). Et puisque l'agenda progressiste de Petro a été caractérisé par sa promotion des droits LGBTQ (22), cela implique que les évangéliques ne seront très probablement pas en mesure d'imposer leur vision de la moralité sociale.
Si Petro remporte les élections présidentielles en Colombie, ce type d'alliances entre la gauche et les évangéliques pourrait devenir de plus en plus courant dans toute l'Amérique latine. Et même si cela ne se produit pas, il est probable qu'elle commencera à provoquer des changements politiques et des transformations majeures dans les communautés évangéliques de la région, car leur nombre et leur participation à la politique ne feront qu'augmenter.
Notes :
1. https://www.nytimes.com/2018/01/17/opinion/evangelicals-p...
2. https://www.eltiempo.com/mundo/venezuela/maduro-busca-el-...
3. https://www.semana.com/nacion/articulo/quien-es-alfredo-s...
4. https://books.google.com.co/books?hl=en&lr=&id=2u...
5. https://www.jstor.org/stable/1387860?casa_token=Buemx_T8i...
6. https://books.google.com.co/books?hl=en&lr=&id=2u...
7. https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/97804...
8. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-43706779
9. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-43706779
10. https://www.svenskakyrkan.se/filer/34555608-8b30-4aec-9d3...
11. http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0121-56122017000...
12. https://nacla.org/alliances-leftists-and-evangelicals-lat...
13. https://www.elespectador.com/politica/criticas-al-pacto-h...
14. https://moe.org.co/wp-content/uploads/2019/04/Libro_Relig...
15. https://nacla.org/news/2020/02/10/Church-and-State-AMLO-M...
16. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45712329
17. https://www.proceso.com.mx/nacional/2019/12/5/evangelicos...
18. https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/gust...
19. https://www.semana.com/nacion/articulo/petro-lidera-la-in...
20. https://www.elcatolicismo.com.co/editorial/la-iglesia-en-...
21. https://politica.expansion.mx/mexico/2021/09/20/morena-va...
22. https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12162143
Source: https://nacla.org/alliances-leftists-and-evangelicals-latin-america
18:33 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : religion, actualité, amérique latine, amérique du sud, amérique ibérique, évangélisme, évangélistes, politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 28 octobre 2021
L'OTAN développe des techniques de guerre cognitive

L'OTAN développe des techniques de guerre cognitive
Leonid Savin
Ex: https://www.geopolitica.ru/article/nato-razrabatyvaet-metody-vedeniya-kognitivnoy-voyny
L'Innovation pour l'excellence en matière de défense et de sécurité (IDEaS), également appelée "Innovation Hub", basée au Canada, joue un rôle de premier plan dans ce domaine. Toutefois, ce centre ne figure pas sur la liste des centres d'excellence de l'OTAN officiellement accrédités, comme le Centre de cyberdéfense en coopération de Tallinn ou le Centre de sécurité énergétique de Vilnius. L'OTAN ne souhaitant probablement pas attirer l'attention sur son travail, elle opère de manière "autonome".
Certes, cette approche de dissimulation a été couronnée de succès, puisque les fils d'actualité montrent que le centre a commencé à fonctionner dès 2017.
Les objectifs officiellement déclarés ne diffèrent pas beaucoup des travaux d'autres centres similaires de l'OTAN. Ils sont décrits dans des phrases générales et représentent:
- Accès à une large communauté d'experts, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'OTAN ;
- Une plateforme collaborative en ligne pour l'interaction avec la communauté ;
- Une base de connaissances sur tous les sujets abordés par le Centre d'innovation ;
- Documents sur les solutions innovantes pour relever les défis futurs de l'OTAN et des capacités nationales ;
- Des occasions d'expliquer les problèmes, de poser des questions ou de proposer des solutions.
Le site web énumère sept domaines dans lesquels le Centre travaille. Il s'agit de l'éducation et de la formation, des mécanismes de prise de décision, du cyberespace, des initiatives humanitaires, de l'information et de la désinformation, des systèmes autonomes et de la stratégie. Cependant, le thème le plus récurrent dans plusieurs domaines à la fois est la guerre cognitive. Fin 2020, le centre a publié une étude sur ce sujet, dont l'auteur est François de Cluzel.
La préface du document indique que "l'esprit humain est désormais considéré comme un nouveau champ de bataille. Avec le rôle croissant de la technologie et la surcharge d'informations, les capacités cognitives individuelles ne suffiront pas à assurer une prise de décision éclairée et opportune, ce qui a conduit à un nouveau concept de guerre cognitive, qui est devenu ces dernières années un terme récurrent dans la terminologie militaire... La guerre cognitive a une portée universelle, de l'individu aux États et aux organisations multinationales. Elle utilise des techniques de désinformation et de propagande visant à épuiser psychologiquement les récepteurs d'information. Chacun y contribue, à des degrés divers, consciemment ou inconsciemment, et cela permet d'acquérir des connaissances inestimables sur la société, en particulier les sociétés ouvertes comme celles de l'Occident. Cette connaissance peut alors facilement être utilisée comme une arme... Les outils de la guerre de l'information, auxquels s'ajoutent les "neuro-armes", élargissent les perspectives technologiques futures, suggérant que le domaine cognitif sera l'un des champs de bataille de demain. Cette perspective est encore renforcée par le développement rapide des nanotechnologies, des biotechnologies, des technologies de l'information, des sciences cognitives et de la compréhension du cerveau."
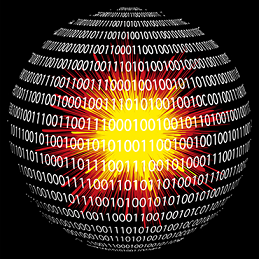
Bien sûr, ces technologies et l'intérêt qu'elles suscitent d'un point de vue militaire ne sont pas nouveaux. Les agences américaines DARPA et IARPA sont engagées dans ces domaines depuis de nombreuses années. Mais dans ce cas, cette approche est reconnue comme une stratégie prometteuse pour les guerres futures par l'OTAN. Et les neuro-armes en tant que composante importante de l'armée
Le rapport fournit un certain nombre de définitions. "La guerre cognitive est une guerre d'idéologies qui cherche à saper la confiance qui sous-tend toute société... La désinformation exploite la vulnérabilité cognitive de ses cibles, en profitant de peurs ou de croyances préexistantes qui les prédisposent à accepter des informations fausses.
Pour cela, l'agresseur doit avoir une compréhension claire des dynamiques sociopolitiques en jeu et une connaissance précise du moment et de la manière de pénétrer afin d'exploiter au mieux ces vulnérabilités.
La guerre cognitive exploite les vulnérabilités innées de l'esprit humain en raison de la manière dont il est conçu pour traiter l'information, qui a bien sûr toujours été utilisée dans la guerre. Cependant, en raison de la rapidité et de l'omniprésence de la technologie et de l'information, l'esprit humain n'est plus capable de traiter le flux d'informations.
Ce qui différencie la guerre cognitive de la propagande, c'est que chacun participe, en grande partie involontairement, au traitement de l'information et à la formation des connaissances d'une manière sans précédent. Il s'agit d'un changement subtil mais significatif. Alors que les individus se soumettaient passivement à la propagande, ils y contribuent désormais activement.
L'exploitation des connaissances humaines est devenue une industrie de masse. Et les nouveaux outils d'intelligence artificielle devraient bientôt offrir aux propagandistes des possibilités radicalement élargies de manipuler l'esprit humain et de modifier le comportement humain."
Le rapport parle également de l'économie comportementale, qui se définit comme une méthode d'analyse économique qui applique une compréhension psychologique du comportement humain pour expliquer la prise de décision économique.
Comme le montre la recherche sur la prise de décision, le comportement devient de plus en plus computationnel.
Sur le plan opérationnel, cela signifie l'utilisation massive et méthodique des données comportementales et le développement de techniques d'approvisionnement actif en nouvelles données. Avec l'énorme quantité de données (comportementales) que chacun génère en grande partie sans notre consentement ou sans que nous en soyons conscients, de nouvelles manipulations sont facilement réalisables.

Les grandes entreprises de l'économie numérique ont mis au point de nouvelles méthodes de collecte de données qui permettent de sortir des informations personnelles que les utilisateurs n'ont pas nécessairement l'intention de divulguer.
Et les données redondantes sont devenues la base de nouveaux marchés prédictifs appelés publicité ciblée.
"Voici les origines du capitalisme de surveillance dans une brassée sans précédent et lucrative : la redondance comportementale, la science des données, l'infrastructure physique, la puissance de calcul, les systèmes algorithmiques et les plateformes automatisées", indique le document.
Et tout cela a déjà été mis au point par des géants occidentaux comme Facebook, Google, Amazon, Microsoft et d'autres. Ce n'est pas une coïncidence s'ils ont été critiqués à plusieurs reprises à la fois pour avoir imposé un monopole et pour avoir utilisé une manipulation basée sur les données des utilisateurs. Et comme ils coopèrent tous activement avec les agences de sécurité américaines en tant que contractants, cela crée un risque de manipulation délibérée pour les utilisateurs du monde entier.
Il a également été suggéré que l'absence de réglementation de l'espace numérique profite non seulement aux régimes de l'ère numérique, qui peuvent exercer une influence importante non seulement sur les réseaux informatiques et les corps humains, mais aussi sur l'esprit de leurs citoyens, mais qu'elle peut également être utilisée à des fins malveillantes, comme l'a démontré le scandale Cambridge Analytica.
Le modèle numérique de Cambridge Analytica décrivait comment combiner les données personnelles avec l'apprentissage automatique à des fins politiques en profilant des électeurs individuels pour les cibler avec des publicités politiques personnalisées.
En utilisant les techniques de sondage et de psychométrie les plus avancées, Cambridge Analytica a en fait pu collecter une énorme quantité de données sur les gens qui lui ont permis de comprendre, grâce à des informations économiques, démographiques, sociales et comportementales, ce que chacun d'entre eux pensait. Cela a littéralement ouvert une fenêtre dans l'esprit des gens pour l'entreprise.
L'auteur écrit que "la gigantesque collecte de données organisée par la technologie numérique est désormais largement utilisée pour identifier et anticiper le comportement humain. Les connaissances comportementales sont un atout stratégique. L'économie comportementale adapte la recherche psychologique aux modèles économiques, créant ainsi une vision plus précise des interactions humaines".
Pendant ce temps, de nombreuses entreprises américaines de ce type continuent tranquillement à opérer en Russie et à collecter les données de nos citoyens.
Un autre aspect intéressant relevé dans l'étude sur la guerre cognitive est la cyberpsychologie, qui se situe à la jonction de deux grands domaines : la psychologie et la cybernétique. Comme il a été dit, " tout cela concerne la défense et la sécurité, et tous les domaines qui sont importants pour l'OTAN dans sa préparation à la transformation. La cyberpsychologie, axée sur l'élucidation des mécanismes de la pensée et des concepts, des usages et des limites des systèmes cybernétiques, est une question clé dans le vaste domaine des sciences cognitives. L'évolution de l'intelligence artificielle introduit de nouveaux mots, de nouveaux concepts, mais aussi de nouvelles théories qui englobent l'étude du fonctionnement naturel des humains et des machines qu'ils créent, et qui sont désormais totalement intégrées dans leur environnement naturel (anthropotechnique). Les hommes de demain devront inventer une psychologie de leur rapport aux machines. Mais le défi consiste à développer également une psychologie des machines, des logiciels dotés d'une intelligence artificielle ou des robots hybrides. La cyberpsychologie est un domaine scientifique complexe qui englobe tous les phénomènes psychologiques liés aux technologies évolutives correspondantes ou affectés par elles. La cyberpsychologie étudie la façon dont les humains et les machines s'influencent mutuellement, et explore comment la relation entre les humains et l'intelligence artificielle modifiera l'interaction humaine et la communication inter-machine."

Le rapport met également en évidence les aspects problématiques de la pensée humaine. Elle indique que "les biais cognitifs peuvent conduire à des jugements inexacts et à une mauvaise prise de décision, ce qui peut provoquer une escalade involontaire ou empêcher l'identification rapide des menaces. Comprendre les sources et les types de biais cognitifs peut aider à réduire les malentendus et à développer des stratégies plus efficaces pour répondre aux tentatives des adversaires de tirer parti de ces biais.
En particulier, le cerveau :
- Ne peut pas déterminer si une information particulière est correcte ou incorrecte ;
- Est utilisé pour déterminer rapidement la validité des messages en cas de surcharge d'informations ;
- A tendance à croire que les déclarations ou les messages qu'il a déjà entendus sont vrais, même s'ils peuvent être faux ;
- Accepte les affirmations comme vraies si elles sont étayées par des preuves, sans tenir compte de l'authenticité de ces preuves".
Il y a également une section sur la Russie. Comme d'autres études de ce type, la référence au rôle de la Russie sert plutôt à justifier le besoin de fonds pour développer des neuro-armes et des techniques de guerre cognitive afin de garantir que l'OTAN ne soit pas dépassée par ses adversaires.
En juin 2021, le Centre a publié une autre étude sur la guerre cognitive.
Il fournit déjà une formulation claire de la terminologie, indiquant que le concept de guerre cognitive a été adopté par l'OTAN.
"La guerre cognitive est une approche globale des armes qui combine les capacités de guerre non cinétique de la cybernétique, de l'information, de l'ingénierie psychologique et sociale pour gagner sans combat physique. Il s'agit d'un nouveau type de guerre, défini comme l'utilisation de l'opinion publique par des acteurs extérieurs comme une arme. Ceci est fait pour influencer et/ou déstabiliser une nation. Ces attaques peuvent être considérées comme une matrice : elles englobent le petit nombre et le grand nombre, influencent les pensées et les actions, visent des cibles allant de la population entière à des mesures individuelles, entre des communautés et/ou des organisations. Les attaques visent à modifier ou à renforcer les pensées. La manière dont elle est menée diffère des domaines plus traditionnels de la guerre. La guerre de l'information tente de contrôler ce que le public cible voit, la guerre psychologique contrôle ce que le public cible ressent, la cyberguerre tente de perturber les capacités technologiques des pays cibles, tandis que la guerre cognitive se concentre sur le contrôle de la façon dont le public cible pense et réagit."
Ce document présente un certain nombre de technologies permettant d'améliorer les performances de l'OTAN. Le premier consiste en des outils de guerre électronique cognitive (GEE) du "monde réel". Il s'agit de l'utilisation de systèmes cognitifs, de l'intelligence artificielle ou de l'apprentissage automatique pour améliorer le développement et le fonctionnement des technologies de guerre électronique (GE) pour la communauté de la défense. Plus proche de la guerre automatisée, elle diffère d'un véritable système cognitif où les plans ont été élaborés en fonction des pensées et du comportement que l'on attendrait de ses adversaires. Il se compose de deux types d'outils CRB. La première est non cinétique et utilise les systèmes REB pour modifier les pensées/comportements de l'ennemi en ciblant ses systèmes d'information/influence. La guerre cinétique, quant à elle, utilise ces systèmes pour modifier les pensées et le comportement de l'ennemi en affectant directement son système nerveux.

Une deuxième technologie est la bio-impression en 3D à partir de tissus neuronaux... Une autre technologie est le simulateur de performance cognitive en réalité virtuelle. Intégrant l'entraînement en réalité virtuelle et l'analyse des données neuronales, cette approche améliore les performances humaines dans les missions militaires. Il associe la réalité virtuelle à des capteurs d'électroencéphalographie (EEG) et à des systèmes de contrôle humain pour améliorer les performances en analysant les données neurales acquises pendant l'entraînement. Le travail dans un environnement stressant impose souvent des exigences supplémentaires aux individus, faisant de la cognition humaine le facteur le plus important. L'objectif est d'accroître la productivité opérationnelle. Le casque de l'utilisateur est équipé de capteurs qui collectent des données EEG pendant certains tours et tout au long du jeu. Dans le test de Stroop, on demande à l'utilisateur de tirer sur des cibles en trois séries distinctes, exposées à des distractions et à un temps croissant. Après chaque tour, l'utilisateur est placé dans une "salle de repos" où son niveau de stress peut revenir à la ligne de base avant d'être soumis à un autre tour du test. Un rapport de suivi détaillé permet de suivre les résultats techniques et tactiques tels que la précision, la prise de décision et l'excitation. Tout cela s'articule autour d'une évaluation unique des performances à la fin de la simulation. Chaque session est mesurée, stockée et analysée dans un système de contrôle manuel, où les données sont affichées à l'aide d'un tableau de bord virtuel.
Cette dernière technologie consiste en l'informatique et la technologie quantique. C'est le seul moyen de traiter des ensembles de données disparates gigantesques et d'obtenir rapidement des données analytiques. À l'avenir, il sera essentiel de pouvoir effectuer une stimulation neuronale à l'échelle nanométrique chez l'homme."
Nous pouvons donc constater que les experts scientifiques de l'OTAN prennent très au sérieux l'introduction de nouvelles méthodes de guerre fondées sur les dernières avancées dans diverses sciences. Incidemment, les premières victimes des innovations en matière de guerre cognitive, développées par l'OTAN, ont été les Canadiens. Les citoyens de ce pays ont été utilisés comme des cobayes, inconscients de la manipulation à laquelle ils étaient soumis.
En avril 2020, un plan de propagande a été élaboré et mis en œuvre, et l'épidémie de Covid-19 a servi de couverture à ce plan. Bien que les Forces armées canadiennes aient déjà reconnu que "les opérations d'information, les politiques et les doctrines de ciblage sont conçues pour les adversaires et ont une application limitée dans le concept national".
Le plan élaboré par le Commandement des opérations interarmées du Canada, également connu sous le nom de CJOC, reposait sur des méthodes de propagande similaires à celles utilisées pendant la guerre en Afghanistan. La campagne appelait à "façonner" et "utiliser" l'information. Le CJOC a fait valoir que le dispositif d'opérations d'information était nécessaire pour prévenir la désobéissance civile parmi les Canadiens pendant la pandémie de coronavirus et pour renforcer les messages du gouvernement sur le problème.

Une initiative distincte, sans rapport avec le plan du CJOC mais supervisée par des officiers de renseignement des Forces armées canadiennes, consistait à recueillir des informations à partir de comptes de médias sociaux accessibles au public en Ontario. Des données ont également été collectées sur les réunions de Black Lives Matter et les leaders de BLM. Les officiers supérieurs de l'armée ont affirmé que ces informations étaient nécessaires pour assurer le succès de l'opération Laser, la mission des Forces armées canadiennes visant à aider les foyers de soins de longue durée touchés par le COVID-19, et à contribuer à la distribution de vaccins dans certaines communautés du Nord. Bien sûr, après que l'information ait été rendue publique dans les médias canadiens, peu de gens ont cru ces excuses, car elles n'étaient absolument pas convaincantes. Enfin, il convient de noter que la conférence du réseau d'innovation de l'OTAN a déjà été programmée pour le 9 novembre. Et le 30 novembre, la conférence du Défi Innovation de l'OTAN se tiendra en Ontario. Cela indique que les développements de la guerre cognitive de la part de l'Occident vont se poursuivre.
09:59 Publié dans Actualité, Défense, Définitions, Militaria | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, guerre cognitive, cyberpsychologie, otan, défense, militaria |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Le défi afghan du XXIe siècle

Le défi afghan du 21ème siècle
Marina Bakanova
Le début du 21e siècle a été marqué par l'arrivée des États-Unis en Afghanistan, qui n'ont été chassés du pays que 20 ans plus tard, tandis que les Afghans ont créé un nouveau concept de fête de l'indépendance, le 19 août, comme jour de victoire sur trois empires : les Britanniques, l'URSS et les États-Unis.
Les attaques terroristes du 11 septembre 2001 aux États-Unis ont conduit à l'opération "Liberté immuable" en Afghanistan. La Force internationale d'assistance à la sécurité (FIAS) en Afghanistan a opéré conformément à la résolution 1386 du Conseil de sécurité des Nations unies du 20 décembre 2001. Depuis août 2003, la FIAS est sous le commandement du bloc de l'OTAN. Quarante-huit pays (pour la plupart membres de l'OTAN) participent à l'ISAF.
La coalition internationale antiterroriste, réunie à la conférence de Bonn en décembre 2001, a défini les grands principes de la reconstruction de l'État afghan et formé le gouvernement provisoire du pays sur la base de la coalition. En janvier 2002, la conférence internationale de Tokyo a décidé d'apporter une aide financière à la reconstruction de l'Afghanistan et a accepté de débourser 4,5 milliards de dollars. En juin 2002, toujours avec la participation officieuse des États-Unis et de leurs alliés de la coalition, la Loya Jirga a été convoquée pour élire Hamid Karzai à la présidence et former l'Autorité transitoire sous sa direction. Enfin, en janvier 2004, l'étape la plus importante de la transition politique a été franchie avec l'adoption de la nouvelle Constitution afghane, qui jette les bases de la nouvelle structure de l'État et stipule les principes démocratiques de la vie publique et les droits des citoyens afghans.
Il convient toutefois de noter que le régime pro-américain n'a été maintenu que dans la capitale et les grandes villes ; en effet, le reste du territoire était sous l'autorité des talibans (et des "gouvernements de l'ombre") et vivait selon des règles complètement différentes.

Ashraf Ghani, arrivé au pouvoir en 2014, s'est révélé être un homme politique extrêmement faible dont le pouvoir dépendait totalement des États-Unis. Malheureusement, sa maîtrise et son doctorat en anthropologie socioculturelle ne lui ont guère servi, alors que cela aurait dû être le contraire. Le retrait des troupes américaines en 2021 l'a très bien montré.
Outre les talibans (interdits dans la Fédération de Russie) eux-mêmes, le gouvernement s'oppose depuis 2016 au groupe ISIS (interdit dans la Fédération de Russie), deux mouvements qui avaient initialement prévu de s'unir, mais les différences d'objectifs avec les talibans se sont avérées trop importantes.
Ainsi, le gouvernement américain et ses alliés ont sérieusement espéré créer un type de démocratie européanisée en Afghanistan. En outre, ils espéraient que les Afghans ordinaires soutiendraient cette décision. Cela ne tenait pas compte du fait que la société afghane - analphabète, peu politisée et religieuse - serait prête à accepter le concept nouveau et étranger du développement. En outre, il n'y a pas eu de publicité et de propagande actives pour promouvoir les nouvelles règles et les nouveaux ordres, apparemment les politologues américains pensaient que tout devait suivre la voie naturelle de la diffusion des idées. Ou peut-être avaient-ils simplement peur de se rendre dans un territoire contrôlé par les talibans.
Dans le même temps, la Russie, ainsi que les voisins de l'Afghanistan, ont parfaitement compris que le Kaboul pro-américain n'avait aucun pouvoir réel et qu'il n'avait pratiquement aucune chance de se maintenir lorsque les troupes de la coalition se retireraient. Néanmoins, ils n'ont pas abandonné les tentatives de rapprochement avec les deux parties au conflit : le Kaboul officiel et les Talibans. Le "format qatari" et le "format moscovite" parlent d'eux-mêmes. Actuellement, malgré la "non-reconnaissance" officielle du gouvernement formé par les talibans, les négociations se poursuivent. Alors que le format occidental (américain) s'est complètement effondré.
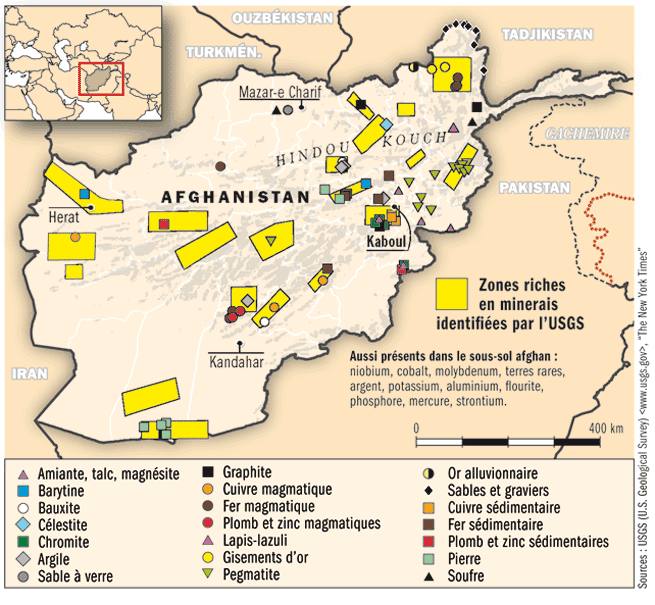
Ainsi, les acteurs mondiaux (Russie et Chine) et régionaux (Pakistan, Iran, pays d'Asie centrale) peuvent actuellement offrir à l'Afghanistan autre chose qu'une occupation militaire et un gouvernement fantoche basé en grande partie sur le pompage des ressources naturelles du pays ou la vente de drogues. Les principaux domaines de développement possibles dans ce contexte sont les gisements de minerai de fer à Hajigak et les gisements de charbon à coke dans les régions voisines de Shabashak et Dar-e-Suf, les exploitations pétrolières et gazières à Balkh, l'extraction de métaux des terres rares tels que le lithium, le cérium, le néodyme, le lanthane, le zinc et le mercure..., les projets transafghans de transport de pétrole, de gaz, d'électricité et même d'internet par câble à haut débit sont bien estimés. Et c'est le minimum, dont la mise en œuvre a été problématique en raison de la puissance instable et des ambitions prédatrices des États-Unis.
Au XXIe siècle, il est devenu évident que :
- Le peuple afghan ne cherche pas à concrétiser les droits et libertés euro-américains, mais attend la stabilité économique et politique ;
- La théorie américaine de la "normalisation" s'est effondrée ;
- Les forces diplomatiques extérieures qui ont dialogué avec les deux parties (le Kaboul officiel et les Talibans) ont désormais un avantage significatif et la possibilité d'influencer l'avenir du CA.
Scénarios probables pour l'avenir de l'Afghanistan : développement politique et économique avec l'aide des pays leaders mondiaux et régionaux intéressés par la stabilisation de la situation dans le pays et aussi - désislamisation progressive du gouvernement taliban par des moyens doux et atténuation de l'influence des facteurs radicaux sur la société afghane.
Source : https://www.geopolitica.ru/article/afganskaya-problema-xxi-veka
09:27 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : afghanistan, actualité, géopolitique, politique internationale, asie, affaires asiatiques, talibans |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook