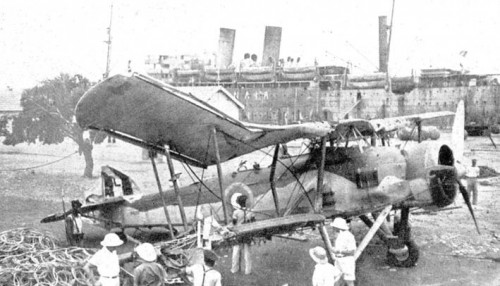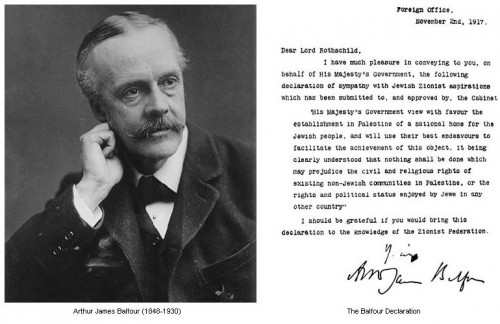mercredi, 20 novembre 2013
Als in Polen die Mark galt

Als in Polen die Mark galt
Während des Ersten Weltkrieges existierte ein von Hohenzollern- und Habsburgerreich errichteter polnischer Nationalstaat
Der 11. November 1918 markiert nicht nur das Ende der Kampfhandlungen des Ersten Weltkrieges, sondern für die Polen zugleich die Wiedergeburt ihres Staates, der 1795 mit der Dritten Teilung des Landes von der Landkarte verschwunden war. Beinahe in Vergessenheit geraten ist in diesem Zusammenhang aber, dass schon fast auf den Tag genau zwei Jahre vorher, nämlich am 5. November 1916, ein neuer polnischer Staat ins Leben gerufen worden war, der als „Regentschaftskönigreich Polen“ in die Annalen einging.
Da es vorläufig noch keinen König gab, wurde im Dezember 1916 zunächst ein Provisorischer Staatsrat als Regierung gebildet. Dieser bestand aus 25 Mitgliedern, wobei 15 aus den seit Beginn des Weltkriegs vom Deutschen Reich besetzten Teilen Kongresspolens kamen und zehn aus dem von Österreich-Ungarn okkupierten Landesteil. Ernannt wurden die Mitglieder des Staatsrates am 11. Januar 1917, die konstituierende Sitzung fand drei Tage später statt. Vorsitzender beziehungsweise Präsident mit dem Titel „Kronmarschall“ wurde Wacław Niemojowski, sein Stellvertreter Józef Mikołwski-Pomorski. Auch der spätere Nationalheld und Gründer der Republik, Józef Piłsudski, gehörte dem Staatsrat an. Er war dort für militärische Angelegenheiten zuständig. Es formierte sich auch ein Parlament, „Nationalrat“ genannt, das vom 16. bis zum 18. März 1917 tagte. Bereits am 9. Dezember 1916 war eine Polnische Nationalbank gegründet worden, die eine neue landeseigene Währung herausgab, die Polnische Mark.
Im April 1917 legte der deutsche Generalgouverneur Generaloberst Hans von Beseler mit Sitz in Warschau die Justiz sowie das Schul- und das Pressewesen in die Hände des Staatsrates. Im selben Monat erfolgte auch ein Werbeaufruf zur Gründung polnischer Streitkräfte. In ihr sollten nur ehemalige russische Untertanen, sogenannte Nationalpolen, dienen, wohingegen die Polen aus dem österreichisch-ungarischen Herrschaftsbereich in der k.u.k. Armee verbleiben sollten. Auf Kritik stieß auch die vom deutschen und dem österreich-ungarischen Generalgouverneur ausgearbeitete Eidesformel: „Ich schwöre zu Gott dem Allmächtigen, dass ich meinem Vaterlande, dem Polnischen Königreich, und meinem künftigen König zu Lande und zu Wasser und an welchen Orten es immer sei, getreu und redlich dienen, in gegenwärtigem Kriege treue Waffenbrüderschaft mit den Heeren Deutschlands und Österreich-Ungarns und der ihnen verbündeten Staaten halten … werde.“ Es gab Vorbehalte dagegen, auf einen König vereidigt zu werden, der noch gar nicht einmal bekannt war. Außerdem wurde kritisiert, dass eine Armee keinen Eid auf eine Waffenbrüderschaft leisten könne, denn nur der Regierung stünde es zu, Bündnisse abzuschließen. Gleichwohl bestätigte der Staatsrat am 3. Juli die Eidesformel, und Soldaten, die den Eid dennoch nicht ablegen wollten, wurden interniert. Aus Protest gegen diese Vorgänge waren Piłsudski und drei weitere dem linken Spektrum angehörige Mitglieder des Staatsrates am Tag zuvor von ihren Ämtern zurückgetreten. Am 22. Juli ließ man Piłsudski schließlich in Schutzhaft nehmen und verbrachte ihn zuerst in die Festung Wesel, später nach Magdeburg. Anfang August 1917 wurde dann die neu aufgestellte polnische Armee an die Ostfront verlegt. Nun zeugten sich die Meinungsverschiedenheiten über den weiteren Weg in aller Deutlichkeit. Ihr Höhepunkt wurde am 6. August erreicht, als Niemojowski darüber sein Amt als Kronmarschall niederlegte. Am 25. August stellte der Staatsrat seine Tätigkeit ein, und in seiner allerletzten Sitzung am 30. August bildete er einen auch „Übergangskomitee“ genannten Interimsausschuss, der vorläufig die Regierungsgeschäfte führen sollte und an dessen Spitze der bisherige stellvertretende Kronmarschall Mikołowski-Pomorski trat.
Bis zum 12. September des Jahres war eine provisorische Verfassung ausgearbeitet. Dieses sogenannte Patent beschrieb Polen als konstitutionelle Monarchie mit einem aus einem Abgeordnetenhaus und einem Senat bestehenden Zweikammerparlament. Bis zur Übernahme der Staatsgewalt durch einen noch zu bestimmenden König sollte diese von einem dreiköpfigen Regentschaftsrat ausgeübt werden, in den man sechs Tage später folgende Personen berief: Aleksander Kardinal Kakowski, Erzbischof von Warschau, Fürst Zdzisław Lubomirski, Stadtpräsident (Oberbürgermeister) von Warschau, und Józef Ostrowski, vormals Vorsitzender des Polenklubs in der russischen Duma in St. Petersburg. Am 15. Oktober 1917, dem 100. Todestag des polnischen Nationalhelden Tadeusz Kosciuszko, wurde der Regentschaftsrat vereidigt. Am 27. Oktober trat er offiziell sein Amt an.
Genau einen Monat später kam es zur Einsetzung einer ersten ordentlichen Regierung unter Ministerpräsident Jan Kucharzewski, nachdem zuvor seit dem 1. Februar 1917 lediglich eine provi-sorische Regierung unter Michał Łempicki, einem Mitglied des Provisorischen Staatsrates, amtiert hatte.
Am 4. Februar 1918 wurde ein Gesetz über die Schaffung eines Parlaments erlassen, das die Bezeichnung „Staatsrat“ erhielt. Dieser setzte sich aus 110 Abgeordneten zusammen. 55 davon wurden von den Gemeinden und Regionalräten am 9. April 1918 gewählt, 43 wurden vom Regentschaftsrat ernannt, und zwölf gehörten ihm kraft ihres Amtes beziehungsweise aufgrund einer Funktion an. Zu letzteren zählten Bischöfe ebenso wie Universitätsrektoren und der Präsident des Obersten Gerichtshofes. An der Spitze fungierte als „Sprecher der Krone“ ein Marschall, ab dem 14. Juni 1918 Francis John Pulaski. Daneben saßen im Parlamentspräsidium zwei Vizemarschälle, Józef Mikołowski-Pomorski und Stefan Badzynski, sowie vier Beisitzer (Sekretäre). Am 21. Juni fand die feierliche Eröffnung statt, und bis zum 7. Oktober, als man die Arbeit einstellte, folgten insgesamt 14 Plenarsitzungen.

Bereits am 6. Januar 1918 war der Regentschaftsrat zum Antrittsbesuch beim Deutschen Kaiser und beim Reichskanzler nach Berlin gekommen. Drei Tage später reiste man weiter nach Wien.
In Polen selbst war man besorgt, ja sogar empört, dass die deutschen Militärbehörden am 11. Dezember 1917 einen unabhängigen litauischen Staat mit Wilna (Vilnius) als Hauptstadt proklamiert hatten, war doch gerade diese Region in der Mehrheit von Polen besiedelt, weshalb die Regierung in Warschau dort auch Territorialansprüche stellte. Dies, die Forderung aus deutschen Militärkreisen nach Schaffung eines „Schutzstreifens“ auf polnischem Gebiet entlang der Grenze zum Deutschen Reich und schließlich die Weigerung der deutschen Besatzungsbehörden, statt nur einer eigeschränkten die volle Verwaltung an die Polen zu übergeben, riefen in der Bevölkerung zunehmend eine antideutsche Haltung hervor, was wiederum den Befürwortern einer austropolnischen Lösung in die Hände spielte, also einer Vereinigung Polens mit dem Habsburgerreich unter einer gemeinsamen Krone. Der österreichische Kaiser Karl I. ging im August 1918 sogar auf Distanz zu allen deutschen Plänen, erklärte eine Anwartschaft Erzherzog Karl Stephans auf die polnische Königskrone für obsolet und favorisierte stattdessen die erwähnte austropolnische Lösung mit ihm selbst als Herrscher über das gesamte Imperium.
Währenddessen wandte sich das Blatt immer mehr zu Ungunsten der Mittelmächte. Am 6. Ok-tober 1918 erklärte der Regentschaftsrat in Warschau die 14 Punkte des US-amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson zur Grundlage einer polnischen Staatsbildung, am folgenden Tag verkündete er gar die vollständige Unabhängigkeit Polens und löste zugleich das Parlament, den Staatsrat, auf. Der deutsche Generalgouverneur von Beseler legte daraufhin die gesamte Administration in polnische Hände und übertrug dem Regentschaftsrat am 23. Oktober auch den Oberbefehl über die polnischen Truppen.
Und dann ging alles ganz schnell: Am 6. November bildet sich unter der Führung des Sozialisten Ignacy Daszynski in Lublin eine „Provisorische Volksregierung der polnischen Republik“, die den Regentschaftsrat für abgesetzt erklärte. Das rief in Warschau den Protest gemäßigter Kräfte hervor, und weil sowohl der Regentschaftsrat als auch dessen Kabinett unter Ministerpräsident Władysław Wróblewski im Amt verblieben, amtierten einige Tage lang zwei Regierungen nebeneinander. Nachdem jedoch am 11. November 1918 der kurz zuvor aus deutscher Haft entlassene Józef Piłsudski in Warschau eingetroffen war und die polnische Republik ausgerufen hatte, übertrugen ihm sowohl die Regierung in Warschau als auch die Gegenregierung in Lublin die Regierungsgewalt. Die deutschen Truppen in der Hauptstadt, die sich geweigert hatten, auf polnische Aufständische zu schießen, wurden entwaffnet, und als der Regentschaftsrat am 14. November endgültig alle Staatsgewalt in die Hände Piłsudskis legte, wurde auch der abschließende Akt besiegelt: Das Regentschaftskönigreich Polen, die vierte und letzte Monarchie auf polnischem Boden, hatte aufgehört zu existieren.
Wolfgang Reith
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, pologne, europe centrale, première guerre mondiale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 15 novembre 2013
Historical Reflections on the Notion of “World War”

Robert Steuckers:
Historical Reflections on the Notion of “World War”
First thesis in this paper is: a World War was started in 1756, during the “Seven Years’ War” or “Austrian Succession War” and has lasted till now. We still experiment the effects of this 1756 World War and present-day events are far results of the scheme inaugurated during that remoted 18th century era.
Of course, it’s impossible to ignore all the dramatic events of the 17th century, which lead to the situation of the mid-18th century, but it would make this short paper too exhaustive. Even if Britain could already master the Western Mediterranean by controling Gibraltar and the Balears Isles after the “Spanish Succession War”, many British historians are anyway aware nowadays that British unmistakeable supremacy was born immediately after the “Seven Years’ War” and that seapower became the most determining factor for global superiority since then. Also it would be silly to forget about a certain globalization of conflicts in the 16th century: Pizzaro conquered the Inca Empire and stole its gold to finance Charles V’s war against the Ottomans in Northern Africa, while the Portuguese were invading the shores of the Indian Ocean, beating the Mameluks’ fleet in front of the Gujarat’s coasts and waging war against the Yemenite and Somali allies of the Turks in Abyssinia. The Spaniards, established in the Philippines, fought successfully against the Chinese pirates, who wanted to disturb Spanish trade in the Pacific. Ivan IV the Terrible by conquering the Volga basin till the Caspian made the first steps in the direction of the Russian conquest of Northern Asia. The war between Christianity (as defined by Emperor Charles V and Philipp II of Spain) and the Muslims was indeed a World War but not yet fully coordinated as it would always be the case after 1759.
For the British historian Frank McLynn, the British could beat their main French enemy in 1759 —the fourth year of the “Seven Years’ War”— on four continents and achieve absolute mastery of the seas. Seapower and sea warfare means automatically that all main wars become world wars, due to the technically possible ubiquity of vessels and the necessity to protect sea routes to Europe (or to any other place in the world), to transport all kind of materials and to support operating troops on the continental theatre. In India the Moghul Empire was replaced by British rule that introduced the harsh discipline of incipient industrialism to a traditional non hectic society and let the derelict Indian masses —of which one-third perished during a famine in 1769— produce huge bulks of cheap goods to submerge the European markets, preventing for many decades the emerging of a genuine large-scale industry in the main kingdoms of continental Europe. While France was tied up in a ruinous war in Europe, the British Prime Minister Pitt could invest a considerable amount of money in the North American war and defeat the French in Canada, taking the main strategical bases along the Saint-Lawrence river and conquering the Great Lakes region, leaving a giant but isolated Louisiana to the French. From 1759 on, Britain as a seapower could definitively control the Northern Atlantic Ocean and the Indian Ocean, even if the French could take revenge by building a new efficient and modern fleet in the 1770s anyway without regaining full global power.
The Treaty of Paris of 1763 marked the end of French domination in India and Canada, a situation that didn’t preoccupy Louis XV and his mistress Madame de Pompadour but puzzled the King’s successor, the future Louis XVI, who is generally considered as a weak monarch only interested in making slots. This is pure propaganda propagated by the British, the French revolutionaries and the modern trends in political thought. Louis XVI was deeply interested in seapower and sea exploration, exactly as the Russian were when they sent Captain Spangberg who explored the Kurils and the main Northern Japanese island of Hokkaido in 1738 and some years or decades later when they sent brilliant sailors and captains around the world such as Bering and his Lieutenant Tshirikov —who was the first officer to hoist the Russian imperial flag on the Pacific coast of Northern America— and Admiral von Krusenstern (who claimed the Hawai Islands for Russia), Fabian Gottlieb Bellingshausen (who circumnavigated the Antarctic for the first time in mankind’s history) and Otto von Kotzebue (who explored Micronesia and Polynesia), working in coordination with land explorers such as Aleksandr Baranov who founded twenty-four naval and fishing posts from the Kamtshatka peninsula to California. If the constant and precious work of these sea and land explorers would have been carried on ceaselessly, the Pacific would have become a Russian lake. But fur trade as a single practiced economical activity was not enough to establish a Russian New World empire directly linked to the Russian possessions in East Siberia, even if Tsar Aleksandr I was —exactly as Louis XVI was for France— in favour of Pacific expension. Tsar Nikolai I, as a strict follower of the ultraconservative principles of Metternich’s diplomacy, refused all cooperation with revolutionary Mexico that had rebelled against Spain, a country protected by the Holy Alliance, which refused of course all modifications in political regimes in name of a too uncompromising traditional continuity.
Louis XVI, after having inherited the crown, started immediately to prepare revenge in order to nullify the humiliating clauses of the 1763 Paris Treaty. Ministers Choiseul and Praslin modernized the dockyards, proposed a better scientific training of the naval officers and favoured explorations under the leading of able captains like Kerguelen and Bougainville. On the diplomatic level, they imposed the Spanish alliance in order to have two fleets totalizing more vessels than the British fleet, especially if they could table on the Dutch as a third potential ally. The aim was to build a complete Western European alliance against British supremacy, while Russia as another latent ally in the East was trying to concentrate its efforts to control the Black Sea, the Eastern Mediterranean and the Northern Pacific. This was a genuine, efficient and pragmatical Eurasianism avant la lettre! The efforts of the French, Spaniards and Dutch contributed to the American revolt and independance, as the colonists of the thirteen British colonies on the East Coast of the present-day US-territory were crushed under a terrible fiscality coined by non-elected officials to finance the English war effort. It is a paradox of modern history that traditional powers like France and Spain contributed to the birth of the most anti-traditional power that ever existed in mankind’s history. But modernity is born out the simple existence of a worldwide thalassocracy. The power which detains seapower (or thalassocracy) is ipso facto the bearer of modern dissolution as naval systems are not bound to Earth, where men live, have always lived and created the continuities of living history.
Pitt ,who was governing England at that time, could not tolerate the constant challenge of the French-Spanish-Dutch alliance, that forced Britain to dedicate huge budgets to cope with the united will of the challenging Western European powers. This lethal alliance had to be broken or the civil peace within the enemies’ borders reduced to nothing in order to paralyze all fruitful foreign policies. French historians such as Olivier Blanc put the hypothesis that the riots of the French Revolution were financed by Pitt’s secret funds in order to annihilate the danger of the French numerous and efficient vessels. And indeed the fall of the French monarchy implied the decay of the French fleet: for a time, vessels were still built in the dockyards to consolidate the seapower of which Louis XVI dreamt of but as the officers were mainly noblemen, they were either dismissed or eliminated or compulsed to emigrate so that there was no enough commanding staff anymore and no able personnel that could have been easily replaced by conscription as for the regiments of the land forces. Prof. Bennichon, as a leading French historian of navies, concludes a recent study of him by saying that workers in the dockyards of Toulon weren’t paid anymore, they and their families were starving and consequently looted the wood reserves, so that the new Republican regime was totally unable to engage the British forces on sea. Moreover, the new violent and chaotic regime was unable to find allies in Europe, the Spaniards and the Dutch prefering to join their forces to the British-lead coalition. The English were then able to reduce French naval activities to coastal navigation. A British blocus of the continent could from then on be organized. On the Mediterranean stage, the French after the battle of Abukir were unable to repatriate their own troops from Egypt and after Trafalgar unable to threaten Britain’s coasts or to attempt a landing in rebelling Ireland. Napoleon didn’t believe in seapower and was finally beaten on the continent in Leipzig and Waterloo. Prof. Bennichon: “Which conclusions can we draw from the Franco-British clash (of the 18th century)? The mastery of seapower implies first of all the long term existence of a political will. If there is no political will, the successive interruptions in naval policy compels the unstable regime to repeated expensive fresh starts without being able in the end to face emergencies... Fleets cannot be created spontaneously and rapidly in the quite short time that an emergency situation lasts: they always should preexist before a conflict breaks out”. Artificially created interruptions like the French revolution and the civil disorders it stirred up at the beginning of the 1790s, as they were apparently instigated by Pitt’s services —or like the Yeltsin era in Russia in the 1990s— have as an obvious purpose to lame long term projects in the production of efficient armaments and to doom the adverse power plunged into inefficiency to yield power on the international chessboard.
The artificially created French revolution can so be perceived as a revenge for the lost battle of Yorktown in 1783, the very year Empress Catherine II of Russia had taken Crimea from the Turks. In 1783 the thalassocratic power in Britain had apparently decided to crush the French naval power by all secret and unconventional means and to control the development of Russian naval power in the Eastern Mediterranean and in the Black Sea, so that Russian seapower couldn’t trespass the limits of the Bosphorus and interfere in the Eastern Mediterranean. What concerns explicitly Russia, an anonymous document from a British government department was issued in 1791 and had as title “Russian Armament”; it sketched the strategy to adopt in order to keep the Russian fleet down, as the defeats of the French in the Mediterranean implied of course the complete British control of this sea area, so that the whole European continent could be entangled from Norway to Gibraltar and from Gilbraltar to Syria and Egypt. This brings us to the conclusion that any single largely dominating seapower is strategically compelled to meddle into other powers’ internal affairs to create civil dissension to weaken any candidate challenger. These permanent interferences —now known as “orange revolutions”— mean permanent war, so that the birth of a global seapower implies quasi automatically the emerging process of permanent global war, replacing the previous state of large numbers of local wars, that couldn’t be thoroughly globalized.
After Waterloo and the Vienna Conference, Britain had no serious challenger in Europe anymore but had now as a constant policy to try to keep all the navies in the world down. The non entirely secured mastery of the Atlantic and the Indian Oceans and the largely but not completed mastery of the Mediterranean was indeed the puzzle that British decision-makers had to solve in order to gain definitively global power. Aiming at acquiring completely this mastery will be the next needed steps. Controling already Gibraltar and Malta, trying vainly to annex to Britain Sicily and Southern Italy, the British had not a complete grasp on the Eastern Mediterranean area, that could eventually come under control of a reborn Ottoman Empire or of Russia after a possible push in direction of the Straights. The struggle for getting control overthere was thus mainly a preventive struggle against Russia and was, in fact, the plain application of the strategies settled in the anonymous text of 1791, “Russian Armament”. The Crimean War was a conflict aiming at containing Russia far northwards beyond the Turkish Straights in order that the Russian navy would never become able to bring war vessels into the Eastern Mediterranean and so to occupy Cyprus of Creta and, by fortifying these insular strong points, to block the planned shortest highway to India through a future digged canal through one of the Egyptian isthmuses. The Crimean War was therefore an wide-scale operation directly or indirectly deduced from the domination of the Indian Ocean after the French-British clash of 1756-1763 and from the gradual mastery of the Mediterranean from the Spanish Succession War to the expulsion of Napoleon’s forces out of the area, with as main obtained geostrategical asset, the taking over of Malta in 1802-1804. The mastery of this island, formerly in the hands of the Malta Knights, allowed the British and the French to benefit from an excellent rear base to send reinforcements and supplies to Crimea (or “Tavrida” as Empress Catherine II liked to call this strategic place her generals conquered in 1783).
The next step to link the Northern Atlantic Ocean to the Indian Ocean through the Mediterranean corridor was to dig the Suez Canal, what a French engineer Ferdinand de Lesseps did in 1869. The British by using the non military weapon of bank speculation bought all the shares of the private company having realised the job and managed so to get the control of the newly created waterway. In 1877 the Rumanians and the Bulgars revolted against their Turkish sovereign and were helped by Russian troops that could have reached the coasts of the Aegean Sea and controled the Marmara Sea and the Straights. The British sent weapons, military trainers and ships to protect the Turkish capital City from any possible Bulgarian invasion and occupation in exchange of an acceptance of British sovereignty on Cyprus, which was settled in 1878. The complete control of the Mediterranean corridor was acquired by this poker trick as well as the English domination on Egypt in 1882, allowing also an outright supervision of the Red Sea from Port Said till Aden (under British supervision since 1821). The completion of the dubble mastery upon the Atlantic and the Indian Ocean, that had already been acquired but was not yet fully secured, made of Britain the main and uncontested superpower on the Earth in the second half of the 19th century.
The question one should ask now is quite simple: “Is a supremacy on the Atlantic and Indian Oceans and in the Mediterranean area the key to a complete global power?”. I would answer negatively. The German geopolitician Karl Haushofer remembered in his memoirs a conversation he had with Lord Kitchener in India on the way to Japan, where the Bavarian artillery officer was due to become a military attaché. Kitchener told Haushofer and his wife that if Germany (that dominated Micronesia after Spain had sold the huge archipelago just before the disasters of the American-Spanish war of 1898) and Britain would lost control of the Pacific after any German-British war, both powers would be considerably reduced as global actors to the straight benefit of Japan and the United States. This vision Kitchener disclosed to Karl and Martha Haushofer in a private conversation in 1909 stressed the importance of dominating three oceans to become a real global unchallenged power: the Atlantic, the Pacific and the Indian Ocean. If there is no added domination of the Pacific the global superpower dominating the Atlantic, the Mediterranean and the Indian Ocean, i. e. Britain at the time of Kitchener, will be inevitably challenged, risking simultaneously to change down and fall back.
In 1909, Russia had sold Alaska to the United States (1867) and had only reduced ambitions in the Yellow Sea and the Sea of Japan, especially after the disaster of Tshushima in 1905. France was present in Indochina but without being able to cut maritime routes dominated by the British. Britain had Australia and New Zeland as dominions but no strategical islands in the Middle and the Northern Pacific. The United States had developped a Pacific strategy since they became a bioceanic power after having conquered California during the Mexican-American war of 1848. The several stages of the gradual Pacific strategy elaborated by the United States were: the results of the Mexican-American War in 1848, i. e. the conquest of all their Pacific coast; the purchase of Alaska in 1867; and the events of the year 1898 when they colonized the Philippines after having waged war against Spain. Even if the Russian Doctor Schaeffer tried to make of the volcanic archipelago of Hawai a Russian protectorate in 1817, US American whale hunters used to winter in the islands so that the islands came gradually under US domination to become an actual US strong point immediately after the conquest of the formerly Spanish Philippines in 1898. But as Japan had inherited in Versailles the sovereignty on Micronesia, the clash foreseen by Lord Kitchener in 1909 didn’t happen in the Pacific between German and British forces but during the Second World War between the American and Japanese navies. In 1945, Micronesia came under American influence, so that the United States could control the entire Pacific area, the North Atlantic area and gradually the Indian Ocean, especially when they finished building a navy and airforce strong point in Diego Garcia in the very middle part of the Indian Ocean, from where they can now strike every position along the coasts of the so-called “Monsoon countries”. According to the present-day American strategist Robert Kaplan, the control of the “Monsoon lands” will be crucial in the near future, as it allows the domination of the Indian Ocean linking the Atlantic to the Pacific where US hegemony is uncontested.
Kaplan’s book on the “Monsoon area” is indeed the proof that American have inherited the British strategy in the Indian Ocean but that, contrary to the British, they also control the Pacific except perhaps the maritime routes along the Chinese coasts in the South China Sea and the Yellow Sea, that are protected by a quite efficient Chinese fleet that is steadily growing in strength and size. They nevertheless are able to disturb intensely the Chinese vital highways if Taiwan, South Korea or Vietnam are recruited into a kind of East Asian naval NATO.
What could be the answer to the challenge of a superpower that controls the three main oceans of this planet? To create a strategical thought system that would imitate the naval policy of Choiseul and Louis XVI, i. e. unite the available forces (for instance the naval forces of the BRICS-countries) and constantly build up the naval forces in order to exercice a continuous pressure on the “big navy” so that it finally risks “imperial overstretch”. Besides, it is also necessary to find other routes to the Pacific, for instance in the Arctic but we should know that if we look for such alternative routes the near North American Arctic bordering powers will be perfectly able to disturb Northern Siberian Arctic coastal navigation by displaying long range missiles along their own coast and Groenland.
History is not closed, despite the prophecies of Francis Fukuyama in the early 1990s. The main problems already spotted by Louis XVI and his brilliant captains as well as by the Russian explorers of the 18th and 19th centuries are still actual. And another main idea to remember constantly: A single World War had been started in 1756 and is not finished yet, as all the moves on the world chessboard made by the actual superpower of the time are derived from the results of the double British victory in India and Canada during the “Seven Years’ War”. Peace is impossible, is a mere and pure theoretical view as long as a single power is trying to dominate the three oceans, refusing to accept the fact that sea routes belong to all mankind.
Robert Steuckers.
(Vorst-Flotzenberg, november 2013).
Bibliography:
-
Philippe Conrad (ed.), “La puissance et la mer”, numéro spécial hors-série (n°7) de La nouvelle revue d’histoire, automne-hiver 2013.
-
Philippe Conrad, “Quand le Pacifique était un lac russe”, in “La puissance et la mer”, op. cit..
-
Philippe Bonnichon, “La rivalité navale franco-anglaise (1755-1805)”, in “La puissance et la mer”, op. cit.
-
Niall Ferguson, Empire – How Britain Made the Modern World, Penguin, Harmondsworth, 2004.
-
Richard Harding, Seapower and Naval Warfare – 1650-1830, UCL Press, London, 1999.
-
Robert Kaplan, Monsoon – The Indian Ocean and the Future of American Power, Random House, New York, 2011.
-
Charles King, The Black Sea – A History, Oxford University Press, 2004.
-
Frank McLynn, 1759 – The Year Britain BecameMaster of the World, Pimlico, London, 2005.
-
Richard Overy, Atlas of 20th Century History, Collins Books, London, 2005.
-
Tom Pocock, Battle for Empire – The Very First World War – 1756-63, Caxton Editions, London, 1998.
-
Robert Steuckers, “Karl Haushofer: l’itinéraire d’un géopoliticien allemand”, sur: http://robertsteuckers.blogspot.com (juillet 2012).
00:05 Publié dans Géopolitique, Histoire, Synergies européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : robert steuckers, histoire, thalassocratie, puissance maritime, marine, thalassopolitique, géopolitique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Okinawa : la « bataille Ragnarök »
Okinawa : la « bataille Ragnarök » (1er avril – 21 juin 1945)
par Rémy VALAT
En mémoire du soldat Tsukamoto Sakuichi, mort au combat à Okinawa (1945)
塚本作一氏を偲んで
Il y a 68 ans s’est déroulée sur l’île d’Okinawa une des batailles les plus sanglantes de la Seconde Guerre mondiale. Les habitants de l’île, retournée sous la souveraineté du Japon en 1972, vivent dans le souvenir de cette bataille et subissent au quotidien les conséquences de celle-ci : présence de l’armée américaine d’occupation, à la fois fardeau financier et source de crimes sexuels, un sol miné par 2 100 tonnes d’obus encore intacts, des séquelles psychologiques et morales. En un mot, le Japon paye encore le prix de la défaite face aux forces alliées en septembre 1945.
Une île martyre…
L’île est encore occupée par un fort contingent de troupes de marine américaines, bien que 9 000 soldats vont être prochainement déplacés sur l’échiquier de la zone Pacifique, en application des accords bilatéraux nippo-américains, récemment révisés, sur le redéploiement des forces américaines stationnées à Okinawa (2006). Les États-Unis vont relocaliser une partie de leurs unités à Guam et à Darwin (Australie). Ces mouvements sont une réponse à la montée en puissance de la flotte de guerre chinoise au sud et à l’est de la Mer de Chine, flotte qui mène d’audacieuses actions de déstabilisations près des îlots dont ils revendiquent la souveraineté (les îles japonaises Senkaku). La stratégie navale chinoise aurait pour ambition de prévenir la présence de porte-avions américains, par la construction de bâtiments de la même catégorie et l’amélioration de son équipement en missiles balistiques anti-navires : la dispersion des unités américaines aurait pour objectif de multiplier les cibles potentielles et de créer une nouvelle donne stratégique. Les unités restantes (9 000 hommes environ) aurait pour zone d’intervention l’Asie du nord-est (péninsule coréenne et façade orientale de la Chine comprise), celle de Guam la zone du Pacifique ouest, et enfin, celle de Darwin, le sud de la Mer de Chine et l’Océan Indien. La présence de la 3e force expéditionnaire du corps des Marine (IIIrd Marine Expeditionary Force) (1) et d’une formation équivalente à un régiment (les 2 200 hommes du 31st Marine Expeditionary Unit) est jugé indispensable par les autorités américaines qui considèrent l’île comme une « position clé de la ligne de front (key frontline base) face à la Chine et à la Corée du Nord. Washington a aussi argué que cette nouvelle répartition faciliterait les interventions humanitaires américaines en cas de catastrophe naturelle majeure dans la zone du Pacifique, ce qui ne peut laisser le gouvernement japonais indifférent après le désastre du 11 mars 2011.
Or la population tolère de moins en moins le coût financier et la présence de l’armée américaine dans l’île, dont 10 % du territoire est affecté aux installations militaires. La soldatesque commet régulièrement des actes de délinquance et les habitants subissent les nuisances des entraînements, et aussi un certain mépris des autorités états-uniennes pour leur sécurité. 24 Osprey MV-22, appareils destinés au remplacement des hélicoptères de transport de troupes CH-46 ont été officiellement choisis pour leurs meilleures capacités techniques comparativement aux hélicoptères CH-46 (vitesse double et capacité de portage triple). Leur rayon d’action (3 900 km) permettrait une rapide projection de troupes sur la péninsule coréenne. Mais, les déficiences techniques à répétition ayant occasionné le décès des personnels embarqués (Maroc, Floride et le 5 août 2013 sur une base américaine d’Okinawa) inquiètent les habitants et autorités locales qui se sont opposés vigoureusement à leur arrivée. Les Okinawaiens font également obstacle au déménagement de la base aéronavale de Futenma (qui doit être réinstallée dans la la baie de Henoko). Cette résistance passive, qui rappelle sur la forme celui du « Mouvement d’opposition à l’extension du camp du Larzac » des années 1970 : un noyau de militants, soutenus par la population, se relaient en permanence sur le chantier pour empêcher la progression des travaux. S’ajoute à cela le fléau des viols perpétrés régulièrement et en quasi-impunité (en raison de l’extra-territorialité des polices militaires) depuis 1945 par des soldats américains (118 viols ont été commis par des GI’s entre 1972 et 2008, selon un décompte de l’association des femmes d’Okinawa contre la violence militaire, réalisé à partir de rapports de police et de la presse locale (2). Ce phénomène récurrent (deux marins américains ont été condamnés cette année par un tribunal japonais à 9 et 10 ans de prison pour le viol en octobre 2012 d’une habitante de l’île) a obligé l’état-major des marines a décrété un couvre-feu pour ses hommes.
L’actualité entretient le souvenir douloureux de la Seconde Guerre mondiale, la bataille est ancrée dans les mémoires, et aussi souvent dans les chairs. L’année dernière (le 23 juin 2012, en marge des cérémonies officielles) des contemporains de l’affrontement ont relaté leur histoire. « Maman, je suis encore venue te voir cette année », susurre une habitante de Naha, Keiko Oshiro (68 ans). Nourrisson en 1945, Oshiro ne se souvient pas du visage de sa jeune mère, Tomi, âgée de 21 ans, atteinte à l’épaule par une balle alors qu’elle l’alimentait au sein. Selon le témoignages de proches, Tomi serait décédée dans une des grottes servant d’abris et d’hôpitaux aux militaires et aux civils. Lorsque le nom de sa mère a été gravé sur l’un des murs du Mémorial en 1995, Oshiro a pu commencer à faire le deuil de cette disparition… Fumi Nakamura (79 ans), une habitante du village de Nakagusuku est également venue rendre hommage à son père, mort de la malaria dans un camp des prisonniers. Résidant à proximité d’un aérodrome militaire américain, Nakamura déclare se crisper lorsqu’elle entend le rugissement du moteur des avions…
On comprend, à la lecture des récits de ces témoins que les habitants de l’île souffrent encore des conséquences de cet épisode de leur histoire : la guerre est restée quelque part en eux. En août 2012, 40 résidents de l’île (survivants ou membres de la famille des victimes) ont décidé d’ester contre le gouvernement : ils réclament un dédommagement financier et moral (une compensation financière de 440 millions de yen et des excuses officielles) pour les souffrances endurées pendant la Seconde Guerre mondiale, soulevant au passage la douloureuse question de l’implication des civils dans la bataille. Cette réclamation s’insère dans un mouvement plus large de reconnaissance des excès de l’armée impériale commis à l’encontre des habitants pendant la guerre.
Okinawa est une île marquée par l’Histoire… De par sa position géostratégique, et les derniers développements dans la région le confirment, l’île reste et restera une pièce maîtresse de l’« échiquier nord-américain» dans la région, notamment en raison de l’importance militaire des îles Nansei, passage obligé pour la marine de guerre chinoise voguant vers le Pacifique. Okinawa est un « porte-avion fixe » et une base avancée de l’armée américaine faisant face au continent est-asiatique. Pour ces raisons, les États-Unis ne sont pas prêts de retirer leurs troupes d’une position aussi importante, de surcroît acquise par la mort au combat de milliers de GI’s et de marines, au cours de ce qui a probablement été la bataille la plus sanglante de la bataille du Pacifique. Bataille ayant eu également pour conséquence (même si ce n’était pas la raison première), les bombardements atomiques de Hiroshima et de Nagasaki… Position qui cependant pourrait légitimement défendue par les forces japonaises elles-mêmes, si l’article 9 de la Constitution venait enfin à être modifié et redonnerait au Japon (troisième puissance économique mondiale) sa dignité et sa place comme grande puissance à part entière. De grands espoirs sont portés sur le Premier ministre Abe Shinzô qui œuvre en ce sens dans un contexte international devenu favorable (3).
La bataille : enjeux, unités engagées, déroulement des opérations et bilan des pertes humaines
Okinawa est une bataille majeure de la guerre Asie – Pacifique : l’ « Opération Iceberg », nom de code donné à l’automne 1944 par l’état-major américain au plan d’invasion des îles Ryûkyû, est l’opération amphibie ayant mobilisé le plus de moyens humains et matériels sur le front Pacifique depuis 1941. Pour la seconde fois, l’armée impériale japonaise va défendre le sol national avec opiniâtreté et courage (Iwo Jima est tombée le26 mars). Surtout, il s’agit d’empêcher l’armée américaine de contrôler les deux bases aériennes de l’île (Yontan et Kadena), autant de facilités pour les flottes de bombardiers stratégiques d’atteindre les îles principales du Japon et sa capitale (550 km environs séparent les deux archipels). Okinawa prise, les troupes américaines pourraient y stationner en prévision de l’invasion du Japon, programmée pour le printemps 1946 (Opération DownFall).
Les troupes alliées, très majoritairement américaines (la contribution britannique et des pays du Commonwealth, plus modeste, est navale et logistique) sont appuyées par une importante marine de guerre. L’armée d’invasion (la Xe armée), de plus de 180 000 hommes ayant une expérience du feu inégale, a été subdivisée en deux corps d’armée et en unités de réserve : le IIIe corps amphibie, composé de deux divisions de marines (1re et 6e divisions); le XXIVe corps d’infanterie (7e et 96e divisions d’infanterie), et en réserve la 2e division de marines ainsi que les 27e et 77e divisions d’infanterie. Cette armée est dirigée par le général Raymond A. Spruance.
 L’armée japonaise (la 32e armée, composée de deux divisions d’infanterie – 24e, 62e divisions – et d’une brigade mixte indépendante), d’un effectif avoisinant 70 000 combattants. La 62e division est une unité aguerrie ayant combattu en Chine. Ce corps principal a été renforcé par des unités à terre de la marine (9 000 hommes), des habitants des îles Ryûkyû réquisitionnés comme combattants ou comme auxiliaires du génie (39 000 individus) et des formations plus modestes composées de lycéens servant de coursiers, de miliciens ou affectés aux hôpitaux de campagne. Les forces navales sont inexistantes ou presque et les forces aériennes reposent sur les unités de Tokubetsu kôgeki-tai (特別攻撃隊), les kamikaze. Comme le firent les officiers commandant les positions de Tarawa ou d’Iwo Jima, les troupes japonaises se sont fortifiées et cantonnées dans des positions souterraines aménagées, construites le plus souvent avec les seuls outils individuels du fantassin (pelle, pioches), un éclairage sommaire et dans des conditions sanitaires pénibles d’un sous-sol volcanique (chaleur et humidité). Les soldats-ouvriers ont ainsi creusé un dense réseau de tunnels de communication et d’installations connectés entre-eux et équipés de discrets systèmes de ventilation. Cette défense a été conçu pour compenser la nette supériorité de la puissance de feu de l’armée d’invasion (aviation, marine et infanterie). D’un point de vue tactique, les fantassins japonais, outre leur valeur intrinsèque, disposent de lance-grenades à tir courbe, très utiles en défense.
L’armée japonaise (la 32e armée, composée de deux divisions d’infanterie – 24e, 62e divisions – et d’une brigade mixte indépendante), d’un effectif avoisinant 70 000 combattants. La 62e division est une unité aguerrie ayant combattu en Chine. Ce corps principal a été renforcé par des unités à terre de la marine (9 000 hommes), des habitants des îles Ryûkyû réquisitionnés comme combattants ou comme auxiliaires du génie (39 000 individus) et des formations plus modestes composées de lycéens servant de coursiers, de miliciens ou affectés aux hôpitaux de campagne. Les forces navales sont inexistantes ou presque et les forces aériennes reposent sur les unités de Tokubetsu kôgeki-tai (特別攻撃隊), les kamikaze. Comme le firent les officiers commandant les positions de Tarawa ou d’Iwo Jima, les troupes japonaises se sont fortifiées et cantonnées dans des positions souterraines aménagées, construites le plus souvent avec les seuls outils individuels du fantassin (pelle, pioches), un éclairage sommaire et dans des conditions sanitaires pénibles d’un sous-sol volcanique (chaleur et humidité). Les soldats-ouvriers ont ainsi creusé un dense réseau de tunnels de communication et d’installations connectés entre-eux et équipés de discrets systèmes de ventilation. Cette défense a été conçu pour compenser la nette supériorité de la puissance de feu de l’armée d’invasion (aviation, marine et infanterie). D’un point de vue tactique, les fantassins japonais, outre leur valeur intrinsèque, disposent de lance-grenades à tir courbe, très utiles en défense.
Avant les opérations terrestres du printemps 1945, l’île a été intensément bombardée : lors du raid du 10 octobre 1944, l’aviation stratégique américaine procède à 1 400 sorties et a lancé 600 tonnes de bombes sur les installations portuaires de Naha et les positions de l’armée. 65 000 civils périrent. Le Jour J, le principal débarquement américain (1er avril 1945) se déroule sans opposition et fait suite aux attaques des îles Kerama et des îlots de Keise prises d’assaut respectivement les 26 et 31 mars.
Sur mer, les unités déployées le long de la côte subissent, à partir du 6 avril, des attaques massives et répétées des unités aériennes de kamikaze : entre le 26 mars et le 30 avril, 20 bâtiments lourds sont coulés et 157 unités ont été endommagées; l’armée de l’air japonaise perd 1 100 appareils… Du début des raids massifs au 22 juin, 1 465 unités de kamikaze ont été engagées avec pour cibles privilégiées : les porte-avions. Dans le même esprit, le cuirassé Yamato (le bâtiment était escorté par 8 destroyers), lancé dans une attaque suicide contre l’U.S. Navy, est coulé par l’aviation embarquée américaine (7 avril) sans avoir pu faire le moindre dégât à la flotte de débarquement alliée. Sur une échelle stratégique générale (période du 3 mars au 16 août 1945), les forces aériennes de l’armée de terre et de la marine japonaises ont perdu 2 571 pilotes et aéronefs; la flotte américaine recense 13 navires coulés (dont 9 destroyers) et un grand nombre de navires sérieusement endommagés (9 cuirassés, 10 porte-avions, 4 croiseurs, 58 destroyerset 93 navires de différentes catégories).
Sur terre, les unités américaines ont lancé l’offensive sur deux axes après leur débarquement sur les plages de Hagushi (au nord de Naha). La partie nord de l’île est tombée assez rapidement : les aérodromes, enjeux de la bataille, ont été capturés peu après le débarquement (Kadena et Yomidan); le 21 avril, un aérodrome est rendu opérationnel sur l’île de Ie. Le 18 avril, la résistance nippone n’est plus que sporadique et locale dans cette partie de l’île.
Mais, comme à Iwo Jima, Ushijima a concentré et fortifié ses unités sur un terrain difficile et c’est dans la partie sud de l’île que va se livrer une sanglante guerre d’usure, proche des combats de la Grande Guerre en Europe. Les positions méridionales de l’île d’Okinawa ont été renforcées et les unités japonaises défendent le terrain pied à pied, avec l’énergie du désespoir et au prix de pertes humaines importantes. Le 12 avril, les unités japonaises contre-attaquent nuitamment avant d’être repoussées et récidivent le 14 avril avec un même résultat. L’offensive américaine reprend, après une relève des unités les plus marquées par l’attrition. La dernière contre-attaque japonaise, le 4 mai, échoue également : mise à découvert, l’artillerie mise en batterie pour appuyer l’assaut a été partiellement anéantie par les canons lourds américains. En juin, sous une pluie continuelle (le phénomène de « mousson japonais », le « tsuyu »), la bataille fait rage autour de la position dite du « Shuri Castle »; celle-ci tombée, la 32e armée se replie, fin mai, encore plus au sud et se positionne sur sa dernière ligne de défense, dans la péninsule de Kiyan. Le dernier carré japonais (environ 40 000 hommes) se bat avec l’énergie du désespoir : face à l’attaque de la 6e division de marines, 4 000 marins japonais (dont l’amiral Minoru Ota) se suicident dans les constructions souterraines leur servant de quartier-général (13 juin).
Le 21 juin se livrent les derniers combats d’importance : les généraux Ushijima et Chô se donnent la mort par éventration dans leurs quartiers généraux de la cote 89. Jusqu’en août 1945, des éléments isolés poursuivaient encore le combat contre l’armée américaine en différents points de l’île.
Les pertes humaines sont sans précédent sur le front du Pacifique : l’armée américaine déplore 62 000 hommes mis hors de combat (dont 12 500 tués ou portés disparus), à titre de comparaison 58 000 GI’s trouveront la mort au Vietnam entre 1967 et 1973… L’armée japonaise déplore 95 000 morts au combat ou s’étant donné la mort par seppuku ou à l’aide d’une grenade à main (voir l’épisode poignant du film de Clint Eastwood, Letters from Iwo Jima, montrant la mort de soldats japonais selon ce procédé). 7 400 soldats japonais ont été faits prisonniers. Les pertes humaines au sein de la population civile sont estimées être entre 42 000 et 150 000 tués; mais les statistiques officielles de l’armée américaine – qui prennent en considération les civils réquisitionnés – avancent le chiffre de 142 058 victimes (soit ? de la population).

Suicides volontaires ou sacrifice programmé ? Un phénomène d’implication totale de l’individu impliquant les militaires…
La bataille d’Okinawa frappe encore les imaginations par les suicides de masse de combattants et de civils, mais aussi par la détermination des combattants (attaques nocturnes au corps-à-corps, collision volontaire de pilotes kamikaze sur les bâtiments de la flotte américaine, flottilles de bateaux suicides, sortie du cuirassé Yamato).
L’histoire des kamikaze a fait coulé beaucoup d’encre. Les morts volontaires de pilotes japonais (et américains) dans le Pacifique étaient avant cela des actes héroïques et isolés, d’hommes aux commandes d’un engin sérieusement endommagé et se trouvant dans une situation sans issue. Dès 1942, des pilotes japonais se sacrifient dans de semblables situations et l’idée d’attaques suicides massives chemine dans les esprits en raison du renversement de la situation militaire. La 201e escadrille est la première formation de volontaires a avoir été formée dans ce but et engagée pendant la bataille de Leyte (la première mission se déroule le 25 octobre 1944). Selon Raymond Lamont-Brown, les pilotes auraient eu différents profils à différents moments de leur implication dans la guerre; des profils qui auraient évolués dans le temps. Dans un premier temps se seraient engagés uniquement des volontaires, patriotes fervents, romantiques et inspirés par l’esprit de la chevalerie japonaise : ce sont eux qui instituent les pratiques et les rituels attribués aux kamikaze (écriture de testaments et de poèmes, port d’attributs patriotiques et faisant référence à l’esprit guerrier japonais, la consommation de la dernière coupe de saké, etc.). Les générations suivantes de volontaires auraient eu des motivations plus « rationnelles » : ces jeunes hommes sont souvent des étudiants dont la formation a été interrompue par la guerre ou plus généralement des individus ayant reçu une excellente éducation (85 % étaient lycéens ou étudiants). La lettre de Sasaki Hachirô ci-dessus témoigne d’une grande maturité, mais aussi et surtout d’une forme de résignation : on se sacrifie par devoir, par nécessité… À l’extrême fin de la guerre, toujours selon Raymond Lamont-Brown, d’autres jeunes pilotes auraient été recrutés parmi les délinquants ou des personnes dont le comportement les mettaient en marge de la société. Il est difficile de prendre pour argent comptant une telle catégorisation, mais il est probable qu’il y ait eu une « dépréciation » de la qualité morales des pilotes (des volontaires éduqués aux exclus de la société) en raison du manque de candidats à la mort… La jeunesse (17 ans pour certains) et le niveau d’éducation élevé des kamikaze montre la volonté consciente ou non des autorités militaires à priver la nation d’un futur… Il témoigne aussi peut-être d’une forte intériorisation des valeurs patriotiques apprises, notamment (mais pas seulement) en milieu scolaire. Pendant la bataille d’Okinawa les pilotes étaient aux commandes de chasseurs de combats ou de bombardiers-torpilles (ohka). Ils ont été engagés dans 10 raids majeurs contre la flotte américaine (6 avril – 2 juin 1945). Sur mer, des navires-torpilles, basés dans l’île de Kerama, n’ont pu être engagés et ont été détruits dans leurs installations par les soldats de la 77e division américaine et le cuirassé Yamato, nous l’avons vu, a été coulé avec 4 destroyers de son escorte.
Enfin, sur terre, l’armée impériale se livre à des attaques nocturnes ayant pour objectif d’engager l’ennemi en limitant les effets ravageurs de sa puissance de feu. On constate pendant la bataille que, comme pendant la Grande Guerre, l’usage d’une puissance de feu considérable ne peut empêcher la confrontation directe et rapprochée des infanteries ennemies. Celle-ci est souvent d’une brutalité multipliée, parce que fondée sur la recherche du corps-à-corps en réponse à la volonté d’annihilation par les armes de destructions massives (exemple des Stosstruppen de la Première Guerre mondiale). Le soldat japonais s’est bâti une solide réputation de combattant résolu autant pour cette raison que pour sa valeur intrinsèque. Toutefois, la détermination des soldats nippons est une composante de la stratégie des armées alliées qui a pris en considération ce « facteur ». Le maréchal William Slim, commandant des forces alliées en Inde aurait déclaré : « Tout le monde parle de se battre jusqu’au dernier homme, mais actuellement seuls les Japonais le font ». Si les « charges banzai » ont eu un impact moral sur les combattants alliés, les moteurs psychologiques de celles-ci sont plus complexes qu’il n’y parait. Dans son ouvrage, Joanna Bourke (4) souligne l’importance de l’action de « tuer ». Sans minorer l’importance des facteurs et effets psychologiques collectifs (camaraderie, propagande, diabolisation de l’ennemi) et individuels, essentiellement la peur de la mort, cette étude apporte un éclairage significatif l’« intimité » de l’homicide en temps de guerre, la mort donnée au contact de l’ennemi. Les représentations de l’acte de tuer, bâtie souvent sur une éducation, une vision romantique de la guerre ou instrumentalisée par la propagande, tiennent une place importante; et bien souvent l’attaque à la baïonnette ou à l’arme blanche, est considérée être la plus virile et prend une dimension mythique (au Japon le « mythe du samurai »), que renforce le « culte de l’offensive » prôné par l’état-major (qui rappelle la doctrine française des premiers mois de la Grande Guerre). L’entraînement et la discipline (très difficiles dans l’armée impériale japonaise) stimulent le sentiment d’agressivité tout en se mariant aux représentations positives (le mythe du guerrier/« nous ») et négatives (dévalorisation de l’ennemi/« eux ») : l’accent est mis sur les comportements instinctifs et les pulsions primales. Ces facteurs « théoriques » prennent une ampleur plus importante avec l’enchaînement des violences et le sentiment de livrer un combat désespéré. Ces facteurs sont des pistes utiles à la compréhension des moteurs psychologiques externes et généraux sous-jacents aux attaques suicides, conduites dans un contexte militaire ayant pour horizon la défaite.

Le suicide individuel ou collectif à la grenade était une pratique de l’armée impériale en campagne, souvent le fait de soldats épuisés, grièvement blessés et d’aucune « utilité » militaire. Le sergent Nishiji Yasumasa, décrit une scène de mort collective dans la jungle birmane :« Il arrivait souvent que les soldats prennent leur propres vies par paires. Ils s’étreignaient et plaçaient une grenade entre eux. Nous appelions cela un suicide double. »
Les officiers supérieurs pratiquaient généralement l’éventration au sabre (exemple sus-mentionné des généraux Ushijima et Chô) ou livraient le dernier combat avec leurs hommes.
Les modes opératoires pourraient être divisés en deux catégories : celui du combattant en pleine potentialité (et correspondant aux normes admises par le groupe) et les autres. Les premiers se donnent la mort avec « noblesse » (seppuku, suicide des pilotes kamikaze) ou au combat avec des armes nobles et viriles (arme blanche, baïonnette); un combat visant au corps-à-corps. Concernant les pilotes d’avion, il pourrait s’agir ici d’une importation des valeurs martiales occidentales qui assimile le combat aérien à un duel chevaleresque (constatations de Joanna Bourke). Que se soit l’arme blanche ou les commandes d’un avion, l’« arme » (avion, sabre, baïonnette) est un prolongement de la main de l’homme : la mort est donnée par la volonté et l’aptitude du combattant à tuer. Il s’agit d’un acte jugé authentique. Les armes de projection (fusils, fusils-mitrailleurs, mitrailleuses, etc.) ou projetées (grenade à main) sont moins valorisantes (parce que utilisées à distance par un tireur susceptible d’atteindre sa cible à l’insu de celle-ci), c’est pourquoi, elles sont utilisées par les combattants ne se trouvant plus en mesure de se battre. Il y a peut-être, au regard de ces constatations, une dimension culturelle et symbolique dans ces actes. Une dimension que nous replacerons dans un contexte général, en infra.
Il est surtout intéressant de constater le phénomène de contagion de la pratique et des méthodes suicidaires des militaires aux civils.
… Et, par contagion, les populations civiles
C’est surtout l’implication directe des civils dans la bataille, phénomène majeur de la Seconde Guerre mondiale (et déjà constaté pendant la Grande Guerre) qui marque encore les esprits, même si en cela la bataille d’Okinawa ne constitue pas un précédent : celle de Saipan (15 juin – 9 juillet 1944), la préfigurait déjà. Pourquoi ? Parce que la prise de cette île signifiait le bombardement régulier du sol national… Le général Saito n’a fait aucune distinction entre civils et militaires dans les derniers moments de la bataille (préconisant que les premiers s’arment de lances en bambou) qui s’est conclue par une attaque suicide de grande ampleur. Dans le cas de la bataille de Saipan également, des civils se sont jetés du haut de falaises…
À la différence de la population d’Iwo Jima, qui a été évacuée sur l’ordre du général Kuribayashi, les habitants d’Okinawa ont dû rester sur place et ont été mobilisés pour des travaux de terrassement et comme combattants. D’ailleurs une population aussi nombreuse aurait-elle pu être déplacée, compte tenu de l’état de délabrement de la flotte japonaise, après plus de trois années de guerre dans le Pacifique ?
La population a souffert des excès de militaires (confiscation de nourriture, exécution d’habitants soupçonnés d’espionnage en raison de la différence de leur dialecte) et des conditions sanitaires. Si une frontière perméable exista entre le statut de civil et de combattant (Jean-Louis Margolin les qualifient de « civils militarisés »), c’était autant pour des motifs opérationnels qu’idéologiques (une nation unie contre l’envahisseur) : les habitants de l’île sont des auxiliaires précieux en raison de leur connaissance du terrain, mais aussi, pratique peu honorable, comme chair à canons : si des soldats porteurs d’une charge d’explosif ont pu se faire passer pour des civils pour commettre des attaques suicides, les civils étaient souvent utilisés pour cette mission ou comme boucliers humains pour couvrir une attaque… Sur l’île d’Ie, des femmes armées de lances se sont opposées aux troupes américaines. Ailleurs, des collégiens ont été enrôlés dès l’âge de 13 ans et divisés en escouades, souvent armés de sabres, voire d’explosifs : leur mission dans ce cas était de se précipiter sur les chars américains ou d’aller au contact de l’ennemi. Imamine Yasunabu témoigne : « Il y eut un cas où le groupe avec qui j’étais aperçut 40 ou 50 militaires américains à peu près à 100 mètres. Nous priâmes notre professeur de nous permettre d’ouvrir le feu. À ce moment, nous disposions de fusils. Il refusa, et l’ennemi finit par disparaître sans que nous ayons eu une chance d’agir. Je fus à cette époque stupéfait du comportement du professeur. Maintenant, je le comprends. Il réalisait que le Japon était en train de perdre, et il ne voulait pas sacrifier ses élèves. Nous n’avions que 6 balles chacun. Si nous avions ouvert le feu, les Américains, bien équipés, nous auraient aisément anéantis. »
La similitude des décisions et du comportement des officiers supérieurs à l’endroit des populations civiles à Saipan et à Okinawa laissent supposer la possible existence de directives de l’état-major général à l’endroit des populations civiles (ce qui a été partiellement admis par le ministère de l’ Éducation japonais en 2006), mais il ne fait aucun doute que celles-ci étaient considérées comme des « combattants ».
Enfin, sur ordre de l’armée, les habitants auraient été incités ou contraints de se suicider sur le modèle des militaires. Les suicides se sont produits par vagues, tout au long de la bataille : la première a eu lieue au moment du débarquement, voire dans certains cas, avant celui-ci, par crainte des représailles et des exactions américaines. Les circonstances ont été décrites par l’historien Jean-Louis Margolin : les responsables, civils ou militaires, organisèrent des regroupements communautaires (familles, voisins); les participants après un toast d’adieu se donnaient la mort (une personne dégoupillait une grenade au milieu d’un petit groupe de participants). Des témoins auraient assistés à des scènes d’horreur entre membres d’une même famille : assassinat à l’arme blanche, matraquages à mort, lapidations…
Komine Masao (77 ans en 2007), un survivant des suicides compulsifs de l’île de Tokashiki, raconte (propos recueillis par Kamata Satoshi, le narrateur dans l’extrait qui suit) :« Monsieur Komine m’a montré une grotte d’évacuation [des populations] construite à flanc de colline. Il avait 15 ans au moment de la bataille, et avec l’aide de son jeune frère (qui avait atteint le premier grade [sic]), il l’a creusé pour que sa famille puisse y trouver refuge. La cavité était large de 3 mètres et profonde de 10 mètres. À l’intérieur, Masao, sa grand-mère , tantes et autres parents y ont trouvé refuge des attaques aériennes et des tirs de l’artillerie de marine, mais le 28 mars, le jour suivant le débarquement américain dans l’île, ils se rendirent à Nishiyama, désigné comme un “ point de rassemblement ”. Ce jour-là, des grenades ont été distribuées aux personnes réunies. Massao et ses parents s’assirent en cercle. Sa mère et sa sœur, qui étaient allées chercher du ravitaillement, à leur retour se joignirent au cercle. Sa mère étreignit ses enfants comme s’ils étaient deux jeunes oisillons. Alors le cercle de chaque famille se resserra, se pressant les uns contre les autres et les grenades détonnèrent. Des explosions assourdissantes se firent écho et les gens crièrent. À cet instant, un feu de mortier américain s’abattit sur eux. Comme il était un enfant, Masao n’a pas reçu de grenade, mais le milicien (“ local defense soldier ” dans le texte, ou bôeitai) près de lui en avait une et elle explosa. Sur le sol gisaient des gens recouverts de sang. Les corps allongés les uns sur les autres. Ce jour-là, 315 personnes moururent sur l’île de Tokashiki, soit le tiers de la population du village de Awaren. Les personnes en familles qui ne parvinrent pas à faire exploser leurs grenades s’entre-tuèrent à la faucille ou au rasoir, en se frappant avec des battes ou des rochers ou s’étranglèrent avec des cordes…Ceux qui encore en vie se pendirent eux-mêmes ».
Dans d’autres cas, les militaires accompagnent en les contraignant peut-être les civils dans la mort, comme en témoigne notamment le récit de Frank Barron, combattant de la 77e division d’infanterie. L’action se déroule à Kerama Retto, le 26 mars 1944 : « Comme nous atteignions le sommet du premier repli de terrain, j’ai réalisé que les fantassins autour de moi étaient pétrifiés. Aussitôt mon attention a été attiré par un groupe de civils. Sur notre droite, sur le rebord du précipice, une jeune femme portant un nourrisson dans ses bras, avec derrière elle, une autre jeune femme, précédée d’un enfant de 2 ou 3 ans. Elles étaient à 30 ou 40 pieds de moi, toutes les deux nous regardant fixement comme de petits animaux apeurés. À cet instant, apparu la tête d’un homme derrière les épaules de la femme (sic). Je n’ai pu seulement voir que sa tête et son cou, mais il avait un collet d’uniforme. Si cet homme a une arme, à savoir une grenade, nous serions réellement en situation périlleuse, à moins que nous n’ouvrions le feu et tuions l’ensemble des individus se trouvant sur cette colline. J’ai fait signe à l’homme de s’approcher de moi, tandis que je me déplaçai de quelques pas pour voir si il avait quelque chose à aux mains. En un instant, ils étaient tous évanouis. Si j’avais fait quelques pas de plus, j’aurais pu voir leurs corps rebondir le long de la paroi jalonnant leur chute. »
Ailleurs, les suicides en masse se firent avec de la mort-au-rat, quand les grenades vinrent à manquer (île de Zamami, en ce lieu 358 civils trouvèrent la mort). Il y eu des cas, où des officiers poussèrent la population au suicide, puis se rendirent aux troupes américaines (îles de Tokashiki et de Zamami).
Cet ensemble de témoignages illustre le contexte d’extrême tension nerveuse dans laquelle se trouvait les habitants. Si il est impossible de connaître les mobiles exacts des personnes à s’entre-tuer ou à commettre l’acte suprême d’autodestruction. Les actes perpétrés par les uns et les autres sont révélateurs d’un contexte : il existe probablement une étude sur ces questions, mais pour saisir ces mécanismes, je renvoie à la lecture du livre d’Alain Corbin (Le village des cannibales), une analyse du massacre d’Hautefaye en 1870.
En définitive, cette tactique délibérée ou non a eu pour effet de raidir l’affrontement : les soldats américains préférant souvent ouvrir le feu, et même sur des enfants, que d’être victimes d’une potentielle attaque suicide.
Okinawa : une « bataille Ragnarök » dans une guerre totale ?
Nous pourrions qualifier l’affrontement d’Okinawa de « bataille Ragnarök », une bataille ultime, eschatologique (nous signalons au passage que cette dimension n’apparaît pas dans la mythologie japonaise). Pourquoi ?
Tout d’abord parce qu’elle se déroule sur le sol national, comme à Iwo Jima. Il ne s’agit plus d’îles lointaines comme auparavant. Nous sommes dans le contexte des bombardements de Tôkyô, celui de la nuit du 9 au 10 mars (20 jours avant l’attaque générale sur Okinawa), surpasse en victimes et en intensité celui de Dresde (100 000 victimes de bombes incendiaires lancées de manière à provoquer un maximum de dégâts sur la population et leurs habitations, 30 km2 de surface urbaines ont été détruits). En cette fin de conflit (commencé en 1937), la violence devient quasi-paroxystique et le nombre des pertes humaines augmente sensiblement (186 000 combattants jusqu’en 1941, puis 2 millions, dont 400 000 civils entre 1942 et 1945).
Les officiers supérieurs (et probablement une large partie de la population) ont conscience de livrer une bataille perdue d’avance… Le capitaine Koichi Itoh a déclaré, lorsqu’il a été interrogé sur ces événements plusieurs années après : « Je n’ai jamais envisagé, après le commencement de la guerre, que nous puissions la gagner. Mais après la chute de Saipan, je me suis résolu à admettre que nous l’avions perdue. »
Quelque puisse être le mobile, l’honneur, la défense de la patrie, différer l’invasion américaine, etc., la guerre est perdue et l’on redoute la ire du vainqueur (le sentiment de peur est entretenu par la propagande) et peut-être la fin d’une vision du Japon.
À cela s’ajoute des facteurs internes, tout d’abord le rôle de la propagande. Si cette dernière a pu être intériorisée par les combattants japonais (et en particulier sur les officiers) et peut-être les plus jeunes habitants d’Okinawa, son impact est difficile à déterminer, mais les acteurs ont dû se positionner par rapport à elle. De la lucide méfiance (dans sa lettre Sasaki Hachirô qualifie de « litanies creuses » les discours des « chefs militaires ») à l’adhésion sincère et naïve (dans son journal personnel un jeune habitant d’Okinawa de 16 ans qualifie les Américains de « Bêtes démoniaques », plusieurs passages du texte répète son patriotisme et son attachement au Japon au point de donner sa vie), la palette des motivations a pu varier dans le temps. Les femmes et les enfants qui se donnent la mort « à chaud » dans la bataille n’ont probablement pas suivi le même « raisonnement » qu’un pilote de kamikaze qui « à froid » décide de se porter volontaire pour une mission sans retour.
Ces suicides marquent aussi un refus de la réalité, de la défaite et de ses possibles conséquences. D’autant et bien qu’occulté par l’ampleur du nombre des suicides parmi les civils, il apparaîtrait aujourd’hui que, comme sur le sol français (et à une échelle moins importante que l’armée russe en Allemagne au printemps 1945), des soldats américains aient violé des habitantes de l’île (peut-être 10 000 cas).
Cette bataille (par un phénomène déjà constaté dans d’autres engagements nippo-américains dans le Pacifique et en particulier à Saipan) prend une dimension symbolique : le Japon offre la valeur (et les valeurs traditionnelles) de ses combattants aux moyensimpersonnels et techniques de l’armée américaine… Cette interprétation paraît résulter autant d’une décision pragmatique sur le champ de bataille que d’une interprétation dépréciative sur la combativité du soldat américain. L’exemple des femmes armées de lance (à l’instar des « fédérés » de la Révolution française, mais aussi parce que les armes longues sont généralement l’apanage des femmes au Japon, par exemple le naginata) symbolise l’engagement total d’un peuple (les femmes étant généralement tenues éloignées du métier des armes) pour défendre son sol, teintés de la part de quelques officiers d’une forme de mépris de la vie humaine. La dimension symbolique se retrouve peut-être également dans les suicides de mères et de leurs enfants du haut des falaises d’Itoman, peut-être un répétition involontaire et inconsciente du sacrifice du jeune empereur Antoku, précipité dans les flots par sa grand-mère Nii qui l’accompagne dans la mort lorsque la bataille navale de Dan-no-Ura (1185) a été perdue pour le clan Taira (face aux Minamoto qui instaureront le premier shôgunat).
Si ces facteurs ont motivés les suicides compulsifs (coercition des militaires, propagande et l’éducation données aux jeunes habitants de l’île dans le cadre d’une politique d’assimilation), on recherche aussi échapper à l’ennemi et la mort paraît être le seul refuge, comme pour les défenseurs de Massada… On redoute la culpabilité et l’infamie pour avoir préféré le déshonneur de vivre et d’endosser une partie de la responsabilité de la défaite… On retrouve un écho de cet état d’esprit (notamment dans la littérature et les mangas) dans la jeune génération n’ayant pas pris les armes de l’après-guerre… Les arguments culturels ont été avancés, le code de l’honneur du « bushidô » (en réalité une construction intellectuelle à destination des Occidentaux) notamment… Mais que penser de la lettre de Ichizu Hayashi, pilote de confession chrétienne ? On se rend bien compte qu’il est quasi-impossible de comprendre totalement le phénomène.
En 1944, le Japon était entré, selon l’expression de Maurice Pinguet, dans l’« engrenage du sacrifice » : « Dans la guerre du Pacifique, l’armée japonaise avait mis son existence en jeu, la défaite serait sa mort – ce serait donc aussi la mort du Japon : elle s’identifiait trop étroitement à la nation pour imaginer une autre conclusion. » Cela, je pense, résume bien ce qui s’est déroulé à Okinawa à une échelle ayant atteint quasiment son paroxysme.
Rémy Valat
Notes
1 : L’accord initial prévoyait, selon une source rendue disponible par la marine américaine en 2009, le départ de l’état-major du IIIrd M.E.F. pour Guam. Cette structure est un élément singulier des forces américaines outre-mers : elle est dirigé par un lieutenant-général qui commande les forces américaines sur l’île et sert de coordinateur pour la « zone d’Okinawa ».
2 : Cf. http://japon.aujourdhuilemonde.com/au-japoncontre-les-viols-des-soldats-americains-les-femmes-lancent-un-cri-dalarme
3 : Le 28 août dernier, le ministre de la Défense japonais, Itsunori Onodera et le secrétaire d’État à la Défense nord-américain, Chuck Hagel, ont entamé une discussion en faveur d’une possibilité pour les forces aériennes d’autodéfense japonaise d’effectuer des frappes préventives sur des bases ennemies (c’est-à-dire contre la Corée du Nord).
4 : Joanna Bourke, Intimate Story of Killing. Face-to-Face Killing in Twentieth-Century Warfare, Londres, Granta, 1999. Cette étude aborde aussi la guerre du Pacifique, bien que centrée sur la Première Guerre mondiale.
Bibliographie
• Astor Gerald, Operation Iceberg. The invasion and conquest of Okinawa in World War II, World War II Library, 1995.
• Daily Yomiuri (The), 24 juin et 16 août 2012.
• Kakehashi Kumiko, Lettres d’Iwo Jima. La plus violente bataille du Pacifique racontée par les soldats japonais, Les Arènes, 2011.
• Lamont-Brown Raymond, Kamikaze. Japan’s suicide samurai, Cassell Military Paperbacks, 1997.
• Margolin Jean-Louis, Violences et crimes du Japon en guerre (1937 – 1945), Hachette, Pluriel, 2007.
• Pinguet Maurice, La mort volontaire au Japon, Tel – Gallimard, 1984.
• Rabson Steve, The Politics of Trauma. Compulsory Suicides During the Battle of Okinawa and Postwar Retrospectives, http://intersections.anu.edu.au/issue24/rabson.htm.
• U.S. Army in the World War II. The War in the Pacific. Okinawa The last battle,www.ibiblio.org/hyperwar/USA/USA-P-Okinawa/USA-P-Okinawa.
Concernant les violences et leur dimension psychologiques en temps de guerre, voici quelques pistes de lectures :
— Alain Corbin, Le village des cannibales, Aubier, 1990.
— Christopher R. Browning, Des hommes ordinaires, le 101e bataillon de réserve de police allemande et la solution finale en Pologne, Belles Lettres, 1994, (chapitre « Des hommes ordinaires »).
— Louis Crocq, Les traumatismes de guerre, Odile Jacob, 2006.
— Jacques Sémelin, Purifier et détruire. Usages politiques des massacres et des génocides, Le Seuil, 2003.
— Rémy Valat, Les calots bleus et la bataille de Paris. Une force de police auxiliaire pendant la guerre d’Algérie, Michalon, 2007 (chapitre « Salah est mort ! Les moteurs psychologiques d’une unité en guerre »).
Article printed from Europe Maxima: http://www.europemaxima.com
URL to article: http://www.europemaxima.com/?p=3397
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : japon, asie, histoire, kamikaze, seconde guerre mondiale, okinawa, deuxième guerre mondiale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 09 novembre 2013
Wall Street & the November 1917 Bolshevik Revolution

Wall Street & the November 1917 Bolshevik Revolution
By Kerry Bolton
Ex: http://www.counter-currents.com
My last article [2] documented the funding of the March 1917 Revolution in Russia.[1] The primary financier of the Russian revolutionary movement 1905–1917 was Jacob Schiff, of Kuhn Loeb and Co., New York. In particular Schiff had provided the money for the distribution of revolutionary propaganda among Russians prisoners-of-war in Japan in 1905 by the American journalist George Kennan who, more than any other individual, was responsible for turning American public and official opinion against Czarist Russia. Kennan subsequently related that it was thanks to Schiff that 50,000 Russian soldiers were revolutionized and formed the cadres that laid the basis for the March 1917 Revolution and, we might add–either directly or indirectly–the consequent Bolshevik coup of November. The reaction of bankers from Wall Street and The City towards the overthrow of the Czar was enthusiastic.
This article deals with the funding of the subsequent Bolshevik coup eight months later which, as paradoxical as it might seem to those who know nothing of history other than the orthodox version, was also greeted cordially by banking circles in Wall Street and elsewhere.
Apologists for the bankers and other highly-placed individuals who supported the Bolsheviks from the earliest stages of the communist takeover, either diplomatically or financially, justify the support for this mass application of psychopathology as being motivated by patriotic sentiment, in trying to thwart German influence over the Bolsheviks and to keep Russia in the war against Germany. Because Lenin and his entourage had been able to enter Russia courtesy of the German High Command on the basis that a Bolshevik regime would withdraw Russia from the war, Wall Street capitalists explained that their patronage of the Bolsheviks was motivated by the highest ideals of pro-Allied sentiment. Hence, William Boyce Thompson in particular stated that by funding Bolshevik propaganda for distribution in Germany and Austria this would undermine the war effort of those countries, while his assistance to the Bolsheviks in Russia was designed to swing them in favor of the Allies.
These protestations of patriotic motivations ring hollow. International banking is precisely what it is called–international, or globalist as such forms of capitalism are now called. Not only have these banking forms and other forms of big business had overlapping directorships and investments for generations, but they are often related through intermarriage. While Max Warburg of the Warburg banking house in Germany advised the Kaiser and while the German Government arranged for funding and safe passage of Lenin and his entourage from Switzerland across Germany to Russia;[2] his brother Paul,[3] a partner of Jacob Schiff’s at Wall Street, looked after the family interests in New York. The primary factor that was behind the bankers’ support for the Bolsheviks whether from London,[4] New York, Stockholm,[5] or Berlin, was to open up the underdeveloped resources of Russia to the world market, just as in our own day George Soros, the money speculator, funds the so-called “color revolutions” to bring about “regime change” that facilitates the opening up of resources to global exploitation. Hence there can no longer be any doubt that international capital a plays a major role in fomenting revolutions, because Soros plays the well-known modern-day equivalent of Jacob Schiff.
Recognition of Bolsheviks Pushed by Bankers
This aim of international finance, whether centered in Germany, England or the USA, to open up Russia to capitalist exploitation by supporting the Bolsheviks, was widely commented on at the time by a diversity of well-informed sources, including Allied intelligence agencies, and of particular interest by two very different individuals, Henry Wickham Steed, editor of The London Times, and Samuel Gompers, head of the American Federation of Labor.
On May 1, 1922 The New York Times reported that Gompers, reacting to negotiations at the international economic conference at Genoa, declared that a group of “predatory international financiers” were working for the recognition of the Bolshevik regime for the opening up of resources for exploitation. Despite the rhetoric by New York and London bankers during the war that a Russian revolution would serve the Allied cause, Gompers opined that this was an “Anglo-American-German banking group,” and that they were “international bankers” who did not adhere to any national allegiance. He also noted that prominent Americans who had a history of anti-labor attitudes were advocating recognition of the Bolshevik regime.[6]
What Gompers claimed, was similarly expressed by Henry Wickham Steed of The London Times, based on his observations. In a first-hand account of the Paris Peace Conference of 1919, Steed stated that proceedings were interrupted by the return from Moscow of William C. Bullitt and Lincoln Steffens, “who had been sent to Russia towards the middle of February by Colonel House and Mr. Lansing, for the purpose of studying conditions, political and economic, therein for the benefit of the American Commissioners plenipotentiary to negotiate peace.”[7] Steed also refers to British Prime Minister Lloyd George as being likely to have known of the Mission and its purpose. Steed stated that international finance was behind the move for recognition of the Bolshevik regime and other moves in favor of the Bolsheviks, and specifically identified Jacob Schiff of Kuhn, Loeb & Co., New York, as one of the principal bankers “eager to secure recognition”:
Potent international financial interests were at work in favor of the immediate recognition of the Bolshevists. Those influences had been largely responsible for the Anglo-American proposal in January to call Bolshevist representatives to Paris at the beginning of the Peace Conference—a proposal which had failed after having been transformed into a suggestion for a Conference with the Bolshevists at Prinkipo. . . . The well-known American Jewish banker, Mr. Jacob Schiff, was known to be anxious to secure recognition for the Bolshevists . . .[8]
In return for diplomatic recognition, Tchitcherin, the Bolshevist Commissary for Foreign Affairs, was offering “extensive commercial and economic concessions.”
Wickham Steed with the support of The Times’ proprietor, Lord Northcliffe, exposed the machinations of international finance to obtain the recognition of the Bolshevik regime, which still had a very uncertain future.
Steed related that he was called upon by US President Wilson’s primary adviser, Edward Mandel House, who was concerned at Steed’s exposé of the relationship between Bolshevists and international financers:
That day Colonel House asked me to call upon him. I found him worried both by my criticism of any recognition of the Bolshevists and by the certainty, which he had not previously realized, that if the President were to recognize the Bolshevists in return for commercial concessions his whole “idealism” would be hopelessly compromised as commercialism in disguise. I pointed out to him that not only would Wilson be utterly discredited but that the League of Nations would go by the board, because all the small peoples and many of the big peoples of Europe would be unable to resist the Bolshevism which Wilson would have accredited.[9]
Steed stated to House that it was Jacob Schiff, Warburg and other bankers who were behind the diplomatic moves in favor of the Bolsheviks:
I insisted that, unknown to him, the prime movers were Jacob Schiff, Warburg, and other international financiers, who wished above all to bolster up the Jewish Bolshevists in order to secure a field for German and Jewish exploitation of Russia.[10]
Steed here indicates an uncharacteristic naïveté in thinking that House would not have known of the plans of Schiff, Warburg, et al. House was throughout his career close to these bankers and was involved with them in setting up a war-time think tank called The Inquiry, and following the war the creation of the Council on Foreign Relations, in order to shape an internationalist post-war foreign policy. It was Schiff and Paul Warburg and other Wall Street bankers who called on House in 1913 to get House’s support for the creation of the Federal Reserve Bank.[11]
House in Machiavellian manner asked Steed to compromise; to support humanitarian aid supposedly for the benefit of all Russians. Steed agreed to consider this, but soon after talking with House found out that British Prime Minister Lloyd George and Wilson were to proceed with recognition the following day. Steed therefore wrote the leading article for the Paris Daily Mail of March 28th, exposing the maneuvers and asking how a pro-Bolshevik attitude was consistent with Pres. Wilson’s declared moral principles for the post-war world?
. . . Who are the tempters that would dare whisper into the ears of the Allied and Associated Governments? They are not far removed from the men who preached peace with profitable dishonour to the British people in July, 1914. They are akin to, if not identical with, the men who sent Trotsky and some scores of associate desperadoes to ruin the Russian Revolution as a democratic, anti-German force in the spring of 1917.[12]
Here Steed does not seem to have been aware that some of the same bankers who were supporting the Bolsheviks had also supported the March Revolution.
Charles Crane,[13] who had recently talked with President Wilson, told Steed that Wilson was about to recognize the Bolsheviks, which would result in a negative public opinion in the USA and destroy Wilson’s post-War internationalist aims. Significantly Crane also identified the pro-Bolshevik faction as being that of Big Business, stating to Steed: “Our people at home will certainly not stand for the recognition of the Bolshevists at the bidding of Wall Street.” Steed was again seen by House, who stated that Steed’s article in the Paris Daily Mail, “had got under the President’s hide.” House asked that Steed postpone further exposés in the press, and again raised the prospect of recognition based on humanitarian aid. Lloyd George was also greatly perturbed by Steed’s articles in the Daily Mail and complained that he could not undertake a “sensible” policy towards the Bolsheviks while the press had an anti-Bolshevik attitude.[14]
Thompson and the American Red Cross Mission
As mentioned, House attempted to persuade Steed on the idea of relations with Bolshevik Russia ostensibly for the purpose of humanitarian aid for the Russian people. This had already been undertaken just after the Bolshevik Revolution, when the regime was far from certain, under the guise of the American Red Cross Mission. Col. William Boyce Thompson, a director of the NY Federal Reserve Bank, organized and largely funded the Mission, with other funding coming from International Harvester, which gave $200,000. The so-called Red Cross Mission was largely comprised of business personnel, and was according to Thompson’s assistant, Cornelius Kelleher, “nothing but a mask” for business interests.[15] Of the 24 members, five were doctors and two were medical researchers. The rest were lawyers and businessmen associated with Wall Street. Dr. Billings nominally headed the Mission.[16] Prof. Antony Sutton of the Hoover Institute stated that the Mission provided assistance for revolutionaries:
We know from the files of the U.S. embassy in Petrograd that the U.S. Red Cross gave 4,000 rubles to Prince Lvoff, president of the Council of Ministers, for “relief of revolutionists” and 10,000 rubles in two payments to Kerensky for “relief of political refugees.”[17]
The original intention of the Mission, hastily organized by Thompson in light of revolutionary events, was ‘”nothing less than to shore up the Provisional regime,” according to the historian William Harlane Hale, formerly of the United States Foreign Service.[18] The support for the social revolutionaries indicates that the same bankers who backed the Kerensky regime and the March Revolution also supported the Bolsheviks, and it seems reasonable to opine that these financiers considered Kerensky a mere prelude for the Bolshevik coup, as the following indicates.
Thompson set himself up in royal manner in Petrograd reporting directly to Pres. Wilson and bypassing US Ambassador Francis. Thompson provided funds from his own money, first to the Social Revolutionaries, to whom he gave one million rubles,[19] and shortly after $1,000,000 to the Bolsheviks to spread their propaganda to Germany and Austria.[20] Thompson met Thomas Lamont of J. P. Morgan Co. in London to persuade the British War Cabinet to drop its anti-Bolshevik policy. On his return to the USA Thompson undertook a tour advocating US recognition of the Bolsheviks.[21] Thompson’s deputy Raymond Robbins had been pressing for recognition of the Bolsheviks, and Thompson agreed that the Kerensky regime was doomed and consequently “sped to Washington to try and swing the Administration onto a new policy track,” meeting resistance from Wilson, who was being pressure by Ambassador Francis.[22]
The “Bolshevik of Wall Street”
Such was Thompson’s enthusiasm for Bolshevism that he was nicknamed “the Bolshevik of Wall Street” by his fellow plutocrats. Thompson gave a lengthy interview with The New York Times just after his four month tour with the American Red Cross Mission, lauding the Bolsheviks and assuring the American public that the Bolsheviks were not about to make a separate peace with Germany.[23] The article is an interesting indication of how Wall Street viewed their supposedly “deadly enemies,” the Bolsheviks, at a time when their position was very precarious. Thompson stated that while the “reactionaries,” if they assumed power, might seek peace with Germany, the Bolsheviki would not. “His opinion is that Russia needs America, that America must stand by Russia,” stated the Times. Thompson is quoted: “The Bolsheviki peace aims are the same as those of the Untied States.” Thompson alluded to Wilson’s speech to the United States Congress on Russia as “a wonderful meeting of the situation,” but that the American public “know very little about the Bolsheviki.” The Times stated:
Colonel Thompson is a banker and a capitalist, and he has large manufacturing interests. He is not a sentimentalist nor a “radical.” But he has come back from his official visit to Russia in absolute sympathy with the Russian democracy as represented by the Bolsheviki at present.
Hence at this time Thompson was trying to sell the Bolsheviks as “democrats,” implying that they were part of the same movement as the Kerensky regime that they had overthrown. While Thompson did not consider Bolshevism the final form of government, he did see it as the most promising step towards a “representative government” and that it was the “duty” of the USA to “sympathize” with and “aid” Russia “through her days of crisis.” He stated that in reply to surprise at his pro-Bolshevik sentiments he did not mind being called “red” if that meant sympathy for 170,000,000 people “struggling for liberty and fair living.” Thompson also saw that while the Bolsheviki had entered a “truce” with Germany, they were also spreading Bolshevik doctrines among the German people, which Thompson called “their ideals of freedom” and their “propaganda of democracy.” Thompson lauded the Bolshevik Government as being the equivalent to America’s democracy, stating:
The present government in Russia is a government of workingmen. It is a Government by the majority, and, because our Government is a government of the majority, I don’t see how it can fail to support the Government of Russia.
Thompson saw the prospects of the Bolshevik Government being transformed as it incorporated a more Centrist position and included employers. If Bolshevism did not proceed thus, then “God help the world,” warned Thompson. Given that this was a time when Lenin and Trotsky held sway over the regime, subsequently to become the most enthusiastic advocates of opening Russia up to foreign capital (New Economic Policy) prospects seemed good for a joint Capitalist-Bolshevik venture with no indication that an upstart named Stalin would throw a spanner in the works.
The Times article ends: “At home in New York, the Colonel has received the good-natured title of ‘the Bolshevik of Wall Street.’”[24] It was against this background that it can now be understood why labor leader Samuel Gompers denounced Bolshevism as a tool of “predatory international finance,” while arch-capitalist Thompson lauded it as “a government of working men.”
The Council on Foreign Relations Report
The Council on Foreign Relations (CFR) had been established in 1921 by President Wilson’s chief adviser Edward Mandel House out of a previous think tank called The Inquiry, formed in 1917–1918 to advise President Wilson on the Paris Peace Conference of 1919. It was this conference about which Steed had detailed his observations when he stated that there were financial interests trying to secure the recognition of the Bolsheviks.[25]
Peter Grose in his semi-official history of the CFR writes of it as a think tank combining academe and big business that had emerged from The Inquiry group.[26] Therefore the CFR report on Soviet Russia at this early period is instructive as to the relationship that influential sections of the US Establishment wished to pursue in regard to the Bolshevik regime. Grosse writes of this period:
Awkward in the records of The Inquiry had been the absence of a single study or background paper on the subject of Bolshevism. Perhaps this was simply beyond the academic imagination of the times. Not until early 1923 could the Council summon the expertise to mobilize a systematic examination of the Bolshevik regime, finally entrenched after civil war in Russia. The impetus for this first study was Lenin’s New Economic Policy, which appeared to open the struggling Bolshevik economy to foreign investment. Half the Council’s study group were members drawn from firms that had done business in pre-revolutionary Russia, and the discussions about the Soviet future were intense. The concluding report dismissed “hysterical” fears that the revolution would spill outside Russia’s borders into central Europe or, worse, that the heady new revolutionaries would ally with nationalistic Muslims in the Middle East to evict European imperialism. The Bolsheviks were on their way to “sanity and sound business practices,” the Council study group concluded, but the welcome to foreign concessionaires would likely be short-lived. Thus, the Council experts recommended in March 1923 that American businessmen get into Russia while Lenin’s invitation held good, make money on their investments, and then get out as quickly as possible. A few heeded the advice; not for seven decades would a similar opportunity arise.[27]
However, financial interests had already moved into Soviet Russia from the beginning of the Bolshevik regime.
The Vanderlip Concession
H. G. Wells, historian, novelist, and Fabian-socialist, observed first-hand the relationship between Communism and big business when he had visited Bolshevik Russia. Travelling to Russia in 1920 where he interviewed Lenin and other Bolshevik leaders, Wells hoped that the Western Powers and in particular the USA would come to the Soviets’ aid. Wells also met there “Mr. Vanderlip” who was negotiating business contracts with the Soviets. Wells commented of the situation he would like to see developing, and as a self-described “collectivist” made a telling observation on the relationship between Communism and “Big Business”:
The only Power capable of playing this role of eleventh-hour helper to Russia single-handed is the United States of America. That is why I find the adventure of the enterprising and imaginative Mr. Vanderlip very significant. I doubt the conclusiveness of his negotiations; they are probably only the opening phase of a discussion of the Russian problem upon a new basis that may lead it at last to a comprehensive world treatment of this situation. Other Powers than the United States will, in the present phase of world-exhaustion, need to combine before they can be of any effective use to Russia. Big business is by no means antipathetic to Communism. The larger big business grows the more it approximates to Collectivism. It is the upper road of the few instead of the lower road of the masses to Collectivism.[28]
In addressing concerns that were being expressed among Bolshevik Party “activists” at a meeting of the Moscow Organization of the party, Lenin sought to reassure them that the Government was not selling out to foreign capitalism, but that, in view of what Lenin believed to be an inevitable war between the USA and Japan, a US interest in Kamchatka would be favorable to Soviet Russia as a defensive position against Japan. Such strategic considerations on the part of the US, it might be added, were also more relevant to US and other forms of so-called “intervention” during the Russian Civil War between the Red and the White Armies, than any desire to help the Whites overturn the Bolsheviks, let alone restore Czarism. Lenin said of Vanderlip to the Bolshevik cadres:
We must take advantage of the situation that has arisen. That is the whole purpose of the Kamchatka concessions. We have had a visit from Vanderlip, a distant relative of the well-known multimillionaire, if he is to he believed; but since our intelligence service, although splendidly organized, unfortunately does not yet extend to the United States of America, we have not yet established the exact kinship of these Vanderlips. Some even say there is no kinship at all. I do not presume to judge: my knowledge is confined to having read a book by Vanderlip, not the one that was in our country and is said to be such a very important person that he has been received with all the honors by kings and ministers—from which one must infer that his pocket is very well lined indeed. He spoke to them in the way people discuss matters at meetings such as ours, for instance, and told then in the calmest tones how Europe should be restored. If ministers spoke to him with so much respect, it must mean that Vanderlip is in touch with the multimillionaires.[29]
Of the meeting with Vanderlip, Lenin indicated that it was based on a secret diplomacy that was being denied by the US Administration, while Vandrelip returned to the USA, like other capitalists such as Thompson, praising the Bolsheviks. Lenin continued:
. . . I expressed the hope that friendly relations between the two states would be a basis not only for the granting of a concession, but also for the normal development of reciprocal economic assistance. It all went off in that kind of vein. Then telegrams came telling what Vanderlip had said on arriving home from abroad. Vanderlip had compared Lenin with Washington and Lincoln. Vanderlip had asked for my autographed portrait. I had declined, because when you present a portrait you write, “To Comrade So-and-so,” and I could not write, “To Comrade Vanderlip.” Neither was it possible to write: “To the Vanderlip we are signing a concession with” because that concession agreement would be concluded by the Administration when it took office. I did not know what to write. It would have been illogical to give my photograph to an out-and-out imperialist. Yet these were the kind of telegrams that arrived; this affair has clearly played a certain part in imperialist politics. When the news of the Vanderlip concessions came out, Harding—the man who has been elected President, but who will take office only next March—issued an official denial, declaring that he knew nothing about it, had no dealings with the Bolsheviks, and had heard nothing about any concessions. That was during the elections, and, for all we know, to confess, during elections, that you have dealings with the Bolsheviks may cost you votes. That was why he issued an official denial. He had this report sent to all the newspapers that are hostile to the Bolsheviks and are on the pay roll of the imperialist parties . . .[30]
This mysterious Vanderlip was in fact Washington Vanderlip who had, according to Armand Hammer, come to Russia in 1919, although even Hammer does not seem to have known much of the matter.[31] Lenin’s rationalizations in trying to justify concessions to foreign capitalists to the “Moscow activists” in 1920 seem disingenuous and less than forthcoming. Washington Vanderlip was an engineer whose negotiations with Russia drew considerable attention in the USA. The New York Times wrote that Vanderlip, speaking from Russia, denied reports of Lenin’s speech to “Moscow activists” that the concessions would serve Bolshevik geopolitical interests, with Vanderlip declaring that he had established a common frontier between the USA and Russia and that trade relations must be immediately restored.[32] The New York Times reporting in 1922: “The exploration of Kamchatka for oil as soon as trade relations between this country and Russia are established was assured today when the Standard Oil Company of California purchased one-quarter of the stock in the Vanderlip syndicate.” This gave Standard Oil exclusive leases on any syndicate lands on which oil was found. The Vanderlip syndicate comprised sixty-four units. The Standard Oil Company has just purchased sixteen units. However, the Vanderlip concessions could not come into effect until Soviet Russia was recognized by the USA.[33]
The Vanderlip syndicate holds concessions for the exploitation of coal, oil, and timber lands, fisheries, etc., east of the 160th parallel in Kamchatka. The Russian Government granted the syndicate alternate sections of land there and will draw royalties amounting to approximately 5 percent on all products developed and marketed by the syndicate.[34]
It is little wonder then that US capitalists were eager to see the recognition of the Soviet regime.
Bolshevik Bankers
In 1922 Soviet Russia’s first international bank was created, Ruskombank, headed by Olof Aschberg of the Nye Banken, Stockholm, Sweden. The predominant capital represented in the bank was British. The foreign director of Ruskombank was Max May, vice president of the Guaranty Trust Company.[35] Similarly to “the Bolshevik of Wall Street,” William Boyce Thompson, Aschberg was known as the “Bolshevik banker” for his close involvement with banking interests that had channeled funds to the Bolsheviks.
Guaranty Trust Company became intimately involved with Soviet economic transactions. A Scotland Yard Intelligence Report stated as early as 1919 the connection between Guaranty Trust and Ludwig C. A. K. Martens, head of the Soviet Bureau in New York when the bureau was established that year.[36] When representatives of the Lusk Committee investigating Bolshevik activities in the USA raided the Soviet Bureau offices on May 7, 1919, files of communications with almost a thousand firms were found. Basil H. Thompson of Scotland Yard in a special report stated that despite denials, there was evidence in the seized files that the Soviet Bureau was being funded by Guaranty Trust Company.[37] The significance of the Guaranty Trust Company was that it was part of the J. P. Morgan economic empire, which Dr. Sutton shows in his study to have been a major player in economic relations with Soviet Russia from its early days. It was also J. P. Morgan interests that predominated in the formation of a consortium, the American International Corporation (AIC), which was another source eager to secure the recognition of the still embryonic Soviet state. Interests represented in the directorship of the American International Corporation (AIC) included: National City Bank; General Electric; Du Pont; Kuhn, Loeb and Co.; Rockefeller; Federal Reserve Bank of New York; Ingersoll-Rand; Hanover National Bank, etc.[38]
The AIC’s representative in Russia at the time of the revolutionary tumult was its executive secretary William Franklin Sands, who was asked by US Secretary of State Robert Lansing for a report on the situation and what the US response should be. Sands’ attitude toward the Bolsheviks was, like that of Thompson, enthusiastic. Sands wrote a memorandum to Lansing in January 1918, at a time when the Bolshevik hold was still far from sure, that there had already been too much of a delay by the USA in recognizing the Bolshevik regime such as it existed. The USA had to make up for “lost time,” and like Thompson, Sands considered the Bolshevik Revolution to be analogous to the American Revolution.[39] In July 1918 Sands wrote to US Treasury Secretary McAdoo that a commission should be established by private interests with government backing, to provide “economic assistance to Russia.”[40]
Armand Hammer
One of those closely associated with Ludwig Martens and the Soviet Bureau was Dr. Julius Hammer, an emigrant from Russia who was a founder of the Communist Party USA. There is evidence that Julius Hammer was the host to Leon Trotsky when the latter with his family arrived in New York in 1917, and that it was Dr. Hammer’s chauffeured car that provided transport to Natalia and the Trotsky children. The Trotskys were met on disembarkation at the New York dock by Arthur Concors, a director of the Hebrew Sheltering and Immigrant Aid Society, whose advisory board included Jacob Schiff of Kuhn, Loeb and Co.[41] Dr. Hammer was the “primary owner of Allied Drug and Chemical Co.,” and “one of those not so rare creatures, a radical Marxist turned wealthy entrepreneur,” who lived an opulent lifestyle, according to Professor Spence.[42] Another financier linked to Trotsky was his own uncle, banker Abram Zhivotovskii, who was associated with numerous financial interests including those of Olof Aschberg.[43]
The intimate association of the Hammer family with Soviet Russia was to be maintained from start to finish, with an interlude of withdrawal during the Stalinist period. Julius’ son Armand, chairman of Occidental Petroleum Corporation, was the first foreigner to obtain commercial concessions from the Soviet Government. Armand was in Russia in 1921 to arrange for the reintroduction of capitalism according to the new economic course set by Lenin, the New Economic Policy. Lenin stated to Hammer that the economies of Russia and the USA were complementary, and in exchange for the exploitation of Russia’s raw materials he hoped for America’s technology.[44] This was precisely the attitude of significant business interests in the West. Lenin stated to Hammer that it was hoped the New Economic Policy would accelerate the economic process “by a system of industrial and commercial concessions to foreigners. It will give great opportunities to the United States.”[45]
Hammer met Trotsky, who asked him whether “financial circles” in the USA regard Russia as a desirable field of investment? Trotsky continued:
Inasmuch as Russia had its Revolution, capital was really safer there than anywhere else because, “whatever should happen abroad, the Soviet would adhere to any agreements it might make. Suppose one of your Americans invest money in Russia. When the Revolution comes to America, his property will of course be nationalized, but his agreement with us will hold good and he will thus be in a much more favorable position than the rest of his fellow capitalists.[46]
The manner by which Russia fundamentally changed direction, resulting eventually in the Cold War when Stalin refused to continue the wartime alliance for the purposes of establishing a World State via the United Nations Organization, traces its origins back to the divergence of opinion, among many other issues, between Trotsky and Stalin in regard to the role of foreign investment in the Soviet Union.[47] The CFR report had been prescient in warning big business to get into Russia immediately lest the situation changed radically.
Regimented Labor
But for the moment, with Trotsky entrenched as the warlord of Bolshevism, and Lenin favorable towards international capital investment, events in Russia seemed to be promising. A further major factor in the enthusiasm certain capitalist interests had for the Bolsheviks was the regimentation of labor under the so-called “dictatorship of the proletariat.” The workers’ state provided foreign capitalists with a controlled workforce. Trotsky had stated:
The militarization of labor is the indispensable basic method for the organization of our labor forces. . . . Is it true that compulsory labor is always unproductive? . . . This is the most wretched and miserable liberal prejudice: chattel slavery too was productive. . . . Compulsory slave labor was in its time a progressive phenomenon. Labor obligatory for the whole country, compulsory for every worker, is the basis of socialism. . . . Wages must not be viewed from the angle of securing the personal existence of the individual worker [but should] measure the conscientiousness, and efficiency of the work of every laborer.[48]
Hammer related of his experiences in the young Soviet state that although lengthy negotiations had to be undertaken with each of the trades unions involved in an enterprise, “the great power and influence of the trade unions was not without its advantages to the employer of labor in Russia. Once the employer had signed a collective agreement with the union branch there was little risk of strikes or similar trouble.”
Breaches of the codes as negotiated could result in dismissal, with recourse by the sacked worker to a labor court which, in Hammer’s experience, did not generally find in the worker’s favor, which would mean that there would be little chance of the sacked worker getting another job.[49]
However, Trotsky’s insane run in the Soviet Union was short-lived. As for Hammer, despite his greatly expanding and diverse businesses in the Soviet Union, after Stalin assumed power Hammer packed up and left, not returning until Stalin’s demise. Hammer opined decades later:
I never met Stalin—I never had any desire to do so—and I never had any dealings with him. However it was perfectly clear to me in 1930 that Stalin was not a man with whom you could do business. Stalin believed that the state was capable of running everything without the support of foreign concessionaires and private enterprise. That is the main reason I left Moscow. I could see that I would soon be unable to do business there and, since business was my sole reason to be there, my time was up.[50]
Foreign capital did nonetheless continue to do business with the USSR[51] as best as it was able, but the promising start that capitalists saw in the March and November revolutions for a new Russia that would replace the antiquated Czarist system with a modern economy from which they could reap the rewards was, as the 1923 CFR report warned, short-lived. Gorbachev and Yeltsin provided a brief interregnum of hope for foreign capital, to be disappointed again with the rise of Putin and a revival of nationalism and opposition to the oligarchs. The policy of continuing economic relations with the USSR even during the era of the Cold War was promoted as a strategy in the immediate aftermath of World War II when a CFR report by George S Franklin recommended attempting to work with the USSR as much as possible, “unless and until it becomes entirely evident that the U.S.S.R. is not interested in achieving cooperation . . .”
The United States must be powerful not only politically and economically, but also militarily. We cannot afford to dissipate our military strength unless Russia is willing concurrently to decrease hers. On this we lay great emphasis.
We must take every opportunity to work with the Soviets now, when their power is still far inferior to ours, and hope that we can establish our cooperation on a firmer basis for the not so distant future when they will have completed their reconstruction and greatly increased their strength. . . . The policy we advocate is one of firmness coupled with moderation and patience.[52]
Since Putin, the CFR again sees Russia as having taken a “wrong direction.” The current recommendation is for “selective cooperation” rather than “partnership, which is not now feasible.”[53]
The Revolutionary Nature of Capital
Should the fact that international capital viewed the March and even the November Revolutions with optimism be seen as an anomaly of history? Oswald Spengler was one of the first historians to expose the connections between capital and revolution. In The Decline of the West he called socialism “capitalistic” because it does not aim to replace money-based values, “but to possess them.” H. G. Wells, it will be recalled, said something similar. Spengler stated of socialism that it is “nothing but a trusty henchman of Big Capital, which knows perfectly well how to make use of it.” He elaborated in a footnote, seeing the connections going back to antiquity:
Herein lies the secret of why all radical (i.e. poor) parties necessarily become the tools of the money-powers, the Equites, the Bourse. Theoretically their enemy is capital, but practically they attack, not the Bourse, but Tradition on behalf of the Bourse. This is as true today as it was for the Gracchuan age, and in all countries . . .[54]
It was the Equites, the big-money party, which made Tiberius Gracchu’s popular movement possible at all; and as soon as that part of the reforms that was advantageous to themselves had been successfully legalized, they withdrew and the movement collapsed.[55]
From the Gracchuan Age to the Cromwellian and the French Revolutions, to Soros’ “color revolutions” of today, the Russian Revolutions were neither the first nor the last of political upheavals to serve the interests of Money Power in the name of “the people.”
Notes
[1] K. R. Bolton, “March 1917: Wall Street & the March 1917 Russian Revolution,” Ab Aeterno, No. 2 (March 2010).
[2] Michael Pearson, The Sealed Train: Journey to Revolution: Lenin–1917 (London: Macmillan, 1975).
[3] Paul Warburg, prior to immigrating to the USA, had been decorated by the Kaiser in 1912.
[4] Col. William Wiseman, head of the British Secret Service, was the British equivalent to America’s key presidential adviser, Edward House, with whom he was in constant communication. Wiseman became a partner in Kuhn, Loeb & Co. From London on May 1, 1918 Wiseman cabled House that the Allies should intervene at the invitation of the Bolsheviks and help organize the Bolshevik army then fighting the White Armies in a bloody Civil War at a time when the Bolshevik hold on Russia was doubtful (Edward M. House, ed. Charles Seymour, The Intimate Papers of Col. House [New York: Houghton, Mifflin Co., 1926], Vol. III, p. 421).
[5] Olof Aschberg of the Nye Banken, Stockholm, the so-called “Bolshevik banker” who became head of the first Soviet international bank, Ruskombank, channeled funds to the Bolsheviks. On September 6, 1948 The London Evening Star commented on Aschberg’s visit to Swiss bankers that he had “advanced large sums to Lenin and Trotsky in 1917. At the time of the revolution Mr. Aschberg gave Trotsky money to form and equip the first unit of the Red Army.”
[6] Samuel Gompers, “Soviet Bribe fund Here Says Gompers, Has Proof That Offers Have Been Made, He Declares, Opposing Recognition. Propaganda Drive. Charges Strong Group of Bankers With Readiness to Accept Lenin’s Betrayal of Russia,” The New York Times, May 1, 1922. Online at Times’ archives: http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=9E00E3D81739EF3ABC4953DFB3668389639EDE [3]
[7] Henry Wickham Steed, “Through Thirty Years 1892–1922 A personal narrative,” The Peace Conference, The Bullitt Mission, Vol. II. (New York: Doubleday Page and Co., 1924), p. 301.
[8] Ibid.
[9] Ibid.
[10] Ibid.
[11] Charles Seymour, 165–66. House was assigned by Wilson to draw up the constitution for the League of Nations, and in 1918 formed a think tank at Wilson’s request, called The Inquiry, to advise on post-war policy, which became the Council on Foreign Relations. House was the US chief negotiator at the Peace Conference in Paris, 1919–1920.
[12] Henry Wickham Steed, “Peace with Honor,” Paris Daily Mail, 28 March 1922; quoted in Steed (1924).
[13] Crane was a member of a 1917 Special Diplomatic Mission to Russia, and a member of the American Section of the Paris Peace Conference in 1919.
[14] H. W. Steed, 1924, op. cit.
[15] Antony Sutton, Wall Street and the Bolshevik Revolution (New York: Arlington House Publishers, 1974), p. 71.
[16] Ibid., p. 75.
[17] Ibid., p. 73.
[18] William Harlan Hale, “When the Red Storm Broke,” America and Russia: A Century and a Half of Dramatic Encounters, ed. Oliver Jensen (New York: Simon and Schuster, 1962), p. 150.
[19] Ibid., p.151.
[20] “Gives Bolsheviki a Million,” Washington Post, 2 February 1918, cited by Sutton, ibid., pp. 82–83.
[21] A. Sutton, op.cit., p. 8.
[22] W. Harlan Hale, op.cit., p. 151.
[23] Trotsky while still in the USA had made similar claims. “People War Weary. But Leo Trotsky Says They Do Not Want Separate Peace,” New York Times, March 16, 1917. This was why he became the focus of British intelligence efforts via R. H. Bruce Lockhart, special agent to the British War Cabinet in Russia.
[24] “Bolsheviki Will Not Make Separate Peace: Only Those Who Made Up Privileged Classes Under Czar Would Do So, Says Col. W. B. Thompson, Just Back From Red Cross Mission,” New York Times, January 27, 1918.
[25] Robert S. Rifkind, ‘”The Wasted Mission,” America and Russia, op. cit., p. 180.
[26] Peter Grose, Continuing The Inquiry: The Council on Foreign Relations from 1921 to 1996 (New York: Council on Foreign Relations, 2006). The entire book can be read online at: Council on Foreign Relations: http://www.cfr.org/about/history/cfr/index.html [4] (Accessed on February 27, 2010).
[27] Ibid. Chapter: “Basic Assumptions.”
[28] H. G. Wells, Russia in the Shadows, Chapter VII, “The Envoy.” Wells went to Russia in September 1920 at the invitation of Kamenev, of the Russian Trade Delegation in London, one of the leaders of the Bolshevik regime. Russia in the Shadows appeared as a series of articles in The Sunday Express. The whole book can be read online at: gutenberg.net.au/ebooks06/0602371h.html [5]
[29] V. I. Lenin, December 6, 1920, Collected Works, 4th English Edition (Moscow: Progress Publishers, 1965), Volume 31, 438–59 http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1920/dec/06.htm [6] (Accessed on August 4, 2010).
[30] Ibid.
[31] A. Hammer, Witness to History (Reading, England: Hodder and Stoughton, 1988), pp.151-152.
[32] “Vanderlip’s Empire,” The New York Times, December 1, 1920, 14.
[33] “Standard Oil Joins Vanderlip Project,” The New York Times, January 11, 1922, p. 1.
[34] Ibid.
[35] Antony Sutton, Wall Street and the Bolshevik Revolution (New York: Arlington House Publishers, 1974), pp. 62–63.
[36] “Scotland Yard Intelligence Report,” London 1919, US State Dept. Decimal File, 316-22-656, cited by A. Sutton, ibid., p. 113.
[37] Basil H. Thompson, British Home Office Directorate of Intelligence, “Special Report No. 5 (Secret),” Scotland Yard, London, July 14, 1919; cited by Sutton, ibid., p. 115.
[38] A Sutton, op.cit., pp. 130–31.
[39] Sands’ memorandum to Lansing, p. 9; cited by Sutton, ibid., pp. 132, 134.
[40] A. Sutton, ibid., p. 135.
[41] Richard B Spence, “Hidden Agendas: Spies, Lies and Intrigue Surrounding Trotsky’s American Visit, January-April 1917,” Revolutionary Russia, Vol. 21, #1 (2008).
[42] Ibid.
[43] Ibid.
[44] A. Hammer, Witness to History, op. cit., p. 143.
[45] Ibid.
[46] Ibid., p. 160.
[47] K. R. Bolton, “Origins of the Cold War: How Stalin Foiled a New World Order,” Foreign Policy Journal, May 31, 2010, http://www.foreignpolicyjournal.com/2010/05/31/origins-of-the-cold-war-how-stalin-foild-a-new-world-order/all/1 [7]
[48] Leon Trotsky, Third All-Russian Congress of Trade Unions, April 6th, 1920. http://www.marxists.org/archive/brinton/1970/workers-control/05.htm [8] (Accessed on August 4, 2010).
[49] A. Hammer, op. cit., p. 217.
[50] Ibid., p. 221.
[51] Charles Levinson, Vodka-Cola (West Sussex: Biblias, 1980). Antony Sutton, National Suicide: Military Aid to the Soviet Union (New York: Arlington House, 1973).
[52] Peter Grose, op. it., “The First Transformation,” http://www.cfr.org/about/history/cfr/first_transformation.html [9]
[53] Jack Kemp, et al., Russia’s Wrong Direction: What the United States Can and Should do, Independent Task Force Report, no. 57 (New York: Council on Foreign Relations, 2006) xi. The entire publication can be downloaded at: http://www.cfr.org/publication/9997/ [10]
[54] Oswald Spengler, The Decline of The West (London: George Allen & Unwin, 1971), Vol. 2, p. 464.
[55] Ibid., p. 402.
Source: Ab Aeterno, no. 5, Fall 2010
Article printed from Counter-Currents Publishing: http://www.counter-currents.com
URL to article: http://www.counter-currents.com/2013/10/wall-street-and-the-november-1917-bolshevik-revolution/
URLs in this post:
[1] Image: http://www.counter-currents.com/wp-content/uploads/2013/10/Lenin-Hammer.jpg
[2] last article: http://www.counter-currents.com/2013/10/wall-street-and-the-march-1917-russian-revolution/
[3] http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=9E00E3D81739EF3ABC4953DFB3668389639EDE: http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=9E00E3D81739EF3ABC4953DFB3668389639EDE
[4] http://www.cfr.org/about/history/cfr/index.html: http://www.cfr.org/about/history/cfr/index.html
[5] gutenberg.net.au/ebooks06/0602371h.html: http://www.counter-currents.comgutenberg.net.au/ebooks06/0602371h.html
[6] http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1920/dec/06.htm: http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1920/dec/06.htm
[7] http://www.foreignpolicyjournal.com/2010/05/31/origins-of-the-cold-war-how-stalin-foild-a-new-world-order/all/1: http://www.foreignpolicyjournal.com/2010/05/31/origins-of-the-cold-war-how-stalin-foild-a-new-world-order/all/1
[8] http://www.marxists.org/archive/brinton/1970/workers-control/05.htm: http://www.marxists.org/archive/brinton/1970/workers-control/05.htm
[9] http://www.cfr.org/about/history/cfr/first_transformation.html: http://www.cfr.org/about/history/cfr/first_transformation.html
[10] http://www.cfr.org/publication/9997/: http://www.cfr.org/publication/9997/
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, russie, urss, révolution bolchevique, communisme, bolchevisme, lénine |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 08 novembre 2013
Wall Street & the March 1917 Russian Revolution

Wall Street & the March 1917 Russian Revolution
By Kerry Bolton
Ex: http://www.counter-currents.com
“There is no proletarian, not even a communist, movement that has not operated in the interests of money, in the directions indicated by money, and for the time permitted by money — and that without the idealists amongst its leaders having the slightest suspicion of the fact.” Oswald Spengler.[1]
The “Russian Revolution” (sic) is heralded in both the popular imagination and by academe as a triumph of the people against Czarist tyranny, even if most concede that the utopian vision turned sour, at least with the eventual dictatorship of Stalin. However a look behind the multiple facades of history shows that the “Russian Revolution” was one of many upheavals that have served those who provide the funding. Few–whether laymen or supposed “experts”–ever seem to question as to where the money comes to finance these revolutions, and we are expected to believe that they are “spontaneous uprisings of the people against oppression,” just as today we are still expected to believe that the so-called “colour revolutions” in the Ukraine, Georgia, Serbia, etc., are “spontaneous demonstrations.” This essay examines the funding of the March 1917 Russian Revolution, the so-called First Revolution that served as an opening scene for the Bolsheviks, and concludes that there are forces at work behind he scenes, whose goals are far removed from the welfare of the masses.
March 2010 marks the ninety-third anniversary of the (First) Russian Revolution, which served as the prelude for the Bolshevik coup the following November, known as the “Bolshevik Revolution.” A look beyond orthodoxy shows with ample documentation that socialism, from social democracy and fabianism[2] to communism, has generally “operated in the interests of money” as Spengler observed.
The Fabian historian and novelist H. G. Wells, when in Russia in 1920 observing the still precarious Bolshevik regime, commenting on how arch-capitalists were even then already going into the embryonic Soviet republic to negotiate commercial concessions[3], wrote:
. . . Big business is by no means antipathetic to Communism. The larger big business grows the more it approximates to Collectivism. It is the upper road of the few instead of the lower road of the masses to Collectivism.[4]
Big Business saw in socialism a means for both destroying the traditional foundations of nations and societies and as a control mechanism. In the case of Old Russia where a State based on monarchical and rural traditions was not amenable to being opened up for global business exploitation of its resources the scene was set for the upheavals of 1917 back in 1905 at the time of the Russo-Japanese War, which played a significant role in the formation of a Russian revolutionary cadre.[5] The funding for the formation of that cadre came from Jacob Schiff, senior partner of Kuhn, Loeb & Co., New York, who backed Japan in the war against Russia.[6]
The individual most responsible for turning American opinion, including government and diplomatic opinion, against Czarist Russia was the journalist George Kennan[7], who was sponsored by Schiff. In a collection of essays on American-Russian diplomacy, Cowley states that during the Russo-Japanese War of 1904-1905 Kennan was in Japan organising Russian POWs into ‘revolutionary cells’ and claimed to have converted “52,000 Russian soldiers into ‘revolutionists’”. Cowley also adds, significantly, “Certainly such activity, well-financed by groups in the United States, contributed little to Russian-American solidarity.”[8]
The source of the revolutionary funding “by groups in the United States” was explained by Kennan at a celebration of the March 1917 Russian Revolution, as reported as by the New York Times:
Mr. Kennan told of the work of the Friends of Russian Freedom in the revolution.
He said that during the Russian-Japanese war he was in Tokio, and that he was permitted to make visits among the 12,000 Russian prisoners in Japanese hands at the end of the first year of the war. He had conceived the idea of putting revolutionary propaganda into the hands of the Russian army.
The Japanese authorities favoured it and gave him permission. After which he sent to America for all the Russian revolutionary literature to be had . . .
“The movement was financed by a New York banker you all know and love,” he said, referring to Mr Schiff, “and soon we received a ton and a half of Russian revolutionary propaganda. At the end of the war 50,000 Russian officers and men went back to their country ardent revolutionists. The Friends of Russian Freedom had sowed 50,000 seeds of liberty in 100 Russian regiments. I do not know how many of these officers and men were in the Petrograd fortress last week, but we do know what part the army took in the revolution.”
Then was read a telegram from Jacob H. Schiff, part of which is as follows: “Will you say for me to those present at tonight’s meeting how deeply I regret my inability to celebrate with the Friends of Russian Freedom the actual reward of what we had hoped and striven for these long years.”[9]
The reaction to the Russian revolution by Schiff and indeed by bankers generally, in the USA and London, was one of jubilation. Schiff wrote enthusiastically to the New York Times:
May I through your columns give expression to my joy that the Russian nation, a great and good people, have at last effected their deliverance from centuries of autocratic oppression and through an almost bloodless revolution have now come into their own. Praised be God on high! Jacob H. Schiff.[10]
Writing to The Evening Post in response to a question about revolutionary Russia’s new status with world financial markets, Schiff replied as head of Kuhn, Loeb & Co.:
Replying to your request for my opinion of the effects of the revolution upon Russia’s finances, I am quite convinced that with the certainty of the development of the country’s enormous resources, which, with the shackles removed from a great people, will follow present events, Russia will before long take rank financially amongst the most favoured nations in the money markets of the world.[11]
Schiff’s reply reflected the general attitude of London and New York financial circles at the time of the revolution. John B. Young of the National City Bank, who had been in Russia in 1916 in regard to a US loan stated in 1917 of the revolution that it has been discussed widely when he had been in Russia the previous year. He regarded those involved as “solid, responsible and conservative.”[12] In the same issue, the New York Times reported that there had been a rise in Russian exchange transactions in London 24 hours preceding the revolution, and that London had known of the revolution prior to New York. The article reported that most prominent financial and business leaders in London and New York had a positive view of the revolution.[13] Another report states that while there had been some disquiet about the revolution, “this news was by no means unwelcome in more important banking circles.”[14]
These bankers and industrialists are cited in these articles as regarding the revolution as being able to eliminate pro-German influents in the Russian government and as likely to pursue a more vigorous course against Germany. Yet such seemingly “patriotic sentiments” cannot be considered the motivation behind the plutocratic support for the revolution. While Max Warburg of the Warburg banking house in Germany, advised the Kaiser and while the German Government arranged for funding and safe passage of Lenin and his entourage from Switzerland across Germany to Russia; his brother Paul,[15] as associate of Schiff’s,[16] looked after the family interests in New York. The factor that was behind this banking support for the revolution whether from London, New York, Stockholm,[17] or Berlin, was that of the tremendous largely untapped resources that would become available to the world financial markets, which had hitherto been denied control under the Czar. It must be kept in mind that these banking dynasties were–and are–not merely national or local banks but are international and do not owe loyalty to any particular nation, unless that nation happens to be acting in their interests at a particular time. [18]
The Bolshevik Revolution of eight months later, despite the violent anti-capitalist rhetoric, was to open Russia’s vast resources up to world capitalism, although with the advent of Stalin, not to the extent that the plutocrats had thought when the Lenin-Trotsky regime had held sway for several years.
Notes
This essay is based on parts of chapters in my book Revolution From Above: Manufacturing “Dissent” in the New World Order (London: Arktos, 2011). I hope to submit a similar essay on the funding of the November 1917 Russian Bolshevik Revolution for the October-November-December issue of Ab Aeterno.
[1] Oswald Spengler, The Decline of The West, 1918, 1926 (London: G. Allen & Unwin, 1971), vol. 2, p. 402.
[2] The Fabian Society features on its coat-of-arms a wolf in sheep’s clothing. Prominent among the founding members were literati such as H. G. Wells and G. B. Shaw. The Fabians founded the London School of Economics and Political Science as a training academy for the future governing elite in a collectivist state. According to co-founder Beatrice Webb, funding for this came from Sir Ernest Cassel of Vickers armaments and Kuhn, Loeb & Co., New York; and the Rothschilds, et al. (K. R. Bolton, op.cit., “Revolution By Stealth”).
[3] Washington A. Vanderlip was in Russia at the same time as Wells, negotiating commercial concessions with the Soviet regime–successfully.
[4] H. G. Wells, Russia in the Shadows, Chapter VII, “The Envoy.” Wells went to Russia in September 1920 at the invitation of Kamenev, of the Russian Trade Delegation in London, one of the leaders of the Bolshevik regime. Russia in the Shadows appeared as a series of articles in The Sunday Express. The whole book can be read online at: gutenberg.net.au/ebooks06/0602371h.html [2]
[5] The Russian monarchy and the Russian peasant were both considered historically passé by the Western financial establishment, in the same manner that in our own time the Afrikaner farming folk were considered passé and their system of apartheid hindered the globalisation of South Africa’s economy. Like the March and November 1917 Russian Revolutions, the ostensibly “Black” revolution in South Africa eliminated the Afrikaner anachronism and under “socialism” has privatised the parastatals (state-owned utility companies) and privatised the economy.
[6] “Jacob Schiff,” Dictionary of American Biography, Vol. XVI, p. 431. Schiff gave a loan of $200,000,000 to the Japanese aggressors, for which he was decorated by the Japanese Emperor.
[7] Robert Cowley, “A Year in Hell,” America and Russia: A Century and a Half of Dramatic Encounters, ed. Oliver Jensen (New York: Simon and Schuster, 1962), pp. 92-121. The introductory note to the chapter indicates the nature of Kennan’s influence: “An American journalist, George Kennan, became the first to reveal the full horrors of Siberian exile and the brutal, studied inhumanity of Czarist ‘justice’.” Cowley quotes historian Thomas A. Bailey as stating of Kennan: “No one person did more to cause the people of the United States to turn against their presumed benefactor of yesteryear.” (A reference to Czarist Russia’s support for the Union during the American Civil War). Cowley, ibid., p. 118.
[8] Ibid., p. 120.
[9] New York Times, 24 March, 1917, pp. 1-2.
[10] Jacob H. Schiff, “Jacob H. Schiff Rejoices, By Telegraph to the Editor of the New York Times,” New York Times, 18 March, 1917. This can be viewed in The New York Times online archives: http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=9802E4DD163AE532A2575BC1A9659C946696D6CF [3] (accessed 12 January 2010).
[11] “Loans easier for Russia,” The New York Times, 20 March 1917. http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=9B04EFDD143AE433A25753C2A9659C946696D6CF [4] (accessed 12 January 2010).
[12] “Is A People’s Revolution.” The New York Times, 16 March 1917.
[13] “Bankers here pleased with news of revolution,” ibid.
[14] “Stocks strong – Wall Street interpretation of Russian News,” ibid.
[15] Paul Warburg, prior to emigrating to the USA, had been decorated by the Kaiser in 1912.
[16] Paul Warburg was also Schiff’s brother-in-law.
[17] Olof Achberg of the Nye Banken, Stockholm was to serve as the conduit for funds between international banks and the Bolsheviks.
[18] For example, what national or prior imperial loyalties could a banking dynasty such as the Rothschilds owe, when they had family branches of the bank in London, Paris, Frankfurt, and Berlin? The same question applies to all such banks, and in our own time to the trans-national corporations.
Source: Ab Aeterno: Journal of the Academy of Social and Political Research, no. 2, March 2010
Article printed from Counter-Currents Publishing: http://www.counter-currents.com
URL to article: http://www.counter-currents.com/2013/10/wall-street-and-the-march-1917-russian-revolution/
URLs in this post:
[1] Image: http://www.counter-currents.com/wp-content/uploads/2013/10/jacobschiff.jpg
[2] gutenberg.net.au/ebooks06/0602371h.html: http://www.counter-currents.comgutenberg.net.au/ebooks06/0602371h.html
[3] http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=9802E4DD163AE532A2575BC1A9659C946696D6CF: http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=9802E4DD163AE532A2575BC1A9659C946696D6CF
[4] http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=9B04EFDD143AE433A25753C2A9659C946696D6CF: http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=9B04EFDD143AE433A25753C2A9659C946696D6CF
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, russie, mencheviks, révolution russe, 1917, février 1917 |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 02 novembre 2013
De Boerenkrijg tussen hamer en aambeeld

Archief 1998
De Boerenkrijg tussen hamer en aambeeld
Wannes Alverdinck en Jan Creve
Ex: http://www.devrijbuiter.be
Tweehonderd jaar geleden werd in de Zuidelijke Nederlanden een ware oorlog uitgevochten. Gedurende 3 maanden streden verspreide plattelandslegertjes tegen één van de machtigste oorlogsmachines van die tijd. De Franse invaller won tenslotte het pleit maar de strijd van de Brigands bleef voortleven in de herinnering. Honderden activiteiten in tal van Vlaamse gemeenten herdachten afgelopen maanden deze 'Boerenkrijg' (1). Maar van overheidswege werd er in alle talen gezwegen. Minister van Binnenlandse Zaken Di Rupo wilde er zelfs geen postzegel aan wijden.
TWEE VISIES
Is de Boerenkrijg wel zo belangrijk geweest dat we er papier aan zouden verspillen!? Grosso modo zijn twee meningen te onderscheiden die lijnrecht tegenover elkaar staan:
1. De Boerenkrijg was de strijd van ons volk tegen een vreemde indringer. Het was een bevrijdingsstrijd. Een heroïsche strijd. De herdenking is een eerbetoon aan deze helden.
2. De Boerenkrijg is een oproer geweest van een minderheid, van wat landvolk en geboefte. Een laatste opstoot van een voorbijgestreefde en verdwijnende wereld. Het betreft een fait-divers dat enkel interesse verdient vanuit wetenschappelijk-historisch oogpunt.
De eerste benadering vindt voornamelijk aanhang bij Vlaamsgezinde katholieken, al is dat ooit anders geweest (2), de tweede is die van het politieke en historisch-wetenschappelijke establishment.
De enen willen bewijzen dat de Boerenkrijg een volksopstand was van Vlaanderen tegen het Franse imperialisme. De anderen (zien zij de wervende kracht van dit postulaat?) grijpen - onder het mom van wetenschappelijkheid - alles aan om de Boerenkrijg te minimaliseren. Zo is er het werk van de Gentse professor Luc François die niets onverlet laat om de Boerenkrijg af te doen als een geheel van onbeduidende en onge-organiseerde opstandjes. Op zich is het uitgangspunt van François en zijn studenten, namelijk de historische feiten scheiden van de 19de eeuwse (romantische) fictie, zéér lovens-waardig. Maar het resultaat is niet om wild van te worden: Het negeren van een aantal historische documenten, vereenvoudigingen, zelfs verdraaiingen zijn eerder regel dan uitzondering. Zo geeft men in dit boek een opsomming van gemeenten "zonder", met "een kleine", "een grotere" en "een sterke actiebereidheid". Wat we hieronder in concreto moeten verstaan is onduidelijk maar de bedoeling van deze werkwijze is dat wel: namelijk aantonen dat in de opsomming van honderden gemeenten 'slechts' enkele tientallen gemeenten een "grotere" of "sterke" actiebereidheid vertoonden. Uitgezet op grafiek komt dat zeer overtuigend over maar wie zich de moeite geeft om dezelfde gegevens eens op een kaart te bekijken kan niet anders dan besluiten dat bepaalde streken werkelijk in vuur en vlam stonden. (3) Het zijn niet de enige zaken waarin de Gentse professor opvalt: zo ontkent hij het bestaan van enige organisatie, stelde hij op een uiteenzetting in Putte dat cijfers over de getalsterkte van het boerenleger door 10 moeten gedeeld worden en, op een andere uiteenzetting in Gent, dat het voornaamste motief voor de Boerenkrijg te vinden is in economische factoren, zijnde de terugval van de huisnijverheid op het platteland einde van de 18de eeuw en de tegenstelling platteland-stad.
EEN POGING TOT SYNTHESE
 Toegegeven, het is niet gemakkelijk de woelige tijd van de Boerenkrijg te reconstrueren. Ongetwijfeld bevatten beide voormelde thesissen een kern van waarheid. De Boerenkrijg was een georganiseerde opstand van de plattelandsbevolking tegen het Frans imperialisme. En ja, de Boerenkrijg ontstond uit spontane woede en was een verbeten wanhoopsdaad om het tij te keren. Maar eigenlijk dringt zich een derde thesis op: Dé Boerenkrijg heeft zich nooit voorgedaan!
Toegegeven, het is niet gemakkelijk de woelige tijd van de Boerenkrijg te reconstrueren. Ongetwijfeld bevatten beide voormelde thesissen een kern van waarheid. De Boerenkrijg was een georganiseerde opstand van de plattelandsbevolking tegen het Frans imperialisme. En ja, de Boerenkrijg ontstond uit spontane woede en was een verbeten wanhoopsdaad om het tij te keren. Maar eigenlijk dringt zich een derde thesis op: Dé Boerenkrijg heeft zich nooit voorgedaan!
Op 12 oktober 1798 begaf zich een groep Franse soldaten, sansculotten (4) naar een boerderij in Overmere (Oost-Vlaanderen) waar een boer weigerde de zoveelste oorlogsbelasting te betalen. Andere bronnen spreken van een opstand van dienstplichtigen. Hoe dan ook, plaatselijke bewoners gingen de Fransen te lijf met alles wat maar op een wapen leek: vliemen, houthakkersbijlen, knuppels, dorsvlegels... Binnen de kortste keren waren de Fransen verdreven. In hun overwinningsroes trokken ze het dorp binnen, kapten de door de Fransen geplante 'vrijheidsboom' om, openden de kerkdeuren en luidden de kerkklokken. (5) Het was de aanleiding voor een opstand die reeds een maand eerder met de afkondiging van de Franse conscriptiewetten nog moeilijk te vermijden leek.
Als een lopend vuur verspreidde de opstand zich over het land. In West-Vlaanderen werd de opstand, met honderden doden in Ingelmunster en Kortrijk, na tien dagen bedwongen. In het Houtland, Waasland, Hulst, tot aan het Vlaams Hoofd voor Antwerpen, trokken de opstandelingen van dorp tot dorp. Maar de verdedigings-mogelijkheden waren in dit vlakke land beperkt en de Franse troepen konden vanuit de steden (Gent, Oostende en Doornik) gemakkelijk deze streken bestrijken. En in Hulst, dat zijn poorten opende voor de Wase Boerenkrijgers, lieten de Brigands zelfs een scheepskonvooi met een lading van 300 kanonnen zomaar voorbijvaren.
In de streek van Bornem, St-Amands, Willebroek en Hingene kon het Boerenleger onder de kundige leiding van de handelaar Emmanuel-Benedict Rollier langer weerstaan. Niet alleen was deze streek, met zijn moerassen, waterlanden en bossen, geprangd tussen enkele rivieren, beter geschikt voor een zich steeds hergroeperend leger, maar daarnaast was dat leger waarschijnlijk ook beter bewapend én getraind. Het kon beschikken over Engelse bakergeweren en Engels geld om de vrijwilligers te betalen. Maar uiteindelijk moest men ook daar zwichten voor de militaire overmacht. Bornem werd grotendeels in de as gelegd en ook elders vonden represailles plaats.
In de Antwerpse en de Limburgse Kempen wist het boerenleger zich langer te verweren. Onder leiding van de drukker Pieter Corbeels, de brouwerszoon Jozef Emmanuel Van Gansen en de jonge advokaat Eelen speelde het boerenleger, dat op een bepaald moment meer dan 5000 strijders telde, tussen Essen en Hasselt gedurende verschillende weken een kat-en-muis-spel met de Fransen. In de morgen van 5 december werd het leger in Hasselt echter verrast en definitief verslagen.
De Boerenkrijg kostte aan duizenden opstandelingen het leven. Corbeels en Meulemans werden met honderden medestanders terechtgesteld. Rollier dook onder, net als van Gansen die de rest van de Franse tijd in zijn eigen dorp overleefde.
Op verschillende plaatsen in het land smeulde de opstand nog na maar nergens kreeg hij nog de afmetingen van wat in het najaar van 1798 had plaatsgevonden. (6)
DE OORZAKEN VAN DE BOERENKRIJG
Ondanks de herhaalde bezettingen en oorlogen behoorden onze streken in de 18de eeuw tot de meest welvarende van Europa. De landbouw kende dankzij het systeem van de teeltwisseling (7) een hoge productiviteit. Er was een goed uitgebouwd net van land- en waterwegen. We kenden een hogere alfabetiseringsgraad dan in de 19de eeuw (tot 60 procent in bepaalde streken). Alle standen en regio's waren vertegenwoordigd in het politiek bestel. De vrijheden en privilegies uit de Middeleeuwen hadden hier, meer dan elders, dankzij de desinteresse van onze vreemde vorsten, kunnen standhouden.
Toen de Oostenrijkse keizer Jozef II met zijn radicale hervormingen deze toestand ongedaan probeerde te maken brak er een gewapende opstand uit (1789) die uitliep op de vorming van de Republiek der Verenigde Nederlandse Staten (République des Etats Unis de la Belgique). Eén van de (geheime) genootschappen die mee aan de basis lag van het verzet tegen de nieuwe denkbeelden van de keizer heette zeer toepasselijk "Pro Aris et Focis" ("Voor Outer en Heerd"). Daarmee duidelijk beklemtonend dat de opstand in feite draaide om het behoud van de tradities tegenover de nieuwlichterij van de keizer. (8) Onderling gekrakeel maakte echter snel een eind aan de jonge republiek. Al in 1790 wisten de Oostenrijkers hun gezag te herstellen. In 1792 marcheerden de Frans-republikeinse troepen hier voor het eerst binnen. Enkele maanden later werden ze opnieuw verdreven maar in juni 1794 behaalden ze met de slag bij Fleurus een definitieve overwinning op de Oostenrijkers. En in oktober 1795 werden de Zuidelijke Nederlanden ingelijfd bij de Franse republiek.
 De ware aard van deze "bevrijding" onder de leuze "vrijheid, gelijkheid, broederlijkheid" werd snel duidelijk. De "nieuwe departementen" werden systematisch geplunderd. Naast deze plunderingen - het Louvre dankt er een groot deel van haar collectie aan - waren er de belastingen; de vorderingen van graan, hooi, vee en paarden; de inkwartiering van Franse soldaten bij de bevolking; de invoering van assignaten, papieren geld dat na herhaaldelijke devaluaties niets meer waard was; de vervolging van priesters die de eed van trouw aan de republiek weigerden af te leggen; de invoering van de republikeinse kalender die de jaartelling startte op 22 september 1792 en de vloer aanveegde met de traditionele feestdagen (Van de 80 dagen waarop er niet diende gewerkt te worden tijdens het "Ancien Régime" bleven er na 1795 nog amper 40 over...).
De ware aard van deze "bevrijding" onder de leuze "vrijheid, gelijkheid, broederlijkheid" werd snel duidelijk. De "nieuwe departementen" werden systematisch geplunderd. Naast deze plunderingen - het Louvre dankt er een groot deel van haar collectie aan - waren er de belastingen; de vorderingen van graan, hooi, vee en paarden; de inkwartiering van Franse soldaten bij de bevolking; de invoering van assignaten, papieren geld dat na herhaaldelijke devaluaties niets meer waard was; de vervolging van priesters die de eed van trouw aan de republiek weigerden af te leggen; de invoering van de republikeinse kalender die de jaartelling startte op 22 september 1792 en de vloer aanveegde met de traditionele feestdagen (Van de 80 dagen waarop er niet diende gewerkt te worden tijdens het "Ancien Régime" bleven er na 1795 nog amper 40 over...).
De opstand smeulde. Vertegenwoordigers van de standen die voordien in de Staten zetelden, organiseerden zich en vroegen om steun bij de vijanden van hun vijanden: de Engelsen, de Pruisen, Oostenrijk en de kringen rond de prins van Oranje die in ballingschap leefde (ook Noord-Nederland was door de Fransen onder de voet gelopen).
Afspraken werden gemaakt. De eerste ladingen geweren, de eerste financiële steun sijpelden het land binnen. Hiervan getuigen onder meer de verslagen van Franse spionnen (9). Een (begin van?) landelijke organisatie lijkt dus wel erg waarschijnlijk. Net als de samenwerking met andere mogendheden. De Engelsen patrouilleerden voor de kust en voerden regelmatig raids uit. Enkele maanden voor de Boerenkrijg uitbrak werd Oostende gebombardeerd vanuit zee. En in Vlissingen was er een mislukte landing. Op 27 oktober zou de Boerenkrijg moeten beginnen. Maar dit plan werd uiteindelijk niet gevolgd, zodat we belanden bij de thesis dat de Boerenkrijg zoals hij gepland was, nooit heeft plaatsgevonden. Reden voor het voortijdig uitbreken van de Boerenkrijg was de invoering van de dienstplicht voor alle jongemannen tussen 20 en 25 jaar, gedurende 5 jaar in vredestijd en voor onbepaalde tijd in oorlogstijd. En het was oorlog. Er was geen houden meer aan. De plattelandsbevolking greep vervroegd naar de wapens.
BETEKENIS
 Het is ontegensprekelijk zo dat het romantische beeld van de Boerenkrijg zoals het in de 19de eeuw is ontstaan nood had aan bijsturing. De Boerenkrijg was géén avant-première van de strijd voor Vlaamse onafhankelijkheid en was ook, in tijd en plaats, geen unieke gebeurtenis. Eerder had in onze streken onder impuls van gelijklopende motieven de Brabantse Omwenteling plaatsgevonden. Elders in Europa waren er de opstanden in de Vendée en in Süd-Tirol; de Klöppelkrieg in Luxemburg, de Chouannerie, het gewapende verzet van Charles Jacquemin de Loupoigne in Vlaams én Waals Brabant, de opstand in het departement van de Ourthe...
Het is ontegensprekelijk zo dat het romantische beeld van de Boerenkrijg zoals het in de 19de eeuw is ontstaan nood had aan bijsturing. De Boerenkrijg was géén avant-première van de strijd voor Vlaamse onafhankelijkheid en was ook, in tijd en plaats, geen unieke gebeurtenis. Eerder had in onze streken onder impuls van gelijklopende motieven de Brabantse Omwenteling plaatsgevonden. Elders in Europa waren er de opstanden in de Vendée en in Süd-Tirol; de Klöppelkrieg in Luxemburg, de Chouannerie, het gewapende verzet van Charles Jacquemin de Loupoigne in Vlaams én Waals Brabant, de opstand in het departement van de Ourthe...
De Boerenkrijg past op die manier in een brede tegenbeweging die overal in Europa op gang kwam tegen de rationalisering en 'modernisering' van de samenleving. Een beweging die niet de "nieuwe" en maakbare mens als norm nam maar de gemeenschap met haar geheel aan gebruiken en tradities. En dààrin ligt ongetwijfeld de betekenis van deze en andere opstanden.
Noten:
(1) Brigand betekende zoveel als rover en was het scheldwoord waar de Franse overheid zich van bediende om opstandelingen aan te duiden.
In de literatuur heeft men het steeds over de 'Boerenkrijg' maar in feite speelden boeren slechts een bescheiden rol in deze oorlog. Het aandeel van ambachtslieden, dagloners, handelaars was minstens even groot.
(2) 'De Boerenkrijg' van Conscience (1852), 'La guerre des paysans' van August Orts (187O) en 'La Belgique sous la domination Française' van Paul Verhaegen (1924) zijn geschreven vanuit een Belgisch-unitair standpunt.
(3) Tekenend voor de werkwijze van deze Gentse professor is dat de gemeenten Menen, Moorslede, Wervik worden opgenomen in de lijst van gemeenten "zonder actiebereidheid" maar in een ander hoofdstuk lezen we dat in Menen al begin oktober pamfletten circuleerden; dat in Moorslede een grote groep Brigands verzamelde; en dat er in Wervik incidenten plaatsvonden en er "een opstand dreigde". Melsele en Kruibeke worden omschreven als gemeente met een kleine actiebereidheid terwijl ze in een ander hoofdstuk omschreven staan als centra van de Boerenkrijg in het Waasland.
(4)sansculotten: diegenen die niet de aristocratische kniebroek maar de povere pantalon, of volksbroek droegen. Buiten Frankrijk werden er de (vaak pover aangeklede) Franse soldaten mee bedoeld.
(5)De vrijheidsboom, was een linde of berk, geplant in opdracht van de republikeinse overheid als symbool van hun vrijheidsstreven. Het omhakken van de vrijheidsboom en het openbreken van de kerkdeuren was in die zin een sterk symbolisch geladen actie.
(6) In de zomer van 1799 liep de Brabantse opstandelingenleider Charles Jacquemin de Loupoigne in een Franse hinderlaag en zijn hoofd werd in Brussel op een staak tentoongesteld. Gevangengenomen Brigands werden massaal gevonnist, steden en dorpen beboet. Daarmee leek er zogoed als een eind gekomen te zijn aan de de reeks van opstanden. In de loop van 1800, Napoleon had zich intussen meester gemaakt van de macht, werden de verbanningsbesluiten t.o.v. duizenden priesters ingetrokken en keerden de meeste gevangengenomen Brigands weer naar huis.
(7) Teeltwisseling veronderstelt de totale bebouwing van het akkerland. Bij het oudere drieslagstelsel werd 1/3 van het akkerland braak gelaten opdat het niet zou uitgeput raken. Bij teeltwisseling werd er gebruik gemaakt van zgn. grondverbeteraars als rapen en klavers wat ervoor zorgde dat het vee niet meer moest gedecimeerd worden voor de voedselarme winter.
(8) Pro Aris et Focis was de geheime organisatie van de "democratische" volgelingen van Jan-Frans Vonck. Of de strijdkreet "Voor Outer en Heerd" effectief gebruikt werd tijdens de Boerenkrijg wordt door verschillende historici betwist. Volgens hen zou de slogan door 19de eeuwse schrijvers aan de Boerenkrijgers zijn toegedicht.
(9) voor het terugvinden van deze aanwijzingen over de internationale draagwijdte van de Boerenkrijg verwijzen wij graag naar het Boerenkrijgkomitee Klein-Brabant dat ondermeer de tentoonstelling in St-Amands 'Het Verzet van 1798. Van Evolutie tot Revolutie, van Zelfbestuur tot Dictatuur en van Federalisme tot Centralisme' heeft gerealiseerd. In feite vormen zij de kern van alle evenementen die zich dit jaar rond de Boerenkrijg hebben afgespeeld. De tento is reeds afgelopen, maar waarschijnlijk zij er nog (zeer uitgebreide) catalogen beschikbaar, Aan alle geïnteresseerden warm aanbevolen. Daarvoor kan u contact opnemen met dhr. Aimé De Decker, tel. nr. 052/33.41.53
Bibliografie:
FRANCOIS, L., De Boerenkrijg. Twee eeuwen feiten en fictie, Leuven 1998.
SUYKENS, A., Franse Revolutie en Boerenkrijg in Klein-Brabant, Brussel, 1948.
VOORDE, H. VAN DE (e.a.), Bastille, Boerenkrijg en Tricolore. De Franse Revolutie in de Zuidelijke Nederlanden, Leuven, 1989.
00:05 Publié dans Belgicana, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : belgicana, belgique, pays-bas autrichiens, histoire, révolte paysanne, flandre, mouvement flamand, 18ème siècle, révolution française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 31 octobre 2013
La Kriegsmarine et l'Opération Barbarossa

La Kriegsmarine et l'Opération Barbarossa
Ingo Lachnit
En conquérant toute la côte atlantique de la France en juin 1940, les armées de Hitler ont dégagé le Reich de l'encerclement maritime que lui avaient imposé les Britanniques et les Français. La victoire allemande à l'Ouest ouvre au Reich les portes du large. A partir de ce moment, la Kriegsmarine ébauche des projets globaux et non plus purement défensifs, limités à la Mer du Nord et à la Baltique. C'est l'Amiral Carls, Commandant en chef du Groupe Est, qui fut le premier à fournir une étude globale, définissant les objectifs de la guerre sur mer (1). Son mémorandum reflète parfaitement l'état d'esprit des chefs de la marine allemande, après que les côtes atlantiques de la France soient tombées aux mains des Allemands.
L'Allemagne: une puissance d'ordre à l'échelon mondial
Carls, dans son mémorandum, parlait un langage clair. Sans circonlocutions, il déclare que l'Allemagne, désormais, doit devenir une puissance mondiale. Il ne craint pas de mener la guerre “contre la moitié ou les deux tiers du monde”. Déjà en 1938, il avait dit que l'Allemagne pouvait envisager de mener un tel combat avec succès. En déclarant que l'Allemagne devait devenir une puissance mondiale, Carls imposait à la marine une ligne de conduite, qui impliquait, à son tour, plusieurs objectifs de guerre: après avoir récupéré les anciennes provinces et territoires du Reich à l'Ouest et réclamé le retour des anciennes colonies africaines, Carls préconisait la constitution d'une confédération des Etats d'Europe du Nord sous l'égide allemande, regroupant, outre le Reich, une Grande-Flandre, les Pays-Bas, le Danemark et la Norvège, y compris leurs possessions d'outre-mer. Les possessions qu'apporteraient le Danemark et la Norvège dans la nouvelle communauté d'Etats (Spitzberg, Groenland, Islande, Iles Féroé), garantirait la domination maritime du Reich dans l'Atlantique-Nord, qui serait encore consolidée par l'annexion des Iles anglo-normandes et des Shetlands —la marine considéraient encore l'annexion de ce petit archipel au Nord de l'Ecosse comme un but de guerre en 1944. Cette position fortifiée dans le Nord aurait permis à l'Allemagne d'avoir un accès libre aux zones centrales de l'Atlantique, grâce à l'inclusion dans la sphère d'influence du Reich d'une bande littorale ouest-française. Les ports de cette bande littorale auraient servi de tremplin vers le sud, permettant du même coup de se rendre maîtres de la côte ouest-africaine. Sur cette côte, l'Allemagne devra s'assurer quelques territoires, de façon à s'aménager des points d'appui. Ensuite, l'Union Sud-Africaine, y compris la Rhodésie du Sud, deviendraient des Etats indépendants et se détacheraient de l'Empire britannique, s'empareraient de Madagascar et des îles avoisinantes, de façon a créer une “chaîne” de points d'appui qui s'étendrait de l'Océan Indien au Pacifique, en passant pas les colonies néerlandaises (Indonésie), tombées sous influence allemande grâce à l'inclusion de la Hollande dans la communauté des Etats du Nord de l'Europe. Cette “chaîne” aboutirait au Bornéo septentrional qui serait, lui aussi, détaché de l'Empire et passerait sous domination allemande.
Cette esquisse des ambitions allemandes, élaborée par Carls, correspondait bel et bien à l'état d'esprit qui régnait dans les états-majors de la marine. Seuls quelques officiers ont émis des revendications plus modérées, mais qui ne portaient que sur les détails, non sur l'essentiel. Ainsi, le Chef du 1er Skl., le Contre-Amiral Fricke, en formulant une ligne de conduite légèrement différente, estimait que l'Allemagne devait en priorité s'affirmer comme puissance européenne dominante. Fricke suggérait de ne pas mettre la charrue avant les bœufs et de ne pas aller trop vite en besogne en voulant faire de l'Allemagne une puissance mondiale. Le Commandant-en-chef de la Marine, le Grand-Amiral Raeder, pour sa part, refusait de s'emballer pour les projets trop audacieux et ne voulait pas perdre de vue l'essentiel: les objectifs à court terme; l'acquisition de points d'appui insulaires et continentaux le long des côtes africaines ne serait alors qu'un objectif à moyen terme. Dans les détails, les buts déclarés variaient d'une personnalité à l'autre. Mais il n'en demeure pas moins vrai que tous les officiers de l'état-major de la marine de guerre étaient d'accord sur un point: l'Allemagne était devenu une puissance d'ordre et devait s'affirmer en tant que telle sur toute la surface du globe. Aucun officier de marine ne mettait en doute la nécessité de faire du Reich la puissance hégémonique en Europe, la puissance organisatrice d'un “grand espace” économique européen, avec son complément colonial africain. Cette mission devait forcément donner à l'Allemagne une vocation planétaire. Toutes les ébauches de la marine impliquaient une Weltpolitik de grande envergure. Sans la moindre hésitation, les officiers de la marine prévoyaient de bétonner et de consolider les positions du “Reich Grand-Allemand” sur le plan géostratégique, de même que ses intérêts outre-mer, de “façon définitive, sur le fond, pour tous les temps”.
L'objectif à court terme: devenir une puissance coloniale
Les exigences coloniales de la marine allemande, de même que sa volonté d'acquérir des points d'appui, vise en premier lieu à asseoir solidement les revendications allemandes. Carls souhaitait un désarmement de l'Angleterre et de la France et pensait qu'il ne fallait réaccorder l'égalité en droit à ces deux puissances que lorsqu'elles auraient accepté l'ordre nouveau imposé par le Reich à l'Europe. Leurs empires coloniaux devront être réduit en dimensions, afin qu'ils soient égaux en taille aux possessions allemandes d'outre-mer, mais ne devront en aucun cas être détruits. Les possessions coloniales de la Grande-Bretagne, de la France et de l'Italie demeureront suffisamment vastes, après que l'Allemagne ait accedé au statut de grande puissance mondiale, “pour leur assurer l'existence et assez de puissance”, toutefois “dans les proportions que nous aurons souhaitées”. L'objectif de devenir “puissance mondiale” ne pourra se concrétiser que dans la mesure où l'Allemagne se montrera capable d'assurer l'équilibre entre les autres puissances. Carls parle en fait d'“auto-limitation” (Selbstbeschränkung) quand il parle du Reich; il ne perçoit pas celui-ci comme une puissance qui règnerait seule sur le destin de la planète, mais qui serait davantage “régulatrice” de la politique internationale. La notion de “puissance mondiale” (Weltmacht) n'est donc pas synonyme, dans la pensée de Carls”, de “domination (non partagée) sur le monde” (Weltherrschaft). Les objectifs coloniaux énoncés dans le mémorandum ont une connotation nettement restauratrice. Ils se contentent, pour l'essentiel, de rétablir les colonies allemands d'avant 1918, en leur adjoignant quelques possessions françaises et la Rhodésie, qui souderait ses colonies entre elles.
Carls renonce à toute acquisition en Méditerranée et à toute intrusion dans les sphères d'infuence américaine et japonaise. Il tient compte du fait “que le Führer ne veut pas s'installer en Méditerranée, ni s'immiscer dans les sphères d'influence américaine et japonaise”. Carls savait intuitivement quel état d'esprit régnait dans le quartier général du Führer et devinait ce que ce dernier voulait entendre. Il élaborait ses plans non pas dans les limites de son propre domaine mais tenait davantage compte des intentions du commandement suprême que Raeder quand il rédigeait ses rapports. Raeder, lui, n'élaborait de projet que sur base de son domaine spécifique et tentait, envers et contre tout, de l'imposer au commandement suprême.
Ce qui frappe, c'est la mansuétude de Carls à l'égard de l'ennemi principal du Reich, la Grande-Bretagne. Celle-ci, dans la mesure du possible —c'est-à-dire si elle ne s'oppose pas au Reich allemand de manière irrémédiable— conserverait son Empire et demeurerait une puissance thalassocratique. Carls exprime de la sorte, outre une admiration pour l'œuvre coloniale des Britanniques, le point de vue de la marine: l'Empire britannique a eu une fonction stabilisante dans l'équilibre international. Sa chute favoriserait le Japon, puissance qui cherche l'hégémonie à l'échelle du globe, et qui se révèlerait, dans un avenir plus lointain, un nouvel adversaire du Reich allemand.
La Marine: facteur de décision dans la guerre
 La marine de guerre allemande s'est toujours définie dans et par sa lutte contre la flotte britannique. Dans cette optique, l'Allemagne, en s'opposant à l'Angleterre, est logiquement, par la volonté du destin, obligée de devenir une puissance thalassocratique à l'échelle du globe. Cette vision des choses est solidement ancrée dans la marine depuis Tirpitz. Le corps des officiers de marine n'a jamais cessé de penser et d'agir dans le cadre de ces idées claires et compactes; tous ses objectifs s'inscrivent dans cette logique implaccable, même après 1918, année de la défaite que n'admettent pas plus les officiers de marine que ceux de l'armée de terre. Dans son Dienstschrift IX (Note de service IX), rédigé en 1894, Tirpitz avait conçu le rôle des armées de terre —protéger l'Etat contre l'arbitraire de l'ennemi— comme inférieur à celui, sublime, de la marine: emporter la décision en cas de guerre. Cet état d'esprit témoigne de la cohésion morale, élitaire et sélective, du corps des officiers de marine allemands; ces hommes étaient convaincus de l'importance de leur arme et cette conviction, largement partagée, s'est perpétuée et renforcée après 1918 et l'intermède de Weimar. Le vocabulaire lui-même en témoigne: la marine est kriegsentscheidend, elle force la décision, fait la décision, en cas de guerre. Tel est le noyau de la pensée stratégique et opérative de la marine. Ce qui explique la franchise avec laquelle la marine élabore ses plans pour faire de l'Allemagne une Weltmacht. Elle n'est pas victime de l'euphorie qui règne dans le Reich après la victoire sur la France mais s'inscrit plus simplement, plus naturellement, dans la tradition forgée à la fin du XIXième siècle par Tirpitz, tout en espérant, avec les nouveaux acquis territoriaux, rencontrer plus de succès.
La marine de guerre allemande s'est toujours définie dans et par sa lutte contre la flotte britannique. Dans cette optique, l'Allemagne, en s'opposant à l'Angleterre, est logiquement, par la volonté du destin, obligée de devenir une puissance thalassocratique à l'échelle du globe. Cette vision des choses est solidement ancrée dans la marine depuis Tirpitz. Le corps des officiers de marine n'a jamais cessé de penser et d'agir dans le cadre de ces idées claires et compactes; tous ses objectifs s'inscrivent dans cette logique implaccable, même après 1918, année de la défaite que n'admettent pas plus les officiers de marine que ceux de l'armée de terre. Dans son Dienstschrift IX (Note de service IX), rédigé en 1894, Tirpitz avait conçu le rôle des armées de terre —protéger l'Etat contre l'arbitraire de l'ennemi— comme inférieur à celui, sublime, de la marine: emporter la décision en cas de guerre. Cet état d'esprit témoigne de la cohésion morale, élitaire et sélective, du corps des officiers de marine allemands; ces hommes étaient convaincus de l'importance de leur arme et cette conviction, largement partagée, s'est perpétuée et renforcée après 1918 et l'intermède de Weimar. Le vocabulaire lui-même en témoigne: la marine est kriegsentscheidend, elle force la décision, fait la décision, en cas de guerre. Tel est le noyau de la pensée stratégique et opérative de la marine. Ce qui explique la franchise avec laquelle la marine élabore ses plans pour faire de l'Allemagne une Weltmacht. Elle n'est pas victime de l'euphorie qui règne dans le Reich après la victoire sur la France mais s'inscrit plus simplement, plus naturellement, dans la tradition forgée à la fin du XIXième siècle par Tirpitz, tout en espérant, avec les nouveaux acquis territoriaux, rencontrer plus de succès.
Le problème de l'Angleterre
Comme les opérations contre la “forteresse insulaire” britannique s'avèrent lentes et n'emportent aucun succès, et comme l'invasion de l'Angleterre est reportée à l'année 1941, les esprits, en Allemagne, se concentrent sur le “problème anglais”. Si l'Angleterre ne peut être vaincue sur son île métropolitaine, il faudra trouver des points faibles dans l'Empire et y remporter des victoires décisives qui obligeront le gouvernement britannique à composer et à accepter la paix allemande. Cette question, essentielle, préoccupait bien entendu tous les militaires allemands, les chefs de la marine comme l'état-major de la Wehrmacht. Pour résoudre le problème anglais, il y avait plusieurs possibilités:
1) Une guerre contre les sources d'approvisionnement qui s'inscrirait dans le cadre d'une guerre économique de plus vaste envergure.
2) Des attaques ponctuelles contre les points névralgiques de l'Empire, de façon à ce qu'il s'effondre. A portée des Allemands, par ordre d'importance, nous avions, à l'époque: Suez, Gibraltar et Malte.
3) L'acquisition de positions stratégiques navales en Afrique du Nord et de l'Ouest, afin de donner aux opérations dans l'Atlantique l'ampleur souhaitée.
4) Intensifier la guerre des croiseurs. C'est l'idée motrice de Raeder.
La question qui se pose alors: où les chefs de la marine allemande doivent-ils porter le poids de leurs armes, en concentrant toutes leurs forces? Afin d'obtenir l'effet escompté le plus rapidement possible, avec les meilleures chances de succès?
Le tonnage anglais se concentrait dans l'Atlantique. C'est par l'Atlantique et la Méditerranée que passent les axes vitaux qui relient la Grande-Bretagne à ses sources d'énergie venues d'outre-mer. Fragmenter ces axes était la mission des sous-marins. Les chefs de la marine considéraient donc que la guerre anti-tonnage dans l'Atlantique était prioritaire. Mais le commandant en chef de la Marine tenait à la guerre traditionnelle des croiseurs, qu'il voulait mener en deux endroits: dans l'Atlantique et en Méditerranée (sur ce théâtre en guise de diversion). Mais comme les plus lourdes unités allemandes se trouvent dans l'Atlantique, elles ne peuvent être déployées en Méditerranée. Convaincu du grand impact que pourrait avoir sa stratégie de diversion —laquelle ne pouvait que s'amplifier dès le début de la guerre du Pacifique et prendre des proportions globales— Raeder envoya ses sous-marins en Méditerranée. Il s'est heurté à une critique sévère des sous-mariniers, hostiles à cette stratégie de diversion. Pour Dönitz, la Méditerranée n'avait qu'une importance secondaire. Selon Dönitz, toutes les mesures qui visent à diviser et disperser les forces ennemies sont erronées, car elles ne peuvent que contribuer à prélever des forces allemandes hors de la zone principale des combats, qui est l'Atlantique. Mais, dans l'optique de Raeder, au contraire, la Méditerranée ne revêt pas une importance stratégique qui ne vaudrait que pour la diversion qu'il entend planifier. En lançant une offensive contre Suez, il veut trancher l'“artère principale” de l'organisme qu'est l'Empire britannique et porter ainsi le coup fatal à l'Angleterre. Après la prise de Suez, les résidus de la domination britannique en Méditerranée pourraient facilement être éliminés avec l'aide de la flotte française. Sans nul doute, Raeder exagérait l'importance de la Méditerranée pour les Britanniques mais n'avait pas tort de valoriser l'importance des côtes du nord et de l'ouest de l'Afrique et comptait sur la coopération française dans les opérations navales dans l'Atlantique.
L'Atlantique, l'Afrique du Nord-Ouest et Suez: tels sont les objectifs principaux de la stratégie de la marine allemande.
Y avait-il communauté d'intérêt entre la France et l'Allemagne?
Au fur et à mesure que les officiers supérieurs de la marine allemande élaborent et peaufinent leur stratégie, la France vaincue acquiert de plus en plus de poids à leurs yeux. Le choc de Mers-el-Kébir et de Dakar du côté français, l'impossibilité de mener à bien l'Opération Seelöwe (le débarquement en Angleterre) du côté allemand, contribuent à un rapprochement franco-allemand, qui devrait se concrétiser par un effort de guerre commun. Et comme les Italiens et les Espagnols n'ont pas réussi à chasser les Britanniques de la Méditerranée, contrairement à ce qu'avaient espéré les Allemands, les chefs de la marine allemande en viennent à estimer que la participation française à la guerre navale contre l'Angleterre est indispensable. Pour que les Français deviennent les adversaires de l'Angleterre, les Allemands doivent leur donner des garanties politiques, qui valent le prix d'une entrée en guerre de Vichy à leurs côtés. Raeder envisage une alliance en bonne et due forme avec les Français et souhaite que Berlin élargisse l'axe tripartite Rome-Berlin-Tokyo à Vichy. L'inclusion de la France dans le nouvel ordre européen a été l'une des exigences de base des chefs de la marine allemande.
Ceux-ci ont trouvé des appuis dans l'état-major de la Wehrmacht. Le Général-Major Warlimont, Chef du L/WFSt, après une visite à Paris, s'est fait l'avocat du rapprochement franco-allemand. L'Afrique du Nord-Ouest et de l'Ouest constitue un flanc stratégique indispensable contre l'Angleterre ainsi qu'un espace économique soustrait au blocus britannique. Le conseiller militaire de Hitler, le Chef de l'état-major général de la Wehrmacht, le Colonel-Général Jodl, partage ce point de vue. La France pourrait aider le IIIième Reich et lui donner la victoire finale, si elle met à la disposition des Allemands ses bases africaines. Si l'Allemagne perd les bases nord-africaines possédées par la France, expliquent les chefs de la marine, il ne sera plus possible de battre l'Angleterre dans la guerre commerciale qui se déroule dans l'Atlantique. Cette formulation est évidemment osée. Mais il n'en demeure pas moins vrai que la masse territoriale nord-africaine et ouest-africaine constitue une barrière importante contre toutes les attaques anglo-saxonnes contre le Sud de l'Europe. En outre, ce territoire peut servir de base pour des attaques de l'aviation allemande contre les Etats-Unis.
 Une alliance franco-allemande constituerait donc un atout complémentaire, qui permettrait au Reich de faire son jeu sur le continent européen. Mais Hitler s'imaginait toujours qu'il allait pouvoir faire la paix avec l'Angleterre. Il laisse le sort de la France dans l'indécision. Après Mers-el-Kébir, l'Allemagne assouplit encore ses mesures de démobilisation, politique qui ne correspond pas du tout aux souhaits de la Marine et de l'état-major de la Wehrmacht, qui, eux, envisageaient de consolider militairement une communauté d'intérêt franco-allemande.
Une alliance franco-allemande constituerait donc un atout complémentaire, qui permettrait au Reich de faire son jeu sur le continent européen. Mais Hitler s'imaginait toujours qu'il allait pouvoir faire la paix avec l'Angleterre. Il laisse le sort de la France dans l'indécision. Après Mers-el-Kébir, l'Allemagne assouplit encore ses mesures de démobilisation, politique qui ne correspond pas du tout aux souhaits de la Marine et de l'état-major de la Wehrmacht, qui, eux, envisageaient de consolider militairement une communauté d'intérêt franco-allemande.
La campagne de Russie
Mais un projet militaire va s'avérer plus déterminant que tous les problèmes soulevés par la stratégie nouvelle, proposée par la marine allemande, plus déterminant aussi que tous les problèmes non résolus et toutes les occasions perdues: celui de lancer une campagne contre la Russie. Ce projet freine définitivement le développement de la stratégie maritime suggéré par Carls. La stratégie maritime dépend désormais de la guerre sur terre.
Pour les chefs de l'armée de terre, la capitulation de la France et l'impossibilité pour la Grande-Bretagne d'entreprendre des opérations sur le continent ont rendu impossible la guerre sur deux fronts. Du moins dans un premier temps. Mais l'élimination de la France n'a pas donné à la Kriegsmarine la liberté qu'elle souhaitait avoir sur ses arrières. Les forces opérationnelles de la marine allemande étant faibles, ses chefs ne pouvaient considérer l'Opération Barbarossa que comme un fardaud supplémentaire. Mais, mise à part cette objection, la marine n'avait nulle crainte quant au déroulement de la guerre à l'Est: “Les forces militaires qu'aligne l'armée russe doivent être considérées comme très inférieures à nos troupes expérimentées. L'occupation d'un territoire s'étendant du Lac Ladoga à la Crimée en passant par Smolensk est militairement réalisable, de façon à ce qu'en détenant ce territoire, il nous soit possible de dicter les conditions de la paix” (2). Les chefs de la marine partagent la conviction des dirigeants politiques de l'Allemagne: le Reich gagnera la guerre à l'Est sans difficulté. Mais doutent que, par cette victoire, la guerre contre l'Angleterre sera plus rapidement terminée. La marine croit en effet que l'impact d'une victoire allemande à l'Est sera mininal sur le moral de l'ennemi occidental. Les victoires allemandes sur le continent ne contraindront nullement la Grande-Bretagne à composer. Au contraire, l'effort exigé par la campagne de Russie sera tel qu'il favorisera une victoire anglaise dans l'Atlantique et rendra aux Britanniques toutes les positions perdues. Pire: si la Russie ne s'effondre pas immédiatement, l'Allemagne court un danger très grave, dans le sens où les territoires non neutralisés de l'URSS deviendront ipso facto des tremplins pour une attaque américaine. Dans l'esprit des chefs de la marine, le combat principal, c'est-à-dire la guerre contre l'Angleterre, pourrait bien être perdu, même si l'Opération Barbarossa débouche sur une victoire.
La guerre à l'Est soulage l'Angleterre
Les chefs de la marine jugent la sécurité globale de l'Allemagne, en incluant le facteur “Russie” dans des catégories qui justifient l'attaque contre l'URSS: la sécurité de l'Allemagne exige la consolidation, par des moyens militaires, d'un espace qui soit à l'abri de toute attaque extérieure, l'élimination, par des moyens politiques, des petits Etats peu fiables, et, enfin, la construction, par des moyens économiques, d'une autarcie continentale. Les chefs de la marine, de surcroît, acceptent les projets de colonisation et les dimensions idéologiques inhérents à la guerre contre l'URSS. Sur un plan politique plus général et animés par la conviction que les forces armées soviétiques de terre et de mer constituent un danger pour le Reich, les chefs de la marine s'alignent exactement sur les thèses du gouvernement allemand. Si les objectifs de construire un espace intangible ou une autarcie économique justifiaient dans une certaine mesure la guerre à l'Est, aux yeux du gouvernement, la marine, elle, tire des conclusions opposées. Dans son évaluation de la situation, trois éléments sont importants: 1) la conviction que l'Allemagne aurait obtenu tout ce qu'elle voulait de la Russie, même sans lui faire la guerre; 2) le problème anglais restait sans solution; 3) un éventail de réflexions sur l'industrie militaire.
Pour la marine, l'Angleterre est l'ennemi n°1
Du point de vue de la marine, le gouvernement du Reich surestime la “masse soviétique” et poursuit, vis-à-vis de Moscou, une politique de concessions inutile. Le gouvernement allemand devrait au contraire montrer à l'Union Soviétique, fragile parce que tout un éventail de crises la guette, la puissance politique et militaire du Reich. Les Russes, pour l'état-major de la marine, sont prêts à négocier, ce qui rend toute guerre inutile. Moscou, pensent les officiers supérieurs de la marine allemande, ira au devant de tous les souhaits de l'Allemagne.
La mission première de la marine de guerre est donc d'affronter directement l'Angleterre. Si celle-ci est abattue, le Reich obtiendra presque automatiquement la victoire. Toute campagne militaire à l'Est influencerait négativement la situation stratégique de l'Allemagne sur mer et jouerait en faveur de l'Angleterre, qui serait de fait soulagée. Le Korvettenkapitän Junge, chef du département “marine” auprès de l'état-major général de la Wehrmacht, tire les mêmes conclusions: l'Allemagne ne doit pas entrer en guerre contre la Russie, avant que l'Angleterre ne soit mise hors course.
La campagne à l'Est a-t-elle été une alternative?
Fricke (Chef de la 1ière Skl.) constatait que les Anglo-Saxons, affaiblis après avoir perdu leur allié continental potentiel, la Russie, ne s'en prendraient plus à la grande puissance continentale que serait devenue l'Allemagne. Mais cette constatation n'a en rien influencé l'élaboration de la stratégie navale allemande, favorable, en gros, à la campagne de Russie. La marine a été incapable de s'opposer avec succès à l'option anti-soviétique du gouvernement allemand. Mais ni Fricke ni les officiers supérieurs de la Kriegsmarine n'ont pu voir dans le projet “Barbarossa” une entreprise qui aurait contribué à abattre l'Angleterre (pour Hitler, ce n'était d'ailleurs pas l'objectif). Les gains territoriaux à l'Est ne compenseront nullement le tonnage que les Allemands, occupés sur le continent, ne pourront couler dans l'Atlantique, théâtre où se décide réellement le sort de la guerre. Les chefs de la marine ne voient ni la nécessité ni l'utilité d'une opération à l'Est, qui éloignerait les Allemands de l'Atlantique. Le Reich, pour les marins, ne perdra ni ne gagnera la guerre en Russie. Le destin de l'Allemagne se joue uniquement dans l'Atlantique.
Si l'option Barbarossa se concrétise, l'industrie de l'armement consacrera tous ses efforts à l'armée de terre et à l'aviation. Si les livraisons russes cessent d'arriver en Allemagne à cause de la guerre germano-soviétique, la marine en essuiera les conséquences et ne pourra plus espérer aucune priorité dans l'octroi de matières premières et de carburants. La guerre à l'Est ôtera à la marine son principal fournisseur de matières premières. Ses chefs ne pensent pas, en conséquence, que les opérations en Russie apporteront une solution au problème des matières premières, domaine où l'Allemagne est dans une situation précaire. Les livraisons de pétrole pour l'Opération Seelöwe ne seront pas nécessairement assurées, une fois l'Opération Barbarossa terminée. En conséquence, la marine estime que la campagne de Russie n'est qu'un élargissement compromettant de la guerre, pire, qu'elle l'étend dans une mauvaise direction et au moment le plus inapproprié.
Appréciation
Avec la victoire sur la France en juin 1940, la marine allemande peut enfin mettre au point sa “grande stratégie”. Mais cette stratégie prend fin avec le débarquement allié en Afrique du Nord de novembre 1942. Pour Raeder, la “grande stratégie navale” est une alternative à l'Opération Seelöwe et, plus tard, à l'Opération Barbarossa, dont il n'a jamais été convaincu de l'utilité. La stratégie maritime n'est pas une stratégie partielle ou complémentaire, qui se déploierait parallèlement à la guerre sur terre. Elle est une stratégie globale qui affecte également les opérations sur le continent. Aujourd'hui, il n'est pas possible de dire comment elle aurait influencé le cours de la guerre, si elle avait été appliquée sans restriction.
Dans les mois qui se sont écoulés entre la fin de la campagne de France et le début de la campagne de Russie, le III° Reich a pu choisir entre plusieurs options: 1) Il se tient coi, renonce à entamer toute opération et organise la défensive; 2) Il poursuit la guerre à l'Ouest jusqu'à la capitulation anglaise et impose sa paix; 3) Il se tourne vers l'Est, soumet la Russie et se retourne vers l'Ouest avec l'atout complémentaire: un continent uni par la force et inexpugnable. Aucune de ces options n'avait la chance de réussir à 100%. Toutes pouvaient réussir ou échouer. Evidemment, la stratégie consistant à demeurer coi ou la stratégie navale préconisée par les chefs de la marine, qui n'a pas été appliquée, ont le beau rôle dans les querelles entre historiens: personne ne peut dire avec certitude qu'elles étaient erronées, puisqu'elles ne se sont pas traduites dans le concret. Quant à la “solution continentale”, recherchée par Barbarossa, elle a échoué. Mais elle aurait pu réussir.
Notes:
(1) M. SALEWSKI, Die deutsche Seekriegsleitung 1935-1945, 3 tomes, tomes 1 & 2, Francfort s. M., 1970-75. Tome 3: Denkschriften und Lagebetrachtungen 1938-1944. Pour notre propos: Tome 3, pp. 108 et suivantes.
(2) 1/Skl, “Betrachtungen über Russland”, 28 juillet 1940 (Salewski, tome 3, pages 141 et suivantes).
00:05 Publié dans Histoire, Militaria | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marine, allemagne, histoire, militaria, kriegsmarine, deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale, thalassocratie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 30 octobre 2013
Munich ou Athènes-sur-l’Isar: ville de culture et matrice d’idées conservatrices-révolutionnaires

Robert STEUCKERS:
Munich ou Athènes-sur-l’Isar: ville de culture et matrice d’idées conservatrices-révolutionnaires
Conférence prononcée à Vlotho im Wesergebirge, université d’été de “Synergies Européennes”, 2002
Cette conférence est la recension des premiers chapitres de:
David Clay Large, Hitlers München – Aufstieg und Fall der Hauptstadt der Bewegung, C. H. Beck, Munich, 1998.
 Le passé de Munich, capitale bavaroise, est marqué par la volonté culturelle de ses rois. Il y a d’abord eu Louis I, qui règne de 1825 à 1848. Ce monarque, quand il était prince héritier, a fait le voyage en Italie, en 1817-1818: il a été, comme beaucoup d’Allemands, fasciné par l’urbanisme traditionnel des villes de la péninsule et veut faire de Munich, sa “Residenzstadt”, un centre culturel allemand incontournable, au service d’une véritable renaissance culturelle qui a, cette fois, pour point de départ, l’espace germanophone du centre de l’Europe. Pour embellir la “ville de résidence”, il fait appel à des architectes comme Leo von Klenze et Friedrich von Gärtner, tous deux appartenant à l’école dite “classique”, renouant avec les canons grecs et romains de l’antiquité, ceux de Vitruve. En épousant la cantatrice espagnole Lola Montez, il se heurte à la bourgeoisie philistine de la ville, hostile aux dépenses de prestige voulues par le roi et qui prend le prétexte de ce mariage avec une roturière étrangère, pour manifester sa désapprobation à l’endroit de la politique royale et du mécénat pratiqué par le monarque. Ce mariage donnera lieu à quantité de ragots irrévérencieux, censés saborder l’autorité de ce monarque tourné vers les arts.
Le passé de Munich, capitale bavaroise, est marqué par la volonté culturelle de ses rois. Il y a d’abord eu Louis I, qui règne de 1825 à 1848. Ce monarque, quand il était prince héritier, a fait le voyage en Italie, en 1817-1818: il a été, comme beaucoup d’Allemands, fasciné par l’urbanisme traditionnel des villes de la péninsule et veut faire de Munich, sa “Residenzstadt”, un centre culturel allemand incontournable, au service d’une véritable renaissance culturelle qui a, cette fois, pour point de départ, l’espace germanophone du centre de l’Europe. Pour embellir la “ville de résidence”, il fait appel à des architectes comme Leo von Klenze et Friedrich von Gärtner, tous deux appartenant à l’école dite “classique”, renouant avec les canons grecs et romains de l’antiquité, ceux de Vitruve. En épousant la cantatrice espagnole Lola Montez, il se heurte à la bourgeoisie philistine de la ville, hostile aux dépenses de prestige voulues par le roi et qui prend le prétexte de ce mariage avec une roturière étrangère, pour manifester sa désapprobation à l’endroit de la politique royale et du mécénat pratiqué par le monarque. Ce mariage donnera lieu à quantité de ragots irrévérencieux, censés saborder l’autorité de ce monarque tourné vers les arts.
De Maximilien II au Prince-Régent Luitpold
 Son successeur sur le trône bavarois, Maximilien II, règnera de 1848 à 1864. En dépit des cabales menées contre son père, il poursuivra l’oeuvre de ce dernier, ajoutant au classicisme une touche de futurisme, en faisant construire un palais des glaces (de fer et de verre) comme celui de Londres, prélude à une architecture différente qui ne table plus uniquement sur la pierre comme matériau de construction. Maximilien II attire des savants d’Allemagne du Nord à Munich, qui ne sont évidemment pas des Bavarois de souche: on parlera alors des “Nordlichter”, des “Lumières du Nord”. Louis II, qui règne de 1864 à 1886, prônera une nouvelle architecture romantique, inspirée par les opéras de Wagner, par le moyen âge, riche en ornementations. On connaît ses châteaux, dont celui, merveilleux, de Neuschwanstein. Cette politique se heurte également à une bourgeoisie philistine, insensible à toute forme de beauté. Après Louis II, après sa mort étrange, le Prince-Régent Luitpold, aimé du peuple, préconise une industrialisation et une urbanisation de la Bavière. Munich connaît alors une évolution semblable à celle de Bruxelles: en 1800, la capitale bavaroise comptait 34.000 habitants; en 1880, elle en avait 230.000; en 1910, 596.000. Pour la capitale belge, les chiffres sont à peu près les mêmes. Mais cette industrialisation/urbanisation provoque des déséquilibres que la Bavière ne connaissait pas auparavant. D’abord il y a l’ensauvagement des moeurs: si la liaison entre Louis I et Lola Montez avait fait scandale, alors qu’elle était toute romantique et innocente, les trottoirs de la ville sont désormais livrés à une prostitution hétérosexuelle et homosexuelle qui n’épargne pas les mineurs d’âge. Il y a ensuite les mutations politiques qu’entraîne le double phénomène moderne de l’industrialisation et de l’urbanisation: les forces politiques conservatrices et catholiques, qui avaient tenu le haut du pavé avant l’avènement du Prince-Régent Luitpold, sont remises en question par la bourgeoisie libérale (déjà hostile aux rois mécènes) et par le prolétariat.
Son successeur sur le trône bavarois, Maximilien II, règnera de 1848 à 1864. En dépit des cabales menées contre son père, il poursuivra l’oeuvre de ce dernier, ajoutant au classicisme une touche de futurisme, en faisant construire un palais des glaces (de fer et de verre) comme celui de Londres, prélude à une architecture différente qui ne table plus uniquement sur la pierre comme matériau de construction. Maximilien II attire des savants d’Allemagne du Nord à Munich, qui ne sont évidemment pas des Bavarois de souche: on parlera alors des “Nordlichter”, des “Lumières du Nord”. Louis II, qui règne de 1864 à 1886, prônera une nouvelle architecture romantique, inspirée par les opéras de Wagner, par le moyen âge, riche en ornementations. On connaît ses châteaux, dont celui, merveilleux, de Neuschwanstein. Cette politique se heurte également à une bourgeoisie philistine, insensible à toute forme de beauté. Après Louis II, après sa mort étrange, le Prince-Régent Luitpold, aimé du peuple, préconise une industrialisation et une urbanisation de la Bavière. Munich connaît alors une évolution semblable à celle de Bruxelles: en 1800, la capitale bavaroise comptait 34.000 habitants; en 1880, elle en avait 230.000; en 1910, 596.000. Pour la capitale belge, les chiffres sont à peu près les mêmes. Mais cette industrialisation/urbanisation provoque des déséquilibres que la Bavière ne connaissait pas auparavant. D’abord il y a l’ensauvagement des moeurs: si la liaison entre Louis I et Lola Montez avait fait scandale, alors qu’elle était toute romantique et innocente, les trottoirs de la ville sont désormais livrés à une prostitution hétérosexuelle et homosexuelle qui n’épargne pas les mineurs d’âge. Il y a ensuite les mutations politiques qu’entraîne le double phénomène moderne de l’industrialisation et de l’urbanisation: les forces politiques conservatrices et catholiques, qui avaient tenu le haut du pavé avant l’avènement du Prince-Régent Luitpold, sont remises en question par la bourgeoisie libérale (déjà hostile aux rois mécènes) et par le prolétariat.
Bipolarisme politique
Un bipolarisme politique voit le jour dans la seconde moitié du 19ème siècle avec, d’une part, le “Patriotenpartei”, fondé en 1868, rassemblant les forces conservatrices catholiques, hostiles à la Prusse protestante et au “Kulturkampf” anti-clérical lancé par le Chancelier Bismarck. Pour les “Patrioten”, l’identité bavaroise est catholique et conservatrice. Les autres idées, importées, sont nuisibles. Face à ce rassemblement conservateur et religieux se dresse, d’autre part, le “parti social-démocrate”, fondé en 1869, qui parvient à rassembler 14% des suffrages à Munich lors des élections de 1878. Le chef de file des sociaux-démocrates, Georg von Vollmar, n’est pas un extrémiste: il s’oppose à tout dogmatisme idéologique et se profile comme un réformiste pragmatique. Cette politique paie: en 1890, les socialistes modérés et réformistes obtiennent la majorité à Munich. La ville est donc devenue rouge dans un environnement rural et semi-rural bavarois majoritairement conservateur et catholique. Cette mutation du paysage politique bavarois s’effectue sur fond d’un antisémitisme ambiant, qui n’épargne que quelques vieilles familles israélites, dont celle du mécène Alfred Pringsheim. Les Juifs, dans l’optique de cet antisémitisme bavarois, sont considérés comme les vecteurs d’une urbanisation sauvage qui a provoqué l’effondrement des bonnes moeurs; on les accuse, notamment dans les colonnes d’une feuille populaire intitulée “Grobian”, de spéculer dans le secteur immobilier et d’être les “produits collatéraux” du progrès, notamment du “progrès automobile”. Cet antisémitisme provoque une rupture au sein des forces conservatrices, suite à la fondation en 1891 d’un nouveau mouvement politique, le “Deutsch-Sozialer Verein” ou DSV, sous la houlette de Viktor Hugo Welcker qui, armé de quelques arguments tirés de cet antisémitisme, entame une campagne sociale et populaire contre les grands magasins, les agences immobilières et les chaînes de petits commerces en franchise, dont les tenanciers ne sont pas les véritables propriétaires de leur boutique.
Les pangermanistes
A l’émergence du DSV s’ajoute celle des cercles pangermanistes (“Alldeutscher Verband”) qui véhiculent également une forme d’antisémitisme mais sont constitués en majorité de protestants d’origine nord-allemande installés en Bavière et hostiles au catholicisme sociologique bavarois qu’ils jugent “rétrograde”. Les pangermanistes vont dès lors s’opposer à ce particularisme catholique bavarois et, par voie de conséquence, au “Patriotenpartei”. Pour les pangermanistes, la Bavière doit se détacher de l’Autriche et de la Bohème majoritairement tchèque, parce que celles-ci ne sont pas “purement allemandes”. Dans une seconde phase, les pangermanistes vont articuler dans la société bavaroise un anti-christianisme sous l’impulsion de l’éditeur Julius Friedrich Lehmann. Pour ce dernier et pour les théoriciens qui lui sont proches, une lutte systématique et efficace contre le christianisme permettrait aux Allemands de mieux résister à l’emprise du judaïsme ou, quand cet anti-christianisme n’est qu’anti-confessionnel et ne touche pas à la personne du Christ, de faire éclore une “chrétienté germanique” mâtinée d’éléments de paganisme. Cette attitude du mouvement pangermaniste en Bavière ou en Autriche s’explique partiellement par le fait que la hiérarchie catholique avait tendance à soutenir les populations rurales slaves de Bohème, de Slovénie ou de Croatie, plus pieuses et souvent plus prolifiques sur le plan démographique. Les protestants “germanisés” dans le cadre du pangermanisme affirmaient que l’Allemagne et la Bavière avaient besoin d’un “nouveau Luther”.
Le contre-monde de Schwabing
Telle était donc la scène politique qui animait la Bavière dans les deux décennies qui ont précédé la première guerre mondiale. Deuxième question de notre exposé aujourd’hui: comment le choc des visions du monde (car c’est bien de cela qu’il s’agit) s’est-il manifesté à Munich au sein de la bohème littéraire, productrice d’oeuvres qui nous interpellent encore et toujours? Cette bohème littéraire a, de fait, généré un contre-monde libre-penseur, débarrassé du fardeau des “tu dois”, propre au chameau de la fable de Nietzsche, un contre-monde qui devait s’opposer aux raideurs du wilhelminisme prussien. On peut dire aujourd’hui que la bohème munichoise était une sorte d’extra-territorialité, installée dans les cafés à la mode du faubourg de Schwabing. Les “Schwabinger” vont remplacer les “Nordlichter” en préconisant une sorte de “laisser-aller joyeux et sensuel” (“sinnenfrohe Schlamperei”) contre les “ours lourdauds en leur cerveau” (“bärenhaft dumpf im Gehirn”). Cette volonté de rendre l’humanité allemande plus joyeuse et plus sensuelle va amorcer un combat contre les étroitesses de la religion (tant catholique que protestante), va refuser les rigidités de l’Etat (et du militarisme prussien), va critiquer la domination de plus en plus patente de la technique et de l’argent (en déployant, à ce niveau-là, une nouvelle forme d’antisémitisme antimoderne). Les “Schwabinger”, dans leurs critiques, vont englober éléments de droite et de gauche.
Le 18 décembre 1890 est le jour de la fondation de la “Gesellschaft für modernes Leben” (“Société pour la vie moderne”), une association animée par Michael Georg Conrad (très hostile aux catholiques), Otto Julius Bierbaum, Julius Schaumberger, Hanns von Gumppenberg. Pour Conrad, qu’admirait Arthur Moeller van den Bruck, la tâche principale de la littérature est “d’abattre les vaches sacrées” (tâche encore plus urgente aujourd’hui!). Conrad s’attaquera à la personnalité de l’Empereur Guillaume II, “le monarque qui n’a pas le temps”, lui reprochant sa frénésie à voyager partout dans le monde, à sacrifier au culte de la mobilité fébrile propre à la Belle Epoque. Conrad sera plusieurs fois condamné pour “crime de lèse-majesté” et subira même un internement de deux mois en forteresse. Mais cet irrévérencieux n’est pas ce que nous appelerions aujourd’hui un “gauchiste”. Il s’oppose avec virulence à l’emprise sur Munich de la SPD sociale-démocrate et de son idéologie de la lutte des classes. Conrad veut une réconciliation des masses et de la monarchie, en dépit des insuffisances actuelles et conjoncturelles du wilhelminisme. Pour lui, les socialistes et les ultramontains sont à mettre dans le même sac car ces deux forces politiques ont pour objectif de détruire “l’esprit national”, lequel n’est nullement “bigot”, “bourgeois” au sens de “Biedermeier” mais, au contraire, doit s’affirmer comme insolent (“frech”) et moqueur (“pfiffig”). L’Allemand de demain doit être, selon Conrad, “uilenspiegelien” (la mère de Charles De Coster était munichoise!) et opposer aux établis coincés le cortège de ses frasques et de ses farces. La littérature a dès lors pour but de “libérer la culture allemande de tout fatras poussiéreux” (“Die deutsche Kultur von allem Angestaubten zu befreien”). L’art est l’arme par excellence de ce combat métapolitique.
Insolence et moqueries
 Insolence et moqueries dans ce combat métapolitique de libération nationale seront incarnées par Oskar Panizza (1853-1921), psychiatre et médecin militaire, auteur de pièces de théâtre et de poèmes. Panizza s’insurge contre le moralisme étouffant de son époque, héritage du formatage chrétien. Pour lui, la sensualité (souvent hyper-sexualisée) est la force motrice de la littérature et de l’art, par voie de conséquence, le moralisme ambiant est totalement incompatible avec le génie littéraire. Panizza consigne ces visions peu conventionnelles (mais dérivées d’une certaine psychanalyse) et blasphématoires dans une série d’écrits et de conférences visant à détruire l’image édulcorée que les piétistes se faisait de l’histoire de la littérature allemande. Dans une pièce de théâtre, “Das Liebeskonzil”, il se moque du mythe chrétien de la Sainte Famille, ce qui lui vaut une condamnation à un an de prison pour atteinte aux bonnes moeurs et aux sentiments religieux: c’est la peine la plus sévère prononcée dans l’Allemagne wilhelminienne à l’encontre d’un auteur. Une certaine gauche spontanéiste, dans le sillage de mai 68, a tenté de récupérer Oskar Panizza mais n’a jamais pu annexer son antisémitisme affiché, de facture pansexualiste et délirante. Panizza, en effet, voyait le judaïsme, et le catholicisme figé, pharisaïque, qui en découlait, comme une source de l’anti-vitalisme dominant en Europe qui conduit, affirmait-il avec l’autorité du médecin-psychiatre, à l’affadissement des âmes et à la perversité sexuelle. Ses tribulations, jugées scandaleuses, le conduisent à un exil suisse puis français afin d’échapper à une condamnation en Allemagne pour lèse-majesté. En 1904, pour se soustraire au jugement qui allait immanquablement le condamner, il sort nu dans la rue, est arrêté, considéré comme fou et interné dans un asile psychatrique, où il mourra en 1921.
Insolence et moqueries dans ce combat métapolitique de libération nationale seront incarnées par Oskar Panizza (1853-1921), psychiatre et médecin militaire, auteur de pièces de théâtre et de poèmes. Panizza s’insurge contre le moralisme étouffant de son époque, héritage du formatage chrétien. Pour lui, la sensualité (souvent hyper-sexualisée) est la force motrice de la littérature et de l’art, par voie de conséquence, le moralisme ambiant est totalement incompatible avec le génie littéraire. Panizza consigne ces visions peu conventionnelles (mais dérivées d’une certaine psychanalyse) et blasphématoires dans une série d’écrits et de conférences visant à détruire l’image édulcorée que les piétistes se faisait de l’histoire de la littérature allemande. Dans une pièce de théâtre, “Das Liebeskonzil”, il se moque du mythe chrétien de la Sainte Famille, ce qui lui vaut une condamnation à un an de prison pour atteinte aux bonnes moeurs et aux sentiments religieux: c’est la peine la plus sévère prononcée dans l’Allemagne wilhelminienne à l’encontre d’un auteur. Une certaine gauche spontanéiste, dans le sillage de mai 68, a tenté de récupérer Oskar Panizza mais n’a jamais pu annexer son antisémitisme affiché, de facture pansexualiste et délirante. Panizza, en effet, voyait le judaïsme, et le catholicisme figé, pharisaïque, qui en découlait, comme une source de l’anti-vitalisme dominant en Europe qui conduit, affirmait-il avec l’autorité du médecin-psychiatre, à l’affadissement des âmes et à la perversité sexuelle. Ses tribulations, jugées scandaleuses, le conduisent à un exil suisse puis français afin d’échapper à une condamnation en Allemagne pour lèse-majesté. En 1904, pour se soustraire au jugement qui allait immanquablement le condamner, il sort nu dans la rue, est arrêté, considéré comme fou et interné dans un asile psychatrique, où il mourra en 1921.
Le “Simplicissimus”
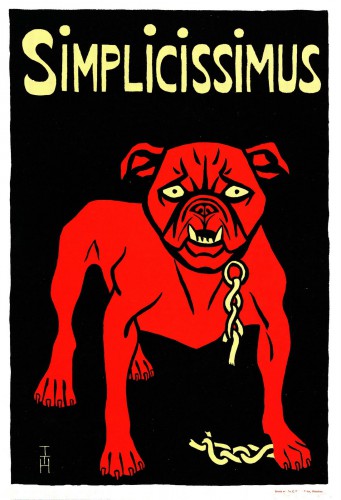 En 1896 se crée à Munich la fameuse revue satirique “Simplicissimus” qui, d’emblée, se donne pour tâche de lutter contre toutes les formes de puritanisme, contre le culte des parades et de la gloriole propre au wilhelminisme, contre la prussianisation de l’Allemagne du Sud (“Simplicissimus” lutte à la fois contre le prussianisme et le catholicisme, la Prusse étant perçue comme un “Etat rationnel”, trop sérieux et donc “ennemi de la Vie”), contre le passéisme bigot et rural de la Bavière. On peut dès lors constater que la revue joue sur un éventail d’éléments culturels et politiques présents en Bavière depuis les années 70 du 19ème siècle. Le symbole de la revue est un “bouledogue rouge”, dont les dents symbolisent l’humour agressif et le mordant satirique que la revue veut incarner. Le mot d’ordre des fondateurs du “Simplicissimus” est donc “bissig sein”, “être mordant”. Cette attitude, prêtée au bouledogue rouge, veut faire comprendre au public que la revue n’adoptera pas le ton des prêcheurs moralistes, qu’elle n’entend pas répéter inlassablement des modes de pensée fixes et inaltérables, tous signes patents d’une “mort spirituelle”. En effet, selon Dilthey (puis selon l’heideggerien Hans Jonas), on ne peut définir une chose que si elle est complètement morte, donc incapable de produire du nouveau, par l’effet de sa vitalité, même atténuée.
En 1896 se crée à Munich la fameuse revue satirique “Simplicissimus” qui, d’emblée, se donne pour tâche de lutter contre toutes les formes de puritanisme, contre le culte des parades et de la gloriole propre au wilhelminisme, contre la prussianisation de l’Allemagne du Sud (“Simplicissimus” lutte à la fois contre le prussianisme et le catholicisme, la Prusse étant perçue comme un “Etat rationnel”, trop sérieux et donc “ennemi de la Vie”), contre le passéisme bigot et rural de la Bavière. On peut dès lors constater que la revue joue sur un éventail d’éléments culturels et politiques présents en Bavière depuis les années 70 du 19ème siècle. Le symbole de la revue est un “bouledogue rouge”, dont les dents symbolisent l’humour agressif et le mordant satirique que la revue veut incarner. Le mot d’ordre des fondateurs du “Simplicissimus” est donc “bissig sein”, “être mordant”. Cette attitude, prêtée au bouledogue rouge, veut faire comprendre au public que la revue n’adoptera pas le ton des prêcheurs moralistes, qu’elle n’entend pas répéter inlassablement des modes de pensée fixes et inaltérables, tous signes patents d’une “mort spirituelle”. En effet, selon Dilthey (puis selon l’heideggerien Hans Jonas), on ne peut définir une chose que si elle est complètement morte, donc incapable de produire du nouveau, par l’effet de sa vitalité, même atténuée.
L’homme qui se profile derrière la revue “Simplicissimus”, en abrégé “Der Simpl’”, est Albert Langen (fondateur d’une maison d’édition qui existe toujours sous le nom de “Langen-Müller”). Il est alors âgé de 27 ans. Il rejette le wilhelminisme comme David Herbert Lawrence rejetait le victorianisme en Angleterre ou August Strindberg l’oscarisme en Suède. Cette position anti-wilhelminienne ne participe pas d’une hostilité au patriotisme allemand: au contraire, Albert Langen veut, pour la nation, contribuer à faire éclore des idéaux combattifs, finalement assez agressifs. Les modèles dont il s’inspire pour sa revue sont français car en France existe une sorte de “métapolitique satirique”, incarnée, entre autres initiatives, par le “Gil Blas illustré”. Pour confectionner le pendant allemand de cette presse parisienne irrévérencieuse, Langen recrute Ludwig Thoma, virtuose des injures verbales, comme le seront aussi un Léon Daudet en France ou un Léon Degrelle en Belgique; ensuite l’Israélite Thomas Theodor Heine, excellent caricaturiste qui fustigeait les philistins, les ploutocrates, les fonctionnaires et les officiers. Le dramaturge Frank Wedekind se joint au groupe rédactionnel pour railler les hypocrisies de la société moderne, industrialisée et urbanisée. Langen, Heine et Wedekind finissent par être, à leur tour, poursuivis pour crime de lèse-majesté. Langen s’exile à Paris. Heine écope de six mois de prison et Wedekind de sept mois. Du coup, la revue, qui tirait à 15.000 exemplaires, peut passer à un tirage de 85.000.
Pour une armée nouvelle
 Les moqueries adressées à la personne de l’Empereur ne signifient pas que nos trois auteurs niaient la nécessité d’une autorité monarchique ou impériale. Au contraire, leur objectif est de rétablir l’autorité de l’Etat face à un monarque qui est “pose plutôt que substance”, attitude risible, estiment-ils, qui s’avère dangereuse pour la substance politique du IIème Reich. Les poses et les parades du wilhelminisme sont la preuve, disaient-ils, d’une immaturité politique dangereuse face à l’étranger, plus équilibré et moins théâtral dans ses affirmations. S’ils critiquaient la caste des officiers modernes, recrutés hors des catégories sociales paysannes et aristocratiques traditionnellement pourvoyeuses de bons soldats, c’est parce que ces nouveaux officiers modernes étaient brutaux et froids et non plus sévères et paternels: nos auteurs plaident pour une armée efficace, soudée, capable de prester les tâches qu’on réclame d’elle. De même, notre trio du “Simpl’”, derrière leurs satires, réclament une meilleure formation technique de la troupe et fustigent l’anti-militarisme des sociaux-démocrates.
Les moqueries adressées à la personne de l’Empereur ne signifient pas que nos trois auteurs niaient la nécessité d’une autorité monarchique ou impériale. Au contraire, leur objectif est de rétablir l’autorité de l’Etat face à un monarque qui est “pose plutôt que substance”, attitude risible, estiment-ils, qui s’avère dangereuse pour la substance politique du IIème Reich. Les poses et les parades du wilhelminisme sont la preuve, disaient-ils, d’une immaturité politique dangereuse face à l’étranger, plus équilibré et moins théâtral dans ses affirmations. S’ils critiquaient la caste des officiers modernes, recrutés hors des catégories sociales paysannes et aristocratiques traditionnellement pourvoyeuses de bons soldats, c’est parce que ces nouveaux officiers modernes étaient brutaux et froids et non plus sévères et paternels: nos auteurs plaident pour une armée efficace, soudée, capable de prester les tâches qu’on réclame d’elle. De même, notre trio du “Simpl’”, derrière leurs satires, réclament une meilleure formation technique de la troupe et fustigent l’anti-militarisme des sociaux-démocrates.
Sur le plan géopolitique, la revue “Simplicissimus” a fait preuve de clairvoyance. En 1903, elle réclame une attitude allemande plus hostile aux Etats-Unis, qui viennent en 1898 d’arracher à l’Espagne les Philippines et ses possessions dans les Caraïbes, l’Allemagne héritant de la Micronésie pacifique auparavant hispanique. L’Allemagne et l’Europe, affirmaient-ils, doivent trouver une réponse adéquate à la Doctrine de Monroe, qui vise à interdire le Nouveau Monde aux vieilles puissances européennes et à une politique agressive de Washington qui chasse les Européens du Pacifique, en ne tenant donc plus compte du principe de Monroe, “l’Amérique aux Américains”. Le “Simpl’” adopte ensuite une attitude favorable au peuple boer en lutte contre l’impérialisme britannique. Il est plus souple à l’égard de la France (qui avait offert l’asile politique à Langen). Il est en revanche hostile à la Russie, alliée traditionnelle de la Prusse.
Les cabarets
 A côté du “Simplicissimus”, le Munich de la première décennie du 20ème siècle voit naître le cabaret “Die Elf Scharfrichter” (“Les onze bourreaux”) qui marquera durablement la chronique entre 1901 et 1903. Ce cabaret, lui aussi, se réfère à des modèles étrangers ou non bavarois: “Le chat noir” de Paris, “Il quatre cats” de Barcelone, le “Bat” de Moscou et l’“Überbrettl” de Berlin. Les inspirateurs français de ce cabaret munichois étaient Marc Henry et Achille Georges d’Ailly-Vaucheret. Mais Berlinois et Bavarois appliquent les stratégies du rire et de l’arrachage des masques préconisées par Nietzsche. En effet, la référence au comique, à l’ironie et au rire chez Nietzsche est évidente: des auteurs contemporains comme Alexis Philonenko ou Jenny Gehrs nous rappellent l’importance critique de ce rire nietzschéen, antidote précieux contre les routines, les ritournelles des conformistes et des pharisiens puis, aujourd’hui, contre la critique aigre et inféconde lancée par l’Ecole de Francfort et Jürgen Habermas. Jenny Gehrs démontre que les cabarets et leur pratique de la satire sont étroitement liés aux formes de critique que suggérait Nietzsche: pour celui-ci, l’ironie déconstruit et détruit les systèmes de valeurs et les modes de pensée qui figent et décomposent par leurs raideurs et leur incapacité vitale à produire de la nouveauté féconde. L’ironie est alors expression de la joie de vivre, de la légèreté d’âme, ce qui n’induit pas une absence de sériosité car le comique, l’ironie et la satire sont les seules voies possibles pour échapper à l’ère du nihilisme, les raideurs, rigidités, pesanteurs ne produisant que “nihil”, tout comme le “politiquement correct” et les conventions idéologiques de notre temps ne produisent aucune pensée féconde, aucune pensée capable de sortir des ornières où l’idéologie et les praxis dominantes se sont enlisées. La pratique de l’ironie implique d’adopter une pensée radicale complètement dépourvue d’indulgence pour les conventions établies qui mutilent et ankylosent les âmes. L’art, pour nos contestataires munichois comme pour Jenny Gehrs, est le moyen qu’il faut déployer pour détruire les raideurs et les rigidités qui mènent le monde à la mort spirituelle. Alexis Philonenko rappelle que sans le rire, propre de l’homme selon Bergson, les sociétés basculent à nouveau dans l’animalité et ruinent les ressorts et les matrices de leur propre culture de base. Si ne règnent que des constructions idéalisées (par les médiacrates par exemple) ou posées comme indépassables ou éternelles, comme celle de la pensée unique, de la bien-pensance ou du “politiquement correct”, le monde sombrera dans la mélancolie, signe du nihilisme et du déclin de l’homme européen. Dans ce cas, il n’y a déjà plus de perspectives innovantes, plus aucune possibilité de faire valoir nuances ou diversités. Le monde devient gris et terne. Pour nos cabaretistes munichois, le wilhelminisme était une praxis politique dominante qui annonçait déjà ce monde gris à venir, où l’homme ne serait plus qu’un pantins aux gestes répétitifs. Il fallait réagir à temps, imméditement, pour que la grisaille envahissante ne dépasse pas la première petite étape de son oeuvre de “monotonisation”.
A côté du “Simplicissimus”, le Munich de la première décennie du 20ème siècle voit naître le cabaret “Die Elf Scharfrichter” (“Les onze bourreaux”) qui marquera durablement la chronique entre 1901 et 1903. Ce cabaret, lui aussi, se réfère à des modèles étrangers ou non bavarois: “Le chat noir” de Paris, “Il quatre cats” de Barcelone, le “Bat” de Moscou et l’“Überbrettl” de Berlin. Les inspirateurs français de ce cabaret munichois étaient Marc Henry et Achille Georges d’Ailly-Vaucheret. Mais Berlinois et Bavarois appliquent les stratégies du rire et de l’arrachage des masques préconisées par Nietzsche. En effet, la référence au comique, à l’ironie et au rire chez Nietzsche est évidente: des auteurs contemporains comme Alexis Philonenko ou Jenny Gehrs nous rappellent l’importance critique de ce rire nietzschéen, antidote précieux contre les routines, les ritournelles des conformistes et des pharisiens puis, aujourd’hui, contre la critique aigre et inféconde lancée par l’Ecole de Francfort et Jürgen Habermas. Jenny Gehrs démontre que les cabarets et leur pratique de la satire sont étroitement liés aux formes de critique que suggérait Nietzsche: pour celui-ci, l’ironie déconstruit et détruit les systèmes de valeurs et les modes de pensée qui figent et décomposent par leurs raideurs et leur incapacité vitale à produire de la nouveauté féconde. L’ironie est alors expression de la joie de vivre, de la légèreté d’âme, ce qui n’induit pas une absence de sériosité car le comique, l’ironie et la satire sont les seules voies possibles pour échapper à l’ère du nihilisme, les raideurs, rigidités, pesanteurs ne produisant que “nihil”, tout comme le “politiquement correct” et les conventions idéologiques de notre temps ne produisent aucune pensée féconde, aucune pensée capable de sortir des ornières où l’idéologie et les praxis dominantes se sont enlisées. La pratique de l’ironie implique d’adopter une pensée radicale complètement dépourvue d’indulgence pour les conventions établies qui mutilent et ankylosent les âmes. L’art, pour nos contestataires munichois comme pour Jenny Gehrs, est le moyen qu’il faut déployer pour détruire les raideurs et les rigidités qui mènent le monde à la mort spirituelle. Alexis Philonenko rappelle que sans le rire, propre de l’homme selon Bergson, les sociétés basculent à nouveau dans l’animalité et ruinent les ressorts et les matrices de leur propre culture de base. Si ne règnent que des constructions idéalisées (par les médiacrates par exemple) ou posées comme indépassables ou éternelles, comme celle de la pensée unique, de la bien-pensance ou du “politiquement correct”, le monde sombrera dans la mélancolie, signe du nihilisme et du déclin de l’homme européen. Dans ce cas, il n’y a déjà plus de perspectives innovantes, plus aucune possibilité de faire valoir nuances ou diversités. Le monde devient gris et terne. Pour nos cabaretistes munichois, le wilhelminisme était une praxis politique dominante qui annonçait déjà ce monde gris à venir, où l’homme ne serait plus qu’un pantins aux gestes répétitifs. Il fallait réagir à temps, imméditement, pour que la grisaille envahissante ne dépasse pas la première petite étape de son oeuvre de “monotonisation”.
Franziska zu Reventlow
 Franziska zu Reventlow est la figure féminine qui opère la jonction entre ce Schwabing anarchisant et la “révolution conservatrice” proprement dite, parce qu’elle a surtout fréquenté le cercle des Cosmiques autour de Stefan George, où se manifestaient également deux esprits profonds, Alfred Schuler et Ludwig Klages, dont la pensée n’a pas encore été entièrement exploitée jusqu’ici en tous ses possibles. David Clay Large définit la vision du monde de Franziska zu Reventlow comme “un curieux mélange d’idées progressistes et réactionnaires”. Surnommée la “Reine de Schwabing”, elle est originaire d’Allemagne du Nord, de Lübeck, d’une famille aristocratique connue, mais, très tôt, elle a rué dans les brancards, sa nature rebelle passant outre toutes les conventions sociales. La lecture du Norvégien Ibsen —il y avait un “Ibsen-Club” à Lübeck— du Français Emile Zola, du socialiste allemand Ferdinand Lassalle et, bien entendu, de Friedrich Nietzsche, dont le “Zarathoustra” constituait sa “source sacrée” (“geweihte Quelle”). Elle arrive à Schwabing à 22 ans et, aussitôt, Oskar Panizza la surnomme “la Vénus du Slesvig-Holstein” (“Die schleswig-holsteinsche Venus”), tout en ajoutant, perfide, qu’elle était “très sale”. Les frasques de Franziska ont choqué sa famille qui l’a déshéritée. A Munich, elle crève de faim, ne prend qu’un maigre repas par jour et se came au laudanum pour atténuer les douleurs qui l’affligent. Rapidement, elle collectionne quelques dizaines d’amants, se posant comme “mère libre” (“freie Mutter”) et devenant ainsi l’icône du mouvement féministe, une sorte de “sainte païenne”.
Franziska zu Reventlow est la figure féminine qui opère la jonction entre ce Schwabing anarchisant et la “révolution conservatrice” proprement dite, parce qu’elle a surtout fréquenté le cercle des Cosmiques autour de Stefan George, où se manifestaient également deux esprits profonds, Alfred Schuler et Ludwig Klages, dont la pensée n’a pas encore été entièrement exploitée jusqu’ici en tous ses possibles. David Clay Large définit la vision du monde de Franziska zu Reventlow comme “un curieux mélange d’idées progressistes et réactionnaires”. Surnommée la “Reine de Schwabing”, elle est originaire d’Allemagne du Nord, de Lübeck, d’une famille aristocratique connue, mais, très tôt, elle a rué dans les brancards, sa nature rebelle passant outre toutes les conventions sociales. La lecture du Norvégien Ibsen —il y avait un “Ibsen-Club” à Lübeck— du Français Emile Zola, du socialiste allemand Ferdinand Lassalle et, bien entendu, de Friedrich Nietzsche, dont le “Zarathoustra” constituait sa “source sacrée” (“geweihte Quelle”). Elle arrive à Schwabing à 22 ans et, aussitôt, Oskar Panizza la surnomme “la Vénus du Slesvig-Holstein” (“Die schleswig-holsteinsche Venus”), tout en ajoutant, perfide, qu’elle était “très sale”. Les frasques de Franziska ont choqué sa famille qui l’a déshéritée. A Munich, elle crève de faim, ne prend qu’un maigre repas par jour et se came au laudanum pour atténuer les douleurs qui l’affligent. Rapidement, elle collectionne quelques dizaines d’amants, se posant comme “mère libre” (“freie Mutter”) et devenant ainsi l’icône du mouvement féministe, une sorte de “sainte païenne”.
Quel est le “féminisme” de Franziska zu Reventlow? Ce n’est évidemment pas celui qui domine dans les esprits de nos jours ou qui a animé le mouvement des suffragettes. Pour la Vénus de Schwabing, le mouvement de libération des femmes ne doit pas demander à ce qu’elles puissent devenir banquières ou courtières en assurances ou toute autre horreur de ce genre. Non, les femmes vraiment libérées, pour Franziska zu Reventlow, doivent incarner légèreté, beauté et joie, contrairement aux émancipées acariâtres que nous avons connues naguère, les “Emanzen” dont se moquent aujourd’hui les Allemands. Franziska les appelaient déjà les “sombres viragos” (“Die finstere Viragines”). Si les femmes libérées ne deviennent ni légères ni belles ni joyeuses le monde deviendra atrocement ennuyeux et sombrera dans la névrose, bannissant en même temps toute forme charmante d’érotisme.
Les “Cosmiques” de Schwabing

Malgré le scandale que suscite ses positions féministes et libératrices, Franziska zu Reventlow demeure d’une certaine manière “conservatrice” car elle valorise le rôle de la femme en tant que mère biologique, dispensatrice de vie mais aussi d’éducation. La femme doit communiquer le sens de la beauté à ses enfants, les plonger dans le patrimoine littéraire de leur nation et de l’humanité toute entière. Cette double fonction, à la fois révolutionnaire et conservatrice, Franziska zu Reventlow la doit à sa fréquentation du cercle des “Cosmiques” de Schwabing, autour de Karl Wolfskehl et Stefan George, d’une part, d’Alfred Schuler et Ludwig Klages, d’autre part, avant la scission du groupe en deux clans bien distincts. Les “Cosmiques”, au nom d’une esthétique à la fois grèco-romaine, médiévisante et romantique, teintée de pré-raphaélisme et d’Art nouveau, présentaient tous les affects anti-industriels de l’époque, déjà repérables chez leurs prédécesseurs anglais; ils vont également renouer avec l’anti-rationalisme des premiers romantiques et manifester des affects anti-parlementaires: la raison conduit, prétendaient-ils, aux horreurs industrielles de la sur-urbanisation inesthétique et aux parlottes stériles des députés incultes, qui se prennent pour des émules de Socrate en n’émettant que de purs discours dépourvus de tous sentiments. Les “Cosmiques” toutefois ne renouent pas avec le christianisme romantique d’un Novalis, par exemple: ils déploient, surtout chez Schuler et Klages, une critique radicale du christianisme et entendent retourner aux sources païennes de la culture européenne pré-hellénique qu’ils appeleront “tellurique”, “chtonienne” ou “pélasgique”. Ce paganisme est, en filigrane, une révolte contre les poncifs catholiques du conservatisme bavarois qui n’abordent la spiritualité ou la “carnalité” de l’homme qu’en surface, avec la suffisance du pharisaïsme: pour les “Cosmiques”, “il existe des chemins sombres et secrets”, qu’il faudra redécouvrir pour redonner une “aura” à la culture, pour la ramener à la lumière. Franziska zu Reventlow, dans ses souvenirs de Schwabing, où elle se moque copieusement des “Cosmiques”, dont certains étaient tout-à-fait insensibles aux séductions de la féminité, que les hommes et les femmes qui emprunteront ces voies “sombres et secrètes” seront les initiés de demain, les “Enormes” (“Die Enormen”), tandis que ceux qui n’auront jamais l’audace de s’y aventurer ou qui voudront les ignorer au nom de conventions désuètes ou étriquées, seront les “Sans importance” (“Die Belanglosen”).
De Bachofen à Klages
Si Stefan George a été le poète le plus célèbre du groupe des “Cosmiques”, Ludwig Klages, qui se détachera du groupe en 1904, en a indubitablement été le philosophe le plus fécond, encore totalement inexploré aujourd’hui en dehors des frontières de la germanophonie. Figure de proue de ce qu’Armin Mohler a défini comme la “révolution conservatrice”, Klages ne basculera jamais dans une tentation politique quelconque; il étudiera Bachofen et Nietzsche, fusionnera leur oeuvre dans une synthèse qui se voudra “chtonienne” ou “tellurique”, tout en appliquant ses découvertes philosophiques à des domaines très pratiques comme la science de l’expression, dont les chapitres sur la graphologie le rendront mondialement célèbre. La postérité a surtout retenu de lui cette dimension de graphologue, sans toutefois vouloir se rappeler que la graphologie de Klages est entièrement tributaire de son interprétation des oeuvres de Bachofen et Nietzsche. En effet, Klages a été l’un des lecteurs les plus attentifs du philosophe et philologue bâlois Bachofen, issu des facultés de philologie classique de Bâle, tout comme Nietzsche. Klages énonce, suite à Bachofen, une théorie du matriarcat primordial, expression spontanée et non détournée de la Vie mouvante et fluide que le patriarcat a oblitéré au nom de l’Esprit, censé rigidifier les expressions vitales. L’histoire du monde est donc une lutte incessante entre la Vie et l’Esprit, entre la culture (matriarcale) et la civilisation (patriarcale). Alfred Schuler, mentor de Klages mais qui n’a laissé derrière lui que des fragments, mourra lors d’une intervention chirurgicale en 1923; Klages s’exilera en Suisse, où il décédera en 1956, après avoir peaufiné son oeuvre qui attend encore et toujours d’être pleinement explorée dans diverses perspectives: écologie, géophilosophie, proto-histoire, etc. Quant à Franziska zu Reventlow, elle quittera Munich pour une autre colonie d’artistes basée à Ascona en Suisse, une sorte de nouveau Schwabing avec, en plus, l’air tonifiant des Alpes tessinoises. Elle y mourra en 1918.
Thomas Mann patriote
La guerre de 1914 balaie le monde de Schwabing, que les conservateurs aigris voulaient voir disparaître, pour qu’il ne puisse plus les ridiculiser. Bon nombre d’artistes s’engagent dans l’armée, dont le poète Richard Dehmel et les peintres August Macke et Franz Marc (du groupe “Blauer Reiter”, le “Cavalier bleu”) qui, tous deux, ne reviendront pas des tranchées. Le “Simplicissimus” cesse de brocarder cruellement les officiers, ces “analphabètes en uniforme”, et les généraux, ces “sombres simplets”, et devient un organe patriotique intransigeant, sous prétexte qu’en temps de guerre, quand la patrie est en danger, “les muses doivent se taire” et qu’il faut participer “à une guerre qui nous est imposée” et “au combat pour défendre la culture menacée par l’étranger (belliciste)”. Thomas Mann participe à l’effort de guerre en opposant la culture (vivante, tirée d’un humus précis) à la civilisation dans un opuscule patriotique intitulé “Gedanken im Kriege” (“Idées en temps de guerre”). La culture (allemande) pour Mann, en cette fin août 1914, est “homogénéité, style, forme, attitude et bon goût”. Quant à la “civilisation”, représentée par l’Ouest, elle est “rationalité (sèche), esprit des Lumières, édulcoration, moralisme, scepticisme et dissolution”. La tâche de l’Allemagne, dans cette guerre est de défendre la fécondité vitale de la culture contre les attaques de la civilisation qui entend “corseter” les âmes, leur faire perdre leurs élans, édulcorer la littérature et la musique qui ne peuvent se développer que sur un terreau “culturel” et non “civilisationnel”. Ces idées nationales de Thomas Mann sont consignées dans “Betrachtungen eines Unpolitischen” (“Considérations d’un apolitique”). Son frère Heinrich Mann, en revanche, plaidait pour une civilisation marquée par l’humanisme de Zola, adepte d’une justice pour chaque individu, au-delà de toute institution ou cadre politique, un Zola qui s’était précisément hissé, lors de l’affaire Dreyfus, au-dessus des institutions politiques de la France: pour Heinrich, Thomas aurait dû prendre une position similaire à l’auteur du “J’accuse” et se hisser au-dessus de l’idée patriotique et de l’Etat semi-autoritaire du wilhelminisme. A partir des années vingt, les deux frères se réconcilieront sur base des idées “occidentales” de Heinrich.
Noire vision spenglerienne
Oswald Spengler était revenu à Munich en 1911, après y avoir passé une année d’étude en 1901: toujours amoureux de la ville bavaroise, il était cependant déçu en s’y réinstallant. Il ne retrouvait plus intact le style classique de Louis I, y découvrait en revanche “l’ornementalisme imbécile” de l’“Art Nouveau” et les “escroqueries expressionnistes”, toutes expressions du déclin qui affecte l’Europe entière. Pour Spengler, qui s’apprête à rédiger sa somme “Der Untergang des Abendlandes”, les affres de décadence qui marquent Munich sont autant de symboles du déclin général de l’Europe, trop influencée par les idées “civilisatrices”. Pour Spengler, la transition entre, d’une part, la phase juvénile que constitue toute culture, créatrice et d’abord un peu fruste, et, d’autre part, la phase sénescente de la civilisation, s’opère inéluctablement, comme une loi biologique et naturelle. Les hommes —les porteurs et les vecteurs de culture vieillissants— se mettent à désirer le confort et le raffinement, abandonnent les exigences créatrices de leur culture de départ, n’ont plus la force juvénile d’innover: tous les peuples d’Occident subiront ce processus de sénescence pour en arriver d’abord à un stade de lutte planétaire entre “pouvoirs césariens”, ensuite à un stade d’uniformité généralisée, à une ère des masses abruties, parquées dans des villes tentaculaires, dont l’habitat sera constitué de “casernements” sordides et sans charme. Ces masses recevront, comme dans le Bas-Empire, du pain et des jeux. Tel est, en gos, le processus de déclin que Spengler a voulu esquisser dans “Der Untergang des Abendlandes”.
Le déclin de Munich et de toute l’Europe était donc en germe avant le déclenchement de la première grande conflagration intereuropéenne. La guerre accélère le processus. Au lendemain de l’armistice de novembre 1918, nous aurons donc affaire à un autre Munich et à une autre Europe. Une autre histoire, bien différente, bien plus triste, pouvait commencer: celle de l’après-Schwabing. Avant d’assister à la lutte plénétaire entre les nouveaux Césars (Hitler, Staline, Churchill, Roosevelt). Après la victoire du César américain, l’ère des masses abruties par la consommation effrénée et par le confort matériel a commencé. Nous y sommes toujours, malgré les ressacs dus aux crises: l’aura des Cosmiques n’élit plus personne. Les masses abruties sont là, omniprésentes. Les villes tentaculaires détruisent les cultures, au Japon, au Mexique, en Afrique. Et pas seulement en Europe et en Amérique du Nord. Les jeux virtuels sont distribués à profusion. Spengler avait raison.
Robert Steuckers.
(Forest-Flotzenberg, Vlotho im Wesergebirge, été 2002).
00:05 Publié dans Histoire, Révolution conservatrice, Synergies européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, révolution conservatrice, munich, bavière, histoire, schwabing |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 29 octobre 2013
Spengler e l’anima russa

Spengler e l’anima russa
La Russia antica e la “pseudomorfosi” illuminista
 Nel Tramonto dell’Occidente[1], Oswald Spengler si sofferma ampiamente sulle peculiarità dell’anima russa. Tale analisi è collocata nella seconda parte dell’opera, che si intitola “Prospettive della storia mondiale”[2], la prima parte essendo dedicata a “Forma e realtà”, ove delinea la sua visione ciclica della storia, definisce l’“anima” di ogni civiltà, con le famose fasi, l’una ascendente (Kultur) e l’altra discendente (Zivilisation) di ogni ciclo storico, per poi tracciare una morfologia comparata delle civiltà che offre un grande scenario di macrostoria [3].
Nel Tramonto dell’Occidente[1], Oswald Spengler si sofferma ampiamente sulle peculiarità dell’anima russa. Tale analisi è collocata nella seconda parte dell’opera, che si intitola “Prospettive della storia mondiale”[2], la prima parte essendo dedicata a “Forma e realtà”, ove delinea la sua visione ciclica della storia, definisce l’“anima” di ogni civiltà, con le famose fasi, l’una ascendente (Kultur) e l’altra discendente (Zivilisation) di ogni ciclo storico, per poi tracciare una morfologia comparata delle civiltà che offre un grande scenario di macrostoria [3].
Altrettanto interessante e stimolante è l’applicazione del metodo comparativo spengleriano per studiare e decifrare l’affinità morfologica che connette interiormente la lingua delle forme di tutti i domini interni ad una data civiltà, dall’arte alla matematica alla geometria, al pensiero filosofico e al linguaggio delle forme della vita economica, essa stessa espressione di una data “anima”, ossia di un “sentimento del mondo” che contraddistingue un certo tipo di sensibilità.
In questa prospettiva, anche i fatti politici, assumono il valore di potenti simboli; per Spengler occorre saper cogliere che cosa significa il loro apparire, l’ “anima” di cui essi sono espressione.
Pseudomorfosi
Nella seconda parte dell’opera, l’Autore colloca lo studio dell’anima russa nel capitolo sulle pseudomorfosi storiche ed è partendo da questa categoria spengleriana che si può comprendere il suo modo di descrivere il mondo russo.
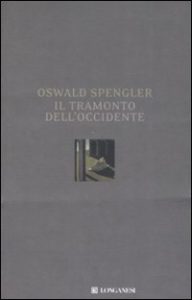 Per spiegare la pseudomorfosi, Spengler parte da una nozione di mineralogia. Egli attinge ad un fenomeno naturale per spiegare e definire un fenomeno storico, in ciò accogliendo un procedimento di osservazione scientifico-naturalistico tipico di Goethe, al quale esplicitamente si richiama nella prima parte della sua opera.
Per spiegare la pseudomorfosi, Spengler parte da una nozione di mineralogia. Egli attinge ad un fenomeno naturale per spiegare e definire un fenomeno storico, in ciò accogliendo un procedimento di osservazione scientifico-naturalistico tipico di Goethe, al quale esplicitamente si richiama nella prima parte della sua opera.
“Si supponga uno strato di calcare che contenga cristalli di un dato minerale. Si producono crepacci e fessure; l’acqua si infiltra e a poco a poco, passando, scioglie e porta via i cristalli, di modo che nel conglomerato non restano più che le cavità da essi occupate. Sopravvengono fenomeni vulcanici che fendono la montagna; colate di materiale incandescente penetrano negli spacchi, si solidificano e danno luogo ad altri cristalli. Ma esse non possono farlo in una forma propria: sono invece costrette a riempire le cavità preesistenti, e così nascono forme falsate, nascono cristalli nei quali la struttura interna contraddice la conformazione esterna, un dato minerale apparendo ora sotto le specie esteriori di un altro. E’ ciò che i mineralogisti chiamano pseudomorfosi” [4].
Dalla nozione di mineralogia passa quindi alle pseudomorfosi storiche.
“Chiamo pseudomorfosi storiche i casi nei quali una vecchia civiltà straniera grava talmente su di un paese che una civiltà nuova, congenita a questo paese, ne resta soffocata e non solo non giunge a forme sue proprie e pure di espressione, ma nemmeno alla perfetta coscienza di sé stessa. Tutto ciò che emerge dalle profondità di una giovane animità va a fluire nelle forme vuote di una vita straniera; una giovane sensibilità si fissa in opere annose e invece dell’adergersi in una libera forza creatrice nasce soltanto un odio sempre più vivo per la costrizione che ancora si subisce da parte di una realtà lontana nel tempo”[5].
Di questo fenomeno Spengler ci offre vari esempi quali la civiltà araba – che egli fa risalire, come sentimento del mondo, al III secolo a.C. – che fu costretta e soffocata nelle forme di una civiltà straniera, quale quella macedone col suo relativo dominio (impresa di Alessandro Magno e civiltà ellenistica).
Non è questa la sede per esaminare la pseudomorfosi araba, perché tale tema ci porterebbe lontano, considerando la peculiarità della visione storica spengleriana, rispetto allo specialismo della storiografia occidentale del suo tempo con la quale egli polemizza e argomenta in modo approfondito.
Altra pseudomorfosi è quella che inizia con la battaglia di Azio del 31 a. C.
“Qui non si trattò di una lotta per la supremazia della romanità o dell’ellenismo; una lotta del genere era stata già combattuta a Canne e a Ama, ove ad Annibale toccò il destino tragico di battersi non per la sua patria bensì per l’ellenismo. Ad Azio la nascente civiltà araba si trovò di fronte alla civilizzazione antica senescente. Si doveva decidere il trionfo dello spirito apollineo o di quello magico, degli dei o del Dio, del principato o del califfato. La vittoria di Antonio avrebbe liberato l’anima magica; invece la sua sconfitta ebbe per conseguenza che sul paesaggio di tale anima si riaffermarono le rigide, disanimate strutture del periodo imperiale”[6].
Pseudomorfosi russa
Un ulteriore esempio di pseudomorfosi ce lo offre la Russia di Pietro il Grande. L’anima russa originaria si esprime nelle saghe di Kiev riguardanti il principe Vladimiro (verso il 1000 d. C.) con la sua Tavola Rotonda e l’eroe popolare Ilja di Muros. Qui il pensatore tedesco coglie l’immensa differenza fra anima russa e anima faustina (ossia quella europea tesa verso l’infinito e simboleggiata dalle cattedrali gotiche) nel divario che intercorre fra tali poemi slavi e quelli sincronici – rispetto ad essi – della saga di Malthus e dei Nibelunghi del periodo delle invasioni “nella forma dell’epica di Ildebrando”[7].
Il periodo “merovingio” russo (ossia il periodo aurorale) inizia con la liberazione dal dominio tartaro di Ivan III (1480) e si sviluppa attraverso gli ultimi Rurik e i primi Romanov fino a Pietro il Grande (1689-1725). Esso corrisponde al periodo che va, in Francia, da Clodoveo(465-511) fino alla battaglia di Testry (687) con la quale i Carolingi si assicurano il potere effettivo. Spengler coglie qui un’affinità morfologica.
 “A questo periodo moscovita delle grandi stirpi bojare e dei patriarchi, durante il quale un partito della Vecchia Russia lottò continuamente contro gli amici della civiltà occidentale, segue, con la fondazione di Pietroburgo (1703) la pseudomorfosi, la quale impose all’anima russa primitiva le forme straniere dell’alto Barocco, poi quelle dell’illuminismo e infine quelle del diciannovesimo secolo. Pietro il Grande fu fatale per la civiltà russa. Si pensi alla sua corrispondenza “sincronica”, a Carlomagno, che metodicamente e con tutte le sue energie attuò ciò che Carlo Martello pochi anni prima aveva scongiurato con la sua vittoria sugli Arabi; il sopravvento dello spirito mauro-bizantino”[8].
“A questo periodo moscovita delle grandi stirpi bojare e dei patriarchi, durante il quale un partito della Vecchia Russia lottò continuamente contro gli amici della civiltà occidentale, segue, con la fondazione di Pietroburgo (1703) la pseudomorfosi, la quale impose all’anima russa primitiva le forme straniere dell’alto Barocco, poi quelle dell’illuminismo e infine quelle del diciannovesimo secolo. Pietro il Grande fu fatale per la civiltà russa. Si pensi alla sua corrispondenza “sincronica”, a Carlomagno, che metodicamente e con tutte le sue energie attuò ciò che Carlo Martello pochi anni prima aveva scongiurato con la sua vittoria sugli Arabi; il sopravvento dello spirito mauro-bizantino”[8].
Nella visione spengleriana, Pietro il Grande impone alla Russia una forma che non le è congeniale, che è lontana dallo spirito contadino, antico, mistico e religioso della Vecchia Russia. Carlomagno avrebbe mutuato in Occidente una forma mauro-bizantina (l’Impero, la struttura gerarchizzata sul modello romano-orientale) che non sarebbe stata congeniale all’Europa dell’alto Medio Evo (adopero questa periodizzazione per farmi intendere, anche se essa non è affatto spengleriana).
Qui lo studioso tedesco introduce una riflessione che è di rilievo centrale e che contribuisce a far comprendere anche la storia della Russia contemporanea.
“Lo zarismo primitivo di Mosca è l’unica forma che ancor oggi sia conforme alla natura russa, ma esso a Pietroburgo fu falsato nella forma dinastica propria all’Europa occidentale. La tendenza verso il Sud sacro, verso Bisanzio e Gerusalemme, profondamente radicata in tutte le anime greco-ortodosse, si trasformò in una diplomazia mondana, in uno sguardo rivolto verso l’Occidente … Furono importate arti e scienze tarde, l’illuminismo, l’etica sociale, il materialismo cosmopolita, benché in questo primo periodo del ciclo russo la religione fosse l’unica lingua nella quale ognuno comprendeva se stesso e comprendeva il mondo” [9].
Questa imposizione di un modello straniero generò un sentimento di odio “davvero apocalittico” contro l’Europa, intendendo con tale termine tutto quanto non era russo, anche Roma e Atene, insomma l’Occidente nella varietà ed anche nell’antichità delle sue manifestazioni.”La prima condizione a che il sentimento nazionale russo si liberi è odiare Pietroburgo con tutto il cuore e con tutta l’anima” scriveva Aksakoff a Dostoevskij.
In altri termini, Mosca è sacra, Pietroburgo è Satana e Pietro il Grande, in una leggenda popolare, viene presentato come l’Anticristo[10].
Tolstoi e Dostoevskij
Per Spengler, se si vogliono comprendere i due grandi interpreti della pseudomorfosi russa, occorre vedere in Dostoevskij il contadino, in Tolstoi l’uomo cosmopolita.
“L’uno non poté mai liberarsi interiormente dalla campagna, l’altro la campagna, malgrado ogni suo disperato sforzo, non riusci mai a ritrovarla”[11].
Qui la lettura di Spengler diviene dirompente e innovativa, con tratti tipici da “rivoluzione conservatrice”.
Egli considera, infatti, Tolstoi come la Russia del passato e Dostoevskij come simbolo della Russia dell’avvenire, il che equivale a dire che l’anima contadina antica della Russia, l’anima legata al sentimento delle radici e delle tradizioni, rappresenta l’avvenire, mentre lo spirito cosmopolita e illuminista, di stampo occidentale moderno, è destinato a tramontare.
Peraltro, questa spirito cosmopolita era profondamente divorato da un odio viscerale contro un’Europa moderna da cui non poteva liberarsi, essendovi profondamente legato. In altri termini, una sorta di amore/odio verso l’Europa.
“Tolstoi odiò potentemente l’Europa da cui non poteva liberarsi. Egli l’odiò in sé stesso e odiò se stesso. Per questo fu il padre del bolscevismo[12]..
Dostoevskij, al contrario, non nutrì un tale odio ma un fervido amore per tutto ciò che è occidentale, nel senso delle antiche radici culturali dell’Europa.
“Un simile odio Dostoevskij non lo conobbe. Egli nutrì un amore altrettanto fervido per tutto quello che è occidentale. “Io ho due patrie, la Russia e L’Europa”[13]. Questa affermazione dello scrittore russo è molto sintomatica delle sue inclinazioni. Spengler passa poi a citare un brano del romanzo I Fratelli Karamazov che è molto eloquente circa quello che lo scrittore russo intende per richiamo interiore verso l’Europa.
“Partirò per l’Europa – dice Ivan Karamazov al fratello Alioscia – io so di non andare che verso un cimitero, ma so anche che questo cimitero mi è caro, che è il più caro di tutti i cimiteri. I nostri sacri morti sono seppelliti là, ogni pietra delle loro tombe parla di una vita passata così fervida, di una fede così appassionata nelle azioni che hanno compiute, nelle loro verità, nelle loro lotte e nelle loro conoscenze che io, lo so di già, mi prosternerò per baciare quelle pietre e per piangere su di esse”[14]
L’Europa, per Dostoevskij, è quella delle radici antiche, della memoria storica, dell’identità, degli avi, delle antiche fedi e delle antiche lotte. In altri termini, l’Europa non è quella dell’illuminismo cui guardava Pietro il Grande, ma esattamente il contrario.
Mentre Tolstoi si muove nell’ottica dell’economia politica e dell’etica sociale, in una dimensione intellettualistica, tipicamente occidentale e moderna, Dostoevskij era al di là delle categorie occidentali, comprese quelle di rivoluzione e di conservatorismo.
“Per lui fra conservatorismo e rivoluzione – scrive Spengler – non vi era differenza alcuna: entrambi erano per lui fenomeni occidentali. Lo sguardo di una tale anima si librava di là da tutto quanto è sociale. Le cose di questo mondo gli apparivano così insignificanti, che egli non dette alcuna importanza al tentativo di migliorarle. Nessuna vera ragione vuole migliorare il mondo dei fatti. Come ogni vero Russo, Dostoevskij un tale mondo non lo nota affatto: gli uomini come lui vivono in un secondo mondo, in un mondo metafisico esistente di là da esso. Che cosa hanno a che vedere i tormenti di un’anima col comunismo?” [15]
Spengler conclude asserendo che “il Russo autentico è un discepolo di Dostoevskij benché non lo abbia letto, anzi proprio perché non sa leggere. Lui stesso è un pezzo di Dostoevskij”[16]
Per Spengler il cristianesimo sociale di Tolstoi era intriso di marxismo; Tolstoi parlava di Cristo ma intendeva Marx, mentre “al cristianesimo di Dostoevskij appartiene invece il millennio che viene”[17]
 L’analisi spengleriana si proietta nel futuro, anticipando di circa un secolo gli sviluppi della storia russa, in un momento storico in cui trionfava il bolscevismo e tutto sembrava andare in direzione contraria. Il punto è capire cosa intenda Spengler per “cristianesimo di Dostoevskij”. Lo studioso tedesco ha fatto riferimento a questa vocazione mistica che trascende il mondo dei fenomeni, dei fatti, ai quali l’anima russa non attribuisce un valore decisivo, il mondo metafisico essendo l’oggetto di interesse centrale e prioritario.
L’analisi spengleriana si proietta nel futuro, anticipando di circa un secolo gli sviluppi della storia russa, in un momento storico in cui trionfava il bolscevismo e tutto sembrava andare in direzione contraria. Il punto è capire cosa intenda Spengler per “cristianesimo di Dostoevskij”. Lo studioso tedesco ha fatto riferimento a questa vocazione mistica che trascende il mondo dei fenomeni, dei fatti, ai quali l’anima russa non attribuisce un valore decisivo, il mondo metafisico essendo l’oggetto di interesse centrale e prioritario.
“L’immensa differenza fra anima faustiana e anima russa si tradisce già nel suono di certe parole. Il termine russo per cielo è njèbo ed è negativo nel suo n. L’uomo d’Occidente volge il suo sguardo verso l’alto, mentre il Russo fissa i lontani orizzonti. Occorre dunque vedere la differenza dell’impulso verso la profondità dell’uno e dell’altro nel fatto che nel primo esso è una passione di penetrare da ogni lato nello spazio infinito, nel secondo è un esteriorizzarsi fino a che l’elemento impersonale nell’uomo si faccia uno con la pianura senza fine…La mistica russa non ha nulla di quel fervore, proprio al gotico, a Rembrandt, a Beethoven, che si porta verso l’alto e che può svilupparsi fino ad un giubilo che invade il cielo. Qui Dio non è la profondità azzurra delle altezze. L’amore mistico russo è quello della pianura, quello verso fratelli che subiscono lo stesso giogo, sempre nella direzione terrestre; è quello per i poveri animali tormentati che vagano sulla terra, per le piante, mai per gli uccelli, per le nubi e per le stelle” [18].
Il cristianesimo russo-ortodosso è, dunque, per Spengler, un misticismo della Madre Terra, dell’immensa pianura, degli spazi sconfinati.
Fra Spengler e Steiner
Introduco qui alcune mie riflessioni. Questa pianura sconfinata è geograficamente - e simbolicamente - un ponte fra Oriente e Occidente. La Russia è una terra che sente storicamente il richiamo di Bisanzio, ossia dell’Impero Romano d’Oriente, come ho dimostrato nei miei contributi su Toynbee e su Zolla ed il loro modo di intendere l’anima russa e i suoi archetipi.
La Russia risente, però, anche di influssi spirituali e culturali spiccatamente orientali.
Un fenomeno che merita di essere osservato con attenzione è quello dell’attuale diffusione del buddhismo in Russia (di cui abbiamo testimonianze e riscontri anche qui in Italia presso i centri buddhisti frequentati dai russi provenienti direttamente dalla loro terra), particolarmente di quello tibetano che, nella sua iconografia e nel suo simbolismo, è segnato da figure luminose, da un senso di chiarità e di Luce spirituale che tradisce anche antiche influenze iraniche, come Filippani Ronconi ha evidenziato in Zarathustra e il Mazdeismo [19].
Questa “mistica della Luce” (adopero qui tale termine in un senso lato, non tecnico) si incontra necessariamente col misticismo della Madre Terra, con propensioni tipiche dell’anima slava.
È a questo punto che va considerata la previsione di Rudolf Steiner, secondo il quale in Russia rinascerà la religione di Zarathustra[20] , ossia una nuova mistica della Luce ed un nuovo sentimento del mondo, quello della lotta fra Luce e Tenebre nella storia, nella dimensione terrena, in forme adatte ad un ben diverso contesto storico, etnico e geografico rispetto a quello in cui maturò la riforma spirituale del Profeta iranico. Nella morfologia delle civiltà di Steiner la civiltà russa sarebbe la sesta civiltà – quella del futuro – dopo le prime cinque (Indiana, Iranica, Egizio-Caldaica-Babilonese, greco-romana, anglo-tedesca) che nel loro susseguirsi denotano una sorta di movimento pendolare da est ad ovest e poi di nuovo verso est. Una tale previsione sulla rinascita della religione di Zarathustra può avere una sua plausibilità ove si consideri appunto la posizione di ponte che la terra russa ha fra Oriente e Occidente e quindi simbolicamente di collegamento, di raccordo spirituale e culturale.
Il bolscevismo aveva significato, per un arco di 70 anni, una interruzione nella comunicazione spirituale fra Oriente e Occidente, un blocco materialistico, nel che può vedersi l’azione di influenze non meramente profane, secondo quella dimensione di profondità della storia che è tipica del “metodo tradizionale”di cui Evola ha parlato ampiamente in Rivolta contro il mondo moderno e sul quale chi scrive è tornato ampiamente ne I Misteri del Sole.
Un tale culto della Luce, ove un domani dovesse diffondersi, dovrà necessariamente innestarsi sul “sentimento della pianura” costitutivo dell’anima russa, per dirla con Spengler, e cogliere nella Madre Terra – la “Santa Madre Russia” – il teatro di una lotta fra Luce e Tenebre, fra Verità e Menzogna, fra elevazione dello spirito e demonìa della materia e dell’economia.
Si colgono, in definitiva, i primi segni premonitori – dal Buddhismo al rilancio dell’Ortodossia – dell’affiorare graduale di una nuova “forma spirituale” che ha profonde connessioni col risveglio del sentimento nazionale russo, di un forte senso delle proprie tradizioni e della propria identità che si esprime oggi nella linea politica di Putin e nel suo rilancio del ruolo di grande potenza della Russia, della sua proiezione mediterranea, del suo interagire e fare blocco con le nazioni del BRICS.
La stessa legislazione contraria alla propaganda dei gay, il rifiuto di Putin a dare i bambini russi in adozione alle coppie gay in Occidente, il forte richiamo alla tradizione religiosa russo-ortodossa, l’opposizione al “politicamente corretto”, sono tutti fatti politici sintomatici di un risveglio dell’anima russa, quella antica, interpretata e sentita da Dostoevskij.
I fatti politici, come diceva Spengler, vanno letti nella loro valenza simbolica, cogliendo i fermenti profondi di cui essi sono espressione e cercando d’intuire e anticipare le linee di tendenza che essi prefigurano.
[1] L’opera è del 1917 in prima edizione; la traduzione che ho consultato e studiato fa riferimento alla seconda edizione del 1923.
[2] O.Spengler, Il Tramonto dell’Occidente, Guanda, Parma, 1991, p. 653 ss.
[3] Id., op.cit., p. 89 ss.
[4] Id., op.cit., p.927.
[5] Id., op.cit., pp.927-928
[6] Id., op .cit., pp. 930-931.
[7] Id., op.cit., p.932.
[8] Id., op.cit., p.932.
[9] Id., op.cit., pp.932-933.
[10] Id., op.cit., p. 934.
[11] Id., op.cit., p.934.
[12] Id., op.cit., p. 936.
[13] Id., op.cit., p. 936
[14] Id., op.cit., p.936.
[15] Id., op.cit., p.937.
[16] Id., op.cit., p. 939.
[17] Id., op.cit., p.939.
[18] Id., op.cit., nt.178, pp.1459-1460.
[19] P. Filippani Ronconi, Zarathustra e il Mazdeismo, Irradiazioni, Roma, 2007.
[20] R. Steiner, Miti e Misteri dell’ Egitto rispetto alle forze spirituali attive nel presente, Antroposofica, Milano, 2000.
00:05 Publié dans Philosophie, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : russie, âme russe, oswald spengler, révolution conservatrice, allemagne, philosophie, philosophie de l'histoire, histoire, pseudomorphose |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 25 octobre 2013
Conversations with History: Robert Fisk
00:05 Publié dans Actualité, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : robert fisk, histoire, entretien |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 24 octobre 2013
Conversations with History: Howard Zinn
00:09 Publié dans Entretiens, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : howard zinn, entretien, history, radical history, histoire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 22 octobre 2013
B. Lugan: les Boers contre l'impérialisme
16:28 Publié dans Evénement, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bernard lugan, histoire, événement, afrique du sud, afrique, affaires africaines, boers, impérialisme britannique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Conversations with History: Chalmers Johnson
00:04 Publié dans Actualité, Entretiens, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : chalmers johnson, histoire, entretien, états-unis, déclin américain, impérialisme, impérialisme américain |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 19 octobre 2013
UN PEUPLE PEU CONNU : LES SARMATES

Jean Pierinot
Ex: http://metamag.fr


00:05 Publié dans archéologie, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sarmates, archéologie, antiquité, proto-histoire, histoire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 17 octobre 2013
Die Geburt der Moderne
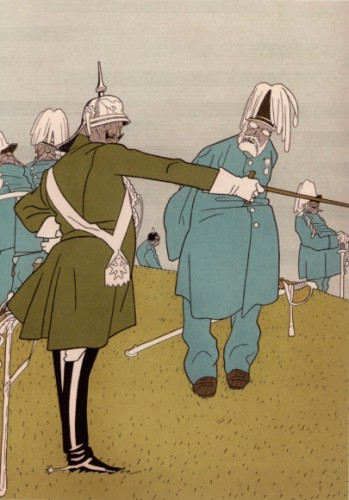
Die Geburt der Moderne
von Benjamin Jahn Zschocke
Ex: http://www.blauenarzisse.de
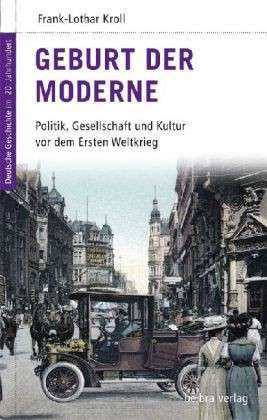 Der Nationalsozialismus ist der absolute Fixpunkt der deutschen Geschichte – wirklich alles ballt sich zu ihm hin. Alle zeitlich daran angrenzenden Epochen verschwinden in seinem Schatten.
Der Nationalsozialismus ist der absolute Fixpunkt der deutschen Geschichte – wirklich alles ballt sich zu ihm hin. Alle zeitlich daran angrenzenden Epochen verschwinden in seinem Schatten.
Der in Chemnitz lehrende Professor für Europäische Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts Frank-Lothar Kroll ist dafür bekannt, eine mittelbar an diese Zeit angrenzende Epoche, nämlich das Deutsche Kaiserreich von 1871 bis 1918, dankenswerter Weise aus diesem Schatten hervorzuholen. Unter Zuhilfenahme aller verfügbaren historischen Quellen betrachtet er diese Epoche so, wie sie war und nicht, wie sie laut der verengten Sichtweise eines „deutschen Sonderweges“ – bei einem gleichzeitig angenommenen „westeuropäischen Normalweg“ – gewesen sein soll.
Ein umfassendes Update der Quellenlage
Krolls aktuellstes Werk Geburt der Moderne. Politik, Gesellschaft und Kultur vor dem Ersten Weltkrieg unternimmt auf reichlich 200 Seiten den Versuch, einen Gesamtüberblick über die gesellschaftlichen Entwicklungslinien zwischen 1900 und 1914 zu geben. Da dies in solcher Kürze fast unmöglich scheint, verzichtet Kroll auf alle narrativen Elemente und gibt dem Leser in höchster Komprimierung sozusagen ein Update der aktuellen Quellenlage, in deren Ergebnis die Annahme des besagten „deutschen Sonderweges“ ebenso definitiv zu den Akten gelegt werden muß, wie das „persönliche Regiment“ unseres letzten Kaisers Wilhelm II.
Die seit gut fünfzig Jahren praktizierte „germanozentrische“ Herangehensweise gelangt bei Kroll ebenfalls auf die Deponie. Vielmehr gehört der historische Blickwinkel nach seinem Verständnis auf eine europäische Dimension geweitet, was allein angesichts der verästelten außenpolitischen Bündnisse dieser Epoche gar nicht anders möglich ist.
Doch Krolls Schwerpunkt liegt in diesem Buch definitiv nicht auf dem Ersten Weltkrieg: ungleich mehr interessiert ihn der kulturelle und soziale Entwicklungsstand eines Landes, das zur damaligen Zeit das fortschrittlichste der Welt war. Krolls große Stärke ist es, nicht nach Belieben zu werten, sondern nüchtern Fakten um Fakten vorzutragen und damit großkalibrig gegen die an deutschen Gymnasien, Universitäten und in den Medien herrschende Guido Knopp-Mentalität vorzugehen.
Kultureller Vorreiter des Kontinents
Besonders der kulturelle Schwerpunkt reizt an Krolls Buch. Die titelgebende These, nach der die Moderne bereits zwischen 1900 – 1914 unter Wilhelm II. ihren Anfang nahm sowie erste Schwerpunkte herauskristallisierte – und damit nicht erst in den gepriesenen (dekadenten und auf Kredit finanzierten) so genannten Goldenen Zwanzigern – macht die Lektüre besonders empfehlenswert. Walther Rathenau schrieb schon 1919 in seinem Text Der Kaiser: „Für Kunst lag [beim Kaiser, Anm. BJZ] eine entschiedene formale Begabung zugrunde, die in rätselhafter Weise über die kunstfremde Umgebung emporhob […]. So ergab sich von selbst der Anspruch des künstlerischen Oberkommandos.“
Unter anderem am Beispiel der Kulturreform aber auch der Jugendbewegung arbeitet Kroll heraus, welche in Europa zur damaligen Zeit einmalige Fülle an verschiedenartigsten Kulturinstitutionen entstand und sich in aller Ruhe, teils sogar mit erheblichen Finanzspritzen, entwickeln konnte. Am bekanntesten sind auf dem Gebiet der Kunst wohl die Strömungen des Jugendstils, des Expressionismus und des Impressionismus, die zwischen 1900 – 1914 ihren Anfang nahmen. Besonders mit Blick auf Letzteren lohnt ebenso die Lektüre des bereits 1989 bei Königshausen & Neumann erschienenen Werkes von Josef Kern Impressionismus im Wilhelminischen Deutschland.
Weimars Probleme im Voraus erkannt – und behoben
Der oben mit „Guido Knopp-Mentalität“ zusammengefaßten Erscheinung heutiger Geschichtsschreibung (eigentlich politischer Bildung), tritt Kroll mit aller Entschiedenheit entgegen: Erhellend sind zum Beispiel seine Erkenntnisse auf dem Gebiet der Presse– und Parteienlandschaft. Er spricht hier von einem „beispiellosen Pluralismus“. Außerdem wird die vielzitierte, himmelschreiende Armut der späten Phase der Industrialisierung (auf die im gymnasialen Geschichtsunterricht „zufällig“ eine monatewährende Behandlung der deutschen Arbeiterbewegung folgt) als Ammenmärchen enttarnt: „Wirkliche Massenarmut, die zur Verelendung trieb, gab es im wilhelminischen Deutschland – anders als im viktorianischen und edwardianischen England – nicht, wenngleich, die Mehrheit der Arbeiterschaft von sehr bescheidenen Einkommen zehrte.“
Am schwerwiegendsten sind, mit Blick auf den anfangs benannten Schatten einer gewissen Epoche wohl Krolls Feststellungen zum angeblich durch und durch judenfeindlichen Deutschland unter Wilhelm II.: „Die unmissverständliche Zurückweisung solcher Zumutungen seitens des Kaisers und der Reichsregierung verdeutlichte einmal mehr, dass im ‚ausgleichenden Klima des wilhelminischen Obrigkeitsstaates‘ dem politischen Einfluss radikalisierter Massen und Massenbewegungen, anders als in den späten Jahren der Weimarer Republik, enge Grenzen gesetzt waren.“
An anderer Stelle wird Kroll noch deutlicher: „Dass sich die Mobilisierung antisemitischer Ressentiments in Deutschland – und nicht etwa in Frankreich, wo sie vor und nach der Jahrhundertwende weitaus stärker verbreitet waren – Jahrzehnte später zu einer parteipolitischen Massenformation verdichten und schließlich in die Katastrophe des ‚Dritten Reiches‘ einmünden sollte, lag, bei aller partiell vorhandenen gesellschaftlichen Diskriminierung der rechtlich gleichgestellten Juden im Kaiserreich, nicht an strukturellen Defiziten oder Defekten des vermeintlichen wilhelminischen Obrigkeitsstaates. Eigentliche Ursache waren vielmehr die fatalen Konsequenzen der militärischen und politischen Niederlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg.“
Hörenswerte Audio-Rezension bei Deutschlandradio Kultur.
Frank-Lothar Kroll: Geburt der Moderne. Politik, Gesellschaft und Kultur vor dem Ersten Weltkrieg. Band 1 der Reihe Deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert. 224 Seiten, Be.Bra Verlag 2013. 19,90 Euro.
Josef Kern: Impressionismus im Wilhelminischen Deutschland. Studien zur Kunst– und Kulturgeschichte des Kaiserreichs. 476 Seiten, Königshausen & Neumann Verlag 1989. 50,00 Euro.
00:05 Publié dans art, Livre, Livre, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : modernisme, modernité, allemagne, livre, histoire, art |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 16 octobre 2013
Ramiro Ledesma Ramos

00:05 Publié dans Evénement, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, espagne, événement, badajoz |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 03 octobre 2013
UN REGARD SUR LES TRENTE GLORIEUSES

Pierre LE VIGAN
Ex: http://metamag.fr
00:05 Publié dans Histoire, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, france, trente glorieuses, livre |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 02 octobre 2013
Brigades internationales de Franco
00:05 Publié dans Evénement, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : événement, lyon, histoire, espagne, guerre civile espagnole, guerre d'espagne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 01 octobre 2013
De verloren erfenis van het Verdinaso

De verloren erfenis van het Verdinaso
Een overzichtsgeschiedenis van het naoorlogse Heel-Nederlandisme en solidarisme
Filip MARTENS
De intellectueel Joris Van Severen (1894-1940) is zonder enige twijfel de meest briljante Vlaamse geest geweest van de laatste 90 jaar. Hij had tevens een zeer sterke en indrukwekkende persoonlijkheid. Na zijn dood in 1940 bleef de door hem gestichte beweging Verdinaso verder leven in de harten van duizenden sympathisanten, die decennialang in neo-Dinaso-groeperingen actief bleven.
Inleiding
De maatschappelijke ideeën van nationale bewegingen kunnen sterk uiteenlopen, daar ze bepaald worden door de context waarin hun staatkundige opvattingen zich ontwikkelen. Nationalisme versmelt steeds staatkundige en maatschappelijke ideeën tot één ondeelbaar geheel. Het Verdinaso vertolkte dit zeer goed met de leuze “Het Dietsche Rijk en Orde”.
Dit blijkt ook uit de ideologische evolutie van Joris Van Severen. Vanuit een katholieke familiale afkomst over flamingantische bezigheden tijdens zijn universiteitsjaren beleefde hij door de oorlogsgruwelen een nationaal-revolutionair ontwaken aan het IJzerfront. Vanaf 1923 ontwikkelde Van Severen een katholiek Groot-Nederlands nationalisme met Italiaans-fascistische inspiratie en vormgeving. Na 1934 plooide hij stelselmatig terug op een Heel-Nederlands revolutionair conservatisme, waarbij de katholieke fundamenten het haalden op de nationaal-socialistische en fascistische modes. Zijn laatste ontwikkelingsstadium vertoont sterke gelijkenissen met de Franse en Duitse Jong-Conservatieven.
Joris Van Severen evolueerde ook in zijn afbakening van de natiestaat. Oorspronkelijk was hij een vurige anti-Belgische flamingant. De romantische zinspreuk “De taal is gansch het volk” was toen voor hem – en voor heel het flamingantisme – de voornaamste maatstaf voor nationale identiteit. Bijgevolg kon België geen natiestaat zijn en moest er een ‘Vlaams’ volk bestaan dat nauw verwant was aan Nederland.
Van Severen stichtte in oktober 1931 het solidaristische en volksnationalistische Verbond van Dietsche Nationaal-Solidaristen (Verdinaso) na een reeks teleurstellingen in de partijpolitiek. Het taalcriterium werd nog geradicaliseerd door het flamingantisme als overbodige tussenstap overboord te gooien: er bestond enkel nog een ‘Diets’ volk in Nederland, Noord-België en Frans-Vlaanderen. Deze niet-partijpolitieke organisatie was dus bij de aanvang Groot-Nederlands en wou een ideologische en leidinggevende elite vormen. Reeds in 1932 wou Van Severen overschakelen op een staatsnationalistische koers, omdat hij inzag dat enerzijds de regering verregaande maatregelen tegen zijn beweging zou nemen en anderzijds de macht over de Belgische staat diende te worden verworven. De invloedrijke Wies Moens kon dit echter nog 2 jaar tegenhouden.
Het openlijk militaristische – met de Dietsche Militie (DM) had het Verdinaso immers een eigen militie – en als staatsgevaarlijk beschouwde Verdinaso kreeg vanaf eind 1933 zeer ernstige moeilijkheden met de Staatsveiligheid: vele huiszoekingen bij en intimidaties van Verdinaso-leiders, uitsluiting van de Verdinaso-vakbond, een speciale wet om de DM te verbieden, … Daarop gooide Van Severen het roer om door het taalnationalisme af te zwakken: zogenaamde “lotsverbonden volkeren” als de Walen, de Luxemburgers en de Friezen waren welkom in de Dietse volksstaat als ze dat wensten. De DM werd omgevormd tot Dinaso Militanten Orde (DMO) en voor het natieverdelende opbod tussen Nederlandstalig en Franstalig België was geen plaats meer. Het Verdinaso refereerde hiermee aan de 15de eeuwse Bourgondisch-Habsburgse Nederlanden. Wies Moens verliet hierop het Verdinaso. Nochtans kwam de fundamentele evolutie in Van Severens staatkundige denken pas later, doch dit viel echter minder op door de geleidelijke evolutie ervan.
De afkondiging van deze (1ste) Nieuwe Marsrichting betekende een duidelijke afname van Van Severens etno-culturele nationalisme ten voordele van de Rijksgedachte. Van Severen werd vanaf dan een gerespecteerd figuur binnen de Belgische adel en aan het koninklijk hof, die met zijn mening terdege rekening hielden. Hij streefde er naar dat koning Albert I hem zou benoemen tot premier, zodat hij een corporatistische staat kon installeren. De koning moest tevens meer bevoegdheden krijgen.
Inzake maatschappelijke ideeën beriep Van Severen zich op de Conservatieve Revolutie. Dit hield een afwijzing in van de Franse Revolutie, de op vrijmetselaarsprincipes gestoelde grondwet, liberalisme, kapitalisme, marxisme, conservatisme, parlementaire democratie en politieke partijen. Het Verdinaso stelde dat politieke partijen moesten verdwijnen omdat ze het organisch karakter van de volksgemeenschap miskenden en elk voor zich streefden naar de macht, zich slaafs lieten misbruiken door de financiële wereld en aldus “de wettige organisatie van het verraad aan en van de uitplundering van het volk” zijn. Tevens werd gepleit voor een organische samenleving gebaseerd op solidarisme en corporatisme die echte democratie inhielden. Dit omvatte een vervanging van de verfoeide parlementaire democratie – de “demoliberale chaos” – door een corporatieve maatschappelijke ordening. Er was ook een behoudsgezind katholicisme aanwezig. Voor dit alles haalde Van Severen zijn inspiratie onder meer bij de pauselijke encyclieken ‘Rerum Novarum’ en ‘Quadragesimo Anno’, de Action française van Charles Maurras (1868-1952), het neothomisme van Jacques Maritain (1882-1973), de katholieke socioloog markies René de la Tour du Pin (1834-1924) en Mussolini’s nieuwe interpretatie van corporatisme. Van Severen vatte de maatschappelijke ideeën van het Verdinaso samen onder de noemer ‘nationaal-solidarisme’.
Het Verdinaso hanteerde een staatkundige visie die niet zozeer Vlaams-regionalistisch was, maar het grotere geheel der volkeren in de Lage Landen beschouwde. Hiermee oversteeg het Verdinaso duidelijk het romantisch-dromerige flamingantisme. De evoluerende staatkundige visie van het Verdinaso toont aan dat voor de achterban de maatschappelijke opvattingen primeerden. Er haakten wel heel wat mensen af, maar de meesten bleven: noch Groot-Nederlandisme, noch anti-Belgicisme waren voor het gros der Dinaso’s essentieel voor het revolutionair gedachtegoed.
Bovendien was het Verdinaso totaal onafhankelijk van buitenlandse machten. Van Severen weigerde immers consequent financiering en inmenging van nazi-Duitsland, dat eerder als ‘goede en nauw verwante buur’ werd gezien. Dit in tegenstelling tot de slaafse knechtenmentaliteit tegenover Duitsland van het flamingantisch-regionalistische VNV in de ijdele hoop dat de Duitsers hen een zelfstandig Vlaanderen zouden geven. Het VNV werd dan ook reeds lang vóór de Tweede Wereldoorlog gefinancierd en gestuurd door Duitsland.
Vanaf augustus 1936 liet Van Severen de term ‘Dietsland’ vallen. Voortaan sprak hij achtereenvolgens over “het Dietse Rijk”, “de Lage Landen”, “de Nederlanden”, “het Dietse Rijk der Nederlanden” en tenslotte vanaf 1938 over “de Zeventien Provinciën”. Vanaf deze 2de Nieuwe Marsrichting moest België niet langer verdwijnen, maar moest de macht gegrepen worden binnen België mét Waalse steun, waarna moest gestreefd worden naar een fusie met Nederland en Luxemburg. Het taalcriterium werd nu volledig verlaten en vervangen door geopolitieke argumenten en het gemeenschappelijk verleden der Nederlanden, terwijl de eeuwenoude lotsverbonden gemeenschap van Dietsers, Friezen, Walen en Luxemburgers diende hersteld te worden door staatkundige eenmaking in een rijksgemeenschap. In dit de facto herstelde Verenigd Koninkrijk der Nederlanden zou de verscheidenheid der Dietsers gevrijwaard worden door provinciaal federalisme.
Deze evolutie was staatkundig veel fundamenteler dan de 1ste Nieuwe Marsrichting van 1934. Met deze 2de Nieuwe Marsrichting verliet dan ook ongeveer één derde der leden het Verdinaso. Pas tegen 1939 stabiliseerde het ledenaantal weer. Het Verdinaso kon nu echter ook andere doelgroepen aanspreken: Franstalige Vlamingen, Belgisch-nationalistische Vlamingen en ook … Walen. Met de 2de Nieuwe Marsrichting werden tevens alle Vlaamse leeuwenvlaggen definitief geweerd: het Verdinaso gebruikte sindsdien consequent de Belgische en Nederlandse vlaggen, terwijl op hun meetings eveneens de vlaggen van alle Belgische en Nederlandse provincies en de volksliederen van beide landen gebruikt werden. Emiel Thiers (1890-1981), algemeen verslaggever, stelde op de 3de Landdag van het Verdinaso te Tielt in oktober 1934 dat het Verdinaso definitief en volledig gebroken had met de vermolmde Vlaamse Beweging: “Wij hebben ons verlost van het ‘flamingantisme’ en van het ‘hollandisme’; thans verlossen wij ons van de ‘separatistenmentaliteit’ (…)”.
Met de 3de Nieuwe Marsrichting in 1939 keerde Van Severen terug naar een etno-cultureel natiebegrip door de Franstaligen op basis van afstamming en bloed tot geromaniseerde Dietsers te verklaren. De historische gemeenschap der Nederlanden werd nu dus eveneens een volksgemeenschap, terwijl ook het Belgisch nationalisme aanvaard werd. De weg naar de Dietse natiestaat liep nu over een machtsovername in België, waarna samenwerking met Nederland en Luxemburg zou beoogd worden. Hiermee lag het Verdinaso aan de basis van de latere Benelux-gedachte.
Significant is voorts dat het Verdinaso zich nadrukkelijk “Noch linksch, noch rechtsch” noemde en als overtuigd antiparlementaire beweging nimmer deelnam aan verkiezingen. De Dinaso’s werden opgeroepen om blanco of ongeldig te stemmen. Desondanks was het Verdinaso toch een grote beweging: op de laatste grote meeting van het Verdinaso in het Antwerpse Sportpaleis in 1939 waren er 9.000 aanwezigen.
Na de dood van Joris Van Severen te Abbeville in mei 1940 kwam Emiel Thiers aan het hoofd van het Verdinaso. Samen met propagandaleider Paul Persyn (1912-1976) blies hij in de zomer van 1940 de beweging krachtig nieuw leven in, met onder meer een sterke aangroei van het ledenaantal en de opening van tientallen nieuwe Dinaso-huizen tot gevolg. In augustus 1940 sloot het Verdinaso een samenwerkingsakkoord met de Belgisch-nationalistische beweging Nationaal Legioen/Légion Nationale. Beide organisaties lieten de Militärverwaltung weten niet te zullen collaboreren zonder goedkeuring van de koning, van wie ze een initiatief verwachtten. In september 1940 volgde een akkoord met Rex-Vlaanderen.
De Duitsers dwongen in 1941 echter Verdinaso-Vlaanderen, Rex-Vlaanderen en het VNV te fuseren tot de Eenheidsbeweging-VNV. Tegelijk werden ook Verdinaso-Wallonië en Verdinaso-Nederland verplicht samen te gaan met respectievelijk Rex-Wallonië en de NSB. Het Nationaal Legioen/Légion Nationale weigerde te fuseren en werd volkomen uitgeschakeld: alle leiders werden naar Duitse concentratiekampen gedeporteerd.
Duitsland had immers als doel om de Lage Landen op termijn te annexeren (wat in juli 1944 ook gebeurde). Daarom onderdrukte de Duitse bezetter ieder Groot- en Heel-Nederlands streven en werd ook de Belgisch-Nederlandse grens gesloten: niemand kon zonder Duitse toestemming over de grens, waardoor bijgevolg geen contacten mogelijk waren over Belgisch-Nederlandse frontvorming. Verder wist Duitsland uiteraard al van vóór de Tweede Wereldoorlog dat het Verdinaso een onafhankelijke beweging was en dus niet te manipuleren viel zoals Rex en het VNV.
Het Verdinaso werd door de Duitse bezetter onder druk gezet: in januari-februari 1941 werd Hier Dinaso! (de periodiek van het Verdinaso) verboden, individuele Verdinaso-leiders zoals Jef François (1901-1996) en Pol Le Roy (1905-1983) werden bewerkt om voor een pro-Duitse koers te kiezen, de putsch van DMO-leider Jef François tegen Verdinaso-leider Thiers werd gesteund en uiteindelijk werd propagandaleider Persyn in april 1941 korte tijd opgesloten. Thiers begreep en trad af, waarop François hem opvolgde, doch slechts een klein deel der Dinaso’s wou François in de collaboratie volgen. François’ mini-Verdinaso werd tot vernederende onderhandelingen gedwongen met het VNV en uiteindelijk legde de Militärverwaltung op 5 mei 1941 een ‘akkoord’ over de Eenheidsbeweging-VNV op.
Door de gedwongen fusie viel het Verdinaso uiteen in 3 delen: primo een groep die actief in het verzet stapte tégen Duitsland, secundo een grote groep die zich neutraal opstelde en niet participeerde aan de oorlog en tertio een kleine groep die zich aansloot bij de collaborerende Eenheidsbeweging-VNV. Deze laatste strekking kreeg na de oorlog te maken met de repressie en epuratie, terwijl de 2 overige groepen ongehinderd nieuwe Dinaso-initiatieven ontplooiden.
Het kleine aantal collaborerende Dinaso’s – vooral uit de DMO en de jeugdorganisatie Jong Dinaso – kreeg de leiding over de SS-Vlaanderen. DMO’ers waren immers fysiek en psychisch gestaalde en ideologisch geschoolde leidersfiguren: zwakkelingen werden nadrukkelijk niet geduld in hun rangen. Ook de Jong Dinaso’s waren gevormd met het ideaalbeeld van de DMO’er voor ogen. En juist zo’n mannen had de SS nodig. Verder was het schenken van zo’n hoge posities aan ex-Dinaso’s uiteraard ook een middel om hen te overtuigen zich aan te sluiten bij de Eenheidsbeweging-VNV: het bewees dat ze geen tweederangsrol zouden moeten spelen.
Het VNV bleek dus voor de Duitsers ideologisch en organisatorisch te weinig onderbouwd. Die partij bestond immers uit meerdere, zéér verschillende strekkingen (zo ongeveer alles van links-flamingantisch tot extreem-rechts), zodat VNV-leider Staf De Clercq constant veel moeite had om deze kakofonie bijeen te houden. Het Verdinaso had daarentegen één – te nemen of te laten – koers gevoerd. Het VNV vertegenwoordigde duidelijk de kleinburgerlijke Vlaamse Beweging, terwijl het Verdinaso groots en Europees dacht.
De Eenheidsbeweging-VNV bleef officieel streven naar een zelfstandig Vlaanderen en naar een taalnationalistisch Groot-Nederland, maar zoals vermeld onderdrukten de Duitsers iedere Groot- (en ook Heel-)Nederlandse uiting snel. Na met veel naïef enthousiasme en zonder enige garanties in de collaboratie gestapt te zijn vielen in de loop der oorlog veel VNV’ers de schellen van de ogen: meer en meer leden werd het duidelijk dat ze gebruikt werden door de Duitse bezetter om voor hen het land te besturen, terwijl een Groot-Nederlandse staat er nooit zou komen. Tegen het voorjaar van 1944 had de Eenheidsbeweging-VNV dan ook al ca. 85% (!) van zijn leden verloren. Toen Duitsland in juli 1944 de Lage Landen annexeerde, stond het door de bevolking gehate VNV politiek schaakmat: wat moest het immers nog verdedigen gezien de annexatie – die het VNV altijd ontkend had – er nu wel gekomen was, waardoor de Dietse staat – die het VNV altijd beloofd had – er nu nooit meer zou komen?
Door de evoluties in Van Severens staatkundige gedachtegoed poogden zelfs de emotioneel anti-Belgische flaminganten hem na de oorlog te recupereren. Voor hen was er de herinnering aan de vroege Van Severen en bewees zijn executie het vermeende anti-Vlaamse karakter van de Belgische staat. Het verklaart waarom de flaminganten Van Severen – die hen nochtans verketterde als Hitlerknechten en separatisten – na de oorlog een plaats gaven in het flamingantische pantheon, ondanks sterk verzet van oud-Dinaso’s. Daarnaast was het flamingantisme ook niet vies van taalnationalistisch Groot-Nederlandisme, louter als middel tegen iedere poging tot verzoening met België. Er mocht alleen niet gepreciseerd worden wat Van Severen in werkelijkheid met het begrip ‘Dietsland’ bedoelde. Het verklaart alvast waarom zowat iedereen in de Vlaamse Beweging een volkomen verkeerd begrip heeft – zowel ideologisch als staatkundig – van Joris Van Severen en zijn beweging. Het Verdinaso van na de Nieuwe Marsrichting van 1934 is immers enkel en alleen de maatstaf voor de Belgischgezinde, Heel-Nederlandse en solidaristische beweging. De liberaal-conservatieve flaminganten vereenzelvigen zich dan ook onterecht met zijn historische erfenis.
De Belgischgezinde neo-Dinaso-beweging tijdens en na de Tweede Wereldoorlog
Onmiddellijk na de ondergang van het Verdinaso in het voorjaar van 1941 stichtten diverse ontevreden Dinaso’s het clandestiene Dietsch Eedverbond, dat ook een aantal misnoegde VNV’ers aantrok. Leden dienden de Dietse Eed, die stelde dat de Dietse gedachte onder alle omstandigheden moest primeren, af te leggen. Het Dietsch Eedverbond opereerde voornamelijk via persoonlijke informele contacten. De groepering bestond tot 1944 en oefende zware kritiek op het collaborerende VNV uit.
Daarnaast werd in 1942 het Heel-Nederlandse Dietsch Studenten Keurfront (DSK) gesticht, dat in 1943 zijn naam in Diets Solidaristisch Keurfront veranderde. Het DSK bestond vooral uit Gentse studenten. In Leuven was onder meer de latere CVP-Minister Frans Van Mechelen (1923-2000) lid. Daarnaast waren er ook nog contacten in Sint-Niklaas en Turnhout. Het DSK telde ca. 200 leden en werd geleid door onder meer Jozef Moorkens, Herman Todts (1921-1993) en Edmond De Clopper (1922-1998). Zij waren ideologisch sterk op het voormalige Verdinaso gericht en wezen de onvoorwaardelijke collaboratie af. Het VNV werd dan ook scherp gehekeld in DSK-pamfletten.
Todts vertelde later over het DSK: “Jonge mensen, overwegend studenten die er een zelfde mentale instelling op nahielden, vonden elkaar in die dagen onder de verzamelnaam Diets Studenten Keurfront. Een jaar later Diets Solidaristisch Keurfront. De kwalificatie ‘Diets’ wees op een streven om de historische Zeventien Provincies van weleer tot één staat te herenigen; de kwalificatie ‘solidaristisch’ beklemtoonde inzet van alle leden van onze samenleving in ons verzet tegen de ons opgedrongen ideeën; terwijl de kwalificatie ‘keurfront’ het geloof in de dominantie van de elite benadrukte.”
Het DSK vergaderde van 1942 tot september 1944 regelmatig in het ouderlijk huis van Edmond De Clopper aan de Vrijdagmarkt in Gent. Na de oorlog werd de studentenorganisatie Solidaristische Beweging (cfr. infra) gesticht door DSK’ers.
Nog tijdens de oorlog richtte E.H. Bonifaas Luykx De Gemeenschap op, dat onmiskenbaar een neo-Dinaso-jongerengroep was en waar relatief veel oud-Dinaso’s bij betrokken waren. Hierover zijn echter weinig gegevens bekend. Daarnaast was er tijdens de oorlog ook nog de beweging rond de Henegouwse Dinaso Louis Gueuning (cfr. infra).
Oud-Dinaso’s die na de oorlog weer politiek actief werden, verspreidden zich over het hele katholiek-conservatieve kamp. Zo vinden we in de christendemocratische zuil bijvoorbeeld Willem Melis (eerste hoofdredacteur van de naoorlogse De Standaard in 1947), Luc Delafortrie (redacteur bij De Standaard in 1954-1978), Rafaël Renard (adjunct-kabinetschef van minister Arthur Gilson (1961-1965) en voorzitter van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (1964-1976)), Jef Van Bilsen (Secretaris-Generaal en later Commissaris van de Koning voor Ontwikkelingssamenwerking in de jaren 1960 en regeringsdeskundige in de jaren 1970) en Frantz Van Dorpe (CVP-burgemeester van Sint-Niklaas in 1965-1976 en VEV-voorzitter vanaf 1959). Allemaal namen uit de strekking die het Verdinaso buiten de collaboratie wilde houden en na het mislukken van dat opzet inactief werd of in het verzet ging.
Daarnaast waren er na de oorlog tal van groepen die zich tot ideologische erfgenaam van het Verdinaso verklaarden en uiteraard afkerig tot vijandig stonden tegenover de Vlaamse Beweging. De neo-Dinaso-visie op de Vlaamse Beweging werd vertolkt door Herman Todts in het artikel ‘Ik klaag aan. Aan mijn vrienden van de Vlaamse Beweging’ in De Uitweg van 31 mei 1952: oorspronkelijk was de Vlaamse Beweging een positieve kracht door haar Nederlandse oriëntatie, die ze op cultureel vlak kreeg van Jan-Frans Willems en die op politiek vlak werd voortgezet door Joris Van Severen; nu was het echter een “lamlendige pruikenbeweging” geworden, die ver was afgedwaald.
Eén der belangrijkste figuren hierbij was Louis Gueuning, voormalig Verdinaso-leider der Romaanse gouwen (cfr. infra). Zijn neo-Dinaso-strekking verdedigde hetzelfde staatkundige en maatschappelijke project als het Verdinaso en keurde de collaboratie af. De repressie en epuratie werden positief gewaardeerd, hoewel men wel oog had voor de vele onschuldigen die er door getroffen werden.
De oud- en neo-Dinaso’s bleven overtuigd van de Dietse Rijksgedachte en bleven steeds het herstel der historische Nederlanden en der vroegere provinciën nastreven. Hun staatkundig project wou net zoals Van Severens Nieuwe Marsrichting in 1934 de Belgische kerngebieden – Belgisch-Vlaanderen en Belgisch-Brabant – de staatsmacht in handen geven. De Belgischgezinde neo-Dinaso’s vertoonden geen enkele affiniteit met het flamingantisme en volgden Van Severens Belgisch-nationalistische koers. Hun aanhang bestond uit radicaal-conservatieve katholieken en Belgisch-nationalisten, zoals Van Severens goede vriend en PSC’er baron Pierre Nothomb (1887-1966).
Onmiddellijk na de oorlog hadden flamingantisme en federalisme bij de publieke opinie van Nederlandstalig België volledig afgedaan, zelfs al vóór de Duitse aftocht in september 1944. Zelfs voor de flaminganten – met uitzondering van een kleine harde kern – werd België opnieuw het onbetwiste vaderland. Pas in de jaren 1960 zou een deel der flaminganten weer kritischer worden over België.
Tot diep in de jaren 1950 was de Heel-Nederlandse beweging heel sterk. De neo-Dinaso’s speelden daarin een vooraanstaande rol doordat velen onder hen niet of nauwelijks met de repressie hadden te maken gehad en dus politiek actief mochten zijn. Bovendien hadden zij na de oorlog, toen openlijke kritiek op de Belgische staatsstructuur gewoonweg ondenkbaar was, het voordeel dat hun staatkundig programma niet op de vernietiging van België gericht was. Daarnaast beschikten de neo-Dinaso’s ook nog eens over erkende verzetslui.
Conform de leer van het Verdinaso waren de neo-Dinaso’s meestal afkerig van partijpolitiek. Zij organiseerden zich voornamelijk als een kern van ideologisch sterk geschoolde leden die een voorbeeldfunctie moest vervullen. Geen enkele groep slaagde er door de stabiliteit der naoorlogse parlementaire democratie echter in om nog maar een fractie van het succes van het Verdinaso te bereiken. Misschien verklaart dit waarom veel neo-Dinaso’s de antipartijpolitieke houding niet consequent volhielden. Heel wat oud-Dinaso’s kwamen immers terecht in de CVP en aanvankelijk zelfs even in de reorganisatie der flamingantische partijpolitiek.
De neo-Dinaso-groepen bereikten door een eindeloze reeks ruzies en afscheuringen zelden een betekenisvolle eenheid. Een logische ontmoetingsmogelijkheid waren uiteraard de jaarlijkse Van Severen-herdenkingen. In februari 1956 schreef de neo-Dinaso Staf Vermeire (1926-1987) aan de gewezen DMO-leider en collaborateur Jef François dat “de sterke tegenstellingen” tussen de oud-Dinaso’s enkel nog konden overwonnen worden op een ééndaagse herdenking. Er bestonden bijgevolg tientallen naoorlogse neo-Dinaso-periodieken. Vrijwel zonder uitzondering werden deze geïllustreerd met hagiografische beschrijvingen, teksten en citaten van Van Severen. Dit toont aan hoe sterk de Leider geïdealiseerd werd door zijn naoorlogse volgelingen. Vanaf de jaren 1960 raakte een herstel der Bourgondische Nederlanden echter gemarginaliseerd door het opkomende taalfederalisme dat eerst de Vlaamse en Waalse Bewegingen en uiteindelijk de media en het politieke establishment veroverde.
De neo-Dinaso-beweging van Louis Gueuning
De Henegouwer Louis Gueuning (1898-1971), leraar aan het atheneum van Soignies, was aanvankelijk actief in het Waalse regionalisme en sloot zich in 1931 aan bij de groepering La Renaissance Wallonne. Zijn waardering voor het Portugese staatshoofd Antonio Salazar en voor gewestelijke geschiedenis en verscheidenheid, evenals een afkeer voor de parlementaire democratie brachten hem en enkele Waalse vrienden in maart 1939 bij het Verdinaso. Met Joris Van Severen ontwikkelde Gueuning al snel een hechte vriendschap en intense correspondentie, hoewel hij geen voorstander was van het militarisme van het Verdinaso. Op 4 mei 1940 werd hij door Van Severen aangeduid als verantwoordelijke voor de Romaanse gouwen.
Na de executie van Van Severen nam de én anti-Duitse én anti-Britse Gueuning tijdens de oorlog een attentistische houding aan: hij voerde een onafhankelijke politieke koers en benadrukte de zelfstandigheid der Lage Landen. Met een tiental Dinaso’s richtte Gueuning de Joris Van Severen-Orde op die onder meer jaarlijks in mei een beperkte, clandestiene herdenking van Van Severen organiseerde en verder Van Severens denkwerk consolideerde. In tegenstelling tot VNV en Rex collaboreerde Gueuning dus niet met de Duitse bezetter én wees hij eveneens samenwerking met de geallieerden af. Hij werd dan ook vervolgd door zowel de Duitse Gestapo tijdens de oorlog als door het communistisch verzet tijdens de repressie. Gueunings neutrale koers bleek echter zijn redding en hij doorstond beide vervolgingen zonder blijvende gevolgen. Wel werd zijn huis geplunderd tijdens de repressie en hij verloor zijn job. In 1950 stichtte Gueuning het Albrecht-en-Isabellacollege in Sint-Pietersleeuw. Dit was een elitaire, Franstalige privé-school met hem aan het hoofd.
Ook na de Tweede Wereldoorlog handhaafde de Gueuning-groep de ideologie van Joris Van Severen en het Verdinaso. Volgens Le Peuple (dd. 15 februari 1946) werden er tijdens de verkiezingscampagne van 1946 al pamfletten verspreid met een oproep om te stemmen óf blanco óf voor kandidaten die voor “le rapprochement des Pays-Bas tout entiers” stonden. Voorts verschenen er diverse periodieken. Zo steunde in 1945-1949 L’Actualité Politique – waaraan vooral André Belmans (1915-2008) meewerkte – Leopold III, terwijl het blad ook streed tegen de partijpolitiek. Vanaf maart 1951 verscheen De Uitweg, dat eerst de heruitgave van Hier Dinaso! (cfr. infra) overnam en daarna door de fusie met Le Cri du Peuple in november 1951 een Franstalige tegenhanger kreeg. Tot eind 1953 verscheen De Uitweg als weekblad, in 1954 werd het een maandblad en later verscheen het door financiële problemen onregelmatig. Uiteindelijk werd het opgevolgd door het blad Politiek nu (1969-1971).
Gueuning bezorgde de Leider in 1951 tevens een grafmonument te Abbeville, waarop Van Severen tot ‘Pater Patriae’ en ‘Novi Belgii Conditor’ verklaard werd. Hij recruteerde zijn aanhangers vooral in Nederlandstalig België en onder tweetalige Brabanders. Verder had hij wisselende contacten met diverse Belgischgezinde Derde Weg-groepen. Voor de door Gueuning samengeroepen ‘Staten-Generaal van Verzet tegen het Regime’ op 13 en 14 september 1952 in de Antwerpse zaal Gruter daagden ca. 300 mensen op.
Ideologisch volgde Gueuning de lijn van Van Severen in diens laatste fase. Belangrijkste doel was het herstel der historische Lage Landen in hun gewestelijke verscheidenheid als een organische natie die de kern moest worden van een nieuw Europa. Grote vijand was “de Vreemde” of “l’Étranger”: de buurlanden hadden er steeds alles aan gedaan om de Nederlanden te verdelen en te beheersen. Groot-Brittannië werd door Gueuning bijzonder geviseerd: ‘Albion’ was de nieuwe bezetter en het door de oorlogsregering van Londen beheerste regime was de nieuwe collaborateur. De flamingantische en wallingantische federalisten dienden bewust of onbewust het belang van “de Vreemde” doordat ze na 1830 nog eens de natie wilden opdelen.
Gueuning publiceerde veel over de nagedachtenis en ideologie van Van Severen. Ter legitimering der Nederlandse natie publiceerde hij over de natuurlijke en historische eenheid en zending ervan. Gueuning was een Heel-Nederlander die op basis van historische en geopolitieke argumenten geloofde in het ideaal der 17 Provinciën. Hij wees nationalisme consequent af aangezien dit product van de 19de eeuwse Romantiek Europa evenveel schade had toegebracht als het liberalisme en marxisme. Hierbij verwees hij naar “de verwoesting” in de Nederlanden door het taal-, sociaal en economisch nationalisme. Zijn duidelijke afwijzing van flamingantisme en wallingantisme betekende dat taal voor Gueuning geen enkele waarde had als afbakeningscriterium voor een natie.
Gueunings denken werd gedomineerd door personalisme en roeping. Primo, personalisme betekent dat de mens zich zo volledig mogelijk moet kunnen ontplooien. Naast zijn Heel-Nederlandse motieven verklaart dit mee waarom Gueuning weigerde te collaboreren met nazi-Duitsland, dat een volledig andere visie op de mens had. Orde was voor hem een noodzakelijke menselijke zelfdiscipline om zich persoonlijk te kunnen ontwikkelen. Secundo, het begrip roeping houdt in dat iedere mens een unieke roeping heeft in zijn leven en in de maatschappij. Door deze roeping zo goed mogelijk te vervullen geeft de mens zin aan zijn handelen en leven. Een maatschappij dient op ieder niveau de roeping van ieder individu te ondersteunen, daar zij het resultaat is van de vervulde roepingen van zichzelf ontplooiende individuen. Vrijheid was hierbij voor Gueuning geen libertijns doel op zich, maar een middel in de ontplooiing van de mens, evenals het begrip orde.
Inzake de sociale ordening hernam Gueuning niet expliciet de solidaristische leer. Hij gebruikte de term solidarisme niet en pleitte ook nauwelijks voor een corporatistische staat. Nochtans zat hij wel op die lijn: het volk diende in de staat vertegenwoordigd te worden door zijn elites: “alle beroepsverenigingen, alle gewestelijke groeperingen, alle levensbeschouwingen die de grondslagen van de nationale gemeenschap niet aantasten, hebben recht vertegenwoordigd te worden”.
Verder promootte Gueuning een autoritair regime rond de koning die ten volle zijn grondwettelijke voorrechten moest kunnen uitoefenen bij de samenstelling van een onafhankelijke regering. Naast dit klassieke discours der Belgischgezinde Derde Weg-beweging diende vooral het partijenstelsel uitgeschakeld te worden. Dit mocht met alle middelen worden bestreden, zelfs onwettige. Deelname aan de partijpolitieke strijd werd zinloos geacht: bij verkiezingen werden de aanhangers opgeroepen om blanco te stemmen.
In elke politieke crisis zag Gueuning het lang verwachte einde van het regime: de troonsafstand van Leopold III, de legering van Britse troepen in de Kempen, de onafhankelijkheid van Congo, … Iedere keer werd het regime dood verklaard en een nieuwe organisatie opgericht om de omwenteling in handen te nemen. Na de afwikkeling van de Koningskwestie waren dit de Aktiecomité’s voor orde en vrijheid/Comités d’action pour la liberté et pour l’ordre, na de Congocrisis was het de Organisatie voor Algemeen Welzijn/Organisation de Salut Public (OAW/OSP). Gueuning wou hiermee een ‘regering van algemeen welzijn’ vormen, los van politieke partijen en geleid door de koning, die een nieuwe, autoritaire staat zou stichten. Het enige noemenswaardige resultaat was telkens een tijdelijke samenwerking met Belgischgezinde Derde Weg-groepen.
Net zoals individuen hadden ook staten volgens Gueuning een unieke roeping die bepaald werd door hun eigen uniciteit. Dit verklaart zijn kritische houding tegenover het naoorlogse Europese eenmakingsproces. Hoewel hij een fervent voorstander was van een Europese integratie op ideële en culturele basis, keurde hij het actuele proces af vanwege de verkeerde motivatie ervan. Een louter economische Europese eenwording had voor hem immers geen enkele zin.
Europa moest voor hem een eenheid in verscheidenheid blijven – “Unitas in diversitate” – waarin ieder land juist door de vervulling van een specifieke roeping zijn eigenheid behield. Een identitair kader voor de Europese integratie zou de unieke aard van ieder Europees volk vrijwaren. De Bourgondische Nederlanden kende hij vanuit de analyse van de geschiedenis een bevoorrechte status toe als motor van zo’n Europees integratieproces. Doorheen de geschiedenis waren de Lage Landen immers een zone voor contact tussen de Europese grootmachten.
Belangrijke Gueuning-medestanders van het eerste uur waren onder meer André Belmans (voormalig medewerker van diverse Verdinaso-periodieken, voormalig leider der Leuvense Dinaso-studenten en notaris te Antwerpen), Gustave Calbrecht (oud-Dinaso uit Brussel), André Godderis (oud-Dinaso), Roger Liefooghe (voormalig Verdinaso-gewestleider te Ieper), Valmy Stassart (apotheker te Jumet en voorzitter van de oudstrijdersvereniging Union Nationale des Croix du Feu) en Pol van Herzeele (voormalig lid der Verdinaso-leiding). In 1955 sloot ook Antwerpenaar Vik Eggermont (°1929) aan. Herman Todts (neo-Dinaso), Juul De Clercq (voormalig lid der Verdinaso-leiding) en Luc Delafortrie (voormalig Verdinaso-medewerker) werkten tijdelijk samen met Gueuning.
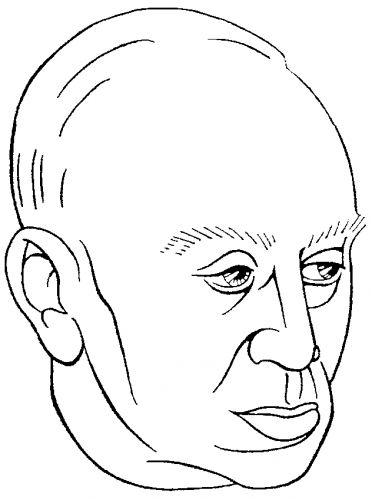
Naast de tijdschriften en de herdenkingen van de Leider werden er niet veel activiteiten op touw gezet, omdat daarvoor de mensen ontbraken. Veel meer dan enkele honderden mensen stelde de Gueuning-strekking nooit voor. Bovendien waren het steeds dezelfde reeds overtuigde mensen. Naarmate de jaren verstreken vielen er veel meer oude gezichten weg dan er nieuwe bijkwamen.
In de flamingantische partij Vlaamse Concentratie en zijn opvolgers Christelijke Vlaamse Volksunie en Volksunie zag Gueuning niets anders dan een nieuw VNV. Deze partijen waren onvermijdelijk “schijnheilig federalistisch” – separatistisch dus – en zouden bijgevolg opnieuw verraad plegen in dienst van “de Vreemde”, al zou dit volgende keer niet noodzakelijk Duitsland zijn.
In juli 1955 schaarde Gueuning zich achter het initiatief van burggraaf Charles Terlinden (1878-1972), een vooraanstaand Belgischgezind activist om een ‘Manifeste contre le séparatisme-Pour l’Unité/Manifest tegen separatisme-Voor eenheid’ te lanceren. De tekst, ondertekend door een reeks vooraanstaande Belgisch-nationalisten, keerde zich ook tegen culturele autonomie als een verkapte vorm van separatisme. Naar aanleiding van de federalistische opstoot bij de Waalse linkerzijde tijdens de staking tegen de Eenheidswet pakte Gueuning opnieuw uit met dit manifest.
Sommige vrienden van Gueuning gingen nog verder. Valmy Stassart was een voorman van de antiflamingantische verzetsbeweging Comité d’Action Nationale/Nationaal Actie Comité (CANNAC) uit het begin der jaren 1960. Historicus Bart De Wever vermoedt dat het CANNAC verantwoordelijk was voor een bomaanslag in juni 1962 tegen het gebouw van de Vlaamse Toeristenbond in Antwerpen, alsook voor aanslagen in 1963 tegen het café van de (tweede; cfr. infra) Volksunie (VU) in Aalst en tegen een autokaravaan van de Vlaamse Volksbeweging (VVB) in Oostende.
Het CANNAC ging ook op flamingantische manifestaties provoceren en trad met de flamingantische militie Vlaamse Militanten Orde (VMO) in een soort wisselwerking van geweld. Eén en ander kwam aan het licht toen op 24 september 1963 een zware ontploffing plaatsvond in een Gentse villa waar CANNAC-leden explosieven maakten voor een aanslag tegen een VU-betoging in Gent. Eén van de betrokkenen was Michel De Munter, een Gueuning-militant.
Het geflirt van sommige neo-Dinaso’s met de Volksunie na de doorbraak van die flamingantische partij in de jaren 1960 ging er bij de Gueuning-aanhangers immers helemaal niet in. Toen oud-Dinaso Albert Brienen (1897-1977) op de Van Severen-herdenking van het VRO (cfr. infra) in Gent op 19 mei 1968 voor een publiek van hoofdzakelijk Gentse VMO’ers verklaarde dat blanco stemmen geen zin meer had en de Volksunie het vertrouwen verdiende, bestempelden ze dit als “schaamteloos verraad tegenover onze betreurde leider”.
In 1970 richtten enkele tientallen getrouwen de Stichting L. Gueuning/Fondation L. Gueuning op om na de dood van Gueuning in 1971 de nagedachtenis van Joris Van Severen te bewaren en uit te dragen. Oud-Dinaso Jef Werkers (1911-2004) werd voorzitter. In 1973 verscheen het tijdschrift L’Accent. In 1978 kreeg dat met Kenmerk een Nederlandstalige pendant, die uitgegeven werd door de Politieke Groep: Studie, Opzoekingen en Contacten. Roger Liefooghe en de Henegouwse oud-Dinaso André Michel waren de drijvende krachten achter Kenmerk/L’Accent. Dit tweemaandelijks blad hernam de klassieke stellingen, maar zonder de revolutionaire ondertoon van voordien. Het engageerde zich in de jaren 1990 in grote betogingen tegen het separatisme en sympathiseerde daarbij met het Belgische Front National. In 2000 werd het blad stopgezet.
Zowel de Gueuning-medewerkers als neo-Dinaso’s van buiten de Gueuning-strekking waren betrokken bij nog een hele reeks gelijkaardige neo-Dinaso-initiatieven. We schetsen hieronder een chronologisch beeld.
1946-1951: Oud-Dinaso’s in de christendemocratie
Verdinaso-sympathisant Emiel De Winter (1902-1985) was als Secretaris-Generaal van het Ministerie van Landbouw tijdens de oorlog verantwoordelijk voor de Nationale Landbouw- en Voedingscorporatie (NLVC). De NLVC stond wegens de voedselschaarste in voor de marktordening en voor de controle der landbouwproductie en voedselverdeling. Boeren werden verplicht volgens teeltplannen te werken en te leveren aan vastgelegde prijzen.
De NLVC telde talrijke oud-Dinaso’s, onder andere Lode Claes (1913-1997), Norbert De Witte (1911-1983), Willem Melis (1907-1984), Pol van Herzeele (1897-1975) en Paul Persyn. De laatste 2 spioneerden er zelfs voor het verzet. Zo gaf Persyn vanaf oktober 1941 gegevens door aan de Groep Athos en vanaf juli 1943 samen met van Herzeele aan de geheime inlichtingendienst Groep Othello van oud-Dinaso Frantz Van Dorpe (1906-1990). Van Dorpe was aanvankelijk eind 1941 toegetreden tot de verzetsgroep Zero en kreeg na de oorlog diverse onderscheidingen voor zijn verzetswerk.
Persyn en Melis trachtten in 1946 een nieuw dagblad op te starten. Ze gingen samenwerken met Emiel De Winter, die behoorde tot de groep die de heruitgave van De Standaard voorbereidde. Het trio zocht hiervoor eind 1946 overal in Nederlandstalig België steun. Melis werd de eerste hoofdredacteur van De Standaard. Persyn haakte echter af, wat De Winter ten zeerste misnoegde, hoewel beiden wel contact hielden. Lode Claes werd begin jaren 1950 hoofd van de Antwerpse redactie van De Standaard.
Toen Persyn in 1948 werd aangezocht door de groep achter de eerste Volksunie (een neo-Dinaso-project, cfr. infra), zou hij geweigerd hebben omdat het volgens hem verloren moeite was en beter de CVP-verruiming kon gesteund worden. Hij bezette in Antwerpen trouwens zelf een onverkiesbare plaats op de CVP-Kamerlijst in 1949. Verder tekende Persyn samen met de voormalige Verdinaso-sympathisanten Emiel De Winter, Jozef Custers (1904-1982) en Victor Leemans (1901-1971) een oproep die vlak voor de verkiezingen in diverse katholieke kranten verscheen om de CVP te steunen in haar strijd om de absolute meerderheid.
Bij de verkiezingen van 1946 had de CVP het electorale potentieel van het flamingantisme opgezogen. Voor de CVP was het van primordiaal belang dat het flamingantisme en ook het Verdinaso zich niet opnieuw politiek zouden organiseren. De Standaard trok bijgevolg vanaf 1949 alle registers open om de CVP aan te zetten zich te verruimen met vertegenwoordigers van die groepen. Zo kregen 3 belangrijke figuren uit Verdinaso-kringen een parlementair mandaat: Custers, De Winter en Leemans. Norbert De Witte werd in 1950 CVP-arrondissementscommissaris van Sint-Niklaas.
1947: De (eerste) Solidaristische Beweging
In het voorjaar van 1947 verscheen het studentenblad Branding. Solidaristisch weekblad. Dit was het orgaan van de kortstondig bestaande Solidaristische Beweging, dat kleine afdelingen had in Leuven en Antwerpen. De katholieke en Heel-Nederlandse Solidaristische Beweging werd geleid door oud-leden van het Dietsch Studenten Keurfront (cfr. supra) zoals Edmond De Clopper, Frans Van Mechelen, Herman Todts en Jozef Moorkens. In zowel Branding als in de Solidaristische Beweging was daarnaast onder meer nog de latere De Standaard-journalist Manu Ruys (°1924) actief, die tevens betrokken was bij het opstarten van het jeugdtijdschrift Vive Le Gueux! (cfr. infra).
Brandingpubliceerde 10 nummers. In het eerste nummer stelde Van Mechelen (die ook het blad liet drukken) dat Branding nodig was omdat er geen leiders meer waren zoals Joris Van Severen waar de jeugd kon naar opkijken. Verder werd nog het partijenstelsel afgewezen als “georganiseerd sectarisme”. Het redactioneel artikel was een traditioneel solidaristisch discours, inclusief afwijzing van liberalisme en marxisme, die voor Branding de “twee gezichten van Lucifer” waren. Tevens werd de komende Benelux toegejuicht. In het laatste nummer van Branding prijkte op de voorpagina een grote foto van en een hagiografisch artikel over de “grote Dietser” Van Severen.
1947-1999: De Heel-Nederlandse jeugdbewegingen
 De nationalistische jeugdbewegingen in Nederlandstalig België waren voor de oorlog al broeihaarden van Heel- en Groot-Nederlandisme. Tijdens de oorlog werden de diverse groepen gedwongen samengevoegd in de eenheidsjeugdbeweging van het collaborerende VNV. Na de oorlog was het georganiseerd Diets-nationalisme volledig uitgeschakeld, maar vrijwel onmiddellijk ontstonden nieuwe nationalistische jeugdgroepen in de steden om jongeren op te vangen die niet wilden of mochten toetreden tot de katholieke jeugdbewegingen. De stichters ervan waren meestal oudgedienden uit de vroegere nationalistische jeugdbewegingen, onder meer figuren die ideologisch beïnvloed waren door het Verdinaso en buiten de collaboratie waren gebleven.
De nationalistische jeugdbewegingen in Nederlandstalig België waren voor de oorlog al broeihaarden van Heel- en Groot-Nederlandisme. Tijdens de oorlog werden de diverse groepen gedwongen samengevoegd in de eenheidsjeugdbeweging van het collaborerende VNV. Na de oorlog was het georganiseerd Diets-nationalisme volledig uitgeschakeld, maar vrijwel onmiddellijk ontstonden nieuwe nationalistische jeugdgroepen in de steden om jongeren op te vangen die niet wilden of mochten toetreden tot de katholieke jeugdbewegingen. De stichters ervan waren meestal oudgedienden uit de vroegere nationalistische jeugdbewegingen, onder meer figuren die ideologisch beïnvloed waren door het Verdinaso en buiten de collaboratie waren gebleven.
Hoewel er ideologisch geen onoverbrugbare verschillen waren, zou er ondanks vele pogingen nooit een eenheidsstructuur ontstaan boven de verschillende jeugdgroepen. Reeds in 1945 poogde Edmond De Clopper met Bundeling – Gemeenschap voor Nederlands Geestesleven tevergeefs een overkoepeling van katholieke jongeren tot stand te brengen. Bundeling bleef een bescheiden initiatief, dat zich beperkte tot het organiseren van voordrachten.
Op initiatief van onder meer Staf Vermeire en Jan Olsen (°1924) verscheen van mei 1947 tot juli 1949 het tijdschrift Vive Le Gueux! dat zich richtte op de diverse nationalistische jeugdgroepen. Het blad wees zowel Vlaams-Waals federalisme als Belgisch-nationalisme af: een Heel-Nederlandse oriëntatie was nodig om tot een herstel der Lage Landen te komen. De collaboratie werd afgekeurd, maar tegelijk was men zeer kritisch over de repressie. Maatschappelijk propageerde Vive Le Gueux! onder de toen actuele term ‘christelijk socialisme’ de facto solidaristische ideeën. Naast Vermeire en Olsen werkten onder meer nog Manu Ruys, Staf Verrept (1921-1985) en de Nederlander Bert van Blokland mee aan dit blad.
In juli 1947 ontstond dan het Jeugdverbond der Lage Landen, dat een aantal losse jeugdgroepen rond Vive Le Gueux! overkoepelde. Vanaf het 3de nummer was Vive Le Gueux! het orgaan van het Jeugdverbond der Lage Landen.
In die periode zochten Olsen, Vermeire en oud-Dinaso André Belmans samenwerking met de Gueuning-groep voor kadervorming. Daaruit kwam het tijdschrift Het Gulden Vlies (1948-1949) voort, dat het ideologisch blad van het Jeugdverbond der Lage Landen werd. Het predikte aristocratische en Heel-Nederlandse principes en meed de partijpolitiek. Belmans schreef de meeste artikels. Daarna raakten de relaties met Gueuning en diens volgelingen verzuurd. Vermeire wou niets meer met hen te maken hebben.
In 1949 scheurden het Antwerpse Sint-Arnoutsvendel van Wim De Roy en de Brugse Rodenbachschaar van Jan Olsen zich af en legden via de stichting van een VZW beslag op de naam Jeugdverbond der Lage Landen. In 1950 fuseerde de Rodenbachschaar met Oostendse, Gentse en Leuvense groepjes onder impuls van Jaak De Meester onder de naam Rodenbachvendel.
De andere groepen gingen onder verbondsleider Staf Vermeire verder onder de naam Algemeen Diets Jeugdverbond (ADJV). In 1951 ontbond het Rodenbachvendel (met onder meer Olsen) zichzelf en sloot opnieuw aan bij het ADJV, dat ook in Nederland afdelingen oprichtte.
Het ADJV, evenals de meeste aanverwante groepen, wenste afstand te houden van de partijpolitiek. Naast de bekende principiële bezwaren speelde daarbij ook het onaangename wedervaren van de jeugdbeweging met het VNV tijdens de oorlog. Bij de oprichting van zowel de eerste Volksunie (een neo-Dinaso-project, cfr. infra) als de Vlaamse Concentratie (een flamingantische kieslijst) werden Vermeire en co dan ook tevergeefs gevraagd om te participeren.
Bij de verkiezingen van 1949 riep het ADJV enkel op om te stemmen voor personen die op katholiek en Nederlands vlak voldeden, vermoedelijk vooral een wenk in de richting van de enkele oud-Dinaso’s op kieslijsten van de Vlaamse Concentratie (VC). Op 16 mei 1950 schreef Vermeire aan Todts: “Ik houd onze kerels en stormers ver van alle politieke gedoe, en niet alleen van de VC”.
Ook tegenover de Christelijke Vlaamse Volksunie en daarna de tweede Volksunie (beide flamingantische partijen) bleef het ADJV strikt afzijdig. Deelname aan partijpolitieke manifestaties en lidmaatschap van een partij waren voor ADJV’ers in principe niet toegelaten. Uiteraard waren ADJV’ers in persoonlijke naam dikwijls toch betrokken bij politieke initiatieven. Bovendien was het Diets-nationalistische wereldje nu eenmaal te klein – met nauwe persoonlijke banden als gevolg – om strikte richtlijnen praktisch vol te houden.

In 1950 werd het blad Het Gulden Vlies opgevolgd door Het Pennoen (1950-1977), dat vanaf 1952 los kwam van de jeugdbeweging om een breder publiek te bereiken. Hoewel het aanvankelijk in dezelfde lijn liep, veranderden initiatiefnemers Olsen en Verrept eind 1955 echter van koers door voor het Vlaams-Waals federalisme te opteren. Het Heel-Nederlandisme werd opgegeven voor een taalnationalistisch Groot-Nederland en Vlaamse autonomie. De leeuw met de bundel van 17 pijlen – symbool voor de 17 Provinciën – verdween van de voorpagina. Vanaf 1956 koos Het Pennoen ook steeds duidelijker voor progressisme. Voor Vermeire betekende dit verraad aan de oorspronkelijke doelstellingen. Tussen de neo-Dinaso’s en het “federalistisch-democratisch-progressistisch soepje” van Het Pennoen groeide een bittere vijandschap.
De antipartijpolitieke houding leverde aanvankelijk geen praktische problemen op aangezien er toch geen enkele nationalistische partij daadwerkelijk van de grond kwam. Met de moeizame uitbouw van de tweede Volksunie (VU) in de 2de helft der jaren 1950 veranderde dat echter. De ADJV-leiding bleef echter halsstarrig samenwerking met dit partijtje afwijzen. Daarom scheurde een deel der Gentse ADJV-afdeling Arteveldevendel zich in 1956 na een hevige crisis af. In 1957 vormden de scheurmakers samen met de Antwerpse groep Marnix van Sint-Aldegonde – een fusie van de 2 Antwerpse jeugdgroepen Sint-Arnoutsvendel en Willem Van Saeftinghe – het Verbond van Blauwvoetvendels (VBV). Het VBV positioneerde zich Heel-Nederlands en katholiek. Het had tevens een uitstekende muziekkapel en stichtte diverse afdelingen in West- en Oost-Vlaanderen.
Het ADJV verstrakte daarop zijn antipartijpolitieke lijn nog: partijpolitieke activiteit werd effectief bestraft met degradatie. Door het toetreden van de Katholieke Jeugdscharen Jong-Vlaanderen (KJJV) in 1957 wijzigde het ADJV zijn naam in Blauwvoetjeugdverbond (BJV), hoewel er ideologisch niets veranderde en de meeste KJJV-leden hun leiders niet volgden in de overstap naar het BJV. In mei 1958 verving Jaak De Meester Vermeire als verbondsleider.
Bij de schoolstrijdverkiezingen van juni 1958 werd de VU net niet electoraal verpletterd in de botsing tussen katholieken en vrijzinnigen: de ene zetel in de Kamer werd nipt behouden. De mislukte verkiezingen waren voor het milieu rond Vermeire, rancuneus vanwege de jeugdbewegingsperikelen van 1956, het sein voor een aanval op de VU. In juni 1958 zond het geheim genootschap Diets Eedverbond ‘De Rebellen’ anoniem honderden exemplaren rond van een Rebellenbrief, een blaadje van 16 pagina’s uitgegeven door “rebellen die bij of rond alle initiatieven stonden ter heropstanding” na de oorlog en waarvan velen “spijts alles” ook in de VU actief waren. Het flamingantisme, de partijpolitiek en vooral de VU werden afgekraakt. Alleen een “revolutionaire rebellie” zou de nationale beweging tot het Dietse einddoel leiden. Verder werd er nog voor amnestie gepleit en een hoop vuile was van de VU buiten gehangen. In juli verscheen er een tweede en vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1958 een derde Rebellenbrief.
De VU-top reageerde bijzonder geprikkeld op deze neo-Dinaso-aanvallen. De vele artikels over de jeugdbewegingstoestand in de Rebellenbrief wezen automatisch naar Vermeire. Die ontkende echter keihard en beschuldigde het Joris Van Severen-Komitee (cfr. infra). Hij maakte officieel zelf deel uit van deze Gueuning-groep, doch was sinds de oprichting inactief gebleven. Liefooghe reageerde hierop door een apocriefe vierde Rebellenbrief uit te brengen. Daarop betichtte Vermeire nogmaals het Joris Van Severen-Komitee en nam er definitief ontslag uit. In de zomer van 1959 bracht hij nog een laatste Rebellenbrief uit.
Vermoedelijk was de basis der jeugdbeweging niet echt doordrongen van het Heel-Nederlandisme. Er werd immers vooral gerecruteerd onder kinderen van flamingantische collaborateurs. Diets-nationalisme was voor hen geen bezwaar, maar voor de meesten bleef dit refereren aan een taalnationalistische vereniging van Noord-België en Nederland. Binnen de jeugdbeweging bestond enerzijds een katholiek, ‘völkisch’ flamingantisme en anderzijds een conservatief-revolutionaire neo-Dinaso-strekking die de Rijksgedachte en het Heel-Nederlandisme poneerde.
De ideologisch geschoolde leiding van het ADJV/BJV was zich van dit probleem bewust. Daarom bleef men tegenover de buitenwereld meestal zeer vaag over de definitie van het begrip ‘Dietsland’. Een pamflet dat het BJV massaal verspreidde op de IJzerbedevaart en het Zangfeest van 1961, pleitte bijvoorbeeld voor een oriëntatie van het flamingantisme op de vereniging van het ganse Nederlandse volk, maar slechts uit 1 zinnetje over de “negentien miljoen Nederlanders” in noord en zuid, kon de lezer afleiden dat ook de Franstalige Belgen daar bijhoorden.
Het onsuccesvolle BJV kreeg de genadeslag door de oprichting van het Vlaams Nationaal Jeugdverbond (VNJ) in 1960. Het beter georganiseerde VNJ sloot veel dichter aan bij het flamingantisme dat op het einde der jaren 1950 opnieuw overeind krabbelde. In de loop der jaren slaagde het er in om zijn concurrenten weg te drummen. Vooral de relatie met het VBV, dat stelde dat het VNJ een loutere partijjeugd was, was bijzonder vijandig.
Ondanks een heftig anti-VNJ-offensief bleef het BJV met een grote ledenafname kampen. Op 1 oktober 1961 ontbond het BJV zich officieel en verdween van het toneel. Een aantal oudgedienden stichtte onder leiding van Maurits Cailliau (°1938), Rik Nauwelaerts en Paul Van Caeneghem (°1938) dezelfde dag nog het Algemeen Diets Jongerenverbond (ADJOV) dat de katholieke en Heel-Nederlandse tradities van het BJV voortzette.
In 1966 trad het ADJOV toe tot de in 1963 gestichte Blauwvoetfederatie, een losse structuur van diverse anti-VNJ-groepen met onder meer het VBV. De katholieke en Heel-Nederlandse Blauwvoetfederatie gaf tot 1973 het maandblad Open uit en verdween vermoedelijk in 1975.
 In mei 1971 stichtte Fred Rossaert het Heel-Nederlandse Scoutsverbond Delta uit verzet tegen de revolte van mei 1968. De organisatie inspireerde zich op de Duitse Wandervögelbeweging, Baden Powells scoutsbeweging, de blauwvoeterij en het Jong Dinaso. Tot 1990 werd het tijdschrift Zonnescharen uitgegeven. Scoutsverbond Delta was actief in de Kempen en telde op zijn hoogtepunt ca. 200 leden. Het onderhield contacten met het Algemeen Vlaams Nationaal Jeugdverbond (een radicale afscheuring van het VNJ), de (derde) Solidaristische Beweging (cfr. infra) en het Franse Europe Jeunesse. Eind 1991 werd Scoutsverbond Delta stopgezet wegens interne moeilijkheden.
In mei 1971 stichtte Fred Rossaert het Heel-Nederlandse Scoutsverbond Delta uit verzet tegen de revolte van mei 1968. De organisatie inspireerde zich op de Duitse Wandervögelbeweging, Baden Powells scoutsbeweging, de blauwvoeterij en het Jong Dinaso. Tot 1990 werd het tijdschrift Zonnescharen uitgegeven. Scoutsverbond Delta was actief in de Kempen en telde op zijn hoogtepunt ca. 200 leden. Het onderhield contacten met het Algemeen Vlaams Nationaal Jeugdverbond (een radicale afscheuring van het VNJ), de (derde) Solidaristische Beweging (cfr. infra) en het Franse Europe Jeunesse. Eind 1991 werd Scoutsverbond Delta stopgezet wegens interne moeilijkheden.
Een laatste neo-Dinaso-jeugdbeweging was het in 1982 opgerichte katholieke Oranjejeugd, dat ontstond uit het op Brusselse kinderen gerichte Grensland. Het ca. 200 leden tellende Oranjejeugd werkte nauw samen met de Gueuning-strekking en met de Heel-Nederlandse Stichting Zannekin. Tevens was voormalig ADJV-leider Staf Vermeire tot zijn overlijden in 1987 een belangrijk mentor. Oranjejeugd besteedde veel aandacht aan vorming en gaf het maandblad Oranjekrant uit. Maurits Cailliau was de eerste voorzitter van Oranjejeugd (tot 1988). Oranjejeugd hield in 1999 op te bestaan.
De teloorgang van de Heel-Nederlandse jeugdbeweging op het einde der jaren 1950 betekende het einde der recruteringsmogelijkheden van de neo-Dinaso-beweging. De jeugdgroepen waren immers ideaal om nieuwe volgelingen te vormen. Hierna begon de tijd zijn ongenadig werk te doen.
1948-1949: De (eerste) Volksunie
Vanaf april 1948 werd in Gent vergaderd door overwegend oud-Dinaso’s en aanverwanten die buiten de collaboratie bleven of in het zogenaamd ‘Diets verzet’ (dat zich niet principieel tegen de collaboratie en het nationaal-socialisme verzette, maar wel tegen het Duits verbod op Diets-nationalisme) stonden. Zij richtten een organisatie op onder de naam Volksunie om de ideologische erfenis van het Verdinaso voort te zetten.
De initiatiefnemers waren de groep achter Branding (Edmond De Clopper, Jozef Moorkens, Frans Van Mechelen en Herman Todts), de latere Antwerpse notaris Gust Peeters, de toenmalige praeses van het Gentse KVHV Wim Jorissen (die tijdens zijn studententijd ideologisch beïnvloed werd door zijn medestudent Todts), het gewezen Verdinaso-kopstuk Juul De Clercq (1897-1955), de oud-Dinaso’s Leo Hosten en Albert Brienen, Gueuning-medewerker en zoon der Brusselse oorlogsburgemeester Wim Grauls en de flamingant en toenmalig voorzitter van het Algemeen Nederlands Zangverbond Herman Wagemans. De leiding van deze eerste Volksunie lag bij Juul De Clercq en Herman Todts.
Op 12 maart 1949 bezochten De Clercq en Todts te Brussel een bijeenkomst van flamingantische prominenten die een gemeenschappelijk standpunt wou bepalen tegenover de parlementsverkiezingen van juni. Men besloot dat het voorbarig was om een nieuwe partij te stichten, maar dat er op basis van enkele inhoudelijke krachtlijnen overal lijsten zou ingediend worden. Dit zou tot de flamingantische kieslijst Vlaamse Concentratie (VC) leiden. Onderhandelingen met de CVP werden afgewezen. De vergadering vormde tevens een ‘coördinatie-comiteit’ van vertegenwoordigers der provincies en arrondissementen, dat regelmatig zou samenkomen om de electorale acties te coördineren. De Clercq werd daarin opgenomen voor West-Vlaanderen.
In werkelijkheid had de Volksunie echter heel andere plannen en was die waarschijnlijk zelfs nooit van plan om met flaminganten samen te werken. Met het oog op de komende verkiezingen trok de Volksunie totaal andere figuren aan. Het betrof Gentse socialisten die tijdens de oorlog, in het spoor van Hendrik De Man (1885-1953), verbrand waren geraakt: Marinus De Rijcke (voormalig schepen van Gent en redacteur van het dagblad Vooruit tijdens de oorlog), Piet Legon, Frans Longville (enkele maanden voor de oorlog BWP-parlementslid en zoon van BWP-senator Henri Longville), Michel Tommelein (voormalig secretaris van Hendrik De Man, voormalig secretaris der Socialistische Jonge Wachten en schepen van Groot-Brussel tijdens de oorlog) en een zekere De Wit. Tevens trad de dissidente CVP’er Fernand Pairon toe, een bemiddeld zakenman en schepen van Kalmthout wiens achterban zich in Antwerpse middenstandskringen situeerde.
Met het verschijnen van de periodiek De Voorpost, met Todts als hoofdredacteur, trad de Volksunie naar buiten. Tussen 15 april en 24 juni 1949 verschenen er 8 nummers. Het eerste nummer kondigde op de voorpagina het “congres van Volksunie” aan in de Antwerpse zaal Gruter op 8 mei 1949, waarbij als sprekers De Clercq, Longville, Peeters en de Gentse advocaat J. Cleymaet aangekondigd werden. Een wollige tekst van De Clercq gaf de krachtlijnen van de nieuwe organisatie weer: christelijk, personalistisch, solidaristisch en nationalistisch. De Clercq keurde ook de repressie en de epuratie goed, maar niet de uitvoering ervan. Er moest eerherstel en schadevergoeding komen voor onterecht veroordeelden en amnestie voor de politieke collaborateurs. Een ander artikel maakte een onderscheid tussen slechte collaboratie (die het nationaal belang ondergeschikt maakte aan Duitsland) en goede collaboratie (die de rust, veiligheid en geestelijke welstand der bevolking als doel had).
De flaminganten waren compleet verrast door het Volksunie-congres in Antwerpen. Ze wilden weten waarom De Clercq zijn actie niet in West-Vlaanderen organiseerde zoals afgesproken. Herman Wagemans ging op 26 april 1949 de gemoederen kalmeren: de Volksunie zou zich niet presenteren als partij en zou op het congres geen kiespropaganda maken voor zichzelf; de bedoeling was om de CVP tot een kartel te dwingen. Hoewel dit laatste flagrant tegen de afspraken was, namen de flaminganten er vrede mee. Ze waren vooral tevreden met Wagemans’ belofte dat er geen 2 lijsten zouden komen.
Uit het eerste nummer van De Voorpost bleek inderdaad niet dat de Volksunie aan de verkiezingen wou deelnemen. Het betoonde zelfs lof voor de CVP’er Gerard Van Den Daele (1908-1984) voor diens verzet tegen de repressie en epuratie. In het tweede nummer van De Voorpost (van 29 april 1949) werd de verkiezingsdeelname ergens weggestopt op de 8ste bladzijde gepubliceerd. De belangrijkste eisen van de Volksunie waren: oplossing van de uitwassen van repressie en epuratie, oplossing van de middenstandsproblemen, toepassing der taalwetten en de terugkeer van Koning Leopold III. Het 19 bladzijden tellende programma der Volksunie was overigens overduidelijk neo-Dinaso.
De flaminganten beseften nu dat ze door de neo-Dinaso’s waren misleid en in snelheid gepakt. Alle afspraken inzake partijvorming en programma werden door De Clercq en Todts gewoon genegeerd. Het congres dreigde nu beslag te leggen op de flamingantische achterban, die hierin het eerste teken zag van een flamingantische partijvorming. De stichtingsvergadering van de VC vond immers pas plaats op 14 mei 1949.
Op 8 mei 1949 liep zaal Gruter voornamelijk vol met flamingantische jongeren. De uitnodigingskaart van het congres vermeldde de Aalsterse advocaat Gilbert Claus, Cleymaet en De Clercq als sprekers. Cleymaet en Claus hadden echter afgehaakt: de eerste werd VC-lijsttrekker in Sint-Niklaas en de tweede verwierf de 6de plaats op de CVP-Kamerlijst in Aalst. De uiteindelijke toespraken zouden, zoals aangekondigd in De Voorpost, gehouden worden door Longville, Peeters en De Clercq. Ook Brienen zou een voordracht houden, waarin hij zijn oorlogsverleden sterk wou benadrukken, wellicht omdat de linkse pers het congres al als een incivieke manifestatie had gebrandmerkt.
Het congres verliep in een duffe sfeer. De toespraken van Longville en Peeters waren langdradig en theoretisch, waardoor het publiek zich sterk verveelde. Het grootste deel van het publiek, dat de heropstanding van het flamingantisme wou vernemen, bleef op zijn honger zitten. Peeters wees integendeel het Vlaams-Waals federalisme af. Brienens toespraak zou het publiek niet te horen krijgen (cfr. infra): “België kan in zijn geheel niet Nederlands zijn van taal, maar België kan het wel zijn met de geest. En wanneer België die weg opgaat, en de Benelux is de eerste grote stap in die richting, dan zullen alle Vlamingen met geestdrift de Belgische vlag als de hunne begroeten, de Belgische vlag, die feitelijk altijd de hunne is geweest”. De Clercq wou onder meer spreken over de Vlaamse Beweging die terecht materiële belangen nastreefde binnen België, maar de hereniging van het Nederlandse volk van de Benelux als einddoel had, wat hen tot “goede Belgische vaderlanders” maakte.
Brienen en De Clercq zouden niet aan het woord komen. Het congres was immers nogal ongelukkig gepland op 8 mei, de herdenkingsdag van het einde der Tweede Wereldoorlog. In Antwerpen vonden verschillende manifestaties van verzetsgroeperingen plaats. Enkele honderden aanhangers daarvan zakten af naar zaal Gruter, want ondanks hun afwijzing van het antibelgicisme en het uitspelen van mensen met een onverdacht oorlogsverleden werden de neo-Dinaso’s toch verdacht van incivisme. De tegenstanders kwamen net binnen toen Peeters uitgebreid hulde bracht aan Leopold III. Vanwege de zware vechtpartij die volgde, ontruimde de politie de zaal en was het congres afgelopen.
Tot eind mei hield De Voorpost vol dat de Volksunie aan de verkiezingen zou deelnemen, maar de facto was het opzet mislukt. Waarschijnlijk wilde het trio Todts-Pairon-De Clopper, dat de feitelijke organisatie van het congres verzorgd had, de schijn hoog houden in de hoop om alsnog een kartel te kunnen sluiten met de CVP. Er was nog tijd tot 3 juni 1949 voor het indienen der kieslijsten, maar De Voorpost van 10 juni 1949 keerde terug naar het traditionele antiparlementaire standpunt en wenste zich verder niet in te laten met “deze zinloze strijd”.
Fernand Pairon diende tenslotte in Antwerpen, met onder andere De Clopper, een onafhankelijke middenstandslijst in. De Clopper maakte propaganda door zich af te zetten tegen de VC via het pamflet ‘Manifest aan de Nederlands-Nationalisten’, onder meer getekend door Todts en Gust Peeters. De lijst-Pairon mikte electoraal louter op sociaal-economische ontevredenheid. Hoewel er slechts 8.000 stemmen behaald werden, miste de VC in Antwerpen hierdoor nipt haar parlementszetel. Pairon werd bij de verkiezingen van 1950 opgevist door de CVP en kreeg de 12de plaats op de Kamerlijst. In 1953 werd hij burgemeester van Kalmthout en vanaf 1954 senator. De Voorpost van 24 juni 1949 pakte nog de Antwerpse VC-lijsttrekkers – de concurrenten van Pairon – persoonlijk zwaar aan.
1948-1953: De Paascongressen
De Clopper, Todts, Jorissen en anderen organiseerden in 1948 een ‘Paascongres der Vlaamse Jongeren’ in naam van de Katholieke Vlaamse Landsbond. Dit op de katholieke jeugd gerichte congres verliep woelig door de contestatie van een grote groep flamingantische jongeren. Meer dan 1.000 jongeren waren aanwezig, evenals een aantal belangrijke CVP-parlementsleden en vertegenwoordigers van de grote katholieke jeugdorganisaties.
Na het mislukte Volksunie-avontuur rees bij de initiatiefnemers vermoedelijk het idee om een bijeenkomst te organiseren waarop potentiële medestanders uit Nederland en België uitgenodigd werden. Het doel was om een actiecomité samen te stellen voor de organisatie van een ‘Paascongres der Heel-Nederlandse jeugd’.
De bijeenkomst te Drakenburg (nabij Hilversum in Nederland) op 7 en 8 januari 1950 nam enkele zeer wollige resoluties aan primo over de eenheid der Nederlandse stam als geestelijke basis der Benelux en secundo dat de politieke doctrine die aan de basis moest liggen der Nederlandse eenheid, moest beantwoorden aan de eigen aard van het volk zoals die uit het verleden organisch gegroeid was. Dit voorzichtig geformuleerd neo-Dinaso-programma wou onder meer Heel-Nederlandse congressen propageren. Todts verzorgde de nieuwsbrief De Lage Landen.
Een tweede bijeenkomst vond plaats in Antwerpen op 30 april 1950. Op de vooravond hield men een openbare vergadering met Jorissen, Wagemans en voormalig scoutsleidster Yvonne Van Haegendoren-Groffi (1911-1953) als sprekers. Er was ook een Zuid-Afrikaan aanwezig. Men besprak een voordracht over “onze doctrine” – geschreven door voormalig scoutsleider Maurits Van Haegendoren (1903-1994) en gebracht door Gust Peeters – en een voorstel van Juul De Clercq om een eenheidsbeweging op te richten. Er werd beslist om tegen het einde van 1950 een Heel-Nederlands congres te organiseren en hiervoor organisatiecomités voor Nederland en België op te richten.
Blijkbaar vlotte de inbreng uit Nederland niet erg goed, want in het najaar van 1950 begonnen Todts en Jorissen een tweede Paascongres der Vlaamse Jongeren te plannen. Dit moest in april 1951 doorgaan en deze keer zonder patronage van de Katholieke Vlaamse Landsbond (wiens activiteit stilgevallen was). Er moest een eenheidsmanifestatie uit ontstaan onder hun leiding. Ze zochten bijgevolg mensen uit zowat alle actieve verenigingen om tot het organisatiecomité toe te treden. Begin 1951 bezochten Jorissen en Olsen zelfs de nationale bestuursvergaderingen van de VC. Na wat strubbelingen participeerde uiteindelijk alleen Frans Van Der Elst (1920-1997). Hij wou een voordracht houden pro amnestie en pro federalisme. Het eerste werd zonder probleem aanvaard, maar het tweede botste uiteraard op zware tegenstand van Todts en congresvoorzitter Jorissen.
De eerste congresdag op 7 april 1951 kende aanvankelijk een relatief normaal verloop. Er daagden ca. 300 jongeren op. De plenaire vergadering ontaardde echter in een scheldpartij tussen neo-Dinaso’s en flaminganten. Volgens De Standaard (dd. 8 april 1951) was een deel der aanwezigen vooral geïrriteerd door een Belgische vlag op het podium.
Todts en Jorissen keerden hierna terug naar hun plan om Heel-Nederlandse congressen te organiseren. Dit leidde tot de ‘Jongerencongressen der Nederlanden’, die eveneens rond Pasen werden gehouden in Maastricht (1952) en Brussel (1953).
Voor het congres in Maastricht werd contact gelegd met de Limburgse regionalistische stroming in Belgisch- en Nederlands-Limburg. Maar enkele Nederlandse kranten maakten het hele opzet verdacht, waarop lokale jeugdverenigingen hun toegezegde participatie annuleerden en een geplande receptie op het stadhuis werd afgezegd. Op het eigenlijke congres werden onder meer voordrachten gehouden door de jezuïet Marcel Brauns (1913-1995) over de confessionele diversiteit der Nederlanden en door Jorissen.
Het congres van 1953 in Brussel lokte 300 aanwezigen. Op de slotvergadering spraken Staf Vermeire, Yvonne Van Haegendoren-Groffi en congresvoorzitter Jorissen. De Standaard (23 april 1953) bekloeg zich over het matte verloop en betreurde dat het congres het flamingantisme wou inruilen voor nationalisme.
Todts zou zich vanaf 1957 engageren in het Verbond van het Vlaams Verzet (cfr. infra). In 1974-1977 werd hij adviseur van CVP-Minister Robert Vandekerckhove (1917-1980) en in 1976-1982 CVP-schepen in Deurne. Todts werd tevens bekend met de boekenreeks ‘Hoop en Wanhoop der Vlaamsgezinden’. De Clopper zou zich voortaan hoofdzakelijk bezighouden met het leiden der Vlaamse Volkskunstbeweging. Hij bleef de neo-Dinaso-actie opvolgen en was nog stichtend lid van de Fondation L. Gueuning/Stichting L. Gueuning. Jorissen evolueerde van neo-Dinaso tot flamingant. Eind 1952 was hij trouwens al medestichter geweest van de VVB, die het Vlaams-Waals federalisme propageerde.
1949-1951: De (tweede) Joris Van Severen-Orde en de (tweede) Solidaristische Beweging
Na de mislukking van de eerste Volksunie stichtte Albert Brienen in september 1949 met enkele andere oud-Dinaso’s naast de gelijknamige groepering van Louis Gueuning (cfr. supra) een tweede Joris Van Severen-Orde, die zich beschouwde als de elitaire kern van een nog op te richten (tweede) Solidaristische Beweging. Aanvankelijk was ook Staf Vermeire betrokken. Precies 10 jaar na de moord op Van Severen – op 20 mei 1950 – kwam de Joris Van Severen-Orde naar buiten met het vormelijk zeer verzorgde blad Joris Van Severen-Orde. Orgaan van de Solidaristische Beweging. Tot maart 1951 zouden er 9 nummers verschijnen. In het najaar van 1950 kwam er een fusie met het Brusselse groepje Concentration Nationale Solidariste, dat niet lang daarvoor was opgericht en geleid werd door de Waalse journalist Ossian Mathieu en de Franstalige Antwerpse advocaat en oud-Rexist José Wilmots. Als gevolg daarvan werd vanaf het 6de nummer de ondertitel van het tijdschrift ook in het Frans vermeld en verschenen er Franstalige artikels van Wilmots en Mathieu.
Heel het initiatief en het tijdschrift waren inhoudelijk doorspekt met typische neo-Dinaso-retoriek over antiparlementarisme, de Koningskwestie en de vestiging van een Dietse solidaristische staat. Ook de organisatiestructuur van het Verdinaso werd gekopieerd. Eind 1950 startte Brienen zelfs met een nieuwe militie – de Joris Van Severen-Ordewacht – waarvan meteen een uniform werd afgebeeld in het blad.
In januari 1951 kwam het tot een samenwerking tussen de Joris Van Severen-Orde en de VMO. Zo hielden Brienen en Mathieu op 27 januari 1951 een voordracht in Antwerpen op een herdenking van VNV-voorman Reimond Tollenaere. De Joris Van Severen-Ordewacht hielp er de VMO om de talrijke tegenbetogers buiten te houden totdat de politie opdaagde. Het gebeuren kon rekenen op ruime belangstelling van de gehele media. De volgende dag ging in Gent op een geheime locatie een solidaristisch congres door dat de start moest zijn van de (tweede) Solidaristische Beweging. De Joris Van Severen-Orde werd herdoopt tot de Solidaristische Beweging en het blad tot Solidarisme. VMO en Joris Van Severen-Ordewacht zorgden opnieuw samen voor de veiligheid.
Brienen droomde al van een samenwerking van alle Dinaso- en flamingantische groepen. Dit front moest dan bij de volgende verkiezingen in de plaats treden van de zieltogende VC en zou vermijden dat er een nieuwe Verdinaso-VNV-tegenstelling ontstond. Brienen onderhandelde ook met Gueuning over een eventuele samenwerking, maar dit eindigde in een conflict.
Ondanks ruime persbelangstelling slaagde de Solidaristische Beweging er echter niet in om veel aanhang te werven. Ze werd bijgevolg in het najaar van 1951 opgedoekt, hoewel Brienen tot eind 1953 tevergeefs bleef ijveren voor samenwerking. In maart 1953 engageerde Wilmots zich in de VC.
1951: Het nieuwe Hier Dinaso!
Begin 1951 verschenen er in de Antwerpse straten affiches die de terugkeer aankondigden van het Verdinaso-weekblad Hier Dinaso!. Op 20 januari 1951 verscheen inderdaad het eerste nummer, dat vormelijk analoog was aan het oorspronkelijke Hier Dinaso!. Het was een éénmansinitiatief van Paul Persyn uit onvrede over zijn oproep tot de oud-Dinaso’s om hun vertrouwen in de CVP te stellen. De absolute CVP-meerderheid na de verkiezingen van 1950 leverde immers noch een sterke regering, noch een oplossing van de repressieproblematiek, noch een terugkeer van Leopold III op. Persyn kondigde een snelle heroprichting aan van het Verdinaso.
Inhoudelijk sloot het nieuwe Hier Dinaso! sterk aan bij de strekking van Gueuning, met wie Persyn duidelijk nauw contact had. Persyn maakte een strijdpunt van een oplossing voor de repressie, die hij een zwaardere vergissing achtte dan de collaboratie. Na 8 edities zat Persyn er financieel door en werd het blad door Gueuning overgenomen en voortgezet als De Uitweg. Het Verdinaso-kenteken op de voorpagina werd vervangen door de leeuw met de 17 pijlen. Persyn verliet de politiek voorgoed en beperkte zich voortaan tot het zakenleven.
1954-begin jaren 1960: Het Verbond van het Vlaams Verzet
Op 31 januari 1954 richtten Albert Brienen en Staf Vermeire het Verbond van het Vlaams Verzet (VVV) op. Hierin zetten mensen met onverdachte vaderlandse papieren zich in voor amnestie: verzetslui, Belgische oorlogsvrijwilligers, politieke gevangenen en anderen die tijdens de oorlog anti-Duitse activiteiten verrichtten. Onder meer De Standaard-journalist en voormalig verzetslid Louis De Lentdecker (1924-1999) was lid van het VVV en vanaf 1957 werd Todts een belangrijk medewerker. Brienen poogde ook mensen van het ‘Diets verzet’ aan te trekken, zoals Paul Daels (1921-1989).
Vermeires betrokkenheid bij het VVV werd hem in flamingantische kringen zeer kwalijk genomen. Dat kwam wellicht door de figuur van voorzitter professor Flor Peeters, een voormalige politieke gevangene die het nationaal-socialisme steeds zeer scherp veroordeelde. Daarnaast waren er inhoudelijke obstakels: het VVV wilde wel de Vlaamse Beweging steunen, maar verklaarde zich expliciet trouw aan de Belgische staat en aan de monarchie. Het VVV verscheen op de IJzerbedevaart, maar droeg er een Belgische vlag met daarop de Vlaamse, Brabantse en Limburgse leeuw op een oranje-wit-blauwe achtergrond. Vermeire bezorgde Brienen – die secretaris van het VVV was – ook lijsten van potentiële leden.
Voormalig politieke gevangene, voormalig hoofdredacteur van Gazet van Antwerpen en CVP-parlementslid Louis Kiebooms (1903-1992) was een der bezielers van het VVV en pleitte voor “een nationale verzoening”. Als militant katholiek en anti-nazi werd hij door de Duitse bezetter in augustus 1940 gearresteerd en verbleef van september 1941 tot april 1945 in het concentratiekamp van Sachsenhausen.
In april 1958 schreef Brienen aan Vermeire: “Alle leiders in het VVV zijn volgelingen of bewonderaars van Joris Van Severen. Wij zullen dan ook in zijn geest handelen”. Dit verklaart een vraag van Louis Kiebooms op 10 april 1957 in de Kamer tijdens de bespreking van een wetsontwerp inzake schadevergoedingen aan burgerlijke oorlogsslachtoffers. Kiebooms vroeg of deze vergoedingen ook zouden worden toegekend aan de 21 personen die in mei 1940 te Abbeville waren vermoord. Tijdens het debat beklemtoonde Kiebooms dat Van Severen een vurig Belgisch-nationalist was geworden en gaf minister Leburton toe dat Van Severens arrestatie en executie onterecht waren geweest. Naast deze parlementaire poging om Van Severen te rehabiliteren was in maart 1954 al een erkenning als oorlogsslachtoffer van de arrestanten van mei 1940 gevraagd in het parlement door Verdinaso-sympathisant en CVP-parlementslid Jozef Custers. Kiebooms kon dergelijke delicate thema’s wegens zijn oorlogsverleden als politiek gevangene met onbetwist moreel gezag aankaarten. In 1957 sprak hij ook op een amnestiecongres van het VVV.
Het VVV gaf de periodiek Het Vlaamse Verzet uit van augustus 1954 tot mei 1958 en organiseerde heel wat meetings, onder meer met oud-Dinaso en leider van verzetsbeweging Groep Othello Frantz Van Dorpe. Hoogtepunten waren een congres in december 1958 (waarop onder meer oud-Dinaso en lid van verzetsbeweging Groep Orchimont Jef Van Bilsen sprak) en het meeorganiseren van een grote amnestiebetoging te Antwerpen in 1959. In het begin der jaren 1960 bloedde de activiteit dood.
1956-begin jaren 1960: Het Joris Van Severen-Komitee
Gueuning-medewerker Roger Liefooghe verzamelde eind 1956 een groep Gentenaren in het Joris Van Severen-Komitee, dat enkele nummers van een gelijknamige periodiek en daarna het kaderblad Band uitbracht. Het betrof voornamelijk oud-Dinaso’s, zoals Albert Brienen, Hendrik Broekaert, Leo Hosten en Arthur Raman. Vooral in 1957 was de groep actief met onder meer een Van Severen-herdenking op 11 mei 1957 te Gent die zeer positief onthaald werd in de katholieke kranten. In 1960 ondersteunde het Joris Van Severen-Komitee de oprichting van het Verbond Recht en Orde (cfr. infra).
1960-1969: Het Verbond Recht en Orde
In 1960 stichtte Armand Wijckmans vanuit de Heel-Nederlandse jeugdgroep Sint-Jorisvendel in Antwerpen het Verbond Recht en Orde (VRO). Diverse oud-Dinaso’s werden hier lid van. De start van het VRO werd gepatroneerd door het Joris Van Severen-Komitee. Het VRO kreeg dan ook de volle steun van de Gueuning-groep, aan wie het een tijdlang de broodnodige militanten leverde voor directe politieke actie, zoals het verstoren van het VVB-congres in 1963 te Antwerpen. Maar in februari 1964 leidden voornamelijk persoonlijke conflicten tussen Gueuning en Wijckmans tot een breuk, waardoor een aantal VRO’ers zich afscheurde en de Werkgemeenschap De Lage Landen stichtte (cfr. infra).
Het VRO verdween kortstondig in de Beweging voor de Verenigde Staten van Europa (cfr. infra) om vanaf september 1966 weer volledig zelfstandig te worden. Op 9 april 1967 organiseerde het VRO een kaderdag in de abdij van Postel waar een gemeenschappelijke programmaverklaring werd uitgewerkt met enkele conservatieve groepen. Het VRO gaf tevens de periodiek Samen in de Nederlanden uit.
In 1967 zocht Wijckmans tevens toenadering tot de VMO, die toen tot de invloedssfeer van de flamingantische partij Volksunie (VU) behoorde. De VU-leiding reageerde door lidmaatschap van de VU en het antiparlementaire VRO onverenigbaar te verklaren.
In 1968 richtte het VRO de militantengroep Studenten- en Arbeidersfront op. In 1969 leidden interne strubbelingen tot de ontbinding van het VRO, waarna een aantal militanten zich aansloot bij de Dietse Solidaristische Beweging (cfr. infra).
1961-1992: De Beweging voor de Verenigde Staten van Europa
Walter Kunnen (1921-2011) was als universiteitsstudent tijdens de oorlog actief bij het DSK waar hij zwaar beïnvloed raakte door het gedachtegoed van het Verdinaso. In 1961 stichtten Kunnen en zijn echtgenote Diane Debray een Vlaamse afdeling van de Beweging voor de Verenigde Staten van Europa (BVSE), die het flamingantisme afwees en ijverde voor een federaal Europa en voor een zesledig federaal België (met Vlaanderen, Brabant, Limburg, Luik, Henegouwen en de Ardennen als bouwstenen). De BVSE gaf het tijdschrift Europa Eén uit, waarvan Staf Vermeire sinds de ondergang van Ter Waarheid (cfr. infra) redactiesecretaris was.
Hoewel de BVSE geen openlijke neo-Dinaso-beweging was, telde ze vele Dinaso’s, zoals de voormalige Jong Dinaso Frans De Hoon. Dit blijkt ook uit de tijdelijke fusie met Wijckmans’ VRO (cfr. supra). Tevens onderhield de BVSE contact met de denktank E Diversitate Unitas die gelijkaardige standpunten had (cfr. infra).
De BVSE ging door Kunnens salonfähigkeit nooit de antiparlementaire of antipartijpolitieke toer op. Kunnen had als ondernemer immers uitgebreide contacten met het establishment. Hierdoor bleven Wijckmans en De Hoon niet bij de BVSE aan boord. Ook Vermeire was niet erg gelukkig met Kunnens salonfähigkeit. Kunnen trad in 1992 af als voorzitter van de BVSE.
1962-1964: Het tijdschrift Ter Waarheid. Met de Nederlanden in Europa
Eind 1961 stichtte Staf Vermeire met een tiental jonge volgelingen uit het pas ontbonden BJV (cfr. supra) het Diets Eedgenootschap (Degen): onder meer Maurits Cailliau, Marcel De Knijf, Rik Nauwelaerts, Rudi Sinia, Hendrik Starckx, Paul Steuperaert en Paul Van Caeneghem. De meesten waren ook lid van het ADJOV. Zoals het Verdinaso wou het Degen een ideologische elitegroep zijn die georganiseerd was als een orde. De deelgenoten beloofden vooraf in een plechtige eed trouw aan Dietsland en absolute geheimhouding.
Het Degen besprak uitvoerig hoe het best zijn Heel-Nederlandse invloed kon doen gelden in de jeugdbeweging en in de VU, bijvoorbeeld door infiltratie of discrete beïnvloeding. Verder bracht het Degen in mei 1962 het vormelijk goed verzorgde maandblad Ter Waarheid. Met de Nederlanden in Europa uit, dat de oorspronkelijke lijn van Het Pennoen hernam en officieel uitgegeven werd door de Werkgroep Nederland Eén. De naam Ter Waarheid verwees naar Van Severens gelijknamige periodiek uit de jaren 1920.
Vermeire beschikte over een klein startkapitaal door de winst die zijn uitgeverij Oranje Uitgaven maakte op Arthur de Bruynes biografie van Van Severen. Hiermee liet hij Ter Waarheid op een nogal ambitieuze oplage van 3.000 exemplaren drukken. Er moesten na één jaar 1.500 abonnees zijn om de kosten te dekken. Hij rekende op het ADJOV voor het werven van abonnementen en voor colportages op grote flamingantische manifestaties als het Zangfeest en de IJzerbedevaart.
Ter Waarheid hanteerde het traditionele neo-Dinaso-discours over de Conservatieve Revolutie, de Dietse Rijksgedachte en het zesledig federalisme. De toon van het blad was bedaard: Vermeire weigerde bijvoorbeeld een tekst van Paul Van Caeneghem waarin de VU, Het Pennoen en de VVB bijna met de grond gelijk werden gemaakt. Toch maakte Ter Waarheid zeker geen geheim van zijn ideologische oorsprong: al in het eerste nummer prijkte een foto van Van Severen met het onderschrift “Hij leeft nog steeds in ons”. Het blad waarschuwde tevens voor de instroom van arrivisten en neomarxisten in de VU. Ter Waarheid was inhoudelijk zwak door de jonge leeftijd der auteurs. Het beheer en de eindredactie kwamen bijna volledig ten laste van Vermeire, waardoor hij nauwelijks zelf iets in zijn blad kon schrijven.
Bij de diverse losse medewerkers bood zich met Vik Eggermont onverwacht ook iemand uit de kring rond Gueuning aan. Vermeire was echter de twisten tussen het Sint-Arnoutsvendel en het ADJV, waarbij Eggermont hem persoonlijk zwaar had aangevallen, nog niet vergeten. Hij nam dan ook de tekst van die “rotvent” niet op. Eggermont vond dat Ter Waarheid bleef hangen “tussen consequent Diets-nationalisme en het romantisme der Vlaamse Beweging” en dat het Van Severen misbruikte.
Met de vernieuwing van het VU-partijbestuur dreigden eind 1962 voor het eerst politieke spanningen in de VU tussen het traditionele flamingantisme en de progressieve nieuwkomers. Toen Vermeire begin september 1962 het artikel ‘Amateurs en vrijgestelden’ ontving, deed zich de kans voor om de VU zware schade toe te brengen. Deze tekst van de jonge radicaal Herman Thuriaux uit Vorst, die toen in de Brusselse VU ageerde tegen de progressieven, verwoordde de frustratie van vele VU-pioniers: de partij was opgebouwd door het ondankbare werk van vrijwilligers, doch na de moeilijke ontstaansperiode kwamen er echter betaalde jonge progressieven, die schaamteloos een parlementszetel nastreefden en het partijblad en de koers der VU domineerden. Vermeire besefte dat publicatie hiervan een enorme impact zou hebben, maar besloot om af te wachten hoe de vernieuwing van het partijbestuur zou verlopen, daar nog steeds de hoop bestond dat de progressieven buitengewerkt konden worden. De ervaring met de Rebellenbrief (cfr. supra) had bovendien geleerd dat zulke aanvallen niet zonder risico’s waren, terwijl Ter Waarheid nog honderden abonnees tekortkwam om kostendekkend te zijn. Een compromis over de samenstelling van het partijbestuur kon uiteindelijk ternauwernood een breuk in het partijtje vermijden.
In Ter Waarheid van februari 1963 verscheen het artikel dan uiteindelijk, wat zoals verwacht tot heel wat positieve en negatieve reacties leidde. De zaak leidde in april 1963 tot een hoog oplopende ruzie in het VU-partijbestuur. Ter Waarheid schreef in het nummer van juni 1963 dat het veel tegenkanting ondervond van de VU.
Het tijdschrift zou deze zaak niet lang overleven. Eind 1962 had het naar eigen zeggen 742 abonnees, wat verre van voldoende was om kostendekkend te zijn. Na 13 nummers was dit niet langer houdbaar en hield Ter Waarheid op te verschijnen. Vermeire was zeer zwaar teleurgesteld in zijn jonge medewerkers: ze schreven wel artikels, maar inzake colportages en abonnementenwerving deden ze volgens hem weinig of niets. Vermeire beweerde een tekort van 30.000 à 50.000 frank aan Ter Waarheid te hebben overgehouden. De relatie met veel mensen – vooral Van Caeneghem en Cailliau – uit het Degen, dat in ruzie eindigde, raakte voor lange tijd verzuurd.
1964-2011: De Werkgemeenschap De Lage Landen:
In maart 1964 stichtte een aantal ex-VRO’ers onder leiding van Vik Eggermont de Werkgemeenschap De Lage Landen, die de periodiek Delta uitgaf. De oplage was in 1966 300 exemplaren, maar verschrompelde tot een 50-tal exemplaren op het einde. De kleine groep volgde inhoudelijk de lijn van Gueuning en werd door hem in 1970 erkend als Antwerpse OAW-afdeling.
1965-jaren 1970: De denktank E Diversitate Unitas
André Belmans, die de samenwerking met Louis Gueuning verbrak, verzamelde vanaf 1965 voornamelijk Franstaligen rond zich in de denktank E Diversitate Unitas. Die gaf in de jaren 1970 het tijdschrift De Federalist uit, dat het herstel der 17 Provinciën en provinciaal federalisme promootte. Deze denktank bracht vooraanstaande politici van diverse strekkingen, denkers en diplomaten uit binnen- en buitenland bij elkaar om te overleggen hoe België kon gered worden uit de communautaire chaos. Daarnaast werden ook heel wat brochures gepubliceerd.
1969-1974: De Dietse Solidaristische Beweging
De Dietse Solidaristische Beweging (DSB) werd gesticht in 1969 na de ontbinding van het VRO (cfr. supra) door de in Wilrijk wonende Nederlandse oud-Dinaso, oud-NSB’er en filoloog Maarten Van Nierop (1912-1979). De DSB verspreidde in 1969-1972 het ledenblad Vrij Dietsland. Vanaf 1971 verscheen tevens het militantenblad Speerpunt voor de militie Verbond van Solidaristische Militanten (een groep militanten onder leiding van oud-VMO’er Karel Luyckx).
De DSB wou een nieuw en eigentijds Verdinaso zijn: naast traditionele elementen als het afwijzen van de partijdemocratie en de taalfederalisering van België, het herstel der 17 Provinciën, de uitbouw der Benelux tot een staatkundige eenheid, provinciaal federalisme en oproepen om blanco te stemmen verzette de DSB zich ook tegen de fusies van gemeenten en tegen de NAVO, terwijl tevens een radicaal ecologisme verdedigd werd. DSB-militanten namen in 1970 deel aan de Limburgse mijnstaking en voerden actie voor het behoud van het Noorderkasteel in Antwerpen en tegen het chemische bedrijf Progil. De DSB had voorts contact met de Franstalige Derde Weg-studentenbeweging Révolution Européenne.
In december 1974 fuseerde de DSB met het Solidaristisch Verbond van voormalig Jong Dinaso-gebiedsleider Arthur Raman en Albert Brienen tot de Solidaristische Beweging.
1971-1974: Het Solidaristisch Verbond
In 1971 stichtten Albert Brienen, Maurits Cailliau en Arthur Raman het Solidaristisch Verbond dat bij de verkiezingen van 1971 al een campagne lanceerde om blanco te stemmen. Het door Raman geleide Solidaristisch Verbond was een overwegend Gentse organisatie en verspreidde achtereenvolgens de periodieken Orde (1971-1972) en De Solidarist (1973-1974).
Brienen viel weg toen het Solidaristisch Verbond op 14 december 1974 fuseerde met de DSB (cfr. supra) tot de Solidaristische Beweging.
1974-1980: De (derde) Solidaristische Beweging
Deze derde (!) Solidaristische Beweging (cfr. supra) ontstond in december 1974 door een fusie van de Dietse Solidaristische Beweging en het Solidaristisch Verbond (cfr. supra). Deze Heel-Nederlandse Solidaristische Beweging (SB) werd geleid door Maarten Van Nierop en sloot ideologisch sterk aan bij de DSB. Bovendien werd de DSB-militie Verbond van Solidaristische Militanten nu omgedoopt in Solidaristische Militanten Orde (SMO).
De SB zette de publicatie voort van het blad De Solidarist, dat in 1973 gelanceerd was door het Solidaristisch Verbond, terwijl ook het in 1971 door de DSB-militie gelanceerde Speerpunt bleef verschijnen als militantenblad van de SMO. De SB onderhield contact met gelijkgezinde groepen in Europa en werkte in België samen met het Scoutsverbond Delta (cfr. supra).
Van Mierops overlijden in juli 1979 en de betrokkenheid van SMO’ers bij een VMO-aanval op een progressieve boekhandel in Mechelen in februari 1980 betekenden het einde der SB.
Vier tekortkomingen van de naoorlogse neo-Dinaso-beweging
1. Politiek marginaal
De Belgischgezinde neo-Dinaso-strekking rekende op de koning als spil van een nieuw regime. Doch hoewel Leopold III tijdens de Koningskwestie en Boudewijn tijdens de Congocrisis wel voorstander waren van een technocratisch kabinet met sterke vorstelijke inbreng, zou de naoorlogse monarchie toch een systeemondersteunende kracht worden.
De neo-Dinaso’s hadden bovendien het probleem dat in de naoorlogse Belgische politiek de tegenstellingen nooit groot genoeg waren om tot een fatale maatschappelijke kortsluiting te leiden. De pacificatiedemocratie slaagde er in om te vermijden dat de door de conservatief-revolutionaire neo-Dinaso’s verfoeide partijpolitiek in mekaar stortte. Na afloop van de repressie, Koningskwestie en Schoolstrijd werd de eendracht in het politieke centrum niet meer ernstig bedreigd.
Het gebruikelijke neo-Dinaso-recept – politiek en economisch corporatisme – was tijdens de jaren 1930 algemeen aanvaard in het politieke discours. Maar door de Tweede Wereldoorlog konden de liberale en marxistische krachten dit buiten de politieke consensus plaatsen. Dat versterkte nog vanaf de jaren 1960 door de fundamentele sociaal-economische en culturele transformatie van de maatschappij. Bijgevolg werd corporatisme enkel nog gecultiveerd in de politieke marginaliteit. De neo-Dinaso’s bleven de maatschappelijke evolutie echter volgens hun compleet verouderde inzichten interpreteren. De instroom van nieuwe aanhangers was bijgevolg zeer gering. Geen enkele groep slaagde er in om meer dan enkele honderden – tot de jaren 1960 – of tientallen – vanaf de jaren 1970 – aanhangers te werven, waardoor op ieder nieuw initiatief vaak weer dezelfde gezichten opdoken.
Op staatkundig vlak verging het de neo-Dinaso’s nog slechter. De Benelux kon zich nooit volwaardig ontwikkelen en bracht daardoor geen nationaal bewustzijn op gang. Het herstel der historische Nederlanden bleef een elitair idee.
2. Achterhaalde standpunten
De neo-Dinaso’s bleven archaïsche ideeën hanteren: ze mankeerden een groot denker als Joris Van Severen om de boodschap van het Verdinaso aan te passen aan de naoorlogse context van Koude Oorlog, dekolonisatie, amerikanisering, mei ’68, secularisering, vervaging van normen en zeden, … Bijgevolg slaagden ze er niet in om een nieuwe synthese te maken van de actuele maatschappelijke situatie. Geen enkele neo-Dinaso-groepering kon een alom bekende kopman naar voor schuiven, die een geactualiseerd gedachtegoed vlot kon verwoorden en aldus aan de man te brengen.
Alleen inzake de opkomende federalisering slaagden de neo-Dinaso’s er in om een nieuw standpunt – namelijk een zesledig federalisme – te formuleren, hoewel ook dit eigenlijk al min of meer door Van Severen vertolkt was. Het provinciaal federalisme vond in de jaren 1960 gehoor bij de Franstalige katholieken. Het tweeledig federalisme boezemde hen immers angst in gezien hun minderheidspositie in Franstalig België. Pierre Nothomb citeerde in dat verband zijn vriend Joris Van Severen tijdens een senaatsdebat in 1960 over de oprichting van Nederlandstalige en Franstalige adviserende cultuurraden: “Combien de fois m’a-t-il [Van Severen] dit, et ses plus beaux écrits en témoignent, que le fédéralisme à deux serait mortel pour la Belgique”. Toen de regering-Lefèvre-Spaak (1961-1965) effectief over de aanpassing der staatsstructuren begon te praten, verdedigde de PSC tijdens de voorbereidende onderhandelingen steeds een provinciale decentralisatie. Toch zou het idee het niet halen: na de staatshervorming van 1970 vond het geen relevant draagvlak meer.
3. Verkeerde achterban
Tot het einde der jaren 1950 werkten veel neo-Dinaso’s via het flamingantisme, vooral in de jeugdbeweging. Aangezien na de oorlog zelfs voor het flamingantisme België opnieuw het onbetwiste vaderland werd, hoopten de neo-Dinaso’s hun staatkundige project te kunnen opleggen aan de Vlaamse Beweging. Dit zou echter tevergeefs blijken. Ook hun onverdachte oorlogsverleden en soms zelfs goede vaderlandse verdiensten waren in flamingantische kringen eerder een nadeel. De kloof tussen flaminganten en Belgischgezinde neo-Dinaso’s werd nog uitgediept door de neo-Dinaso-visie op de collaboratie, repressie en epuratie. De Belgischgezinde neo-Dinaso-beweging slaagde er bijgevolg niet in om allianties sluiten met het flamingantisme.
Met de nieuwe opkomst van het flamingantisme in de jaren 1960 verdwenen de neo-Dinaso’s in de marge. De tijdelijke tactische pogingen tot beïnvloeding van het flamingantisme door infiltratie mislukten. De kloof tussen taalnationalisme en de Dietse Rijksgedachte bleek te diep.
Met Franstalige Derde Weg-groeperingen werden wel allianties gesloten, maar deze mislukten telkens weer doordat zij hun Belgisch nationalisme niet altijd wilden koppelen aan Heel-Nederlandisme. Ook in het progressieve Nederland werd tevergeefs steun gezocht voor solidarisme en zelfs voor staatkundige eenmaking. Een Heel-Nederlandse en solidaristische beweging kan dus alléén in België ontstaan én de kern ervan moet in het demografisch en economisch dominante Belgisch-Vlaanderen en Belgisch-Brabant liggen.
4. Veronachtzamen van kernaspecten van het Verdinaso:
Hoewel de reputatie van de geüniformeerde DMO – hét paradepaardje van het Verdinaso – tot op heden nazindert, richtten de neo-Dinaso’s deze oermilitie niet opnieuw op. De Joris Van Severen-Ordewacht en de (D)SB-militie Verbond van Solidaristische Militanten/Solidaristische Militanten Orde waren de enige uitzonderingen. Dat Louis Gueuning van bij zijn toetreding tot het Verdinaso het militarisme afwees, verklaart ook waarom hij nooit een nieuwe militie oprichtte. Het succes van de in 1950 opgerichte flamingantische VMO – die grotendeels op de roemruchte DMO geïnspireerd was – bewees nochtans dat dit zeer sterk kon bijdragen tot het welslagen van een politieke beweging. Immers, zowel praktisch – voor het veilig laten doorgaan van bijeenkomsten en manifestaties – als propagandistisch – door het houden van parades met vlaggen en muziekkapel – bleek zoiets een enorm voordeel. Mét een militie zou bijvoorbeeld het congres van de eerste Volksunie in 1949 nooit verstoord zijn door politieke tegenstanders en had dit project wel een kans op slagen gehad.
De neo-Dinaso’s richtten ook het Verdinaso zelf nooit terug op. Alleen Paul Persyn lanceerde in 1951 opnieuw Hier Dinaso! en droomde van een nieuw Verdinaso, maar na de overname door Gueuning veranderde deze de naam in De Uitweg en verdween het Verdinaso-kenteken op de voorpagina. Dat toonde aan dat Gueuning duidelijk een andere richting wou volgen dan Van Severen.
Geen enkele neo-Dinaso-groepering bouwde een totale structuur op naar het voorbeeld van het Verdinaso met een jeugdbeweging, een studentenorganisatie, een militie, een vakbond, een landbouwersorganisatie, eigen medewerkers, … Kortom, men had geen contact met de reële maatschappij en kon daardoor nooit een brede achterban opbouwen. Nochtans blijkt uit het relatieve succes van de tweede Joris Van Severen-Orde, het Joris Van Severen-Komitee en van de (D)SB dat er wel degelijk een potentieel bestond voor een nieuw Verdinaso.
Tegen hun ideologische overtuiging in waagden sommigen zich ook aan partijpolitieke experimenten. Dat kon niet anders dan verkeerd lopen. Bij heel wat neo-Dinaso’s verwaterde tevens het solidaristische en katholieke gedachtegoed, waardoor zij zich louter tot Heel-Nederlandisme beperkten en dus ver afdwaalden van de oorspronkelijke doelstellingen voor een conservatief-revolutionaire herordening van de maatschappij. Veel neo-Dinaso-groepen beperkten zich ook te veel tot nostalgische Van Severen-verering in plaats van het concretiseren van politieke doelstellingen.
Conclusie
Joris Van Severen werd ideologisch vooral bepaald door de diverse stromingen van de Conservatieve Revolutie en eindigde finaal bij de Jong-Conservatieve strekking. Hoewel het Verdinaso aanvankelijk kortstondig een anti-Belgische tendens kende, herdefinieerde Van Severen de staatkundige opvattingen van het Verdinaso grondig. Het nieuwe staatkundige objectief omvatte nu het grondgebied der Bourgondisch-Habsburgse Nederlanden. Deze eerste Nieuwe Marsrichting werd later nog verfijnd en grondig uitgewerkt. Door deze diepgaande evolutie ligt het eigenlijke zwaartepunt van het Verdinaso ná 1934. De sociaal-economische ideologie van het Verdinaso omvatte niet enkel het politieke niveau, maar was een totaalsysteem van het menselijk handelen en denken.
De invloed van de Leider bleef decennialang bestaan en bestaat zelfs nog steeds. De neo-Dinaso’s zijn heden echter nagenoeg uitgestorven, hoewel de Dinaso-geest nog steeds jongeren inspireert. De naoorlogse neo-Dinaso-beweging oogstte door haar 4 tekortkomingen weinig succes. Primo stonden de neo-Dinaso’s immers totaal geïsoleerd, secundo waren hun standpunten politiek achterhaald, tertio richtten ze zich op een verkeerde achterban en quarto veronachtzaamden ze enkele kernaspecten van het Verdinaso. Hierdoor vormden de diverse neo-Dinaso-groeperingen nooit meer dan bescheiden groupuscules.
De (D)SB van Maarten Van Nierop was in 1969-1980 de eerste én enige poging om een geactualiseerd Verdinaso op te richten. Er leek zelfs even wat meer eenheid te komen onder de neo-Dinaso’s door de fusie met het Solidaristisch Verbond. Er was met het Verbond van Solidaristische Militanten/Solidaristische Militanten Orde zelfs een militie. Daarnaast waren er ook goede contacten met de jeugdbeweging Scoutsverbond Delta en met de Franstalige studentenbeweging Révolution Européenne, waardoor zelfs een bredere beweging in de maak leek.
Referenties
1. Boeken:
CAILLIAU (M.), Staf Vermeire 1926-1987. Diets jeugdleider en rebel, Turnhout, Oranjejeugd vzw, 1988, pp. 64.
CAILLIAU (M.) e.a., Louis Gueuning 1898-1971. Een leven in rechtlijnigheid, Turnhout, Oranjejeugd vzw, 1991, pp. 47.
DE BRUYNE (A.), De Kwade Jaren, deel 4, Brecht, Uitgeverij De Roerdomp, 1973, pp. 318.
DE BRUYNE (A.), Joris Van Severen. Droom en daad, Zulte, Oranje Uitgaven, 1961, pp. 342.
DELAFORTRIE (L.), Joris Van Severen en De Nederlanden. Een levensbeeld, Zulte, Oranje Uitgaven, 1963, pp. 272.
DE SCHRIJVER (R.) e.a., Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, 3 delen, Tielt, Uitgeverij Lannoo, 1998, pp. 3799.
DE WEVER (BR.) en DE WEVER (BA.), Groot-Nederland als utopie en voorwendsel, in: DEPREZ (K.) en VOS (L.) eds., Nationalisme in België. Identiteiten in beweging 1780-2000, Antwerpen-Baarn, Houtekiet, 1999, pp. 352.
EGGERMONT (V.), Van Sint-Arnout tot Jeugdverbond Der Lage Landen (1945-1956). Poging tot een nieuwe jeugdbeweging. Een algemeen historische benadering, Antwerpen, 1999, pp. 105.
HEYLEN (G.) en HEYLEN-KIEBOOMS (B.), Louis Kiebooms. Christen-democratisch journalist en politicus. Vijf jaar politieke gevangene en voorvechter van de amnestiegedachte, Kapellen, Uitgeverij Pelckmans, 1995, pp. 287.
LERMYTE (J.M.) en VAN SEVEREN (A.), Jules De Clercq. Vlaams voorman, Izegem, NV Arizona, 2000, pp. 205.
PAUWELS (L.), De ideologische evolutie van Joris Van Severen (1984-1940). Een hermeneutische benadering, in: Jaarboek van het Studie- en Coördinatiecentrum Joris Van Severen, nr. 3, Ieper, 1999, pp. 272.
TODTS (H.), Nationalistische stromingen en gedachten in Vlaanderen. Na de bevrijding, Antwerpen, Adauperta, 1950, pp. 63.
VAN HOOREBEECK (M.), Oranje dassen 1944-1961. Geschiedenis van het Algemeen Diets Jeugdverbond, Uitgeverij De Nederlanden, Antwerpen, 1986, pp. 166.
WILS (Lode), Joris Van Severen, Leuven, Davidsfonds, 1994, pp. 72.
2. Tijdschriftartikels:
DE WEVER (B.), De schaduw van de leider, in: Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, nr. 1-2, jg. 31, 2001, pp. 177-252.
VERHOEYEN (E.), L’Extrème-droite en Belgique III. Les mouvements solidaristes, in: Courrier Hebdomadaire du C.R.I.S.P., nr. 715-716, 26 maart 1976.
3 Licentiaatsverhandelingen:
CREVE (J.), Het Verdinaso en zijn milities. Militievorming tussen beide wereldoorlogen in Vlaanderen en Nederland (1928-1941), Gent, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, UG, 1985, pp. 259.
JANSSENS (P.), Les Dinasos wallons: 1936-1941, Luik, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, ULg, 1982, pp. XVI + 291.
VAN DEN BOSSCHE (R.), De maatschappijleer van het Verdinaso en zijn katholieke achtergrond, Leuven, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, KUL, 1977, pp. XXIX + 248.
00:05 Publié dans Belgicana, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : belgicana, belgique, flandre, histoire, verdinaso, solidarisme, politique, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 25 septembre 2013
23 septembre 1940 : l’agression britannique sur Dakar
23 septembre 1940 : l’agression britannique sur Dakar
par José CASTANO
Ex: http://linformationnationaliste.hautetfort.com
Cette expédition reposait sur deux principes et deux ambitions :
Ainsi se passa la première journée, celle du 23 septembre.
 |
| Le Mogador à Mers-el-Kebir |
Citations
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, deuxième guerre mondiale, 1940, années 40, seconde guerre mondiale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 22 septembre 2013
Raoul Girardet est mort
L’historien Raoul Girardet est mort
L’historien Raoul Girardet, spécialiste des sociétés militaires et du nationalisme français, qui a enseigné à Sciences-Po, à l’ENA ou encore à Polytechnique, est mort mercredi 18 septembre 2013 dans sa 96e année.
C’était un ancien membre de l’Action française, de la résistance, rédacteur à La Nation Française de Pierre Boutang puis à L’Esprit public comme défenseur de l’Algérie française.

Une figure de l’enseignement de l’histoire est partie. Né le 6 octobre 1917, agrégé d’histoire et docteur ès-lettres, Raoul Girardet est une personnalité qui a marqué Sciences-Po, où il a enseigné pendant plus de 30 ans et a notamment créé le cycle d’études d’histoire du XXe siècle. Son cours sur le "Mouvement des idées politiques dans la France contemporaine" et son séminaire sur la France des années 30, assurés conjointement avec Jean Touchard et René Rémond, ont marqué des générations d’étudiants. Raoul Girardet a publié des ouvrages de référence sur "La Société militaire en France", "Le nationalisme français", "L’idée coloniale en France" et un essai sur "Mythes et mythologies politiques".
En 1990, dans un livre d’entretiens avec le journaliste Pierre Assouline, "Singulièrement libre", il était revenu sur son parcours personnel : la Résistance puis l’engagement en faveur de l’Algérie française, qui l’ont conduit deux fois en prison. Raoul Girardet a également enseigné à l’Ecole nationale d’administration, à l’Ecole Polytechnique et à l’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr. Il était Croix de guerre 1939-1945 et officier de la Légion d’honneur. Ses obsèques seront célébrées le 23 septembre dans l’Eure, dans l’intimité familiale. Une célébration aura lieu ultérieurement à Paris.
19:28 Publié dans Actualité, Histoire, Hommages | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : raoul girardet, histoire, actualité, france |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Rechtsphilosophie nach ’45
 Rechtsphilosophie nach ’45
Rechtsphilosophie nach ’45
von Günter Maschke
Ex: http://www.sezession.de
Zwar können Skizzen stärker anregen als penibel ausgeführte Gemälde, doch auch sie benötigen ihr Maß. Der Versuchung, sie allzu kärglich ausfallen zu lassen, widerstehen nur wenige.
Auch ein so umsichtiger und kenntnisreicher Rechtshistoriker wie Hasso Hofmann, dessen oft ungerechtes Buch Legitimität und Legalität – Der Weg der politischen Philosophie Carl Schmitts (1964) für immer aus dem Ozean der Carl-Schmitt-Literatur herausragt, ist dieser Gefahr erlegen. Wer die nunmehr 67 Jahre umfassende Geschichte der deutschen Rechtsphilosophie und -theorie seit dem Kriegsende auf 61 Seiten abhandelt (die Seiten 62–75 enthalten eine relativ stattliche Bibliographie), übertreibt den löblichen Willen, sparsam mit Papier umzugehen. Doch eine Taschenlampe ist nur eine Taschenlampe und ersetzt nicht einmal eine Notbeleuchtung.
Hofmanns asthenische Schrift (Rechtsphilosophie nach 1945 – Zur Geistesgeschichte der Bundesrepublik Deutschland, Berlin: Duncker&Humblot 2012. 75 S., 18 €), auf einem Vortrag vom Oktober 2011 bei der Siemens-Stiftung beruhend, beginnt mit der berühmten »Naturrechtsrenaissance« nach 1945. Ein eher behauptetes denn durchgeformtes aristotelisch-thomistisches Naturrecht, sich legierend mit der Soziallehre des politischen Katholizismus, bestimmte damals bis in die fünfziger Jahre die juristischen und rechtstheoretischen Debatten der frühen Bundesrepublik. Wie schon 1918 ließen sich die Geschlagenen vom sonst gerne ignorierten katholischen Gedanken anleiten. Zum großen Schuldigen am Desaster der Justiz unterm Nationalsozialismus wurde der »Rechtspositivismus« ernannt. Daß die deutschen Juristen sich zwischen 1933 und 1945 so willfährig zeigten, lag angeblich am hergebrachten »Gesetz-ist-Gesetz«-Denken, mit dem man das die Menschenwürde und die Menschlichkeit achtende Naturrecht ignorierte. Jetzt aber sollte der Vorrang der Lex naturalis (des durch die Vernunft allgemein erkennbaren Teils eines angeblich »ewigen Gesetzes«) gegenüber dem Jus positivum durchgesetzt werden; letzteres hatte sich ersterem unterzuordnen.
Aber der Skandal der Jurisprudenz während des Nationalsozialismus findet sich (zumal wenn man die damals eher geringe Produktion neuer Gesetze bedenkt!) nicht in einem knechtischen Rechtspositivismus, sondern in der Tendenz zur »unbegrenzten Auslegung« (Bernd Rüthers) schon lange bestehender Gesetze. Dabei darf man auch daran erinnern, daß diese sinistre Kunst der Auslegung sich nicht selten auf ein angebliches nationalsozialistisches Naturrecht stützte. Man begann also 1945 mit einer Legende – mit der Legende von der Schuld des Rechtspositivismus; Hofmann spricht hier triftigerweise von »Bewältigungsliteratur«. Diese Legende barg auch ein beachtliches destruktives Potential: Jetzt konnte man den Staat diffamieren und ihn bzw. das, was von ihm noch übriggeblieben war, demontieren. Der den Rechtspositivismus durchsetzende Leviathan wurde zerschnitten. Mittels der Legende vom Rechtspositivismus fälschte man den radikalen Nicht-Staat des Nationalsozialismus, einen wahren Behemoth, zu einem Staat, nein: zu einem extremen Hyper-Staat um. So wurde der Staat, die wehrhafte Relation von Schutz und Gehorsam, ein weiteres Mal, diesmal von einer anderen Seite her, attackiert. Im endlich vollendeten Großtrizonesien weihten sich schließlich auch die Juristen der vermeintlich so menschenfreundlichen Staatsfeindschaft.
Tatsächlich setzte diese Entwicklung, heute offen zutageliegend, 1945 mit den Leerformeln des Naturrechts ein. In einer sich beschleunigt säkularisierenden, partikularisierenden, an der Oberfläche pluralisierenden Gesellschaft wurde ein ewiges Sittengesetz verkündet, von dem man bekanntlich rasch gehörige Abstriche machen mußte. Der Einfluß des – wie seine Geschichte beweist! – so wandelbaren Naturrechts führte zu Absurditäten wie der, daß der Bundesgerichtshof 1954 den Verlobtenbeischlaf zur »Unzucht« erklärte. Die Meinung machte die Runde, daß das Recht dazu da sei, die Bevölkerung zu einer bestimmten Moral anzuhalten, – zu einer Moral, in der sich das wahre Wesen und die wahre Bestimmung des Menschen ausdrücken sollten. Im Rückblick verwundert es nicht, daß die mit Aplomb vorgetragenen Naturrechtsfragmente bald in einer Wertphilosophie des Rechts ihre Erbin fanden, einer Wertphilosophie, die mittlerweile das Staats- und Verfassungsrecht mit moralisierenden Suggestionen und Gesinnungseinforderungen zersetzt und die eine schreckliche Tochter gebar: die political correctness. Hier fehlt auch ein kritischer Blick auf das Surrogat einer Verfassung, auf das politisch wie intellektuell defizitäre Grundgesetz, das eher ein Oktroi der Besatzer war als eine eigene Schöpfung, – Hofmann rafft sich bei dieser Gelegenheit immerhin dazu auf, etwas spöttisch dessen »Sakralisierung« zu vermerken.
Gewiß hat sich der ideologische Überbau der Jurisprudenz seit den Jahren 1945 bis ca. 1955 beträchtlich verwandelt. Geblieben aber ist die Tendenz zur Abschaffung der Freiheit mittels der »Werte«. Zuweilen spürt man, daß Hofmann gegenüber einigen Aspekten dieser Entwicklung Einwände hegt, doch er spitzt nur mit großer Dezenz die Lippen und verbietet sich das Pfeifen. Die sich gemäß den hastigen Zeitläuften rasch ändernde Melange aus suggestiv sein sollenden Naturrechtselementen, aus dem Staate vorgelagerten »Werten« und aus einer eklektisch-vagen Humanitätsphilosophie, die zu unerbittlichen Exklusionen fähig ist, angereichert mit etwas Orwell und etwas Huxley – all diese so wandelbar scheinenden Ideologeme, die doch nur modernisierte Versionen der Melodie von 1945 sind, kommen zum immergleichen Refrain: Wen diese Worte nicht erfreuen, der verdienet nicht, ein Mensch zu sein.
Hofmann geht auch auf die Debatte zur analytischen Rechtsphilosophie, zur Rechtslogik und zur Topik ein, sowie auf die in den sechziger und siebziger Jahren Terrain gewinnende Rechtssoziologie. Man darf aber annehmen, daß sowohl das Rechtsbewußtsein der Bevölkerung als auch die juristische Praxis von dieser Art theoretischer Erörterungen wenig beeinflußt wurden. Bedeutsamer scheint da wohl der bald die Verfassungsebene erreichende Weg vom Rechtsstaat zum sozialen Rechtsstaat zu sein. Wir möchten hier aber Hofmanns so knappe Skizze nicht mittels einer noch kürzeren abschildern und reflektieren.
Zum Schluß wirft Hofmann noch einen Blick auf die allüberall kundgetane »Ankunft in der Weltgesellschaft«. In dieser wird angeblich die »Frage nach Zukunft« (Hofmann) unabweisbar. Doch die Forderung Kants, daß die »Rechtsverletzung an einem Platz der Erde an allen gefühlt« werde, ist nur eine trügerische, dazu noch intellektuell peinliche Hoffnung. Ein Weltbürgerrecht als Recht von Individuen, das an die Stelle des internationalen zwischenstaatlichen Rechts tritt, führt nur zu einem zügellosen Pan-Interventionismus und Menschenrechtsimperialismus, dessen »Vorgriffe« auf das Weltbürgerrecht uns in den letzten Jahren einige entsetzliche Blutbäder bescherten. Der Träger des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels, Jürgen Habermas, hielt den Kosovo-Krieg, in dem die NATO alle bisherigen Rekorde in der Disziplin »Propagandalüge« brach, für einen derartigen »Vorgriff« auf die von ihm geliebte schwarze Utopie des Weltbürgerrechts, – wenn auch, wie es einem kritischen Intellektuellen bei uns ziemt, aus Naivität und nicht aus Bosheit.
Soll man zum Ewigen Frieden durch den Ewigen (dazu noch Gerechten) Krieg gelangen? Es gibt einige alte, sich immer wieder bestätigende Wahrheiten: Wer Menschheit sagt, will betrügen, und Ordnung kann nur auf Ortung beruhen. An diesen Wahrheiten festzuhalten, wäre die ehrenvolle Aufgabe eines Rechtsdenkens, das, um seine fast ausweglose Schwäche wissend, die furchtbaren Tatsächlichkeiten beim Namen nennt und diese weder ganz oder partiell beschweigt, verharmlost, noch, nachdem man sich zum Hans Wurst des Gerechten Krieges machte, mit etwas Bedauern rechtfertigt. Dazu sollte man auch verstehen, daß das Recht nicht den Frieden schaffen kann, sondern – im Glücksfall! – der Frieden das Recht.
Article printed from Sezession im Netz: http://www.sezession.de
URL to article: http://www.sezession.de/39659/rechtsphilosophie-nach-45.html
URLs in this post:
[1] Image: http://www.sezession.de/wp-content/uploads/2013/06/49.jpg
00:05 Publié dans Droit / Constitutions, Histoire, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : günter maschke, droit, allemagne, théorie politique, sciences politiques, politologie, philosophie, histoire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 21 septembre 2013
En el centenario de la Declaración Balfour
por Nur Masalha*
Ex: http://paginatransversal.wordpress.com
La Declaración Balfour del 2 de noviembre de 1917 fue fundamental para alianza británico-sionista durante la Primera Guerra Mundial y una poderosa herramienta de propaganda judio-sionista. Al acercarse el centenario de la Declaración es oportuno volver a examinar el impacto tanto de la declaración como de las políticas británicas respecto a Palestina y su población originaria. Este artículo apela al Reino Unido a que reconozca su responsabilidad histórica en las desastrosas consecuencias del colonialismo sionista de asentamiento en Palestina y la subsiguiente catástrofe palestina (Nakba).
Sin el apoyo total de Imperio Británico, el sionismo político no habría podido conseguir sus objetivos a costa de la libertad y la autodeterminación del pueblo palestino. El Estado de Israel era y todavía es fundamental para los proyectos occidentales en Oriente Próximo. De hecho, Israel debe su propia existencia al poder colonial británico en Palestina, a pesar de la tensión militar durante la última década de periodo del Mandato Británico entre la potencia colonial y los dirigentes del militarizado Yishuv, es decir, la comunidad de colonos de asentamiento blancos asquenazíes (1) en Palestina.
Los colonos sionistas europeos eran poco numerosos bajo el Imperio Otomano y nunca se les dio verdaderamente carta blanca en Palestina; si se hubiera dejado al Imperio Otomano el control de Palestina después de la Primera Guerra Mundial, es muy poco probable que el Estado judío se hubiera hecho realidad a expensas de la población indígena. La situación cambió radicalmente con la ocupación de Palestina por parte de los británicos en 1917. Pero antes, el 2 de noviembre de 1917, la Declaración Balfour (cuyas catastróficas consecuencias para el pueblo palestino tienen repercusiones todavía hoy) ya había concedido al sionismo derecho a Palestina. El secretario de Exteriores [británico] Arthur James Balfour envió a la Federación Sionista la carta que contenía la Declaración a través de un prominente judío británico, el barón Walter Rothschild. En ella el gobierno británico declaraba su compromiso con el sionismo: “El gobierno de Su Majestad considera favorablemente el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y utilizará sus mejores esfuerzos para facilitar la consecución de este objetivo”.
Lo verdaderamente crucial fue que los términos de la Declaración Balfour se incorporaron al Mandato Británico en Palestina en 1922 y fueron aprobados por la Liga de las Naciones. Esto constituyó un espectacular logro político y de propaganda para el movimiento sionista internacional que en aquel momento era un grupo minoritario dentro de los judíos del mundo. Curiosamente, el documento fue criticado duramente por el único miembro judío del gobierno del primer ministro británico Lloyd George: Sir Edwin Montagu, secretario de Estado para India, hizo una clara distinción entre judaísmo y sionismo (una ideología política moderna). Le preocupaba el estatus y la potencial doble lealtad de los judíos británicos y puso en tela de juicio el derecho de la organización sionista a hablar en nombre de todos los judíos.
En 1917 la población judía de Palestina era inferior al 10% del total de su población. El contenido de la Declaración Balfour se arraigaba en la política colonial racista de la denegación. No mencionaba siquiera al pueblo palestino, ya fueran cristianos o musulmanes, que conformaba más del 90% de la población del país. De hecho, el pueblo palestino era propietario de más del 97% de la tierra que Gran Bretaña pretendía regalar. La Declaración se refería a los palestinos cristianos o musulmanes como “las comunidades no judías que existen en Palestina” al tiempo que omitía por completo sus derechos nacionales y políticos. La Declaración es típica del estilo supremacista blanco de la época y encaja con la noción de “una tierra sin pueblo [para un pueblo sin tierra]”, creada para justificar la colonización europea y la negación de los derechos fundamentales de los palestinos.
Envalentonado por la Declaración Balfour, en enero de 1919 el destacado sionista británico Chaim Weizmann acudió a la Conferencia de París y y pidió una Palestina pura “tan judía como Inglaterra es inglesa”. Esto sucedía en un momento en que el principio de “autodeterminación para los pueblos del Imperio Otomano” estaba consagrado en los “Catorce Puntos” del presidente estadounidense Woodrow Wilson. Lloyd George saludó estos principios al tiempo que negaba este reconocimiento internacional del pueblo palestino.
A menudo se explican la alianza británico-sionista y la Declaración Balfour en términos de cálculos de guerra y objetivos estratégicos militares (incluido la proximidad de Palestina al Canal de Suez controlado por Gran Bretaña y la ruta a India). Los historiadores pasan por alto los factores y mitos británicos históricos, ideológicos, de la cultura bíblica protestante y simbólicos. Gran Bretaña y gran parte de Europa habían sido la cuna de las Cruzadas Latinas y de los recuerdos colectivos de la lucha por Jerusalén y Palestina, una amarga “guerra santa” contra el islam que duró varios siglos hasta bien entrado el inicio del periodo moderno y cuya memoria colectiva se revivió en Europa en el momento culminante del imperio en el siglo XIX. Antes de la Declaración Balfour dos imanes, la “Biblia y la espada”, en brillante expresión de Barbara Tuchman (Bible and Sword: England and Palestine from the Bronze Age to Balfour) atrajeron a gran cantidad de cruzados, peregrinos, misioneros, arqueólogos bíblicos, viajeros, cartógrafos, cónsules y miembros del Cuerpo de Ingenieros Reales a Tierra Santa de Palestina. En última instancia esto llevó a la conquista de Jerusalén por parte de Gran Bretaña en diciembre de 1917.
La propia Declaración Balfour estaba calculada para coincidir con el avance del general Edmund Allenby hacia Jerusalén durante la Primera Guerra Mundial. Fue el fruto de unas intensas negociaciones a lo largo de doce meses entre destacados sionistas británicos (el “lobby judío-sionista) y altos cargos del Foreign Office y, en última instancia, del gobierno de guerra de Lloyd George.
El 11 de diciembre de 1917 Allenby entró a pie en Jerusalén y anduvo triunfalmente por la Ciudad Vieja. Era el primer cristiano que conquistaba Jerusalén desde las Cruzadas medievales. Este simbolismo no pasó desapercibido para Allenby o Lloyd George, que describieron la toma de Jerusalén como “un regalo cristiano al pueblo británico”. Allenby fue incluso más explícito: “Ahora han terminado las guerras de los cruzados”, afirmó, dando a entender que su conquista de Palestina por parte de las fuerzas británicas era la “última cruzada”.
El general Allenby nos ha dejado otros símbolos de los antiguos y nuevos cruzados: el “Puente Allenby” (todavía denominado así por los israelíes) que cruza del río Jordán fue construido en 1918 por el propio Allenby sobre los restos de un viejo puente otomano. Actualmente es el único punto de entrada y de salida para los palestinos bajo ocupación israelí que viajen fuera de Cisjordania y a Cisjordania. Tanto Allenby como Balfour son muy apreciados en Israel. Allenby da su nombre a una importante calle de Tel Aviv, “Allenby Street”. Balfouria es una colonia judía al sur de Nazareth fundada en 1922 y fue el tercer moshav (2) que se estableció en la Palestina del Mandato. Toma su nombre del secretario de Exteriores británico que redactó la tristemente célebre Declaración.
En 1917 Weizmann, amigo íntimo del general Jan Smuts, un defensor de la separación racial, primer ministro de Sudáfrica y que se asocia a la redacción del borrador de la Declaración, argumentó: “Una Palestina judía sería una salvaguarda para Inglaterra, en particular con respecto al Canal de Suez”. Sin embargo, tanto Lloyd George como Balfour eran miembros de Iglesias protestantes que compartían la creencia sionista cristiana de que había que “restituir” en Palestina a los judíos del Viejo Testamento antes de la Segunda Venida de Jesús.
La Biblia ha sido el texto clave para redimir el colonialismo de asentamiento europeo. El “primer” texto de Occidente ha sido (y sigue siendo) fundamental para el apoyo occidental al Estado de Israel. La “Biblia y la espada”, las dos herramientas heredadas de las Cruzadas latinas y del colonialismo británico, también han sido fundamentales para la estrategia sionista israelí desde 1948.
Desde finales del siglo XIX el sionismo político (y actualmente el lobby pro-israelí) ha seguido disfrutando de una extraordinaria influencia en las altas esferas de Occidente. Por diferentes razones (entre las que se incluye la epistemología y la política del texto bíblico), el Estado de Israel ha sido fundamental para las políticas de Occidente en el rico en petróleo Oriente Próximo. Además de su valor geopolítico y estratégico, y de sus inmensas capacidades militares y nucleares, el Estado de Israel ha tenido una enorme trascendencia para las políticas occidentales posteriores a la Segunda Guerra Mundial. En el periodo posterior al Holocausto el fuerte apoyo financiero, militar y político concedido al “Estado judío” en Palestina también ha sido considerado una oportunidad de “redimir” a Europa (y a Occidente) por el genocidio nazi.
El sionismo político surgió en Europa a finales del siglo XIX en el momento culminante del imperialismo europeo, directamente influido por el pangermanismo y panjudaísmo. Combinó con éxito los nacionalismos de Europa central y del este con el colonialismo de asentamiento y la Biblia. Los padres fundadores laicos del sionismo judío trataron de sustentar con el texto bíblico la legitimidad de su movimiento colonial de asentamientos.
Desde un principio estuvo claro que el proyecto “restauracionista” solo se podía lograr con el respaldo y el apoyo activo de las potencias europeas. Desde Theodor Herzl a Chaim Weizmann y David Ben-Gurion los dirigentes sionistas eran plenamente conscientes de que no se podía garantizar su programa sin el apoyo de las potencias imperialistas. Herzl escribió claramente acerca de la tierra asiática (no europea) “reclamada” por el sionismo y el establecimiento de un Estado casi europeo de colonos blancos en Palestina: “Si Su Majestad el Sultán [otomano] nos concediera Palestina, a cambio nosotros podríamos emprender la regulación de todas las finanzas de Turquía. Conformaríamos ahí parte de una muralla defensiva para Europa en Asia, un puesto de avanzada de la civilización contra la barbarie”.
Sin embargo, el entonces presidente de la Agencia Judía, Ben-Gurion, declaró al presentar testimonio ante la “Comisión Real de Palestina” encabezada por Lord Peel en 1936: “La Biblia es nuestro mandato”. Para Ben-Gurion la Biblia era el texto matriz del sionismo y el texto fundacional del Estado de Israel. Como Ben-Gurion, Lloyd George y Balfour consideraban la Biblia no solo una fuente histórica de confianza sino también una guía de las políticas cristianas y sionistas en relación con los habitantes indígenas de Palestina. Las militaristas tradiciones y relatos bíblicos de la tierra, reconfiguradas y reinventadas en el siglo pasado como una metanarrativa “fundacional” del sionismo y del Estado de Israel, han sido decisivas en la limpieza étnica de Palestina. Hoy las mismas militaristas tradiciones bíblicas de la tierra siguen estando en el centro del desplazamiento y la desposesión de los palestinos (tanto musulmanes como cristianos) de Jerusalén. Irónicamente, es más probable que, a diferencia de Ben-Gurion, los palestinos modernos sean descendientes de los antiguos israelíes cananeos y filisteos que lo sean los asquenazíes y padres fundadores blancos del Estado de Israel.
El historiador británico Arnold Toynbee calificó una vez a Balfour de “hombre malvado”. Toynbee creía que Balfour y Lloyd George conocían las catastróficas implicaciones que tenían para los palestinos originarios la Declaración Balfour y el hecho de que los británicos fomentaran una comunidad colonial de asentamiento blanca en Palestina.
Por supuesto, ni los cruzados latinos ni la moderna Gran Bretaña tenían derechos de soberanía sobre Palestina. Es indudable que Gran Bretaña no tenía autoridad moral o legal para entregar la tierra que no le pertenecía a un tercero y a un pueblo que no residía en el país. Sin embargo, la Declaración Balfour creó el marco para la lucha sionista por apoderarse de la tierra de Palestina y controlarla, una lucha que ha seguido hasta nuestros días. Por ello la Declaración se convirtió en un elemento fundamental de las exigencias judiciales sionistas e israelíes. Entre 1914 y 1948 la potencia colonial británica en Palestina permitió al movimiento judío establecer en Palestina a cientos de miles de colonos judíos europeos, incluidas varias ciudades, y estableció las bases políticas, militares y de seguridad, económicas, industriales, demográficas, culturales y académicas del Estado de Israel.
Medio siglo después de la Declaración Balfour la primera colonia blanca en Palestina, Kerem Avraham, hoy un barrio de Jerusalén, empezó como una pequeña colonia británica fundada en 1855 por el muy influyente cónsul británico en Jerusalén, James Finn, y su mujer, Elizabeth Anne. Finn combinó un antiguo celo cruzado con un moderno pensamiento “restauracionista” protestante y actividades misioneras con el trabajo oficial de funcionario británico. Él y su mujer eran originariamente miembros de la “Sociedad Londinense para Promover el Cristianismo entre los Judíos”. James Finn también fue un estrecho socio de Anthony Ashley Cooper, séptimo conde de Shaftesbury, un destacado diputado tory, milenarista protestante y colaborador clave del sionismo victoriano cristiano y del evangelismo que preconizaba la vuelta a la Biblia. A Shaftesbury le guiaba el pensamiento victoriano de la “Biblia y la espada”, una combinación de imperialismo victoriano y de profecía mesiánica cristiana. Argumentaba que el “restauracionismo judío en Palestina tendría ventajas políticas y económicas para el Imperio Británico y según la profecía de la Biblia, aceleraría la segunda venida de Jesús. En un artículo publicado en Quarterly Review (enero de 1839), Shaftesbury (inventor del mito “una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra”) escribió: “La tierra y el clima de Palestina están singularmente adaptados para que crezcan productos requeridos por las exigencias del Imperio británico: se puede obtener el algodón más fino en una casi ilimitada abundancia, la seda y la rubia roja (3) son los productos principales del país y el aceite de oliva es ahora, como siempre lo ha sido, la propia grasa del país. Solo se requieren capital y habilidades: la presencia de un oficial británico y la mayor seguridad de la propiedad que su le conferirá presencia, pueden invitar a los de estas islas al cultivo en Palestina; y los judíos, que no se trasladarán a ninguna otra tierra para cultivarla ya que han encontrado en la persona del cónsul británico [James Finn] un mediador entre su pueblo y el Pachá [otomano], probablemente volverán en cantidades aún mayores y se convertirán una vez más en el esposo de Judea y Galilea”.
Con el apoyo del entonces secretario de Exteriores británico Lord Palmerston, Shaftesbury empezó a promover la “restauración” de los judíos en Palestina entre la Inglaterra victoriana de la década de 1830. Shaftesbury también desempeñó un papel decisivo en el establecimiento del consulado británico en Jerusalén en 1839. Las actividades públicas de Shaftesbury, James Finn y sus compañeros “restauracionistas”, que precedieron en casi medio siglo a la fundación del movimiento sionista político europeo por Theodor Herzl, demuestran claramente que el “sionismo” empezó como un claro movimiento de cruzada protestante cristiano y no uno laico judío.
Con todo, lo que llevó al crecimiento del sionismo protojudío laico fueron los estudios del Fondo de Exploración de Palestina (PEF, por sus siglas en inglés) y los mapas de Cuerpo Británico de Ingenieros Reales realizados en la década de 1870. La pacífica cruzada del PEF británico, fundado en 1865 por un grupo de eruditos de la Biblia, geógrafos bíblicos, altos cargos militares y de la inteligencia, y clérigos protestantes, entre los que destacaba el deán de la Abadía de Westminster, Arthur P. Stanley, estaba estrechamente coordinada por la clase dirigente político-militar británica y los servicios de inteligencia ansiosos de penetrar en la Palestina otomana, un país gobernado por el “hombre enfermo de Europa” musulmán (4).
El PEF, que cuenta con oficinas en el centro de Londres, es hoy una organización activa que tiene una publicación académica, Palestine Exploration Quarterly. Por otra parte, el PEF da charlas públicas y financia proyectos de investigación en Cercano Oriente. Según su página web, “entre 1867 y 1870 el capitán Warren llevó a cabo exploraciones en Palestina que conforman la base de nuestro conocimiento de la topografía del Jerusalén antiguo y de la arqueología del Templo del Monte/Haram al-Sherif [sic]”. “Además de estas exploraciones en, bajo y alrededor del Templo del Monte/al-Haram al-Sherif, Warren analizó la Llanura de Philistia y llevó a cabo un muy importante reconocimiento de la parte central del [río] Jordán”. El capitán (después general Sir) Charles Warren, de los Ingenieros Reales y uno de los altos cargos clave del PEF ordenó trazar el mapa de la “topografía bíblica” de Jerusalén e investigar “el emplazamiento del templo”, y observó: “El cónsul [británico] del rey [James Finn] es la autoridad máxima, no de los nativos de la ciudad, sino de los extranjeros. No obstante, en su mayor parte estos extranjeros son los dueños legítimos y los nativos en su mayor parte son los usurpadores”. Al parecer Warren y Finn “cavaron literalmente” bajo los santuarios musulmanes de Jerusalén para trazar el mapa de las “dimensiones originales” del “Templo del Monte”. La arqueología bíblica, los mapas y los estudios de topografía y toponimia llevados a cabo por Warren y los Ingenieros Reales han seguido constituyendo los datos básicos de muchos arqueólogos, geógrafos y planificadores estratégicos oficiales israelíes actuales en su campaña por judaizar la Ciudad Vieja de Jerusalén.
Cuando los colonos judíos blancos se trasladaron a Palestina su actitud respecto a la población originaria fue la típica actitud colonial respecto a pueblos “inferiores” y “no civilizados”, aunque las colonias sionistas siguieron siendo muy pequeñas hasta que los británicos ocuparon Palestina en 1917. Después de la ocupación el proceso se aceleró rápidamente bajo la protección de la potencia colonial. Durante este periodo los sionistas insistieron en que se denominara oficialmente a Palestina la “Tierra bíblica de Israel”. Las autoridades del Mandato Británico concedieron el uso del acrónimo hebreo para “Eretz Yisrael” (la “Tierra de Israel”) tras el nombre de Palestina en todos los documentos oficiales, moneda, sellos, etc.
Durante este periodo (1918-1948) los colonos blancos asquenazíes no hicieron esfuerzo alguno por integrar sus luchas en las de los palestinos que luchaban contra el colonialismo británico. Por el contrario, los colonos actuaron desde la convicción de que la población originaria tendría que ser sometida o expulsada, con la ayuda de los británicos.
Para la década de 1930 la Declaración Balfour se asociaba estrechamente en el pensamiento sionista oficial a la colonización práctica de Palestina y a la limpieza étnica de los palestinos originarios. Desde principios de la década de 1930 en adelante los “comités de traslado” (un eufemismo de “comités de limpieza étnica”) y altos cargos del Yishuv elaboraron una serie de planes específicos que implicaban en general a Trasnjordania, Siria e Iraq. En 1930, sobre el fondo de los disturbios de 1929 en Palestina, Weizmann, entonces presidente tanto de la Organización Sionista Mundial como de la Ejecutiva de la Agencia Judía, empezó a promover activamente en discusiones privadas con altos cargos y ministros británicos la idea del “traslado” de árabes. Planteó al secretario colonial, Lord Passfield, una propuesta oficial aunque secreta de traslado de campesinos palestinos a Transjordania, para lo cual se obtendría un préstamo de un millón de libras palestinas de fuentes financieras judías para la operación de reasentamiento. Lord Passfield rechazó la propuesta. Sin embargo, la justificación que Weizmann había utilizado para defender su propuesta fue la base de los posteriores argumentos sionistas de traslado de población. Weizmann afirmaba que no había nada de inmoral en la limpieza étnica de la tierra, que la expulsión de poblaciones ortodoxas griegas y musulmanas (“turcas”), “intercambios de población”, a principios de la década de 1920 eran un precedente de una medida similar en relación con los palestinos.
Si la Declaración Balfour se convirtió en un elemento fundamental de la memoria colectiva, los mitos y la propaganda sionistas, la Declaración, conocida como “Wa’ad Balfour” o la “Promesa Balfour” en árabe, se convirtió en un elemento fundamental de la memoria colectiva palestina de resistencia. Durante toda la época del Mandato el aniversario de la Declaración (2 de noviembre) se conmemoró de manera generalizada por medio de protestas y huelgas nacionalistas. Los palestinos movilizaron el recuerdo del engaño y la traición británicos como una herramienta de resistencia pacífica a las políticas británica y sionista en Palestina.
La colonización blanca de asentamiento de Palestina culminó con el establecimiento del Estado de Israel en 1948 y la Nakba palestina, la catástrofe de la limpieza étnica y la destrucción de gran parte de la Palestina histórica. La guerra psicológica y la presión militar sionistas expulsaron, en muchos casos a punta de pistola, a aproximadamente el 90% de los palestinos del territorio ocupado por los israelíes en 1948, a menudo bajo la atenta mirada de los británicos que continuaron a cargo del país hasta mediados de 1948. La guerra simplemente proporcionó la oportunidad y el contexto necesarios para purgar la tierra y crear un Estado judío en gran parte libre de árabes. Concentró las mentes judío-sionistas y proporcionó tanto la seguridad como las explicaciones y justificaciones militares y estratégicas para purgar el Estado y desposeer al pueblo palestino. Actualmente, aproximadamente dos terceras partes de los palestinos son refugiados, millones de ellos viven en campos de refugiados miserables en Oriente Próximo y otros millones están repartidos por todo el mundo.
El sionismo militarista e Israel han utilizado la Biblia no solo como una herramienta para la limpieza étnica de Palestina y el “exilio” de millones de palestinos de su patria ancestral, sino también como una manera de borrar la historia palestina y de suprimir la memoria palestina. Actualmente la Nakba palestina está más o menos ausente de la memoria colectiva tanto británica como occidental.
Por otra parte, los palestinos no solo continúan sometidos a la actual limpieza étnica y a las políticas de cruzada en Jerusalén en pleno siglo XXI, sino que durante las seis últimas décadas los israelíes y el lobby proisraelí han desafiado y silenciado los intentos por parte de los palestinos de constituir un relato coherente de su propio pasado. Todavía hoy la Catástrofe de 1948 se excluye del discurso oficial en Gran Bretaña mientras que Israel goza de un apoyo extraordinario en el gobierno británico y la mayoría de los diputados conservadores son miembros de “Amigos Conservadores de Israel”.
La clase dirigente británica elige públicamente una “posición neutral” sobre Palestina que a menudo adopta la forma de silencio o de amnesia colectiva. Dada la responsabilidad histórica de Gran Bretaña en la catástrofe palestina, no puede existir esta neutralidad o indiferencia hacia la injusticia cometida en Palestina.
Se ha creado el proyecto Balfour Project para conmemorar el centenario de la Declaración Balfour y el simbolismo de la alianza británico-sionista y el catastrófico impacto sobre los palestinos. Este proyecto busca: a) honestidad en el debate público y un reconocimiento de las desastrosas consecuencias de las acciones británicas en la época de la Declaración Balfour y a lo largo de todo el Mandato Británico en Palestina, y particularmente el engaño respecto a las verdaderas intenciones británicas; b) disculpas por la mala actuación británica; c) disculpas oficiales británicas a los palestinos por haber ignorado intencionadamente sus legítimas aspiraciones políticas; y d) integridad en el futuro cuando Gran Bretaña aborde la cuestión palestina.
* El Prof. Nur Masalha es Director de Programa del Máster en Religión, Política y Resolución de Conflictos. Formó parte de un equipo de postgrado del Arts and Humanities Research Council (AHRC) y fue miembro del AHRC Peer Review College. Ha sido director el Proyecto de Investigación de Tierra Santa desde 2001 y del Centro para la Religión y la Historia desde 2007. El profesor Masalha también edita Holy Land Studies: A Multidisciplinary Journal (publicado por Edinburgh University Press).
Sus libros más recientes son: The Bible and Zionism: Invented Tradition, Archaeology and Post-Colonialism in Israel-Palestine (2007), La Biblia leída con los ojos de los Cananeos (Editorial Canaán, 2011) y The Palestine Makba: Decolonising History, Narrating the Subaltern, Reclaiming Memory (2012). Próximamente publicará The Politics of Reading the Bible in Israel (2013).
(Traducido del inglés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos)
Notas de la traductora:
(1) Los judíos asquenazíes son los judíos oriundos de Europa central y del este.
(2) Moshav es una comunidad rural judío de carácter cooperativo
(3) La llamada rubia roja es una planta cuya raíz se utilizaba para fabricar tintes de color rojo destinados a la industria textil y a la farmacología.
(4) La expresión “hombre enfermo de Europa” se ha aplicado a lo largo de la historia a diferentes países europeos en referencia a la debilidad o decadencia de una economía aparentemente normal.
Fuente: Global Research
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : politique internationale, histoire, déclaration balfour, balfour, palestine, levant, proche orient, question palestinienne, monde arabe, monde arabo-musulman |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 19 septembre 2013
Silvio Gesell: der “Marx” der Anarchisten
Robert STEUCKERS:
Silvio Gesell: der “Marx” der Anarchisten
Analyse: Klaus SCHMITT/Günter BARTSCH (Hrsg.), Silvio Gesell, “Marx” der Anarchisten. Texte zur Befreiung der Marktwirtschaft vom Kapitalismus und der Kinder und Mütter vom patriarchalischen Bodenunrecht, Karin Kramer Verlag, Berlin, 1989, 303 S., ISBN 3-87956-165-6.
 Silvio Gesell war ein nonkonformistischer Ökonom. Er nahm zusammen mit Figuren sowie Niekisch, Mühsam und Landauer an der Räteregierung Bayerns teil. Der gebürtige Sankt-Vikter entwickelte in seinem wichtigsten Buch “Die natürliche Ordnung” ein Projekt der Umverteilung des Bodens, damit ein Jeder selbständig-autonom in totaler Unabhängigkeit von abstrakten Strukturen leben konnte. Günter Bartsch nennt ihn ein “Akrat”, d.h. ein Mensch, der frei von jeder Bevormündung ist, sei diese politischer, religiöser oder verwaltungsartiger Natur. Für Klaus Schmitt, der Gesell für die deutsche nonkonforme Linke wiederentdeckt (aber nicht kritiklos), ist der räterepublikanische Akrat ein der schärfsten Kritiker der “Macht Mammons”. Diese Allmacht wollte Gesell mit der Einführung eines “Schwundgeldes” bzw. einer “Freigeld-Lehre” zerschmettern. Unter “Schwundgeld” verstand er ein Geld, das man nicht thesaurisieren konnte und für das keine Zinsen gezahlt wurden. Im Gegenteil war für Gesell die Hortung von Geldwerten die Hauptsünde. Geld, das nicht in Sachen (Maschinen, Geräte, Technik, Erziehung, Boden, Vieh, usw.) investiert wird, mußte durch moralischen und ökonomischen Zwang an Wert verlieren. Solche Ideen entwickelten auch der Vater des kanadischen und angelsächsichen Distributismus, C. H. Douglas, und der Dichter Ezra Pound, der in den amerikanischen Regierung ein Instrument des Teufels Mammon sah. Douglas entwickelte distributistische Bauern-Projekte in Kanada, die teilweise noch heute existieren. Pound drückte seinen Dichterhaß gegen Geld- und Bankwesen, indem er die italienischen “Saló-Republik” am Ende des Krieges unterstütze. Pound versuchte, seine amerikanische Landgenossen zu überzeugen, keinen Krieg gegen Mussolini und das spätfaschistischen Italien zu führen. Nach 1945, wurde er in den VSA zwölf Jahre lang in einer Irrenanstalt eingesperrt. Er kam trotzdem aus dieser Hölle ungebrochen zurück und ging bei seiner Dochter Mary de Rachewiltz in Südtirol wohnen, wo er 1972 starb.
Silvio Gesell war ein nonkonformistischer Ökonom. Er nahm zusammen mit Figuren sowie Niekisch, Mühsam und Landauer an der Räteregierung Bayerns teil. Der gebürtige Sankt-Vikter entwickelte in seinem wichtigsten Buch “Die natürliche Ordnung” ein Projekt der Umverteilung des Bodens, damit ein Jeder selbständig-autonom in totaler Unabhängigkeit von abstrakten Strukturen leben konnte. Günter Bartsch nennt ihn ein “Akrat”, d.h. ein Mensch, der frei von jeder Bevormündung ist, sei diese politischer, religiöser oder verwaltungsartiger Natur. Für Klaus Schmitt, der Gesell für die deutsche nonkonforme Linke wiederentdeckt (aber nicht kritiklos), ist der räterepublikanische Akrat ein der schärfsten Kritiker der “Macht Mammons”. Diese Allmacht wollte Gesell mit der Einführung eines “Schwundgeldes” bzw. einer “Freigeld-Lehre” zerschmettern. Unter “Schwundgeld” verstand er ein Geld, das man nicht thesaurisieren konnte und für das keine Zinsen gezahlt wurden. Im Gegenteil war für Gesell die Hortung von Geldwerten die Hauptsünde. Geld, das nicht in Sachen (Maschinen, Geräte, Technik, Erziehung, Boden, Vieh, usw.) investiert wird, mußte durch moralischen und ökonomischen Zwang an Wert verlieren. Solche Ideen entwickelten auch der Vater des kanadischen und angelsächsichen Distributismus, C. H. Douglas, und der Dichter Ezra Pound, der in den amerikanischen Regierung ein Instrument des Teufels Mammon sah. Douglas entwickelte distributistische Bauern-Projekte in Kanada, die teilweise noch heute existieren. Pound drückte seinen Dichterhaß gegen Geld- und Bankwesen, indem er die italienischen “Saló-Republik” am Ende des Krieges unterstütze. Pound versuchte, seine amerikanische Landgenossen zu überzeugen, keinen Krieg gegen Mussolini und das spätfaschistischen Italien zu führen. Nach 1945, wurde er in den VSA zwölf Jahre lang in einer Irrenanstalt eingesperrt. Er kam trotzdem aus dieser Hölle ungebrochen zurück und ging bei seiner Dochter Mary de Rachewiltz in Südtirol wohnen, wo er 1972 starb.
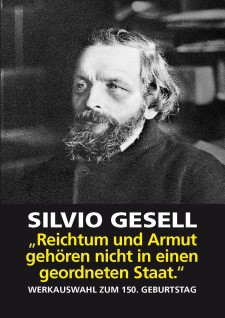 Neben seiner ökonomischen Lehren über das Schwund- und Freigeld, theorisierte Gesell einen Anarchofeminismus, wobei er besonders die Kinder und die Frauen gegen männliche Ausbeutung schützen wollte. Diese Interpretation des matriarchalischen Archetyp implizierte eine ziemlich scharfe Kritik des Vaterrechts, der in seinen Augen die Position der Kinder in der Gesellschaft besonders labil machte. Insofern war Gesell ein Vorfechter der Kinderrechte. Praktish bedeutete dieser Anarchofeminismus die Einführung einer “Mutterrente”. «Gesell und sein Anhänger wollten den gesamten Boden den Müttern zueignen und ihnen bzw. ihren Kinder die Bodenrente bis zum 18. Lebensjahr der Kinder als “Mutter-” bzw. “Kinderrente” zukommen lassen. Ein “Bund der Mütter” soll den gesamten nationalen und in ferner Zukunft den gesamten Boden unseres Planeten verwalten und (...) an den oder die Meistbietenden verpachten. Nach diesem Verfahren hätte jeder einzelne Mensch und jede einzelne Gruppe (z. B. eine Genossenschaft) die gleichen Chancen wie alle anderen, Boden nutzen zu können, ohne von privaten oder staatlichen Parasiten ausgebeutet zu werden» (S. 124). Wissenschaftliche Benennung dieses Systems nach Gesell hieß “physiokratische Mutterschaft”.
Neben seiner ökonomischen Lehren über das Schwund- und Freigeld, theorisierte Gesell einen Anarchofeminismus, wobei er besonders die Kinder und die Frauen gegen männliche Ausbeutung schützen wollte. Diese Interpretation des matriarchalischen Archetyp implizierte eine ziemlich scharfe Kritik des Vaterrechts, der in seinen Augen die Position der Kinder in der Gesellschaft besonders labil machte. Insofern war Gesell ein Vorfechter der Kinderrechte. Praktish bedeutete dieser Anarchofeminismus die Einführung einer “Mutterrente”. «Gesell und sein Anhänger wollten den gesamten Boden den Müttern zueignen und ihnen bzw. ihren Kinder die Bodenrente bis zum 18. Lebensjahr der Kinder als “Mutter-” bzw. “Kinderrente” zukommen lassen. Ein “Bund der Mütter” soll den gesamten nationalen und in ferner Zukunft den gesamten Boden unseres Planeten verwalten und (...) an den oder die Meistbietenden verpachten. Nach diesem Verfahren hätte jeder einzelne Mensch und jede einzelne Gruppe (z. B. eine Genossenschaft) die gleichen Chancen wie alle anderen, Boden nutzen zu können, ohne von privaten oder staatlichen Parasiten ausgebeutet zu werden» (S. 124). Wissenschaftliche Benennung dieses Systems nach Gesell hieß “physiokratische Mutterschaft”.
Neben den langen Aufsätzen von Bartsch und Schmitt enthält das Buch auch Texte von Gustav Landauer (“Sehr wertvolle Vorschläge”) und Erich Mühsam (“Ein Wegbahner. Nachruf zum Tode Gesells 1930”).
Fazit: Das Buch hilft uns, die Komplexität und Verwicklung von Ideen zu verstehen, die in der Räterepublik anwesend waren. Ist Niekisch wiederentdeckt und breit kommentiert, so ist seine Nähe zu Personen wie Landauer, Mühsam und Gesell kaum erforscht. Auch interressant wäre es, die Beziehungspunkte zwischen Gesell, Douglas und Pound zu analysieren und zu vergleichen. Letztlich wäre es auch, die Lehren Gesells mit den national-revolutionären Theorien eines Henning Eichbergs in den Jahren 60 und 70 und mit dem Gedankengut, das eine Zeitschrift wie Wir Selbst verbreitet hat. Eichberg hat ja auch immer den Akzent auf das Mütterliche gelegt. Er sprach eher von einem mütterlich-schützende Mutterland statt von einem patriarchalisch-repressive Vaterland. Ähnlichkeiten, die der Ideen-Historiker nicht vernachlässigen kann (Robert STEUCKERS).
00:05 Publié dans Histoire, Livre, Livre, Nouvelle Droite, Synergies européennes, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : silvio gesell, anarchisme, allemagne, histoire, nouvelle droite, théorie politique, sciences politiques, politologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 15 septembre 2013
Er formte Preußens Generalstab
Karl von Grolmann unterstützte Scharnhorst in der Militär-Reorganisationskommission und Blücher bei Belle-Alliance
 Der preußische Militärreformer Karl von Grolman war von einer enormen Prinzipienfestigkeit, Konsequenz und Rigorosität, um nicht zu sagen Radikalität, im Denken und Handeln. Mit dem Generalstab schuf er Moltke das Instrument, um an der deutschen Einigung maßgeblich mitzuwirken, die ihm selber zu erleben nicht mehr vergönnt war. Er starb vor 170 Jahren im 67. Lebensjahr.
Der preußische Militärreformer Karl von Grolman war von einer enormen Prinzipienfestigkeit, Konsequenz und Rigorosität, um nicht zu sagen Radikalität, im Denken und Handeln. Mit dem Generalstab schuf er Moltke das Instrument, um an der deutschen Einigung maßgeblich mitzuwirken, die ihm selber zu erleben nicht mehr vergönnt war. Er starb vor 170 Jahren im 67. Lebensjahr.
„Er huldigt nur dem Verstande und ehrt von den Gemütskräften nur die Willenskraft“, sagte August Neidhardt von Gneisenau, ein weiterer Großer der preußischen Reformbewegung, über ihn. Diese Willenskraft kommt schon darin zum Ausdruck, dass der am 30. Juli 1777 in Berlin geborene Preuße sich bereits als Kind gegen die Fortsetzung der Familientradition entschied. Im Gegensatz zu seinem Vater, der als Obertribunalpräsident und Mitautor des Allgemeinen Landrechts in der Justiz erfolgreich Karriere machte, und seinem Großvater mütterlicherseits, der Kriminalrat war, wurde Karl bereits als 14-Jähriger Soldat. Beim Militär fand er seine Berufung. Mit Enthusiasmus ging er in seinem Beruf auf und erfuhr entsprechende Resonanz.
Die für Preußen katastrophal endende Doppelschlacht bei Jena und Auerstedt machte er als Adjutant des Feldmarschalls Wichard von Möllendorf mit. Es folgte eine Verwendung als Adjutant des Befehlshabers des Feldheeres, Friedrich Ludwig Fürst zu Hohenlohe-Ingelfingen. Dessen ruhmlose und auf die preußische Moral verheerend wirkende Kapitulation bei Prenzlau brauchte er nicht mitzuerleben, da er vorher als Kurier zu seinem König Friedrich Wilhelm III. entsandt worden war. Im weiteren Verteidigungskampf Preußens gegen das überlegene napoleonische Kaiserreich bildete Grolman mit seiner Entschlossenheit und Tapferkeit eine ruhmreiche Ausnahme. Für sein Verhalten in dem Gefecht bei Soldau vom 26. Dezember 1806, in dem er schwer verwundet wurde, erhielt er den Orden Pour le Mérite.
Nach dem Krieg, dessen Verlust auch er nicht hatte abwenden können, wurde er in Gerhard von Scharnhorsts Militär-Reorganisationskommission berufen. Er war nicht nur im vorausgegangenen Vierten Koalitionskrieg positiv aufgefallen, sondern kannte Scharnhorst auch von der „Militärischen Gesellschaft“ her. Als Mitglied der Reorganisationskommission und der Untersuchungskommission, die das Verhalten der Offiziere während des Krieges zu prüfen und zu beurteilen hatte, sowie als für Personal- und Disziplinarangelegenheiten zuständiger Abteilungsdirektor des 1808 geschaffenen Kriegsministeriums half er mit der Schärfe seines Verstandes bei der Suche nach den Ursachen für die Niederlage und mit seiner unerbittlicher Strenge wie „rücksichtslosen Wahrheitsliebe“, um mit dem preußischen Reformer Hermann von Boyen zu sprechen, bei der Verfolgung der Schuldigen.
Diese Arbeit am Schreibtisch befriedigte ihn jedoch nicht. Er wollte mit der Waffe in der Hand gegen Napoleon kämpfen und das war nach dem Tilsiter Frieden von 1806 zumindest vorerst nicht mehr möglich. Als sich dann 1809 Österreich gegen Bonaparte erhob, nutzt er die Gelegenheit und wechselte von preußische in österreichische Dienste. Doch noch im selben Jahr endete auch dieser Fünfte Koalitionskrieg mit einem Sieg Napoleons.
Grolman gelang die Flucht in das mit dem Habsburgerreich verbündete England. In Spanien wurde immer noch beziehungsweise schon wieder mit britischer Unterstützung militärischer Widerstand gegen Bonaparte geleistet und so ging Grolman 1810 als Kämpfer der Legion extranjera, einer Art Fremdenlegion der dortigen Armee, nach Spanien. Dort kämpfte er als Bataillonskommandeur gegen Napoleon. 1812 gehörte er zu den Verteidigern Valencias gegen die französische Belagerer. Bei dessen Eroberung geriet er in französische Kriegsgefangenschaft. Er wurde nach Frankreich verbracht. Während seiner Zeit in Spanien wurde Grolman zum Anhänger der konstitutionellen Monarchie – was ihn in den Augen preußischer Reaktionäre zum Jakobiner und Demokraten werden ließ.
In Frankreich gelang ihm noch in eben jenem Jahre 1812 die Flucht in die benachbarte Schweiz. Von dort reiste er mit falscher Identität über Bayern nach Jena, wo er ein Geschichtsstudium aufnahm. Zeitgleich mit dem Seitenwechsel Preußens am Ende von Bonapartes Russlandfeldzug kehrte Grolman nach Preußen und in dessen Armee zurück. Wieder war Grolman mit Engagement bei der Sache. Sein Einsatz bei der Völkerschlacht bei Leipzig brachte ihm das Eichenlaub zum Pour le Mérite.
Im Gegensatz zu den Österreichern, die im metternichschen Geiste Frankreich als Großmacht erhalten sehen wollten, trat nun Grolman mit Gneisenau und Gebhard Leberecht von Blücher dafür ein, den bei Leipzig geschlagenen Franzosenkaiser bis in sein eigenes Land zu verfolgen und dort niederzukämpfen. Die Preußen setzten sich in diesem Punkte gegen die Österreicher durch und der Krieg wurde bis zu Napoleons Kapitulation fortgesetzt.
Als Bonaparte 1815 von Elba nach Frankreich zurückkehrte, gehörte Grolman zusammen mit Gneisenau und Blücher zu jenen, die Napoleons Karriere endgültig beendeten. Während Blücher das Kommando über die preußischen Truppen führte, war Gneisenau sein Generalstabschef und Grolman sein Generalquartiermeister. Es war nicht zuletzt die logistische Leistung des Generalquartiermeisters Grolman, welche die Preußen noch rechtzeitig genug auf dem Schlachtfeld von Belle-Alliance erscheinen ließ, um die Entscheidung zu bringen.
Nach den napoleonischen Kriegen leitete Grolman unter dem preußischen Reformer und Kriegsminister Boyen das 2. Departement des Kriegsministeriums. In dieser Funktion baute Grolman den preußischen Generalstab auf, widmete sich dessen Organisation und Ausbildung. Neben der Beteiligung an der preußischen Heeresreform unter Scharnhorst und der Niederringung Bonapartes nach dessen Rückkehr von Elba unter Blücher ist sein konstituierendes Wirken als erster preußischer Generalstabschef die dritte große Leistung Grolmans von historischer Bedeutung.
Wie sein Minister wurde auch Grolman ein Opfer der Reaktion, die nach den napoleonischen Kriegen wieder ihr Haupt erhob. Ganz im Sinne Scharnhorsts hatten sich die beiden preußischen Reformer für ein Volk in Waffen, den Bürger in Uniform und damit für die Landwehr eingesetzt, während die Reaktion diese Errungenschaft der Befreiungskriege zugunsten des traditionellen auf den König eingeschworenen und von Berufssoldaten geführten stehenden Heeres zurückdrängen wollte. Der König schlug sich auf die Seite der Reaktion und Grolman nahm mit seinem Minister Boyen deshalb im Jahre 1819 den Abschied.
Auf Betreiben des Prinzen August von Preußen wurde Grolman jedoch 1825 reaktiviert. Nachdem er die 9. Division in Glogau kommandiert hatte, wurde er schließlich Nachfolger des 1831 verstorbenen Gneisenau. 1832 erst interimistisch und 1835 dann offiziell und definitiv wurde ihm das Kommando über das V. Armeekorps in Posen übertragen. In Posen war es denn auch, wo Karl von Grolman am 15. September 1843 starb.
Manuel Ruoff
00:05 Publié dans Histoire, Militaria | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, prusse, allemagne, militaria |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook