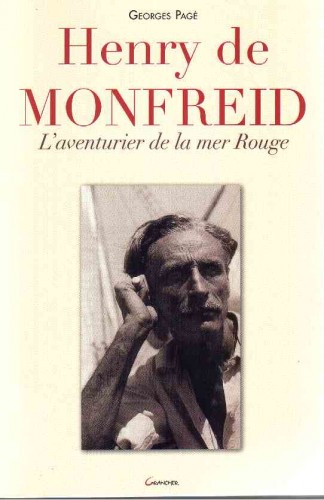 Di Henry De Monfreid in Italia si sa poco o niente e sono scarse le traduzioni, disponibili tra l'altro solo da qualche anno. «L'ultimo vero filibustiere della letteratura europea» lo ha invece definito Stenio Solinas. «Ho avuto una ricca, irrequieta e magnifica» dichiarò lo scrittore alcuni giorni prima di morire all'età di 95 anni nel 1974. Prima che autore fu uomo di mare e d'avventure e iniziò a scrivere passati i cinquant'anni. Una seconda vita la sua, quella da scrittore. Anzi la terza. Perchè quando nasce, a La Franqui-Leucate (Aude), sulla costa mediterranea il 14 novembre 1879, c'è solo il mare a presagire che tipo di vita sceglierà.
Di Henry De Monfreid in Italia si sa poco o niente e sono scarse le traduzioni, disponibili tra l'altro solo da qualche anno. «L'ultimo vero filibustiere della letteratura europea» lo ha invece definito Stenio Solinas. «Ho avuto una ricca, irrequieta e magnifica» dichiarò lo scrittore alcuni giorni prima di morire all'età di 95 anni nel 1974. Prima che autore fu uomo di mare e d'avventure e iniziò a scrivere passati i cinquant'anni. Una seconda vita la sua, quella da scrittore. Anzi la terza. Perchè quando nasce, a La Franqui-Leucate (Aude), sulla costa mediterranea il 14 novembre 1879, c'è solo il mare a presagire che tipo di vita sceglierà. lundi, 18 octobre 2010
Henry de Monfreid
Henry De Monfreid, il fascista che ispirò Hergé e Pratt finalmente pubblicato in Italia
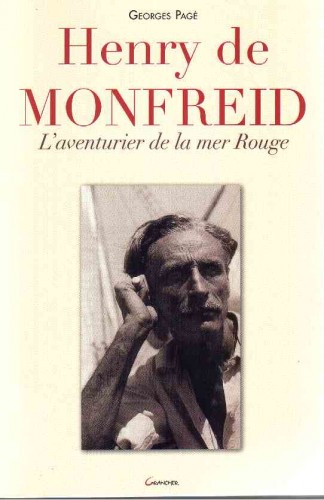 Di Henry De Monfreid in Italia si sa poco o niente e sono scarse le traduzioni, disponibili tra l'altro solo da qualche anno. «L'ultimo vero filibustiere della letteratura europea» lo ha invece definito Stenio Solinas. «Ho avuto una ricca, irrequieta e magnifica» dichiarò lo scrittore alcuni giorni prima di morire all'età di 95 anni nel 1974. Prima che autore fu uomo di mare e d'avventure e iniziò a scrivere passati i cinquant'anni. Una seconda vita la sua, quella da scrittore. Anzi la terza. Perchè quando nasce, a La Franqui-Leucate (Aude), sulla costa mediterranea il 14 novembre 1879, c'è solo il mare a presagire che tipo di vita sceglierà.
Di Henry De Monfreid in Italia si sa poco o niente e sono scarse le traduzioni, disponibili tra l'altro solo da qualche anno. «L'ultimo vero filibustiere della letteratura europea» lo ha invece definito Stenio Solinas. «Ho avuto una ricca, irrequieta e magnifica» dichiarò lo scrittore alcuni giorni prima di morire all'età di 95 anni nel 1974. Prima che autore fu uomo di mare e d'avventure e iniziò a scrivere passati i cinquant'anni. Una seconda vita la sua, quella da scrittore. Anzi la terza. Perchè quando nasce, a La Franqui-Leucate (Aude), sulla costa mediterranea il 14 novembre 1879, c'è solo il mare a presagire che tipo di vita sceglierà.
00:05 Publié dans Littérature, Voyage | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mer rouge, voyages, henry de monfreid, littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, france, aventure, mer, marine, marins |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 17 octobre 2010
Gli incubi solitari di Edgar Allan Poe
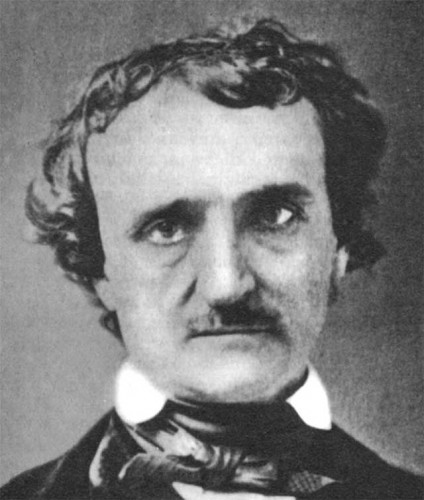
Gli incubi solitari di Edgar Allan Poe
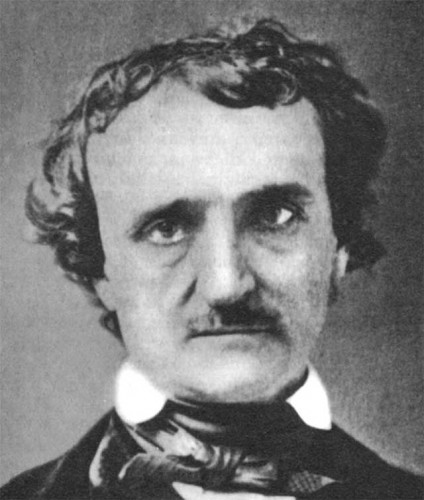
di Silvio Botto
Ex: http://robertoalfattiappetiti.blogspot.com/
«Nessuno scrittore del terrore – spiega l'autore e critico Francesco Lamendola - né americano, né europeo, ha potuto evitare di fare i conti con lui, di prendere posizione rispetto alla sua figura gigantesca». Infatti non è un caso che nel corso del Novecento le opere di Edgar Allan Poe siano state letteralmente saccheggiate da altri scrittori, da autori cinematografici (la prima trasposizione sul grande schermo, La caduta della casa Usher, è del 1928, ma ne seguiranno molte altre), da musicisti (Lou Reed, Iron Maiden e Alan Parsons Project), da soggettisti di fumetti e persino dai creatori della serie I Simpson, che hanno dedicato un miniepisodio televisivo al racconto “Il corvo”.
 Per Edgar Allan Poe sono gli anni migliori. Ottiene buoni risultati nella sua carriera di giornalista e soprattutto comincia a pubblicare con un certo successo i romanzi e racconti che lo renderanno universalmente famoso. Fra il 1837 e 1838 scrive la “Storia di Arthur Gordon Pym”, un romanzo che secondo il critico Gianfranco De Turris prosegue e riprende un’antica tradizione narrativa (con riferimento ad autori come Coleridge, Swift, Cooper), nella quale sono presenti immagini che si ripetono varie volte: il viaggio per mare, la caduta nell’abisso, le tempeste ed i naufragi che colpiscono i protagonisti, la fame e la pratica del cannibalismo, l’esplorazione di terre sconosciute e il contatto con nuove genti indigene. Tutte queste immagini devono essere considerate anche come elementi di un duro itinerario iniziatico del protagonista che, attraversando l’esperienza del dolore, della morte e della resurrezione, assurge nel finale ad una più sublime e superiore dimensione dell’Essere.
Per Edgar Allan Poe sono gli anni migliori. Ottiene buoni risultati nella sua carriera di giornalista e soprattutto comincia a pubblicare con un certo successo i romanzi e racconti che lo renderanno universalmente famoso. Fra il 1837 e 1838 scrive la “Storia di Arthur Gordon Pym”, un romanzo che secondo il critico Gianfranco De Turris prosegue e riprende un’antica tradizione narrativa (con riferimento ad autori come Coleridge, Swift, Cooper), nella quale sono presenti immagini che si ripetono varie volte: il viaggio per mare, la caduta nell’abisso, le tempeste ed i naufragi che colpiscono i protagonisti, la fame e la pratica del cannibalismo, l’esplorazione di terre sconosciute e il contatto con nuove genti indigene. Tutte queste immagini devono essere considerate anche come elementi di un duro itinerario iniziatico del protagonista che, attraversando l’esperienza del dolore, della morte e della resurrezione, assurge nel finale ad una più sublime e superiore dimensione dell’Essere.
00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : etats-unis, poe, littérature, littérature américaine, lettres, letres américaines |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 16 octobre 2010
Italo Svevo
di Graziella Balestrieri
Fonte: Roberto Alfatti Appetiti (Blog) [scheda fonte]
"Ogni lettore, quando legge, legge sé stesso. L'opera dello scrittore è soltanto una specie di strumento ottico che egli offre al lettore per permettergli di discernere quello che, senza libro, non avrebbe forse visto in se stesso". (M.Proust)
 N.S.
N.S.
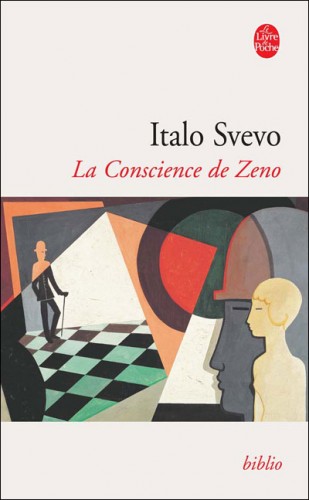 Così, nel sembrare un pessimista di natura, cerca nei suoi personaggi la chiave per descrivere l’uomo che cade in piedi. Che non è semplice, perché se cadi il segno di un livido ti rimane, cadendo e rimanendo in piedi il dolore lo senti solo dentro. Non è fisico, è solo mentale. Alfonso Nitti, bancario che lascia la mamma e si ritrova in una città che non sembra appartenergli, a cui non vuole appartenere, il personaggio di Una vita ricalca l’archetipo del debole, di colui che si arrende all’amore perché non è amato dalla donna che vorrebbe, che si arrende alla perfezione e alla cura estetica del collega che lo snerva nel suo essere borghese e arrivista, si arrende alla distanza inevitabile del suo capo, il Maller. Solo la morte per quanto crudele e distante, riuscirà ad avvicinarlo alla perfezione della vita, ma questo nemmeno servirà ad sentire più vicini quelli che lui considerava mal volentieri “colleghi”."La Banca Maller, in puro stile burocratico, annuncia un funerale che avviene con l’intervento dei colleghi e della direzione" (Una vita). Alfonso, che si dà colpe non sue, scriverà alla mamma: “Non credere, mamma, che qui si stia tanto male; sono io che ci sto male”. Non faceva nulla e quel nulla lo portava ad avere un’inerzia totale dinnanzi alle cose. Non era stanco, era solo annoiato. Tutti i giorni lì su quella sedia, tutti i giorni a subire e non capire, tutti i giorni un pezzo di vita che si vedeva portar via, ma la cosa assurda è che mentre gli altri “sembravano” contenti di vivere così, Alfonso era contento di non vivere. Avrà ragione Joyce a dire che nella penna di un uomo c’è un solo romanzo e che quando se ne scrivono diversi si tratta sempre del medesimo più o meno trasformato. Così da Una Vita si passa alla Coscienza di Zeno, che nel 1924 Svevo spedisce al suo ormai amico Joyce, trasferitosi a Trieste e suo professore di inglese che Livia Veneziani Svevo descriverà così: “Fra il maestro, oltremodo irregolare, ma d’altissimo ingegno e lo scolaro d’eccezione le lezioni si svolgevano con un andamento fuori dal comune”. Joyce, entusiasta del suo “allievo”, fa conoscere il manoscritto in Francia dove verrà pubblicato. In Italia sarà per merito di Eugenio Montale, sulle pagine della rivista L’Esame, che Svevo riuscirà ad avere la prima notorietà. Zeno Cosini che cerca di guarire da una malattia non ancora ben definita ed inizia il percorso psicoanalitico presso il Dottor S. Dottore che, per quanto poco si sforzi di capire il problema, non riuscirà a farlo e nel momento dell’abbandono della terapia da parte di Zeno si vendicherà pubblicando le memorie del suo paziente con la speranza che questo gli procuri dolore. Ma Zeno, che è più impegnato ad amare la sua sigaretta non farà altro che ridere e deridere il suo analista.
Così, nel sembrare un pessimista di natura, cerca nei suoi personaggi la chiave per descrivere l’uomo che cade in piedi. Che non è semplice, perché se cadi il segno di un livido ti rimane, cadendo e rimanendo in piedi il dolore lo senti solo dentro. Non è fisico, è solo mentale. Alfonso Nitti, bancario che lascia la mamma e si ritrova in una città che non sembra appartenergli, a cui non vuole appartenere, il personaggio di Una vita ricalca l’archetipo del debole, di colui che si arrende all’amore perché non è amato dalla donna che vorrebbe, che si arrende alla perfezione e alla cura estetica del collega che lo snerva nel suo essere borghese e arrivista, si arrende alla distanza inevitabile del suo capo, il Maller. Solo la morte per quanto crudele e distante, riuscirà ad avvicinarlo alla perfezione della vita, ma questo nemmeno servirà ad sentire più vicini quelli che lui considerava mal volentieri “colleghi”."La Banca Maller, in puro stile burocratico, annuncia un funerale che avviene con l’intervento dei colleghi e della direzione" (Una vita). Alfonso, che si dà colpe non sue, scriverà alla mamma: “Non credere, mamma, che qui si stia tanto male; sono io che ci sto male”. Non faceva nulla e quel nulla lo portava ad avere un’inerzia totale dinnanzi alle cose. Non era stanco, era solo annoiato. Tutti i giorni lì su quella sedia, tutti i giorni a subire e non capire, tutti i giorni un pezzo di vita che si vedeva portar via, ma la cosa assurda è che mentre gli altri “sembravano” contenti di vivere così, Alfonso era contento di non vivere. Avrà ragione Joyce a dire che nella penna di un uomo c’è un solo romanzo e che quando se ne scrivono diversi si tratta sempre del medesimo più o meno trasformato. Così da Una Vita si passa alla Coscienza di Zeno, che nel 1924 Svevo spedisce al suo ormai amico Joyce, trasferitosi a Trieste e suo professore di inglese che Livia Veneziani Svevo descriverà così: “Fra il maestro, oltremodo irregolare, ma d’altissimo ingegno e lo scolaro d’eccezione le lezioni si svolgevano con un andamento fuori dal comune”. Joyce, entusiasta del suo “allievo”, fa conoscere il manoscritto in Francia dove verrà pubblicato. In Italia sarà per merito di Eugenio Montale, sulle pagine della rivista L’Esame, che Svevo riuscirà ad avere la prima notorietà. Zeno Cosini che cerca di guarire da una malattia non ancora ben definita ed inizia il percorso psicoanalitico presso il Dottor S. Dottore che, per quanto poco si sforzi di capire il problema, non riuscirà a farlo e nel momento dell’abbandono della terapia da parte di Zeno si vendicherà pubblicando le memorie del suo paziente con la speranza che questo gli procuri dolore. Ma Zeno, che è più impegnato ad amare la sua sigaretta non farà altro che ridere e deridere il suo analista.
 Stupida come cosa, ma immediatamente riuscii a capire il veleno che ti attraversa le vene, riuscii a capire quanto sia debole un uomo dinnanzi ad un vizio, che non ti serve, che non è utile, che è dannoso, ma diventa vitale. E più di tutto mi impressionò in Zeno il tentativo di voler smettere e la volontà certa di non farlo mai. Il medico della casa di cura dove venne “rinchiuso” per smettere di fumare gli dice:"Non capisco perché lei, invece di cessare di fumare, non si sia piuttosto risolto di diminuire il numero delle sigarette che fuma". Il non averci mai pensato di Zeno risulta l’immagine migliore del romanzo, il dolore che vivi dallo stacco brutale da un qualcosa a cui sei morbosamente legato ti ripaga dell’amore per cui morbosamente sei legato a quella cosa. Così o si rinuncia in maniera totale o non si rinuncia. Così Zeno passerà ogni sera ad annotare una U.S, un’ultima sigaretta mai spenta.
Stupida come cosa, ma immediatamente riuscii a capire il veleno che ti attraversa le vene, riuscii a capire quanto sia debole un uomo dinnanzi ad un vizio, che non ti serve, che non è utile, che è dannoso, ma diventa vitale. E più di tutto mi impressionò in Zeno il tentativo di voler smettere e la volontà certa di non farlo mai. Il medico della casa di cura dove venne “rinchiuso” per smettere di fumare gli dice:"Non capisco perché lei, invece di cessare di fumare, non si sia piuttosto risolto di diminuire il numero delle sigarette che fuma". Il non averci mai pensato di Zeno risulta l’immagine migliore del romanzo, il dolore che vivi dallo stacco brutale da un qualcosa a cui sei morbosamente legato ti ripaga dell’amore per cui morbosamente sei legato a quella cosa. Così o si rinuncia in maniera totale o non si rinuncia. Così Zeno passerà ogni sera ad annotare una U.S, un’ultima sigaretta mai spenta.
N.S
Tante altre notizie su www.ariannaeditrice.it
00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres italiennes, littérature italienne, italie, allemagne, autriche-hongrie, 20ème siècle |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 08 octobre 2010
Olivier Bardolle - Petit traité des vertus réactionnaires
Présentation de l'éditeur
En Occident, depuis près d'un demi-siècle, les idées progressistes tiennent le haut du pavé. Il semblerait pourtant que l'on redécouvre aujourd'hui certaines vertus à la pensée réactionnaire. Ne serait-ce qu'une capacité de résistance certaine aux ravages de l'hypermodernité et aux bienfaits immodérés de la pensée unique. Sans tomber dans le manichéisme propre à l'époque, ce petit traité, particulièrement tonique, dénonce les fausses valeurs avec jubilation et poussera chacun, qu'il se prétende de droite ou de gauche, à réviser son catéchisme idéologique. C'est ainsi qu'Eric Naulleau, réputé de gauche, n'a pas hésité à préfacer ce texte en toute indépendance d'esprit. A lire sans modération
L'auteur
Olivier Bardolle, né en 1952, est un essayiste reconnu et un interlocuteur recherché (on l'a vu plusieurs fois dans l'émission de Frédéric Taddeï, Ce soir ou jamais). Du Monologue implacable (Ramsay, 2003) à De la prolifération des homoncules sur le devenir de l'espèce (L'Esprit des Péninsules, 2008) ou à ce Petit traité des vertus réactionnaires, Olivier Bardolle tisse, dans la lignée de Philippe Muray (à qui ce dernier ouvrage est dédié), le portrait de l'hypermodernité avec sagacité, ironie, mordant et, ce qui n est pas encore interdit : érudition. Chacun de ses essais épingle la bien-pensance et les idées toutes faites de ses chers contemporains.
Olivier Bardolle, Petit traité des vertus réactionnaires, L'Editeur, 2010.
Commande possible sur Amazon.fr.
00:10 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, lettres, littérature, littérature française, lettres françaises, réflexions personnelles, livre |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Ernst Jüngers Lieblingspsalm
Ernst Jüngers Lieblingspsalm
 Der 26. September 1996 war ein bedeutender Tag – auch wenn dies die Öffentlichkeit erst mehr als ein Jahr später erfahren sollte. An diesem Tag wurde Ernst Jünger in die katholische Kirche aufgenommen. Beim Gottesdienst zu diesem Anlaß wurde nach Jüngers Wunsch der Psalm 73 gebetet, in dem er die oft verschlungenen Pfade seines Lebens widergespiegelt sah:
Der 26. September 1996 war ein bedeutender Tag – auch wenn dies die Öffentlichkeit erst mehr als ein Jahr später erfahren sollte. An diesem Tag wurde Ernst Jünger in die katholische Kirche aufgenommen. Beim Gottesdienst zu diesem Anlaß wurde nach Jüngers Wunsch der Psalm 73 gebetet, in dem er die oft verschlungenen Pfade seines Lebens widergespiegelt sah:
„Lauter Güte ist Gott für Israel, für alle Menschen mit reinem Herzen. Ich aber – fast wären meine Füße gestrauchelt, beinahe wäre ich gefallen. Denn ich habe mich über die Prahler ereifert, als ich sah, daß es diesen Frevlern so gut ging. Sie leiden ja keine Qualen, ihr Leib ist gesund und wohlgenährt. (…) Sie sehen kaum aus den Augen vor Fett, ihr Herz läuft über von bösen Plänen (…) Sie reißen ihr Maul bis zum Himmel auf und lassen auf Erden ihrer Zunge freien Lauf. Darum wendet sich das Volk ihnen zu und schlürft ihre Worte in vollen Zügen. (…) Also hielt ich umsonst mein Herz rein und wusch meine Hände in Unschuld.
Und doch war ich alle Tage geplagt und wurde jeden Morgen gezüchtigt. Mein Herz war verbittert, mir bohrte der Schmerz in den Nieren. (…) Da sann ich nach, um das zu begreifen; es war eine Qual für mich, bis ich dann eintrat ins Heiligtum Gottes und begriff, wie sie enden. (…) Sie werden plötzlich zunichte, werden dahingerafft und nehmen ein schreckliches Ende. (…) Ich aber – Gott nahe zu sein ist mein Glück. Ich setze auf Gott, den Herrn, mein Vertrauen. Ich will all deine Taten verkünden.“
„Sie reißen ihr Maul bis zum Himmel auf“
Jünger konnte diesen Bibeltext auf seine lange religiöse Suche beziehen. Die Nationalsozialisten haben oftmals versucht, ihn für ihre Ideologie zu gewinnen und so wäre Jünger beinahe gestrauchelt. Doch Jünger erkannte ihre „bösen Pläne“ immer deutlicher, was schließlich 1933 zu seinem Ausschluss aus der Dichterakademie führte.
Wer vor dem Hintergrund der Biographie Ernst Jüngers den Psalm 73 liest, sieht vor seinem geistigen Auge Hermann Göring und Joseph Goebbels, wenn die Frevler beschrieben werden „sie sehen kaum aus ihren Augen vor Fett“ und „sie reißen ihr Maul bis zum Himmel auf.“
Wenn im Psalm von der Verbitterung des Herzens die Rede ist, denkt der Jünger-Freund unwillkürlich an die letzten Kriegsjahre in Paris, wo Jünger die „Pariser Tagebücher“ verfaßte, die später in seine „Strahlungen“ aufgenommen wurden.
Das Unsichtbare läßt sich für Jünger nur in Gleichnissen fassen
Doch der Psalm endet mit der Hinwendung zu Gott – ganz so wie das lange Leben Ernst Jüngers selbst. In seinem Alterswerk „Die Schere“ schreibt Jünger von der „Welt, die außerhalb unserer Erfahrung liegt.“ Er unterscheidet „zwischen dem Sichtbaren, dem Unsichtbaren und dem Nicht-Vorhandenen.“ Dieses Unsichtbare läßt sich für Jünger nur in Gleichnissen fassen.
Daher schreibt er „Gott“ immer in Anführungszeichen. Seine Begründung: „Die Wirklichkeit des Göttlichen ist für mich unleugbar, aber sie ist auch schwer zu definieren und zu benennen.“ Wie seine Konversion zeigt, war er allerdings der Meinung, daß der katholische Glaube der unfassbaren göttlichen Wahrheit wohl am nächsten kommt.
00:10 Publié dans Littérature, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres allemandes, littérature allemande, ernst jünger, révolution conservatrice, allemagne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 07 octobre 2010
Céline et L'Oréal
Céline et L’Oréal
Ex: http://lepetitcelinien.blogspot.com/
 Il a beaucoup été question, cet été, de l’affaire Bettancourt. Elle oppose, comme on sait, Liliane Bettencourt à sa fille, avec en outre des interférences avec le gouvernement français. Quel rapport avec Céline ? Le 17 février 1942, dans une lettre à Lucien Combelle, il eut des mots très vifs à l’égard du père de Liliane, Eugène Schueller (1881-1957) : « Votre Shoeller [sic] avec toutes ses pitreries me semble bien youtre. Il ne parle jamais des juifs dans ses livres. Il paraît que son conseil d’administration recèle de forts puissants youtres, anglais et américains. » C’est que deux jours auparavant, dans son journal Révolution nationale, Combelle avait publié un grand article d’Eugène Schueller sur « Le salaire proportionnel ». Dans une société libérée du capitalisme libéral et des syndicats, qu’il appelait de ses vœux, les ouvriers eussent touché un triple salaire : un salaire d’activité, un salaire familial calculé en fonction de leur nombre d’enfants, et un salaire de productivité. Schueller avait déjà traité ce thème dans son livre, La Révolution de l’économie, paru l’année précédente et que l’auteur des Beaux draps avait certainement lu. Si Céline se méfiait de Schueller, c’est parce qu’il participait à la direction du RNP de Marcel Déat. Lequel était également suspect aux yeux de Céline en raison de ses liens avec la franc-maçonnerie et de son appartenance au monde parlementaire de la IIIe République que l’écrivain n’avait guère en haute estime. Coïncidence : en exil, Céline sympathisera avec le représentant de L’Oréal au Danemark, Georges Sales, et sa jeune épouse. « Ma compatriote, la petite bretonne... » dira d’elle Céline (1).
Il a beaucoup été question, cet été, de l’affaire Bettancourt. Elle oppose, comme on sait, Liliane Bettencourt à sa fille, avec en outre des interférences avec le gouvernement français. Quel rapport avec Céline ? Le 17 février 1942, dans une lettre à Lucien Combelle, il eut des mots très vifs à l’égard du père de Liliane, Eugène Schueller (1881-1957) : « Votre Shoeller [sic] avec toutes ses pitreries me semble bien youtre. Il ne parle jamais des juifs dans ses livres. Il paraît que son conseil d’administration recèle de forts puissants youtres, anglais et américains. » C’est que deux jours auparavant, dans son journal Révolution nationale, Combelle avait publié un grand article d’Eugène Schueller sur « Le salaire proportionnel ». Dans une société libérée du capitalisme libéral et des syndicats, qu’il appelait de ses vœux, les ouvriers eussent touché un triple salaire : un salaire d’activité, un salaire familial calculé en fonction de leur nombre d’enfants, et un salaire de productivité. Schueller avait déjà traité ce thème dans son livre, La Révolution de l’économie, paru l’année précédente et que l’auteur des Beaux draps avait certainement lu. Si Céline se méfiait de Schueller, c’est parce qu’il participait à la direction du RNP de Marcel Déat. Lequel était également suspect aux yeux de Céline en raison de ses liens avec la franc-maçonnerie et de son appartenance au monde parlementaire de la IIIe République que l’écrivain n’avait guère en haute estime. Coïncidence : en exil, Céline sympathisera avec le représentant de L’Oréal au Danemark, Georges Sales, et sa jeune épouse. « Ma compatriote, la petite bretonne... » dira d’elle Céline (1).Qui était Eugène Schueller ? Ce chimiste génial mit au point les premières teintures capillaires de synthèse puis créa en 1909 la Société française de teintures inoffensives pour cheveux, futur L’Oréal. Devenu riche, le père de Liliane Bettencourt finança la fameuse Cagoule dans les années trente. C’est après la victoire du Front populaire que Schueller s’intéressa au mouvement nationaliste et devint l’intime d’Eugène Deloncle, l’un des chefs cagoulards. Avec ce dernier, Jean Fontenoy et Jacques Dursort, il fonda en octobre 1940 le Mouvement Social-Révolutionnaire (MSR) qui fit long feu. Les réunions de la direction du MSR se tenaient au siège de L’Oréal (14, rue Royale à Paris) (2). L’année suivante, il devint le président de la Commission des Affaires Économiques du RNP. Après la guerre, nombreux seront ceux qui, soit épurés, soit ayant appartenu au mouvement cagoulard, se verront embauchés chez L’Oréal. Dont Pierre Monnier qui fit toute sa carrière dans ce groupe à partir des années 50. À propos de Schueller, Céline, qui l’avait rencontré avant guerre chez Denoël, lui dira : « Il était aussi intelligent et intuitif que vous le dites, et bien entendu paranoïaque !... ». À l’Oréal, Monnier eut comme patron François Dalle (1918-2005) auquel l’homme d’affaires Jean Frydman reprocha publiquement – mais en 1995 seulement – d’avoir fait de l’entreprise un refuge d’anciens cagoulards et de collaborateurs.
André Bettencourt (1919-2007) ne fut pas davantage exempt de reproches. On lui fit grief des articles parus dans La Terre française (dont il assurait la direction) qui soutenaient activement la Révolution Nationale. Et qui étaient parfois franchement antisémites. Ensuite, l’histoire de L’Oréal est intimement liée à celle de la IVe et de la Ve République. Si Bettencourt fut plusieurs fois ministre, ce fut aussi le cas de son ami de jeunesse (qui témoigna à la Libération en faveur d’Eugène Schueller) : un certain François Mitterrand, beau-frère d’une nièce de Deloncle. Et l’on sait qu’il dirigea pendant deux ans Votre beauté, mensuel du groupe L’Oréal. On imagine les commentaires sarcastiques que toute cette histoire inspirerait aujourd’hui à Céline !
Marc LAUDELOUT
1. Pierre Monnier, Ferdinand furieux, L’Age d’homme, 1979, p. 14.
2. Schueller faisait partie du Comité exécutif du MSR, présidait et dirigeait « toutes les Commissions techniques et Comités d’études » du mouvement (Révolution Nationale, n° 3, 26 octobre 1941).
Pour plus de détails, voir l’article de Bruno Abescat, « Les secrets de la première fortune de France », L’Express, 30 novembre 2000 (disponible sur http://www.lexpress.fr).
00:15 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, céline, france |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 06 octobre 2010
Dichtersoldat und Künder neuen Lebens
Archives - 2003
Dichtersoldat und Künder neuen Lebens
Vor 65 Jahren starb der aristokratische Nationalist Gabriele D’Annunzio
 Das 20. Jahrhundert bot geistigen Abenteurern Entfaltungsmöglichkeiten, von denen wir Heutige angesichts einer »verwalteten Welt« nur träumen können. Eine dieser abenteuerlichen Biographien des letzten Jahrhunderts hatte der italienische Dichter, Krieger und Nationalist Gabriele D’Annunzio (1863–1938). Beeinflußt von der Lebensphilosophie Friedrich Nietzsches, eroberte er nach Ende des Ersten Weltkriegs handstreichartig die Adriastadt Fiume und errichtete eine nationalistische Herrschaft des totalen Lebens.
Das 20. Jahrhundert bot geistigen Abenteurern Entfaltungsmöglichkeiten, von denen wir Heutige angesichts einer »verwalteten Welt« nur träumen können. Eine dieser abenteuerlichen Biographien des letzten Jahrhunderts hatte der italienische Dichter, Krieger und Nationalist Gabriele D’Annunzio (1863–1938). Beeinflußt von der Lebensphilosophie Friedrich Nietzsches, eroberte er nach Ende des Ersten Weltkriegs handstreichartig die Adriastadt Fiume und errichtete eine nationalistische Herrschaft des totalen Lebens.
Seit dem 18. Januar 1919 tagte die Pariser Friedenskonferenz unter dem Vorsitz des französischen Deutschenhassers Clemenceau und beriet über das Schicksal der Mittelmächte. Als die Sieger des Weltkrieges am 28. Juni 1919 unter der Drohung einer vollständigen militärischen Besetzung des Reiches und der Aufrechterhaltung der Hungerblockade die deutsche Unterzeichnung des Versailler Vertrages erzwangen, war die Empörung des gedemütigten deutschen Volkes über alle Parteigrenzen hinweg groß. Mit eiserner Hand zeichneten die Mitglieder des »Rates der Vier« völlig willkürlich eine neue Staatenkarte Nachkriegseuropas, die die Volkstumsgrenzen vielfach mißachtete. So sprach man Italien, das im Mai 1915 Österreich den Krieg erklärt hatte, völkerrechtswidrig den Süden Tirols zu.
Obwohl der italienische Regierungschef Orlando dem Vierer-Gremium der Sieger angehörte und eine reiche Kriegsbeute zulasten Deutsch-Österreichs aushandelte, fühlte man sich in Italien um den gerechten Lohn des Krieges betrogen. Der Tradition des sogenannten Irredentismus folgend, der italienische »Heimaterde« an das Mutterland anzuschließen gedachte, warf man auch begehrliche Blicke auf die gegenüberliegende Adriaküste.
So entbrannte zwischen Italien und dem künstlich geschaffenen Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen 1919 ein politischer Streit um die in der Nähe Triests liegende Grenz- und Hafenstadt Fiume, das heutige Rijeka. In den Versailler Verhandlungsrunden beschloß man die Entsendung einer alliierten Truppe in die strittige und gemischt-ethnische Stadt. Nun sollte die geschichtliche Stunde des Gabriele D’Annunzio schlagen.
An der Spitze mehrerer hundert Soldaten der italienischen Sturmtruppen, der Arditi, rückte der weltbekannte Dichter und italienische Kriegsheld widerstandslos in die Adriastadt ein. In seiner ersten Rede verkündete er »die Heimkehr Fiumes, das in der tollen und niedrigen Welt der Verworfenheit die einzige Wahrheit, die einzige Liebe, das strahlende Flammenzeichen des italienischen Widerstandes ist.«
Was sich in den nächsten fünfzehn Monaten in dieser Stadt des nietzscheanischen Lebens abspielte, kann politische Romantiker und revolutionäre Enthusiasten noch heute in Begeisterung versetzen. Es war ein die Sinne betörender Reigen aus nationalistischen Reden und Festen, aus Liebe, Rausch und Gesang, aus klirrenden Waffen, wehenden Fahnen und schwarzen Uniformen. In einem Brief fing D’Annunzio diese wohl einmalige Atmosphäre ein: »Gestern abend habe ich eine große Rede gehalten, mitten im brennenden Delirium. Du kannst dir dieses merkwürdige Leben in Fiume nicht vorstellen, wir verbringen die Nächte mit coup de mains, wie Diebe und Piraten.«
Antibürgerliches Traumreich
Die gewöhnlichen Gesetze der Politik waren außer Kraft gesetzt; das Leben spielte sich in einem Traumreich ab. Der Historiker Ernst Nolte bemerkte dazu: »All das war sehr viel mehr als das gigantische Theater eines genialen Regisseurs. Es waren nicht zuletzt englische Gäste, die vom Charme des Kommandanten bezaubert und von dem staatlichen Gegenbild zur alltäglichen Nüchternheit der bürgerlichen Gesellschaft hingerissen waren.«
Neben D’Annunzio prägten vor allem die schwarzuniformierten italienischen Elitesoldaten, die Arditi, das Leben der Stadt. Im Weltkrieg für die gefährlichsten Unternehmen eingesetzt, lebten sie die Nietzsche-Forderung: Lebe gefährlich! Stirb stolz! Ihr Lied, die »Giovinezza«, wurde später die Hymne des italienischen Faschismus; ihr weißer Totenkopf auf schwarzem Hemd symbolisierte die Macht über Leben und Tod. Mit kurzen, glühenden Worten schrieb D’Annunzio:
»Bei den Arditi. Gegen Abend. Das wahre Feuer. Die Rede, die gierigen Gesichter – Die Rasse aus Flammen. Die Chöre – die offenen, klangvollen Lippen – Die Blumen, der Lorbeer. Der Ausgang. Die Dolche nackt in der Faust. Eine ,Grandezza‘, die ganz römisch ist. Alle Dolche hoch. Die Rufe. Der begeisterte Lauf der Kohorte. Das Fleisch auf Holzglut gebraten. Die auflodernde Flamme brennt im Gesicht – Das Delirium des Mutes. Rom: das Ziel!«
Der dichtende Volkstribun schmetterte vom Balkon des Gouverneurspalastes seine mitreißenden Reden und versetzte die Menge in Zustände der Ekstase. D’Annunzio feierte sich, die Jugend, das Leben und das Vaterland. Wenn der »Comandante« die Frage »Wem gehört Italien?« in die Menge seiner Landsleute schleuderte, donnerte es ein »Uns!« zurück. Für den alternden Kriegsheld war Fiume mehr als ein Jungbrunnen, es war die glutvolle Revolte gegen eine rationale, materialistische Bürgerwelt: »Hier bin ich, ecce Homo (…). Ich bitte nur um das Recht, Bürger der Stadt des Lebens zu sein. In dieser närrischen und feigen Welt ist heute Fiume ein Zeichen der Freiheit.«
Fiume wurde mit den Monaten aber auch Zeichen der Dekadenz: Vielfältige sexuelle Ausschweifungen prägten das Nachtleben, Drogen machten die Runde und die zahlreichen Fest- lichkeiten und Kulturveranstaltungen zerrütteten die Stadtfinanzen. Um die Anflüge von nationaler Anarchie einzudämmen und dem gemeinschaftlichen Leben wieder eine feste Form zu geben, erließ der Comandante im August 1920 eine neue Verfassung, die Carta del Canaro, die nationalistische, syndikalistische und aristokratische Elemente in sich vereinigte. Dieser Neuordnung sollte aber keine lange Dauer beschieden sein.
Nachdem sich Rom und Belgrad über den zukünftigen Status von Fiume als »Freistaat« geeinigt hatten, wurde der D’Annunzio zum Verlassen der Stadt aufgefordert. Als er dieser Forderung nicht nachkam, eröffnete das italienische Schlachtschiff »Andrea Doria« Ende Dezember 1920 das Feuer auf die Stadt, dem fast 40 Arditi zum Opfer fielen. Auf diese Weise endete das römische »Gesamtkunstwerk« Fiume. In einer letzten Rede verabschiedete sich D’Annunzio von der Adriaperle mit den Worten: »Wir werfen heute nacht den Trauerruf ,Alala‘ über die ermordete Stadt.«
Ästhetisierung der Politik
Was von dieser Nachkriegsepisode aber blieb, war der dort kreierte »faschistische Stil«, der für die nationalistischen Massenbewegungen bis 1945 bestimmend blieb. Sein Erfolgsgeheimnis war die Ästhetisierung der Politik und nicht die Politisierung der Kunst, wie sie die Kommunisten betrieben.
Das Fiume-Abenteuer mit seinem ungezügelten Leben, den Selbstinszenierungsmöglichkeiten und dem Ausleben eines heroischen Ästhetizismus war dem 1863 als Sohn eines Bürgermeisters geborenen Gabriele auf den Leib geschnitten. Von Eltern und Schwestern umhätschelt und von den Musen geküßt, entwickelte er früh ein außerordentliches Selbstbewußtsein: »Ich bin sechzehn Jahre alt und schon spüre ich in der Seele und im Geist das erste Feuer jener Jugend erglühen, die naht: in meinem Herzen ist tief eingeprägt ein maßloser Wunsch nach Wissen und Ruhm, welcher oft über mich mit einer düsteren und quälenden Melancholie herfällt und mich zum Weinen zwingt: ich dulde kein Joch.«
Schnell machte er sich in Künstlerkreisen einen Namen und lebte seinen heidnischen Schönheits- und Sinnenkult in vollen Zügen aus. Er liebte extravagante Kleidung, Luxus in jeder Form und vor allem die Frauen, denen er in notorischer Untreue verfallen war. Seine großen Bücher »Lust« (1889), »Der Triumph des Todes« (1894) und »Feuer« (1900) drehen sich alle um stürmische Liebschaften und harsche Enttäuschungen großer Ästheten. Im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts erreichte der Dichter bereits den Zenit seines künstlerischen Schaffens. Als der extrovertierte Dandy 1910 wieder einmal in eine finanzielle Krise geriet, siedelte er nach Frankreich über, wo sein politisches Bewußtsein und sein Draufgängertum reifte. Als 1914 der Weltkrieg ausbrach, forderte D’Annunzio den Kriegseintritt Italiens: »Ich hoffe, daß wir in zwei Wochen Österreich den Krieg erklären. Das wäre für mich eine freudige und schöne Gelegenheit, um in die Heimat zurückkehren zu können.«
Als Italien dem deutschen Verbündeten 1915 den Krieg erklärte, wofür auch der damalige Sozialist Benito Mussolini kräftig getrommelt hatte, meldete sich der 52-jährige D’Annunzio freiwillig an die Front. Schnell erwarb er sich legendären Kriegsruhm. Noch nachdem er bei einer Flugzeuglandung ein Auge verloren hatte, steuerte er 1918 ein Flugzeug bis nach Wien, wo er anti-österreichische Flugblätter abwarf und nach der Überlieferung über dem Parlamentsgebäude einen Topf mit Exkrementen entleerte. Zugegebermaßen ein origineller Ausdruck seiner Parlaments- und Habsburgerverachtung.
Das Ende des Krieges und damit der Steigerung aller Lebenskräfte im Waffengang entließ ihn wieder in das fade Leben der westlichen Gesellschaft. »Was soll ich mit dem Frieden anfangen?«, fragte er sich. Doch dann rief ihn Fiume!
D’Annunzios Verhältnis zum seit 1922 regierenden Faschismus war distanzierter als man vielleicht annehmen möchte. Als Mussolini nach dem Tode des Dichtersoldaten vor 65 Jahren dessen Anwesen besuchte und mit ihm Zwiesprache hielt, sagte er: »Nein, Comandante, du bist nicht tot, und du wirst niemals sterben, solange es, eingepflanzt inmitten des Mittelmeeres, eine Halbinsel gibt, die man Italien nennt«
Als Repräsentant eines elitären deutschen Nationalismus wäre Gabriele D’Annunzio mit seinen schweren Anflügen von Dekadenz undenkbar gewesen. Georg L. Mosse stellt deutlich den Unterschied des italienischen »Fascho-Dandys« etwa zum deutschen Dichterkreis um Stefan George und dessen Ideal der Reinheit und Zucht heraus:
»Sie hätten jedwede Bezichtigung der Dekadenz von sich gewiesen, und wirklich hätten die ihnen eigene Harmonie der Form, die Klarheit des Ausdrucks und die Ergebenheit gegenüber dem nationalen Anliegen keinen Platz in der Dekadenzbewegung gefunden. Gabriele D’Annunzios mystische Ekstasen, seine erotische Hemmungslosigkeit waren ihnen fremd. Sein überbordender italienischer Nationalismus steht im Gegensatz zu ihrem ernsthaften und eindringlichen Versuch, das wahre Deutschland zu enthüllen.«
Jürgen W. Gansel
00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres italiennes, littérature italienne, italie, d'annunzio, première guerre mondiale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 04 octobre 2010
Dos Passos, questo sconosciuto

di Marco Iacona
Fonte: Linea Quotidiano [scheda fonte]
Lost generation. La “generazione perduta”, per chi non lo sapesse, è un gruppo di scrittori americani giunti in Europa nella prima parte del Novecento e del quale fanno parte Ernest Hemingway, Ezra Pound e Francis Scott Fitzgerald; tre riferimenti essenziali per i contestatori non solo stelle-e-strisce che verranno dopo, compresa l’arcinota Beat generation di Allen Ginsberg e Jack Kerouac. Entrambe le “generazioni” rappresentano quell’America che ci piace, capace di rappresentare con sincerità fatti e personaggi, di autorappresentarsi (contemporaneamente) con afflitta “gagliardia” o affilata confidenza; ma senza trascurare sogni e aspirazioni seppur camuffati da rigide e fredde disillusioni… un atteggiamento pienamente anticonformista, (chi più di loro?), riconoscibile a fatica (con una prosa particolarmente schietta, curata o meno), che affascinerà intellettuali e narratori italiani fino ai nostri giorni. Due nomi su tutti: Italo Calvino e Cesare Pavese. Tante altre notizie su www.ariannaeditrice.it
Del gruppo di contestatori d’inizio Novecento, fra i primi peraltro a toccare con mano le degenerazioni della società del nuovo secolo (guerra compresa, ovviamente), è parte integrante anche John Dos Passos del quale vogliamo ricordare in queste pagine i quarant’anni dalla morte (28 settembre 1970). Come definirlo innanzitutto? Come definire quell’intellettuale e scrittore che nei primi anni Sessanta venne in Italia invitato da Giano Accame per partecipare agli “Incontri romani della cultura” grazie anche all’organizzazione del “Centro di vita italiano” di Ernesto De Marzio, e insieme a lui Gabriele Marcel, Michel Déon, Odysseus Elytis (futuro premio Nobel) e James Burnham? Anarchico sicuramente, anarchico nella misura in cui Dos Passos, da un punto di vista politico, fu definitivamente poco etichettabile. Di “destra” nel secondo dopoguerra (anche con posizioni maccartiste), e di “sinistra” filocomunista negli anni precedenti, i Venti e i Trenta (ricordiamo l’impegno civile, il rifiuto dell’evento bellico e la collaborazione alla rivista “New Masses”), anni nei quali si registra – dicono i critici – un apparentamento quasi “perfetto” fra impegno politico, temi e forme sperimentali dell’attività dell’ex studente di Harvard. In anni diciamo così “intermedi” (quasi simbolicamente, fra le due posizioni) il nostro venne anche catturato dalle prospettive del “New Deal” americano. Dos Passos può essere considerato allora un anticipatore ideale e pratico (fece volontariato, fra le altre istituzioni, presso la Croce Rossa), dell’intellettuale mai fermo su posizioni rigide, capace di “riposizionarsi”, e pronto a sfidare le (immancabili) vestali dell’ortodossia politica. Sovente le “peregrinazioni” politiche coincideranno con le fortune o le sfortune del romanziere, abilmente decretate dalla critica internazionale.
Dos Passos, e questo lo rese diverso da buona parte degli scrittori della sua generazione, amava anche “volare basso”, fondendo i grandi ideali (chi mai non ne ebbe?) a pagine di critica ordinaria e di schietto giornalismo; scrisse pagine seducenti sui grandi miti del cinema (miti pop, ma allora quasi nessuno lo sapeva), James Dean e Rodolfo Valentino che vide morire l’uno dopo l’altro, confermandosi in questo settore uno scrittore senza molte “regole”, se non la propria volontà e il proprio gusto. Ma anarchico o difensore degli anarchici il nostro lo fu soprattutto in relazione alle vicende legate ai due anarchici italiani in terra americana, vale a dire Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, sfortunati protagonisti di una storia mai dimenticata. Nel 1926, un anno prima della loro condanna a morte (erano anarchici ma non comunisti), l’uno operaio l’altro pescivendolo, Dos Passos dava alle stampe e per conto di un “Comitato di difesa” per i due italiani detenuti dal 1921 Facing the Chair, un libro nel quale da perfetto libertario biasimava il comportamento dei giudici americani vittime, a suo dire, di pregiudizi politici. In quel periodo, con largo anticipo rispetto alla “caccia alle streghe” del prossimo dopoguerra, in America si viveva infatti un clima repressivo rivolto alla cosiddetta sovversione politica. A farne le spese, fra gli altri, i due anarchici italiani emigrati nel 1908 e accusati di rapina e duplice omicidio benché già scagionati da un testimone. Con Dos Passos altri intellettuali illuminati si schiereranno dalla parte degli italiani “Nick” e “Bart”: da Bertrand Russel a Dorothy Parker, da G. B. Shaw a H. G. Wells. Tutto inutile, naturalmente. Fra le proteste generali i due verranno uccisi tramite sedia elettrica nell’agosto del 1927. Successivamente riabilitati (cinquant’anni dopo!) ma penosamente sacrificati sull’“altare della fermezza” di un’America oppressiva e giustizialista, un’America violenta che a, questo punto, non poteva essere per lo scrittore libertario nato a Chicago nel 1896.
Malgrado la ricca biografia, e malgrado il sentimento di apertura verso un mondo che dal secondo decennio del Novecento offriva più canali di comunicazione (soprattutto: il cinema di Eisenstein, la radio e il teatro sperimentale), Dos Passos è un autore oggi poco conosciuto ad eccezione - forse - di due volumi Manhattan Transfer del 1925 e Il 42° parallelo del 1930. In molti, da tempo, hanno dimenticato gli attestati di stima ricevuti (da J. Paul Sartre nel 1947, per esempio: «considero Dos Passos il più grande degli scrittori del nostro tempo»), ma hanno dimenticato, soprattutto, i suoi libri della fase giovanile e quelli dell’ultimo periodo. I primi sono tout court lo specchio di un’epoca il cui “superamento” condurrà l’autore ad abbracciare quelle posizioni radicali che i più conoscono; le posizioni che negli anni hanno affascinato la critica di sinistra, per intenderci... Come per esempio il “libro di guerra” One Man’s Initiation, interessante in proiezione di una crescita “ideale” di Dos Passos (con timbri espressionisti alla maniera di Ernst Jünger, ma assai diverso per ragioni e architetture), e non del tutto differente dalla copiosa narrativa di guerra che conquisterà i mercati occidentali dagli anni Venti in poi, o come Three Soldiers (1921), che si può considerare un romanzo di “tradizione” decadentista, pessimista, diretto a rivelare i tremendi meccanismi di una società moderna attraverso l’esperienza della guerra.
Ma le capacità di narratore-plurale di Dos Passos (qui sì, anticipatore di quella postmodernità che ama rilegare in capitoli unici le fonti che giungono dagli angoli diversi dello scibile), emergono all’interno del romanzo-denuncia sulla condizione del mondo investito dal progresso tecnologico (Manhattan Transfer). Accanto alla denuncia di un’epoca ove hanno preso il sopravvento le divinità malvagie del macchinismo («le turbine, i motori a scoppio e la dinamite … sono le nostre divinità crudeli e vendicative…»), in questo periodo, in Dos Passos, è possibile reperire una quantità importante di citazioni capaci di posizionare l’autore al crocevia di due percorsi essenziali della letteratura mondiale: fra i più classici come Mark Twain alle avanguardie europee e prim’ancora a Walt Whitman inteso alla maniera radicale. Qui la “sociologia” di Dos Passos ci mostra con linguaggio contemporaneo quel grigio mondo, ancora una volta: a lui contemporaneo, che autori anche molto diversi (si pensi a Chaplin o a Garcia Lorca) ci hanno rivelano nelle pieghe più comiche o sentimentali. Norman Mailer e William Burroughs terranno conto, e tanto, delle sue lezione narrative.
Dos Passos possiede la “fortuna” di trovarsi a raccontare un periodo storico che rappresenta l’alfa della nostra epoca, credendo inoltre di scorgerne, da “buon radicale” militante, “sperimentatore” e “proletario d’elezione” (ma borghese d’estrazione) anche l’inevitabile omega. È questo che affascina i militanti d’ogni “estrazione”. I suoi lavori degli anni Trenta (la ben nota trilogia U.S.A formata dal 42° parallelo, 1919 e Un mucchio di quattrini), rappresentano il punto di massimo impegno “guerrigliero”, si tratta di affreschi complessi di vita americana (con apoteosi del collettivismo), composti con tecniche sperimentali di “finto” realismo. Ma è in codesti stessi capitoli che si consuma anche politicamente il ribellismo anticapitalistico “a sinistra” di Dos Passos. Resosi finalmente conto dell’incolmabile iato esistente fra idea e prassi comunista, già a metà degli anni Trenta lo scrittore cercherà di indirizzare le sue attitudini libertarie verso sponde liberali di “destra”. Era ora… È questo il periodo (c’era da aspettarselo dopotutto), nel quale tutti parleranno di “crisi”, “declino”, eccetera. È questo il periodo (mancheranno ancora più di trent’anni dalla morte!) nel quale Dos Passos comincia a essere un grande dimenticato (“perduto” di nome e adesso anche di fatto). Eppure l’autore di saggi e testi teatrali e di oltre quaranta romanzi (alcuni dei quali, i più famosi e già citati, tradotti da Pavese), continuerà il proprio lavoro fino alla morte, pubblicando fra gli altri un’altra trilogia di vita americana, District of Columbia, una storia degli avi portoghesi, saggi su Jefferson, diari ed epistolari. A nulla servirà la sua indignazione (a parte la dimensione collettiva e militante, resta il tema del pericolo corso dall’individuo nel mondo contemporaneo). A nulla serviranno (anzi!) gli attestati di stima degli intellettuali anticonformisti di “destra”. A quarant’anni dalla morte cos’altro possiamo aggiungere allora, rispetto alla circostanza che Dos Passos sia ancora un autore quasi tutto da scoprire?
00:14 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lettres, littérature, littérature américaine, lettres américaines, etats-unis, dos passos |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
"Le Héros" de Baltasar Gracian
« LE HÉROS », de Baltasar GRACIÁN
Traduit de l’espagnol, préfacé et annoté par Catherine VASSEUR
Par Pierre Marcowich
Ex: http://www.oswald-spengler-le-retour.net/
C’est en acquérant le sens de l’honneur qu l’on parvient à réussir. Telle est la thèse de l’auteur. L’honneur ! C’est donc bien un Espagnol qui a écrit ce livre. On peut comprendre son entreprise, si l’on sait que Baltasar GRACIÁN fut, en 1644, l’aumônier militaire des troupes espagnoles qui battirent près de la ville de LÉRIDA les troupes françaises qui tentaient de s’emparer de la CATALOGNE pour le compte du Roi de France, LOUIS XIV, âgé de 6 ans, le Cardinal MAZARIN exerçant la réalité pouvoir. On dit qu’il y fit preuve d’une grande bravoure. L’auteur nous propose de pratiquer toutes les vertus de l’honneur dans la vie mondaine pour parvenir au succès. Cependant, Baltasar GRACIÁN ne semble pas trop croire à l’efficacité absolue de sa recette, puisqu’à la fin du livre, le lecteur apprend que le « héros » est finalement banni, ostracisé par la société, parce que, peut-être, les hommes du commun ne peuvent pas le comprendre. Mais le bannissement inéluctable du « héros » de Baltasar GRACIÁN, qui, plus tard, va récidiver avec un autre ouvrage (EL CRITICON en 1651), est peut-être aussi le pressentiment de l’incompréhension sévère qu’il allait rencontrer, de la part de ses supérieurs de l’Ordre des Jésuites, soucieux de ne pas donner prise aux critiques des jansénistes qui tenaient alors le haut du pavé « médiatique ». Pour exposer les qualités de son Héros, tel qu’il l’envisage, Baltasar GRACIÁN prend pour exemples des héros incontestables que l’Histoire a reconnus et dont il fait ressortir les qualités de chacun que le héros doit adopter. Tout au long de l’ouvrage, Baltasar GRACIÁN fait défiler tout de son ouvrages des héros, tels que TIBÈRE, LOUIS XI, ISABELLE LA CATHOLIQUE, le Roi SALOMON, ALEXANDRE, CÉSAR, CHARLES VII (« le roi de Bourges »), le GRAND TURC, PHILIPPE II (d’Espagne), et bien d’autres encore. Voici, succinctement exposées, les principales règles qu’il nous propose : 1) ne jamais dévoiler toutes les ressources dont on dispose ; 2) dissimuler sa sensibilité ; 3) faire preuve d’intelligence ; 4) montrer de la grandeur dans ses actes ; 5) disposer d’un goût en conformité avec son rang ; 6) ne jamais se trouver le second dans son art ; 7) être le meilleur avec excellence ; 8) être réaliste dans ses engagements ; 9) rechercher l’emploi où l’on se trouvera le meilleur ; 10) évaluer sa chance (fortune) et celle de ses adversaires ; et ainsi de suite. Les qualités sont présentées en gradation, chacune par rapport à la précédente, jusqu’à la 17ème qualité, le « bouquet final », par laquelle il est exigé que le héros doit pratiquer une sorte d’émulation avec les héros du passé. Ce sont donc 17 qualités que le héros doit cumulativement posséder. On est droit de se demander pourquoi de si grands efforts, quasi surhumains, alors que le héros va finir banni, ostracisé par son entourage, tel un moderne ALCIBIADE, dont Baltasar GRACIÁN évoque formellement la figure. (2)  Écrit vers 1636 par un jésuite espagnol, Baltasar GRACIÁN, l’ouvrage « LE HÉROS » (1), petit opuscule de 104 pages, nous enseigne comment devenir un personnage hors du commun, non pas en trompant son entourage, contrairement à l’enseignement de MACHIAVEL, mais en combattant ses penchants.
Écrit vers 1636 par un jésuite espagnol, Baltasar GRACIÁN, l’ouvrage « LE HÉROS » (1), petit opuscule de 104 pages, nous enseigne comment devenir un personnage hors du commun, non pas en trompant son entourage, contrairement à l’enseignement de MACHIAVEL, mais en combattant ses penchants. 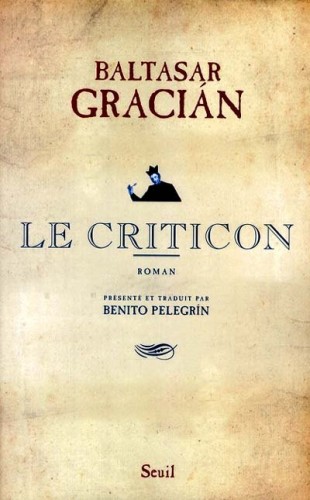 Dans sa préface, Catherine VASSEUR nous donne une clef pour comprendre la problématique de Baltasar GRACIÁN :
Dans sa préface, Catherine VASSEUR nous donne une clef pour comprendre la problématique de Baltasar GRACIÁN :
« Car la sagesse, la puissance, le courage, la sainteté, les terres inconnues ont déjà été conquis par ceux qu’il cite en exemple. Le héros de Baltasar GRACIÁN est l’héritier d’un monde qui n’est plus à conquérir. Aussi lui reste-t-il à se conquérir soi-même. » (3) (souligné par P.M.)
00:10 Publié dans Littérature, Livre, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, littérature, lettres, lettres espagnoles, littérature espagnole, espagne, 17ème siècle, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 01 octobre 2010
Le Bulletin célinien n°323 (oct. 2010)
Le Bulletin célinien n°323 - Octobre 2010
 Au sommaire du Bulletin célinien n°323 d'octobre 2010:
Au sommaire du Bulletin célinien n°323 d'octobre 2010:Marc Laudelout : Bloc-notes
M. L. : Les souvenirs de Naud et Tixier
David Alliot : Céline et ses juges
Thierry Bouclier : La défense de Tixier-Vignancour
André Brissaud : Louis-Ferdinand Céline est amnistié (1951)
Éric Mazet et Pierre Pécastaing : Naud le temporisateur
M. L. : L’accueil critique de « Bagatelles pour un massacre »
G. P. : Le paysage urbain crépusculaire dans « Voyage au bout de la nuit » et « Mort à crédit » (II)
M. L. : Céline et les châtaignes grillées
Le numéro 6 euros à :
Le Bulletin célinien
B. P. 70
B 1000 Bruxelles 22
Le Bulletin célinien n°323 - Bloc-notes
 Louis-Daniel Hirsch fut le directeur commercial des éditions Gallimard de 1922 à 1974. « Hirsch, ses amis, les cocos, Sartre, etc... » (1). Dixit Céline dans un bel amalgame. En exil, il est plus incisif : « C’est Hirsch qui commande la NRF comme Mayer commande la justice. Le reste est blabla (2). ». Vieilles obsessions… Mais il faut prendre garde à ne pas se laisser abuser par un être plus ambivalent que le laissent supposer ses ultimes invectives.
Louis-Daniel Hirsch fut le directeur commercial des éditions Gallimard de 1922 à 1974. « Hirsch, ses amis, les cocos, Sartre, etc... » (1). Dixit Céline dans un bel amalgame. En exil, il est plus incisif : « C’est Hirsch qui commande la NRF comme Mayer commande la justice. Le reste est blabla (2). ». Vieilles obsessions… Mais il faut prendre garde à ne pas se laisser abuser par un être plus ambivalent que le laissent supposer ses ultimes invectives.C’est le piège dans lequel est tombé Mikaël Hirsch, petit-fils du précédent, qui signe un roman dans lequel Céline tient une grande place (3). Le personnage central est Gérard Cohen qui se définit « demi-juif ». Jeune coursier des éditions Gallimard dans les années cinquante, il se rend fréquemment à Meudon pour y apporter le courrier mais se garde bien de révéler son identité. Crédible. Ce qui l’est moins, c’est que, dès la première rencontre, Céline l’appelle « mon p’tit Gérard » (!). Vétille…
Pour le reste, c’est un Céline conforme à sa légende noire qui est imaginé par l’auteur : « J’étais tout ce qu’il haïssait profondément. (…) Eût-il su qui j’étais, son attitude aurait certainement changé du tout au tout. » Voire... Mikaël Hirsch serait sans doute bien étonné d’apprendre qu’à la même époque, Céline sympathisait avec un militant sioniste, ancien agent du groupe terroriste Stern qui avait lutté contre la colonisation britannique en Palestine. Voici son témoignage : « Quand la presse israélienne, à l’époque, eut vent de ma correspondance avec Céline, elle m’a attaqué de façon absolument ignoble. Ce qui ne m’a pas empêché de rencontrer Céline à deux reprises chez lui, à Meudon. Nous avons évoqué bien entendu la question juive. À sa demande pressante, je lui ai décrit l’aventure des premiers colons socialistes qui rêvaient d’une société nouvelle et s’étaient acharnés, dans des conditions impossibles, à défricher des marais, à fertiliser des déserts. “Je dois vous dire que j’admire profondément ces gens-là”, me disait-il, et je savais qu’il était sincère, qu’il avait une très grande considération pour l’État d’Israël (4) ». Singulier contraste avec l’antisémitisme rabique attaché à la figure de Céline jusque dans les dernières années de sa vie. Ainsi récolte-t-on ce que l’on a semé…
L’antisémitisme est chez lui l’arbre qui cache la forêt : un profond attachement à la sauvegarde de la race. À un autre admirateur juif, il écrivait : « Il est temps que l’on mette un terme à l’antisémitisme par principe, par raison d’idiotie fondamentale, l’antisémitisme ne veut plus rien dire — On reviendra sans doute au racisme, mais plus tard et avec les juifs — et sans doute sous la direction des juifs, s’ils ne sont point trop aveulis, avilis, abrutis. » Et dans une lettre ultérieure : « ...Les juifs sont précisément les premiers et les plus tenaces racistes du monde. Il faut créer un nouveau racisme sur des bases biologiques, les éléments existent (5). »
Ceci nous éloigne assurément de la figure convenue de l’ermite de Meudon décrite par Mikaël Hirsch. Dommage car, dans un roman évoquant le Céline des dernières années, il y avait là un thème qu’il eût été intéressant d’esquisser. Cette simplification n’enlève rien au talent de l’auteur. Le constat vaut pour le style et cette manière de transcender ses obsessions et sa fascination mêlée de répulsion pour un écrivain de génie.
Marc LAUDELOUT
1. Lettre à Gaston Gallimard, 8 décembre 1954 in Lettres à la N.R.F., 1931-1961, Gallimard, 1991, p. 264.
2. Lettre à Pierre Monnier, 12 mai 1950 in P. Monnier, Ferdinand furieux, L’Age d’homme, 1979, p. 133.
3. Mikaël Hirsch, Le réprouvé, L’Éditeur, 2010.
4. Éric Mazet, « Quatorze lettres à Jacques Ovadia » in L’Année Céline 1991, Du Lérot / Imec, 1992, pp. 55-66.
5. Lettres à Milton Hindus des 14 juin et 10 août 1947 in M. Hindus, L.-F. Céline tel que je l’ai vu, L’Herne, 1969, pp. 148 et 161.
14:16 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres françaises, céline, littérature française, france |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 23 septembre 2010
Louis-Ferdinand Céline - An Anarcho-Nationalist
Louis-Ferdinand Céline
An Anarcho-Nationalist
Ex: http://www.counter-currents.com/
 In his imaginary self-portrayal, the French novelist Louis-Ferdinand Céline (1894–1961) would be the first one to reject the assigned label of anarcho-nationalism. For that matter he would reject any outsider’s label whatsoever regarding his prose and his personality. He was an anticommunist, but also an anti-liberal. He was an anti-Semite but also an anti-Christian. He despised the Left and the Right. He rejected all dogmas and all beliefs, and worse, he submitted all academic standards and value systems to brutal derision. Briefly, Céline defies any scholarly or civic categorization. As a classy trademark of the French literary life, he is still considered the finest French author of modernity—despite the fact that his literary opus rejects any academic classification. Even though his novels are part and parcel of the obligatory literature in the French high school syllabus and even though he has been the subject of dozens of doctoral dissertations, let alone thousands of polemics denouncing him as the most virulent Jew-baiting pamphleteer of the 20th century, he continues to be an oddity eluding any analysis, yet commanding respect across the political and academic spectrum. Can one offer a suggestion that those who will best grasp L. F. Céline must also be his lookalikes — the replicas of his nihilist character, his Gallic temperament and his unsurpassable command of the language?
In his imaginary self-portrayal, the French novelist Louis-Ferdinand Céline (1894–1961) would be the first one to reject the assigned label of anarcho-nationalism. For that matter he would reject any outsider’s label whatsoever regarding his prose and his personality. He was an anticommunist, but also an anti-liberal. He was an anti-Semite but also an anti-Christian. He despised the Left and the Right. He rejected all dogmas and all beliefs, and worse, he submitted all academic standards and value systems to brutal derision. Briefly, Céline defies any scholarly or civic categorization. As a classy trademark of the French literary life, he is still considered the finest French author of modernity—despite the fact that his literary opus rejects any academic classification. Even though his novels are part and parcel of the obligatory literature in the French high school syllabus and even though he has been the subject of dozens of doctoral dissertations, let alone thousands of polemics denouncing him as the most virulent Jew-baiting pamphleteer of the 20th century, he continues to be an oddity eluding any analysis, yet commanding respect across the political and academic spectrum. Can one offer a suggestion that those who will best grasp L. F. Céline must also be his lookalikes — the replicas of his nihilist character, his Gallic temperament and his unsurpassable command of the language?
Cadaverous Schools for Communist and Liberal Massacres
The trouble with L. F. Céline is that although he is widely acclaimed by literary critics as the most unique French author of the 20th century and despite the fact that a good dozen of his novels are readily available in any book store in France, his two anti-Semitic pamphlets are officially off limits there.
Firstly, the word pamphlet is false. His two books, Bagatelles pour un massacre (1937) and Ecole des cadavres (1938), although legally and academically rebuked as “fascist anti-Semitic pamphlets,” are more in line with the social satire of the 15th century French Rabelaisian tradition, full of fun and love-making than modern political polemics about the Jewry. After so many years of hibernation, the satire Bagatelles finally appeared in an anonymous American translation under the title of Trifles for a Massacre, and can be accessed online.
The anonymous translator must be commended for his awesome knowledge of French linguistic nuances and his skill in transposing French argot into American slang. Unlike the German or the English language, the French language is a highly contextual idiom, forbidding any compound nouns or neologisms. Only Céline had a license to craft new words in French. French is a language of high precision, but also of great ambiguities. Moreover, any rendering of the difficult Céline’s slangish satire into English requires from a translator not just the perfect knowledge of French, but also the perfect knowledge of Céline’s world.
Certainly, H. L. Mencken’s temperament and his sentence structure sometimes carry a whiff of Céline. Ezra Pound’s toying with English words in his radio broadcasts in fascist Italy also remind a bit of Céline’s style. The rhythm of Harold Covington’s narrative and the violence of his epithets may remind one a wee of Celine’s prose too.
But in no way can one draw a parallel between Céline and other authors—be it in style or in substance. Céline is both politically and artistically unique. His language and his meta-langue are unparalleled in modern literature. To be sure Céline is very bad news for Puritan ears or for a do-good conservative who will be instantly repelled by Céline’s vocabulary teeming as it does with the overkill of metaphorical “Jewish dicks and pricks.”
Trifles is not just a satire. It is the most important social treatise for the understanding of the prewar Europe and the coming endtimes of postmodernity. It is not just a passion play of a man who gives free reign to his emotional outbursts against the myths of his time, but also a visionary premonition of coming social and cultural upheavals in the unfolding 21st century. It is an unavoidable literature for any White in search of his heritage.
These weren’t Hymie jewelers, these were vicious lowlifes, they ate rats together . . . They were as flat as flounders. They had just left their ghettos, from the depths of Estonia, Croatia, Wallachia, Rumelia, and the sties of Bessarabia . . . . The Jews, they now frequent the guardhouse, they are no longer outside… When it comes to crookedness, it is they who take first place . . . All of this takes place under the hydrant! with hoses as thick as dicks! beside the yellow waters of the docks… enough to sink all the ships in the world . . . in a décor fit for phantoms . . . with a kiss that’ll cut your ass clean open . . . that’ll turn you inside out.
The satire opens up with imaginary dialogue with the fictional Jew Gutman regarding the role of artistry by the Jews in the French Third Republic, followed by brief chapters describing Céline’s voyage to the Soviet Union.
Between noon and midnight, I was accompanied everywhere by an interpreter (connected with the police). I paid for the whole deal. . . . Her name was Natalie, and she was by the way very well mannered, and by my faith a very pretty blonde, a completely vibrant devotee of Communism, proselytizing you to death, should that be necessary. . . . Completely serious moreover…try not to think of things! …and of being spied upon! nom de Dieu! . . . . The misery that I saw in Russia is scarcely to be imagined, Asiatic, Dostoevskiian, a Gehenna of mildew, pickled herring, cucumbers, and informants. . . . The Judaized Russian is a natural-born jailer, a Chinaman who has missed his calling, a torturer, the perfect master of lackeys. The rejects of Asia, the rejects of Africa. . . . They were just made to marry one another. . . . It’s the most excellent coupling to be sent out to us from the Hells.
When the satire was first published in 1937, rare were European intellectuals who had not already fallen under the spell of communist lullabies. Céline, as an endless heretic and a good observer refused to be taken for a ride by communist commissars. He is a master of discourse in depicting communist phenotypes, and in his capacity of a medical doctor he delves constantly into Jewish self-perception of their physique . . . and their genitalia.
The peculiar feature of Céline narrative is the flood of slang expressions and his extraordinary gift for cracking jokes full of obscene humors, which suddenly veer off in academic passages full of empirical data on Jews, liberals, communists, nationalists, Hitlerites and the whole panoply of famed European characters.
But here we accept this, the boogie-woogie of the doctors, of the worst hallucinogenic negrito Jews, as being worth good money! . . . Incredible! The very least diploma, the very least new magic charm, makes the negroid delirious, and makes all of the negroid Jews flush with pride! This is something that everybody knows. . . . It has been the same way with our own Kikes ever since their Buddha Freud delivered unto them the keys to the soul!
Mortal Voyage to Endtimes
In the modern academic establishment Céline is still widely discussed and his first novels Journey to the End of the Night and Death on the Installment Plan
are still used as Bildungsromane for the modern culture of youth rebellion. When these two novels were first published in the early 30s of the twentieth century, the European leftist cultural establishment made a quick move to recuperate Céline as of one of its own. Céline balked. More than any other author his abhorrence of the European high bourgeoisie could not eclipse his profound hatred of leftist mimicry.
Neither does he spare leftists scribes, nor does he show mercy for the spirit of “Parisianism.” Unsurpassable in style and graphics are Céline’s savaging caricatures of aged Parisian bourgeois bimbos posturing with false teeth and fake tits in quest of a rich man’s ride. Had Céline pandered to the leftists, he would have become very rich; he would have been awarded a Nobel Prize long ago.
In the late 50’s the burgeoning hippie movement on the American West Coast also tried to lump him together with its godfather Jack Kerouac, who was himself enthralled with Céline’s work. However, any modest reference to his Bagatelles or Ecole des Cadavres has always carefully been skipped over or never mentioned. Equally hushed up is Céline’s last year of WWII when, unlike hundreds of European nationalist scholars, artists and novelists, he miraculously escaped French communist firing squads or the Allied gallows.
His endless journey to the end of the night envisioned no beams of sunshine on the European horizon. In fact, his endless trip took a nasty turn in the late 1944 and early 1945, when Céline, along with thousands of European nationalist intellectuals, including the remnants of the French pro-German collaborationist government fled to southern Germany, a country still holding firm in face of the oncoming disaster. The whole of Europe had been already set ablaze by death-spitting American B17’s from above and raping Soviet soldiers emerging in the East. These judgment day scenes are depicted in his postwar novels D’un château l’autre (Castle to Castle (French Literature)) and Rigadoon
.
Céline’s sentences are now more elliptic and the action in his novels becomes more dynamic and more revealing of the unfolding European drama. His novels offer us a surreal gallery of characters running and hiding in the ruins of Germany. One encounters former French high politicians and countless artists facing death—people who, just a year ago, dreamt that they would last forever. No single piece of European literature is as vivid in the portrayal of human fickleness on the edge of life and death as are these last of Céline’s novels.
But Céline’s inveterate pessimism is always couched in self-derision and always stung with black humor. Even when sentenced in absentia during his exile in Denmark, he never lapses into self pity or cheap sentimentalism. His code of honor and his political views have not changed a bit from his first novel.
Upon his return to France in 1951, the remaining years of Céline’s life were marred by legal harassment, literary ostracism, and poverty. Along with hundreds of thousands Frenchmen he was subjected to public rebuke that still continues to shape the intellectual scene in France. Today, however, this literary ostracism against free spirits is wrapped up in stringent “anti-hate” laws enforced by the thought police— 70 years after WWII! Stripped of all his belongings, Céline, until his death, continued to use his training as a physician to provide medical help to his equally disfranchised suburban countrymen, always free of charge and always remaining a frugal and modest man.
From The Occidental Observer, March 24, 2010, http://www.theoccidentalobserver.net/authors/Sunic-Celine...
00:15 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, france, céline |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 21 septembre 2010
Louis-Ferdinand Céline et Roland Cailleux
Louis-Ferdinand Céline et Roland Cailleux
 La création d'un site consacré à Roland Cailleux, www.roland-cailleux.weebly.com, écrivain méconnu, est l'occasion de rappeler le lien Céline-Cailleux.
La création d'un site consacré à Roland Cailleux, www.roland-cailleux.weebly.com, écrivain méconnu, est l'occasion de rappeler le lien Céline-Cailleux.Le volume Avec Roland Cailleux paru au Mercure de France (coll. " Ivoire ") en 1985, hommage à cet excellent auteur méconnu, comportait un important entretien de 1961 avec Céline que Philippe Alméras cite assez largement dans son Dictionnaire Céline. Mais au fur et à mesure de la mise à jour des archives Cailleux, d'autres commentaires apparaissent, dont celui-ci, daté du 19 juin 1957.
L’admiration pour le phénomène de la littérature française est, comme toujours, entière. Cailleux, cependant, place des bémols sur la sincérité de Céline, ses rapports à la chose littéraire, à l’argent, etc. Même plus que des bémols... Il s’exprime avec un excès de violence qui appelle une remarque : Cailleux souffrait de cyclothymie. Il subissait en alternance deux ans de déprime et deux ans de réactivité accrue. Très vraisemblablement se trouvait-il dans la seconde phase en abordant le cas Céline de la sorte. Cette notion précisée, la pièce n’en a que plus de spontanéité et, à ce titre, mérite d’être versée au dossier.
À cette occasion, il ne sera pas inutile non plus de rappeler le rôle que joua Roland Cailleux dans la genèse des Deux Étendards de Lucien Rebatet. Ils s’étaient connus à l’école Bossuet, où l’un était élève quand l’autre était pion. Une amitié de toute une vie s’en était suivie, indéfectible au point que Roland fut le plus fidèle soutien et visiteur de son aîné à Fresnes, extrayant de la clôture, page à page, le manuscrit du condamné. Il est le destinataire des Lettres de prison, de Rebatet, publiées en 1993 au Dilettante. Précisons toutefois que si la fidélité de Cailleux était légendaire, il n'approuvait pas les idées de Rebatet et, à plusieurs reprises par le passé, l'avait mis en garde.
Roland Cailleux (1908-1980) a partagé sa vie entre l’exercice de la médecine thermale à Chatel-Guyon pendant l’été, et une vie littéraire, l’hiver, dans les milieux de la N.R.F. Il fut le très exigeant et rare auteur de cinq livres: Saint-Genès ou la vie brève, Une lecture, Les Esprits animaux, À moi-même inconnu, et (posthume) La Religion du Cœur.
Christian DEDET
Le 19 juin 1957
Après avoir écrit à Nimier que je n'écrirai pas d'article sur Céline, j'ai envie de parler de lui aujourd'hui.
Il y a des mois, quand j'ai été le voir avec Nimier justement (je l'avais vu depuis la guerre une autre fois à Meudon, mais seul), il nous a lu le premier et le dernier chapitre d'Un château l’autre. On ne peut pas juger sur une lecture bien sûr (d'autant plus que Céline bafouille et accroche sans arrêt), mais il m'a semblé que je retrouvais l'auteur de Voyage et de Mort à crédit. Je suis sorti de là en disant à Nimier que c'était incontestablement le plus grand écrivain vivant. Je le pensais en entrant, et si la lecture avait été décevante je n'en aurais pas moins pensé la même chose. Mais j'aurais dit: le plus grand d'écrivain vivant baisse ou déconne, ce que j'ai dit pour pas mal d'ouvrages depuis Mort à crédit: les politiques avant tout, et ceux qui ont paru depuis son retour, excepté Casse-pipe. Mais j'ai beaucoup aimé des tas de morceaux des Entretiens avec le Professeur Y, et j’ai lu tout haut Normance (ça me paraissait mieux lu de cette façon, il est vrai que je ne l'ai pas terminé).
Entre-temps, Nimier l'a relancé, comme je lui écrivais hier, Céline lui doit une fière chandelle. J'avais moi-même écrit, quelques jours après ma visite à Céline, une lettre où je lui disais l'admiration profonde que j'ai pour lui et ma joie que c'était de connaître le plus grand écrivain français vivant, que, d'après cette lecture, on avait l'impression qu'on l'avait retrouvé.
Depuis, j'ai téléphoné à Nimier pour lui demander ce qu'il y avait dans l'intervalle, entre le premier et le dernier chapitre, et il ne m'a pas caché que c'était moins bon, il n'est pas fou, Ferdinand, en ayant l'air de feuilleter au hasard (tout en nous assurant avec un culot insensé, que tout était parfait dans son livre).
Depuis, le travail de Nimier a été effectif; le bouquin n'a pas encore paru et on ne parle que D’un château l’autre. C'est très bon pour Céline, mais c'est tout de même de curieuses mœurs. Ils me font chier avec leurs avant-premières; ça ressemble à de la publicité pour un savon gras qu’on lance. Ils vous détergent, c’est le meilleur, c’est insensé, quelle peau ça vous fait, oh, là, là, et personne ne s’est encore lavé, on n’a pas vu le produit. C’est du délire collectif. Faut-il que les gens soient bêtes et moutonniers ! Il doit bien rigoler Céline. Vous parlez d’un lancement. Tout ça n’est évidemment pas sérieux. Que Céline soit bien content parce que ça va se vendre, d’accord, mais que ça soit bon, j’attends de voir!
Oh, c'est très bien fait. Non seulement la presse de droite donne, dans Rivarol, Poulet qui avait été dur pour Normance et Féerie pour une autre fois, redélire (1). L'a-t-il lu, ce nouveau bouquin? Je n'en sais rien, car il n'en parle pas, ça sera pour un second article.
Dans la Nouvelle Revue Française, Nimier a fait un catéchisme tordant pour présenter Céline, et il y a un long extrait de Céline, c'est le début de son bouquin qu'il nous avait lu, avec: "À suivre" (2). Aujourd'hui, dans Arts, où on avait déjà reproduit la présentation presque intégrale de Nimier auparavant, il y a une interview de Céline, un très bon article de Bernard de Fallois sur le style de Céline (mais pas sur D’un château l’autre), et quatre jeunes romanciers parlent de lui aussi (3).
Enfin, ça c'est le plus beau succès de Nimier, j'imagine, il a trouvé le moyen de lui faire prendre un interview dans L’Express, où Céline met par terre tous les imbéciles du journal en dépit d'un chapeau dégueulasse de Françoise Giroud, d'un second chapeau avant l'interview et de dessins assez infâmes de Jean Eiffel (4). L'interview d'Arts est mauvaise, tandis que celle de L’Express est merveilleux car Céline y est prodigieux.
Céline a le front, dans Arts, aujourd'hui, de reconnaître qu'il est devenu le "faits-divers" à la mode et qu'il en donne aux interviewers pour leur argent. C'est bien mon avis, c'est pourquoi je n'écrirai pas d'article.
Autant il était bon d'en parler quand personne n’en disait rien, autant il est ridicule de prendre la suite du snobisme à la mode. Nous attendrons qu’il soit de nouveau dans la panade pour en reparler. En ce moment, il nous casse les pieds.
Et la panade d'ailleurs!...
Il se les est roulés pendant la guerre, et surtout pendant; il gueulait comme un sourd qu'il crevait de faim, et les gens marchaient. Je les connais, moi, les combines de Voyage et de Mort à crédit, et les éditions de luxe, et Gen Paul, qui bariolait avec un peu d'aquarelle ses gravures sur une édition de luxe pour la revendre un peu plus cher, sous les nazis, j'ai vu ça. Il y en avait d'autres qui crevaient de faim à ce moment-là, c'était pas Céline. Ça a changé quand il a foutu le camp, assez ignoblement, sans prévenir les copains, et puis, quand il a été en prison au Danemark. Mais à Sigmaringen, je connais la musique, moi, et il ne la raconte pas dans D’un château l’autre. Rebatet m'a raconté, j'en aurais, moi aussi, à dire. Seulement, moi je n'étais pas là-bas. Je comptais les tickets d'alimentation. J'avais pas des lingots de côté. Aussi je n'avais pas à les emporter avec les Allemands. Il avait un grand ami, Céline: Le Vigan. Il faut voir comment il l'a laissé tomber (5) . C'est pas croyable. Seulement, si moi, j'y étais pas, il y a des gens qui y étaient et qui sont encore vivants. Pour peu qu'ils parlent, on va voir déballer un joli linge sale. Je suis persuadé que Céline s'en fout, pourvu qu'il se vende. Mais il faut avouer qu'il s'est bien vendu, au sens précis du terme (au pluriel). Il nous fait suer, c'est le plus grand écrivain vivant, d'accord, mais c'est un beau salaud. Il a toute honte bue, le cochon, il a prétendu après guerre, qu'il avait pas été antisémite, qu'on avait mal compris. Aujourd'hui, il nous raconte dans Arts que c'était le plus grand ennemi d'Hitler. Je suis persuadé qu'il aimait pas Hitler, mais quand il écrivait dans les feuilles les plus antisémites et quand il publiait Les Beaux draps (là, il se retenait, il n'a pas pu trouver les vaincus), ça n'était pas joli, joli; ils étaient grassement payés, les articles dans les feuilles antisémites. Ne vous inquiétez pas, il n'avait pas de difficultés avec les tickets d'alimentation. D'ailleurs, il le sait bien, il le reconnaît qu'il est une ordure, aussi. Il n'y avait pas besoin de savoir non plus des détails sur sa vie privée (la façon dont il a traité ses enfants [sic] et ses petits-enfants qu'il ne voulait pas voir, qu'il ne recevait pas quand il crevait d'argent), pour le deviner, il n'y avait qu'à le lire (7). Le Bardamu, c'est aussi une crapule, un dégueulasse, ça n'est pas moi qui le dit: c'est lui. Et Robinson, qui est son double? Comme Monsieur Verdoux est le double du Charlot des Lumières de la ville, il est ignoble, et le fait de l'avouer n'enlève rien à sa saloperie.
 Moi, pauvre idiot, quand j'ai appris qu'on fondait le prix des Écrivains médecins et que tous les médecins de un à cent dix ans pouvaient s'y présenter (il y avait Pierre Dominique (8) qui avait de la bouteille et le Doyen de la Faculté de Médecine, ce vieux con de Binet qui avait le front de se présenter aussi, et des tas d'autres, tous des merdes... tout de même Duhamel n'avait pas osé), j'ai été voir Mondor, et je lui ai dit: "Y en a qu’un, un seul, c’est Céline, c’est à lui qu’il faut donner le prix", il a été un peu épaté. J’ai l’impression qu’il ne savait pas très bien ce qu’était Céline à ce moment-là. J’exagère. D’ailleurs, il s’est rattrapé depuis, et il a fait pour Céline tout ce qu’on pouvait faire. Un homme admirable, Mondor (9).
Moi, pauvre idiot, quand j'ai appris qu'on fondait le prix des Écrivains médecins et que tous les médecins de un à cent dix ans pouvaient s'y présenter (il y avait Pierre Dominique (8) qui avait de la bouteille et le Doyen de la Faculté de Médecine, ce vieux con de Binet qui avait le front de se présenter aussi, et des tas d'autres, tous des merdes... tout de même Duhamel n'avait pas osé), j'ai été voir Mondor, et je lui ai dit: "Y en a qu’un, un seul, c’est Céline, c’est à lui qu’il faut donner le prix", il a été un peu épaté. J’ai l’impression qu’il ne savait pas très bien ce qu’était Céline à ce moment-là. J’exagère. D’ailleurs, il s’est rattrapé depuis, et il a fait pour Céline tout ce qu’on pouvait faire. Un homme admirable, Mondor (9).Malheureusement, à ce moment-là, ce n'était pas possible, paraît-il, de lui donner le Prix, il était trop marqué pour le genre de Jury du Prix des Médecins Écrivains. On me l'a donné à l'unanimité quand Mondor m'a dit que je devais me présenter. Ça ne m'a pas rapporté la réédition de mon livre qui était épuisé. Les journalistes, à la sortie du Prix, n'ont pas pu le trouver chez Gallimard. J'avais une publicité formidable huit ans après la publication de Saint Genès, mais ça ne m'a servi rigoureusement à rien. Il n’est toujours pas réédité, Saint Genès. Alors, moi aussi, je l'aime Gallimard, comme Céline, seulement j'ai plus de raisons.
Ça m'a tout de même rapporté deux cent mille francs, ce Prix. Je n'avais pas beaucoup d'argent, j'étais criblé de dettes à ce moment-là, et puis, moi j'avais gardé mes enfants, pas comme Céline. J'ai tout de même téléphoné à Marcel Aymé pour lui demander si Céline n'était pas dans la panade, autant qu'on le disait, et pour savoir si je devais lui envoyer l'argent. Marcel Aymé m'a dit de ne pas faire une pareille sottise et que Céline se démerdait très bien, et c'était vrai qu'il avait touché des millions de ses éditeurs qu'il vilipendait. Moi, quand je touche cinquante ou cent mille francs d'avance, je suis bien épaté, et mon Saint Genès n’a été tiré qu’à six mille. Quant à Une lecture et Les Esprits animaux, il y en a encore plein les réserves. Et on les avait tirés pourtant qu'à trois mille, à 10 % que ça me rapporte, calculez combien je suis riche.
Alors, de la pitié pour Céline, je veux bien, mais c'est pas moi qui l'aie obligé à faire de la politique, il n'avait qu'à rester médecin comme moi. Paie un peu trop sa connerie, c'est vrai, mais pourquoi a-t-il été si con? Il gémit aujourd'hui dans Arts parce qu'il s'est trompé de cas. C'est un comble. Il voudrait la place de Mauriac, il est écœurant.
J'ai entendu aussi Rebatet raconter ça, qu'il s'était trompé de cas et que c'était sur Staline qu'il aurait dû miser. Ah, ils sont propres, nos pamphlétaires !
Mais ils ont des excuses. Le second surtout qui n'a aucun sens pratique, tandis que Céline est beaucoup plus roué. Il crie à la misère et à force de la crier, ça prend. Il peut pas manger, il faut qu'il fasse son marché lui-même, il n'a pas d'auto, il est vieux, sa femme travaille (ça c'est vrai, mais ça ne doit pas rapporter beaucoup, avec ses leçons de danse, à Meudon!), mais enfin il n'en serait pas là (si vraiment il en est là) s'il n'avait pas fait tout ce qu'il a fait. Oui, il a eu une vie difficile (mais pas en Amérique où il a épousé une femme américaine, qui était riche (11), mais pas à la Société des Nations où il avait une planque confortable, mais pas, encore une fois, au temps du succès et surtout au temps des Allemands). Où ils sont passés, ces lingots? Il se plaint qu'on lui ait tout barboté dans son appartement, même les murs. Tel que je le connais, quand il avait foutu le camp, il n'avait pas dû laisser grand-chose. Il n'a rien retrouvé quand il est revenu. Admettons-le. Il est déchu national (12). On s'en fout. Mais enfin, les millions qu'il a eus au retour, qu'est-ce qu'il en a fait? C'est une question que lui pose Parinaud dans Arts ce matin. Il prétend qu'il cherche une combine qui lui permettrait de gagner les vingt mille ou trente mille francs qui, en plus de sa retraite, lui permettraient de vivre. "— Mais votre éditeur vous a déjà avancé des millions et avec ce livre il vous fait une rente"; il ne trouve qu’à répondre, le Céline (c’est pas brillant): "Qui vous a dit ça?" Réponse de Parinaud: "C’est mon métier de savoir." Alors une dérobade insensée de Céline: "Cela ne m’empêche pas de manger des nouilles et de boire de l’eau", à quoi l’autre rétorque excellemment: "Le Docteur Destouches sait mieux que personne pourquoi Céline est au régime." Dernière riposte de Céline qui éclate de rire: "J’ai toujours été masochiste et con."
On ne peut pas mieux dire.
D'autre part, il a été grand mutilé de guerre de 1914, et il a des droits sur nous, mais peut-être pas le droit de s'engraisser sous les Allemands, pas le droit de nous faire prendre des vessies pour des lanternes, et de crier à la misère. Il l'a tout de même achetée, sa maison de Meudon (13) . C'est ce qu'il voulait dans Les Beaux draps, et que tous les Français aient un pavillon en banlieue et cent francs par jours. Maintenant, ça ferait trois mille francs. Je suis tranquille, il les a, et il a même un grand jardin. C'est lui qui nous prend pour des cons. Il a raison d'ailleurs, ça réussit toujours. Je ne donnerai pas cher de la reconnaissance qu’il aura pour Nimier (11) . On verra bien. Mais à la façon dont il a traité Paulhan qui a fait tout pour lui, au moment où c'était le plus difficile, et sur lequel il bave déjà dans le Professeur Y et plus encore dans D’un château l’autre, ça promet du joli. Nimier, d'ailleurs, s'en moque. Encore une fois, on verra bien.
Ceci dit, et les choses mises un peu au point, je me sens tout à fait à l'aise pour parler de mon admiration pour notre plus grand écrivain vivant. vais même faire une conférence à Cambridge sur lui. Tout ça c'est des intentions bien sûr, et je suis cossard. Je suis généreux, mais paresseux. Je suis généreux quand Céline est par terre, mais je suis aussi vaniteux, et quand Céline dans L’Express déclare qu'il n'y a pas un écrivain de la jeune génération qu'il connaisse et qui en vaille la peine, j'ai envie de lui foutre mon pied dans le cul. D'ailleurs, il ne lit pas, il écrit des sottises insensées sur Proust dans Bagatelles pour un massacre. En dépit de la citation que fait aujourd'hui Fallois sur le même Proust, dans les Voyages. Il n'y a que Céline qui compte. Aucune importance, c'est ce qui fait sa force.
Je suis injuste. Je ne crois pas lui avoir envoyé Une lecture, et je ne sais pas s'il a lu Les Esprits animaux. S'il les a lus, il a bien le droit de ne pas les aimer (quoique ça pourrait lui plaire). Mais pour Saint Genès je le lui ai envoyé en lui demandant de me dire ce qu'il en pensait. Et, direct, et sans fioritures, il m'a répondu. Une belle lettre.
Donc, il faudrait parler avant tout de son style. Fallois, qui prétend en parler, ne fait que des citations. Il y a eu un article de Claude Jamet pendant la guerre, que je voudrais me procurer, mais que je n'ai pas lu (14) . Je n'ai rien de sérieux sur son style, la seule chose sérieuse. D'ailleurs, aucun critique ne parle du style, il en serait incapable. Ou bien ils le pignochent au microscope, comme Marcel Berger. Ils n'y comprennent rien. C'est que c'est très difficile. Il n'y a que les auteurs qui pourraient bien en parler. C'est pour ça que j'aime tant quand ça arrive. C'est exceptionnel. Ils n'ont pas le temps. Ils y réfléchissent en écrivant. Pour leur propre compte. Ce ne sont pas des critiques. Mais il y a, heureusement, deux ou trois bouquins de Gide, et, les dépassant infiniment, le Contre Sainte-Beuve de Proust.
Et puis aussi quelques notes de Céline sur son style dans les Entretiens avec le Professeur Y.
C'est de là qu'il faudrait partir, car il sait tout de même de quoi il parle. Ce qui n'empêcherait pas de contrer tout ce qu'il y a de mauvais dans son style, sa facilité... son désossement, son manque de rigueur, tout ou à peu près tout ce qui a paru depuis Voyage et Mort à crédit. Il écrit ou il éjacule. On n'écrit pas un bouquin uniquement avec des cris de jouissance ou de torture. Ça fait poétique à bon compte. Lui aussi, il est responsable de la décadence de la langue française, il l'a désarticulée, liquéfiée, tout est à refaire; tu parles d'un trait de décomposition! Il faudra absolument que j'en parle de ce côté-là, c'est nouveau.
Et puis, il n'est pas unique, ça n'est pas un météore, on oublie que James Joyce avait commencé.
Dutourd, aujourd'hui, cite, ce qui est beaucoup moins profond, Vallès, Rictus, Barbusse et Vadé (!) au dix-huitième. Et Restif de la Bretonne. C'est bien facile.
Mais il n'y a pas que son style qui — j'y reviens, et ce n'est pas contradictoire — est admirable aussi. Dans Voyage, Mort à crédit, et Casse-pipe.
Il y a aussi son merveilleux bon sens, ça n'est pas d'aujourd'hui que les fous, les délirants, font sortir la vérité de leur bouche comme les enfants. C'est affolant, elle est toute nue, c'en est même obscène. Mais c'est ça. C'est criant, c'est scandaleux. J'adore ça. C'est vrai, ça me suffit. Pas: dégueuler, vomir. Chier à la face.
Montaigne, c'est très bien, mais c'est tout de même précieux par rapport à Céline. Au dix-septième siècle, n'en parlons pas. Ils ont tous des perruques dans leur style, et La Bruyère a des côtés petit marquis, Montesquieu est voltairien avant la lettre, il est persan à sa manière. Au dix-huitième, les encyclopédistes ont tout de même des crinolines. Et Rousseau est une chochotte, qui se balance majestueusement sur son escarpolette à la Gide. Ah, les belles tirades! Ah, je m'aime-t-y! Ah, je m'en fous! Au dix-neuvième, c'est le délire ou la comédie. Romantiques ou hérétiques, toujours moqueurs, ou presque tous. Depuis Rabelais, on n'avait plus entendu ça. Et encore Rabelais avait-il une bonne couche moyenâgeuse, des replis hercyniens de culture.
Oui, l'arrivée de Céline a été un grand moment de la littérature française.
Roland CAILLEUX
Source
Notes
1. Allusion au bref article de Robert Poulet paru le 13 juin 1957 dans Rivarol. La critique littéraire proprement dite parut le 4 juillet. À noter que le livre sortira le 20 juin, le lendemain même de la rédaction de ces notes dictées par Roland Cailleux à sa secrétaire.
2. "Céline au catéchisme", article sous forme de questions-réponses, par Roger Nimier, accompagné de bonnes feuilles de D’un château l’autre, La N.N.R.F., juin 1957.
3. Cette interview d'André Parinaud était accompagnée d'une enquête auprès de quatre jeunes romanciers : Jean Dutourd, Pierre Gascar, Jacques Perret et Roger Vailland.
4. Cette interview, faite (à l'instigation de Nimier) par Madeleine Chapsal et titrée "Voyage au bout de la haine ", parut le 14 juin 1957, soit une semaine avant la sortie du livre en librairie.
5. Robert Le Vigan fit pourtant l'éloge de Céline lors de son procès.
6. En réalité, Céline a toujours refusé d'être payé pour les lettres-articles qu'il donnait parfois à la presse.
7. "[Destouches] vint voir son père à Meudon plusieurs fois, et ils se téléphonaient assez souvent, mais il lui interdit de lui amener ses enfants. Quand elle insistait, il répondait toujours qu'il était trop sensible, qu'il s'attachait trop facilement, surtout aux enfants. Il refusait d'aller au-devant de nouvelles affections et préférait les ignorer pour n'avoir pas ensuite à en souffrir" (François Gibault, Céline, III, Mercure de France, 1981, p. 306).
8. Pierre Dominique (1891-1973).
9. Henri Mondor, futur préfacier de Céline dans la Pléiade et témoin à décharge lors du procès devant la Cour de justice de Paris.
10. "Oh que cela est magnifique ! Quelle résurrection ! grâce à vous !...". Lettre de Céline à Roger Nimier (17 juillet 1957) in Lettres à la N.R.F., 1931-1961, Éd. Gallimard, 1991.
11. Allusion à Elizabeth Craig que Roland Cailleux croit donc avoir été l'épouse de Céline.
12. Céline avait été déclaré en état d'indignité nationale.
13. Le pavillon de Meudon fut acquis grâce à un héritage que fit Lucette Destouches.
14. Allusion à un article intitulé "Préliminaires à l'esthétique de L.-F. Céline" paru le 25 mars 1944 dans Révolution nationale. Cet article sera repris en 1948 dans le recueil d'articles de cet auteur, Images mêlées de la littérature et du théâtre (Éditions de l'Élan).
00:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, céline, france |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 17 septembre 2010
Bulletin célinien n°322
Septembre 2010
Au sommaire du Bulletin célinien n°322 de septembre 2010 :
Marc Laudelout : Bloc-notes
La citation du mois (Michel Marmin)
Frédéric Saenen : Céline et le droit. Entretien avec Maître François Gibault
Marc Laudelout : Céline et L’Oréal
Jean Rougerie : Adapter Céline au théâtre (1979)
Paul Chambrillon : Mon ami Jean Rougerie
G. P. : Le paysage urbain crépusculaire dans Voyage au bout de la nuit et Mort à crédit (I)
Jean-Paul Louis : L’Année Céline 2009
Un numéro de 24 pages, 6 euros franco de port:
Le Bulletin célinien
B. P. 70
B 1000 Bruxelles 22
Marc LAUDELOUT
1. « Je possède, médecin, buveur d’eau, non fumeur, une mémoire atroce. »(Lettre de Céline à Jean Galtier-Boissière, mars 1953)
2. Émile Brami, Céline. « Je ne suis pas assez méchant pour me donner en exemple... », Écriture, 2003.
3. [Jean-Paul Louis], « Livres reçus. Céline (II) », Histoires littéraires, vol. IV, n° 16, octobre-novembre-décembre 2003, pp. 178-180.
4. Émile Brami, « Pour qui aime la littérature, il y a des écrivains indispensables » [propos recueillis par Joseph Vebret], Le Magazine des Livres, n° 25, juillet-août 2010, pp. 36-38.
5. Le Canard enchaîné, sous la plume d’un célinien patenté, a déploré qu’il défende parfois Céline « bec et ongles jusqu’à l’indéfendable ». La revue Études céliniennes, elle, estime que certains de ses commentaires « laissent une impression de malaise » [sic].
6. Marc Laudelout, « Le Céline d’Émile Brami », Le Bulletin célinien, n° 246, octobre 2003, pp. 3-5.
7. « Le lecteur verra que je ne cherche pas à cacher mon attachement pour Céline, pour son art, du meilleur au pire : curieuse sympathie qui se développe, entre un écrivain et son éditeur, par-delà le temps qui les sépare, sans laquelle nul ne saurait lire, comprendre et faire connaître quelque œuvre que ce soit. » (Lettres à Marie Canavaggia, 1936-1960, Gallimard, 2007, p. 33).
8. Jean-Paul Louis, « Ménage de printemps » in Autour de Céline, 3, Le Lérot rêveur, n° 57, printemps 1994, pp. 23-26.
9. D’autant que l’explication est plus simple : « Je l’appelle : le Vieux, par référence à Flaubert qui, on le sait, désignait Sade ainsi dans les lettres familières. » (Jean-Paul Louis, Histoires du Vieux et autres nouvelles in Le Lérot rêveur, n° 59, printemps 1999, p. 12).
10. Le mot est de Pol Vandromme qui ajoute : « Il faut se rappeler ce qu’était Au Pilori, officine de délation où des stipendiés en proie au délire se flattaient de leurs mouchardages. Que le plus grand écrivain du siècle participe à la carmagnole en compagnie d’individus tarés et de propagandistes tarifés a de quoi scandaliser l’esprit le plus indulgent à l’inconscience des littérateurs. » (Pol Vandromme, Journal de lectures, L’Age d’Homme, 1991, pp.65-66.)
13:58 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, céline, littérature, lettres, lettres françaises, france, littérature française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
William Butler Yeats: A Poet for the West
William Butler Yeats: A Poet for the West
Vic OLVIR
 In saner times our great poets, writers, and philosophers expressed the feelings and ideas which came naturally from the race-soul. In these times those feelings and ideas are too “controversial” to be expressed freely, so where they cannot be suppressed outright, they are reinterpreted, obscured, and selectively anthologized by the alien arbiters of our culture. For no poet of our race has this been more true than for William Butler Yeats.
In saner times our great poets, writers, and philosophers expressed the feelings and ideas which came naturally from the race-soul. In these times those feelings and ideas are too “controversial” to be expressed freely, so where they cannot be suppressed outright, they are reinterpreted, obscured, and selectively anthologized by the alien arbiters of our culture. For no poet of our race has this been more true than for William Butler Yeats.
William Butler Yeats was probably the greatest poet of the modern age; T. S. Eliot acknowledged as much. His roots were deep in Ireland, but, withal, he embodied the questing spirit of the whole of Western culture.
It is impossible without writing a volume (or two) to render even a partial appreciation of his many-faceted life and work. He was born into the Irish Protestant tradition, of that line which included Swift, Burke, Grattan, Parnell. He was poet, playwright, guiding spirit of the famed Abbey Theatre, essayist, philosopher, statesman, mystic. But, as he once wrote, “The intellect of man is forced to choose “Perfection of the life, or of the work” ["The Choice"], and it is primarily in his poetry that most people seek an understanding of his genius.
Some of his views confounded the mediocre, left-wing poets and intellectuals who sought him out in his later years. Unable, of course, to ignore him, they attempted to appropriate him as their own, much as Walter Kaufmann, a Jew, attempted to do with Friedrich Nietzsche some years later. Thus, many writings about Yeats totally ignore his more “controversial” ideas, or at best refer to them only obliquely.
For example, Yeats believed in reincarnation, not only in a poet’s way, as a dramatic symbol. but quite literally: the individual human spirit remained a part of the collective race-soul even after the body died, and as long as the race endured the individual spirit might re-emerge later in another body. In an early poem, written when he was about 24, we have:
“Ah, do not mourn,” he said,
‘That we are tired, for other loves await us;
Hate on and love through unrepining hours.
Before us lies eternity; our souls
Are love, and a continual farewell.
– “Ephemera”
And just a few months before his death in 1939 at age 73, with matured powers of creative expression:
Many times man lives and dies Between his two eternities,
That of race and that of soul,
And ancient Ireland knew it all.
Whether man die in his bed
Or the rifle knock him dead,
A brief parting from those dear
Is the worst man has to fear.
Though grave-diggers’ toil is long,
Sharp their spades, their muscles strong,
They but thrust their buried men
Back in the human mind again.
– “Under Ben Bulben”
Modern liberalism and democracy were anathema to Yeats’s aristocratic spirit. He was a good friend of Ezra Pound. He was associated for a time with the Irish Blueshirts, led by General O’Duffy, and he wrote some marching songs for them. He spoke of “Mussolini’s incomparable Fascisti” (although being the kind of man he was he recoiled somewhat from the demagogic elements of fascist movements).
He read widely and avidly on race, eugenics, Italian Fascism, and German National Socialism. On eugenics, according to his biographer, Yeats “spoke much of the necessity of the unification of the State under a small aristocratic order which would prevent the materially and spiritually uncreative families and individuals from prevailing over the creative.”[1] Eugenics, to Yeats, had both physical and spiritual aspects, It is touched upon in some of the poems. In “Under Ben Bulben” he wrote:
Poet and sculptor, do the work
Nor let the modish painter shirk
What his great forefathers did,
Bring the soul of man to God,
Make him fill the cradles right.
Irish poets, learn your trade,
Sing whatever is well made
Scorn the sort now growing up
All out of shape from toe to top,
Their unremembering hearts and heads
Base-born products of base beds.
A much earlier poem reads:
All things uncomely and broken, all things worn out and old,
The cry of a child by the roadway, the creak of a lumbering cart,
The heavy steps of the ploughman, splashing the wintry mould,
Are wronging your image that blossoms a rose in the deeps of my heart.
The wrong of unshapely things is a wrong too great to be told;
I hunger to build them anew and sit on a green knoll apart,
With the earth and the sky and the water, re-made, like a casket of gold.
For my dreams of your image that blossoms a rose in the deeps of my heart.
– “The Lover Tells of the Rose in His Heart”
Yeats did not write for scholars, but for the people, and schoolchildren throughout the English-speaking world are familiar with at least a few of his works–or, perhaps, just a line or a phrase from them. Many youngsters have recited in school this verse by the young Yeats:
Down by the salley gardens my love and I did meet;
She passed the salley gardens with little snow-white feet.
She bid me take love easy, as the leaves grow on the tree;
But I, being young and foolish, with her would not agree.
– “Down by the Salley Gardens”
Another favorite is ”The Lake Isle of Innisfree.” During his many tours of the United States, every American audience insisted he recite it for them:
I will arise and go now, and go to Innisfree,
And a small cabin build there, of clay and wattle made:
Nine bean-rows will I have there, a hive for the honeybee,
And live alone in the bee-loud glade.
Nearly as familiar is the stark vision of “The Second Coming”:
Turning and turning in the widening gyre
The falcon cannot hear the falconer;
Things fall apart; the centre cannot hold;
Mere anarchy is loosed upon the world,
The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere
The ceremony of innocence is drowned;
The best lack all conviction, while the worst
Are full of passionate intensity.
Surely some revelation is at hand;
Surely the Second Coming is at hand.
The Second Coming! Hardly are those words out
When a vast image out of Spiritus Mundi
Troubles my sight: somewhere in the sands of the desert
A shape with lion body and the head of a man,
A gaze blank and pitiless as the sun,
Is moving its slow thighs, while all about it
Reel shadows of the indignant desert birds.
The darkness drops again; but now I know
That twenty centuries of stony sleep
Were vexed to nightmare by a rocking cradle,
And what rough beast, its hour come round at last,
Slouches toward Bethlehem to be born?
People with a liberal mind set have often quoted this last poem, but some do so with a certain amount of unease, and rightly. Accepting historical necessity, Yeats is not, as the American Jewish critic Harold Bloom pointed out, necessarily averse to this “rough beast.”[2]
Thus, liberal critics are never completely comfortable in the company of Yeats. In “Under Ben Bulben,” one of Yeats’s last poems and a general summary of his ideas, he writes:
You that Mitchel’s prayer have heard
“Send war in our time, O Lord!”
Know that when all words are said
And a man is fighting mad,
Something drops from eyes long blind,
He completes his partial mind,
For an instant stands at ease,
Laughs aloud, his heart at peace.
Even the wisest man grows tense
With some sort of violence
Before he can accomplish fate,
Know his work or choose his mate.
Bloom charged that Yeats “abused the Romantic tradition” in these lines. But Yeats would have shown Bloom the contempt he deserves; in one of Yeats’s letters we can read: “I am full of life and not too disturbed by the enemies I must make. This is the proposition on which I write: There is now overwhelming evidence that man stands between eternities, that of his family and that of his soul. I apply those beliefs to literature and politics and show the change they must make. . . . My belief must go into what I write, even if I estrange friends; some when they see my meaning set out in plain print will hate me for poems which they have thought meant nothing.”
Earlier Yeats had written of war, politics, and pleasant but self-defeating illusions. In “Nineteen Hundred and Nineteen” he surveyed both the halcyon pre-World War I years and the grim aftermath of war, civil war, and revolution:
We too had many pretty toys when young:
A law indifferent to blame or praise,
To bribe or threat; habits that made old wrong
Melt down, as it were wax in the sun’s rays;
Public opinion ripening for so long
We thought it would outlive all future days.
O what fine thoughts we had because we thought
That the worst rogues and rascals had died out. . . .
Now days are dragon-ridden, the nightmare
Rides upon sleep: a drunken soldiery
Can leave the mother, murdered at her door,
To crawl in her own blood, and go scot-free;
The night can sweat with terror as before
We pieced our thoughts into philosophy,
And planned to bring the world under a rule,
Who are but weasels fighting in a hole.
Yeats himself did not take an active part in the Irish civil war, and he may have felt a certain uneasiness about the physical side of the struggle:
An affable Irregular,
A heavily-built Falstaffian man,
Comes cracking jokes of civil war
As though to die by gunshot were
The finest play under the sun.
– “Meditations in Time of Civil War”
Yeats, it is true, spent much time contemplating and expressing himself on the great problems of the age and of the individual living in this age, but he never strayed far from whimsy. As typical of his poetry as anything he wrote is the neatly lyrical “To Anne Gregory,” addressed to the granddaughter of his friend and fellow playwright Lady Augusta Gregory:
“Never shall a young man,
Thrown into despair
By those great honey-colored
Ramparts at your ear,
Love you for yourself alone
And not your yellow hair:
“But I can get a hair-dye
And set such color there,
Brown, or black, or carrot,
That young men in despair
May love me for myself alone
And not my yellow hair.’
“I heard an old religious man
But yestemight declare
That he had found a text to prove
That only God, my dear,
Could love you for yourself alone
And not your yellow hair.”
I know of no English or American poet writing today who can approach even remotely Yeats’s lyrical power or his poetic shaping of strong and startling ideas. Most of today’s poets are professors of English or fine arts who grind out pedestrian or pretentious drivel, presumably for prestige within the academic community. And it is hardly conceivable that there are any campus publications, literary or otherwise, that would publish all of Yeats’s material were he writing today. What, for instance, would they do with these lines from “John Kinsella’s Lament For Mrs. Mary Moore”?:
Though stiff to strike a bargain,
Like an old Jew man,
Her bargain struck we laughed and talked
And emptied many a can . . . .
Perhaps Yeats was the culmination of that great, surging Romantic wave, now in recession.
Though the great song return no more
There’s keen delight in what we have:
The rattle of pebbles on the shore
Under the receding wave.
– “The Nineteenth Century and After”
Perhaps. And perhaps a revitalized and resurgent West can at least produce poets in the great tradition, who refuse to wallow in mud and make a career of destroying our language.
Sing the peasantry, and then
Hard-riding country gentlemen,
The holiness of monks, and after
Porter-drinkers randy laughter;
Sing the lords and ladies gay
That were beaten into the clay
Through seven heroic centuries;
Cast your mind on other days
That we in coming days may be
Still the indomitable Irishry.
– “Under Ben Bulben”
These lines also proved upsetting to Bloom, and understandably. Yeats here issues a clear tribal call for cultural unity by appealing to racial instinct and historical experience: blood and soil. A Jewish critic, who had never shared in the experience, but rather was steeped in another totally alien, and thus had no real comprehension of the soul-state from which the poet spoke, would, as a matter of course, feel hostile to such verse. Too bad for Bloom and his fellows that Yeats’s reputation is already established; they have now little other to do but to wring their hands and rend their garments in their studies.
William Butler Yeats: rooted in Ireland, a seeker in the Western tradition, a giant of our race and culture; like Nietzsche, a “conqueror of Time”; and, perchance, one of the heralds of the times to come:
O silver trumpets, be you lifted up
And cry to the great race that is to come.
Long-throated swans upon the waves of time,
Sing loudly, for beyond the wall of the world
That race may hear our music and awake.
– “The King’s Threshold”
Notes
[1] Joseph M. Hone, W. B. Yeats, 1865–1939 (1943).
[2] Harold Bloom, Yeats (1972).
00:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres anglaises, littérature anglaise, lettres irlandaises, littérature irlandaise, irlande, nationalisme irlandais, celtes, celticité, celtitude, yeats |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 14 septembre 2010
Das Stierlein - Zum Tode von Liselotte Jünger
Das StierleinZum Tode von Liselotte JüngerVon Lutz HagestedtEx: http://www.literaturkritik.de/1963 wäre Ernst Jünger beinahe das Opfer der tückischen Strömung im Meer an dem sardinischen Badeort Villasimius geworden. Als er sich, quasi in letzter Minute und völlig entkräftet an den Strand retten kann, wirft sich seine Frau, liebevoll „Stierlein“ genannt, über ihn. Ernst und Liselotte Jünger sind auf diesen Schicksalstag des öfteren zu sprechen gekommen: Seit 1962 erst waren sie miteinander verheiratet, für beide war es die zweite Ehe. Die im Sternbild des Stieres 1917 geborene Liselotte Bäuerle, verwitwete Lohrer, genoss allgemein Respekt. Von zierlicher Gestalt, dabei lebhaft und humorvoll, ertrug sie gefasst die immer wieder aufs Neue entfachten Debatten um das politisch Anstößige ihres Mannes. Der Schriftsteller hatte die promovierte Verlagshistorikerin zwei Jahre nach dem Tod von „Perpetua“ (Gretha von Jeinsen), seiner an Krebs gestorbenen ersten Frau, geheiratet. Der Autor und sein Stierlein kannten sich schon vor ihrer Ehe, denn nach ihrer Promotion arbeitete Liselotte Lohrer in Marbach und lektorierte Jüngers Werke für den Klett Verlag. Sie war maßgeblich an der ersten und dann auch an der zweiten Werkausgabe beteiligt und fungierte als Herausgeberin des „Schlusssteins“ der „Sämtlichen Werke“. Die gelernte Bibliothekarin, die mit einer Geschichte des Cotta Verlages promoviert wurde, hat sich um Jüngers Werk und Person verdient gemacht: Sie führte und ordnete seine Korrespondenz, begleitete Jünger auf seinen Reisen, versorgte seine Katzen, führte ihm den Haushalt, wachte über seine Arbeitsruhe, kutschierte ihn in ihrem PKW. Seine Gäste, Staatsgäste zumal, waren auch die ihren: Resolut wachte sie über die Oberförsterei im schwäbischen Wilflingen. Sie gab einzelne Texte heraus (zum Beispiel Jüngers Fragment „Prinzessin Tarakanow“), betreute den Vorlass und später auch den Nachlass. Großzügig förderte sie die Forschung, und auf Tagungen gab sie unermüdlich Auskunft, so sehr hatte sie sich die Perspektive ihres Mannes zu eigen gemacht. Als bei der Enthüllung von Gerold Jäggles Jünger-Denkmal am Wilflinger Weiher ein Dummer-Jungen-Streich zum Vorschein kam, war sie es, die durch ein herzliches Lachen den Bann brach. Oft ist in den Tagebüchern von ihr die Rede, zahllose Briefe in Jüngers Namen hat sie unterzeichnet. In der Nacht vom 31. August auf den 1. September ist sie 93-jährig in Überlingen gestorben. |
15:41 Publié dans Hommages, Littérature, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst jûnger, littérature, lettres, lettres allemandes, littérature allemande, révolution conservatrice, hommage |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Liselotte Jünger gestorben
|
"Die frühere Leiterin des Cotta-Archivs, Liselotte Jünger, ist 93-jährig in Überlingen gestorben. Die zweite Ehefrau des Schriftstellers Ernst Jünger (1895-1998) hatte das Verlags-Archiv in den Jahren 1952 bis 1962 geleitet, das als das bedeutendste und am besten erschlossene Verlagsarchiv des 19. Jahrhundert in Deutschland gilt. Nach der Hochzeit mit Ernst Jünger verließ Liselotte Jünger das Archiv und widmete sich als Archivarin und Lektorin dem Werk ihres Mannes. Trotzdem blieb Liselotte Jünger dem Literaturarchiv in Marbach eng verbunden."
Quelle: Rheinische Post, 3.9.2010 (Print) "Liselotte Jünger (geb. Bäuerle) ist am 31. August 2010 in Überlingen gestorben. .....Die Germanistin und Historikerin Liselotte Jünger, geboren am 20. Mai 1917, schrieb ihre Promotion an der Universität Gießen über die Komödien von Sebastian Sailer, einem Prediger und schwäbischen Mundartdichter des Barock. Von 1943 bis 1952 war sie Archivarin der J. G. Cotta’schen Buchhandlung, dann in gleicher Funktion Angestellte der »Stuttgarter Zeitung«. Nachdem die von der Stuttgarter Zeitung gestiftete »Cotta'sche Handschriftensammlung« (1952) und die Archivbibliothek (1954) dem Deutschen Literaturarchiv übergeben wurden, hat sie das Cotta-Archiv im Deutschen Literaturarchiv maßgeblich aufgebaut und betreut. Außerdem verfasste Liselotte Jünger u. a. eine Verlagsgeschichte (1959), ein Bestandsverzeichnis (1963) und gab gemeinsam mit Horst Fuhrmann den Schelling-Cotta-Briefwechsel (1965) heraus. .....[I]hr Herzensanliegen war es zuletzt, das ehemalige Wohnhaus Ernst Jüngers im oberschwäbischen Wilflingen als Erinnerungsstätte für Ernst Jünger zu erhalten: Das Ernst-Jünger-Haus wird nun im Frühjahr 2011 nach Sanierung wiedereröffnet. An der Vorbereitung der großen Ernst Jünger-Retrospektive, die das Deutsche Literaturarchiv am 7. November 2010 eröffnen wird, nahm sie bis zuletzt lebhaft Anteil." Quelle: Literaturarchiv Marbach 039/2010 Wolf Thomas - am Sonntag, 5. September 2010
|
15:33 Publié dans Hommages, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hommage, littérature, lettres, lettres allemandes, littérature allemande, révolution conservatrice, ernst jünger |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 12 septembre 2010
Relire Soljénitsyne
|
Robert STEUCKERS : Relire Soljénitsyne
Conférence tenue à Genève, avril 2009, et au « Cercle de Bruxelles », septembre 2009
Pourquoi évoquer la figure d’Alexandre Soljénitsyne, aujourd’hui, dans le cadre de nos travaux ? Décédé en août 2008, Soljénitsyne a été une personnalité politique et littéraire tout à la fois honnie et adulée en Occident et sur la place de Paris en particulier. Elle a été adulée dans les années 70 car ses écrits ont servi de levier pour faire basculer le communisme soviétique et ont inspiré, soi-disant, la démarche des « nouveaux philosophes » qui entendaient émasculer la gauche française et créer, après ce processus d’émasculation, une gauche anti-communiste, peu encline à soutenir l’URSS en politique internationale. Après cette période d’adulation presque sans bornes, la personne d’Alexandre Soljénitsyne a été honnie, surtout après son discours à Harvard, essentiellement pour cinq motifs : 1) Soljénitsyne critique l’Occident et ses fondements philosophiques et politiques, ce qui n’était pas prévu au programme : on imaginait un Soljénitsyne devenu docile à perpétuité, en remercîment de l’asile reçu en Occident ; 2) Il critique simultanément la chape médiatique qui recouvre toutes les démarches intellectuelles officielles de l’Occident, brisant potentiellement tous les effets de la propagande « soft », émanant des agences de l’ « américanosphère » ; 3) Il critique sévèrement le « joujou pluralisme » que l’Occident a voulu imposer à la Russie, en créant et en finançant des cénacles « russophobes », prêchant la haine du passé russe, des traditions russes et de l’âme russe, lesquelles ne génèrent, selon les « pluralistes », qu’un esprit de servitude ; par les effets du « pluralisme », la Russie était censée s’endormir définitivement et ne plus poser problème à l’hegemon américain ; 4) Il a appelé à la renaissance du patriotisme russe, damant ainsi le pion à ceux qui voulaient disposer sans freins d’une Russie anémiée et émasculée et faire main basse sur ses richesses ; 5) Il s’est réconcilié avec le pouvoir de Poutine, juste au moment où celui-ci était décrié en Occident.
Jeunesse
Ayant vu le jour en 1918, Alexandre Soljénitsyne nait en même temps que la révolution bolchevique, ce qu’il se plaira à souligner à maintes reprises. Il nait orphelin de père : ce dernier, officier dans l’armée du Tsar, est tué lors d’un accident de chasse au cours d’une permission. Le jeune Alexandre est élevé par sa mère, qui consentira à de durs sacrifices pour donner à son garçon une excellente éducation. Fille de propriétaires terriens, elle appartient à une famille brisée par les effets de la révolution bolchevique. Alexandre étudiera les mathématiques, la physique et la philosophie à Rostov sur le Don. Incorporé dans l’Armée Rouge en 1941, l’année de l’invasion allemande, il sert dans un régiment d’artillerie et participe à la bataille de Koursk, qui scelle la défaite de l’Axe en Russie, et à l’Opération Bagration, qui lance la première grande offensive soviétique en direction du Reich. Cette campagne de grande envergure le mènera, devenu officier, en Prusse Orientale, au moment où l’Armée Rouge, désormais victorieuse, s’apprête à avancer vers la Vistule et vers l’Oder. Jusque là son attitude est irréprochable du point de vue soviétique. Soljénitsyne est certes un patriote russe, incorporé dans une armée soviétique dont il conteste secrètement l’idéologie, mais il n’est pas un « vlassoviste » passé à l’Axe, qui entend délivrer la Russie du stalinisme en s’alliant au Reich et à ses alliés (en dépit des réflexes patriotiques que ce même stalinisme a suscité pour inciter les masses russes à combattre les Allemands).
Arrestation et emprisonnement
Mais ce que voit Soljénitsyne en Prusse Orientale, les viols, les massacres, les expulsions et les destructions perpétrées par l’Armée Rouge, dont il est officier, le dégoûte profondément, le révulse. L’armée de Staline déshonore la Russie. Le séjour de Soljénitsyne en Prusse Orientale trouve son écho littéraire dans deux ouvrages, « Nuits en Prusse Orientale » (un recueil de poèmes) et « Schwenkitten 45 », un récit où il retourne sur les lieux d’août 1914, où son père a combattu. Le NKVD, la police politique de Staline, l’arrête peu après, sous prétexte qu’il avait été « trop tendre » à l’égard de l’ennemi (ce motif justifiait également l’arrestation de son futur compagnon d’infortune Lev Kopelev) et parce qu’il a critiqué Staline dans une lettre à son beau-frère, interceptée par la police. Staline y était décrit comme « l’homme à la moustache », désignation jugée irrespectueuse et subversive par les commissaires politiques (1). Il est condamné à huit ans de détention, d’abord dans les camps de travail du goulag (ce qui donnera la matière d’ « Une journée d’Ivan Denissovitch » et de « L’Archipel Goulag », puis dans une prison réservée aux scientifiques, la fameuse « prison spéciale n°16 », la Sharashka, dans la banlieue de Moscou. Cette expérience, entre les murs de la prison spéciale n°16, constitue tout à la fois la genèse de l’œuvre et de la pensée ultérieure de notre auteur, y compris les linéaments de sa critique de l’Occident, et la matière d’un grand livre, « Le premier cercle », esquivé par les « nouveaux philosophes » qui n’y auraient pas trouvé leur miel mais, au contraire, une pensée radicalement différente de la leur, qui est, on le sait trop bien, caractérisée par une haine viscérale de toutes « racines » ou enracinements.
Le décor de la Sharashka
Dans la « Sharashka », il rencontre Lev Kopelev (alias le personnage de Roubine) et Dmitri Panine (alias Sologdine). Dans « Le premier cercle », Soljénitsyne lui-même sera représenté par le personnage de « Nergine ». « Le premier cercle » est constitué de dialogues d’une grande fécondité, que l’on peut comparer à ceux de Thomas Mann, tenus dans le sanatorium fictif de la « Montagne magique ». Le séjour à la Sharashka est donc très important pour la genèse de l’œuvre, tant sur le plan de la forme que sur le plan du fond. Pour la forme, pour la spécificité de l’écriture de Soljénitsyne, la découverte, dans la bibliothèque de cette prison, des dictionnaires étymologiques de Vladimir Dahl (un philologue russe d’origine danoise) a été capitale. Elle a permis à Soljénitsyne de récréer une langue russe débarrassée des adstrats maladroits du soviétisme, et des apports étrangers inutiles, lourds et pesants, que l’internationalisme communiste se plaisait à multiplier dans sa phraséologie.
Les pensées des personnages incarcérés à la Sharashka sont celles de larges strates de la population russe, en dissidence par rapport au régime. Ainsi, Dmitri Panine/Sologdine est dès le départ hostile à la révolution. De quelques années plus âgé que Soljénitsyne/Nergine, Panine/Sologdine a rejeté le bolchevisme à la suite d’horreurs dont il a été témoin enfant. Il a été arrêté une première fois en 1940 pour pensée contre-révolutionnaire et une seconde fois en 1943 pour « défaitisme ». Il incarne des valeurs morales absolues, propres aux sociétés fortement charpentées par la religion. Ces valeurs morales vont de paire avec un sens inné de la justice. Panine/Sologdine fascine littéralement Soljénitsyne/Nergine. Notons que des personnages similaires se retrouvent dans « L’Archipel Goulag », ouvrage qui a servi, soi-disant, de détonateur à la « nouvelle philosophie » parisienne des années 70. Mais, apparemment, les « nouveaux philosophes » n’ont pas pris acte de ces personnages-là, pourtant d’une grande importance pour le propos de Soljénitsyne, ce qui nous permet de dire que cette approche fort sélective jette le doute sur la validité même de la « nouvelle philosophie » et de ses avatars contemporains. Pur bricolage idéologique ? Fabrication délibérée ?
Kopelev / Roubine
Lev Kopelev/Roubine est juif et communiste. Il croit au marxisme. Pour lui, le stalinisme n’est qu’une « déviation de la norme ». Il est un homme chaleureux et généreux. Il donne la moitié de son pain à qui en a besoin pour survivre ou pour guérir. Ce geste quotidien de partage, Soljénitsyne l’apprécie grandement. Mais, ironise Soljénitsyne/Nergine, il a besoin d’une agora, contrairement à notre auteur qui, lui, a besoin de solitude (ce sera effectivement le cas à la « prison spéciale n°16 », à Zurich dans les premières semaines d’exil et dans le Vermont aux Etats-Unis). Mort en 1997, Kopelev restera l’ami de Soljénitsyne après leur emprisonnement, malgré leurs différences philosophiques et leurs itinéraires divergents. Il se décarcassera notamment pour trouver tous les volumes du dictionnaire de Dahl et les envoyer à Soljénitsyne. Pourquoi ce communiste militant a-t-il été arrêté, presqu’en même temps que Soljénitsyne ? Il est, dès son jeune âge, un germaniste hors pair et un philosophe de talent. Il sert dans une unité de propagande antinazie qui émet à l’attention des soldats de la Wehrmacht. Il joue également le rôle d’interprète pour quelques généraux allemands, pris prisonniers au cours des grandes offensives soviétiques qui ont suivi la bataille de Koursk. Mais lui aussi est dégoûté par le comportement de certaines troupes soviétiques en Prusse Orientale car il reste un germanophile culturel, bien qu’antinazi. Kopelev/Roubine est véritablement le personnage clef du « Premier cercle ». Pourquoi ? Parce qu’il est communiste, représente la Russie « communisée » mais aussi parce qu’il culturellement germanisé, au contraire de Panine/Sologdine, incarnation de la Russie orthodoxe d’avant la révolution, et de Soljénitsyne/Nergine, et, de ce fait, partiellement « occidentalisé ». Il est un ferment non russe dans la pensée russe, respecté par le russophile Soljénitsyne. Celui-ci va donc analyser, au fil des pages du « Premier cercle », la complexité de ses sentiments, c’est-à-dire des sentiments des Russes soviétisés. Au départ, Soljénitsyne/Nergine et Kopelev/Roubine sont proches politiquement. Nergine n’est pas totalement immunisé contre le soviétisme comme l’est Sologdine. Il en est affecté mais il va guérir. Dans les premières pages du « Premier cercle », Nergine et Roubine s’identifient à l’établissement soviétique. Ce n’est évidemment pas le cas de Sologdine.
Panine / Sologdine
Celui-ci jouera dès lors le rôle clef dans l’éclosion de l’œuvre de Soljénitsyne et dans la prise de distance que notre auteur prendra par rapport au système et à l’idéologie soviétiques. Panine/Sologdine est ce que l’on appelle dans le jargon des prisons soviétiques, un « Tchoudak », c’est-à-dire un « excentrique » et un « inspiré » (avec ou sans relents de mysticisme). Mais Panine/Sologdine, en dépit de cette étiquette que lui collent sur le dos les commissaires du peuple, est loin d’être un mystique fou, un exalté comme en a connus l’histoire russe. Son exigence première est de retourner à « un langage de la clarté maximale », expurgé des termes étrangers, qui frelatent la langue russe et que les Soviétiques utilisaient à tire-larigot. L’objectif de Panine/Sologdine est de re-slaviser la langue pour lui rendre sa pureté et sa richesse, la dégager de tous les effets de « novlangue » apportés par un régime inspiré de philosophies étrangères à l’âme russe.
Le prisonnier réel de la Sharashka et le personnage du « Premier cercle » qu’est Panine/Sologdine a étudié les mathématiques et les sciences, sans pour autant abjurer les pensées contre-révolutionnaires radicales que les scientismes sont censés éradiquer dans l’esprit des hommes, selon les dogmes « progressistes ». Panine/Sologdine entretient une parenté philosophique avec des auteurs comme l’Abbé Barruel, Joseph de Maistre ou Donoso Cortès, dans la mesure où il perçoit le marxisme-léninisme comme un « instrument de Satan », du « mal métaphysique » ; de plus, il est une importation étrangère, comme les néologismes de la langue (de bois) qu’il préconise et généralise. La revendication d’une langue à nouveau claire, non viciée par les alluvions de la propagande, est l’impératif premier que pose ce contre-révolutionnaire indéfectible. C’est lui qui demande que l’on potasse les dictionnaires étymologiques de Vladimir Dahl car le retour à l’étymologie est un retour à la vérité première de la langue russe, donc de la Russie et de la russéité. Les termes fabriqués par l’idéologie ou les importations étrangères constituent une chape de « médiateté » qui interdit aux Russes soviétisés de se réconcilier avec leur cœur profond. « Le Premier cercle » rapporte une querelle philosophique entre Panine/Sologdine et Soljénitsyne/Nergine : ce dernier est tenté par la sagesse chinoise de Lao Tseu, notamment par deux maximes, « Plus il y a de lois et de règlements, plus il y aura de voleurs et de hors-la-loi » et « L’homme noble conquiert sans le vouloir ». Soljénitsyne les fera toujours siennes mais, fidèle à un anti-asiatisme foncier propre à la pensée russe entre 1870 et la révolution bolchevique, Panine/Sologdine rejette toute importation de « chinoiseries », proclame sa fidélité indéfectible au fond qui constitue la tradition chrétienne orthodoxe russe, postulant une « foi en Dieu sans spéculation ».
L’éclosion d’une pensée politique véritablement russe
Dans le contexte même de la rencontre de ces trois personnages différents entre les murailles de la Sharashka, avec un Soljénitsyne/Nergine au départ vierge de toute position tranchée, la pensée du futur dissident soviétique, Prix Nobel de littérature et fustigateur de l’Occident décadent et hypocrite, va mûrir, se forger, prendre les contours qu’elle n’abandonnera jamais plus. Face à ses deux principaux interlocuteurs de la Sharashka, la première intention de Soljénitsyne/Nergine est d’écrire une histoire de la révolution d’Octobre et d’en dégager le sens véritable, lequel, pense-t-il au début de sa démarche, est léniniste et non pas stalinien. Pour justifier ce léninisme antistalinien, Soljénitsyne/Nergine interroge Kopelev/Roubine, fin connaisseur de tous les détails qui ont précédé puis marqué cette révolution et la geste personnelle de Lénine. Kopelev/Roubine est celui qui fournit la matière brute. Au fil des révélations, au fur et à mesure que Soljénitsyne/Roubine apprend faits et dessous de la révolution d’Octobre, son intention première, qui était de prouver la valeur intrinsèque du léninisme pur et de critiquer la déviation stalinienne, se modifie : désormais il veut formuler une critique fondamentale de la révolution. Pour le faire, il entend poser une batterie de questions cruciales : « Si Lénine était resté au pouvoir, y aurait-il eu ou non campagne contre les koulaks (l’Holodomor ukrainien), y aurait-il eu ou non collectivisation, famine ? ». En tentant de répondre à ces questions, Soljénitsyne demeure antistalinien mais se rend compte que Staline n’est pas le seul responsable des errements du communisme soviétique. Le mal a-t-il des racines léninistes voire des racines marxistes ? Soljénitsyne poursuit sa démarche critique et en vient à s’opposer à Kopelev, en toute amitié. Pour Kopelev, en dépit de sa qualité d’israélite russe et de prisonnier politique, pense que Staline incarne l’alliance entre l’espérance communiste et le nationalisme russe. En prison, à la Sharashka, Kopelev en arrive à justifier l’impérialisme rouge, dans la mesure où il est justement « impérial » et à défendre des positions « nationales et bolcheviques ». Kopelev admire les conquêtes de Staline, qui est parvenu à édifier un bloc impérial, dominé par la nation russe, s’étendant « de l’Elbe à la Mandchourie ». Soljénitsyne ne partage pas l’idéal panslaviste, perceptible en filigrane derrière le discours de Kopelev/Roubine. Il répétera son désaccord dans les manifestes politiques qu’il écrira à la fin de sa vie dans une Russie débarrassée du communisme. Les Polonais catholiques ne se fondront jamais dans un tel magma ni d’ailleurs les Tchèques trop occidentalisés ni les Serbes qui, dit Soljénitsyne, ont entrainé la Russie dans une « guerre désastreuse » en 1914, dont les effets ont provoqué la révolution. Dans les débats entre prisonniers à la Sharashka, Soljénitsyne/Nergine opte pour une russéité non impérialiste, repliée sur elle-même ou sur la fraternité entre Slaves de l’Est (Russes/Grands Russiens, Ukrainiens et Biélorusses).
Panine, le maître à penser
Pour illustrer son anti-impérialisme en gestation, Soljénitsyne évoque une réunion de soldats en 1917, à la veille de la révolution quand l’armée est minée par la subversion bolchevique. L’orateur, chargé de les haranguer, appelle à poursuivre la guerre ; il évoque la nécessité pour les Russes d’avoir un accès aux mers chaudes. Cet argument se heurte à l’incompréhension des soldats. L’un d’eux interpelle l’orateur : « Va te faire foutre avec tes mers ! Que veux-tu qu’on en fasse, qu’on les cultive ? ». Soljénitsyne veut démontrer, en évoquant cette verte réplique, que la mentalité russe est foncièrement paysanne, tellurique et continentale. Le vrai Russe, ne cessera plus d’expliquer Soljénitsyne, est lié à la glèbe, il est un « pochvennik ». Il est situé sur un sol précis. Il n’est ni un nomade ni un marin. Ses qualités se révèlent quand il peut vivre un tel enracinement. Ce « pochvennikisme », associé chez Soljénitsyne à un certain quiétisme inspiré de Lao Tseu, conduit aussi à une méfiance à l’endroit de l’Etat, de tout « Big Brother » (à l’instar de Proudhon, Bakounine voire Sorel). Ce glissement vers l’idéalisation du « pochvennik » rapproche Soljénitsyne/Nergine de Panine/Sologdine et l’éloigne de Kopelev/Roubine, dont il était pourtant plus proche au début de son séjour dans la Sharashka. Le fil conducteur du « Premier cercle » est celui qui nous mène d’une position vaguement léniniste, dépourvue de toute hostilité au soviétisme, à un rejet du communisme dans toutes ses facettes et à une adhésion à la vision traditionnelle et slavophile de la russéité, portée par la figure du paysan « pochvennik ». Panine fut donc le maître à penser de Soljénitsyne.
Ce ruralisme slavophile de Soljénitsyne, né à la suite des discussions entre détenus à la Sharashka, ne doit pas nous induire à poser un jugement trop hâtif sur la philosophie politique de Soljénitsyne. On sait que le rejet de la mer constitue un danger et signale une faiblesse récurrente des pensées politiques russes ou allemandes. Oswald Spengler opposait l’idéal tellurique du chevalier teutonique, œuvrant sur terre, à la figure négative du pirate anglo-saxon, inspiré par les Vikings. Arthur Moeller van den Bruck préconisait une alliance des puissances continentales contre les thalassocraties. Carl Schmitt penche sentimentalement du côté de la Terre dans l’opposition qu’il esquisse dans « Terre et Mer », ou dans son « Glossarium » édité dix ans après sa mort, et exalte parfois la figure du « géomètre romain », véritable créateur d’Etats et d’Empires. Friedrich Ratzel et l’Amiral Tirpitz ne cesseront, devant cette propension à « rester sur le plancher des vaches », de dire que la Mer donne la puissance et que les peuples qui refusent de devenir marins sont condamnés à la récession permanente et au déclin politique. L’Amiral Castex avancera des arguments similaires quand il exhortera les Français à consolider leur marine dans les années 50 et 60.
Les ouvrages des années 90
Pourquoi l’indubitable fascination pour la glèbe russe ne doit pas nous inciter à considérer la pensée politique de Soljénitsyne comme un pur tellurisme « thalassophobe » ? Dans ses ouvrages ultérieurs, comme « L’erreur de l’Occident » (1980), encore fort emprunt d’un antisoviétisme propre à la dissidence issue du goulag, comme « Nos pluralistes » (1983), « Comment réaménager notre Russie ? » (1990) et « La Russie sous l’avalanche » (1998), Soljénitsyne prendra conscience de beaucoup de problèmes géopolitiques : il évoquera les manœuvres communes des flottes américaine, turque et ukrainienne en Mer Noire et entreverra tout l’enjeu que comporte cette mer intérieure pour la Russie ; il parlera aussi des Kouriles, pierre d’achoppement dans les relations russo-japonaises, et avant-poste de la Russie dans les immensités du Pacifique ; enfin, il évoquera aussi, mais trop brièvement, la nécessité d’avoir de bons rapports avec la Chine et l’Inde, ouvertures obligées vers deux grands océans de la planète : l’Océan Indien et le Pacifique. « La Russie sous l’avalanche », de 1998, est à cet égard l’ouvrage de loin le mieux construit de tous les travaux politiques de Soljénitsyne au soir de sa vie. Le livre est surtout une dénonciation de la politique de Boris Eltsine et du type d’économie qu’ont voulu introduire des ministres comme Gaïdar et Tchoubaïs. Leur projet était d’imposer les critères du néo-libéralisme en Russie, notamment par la dévaluation du rouble et par la vente à l’encan des richesses du pays. Nous y reviendrons.
La parution d’ « Une journée d’Ivan Denissovitch »
La consécration, l’entrée dans le panthéon de la littérature universelle, aura lieu en 1961-62, avec la publication d’ « Une journée d’Ivan Denissovitch », un manuscrit relatant la journée d’un « zek » (le terme soviétique pour désigner un détenu du goulag). Lev Kopelev avait lu le manuscrit et en avait décelé le génie. Surfant sur la vague de la déstalinisation, Kopelev s’adresse à un ami de Khrouchtchev au sein du Politburo de l’Union Soviétique, un certain Tvardovski. Khrouchtchev se laisse convaincre. Il autorise la publication du livre, qu’il perçoit comme un témoignage intéressant pour appuyer sa politique de déstalinisation. « Une journée d’Ivan Denissovitch » est publiée en feuilleton dans la revue « Novi Mir ». Personne n’avait jamais pu exprimer de manière aussi claire, limpide, ce qu’était réellement l’univers concentrationnaire. Ivan Denissovitch Choukhov, dont Soljénitsyne relate la journée, est un paysan, soit l’homme par excellence selon Soljénitsyne, désormais inscrit dans la tradition ruraliste des slavophiles russes. Trois vertus l’animent malgré son sort : il reste goguenard, ne croit pas aux grandes idées que l’on présente comme des modèles mirifiques aux citoyens soviétiques ; il est impavide et, surtout, ne garde aucune rancune : il pardonne. L’horreur de l’univers concentrationnaire est celle d’un interminable quotidien, tissé d’une banalité sans nom. Le bonheur suprême, c’est de mâchonner lentement une arête de poisson, récupérée en « rab » chez le cuisinier. Dans cet univers, il y a peut-être un salut, une rédemption, en bout de course pour des personnalités de la trempe d’un Ivan Denissovitch, mais il n’y en aura pas pour les salauds, dont la définition n’est forcément pas celle qu’en donnait Sartre : le salaud dans l’univers éperdument banal d’Ivan Denissovitch, c’est l’intellectuel ou l’esthète désincarnés.
Trois personnages animent la journée d’Ivan Denissovitch : Bouynovski, un communiste qui reste fidèle à son idéal malgré son emprisonnement ; Aliocha, le chrétien renonçant qui refuse une église inféodée à l’Etat ; et Choukhov, le païen stoïque issu de la région de Riazan, dont il a l’accent et dont il maîtrise le dialecte. Soljénitsyne donnera le dernier mot à ce païen stoïque, dont le pessimisme est absolu : il n’attend rien ; il cultive une morale de la survie ; il accomplit sa tâche (même si elle ne sert à rien) ; il ne renonce pas comme Aliocha mais il assume son sort. Ce qui le sauve, c’est qu’il partage ce qu’il a, qu’il fait preuve de charité ; le négateur païen du Dieu des chrétiens refait, quand il le peut, le geste de la Cène. En cela, il est le modèle de Soljénitsyne.
Retour de pendule
« Une journée d’Ivan Denissovitch » connaît un succès retentissant pendant une vingtaine de mois mais, en 1964, avec l’accession d’une nouvelle troïka au pouvoir suprême en Union Soviétique, dont Brejnev était l’homme fort, s’opère un retour de pendule. En 1965, le KGB confisque le manuscrit du « Premier cercle ». En 1969, Soljénitsyne est exclu de l’association des écrivains. En guise de riposte à cette exclusion, les Suédois lui accordent le Prix Nobel de littérature en 1970. Soljénitsyne ne pourra pas se rendre à Stockholm pour le recevoir. La répression post-khrouchtchévienne oblige Soljénitsyne, contre son gré, à publier « L’Archipel goulag » à l’étranger. Cette publication est jugée comme une trahison à l’endroit de l’URSS. Soljénitsyne est arrêté pour trahison et expulsé du territoire. La nuit du 12 au 13 février 1974, il débarque d’un avion à l’aéroport de Francfort sur le Main en Allemagne puis se rend à Zurich en Suisse, première étape de son long exil, qu’il terminera à Cavendish dans le Vermont aux Etats-Unis. Ce dernier refuge a été, pour Soljénitsyne, un isolement complet de dix-huit ans.
Euphorie en Occident
De 1974 à 1978, c’est l’euphorie en Occident. Soljénitsyne est celui qui, à son corps défendant, valorise le système occidental et réceptionne, en sa personne, tout le mal que peut faire subir le régime adverse, celui de l’autre camp de la guerre froide. C’est la période où émerge du néant la « nouvelle philosophie » à Paris, qui se veut antitotalitaire et se réclame de Soljénitsyne sans pourtant l’avoir lu entièrement, sans avoir capté véritablement le message du « Premier cercle », le glissement d’un léninisme de bon aloi, parce qu’antistalinien, vers des positions slavophiles, totalement incompatibles avec celles de la brochette d’intellos parisiens qui se vantaient d’introduire dans le monde entier une « nouvelle philosophie » à prétentions universalistes. La « nouvelle philosophie » révèle ainsi son statut de pure fabrication médiatique. Elle s’est servi de Soljénitsyne et de sa dénonciation du goulag pour faire de la propagande pro-américaine, en omettant tous les aspects de son œuvre qui indiquaient des options incompatibles avec l’esprit occidental. Dans ce contexte, il faut se rappeler que Kissinger avait empêché Gerald Ford, alors président des Etats-Unis, d’aller saluer Soljénitsyne, car, avait-il dit, sans nul doute en connaissant les véritables positions slavophiles de notre auteur, « ses vues embarrassent même les autres dissidents » (c’est-à-dire les « zapadnikis », les occidentalistes). Ce hiatus entre le Soljénitsyne des propagandes occidentales et de la « nouvelle philosophie », d’une part, et le Soljénitsyne véritable, slavophile et patriote russe anti-impérialiste, d’autre part, conduira à la thèse centrale d’un ouvrage polémique de notre auteur, « Nos pluralistes » (1983). Dans ce petit livre, Soljénitsyne dénonce tous les mécanismes d’amalgame dont usent les médias. Son argument principal est le suivant : les « pluralistes », porte-voix des pseudo-vérités médiatiques, énoncent des affirmations impavides et non vérifiées, ne retiennent jamais les leçons de l’histoire réelle (alors que Soljénitsyne s’efforce de la reconstituer dans la longue fresque à laquelle il travaille et qui nous emmène d’août 1914 au triomphe de la révolution) ; les « pluralistes », qui sévissent en Russie et y répandent la propagande occidentale, avancent des batteries d’arguments tout faits, préfabriqués, qu’on ne peut remettre en question, sous peine de subir les foudres des nouveaux « bien-pensants ». Le « pluralisme », parce qu’il refuse toute contestation de ses propres a priori, n’est pas un pluralisme et les « pluralistes » qui s’affichent tels sont tout sauf d’authentiques pluralistes ou de véritables démocrates.
Dès 1978, dès son premier discours à Harvard, Soljénitsyne dénonce le vide spirituel de l’Occident et des Etats-Unis, leur matérialisme vulgaire, leur musique hideuse et intolérable, leur presse arrogante et débile qui viole sans cesse la vie privée. Ce discours jette un froid : « Comment donc ! Ce Soljénitsyne ne se borne pas à n’être qu’un simple antistalinien antitotalitaire et occidentaliste ? Il est aussi hostile à toutes les mises au pas administrées aux peuples par l’hegemon américain ! ». Scandale ! Bris de manichéisme ! Insolence à l’endroit de la bien-pensance !
« La Roue Rouge »
De 1969 à 1980, Soljénitsyne va se consacrer à sa grande œuvre, celle qu’il s’était promise d’écrire lorsqu’il était enfermé entre les murs de la Sharashka. Il s’attelle à la grande fresque historique de l’histoire de la Russie et du communisme. La série intitulée « La Roue Rouge » commence par un volume consacré à « Août 1914 », qui paraît en français, à Paris, en 1973, peu avant son expulsion d’URSS. La parution de cette fresque en français s’étalera de 1973 à 1997 (« Mars 1917 » paraitra en trois volumes chez Fayard). « Août 1914 » est un ouvrage très dense, stigmatisant l’amateurisme des généraux russes et, ce qui est plus important sur le plan idéologique et politique, contient une réhabilitation de l’œuvre de Stolypine, avec son projet de réforme agraire. Pour retourner à elle-même, sans sombrer dans l’irréalisme romantique ou néo-slavophile, après les sept décennies de totalitarisme communiste, la Russie doit opérer un retour à Stolypine, qui fut l’unique homme politique russe à avoir développé un projet viable, cohérent, avant le désastre du bolchevisme. La perestroïka et la glasnost ne suffisent pas : elles ne sont pas des projets réalistes, ne constituent pas un programme. L’espoir avant le désastre s’appelait Stolypine. C’est avec son esprit qu’il faut à nouveau communier. Les autres volumes de la « Roue Rouge » seront parachevés en dix-huit ans (« Novembre 1916 », « Mars/Février 1917 », « Août 1917 »). « Février 1917 » analyse la tentative de Kerenski, stigmatise l’indécision de son régime libéral, examine la vacuité du blabla idéologique énoncé par les mencheviks et démontre que l’origine du mal, qui a frappé la Russie pendant sept décennies, réside bien dans ce libéralisme anti-traditionnel. Après la perestroïka, la Russie ne peut en aucun cas retourner à un « nouveau février », comme le faisait Boris Eltsine. La réponse de Soljénitsyne est claire : pas de nouveau menchevisme mais, une fois de plus, retour à Stolypine. « Février 1917 » rappelle aussi le rôle du banquier juif allemand Halphand, alias Parvus, dans le financement de la révolution bolchevique, avec l’appui des autorités militaires et impériales allemandes, soucieuses de se défaire d’un des deux fronts sur lequel combattaient leurs armées. Les volumes de la « Roue Rouge » ne seront malheureusement pas des succès de librairie en France et aux Etats-Unis (sauf « Août 1914 ») ; en Russie, ces volumes sont trop longs à lire pour la jeune génération.
Retour à Moscou par la Sibérie
Le 27 mai 1994, Soljénitsyne retourne en Russie et débarque à Magadan en Sibérie orientale, sur les côtes de la Mer d’Okhotsk. Son arrivée à Moscou sera précédée d’un « itinéraire sibérien » de deux mois, parcouru en dix-sept étapes. Pour notre auteur, ce retour en Russie par la Sibérie sera marqué par une grande désillusion, pour cinq motifs essentiellement : 1) l’accroissement de la criminalité, avec le déclin de toute morale naturelle ; 2) la corruption politique omniprésente ; 3) le délabrement général des cités et des sites industriels désaffectés, de même que celui des services publics ; 4) la démocratie viciée ; 5) le déclin spirituel.
La position de Soljénitsyne face à la nouvelle Russie débarrassée du communisme est donc celle du scepticisme (tout comme Alexandre Zinoviev) à l’égard de la perestroïka et de la glasnost. Gorbatchev, aux yeux de Soljénitsyne et de Zinoviev, n’inaugure donc pas une renaissance mais marque le début d’un déclin. Le grand danger de la débâcle générale, commencée dès la perestroïka gorbatchévienne, est de faire apparaître le système soviétique désormais défunt comme un âge d’or matériel. Soljénitsyne et Zinoviev constatent donc le statut hybride du post-soviétisme : les résidus du soviétisme marquent encore la société russe, l’embarrassent comme un ballast difficile à traîner, et sont désormais flanqués d’éléments disparates importés d’Occident, qui se greffent mal sur la mentalité russe ou ne constituent que des scories dépourvus de toute qualité intrinsèque.
Critique du gorbatchévisme et de la politique d’Eltsine
Déçu par le gorbatchévisme, Soljénitsyne va se montrer favorable à Eltsine dans un premier temps, principalement pour le motif qu’il a été élu démocratiquement. Qu’il est le premier russe élu par les urnes depuis près d’un siècle. Mais ce préjugé favorable fera long feu. Soljénitsyne se détache d’Eltsine et amorce une critique de son pouvoir pour deux raisons : 1) il n’a pas défendu les Russes ethniques dans les nouvelles républiques de la CEI ; 2) il vend le pays et ses ressources à des consortiums étrangers.
Au départ, Soljénitsyne était hostile à Poutine, considérant qu’il était une figure politique issue des cénacles d’Eltsine. Mais Poutine, discret au départ, va se métamorphoser et se poser comme celui qui combat les stratégies de démembrement préconisées par Zbigniew Brzezinski, notamment dans son livre « Le Grand Echiquier » (« The Grand Chessboard »). Il est l’homme qui va sortir assez rapidement la Russie du chaos suicidaire de la « Smuta » (2) post-soviétique. Soljénitsyne se réconciliera avec Poutine en 2007, arguant que celui-ci a hérité d’un pays totalement délabré, l’a ensuite induit sur la voie de la renaissance lente et graduelle, en pratiquant une politique du possible. Cette politique vise notamment à conserver les richesses minières, pétrolières et gazières de la Russie entre des mains russes.
Le voyage en Vendée
En 1993, sur invitation de Philippe de Villers, Soljénitsyne se rend en Vendée pour commémorer les effroyables massacres commis par les révolutionnaires français deux cent années auparavant. Les « colonnes infernales » des « Bleus » pratiquaient la politique de « dépopulation » dans les zones révoltées, politique qui consistait à exterminer les populations rurales entrées en rébellion contre la nouvelle « république ». Dans le discours qu’il tiendra là-bas le 25 septembre 1993, Soljénitsyne a rappelé que les racines criminelles du communisme résident in nuce dans l’idéologie républicaine de la révolution française ; les deux projets politiques, également criminels dans leurs intentions, sont caractérisés par une haine viscérale et insatiable dirigée contre les populations paysannes, accusées de ne pas être réceptives aux chimères et aux bricolages idéologiques d’une caste d’intellectuels détachés des réalités tangibles de l’histoire. La stratégie de la « dépopulation » et la pratique de l’exterminisme, inaugurés en Vendée à la fin du 18ème siècle, seront réanimées contre les koulaks russes et ukrainiens à partir des années 20 du 20ème siècle. Ce discours, très logique, présentant une généalogie sans faille des idéologies criminelles de la modernité occidentale, provoquera la fureur des cercles faisandés du « républicanisme » français, placés sans ménagement aucun par une haute sommité de la littérature mondiale devant leurs propres erreurs et devant leur passé nauséabond. Soljénitsyne deviendra dès lors une « persona non grata », essuyant désormais les insultes de la presse parisienne, comme tous les Européens qui osent professer des idées politiques puisées dans d’autres traditions que ce « républicanisme » issu du cloaque révolutionnaire parisien (cette hostilité haineuse vaut pour les fédéralistes alpins de Suisse ou de Savoie, de Lombardie ou du Piémont, les populistes néerlandais ou slaves, les solidaristes ou les communautaristes enracinés dans des continuités politiques bien profilées, etc. qui ne s’inscrivent dans aucun des filons de la révolution française, tout simplement parce que ces filons n’ont jamais été présents dans leurs pays). On a même pu lire ce titre qui en dit long dans une gazette jacobine : « Une crapule en Vendée ». Tous ceux qui n’applaudissent pas aux dragonnades des « colonnes infernales » de Turreau reçoivent in petto ou de vive voix l’étiquette de « crapule ».
Octobre 1994 : le discours à la Douma
En octobre 1994, Soljénitsyne est invité à la tribune de la Douma. Le discours qu’il y tiendra, pour être bien compris, s’inscrit dans le cadre général d’une opposition, ancienne mais revenue à l’avant-plan après la chute du communisme, entre, d’une part, occidentalistes (zapadniki) et, d’autre part, slavophiles (narodniki ou pochvenniki, populistes ou « glèbistes »). Cette opposition reflète le choc entre deux anthropologies, représentées chacune par des figures de proue : Sakharov pour les zapadniki et Soljénitsyne pour les narodniki. Sakharov et les zapadniki défendaient dans ce contexte une « idéologie de la convergence », c’est-à-dire d’une convergence entre les « deux capitalismes » (le capitalisme de marché et le capitalisme monopoliste d’Etat). Sakharov et son principal disciple Alexandre Yakovlev prétendaient que cette « idéologie de la convergence » annonçait et préparait une « nouvelle civilisation mondiale » qui adviendrait par le truchement de l’économie. Pour la faire triompher, il faut « liquider les atavismes », encore présents dans la religion et dans les sentiments nationaux des peuples et dans les réflexes de fierté nationale. La liquidation des atavismes s’effectuera par le biais d’un « programme de rééducation » qui fera advenir une « nouvelle raison ». Dans son discours à la Douma, Soljénitsyne fustige cette « idéologie de la convergence » et cette volonté d’éradiquer les atavismes. L’une et l’autre sont mises en œuvre par les « pluralistes » dont il dénonçait déjà les manigances et les obsessions en 1983. Ces « pluralistes » ne se contentent pas d’importer des idées occidentales préfabriquées, tonnait Soljénitsyne du haut de la chaire de la Douma, mais ils dénigrent systématique l’histoire russe et toutes les productions issues de l’âme russe : le discours des « pluralistes » répète à satiété que les Russes sont d’incorrigibles « barbares », sont « un peuple d’esclaves qui aiment la servitude », qu’ils sont mâtinés d’esprit mongol ou tatar et que le communisme n’a jamais été autre chose qu’une expression de cette barbarité et de cet esprit de servitude. Le programme du « républicanisme » et de l’ « universalisme » français (parisien) est très similaire à celui des « pluralistes zapadnikistes » russes : les Français sont alors campés comme des « vichystes » sournois et incorrigibles et toutes les idéologies françaises, même celles qui se sont opposées à Vichy, sont accusées de receler du « vichysme », comme le personnalisme de Mounier ou le gaullisme. C’est contre ce programme de liquidation des atavismes que Soljénitsyne s’insurge lors de son discours à la Douma d’Etat. Il appelle les Russes à le combattre. Ce programme, ajoutait-il, s’enracine dans l’idéologie des Lumières, laquelle est occidentale et n’a jamais procédé d’un humus russe. L’âme russe, par conséquent, ne peut être tenue responsable des horreurs qu’a générées l’idéologie des Lumières, importation étrangère. Rien de ce qui en découle ne peut apporter salut ou solutions pour la Russie postcommuniste. Soljénitsyne reprend là une thématique propre à toute la dissidence est-européenne de l’ère soviétique, qui s’est révoltée contre la volonté d’une minorité activiste, détachée du peuple, de faire advenir un « homme nouveau » par dressage totalitaire (Leszek Kolakowski). Cet homme nouveau ne peut être qu’un sinistre golem, qu’un monstre capable de toutes les aberrations et de toutes les déviances politico-criminelles.
« Comment réaménager notre Russie ? »
Mais en quoi consiste l’alternative narodniki, préconisée par Soljénitsyne ? Celui-ci ne s’est-il pas contenté de fustiger les pratiques métapolitiques des « pluralistes » et des « zapadnikistes », adeptes des thèses de Sakharov et Yakovlev ? Les réponses se trouvent dans un ouvrage paru en 1991, « Comment réaménager notre Russie ? ». Soljénitsyne y élabore un véritable programme politique, valable certes pour la Russie, mais aussi pour tous les pays souhaitant se soustraire du filon idéologique qui va des « Lumières » au « Goulag ».
Soljénitsyne préconise une « démocratie qualitative », basée sur un vote pour des personnalités, dégagée du système des partis et assise sur l’autonomie administrative des régions. Une telle « démocratie qualitative » serait soustraite à la logique du profit et détachée de l’hyperinflation du système bancaire. Elle veillerait à ne pas aliéner les ressources nationales (celles du sol, les richesses minières, les forêts), en n’imitant pas la politique désastreuse d’Eltsine. Dans une telle « démocratie qualitative », l’économie serait régulée par des normes éthiques. Son fonctionnement serait protégé par la verticalité d’un pouvoir présidentiel fort, de manière à ce qu’il y ait équilibre entre la verticalité de l’autorité présidentielle et l’horizontalité d’une démocratie ancrée dans la substance nationale russe et liée aux terres russes.
La notion de « démocratie qualitative »
Une telle « démocratie qualitative » passe par une réhabilitation des villages russes, explique Soljénitsyne en s’inscrivant très nettement dans le filon slavophile russe, dont les inspirations majeures sont ruralistes et « glèbistes » (pochvenniki). Cette réhabilitation a pour corollaire évident de promouvoir, sur les ruines du communisme, des communautés paysannes ou un paysannat libre, maîtres de leur propre sol. Cela implique ipso facto la liquidation du système kolkhozien. La « démocratie qualitative » veut également réhabiliter l’artisanat, un artisanat qui serait propriétaire de ses moyens de production. Les fonctionnaires ont été corrompus par la libéralisation post-soviétique. Ce fonctionnariat devenu voleur devrait être éradiqué pour ne laisser aucune chance au « libéralisme de type mafieux », précisément celui qui s’installait dans les marges du pouvoir eltsinien. La Russie sera sauvée, et à nos yeux pas seulement la Russie, si elle se débarrasse de toutes les formes de gouvernement dont la matrice idéologique et « philosophique » dérive des Lumières et du matérialisme qui en découle. Les formes de « libéralisme » et de fausse démocratie, de démocratie sans qualités, ouvrent la voie aux techniques de manipulation, donc à l’asservissement de l’homme par le biais de son déracinement, conclut Soljénitsyne. Dans le vide que créent ces formes politiques dérivées des Lumières, s’installe généralement la domination étrangère par l’intermédiaire d’une dictature d’idéologues, qui procèdent de manière systématique et sauvage à l’asservissement du peuple. Cette domination, étrangère à la substance populaire, enclenche un processus de décadence et de déracinement qui détruit l’homme, dit Soljénitsyne en se mettant au diapason du « renouveau ruraliste » de la littérature russe des années 60 à 80, dont la figure de proue fut Valentin Raspoutine.
De la démarche ethnocidaire
Soljénitsyne dénonce le processus d’ethnocide qui frappe le peuple russe (et bon nombre d’autres peuples). La démarche ethnocidaire, pratiquée par les élites dévoyées par l’idéologie des Lumières, commence par fabriquer, sur le dos du peuple et au nom du « pluralisme », des sociétés composites, c’est-à-dire des sociétés constituées d’un mixage d’éléments hétérogènes. Il s’agit de noyer le peuple-hôte principal et de l’annihiler dans un « melting pot ». Ainsi, le système soviétique, que n’a cessé de dénoncer Soljénitsyne, cherchait à éradiquer la « russéité » du peuple russe au nom de l’internationalisme prolétarien. En Occident, le pouvoir actuel cherche à éradiquer les identités au nom d’un universalisme panmixiste, dont le « républicanisme » français est l’exemple le plus emblématique.
« Semstvo » et « opoltcheniyé »
Le peuple doit imiter les anciens, ceux du début du 17ème siècle, et se dresser contre la « smuta » qui ne profite qu’à la noblesse querelleuse (les « boyards »), à la Cour, aux faux prétendants au trône et aux envahisseurs (en l’occurrence les envahisseurs polonais et catholiques). Aujourd’hui, c’est un nouveau profitariat qui exploite le vide eltsinien, soit la nouvelle « smuta » : les « oligarques », la clique entourant Eltsine et le capitalisme occidental, surtout américain, qui cherche à s’emparer des richesses naturelles du sol russe. Au 17ème siècle, le peuple s’était uni au sein de la « semstvo », communauté politique de défense populaire qui avait pris la responsabilité de voler au secours d’une nation en déliquescence. La notion de « semstvo », de responsabilité politique populaire, est inséparable de celle d ‘ « opoltcheniyé », une milice d’auto-défense du peuple qui se constitue pour effacer tous les affres de la « smuta ». C’est seulement à la condition de réanimer l’esprit et les pratiques de la « semstvo » et de l’ « opoltcheniyé » que la Russie se libèrera définitivement des scories du bolchevisme et des misères nouvelles du libéralisme importé pendant la « smuta » eltsinienne. Conclusion de Soljénitsyne : « Pendant la Période des Troubles (= « smuta »), l’idéal civique de la « semstvo » a sauvé la Russie ». Dans l’avenir, ce sera la même chose.
Propos de même teneur dans un entretien accordé au « Spiegel » (Hambourg, n°44/1994), où Soljénitsyne est sommé de s’expliquer par un journaliste adepte des idées libérales de gauche : « On ne peut appeler ‘démocratie’ un système électoral où seulement 30% des citoyens participent au vote ». En effet, les Russes n’accouraient pas aux urnes et les Américains ne se bousculaient pas davantage aux portillons des bureaux de vote. L’absentéisme électoral est la marque la plus patente des régimes démocratiques occidentaux qui ne parviennent plus à intéresser la population à la chose publique. Toujours dans les colonnes du « Spiegel », Soljénitsyne exprime son opinion sur l’Amérique de Bush : « En septembre 1992, le Président américain George Bush a déclaré devant l’Assemblée de l’ONU : ‘Notre objectif est d’installer partout dans le monde l’économie de marché’. C’est une idée totalitaire ». Soljénitsyne s’est ainsi fait l’avocat de la pluralité des systèmes, tout en s’opposant aux prédicateurs religieux et économiques qui tentaient, avec de gros moyens, de vendre leurs boniments en Russie.
Conclusion
L’œuvre de Soljénitsyne, depuis les réflexions inaugurales du « Premier cercle » jusqu’au discours d’octobre 1994 à la Douma et à l’entretien accordé au « Spiegel », est un exemple de longue maturation politique, une initiation pour tous ceux qui veulent entamer les démarches qu’il faut impérativement poser pour s’insurger comme il se doit contre les avatars de l’idéologie des Lumières, responsables d’horreurs sans nom ou de banalités sans ressort, qui ethnocident les peuples par la violence ou l’asservissement. Voilà pourquoi ses livres doivent nous accompagner en permanence dans nos réflexions et nos méditations.
Robert STEUCKERS. (conférence préparée initialement pour une conférence à Genève et à Bruxelles, à Forest-Flotzenberg, à Pula en Istrie, aux Rochers du Bourbet et sur le sommet du Faux Verger, de janvier à avril 2009).
La présente étude est loin d’être exhaustive : elle vise essentiellement à montrer les grands linéaments d’une pensée politique née de l’expérience de la douleur. Elle ne se concentre pas assez sur le mode d’écriture de Soljénitsyne, bien mis en exergue dans l’ouvrage de Georges Nivat (« Le phénomène Soljénitsyne ») et n’explore pas l’univers des personnages de l’ « Archipel Goulag », l’œuvre étant pour l’essentiel tissée de discussions entre dissidents emprisonnés, exclus du raisonnement politique de leur pays. Une approche du mode d’écriture et une exploration trop approfondie des personnages de l’ « Archipel Goulag » aurait noyé la clarté didactique de notre exposé, destiné à éclairer un public non averti des subtilités de l’oeuvre.
Notes : (1) Dans son ouvrage sur la bataille de Berlin, l’historien anglais Antony Beevor rappelle que les unités du NKVD et du SMERSH se montrèrent très vigilantes dès l’entrée des troupes soviétiques sur le territoire du Reich, où celles-ci pouvaient juger les réalisations du régime national-socialiste et les comparer à celle du régime soviétique-stalinien. Le parti était également inquiet, rappelle Beevor, parce que, forte de ses victoires depuis Koursk, l’Armée gagnait en prestige au détriment du parti. L’homme fort était Joukov qui faisait de l’ombre à Staline. C’est dans le cadre de cette nervosité des responsables communistes qu’il faut replacer cette vague d’arrestations au sein des forces armées. Beevor rappelle également que les effectifs des ultimes défenseurs de Berlin se composaient comme suit : 45.000 soldats d’unités diverses, dont bon nombre d’étrangers (Norvégiens, Français,…), avec, au moins 10.000 Russes ou ex-citoyens soviétiques (Lettons, Estoniens, etc.) et 40.000 mobilisés du Volkssturm. (2) Le terme « smuta », bien connu des slavistes et des historiens de la Russie, désigne la période de troubles subie par la Russie entre les dernières années du 16ème siècle et les premières décennies du 17ème. Par analogie, on l’a utilisée pour stigmatiser le ressac général de la Russie comme puissance après la chute du communisme.
Bibliographie :
Outre les ouvrages de Soljénitsyne cités dans cet article, nous avons consulté les livres et articles suivants :
- Jürg ALTWEGG, « Frankreich trauert – Der ‘Schock Solschenizyn’ » , ex : http://www.faz.net/ ou Frankfurter Allgemeine Zeitung, 4 août 2008 (l’article se concentre sur l’hommage des anciens « nouveaux philosophes » par un de leurs ex compagnons de route ; monument d’hypocrisie, truffé d’hyperboles verbales). - Ralph DUTLI, « Zum Tod von Alexander Solschenizyn – Der Prophet im Rad der Geschichte », ex : http://www.faz.net/ ou Frankfurter Allgemeine Zeitung, 5 août 2008. - Aldo FERRARI, La Russia tra Oriente & Occidente, Edizioni Ares, Milano, 1994 (uniquement les chapitre sur Soljénitsyne). - Giuseppe GIACCIO, « Aleksandr Solzenicyn : Riconstruire l’Uomo », in Diorama Letterario, n°98, novembre 1986. - Juri GINZBURG, « Der umstrittene Patriarch », ex : http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/archiv/ ou Berliner Zeitung / Magazin, 6 décembre 2003. - Kerstin HOLM, « Alexander Solschenizyn : Na islomach – Wie lange wird Russland noch von Kriminellen regiert ? », ex : http://www.faz.net/s/Rub79…/ ou Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20 juillet 1996, N°167, p. 33. - Kerstin HOLM, « Alexander Solschenizyn : Schwenkitten ’45 – Wider die Architekten der Niedertracht », in Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2 octobre 2004 ou http://www.faz.net/ . - Kerstin HOLM, « Die russische Krise – Solschenizyn als Geschichtskorektor », ex : http://www.faz.net/s/Rub… ou Frankfurter Allgemeine Zeitung, 3 mai 2006. - Kerstin HOLM, « Solschenizyn : Zwischen zwei Mühlsteinen – Moralischer Röntgenblick », ex : http://www.faz.net/s/ ou Frankfurter Allgemeine Zeitung, 26 mai 2006, n°121, p. 34. - Kerstin HOLM, « Das Gewissen des neuen Russlands », ex : http://www.faz.net/ ou Frankfurter Allgemeine Zeitung, 5 août 2008. - Michael T. KAUFMAN, « Solzhenitsyn, Literary Giant Who defied Soviets, Dies at 89 », The New York Times ou http://www.nytimes.com/ . - Hildegard KOCHANEK, Die russisch-nationale Rechte von 1968 bis zum Ende der Sowjetunion – Eine Diskursanalyse, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 1999. - Lew KOPELEW, Und dennoch hoffen / Texte der deutsche Jahre, Hoffmann und Campe, 1991 (recension par Willy PIETERS, in : Vouloir n°1 (nouvelle série), 1994, p.18. - Walter LAQUEUR, Der Schoss ist fruchtbar noch – Der militante Nationalismus der russischen Rechten, Kindler, München, 1993 (approche très critique). - Reinhard LAUER, « Alexander Solschenizyn : Heldenleben – Feldherr, werde hart », ex : http://ww.faz.net/s/Rub79… ou Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2 avril 1996, n°79, p. L11. - Jean-Gilles MALLIARAKIS, « Le retour de Soljénitsyne », in Vouloir, n°1 (nouvelle série), 1994, p.18. - Jaurès MEDVEDEV, Dix ans dans la vie de Soljénitsyne, Grasset, Paris, 1974. - Georges NIVAT, « Le retour de la parole », in Le Magazine Littéraire, n°263, mars 1989, pp. 18-31. - Michael PAULWITZ, Gott, Zar, Muttererde : Solschenizyn und die Neo-Slavophilen im heutigen Russland, Burschenschaft Danubia, München, 1990. - Raf PRAET, « Alexander Solzjenitsyn – Leven, woord en daad van een merkwaardige Rus » (nous n’avons pas pu déterminer l’origine de cet article ; qui peut nous aider ?). - Gonzalo ROJAS SANCHEZ, « Alexander Solzhenitsyn (1918-2008), Arbil, n°118/2008, http://www.arbil.org/ . - Michael SCAMMELL, Solzhenitsyn – A Biography, Paladin/Grafton Books, Collins, London/Glasgow, 1984-1986. - Wolfgang STRAUSS, « Février 1917 dans ‘La Roue Rouge’ de Soljénitsyne », in http://euro-synergies.hautetfort.com/ (original allemand in Criticon, n°119/1990). - Wolfgang STRAUSS, « La fin du communisme et le prochain retour de Soljénitsyne », in Vouloir, N°83/86, nov.-déc. 1991 (original allemand in Europa Vorn, n°21, nov. 1991). - Wolfgang STRAUSS, « Soljénitsyne, Stolypine : le nationalisme russe contre les idées de 1789 », in Vouloir, n°6 (nouvelle série), 1994 (original allemand dans Criticon, n°115, 1989). - Wolfgang STRAUSS, « Der neue Streit der Westler und Slawophilen », in Staatsbriefe 2/1992, pp. 8-16. - Wolfgang STRAUSS, Russland, was nun ?, Eckhartschriften/Heft 124 - Österreichische Landmannschaft, Wien, 1993 - Wolfgang STRAUSS, « Alexander Solschenizyns Rückkehr in die russische Vendée », in Staatsbriefe 10/1994, pp. 25-31. - Wolfgang STRAUSS, « Der Dichter vor der Duma (1) », in Staatsbriefe 11/1994, pp. 18-22. - Wolfgang STRAUSS, « Der Dichter vor der Duma (2) », in Staatsbriefe 12/1994, pp. 4-10. - Wolfgang STRAUSS, « Solschenizyn, Lebed und die unvollendete Revolution », in Staatsbriefe 1/1997, pp. 5-11. - Wolfgang STRAUSS, « Russland, du hast es besser », in Staatsbriefe 1/1997, pp. 12-14. - Wolfgang STRAUSS, « Kein Ende mit der Smuta », in Staatsbriefe 3/1997, pp. 7-13. - Reinhard VESER, « Russische Stimmen zu Solschenizyn – Ehrliches Heldentum », ex : http://www.faz.net/ ou Frankfurter Allgemeine Zeitung, 4 août 2008. - Craig R. WHITNEY, «Lev Kopelev, Soviet Writer In Prison 10 Years, Dies at 85 », The New York Times, June 20, 1997 ou http://www.nytimes.com/1997/06/20/world/ . - Alexandre ZINOVIEV, « Gorbatchévisme », in L’Autre Europe, n°14/1987. - Alexandre ZINOVIEV, Perestroïka et contre-perestroïka, Olivier Orban, Paris, 1991. - Alexandre ZINOVIEV, La suprasociété globale et la Russie, L’Age d’Homme, Lausanne, 2000.
Acquis et lu après la conférence : - Georges NIVAT, Le phénomène Soljénitsyne, Fayard, Paris, 2009. Ouvrage fondamental ! |
00:19 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres russes, littérature russe, russie, urss, union soviétique, totalitarisme, communisme, camps de concetration, politologie, sciences politiques, théorie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 07 septembre 2010
Lovecraft's Politics
Lovecraft’s Politics
To many of his admirers, the scariest things H. P. Lovecraft wrote were not about Cthulhu, they were about politics. But, as I hope to show, the politics of this master of looming, irrational, metaphysical horror are solidly grounded in reality and reason.
Lovecraft, like many of the literati who turned to Left- or Right-wing politics early in the 20th century, was concerned with the impact of capitalism and technology on society and culture. The economic reductionism of capitalism was simply mirrored by Marxism, both of them emanations of the same modern materialist Zeitgeist.
Beginning in the late 19th century, a pervasive discontent with materialism led to a search for an alternative form of society, including alternative foundations for socialism, which occupied Europe’s leading socialist minds like Georges Sorel. What emerged early in the 20th Century was variously called “neosocialism” and “planism,” the most prominent exponents of which were Marcel Deat in France and Henri De Man in Belgium. Neosocialism, in turn, influenced the rise of fascism.[1]
Neosocialists primarily feared that the material abundance and leisure promised by socialism would lead to decadence and banality unless joined to a hierarchical vision of culture and education.
This was, for instance, the focus of Oscar Wilde’s The Soul of Man under Socialism, which envisioned an individualistic socialism that liberated humanity from economic necessity to pursue self-actualization and higher cultural and spiritual activities, even if these consisted of nothing more than quietly contemplating the cosmos.[2]
Such concerns cannot be dismissed as effete dandyism. They were shared, for instance, by the famous Depression era New Zealand Labour politician John A. Lee, a one-armed hero of the First World War who more than any other individual tried to pressure the 1935 Labour Government into keeping its election pledges on banking and state credit.[3] In Lee’s words:
Joe Savage . . . sees socialism as piles of goods fairly equitably divided and work equitably divided. I am sure he never sees it as the opportunity to play football, get brown on a beach, dance a fox trot, lie on one’s back beneath the trees, enjoy the intoxication of verse, the perfume of flowers, the joys of a novel, the thrill of music.[4]
Lee envisioned a form of socialism that was not directed primarily towards “piles of goods and work equitably distributed” as an end in itself, but as the means of achieving higher levels of being.
These neosocialist concerns were also shared by the fascists and National Socialists. Combating the enervating and leveling effects of wealth and leisure, and edifying the characters and tastes of the masses were the goals of Dopolavoro in Fascist Italy and Strength Through Joy in National Socialist Germany, as disquieting as this thought may be to socialists of the Left.
While it seems unlikely that Lovecraft was aware of this ideological tumult in European socialism, he arrived at similar conclusions in some key areas.
Lovecraft, like other writers who rejected Marxism,[5] deemed both democracy and communism “fallacious for Western Civilization.”[6] Instead, Lovecraft favored:
. . . a kind of fascism which may, whilst helping the dangerous masses at the expense of the needlessly rich, nevertheless preserves the essentials of traditional civilization and leaves political power in the hands of a small and cultivated (though not over-rich) governing class largely hereditary but subject to gradual increase as other individuals rise to its cultural level.[7]
Lovecraft feared that socialism, like capitalism, would pave the way for universal proletarianization and the consequent leveling of culture. Thus he proposed instead full employment and the shortening of the work day through mechanization under the cultural guidance of an aristocratic socialist-fascist regime.
This again was probably a perceptive insight arrived at independently by Lovecraft, but it was very much a part of the new economic thinking of the time. In England, the Fabian-socialist review, The New Age, edited by guild-socialist A. R. Orage, became a forum for discussing Maj. C. H. Douglas’ “Social Credit” theory, which was proposed as an alternative to the debt finance system, with the issue of a “social credit” to all citizens through a “National Dividend” allowing the full value of production to be consumed. They also aimed at fostering mechanization to decrease work hours and increase leisure, which they thought would be conducive to the blossoming of culture. (These ideas have renewed relevance as the eight-hour workday, the long-fought gain of the early labor movement, is becoming a rarity.)
Both Ezra Pound and New Zealand poet Rex Fairburn were Social Crediters because they judged it the best economic system for the arts and culture.
Lovecraft was concerned at the elimination of the causes of social revolution, and he advocated the limitation of the vast accumulation of wealth, while recognizing the need to maintain wage disparities based on merit. His concern was the elimination of the “commercial oligarchs,”[8] which in practical terms was the purpose of Social Credit and of the neosocialists.
While regarding the primary goal of a nation to be the development of high aesthetic and intellectual standards, Lovecraft recognized that such a society must be based on the traditional social organization of “order, courage and endurance,” his definition of civilization being that of a social organism devoted to “a high qualitative goal” maintained by the aforesaid ethos.
Lovecraft thought the hierarchical social order best fitted to the practicalities of the new machine age was a “fascistic one.” The “demand-supply motive” would replace the profit motive in a state-directed economy that would reduce working hours while increasing leisure hours. The citizen could then be elevated culturally and intellectually as far as innate abilities allowed, “so that this leisure will be that of a civilized person rather than that of a cinema-haunting, dance-hall frequenting, pool-room loafing clod.”
Lovecraft saw no wisdom in universal suffrage. He advocated a type of neo-aristocracy or meritocracy, with voting rights and the holding of public office “highly restricted.” A technological, specialized civilization had rendered universal suffrage “a mockery and a jest.” He wrote that, “People do not generally have the acumen to run a technological civilization effectively.” This anti-democratic principle Lovecraft held to be true regardless of one’s social or economic position, whether as menial laborer or as an academic.
The uninformed vote upon which democracy rests, Lovecraft wrote, “is a subject for uproarious cosmic laughter.” The universal franchise meant that the unqualified, generally representing some “hidden interest,” would assume office on the basis of having “the glibbest tongue” and “the flashiest catch-words.”
His reference to “hidden interests” can only refer to his understanding of the oligarchic nature of democracy. This would have to be replaced by “a rational fascist government,” where office would require a prerequisite test of knowledge on economics, history, sociology and business administration, although everyone—other than unassimilable aliens—would have the opportunity to qualify.[9]
A year after Mussolini took power in 1922 Lovecraft wrote that, “Democracy is a false idol—a mere catchword and illusion of inferior classes, visionaries and dying civilizations.” He saw in Fascist Italy “the sort of authoritative social and political control which alone produce things which make life worth living.”
This was also why Ezra Pound admired Fascist Italy, writing “Mussolini has told his people that poetry is a necessity to the state.”[10] And: “I don’t believe any estimate of Mussolini will be valid unless it starts from his passion for construction. Treat him as artifex and all the details fall into place. Take him as anything save the artist and you will get muddled with contradictions.”[11]
Such figures as Pound, Marinetti, and Lovecraft viewed fascism as a movement that could successfully subordinate modern technological civilization to high art and culture, freeing the masses from a coarse and brutalizing commoditized popular culture.
Lovecraft thought the cosmos indifferent to mankind and concluded that the only meaning of human existence is to reach ever higher levels of mental and aesthetic development. What Sir Oswald Mosley called actualization to Higher Forms in his post-war thinking,[12] and what Nietzsche called the goal of Higher Man and the Overman,[13] could not be achieved through “the low cultural standards of an underdeveloped majority. Such a civilization of mere working, eating drinking, breeding and vacantly loafing or childishly playing isn’t worth maintaining.” It is a form of lingering death and is particularly painful to the cultural elite.
Lovecraft was heavily influenced by Nietzsche and Oswald Spengler.[14] He recognized the organic, cyclic nature of cultural birth, youthfulness, maturity, senility and death as the basis of the history of the rise and fall of civilizations. Thus the crisis brought to Western Civilization by the machine age was not unique. Lovecraft cites Spengler’s The Decline of The West as support for his view that civilization had reached the cycle of “senility.”
Lovecraft saw cultural decline as a slow process that spans 500 to 1000 years. He sought a system that could overcome the cyclical laws of decay, which was also the motivation of Fascism.[15] Lovecraft believed it was possible to re-establish a new “equilibrium” over the course of 50 to 100 years, stating: “There is no need of worrying about civilization so long as the language and the general art tradition survives.” The cultural tradition must be maintained above and beyond economic changes.[16]
In 1915 Lovecraft established his own political journal called The Conservative, which ran for 13 issues until 1923. The focus of the journal was defending high cultural standards, particularly in the field of Letters, but it also opposed pacifism, anarchism, and socialism and supported “moderate, healthy militarism” and “Pan-Saxonism,” meaning “the domination of English and kindred races over the lesser divisions of mankind.”[17]
Like the neosocialists in Europe, Lovecraft opposed the materialistic conception of history as being equally bourgeois and Marxist. He saw Communism as “destroying the zest for life” for the sake of a theory.[18] Rejecting economic determinism as the primary motive of history, he saw “natural aristocrats” arising from all sectors of a population regardless of economic status. The aim of a society was to substitute “personal excellence for that of economic position”[19] which is, despite Lovecraft’s declared opposition to “socialism,” nonetheless essentially the same as the “ethical socialism” propounded by Henri De Man, Marcel Deat et al. Lovecraft saw Fascism as the attempt to achieve this form of aristocracy in the context of modern industrial and technological society.
Lovecraft saw the pursuit of “equality” as a destructive rationale for “an atavistic revolt” against civilization by those who are uneasy with culture. The same motive was the root of Bolshevism, the French Revolution, the “back to nature” cult of Rousseau, and the 18th Century Rationalists. Lovecraft saw that the same revolt was being taken up by “backward races” under the leadership of the Bolsheviks.[20]
These views are clearly Nietzschean, but they even more specifically resemble those of The Revolt Against Civilization: The Menace of the Underman[21] by the then popular author Lothrop Stoddard, whose work would certainly have attracted Lovecraft, with his concern for the maintenance and rebirth of civilization and rejection of leveling creeds.
Although Lovecraft rejected egalitarianism, he did not advocate a tyranny that represses the masses for the benefit of the few. Instead, he viewed elite rule as a necessary means for achieving the higher goals of cultural actualization. Lovecraft wished to see the elevation of the greatest number possible.[22] Lovecraft also rejected class divisions as “vicious,” whether emanating from the proletariat or the aristocracy. “Classes are something to be gotten rid of or minimized—not to be officially recognized.” Lovecraft proposed to replace class conflict with an integral state that reflected the “general culture-stream.” Between the individual and the state would exist a two-way loyalty.
Lovecraft regarded pacifism as an “evasion and idealistic hot air.” He declared internationalism “a delusion and a myth.”[23] He saw the League of Nations as “comic opera.”[24] Wars are a constant in history and must be prepared for via universal conscription.[25] Historically war had strengthened the “national fiber,” but mechanized warfare had negated the process; in fact the mass technological destruction of the First World War was widely recognized as dysgenic. Nonetheless the European, and specifically the Anglo-Saxon, must maintain his supremacy through firepower, for “a foeman’s bullet is sweeter than a master’s whip.”[26] However, as one might expect from an anti-materialist, Lovecraft repudiated the typical modern cause of warfare, that of fighting for mercantile supremacy, “defense of one’s own land and race [being] the proper object of armament.”[27]
Lovecraft saw Jewish representation in the arts as responsible for what Francis Parker Yockey would call “culture distortion.” New York City had been “completely Semiticized” and lost to the “national fabric.” The Semitic influence in literature, drama, finance, and advertising created an artificial culture and ideology “radically hostile to the virile American attitude.” Like Yockey, Lovecraft saw the Jewish Question as a matter of an “antagonistic culture-tradition” rather than as a difference of race. Thus Jews could theoretically become assimilated into an American cultural tradition. The Negro problem, however, was one of biology and must be recognized by maintaining “an absolute color-line.”[28]
This brief sketch is sufficient, I think, to show that H. P. Lovecraft belongs among an illustrious list of 20th century creative geniuses—including W. B. Yeats, Ezra Pound, D. H. Lawrence, Knut Hamsun, Henry Williamson, Wyndam Lewis, and Yukio Mishima—whose rejection of materialism, egalitarianism, and cultural decadence caused them to search for a vital, hierarchical alternative to both capitalism and communism, a search that led them to entertain and embrace proto-fascist, fascist, or National Socialist ideas.
Notes
[1] Zeev Sternhell, Neither Left Nor Right: Fascist Ideology in France (Princeton: Princeton University Press, 1986).
[2] Oscar Wilde, The Soul of Man Under Socialism, 1891.
[3] After the tour of C. H. Douglas to New Zealand, the banking system and usury were very well understood by the masses of people, and banking reform was a major platform that achieved Labour’s victory. As it transpired, they attempted to renege, but Lee succeeded in getting the Government to issue 1% Reserve Bank state credit to build the iconic and enduring State Housing project that in one fell swoop reduced unemployment by 75%. Lee soon became a bitter opponent of the opportunism of the Labour politicians. However the state credit, albeit forgotten by most, stands as a permanent example of how a Government can bypass private banking and issue its own credit.
[4] Erik Olssen, John A. Lee (Dunedin, New Zealand: University of Otago Press, 1977), p. 66.
[5] K. R. Bolton, Thinkers of the Right (Luton: Luton Publications, 2003).
[6] H. P. Lovecraft: Selected Letters, ed. August Derleth and James Turner (Wisconsin: Arkham House, 1976), Vol. IV, p. 93.
[7] Selected Letters, vol. IV, p. 93.
[8] Selected Letters, vol. V, p. 162.
[9] Selected Letters, vol. IV, pp. 105–108.
[10] Quoted by E. Fuller Torrey, The Roots of Treason (London: Sidgwick and Jackson, 1984), p. 138.
[11] Ezra Pound, Jefferson and/or Mussolini, 1935 (New York: Liveright, 1970), pp. 33–34.
[12] Oswald Mosley, Europe: Faith and Plan (London: Euphorion, 1958), “The Doctrine of Higher forms,” pp. 143–47.
[13] Friedrich Nietzsche, Thus Spoke Zarathustra (Middlesex: Penguin Books, 1975), “The Higher Man,” pp. 296–305. A glimpse of Nietzschean philosophy is alluded to in Lovecraft’s “Through the Gates of the Silver Key” where Carter discerns words from beyond the normal ken: “‘The Man of Truth is beyond good and evil,’ intoned a voice. ‘The Man of Truth has ridden to All-Is-One…’” (Lovecraft, The Dream Quest of Unknown Kadath [New York: Ballantine Books, 1982], “Through the Gates of the Silver Key,” p. 189).
[14] Oswald Spengler, The Decline of The West, 1928 (London: George Allen and Unwin, 1971).
[15] “Fascism . . . was a movement to secure national renaissance by people who felt themselves threatened with decline into decadence and death and were determined to live, and to live greatly.” Sir Oswald Mosley, My Life (London: Nelson, 1968), p. 287.
[16] Selected Letters, vol. IV, p. 323.
[17] H. P. Lovecraft, “Editorial,” The Conservative, vol. I, July 1915.
[18] Selected Letters, vol. IV, p. 133.
[19] Selected Letters, vol. V, pp. 330–33.
[20] Selected Letters, vol. V, p. 245.
[21] Lothrop Stoddard, The Revolt of Against Civilization: The Menace of the Underman (London: Chapman and Hall, 1922).
[22] Selected Letters, vol. IV, pp. 104–105.
[23] Selected Letters, vol. V, pp. 311–12.
[24] Selected Letters, vol. IV, pp. 15–16.
[25] Selected Letters, vol. IV, p. 22.
[26] Selected Letters, vol. IV, pp. 311–12.
[27] Selected Letters, vol. IV, p. 31.
[28] Selected Letters, vol. IV, pp. 193–95.
00:07 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres américaines, littérature américaine, etats-unis, lovecraft, 19ème siècle |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 31 août 2010
Letture e riflessioni sull'opera letteraria di Edgar Allan Poe
Letture e riflessioni sull’opera letteraria di Edgar Allan Poe
 Edgar Allan Poe nasce a Boston nel 1809 e muore a Baltimora nel 1849. La sua breve e infelice esistenza è stata caratterizzata da tre successivi, laceranti distacchi da altrettante figure femminili per lui altamente significative: la madre, morta quand’egli aveva appena tre anni (il padre li aveva entrambi abbandonati), per cui fu accolto in casa dai coniugi Allan; la signora Francesc Allan, quand’egli ne aveva venti, e che non poté neanche giungere in tempo per salutare l’ultima volta prima delle esequie; e la moglie-bambina, quella Virginia Clemm (sposata appena tredicenne), che era sua cugina prima – in quanto figlia della zia paterna Maria Clemm – e che morirà, dopo una lunga agonia, consumata dalla tubercolosi. Come scrittore si è cimentato in molti ambiti della letteratura. In quello della teoria e della critica letteraria ha scritto Fondamento del verso, 1843; La filosofia della composizione, 1846; Marginalia ed Eureka, 1849; Il principio poetico, pubblicato postumo, nel 1850. Tutte queste opere sono state studiate e tradotte in Europa, specialmente da Charles Baudelaire; in esse Poe prende posizione contro la concezione romantica della spontaneità dell’arte (sintetizzata dal pittore tedesco Caspar David Friedrich nella formula: “L’unica vera sporgente dell’arte è il nostro cuore”) e a favore di una concezione secondo la quale l’opera letteraria può essere creata come un sapiente meccanismo, montata e smontata pezzo a pezzo.
Edgar Allan Poe nasce a Boston nel 1809 e muore a Baltimora nel 1849. La sua breve e infelice esistenza è stata caratterizzata da tre successivi, laceranti distacchi da altrettante figure femminili per lui altamente significative: la madre, morta quand’egli aveva appena tre anni (il padre li aveva entrambi abbandonati), per cui fu accolto in casa dai coniugi Allan; la signora Francesc Allan, quand’egli ne aveva venti, e che non poté neanche giungere in tempo per salutare l’ultima volta prima delle esequie; e la moglie-bambina, quella Virginia Clemm (sposata appena tredicenne), che era sua cugina prima – in quanto figlia della zia paterna Maria Clemm – e che morirà, dopo una lunga agonia, consumata dalla tubercolosi. Come scrittore si è cimentato in molti ambiti della letteratura. In quello della teoria e della critica letteraria ha scritto Fondamento del verso, 1843; La filosofia della composizione, 1846; Marginalia ed Eureka, 1849; Il principio poetico, pubblicato postumo, nel 1850. Tutte queste opere sono state studiate e tradotte in Europa, specialmente da Charles Baudelaire; in esse Poe prende posizione contro la concezione romantica della spontaneità dell’arte (sintetizzata dal pittore tedesco Caspar David Friedrich nella formula: “L’unica vera sporgente dell’arte è il nostro cuore”) e a favore di una concezione secondo la quale l’opera letteraria può essere creata come un sapiente meccanismo, montata e smontata pezzo a pezzo.
Pertanto se egli si situa, per motivi cronologici, nel contesto del romanticismo, la sua poetica nondimeno si colloca piuttosto alle sorgenti del simbolismo e precorre la grande stagione decandetistica, su su fino a Borges e a quegli scrittori che tendono a vedere nella scrittura un ambito totalmente autonomo, che vive di leggi proprie, separate dalla vita quotidiana. Nella poesia si è cimentato con la raccolta giovanile Tamerlano e altre poesie, del 1827; poi con Al Aaraaf, del 1829; con Poesie del 1831; e infine con Il corvo e altre poesie, del 1845: quest’ultima è stata la sua definitiva rivelazione e gli ha procurato (a soli quattro anni dalla morte) una certa, tardiva celebrità.
Ne Il Corvo (The Raven) il poeta, immerso nello studio ove cerca di soffocoare il dolore per la perdita della donna amata, ode un fruscìo a tarda notte: apre la porta, ma non c’è nessuno; poi sente ripetersi il rumore alla finestra: la apre, e un corvo entra e si posa su un busto di Minerva, fissandolo con occhi scontillanti e quasi demoniaci. Il poeta lo interroga per dare sollievo alla propria pena, e gli chiede se riuscirà mai ad attenuare il dolore che lo trafigge, ma sempre l’uccello risponde:
“Mai più” (“Nevermore”). […]
“‘O profeta, figlio del maligno – dissi – uccello
o demone, che ti mandi il Tentatore o ti porti la tempesta,
solitario eppure indomito sopra questa desolata
incantata terra, in questa casa orrida,
ti supplico,
di’: c’è un balsamo in Galaad? Dillo, avanti, te ne supplico!’
Ed il Corvo qui: ‘Mai più!’
‘O profeta – dissi – figlio del maligno, uccello
o demone,
per il Cielo sopra noi, per il Dio di tutti e due,
di’ a quest’anima angosciata se nel Paradiso mai
rivedrà quella fanciulla che Lenore chiamano
gli angeli,
la fanciulla pura e splendida che Lenore
chiamano gli angeli!’
Ed il Corvo qui: ‘Mai più!’.
‘E sia questa tua sentenza un addio fra noi’ alzandomi
gridai ‘torna alle plutonie rive oscure e alle tempeste!
Non lasciar neanche una piuma a ricordo de tuo inganno!
Voglio stare in solitudine, lascia il busto
sulla porta!’
Disse il Corvo qui: ‘Mai più!’
Ma quel corvo non volò, ed ancora, ancora posa
sopra il busto di Minerva, sulla porta
della stanza,
ed ha gli occhi come quelli di un diavolo
che sogna,
e la luce ne proietta l’ombra sopra il pavimento.
la mia anima dall’ombra mossa sopra il
pavimento
Non si leverà – mai più! [Trad. di A. Quattrone].
Anche per la “scoperta” della poesia di Poe è stata determinante la mediazione della cultura europea, e di quella francese in modo particolare: tradotto da Mallarmé, egli è giunto nel “salotto buono” della cultura americana solo molto più tardi, dopo la prematura scomparsa. Per quasi tutta la sua vita egli era stato uno spostato, un emarginato, un giullare, ignorato dai critici letterari imbevuti di puritanesimo e di “sano” pragmatismo; eppure aveva saputo interpretare più di chiunque altro gli incubi e le nevrosi dei suoi compatrioti, proprio in quanto essi li avevano negati o rimossi. La “scoperta” di Poe da parte degli Europei, d’altronde, non significa affatto – come pure è stato detto – che Poe sia il più “europeo” degli scrittori americani: anzi, è americanissimo (e in Europa, in Scozia per la precisione, non visse che pochi anni, da bambino, al seguito degli Allan, però in collegio); ma, per una serie di ragioni storico-culturali, la letteratura europea era più matura per riceverne e comprenderne il messaggio. Poe, inoltre, è stato un giornalista molto dotato; ha collaborato con giornali e riviste quali il Courier, il Southern Literary Messanger di Richmond, il Gift ed il Graham’s Magazine: portando quest’ultimo, tanto per fare un esempio delle sue eccezionali capacità, da una tiratura di 5.000 copie ad una di
40.000, dunque otto volte superiore.
Si è poi cimentato nel romanzo e nel racconto, ed è questo l’ambito dove ha lasciato l’orma più durevole, tanto che nessuno scrittore del terrore, dopo di lui – né americano, né europeo – ha potuto evitare di fare i conti con lui, di prendere posizione rispetto alla sua figura gigantesca. Come romanziere ha scritto Le avventure di Arthur Gordon Pym, pubblicato nel 1838: resoconto di una navigazione antartica permeato d’inquietudine, di orrore e di mistero, che risente del clima di entuasiamo per le prime scoperte antartiche da parte di Russi, Britannici, Francesi e Statunitensi. Il romanzo rimane volutamente interrotto e ha stuzzicato a tal punto la fantasia delle generazioni successive, che Jules Verne volle scriverne il seguito con La sfinge dei ghiacci. Verso la fine dell’opera, infatti, il protagonista e un suo compagno d’avventura, che una inspiegabile corrente marina calda ha portato oltre la barriera dei ghiacci gallegganti, verso le acque libere del Polo Sud, intravvedono, in mezzo al volo d’innumerevoli uccelli bianchi, una gigantesca figura umana che si leva all’orizzonte, d’un candore innaturale, e si staglia torreggiante su di loro.
“5 marzo. – Il vento era completamente cessato, ma noi continuavamo a correre lo stesso verso il sud, trascinati da una corrente irresistibile. Sarebbe stato naturale che provassimo dell’apprensione per la piega che prendevano le cose, invece niente. […]
“6 marzo.- Il vapore si era alzato di parecchi gradi e andava a poco a poco perdendo la sua tinta grigiastra. L’acqua era calda più che mai, e ancora più lattiginosa di prima. Ci fu una violenta agitazione del mare proprio vicinissimo a noi, accompagnata, come al solito, da uno strano balenio del vapore e da una momentana frattura lungo la base di esso. […]
“9 marzo. – La strana sostanza come di cenere continuava a pioverci attorno. La barriera di vapore era salita sull’orizzonte sud a un’altezza prodigiosa, e cominciava ad assumere una forma distinta. Io non sapevo paragonarla altro che a una immane cateratta la quale precipitasse silenziosamente in mare dall’alto di qualche favolosa montagna perduta nel cielo. La gigantesca cortina occupava l’orizzonte in tutta la sua estensione. Da essa non veniva alcun rumore.
“21 marzo. – Una funebre oscurità aleggiava su di noi ma dai lattiginosi recessi dell’oceano scaturiva un fulgore che si riverberava sui fianchi del battello. Eravamo quasi soffocati dal tempestare della cenere bianca che si accumulava su di noi e riempiva l’imbarcazione, mentre nell’acqua si scioglieva. La sommità della cateratta si perdeva nella oscurità della distanza. Nel frattempo risultava evidente che correvamo diritto su di essa ad una impressionante velocità. A tratti, su quella cortina sterminata, si aprivano larghe fenditure, che però subito si richiudevano, attraverso le quali, dal caos di indistinte forme vaganti che si agitavano al d ilà, scaturivano possenti ma silenziose correnti d’aria che sconvolgevano, nel loro turbine, l’oceano infiammato.
“22 marzo. – L’oscurità si era fatta più intensa e solo il luminoso riflettersi delle acque della bianca cortina tesa dinanzi a noi la rischiarava ormai. Una moltitudine di uccelli giganteschi, di un livido color bianco, si alzava a volo incessantemente dietro a noi per battere, appena ci vedevano, in ritirata gridando il sempiterno Tekeli-li. Nu-Nu [un indigeno della misteriosa isola di Tsalal che i due avevano fatto prigioniero] ebbe, a quelle grida un movimento sul fondo del battello, e, come noi lo toccammo, scoprimmo che aveva reso l’ultimo respiro. Fu allora che la nostra imbarcazione si precipitò nella morsa della cateratta dove si era spalancato un abisso per riceverci. Ma ecco sorgere sul nostro cammino una figura umana dal volto velato, di proporzioni assai più grandi che ogni altro abitatore della terra. E il colore della sua pelle era il bianco perfetto della neve.” [trad. di Elio Vittorini].
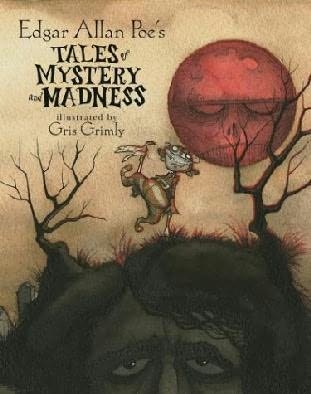 Dicevamo della lucidità, della “scientificità”della poetica del Nostro: ebbene, coloro che si son presi la briga di riportare sulla carta geografica la rotta della nave di Gordon Pym attraverso gli oceani, hanno avuto una sorpresa: congiungendone i punti, appariva nettamente la sagoma di un grande uccello con le ali spiegate – come i misteriosi uccelli bianchi che gridano il loro incessante Tekeli-li. Un caso, una semplice coincidenza? Ma Poe amava moltissimo i giochi di decrittazione, gli enigmi logici e linguistici: sempre nel Gordon Pym, il protagonista scopre, incisi sulla roccia dell’isola sconosciuta, dei caratteri apparentemente senza significato, ma che si riveleranno poi parole di antico egiziano, di etiopico, di arabo le quali accennano al segreto inaudito che si annida nella regione del Polo antartico. E tale passione per le sciarade, per i rompicapi, per l’applicazione pratica di una logica rigorosa di tipo matematico si rivela pienamente nel filone dei racconti polizieschi, particolarmente ne I delitti della rue Morgue, ne Lo scarabeo d’oro, ne La lettera rubata. Ricordi, forse, degli studi fatti a West Point, all’epoca del breve e fallimentate tentativo di farsi una carriera nell’esercito.
Dicevamo della lucidità, della “scientificità”della poetica del Nostro: ebbene, coloro che si son presi la briga di riportare sulla carta geografica la rotta della nave di Gordon Pym attraverso gli oceani, hanno avuto una sorpresa: congiungendone i punti, appariva nettamente la sagoma di un grande uccello con le ali spiegate – come i misteriosi uccelli bianchi che gridano il loro incessante Tekeli-li. Un caso, una semplice coincidenza? Ma Poe amava moltissimo i giochi di decrittazione, gli enigmi logici e linguistici: sempre nel Gordon Pym, il protagonista scopre, incisi sulla roccia dell’isola sconosciuta, dei caratteri apparentemente senza significato, ma che si riveleranno poi parole di antico egiziano, di etiopico, di arabo le quali accennano al segreto inaudito che si annida nella regione del Polo antartico. E tale passione per le sciarade, per i rompicapi, per l’applicazione pratica di una logica rigorosa di tipo matematico si rivela pienamente nel filone dei racconti polizieschi, particolarmente ne I delitti della rue Morgue, ne Lo scarabeo d’oro, ne La lettera rubata. Ricordi, forse, degli studi fatti a West Point, all’epoca del breve e fallimentate tentativo di farsi una carriera nell’esercito.
Ma i racconti ai quali è principalmente legata la fama di Poe sono, senza dubbio, quelli del mistero e del terrore: particolarmente alla raccolta Racconti del grottesco e dell’arabesco, del 1840. Solo una parte di essi si serve dell’elemento soprannaturale; tutti, però, nascono da un profondo sentimento di inquietudine, analizzato con freddo e lucido distacco, anche nelle situazioni più drammatiche e disperate. L’inquietudine, intendiamoci, può essere essenzialmente di due generi: quella metafisica e quella storica. L’inquietudine metafisica è strutturalmente legata alla condizione ontologica dell’uomo: creatura finita che anela all’infinito; come dice Sant’Agostino nelle Confessiones: “Inquietum est cor meum, donec requiescat in Te, Domine” (“inquieto è il mio cuore, finché non trova pace e riposo in Te, mio Dio”). E l’arte, per usare la terminologia del filosofo spiritualista Luigi Stefanini, è la “Parola Assoluta” che la persona finita pronunzia nel mondo dei sensibili, una parola carica di nostalgia verso la Persona Infinita dalla quale trae origine. Al contrario, l’inquietudine storica è frutto di condizioni particolari dello spazio-tempo di una determinata società; esprime l’angoscia dei momenti drammatici di trapasso dai “vecchi” valori ai “nuovi”: gli uni orma tramontati, gli altri non ancora ben delineati all’orizzonte. Una tipica età di trapasso, ad esempio, è stata quella della tarda antichità, del tardo paganesimo greco-romano: e, non a caso, essa è stata caratterizzata da una straordinaria angoscia esistenziale, da un senso di raccapriccio e di paura solo in séguito rischiarato da altre certezze. Ebbene l’inquietudine che caratterizza il mondo poetico di Poe appartiene a questo secondo tipo ed esprime, a nostro avviso, il dramma del passaggio dalla società pre-moderna alla piena modernità, caratterizzata dall’eclisse del sacro, dalla mercificazione totale dei rapporti umani, dall’efficientismo e dal produttivismo esasperati, dalla perdita del senso del limite e del mistero, dalla hybris (o dismisura) di un Logos strumentale e calcolante proteso ad affermare il suo dominio brutale sul mondo naturale, ridotto a pura riserva di beni da sfruttare e a discarica ove smaltire i prodotti di rifiuto del processo industriale. Nella letteratura anglo-americana dell’Ottocento, poi, vi è un significativo, assordante silenzio circa uno dei risvolti più terribili dell’avvento della modernità: lo sterminio del bisonte, lo sterminio dell’Indiano, vero peccatum originalis di una società nata all’insegna della democrazia e della tolleranza e che ha saputo distruggere, in pochi decenni, non solo una natura e una civiltà, ma un modo di essere, un modo di esprimere la sacralità delle cose (le Colline Nere del Dakota consacrate al Grande Spirito e prese d’assalto dall’uomo bianco in nome della sua insaziabile auri sacra fames di virgiliana memoria, la “maledetta brama dell’oro”). I grandi scrittori – Washington Irving, Hawthorne, Melville, Twain, Emerson, Thoreau, Whitman, lo stesso Poe – tacciono completamente al riguardo; pure in quel silenzio, in quella radicale rimozione, vi è un grido disperato, che è poi anche il grido del crimine commesso dall’uomo bianco contro se stesso, contro la parte migliore di sé, strangolata in nome del marcusiano homo oeconomicus.
Ma negli incubi e nei terrori dell’opera di Poe si direbbe prenda voce quel crimine rimosso, quel terribile silenzio della cultura “ufficiale”. Ed ecco i racconti del terrore di Poe, popolati da una umanità dolente e allucinata, i cui protagonisti sono altrettanti alter ego dell’autore, in cui ricorrono le sue funebri ossessioni: l’attrazione morbosa per la decadenza e la morte; la sepoltura da vivi e il ritorno dei non-morti; i torturanti sensi di colpa; la vendetta a lungo covata e ferocemente messa in opera; in una parola, il cupio dissolvi, il desiderio di auto-distruzione venato di sado-masochismo e di necrofilia, in una spirale sempre più asfittica e vorticosa, sempre più disperatamente chiusa in sé stessa.
Nel Manoscritto trovato in una bottiglia il protagonista, durante un viaggio per mare, viene trascinato dalla tempesta verso le estreme latitudini meridionali (come nel Gordon Pym), finchè il suo piccolo veliero è letteralmente travolto da una nave dalle dimensioni immense che si abbatte su di esso dall’alto di una formidabile ondata. Scaraventato a bordo della nave misteriosa, egli non tarda ad accorgersi che il suo equipaggio, che si comporta come se non lo vedesse affatto, è costituito in realtà da fantasmi, ovvero da esseri umani di un altro mondo, di un’altra dimensione. Vi è un’eco dantesca in questo racconto, un clima da epos della scoperta e della punizione che ricorda da vicino il “folle vollo” di Ulisse nel famoso XXVI canto dell’Inferno di Dante Alighieri; e anche una reminiscenza della celebre leggenda dell’Olandese Volante, il capitano di veliero del XVI secolo che, al passaggio del Capo di Buona Speranza, fu punito dalla giustizia divina per aver osato lanciare un’empia sfida alle leggi di Dio e della natura.
“Intendere l’orrore di ciò che io provo è, credo, assolutamente impossibile, e tuttavia una strana curiosità di penetrare i misteri di queste regioni spaventose ha il sopravvento persino sulla mia disperazione stessa, e certo mi riconcilierà con la visione della più orrida delle morti. È evidente che noi siamo spinti innanzi verso qualche affascinante conoscenza, verso qualche segreto mai rivelato ad alcuno, il raggiungimento del quale significa distruzione. Forse questa corrente ci conduce direttamente al Polo Sud, e devo ammettere che un’ipotesi apparentemente tanto avventata ha ogni probabilità in suo favore. Gli uomini dell’equipaggio si muovono sul ponte con passi inquieti, tremebondi, ma vi è nei loro volti una espressione più di attesa e di speranza che di apatia o di disperazione.
“Frattanto abbiamo senpre il vento in poppa e, poiché trasportiamo una mole incredibile di vele, il vascello è a volte sollevato di peso fuor del mare… Oh, orrore che non ha eguali! Il ghiaccio si apre subitamente a dritta e a manca, e noi stiamo roteando vorticosamente in immensi cerchi concentrici, torno torno agli orli di un gigantesco anfiteatro, il culmine delle cui muraglie si perde nelle tenebre e nella distanza. Ma poco tempo mi rimarrà per riflettere sul mio destino: i cerchi rimpiccioliscono rapidamente, stiamo inabissandoci a velocità pazzesca entro le fauci del vortice, e, fra un tumultuare, un muggire, un rombare di oceano e di tempesta, la nave vibra, scricchiola. Oh Dio!… Affonda!”
La situazione finale del Manoscritto viene poi pienamente sviluppata nel celebre Una discesa nel Maelstrom, ove l’orrore per le mostruose forze naturali scatenate quasi diabolicamente non è stemperato, ma anzi accresciuto dalla maniacale, incongrua lucidità con cui il protagonista – un pescatore travolto nel pauroso vortice norvegese, al laro delle Isole Lofoten – osserva ogni dettaglio della situazione e riesce perfino a coglire la dimensione estetica di quella muraglia d’acqua che si avvolge entro sé stessa – a coglierne lo spirito dell’orrido che, come pensava Schopenhauer, non è che una particolare situazione del sublime.
“Non potrò mai dimenticare il senso di terrore arcano, di orrore, di meraviglia che mi afferò non appena volsi lo sguardo a contemplare lo spettacolo che mi circondava. La barca sembrava sospesa a mezzavia, come per opera d’incantesimo, sulla superficie interna di un imbuto immenso di circonferenza, prodigioso di profondità, e le cui pareti perfettamente lisce potevano essere scambiate per ebano, non fosse stato per la rapidità vertiginosa con cui roteavano torno torno, e per la scintillante, spettrale radiosità che emanava da esse, quasi che i raggi della luna al suo colmo, da quello squarcio circolare frammezzo alle nubi che già ho descritto, sgorgassero in un fiotto di gloria dorata lungo le nere muraglie, giù, giù, sin entro i più riposti recessi dell’abisso”.
E ancora, si noti la selvaggia maestà di questo notturno lunare, degno di un Alcmane nella sua solenne, pensosa grandiosità, ma che altro non è, a ben guardare, se non un’ennesima trasposizione dell’incubo ricorrenti della sepoltura da vivo – una sepoltura liquida, nella tomba dell’oceano, non meno terrorizzante di quella in una solida bara, ma in qualche modo riscattata dalla sontuosa magnificenza spettrale che emana dalla scena nel suo insieme:
“I raggi della luna sembravano frugare in cerca del fondo stesso dell’insondabile abisso, ma io ancora non riuscivio a vedere distintamente, a causa di una fitta nebbia in cui ogni cosa era avvolta, e sulla quale si tendeva un meraviglioso arcobaleno simile all’angusto, vacillante ponte che i mussulmani dicono sia il solo passaggio tra il Tempo e l’Eternità. Questa foschia, o spuma, era senza dubbio prodotta dal cozzo delle grandi pareti dell’imbuto, ogni qualvolta esse si incontravano insieme nel fondo; ma l’ululato che saliva sino ai cieli fuor di quella nebbia io non mi arrischierò a descriverlo”.
Il protagonista de Una discesa, tuttavia, riesce miracolosamente a sopravvivere, legandosi a un barilotto e venendo poi tratto in salvo da alcuni pescatori: ma l’esperienza dell’orrido, del passaggio simbolico dal Tempo all’Eternità, lo ha segnato per sempre e precocemente invecchiato. Non è stata una morte e una rinascita di tipo iniziatico; egli è risalito dall’abisso svuotato di ogni energia, distrutto nel fisico e nello spirito. Per dirla col Nietzsche di Al di là del bene e del male: “Non puoi guardare a lungo nell’abisso, senza che l’abisso non finisca per guardare te dentro agli occhi”: e non è un’esperienza catartica, ma solo distruttiva.
“Coloro che mi issarono a bordo erano miei vecchi amici e compagni di tutti i giorni, ma non mi riconobbero più di quanto avrebbero riconosciuto un viaggiatore di ritorno dal mondo degli spettri: i miei capelli, che solo il giorno innanzi erano stati di un nero corvino, erano divenuti bianchi come tu li vedi adesso. Raccontai loro la mia avventura… ma non mi credettero. Io la ripeto a te… ma non spero che tu mi presti maggior fede di quanto me ne abbiano prestata gli allegri pescatori di Lofoten.”
Con il celeberrimo Il pozzo e il pendolo si passa da una dimensione di orrore naturale, cosmico, a un altro genere di orrore, diabolicamente umano – se ci è lecito l’ossimoro; la diabolica malignità che gli aguzzini dell’Inquisizione spagnola sanno escogitare a danno di un condannato, rinchiuso nelle loro carceri di Toledo. Dapprima l’uomo è gettato in una cella totalmente immersa nell’oscurità, ove per un puro caso evita di precipitare in un pozzo dalle profondità smisurate, insondabili, ove i suoi carnefici avrebbero voluto farlo precipitare; poi, dopo aver mangiato del cibo drogato, si risveglia legato ad un lettuccio, mentre un mostruoso pendolo dalla lama tagliente come un coltello affilatissimo, oscillando lentamente lungo tutta l’ampiezza della cella, scende millimentro dopo millimetro verso il suo petto indifeso. Egli vede avvicnarsi il terribile marchingegno ed è in grado di riflettere lucidamente, bevendo il terrore goccia a goccia e perfino calcolando quanti minuti ancora ci vorranno prima che la lama lo sfiori indi ne laceri lentamente la veste di sargia, infine gli apra il cuore. All’ultimo momento, con un misto di abilità calcolatrice e d’incredibile sangue freddo, egli riesce a liberarsi dai lacci e a sottrarsi al contatto fatale; ma solo per vedere le pareti metalliche della cella arroventarsi e poi deformarsi, restringendosi e sospingendolo sempre più verso una orribile morte. All’ultimo istante, quando tutto sembra perduto, il supplizio è interrotto. Le truppe francesi sono entrate a Toledo e il prigioniero è tratto in salvo, miracolosamente.
“La vibrazione del pendolo era ad angolo retto rispetto alla mia lunghezza. Compresi che la mezzaluna era stata disegnata per attraversare la regione del cuore. Avrebbe sfrangiato la sargia del mio saio… sarebbe ritornata, avrebbe ripetuto questa operazione… all’infinito. Nonostante la sua oscillazione di ampiezza terrificante (circa dieci metri e più) e il vigore sibilante della sua discesa, bastevole a fendere quelle stesse pareti di ferro, per parecchi minuti esso non avrebbe fatto che accentuare lo sfrangiamento della mia veste. E dinanzi a questo pensiero la mia mente sostò: non osavo andare oltre questa riflessione. Mi soffermai su questo punto con attenzione petinace… Come se in questo mio soffermarmi della mente potessi arrestare la discesa dell’acciaio. Mi forzai a pensare al brusio della mezzaluna quando fosse passata attraverso l’indumento, a quella particolare vibrante sensazione che il fruscio delle vesti produce sui nervi. Indulsi a questa frivola considerazione finché mi sentii allegare i denti.
“E intanto quell’orribile arnese scendeva… scendeva senza posa. Presi un piacere frenetico a paragonare la sua velocità discendente con quella laterale. A destra, a sinistra, innanzi, indietro, ululando come uno spirito dannato, sempre più presso al mio cuore con il passo felpato della tigre! Io alternavo le risate alle strida a seconda che predominasse questo o quel pensiero. “Giù… giù, inesorabilmente, sempre più giù! Vibrava ormai a soli pochi centimetri dal mio petto…”.
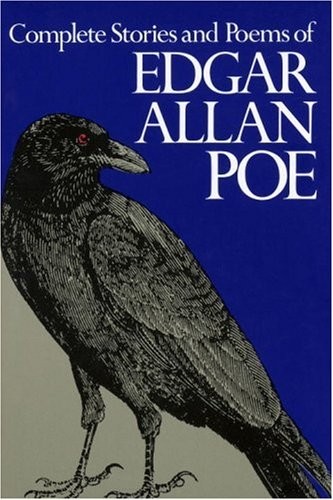 L’incubo della sepoltura da vivi è esplicitamente al centro del racconto Le esequie premature (come lo sarà in altri racconti, tra i quali Berenice, Ligeia e Il crollo della Casa Usher). Nella parte introduttiva di quest’opera, Poe sviluppa alcune riflessioni che potremmo definire filosofiche circa la difficoltà di delimitare con chiarezza la “zona grigia” che separa il regno della vita dal dominio della morte (precorrendo una analoga riflessione dell’epistemologo franco-polacco Mirko Grzimek, che alla morte e alla malattia ha dedicato, sul finire del Novecento, alcuni studi ormai entrati fra i classici del genere).
L’incubo della sepoltura da vivi è esplicitamente al centro del racconto Le esequie premature (come lo sarà in altri racconti, tra i quali Berenice, Ligeia e Il crollo della Casa Usher). Nella parte introduttiva di quest’opera, Poe sviluppa alcune riflessioni che potremmo definire filosofiche circa la difficoltà di delimitare con chiarezza la “zona grigia” che separa il regno della vita dal dominio della morte (precorrendo una analoga riflessione dell’epistemologo franco-polacco Mirko Grzimek, che alla morte e alla malattia ha dedicato, sul finire del Novecento, alcuni studi ormai entrati fra i classici del genere).
“L’infelicità vera, l’afflizione suprema è delimitata, non diffusa. E che le estreme ambasce dell’agonia siano sopportate dall’uomo individuo, non mai dall’uomo massa… sia ringraziato di questo un Dio misericordioso! Essere seppelliti ancora vivi è senza dubbio il più spaventoso di questi estremi che mai sia toccato in sorte a un essere mortale. Che ciò sia accaduto frequentemente, assai frequentemente, non sarà certo negato da color che pensano. I confini delimitanti la vita dalla Morte sono innegabilmente tenebrosi e vaghi. Chi può dire dove quella finisce e dove questa incomincia?”
Il racconto L’appuntamento è un gotico veneziano, un “notturno” dagli ingredienti un po’ convenzionali, sul quale non ci soffermeremo in questa sede. Ne approfittiamo invece per fare una riflessione di carattere generale. Non tutto quel che ha scritto Poe è arte; vi sono cose che ha scritto sotto l’urgenza della necessità economica (era “un forzato della penna”, un po’ come – in tutt’altro ambito e su tutt’altro piano – il nostro Emilio Salgàri -; e doveva fare i conti con i gusti del pubblico, che, in fatto di terrore, è sovente di palato alquanto grossolano. L’epoca in cui visse Poe è caratterizzata dall’avvento di una situazione del tutto nuova per lo scrittore. Scomparsa la committenza tradizionale, ora egli è a tu per tu con un pubblico molto più vasto ma anche più indifferenziato. Per tale ragione egli è più libero che in passato; ma anche, paradossalmente, più vincolato: perchè fra lui e il pubblico vi è il diaframma dell’industria editoriale, retta dalle ferree logiche del mercato (ancora la produzione, ancora l’homo oeconomicus: vera e grande maledizione della modernità); ed è essa il suo concreto interlocutore. Poe, per carattere e per convinzioni, intendeva l’arte come una sfera del tutto autonoma, e della sua arte di scrittore volle vivere, fin da giovanissimo, affrontando ogni sorta di difficoltà per non dover scendere a compromessi; ma è un fatto che i compromessi, specialmente come giornalista, dovette accettarli, in maggiore o minor misura; e la sua vasta opera letteraria, nella sua differente qualità artistica, ne mostra i segni più d’una volta. Ma torniamo ai racconti del terrore.
Con Berenice entriamo nel vivo di uno dei temi dominanti delle sue ossessioni erotiche: l’attrazione-repulsione per la donna esangue, spettrale, vera e propria controfigura della morte e della propria ansia di auto-distruzione; donna verso la quale si sente attratto – come il protagonista del notevole romanzo Fosca dello scapigliato Iginio Ugo Tarchetti – non già a dispetto dei segni evidenti della malattia, del decadimento e della prossima fine, ma appunto per quei segni: confine sottile, e tuttavia decisivo, fra l’eros “normale” e l’eros “sadico-anale” (direbbe Freud). Non aveva forse sostenuto, Poe, nella sua Filosofia della composizione, che “la morte di una bella donna è senza dubbio l’argomento più poetico del mondo”? (Del resto, questione di gusti; Virgilio, dal canto suo, avrebbe certamente ribattuto che l’argomento più è offerto dalla morte dei bei giovinetti, come i vari Eurialo, Niso, Lauso e Pallante attestano, imperversando nella seconda parte dell’). Sicché il binomio Eros- Thanatos, in Poe, non è mai direzionato dal primo al secondo elemento, bensì, immancabilmente, dal secondo al primo: è attraverso il presentimento della loro morte vicina che i protagoinisti maschili dei suoi racconti – indifferenti o solo distaccatamente ammirati in senso estetico allorché le fanciulle, agili e leggiadre, godevano di apparente buona salute – s’infiammano poi di un sinistro, incofessabile desiderio; spesso concentrato non sull’insieme della loro persona, ma – feticisticamente – su un particolare anatomico, su un dettaglio, come i denti, appunto, in Berenice, o gli occhi in Ligeia; e, per quel dettaglio, arrivano a compiere azioni orribili e inconfessabili.Eneide
“Era frutto della mia immaginazione eccitata, o dell’influenza nebbiosa dell’atmosfera, o del crepuscolo incerto della stanza, o erano forse i grigi panneggi che cadevano in pieghe attorno alla sua figura, che provocavano in questa un aspetto così vacillante e vago?- si chiede, con sgomento, il protagonista di Berenice. – “Non saprei dire. Ella non proferiva parola, e io… neppure con uno sforzo sovrumano sarei riuscito a pronunciare una sola sillaba. Un brivido di ghiaccio mi corse per le ossa; mi sentii opporesso da una sensazione d’insopportabile angoscia; una curiosità divorante mi pervase l’anima, e ricadendo all’indietro sulla sedia rimasi per qualche tempo immobile e senza fiato, gli occhi fissi sulla sua persona. Ahimé! La sua emaciatezza era estrema, e in tutto il suo aspetto non vi era più neppure una lontana traccia dell’antica creatura. Alla fine il mio sguardo bruciante si posò sul suo viso.
“La fronte era alta, pallidissima, stranamente serena.; e i capelli un tempo color del giaietto ricadevano parzialmente su di essa adombrando le tempie cave d’innumerevoli riccioli ora d’un giallo vivo e sgradevolmente discordanti nel loro fantastico aspetto con la malinconia predominante nelle sembianze di lei. Gli occhi erano senza vita, opachi, apparentemente privi di pupille, e io mi ritrassi involontariamente dalla loro vitrea fissità per contemplare le labbra sottili, affilate. Queste si aprirono, e in un sorriso di particolare significato i denti della mutata Berenice si dischiusero lentamente ai miei occhi. Volesse il cielo che io non li avessi veduti, o che dopo quell’attimo in cui io li vidi, fossi morto!”
Poco dopo Berenice muore e viene sepolta, forse con troppa precipitazione; ma ormai l’anima del protagonista è irrimediabilmente stregata dalla visione di quei denti bianchissimi, che la possiedono per mezzo di un fascino malsano. Nella pagina finale del racconto, la scena acquista gradualmente l’orribile chiarezza di una rivelazione che coglie di sorpresa lo stesso protagonista: in stato di sonnambulismo, egli si rende conto di aver commesso un atto esecrando e indicibile.
“Sul tavolo accanto a me bruciava una lampada, e accanto a questa era posata una piccola scatola. Non presentava alcuna caratteristica particolare e già io l’avevo veduta molte altre volte, essendo di proprietà del nostro medico di famiglia; ma come era venuta a finire lì, sul mio tavolo, e perché rabbrividivo nel guardarla? Non sapevo in alcun modo spiegarmi questo mio stato d’animo, finché i miei occhi caddero sulle pagine aperte di un libro, e precisamente su una frase sottolineata in esso. Erano le strane e pur semplici parole del poeta Ebn Zaiat: ‘Dicebant mihi sodales si sepulchrum amicae visitarem, curas mea aliquantulum fore levatas.‘ Perché dunque nello scorrere quelle poche righe i capelli mi si rizzarono sul capo, e il sangue del mio corpo si rallegrò entro le mie vene?
“In quella si intese all’uscio della biblioteca un bussare sommesso, e pallido come l’abitante di una tomba un domestico entrò in punta di piedi. Aveva lo sguardo alterato dalla paura, e si rivolse a me con voce tremante, soffocata, bassissima. Che cosa mi disse? Non afferrai che alcune frasi rotte. Mi narrò di un grido forsennato che aveva squarciato il silenzio della notte, che i familiari si erano radunati, che ricerche erano state fatte in direzione del grido, e a questo punto i suoi accenti divennero paurosamente distinti, mentre egli mi sussurrava di una tomba violata, di un corpo avvolto nel sudario sfigurato, eppure ancora respirante, ancora palpitante, ancora vivo. Parlando, il domestico appuntò l’indice contro i miei abiti; erano coperti di fango, e tutti ingrommati di sangue. Io non parlai, ed egli mi prese dolcemente la mano: era tutta segnata dall’impronta di unghie umane. Rivolse quindi la mia attenzione a un oggetto appoggiato contro la parete; lo fissai per alcuni minuti: era una vanga. Con un urlo, balzai verso il tavolo, afferrai la scatola che vi era posata sopra. Non ebbi però la forza di aprirla; tremavo tanto che essa mi scivolò di mano e cadde pesantemente frantumandosi in mille pezzi. Da essa, con un rumore secco, crepitante, uscirono rotolando alcuni strumenti di chirurgia dentaria, mescolati a trentadue piccole cose bianche, eburnee, che si sparsero qua e là sul pavimento.”
Dunque, l’uomo ha strappato uno ad uno i denti di Berenice, lottando con la donna ancor viva, ridestata – probabilmente – dal dolore provocatole; e venendo da lei graffiato; poi ha riportato in casa, e nascosto nella scatoletta, il suo prezioso e innominabile bottino. Il risvolto più intrigante del racconto sta proprio in questa dimensione inconscia dell’io del protagonista: il quale scopre, con raccapriccio, di aver fatto qualcosa che la sua coscienza desta non avrebbe mai osato nemmeno concepire.
In Berenice, quindi, manca l’elemento soprannaturale del terrore; in Morella esso è adombrato alla fine della vicenda perché, dopo aver sepolto successivamente la moglie e, molti anni dopo, la figlia – a lei terribilmente somigliante, e alla quale aveva imposto lo stesso nome -, il protagonista maschile scopre che la bara della “prima” Morella era vuota e si rende così conto che la “seconda” non era altri che la donna ritornata, inesplicabilmente, dall’altro mondo. Morella, diafana e taciturna creatura immersa nella scienza proibita di saperi antichissimi, prima di ammalarsi esercita uno strano fascino intellettuale sull’uomo, fascino che diviene apertamente sensuale solo dopo la morte di lei.
“In seguito, allorché, meditando assiduamente su pagine proibite, io sentivo accendersi entro di me uno spirito proibito, Morella soleva porre la sua fredda mano sulla mia, e frugare tra le ceneri di una filosofia morta qualche strana, singolare parola, il cui misterioso significato s’imprimeva bruciante nella mia memoria. Allora, per ore e ore, io indugiavo al suo fianco, inebriandomi della musica della sua voce, sino a quando, a un tratto, la sua musicalità si soffondeva di terrore. Allora un’ombra cadeva sulla mia anima, e io impallidivo e rabbrividivo interiormente a quegli accenti troppo ultraterreni. Allora la gioia si tramutava improvvisamente in orrore, e il supremamente bello si faceva ributtante, così come Hinnon divenne Gehenna”.
Ancora una volta, dunque, la linea ambigua e sottilissima che separa il sublime dall’orrido; ma, questa volta, considerata nel suo movimento dal primo al secondo, e non viceversa (come nel paesaggio naturale de Una discesa nel Maelstrom). La parte più intensa e originale del racconto, tuttavia, è quella in cui Poe descrive il sentimento torbido, tenebroso con cui il protagonista segue le ultime fasi della malattia mortale di Morella (la prima), attendendone la morte con un inconfessabile desiderio di liberazione – primo seme di quel futuro senso di colpa che, come nel caso di Roderick Usher, renderà particolarmente amari e terribili i giorni successivi al funebre evento.
“Dovrò dunque dire che attendevo con un desiderio ansioso, divorante, il momento del trapasso di Morella? Eppure è vero, ma il fragile spirito si avviticchiò al suo abitacolo di creta, per molti giorni, per molte settimane e tediosi mesi, sino a che i miei nervi tormentati ottennero il dominio della mia mente, e il ritardo mi infuriò, e con cuore demoniaco maledissi i giorni, le ore, gli amari momenti che sembravano allungarsi senza fine mentre la sua dolce vita declinava così come si allungano le ombre nello smorire del giorno”.
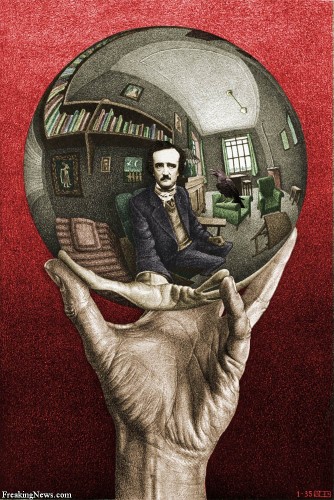 Il binomio Eros-Thanatos si colora qui di evidenti tracce di sadismo e di inconscia necrofilia, poiché desiderare l’affrettarsi della morte di Morella significa anche pregustare il momento in cui ella non sarà che un corpo abbandonato, indifeso, un corpo interamente alla mercé del maschio: così come il corpo di Pentesilea, dopo essere stato trafitto a morte, accende il desiderio di Achille sotto le mura di Troia, e lo spinge all’estremo oltraggio della sua postuma bellezza.
Il binomio Eros-Thanatos si colora qui di evidenti tracce di sadismo e di inconscia necrofilia, poiché desiderare l’affrettarsi della morte di Morella significa anche pregustare il momento in cui ella non sarà che un corpo abbandonato, indifeso, un corpo interamente alla mercé del maschio: così come il corpo di Pentesilea, dopo essere stato trafitto a morte, accende il desiderio di Achille sotto le mura di Troia, e lo spinge all’estremo oltraggio della sua postuma bellezza.
In Ligeia, il particolare anatomico che scatena il morboso interesse del protagonista sono gli occhi; e Ligeia, del resto, si rivelerà una donna-vampiro, una non-morta (ispirando, probabilmente, il filone baudelaireiano della donna-vampiro nei Fleurs du Mal): non una vittima, come la sventurata Berenice, bensì una creatura immortale e pericolosa.
“Senza Ligeia ero come un bambino che si aggira tastoni la notte. La sua presenza, le sue letture semplicemente, rendevano vividamente luminosi i molteplici misteri del tradscendentalismo nel quale eravamo immersi. Senza il radioso splendore dei suoi occhi, le lettere, fiammee e dorate, divenivano più opache del piombo saturnio. Ed ecco che quegli occhi brillarono sempre meno di frequente sulle pagine da me compulsate. Ligeia si ammalò. I suoi occhi smarriti lucevano di un troppo… troppo glorioso fulgore: le pallide dita di lei assunsero la translucida cereità della tomba, le vene azzurrine della sua eccelsa fronte si inturgidivano e si afflosciavano d’impeto con l’avvicendarsi della finanche più lieve emozione. Compresi che ella sarebbe morta, e lottai disperatamente in ispirito con il funebre Azrael.”
Più tardi, alla morte di Ligeia, il protagonista ne veglia penosamente il cadavere; ma è una notte di orrore in cui l’impensabile può accadere, in cui i morti possono ridestarsi.
“Il cadavere, ripeto, si muoveva, e adesso più energicamente delle altre volte. I colori della vita ne invermigliavano con inconsueta energia il volto, le membra si rilassarono e, tranne che per le palpebre ancora pesantemente abbassate e per le acconciature e i panneggiamenti tombali che ancora davano alla figura un aspetto macabro, io avrei potuto immaginare che Rowena si fosse davvero liberata e per sempre dai legami della Morte. Ma se io non potevo accettare del tutto questa realtà neppure in quel momento, non mi fu più possibile dubitare allorché, levandosi dal letto, e vacillando con deboli passi, con occhi chiusi,, con l’atteggiamento di chi è reso attonito da un sogno, la cosa avvolta nel sudario avanzò audacemente, tangibilmente, sin nel mezzo della stanza”.
Ne Il crollo della casa degli Usher esiste una misteriosa, inesplicabile relazione tra l’antica dimora immersa nella nebbia dello stagno che la circonda, fatta di antichissime pietre solcate da una fenditura quasi impercettibile, e tuttavia nettissima, che l’attraversa tutta obliquamente; l’ultimo rampollo dell’antica casata, sir Roderick, sfibrato da una indefinibile malattia, o meglio somma di malattie, consistente – oltre che in una sindrome maniaco-depressiva, in una estrema, sorprendente acutizzazione dei cinque sensi, per cui egli può indossare solo abiti di un certo tessuto e vive nell’eterna penombra, al riparo da luci e da suoni troppo forti (dato che percepisce nettamente anche quelli più impercettibili); e la sorella gemella di lui, lady Madeline, a sua volta afflitta da una sconosciuta malattia, pallido fantasma che si spegne pochi giorni dopo l’arrivo del narratore, un vecchio amico d’infanzia di Roderick chiamato da una lettera d’aiuto quasi disperata. Il racconto è stato sezionato ed analizzato in termini di psicanalisi classica da un’allieva diretta di Freud, Maria Bonaparte, principessa di Grecia; colei che aiutò il maestro a fuggire dall’Austria invasa dai nazisti mediante l’Anschluss del 1938. Per lei, il dramma di Poe – qui sdoppiato nei due personaggi di Roderick e del narratore – consiste nell’amore incestuoso per la sorella e nel tradimento della madre (la madre perduta nella prima infanzia, “tradita” simbolicamente con la sposa-bambina Virginia), dunque in un senso di colpa che culmina nella catastrofe finale, in cui Roderick, Madeleine e la casa- utero di entrambi vengono distrutti simultaneamente. Anche qui, infatti, abbiamo una sepoltura affrettata della sventurata Madeline; anche qui la morta si ridesta per tornare dal fratello e condurlo a morte con sé, vittima del terrore che la sua apparizione gli suscita.
“Durante un giorno triste, cupo, senza suono, verso il finire dell’anno, un giorno in cui le nubi pendevano opprimentemente basse nei cieli, io avevo attraversato solo, a cavallo, un tratto di regione singolarmente desolato, finché ero venuto a trovarmi, mentre già si addensavano le ombre della sera, in prossimità della malinconica Casa degli Usher. Non so come fu, ma al primo sguardo che io diedi all’edificio, un senso intollerabile di abbattimento invase il mio spirito. Dico intollerabile poiché questo mio stato d’animo non era alleviato per nulla da quel sentimento che per essere poetico è semipiacevole, grazie al quale la mente accoglie di solito anche le più tetre immagini naturali dello sconsolato e del terribile. Contemplai la scena che mi si stendeva dinanzi, la casa, l’aspetto della tenuta, i muri squallidi, le finestre simili a occhiaie vuote, i pochi giunchi maleolenti, alcuni bianchi tronchi d’albero ricoperti di muffe: contemplai ogni cosa con tale depressione d’animo ch’io non saprei paragonarla ad alcuna sensazione terrestre se non al risveglio del fumatore d’oppio, l’amaro ritorno alla vita quotidiana, il pauroso squarciarsi del velo. Sentivo intorno a me una freddezza, uno scoramento, una nausea, un’invincibile stanchezza di pensiero che nessun pungolo dell’immaginazione avrebbe saputo affinare ed esaltare in alcunché di sublime. Che cos’era, mi soffermai a riflettere, che cos’era che tanto m’immalinconiva nella contemplazione dela Casa degli Usher?”
Nel corso di un drammatico colloquio, Roderick fnisce per rivelare all’amico -in parte – i terrori paurosi di cui è vittima, e profetizza l’approssimarsi della propria, inevitabile fine.
“Mi avvidi che era schiavo, legato mani e piedi, di una forma anomala di terrore. “Io morirò – mi disse – dovrò morire in questa disperata follia. Così, così, non altrimenti, mi perderò. Temo gli avvenimenti del futuro non di per se stessi, ma per i loro risultati. Rabbrividisco al pensiero di un fatto qualsiasi, anche il più comune, che possa operare su questa agitazione intollerabile del mio spirito. In realtà non rifuggo dal pericolo, se non nel suo effetto assoluto, cioè il terrore. In questo senso di smarrimento dei nervi, in questa pietosa condizione, temo che spraggiungerà presto o tardi il momento in cui mi vedrò costretto ad abbandonare la vita e la ragione insieme in qualche conflitto con il sinistro fantasma della paura”.
Ma non è un fatto qualsiasi, non è un conflitto con un fantasma indifferenziato quello che porta Roderick Usher alla rovina, bensì un evento preciso e una colpa (o un desiderio) inconfessabile: le esequie premature della sorella e il ritorno vendicativo di lei dalla cripta ove il suo corpo è stato momentaneamente deposto, in attesa della sepoltura definitiva. Durante una notte da tregenda, quando la tempesta spazza la casa e l’aria è satura di elettricità e di bagliori delle scariche temporalesche, l’amico cerca disperatamente di distrarre le angosce inenarrabili del padrone di casa e gli legge – invero poco opportunamente – la drammatica storia di Etelredo, l’eroe celtico; storia il cui finale sembra ricalcare e rievocare i terrori da cui l’animo di Roderick è sempre più turbato. Alla fine, questi erompe in un grido di disperazione e di raccapriccio:
“Non l’ho udito? Certo che l’ho udito! E lo odo ancora. Da tanto… tanto… tanto. Da molti minuti, da molte ore, da molti giorni, io lo odo, e tuttavia non ho osato… oh, pietà di me, miserabile sciagurato che sono! Non osavo… non osavo parlare! L’abbiamo calata nella tomba viva! Non ti dicevo che i miei sensi sono acutissimi? Ebbene ti dico adesso che io ho inteso persino i suoi primi deboli movimenti nella cavità del sarcofago. Vi ho avvertiti… molti, molti giorni fa… e tuttavia non osavo… non osavo parlare! Ed ecco che… stanotte… Ethlred… Ah! Ah! L’abbattersi dell’uscio dell’eremita, e l’urlo di morte del drago, e il clangore dello scudo!… Vuoi dire piuttosto l’infrangersi della sua bara, il suono stridente dei cardini di ferro della sua prigione, il suo dibattersi entro l’arcata foderata di rame della cripta! Oh, dove fuggire? Non sarà ella qui tra poco? Non sta forse affrettandosi per rimproverarmi la mia precipitazione? Forse che non ho inteso il suo passo sulle scale? Non distinguo forse lo spaventoso pesante battito del suo cuore? Pazzo! – A questo punto balzò in piedi come una furia e urlò queste parole come se nello sforzo esalasse tutta la sua anima: – Pazzo! Ti dico che ella sta ora in piedi fuori dell’uscio!
“Quasi che la sovrumana energia della sua voce contenesse la potenza evocatrice di un incantesimo, gli enormi antichi pannelli che egli additava, dischiusero lentamente, in quel medesimo istante, le loro poderose nere fauci. Fu senza dubbio l’opera dell’uragano infuriante; ma ecco che fuor di quell’uscio si ergeva veramente l’alta ammantata figura di lady Madeline Usher. Il suo bianco sudario era macchiato di sangue, e su tutto il suo corpo emaciato apparivano evidenti i segni di una disperata lotta. Per un attimo ella rimase tremante, vacillante sulla soglia, poi con un gemito sommesso e prolungato cadde pesantemente sul corpo del proprio fratello e nei suoi violenti e ormai supremi spasimi agonici lo buttò al suolo cadavere, vittima dei giustificati terrori che lo avevano agitato”.
“Da quella camera e da quella casa io fuggii inorridito. L’uragano infuriava ancora in tutta la sua collera mentre io attraversavo l’antico sentiero selciato. A un tratto rifulse sul viottolo una luce abbagliante e io mi volsi a guardare donde poteva provenire un così insolito fulgore, poiché dietro di me avevo soltanto l’immensa casa e le sue ombre. Il chiarore proveniva dalla luna calante, al suo colmo, sanguigna, che ora splendeva vividamente attraverso quell’unica fessura appena discernibile di cui ho già parlato e che si stendeva dal tetto dell’edificio in direzione irregolare, serpeggiante, sino alla sua base. Mentre guardavo, questa fessura rapidamente si allargò, il turbine di vento infuriò in supremo anelito, tutta l’orbita del pianeta si rivelò improvvisa alla mia vista, il mio cervello vacillò, mentre i miei occhi vedevano le possenti mura spalancarsi, s’intese un lungo tumultuante urlante rumore simile al frastuono di mille acque, e il profondo fangoso stagno ai miei piedi si chiuse cupo e silenzioso sui resti della Casa degli Usher”.
Nel racconto La maschera della Morte Rossa, di ambientazione apparentemente italiana, si narra di come il principe Prospero si rinchiude con un migliaio di amici e cortigiani in un formidabile castello, follegggiando di festa in festa mentre, tutt’intorno, una spaventosa epidemia di peste falcidia la popolazione, trasformando le sue vittime in altrettante orribili maschere, rosse per le chiazze sanguinolente che si diffondono su tutto il corpo. Ma un giorno, al culmine della festa, mentre un orologio batte ossessivamente le ore della notte suscitando oscuri presentimenti, un ospite sconosciuto si presenta ai convitati, vestito con le lacere vesti e con le orrende sembianze della Morte Rossa, suscitando un generale moto d’indignazione e di orrore.
“Anche per gli esseri più perduti, per i quali la vita e la morte sono egualmente motivo di beffa, esistono cose di cui non è possibile beffarsi. Tutti gli astanti insomma sentivano ormai che nel costume e nel portamento dello straniero non vi erano né spirito né decenza. La figura era alta e scarna, e avvolta da capo a piedi nei vestimenti della tomba. La maschera che ne nascondeva il viso era talmente simile all’aspetto di un cadavere irrigidito che anche l’occhio piiù attento avrebbe stentato a scoprire l’inganno. Eppure tutto ciò avrebbe potuto essere sopportato, se non approvato, dai gaudenti forsennati che si aggiravano per quelle sale: ma il travestimento aveva spinto tant’oltre la sfrontatezza da assumere le sembianze della ‘morte rossa’. Le sue vesti erano intrise di sangue, e la sua vasta fronte e tutti i lineamenti della sua faccia erano spruzzati dell’orrore scarlatto”.
Sdegnato, il principe ha un moto di ribellione, ma un inspiegabile terrore lo paralizza, insieme ai cortigiani, mentre lo straniero si allontana in mezzo ai convitati, attraversando una dopo l’altra le sette stanze colorate di un’ala poco frequentata del castello: la sala turchina, poi la purpurea, la verde, l’arancione, la bianca, la violetta e, ultima, la paurosa sala nera, done provengono i sinistri rintocchi dell’orologio a pendolo. Il principe Prospero, riavutosi dallo smarrimento e reso pazzo dalla vergogna per quella momentanea viltà, si slancia all’inseguimento armato di spada; ma, raggiunto lo straniero nella sala nera, un urlo d’agonia esce strozzato dalla sua gola, e il suo corpo si abbatte al suolo senza vita. Allora, raccogliendo il coraggio della disperazione, i suoi cortigiani si precipitano a loro volta nella sala decisi a vendicarlo, ma solo per rendersi conto, con inesprimibile terrore, che lo straniero non è affatto vestito in maschera: sotto il sudario non c’è alcuna forma tangibile, poiché egli è la Morte Rossa in persona, ed è giunto fra loro per perderli tutti.
“E allora tutti compresero e riconobbero la presenza della Morte Rossa giunta come un ladro nella notte, e ad uno ad uno i gaudenti giacquero nelle sale irrorate di sangue delle loro gozzoviglie, e ciascuno morì nell’atteggiamento disperato in cui era caduto. E la vita della pendola d’ebano si estinse con quella dell’ultimo dei baldorianti. E le fiamme dei tripodi si spensero. E l’Oscurità, la Decomposizione e la Morte Rossa regnarono indisturbate su tutto”.
Ne Il cuore rivelatore non compare alcun elemento soprannaturale, si tratta di una storia basata unicamente sulla psiche malata del protagonista; pure, Poe sa tendere a un punto tale l’arco della lucida, ossessionante analisi dei meandri tortuosi della psiche umana, da conferire al racconto un tono altamente impressionante e drammatico. Un vecchio ha preso in casa un giovane uomo, non si sa bene se come figlio adottivo o come servitore; ma quest’ultimo è letteralmente ossessionato da un particolare anatomico del padrone di casa: un occhio dalla palpebra velata, che gli ricorda un orribile occhio di avvoltoio. Il pregio maggiore di questo racconto consiste nel contrasto fra l’estrema, meticolosa lucidità con cui il protagonista analizza la situazione, agisce e descrive i fatti, e con cui rifiuta di essere considerato pazzo “perché i pazzi non sanno di esserlo”, mentre lui “ode tutte le cose del cielo e della terra” (vengono in mente le “voci” dei grandi santi e dei mistici, e come sia sottile il filo che le separa da stati di coscienza alterati di origine patologica), e l’abisso di feroce follìa omicida in cui egli si abbandona, andando incontro al suo inevitabile destino di auto-distruzione.
” È impossibile dire come l’idea mi sia entrata per la prima volta nel cervello. Ma non appena l’ebbi concepita mi ossessionò notte e giorno. Scopo non ne avevo. Odio neppure. Volevo bene al vecchio. Non mi aveva mai fatto del male. Non mi aveva mai insultato. Non desideravo il suo oro. Credo fosse il suo occhio! Sì, fu proprio così! Aveva l’occhio di un avvoltoio,un occhio pallido azzurro, coperto di una pellicola. Ogni volta che esso si posava su di me il mio sangue si raggelava, e così per gradi, oh, per gradi molto lenti, io decisi di togliere la vita al vecchio, e sbarazzarmi così per sempre di quell’occhio”.
Di notte, quando il vecchio dorme, il protagonista si avvicina piano piano alla sua camera, ne socchiude l’uscio con infinite precauzioni, indi proietta il raggio di una lanterna cieca sull’occhio di avvoltoio, restando inorridito e affascinato a contemplarlo, per ore ed ore.
Per sette notti consecutive, a mezzanotte, il folle rito si ripete: l’uomo ha già deciso di compiere il delitto, ma ogni volta rimanda, perché nel sonno l’occhio del vecchio rimane chiuso e appare normale; e non è il vecchio ch’egli vuole uccidere, ma il suo Occhio. Chi ha un poco di familiarità con le pagine della cronaca nera di questi ultimi anni avrà colto l’analogia con alcuni tremendi delitti, originati da una fissazione maniacale da parte dell’omicida, convinto di essere inesplicabilmente ma mortalmente minacciato da qualcosa che risiede nella sua vittima, qualcosa che egli non sa precisare, ma che “le voci” gli ordinano di eliminare per sempre. In genere, si tratta di delitti maturati nell’ambiente della magia nera e degli adoratori del diavolo: le “voci”, in questi casi, svolgono una lenta, metodica istigazione al delitto. Delitto che resta inspiegabile in termini razionali, poiché non è giustificato da moventi razionalmente riconoscibili; e anche il furto, ammesso che vi sia, non appare che una messa in scena per dare plausibilità all’assassinio. Ma nel racconto di Poe le “voci” non sono meglio precisate, e nulla suggerisce che vi sia un’ispirazione diabolica o un qualunque elemento soprannaturale. Anche la percezione dei battiti del cuore, che – come suggerisce già il titolo del racconto – provocheranno la scoperta del delitto, può avvenire solo nella fantasia malata del protagonista, sconvolto dal senso di colpa e da oscure manie di persecuzione.
“Dopo aver aspettato a lungo, con infinita pazienza, senza averlo udito riadagiarsi, decisi di socchiudere, oh, appena appena, una sottilissima fenditura nella lanterna. L’aprii dunque, non potete immaginare con quanta, quanta cautela, sinché un sottilissimo tenuissimo raggio, simile al filo d’un ragno, balzò fuor della fenditura e cadde in pieno sull’occhio d’avvoltoio. Era aperto, tutto aperto, completamente spalancato, e nel fissarlo la furia mi invase. Lo vedevo distintissimamente, tutto di un azzurro opaco, con quell’odioso velo che lo ricopriva e che faceva raggelare persino il midollo delle mie ossa; ma non potevo vedere altro del vecchio, né della sua faccia, né del suo corpo, poiché avevo rivolto il raggio come per istinto su quell’unico maledetto punto”.
Così, destato dal rumore, il vecchio si sveglia e grida spaventato, spalancando l’occhio deforme; e il protagonista, infuriato a quella vista, si slancia contro di lui e lo sopprime. Poi, davanti ai poliziotti che alcuni vicini hanno indirizato in quella casa, recita con perfetto sangue freddo la commedia dell’ignaro domestico: li invita a visitare l’abitazione, a fugare ogni sospetto. I resti del vecchio, atrocemente sezionato, giacciono sotto i palchetti di legno del pavimento, e quest’ultimo è stato ripulito e riassestato così bene, che nulla all’esterno trapela. Spinto da una baldanza insensata, da un isterico desiderio di trionfo, l’uomo trattiene deliberatamente i poliziotti, soffermandosi proprio nel punto ove giacciono i macabri resti. Ma ecco che al suo udito finissimo e sovreccitato cominciano a giungere i battiti del cuore della sua vittima: assurdamente, inspiegabilmente; e divengono sempre più forti, sempre più forti. Per un po’ egli tenta di coprirli con le sue parole; ma intanto una crescente agitazione si impadronisce di lui, e i suoi gesti e i suoi discorsi si fanno sempre più strani e alterati. Alla fine il battito è divenuto un rombo assordante, ed egli è convinto che anche gli altri lo odano, ma fingano il contrario per farsi beffe di lui, per deriderlo.
“Senza dubbio dovevo essere diventato pallidissimo, ma seguitavo a discorrere sempre più animatamente, a alzando il tono della mia voce. Nondimeno il rumore aumentava, e che cosa potevo fare? Era un rumore sommesso, soffocato, veloce, assomigliava moltissimo al rumore che fa un orologio quando è avvolto nel cotone. Ansimai: mi sentivo il fiato mozzo; e tuttavia i poliziotti non lo avevano avvertito. Parlai ancora più in fretta, con irruenza ancora maggiore, ma il rumore aumentava inesorabilmente. Mi alzai e presi a discutere di sciocchezze, in tono di voce altissimo e gesticolando violentemente, ma il rumore cresceva implacabile. Perché non se ne andavano? Incominciai a passeggiare innanzi e indietro a lunghi passi, quasiché i discorsi di quegli uomini mi avessero infuriato, ma il rumore cresceva, cresceva sempre. Oh, Dio! Che cosa potevo fare? Schiumavo, vaneggiavo, bestemmiavo! Volsi di scatto la seggiola su cui mi ero messo a sedere, la trascinai sulle tavole, ma il rumore copriva ogni cosa aumentando continuamente. Si faceva sempre più forte, sempre più forte, sempre più forte! E tuttavia gli uomini seguitavano a discorrere piacevolmente, e sorridevano. Era mai possibile che non udissero? Dio onnipotente! No, no! Certo che lo udivano! Sospettavano! Sapevano! Si beffavano della mia disperazione! Questo pensai, e questo penso. Ma qualsiasi cosa era meglio dell’angoscia mortale che mi attanagliava! Qualsiasi cosa era più tollerabile di quella derisione! Non potevo più sopportare quei sorrisi ipocriti! Compresi che dovevo urlare o altrimenti sarei morto! Ed ecco, ancora! Ascoltate! Più forte! Più forte! Più forte! Più forte!
“- Mascalzoni! – urlai, – smettetela di fingere! Confesso il delitto! Togliete quelle tavole! Qui, qui! È il battito del suo odioso cuore!”
La situazione finale de Il cuore rivelatore si ritrova in un altro celebre racconto del terrore di Poe, Il gatto nero. Qui un uomo, dedito all’alcool e ai disordini, dapprima uccide crudelmente il proprio gatto, impiccandolo a un albero; poi si salva a stento dall’incendio della propria casa, mentre sulla parete semi-carbonizzata appare la sagoma gigantesca di un gatto. Più tardi, trova per caso, all’osteria, un altro gatto, misteriosamente identico al primo, e lo porta con sé nella nuova casa. Qui, in un momento di furore, cava un occhio alla bestia e subito dopo, con una scure, assassina la propria moglie e nasconde il cadavere, murandolo dietro una parete. Anche qui si presentano i poliziotti per fare delle indagini: ispezionano la casa (il gatto, frattanto, è scomparso), ma non trovano nulla e stanno per andarsene, quando avviene la terribile rivelazione.
“Signori – dissi infine, mentre già stavano salendo i gradini – sono lieto di avere calmato i vostri sospetti. Vi auguro buona notte, e vi porgo i miei omaggi. A proposito, signori, questa… questa è una casa costruita meravigliosamente bene – (Nel desiderio morboso di parlare con disinvoltura, quasi non mi rendevo conto delle parole che proferivo). Posso dire anzi che è una casa costruita in maniera eccellente. Queste pareti, ve ne state già andando, signori?, queste pareti, guardate come sono solide! – E a questo punto, in una vera frenesia di sfida, picchiai pesantemente con la mazza che tenevo in mano proprio su quel tratto di opera muraria dietro il quale stava il cadavere della moglie che io avevo tanto amata.
“Ma possa Iddio proteggermi e liberarmi dagli artigli dell’Arcidemonio! Non appena gli echi dei miei colpi si furono spenti nel silenzio, ecco che ad essi una voce rispose dal segreto loculo! Era un pianto, dapprima soffocato e interrotto, come il singhiozzare di un bambino che rapidamente si enfiò sino a divenire un unico lungo, alto, continuo urlo, indicibilmente strano e inumano, un ululato, uno stridio guaiolante, per metà di orrore e per metà di trionfo, quale solo avrebbe potuto levarsi dal fondo dell’inferno, se le gole di tutti i dannati nella loro angoscia e tutti i demoni nell’esultanza della dannazione umana si fossero insieme congiunte.
“Di quel che fossero i miei pensieri in quel momento è follia parlare. Sentendomi venir meno, arretrai barcollando verso la parete opposta. Per un attimo i poliziotti, giunti in cima alle scale, ristettero immobili, raggelati dall’orrore e da una specie di acana paura. Un attimo dopo dodici braccia robuste si davano da fare attorno alla parete. Questa cadde di colpo in tutta la sua massa. Il cadavere, già quasi interamente decomposto e chiazzato di sangue raggrumato, apparve eretto dinanzi agli occhi degli agenti. Sul suo capo, con la rossa bocca spalancata e l’unico occhio di fiamma, sedeva lo spaventoso animale la cui malizia mi aveva indotto al delitto, e la cui voce rivelatrice mi aveva consegnato al boia. Avevo murato il mostro entro la tomba!”
Se l’uccisione del primo gatto (e la mutilazione del secondo) può ricordare l’uccisione dell’albatro ne La ballata del vecchio marinaio di Samuel Taylor Coleridge, la scoperta del delitto rimanda ai racconti polizieschi dello stesso Poe, mentre il tema della vittima murata nelle cantine ritorna in un altro racconto del terrore interamente privo di elementi sovrannaturali: Il barilozzo di Amontillado, anch’esso (come La maschera della Morte Rossa) di ambientazione genericamente italiana. Ma, se ne La maschera della Morte Rossa il soggetto può essergli stato ispirato dalla situazione iniziale del Decameron di Boccaccio (la “peste nera” del 1348 e la “lieta brigata” dei giovani fiorentini), qui il tema dominante è la vendetta, lucida e spietata, freddamente covata per anni e dissimulata al fine di poter meglio soprendere l’avversario, che da carnefice diventa vittima impotente (con un totale rovesciamento di ruoli rispetto alla situazione precedente, di cui pochissimo viene detto al lettore). Epica e moralistica è dunque l’ispirazione dell’altro racconto, psicologica e “banale” – della banalità del Male, appunto – quella di quest’ultimo.
Montrésor decide di vendicarsi delle lunghe offese di Fortunato; e un giorno, durante il carnevale, lo conduce, semi-ubriaco, a visitare le cantine del suo palazzo, con la scusa di mostrargli un prezioso barilozzo di Amontillado, poiché lo sa esigente intenditore di vini. Giunto nella parte più profonda dei sotterranei, lo ammanetta alle catene predisposte sulla parete, quindi inizia a disporre i mattoni con la calce, strato su strato, in maniera da murarlo vivo, lentamente, nel buio. Fortunato, che è vestito da giullare, scuote i campanelli del suo berretto nel fremito di orrore, quando comincia a rendersi conto che Montrésor non sta affatto scherzando, e che – nel giro di pochi minuti – si troverà sepolto vivo, nell’oscurità totale, destinato a una lunga, orribile agonia, mentre nessuno saprà mai cosa gli è accaduto.
“Era ormai mezzanotte, e la mia opera stava per terminare. Avevo completato l’ottavo, il nono e il decimo strato. Avevo finita una parte dell’undicesimo e ultimo; non mi restava più a commettere e cementare che una sola pietra. Lottavo con il suo peso; la posai parzialmente nel suo posto designato. Ma ecco giungermi dalla nicchia un riso sommesso che mi fece rizzare i capelli in capo. A questo seguì una voce triste che ebbi difficoltà a riconoscere per quella del nobile Fortunato. La voce diceva:
” – Ah! Ah! Ah! Ih! Ih! Ih! Gran bello scherzo davvero: una beffa magnifica. Ne faremo di risate a questo proposito al palazzo: Ih! Ih! Ih! A proposito del nostro vino… Ih! Ih! Ih!
” – L’Amontillado -, dissi.
” – Ih! Ih! Ih! Ih! Ih! Ih! Già, l’Amontillado. Ma non si sta facendo tardi? Non ci staranno aspettando al palazzo, madonna Fortunato e gli altri? Andiamocene.
“- Già – dissi -, andiamocene.
“- Per l’amor di Dio, Montrésor!” – Già – ripetei -, per l’amor di Dio!
“Ma attesi invano una risposta a queste parole. Divenni impaziente… chiamai forte…
“- Fortunato!
“Nessuna risposta. Chiamai di nuovo…
“- Fortunato!“Ancora nessuna risposta. Infilai una torcia nel piccolo vano rimasto aperto e la lasciai cadere nell’interno. Mi giunse in risposta soltanto un tintinnio di campanelli. Il mio cuore ebbe un brivido: era l’umidità delle catacombe che produceva in me questo effetto. Mi affrettai a terminare la mia bisogna. A forza spinsi in sito l’ultima pietra e la cementai. Contro la nuova opera murararia reinnalzai l’antico contrafforte d’ossa. Da mezzo secolo nessuna creatura mortale le ha più disturbate. In pace requiescant.”
Ancora la vendetta, una vendetta feroce, disumana, è al centro di un altro racconto che alcuni considerano uno dei migliore del Poe “nero”: Hop Frog. È la storia di come un nano buffone si vendica di uno sgarbo del suo re, inducendolo a travestirsi da scimmione, insieme ai suoi dodici consiglieri, e poi li fa bruciare vivi mentre ruotano, sospesi a una sorta di giostra di legno che gira in circolo, sotto gli occhi di tutta la corte. A noi non pare un racconto degno del miglior Poe: e non perché vi manchino l’elemento soprannaturale o, genericamente, l’elemento del mistero, ma perché si tratta semplicemente di una storia orribile, descritta con noiosa pedanteria, in cui la sproporzione fra l’offesa ricevuta dal nano (anzi, da una sua amica) e la vendetta da lui consumata è talmente abissale da suscitare ripugnanza e disgusto nel lettore. Non si tratta di un’offesa o di una minaccia immaginaria (come ne Il cuore rivelatore), ciò che renderebbe interessante la psicologia del delitto; il nano di Hop Frog è una creatura malvagia che non ha nulla di patologico e nulla di demoniaco: è semplicemente un essere umano capace di serbare un immenso rancore e di attuare lucidamente una rivalsa che va al di là di ogni immaginazione, dopo di che, riesce a farla franca, fuggendo per i tetti. Non vi è il senso di una giustizia divina, come ne La maschera della morte rossa, e non vi è possibilità di una catarsi, per quanto remota, attraverso l’espiazione del male fatto, come ne Il gatto nero. È il trionfo del male puro e semplice, senza insegnamenti per alcuno, senza una morale; di una intelligenza sottile e tortuosa, cui unico scopo è placare il ressentiment di un orgoglio ferito da parte dell’inferiore verso il superiore. È, lo ripetiamo, una vuota storia orribile, non una storia dell’orrore; il piano di guerra del nano feroce è descritto con fastidiosa meticolosità, ma senza il lampo di genio che aveva fatto del protagonista de Il cuore rivelatore un’anima infelice, tormentata ed estremamente interessante.
Concludiamo queste riflessioni sull’opera di Edgar Allan Poe riportando una riflessione del suo biografo Philip Lindsay: “Tormentato nell’anima, cercò non la pace ma l’infelicità, creando a se stesso situazioni disperate, solitudine e desolazione”. Poe, infatti, non fa morire i suoi personaggi per poter, lui, sopravvivere; non li fa seppellire vivi per morire con loro e poi risorgere, metaforicamente: egli si getta a capofitto negli orrori che sa evocare con mano abilissima, quasi pervaso da un’ansia di punizione e di auto-distruzione. E la sua misera morte, in stato di delirium tremens, dopo che lo avevano raccolto – incosciente – per le vie di Baltimora, ai primi di ottobre 1849, ha il sapore di una catastrofe annunciata. Probabilmente, era stato drogato o ubriacato da una squadra di reclutatori di voti per le elezioni politiche in corso, che poi lo aveva abbandonato privo di conoscenza; ma, in un senso più profondo, quella morte egli l’aveva a lungo cercata – con terrore, ma anche con desiderio. Pochi istanti prima di spirare, si era levato sul letto d’ospedale e aveva pronunciato, come fra sé, queste sole, brevi parole: “Oh signore, aiuta la mia povera anima!”. Forse non aveva trovato la risposta alle sue molte domande, ma aveva infine trovato la pace per il suo spirito tormentato.
* * *
Conferenza tenuta dall’Autore a Oderzo, il 16 marzo 2007, nel Palazzo Foscolo (via Garibaldi, 80), nell’ambito delle manifestazioni di “Oderzoinquieta” (9 marzo-29 aprile 2007), a cura della Fondazione Oderzo Cultura e del Comune di Oderzo.
00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : etats-unis, littérature, lettres, lettres américaines, littérature américaine, fantastique, edgar allan poe, poe |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 30 août 2010
Roy Campbell
Roy Campbell
 Roy Campbell was born in October 1902 in the Natal District of South Africa. He enjoyed an idyllic childhood, growing up in South Africa and being imbued as much with Zulu traditions and language as with his Scottish heritage. He showed early talent as an artist but an interest in literature including poetry soon became predominant.
Roy Campbell was born in October 1902 in the Natal District of South Africa. He enjoyed an idyllic childhood, growing up in South Africa and being imbued as much with Zulu traditions and language as with his Scottish heritage. He showed early talent as an artist but an interest in literature including poetry soon became predominant.
In 1918 he traveled to England to attend Oxford where by this time he was an agnostic with a love for the Elizabethan literature. Campbell’s friendship with the composer William Walton at Oxford brought him into contact with the literati including T. S. Eliot, the Sitwells and Wyndham Lewis. He was by now reading Freud, Darwin and Nietzsche, and had a distaste for Anglo-Saxonism and the ‘drabness of England’ and found an affinity with the Celts. He also identified with the Futurist movement in the arts. Campbell writes at this time in a manner suggesting the Classicism of Hulme, Lewis, Pound, and the Vorticists.
Art is not developed by a lot of long-haired fools in velvet jackets. It develops itself and pulls those fools wherever it wants them to go . . . Futurism is the reaction caused by the faintness, the morbid wistfulness of the symbolists. It is hard, cruel and glaring, but always robust and healthy.
Campbell continues by describing the new art in Nietzschean and Darwinian terms of struggle, survival and victory, but also suggesting something of his own colonial character:
It is art pulling itself together for another tremendous fight against annihilation. It is wild, distorted, and ugly, like a wrestler coming back for a last tussle against his opponent. The muscles are contorted and rugged, the eyes bulge, and the legs stagger. But there it is, and it has won the victory.
Campbell escaped from England’s ‘drabness’ to Provence where he worked on fishing boats and picked grapes. Despite his agnosticism he was impressed by the simple faith of the peasants, and started writing poems of a religious nature such as Saint Peter of the Candles—the Fisher’s Prayer, which took ten years to complete and portrays Campbell’s spiritual odyssey He returned to London in 1921, married Mary Garman, and became highly regarded among the Bloomsbury coterie who were impressed with his rough manners and hard drinking.
His wife inspired his first epic poem The Flaming Terrapin, written while the couple lived for over a year at a remote Welsh village where their first daughter was born. T. E. Lawrence was immediately impressed with the poem and took it to Jonathan Cape for publication. This established Campbell’s reputation as a poet.
Nietzsche, Christ, & the Heroic Poet
The Flaming Terrapin is a combination of Christianity and Nietzsche. In a letter to his parents Campbell sought to explain the symbolism as being founded on Christ’s statement: “Every tree that bringeth not forth good fruit is, hewn down and cast into fire,” and “Ye are the salt of the earth but if that salt shall have lost its savor it shall he scattered abroad and trodden under the feet of men.”
Campbell now realized that Christ, was the first to “proclaim the doctrine of heredity and survival of the fittest,” and that his “aristocratic outlook” was misunderstood by Nietzsche as being a religion of the weak. World War I had destroyed the best breeding stock and demoralized humanity. The Russians for example had succumbed to Bolshevism. But Campbell hoped that a portion might have become ennobled from the suffering.
He continued to explain that the deluge in The Flaming Terrapin represents the World War, and that the Noah family represents “the survival of the fittest,” triumphing over the terrors of the storm to colonize the earth. The terrapin in eastern tradition is the tortoise that represents “strength, longevity, endurance and courage” and is the symbol of the universe. It is this “flaming terrapin” that tows the Ark, and wherever he crawls upon the earth creation blossoms forth. He is “masculine energy” and where his voice roars man springs forth from the soil. His acts of creation are born from “action and flesh in one clean fusion.”
The poem published in 1924 in Britain and the USA received critical acclaim from the press as a fresh and youthful breath, as breaking free from both the banalities of the past and from the skeptical nihilism of the new generation. Campbell and his family returned to South Africa where he was welcomed as a celebrity. Here Campbell lectured on Nietzsche, and praised Nietzsche’s condemnation of the meanness of modern democracy. In this lecture Campbell also attacked the ascendancy of technology, stating that the rush to progress and enthronement of science during the previous century has outpaced mans’ mental and moral faculties and that man has becoming suddenly “lost.”
All those useful mechanical toys which man primarily invented for his own convenience have begun to tyrannize every moment of his life.
This was a theme that concerned Campbell throughout his life. In a poem written a year later entailed The Serf, Campbell proclaimed the tiller of the soil as “timeless” as he “plows down palaces and thrones and towers.” The tiller of the soil, states a hopeful Campbell, endures through eternity while the cycles of history rise and fall around him. This gives a sense of permanence in a constantly shifting world.
His poem in honor to his wife Dedication to Mary Campbell is Nietzschean in theme but also a criticism of his fellow South Africa, referring to the poet as “living by sterner laws,” as not concerned with their commerce, and as worshiping a god “superbly stronger than their own.”
Estranged from South Africans
In 1925 he became editor of Voorslag and was closely associated with William Plomer whose first novel Turbott Wolfe involves inter-racial marriage. However, despite their friendship and Campbell’s disdain for the racial situation in South Africa he reviewed Plomer’s novel and found it having “a very strong bias against the white colonists.” Nevertheless, Campbell was not impressed by what he considered as white South Africa, “reclining blissfully in a grocer’s paradise on the labor of the natives.”
Campbell resigned from editorship after the publisher’s interference. Some of Campbell’s best poems written in South Africa at this time are considered to be among his best. To a Pet Cobra returns to Nietzschean themes, describing poets in heroic terms, the Zarathustrian solitary atop the mountain peaks.
There shines upon the topmost peak of peril
There is not joy like them who fight alone
And in their solitude a tower of pride
Bloomsbury & Provence
On their return to Britain Campbell and his wife were introduced to the Bloomsbury coterie, including the poetess Vita Sackville-West her husband the novelist Harold Nicolson, Virginia and Leonard Wolfe, Richard Aldington, Aldous Huxley, Lytton Strachey, et al. The robust Campbell found their refined manners, pervasive homosexuality, and pretentiousness sickening, writing in Some Thoughts on Bloomsbury that his own voice is the only one he likes to hear when around all the “clever people.” Several years later in The Georgiad he satirizes the dinner parties of Bloomsbury where wishing to stop the ‘din’ of his ‘dizzy’; head he imagines stuffing his ears with meat and bread, and wishes the diners would choke on their food that their chattering would be halted.
In 1928 the Campbells returned to Provence. The atmosphere was altogether different from England and the wealthy socialist intelligentsia from which he sought escape. The Campbells fully involved themselves in the community, celebrated the harvest feasts, and welcomed the local folk into their home. Campbell became a celebrated figure in the dangerous sport of “water jousting.” He also assisted in the ring at bullfights. Campbell found in the customs and culture of the Provencal villagers stability and permanence in a changing world obsessed by science and “progress.” His own aesthetics, at the basis of his rejection of liberalism and socialism, was a synthesis of the romanticism of Provence and the Classicism of the Graeco-Roman. He admired Caesar and the stoicism and martial ethos of the ancients. His ideal was a combination of aesthete and athlete.
In Taurine Provence, published in 1932 Campbell writes of this:
So men in whom the heroic principle works will be driven by their very excess of vitality to flaunt their defiance in the face of death or danger, as in the modern arena.
Campbell, freed from the English intelligentsia, now renewed his attack with fury. Writing in 1928 in Scrutinies by Various Writers, he states that the dominant philosophy of the contemporary writer is dictated by “fear of discomfort, excitement or pain than by love of life.” His attack on the “sex-socialism” of Bloomsbury as being flabby and effete is contrasted with his own robust nature that could not fit in with the simpering and decadent atmosphere of the intellectual. Following on from Wyndham Lewis’ scathing attack on Bloomsbury, The Apes of God, which Campbell enjoyed immensely, Campbell wrote The Georgiad in 1931, as his own broadside. This would bring against him the mixture of condemnation and silence that the intellectual coterie had been using against Wyndham Lewis.
The Georgiad expresses Campbell’s disdain for the way Bloomsbury makes sickly everything it touches. Campbell compares his own ‘hate’ with that of their “dribbles.”
Like lukewarm bilge out of a running leak
Scented with lavender and stale cologne
Lest by its true effluvium should be known
The stagnant depth of envy that you swim in,
Who hate like gigolos and fight like women.
Bulwark of Christendom
In 1933 the Campbells left Provence for Spain due to financial hardship, despite the success of Campbell’s acclaimed volume of poems Adamastor, published in both the USA and England. This was the final work to be well-received from the Bloomsbury crowd, while his Georgiad received what The Times Literary Supplement was to recall in 1950 as a “conspiracy of silence.”
The Campbells arrived at Barcelona where a right-wing electoral victory resulted in strikes and violence by the anarchists and where machine guns were much in evidence on the streets. However, the Campbells were greatly impressed by the traditional Catholic culture.
Campbell described himself for the first time as a “Catholic” in his 1933 autobiography Broken Record, attacking both English Protestantism as “a cowardly form of atheism” and the Freudianism that pervaded the Bloomsbury progressives. He contrasted this with the “traditional human values” that continued to form the basis of Spanish culture. Broken Record was a break with modernism, but still lacked a coherent philosophy.
Despite the reference to Catholicism, Campbell had not yet converted, but spiritual questions had long occupied him, with an interest in Mithraism emerging in Provence. This cult was still to be seen in the shrines of Provence. That it was the religion most favored by the Roman legions, with its strong martial ethos, together with the mythos of the bull, appealed to Campbell.
However, he had also been strongly impressed with the faith and traditionalism of the fishermen and farmers among whom he had been so popular in Provence. His Mithraic Sonnets are a reflection of Campbell’s own spiritual odyssey beginning with Mithras and ending with the triumph of Christ, a mixture of the two religions. The Mithraic conquering sun. Sol Invictus, the byword of the Roman legions, becomes transmogrified as the Sun of the Son of God, “the shining orb” reflecting as a mirrored shield the image of Christ. It is with these vague feelings towards Christianity and Catholic culture that the Campbells moved south to the rural village of Altea in 1934.
Campbell continued to sing the song of Catholicism in martial terms, of the solar Christ as “captain” winning the battle of faith. Spain breathes its Catholic tradition and in The Fight Campbell writes again with a martial flavor, an aerial dog-fight for Campbell’s soul; his “red self” of atheism shot down by the “white self” of the Solar Christ, “the unknown pilot.” At Altea, Campbell was again impressed with the “freshness, bravery and reverence” of the people Under such an impress the whole Campbell family, actually at the initiative of his wife, converted in 1935, received by the village priest Father Gregorio.
His daughter Anna related many years later, that for Campbell, Spain was the last country left in Europe that was still a pastoral society while much of the rest had become industrialized under the impress of Protestantism. Such was Campbell’s aversion to machinery that he never learnt to drive or even used a typewriter.
At this time Campbell wrote Rust. The rust of time that brings ruin to the intentions of those who would industrialize and modernize:
So there, and there it gnaws, the Rust,
Shall grind their pylons into dust . . .
Lackeys of Capitalism
Campbell’s political outlook becomes coherent with his religious conversion. An article published in 1935 in the South African magazine The Critic shows just how clear Campbell’s knowledge of politics now was:
The artist as romantic ‘rebel’ is the tamest mule imaginable. He dates from the industrial era and has been politicized to play into the hands of the great syndicates and cartels. First by dogmatizing immorality, breaking up the “Family,” that one definitive unit that have withstood the whole effort of centuries to enslave, dehumanize and mechanize the individual, thereby cheapening and multiplying labor. It is the “Intellectual” which had been chiefly politicized into selling his fellow mates to capitalism, whether the capitalism be disguised as a vast inhuman state [as in the USSR under communism] or whether a gang of individuals. The last century has seen more class-wars, and wars between generations, than any other period. They have been deliberately fostered by capitalism, of which bolshevism is merely an anonymous form. Divide and rule, said Cicero: encourage your slaves to quarrel and your authority will be supreme. A thousand artists and reformers with the highest ideals have leaped ignorantly and romantically into these rackets, and by means of causing hate between man and woman, father and son, class and class, white and black, almost irretrievably embroiled the human individual in profitless, exhausting struggles which leave him at the mercy of the unscrupulous few.
In 1936 Campbell met British Fascist leader Sir Oswald Mosley, at the suggestion of Wyndham Lewis. Although Campbell declined to join Mosley as British Fascism’s official poet, his poetry was to appear in Mosley’s magazines both before and after the War.
Toledo, the Sacred City
The Campbells next moved to Toldeo, which had been Spain’s capital under Charles V during the Holy Roman Empire. The city was isolated and timeless, medieval, full of churches, monasteries, convents, and shrines. The old Fortress, the Alcazar, designed to play a pivotal role in the defense of Christendom against Bolshevism, served as a military academy. The city was full of priests, nuns, monks, and soldiers, a combination of the religious, the military, and the traditional that prompted Campbell to call Toldeo the “sacred city of the mind.”
The assumption to power of the Left-wing Popular Front resulted in the release of communist and anarchist revolutionaries from gaol amidst increasing political violence in Madrid and Barcelona and street fighting between Left-wing and Right-wing factions. Churches were now being desecrated and destroyed throughout Spain. The violence reached Toledo where priests and monks were attacked and a church set ablaze.
The Campbells sheltered several Carmelite monks in their home. Campbell, well known for his anti-Bolshevik views and for his faith, was severely beaten by Government “red” guards and paraded through the streets to police headquarters. His gypsy friend, with whom he was riding at the time of his capture, “Mosquito” Bargas, was murdered at the time of the arrest. Campbell was probably spared this fate by being a foreigner. In his tribute to his friend In Memoriam of Mosquito, Campbell writes with typical stoicism and faith when beaten bloody and dragged through Toledo:
I never felt such glory
As handcuffs on my wrists.
My body stunned and gory
With tooth marks on my wrists . . .
While Spain was on the verge of civil war the Campbells were confirmed into the Church by Cardinal Goma, Archbishop of Toledo and Primate of Spain, in a secret ceremony.
In July 1938 the Government’s red guards killed parliamentary opposition leader Calvo Sotel, the leader of the monarchists. Four days later the military under General Franco revolted against the Government to restore order and liberty of worship. With the Alcazar being a military academy, Toldeo was easily taken by Nationalist troops, and peasants from the surrounding countryside fled to the city for refuge. The Government militia from Madrid prepared to attack Toledo, and the Alcazar was bombed and shelled. The Campbells hid the archives of the Carmelite monks at their home for the duration of the civil war.
Seventeen Carmelite monks were herded into the streets by the red forces and shot. Among them was the Campbell’s father confessor who died with a smile and the shout of “Long live Christ’ Long live Spain!” (Father Easebio who had received the Campbells into the Church was also killed).
In Campbell’s excursion into the city he came across the Carmelites lying in the street and found the bodies of the Marista monks. Smeared in their blood on a wall was: “Thus strike and Cheka,” a reference to the Soviet secret police. In the city square religious artifacts from churches and private homes were tossed onto bonfires.
In the besieged Alaczar were 1000 soldiers and 700 civilians, mostly women and children. Under the Command of Colonel Moscardo they held out, even as the Colonel’s 24-year-old son Louis, captured by the Red forces, was compelled to telephone his father and say that he would be shot unless Alcazar was surrendered. In an epic of heroism and martyrdom that helped make Alcazar a shrine to this day the Colonel replied to his son: “Commend your soul to God, shout ‘Viva Espana!’ And die like a hero. The Alcazar will never surrender.”
The Campbells left Spain and returned to London. They felt isolated in England where most of the literati supported the “Left” in the Spanish civil war. The family soon moved to a fishing village in Portugal, a nation that retained the same spirit of faith and tradition as Spain.
Campbell returned to Spain as a correspondent for the British Catholic newspaper The Tablet and was given safe conduct to the Madrid front. His desire to enlist in the Nationalist forces was unsuccessful as the Nationalist authorities were insistent that he could do more good for the cause as a writer. He was decorated for saving life under fire on multiple occasions, met Franco, and was present at the Nationalist victory parade in Madrid.
The Civil War was to result in the murder of 12 bishops. 4,184 priests, 2,365 monks, and around 300 nuns. George Orwell who had gone to Spain along with others of the literati to fight with the Reds, was to remark that, “Churches were pillaged everywhere as a matter of course in six months in Spain I only saw two undamaged churches” (Homage to Catalonia).
Flowering Rifle
Campbell’s epic saga Flowering Rifle is a detailed explanation of his poetical credo, a tribute to his Catholicism, to Spain’s faith and martyrdom and also a condemnation of the British intelligentsia. It his introductory note Campbell explains that “humanitarianism” is the “ruling passion” of the British intelligentsia which
sides automatically with the Dog against the Man, the Jew against the Christian, the black against the white, the servant against the master, the criminal against the judge.
As a form of “moral perversion” it was natural that such humanitarians sided with Bolshevik mass murderers. The poem begins with a description of the (fascist) salute, the “opening palm, of victory” the sign, of “palms triumphant foresting the day.” By contrast is the clenched fist of communism, “a Life-constricting tetanus of fingers,” the sign of an “outworn age” under which “all must starve under the lowest Caste.” The Bloomsbury intelligentsia represents the connection between capitalism and communism. Behind these stand “the Yiddisher’s convulsive gold”: one of many allusions to the prominent role played by Jews in Communism and in the International Brigades.
Spain is heralded as a resurrected nation that might show the rest of Europe the path to regeneration and stand against Bolshevism “which no godless democracy could quell.” The martyrs of the Nationalist cause are described in mystical terms, each death “a splinter of the Cross,” each body building a Cathedral to the sky. Nobility is achieved through suffering and sacrifice, as Christ, the “Captain” suffered. But when suffering and sacrifice are eliminated from life mankind is “shunned by the angels as effete baboons.”
Primo de Rivera, the charismatic young leader of the Falangists who had been shot without trial while in the custody of the Leftist Government, was similarly eulogized:
Whose phoenix blood in generous libation
With fiery zest rejuvenates the nation . . .
The Marxist deaths on the other hand were vacuous, for their gods are economics, science, gold, and sex, and as exponents of abortion and birth control they are the essence of anti-life. But capitalism, is just as much a debasement of man, as communism:
To cheapen thus for slavery and hire
The racket of the Invert and the Jew
Which is through art and science to subdue.
Humiliate, and to pulp reduce
The Human Spirit for industrial use
Whether by Capital or by Communism
It’s all the same despite their seeming schisms
Those who are debased the most are, under democracy, elevated to positions of honor and state, elected by the voting masses who are mesmerized by the media and the literati, the politicians hang about the League of Nations
That sheeny club of communists and masons
He bombs the Arabs, when his Jews invade.
Britannia’s trident had become a “graveyard spade” while condemning Germany and Italy. “Who from the dead have raised more vital forces…” Franco, Mussolini, and Portugal’s Salazar had “muzzled up the soul destroying lie” of communism, and as Spain had shown, victory would come through nationhood, not League sanctions, wealth or arms. Meanwhile Britain shunned its unbought men, such as Campbell who brings “the tidings that Democracy is dead.”
When the Campbells traveled to Italy in 1938 the exiled Spanish king Alfonso XIII, who was greatly impressed with Flowering Rifle, cordially greeted them. Of course the British literati were outraged, and even some Catholics felt the poem lacked “charity.”
War Service
Campbell and his wife returned to Toledo in 1939, the Nationalists having triumphed. But there was now widespread famine. Mary opened a soup kitchen and refurbished the damaged chapel, and both literally gave their clothes away to help the distressed inhabitants. As the world war approached Campbell considered that there would be two great contending forces: Fascism and Communism. With the exception of what he considered to be a pagan orientation in Germany, the Fascist states were eminently Christian and allowed Christians the right to live, whereas Bolshevism simply killed and degraded everything, being the enemy of every form of religion.
However, despite his antagonism to the English bourgeoisie and democratic Britain, Campbell always had an admiration for the heroic spirit of the British Empire and a feeling for those Britons facing an enemy. He sought to enlist, although under no illusions about the justice of the Allied cause. His animosity by this time was against all systems, fascism, democracy, and bolshevism, which he dubbed as Fascidemoshevism.
His ideal was not the cumbersome state of any of these systems but that of small, self-reliant and co-operating, family based communities, like those he had experienced in Provence, Spain, and Portugal.
In the Moon of Short Rations Campbell considered the Allied cause to be that of both socialism and the multi-national corporations, twin figures of a universal sameness. He saw that the post-war world would be ever more depersonalized and mechanical. Campbell could not sit still or take a soft option as a number of his pro-war Left-wing intellectual accusers were doing while Britons marched to war. He lampooned these hypocrites such as Spender and Cecil Day-Lewis who had a job in the Ministry of Information, when they attacked his “fascism,” and he wrote The Volunteer’s Reply to the Poet stating:
It will be the same, but a bloody sight worse . . .
Since you have a hand in the game . . .
You coin us the catchwords and phrases
For which to be slaughtered . . .
However, because of his age and a bad hip Campbell, had to be content with the home guard until 1942 when he was recruited into the Army Intelligence Corps due to his skills in languages. Britain in wartime had in Campbell’s view awakened from its “drabness” to become again a “warrior nation.” Campbell was popular with the troops as a “grandfatherly” figure, and was stationed in East Africa. Contracting malaria and with a deteriorating hip condition necessitating the use of a cane, he was discharged with an “excellent military record”
The Post-War World
The England of the post-war years returned to its drab routine and worse still for Campbell, the prospects of an all-consuming welfare state. Campbell soon went back into fighting mode against the Left-wing poets with The Talking Bronco (a name that Spender had applied to him). Even Vita Sackville-West, calling Campbell “one of our most considerable living poets” acclaimed this volume. Desmond McCarthy writing in The Sunday Times regarded Campbell as “the most democratic poet,” not politically, but in his feeling for the common man and for the common soldier. Others were of course outraged. Cecil Day-Lewis believed Campbell should be sacked as a “fascist” from the job he now had as producer of the BBC talk programs, since he was not fit to “direct any civilized form of cultural expression.”
Campbell was horrified by the Allied victory that had placed half of Europe under the USSR. However, he was equally horrified by the rest of the world falling under the dominion of the multinational corporations and their creed of global consumerism, or what we today call globalization. For Campbell the Cold War was a contention between two equally internationalist forces.
His daughter Anna wrote in 1999 that Campbell admired all types of ethnic civilization as opposed to the mass conformity of Marxism and the globalization of the likes of MacDonalds and Coca-Cola. His concern was in “everything becoming the same.” He would have been “horrified by what the world has become now” she wrote.
Despite Campbell’s sensitivity to being called a “fascist,” he was unapologetically a man of the “Right,” of tradition and nationalism, and continued to forthrightly expound this position after the war in his poetry and essays. Writing in “A Decade in Retrospect” in the Jesuit journal The Month May 1950, he refers to the “Gaderene stampede” of progress for the want of two sensible standbys (a brake and a steering wheel). In “Tradition and Reaction,” he writes: “A body without reactions is a corpse. So is a Society without Tradition.”
In 1949 Campbell left his job with the BBC to take over the editorship of The Catacomb, founded by his close friend the poet Rob Lyie as a defense of Catholic and Classical traditions against socialism and secularism.
The Catacomb stopped publication in 1951. In 1952 the family moved to Portugal. Before leaving England, Campbell got together with a number of South African literary friends and signed an open letter to the South African Government protesting voting restrictions on the colored population. However, Campbell’s misgivings about the South African situation were not prompted by the liberal desire for a democratic, monocultural state. He feared that antagonism between the races would result in Bolshevism and the destruction of his rustic ideal. With the advent of Black rule, free market capitalism was ushered in on the wings of Marxism and revolution. Today the ANC today calls globalization and trade liberalization the “correct path to Marxism-Leninism.”
In 1954 his views on his native land were given when accepting an honorary doctorate from Natal. In an off the cuff speech, much to the embarrassment of the liberal audience, he defended South Africa against England’s condemnation of apartheid, ridiculing Churchill and Roosevelt, who had sold “two hundred million natives of Europe” to the far worse slavery of bolshevism.
While in the USA on a speaking tour he praised “the two greatest Yanks” Senator McCarthy and General MacArthur.
In April 1957 returning from Spain, Campbell and his wife had a motor accident. Campbell’s neck was broken, and he died at the scene. Mary survived him by 22 years.
Edith Sitwell who converted to Catholicism through the example of the Campbells, remarked: “He died as he had lived, like a flash of lightning.”
00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres anglaises, littérature anglaise, littérature sud-africaine, lettres sud-africaines, afrique, espagne, afrique du sud, angleterre |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 29 août 2010
Henry Williamson: Nature's Visionary
Henry Williamson: Nature’s Visionary
 The fact that the name of Henry Williamson is today so little known across the White world is a sad reflection of the extent to which Western man has allowed himself to be deprived of his culture and identity over the last 50 years. Until the Second World War Williamson was generally regarded as one of the great English Nature writers, possessing a unique ability to capture the essential essence and meaning of the natural world in all its variety and forms.
The fact that the name of Henry Williamson is today so little known across the White world is a sad reflection of the extent to which Western man has allowed himself to be deprived of his culture and identity over the last 50 years. Until the Second World War Williamson was generally regarded as one of the great English Nature writers, possessing a unique ability to capture the essential essence and meaning of the natural world in all its variety and forms.
His most famous Nature book, Tarka the Otter, was published in 1927 and became one of the best-loved children’s books of all time, with its vivid descriptions of animal and woodland life in the English countryside. It was publicly praised by leading English literary figures such as Thomas Hardy, Arnold Bennett, and John Galsworthy. Hardy called Tarka a “remarkable book,” while Bennett declared it to be “marvelous.” Even T. E. Lawrence, also known as Lawrence of Arabia, admitted that “the book did move me and gratify me profoundly.”
Tarka was awarded the coveted Hawthornden Prize for literature in 1928 and eventually attracted the interest of Walt Disney, who offered a small fortune for the film rights. Williamson, however, was concerned that such an arrangement might compromise his artistic integrity, and he rejected the offer.
Seventy years later, however, Tarka, like the majority of Williamson’s books, is relatively unknown and has only just become available in print again. The reason: Like several other leading European authors, Williamson was a victim of the Second World War. Not only did his naturalistic message conflict with the materialistic culture that has pervaded the Western world since 1945, but he himself was a political fighter who actively opposed the war on ideological grounds.
Born in Brockley, southeast London, in December 1895, Williamson was educated at Colfe’s Grammar School, Lewisham. He spent much of his early life exploring the nearby Kent countryside, where his love of Nature and animals and his artistic awareness and sensitivity were first stimulated. Never satisfied unless he had seen things for himself, he always made sure that he studied things closely enough to get the letter as well as the spirit of reality. This enabled him to develop a microscopic observational ability which came to dominate his life.
Williamson joined the British Army at the outbreak of war in 1914 and fought at the Battle of the Somme and at Passchendaele, where he was seriously wounded. It was this experience as a frontline soldier which was the redefining moment in his life and artistic development, stimulating in him a lifelong Faustian striving to experience and comprehend the “life flow” permeating his own, and all, existence.
His spiritual development continued after the war. In 1919 he read for the first time the visionary The Story of My Heart, which was written by the English Nature writer Richard Jefferies and published in 1893. For Williamson, discovering Jefferies acted as a liberation of his consciousness, stimulating all the stored impressions of his life to return and reveal a previously smothered and overlaid self. It was not just an individual self that he discovered, however, but a racial self in which he began to recognize his existence as but a link in an eternal chain that reached back into the mists of time, and which — if it were permitted — would carry on forever.
Williamson sensed this truth in his own feeling of oneness with Nature and the ancient, living, breathing Universe as represented by the life-giving sun. It also was reflected in his idea of mystical union between the eternal sunlight and the long history of the earth. For Williamson the ancient light of the sun was something “born in me” and represented the real meaning of his own existence by illuminating his ancestral past and revealing the truth of redemption through Nature. Like Jefferies before him, Williamson “came to feel the long life of the earth back in the dimmest past while the sun of the moment was warm on me … This sunlight linked me through the ages to that past consciousness. From all the ages my soul desired to take that soul-life which had flowed through them as the sunbeams had continually found an earth.” [1]
After the war Williamson became a journalist for a time while beginning work on his first novel, The Beautiful Years (1922). Finally he decided to break all contact with London and in 1922 moved to an ancient cottage in Georgham, North Devon, which had been built in the days of King John. Living alone and in hermit fashion at first, Williamson disciplined himself to study Nature with the same meticulous observations as Jefferies, tramping about the countryside and often sleeping out. The door and windows of the cottage were never closed, and his strange family of dogs and cats, gulls, buzzards, magpies, and one otter cub were free to come and go as they chose.
 It was his experiences with the otter cub which stimulated Williamson to write Tarka. He had rescued it after its mother had been shot by a farmer, and he saved its life by persuading his cat to suckle it along with her kitten. Eventually the otter cub was domesticated and became Williamson’s constant companion, following him around like a dog. On one walk, however, it walked into a rabbit trap, panicked, and ran off. Williamson spent years following otters’ haunts in the rivers Taw and Torridge, hunting for his lost pet.
It was his experiences with the otter cub which stimulated Williamson to write Tarka. He had rescued it after its mother had been shot by a farmer, and he saved its life by persuading his cat to suckle it along with her kitten. Eventually the otter cub was domesticated and became Williamson’s constant companion, following him around like a dog. On one walk, however, it walked into a rabbit trap, panicked, and ran off. Williamson spent years following otters’ haunts in the rivers Taw and Torridge, hunting for his lost pet.
The search was in vain, but his intimate contact with the animal world gave him the inspiration for Tarka: “The eldest and biggest of the litter was a dog cub, and when he drew his first breath he was less than five inches long from his nose to where his tail joined his back-bone. His fur was soft and grey as the buds of the willow before they open up at Eastertide. He was called Tarka, which was the name given to the otters many years ago by men dwelling in hut circles on the moor. It means Little Water Wanderer, or Wandering as Water.”
Williamson never attempted to pass any kind of moral judgment on Nature and described its evolutionary realities in a manner reminiscent of Jack London:
Long ago, when moose roamed in the forest at the mountain of the Two Rivers, otters had followed eels migrating from ponds and swamps to the seas. They had followed them into shallow waters; and one fierce old dog had run through the water so often that he swam, and later, in his great hunger, had put under his head to seize them so often that he dived. Other otters had imitated him. The moose are gone, and their bones lie under the sand in the soft coal which was the forest by the estuary, thousands of years ago. Yet otters have not been hunters in water long enough for the habit to become an instinct.
Williamson actually rewrote Tarka 17 times, “always and only for the sake of a greater truth.” [2] Mere polishing for grace and expression or literary style did not interest him, and he strove always to illuminate a scene or incident with what he considered was authentic sunlight.
He also believed that European man could be spiritually healthy and alive to his destiny only by living in close accord with Nature. Near the end of Tarka, for instance, he delightfully describes how “a scarlet dragonfly whirred and darted over the willow snag, watched by a girl sitting on the bank … Glancing round, she realized that she alone had seen the otter. She flushed, and hid her grey eyes with her lashes. Since childhood she had walked the Devon rivers with her father looking for flowers and the nests of birds, passing some rocks and trees as old friends, seeing a Spirit everywhere, gentle in thought to all her eyes beheld.”
Williamson’s sequel to Tarka was Salar the Salmon, which was also the result of many months of intimate research and observation of Nature in the English countryside. Then came The Lone Swallow, The Peregrine’s Saga, Life in a Devon Village, and A Clear Water Stream, all of which, in the eyes of the English writer Naomi Lewis, displayed “a crystal intensity of observation and a compelling use of words, which exactly match the movement and life that he describes.”
To Williamson himself, however, his Nature stories were not the most important part of his literary output. His greatest effort went into his two semi-autobiographical novel groups, the tetralogy collected as The Flax of Dreams, which occupied him for most of the 1920s, and the 15-volume A Chronicle of Ancient Sunlight, which began with The Dark Lantern in 1951 and ended with The Gale of the World in 1969.
Williamson’s experiences during the First World War had politicized him for life. A significant catalyst in this development was the Christmas truce of 1914, when British and German frontline soldiers spontaneously left their trenches, abandoned the fighting, and openly greeted each other as brothers.
Williamson later spoke of an “incoherent sudden realization, after the fraternization of Christmas Day, that the whole war was based on lies.” Another experience that consolidated this belief was when a German officer helped him remove a wounded British soldier who was draped over barbed wire on the front line. He was thus able to contrast his own wartime experiences with the vicious anti-German propaganda orchestrated by the British political establishment both during and after the war, and he was able to recognize the increasing moral bankruptcy of that establishment. In Williamson’s view the fact that over half of the 338 Conservative Members of Parliament who dominated the 1918 governing coalition were company directors and financiers who had grown rich from war profits was morally wrong and detestable.
This recognition, in itself a reflection of an already highly developed sense of altruism, meant that Williamson could never be content with just isolating himself in the countryside. He had to act to try to change the world for the better. Perhaps not surprisingly he came to see in the idea of National Socialism a creed which not only represented his own philosophy of life, but which offered the chance of practical salvation for Western Civilization. He saw it as evolving directly from the almost religious transcendence which he, and thousands of soldiers of both sides, had experienced in the trenches of the First World War. This transcendence resulted in a determination that the “White Giants” of Britain and Germany would never go to war against each other again, and it rekindled a sense of racial kinship and unity of the Nordic peoples over and above separate class and national loyalties. [3]
Consequently, not only was Williamson one of the first of the “phoenix generation” to swear allegiance to Oswald Mosley and the British Union of Fascists, but he quickly came to believe that National Socialist Germany, under the leadership of Adolf Hitler, pointed the way forward for European man. Williamson identified closely with Hitler — “the great man across the Rhine whose life symbol is the happy child,” seeing him as a light-bringing phoenix risen from the chaos of European civilization in order to bring a millennium of youth to the dying Western world. [4]
Williamson visited Germany in 1935 to attend the National Socialist Congress at Nuremberg and saw there the beginnings of the “land fit for heroes” which had been falsely promised the young men of Britain during the First World War by the government’s war propagandists. He was very impressed by the fact that, while the British people continued to languish in poverty and mass unemployment, National Socialism had created work for seven million unemployed, abolished begging, freed the farmers from the mortgages which had strangled production, developed laws on conservation, and, most importantly, had developed in a short period of time a deep sense of racial community. [5]
Inspired to base their lives on a religious idea, Williamson believed that the German people had been reborn with a spiritual awareness and physical quality that he himself had long sought. Everywhere he saw “faces that looked to be breathing extra oxygen; people free from mental fear.” [6]
Through the Hitler Youth movement, which brought back fond memories of his own time as a Boy Scout, he recognized “the former pallid leer of hopeless slum youth transformed into the suntan, the clear eye, the broad and easy rhythm of the poised young human being.”
In Hitler’s movement Williamson identified not only an idea consistent with Nature’s higher purpose to create order out of chaos, but the physical encapsulation of a striving toward Godhood. Influenced by his own lifelong striving for perfection, Williamson believed that the National Socialists represented “a race that moves on the poles of mystic, sensual delight. Every gesture is a gesture from the blood, every expression a symbolic utterance … Everything is of the blood, of the senses.” [7]
Williamson always believed that any spiritual improvement could only take place as a result of a physical improvement, and, like his mentor Richard Jefferies, he was a firm advocate of race improvement through eugenics. He himself was eventually to father seven children, and he decried the increasing lack of racial quality in the mass of the White population. He urged that “the physical ideal must be kept steadily in view” and called for the enforcement of a discipline and system along the lines of ancient Sparta in order to realize it. [8]
In 1936 Williamson and his family moved to Norfolk, where he threw himself into a new life as a farmer, the first three years of which are described in The Story of a Norfolk Farm (1941). But with the Jews increasingly using England as a base from which to agitate for war against Germany, Williamson remained very active through his membership in the British Union of Fascists in promoting the idea of Anglo-German friendship. Until it was banned in 1940, Williamson wrote eight articles for the party newspaper Action and had 13 extracts reprinted from his book The Patriot’s Progress. He called consistently for Hitler to be given “that amity he so deserved from England,” so as to prevent another brothers’ war that would see the victory only of Asiatic Bolshevism and the enslavement of Europe. On September 24, 1939, for instance, he wrote of his continuing conviction that Hitler was “determined to do and create what is right. He is fighting evil. He is fighting for the future.”
Williamson viewed the declaration of war on Germany by Britain and France as a spiteful act of an alien system that was determined to destroy the prospect of a reborn and regenerated European youth. And his continued opposition to it led to his arrest and internment in June 1940, along with Mosley and hundreds of others. His subsequent release on parole was conditional upon his taking no further action to oppose the war. Silently, however, Williamson remained true to his convictions. Visiting London in January 1944, he observed with satisfaction that the ugliness and immorality represented by its financial and banking sector had been “relieved a little by a catharsis of high explosive” and somewhat “purified by fire.”
National Socialism’s wartime defeat, however, dealt Williamson a heavy blow. Decrying the death struggle of “the European cousin nations” he lamented that “the hopes that have animated or agitated my living during the past thirty years and four months are dead.” [9]
Consequently, his first marriage broke up in 1947, and he returned to North Devon to live in the hilltop hut which he had bought in 1928 with the prize money from Tarka.
But it was not in Williamson’s character to give up on what he knew to be true and right, and, as his most recent biographer makes clear, he never recanted his ideas about Hitler. [10]
On the contrary, he continued to publicly espouse what he believed, and he fervently contested the postwar historical record distorted by false Jewish propaganda — even though his effort resulted, as he realized it would, in his continued literary ostracism.
In The Gale of the World, the last book of his Chronicle, published in 1969, Williamson has his main character Phillip Maddison question the moral and legal validity of the Nuremberg Trials. Among other things, he muses why the Allied officers who ordered the mass fire bombing of Germany, and the Soviet generals who ordered the mass rape and mass murder during the battle for Berlin, were not on trial; and whether it would ever be learned that the art treasures found in German salt mines were put there purely to be out of the way of the Allied bombing. He also questions the official view of the so called “Holocaust,” stating his belief that rather than being the result of a mass extermination plan, the deaths in German concentration camps were actually caused by typhus brought about by the destruction of all public utility systems by Allied bombing.
In the book Williamson also reiterates his belief that Adolf Hitler was never the real enemy of Britain. And in one scene Phillip Maddison, in conversation with his girl friend Laura, questions whether it was Hitler’s essential goodness and righteousness that was responsible for his downfall in the midst of evil and barbarity:
Laura: I have a photograph of Hitler with the last of his faithful boys outside the bunker in Berlin. He looks worn out, but he is so gentle and kind to those twelve- and thirteen-year-old boys.
Phillip: Too gentle and kind Laura … Now the faithful will be hanged.
Williamson also remained loyal in the realm of political ideas and action. When Oswald Mosley had returned to public life in Britain in 1948 by launching the Union Movement, Williamson was one of the first to give his support for an idea which he had long espoused: the unity of Western man. Contributing an article to the first issue of the movement’s magazine, The European, he called for the development of a new type of European man with a set of spiritual values that were in tune with himself and Nature.
Such positive and life-promoting thinking did not endear Williamson to the powers that be in the gray and increasingly decadent cultural climate of post-Second World War Britain. His books were ignored, and his artistic achievement remained unrecognized, with even the degrees committee at the university to which he was a benefactor twice vetoing a proposal to award him an honorary doctorate. The evidence suggests, in fact, that Williamson was subject to a prolonged campaign of literary ostracism by people inside the British establishment who believed he should be punished for his political opinions.
For Williamson, however, the machinations of trivial people in a trivial age were irrelevant; what was important was that he remained true in the eyes of posterity to himself, his ancestors, and the eternal truth which he recognized and lived by. In fact, as one observer described him during these later years, he remained a “lean, vibrant, almost quivering man with … blazing eyes, possessing an exceptional presence [and a] … continued outspoken admiration for Hitler … as a ‘great and good man.’” [11]
Certainly, Williamson knew himself, and he knew what was necessary for Western man to find himself again and to fulfill his destiny. In The Gale of the World he cited Richard Jefferies to emphasize that higher knowledge by which he led his life and by which he was convinced future generations would have to lead their lives in order to attain the heights that Nature demanded of them: “All the experience of the greatest city in the world could not withhold me. I rejected it wholly. I stood bare-headed in the sun, in the presence of earth and air, in the presence of the immense forces of the Universe. I demand that which will make me more perfect now this hour.”
Henry Williamson’s artistic legacy must endure because, as one admirer pondered in his final years, his visionary spirit and striving “came close to holding the key to life itself.”
He died on August 13, 1977, aged 81.
Notes
[1] Ann Williamson, Henry Williamson: Tarka and the Last Romantic, (London, 1995), 65.
[2] Eleanor Graham, “Introduction” to the Penguin edition of Tarka the Otter (1985).
[3] Higginbottom, Intellectuals and British Fascism , (London, 1992), 10.
[4] Henry Williamson, The Flax of Dreams (London, 1936) and The Phoenix Generation (London, 1961).
[5] Henry Williamson, A Solitary War (London, 1966).
[6] Higginbotham, op. cit., 41-42.
[7] J. W. Blench, Henry Williamson and the Romantic Appeal of Fascism , (Durham, 1988).
[8] Henry Williamson, The Children of Shallow Ford, (London, 1939).
[9] Higginbotham, op. cit., 49.
[10] Ann Williamson, op. cit., 195.
[11] Higginbotham, op. cit., 53.
National Vanguard, 117 (1997), 17-20.
00:09 Publié dans Ecologie, Littérature, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres anglaises, littérature anglaise, écologie, nature, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 28 août 2010
Reflections on the Aesthetic & Literary Figure of the Dandy
Reflections on the Aesthetic & Literary Figure of the Dandy
Translated by Greg Johnson
Before getting to the quick of the subject, I would like to make three preliminary remarks:
I hesitated to accept your invitation to speak on the figure of the dandy, for this sort of issue is not my main subject of interest.
I finally accepted because I rediscovered a magisterial and lucid essay by Otto Mann, published many years ago in Germany: “Dandyism as Conservative Lifestyle” (“Dandysmus als konservative Lebensform”). This essay deserves to be republished, with commentaries.
My third remark is methodological and definitional. Before speaking of the “dandy,” and relating the subject to the excellent work of Otto Mann, I must set forth the different definitions of the “dandy.” These definitions are for the most part erroneous, or superficial and insufficient.
Some define the dandy as “a pure phenomenon of fashion,” as an elegant personage, nothing more, concerned only to dress himself in the latest style. Others define him as a superficial personage who loves the good life and wanders idly from cabaret to cabaret. Françoise Dolto has painted a psychological portrait of the dandy. Still others emphasize almost exclusively the homosexual dimension of certain dandies like Oscar Wilde. Less commonly, the dandy is assimilated to a sort of avatar of Don Juan, who filled his emptiness by racking up female conquests. These definitions are not those of Otto Mann, which I have adopted.
The Archetype: George Bryan Brummell
Following Otto Mann, I hold that the dandy has a far deeper cultural significance than superficial Epicureans, hedonists, homosexuals, Don Juans, and fashion victims. For Otto Mann, the model, the archetype of the dandy remains George Bryan Brummell, a figure of the early 19th century, which he opposed.
Brummell, contrary to certain later pseudo-dandies, was a discrete man, who did not seek to draw attention to himself by vestimentary or behavioral eccentricities. Brummell avoided loud colors, did not wear jewels, was not devoted to purely artificial social games. Brummell was distant, serious, dignified; he did not try to make an impression, as did later figures as varied as Oscar Wilde, Stefan George, or Henry de Montherlant. For him, spiritual tendencies predominate. Brummell engaged society, conversed, told stories, using irony and even mockery. To speak like Nietzsche or Heidegger, we could say that he rose above the “human, too human” or quotidian banality (Alltäglichkeit).
Brummell, a first generation dandy, incarnates a cultural form, a way of being, that our contemporary society should accept as valid, indeed as solely valid, but that it can no longer generate, or generate sufficiently. Which is why the dandy opposes our society. The principal reasons that underlie his opposition are the following: (1) society appears as superficial and marked with inadequacies and insufficiencies; (2) the dandy, as a cultural form, as the incarnation of a manner of being, poses as superior to this inadequate and mediocre society; (3) the Brummellian dandy does nothing exaggerated or scandalous (sexually, for example), does not commit crimes, does not have political commitments (contrary to the dandies of the second generation like Lord Byron). Brummell himself could not maintain this attitude to the end of his days, because he was crippled by debts and died in poverty in a hospice in Caen. At a certain point, he had turned his back on the fragile equilibrium required by the initial posture of the dandy, of which he was the first incarnation.
An Ideal of Culture, Balance, & Excellence
If the dandy’s behavior and way of being contain no exaggeration, no flamboyant originality, then why does he appear important, or merely interesting, to us at all? Because he incarnates an ideal, which is to some extent, mutatis-mutandis, the same as Greek paiedeia or Roman humanitas. In Evola and Jünger, there is nostalgia for Latin magnanimitas, for the hochmuote of the Germanic knights of the 12th and 13th centuries, Roman or medieval avatars of a Persian proto-historical model, first advanced by Gobineau then by Henry Corbin. The dandy is the incarnation of this ideal of culture, balance, and excellence during one of the most trivial periods in history, where the crude, calculating bourgeois and the rowdy militant of the Hébertist or Jacobin sort took the place of the aristocrat, the knight, the monk, and the peasant.
At the end of the 18th century, with the French Revolution, these virtues, rising from the oldest proto-historical depths of European humanity, were completely called into question. First by the ideology of the Enlightenment and its corrolary, militant egalitarianism, which would erase all the visible and invisible traces of this ideal of excellence. Then, by the Sturm und Drang and Romanticism, which, by way of reaction, sometimes tilted toward ineffectual sentimentalism, which is also an expression of disequilibrium. The immemorial models, sometimes blurred and diffuse, the surviving archetypal attitudes . . . disappear.
The English first became aware of it, at the end of the 17th century, even before the upheavals of the 18th: Addison and Steele in the columns of the Spectator and the Tatler noted the urgent necessity of preserving and maintaining a system of education, a general culture able to guarantee the autonomy of man. A value that the current media do not promote, quiet proof that we have indeed fallen into an Orwellien world, which dons the mask of the “good democratic apostle,” inoffensive and “tolerant,” but pitilessly hounds down all residues of autonomy in the world today. In their successive articles, Addison and Steele bequeathed us an implicit vision of the cultural and intellectual history of Europe.
The highest cultural ideal Europe has ever known is of course ancient Greek paideia. It had been reduced to naught by primitive Christianity, but, from the 14th century on, one sees throughout Europe a desire for ancient ideals to be reborn. The dandy, and, long before his emergence on the European cultural scene, the two English journalists Steele and Addison, wished to incarnate this nostalgia for paideia, in which the autonomy of each individual is respected. In fact, they try to concretely realize in society Goethe’s objective: to incite their contemporaries to forge and fashion a personality, which will be moderate in its needs, satisfied with little, but above all capable, through this quiet asceticism, of reaching the universal, of being a model for all, without betraying its original humanity (Ausbildung seiner selbst zur universalen und selbstgenugsamen Persönlichkeit).
This Goethean ideal, shared avant la lettre by the two English publicists then incarnated by Brummell, was not unscathed by the vicissitudes of the French Revolution, the industrial revolution, and the assorted scientific revolutions. Under the blows of modernity’s contempt for the Ancient, Europe found itself devoid of any substantial culture, any ethical backbone. The consequences are fully apparent today in the decline of education.
From 1789 throughout the 19th century, the cultural level steadily collapsed. Cultural decline started at the top of the social pyramid, henceforth occupied by the triumphant bourgeoisie which, contrary to the dominant classes of former times, has no moral (sittlich) base capable of maintaining a high level of civilization; it has no religious base, nor any real professional ethic, unlike the craftsmen and tradesmen once supervised by their guilds or corporations (Zünfte). The sole aim of the bourgeoisie is the contemptible accumulation of cash, which allows us to speak, following René Guénon, of a “reign of quantity” in which all quality is banished.
In the disadvantaged classes at the bottom of the social ladder, any element of culture is eradicated quite simply because the pseudo-elites no longer uphold a cultural standard; the people, alienated, insecure, proletarianized, are no longer a matrix of specific enthnically determined values, much less a matrix capable of generating an active counter-culture that could easily nullify what Thomas Carlyle called the “cash-flow mentality.” In short, we are witnessing the rise of an affluent barbarism (eine ökonomisch gehobene Barbarei), economically advanced and culturally void.
One cannot be rich in the bourgeois style and also refined and intelligent. This is obviously true: nobody cultivated wants to find himself at dinner, or in conversation, with billionaires like Bill Gates or Albert Frère, nor with bankers or manufacturers of automobiles or refrigerators. The true man of culture, who would be lost in the presence of such dismal characters, would continually have to repress yawns at their inept chatter. (Those of a more volcanic temperament would have to repress the desire to rub a pie in the fat faces of these nullities.) The world would be purer—and surely more beautiful—without such creatures.
The Mission of the Artist According to Baudelaire
For the dandy, it is necessary to reinject aesthetics into this barbarism. In England, John Ruskin (1819–1899), the Pre-Raphaelites with Dante Gabriel Rossetti and William Morris, went to work. Ruskin elaborated architectural projects to embellish the cities made ugly by the anarchic industrialization of the Manchesterian era. Specifially, this led to the construction of “garden cities.” Henry van de Velde and Victor Horta, Belgian and German Art Nouveau or Jugendstil architects, took up this torch. But all the while, in spite of these concrete achievements—for architecture more easily allows concrete realization—the gulf between the artist and society never ceased growing. The dandy is like the artist.
In France, Baudelaire, in his theoretical writings, sets the artist up as the new “aristocrat,” whose attitude must be stamped with distant coldness, whose feelings should neither be excited nor irritated beyond measure, whose principal quality must be irony, along with the ability to tell pleasant anecdotes. The artistic dandy takes a distance from all the conventional hobby-horses of society.
Baudelaire’s views are summarized in the words of a character of Ernst Jünger’s novel Heliopolis: “I became a dandy, who makes the unimportant important, who smiles at the important” (“Ich wurde zum Dandy, der das Unwichtige wichtig nahm, das Wichtige belächelte”). Baudelaire’s dandy, following the example of Brummell, is thus not a scandalous and sulfurous character like Oscar Wilde, but a cold observer (or, to paraphrase Raymond Aron, a “disengaged spectator”), who sees the world as a mere theatre, often insipid, where characters without real substance move about and gesticulate. The Baudelairian dandy has a bit of a taste for provocation, but it remains confined, in most cases, by irony. These later exaggerations, often mistaken for expressions of dandyism, do not correspond to the attitudes of Brummell, Baudelaire, or Jünger.
Thus Stefan George, in spite of the great interest of his poetic work, pushes aestheticism to the point of self-parody. For George, it is a small price to pay in an era when the “loss of every happy medium” becomes the rule. (Hans Sedlmayr explained this loss of the “happy medium” quite clearly in a famous book on contemporary art, Verlust der Mitte.) Sedlmayr clarifies this urge to seek the “piquant.” George found it in the revival of classical Greece.
Oscar Wilde ultimately put only himself on stage, proclaiming himself “aesthetic reformer.” Art, from his point of view, is nothing more than a space of contestation destined ultimately to absorb all social reality, becoming the only true reality. The economic, social, and political spheres are devalued; Wilde denies them all substantiality, reality, concreteness. If Brummell retained an entirely sober taste, if he kept his head on his shoulders, Oscar Wilde posed from the start as a demigod, wore extravagant clothing, with loud colors, a bit like the Incroyables and the Merveilleuses of the French Revolution. A provocateur, he also started a negative process of “feminization/ devirilisation,” walking through the streets with flowers in his hand. One can regard it as a precursor of today’s “gay pride” parades. His poses are pure theatre, far removed from Brummell’s tranquil feeling of superiority, of virile dignity, of “nil admirari.”
Self-Satisfaction & the Expansion of the “Ego”
For Otto Mann, this quotation from Wilde is emblematic:
The gods had given me almost everything. I had genius, a distinguished name, high social position, brilliancy, intellectual daring: I made art a philosophy, and philosophy an art: I altered the minds of men and the colours of things: there was nothing I said or did that did not make people wonder: I took the drama, the most objective form known to art, and made it as personal a mode of expression as the lyric or the sonnet, at the same time that I widened its range and enriched its characterisation: drama, novel, poem in rhyme, poem in prose, subtle or fantastic dialogue, whatever I touched I made beautiful in a new mode of beauty: to truth itself I gave what is false no less than what is true as its rightful province, and showed that the false and the true are merely forms of intellectual existence. I treated Art as the supreme reality, and life as a mere mode of fiction: I awoke the imagination of my century so that it created myth and legend around me: I summed up all systems in a phrase, and all existence in an epigram. Along with these things I had things that were different. (De Profundis)
The patent self-satisfaction, the expansion of the “ego,” reach the point of mystification.
These exaggerations kept growing, even in the orbit of the stoic virility dear to Montherlant. He too strikes exaggerated poses: as practitioner of an extremely ostentatious bullfighting, being photographed wearing the mask of a Roman Emperor, etc. Lesser followers risk falling into flashy “lookism” and bad taste, formalizing to the extreme the attitudes or postures of the poet or the writer. In any case, they are not a solution to the phenomenon of decadence.
As regards dandyism, the only way out is to return calmly to Brummell himself, before he sank under financial vexations. Because this return to Brummell is equivalent, if one remembers the earlier exhortations of Addison and Steele, to a more modern—more civil and perhaps more trivial—form of paideia or humanitas. But, trivial or not, these values would be still be maintained, would continue to exist and shape minds.
This mix of good sense and the dandy aesthetic would make it possible to pursue a practical political objective: to defend the school in the classical sense of the term, to increase its power to transmit the legacy of Hellenic and Roman antiquity, to envisage a new and effective pedagogy, which would mix the idealism of Schiller, traditional methods, and the methods inspired by Pestalozzi.
Return to Religion or “Unhappy Consciousness”?
The figure of the dandy must thus be put back in the context of the 18th century, when the ideals and classical models of traditional Europe were being battered and destroyed under the butcher’s blows of leveling modernity. The substance of religion—whether Christian or pre-Christian under Christian varnish—becomes hollow and exhausted. The Moderns take the place of the Ancients. This process led inevitably to an existential crisis throughout European civilization.
Two paths are available to those who try to escape this sad destiny: (1) The return to religion or tradition, important paths that are not our topic today, to the extent that it represents an extremely vast continent of thought, deserving a complete seminar to itself. (2) To cultivate what the Romantics called Weltschmerz, the pain caused by a disenchanted world, which amounts to assuming an attitude of permanent critique toward the manifestations of modernity, developing an unhappy consciousness that generates a self-marginalizing culture where the political spirit can formulate an opposition to the mainstream.
For the dandy and the Romantic who oscillate between the return to religion and the feeling of Weltschmerz, the latter is most deeply felt. In the interiority of the poet or the artist this feeling will mature, grow, develop. To the point of becoming immune to the power of the unhappy consciousness to cause both languid and violent emotions. In the end, the dandy must become a cold and impartial observer in control of his feelings and emotions. If his blood boils at “economic horrors” it must quickly cool, leading to impassiveness, if he is to be able to face them effectively. The dandy who underwent this process thus reached a double impassibility: nothing external can shake him any longer; but neither can any interior emotion.
Pierre Drieu La Rochelle was never able to arrive at such a balance, which gives a very peculiar and seductive note to his work, quite simply because it reveals this process underway, with all its eddies, calms, and advances. Drieu suffers from the world, is tested on the front lines, is seduced by the discipline and “metallic” aspects of “immense and red” Fascism, on the march in his time, mentally accepts the same discipline in the Communists and Stalinists, but never really becomes a “cold and impartial observer” (Benjamin Constant). The work of Drieu La Rochelle is justly immortal because it reveals this permanent tension, this fear to falling into the ruts of a barren emotion, this joy at seeing vigorous alternatives to modern torpor, like Fascism or the satire of Doriot.
Strengthening Mind & Character
In short, the deconstruction of the ideas of ancient paideia and the deliquescence of immemorial religious substantialities beginning at the end of the 18th century, is equivalent to an existential crisis throughout all Western countries. The response of intelligence to this crisis is double: either it calls for a return to religion or it causes a deeply rooted pain in the depths of the soul, the famous Weltschmerz of the Romantics.
Weltschmerz is felt in the deepest interiority of the man who faces this crisis, but it is also in his interiority that he works silently to rise above this pain, to make it the material from which he forges the answer and alternative to this terrible loss of substantiality that is presided over by a deleterious economicism. It is thus necessary to harden the mind and character against the pangs entailed by the loss of substantiality without inventing out of whole cloth a rather lame substitute for what has been lost.
Baudelaire and Wilde think, each in his own way, that art will offer an alternative to the old substantialities that is almost identical in all ways but more flexible and moving. But in this case, art need not be understood as simple aestheticism. The toughening of the mind and character must serve to combat the ambient economicism, to fight against those who incarnate it, accept it, and puts their energies in its service. This toughness must be used as the firm moral and psychological base of the ideals of political and metapolitical struggle.
This toughness must be the carapace of what Evola called the “differentiated man,” he who “rides the tiger,” who wanders, unperturbed and imperturbable, “among the ruins,” the one Jünger called the “Anarch.” “The differentiated man who rides the tiger among the ruins” or the “Anarch” are described as impartial, impassive observers. These tough, differentiated men rise above two kinds of obstacles: external obstacles and those generated from their own interiority. That is to say, the impediments posed by inferior men and the weaknesses of a soul in distress.
Chandala Figures of Decadence
The existential crisis that began around the middle of the 18th century led to nihilism, quite judiciously defined by Nietzsche as an “exhaustion of life,” as a “devaluation of the highest values,” which is often expressed by a frantic agitation and the inability to really enjoy leisure, an agitation that accelerates the process of exhaustion.
The abstraction of existence is the clear indication that our “societies” no longer constitute “bodies” but, as Nietzsche says, mere “conglomerates of Chandalas,” in whom nervous and psychological maladies accumulate, a sign that the defensive power of strong natures is no more than a memory. It is precisely this “defensive power” that the “differentiated” man must—at the end of his search for traditional mysteries—reconstitute in himself.
Nietzsche very clearly enumerates the vices of the Chandala, the emblematic figure of European decadence, resulting from the existential crisis and nihilism: the Chandala suffers various pathologies: an increase in criminality, generalized celibacy and voluntary sterility, hysteria, constant weakening of the will, alcoholism (and various drug addictions as well), systematic doubt, a methodical and relentless destruction of any residue of strength.
Among the Chandala figures of decadence and nihilism, Nietzsche includes those he calls “official nomads” (Staatsnomaden), who are civil servants without real fatherlands, servants of the “cold monster,” with abstract minds that, consequently, generate always more abstractions, whose parasitic existence generates, by their appalling but persistent sluggishness, the decline of families, in a environment made of contradictory and crumbling diversities, where one finds the “discipline” (Züchtung) of characters to serve the abstractions of the cold monster—a generalized lubricity in the form of irritability and as the expression of an insatiable and compensatory need for stimuli and excitations—neuroses of all types—political “presentism” (Augenblickdienerei) in which long memory, deep perspectives, or a natural and instinctive sense for the right no longer prevail—pathological sensitiveness—barren doubts proceeding of a morbid fear of the unyielding forces that made and will still make history/power—a fear of mastering reality, of seizing the tangible things of this world.
Victor Segalen in Oceania, Ernst Jünger in Africa
In this complex of frigidity, of agitated opposition to change, barren frenzies, and neuroses, one primary response to nihilism is to exalt and concretize the principle of adventure, in which the protester will leave the bourgeois world, with its tissue of artifices, moving towards virgin spaces that are intact, authentic, open, mysterious.
Gauguin left for the Pacific Islands.
Victor Segalen, in his turn, praises primordial Oceania and imperial China perishing under the blows of the Westernization. Segalen remains Breton, according to what he calls the “return to the ancestral marrow,” denounces the invasion of Tahiti by the “American romantics,” these “filthy parasites,” writes an “Essay on Exoticism” and “An Aesthetics of the Different.” The rejection of bits and pieces without much of a past cost Segalen an unjustified ostracism in his fatherland. From our point of view, he is an author worth rediscovering.
The young Jünger, still in adolescence, dreamed of Africa, the continent of elephants and other fabulous creatures, where spaces and landscapes are not ravaged by industrialization, where nature and indigenous people preserved a formidable purity, where everything was still possible. The young Jünger joined the French Foreign Legion to realize this dream, to be able to land on this new continent, glutted with mysteries and vitality.
The year 1914 gave him, and his whole generation, a chance to abandon an enervating existence. In the same vein, Drieu La Rochelle spoke of the élan of Charleroi. And later, Malraux, of “Royal roads.”
On the “left” (in so far as this political distinction has any meaning), one instead speaks of “engagement.” This enthusiasm was especially apparent at the time of the Spanish Civil War, where Hemingway, Orwell, Koestler, and Simone Weil joined the Republicans, and Roy Campbell the Nationalists, who were also lauded by Robert Brasillach.
The adventure and engagement, in the uniform of a soldier of the phalangist militia, in the ranks of the international brigades or the partisans, are perceived as antidotes to the hyperformalism of a colorless civilian life. “I was tired of civilian life, therefore I joined the IRA,” goes the Irish nationalist song, which, in its particular context, proclaims, with a jaunty tune, this great existentialist uprising of the early 20th century with all the ease, vivacity, rhythm, and humor of Green Éire.
 Intoxication? Drugs? Amoralism?
Intoxication? Drugs? Amoralism?
But if political or military commitment fulfills the spiritual needs of those those who are bored by the unrelieved formalism of civilian life without traditional balance, the rejection of all formalism can lead to other less positive attitudes. The dandy, who departs from the balanced pose of Brummell or the delicately crafted criticism of Baudelaire, will want to experience ever new excitations, merely for the sterile pleasure of trying them.
Drugs, drug-addiction, the excessive consumption of alcohol constitute possible escapes: the romantic figure created by Huysmans, Des Esseintes, fled to liquor. Thomas De Quincey evoked “The Opiumeaters.” Baudelaire himself tried opium and hashish.
Falling into drug-addiction is explained by the closing of the world, after the colonization of Africa and other virgin territories; real, dangerous adventure is no longer possible there. War, tested by Jünger around the same time as “drugs and intoxications,” lost its attraction because the figure of the warrior becomes an anachronism as wars are excessively professionalized, mechanized, and technologized.
Amorality and anti-moralism are more dead-ends. Oscar Wilde frequented sleazy bars, ostentatiously flaunting his homosexuality. His character Dorian Gray becomes a criminal in order to press his transgressions ever further, with a pitiful sort of hubris. One might also recall Montherlant’s painful end and keep in mind his dubious heritage, continued to this day by his executor, Gabriel Matzneff, whose literary style is certainly quite brilliant but in whose wake the saddest scenarios unfold, carried on in secret, in closed circles, all the more perverse and ridiculous since the sexual revolutuion of the 1960s also allows enjoyment without petty moralism of many strong pleasures.
These drugs, transgressions, and sex-crazed buffooneries, are just so many existential traps and cul-de-sacs where unfortunates ruin themselves in search of their “spiritual needs.” They wish to “transgress,” but this, to the ironical observer, is nothing more than a sad sign of wasted lives, the absence of real vitality, and sexual frustrations due to defects or physical infirmities. Certainly, one cannot “ride the tiger”—indeed it would be hard to find one—in the salons where the old fop Matzneff lets drop tidbits of his sexual encounters to his creepy little admirers.
Religious Asceticism
The true alternative to the bourgeois world of “little jobs” and “petty calculations” mocked by Hannah Arendt, in a world now closed, where adventures and discoveries are henceforth nothing but repetitions, where war is “high tech” and no longer chivalrous, lies in religious asceticism, in a certain return to the monarchism of meditation, in the return to Tradition (Evola, Guénon, Schuon). Drieu La Rochelle evokes this path in his “Journal,” after his political disappointments, and gives an account of his reading of Guénon.
The Schuon brothers are exemplary in this context: Frithjof joined the Foreign Legion, surveyed the Sahara, made the acquaintance of the Sufis and the marabouts of the desert and the Atlas Mountains, adhered to an Isamized Sufi mysticism, then went to the Sioux Indian reservations in the United States, and left a stunning and astounding body of pictorial work.
His brother, named “Father Galle,” surveyed the Indian reservations of North America, translated the Gospels into the Sioux language, withdrew to a Trappist monastery in Walloonia, where he trained young horses Indian-style, met Hergé, and became friends with him.
Their lives prove that adventure and total escape from the artificial and corrupting world of the Westernization (Zinoviev) remains possible and fruitful.
For the rebellion is legitimate, if one does not fall into the traps.
Contribution to the “SYNERGON-Deutschland” seminar, Lower Saxony, May 6, 2001.
00:10 Publié dans Littérature, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, lettres, dandy, dandysme, philosophie, théorie littéraire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Jean Mabire: de quelques écrivains guerriers
De quelques écrivains-guerriers
Ils sont ici un peu moins d’une vingtaine – deux groupes de combat avec leur équipe de voltige et leur pièce d’appui – qui seraient parfois surpris de se trouver ensemble. Les conflits qu’ils ont vécus se suivent et ne se ressemblent pas, tout au long de ce bref quart de siècle où la France a réussi à perdre trois guerres et à n’en gagner qu’une seule, dans le sillage d’alliés qui ont fait le plus gros de la besogne. Mais ces hommes, quels sont-ils? Des écrivains ou des guerriers? Les deux, tour à tour et parfois en même temps.
Remarquons d’abord qu’il y a peu de professionnels. Les guerres modernes ont été tragiquement vécues par ceux dont ce n’était pas le métier. Aussi ne se trouve-t-il qu’un seul saint-cyrien dans cette cohorte: Pierre Sergent. Et encore il intégra Coët en 1944, après avoir été volontaire dans un maquis.
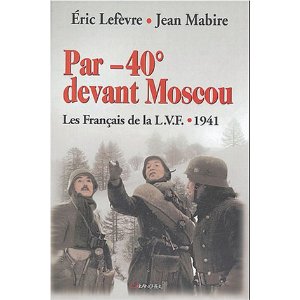 Et Marcel Bigeard? Mais c’est le type même de l’officier sorti du rang, qui commence sa carrière avec les godillots de 2e classe et la termine avec les étoiles de général. Sans la captivité et surtout sans la Résistance, il serait resté petit employé de banque, peut-être directeur d’une succursale dans une sous-préfecture des marches de l’Est. Bigeard n’en reste pas moins l’exemple même de ceux que les événements ont révélé à lui-même: ce n’est pas un militaire, c’est un soldat. Ce n’est pas un mince compliment. Il ne deviendra écrivain que sur le tard, à l’âge de la retraite (mot qu’il n’aime pas) et des Mémoires. Il y nourrit ses nostalgies guerrières de quelques jugements parlementaires menés, selon son habitude, tambour battant.
Et Marcel Bigeard? Mais c’est le type même de l’officier sorti du rang, qui commence sa carrière avec les godillots de 2e classe et la termine avec les étoiles de général. Sans la captivité et surtout sans la Résistance, il serait resté petit employé de banque, peut-être directeur d’une succursale dans une sous-préfecture des marches de l’Est. Bigeard n’en reste pas moins l’exemple même de ceux que les événements ont révélé à lui-même: ce n’est pas un militaire, c’est un soldat. Ce n’est pas un mince compliment. Il ne deviendra écrivain que sur le tard, à l’âge de la retraite (mot qu’il n’aime pas) et des Mémoires. Il y nourrit ses nostalgies guerrières de quelques jugements parlementaires menés, selon son habitude, tambour battant.
Son âge lui a permis de participer à toutes les guerres: 39-40, la résistance, 44-45, l’Indo, l’Algérie, sans compter quelques aventures qui ne sont plus qualifiées aujourd’hui «coloniales», mais seulement «extérieures». De tous les guerriers de ce recueil, il reste le plus incontournable et de tous les écrivains, le moins nécessaire. Mais quel personnage!
Ce n’est pas sur une réputation militaire que s’est établie la renommée de Guy des Cars. Cet aristocrate devenu un des champions du roman populaire à gros tirage a pourtant fait, à trente ans, une entrée fracassante dans la république des Lettres, en 1941, avec un superbe récit, L’Officier sans nom, dans lequel il racontait avec un accent de vérité indéniable ce que fut sa guerre de 39-40.
On a trop oublié que l’armée française devait laisser sur le terrain cent vingt mille tués. Le fameux devoir de mémoire plaçait alors le sacrifice de ces garçons en priorité absolue dans le souvenir de leurs compatriotes. S’ils ne sont pas aujourd’hui totalement oubliés, c’est entre autres à Guy des Cars qu’on le doit.
Après cette brève et désastreuse expérience militaire, il devait remiser à jamais son uniforme dans la naphtaline d’une vieille cantine et on ne le verra plus sur un champ de bataille. Mais il représente fort bien l’itinéraire des meilleurs de sa génération. Quant à sa trajectoire d’écrivain, elle est plus honorable que ne veulent l’avouer ces critiques envieux qui l’avaient surnommé «Guy des Gares».
 À la même génération appartient Marc Augier. Si sa campagne de 39-40 ne fut guère mémorable, il devait se rattraper par la suite. Militant socialiste et pacifiste du temps du Front populaire, il avait commencé une originale carrière de journaliste, de motard et de campeur, publiant un assez beau récit sur un Solstice en Laponie. Après avoir partagé les espoirs et les rêves de ses camarades des Auberges de la jeunesse, Les Copains de la belle étoile, on le retrouve animateur d’un mouvement d’adolescents au temps de ce qu’on nommait l’Europe nouvelle. Il n’était pas homme à inciter ses garçons à aller se battre en Russie sans s’y rendre lui-même, sous-officier de la LVF et correspondant de guerre. Il en ramènera un court récit, Les Partisans, et une réputation de maudit qui lui collera à jamais à la peau. Pourchassé et exilé en Amérique du Sud, le réprouvé Augier deviendra le romancier Saint-Loup. Sans une indiscrétion sur son passé, il aurait sans doute obtenu le prix Goncourt en 1952. Il fera mieux et réussira à gagner un public vite fanatique d’une œuvre qui doit beaucoup à ses expériences vécues dangereusement.
À la même génération appartient Marc Augier. Si sa campagne de 39-40 ne fut guère mémorable, il devait se rattraper par la suite. Militant socialiste et pacifiste du temps du Front populaire, il avait commencé une originale carrière de journaliste, de motard et de campeur, publiant un assez beau récit sur un Solstice en Laponie. Après avoir partagé les espoirs et les rêves de ses camarades des Auberges de la jeunesse, Les Copains de la belle étoile, on le retrouve animateur d’un mouvement d’adolescents au temps de ce qu’on nommait l’Europe nouvelle. Il n’était pas homme à inciter ses garçons à aller se battre en Russie sans s’y rendre lui-même, sous-officier de la LVF et correspondant de guerre. Il en ramènera un court récit, Les Partisans, et une réputation de maudit qui lui collera à jamais à la peau. Pourchassé et exilé en Amérique du Sud, le réprouvé Augier deviendra le romancier Saint-Loup. Sans une indiscrétion sur son passé, il aurait sans doute obtenu le prix Goncourt en 1952. Il fera mieux et réussira à gagner un public vite fanatique d’une œuvre qui doit beaucoup à ses expériences vécues dangereusement.
De la demi-douzaine de garçons qui ont choisi la Résistance et se retrouvent ici, on peut d’abord dire qu’ils étaient jeunes, très jeunes même quand ils ont choisi leur camp, au risque de leur peau. Ils n’avaient rien écrit, sauf quelques dissertations scolaires quand ils se sont lancés dans la bagarre.
Alain Griotteray fut du premier rendez-vous, celui qui lança quelques étudiants devant l’Arc-de-Triomphe par un glacial 11 novembre d’occupation. Cette manifestation trop oubliée fut le prélude d’un mouvement de défi qui porta les plus intrépides vers les maquis.
Pierre de Villemarest choisit pour sa part ce massif montagneux, véritable forteresse naturelle qui devait devenir le plus célèbre haut lieu des combattants de la nuit et du brouillard: le Vercors.
Pierre Sergent se retrouve en Sologne, soldat sans uniforme, en un temps où les volontaires ne se bousculaient pas, car les occupants tenaient solidement le pays. Il choisit ainsi d’entrer dans la carrière des armes par la porte la plus étroite et la plus rude.
Le maquis de Roger Holeindre, ce fut le pavé de Paris où il joua au Gavroche sur les barricades, s’emparant de haute lutte d’une mitrailleuse ennemie et gagnant à jamais le droit d’ouvrir sa gueule quand poussèrent comme champignons les fameux «résistants de septembre», une fois l’orage de feu apaisé.
André Figueras réussit à fuir le pays occupé et à rejoindre l’armée régulière, ce qui lui valut de revenir au pays pistolet-mitrailleur au poing et coiffé du béret noir des commandos.
Sergent, comme les quatre autres, a vécu assez pour se faire traiter de «fasciste» par ceux qui arborent à la boutonnière le triangle rouge des déportés politiques devenu l’insigne de «Ras l’front», plus d’un demi-siècle après la fin de la dernière guerre, tout danger écarté.
Parmi les cent soixante-dix-sept Français qui débarquèrent de vive force sur les côtes normandes à l’aube du 6 juin 1944, se trouvait un garçon de 19 ans. Ce jeune Breton de Cornouailles avait déjà réussi un exploit en rejoignant l’Angleterre à bord d’un minuscule rafiot à voile. Il se nomme Gwen-Aël Bolloré et sert alors comme quartier-maître infirmier.
 Une belle carrière l’attend: chef d’entreprise, océanographe, éditeur, poète, romancier, mémorialiste. L’ancien du commando Kieffer sera lié avec toutes les personnalités de la république des Lettres. Mais son plus grand titre de gloire est d’avoir défié le pouvoir, en s’en prenant au général-président, dont il n’approuvait guère la politique algérienne. Il avait montré du courage et du talent. Il devait prouver alors qu’il avait aussi du caractère, chose surprenante chez un personnage aussi convivial.
Une belle carrière l’attend: chef d’entreprise, océanographe, éditeur, poète, romancier, mémorialiste. L’ancien du commando Kieffer sera lié avec toutes les personnalités de la république des Lettres. Mais son plus grand titre de gloire est d’avoir défié le pouvoir, en s’en prenant au général-président, dont il n’approuvait guère la politique algérienne. Il avait montré du courage et du talent. Il devait prouver alors qu’il avait aussi du caractère, chose surprenante chez un personnage aussi convivial.
Ceux pour qui la résistance – la vraie – prenait fin avec la défaite du iiie Reich et le jugement de Nuremberg, n’en avaient pas fini avec le combat. En Extrême-Orient, une guerre s’allumait. Les Viets arboraient l’étoile des anciens alliés soviétiques. La croix gammée fracassée, cette étoile devenait pour eux le symbole de l’ennemi. Pas question de se mettre à écrire tranquillement. Des volontaires partaient à l’autre bout du monde. Les meilleurs servaient dans les parachutistes, vite légendaires. On allait y retrouver nos anciens résistants: Holeindre avec le béret rouge des paras coloniaux et Sergent avec le béret vert des légionnaires paras.
Bientôt les rejoint un jeune sous-lieutenant qui devait devenir, quelques années plus tard, le plus célèbre des écrivains guerriers, garçon qui fit ses universités à Diên Biên Phu. Il se nommait Erwan Bergot. Comme tous ses camarades d’aventure indochinoise, il allait être marqué par ce «mal jaune», grande nostalgie maladive du Sud lointain.
Servant comme chef de section dans les rangs du bataillon Bigeard, il se révélera le meilleur parmi les meilleurs. Une promotion de l’école des élèves-officiers de réserve de l’école d’Infanterie de Montpellier portera un jour son nom. Les jeunes aspirants qui ont choisi ce patron se réclamaient à la fois du combattant et de l’écrivain, car il fut l’incarnation exemplaire de ces deux vocations exigeantes.
L’année même où tombaient l’un après l’autre les pitons aux noms de femmes disséminés dans la sinistre cuvette choisie par le haut-commandement, un autre feu s’allumait en Algérie. Bigeard devait y construire sa légende tout au long de la «piste sans fin» où progressaient ses léopards, l’index crispé sur la queue de détente de leur MAT 49. Un jour, devenu général, député, ministre, il écrira des livres. Pour le moment, c’est sur le terrain qu’il se veut maître et seigneur.
Cette guerre, où combattent côte à côte gens de métier et gars du contingent, va être la grande aventure de toute une nouvelle génération. Seuls les aînés comme Holeindre ou Sergent ont connu la résistance et seul Bergot – comme son chef Bigeard – a vécu l’enfer des camps viets, où la mortalité était pire qu’à Dachau ou à Tambow. Leurs camarades, futurs écrivains, mais provisoires combattants, sont des garçons dont ce n’est pas le métier de se battre, mais qui vont se débrouiller aussi bien que leurs aînés des maquis et des rizières.
Rien ne distingue, sur les superbes photos prises par l’officier marinier René Bail, ancien de l’Aéronavale, les appelés et les professionnels. Ils portent la même tenue camouflée, ils ont le même visage ruisselant de sueur sous la casquette de combat.
Dans cette armée qui passe ses nuits et ses jours dans les djebels, rien ne sépare les gradés de leurs hommes. Ils partagent tout. Et la soif et la peur et le froid («L’Algérie est un pays froid où le soleil est chaud», disent les anciens). Ils vivent en plein vent, dans la caillasse et la boue, dans le sable et les ronciers. Finalement, ils ont le même âge ou presque et se ressemblent étrangement en cette fin des années cinquante de notre siècle.
Les soldats d’outre-Méditerranée sont alors en train de durement gagner sur le terrain, tandis que d’autres à Paris vont jeter la crosse après le fusil, comme on jette le manche après la cognée. Cette défaite programmée fera d’eux des rebelles et même des hors-la-loi, marqués à jamais par cette expérience tragique du courage et de la peur, où ils ont vu tomber pour rien les meilleurs de leurs camarades.
Ce fut une sacrée équipe que celle de ces soldats plus ou moins perdus, dont les chemins par la suite ne vont cesser de se croiser et de se recroiser. En voici une demi-douzaine, dont l’amertume et la lucidité ne vont pas faire oublier les dures joies de la camaraderie et de l’enthousiasme. Nous les découvrons côte à côte, une dernière fois, sur cette terre d’Algérie (et de Tunisie pour l’un d’eux) qui les a tant marqués: le quartier-maître de fusiliers marins commandos Georges Fleury, le brigadier de chasseurs d’Afrique Jean Bourdier, le sergent de chasseurs à pied Dominique Venner, le lieutenant de tirailleurs Philippe Héduy, le lieutenant d’alpins Jean Mabire.
À eux cinq, appelés ou rappelés, ils incarnent des vertus militaires que ne désavouèrent pas le «vieux» briscard parachutiste Roger Holeindre qui n’a guère soufflé depuis la Résistance et poursuit en Algérie les opérations de commando inaugurées en Indochine.
Leurs chansons, leurs crapahuts, leurs combats impressionnent fort un garçon plus jeune qu’eux, fils et petit-fils de soldats, marqué au fer rouge par la disparition en Indochine de son père, un légionnaire d’origine russe. Ainsi, par le privilège du sang versé par les siens, Serge de Beketch figure ici à côté de ses aînés.
Tout comme le romancier Serge Jacquemard, très jeune témoin des atrocités de plusieurs guerre celle d’Espagne où ses parents furent pris en otage, celle de l’Occupation et de ses rigueurs et celle du coup d’État en Indonésie qui porta Suharto au pouvoir pour plusieurs décennies. S’il ne fut pas véritablement guerrier lui-même, sa rencontre avec le Bat’ d’Af’ Maurice H. influencera une grande partie de son œuvre.
Et puis, pour beaucoup, ce sera le retour, le retour écœurant dont parlait Pierre Mac Orlan. Viendront le complot, l’aventure, la prison, l’exil, ce qu’ils nomment parfois «la politique» et qui n’est pour eux qu’une nouvelle manière de se battre. Ils ne seront pas des journalistes ou des écrivains «comme les autres». Leurs articles ou leurs bouquins gardent toujours l’empreinte de combats vécus avant d’être rêvés. Ils sont à jamais différents du monde des civils, méprisant cette «civilisation» qui a voulu transformer les centurions en boutiquiers. Ils ne marchent pas dans la société marchande. Ils sont à jamais libérés du libéralisme. Ils savent que la vie est une lutte et que toutes les armes comme toutes les ruses y sont bonnes.
Ils ne croient pas plus à la droite qu’à la gauche. Ils savent que la première des consignes, dans la paix comme dans la guerre, est de garder ses distances… Ils étaient des soldats d’occasion. Ils ne sont pas vraiment sûrs d’être des écrivains de métier. Ils savent seulement qu’il n’est plus possible de tricher. Leur encre aura toujours le goût du sang.
* * *
Préface au livre Ils ont fait la guerre de Philippe Randa (en vente sur www.dualpha.com).
00:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean mabire, littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, guerre, militaria, soldats |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 24 août 2010
Frank Goovaerts: Aphorismes (1) / 1985

Frank GOOVAERTS :
Aphorismes (1)
1985
Le prêtre veut ton âme. Le fisc veut ton argent. Seule la femme est plus exigeante encore : elle veut les deux.
La Vie : l’éternel retour du chemin qui ne mène nulle part.
Je comprends sacrément bien que je ne suis pas un homme de ce siècle. Mais cela ne signifie pas pour autant que je me défendrai avec des moyens moyenâgeux.
X est une de mes connaissances, inspirée par les idées gauchistes. Chaque jour, il fulmine contre la pauvreté, la faim et la misère dans ce bas monde. « Les capitalistes », dit-il chaque fois en concluant ses discours, « ne méritent qu’une chose, être pendus, car ils sont seuls responsables de l’exploitation du Tiers Monde ». Parmi ses dadas, il y a aussi la perte de toute dignité des indigènes de tous poils.
Récemment, X m’a pris par le bras, tout excité, pour me raconter, sur un ton fou, le « voyage de rêve » qu’il venait de faire en Thaïlande. En extase, il évoquait ses escapades érotiques avec les belles de ce lieu.
« Et », ajoutait-il, «baiser, là-bas, cela ne coûte presque rien. Pour obtenir quelques-unes de nos devises occidentales, ces misérables satisfont même nos désirs les plus intimes… ».
Beaucoup pensent que pour nager à contre-courant, il faut simplement avoir des muscles puissants. Cela nous explique, du moins en partie, pourquoi tant d’imbéciles s’adonnent au body building, surtout au niveau intellectuel.
« De l’école de guerre qu’est la vie : ce qui ne m’abat pas, me rend plus fort » (Nietzsche). Comme c’est merveilleux, après lecture de cet aphorisme, de se sentir soi-même général.
Ah, ce bon vieux prof de philo qui nous disait : « Marx a inversé Hegel et l’a mis sur la tête ; Lénine a inversé Marx. C’est cela le communisme ».
Le communisme serait-il… gymnastique ?
Qu’est Dieu sinon l’ultime réponse à la toute dernière question.
Les femmes ! Je sais tout d’elles. C’est justement pourquoi jamais je ne prétendrai les connaître.
Les termes « maquignonnage » et « deux poids deux mesures » surgissent maintes fois dans les discours en Flandre. Il faut en chercher l’origine dans le fait que les Flamands aiment finalement se faire traire par la Belgique et que leurs dirigeants politiques sont des poids plumes.
Tu es en vacances en Provence et des connaissances t’invitent à une petite fête. Après quelques verres, quelqu’un a l’idée lumineuse de faire un petit tour à moto. Dans l’allégresse et la joie générales, tu heurtes le bord d’un trottoir. Résultat : ta moto est foutue, tu as récolté des blessures visibles et invisibles, tu as dû subir une intervention chirurgicale pour faire raccommoder ton estomac, tu la subis en bon état d’éveil (et tu ne tombes dans le coma qu’après…) et tu passes trois semaines à l’hôpital.
Adieu vacances, adieu soleil, adieu vin rouge, adieu demoiselles faciles ! Toute une année d’espérances s’évanouit comme neige au soleil. Et quand tu émerges du coma trois jours plus tard, les premiers mots du médecin : « Vous avez eu beaucoup de chance ! ».
Un homme intelligent peut commettre beaucoup d’erreurs, un demeuré ne peut en commettre qu’une seule.
La politique, c’est le télescopage quotidien des Weltanschauungen. Mais le plus souvent, c’est le télescopage d’intérêts.
Althusser s’est vengé pour Socrate.
L’argument inévitable d’une femme laide dans une conversation traitant de jolies filles : « D’une belle table, tu ne peux point manger ! ». C’est bien possible mais une table laide ne m’éveille pas l’appétit.
« La volonté est forte mais la chair est faible ». C’est une parole qui dévoile votre véritable visage, vous les matérialistes !
Quand tes ennemis recensent ton travail, l’envie te prend de leur envoyer une lettre piégée. Mais quand tes amis font de même, tes mains nues devraient suffire !
Dieu est certes devenu un pécheur convaincu le jour où l’Eglise a inventé le péché.
Et JE vis, MOI, que c’était bien.
Il appartenait à cette espèce d’hommes qui ne croit qu’en Dieu et qu’aux miracles le jour où il a rempli son formulaire de loto.
Dieu a été suicidé par les chrétiens.
A une femme que tu aimes vraiment, jamais ton amour ne déclareras.
Tu te demandes parfois pourquoi Dieu a crée l’homme, s’il abhorre tant le péché.
L’Eglise est si entichée du péché qu’elle aimerait bien amener Dieu lui-même dans le confessionnal, parce qu’il a créé l’homme.
Le « sens de la vie » est l’éternelle question que posent ceux qui sont trop faibles pour lui donner eux-mêmes du sens.
Ex : Frank Goovarts, « Aforismen », Were Di, Antwerpen, 1991.
00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : anvers, flandre, littérature, lettres, lettres flamandes, lettres néerlandaises, littérature néerlandaise, mouvement flamand |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 23 août 2010
Paganismo y filosofia de la vida en Knut Hamsun y D. H. Lawrence
Paganismo y filosofía de la vida en Knut Hamsun y D.H. Lawrence
Robert STEUCKERS
Knut Hamsun en "Dikterstuen", Nørholm, 1930

Robert Steuckers*
El filólogo húngaro Akos Doma, formado en Alemania y los Estados Unidos, acaba de publicar una obra de exégesis literaria, en el que hace un paralelismo entre las obras de Hamsun y Lawrence. El punto en común es una “crítica de la civilización”. Concepto que, obviamente, debemos aprehender en su contexto. En efecto, la civilización sería un proceso positivo desde el punto de vista de los “progresistas”, que entienden la historia de forma lineal. En efecto, los partidarios de la filosofía del Aufklärung y los adeptos incondicionales de una cierta modernidad tienden a la simplificación, la geometrización y la “cerebrización”. Sin embargo, la civilización se nos muestra como un desarrollo negativo para todos aquellos que pretenden conservar la fecundidad inconmensurable de los veneros culturales, para quienes constatan, sin escandalizarse por ello, que el tiempo es plurimorfo; es decir, que el tiempo para una cultura no coincide con el de otra, en contraposición a los iluministas quienes se afirman en la creencia de un tiempo monomorfo y aplicable a todos los pueblos y culturas del planeta. Cada pueblo tiene su propio tiempo. Si la modernidad rechaza esta pluralidad de formas del tiempo, entonces entramos irremisiblemente en el terreno de lo ilusorio.
Desde un cierto punto de vista, explica Akos Doma, Hamsun y Lawrence son herederos de Rousseau. Pero, ¿de qué Rousseau? ¿Quién que ha sido estigmatizado por la tradición maurrasiana (Maurras, Lasserre, Muret) o aquél otro que critica radicalmente el Aufklärung sin que ello comporte defensa alguna del Antiguo Régimen? Para el Rousseau crítico con el iluminismo, la ideología moderna es, precisamente, el opuesto real del concepto ideal en su concepción de la política: aquél es antiigualitario y hostil a la libertad, aunque reivindique la igualdad y la libertad. Antes de la irrupción de la modernidad a lo largo del siglo XVIII, para Rousseau y sus seguidores prerrománticos, existiría una “comunidad sana”, la convivencia reinaría entre los hombres y la gente sería “buena” porque la naturaleza es “buena”. Más tarde, entre los románticos que, en el terreno político, son conservadores, esta noción de “bondad” seguirá estando presente, aunque en la actualidad tal característica se considere en exclusiva patrimonio de los activistas o pensadores revolucionarios. La idea de “bondad” ha estado presente tanto en la “derecha” como en “izquierda”.
Sin embargo, para el poeta romántico inglés Wordsworth, la naturaleza es “el marco de toda experiencia auténtica”, en la medida en que el hombre se enfrenta de una manera real e inmediatamente con los elementos, lo que implícitamente nos conduce más allá del bien y del mal. Wordsworth es, en cierta forma, un “perfectibilista”: el hombre fruto de su visión poética alcanza lo excelso, la perfección; pero dicho hombre, contrariamente a lo que pensaban e imponían los partidarios de las Luces, no se perfecciona sólo con el desarrollo de las facultades de su intelecto. La perfección humana requiere sobre todo pasar por la prueba de lo elemental natural. Para Novalis, la naturaleza es “el espacio de la experiencia mística, que nos permite ver más allá de las contingencias de la vida urbana y artificial”. Para Eichendorff, la naturaleza es la libertad y, en cierto sentido, una trascendencia, pues permite escapar a los corsés de las convenciones e instituciones.
Con Wordsworth, Novalis y Eichendorff, las cuestiones de lo inmediato, de la experiencia vital, del rechazo de las contingencias surgidas de la artificialidad de los convencionalismos, adquieren un importante papel. A partir del romanticismo se desarrolla en Europa, sobre todo en Europa septentrional, un movimiento hostil hacia toda forma moderna de vida social y económica. Carlyle, por ejemplo, cantará el heroísmo y denigrará a la “cash flow society”. Aparece la primera crítica contra el reino del dinero. John Ruskin, con sus proyectos de arquitectura orgánica junto a la concepción de ciudades-jardín, tratará de embellecer las ciudades y reparar los daños sociales y urbanísticos de un racionalismo que ha desembocado en puro manchesterismo. Tolstoi propone una naturalismo optimista que no tiene como punto de referencia a Dostoievski, brillante observador este último de los peores perfiles del alma humana. Gauguin transplantará su ideal de la bondad humana a la Polinesia, a Tahití, en plena naturaleza.
Hamsun y Lawrence, contrariamente a Tolstoi o a Gauguin, desarrollarán una visión de la naturaleza carente de teología, sin “buen fin”, sin espacios paradisiacos marginales: han asimilado la doble lección del pesimismo de Dostoievski y Nietzsche. La naturaleza en éstos no es un espacio idílico propicio para excursiones tal y como sucede con los poetas ingleses del Lake District. La naturaleza no sólo no es un espacio necesariamente peligroso o violento, sino que es considerado apriorísticamente como tal. La naturaleza humana en Hamsun y Lawrence es, antes de nada, interioridad que conforma los resortes interiores, su disposición y su mentalidad (tripas y cerebro inextricablemente unidos y confundidos). Tanto en Hamsun como en Lawrence, la naturaleza humana no es ni intelectualidad ni demonismo. Es, antes de nada, expresión de la realidad, realidad traducción inmediata de la tierra, Gaia; realidad en tanto que fuente de vida.

D H Lawrence
Frente a este manantial, la alienación moderna conlleva dos actitudes humanas opuestas: 1.º necesidad de la tierra, fuente de vitalidad, y 2.º zozobra en la alienación, causa de enfermedades y esclerosis. Es precisamente en esa bipolaridad donde cabe ubicar las dos grandes obras de Hamsun y de Lawrence: Bendición de la tierra, para el noruego, y El arcoiris del inglés.
En Bendición de la tierra de Hamsun, la naturaleza constituye el espacio el trabajo existencial donde el hombre opera con total independencia para alimentarse y perpetuarse. No se trata de una naturaleza idílica, como sucede en ciertos utopistas bucólicos, y además el trabajo no ha sido abolido. La naturaleza es inabarcable, conforma el destino, y es parte de la propia humanidad de tal forma que su pérdida comportaría deshumanización. El protagonista principal, el campesino Isak, es feo y desgarbado, es tosco y simple, pero inquebrantable, un ser limitado, pero no exento de voluntad. El espacio natural, la Wildnis, es ese ámbito que tarde o temprano ha de llevar la huella del hombre; no se trata del espacio o el reino del hombre convencional o, más exactamente, el acotado por los relojes, sino el del ritmo de las estaciones, con sus ciclos periódicos. En dicho espacio, en dicho tiempo, no existen interrogantes, se sobrevive para participar al socaire de un ritmo que nos desborda. Ese destino es duro. Incluso llega a ser muy duro. Pero a cambio ofrece independencia, autonomía, permite una relación directa con el trabajo. Otorga sentido, porque tiene sentido. En El arcoiris, de Lawrence, una familia vive de forma independiente de la tierra con el único beneficio de sus cosechas.
Hamsun y Lawrence, en estas dos novelas, nos legan la visión de un hombre unido al terruño (ein beheimateter Mensch), de un hombre anclado a un territorio limitado. El beheimateter Mensch ignora el saber libresco, no tiene necesidad de las prédicas de los medios informativos, su sabiduría práctica le es suficiente; gracias a ella, sus actos tienen sentido, incluso cuando fantasea o da rienda suelta a los sentimientos. Ese saber inmediato, además, le procura unidad con los otros seres.
Desde una óptica tal, la alienación, cuestión fundamental en el siglo XIX, adquiere otra perspectiva. Generalmente se aborda el problema de la alienación desde tres puntos de vista doctrinales:
1.º Según el punto de vista marxista e historicista, la alienación se localizaría únicamente en la esfera social, mientras que para Hamsun o Lawrence, se sitúa en la naturaleza interior del hombre, independientemente de su posición social o de su riqueza material.
2.º La alienación abordada a partir de la teología o la antropología.
3.º La alienación percibida como una anomalía social.

D H Lawrence
En Hegel, y más tarde en Marx, la alienación de los pueblos o de las masas es una etapa necesaria en el proceso de adecuación gradual entre la realidad y el absoluto. En Hamsun y Lawrence, la alienación es un concepto todavía más categórico; sus causas no residen en las estructuras socioeconómicas o políticas, sino en el distanciamiento con respecto a las raíces de la naturaleza (que no es, en consecuencia, una “buena” naturaleza). No desaparecerá la alienación con la simple instauración de un nuevo orden socioeconómico. En Hamsun y Lawrence, señala Doma, es el problema de la desconexión, de la cesura, el que tiene un rango esencial. La vida social ha devenido uniforme, desemboca en la uniformidad, la automatización, la funcionalización a ultranza, mientras que la naturaleza y el trabajo integrado en el ciclo de la vida no son uniformes y requieren en todo momento la movilización de energías vitales. Existe inmediatez, mientras que en la vida urbana, industrial y moderna todo está mediatizado, filtrado. Hamsun y Lawrence se rebelan contra dichos filtros.
Para Hamsun y, en menor medida, Lawrence las fuerzas interiores cuentan para la “naturaleza”. Con la llegada de la modernidad, los hombres están determinados por factores exteriores a ellos, como son los convencionalismos, la lucha política y la opinión pública, que ofrecen una suerte de ilusión por la libertad, cuando en realidad conforman el escenario ideal para todo tipo de manipulaciones. En un contexto tal, las comunidades acaba por desvertebrarse: cada individuo queda reducido a una esfera de actividad autónoma y en concurrencia con otros individuos. Todo ello acaba por derivar en debilidad, aislamiento y hostilidad de todos contra todos.
Los síntomas de esta debilidad son la pasión por las cosas superficiales, los vestidos refinados (Hamsun), signo de una fascinación detestable por lo externo; esto es, formas de dependencia, signos de vacío interior. El hombre quiebra por efecto de presiones exteriores. Indicios, al fin y a la postre, de la pérdida de vitalidad que conlleva la alienación.
En el marco de esta quiebra que supone la vida urbana, el hombre no encuentra estabilidad, pues la vida en las ciudades, en las metrópolis, es hostil a cualquier forma de estabilidad. El hombre alienado ya no puede retornar a su comunidad, a sus raíces familiares. Así Lawrence, con un lenguaje menos áspero pero acaso más incisivo, escribe: “He was the eternal audience, the chorus, the spectator at the drama; in his own life he would have no drama” (“Era la audiencia eterna, el coro, el espectador del drama; pero en su propia vida, no había drama alguno”); “He scarcely existed except through other people” (“Apenas existía, salvo en medio de otras personas”); “He had come to a stability of nullification” (“Había llegado a una estabilidad que lo había anulado”).
En Hamsun y Lawrence, el Ent-wurzelung y el Unbehaustheit, el desarraigo y la carencia de hogar, esa forma de vivir sin fuego, constituye la gran tragedia de la humanidad de finales del siglo XIX y principios del XX. Para Hamsun el hogar es vital para el hombre. El hombre debe tener hogar. El hogar de su existencia. No se puede prescindir del hogar sin autoprovocarse una profunda mutilación. Mutilación de carácter psíquico, que conduce a la histeria, al nerviosismo, al desequilibro. Hamsun es, al fin y al cabo, un psicólogo. Y nos dice: la conciencia de sí es a menudo un síntoma de alienación. Schiller, en su ensayo Über naive und sentimentalische Dichtung, señalaba que la concordancia entre sentir y pensar era tangible, real e interior en el hombre natural, al contrario que en el hombre cultivado que es ideal y exterior (“La concordancia entre sensaciones y pensamiento existía antaño, pero en la actualidad sólo reside en el plano ideal. Esta concordancia no reside en el hombre, sino que existe exteriormente a él; se trata de una idea que debe ser realizada, no un hecho de su vida”).
Schiller aboga por una Überwindung (superación) de dicha quiebra a través de una movilización total del individuo. El romanticismo, por su parte, considerará la reconciliación entre Ser (Sein) y conciencia (Bewußtsein) como la forma de combatir el reduccionismo que trata de arrinconar la conciencia bajo los corsés de entendimiento racional. El romanticismo valorará, e incluso sobrevalorará, al “otro” con relación a la razón (das Andere der Vernunft): percepción sensual, instinto, intuición, experiencia mística, infancia, sueño, vida bucólica. Wordsworth, romántico inglés, representante “rosa” de dicha voluntad de reconciliación entre Ser y conciencia, defenderá la presencia de “un corazón que observe y apruebe”. Dostoievski no compartirá dicha visión “rosa” y desarrollará una concepción “negra”, donde el intelecto es siempre causa de mal, y el “poseso” un ser que tenderá a matar o a suicidarse. En el plano filosófico, tanto Klages como Lessing retomarán por su cuenta esta visión “negra” del intelecto, profundizando, no obstante, en la veta del romanticismo naturalista: para Klages, el espíritu es enemigo del alma; para Lessing, el espíritu es la contrapartida de la vida, que surge de la necesidad (“Geist ist das notgeborene Gegenspiel des Lebens”).
Lawrence, fiel en cierto sentido a la tradición romántica inglesa de Wordsworth, cree en una nueva adecuación del Ser y la conciencia. Hamsun, más pesimista, más dostoievskiano (de ahí su acogida en Rusia y su influencia en los autores llamados ruralistas, como Vasili Belov y Valentín Rasputín), nunca dejará de pensar que desde que hay conciencia, hay alienación. Desde que el hombre comienza a reflexionar sobre sí mismo, se desliga de la continuidad que confiere la naturaleza y a la cual debiera estar siempre sujeto. En los ensayos de Hamsun, encontramos reflexiones sobre la modernidad literaria. La vida moderna, ha escrito, influye, transforma, lleva al hombre a arrancarlo de su destino, a apartarlo de su punto de llegada, de sus instintos, más allá del bien y del mal. La evolución literaria del siglo XIX muestra una fiebre, un desequilibrio, un nerviosismo, una complicación extrema de la psicología humana. “El nerviosismo general (ambiente) se ha adueñado de nuestro ser fundamental y se ha fijado en nuestra vida sentimental”. El escritor se nos muestra así, al estilo de un Zola, como un “médico social” encargado de diagnosticar los males sociales con objeto de erradicar el mal. El escritor, el intelectual, se embarca en una tarea misionera que trata de llegar a una “corrección política”.

Nietzsche con el uniforme de artillero prusiano, 1868
Frente a esta visión intelectual del escritor, el reproche de Hamsun señala la imposibilidad de definir objetivamente la realidad humana, pues un “hombre objetivo” es, en sí mismo, una monstruosidad (ein Unding), un ser construido como si de un mecano se tratase. No podemos reducir al hombre a un compendio de características, pues el hombre es evolución, ambigüedad. El mismo criterio encontramos en Lawrence: “Now I absolutely flatly deny that I am a soul, or a body, or a mind, or an intelligence, or a brain, or a nervous system, or a bunch of glands, or any of the rest of these bits of me. The whole is greater than the part” (“Bien, yo niego absoluta y francamente ser un alma, o un cuerpo, o un espíritu, o una inteligencia, o un cerebro, o un sistema nervioso, o un conjunto de glándulas, o cualquier otra parte de mí mismo. El todo es más grande que las partes”). Hamsun y Lawrence ilustran en sus obras la imposibilidad de teorizar o absolutizar una visión diáfana del hombre. El hombre no puede ser vehículo de ideas preconcebidas. Hamsun y Lawrence confirman que los progresos en la conciencia de uno mismo no conllevan procesos de emancipación espiritual, sino pérdidas, despilfarro de la vitalidad, del tono vital. En sus novelas, son las figuras firmes (esto es, las que están arraigadas a la tierra) las que logran mantenerse, las que triunfan más allá de los golpes de suerte o las circunstancias desgraciadas.
No se trata, en absoluto, repetimos, de vidas bucólicas o idílicas. Los protagonistas de las novelas de Hamsun y Lawrence son penetrados o atraídos por la modernidad, los cuales, pese a su irreductible complejidad, pueden sucumbir, sufren, padecen un proceso de alienación, pero también pueden triunfar. Y es precisamente aquí donde intervienen la ironía de Hamsun o la idea del “Fénix” de Lawrence. La ironía de Hamsun taladra los ideales abstractos de las ideologías modernas. En Lawrence, la recurrente idea del “Fénix” supone una cierta dosis de esperanza: habrá resurrección. Es la idea de Ave Fénix, que renace de sus propias cenizas.
El paganismo de Hamsun y Lawrence
Si dicha voluntad de retorno a una ontología natural es fruto de un rechazo del intelectualismo racionalista, ello implica al mismo tiempo una contestación de calado al mensaje cristiano.
En Hamsun, se ve con claridad el rechazo del puritanismo familiar (concretado en la figura de su tío Han Olsen) y el rechazo al culto protestante por los libros sagrados; esto es, el rechazo explícito de un sistema de pensamiento religioso que prima el saber libresco frente a la experiencia existencial (particularmente la del campesino autosuficiente, el Odalsbond de los campos noruegos). El anticristianismo de Hamsun es, fundamentalmente, un acristianismo: no se plantea dudas religiosas a lo Kierkegaard. Para Hamsun, el moralismo del protestantismo de la era victoriana (de la era oscariana, diríamos para Escandinavia) es simple y llanamente pérdida de vitalidad. Hamsun no apuesta por experiencia mística alguna.
Lawrence, por su parte, percibe la ruptura de toda relación con los misterios cósmicos. El cristianismo vendría a reforzar dicha ruptura, impediría su cura, imposibilitaría su cicatrización. En este sentido, la religiosidad europea aún conservaría un poso de dicho culto al misterio cósmico: el año litúrgico, el ciclo litúrgico (Pascua, Pentecostés, Fuego de San Juan, Todos los Santos, Navidad, Fiesta de los Reyes Magos). Pero incluso éste ha sido aherrojado como consecuencia de un proceso de desencantamiento y desacralización, cuyo comienzo arranca en el momento mismo de la llegada de la Iglesia cristiana primitiva y que se reforzará con los puritanismos y los jansenismos segregados por la Reforma. Los primeros cristianos se plantearon como objetivo apartar al hombre de sus ciclos cósmicos. La Iglesia medieval, por el contrario, quiso adecuarse, pero las Iglesias protestantes y conciliares posteriores han expresado con claridad su voluntad de regresar al anticosmicismo del cristianismo primitivo. En este sentido, Lawrence escribe: “But now, after almost three thousand years, now that we are almost abstracted entirely from the rhythmic life of the seasons, birth and death and fruition, now we realize that such abstraction is neither bliss nor liberation, but nullity. It brings null inertia” (“Pero hoy, después de tres mil años, después que estamos casi completamente abstraídos de la vida rítmica de las estaciones, del nacimiento, de la muerte y de la fecundidad, comprendemos al fin que tal abstracción no es ni una bendición ni una liberación, sino pura nada. No nos aporta otra cosa que inercia”). Esta ruptura es consustancial al cristianismo de las civilizaciones urbanas, donde no hay apertura alguna hacia el cosmos. Cristo no es un Cristo cósmico, sino un Cristo rebajado al papel de asistente social. Mircea Eliade, por su parte, se ha referido a un “hombre cósmico”, abierto a la inmensidad del cosmos, pilar de todas las grandes religiones. En la perspectiva de Eliade, lo sagrado es lo real, el poder, la fuente de vida y de la fertilidad. Eliade nos ha dejado escrito: “El deseo del hombre religioso de vivir una vida en el ámbito de lo sagrado es el deseo de vivir en la realidad objetiva”.

Knut Hamsun, 1927
La lección ideológica y política de Hamsun y Lawrence
En el plano ideológico y político, en el plano de la Weltanschauung, las obras de Hamsun y de Lawrence han tenido un impacto bastante considerable. Hamsun ha sido leído por todos, más allá de la polaridad comunismo/fascismo. Lawrence ha sido etiquetado como “fascista” a título póstumo, entre otros por Bertrand Russell que llegó incluso a referirses a su “madness”: “Lawrence was a suitable exponent of the Nazi cult of insanity” (“Lawrence fue un exponente típico del culto nazi a la locura”). Frase tan lapidaria como simplista. Las obras de Hamsun y de Lawrence, sgún Akos Doma, se inscriben en un cuádruple contexto: el de la filosofía de la vida, el de los avatares del individualismo, el de la tradición filosófica vitalista, y el del antiutopismo y el irracionalismo.
1.º La filosofía de la vida (Lebensphilosophie) es un concepto de lucha, que opone la “vivacidad de la vida real” a la rigidez de los convencionalismos, a los fuegos de artificio inventados por la civilización urbana para tratar de orientar la vida hacia un mundo desencantado. La filosofía de la vida se manifiesta bajo múltiples rostos en el contexto del pensamiento europeo y toma realmente cuerpo a partir de la reflexiones de Nietzsche sobre la Leiblichkeit (corporeidad).
2.º El individualismo. La antropología hamsuniana postula la absoluta unidad de cada individuo, de cada persona, pero rechaza el aislamiento de ese individuo o persona de todo contexto comunitario, familiar o carnal: sitúa a la persona de una manera interactiva, en un lugar preciso. La ausencia de introspección especulativa, de conciencia y de intelectualismo abstracto hacen incompatible el individualismo hamsuniano con la antropología segregada por el Iluminismo. Para Hamsun, sin embargo, no se combate el individualismo iluminista sermoneando sobre un colectivismo de contornos ideológicos. El renacimiento del hombre auténtico pasa por una reactivación de los resortes más profundos de su alma y de su cuerpo. La suma cuantitativa y mecánica es una insuficiencia calamitosa. En consecuencia, la acusación de “fascismo” hacia Lawrence y Hamsun no se sostiene en pie.
3.º El vitalismo tiene en cuenta todos los acontecimientos de la vida y excluye cualquier jerarquización de base racial, social, etc. Las oposiciones propias del vitalismo son: afirmación de la vida / negación de la vida; sano / enfermo; orgánico / mecánico. De ahí, que no se pueda reconducirlas a categorías sociales, a categorías políticas convencionales, etc. La vida es una categoría fundamental apolítica, pues todos los hombres sin distinción están sometidos a ella.
4.º El “irracionalismo” reprochado a Hamsun y Lawrence, igual que su antiutopismo, tienen su base en una revuelta contra la “viabilidad” (feasibility; Machbarkeit), contra la idea de perfectibilidad infinita (que encontramos también bajo una forma “orgánica” en los románticos ingleses de la primera generación). La idea de viabilidad choca directamente con la esencia biológica de la naturaleza. De hecho, la idea de viabilidad es la esencia del nihilismo, como ha apuntado el filósofo italiano Emanuele Severino. Para Severino, la viabilidad deriva de una voluntad de completar el mundo aprehendiéndolo como un devenir (pero no como un devenir orgánico incontrolable). Una vez el proceso de “acabamiento” ha concluido, el devenir detiene bruscamente su curso. Una estabilidad general se impone en la Tierra y esta estabilidad forzada es descrita como un “bien absoluto”. Desde la literatura, Hamsun y Lawrence, han precedido así a filósofos contemporáneos como el citado Emanuele Severino, Robert Spaemann (con su crítica del funcionalismo), Ernst Behler (con su crítica de la “perfectibilidad infinita”) o Peter Koslowski. Estos filósofos, fuera de Alemania o Italia, son muy poco conocidos por el gran público. Su crítica a fondo de los fundamentos de las ideologías dominantes, provoca inevitablemente el rechazo de la solapada inquisición que ejerce su dominio en París.
Nietzsche, Hamsun y Lawrence, los filósofos vitalistas o, si se prefiere, “antiviabilistas”, al insistir sobre el carácter ontológico de la biología humana, se opusieron a la idea occidental y nihilista de la viabilidad absoluta de cualquier cosa; esto es, de la inexistencia ontológica de todas las cosas, de cualquier realidad. Buen número de ellos —Hamsun y Lawrence incluidos— nos llaman la atención sobre el presente eterno de nuestros cuerpos, sobre nuestra propia corporeidad (Leiblichkeit), pues nosotros no podemos conformar nuestros cuerpos, en contraposición a esas voces que nos quieren convencer de las bondades de la ciencia-ficción.
La viabilidad es, pues, el “hybris” que ha llegado a su techo y que conduce a la fiebre, la vacuidad, la ligereza, el solipsismo y el aislamiento. De Heidegger a Severino, la filosofía europea se ha ocupado sobre la catástrofe que ha supuesto la desacralización del Ser y el desencantamiento del mundo. Si los resortes profundos y misteriosos de la Tierra o del hombre son considerados como imperfecciones indignas del interés del teólogo o del filósofo, si todo aquello que ha sido pensado de manera abstracta o fabricado más allá de los resortes (ontológicos) se encuentra sobrevalorado, entonces, efectivamente, no puede extrañarnos que el mundo pierda toda sacralidad, todo valor. Hamsun y Lawrence han sido los escritores que nos han hecho vivir con intensidad dicha constante, por encima incluso de algunos filósofos que también han deplorado la falsa ruta emprendida por el pensamiento occidental desde hace siglos. Heidegger y Severino en el marco de la filosofía, Hamsun y Lawrence en el de la creación literaria, han tratado de restituir la sacralidad en el mundo y revalorizar las fuerzas que se esconden en el interior del hombre: desde ese punto de vista, estamos ante pensadores ecológicos en la más profunda acepción del término. El oikos nos abre las puertas de lo sagrado, de las fuerzas misteriosas e incontrolables, sin fatalismos y sin falsa humildad. Hamsun y Lawrence, en definitiva, anunciaron la dimensión geofilosófica del pensamiento que nos ha ocupado durante toda esta universidad de verano. Una aproximación sucinta a sus obras se hacía absolutamente necesaria en el temario de 1996.
________________
* Comentario al libro de Akos Doma, Die andere Moderne. Knut Hamsun, D.H. Lawrence und die lebensphilosophische Strömung des literarischen Modernismus (Bouvier, Bonn, 1995), leído como conferencia en Lombardía, en julio de 1996. Traducción de Juan C. García Morcillo.
[Tomo el artículo del archivo de su fuente primera, la asociación Sinergias Europeas, que editaba el boletín InfoEuropa. Ya no cabalgan.]
00:10 Publié dans Littérature, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres norvégiennes, lettres scandinaves, lettres anglaises, littérature anglaise, littérature norvégienne, littérature scandinave, norvège, angleterre, scandinavie, paganisme, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook









 La genèse de l’œuvre et de la pensée politique de Soljénitsyne doit donc être recherchée dans les discussions entre prisonniers à la Sharashka, dans la « Prison spéciale n°16 », où étaient confinés des intellectuels, contraints de travailler pour l’armée ou pour l’Etat. Soljénitsyne purgera donc in extenso les huit années de détention auxquelles il avait été condamné en 1945, immédiatement après son arrestation sur le front, en Prusse Orientale. Il ne sera libéré qu’en 1953. De 1953 à 1957, il vivra en exil, banni, à Kok-Terek au Kazakhstan, où il exercera la modeste profession d’instituteur de village. Il rédige « Le Pavillon des cancéreux », suite à un séjour dans un sanatorium. Réhabilité en 1957, il se fixe à Riazan. Son besoin de solitude demeure son trait de caractère le plus spécifique, le plus étalé dans la durée. Il s’isole et se retire dans des cabanes en forêt.
La genèse de l’œuvre et de la pensée politique de Soljénitsyne doit donc être recherchée dans les discussions entre prisonniers à la Sharashka, dans la « Prison spéciale n°16 », où étaient confinés des intellectuels, contraints de travailler pour l’armée ou pour l’Etat. Soljénitsyne purgera donc in extenso les huit années de détention auxquelles il avait été condamné en 1945, immédiatement après son arrestation sur le front, en Prusse Orientale. Il ne sera libéré qu’en 1953. De 1953 à 1957, il vivra en exil, banni, à Kok-Terek au Kazakhstan, où il exercera la modeste profession d’instituteur de village. Il rédige « Le Pavillon des cancéreux », suite à un séjour dans un sanatorium. Réhabilité en 1957, il se fixe à Riazan. Son besoin de solitude demeure son trait de caractère le plus spécifique, le plus étalé dans la durée. Il s’isole et se retire dans des cabanes en forêt.  Le 28 octobre 1994, lors de son discours à la Douma d’Etat, Soljénitsyne a répété la quintessence de ce qu’il avait écrit dans « Comment réaménager notre Russie ? ». Dans ce discours d’octobre 1994, Soljénitsyne dénonce en plus le régime d’Eltsine, qui n’a pas répondu aux espoirs qu’il avait éveillés quelques années plus tôt. Au régime soviétique ne s’est pas substitué un régime inspiré des meilleures pages de l’histoire russe mais une pâle copie des pires travers du libéralisme de type occidental qui a précipité la majorité du peuple dans la misère et favorisé une petite clique corrompue d’oligarques vite devenus milliardaires en dollars américains. Le régime eltsinien, parce qu’il affaiblit l’Etat et ruine le peuple, représente par conséquent une nouvelle « smuta ». Soljénitsyne, à la tribune de la Douma, a répété son hostilité au panslavisme, auquel il faut préférer une union des Slaves de l’Est (Biélorusses, Grands Russiens et Ukrainiens). Il a également fustigé la partitocratie qui « transforme le peuple non pas en sujet souverain de la politique mais en un matériau passif à traiter seulement lors des campagnes électorales ». De véritables élections, capables de susciter et de consolider une « démocratie qualitative », doivent se faire sur base locale et régionale, afin que soit brisée l’hégémonie nationale/fédérale des partis qui entendent tout régenter depuis la capitale. Les concepts politiques véritablement russes ne peuvent éclore qu’aux dimensions réduites des régions russes, fort différentes les unes des autres, et non pas au départ de centrales moscovites ou pétersbourgeoises, forcément ignorantes des problèmes qui affectent les régions.
Le 28 octobre 1994, lors de son discours à la Douma d’Etat, Soljénitsyne a répété la quintessence de ce qu’il avait écrit dans « Comment réaménager notre Russie ? ». Dans ce discours d’octobre 1994, Soljénitsyne dénonce en plus le régime d’Eltsine, qui n’a pas répondu aux espoirs qu’il avait éveillés quelques années plus tôt. Au régime soviétique ne s’est pas substitué un régime inspiré des meilleures pages de l’histoire russe mais une pâle copie des pires travers du libéralisme de type occidental qui a précipité la majorité du peuple dans la misère et favorisé une petite clique corrompue d’oligarques vite devenus milliardaires en dollars américains. Le régime eltsinien, parce qu’il affaiblit l’Etat et ruine le peuple, représente par conséquent une nouvelle « smuta ». Soljénitsyne, à la tribune de la Douma, a répété son hostilité au panslavisme, auquel il faut préférer une union des Slaves de l’Est (Biélorusses, Grands Russiens et Ukrainiens). Il a également fustigé la partitocratie qui « transforme le peuple non pas en sujet souverain de la politique mais en un matériau passif à traiter seulement lors des campagnes électorales ». De véritables élections, capables de susciter et de consolider une « démocratie qualitative », doivent se faire sur base locale et régionale, afin que soit brisée l’hégémonie nationale/fédérale des partis qui entendent tout régenter depuis la capitale. Les concepts politiques véritablement russes ne peuvent éclore qu’aux dimensions réduites des régions russes, fort différentes les unes des autres, et non pas au départ de centrales moscovites ou pétersbourgeoises, forcément ignorantes des problèmes qui affectent les régions. 






