mardi, 17 juillet 2012
Deux nouvelles parutions aux éditions du Trident
Bonjour
Nous vous proposons aujourd’hui
deux nouvelles parutions aux éditions du Trident
"La Gaule avant César" par Camille Jullian
… la première page de l'Histoire de France
HTTP://editions-du-trident.fr/catalogue#gaule
"La Grande guerre de 1793"
… premier volume de "l'Histoire de la Vendée militaire" de Jacques Crétineau-Joly
HTTP: //editions-du-trident.fr/catalogue#vendee
17:47 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, vendee, 1793, revolution francaise, gaule, gaulois |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 12 juillet 2012
The Fourth Political Theory

A Note from the Editor
Foreword by Alain Soral
Introduction: To Be or Not to Be?
1. The Birth of the Concept
2. Dasein as an Actor
3. The Critique of Monotonic Processes
4. The Reversibility of Time
5. Global Transition and its Enemies
6. Conservatism and Postmodernity
7. ‘Civilisation’ as an Ideological Concept
8. The Transformation of the Left in the Twenty-first Century
9. Liberalism and Its Metamorphoses
10. The Ontology of the Future
11. The New Political Anthropology
12. Fourth Political Practice
13. Gender in the Fourth Political Theory
14. Against the Postmodern World
Appendix I: Political Post-Anthropology
Appendix II: The Metaphysics of Chaos
00:05 Publié dans Livre, Nouvelle Droite, Synergies européennes, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, alexandre douguine, russie, theorie politique, sciences politiques, politologie, nouvelle droite russe |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 09 juillet 2012
Augustin Cochin on the French Revolution

From Salon to Guillotine
Augustin Cochin on the French Revolution
By F. Roger Devlin
Ex: http://www.counter-currents.com/
Augustin Cochin
Organizing the Revolution: Selections From Augustin Cochin [2]
Translated by Nancy Derr Polin with a Preface by Claude Polin
Rockford, Ill.: Chronicles Press, 2007
The Rockford Institute’s publication of Organizing the Revolution marks the first appearance in our language of an historian whose insights apply not only to the French Revolution but to much of modern politics as well.
Augustin Cochin (1876–1916) was born into a family that had distinguished itself for three generations in the antiliberal “Social Catholicism” movement. He studied at the Ecole des Chartes and began to specialize in the study of the Revolution in 1903. Drafted in 1914 and wounded four times, he continued his researches during periods of convalescence. But he always requested to be returned to the front, where he was killed on July 8, 1916 at the age of thirty-nine.
Cochin was a philosophical historian in an era peculiarly unable to appreciate that rare talent. He was trained in the supposedly “scientific” methods of research formalized in his day under the influence of positivism, and was in fact an irreproachably patient and thorough investigator of primary archives. Yet he never succumbed to the prevailing notion that facts and documents would tell their own story in the absence of a human historian’s empathy and imagination. He always bore in mind that the goal of historical research was a distinctive type of understanding.
Both his archival and his interpretive labors were dedicated to elucidating the development of Jacobinism, in which he (rightly) saw the central, defining feature of the French Revolution. François Furet wrote: “his approach to the problem of Jacobinism is so original that it has been either not understood or buried, or both.”[1]
Most of his work appeared only posthumously. His one finished book is a detailed study of the first phase of the Revolution as it played out in Brittany: it was published in 1925 by his collaborator Charles Charpentier. He had also prepared (with Charpentier) a complete collection of the decrees of the revolutionary government (August 23, 1793–July 27, 1794). His mother arranged for the publication of two volumes of theoretical writings: The Philosophical Societies and Modern Democracy (1921), a collection of lectures and articles; and The Revolution and Free Thought (1924), an unfinished work of interpretation. These met with reviews ranging from the hostile to the uncomprehending to the dismissive.
“Revisionist” historian François Furet led a revival of interest in Cochin during the late 1970s, making him the subject of a long and appreciative chapter in his important study Interpreting the French Revolution and putting him on a par with Tocqueville. Cochin’s two volumes of theoretical writings were reprinted shortly thereafter by Copernic, a French publisher associated with GRECE and the “nouvelle droit.”
The book under review consists of selections in English from these volumes. The editor and translator may be said to have succeeded in their announced aim: “to present his unfinished writings in a clear and coherent form.”
Between the death of the pioneering antirevolutionary historian Hippolyte Taine in 1893 and the rise of “revisionism” in the 1960s, study of the French Revolution was dominated by a series of Jacobin sympathizers: Aulard, Mathiez, Lefevre, Soboul. During the years Cochin was producing his work, much public attention was directed to polemical exchanges between Aulard, a devotee of Danton, and his former student Mathiez, who had become a disciple of Robespierre. Both men remained largely oblivious to the vast ocean of assumptions they shared.
Cochin published a critique of Aulard and his methods in 1909; an abridged version of this piece is included in the volume under review. Aulard’s principal theme was that the revolutionary government had been driven to act as it did by circumstance:
This argument [writes Cochin] tends to prove that the ideas and sentiments of the men of ’93 had nothing abnormal in themselves, and if their deeds shock us it is because we forget their perils, the circumstances; [and that] any man with common sense and a heart would have acted as they did in their place. Aulard allows this apology to include even the very last acts of the Terror. Thus we see that the Prussian invasion caused the massacre of the priests of the Abbey, the victories of la Rochejacquelein [in the Vendée uprising] caused the Girondins to be guillotined, [etc.]. In short, to read Aulard, the Revolutionary government appears a mere makeshift rudder in a storm, “a wartime expedient.” (p. 49)
Aulard had been strongly influenced by positivism, and believed that the most accurate historiography would result from staying as close as possible to documents of the period; he is said to have conducted more extensive archival research than any previous historian of the Revolution. But Cochin questioned whether such a return to the sources would necessarily produce truer history:
Mr. Aulard’s sources—minutes of meetings, official reports, newspapers, patriotic pamphlets—are written by patriots [i.e., revolutionaries], and mostly for the public. He was to find the argument of defense highlighted throughout these documents. In his hands he had a ready-made history of the Revolution, presenting—beside each of the acts of “the people,” from the September massacres to the law of Prairial—a ready-made explanation. And it is this history he has written. (p. 65)
 In fact, says Cochin, justification in terms of “public safety” or “self- defense” is an intrinsic characteristic of democratic governance, and quite independent of circumstance:
In fact, says Cochin, justification in terms of “public safety” or “self- defense” is an intrinsic characteristic of democratic governance, and quite independent of circumstance:
When the acts of a popular power attain a certain degree of arbitrariness and become oppressive, they are always presented as acts of self-defense and public safety. Public safety is the necessary fiction in democracy, as divine right is under an authoritarian regime. [The argument for defense] appeared with democracy itself. As early as July 28, 1789 [i.e., two weeks after the storming of the Bastille] one of the leaders of the party of freedom proposed to establish a search committee, later called “general safety,” that would be able to violate the privacy of letters and lock people up without hearing their defense. (pp. 62–63)
(Americans of the “War on Terror” era, take note.)
But in fact, says Cochin, the appeal to defense is nearly everywhere a post facto rationalization rather than a real motive:
Why were the priests persecuted at Auch? Because they were plotting, claims the “public voice.” Why were they not persecuted in Chartes? Because they behaved well there.
How often can we not turn this argument around?
Why did the people in Auch (the Jacobins, who controlled publicity) say the priests were plotting? Because the people (the Jacobins) were persecuting them. Why did no one say so in Chartes? Because they were left alone there.
In 1794 put a true Jacobin in Caen, and a moderate in Arras, and you could be sure by the next day that the aristocracy of Caen, peaceable up till then, would have “raised their haughty heads,” and in Arras they would go home. (p. 67)
In other words, Aulard’s “objective” method of staying close to contemporary documents does not scrape off a superfluous layer of interpretation and put us directly in touch with raw fact—it merely takes the self-understanding of the revolutionaries at face value, surely the most naïve style of interpretation imaginable. Cochin concludes his critique of Aulard with a backhanded compliment, calling him “a master of Jacobin orthodoxy. With him we are sure we have the ‘patriotic’ version. And for this reason his work will no doubt remain useful and consulted” (p. 74). Cochin could not have foreseen that the reading public would be subjected to another half century of the same thing, fitted out with ever more “original documentary research” and flavored with ever increasing doses of Marxism.
But rather than attending further to these methodological squabbles, let us consider how Cochin can help us understand the French Revolution and the “progressive” politics it continues to inspire.
It has always been easy for critics to rehearse the Revolution’s atrocities: the prison massacres, the suppression of the Vendée, the Law of Suspects, noyades and guillotines. The greatest atrocities of the 1790s from a strictly humanitarian point of view, however, occurred in Poland, and some of these were actually counter-revolutionary reprisals. The perennial fascination of the French Revolution lies not so much in the extent of its cruelties and injustices, which the Caligulas and Genghis Khans of history may occasionally have equaled, but in the sense that revolutionary tyranny was something different in kind, something uncanny and unprecedented. Tocqueville wrote of
something special about the sickness of the French Revolution which I sense without being able to describe. My spirit flags from the effort to gain a clear picture of this object and to find the means of describing it fairly. Independently of everything that is comprehensible in the French Revolution there is something that remains inexplicable.
Part of the weird quality of the Revolution was that it claimed, unlike Genghis and his ilk, to be massacring in the name of liberty, equality, and fraternity. But a deeper mystery which has fascinated even its enemies is the contrast between its vast size and force and the negligible ability of its apparent “leaders” to unleash or control it: the men do not measure up to the events. For Joseph de Maistre the explanation could only be the direct working of Divine Providence; none but the Almighty could have brought about so great a cataclysm by means of such contemptible characters. For Augustin Barruel it was proof of a vast, hidden conspiracy (his ideas have a good claim to constitute the world’s original “conspiracy theory”). Taine invoked a “Jacobin psychology” compounded of abstraction, fanaticism, and opportunism.
Cochin found all these notions of his antirevolutionary predecessors unsatisfying. Though Catholic by religion and family background, he quite properly never appeals to Divine Providence in his scholarly work to explain events (p. 71). He also saw that the revolutionaries were too fanatical and disciplined to be mere conspirators bent on plunder (pp. 56–58; 121–122; 154). Nor is an appeal to the psychology of the individual Jacobin useful as an explanation of the Revolution: this psychology is itself precisely what the historian must try to explain (pp. 60–61).
Cochin viewed Jacobinism not primarily as an ideology but as a form of society with its own inherent rules and constraints independent of the desires and intentions of its members. This central intuition—the importance of attending to the social formation in which revolutionary ideology and practice were elaborated as much as to ideology, events, or leaders themselves—distinguishes his work from all previous writing on the Revolution and was the guiding principle of his archival research. He even saw himself as a sociologist, and had an interest in Durkheim unusual for someone of his Catholic traditionalist background.
The term he employs for the type of association he is interested in is société de pensée, literally “thought-society,” but commonly translated “philosophical society.” He defines it as “an association founded without any other object than to elicit through discussion, to set by vote, to spread by correspondence—in a word, merely to express—the common opinion of its members. It is the organ of [public] opinion reduced to its function as an organ” (p. 139).
It is no trivial circumstance when such societies proliferate through the length and breadth of a large kingdom. Speaking generally, men are either born into associations (e.g., families, villages, nations) or form them in order to accomplish practical ends (e.g., trade unions, schools, armies). Why were associations of mere opinion thriving so luxuriously in France on the eve of the Revolution? Cochin does not really attempt to explain the origin of the phenomenon he analyzes, but a brief historical review may at least clarify for my readers the setting in which these unusual societies emerged.
About the middle of the seventeenth century, during the minority of Louis XIV, the French nobility staged a clumsy and disorganized revolt in an attempt to reverse the long decline of their political fortunes. At one point, the ten year old King had to flee for his life. When he came of age, Louis put a high priority upon ensuring that such a thing could never happen again. The means he chose was to buy the nobility off. They were relieved of the obligations traditionally connected with their ancestral estates and encouraged to reside in Versailles under his watchful eye; yet they retained full exemption from the ruinous taxation that he inflicted upon the rest of the kingdom. This succeeded in heading off further revolt, but also established a permanent, sizeable class of persons with a great deal of wealth, no social function, and nothing much to do with themselves.
The salon became the central institution of French life. Men and women of leisure met for gossip, dalliance, witty badinage, personal (not political) intrigue, and discussion of the latest books and plays and the events of the day. Refinement of taste and the social graces reached an unusual pitch. It was this cultivated leisure class which provided both setting and audience for the literary works of the grand siècle.
The common social currency of the age was talk: outside Jewish yeshivas, the world had probably never beheld a society with a higher ratio of talk to action. A small deed, such as Montgolfier’s ascent in a hot air balloon, could provide matter for three years of self-contented chatter in the salons.
Versailles was the epicenter of this world; Paris imitated Versailles; larger provincial cities imitated Paris. Eventually there was no town left in the realm without persons ambitious of imitating the manners of the Court and devoted to cultivating and discussing whatever had passed out of fashion in the capital two years earlier. Families of the rising middle class, as soon as they had means to enjoy a bit of leisure, aspired to become a part of salon society.
Toward the middle of the eighteenth century a shift in both subject matter and tone came over this world of elegant discourse. The traditional saloniste gave way to the philosophe, an armchair statesman who, despite his lack of real responsibilities, focused on public affairs and took himself and his talk with extreme seriousness. In Cochin’s words: “mockery replaced gaiety, and politics pleasure; the game became a career, the festivity a ceremony, the clique the Republic of Letters” (p. 38). Excluding men of leisure from participation in public life, as Louis XIV and his successors had done, failed to extinguish ambition from their hearts. Perhaps in part by way of compensation, the philosophes gradually
created an ideal republic alongside and in the image of the real one, with its own constitution, its magistrates, its common people, its honors and its battles. There they studied the same problems—political, economic, etc.—and there they discussed agriculture, art, ethics, law, etc. There they debated the issues of the day and judged the officeholders. In short, this little State was the exact image of the larger one with only one difference—it was not real. Its citizens had neither direct interest nor responsible involvement in the affairs they discussed. Their decrees were only wishes, their battles conversations, their studies games. It was the city of thought. That was its essential characteristic, the one both initiates and outsiders forgot first, because it went without saying. (pp. 123–24)
Part of the point of a philosophical society was this very seclusion from reality. Men from various walks of life—clergymen, officers, bankers—could forget their daily concerns and normal social identities to converse as equals in an imaginary world of “free thought”: free, that is, from attachments, obligations, responsibilities, and any possibility of failure.
In the years leading up to the Revolution, countless such organizations vied for followers and influence: Amis Réunis, Philalèthes, Chevaliers Bienfaisants, Amis de la Verité, several species of Freemasons, academies, literary and patriotic societies, schools, cultural associations and even agricultural societies—all barely dissimulating the same utopian political spirit (“philosophy”) behind official pretenses of knowledge, charity, or pleasure. They “were all more or less connected to one another and associated with those in Paris. Constant debates, elections, delegations, correspondence, and intrigue took place in their midst, and a veritable public life developed through them” (p. 124).
Because of the speculative character of the whole enterprise, the philosophes’ ideas could not be verified through action. Consequently, the societies developed criteria of their own, independent of the standards of validity that applied in the world outside:
Whereas in the real world the arbiter of any notion is practical testing and its goal what it actually achieves, in this world the arbiter is the opinion of others and its aim their approval. That is real which others see, that true which they say, that good of which they approve. Thus the natural order is reversed: opinion here is the cause and not, as in real life, the effect. (p. 39)
Many matters of deepest concern to ordinary men naturally got left out of discussion: “You know how difficult it is in mere conversation to mention faith or feeling,” remarks Cochin (p. 40; cf. p. 145). The long chains of reasoning at once complex and systematic which mark genuine philosophy—and are produced by the stubborn and usually solitary labors of exceptional men—also have no chance of success in a society of philosophes (p. 143). Instead, a premium gets placed on what can be easily expressed and communicated, which produces a lowest-common-denominator effect (p. 141).
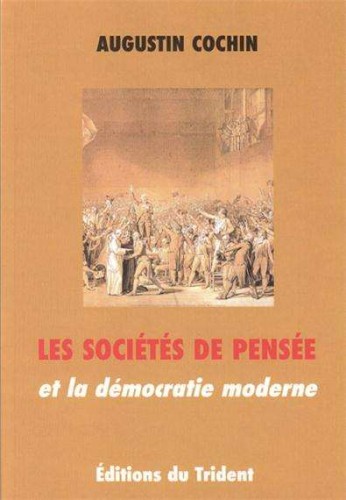
The philosophes made a virtue of viewing the world surrounding them objectively and disinterestedly. Cochin finds an important clue to this mentality in a stock character of eighteenth-century literature: the “ingenuous man.” Montesquieu invented him as a vehicle for satire in the Persian Letters: an emissary from the King of Persia sending witty letters home describing the queer customs of Frenchmen. The idea caught on and eventually became a new ideal for every enlightened mind to aspire to. Cochin calls it “philosophical savagery”:
Imagine an eighteenth-century Frenchman who possesses all the material attainments of the civilization of his time—cultivation, education, knowledge, and taste—but without any of the real well-springs, the instincts and beliefs that have created and breathed life into all this, that have given their reason for these customs and their use for these resources. Drop him into this world of which he possesses everything except the essential, the spirit, and he will see and know everything but understand nothing. Everything shocks him. Everything appears illogical and ridiculous to him. It is even by this incomprehension that intelligence is measured among savages. (p. 43; cf. p. 148)
In other words, the eighteenth-century philosophes were the original “deracinated intellectuals.” They rejected as “superstitions” and “prejudices” the core beliefs and practices of the surrounding society, the end result of a long process of refining and testing by men through countless generations of practical endeavor. In effect, they created in France what a contributor to this journal has termed a “culture of critique”—an intellectual milieu marked by hostility to the life of the nation in which its participants were living. (It would be difficult, however, to argue a significant sociobiological basis in the French version.)
This gradual withdrawal from the real world is what historians refer to as the development of the Enlightenment. Cochin calls it an “automatic purging” or “fermentation.” It is not a rational progression like the stages in an argument, however much the philosophes may have spoken of their devotion to “Reason”; it is a mechanical process which consists of “eliminating the real world in the mind instead of reducing the unintelligible in the object” (p. 42). Each stage produces a more rarified doctrine and human type, just as each elevation on a mountain slope produces its own kind of vegetation. The end result is the world’s original “herd of independent minds,” a phenomenon which would have horrified even men such as Montesquieu and Voltaire who had characterized the first societies.
It is interesting to note that, like our own multiculturalists, many of the philosophes attempted to compensate for their estrangement from the living traditions of French civilization by a fascination with foreign laws and customs. Cochin aptly compares civilization to a living plant which slowly grows “in the bedrock of experience under the rays of faith,” and likens this sort of philosophe to a child mindlessly plucking the blossoms from every plant he comes across in order to decorate his own sandbox (pp. 43–44).
Accompanying the natural “fermentation” of enlightened doctrine, a process of selection also occurs in the membership of the societies. Certain men are simply more suited to the sort of empty talking that goes on there:
young men because of their age; men of law, letters or discourse because of their profession; the skeptics because of their convictions; the vain because of their temperament; the superficial because of their [poor] education. These people take to it and profit by it, for it leads to a career that the world here below does not offer them, a world in which their deficiencies become strengths. On the other hand, true, sincere minds with a penchant for the concrete, for efficacy rather than opinion, find themselves disoriented and gradually drift away. (pp. 40–41)
In a word, the glib drive out the wise.
The societies gradually acquired an openly partisan character: whoever agreed with their views, however stupid, was considered “enlightened.” By 1776, d’Alembert acknowledged this frankly, writing to Frederick the Great: “We are doing what we can to fill the vacant positions in the Académie française in the manner of the banquet of the master of the household in the Gospel: with the crippled and lame men of literature” (p. 35). Mediocrities such as Mably, Helvétius, d’Holbach, Condorcet, and Raynal, whose works Cochin calls “deserts of insipid prose” were accounted ornaments of their age. The philosophical societies functioned like hired clappers making a success of a bad play (p. 46).
On the other hand, all who did not belong to the “philosophical” party were subjected to a “dry terror”:
Prior to the bloody Terror of ’93, in the Republic of Letters there was, from 1765 to 1780, a dry terror of which the Encyclopedia was the Committee of Public Safety and d’Alembert was the Robespierre. It mowed down reputations as the other chopped off heads: its guillotine was defamation, “infamy” as it was then called: The term, originating with Voltaire [écrasez l’infâme!], was used in the provincial societies with legal precision. “To brand with infamy” was a well-defined operation consisting of investigation, discussion, judgment, and finally execution, which meant the public sentence of “contempt.” (p. 36; cf. p. 123)
Having said something of the thought and behavioral tendencies of the philosophes, let us turn to the manner in which their societies were constituted—which, as we have noted, Cochin considered the essential point. We shall find that they possess in effect two constitutions. One is the original and ostensible arrangement, which our author characterizes as “the democratic principle itself, in its principle and purity” (p. 137). But another pattern of governance gradually takes shape within them, hidden from most of the members themselves. This second, unacknowledged constitution is what allows the societies to operate effectively, even as it contradicts the original “democratic” ideal.
The ostensible form of the philosophical society is direct democracy. All members are free and equal; no one is forced to yield to anyone else; no one speaks on behalf of anyone else; everyone’s will is accomplished. Rousseau developed the principles of such a society in his Social Contract. He was less concerned with the glaringly obvious practical difficulties of such an arrangement than with the question of legitimacy. He did not ask: “How could perfect democracy function and endure in the real word?” but rather: “What must a society whose aim is the common good do to be founded lawfully?”
Accordingly, Rousseau spoke dismissively of the representative institutions of Britain, so admired by Montesquieu and Voltaire. The British, he said, are free only when casting their ballots; during the entire time between elections there are as enslaved as the subjects of the Great Turk. Sovereignty by its very nature cannot be delegated, he declared; the People, to whom it rightfully belongs, must exercise it both directly and continuously. From this notion of a free and egalitarian society acting in concert emerges a new conception of law not as a fixed principle but as the general will of the members at a given moment.
Rousseau explicitly states that the general will does not mean the will of the majority as determined by vote; voting he speaks of slightingly as an “empirical means.” The general will must be unanimous. If the merely “empirical” wills of men are in conflict, then the general will—their “true” will—must lie hidden somewhere. Where is it to be found? Who will determine what it is, and how?
At this critical point in the argument, where explicitness and clarity are most indispensable, Rousseau turns coy and vague: the general will is “in conformity with principles”; it “only exists virtually in the conscience or imagination of ‘free men,’ ‘patriots.’” Cochin calls this “the idea of a legitimate people—very similar to that of a legitimate prince. For the regime’s doctrinaires, the people is an ideal being” (p. 158).
There is a strand of thought about the French Revolution that might be called the “Ideas-Have-Consequences School.” It casts Rousseau in the role of a mastermind who elaborated all the ideas that less important men such as Robespierre merely carried out. Such is not Cochin’s position. In his view, the analogies between the speculations of the Social Contract and Revolutionary practice arise not from one having caused or inspired the other, but from both being based upon the philosophical societies.
Rousseau’s model, in other words, was neither Rome nor Sparta nor Geneva nor any phantom of his own “idyllic imagination”—he was describing, in a somewhat idealized form, the philosophical societies of his day. He treated these recent and unusual social formations as the archetype of all legitimate human association (cf. pp. 127, 155). As such a description—but not as a blueprint for the Terror—the Social Contract may be profitably read by students of the Revolution.
Indeed, if we look closely at the nature and purpose of a philosophical society, some of Rousseau’s most extravagant assertions become intelligible and even plausible. Consider unanimity, for example. The society is, let us recall, “an association founded to elicit through discussion [and] set by vote the common opinion of its members.” In other words, rather than coming together because they agree upon anything, the philosophes come together precisely in order to reach agreement, to resolve upon some common opinion. The society values union itself more highly than any objective principle of union. Hence, they might reasonably think of themselves as an organization free of disagreement.
Due to its unreal character, furthermore, a philosophical society is not torn by conflicts of interest. It demands no sacrifice—nor even effort—from its members. So they can all afford to be entirely “public spirited.” Corruption—the misuse of a public trust for private ends—is a constant danger in any real polity. But since the society’s speculations are not of this world, each philosophe is an “Incorruptible”:
One takes no personal interest in theory. So long as there is an ideal to define rather than a task to accomplish, personal interest, selfishness, is out of the question. [This accounts for] the democrats’ surprising faith in the virtue of mankind. Any philosophical society is a society of virtuous, generous people subordinating political motives to the general good. We have turned our back on the real world. But ignoring the world does not mean conquering it. (p. 155)
(This pattern of thinking explains why leftists even today are wont to contrast their own “idealism” with the “selfish” activities of businessmen guided by the profit motive.)
We have already mentioned that the more glib or assiduous attendees of a philosophical society naturally begin exercising an informal ascendancy over other members: in the course of time, this evolves into a standing but unacknowledged system of oligarchic governance:
Out of one hundred registered members, fewer than five are active, and these are the masters of the society. [This group] is composed of the most enthusiastic and least scrupulous members. They are the ones who choose the new members, appoint the board of directors, make the motions, guide the voting. Every time the society meets, these people have met in the morning, contacted their friends, established their plan, given their orders, stirred up the unenthusiastic, brought pressure to bear upon the reticent. They have subdued the board, removed the troublemakers, set the agenda and the date. Of course, discussion is free, but the risk in this freedom minimal and the “sovereign’s” opposition little to be feared. The “general will” is free—like a locomotive on its tracks. (pp. 172–73)
Cochin draws here upon James Bryce’s American Commonwealth and Moisey Ostrogorski’s Democracy and the Organization of Political Parties. Bryce and Ostrogorski studied the workings of Anglo-American political machines such as New York’s Tammany Hall and Joseph Chamberlain’s Birmingham Caucus. Cochin considered such organizations (plausibly, from what I can tell) to be authentic descendants of the French philosophical and revolutionary societies. He thought it possible, with due circumspection, to apply insights gained from studying these later political machines to previously misunderstand aspects of the Revolution.
One book with which Cochin seems unfortunately not to have been familiar is Robert Michels’ Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy, published in French translation only in 1914. But he anticipated rather fully Michels’ “iron law of oligarchy,” writing, for example, that “every egalitarian society fatally finds itself, after a certain amount of time, in the hands of a few men; this is just the way things are” (p. 174). Cochin was working independently toward conclusions notably similar to those of Michels and Gaetano Mosca, the pioneering Italian political sociologists whom James Burnham called “the Machiavellians.” The significance of his work extends far beyond that of its immediate subject, the French Revolution.
The essential operation of a democratic political machine consists of just two steps, continually repeated: the preliminary decision and the establishment of conformity.
First, the ringleaders at the center decide upon some measure. They prompt the next innermost circles, whose members pass the message along until it reaches the machine’s operatives in the outermost local societies made up of poorly informed people. All this takes place unofficially and in secrecy (p. 179).
Then the local operatives ingenuously “make a motion” in their societies, which is really the ringleaders’ proposal without a word changed. The motion passes—principally through the passivity (Cochin writes “inertia”) of the average member. The local society’s resolution, which is now binding upon all its members, is with great fanfare transmitted back towards the center.
The central society is deluged with identical “resolutions” from dozens of local societies simultaneously. It hastens to endorse and ratify these as “the will of the nation.” The original measure now becomes binding upon everyone, though the majority of members have no idea what has taken place. Although really a kind of political ventriloquism by the ringleaders, the public opinion thus orchestrated “reveals a continuity, cohesion and vigor that stuns the enemies of Jacobinism” (p. 180).
In his study of the beginnings of the Revolution in Brittany, Cochin found sudden reversals of popular opinion which the likes of Monsieur Aulard would have taken at face value, but which become intelligible once viewed in the light of the democratic mechanism:
On All Saints’ Day, 1789, a pamphlet naïvely declared that not a single inhabitant imagined doing away with the privileged orders and obtaining individual suffrage, but by Christmas hundreds of the common people’s petitions were clamoring for individual suffrage or death. What was the origin of this sudden discovery that people had been living in shame and slavery for the past thousand years? Why was there this imperious, immediate need for a reform which could not wait a minute longer?
Such abrupt reversals are sufficient in themselves to detect the operation of a machine. (p. 179)
The basic democratic two-step is supplemented with a bevy of techniques for confusing the mass of voters, discouraging them from organizing opposition, and increasing their passivity and pliability: these techniques include constant voting about everything—trivial as well as important; voting late at night, by surprise, or in multiple polling places; extending the suffrage to everyone: foreigners, women, criminals; and voting by acclamation to submerge independent voices (pp. 182–83). If all else fails, troublemakers can be purged from the society by ballot:
This regime is partial to people with all sorts of defects, failures, malcontents, the dregs of humanity, anyone who cares for nothing and finds his place nowhere. There must not be religious people among the voters, for faith makes one conscious and independent. [The ideal citizen lacks] any feeling that might oppose the machine’s suggestions; hence also the preference for foreigners, the haste in naturalizing them. (pp. 186–87)
(I bite my lip not to get lost in the contemporary applications.)
The extraordinary point of Cochin’s account is that none of these basic techniques were pioneered by the revolutionaries themselves; they had all been developed in the philosophical societies before the Revolution began. The Freemasons, for example, had a term for their style of internal governance: the “Royal Art.” “Study the social crisis from which the Grand Lodge [of Paris Freemasons] was born between 1773 and 1780,” says Cochin, “and you will find the whole mechanism of a Revolutionary purge” (p. 61).
Secrecy is essential to the functioning of this system; the ordinary members remain “free,” meaning they do not consciously obey any authority, but order and unity are maintained by a combination of secret manipulation and passivity. Cochin relates “with what energy the Grand Lodge refused to register its Bulletin with the National Library” (p. 176). And, of course, the Freemasons and similar organizations made great ado over refusing to divulge the precise nature of their activities to outsiders, with initiates binding themselves by terrifying oaths to guard the sacred trust committed to them. Much of these societies’ appeal lay precisely in the natural pleasure men feel at being “in” on a secret of any sort.
In order to clarify Cochin’s ideas, it might be useful to contrast them at this point with those of the Abbé Barruel, especially as they have been confounded by superficial or dishonest leftist commentators (“No need to read that reactionary Cochin! He only rehashes Barruel’s conspiracy thesis”).
Father Barruel was a French Jesuit living in exile in London when he published his Memoirs Illustrating the History of Jacobinism in 1797. He inferred from the notorious secretiveness of the Freemasons and similar groups that they must have been plotting for many years the horrors revealed to common sight after 1789—conspiring to abolish monarchy, religion, social hierarchy, and property in order to hold sway over the ruins of Christendom.
Cochin was undoubtedly thinking of Barruel and his followers when he laments that
thus far, in the lives of these societies, people have only sought the melodrama—rites, mystery, disguises, plots—which means they have strayed into a labyrinth of obscure anecdotes, to the detriment of the true history, which is very clear. Indeed the interest in the phenomenon in question is not in the Masonic bric-a-brac, but in the fact that in the bosom of the nation the Masons instituted a small state governed by its own rules. (p. 137)
For our author, let us recall, a société de pensée such as the Masonic order has inherent constraints independent of the desires or intentions of the members. Secrecy—of the ringleaders in relation to the common members, and of the membership to outsiders—is one of these necessary aspects of its functioning, not a way of concealing criminal intentions. In other words, the Masons were not consciously “plotting” the Terror of ’93 years in advance; the Terror was, however, an unintended but natural outcome of the attempt to apply a version of the Mason’s “Royal Art” to the government of an entire nation.
Moreover, writes Cochin, the peculiar fanaticism and force of the Revolution cannot be explained by a conspiracy theory. Authors like Barruel would reduce the Revolution to “a vast looting operation”:
But how can this enthusiasm, this profusion of noble words, these bursts of generosity or fits of rage be only lies and play-acting? Could the Revolutionary party be reduced to an enormous plot in which each person would only be thinking [and] acting for himself while accepting an iron discipline? Personal interest has neither such perseverance nor such abnegation. Throughout history there have been schemers and egoists, but there have only been revolutionaries for the past one hundred fifty years. (pp. 121–22)
And finally, let us note, Cochin included academic and literary Societies, cultural associations, and schools as sociétés de pensée. Many of these organizations did not even make the outward fuss over secrecy and initiation that the Masons did.
By his own admission, Cochin has nothing to tell us about the causes of the Revolution’s outbreak:
I am not saying that in the movement of 1789 there were not real causes—[e.g.,] a bad fiscal regime that exacted very little, but in the most irritating and unfair manner—I am just saying these real causes are not my subject. Moreover, though they may have contributed to the Revolution of 1789, they did not contribute to the Revolutions of August 10 [1792, abolition of the monarchy] or May 31 [1793, purge of the Girondins]. (p. 125)
With these words, he turns his back upon the entire Marxist “class struggle” approach to understanding the Revolution, which was the fundamental presupposition of much twentieth-century research.
The true beginning of the Revolution on Cochin’s account was the announcement in August 1788 that the Estates General would be convoked for May 1789, for this was the occasion when the men of the societies first sprang into action to direct a real political undertaking. With his collaborator in archival work, Charpentier, he conducted extensive research into this early stage of the Revolution in Brittany and Burgundy, trying to explain not why it took place but how it developed. This material is omitted from the present volume of translations; I shall cite instead from Furet’s summary and discussion in Interpreting the French Revolution:
In Burgundy in the autumn of 1788, political activity was exclusively engineered by a small group of men in Dijon who drafted a “patriotic” platform calling for the doubling of the Third Estate, voting by head, and the exclusion of ennobled commoners and seigneurial dues collectors from the assemblies of the Third Estate. Their next step was the systematic takeover of the town’s corporate bodies. First came the avocats’ corporation where the group’s cronies were most numerous; then the example of that group was used to win over other wavering or apathetic groups: the lower echelons of the magistrature, the physicians, the trade guilds. Finally the town hall capitulated, thanks to one of the aldermen and pressure from a group of “zealous citizens.” In the end, the platform appeared as the freely expressed will of the Third Estate of Dijon. Promoted by the usurped authority of the Dijon town council, it then reached the other towns of the province.[2]
. . . where the same comedy was acted out, only with less trouble since the platform now apparently enjoyed the endorsement of the provincial capital. Cochin calls this the “snowballing method” (p. 84).
An opposition did form in early December: a group of nineteen noblemen which grew to fifty. But the remarkable fact is that the opponents of the egalitarian platform made no use of the traditional institutions or assemblies of the nobility; these were simply forgotten or viewed as irrelevant. Instead, the nobles patterned their procedures on those of the rival group: they thought and acted as the “right wing” of the revolutionary party itself. Both groups submitted in advance to arbitration by democratic legitimacy. The episode, therefore, marked not a parting of the ways between the supporters of the old regime and adherents of the new one, but the first of the revolutionary purges. Playing by its enemies’ rules, the opposition was defeated by mid-December.[3]
In Brittany an analogous split occurred in September and October rather than December. The traditional corporate bodies and the philosophical societies involved had different names. The final purge of the nobles was not carried out until January 1789. The storyline, however, was essentially the same. [4] La Révolution n’a pas de patrie (p. 131).
The regulations for elections to the Estates General were finally announced on January 24, 1789. As we shall see, they provided the perfect field of action for the societies’ machinations.
The Estates General of France originated in the fourteenth century, and were summoned by the King rather than elected. The first two estates consisted of the most important ecclesiastical and lay lords of the realm, respectively. The third estate consisted not of the “commoners,” as usually thought, but of the citizens of certain privileged towns which enjoyed a direct relation with the King through a royal charter (i.e., they were not under the authority of any feudal lord). The selection of notables from this estate may have involved election, although based upon a very restricted franchise.
In the Estates General of those days, the King was addressing
the nation with its established order and framework, with its various hierarchies, its natural subdivisions, its current leaders, whatever the nature or origin of their authority. The king acknowledged in the nation an active, positive role that our democracies would not think of granting to the electoral masses. This nation was capable of initiative. Representatives with a general mandate—professional politicians serving as necessary intermediaries between the King and the nation—were unheard of. (pp. 97–98)
Cochin opposes to this older “French conception” the “English and parliamentary conception of a people of electors”:
A people made up of electors is no longer capable of initiative; at most, it is capable of assent. It can choose between two or three platforms, two or three candidates, but it can no longer draft proposals or appoint men. Professional politicians must present the people with proposals and men. This is the role of parties, indispensable in such a regime. (p. 98)
In 1789, the deputies were elected to the States General on a nearly universal franchise, but—in accordance with the older French tradition—parties and formal candidacies were forbidden: “a candidate would have been called a schemer, and a party a cabal” (p. 99).
The result was that the “electors were placed not in a situation of freedom, but in a void”:
The effect was marvelous: imagine several hundred peasants, unknown to each other, some having traveled twenty or thirty leagues, confined in the nave of a church, and requested to draft a paper on the reform of the realm within the week, and to appoint twenty or thirty deputies. There were ludicrous incidents: at Nantes, for example, where the peasants demanded the names of the assembly’s members be printed. Most could not have cited ten of them, and they had to appoint twenty-five deputies.
Now, what actually happened? Everywhere the job was accomplished with ease. The lists of grievances were drafted and the deputies appointed as if by enchantment. This was because alongside the real people who could not respond there was another people who spoke and appointed for them. (p. 100)
These were, of course, the men of the societies. They exploited the natural confusion and ignorance of the electorate to the hilt to obtain delegates according to their wishes. “From the start, the societies ran the electoral assemblies, scheming and meddling on the pretext of excluding traitors that they were the only ones to designate” (p. 153).
“Excluding”—that is the key word:
The society was not in a position to have its men nominated directly [parties being forbidden], so it had only one choice: have all the other candidates excluded. The people, it was said, had born enemies that they must not take as their defenders. These were the men who lost by the people’s enfranchisement, i.e., the privileged men first, but also the ones who worked for them: officers of justice, tax collectors, officials of any sort. (p. 104)
This raised an outcry, for it would have eliminated nearly everyone competent to represent the Third Estate. In fact, the strict application of the principle would have excluded most members of the societies themselves. But pretexts were found for excepting them from the exclusion: the member’s “patriotism” and “virtue” was vouched for by the societies, which “could afford to do this without being accused of partiality, for no one on the outside would have the desire, or even the means, to protest” (p. 104)—the effect of mass inertia, once again.
Having established the “social mechanism” of the revolution, Cochin did not do any detailed research on the events of the following four years (May 1789–June 1793), full of interest as these are for the narrative historian. Purge succeeded purge: Monarchiens, Feuillants, Girondins. Yet none of the actors seemed to grasp what was going on:
Was there a single revolutionary team that did not attempt to halt this force, after using it against the preceding team, and that did not at that very moment find itself “purged” automatically? It was always the same naïve amazement when the tidal wave reached them: “But it’s with me that the good Revolution stops! The people, that’s me! Freedom here, anarchy beyond!” (p. 57)
During this period, a series of elective assemblies crowned the official representative government of France: first the Constituent Assembly, then the Legislative Assembly, and finally the Convention. Hovering about them and partly overlapping with their membership were various private and exclusive clubs, a continuation of the pre-Revolutionary philosophical societies. Through a gradual process of gaining the affiliation of provincial societies, killing off rivals in the capital, and purging itself and its daughters, one of these revolutionary clubs acquired by June 1793 an unrivalled dominance. Modestly formed in 1789 as the Breton Circle, later renamed the Friends of the Constitution, it finally established its headquarters in a disused Jacobin Convent and became known as the Jacobin Club:
Opposite the Convention, the representative regime of popular sovereignty, thus arises the amorphous regime of the sovereign people, acting and governing on its own. “The sovereign is directly in the popular societies,” say the Jacobins. This is where the sovereign people reside, speak, and act. The people in the street will only be solicited for the hard jobs and the executions.
[The popular societies] functioned continuously, ceaselessly watching and correcting the legal authorities. Later they added surveillance committees to each assembly. The Jacobins thoroughly lectured, browbeat, and purged the Convention in the name of the sovereign people, until it finally adjourned the Convention’s power. (p. 153)
Incredibly, to the very end of the Terror, the Jacobins had no legal standing; they remained officially a private club. “The Jacobin Society at the height of its power in the spring of 1794, when it was directing the Convention and governing France, had only one fear: that it would be ‘incorporated’—that it would be ‘acknowledged’ to have authority” (p. 176). There is nothing the strict democrat fears more than the responsibility associated with public authority.
The Jacobins were proud that they did not represent anyone. Their principle was direct democracy, and their operative assumption was that they were “the people.” “I am not the people’s defender,” said Robespierre; “I am a member of the people; I have never been anything else” (p. 57; cf. p. 154). He expressed bafflement when he found himself, like any powerful man, besieged by petitioners.
Of course, such “direct democracy” involves a social fiction obvious to outsiders. To the adherent “the word people means the ‘hard core’ minority, freedom means the minority’s tyranny, equality its privileges, and truth its opinion,” explains our author; “it is even in this reversal of the meaning of words that the adherent’s initiation consists” (p. 138).
But by the summer of 1793 and for the following twelve months, the Jacobins had the power to make it stick. Indeed, theirs was the most stable government France had during the entire revolutionary decade. It amounted to a second Revolution, as momentous as that of 1789. The purge of the Girondins (May 31–June 2) cleared the way for it, but the key act which constituted the new regime, in Cochin’s view, was the levée en masse of August 23, 1793:
[This decree] made all French citizens, body and soul, subject to standing requisition. This was the essential act of which the Terror’s laws would merely be the development, and the revolutionary government the means. Serfs under the King in ’89, legally emancipated in ’91, the people become the masters in ’93. In governing themselves, they do away with the public freedoms that were merely guarantees for them to use against those who governed them. Hence the right to vote is suspended, since the people reign; the right to defend oneself, since the people judge; the freedom of the press, since the people write; and the freedom of expression, since the people speak. (p. 77)
An absurd series of unenforceable economic decrees began pouring out of Paris—price ceilings, requisitions, and so forth. But then, mirabile dictu, it turned out that the decrees needed no enforcement by the center:
Every violation of these laws not only benefits the guilty party but burdens the innocent one. When a price ceiling is poorly applied in one district and products are sold more expensively, provisions pour in from neighboring districts, where shortages increase accordingly. It is the same for general requisitions, censuses, distributions: fraud in one place increases the burden for another. The nature of things makes every citizen the natural enemy and overseer of his neighbor. All these laws have the same characteristic: binding the citizens materially to one another, the laws divide them morally.
Now public force to uphold the law becomes superfluous. This is because every district, panic-stricken by famine, organizes its own raids on its neighbors in order to enforce the laws on provisions; the government has nothing to do but adopt a laissez-faire attitude. By March 1794 the Committee of Public Safety even starts to have one district’s grain inventoried by another.
This peculiar power, pitting one village against another, one district against another, maintained through universal division the unity that the old order founded on the union of everyone: universal hatred has its equilibrium as love has its harmony. (pp. 230–32; cf. p. 91)
The societies were, indeed, never more numerous, nor better attended, than during this period. People sought refuge in them as the only places they could be free from arbitrary arrest or requisitioning (p. 80; cf. p. 227). But the true believers were made uneasy rather than pleased by this development. On February 5, 1794, Robespierre gave his notorious speech on Virtue, declaring: “Virtue is in the minority on earth.” In effect, he was acknowledging that “the people” were really only a tiny fraction of the nation. During the months that ensued:
there was no talk in the Societies but of purges and exclusions. Then it was that the mother society, imitated as usual by most of her offspring, refused the affiliation of societies founded since May 31. Jacobin nobility became exclusive; Jacobin piety went from external mission to internal effort on itself. At that time it was agreed that a society of many members could not be a zealous society. The agents from Tournan sent to purge the club of Ozouer-la-Ferrière made no other reproach: the club members were too numerous for the club to be pure. (p. 56)
Couthon wrote from Lyon requesting “40 good, wise, honest republicans, a colony of patriots in this foreign land where patriots are in such an appalling minority.” Similar supplications came from Marseilles, Grenoble, Besançon; from Troy, where there were less than twenty patriots; and from Strasbourg, where there were said to be fewer than four—contending against 6,000 aristocrats!
The majority of men, remaining outside the charmed circle of revolutionary virtue, were:
“monsters,” “ferocious beasts seeking to devour the human race.” “Strike without mercy, citizen,” the president of the Jacobins tells a young soldier, “at anything that is related to the monarchy. Don’t lay down your gun until all our enemies are dead—this is humanitarian advice.” “It is less a question of punishing them than of annihilating them,” says Couthon. “None must be deported; [they] must be destroyed,” says Collot. General Turreau in the Vendée gave the order “to bayonet men, women, and children and burn and set fire to everything.” (p. 100)
Mass shootings and drownings continued for months, especially in places such as the Vendée which had previously revolted. Foreigners sometimes had to be used: “Carrier had Germans do the drowning. They were not disturbed by the moral bonds that would have stopped a fellow countryman” (p. 187).
Why did this revolutionary regime come to an end? Cochin does not tell us; he limits himself to the banal observation that “being unnatural, it could not last” (p. 230). His death in 1916 saved him from having to consider the counterexample of Soviet Russia. Taking the Jacobins consciously as a model, Lenin created a conspiratorial party which seized power and carried out deliberately the sorts of measures Cochin ascribes to the impersonal workings of the “social mechanism.” Collective responsibility, mutual surveillance and denunciation, the playing off of nationalities against one another—all were studiously imitated by the Bolsheviks. For the people of Russia, the Terror lasted at least thirty-five years, until the death of Stalin.
Cochin’s analysis raises difficult questions of moral judgment, which he does not try to evade. If revolutionary massacres were really the consequence of a “social mechanism,” can their perpetrators be judged by the standards which apply in ordinary criminal cases? Cochin seems to think not:
“I had orders,” Fouquier kept replying to each new accusation. “I was the ax,” said another; “does one punish an ax?” Poor, frightened devils, they quibbled, haggled, denounced their brothers; and when finally cornered and overwhelmed, they murmured “But I was not the only one! Why me?” That was the helpless cry of the unmasked Jacobin, and he was quite right, for a member of the societies was never the only one: over him hovered the collective force. With the new regime men vanish, and there opens in morality itself the era of unconscious forces and human mechanics. (p. 58)
Under the social regime, man’s moral capacities get “socialized” in the same way as his thought, action, and property. “Those who know the machine know there exist mitigating circumstances, unknown to ordinary life, and the popular curse that weighed on the last Jacobins’ old age may be as unfair as the enthusiasm that had acclaimed their elders,” he says (p. 210), and correctly points out that many of the former Terrorists became harmless civil servants under the Empire.
It will certainly be an unpalatable conclusion for many readers. I cannot help recalling in this connection the popular outrage which greeted Arendt’s Eichmann in Jerusalem back in the 1960s, with its similar observations.
But if considering the social alienation of moral conscience permits the revolutionaries to appear less evil than some of the acts they performed, it also leaves them more contemptible. “We are far from narratives like Plutarch’s,” Cochin observes (p. 58); “Shakespeare would have found nothing to inspire him, despite the dramatic appearance of the situations” (p. 211).
Not one [of the Jacobins] had the courage to look [their judges] in the eye and say “Well, yes, I robbed, I tortured and I killed lawlessly, recklessly, mercilessly for an idea I consider right. I regret nothing; I take nothing back; I deny nothing. Do as you like with me.” Not one spoke thus—because not one possessed the positive side of fanaticism: faith. (p. 113)
Cochin’s interpretive labors deserve the attention of a wider audience than specialists in the history of the French Revolution. The possible application of his analysis to subsequent groups and events is great indeed, although the possibility of their misapplication is perhaps just as great. The most important case is surely Russia. Richard Pipes has noted, making explicit reference to Cochin, that Russian radicalism arose in a political and social situation similar in important respects to France of the ancien régime. On the other hand, the Russian case was no mere product of social “mechanics.” The Russian radicals consciously modeled themselves on their French predecessors. Pipes even shows how the Russian revolutionaries relied too heavily on the French example to teach them how a revolution is “supposed to” develop, blinding themselves to the situation around them. In any case, although Marxism officially considered the French Revolution a “bourgeois” prelude to the final “proletarian” revolution, Russian radicals did acknowledge that there was little in which the Jacobins had not anticipated them. Lenin considered Robespierre a Bolshevik avant la lettre.
The rise of the “Academic Left” is another phenomenon worth comparing to the “development of the enlightenment” in the French salons. The sheltered environment of our oversubsidized university system is a marvelous incubator for the same sort of utopian radicalism and cheap moral posturing.
Or consider the feminist “Consciousness Raising” sessions of the 1970’s. Women’s “personal constructs” (dissatisfaction with their husbands, feelings of being treated unfairly, etc.) were said to be “validated by the group,” i.e., came to be considered true when they met with agreement from other members, however outlandish they might sound to outsiders. “It is when a group’s ideas are strongly at variance with those in the wider society,” writes one enthusiast, “that group validation of constructs is likely to be most important.”[5] Cochin explained with reference to the sociétés de pensée exactly the sort of thing going on here.
Any serious attempt to extend and apply Cochin’s ideas will, however, have to face squarely one matter on which his own statements are confused or even contradictory.
Cochin sometimes speaks as if all the ideas of the Enlightenment follow from the mere form of the société de pensée, and hence should be found wherever they are found. He writes, for example, “Free thought is the same in Paris as in Peking, in 1750 as in 1914” (p. 127). Now, this is already questionable. It would be more plausible to say that the various competing doctrines of radicalism share a family resemblance, especially if one concentrates on their negative aspects such as the rejection of traditional “prejudices.”
But in other passages Cochin allows that sociétés de pensée are compatible with entirely different kinds of content. In one place (p. 62) he even speaks of “the royalist societies of 1815” as coming under his definition! Stendhal offers a memorable fictional portrayal of such a group in Le rouge et le noir, part II, chs. xxi–xxiii; Cochin himself refers to the Mémoires of Aimée de Coigny, and may have had the Waterside Conspiracy in mind. It would not be at all surprising if such groups imitated some of the practices of their enemies.
But what are we to say when Cochin cites the example of the Company of the Blessed Sacrament? This organization was active in France between the 1630s and 1660s, long before the “Age of Enlightenment.” It had collectivist tendencies, such as the practice of “fraternal correction,” which it justified in terms of Christian humility: the need to combat individual pride and amour-propre. It also exhibited a moderate degree of egalitarianism; within the Company, social rank was effaced, and one Prince of the Blood participated as an ordinary member. Secrecy was said to be the “soul of the Company.” One of its activities was the policing of behavior through a network of informants, low-cut evening dresses and the sale of meat during lent being among its special targets. Some fifty provincial branches accepted the direction of the Paris headquarters. The Company operated independently of the King, and opponents referred to it as the cabale des devots. Louis XIV naturally became suspicious of such an organization, and officially ordered it shut down in 1666.
Was this expression of counter-reformational Catholic piety a société de pensée? Were its members “God’s Jacobins,” or its campaign against immodest dress a “holy terror”? Cochin does not finally tell us. A clear typology of sociétés de pensée would seem to be necessary before his analysis of the philosophes could be extended with any confidence. But the more historical studies advance, the more difficult this task will likely become. Such is the nature of man, and of history.
Notes
[1] François Furet, Interpreting the French Revolution (Cambridge: Cambridge University Press, 1981), 173.
[2] Furet, 184.
[3] Furet, 185.
[4] Furet, 186–90.
[5] http://www.uow.edu.au/arts/sts/bmartin/pubs/01psa.html [3]
Source: TOQ, vol. 8, no. 2 (Summer 2008)
Article printed from Counter-Currents Publishing: http://www.counter-currents.com
URL to article: http://www.counter-currents.com/2012/06/from-salon-to-guillotine/
00:05 Publié dans Histoire, Livre, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, 18ème siècle, sociétés de pensée, salons, révolution, révolution française, livre, augustin cochin, conservatisme, action française, philosophie, philosophie des lumières |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 08 juillet 2012
American Transcendentalism
American Transcendentalism:
An Indigenous Culture of Critique
By Kevin MacDonald
Ex: http://www.counter-currents.com/
 Philip F. Gura
Philip F. Gura
American Transcendentalism: A History [2]
New York: Hill and Wang, 2007
Philip Gura’s American Transcendentalism provides a valuable insight into a nineteenth-century leftist intellectual elite in the United States. This is of considerable interest because Transcendentalism was a movement entirely untouched by the predominantly Jewish milieu of the twentieth-century left in America. Rather, it was homegrown, and its story tells us much about the sensibility of an important group of white intellectuals and perhaps gives us hints about why in the twentieth century WASPs so easily capitulated to the Jewish onslaught on the intellectual establishment.
Based in New England, Transcendentalism was closely associated with Harvard and Boston—the very heart of Puritan New England. It was also closely associated with Unitarianism which had become the most common religious affiliation for Boston’s elite. Many Transcendentalists were Unitarian clergymen, including Ralph Waldo Emerson, the person whose name is most closely associated with the movement in the public mind.
These were very intelligent people living in an age when religious beliefs required an intellectual defense rather than blind acceptance. Their backgrounds were typical of New England Christians of the day. But as their intellectual world expanded (often at the Harvard Divinity School), they became aware of the “higher criticism” of the Bible that originated with German scholars. This scholarship showed that there were several different authors of Genesis and that Moses did not write the first five books of the Old Testament. They also became aware of other religions, such as Buddhism and Hinduism which made it unlikely that Christianity had a monopoly on religious truth.
In their search for an intellectual grounding of religion, they rejected Locke’s barren empiricism and turned instead to the idealism of Kant, Schelling, and Coleridge. If the higher criticism implied that the foundations of religious belief were shaky, and if God was unlikely to have endowed Christianity with unique religious truths, the Transcendentalists would build new foundations emphasizing the subjectivity of religious experience. The attraction of idealism to the Transcendentalists was its conception of the mind as creative, intuitive, and interpretive rather than merely reactive to external events. As the writer and political activist Orestes Brownson summed it up in 1840, Transcendentalism defended man’s “capacity of knowing truth intuitively [and] attaining scientific knowledge of an order of existence transcending the reach of the senses, and of which we can have no sensible experience” (p. 121). Everyone, from birth, possesses a divine element, and the mind has “innate principles, including the religious sentiment” (p. 84).
The intuitions of the Transcendentalists were decidedly egalitarian and universalist. “Universal divine inspiration—grace as the birthright of all—was the bedrock of the Transcendentalist movement” (p. 18). Ideas of God, morality, and immortality are part of human nature and do not have to be learned. As Gura notes, this is the spiritual equivalent of the democratic ideal that all men (and women) are created equal.
Intuitions are by their very nature slippery things. One could just as plausibly (or perhaps more plausibly) propose that humans have intuitions of greed, lust, power, and ethnocentrism—precisely the view of the Darwinians who came along later in the century. In the context of the philosophical milieu of Transcendentalism, their intuitions were not intended to be open to empirical investigation. Their truth was obvious and compelling—a fact that tells us much about the religious milieu of the movement.
On the other hand, the Transcendentalists rejected materialism with its emphasis on “facts, history, the force of circumstance and the animal wants of man” (quoting Emerson, p. 15). Fundamentally, they did not want to explain human history or society, and they certainly would have been unimpressed by a Darwinian view of human nature that emphasizes such nasty realities as competition for power and resources and how these play out given the exigencies of history. Rather, they adopted a utopian vision of humans as able to transcend all that by means of the God-given spiritual powers of the human mind.
Not surprisingly, this philosophy led many Transcendentalists to become deeply involved in social activism on behalf of the lower echelons of society—the poor, prisoners, the insane, the developmentally disabled, and slaves in the South.
* * *
The following examples give a flavor of some of the central attitudes and typical social activism of important Transcendentalists.
Orestes Brownson (1803–1876) admired the Universalists’ belief in the inherent dignity of all people and the promise of eventual universal salvation for all believers. He argued “for the unity of races and the inherent dignity of each person, and he lambasted Southerners for trying to enlarge their political base” (p. 266). Like many New Englanders, he was outraged by the Supreme Court decision in the Dred Scott case that required authorities in the North to return fugitive slaves to their owners in the South. For Brownson the Civil War was a moral crusade waged not only to preserve the union, but to emancipate the slaves. Writing in 1840, Brownson claimed that we should “realize in our social arrangements and in the actual conditions of all men that equality of man and man” that God had established but which had been destroyed by capitalism (pp. 138–39). According to Brownson, Christians had
to bring down the high, and bring up the low; to break the fetters of the bound and set the captive free; to destroy all oppression, establish the reign of justice, which is the reign of equality, between man and man; to introduce new heavens and a new earth, wherein dwelleth righteousness, wherein all shall be as brothers, loving one another, and no one possessing what another lacketh. (p. 139)
George Ripley (1802–1880), who founded the utopian community of Brook Farm and was an important literary critic, “preached in earnest Unitarianism’s central message, a belief in universal, internal religious principle that validated faith and united all men and women” (p. 80). Ripley wrote that Transcendentalists “believe in an order of truths which transcends the sphere of the external senses. Their leading idea is the supremacy of mind over matter.” Religious truth does not depend on facts or tradition but
has an unerring witness in the soul. There is a light, they believe, which enlighteneth every man that cometh into the world; there is a faculty in all, the most degraded, the most ignorant, the most obscure, to perceive spiritual truth, when distinctly represented; and the ultimate appeal, on all moral questions, is not to a jury of scholars, a hierarchy of divines, or the prescriptions of a creed, but to the common sense of the race. (p. 143)
Ripley founded Brook Farm on the principle of substituting “brotherly cooperation” for “selfish competition” (p. 156). He questioned the economic and moral basis of capitalism. He held that if people did the work they desired, and for which they had a talent, the result would be a non-competitive, classless society where each person would achieve personal fulfillment.
Amos Bronson Alcott (1799–1888) was an educator who “believed in the innate goodness of each child whom he taught” (p. 85). Alcott “realized how Unitarianism’s positive and inclusive vision of humanity accorded with his own” (p. 85). He advocated strong social controls in order to socialize children: infractions were reported to the entire group of students, which then prescribed the proper punishment. The entire group was punished for the bad behavior of a single student. His students were the children of the intellectual elite of Boston, but his methods eventually proved unpopular. The school closed after most of the parents withdrew their children when Alcott insisted upon admitting a black child. Alcott supported William Garrison’s radical abolitionism, and he was a financial supporter of John Brown and his violent attempts to overthrow slavery.
Ralph Waldo Emerson (1803–1882) stirred a great deal of controversy in his American Scholar, an 1832 address to the Harvard Divinity School, because he reinterpreted what it meant for Christ to claim to be divine:
One man was true to what is in you and me. He saw that God incarnates himself in man, and evermore goes forth to take possession of his world. He said, in this jubilee of sublime emotion, “I am divine. Through me, God acts; through me, he speaks. Would you see God, see me; or, see thee, when thou also thinkest as I now think.” (p. 103)
Although relatively individualistic by the standards of Transcendentalism, Emerson proposed that by believing in their own divine purpose, people would have the courage to stand up for social justice. The divinely powered individual was thus linked to disrupting the social order.
Theodore Parker (1810–1860) was a writer, public intellectual, and model for religiously motivated liberal activism. He wrote that “God is alive and in every person” (p. 143). Gura interprets Parker as follows: “God is not what we are, but what we need to make our lives whole, and one way to realize this is through selfless devotion to God’s creation” (p. 218).
Parker was concerned about crime and poverty, and he was deeply opposed to the Mexican war and to slavery. He blamed social conditions for crime and poverty, condemning merchants: “We are all brothers, rich and poor, American and foreign, put here by the same God, for the same end, and journeying towards the same heaven, and owing mutual help” (p. 219). In Parker’s view, slavery is “the blight of this nation” and was the real reason for the Mexican war, because it was aimed at expanding the slave states. Parker was far more socially active than Emerson, becoming one of the most prominent abolitionists and a secret financial supporter of John Brown.
When Parker looked back on the history of the Puritans, he saw them as standing for moral principles. He approved in particular of John Eliot, who preached to the Indians and attempted to convert them to Christianity.
Nevertheless, Parker is a bit of an enigma because, despite being a prominent abolitionist and favoring racial integration of schools and churches, he asserted that the Anglo-Saxon race was “more progressive” than all others.[1] He was also prone to making condescending and disparaging comments about the potential of Africans for progress.
William Henry Channing (1810–1884) was a Transcendentalist writer and Christian socialist. He held that economic activity conducted in the spirit of Christian love would establish a more egalitarian society that would include immigrants, the poor, slaves, prisoners, and the mentally ill. He worked tirelessly on behalf of the cause of emancipation and in the Freedman’s Bureau designed to provide social services for former slaves. Although an admirer of Emerson, he rejected Emerson’s individualism, writing in a letter to Theodore Parker that it was one of his deepest convictions that the human race “is inspired as well as the individual; that humanity is a growth from the Divine Life as well as man; and indeed that the true advancement of the individual is dependent upon the advancement of a generation, and that the law of this is providential, the direct act of the Being of beings.”[2]
* * *
In the 1840s there was division between relatively individualist Trancendentalists like Emerson who “valued individual spiritual growth and self-expression,” and “social reformers like Brownson, Ripley, and increasingly, Parker” (p. 137). In 1844 Emerson joined a group of speakers that included abolitionists, but many Transcendentalists questioned his emphasis on self-reliance given the Mexican war, upheaval in Europe, and slavery. They saw self-reliance as ineffectual in combating the huge aggregation of interests these represented. Elizabeth Peabody lamented Emerson’s insistence that a Transcendentalist should not labor “for small objects, such as Abolition, Temperance, Political Reforms, &c.” (p. 216). (She herself was an advocate of the Kindergarten movement as well as Native American causes [p. 270].)
But Emerson did oppose slavery. An 1844 speech praised Caribbean blacks for rising to high occupations after slavery: “This was not the case in the United States, where descendants of Africans were precluded any opportunity to be a white person’s equal. This only reflected on the moral bankruptcy of American white society, however, for ‘the civility of no race can be perfect whilst another race is degraded’” (p. 245).
Emerson and other Transcendentalists were outraged by the Fugitive Slave Law of 1850. Gura notes that for Emerson, “the very landscape seemed robbed of its beauty, and he even had trouble breathing because of the ‘infamy’ in the air” (p. 246). After the John Brown debacle, Emerson was “glad to see that the terror at disunion and anarchy is disappearing,” for the price of slaves’ freedom might demand it (p. 260). Both Emerson and Thoreau commented on Brown’s New England Puritan heritage. Emerson lobbied Lincoln on slavery, and when Lincoln emancipated the slaves, he said “Our hurts are healed; the health of the nation is repaired” (p. 265). He thought the war worth fighting because of it.
* * *
After the Civil War, idealism lost its preeminence, and American intellectuals increasingly embraced materialism. Whereas Locke had been the main inspiration for materialism earlier in the century, materialism was now exemplified by Darwin, Auguste Comte, and William Graham Sumner. After the Civil War, the Transcendentalists’ contributions to American intellectual discourse “remained vital, if less remarked, particularly among those who kept alive a dream of a common humanity based in the irreducible equality of all souls” (p. 271). One of the last Transcendentalists, Octavius Brooks Frothingham, wrote that Transcendentalism was being “suppressed by the philosophy of experience, which, under different names, was taking possession of the speculative world” (p. 302). The enemies of Transcendentalism were “positivists” (p. 302). After Emerson’s death, George Santayana commented that he “was a cheery, child-like soul, impervious to the evidence of evil” (pp. 304–305).
By the early twentieth century, then, Transcendentalism was a distant memory, and the new materialists had won the day. The early part of the twentieth century was the high water mark of Darwinism in the social sciences. It was common at that time to think that there were important differences between the races in both intelligence and moral qualities. Not only did races differ, they were in competition with each other for supremacy. Whereas later in the century, Jewish intellectuals led the battle against Darwinism in the social sciences, racialist ideas were part of the furniture of intellectual life—commonplace among intellectuals of all stripes, including a significant number of Jewish racial nationalists concerned about the racial purity and political power of the Jewish people.[3]
The victory of Darwinisn was short-lived, however, as the left became reinvigorated by the rise of several predominantly Jewish intellectual and political movements: Marxism, Boasian anthropology, psychoanalysis, and other ideologies that collectively have dominated intellectual discourse ever since.[4]
* * *
So what is one to make of this prominent strand of egalitarian universalism in nineteenth-century America? The first thing that strikes one about Transcendentalism is that it is an outgrowth of the Puritan strain of American culture. Transcendentalism was centered in New England, and all its major figures were descendants of the Puritans. I have written previously of Puritanism as a rather short-lived group evolutionary strategy, supplementing the work of David Sloan Wilson on Calvinism, the forerunner of Puritanism.[5] The basic idea is that, like Jews, Puritans during their heyday had a strong psychological sense of group membership combined with social controls that minutely regulated the behavior of ingroup members. Their group strategy depended on being able to control a particular territory—Massachusetts—but by the end of theseventeenth century, they were unable to regulate the borders of the colony due to the policy of the British colonial authorities, hence the government of Massachusetts ceased being the embodiment of the Puritans as a group. In the absence of political control, Puritanism gradually lost the power to enforce its religious strictures (e.g., church attendance and orthodox religious beliefs), and the population changed as the economic prosperity created by the Puritans drew an influx of non-Puritans into the area.
The Puritans were certainly highly intelligent, and they sought a system of beliefs that was firmly grounded in contemporary thinking. One striking aspect of Gura’s treatment is his description of earnest proto-Transcendentalists trekking over to Germany to imbibe the wisdom of German philosophy and producing translations and lengthy commentaries on this body of work for an American audience.
But the key to Puritanism as a group strategy, like other strategies, was the control of behavior of group members. As with Calvin’s original doctrine, there was a great deal of supervision of individual behavior. Historian David Hackett Fischer describes Puritan New England’s ideology of “Ordered Liberty” as “the freedom to order one’s acts in a godly way—but not in any other.”[6] This “freedom as public obligation” implied strong social control of thought, speech, and behavior.
Both New England and East Anglia (the center of Puritanism in England) had the lowest relative rates of private crime (murder, theft, mayhem), but the highest rates of public violence—“the burning of rebellious servants, the maiming of political dissenters, the hanging of Quakers, the execution of witches.”[7] This record is entirely in keeping with Calvinist tendencies in Geneva.[8]
The legal system was designed to enforce intellectual, political, and religious conformity as well as to control crime. Louis Taylor Merrill describes the “civil and religious strait-jacket that the Massachusetts theocrats applied to dissenters.”[9] The authorities, backed by the clergy, controlled blasphemous statements and confiscated or burned books deemed to be offensive. Spying on one’s neighbors and relatives was encouraged. There were many convictions for criticizing magistrates, the governor, or the clergy. Unexcused absence from church was fined, with people searching the town for absentees. Those who fell asleep in church were also fined. Sabbath violations were punished as well. A man was even penalized for publicly kissing his wife as he greeted her on his doorstep upon his return from a three-year sea voyage.
Kevin Phillips traces the egalitarian, anti-hierarchical spirit of Yankee republicanism back to the settlement of East Anglia by Angles and Jutes in post-Roman times.[10] They produced “a civic culture of high literacy, town meetings, and a tradition of freedom,” distinguished from other British groups by their “comparatively large ratios of freemen and small numbers of servi and villani.”[11] President John Adams cherished the East Anglian heritage of “self-determination, free male suffrage, and a consensual social contract.”[12] East Anglia continued to produce “insurrections against arbitrary power”—the rebellions of 1381 led by Jack Straw, Wat Tyler, and John Ball; Clarence’s rebellion of 1477; and Robert Kett’s rebellion of 1548. All of these rebellions predated the rise of Puritanism, suggesting an ingrained cultural tendency.
This emphasis on relative egalitarianism and consensual, democratic government are tendencies characteristic of Northern European peoples as a result of a prolonged evolutionary history as hunter-gatherers in the north of Europe.[13] But these tendencies are certainly not center stage when thinking about the political tendencies of the Transcendentalists.
What is striking is the moral fervor of the Puritans. Puritans tended to pursue utopian causes framed as moral issues. They were susceptible to appeals to a “higher law,” and they tended to believe that the principal purpose of government is moral. New England was the most fertile ground for “the perfectibility of man creed,” and the “father of a dozen ‘isms.’”[14] There was a tendency to paint political alternatives as starkly contrasting moral imperatives, with one side portrayed as evil incarnate—inspired by the devil.
Whereas in the Puritan settlements of Massachusetts the moral fervor was directed at keeping fellow Puritans in line, in the nineteenth century it was directed at the entire country. The moral fervor that had inspired Puritan preachers and magistrates to rigidly enforce laws on fornication, adultery, sleeping in church, or criticizing preachers was universalized and aimed at correcting the perceived ills of capitalism and slavery.
Puritans waged holy war on behalf of moral righteousness even against their own cousins—perhaps a form of altruistic punishment as defined by Ernst Fehr and Simon Gächter.[15] Altruistic punishment refers to punishing people even at a cost to oneself. Altruistic punishment is found more often among cooperative hunter-gatherer groups than among groups, such as Jews, based on extended kinship.[16]
Whatever the political and economic complexities that led to the Civil War, it was the Yankee moral condemnation of slavery that inspired and justified the massive carnage of closely related Anglo-Americans on behalf of slaves from Africa. Militarily, the war with the Confederacy was the greatest sacrifice in lives and property ever made by Americans.[17] Puritan moral fervor and punitiveness are also evident in the call of the Congregationalist minister at Henry Ward Beecher’s Old Plymouth Church in New York during the Second World War for “exterminating the German people . . . the sterilization of 10,000,000 German soldiers and the segregation of the woman.”[18]
It is interesting that the moral fervor the Puritans directed at ingroup and outgroup members strongly resembles that of the Old Testament prophets who railed against Jews who departed from God’s law, and against the uncleanness or even the inhumanity of non-Jews. Indeed, it has often been noted that the Puritans saw themselves as the true chosen people of the Bible. In the words of Samuel Wakeman, a prominentseventeenth-century Puritan preacher: “Jerusalem was, New England is; they were, you are God’s own, God’s covenant people; put but New England’s name instead of Jerusalem.”[19] “They had left Europe which was their ‘Egypt,’ their place of enslavement, and had gone out into the wilderness on a messianic journey, to found the New Jerusalem.”[20]
Whereas Puritanism as a group evolutionary strategy crumbled when the Puritans lost control of Massachusetts, Diaspora Jews were able to maintain their group integrity even without control over a specific territory for well over 2,000 years. This attests to the greater ethnocentrism of Jews. But, although relatively less ethnocentric, the Puritans were certainly not lacking in moralistic aggression toward members of their ingroup, even when the boundaries of the ingroup were expanded to include all of America, or indeed all of humanity. And while the Puritans were easily swayed by moral critiques of white America, because of their stronger sense of ingroup identity, Jews have been remarkably resistant to moralistic critiques of Judaism.[21]
With the rise of the Jewish intellectual and political movements described in The Culture of Critique, the descendants of the Puritans readily joined the chorus of moral condemnation of America.
The lesson here is that in large part the problem confronting whites stems from the psychology of moralistic self-punishment exemplified at the extreme by the Puritans and their intellectual descendants, but also apparent in a great many other whites. As I have noted elsewhere:
Once Europeans were convinced that their own people were morally bankrupt, any and all means of punishment should be used against their own people. Rather than see other Europeans as part of an encompassing ethnic and tribal community, fellow Europeans were seen as morally blameworthy and the appropriate target of altruistic punishment. For Westerners, morality is individualistic—violations of communal norms . . . are punished by altruistic aggression. . . .
The best strategy for a collectivist group like the Jews for destroying Europeans therefore is to convince the Europeans of their own moral bankruptcy. A major theme of [The Culture of Critique] is that this is exactly what Jewish intellectual movements have done. They have presented Judaism as morally superior to European civilization and European civilization as morally bankrupt and the proper target of altruistic punishment. The consequence is that once Europeans are convinced of their own moral depravity, they will destroy their own people in a fit of altruistic punishment. The general dismantling of the culture of the West and eventually its demise as anything resembling an ethnic entity will occur as a result of a moral onslaught triggering a paroxysm of altruistic punishment. Thus the intense effort among Jewish intellectuals to continue the ideology of the moral superiority of Judaism and its role as undeserving historical victim while at the same time continuing the onslaught on the moral legitimacy of the West. [22]
The Puritan legacy in American culture is indeed pernicious, especially since the bar of morally correct behavior has been continually raised to the point that any white group identification has been pathologized. As someone with considerable experience in the academic world, I can attest to feeling like a wayward heretic back in seventeenth-century Massachusetts when confronted, as I often am, by academic thought police. It’s the moral fervor of these people that stands out. The academic world has become a Puritan congregation of stifling thought control, enforced by moralistic condemnations that aseventeenth-century Puritan minister could scarcely surpass. In my experience, this thought control is far worse in the East coast colleges and universities founded by the Puritans than elsewhere in academia—a fitting reminder of the continuing influence of Puritanism in American life.
Given this state of affairs, what sorts of therapy might one suggest? To an evolutionary psychologist, this moralistic aggression seems obviously adaptive for maintaining the boundaries and policing the behavior of a close-knit group. The psychology of moralistic aggression against deviating Jews (often termed “self-hating Jews”) has doubtless served Jews quite well over the centuries. Similarly, groups of Angles, Jutes, and their Puritan descendants doubtlessly benefited greatly from moralistic aggression because of its effectiveness in enforcing group norms and punishing cheaters and defectors.
There is nothing inherently wrong with moralistic aggression. The key is to convince whites to alter their moralistic aggression in a more adaptive direction in light of Darwinism. After all, the object of moralistic aggression is quite malleable. Ethnonationalist Jews in Israel use their moral fervor to rationalize the dispossession and debasement of the Palestinians, but many of the same American Jews who fervently support Jewish ethnonationalism in Israel feel a strong sense of moralistic outrage at vestiges of white identity in the United States.
A proper Darwinian sense of moralistic aggression would be directed at those of all ethnic backgrounds who have engineered or are maintaining the cultural controls that are presently dispossessing whites of their historic homelands. The moral basis of this proposal is quite clear:
(1) There are genetic differences between peoples, thus different peoples have legitimate conflicts of interest.[23]
(2) Ethnocentrism has deep psychological roots that cause us to feel greater attraction and trust for those who are genetically similar.[24]
(3) As Frank Salter notes, ethnically homogeneous societies bound by ties of kinship and culture are more likely to be open to redistributive policies such as social welfare.[25]
(4) Ethnic homogeneity is associated with greater social trust and political participation.[26]
(5) Ethnic homogeneity may well be a precondition of political systems characterized by democracy and rule of law.[27]
The problem with the Transcendentalists is that they came along before their intuitions could be examined in the cold light of modern evolutionary science. Lacking any firm foundation in science, they embraced a moral universalism that is ultimately ruinous to people like themselves. And because it is so contrary to our evolved inclinations, their moral universalism needs constant buttressing with all the power of the state—much as the rigorous rules of the Puritans of old required constant surveillance by the authorities.
Of course, the Transcendentalists would have rejected such a “positivist” analysis. Indeed, one might note that modern psychology is on the side of the Puritans in the sense that explicitly held ideologies are able to exert control over the more ancient parts of the brain, including those responsible for ethnocentrism.[28] The Transcendentalist belief that the mind is creative and does not merely respond to external facts is quite accurate in light of modern psychological research. In modern terms, the Transcendentalists were essentially arguing that whatever “the animal wants of man” (to quote Emerson), humans are able to imagine an ideal world and exert effective psychological control over their ethnocentrism. They are even able to suppress desires for territory and descendants that permeate human history and formed an important part of the ideology of the Old Testament—a book that certainly had a huge influence on the original Puritan vision of the New Jerusalem.
Like the Puritans, the Transcendentalists would have doubtlessly acknowledged that some people have difficulty controlling these tendencies. But this is not really a problem, because these people can be forced. The New Jerusalem can become a reality if people are willing to use the state to enforce group norms of thought and behavior. Indeed, there are increasingly strong controls on thought crimes against the multicultural New Jerusalem throughout the West.
The main difference between the Puritan New Jerusalem and the present multicultural one is that the latter will lead to the demise of the very white people who are the mainstays of the current multicultural Zeitgeist. Unlike the Puritan New Jerusalem, the multicultural New Jerusalem will not be controlled by people like themselves, who in the long run will be a tiny, relatively powerless minority.
The ultimate irony is that without altruistic whites willing to be morally outraged by violations of multicultural ideals, the multicultural New Jerusalem is likely to revert to a Darwinian struggle for survival among the remnants. But the high-minded descendants of the Puritans won’t be around to witness it.
Notes
[3] Kevin MacDonald, Separation and Its Discontents: Toward an Evolutionary Theory of Anti-Semitism (Bloomington, Ind.: Firstbooks, 2004), Chapter 5.
[4] Kevin MacDonald, The Culture of Critique: An Evolutionary Analysis of Jewish Involvement in Twentieth-Century Intellectual and Political Movements (Bloomington, Ind.: Firstbooks, 2002).
[5] David Sloan Wilson, Darwin’s Cathedral (Chicago: University of Chicago Press, 2002); Kevin MacDonald, (2002). “Diaspora Peoples,” Preface to the First Paperback Edition of A People That Shall Dwell Alone: Judaism as a Group Evolutionary Strategy (Lincoln, Nebr.: iUniverse, 2002).
[6] David H. Fischer, Albion’s Seed: Four British Folkways in America (New York: Oxford University Press, 1989), 202.
[7] Albion’s Seed, 189.
[8] See Darwin’s Cathedral.
[9] Louis T. Merrill, “The Puritan Policeman,” American Sociological Review 10 (1945): 766–76, p. 766.
[10] Kevin Phillips, The Cousins’ Wars: Politics, Civil Warfare, and the Triumph of Anglo-America (New York: Basic Books, 1999).
[11] Ibid., 26.
[12] Ibid., 27.
[13] Kevin MacDonald, “What Makes Western Civilization Unique?” in Cultural Insurrections: Essays on Western Civilization, Jewish Influence, and Anti-Semitism (Atlanta: The Occidental Press, 2007).
[14] Albion’s Seed, 357.
[15] Ernst Fehr and Simon Gächter, “Altruistic Punishment in Humans,” Nature 412 (2002): 137-40.
[16] See my discussion in “Diaspora Peoples.”
[17] The Cousins’ Wars, 477.
[18] Ibid., 556.
[19] A. Hertzberg, The Jews in America: Four Centuries of an Uneasy Encounter (New York: Columbia University Press, 1998), 20–21.
[20] Ibid., 20.
[21] See Kevin MacDonald, “The Israel Lobby: A Case Study in Jewish Influence,” The Occidental Quarterly 7 (Fall 2007): 33–58.
[22] Preface to the paperback edition of The Culture of Critique.
[23] Frank K. Salter, On Genetic Interests: Family, Ethnicity, and Humanity in an Age of Mass Migration (New Brunswick, N.J.: Transaction, 2006).
[24] J. Philippe Rushton, “Ethnic Nationalism, Evolutionary Psychology, and Genetic Similarity Theory,” Nations and Nationalism 11 (2005): 489–507.
[25] Frank K. Salter, Welfare, Ethnicity and Altruism: New Data and Evolutionary Theory (London: Routledge, 2005).
[26] Robert Putnam, “E Pluribus Unum: Diversity and Community in the Twenty-first Century,” The 2006 Johan Skytte Prize Lecture, Scandinavian Journal of Political Studies 30 (2007): 137–74.
[27] Jerry Z. Muller, “Us and Them: The Enduring Power of Ethnic Nationalism,” Foreign Affairs, March/April 2008.
[28] Kevin MacDonald, “Psychology and White Ethnocentrism,” The Occidental Quarterly 6 (Winter, 2006–2007): 7–46.
Source: TOQ, vol. 8, no. 2 (Summer 2008).
Article printed from Counter-Currents Publishing: http://www.counter-currents.com
URL to article: http://www.counter-currents.com/2012/06/american-transcendentalism/
00:05 Publié dans Livre, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, philosophie, transcendentalisme américain, transcendentalisme, etats-unis, kevin macdonald |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 01 juillet 2012
Europa verteidigen – gegen die selbstzerstörende Hassideologie!
|
Europa verteidigen – gegen die selbstzerstörende Hassideologie!
|
|
Geschrieben von: Harald Schmidt-Lonhart |
|
Ex: http://www.blauenarzisse.de/
|
|
Mehr als bloße Islamkritik Vor Breivik war Fjordman, der in Wahrheit den bürgerlichen Namen Peder Jensen trägt, eigentlich nur einer kleinen islamkritischen Szene bekannt. Dabei gehen die zahlreichen Essays weiter als bloße Islamkritik und befassen sich auch mit grundlegenden Sachverhalten, wie beispielsweise dem Zusammenwirken von Liberalismus und Neomarxismus oder der Verbindung zwischen Macht und Elite. Die ausgewählten Texte Fjordmans wurden von den beiden Herausgebern Kleine-Hartlage und Lichtmesz in drei Kapitel unterteilt. Das erste bündelt das Thema Islamkritik. Der zweite Text „Was kostet Europa die islamische Zuwanderung?“ kann von demjenigen, der seine Hausaufgaben bei Oberlehrer Sarrazin gemacht hat, getrost übersprungen werden. Jedoch ist es wichtig, in Kapitel Zwei (Kulturkritik) und Drei (Globalismus/EU) am Ball zu bleiben. Hier liegt der Hase im Pfeffer. Dieser Aufbau des Herausgeberduos ist durchaus gelungen, da es die anfängliche Sicht gen Mekka um 180 Grad in Richtung des eigenen Inneren bzw. den Westen dreht und so für die richtige Frontstellung sorgt. So faßt Fjordman den Islam nicht als Gegner, sondern vielmehr die Islamisierung als Symptom einer „mit kulturellem AIDS“ geschwächten Gesellschaft auf. Die kalte Dusche der Lageerkennung Den Essays fehlt es dessen ungeachtet spürbar an der gewissen Portion sprachlicher Feinheiten und Raffinessen. Den Grund hierfür wird man im Übersetzungsprozess vom Norwegischen über das Englische ins Deutsche zu suchen haben. Auch der Vortragsstil von Fjordman ist stellenweise ermüdend. Der Norweger häkelt seine Gedanken Masche für Masche aneinander und arbeitet dabei auf eine Grundthese hin, die er am Ende seiner Texte zusammenfasst. Die einzelnen Maschen füllt er mit Beispielen und Zitaten. Dabei geraten einige Maschen zu weit und werden zu ausführlich. Andere wiederholen sich oder sind hinsichtlich der finalen Grundthese gar überflüssig. Auch das Niveau der Zitierten schwankt von zweitklassigen Bloggern oder kanadischen Polizisten bis hin zu einem Staatsmann wie Vaclav Klaus oder dem marxistischen Philosophen Antonio Gramsci. Trotz dieser gefühlsarmen, leicht klotzigen Ausdrucksform fabriziert die Lektüre innerlich Erstaunen, Kummer, manchmal auch Zorn. Dieser gefühlstechnische Wellengang wird durch das mit Fakten untermauerte, meist einleuchtende Gesamtbild der fjordmanschen Texte erzeugt. Der Autor verpasst dem Leser die kalte Dusche der Lageerkennung. Fjordman fegt Wohlstand und Spaß bei Seite und ermöglicht Einblick in die Lava, welche längst unter der Oberfläche der Gesellschaft brodelt. Wer Optimismus sucht, ist hier verkehrt Wer die Gefahren einer schleichenden Islamisierung bislang nicht sehen wollte und Islamkritik pauschal für einen von Rassismus geschwängerten, populistischen Gedankenschluckauf hielt, muß angesichts der Faktenlage, die Fjordman zusammenträgt, seine Augen zukünftig noch fester zu kneifen, wenn er seine Sicht auf die Dinge nicht ändern will. Wer in der Political Correctness lediglich einen lästigen Schabernack von Freund Zeitgeist sah, erhält Einsicht in den langwierigen Hintergedanken, der damit verfolgt wird. Worthülsen wie „Toleranz“ und „Multikulturalismus“ werden von Fjordman als Teil einer selbstzerstörenden Hassideologie entlarvt und das dahinter stehende Kalkül zum Machterhalt der Eliten erklärt. Ähnlich geht Fjordman mit Feminismus und Gleichberechtigung ins Gericht, indem er die positiven Errungenschaften der Frauenrechtsbewegung von den Schäden für Gesellschaft und Individuum durch den Galle geifernden Feminismus ab den 60er Jahren trennt. Das Buch Europa verteidigen ist keine angenehme Gutenachtlektüre. Man wird stetig von dem Gefühl heimgesucht, das man bekommt, wenn man im Sommer die Sonnenbrille absetzt und schlagartig das grelle Licht der Sonne wahrnimmt. Es brennt auf der Netzhaut und man ist gewillt, sogleich wieder die Brille auf die Nase zu schieben. Trotzdem ist es wichtig und richtig, die von Fjordman beackerten Themengebiete nicht kampflos aufzugeben. Ein Rückzug in diesem Bereich der freien Meinungsäußerung würde ein wichtiges Ventil verschließen und letztlich den Weg in die Eskalation beschleunigen. Denn man darf sich sicher sein, dass die schreckliche Bluttat von Breivik nur der Vorgeschmack von dem Chaos ist, welches Fjordman fürchtet und zu verhindern sucht. Fjordman: Europa verteidigen. Zehn Texte. Herausgegeben von Martin Lichtmesz und Manfred Kleine-Hartlage. 240 Seiten, Edition Antaios, 2011. 19,00 Euro. |
00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, fjordman, norvège, actualité, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 17 juin 2012
Géopolitique du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord
Géopolitique du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord

Florian Louis, Frédéric Pichon, Tancrède Josseran
Sommaire |
Une présentation complète et structurée des grands enjeux géopolitiques et géoéconomiques du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord, à l’heure de la mondialisation.
Caractéristiques
- 192 pages
- 25.00 €
- ISBN : 978-2-13-060638-3
- Collection "Major"
- N° d'édition : 1
- Date de parution : 25/04/2012
- Discipline : Droit/Sc. politiques / Relat. inter.
- Sous-discipline : Relations internationales
L'ouvrage
Du Maroc à l’Iran en passant par l’Égypte, on disait le « grand Moyen-Orient » (Middle East and North Africa pour les Anglo-Saxons) immobile. Le voilà en ébullition. L’ambition de cet ouvrage est d’offrir les outils pour comprendre cette région au cœur de l’actualité, dont l’intelligence est souvent obstruée par le flot d’idées reçues et de contre-vérités qu’elle charrie.
A contrario d’une vision simpliste qui réduirait le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord à un univers soudé autour du dénominateur commun islamique, l’ouvrage explique en quoi la diversité, voire la fragmentation, en constitue la caractéristique fondamentale. Une pluralité qui est une inestimable richesse en termes de civilisations, mais provoque en contrepartie une très forte instabilité.
Cependant, loin de réduire le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord à un terrain d’affrontement entre des impérialismes venus d’ailleurs, l’ouvrage montre surtout comment certains pays qui les composent s’affirment progressivement comme des acteurs à part entière de la mondialisation.
Table des matières
Un Orient simple mais pluriel. Introduction
Au centre de l’ancien monde : le Moyen-Orient. Contraintes et horizons
I.Entre montagne et désert
II.Du sable, des cailloux, de l’eau et des hommes
III.Entre terre et mer
IV.Des constances naturelles
V.Le nœud gordien
La terre des prophètes. L’empreinte de l’histoire et des religions
I.L’islam comme ciment
II.La ville et le bédouin
III.Les religions du livre
IV.La tour de Babel
V.Peuple de la steppe et peuple du désert
VI.Le choc de l’Occident
Le rejet de la soumission étrangère. Le Moyen-Orient du XIXe siècle à nos jours
I.Déclin ottoman et intrusion européenne
II.Le grand bouleversement de la Première Guerre mondiale
III.Le Moyen-Orient face aux défis des indépendances
IV.L’impossible démocratie ?
La malédiction de la rente. Des économies déficientes
I.Au pays de l’or noir : économie et géopolitique des hydrocarbures
II.Des économies rentières et peu diversifiées
III.Des économies en panne
IV.Un tropisme méditerranéen ?
Le bal des puissances. Une région en quête de leadership
I.La lutte pour le leadership régional des puissances non arabes
II.Le monde arabe en quête de leader
Sous le signe de Mars. Une zone de conflits
I.Les frontières de sang
II.Caïn contre Abel : la guerre civile
III.Briser les chaînes : les conflits pour l’indépendance
IV.Les guerriers de Dieu
Un épicentre de la géopolitique mondiale. Une région au cœur des rivalités de puissance planétaires
I.Une région au cœur d’enjeux planétaires
II.Le Moyen-Orient vu d’ailleurs
Un acteur de la mondialisation. Une intégration croissante à l’espace mondial
I.Une puissance multiforme
II.Le monde vu du Moyen-Orient
Moyen-Orient et Afrique du Nord à l’épreuve de la mondialisation
Bibliographie
Glossaire des termes arabes, hébreux et turcs
Index
A propos des auteurs
Tancrède Josseran, auteur de La nouvelle puissance turque, prix Anteios du livre de géopolitique, collabore à l’observatoire du monde turc dans la Lettre Sentinel. Analyses et solutions.
Florian Louis est agrégé d’histoire.
Frédéric Pichon est auteur d’une thèse sur la Syrie, diplômé d’arabe et enseigne l’histoire et la géopolitique en classes préparatoires.
- Accédez aux fiches auteurs : Florian Louis, Frédéric Pichon, Tancrède Josseran
Les directeurs
Où se procurer cet ouvrage ?
- En librairie
- En ligne
- avec Amazon.fr
- avec Fnac.com
- avec Librairie Dialogues.fr
00:05 Publié dans Géopolitique, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, géopolitique, moyen orient, proche orient, afrique du nord, afrique, affaires africaines, monde arabe, monde arabo-musulman, turquie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 16 juin 2012
Artists of the Right: Resisting Decadence
Forthcoming from Counter-Currents!
Artists of the Right: Resisting Decadence
We are pleased to announce our thirteenth title:
Kerry Bolton
Artists of the Right: Resisting Decadence
Edited by Greg Johnson
San Francisco: Counter-Currents, 2012
210 pages
hardcover: $35
paperback: $20
We will announce the publication date when we receive and approve final proof copies from the printers. We estimate an early July date.
About Artists of the Right
Kerry Bolton’s Artists of the Right: Resisting Decadence is a study of ten leading 20th-century literary artists—including pioneering modernists—who were sympathetic with Fascism and/or National Socialism:
D. H. Lawrence
H. P. Lovecraft
Gabriele D’Annunzio
Filippo Marinetti
W. B. Yeats
Knut Hamsun
Ezra Pound
Wyndham Lewis
Henry Williamson
Roy Campbell
Bolton relates their political commitments to their lives, their art, and their economic, religious, and philosophical convictions. In lucid, driving prose, Kerry Bolton utterly demolishes some of the sturdiest prejudices of the liberal mind.
Advance Praise for Artists of the Right
“Kerry Bolton’s book Artists of the Right blows away the notion of right-wing philistinism and, instead, leads to a radically different assessment of the arts during the first half of the 20th century. For it now appears that almost every significant artist of the period (Pound, Yeats, Lewis) rejected both materialism and the egalitarian solutions of the Left. Bolton’s analysis is brash, opinionated, peppery, honest, and trail-blazing. In the biographies of his major figures he tends to include the material which is habitually left out or skirted over.”
—Jonathan Bowden
“Kerry Bolton is a maverick among scholars. In Artists of the Right he distills for us the political, social, and religious thinking of some of the most outstanding artists of the twentieth century in infinitely readable prose. This is a book that belongs on the shelf of every free-thinking patriot and defender of European man.”
—Leo Yankevich
“K. R. Bolton’s Artists of the Right is something that we have needed for a long time: a clear and unapologetic study of those literary and artistic figures of the last century who explicitly and forthrightly rejected leftism and left-liberalism. Marxist and socialist ideologies are too easily assumed to be the natural badges of modern artists. Bolton shows that was certainly not the case for a great many major figures of the 20th century. His straightforward exposition of the lives and work of these men shows two things: first, that many important poets, novelists, and thinkers of the 20th century were profoundly rightist in their political views; and second, that they by no means presented a seamless front of solidarity in their opinions. Their independence of mind saved them from leftist groupthink, but it also guaranteed that even among themselves they would be strongly divided on many issues. Bolton’s approach is sympathetic and appreciative, and that in itself is a welcome departure from the condemnatory or patronizing tone that a typical liberal academic would have brought to this task.”
—Dr. Joseph S. Salemi, Hunter College, C.U.N.Y.
“Kerry Bolton is the Noam Chomsky of the New Right. His double doctorates in theology and encyclopedic knowledge of 20th century history qualify him as a guru, and as such I recommend his writings on geopolitics, culture, and spirituality to anyone with more than a passing interest in these subjects. Every day since VE Day has been a Marxist holiday for the culture makers of the West. Artists on the Right is a declaration of the manifest bankruptcy of this legacy.”
—Charles Krafft
“Eye-opening, exhilarating, and inspiring, Bolton examines figures both familiar and almost unknown, constructing a counter-canon to show that, no matter what your teachers told you, the great minds of the 20th century were culturally, politically and spiritually of the Right.”
—James J. O’Meara
Contents
Introduction by Greg Johnson
D. H. Lawrence
H. P. Lovecraft
Gabriele D’Annunzio
Filippo Marinetti
W. B. Yeats
Knut Hamsun
Ezra Pound
Wyndham Lewis
Henry Williamson
Roy Campbell
Index
About the Author
Kerry Bolton holds Doctorates in Theology and a Ph.D. h.c. He is a contributing writer for Foreign Policy Journal and a Fellow of the Academy of Social and Political Research in Greece. His books include Revolution from Above (London: Arktos Media, 2011). His articles have been published by both scholarly and popular media, including the International Journal of Social Economics; Journal of Social, Political, and Economic Studies; Geopolitika; World Affairs; India Quarterly; The Occidental Quarterly; North American New Right; Radio Free Asia; Irish Journal of Gothic & Horror Studies, Trinity College; International Journal of Russian Studies, and many others. His writings have been translated into French, German, Russian, Italian, Czech, Latvian, Farsi, and Vietnamese.
Ordering Information
hardcover: $35
 paperback: $20
paperback: $20
NB: We will announce the publication date when we receive and approve final proof copies from the printers. We estimate an early July date.
Article printed from Counter-Currents Publishing: http://www.counter-currents.com
URL to article: http://www.counter-currents.com/2012/06/artists-of-the-right-resisting-decadence/
URLs in this post:
00:09 Publié dans Livre, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, révolution conservatrice |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 12 juin 2012
Recension: le livre de cécile Vanderpelen-Diagre sur la littérature catholique belge dans l’entre-deux-guerres
Recension: le livre de cécile Vanderpelen-Diagre sur la littérature catholique belge dans l’entre-deux-guerres
Script du présentation de l’ouvrage dans les Cercles de Bruxelles, Liège, Louvain, Metz, Lille et Genève
Recension : Cécile Vanderpelen-Diagre, Écrire en Belgique sous le regard de Dieu, éd. Complexe / CEGES, Bruxelles, 2004.
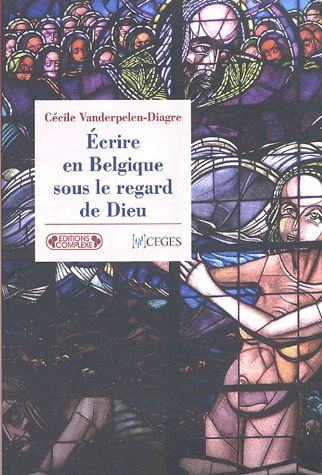 Dans son ouvrage majeur, qui dévoile à la communauté scientifique les thèmes principaux de la littérature catholique belge de l’entre-deux-guerres, Cécile Vanderpelen-Diagre aborde un continent jusqu’ici ignoré des historiens, plutôt refoulé depuis l’immédiat après-guerre, quand le monde catholique n’aimait plus se souvenir de son exigence d’éthique, dans le sillage du Cardinal Mercier ni surtout de ses liens, forts ou ténus, avec le rexisme qui avait choisi le camp des vaincus pendant la Seconde Guerre mondiale.
Dans son ouvrage majeur, qui dévoile à la communauté scientifique les thèmes principaux de la littérature catholique belge de l’entre-deux-guerres, Cécile Vanderpelen-Diagre aborde un continent jusqu’ici ignoré des historiens, plutôt refoulé depuis l’immédiat après-guerre, quand le monde catholique n’aimait plus se souvenir de son exigence d’éthique, dans le sillage du Cardinal Mercier ni surtout de ses liens, forts ou ténus, avec le rexisme qui avait choisi le camp des vaincus pendant la Seconde Guerre mondiale.
Pendant plusieurs décennies, la Belgique a vécu dans l’ignorance de ses propres productions littéraires et idéologiques, n’en a plus réactivé le contenu sous des formes actualisées et a, dès lors, sombré dans l’anomie totale et dans la déchéance politique : celle que nous vivons aujourd’hui. Plus aucune éthique ne structure l’action dans la Cité.
Le travail de C. Vanderpelen-Diagre pourrait s’envisager comme l’amorce d’une renaissance, comme une tentative de faire le tri, de rappeler des traditions culturelles oubliées ou refoulées, mais il nous semble qu’aucun optimisme ne soit de mise : le ressort est cassé, le peuple est avachi dans toutes ses composantes (à commencer par la tête...). Son travail risque bien de s’apparenter à celui de Schliemann : n’être qu’une belle œuvre d’archéologue. L’avenir nous dira si son livre réactivera la “virtù” politique, au sens que lui donnaient les Romains de l’antiquité ou celui qui entendait la réactiver, Nicolas Machiavel.
“Une littérature qui a déserté la mémoire collective”
Dès les premiers paragraphes de son livre, C. Vanderpelen-Diagre soulève le problème majeur : si la littérature catholique, qui exigeait un sens élevé de l’éthique entre 1890 et 1945, a cessé de mobiliser les volontés, c’est que ses thèmes “ont déserté la mémoire collective”. Le monde catholique belge (et surtout francophone) d’aujourd’hui s’est réduit comme une peau de chagrin et ce qu’il en reste se vautre dans la fange innommable d’un avatar lointain et dévoyé du maritainisme, d’un festivisme abject et d’un soixante-huitardisme d’une veulerie époustouflante. Aucun citoyen honnête, possédant un “trognon” éthique solide, ne peut se reconnaître dans ce pandémonium. Nous n’échappons pas à la règle : né au sein du pilier catholique parce que nos racines paysannes ne sont pas très loin et plongent, d’une part, dans le sol hesbignon-limbourgeois, et, d’autre part, dans ce bourg d’Aalter à cheval sur la Flandre occidentale et orientale et dans la région d’Ypres, comme d’autres naissent en Belgique dans le pilier socialiste, nous n’avons pas pu adhérer (un vrai “non possumus”), à l’adolescence, aux formes résiduaires et dévoyées du catholicisme des années 70 : c’est sans nul doute pourquoi, en quelque sorte orphelins, nous avons préféré le filon, alors en gestation, de la “nouvelle droite”.
L’époque de gloire du catholicisme belge (francophone) est oubliée, totalement oubliée, au profit du bric-à-brac gauchiste et pseudo-contestataire ou de parisianismes de diverses moutures (dont la “nouvelle droite” procédait, elle aussi, de son côté, nous devons bien en convenir, surtout quand elle a fini par se réduire à son seul gourou parisien et depuis que ses antennes intéressantes en dehors de la capitale française ont été normalisées, ignorées, marginalisées ou exclues). Cet oubli frappe essentiellement une “éthique” solide, reposant certes sur le thomisme, mais un thomisme ouvert à des innovations comme la doctrine de l’action de Maurice Blondel, le personnalisme dans ses aspects les plus positifs (avant les aggiornamenti de Maritain et Mounier), l’idéal de communauté. Cette “éthique” n’a plus pu ressusciter, malgré les efforts d’un Marcel De Corte, dans l’ambiance matérialiste, moderniste et américanisée des années 50, sous les assauts délétères du soixante-huitardisme des années 60 et 70 et, a fortiori, sous les coups du relativisme postmoderne et du néolibéralisme.
L’exigence éthique, pierre angulaire du pilier catholique de 1884 à 1945, n’a donc connu aucune résurgence. On ne la trouvait plus qu’en filigrane dans l’œuvre de Hergé, dans ses graphic novels, dans ses “romans graphiques” comme disent aujourd’hui les Anglais. Ce qui explique sans doute la rage des dévoyés sans éthique — viscéralement hostiles à toute forme d’exigence éthique — pour extirper les idéaux discrètement véhiculés par Tintin.
Les imitations serviles de modèles parisiens (ou anglo-saxons) ne sont finalement d’aucune utilité pour remodeler notre société malade. C. Vanderpelen-Diagre, qui fait œuvre d’historienne et non pas de guide spirituelle, a amorcé un véritable travail de bénédictin. Que nous allons immanquablement devoir poursuivre dans notre créneau, non pour jouer aux historiens mais pour appeler à la restauration d’une éthique, fût-elle inspirée d’autres sources (Mircea Eliade, Seyyed Hossein Nasr, Walter Otto, Karl Kerenyi, etc.). Il s’agit désormais d’analyser le contenu intellectuel des revues parues en nos provinces entre 1884 et 1945 au sein de toutes les familles politiques, de décortiquer la complexité idéologique qu’elles recèlent, de trouver en elles les joyaux, aussi modestes fussent-ils, qui relèvent de l’immortalité, de l’impassable, avec lesquels une “reconstruction” lente et tâtonnante sera possible au beau milieu des ruines (dirait Evola), en plein désert axiologique, où qui conforteront l’homme différencié (Evola) ou l’anarque (Jünger) pour (sur)vivre au milieu de l’horreur, dans le Château de Kafka, ou dans labyrinthe de son Procès.
Les travaux de Zeev Sternhell sur la France, surtout son Ni gauche, ni droite, nous induisaient à ne pas juger la complexité idéologique de cette période selon un schéma gauche/droite trop rigide et par là même inopérant. Dans le cadre de la Belgique, et à la suite de C. Vanderpelen-Diagre et de son homologue flamande Eva Schandervyl (cf. infra), c’est un mode de travail à appliquer : il donnera de bons résultats et contribuera à remettre en lumière ce qui, dans ce pays, a été refoulé pendant de trop nombreuses décennies.
La “Jeune Droite” d’Henry Carton de Wiart
 Pour C. Vanderpelen-Diagre, les origines de la “révolution conservatrice” belge-francophone, essentiellement catholique, plus catholique que ses homologues dans la France républicaine, plus catholique que l’Action Française trop classiciste et pas assez baroque, se trouvent dans la Jeune Droite d’Henry Carton de Wiart (1869-1951), assisté de Paul Renkin et de l’historien arlonnais germanophile Godefroid Kurth, animateur du Deutscher Verein avant 1914 (le déclenchement de la Première Guerre mondiale et le viol de la neutralité belge l’ont forcé, dira-t-il, de « brûler ce qu’il a adoré » ; pour un historien qui s’est penché sur la figure de Clovis, cette parole a du poids...). La date de fondation de la Jeune Droite est 1891, 2 ans avant l’encyclique Rerum Novarum. La Jeune Droite n’est nullement un mouvement réactionnaire sur le plan social : il fait partie intégrante de la Ligue démocratique chrétienne. Il publie 2 revues : L’Avenir social et La Justice sociale. Les 2 publications s’opposent à la politique libéraliste extrême, prélude au néo-libéralisme actuel, préconisée par le ministre catholique Charles Woeste. Elles soutiennent aussi les revendications de l’Abbé Adolf Daens, héros d’un film belge homonyme qui a obtenu de nombreux prix et où l’Abbé, défenseur des pauvres, est incarné par le célèbre acteur flamand Jan Decleir.
Pour C. Vanderpelen-Diagre, les origines de la “révolution conservatrice” belge-francophone, essentiellement catholique, plus catholique que ses homologues dans la France républicaine, plus catholique que l’Action Française trop classiciste et pas assez baroque, se trouvent dans la Jeune Droite d’Henry Carton de Wiart (1869-1951), assisté de Paul Renkin et de l’historien arlonnais germanophile Godefroid Kurth, animateur du Deutscher Verein avant 1914 (le déclenchement de la Première Guerre mondiale et le viol de la neutralité belge l’ont forcé, dira-t-il, de « brûler ce qu’il a adoré » ; pour un historien qui s’est penché sur la figure de Clovis, cette parole a du poids...). La date de fondation de la Jeune Droite est 1891, 2 ans avant l’encyclique Rerum Novarum. La Jeune Droite n’est nullement un mouvement réactionnaire sur le plan social : il fait partie intégrante de la Ligue démocratique chrétienne. Il publie 2 revues : L’Avenir social et La Justice sociale. Les 2 publications s’opposent à la politique libéraliste extrême, prélude au néo-libéralisme actuel, préconisée par le ministre catholique Charles Woeste. Elles soutiennent aussi les revendications de l’Abbé Adolf Daens, héros d’un film belge homonyme qui a obtenu de nombreux prix et où l’Abbé, défenseur des pauvres, est incarné par le célèbre acteur flamand Jan Decleir.
Henry Carton de Wiart, alors jeune avocat, réclame une amélioration des conditions de travail, le repos dominical pour les ouvriers, s’insurge contre le travail des enfants, entend imposer une législation contre les accidents de travail. Il préconise également d’imiter les programmes sociaux post-bismarckiens, en versant des allocations familiales et défend l’existence des unions professionnelles. Très social, son programme n’est pourtant pas assimilable à celui des socialistes qui lui sont contemporains : Carton de Wiart ne réclame pas le suffrage universel pur et simple, et lui substitue la notion d’un suffrage proportionnel à partir de 25 ans, dans un système de représentation également proportionnelle.
En parallèle, Henry Carton de Wiart s’associe à d’autres figures oubliées de notre patrimoine littéraire et idéologique, Firmin Van den Bosch (1864-1949) et Maurice Dullaert (1865-1940). Le trio s’intéresse aux avant-gardes et réclame l’avènement, en Belgique, d’une littérature ouverte à la modernité. Deux autres revues serviront pour promouvoir cette politique littéraire : d’abord, en 1884, la jeune équipe tente de coloniser Le Magasin littéraire et artistique, ensuite, en 1894, 3 ans après la fondation de la Jeune Droite et un an après la proclamation de l’encyclique Rerum Novarum, nos 3 hommes fondent la revue Durandal qui paraîtra pendant 20 ans (jusqu’en 1914). Comme nous le verrons, le nom même de la revue fera date dans l’histoire du “mouvement éthique” (appellons-le ainsi...). Parmi les animateurs de cette nouvelle publication, citons, outre Henry Carton de Wiart lui-même, Pol Demade, médecin spécialisé en médecine sociale, et l’Abbé Henri Moeller (1852-1918). Ils seront vite rejoints par une solide équipe de talents : Firmin Van den Bosch, Pierre Nothomb (stagiaire auprès du cabinet d’avocat de Carton de Wiart), Victor Kinon (1873-1953), Maurice Dullaert, Georges Virrès (1869-1946), Arnold Goffin (1863-1934), Franz Ansel (1874-1937), Thomas Braun (1876-1961) et Adolphe Hardy (1868-1954).
Spiritualité et justice sociale
Leur but est de créer un “art pour Dieu” et leurs sources d’inspiration sont les auteurs et les artistes s’inspirant du “symbolisme wagnérien”, à l’instar des Français Léon Bloy, Villiers de l’Isle-Adam, Francis Jammes et Joris Karl Huysmans. Pour cette équipe, comme aussi pour Bloy, les catholiques sont une “minorité souffrante”, surtout en France à l’époque où sont édictées et appliquées les lois du “petit Père Combes”. Autres références françaises : les œuvres d’Ernest Psichari et de Paul Claudel. Le wagnérisme et le catholicisme doivent, en fusionnant dans les œuvres, générer une spiritualité offensive qui s’opposera au “matérialisme bourgeois” (dont celui de Woeste). La spiritualité et l’idée de justice sociale doivent donc marcher de concert. Le contexte belge est toutefois différent de celui de la France : les catholiques belges avaient gagné la bataille métapolitique, ils avaient engrangé une victoire électorale en 1884, à l’époque où Firmin Van den Bosch tentait de noyauter Le Magasin littéraire et artistique. Dans la guerre scolaire, les catholiques enregistrent également des victoires partielles : face aux libéraux, aux libéraux de gauche (alliés implicites des socialistes) et aux socialistes, il s’agit, pour la jeune équipe autour de Carton de Wiart et pour la rédaction de Durandal, de « gagner la bataille de la modernité ». À l’avant-garde socialiste (prestigieuse avec un architecte “Art Nouveau” comme Horta), il faut opposer une avant-garde catholique. La modernité ne doit pas être un apanage exclusif des libéraux et des socialistes. La différence entre ces catholiques qui se veulent modernistes (sûrement avec l’appui du Cardinal) et leurs homologues laïques, c’est qu’ils soutiennent la politique coloniale lancée par Léopold II en Afrique centrale. Le Congo est une terre de mission, une aire géographique où l’héroïsme pionnier ou missionnaire pourra donner le meilleur de lui-même.
Quelles valeurs va dès lors défendre Durandal ? Elle va essentiellement défendre ce que ses rédacteurs nommeront le “sentiment patrial”, présent au sein du peuple, toutes classes confondues. On retrouve cette idée dans le principal roman d’Henry Carton de Wiart, La Cité ardente, œuvre épique consacrée à la ville de Liège. La notion de “sentiment patrial”, nous la retrouvons surtout dans les textes annonciateurs de la “révolution conservatrice” dus à la plume de Hugo von Hofmannsthal, où l’écrivain allemand déplore la disparition des “liens” humains sous les assauts de la modernité et du libéralisme, qui brisent les communautés, forcent à l’exode rural, laissent l’individu totalement esseulé dans les nouveaux quartiers et faubourgs des grandes villes industrielles et engendrent des réflexes individualistes délétères dans la société, où les plaisirs hédonistes, furtifs ou constants selon la fortune matérielle, tiennent lieu d’Ersätze à la spiritualité et à la charité. Cette déchéance sociale appelle une “restauration créatrice”. Le sentiment d’Hofmannsthal sera partagé, mutatis mutandis, par des hommes comme Arthur Moeller van den Bruck et Max Hildebert Boehm.
L’idée “patriale” s’inscrit dans le projet du Chanoine Halflants, issu d’une famille tirlemontoise qui avait assuré le recrutement en Hesbaye de nombreux zouaves pontificaux, pour la guerre entre les États du Pape et l’Italie unitaire en gestation sous l’impulsion de Garibaldi. Avant 1910, le Chanoine Halflants préconisera tolérance et ouverture aux innovations littéraires. Après 1918, il prendra des positions plus “réactionnaires”, plus en phase avec la “bien-pensance” de l’époque et plus liées à l’idéal classique. Qu’est ce que cela veut dire ? Que le Chanoine entendait, dans un premier temps, faire figurer les œuvres littéraires modernes dans les anthologies scolaires, ainsi que la littérature belge (catholique qui adoptait de nouveaux canons stylistiques et des thématiques romanesques profanes). Il s’opposait dans ce combat aux Jésuites, qui n’entendaient faire étudier que des auteurs grecs et latins antiques. Halflants gagnera son combat : les Jésuites finiront par accepter l’introduction de nouveaux écrivains dans les curricula scolaires. De ces efforts naîtra une “anthologie des auteurs belges”. L’objectif, une fois de plus, est de ne pas abandonner les formes modernes d’art et de littérature aux forces libérales et socialistes qui, en épousant les formes multiples d’ “Art Nouveau” apparaissaient comme les pionniers d’une culture nouvelle et libératrice.
Bourgeoisie ethétisante et prêtres maurrassiens
Cette agitation de la Jeune Droite et de Durandal repose, mutatis mutandis, sur un clivage bien net, opposant une bourgeoisie industrielle et matérialiste à une bourgeoisie cultivée et esthétique, qui a le sens du Bien et du Beau que transmettent bien évidemment les humanités gréco-latines. La bourgeoisie matérialiste et industrielle est incarnée non seulement par les libéraux sans principes éthiques solides mais aussi par des catholiques qui se laissent séduire par cet esprit mercantile, contraire au “sentiment patrial”. Cette idée d’un clivage entre matérialistes et esthètes, on la retrouve déjà dans l’œuvre laïque et irreligieuse de Camille Lemonnier (édité en Allemagne, dans des éditions superbes, par Eugen Diederichs). La bourgeoisie affairiste provoque une décadence des mœurs que l’esthétisme de ceux de ses enfants, qui sont pieux et contestataires, doit endiguer. Pour enrayer les progrès de la décadence, il faut, selon les directives données antérieurement par Louis de Bonald en France, lutter contre le libéralisme politique.
C’est à partir du moment où certains jeunes catholiques belges, soucieux des questions sociales, entendent suivre les injonctions de Bonald, que la Jeune Droite et Durandal vont s’inspirer de Charles Maurras, en lui empruntant son vocabulaire combatif et opérant. Les catholiques belges de la Jeune Droite et les Français de l’Action française s’opposent donc de concert au libéralisme politique, en le fustigeant allègrement. Dans ce contexte émerge le phénomène des “prêtres maurrassiens”, avec, à Liège, Louis Humblet (1874-1949), à Mons, Valère Honnay (1883-1949) et, à Bruxelles, Ch. De Smet (1833-1911) et J. Deharveng (1867-1929). Ce maurrasisme est seulement stylistique dans une Belgique assez germanophile avant 1914. Les visions géopolitiques et anti-allemandes du filon maurrassien ne s’imposeront en Belgique qu’à partir de 1914. D’autres auteurs français influencent l’idéologie de Durandal, les 4 “B” : Barrès, Bourget, Bordeaux et Bazin.
C’est Bourget qui exerce l’influence la plus importante : il veut, en des termes finalement très peu révolutionnaires, une “humanité non dégradée”, reposant sur la famille, l’honneur conjugal et les fortes convictions (religieuses). Le poids de Bourget sera de longue durée : on verra que cette éthique très pieuse et très conventionnelle influencera le groupe de la “Capelle-aux-Champs” que fréquentera Hergé, le créateur de Tintin, et Franz Weyergans, le père de François Weyergans (qui répondra par un livre aux idéaux paternels, inspirés de Paul Bourget, livre qui lui a valu le “Grand Prix de la langue française” en 1997, ce qui l’amena plus tard à occuper un siège à l’Académie Française ; cf. : Franz et François, Grasset, 1997 ; pour comprendre l’apport de Bourget, tout à la fois à la modernisation du sentiment littéraire des catholiques et à la critique des œuvres contemporaines de Baudelaire, Stendhal, Taine, Renan et Flaubert, lire : Paul Bourget, Essais de psychologie contemporaine, Plon, Paris, 1937).
La Première Guerre mondiale va bouleverser la scène politique et métapolitique d’une Belgique qui, de germanophile, virera à la francophilie, surtout dans les milieux catholiques. La Grande Guerre génère d’abord une littérature inspirée par les souffrances des soldats. Parmi les morts au combat : le jeune Louis Boumal, lecteur puis collaborateur belge de L’Action française. Autour de ce personnage se créera le “mythe de la jeunesse pure sacrifiée”, que Léon Degrelle, plus tard, reprendra à son compte. Mais c’est surtout son camarade de combat Lucien Christophe (1891-1975), qui a perdu son frère Léon pendant la guerre, qui défendra et illustrera la mémoire de Louis Boumal. Celui-ci, tout comme Christophe, était un disciple d’Ernest Psichari, chantre catholique de l’héroïsme et du dévouement guerriers. Les anciens combattants de l’Yser, Christophe en tête, déploreront l’ingratitude du pays à partir de 1918, l’absence de solidarité nationale une fois les hostilités terminées. Christophe et les autres combattants estiment dès lors que les journalistes et les écrivains doivent s’engager dans la Cité. Un écrivain ne peut pas rester dans sa tour d’ivoire. C’est ainsi que les anciens combattants rejettent l’idée d’un art pour l’art et ajoutent à l’idée d’un art pour Dieu, présent dans les rangs de la Jeune Droite avant 1914, celle d’un art social. Le catholicisme militant, social dans le sillage de Daens et de Rerum Novarum, national au nom du sacrifice de Louis Boumal et Léon Christophe, réclame, à l’instar d’autres idéologies, d’autres milieux sociaux ou habitus politiques, l’engagement.
ACJB et Cercle Rerum novarum
Lucien Christophe va donner l’éveil à une génération nouvelle, qui comptera de jeunes plumes dans ses rangs : Luc Hommel (1896-1960), Carlo de Mey (1895-1962), Camille Melloy (de son vrai nom Camille De Paepe, 1891-1941) et Léopold Levaux (1892-1956). C’est au départ de ce groupe, inspiré par Christophe plutôt que par Carton de Wiart, que se forme l’ACJB (Association Catholique de la Jeunesse Belge). Pierre Nothomb, qui entend préserver l’unité du bloc catholique, œuvrera pour que le groupe rassemblé au sein de la revue Durandal fusionne avec l’ACJB. Quant à la Jeune Droite de Carton de Wiart, avec ses aspirations à la justice sociale, elle fusionnera avec le Cercle Rerum Novarum, animé, entre autres personnalités, par Pierre Daye, futur sénateur rexiste en 1936. Daye a des liens avec les Français Marc Sangnier et l’Abbé Lugan, fondateurs d’une Action Catholique, hostile à l’Action française de Maurras et Pujo.
Le Cercle Rerum Novarum poursuivait les mêmes objectifs que ceux de la Jeune Droite de Carton de Wiart, dans la mesure où il s’opposait à toute politique économique libérale outrancière, comme celle d’un Charles Woeste pourtant ponte du parti catholique, entendait ensuite remobiliser les idéaux de l’Abbé Daens. Il n’était pas sur la même longueur d’onde que l’Action française, plus nationaliste que catholique et plus préoccupée de justifier la guerre contre l’Allemagne (même celle de la république laïcarde) que de réaliser en France, et pour les Français, des idéaux de justice sociale. En Belgique, nous constatons donc, avec C. Vanderpelen-Diagre, que les idéaux nationaux (surtout incarnés par Pierre Nothomb) sont intimement liés aux idéaux de justice sociale et que cette fusion demeurera intacte dans toutes les expressions du catholicisme idéologique belge jusqu’en 1945 (même dans des factions hostiles les unes aux autres, surtout après l’émergence du rexisme).
En 1918, Pierre Nothomb et Gaston Barbanson plaident tous deux pour une “Grande Belgique”, en préconisant l’annexion du Grand-Duché du Luxembourg, du Limbourg néerlandais et de la Flandre zélandaise. Ils prennent des positions radicalement anti-allemandes, rompant ainsi définitivement avec la traditionnelle germanophilie belge du XIXe siècle. Ces positions les rapprochent de l’Action française de Maurras et du maurrassisme implicite du Cardinal Mercier, hostile à l’Allemagne prussianisée et protestante comme il est hostile à l’éthique kantienne, pour lui trop subjectiviste, et, par voie de conséquence, hostile au mouvement flamand et à la flamandisation de l’enseignement supérieur, car ce serait là offrir un véhicule à la germanisation rampante de toute la Belgique, provinces romanes comprises.
Les annexionnistes sont en faveur d’une alliance militaire franco-belge, qui sera fait acquis dès 1920 mais que contesteront rapidement et l’aile gauche du parti socialiste et le mouvement flamand (cf. Dr. Guido Provoost, Vlaanderen en het militair-politiek beleid in België tussen de twee wereldoorlogen – Het Frans-Belgisch militair akkoord van 1920, Davidsfonds, Leuven, 1977). En adoptant cette démarche, les adeptes de la “Grande Belgique” quittent l’orbite du “démocratisme chrétien” qui avait été le leur et celui de leurs amis pour fonder une association nationaliste, le Comité de Politique Nationale (CPN), où se retrouvent Pierre Daye (qui n’est plus alors à proprement parler un “rerum-novarumiste” ou un “daensiste”), l’historien Jacques Pirenne (qui renie ses dettes intellectuelles à l’historiographie allemande), Léon Hennebicq, le leader socialiste et interventionniste Jules Destrée, ami des interventionnistes italiens regroupés autour de Mussolini et d’Annunzio, et un autre socialiste, Louis Piérard.
Les annexionnistes germanophobes et hostiles aux Pays-Bas réclament une occupation de l’Allemagne, son morcellement à l’instar de ce que venait de subir la grande masse territoriale de l’Empire austro-hongrois défunt ou l’Empire ottoman au Levant. Ils réclament également l’autonomisation de la Rhénanie et le renforcement de ses liens économiques (qui ont toujours été forts) avec la Belgique. Enfin, ils veulent récupérer le Limbourg devenu officiellement néerlandais en 1839 et la Flandre zélandaise afin de contrôler tout le cours de l’Escaut en aval d’Anvers. Ils veulent les cantons d’Eupen-Malmédy (qu’ils obtiendront) mais aussi 8 autres cantons rhénans qui resteront allemands. Le Roi Albert Ier refuse cette politique pour ne pas se mettre définitivement les Pays-Bas et le Luxembourg à dos et pour ne pas créer l’irréparable avec l’Allemagne. Les annexionnistes du CPN se trouveront ainsi en porte-à-faux par rapport à la personne royale, que leur option autoritariste cherchait à valoriser.
Le ressourcement italien de Pierre Nothomb
 Le passage du démocratisme de la Jeune Droite au nationalisme du CPN s’accompagne d’un véritable engouement pour l’œuvre de Maurice Barrès. Plus tard, quand l’Action française, et, partant, toutes les formes de nationalisme français hostiles aux anciens empires d’Europe centrale, se retrouvera dans le collimateur du Vatican, le nouveau nationalisme belge de Nothomb et la frange du parti socialiste regroupée autour de Jules Destrée va plaider pour un “ressourcement italien”, suite au succès de la Marche sur Rome de Mussolini, que Destrée avait rencontré en Italie quand il allait, là-bas, soutenir les efforts des interventionnistes italiens avant 1915. Nothomb [ci-contre] traduira ce nouvel engouement italophile, post-barrèsien et post-maurrassien, en un roman, Le Lion ailé, paru en 1926, la même année où la condamnation de l’Action française est proclamée à Rome. Le Lion ailé, écrit C. Vanderpelen-Diagre, est une ode à la nouvelle Italie fasciste. Celle-ci est posée comme un modèle à imiter : il faut, pense Nothomb, favoriser une “contagion romaine”, ce qui conduira inévitablement à un “rajeunissement national”, par l’émergence d’un “ordre vivant”. Jules Destrée, le leader socialiste séduit par l’Italie, celle de l’interventionnisme et celle de Mussolini, salue la parution de ce roman et en encourage la lecture. La réception d’éléments idéologiques fascistes n’est donc pas le propre d’une droite catholique et nationale : elle a animé également le pilier socialiste dans le chef d’un de ses animateurs les plus emblématiques.
Le passage du démocratisme de la Jeune Droite au nationalisme du CPN s’accompagne d’un véritable engouement pour l’œuvre de Maurice Barrès. Plus tard, quand l’Action française, et, partant, toutes les formes de nationalisme français hostiles aux anciens empires d’Europe centrale, se retrouvera dans le collimateur du Vatican, le nouveau nationalisme belge de Nothomb et la frange du parti socialiste regroupée autour de Jules Destrée va plaider pour un “ressourcement italien”, suite au succès de la Marche sur Rome de Mussolini, que Destrée avait rencontré en Italie quand il allait, là-bas, soutenir les efforts des interventionnistes italiens avant 1915. Nothomb [ci-contre] traduira ce nouvel engouement italophile, post-barrèsien et post-maurrassien, en un roman, Le Lion ailé, paru en 1926, la même année où la condamnation de l’Action française est proclamée à Rome. Le Lion ailé, écrit C. Vanderpelen-Diagre, est une ode à la nouvelle Italie fasciste. Celle-ci est posée comme un modèle à imiter : il faut, pense Nothomb, favoriser une “contagion romaine”, ce qui conduira inévitablement à un “rajeunissement national”, par l’émergence d’un “ordre vivant”. Jules Destrée, le leader socialiste séduit par l’Italie, celle de l’interventionnisme et celle de Mussolini, salue la parution de ce roman et en encourage la lecture. La réception d’éléments idéologiques fascistes n’est donc pas le propre d’une droite catholique et nationale : elle a animé également le pilier socialiste dans le chef d’un de ses animateurs les plus emblématiques.
Nothomb avait créé, comme pendant à son CPN, les Jeunesses nationales en 1924. Ce mouvement appelle à un renforcement de l’exécutif, à une organisation corporative de l’État, à l’émergence d’un racisme défensif et d’un anti-maçonnisme, tout en prônant un catholicisme intransigeant (ce qui n’était pas du tout le cas dans l’Italie de l’époque, les Accords du Latran n’ayant pas encore été signés). Le CPN et les Jeunesses nationales entendant, de concert, poser un “compromis entre la raison et l’aventure”. Ce message apparaît trop pauvre pour d’autres groupes en gestation, dont la Jeunesse nouvelle et le groupe royaliste Pour l’autorité. Ces 2 groupes, fidèles en ce sens à la volonté du Roi, refusent le programme de politique étrangère du CPN et des Jeunesses nationales : ils veulent maintenir des rapports normaux avec les Pays-Bas, le Luxembourg et l’Allemagne. Ils insistent aussi sur la nécessité d’imposer une “direction de l’âme et de l’esprit”. En réclamant une telle “direction”, ils enclenchent ce que l’on pourrait appeler, en un langage gramscien, une “bataille métapolitique”, qu’ils qualifiaient, en reprenant certaines paroles du Cardinal Mercier, d’“apostolat par la plume”. Ils s’alignent ainsi sur la volonté de Pie XI de promouvoir un “catholicisme plus intransigeant”, en dépit de l’hostilité du Pontife romain à l’endroit de la francophilie maurrassienne du Primat de Belgique. Enfin, les 2 nouveaux groupes sur l’échiquier politico-métapolitique belge entendent suivre les injonctions de l’encyclique Quas Primas de 1925, proclamant la « royauté du Christ », du « Christus Rex », induisant ainsi le vocable “Rex” dans le vocabulaire politique du pilier catholique, ce qui conduira, après de nombreux avatars, à l’émergence du mouvement rexiste de Léon Degrelle, quand celui-ci rompra les ponts avec ses anciens associés du parti catholique. Le « catholicisme plus intransigeant », réclamé par Pie XI, doit s’imposer aux sociétés par des moyens modernes, par des technologies de communication comme la “TSF” et l’édition de masse (ce à quoi s’emploiera Degrelle, sur ordre de la hiérarchie catholique la plus officielle, au début des années 30).
Beauté, intelligence, moralité
L’appareil de cette offensive métapolitique s’est mis en place, par la volonté du Cardinal Mercier, au moins dès 1921. Celui-ci préside à la fondation de La Revue catholique des idées et des faits (RCIF), revue plus philosophique que théologique, Mercier n’étant pas théologien mais philosophe. Le Cardinal confie la direction de cette publication à l’Abbé René-Gabriel Van den Hout (1886-1969), professeur à l’Institut Saint Louis de Bruxelles et animateur du futur quotidien La Libre Belgique dans la clandestinité pendant la Première Guerre mondiale. L’Abbé Van den Hout avait également servi d’intermédiaire entre Mercier et Maurras. Volontairement le Primat de Belgique et l’Abbé Van den Hout vont user d’un ton et d’une verve polémiques pour fustiger les adversaires de ce renouveau à la fois catholique et national (ton que Degrelle et son caricaturiste Jam pousseront plus tard jusqu’au paroxysme). En 1924, avant la condamnation de Maurras et de l’Action française par le Vatican, les Abbés Van den Hout et Norbert Wallez, flanqués du franciscain Omer Englebert, envisagent de fonder une Action belge (AB), pendant de ses homologues française et espagnole (sur l’Accion Española, cf. Raùl Morodo, Los origenes ideologicos del franquismo : Accion Española, Alianza Editorial, Madrid, 1985). On a pu parler ainsi du “maurrassisme des trois abbés”. Le programme intellectuel de la RCIF et de l’AB (qui restera finalement en jachère) est de lutter contre les formes de romantisme, mouvement littéraire accusé de véhiculer un “subjectivisme relativiste” (donc un individualisme), ou, comme le décrira Carl Schmitt en Allemagne, un “occasionalisme”. Les abbés et leurs journalistes plaideront pour le classicisme, reposant, lui, à leurs yeux, sur 3 critères : la beauté, l’intelligence et la moralité (le livre de référence pour ce “classicisme” demeure celui d’Adrien de Meeüs, Le coup de force de 1660, Nouvelle Société d’Édition, Bruxelles, 1935 ; à ce propos, voir plus bas notre article « Années 20 et 30 : la droite de l’établissement francophone en Belgique, la littérature flamande et le ‘nationalisme de complémentarité’ »).
Revenons maintenant à l’ACJB. En 1921 également, les abbés Brohée et Picard (celui-là même qui mettra Degrelle en selle 10 ans plus tard) entament, eux aussi, un combat métapolitique. Leur objectif ? “Guider les lectures” par le truchement d’un organe intitulé Revue des auteurs et des livres. Au départ, cet organe se veut avant-gardiste mais proposera finalement des lectures figées, déduites d’une littérature bien-pensante. L’ACJB a donc des objectifs culturels et non pas politiques. C’est cette option métapolitique qui provoque une rupture qui se concrétise par la fondation de la Jeunesse nouvelle, parallèle à l’éparpillement de l’équipe de Durandal, dont les membres ont tous été appelés à de hautes fonctions administratives ou politiques. La Jeunesse nouvelle se donne pour but de “régénérer la Cité”, en y introduisant des ferments d’ordre et d’autorité. Elle vise l’instauration d’une monarchie antiparlementaire et nationaliste. Elle réagit à l’instauration du “suffrage universel pur et simple”, imposé par les socialistes, car celui-ci exprimerait la “déchéance morale et politique” d’une société (sa fragmentation et son émiettement en autant de petites républiques individuelles – la “verkaveling” dit-on en néerlandais ; cf. l’ouvrage humoristique mais intellectuellement fort bien charpenté de Rik Vanwalleghem, België Absurdistan – Op zoek naar de bizarre kant van België, Lannoo, Tielt, 2006, livre qui met en exergue l’effet final et contemporain de l’individualisme et de la disparition de toute éthique). La Jeunesse nouvelle s’oppose aussi au nouveau système belge né des “accords de Lophem” de 1919 où les acteurs sociaux et les partis étaient convenus d’un “deal”, que l’on entendait pérenniser jusqu’à la fin des temps en excluant systématiquement tout challengeur survenu sur la piste par le biais d’élections. Ce “deal” repose sur un canevas politique donné une fois pour toutes, posé comme définitif et indépassable, avec des forces seules autorisées à agir sur l’échiquier politico-parlementaire.
L’organe de la Jeunesse nouvelle, soit La Revue de littérature et d’action devient La Revue d’action dès que l’option purement métapolitique cède à un désir de s’immiscer dans le fonctionnement de la Cité. La revue d’Action devient ainsi, de 1924 à 1934, la porte-paroles du mouvement Pour l’autorité, dont la cheville ouvrière sera un jeune historien en vue de la matière de Bourgogne, Luc Hommel. Pour celui-ci, la revue est un “laboratoire d’idées” visant une réforme de l’État, qui reposera sur un renforcement de l’exécutif, sur le corporatisme et le nationalisme (à références “bourguignonnes”) et sur le suffrage familial, appelé à corriger les effets jugés pervers du “suffrage universel pur et simple”, imposé par les socialistes dès le lendemain de la Première Guerre mondiale. Hommel et ses amis préconisent de rester au sein du Parti Catholique, d’y être un foyer jeune et rénovateur. Les adeptes des thèses de la La Revue d’action ne rejoindront pas Rex. Parmi eux : Etienne de la Vallée-Poussin (qui dirigera un moment Le Vingtième siècle fondé par l’Abbé Wallez), Daniel Ryelandt (qui témoignera contre Léon Degrelle dans le fameux film que lui consacrera Charlier et qui était destiné à l’ORTF mais qui ne passera pas sur antenne après pression diplomatique belge sur les autorités de tutelle françaises), Gaëtan Furquim d’Almeida, Charles d’Aspremont-Lynden, Paul Struye, Charles du Bus de Warnaffe. La revue et le groupe Pour l’autorité cesseront d’exister en 1935, quand Hommel deviendra chef de cabinet de Paul van Zeeland. Plusieurs protagonistes de Pour l’autorité œuvreront ensuite au Centre d’Études pour la Réforme de l’État (CERE), dont Hommel, de la Vallée-Poussin et Ryelandt. Ils s’opposeront farouchement Rex en dépit d’une volonté commune de renforcer l’exécutif autour de la personne du Roi. L’idéal d’un renforcement de l’exécutif est donc partagé entre adeptes et adversaires de Rex.
La “Troisième voie” de Raymond De Becker
 La période qui va de 1927 à 1939 est aussi celle d’une recherche fébrile de la “troisième voie”. C’est dans ce contexte qu’émergera une figure que l’on commence seulement à redécouvrir en Belgique, en ce début de deuxième décennie du XXIe siècle : Raymond De Becker. Contrairement à tous les mouvements que nous venons de citer, qui veulent demeurer au sein du pilier catholique, les hommes partis en quête d’une “troisième voie” cherchent à élargir l’horizon de leur engagement à toutes les forces sociales agissant dans la société. Ils ont pour point commun de rejeter le libéralisme (assimilé au “vieux monde”) et entendent valoriser toutes les doctrines exigeant une adhésion qu’ils apparentent à la foi : le catholicisme, le communisme, le fascisme, considérés comme seules forces d’avenir. C’est la démarche de ceux que Jean-Louis Loubet del Bayle nommera, dans son ouvrage de référence, les “non-conformistes des années 30”. Loubet del Bayle n’aborde que le paysage intellectuel français de l’époque. Qu’en est-il en Belgique ? Le cocktail que constituera la “troisième voie” ardemment espérée contiendra, francophonie oblige, bon nombre d’ingrédients français : Blondel (vu ses relations et son influence sur le Cardinal Mercier, sans oublier sa “doctrine de l’action”), Archambault, Mounier (le personnalisme), Gabriel Marcel (la distinction entre l’Être et l’Avoir), Maritain et Daniel-Rops. Après la condamnation de Maurras et de l’Action française par le Vatican, Jacques Maritain, que Paul Sérant classe comme un “dissident de l’Action française”, remplace, dès 1926, Maurras comme gourou de la jeunesse catholique et autoritaire en Belgique. R. de Becker et Henry Bauchau (toujours actif aujourd’hui, et qui nous livre un regard sur cette époque dans son tout récent récit autobiographique, L’enfant rieur, Actes Sud, 2011 ; R. De Becker y apparaît sous le prénom de “Raymond” ; voir surtout les pp. 157 à 166) sont les 2 hommes qui entretiendront une correspondance avec Maritain et participeront aux rencontres de Meudon. Du “nationalisme intégral de Maurras”, que voulait importer Nothomb, on passe à l’“humanisme intégral” de Maritain.
La période qui va de 1927 à 1939 est aussi celle d’une recherche fébrile de la “troisième voie”. C’est dans ce contexte qu’émergera une figure que l’on commence seulement à redécouvrir en Belgique, en ce début de deuxième décennie du XXIe siècle : Raymond De Becker. Contrairement à tous les mouvements que nous venons de citer, qui veulent demeurer au sein du pilier catholique, les hommes partis en quête d’une “troisième voie” cherchent à élargir l’horizon de leur engagement à toutes les forces sociales agissant dans la société. Ils ont pour point commun de rejeter le libéralisme (assimilé au “vieux monde”) et entendent valoriser toutes les doctrines exigeant une adhésion qu’ils apparentent à la foi : le catholicisme, le communisme, le fascisme, considérés comme seules forces d’avenir. C’est la démarche de ceux que Jean-Louis Loubet del Bayle nommera, dans son ouvrage de référence, les “non-conformistes des années 30”. Loubet del Bayle n’aborde que le paysage intellectuel français de l’époque. Qu’en est-il en Belgique ? Le cocktail que constituera la “troisième voie” ardemment espérée contiendra, francophonie oblige, bon nombre d’ingrédients français : Blondel (vu ses relations et son influence sur le Cardinal Mercier, sans oublier sa “doctrine de l’action”), Archambault, Mounier (le personnalisme), Gabriel Marcel (la distinction entre l’Être et l’Avoir), Maritain et Daniel-Rops. Après la condamnation de Maurras et de l’Action française par le Vatican, Jacques Maritain, que Paul Sérant classe comme un “dissident de l’Action française”, remplace, dès 1926, Maurras comme gourou de la jeunesse catholique et autoritaire en Belgique. R. de Becker et Henry Bauchau (toujours actif aujourd’hui, et qui nous livre un regard sur cette époque dans son tout récent récit autobiographique, L’enfant rieur, Actes Sud, 2011 ; R. De Becker y apparaît sous le prénom de “Raymond” ; voir surtout les pp. 157 à 166) sont les 2 hommes qui entretiendront une correspondance avec Maritain et participeront aux rencontres de Meudon. Du “nationalisme intégral de Maurras”, que voulait importer Nothomb, on passe à l’“humanisme intégral” de Maritain.
Le passage du maurrassisme au maritainisme implique une acceptation de la démocratie et de ses modes de fonctionnement, ainsi que du pluralisme qui en découle, et constate l’impossibilité de retrouver le pouvoir supratemporel du Saint Empire (vu de France, on peut effectivement affirmer que le Saint Empire, assassiné par Napoléon, ou l’Empire austro-hongrois, assassiné par Poincaré et Clemenceau, est une “forme morte” ; ailleurs, notamment en Autriche et en Hongrie, c’est moins évident... Il suffit d’évoquer les propositions très récentes du ministre hongrois Orban pour “resacraliser” l’État, notamment en le dépouillant du label de “république”). Par voie de conséquence, les maritainistes ne réclameront pas l’avènement d’une “Cité chrétienne”. En ce sens, ils vont plus loin que le Chanoine Jacques Leclercq (cf. infra) en Belgique, dont le souci, tout au long de son itinéraire, sera de maintenir une dose de divin et, subrepticement, un certain contrôle clérical sur la Cité, même aux temps d’après-guerre où le maritainisme débouchera partiellement sur la création et l’animation d’un parti politique “catho-communisant”, l’UDB (auquel adhèrera un William Ugeux, ancien journaliste au Vingtième Siècle et responsable de la “Sûreté de l’État” pour le compte du gouvernement Pierlot revenu de son exil londonien).
La Cité, rêvée par les adeptes d’une “troisième voie” d’inspiration maritainiste, est un “contrat entre fidèles et infidèles”, visant l’unité de la Cité, une unité minimale, certes, mais animée par l’amitié et la fraternité entre les hommes. Cette vision repose évidemment sur la définition “ouverte” que Maritain donne de l’humanisme. D’où la question que lui poseront finalement R. de Becker et Léon Degrelle : “Où sont les points d’appui ?”. En effet, l’idée d’une “humanité ouverte” ne permet pas de construire une Cité, qui, toujours, par la force des choses, aura des limites et/ou des frontières. Le maritainisme ne fera pas l’unité des anciens maurrassiens, des chercheurs de “troisièmes voies” voire des thomistes recyclés, modernisant leur discours, ou des “demanistes” socialistes non hostiles à la religion : le monde catholique se divisera en chapelles antagonistes qui le conduiront à l’implosion, à une sorte de guerre civile entre catholiques (surtout à partir de l’émergence de Rex) et à une sorte d’aggiornamento technocratique (qui, parti du technocratisme à l’américaine de Van Zeeland, donnera à terme la “plomberie” de Dehaene et son basculement dans les fiascos financiers postérieurs à l’automne 2008) ou à un discours assez hystérique et filandreux, évoquant justement le thème de l’humanisme maritainien, avec Joëlle Milquet qui abandonne l’appelation de Parti Social-Chrétien pour prendre celle de CdH (Centre Démocrate et Humaniste).
Marcel De Corte
 [En septembre 1975, Marcel De Corte accorde une entretien au Front de la jeunesse publié dans la rubrique "Europe-Jeunesse" du Nouvel Europe magazine (NEM)]
[En septembre 1975, Marcel De Corte accorde une entretien au Front de la jeunesse publié dans la rubrique "Europe-Jeunesse" du Nouvel Europe magazine (NEM)]
Quelles seront les expressions de l’humanisme intégral de Maritain en Belgique ? Il y aura notamment la Nouvelle équipe d’Yvan Lenain (1907-1965). Lenain est un philosophe thomiste de formation, qui veut “une Cité régénérée par la spiritualité”. Si, au départ, Lenain s’inscrit dans le sillage de Maritain, les évolutions et les aggiornamenti de ce dernier le contraindront à adopter une position thomiste plus traditionnelle. Par ailleurs, l’ouverture aux gens de gauche, les “infidèles” avec lesquels on aurait pu, le cas échéant, conclure un contrat, s’est avérée un échec. Le repli sur un thomisme plus classique est sans doute dû à l’influence d’une figure aujourd’hui oubliée, Marcel De Corte (1905-1994), professeur de philosophie à l’Université de Liège. De Corte, actif partout, notamment dans une revue peu suspecte de “catholicisme”, comme Hermès de Marc. Eemans et René Baert, est beaucoup plus ancré dans le catholicisme traditionnel (et aristotélo-thomiste) que ne l’était Lenain au départ : il rompra d’ailleurs avec Maritain en 1937, comme beaucoup d’autres auteurs belges, qui ne supportaient pas le soutien que l’humaniste intégral français apportait aux républicains espagnols (en Belgique, l’hostilité, y compris à gauche, à la République espagnole vient du fait que l’ambassadeur de Belgique, qui avait fait des locaux de l’ambassade du royaume un centre de la Croix Rouge, fut abattu par la police madrilène en 1936, laquelle vida ensuite le bâtiment de la légation de tous les réfugiés et éclopés qui s’y trouvaient et massacra les blessés dans la foulée). La pensée de De Corte, consignée dans 2 gros volumes parus dans les années 50, reste d’actualité : la notion de “dissociété”, qu’il a contribué à forger, est reprise aujourd’hui, même à gauche de l’échiquier politique français, notamment par le biais de l’ouvrage de Jacques Généreux, intitulé La dissociété (Seuil, 2006 ; pour se référer à De Corte directement, lire : Marcel De Corte, De la dissociété, éd. Remi Perrin, 2002).
Raymond De Becker : électron libre
Entre toutes les chapelles politico-littéraires de la Belgique francophone des années 30, R. De Becker va jouer le rôle d’intermédiaire, tout en demeurant un “électron libre”, comme le qualifie C. Vanderpelen-Diagre. De Becker, bien que catholique à l’époque (après la guerre, il ne le sera plus, lorsqu’il œuvrera, avec Louis Pauwels, dans le réseau Planète), ne plaide jamais pour une orthodoxie catholique : il incarne en effet un mysticisme très personnel, rétif à tout encadrement clérical. Dans ses efforts, il aura toujours l’appui de Maritain (avant la rupture suite aux événements d’Espagne) et du Chanoine Jacques Leclercq, qui fut d’abord un maritainiste plus ou mois conservateur avant de devenir, via les revues et associations qu’il animait, le fondateur du nouveau démocratisme chrétien, à tentations marxistes, de l’après-1945. De Becker va jouer aussi le rôle du relais entre les “non-conformistes” français et leurs homologues belges. En 1935, il se rend ainsi à la fameuse abbaye de Pontigny en Bourgogne, véritable laboratoire d’idées nouvelles où se rencontraient des hommes d’horizons différents soucieux de dépasser les clivages politiques en place. C’est à l’invitation de Paul Desjardins (2), qui organise en 1935 une rencontre sur le thème de l’ascétisme, que De Becker rencontre à Pontigny Nicolas Berdiaev, André Gide et Martin Buber.
Le reproche d’antisémitisme qu’on lui lancera à la tête, surtout dans le milieu assez abject des “tintinophobes” parisiens, ne tient pas, ne fût-ce qu’au regard de cette rencontre ; par ailleurs, les séminaires de Pontigny doivent être mis en parallèle avec leurs équivalents allemands organisés par le groupe de jeunesse Köngener Bund, auxquelles Buber participait également, aux côtés d’exposants communistes et nationaux-socialistes. En étudiant parallèlement de telles initiatives, on apprendra véritablement ce que fut le “non-conformisme” des années 30, dans le sillage de l’esprit de Locarno (sur l’impact intellectuel de Locarno : lire les 2 volumes publiés par le CNRS sous la direction de Hans Manfred Bock, Reinhart Meyer-Kalkus et Michel Trebitsch, Entre Locarno et Vichy – les relations culturelles franco-allemandes dans les années 30, CNRS éditions, 1993 ; cet ouvrage explore dans le détail les idéaux pacifistes, liés à l’idée européenne et au désir de sauvegarder le patrimoine de la civilisation européenne, dans le sillage d’Aristide Briand, du paneuropéisme à connnotations catholiques, de Friedrich Sieburg, des personnalistes de la revue L’Ordre nouveau, de Jean de Pange, des germanistes allemands Ernst Robert Curtius et Leo Spitzer, de la revue Europe, où officiera un Paul Colin, etc.).
De Becker, toujours soucieux de traduire dans les réalités politiques et culturelles belges les idées d’humanisme intégral de Maritain, accepte le constat de son maître-à-penser français : il n’est plus possible de rétablir l’harmonie du corporatisme médiéval dans les sociétés modernes ; il faut donc de nouvelles solutions et pour les promouvoir dans la société, il faut créer des organes : ce sera , d’une part, la Centrale politique de la jeunesse, présidée par André Mussche, dont le secrétaire sera De Becker, et, d’autre part, la revue L’esprit nouveau, où l’on retrouve l’ami de toujours, celui qui ne trahira jamais De Becker et refusera de le vouer aux gémonies, Henry Bauchau. Les objectifs que se fixent Mussche, De Becker et Bauchau sont simples : il faut traduire dans les faits la teneur des encycliques pontificales, en instaurant dans le pays une économie dirigée, anti-capitaliste, ou plus exactement anti-trust, qui garantira la justice sociale. Toujours dans l’esprit de Maritain, De Becker se fait le chantre d’une “nouvelle culture”, personnaliste, populaire et attrayante pour les non-croyants (comme on disait à l’époque). Il appellera cette culture nouvelle, la “culture communautaire”. Lors du Congrès de Malines de 1936, Bauchau se profile comme le théoricien et la cheville ouvrière de ce mouvement “communautaire” ; il est rédacteur depuis 1934 à La Cité chrétienne du Chanoine Leclercq, qui essaie de réimbriquer le christianisme (et, partant, le catholicisme) dans les soubresauts de la vie politique, animée par les totalitarismes souvent victorieux à l’époque, toujours challengeurs. Cette volonté de “ré-imbriquer” passe par des compromissions (qu’on espère passagères) avec l’esprit du temps (ouverture au socialisme voire au communisme).
“Communauté” et “Capelle-aux-Champs”
 En 1937, les “communautaires” maritainiens créent l’École supérieure d’humanisme, établie au n°21 de la Rue des Deux Églises à Bruxelles. Cette école prodigue des cours de “formation de la personnalité”, comprenant des leçons de philosophie, d’esthétique et d’histoire de l’art et de la culture. Le corps académique de cette école est prestigieux : on y retrouve notamment le Professeur De Corte. Cette école dispose également de relais, dont l’auberge “Au Bon Larron” de Pepinghem, où l’Abbé Leclercq reçoit ses étudiants et disciples, le cercle “Communauté” à Louvain chez la mère de De Becker, où se rend régulièrement Louis Carette, le futur Félicien Marceau. Enfin, dernier relais à signaler : le groupe de la “Capelle-aux-Champs”, sous la houlette bienveillante du Père Bonaventure Feuillien et du peintre Evany [Eugène van Nijverseel] (ami d’Hergé). Le créateur de Tintin fréquentera ce groupe, qui est nettement moins politisé que les autres et où l’on ne pratique pas la haute voltige philosophique. Quelles autres figures ont-elles fréquenté le groupe de la “Capelle-aux-Champs” ? La “Capelle-aux-Champs” ou Kapelleveld se situe exactement à l’endroit du campus de Louvain-en-Woluwé et de l’hôpital universitaire Saint Luc. C’était avant guerre un lieu idyllique, comme en témoigne la fresque ornant la station de métro “Vandervelde” qui y donne accès aujourd’hui.
En 1937, les “communautaires” maritainiens créent l’École supérieure d’humanisme, établie au n°21 de la Rue des Deux Églises à Bruxelles. Cette école prodigue des cours de “formation de la personnalité”, comprenant des leçons de philosophie, d’esthétique et d’histoire de l’art et de la culture. Le corps académique de cette école est prestigieux : on y retrouve notamment le Professeur De Corte. Cette école dispose également de relais, dont l’auberge “Au Bon Larron” de Pepinghem, où l’Abbé Leclercq reçoit ses étudiants et disciples, le cercle “Communauté” à Louvain chez la mère de De Becker, où se rend régulièrement Louis Carette, le futur Félicien Marceau. Enfin, dernier relais à signaler : le groupe de la “Capelle-aux-Champs”, sous la houlette bienveillante du Père Bonaventure Feuillien et du peintre Evany [Eugène van Nijverseel] (ami d’Hergé). Le créateur de Tintin fréquentera ce groupe, qui est nettement moins politisé que les autres et où l’on ne pratique pas la haute voltige philosophique. Quelles autres figures ont-elles fréquenté le groupe de la “Capelle-aux-Champs” ? La “Capelle-aux-Champs” ou Kapelleveld se situe exactement à l’endroit du campus de Louvain-en-Woluwé et de l’hôpital universitaire Saint Luc. C’était avant guerre un lieu idyllique, comme en témoigne la fresque ornant la station de métro “Vandervelde” qui y donne accès aujourd’hui.
C’est donc là, au beau milieu de ce sable et de ces bouleaux, que se retrouvaient Marcel Dehaye (qui écrira dans la presse collaborationniste sous le pseudonyme plaisant de “Jean de la Lune”), Jean Libert (qui sera épuré), Franz Weyergans (le père de François Weyergans) et Jacques Biebuyck. L’idéal qui y règne est l’idéal scout (ce qui attire justement Hergé) ; on n’y cause pas politique, on vise simplement à donner à ses contemporains “un cœur simple et bon”. L’initiative a l’appui de Jacques Leclercq. En dépit de ses connotations catholiques, le groupe se reconnaît dans un refus général de l’esprit clérical et bondieusard (voilà sans doute pourquoi Tintin, héros créé par la presse catholique, n’exprime aucune religion dans ses aventures. Comme bon nombre d’avatars du maritainisme, les amis de la “Capelle-aux-Champs” manifestent une volonté d’ouverture sur l’“ailleurs”. Mais leurs recherches implicites ne sont pas tournées vers une réforme en profondeur de la Cité. Les thèmes sont plutôt moraux, au sens de la bienséance de l’époque : on y réfléchit sur le péché, l’adultère, un peu comme dans l’œuvre de François Mauriac, qui avait appelé à jeter « un regard franc sur un monde dénaturé ».
L’esprit de “Capelle-aux-Champs” est également, dans une certaine mesure, un avatar lointain et original de l’impact de Bourget sur la littérature catholique du début du siècle (pour saisir l’esprit de ce groupe, lire entre autres ouvrages : J. Libert, Capelle aux Champs, Les écrits, Bruxelles, 1941 [5°éd.] et Plénitude, Les écrits, 1941 ; J. Biebuyck, Le rire du cœur, Durandal, Bruxelles, [s. d., probablement après guerre] et Le serpent innocent, Casterman, Tournai, 1971 [préf. de F. Weyergans] ; Franz Weyergans, Enfants de ma patience, éd. Universitaires, Paris, 1964 et Raisons de vivre, Les écrits, 1944 ; cet ouvrage est un hommage de F. Weyergans à son propre père, exactement comme son fils François lui dédiera Franz et François en 1997).
Notons enfin que les éditions “Les Écrits” ont également publié de nombreuses traductions de romans scandinaves, finnois et allemands, comme le firent par ailleurs les fameuses éditions de “La Toison d’Or”, elles carrément collaborationnistes pendant la Seconde Guerre mondiale, dans le but de dégager l’opinion publique belge de toutes les formes de parisianismes et de l’ouvrir à d’autres mondes. Le traducteur des éditions “Les Écrits” fut-il le même que celui des éditions “La Toison d’Or”, soit l’Israélite estonien Sulev J. Kaja (alias Jacques Baruch, 1919-2002), condamné sévèrement par les tribunaux incultes de l’épuration et sauvé de la misère et de l’oubli par Hergé lors du lancement de l’hebdomadaire Tintin dès 1946 ? Le pays aurait bien besoin de quelques modestes traducteurs performants de la trempe d’un Sulev J. Kaja...) (2).
Revenons aux animateurs du groupe de la Capelle-aux-Champs. Il y a d’abord Marcel Dehaye (1907-1990) qui explore le monde de l’enfance, exalte la pureté et l’innocence et, avec son personnage Bob ou l’enfant nouveau campe un garçonnet « qui ne sera ni banquier ni docteur ni soldat ni député ». Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Dehaye collabora au Soir et au Nouveau Journal sous le pseudonyme de “Jean de la Lune”, ce qui le sauvera sans nul doute des griffes de l’épuration : il aurait été en effet du plus haut grotesque de lire une manchette dans la presse signalant que « l’auditorat militaire a condamné Jean de la Lune à X années de prison et à l’indignité nationale ».
Jacques Biebuyck (1909-1993) est issu, lui, d’une famille riche, ruinée en 1929. Il a fait un séjour de 3 mois à la Trappe. Il a d’abord été fonctionnaire au ministère de l’intérieur puis journaliste. C’est un ami de Raymond De Becker. Il professe un anti-intellectualisme et prône de se fier à l’instinct. Pour lui, la jeunesse doit demeurer “vierge de toute corruption politique”. Biebuyck rejette la politique, qui se déploie dans un “monde de malhonnêtes”. Il renoue là avec un certain esprit de l’ACJB à ses débuts, où le souci culturel primait l’engagement proprement politique. L’illustrateur des œuvres de Biebuyck, et d’autres protagonistes de la Capelle-aux-Champs fut Pierre Ickx, ami d’Hergé et spécialisé dans les dessins de scouts idéalisés.
Jean Libert (1913-1981), lui, provient d’une famille qui s’était éloignée de la religion, parce qu’elle estimait que celle-ci avait basculé dans le “mercantilisme”. À 16 ans, Libert découvre le mouvement scout (comme Hergé auparavant). Ses options spirituelles partent d’une volonté de suivre les enseignements de Saint François d’Assise, comme le préconisait aussi le Père Bonaventure Feuillien. “Nono”, le héros de J. Libert dans son livre justement intitulé Capelle-aux-Champs (cf. supra), va incarner cette volonté. Il s’agit, pour l’auteur et son héros, de conduire l’homme vers une vie joyeuse et digne, héroïque et féconde. Libert se fait le chantre de l’innocence, de la spontanéité, de la pureté (des sentiments) et de l’instinct.
Jean Libert et la “mystique belge”
En 1938, avec Antoine Allard, Jean Libert opte pour l’attitude pacifiste et neutraliste, induite par le rejet des accords militaires franco-belges et la déclaration subséquente de neutralité qu’avait proclamée le Roi Léopold III en octobre 1936, tout en arguant qu’une conflagration qui embraserait toute l’Europe entraînerait le déclin irrémédiable du Vieux Continent (cf. les idées pacifistes de Maurice Blondel, à la fin de sa vie, consignée dans son ouvrage, Lutte pour la civilisation et philosopohie de la paix, Flammarion, 1939 ; cet ouvrage est rédigé dans le même esprit que le “manifeste neutraliste” et inspire, fort probablement, le discours royal aux belligérants dès septembre 1939). J. Libert signe donc ce fameux manifeste neutraliste des intellectuels, notamment patronné par Robert Poulet.
Parallèlement à cet engagement neutraliste, dépourvu de toute ambigüité, Libert plaide pour l’éclosion d’une “mystique belge” que d’autres, à la suite de l’engouement de Maeterlinck pour Ruusbroec l’Admirable au début du siècle, voudront à leur tour raviver. On pense ici à Marc. Eemans et René Baert, qui, outre Ruusbroec (non considéré comme hérétique par les catholiques sourcilleux car il refusera toujours de dédaigner les “œuvres”), réhabiliteront Sœur Hadewijch, Harphius, Denys le Chartreux et bien d’autres figures médiévales (cf. Marc. Eemans, Anthologie de la Mystique des Pays-Bas, éd. de la Phalange / J. Beernaerts, Bruxelles, s. d. ; il s’agit des textes sur les mystiques des Pays-Bas publiés dans les années 30 dans la revue Hermès). R. De Becker se penchera également sur la figure de Ruusbroec, notamment dans un article du Soir, le 11 mars 1943 (« Quand Ruysbroeck l’Admirable devenait prieur à Groenendael »). Comme dans le cas du mythe bourguignon, inauguré par Luc Hommel (cf. supra) et Paul Colin, le recours à la veine mystique médiévale participe d’une volonté de revenir à des valeurs nées du sol entre Somme et Rhin, pour échapper à toutes les folies idéologiques qui secouaient l’Europe, à commencer par le laïcisme républicain français, dont la nuisance n’a pas encore cessé d’être virulente, notamment par le filtre de la “nouvelle philosophie” d’un marchand de “prêt-à-penser” brutal et sans nuances comme Bernard-Henri Lévy (classé récemment par Pascal Boniface comme « l’intellectuel faussaire », le plus emblématique).
Fidèle à son double engagement neutraliste et mystique, Jean Libert voudra œuvrer au relèvement moral et physique de la jeunesse, en prolongeant l’effet bienfaisant qu’avait le scoutisme sur les adolescents. Au lendemain de la défaite de mai 1940, J. Libert rejoint les Volontaires du Travail, regroupés autour de Henry Bauchau, Théodore d’Oultremont et Conrad van der Bruggen. Ces Volontaires du travail devaient prester des travaux d’utilité publique, de terrassement et de déblaiement, dans tout le pays pour effacer les destructions dues à la campagne des 18 jours de mai 1940. C’était également une manière de soustraire des jeunes aux réquisitions de l’occupant allemand et de maintenir sous bonne influence “nationale” des équipes de jeunes appelés à redresser le pays, une fois la paix revenue. Pendant la guerre, J. Libert collaborera au Nouveau Journal de Robert Poulet, ce qui lui vaudra d’être épuré, au grand scandale d’Hergé qui estimait, à juste titre, que la répression tuait dans l’œuf les idéaux positifs d’innocence, de spontanéité et de pureté (le “cœur pur” de Tintin au Tibet). Jamais le pays n’a pu se redresser moralement, à cause de cette violence “officielle” qui effaçait les ressorts de tout sursaut éthique, à coup de décisions féroces prises par des juristes dépourvus de “Sittlichkeit” et de culture. On voit les résultats après plus de 6 décennies...
Franz Weyergans
Parmi les adeptes du groupe de la “Capelle-aux-Champs”, signalons encore Franz Weyergans (1912-1974), père de François Weyergans. Lui aussi s’inspire de Saint François d’Assise. Il sera d’abord journaliste radiophonique comme Biebuyck. La littérature, pour autant qu’elle ait retenu son nom, se rappellera de lui comme d’un défenseur doux mais intransigeant de la famille nombreuse et du mariage. Weyergans plaide pour une sexualité pure, en des termes qui apparaissent bien désuets aujourd’hui. Il fustige notamment, sans doute dans le cadre d’une campagne de l’Église, l’onanisme.
Franz Weyergans est revenu sous les feux de la rampe lorsque son fils François, publie chez Grasset Franz et François une sorte de dialogue post mortem avec son père. Le livre recevra un prix littéraire, le Grand Prix de la Langue Française (1997). Il constitue un très beau dialogue entre un père vertueux, au sens où l’entendait l’Église avant-guerre dans ses recommandations les plus cagotes à l’usage des tartufes les plus assomants, et un fils qui s’était joyeusement vautré dans une sexualité picaresque et truculente dès les années 50 qui annonçaient déjà la libération sexuelle de la décennie suivante (avec Françoise Sagan not.). Deux époques, deux rapports à la sexualité se télescopent dans Franz et François mais si François règle bien ses comptes avec Franz — et on imagine bien que l’affrontement entre le paternel et le fiston a dû être haut en couleurs dans les décennies passées — le livre est finalement un immense témoignage de tendresse du fils à l’égard de son père défunt.
L’angoisse profonde et terrible qui se saisit d’Hergé dès le moment où il rencontre celle qui deviendra sa seconde épouse, Fanny Vleminck, et lâche progressivement sa première femme Germain Kieckens, l’ancienne secrétaire de l’Abbé Wallez au journal Le Vingtième siècle, ne s’explique que si l’on se souvient du contexte très prude de la “Capelle-aux-Champs” ; de même, son recours à un psychanalyste disciple de Carl Gustav Jung à Zürich ne s’explique que par le tournant jungien qu’opèreront R. De Becker, futur collaborateur de la revue Planète de Louis Pauwels, et Henry Bauchau dès les années 50.
Biebuyck et Weyergans, même si nos contemporains trouveront leurs œuvres surannées, demeurent des écrivains, peut-être mineurs au regard des critères actuels, qui auront voulu, et parfois su, conférer une “dignité à l’ordinaire”, comme le rappelle C. Vanderpelen-Diagre. Jacques Biebuyck et Franz Weyergans, sans doute contrairement à Tintin (du moins dans une certaine mesure), ne visent ni le sublime ni l’épique : ils estiment que “la vie quotidienne est un pèlérinage ascétique”.
De l’ACJB à Rex
Mais dans toute cette effervescence, inégalée depuis lors, quelle a été la genèse de Rex, du mouvement rexiste de Léon Degrelle ? Les 29, 30 et 31 août 1931 se tient le congrès de l’ACJB, présidé par Léopold Levaux, auteur d’un ouvrage apologétique sur Léon Bloy (Léon Bloy, éd. Rex, Louvain, 1931). À la tribune : Monseigneur Ladeuze, Recteur magnifique de l’Université Catholique de Louvain, l’Abbé Jacques Leclercq et Léon Degrelle, alors directeur des Éditions Rex, fondées le 15 janvier 1931. Le futur fondateur du parti rexiste se trouvait donc à la fin de l’été 1931 aux côtés des plus hautes autorités ecclésiastiques du pays et du futur mentor de la démocratie chrétienne, qui finira par se situer très à gauche, très proche des communistes et du résistancialisme qu’ils promouvaient à la fin des années 40. L’organisation de ce congrès visait le couronnement d’une série d’activités apostoliques dans les milieux catholiques et, plus précisément, dans le monde de la presse et de l’édition, ordonnées très tôt, sans doute dès le lendemain de la Première Guerre mondiale, par le cardinal Mercier lui-même. L’année de sa mort, qui est aussi celle de la condamnation de l’Action française par le Vatican (1926), est suivie rapidement par la fameuse “substitution de gourou” dans les milieux catholiques belges : on passe de Maurras à Maritain, du nationalisme intégral à l’humanisme intégral. En cette fin des années 20 et ce début des années 30, Maritain n’a pas encore une connotation de gauche : il ne l’acquiert qu’après son option en faveur de la République espagnole.
C’est une époque où le futur Monseigneur Picard s’active, notamment dans le groupe La nouvelle équipe et dans les Cahiers de la jeunesse catholique. En août 1931, à la veille de la rentrée académique de Louvain, il s’agit de promouvoir les éditions Rex, sous la houlette de Degrelle (c’est pour cela qu’il est hissé sur le podium à côté du Recteur), de Robert du Bois de Vroylande (1907-1944) et de Pierre Nothomb. En 1932, l’équipe, dynamisée par Degrelle, lance l’hebdomadaire Soirées qui parle de littérature, de théâtre, de radio et de cinéma. Les catholiques, auparavant rétifs à toutes les formes de modernité même pratiques, arraisonnent pour la première fois, avec Degrelle, le secteur des loisirs. La forme, elle aussi, est moderne : elle fait usage des procédés typographiques américains, utilise en abondance la photographie, etc. La parution de Soirées, hebdomadaire en apparence profane, apporte une véritable innovation graphique dans le monde de la presse belge. Les éditions Rex ont été fondées “pour que les catholiques lisent”. L’objectif avait donc clairement pour but de lancer une offensive “métapolitique”.
L’équipe s’étoffe : autour de Léon Degrelle et de Robert du Bois de Vroylande, de nouvelles plumes s’ajoutent, dont celle d’Aman Géradin (1910-2000) et de José Streel (1911-1946), auteur de 2 thèses, l’une sur Péguy, l’autre sur Bergson. Plus tard, Pierre Daye, Joseph Mignolet et Henri-Pierre Faffin rejoignent les équipes des éditions Rex. Celles-ci doivent offrir aux masses catholiques des livres à prix réduit, par le truchement d’un système d’abonnement. C’est le pendant francophone du Davidsfonds catholique flamand (qui existe toujours et est devenu une maison d’édition prestigieuse). Cependant, l’épiscopat, autour des ecclésiastiques Picard et Ladeuze, n’a pas mis tous ses œufs dans le même panier. À côté de Rex, il patronne également les Éditions Durandal, sous la direction d’Edouard Ned (1873-1949). Celui-ci bénéficie de la collaboration du Chanoine Halflants, de Firmin Van den Bosch, de Georges Vaxelaire, de Thomas Braun, de Léopold Levaux et de Camille Melloy. L’épiscopat a donc créé une concurrence entre Rex et Durandal, entre Degrelle et Ned. C’était sans doute, de son point de vue, de bonne guerre. Les éditions Durandal, offrant des ouvrages pour la jeunesse, dont nous disposions à la bibliothèque de notre école primaire (vers 1964-67), continueront à publier, après la mort de Ned, jusqu’au début des années 60.
Degrelle rompt l’unité du parti catholique
 Léon Degrelle veut faire triompher son équipe jeune (celle de Ned est plus âgée et a fait ses premières armes du temps de la Jeune Droite de Carton de Wiart). Il multiplie les initiatives, ce qui donne une gestion hasardeuse. Les stocks d’invendus sont faramineux et les productions de Rex contiennent déjà, avant même la formation du parti du même nom, des polémiques trop politiques, ce qui, ne l’oublions pas, n’est pas l’objectif de l’ACJB, organisation plus culturelle et métapolitique que proprement politique et à laquelle les éditions Rex sont théoriquement inféodées. Degrelle est désavoué et Robert du Bois de Vroylande quitte le navire, en dénonçant vertement son ancien associé. Meurtri, accusé de malversations, Degrelle se venge par le fameux coup de Courtrai, où, en plein milieu d’un congrès du parti catholique, il fustige les “banksters”, c’est-à-dire les hommes politiques qui ont créé des caisses d’épargne et ont joué avec l’argent que leur avaient confié des petits épargnants pieux qui avaient cru en leurs promesses (comme aujourd’hui pour la BNP et Dexia, sauf que la disparition de toute éthique vivante au sein de la population n’a suscité aucune réaction musclée, comme en Islande ou en Grèce par ex.).
Léon Degrelle veut faire triompher son équipe jeune (celle de Ned est plus âgée et a fait ses premières armes du temps de la Jeune Droite de Carton de Wiart). Il multiplie les initiatives, ce qui donne une gestion hasardeuse. Les stocks d’invendus sont faramineux et les productions de Rex contiennent déjà, avant même la formation du parti du même nom, des polémiques trop politiques, ce qui, ne l’oublions pas, n’est pas l’objectif de l’ACJB, organisation plus culturelle et métapolitique que proprement politique et à laquelle les éditions Rex sont théoriquement inféodées. Degrelle est désavoué et Robert du Bois de Vroylande quitte le navire, en dénonçant vertement son ancien associé. Meurtri, accusé de malversations, Degrelle se venge par le fameux coup de Courtrai, où, en plein milieu d’un congrès du parti catholique, il fustige les “banksters”, c’est-à-dire les hommes politiques qui ont créé des caisses d’épargne et ont joué avec l’argent que leur avaient confié des petits épargnants pieux qui avaient cru en leurs promesses (comme aujourd’hui pour la BNP et Dexia, sauf que la disparition de toute éthique vivante au sein de la population n’a suscité aucune réaction musclée, comme en Islande ou en Grèce par ex.).
Degrelle, en déboulant avec ses “jeunes plumes” dans le congrès des “vieilles barbes”, a commis l’irréparable aux yeux de tous ceux qui voulaient maintenir l’unité du parti catholique, même si, parfois, ils entendaient l’infléchir vers une “voie italienne” (comme Nothomb avec son “Lion ailé”) ou vers un maritainisme plus à gauche sur l’échiquier politique, ouvert aux socialistes (notamment aux idées planistes de Henri De Man et pour mettre en selle des coalitions catholiques / socialistes) voire carrément aux idées marxistes (pour absorber une éventuelle contestation communiste). De l’équipe des éditions Rex, seuls Daye, Streel, Mignolet et Géradin resteront aux côtés de Degrelle : ils forment un parti concurrent, le parti rexiste qui remporte un formidable succès électoral en 1936, fragilisant du même coup l’épine dorsale de la Belgique d’après 1918, forgée lors des fameux accords de Lophem. Ceux-ci prévoyaient une démocratie réduite à une sorte de circuit fermé sur 3 formations politiques seulement : les catholiques, les libéraux et les socialistes, avec la bénédiction des “acteurs sociaux”, les syndicats et le patronat. Les Accords de Lophem ne prévoyaient aucune mutation politique, aucune irruption de nouveautés organisées dans l’enceinte des Chambres. Et voilà qu’en 1936, 3 partis, non prévus au programme de Lophem, entrent dans l’hémicycle du parlement : les nationalistes flamands du VNV, les rexistes et les communistes.
Toute innovation est assimilée à Rex et à la Collaboration
Les rexistes (en même temps que les nationalistes flamands et les communistes), en gagnant de nombreux sièges lors des élections de 1936, relativisent ipso facto les fameux accords de Lophem et fragilisent l’édifice étatique belge, dont les critères de fonctionnement avaient été définis à Lophem. Depuis lors, toute nouveauté, non prévue par les accords de Lophem, est assimilée à Rex ou au mouvement flamand. Fin des années 60 et lors des élections de 1970, des affiches anonymes, placardées dans tout Bruxelles, ne portaient qu’une seule mention : “FDF = REX”, alors que les préoccupations du parti de Lagasse n’avaient rien de commun avec celles du parti de Degrelle. Ce n’est pas le contenu idéologique qui compte, c’est le fait d’être simplement challengeur des accords de Lophem. Même scénario avec la Volksunie de Schiltz (qui, pour sauver son parti, fera son aggiornamento belgicain, lui permettant de se créer une niche nouvelle dans un scénario de Lophem à peine rénové). Et surtout même scénario dès 1991 avec le Vlaams Blok, assimilé non seulement à Rex mais à la collaboration et, partant, aux pires dérives prêtées au nazisme et au néo-nazisme, surtout par le cinéma américain et les élucubrations des intellectuels en chambre de la place de Paris.
Le choc provoqué par le rexisme entraîne également l’implosion du pilier catholique belge, jadis très puissant. Le voilà disloqué à jamais : une recomposition sur la double base de l’idéal d’action de Blondel (avec exigence éthique rigoureuse) et de l’idéal de justice sociale de Carton de Wiart et de l’Abbé Daens, s’est avérée impossible, en dépit des discours inlassablement répétés sur l’humanisme, le christianisme, les valeurs occidentales, la notion de justice sociale, la volonté d’être au “centre” (entre la gauche socialiste et la droite libérale), etc. Une telle recomposition, s’il elle avait été faite sur base de véritables valeurs et non sur des bricolages idéologiques à base de convictions plus sulpiciennes que chrétiennes, plus pharisiennes que mystiques, aurait permit de souder un bloc contre le libéralisme et contre toutes les formes, plus ou moins édulcorées ou plus ou moins radicales, de marxisme, un bloc qui aurait véritablement constitué un modèle européen et praticable de “Troisième Voie” dès le déclenchement de la guerre froide après le coup de Prague de 1948.
Cet idéal de “Troisième Voie”, avec des ingrédients plus aristotéliciens, grecs et romains, aurait pu épauler avec efficacité les tentatives ultérieures de Pierre Harmel, un ancien de l’ACJB, de rapprocher les petites puissances du Pacte de Varsovie et leurs homologues inféodées à l’OTAN (sur Harmel, lire : Vincent Dujardin, Pierre Harmel, Le Cri, Bruxelles, 2004). L’absence d’un pôle véritablement personnaliste (mais un personnalisme sans les aggiornamenti de Maritain et des personnalistes parisiens affectés d’un tropisme pro-communiste et craignant de subir les foudres du tandem Sartre-De Beauvoir) n’a pas permis de réaliser cette vision harmélienne d’une “Europe Totale” (probablement inspirée de Blondel, cf. supra), qui aurait parfaitement pu anticiper de 20 ans la “perestroïka” et la “glasnost” de Gorbatchev.
Une véritable implosion du bloc catholique
Le pilier catholique de l’après-guerre n’ose plus revendiquer expressis verbis un personnalisme éthique exigeant. Fragmenté, il erre entre plusieurs môles idéologiques contradictoires : celui d’un personnalisme devenu communisant avec l’UDB (où se retrouve un William Ugeux, ex-journaliste du Vingtième Siècle de l’Abbé Wallez, l’admirateur sans faille de Maurras et de Mussolini !), qui, après sa dissolution dans le désintérêt général, va générer toutes les variantes éphémères du “christianisme de gauche”, avec le MOC et en marge du MOC (Mouvement Ouvrier Chrétien) ; celui du technocratisme qui, comme toutes les autres formes de technocratisme, exclut la question des valeurs et de l’éthique de l’orbite politique et laisse libre cours à toutes les dérives du capitalisme et du libéralisme, provoquant à terme le passage de bon nombre d’anciens démocrates chrétiens du PSC, ceux qui confondent erronément “droite” et “libéralisme”, dans les rangs des PLP, PRL et MR libéraux ; le technocratisme fut d’abord importé en Belgique par Paul Van Zeeland, immédiatement dans la foulée de sa victoire contre Rex, lors des élections de 1937, provoquées par Degrelle qui espérait déclencher un nouveau raz-de-marée en faveur de son parti.
Van Zeeland avait besoin d’un justificatif idéologique en apparence neutre pour pouvoir diriger une coalition regroupant l’extrême-gauche communiste, les socialistes, les libéraux et les catholiques. Les avatars multiples du premier technocratisme zeelandien déboucheront, dans les années 90, sur la “plomberie” de Jean-Luc Dehaene, c’est-à-dire sur les bricolages politiciens et institutionnels, sur les expédiants de pure fabrication, menant d’abord à une Belgique sans personnalité aucune (et à une Flandre et à une Wallonie sans personnalité séduisante) puis sur une “absurdie”, un “Absurdistan”, tel que l’a décrit l’écrivain flamand Rik Vanwalleghem (cf. supra). Enfin, on a eu des formes populistes vulgaires dans les années 60 avec les “listes VDB” de Paul Van den Boeynants qui ont débouché au fil du temps dans le vaudeville, le stupre et la corruption. Autre résultat de la mise entre parenthèse des questions axiologiques ou éthiques...
De l’UDB au PSC et du PSC au CdH, l’évacuation de toutes les “valeurs” structurantes a été perpétrée parce que Degrelle avait justifié son “Coup de Courtrai”, son “Opération Balais” et ses éditoriaux au vitriol au nom de l’éthique, une éthique qu’il avait d’abord partagée avec bon nombre d’hommes politiques ou d’écrivains catholiques (qui ne deviendront ni rexistes ni collaborateurs). Toute référence à une éthique (catholique ou maritainiste au sens du premier Maritain) pourrait autoriser, chez les amateurs de théories du complot et les maniaques de l’amalgame, un rapprochement avec Rex, donc avec la collaboration, ce que l’on voulait éviter à tout prix, en même temps que les campagnes de presse diffamatoires, où l’adversaire est toujours, quoi qu’il fasse ou dise, un “fasciste”. Cette éthique pouvait certes indiquer une “proximité” avec Rex, sur le plan philosophique, mais non une identité, vu les différences notoires entre Rex et ses adversaires (catholiques) sur les réformes à promouvoir aux plans politique et institutionnel. Le fait que Degrelle ait justifié ses actions perturbantes de l’ordre établi à Lophem au nom d’une certaine éthique catholique, théorisée notamment par José Streel, qui lui ajoute des connotations populistes tirées de Péguy (“les petites et honnêtes gens”), n’exclut pas qu’un pays doit être structuré par une éthique née de son histoire, comme des auteurs aussi différents que Colin, Hommel, Streel, Libert, De Becker ou Bauchau l’ont réclamé dans les années 30.
En changeant de nom, le PSC devenu CdH (Centre démocrate et humaniste) optait pour un retour à l’universalisme gauchisant du dernier Maritain, s’ôtant par là même tout socle éthique et concret sous prétexte qu’on ne peut exiger de la rigueur au risque de froiser d’autres croyants ou des “incroyants” ; on se privait volontairement d’une éthique capable de redonner vigueur à la vie politique du royaume. L’idéologie vague du CdH, sans plus beaucoup de volonté affichée d’ancrage local en Wallonie et même sans plus aucun ancrage catholique visibilisé, laisse un pan (certes de plus en plus ténu en Wallonie mais qui se fortifie à Bruxelles grâce aux voix des immigrants subsahariens) de l’électorat ouvert à toutes les dérives du festivisme contemporain ou d’un utilitarisme libéral, néo-libéral et sans profondeur : la société marchande, la dictature des banquiers et des financiers, ne rencontre plus aucun obstacle dans l’intériorité même des citoyens. Cette fraction de l’électorat, que l’on juge, à tort, susceptible d’opposer un refus éthique, puisque “religieux” ou “humaniste”, à la dicature médiatique, festiviste et utilitariste dominante, est alors “neutralisé” et ne peut plus contribuer à redonner vigueur à la virtù de machiavélienne mémoire. De cette façon, on navigue de Charybde en Scylla. La spirale du déclin moral, physique et politique est en phase descendante et “catamorphique” sans remède apparent.
La théorie de Pitirim Sorokin pour théoriser la situation
Quel outil théorique pourrait-on utiliser pour saisir toute la problématique du catholicisme belge, où il y a eu d’abord exigence d’éthique dans le sillage du Cardinal Mercier, sous l’impulsion directe de celui-ci, puis déconstruction progressive de cette exigence éthique, après le paroxysme du début des années 30 (avec l’ouvrage de Monseigneur Picard, Le Christ-Roi, éd. Rex, Louvain, 1929). La condamnation de l’Action française par Rome en 1926, le remplacement de l’engouement pour l’Action Française par l’universalisme catholique de Maritain, qui deviendra vite vague et dépourvu de socle, la tentation personnaliste théorisée par Mounier, le choc du rexisme qui fait imploser le bloc catholique sont autant d’étapes dans cette recherche fébrile de nouveauté au cours des années 30 et 40.
Le sociologue russe blanc Pitirim Sorokin (1889-1968), émigré aux États-Unis après la révolution bolchevique, nous offre sans doute, à nos yeux, la meilleure clef interprétative pour comprendre ce double phénomène contradictoire d’exigence éthique, parfois véhémente, et de deconstruction frénétique de toute assise éthique, qui a travaillé le monde politico-culturel catholique de la Belgique entre 1884 et 1945 et même au-delà. P. Sorokin définit 3 types de mentalité à l’œuvre dans le monde, quand il s’agit de façonner les sociétés. Il y a la mentalité “ideational”, la mentalité “sensate” et la mentalité intermédiaire entre “ideational” et “sensate”, l’”idealistic”. Pour Sorokin, les hommes animés par la mentalité “ideational” sont mus par la foi, la mystique et/ou l’intuition. Ils créent les valeurs artistiques, esthétiques, suscitent le Beau par leurs actions. Certains sont ascètes. Ceux qui, en revanche, sont animés par la mentalité “sensate”, entendent dominer le monde matériel en usant d’artifices rationnels. Les “idealistic” détiennent des traits de caractère communs aux 2 types. La dynamique sociale repose sur la confrontation ou la coopération entre ces 3 types d’hommes, sur la disparition et le retour de ces types, selon des fluctuations que l’historien des idées ou de l’art doit repérer.
La civilisation grecque connaît ainsi une première phase “ideational” (quand émerge la “période axiale” selon Karl Jaspers ou Karen Armstrong), suivie d’une phase “idealistic” puis d’une phase de décadence “sensate”. De même, le Moyen Âge ouest-européen commence par une phase “ideational”, qui dure jusqu’au XIIe siècle, suivie d’une phase hybride de type “idealistic” et du commencement d’une nouvelle phase “sensate”, à partir de la fin du XVe siècle. Sorokin estimait que le début du XXe siècle était la phase terminale de la période “sensate” commencée fin du XVe siècle et qu’une nouvelle phase “ideational” était sur le point de faire irruption sur la scène mondiale. La vision du temps selon Sorokin n’est donc pas linéaire ; elle n’est pas davantage cyclique : elle est fluctuante et véhicule des valeurs toujours immortelles, toujours susceptibles de revenir à l’avant-plan, en dépit des retraits provisoires (le “withdrawal-and-return” de Toynbee), qui font croire à leur disparition. Une volonté bien présente dans un groupe d’hommes à la mentalité “ideational” peut faire revenir des valeurs non matérielles à la surface et amorcer ainsi une nouvelle période féconde dans l’histoire d’une civilisation (cf. Prof. Dr. S. Hofstra, « Pitirim Sorokin », in : Hoofdfiguren uit de sociologie, deel 1, Het Spectrum, coll. “Aula”, nr. 527, Utrecht / Antwerpen, 1974, pp. 202-220).
De l’”ideational” au “sensate”
La phase “ideational” est celle qui recèle encore la virtus politique romaine, ou la virtù selon Machiavel. Elle correspond au sentiment religieux de nos auteurs catholiques (rexisants ou non) et à leur volonté d’œuvrer au Beau et au Bien. Face à ceux-ci, les détenteurs de la mentalité “sensate” qui, dans une première phase, sont matérialistes ou technocratistes ; ils ne jugent pas la recherche du profit comme moralement indéfendable ; ils seront suivis par des “sensate” encore plus radicaux dans le sillage de mai 68 et du festivisme qui en découle puis dans la vague néo-libérale qui a conduit l’Europe à la ruine, surtout depuis l’automne 2008. Le bloc catholique en liquéfaction dans le paysage politique belge a d’abord été animé par une frange jeune, nettement perceptible comme “ideational”, une frange au sein de laquelle émergera un conflit virulent, celui qui opposera les adeptes et les adversaires de Rex.
Au départ, ces 2 factions “ideational” partageaient les mêmes aspirations éthiques et les mêmes vues politiques (renforcement de l’exécutif, etc.) : les uns feront des compromis avec les tenants des idéologies “sensate” pour ne pas être marginalisés ; les autres refuseront tout compromis et seront effectivement marginalisés. Les premiers se forceront à oublier leur passé “ideational” pour ne pas être confondus avec les seconds. Ces derniers seront mis au ban de la société après la défaite de l’Allemagne en 1945 et des mesures d’ordre judiciaire les empêcheront de s’exprimer aux tribunes habituelles d’une société démocratique (journalisme, enseignement, etc.). Toute forme d’expression politique de nature “ideational” sera réellement ou potentiellement assimilée à Rex (et à la collaboration). C’est ce que C. Vanderpelen-Diagre veut dire quand elle dit que les valeurs véhiculées par ces auteurs catholiques, les scriptores catholici, « ont déserté la mémoire collective ». On les a plutôt exilé de la mémoire collective...
Sa collègue de l’ULB, Bibiane Fréché, évoque, elle, l’émergence dans l’immédiat après-guerre d’une « littérature sous surveillance », bien encadrée par les institutions étatiques qui procurent subsides (souvent chiches) et sinécures à ceux qui veulent bien s’aligner en « ignorant le présent », « en se détachant des choses qui passent », bref en ne prenant jamais parti pour un mouvement social ou politique. On préconise la naissance d’une nouvelle littérature post-rexiste ou post-collaborationniste, et aussi post-communiste, qui serait détachée des réalités socio-politiques concrètes, des engagements tels qu’ils sont exaltés par les existentialistes français : bref, la littérature ne doit pas aider à créer les conditions d’une contestation des accords de Lophem. Il y a donc bien eu une tentative d’aligner la littérature sur des canons “gérables”, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale (Bibiane Fréché, Littérature et société en Belgique francophone (1944-1960), Le Cri / CIEL-ULB-Ulg, Bruxelles, 2009). L’implosion du bloc catholique suite à la victoire de Rex en 1936 et la volonté de “normaliser” la littérature après 1945 créent une situation particulière, un blocage, qui empêche la restauration du politique au départ de toute initiative métapolitique. Les verrous ont été mis.
Quand un homme comme le Sénateur MR de Bruxelles, Alain Destexhe, entend, dans plusieurs de ses livres, “restaurer le politique” contre la déliquescence politicienne, il exprime un vœu impossible dans le climat actuel, héritier de cet envahissement du “sensate”, de cette inquisition répressive des auditorats militaires de l’après-guerre et de la volonté permanente et vigilante de “normalisation” voulue par les nouveaux pouvoirs : on ne peut restaurer ni le politique (au sens où l’entendaient Carl Schmitt et Julien Freund) ni la force dynamisante de la virtù selon Machiavel, sans recours à l’ “ideational” fondateur de valeurs qui puise ses forces dans le plus lointain passé, celui des périodes axiales de l’histoire (Jaspers, Armstrong). Pour revenir à Sorokin, la transition subie par la Belgique au cours du XXe siècle est celle qui l’a fait passer brutalement d’une période pétrie de valeurs “ideational” à une période entièrement dominée par les non valeurs “sensate”.
La réhabilitation tardive de Raymond De Becker
La récente réhabilitation de R. De Becker par les universités belges, exprimée par un long colloque de 3 jours au début avril 2012 dans les locaux des Facultés Universitaires Saint Louis de Bruxelles, est une chose dont il faut se féliciter car De Becker a d’abord été totalement ostracisé depuis sa condamnation à mort en 1946 suivie de sa grâce, sa longue détention sur la paille humide des cachots et le procès qu’il a intenté à l’État belge en 1954 et qu’il a gagné. Il est incontestablement l’homme qu’il ne fallait plus ni évoquer ni citer pour “chasser de la mémoire collective” une époque dont beaucoup refusaient de se souvenir. La fidélité que lui a conservée Bauchau a sans doute été fort précieuse pour décider le monde académique à réouvrir le dossier de cet homme-orchestre unique en son genre. L’intérêt intellectuel qu’il y avait à réhabiliter complètement De Becker vient justement de sa nature d’”électron libre” et de “passeur” qui allait et venait d’un cénacle à l’autre, correspondait avec d’innombrables homologues et surtout avec Jacques Maritain.
Cécile Vanderpelen-Diagre, dans un ouvrage rédigé avec le Professeur Paul Aron (Vérités et mensonges de la collaboration, éd. Labor, Loverval, 2006 ; sur De Becker, lire les pp. 13-36) souligne bien cette qualité d’homme-orchestre de De Becker et surtout l’importance de son ouvrage Le livre des vivants et des morts, où il retrace son itinéraire intellectuel (jusqu’en 1941). Elle reproche à De Becker, qui n’avait jamais été germanophile avant 1940-41, de s’octroyer dans cet ouvrage une certaine germanophilie dans l’air du temps. Ce reproche est sans nul doute fondé. Mais l’historienne des idées semble oublier que la conversion, somme toute assez superficielle, de De Becker à un certain germanisme (organique et charnel) vient de l’écrivain catholique Gustave Thibon, inspirateur de Jean Giono, qui avait rédigé sa thèse sur le philosophe païen et vitaliste Ludwig Klages, animateur en vue de la Bohème munichoise de Schwabing au début du siècle puis exilé en Suisse sous le national-socialisme mais inspirateur de certains protagonistes du mouvement anti-intellectualiste völkisch (folciste), dont certains s’étaient ralliés au nouveau régime.
Ubiquité de De Becker : personnalisme, socialisme demaniste + “Le Rouge et le Noir”
Vu l’ubiquité de De Becker dans le paysage intellectuel des années 30 en Belgique comme en France, et vu ses sympathies pour le socialisme éthique de Henri De Man, il est impossible de ne pas inclure, dans nos réflexions sur le devenir de notre espace politique, l’histoire des idées socialistes, notamment après analyse de l’ouvrage récent d’Eva Schandevyl, professeur à la VUB, qui vient de consacrer un volume particulièrement dense et bien charpenté sur l’histoire des gauches belges : Tussen revolutie en conformisme – Het engagement en de netwerken van linkse intellectuelen in België, 1918-1956 (ASP, Bruxelles, 2011). Sans omettre non plus l’histoire du mouvement et de la revue Le Rouge et le Noir, organe et tribune anarchiste-humaniste avant-guerre, dont l’un des protagonistes, Gabriel Figeys (alias Mil Zankin), se retrouvera sous l’occupation aux côtés de Louis Carette (le futur Félicien Marceau) à l’Institut National de Radiodiffusion (INR) et dont l’animateur principal, Pierre Fontaine, se retrouvera à la tête du seul hebdomadaire de droite anti-communiste après la guerre, l’Europe-Magazine (avant la reprise de ce titre par Émile Lecerf).
Les aléas du Rouge et Noir sont très bien décrits dans l’ouvrage de Jean-François Füeg (Le Rouge et le Noir : La tribune bruxelloise non-conformiste des années 30, Quorum, Ottignies / Louvain-la-Neuve, 1995). Füeg, professeur à l’ULB, montre très bien comment l’anti-communisme des libertaires non-conformistes, né comme celui d’Orwell dans le sillage de l’affontement entre anarcho-syndicalistes ibériques et communistes à Barcelone pendant la guerre civile espagnole, comment le neutralisme pacifiste des animateurs du Rouge et Noir a fini par accepter la politique royale de rupture de l’alliance privilégiée avec une France posée comme indécrottablement belliciste et première responsable des éventuelles guerres futures (Koestler mentionne cette attitude pour la critiquer dans ses mémoires), ce qui conduira, très logiquement, après l’effondrement de la structure que constituait “le rouge et le noir”, à redessiner, pendant la guerre et dans les années qui l’ont immédiatement suivie, un paysage intellectuel politisé très différent de celui des pays voisins. La lecture de ces itinéraires interdit toute lecture binaire de notre paysage intellectuel tel qu’il s’est déployé au cours du XXe siècle. Ce que nous avions toujours préconisé depuis la toute première conférence de l’EROE sur Henri De Man en septembre 1983, en présence de témoins directs, aujourd’hui tous décédés, tels Léo Moulin, Jean Vermeire (du Vingtième Siècle et puis du Pays Réel) et Edgard Delvo (sur Delvo, lire : Frans Van Campenhout, Edgard Delvo – Van marxist en demanist naar Vlaams-nationalist, chez l’auteur, Dilbeek, 2003 ; l’auteur est un spécialiste du mouvement “daensiste”).
Au-delà du clivage gauche/droite
Nos initiatives ont toujours voulu transcender le clivage gauche/droite, notamment en incluant dans nos réflexions les critiques précoces du néo-libéralisme par les auteurs des éditions “La Découverte” qui préconisaient le “régulationnisme”. C’était Ange Sampieru qui se faisait à l’époque le relais entre notre rédaction et l’éditeur parisien de gauche, tout en essuyant les critiques ineptes et les sabotages irrationnels d’un personnage tout à la fois bouffon et malfaisant, l’inénarrable et narcissique Alain de Benoist, qui s’empressera de se placer, 2 ou 3 ans plus tard, dans le sillage de Sampieru, qu’il ignorera par haine jalouse et complexe d’infériorité et qu’il évincera avant de l’imiter. Le “Pape de la ‘nouvelle droite’” ira flatter de manière ridiculemernt obséquieuse les animateurs du MAUSS (Mouvement Anti-Utilitariste dans les Sciences Sociales), qui publiaient chez “la Découverte”, pour essuyer finalement, sur un ton goguenard, une fin de non recevoir et glâner une “lettre ouverte” moqueuse et bien tournée... Notre lecture de Nietzsche était également tributaire de ce refus, dans la mesure où nous n’avons jamais voulu le lire du seul point de vue de “droite” et que nous avons toujours inclu dans nos réflexions l’histoire de sa réception à gauche des échiquiers politiques, surtout en Allemagne.
Quant au catholicisme politique belge, il s’est suicidé et perpétue son suicide en basculant toujours davantage dans les fanges les plus écœurantes du festivisme (Milquet) ou de la corruption banksterienne (Dehaene), au nom d’une très hypothétique “efficacité politique” ou par veulerie électoraliste. Il est évident qu’il ne nous attirera plus, comme il ne nous a d’ailleurs jamais attiré. Il n’empêche que la Belgique, de même qu’une Flandre éventuellement indépendante et que la Wallonie, est le produit de la reconquête des Pays-Bas par les armées de Farnèse et de la Contre-Réforme, comme le disait déjà avant guerre le Professeur louvaniste Léon van der Essen et que cette reconquête est celle des iconodules pré-baroques qui reprennent le contrôle du pays après les exactions des iconoclastes, qui avaient ravagé le pays en 1566 (3) : un Martin Mosebach, étoile de la littérature allemande contemporaine, dirait qu’il s’agit d’une victoire de la forme sur la “Formlosigkeit”, tout comme l’installation des “sensate” dans les rouages de la politique et de l’État est, au contraire, une victoire de la “Formlosigkeit” sur les formes qu’avaient voulu sauver les “ideational” ou gentiment maintenir les “idealistic”.
Même si la foi a disparu sous les assauts du relativisme postmoderne ou par épuisement, 2 choses demeurent : le territoire sur lequel nous vivons est une part détachée de l’ancien Saint-Empire, dont la référence était catholique, et la philosophie qui doit nous animer est surtout, même chez les adversaires de Philippe II ralliés au Prince d’Orange ou à Marnix de Sainte-Aldegonde, celle d’Érasme, très liée à l’antiquité et très marquée par le meilleur des humanismes renaissancistes. Érasme n’a pas rejoint le camp de la Réforme non pas pour des raisons religieuses, mais parce qu’un retour au biblisme le plus littéral, hostile au recours de la Renaissance à l’Antiquité, le révulsait et suscitait ses moqueries : autre volonté sereine de maintenir les formes antiques, née à la période axiale de l’histoire et ravivée sous Auguste, contre la “Formlosigkeit” que constitue les autres formes, importées ou non. Nous devons donc rester, devant cet héritage du XXe siècle et devant les ruines qu’il a laissés, des érasmiens impériaux, bien conscients de la folie des hommes.
► Robert Steuckers (Forest-Flotzenberg, mai 2012).
Notes :
(1) Paul Desjardins inaugure un filon de la pensée qui apaise et fortifie les esprits tout à la fois. Dreyfusard au moment de l’”affaire”, il achète en 1906 l’Abbaye de Pontigny confisquée et vendue suite aux mesures du “P’tit Père Combes”. Dans cette vénérable bâtisse, il crée les Décades de Pontigny, périodes de chaque fois 10 jours de séminaires sur un thème donné. Elles commencent avant la Première Guerre mondiale et reprennent en 1922. Parallèlement à ces activités qui se tenaient dans le département de l’Yonne, P. Desjardins suit les Cours universitaires de Davos, en Suisse, où, de 1928 à 1931, des intellectuels français et allemands, flanqués d’homologues venus d’autres pays, se rencontreront en terrain neutre. En 1929, Heidegger, Gonzague de Reynold, Ernst Cassirer et le théologien catholique et folciste (völkisch) Erich Przywara y participent en tant que conférenciers. Parmi les étudiants invités, il y avait Norbert Elias, Karl Mannheim, Emmanuel Lévinas, Léo Strauss et Rudolf Carnap. L’axe des réflexions des congressistes est l’anti-totalitarisme. En 1930, on y trouve Henri De Man et Alfred Weber (le frère trop peu connu en dehors d’Allemagne de Max Weber, décédé en 1920). En 1931, on y retrouve l’Italien Guido Bartolotto, théoricien de la notion de “peuple jeune”, Marcel Déat, Hans Freyer et Ernst Michel (disciple de Carl Schmitt). On peut comparer mutatis mutandis ces activités intellectuelles de très haut niveau au projet lancé à l’époque par Karl Jaspers, visant à établir l’état intellectuel de la nation (allemande) dans une perspective pluraliste et constructive, initiative que Jürgen Habermas tentera, à sa façon, d’imiter à l’aube des années 80 du XXe siècle. P. Desjardins collabore également à la Revue politique et littéraire, plus connue sous le nom de Revue Bleue, vu la couleur de sa couverture. Sa fille Anne Desjardins, épouse Heurgon, poursuit l’œuvre de son père mais vend l’Abbaye de Pontigny pour acheter des locaux à Cerisy-la-Salle, où se tiendront de nombreux colloques philosophico-politiques.
Plus tard, surgit sur la scène française un auteur, apparemment sans lien de parenté avec P. Desjardins, qui porte le même patronyme, Arnaud Desjardins (1925-2011). Ce disciple de Gurdjieff, comme le sera aussi Louis Pauwels qui s’assurera pour Planète le concours de Raymond De Becker, influence également De Becker (et par le truchement de De Becker, Hergé) et infléchit les réflexions de ses lecteurs en direction du yoga et de la spiritualité indienne, dans le sillage de Swâmi Prâjnanpad. Son ouvrage Chemins de la sagesse influencera un grand nombre d’Occidentaux friands d’un “ailleurs” parce que leur civilisation, sombrant dans le matérialisme et la frénésie acquisitive, ne les satisfaisait plus. A. Desjardins participera à plusieurs expéditions, en minibus Volkswagen, en Afghanistan, dont il rapportera, à l’époque, des reportages cinématographiques époustouflants. Signalons également qu’A. Desjardins fut un animateur en vue du mouvement scout, auquel il voulait insuffler une vigueur nouvelle, plus aventureuse et plus friande de grands voyages, à la façon des Nerother allemands. Le scoutisme d’A. Desjardins participera à la résistance, notamment en facilitant l’évasion de personnes cherchant à fuir l’Europe contrôlée par l’Axe.
Le fils d’Arnaud, Emmanuel Desjardins, prend le relais, œuvre actuellement, et a notamment publié Prendre soin du monde – Survivre à l’effondrement des illusions (éd. Alphée / Jean-Paul Bernard, Monaco, 2009), où il dresse le bilan de la « crise du paradigme du progrès » inaugurant le « règne de l’illusion » suite au « déni du réel » et de la « dénégation du tragique ». Il analyse de manière critique l’”intransigeance idéaliste” (à laquelle un De Becker, par ex., avoue avoir succombé). E. Desjardins tente d’esquisser l’émergence d’un nouveau paradigme, où il faudra avoir le « sens du long terme » et « agir dans la complexité ». Il place ses espoirs dans une écologie politique bien comprise et dans la capacité des êtres de qualité à « se changer eux-mêmes » (par une certaine ascèse). Enfin, E. Desjardins appelle les hommes à « retrouver du sens au cœur du tragique » (donc du réel) en « renonçant au confort idéologique » et en « prenant de la hauteur ».
La trajectoire cohérente des 3 générations Desjardins est peut-être le véritable filon idéologique que cherchaient en tâtonnant, et dans une fébrilité “pré-zen”, ceux de nos rêveurs qui cherchaient une “troisième voie” spiritualisée et politique (qui devait spiritualiser la politique), surtout De Becker et Bauchau, dont les dernières parties du journal, édité par “Actes Sud”, recèlent d’innombrables questionnements mystiques, autour de Maître Eckart notamment. Hergé, très influencé par De Becker en toutes questions spirituelles, surtout le De Becker d’après-guerre, avait reconnu sa dette à l’endroit d’Arnaud Desjardins dans un article intitulé « Mes lectures » et reproduit 23 ans après sa mort dans un numéro spécial du Vif-L’Express et de Lire – Hors-Série, 12 déc. 2006. Hergé insiste surtout sur l’œuvre de Carl Gustav Jung et sur les travaux d’Alan Wilson Watts (1915-1973), ami d’A. Desjardins. Alan Watts est considéré comme le père d’une certaine “contre-culture” des années 50, 60 et 70, qui puise son inspiration dans les philosophies orientales.
(2) Sur Sulev J. Kaja, lire : Michel Fincœur, Sulev J. Kaja, un Estonien de cœur.
(3) Lire : Solange Deyon et Alain Lottin, Les casseurs de l’été 1566 : l’iconoclasme dans le Nord de la France, Hachette, 1981.
00:06 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, belgique, belgicana, wallonie, catholicisme, littérature, lettres, littérature belge, lettres belges, années 20, années 30, années 40, léon degrelle, raymon de becker, pierre nothomb, henri carton de wiart, rexisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 11 juin 2012
PORTRAIT PSYCHOLOGIQUE DES “BABA COOLS”
 PORTRAIT PSYCHOLOGIQUE DES “BABA COOLS”
PORTRAIT PSYCHOLOGIQUE DES “BABA COOLS”
Je confesse avoir commis une négligence, avoir laissé moisir pendant 5 ans un excellent livre dans un coin sombre de la petite bibliothèque qui se dresse à mon chevet. Ce livre est l'œuvre de Matthias Horx (né à Düsseldorf en 1955), chroniqueur à Pflasterstrand, Tempo et Die Zeit, auteur de 2 ouvrages de science-fiction et de 2 critiques des engouements contemporains (ceux des alternatifs et ceux des “battants” reagano-thatchériens du début des années 80). Son titre ? Aufstand im Schlaraffenland (Révolte au pays de cocagne). C'est une sorte de biographie politique et culturelle d'une génération d'enfants gâtés, la première génération du siècle qui n'a pas été confrontée à une grande guerre et qui n'avait qu'un souci, fort fébrile : expérimenter du neuf, être contre tout, rêver d'un trip à la marijuana ou d'une passe exaltante, comme dans les manuels de sexualité avancée, mais qui n'est évidemment jamais venue. Horx :
« Si nous sommes honnêtes, nous devons confesser que nous étions tout de même des privilégiés. Enfants, nous avons encore vécu dans de petites familles intactes, dans le contexte d'un progrès ininterrompu et c'est avec cet arrière-plan finalement solide que nous avons expérimenté la révolution tout en grandissant, alors que les utopies, promettant une “autre vie” ; n'avaient pas encore été tentées et n'avaient pas encore déçu ; à l'époque, existait encore bel et bien un “système” que l'on pouvait critiquer radicalement, pour de bonnes raisons. Nous, garçons et filles d'une génération qui, comme aucune autre, a cherché l’ALTERNATIVE, le HORS-NORMES, n'avons, en fin de compte qu'accélérer un processus que cette société, que nous faisions mine de haïr, a “normalisé”. Car notre révolte, avec ses rêves à la fois fous et comiques, ses prétentions ridicules, ses appels emphatiques à l'émancipation totale, n'a finalement contribué qu'à maintenir à flot la modernité dans la société. En empruntant les chemins de détour du fondamentalisme le plus bizarre, elle a fait en sorte que l'héritage de nos pères, c'est-à-dire un pays un peu figé, encore marqué par notre passé pré-démocratique mais où le miracle économique a été possible, soit devenu le chaos actuel. La démocratie de nos pères était imparfaite : elle était encore en chantier, mais ce chantier n'était pas le plus mauvais du monde ».
Ensuite, Matthias Horx croque avec cruauté et à propos les 11 principaux défauts du fondamentaliste soixante-huitard :
1. La rouspétance idéologique.
Elle a pris des proportions insoupçonnées. Indice quotidien de cette maladie : le courrier des lecteurs des journaux de la “gauche branchée” : « Si X écrit encore des articles dans votre journal, je me désabonne sur le champ ». La menace : je vous retire mon amour. Règne des positionnements binaires : l'homme (nous) et les cochons (les autres, les vieux cons, les beaufs et les inévitables fachos), l'État (policier, bien sûr) et la Résistance (nous), le Bien et le Mal. Sur la persistance de ces agrégats, il est impossible de bâtir un corpus idéologique pragmatique, donc le seul exercice que peuvent encore pratiquer ces messieurs-dames, conclut Horx, c'est la dénonciation. On pense à messires Monzat, Soudais, Olender, Grodent, Brewaeys, Duplat et à d'autres reliques inamovibles du sous-journalisme contemporain.
2. La régression permanente.
Dans les résidus du soixante-huitardisme allemand, le vocabulaire infantile fait recette : « Mon nounours adoré, Ta petite souris te salue, te fait un bisou, Je t'aime mon gros Lapinos, etc. ». Horx a repéré cette phraséologie dans le courrier des lecteurs du TAZ berlinois, organe par excellence de ce public infantilisé. Les petits couples, né sur les campus, d'intellos branchés sur les idées abstraites et déconnectés du réel charnu ou âpre, rugueux ou enflammé, sont aujourd'hui bien fânés, affectés de vilains embonpoints, aiment les autocollants pour orner l'arrière de leur Golf orange : les plus prisés sont ceux avec un gros matou yankee fatigué : Garfield. Symptomatique. D'un rousseauisme non individualiste, ajoute Horx, posant comme acquis que nous serions tous des “copains solidaires”, si la société ne nous avait pas pervertis, n'avait pas cassé nos réflexes communautaires. L'axiome de cette démarche, c'est que les conflits sociaux ne surviennent qu'à cause des institutions (État, justice, etc.). Mais le temps a prouvé que même (et surtout) dans les “communes alternatives”, les “communautés de squatters”, les “groupes de base”, inimitiés, jalousies, incompatibilités d'humeur, luttes pour la conquête sexuelle, étaient le lot quotidien. Les recours artificiels à des “communautés”, sectes détachées des flux réels de l'existence, conduit à des chamailleries à l'infini. En dehors de la famille réelle, des liens de sang, il n'y a pas de communauté idéale possible. Les imitateurs droitiers de ce régressisme de 68 (où la psychologie est la même que dans cette gauche infantilisée, mais où seul varient discours et références) tombent dans les mêmes travers, comme le souligne par ailleurs le philosophe allemand Günter Maschke, issu des agitateurs du SDS gauchiste pour déboucher aujourd'hui dans le “schmittisme” contre-révolutionnaire : la lecture rapide et impréparée, a-critique, de Nietzsche entraîne souvent, si elle est concomitante à celle des aventures d'Astérix, vers un imaginaire néo-païen qui reconstitue inconsciemment le petit village d'Armorique, protégé des agressions du monde extérieur par la potion magique d'un discours jugé “vrai et pur”, baptisé “nos idées” (à prononcer avec trémolos dans la voix). Aux fermes biologiques des gauchistes devenus “verts” correspondent certaines demeures “communautaires” avec pierre solaire ou menhir, où quinquagénaires bedonnants et adolescents boutonneux dansent en rond, au coucher du soleil, en évoquant les Gaulois, les Vikings ou la Hitlerjugend. À gauche comme à droite, en dépit des “façons de parler” idéologiques, en dépit des poses que l'on prend, on est finalement fils d'une même époque, enfants gâtés d'une même civilisation de la consommation, où s'estompe le sens du réel et des responsabilités, au profit d'esthétismes inféconds et d'utopies niaises (cf. G.Maschke, « Kraut & Rüben : Vorletzte Lockerungen », in Etappe, 3, 1989, p.136).
3. Se complaire dans les (auto)applaudissements.
Toutes les réunions sont ponctuées d'applaudissements, comme les messes de jadis étaient ponctuées d'amen. L'ouvrier qui a basculé dans le chômage et qui s'égare dans ces poulaillers pour lever timidement le doigt et demander au public de retomber à pieds joints dans le concret est applaudi. Ses contradicteurs du podium qui lui reprochent sa naïveté, de ne pas comprendre les mécanismes subtils de l'aliénation, sont également applaudis. Les rituels sont immuables : désigner l'ennemi, prononcer une blague amère sur Helmut Kohl, critiquer les flics, entrelarder le tout d'appels au concret jamais suivis d'effets.
4. La pensée d'un camp retranché.
Toute question doit être éludée si elle ne conforte pas les certitudes du groupe, de la “gauche” comme “camp mythique” : toute démarche critique, tout apport de paramètres nouveaux sont exclus. Il est interdit de penser ce qui peut relativiser les certitudes. Risque : l'ensemble du corpus doctrinal perdra toute crédibilité sur le long terme, parce que toute innovation, tout écart, sont soustraits au discours, à la discussion, réduisant par là même le corpus à un jeu de coquilles vides : celui qui voit dans l'adversaire, ou dans l'esprit critique de son propre camp, un “mauvais” ou un “traître” finira par perdre la bataille. Rigidifiée, pétrifiée, la doctrine ne travaille ni n'absorbe plus de substance et ne peut pas faire face à l'adversaire qui, ignorant les interdits de langage, récupère cette substance, la travaille et l'instrumentalise.
5. Un besoin et une nostalgie d'identification.
Il faut s'identifier à quelque chose, à un camp, à un petit groupe replié sur lui-même, jouissant de l'infaillibilité, fermé à tout compromis. Survient la moindre contrariété, le camp n'offrant plus la perfection tant attendue et espérée, ne correspondant plus à 100% à l'idée, le militant, rigoriste, migre vers une nouvelle “totalité”, où il croit pouvoir s'investir à fond, réaliser son fantasme à 100%. Ces militants-fantasmeurs, ces fanas du 100%, s'avèrent vite inintéressants : leurs images du monde ne tolèrent plus de contradictions fécondes.
6. Tout savoir.
Croire qu'on sait tout, qu'on est détenteur d'une infaillible Besserwisserei. Le militant de la commune sait tout : comment on règle la politique extérieure du Zimbabwe, la politique économique du Cuba de Castro, les négociations américano-soviétiques sur la réduction des missiles nucléaires balistiques, comment on met une pièce de Brecht en scène, on joue le rôle de modérateur dans un talkshow. Ce savoir implicite du sectaire ou du gourou, expert universel, est bien entendu pourvu de toutes les qualités, sauf une : la curiosité. Plus besoin de chercher, on sait déjà tout, on a des recettes pour tout. Affirmer joyeusement ses propres vérités peut être fécond, à la condition, ajoute Horx, que l'on garde une distance critique.
7. La nostalgie.
Les activistes d'hier se sont calmés. Ils sont rassis. Mais ils croient toujours aux phrases qu'ils ont hurlées dans les manifs ou aux oreilles de leurs contradicteurs, musclés ou ironiques. Toutes les sous-cultures, de gauche comme de droite, réagissent à des chiffres, signes et symboles, à des petits dessins connus, des lettrages complices, à des petites faucilles et croix, à des marteaux soviétiques ou de Thor, etc. La réalité, hyper-complexe, que ces malheureux militants sont incapables de saisir, cette réalité qui fait peur, cette réalité que l'on doit malgré tout affronter quand on quitte papa et maman, son ours en peluche ou sa petite armée de soldats Airfix qui ne peut prendre aucun palais d'hiver, ne délivrer aucun Stalingrad, ne sauter sur aucun Diên Biên Phu, est réduite à des dénominateurs communs forts simples. À gauche, les termes “solidarité”, “révolution”, “émancipation”, etc., sont investis d'une aura positive : il suffit de les évoquer, même furtivement, pour que les circonstances désignées sous l'un ou l'autre de ces labels soient d'office considérées comme “positives”. Ainsi, la “révolution iranienne” est restée longtemps une “chose finalement positive” pour les tenants de l'idéologie de 68, qui pourtant, selon leur propre logique, devaient refuser toute forme d'autoritarisme religieux. Horx cite l'ambivalence des discours de gauche sur l'Iran (“Chah t'Iran”), sur le port du tchador (symbole d'anti-impérialisme), sur les nationalismes basque et irlandais (pourtant bel et bien farouchement identitaires), sur la corruption de la junte révolutionnaire nicaraguéenne, etc. La nostalgie d'une “bonne révolution”, non encore advenue, se retrouve dans les jugements sur les révolutions réelles, qui ont utilisé, pour briser les résistances des régimes en place, des argumentaires non progressistes, archétypaux, religieux (opium du peuple ?), théocratiques, nationalistes, mythologiques, etc. Sans de tels agrégats et résidus, aucune foule ne peut être activée, aucun bouleversement violent n'est possible. Le progressisme n'est donc pas bon pour la révolution : il l'inhibe. Constat qui aurait dû forcer les soixante-huitards à davantage de scepticisme.
8. Le statut de victime.
La sempiternelle et aveugle glorification des “petits et des justes" conduit à un culte de l'échec. Le militant, que Horx nomme le Politfreak, a connu tant de révolutions qui, au lieu d'apporter libération et émancipation, ont mis en place des régimes durs, policiers et obscurantistes, qu'il en vient à croire que les vaincus seuls restent purs. Sentiment que partagent désormais droites post-collaborationnistes et gauches post-modernes. Il vaut dès lors mieux demeurer victime des circonstances, rester un opprimé que de se rendre complice d'un activisme qui trahit l'idée, l'utopie. Ce sentiment d'impuissance se transpose dans la vie quotidienne : je trouve pas d'appart' ? C'est la faute à la société ; pas de boulot... ? Toujours cette foutue société... J'peux plus parler à France-Culture ? C'est la société d'exclusion qui m'exclut, moi, le génie tant attendu, l'infaillible d'entre les infaillibles...
9. L'envie sociale.
Certains soixante-huitards ont réussi : dans la publicité, dans le dessin, dans la création culturelle. Cette réussite a généralement exigé beaucoup de travail, d'abnégation : mais les vieilles règles du labeur acharné paient toujours. Malheur à ces battants ! Leurs camarades-victimes leur en veulent à mort, leur reprochent leur petite Golf, leur appartement, leur vacances. Mais la pauvreté de ces jaloux n'est pas pauvreté réelle, explique Horx, c'est une pauvreté “idéologisée”, artificielle : le jaloux qui feint de haïr l'argent est en réalité obnubilé par l'argent. Il en veut, et il veut du luxe, mais sans efforts, pour récompenser son génie, même si celui-ci n'est producteur de rien. La conjugaison de ces désirs et de cette paresse le conduit dans l'ornière de l'incompatibilité sociale. Le marginal de ce type, plus que le capitaliste, fait de l'argent la mesure de toutes choses.
10. Le mélange des genres.
Le soixante-huitard G., pas plus doué qu'un autre, parvient à gérer ses salles de cinéma. Il distingue la sphère privée de la sphère professionnelle. Sa copine K. ne parvient pas à faire tourner sa petite boutique alternative : mais elle engage des copains, se fournit chez d'autres camarades, paie des salaires que ne peut rapporter l'entreprise, etc. Elle mélange politique et privé, entreprise et copinage, idéologie et réalité. Ces pratiques conduisent à des bricolages inimaginables, à de la corruption, à une dictature des paramètres psycho-affectifs. Une quantité inutile de grains de sable s'infiltre dans les rouages de la machine, des intérêts qui ne sont pas rationnellement définissables, et que personne d'extérieur n'est à même de comprendre, bloquent le bon fonctionnement de l'entreprise ou de l'appareil.
11. L'exagération obligatoire.
Les exagérations de la scène 68arde sont bien connues : en France, une Claire Brétecher et un Lauzier les ont croquées avec une causticité aussi vraie que pertinente. Quand la police ouest-allemande recherchait la bande à Baader, c'était le fascisme qui revenait, la peste brune qui se réinstallait ; quand le gouvernement organise un recensement, il met un terme à la démocratie ; etc. Ces métaphores didactiques avaient, aux yeux de ceux qui les ont employées pour la première fois, une valeur “éducative”. Faire réfléchir, montrer les déviances possibles, nuancer, contraindre à plus de modération, etc., au départ d'une description volontairement caricaturale, sont des pratiques rhétoriques très anciennes : le problème, c'est que la génération 68 a pris les figures de style, les métaphores, pour des réalités bien tangibles. Et les a transposées dans la vie quotidienne privée, affective, politique. On a commencé à parler d'“exploitation émotionnelle” dans le ménage, de “fonctionnalisation” dans le travail militant au sein même du projet alternatif, etc. Ce soupçon permanent, qui voit en tout une simple façade masquant une exploitation ou une tromperie, conduit à tout examiner, tout retourner, tout décortiquer, pour trouver, en bout de course, quelque chose de fondamentalement pourri, mauvais, pervers. La conséquence de cette méfiance quasi pathologique, paranoïaque, c'est l'incapacité à nouer des relations normales avec des hommes et des femmes d'un autre parti, d'un autre bord, avec d'autres catégories professionnelles, plus axées sur la technique, plus focalisées sur des critères pragmatiques, à accepter les goûts d'autrui, pire, dans les cas extrêmes, à n'être plus capable de nouer des relations humaines normales. Fatalité : l'exagérateur a toujours raison: il est vrai que l'amour, le couple, recèlent toujours, quelque part, une forme ou une autre de dépendance, que la vie de groupe implique toujours une dose d'exploitation réciproque. Mais le soupçon incessant, la volonté constante de dénoncer l'exploitation larvée, le défaut caché, l'immoralité occultée, conduit au néant social, au solipsisme. Le jusqu'auboutisme du processus de dénonciation conduit à des problématisations ad infinitum. La vie ne peut se déployer que si l'on refuse ces problématisations inutiles. Si on est capable de “laisser tomber”... Horx : « Cela, justement, nous l'avons très mal appris ».
◘ Matthias Horx, Aufstand im Schlaraffenland. Selbsterkenntnisse einer rebellischen Generation, Carl Hanser Verlag, München, 1989, 216 p.
► Robert Steuckers, Nouvelles de Synergies Européennes n°6, 1994.
00:05 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, moeurs contemporains, nouvelle droite, synergies européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 01 juin 2012
Guillaume Faye’s Why We Fight
The Rectification of Names:
Guillaume Faye’s Why We Fight
By F. Roger Devlin
Ex: http://www.counter-currents.com/
 Guillaume Faye
Guillaume Faye
Why We Fight: Manifesto of the European Resistance
London: Arktos Media, 2011
Available from Counter-Currents [2] and from Amazon.com [3]
Guillaume Faye’s newly translated Kampfschrift aims to rally Europe, “our great fatherland, that family of kindred spirits, however politically fragmented, which is united on essentials, favoring thus the defense of our civilization.” He sees even nationalism as a kind of sectarianism which European man cannot afford at present: “when the house is on fire domestic disputes are put on hold.” For this reason, Faye has never belonged to the Front National, but has more recently lent support to the French Euronationalist organization Nationality-Citizenship-Identity (see www.nationalite-citoyennete-identite.com [4]).
Over three-quarters of the present volume is devoted to what a Confucian philosopher would call “the rectification of names [5].” It is interesting to observe how revolutionary ideologies are never able to express themselves in ordinary language. Being based upon a partial and distorted view of reality, they necessarily create a jargon all their own. Once they succeed in imposing it upon a subject population, they have won half their battle. Who exactly decided that loyalty to one’s people, known since time immemorial as patriotism and considered as one of the most essential virtues, would henceforth become the crime of racism? Faye’s “metapolitical dictionary” is a blow directed against such semantic distortion.
Here follows a brief sample:
Aristocracy: those who defend their people before their own interests. An aristocracy has a sense of history and blood lineage, seeing itself as the representative of the people it serves, rather than as members of a caste or club. Not equivalent to an economic elite, it can never become entirely hereditary without becoming sclerotic.
Biopolitics: a political project oriented to a people’s biological and demographic imperatives. It includes family and population policy, restricts the influx of aliens, and addressed issues of public health and eugenics.
Devirilisation: declining values of courage and virility for the sake of feminist, xenophile, homophile and humanitarian values.
Discipline: the regulation and positive adaptation of behavior through sanction, reward and exercise. Egalitarian ideology associates discipline and order with their excesses, i.e., with arbitrary dictatorship. But just the contrary is the case, for freedom and justice are founded on rigorous social discipline. Every society refusing to uphold law and order, i.e., collective discipline, is ripe for tyranny and the loss of public freedoms.
Germen: a people’s or civilization’s biological root. In Latin, germen means ‘germ’, ‘seed.’ If a culture is lost, recovery is possible. When the biological germen is destroyed, nothing is possible. The germen is comparable to a tree’s roots. If the trunk is damaged or the foliage cut down, the tree can recover—but not if the roots are lost. That’s why the struggle against race-mixing, depopulation and the alien colonization of Europe is even more important than mobilizing for one’s cultural identity and political sovereignty.
Identity: etymologically, ‘that which makes singular’. A people’s identity is what makes it incomparable and irreplaceable.
Involution: the regression of a civilization or species to maladaptive forms that lead to the diminishing of its vital forces. Cultural involution has been stimulated by the decline of National Education (40% of adolescents are now partially or completely illiterate), the regression of knowledge, the collapse of social norms, the immersion of youth in a world of audio/visual play [and] the Africanization of European culture.
Mental AIDS: the collapse of a people’s immune system in the face of its decadence and its enemies. Louis Pauwels coined the term in the 1980s and it set off a media scandal. In general, the more the neo-totalitarian system is scandalized by an idea and demonizes it, the more likely it’s true.
With biological AIDS, T4 lymphocytes, which are supposed to defend the organism, fail to react to the HIV virus as a threat, and instead treat it as a ‘friend’, helping it to reproduce. European societies today are [similarly] menaced by the collapse of their immunological defenses. As civil violence, delinquency and insecurity explode everywhere, police and judicial measures that might curb them are being undermined. The more Third World colonization damages European peoples, the more measures are taken to continue it. Just as Europe is threatened with demographic collapse, policies which might increase the birth rate are denounced and homosexuality idealized. Catholic prelates argue with great conviction that ‘Islam is an enrichment’, even as it clearly threatens to destroy them.
Museologicalization: the transformation of a living tradition into a museum piece, which deprives it of an active meaning or significance. A patrimony is constructed every day and can’t, thus, be conserved in a museum. Modern society is paradoxically ultra-conservative and museological, on the one hand, and at the same time hostile to the living traditions of identity.
Populism: the position which defends the people’s interests before that of the political class—and advocates direct democracy. This presently pejorative term must be made positive. The prevailing aversion to populism expresses a covert contempt for authentic democracy. For the intellectual-media class, ‘people’ means petits blancs—the mass of economically modest, non-privileged French Whites—who form that social category which is expected to pay its taxes and keep quiet. On the subjects of immigration, the death penalty, school discipline, fiscal policies—on numerous other subjects—it’s well known that the people’s deepest wishes as revealed in referenda and elsewhere never, despite incessant media propaganda, correspond to those of the government. Anti-populism marks the final triumph of the isolated, pseudo-humanist, and privileged political-media class—which have confiscated the democratic tradition for their own profit.
Resistance and Reconquest: faced with their colonization by peoples from the south and by Islam, Europeans, objectively speaking, are in a situation of resistance. Like Christian Spain between the Eighth and Fifteenth centuries, their project is one of reconquest. Resistance today is called ‘racism or ‘xenophobia’, just as native resisters to colonial oppression were formerly called ‘terrorists.’ A semantic reversal is in order here: those who favor the immigrant replacement population ought, henceforward, to be called ‘collaborators.’
Many of our false sages claim that it’s already too late, that the aliens will never leave, that the best that can be expected is a more reasonable form of ethnic cohabitation. [They] do so on the basis not of reasoned analysis, but simply from their lack of ethnic consciousness.
Revolution: a violent reversal of the political situation, following the advent of a crisis and the intervention of an active minority.
For Europeans, revolution represents a radical abolition, a reversal, of the present system and the construction of a new political reality based on the following principles: 1) an ethnocentric Eurosiberia, free of Islam and the Third World’s colonizing masses; 2) continental autarky, breaking with globalism’s free-trade doctrines; 3) a definitive break with the present organization of the European Union; and 4) a general recourse to an inegalitarian society that is disciplined, authentically democratic, aristocratic and inspired by Greek humanism. (Faye has previously written of the need for Euronationalists to reclaim the idea of revolution from the poseurs of the left.)
In a brief closing chapter, Faye answers the question posed by his book’s title:
We fight for Europe. We fight for a Europe infused with ideas of identity and continuity, of independence and power—this Europe that is an ensemble of ethnically related peoples. We fight for a vision of the world that is both traditional and Faustian, for passionate creativity and critical reason, for an unshakable loyalty and an adventurous curiosity, for social justice and free inquiry. We fight nor just for the Europeans of today, but for the heritage of our ancestors and the future of our descendents.
Faye’s writing has a bracing quality which never lapses into elegy or pessimism:
Nothing is lost. It’s completely inappropriate to see ourselves in the nostalgia of despair, as a rearguard, a last outpost, that struggles with panache for a lost cause. World events give us cause to believe that the situation is heading toward a great crisis—toward a chaos from which history will be reborn.
Two years after Why We Fight (2001), Faye published his analysis of the coming crisis under the title The Convergence of Catastrophes. This will be the next of Faye’s works to be brought out in English translation by Arktos.
Article printed from Counter-Currents Publishing: http://www.counter-currents.com
URL to article: http://www.counter-currents.com/2012/05/the-rectification-of-names/
00:05 Publié dans Livre, Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, nouvelle droite, guillaume faye, théorie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 25 mai 2012
“Le Complexe de Narcisse”, recension de l’ouvrage de C. Lasch
“Le Complexe de Narcisse”, recension de l’ouvrage de C. Lasch
par Guillaume FAYE
Ex: http://vouloir.hautetfort.com/
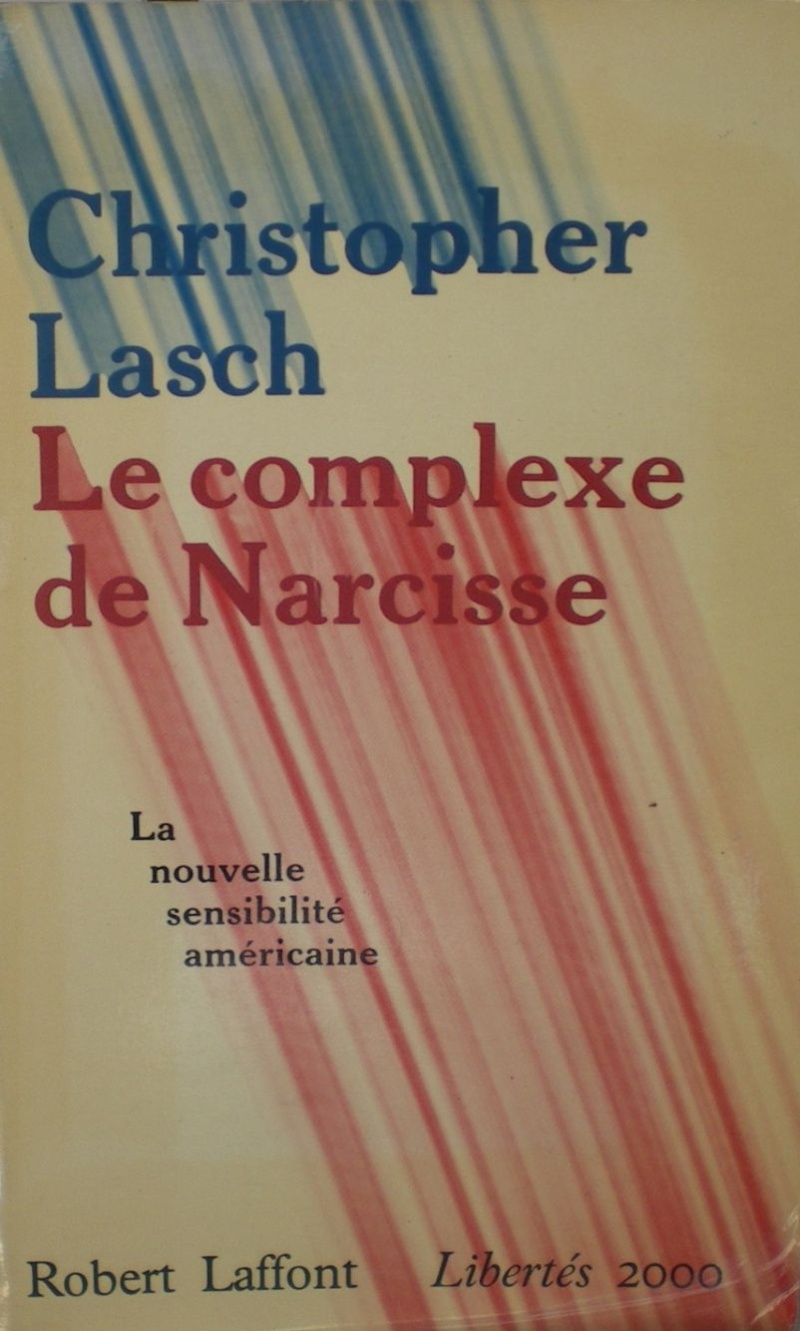 « Partout, la société bourgeoise semble avoir épuisé sa réserve d’idées créatrices (…) La crise politique du capitalisme reflète une crise générale de la culture occidentale. Le libéralisme (…) a perdu la capacité d’expliquer les événements dans un monde où règnent l’État-Providence et les sociétés multinationales et rien ne l’a remplacé. En faillite sur le plan politique, le libéralisme l’est tout autant sur le plan intellectuel ».
« Partout, la société bourgeoise semble avoir épuisé sa réserve d’idées créatrices (…) La crise politique du capitalisme reflète une crise générale de la culture occidentale. Le libéralisme (…) a perdu la capacité d’expliquer les événements dans un monde où règnent l’État-Providence et les sociétés multinationales et rien ne l’a remplacé. En faillite sur le plan politique, le libéralisme l’est tout autant sur le plan intellectuel ».
Ce diagnostic porté par Christopher Lasch, l’un des observateurs les plus lucides de l’actuelle société américaine, donne le ton du réquisitoire qu’il a fait paraitre contre la mentalité et l’idéologie décadente des sociétés bourgeoises, sous le titre de The Culture of Narcissism (en traduction française, Le complexe de Narcisse). Dans cet essai, Lasch s’efforce de donner une description aussi précise que possible d’une « nouvelle sensibilité américaine » que l’on retrouve aujourd’hui, plus ou moins atténuée ou déformée, dans la plupart des pays industriels. Conclusion générale de son analyse l’individualisme traditionnel propre à l’idéologie libérale ne se traduit plus aujourd’hui, contrairement à ce qui se passait encore dans les années 60, par une politisation de l’opinion ou une radicalisation de la recherche du bien-être économique, mais par un repli radical sur le “moi” individuel. Ce repli correspond à la poursuite effrénée du “bonheur intérieur”. L’homme contemporain part à la recherche de lui-même, sans illusions politiques, mû par une angoisse qu’il tente d’apaiser par un recours systématique à toutes les formes de sécurité. C’est le triomphe de Narcisse.
Passant en revue l’évolution de la littérature, du système d’éducation, des médias de masse et du discours politique, C. Lasch dresse ainsi la “géographie” d’un narcissisme contemporain dans lequel il n’est pas éloigné de voir, à juste titre, le stade ultime du déclin d’une civilisation.
L’« invasion de la société par le moi » produit, dit-il, une course sans limites vers la « sécurité physique et psychique ». Équivalant à une existence menée dans un perpétuel présent, elle interdit « tout sens de la continuité historique ». Les modes “psy”, les obsessions sexuelles étalées dans le discours public, la frénésie des “expérimentations personnelles”, le désintérêt pour le travail, “l’égotisme” d’une famille nucléaire essentiellement consommatrice, la “théâtralisation de l’existence”, le mimétisme vis-à-vis des “vedettes” de la scène ou de la chanson, sont autant de traits caractéristiques du narcissisme.
« Cette concentration sur soi définit (…) le mouvement de la nouvelle conscience », note Lasch, qui ajoute : « La recherche de son propre accomplissement a remplacé la conquête de la nature et de nouvelles frontières ». Sur le plan politique, un tel comportement s’observe à gauche aussi bien qu’à droite. La gauche était d’ailleurs, depuis longtemps, acquise à une idéologie de refus de la vie-comme-combat. La droite, elle, a peu à peu été gagnée aux valeurs de la pensée rationnelle, calculatrice et bourgeoise. La fuite devant la lutte aboutit ainsi à un psychisme « misérabiliste », que Lasch décrit en ces termes : l’homme « est hanté, non par la culpabilité, mais par l’anxiété (…) Il se sent en compétition avec tout le monde pour l’obtention des faveurs que dispense l’État paternaliste. Sur le plan de la sexualité (…) son émancipation des anciens tabous ne lui apporte pas la paix (…) Il répudie les idéologies fondées sur la rivalité, en honneur à un stade antérieur du développement capitaliste. Il exige une gratification immédiate et vit dans un état de désir inquiet et perpétuellement inassouvi ».
L’origine de ce « complexe de Narcisse », état psychologique ultime de la mentalité individualiste, est à rechercher dans la décomposition d’une société qui, fondée sur l’égalité et l’autonomie individuelle, s’est peu à peu transformée en jungle sociale. « La culture de l’individualisme compétitif est une manière de vivre qui est en train de mourir — note à ce propos C. Lasch. Celle-ci, dans sa décadence, a poussé la logique de l’individualisme jusqu’à l’extrême de la guerre de tous contre tous, et la poursuite du bonheur jusqu’à l’impasse d’une obsession narcissique de l’individu pour lui-même. La stratégie de la survie narcissique (…) donne naissance à une « révolution culturelle qui reproduit les pires traits de cette même civilisation croulante qu’elle prétend critiquer (…) La personnalité autoritaire n’est plus le prototype de l’homme économique. Ce dernier a cédé la place à l’homme psychologique de notre temps — dernier avatar de l’individualisme bourgeois ».
Soumis aux “experts” et dominé par les psychiatres, l’homme contemporain s’est donc anxieusement lancé à la poursuite de son “moi”. Démobilisé dans ses instances profondes, imperméable à toute visée politique de longue durée, inapte à la compréhension d’un destin collectif, indifférent à l’histoire, il planifie, comme un comptable, l’obtention de son bonheur intime. Ce dernier, jusqu’à la fin des années 60, se confondait avec la réussite matérielle et le bien-être du confort domestique. C’était l’époque de la deuxième “révolution industrielle”, animée par une idéologie de la compétition individuelle et caractérisée par l’accession massive des classes moyennes au standing de la bourgeoisie aisée. Mais aujourd’hui, l’idée de bonheur a pris une autre résonance. Elle a dépassé sa connotation purement matérielle pour se doter d’une portée “psychologique”. Il s’agit maintenant de sécuriser son “moi”, de “partir à la recherche de soi-même”, sur la base d’une introspection presque pathologique. À la quête du bonheur économique, dont les limites apparaissent désormais clairement, s’ajoute la recherche du “bonheur intérieur”. L’idéal mercantile du bien-être petit-bourgeois conserve sa vigueur, mais il ne suffit plus à étancher la soif de l’homme contemporain. Celui-ci veut accéder à la “félicité psychique”. Il se tourne vers une série d’utopies nouvelles. L’État-Providence est là pour lui promettre la “bonne vie” sans le stress, le maximum de droits avec le minimum de devoirs, le confort à peu de frais, la prospérité matérielle dans la quiétude du “moi”.
Toutefois, les gourous du mieux-vivre, s’ils ont rejeté les valeurs de compétition et de risque, n’ont pas abandonné pour autant les aspirations matérialistes de la bourgeoisie traditionnelle. Narcisse, obsédé par son désir d’apaiser ses “tensions” psychologiques, de réaliser ses “pulsions” libidinales, n’entame pas une critique sur le fond de la société de consommation. Il veut l’abondance, mais sans avoir à se battre pour l’obtenir ; la richesse, mais sans effort, et, en plus, la plénitude sexuelle et l’apaisement de ses conflits quotidiens.
L’impossibilité évidente de satisfaire en même temps ces exigences contradictoires donne à la mentalité narcissique une conscience à la fois infantile et douloureuse. Plus l’individu se replie sur lui-même, plus il se découvre des “problèmes” nouveaux et insolubles. La recherche du bonheur débouche sur une angoisse qui n’est plus regardée comme un défi, mais comme une menace. La nouvelle bourgeoisie narcissique est une classe fragile, inquiète, hypersensible, superficielle, instable.
Une autre cause du narcissisme contemporain, qui « recroqueville le moi vers un état primaire et passif dans lequel le monde n’est ni crée ni formé », réside dans la permissivité sociale et la bureaucratisation. La permissivité détruit les normes de conduite collectives. Loin de libérer, elle isole. Elle fait exploser le sens. Privé du cadre éducatif et des institutions hérités, l’individu ne sait plus comment se comporter. Il s’en remet alors ans injonctions éphémères que lui distillent les médias, la publicité, les “manuels” d’éducation sexuelle, etc. Les conseils (intéressés) des magazines ou de la télévision se substituent à l’expérience intériorisée de la tradition familiale ou communautaire. Les règles de vie ne sont plus trouvées que par fragments ou par accident, dans le champ anonyme et frustrant du “discours public”. Le “surmoi” social s’est effondré. Les normes de comportement, auxquelles nulle société n’échappent, ne proviennent plus que des structures dominantes, économiques et techniques, de la société, Privé d’autodiscipline, puisqu’il n’intériorise pas les règles sociales, l’individu se heurte brutalement aux interdits socio-économiques qu’il découvre en arrivant à l’âge adulte : règles bureaucratiques, pratiques bancaires, impératifs commerciaux, etc. Élevé dans le mythe d’une “liberté” formelle, il supporte de moins en moins bien ces contraintes et réagit en se renfermant d’autant plus sur lui-même.
La bureaucratisation des activités sociales accentue la tendance. Déchargeant les hommes des soucis de la lutte quotidienne, elle donne aux hommes l’illusion de l’irresponsabilité. L’individu se découvre étranger à ceux qui l’entourent, à ceux qui partagent son existence quotidienne et à qui, désormais, plus rien ne le lie. La mentalité d’assistance, le recours perpétuel à des “droits” que rien ne vient plus fonder, la sécurisation de la vie privée par la bureaucratisation de l’État-Providence décharge l’individu de son rôle actif. Que lui reste-t-il à faire alors, puisque rien ne l’attache plus aux autres, sinon à se passionner pour lui-même ?
Le déclin des idéaux révolutionnaires et du marxisme orthodoxe a fait perdre l’espoir d’une transformation radicale de la société. L‘idéologie égalitaire a reporté ses visées dans le domaine des contre-pouvoirs insignifiants et des micro-aménagements quotidiens. L’égalitarisme ne laisse plus entrevoir de “paradis social”, mais seulement des “paradis individuels”. L’utopie du bonheur s’affaiblit sur le plan collectif et se rétracte au niveau intime et personnel. Nous en sommes à l’ère, prévue (et voulue) par l’École de Francfort, des “révolutions minuscules”.
La “fin de l’histoire”, elle aussi, est recherchée sur le plan individuel après l’avoir usé sur le plan social et collectif, Même la société “bonheurisée” et privée de véritable histoire politique que nous connaissons actuellement apparaît comme trop astreignante. Elle ne constitue pas encore un refuge suffisamment sécurisant contre le stress. Elle n’endort pas encore assez. L’individu, en se repliant sur sa sphère psychique, prend mentalement sa retraite dès l’âge de 20 ans. La société n’entend plus sortir directement de l’histoire ; c’est l’individu qui se retire de la société.
Oublieuse de toute notion de continuité historique, de toute perception dense des liens sociaux, la société narcissique incite à vivre pour soi-même et à n’exister que dans l’instant. Tel est d’ailleurs le sens de la plupart des messages publicitaires. Tel est aussi le “discours” distillé à longueur de temps par des magazines, de plus en plus nombreux, qui se spécialisent dans la résolution “catégorielle” des problèmes individuels (parents, enfants, jeunes femmes, amateurs de vidéo, etc.) et l’étude “micro-dimensionnelle” de la vie quotidienne. Dans cette recherche, nulle place n’est laissée à l’accomplissement personnel dans le sens d’un style aristocratique ou d’un dépassement de soi. On en reste aux fantasmes stéréotypes, à la planification “micro-procédurière”, à l’introspection complaisante d’un “moi” de plus en plus étiolé. « La survie individuelle est maintenant le seul bien », observe C. Lasch. Le XXIe siècle, à ce rythme, ne sera pas un siècle religieux, mais un siècle thérapeutique.
Dans cette perspective, le culte de la fausse intimité, l’intensification artificiel le des rapports subjectifs, la simplification primitiviste des “rituels” de séduction et d’approche, constituent des formes maladroites de compensation par rapport au cynisme social et à l’absence de valeurs partagées. L’existence de liens entre l’individu et des valeurs de type communautaire reste en effet une nécessité inéluctable dans toute société, quand bien même la conscience individuelle les refuse. Les liens affectifs individuels demeurent insuffisants pour donner aux individus un sens à leur existence. Ainsi, paradoxalement, la vague actuelle de “sentimentalité” qui tend à isoler l’individu à l’intérieur du couple, et le couple à l’intérieur de l’ensemble de la société, débouche sur la mort de toute affection authentique et sur la fragilisation des rapports d’union. L’amour comme l’amitié, pour être durables, doivent s’insérer dans un cadre plus large que celui défini par leurs protagonistes immédiats. Or, c’est cette dimension communautaire que le “narcissisme” attaque dans ses racines. Lorsque l’individu ne peut plus ni percevoir ni “idéaliser” le groupe, la cité, la communauté à laquelle il appartient, il est obligatoirement conduit à intensifier ses rapports infimes de façon si hypertrophique qu’il finit en fait par les détruire. C’est ainsi, par ex., que la vague récente de “néoromantisme”, évoquée par Edouard Shorter (Naissance de la famille moderne, Seuil, 1979), ne débouche pas sur l’amour, mais sur l’égotisme et sur l’obsession de soi.
De même, les fausses expérimentations vitales, qui ne reposent sur aucune habitude culturelle, sur aucun besoin intériorisé, dépersonnalisent l’individu au lieu de le recentrer, le “débranchent” en quelque sorte du monde vécu sans lui fournir “l’autre dimension” souhaitée. N’ayant pas trouvé le bonheur dans la consommation matérielle et le confort économique, la nouvelle bourgeoisie “narcissique” tente de l’atteindre dans une consommation de “produits spirituels”, dont la qualité laisse, évidemment, fort à désirer. Les États-Unis, et plus spécialement la sphère “californienne”, sont particulièrement en pointe dans ce style d’entreprises, dont certains essaient de nous persuader qu’elles constituent la naissance d’une nouvelle culture ou la source possible d’un renouveau de la spiritualité.
La description que donne C. Lasch est convaincante de bout en bout. Pourtant, Lasch semble ne pas tirer toutes les conclusions de son propos, probablement parce qu’il se trouve lui-même immergé dans une société américaine dont il n’ose pas remettre en cause les idéaux fondateurs (dont le “narcissisme” est pourtant l’aboutissement). C’est pourquoi il propose, de façon assez peu crédible un retour à des valeurs anciennes auxquels il n’envisage à aucun moment de donner un nouveau fondement. (Certains pourront voir là un essai de réactivation du puritanisme américain traditionnel).
Ce n’est pourtant pas, à notre avis, dans un quelconque “ordre moral” que réside la solution au “mal de vivre” de Narcisse. La solution ne peut procéder d’une manipulation sociale, d’une transformation des institutions, d’une évolution mécanique des codes sociaux ou d’un discours purement moral, Pour en finir avec “l’idéologie de la compassion” et la mentalité de “l’avoir-droit narcissique”, toute attitude répressive ou, au contraire, de simple lamentation, ne peut que se révéler sans effet. Seuls peuvent mobiliser les individus en tant que parties intégrantes d’un peuple, des projets d’essence politique et culturelle, fondés sur des valeurs (et des contre-valeurs) entièrement opposées à celles qui ont présidé à la naissance de la “république universelle” des États-Unis d’Amérique. Ce n’est pas, bien entendu, d’outre-Atlantique, que l’on peut les attendre.
◘ Le complexe de Narcisse : La nouvelle sensibilité américaine, traduit par Michel Landa, Robert Laffont, coll. Libertés 2000, 1981. [Version remaniée : La Culture du narcissisme, Champs-Flam, 2006]
► Guillaume Faye, Nouvelle École n°37, 1982.
00:05 Publié dans Livre, Nouvelle Droite, Philosophie, Sociologie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : livre, christopher lash, guillaume faye, nouvelle droite, sociologie, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
La beauté de l'imperfection...
La beauté de l'imperfection...
Ex: http://metapoinfos.hautetfort.com/
Les éditions Arléa viennent de publier Les Lieux et la poussière - Sur la beauté de l'imperfection, un essai de Roberto Peregalli, dans lequel il dénonce la laideur froide et sans défaut de l'habitat moderne. Architecte milanais, Roberto Peregalli a suivi des études de philosophie et a été influencé par sa lecture d'Heidegger. Il est déjà l'auteur d'un essai intitulé La cuirasse brodée (Le Promeneur, 2009).
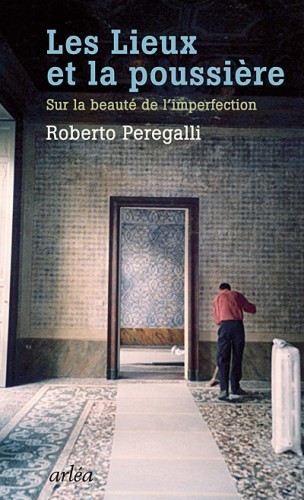
"Les Lieux et la poussière est un essai en douze chapitres sur la beauté et la fragilité. La beauté de notre monde périssable, la fragilité des choses et des vies, la nostalgie qui habite les objets etles lieux.
Roberto Peregalli voit les façades des maisons comme des visages. Il regarde le blanc, le verre, ou la lumière des temples, descathédrales, de la pyramide du Louvre. Il dénonce l’effroi provoqué par le gigantisme et l’inadaptation de l’architecture moderne, la violence de la technologie. Il s’attarde sur le langage et la splendeur des ruines, de la patine et et de la pénombre. Il dénonce l’incurie de l’homme quant à son destin.
Roberto Peregalli nous renvoie à notre condition de mortel. Il nous rappelle combien tout est fragile dans notre être et notre façon d’être. Combien tout est poussière. Combien nous oublions de prendre soin de nous dans notre rapport aux choses et au monde.
Son texte a la force soudaine de ces objets qu’on retrouve un jour au fond d’un tiroir et qui disent de façon déchirante et immédiate tout ce que nous sommes, et que nous avons perdu.
À la façon de Tanizaki, dans Éloge de l’ombre, il dévoile avec sensibilité et intelligence l’effondrement de valeurs qui sont les nôtres et qui méritent d’être en permanence repensées et préservées."
00:05 Publié dans Architecture/Urbanisme, Livre, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : architecture, livre, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 24 mai 2012
Le Dictionnaire des polémistes
Un nouveau Bouquin de Synthèse nationale :
Le Dictionnaire des polémistes,
d'Antoine de Rivarol à François Brigneau,
Tout au long de l’année 2011, Robert Spieler a proposé aux lecteurs de Rivarol, l’hebdomadaire de l’opposition nationale et européenne, une série d’articles consacrés aux polémistes qui marquèrent l’histoire de la presse depuis la Révolution française, jusqu’au milieu du XXe siècle. Il reprend ainsi le travail effectué par Pierre Dominique dans son ouvrage publié au début des années 60 (et aujourd’hui épuisé) Les Polémistes français depuis 1789.
Ce Dictionnaire des polémistes rassemble tous ces articles. Vous retrouverez ici les grands noms qui, en leur temps, marquèrent les esprits. Ils n’hésitaient pas à dénoncer les puissants du moment. Beaucoup parmi eux payèrent très cher leur engagement. Aujourd’hui, la liberté d’expression se heurte encore aux ukases du politiquement correct et, comme hier, des lois liberticides, beaucoup plus insidieuses sans doute, empêchent les vrais polémistes de s’exprimer…
Robert Spieler, ancien député, fondateur d’Alsace d’abord, Délégué général de la Nouvelle Droite Populaire, est aussi l’un des journalistes de l’hebdomadaire Rivarol. Chaque semaine il décortique avec délectation et cynisme l’actualité dans sa fameuse Chronique de la France asservie et résistante.
■ Commandez le Dictionnaire des Polémistes :
Règlement à la commande par chèque à l’ordre de Synthèse nationale à retourner à :
Synthèse nationale 116, rue de Charenton 75012 Paris
18, 00 € l’exemplaire (+ 3 € de port)
Bulletin de commande : cliquez ici
00:05 Publié dans Littérature, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, littérature, lettres, lettres françaises, france, littérature française, robert spieler |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 18 mai 2012
Dominique Venner: l'imprévu dans l'histoire
00:14 Publié dans Livre, Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, nouvelle droite, dominique venner, histoire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 16 mai 2012
« L'Inquisition médiatique » de Francis Puyalte
« L'Inquisition médiatique » de Francis Puyalte
Ex: http://www.polemia.com/

De minimis non curat praetor, dit l’adage latin, mais il n’est pas de sujet, si subalterne soit-il en apparence, qui échappe aux champions de la désinformation. On ne s’étonnera donc pas de voir ceux-ci à l’œuvre dans le traitement des faits divers, ce qui est logique dans la mesure où ces derniers passionnent un public trop souvent, hélas, indifférent à la politique. _________________________________________________________________________________________
Au lendemain du premier tour de la présidentielle, Valeurs actuelles révélait le résultat des votes internes organisés au Centre de formation des journalistes et à l’Ecole supérieure des journalistes de Lille : soit 100% des voix pour la gauche dans le premier, et 87% dans la seconde, Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen n’obtenant pas un seul suffrage de la part des étudiants qui, demain, seront nos « dealers d’opinion » !
On sait depuis longtemps à quoi s’en tenir sur la désinformation journalistique en matière politique. Dans L’Inquisition médiatique, Francis Puyalte, ancien de Paris-jour, de L’Aurore puis du Figaro, démontre que l’esprit partisan est également de règle, et donc le public est tout aussi fourvoyé en matière de faits divers. Et de citer en exemple le scandale d’Outreau, le « naufrage » des Kurdes (pseudo-irakiens et soi-disant persécutés) du cargo East Sea échoué près de Fréjus en 2001 et surtout l’affaire Kamal, dont l’opportune relecture par Puyalte occupe la moitié du livre. Rappelons pour ceux, sans doute nombreux, qui l’auraient oublié que, pour justifier l’enlèvement de sa petite fille Lauriane et sa fuite aux Etats-Unis, le Franco-Marocain Karim Kamal avait accusé son ex-femme Marie-Pierre Guyot, fille d’un haut magistrat, d’avoir violé et fait violer la gamine lors d’orgies titanesques auxquelles aurait participé le gratin de la justice et de la police niçoises, en particulier le doyen des juges d’instruction Jean Pierre Renard et le procureur général Paul-Louis Auméras (*).
Pendant des lustres, ces accusations gravissimes, mais qui n’ont jamais reçu l’ombre d’un début de preuve malgré de nombreuses enquêtes, ont fait régner dans les tribunaux des Alpes-Maritimes un climat délétère, encore attisé par l’attitude équivoque du procureur Eric de Montgolfier, successeur d’Auméras et, semble-t-il, plus enclin à hurler avec les loups de presse qu’à établir la vérité et à protéger les institutions.
A la remorque du Monde
Or, qui avait lancé la rumeur ? Le journaliste Hervé Gattegno, alors protégé, au Monde, du fanatique Edwy Plenel – qui, aujourd’hui patron du site Mediapart, peut à bon droit se vanter d’avoir eu la peau de Nicolas Sarkozy en faisant état, peu avant le scrutin présidentiel, des allégations d’un ministre libyen affirmant que la campagne du vainqueur de 2007 avait été financée à hauteur de 50 millions d’euros par le colonel Kadhafi. En reprenant l’argumentation de Karim Kamal, il s’agissait pour le tandem Plenel-Gattegno de jeter l’opprobre sur Nice, ville restée trop « médeciniste » aux yeux de ces moralistes.
Francis Puyalte montre d’ailleurs bien le rôle moteur joué par Le Monde dans le traitement des faits divers. Il faut se souvenir, d’ailleurs, de la place extravagante réservée en 1986 par ce quotidien dit « de référence » à la mort accidentelle de l’étudiant manifestant Malik Oussekine dont le décès, attribué à la « violence policière », obligea Jacques Chirac et Alain Devaquet à remiser leur réforme des Universités… et d’une manière générale à oublier toutes les promesses faites à l’électorat droitier. Or, loin de se livrer à des investigations personnelles pour tenter de démêler le vrai du faux, presse écrite et télévisions se mettent à la remorque du Monde et en adoptent toutes les thèses. Comme si ce quotidien était leur directeur de conscience.
Et malheur aux dissidents – fussent-ils collaborateurs du Figaro – qui tentent de faire entendre leur vérité ! Ils sont à leur tour victimes de l’Inquisition médiatique, traités de racistes ou d’ « anticommunistes primaires », tel l’auteur qui, aujourd’hui retraité, se souvient : « J’ai couvert presque toutes les grandes manifs des années 1970-1980. Elles m’ont éclairé sur le rôle de la presse, son singulier suivisme, sa propension à aller dans le sens du vent, qui soufflait souvent de l’Est […] Certes, je fus témoin, bien sûr, de quelques excès et même de bavures [policières]. Mais, en général, je constatais et j’admirais la placidité et le sang-froid des CRS et gendarmes mobiles qui supportaient pendant des heures les injures les plus abjectes […], les cailloux et les pierres, les jets d’œufs pourris et les cocktails Molotov dans l’attente d’un ordre, qui ne venait pas. » Surtout face aux « bandes ethniques », « un phénomène que je m’honore de ne pas avoir occulté », écrit Francis Puyalte en insistant sur la discipline de ces bandes allogènes « dont le seul but était le pillage ». Un but ignoré par les lecteurs du Monde…
Ecrit sans prétention par un journaliste « à l’ancienne » formé non dans quelque « prestigieuse » école mais aux chiens écrasés – et à la lecture de son « cher Céline » ! – et enrichi d’une intéressante préface de Christian Millau, ce témoignage éclaire sur la nocivité et l’omnipotence des forces de désinformation, auxquelles aucun domaine n’est étranger dès lors qu’il s’agit de culpabiliser le lecteur lambda.
Florent Dunois
8/05/2012
Francis Puyalte, L’Inquisition médiatique, préface de Christian Millau, Dualpha éditions, Collection Vérité pour l’Histoire, octobre 2011, 338 pages.
(*) Aux mêmes éditions et dans la même collection, Paul-Louis Auméras livre son propre témoignage dans Parcours de proc, préfacé par François Missen. 380 pages.
Voir article de Polémia :
Comment les écoles de journalisme enseignent le conformisme (Polémia 13/12/2011)
Correspondance Polémia 10/05/2012
00:05 Publié dans Actualité, Livre, Manipulations médiatiques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, médias, manipulations médiatiques, livre |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 15 mai 2012
Philippe Conrad présente "La Nouvelle impuissance américaine", d'Olivier Zajec
00:05 Publié dans Actualité, Géopolitique, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, livre, etats-unis, géopolitique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 09 mai 2012
Keine US-Atombomben im Juli/August 1945!
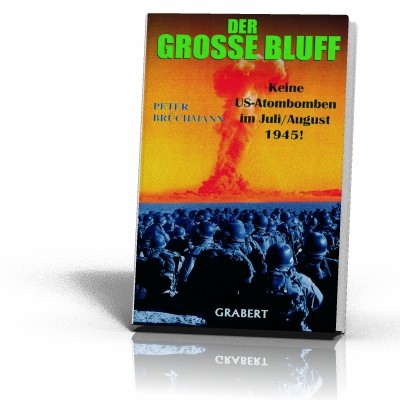
Keine US-Atombomben im Juli/August 1945!
220 Seiten - Leinen - 110 Abbildungen
Kurztext:
Dieses Buch enthüllt ein seit Kriegsende von den Siegermächten streng gehütetes Geheimnis des deutschen Untergangs 1945.Die sofortige Geheimhaltung der bei Kriegsende in Mitteldeutschland erbeuteten nuklearen Hochtechnologie wurde mit der lapidaren Behauptung »die US-Army hat nichts gefunden« verbunden. Die Untersuchung des historischen Sachverhaltes bestätigt jetzt eine von den USA inszenierte und seit 1945 gepflegte Falschdarstellung der Atombomben-Entwicklungsgeschichte. Die Reichsregierung hatte sich felsenfest auf den von der Wissenschaft zugesicherten Besitz der Atombombe verlassen. So wurde die Entwicklung der ›Siegeswaffe‹ gegenüber der eigenen Bevölkerung bis zum Kriegsende streng geheimgehalten. Als der Zusammenbruch kam, bevor die Atombomben eingesetzt wurden, brauchte die Geheimhaltung der deutschen Atombombe von den USA lediglich fortgeführt zu werden.
Das Buch räumt mit bisherigen Ansichten zur Frühzeit der Atombomben auf und zeigt, wie das offizielle Amerika die Zeitgeschichte in einem wichtigen Bereich fälschte.
Klappentext:
00:05 Publié dans Histoire, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, livre, allemagne, etats-unis, deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale, armes nucléaires, bombe atomique, armes atomiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 03 mai 2012
North American New Right, vol. 1
North American New Right, vol. 1
 North American New Right, volume 1
North American New Right, volume 1
Edited by Greg Johnson
366 pages
hardcover: $120
paperback: $30
Publication date: May 30, 2012
North American New Right is the journal of a new intellectual movement, the North American New Right. This movement seeks to understand the causes of the ongoing demographic, political, and cultural decline of European peoples in North America and around the globe — and to lay the metapolitical foundations for halting and reversing these trends.
The North American New Right seeks to apply the ideas of the European New Right and allied intellectual and political movements in the North American context. Thus North American New Right publishes translations by leading European thinkers as well as interviews, articles, and reviews about their works.
NOTE: The hardcover edition of NANR is so expensive because it is a premium available to donors who give more than $120 in a given year. If you have already given such a donation, you already own a copy.
CONTENTS
INTRODUCTION
“Toward a North American New Right”
Greg Johnson
FRANCIS PARKER YOCKEY: IN MEMORIAM
“The Death of Francis Parker Yockey”
Michael O’Meara
“Spiritual & Structural Presuppositions of the European Union”
Julius Evola
“A Contemporary Evaluation of Francis Parker Yockey”
Kerry Bolton
“The Overman High Culture & the Future of the West”
Ted Sallis
Six Poems for Francis Parker Yockey
Juleigh Howard-Hobson
INTERVIEWS
Interview with Alain de Benoist
Bryan Sylvain
Interview with Harold Covington
Greg Johnson
ESSAYS
“What is to be Done?”
Michael O’Meara & John Schneider
“Pan-European Preservationism”
Ted Sallis
“Vanguard, Aesthetics, Revolution”
Alex Kurtagić
“Absolute Woman: A Clarification of Evola’s Thoughts on Women”
Amanda Bradley
“D. H. Lawrence’s Women in Love”
Derek Hawthorne
“’The Flash in the Pan’: Fascism & Fascist Insignia in the Spy Spoofs of the 1960s”
Jef Costello
TRANSLATIONS
“The Lesson of Carl Schmitt”
Guillaume Faye & Robert Steuckers
“Homer: The European Bible”
Dominique Venner
“Mars & Hephaestus: The Return of History”
Guillaume Faye
“Post-Modern Challenges: Between Faust & Narcissus”
Robert Steuckers”
“Jean Thiriart: The Machiavelli of United Europe”
Edouard Rix
REVIEW ESSAYS
Michael O’Meara’s Toward the White Republic
Michael Walker”
Michael Polignano’s Taking Our Own Side
Kevin MacDonald
“A Serious Case: Guillaume Faye’s Archeofuturism”
F. Roger Devlin
Julius Evola’s Metaphysics of War
Derek Hawthorne
Abir Taha’s The Epic of Arya
Amanda Bradley
Jack Malebranche’s Androphilia
Derek Hawthorne
“Sir Noël Coward, 1899–1973: The Noël Coward Reader”
James J. O’Meara
“Arkham Asylum: An Analysis”
Jonathan Bowden
“Christopher Nolan’s Batman Begins & The Dark Knight”
Trevor Lynch
ABOUT THE EDITOR
Greg Johnson, Ph.D., Editor-in-Chief of Counter-Currents Publishing Ltd. and Editor of the annual journal North American New Right. From 2007 to 2010 he was Editor of The Occidental Quarterly. In 2009, he created TOQ Online with Michael J. Polignano and was its Editor for its first year.
He is the author of Confessions of a Reluctant Hater (San Francisco: Counter-Currents, 2010).
He is editor of Alain de Benoist, On Being a Pagan, trans. John Graham (Atlanta: Ultra, 2004); Michael O’Meara, Toward the White Republic (San Francisco: Counter-Currents, 2010); Michael J. Polignano, Taking Our Own Side (San Francisco: Counter-Currents, 2010); Collin Cleary, Summoning the Gods: Essays on Paganism in a God-Forsaken World (San Francisco: Counter-Currents, 2011); Irmin Vinson, Some Thoughts on Hitler and Other Essays (San Francisco: Counter-Currents, 2011); and Kerry Bolton, Artists of the Right: Resisting Decadence (San Francisco: Counter-Currents, 2012).
16:57 Publié dans Livre, Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : etats-unis, livre, nouvelle droite, idéologie, théorie politique, sciences politiques, politologie, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 02 mai 2012
Une maîtresse imprévisible

Une maîtresse imprévisible
par Georges FELTIN-TRACOL
En 1988, Dominique Venner, futur responsable de la Nouvelle Revue d’Histoire, publiait chez Plon Treize meurtres exemplaires, un ouvrage consacré à l’assassinat de treize personnalités politiques du XXe siècle. Vingt-quatre ans plus tard, il réédite le livre dans une version revue, corrigée et augmentée chez un nouvel éditeur plein d’avenir, Pierre-Guillaume de Roux, fils du célébrissime écrivain et éditeur anticonformiste Dominique de Roux.
Dominique Venner a remplacé les chapitres sur une bavure du Mossad en 1973 contre Ahmed Bouchiki et l’assassinat toujours inexpliqué de Jean de Broglie en 1976 par l’attentat contre Hitler en juillet 1944 fomenté par le colonel von Stauffenberg et par la disparition – qui laisse perplexe – de son ami François de Grossouvre « suicidé » en avril 1994 dans son bureau de l’Élysée. Il a aussi tenu à y adjoindre un prologue et un épilogue explicatifs et en a modifié l’intitulé, « Treize meurtres exemplaires » devenant le sous-titre de L’imprévu dans l’Histoire.
En fin historien et ayant lui-même jadis envisagé d’abattre Charles de Gaulle pendant la Guerre d’Algérie comme il l’écrivit dans le merveilleux Cœur rebelle (1994), Dominique Venner s’intéresse aux attentats contre des personnes connues. En effet, à part le cas de Grossouvre, les douze choix du livre appartiennent à un mode opératoire qu’on désigne habituellement comme du terrorisme même si, ici, les actes ne concernent que des victimes individuelles et non des masses comme pour le 11 septembre 2001. À l’exception de John Fitzgerald Kennedy, son étude se concentre sur des événements européens quand bien même Léon Trotsky est exécuté à Mexico et que l’amiral Darlan meurt à Alger, à l’époque ville française.
On note une répartition équilibrée des sujets traités : trois pour la Russie (Pierre Stolypine, Raspoutine, Trotsky), quatre pour le monde slave si on y ajoute la mort d’Alexandre de Yougoslavie à Marseille en 1934 par des militants croates soutenus par les redoutables partisans de l’O.R.I.M. (Organisation révolutionnaire intérieure macédonienne); trois pour la France (Gaston Calmette, Darlan et Grossouvre), voire quatre avec l’exécution à Paris en 1941 de l’aspirant Moser par des communistes; trois pour l’Allemagne et le monde germanique (François-Ferdinand à Sarajevo, Walter Rathenau en 1922, Stauffenberg), quatre avec Moser. Il y a enfin les États-Unis avec J.F.K. en 1963 et, pour l’Italie, Aldo Moro en 1979.
Ce n’est pas par hasard si Dominique Venner a pris ces exemples. Il les inscrit dorénavant dans l’imprédictibilité de l’histoire. L’histoire n’est pas une science dure, mathématique, logique et causaliste. Clio est une maîtresse imprévisible, irascible et impétueuse pour les civilisations, les peuples et les êtres. Hormis les questions démographiques, les prévisions des historiens ne se réalisent que très rarement, d’où leur réputation de « prophètes du passé » ! L’histoire est le domaine de l’hétérotélie, terme forgé par Jules Monnerot pour désigner des résultats contraires à ce que l’on désirait. Oui, l’histoire est toujours inattendue parce qu’elle est l’amante du Kairos, de ce moment décisif, qu’il faut saisir immédiatement. Pour s’approprier cet instant crucial, il importe de posséder des qualités fondamentales. « Un certain héritage historique et culturel, la fortune (l’inattendu) et la virtù sont les déterminants majeurs que l’on peut voir à l’œuvre derrière tous les grands événements de l’Histoire, plaide Dominique Venner (p. 268). »
Certains cas qu’il examine le prouvent aisément. Dominique Venner ne cache pas son admiration pour Stolypine, le Premier ministre de Nicolas II de Russie de 1906 à 1911. Ce traditionaliste réformateur s’opposa aussi bien aux révolutionnaires rouges qu’aux réactionnaires noirs. Très au fait des équilibres continentaux, sa présence à l’été 1914 lors de la crise entre la Serbie et l’Autriche-Hongrie aurait peut-être permis de temporiser l’antagonisme entre Belgrade et Vienne et de contenir le bellicisme germanophobe de certains milieux russes. Stolypine aurait pu s’appuyer sur le Français Joseph Caillaux, certainement président du Conseil si celui-ci n’avait pas été contraint de démissionner à la suite de l’assassinat du directeur du Figaro, Gaston Calmette, le 16 mars 1914, par Henriette Caillaux, son épouse lasse des attaques incessantes et vénéneuses contre son ministre de mari. L’historien féru d’uchronies peut même se demander si la survie de Raspoutine n’aurait pas incité Nicolas II à imposer aux belligérants une paix des braves comme le suggèrent Jacqueline Dauxois et Vladimir Volkoff dans leur étonnant roman Alexandra (1994).
Les assassinats de Stolypine, de Calmette et de François-Ferdinand démontrent qu’il y a bien un « effet-papillon » en histoire, terrain propice à la théorie du chaos. La disparition d’une personnalité-clé peut avoir des répercussions considérables dans le monde… L’inattendu est le synonyme de la tragédie et celle-ci n’œuvre pas que dans le terrorisme. Ainsi, Ernst Jünger a-t-il souvent médité sur la catastrophe estimée impossible du Titanic en 1912. Pour lui, ce naufrage annonçait la tendance titanesque du nouveau siècle.
On ne détaillera pas, même succinctement, les treize meurtres politiques décrits par Dominique Venner. On se permettra en revanche d’émettre quelques critiques. Il est dommage, concernant Darlan, que l’auteur ne mentionne pas l’extraordinaire De Gaulle et Giraud : l’affrontement, 1942 – 1944 (2005) de Michèle Cointet qui démêle avec brio la grande complexité politique de l’Afrique française du Nord en novembre – décembre 1942. On notera que l’enlèvement et l’assassinat d’Aldo Moro restent obscurs. Dominique Venner peut n’avoir pas pris connaissance des thèses situationnistes et/ou d’ultra-gauche qui avancent avec une argumentation probante, la manipulation des groupes armés d’extrême droite et d’extrême gauche par l’O.T.A.N. et certains cénacles occultes liés à l’État profond U.S. Par ailleurs, ce même État profond est largement impliqué dans l’élimination de John Fitzgerald Kennedy. Lee Harvey Oswald et le complot soviéto-cubain ne sont que des leurres, des couvertures, qui masquent l’immense et néfaste influence bankstériste à Washington.
Nonobstant ces quelques désaccords, L’imprévu dans l’Histoire doit être lu et médité non seulement pour le XXe siècle, mais aussi et surtout pour le XXIe. Les attentats contre Rathenau, Alexandre de Yougoslavie et Trotsky sont le fait d’hommes (et de femmes !) déterminés, prêts à sacrifier leur vie pour leur cause; ils sont les grains de sable qui entravent la « grande roue de l’histoire ». Ils sont les vecteurs de l’aléa. Or « penser l’inattendu serait un sujet de réflexion philosophique aussi utile que celui de penser la guerre (p. 268) ». Cet ouvrage nous ouvre enseigne donc une philosophie de l’histoire immédiate, celle des chocs entre la foi, les mémoires et les identités.
Georges Feltin-Tracol
• Dominique Venner, L’imprévu dans l’Histoire. Treize meurtres exemplaires, Pierre-Guillaume de Roux (41, rue de Richelieu, F – 75 001 Paris, www.pgderoux.fr), 2012, 272 p., 22 €.
Article printed from Europe Maxima: http://www.europemaxima.com
URL to article: http://www.europemaxima.com/?p=2501
00:05 Publié dans Histoire, Livre, Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, histoire, nouvelle droite, dominique venner, crimes, criminalité |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 30 avril 2012
Giorgio Agamben: Höchste Armut
|
|
|
Geschrieben von: Timo Kölling |
|
Ex: http://www.blauenarzisse.de/
|
|
Am wenigsten verzeiht der Bürger, dass das, was er liebt und wovon er lebt, das schier Augenscheinliche, sich letztlich doch ihm entzieht. Diese fundamentale Unsicherheit des Bürgers, Grund seiner zahlreichen „Nihilismen“, die in erster Linie nur der Rechtfertigung des Kitschs dienen, ist epochal geworden, keine phänomenologische Konstruktion von „Wesensgründen“ (die ihrerseits schon dem „Nihil“ aufruhen) hat daran etwas ändern können. Am Ende wird stets in Abrede gestellt werden, hinter dem erhaschten Zipfel habe je sich ein Kleid verborgen. Die beliebte Metapher des „Schillerns“ enthält sie bereits, diese Kritik. Alles kann in den Augen des Bürgers von jetzt auf gleich zu „schillern“ beginnen: Titel, Thesen, Begriffe, Charaktere, Gesten, Bedeutungen. Die Redaktion bedankt sich bei Timo Kölling für die Erlaubnis zur Übernahme dieses Beitrags. |
00:08 Publié dans Livre, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, livre, italie, giorgio agamben, pauvreté, ascétisme, moyen âge, ordres religieux |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 27 avril 2012
Jonathan Bowden’s Kratos
In Remembrance of the Surrealist British Artist and Philosopher Jonathan Bowden
Jonathan Bowden’s Kratos
By John Michael McCloughlin
Ex: http://www.counter-currents.com/
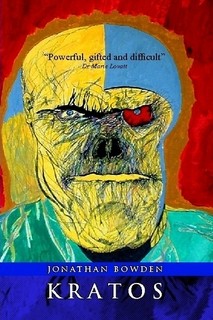 Jonathan Bowden
Jonathan Bowden
Kratos and Other Works [2]
London: The Spinning Top Club, 2008
The book Kratos was published by the Spinning Top Club in very early 2008. It extends over 157 pages. It consists of four independent stories of around the same length.
The first (“Kratos”) deals with a Lombrosian tale about criminality and psychopathia. It delineates a Yorkshire axe-man called Billy-O or Dung Beetle whose intentions are fundamentally misread by an upper-class fop, Basildon Lancaster.
One might characterize it as an exercise in Degeneration theory from the late nineteenth century brought up to date — hence its debt to Cesare Lombroso’s Criminal Man from 1876, I believe. A highly filmic coloration befits this piece — almost in a lucid or paranormal light and this lends it a dream-like or magical intention. Bowden’s pieces tend to be extremely visual, oneiric, outsider drawn or filmic in compass — he is definitely what could be called a Visualiser. There also, to this particular critic, seems to be a correlation between all of these fictions and the comics or graphic novels that he produced as a child. All of them have a violent, immediate and aleatory dimension, to be sure, yet I infer something more.
What I mean is that just like a film which is planned on a story-board, for example, these literary tales move simultaneously on many levels and with a visual candor. It is almost as if Mister Bowden split his creative sensibility in moving from boy to man: the verbal bubbles or lettering (as they are called) in the graphic novels split off to become fictions; while the images morphed into fine art-works. They became stand alone paintings in their own right.
Kratos deals with insanity but on distinct levels, some of which fast forward and back — while parallel dimensions, parts of the mind, stray visual eddies or prisms, and telescoped refractions all recur. This filmic quality proceeds throughout the piece akin to Hitchcock or Blatty, but a strong narrative impulse bestrides this magic realism. It lends the excoriation at the tale’s end something akin to the reverberation of Greek tragedy.
From a Right-wing or elitist perspective, I think that Bowden’s fictional trajectory works in the following manner. From the very beginning there is an exoteric dimension (much like the political trappings of a reasonably notorious political movement from early in the twentieth century). This deals with the artistry, story, structure, prism effect in terms of H. T. Flint’s Physical Optics, as well as the narratives dealt with above.
But, in my view, there is another hidden, buried, esoteric, occultistic, and numinous aspect. It is slightly and from a liberal perspective rather scandalously linked to a thesis in the book Nietzsche, Prophet of Nazism [3] by a Lebanese and Maronite intellectual [4]; together with the Occultistic text The Morning of the Magicians. This inner urge or poetic trope is an attempt to create the Superman via a manipulation of consciousness.
Most Western cultural standards, menhirs, sacred stones, or objects on the ground have been devastated or destroyed — even though the odd echo can be heard. (This might be said to be a small Classics department at a provincial university, for instance.) Nonetheless, Bowden preaches re-integration — beginning within oneself — and ending up with the maximalization of strength. One should remember or factor in that almost every other literary tendency is contrary or reverse-wise. Characters are chaotic, broken, stunted, uncertain, apolitical, non-religious, without any metaphysic whatsoever, chronically afraid, sexually and emotionally neurotic, tremulous about death, et cetera . . . While Bowden’s Oeuvre intimates the re-ordination of the Colossus — both gradually and over time.
Hence we begin to perceive a glacial imprimatur in his work; in that characterization is non-Dual, beyond good and evil, semi-Gnostic, Power oriented in the manner of Thrasymachus, “demented,” furious, even non-Christian. It ennobles the prospect of Odin without the overlay of Marvel Comics and as a Trickster God . . . i.e., it’s the moral equivalent of Batman’s Joker as reviewed, via The Dark-Knight [5], elsewhere on this site. It also ramifies with the words of the anti-humanist intellectual, Bill Hopkins, who, in a cultural magazine close to the polymath Colin Wilson known as Abraxas, once remarked: “The purpose of literature is to create New Titans.”
One other cultural idea suffices here . . . this has to do with Joseph Goebbels’ answer to a question about his interpretation of the Divine. This should be seen as part of the frontispiece of his expressionist novel Michael, a third positionist work from the ‘twenties. He described “God” as a multi-proportioned or eight-limbed idol, replete with heavy jambs and rubiate eyes, and possibly constructed from orange sandstone. Such an effigy was associated with the following: flaming tapers or torches, brands, naked female dancers, and human sacrifice. To which the Herr Doktor’s interlocutor remarked: “It doesn’t sound very Christian to me!” The propaganda minister’s response came back as quick as a shot: “You’re mistaken; THAT IS CHRIST!”
I think that Jonathan Bowden believes much the same about the meta-ethic of his own literary output. The other stories in this volume were “Origami Bluebeard” (a marriage, a murder, a threnody, a Ragman, a take on Thomas Carlyle’s Sartor Resartus); “Grimaldi’s Leo” (a lighter variant on Animal Liberation), and “Napalm Blonde.” This was an attempt at Greek Tragedy, configures a Tiresius who maybe alone but not in a wasteland, and happens to be radically heterosexualist after Anthony Ludovici’s analysis.
For those who have ears to hear — let them hear.
Note: Kratos can be read or purchased here [2].
Article printed from Counter-Currents Publishing: http://www.counter-currents.com
URL to article: http://www.counter-currents.com/2010/10/jonathan-bowdens-kratos/
URLs in this post:
[1] Image: http://www.counter-currents.com/wp-content/uploads/2010/10/kratos.jpg
[2] Kratos and Other Works: http://www.jonathanbowden.co.uk/publications.html
[3] Nietzsche, Prophet of Nazism: http://www.amazon.com/Nietzsche-Prophet-Nazism-Superman-Unveiling-Doctrine/dp/1420841211/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1286602280&sr=1-1
[4] a Lebanese and Maronite intellectual: http://www.counter-currents.com/tag/abir-taha/
[5] The Dark-Knight: http://www.counter-currents.com/2010/09/the-dark-knight/
00:27 Publié dans Livre, Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, nouvelle droite, jonathan bowden, hommage |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 14 avril 2012
Pour en finir avec la Françamérique
Pour en finir avec la Françamérique, par Jean-Philippe Immarigeon

C'est parce que l'auteur comprend de moins en moins, malgré les évènements récents ayant marqué l'histoire du monde, la persistance de la dépendance de la France, dans toutes ses composantes, au mythe d'une civilisation commune avec les Etats-Unis, qui nous empêche de nous décider enfin à prendre en mains nous-mêmes notre destin.
L'auteur, excellent connaisseur des Etats-Unis, où il exerce une partie de son activité professionnelle, ne comprend pas l'aveuglement des Français à vouloir dans tous les domaines s'abriter sous la référence américaine, au lieu de faire appel à leurs propres ressources. Même ceux qui sont obligés par la force des choses de confesser une perte de puissance américaine n'en tirent pas arguments pour enfin rompre le lien affectif qui les unit à une Amérique dont ils se donnent une image largement fantasmée et inexacte. Même ceux qui veulent rompre ce lien n'osent pas le faire pleinement. La peur d'être condamnés comme anti-américaniste sommaires les empêchent de voir et d'évoquer les raisons qui devraient nous obliger à devenir enfin indépendants.
Nous n'allons pas ici reprendre les arguments de l'auteur. Le livre est suffisamment court et vivant pour mériter d'être lu par tous ceux qui ne souhaitent pas s'engager dans des considérations géopolitiques complexes. Bornons-nous à quelques questions.
* L'addiction à l'Amérique se limite-t-elle à la France? Ne faudrait-il pas envisager une « américanomanie européenne » qui paralyserait toute l'Europe? Elle culminerait au niveau des institutions européennes mais aussi dans chacun des gouvernements de l'Union. Elle ne se limiterait pas aux cercles dirigeants mais elle toucherait l'ensemble de la population. Partout, la peur de rompre le cordon qui relie l'Europe à une Amérique présentée comme légitimement en charge des affaires du monde paralyse les velléités de saisir les opportunités qui s'offrent désormais à l'Europe, lui permettant de jouer enfin sa partie dans un monde devenu multipolaire. Les perspectives présentées par Franck Biancheri, directeur du Laboratoire Européen d'Anticipation Politique (LEAP) n'éveillent encore qu'un faible écho. 1) Elles devraient pourtant dynamiser les énergies européennes, puisque celui-ci montre que, entre une Amérique déclinante et une montée en puissance du BRICS, un large créneau d'opportunité s'ouvre à l'Europe (et à l'euro) pour valoriser et développer des ressources qui restent considérables.
* Mais si c'est l'Europe toute entière qui est frappée d'impuissance par son américanomanie, ne faut-il pas s'attacher à mettre en évidence les processus par lesquels depuis la seconde guerre mondiale les Etats-Unis se sont faits, sous les apparences, l'ennemi délibéré de la construction d'une Europe-puissance indépendante d'eux. Il faudrait à cet égard parler d'une véritable entreprise coloniale, par laquelle les nouveaux colons américains se sont attachés à déposséder de leur culture propre les Européens, comme ils l'avaient fait précédemment des Indiens d'Amérique.
Or pourquoi les Européens se sont-ils soumis si facilement à la colonisation militaire, économique et culturelle américaine. La question a été souvent posée. Elle continue à l'être. La réponse la plus évidente paraît tenir au fait que les oligarchies financières, gouvernementales et médiatiques européennes trouvent beaucoup plus facile pour assurer leur pouvoir de se mettre sous la dépendance de leurs homologues américaines depuis longtemps dominantes plutôt que chercher leurs propres voies de développement. La dégradation lente de la puissance américaine n'est pas encore suffisamment affirmée pour qu'elles cherchent ailleurs des alliances de rechange.
* Quand on constate à cette égard la servilité avec laquelle les forces politiques et intellectuelles de nos voisins européens persistent à se rendre vassales d'une Amérique qui compense sa perte de puissance sur le monde en renforçant sa domination sur l'Europe, ne pourrait-on penser que la France, malgré ses abaissements consentis, n'est pas celle à qui il faudrait reprocher le plus grand esprit de capitulation. La défense de la souveraineté française eut d'abord ses grandes heures avec le Gaullisme, grâce auquel nous disposons encore de ressources technologiques que n'ont pas l'Allemagne et les pays européens du Nord pourtant réputés par leur puissance économique. Il n'en demeure malheureusement plus grand chose aujourd'hui du fait des efforts continus de l'actuel président de la République pour démobiliser ce qui restait d'indépendance dans la diplomatie et dans la défense française. Ceci s'est fait directement, notamment par le plein retour de la France dans l'Otan. La tentative se poursuit aussi indirectement, par exemple du fait de la pénétration dans notre potentiel industriel des capitaux du Qatar, eux-mêmes très proches des intérêts américains - ainsi que d'autres tout aussi dangereux. .
Il reste quand même en France quelques ressources qui pourraient, convenablement valorisées par un prochain gouvernement français, servir de base à une résurrection industrielle et diplomatique non seulement française mais européenne. L'exemple en est le Rafale, l'avion de combat français qui se révèle porteur de ce que sans excès d'enthousiasme on pourrait présenter comme une alternative civilisationnelle à celle que les Etats-Unis voulaient imposer à l'ensemble du monde et pour plus d'un demi-siècle en refusant toute alternative autre que l'acquisition obligée de leur Joint Strike Fighter F 35. Nous avons pour ce qui nous concerne suivi de près la montée et la chute d'un appareil qui se révèle aujourd'hui comme un concentré ingérable de technologies, véritable fer-à-repasser volant. Pour s'en convaincre, il fallait suivre la chronique extraordinairement documentée et inspirés qu'en a donnée depuis plus de 10 ans notre ami Philippe Grasset 1). Aujourd'hui cependant, comme le montre Philippe Grasset, le Rafale français, beaucoup plus réaliste au point de vue technique, semble en train de s'imposer, non seulement par ses qualités propres mais parce qu'incarnant une nouvelle forme de souveraineté politique, dont le Gaullisme avait été pour la France l'illustration, et qui est en train de gagner du terrain, sous des formes voisines, dans les Etats décidés à se libérer de l'emprise américaine. 3)
* L'abaissement de la France et avec elle de l'Europe devant l'Amérique, est-il irréversible? L'évolution actuelle des Etats-Unis, en mettant en évidence la fausseté des mythes par lesquels nous acceptions leur domination, suffira-t-elle à nous en prémunir dorénavant. On peut en douter car trop rares sont ceux qui comme Jean-Philippe Immarigeon décrivent l'Amérique comme elle apparaît dorénavant en profondeur: raciste, inégalitaire, obtue intellectuellement, en proie à des religions auxquelles l'islamisme n'a rien à envier en termes d'esprit de conquête et de refus du rationnel scientifique. L'Amérique reste encore très forte du fait de la puissance de son potentiel militaire et de ses capacités en termes de recherche technologique. Mais nous sommes bien placés ici pour montrer que ces potentiels sont désormais au service d'une volonté de contrôle total 4) ne laissant plus guère de place à nos conceptions républicaines et démocratiques.
Or faire ces constatations et recommander que l'Europe se ressaisisse, qu'elle exploite comme le propose Franck Biancheri les atouts potentiels importants dont elle dispose encore, est rejeté par les intérêts européens dominants, dont nous avons souligné une soumission à l'atlantisme qui leur parait la meilleure façon d'assurer le maintien de leurs pouvoirs. D'une façon générale, plus se renforceront les menaces pesant sur le monde, plus les Européens se sentiront paralysées à l'idée de se détacher d'une Amérique où ils continuent à voir un recours, sans se rendre compte que celle-ci, lorsqu'elle aura épuisé les ressources tirées jusqu'ici de ses vassaux européens, les rejettera comme inutiles et dangereux.
*Mais alors quelles voies Jean-Philippe Immarigeon proposerait-il pour permettre aux Français, voire aux Européens, de se déprendre de la Franceamérique? L'exhortation risque de ne pas suffire. A une époque où, de plus en plus, s'imposent des choix géostratégiques décisifs, à une époque où la France elle-même, malgré son refus de voir ces réalités en face, devra bien prendre des décisions lourdes de conséquences, on est un peu déçu de constater que l'auteur, malgré son expérience, ne se prononce pas clairement. Il court le risque de se voir reprocher la répétition de livre en livre du même message, en piétinant sur place faute de laisser entrevoir des solutions. Peut-être veut-il nous laisser devant nos propres responsabilités, une fois le mal dénoncé? Nous aimerions savoir pourtant, naïfs impénitents que nous sommes, pour quel candidat il va voter lors des prochaines élections présidentielles françaises.
Notes
1) Franck Biancheri, Crise mondiale. En route pour le monde d'après. France-Europe Monde dans la décennie 2010-2020. Anticipolis, 2010.
2) Sur son site DeDefensa.org (également pratiqué et apprécié par Jean-Philippe Immarigeon).
3) Jean-Luc Mélanchon, cas exceptionnel parmi les hommes politique français, a bien compris ce rôle emblématique du Rafale. A une journaliste qui lui reprochait récemment, sur le site Médiapart, de s'intéresser à un système d'armes français tel que le Rafale, plutôt qu'à un vague projet humanitaire, il a répondu qu'il ne faisait pas cela pour rendre service à la firme Dassault, mais parce que selon lui les Etats du monde doivent désormais choisir, en matière d'avions de combat, entre 3 ou 4 conceptions du monde, celle encore défendue par une Amérique de plus en plus régressive, la russe, la chinoise et la française. Il est triste de constater que la grande majorité des hommes politiques européens ne l'aient pas encore compris et ne voient aucun inconvénient à ce que l'Europe s'équipe en appareils américains ou se raccrochent à l'Eurofighter qui n'a d'européen que le nom.
4) Alain Cardon " Vers un système de contrôle total "
Ouvrage au format.pdf accessible en téléchargement gratuit
(publié sous Licence Creative Commons)
http://www.admiroutes.asso.fr/larevue/2011/121/controletotal.pdf
Jean Philippe Immarigeon nous écrit:
" Je suis monomaniaque (d'un livre à l'autre) parce qu'il ne sert à rien de penser un après tant qu'on est piègé dans l'hier. Dit plus simplement, j'ai compris en vivant aux Etats-Unis, en bossant avec eux également ensuite et en discutant toutes les semaines avec mon ami Rick (patron de Harper's Magazine) qui ne supporte plus son pays, ce que Tocqueville écrivait de l'étouffement de la pensée que pratique la civilisation américaine. Dit encore autrement, qu'il s'agisse de la réforme de l'OTAN ou du carcan idéologique atlantiste, il est vain et vaniteux de penser faire de l'entrisme et changer les choses de l'intérieur, par subversion. C'est sous-estimer la puissance américaine, les moyens de communication, l'importance des thinks tanks, le nombre incalculable de bureaucrates payés à faire de la propagande depuis 1945. On ne peut lutter à armes égales. Il faut donc d'abord sortir et faire de l'asymétrique, sinon c'est une perte de temps et d'énergie".
Pour en savoir plus
* Jean-Philippe Immarigeon blog http://americanparano.blog.fr/
00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, géopolitique, france, etats-unis, europe, affaires européennes, atlantisme, livre |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 13 avril 2012
Histoire des Berbères, des origines à nos jours


Les Berbères ou Imazighen (Amazigh au singulier) constituent le fond ancien de la population de l’Afrique du Nord. Ils formaient à l’origine un seul Peuple peu à peu fragmenté par une histoire à la fois riche, complexe et mouvementée. Des dynasties berbères régnèrent sur le Maghreb jusqu’au XVI° siècle.
Les partisans de l’arabo-islamisme affirment que les Berbères sont sortis de l’histoire, leur conversion à l’Islam les ayant inscrits de façon irréversible dans l’aire politico-culturelle de l’arabité. Dans les années 1950, la revue Al Maghrib alla ainsi jusqu’à écrire qu’ils ne peuvent accéder au Paradis que s’ils se rattachent à des lignées arabes. Quant auministre algérien de l’Education nationale, il déclara en 1962 qu’ils « sont une invention des Pères Blancs ».
Aujourd’hui, les dirigeants arabo-islamiques nord africains doivent faire face au réveil berbère si fortement exprimé en 2004 par Mohammed Chafik au travers de sa célèbre question réponse: « Au fait, pourquoi le Maghreb arabe n’arrive-t-il pas à se former ? C’est précisément parce qu’il n’est pas Arabe ». Cette phrase était incluse dans un article dont le titre explosif était : « Et si l’on décolonisait l’Afrique du Nord pour de bon ! », intitulé signifiant qu’après avoir chassé les Français, il convenait désormais pour les Berbères d’en faire de même avec les Arabes…
Qui sont donc les Berbères ? Quelle est leur origine ? Comment furent-ils islamisés ? Quelle est leur longue histoire ? Comment se fait aujourd’hui la renaissance de la berbérité? Peut-elle être une alternative au fondamentalisme islamique ?
C’est à ces questions qu’est consacré ce livre qui n’a pas d’équivalent. Son approche est ethno historique et couvre une période de 10 000 ans. Il est illustré par de nombreuses cartes en couleur et par des photographies.
Table des matières
Première partie : La Berbérie jusqu’à la conquête arabe
Chapitre I : Une très longue histoire
A) L’état des connaissances
B) L’Egypte, une création berbère ?
Chapitre II : Les Berbères durant l’Antiquité classique
A) Les Peuples et les Etats
B) Les Berbères furent-ils romanisés ?
Chapitre III : Les Berbères, les Vandales et les Byzantins
A) L’intrusion vandale
B) L’échec de Byzance
Deuxième partie : Les Berbères se convertissent à l’islam mais ils résistent à l’arabisation (VI°-XV°siècle)
Chapitre I : Les Berbères face à la conquête et à l’islamisation
A) Les résistances à la conquête
B) La révolte berbère du VIII° siècle
Chapitre II : Le monde berbère du IX° au XII° siècle
A) La Berbérie au IX° siècle
B) Le Maghreb berbéro musulman du X° au XII° siècle
Chapitre III : Les grandes mutations du monde berbère (XII°-XV° siècle)
A) Les Berbères almohades et l’arabisation du Maghreb (XII°-XIII°)
B) La question arabe
C) Le tournant des XIII°-XV° siècles
Troisième partie : Des Berbères dominés à la renaissance de la Tamazgha
Chapitre I : Les Berbères perdent la maîtrise de leur destin (XVI°-XIX° siècle)
A) Le Maroc entre Arabes et Berbères
B) Les Berbères et les Ottomans (XVI°-XIX° siècle)
Chapitre II : Les Berbères et la colonisation
A) Algérie : de la marginalisation à la prise de conscience
B) Maroc : les Berbères victimes du Protectorat ?
Chapitre III : La renaissance berbère aujourd’hui
A) Maroc : de la stigmatisation à la cohésion nationale
B) Algérie : entre berbérisme et jacobinisme arabo-musulman
C) Les autres composantes de la Tamazgha
- Bibliographie
- Index des noms de personnes
- Index des tribus et des peuples
00:05 Publié dans Histoire, Livre | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : livre, bernard lugan, histoire, berbères, afrique, afrique du nord, peuples hamito-sémitiques, affaires africaines |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 12 avril 2012
Deutsche Meisterdenker

Deutsche Meisterdenker
von Siegfried Gerlich
Ex: http://www.sezession.de/
Der Regin-Verlag hat eine glückliche Wahl getroffen, seine von Sebastian Maaß herausgegebene Gesprächsreihe »ad rem« mit Selbstportraits der besten Köpfe der radikalen Rechten zu eröffnen. Dabei wecken die Biographien Hans-Dietrich Sanders und Günter Maschkes den Verdacht, daß deren intellektueller Rang sich nicht unmaßgeblich ihren marxistischen Lehrjahren verdankt.
Der auf mecklenburgischem Land aufgewachsene »nationale Dissident« Sander stand als Theaterkritiker in der frühen DDR zunächst unter dem Einfluß Bertolt Brechts, bevor er in die BRD übersiedelte und sein politisches Denken an Carl Schmitt neu schulte. Von der Borniertheit der Rechten abgestoßen, bezog Sander stets einen parteiübergreifend gesamtdeutschen Standpunkt. So erwuchs mit dem jungen Mitarbeiter der Welt und späteren Herausgeber der Staatsbriefe nicht nur dem Establishment ein Störenfried, sondern auch dem nationalen Lager ein Konkurrent. Unermüdlich gegen die »postfaschistische Resignation« ankämpfend, verachtete Sander den Neuen Konservatismus Schrenck-Notzings und Kaltenbrunners als kraftlos und konformistisch.
Trotz seines Bekenntnisses zum Preußentum als der »Quintessenz des deutschen Geistes« macht Sander keinen Hehl daraus, daß ihm für die Wiederherstellung des Deutschen Reiches die Rückgewinnung der ostdeutschen wie der deutsch-österreichischen Gebiete noch immer als »nationaler Imperativ« gilt. Nur von dieser Höhe, wenn nicht Hybris, seines »ghibellinischen« Reichsnationalismus her wird Sanders Argwohn verständlich, die Alliierten hätten mit der Wiedervereinigung »die Endlösung der deutschen Frage« bezweckt. Selbstbewußt beansprucht Sander, seit Kriegsende wie kein anderer »den deutschen Geist verkörpert zu haben«. Mit seiner scharfen Kritik der den Untergang einer entorteten Welt beschleunigenden jüdischen Apokalyptik stemmte er zumal den deutschen Antijudaismus auf ein einsames philosophisches Niveau. Um so widersprüchlicher wirkt Sanders eigener apokalyptischer Ton, in dem er ein »schnelles Ende« des bestehenden Deutschland beschwört, da erst nach einer »restlosen Implosion des status quo« eine neue Reichsherrlichkeit anbrechen könne. Ernst Jünger jedenfalls quittierte die Zusendung von Sanders grandiosem Hauptwerk Die Auflösung aller Dinge mit den mahnenden Worten: »Wir haben unser Cannae hinter uns.«
Zu Sanders heimatlich wohlverortetem deutschen Geist bildet Maschkes abenteuerliches Herz und sein nachgerade französischer Esprit einen harten Kontrast. Die Jugendjahre vis-à-vis dem Geburtshaus von Karl Marx in Trier verlebend, zog es den philosophisch ambitionierten Studenten zu Ernst Bloch nach Tübingen, wo er eine führende Rolle in der dadaistischen »Subversiven Aktion«, der auch Rudi Dutschke und Bernd Rabehl angehörten, spielen sollte. Der von Dutschke als »Maschkiavelli« Titulierte despektierte diesen wiederum als »reinen Toren«, da sich in dessen Revolutionsromantik die Machtfrage nicht stellte.
Nach seiner Desertion aus der Bundeswehr 1965 floh Maschke nach Wien, um als Kommunarde Adorno und Marcuse zu propagieren, bis Bruno Kreisky ihn in Abschiebehaft nahm. Das rettende kubanische Asyl 1968/69 bewahrte Maschke indessen nicht vor der Desillusionierung über Castros Sozialismus, und seine Hilfsdienste für eine Umsturzpläne schmiedende oppositionelle Gruppe führten zu seiner Ausweisung. Nach der Heimkehr nach Deutschland trat Maschke seine ausstehende Haftstrafe an und nahm eine schmerzliche Grundrevision seiner ideologischen Überzeugungen in Angriff. Ab 1973 als freier Mitarbeiter bei der FAZ beschäftigt, wandte sich Maschke allmählich der Neuen Rechten zu. Besiegelt wurde seine Konversion durch die 1979 geschlossene Freundschaft zu Carl Schmitt, als dessen Herausgeber und profunder Kenner Maschke sich internationale Anerkennung erwarb.
In seinen wenigen, aber gewichtigen Büchern und Aufsätzen richtete »der einzige Renegat der 68er-Bewegung« (Habermas) sein »bewaffnetes Wort« zunehmend gegen die degenerierten Nachkriegsdeutschen als »Fellachen de luxe« und die USA als »Schurkenstaat Nr. 1«, und mit seiner Stilisierung Castros zum »Katechon« einer in den Abgrund rasenden globalisierten Welt erwies der »Kritiker des Guerilleros« diesem eine späte Reverenz. Wie ein »Partisan, der die Waffen nimmt, wo er sie kriegen kann«, schätzt Maschke den unverminderten diagnostischen Wert der marxistischen Theorie und verachtet die »Lesefaulheit und latente Theoriefeindschaft vieler Rechter, die glauben, mit ihren Affekten auszukommen.« Gerade am autoritären Marxismus imponiert dem Nationalrevolutionär der Anspruch einer »höheren Sittlichkeit«, wohingegen die libertäre Linke sich mit dem bourgeoisen Liberalismus arrangiert habe und dessen hedonistischen Verfall auch noch forciere und als Emanzipation feiere. In seinen erfrischenden Heterodoxien erweist sich Maschke als einer jener freien Geister, die in allen Lagern selten geworden sind: »Nichts korrumpiert das Denken so sehr wie die Angst vor dem Beifall von der falschen Seite.«
Hans-Dietrich Sander/Sebastian Maaß: »Im Banne der Reichsrenaissance«, Kiel: Regin 2011. 126 S., 14.95 €
Günter Maschke/Sebastian Maaß: »Verräter schlafen nicht«, Kiel: Regin 2011. 206 S., 16.95 €
00:05 Publié dans Livre, Nouvelle Droite, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, günter maschke, allemagne, philosophie, nouvelle droite |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 08 avril 2012
Pequeño léxico del partisano europeo
Pequeño léxico del partisano europeo
Publicado por edicionesnuevarepublica

Pequeño léxico del partisano europeo
NOVEDAD
De G. Faye, P. Freson y R. Steuckers
Colección «El Partisano Europeo» /7
● 1ª edición, Barcelona, 2012
● 20×13 cms., 88 págs.
● Cubierta a todo color, con solapas y plastificada brillo
● PVP: 10 euros
Orientaciones:
El Petit lexique du partisan Européen (Pequeño léxico del partisano europeo) fue editado por primera vez en 1985. Sus autores, Guillaume Faye, Pierre Fresón y Robert Steuckers pertenecían —o habían pertenecido— a la denominada “Nueva Derecha”, etiqueta política muy al uso en Francia e Italia, pero incomprensible en España.
Su finalidad al escribir este léxico era la de dotar de un corpus doctrinal claro, eficaz y directo al “activista europeo”, proporcionarle una batería de ideas alternativas al discurso dominante de las ideologías de lo “políticamente correcto”, formarle y clarificarle en un léxico propio, un léxico para militantes de la Europa disidente.
[...] es el intenso compromiso político que distingue al partisano de otros combatientes. [...] el partisano lucha en un frente político, y precisamente el carácter político de su actividad revaloriza el sentido originario de la palabra partisano. La palabra se deriva de partido, e indica los vínculos con un partido o un grupo que lucha o hace la guerra o actúa políticamente de alguna forma. Y es en esta definición de Carl Schmitt donde encaja perfectamente el compromiso del militante europeísta. Su carácter de soldado político le convierte en un Partisano, en un miembro de la resistencia europea contra el Nuevo Orden Mundial.
[del prólogo de Juan Antonio Llopart]
Pedidos:
enrpedidos@yahoo.es
Tlf: 682 65 33 56
00:05 Publié dans Livre, Nouvelle Droite, Synergies européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, nouvelle droite, synergies européennes, guillaume faye |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook







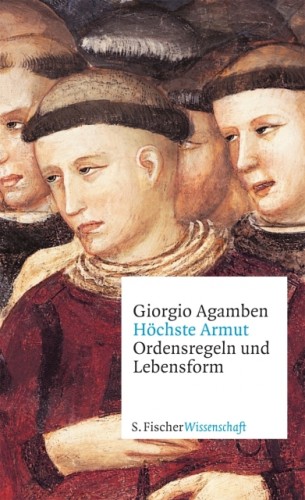 Das Verdikt über das Unverständliche ist die Rache des Bürgertums an Autoren, von denen, wenn sie einer Erkenntnis folgen, es immer nur jenen Zipfel zu greifen bekommt, der als reine Bedeutung explizit wird. Die fetischisierten Bedeutungen markieren am deutlichsten das bürgerliche Desinteresse an jeder Form von réalisation. Schon dass es Erkenntnisse gibt, ist des Bürgers Sache nicht. Sie stören die Wonne seines Meinens. Die Rache pflegt desto grausamer auszufallen, je bunter der Zipfel war, den der Autor preisgab, je „schillernder“, je mehr zum interessierten Gespräch Anlass gebend, zum Skandal taugend.
Das Verdikt über das Unverständliche ist die Rache des Bürgertums an Autoren, von denen, wenn sie einer Erkenntnis folgen, es immer nur jenen Zipfel zu greifen bekommt, der als reine Bedeutung explizit wird. Die fetischisierten Bedeutungen markieren am deutlichsten das bürgerliche Desinteresse an jeder Form von réalisation. Schon dass es Erkenntnisse gibt, ist des Bürgers Sache nicht. Sie stören die Wonne seines Meinens. Die Rache pflegt desto grausamer auszufallen, je bunter der Zipfel war, den der Autor preisgab, je „schillernder“, je mehr zum interessierten Gespräch Anlass gebend, zum Skandal taugend.