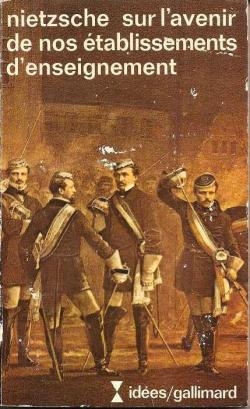mercredi, 04 mai 2022
Le problème de l'hybris

Le problème de l'hybris
Alexander Bovdunov
https://www.geopolitika.ru/es/article/el-problema-de-la-hibris
Les Grecs anciens considéraient l'ὕβρις (Hýbris) de manière négative et utilisaient ce mot pour parler d'un mixte qui est le produit de l'orgueil, de l'arrogance et de la confiance excessive en soi.
 Le politologue réaliste Hans Morgenthau (photo) avait l'habitude de faire remarquer que le concept d'ὕβρις avait une signification assez particulière dans l'Histoire de la guerre du Péloponnèse de Thucydide. Contrairement aux néo-réalistes, les réalistes anglo-saxons proposent de revenir aux penseurs classiques (c'est-à-dire les Grecs) et de retrouver des catégories telles que "équilibre des forces", "puissance" et "anarchie internationale" pour comprendre la réalité.
Le politologue réaliste Hans Morgenthau (photo) avait l'habitude de faire remarquer que le concept d'ὕβρις avait une signification assez particulière dans l'Histoire de la guerre du Péloponnèse de Thucydide. Contrairement aux néo-réalistes, les réalistes anglo-saxons proposent de revenir aux penseurs classiques (c'est-à-dire les Grecs) et de retrouver des catégories telles que "équilibre des forces", "puissance" et "anarchie internationale" pour comprendre la réalité.
Les réalistes soutiennent que l'ὕβρις a été la cause du déclin et de la défaite d'Athènes, car c'est le déclin de la vertu qui a finalement provoqué la chute de cette polis grecque. Selon les réalistes, la maîtrise de soi est l'un des fondements du pouvoir et ne pas la pratiquer ne peut que conduire au désastre. Morgenthau a écrit que "l'arrogance qui apparaît dans les tragédies grecques et chez Shakespeare se retrouve chez des personnages historiques bien connus tels qu'Alexandre, Napoléon et Hitler".
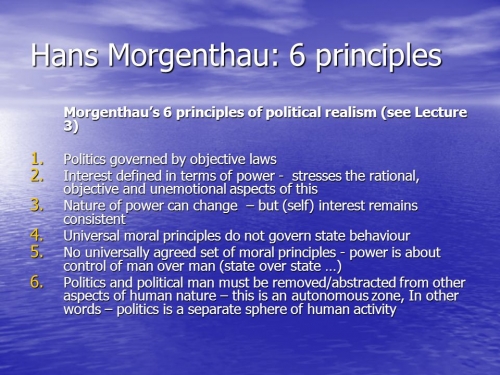
Le succès et l'ivresse du pouvoir conduisent à l'ὕβρις et font que les dirigeants d'un État - et par extension l'État lui-même - finissent par surestimer leur capacité à contrôler le monde entier: c'est l'arrogance qui, dans les tragédies grecques, conduit au désastre. Les Grecs considéraient l'ὕβρις comme une caractéristique des Titans qui conduisait les hommes à la perte de la peripeteia - c'est-à-dire l'épuisement de la fortune - et finalement à la nemesis - le châtiment divin.
Toutefois, ce n'est pas seulement l'équilibre des forces qui assure la stabilité d'un État, mais aussi l'ordre, la loi et le "nomos" (c'est-à-dire la modération). Le manque de retenue et l'arrogance conduisent à l'anomie, et l'anomie ne peut être surmontée sans le rétablissement de l'ordre. On pourrait dire que la tragédie grecque nous aide à comprendre les relations internationales.
Or, la seule superpuissance qui existe aujourd'hui, les États-Unis, a commencé à être détruite par sa propre "arrogance", notamment en raison de son abolition et de sa violation des lois écrites et non écrites du droit international (nomos). Cela a conduit les Américains non seulement à revendiquer et à conquérir de plus en plus de territoires, mais les a également poussés à une confrontation directe avec la Russie et la Chine. Le conflit actuel en Ukraine est une conséquence directe du déclin des États-Unis et est causé par leur propre perte de puissance. Cependant, les tragédies nous rappellent qu'il est possible d'exorciser et de purifier ces maux, en retrouvant le caractère sacré de la loi et en rétablissant l'ordre et la justice, comme le raconte la tragédie d'Antigone de Sophocle: un nouvel ordre naît de la tragédie déclenchée par la "légalité" d'un État corrompu par l'ὕβρις.
Nous pouvons aller plus loin et souligner que le Titanisme ne se caractérise pas seulement par l'excès mais aussi par la défense d'un ordre juridique injuste qui ignore les limites des actions et de la pensée. Si nous voulons contrer ces défauts, nous devons envisager les choses de manière claire et globale, c'est-à-dire au moyen d'une "théorie".
17:05 Publié dans Définitions, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : définition, hybris, réalisme politique, théorie politique, politologie, sciences politiques, philosophie, philosophie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 14 avril 2022
Le diagnostic du déclin occidental (vu par Spengler)

Le diagnostic du déclin occidental (vu par Spengler)
Il y a cent ans, Spengler publiait son essai monumental "Le déclin de l'Occident". Maintenant, la maison d'édition Aragno publie le deuxième volume de l'ouvrage en traduction italienne. L'occasion de reparler des concepts mis en avant par le philosophe allemand de l'histoire.
par Gennaro Malgieri
Source: https://www.barbadillo.it/103985-la-diagnosi-del-declino-occidentale-vista-da-spengler/
Une admirable description de la décadence des formes organiques, voilà ce qu'offre la fresque d'Oswald Spengler à ses lecteurs dans les pages du deuxième volume du Déclin de l'Occident, publié en 1922, il y a cent ans. Aujourd'hui, ils réapparaissent dans toute leur dramaturgie préconçue. Les "perspectives de l'histoire universelle" dans lesquelles l'auteur s'attarde, avec des références très cultivées, cachées dans les plis du temps des civilisations, sont celles parmi lesquelles, depuis quelques millénaires, nous, héritiers du faustianisme en liquidation, errons, perdus, contemplant parfois avec complaisance notre état de paria. La plante qui a poussé, grandi et s'est développée est en train de mourir. Le morphologue a l'obligation morale de nous sauver de nos illusions. Les civilisations sont des plantes. L'homme est une plante. Son début est sa fin. Avec lui, la Kultur se termine puis renaît, mais la perspective ne nous empêche pas de vivre avec la Zivilisation notre destin extrême.
Les civilisations, comme toutes les formes de vie, appartiennent au "monde organique" et répondent donc à un principe biologique. C'est pourquoi elles sont dotées d'une âme qui les caractérise. Avoir une histoire, cultiver un destin, c'est adhérer aux dictats de l'âme. Dans la période ascendante d'une civilisation (Kultur), les valeurs spirituelles et morales prédominent, donnant un sens à l'existence des êtres qui vivent selon les préceptes de la loi naturelle; l'existence communautaire est organisée en ordres, castes et hiérarchies ; un profond sentiment religieux domine dans le cœur des peuples, imprégnant l'art, la politique, l'économie et la littérature. Lorsque la civilisation vieillit et que son âme se flétrit, elle passe au stade de la "civilisation" (Zivilisation); le principe de la qualité est remplacé par celui de la quantité ; l'artisanat est remplacé par la technologie ; l'envahissement de la massification des goûts et des coutumes écrase les différences ; la ville, évoquant la vie de la campagne et organisée à l'échelle humaine, est remplacée par la mégalopole comme forme extrême de l'indifférentisme, une termitière sans dimension humaine ; les sociétés sont nivelées, l'hédonisme et l'argent sont les seules valeurs reconnues. Ce n'est que lorsque, avec l'avènement de la civilisation", écrit Spengler, "commence la marée basse de tout le monde des formes, que les structures des simples conditions de vie apparaissent nues et dominantes : Les temps viennent où le dicton vulgaire selon lequel "la faim et le sexe" sont les vrais moments de l'existence, cesse d'être ressenti comme une impudeur, les temps où ce n'est pas devenir fort en vue d'une tâche, mais le bonheur du plus grand nombre, le bien-être et le confort, panem et circenses, qui constituent le sens de la vie et où la grande politique cède la place à la politique économique comprise comme une fin en soi".
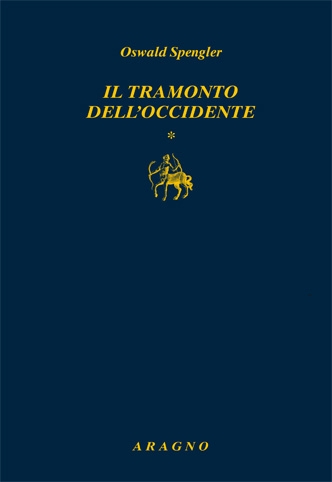
Des mots qui semblent avoir été écrits en ces temps troublés : ils ont été pensés il y a plus d'un siècle, lorsque Spengler a voulu créer, vers les années 1910, un grand roman historique et s'est retrouvé, transporté par le sentiment de décadence, à décrire ce qui allait inévitablement se produire. L'heure du coucher du soleil est notre heure. Celui qui nous a mis devant ce destin sévère, aussi livide que les couchers de soleil d'hiver, est notre contemporain. Ses avertissements doivent être accueillis avec le sérieux et la préoccupation qu'ils méritent. Le politiquement correct, l'organisation gluante du consensus égalitaire, la culture de l'annulation, l'homologation des coutumes, des vices et de l'absence de vertus, la construction du "dernier homme" voué au happy end et à l'existence de fellah sont autant d'éléments d'un déclin qui ne peut être endigué, tandis que la gloire effrayante du nihilisme se réjouit de nos destins rétrécis.
Le deuxième volume du Déclin - publié quatre ans après le premier, qui a secoué les consciences les plus alertes de l'époque, et réédité il y a quelques années par Nino Aragno (pp. 787, € 40,00) dans son habituel format élégant et son remarquable choix graphique - est la manière la plus solennelle, compte tenu de l'époque, de déclarer un anticonformisme absolu dépourvu de justification. Et Spengler noue l'élémentaire avec le complexe, identifiant les symptômes de la décadence dans le mode de vie de l'Occidental qui a écrit sa fin dans le mode de vie standardisé.

Voici les plus essentiels. La monumentalité des logements et des structures esthétiques, hideuses par définition puisqu'elles sont inspirées par le critère de l'utilité et non de la beauté pour réconforter nos petites âmes corrompues pour la plupart inadaptées à comprendre la grandeur, le pouvoir vulgaire de l'argent comme moteur de la vie bovine que nous menons, l'arrogance du démos inculte qui pousse la modernité jusqu'au sentiment de divertissement de masse nauséabond et terrifiant, sont les éléments qui connotent la fin de la Civilisation, les signes éloquents de la Civilisation.

Le "royaume" dans lequel tout cela se déroule est la ville. C'est le portrait tragique de Spengler qu'il a formulé avec une heureuse et dramatique clairvoyance au début des années 1920, lorsque la deuxième partie du Déclin prenait forme : "Le colosse de pierre appelé 'cosmopolis' se dresse à la fin du cycle de vie de chaque grande civilisation. L'homme de la civilisation, façonné psychiquement par la campagne, devient la proie de sa propre création, la ville ; il est obsédé par sa créature, devient son organe exécutif et finalement sa victime. Cette masse de pierre est la ville absolue. Son image, telle qu'elle se dessine en lignes d'une beauté grandiose dans le monde de lumière de l'œil humain, recueille le sublime symbolisme mortuaire de tout ce qui est définitivement "devenu". L'histoire millénaire du style a finalement transformé la pierre spiritualisée des bâtiments gothiques en la matière désanimée de ce désert démoniaque et saxicole (= qui vit sur le roc, sur les rochers)".
Spengler dit, et nous ne pouvons que le constater, que les maisons qui composent les villes n'ont rien des origines archaïques du style ionique ou baroque, elles ne rappellent pas l'ancienne demeure paysanne, ce ne sont pas des maisons dans lesquelles les dieux peuvent trouver une place, comme sur les petits autels des maisons helléniques et romaines. Ce sont des maisons désacralisées. Les villes sont des agrégations anonymes dans lesquelles on célèbre la frénésie orgiaque d'une vie sans but, comme l'aurait dit le plus grand poète allemand du 20ème siècle, Gottfried Benn, dans ses poèmes déchirants: "Les maisons sont les atomes dont elles sont composées". La deuxième partie du Déclin célèbre le mythe de la Zivilisation faustienne.

Le chapitre intitulé "L'âme de la ville", qui constitue le cœur du livre, propose les tons, les couleurs et les angoisses qui seront rendus célèbres par le chef-d'œuvre de Fritz Lang, Metropolis (1927). À l'arrière-plan se trouve "notre" avenir, le monde romain, dont le faustisme trace inévitablement les contours politiques. La monumentalité et la corruption, la domination de l'argent comme force prépondérante des pouvoirs obscurs du démos, c'est-à-dire les éléments constitutifs du césarisme, se mêlent à une perception de la modernité que l'on pourrait qualifier de psychédélique. Et dans ce tourbillon d'éléments hétérogènes, au centre duquel se prépare la catastrophe de la Seconde Guerre mondiale, l'œil de Spengler voit plus et mieux que ses contemporains. Ses "erreurs", a écrit Ernst Jünger, "sont plus significatives que les vérités de ses adversaires".
De la dissolution des formes organiques aux baraquements. La métaphore de la décadence est complète. Et pour la compléter, elle se déploie dans le déclin de la prolificité, dans la virilité flétrie, dans la fin de la fonction royale et maternelle des femmes, dans le repli de l'amour sur une sexualité dépourvue de séduction et d'érotisme, dans l'existence du guerrier réduit à un militarisme bureaucratique dépourvu d'héroïsme.
Spengler ne néglige aucun aspect du chemin de transformation de la vie associée jusqu'à son déclin.
La deuxième partie du Déclin est l'admirable ascension de l'intelligence dans le vertige de l'histoire de l'homme occidental. Contrairement à la première partie, le "paysage" domine la description morphologique. Et ce qui en ressort sont des joyaux de génie authentique dans la composition et la décomposition des âges jusqu'à nos jours.
Dans des pages à la fois séduisantes et choquantes, comme une tempête nocturne qui nous empêche de dormir, l'œil de Spengler poursuit le tourbillon des éléments constitutifs de la civilisation et, tout étourdi que nous soyons, réussit à nous faire comprendre l'état dans lequel nous nous trouvons. Le char de la civilisation est descendu jusqu'à nous. Les marchandises qu'il transporte sont de peu de valeur. Que se passera-t-il après le naufrage de la dernière illusion, le césarisme ? Spengler répond à cette question par la phrase qui clôt son livre prophétique, tirée des Épîtres à Lucilius de Lucius Anneus Seneca : Ducunt fata volentem, nolentem trahunt (Le destin guide ceux qui veulent être guidés et entraîne ceux qui ne le veulent pas).
On ne peut rien ajouter d'autre, sinon que face à tous les couchers de soleil de nos fragiles existences, la prière reste le dernier acte de l'esprit, tandis que l'intelligence, se tournant vers les pages de Spengler, peut saisir les signes d'un destin qui n'est qu'apparemment indéchiffrable. Ce que l'on ne comprend pas, c'est parce que l'on ne le connaît pas. Oswald Spengler paie sa dette d'homme du vingtième siècle envers l'humanité souffrante dont il fait partie en enlevant les voiles de la réalité qui dissimulent les falsifications de la modernité afin de nous relier au passé, dans la vision cyclique de l'histoire, non pas pour le restaurer, mais pour comprendre l'avenir pour ceux qui l'auront.
@barbadilloit
Gennaro Malgieri
16:51 Publié dans Livre, Livre, Philosophie, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : oswald spengler, livre, déclin de l'occident, révolution conservatrice, philosophie, philosophie de l'histoire, allemagne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 13 avril 2022
Le crépuscule des démocraties libérales

Le crépuscule des démocraties libérales
par Andrea Zhok
Source: https://www.ideeazione.com/il-crepuscolo-delle-liberaldemocrazie/
I. Les démocraties fantastiques et où les trouver
Dans les discussions publiques sur le conflit russo-ukrainien, au-delà des arguments nombreux et souvent confus, la dernière ligne du front mental semble suivre une seule opposition : celle entre "démocraties" et "autocraties". Tous les faits peuvent être vrais ou faux, tous les arguments peuvent être valables ou non, mais en fin de compte, l'essentiel est que, Dieu merci, d'un côté il y a "nous", les démocraties, et de l'autre côté ce que la démocratie n'est pas. D'un côté de l'abîme se trouveraient les "démocraties", identifiables aux démocraties libérales qui se sont développées sous l'aile des États-Unis (Europe occidentale, Canada, Australie, Israël, et peu d'autres), et de l'autre côté se trouveraient les "autocraties", ou "pseudo-démocraties corrompues" (essentiellement impossibles à distinguer des autocraties).
Ce grand projet se nourrit de préjugés tenaces, comme l'idée que les démocraties sont naturellement pacifiques et ne font jamais la guerre - sauf, bien sûr, lorsqu'elles y sont contraintes par les infâmes "non-démocraties". Le motif est aussi vague qu'imperméable, aussi opaque dans ses détails qu'il est ferme dans la foi qu'il insuffle.
Pourtant, lorsque nous examinons les situations en détail, nous découvrons une image curieusement en dents de scie.

Andrea Zhok
Nous pouvons découvrir, par exemple, que dans l'histoire, pourtant brève, des démocraties (qui, à quelques exceptions près, commence après 1945), les conflits entre elles n'ont pas manqué (de la guerre du Cachemire entre le Pakistan et l'Inde, aux guerres de Paquisha et Cenepa entre le Pérou et l'Équateur, en passant par les guerres entre les républiques yougoslaves, jusqu'à la guerre des Six Jours - avec le Liban et Israël gouvernés par des démocraties, etc.)
Et puis, nous pouvons découvrir que la démocratie par excellence, les États-Unis, est curieusement le pays impliqué dans le plus grand nombre de conflits au monde (102 depuis sa naissance, 30 depuis 1945), des conflits, personne n'en doute, auxquels les États-Unis ont été contraints malgré eux par des autocraties malfaisantes et corrompues; et pourtant, il reste singulier qu'aucune de ces autocraties belliqueuses ne puisse, même de loin, rivaliser avec les États-Unis en termes de niveau d'activité guerrière.
Mais en dehors de ces points, qui peuvent être considérés comme des accidents, les véritables questions sont les suivantes : qu'est-ce qui constitue l'essence d'une démocratie ? Et pourquoi une démocratie peut-elle être considérée comme un ordre institutionnel de valeur ?
II. La démocratie : procédure ou idéal ?
Il y a ceux qui pensent que la démocratie est simplement un ensemble de procédures, sans essence fonctionnelle ou idéale. Par exemple, la procédure électorale au suffrage universel serait caractéristique des démocraties. Mais il est clair que la tenue d'élections n'est pas une condition suffisante pour être considéré comme démocratique: après tout, des élections ont également eu lieu sous le fascisme. Et qu'en est-il de la combinaison d'avoir des élections et un système multipartite ? Du moins, si l'on s'en tient à la perception de l'opinion publique occidentale, ces conditions ne semblent pas non plus suffisantes, puisque dans les médias, on entend parler de pays où se tiennent régulièrement des élections multipartites (par exemple, la Russie, le Venezuela et l'Iran) comme d'autocraties, ou du moins de non-démocraties. Mais si c'est le cas, alors nous devrions nous demander un peu plus loin ce qui qualifie réellement un système démocratique comme tel. Quelle est la signification d'une démocratie ? Qu'est-ce qui lui donne de la valeur ?

Le sujet est vaste, controversé et ne peut être traité de manière exhaustive ici, mais je vais essayer de fournir, de manière quelque peu affirmative, quelques traits de base qui dessinent le cœur d'un ordre démocratique authentique.
Je crois qu'une démocratie tire ses mérites fondamentaux de deux cas idéaux, le premier plus explicite, le second un peu moins :
1) L'acceptation d'un pluralisme des besoins. Il est juste que tous les sujets d'un pays - s'ils sont capables de comprendre et de vouloir - aient la possibilité concrète de faire entendre leurs besoins, de les exprimer, et d'avoir une représentation politique capable de les assumer. Cette idée est principalement de nature défensive, et sert à exclure la possibilité que seule une minorité soit en mesure d'imposer politiquement son agenda et de faire valoir ses besoins, au détriment des autres.
2) L'acceptation d'un pluralisme de visions. Deuxièmement, nous pouvons également trouver une idée positive, concernant la dimension fondatrice du "peuple". Une vision du monde et de l'action collective dans le monde tire ses avantages, ses forces et ses vérités du fait qu'elle peut bénéficier d'une pluralité de points de vue, non restreints à une classe, un groupe culturel ou un contexte expérientiel. Si, dans la communication interne d'une démocratie (au sens étymologique du terme "politique"), une synthèse de ces différentes perspectives expérientielles est réalisée, alors, en principe, une vision plus riche et plus authentique du monde peut être obtenue. Cette idée n'est pas simplement défensive, mais donne à la pluralité des perspectives sociales une valeur proactive : la "vérité" sur le monde dont nous faisons l'expérience n'est pas le monopole d'un groupe particulier, mais émerge de la multiplicité des perspectives sociales et expérientielles. Cette dernière idée est plus ambitieuse et part du principe qu'un biais expérientiel tend de toute façon à créer une vision abstraite et limitative du monde, et que cette limitation est intrinsèquement porteuse de problèmes.

Ces deux instances, cependant, représentent en quelque sorte des idéalisations qui nécessitent l'existence de mécanismes capables de transférer ces instances dans la réalité. Il doit donc exister des pratiques sociales, des lois, des coutumes et des institutions capables de transformer le pluralisme des besoins et le pluralisme des visions en représentation et en action collectives.
Le mécanisme électoral n'est que l'un de ces mécanismes, et on peut se demander s'il est le plus important, bien que l'exposition périodique à un système d'évaluation directe soit d'une certaine manière cruciale en tant que méthode de contrôle et de correction par le bas.
Maintenant, la vérité est que le système de pratiques, de lois, de coutumes et d'institutions qui permet aux instances démocratiques susmentionnées de se concrétiser est extrêmement vaste et complexe. En fait, nous avons affaire à un système de conditions, dans lequel le dysfonctionnement grave d'un seul facteur peut suffire à compromettre l'ensemble. Une politique non représentative de la volonté du peuple, un pouvoir judiciaire conditionné par des puissances extérieures, un système économique soumis au chantage, un système médiatique vendu, etc. Tous ces facteurs, et chacun d'entre eux à lui seul, peuvent briser la capacité du système institutionnel à répondre aux instances idéales 1) et 2) ci-dessus.
En revanche, prenons le cas d'un système souvent mentionné comme manifestement antidémocratique, à savoir le système politique chinois. Il n'est pas caractérisé par le multipartisme (bien que des partis autres que le parti communiste aient été récemment autorisés). Toutefois, il s'agit d'une république et non d'une autocratie, car il existe des élections régulières qui peuvent effectivement choisir des candidats alternatifs (les députés du Congrès du peuple, qui peuvent élire des députés du Congrès du peuple à un niveau successivement plus élevé, dans un système ascendant jusqu'au Congrès national du peuple, qui élit le président de l'État). S'agit-il d'une démocratie ? Si nous avons les démocraties occidentales à l'esprit, certainement pas, car il lui manque plusieurs aspects. Cependant, dans une certaine mesure, il s'agit d'un système qui, au moins dans cette phase historique, semble s'accommoder au moins des instances négatives (1) mentionnées ci-dessus : il accueille les besoins et les demandes d'en bas et y répond de manière satisfaisante. Est-ce un heureux accident ? S'agit-il d'une "démocratie sui generis" ?

Si, d'autre part, nous examinons le système politique russe, nous sommes ici confrontés à quelque chose de plus similaire en termes de structure aux systèmes occidentaux, puisque nous avons ici des élections avec plusieurs partis en compétition. Mais ces élections sont-elles équitables ? Ou bien le conditionnement de la liberté de la presse et de l'information est-il déterminant ? Là aussi, il y a eu une amélioration des conditions de vie de la population au cours des vingt dernières années, ainsi que quelques ouvertures limitées en termes de droits, mais avons-nous affaire à une démocratie complète ?
III. Démocraties formelles et oligarchies économiques
Ces modèles (Chine, Russie), que l'on qualifie souvent de non-démocratiques, sont certes différents des démocraties libérales du modèle anglo-saxon, mais cette diversité présente également des aspects intéressants dans une perspective proprement démocratique, au sens des exigences 1) et 2). L'aspect le plus intéressant est une moindre exposition à l'influence de puissances économiques indépendantes, étrangères à la sphère politique.
Ce point, il faut le noter, peut être lu à la fois comme un plus et un moins en termes démocratiques. Certains diront que parmi les composantes sociales dont les intérêts doivent être pris en compte dans une démocratie (personne dans une démocratie ne doit être sans voix), il doit aussi y avoir les intérêts des classes aisées, et que par conséquent les systèmes qui ne sont pas sensibles à ces demandes seraient démocratiquement défectueux.
Ici, cependant, nous nous trouvons près d'un point critique. Nous pouvons prétendre que, dans le monde moderne, les représentants des pouvoirs économiques sont un pouvoir à côté des autres, un corps social à côté des autres : il y aurait des représentants des retraités, des métallurgistes, des agriculteurs directs, des enseignants, des défenseurs des droits des animaux et puis aussi des fonds d'investissement internationaux, comme un groupe de pression à côté des autres. Seulement, il s'agit, bien sûr, d'une fraude pieuse. Dans le monde d'aujourd'hui, suite à l'évolution du système capitaliste moderne, le pouvoir de loin le plus influent et le plus omnivore est représenté par les grands détenteurs de capitaux, qui, lorsqu'ils agissent dans l'intérêt de leur classe, exercent un pouvoir qui ne peut être limité par aucune autre composante sociale. Pour cette raison, c'est-à-dire en raison du rôle anormal en termes de pouvoir que peut exercer le capital aujourd'hui, il peut arriver que des formats institutionnels moins "démocratiquement réceptifs" dans des pays à la "démocratie imparfaite" offrent une plus grande résistance aux demandes du capital que dans des pays plus démocratiques sur le papier.
Ce point doit être bien compris, car il est en effet très délicat.
D'une part, le fait que les démocraties, en l'absence d'une surveillance robuste et de correctifs forts, peuvent rapidement dégénérer en ploutocraties, c'est-à-dire en règne de facto d'élites économiques étroites, ne fait aucun doute. Il s'agit d'une tendance structurelle que seuls les aveugles ou les hypocrites peuvent nier. D'autre part, cela ne signifie pas en soi que les systèmes qui se présentent comme potentiellement "résistants à la pression ploutocratique" le sont réellement, ni qu'ils sont effectivement capables de promouvoir un agenda d'intérêts proches du peuple (le cas historique du fascisme italien, inventeur de l'expression "démoplutocratie", reste là comme un avertissement).
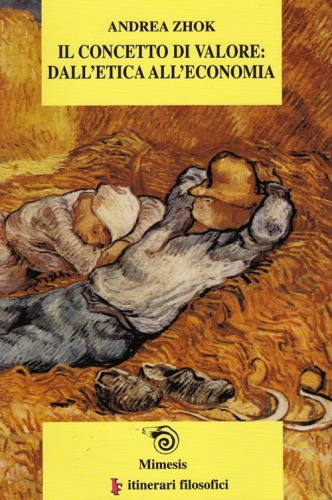
Dans cette phase historique, le problème vu du point de vue d'une démocratie libérale occidentale n'est pas d'idéaliser d'autres systèmes ou d'imiter d'autres modèles, qui se montrent peut-être à ce moment-là capables de servir les intérêts de leur propre peuple. Pour tout dire, on peut affirmer que le système institutionnel chinois de ces dernières décennies gagne en crédit pour sa capacité à améliorer, non seulement sur le plan économique, la condition de son immense population. Mais il s'agit d'un système qui a évolué sur des bases culturelles et historiques très spécifiques, qui ne peuvent être reproduites ou transférées. Il est donc approprié de l'étudier, il est juste de le respecter dans sa diversité, mais nous devons également éviter les idéalisations ou les improbables "transferts de modèles".
L'importance historique de l'existence d'une pluralité de modèles est à la fois géopolitique et culturelle. Sur le plan géopolitique, le pluralisme multipolaire peut limiter les tentations impériales d'un seul agent historique : avec toutes les limites de l'URSS, sa simple existence après la Seconde Guerre mondiale a produit de plus grands espaces d'opportunités en Occident, grâce au stimulus fourni par l'existence d'un modèle social alternatif auquel se comparer. La multipolarité est une sorte de "démocratie entre les nations", et permet d'obtenir au niveau des communautés historiques les mêmes effets que ceux qui sont idéalement promus en interne par une démocratie : l'acceptation d'une pluralité de besoins et d'une pluralité de visions.
IV. Options crépusculaires
Le problème auquel nous sommes maintenant confrontés, avec une urgence et une gravité terribles, est que le système des démocraties libérales occidentales montre des signes clairs d'avoir atteint un point de non-retour. Après cinquante ans d'involution néolibérale, le bloc des démocraties libérales occidentales est dans un état de faillite démocratique avancée. Après la crise de 2008, et de plus en plus, nous avons assisté à un alignement des intérêts des grandes puissances financières, un alignement dépendant de la perception d'une crise naissante qui fera époque et qui impliquera tout le monde, y compris les représentants du grand capital.
Des choses connues depuis longtemps, mais dont la prise de conscience avait jusqu'alors été tenue à l'écart de la conscience opérationnelle, se présentent désormais comme des évidences qui ne peuvent plus être contournées par les grands acteurs économiques.
Il est bien connu que le système économique capitaliste issu de la révolution industrielle a besoin de s'étendre, de s'agrandir et de croître indéfiniment afin de répondre aux attentes qu'il génère (et qui le maintiennent en vie). Il est également bien connu qu'un système de croissance infinie est autodestructeur à long terme : il est destructeur pour l'environnement pour des raisons logiques, mais bien avant d'atteindre des crises environnementales définitives, il semble être entré en crise au niveau politique, car la surextension du système de production mondial l'a rendu de plus en plus fragile. L'arrêt du processus de mondialisation, dont on parle en ce moment, n'est pas un événement parmi d'autres, mais représente le blocage de la principale direction de croissance de ces dernières décennies. Et le blocage de la phase d'expansion pour ce système est équivalent au début d'un effondrement/changement de système.
Les lecteurs de Marx, en entendant évoquer l'idée d'un effondrement systémique, pourraient bien lui souhaiter bonne chance : après tout, la prophétie sur la non-durabilité du capitalisme a une tradition riche et prolifique. Malheureusement, l'idée que le renversement du capitalisme devrait déboucher sur un système idéalement égalitaire, un viatique pour la réalisation du potentiel humain, est longtemps apparue comme une perspective souffrant d'une mécanique peu crédible.
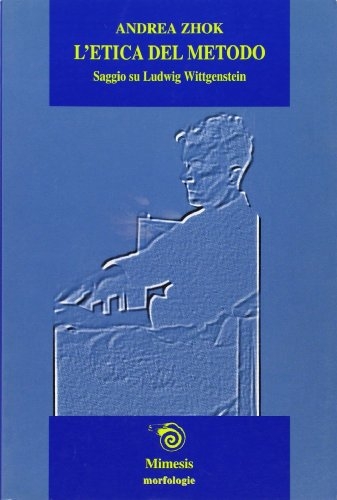
La situation qui se dessine aux yeux des acteurs économiques internationaux les plus attentifs et les plus puissants est plutôt la suivante. Face à une promesse de croissance de plus en plus instable et incertaine, il n'y a essentiellement que deux directions possibles, que nous pourrions appeler les options : a) "cataclysmique" et b) "néo-féodale".
a) Les processus dégénératifs déclenchés par les crises naissantes peuvent aboutir à une grande destruction des ressources (comme ce fut le cas la dernière fois, lors de la Seconde Guerre mondiale), une destruction telle qu'elle contraint le système à se rétrécir, tant sur le plan économique que démographique, ouvrant ainsi la voie à une réédition de la perspective traditionnelle, à un nouveau cycle identique aux précédents, où la croissance est la solution invoquée à tous les maux (chômage, dette publique, etc.). Il est difficile de dire si quelqu'un poursuit effectivement activement une telle voie, mais il est probable qu'au sommet de la pyramide alimentaire actuelle, cette perspective est perçue comme une possibilité à accepter sans tapage particulier, comme une option intéressante et non malvenue.
b) En l'absence d'événements cataclysmiques, l'autre voie ouverte aux grands détenteurs de capitaux est la consolidation de leur pouvoir économique dans des formes de pouvoir moins mobiles que le pouvoir financier, moins dépendantes des vicissitudes du marché. Le pouvoir économique aspire désormais à passer de plus en plus d'une forme liquide à une forme "solide", que ce soit sous forme de propriété territoriale ou immobilière, ou sous forme de pouvoir politique direct ou (ce qui revient au même) médiatique. Cette option, un peu comme celle qui s'est produite à la chute de l'Empire romain, devrait permettre aux grands détenteurs de capitaux de se transformer directement en autorités ultimes, en une sorte de nouvelle aristocratie, un nouveau féodalisme, mais sans investiture spirituelle.

Toutefois, ce double scénario peut également prendre la forme d'oscillations entre des mises en œuvre partielles de ces options. Il est fort probable que, comme c'est le cas pour les sujets habitués à "différencier les portefeuilles" afin de réduire les risques, au sommet, les deux options (a) et (b) sont envisagées en parallèle, pesées et préparées simultanément. C'est là un trait typique de la rationalité capitaliste et spécifiquement néolibérale : on ne se fixe jamais sur une perspective unique, qui en tant que telle est toujours contingente et renonçable : ce qui compte, c'est la configuration créée par l'oscillation entre les différentes options, à condition que cette oscillation permette de rester en position de prééminence. Ainsi, il est possible que le résultat de cette double option soit une oscillation entre deux versions partielles : des destructions plus circonscrites d'un cataclysme mondial, combinées à des appropriations plus circonscrites du pouvoir politique et médiatique d'un saut systémique dans un nouveau féodalisme postmoderne.
Cette troisième option est la plus probable et la plus insidieuse, car elle peut prolonger une agonie sociopolitique sans fin pendant des décennies, effaçant progressivement le souvenir d'un monde alternatif dans la population. La phase dans laquelle nous nous trouvons est celle de l'accélération de ces processus. Les médias des démocraties libérales sont déjà presque à l'unisson sur toutes les questions clés, créant des agendas de "questions du jour" avec leurs interprétations obligatoires. Il est ici important de réaliser que dans les systèmes de masse et d'extension tels que les modernes, il n'est jamais important d'avoir un contrôle à 100% du champ. La survie des instances et des voix minoritaires, fragilisées et dépourvues de capitaux pour les soutenir, n'est ni un risque ni une entrave. Un contrôle à 100% n'est souhaitable que dans les formes où la dimension politique est prioritaire, où une opinion minoritaire peut gagner les esprits et devenir l'opinion majoritaire. Mais si la politique est en fait déjà détenue par des forces extra-politiques, telles que les structures de financement ou le soutien des médias, une dissidence marginale peut être tolérée (du moins jusqu'à ce qu'elle devienne dangereuse).
Les démocraties libérales occidentales, qui jouent aujourd'hui le rôle du chevalier de l'idéal offensé par la brutalité autocratique, sont en vérité depuis longtemps des théâtres fragiles dans lesquels la démocratie est une suggestion et, pour certains, une nostalgie, avec peu ou rien de réel derrière elle. Avec la politique et les médias déjà massivement soumis au chantage - ou à la solde - nos démocraties fantasment sur la représentation d'un monde qui n'existe plus, s'il a jamais existé.
Par rapport aux systèmes qui n'ont jamais prétendu être pleinement démocratiques, nos systèmes ont un problème supplémentaire : ils ne sont pas le moins du monde conscients d'eux-mêmes, de leurs propres limites et donc aussi du danger qu'ils courent. Les démocraties libérales occidentales sont habituées à être cette partie du monde qui a traité le reste de la planète comme son propre pied-à-terre au cours des deux derniers siècles ; à partir de cette attitude de supériorité et de suffisance, les citoyens des nations occidentales sont incapables de se voir à travers les yeux de quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes, ils sont incapables de se représenter sauf sous la forme de leur propre autoreprésentation idéale (souvent cinématographique), ils ne peuvent même pas imaginer que des formes de vie et de gouvernement autres que les leurs puissent exister.
L'Occident se retranche, comme un dernier bastion, derrière des bribes de sagesse commune, comme le célèbre aphorisme de Churchill : "La démocratie est la pire forme de gouvernement, à l'exception de toutes les autres qui ont été essayées jusqu'à présent. Cette brillante boutade, maintes fois répétée, intègre le geste consolateur de penser que, oui, nous avons peut-être beaucoup de défauts, mais une fois que nous leur avons rendu un hommage formel, nous n'avons plus à nous en préoccuper, car nous sommes toujours, sans comparaison, ce que l'histoire humaine a produit de mieux.
Les Romains ont dû se répéter quelque chose comme ça jusqu'à la veille du jour où les Wisigoths d'Alaric ont mis Rome à sac.
22:26 Publié dans Actualité, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : démocraties libérales, actualité, théorie politique, andrea zhok, politologie, sciences politiques, philosophie, philosophie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 12 avril 2022
Défense de la méthode scolastique : le meilleur outil pour apprendre à "bien penser"

Défense de la méthode scolastique: le meilleur outil pour apprendre à "bien penser"
José Antonio Bielsa Arbiol
Le grand problème de la pédagogie de notre temps est son incapacité à se renouveler de manière cohérente, c'est-à-dire à le faire en fonction des exigences qu'une réalité complexe requiert, ou devrait requérir. L'échec du système éducatif espagnol, biaisé dans sa méthodologie et sectaire dans ses programmes, se reflète dans ce bilan: jour après jour, de plus en plus de jeunes terminent leurs études réglementées sans avoir atteint un niveau minimal de compréhension de l'écrit, et encore moins la simple articulation des idées selon un ordre rationnel, c'est-à-dire logique. L'hyper-fragmentation des récits qui répudient la vie nue, une tendance malsaine à aplatir les solides normes de compréhension d'antan, fait de la perception du monde une expérience douloureuse, voire malsaine, face au maelström de saleté et de laideur qui sont monnaie courante sur le marché postmoderne.
La grande réussite des technocrates de l'Ordre nouveau n'est autre que "la destruction progressive de l'esprit des personnes instruites". Face à la crise des valeurs qui traverse et secoue l'Occident, nous devrions sérieusement nous demander si les meilleures solutions ne consistent pas à revenir aux modèles cognitifs d'il y a trente ans. Dans le cas de l'Espagne, la désastreuse LOGSE a donné le coup de grâce à un système qui, jusqu'alors, était pour le moins efficace pour les besoins de la vie ordinaire. Aujourd'hui, cependant, le système ne parvient plus, tout au plus, qu'à "produire" des inadaptés sociaux et autres excroissances qui ne peuvent être assimilés dans un système éducatif traditionnel.
Face à tous ces fiascos et ces désertions, les grands maîtres de la pensée médiévale nous proposent des solutions, toutes plus solides les unes que les autres, pour nous sortir de l'impasse (il ne serait pas déraisonnable de se tourner à nouveau vers la Silicon Valley, quartier général où l'élite mondiale du savoir met en pratique les méthodes d'apprentissage les plus conservatrices pour ses élus...). Il est urgent, en somme, d'abolir l'empire des "images" a-signifiantes et de réhabiliter au plus vite la MÉTHODE SCOLASTIQUE : Elle seule peut nous protéger de la farce pédagogique actuelle, qui rend impossible aux nouvelles générations l'exercice de la simple pensée ; en effet, la devise de la méthode scolastique affirmait que "la pensée est un métier dont les lois sont minutieusement fixées".
Pour arriver à cette affirmation, la Méthode part du principe que la philosophie est une science fondée sur son propre langage, et que la connaissance repose sur la démonstration: il faut connaître les lois de la discussion et de l'inférence, et savoir les appliquer à la réalité, afin qu'elles ne restent pas de simples mots d'esprit. A l'heure de la dissolution paranoïaque-narcissique, du relativisme grossier et du personnalisme inerte, la Méthode Scolastique propose une sorte de gymnastique intellectuelle rigoureuse en classe; pour systématiser ce plan d'étude, la Méthode consolide la compréhension de la Réalité au moyen de l'appréhension du Langage (comme nous le savons : l'homme est homme en tant qu'animal de langage) ; l'utilisation correcte de la Méthode dans le système Scolastique présuppose au moins trois phases, à savoir :
- I) la Lectio ou lecture du texte par l'enseignant, lecture qui comporte trois niveaux : a) le niveau grammatical ; b) l'explication du sens du texte ; et c) l'approfondissement du sens du texte ;
- II) la Disputatio ou discussion, qui permet d'aller au-delà de la première compréhension du texte, en signalant de nouveaux problèmes (qui sont également discutés) ; et
- III) la Determinatio : à la fin de la discussion, l'enseignant fournit sa solution.
(Nous laisserons de côté les disputationes de quodlibet, des disputationes publiques tenues deux ou trois fois par an).
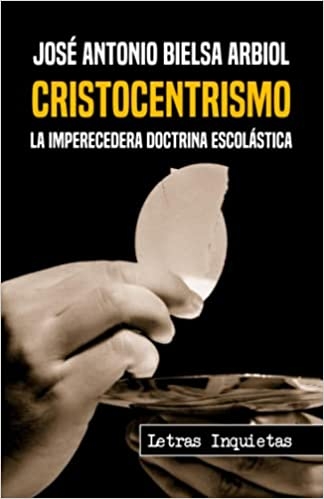
Par son énorme richesse et ses perfections intrinsèques, la méthode scolastique a marqué l'âge d'or de la pensée occidentale, et a apporté avec elle de grands progrès tant dans l'ordre cognitif que dans les domaines de la logique et de la philosophie du langage.
Le meilleur de l'Europe, lorsqu'elle s'appelait "chrétienté", provenait de l'intégration parfaite de la Raison et de la Foi. Antithèse pure et douloureuse de notre funeste présent, dirigé par des sophistes éphémères, ennemis jurés du christianisme et de l'exercice droit, précis et équanime de la "bien-pensance".
Le livre Cristocentrismo : La imperecedera doctrina escolástica (Letras Inquietas, 2022) est disponible sur Amazon :
21:55 Publié dans Livre, Livre, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, livre, scholastique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 10 avril 2022
L'homme habite géopolitiquement la Terre

L'homme habite géopolitiquement la Terre
par Gennaro Scala
Source : Gennaro Scala & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/geo-politicamente-abita-l-uomo
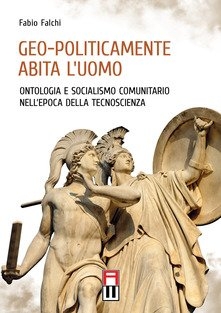 Le livre en question est une réflexion "métapolitique" sur la géopolitique, c'est-à-dire qu'il dépasse les questions spécifiques que traite cette discipline pour s'interroger sur le "pourquoi", sur les questions fondamentales dont découlent les questions géopolitiques et politiques tout court. Pourquoi s'occuper de géo-politique ? D'un point de vue immédiat, chaque État ne peut ignorer les questions géopolitiques, sous peine de graves conséquences. Un certain niveau de connaissances géopolitiques, c'est-à-dire des relations entre les États, est nécessaire à la classe politique de chaque État. Cependant, tous les États n'en ont pas besoin et ne peuvent pas l'utiliser de la même manière, cela dépend de la capacité d'action, qui dépend à son tour de la puissance d'un État. Un État qui est totalement subordonné aux politiques internationales d'un autre État, et il en existe, il faut le savoir, n'a guère besoin de connaissances géopolitiques puisque la décision sur les politiques internationales sera dictée par d'autres. Mais ce peu ne signifie pas zéro, un certain degré de connaissances géopolitiques est toujours nécessaire, une marge de manœuvre subsiste toujours, même si elle est devenue beaucoup plus étroite que la "souveraineté limitée" dont a bénéficié l'Italie de l'après-guerre jusqu'à l'effondrement de l'URSS. Mais si c'est le niveau immédiat d'où découle le besoin de connaissances géopolitiques, on ne peut s'y arrêter, sinon nous aurions une géopolitique purement nationaliste.
Le livre en question est une réflexion "métapolitique" sur la géopolitique, c'est-à-dire qu'il dépasse les questions spécifiques que traite cette discipline pour s'interroger sur le "pourquoi", sur les questions fondamentales dont découlent les questions géopolitiques et politiques tout court. Pourquoi s'occuper de géo-politique ? D'un point de vue immédiat, chaque État ne peut ignorer les questions géopolitiques, sous peine de graves conséquences. Un certain niveau de connaissances géopolitiques, c'est-à-dire des relations entre les États, est nécessaire à la classe politique de chaque État. Cependant, tous les États n'en ont pas besoin et ne peuvent pas l'utiliser de la même manière, cela dépend de la capacité d'action, qui dépend à son tour de la puissance d'un État. Un État qui est totalement subordonné aux politiques internationales d'un autre État, et il en existe, il faut le savoir, n'a guère besoin de connaissances géopolitiques puisque la décision sur les politiques internationales sera dictée par d'autres. Mais ce peu ne signifie pas zéro, un certain degré de connaissances géopolitiques est toujours nécessaire, une marge de manœuvre subsiste toujours, même si elle est devenue beaucoup plus étroite que la "souveraineté limitée" dont a bénéficié l'Italie de l'après-guerre jusqu'à l'effondrement de l'URSS. Mais si c'est le niveau immédiat d'où découle le besoin de connaissances géopolitiques, on ne peut s'y arrêter, sinon nous aurions une géopolitique purement nationaliste.
Ce n'est pas le cas de Fabio Falchi pour qui la géopolitique découle de notre "être au monde" et d'une certaine manière d'"habiter la terre". En tant que mortels, nous habitons "poétiquement" la terre, le mot étant la "maison de l'être" et concernant donc notre être chez nous dans le monde, mais nous sommes des êtres situés entre le ciel et la terre, donc le poétique présuppose l'impoétique, autant l'homme habite poétiquement la terre, autant il l'habite géo-politiquement. Ce "poétique vs. impoétique" se traduit philosophiquement dans l'opposition "Heidegger vs. Schmitt" (chapitre II), Schmitt venant rappeler que l'occupation de la terre par l'homme se fait à partir d'une partition, et la géopolitique s'en occupe, mais c'est donner la prévalence à "l'être-contre-les-autres". En jouant dialectiquement Heidegger contre Schmitt et vice versa, cependant, la priorité "ontologique" de "l'être-avec-les-autres" est rétablie (p.52), tout en reconnaissant l'être contre une possibilité toujours présente dans les relations humaines.

Fabio Falchi veut retrouver l'opposition terre-mer de Schmitt, tout en rejetant, avec Heidegger, l'opposition ami-ennemi comme opposition ultime, ontologique, fondatrice de la politique. Je pense plutôt qu'il s'agit d'un mythe taillé dans le conflit Allemagne-Angleterre, l'histoire n'est pas marquée par cette éternelle opposition entre les puissances terrestres et maritimes (à ces dernières s'ajoutent, avec la technologie moderne, des puissances qui s'appuient sur le contrôle du ciel), cette opposition ne s'applique guère à l'histoire ancienne, comme le reconnaît aussi Falchi, et même avec la "révolution spatiale" qui a eu lieu avec la découverte des Amériques et la navigation sur l'ensemble du globe, elle ne devient pas plus valable. Le problème est plutôt de surmonter le mondialisme, le rêve de domination mondiale, qui est né de l'expansion mondiale des puissances européennes. L'Allemagne du siècle dernier était certes une puissance qui s'appuyait davantage sur des forces terrestres, mais elle a hérité du rêve de la domination mondiale anglo-saxonne, qu'elle a finalement voulu réaliser "par voie terrestre" par l'invasion de la Russie, pour laquelle elle s'est inspirée de la "conquête de l'Ouest".
Ainsi, s'il est juste de rétablir le fondement universaliste de l'appartenance humaine commune, tout en reconnaissant que c'est précisément le fait d'être ensemble qui peut aboutir à être contre, ou à la possibilité toujours présente d'un conflit, comment l'appartenance commune peut-elle prévaloir sur la tendance également inhérente au conflit ? Ce qui, traduit en termes géopolitiques universels, signifie pour moi aujourd'hui: comment éviter le choc des civilisations ? À cette fin, il est notamment essentiel de rétablir le sens de la limitation humaine par rapport à la volonté illimitée de puissance qui a donné naissance à la technologie. Et à cet égard, Heidegger est si utile, étant parmi ceux qui se sont le plus concentrés sur le problème, si trompeur car la différence ontologique et l'oubli de l'être sont à mon avis de mauvaises réponses. Le concept de différence ontologique de Heidegger est celui qu'il faut le plus dépasser; il crée une fracture entre l'être et le devenir, reproduisant les anciens dualismes. Identifier l'être à tout ce qui n'est pas l'être signifie une dé-substantiation de l'Être, qui est au contraire ce qu'il y a de plus réel, c'est l'ens realissimus. Pensé à travers la différence ontologique, l'être est la non-entité, la ni-entité. Identité donc de l'être et du néant. Et nous revenons ici au célèbre début de la Science de la Logique, d'où partent les réflexions de Heidegger. Il y aurait un discours à faire sur la nature problématique de la dialectique hégélienne que nous ne pouvons pas faire ici, sur lequel Enrico Berti a écrit des pages fondamentales. Certes, l'être ne peut être réduit à une entité déterminée, mais c'est ce que nous faisons dans la mesure où nous parlons de l'être avec l'article déterminatif.

L'être ne peut être oublié car, en tant qu'êtres humains limités, nous ne pouvons pas l'embrasser, mais ce que nous ne pouvons pas oublier, c'est que notre connaissance de la nature, et notre capacité à connaître et à contrôler certains phénomènes naturels, est toujours petite comparée à la puissance infinie de la Nature qui nous a engendrés. L'Être est le monde infini qui a également engendré l'homme; il ne peut être embrassé par un être fini tel que l'être humain, mais seulement pensé comme un au-delà. Nous n'approchons l'être qu'à travers l'être de manière finie et déterminée, mais il s'agit toujours d'une réduction, car, et c'est l'une des acquisitions les plus importantes de la science moderne, même le grain de sable a des déterminations infinies si on l'analyse en profondeur. Réfléchir sur l'être, c'est réfléchir sur les limites de la connaissance humaine, mais aussi sur le caractère merveilleux de cette connaissance. Que serait un monde s'il ne présentait pas plus de défis et de mystères à l'homme?
Fabio Falchi conclut son ouvrage en rappelant que le rétablissement du sens de l'émerveillement envers la Physis est fondamental face à un appareil technocratique qui voudrait réduire le monde à quelque chose d'entièrement manipulable et contrôlable. Une "question métaphysique" que la pensée faible (pensiero debole) d'un Vattimo voudrait plutôt effacer, montrant une convergence fondamentale avec la pensée néo-libérale à laquelle il dit vouloir s'opposer. Cacciari saisit entre autres un point crucial lorsqu'il rappelle le double sens du terme grec Thauma, qui désigne un rapport au monde dans lequel la terreur et l'émerveillement ont la même origine. D'autre part, Heidegger (et Severino lui-même) n'a privilégié que l'aspect de l'angoisse inhérente à la finitude de l'être humain, qui est "in-éradicable", mais c'est précisément cela qui peut être transformé en émerveillement devant le monde, qui transforme le court voyage de la vie en quelque chose qui a un sens et une valeur.

Cependant, si nous devons rétablir l'idée de la subordination inévitable de l'être humain à la Nature, nous ne pouvons pas rétablir le "sens du sacré" des anciens, qui découlait du sens naturel, pour ainsi dire, de la subordination de l'être humain à la Nature. L'être humain s'est libéré de sa dépendance à l'égard de certains phénomènes naturels, ce qui a été un chemin positif et, dans l'ensemble, obligatoire, puisque l'"animal nu" appelé homme, qui n'a pas de griffes pour se défendre ni de membres rapides pour courir, a dû développer la technologie. Cette voie a toutefois abouti à la domination de la Technique, qui est une forme d'hybris, l'illusion de pouvoir contrôler et manipuler le monde à volonté. Dans cette voie, le sentiment de subordination de l'être humain à la Nature doit être reconstitué sur une nouvelle base.
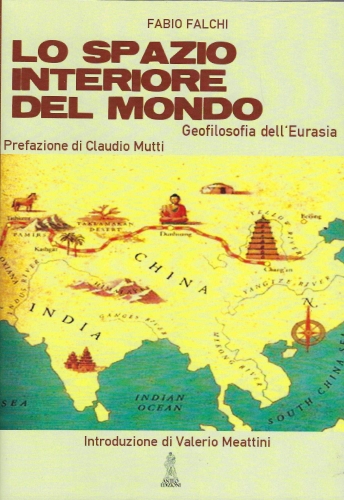
Établir une relation adéquate avec la transcendance de la Nature, avec l'Être, avec Dieu, ou quelle que soit la façon dont on souhaite désigner le monde infini qui nous a engendrés, est également fondamental pour la géopolitique. Car établir une relation adéquate avec la transcendance signifie rétablir le sens de la limite pour l'être humain. En termes géopolitiques, cela signifie une inversion de l'absurdité du projet occidental de contrôle total des êtres humains sur la Terre. Il y a des limites à ne pas franchir, et celles-ci devraient être les nouveaux Hercules de demain, qui ne sont plus géographiques mais politiques.
Une limite à ne pas franchir au-delà de laquelle il existe un risque de déclencher un conflit de civilisations, qui pourrait avoir des conséquences imprévisibles. Il convient de rappeler l'extraordinaire pertinence du Canto XXVI de Dante, qui commence par la condamnation de l'impérialisme de Florence qui "per mare e per terra batte l'ale", son désir d'expansion sans limites. Dans "l'in-éliminabilité" de la dimension conflictuelle, qui est une dimension in-éliminable de l'habitation de la terre, comme le souligne à juste titre Falchi, se révèle à mon avis la subordination de l'être humain à la nature. C'est la même conclusion à laquelle Tolstoï est parvenu lorsqu'il a voulu raconter "la guerre et la paix". Cela ne signifie pas que le conflit est inévitable, cela signifie que le conflit doit être "façonné" (pour utiliser la terminologie de Tolstoï), il doit être régi et orienté vers des formes qui ne sont pas destructrices pour tous les prétendants.

Je considère que celui de Fabio Falchi est un travail de réflexion méritoire et assez rare dans le panorama intellectuel italien asphyxié, pour la profondeur et l'ampleur des vues, sur les fondements de la (géo)politique, cependant, un effort devrait être fait pour surmonter ce bloc de la culture européenne, dont parle Pierluigi Fagan, selon lequel "la philosophie occidentale pratique, sa politique et son éthique sont arrêtées au 19ème siècle". En effet, nous ballottons entre Heidegger, Nietzsche et Marx, souvent dans un mélange de ceux-ci. La philosophie italienne d'après-guerre a fait des pas en avant qu'il faut valoriser par rapport à la philosophie allemande, je pense à la critique de Heidegger par Severini, mais aussi à la critique de la dialectique par Enrico Berti. Heidegger a été "sacralisé" par une certaine intellectualité européenne, surtout de gauche, comme l'écrit Dominique Janicaud dans Heidegger en France, car "la destruction de la métaphysique" correspondait à la nécessité de se débarrasser des "récits" progressistes, une opération certes nécessaire mais qui a ensuite conduit à une adhésion nihiliste aux valeurs fondamentales du néolibéralisme, même si elle était ensuite assaisonnée d'un anarchisme inoffensif, comme l'observe Fabio Falchi à propos de Vattimo. Je ne connais pas suffisamment la philosophie de Vattimo, je ne peux donc exprimer qu'un jugement consciemment sommaire, mais je peux dire qu'en première lecture, le "nihilisme libérateur" de Vattimo ne me convainc pas du tout. Je ne crois pas que "ce qui rend libre est vrai", mais plutôt que la communauté ne peut être fondée que sur une base de vérité. La vérité n'est pas l'imposition du discours dominant. Une formulation qui n'échappe pas à l'objection classique du relativisme, puisqu'elle aussi voudrait être une vérité. Heidegger doit être "dépassé", selon le sens hégélien du terme, sinon notre critique de ses élèves "gauchistes" est nécessairement faible. Le concept de vérité de Vattimo doit être rejeté.
Le problème est que cette faiblesse envers un certain nihilisme découle d'un problème précis qui est un vide difficilement surmontable. Heidegger a pensé et agi du point de vue de la défense de la civilisation européenne, pour laquelle il a pensé utiliser le nihilisme produit par la décadence de cette même civilisation, un court-circuit qui l'a conduit à rejoindre le nazisme, qui a fonctionné comme un accélérateur de la décadence européenne. Pour nous, cependant, cet effondrement est déjà un fait accompli, en effet il n'y a plus rien à défendre, seulement les décombres. Bien que cette question ne soit pas mentionnée dans le livre, je sais bien, connaissant un peu la pensée de l'auteur, qu'elle est en arrière-plan. Il n'est pas mentionné parce qu'il ne s'agit pas d'un problème soluble, mais il reste un problème classé sans être surmonté. La "racine terrestre" ne peut se trouver que dans sa propre culture. Notre culture d'appartenance aurait dû être cette civilisation européenne dans laquelle s'inscrit l'État-nation individuel. Cependant, elle s'est effondrée avec la Première et la Deuxième Guerre mondiale, nous laissant dans l'étrange hybride qu'est la "civilisation occidentale", un non-lieu destiné à se dissoudre. Mais si nous ne pouvons pas penser dans la perspective d'une appartenance à la civilisation européenne, quand bien même cette appartenance n'épuiserait pas ou ne serait pas l'horizon ultime de notre " être au monde ", nous pouvons penser dans la perspective d'une renaissance, dans la conviction d'une renaissance, puisque la civilisation est ce qui renaît toujours des germes laissés par la précédente. Même si cette renaissance ne signifie pas que la civilisation européenne renaîtra comme avant. Je me rends compte qu'il s'agit d'une solution idéale au problème, appartenir à une véritable civilisation est autre chose, mais je ne pense pas que nous puissions faire mieux pour le moment. Je pense donc que l'approche à dominante universaliste du livre est fondée, nous ne pouvons traiter que des "problèmes universels" sachant qu'ils restent déconnectés de l'ancrage à une véritable civilisation. Cet universalisme dans lequel l'intellectualité italienne a déjà dû se confiner en d'autres occasions, comme Gramsci l'a déjà noté. Mais je crois que préserver la perspective de la renaissance nous permet de considérer les problèmes nationaux en perspective, en ayant une direction, dans la collation d'un potentiel futur grand espace européen qui est le sujet et non seulement l'objet de la politique des autres "grands espaces" existant actuellement sur Terre.
10:40 Publié dans Géopolitique, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : géopolitique, philosophie, martin heidegger, terre |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 07 avril 2022
La philosophie avant la philosophie: une étude innovante de Luca Grecchi

La philosophie avant la philosophie: une étude innovante de Luca Grecchi
Giovanni Sessa
Source: https://www.paginefilosofali.it/la-filosofia-prima-della-filosofia-uno-studio-innovativo-di-luca-grecchi-giovanni-sessa/
Les historiens de l'antiquité et les philologues débattent des origines de la philosophie depuis des siècles. Par convention, la plupart des auteurs pensent que cette forme de pensée, qui a caractérisé le cours historique de l'homme européen jusqu'à aujourd'hui, est née avec les présocratiques au sixième siècle avant J.-C., dans les colonies ioniennes d'Asie mineure. À partir des années 1970, l'enseignement de Giorgio Colli s'est orienté vers des époques plus archaïques, puisque l'éminent spécialiste de la sagesse grecque affirmait que la philosophie était née en continuité avec le mythe, et non en opposition avec lui. Une étude de Luca Grecchi est récemment parue dans le catalogue de la maison d'édition Scholé, productrice d'une innovation importante à ce sujet. Nous nous référons à La filosofia prima della filosofia. Creta, XX secolo a.C., Magna Grecia, VIII secolo a.C. (pp. 198, euro 22.00). Le volume est précédé d'une introduction de l'archéologue Daniela Lefèvre-Novaro. L'auteur, maître de conférences à l'Université de Milan-Bicocca, a déjà publié plusieurs ouvrages sur le sujet.

Dans ces pages, il part de l'hypothèse aristotélicienne selon laquelle ce qui est en acte doit avoir été préalablement en puissance. Or, si tous les exégètes s'accordent à rapporter qu'il est possible de parler d'actualisation de la philosophie, à partir du sixième siècle avant J.-C., il est nécessaire de pousser l'investigation jusqu'aux siècles précédents pour identifier le terrain "potentiel" d'où aurait surgi la philosophie. Grecchi pose cette définition de la philosophie comme fil rouge de son propre travail exégétique : "une connaissance visant à la recherche de la vérité du tout, caractérisée par la méthode dialectique, ayant comme fondement de sens et de valeur l'homme compris dans son universalité" (p. 13). La philosophie traite de deux contenus, négligés par les sciences, la vérité et le bien : c'est une discipline qui exige une praxis capable de renverser dans une action vertueuse les acquisitions du niveau théorique. Telle était donc la philosophie dans le monde antique : "Il ne peut être accidentel [...] que la philosophia se soit formée dans la Grèce antique" (p. 17) et non en Orient, où le prérequis politique et social d'un tel développement, la polis, faisait défaut.
En utilisant une approche multidisciplinaire, dans laquelle un rôle important est attribué aux données archéologiques, Grecchi s'emploie à démontrer que le processus d'incubation de la graine philosophique peut être daté d'une époque très ancienne "et dans un lieu inattendu, à savoir au vingtième siècle avant J.-C. en Crète. Cet enracinement a influencé, de manière décisive, l'ensemble de la culture grecque jusqu'à l'époque classique" (p. 16). Et si la polis était le milieu qui permettait à la fleur philosophique de se manifester dans toute sa luxuriance, c'est encore en Crète que l'on peut retrouver l'origine de la cité-état, notamment à la lumière des études historico-archéologiques de Doro Levi et Henri Van Effenterre.

La philosophie est déjà en gestation dans les fragments des Présocratiques et c'est la connaissance qui est en quelque sorte présente, avant que le terme lui-même ne devienne communément utilisé avec Platon. Homère et Hésiode la connaissaient, mais elle avait son antécédent dans la "Crète des premiers palais, qui constitue, sur le sol hellénique, la plus ancienne expérience politique et culturelle dont nous ayons la trace" (p. 24). L'auteur rejette la lecture habituelle de l'époque minoenne, qui tend à voir l'île comme le site d'un système monarchique rigide à ce moment de l'histoire. Au contraire : "La civilisation palatiale [...] constituait [...] l'une des expériences politiques et culturelles les plus communautaires qui aient jamais existé dans tout le monde antique" (p. 25).
Dans les Palais, pour la première fois en Grèce, une réflexion a été menée sur l'ensemble compris dans ses trois éléments constitutifs : la nature, le divin et l'humain. Les gens de cette époque ont décidé comment vivre, sur quelles valeurs fonder leur coexistence civile, ils se sont interrogés sur les relations à entretenir avec les dieux et avec la nature et, surtout, ils ont remis en question la répartition des ressources, de l'espace et des biens. Ils sont arrivés à : "une 'planification communautaire' élaborée [...] Elle était [...] organisée de telle sorte que tous contribuent, de manière coopérative, au meilleur développement de la vie sociale" (p. 29). Le système palatial crétois est devenu un paradigme pour toute la civilisation hellénique. L'auteur retrace les signes de continuité entre les civilisations minoenne et mycénienne et les preuves tout aussi pertinentes de la relation entre cette dernière et l'ère classique. L'expérience sociopolitique de la Crète "avec ses palais, qui servaient de centre de coordination politique, économique, social, culturel et religieux, constituait [...] le modèle pour les siècles à venir" (p. 31), le modèle du poleis classique, dans le climat spirituel duquel se sont épanouies les écoles philosophiques fondées sur la co-philosophie et la dimension dialogique.
Sur l'île, il était entendu que le processus économique devait être confié à la planification communautaire, et non laissé à la merci du jeu des intérêts particuliers. La philosophie n'est pas seulement née face à l'émerveillement induit par la rencontre avec la physis, mais elle a été une tentative de faire taire l'angoisse existentielle qui naît chez l'homme de la conscience que notre vie est exposée au danger et à la mort. Grecchi, avec une argumentation pertinente, décrit les aspects les plus pertinents de la civilisation minoenne, en partant de la période néolithique et en soulignant les apports qu'elle a su tirer de l'Orient, il fait l'éloge de son harmonie sociale et dresse un tableau clair de l'origine de l'écriture. Il traverse les siècles que l'historiographie officielle s'obstine à définir comme "obscurs", pour pénétrer au cœur de l'œuvre d'Homère. Enfin, il montre le lien étroit entre les dynamiques sociales et culturelles dans les poleis qui ont surgi au 8e siècle avant J.-C. en Grande-Grèce et en Sicile, où la philosophie a trouvé le terrain propice pour s'épanouir définitivement.

Le livre a le mérite de montrer clairement que l'époque contemporaine est structurellement antithétique à l'épanouissement de la philosophie, tant sur le plan économique et social qu'existentiel. Cette connaissance, si elle était réellement pratiquée, comme une recherche de la vie bonne, produirait un écho dissonant par rapport au système techno-scientifique, par rapport auquel, au contraire, les "philosophies" de la rue jouent un rôle accessoire. L'analyse de Grecchi, bien que novatrice, semble négliger la pertinence du mythe dans la naissance de la philosophie. Pour remonter aux origines de la Sagesse, c'est dans cette direction qu'il faut retourner pour regarder : alors, derrière l'harmonie sociale crétoise, se révélera le visage conflictuel, chaotique de la vie. Le visage de Dionysos, le dieu né dans une caverne du mont Ida.
Giovanni Sessa.
17:37 Publié dans Livre, Livre, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, philosophie, philosophie grecque, antiquité grecque, crète, crète antique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 05 avril 2022
Martin Heidegger, la Russie et la philosophie politique

Martin Heidegger, la Russie et la philosophie politique
Leonid Savin
Source: https://www.geopolitica.ru/it/article/martin-heidegger-russia-e-filosofia-politica
Les œuvres de Martin Heidegger ont récemment fait l'objet d'un intérêt accru dans plusieurs pays. Si les interprétations de ses textes varient considérablement, il est intéressant de constater que l'héritage de Heidegger est constamment critiqué par les libéraux, quel que soit le lieu et l'objet de la critique, qu'il s'agisse du travail de Heidegger en tant que professeur d'université, de son intérêt pour la philosophie de la Grèce antique et des interprétations connexes de l'antiquité, ou de sa relation avec le régime politique en Allemagne avant et après 1945. On a l'impression que les libéraux s'efforcent intentionnellement de diaboliser Heidegger et ses œuvres, mais la profondeur et l'ampleur de la pensée de ce philosophe allemand ne leur laissent aucun répit. Il est clair que c'est parce que les idées de Heidegger sont porteuses d'un message pertinent pour la création d'un projet contre-libéral qui peut être réalisé sous les formes les plus diverses. C'est l'idée du "Dasein" appliquée à une perspective politique. Nous en parlerons plus en détail ci-dessous, mais il est d'abord nécessaire d'entreprendre une brève excursion dans l'histoire de l'étude des idées de Martin Heidegger en Russie.
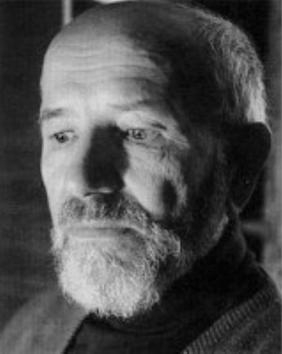 En Union soviétique, les idées de Martin Heidegger n'étaient pas connues du grand public, principalement parce que l'apogée de ses activités a coïncidé avec le régime nazi en Allemagne. Heidegger lui-même, comme de nombreux idéologues de la révolution conservatrice en Allemagne, a critiqué de nombreux aspects du national-socialisme, mais à l'époque soviétique, toute philosophie qui ne suivait pas la tradition marxiste était traitée comme bourgeoise, fausse et nuisible. La seule exception est peut-être le travail de Vladimir Bibikhin (photo), bien que ses traductions de "L'Être et le temps" et d'autres ouvrages de Heidegger n'aient été publiées en Russie qu'après l'effondrement de l'Union soviétique. En outre, ces traductions ont été critiquées à plusieurs reprises pour leur approche trop simpliste, leurs interprétations terminologiques incorrectes, leurs erreurs linguistiques, etc. Les cours de Bibikhin sur le premier Heidegger à l'Université d'État de Moscou n'ont été dispensés qu'en 1990-1992, c'est-à-dire à la fin de la Perestroïka, lorsque les horizons de ce qui était autorisé en URSS s'élargissaient. Cela dit, il convient de noter qu'un cercle de partisans des idées de Martin Heidegger s'était formé dans la sphère universitaire à Moscou dès les années 1980. Une situation similaire est apparue à Saint-Pétersbourg, qui s'est ensuite manifestée dans les activités de traduction et d'édition.
En Union soviétique, les idées de Martin Heidegger n'étaient pas connues du grand public, principalement parce que l'apogée de ses activités a coïncidé avec le régime nazi en Allemagne. Heidegger lui-même, comme de nombreux idéologues de la révolution conservatrice en Allemagne, a critiqué de nombreux aspects du national-socialisme, mais à l'époque soviétique, toute philosophie qui ne suivait pas la tradition marxiste était traitée comme bourgeoise, fausse et nuisible. La seule exception est peut-être le travail de Vladimir Bibikhin (photo), bien que ses traductions de "L'Être et le temps" et d'autres ouvrages de Heidegger n'aient été publiées en Russie qu'après l'effondrement de l'Union soviétique. En outre, ces traductions ont été critiquées à plusieurs reprises pour leur approche trop simpliste, leurs interprétations terminologiques incorrectes, leurs erreurs linguistiques, etc. Les cours de Bibikhin sur le premier Heidegger à l'Université d'État de Moscou n'ont été dispensés qu'en 1990-1992, c'est-à-dire à la fin de la Perestroïka, lorsque les horizons de ce qui était autorisé en URSS s'élargissaient. Cela dit, il convient de noter qu'un cercle de partisans des idées de Martin Heidegger s'était formé dans la sphère universitaire à Moscou dès les années 1980. Une situation similaire est apparue à Saint-Pétersbourg, qui s'est ensuite manifestée dans les activités de traduction et d'édition.
À partir de la fin des années 1990, d'autres œuvres de ce penseur allemand ont commencé à être traduites et publiées. La qualité des traductions s'est considérablement améliorée (et a été réalisée par plusieurs auteurs) et l'héritage de Heidegger a commencé à être enseigné dans plusieurs universités russes. Les principaux concepts philosophiques de Heidegger sont devenus objets d'étude obligatoires pour les étudiants des facultés de philosophie. Toutefois, l'étude des idées philosophiques ne signifie pas que les étudiants deviendront des philosophes ou qu'ils feront appel à certains concepts de ce type en ce qui concerne les processus politiques. Platon et Aristote sont étudiés dans les écoles depuis le début, mais qui est sérieux lorsqu'il s'agit d'utiliser les idées de ces anciens philosophes grecs pour discuter de questions sociopolitiques aujourd'hui ?
L'intérêt pour les idées de Martin Heidegger dans le contexte de la politique russe a été déclenché au début des années 2000 par divers articles et présentations du philosophe et géopoliticien russe Alexandre Douguine.
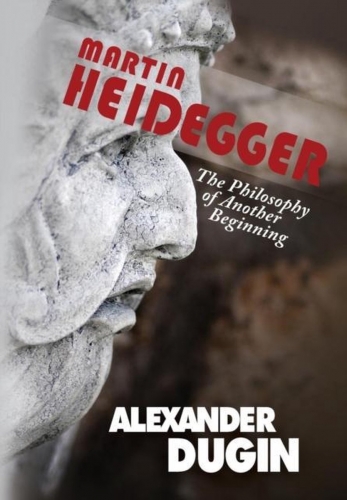
Par la suite, ces matériaux ont été systématisés et présentés dans des textes volumineux. En 2010, la maison d'édition "Academic Project" a publié le livre d'Alexandre Douguine "Martin Heidegger : la philosophie d'un autre commencement" qui a été logiquement suivi l'année suivante par "Martin Heidegger : la possibilité d'une philosophie russe". En 2014, les deux ouvrages ont été publiés par le même éditeur en un seul volume intitulé "Martin Heidegger : le dernier Dieu". L'interprétation des idées de Heidegger par Douguine est liée à l'histoire des idées russes, au christianisme orthodoxe et à une voie particulière de développement de l'État, y compris la théorie de l'eurasianisme.
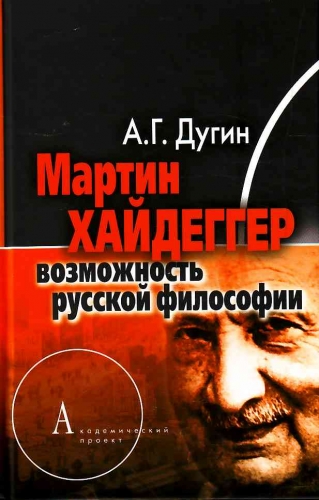
Inutile de dire qu'il serait insensé de relater la doctrine philosophique de Heidegger dans une courte publication dans un journal. Des centaines de volumes comprenant des œuvres entières, des conférences et des journaux intimes ont été publiés rien qu'en Allemagne. Pour notre propos, concentrons-nous uniquement sur quelques dispositions qui, à notre avis, sont applicables dans un contexte politique.
Tout d'abord, il convient de noter que Heidegger a utilisé de nombreux néologismes pour décrire le déroulement du temps et de l'être. L'un de ces concepts clés est le Dasein, que l'on traduit souvent par "être-là". Le philosophe français Henry Corbin a traduit ce terme par "réalité humaine", mais pour une compréhension authentique et complète, il est préférable de ne pas traduire ce terme et bien d'autres de Heidegger. Ils doivent être donnés dans l'original avec quelque chose de similaire dans la langue maternelle de chacun. Par exemple, das Man (le "on") exprime un Dasein inauthentique qui est tombé dans la banalité, alors que dans l'existant authentique, le Dasein a la propriété d'être face à la mort - Sein zum Tode - qui représente la terreur essentielle. La terreur s'oppose à la crainte, qui imprègne le monde de choses extérieures et le monde intérieur de préoccupations vides. Il est intéressant de noter ici le fait que la politique occidentale moderne et le libéralisme en tant que tel sont construits sur la peur. Cette tendance remonte à plusieurs siècles et est directement liée à la formation de la philosophie occidentale (européenne).
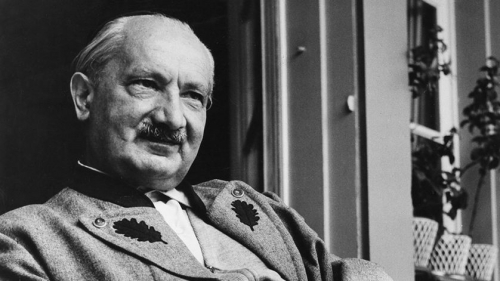
Ajoutons qu'une autre des propriétés du Dasein est la spatialité, puisque l'espace est dépendant du Dasein, alors que d'autre part il n'est pas fonction du temps. Le Dasein existe conditionnellement entre l'externe et l'interne, le passé et le présent, la marge et l'instant. Le Dasein a des paramètres existentiels : être-dans-le-monde (In-der-Welt-Sein), être-avec (Mit-sein), se soucier (die Sorge), le jeté-là (Geworfenheit), Befindlichkeit (syntonie, sofindingness, disposition), peur (Furcht), compréhension (Verstehen), parole (Rede) et humeur (Stimmung).
Un autre élément important de la philosophie de Heidegger est le "quadruple" (Geviert) comprenant le Ciel, les Déités, la Terre et les Mortels - qui sont représentés de la manière suivante : le Ciel en haut à gauche, les Déités (immortels) en haut à droite, les Mortels (personnes) en bas à gauche et la Terre en bas à droite. Un axe passe entre le peuple et les dieux et un autre entre le Ciel et la Terre. Le centre du "quadruple" est le modus le plus authentique de l'existence du Dasein.
Il convient également de noter que Heidegger fait une distinction entre le passé et ce qui est passé, entre le présent et ce qui est maintenant, et entre le futur et ce qui est imminent. Le Dasein, selon Heidegger, doit faire un choix fondamental entre l'imminent et le futur, c'est-à-dire le choix de l'existence authentique et de la confrontation directe (Seyn). Alors l'imminent deviendra l'avenir. Si le Dasein choisit l'existence inauthentique, alors l'imminent ne sera qu'imminent et ne verra donc pas le jour.
En détaillant tous ces éléments de la philosophie de Heidegger, Alexandre Douguine pose une question : peut-on parler d'un Dasein russe spécifique ? Quelles sont ses existences ? En quoi diffère-t-il du Dasein européen ? Douguine en arrive à la conclusion qu'il existe un Dasein russe particulier, et pas seulement russe, car au cœur de chaque civilisation, il existe une "présence pensante" particulière, le Dasein, qui détermine la structure du Logos d'une civilisation donnée. Il s'ensuit que chaque peuple (civilisation) possède son propre ensemble spécial d'existentiels.
Et c'est ici que nous pouvons trouver la dimension politique du Dasein telle que Douguine la voit dans le concept proposé de la Quatrième théorie politique.
Douguine s'est concentré sur trois théories politiques déclarées universelles : le libéralisme, le marxisme et le fascisme (national-socialisme). Tous ont leur propre sujet d'histoire.
L'expérience historique a montré que le monde libéral occidental a tenté d'imposer sa volonté à tous les autres par la force. Selon cette idée, tous les systèmes publics sur Terre sont des variantes du système libéral occidental [1] et leurs caractéristiques distinctives devraient disparaître avant que la conclusion de cette ère mondiale n'approche [2].

Jean Baudrillard affirme également qu'il ne s'agit pas d'un choc des civilisations, mais d'une résistance quasi innée entre une culture homogène universelle et ceux qui résistent à cette mondialisation [3].
Outre le libéralisme, deux autres idéologies sont connues pour avoir tenté d'atteindre la suprématie mondiale : le communisme (c'est-à-dire le marxisme sous ses différents aspects) et le fascisme/socialisme national. Comme le fait très bien remarquer Alexandre Douguine, le fascisme est apparu après ces deux idéologies et a disparu avant elles. Après la désintégration de l'URSS, le marxisme né au XIXe siècle a également été définitivement discrédité. Le libéralisme basé principalement sur l'individualisme et une société atomistique, les droits de l'homme et l'État Léviathan décrit par Hobbes est apparu à cause du bellum omnium contra omnes [4] et a perduré pendant longtemps.
Il est ici nécessaire d'analyser la relation de ces idéologies dans les contextes des époques et des lieux temporaires dont elles sont issues.
Nous savons que le marxisme était une idée plutôt futuriste : le marxisme prophétisait la victoire future du communisme dans une époque qui restait néanmoins incertaine. En ce sens, il s'agit d'une doctrine messianique, étant donné le caractère inévitable de sa victoire qui marquerait l'aboutissement et la fin du processus historique. Mais Marx était un faux prophète et la victoire n'a jamais eu lieu.
Le national-socialisme et le fascisme, au contraire, ont essayé de recréer l'abondance d'un âge d'or mythique, mais avec une forme moderniste [5]. Le fascisme et le national-socialisme étaient des tentatives d'inaugurer un nouveau cycle du temps, jetant les bases d'une nouvelle civilisation à la suite de ce qui était considéré comme un déclin culturel et la mort de la civilisation occidentale (d'où très probablement l'idée du Reich millénaire). Cette approche a également été abandonnée.
Le libéralisme (comme le marxisme) a proclamé la fin de l'histoire, décrite de manière très convaincante par Francis Fukuyama (The End of History and the Last Man) [6]. Cette fin n'a cependant jamais eu lieu et nous avons plutôt une "société de l'information" nomade composée d'individus égoïstes atomisés [7] qui consomment avidement les fruits de la techno-culture. De plus, de formidables effondrements économiques se produisent partout dans le monde ; des conflits violents ont lieu (de nombreux soulèvements locaux, mais aussi des guerres à long terme à l'échelle internationale), et c'est donc la déception qui domine notre monde plutôt que l'utopie universelle promise au nom du "progrès" [8].
À partir d'une telle perspective historique, il est possible de comprendre les liens entre l'émergence d'une idéologie au sein d'une époque historique particulière ; ou ce que l'on a appelé le zeitgeist ou "l'esprit d'une époque".
Le fascisme et le national-socialisme voyaient le fondement de l'histoire dans l'État (fascisme) ou la race (national-socialisme d'Hitler). Pour le marxisme, il s'agissait de la classe ouvrière et des relations économiques entre les classes. Le libéralisme, quant à lui, voit l'Histoire sous l'angle de l'individu atomisé, détaché d'un complexe d'héritage culturel et de contacts et communications inter-sociaux. Cependant, personne n'a considéré comme sujet d'histoire le Peuple en tant qu'Être, avec toute la richesse des liens interculturels, des traditions, des caractéristiques ethniques et de la vision du monde.
Si nous considérons les différentes alternatives, même les pays nominalement "socialistes" ont adopté des mécanismes et des modèles libéraux qui ont exposé les régions ayant un mode de vie traditionnel à une transformation accélérée, à une détérioration et à un effacement total. La destruction par le marxisme de la paysannerie, de la religion et des liens familiaux sont des manifestations de cet effondrement des sociétés organiques traditionnelles, tant en Chine maoïste qu'en URSS sous Lénine et Trotsky.
Cette opposition fondamentale à la tradition incarnée à la fois par le libéralisme et le marxisme peut être comprise par la méthode d'analyse historique considérée plus haut : le marxisme et le libéralisme ont tous deux émergé du même zeitgeist dans le cas de ces doctrines, de l'esprit de l'argent [9].
Plusieurs tentatives de créer des alternatives au néolibéralisme sont désormais visibles : la politique chiite en Iran, où le principal objectif de l'État est d'accélérer l'arrivée du Mahdi, et la révision du socialisme en Amérique latine (les réformes en Bolivie sont particulièrement indicatives). Ces réponses antilibérales sont toutefois limitées aux frontières de l'État unique concerné.
La Grèce antique est la source de ces trois théories de philosophie politique. Il est important de comprendre qu'au début de la pensée philosophique, les Grecs se sont penchés sur la question primordiale de l'Être. Mais ils risquaient d'être obscurcis par les nuances de la relation plus compliquée entre l'être et la pensée, entre l'être pur (Seyn) et son expression dans l'existence (Seiende), entre l'être humain (Dasein) et l'être-en-soi (Sein) [10].

Il est intéressant de noter que trois vagues de mondialisation ont été les corollaires des trois théories politiques susmentionnées (marxisme, fascisme et libéralisme). Par conséquent, nous avons besoin après eux d'une nouvelle théorie politique, qui engendrerait la Quatrième Vague : le rétablissement de (chaque) Peuple avec ses valeurs éternelles. En d'autres termes, le Dasein sera l'objet de l'histoire. Et chaque peuple a son propre Dasein. Et bien sûr, après la nécessaire réflexion philosophique, il faut passer à l'action politique.
Poursuivons la discussion actuelle sur les idées de Heidegger en Russie dans le contexte de la politique. Il est significatif qu'en Russie, en 2016, les carnets de Heidegger, Réflexions II-VI, connus sous le nom de ses "Carnets noirs 1931-1938", aient été publiés par l'Institut Gaïdar - une organisation libérale que les cercles conservateurs russes considèrent comme un réseau d'agents de l'influence occidentale. Yegor Gaidar est l'auteur des réformes économiques libérales en Russie sous le président Eltsine et a occupé le poste de ministre des finances en 1992. Gaidar a également été Premier ministre par intérim de la Fédération de Russie et ministre de l'économie par intérim en 1993-1994. En raison de ses réformes, le pays a été soumis à l'inflation, la privatisation et de nombreux secteurs de l'économie ont été ruinés. Cette dernière œuvre de Heidegger est considérée comme sa plus politisée, dans laquelle il discute non seulement des catégories philosophiques, mais aussi du rôle des Allemands dans l'histoire, l'éducation et le projet politique du national-socialisme. Il est très probable que l'Institut Gaidar avait l'intention de discréditer les enseignements de Heidegger avec de telles publications, mais c'est le contraire qui s'est produit, car la publication des journaux intimes de Heidegger a suscité un intérêt général.
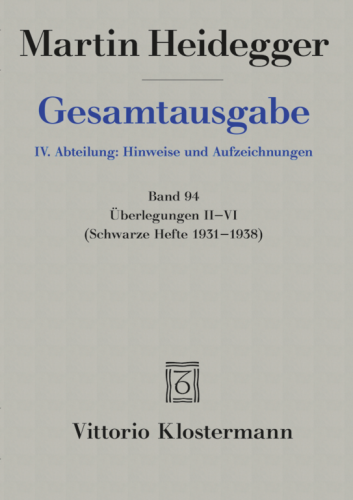
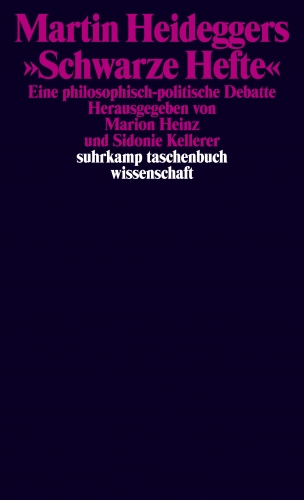
Paradoxalement, dans cet ouvrage, Heidegger critique le libéralisme de la manière suivante : "Le 'libéral' voit le 'lien' à sa manière. Il ne voit que des 'dépendances' - des 'influences', mais il ne comprend jamais qu'il peut y avoir une influence qui sert le véritable flux de base de tout et qui fournit un chemin et une direction" [11]. Nous présentons quelques autres citations de ce travail qui nous semblent intéressantes pour notre approche.
"La métaphysique du Dasein doit s'approfondir conformément à la structure plus intime de cette métaphysique et doit s'étendre à la métapolitique 'du' peuple historique." [12]
"La valeur du pouvoir découle de la grandeur du Dasein et le Dasein de la vérité de sa mission." [13]
"L'éducation : la réalisation effective et contraignante du pouvoir de l'État, en prenant ce pouvoir comme la volonté d'un peuple pour lui-même." [14]
"Le problème est un saut spécifiquement historique dans le Dasein. Ce saut ne peut être fait que comme une libération de ce qui est donné comme une dotation dans ce qui est donné comme une tâche." [15]
Comme l'a souligné Douguine, si le premier Heidegger supposait que le Dasein était quelque chose de donné, le Heidegger ultérieur a conclu que le Dasein est quelque chose qui doit être découvert, motivé et constitué. Pour ce faire, il est d'abord nécessaire de mener une démarche intellectuelle sérieuse (voir "Ce qu'on appelle penser" de Hedeigger).
Il est crucial de comprendre que, bien que les idées de Heidegger soient considérées comme une sorte d'aboutissement de la philosophie européenne (qui a commencé avec les Grecs anciens, un point symbolique en soi puisque Heidegger a construit ses hypothèses sur une analyse des philosophes de la Grèce antique), Heidegger est aussi souvent classé comme un penseur qui a transcendé l'eurocentrisme. Ainsi, même de son vivant, de nombreux concepts de Heidegger ont été repris dans des régions qui avaient développé des critiques de la philosophie à l'égard de l'héritage européen dans son ensemble. Par exemple, un énorme intérêt pour les œuvres de Heidegger a pu être constaté en Amérique latine au 20e siècle. Au Brésil, les œuvres de Heidegger ont été abordées par Vicente Ferreira da Silva, en Argentine par Carlos Astrada, Vicente Fantone, Enrique Dussel et Francisco Romero, au Venezuela par Juan David Garcia Bacca et en Colombie par Ruben Sierra Mejia. On en trouve une confirmation supplémentaire dans les propos du philosophe iranien Ahmad Fardid, selon lequel Heidegger peut être considéré comme une figure mondiale, et pas seulement comme un représentant de la pensée européenne. Étant donné que Fardid, connu pour son concept de Gharbzadegi, ou "intoxication occidentale", était un critique constant de la pensée occidentale, qui, selon lui, a contribué à l'émergence du nihilisme, une telle reconnaissance de Heidegger est assez révélatrice.
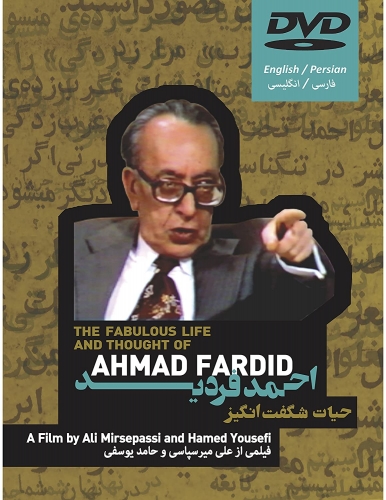
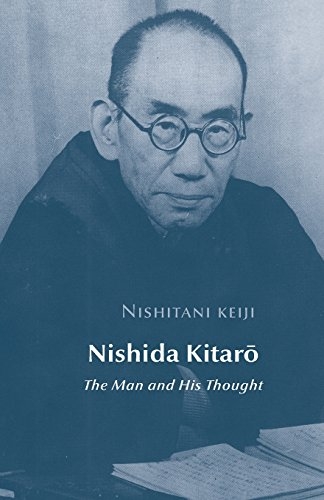
En effet, Heidegger avait des adeptes non seulement en Iran, mais aussi dans de nombreux pays asiatiques. Au Japon, dans les années 1930, Kitaro Nishida, un étudiant de Heidegger, a fondé l'école de philosophie de Kyoto. Bien qu'au Japon, Heidegger ait été largement considéré comme un porteur de l'esprit européen (à la suite des réformes Meiji, le Japon a été balayé par un enthousiasme excessif pour tout ce qui est européen, en particulier la culture et la philosophie allemandes), il est intéressant de noter que la notion d'"existence" de Heidegger a été reformulée dans un esprit bouddhiste comme "être véritable" (genjitsu sonzai) et que le "néant" a été interprété comme "vide" (shunya). En d'autres termes, les Japonais ont interprété les concepts fondamentaux de Martin Heidegger selon leurs propres concepts et ont souvent mélangé ses termes avec les concepts des existentialistes européens tels que Jean-Paul Sartre, Albert Camus et Gabriel Marcel. Un autre philosophe japonais, Keiji Nishitani, a adapté les idées de Heidegger aux modèles traditionnels orientaux, comme c'est souvent le cas en Orient. Des parallèles entre la philosophie orientale traditionnelle et l'analyse heideggérienne ont également été établis en Corée par Hwa Yol Jung.
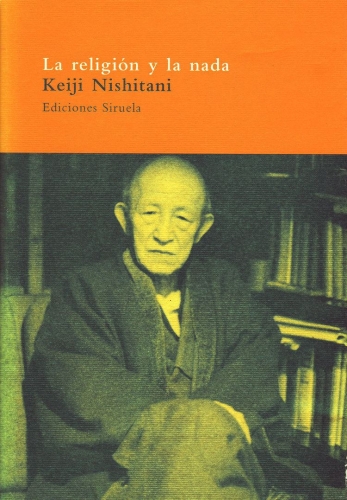
À cet égard, la Russie et l'étude de l'héritage de Martin Heidegger constituent une sorte de pont entre l'Europe et l'Orient, entre le rationalisme rigide qui subsume la conscience européenne depuis le Moyen Âge et la pensée contemplative abstraite caractéristique des peuples asiatiques. Disons même plus directement que l'eurasianisme et le heideggérisme sont en quelque sorte des tendances interconnectées et spirituellement proches parmi les courants idéologiques contemporains en Russie.
Bien que ces deux écoles puissent également être examinées en tant que doctrines philosophiques indépendantes, comme le font souvent les chercheurs laïques et les politologues opportunistes, une compréhension profonde de l'une ne peut être obtenue qu'en appréhendant l'autre.
Notes:
[1] Par exemple, l'insistance pour que tous les États et les peuples adoptent le système parlementaire anglais de Westminster comme modèle universel, sans tenir compte des anciennes traditions, structures sociales et hiérarchies.
[2] "Les droits de l'homme et le nouvel occidentalisme" dans "L'Homme et la société" (numéro spécial - 1987, page 9).
[3] Jean Baudrillard, "L'enfer du pouvoir", Paris : Galilée, 2002. Voir aussi, par exemple, Jean Baudrillard, "La violence du global".
http://www.ctheory.net/articles.aspx?id=385
[4] En italien : la guerra di tutti contro tutti.
[5] D'où la critique du national-socialisme et du fascisme par des droitiers traditionalistes tels que Julius Evola. Voir KR Bolton, "Thinkers of the Right" (Luton, 2003), p. 173.
[6] Francis Fukuyama "The End of History and the Last Man", Penguin Books, 1992.
[7] G Pascal Zachary, "The Global Me", NSW, Australie : Allen et Unwin, 2000.
[8] Clive Hamilton, "Affluenza : When Too Much is Never Enough", NSW, Australie : Allen and Unwin, 2005.
[9) C'est le sens de la déclaration de Spengler selon laquelle "C'est là que réside le secret de la raison pour laquelle tous les partis radicaux (c'est-à-dire pauvres) deviennent nécessairement les outils des puissances d'argent, des Equites, de la Bourse. Théoriquement, leur ennemi est le capital, mais en pratique, ils ne s'attaquent pas à la Bourse, mais à la Tradition au nom de la Bourse. Cela est aussi vrai aujourd'hui qu'à l'époque de Gracchus et dans tous les pays..." Oswald Spengler, "The Decline of the West" (Londres : George Allen & Unwin, 1971), vol. 2, p. 464.
[10] Voir Martin Heidegger sur ces termes.
[11] Martin Heidegger, " Ponderings II-VI : Black Notebooks 1931-1938 " (Bloomington, Indiana University Press, 2016), 28.
[12] Ibid, 91.
[13] Ibid, 83.
[14] Ibid, 89.
[15] Ibid, 173.
18:53 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, martibn heidegger, alexandre douguine, russie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 03 avril 2022
Homo homini lupus: le vrai visage de l'"Umma" néolibérale
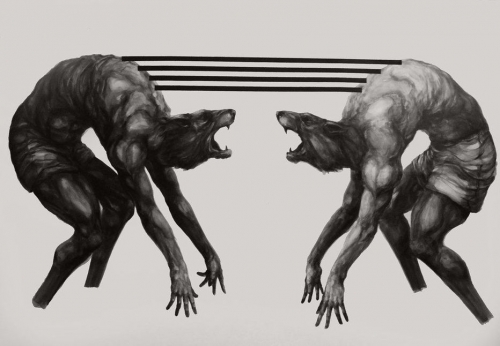
Homo homini lupus: le vrai visage de l'"Umma" néolibérale
Emiliano Laurenzi
Source: https://www.azionetradizionale.com/2022/04/01/fuoco-homo-homini-lupus-il-vero-volto-della-umma-neoliberista/
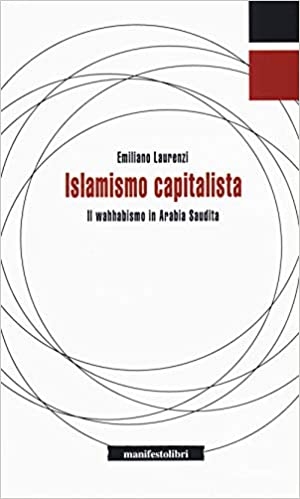 Emiliano Laurenzi est un sociologue des processus culturels, amateur de littérature et de voyages à moto, auteur de "L'islamisme capitaliste" pour les éditions Manifestolibri et co-auteur de divers essais de médiologie, il se consacre à l'étude par passion et ténacité.
Emiliano Laurenzi est un sociologue des processus culturels, amateur de littérature et de voyages à moto, auteur de "L'islamisme capitaliste" pour les éditions Manifestolibri et co-auteur de divers essais de médiologie, il se consacre à l'étude par passion et ténacité.
Affirmer que le wahhabisme est non seulement compatible avec la propagation du capitalisme de consommation en Arabie saoudite, mais qu'il y contribue également, signifie tout d'abord revoir les hypothèses idéologiques, plutôt que culturelles, à travers lesquelles notre société se représente. A l'origine de cette convergence entre la version du littéralisme coranique le plus desséché et l'adoption des comportements et des modes de vie consuméristes les plus avancés, il y a en fait une double dissimulation concernant les modes et les formes de légitimation du pouvoir d'une part, et le rôle du droit à l'égard des individus d'autre part. Aujourd'hui, nous avons du mal à reconstruire ces liens en raison de l'hégémonie exercée par le concept libéral de société civile.
Au cours des 40 dernières années, la version dominante du néolibéralisme a déployé tout son potentiel. Cela s'est manifesté non seulement dans l'économie et la finance, mais surtout dans la réduction radicale, voire la destruction pure et simple, de toute fonction de redistribution, de protection et de sauvegarde des sections les plus faibles de la population, ainsi que dans la liquéfaction des partis de masse et des syndicats. En bref, toutes les fonctions et organisations visant la médiation et la négociation. En d'autres termes, les résidus des fonctions sociales de l'État, fils du droit positif affirmé avec la révolution française, pour se limiter aux démocraties libérales. Mais aussi les manifestations concrètes du contractualisme : la source, pas par hasard clairement en crise dans tout l'Occident dit démocratique, de la légitimité étatique depuis 200 ans, c'est-à-dire depuis la destruction de l'Ancien Régime.
C'est précisément l'idée de la société civile, censée être un centre d'échange et de défense des libertés individuelles, qui a joué un rôle extrêmement efficace et flexible dans cette opération de démantèlement. La société civile s'est révélée prospère dans la crise des formes du contractualisme moderne, en leur absence, ou souvent comme instrument de leur destruction. On l'a vu avec les mouvements en Europe qui ont tenté de combler le vide laissé par les partis de masse - avec des résultats risibles - à ceux qui ont déclenché les soi-disant printemps arabes - étant ensuite systématiquement et tragiquement écrasés par les forces qu'ils avaient contribué à déclencher.
Ainsi, plusieurs éléments communs apparaissent en filigrane entre le cœur de la pensée libérale à partir duquel s'est développée l'idée de société civile et une certaine déclinaison de l'idée même d'umma, spécifiquement wahhabite. Les deux tendent à se présenter comme une dimension universelle, déclenchant une consonance entre l'idée libérale de la dimension économique de l'individu en tant que forme universelle authentique du droit naturel, et la nature de l'umma en tant que groupe de croyants soumis au droit divin. Les deux conceptions prétendent d'ailleurs remplir leur fonction et trouver leur propre sens au-delà des conditionnements culturels locaux et, surtout, au-delà des régimes politiques en vigueur, bien qu'il s'agisse plus d'une prétention qu'autre chose. Dans aucun des deux cas, il n'est question d'une quelconque forme de contestation de la domination de la dimension économique, dont le motif, pour ainsi dire, reste inaccessible à une approche rationnelle et confiné à une dimension fidéiste. Elle n'est pas, en fait, soumise à la négociation. Il n'est donc pas surprenant que le concept de société civile constitue le terrain privilégié sur lequel, depuis plus d'une décennie, on tente de combiner une conception vague et confuse de l'Islam avec l'économie de marché.
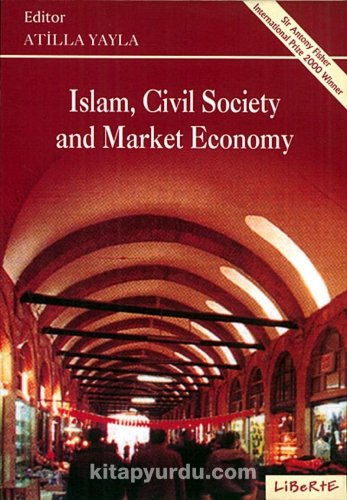
"La vérité est claire : il ne peut y avoir de société civile sans économie de marché; par conséquent, l'un des moyens de promouvoir la société civile dans les pays islamiques est de promouvoir l'économie de marché". Ainsi se termine l'introduction d'un court recueil d'essais (A. Yayla, Islam and the Market Economy), publié en Turquie en 2002, édité par Atilla Yayla. Une collection centrée précisément sur l'idée de combiner l'Islam et la société civile sur la base de l'économie de marché. Ce n'est pas un hasard si les références philosophiques du penseur turc - l'un des principaux partisans du libéralisme islamique - sont Hume et Locke, mais surtout von Hayek. Disons tout de suite que 18 ans plus tard, le souhait et la prédiction de Yayla se sont tous deux révélés fallacieux. Mais isolons le cas saoudien, qui nous occupe : De tous les pays musulmans, c'est sans doute celui qui a vu la montée et la consolidation progressives d'un islamisme - décliné sous les formes du terrorisme, de l'identitarisme religieux et du militarisme - parfaitement à l'aise avec les formes les plus avancées du capitalisme, ainsi qu'avec l'imposition des formes les plus féroces de l'économie de marché - on pense aux conditions de semi-esclavage avec lesquelles les travailleurs sont traités - et d'un contrôle impitoyable de l'information, jusqu'au massacre du journaliste Jamal Khashoggi. Faut-il donc en déduire l'absence absolue de société civile, selon les canons du néolibéralisme actuel ? Absolument pas, si l'on analyse de près sa conception. Mais procédons dans l'ordre.
Lorsque nous émettons l'hypothèse de l'existence d'une sorte d'umma néo-libérale - dont les signes sont très évidents en Arabie Saoudite - nous nous référons tout d'abord aux modes et aux formes de légitimation du pouvoir, ainsi qu'au rôle du droit vis-à-vis des individus. C'est en effet de ces deux caractéristiques du régime actuel que l'on peut déduire la position du sujet individuel par rapport à la loi, et de quelle manière le pouvoir se fonde, et établit ainsi un espace régulé. En tant qu'umma, la communauté des croyants ne se reconnaît pas dans une forme étatique, et en même temps, l'une de ses principales caractéristiques est précisément la soumission de ses membres à la loi sacrée. Ce qui intéresse le néolibéralisme, en ce sens, c'est précisément l'absence de législation souveraine, c'est-à-dire créée, comme l'a souligné von Hayek, avec un commandement totalement mondain - celui qui fonde l'État - tandis que la dimension à laquelle l'individu appartiendrait essentiellement est la loi de l'offre et de l'échange, dont la nature n'est pas du tout scientifique, mais a tous les traits d'une revendication fidéiste. Une conception très proche de celle de la loi islamique, la charia, qui est fondamentalement et intégralement une loi d'origine transcendante, même si elle a été élaborée par des juristes.

En substance, les deux conceptions tendent à saper les prémisses mêmes de la souveraineté étatique à l'origine du contractualisme - cette souveraineté étatique qui sert de "cadre" à la confrontation politique - et à laisser l'individu dans une dimension réglementaire unique, absolument inaccessible à la dynamique du marchandage politique, c'est-à-dire étrangère à la dynamique de la sécularisation du jeu politique. Le néo-libéralisme parce qu'il ne reconnaît pas les prérogatives de l'Etat souverain comme source de régulation autonome, juridique et politique. L'Islam wahhabite parce qu'il ne reconnaît qu'Allah comme souveraineté unique et authentique, ne reconnaissant au pouvoir temporel qu'un rôle vicaire et/ou patrimonial. Tous deux, il faut le souligner en passant, mais aussi pour faire ressortir certaines "affinités électives", se tournent vers le pouvoir en place - qu'il s'agisse de l'État ou du roi - comme garants de leurs privilèges et activités : le néolibéralisme lorsqu'il exige de l'État la défense juridique et la protection militaire de la propriété et du capital, le wahhabisme lorsqu'il obtient du roi des privilèges, des dotations et un contrôle social en échange d'une caution religieuse. De plus, le néolibéralisme a tendance à se débarrasser des appareils juridiques trop contraignants et ce n'est pas un hasard s'il a toujours montré une préférence pour les systèmes juridiques coutumiers, qui sont moins exposés aux codifications rigides résultant d'une intervention politique. Au contraire, le wahhabisme efface d'emblée toute possibilité législative, pliant la réglementation des comportements individuels à la charia, une loi sacrée, laissée à la totale discrétion du juge dans son application, et loin d'être le résultat d'un processus législatif laïc. Ce n'est pas un hasard si la codification des activités qui ne relèvent pas de la charia, en Arabie saoudite, est techniquement déléguée à de simples règlements ou à des édits royaux.
Une affinité particulière se dessine donc entre le néo-libéralisme et le wahhabisme, non seulement pour la dimension universelle particulière à laquelle ils se réfèrent, mais surtout pour les limites très précises qu'ils prétendent attribuer à cette dimension (d'où l'apparente contradiction qui les distingue). Tant le néo-libéralisme que le wahhabisme préfigurent donc une dimension extra-étatique donnée comme originelle : pour le néo-libéralisme, l'état de nature compris comme constitutivement économique (ce qui, je le répète, est une prétention totalement antiscientifique), et pour le wahhabisme, une déclinaison particulière de l'umma que l'on pourrait définir comme discrétionnaire à toutes fins utiles, donc éloignée de sa dimension religieuse authentique. Ce qui, cependant, enflamme et signale la convergence, c'est que les deux, à cette dimension, accompagnent une très puissante conventio ad excludendum. Le néolibéralisme à l'égard de toute tentative de rejeter la nature de l'être humain en tant que simple homo oeconomicus, et tend vers des formes de régulation et d'organisation des interactions sociales sur des bases non exclusivement dédiées au profit ; le wahhabisme à l'égard de tous les croyants qui ne se conforment pas à sa propre vision de ce que l'Islam devrait être, et sont considérés sic et simpliciter comme des non-croyants, des ennemis de la vraie foi, étrangers à l'umma.
Ces deux attitudes - qui découlent des formes de légitimation du pouvoir et du rôle du droit dans la régulation de la vie des individus - sont dissimulées derrière le rideau idéologique du concept de société civile et de son hégémonie culturelle. L'idée de la société civile, en fait, est l'instrument avec lequel la conventio ad excludendum est mise en œuvre, tant dans le néolibéralisme que dans le wahhabisme (mais aussi dans de nombreuses autres formes de religiosité, islamiques ou non). Elle s'épanouit dans le vide de l'espace politique comme un simple jeu de valeurs et de croyances - auquel les dimensions de l'empreinte médiatique sont perçues comme absolument hors d'échelle - sans pouvoir réel d'affecter la construction des formes de pouvoir, et encore moins leur légitimation. En ce sens, toute idée de société en tant qu'ensemble de sujets interdépendants a disparu, de même que toute idée d'une umma de croyants rendus hypocritement "égaux" en vertu d'une interprétation idéologique, arbitraire et littéraliste de la doctrine coranique, nous revenons à cet homo homini lupus hobbesien dont nous sommes partis.
19:50 Publié dans Actualité, Définitions, Economie, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, néolibéralisme, wahhabisme, umma, droit, économie, philosophie, philosophie politique, islam, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Massimo Donà et la philosophie de Goethe: une seule vision

Massimo Donà et la philosophie de Goethe: une seule vision
Giovanni Sessa
Source: https://www.paginefilosofali.it/massimo-dona-e-la-filosofia-di-goethe-una-sola-visione-giovanni-sessa/
Un livre très important de Massimo Donà vient de paraître, Una sola visione. La filosofia di Johann Wolfgang Goethe (pp. 327, euro 14,00). Dans ses pages, le philosophe se confronte à la pensée du grand poète allemand, dont il lit les œuvres en termes théoriques. Ce livre a été précédé de deux autres monographies, consacrées respectivement à Leopardi et à Shakespeare. Le motif qui unit les trois volumes est le même. Donà interprète ces trois grands, en soulignant, à la lumière de ses propres positions spéculatives, leurs traits anti-platoniques, anti-universalistes. Ce n'est pas un hasard, soutient l'auteur, si Goethe était mû par un "amour surhumain pour l'unicité irrépétable de l'existence" (p. 21) : il comprenait la vie et la nature comme "l'expression d'une puissance incoercible dont il aurait été vain d'essayer de prédéterminer le cours et la direction [...] puisque "en tout lieu nous sommes en son centre"" (p. 22). Sur la base de cette intuition, le génie de Weimar a compris l'inanité des "universaux", des "idées", pour comprendre la réalité. Les concepts déterminent, "pétrifient" le connu, au mieux compartimentent, par la procédure analytique, l'Un-Tout.
L'observateur le plus superficiel de la nature est conscient de son mouvement perpétuel. Comment, dès lors, est-il concevable de prétendre la connaître à partir de la "tranquillité" des idées ? Goethe était clairement conscient de cette contradiction. Il savait également que l'attitude gnoséologique platonicienne avait survécu dans la philosophie moderne. Les formes a priori de Kant, en effet, se caractérisent par la même nature statique que les universaux. Et pourtant, chez le penseur de Könisberg, dans la Critique du jugement, palpite une autre-non-autre manière de se rapporter au monde. La même vision se manifeste chez Bruno, Leibniz, de La Mettrie et Leopardi, sans oublier Spinoza. Leur pensée ne réduisait pas la nature à une série de "problèmes" (en tant que tels solubles) mais se présente sous le trait d'une "véritable écriture de l'énigme" (p. 28). Une position qui réapparaîtra, souligne Donà, également dans la philosophie du vingtième siècle: chez Deleuze, chez Arendt et, ajouterions-nous, également dans l'idéalisme magique d'Evola. Des formes de pensée qui échappent au logo-centrisme. Pour comprendre l'ubi consistam réel de l'idée de nature de Goethe, il est bon de se référer à la "matière": elle, l'être de tout ce qui est, en un : "dit son être placé et son ne pas être placé par moi" (p. 35).
Cela signifie, d'une part, que moi, le sujet connaissant et l'objet connu, vivons une relation d'attraction, qui fait que nous ne sommes pas autres l'un par rapport à l'autre, mais identiques. En même temps, nous sommes obligés de reconnaître que cette relation se développe de manière contradictoire, dans la mesure où la signification, la "compréhension" du monde me le fait vivre comme absolument autre que moi-même. Toute réalité est : "à la fois phénomène (dans la mesure où elle est référençable pour moi) et noumène (inconnaissable)" (p. 36). La matière est donc constituée de deux forces, dont Kant et Schelling avaient déjà parlé, l'une attractive et l'autre répulsive. Dans ce contexte spéculatif, Goethe introduit le concept de "métamorphose", cœur vital de son exégèse du naturel. Cette expression doit être comprise comme ce qui se passe "au-delà de la forme". En elle, précise Donà, il n'y a pas de référence à la cyclicité, mais à ce qui dépasse toute forme donnée. Pour cette raison, l'instrument privilégié dans l'exégèse de la nature est l'analogie, et non la similitude. Connaître par analogie implique de comprendre que, dans des espaces différents, il y a la même chose. L'idée même d'identité doit être repensée. Elle ne peut être posée que d'une seule manière: "comme ce qui en vérité n'a pas de forme" (p. 41), puisque ce qui revient dans les métamorphoses continues de la nature est "toujours et seulement la négation d'une forme" (p. 41).

La "matière" représente ce mouvement qui n'est aucun des "déterminés", des entités que je rencontre dans l'expérience, mais qui est seulement donné en eux. La métamorphose de Goethe, soutient Donà, est différente du dialectisme hégélien (et, en partie, de celui de Schelling également). Le système panlogistique a des règles déterminées, capables de dessiner une identité. Chez Hegel, la synthèse, le point d'arrivée, est déjà inscrit au commencement : "La nature n'a pas de système [...] elle a la vie [...] Elle est vie et succession d'un centre inconnu vers une limite inconnaissable" (p. 50). L'energheia, pour reprendre l'expression leibnizienne, est une force centrifuge, dispersive, entropique qui, du centre, tend vers l'extérieur. La désintégration du vivant n'a pas lieu: "précisément en vertu d'une force opposée [...] "centripète" (p. 51), qui tend vers l'extérieur (p. 51), qui tend à se spécifier, à "se préserver". Nous sommes enveloppés par la nature, l'horizon transcendantal de l'homme, comme dirait Löwith, et nous ne pouvons y échapper. Face à la luxuriance des jardins de Palerme, l'Allemand comprend que l'Urpflanze, la plante originelle, n'est pas réductible à la dimension de la Gestalt, de la forme platonicienne; au contraire, elle fait allusion au centre inconnu du Tout. C'est pourquoi Goethe, comme plus tard Heidegger, considérait que la physis coïncidait avec l'être, avec l'"épanouissement".
Où que l'on soit, on est toujours au centre de la nature, impliqué dans sa danse éternelle, dans le jeu éternel de la métamorphose dionysiaque. Dans ce livre : "Tout est nouveau et pourtant toujours ancien" (p. 61). L'Antiquité est l'informe, la négation originelle qui se donne "positivement" dans les entités. Notre action est donc le fait de la nature elle-même. En elle, Orphée et Prométhée ne font qu'un et nous faisons l'expérience du fini comme quelque chose qui doit toujours être dépassé, nous avons tendance, dans la mesure où nous relevons de la physis, à nous déterminer/à nous in-déterminer (la conception augustinienne du temps comme distensio animae a une grande pertinence pour Donà à cet égard). Le postulat hermétique "tout pense" découle de cette vision du Tout, de ses corrélations sympathiques. La pensée, en somme, est l'ouverture d'un monde. Goethe devient le porteur de cette connaissance non verbale particulière, qu'Aristote qualifie dans le livre IV de la Métaphysique, en l'attribuant aux plantes, de connaissance de ceux qui "ne disent rien" (p. 122). Cette connaissance, qui ne s'oppose pas au principe d'identité, adoucit sa lumière apodictique et évite le jeu du "être autre que moi-même", auquel elle renvoie inévitablement. Après tout, c'est la pensée du néant! Elle est pensée autrement que non-autrement par rapport au théorème et, chez Goethe, elle conduit à l'intuition.
Massimo Donà
Il nous permet "d'embrasser dans une seule vision ordonnatrice l'activité vitale infiniment libre d'un seul royaume de la nature" (p. 155). L'unité véritable devait se caractériser par l'infini et la liberté: "explosion d'un multiple jamais contraignable à des 'distinctions irréversibles'" (p. 157). En bref, le mouvement naturel est pensé par Goethe "comme une unité immédiatement destinée à se dire dans la "forme de deux", c'est-à-dire comme une polarité absolue. Absolu parce qu'il est original" (p. 161). Cette thèse est confirmée dans la Théorie des couleurs. Les couleurs ne sont déterminées qu'à partir d'une impossible superposition de l'obscurité sur la lumière ou de la lumière sur l'obscurité: " qui sont 'un' [...] parce qu'ils ne peuvent pas se déterminer comme absolument différents les uns des autres " (p. 265). Les couleurs ressortent (comme l'a également souligné Steiner) sur la frontière ambiguë qui semble diviser la lumière de l'obscurité. Le jeu des contraires est retracé par Donà, dans une exégèse précise des Affinités électives, dans les relations amoureuses des quatre personnages principaux du roman.
Un livre important, Un sola visione, non seulement pour la lecture éclairante de Goethe, mais aussi pour ceux qui souhaitent regarder le monde avec un regard renouvelé.
Giovanni Sessa
19:13 Publié dans Littérature, Livre, Livre, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : goethe, allemagne, littérature, lettres, lettres allemandes, littérature allemande, livre, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
La Tradition juridico-religieuse romaine: la pensée de Julius Evola et l'idéologie du droit naturel

La Tradition juridico-religieuse romaine: la pensée de Julius Evola et l'idéologie du droit naturel
Giandomenico Casalino
* Essai publié dans la revue Vie della Tradizione n. 178/179 (janvier-décembre 2020)
Source: https://www.paginefilosofali.it/la-tradizione-giuridica-religiosa-romana-il-pensiero-di-julius-evola-e-lideologia-del-diritto-naturale-giandomenico-casalino/
Dans ses écrits, Julius Evola a explicité en termes morphologiquement universels et donc exhaustifs ce qu'il faut entendre par Loi et Droit dans le monde de la Tradition universelle ; et par conséquent, il a également traité de la signification du Droit dans la sphère de la culture traditionnelle de l'Occident helléno-romano-germanique, en le considérant comme un aspect essentiel de la nature même des lignées indo-européennes, dans la valorisation de leurs événements plus mythiques-symboliques [1] qu'historiques. Ici, ne voulant pas nous étendre sur ce sujet, nous allons le considérer comme un "donné" acquis et, l'assumant, nous nous intéresserons à un aspect de la vision du Droit chez Evola qui, loin d'être secondaire ou marginal, est au contraire préparatoire à la compréhension de la polarité [2] (typique alors de la Denkform indo-européenne...) intrinsèque à sa propre vision de la réalité.
La polarité dont nous parlons se manifeste de manière évidente dans la façon dont Evola affronte le "quaestio" de la soi-disant Loi naturelle, dans un chapitre dense et articulé de L'arc et la massue [3], intitulé : "Idée olympique et Loi naturelle". Notre intention est de prouver, de manière documentée et donc incontestable, que la position d'Evola, son opinion très critique du "mythe" de l'ancien Droit Naturel et "a fortiori" du droit naturel, est non seulement cohérente avec la vision traditionnelle et organique du monde et de la vie, mais est substantiellement la même que celle qui, pour un œil attentif, semble émerger de la culture juridico-religieuse romaine, comme une "forma mentis" contenue dans les sources mêmes du Droit romain.
Il est cependant bon, de manière préliminaire, d'essayer de mettre de l'ordre autour des valeurs sémantiques des mots que nous utiliserons dans cet article, à la lumière de leur étymologie. Il n'est pas possible, en effet, d'entrer dans la "valeur" de ce que la doctrine traditionnelle, et donc Evola lui-même, entendent lorsqu'ils utilisent le terme nature, sans effectuer un authentique "opus remotionis" des incrustations de significations chrétiennes et/ou modernes qui dissimulent et mystifient le discours original. L'"incipit" de Révolte contre le monde moderne [4] est d'une clarté solaire à cet égard : il y a un infernal (c'est-à-dire inferior.... Il y a une nature obscure infernale (c'est-à-dire inférieure...) et il y a une nature lumineuse supérieure ; il y a une nature chthonique, terrestre et il y a une nature céleste ; mais, en termes splendidement platoniciens, pour Evola aussi, le Tout est Phylysis, c'est-à-dire les Dieux, les démons, les hommes, les plantes et les animaux, les forces "subtiles", les Réalités Divines psychiques et objectives en tant qu'états supérieurs de l'Être, les Idées au sens platonicien ; et Hegel, également à la manière platonicienne, conclut en affirmant que "le Tout est le Vrai ! ".
Ici, il n'y a pas de dualismes entre le ciel et la terre, ni de "spiritualisme" ou de "matérialisme", ni de "sujet" et d'"objet", pour le monde traditionnel gréco-romain et sa sagesse, de telles absurdités n'existent pas, elles n'auraient eu aucun sens: voici les premières fictions modernes dont il faut se débarrasser lorsqu'on aborde cette question. La Physique d'Aristote, B, 1, et le commentaire de Heidegger [5] sur le même passage, sont, propédeutiquement et pédagogiquement, clarifiants afin aussi et surtout au fait que, étant à la fois le Timée platonicien et la Physique aristotélicienne, les livres fondamentaux de l'Occident, ils incluent aussi la soi-disant (par nous) "métaphysique" où, Il est bien connu qu'en ce qui concerne l'ensemble des écrits aristotéliciens qu'Andronicus a mis en ordre et placés après la Physique, ce ne sont que des notes de cours scolaires portant non plus sur la Phyosophie en général (c'est-à-dire la Physique) mais sur "l'être en tant qu'être" qui en émerge toujours et qui est toujours là, résidant en elle. Dans la Grèce archaïque et classique (certainement pas dans l'illumination maçonnique de l'intellectualité sophistique...) Physis [6] n'est donc absolument pas la nature physique au sens moderne et donc mécaniste et grossièrement matérielle [7], mais c'est l'Ordre divin du monde, Themis, donné "ab aeterno", où le nòmos de la Cité s'identifie avec lui. Un trait distinctif de la spiritualité grecque traditionnelle est le fait que pour l'Hellène, Physis en tant qu'Ordre cosmique, étant le donné, est comme voulu [8], dans le sens où l'ordre humain est l'imitation, nécessaire et implicite de la Loi, de celle-ci, l'adaptation à celle-ci dans une tension essentiellement héroïque et dans la conviction que le nòmos est dikàios = juste, seulement si et dans la mesure où il est "mimesis" de la Physis : "La souveraineté de la loi est semblable à la souveraineté divine, tandis que la souveraineté de l'homme accorde beaucoup à sa nature animale... la loi est une intelligence sans passions..." (Aristote, Politique, III, 16, 1278a). Puisque nous savons que la Divinité pour les Grecs, et pour Platon et Aristote en particulier, est dans le Cosmos [9] il est évident que si la Loi est semblable à la souveraineté Divine, la même Loi est celle visuelle des Dieux de la Lumière et du Ciel lumineux. La Cité est ordonnée selon le nòmos qu'est dìke, la fille divine de Zeus et Thémis, c'est-à-dire la justice universelle des Dieux olympiques dans sa mise en œuvre humaine [10] et non selon le nòmos des Dieux chtonei et maternels, ce dernier ordre qui a précédé celui des Hellènes et qui lui est hiérarchiquement soumis. En effet, selon les mots d'Aristote, il y a l'essence de la grécité : le monde est une manifestation à la Lumière des Formes de l'Être et de la Vie (comme le dit W. F. Otto), distincte, définie, et de l'essence du monde grec. Otto), distinct, défini, dépourvu de passions et si tel est, en termes mythiques, l'Ordre que la royauté cosmique de Zeus impose aux Puissances primordiales de l'Être qu'il vainc par son avènement [11], en termes platoniciens, c'est la fonction archétypale de Dieu en tant que "mesure de toutes choses" [12] qui est le Bien-Un en tant que Mèghiston Màthema = Connaissance suprême qui est Apollon; tandis que chez le Stagirite, c'est la Divinité en tant qu'Harmonie invisible du monde, Pensée de la Pensée.
* * *

Ce qui oppose radicalement la culture juridico-religieuse romaine à la spiritualité hellénique est l'attitude différente, en termes anthropologiques, que le Romain a envers le monde, envers le "donné". Pour le Romain, en effet, le monde n'existe pas "a priori" et de toute éternité ; c'est plutôt le principe inverse qui s'applique : le voulu est comme le donné [13] (alors que nous avons expliqué précédemment que dans le monde grec, le donné est comme le voulu).
Le Romain, donc, avec l'action rituelle, fait, crée le cosmos qui est la Res Publica, l'ordre des Dieux, en particulier Jupiter, Dieu de la Fides, de la Loi et des accords, la divinité suprême de la fonction primaire qui est magico-légale.
Il est l'État romain [14], qui est la conquête et l'ordonnancement culturels d'un "datum" antérieur biologique et chaotique, en un mot naturel, c'est-à-dire le ius gentium. En observant la Romanité d'un point de vue encore plus universel, ainsi que du point de vue de sa métaphysique, nous croyons avoir démontré ailleurs [15] et en développant toujours, par la méthode traditionnelle de l'analogie et de l'anagogie [16], certains aspects de la connaissance évolienne de la symbologie hermétique et de la Tradition, que l'essence la plus intime, et donc ésotériquement "cachée" pour la plupart, de la Romanité réside dans la présence de deux Réalités Divines : Vénus (Énée) et Mars (Romulus). Le sens ultime du cycle romain, ainsi que de l'apparition de la Cité elle-même, comme sa sortie de l'Immanifesté vers le manifesté, du Prémonadique vers le monadique (l'Ergriffenheit, selon Kerenyi), Tout cela consiste dans le Mystère du Rite comme Ascèse de l'Action qui, se projetant sur Vénus, la transforme en Mars (et c'est l'apparition de Rome-Romulus) et avec cette puissance agite et fixe Mercure (la Force vitale qui se déchaîne) pour obtenir Jupiter (et c'est la Voie Héroïque vers le Sacré et vers la Somme de la Romanité au moyen de la Guerre Sacrée) réalisant finalement Saturne comme Roi Primordial de l'Age d'Or (la Pax Romana, symbolisée par Auguste, Imperator et Pontifex Maximus). De cette vision, nous dirions bachofénienne, de l'ensemble de la romanité, émerge ce qu'Evola lui-même indique à propos de la morphologie générale du Rite qui : "[...] met en œuvre le Dieu à partir de la substance des influences convenues [...] nous avons ici quelque chose comme une dissolution et un resucrage. C'est-à-dire que le contact avec les forces infernales qui sont le substrat d'une divinisation primordiale est renouvelé de manière évocatrice, mais aussi la violence qui les a arrachées à elles-mêmes et les a libérées sous une forme supérieure [...]" [17]. Ce passage, déjà cité par nous à une autre occasion, malgré son énorme importance, n'a pas été suffisamment mis en évidence par les spécialistes de l'œuvre d'Evola. En elle s'exprime la loi universelle du processus et la finalité même de l'action rituelle qui, renouvelant l'Ordre, fait les Dieux et, donc, par analogie, du Rite juridico-religieux romain [18]. Il découle de ce qui a été dit que, loin d'accepter une "nature" préconstituée (même si elle est toujours comprise en termes non matériellement modernes) et loin d'agir après avoir accepté le datum comme dans la grécité, le Romain commence son entrée dans l'histoire en la sacralisant avec le Rite et avec lui, ou plutôt, en vertu de ses effets dans l'Invisible qui se répercutent dans le visible, il transforme le chaos en cosmos et, par cette métaphysique pratique, il réalise le Fas du Ius, c'est-à-dire le Dharman du rtà, comme il est dit dans le RgVeda [19]. Le Romain a un concept "pauvre" de la nature, puisque l'Ordre complexe des formes qui émerge des profondeurs de la nature, qui est la Phylysis des Grecs, n'existe pas pour son esprit et devant ses yeux ; il ne pense à la nature que lorsqu'elle est ordonnée par le Ius civil [20], avec une action culturelle précipitée qui est, par essence, cultuelle, c'est-à-dire rituelle. De telle sorte que la nature et la loi s'avèrent être la même chose, mais pas "a priori" comme pour le grec, mais "a posteriori", c'est-à-dire après que la forme, le sceau, le sens, l'Ordre (la Loi) soit imprimé sur la nature (qui n'existe pas... et est de la cire informe). C'est donc le Droit qui crée littéralement la nature à son image, puisqu'il n'y a pas "deux" réalités mais une seule réalité : la nature qui est pensée juridiquement, c'est-à-dire selon l'ordre du Ius civil, qui est le Ius romanorum. Le Romain écoute, voit et sait et, par conséquent, agit dans les termes dans lesquels la Loi est la nature ordonnée dans le cosmos !
Evola a intuitionné et exprimé tout cela dans toute son œuvre et le discours que nous menons n'est rien d'autre que le développement logique (évidemment pas en termes de logique abstraite, c'est-à-dire moderne...) ainsi que comparatif avec d'autres études (Kerenyi, Eliade, Dumézil, Sabbatucci, Bachofen et Altheim) de ses arguments, également apparemment sans rapport avec la question que nous traitons. Cela dit, l'idée même d'un "droit naturel", même dans les termes stoïciens que nous mentionnerons, est totalement étrangère à la mentalité juridico-religieuse romaine, et ce depuis l'âge archaïque jusqu'à l'Antiquité tardive pré-chrétienne. Il est en effet impossible pour le Romain, qu'il soit magistrat, prêtre ou juriste, de penser à une "nature" a priori, de quelque manière que ce soit, qui dicte et indique déontologiquement les normes fondamentales de la Res Publica auxquelles le Ius civil doit se conformer. C'est impossible, car, étant donné les prémisses mentionnées ci-dessus, une telle logique aurait été la dénaturation de l'âme même de la romanité ; en effet, nous pourrions dire que, si par l'absurde, elle l'avait fait sienne, elle aurait causé sa mort (ce qui s'est en fait produit ponctuellement avec l'avènement de l'Empire désormais christianisé et la lente infiltration dans le corps du droit romain post-classique de l'idéologie chrétienne dualiste).
La preuve supplémentaire du caractère étranger à la mentalité romaine traditionnelle de la culture et de la pensée même d'un Droit conforme à une prétendue nature, considérée comme une réalité physique ou "morale" donnée "ab aeterno", réside dans un célèbre passage d'Ulpianus/Ulpien, qu'il est nécessaire de citer intégralement : "[...] ius naturale est, quod natura omnia animalia docuit : nam ius istud non umani generis proprium, sed omnium animalium, quae in terra quae in mari nascuntur, avium quoque commune est, hinc descendit maris et feminae coniunctio, quam nos matrimonium appellamus, hinc liberorum procreatio, hinc educatio : videmus etenim cetera quoque animalia, feras, istius iuris peritia censeri" [21] (Digest 1. 1.1.3 e 4).

Il y apparaît de manière solaire que le "chaos" dont nous avons parlé, c'est-à-dire la nature comme néant acosmique que le Romain avec le rite juridico-religieux change en Cosmos selon le Fas du Ius, n'est rien d'autre que la Loi naturelle identifiée à la coutume des animaux = more ferarum. Ulpien dit, et en lettres claires, que le Ius naturale est ce que la nature biologique-physique indique, impose à tous les animaux et certainement pas à l'homme, sinon dans sa dimension strictement et proprement naturaliste au sens biologique, comme des rythmes de vie qui, toutefois, sont régis et ordonnés de manière subordonnée et hiérarchisée par une sphère culturelle précise qui ramène toujours et uniquement au monde de l'Esprit qui est celui du Ius civile et qui est essentiellement de nature religieuse. Cet exposé d'Ulpien, qui est, ne l'oublions pas, un juriste du IIIe siècle de notre ère (et qui, on le suppose, a pu assimiler toute la littérature, tant strictement philosophique sur le sujet que la pensée même des juristes qui l'ont précédé), est si éclairant qu'il n'a pas été apprécié par un juriste-philosophe comme Guido Fassò, de formation culturelle catholique, qui reproche même [22] à Ulpianus une conception excessivement "naturaliste" (sic !) du Droit Naturel qui, de toute évidence, n'est pas conforme aux principes du droit naturel, ce qui ne convient évidemment pas à l'idée que Fassò lui-même veut transmettre, conformément à son inspiration chrétienne.

Nous croyons, par contre, pouvoir utiliser "au contraire" les mêmes censures faites par Fassò à l'encontre d'Ulpien et dire que, loin de se limiter ou de s'écarter de la pensée du juriste romain et loin de monter sur les miroirs d'une vaine bataille herméneutique, d'ailleurs clairement intolérante parce que non respectueuse de la source elle-même et de ses significations, précisément du passage cité ci-dessus il ressort combien est historiquement véridique, parce qu'idéologiquement cohérent, ce que nous avons essayé d'expliquer ici. La conception de la "loi naturelle" comme ordre moral auquel le droit positif des hommes doit se conformer, non seulement n'a jamais existé dans la culture juridico-religieuse romaine (Cicéron, en fait, lorsqu'il semble parler de cette manière, dans "De Republica" 3,22,33 et "De Legibus" 2,4,8, même si c'est d'une manière stylistiquement valable, ne fait rien de plus que présenter au public romain érudit, des théories stoïciennes qu'il a reconsidérées. Ce n'est donc pas le juriste qui parle mais le juriste amoureux de la philosophie grecque...) ; mais ce qui est parfois cité dans les textes des juristes, toujours juristes à travers le recueil de Justinien, comme "Ius naturale", est confondu dans la tradition juridique romaine avec Ius gentium qui est, comme nous le savons, le Droit non romain que la puissance de l'Action spirituelle de la romanité elle-même reçoit dans l'orbis romanus en le changeant en Ius civile, c'est-à-dire un événement culturel romain. La Constitutio Antoniniana de 212 AD.... est emblématique de cette attitude. Le Ius gentium est donc l'ensemble des coutumes, des habitudes et des usages juridiques et religieux des gentes, aussi bien celles qui ont précédé la naissance de Rome que les populations entières au sens de nationes que Rome elle-même allait rencontrer ; tout cela, le Romain le juge comme quelque chose d'étranger à la civitas, de naturaliste au sens de primitif et que la Res Publica en termes culturels romanise tout en conservant leurs principales caractéristiques et éléments distinctifs, réalisant ce que nous appelons le miracle de la tolérance de la cité qui devient le monde : le seul exemple de mondialisation équitable dans l'histoire de l'humanité !
D'autre part, il faut le dire une fois pour toutes, la doctrine du soi-disant droit naturel, dans sa caractéristique intrinsèque : toujours comme une pulsion individualiste, d'abord dans une clé psychiquement fidéiste, c'est-à-dire chrétienne, et ensuite, sécularisée, dans le droit naturel moderne, ne vient même pas de la philosophie grecque. Les stoïciens, en effet, entendaient par "nature" la "naturalis ratio", la nature rationnelle de l'homme - rectius du sage - et non la nature animale, car ils ne s'intéressaient absolument pas à la multitude des hommes en général, n'étant pas et ne pouvant pas être les mêmes que les sages. En cela, ils ont obéi au critère de jugement caractéristique de toute culture classique, c'est-à-dire purement élitiste et aristocratique. L'origine de la mystification de la doctrine stoïcienne, de sa démocratisation vient donc de l'individualisme inhérent au christianisme jusqu'à la Révolution française, y compris les Lumières elles-mêmes ; puis de Thomas d'Aquin, à travers le courant franciscain, la seconde scolastique, jusqu'à Grotius et Domat [23]. D'autre part, la conception de l'État chez Augustin est péremptoirement individualiste-contractualiste et donc délibérément anti-traditionnelle. Pour le natif d'Hippone, en effet, l'État naît de la violence et du sang [24] et dans son "De Civitate Dèi", citant le fratricide de Romulus, il déclare que l'État est toujours fondé sur l'injustice ; il ne peut donc être l'État tel qu'il le conçoit tant qu'il ne s'identifie pas à ce qu'Augustin lui-même appelle la "Cité de Dieu" fondée et régie par les lois du Christ ; concluant que, pour l'effet, l'État romain n'est jamais parvenu à être tel ! Je ne sais pas à quel point cela est obstinément subversif, inouï et étranger à la culture gréco-romaine classique. C'est la parabole descendante de ce que les stoïciens ont théorisé comme étant la "loi naturelle". Cela manifeste la transposition en termes anthropologiques du discours stoïcien dans la psychologie de l'âme-démocratique de l'individu chrétien et dans sa praxis politique et culturelle. La pensée équilibrée d'un Romain tel que l'Auguste Marc Aurèle, la sagesse d'un Épictète ou les convictions philosophiques de nature platonicienne d'un Cicéron se transforment, dans la mentalité judéo-chrétienne, en une haine tenace du monde, de la Politique et de l'Empire, en une "vision" utopique, subversive et hallucinée de ce qu'Augustin lui-même définit comme la "Jérusalem céleste". Et tout cela, même atténué par l'acceptation de la rationalité aristotélicienne, restera jusque dans la scolastique médiévale comme un doigt accusateur pointé par l'Église sur l'Empire, s'arrogeant le droit de remettre en cause la légitimité même de l'autorité impériale, selon le dictat que Thomas fait référence à la fois à la "Lex divina" et à la "Lex naturalis", confirmant ainsi l'exorbitante prétention chrétienne de la subordination de l'Empire à l'Église, comme on dit le Soleil à la Lune ! (Summa Theologiae, Ia 2ae, q. 93, art. 2 ; q.91, art. 2 et 4 ; q. 91, art. 3 ; q. 95, art. 2).
* * *

Non sans raison, en traitant de la Romanité, nous avons toujours utilisé [25] un néologisme de notre cru, qui est le mot composé : juridico-religieux, parce que nous sommes convaincus que pour le Romain, puisque c'est le Rite qui fonde et crée la Civitas et qu'il est intrinsèquement ressenti par le Peuple des Quirites comme une action juridico-religieuse, alors, par conséquent, dans son essence, cette Civilisation, en tant que fait historique, ne peut qu'être de nature juridico-religieuse [26]. On peut dire que ce type d'approche a fait son chemin au cours des dernières décennies, tant dans le domaine des études de la Religion romaine que parmi celles de la Jurisprudence, cessant ainsi de considérer, en termes stupidement modernes et donc toujours comme un effet de la culture chrétienne, les deux sphères, Droit et Religion dans la Romanité, comme séparées de telle sorte que les études qui s'y rapportent, bien qu'excellentes dans leur domaine, ont toujours été presque comme deux lignes parallèles destinées à ne jamais se rencontrer. Disons que les noms d'Axel Hägerström [27], Pietro de Francisci, en ce qui concerne les précurseurs, et Pierangelo Catalano [28], John Scheid [29], Giuseppe Zecchini [30] et surtout Dario Sabbatucci [31] pour les temps plus récents, peuvent donner une idée de ce que peut signifier aborder la romanité, penser et étudier son histoire de manière unitaire à la fois comme juristes et comme historiens de la religion ancienne, entrant ainsi dans l'idée de sa mentalité, dans un effort d'humilité herméneutique, essayant de regarder le monde à travers les yeux des Romains afin de comprendre les présupposés idéaux, les valeurs vécues par la même Communauté dans sa continuité historique et les catégories de pensée, en tant que forma mentis, sur lesquelles elles se fondent. Qui, pourtant, presque dans la solitude, dans un monde et à une époque enchantés par l'exotisme et l'asiatisme, où prévalait encore la conviction, aussi populaire que catholique, partagée d'ailleurs par les mêmes milieux traditionnels (voir la pensée de Guénon sur la civilisation gréco-romaine) que la romanité n'avait finalement été qu'une civilisation juridico-politique mais que le fait religieux en soi avait toujours existé, au début, une idée entièrement primitive et animiste, qu'elle a ensuite enrichie, au fil du temps, au contact de la culture grecque, en acquérant les données mythologiques de cette dernière et que, surtout, tout cela n'avait rien ou presque rien à voir avec le Droit ; eh bien, comme nous le disions, la personne qui, à une telle époque, a toujours osé affronter le monde spirituel de Rome d'une manière unitaire juridico-religieuse, ce fut Evola ! En fait, il pressentait, et cela est présent depuis les écrits des années vingt jusqu'à Impérialisme païen, qu'il est impossible d'approcher l'essence de la romanité si l'on ne s'efforce pas de combiner ces deux éléments (Loi et Religion) qui pour l'homme moderne paraissent incongrus et peut-être incongrus mais qui pour le Romain sont naturaliter, sont sa façon d'être au monde et la raison de son action rituelle dans le même monde. Nous croyons qu'Evola est parvenu à la connaissance de cette vérité en vertu de son affinité démoniaque avec l'âme de cette Civilisation, nous révélant ainsi que le lien, la liaison entre les "deux" sphères (qui ne sont pas telles mais substantiellement une) est le Rite et que, par conséquent, pour tenter de donner une valeur explicative aux attitudes, aux faits, aux événements et aux actions de toute l'histoire de Rome, comprise avant tout comme l'histoire du Droit public romain dans sa dimension symbolique et sacrée, en vertu de l'identification prééminemment romaine du Public avec le Sacré [32]; c'est de là qu'il faut partir, de la romanité comme ascèse de l'action, c'est-à-dire de ce sens magique de créateur et ordonnateur du monde que le Rite [33] a à Rome, en l'abordant donc de manière traditionnelle, c'est-à-dire organique. En termes d'interdisciplinarité, elle est la seule, en effet, à nous permettre d'acquérir la grille d'interprétation dans une clé profondément et essentiellement spirituelle de l'ensemble du cycle romain.

Par conséquent, la conception qu'Evola exprime par rapport au droit dans le contexte du discours ci-dessus, il est légitime de dire qu'elle coïncide de manière surprenante, seulement pour ceux qui ne veulent ou ne peuvent pas voir, en raison d'une ignorance radicale de la nature la plus intime du droit romain et de la pensée unitaire d'Evola lui-même, avec la même idée et la même pratique politique que les Romains avaient et qui ressort des textes qui nous ont été transmis, à condition de les lire sans lentilles idéologiquement modernes et donc déformantes. Ce qu'Ulpien veut exprimer, en fait, dans le passage cité, montre qu'un juriste romain jusqu'à l'ensemble de la période classique et postclassique, non seulement ne pouvait avoir que peu ou pas d'intérêt pour ce que Cicéron, en tant que philosophe, avait dit sur les thèmes stoïciens, mais qu'en lui est présente dans la ronde précisément cette polarité, que nous avons mentionnée au début de cet essai, entre les forces biologiques et les réalités spirituelles (entre le "Ius naturale" qui enseigne et indique à tous les animaux et seulement à eux et le "Ius civile" qui est propre au monde civil et donc à la Romanité) qui est la même que celle présente chez Evola dans toute son exégèse traditionnelle et en particulier dans son jugement sur le soi-disant Droit naturel. Dans le chapitre cité "Idée olympique et Droit naturel", Evola, en effet, développant les intuitions et les arguments de Bachofen [34], donne déjà dans le titre même le cadre de cette polarité, quand il oppose, même dans le langage, l'Idée, en termes platoniciens, qui est par nature olympique, et donc liée au monde supérieur de l'Être, au Droit naturel qui, de façon très "ulpienne", (même si Evola interprète le passage différemment...) définit non pas le droit par excellence et donc le droit de l'être humain, mais le droit du monde civil. ) définit non pas le droit par excellence et dans l'absolu mais un droit, c'est-à-dire une manière, propre à une certaine "race de l'esprit", de concevoir l'ordre politique dans une praxis ... anti-politique, c'est-à-dire anti-virile et donc complètement naturaliste-biologique, égalitaire et féminine, référable à la sphère de l'"éthique" de l'utile typique des producteurs dans la tripartition platonicienne de l'État et à la domination de l'âme concupiscente dans le "petit" État. Cette idéologie précède, selon Evola, même l'avènement du christianisme et, comme un courant souterrain à l'itinéraire spirituel de la même civilisation indo-européenne, est présente dans toutes les formes d'absolutisme asiatique-maternel assumant alors les mêmes caractéristiques de marque tyrannique ou plébéienne, contre laquelle Rome s'est toujours dressée dans sa guerre sacrée contre Dionysos et la Femme qui est histoire historique et symbolique ensemble.
Se référant aux études du brillant Vittorio Macchioro [35] qui fut le premier à identifier le fil rouge reliant les courants orphiques-dionysiaques au paulinisme chrétien et à sa conception désespérée d'une âme déchirée, Evola expose, anticipant de plusieurs décennies les récentes acquisitions de la science politique de l'antiquité [36], la nature et les véritables causes, c'est-à-dire juridico-religieuses, du conflit entre le patriciat romain - d'origine indo-européenne et de culture pastorale, dont les dieux sont masculins et célestes - et la plèbe - avec ses cultes, ses rites et sa loi, avec l'Aventin comme colline en opposition au Capitole, avec sa Triade (Ceres, Libero et Libera, divinités agricoles et féminines, où Libero est Dionysos) qui contraste avec la Triade archaïque des patriciens (Jupiter, Mars, Quirinus), dieux magiques-légaux et guerriers.
Evola ne pouvait pas ne pas avoir ce jugement sur l'idéologie et l'ancien "mythe" du Droit Naturel, précisément parce qu'en lui, et "a fortiori" dans sa christianisation, il identifiait, habilités par le nouveau type humain dominant et donc avec des capacités de déclenchement, tous ces éléments d'individualisme volontariste d'abord (Augustin) et ensuite rationaliste (Thomas) en conjonction avec l'âme féminine conséquente du christianisme, qui avaient provoqué un changement radical des bases idéales de la vie, brisant la vision unitaire de la civilisation classique : l'"ordo ordinatus" à la fois comme "donné = voulu" selon la mentalité grecque et comme "voulu = donné" selon la mentalité romaine. Evola souligne, même dans cette pensée très proche d'un ancien juriste romain, que tout cela ne pouvait qu'anéantir la vision sereine et objective de la tradition classique, en raison de la présence du moment créatif et subjectif introduit par l'individualisme chrétien en liaison avec son concept inédit de "volonté" (complètement absent dans la vision gréco-romaine qui ne connaissait que la "nécessité"...) du Dieu créateur et de sa "volonté") du Dieu créateur et de sa loi, qui, avec l'avènement du monde moderne et sa sécularisation, produisant l'annulation de la foi chrétienne, est devenue la subjectivité publique abstraite de la rationalité bourgeoise et mercantile, en un mot, le droit naturel moderne, le père lointain du fantasme juridique de Kelsen connu sous le nom de rule of law. À l'animalité et à la sphère purement biologique (Paul, aux Athéniens scandalisés qui ne connaissaient que la résurrection de l'âme du corps, parle de quelque chose de vulgaire comme la résurrection du corps et en fait à sa conception du mariage il superpose pìstis = la foi comme "bénédiction" d'une relation qui pour lui reste toujours animaliste) qui est, précisément en termes vétérotestamentaires, définis, avec un autre terme inouï et inconnu de la culture gréco-romaine, comme "chair", le chrétien ne peut rien opposer d'organique et de viril sinon sa phychè purement lunaire et certainement pas l'État comme esprit = Nòus comme Idée qui donne Forme à la "chóra" platonicienne, dans toutes ses acceptions. À tel point que, dans toute la culture catholique, même la plus conservatrice, on ne parle jamais d'"État" organique, qui qualifie la vision traditionnelle hellénistique-romaine et en est précipitée, mais de "société" organique, privilégiant presque par instinct la sphère chthonique et féminine correspondante, ne pouvant voir et donc ignorant la sphère céleste, virile et/ou supérieure. C'est pourquoi Evola affirme, en lettres claires, que l'origine, la nature et les objectifs de l'idéologie du soi-disant Droit naturel sont, en tant que catégories au niveau morphologique, éminemment modernes en ce qu'ils sont biologiquement égalitaires sinon plébéiens et donc anti-traditionnels et tendent à subvertir l'Ordre juridico-religieux de la Théologie de l'Empire, une réalité métapolitique et spirituelle, le principe ordonnateur de la "nature" ; subversif, donc, d'un monde de certitudes métaphysiques objectives, c'est-à-dire essentiellement spirituelles et certainement pas d'une nature psychiquement fidéiste et, donc, humaine..... trop humaine ! De là à la sécularisation de l'idéologie chrétienne du droit naturel, qui est à son tour une démocratisation psychique de l'ancienne doctrine stoïcienne, dans le droit naturel moderne, il n'y a qu'un pas vers le coucher de soleil de l'écoumène médiéval et l'avènement du rationalisme athée et utilitaire de la bourgeoisie, non pas tant et pas seulement en tant que classe dominante mais en tant que culture et vision du monde.

Ici, la "nature" n'est plus ce dont parlait le christianisme, à savoir l'ordre "moral" selon la loi du Dieu chrétien auquel le droit positif doit se conformer. Ayant expulsé la "foi" comme un élément artificiel superposé à une nature déjà conçue par le christianisme lui-même en termes mécanistes et matérialistes, anticipant presque Hobbes, Descartes et Newton (ayant annulé à la fois la sacralité de l'État, c'est-à-dire de l'Empire, et toute la conception apportée par la culture grecque des grands mythes naturels et de la nature vue comme "pleine de Dieux..."[37] et qui, au contraire, pour le chrétien sera : "massa diaboli ac perditionis [...]") ; il ne reste que la nature beaucoup plus prosaïquement rationaliste de l'individu (Grotius et Domat) et du monde vu par Descartes comme "res extensa", des corps matériels se déplaçant mécaniquement par eux-mêmes dans un espace désolément vide.
Cet individu, "libéré" de cette "foi", ne verra que ses droits "naturels" (et voici le droit naturel moderne) de propriété, de liberté, d'association, de profit, tous vécus uti singulus et contra omnes ; en vertu desquels et en les brandissant comme une arme de chantage, il imposera son "contrat social" (comme Augustin pensait que la société politique était née...) et ne tolérera que l'État qui ne lui permettra pas d'en faire partie. ) et ne tolérera que l'Etat qui lui permettra de les exercer à son profit, jugeant alors de ce point de vue la légalité et la légitimité de cette même larve d'Etat et de son droit positif. Et, à la réflexion, cette même dernière idéologie du genre, qui est la négation du concept naturel du genre, n'est rien d'autre que la conséquence terminale de toute la "religion" moderne entêtée des droits de l'individu, qui, à ce stade, ne sont plus "naturels" mais, dans un renversement satanique de la doctrine traditionnelle, et c'est la contre-transformation, doivent être reconnus et protégés comme "culturels" qui sont le résultat de choix opérationnels de l'individu qui, ainsi, rejette et ne reconnaît pas sa propre nature ! C'est le résultat final, d'un âge sombre avancé, du droit naturel, et cela démontre, au contraire, combien la doctrine traditionnelle est vraie, quand elle identifie l'essentialité de la polarité entre l'élément culturel-spirituel céleste qui est formateur et ordonnateur et l'élément inférieur qui est la donnée naturelle et biologique ordonnée ; Il est, en effet, tellement vrai cette doctrine que, après les intoxications naturalistes de la modernité, les derniers temps reviennent au même d'une manière, toutefois, comme mentionné ci-dessus, sataniquement parodique, juste dans la même idéologie du genre qui est, donc, la dénaturalisation de l'être humain, certes orientée vers l'Esprit mais des Ténèbres et non plus et plus jamais de la Lumière !
Tout ceci étant acquis, la vieille polémique entretenue par certains cercles idéologico-culturels de l'aire présumée catholique, selon laquelle Julius Evola, précisément en vertu de son traditionalisme, aurait dû non seulement consentir au courant de pensée que, par commodité, nous définissons comme le "Droit naturel", mais aurait plutôt dû en faire un usage paradigmatique et référentiel par rapport à la conception moderne du Droit (qui est contractualiste-individualiste, dépourvue de toute légitimation d'en haut et donc éthiquement indéterminée ainsi que finalement neutre) apparaît non seulement et non pas tant fausse, c'est-à-dire non vraie dans la mesure où elle manque de fondements historico-culturels, que subrepticement contradictoire. En effet, une telle "thèse" prétendrait combiner la culture traditionnelle au sens large, sinon la Tradition juridico-religieuse occidentale qu'est la tradition romaine, avec la théorie et l'idéologie du droit naturel dont nous pensons avoir montré qu'elle lui est totalement et radicalement opposée, lui étant aussi étrangère que les quiddités de la même conception bourgeoise et libérale-démocratique de l'État et du droit, c'est-à-dire de l'idéologie de Kelsen du soi-disant État de droit. Tout cela, Evola l'a explicité dans ses œuvres, dans toutes ses œuvres, et il ne reste plus qu'à ceux qui savent et sont capables de tirer des réflexions organiques dans leur propre champ d'investigation, selon l'esprit de la vision traditionnelle du monde, qui est synthétique et symbolique et non analytique et diabolique, de le faire, selon les diverses équations personnelles.
Notes :
[1] J. EVOLA, Rivolta contro il mondo moderno, Rome, 1998, pp. 30 et suivantes ; IDEM, La tradizione ermetica, Rome 1971, p. 31 ; GRUPPO DI UR (édité par J. EVOLA), Introduzione alla magia, Rome 1971, vol. III, p. 66 ; K. HÜBNER, La verità del mito, Milan 1990 ; M. ELIADE, Mito e realtà, Milan 1974.
[2] G. E. R. LLOYD, Polarité et Analogie. Due modi di argomentazione del pensiero greco classico, Napoli 1992 ; C. DIANO, Forma ed evento, Venezia 1993.
[3] J. EVOLA, L'arco e la clava, Milan 1971, pp. 66 et suivantes.
[4] J. EVOLA, Rivolta contro il mondo moderno, Rome, 1969, pp. 19 et suivantes.
[5] M. HEIDEGGER, Segnavia, Milan 1987, pp. 193 et suivantes.
[6] Sur la convergence entre la vision de la nature de toute la sagesse grecque et la doctrine traditionnelle elle-même (voir à ce sujet J. EVOLA, La Tradizione Ermetica, Roma 1971, p. 37), cf. G. REALE, Storia della Filosofia Antica, Milano 1980, vol. I, p. 115, 145, 169 et vol. V, p. 209 et suivantes ; G. R. LLOYD, Magia, ragione, esperienza. Nascita e forme della scienza greca, Turin 1982, pp. 28 et suivantes et p. 187 notes n. 53 et 54 ; L. GERNET, Antropologia della Grecia antica, Mondadori, Milan 1983, pp. 339 et suivantes ; F CAPRA, Il Tao della fisica, Milan 1982, pp. 20 et suivantes ; O. BRUNNER, Vita nobiliare e cultura europea, Bologne 1972, pp. 91 et suivantes ; K. KERENYI, La religione antica nelle sue linee fondamentali, Rome 1951, pp. 95 et suivantes ; A. SOMIGLIANA, Il Tao della fisica, Milan 1982, pp. 20 et suivantes. SOMIGLIANA, Monismo indiano e monismo greco nei frammenti di Eraclito, Padoue 1961, p. 19, note n. 48.
[7) Le mot "matière" doit également être clarifié : les Grecs (PLOTIN, Sur la matière, IV, 9,45 ; PLATON, Timée, 52b2) ne connaissaient pas ce terme moderne et/ou chrétien et le concept relatif, pour eux seul ce qui existe est connaissable et seule la forme, l'être, existe ; la "matière" sans forme n'est pas connaissable et donc n'existe pas ; c'est le sens du fragment de Parménide dans lequel il est dit que "l'être et la pensée sont identiques". En fait, hýle est quelque chose d'autre, dans Aristote, c'est un terme technique qui signifie "un ensemble de bois empilé sans ordre" prêt à être utilisé. Par conséquent, ils ne connaissaient pas le terme sòma = corps en référence à l'être vivant mais seulement en référence au cadavre ou à ceux qui se préparent... à mourir : et l'usage initiatique qu'en fait Platon dans le Phédon est évident..., cf. sur cette question R. DI GIUSEPPE, La teoria della morte nel Fedone platonico, Bologna 1993 ; H. FRANKEL, Poesia e filosofia della Grecia arcaica, Bologna 1997, pp. 33ff ; R. B. ONIANS, Le origini del pensiero europeo, Milano 1998, pp. 119ff ; G. CASALINO, L'origine. Contributi per la filosofia della spiritualità indoeuropea, Genova 2009, pp. 28ff.

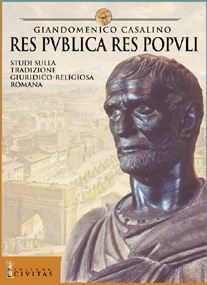
[8] G. CASALINO, Il sacro e il diritto, Lecce, 2000, pp. 45 et suivantes.
[9] R. GASPAROTTI, Movimento e sostanza. Saggio sulla teologia platonico-aristotelica, Milano 1995 ; C. NATALI, Cosmo e divinità. La struttura logica della teologia aristotelica, L'Aquila 1974 ; W. JÄGER, La teologia dei primi pensatori greci, Firenze 1961.
[10] E. CANTARELLA - A. BISCARDI, Profilo del diritto greco antico, Milano 1974.
[11] Sur le caractère cosmique de la royauté de Jupiter, voir P. PHILIPPSON, Origini e forme del Mito greco, Torino, 1983, pp. 45 et suivantes : où, cependant, à la définition de précosmique, en relation avec ce qui "précède" Jupiter, nous préférons le terme hypercosmique, c'est-à-dire Primordial, c'est-à-dire le royaume de Saturne, l'Âge d'or et/ou de l'Être.
[12] PLATON, Des Lois, X, 889 et suivants ; M. GIGANTE, Nòmos basileus, Naples, 1993 ; A. LO SCHIAVO, Themis e la sapienza dell'ordine cosmico, Naples 1997, pp. 270 et suivantes ; G. ZANETTI, La nozione di giustizia in Aristotele, Bologne 1993, pp. 45 et suivantes.
[13] G. CASALINO, Il sacro e il diritto, cit. pp. 45 et suivantes.
[14] K. KOCK, Giove romano, Roma 1986.
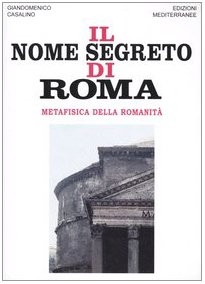
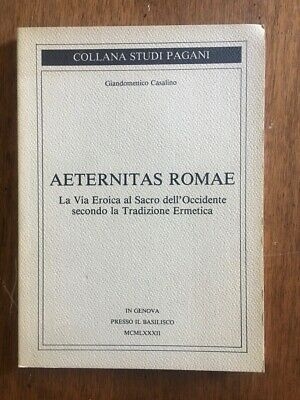
[15] G. CASALINO, Aeternitas Romae. La via eroica al sacro dell'Occidente, Genova 1982; IDEM., Il nome segreto di Roma. Metafisica della romanità, Rome 2013 ; cf. également C. G. JUNG-K. KERENYI, Prolegomeni allo studio scientifico della mitologia, Turin 1972, p. 40 et suivantes.
[16) Le processus commence par une analogie horizontale, puis s'élève par une anagogie verticale : "[...] On voit donc que toute herméneutique implique l'interprétation de "niveaux" distincts des Textes sacrés, qui s'élèvent les uns par rapport aux autres dans ce mouvement ascendant d'"anaphore", proprement symbolique, sur lequel j'ai insisté précédemment. En d'autres termes, le processus métaphysique dans son ensemble pourrait être représenté par une expansion "horizontale" de l'analogie, et le processus anaphorique par une orientation "verticale" vers le Signifiant lui-même. Issue du Verbe, la parole retourne à Lui, et ce retour du fleuve à sa source correspond à une "ascension" qui découvre de nouveaux horizons, toujours plus larges et plus profonds, pour l'Esprit qui les contemple, se reconnaissant en eux comme il dévoile chacun de ses miroirs [...], R. ALLEAU, La Scienza dei Simboli, Florence 1983, p. 113.
[17] J. EVOLA, Révolte contre le monde moderne, cité, p. 53-54.
[18] G. CASALINO, Riflessioni sulla dottrina esoterica del diritto arcaico romano, in "Arthos" n. 19, Genova 1982, pp. 255 et suivantes.

[19] A. BERGAIGNE, La religion vedique, Paris 1883, vol. III, p. 220 et 239. La racine "weid" contient la notion indo-européenne de "voir-savoir" : cf. P. SCARDIGLI, Filologia germanica, Firenze 1977, pp. 96 et suivantes ; Id est l'une des racines (les autres sont : maintenant "op") du verbe grec "orào" qui signifie voir ; en latin, il s'agit de vidéo, tandis que le sens ésotérique des livres sacrés tels que l'Edda ou le Veda est clair : les Livres de la Vision ou, plus simplement, la Vision ...
[20] Y. THOMAS, J CHIFFOLEAU, L'istituzione della natura, Macerata 2020, pp. 16 et suivantes.
[21] "[...] La loi naturelle est celle que la nature a enseignée à tous les êtres animés (animalia) ; et en effet, cette loi n'est pas propre à l'espèce humaine, mais elle est commune à tous les êtres animés nés sur terre et sur mer, et même aux oiseaux. D'ici descend l'union du mâle et de la femelle, que nous appelons mariage, d'ici la procréation et l'éducation des enfants ; et en fait, nous voyons que les autres animaux, même les sauvages, se voient attribuer la pratique de ce droit...".
[22] G. FASSÒ, Storia della filosofia del diritto, Bologna 1970, vol. I, pp. 151 et suivantes.
[23] M. VILLEY, Leçon d'histoire de la philosophie du droit, Paris 1962, p. 221 et suivantes; A. TOURAIN, Critique du modernisme, Bologne 1970, vol. TOURAIN, Critique de la modernité, Milan 1997, p. 49 et suivantes.
[24] AGOSTINO, De Civitate Dei, XV, 5 ; II, 21 ; CELSO, Il discorso vero, Milano 1987 ; L. ROUGIER, La sovversione cristiana e la reazione pagana sotto l'impero romano, Roma s. i. d. ; W... NESTLE, Storia della religiosità greca, Firenze 1973 ; en particulier pp. 464ss. ; W. F..OTTO, Spirito classico e mondo cristiano, Firenze 1973 ; SALUSTIO, Sugli Dei e il Mondo, Milano 2000.
[25] G. CASALINO, Il nome segreto di Roma. Metafisica della romanità, cit. ; IDEM, Il sacro e il diritto, cit. ; IDEM, Res publica res populi, Forlì 2004 ; IDEM, Tradizione classica ed era economistica, Lecce 2006 ; IDEM, Le radici spirituali dell'Europa. Romanità ed ellenicità, Lecce 2007 ; IDEM, L'origine... cit. ; IDEM, L'essenza della romanità, Genova 2014 ; IDEM, La spiritualità indoeuropea di Roma e il Mediterraneo, Roma 2016 ; IDEM, Sigillum scientiae, Taranto 2017.
[26] Sur la nature magico-religieuse du droit romain, cf. en outre nos Riflessioni sulla dottrina..., cit. ; H. WAGENVOORT, Roman Dynamism, Oxford 1947 ; W. CESARINI SFORZA, Diritto, Religione e magia, in "Idee e problemi di filosofia giuridica", Milan 1956, p. 313ss ; R. SANTORO, Potere ed azione nell'antico diritto romano, in "Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo", vol. XXX, Palerme 1967 : dans lequel le point de vue de WAGENVOORT est développé et confirmé avec autorité à partir de la legis actio... ; P. HUVELIN, Magie et droit individuel, dans "Annèe Sociologique", 10, 1907 et Les tablettes magiques et le droit romain, dans "Etudes d'Historie du droit romain", 1900, pp. 229 ss ; A. HAGERSTRÒM, Das Kommunikation et le droit romain, 1900, pp. 229 ss ; A. HAGERSTRÒM, Das Kommunikation et le droit individuel, dans "Annèe Sociologique", 10, 1907. HAGERSTRÒM, Das magistratische Ius in seinem Zusammenbange mit d. rom. Sakralrechte, Upsala 1929 (où il est explicitement indiqué que la forma mentis juridique romaine est essentiellement magique, comme nous l'avons nous-mêmes soutenu ailleurs sur la base des hypothèses traditionnelles). Et enfin, voir ce monument de connaissance et d'intuition qu'est Primordia Civitatis de P. DE FRANCISCI, Rome 1959, en particulier les pp. 199-406. L'ouvrage de l'éminent romaniste se laisse toutefois aller à des confusions "animistes" concernant la définition du Numen. Pour une distinction avec les interprétations animistes, voir J. BAYET, La religione romana storia politica e psicologica, Turin 1959, p. 45 et suivantes et 119 et suivantes. Toutefois, sur Numen à Rome, voir J. EVOLA, Diorama filosofico, Rome 1974, p. 67 et suivantes, et P. PFISTER, voce : Numen, dans PAULY et WISSOWA, Real Encycl., vol. XVII, 2 coli. 1273 ff., Stuttgart 1893 ff. Voir aussi F. DE COULANGES, La città antica, Florence 1972 : où l'on considère que tout le droit public et privé est fondé sur la religion; P. VOCI, Diritto sacro romano in età arcaica, in "Studia et Documenta Historiae et Iuris", vol. XIX, 1953, p. 39 et suivantes, en particulier la note n° 22 à la p. 43. Enfin, sur la source "charismatique" = de l'autorité supérieure, voir P. DE FRANCISCI, Arcana Imperii, Rome 1970, vol. III (en deux tomes).
[27] H. HÄGERSTRÖM, Das magistratische Ius in seinem Zusammenhange mit d. rom. Sacralrechte, cit.
[28] P. CATALANO, Contributi allo studio del diritto augurale, vol. I, Turin 1960.
[29] J. SCHEID, La religione a Roma, Bari 1983.
[30] ZECCHINI, Il pensiero politico romano, Roma 1996.
[31] D. SABBATUCCI, Lo Stato come conquista culturale, Rome 1975.
[32] G. CASALINO, Il sacro e il diritto, cit. pp. 75 et suivantes.
[33] J. SCHEID, Quando fare è credere, Bari 2011.
[34] J. J. BACHOFEN, Diritto e storia, scritti sul matriarcato, l'antichità e l'Ottocento, Venise 1990, pp. 44 et suivantes ; IDEM, Le madri e la virilità olimpica. Studi sulla storia segreta dell'antico mondo mediterraneo, Roma s. d.
[35] V. MACCHIORO, Orphisme et Paulinisme, Foggia 1982.
[36] G. ZECCHINI, op. cit. p. 14.
[37] G. SERMONTI, L'anima scientifica, Rome 1982, pp. 42-43 ; R. FONDI, Organicismo ed evoluzionismo, Rome 1984.
Giandomenico Casalino
18:14 Publié dans Droit / Constitutions, Philosophie, Théorie politique, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : droit, droit romain, droit naturel, rome, rome antique, antiquité romaine, philosophie, philosophie du droit, théorie politique, politologie, sciences politiques, tradition, traditions, traditionalisme, julius evola |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 01 avril 2022
Mythe, utopie, & réalisme pluriversel

Mythe, utopie, & réalisme pluriversel
Leonid Savin (2013)
Source: https://www.geopolitica.ru/en/article/myth-utopia-pluriversal-realism
Georges Sorel divisait les formations sociales et politiques en deux types : (1) celles qui avaient un mythe comme base de leur idéologie, et (2) celles qui faisaient appel à des idées utopiques. La première catégorie, il l'attribue au socialisme révolutionnaire, où les véritables mythes révolutionnaires ne sont pas des descriptions de phénomènes, mais l'expression de la volonté humaine. La deuxième catégorie est celle des projets utopiques, qu'il attribue à la société bourgeoise et au capitalisme.
Contrairement au mythe, avec ses attitudes irrationnelles, l'utopie est le produit du travail mental. Selon Sorel, elle est l'œuvre de théoriciens qui tentent de créer un modèle avec lequel critiquer la société existante et mesurer le bien et le mal en son sein. L'utopie est un ensemble d'institutions imaginaires, mais elle offre également de nombreuses analogies claires avec des institutions réelles.
Les mythes nous poussent à nous battre, alors que l'utopie vise à réformer. Ce n'est pas un hasard si certains utopistes, après avoir acquis une expérience politique, deviennent souvent d'habiles hommes d'État.
Le mythe ne peut être réfuté, car il est tenu de concert comme une croyance de la communauté et est donc irréductible. Les utopies, en revanche, peuvent être examinées et rejetées.
Comme nous le savons, les diverses formes de socialisme, tant à gauche qu'à droite de l'échiquier politique, ont en fait été construites sur des mythes, comme en témoignent aisément les ouvrages de leurs défenseurs. Il suffit de rappeler le Mythe du 20e siècle d'Alfred Rosenberg, qui s'est fait l'apologiste du national-socialisme allemand.
À l'autre extrémité du socialisme, nous constatons également une base mythologique, bien qu'elle soit analysée post-facto. Même si Marx disait que le prolétariat n'a pas besoin de mythes, qui sont détruits par le capitalisme, Igor Shafarevich a démontré de manière concluante le lien entre les attentes eschatologiques du christianisme primitif et le socialisme. La théologie de la libération en Amérique latine confirme également la forte présence du mythe à l'œuvre au sein du socialisme de gauche du 21e siècle

Si nous parlons en termes de deuxième et troisième théories politiques qui ont lutté contre le libéralisme, il est pertinent de rappeler la remarque de Friedrich von Hayek qui, dans son ouvrage La route de la servitude, note que, "en février 1941, Hitler a jugé bon de dire dans un discours public que le national-socialisme et le marxisme sont fondamentalement la même chose".
Bien entendu, cela ne diminue pas l'importance du mythe politique moderne et explique également la haine qu'en ont les représentants du libéralisme moderne. Ainsi, les alternatives politiques - que ce soit la Nouvelle Droite, l'indigénisme ou l'eurasisme - représenteraient une nouvelle menace totalitaire pour les néolibéraux. Les libéraux, qu'ils soient classiques ou néo-libéraux, nous refusent nos idéaux, car ils pensent qu'ils ont un caractère largement mythologique et ne peuvent donc pas être traduits dans la réalité.
Revenons maintenant à l'utopie. L'économie politique libérale, comme le note à juste titre Sorel, est elle-même l'un des meilleurs exemples de pensée utopique. Toutes les relations humaines sont réduites à la forme de l'échange sur le marché libre. Ce réductionnisme économique est présenté par les utopistes libéraux comme une panacée aux conflits, aux malentendus et à toutes sortes de distorsions qui surgissent dans les sociétés.
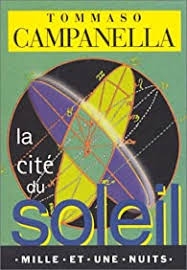 La doctrine de l'utopisme a émergé des œuvres de Tommaso Campanella, Francis Bacon, Thomas More et Jonathan Swift, ainsi que de philosophes-libéraux comme le chef de file des radicaux britanniques Jeremy Bentham. L'incarnation de l'utopie a d'abord été érigée sur une politique réglementaire rigide, qui incluait en même temps la violence comme forme de coercition sur ses citoyens. Elle est ensuite passée à l'expansion coloniale, qui a permis l'accumulation de capitaux et l'établissement d'une seule et même "norme civilisée" pour les autres pays. Puis l'utopie libérale est allée encore plus loin, devenant, selon les termes de Bertram Gross, un "fascisme amical", dans la mesure où elle a commencé à institutionnaliser la domination et l'hégémonie par le biais d'un régime de lois et de règlements internationaux. À ce moment-là, l'utopie libérale est elle-même devenue un mythe moderne : technocentrique, rationnelle et totalitaire - démasquant la première idée utopique d'une société juste et la remplaçant par le matérialisme et la loi utilitaire, devenant, en fait, une dystopie.
La doctrine de l'utopisme a émergé des œuvres de Tommaso Campanella, Francis Bacon, Thomas More et Jonathan Swift, ainsi que de philosophes-libéraux comme le chef de file des radicaux britanniques Jeremy Bentham. L'incarnation de l'utopie a d'abord été érigée sur une politique réglementaire rigide, qui incluait en même temps la violence comme forme de coercition sur ses citoyens. Elle est ensuite passée à l'expansion coloniale, qui a permis l'accumulation de capitaux et l'établissement d'une seule et même "norme civilisée" pour les autres pays. Puis l'utopie libérale est allée encore plus loin, devenant, selon les termes de Bertram Gross, un "fascisme amical", dans la mesure où elle a commencé à institutionnaliser la domination et l'hégémonie par le biais d'un régime de lois et de règlements internationaux. À ce moment-là, l'utopie libérale est elle-même devenue un mythe moderne : technocentrique, rationnelle et totalitaire - démasquant la première idée utopique d'une société juste et la remplaçant par le matérialisme et la loi utilitaire, devenant, en fait, une dystopie.
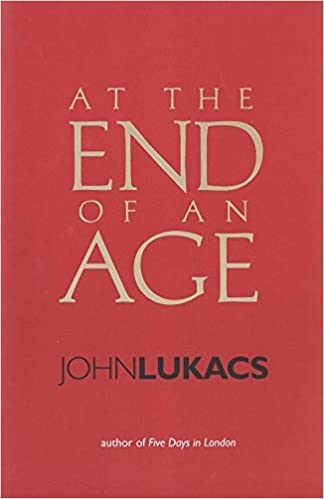 Dans le cas des deux sociétés centrées sur le mythe, et des utopies, mises en œuvre de manière cohérente par des expériences de droit, d'économie, de philosophie et de politique, une erreur majeure a été commise en essayant d'étendre le modèle à l'échelle mondiale. Le fascisme et le marxisme sont tombés en premier historiquement. Cependant, le libéralisme est désormais lui aussi remis en question, comme l'a noté avec prescience il y a une vingtaine d'années John Lukacs dans son ouvrage La fin du 20e siècle et la fin de l'ère moderne.
Dans le cas des deux sociétés centrées sur le mythe, et des utopies, mises en œuvre de manière cohérente par des expériences de droit, d'économie, de philosophie et de politique, une erreur majeure a été commise en essayant d'étendre le modèle à l'échelle mondiale. Le fascisme et le marxisme sont tombés en premier historiquement. Cependant, le libéralisme est désormais lui aussi remis en question, comme l'a noté avec prescience il y a une vingtaine d'années John Lukacs dans son ouvrage La fin du 20e siècle et la fin de l'ère moderne.
Le mythe et l'utopie ont tous deux tiré leur force du monde pluriversel, l'homogénéisant et détruisant sa richesse de cultures et de visions du monde. Le pluriversum était la base sur laquelle se formait la superstructure de l'utopie. C'est également là que certaines forces modernes visant à mettre en œuvre des projets historiques violents ont puisé dans les couches mythologiques profondes.
Dans la réalité pluriverselle, il y a de l'espace pour le mythe et l'utopie, s'ils sont limités à un certain espace avec des caractéristiques civilisationnelles uniques et séparés les uns des autres par des frontières géographiques. Le mythe peut être réalisé sous la forme d'une théocratie ou d'un empire futurologique. L'utopie pourrait en même temps tendre vers une technopole biopolitique ou un melting pot des nations, mais bien sûr séparément des ordres centrés sur le mythe.
Carl Schmitt a suggéré la construction et la reconnaissance de tels "Grands Espaces Politiques" autonomes ou Grossräume. La formation de ces espaces nécessiterait un programme mondial de pluriversalisme, faisant appel aux mythes distinctifs et aux fondements culturels des différents peuples. Mais toutes les parties à un ordre pluriversel doivent avoir une chose en commun comme condition préalable : la déconstruction de la superstructure de l'utopie néolibérale naissante.
17:59 Publié dans Actualité, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : utopie, mythe, pluriversum, pluversalité, leonid savin, réalisme pluriversel, réalisme, philosophie, philosophie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 31 mars 2022
Le Marx de Costanzo Preve

Le Marx de Costanzo Preve
Daniele Perra
Source: https://www.lintellettualedissidente.it/controcultura/filosofia/il-marx-di-costanzo-preve/
Costanzo Preve est souvent cité à mauvais escient par les présentateurs de télévision et les conférenciers de toutes sortes. Un texte récemment publié (Karl Marx. Un'interprétazione) nous permet de redécouvrir la pensée non seulement d'un interprète de Marx, mais aussi du dernier véritable philosophe italien.
Costanzo Preve n'était pas seulement un analyste politique et géopolitique lucide. Avant même d'être philosophe, il était un érudit de la pensée et des idées en tant que "natures vivantes", dans la conscience précise que la philosophie est le seul motif rationnel possible pour penser et pratiquer une réunification communautaire de la société.
Costanzo Preve était un penseur communautaire. Cette déclaration simple et claire explique à elle seule la raison de l'ostracisme académique qu'il a dû subir de son vivant. Le communautarisme est jugé démodé, il serait anti-moderne et, à ce titre, est détesté par la classe dite "semi-cultivée", qui déteste le peuple (posé comme "lourd et ennuyeux") et aime tout ce qui est "exotique" et, par suite, inoffensif pour le système dont elle se nourrit.

Costanzo Preve et son disciple Diego Fusaro
Il n'y a pas de meilleure façon d'aborder la pensée de Costanzo Preve que de partir de son interprétation de la science philosophique de Karl Marx, qu'il a analysée et étudiée toute sa vie, par opposition à la "formation idéologique" marxiste. Selon Preve, la pensée de Marx (ainsi que celle de Hegel, son principal point de référence philosophique) a été mal comprise et mal interprétée à plusieurs reprises, au point de la déformer complètement et d'en faire quelque chose de tout à fait différent de ce que le penseur de Trèves avait prévu.
L'objectif de Preve, en ce sens, était de renverser le lieu commun qui considère Marx comme le fondateur du marxisme - un mélange de pseudo-science et de semi-religion - qui, au contraire, n'est que le produit d'une époque où la science était considérée comme une sorte de religion civile. Ce contresens vient du fait que Marx, contrairement à la croyance populaire, avant d'être un bâtisseur de projets d'avenir plus ou moins utopiques, était un critique et, pour être précis, un critique de l'économie politique et de l'utilitarisme qui a fondé sa pensée sur le doute le plus hyperbolique de tous : celui qui porte sur la naturalité présumée de la propriété privée.

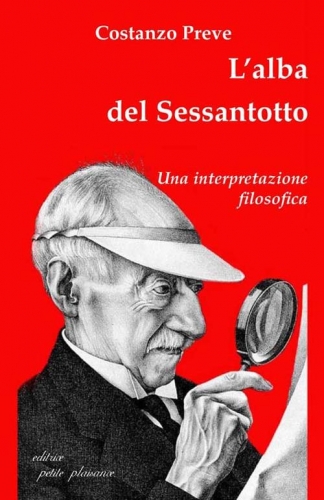
L'originalité de la pensée marxienne réside dans le fait que Marx insère, au sein de cette critique scientifique, un concept absolument philosophique : celui d'aliénation, qu'il hérite directement de Hegel. Pour cette raison, Preve considère que Marx est la meilleure clé pour comprendre Hegel et, accessoirement, même Aristote. Marx et Hegel, en effet, ont en commun l'objet (la totalité ontologique de la société humaine) et la méthode (la dialectique) de leur cheminement philosophique. Dans cas, la méthode (composée de μετα - en direction de, à la recherche de - et ὁδός - voie, chemin) est à comprendre au sens " initial " du terme, bien souligné à plusieurs reprises par Martin Heidegger : c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de la "procédure d'investigation" mais de l'investigation elle-même. La deuxième source de la pensée marxienne est en fait Aristote.
Or, Aristote représente déjà un écart par rapport à la pensée grecque primitive (Parménide et Héraclite, par exemple). Cependant, sa pensée, centrée sur le rejet de l'illimité (ἄπειρον) et l'éloge de la mesure (μέτρον), est encore loin de l'individualisme possessif de la modernité. Ce que Marx essaie de démontrer à travers Aristote (et aussi Epicure), c'est que justifier l'accumulation capitaliste comme quelque chose d'inhérent à l'homme est une idée abstraite et absolument ahistorique. L'économie (au sens grec) a en fait pour objectif la "bonne vie" et non l'accumulation effervescente et illimitée, qui, à l'époque de Marx, était déjà devenue la seule "économie légitime".
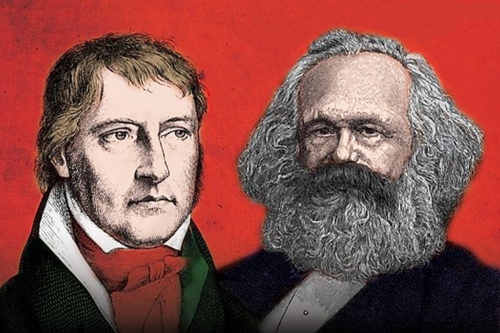
Hegel et Marx
Ce concept bouleverse un autre lieu commun sur le monde grec (également adopté par Nietzsche et pour cette raison largement stigmatisé par Heidegger) : celui selon lequel le tissu social de la Grèce antique était polarisé entre quelques riches et de nombreux esclaves misérables. Contrairement à la croyance populaire, en fait, ce système - basé essentiellement sur une formation économique et sociale de petits producteurs indépendants - ne pouvait en aucun cas être défini comme esclavagiste. Il était simplement "communautaire" dans son essence la plus profonde. Et c'est précisément à partir du monde grec que Marx commence à interpréter l'histoire comme un conflit/une lutte entre la mesure et l'illimité. Cette interprétation, médiatisée par le concept hégélien du "système des besoins", repose sur l'idée que le besoin lui-même n'est jamais illimité par nature.
Cependant, il existe également une séparation claire entre Hegel (et Marx) et la Grèce classique. Cela est donné par une évolution de la pensée qui a conduit au passage de l'idéalisme bimondain platonicien à l'idéalisme monomondain, qui a en quelque sorte servi de prélude au développement de la pensée matérialiste. En d'autres termes, une séparation claire et irréversible entre le ciel du divin et le monde des hommes, due à la "disparition" moderne de l'inter-monde dans lequel ils se rencontraient. Cette séparation a conduit à la négation même des réalités supraterrestres.
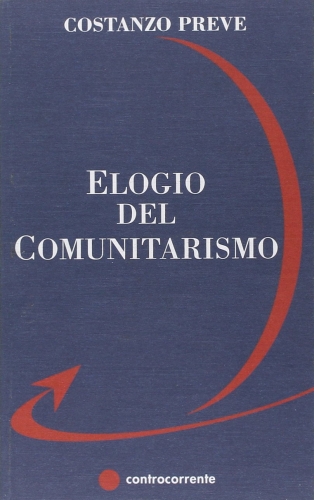
Le lien Hegel-Marx est crucial dans l'analyse de Preve, car il explique le matérialisme marxien à la lumière de l'idéalisme hégélien. Preve, de manière provocante, fait de Marx le dernier grand idéaliste. Un idéaliste qui utilise le matérialisme comme une "intégration métaphorique" qui "exploite" la matière pour indiquer trois attitudes distinctes : l'athéisme, la praxis et le structuralisme comme la prédominance de la structure sur la superstructure. Ce marxisme hégélien, selon Preve, est la seule voie à suivre et s'oppose aux deux autres "positions marxistes" : la position kantienne, comprise comme la possibilité transcendantale d'une seule morale universelle même en présence d'énormes lacérations sociales, largement répandue dans le monde intellectuel et académique, et la position positiviste qui transforme le marxisme en une science moderne, en le fondant comme tel sur une présumée infaillibilité calculatrice.
Preve, comme Marx, était aussi et surtout un critique : un critique à la fois de Marx lui-même et du marxisme en tant qu'"idéologie". Sa critique de Marx repose sur le soulignement ("au crayon rouge", dirait Preve) de certaines de ses erreurs macroscopiques. L'une des plus évidentes est celle de l'analogie historique. Marx pensait que le passage du féodalisme au capitalisme se répéterait avec le passage du capitalisme au communisme. Cependant - tout le monde peut en témoigner aujourd'hui - malgré la catastrophe environnementale et anthropologique, le capitalisme s'est montré parfaitement capable de résister, de se renouveler et même de se fortifier à travers ses cycles périodiques de crise, comme l'a brillamment souligné le chercheur Gianfranco La Grassa.

"Karl Marx. Un'Interpretazione" par Costanzo Preve, Novaeuropa, 2018.
La deuxième critique principale que Preve adresse à Marx est celle liée à la théorie controversée de l'extinction de l'État. Une théorie qui donne un afflatus utopique (un "souffle" utopique) à une pensée que Preve considère comme n'étant globalement pas utopique, puisque le communisme marxien lui-même est pensé comme un développement de la substantialité déjà présente dans le capitalisme. Que cette "prédiction" soit correcte ou non est une autre question. Ce qui importe ici, c'est le fait que la pensée marxienne n'est pas utopique mais, au contraire, représente la "fin de l'utopie".
En ce sens, la révolution prend un sens différent de celui que Marx lui-même lui attribue. Il ne s'agit pas de la locomotive marxienne de l'histoire mais, comme le dit Walter Benjamin, de l'utilisation du frein de secours par le peuple. Ainsi, la révolution bolchevique, à comprendre principalement comme une "révolution contre le capital", est un acte hérétique qui renverse les hypothèses idéologiques du marxisme lui-même. Lénine configure la révolution comme un acte qui commence par les maillons faibles de la chaîne impérialiste mondiale et cherche à s'étendre aux niveaux supérieurs. Staline n'éteint pas l'État mais le renforce et, comme l'affirme Preve lui-même, met en place le seul système viable dans lequel les classes inférieures (paysans et ouvriers) imposent leur hégémonie aux classes supérieures.
La révolution s'impose donc comme une "restauration" de la primauté du politique sur l'économique. C'est la politique qui s'oppose au cannibalisme de l'absolutisme capitaliste. Hegel, disait Carl Schmitt au début des années 1920, avait quitté Berlin pour Moscou. Et cette révolution, en raison des tendances innées du peuple russe, a inévitablement pris des connotations religieuses-messianiques.
Cependant, le collectivisme soviétique n'a pas pu répondre au problème inhérent à la catégorie philosophique que Marx a placée au cœur de sa critique économique : cette aliénation que Marx lui-même, comme le note brillamment Preve, a vécue de la même manière que Heidegger, à savoir comme le "sans-abrisme" de l'homme. Dans le collectivisme, l'homme reste un homme déraciné. Le travail ne retrouve pas le sens pré-moderne d'une activité humaine directement liée à une profession spécifique. Le travailleur, bien que théoriquement propriétaire des moyens de production, reste mécaniquement séparé du produit de son travail, et la temporalité elle-même est "schématisée" sur la base de l'idée que l'on peut intervenir dans le futur.
Un tel système, ayant abandonné le moment politique de l'acte révolutionnaire, est retombé dans le simple économisme, dans la stagnation des forces productives et idéologiques. L'idéologie, qui était une représentation unitaire expressive du monde, s'est transformée en une représentation unitaire expressive falsifiée du monde. Et le système soviétique, s'effondrant en raison du développement d'une classe moyenne tendanciellement contre-révolutionnaire, dont Gorbatchev était la plus haute expression, s'est transformé en une proie facile pour le système le plus idéologique et le plus totalisant de l'histoire mondiale : le capitalisme libéral occidental.
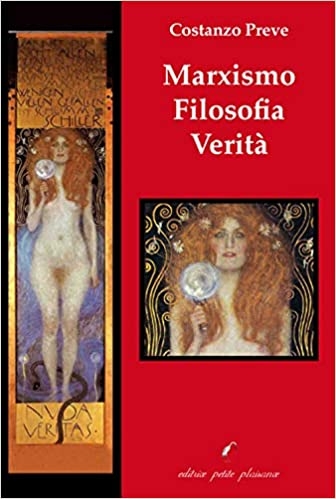
Face à l'échec du socialisme réel et au triomphe du capitalisme absolu, le potentiel critique de la théorie marxienne a été "gelé". Costanzo Preve a reconnu la nécessité de refonder cette pensée sur la base, en premier lieu, de la perception du monde des classes subalternes. Il était bien conscient que cela n'arriverait pas de sitôt, et il pressentait que cette "refondation" devrait inévitablement passer par un "pouvoir du négatif" qu'il identifiait dans l'appauvrissement progressif de couches toujours plus larges de la classe moyenne dans les pays capitalistes avancés. Cependant, il était également conscient que la première étape pour sortir de cette impasse était d'identifier correctement qui était le véritable ennemi. Ainsi, faisant une concession à la géopolitique, à laquelle il s'est consacré pendant les dernières années de sa vie, Preve l'identifie dans l'empire mondial nord-américain et dans cette élite semi-cultivée qui occupe littéralement la culture, jouant le rôle bien rémunéré de chien de garde du pouvoir.
16:08 Publié dans Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : costanzo preve, karl marx, marxisme, hegel, hegelianisme, philosophie, philosophie politique, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 28 mars 2022
Les vertus de la droite antilibérale
Michael Millerman:
Les vertus de la droite antilibérale
Source: https://novaresistencia.org/2022/03/23/as-virtudes-da-direita-antiliberal/
La droite antilibérale est historiquement marquée par un profond refus des modèles libéraux et communistes du 20e siècle, tandis que sa révolte s'enracinait dans quelque chose de plus vaste que le racisme, le chauvinisme, le nihilisme et la destruction dont ses précurseurs et ses adeptes auraient continuellement été marqués, même à tort. Michael Millerman nous accompagne à la manière d'un dialogue dans une réflexion sur les origines et les possibilités de ce courant de pensée. De Platon à Carl Schmitt et Leo Strauss.
Lorsque nous réfléchissons à l'horizon intellectuel contemporain, sur le problème du libéralisme et de ses alternatives, il est important de ne pas ignorer le phénomène de l'anti-libéralisme de droite. Néanmoins, le phénomène n'est pas aussi bien compris qu'il devrait l'être. Les raisons historiques de cette situation ne sont pas difficiles à comprendre et ne nécessitent pas d'élaboration. Mais la question reste de savoir si quelque chose d'important a été perdu lorsque le discrédit de l'histoire politique a frappé les alternatives de droite au libéralisme. L'incapacité à comprendre les variétés et les méthodes théoriques de la droite antilibérale rend difficile d'aborder correctement son retour, si du moins il y en aura un. Les critiques historiquement justifiées des vices de cette droite nous ont peut-être rendus aveugles à ses vertus. Mais nous ne parviendrons à rien en errant aveuglément tout en soulevant une question de cette importance.
 Il n'est pas possible d'établir une liste des trois, quatre ou cinq plus grands anti-libéraux de droite, avec beaucoup de certitude, sans citer Carl Schmitt. Au nom de la distinction ami-ennemi et de la possibilité réelle de la mort physique de l'ennemi dans la guerre, le concept schmittien du Politique polémique contre le libéralisme avec une clarté conceptuelle et une réserve létale inégalées. Schmitt, le juriste dit "nazi", nous rappelle comme nul autre, en si peu d'espace et de manière si efficace, que la dépolitisation, la neutralisation et l'évasion des responsabilités souveraines ne représentent pas une voie sûre et sérieuse pour le peuple.
Il n'est pas possible d'établir une liste des trois, quatre ou cinq plus grands anti-libéraux de droite, avec beaucoup de certitude, sans citer Carl Schmitt. Au nom de la distinction ami-ennemi et de la possibilité réelle de la mort physique de l'ennemi dans la guerre, le concept schmittien du Politique polémique contre le libéralisme avec une clarté conceptuelle et une réserve létale inégalées. Schmitt, le juriste dit "nazi", nous rappelle comme nul autre, en si peu d'espace et de manière si efficace, que la dépolitisation, la neutralisation et l'évasion des responsabilités souveraines ne représentent pas une voie sûre et sérieuse pour le peuple.
Malgré cela et même de manière surprenante, dans ses notes sur le livre de Schmitt, le plus modéré Leo Strauss affirme que Schmitt n'a jamais trouvé d'horizon au-delà du libéralisme. Pour Strauss, la position de Schmitt est celle d'un libéralisme à polarité inversée. Alors que le libéralisme tolère toute forme de vie tant qu'elle est pacifique, Schmitt tolère toute forme de vie tant qu'elle est dangereuse. Tous deux sont neutres en termes de contenu et se reflètent mutuellement dans un formalisme vide. De plus, Schmitt revient sur l'état de sauvagerie de l'homme, point de départ de la pacification pour Hobbes. Ainsi, Schmitt ne va pas au-delà de Hobbes, le fondateur du libéralisme.

Schmitt prétend que Strauss l'a vu, lui, comme à travers une radiographie. Ainsi, nous avons l'autorité de Schmitt lui-même pour affirmer que l'interprétation de Strauss a du mérite et mérite donc l'attention. Pour Strauss, la première cause de désaccord entre les hommes concerne la dispute sur la bonne façon de vivre. Un homme qui ne se pose plus de questions sur ce qui est juste n'est plus un homme. "Mais si nous nous demandons sérieusement ce qui est juste, la dispute est engagée... la dispute de la vie et de la mort : la politique - le groupement des amis et des ennemis - doit sa légitimité au sérieux de la question sur ce qui est juste". Il ne s'agit pas d'un formalisme vide, mais d'une question de fond de la plus haute importance : qu'est-ce qui définit le domaine politique ? Nous ne pouvons toutefois pas nous demander ce qui est juste ou bon sans comprendre comment la tradition de la philosophie politique a influencé la manière dont nous formulons cette question et y répondons. La vie a besoin d'une histoire de la philosophie politique. Pour réitérer ce point surprenant, en partant du principe d'or de la droite antilibérale - le concept schmittien du politique - nous nous retrouvons rapidement sur un chemin qui commence non pas par l'inimitié et le risque, mais par la question du bien, de son origine et de sa tradition, chez Platon et Aristote (et dans la Bible).
Mais nous allons trop vite. Laissez-nous ralentir. Il est possible de dire que pour Schmitt, ou plus globalement pour une certaine forme de droite antilibérale, ce qui compte, c'est la volonté de risquer sa vie dans la bataille contre l'ennemi. Ce qui compte, c'est le courage. Pourquoi le courage serait-il la première vertu ? Strauss argumente comme suit. L'idéal bourgeois est une vie sans risque : nous sommes motivés pour éviter la mort violente et rechercher une auto-préservation toujours plus confortable. La manière la plus directe de rejeter l'idéal bourgeois est d'embrasser une vie risquée, d'être ouvert à la mort et de s'exposer à un sacrifice non utilitaire. Ce point est clair. Quel est le problème ?
 Le problème de la place du courage en tant que vertu dans l'ordre des affaires humaines ne commence pas avec Schmitt et ses disciples. C'est un vieux problème. Vous le trouvez chez Platon. En fait, le début des Lois de Platon est la meilleure façon d'aborder la martialité comme une vertu primaire de l'homme.
Le problème de la place du courage en tant que vertu dans l'ordre des affaires humaines ne commence pas avec Schmitt et ses disciples. C'est un vieux problème. Vous le trouvez chez Platon. En fait, le début des Lois de Platon est la meilleure façon d'aborder la martialité comme une vertu primaire de l'homme.
Les Lois raconte l'histoire d'un vieil homme d'Athènes qui se rend en Crète pour parler de la loi avec un vieux Crétois et un vieux Spartiate. La première question du dialogue est de savoir qui a accordé les lois, un dieu ou un homme ? Au demeurant, cette question rend déjà le dialogue indispensable pour un problème théologico-politique et pas seulement pour le statut du courage. Ils répondent en disant que, pour répondre justement, leurs lois étaient divines. L'étranger athénien demande alors : Dans quel but votre législateur légifère-t-il ? Dans notre cas, nous serions familiers avec une loi visant la vie, la liberté et le bonheur, l'ordre et le bon gouvernement, quelque chose comme ça. Les interlocuteurs du dialogue répondent que leurs législateurs légifèrent pour la victoire dans la guerre ; toutes les villes sont en guerre les unes contre les autres. L'étranger athénien, qui s'interroge comme Socrate, demande si les individus aussi sont en guerre permanente les uns avec les autres, et s'ils sont en guerre avec eux-mêmes. Oui, ils disent. Lorsque nous célébrons la victoire à la guerre, demande-t-il, ne célébrons-nous pas la victoire du bien contre le mal ? Après tout, nous ne célébrerions pas la victoire du mal contre le bien, n'est-ce pas ? Correct. Ainsi, l'objectif de la victoire à la guerre a une certaine orientation sur la question du bien et du mal, et il n'est pas possible que le dieu, qui est sage, veuille que nous pensions uniquement à la victoire et non à l'autre question. Ils sont d'accord.
Si nous sommes attentifs, nous nous apercevons bien vite que l'étranger athénien fait prudemment la leçon pour amener ses interlocuteurs à une réforme du code des lois. Mais pour notre propos, nous devons souligner que Platon montre qu'il comprend correctement, indépendamment des références aux dieux, que le courage n'est pas nécessairement le signe d'une excellence humaine, et qu'il n'est pas vrai qu'il soit la plus grande vertu politique. Il est facile de percevoir dans les textes de Platon le rejet de l'idéal bourgeois, comme nous le rejetons aussi en nous dirigeant spontanément dans cette direction. Cependant, sous le large spectre des vertus que cherche à incarner et à promouvoir la droite antilibérale, nous devons reconnaître que l'argument de Platon, qui remet également l'idéal bourgeois à sa place dans la hiérarchie des signes de l'excellence humaine.
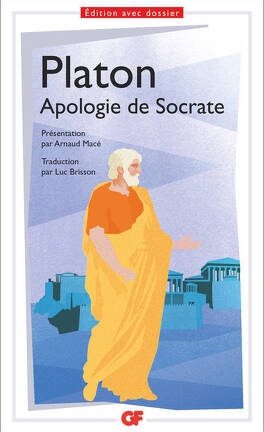 Encore une fois, nous allons trop vite. Il est relativement facile de passer de la droite anti-libérale à Platon. Si c'était une démarche aussi évidente, nous verrions davantage de platoniciens parmi les "déplorables" plus âgés ou les sous-groupes plus radicaux. Mais il est plus facile d'y voir Nietzsche, Schmitt et d'autres grands penseurs de la révolution traditionaliste et conservatrice. Dans les oeuvres de ces penseurs, il existe des obstacles qui empêchent un simple retour à Platon. Prenons l'exemple le plus évident. Nietzsche critique le platonisme avec une certaine habileté, jusqu'à un certain point. Heidegger, aussi. Le platonisme ressemble à quelque chose de désuet et de réfuté. Socrate était vieux et laid. La nouvelle droite antilibérale est jeune et ardente. Que faisait le Socrate de Platon ? Il a parlé, parlé et encore parlé. Mais nous en avons assez des discours, nous voulons de l'action !
Encore une fois, nous allons trop vite. Il est relativement facile de passer de la droite anti-libérale à Platon. Si c'était une démarche aussi évidente, nous verrions davantage de platoniciens parmi les "déplorables" plus âgés ou les sous-groupes plus radicaux. Mais il est plus facile d'y voir Nietzsche, Schmitt et d'autres grands penseurs de la révolution traditionaliste et conservatrice. Dans les oeuvres de ces penseurs, il existe des obstacles qui empêchent un simple retour à Platon. Prenons l'exemple le plus évident. Nietzsche critique le platonisme avec une certaine habileté, jusqu'à un certain point. Heidegger, aussi. Le platonisme ressemble à quelque chose de désuet et de réfuté. Socrate était vieux et laid. La nouvelle droite antilibérale est jeune et ardente. Que faisait le Socrate de Platon ? Il a parlé, parlé et encore parlé. Mais nous en avons assez des discours, nous voulons de l'action !
Il est naturel que la jeune génération veuille de l'action. Ce serait un manquement au devoir et un signe d'incompétence de la part de leurs aînés de ne pas le comprendre et d'offrir des bromures pathétiques qui renforcent chez les jeunes l'impression que les vieux et les laids ne comprennent rien. C'est ce que Strauss a soutenu en 1941 lorsqu'il a déclaré que la chose la plus dangereuse pour les jeunes Allemands nihilistes, ceux qui rejetaient la civilisation et détestaient la version gauchiste de l'avenir, était les enseignants progressistes qui ne comprenaient pas la signification positive de leur "non" juvénile non accompagné d'un "oui" cohérent. De vieux professeurs sans assez de dogmes pour comprendre le désir ardent des jeunes et qui pourraient les aider à voir une alternative autre que la destruction jusqu'au bout de la vie bourgeoise et de la vision communiste. Mais il n'y avait pas de tels enseignants, et les étudiants étaient radicalisés par des progressistes aveugles.
Strauss a finalement reconnu la décence de la passion morale représentée par l'antipathie de la droite anti-libérale contre les idéaux bourgeois et communistes, une passion qu'il dit être partagée par Platon, Rousseau et Nietzsche. Son analyse du nihilisme allemand montre que, bien que les circonstances de cette passion morale se soient partiellement et vulgairement exprimées sous la forme de l'hitlérisme, elle avait des antécédents profonds et justifiables à un haut degré. Strauss combine sa justification de la critique philosophiquement nécessaire de la civilisation moderne avec une correction, empreinte de responsabilité, de ce qu'il considère comme des conséquences politiquement désastreuses. Il l'a fait en partie et en se référant à la situation qui prévalait alors, arguant que l'idéal pré-moderne, plus désirable que le moderne, était mieux préservé dans les pays développés de l'Ouest que dans la jeune Allemagne, qui, dans son rejet militariste zélé de la civilisation moderne, a oublié le souci classique de la bonne vie.

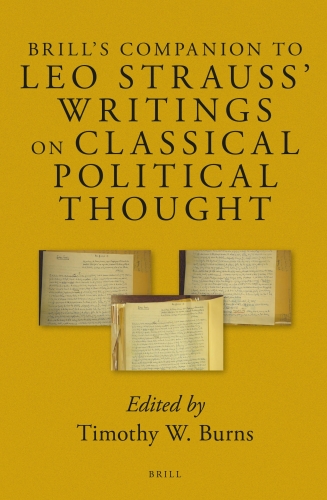
Plus important encore, la récupération par Strauss de la tradition classique de la philosophie politique montre que le caractère inutilement immodéré de la quête philosophique de la sagesse n'est pas nécessairement incompatible avec la vertu de modération. Pour paraphraser l'une des nombreuses formulations brillamment astucieuses de Strauss, la modération est une vertu non pas de la pensée philosophique, qui est privée, mais du discours, public ou politique. La question est ouverte de savoir dans quelle mesure la droite antilibérale contemporaine partage ces vertus de pensée et de discours. Ils ne sont pas particulièrement platoniques. Pour Strauss, ils incarnent la tradition de la philosophie politique, où, d'une part, la modération discursive se traduit par la pratique de l'écriture exotérique et, d'autre part, la démesure de la pensée, par la pratique de l'écriture entre les lignes. Cela suggère qu'une alternative à la droite antilibérale prônant la vertu du courage n'a pas besoin de retourner à Platon : elle peut s'inspirer de la tradition plus large que Strauss reconnaît comme la "philosophie politique platonicienne", qu'il perçoit comme une combinaison spécifique de modération et de démesure, telle que citée ci-dessus.
Le fait que des variétés existent dans la droite antilibérale soulève la question de leur véracité. Nous ne sommes pas suffisamment équipés pour comprendre ne serait-ce que l'intention de cette question, car qui croit encore ou pense pouvoir prouver qu'il existe une vérité simple dans la vie politique ?
Le problème est que nous remettons à plus tard de vieux débats qui deviennent rapidement des questions de la plus haute importance et ne peuvent plus être repoussés. Il y a quatre-vingts ans, Strauss s'est penché sur l'affirmation de Spengler selon laquelle les connaissances scientifiques et les autres domaines de la vie humaine sont relatifs au temps et à l'espace, et ne peuvent donc pas être des vérités simples, ni en mathématiques et en logique, ni en politique. Strauss affirme que l'un des problèmes fatals de l'approche de Spengler est que l'auteur a trop présumé. En affirmant que la vérité varie selon la culture, il supposait qu'il pouvait décrire quelque chose comme une culture, qui, elle, ne se décrivait pas de cette façon, ou qu'il pouvait interpréter la vie culturelle en termes de préoccupations centrales et périphériques, indépendamment de la question de savoir si les gens dont il parlait divisaient leurs préoccupations en centrales et périphériques, et si oui, si les domaines spécifiques étaient les mêmes que ceux que Spengler prenait pour acquis.
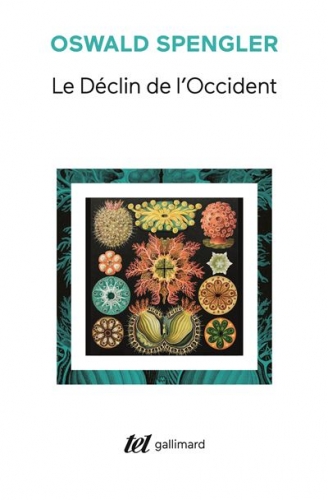 Strauss montre qu'une approche herméneutiquement adéquate de la variation culturelle de la vérité exigerait une étude des textes culturels pour comprendre comment elle est comprise, sans lui imposer d'emblée des schémas conceptuellement modernes (par exemple, nous ne comprenons pas la polis comme une "cité-état", parce que "état" est une interprétation tirée d'un concept étranger à la compréhension de la pensée politique de la Grèce antique). Si nous partons de la thèse selon laquelle toute vérité est culturellement relative, nous sommes conduits à l'effort d'interprétation visant à comprendre les cultures selon leurs propres termes à travers l'étude de leur histoire. Cette étude, pensait Strauss, ne conduit pas à un relativisme historique et culturel, mais à une série de problèmes et de préoccupations de base qui restent constants à travers le temps et l'espace, qui révèlent alors quelque chose de permanent dans la nature humaine. Si cela est correct, il serait possible de se demander si un enseignement est une simple vérité sur la nature humaine. Le relativisme ne tient pas. La question de la véracité de la droite anti-libérale est significative.
Strauss montre qu'une approche herméneutiquement adéquate de la variation culturelle de la vérité exigerait une étude des textes culturels pour comprendre comment elle est comprise, sans lui imposer d'emblée des schémas conceptuellement modernes (par exemple, nous ne comprenons pas la polis comme une "cité-état", parce que "état" est une interprétation tirée d'un concept étranger à la compréhension de la pensée politique de la Grèce antique). Si nous partons de la thèse selon laquelle toute vérité est culturellement relative, nous sommes conduits à l'effort d'interprétation visant à comprendre les cultures selon leurs propres termes à travers l'étude de leur histoire. Cette étude, pensait Strauss, ne conduit pas à un relativisme historique et culturel, mais à une série de problèmes et de préoccupations de base qui restent constants à travers le temps et l'espace, qui révèlent alors quelque chose de permanent dans la nature humaine. Si cela est correct, il serait possible de se demander si un enseignement est une simple vérité sur la nature humaine. Le relativisme ne tient pas. La question de la véracité de la droite anti-libérale est significative.
Strauss a également réalisé que la thèse du relativisme historique et culturel a une dimension philosophique plus sérieuse que celle que Spengler a fournie, nominalement, à la philosophie de Heideger. L'historicisme de Heidegger nous oblige à penser différemment la vérité et les vertus de la droite anti-libérale. Mais où ce projet de recherche est-il développé de manière compétente ? Avons-nous une compréhension suffisante de Heidegger pour le considérer en relation avec Schmitt et d'autres critiques des idéaux bourgeois et communistes ? La philosophie de Heidegger nous concerne intimement au moment de la crise du libéralisme.
Et si la question de la vérité d'un enseignement ne comptait pas, non pas parce que la vérité est relative à l'espace et au temps, mais parce que les vérités de la raison sont subordonnées à une autorité supérieure ? Parmi les variétés de la droite antilibérale, on trouve, après tout, non seulement l'incrédulité à l'égard de Nietzsche, mais aussi des positions fondées sur l'obéissance à un commandement divin, des théologies politiques. Vous pouvez déjà imaginer certaines personnes dont l'horizon intellectuel représente cette alternative.
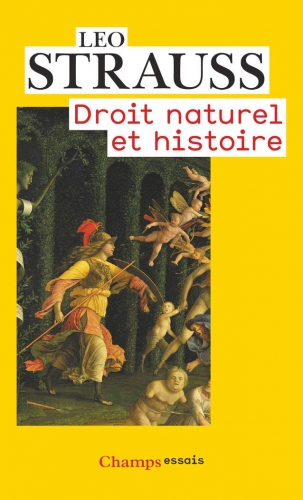
Ceci n'est toutefois pas nouveau. C'est sur une dynamique similaire que Strauss écrivait en 1940, lorsqu'il relatait l'atmosphère intellectuelle de l'Allemagne d'après-guerre. Lorsque nous sommes confrontés à la même situation, avec une incrédulité radicale d'un côté et l'obéissance à l'autorité divine de l'autre, et alors ? Selon Strauss, ses contemporains n'étaient pas en mesure, d'un point de vue conceptuel, de réfléchir clairement à une telle situation. Sommes-nous meilleurs qu'eux ?
Certains parmi les contemporains de Strauss qui voulaient passer de l'autorité à la raison se sont tournés vers les théories du droit naturel des 17e et 18e siècles. Au moins de cette manière, il pourrait y avoir une norme morale rationnellement défendable pour donner de la cohésion à une communauté politique. Cependant, Strauss a montré que ces enseignements ne constituaient pas une base solide pour un retour à la raison. Ils se sont excessivement appuyés sur la croyance traditionnelle selon laquelle la philosophie moderne a réfuté la philosophie classique et a progressé au-delà de celle-ci sur la base de cette réfutation. Heidegger, cependant, a détruit cette croyance. Il a montré que les classiques n'étaient pas réfutés parce qu'ils étaient mal compris. Un retour à la raison non engagée par une tradition fallacieuse devrait revenir à une raison pré-moderne. Ce retour ne se contente pas de la scolastique, car il est clair que celle-ci dépend d'Aristote ; elle en possède la nature dérivée. Un véritable retour à la raison est un retour à Platon et Aristote. Toute la philosophie ultérieure, selon Strauss, s'est fondée sur des concepts hérités d'eux, sans tenir compte de la rencontre authentique avec la vie ordinaire qui a engendré ces concepts. Étudier Platon et Aristote signifiait rencontrer le monde naturel de la vie de l'homme, voir avec ingéniosité dans le meilleur sens possible et de la seule manière dont nous pouvons encore le faire. Les philosophies ultérieures sont des constructions artificiellement arrachées à cet état naturel, elles-mêmes progressivement oubliées. En nous interprétant à leur lumière, nous sommes nous aussi déracinés.
De la thèse de la relativité de Spengler, en passant par l'autorité irrationnelle de la théologie politique jusqu'à l'invocation inadéquate du droit naturel et de la scolastique, Strauss nous renvoie ensuite à Platon. Serait-ce là la plus grande vertu de la droite anti-libérale : que, contrairement au libéralisme et à l'anti-libéralisme de gauche, elle nous ramène à l'origine de notre histoire, et à l'origine de notre avenir ? Car on ne peut vaincre Platon sans l'avoir compris.
Source : IM-1776
17:43 Publié dans Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : léo strauss, platon, philosophie, philosophie politique, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 21 mars 2022
Diego Fusaro: la société totalitaire du spectacle

La société totalitaire du spectacle
Diego Fusaro
Source: https://www.geopolitica.ru/es/article/la-sociedad-totalitaria-del-espectaculo
Traduction : Carlos X. Blanco
L'impossibilité de distinguer la réalité du monde de son récit médiatique est, une fois de plus, ce qui garantit le caractère durable d'une tromperie d'autant plus difficile à démasquer que le contact concret avec la "vraie réalité" fait défaut. Dans l'apothéose de la virtualisation de l'être, le système médiatique n'est plus un média qui raconte le monde, mais est, en fait, le monde lui-même. C'est ce que Baudrillard appelait le crime parfait : la superposition des médias sur la réalité s'accompagne d'une définition très élevée du support, qui correspond à une définition très basse du message. En effet, comme la caverne de Platon, la variante post-moderne de la société régie par le simulacre et le virtuel se caractérise par le fait d'être un spectacle permanent ou, selon la formule de Debord dans La Société du spectacle, par le fait d'être une "immense accumulation de spectacles" (§ 1) : dans les espaces desquels le vécu et l'expérience sont dépossédés au profit de la représentation et de la mise en scène.
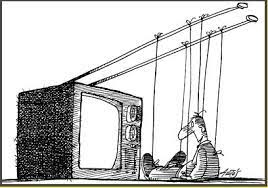
Le réel ne doit en aucun cas être compris comme une altérité avec laquelle le virtuel entretient une relation d'imitation plus ou moins étroite, selon les cas. Au contraire, le réel doit se résoudre sans réserve à une production du virtuel lui-même, de sorte que les deux instances se voient attribuer une identité complète : et le virtuel devient ainsi le seul réel, saturant ses espaces. Dans le triomphe de la dyade du simulacre et de la simulation évoquée par Baudrillard, il ne doit y avoir aucune autre réalité, aucune autre vérité et aucune autre existence que les flux d'images que la société du spectacle fait couler sur ses écrans, falsifiant complètement la vie sociale, divertissant les postmodernes enchaînés et les incitant à aimer leur propre captivité par le spectacle. La "société du simulacre", comme l'appelle Mario Perniola, correspond au monde transformé en fable, où la plenitudo essendi du réel est remplacée par la εἴδωλα organisée par les sophistes technocrates modernes et où les citoyens conscients et actifs sont dépossédés par les spectateurs manipulés et passifs.
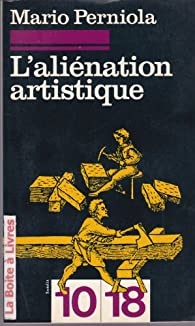 Par conséquent, sortir de la caverne signifie également se libérer de l'autorité "positionnelle" de ceux qui contrôlent les médias et régissent ainsi les informations que les prisonniers reçoivent. En même temps, cela signifie cesser d'accepter que les conditions structurelles - être au fond de la grotte ou à son entrée - légitiment implicitement les formes d'autorité culturelle "d'en haut". Le royaume du mondialisme capitaliste, dans lequel les simulacres ont autonomisé et supplanté le réel - "le monde autonomisé de l'image" évoqué par Debord (§ 2) - est le royaume de l'accumulation capitaliste et de son fétichisme co-essentiel porté à son degré maximal d'extension (planétarisation) et d'intensité (la marchandisation de tout l'imaginaire). Le vecteur privilégié de ce qui a été défini comme la domination culturelle, le spectacle permanent qui, sans jamais faiblir, occupe tous les coins de la caverne mondiale, coïncide pleinement avec le capital devenu ab-solutus, "réalisé" parce que désormais "libéré" de toutes les contraintes matérielles et immatérielles survivantes.
Par conséquent, sortir de la caverne signifie également se libérer de l'autorité "positionnelle" de ceux qui contrôlent les médias et régissent ainsi les informations que les prisonniers reçoivent. En même temps, cela signifie cesser d'accepter que les conditions structurelles - être au fond de la grotte ou à son entrée - légitiment implicitement les formes d'autorité culturelle "d'en haut". Le royaume du mondialisme capitaliste, dans lequel les simulacres ont autonomisé et supplanté le réel - "le monde autonomisé de l'image" évoqué par Debord (§ 2) - est le royaume de l'accumulation capitaliste et de son fétichisme co-essentiel porté à son degré maximal d'extension (planétarisation) et d'intensité (la marchandisation de tout l'imaginaire). Le vecteur privilégié de ce qui a été défini comme la domination culturelle, le spectacle permanent qui, sans jamais faiblir, occupe tous les coins de la caverne mondiale, coïncide pleinement avec le capital devenu ab-solutus, "réalisé" parce que désormais "libéré" de toutes les contraintes matérielles et immatérielles survivantes.
Pour paraphraser Debord, le spectacle dominant dans la caverne mondiale coïncide avec le capital qui, correspondant parfaitement à son propre concept, devient une image et réduit l'ensemble de l'être à un spéculum sur la surface duquel il se reflète de manière tautologique et sans zones libres. Telle est l'essence du tout nouveau monde de la réification intégrale, un seul camp de concentration qui, pour paraphraser Adorno, se croit un paradis parce que rien n'existe réellement pour s'y opposer.
Le zénith du fétichisme est ainsi atteint. Le non-vivant, l'accumulation cosmique de marchandises, est autonomisé et devient un spectacle permanent. De cette façon, il réalise cette inversion du Sujet et de l'Objet en vertu de laquelle les morts dominent désormais les vivants, la chose l'humain, le produit le producteur. Le spectacle de la caverne tend, pour cette raison même, à se redéfinir dans les termes de la camera obscura posée par Marx et Engels : sa prérogative est de montrer sous une forme inversée le réel qu'il reproduit, présentant les ombres idéologiques comme autonomes et comme déterminantes des actions humaines dont ces mêmes ombres découlent. Les deux fonctions, mises en évidence par Diderot, du spectacle que, dans le dos de spectateurs peu méfiants, les anciens et les nouveaux sophistes gèrent dans l'anonymat, sont co-présentes dans la réalité totalement médiatisée d'aujourd'hui. D'une part, comme dans la description de Platon, le spectacle éveille l'illusion très forte que le simulacre est le réel et qu'il n'y a pas d'autre réel que le simulacre (le perçu tient seul lieu de réalité) : les ombres remplacent la lumière et les spectateurs de la caverne n'ont pas d'autre cadre cognitif que celui que leur a forgé la société du spectacle et ses marionnettistes.
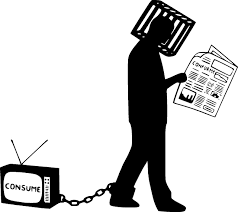
Comme dans le récit platonicien, le spectacle projeté sur les parois de la grotte ne fait que répéter, dans des formes simulées de pluralisme, que l'espace de la grotte est le seul et qu'il coïncide avec le meilleur des mondes possibles, et le seul. De cette façon, le spectacle remplit effectivement la fonction de "discours ininterrompu" et de "monologue laudatif" - le mot de Debord - que le rapport de force réellement donné entretient sur lui-même, afin de se légitimer en éliminant la possibilité de conceptualiser toute alternative possible. Telle est l'essence - "l'autoportrait", écrit Debord (§ 24) - du pouvoir techno-capitaliste, qui a réalisé son administration totale des conditions d'existence et de l'imaginaire. Selon l'enseignement de l'Histoire de la propagande de Jacques Ellul, "la propagande doit être totale", c'est-à-dire telle qu'elle emploie tous les moyens et étouffe tout espace d'authenticité, comme dans l'antre platonicien. D'autre part, le spectacle divertit et amuse, distrait et tranquillise, selon le sens double et synergique du divertissement déjà étudié par Pascal. De plus, elle génère la dépendance et crée les conditions de la dictature caractéristique de la société de masse déjà esquissée, d'un œil prophétique, par Tocqueville, lorsqu'il imaginait les traits avec lesquels se présenterait le nouveau despotisme (sous quels traits nouveaux le despotisme pourrait se produire dans le monde) ou, si nous préférons, la nouvelle caverne de l'enfermement humain avec spectacle et jouissance incorporés.
Source première: https://avig.mantepsei.it/single/la-societa-totalitaria-dello-spettacolo
17:28 Publié dans Actualité, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société du spectacle, guy debard, diego fusaro, philosophie, actualité |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 14 mars 2022
Les philistins de la culture, vrais barbares modernes (Friedrich Nietzsche)
00:26 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ego non, philosophie, friedrich nietzsche, allemagne, 19ème siècle |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 12 mars 2022
L'Europe suspendue entre l'être et le non-être : est-ce une patrie commune ou un cadavre atlantique ?

L'Europe suspendue entre l'être et le non-être: est-ce une patrie commune ou un cadavre atlantique?
par Luigi Tedeschi
Source : Italicum & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/l-europa-sospesa-tra-essere-e-non-essere-e-una-patria-comune-o-un-cadavere-atlantico
L'avènement du multilatéralisme dans la géopolitique mondiale place l'Europe devant un dilemme existentiel entre: être une patrie commune ou ne pas être un cadavre atlantique. L'histoire impose parfois des choix cruciaux et inéluctables.
La nécessaire neutralité de l'Ukraine
La guerre en Ukraine a des origines lointaines. Elle est le résultat de tensions de longue date qui ont explosé en raison de l'ineptie européenne et de la politique expansionniste de l'OTAN, qui ont empêché l'existence d'un équilibre stable entre la Russie et l'Occident. Avec l'effondrement de l'URSS et l'indépendance des républiques d'Europe de l'Est qui faisaient déjà partie de l'ancien empire soviétique, la logique de partition déjà éprouvée à Versailles en 1919 avec le démembrement des empires centraux s'est reproduite. L'Europe était en fait fragmentée en de nombreux États, souvent artificiels, et de nombreux peuples, très différents sinon hostiles les uns aux autres, étaient contraints de vivre ensemble. Comme on le sait, Versailles a jeté les bases de la Seconde Guerre mondiale.
L'ouest de l'Ukraine est peuplé de catholiques ukrainophones qui veulent être intégrés à l'Europe, tandis que l'est est habité par une population majoritairement orthodoxe et russophone qui s'identifie à la Russie. Pour Kissinger, l'indépendance de l'Ukraine était un facteur d'instabilité politique potentielle. Soljénitsyne, qui considérait que l'Ukraine faisait partie intégrante de l'histoire et de l'identité russes, s'y opposait. Une réconciliation pacifique entre les deux âmes de l'Ukraine s'est avérée impossible, en raison de l'expansion progressive de l'OTAN à l'est, qui envisageait l'intégration de l'Ukraine à l'Ouest en hostilité ouverte avec la Russie, qui, elle, voyait sa sécurité menacée. Le coup d'État pro-occidental de Maidan en 2014 en est une preuve objective.
Il était possible de parvenir à un équilibre géopolitique qui empêcherait cette guerre d'éclater : la médiation européenne aurait pu favoriser l'entrée de l'Ukraine dans l'UE, à condition qu'elle ne rejoigne pas l'OTAN. Une telle perspective aurait impliqué une rupture entre l'Europe et l'Alliance atlantique. Mais l'Europe n'est pas une entité géopolitique indépendante ; au contraire, elle ne trouve son unité que dans le contexte atlantique.
En effet, l'Ukraine est déjà associée à l'UE depuis 2017 et a bénéficié d'un financement européen de plus de 5 milliards, en plus des 1,2 milliard déboursés récemment. Par ailleurs, les accords de Minsk de 2014 (jamais respectés par l'Ukraine), entre la Russie et l'Ukraine, qui prévoyaient l'autonomie des républiques russophones du Donbass, ramenées à la souveraineté ukrainienne, ont été signés sous les auspices de l'OCDE. Afin d'éviter un conflit russo-ukrainien, l'Europe pourrait exiger que la partie ukrainienne les respecte. Mais l'Europe a brillé par son ignorance coupable.
Cette guerre entraînera une redéfinition des frontières entre l'Occident et la Russie, évoquant un retour au rideau de fer qui a marqué l'époque de la guerre froide. Mais les similitudes sont plus apparentes que réelles. Pendant la guerre froide, deux puissances mondiales, les États-Unis et l'URSS, se sont affrontées en tant que systèmes idéologiques, politiques et économiques alternatifs, entre lesquels les affrontements (jamais directs) alternaient avec les négociations. Aujourd'hui, les États-Unis et la Russie sont tous deux des puissances capitalistes. Les Américains ne reconnaissent pas le statut de puissance mondiale de la Russie et ne concluent donc pas d'accords avec Poutine, qui n'est pas considéré comme un partenaire égal. Avec la dissolution de l'URSS et la dissolution du Pacte de Varsovie, l'OTAN, en tant qu'alliance de défense de l'Occident contre la menace soviétique, aurait également dû être liquidée. L'expansion dans les pays d'Europe de l'Est et les guerres "humanitaires" menées par l'OTAN sur une période de 30 ans ont réfuté la nature défensive de l'Alliance atlantique. Il faut également considérer que l'OTAN a été fondée en 1949, tandis que le Pacte de Varsovie a vu le jour en 1955. Donc, entre les États-Unis et l'URSS, qui a dû se défendre contre qui ? La nature agressive de l'OTAN n'était-elle pas génétique ?
Cette guerre aurait pu être évitée si la nécessaire neutralité de l'Ukraine avait été reconnue. La stabilité et la sécurité de la région ne peuvent être garanties que par la neutralité ukrainienne, comme l'a observé Henry Kissinger : "Trop souvent, la question ukrainienne se présente comme une épreuve de force : l'Ukraine choisit-elle de rejoindre l'Est ou l'Ouest ? Mais si l'objectif de l'Ukraine est de survivre et de prospérer, elle ne peut être l'avant-poste de deux factions qui se combattent - elle doit être un pont." Kissinger, en 2014, était également un prophète facile lorsqu'il a déclaré qu'en l'absence d'une politique de réconciliation, "la dérive vers le conflit va s'accélérer, et à ce rythme, elle se produira assez rapidement".
L'Amérique, une puissance en crise entre pacifisme et russophobie
Cette guerre a éclaté parce qu'elle a été déclenchée par le désir de la Russie de sauvegarder sa sécurité et de contrer l'avancée de l'OTAN à l'est et par le désir des États-Unis d'éradiquer toute relation entre l'Europe et la Russie et de réaffirmer ainsi leur domination sur l'Europe elle-même. Les États-Unis ont en fait facilité l'invasion russe en déclarant leur réticence à s'engager dans une intervention militaire directe et en refusant tout accord avec Poutine. L'Amérique de Biden est pacifiste. Les divisions au sein de la société américaine ont eu pour effet de paralyser la politique étrangère américaine. L'aile libérale de la côte américaine ne veut pas la guerre pour des raisons pacifistes-idéologiques, pas plus que la population intérieure, patriotique par nature mais désormais fatiguée et désabusée par la succession des défaites américaines dans le monde.
L'Occident veut donc contrer la Russie avec l'arme des sanctions. Avec l'éviction de la Russie du système de paiement rapide et l'embargo économique, elle veut provoquer l'implosion financière de la Russie, avec le défaut de paiement russe associé. Mais la Russie est déjà sous le coup de sanctions depuis 2014. L'arme des sanctions provoque nécessairement des représailles et s'est toujours révélée inefficace. Au contraire, les sanctions politiques renforcent la cohésion interne des nations et encouragent la production de biens pour remplacer les produits étrangers qui ne sont plus importés. En outre, la Russie a été bien équipée au fil des ans pour faire face à de telles éventualités. Devenue économiquement vulnérable lors de la crise de 2014, la Russie a adopté ses propres contre-mesures. Depuis 2016, l'économie russe a enregistré une croissance annuelle du PIB de plus de 4 %, augmenté ses réserves de 631 milliards de dollars, principalement en devises autres que le dollar, contre une dette de 350 milliards de dollars, augmenté ses réserves d'or de 196 %, réalisé d'importants investissements dans le numérique, et le commerce avec la Chine s'élève désormais à 140 milliards de dollars, avec l'objectif d'atteindre 200 milliards de dollars.
Les sanctions ont évidemment aussi un impact majeur sur l'Occident, étant donné l'interdépendance des marchés mondiaux. L'Europe dépend du gaz russe pour 40 % de ses besoins et, puisque les approvisionnements de Gazprom ont été exclus des sanctions, paradoxalement, l'UE finance indirectement les dépenses militaires russes pour l'invasion de l'Ukraine avec les revenus de l'énergie. Alors que la bourse russe a été fermée pour cause de baisse excessive et que le rouble est à son plus bas niveau historique, les marchés européens ont enregistré des pertes de plus de 20 % depuis janvier. Standard & Poor's a rétrogradé la dette publique de la Russie au statut de "junk", mais cette dette ne représente que 20 % du PIB. La crise énergétique, avec des prix du gaz et du pétrole à des niveaux records et une inflation galopante, ainsi que la hausse des prix des matières premières, causent des dommages importants à l'économie européenne. Par le biais de sanctions, l'Occident veut amener la Russie à faire défaut, mais toute implosion russe impliquerait aussitôt l'Europe, étant donné l'exposition du système bancaire européen à la Russie (l'Italie seule est exposée pour plus de 25 milliards), et le blocage des flux commerciaux avec la Russie elle-même. Pour l'Europe, les dommages causés par les mesures de sanction sont encore incalculables.
L'expansion progressive de l'OTAN en Eurasie occidentale est conforme à une stratégie américaine bien connue, poursuivie depuis 1991. La pénétration de l'Atlantisme en Eurasie entraînerait la déstabilisation de la Russie. Les guerres qui ont déjà éclaté en Géorgie et en Tchétchénie, ainsi que la révolution colorée en Ukraine, sont des événements fonctionnels à une stratégie globale : la décomposition de la Russie en de nombreux petits États et leur insertion dans le contexte de l'OTAN, avec l'exploitation indiscriminée de leurs ressources, sous l'égide de la domination américaine.
L'objectif est de reproduire en Russie la stratégie qui a conduit à la fragmentation de l'ex-Yougoslavie (qui a également été expérimentée sans succès au Moyen-Orient). Mais quelqu'un a-t-il prévenu Biden et son équipe que la Russie n'est pas comparable à la Yougoslavie ? Le défaut de paiement et la déstabilisation économique de la Russie devraient être suivis d'une déstabilisation politique, avec la défenestration de Poutine par un complot ourdi par les oligarques russes sanctionnés. Mais les États-Unis, qui ont été incapables de faire tomber Saddam, Assad ou Milosevic, pourront-ils un jour faire tomber Poutine et avec lui tout l'appareil politique et militaire russe ?
À l'ONU, la résolution condamnant la Russie, outre l'unité des talibans européens pro-OTAN et son approbation par 141 voix, a enregistré 35 abstentions et 5 voix contre. Parmi les abstentions figurent la Chine, l'Inde, l'ensemble du monde islamique (à l'exception du Qatar et du Koweït), l'Afrique du Sud, le Brésil, le Mexique et le Congo. Il est donc nécessaire de réfléchir à l'importance économique et géopolitique de ces pays (qui, par ailleurs, détiennent une grande partie des matières premières mondiales et représentent la moitié de la population mondiale). La Turquie elle-même n'appliquera pas de sanctions à la Russie et Israël s'est déclaré prêt à jouer un rôle de médiateur dans le conflit : les intérêts d'Israël ne coïncident manifestement pas toujours avec ceux des Américains. Le front abstentionniste est donc hostile à l'Occident et constitue une démonstration tangible que la Russie n'est nullement isolée dans le contexte géopolitique mondial. La politique de l'Occident américain est inspirée par une profonde russophobie, qui conduira à l'isolement de l'Occident lui-même et à sa réduction géopolitique.
La politique expansive de l'OTAN a favorisé la création d'un partenariat russo-chinois qui pourrait devenir stratégique. La Chine a adopté une politique d'attention prudente dans le conflit russo-ukrainien. La Chine est le premier partenaire commercial de l'Ukraine, mais il faut surtout noter que 90 % du commerce de l'Europe avec la Chine passe par la Russie et l'Asie centrale. Cette guerre pourrait être un coup mortel pour l'économie européenne. Mais le plus important est que l'intensification des relations économiques et politiques de la Chine, de l'Inde et du monde islamique avec la Russie entraînerait une contraction drastique de la zone dollar, qui a jusqu'à présent dominé le commerce mondial. Et, à cet égard, on peut s'interroger : mais l'euro n'a-t-il pas été créé comme monnaie alternative au dollar afin de libérer l'Europe de la tyrannie financière américaine ? Cependant, des changements systémiques dans l'économie mondiale nous attendent.
L'Europe sortira-t-elle de son hibernation historique ?
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec les accords de Yalta et de Potsdam, l'Europe est divisée en deux zones d'influence : l'américaine à l'ouest et la soviétique à l'est. Alors que l'Europe de l'Est a souffert de l'occupation soviétique et de ses régimes totalitaires, l'Europe occidentale a accepté la domination américaine avec un large consentement. Le régime pro-américain de souveraineté limitée a ensuite été étendu, après 1989, aux pays de l'ancien bloc soviétique et s'est étendu à l'UE elle-même, au point de déterminer une identification parfaite entre l'Europe et l'OTAN.
L'Europe a ainsi renoncé à son indépendance et à un rôle puissant dans le contexte géopolitique mondial. Le statut de l'Europe est comparable à celui d'un colonialisme consentant, c'est-à-dire un groupe de pays économiquement avancés, à la prospérité généralisée, mais politiquement aseptisés, culturellement américanistes, dépourvus de pouvoir de décision et de responsabilité en matière de défense et de politique internationale, délégués aux États-Unis. Ce statut colonial, perpétué jusqu'à ce jour, a représenté la sortie de l'Europe de l'histoire.
Ce modèle socio-politique, qui a présidé à la fondation de l'UE elle-même, trouve sa pleine réalisation en Allemagne, qui, en vertu de sa suprématie économique continentale, l'a imposé à l'ensemble de l'Europe. Depuis 70 ans, l'Allemagne vit dans la dimension de la post-histoire. Le diplomate allemand Thomas Bagger a effectivement déclaré que "la fin de l'histoire était une idée américaine, mais une réalité allemande". Dans un article paru dans Limes, Ulrike Franke affirme que, pour la génération des millennials allemands, l'histoire est un récit d'événements passés, et non un processus dynamique en constante évolution. L'oubli de la mémoire historique a condamné les nouvelles générations à vivre dans une dimension existentielle absorbée par l'éternel présent. Il s'agit d'une dimension nihiliste, qui implique l'impossibilité de concevoir des réalités historiques et des horizons futurs comme des alternatives à celle-ci. Le progrès, le bien-être, le cosmopolitisme libéral pacifiste et le marché mondial sont les traits distinctifs d'un modèle économique et social occidental post-historique, qui a néanmoins généré dans la génération post-1989 l'idée de vivre dans le meilleur des mondes possibles.
Ulrike Franke dit : "Et la fin de l'histoire a pris notre avenir. Après tout, nous savions tous comment cela allait se terminer. La politique est devenue ennuyeuse - une activité administrative plutôt qu'une compétition idéologique. Et cela peut aussi nous aider à comprendre pourquoi tous les partis allemands prétendent toujours être du centre. Il semble qu'il ne soit pas nécessaire de penser stratégiquement à l'avenir. Une telle vision ahistorique de la réalité a été transmise à l'ensemble de l'Europe, qui est devenue un continent dépourvu de toute identité culturelle et sans aucune perspective d'avenir".
L'avènement de la post-histoire est lié à une époque où la souveraineté politique de l'Europe était dévolue au protectorat atlantique. L'UE elle-même a été créée en tant qu'organe supranational intégré à l'OTAN à l'extérieur et en tant que structure financière qui a établi un système économique d'extrême compétitivité entre les États à l'intérieur. L'UE n'a pas favorisé le développement et l'émancipation, mais a créé un système de domination économique de l'Allemagne et de ses satellites dans lequel la croissance allemande s'est accompagnée d'une dépression dans les pays du sud. Mais aujourd'hui, l'Europe est confrontée à un ordre géopolitique considérablement modifié. Les États-Unis poursuivent des objectifs qui ne sont pas compatibles, voire conflictuels, avec l'Europe.
Les États-Unis, qui se sont engagés à contenir la Russie et la Chine, n'ont plus l'intention de soutenir les dépenses militaires pour la défense des pays européens, qui sont tenus de consacrer 2 % de leur PIB à l'armement. L'objectif géopolitique poursuivi par les Américains n'est en fait pas la défense de l'Ukraine contre l'invasion russe, mais la restauration de leur domination politique absolue dans l'espace européen, en rompant les relations entre l'Europe et la Russie et en interrompant les flux commerciaux entre l'Europe et la Chine. Une Europe, dévastée par la crise économique provoquée par l'urgence énergétique et réduite dans son rôle de puissance économique dans le monde (surtout en ce qui concerne ses exportations vers les USA), pourrait être réduite à une condition de subordination totale aux USA. Les États-Unis pourraient alors imposer à l'Europe un traité de libre-échange transatlantique capricieux, semblable au tristement célèbre TTIP.
Le retrait américain d'Afghanistan a entraîné un changement substantiel de la stratégie géopolitique américaine. La politique étrangère de Biden, dans la continuité de celle d'Obama et de Trump, n'envisage pas d'interventions militaires dans le monde, sauf si les intérêts américains sont directement menacés. Par conséquent, des déploiements politico-militaires de dimension continentale ont été mis en place pour sauvegarder les zones d'influence de l'Amérique dans le monde. Dans le cadre de cette nouvelle stratégie géopolitique américaine, à travers le pacte abrahamique, la nouvelle OTAN du Moyen-Orient a été établie, dirigée par Israël et avec la participation de nombreux pays arabes. Et aussi l'AUKUS, qui est une alliance militaire dans la zone Indo-Pacifique qui vise à contenir la puissance chinoise. La décision de l'Allemagne d'allouer 100 milliards d'euros aux dépenses d'armement doit être interprétée de la même manière. Jusqu'à hier, le réarmement allemand aurait suscité l'inquiétude de tout l'Occident. L'Europe, sous la direction de l'Allemagne, devrait devenir une puissance continentale au sein de l'OTAN dans une fonction anti-russe. Mais il semble hautement improbable que la société allemande accepte de mourir pour l'Ukraine, comme la société japonaise le ferait pour Taïwan.
La phase post-historique de l'Europe touche donc à sa fin. Une perpétuation de l'hibernation historique de l'Europe est inconcevable. Nous devons occuper une place dans une histoire en constante évolution, sinon l'histoire elle-même s'occupera de nous, c'est-à-dire que d'autres décideront pour nous en fonction de leurs propres intérêts. Et dans notre cas, ce seront les Américains qui décideront.
L'Europe à la croisée des chemins entre multilatéralisme et abandon de l'histoire
Le conflit entre Poutine et l'Occident a pris la dimension d'une opposition d'époque de nature historico-idéologique. Depuis la crise de 2014, la réaction de Poutine au tournant pro-occidental en Ukraine a été interprétée par le courant dominant officiel comme la renaissance d'une conception de la politique du XIXe siècle, qui a été reproposée à travers la résurrection du nationalisme russe comme une réaction à une Russie assiégée et visant à défendre ses frontières et à sauvegarder son indépendance nationale. Ces concepts étaient considérés par l'intelligentsia libérale comme relégués à des époques historiques dépassées. Poutine est donc considéré comme un leader anti-historique.
Cependant, nous voyons dans le conflit ukrainien une opposition géopolitique et un affrontement idéologique, qui avaient déjà émergé dans l'histoire récente. L'Occident est dominé par un système néolibéral et une culture postmoderne qui postulent l'individualisme absolu, les droits de l'homme, la primauté de l'économie sur la politique, l'éradication des cultures identitaires et la dissolution des États. Ainsi, le conflit entre l'Occident et la Russie, selon l'idéologie libérale, est interprété comme le choc entre liberté et répression, progrès et réaction, démocratie et autocratie, laïcité et obscurantisme.
L'émergence de nouvelles puissances continentales telles que la Russie, la Chine, l'Inde, l'Iran et d'autres puissances mineures, qui revendiquent au contraire leur propre identité nationale, la valeur de la patrie en tant que destin commun des peuples, leurs racines historiques et culturelles, a mis en évidence depuis longtemps le déclin de l'idéologie libérale comme seul canon d'interprétation de la réalité dans une clé post-historique, individualiste et progressiste. La défense des droits de l'homme et l'imposition du système libéral-démocratique au niveau mondial constituent donc les valeurs en vertu desquelles l'Occident revendique sa suprématie morale dans le monde. Ces principes constituent la légitimation idéologique du "Nouvel Ordre Mondial". Les conflits qui ont eu lieu au cours des dernières décennies démentent les hypothèses idéologiques sur lesquelles repose le "Nouvel Ordre". C'est ce que dit Alberto Negri dans son article dans "Il Manifesto" du 13/02/2022 : "Cette fois, l'atlantisme est nu. Comme le roi" : "Quel "ordre" libéral les États-Unis et l'OTAN préconisent-ils? Celle qui a incité Washington à utiliser les djihadistes contre l'URSS dans les années 1980? Celle de l'Afghanistan 2021? L'"ordre" de l'intervention fabriquée en Irak en 2003? L'"ordre" de la guerre en Libye en 2011, dont les désastres sont encore sous nos yeux?
L'"ordre" américain qui nous a valu des attaques en Europe et des millions de migrants traités comme des objets et repoussés dans le désespoir, tout en nous privant des ressources énergétiques de nos voisins? L'"ordre" de la Turquie, un pays de l'OTAN utile pour massacrer les Kurdes sous le sultan Erdogan? L'"ordre" qui réduit au silence et efface les Palestiniens?
Les Américains et les atlantistes s'arrogent le droit de décider de ce qui est bon et de ce qui est mauvais, s'accrochant à des principes d'autodétermination des peuples qu'ils sont les premiers à violer.
Prenez la Syrie : pendant des années, Washington et Bruxelles ont déclaré que "Assad devait partir", mais pour le déstabiliser, ils ont encouragé Erdogan à envoyer des milliers d'égorgeurs djihadistes de l'autre côté de la frontière. Ils ont demandé à la Syrie de rompre ses liens avec l'Iran, puis la Russie, alliée historique de Damas, est intervenue.
Que voulait l'Occident, peut-être le bien des Syriens, toujours maintenus sous un embargo dramatique? Que voulaient les Américains de l'Afghanistan? Pour se venger du 11 septembre 2001, comme Biden l'a lui-même admis? Eh bien, après avoir tué Ben Laden, ils auraient pu partir, mais ils sont restés et ont tué plus de civils que les talibans, à qui ils ont rendu le pays, et maintenant ils se vengent sur la population en gelant les fonds afghans et en entravant l'acheminement de l'aide humanitaire.
L'unilatéralisme américain a généré de nouveaux conflits dans le monde entier entre les États dominés par le néolibéralisme et les États dominés par la souveraineté, entre les gagnants et les perdants de la mondialisation, entre l'Occident post-moderniste et l'Orient traditionaliste. Ce conflit irréductible est également présent au sein de la société occidentale. Les classes dominantes sont idéologiquement libérales et mondialistes, les classes subalternes revendiquent les valeurs communautaires, l'État-providence, les cultures identitaires.
Le monde occidental s'est révélé anti-historique dans la mesure où il n'a pas su comprendre l'esprit de notre époque, dans laquelle un nouvel ordre multipolaire émerge dans la géopolitique mondiale. Et c'est la cause du déclin progressif de l'unilatéralisme américain.
Nous sommes au seuil d'un tournant historique, annoncé prophétiquement par Alexandre Douguine dans son ouvrage La quatrième théorie politique: "La seule alternative plausible, aujourd'hui, se trouve dans le contexte d'un monde multipolaire. Le multipolarisme peut garantir à chaque pays et civilisation de la planète le droit et la liberté de développer son propre potentiel, de s'organiser intérieurement selon l'identité de sa culture et de son peuple, de fournir une base acceptable pour un système de relations internationales justes et équilibrées entre les nations du monde. La multipolarité doit être fondée sur le principe d'équité entre les différentes organisations politiques, sociales et économiques des diverses nations. Le progrès technologique et l'ouverture croissante doivent favoriser le dialogue entre les peuples et les nations et leur prospérité, mais ne doivent pas pour autant mettre en péril leur identité. Les différences entre les civilisations ne doivent pas nécessairement culminer dans un affrontement inévitable - contrairement à ce que pensent de manière simpliste certains auteurs américains. Le dialogue - ou plutôt le polylogue - est une possibilité réaliste que nous devrions tous explorer.
L'avènement du multilatéralisme dans la géopolitique mondiale place l'Europe devant un dilemme existentiel entre être une patrie commune ou ne pas être un cadavre atlantique. L'histoire impose parfois des choix cruciaux et inéluctables.
16:35 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, affaires européennes, politique internationale, géopolitique, otan, atlantisme, occident, occidentalisme, philosophie, philosophie politique, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Idéologie, propagande et conflit
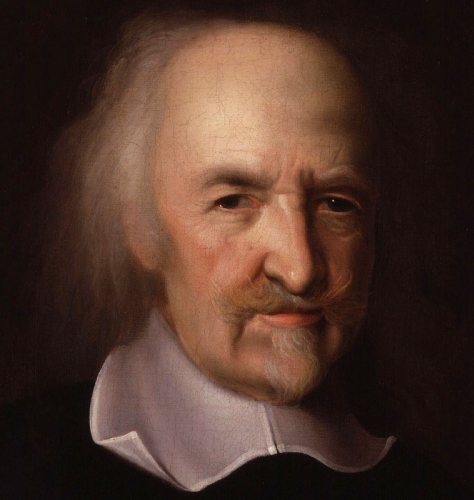
Idéologie, propagande et conflit
Par Daniele Perra
Source: https://www.eurasia-rivista.com/ideologia-propaganda-e-conflitto/
"Par conséquent, c'est un précepte ou une règle générale de la raison que tout homme doit s'efforcer d'obtenir la paix, dans la mesure où il a l'espoir de l'obtenir, et lorsqu'il ne peut l'obtenir, rechercher et utiliser toutes les aides et tous les avantages de la guerre. La première partie de cette règle contient la première loi fondamentale de la nature, qui est de rechercher la paix et de l'obtenir. La seconde, la somme de la loi de la nature, qui consiste à se défendre par tous les moyens possibles."
(Thomas Hobbes, Léviathan)
Dans son interprétation personnelle de l'œuvre la plus célèbre de Thomas Hobbes, Carl Schmitt souligne combien la figure du Léviathan évoque avant tout "un symbole mythique plein de significations cachées" [1]. Ce mythe, selon le grand juriste allemand, doit être compris avant tout comme une lutte séculaire d'images. En effet, dans le livre de Job, à côté de la figure du Léviathan (l'animal marin le plus fort et le plus indomptable), un autre animal est dépeint avec autant d'importance et de richesse de détails : le Béhémoth terrestre.
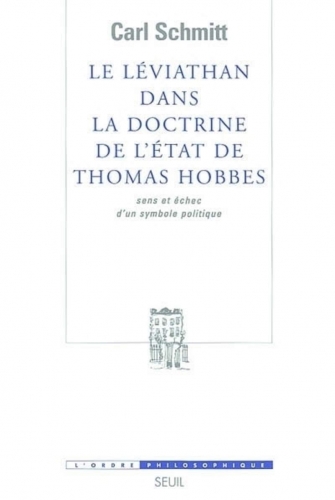
Après un rapide examen des interprétations chrétiennes de ce "mythe" (par exemple, selon l'Apocalypse de Jean, dans le célèbre Liber Floridus du 12e siècle, l'Antéchrist est représenté trônant sur Léviathan tandis qu'un démon chevauche Béhémoth), Schmitt se concentre sur l'exégèse juive, où les deux bêtes deviennent des symboles des puissances mondaines et païennes hostiles aux Juifs. "Le Léviathan", affirme Schmitt, "représente les bêtes sur mille montagnes (Psaumes 50:10), c'est-à-dire les peuples païens" [2]. Dans ce sens, l'histoire du monde est présentée comme une lutte des peuples païens les uns contre les autres. En particulier, la lutte se déroule entre le Léviathan - les puissances maritimes - et le Béhémoth - les puissances terrestres.

Béhémoth essaie de déchirer le Léviathan avec ses cornes, tandis que le Léviathan bouche la gueule et les narines de Béhémoth avec ses nageoires, le tuant. Ceci, poursuit Schmitt, est "une belle image de l'étranglement d'une puissance terrestre par un blocus naval" [3] (la référence, bien sûr, est au blocus naval avec lequel les Britanniques ont étranglé l'économie allemande pendant la Première Guerre mondiale). Dans tout cela, les Juifs regardent les peuples de la terre s'entretuer: "pour eux, ces massacres et égorgements mutuels sont légaux et casher. C'est pourquoi ils mangent la chair des peuples tués et en tirent la vie" [4].
Si l'interprétation schmittienne de ce thème biblique est appliquée aux événements actuels, il n'est pas particulièrement difficile d'identifier la Russie et l'Europe respectivement comme le Béhémoth et le Léviathan, et les États-Unis comme ceux qui "se nourrissent de la chair des tués et en vivent".
Dans deux articles publiés sur le site Eurasia, intitulés "L'ennemi de l'Europe" et "Comparaison des modèles géopolitiques", on a tenté d'expliquer comment les Etats-Unis, à travers deux guerres mondiales en l'espace de trente ans (ce n'est pas une coïncidence si l'historien Eric Hobsbawm a parlé d'une "deuxième guerre de trente ans" et Ernst Nolte d'une "guerre civile européenne"), ont réussi à évincer la Grande-Bretagne de son rôle de puissance mondiale, l'épuisant dans une lutte sans merci avec l'Allemagne. La "Grande Guerre" se prête particulièrement bien à ce schéma d'interprétation, puisque les États-Unis ne sont intervenus qu'après s'être transformés de pays débiteur en pays créditeur et après s'être assurés que les concurrents européens sortiraient du conflit, quelle que soit l'issue, dans des conditions économiques désastreuses. Et il ne semble pas déplacé d'utiliser le même schéma d'interprétation pour la crise actuelle en Europe de l'Est, étant donné que, aujourd'hui comme en 1914, les États-Unis sont le plus grand pays débiteur du monde.
Toutefois, une telle approche nécessite une réflexion approfondie. Nous avons choisi de commencer cette analyse par une citation de Thomas Hobbes pour la simple raison que le philosophe anglais reconnaît que l'État est avant tout un système de sécurité destiné à garantir la sécurité de son peuple et à éviter un retour à l'état de nature : la lutte de tous contre tous.
 Hobbes déclare expressément qu'il est du devoir de tout homme de rechercher la paix. Mais lorsque cela ne peut être réalisé, il a le droit d'utiliser les avantages de la guerre. Le penseur de Malmesbury, à son crédit, dit aussi autre chose. Plus précisément, il affirme la nécessité du respect des pactes, car : "sans une telle garantie les pactes sont vains et ne sont que des paroles vides, et le droit de tous les hommes à toutes choses demeurant, on est toujours dans la condition de la guerre [...] Mais quand un pacte est fait, alors le rompre est injuste et la définition de l'injustice n'est rien d'autre que le non-respect du pacte" [5].
Hobbes déclare expressément qu'il est du devoir de tout homme de rechercher la paix. Mais lorsque cela ne peut être réalisé, il a le droit d'utiliser les avantages de la guerre. Le penseur de Malmesbury, à son crédit, dit aussi autre chose. Plus précisément, il affirme la nécessité du respect des pactes, car : "sans une telle garantie les pactes sont vains et ne sont que des paroles vides, et le droit de tous les hommes à toutes choses demeurant, on est toujours dans la condition de la guerre [...] Mais quand un pacte est fait, alors le rompre est injuste et la définition de l'injustice n'est rien d'autre que le non-respect du pacte" [5].
Et encore : "C'est pourquoi celui qui rompt l'alliance qu'il a contractée, et qui déclare par conséquent qu'il pense pouvoir le faire avec raison, ne peut être reçu dans une société qui se réunit pour la paix et la défense, si ce n'est par l'erreur de ceux qui le reçoivent, ni, une fois reçu, rester sans que ceux qui voient le danger de leur erreur" [6].
Quelle est l'utilité de ces citations face au conflit actuel en Ukraine ? Il est bon de procéder par ordre. En 1987, les États-Unis et l'Union soviétique ont signé le traité INF - Intermediate-range Nuclear Force Treaty, qui réglementait le placement de missiles balistiques à courte et moyenne portée sur le sol européen. À peu près au même moment, Washington a donné à Moscou des garanties que l'OTAN ne s'étendrait pas vers l'est.
En 2014, l'Ukraine était dirigée par Viktor Ianoukovitch, dont le principal défaut (plus que la corruption généralisée) était d'avoir opté pour une éventuelle entrée du pays dans l'Union économique eurasienne. En effet, dans sa vision, l'ex-république soviétique était censée être un pont entre l'est et l'ouest et non une rupture géographique entre la Russie et le reste de l'Europe. Dans une interview accordée à CNN quelques semaines après le coup d'État à Kiev, le spéculateur ("philanthrope") George Soros a ouvertement déclaré qu'il avait contribué à renverser le "régime pro-russe" afin de créer les conditions nécessaires au développement d'une démocratie de type occidental. Non seulement cela, mais le gouvernement ukrainien post-golpiste a été sélectionné selon une méthodologie d'entreprise. Plus précisément, la sélection a été effectuée par deux cabinets de "chasseurs de têtes", Pedersen & Partners et Korn Ferry, qui ont choisi 24 personnes sur une liste de 185 candidats parmi les étrangers vivant en Ukraine (sans surprise, le gouvernement post-golpiste comprenait un Américain, un Lituanien et un Géorgien) et les Ukrainiens vivant au Canada et aux États-Unis. L'ensemble du processus - et cela ne devrait pas être une surprise - a été financé par Soros lui-même par le biais de la fondation Renaissance et du réseau de conseil politique [7].
Non moins troublant a été le processus de sélection de l'actuel président ukrainien, que la propagande atlantiste, dans un élan d'humour et de blasphème, a comparé à Salvador Allende. Volodymir Zelens'kyi, acteur et comédien d'origine juive aux talents incontestables (étant donné sa capacité à hypnotiser un public occidental déjà enivré par deux années de rhétorique pandémique militariste), avant de se consacrer à la politique était sous contrat avec la télévision privée du puissant oligarque Igor Kolomoisky. Également d'origine juive, ancien président de la Communauté juive unie d'Ukraine et du Conseil européen des communautés juives, Kolomoisky est également connu pour avoir financé les groupes paramilitaires qui massacrent les civils dans le Donbass depuis huit ans et pour avoir placé des primes de 10.000 dollars sur les têtes des miliciens séparatistes (Il va sans dire que ce sont les mêmes groupes qui ont assassiné le journaliste italien Andy Rocchelli (photo, ci-dessous) dans le silence absolu de nos médias, bien plus intéressés à défendre les droits bafoués d'un étudiant égyptien en études de genre).

Biographie: https://www.worldpressphoto.org/andy-rocchelli
Or, pour en revenir à l'affirmation hobbesienne selon laquelle "la définition de l'injustice n'est rien d'autre que le non-respect de l'alliance", on ne peut manquer de rappeler qu'en plus d'avoir accepté une large expansion de l'OTAN vers l'Est, les États-Unis ont opté en 2018 (sous l'administration Trump) pour un retrait unilatéral du FNI, sanctionnant de fait la possibilité d'amener leurs missiles aux frontières de la Russie. Comment la deuxième puissance militaire du monde aurait-elle dû réagir à un tel acte ? Il est bon de commencer par les aspects diplomatiques.
Le 17 décembre 2021, le ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie a publié le projet d'accord sur les garanties de sécurité soumis à l'OTAN et aux États-Unis. Il s'agissait notamment : a) d'exclure toute nouvelle expansion de l'OTAN vers l'est (y compris l'Ukraine) ; b) de ne pas déployer de troupes supplémentaires ; c) d'abandonner les activités militaires de l'OTAN en Ukraine, en Europe de l'Est, dans le Caucase et en Asie centrale ; d) de ne pas déployer de missiles à moyenne et courte portée dans des zones à partir desquelles d'autres territoires peuvent être touchés ; e) de s'engager à ne pas créer de conditions pouvant être perçues comme des menaces ; f) de créer une ligne directe pour les contacts d'urgence [8].
En outre, Moscou a expressément exigé le retrait de la déclaration de Bucarest dans laquelle l'OTAN a établi le principe de la "porte ouverte" en ce qui concerne l'adhésion de l'Ukraine et de la Géorgie à l'alliance. Naturellement, Washington et l'OTAN ont rejeté en bloc les demandes russes.
Il est essentiel de souligner ce fait, car la liberté invoquée aujourd'hui par le président ukrainien dans ses appels "sincères" n'est rien d'autre que la "liberté" de ses protecteurs de placer sur le sol ukrainien des missiles qui peuvent atteindre Moscou en quelques minutes, la détruisant avant même qu'elle ait une chance de réagir. Et la rhétorique belliqueuse utilisée par les gouvernements collaborationnistes européens (l'Italie en premier lieu) défend cette idée plutôt bizarre de liberté, sur la base de laquelle (nous le répétons) la deuxième puissance militaire du monde (ainsi que le principal fournisseur d'énergie de l'Europe) ne se voit pas garantir le droit à la sécurité.
Pour cette idée malsaine de la liberté (l'Italie est une fois de plus au premier rang, malgré la présence de plus de 70 têtes nucléaires américaines qui en font une cible directe en cas d'éventuelles représailles), il a été décidé d'envoyer des armes à Kiev (qui finiront dans les mains de groupes paramilitaires plus intéressés par la chasse à leurs concitoyens pro-russes que par la guerre contre les Russes) et de ne soumettre qu'un quart du système bancaire russe à des sanctions.
Au nom de cette idée de liberté, produit de la manipulation idéologico-géographique qui porte le nom d'Occident, le suicide économique et financier de l'Europe a été décidé (à la grande joie de Washington). Et toujours sur la base de cette idée dérangeante de la liberté, une "chasse aux sorcières" a été déclenchée, dans laquelle des artistes de renommée internationale sont priés d'abjurer leur patrie ; dans laquelle des cours sur Dostoïevski sont annulés, pour être ensuite rétablis lorsqu'un auteur ukrainien donne un avis "contradictoire" (comme si le par condicio pouvait s'appliquer à la littérature) ; dans laquelle toute voix en désaccord avec la vulgate officielle est réduite au silence et accusée de pro-poutinisme ; et dans laquelle les trente dernières années d'agression de l'OTAN (dont soixante-dix-huit jours de bombardement de la Serbie) et les huit années précédentes de guerre en Ukraine sont oubliées.
Il existe un terme pour tout cela : la guerre idéologique. La guerre idéologique est une guerre dans laquelle, pour reprendre la définition de Schmitt, l'ennemi est diabolisé et criminalisé. Par conséquent, elle devient digne d'être anéantie. La guerre idéologique ne connaît aucune limite et se fonde sur la subversion de la réalité. C'est la guerre imaginaire des pseudo-intellectuels, des journalistes et des analystes géopolitiques en proie à une surexcitation guerrière. C'est la guerre dans laquelle de faux mythes sont créés : la résistance héroïque des soldats ukrainiens sur l'île aux Serpents (qui se sont rendus sans tirer un coup de feu), le fantôme de Kiev abattant six avions de chasse russes (qui n'ont jamais existé), la résistance ukrainienne retournant les panneaux de signalisation pour confondre l'avancée russe (à l'ère de la guerre technologique). Cette guerre imaginaire est celle dans laquelle la Russie est décrite comme un pays isolé alors qu'en réalité elle renforce sa coopération avec la Chine et le Pakistan (deux puissances nucléaires) et dans laquelle l'UE et l'Anglosphère sont présentées comme le "monde entier".
NOTES
[1] C. Schmitt, Sul Leviatano, Il Mulino, Bologna 2011, p. 39.
[2] Ibid, p. 45.
[3] Ibid.
[4] Ibid.
[5] T. Hobbes, Leviatano, BUR, Milan 2011, p. 149.
[6] Ibidem, p. 155.
[7] Se Soros e la finanza scelgono il governo dell’Ucraina, www.ilsole24ore.com.
[8] Russie : les garanties de sécurité demandées à l'OTAN sont révélées, www.sicurezzainternazionale.luiss.it.
16:00 Publié dans Actualité, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : idéologie, propagande, conflit, thomas hobbes, carl schmitt, actualité, théorie politique, ukraine, europe, affaires européennes, politologie, sciences politiques, philosophie, philosophie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 10 mars 2022
Comment l'individualisme défait le conservatisme
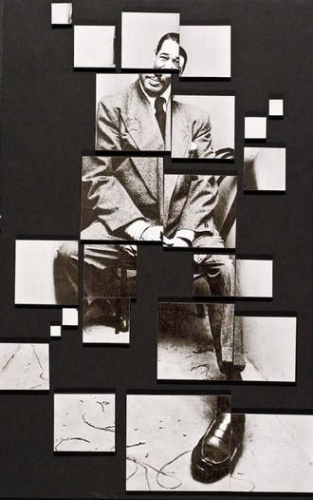
Comment l'individualisme défait le conservatisme
par Brett Stevens
Source: http://www.amerika.org/politics/how-individualism-defeats-conservatism/
Les conservateurs ne succombent pas directement à la gauche ; au contraire, selon la stratégie classique des gauches, ils sont secrètement envahis, divisés contre eux-mêmes, et ainsi subvertis et transformés en véhicule pour ces mêmes idées de gauche. Cela peut être observé dans le conservatisme traditionnel à travers la première loi de O'Sullivan :
- La première loi d'O'Sullivan stipule que toute organisation ou entreprise qui n'est pas expressément de droite deviendra de gauche avec le temps. La loi porte le nom du journaliste britannique et ancien rédacteur en chef de National Review, John O'Sullivan.
... [La motivation première d'un conservateur de gauche] est de signaler sa fidélité à la "seule vraie foi" en désignant l'hérétique le plus proche de lui et en criant "sorcière" [par] l'utilisation de la propriété transitive pour relier l'ennemi ciblé à un mal imaginaire et, bien sûr, l'exigence que la cible abandonne sa position ou risque d'être qualifiée d'hérétique [avec] ses interrogations dérangeantes qui sont jugées hors de portée des gens décents.
...Ils ont toujours été juste à la droite de la gauche officielle... [Leur présence sur l'échiquier politico-intellectuel n'a] jamais été expressément de droite, il s'agissait plutôt d'un véhicule de marketing pour les personnes qui les ont lancés. Tous sont passés à autre chose au fur et à mesure que l'entreprise remplissait son objectif.

En d'autres termes, une opportunité de marché est créée pour les droitiers, mais le meilleur produit est celui qui est comme tout le reste, mais suffisamment différent pour plaire, sans toutefois susciter l'ire du reste du troupeau. En conséquence, il fait fuir la droite de principe et attire les opportunistes, qui se font un revenu juteux en fanfaronnant sur leur différence, mais finissent par céder à la tendance dominante.
L'individualisme de ces opportunistes convertit le conservatisme en une autre forme de gauchisme, et le rend plus prompt à être accepté par le troupeau car il ressemble à ce que font les autres, et les humains ne sont rien d'autre que des conformistes.
La droite ne peut vaincre cela qu'en rendant la grande tente non pas intersectionnelle, mais hiérarchique. Le conservatisme doit redécouvrir ses principes fondamentaux de la manière la plus simple possible et faire dériver tous les autres principes de ceux-ci.
Comme écrit précédemment sur amerika.org, le noyau du véritable conservatisme est double :
- Des résultats éprouvés par le temps, ou un conséquentialisme basé non pas sur la préférence individuelle mais sur les effets observables dans la réalité, ce qui nous permet de faire correspondre la cause à l'effet et de comprendre les principes qui font une société prospère.
- Afin de comprendre pourquoi avoir une société prospère, et à quoi cela ressemble, le conservatisme s'appuie également sur le transcendantalisme ou la compréhension de l'ordre de la nature comme étant plus intelligent que l'humanité, et à travers cela, la découverte d'un désir d'exister en équilibre avec elle.
La forme corrompue du conséquentialisme, détruite de la même manière que le conservatisme l'a été, est une version basée sur les préférences qui assimile les "conséquences" à "ce que les gens pensent qu'ils aiment", dans un gambit utilitaire classique. Le conséquentialisme originel examine les résultats non seulement dans le présent, mais sur toute la durée, afin que nous puissions comparer avec précision et honnêteté différentes actions/causes.
Tant que la droite ne redécouvrira pas cette orientation primitive, elle sera à jamais subvertie parce que ses principes intermédiaires - marchés libres, liberté, liberté, petit gouvernement - sont en fait des orteils trempés dans l'eau tiède et putride du gauchisme, ou suffisamment proches pour que les deux deviennent rapidement identiques dans l'esprit de son public.
S'il revient à une voie distincte incompatible avec le gauchisme, et donc non sujette aux sottises du "bipartisme" et du "compromis", il peut atteindre son objectif de ralentir et éventuellement d'inverser le déclin de la civilisation. Mais lorsque ce conservatisme est transformé en un produit simplifié et juste axé sur la marge, comme un cheeseburger, il redevient la même chose que tout le reste, juste avec un arôme ajouté et sans réelle substance.
11:47 Publié dans Actualité, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : conservatisme, individualisme, droite, théorie politique, politologie, sciences politiques, john o'sullivan, philosophie, philosophie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Le côté obscur des Lumières

Le côté obscur des Lumières
Yoram Hazony
Source: http://novaresistencia.org/2020/08/14/o-lado-sombrio-do-iluminismo/
Dans ce texte, Yoram Hazony, philosophe et président de la "Fondation Edmund Burke", remet en question plusieurs dogmes de la littérature dite des "néo-Lumières".
Sur la base d'éléments historiques et conceptuels, l'auteur démontre que les différents courants conservateurs ont développé leurs propres idées sur la raison, l'équilibre des pouvoirs et la liberté. Ainsi, le siècle des Lumières n'a "inventé" aucune de ces vertus civiques et les a même persécutées et censurées à plusieurs reprises
Actuellement, de nombreuses personnes font la promotion des Lumières. Après le vote du Brexit et l'élection du président Trump, David Brooks a publié une proposition pour le "projet des Lumières", le déclarant attaqué et demandant aux lecteurs de se "lever" et de le sauver. Le magazine Commentary m'a envoyé une lettre demandant un don pour fournir aux lecteurs "les lumières que nous désirons tous si désespérément". Et maintenant, il y a le nouveau livre impressionnant de Steven Pinker, Enlightenment Now, qui pourrait être la déclaration définitive du mouvement néo-Enlightenment qui lutte contre la marée de la pensée nationaliste en Amérique, en Grande-Bretagne et au-delà.
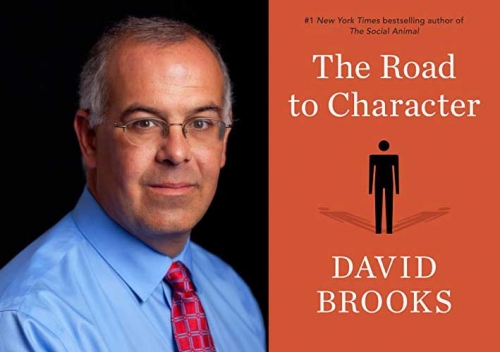
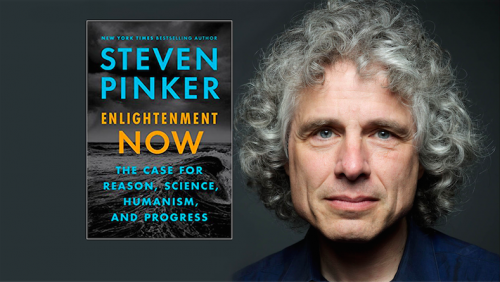
Avons-nous tous la nostalgie des Lumières? Moi pas. J'aime et je respecte M. Pinker, M. Brooks et d'autres personnes de leur camp, mais la philosophie des Lumières n'a pas obtenu une fraction du bien qu'ils prétendent apporter et, au contraire, a causé beaucoup de mal.
Les boosters actuels des Lumières sont un cas intéressant. La science, la médecine, les institutions politiques libres, l'économie de marché - ces choses ont considérablement amélioré nos vies. Ils sont tous, écrit Pinker, le résultat "d'un processus initié par les Lumières à la fin du 18e siècle", lorsque les philosophes "ont remplacé le dogme, la tradition et l'autorité par la raison, le débat et les institutions qui se donnaient pour tâche de rechercher la vérité". Brooks est d'accord, assurant à ses lecteurs que "le projet des Lumières nous a donné le monde moderne". Remerciez donc "des penseurs comme John Locke et Emmanuel Kant, qui ont fait valoir que les gens devraient cesser de se soumettre aveuglément à l'autorité" et plutôt "réfléchir à partir de zéro".
Comme le résume Pinker, "le progrès est un cadeau des idéaux des Lumières et se poursuivra dans la mesure où nous nous consacrons à ces idéaux."
Très peu de cela est vrai. Considérez l'affirmation selon laquelle la Constitution américaine est un produit de la pensée des Lumières, issue du rejet des traditions politiques du passé et de l'application sans retenue de la raison humaine. Pour réfuter cette idée, il suffit de lire les auteurs antérieurs qui ont contribué à asseoir la constitution anglaise. Le traité largement diffusé du 15e siècle In Praise of the Laws of England, écrit par le juriste John Fortescue, explique clairement la procédure régulière de la loi et la théorie aujourd'hui appelée checks and balances. Fortescue écrit que la constitution anglaise établit la liberté personnelle et la prospérité économique en protégeant l'individu et ses biens du gouvernement. Les protections qui figurent dans la Déclaration des droits des États-Unis ont été établies principalement dans les années 1600 par ceux qui ont rédigé les documents constitutionnels de l'Angleterre - des hommes comme John Selden, Edward Hyde et Matthew Hale.

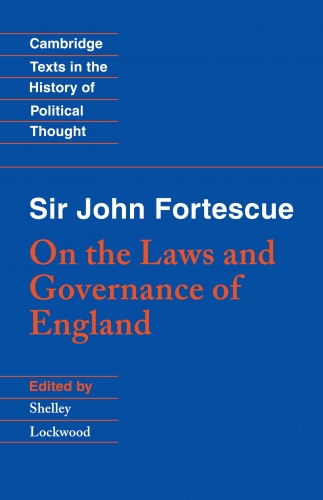
Ces hommes d'État et philosophes ont formulé les principes du constitutionnalisme anglo-américain moderne des siècles avant la création des États-Unis. Cependant, ils n'étaient pas des hommes des Lumières. Ils étaient religieux, nationalistes anglais et conservateurs politiques. Ils connaissaient l'affirmation selon laquelle la raison sans restriction devait refaire la société, mais ils l'ont rejetée en faveur de l'élaboration d'une constitution traditionnelle qui a fait ses preuves. Lorsque Washington, Jay, Hamilton et Madison ont mis en place un gouvernement national pour les États-Unis, ils se sont principalement tournés vers cette tradition conservatrice, en l'adaptant aux conditions locales.
Il n'y a pas non plus beaucoup de vérité dans l'affirmation selon laquelle nous devons la science et la médecine modernes à la pensée des Lumières. Une revendication d'origine plus sérieuse peut être faite par la Renaissance, la période entre le 15e et le 17e siècle, principalement en Italie, en Hollande et en Angleterre. Les rois anglais, liés à la tradition, ont par exemple parrainé des institutions scientifiques innovantes, comme le Collège royal des médecins, fondé en 1518. L'un de ses membres, William Harvey, a découvert la circulation sanguine au début du 17e siècle. La Royal Society of London pour l'amélioration des connaissances naturelles, fondée en 1660, était dirigée par des hommes comme Robert Boyle et Isaac Newton, des figures décisives dans l'évolution de la science physique et de la chimie. Là encore, il s'agissait de personnalités politiquement et religieusement conservatrices. Ils connaissaient les arguments, plus tard associés aux Lumières, pour renverser la tradition politique, morale et religieuse, mais les ont fondamentalement rejetés.
En bref, les principales avancées que les enthousiastes des Lumières d'aujourd'hui veulent revendiquer ont été "déclenchées" bien plus tôt. Et il n'est pas certain que les Lumières aient été utiles lorsqu'elles sont arrivées sur l'avant-scène intellectuelle.
Qu'est-ce donc que les "Lumières" ? Ce terme a été promu pour la première fois par le philosophe Emmanuel Kant, à la fin du 18e siècle. Pinker ouvre son premier chapitre en souscrivant à l'affirmation de Kant selon laquelle la raison seule permet aux êtres humains de sortir de leur "immaturité auto-imposée" en mettant de côté les "dogmes et formules" de l'autorité et de la tradition.

Pour Kant, la raison est universelle, infaillible et a priori - c'est-à-dire indépendante de l'expérience. En ce qui concerne la raison, il existe une réponse éternellement valable et inexactement correcte à toutes les questions de science, de moralité et de politique. L'homme n'est rationnel que dans la mesure où il le reconnaît et passe son temps à essayer d'arriver à cette réponse correcte.
Cette arrogance étonnante repose sur une idée-force : les mathématiques peuvent produire des vérités universelles en partant de prémisses évidentes - ou, comme l'avait dit René Descartes, "d'idées claires et distinctes" - puis en procédant par déductions infaillibles à ce que Kant appelait la "certitude apodictique". Puisque cette méthode fonctionnait en mathématiques, avait insisté Descartes, elle pouvait être appliquée à toutes les autres disciplines. Cette idée a ensuite été adoptée et affinée par Thomas Hobbes, Baruch Spinoza, John Locke et Jean-Jacques Rousseau, ainsi que par Kant.
Cette vision de la "raison" - et de son pouvoir, libérée des chaînes de l'histoire, de la tradition et de l'expérience - est ce que Kant a appelé les "Lumières". C'est complètement faux. La raison humaine est incapable d'atteindre des réponses universellement valides et inextricablement correctes aux problèmes de la science, de la morale et de la politique en appliquant les méthodes des mathématiques.
Le premier avertissement à ce sujet fut le magnum opus de Descartes en 1644, "Les principes de la philosophie", qui prétendait parvenir à une détermination finale de la nature de l'univers en passant des prémisses évidentes aux déductions infaillibles. Cet ouvrage volumineux est si outrageusement absurde qu'il n'existe aujourd'hui aucune version anglaise complète. Néanmoins, le chef-d'œuvre de Descartes a fait des ravages en Europe et a été pendant des décennies le principal manuel de l'école cartésienne des sciences. Kant a suivi cet exemple douteux avec ses "Fondements métaphysiques de la science naturelle" (1786), dans lesquels il prétendait avoir déduit les lois du mouvement de Newton en utilisant la raison pure, sans preuve empirique.
Il fut un temps où l'on comprenait bien qu'une grande partie du succès du monde moderne provenait de traditions conservatrices qui se méfiaient ouvertement de la raison. Lorsque j'étais étudiant diplômé à Rutgers dans les années 1980, le cours d'introduction à la théorie politique moderne comportait une section intitulée "Critiques des Lumières". Ces personnalités comprenaient des penseurs plus conservateurs tels que David Hume, Adam Smith et Edmund Burke. Ils ont souligné le manque de fiabilité du "raisonnement abstrait", qui, selon eux, pouvait finir par justifier pratiquement n'importe quelle idée, aussi déconnectée de la réalité soit-elle, tant qu'elle semblait évidemment vraie pour quelqu'un.
L'un de ces mythes était l'affirmation de Locke selon laquelle l'État était fondé par un contrat entre des individus libres et égaux - une théorie que les critiques des Lumières considéraient comme historiquement fausse et dangereuse. Bien que la théorie ait fait relativement peu de dégâts dans la Grande-Bretagne plus traditionnelle, elle a entraîné une catastrophe en Europe. Importée en France par Rousseau, elle a rapidement renversé la monarchie et l'État, produisant une série de constitutions ratées, le règne de la Terreur et enfin les guerres napoléoniennes - tout cela au nom de la raison infaillible et universelle. Des millions de personnes sont mortes alors que les armées de Napoléon tentaient de détruire et de reconstruire tous les gouvernements d'Europe, selon la théorie politique jugée correcte et seule autorisée par la philosophie des Lumières. Cependant, Napoléon essayait simplement, selon l'expression de Brooks, de "penser les choses à partir de zéro".
Les défenseurs des Lumières ont tendance à sauter cette partie de l'histoire. Le livre de 450 pages de Pinker ne mentionne pas la Révolution française. Pinker cite Napoléon comme un "exposant de la gloire martiale" mais ne dit rien sur le lancement d'une guerre universelle au nom de la raison. Ces auteurs ont également tendance à transmettre la dette de Karl Marx envers les Lumières. Marx se voyait comme le promoteur de la raison universelle, prolongeant l'œuvre de la Révolution française, insistant pour que les travailleurs du monde cessent (toujours selon les mots de Brooks) de "se soumettre aveuglément à l'autorité". La science que Marx a développée "à partir de rien" a tué des dizaines de millions de personnes au 20e siècle.
Les Lumières ont également propagé le mythe selon lequel les seules obligations morales des gens sont celles qu'ils choisissent librement par le raisonnement. Cette théorie a dévasté la famille, une institution fondée sur des obligations morales que beaucoup de gens, semble-t-il, ne choisiront pas à moins d'être guidés par la tradition. Le livre de Pinker est rempli de graphiques montrant l'amélioration des conditions matérielles au cours des derniers siècles. Il ne nous offre aucun graphique décrivant l'effondrement du mariage ou l'augmentation des naissances hors mariage dans les sociétés des "Lumières". Il n'est pas non plus préoccupé par la destruction de la religion ou de l'État-nation. Kant estimait que les deux étaient en contradiction avec la raison, et Pinker ne voit aucune raison de ne pas être d'accord.
Ce qui nous amène au cœur de ce qui ne va pas avec le mouvement néo-lumières. Pinker fait l'éloge du scepticisme en tant que pierre angulaire du "paradigme des Lumières sur la manière d'obtenir des connaissances fiables", mais les figures de proue de la philosophie des Lumières n'étaient pas des sceptiques. Bien au contraire, leur objectif était de créer leur propre système de vérités universelles et certaines, et dans cette quête, ils étaient aussi rigides que les médiévistes les plus dogmatiques.
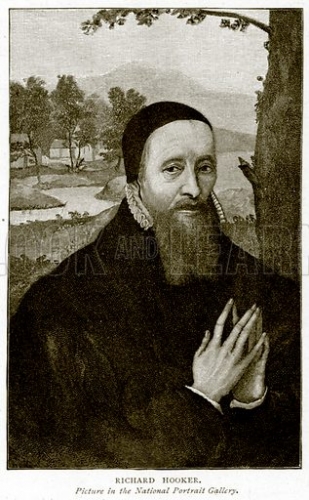
Les conservateurs anglo-écossais, de Richard Hooker et Selden à Smith et Burke, recherchaient quelque chose de très différent. Ils défendaient les coutumes nationales et religieuses tout en cultivant un "scepticisme modéré" - une combinaison que le monde anglophone appelle le "bon sens". Si les vieilles institutions n'ont pas besoin d'être réparées de manière évidente, le bon sens veut qu'on les laisse en l'état, car il y a toujours le risque d'aggraver la situation. Cependant, ils ont également vu le potentiel des tentatives d'amélioration des connaissances de l'humanité, tant que la faiblesse et le manque de fiabilité de la raison humaine étaient gardés en vue. Comme l'écrit Newton dans ses "Opticks" : "Argumenter à partir d'expériences et d'observations par induction n'est pas une démonstration de conclusions générales, mais c'est la meilleure façon d'argumenter ce que la nature des choses admet."
Je pense souvent à ces mots modérés et sceptiques ces jours-ci, alors que je suis la transformation politique et culturelle du monde anglophone. Les élites américaines et britanniques, autrefois attachées à un mélange de tradition et de scepticisme, réclament désormais les Lumières. Ils insistent sur le fait qu'ils ont atteint des certitudes universelles. Ils font preuve d'un mépris digne de Kant lui-même envers ceux qui refusent d'adopter leurs dogmes - les qualifiant de "non éclairés", "immatures", "illibéraux", "rétrospectifs", "déplorables", et pire encore.
Si ces élites avaient encore accès au bon sens, elles ne parleraient pas comme ça. L'excès de confiance dans les Lumières a suffisamment dérapé pour justifier de sérieux doutes sur les affirmations faites au nom de la raison - tout comme le doute est précieux pour aborder d'autres systèmes de dogmes. De tels doutes conseilleraient la tolérance à l'égard des différentes façons de penser. Les institutions nationales et religieuses ne correspondent peut-être pas au siècle des Lumières, mais elles peuvent néanmoins avoir des choses importantes à nous apprendre.
La vérité politique la plus importante de notre génération est peut-être celle-ci : vous ne pouvez pas avoir les Lumières et le scepticisme. Vous devez choisir l'un d'entre eux.
11:33 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lumières, idéologie des lumières, philosophie, 18ème siècle, néo-lumières |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Gadamer et la tradition

Luiz Campos
Gadamer et la tradition
Source: http://novaresistencia.org/2019/09/12/gadamer-e-o-tradicionalismo/
Est-il correct de considérer Hans-Georg Gadamer comme un traditionaliste ? Ses remises en question et ses critiques de la modernité et des principes des Lumières montrent qu'il l'est de fait. Le penseur allemand examine l'utilisation de la "méthode", qui cherche à atteindre une vérité incontestable, comme dans la philosophie de Descartes. L'erreur des Lumières a été la confiance aveugle dans la raison comme seul outil d'analyse pour les humains. L'ère moderne se caractérise par le mariage de la méthode et de la raison, une union qui a légitimé la connaissance scientifique comme source de vérité suprême.
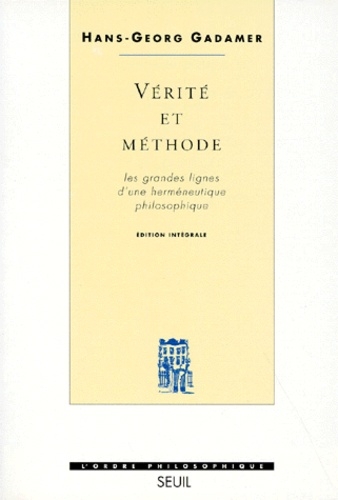
Descartes et les Lumières étaient des ennemis de la tradition, cherchant à la critiquer et à la juger. Gadamer, inspiré par des hautes figures du romantisme allemand comme Schleirmacher et Schlegel, et outre son maître Martin Heidegger, cherche à réhabiliter et à approfondir le sens de la tradition. Les philosophes des Lumières ont commis une grande erreur en pensant que toute forme de pensée pouvait se développer en s'isolant de la tradition.
La tradition n'est pas quelque chose qui peut être analysé par une raison qui prétend vainement être pure, car cette même raison fait partie d'une tradition qu'elle tente de juger. Pour Gadamer, la tradition est l'âme qui rend la culture vivante, et non un amas de valeurs illogiques et de connaissances sans fondement. Cette conception de Gadamer dialogue fortement avec notre vision des cultures traditionnelles, ce qui prouve qu'il est un penseur à étudier et à adapter à notre praxis. La tradition, en fait, est quelque chose de vivant, pas un fétiche du passé. Elle brille comme un soleil dont émanent les manifestations culturelles populaires les plus variées.
09:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hans-georg gadamer, gadamer, philosophie, tradition |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Nous devons parler de l'échec de la civilisation

Nous devons parler de l'échec de la civilisation
par Brett Stevens
Source: http://www.amerika.org/politics/we-must-talk-about-civilizational-failure/
Les gens avaient l'habitude de parler de l'éléphant dans la pièce, une métaphore pour désigner un sujet de conversation si sensible que tout le monde l'évite et parle de banalités à la place.
La métaphore fonctionne parce que vous pouvez facilement visualiser les gens discutant de toutes sortes de petites choses et ignorant la grande évidence, car c'est là le comportement humain par défaut.
Si vous reprenez une entreprise, un groupe militaire, une église ou un groupe d'amis, vous faites bien de commencer par une chasse à l'éléphant. Si l'entreprise n'est pas performante, il doit y avoir un tel "éléphant" ou quelque chose dont tout le monde nie l'existence.
Dans une entreprise, il s'agit généralement de la concurrence, d'une défaillance du produit ou d'un défaut de la chaîne d'approvisionnement. Dans un groupe, il peut s'agir de personnalités toxiques ou d'une situation où toutes les personnes talentueuses sont parties.
L'éléphant dans la pièce pour nous, en Occident, c'est l'échec patent de la civilisation. Notre civilisation a échoué lorsqu'elle a adopté la pathologie de l'individualisme, se manifestant par l'égalitarisme, y compris par la démocratie.
Son échec était patent à l'époque de la Première Guerre mondiale, et il est alors devenu évident que nous étions devenus fous parce que nous poursuivions des objectifs insensés qui sont paradoxaux par rapport à la réalité qui fonctionne en termes de cycles, de modèles et d'autres structures intangibles.
Nous devons parler de l'échec de la civilisation, de la manière de l'inverser et d'éviter qu'il ne se reproduise.
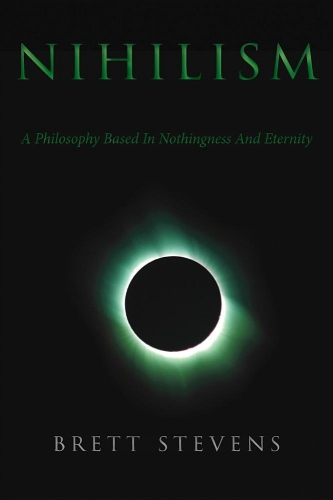
Tout le reste n'est que distraction. En tant qu'auteur d'une philosophie appelée Parallélisme, je me dois de signaler que nos échecs personnels sont parallèles aux échecs de notre civilisation.
Presque tout le monde en Occident a perdu la raison à ce stade, et presque tout ce qui est accepté comme "fait" ou comme "bien" est en fait une illusion. N.B. : le reste du monde est moins compétent et plus fou, mais cela n'a en fait aucune incidence sur notre avenir.
Les choses semblent sombres en ce moment, mais cela aussi est une illusion.
Nous sommes dans le déni de l'éléphant dans la pièce (EITR/"Elephant in the Room") depuis des siècles, voire plus. Notre civilisation a réussi, et nous avons donc perdu le sens de l'objectif fixé, et c'est alors que les personnes incapables de faire quoi que ce soit ont remplacé les personnes capables de faire quelque chose, en faisant appel à la peur collective de l'insuffisance personnelle.
La socialisation et le statut social ont remplacé la fonction. L'illusion populaire a remplacé l'élan vers la réalité et l'excellence en son sein (arete). L'égoïsme a remplacé la fierté de faire le bien et de faire partie d'une tribu.
Nous avons été dans le déni pendant des siècles. Maintenant, le déni prend fin. Oui, cela fera mal pendant un certain temps, mais une fois que nous aurons passé l'obstacle de notre propre illusion, nous aurons une grande opportunité de faire beaucoup mieux.
09:00 Publié dans Actualité, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : brett stevens, philosophie, nihilisme, civilisation, déclin, décadence |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 09 mars 2022
Lucian Blaga: Vision, identité et culture populaire

Augusto Fleck
Vision, identité et culture populaire
Source: http://novaresistencia.org/2022/03/08/visao-identidade-e-cultura-popular/
Il existe un long débat au sein des sphères dissidentes et conservatrices sur la position de la culture populaire, des structures les plus caractéristiques du peuple aux festivals et à l'art produit à l'écart des cercles élitistes et bourgeois. Avec l'aide de la philosophie du poète roumain Lucian Blaga, nous pouvons réfléchir à la manière dont cette culture est proprement le fruit de notre "vision".
Lucian Blaga est un philosophe peu connu en dehors de la sphère universitaire roumaine. Sa poésie, en revanche, est plus répandue et fait même l'objet de traductions en portugais, bien que son impression et sa lecture soient également limitées. Philosophe entre deux mondes, sous l'influence de l'idéalisme et de la poésie d'Allemagne ainsi que de la culture roumaine qui l'entourait, Blaga a également dialogué intensément avec la métaphysique et la phénoménologie.
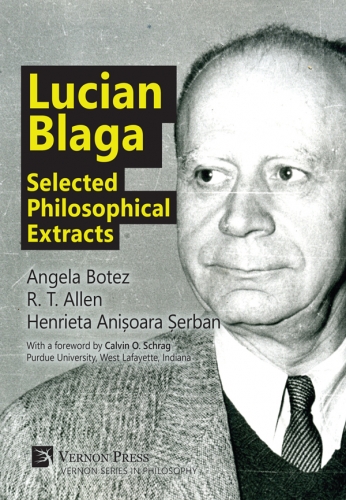
Dans le domaine de l'épistémologie, il a eu l'audace de réaliser que les catégories kantiennes qui sous-tendaient la physique moderne étaient insuffisantes pour lire adéquatement la nouvelle physique et pour saisir la conscience de la connaissance dans son ensemble, en proposant que dans l'horizon des mystères, non seulement la lumière qui atténue le mystère produit la connaissance, mais qu'il existe un autre type de "cognoscence" qui intensifie et radicalise le mystère jusqu'à sa limite.
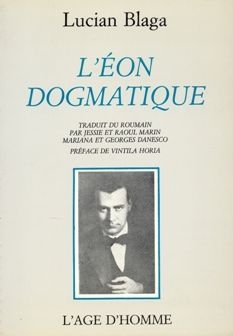 Comme produit de ses réflexions, une théorie entièrement nouvelle sur les processus de formation culturelle émerge, puisqu'il a compris l'homme lui-même comme une sorte de mutation ontologiquement culturelle, la culture étant une réponse imagée ou métaphorique de l'homme pour comprendre le mystère qui se trouve au-delà de l'horizon. L'horizon, pour Blaga, est une sorte d'atmosphère axiologique, d'orientation ou de forme, capable de donner un sens à la création culturelle. La culture est donc une manifestation ou une cristallisation anthropologique et géosophique d'horizons spatiaux subconscients.
Comme produit de ses réflexions, une théorie entièrement nouvelle sur les processus de formation culturelle émerge, puisqu'il a compris l'homme lui-même comme une sorte de mutation ontologiquement culturelle, la culture étant une réponse imagée ou métaphorique de l'homme pour comprendre le mystère qui se trouve au-delà de l'horizon. L'horizon, pour Blaga, est une sorte d'atmosphère axiologique, d'orientation ou de forme, capable de donner un sens à la création culturelle. La culture est donc une manifestation ou une cristallisation anthropologique et géosophique d'horizons spatiaux subconscients.
Dans l'ordre, cet horizon spatial subconscient produit chez l'homme une "vision", une capacité qui fait de lui, en fait, un Homme. C'est lorsqu'il contemple l'horizon et réfléchit à sa finitude, qui reflète la finitude même de l'être, que la nature "rompt" avec son imperturbable sommeil conscient et en vient à exister pour le mystère et à le tenter.
Cette vision, bien sûr, est la muse la plus fondamentale du processus créatif et culturel. La culture n'est pas, comme l'a supposé la modernité à bien des égards, un ensemble de structures fonctionnelles produites par l'homme pour le maintien de son bien-être physique et la garantie de ses biens, mais une condition stylistique et linguistique qui donne un sens au sujet, des outils pour traiter le mystère.

Dans le sillage de ce processus, chaque identité qui se forme est une matrice stylistique et structurelle correspondant à la relation entre l'horizon spatial (subconscient), la vision et l'horizon phénoménal de chaque peuple, un "être-avec historique". C'est pourquoi, contrairement aux animaux, la culture humaine posséderait, pour Blaga, tant de différences organisationnelles et dynamiques. Ainsi, exister ne peut réellement avoir un sens qu'à partir d'une vision spécifique sous laquelle nous modulons notre interaction avec le monde. Dans ce sens, Blaga dialogue à la fois avec les "styles civilisationnels" de Spengler, l'être de Heidegger et la cosmologie civilisationnelle de Douguine. Un amalgame presque typiquement roumain de leurs philosophies, pour être précis. Nonobstant la roumanité intrinsèque des images proposées par Blaga, ses catégories proposent une universalisation métaphysique, épistémologique et anthropologique qui peut être adéquate dans un autre système linguistique, tel que le nôtre (ndt: lusophone).

Par conséquent, la culture populaire en tant que création identitaire à partir de la vision est un élément irrémédiablement concret de la relation existentielle et quotidienne de l'homme avec ce qui le rend homme.
Cela nous ramène, en quelque sorte, au problème de la culture populaire vs la culture de masse, tant en ce qui concerne la production artistique que le statut de nos fêtes populaires, sévèrement critiquées pour être barbares, immondes, etc.
La critique de la culture populaire est un thème récurrent dans les milieux conservateurs comme symptôme de décadence. En fait, il ne semblera pas étrange à tout traditionaliste de réaliser que lorsqu'une civilisation s'épuise dans la véritable essence de son esprit et que le crépuscule approche - ou plutôt, lorsque sa vision devient floue et que l'horizon n'est pas plus contemplatif qu'une obscurité métaphysique - l'art même produit sera en quelque sorte d'affecté.
Le problème de cette interprétation et du comportement subséquent, consistant à fétichiser l'exotique et l'exogène culturel, est une mauvaise compréhension de la civilisation même dont on fait partie. Il faut reconnaître qu'à l'orée de notre existence, aucun type de création culturelle ne dialogue avec l'aspect mystérieux et révélateur de l'existence aussi bien que la nôtre. Douguine souligne cet aspect lorsqu'il applique au cosmos la condition d'accès à l'infini, l'unité dans la multiplicité, l'immersion totale dans le particulier comme condition de l'éternel.

Cela ne signifie pas, par exemple, un rejet total de ce qui est extérieur, car les grandes œuvres ont également le pouvoir de toucher le mystère par le biais de métaphores et de les exposer de telle sorte qu'une comparaison soit possible. La philosophie est aussi un art de la traduction.
Les deux éléments les plus troublants s'avèrent être : (1) une aliénation complète du sujet par rapport à son identité culturelle propre, tandis qu'il cherche dans le passé des cultures anciennes et éteintes, dans son sommet et sa mémoire apollinienne, une sorte d'ode à la beauté comme forme catégorique (2); une réduction de l'art populaire contemporain à l'état décadent du monde, une généralisation dangereuse et potentiellement délétère.
Même aux heures les plus sombres de la nuit de la civilisation, chaque peuple possède encore sa puissance immanente et un mouvement vers l'horizon et la cristallisation révélatrice. C'est cela qui potentialise le renouvellement de la puissance vers l'éternel que les fêtes populaires et l'art de notre peuple produisent, à travers notre matrice stylistique, sans avoir à recourir au plâtre effrité et décoloré des époques culturelles antérieures.
En réalité, toutes ces préoccupations et ces excès découlent de la même inquiétude et du même manque de soin qui imprègnent presque tout le travail intellectuel : savoir séparer ce qui est universel et qui relève de la démarche philosophique, anthropologique et métaphysique, de ce qui est particulier et qui reflète un horizon spécifique, qui ne manque pas, même dans l'abîme, de toucher et de dialoguer intimement avec le mystère qui nous rend humains.
11:38 Publié dans Littérature, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lucian blaga, philosophie, littérature, littérature roumaine, lettres, lettres roumaines, roumanie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 28 février 2022
Souvenir de Giorgio Locchi, qui a pressenti le "mal américain" avant les autres
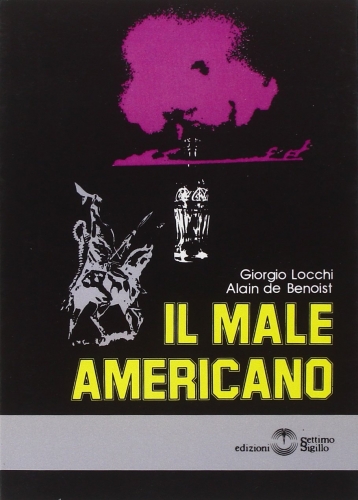
Souvenir de Giorgio Locchi, qui a pressenti le "mal américain" avant les autres
par Antonio Pannullo
Ex : http://www.secoloditalia.it
Giorgio Locchi est décédé à Paris, où il vivait depuis les années 50, le 25 octobre 1992. Aujourd'hui, Giorgio Locchi, journaliste, essayiste et écrivain, n'est plus très connu en Italie, surtout des jeunes, mais il est l'un des penseurs qui ont eu le plus d'impact sur la communauté anticommuniste européenne (il n'aimait pas le terme "droite") à partir des années 1970. On sait peu de choses de sa vie privée, et ce que l'on sait, on le doit à la fréquentation systématique de ses "disciples" italiens, des jeunes hommes issus du mouvement missiniste (MSI) des années 1970. Ces jeunes hommes, enflammés par le feu sacré de la politique et le désir de changer ce monde, se rendent à Paris, à Saint-Cloud, où Locchi vit et gagne sa vie comme correspondant du quotidien romain Il Tempo. Parmi ces jeunes hommes, nous nous souvenons certainement de Gennaro Malgieri, Giuseppe Del Ninno, Mario Trubiano, Marco Tarchi et d'autres. Quoi qu'il en soit, bien que méconnu en Italie, Giorgio Locchi a été en quelque sorte le "père noble" des grands bouleversements culturels européens dans la mouvance de la droite (nous n'écrivons le mot "droite" que par convention), lorsque de ce néofascisme missiniste pur est née la dimension culturelle, incarnée par une Nouvelle Droite, comme on l'a appelée en fait plus tard. Cette Nouvelle Droite regardait au-delà du régime fasciste mais pensait plutôt au potentiel, partiellement mis en pratique, de cette philosophie et doctrine européiste et anti-égalitaire, bien que modernisatrice, qui aurait encore beaucoup à dire et à donner à notre civilisation quelque peu décadente (pour être généreux). Ensuite, la figure de Giorgio Locchi a été révélée en France, mais grâce aux Italiens, comme le rappelle Del Ninno. Locchi était l'un des fondateurs du G.R.E.C.E., le Groupement de recherche et d'études pour la civilisation européenne, créé en 1968 notamment avec Alain de Benoist, un intellectuel et journaliste français bien connu, qui était avec Locchi dès le début, même si de Benoist était plus jeune.

Giorgio Locchi a vécu à Paris pendant de nombreuses années. Il est toutefois né à Rome en 1923, sa famille avait des liens avec le monde du cinéma et du doublage, il était lui-même un ami de la famille de Sergio Leone ; il a fait ses études à l'école classique nazaréenne où, bien que totalement non-catholique, il a gardé son estime et sa gratitude pour les pères piaristes, qui ont toujours respecté sa liberté de pensée et qui lui ont toujours garanti une autonomie maximale de jugement et de critique. Il a poursuivi ses études, notamment en germanistique, musique, sciences politiques, mais surtout en civilisation indo-européenne, sujet sur lequel il nous a laissé un livre et de nombreux écrits.
Les jeunes du Fronte della Gioventù et du MSI des années 1970 et 1980 ont été littéralement foudroyés par son livre Il male americano (Lede editrice), dans lequel Locchi prédisait tout ce qui ne devait pas arriver mais qui nous arrive encore. Pour Locchi, le fait d'avoir été vaincu par une guerre dévastatrice n'annihile pas les idées qui ont conduit à cette guerre. Ils survivent sous les formes et les nuances les plus disparates. Après la création du G.R.E.C.E., que nous appellerions aujourd'hui un think tank, la Nouvelle Droite a commencé à se faire un nom non seulement en France et en Italie, mais dans toute l'Europe occidentale. Et en parlant d'Europe, Locchi voulait se rendre à Berlin à l'époque de la réunification allemande. À partir de ce moment, la signature de Locchi, qui utilisait également le pseudonyme Hans-Jürgen Nigra, a commencé à apparaître dans des magazines proches de la Nouvelle Droite, tels que Nouvelle Ecole, Eléments, Intervento, la Destra, l'Uomo libero et bien sûr notre quotidien Secolo d'Italia. Entre-temps, il a fourni de précieuses informations aux lecteurs italiens avec une superbe correspondance sur les événements en Algérie, sur les Français de 68, et aussi sur la naissance de l'existentialisme.
Comme l'a clairement écrit Gennaro Malgieri dans son admirable hommage à Giorgio Locchi (1923-1992) dans Synergies européennes en février 1993 (ndt: dans la revue Vouloir, pour être exact), les idées de Locchi étaient en fait les idées d'une Europe qui n'existe plus, mais ce n'était pas une raison pour ne pas en défendre ou en illustrer les principes. Ces idées portent sur cette Europe éternelle à laquelle l'Europe économique de notre période d'après-guerre ne ressemble en rien. Par exemple, note encore Malgieri, l'attitude de Locchi à l'égard du fascisme n'est pas une simple nostalgie ou une protestation, mais il a recueilli dans le ferment culturel de cette époque et de cette expérience toutes les idées et initiatives qui n'étaient pas et ne sont pas obsolètes. "Il nous a fait part de ses réflexions à ce sujet dans son ouvrage intitulé L'essence du fascisme (Il Tridente, 1981). Il fait référence à la vision du monde qui a inspiré le fascisme historique, mais qui n'a pas disparu avec la défaite de ce dernier. Ce livre est encore un prodigieux "discours de vérité" au sens grec du terme, qui cherche à écarter du fascisme toutes les explications fragmentaires qui sont faites actuellement et toutes les formes de diabolisation visant à générer des préjugés". Giorgio Locchi a également écrit un livre sur le "mythe surhumaniste".
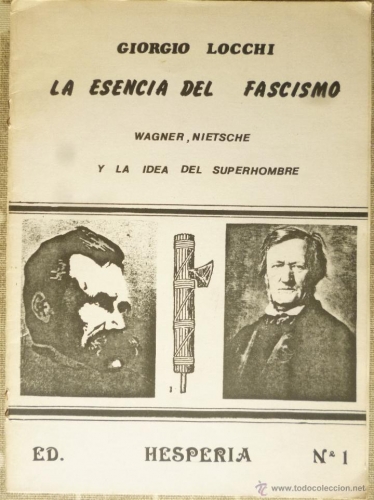
Dans son enquête, Locchi affirme qu'il n'est pas possible de comprendre le fascisme si l'on ne réalise pas qu'il est la première manifestation politique d'un phénomène spirituel plus large, dont il fait remonter les origines à la seconde moitié du XIXe siècle et qu'il appelle "surhumanisme". Les pôles de ce phénomène, qui ressemble à un énorme champ magnétique, sont Richard Wagner et Friedrich Nietzsche qui, à travers leurs œuvres, ont mélangé le nouveau principe et l'ont introduit dans la culture européenne à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Sur ce, Locchi a écrit le livre Wagner, Nietzsche et le mythe surhumaniste (éditions Akropolis), difficile mais extrêmement lucide, qui a eu les éloges du critique musical Paolo Isotta dans les colonnes du Corriere della Sera.
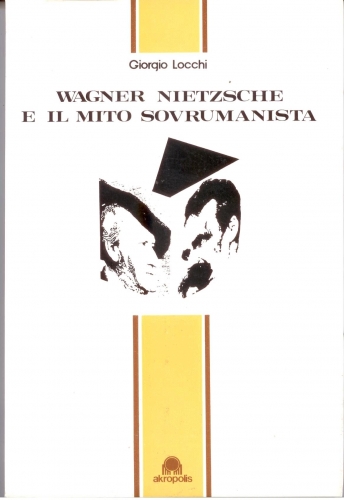

Locchi nous a laissé des livres peu nombreux mais importants. Sa vie témoigne d'un engagement cohérent, profond et crucial, qu'il serait bon d'explorer davantage aujourd'hui. Il y a quelques années, Francesco Germinario lui a consacré un livre, Tradizione, Mito e Storia (éditions Carocci), dans lequel l'auteur définit les caractéristiques de la droite radicale, en s'attardant sur ses exposants les plus significatifs. Il y a deux ans, au siège romain de Casapound, s'est tenue une conférence sur Giorgio Locchi en présence de son fils Pierluigi et d'Enzo Cipriano, également ami et disciple de Locchi depuis des années.

16:53 Publié dans Hommages, Nouvelle Droite, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : giorgio locchi, nouvelle droite, philosophie, hommage |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 26 février 2022
Katechon et Antikeimenos, la bataille géopolitique et spirituelle

Katechon et Antikeimenos, la bataille géopolitique et spirituelle
Lorenzo Maria Pacini
Source: https://www.geopolitica.ru/it/article/katechon-e-antikeimenos-la-battaglia-geopolitica-dello-spirito
Il ne s'agit pas d'une guerre qui a commencé en Ukraine il y a quelques heures, ni d'une vicissitude parmi d'autres vicissitudes entre deux nations qui sont déjà en conflit depuis des années. Nous assistons à un affrontement plus général entre deux visions du monde: d'une part, la vision postmoderne, techno-fluide, de l'empire matériel, de la démocratie importée à coup de bombes, des droits de l'homme et des révolutions de couleur qui se révèlent tyrannie, de big tech et de big pharma, de la destruction des identités et de l'assujettissement des masses aux élites du pouvoir oligarchique, soit le Great Reset ; d'autre part, la vision qui affirme l'autodétermination, la liberté, les identités de chaque peuple, la Tradition, les droits fondés sur l'ontologie, l'indépendance financière et la politique visant le bien commun, le Grand Réveil. Il s'agit d'un affrontement apocalyptique, intrinsèquement eschatologique, et ne pas comprendre la portée métaphysique de cette bataille revient à ignorer le cœur de ce qui est là, devant nous, en train de se passer.
Il ne s'agit pas, répétons-le, d'une guerre de simples intérêts, avec d'un côté l'Occident atlantiste qui tente, comme il l'a toujours fait, d'étendre son empire et d'écraser les peuples libres, actuellement représentés par la Russie en tant que leader d'un petit reste dans le monde ; nous ne sommes pas non plus simplement confrontés à deux visions politiques, l'une de la tyrannie libérale et l'autre du national-socialisme démocratique ; nous nous trouvons à un carrefour évolutif pour l'ensemble de l'humanité, une étape qui marque déjà une prise de position et un profond discernement entre ceux qui soutiennent et alimentent l'involution de la grande réinitialisation mondialiste et ceux qui, au contraire, sont les pionniers d'un monde nouveau qui jaillira de l'éveil global des consciences.

La confusion méphistophélique avec laquelle on communique sur ce qui se passe est si grande qu'elle laisse désorienté, mais cela aussi est utile, car seuls les esprits les plus fins parviennent à passer à travers les mailles de ce filet qui sépare l'ivraie du bon grain. C'est plutôt avec le cœur qu'il faut décider quel côté prendre, car ce n'est qu'à travers le cœur que le monde peut changer.

La Russie est actuellement le rempart contre l'hégémonie de l'Occident perverti, qui a trahi ses origines, sa Foi, qui a subjugué la majorité du monde par la violence, les guerres ouvertes et secrètes, la colonisation culturelle et militaire. Avec les autres États qui n'ont plié devant aucun maître politique et qui ont préservé leur identité et leur tradition, il existe une lumière venue d'Orient qui, dans l'effondrement de la dualité de ce monde, agit comme un contrepoids dans l'histoire et nous demande de choisir un camp. Ex oriente lux, disaient les anciens, et c'est précisément ce salut préconçu que nous pouvons reconnaître allégoriquement dans ce moment tragique.
Soyons clairs : la guerre n'est pas le moyen de faire la paix. Pas de guerre, d'aucune sorte. La guerre est un acte qui ne peut engendrer autre chose que la guerre, avant ou après, appelant la vengeance dans le sang même des peuples qui la font et qui la subissent. Ce n'est pas en alimentant davantage cette gigantesque monstruosité que le monde changera, quel que soit le camp dans lequel on décide de se placer. Ce que nous nourrissons vit, donc si nous continuons à nous faire la guerre, le monde ne peut être que guerre.
Or, c'est précisément par le biais de conflits à l'échelle mondiale que, selon les récits eschatologiques des différentes religions, s'établit d'abord le règne du Mal, puis triomphe le règne du Bien ; ce n'est que par l'effondrement total de ce monde tel que nous l'avons construit qu'il sera possible d'en bâtir un nouveau.
Tout ce qui a été prédit doit s'accomplir, c'est pourquoi nous sommes au milieu d'un conflit d'époque, inévitable pour le passage entre deux époques et deux mondes comme celui que nous traversons. C'est la bataille des Katechon contre les Antikeimenos (leurs adversaires qui s'exaltent et se révèlent "accélérationnistes" et eschtologistes, ndt), et les destins sont déjà écrits dans l'un ou l'autre camp.
19:32 Publié dans Philosophie, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : katechon, religion, théologie, théologie politique, tradition, traditionalisme, philosophie, antikeimenos |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 24 février 2022
La privatisation de la vie et les caprices des consommateurs sont appelés droits civils

La privatisation de la vie et les caprices des consommateurs sont appelés "droits civils"
Diego Fusaro
Source: http://adaraga.com/la-privatizacion-de-la-vida-y-los-caprichos-del-consumidor-se-llaman-derechos-civiles/
La pratique de l'agression menée par le suzerain financier contre le serf en retraite trouve son moment fondamental dans la reconfiguration des droits en tant que marchandises disponibles selon la valeur d'échange.
Alors que les droits étaient autrefois garantis inconditionnellement à chaque membre de la communauté en tant que tel (c'est-à-dire en tant que porteur libre et égal de droits et de devoirs liés à la citoyenneté), ils tendent aujourd'hui de plus en plus à devenir, comme les autres marchandises de la sphère de circulation, des biens achetables et donc dépendants de l'équivalent général et abstrait de la monnaie.
Les figures interconnectées de la citoyenneté et du citoyen, articulées avec l'éthique de l'État-nation souverain, sont désormais éclipsées. Et, conformément à la redéfinition de la société dans son ensemble comme un "système de besoins", ils tendent à être remplacés par les nouveaux profils du client et de la consommation, avec la centralité de la "marchandisation de la citoyenneté", de la forme marchandise et de la valeur d'échange différemment distribuée.
Dans la terminologie de l'essai marxien De la question juive (1843), le profil du bourgeois, de l'individu privatisé qui construit ses relations sur la base du théorème de l'"insupportable sociabilité" (ou, en termes hégéliens, de la "dépendance omnilatérale"), a été globalisé, non pas le profil du citoyen, qui est éclipsé, mais celui du bourgeois. Selon les termes de Das Kapital, "l'indépendance des hommes les uns par rapport aux autres est intégrée dans un système de dépendance omnilatérale imposé aux choses", au sommet de la réification.
C'est, comme on le sait, la socialité compétitive que, de la "main invisible" d'Adam Smith à la "sociabilité insupportable" de Kant en passant par les Dix-huit leçons sur la société industrielle de Raymond Aron (1955-1956), le système planétarisé des besoins promeut dans l'acte même de délégitimer les autres.
Selon les termes de la quatrième thèse de l'Idée d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolite de Kant (1784), "le moyen que la nature utilise pour amener le développement de toutes ses dispositions est son antagonisme dans la société, dans la mesure où cet antagonisme est finalement la cause d'un ordre civil de la société elle-même".
L'harmonie sociale de l'"ordre civil" est ainsi admise et reconnue comme le telos ultime : et, en même temps, on célèbre le chemin qui devrait mener (et qui a historiquement mené) au résultat opposé, à ce nouveau bellum omnium contra omnes planétaire, qui est l'antithèse de l'harmonie sociale.
Cela conduit à ce que Hegel appelle la "perte d'éthicité" (Sittlichkeit) : à ce niveau, la société civile se présente comme le "monde phénoménal de l'éthique". En fait, l'universel éthique n'existe que sous une forme apparente, le particularisme de l'intérêt individuel dé-éthique prévalant et se rapportant à tous les autres intérêts sous la forme d'une dépendance omnilatérale au système d'échange du marché.
La connectivité totale de l'insociable sociabilité est telle que tous, pour ne pas succomber, doivent se soumettre à la lex du libre-échange, qu'ils soient ou non motivés par l'appât du gain.
Célébrés d'un coup de chéquier par la même classe qui travaille avec zèle au démantèlement des droits sociaux et du travail, les soi-disant "droits civils" coïncident aujourd'hui presque entièrement avec les droits du bourgeois ou, plutôt, du consommateur : ce sont des droits sous forme de marchandises, disponibles dans l'abstrait pour tous et dans la pratique seulement pour ceux qui peuvent les payer.
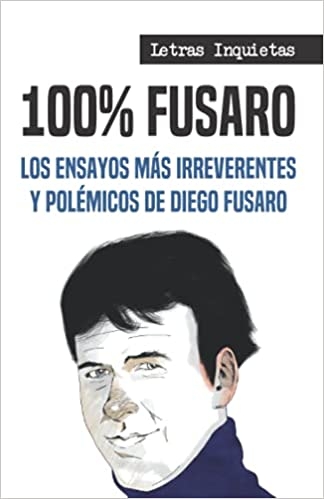
Diego Fusaro : 100% Fusaro, Les essais les plus irrévérencieux et polémiques de Diego Fusaro. Letras Inquietas (juillet 2021).
Pour commander le livre: https://www.amazon.com/100-Fusaro-irreverentes-pol%C3%A9micos-Inquietas/dp/B098WHPB64
16:25 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : diego fusaro, philosophie, philosophie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook