 Ex: http://rezistant.blogspot.com/
Ex: http://rezistant.blogspot.com/samedi, 06 février 2010
Das Wesen der Aufklärung
Das Wesen der Aufklärung
[...]
Und selbst die Moral, dieses Urgebiet der Freiheit, soll ein "Gesetz" der Freiheit finden, das moralische Gesetz in mir, in Parallele zu dem Gesetz der Himmelsmechanik, dem gestirnten Himmel über mir, das Gesetz: allgemeingültig zu handeln, wie Kants kategorischer Imperativ es fordert.
Dieses Gesetzesdenken will etwas. Alle Aufklärung ist zweckhaft. Es will herrschen. Erkenntnis ist nicht mehr Staunen und Betroffensein vom Seienden und seiner Fülle, wie es die griechische "Theorie" gewesen war, ujnd wie sie das gesamte abendländische Denken bisher vertreten hatte. Das aufgeklärte Wissen will rechnen ujnd darin absehen von allen qualitativen Gehalten, die man ja nicht errechnen kann. Es will nicht mehr Substanz, es will Funktion, Regel, Verbindung immer gleichen Geschehens, das man in Quantität, in Zahl und mathematischer Formel ausdrücken kann. Und es will - so sagt Kant äusserst charakteristisch - der Natur als der uns Menschen erkennbaren Erscheinungswelt ihre Gesetze, ihre Regelhaftigkeit in Gemässheit unseres Denkens über sie "vorschreiben". Es will verfügen, gebieten, ordnen und verwerten. Es will herrschen gemäss dem praktischen Sinn aller Aufklärung: es will die Welt gestalten gemäss der Einsicht in ihre Gesetzlichkeit. Und eben da schlägt die Geburtsstunde unserer modernen Technik. Sie ist das legitime Kind der Aufklärung, ihr Erbe an das 19. Jahrhundert und nicht zuletzt auch uns selbst. Verwertung der Naturgesetze zur Lebensgestaltung: das ist der Wille der aufgeklärten Wissenschaft von der Natur.
Theodor Steinbüchel, Zerfall des christlichen Ethos im XIX. Jahrhundert. Josef Knecht, Frankfurt am Main 1951.
00:10 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, 18ème siècle, lumières |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 05 février 2010
Le bourgeois selon Sombart
 Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1979
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1979
Le bourgeois selon Sombart
par Guillaume Faye
Dans Le Bourgeois, paru en France pour la première fois en 1926, Werner Sombart, une des figures les plus marquantes de l'école économique "historique" allemande, analyse la bourgeoisie comme l'effet d'une rencontre entre un phénomène de "psychologie historique" et des faits proprement économiques. Cette analyse le sépare de la pensée libérale comme des idées marxistes.
Comme pour Groethuysen, le bourgeois représente d'après Sombart, "l'homme de notre temps". "Le bourgeois", écrit-il, représente la forme la plus typique de l'esprit de notre temps". Le bourgeois n'est pas seulement un type économique, mais "un type social et psychologique".
Sombart accorde au bourgeois l'"esprit d'entreprise"; et c'est, effectivement, de notre point de vue, une de ses caractéristiques jusqu'au milieu du XXème siècle. Mais Sombart prophétise qu'à la fin du XXème siècle, la bourgeoisie, largement "fonctionnarisée" et créatrice de l'Etat-Providence aura perdu cet esprit d'entreprise au profit de la "mentalité du rentier".
Cependant, elle a conservé ce que décelait Sombart à l'origine de sa puissance: "la passion de l'or et l'amour de l'argent ainsi que l'esprit de calcul", comme le note également d'ailleurs Gehlen.
"Il semblerait, écrit Sombart, que l'âpreté au gain (lucri rabies) ait fait sa première apparition dans les rangs du clergé. Le bourgeois en héritera directement".
Sombart, décelant le "démarrage" de l'esprit bourgeois au Moyen Age, en relève une spécificité fondamentale: l'esprit d'épargne et de rationalité économique (1), caractère qui n'est pas critiquable en soi, à notre avis, mais qui le devient dès lors que, comme de nos jours, il est imposé comme norme à toutes les activités de la société (réductionnisme).
Il ne faut donc pas soutenir que l'esprit bourgeois ne fait pas partie de notre tradition culturelle; de même, Sombart remarque que le mythe de l'or était présent dans les Eddas et que les peuples européens ont toujours été attachés à la "possession des richesses" comme "symboles de puissance".
Dans notre analyse "antibourgeoise" de la civilisation contemporaine, ce n'est pas cet esprit économique que nous critiquons "en soi", c'est sa généralisation. De même l'appât des richesses ne peut être honni "dans l'absolu", mais seulement lorsqu'il ne sert qu'à l'esprit de consommation et de jouissance passive.
Au contraire, le goût de la richesse (cf. les mythes européens du "Trésor à conquérir ou à trouver"), lorsqu'il se conjugue avec une volonté de puissance et une entreprise de domination des éléments s'inscrit dans nos traditions ancestrales.
La figure mythique -ou idéaltypique- de l'Harpagon de Molière définit admirablement cette "réduction de tous les points de vues à la possession et au gain", caractéristiques de l'esprit bourgeois.
Pour Sombart, le "bourgeois vieux style" est caractérisé entre autres par l'amour du travail et la confiance dans la technique. Le bourgeois "moderne" est devenu décadent: le style de vie l'emporte sur le travail et l'esprit de bien-être et de consommation sur le sens de l'action. En utilisant les "catégories" de W. Sombart, nous pourrions dire, d'un point de vue anti-réductionniste, que nous nous opposons au "bourgeois en tant que tel" et que nous admettons le "bourgeois entrepreneur" qui doit avoir sa place organique (3ème fonction) dans les "communautés de mentalité et de tradition européennes", comme les nomme Sombart.
L'entrepreneur est "l'artiste" et le "guerrier" de la troisième fonction. Il doit posséder des qualités de volonté et de perspicacité; c'est malheureusement ce type de "bourgeois" que l'univers psychologique de notre société rejette. Par contre, le "bourgeois en tant que tel" de Sombart correspond bien à ce que nous nommons le bourgeoisisme -c'est-à-dire la systématisation dans la société contemporaine de traits de comportements qualifiés par W. Sombart d'"économiques" par opposition aux attitudes "érotiques". Sombart veut dire par là que la "principale valeur de la vie" est, chez le bourgeois, d'en profiter matériellement, de manière "économique". La vie est assimilée à un bien consommable dont les "parties", les unités, sont les phases de temps successives. Le temps "bourgeois" est, on le voit, linéaire, et donc consommable. Il ne faut pas le "perdre"; il faut en retirer le maximum d'avantages matériels.
Par opposition, la conception érotique de la vie -au sens étymologique- ne considère pas celle-ci comme un bien économique rare à ne pas gaspiller. L'esprit "aristocratique" reste, pour Sombart, "érotique" parce qu'il ne calcule pas le profit à tirer de son existence. Il donne, il se donne, selon une démarche amoureuse. "Vivre pour l'économie, c'est épargner; vivre pour l'amour, c'est dépenser", écrit Sombart. On pourrait dire, en reprenant les concepts de Sombart, que le "bourgeoisisme" serait la perte, dans la bourgeoisie, de la composante constituée par l'esprit d'entrepreneur; seul reste "l'esprit bourgeois proprement dit".
Au début du siècle par contre, Sombart décèle comme "esprit capitaliste" l'addition de ces deux composantes: esprit bourgeois et esprit d'entreprise.
L'esprit bourgeois, livré à lui-même, systématisé et massifié, autrement dit le bourgeoisisme contemporain, peut répondre à cette description de Sombart: "Type d'homme fermé (...) qui ne s'attache qu'aux valeurs objectives de ce qu'il peut posséder, de ce qui est utile, de ce qu'il thésaurise. Grégaire et accumulateur, le bourgeois s'oppose à la mentalité seigneuriale, qui dépense, jouit, combat. (...) Le Seigneur est esthète, le bourgeois moraliste".
 Sombart, opposant la mentalité aristocratique à l'esprit "bourgeois proprement dit" (c'est-à-dire dénué de la composante de l'esprit d'entreprise), note: "Les uns chantent et résonnent, les autres n'ont aucune résonnance; les uns sont resplendissants de couleurs, les autres totalement incolores. Et cette opposition s'applique non seulement aux deux tempéraments comme tels, mais aussi à chacune des manifestations de l'un et de l'autre. Les uns sont artistes (par leur prédispositions, mais non nécessairement par leur profession), les autres fonctionnaires, les uns sont faits de soie, les autres de laine". Ces traits de "bourgeoisime" ne caractérisent plus aujourd'hui une classe (car il n'y a plus de classe bourgeoise) mais la société toute entière. Nous vivons à l'ère du consensus bourgeois.
Sombart, opposant la mentalité aristocratique à l'esprit "bourgeois proprement dit" (c'est-à-dire dénué de la composante de l'esprit d'entreprise), note: "Les uns chantent et résonnent, les autres n'ont aucune résonnance; les uns sont resplendissants de couleurs, les autres totalement incolores. Et cette opposition s'applique non seulement aux deux tempéraments comme tels, mais aussi à chacune des manifestations de l'un et de l'autre. Les uns sont artistes (par leur prédispositions, mais non nécessairement par leur profession), les autres fonctionnaires, les uns sont faits de soie, les autres de laine". Ces traits de "bourgeoisime" ne caractérisent plus aujourd'hui une classe (car il n'y a plus de classe bourgeoise) mais la société toute entière. Nous vivons à l'ère du consensus bourgeois.
Avec un trait de génie, Werner Sombart prédit cette décadence de la bourgeoisie qui est aussi son apogée; décadence provoquée, entre autres causes, par la fin de l'esprit d'entreprise, mais également par cet esprit de "bien-être matériel" qui asservit et domestique les Cultures comme l'ont vu, après Sombart, K. Lorenz et A. Gehlen. Le génie de Sombart aura été de prévoir le phénomène en un temps où il était peu visible encore.
Le Bourgeois, livre remarquable, devenu grand classique de la sociologie contemporaine, se conclut par cet avertissement, dont les dernières lignes décrivent parfaitement une de nos principales ambitions: "Ce qui a toujours été fatal à l'esprit d'entreprise, sans lequel l'esprit capitaliste ne peut se maintenir, c'est l'enlisement dans la vie de rentier, ou l'adoption d'allures seigneuriales. Le bourgeois engraisse à mesure qu'il s'enrichit et il s'habitue à jouir de ses richesses sous la forme de rentes, en même temps qu'il s'adonne au luxe et croit de bon ton de mener une vie de gentilhomme campagnard (...).
Mais un autre danger menace encore l'esprit capitaliste de nos jours: c'est la bureaucratisation croissante de nos entreprises. Ce que le rentier garde encore de l'esprit capitaliste est supprimé par la bureaucratie. Car dans une industrie gigantesque, fondée sur l'organisation bureaucratique, sur la mécanisation non seulement du rationalisme économique, mais aussi de l'esprit d'entreprise, il ne reste que peu de place pour l'esprit capitaliste.
La question de savoir ce qui arrivera le jour où l'esprit capitaliste aura perdu le degré de tension qu'il présente aujourd'hui, ne nous intéresse pas ici. Le géant, devenu aveugle, sera peut-être condamné à traîner le char de la civilisation démocratique. Peut-être assisterons-nous aussi au crépuscule des dieux et l'or sera-t-il rejeté dans les eaux du Rhin.
"Qui saurait le dire?"
Guillaume FAYE.
(janvier-février 1979).
(1) La vie aristocratique et seigneuriale était plus orientée vers la "dépense".
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, sociologie, théorie politique, politologie, sciences politiques, nouvelle droite, économie, révolution conservatrice, allemagne, weimar, années 20, années 30 |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 04 février 2010
Zum 150. Todestag von Ernst Moritz Arndt
 Karlheinz Weissmann:
Karlheinz Weissmann:
Arndt, Diwald, der Patriot schlechtin
Zum 150. Todestag von Ernst Moritz Arndt
Am 27. Januar 1970 hielt Hellmut Diwald vor der Siemens-Stiftung in München einen Vortrag über Ernst Moritz Arndt. Das Datum lag kurz vor dessen 110. Todestag, einen Monat nach dessen 200. Geburtstag. Das Gedenken war dürftig gewesen, der neue Zeitgeist duldete keinen Bezug auf jemanden, der im Ruch des Nationalisten und Antisemiten stand.
Diwald wußte das genau und also auch, daß er mit seinem Thema und der Art der Darstellung ein Tabu brach, ein junges Tabu zwar, aber eines, das rasch, geschickt und mit erheblicher Wirkung etabliert worden war: das Tabu, sich anders als negativ über die deutsche Nationalgeschichte zu äußern.
Diwald, der zu dem Zeitpunkt politisch noch ein unbeschriebenes Blatt war, wollte gegen dieses Tabu verstoßen. Sein Vortrag entwickelte das Thema unter dem Gesichtspunkt der Rolle Arndts für das „Entstehen des deutschen Nationalbewußtseins“. Damit war die Absicht verbunden, ältere wie jüngere Verzeichnungen zu korrigieren. Arndt erschien bei Diwald nicht als Teutomane, sondern als jemand, der um den Anteil am Gemachten jeder Nation wußte, der nicht naiv an das Organische glaubte, sondern von der Notwendigkeit überzeugt war, die Nation zu erziehen und zu mobilisieren, der kaum etwas hielt von der selbstverständlichen Güte des einfachen Mannes, aber Respekt vor dem Volk hatte, und insoweit Demokrat war, aber nicht der Jakobiner, zu dem ihn Metternich im Negativen, die DDR im Positiven machen wollten, keinesfalls ein Reaktionär, obwohl er der monarchischen Idee anhing, eher ein konservativer Revolutionär im präzisen Sinn: „Die Schwächlichen und Elendigen fliehen zu dem Alten zurück, wo ihrer Furcht vor dem Neuen graut.“
Diwald wollte der Persönlichkeit Arndts Gerechtigkeit widerfahren lassen, sie in den historischen Zusammenhang einordnen, des Spätabsolutismus und der Französischen Revolution, des Idealismus, der Romantik, der „Deutschen Bewegung“, der Befreiungskriege und des Vormärz. Das persönliche – auch das in Teilen schwere – Schicksal Arndts trat dagegen zurück, und Diwald setzte die Akzente so, daß selbst Arndts übel beleumdete Schrift Über den Volkshaß ihren Sitz im Leben erhielt, die ganz abgeblaßte Lage Deutschlands unter dem napoleonischen Joch wieder hervortrat.
Diwald war aber nicht nur als Historiker interessiert. Er schloß seinen Vortrag mit den Worten: „Wir haben später diesen `deutschen Lehrer, Schreiber, Sänger und Sprecher´ nicht bei seinen lorbeerbekränzten, adagio handelnden, sich mit der Obrigkeit arrangierenden Zeitgenossen, unseren Olympiern, einziehen lassen. Das wäre ungerecht gewesen, eine Kränkung Ernst Moritz Arndts, denn gerade ihm ist die gleichgültige Reverenz nicht zuzumuten, mit der wir schon so lange die herausragenden Figuren unserer Geschichte sterilisieren und festgerahmt an die Wände der Museen hängen.“
Es lag darin Bewunderung für ein konsequentes Leben, wenn auch wohl keine Prognose für das eigene Schicksal, obwohl man sagen könnte, daß die Erfahrungen, die Diwald in den folgenden Jahren machen mußte, denen Arndts ähnelten. Und ihn erwartete nicht einmal der Trost, den das Alter für Arndt bereitgehalten hatte, nur dasselbe Bewußtsein, dem inneren Gesetz Genüge getan zu haben.
Abbildung: Umschlag eines Reprints aus dem DDR-Verlag der Nation, 1988!
Article printed from Sezession im Netz: http://www.sezession.de
URL to article: http://www.sezession.de/11446/arndt-diwald-der-patriot-schlechthin.html
00:10 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, patriotisme, nationalisme, allemagne, nationalisme allemand, 19ème siècle, histoire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 31 janvier 2010
Citation de Gustave Le Bon

On rencontre beaucoup d’hommes parlant de libertés, mais on en voit très peu dont la vie n’ait pas été principalement consacrée à se forger des chaînes.
00:10 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, citation, sociologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Quelle philosophie politique de l'écologie?

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1990
Robert STEUCKERS
Quelle philosophie politique de l'écologie?
Les bons scores des Verts français à la suite des dernières campagnes électorales dans l'Hexagone, la persistance des Grünen ouest-allemands et les sondages favorables aux listes écologistes en Belgique pour les prochaines élections (12% à Bruxelles!) obligent tous les militants politiques, de quelque horizon qu'ils soient, à développer un discours écologique cohérent. En effet, pour la décennie qui vient, pour les premières décennies du XXIième siècle, se dessine une nouvelle bipolarité entre, d'une part, les nationaux-identitaires, animés par une forte conscience historique, et, d'autre part, les Verts, soucieux de préserver le plus harmonieusement possible le cadre de vie de nos peuples. Cette bipolarisation est appelée à refouler graduellement dans la marginalité les anciennes polarisations entre partisans du laissez-faire libéral et partisans de l'Etat-Providence. C'est en tout cas ce qu'observe un professeur américain, Peter Drucker (1), dont la voix exprime des positions quasi officielles. Toutes les formes de libéralisme, malgré le sursaut tapageur des années Reagan, sont appelées à disparaître en ne laissant que les traces de leurs ravages moraux et sociaux; en effet, les impératifs de l'heure sont des impératifs globaux de préservation: préserver une conscience historique et préserver un cadre de vie concret contre les fantasmes de la «table rase» et contre le messianisme qui promet, avec un sourire vulgairement commercial, des lendemains qui chantent. Ces impératifs exigent des mobilisations collectives; dès lors, beaucoup de réflexes ne seront plus de mise, notamment l'engouement dissolvant pour l'individualisme méthodologique, propre du libéralisme, avec sa sainte horreur des obligations collectives structurantes qui, elles, parient sur le très long terme et ne veulent pas se laisser distraire par les séductions de l'instant (le «présentisme» des sociologues).
Le libéralisme politique et économique a engendré la mentalité marchande. C'est un fait. Même si d'aucuns, dans des clubs agités par une hayekite aigüe, croient pouvoir prouver que les choses auraient pu tourner autrement. On connaît le bon mot: avec des "si", on met Paris en bouteille. L'histoire est là qui montre l'involution lente mais sûre du libéralisme théorique d'Adam Smith à la déliquescence sociale totale que l'on observe chez les hooligans de Manchester ou de Liverpool, chez les consommateurs de crack du Bronx ou dans la déchéance ensoleillée et sidaïque de San Francisco. Le fantasme libéral de la perfectibilité infinie (2), qu'on lira à l'état pur chez un Condorcet, a induit les peuples à foncer bille en tête vers les promesses les plus fumeuses, dans une quête forcenée de plaisirs éphémères, de petits paradis d'inaction et de démobilisation. La jouissance hédoniste de l'instant est ainsi devenue le telos (le but) des masses, tandis que les gagneurs, plus puritains, tablaient sur la rentabilité immédiate de leurs investissements. Jouissance et rentabilité immédiates impliquent deux victimes: l'histoire (le temps), qui est oubliée et refoulée, et l'environnement (l'espace), qui est négligé et saccagé, alors que ce sont deux catégories incontournables dans toute société solidement assise, deux catégories qui résistent pied à pied aux fantasmes du «tout est possible - tout est permis» et qu'il sera toujours impossible de faire disparaître totalement.
Ce résultat navrant du libéralisme pratique, de cette vision du monde mécanique (qui a le simplisme extrême des mécaniques) et de ces suppléments d'âme moralisants (participant d'une morale auto-justificatrice, d'une morale-masque qui cache l'envie intempérante de tout avoir et tout maîtriser), nous force à adopter
1) une philosophie qui tienne compte du long terme, tout en préservant
a) les ressources de la mémoire historique, laquelle est un réceptacle de réponses acquises et concrètes aux défis du monde, et
b) les potentialités de l'environnement, portion d'espace à maintenir en bon état de fonctionnement pour les générations futures;
2) une pratique politique qui exclut les discours moralisants et manipulateurs, discours gratuits et a fortiori désincarnés, blabla phatique qui distrait et endort les énergies vitales.
Enfin, l'état du monde actuel et la bipolarisation en train de s'installer nous obligent à déployer une stratégie précise qui empêchera 1) les rescapés du bourgeoisisme libéral d'investir le camp des «identitaires historicisés» et 2) les rescapés de l'égalitarisme caricatural des vieilles gauches, vectrices de ressentiments, d'investir le camp des «identitaires éco-conscients». Cette stratégie peut paraître présomptueuse: comment, concrètement, réaliser un double travail de ce type et, surtout, comment affermir une stratégie en apparence aussi détachée des combats quotidiens, aussi régalienne parce que non partisane et non manichéenne, aussi réconciliatrice de contraires apparemment irréconciliables? Les traditions gramsciennes et la métapolitique nous ont enseigné une chose: ne pas craindre les théories (surtout celles qui visent la coincidentia oppositorum), être attentif aux mouvements d'idées, même les plus anodins, être patient et garder à l'esprit qu'une idée nouvelle peut mettre dix, vingt, trente ans ou plus pour trouver une traduction dans la vie quotidienne. Organiser une phalange inflexible d'individus hyper-conscients, c'est la seule recette pour pouvoir offrir à son peuple, pour le long terme, un corpus cohérent qui servira de base à un droit nouveau et une constitution nouvelle, débarrassée des scories d'un passé récent (250 ans), où se sont multipliés fantasmes et anomalies.
Une société de pensée a pour mission d'explorer minutieusement bibliothèques et corpus doctrinaux, œuvres des philosophes et des sociologues, enquêtes des historiens, pour forger, en bout de course, une idéologie cohérente, souple, prête à être comprise par de larges strates de la population et à s'inscrire dans la pratique politique quotidienne. Les idéologies qui nous ont dominés et nous dominent encore dérivent toutes d'une matrice idéologique mécaniciste, idéaliste, moralisante. Le libéralisme dérive des philosophies mécanicistes du XVIIIième siècle et de l'idéalisme moralisant et hédoniste des utilitaristes anglais. Ce bricolage idéologique libéral ne laissait aucune place à l'exploration féconde du passé: dans sa méthodologie, aucune place n'était laissée au comparatisme historicisant, soit à la volonté de se référer à la geste passée de son peuple pour apprendre à faire face aux défis du présent, à la mémoire en tant que ciment des communautés (où, dans une synergie holiste, éléments économiques, psychologiques et historiques s'imbriquent étroitement), si bien qu'un Jacques Bude (3) a pu démontrer que le libéralisme était un obscurantisme, hostile à toute investigation sociologique, à toute investigation des agrégats sociaux (considérés comme des préjugés sans valeur).
Par ailleurs, la philosophie linéaire de l'histoire que s'est annexée le libéralisme dans sa volonté de parfaire infiniment l'homme et la société, a conduit à une exploitation illimitée et irréfléchie des ressources de la planète. Pratique qui nous a conduit au seuil des catastrophes que l'on énumerera facilement: pollution de la Sibérie et de la Mer du Nord, désertification croissante des régions méditerranéennes, ravage de la forêt amazonienne, développement anarchique des grandes villes, non recyclage des déchets industriels, etc.
Le marxisme a été un socialisme non enraciné, fondé sur les méthodes de calcul d'une école libérale, l'école anglaise des Malthus et Ricardo. Il n'a pas davantage que le libéralisme exploré les réflexes hérités des peuples ni mis des limites à l'exploitation quantitative des ressources du globe. En bout de course, c'est la faillite des pratiques mécanicistes de gauche et de droite que l'on constate aujourd'hui, avec, pour plus bel exemple, les catastrophes écologiques des pays naguère soumis à la rude férule du «socialisme réel». A ce mécanicisme global, qui n'est plus philosophiquement défendable depuis près d'un siècle, se substituera progressivement un organicisme global. Les pratiques politico-juridiques, l'idéologie dominante des établissements, notamment en France et en Belgique, sont demeurées ancrées solidement dans le terreau mécaniciste. L'alternative suggérée par le mouvement flamand, appuyée par les sociologues de la Politieke Akademie créée par Victor Leemans à Louvain dans les années 30 (4), a été soit éradiquée par l'épuration de 1944-51 soit récupérée et anémiée par la démocratie-chrétienne soit refoulée par une inquisition têtue qui ne désarme toujours pas. Or cette alternative, et toute autre alternative viable, doit se déployer au départ d'une conscience solidissime de ses assises. Ces assises, quelles sont-elles? Question qu'il est légitime de poser si l'on veut prendre conscience de la généalogie de nos positions actuelles, tout comme les néo-libéraux avaient exhumé Adam Smith, Mandeville, Condorcet, Paine, Constant, etc. (5), au moment où ils se plaçaient sous les feux de la rampe, avec la complaisance béotienne de la médiacratie de droite. L'archéologie de notre pensée, qui conjugue conscience historique et conscience écologique, a ses propres chantiers:
1) Les textes de la fin du XVIIIième siècle, où on lit pour la première fois des réticences à l'endroit de la mécanicisation/détemporalisation du monde, portée par des Etats absolutistes/modernistes, conçus comme des machines entretenues par des horlogers (6). L'idéologie révolutionnaire reprendra à son compte le mécanicisme philosophico-politique des absolutismes. L'hystérie des massacres révolutionnaires, perçue comme résultat négatif du mécanicisme idéologique, induit les philosophes à re-temporaliser et re-vitaliser leur vision du politique et de l'Etat. Dans sa Critique de la faculté de juger (1790), Kant, auparavant exposant des Lumières, opère une volte-face radicale: les communautés politiques ne sont pas des systèmes d'engrenages plus ou moins complexes, mais des Naturprodukte (des produits de nature) animés et mus par une force intérieure, difficilement cernable par la raison. Le poète Schiller prendra le relais du Philosophe de Königsberg, popularisant cette nouvelle attention pour les faits de monde organiques. Dans ce Kant tardif, l'organicisme que nous défendons prend son envol. Intellectuellement, certains libéraux, cosmopolites et universalistes qui battent l'estrade du petit monde parisien depuis quelques années, se revendiquent d'un Kant d'avant 1790; le philosophe de Königsberg s'était pourtant bien rendu compte de l'impasse du mécanicisme désincarné... Remarquons, par ailleurs, qu'un Konrad Lorenz a puisé énormément de ses intuitions dans l'œuvre de Kant; or, ne l'oublions pas, il pourfend simultanément deux maux de notre temps, a) l'égalitarisme, stérilisateur des virtualités innombrables et «différenciantes» des hommes, et b) le quantitativisme, destructeur de l'écosystème. Notre axe philosophique part de la volte-face de Kant pour aboutir aux critiques organicistes très actuelles et pionnières de Konrad Lorenz et, depuis son décès, de l'épistémologie biologique de ses successeurs (Rupert Riedl, Franz Wuketits). De cette façon, nous formulons une double réponse aux défis de notre fin de siècle: 1) la nécessité de replonger dans l'histoire concrète et charnelle de nos peuples, pour ré-orienter les masses distraites par l'hédonisme et le narcissisme de la société de consommation, et 2) la nécessité de prendre les mesures qui s'imposent pour sauvegarder l'environnement, soit la Terre, la Matrice tellurique des romantiques et des écolos...
2) La révolution épistémologique du romantisme constitue, pour nous, la carrière immense et féconde, où nous puisons les innombrables facettes de nos démarches, tant dans la perspective identitaire/nationale que dans la perspective éco-consciente. C'est un ancien professeur à la faculté des Lettres de Strasbourg, Georges Gusdorf (7), qui, dans son œuvre colossale, a dévoilé au public francophone les virtualités multiples du romantisme scientifique. Pour lui, le romantisme, dans sa version allemande, est mobilisateur des énergies populaires, tandis que le romantisme français est démobilisateur, individuo-subjectif et narcissique, comme l'avaient remarqué Maurras, Lasserre et Carl Schmitt. En Allemagne, le romantisme dégage une vision de l'homme, où celui-ci est nécessairement incarné dans un peuple et dans une terre, vision qu'il baptise, à la suite de Carus (8), anthropocosmomorphisme. Gusdorf souligne l'importance capitale du Totalorganizismus de Steffens, Carus, Ritter et Oken. L'homme y est imbriqué dans le cosmos et il s'agit de restaurer sa sensibilité cosmique, oblitérée par l'intellectualisme stérile du XVIIIième. Nos corps sont des membres de la Terre. Ils sont indissociables de celle-ci. Or, comme il y a priorité ontologique du tout sur les parties, la Terre, en tant que socle et matrice, doit recevoir notre respect. Philosophie et biosophie (le mot est du philosophe suisse Troxler) se confondent. Le retour de la pensée à cet anthropocosmomorphisme, à ce nouveau plongeon dans un essentiel concret et tellurique, doit s'accompagner d'une révolution métapolitique et d'une offensive politique qui épurera le droit et les pratiques juridiques, politiques et administratives de toutes les scories stérilisantes qu'ont laissées derrière elles les idéologies schématiques du mécanicisme du XVIIIième.
3) Dans le sillage de la révolution conservatrice, le frère d'Ernst Jünger, Friedrich Georg Jünger (1898-1977), publie Die Perfektion der Technik (1939-1946), une sévère critique des mécanicismes de la philosophie occidentale depuis Descartes. En 1970, il fonde avec Max Himmelheber la revue Scheidewege qui paraîtra jusqu'en 1982. Cette œuvre constitue, elle aussi, un arsenal considérable pour critiquer le fantasme occidental du progrès infini et linéaire et dénoncer ses retombées concrètes, de plus en plus perceptibles en cette fin de siècle.
4) Enfin, dans les philosophies post-modernes, critiques à l'égard des «grands récits» de la modernité idéologique, le fantasme d'un monde meilleur au bout de l'histoire ou d'une perfectibilité infinie est définitivement rayé de l'ordre du jour (9).
Dans la sphère métapolitique, qui n'est pas «sur orbite» mais constitue l'anti-chambre de la politique, la tâche qui attend cette phalange inflexible des militants hyper-conscients, dont je viens de parler, est d'explorer systématiquement les quatre corpus énumérés ci-dessus, afin de glâner des arguments contre toutes les positions passéistes qui risqueraient de s'infiltrer dans les deux nouveaux camps politiques en formation. Traquer les reliquats de libéralisme et les schématisations d'un intégrisme religieux stupidement agressif —qui relève davantage de la psychiatrie que de la politique— traquer les idéologèmes désincarnants qui affaiblissent en ultime instance le mouvement écologique, traquer l'infiltration des réflexes dérivés de la vulgate jusqu'ici dominante: voilà les tâches à parfaire, voilà des tâches qui exigent une attention et une mobilisation constantes. Mais elles ne pourront être parfaites, que si l'on a réellement intériorisé une autre vision du monde, si l'on est intellectuellement armé pour être les premiers de demain.
Robert Steuckers,
Bruxelles, 15 août 1990.
00:05 Publié dans Ecologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, théorie politique, écologie, politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 30 janvier 2010
Manu as a weapon against egalitarianism: Nietzsche and Hindu political philosophy
Manu as a weapon against egalitarianism:
Nietzsche and Hindu political philosophyDr. Koenraad Elst
Introduction
Friedrich Nietzsche greatly preferred the ‘healthier, higher, wider world’ of the Hindu social code Mânava-Dharma-Shâstra (‘Code of Human Ethics’), also known as Manu-Smrti (‘Manu’s Classic’), to ‘the Christian sick-house and dungeon atmosphere’ (TI Improvers 3). We want to raise two questions about his eager use of this ancient text:
Firstly, a question of historical fact, viz. how correct was Nietzsche’s understanding of the text and the society it tried to regulate? The translation used by him suffers from some significant philological flaws as well as from interpretative bias, to which he added an agenda-driven reading of his own.
Secondly, to what extent did Nietzsche’s understanding of Hindu society play a role in his socio-political views? At first sight, its importance is quite limited, viz. as just an extra illustration of pre-Christian civilization favoured by him, as principally represented by Greece. Crucial pieces of Manu’s worldview, such as the centrality of a priestly Brahmin class and the notion of ritual purity, seem irrelevant to or in contradiction with Nietzsche’s essentially modern philosophical anthropology. To others he didn’t pay due attention, e.g. Manu’s respect for asceticism as a positive force in society, seemingly so in conflict with the Nietzschean contempt for ‘otherworldiness’, resonates with subtler pro-ascetic elements in Nietzsche’s conception of the Übermensch. Yet, a few specifically Indian elements did have a wider impact on his worldview, especially the notion of Chandâla (untouchable), to which however he gave an erroneous expansion unrelated to Manu.
1. What is the Manu-Smrti?
Friedrich Nietzsche greatly preferred the ‘healthier, higher, wider world’ of the Hindu social code Mânava-Dharma-Shâstra, the ‘Textbook of Human Ethics’, also known as Manu-Smrti, ‘Manu’s Classic’, to what he called ‘the Christian sick-house and dungeon atmosphere’ (TI Improvers 3). In a letter to his friend Peter Gast, he wrote:
This absolutely Aryan testimony, a priestly codex of morality based on the Vedas, of a presentation of caste and of ancient provenance – not pessimistic eventhough priestly – completes my conceptions of religion in the most remarkable manner. (KSA 14.420)
To his mind, the contrast between Manu’s classic and the Bible was so diametrical that ‘mentioning it in one breath with the Bible would be a sin against the spirit’ (AC 56). So, at first sight, he was very enthusiastic about this founding text of caste doctrine, though we shall have to qualify that impression. We want to raise two questions about his use of this ancient text, one of historical accuracy and one of the meaning Nietzsche accorded to this acknowledged source of inspiration in his view of society. But first of all, a few data about the Manu-Smrti must necessarily be stated before we can understand what role it could play in Friedrich Nietzsche’s thinking.
1.1. Manu, the patriarch
There is no indication that Nietzsche had much of an idea about who this Manu was after whom India’s ancient ethical code had been named. In Hindu tradition as related in the Veda and in the Itihâsa-Purâna literature (‘history’, comparable to Homer or to the Sagas, and ‘antiquities’, i.e. mythohistory comparable to Hesiod or the Edda), Manu was, through his numerous sons, the ancestor of all the known pre-Buddhist Indian dynasties. He himself is often described as a ‘son of Brahma’, though his full name, Manu Vaivasvata, implies that he was one of the ten surviving sons of Vivasvat, himself a son of Sûrya, the sun.
During the Flood, Manu had led a party of survivors by boat up the Gangâ to the foothills of the Himâlaya, then founded his capital in Ayodhyâ. His son Ikshvâku founded the ‘solar dynasty’ which retained the city of Ayodhyâ. Ikshvâku’s descendent Râma, hero of the Râmâyana epic, ruled there. The Buddha belonged to a minor branch of the same lineage, the Shakya clan which was so jealous of its noble ancestry that it practised the strictest endogamy. The later Gupta dynasty, presiding over India’s ‘golden age’, likewise claimed to be a branch of the solar dynasty. Another of Manu’s sons, Sudyumna, or alternatively his daughter Ilâ, founded the ‘lunar dynasty’ with capital at the Gangâ-Yamunâ confluence in Prayâga. His descendent Yayâti established himself to the west in the Saraswatî basin, present-day Haryânâ, where his five sons founded the ‘five nations’, the ethnic horizon of the Vedas.
Yayâti’s anointed heir was Puru, whose Paurava nation was to compose the Rg-Veda, the foundational collection of hymns to the gods. The Vedic age started with the Paurava king Bharata, after whom India has been named Bhâratavarsha or just Bhârat (as on India’s post stamps). In his clan, dozens of generations later, an internal quarrel developed into a full-scale war, the subject-matter of the Mahâbhârata, the ‘great (epic) of the Bhârata-s’. A key role in this war, which marked the end of the Vedic age, was played by the fighting brothers’ distant cousin Krishna, a descendent of Yayâti’s son Yadu. Yet another son of Yayâti’s, Anu, is said to be the ancestor of the Asura-worshippers, i.e. the Iranians, who were at times the enemies of the Deva-worshipping Vedic people..
So, Manu is known as the ancestor of all the Ârya people (vide §1.2), preceding all the quasi-historical events reported in Sanskrit literature. The account by Seleucid Greek ambassador Megasthenes of Hindu royal genealogy, where Manu is identified with Dionysos, times his enthronement at 6776 BC (Arrian: Indica 9.9, Pliny: Naturalis Historia 6.59, in Majumdar 1960 223 and 340), an intractable point of chronology that we must leave undecided for now.
The Vedic seers repeatedly call Manu ‘father’ (1.80.16, 1.114.2, 8.63.1) and ‘our father’ (2.33.13), and otherwise mention him over a hundred times. They pray to the gods: ‘May you not lead us far from the ancestral path of Manu’ (8.30.3). They address the fire-god Agni thus: ‘Manu established you as a light for the people’ (1.36.19). The Vedic worship of ‘33 great gods’ (often mistranslated as ‘330,000,000 gods’, koti meaning ‘great’ but later acquiring the mathematical sense of ‘ten million’), mostly enumerated as earth, heaven, eight earthly, eleven atmospheric and twelve heavenly gods, is said to have been instituted by Manu (8.30.2). Moreover, one common term for ‘human being’ is manushya, ‘progeny of Manu’.
Because of his name’s prestige, the ancient patriarch is also anachronistically credited with the authorship of the Manu-Smrti (‘Manu’s Recollection-Classic’) or Mânava-Dharma-Shâstra (translatable as both ‘Manu’s Ethical Code’ and ‘Human Ethical Code’), a text edited from slightly older versions in probably the 1st century CE. Friedrich Nietzsche exclusively refers to Manu as the author of the Mânava-Dharma-Shâstra, seemingly unaware of his legendary status as the progenitor of the Ârya-s.
1.2. The Code of the Ârya-s
For at least two thousand years, the word Ârya has meant: ‘noble’, ‘gentleman’, ‘civilized’, and in particular ‘member of the Vedic civilization’. The Manu Smrti uses it in this sense and emphatically not in either of the two meanings which ‘Aryan’ received in 19th century Europe, viz. the linguistic sense of ‘Indo-European’ and the racial sense of ‘white’ or ‘Nordic’. Thus, MS 10.45 says that those outside the caste system, ‘whether they speak barbarian languages or Ârya languages, are regarded as aliens’, indicating that some people spoke the same language as the Ârya-s but didn’t have their status of Ârya. As for race, the Manu Smrti (10.43f.) claims that the Greeks and the Chinese had originally been Ârya-s too but that they had lapsed from Ârya standards and therefore lost the status of Ârya. So, non-Indians and non-whites could be Ârya, on condition of observing certain cultural standards, viz. those laid down in the MS itself. The term Ârya was culturally defined: conforming to Vedic tradition.
But at least in the two millennia since the Manu Smrti, the only ones fulfilling this requirement of living by Vedic norms were Indians. When, during India’s freedom struggle, philosopher and freedom fighter Sri Aurobindo Ghose (1872-1950) wrote in English about ‘the Aryan race’, he meant very precisely ‘the Hindu nation’, nothing else. In 1914-21, together with a French-Jewish admirer, Mirra Richard-Alfassa, he also published a monthly devoted to the cause of India’s self-rediscovery and emancipation, the Ârya. In 1875, a socially progressive but religiously fundamentalist movement (‘back to the Vedas’, i.e. before the ‘degeneracy’ of the ‘casteist’ Shâstra-s and the ‘superstitious’ mythopoetic Purâna-s) had been founded under the name Ârya Samâj, in effect the ‘Vedicist society’. If the word Ârya had not become tainted by the colonial and racist use of its Europeanized form Aryan/Arier, chances are that by now it would have replaced the word Hindu (which many Hindus resent as a Persian exonym unknown to Hindu scripture) as the standard term of Hindu self-reference.
Against the association of the anglicised form ‘Aryan’ with colonial and Nazi racism, modern Hindus always insist that the term only means ‘Vedic’ or ‘noble’ and has no racial or ethnic connotation. This purely moral, non-ethnic meaning is in evidence in the Buddhist notions of the ‘four noble truths’ (chatvâri-ârya-satyâni) and the ‘noble eightfold path’ (ârya-ashtângika-mârga). So, the meaning ‘noble’ applies for recent centuries and as far back as the Buddha’s age (ca.500 BC), but not for the Vedic age (beyond 1000 BC), especially its earliest phase. Back then, against a background of struggle between the Vedic Indians and the proto-Iranian tribes, the Dâsa-s and Dasyu-s, we see the Indians referring to themselves, but not to the Iranians, as Ârya; and conversely, the Iranians referring to themselves, but not to the Indians, as Airya (whence Airyânâm Xshathra, ‘empire of the Aryans’, i.e. Iran). And if we look more closely, we see the Vedic Indians, i.e. the Paurava nation, refer to themselves but not to other Indians as Ârya. So at that point it did have a self-referential ethnic meaning (Talageri 2000 154 ff.).
Possibly this can be explained with the etymology of the word, but this is still heavily under dispute. Köbler (2000 48 ff.) gives a range of possibilities. It has been analysed as stemming from the root *ar-, ‘plough, cultivate’ (cfr. Latin arare, aratrum), which would make them the sedentary people as opposed to the nomads and hunter-gatherers; and lends itself to a figurative meaning of ‘cultivated, civilized’. Or from a root *ar-, ‘to fit; orderly, correct’ (cfr. Greek artios, ‘fitting, perfect’) and hence ‘skilled, able’ (cfr. Latin ars, ‘art, dexterity’; Greek arête, ‘virtue’, aristos, ‘best’), which may in turn be the same root as in the central Vedic concept rta, ‘order, regularity’, whence rtu, ‘season’ (cfr. Greek ham-artè, ‘at the same time’). Or from a root *ar, ‘possess, acquire, share’ (cfr. Greek aresthai, ‘acquire’), an interpretation beloved of Marxist scholars who interpret the Ârya class as the owner class. Or, surprisingly, from a root *al-, ‘other’ (cfr. Greek allos and Latin alius, ‘other’), hence ‘inclined towards the other/stranger’, hence ‘hospitable’, like in the name of the god Aryaman, whose attribute is hospitality. It is the latter sense from which the ethnic meaning is tentatively derived: ‘we, the hospitable ones’, ‘we, your hosts’, hence ‘we, the lords of this country’. The linguists are far from reaching a consensus on this, and for now, we must leave it as speculative.
At any rate, the form Ârya, though probably indirectly related with words in European languages, exists as such only in the Indo-Iranian branch of the Indo-European language family. The common belief that Eire as ethnonym of the westernmost branch of the Indo-European speech community is equivalent with Ârya, is etymologically incorrect, as is the eager linkage of either with German Ehre, ‘honour’. This is one reason why the use of the English word ‘Aryan’ for the whole Indo-European language family was misconceived and has rightly been abandoned.
The main point for now is that the legendary Manu was the patriarch and founder of Vedic or Ârya civilization. His name carried an aura, so the naming of a far more recent book after him was merely a classic attempt to confer more authority on the book. The name of the book’s real author or final editor is unknown, but he must have lived at the very beginning of the Christian age. Older versions of the Dharma-Shâstra-s have been referred to in the literature of the preceding centuries, citing injunctions no longer extant in the classical versions. This confirms to us moderns, though not to the disappearing breed of traditionalist Hindus, that the law codes including Manu’s are products of history, moments in a continuous evolution, rather than an immutable divine law laid down at the time of creation.
1.3. Is the Manu Smrti a law book?
In 1794, Bengal Supreme Court judge Sir William Jones (1746-94), discoverer or at least herald of the kinship of the Indo-European languages in 1786, translated the Manu Smrti in English. Soon the British East India Company made the Manu Smrti the basis of the Code of Hindu Law in its domains, parallel with the Shari’a for Muslim Law. Colonial practice was to avoid trouble with the natives by respecting their customs, so British or British-appointed judges consulted the MS to decide in disputes between Hindus. But this was the first time in history that the book had any force of law.
It is an important feature of the Manu Smrti that it explicitly recognizes that laws are changeable. That doesn’t mean that anything goes, for the right to amend the laws is strictly confined to Brahmins well-versed in the existing law codes (12.108), so that they will preserve the spirit of the law even while changing its letter. Nonetheless, this provision for change helps to explain why Hindus have been far more receptive to social reform than their Muslim compatriots, for whom Islamic law is a ‘seamless garment’: pull out one thread and the whole fabric comes apart. On the other hand, this openness to reform never led to serious changes in social practice until the pressure from outside became immense, viz. under British colonial rule with its modernizing impact. But at least the principle that the Manu Smrti was perfectible and changeable was understood from the start and is implied in its classification as a Smrti, a man-made ‘memorized text’ or ‘classic’, or Shâstra, a man-made ‘rule book’, in contrast with the Shruti literature (‘glory’, often mistranslated as ‘heard text’ in the sense of ‘divinely revealed text’, like the Qur’ân), i.e. the Vedas, which had by then been exalted to divine status, and which don’t have the character of rule books but of hymns addressed to the gods.
Manu (as we shall call the anonymous author) explicitly acknowledges the validity of customary law: ‘He must consider as law that which the people’s religion sanctions’ (7:203). Much of what he describes was nothing but existing practice. Until the enactment of modern laws by the British and the incipient Indian republic, the final authority for intra-caste disputes was the caste pañchâyat (‘council of five’), for inter-caste disputes the village pañchâyat, in which each local caste was represented and had a veto right. These councils were sovereign and not formally bound by the Manu Smrti or any other Shâstra-s, though these could be cited in the deliberations by way of advice.
Apart from Manu’s own Shâstra, there were quite a few rival texts written with the same purpose. In anti-Hindu polemics arguing for the utter inhumanity of the caste system, Manu is often accused of laying down the rule that ‘if an untouchable listens attentively to Veda recitation, molten lead must be poured into his ears’ (because his unclean person would pollute the Vedic vibration, with detrimental consequences for the whole of society…). This rule is nowhere to be found in Manu. Yet it is authentic, but it is from the less prestigious Gautama-Dharma-Sûtra (12.4). The most famous Dharma-Shâstra apart from Manu’s is probably the one credited to Yajñavalkya, the Vedic philosopher who introduced the crucial notion of the Self (âtman) in the Brhadâranyakopanishad. But here again, the extant text, more streamlined and contradiction-free than Manu’s, is a number of centuries younger than its purported author.
Though not law books stricto sensu, these Shâstra-s (presented exhaustively in Kane 1930 ff.) do communicate a legal philosophy and directive principles for how people should conduct themselves in society and how rulers should organize it. Their most striking feature when compared with modern law, though not dissimilar to most pre-modern law systems even in West Asia and Europe, is that they allot different rights, prohibitions and punishments to different classes of people. In particular, and to Nietzsche’s great enthusiasm, it thinks of the social order in terms of the varna-vyavasthâ, approximatively translated as the ‘caste system’.
Thus, the murder of a Brahmin is punished more heavily than the murder of a low-caste person. For theft, a high-caste person received a heavier punishment than a low-caste person (Gopal 1959 190). And in a rule to which Friedrich Nietzsche alludes (14[176] 13.362), a labourer is not punished for drunkenness, but a Brahmin is, because according to Nietzsche, ‘drunkenness makes him sink to the level of the Shudra’. From the Hindu viewpoint, the rationale for the latter rule was more probably that a drunken Brahmin might desecrate the Vedas by reciting them in a jocular or mocking manner, which would be highly inauspicious, whereas a labourer’s loss of self-control is less consequential. So, while Manu is unabashedly non-egalitarian, Nietzsche overdoes this focus on inequality because he doesn’t empathize with other, religious considerations that were crucial to Manu.
In Manu’s view, everyone has to do his swadharma, ‘own duty’, which implies distinctive rules as well as privileges. This is not conceived in an individualistic sense (as in Nietzsche’s Zarathustra calling to ‘walk the one road no one can walk but you’) but as one’s caste duty. It is mostly because of its casteism that the Manu-Smrti is abhorred by Indian and Western egalitarians, and that it was admired by pro-aristocratic thinkers such as Nietzsche.
1.4. Reconciling Vedic theory with Hindu practice
In his letter to Peter Gast of 31 May 1888, Nietzsche called the Manu-Smrti ‘a priestly codex of morality based on the Vedas’ (KSA 14.420). Manu’s understanding of ‘Vedic’, like that of modern Hindus, and like Nietzsche’s borrowed idea, is not certified by scholars as historically Vedic. More than a thousand years had elapsed between the final edition of the Vedas and the composition of the Manu-Smrti, and society had evolved considerably. One of Manu’s self-imposed tasks was to offer justification from the Veda-s, then already an old and little-understood corpus, for the mores and social ideals of his own day.
Nietzsche thought these ancient laws, Manu’s as much as Moses’, were endowed with authority through the pious lie of divine sanction. In fact, Manu does not claim a divine origin for his code the way Moses did, but the distinction is only technical; the attribution of the MS to the ancient patriarch and the mere fact of its use of the sacred Sanskrit language gave it a religious aura. Manu was a great trend-setter for the later and current Hindu tendency to back-project all later Hindu practices (e.g. idol-worship, astrology) and beliefs (e.g. in reincarnation, inviolability of the cow) unhistorically onto the Vedas. In particular, Manu’s account of caste relations has no precedent in the Vedic corpus, which apparently reflects the simpler social structure of a simpler age.
The Rg-Veda, and then only its youngest book, mentions the four varna-s (castes) as springing from the different body-parts of the Cosmic Man: the Brâhmana from his face, the Kshatriya from his upper body, the Vaishya from his lower body, the Shûdra from his feet (RV 10.90.12). It is thus literally a corporatist explanation of society, with the social classes united in purpose as the limbs of a single body, similar to the corporatism found in Titus Livius’ account of Menenius Agrippa’s speech against class struggle, and in Saint Paul (1 Corinthians 12). This founding text is of course quoted approvingly by Manu (1:93).
However, the Rg-Veda doesn’t yet mention the really operative units of Hindu society, the thousands of jâti-s, or endogamous groups. Nor does it link the varna-s to hereditary profession, another important feature of caste. It is merely stated that these four functions exist in late-Vedic society, as they do in most developed societies. Presumably, just as the relation between the sexes was demonstrably more flexible in the Vedic as compared with the classical Hindu period (Altekar 1959), the relations between the social strata was likewise not as rigid yet. The Manu Smrti marks the phase of crystallization of the system of caste segregation.
The notion of inborn ritual uncleanness or untouchability (asprshyatâ) doesn’t figure in the Rg-Veda either. That is why modern Hindu social reformers could appeal to the Rg-Veda as scriptural justification for abolishing untouchability. The first apparent mention of untouchables is probably in the Chândogya Upanishad (5.3-10), where the Brahmins Uddâlaka Gautama Aruni and his son Shvetaketu find that they don’t know the answer to questions about life after death on which a prince has quizzed them. They go to the king who tells them that his own Kshatriya caste wields power thanks to the secret knowledge which until then they never shared with the Brahmins, viz. that man reincarnates. At once he adds the retributive understanding of reincarnation: ‘Those who are of pleasant conduct here, the prospect is, indeed, that they will enter a pleasant womb, either the womb of a Brahmin, the womb of a Kshatriya, or the womb of a Vaishya. But those who are of stinking conduct here, the prospect is, indeed, that they will enter a stinking womb, either the womb of a dog, or the womb of a swine, or the womb of a Chandâla’ (5.10.7).
In theory, the meaning of Chandâla in this early context is open, it could be an ethnonym for some feared or despised foreign tribe (arguably the Kandaloi mentioned in Ptolemy’s Treatise on Geography 7.1.66) which got incorporated only later as a lowly caste. However, the term’s appearance in contrast with the explicitly named upper castes indicates that it already refers to an unclean or untouchable caste. By Manu’s time, the Chandâla’s or ‘fierce’ untouchables (possibly a folk etymology for what was originally a non-Sanskritic ethnonym) were an established feature of Hindu society. They were also called avarna, ‘colourless’, ‘without caste pride’. But it would be wrong to translate this as ‘casteless’, for they too live in endogamous jâti communities.
Nowadays, jâti is often infelicitously translated as ‘subcaste’, but ‘caste’ would be more accurate, i.e. endogamous group. The British colonizers initially translated this term as ‘tribe’ (as in ‘the Brahmin tribe’), which inadvertently held the key to the jâti-s’ historical origin. As a general rule, jâti-s originated as independent tribes that got integrated into the expanding Vedic society, whose heartland was limited to the region around present-day Delhi. It was part of the Brahminical genius to let them keep or even strengthen their separate identities, founded in their endogamy, all while ‘sanskritizing’ them, i.e. bringing them into the Vedic ritual order (somewhat like the Catholic Church facilitated the christianization of the Pagans in the Roman Empire by integrating some of their customs and institutions). Secondarily, some specific jâti-s originated by division (or, in the modern age, fusion through intermarriage) of pre-existing jâti-s.
The four varna’s were originally not endogamous by definition. They were hereditary, but only through the paternal line, as we see in a number of inter-varna couples in the Vedic literature and the epics. A man could marry a woman from any caste (though preferably not from a higher caste), she would move into his house and his varna community, and their children would naturally become part of their father’s varna. However, intermarriage between varna-s also went out of use, and Manu reports the practice but expresses his disapproval. The effective unit of endogamy was the jâti, not the varna, but since most jâti-s were classified under one of the varna-s, any inter-varna marriage would be an inter-jâti marriage and hence forbidden. While a hypergamous marriage between a higher-born man and a lower-born woman would be frowned upon but often tolerated (though least so in the Brahmin caste), a hypogamous union was strictly out of bounds: ‘If a young girl likes a man of a class higher than her own, the king should not make her pay the slightest fine; but if she unites herself with a man of inferior birth, she should be imprisoned in her house and placed under guard. A man of low origin who makes love to a maiden of high birth deserves a corporal or capital punishment’ (MS 8.365f.).
Hindu reformists often claim that caste was never hereditary, and that the Bhagavad-Gîtâ, the most authoritative source in everyday Hinduism, edited in about the same era as the MS, defines a person’s varna by his guna, ‘quality, aptitude’ and karma, ‘work’ (4.13). But those criteria are not given in opposition to heredity, on the contrary: in terms of work and aptitude, people in pre-modern societies tended to follow in their parents’ footsteps, statistically speaking. Moreover, the Gîtâ itself is explicit enough about the understanding of caste identity as hereditary and implying endogamy. When its hero Arjuna shies away from battle and displays a failing in the martial quality (guna) befitting a warrior, his adviser Krshna does not tell him that by guna he clearly isn’t a Kshatriya and hence free from military duty, but instead tells him to overcome his doubts and do his Kshatriya duty, for regardless of his personal traits he just happens (viz. by birth) to be a member of the Kshatriya caste.
When the two argue opposing positions regarding the justice of waging the fraternal war, they do so with reference to the same concern, viz. the need to avoid varna-sankara, roughly ‘mixing of castes’. Both say that the other’s proposed line of action, viz. fighting c.q. avoiding the war, would lead to the ‘immorality of women’ and thence to breaches of caste endogamy. (BG 1.41-43, 3.24). When in a society two opposing arguments are based on the same value, you know that that value is deeply entrenched in that society,-- i.c. caste as an hereditary communal identity guarded by endogamy.
2. Nietzsche’s understanding of the text
Friedrich Nietzsche didn’t share the enthusiasm for all things Indian evinced by many of his contemporaries. Thinkers critical of Christianity from Voltaire to Arthur Schopenhauer and Ernest Renan had been using the glory of Indian civilization as a counterweight against the ideological influence which Christianity still wielded even among nominal unbelievers. Indology had been arousing a lot of interest in its own right, but was also instrumentalized in Europe’s self-discovery and self-glorification through the study of the Indo-European language family and the presumed civilization underlying its original expansion. Moreover, there was always the titillating element in India’s exotic features, charming or horrifying, such as the much-discussed custom of widows’ self-immolation (satî). All this seems to have left Nietzsche cold. At any rate none of it figures in his published works, except for his references to Manu’s thinking on caste.
The extant literature on the understanding of Manu in Nietzsche’s work is limited in quantity. This is logical, given that Nietzsche’s own discussion of Manu amounts to only a few pages in total. In a short but important paper, Annemarie Etter (1987, further built upon by Berkovitz 2003 and 2006, Smith 2006, Bonfiglio 2006; while Lincoln 1999 101-120 seems to have worked independently on the same theme) draws attention to the poor quality of the Manu Smrti translation which Nietzsche used, viz. the one included in Louis Jacolliot’s book Les Législateurs Religieux: Manou, Moïse, Mahomet (1876), to be discussed here in §2.4. But apart from flaws in the text version used by Nietzsche, there are three more sources of distortion in his understanding of caste society, viz. Manu himself, Jacolliot’s personal additions to his translation of the received text, and Nietzsche himself.
2.1. Errors in Manu
The Manu Smrti is usually referred to, especially by its modern leftist critics in India, as the casteist manifesto pure and simple. This is fair enough in the sense that there is no unjustly disregarded anti-caste element tucked away somewhere in Manu’s vision of society; the text is indeed casteist through and through. However, the scope of the Manu Smrti is broader, dealing with intra-family matters, the punishment of crime, the king’s (in the sense of: the state’s) duties, money-lending and usury, et al. Matters are further complicated by the fact that the text itself contains contradictions, e.g. allowing niyoga or levirate marriage (9.59-63) only to disallow it in the next paragraph (9.64-69, as pointed out by Kane 1930.I.331); recommending meat-eating on certain ceremonial occasions (5.31-41) yet imposing strict vegetarianism elsewhere (5.48-50); describing the father as equal to a hundred Vedic teachers, then reversing this by calling the teacher superior to the father (2.145f.).
Part of the treatise’s self-imposed mission was to reconcile ancient Vedic injunctions, then already obsolete, with social mores actually existing in India around the turn of the Christian era. This seriously muddles Manu’s account of caste, e.g. first allowing a Brahmin man to marry a Shûdra woman (2.16, 3.12f.), as was clearly the case in the Vedic age, then prohibiting the same (3.14-19).
In order to fit the observed reality of numerous jâti-s into the simple Vedic scheme of four varna-s, Manu develops a completely far-fetched theory that each jâti originated from a particular combination of varna-s through inter-varna marriage. This makes no historical or logical sense. In fact, many jâti-s were tribes whose existence as distinct endogamous groups predated the Vedic age, let alone the MS’s age, and even the more recently originated jâti-s didn’t come into being the way Manu suggested.
Manu despises the lowest jâti-s not on account of race, nor ostensibly because of unclean occupations, but because they were born from sinful unions. Most of all he condemns the marriage uniting people from the varna-s at opposing ends of the varna hierarchy and thus most contrary to the ideal of varna endogamy. Not always consistently, but the general thrust of his teaching on endogamy is clear enough. And as if in punishment for their parents’ sins, the children of inter-caste unions became the people performing the lowliest and most unclean tasks.
The Dharma-Shâstra–s give a completely far-fetched theory of the origins of the castes, e.g. the Gautama-Dharma-Shâstra (4.17) relays the view that the union of a Shûdra woman with a Brâhmana, a Kshatriya or a Vaishya man brings forth the Pârashava c.q. the Yavana (‘Ionian’, Greek or West-Asian) and the Karana jâti. Likewise, Manu claims that ‘the Chandâla-s, the worst of men’ are the progeny of a servant father and a priestly mother (10.12). Clearly, the Chandâla-s were looked down upon already, mainly because of their unclean labour (any work involving decomposing living substances, esp. funeral work, sweeping, garbage-collecting, leather-work), possibly also because of a memory of them as originally being subjugated enemy tribes, decried for having first terrorized the Ârya-s and thus ‘deserving’ their reduction to the lowliest occupations. Manu then used this existing contempt in his plea against caste-mixing, by depicting the latter as the cause of the well-known degraded state of the Chandâla-s.
Here, Manu gives in to a typically Brahminical (or intellectuals’) tendency of subjugating reality to neat little models, in this case also with a moralistic dimension. Practice of course is both simpler and more complicated than Manu’s model of caste relations. Low-castes are typically the children of low-castes, not of mixed unions between people of different higher castes. And children of mixed unions do not form new castes, they are accepted into one (usually the lower) of the two parental castes. But Nietzsche is not known to have taken an interest in such historical and sociological detail, neither for its own sake nor for the purpose of giving a verified groundwork to his Manu-based speculations.
2.2. Manu and race
In one respect, Manu’s idea of blaming social disorder on intermarriage seemed attractive to Western readers in the late 19th century, for it agreed with one of the tenets of the flourishing race theories, viz. that race-mixing has a negative effect on the individuals born from such unions. Better a negro than a mulatto, for the latter may have inherited a share of ‘superior’ Caucasian genes, but he will be plagued by an internal conflict between the diverging ‘natures’ of the two parent races. Likewise, the promiscuous servant woman described by Manu may have felt flattered by the interest her Brahmin lover took in her, but for her offspring it would have been better if she had restricted her favours to someone of her own caste. So, a pure low-caste ends up superior to a mixed offspring of high and low castes. While it remains absurd to posit that sweepers and funeral workers (the lowest castes) came into being as children of unions between priests and maidservants, or between the princess and the miller’s son, Manu’s little idea resonated with a cherished belief of Nietzsche’s contemporaries.
In another respect, though, this contrived idea of Manu’s, and Nietzsche’s injudicious acceptance of it, conflicts with 19th -century racial thought. It was then generally believed that the ‘Aryan race’ had invaded India, bringing the Sanskrit language and proto-Vedic religion with them, then subjugated the natives and locked them into the lower rungs of the newly-invented caste system, a kind of apartheid system designed to preserve the Aryan upper castes’ racial purity. (For a critical review of this theory, vide Elst 2007).
In that connection, the reading of varna, ‘colour, social class’, as referring to skin colour, was upheld as proof of the racial basis of caste. To put this false trail of 19th -century race theory to rest, let us observe here that neither the Rg-Veda nor the Manu Smrti connects varna to skin colour. The term varna, ‘colour’, is used here in the sense of ‘one in a spectrum’, just as the alphabet is called varna-mâla, ‘rosary of colours’, metaphor for ‘spectrum (of sounds)’. So, the varna-vyavasthâ is the ‘colour system’, i.e. the ‘spectrum’ of social functions, the role division in society. Just as the existence of social classes in our society doesn’t imply their endogamous separateness, the Vedic varna-s were not defined as endogamous castes.
Physical anthropology has refuted the thesis of caste as racial apartheid long ago (Ghurye 1932), refuted at least according to the scientific standards of the day. Today the science of genetics is fast deepening our knowledge of the biological basis of caste, including the migration history involved in it. As the jury is still out on the genetic verdict, we cannot use that fledgling body of evidence as an argument in either sense here. But the use of colours as a purely symbolical, non-racial marker of social class is attested in several other Indo-European-speaking societies, the closely related Iranian society but also the distant and all-white Nordic class society of jarl (nobleman) with colour white, karl (freeman) red, and thraell (serf) black, as described in the Edda chapter Rigsthula.
In the predominant racialist view of the 19th century, the lowest castes were the pure natives, the highest the pure Aryan invaders, and the intermediate castes the mixed offspring of both. But Manu’s view, though often decried as ‘racist’ in pamphlets, is irreconcilable with this, for it classifies the lowest castes as partially the offspring, even if the sinful offspring, of the highest castes. The caste hierarchy as conceived by him is not a racial apartheid system. As an aspiring historian of caste society, Manu may have been seriously mistaken; but if read properly and not judged from simplifying hearsay, he was not an ideologue of racial hierarchy.
However, though the castes may not have originated as genetically distinct groups, their biological and social separation by endogamy over a number of generations was bound to promote distinctive traits in each. Nietzsche sees Manu’s proposed task as one of ‘breeding no fewer than four races at once’ (TI Improvers 3), each with distinct qualities. As a classicist, Nietzsche was certainly aware of the eugenicist element in Plato’s vision of society and he hints at the similarity with Manu: ‘[…] but even Plato seems to me to be in all main points only a Brahmin’s good pupil’ (letter to Peter Gast, KSA 14.420). As for the medieval European society with its division in endogamous nobility and commoners: ‘The Germanic Middle Ages was geared towards the restoration of the Aryan caste order’ (14[204] 13.386). Indeed:
Medieval organisation looks like a strange groping for winning back those conceptions on which the ancient Indian-Aryan society rested,- but with pessimistic values stemming from racial decadence. (letter to Peter Gast, KSA 14.420)
It was mainly European nostalgics of the ancien régime who got enamoured of the caste system. Yet, the rising tide of modern racism also managed to incorporate its own analysis, unsupported by the Hindu sources, of the Hindu caste ‘apartheid’ as a design to preserve the ‘Aryan race’. Nietzsche remained aloof from that line of discourse.
2.3. Manu, priest-craft and legislation
One element in Manu which isn’t easy to fit into Nietzsche’s viewpoint, is his pro-Brahmin bias. On the one hand, Nietzsche couldn’t fail to appreciate the determination of a whole society to set aside resources for a separate caste fully devoted to spiritual and intellectual work. Could a non-caste society have achieved the Brahminical feat of transmitting the Vedas and the ancillary texts and sciences through several thousands of years’ worth of all manner of turmoil? On the other hand, he couldn’t muster much enthusiasm for a system placing the priestly class on top.
Manu is candid and explicit about this: ‘The priest is the lord of the classes because he is pre-eminent, because he is the best by nature, because he maintains the restraints, and because of the pre-eminence of his transformative rituals’ (10.3). In theory, and because it was Brahmins who did all the writing, the Brahmins were the highest caste, and Nietzsche doesn’t seem to question this. But the tangible power in Hindu society lay with the Kshatriya-s, the counterpart of the European aristocracy, which enjoyed Nietzsche’s sympathy far more than any priestly group. For all his sympathy with Manu’s vision, Nietzsche had to criticize Manu’s ‘priest-craft’, debunking it as just a ploy for wresting power:
Critique of Manu’s law-book. The whole book rests on a holy lie: […] Bettering man – whence is this purpose inspired? Whence the concept of the better? We find this type of man, the priestly type that feels itself to be the norm, the peak, the highest expression of humanity: out of itself it takes the concept of the ‘better’. It believes in its superiority, and wants it in fact: the cause of the holy lie is the will to power. (15[45] 13.439)
Nietzsche, however, fails to question Manu’s implicit and explicit claims for Brahminical legislative authority. Through the format of his book, Manu creates an impression (which Nietzsche swallowed whole) that he is laying down a law, but when read more closely, his work proves in fact to be more descriptive than normative, not a law book but rather a treatise on existing social norms and values. ‘Manu prohibits X’ should in most cases be replaced with ‘Manu disapproves of X’ or ‘Manu notes that X is prohibited’. The many contradictions are also quite misplaced in a law book, but perfectly normal in a treatise dealing with the sometimes irregular or conflicting customs in a living society and with ideals versus realities. Moreover, Manu enjoins the ruler to restrain his zeal for law-making and instead respect existing customs in civil society. Manu’s treatise is antirevolutionary, holding off all revolutionary changes whether imposed from above or from below.
Therefore, it bears repeating that Manu with his limited ambitions was not a law-giver gate-crashing into society to impose his own designs. Once caste went out of favour, Manu and the Brahmins were often blamed for having created and imposed the caste system. Yet in fact, as B.R. Ambedkar, a born untouchable who became independent India’s first Law Minister, observed, it was quite outside their power to impose it:
One thing I want to impress upon you is that Manu did not give the law of caste and that he could not do so. Caste existed long before Manu. He was an upholder of it and therefore philosophized about it, but certainly he did not and could not ordain the present order of Hindu Society […] The spread and growth of the caste system is too gigantic a task to be achieved by the power or cunning of an individual or of a class […] The Brahmins may have been guilty of many things, and I dare say they were, but the imposing of the caste system on the non-Brahmin population was beyond their mettle. (Ambedkar 1916 16)
Ambedkar held that castes had evolved from tribes, self-contained communities that maintained their endogamy and distinctness after integrating into a larger more complex society. This continuity has been confirmed from the angle of anthropological research (Ghurye 1959). Nietzsche speaks of the caste system as a grand project of breeding four different nations, but the system simply didn’t come about as the result of a project. Then again, Manu’s choice to preserve and fortify a system already in existence, was also a ‘project’, the alternative being to allow for negligence in caste mores ending in the mixing of castes, of the kind that in the 19th and 20th century started drowning the distinctive identity of the European nobility through intermarriage with the bourgeoisie.
Yet, in other places, Nietzsche drops the idea of a ‘project’ and acknowledges that Manu’s caste scheme is little more than an explicitation and perhaps a radicalization of an entirely natural and spontaneous condition. Like seeks like, people avoid intermarriage with foreigners or with people located much higher or much lower in the social hierarchy, so there is a natural tendency towards endogamy (jâti). Even more natural is the differentiation of social classes (varna) in duties, rights and privileges, i.e social inequality:
The order of castes, the highest and dominant law, is only the sanction of a natural order, a law of nature of the first rank, over which no arbitrariness and no ‘modern idea’ has any power. (AC 57).
In Nietzsche’s books, this counts as a plus for Manu: the Hindu lawgiver didn’t go against the way of the world, whereas Christianity intrinsically militates against nature.
2.4. Jacolliot’s errors
When Nietzsche quotes Manu in his Antichrist and Twilight of the Idols, and in loose notes from the same period (Spring 1888), it is from the French translation by Louis Jacolliot, included in his book Les législateurs religieux, Manou, Moïse, Mahomet (Paris 1876). He says so himself in his letter to Peter Gast. Colli and Montinari remark that ‘the book of Jacolliot about the Indian Law of Manu made a big, indeed exaggerated impression on him’ (6.667).
Jacolliot had served as a magistrate in Chandernagor, a small French colony in Bengal (later he also served in Tahiti), and claimed to have travelled ‘all over India’ in the 27 months he spent in the country. In his attempts at scholarship, he was an amateur and inclined to far-fetched speculations, especially tending to derive any and every philosophy and religion in the world from Indian sources. In his own account, he made his translation with the help of South-Indian pandits. The text from which they worked (and which is apparently lost) was fairly deviant, missing more than half of the standard version, and was apparently already a Tamil translation from Sanskrit. Though his travel stories were very popular among the greater reading public, Jacolliot was not taken seriously by the philologists, finding himself openly denounced as a crackpot by such leading lights as Friedrich Max Müller.
Some parts of Jacolliot’s rendering, including two passages quoted by Nietzsche, do not appear in the standard version of the text. Moreover, in his list of ‘protective measures of Indian morality’ (in TI Improvers 3), Nietzsche makes the additional mistake of quoting as Manu’s text what is in fact a footnote by Jacolliot. This faulty reading is so significant for Nietzsche’s thought that we will consider it separately in §2.5.
Etter notes that until 1987, for a whole century, no Indologist seems to have noticed the textual errors in Nietzsche’s quotations from Manu, though at least Nietzsche’s friend Paul Deussen and later Winternitz (1920) did care to mention Nietzsche’s enthusiasm for Manu. Doniger (1991 xxii), though unaware of Etter’s work, does note a faulty quotation (in Antichrist 56) from Manu 5.130-133, where Nietzsche cites Jacolliot’s non-Manu phrase: ‘Only in the case of a girl is the whole body pure’, as illustration of Manu’s sympathy for women. However, she doesn’t look in a systematic way into the problem of Nietzsche’s source text. This indicates that the eye of the Indologists had not been struck by any serious injustice done to Manu’s message by Nietzsche. Even if the letter of his text was flawed, it did nevertheless carry the gist of Manu’s social vision.
So we shouldn’t make too much of his reliance on a distorted text version, at least in so far as he deals with Manu’s ideology of caste. Indeed, as we shall see, Nietzsche’s faulty understanding of a particularly strange claim made by Jacolliot does not pertain to Manu’s own subject-matter, the caste system, but to a subject entirely outside Manu’s horizon, viz. a supposed role of emigrated Chandâla-s in the genesis of West-Asian religions.
One reason why, in spite of relying on Jacolliot’s flawed translation for quotation purposes, Nietzsche doesn’t do injustice to Manu’s thought, is that he must have been familiar with Manu’s outlook through indirect sources. Indo-European philology was a hot item in 19th century Germany, partly because it had ideological ramifications deemed useful in the political struggles of the day. Indocentrism was most strongly in evidence in Arthur Schopenhauer, a principal influence on Nietzsche. Johann Wolfgang von Goethe had propagated Kâlidâsa’s play Shakuntalâ in Germany. Even G.W.F. Hegel (1826), by no means an Orient-lover, had written a comment on the Bhagavad-Gîtâ, including reflections on the caste system.
So, it is likely that Nietzsche had had a certain exposure to the then-available knowledge of the caste system as outlined by Manu. In particular, he may have already been exposed to Johann Hüttner’s German translation (Die Gesetze des Manu, Weimar 1797, based on William Jones’s English translation, 1796), at least indirectly. If only through his Indologist acquaintances and through general reading, he must have acquired a broad outline of Manu’s caste philosophy.
Nietzsche’s preference for Jacolliot’s over more scholarly Western editions of the MS is a bit of a mystery. He had sufficient training in and practice of philology, as well as philologist acquaintances, to see through Jacolliot’s amateurism. This strange error of judgment remains unexplained, short of the rather sweeping solution of seeing it as a prodrome of his loss of sanity, which befell him only a year later.
2.5. Jacolliot and the Jews
There is one very serious mistake in Jacolliot that seems to have made an important difference to Nietzsche’s thought: his far-fetched speculation that the Chandâla-s left India in 4000 BC (Jacolliot dates the Manu-Smrti itself to 13,300 BC!) and became the Semites. The point here is not the eccentrically early chronology. The exact age of the Vedas was a much-discussed topic, still not entirely resolved, and dating at least the Rg-Veda to beyond 4000 BC, as against Max Müller’s estimate of 1500 to 1200 BC, was not uncommon even among serious scholars like Hermann Jacobi (1894). The point is the alleged Indian and low-caste origin of the ‘Semites’.
Nietzsche hesitates whether to believe Jacolliot on this:
I cannot oversee whether the Semites have not already in very ancient times been in the terrible service of the Hindus: as Chandalas, so that then already certain properties took root in them that belong to the subdued and despised type (like later in Egypt). Later they ennobled themselves, to the extent that they become warriors […] and conquer their own lands and own gods. The Semitic creation of gods coincides historically with their entry into history. (14[190] 13.377f.)
To the ignorant reader, this hypothesis is strengthened considerably by Jacolliot’s additional claim, uncritically quoted in full by Nietzsche (TI Improvers 3, referring to the demeaning features of Chandâla existence enumerated in Manu 10.52), that the Chandâla-s were circumcised. This is based on a mistranslation of daushcharmyam in a verse (MS 11:49) which strictly isn’t about Chandâla-s but about the karmic punishment for the student who has slept with his guru’s wife, either in this or a former lifetime. The mistranslation first appeared in a commentary on Manu by Kullûka from the 13th century, when Northern India had been conquered by Muslims. The word means ‘having a skin defect’ but was reinterpreted as ‘missing skin (on the penis)’, hence ‘circumcised’. The medieval Hindu commentator’s purpose clearly was to classify Muslims as contemptible Chandâla-s. Some Hindu scribes were very conscientious in rendering texts unaltered, others felt it would be helpful for the reader if they updated the old texts a bit, which seems to have happened in this case.
An anomaly in Nietzsche’s reference to male circumcision as an alleged link between the Chandâla-s and the Jews is that he extends the alleged Chandâla observance of ‘the law of the knife’ to ‘the removal of the labia in female children’ (TI Improvers 3). Female circumcision, in origin a pre-Islamic African tradition, is a common practice in some Muslim communities. Among South-Asian Muslims, it is rare but not non-existent. However, it is not a Jewish practice, certainly not among the Ashkenazi Jewish communities Nietzsche knew in Germany, and it is not part of the commandments in Moses’ law. So, his own assumption that the Chandâla-s (with whom Kullûka associated the Muslims) practised female circumcision should have put him on guard against the deduction of a connection with the Jews.
At one point in his unpublished speculations about Manu’s caste rules, Nietzsche actually uses the term ‘circumcised one’ where the context indicates that he means someone at the bottom end of the caste hierarchy:
The killer of a cow should cover himself for three months with the skin of this cow and then spend three months in the service of a cowherd. After that he should make a gift to the Brahmin of ten cows and a bull, or better even, all he possesses: then his fault will have been evened off. He who kills a circumcised one, purifies himself with a simple sacrifice (whereas even killing a mere animal demands a penitence of six months in the forest, unshaven). (14[178] 13.363)
Through Jacolliot’s clumsy translation, this seems to refer to the authentic passage listing the different punishments for killing people belonging to different social classes, as well as for killing different categories of animals (MS 11.109-146). There, for instance, the punishment for killing a member of the servant class is candidly evaluated as rather unimportant: it is fixed at one-sixteenth of the punishment for killing a priest (11.127). Nietzsche’s information that a cow-killer should cover himself with the cow’s skin as part of his penance is also correct (MS 11.109). That killers doing penance should live in the forest unkempt and with matted hair is stipulated in MS 11.129. So, in broad outline, Nietzsche is conveying a genuine tradition. However, this passage from Manu doesn’t specify any particular level of punishment for the case of untouchables, the lowliest subset within the ‘servant’ class. Even conceding that Nietzsche correctly renders Manu’s general intention in allotting only a minimal punishment for the killing of people with minimal standing in the caste hierarchy, the fact remains that the authentic passage contains no reference to ‘skin-defective’ people, let alone to Kullûka’s and Jacolliot’s interpretation of that term, viz. ‘circumcised ones’. But Nietzsche had genuinely interiorized the notion that Indian low-castes in the first century CE were circumcised. In calling them ‘circumcised ones’ off-hand, he treats the alleged circumcision of the Chandâla-s as a given.
Compounding this important mistake, Nietzsche (TI Improvers 3) further quotes from Jacolliot’s Manu version an insertion by the medieval commentator to the effect that the Chandâla-s used a right-to-left script, allegedly because writing from left to right like in the Sanskritic script, and even the use of the right hand, was forbidden to them. Like circumcision, the leftward script is a feature of Muslim culture. But to confuse matters further for Nietzsche, both features are also in evidence among the Jews, whose alphabet has a common origin with the Arabic one. Joining the dots, Nietzsche concludes that: ‘The Jews appear in this context as a Chandala race’, and explains the Jewish people’s alleged priestly leanings from their supposed origins as a class of underlings of the Hindu priestly caste, ‘which learns from its masters the principles by which a priesthood becomes master and organizes society’ (letter to Peter Gast, KSA 14.420).
As an exercise in genealogy, this hypothesis of Nietzsche’s is highly unconvincing. If something is to be explained about the Jews by their purported provenance from specific Indian low-castes, wouldn’t it be more logical, and certainly simpler, to let them continue the cultural features of low-caste life, as is effectively the case with the Gypsies? Conversely, if the Jews had to be of Indian origin and if they were suspected of ‘priest-craft’, shouldn’t they rather be descendents of the Brahmin caste?
The question is all the more poignant when we consider that the idea of a Jewish-Brahmin connection was already quite ancient. In his plea Contra Apionem (1.179) the Jewish-Roman historian Flavius Josephus quotes Aristotle’s pupil Clearchos of Soli as having claimed that Aristotle had been very impressed once with the discourses of a Jewish visitor, and more so with the steadfastness of his dietary discipline, and had concluded that in origin the Jews had been Indian philosophers. A similar claim is found in the Hellenistic-Jewish philosopher Aristoboulos. So, two millennia before Nietzsche, an Indian origin was already ascribed to the Jews. (A Brahminical connection is still attributed to the Jews in today’s India, both by Hindu nationalists who believe everything of value originates in India and invoke the superficial phonetic similarity between ‘Brahma/Saraswati’ and ‘Abraham/Sarah’, and by low-caste activists whose anti-Brahminism borrows the rhetoric of international anti-Semitism, attacking the Brahmins as ‘Jews of India’, e.g. Rajshekar 1983 2.)
Unlike Jacolliot, Nietzsche was interested in Judaism and its purported Chandâla origin mainly as an angle from which to attack Christianity. As Lincoln (1999 110) observes,
he came to be infinitely more critical of Christianity than of Judaism, and he saved some of his most scathing contempt for those (like Wagner, Bernhard Förster, and others of the Bayreuth circle) who were only anti-Semites in the narrowest sense, that is, Christians who failed to realize that everything wrong in Judaism was amplified and exacerbated in Christianity.
So, in Nietzsche’s view, the alleged Chandâla traits, especially resentment against the noble and the successful, though carried over by Judaism, were in fact at their most powerful and noxious in Christianity:
Christianity, which has sprung from Jewish roots and can only be understood as a plant that has come from this soil, represents the counter-movement to every morality of breeding, race or privilege:- it is the anti-Aryan religion par excellence: Christianity the transvaluation of all Aryan values, the victory of Chandala values. (TI Improvers 4)
Though not very important in quantity, the Chandâla statements in Nietzsche’s work have made a mark on his whole anthropology, with the Chandâla as the lowest extreme in the range of human diversity. Sentences like the one just quoted corroborated the emerging dichotomy of ‘Jewish’ and ‘Aryan’, which was by no means intrinsic to the concept of ‘Aryan’ even after its somewhat distortive adoption into European languages from Sanskrit. They also helped make Nietzsche’s image as an incorrigible anti-egalitarian who burdened the lower classes with a caste-like inborn inferiority. Even if his anti-egalitarianism was not of the racist or anti-Semitic kind, it was nonetheless in sharp conflict with the rising tide of liberalism and socialism. Any ‘leftist Nietzscheanism’ was thereby forever doomed to a contrived denial or uneasy management of this contradiction between the freedom-loving element in Nietzsche and his condemnation of certain communities to a permanent position of contempt. That is one reason why Monville (2007) speaks of ‘the misery of leftist Nietzscheanism’. As his book’s reviewer in the Belgian Communist Party paper Le Drapeau Rouge (Oct. 2007) sums it up: ‘This German philosopher was openly racist and endowed with a remarkable and odious contempt for the social condition of the losers in the caste struggle.’
2.6. Nietzsche’s errors
Nietzsche has been accused of being very selective in what he retained and quoted from the Manu Smrti, especially its most un-Christian pieces of praise for the female sex, e.g. that all good things including access to heaven ‘depend upon a wife’ (MS 9:28). On that basis, he waxes eloquent about the woman-friendliness of the Hindu sages:
I know no book in which so many gentle and nice things are said to women as in Manu’s law book; these old greybeards and saints have a manner of being kind to women that has perhaps not been outdone. (AC 56)
The quotations are by and large genuine, but ought to be counterbalanced by far less flattering quotations from the same text. Wendy Doniger (1991.xxi) chides Nietzsche for this one-sided representation and quotes Manu (9.17): ‘The bed and the seat, jewellery, lust, anger, crookedness, a malicious nature and bad conduct are what Manu assigned to women.’
However, Nietzsche’s selectiveness doesn’t really misrepresent Manu’s attitude in what was to him the relevant issue, for this much remains true, that Manu genuinely values the role of women as wives and mothers. They were not equal with men (‘It is because a wife obeys her husband that she is exalted in heaven’, 5.155), just like in most other cultures, and Manu too considered them fickle and untrustworthy and what not, but fundamentally they were a very auspicious part of the cosmic order. The good thing about women was not their equality with men, which would have been a ridiculous notion to Manu just as it was to Nietzsche, but that they provided pleasure in life and perpetuated the species. For the same reason, sex is treated in a matter-of-fact manner because even if a delicate subject with problematic ramifications in day-to-day human relations, in essence it is an auspicious cornerstone of the cosmic order. Nietzsche contrasts this with an alleged woman-hating and anti-sexual tendency in Christianity as well as in Buddhism.
On the whole, Nietzsche does justice to Manu’s view of man and society. His main error does not consist in false or mistaken assertions about Manu’s position, only in a limited grasp of the Indian historical context. He was too much in a hurry to enlist Manu in his own ideological agenda to familiarize himself with the actual reality as well as with the philosophical background of caste society.
3. Nietzsche’s use of Manu
To what extent did Nietzsche’s idealized view of Hindu caste society play a role in his views of socio-political matters and of religion?
3.1. Favourable contrasts with Christianity
For Nietzsche, Manu’s vision contrasts favourably with Christianity in several specific respects. Firstly, its goal is not to deform mankind and clip its wings, but to ‘breed’ it, to direct its natural growth and evolution in a certain direction. Consistently with this difference in goals, there is a different approach: while Christianity ‘tames’, Manu ‘breeds’, i.e. he manipulates natural tendencies in a chosen direction. He does not destroy but shapes up. He shows no resentment against the existing order but tries to preserve and ‘improve’ it (AC 56f.).
Secondly, Nietzsche applauds Manu’s candid acceptance and promotion of inequality, which follows naturally from an acceptance of life:
And do not forget the central point, the fundamental difference between it and every type of Bible: it lets the noble classes, the philosophers and warriors, stand above the crowd; noble values everywhere, a feeling of perfection, saying yes to life,- the sun shines over the entire book. All the things that Christianity treated with its unfavourable meanness, procreation for instance, women, marriage, are here treated with seriousness, with respect, with love and trust. How can you really put a book into the hands of children and women when it contains that mean-spirited passage: ‘To avoid fornication, let every man have his own wife and every woman her own husband: it is better to marry than to burn.’ [Paul: 1 Cor.6:2-9 - KE] (AC 56)
Thirdly, he welcomes Manu’s intolerance towards pessimism: even the ugly and lowly are part of the world’s perfection. There is no need to ‘cure’ the world of their presence, they are given a place somewhere in the system.
Fourthly, asceticism is present in Brahmanism as much as in Christianity, but its outlook and motivation is radically different. It does not stem from nor aim at life-denial, it is the joy of the strong who thereby feel and enjoy their strength of character. It is significant that the ascetic tradition originated in the martial Kshatriya caste, to which the Buddha and Mahâvîra Jîna, founders of the surviving ascetic sects of Buddhism and Jainism, belonged by birth. The Indian ascetic’s striving is of the heroic type, seeking to achieve liberation by conquest of the self, not by imprecating divine favours. His celibacy is not a matter of prudery or distrust of sexuality, but of preserving one’s sexual energy and of not diluting masculine standards by symbiosis with women and children.
And whereas these ascetic traditions would still fail to earn Nietzsche’s full approbation because of their hostility to the worldly vale of tears (though their assumption of suffering as the profound nature of all experience might also resonate with the sceptical-pessimist streak in Nietzsche), the Brahminical ascetic tradition as expressed in the Upanishads bases its inner quest on the perception of joy as the intrinsic nature of all experience. According to the Taittiriya Upanishad (2.5), the innermost level of consciousness, underneath the physical, energetic, mental and intellectual ‘sheaths’ covering the Self (âtman), is the sheath consisting of bliss (ânandamaya kosha):
Verily, other than and within that one that consists of understanding [= the intellect – KE] is a self that consists of bliss. […] Pleasure is its head; delight, the right side; great delight, the left side; bliss, the body; Brahma, the lower part, the foundation.
So, the level of consciousness into which the yogi sinks when he stills his thought processes, is one of natural bliss. This illustrates how asceticism as a practice of profound self-mastery need not be based on a sense of tiredness and loathing of the world. The focus in this case is not on the painful experiences from which yoga delivers us, but on the joy which is ever-present and can be awakened further by yoga. To complete this more positive conception of asceticism, Manu does not define the ascetic as one who rejects family and society (the way the Buddha did, or the way Christian monks do), nor as one who spurns normal life for the ascetic life; but as one who completes normal life with an ascetic phase, one who fulfils his social duties first and then, in middle age, crowns his career with the promotion to the ascetic’s lifestyle:
When a man has studied the Veda in accordance with the rules, and begotten sons in accordance with his duty, and sacrificed with sacrifices according to his ability, he may set his mind-and-heart on freedom. (MS 6.36)
Eventually, Nietzsche never got farther than a mere glimpse of this alternative view of asceticism, which contrasts so promisingly with the Christian one of self-punishment. He was locked in his European freethinker’s struggle with the Christian heritage. In the brief months of mental clarity that remained, he didn’t find the time or the appetite to explore the potential help that Hindu thought could have offered him in resolving his very European questions.
3.2. Goddamn this priest-craft
Anything good that may have sprung from Manu has come about thanks to the cunning schemes of Hindu priest-craft, for Nietzsche invariably a vector of the ‘lie’. Given Nietzsche’s views on ‘the uses and drawbacks of truth for life’, the use of this despised priest-craft becomes acceptable because it ends up serving the aims of life rather well. That’s better than the alleged life-denying impact of the Christian lie, but it’s still a lie. Only with that limitation can we say Nietzsche was enthusiastic about Manu.
While Christianity keeps its flock in check with promises and threats of the consequences in the afterlife, Manu achieves the same control with promises and threats of the karmic results in the next incarnations. That at least was and is the common view, and Nietzsche was not sufficiently versed in the subject to know and point out that among Hindu classics, Manu stands out by making only a limited use of the reincarnation doctrine and actually making much more reference to the promise of achieving, or the threat of withholding, access to swarga, ‘heaven’. Numerous times heaven is held up as reward, hell as punishment, only rarely is karma invoked, e.g. an unfaithful wife will be reborn as a jackal (9.30). This afterlife with heaven and hell is the old view of the Vedas, where the heroes go to some kind of exuberant paradise, the way the Greek warriors went to the Elysean Fields, the Germanic ones to the Walhalla, or the Islamic jihâd fighters to Jannat where numerous houri-s (nymphs) shower them with their attentions. By contrast, the notion of reincarnation was a later Upanishadic and Shramanic (i.e. monastic, principally Jain and Buddhist) innovation. Both views of the hereafter get mixed up in Manu, e.g. the punishment for perjury is that the culprit is ‘helplessly bound fast by Varuna’s ropes for a hundred births’ (8.82, meaning he will suffer dropsy during that many incarnations, vide Doniger 1991 160), but also that he ‘goes headlong to hell in blind darkness’ (8.94).
From Nietzsche’s distant viewpoint, however, this made little difference, for either way, priests were exploiting supernatural beliefs about people’s invisible fate after death to impose their law on their people: ‘Reduction of human motives to fear of punishment and hope for reward: viz. for the law that has both in its hand’ (14[203] 13.385).
In this respect, Nietzsche classifies Manu along with Moses, Confucius, Plato, Mohammed as just another religious law-giver, i.e. an immoral liar who tricked his society into a certain morality by means of a pious fantasy. They were all the same, e.g.: ‘Mohammedanism has learned it again from the Christians: the use of the hereafter as organ of punishment’ (14[204] 13.386).
It is the way of priests to present the mos maiorum, or whichever innovation they wanted to introduce into it, as divinely revealed:
A law book like that of Manu comes about in the same way as every book of law: it summarizes the experience, shrewdness and experiments in morality of many centuries, it draws a conclusion, nothing more. (AC 57)
To prevent further experimentation by communities affirming their human autonomy,
a double wall is set up […]: first, revelation, that is the claim that the reason behind the law is not of human provenance, has not been slowly and painstakingly looked for and discovered, but instead has a divine origin, [arriving] whole, complete, without history, a gift, a miracle, simply communicated… And second tradition, that is the claim that the law has existed from time immemorial, that it is irreverent to cast doubt on it, a crime against the ancestors. The authority of the law is founded upon the theses: God gave it, the ancestors lived it. (AC 57)
Therefore, Nietzsche rejects a certain anti-Semitic rhetoric then common in ex-Christian circles, and pleads that in this respect, the Aryan Manu is no better than the Semitic Bible, whose priestly vision actually had Aryan origins:
There is a lot of talk nowadays about the Semitic spirit of the New Testament: but what one calls by that name is merely priestly,- and in the Aryan law book of the purest kind, in Manu, this type of ‘Semitism’, i.e. priestly spirit, is worse than anywhere. The development of the Jewish priestly state is not original: they got to know the blueprint in Babylon: the blueprint is Aryan. If the same returned to dominate again in Europe, under the impact of the Germanic blood, then it was in conformity with the spirit of the ruling race: a great atavism. (14[204] 13.386)
Once, in an unpublished note, Nietzsche expresses a healthy modern scepticism towards the pious caste order with its touch-me-not-ism:
[…] the Chandala-s must have had the intelligence and the more interesting side of things to themselves. They were the only ones who had access to the true source of knowledge, the empirical. Add to this the inbreeding of the castes. (14[203] 13.386)
So, to the modern man Nietzsche, the uptight purity rules against inter-caste contact and the distance which the upper castes kept from activities that would get their hands dirty, remains too stifling for comfort. While generally inclined towards the aristocratic system, he did not want to spend his energies campaigning against class- or race-mixing, unlike many Europeans and Americans during the century preceding 1945. Indeed, his ‘genealogical’ speculations largely aimed at disentangling the different components of Europe’s culture and value system, for he was fully aware of the mixed character of the European civilization and nations. In the caste system, he admired the elitist spirit, but not to the extend of trying to uphold its obsessive purity rules in modern society. And while caste ensured stability, a condition cherished by priestly types, Nietzsche was temperamentally more favourable to scenarios of upheaval. In that respect, the modern world was more congenial to him than medieval European or ancient Indian hierarchies, which he preferred to admire from a comfortable distance.
3.3. The racism Nietzsche didn’t borrow from Manu
In Nietzsche’s day, racism was a fully accepted and even dominant paradigm. Nietzsche himself was not its champion or its mastermind, but neither did he stand as a rock against the racially-inclined spirit of the times. The term ‘race’ had a wider range of meanings then, from ‘family’, ‘clan’ and ‘nation’ to phenotypical ‘race’ to the ‘human race’ (exactly the range of meaning that jâti has in colloquial Hindi). In Nietzsche’s case, it only rarely seems to have the fully biological sense that was gaining ground then:
His not infrequent use of the expressions ‘classes’ and ‘estates’ along with ‘races’ strengthens the suspicion that Nietzsche saw the ‘Aryans’ and ‘Semites’ in the first place as social units, rather as ‘peoples’ or societal ranks, less as ‘races’ in the modern sense. They are what they are because they have lived in specific ‘environments’ for a long time. (Schank 2000 60)
Nietzsche shows some knowledge of the findings of Indo-European philology, especially the theories about the wanderings of the ‘Aryans’ and the resultant substratum effect of pre-Indo-European native languages on the language of the Indo-European settlers (Schank 2000 54). Thus, non-Indo-European roots borrowed from lost substratum languages account for nearly 30% of the core vocabulary in Germanic and nearly 40% in Greek, and the differentiation of Proto-Indo-European into its daughter languages is partly due to the respective impact of different substratum languages on its dialects. Nietzsche fully accepted the then-common view that the native Europeans had adopted their Indo-European languages from tribes immigrating from the East, an Urheimat located anywhere between Ukraine and Afghanistan.
Early in the 19th century, this line of research originally had a fairly Indocentric focus, with India itself being the favourite Urheimat, but as India’s status declined from a mystical wonderland to just another colony, the preferred homeland moved westward. The quest for the early history of Indo-European was interdisciplinary avant la lettre in that it brought proto-sociological insights into its historical-linguistic speculations. Thus, what is now called the ‘elite dominance’ model of language spread, in which the dominant Indo-Europeans imparted their language to the substratum populations, included considerations of the caste system.
The Hindu caste system was widely interpreted in racial terms, viz. apartheid between Aryan conquerors and pre-Aryan natives. Likewise, the situation of the Greeks in Greece, with a vocabulary including numerous pre-Indo-European loanwords and the coexistence of free Greeks with a lower class of helots and slaves, was commonly understood as reflecting the subjugation of a native race by the superior invading Aryan race. Nietzsche accepted this racial scenario to an extent in the case of Europe, but most remarkably did not apply this paradigm to Indian society. Adopting Manu’s view, he saw the difference between high and low castes as not being one between superior and inferior races, but between pure and mixed lineages: ‘good proper marriages bring forth good children; a bad one, bad ones’ (14[202] 13.385). To Manu, good marriages are endogamous marriages, e.g. a marriage between two low-caste people is good.
It is only in a very loose sense of the term that Manu could still be described as a racist, viz. in the sense that he did derive people’s rights from the kinship group to which they belonged. These groups need not be distinguished by phenotypical traits, as races in the modern conception are, but just like races they are communities to which one belongs through birth. That is why recent UN campaigns against racism have tended to include casteism as a peculiar case of racism.
Where Nietzsche did (unsystematically) espouse ideas that were later incorporated in the prevalent racist discourse, he definitely didn’t get them from Manu. Thus, the notion of the ‘blonde Bestie’, which, according to Lincoln (1999 104 ff.), cannot be uncoupled from racial thought, has nothing whatsoever in common with Manu’s view of mankind. Firstly, Nietzsche goes along with the then-common identification of ‘Aryan’ with ‘blond’, as when he speaks of ‘the blond, that is Aryan, conqueror-race’ (GM I 5). This idea was totally unknown to Manu, who may well never have seen a blond person in his life yet lived in the centre of what he called Ârya society. But let us add that Nietzsche doesn’t go all the way in this identification of blondness with superiority, for in the same paragraph he goes on to include the warrior aristocracies from Arabia and Japan.
Secondly, Nietzsche’s glorification of the unbridled norm-breaking wildness as a privilege of the conquerors and ruling class, personified as the ‘blond beast’, is without parallel in Manu or the other masterminds of Hindu civilization. In Nietzschean terms, Manu stands for the ‘Apollinian’ values of order, balance, clarity and stability, not at all for the disruptive ‘Dionysian’ exuberance of the ‘blond beast’.
3.4. The antisemitism Nietzsche didn’t borrow from Manu
Nietzsche did not posit a simple division of the world’s religions in two categories, such as ‘Abrahamic’ vs. ‘Pagan’. Even in typologically similar and genealogically related religions, he sees the opposition between deeper psychological tendencies. Thus, both the ‘Aryan’ and the ‘Semitic’ religions show the same division in ‘yes-saying’ and ‘no-saying’ attitudes:
What a yes-saying Aryan religion, born from the ruling classes, looks like: Manu’s law-book. What a yes-saying Semitic religion, born from the ruling classes, looks like: Mohammed’s law-book, the Old Testament in its older parts. What a no-saying Semitic religion, born from the oppressed classes, looks like: the New Testament, in Indian-Aryan terms a Chandala religion. What a no-saying Aryan religion, grown up among the ruling classes, looks like: Buddhism. It is perfectly in order that we have no religion of oppressed Aryan races, for that would be a contradiction: a lordly race is either on top on going extinct. (14[195] 13.380f.)
Note that his judgment of the Jewish Old Testament, with its wars and love stories, is less negative than that of the Christian New Testament. Not that he failed to share some of the common opinions about the Jews, e.g. that they are only middlemen, not creators: ‘The Jews here also seem to me merely “intermediaries”/“middlemen”, – they don’t invent anything’ (KSA 14.420). He also seems to have seconded the ancient view that the Jews were motivated by hatred of the rest of mankind:
These measures are instructive enough: in them we have at once the Aryan humanity, wholly pure, wholly original,- we learn that the concept of ‘pure blood’ is the opposite of a harmless concept. On the other hand, it is clear in which people this hatred, the Chandâla-hatred of this ‘humanity’, has been eternalized, where this hatred had become a religion, where it has become genius. (TI Improvers 4)
And though Judaism was less harmful to man than Christianity, the latter’s Chandâla resentment has ‘sprung from Jewish roots and is only understandable as a plant from that soil’ (TI Improvers 4).
Yet, it bears repeating here that Nietzsche refused to conclude from these common opinions that an anti-Jewish mobilization as envisaged by the rising (self-described) anti-Semitic movement was necessary or even desirable. In a letter to Theodor Fritsch, a declared anti-Semite, he stated:
Believe me: this terrible eagerness by tedious dilettantes to speak up in the debate on the value of people and races, this subjugation to “authorities” which are rejected with cold contempt by every thinking mind […], these continuous absurd falsifications and applications of the vague concepts ‘Germanic’, ‘Semitic’, ‘Aryan’, ‘Christian’, ‘German’ -- all this could end up seriously infuriating me and bringing me out of the ironic benevolence with which I have so far watched the virtuous velleities and phariseisms of the contemporary Germans. -- And finally, what do you think I experience when the name Zarathustra is uttered by anti-Semites? (KSA 14.420f.)
On the other hand, Nietzsche’s linking the Jews with the lowly Chandâla-s, though borrowed from Jacolliot (and unknown to Manu), remains largely his own original contribution to modern anti-Jewish thought. Many things had been said against the Jews, but that one was quite new. It is simply counter-intuitive. If at all Jews, with their distinctive dress and hairdo and cumbersome ritual observances, had to be linked with any Hindu castes, then the purity-conscious and ritual-centred Brahmins (apart from the money-savvy Vaishyas) would seem a more logical choice.
Chandâla-s are the people who do deeply unclean work involving intimate contact with decomposing substances. While notions of clean and unclean exist in many cultures, the specific institution of untouchability is peculiar and is foreign to most societies, probably including the ancient Vedic society of North India. Its origin arguably lay in the Dravidian-speaking society of South India, where the lowest caste is called the Paraiya-s, famously anglicised as Pariah. According to Hart (1983 117):
Before the coming of the Aryans […] the Tamils believed that any taking of life was dangerous, as it released the spirits of the things that were killed. Likewise, all who dealt with the dead or with dead substances from the body were considered to be charged with the power of death and were thought to be dangerous. Thus, long before the coming of the Aryans with their notion of varna, the Tamils had groups that were considered low and dangerous and with whom contact was closely regulated.
The Jews, far from seeing themselves as similarly unclean, had their own set of cleanliness rules protecting their religious personnel from polluting contacts. Thus, the hereditary priestly clan, the Kohanim, have to stay away from funerals to protect their religious charisma from the uncleanness of death. Nor are they allowed to marry converts to Judaism, let alone non-Jews. There is nothing Chandâla-like about this pattern, which closely resembles the Brahmanical attitude. Conversely, orthodox Judaism practises a certain discrimination, though nothing quite as deep and permanent as with the Indian untouchables, against people doing unclean work.
Thus, it has been argued that Saint Paul, who made his living as a tent-maker working for the Roman army and frequently using animal skins, became so eager to renounce Jewish law precisely because by occupation he was unclean under that law (Wilson 1999 43). Even today, missionaries recruiting converts among the Dalit-s (‘broken’, oppressed, the current self-designation of militant ex-untouchables) and trying to make the Gospel relevant to their situation, typically tell them that the shepherds tending the cattle that was to be sent for sacrifice to the temple in Jerusalem, the ones who came to praise Christ in His cradle, were themselves barred from entering the temple. This way, they establish a parallel between Christianity’s superseding Moses’ law with the Indian convert’s emancipation from Manu’s law.
3.6. The politics Nietzsche doesn’t discuss
Nietzsche discourses in general terms about a system of law but doesn’t pay the least attention to the actual laws (or proposals of law, or law-recipes) enumerated in the Manu Smrti or implemented by rulers who took inspiration from this classic. Worse, he pays no attention to the institutions that make caste society possible, e.g. the authority vested in caste pañchâyat or intra-caste council governing caste matters and internal disputes; or in the village pañchâyat, the inter-caste council in which each caste, even the lowest, had a veto right. A consensus had to be reached between the castes, which meant in practice that the harshest discriminations were somewhat mitigated. (Likewise, the ruling council of ancient India’s ‘republics’, composed exclusively of Kshatriyas, had to decide by consensus.)
Conversely, Nietzsche was apparently also unaware of the attempts to reform or abolish the caste system by the Ârya Samâj and other contemporaneous movements. In his own day, the institution of caste was under attack, both from low-caste rebels and from high-caste nationalists who sought to unite their nation across caste divisions. This led to a whole pamphlet literature by reformers and also by defenders of the old system, to court cases and legislative initiatives in British India. In short, for a student of the pros and cons of caste, there were plenty of revealing polemics with freshly mustered data for the taking. And there was an implicit appeal to take sides in that social struggle.
In spite of this, Nietzsche never discussed the actual politics of the caste system. In the ongoing debate on whether he was a political or a non-political thinker, his treatment of Manu weighs in on the side of the second position. His fondness for Manu was a purely theoretical position, less concerned with India’s quaint social divisions as with the underlying spirit of elitism and of accepting the inequality that nature has imposed on mankind.
3.7. The Übermensch connection
With his merely incipient knowledge of Hindu tradition, Nietzsche missed a number of links between his own philosophy and Hindu tradition. His friend Paul Deussen saw a resemblance between the notion of ‘eternal return’ and the Hindu cyclical view of the universe. He rejected Nietzsche’s ‘eternal return’, though, on grounds that are not specifically Hindu. Whereas Nietzsche deduced the inevitability of eternal return from the finiteness of the number of possible combinations of all particles in the universe, Deussen in his Erinnerungen an Friedrich Nietzsche (1901) argues against this that, on the contrary, ‘the game of evolution of the world will have infinite variations’ (quoted in Smith 2005 147).
Likewise, others have seen the potential conceptual kinship between Nietzsche’s notion of the Übermensch and the ‘awakened’ yogi:
Both understand human being as an ever-changing flux of multiple psychophysical forces, and within this flux there is no autonomous or unchanging subject (“ego”, “soul”). Both emphasise the hierarchy that exists or can exist not only among individuals but among the plurality of forces that compose us. For Nietzsche the pinnacle of that hierarchy is the Übermensch, a goal not yet achieved although a potential at least for some; for Buddhism that potential was attained by Shakyamuni Buddha, and at least to some degree by many after him, for it is a potential all human beings are able to realise. (Loy 1998 129)
In Hindu tradition, the sannyâsin or ascetic stands outside the caste order. In spite of all his regulations for a caste-based society, Manu provided for a position outside the caste order. Upon being initiated, the sannyâsin performs his own funeral rites, gives up his name and caste and family ties, and becomes free. That is the job of the Hindu ascetic: to be free. The only ‘work’ he is expected to do, is to subdue in himself all his weaknesses and attachments. The royal road to achieve this is yoga, i.e. quieting the mind, disciplining the monkeys of our thoughts.
The common denominator with Nietzsche’s ideal is self-overcoming, in combination with a spurning of the comforts and certainties of ordinary life. Nietzsche did not explore or develop this connection: ‘To use [the concepts of Übermensch and eternal return - KE] the way he did shows Nietzsche to have been oblivious of the obvious Indian parallels’ (Smith 2005 147). It could have saved him a lot of misinterpretation by admirers who conceived of the Übermensch in eugenic terms.
3.8. Missed opportunities regarding God
Deconstructing God and rethinking the universe as godless were among Nietzsche’s central projects. From Voltaire onwards, many European freethinkers had used India in their personal freedom-struggle as a reference for counterbalancing Christianity. In that light, it is surprising how Nietzsche failed to exploit data from the history of Hindu philosophy in his anti-Christian crusade.
In the period of the late-Vedic handbooks of ritual, the Brâhmana-s, i.e. the apogee of Brahmanical ritualism, the idea dawned on the ritualists that the gods they invoked weren’t really heavenly persons who were listening at the other end of the line and then responded to the human imprecations by granting the hoped-for boon, but mere name-tags for the unseen phases of the magical mechanism which led from the performance of the ritual to the materialization of the requested boon (Clooney 1997). This idea was theorized further by the Mîmânsâ school of philosophy. Likewise, the subsequent shift from ritualism to asceticism (tapas, ‘heat’) proclaimed man’s supreme power to subject the gods to his own will.
The point is illustrated in the life-story of many ascetics including the Buddha, where Indra and Brahma and the other gods come and congratulate him for achieving his awakening (bodhi). In many stories, the gods are afraid of the increasing power of the ascetic and send seductresses to make him abandon his practice. Tapas or asceticism is a Promethean exercise, in which man steals the gods’ thunder. The ascetic schools in the pre-Christian centuries were mostly inclined towards atheism. In the philosophical schools of Sâmkhyâ and early Vaisheshika, and in the non-Vedic school of Jainism, the gods disappear from sight. The Manu-Smrti obliquely testifies to this climate of theism’s lowest ebb. That gods are worshipped is a fact which Manu acknowledges as part of the human landscape, but he hardly concedes any agency to them. The envisioned rewards and punishments for good or evil conduct are not conceived as handed out by a heavenly person, but rather as mechanical (karmic) results of one’s own actions.
Though Nietzsche never published any reflections on this genesis of a kind of atheism within the late-Vedic tradition, his Nachlass indicates he was summarily aware of it:
‘With God, nothing is impossible’, the Christian thinks. But the Indian says: ‘With piety [for] and knowledge of the Veda, nothing is impossible: the gods are submissive and obedient to them. Where is the god who can resist the pious earnestness and prayer of a renouncing ascetic in the forest?’ (14[198] 13.382)
Or, more forcefully: ‘The Brahmin is an object of worship for the gods’ (14[178] 13.363). Like modern man, the sages of India believed in themselves rather than in God.
However, in dealing with ancient Hindu atheism, Nietzsche would also have had to face the subsequent resurgence of theism. Not just in popular religion did theistic devotion (Bhakti) gain an all-India upper hand in the course of the first millennium CE, it also conquered philosophical systems which had started out as atheistic. Consider the increasing impact of a doctrine of a supreme God in the successively emerging schools of Sâmkhyâ (‘enumeration’ of the universe’s components), Vaisheshika (‘distinction-making’, atomism) and Nyâya (‘judgment’, logic):
It hardly had any access into the classical Sâmkhyâ system which at that time was already paralysing and declining. And the branch of the school which accepted the notion of a supreme God, did not attain any great importance. […] In [Vaisheshika - KE] we see clearly how the doctrine of a supreme God gradually forced its way and became established. […] The matter is again quite different with the youngest of these systems, the Nyâyah. In it the concept of God appears in the sûtras themselves and quickly gains importance. (Frauwallner 1955.35-36)
Likewise, in Patañjali’s Yoga Sûtra, the non-theistic core text which describes yoga practice as a purely human endeavour, is overlaid with theistic additions to the extent that modern teachers of Hindu philosophy classify Yoga as a theistic system. Even Buddhism often ended up replacing its original emphasis on individual effort with devotional surrender to a quasi-deity like the Amitabha Buddha (‘of the infinite light’). The monistic Vedânta philosophy initially rejected the distinction between sentient beings down here and a supreme being up there, but in the Middle Ages, it developed theistic variants which are now completely dominant in numerical terms.
Modern Hindus who want to flaunt the liberal virtues of their religion, like to say that ‘a Hindu can even be an atheist’. That may be true in theory, but today, a Hindu is typically a devotional theist. So, in the polemic over the death of God, religious people could take heart from the Hindu precedent of God’s resurrection.
Conclusion
At first sight, the importance of Nietzsche’s discovery of the Manu-Smrti is quite limited, viz. as a collateral illustration of pre-Christian civilization glorified by him, principally represented by Greece but now also found to have flowered in the outlying Indian branch of the Indo-European world. Crucial pieces of Manu’s worldview, such as the centrality of a priestly class (Nietzsche’s sympathy being more with the martial aristocracy) and the notion of ritual purity, seem irrelevant to Nietzsche’s ultimately very modern philosophical anthropology. They are sometimes mentioned disparagingly, while other Hindu ideas are not given due attention, e.g. dharma as caste-specific duty. In particular, the transparently priestly character of Manu’s code, with its dangling of supernatural rewards (c.q. punishments) after death in order to keep people in line, is dismissed as but a variation on similar ‘tricks’ in the much-maligned Judeo-Christian tradition. Yet, a few specifically Indian notions did have a wider impact on Nietzsche’s worldview.
Principally, the notion of Chandâla became a cornerstone in Nietzsche’s view of mankind, representing the most lowly and contemptible type of man, who broods on revenge against superior types. In a far-fetched departure from Manu’s use of the term, he relates the concept of Chandâla to the psycho-sociological origin of the Jewish national character and thence to the psychology of resentment allegedly underlying Christianity. Secondly, Manu’s strict opposition to caste-mixing tallied with Nietzsche’s aristocratism, which values people’s genealogy and encourages the differentiation of mankind into specialized classes. In the spirit of the times, however, it was also susceptible to co-optation into the then-emerging racialist reading of human reality as well as of Nietzsche’s own work. But the philosopher never committed himself to any Manu-inspired politics.
Finally, Manu’s respect for asceticism as a positive force in society (though best left to a class of specialists, not a norm for all), seemingly so in conflict with Nietzsche’s contempt for ‘otherworldliness’, resonates with subtler pro-ascetic elements in Nietzsche’s philosophy, especially in his conception of the Übermensch. But this, along with the budding atheism in ancient Hinduism, was to remain one of the potential Hindu sources of inspiration that Nietzsche left unexplored.
Bibliography
Altekar, A.S., 1959, The Position of Women in Hindu Civilisation, 2nd ed., Delhi: Motilal Banarsidass (reprint 1995).
Ambedkar, ‘Babasaheb’ Bhimrao Ramji, 1916, ‘Castes in India. Their Mechanism, Genesis and Development’, in: Writings and Speeches, Bombay: Government of Maharashtra, 1989, pp.3-22.
Berkowitz, Roger, 2003, ‘Friedrich Nietzsche, the Code of Manu, and the Art of Legislation’, in: Cardozo Law Review, 24:3, pp.1131-1149.
Berkowitz, Roger, 2006, ‘Friedrich Nietzsche, the Code of Manu, and the Art of Legislation’, in: New Nietzsche Studies, 6:3/4 & 7:1/2, pp.155-169.
Bonfiglio, Thomas Paul, 2006, ‘Toward a Genealogy of Aryan Morality: Nietzsche and
Jacolliot’, in: New Nietzsche Studies, 6:3/4 & 7:1/2, pp.170-186.
Clooney, Francis, 1997, ‘What’s a god? The quest for the right understanding of devatâ in Brâhmanical ritual theory’, in: International Journal for Hindu Studies, Aug. 1997, pp.337-385.
Daniélou, Alain, 1975, Les Quatre Sens de la Vie. Structure Sociale de l’Inde Traditionnelle, Paris: Buchet-Chastel (reprint 1984).
Doniger, Wendy, 1991, The Laws of Manu, London: Penguin.
Elst, Koenraad, 2007, Asterisk in Bhâropîyasthân. Minor Writings on the Aryan Invasion Debate, Delhi: Voice of India.
Etter, Annemarie, 1987, ‘Nietzsche und das Gesetzbuch des Manu’, in: Nietzsche-Studien, 16, Berlin/New York: Walter de Gruyter.
Frauwallner, Erich, 1955, ‘The original beginning of the Vaisheshika Sûtras’, in: Posthumous Essays, Delhi: Aditya Prakashan 1994, pp.35-41.
Ghurye, Govind Sadashiv, 1932, Caste and Race in India, Bombay: Popular Prakashan (reprint 1986).
Ghurye, Govind Sadashiv, 1959 (2nd ed.), The Scheduled Tribes, Bombay: Popular Prakashan (reprint 1995; first published as The Adivasis – So-Called, and Their Future, 1943).
Gopal, Ram, 1959, India of Vedic Kalpasûtras, Delhi: Motilal Banarsidass (reprint 1983).
Hart, George L., III, 1980, ‘The Theory of Reincarnation among the Tamils’, in Wendy Doniger (ed.), 1983, Karma and Rebirth in Classical Indian Traditions, Indian reprint Delhi: Motilal Banarsidass.
Hegel, G.W.F., 1826, Ueber die unter dem Namen Bhagavad-Gita bekannte Episode des Mahabharata von Wilhelm von Humboldt, Berlin (tr. Herbert Herring, On the Episode of the Mahâbhârata known by the Name of Bhagavad-Gîtâ by Wilhelm von Humboldt, Delhi: Indian Council of Philosophical Research, 1925).
Jacobi, Hermann, 1894, ‘On the date of the Rgveda’, reproduced in K.C. Verma et al., eds., 1986, Rtambhara: Studies in Indology, Ghaziabad: Society for Indic Studies, pp.91-99.
Kane, Pandurang Vaman, 1930, History of Dharma Shâstra, vol.1, Pune: Bhandarkar Oriental Research Institute (reprint, 1990).
Köbler, Gerhard, 2000, Indogermanisches Wörterbuch, 3rd ed., Innsbruck: Internationale Germanistische Etymologische Lexikothek (online).
Loy, David R., 1998, review of Robert G. Morison, Nietzsche and Buddhism (OUP 1997), in: Asian Philosophy, 8/2, pp.129-131.
Majumdar, Ramesh Chandra, 1960, The Classical Accounts of India, Calcutta: Firma KLM reprint 1981.
Monville, Aymeric, 2007, Misère du nietzschéisme de gauche: de Georges Bataille à Michel Onfray, Brussels: Éd. Aden.
Rajshekar, Vontibettu Thimmappa, 1983, Why Godse Killed Gandhi, Dalit Sahitya Akademy, Bangalore.
Ridley, Aaron / Norman, Judith, (eds.), 2005, Nietzsche, Friedrich: The Anti-Christ, Ecce Homo, Twilight of the Idols, and Other Writings; Cambridge University Press.
Schank, Gerd, 2000, ‘Rasse’ und ‘Züchtung’ bei Nietzsche, Berlin/New York: Walter de Gruyter.
Sharma, R.N. (ed.), 1998, Manusmrti, Delhi: Chaukhamba Sanskrit Pratishthan.
Singh, Kumar Suresh, 1999, The Scheduled Castes, 2nd ed., Delhi: OUP.
Smith, David, 2006, ‘Nietzsche’s Hinduism, Nietzsche’s India’, in: New Nietzsche Studies, 6:3/4 & 7:1/2, pp.131-154.
Wilson, Andrew Norman, 1997, Paul: the Mind of the Apostle, New York: W.W. Norton (Dutch tr.: Paulus, de Geest van de Apostel, Amsterdam: Prometheus, 1999).
Winternitz, Moriz, 1907, Geschichte der indischen Literatur (English tr. 1920, Motilal Banarsidass; reprint, Delhi 1987).
00:10 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, nietzsche, hindouisme, philosophie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 29 janvier 2010
La décense commune contre l'égoïsme libéral
| La décence commune contre l'égoïsme libéral |
| « Un noir pessimisme imprègne la conception libérale de la nature humaine. L’homme est un loup pour l’homme. L’égoïsme constitue le fond de son caractère. A la suite des sanglantes guerres de religion, les penseurs qui furent plus tard rangés sous la bannière libérale en sont sûrs : tout homme est une canaille irrécupérable. […] La vision pessimiste de la nature humaine est-elle absolument correcte ? Nous voudrions montrer que, comme le dit Chamfort, la vérité est au milieu, un peu au-dessus de ces deux erreurs symétriques que sont l’optimisme et le pessimisme.
Pour s’en tenir au domaine politique, on se fiera à George Orwell. Socialiste monarchiste, anarchiste conservateur, il a insisté sur la notion de common decency que les traducteurs nomment en français décence ou honnêteté communes. La décence commune résume un certain nombre de règles que presque tout le monde (à part les enfants-rois et les intellectuels post-modernes) connaît et pratique : on ne dénonce personne, on ne triche pas, on ne frappe pas un homme à terre, on ne s’attaque pas à un plus faible que soi, surtout pas en bande, on est galant avec les dames, on respecte les vieillards, on est spontanément bienveillant, on aide ses proches, etc. Dans une société où règne la décence commune, le don est premier. Chaque enfant reçoit de ses parents la vie et le langage. L’anthropologie montre que la triple obligation de “donner, recevoir, rendre” fonde l’ordre interne de maintes communautés. Les milieux “avancés” semblent vouloir échapper au cycle du don et lui substituer la devise du Figaro de Beaumarchais, valet malin, désireux de grimper dans le monde et de devenir maître : “demander, recevoir, prendre”. C’est la mentalité d’aujourd’hui, minoritaire mais insidieuse, qui unit dans la même attitude le prédateur et la victime. Dans les sociétés bien réglées, “ça ne se fait pas de demander”. Dans un régime de prédateur-victime, je demande parce que j’ai droit à tout, je reçois ce qui m’est dû, je le prends en chassant de mon esprit toute idée de dette, puis je recommence jusqu’à plus soif. Par aveuglement idéologique, certains veulent conformer la nature humaine à un modèle libéral, efficace seulement à courte échéance, l’encourager à l’égoïsme, à la compétition pour la compétition, à faire carrière plutôt qu’à exercer un métier, le soumettre à une concurrence illimitée et à une consommation obligatoire, jusqu’à créer ce que les psychologues appellent des addictions. C’est rendre le monde invivable. »
Jacques Perrin, “Le bien, banal et fragile”, La Nation, 15 janvier 2010 |
00:20 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, libéralisme, sociologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 28 janvier 2010
Sobre el disenso como método
Sobre el disenso como método
Alberto Buela (*)
 Los filósofos como los científicos más que probar teorías, disponen de teorías para explicitar lo implícito en el caso de la filosofía y para ampliar los alcances de la ciencia en el caso de los científicos.
Los filósofos como los científicos más que probar teorías, disponen de teorías para explicitar lo implícito en el caso de la filosofía y para ampliar los alcances de la ciencia en el caso de los científicos.
Esta verdad que resulta una verdad a plomo, que cae por su propio peso, que es evidente por sí misma ha sido y es de difícil aceptación pues, en general, se dice que se tienen teorías o se quiere probar una teoría. Lo cual no es correcto.
El hecho de darse cuenta, que uno puede disponer de una teoría facilita el trabajo de investigación pues la teoría se transforma allí en un medio de acceso a la verdad y no un fin en sí misma como erróneamente es tomada.
La realidad, los entes para hablar filosóficamente, son la consecuencia del proceso de investigación y las prácticas científicas que vienen a convalidar la teoría. Así, si esa teoría es verdadera confirma esa realidad, esos entes.
La atribución de verdad, de realidad, de coherencia, de consistencia, de adecuación es lo que permite avanzar en el camino del conocimiento. En una palabra, no se avanza justificando teorías sino que se avanza disponiendo de teorías que las prácticas científicas en el caso de la ciencia o las prácticas fenomenológicas en el caso de la filosofía pueden atribuir verdad .
La ciencia, y la filosofía lo es, puede ser pensada en este sentido como un conjunto de representaciones que se manifiestan como teorías (Aristóteles), paradigmas (Kuhn), programas (Lakatos), modelos (Popper), tradiciones (MaIntayre) que se confirman en las prácticas y no meramente en la representación.
Nosotros, en nuestro caso, hemos dispuesto de una teoría: La teoría del disenso a partir de la cual intentamos explicar al hombre, el mundo y sus problemas desde una mirada no conformista y alejada del pensamiento único, típico de nuestra época.
El disenso entendido como otro sentido al dado y establecido nos ha permitido crear teoría verdaderamente crítica y no “nominalmente crítica” como ha sucedido en definitiva con la Escuela neomarxista de Frankfurt.
Recuerdo a Conrado Eggers Lan lo enojado que estaba cuando en Estados Unidos lo recibió Marcuse del otro lado de un soberbio escritorio judicial, cómodamente apoltronado y criticando al capitalismo, siendo que era un satisfecho del sistema capitalista como pocos.
La producción de teoría crítica desde el disenso exige un compromiso no solo político sino existencial. Es que el otro para la teoría del disenso no es el del ómnibus, colectivo o subte es aquel que me opugna y disiente y al que “localizo” existencialmente. En este sentido el
disenso rompe el simulacro de la mentalidad ilustrada de “hacer como si tengo en cuenta al otro” por una exigencia civilizada cuando en realidad lo que busco es distanciarme sin que se de cuenta. La filantropía, como alejada ocupación del otro (por ej. con un cheque un filántropo salva su conciencia, aun cuando ese dinero termine en los bolsillos de un sátrapa en compra de armas para matar a quienes se dice ayudar) reemplazó en la modernidad a la caridad que es la ocupación gratuita del otro, pero entendido como singular y concreto. Por ello se habla en el catolicismo de “las caridades concretas” y nuestros viejos padres criollos nos exigían incluso “tocar físicamente” aquel a quien se auxilia.
Es sabido que todo método es un camino para llegar a alguna parte, en este sentido el disenso como método no se agota en el fenómeno como la fenomenología sino que además privilegia la preferencia de nosotros mismos. Parte del acto valorativo como un mentís profundo a la neutralidad metodológica, que es la primera gran falsedad del objetivismo científico, sea el propuesto por el materialismo dialéctico sea el del cientificismo tecnocrático. Rompe con el progresismo del marxismo para quien toda negación lleva en sí una superación progresiva y constante. Por el contrario, el disenso no es omnisciente, pues puede decir “no sé” y así se transforma en un método también del saber popular, que se caracteriza por no negar la existencia de algo que es o existe sino que cuando niega, sólo niega la vigencia de ese algo.
En cuanto a la preferencia de uno mismo siempre se realiza a partir de una situación dada, un locus histórico, político, económico, social y cultural determinado. En nuestro caso el dado por la ecúmene iberoamericana. Esto obliga a pensar el disenso como un pensamiento situado que tiene como petición de principio el hic Rhodus, hic saltus (aquí está Rodas, aquí hay que bailar) de Hegel al comienzo nomás de su Filosofía del Derecho.
Esto nos ha permitido establecer un pensamiento de ruptura con la opinión pública, que hoy no es otra que la opinión publicada.
Este pensamiento de ruptura, o mejor, pensamientos de rupturas, nos ha permitido dar respuestas breves a esa multiplicidad de imágenes truncas que nos brinda la postmodernidad respecto de la vida hoy. A esos analfabetos culturales locuaces (Fayerabend) que son los periodistas y locutores que hablan de todo sin decir que nada es verdadero o falso o, peor aun, cuando lo hacen siempre se encuentran del lado de la falsedad. Ello es así, porque son simples voceros del pensamiento único y políticamente correcto. De esta forma de ver y pensar las cosas y los problemas que nace desde los grandes gestores culturales (los famosos en cada disciplina) que no buscan otra cosa que la consolidación del estado de cosas tal como está. Es que la realidad tal como se da en todos los órdenes es la que les permitió ser lo que son, y la metafísica enseña que todo ente busca perseverar en su ser.
La ruptura por parte del disidente, en general rebelde y marginado, de este círculo hermenéutico (de interpretación de lo que es) se ha transformado así en una masa compacta e impenetrable pues si se atacan las teorías de los famosos (en filosofía el humanismo, en ciencia el objetivismo, en arte el subjetivismo caprichoso y arbitrario, en religión el ecumenismo de todos por igual, en política el progresismo democrático) sale uno del mundo, queda marginado, alienado, cuando no demonizado.
Sin embargo, la única posibilidad que se vislumbra es la creación de teoría crítica a partir del disenso como método que es quien rompe el consenso de los satisfechos del sistema tanto en las sociedades opulentas como en las otras.
00:20 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, argentine, amérique latine, amérique du sud, dissidence, théorie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
G. Faye: L'Essai sur la violence de M. Maffesoli
 Archives « Guillaume Faye » - 1985
Archives « Guillaume Faye » - 1985
Guillaume FAYE:
L’ “Essai sur la violence” de Michel Maffesoli
Michel Maffesoli n’aime pas le “devoir-être”; la sociologie qu’il a fondée, orientée vers l’analyse de la “socialité” quotidienne et imprégnée de paganisme dionysiaque, échappe autant à l’énoncé de solutions historiques et politiques pour notre temps qu’à l’alignement sur les prêts-à-penser idéologiques. “Laissant à d’autres le soin d’être utiles, note-t-il dans la préface de la deuxième édition de ses “Essais sur la violence”, il me semble possible d’envisager les problèmes sociaux sous l’angle métaphorique (…). On est loin de ce qu’il est convenu d’appeler la demande sociale ou autres fariboles de la même eau. C’est de l’esthétisme. Peut-être faut-il en accepter le risque”. Cet esthétisme donne lieu en tous cas à un travail très complet et fort sérieux: la réédition des “essais sur la violence”, publiés en 1978 dans un ouvrage maintenant épuisé (« La violence fondatrice », Ed. du Champs Urbain, Paris, avec une préface de Julien Freund) offre à la réflexion l’une des meilleurs approches sur le statut et la fonction sociale de « cette mystérieuse violence » qui est, dit l’auteur, « peut-être préférable à l’ennui mortifère d’une vie sociale aseptisée ».
Prenant le contre-pied de l’humanisme chrétien qui, comme la plupart des idéologies contemporaines qu’il a innervées, considère la violence —sociale ou politique— comme une anomalie anthropologique. Maffesoli, dans la lignée de Max Weber et de Carl Schmitt, voit dans la violence, la lutte et l’hostilité, « les moteurs principaux du dynamisme des sociétés » (p. 13). A une société « monothéiste » qui prétendrait éliminer toute violence pour uniformiser les valeurs, Maffesoli voit dans la reconnaissance de la violence comme trame du social, la marque d’un esprit polythéiste et antitotalitaire. Analysant la « dynamique » de la violence, son « invariance », son caractère « dionysiaque » et expliquant comment une violence ritualisée et intégrée par la société civile —par le peuple— peut constituer un moyen de défense de la communauté organique contre les impératifs et les normes (autrement violents) de l’Etat égalitaire. Maffesoli met en lumière l’ « ambivalence » de la violence : elle est à la fois structurante —si elle s’avère ritualisée et organique— et déstructurante —si elle s’éprouve comme délinquance chaotique dans une société policée et sécurisée—, libératrice et totalitaire, créatrice et destructrice à l’image du Scorpion, le signe zodiacal de Maffesoli lui-même !
S’appuyant parfois sur les travaux des éthologistes, Maffesoli qui échappe —chose rare aujourd’hui— aux angélismes et aux utopies du siècle, souligne le caractère fondateur de la violence dans la dynamique des rapports sociaux, qu’ils soient institutionnels ou privés, exceptionnels (le « débridement passionnel orgiastique ») ou ressortissant de la banalité de la vie de tous les jours.
 Mais, quoiqu’il prétende ne pas toucher à l’idéologie politique, Maffesoli donne tout de même en cette matière une importante leçon. En refusant de légitimer ou de ritualiser la violence, en s’en arrogeant aussi le monopole sous une forme « rationnelle » et « neutre », l’Etat égalitaire moderne fonde paradoxalement « la violence totalitaire, l’abstraction du pouvoir par rapport à la socialité », comme la définit Maffesoli, qui ajoute : « ce qui se dessine (…), c’est que la maîtrise de cette menace organisée, en étant déliée d’un enracinement social, devienne le lot d’un Big Brother anonyme, contrôleur et constructeur de la réalité » (p. 17). Dès lors que la violence est « décommunalisée », abstraitement et légalement détenue par une technocratie et qu’elle n’est plus légitime au sein de la société civile qui savait la ritualiser, dès lors donc que la société est sécurisée par l’Etat, on assiste paradoxalement à l’émergence de la violence irrationnelle, « terrifiante et angoissante », celle de l’insécurité d’aujourd’hui : « La mise en spectacle rituelle de la violence permettrait que celle-ci fût en quelque sorte extériorisée. Sa monopolisation, son devenir rationnel tend au contraire à l’intérioriser » (p. 18).
Mais, quoiqu’il prétende ne pas toucher à l’idéologie politique, Maffesoli donne tout de même en cette matière une importante leçon. En refusant de légitimer ou de ritualiser la violence, en s’en arrogeant aussi le monopole sous une forme « rationnelle » et « neutre », l’Etat égalitaire moderne fonde paradoxalement « la violence totalitaire, l’abstraction du pouvoir par rapport à la socialité », comme la définit Maffesoli, qui ajoute : « ce qui se dessine (…), c’est que la maîtrise de cette menace organisée, en étant déliée d’un enracinement social, devienne le lot d’un Big Brother anonyme, contrôleur et constructeur de la réalité » (p. 17). Dès lors que la violence est « décommunalisée », abstraitement et légalement détenue par une technocratie et qu’elle n’est plus légitime au sein de la société civile qui savait la ritualiser, dès lors donc que la société est sécurisée par l’Etat, on assiste paradoxalement à l’émergence de la violence irrationnelle, « terrifiante et angoissante », celle de l’insécurité d’aujourd’hui : « La mise en spectacle rituelle de la violence permettrait que celle-ci fût en quelque sorte extériorisée. Sa monopolisation, son devenir rationnel tend au contraire à l’intérioriser » (p. 18).
Guillaume FAYE.
(recension parue dans « Panorama des idées actuelles », mars 1985 ; cette revue des livres et des idées était dirigée par le grand indianiste français Jean Varenne, disparu prématurément en 1997 ; avec l’aimable autorisation de l’auteur).
Michel MAFFESOLI, Essai sur la violence banale et fondatrice, Librairie des Méridiens, paris, 1984, 174 pages.
00:15 Publié dans Sociologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, sociologie, violence, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 27 janvier 2010
Kapital als Aberglaube
Kapital als Aberglaube
 Das Kapital ist ein Glaube, und das Schlimme an diesem Glauben ist, dass es ein unethischer Glaube ist, - dass es ein Glaube ist, der nur regiert wird von einem einzigen Instinkt des Menschen, von seinem unmittelbaren, atavistischen, vom Egoismus, und dass dieser Egoismus nur gehemmt wird durch die Furcht vor dem Egoismus der anderen. Wie ein wildes Tier arbeitet eine Firma gegen die andere, rücksichtslos bedrängt der Fiskus den Bürger, und verschlagen und rücksichtslos versucht der Bürger, der Steuer zu entgehen. Wunderschöne Namen sind dafür erfunden worden. Eine ganze Wissenschaft hat sich aufgebaut aus dem Wunsch des Bürgers, dem Staat nur so wenig Steuern bezahlen zu müssen, als es irgendwie geht, und grosse Büros mit vornehm klingenden Namen leben von diesem Wunsch. Ein Spiel um Worte, denn dass der Staat Geld braucht, das ist ja klar, und dass er eigentlich gerecht besteuern müsste, müssten wir nach allem, was wir in der Schule von Ethik gelernt haben, wohl voraussetzen. Die Praxis beweist das Gegenteil. Der Staat wird als Feind betrachtet, und der Staat betrachtet seinen Bürger, der ihm Steuern zahlt, zunächst als Betrüger.
Das Kapital ist ein Glaube, und das Schlimme an diesem Glauben ist, dass es ein unethischer Glaube ist, - dass es ein Glaube ist, der nur regiert wird von einem einzigen Instinkt des Menschen, von seinem unmittelbaren, atavistischen, vom Egoismus, und dass dieser Egoismus nur gehemmt wird durch die Furcht vor dem Egoismus der anderen. Wie ein wildes Tier arbeitet eine Firma gegen die andere, rücksichtslos bedrängt der Fiskus den Bürger, und verschlagen und rücksichtslos versucht der Bürger, der Steuer zu entgehen. Wunderschöne Namen sind dafür erfunden worden. Eine ganze Wissenschaft hat sich aufgebaut aus dem Wunsch des Bürgers, dem Staat nur so wenig Steuern bezahlen zu müssen, als es irgendwie geht, und grosse Büros mit vornehm klingenden Namen leben von diesem Wunsch. Ein Spiel um Worte, denn dass der Staat Geld braucht, das ist ja klar, und dass er eigentlich gerecht besteuern müsste, müssten wir nach allem, was wir in der Schule von Ethik gelernt haben, wohl voraussetzen. Die Praxis beweist das Gegenteil. Der Staat wird als Feind betrachtet, und der Staat betrachtet seinen Bürger, der ihm Steuern zahlt, zunächst als Betrüger.Der Kapitalismus ist ein unmoralischer Glaube, besser gesagt, er ist ein amoralischer. Aber der erste Schritt ist bereits getan, wenn man weiss, dass der Kapitalismus eigentlich ein Aberglaube ist, ein Aberglaube, wie die Astrologie, die ja auch amoralisch ist und sich jetzt mit einem Mäntelchen der Moral umkleidet.
Der Kapitalismus ähnelt überhaupt sehr stark der Astrologie. Denn ebenso blind, wie diese Pseudowissenschaft, begünstigt und vernichtet er die Individualität des einzelnen.
Wolfgang Forell, Kapital als Aberglaube. Betrachtung über einige aktuelle Fragen in der heutigen Zeit. In: Gegner, Heft 3, 15. August 1931, S. 15-17.
00:17 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, sociologie, théorie politique, politologie, économie, sciences politiques, politique, capitalisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Saint Chesterton, riez pour nous !
Saint Chesterton, riez pour nous !
Dieu : la preuve par l’Absurde
Puisque la mode est aux béatifications, j’en ai une bien bonne à vous raconter ! En plus, celle-là n’a guère été médiatisée, et pour cause : Gilbert K. Chesterton n’a pas été pape de 1939 à 1945. Primo, la place était prise ; deuxio les papes anglais, ça se fait plutôt rare ces deux mille dernières années ; et puis de toute façon, l’intéressé était mort depuis trois ans.
Accessoirement, la cause de béatification de Gilbert n’en est qu’à ses tout débuts. C’est seulement l’été passé que le Chesterton Institute a eu l’idée de l’introduire auprès du Vatican, à l’issue d’un colloque judicieusement intitulé “The Holiness of Gilbert K. Chesterton“.
La nouvelle fut annoncée au monde ébahi le 14 juillet dernier par Paolo Giulisano, auteur de la première biographie en italien de mon écrivain ultra-mancien préféré1.
Il y raconte comment Pie XI avait réagi à l’annonce du décès de Chesterton (par la plume de son secrétaire d’Etat Eugenio Pacelli, encore lui !) Bref le pape Ratti déplorait, dans son message de condoléances, la perte de ce “fils fervent de la Sainte Eglise, brillant défenseur des bienfaits de la foi catholique.”
C’était seulement la deuxième fois dans l’Histoire qu’un pontife décernait ce titre, jadis prestigieux, de “défenseur de la foi” à un Anglais. Et encore, rappelle malicieusement Giulisano, la première fois ce ne fut pas un succès : ça concernait Henry VIII, peu avant qu’il n’invente sa propre Eglise pour des raisons de convenance personnelle2.
Le chemin de Chesterton fut exactement inverse : élevé dans le protestantisme pur porc, marié à une “high anglican“, il n’a cessé de se rapprocher du catholicisme jusqu’à s’y convertir.
Dès ses jeunes années de journaliste, Gilbert s’exerça à dézinguer tour à tour les penseurs organiques de la société anglicano-victorienne : Kipling, Wells, G.-B. Shaw et leur “monde rapetissé”.
En 1901, il publie ses chroniques dans un recueil aimablement intitulé Hérétiques. Pourtant, il ne sortira lui-même officiellement de cette hérésie dominante, en se faisant baptiser, qu’à 40 ans passés… Le temps sans doute de peser la gravité d’une telle apostasie, et surtout de ménager son épouse – qui le suivra un an plus tard dans cette conversion. Happy end !
Dans l’intervalle, il avait quand même publié Orthodoxie, son Génie du christianisme à lui, en moins chiant quand même. Ce Credo iconoclaste, si l’on ose dire, fut sa réponse à une question mille fois entendue, genre : “C’est bien beau de tout critiquer, mais tu proposes quoi, petit con ?” (Gilbert avait 27 ans à la parution d’Hérétiques.) Une réponse en forme de pamphlet prophétique et drôle qui à coup sûr, un siècle plus tard, a moins vieilli que l’avant-dernier Onfray.
Je ne saurais trop recommander la lecture de ce chef-d’œuvre d’humour et d’amour – y compris à ceux d’entre vous qui n’ont “ni Dieu ni Diable”, comme disait ma grand-mère3. Après tout, les amateurs de films de vampires ne croient pas tous à l’existence de ces fantômes suceurs de sang…
Je reviendrai volontiers, à l’occasion, sur l’apologétique chestertonienne, pour peu qu’Elisabeth Lévy m’en prie… Mais pour aborder le bonhomme, dont toute l’œuvre n’a d’autre but que de mettre l’esprit au service de l’Esprit, il semble plus raisonnable de commencer par le “e” minuscule. Surtout sur un site comme Causeur – laïc et gratuit, faute hélas d’être obligatoire.
Journaliste, essayiste et romancier, “confesseur de la Foi” et auteur de polars, Chesterton fut d’abord, dans toutes ces entreprises, un incomparable théoricien mais aussi praticien du Rire (contrairement à l’ami Bergson, qui rit quand il se brûle4).
Ainsi, dans Le Défenseur5, publié la même année qu’Hérétiques, consacre-t-il un chapitre à la “Défense du nonsense”. Est-ce à dire que sa foi relève elle-même du nonsense ?
La réponse est oui à toutes les questions ! Ce punk, figurez-vous, n’hésite pas à justifier un paradoxe par un jeu de mots. Le fou, le vrai, nous dit-il, ce n’est pas comme dans le dico l’homme qui a perdu la raison ; c’est “celui qui a tout perdu sauf la raison”.
Le nonsense au sens de l’oncle Gilbert, c’est le contraire de la folie : une des façons les plus sensées, pour nous autres pauvres créatures – peut-être même pas créées ! – d’assumer notre condition. Et d’abord notre incapacité naturelle à “comprendre” l’Univers qui nous inclut. Il ferait beau voir, n’est ce pas, qu’un contenu explique son contenant !
Mais Chesterton ne plaisante pas avec le nonsense. N’allez pas, par exemple, lui parler de Lewis Carroll ! Son Alice au Pays des Merveilles relève tout juste de l’ ”exercice mathématique”. Loin d’abjurer la foi en la déesse Raison, il en intègre tous les principes. Ses fantaisies millimétrées ne sont pas un moyen d’évasion : juste la cour de la prison !
Le vrai nonsense selon G.K., il faut aller le chercher chez Edward Lear (1812-1888), passé d’extrême justesse à la postérité grâce à ses Nonsense poems6. Pourtant, au temps de Chesterton déjà, ce ouf malade était bien démodé, quand “Alice” avait commencé de s’imposer comme la Bible du nonsense.
Eh bien, Gilbert s’en fout : la différence irréductible, explique-t-il, c’est que les limericks de Lear ne riment littéralement à rien – même si leur versification, elle, a la rigueur métronomique d’une nursery rhyme. Et si l’ensemble donne une idée de l’Absolu, c’est qu’il n’est relatif à rien de particulier : ouvert comme un Oulipo en plein air.
Bien sûr la lettre en est inaccessible, et plus encore au lecteur non anglophone. Reste l’esprit, qui n’en est que plus libre.
Un exemple ? Mais bien volontiers : à la demande générale, laissez-moi “traduire” les premiers vers de Cold are the crabs, un des plus beaux poèmes du roi Lear 7. Ça m’a pris plus d’une heure pour un quatrain, alors doucement les basses ! De toute façon, je ne risque rien : personne n’a jamais pu faire le job convenablement, même Google !
Faute de “sens” conventionnel, que traduire exactement ? Rien. A sa façon, le learisme est un darwinisme : adapt or die ! Voici donc mon adaptation de Cold are the crabs8 (on considérera comme muets, par licence poétique, les “e” qui figurent entre parenthèses) :
“Froids sont les crab(e)s qui rampent sur nos monts,
Et plus froids les concombr(e)s qui poussent tout au fond ;
Mais plus froides encor(e) les menteries cyniques
Qui emballent nos trist(e)s pilules philosophiques.”
Comment ça, je ne suis pas fidèle au texte ? Mais qui êtes-vous pour parler de contre-sens dans l’adaptation d’un nonsense ? Bien sûr, là où j’écris “menteries cyniques”, Google préfère traduire littéralement “côtelettes d’airain”. Du coup ça vous prend une consonance surréaliste, et ça perd tout sens.
Or, pour notre ami Gilbert, le vrai nonsense a un sens, et c’est précisément que le sens de la vie nous est caché ! On ne peut y accéder qu’en passant par le “Royaume des Elfes”.
Pas les délires formatés à la Lewis Carroll ; plutôt les rêveries inspirées à la C.S. Lewis… Je sais : Chesterton n’a connu que l’un des deux, et moi aucun. Mais à ce compte-là, qu’est ce qu’on fait de vous ?
En tout cas, ça serait con de se brouiller maintenant, surtout sans raison. Alors j’en ai trouvé une excellente : pinailler jusqu’au bout sur le sens du nonsense.
Deux erreurs de perspective, plutôt courantes ces derniers siècles, consistent d’un même mouvement à naturaliser le surnaturel et à surnaturaliser le naturel. Grâce au nonsense, prêche le père Gilbert, sortons enfin de ce cercle vicieux !
Admettons-le une fois pour toutes en souriant : quelque chose ici-bas nous dépasse ! “Et si les plus vieilles étoiles n’étaient que les étincelles d’un feu de joie allumé par un enfant ?”
- Et encore, il la partage avec l’excellent Hilaire Belloc (”Chesterton & Belloc : Apologia e Profezia”, Ed. Ancora). ↩
- Du temps de son “Adversus Lutherum”, qui fait toujours autorité. ↩
- Maternelle. L’autre était athée. ↩
- Et encore, au deuxième degré ! ↩
- Un des noms de Dieu dans la Bible. ↩
- Que Chesterton et son pote Hilaire ont même tenté d’imiter ; mais on ne peut pas être doué pour tout, n’est ce pas ? Moi-même, etc. ↩
- D’après moi. ↩
- Cold are the crabs that crawl on yonder hills,
Colder the cucumbers that grow beneath,
And colder still the brazen chops that wreathe
The tedious gloom of philosophic pills ! ↩
00:15 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, catholicisme, lettres anglaises, littérature anglaise, angleterre, théologie, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Anarchici "di destra"
Anarchici “di destra”
Anarchico era Papini, quando si firmava Gianfalco e nei primi anni del Novecento progettava una filosofia della trasgressione violenta: «Noi dobbiamo ricercare, esaltare e realizzare la vita piena, completa, ricca, esuberante, traboccante, tropicale, ascendente e dobbiamo perciò perseguitare, esiliare, sopprimere tutto quello che tende a impoverire, ad abbassare, a limitare, a imprigionare la vita». Lo scrisse nel 1905, con circa un trentennio di vantaggio sull’Arbeiter di Jünger, gettando le prime basi di quella saldatura tra individualismo “faustiano” e comunitarismo gerarchico che si chiamò poi fascismo. Il Papini giovane si definì anarchico a chiare lettere, ma di un anarchismo anti-nichilista, neopagano feroce, futurista, superomista, nietzscheano. E anarchico era Lorenzo Viani, il pittore viareggino che scriveva anche racconti sulla povera gente rivierasca, marinai taciturni, a contatto con la morte. Progettò Viani una “repubblica sociale” alla maniera anarchica insieme con Riccardo Roccatagliata Ceccardi, bizzarrissima figura di sregolato genialoide: doveva essere la “Repubblica Apuana”. Viani, amico del vecchio libertario Errico Malatesta, fu poi squadrista e negli anni trenta collaborò al Popolo d’Italia, ma da povero, da schivo e riservato. Come Marcello Gallian, altro anarchico alternativo, anti-borghese viscerale, uno che non smise di crederci per tutta la vita, che come tanti della “sinistra” vide nel fascismo della prima ora e in Mussolini capo dinamico la risposta rivoluzionaria, innovatrice, sbrigliata, ai conformismi di “destra” e di “sinistra”. Gallian rimase fedele al suo ideale anche di fronte a tante sfasature del regime. E, come pochi altri, ingenui e nobili, finì povero, anzi poverissimo. E anarchico era Berto Ricci, grande ammiratore di Stirner, instancabile stimolatore di idee, vero uomo libero che mise la sua intelligenza al servizio di una volontà di rinnovamento direi antropologico del tipo d’uomo all’italiana. E lo stesso Mussolini, negli anni precedenti la prima guerra mondiale, fece i conti con Stirner, la cui figura dell’Unico dominatore voleva fondere con il solidarismo comunitario. Al contrario di Evola che, da posizioni individualiste, tratteggiò un algido Autarca fatto di echi stirneriani, ma lontano da ogni risvolto popolare.
Tutto questo fu “anarchismo di destra”, perché, a differenza dell’altro, non era egualitario, ma anzi convintamene differenzialista. Credeva nella forza del genio, nella potenza dell’individuo d’eccezione, il fuorilegge ribaltatore degli strati sociali, il titano che con la sua volontà rovescia i mondi filosofici ma, all’occorrenza, sa fare e disfare la storia. Anarchismo con venature alla Plechanov, molto Nietzsche, poca utopia libertaria, più concretezza, più realismo, tanto sangue ribellistico, buone dosi di Stirner, ma dello Stirner profondo, quello che riservò un paragrafo del suo libro sull’Unico alla “gerarchia” e alla celebrazione, quasi razziale, della superiorità della stirpe caucasica: la migliore, quella che rifarà il mondo.
A destra troviamo dunque questo anarchismo, diciamo così, culturale, sul quale si arrovellarono in parecchi. Anarchismo di istinti, di carne. Poi ce ne fu uno più propriamente politico, ideologico, militante. Al capolinea dell’interventismo, nel 1914, intrecciarono i loro destini la rivolta sociale e il mito della liberazione nazionale. Ci furono avanguardie che incontrarono altre avanguardie. L’anarco-interventismo si trovò a fianco del sindacalismo rivoluzionario, e i Corridoni e i Mussolini a loro volta si unirono ai d’Annunzio, ai Locchi, ai Corradini, agli Slataper, i poeti della patria libera. Quando poi, nel dopoguerra, si videro bande nere ribelli, quando si sentì parlare di repubblica, di liberazione dalle vecchie ipoteche conservatrici e clericali, si lessero programmi, come quello sansepolcrista, che parlavano di consigli del lavoro, di espropriazione delle ricchezze, di partecipazione dei lavoratori alla gestione dell’impresa etc., la saldatura si fece da sola. Gli anarchici di “destra”, anti-utopisti, politici realisti, come erano divenuti interventisti capendo la portata rinnovatrice della guerra, così si fusero col fascismo, intuendone la portata destabilizzatrice della decrepita Italia monarchico-liberal-giolittiana. Il filone anarchico che confluì nel fascismo, sposandone in pieno il progetto politico, non fu poca cosa. E fu anche evento naturale, che combaciò con posizioni ribellistiche come l’arditismo e lo squadrismo.Ci furono adesioni singole di base. Ma ci furono anche uomini che, provenendo direttamente dall’anarchismo, ne continuarono l’attitudine anti-sistema dai vertici del fascismo-movimento e anche da quelli del fascismo-regime. Da Leandro Arpinati, poi gerarca potente e infine emarginato, a Massimo Rocca, elemento influente nei primi anni venti, a Mario Gioda, primo segretario del Fascio torinese e grande avversario del monarchico De Vecchi, che immancabilmente finirà col surclassarlo. Fino a Edoardo Malusardi, punta di diamante del primo fascismo veronese, una realtà nata molto inclinata a “sinistra”. Malusardi, sindacalista-integralista, corridoniano, operaista, rimase nelle seconde file del fascismo, fedele ai suoi ideali di “lotta contro la proprietà e il capitale improduttivo e contro la burocrazia parassitaria”.
Bisogna dire che proprio in questo anarco-fascismo militante si celava a volte una contraddizione singolare, che è poi quella stessa che rende le ideologie non di rado pieghevoli e sinuose, fino a produrre connubi impensabili. Nato individualista, l’anarchismo reca in sé un’anima “liberale”. Stirner, non a caso, si formò su Hobbes. Arpinati, amico di Torquato Nanni, chiuse la carriera da perfetto liberale. Rocca, al tempo della sua idea élitaria sui “gruppi di competenza”, aveva in mente un’idea di gerarchia tecnocratica che potrebbe essere benissimo definita liberale. L’anarco-libertaria Maria Rygier, divenuta fascista e poi andata in esilio, finì nel dopoguerra con l’iscriversi al PLI. Cosa succedeva? L’accento sull’individuo, se esce dalla filosofia “faustiana” ed entra in società, può produrre guasti: anarco-capitalismo è il nome di un recente rampollo nato da incroci ideologici, per i quali non si è ancora trovata alcuna profilassi.
00:10 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : anarchisme de droite, philosophie, italie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
L'itinéraire d'Edgar Julius Jung
 Archives de Synergies Européennes - 1992
Archives de Synergies Européennes - 1992
L'itinéraire d'Edgar Julius Jung
par Robert Steuckers
Né le 6 mars 1894 à Ludwigshafen, fils d'un professeur de Gymnasium, Edgar Julius Jung entame, à la veille de la première guerre mondiale, des études de droit à Lausanne, où il suit les cours de Vilfredo Pareto. Quand la guerre éclate, Jung se porte volontaire dans les armées impériales et acquiert le grade de lieutenant. A sa démobilisation, il reprend ses études de droit à Heidelberg et à Würzburg mais participe néanmoins aux combats de la guerre civile allemande de 1918-19. Engagé dans le corps franc du Colonel Chevalier von Epp, il participe à la reconquête de Munich, gouvernée par les «conseils» rouges. Jung organise ensuite la résistance allemande contre la présence française dans le Palatinat. En 1923, il doit quitter précipitamment les zones occidentales occupées pour avoir trempé dans le complot qui a abouti à l'assassinat du leader séparatiste francophile Heinz Orbis. C'est de cette époque que date son aversion pour la personne de Hitler: ce dernier, sollicité par Jung envoyé par Brüning, avait refusé de rejoindre le front commun des nationaux et des conservateurs contre l'occupation française, estimant que le «danger juif» primait le «danger français». Pour Jung, ce refus donnait la preuve de l'immaturité politique de celui qui allait devenir le chef du IIIième Reich. En 1925, Jung ouvre un cabinet d'avocat à Munich. Il renonce à l'activisme politique et rejoint la DVP nationale-libérale, un parti toléré par les Français dans le Palatinat et qui rassemblait, là-bas, tous les adversaires du détachement de cette province allemande. Quand Stresemann opte pour une politique de réconciliation avec la France, dans la foulée du Pacte de Locarno (1925), Jung se distancie de ce parti, mais en reste formellement membre jusqu'en 1930. Il consacre ses énergies à toutes sortes d'entreprises «métapolitiques» et d'activités «clubistes». En effet, entre 1925 et 1933, la République de Weimar voit se constituer un véritable réseau de clubs conservateurs qui organisent des conférences, publient des revues intellectuelles, cherchent des contacts avec des personnalités importantes du monde de l'économie ou de la politique. Après avoir eu quelques contacts avec le Juniklub et le Herren-Klub de Heinrich von Gleichen et Max Hildebert Boehm (dont il retiendra la définition du Volk), Jung adhère et participe successivement aux activités du Volksdeutsches Klub (de Karl Christian von Loesch), de la Nationalpolitische Vereinigung (à Dortmund) et du Jungakademisches Klub de Munich, dont il est le fondateur. L'objectif de cette stratégie métapolitique est de créer une nouvelle conscience politique chez les étudiants, de manier l'arme de la science contre les libéraux et les gauches et de fonder une éthique pour les temps nouveaux. En 1927, paraît la première édition de son livre Die Herrschaft der Minderwertigen (= La domination des hommes de moindre valeur), véritable vade-mecum de la révolution conservatrice d'inspiration traditionaliste ou jungkonservative (que nous distinguons de ses inspirations nihiliste, nationale-révolutionnaire, soldatique comme chez les frères Jünger, nationale-bolchévique, völkische, etc.). Entre 1929 et 1932, paraissent plusieurs éditions d'une nouvelle version, comptant deux fois plus de pages, et approfondissant considérablement l'idéologie jungkonservative. Petit à petit, pense Jung, une idéologie conservatrice et traditionaliste, puisant dans les racines religieuses de l'Europe, remplacera la «domination des hommes de moindre valeur», établie depuis 1789. Mais, secouée par la crise, l'Allemagne n'emprunte pas cette voie conservatrice: le parlementarisme libéral s'effondre, plus tôt que Jung ne l'avait prévu, mais pour laisser le chemin libre aux communistes ou aux nationaux-socialistes. Jung constate avec amertume que le noyau conservateur qu'il avait formé dans ses clubs ne fait pas le poids devant les masses enrégimentées. Pour gagner du temps et barrer la route au mouvement hitlérien, Jung estime qu'il faut soutenir le gouvernement de Brüning. Ce gouvernement prolongerait la vie de la démocratie libérale pendant le temps nécessaire pour former une élite conservatrice, capable de passer aux affaires et de construire l'«Etat organique et corporatif» dont rêvaient les droites catholiques. Pour Jung, l'avènement du national-socialisme totalitaire serait la conséquence logique de 1789 et non son éradication définitive par une «éthique de plus haute valeur». En 1930-31, il rejoint les rangs de la Volkskonservative Vereinigung, qui soutient Brüning, et cherche à la rebaptiser Revolutionär-konservative Vereinigung pour séduire une partie de l'électorat national-socialiste. En mai 1932, Brüning tombe. Jung décide de soutenir son successeur Papen, qu'il juge aussi falot que lui. Jung devient toutefois son conseiller. Quand Hitler accède au pouvoir en janvier 1933, Jung prépare aussitôt les élections de mars 1933 en organisant la campagne électorale du Kampffront Schwarz-Weiß-Rot, visant à soutenir l'aile conservatrice du nouveau gouvernement et à transformer la révolution nationale de Hitler, marquée par une démagogie tapageuse, en une révolution conservatrice, chrétienne, tranquille, sérieuse, décidée. Cette ultime tentative connaît l'échec. Jung continue cependant à écrire les discours de von Papen. Le 17 juin 1934, ce dernier, lors d'un rassemblement universitaire à Marbourg, prononce un discours écrit par Jung, où celui-ci dénonce le «byzantinisme du national-socialisme», ses prétentions totalitaires contre-nature, ses polémiques contre l'esprit et la raison et réclame le retour d'une «humanité véritable» qui inaugurera l'«apogée de la culture antique et chrétienne». Le régime réagit en interdisant la radiodiffusion du discours et la circulation de sa version imprimée. Papen démissionne mais cède ensuite aux pressions de la police. Jung est arrêté le 25 juin et, cinq jours plus tard, on retrouve son cadavre criblé de balles dans un petit bois près d'Oranienburg. Le destin de Jung montre l'impossiblité de mener à bien une révolution conservatrice/traditionaliste à l'âge des masses.
La domination des hommes de moindre valeur. Son effondrement et sa dissolution par un Règne nouveau (Die Herrschaft der Minderwertigen. Ihr Zerfall und ihre Ablösung durch ein neues Reich), 1929
Jung a voulu faire de cet ouvrage une sorte de «bible» de la «révolution conservatrice», une révolution qu'il voulait culturelle et annonciatrice d'un grand bouleversement politique. S'adressant aux jeunes et aux étudiants, Jung veut donner à son conservatisme —son Jungkonservativismus— une dimension «révolutionnaire». Il explique que l'idéologie progressiste a eu son sens et son utilité historique; il fallait qu'elle brise l'hégémonie de formes mortes. Mais depuis que celles-ci ont disparu de la scène politique, l'attitude progressiste n'a plus raison d'être. L'idéologie du progrès n'est plus qu'une machine qui tourne à vide. Pire, quand elle reste sur sa lancée, elle peut s'avérer suicidaire. A la suite de la parenthèse progressiste, doit s'ouvrir une ère de «maintien», de conservation. Le Jungkonservativismus ne cherche donc pas à perpétuer des formes politiques dépassées. Quant aux formes sociales et politiques actuelles, pense Jung, elles ne sont plus des formes au sens propre du mot, mais des résidus évidés, balottés dans le chaos de l'histoire. Jung définit ensuite son conservatisme comme «évolutionnaire»: il vise le dépassement d'un monde vermoulu, l'inversion radicale et positive de ses fausses valeurs. Ce travail d'inversion/restauration est, aux yeux de Jung, proprement révolutionnaire.
La période qui suit la Grande Guerre est caractérisée par la crise épocale des valeurs individualistes et bourgeoises en pleine décadence. Pour les relayer, le Jungkonservativismus jungien propose un recours à Dilthey et à Bergson, à Spengler, Tönnies, Roberto Michels, Vilfredo Pareto et Nicolas Berdiaev. La crise s'explique, en langage spenglérien, par le passage au stade de «civilisation» qui est le couronnement de l'esprit libéral. Les liens sociaux sont détruits et les peuples tombent sous la coupe d'une démocratie inorganique, gérée par les «hommes de moindre valeur». Tel est le diagnostic. Pour sortir de cette impasse, il faut restaurer les vertus religieuses. Abandonnant ses positions initiales, lesquelles reposaient sur une philosophie des valeurs tirée du néo-kantisme, Jung veut désormais ancrer son «axiome de l'immuabilité de la pulsion métaphysique» dans un discours théologisé. Deux philosophes de la religion contribuent à le faire passer du néo-kantisme au néo-théologisme: Nicolas Berdiaev et Leopold Ziegler (qui deviendra son ami personnel). Jung embraye sur l'idée de Berdiaev qui évoque le fin imminente de l'époque moderne qui a vu le triomphe de l'irreligion. Pour Jung comme pour Berdiaev ou Ziegler, l'époque qui succèdera au libéralisme moderne sera un «nouveau Moyen Age» pétri de religion, réchristianisé. Eliminant les catastrophes de l'individualisme, ce nouveau «Moyen Age» restaure une holicité (Ganzheit), un universalisme dans le sens où l'entendait Othmar Spann, un «organicisme» historique et non biologique. Cette dernière position distingue Jung des nationalistes de toutes catégories. En effet, il rejette le concept de «nation» comme «occidental», c'est-à-dire «français» et révolutionnaire, libéral et atomiste. Dans ce concept de «nation», domine le rationalisme raisonneur de l'idéologie des Lumières. Les «nations», dans ce sens, sont les peuples malades ou morts. Les peuples qui n'ont pas subi l'emprise de l'idéologie nationale, qui est d'essence révolutionnaire et est donc perverse, sont vivants, conservent au fond d'eux-mêmes des énergies intactes et demeurent les «porteurs de l'histoire». Jung relativise ainsi au maximum la valeur attribuée à l'Etat national, fermé sur lui-même. Les concepts-clé sont pour lui ceux de peuple (Volk) et de Reich. Cette dernière instance, supra-nationale et incarnation politique du divin sur la Terre, est une idée d'ordre fédérative, tout à fait adaptée à l'espace centre-européen. De là, elle devra être étendue à l'ensemble du continent européen, de façon à instaurer un europäischer Staatenbund (une fédération des Etats européens). Sur le plan spirituel, l'idée de Reich est le seul barrage possible contre le processus de morcellement rationaliste et nationaliste. Les Etats-Nations reposent sur un fait figé rendu immuable par coercition, tandis que le Reich est un mouvement perpétuel dynamique qui travaille sans interruption les matières «peuples». Pour Jung, né protestant mais devenu catholique de fait, l'idée nationale est une tradition protestante en Allemagne, tandis que l'idée dynamique de Reich est une idée catholique. Sur le plan intérieur, ce Reich fédératif est organisé corporativement. A la place du Parlement et du suffrage universel, Jung suggère l'introduction d'une représentation populaire corporative et d'un droit de vote échelonné et différencié. L'organisation intérieure de son Reich idéal, Jung la calque sur les idées du sociologue et philosophe autrichien Othmar Spann. C'est le talon d'Achille de son idéologie: cette organisation corporative ne peut s'appliquer dans un Etat moderne et industriel. Son appel à l'ascèse et au sacrifice ne pouvait nullement mobiliser les Allemands de son époque, durement frappés par l'inflation, la crise de 29, la famine du blocus et les dettes de Versailles.
(Robert Steuckers).
- Bibliographie: Die geistige Krise des jungen Deutschland, 1926 (discours, 20 p.); Die Herrschaft der Minderwertigen. Ihr Zerfall und ihre Ablösung, 1927 (XIV + 341 pages); Die Herrschaft der Minderwertigen. Ihr Zerfall und ihre Ablösung durch ein neues Reich, 1929 (2ième éd.), 1930 (3ième éd.) (692 pages); Föderalismus aus Weltanschauung, 1931; Sinndeutung der deutschen Revolution, 1933; une copie du mémoire rédigé par E.J. Jung à l'adresse de Papen en avril 1934 se trouve à l'Institut für Zeitgeschichte de Munich, archives photocopiées 98, 2375/59 et chez Edmund Forschbach, ami et biographe d'E.J. Jung (cf. infra); d'après Karlheinz Weißmann (cf. infra), Jung serait l'auteur de la plupart des textes contenus dans le recueil de discours de Franz von Papen intitulé Apell an das deutsche Gewissen. Reden zur nationalen Revolution. Schriften an die Nation, Bd. 32/33, Oldenburg i.O., 1933.
- Principaux articles de philosophie politique: 1) Dans la revue Deutsche Rundschau: «Reichsreform» (nov. 1928); «Der Volksrechtsgedanke und die Rechtsvorstellungen von Versailles» (oct. 1929); «Volkserhaltung» (mars 1930); «Aufstand der Rechten» (1931, pp.81-88); «Neubelebung von Weimar?» (juin 1932); «Revolutionäre Staatsführung» (oct. 1932); «Deutsche Unzulänglichkeit» (nov. 1932); «Verlustbilanz der Rechten» (1/1933); «Die christiliche Revolution» (sept. 1933, pp. 142-147); «Einsatz der Nation» (1933, pp. 155-160); 2) Dans les Schweizer Monatshefte: 1930/31: Heft 1, p. 37, Heft 7, p. 321; 1932/33: Heft 5/6, p. 275; 3) Dans la Rheinisch- Westfälische Zeitung, où Jung utilisait le pseudonyme de Tyll, voir les dates suivantes: 1/1/1930; 5/3/1930; 5/4/1930; 24/4/1930; 2/5/1930; 31/5/1930; 12/10/1930; 8/11/1930; 30/12/1930; 28/1/1931; 7/2/1931; 4/3/1931; 1/4/1931; 10/4/1931; 1/8/1931; été 1931; 15/3/1932; 4) Dans les Münchner Neueste Nachrichten, voir les dates suivantes: 20/3/1925; 28/1/1930; 23/11/1930; 3/1/1931; 25/7/1931; 4/7/1931; 5) Dans les Süddeutsche Monatshefte: «Die Tragik der Kriegsgeneration», mai 1930, pp. 511-534; 6) Dans Die Laterne: «Was ist liberal?», Folge 6, 6/5/1931.
- Participation à des ouvrages collectifs: «Deutschland und die konservative Revolution», in E.J. Jung, Deutsche über Deutschland. Die Stimme des unbekannten Politikers, Munich, 1932, pp. 369-383; on signale également une contribution d'E.J. Jung («Die deutsche Staatskrise als Ausdruck der abandländischen Kulturkrise») dans Karl Haushofer et Kurt Trampler (éd.), Deutschlands Weg an der Zeitenwende, Munich, 1931; le livre signé par Leopold Ziegler, Fünfundzwanzig Sätze vom Deutschen Staat (Berlin, 1931) serait en fait dû à la plume de Jung.
- Sur Edgar Julius Jung: Leopold Ziegler, Edgar Julius Jung. Denkmal und Vermächtnis, Salzbourg, 1955; «Edgar Jung und der Widerstand» in Civis 59, Bonn, Nov. 1959; Friedrich Grass, «Edgar Julius Jung (1894-1934)», in Kurt Baumann (éd.), Pfälzer Lebensbilder, Bd. 1, Spire, 1964; Karl Martin Grass, Edgar Julius Jung, Papenkreis und Röhmkrise 1933-1934, dissertation phil., Heidelberg, 1966; Bernhard Jenschke, Zur Kritik der konservativ-revolutionäre Ideologie in der Weimarer Republik. Weltanschauung und Politik bei Edgar Julius Jung, Munich, 1971 (avec une bibliographie reprenant 79 articles importants d'E.J. Jung); Karl-Martin Grass, «Edgar J. Jung», in Neue Deutsche Biographie, 10. Bd., Berlin, 1974; Joachim Kaiser, Konservative Opposition gegen Hitler 1933/34. Edgar Julius Jung und Ewald von Kleist-Schmenzin, Texte non publié d'un séminaire de l'Université d'Aix-la-Chapelle, 1984; Edmund Forschbach, Edgar J. Jung, ein konservativer Revolutionär 30. Juni 1934, Pfullingen, 1984; Gilbert Merlio, «Edgar Julius Jung ou l'illusion de la "Révolution Conservatrice"», in Revue d'Allemagne, tome XVI, n°3, 1984; Karlheinz Weißmann, «Edgar J. Jung» in Criticón, 104, 1987, pp. 245-249; Armin Mohler, Die Konservative Revolution in Deutschland 1918-1932. Ein Handbuch, 3ième éd., Darmstadt, 1989.
- Pour comprendre le contexte historique: Klemens von Klemperer, Konservative Bewegungen zwischen Kaiserreich und Nationalsozialismus, Munich/Vienne, 1957; Erasmus Jonas, Die Volkskonservativen 1928-1933, Düsseldorf, 1965; Theodor Eschenburg, «Hindenburg, Brüning, Groener, Schleicher», in Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, 9. Jg. 1961, 1; Kurt Sontheimer, Antidemokratisches Denken in der Weimarer Republik, Munich 1962; Franz von Papen, Vom Scheitern einer Demokratie 1930-1933, Mayence, 1968; Klaus Breuning, Die Vision des Reiches. Deutscher Katholizismus zwischen Demokratie und Diktatur, Munich, 1969; Volker Mauersberger, Rudolf Pechel und die «Deutsche Rundschau» 1919-1933. Eine Studie zur konservativ-revolutionären Publizistik in der Weimarer Republik, Brème, 1971; Jean-Pierre Faye, Langages totalitaires, Paris, 1972; Martin Greiffenhagen, Das Dilemma des Konservatismus in Deutschland, Munich, 1977.
00:05 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : révolution conservatrice, philosophie, théorie politique, années 20, années 30, allemagne, sciences politiques, politologie, weimar, révolution conservatrice |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 24 janvier 2010
Erik M. Ritter von Kuehnelt-Leddihn: Garantiert unmodern
Garantiert unmodern
Ex: http://www.deutsche-stimme.de/
Immer noch lesenswert: Randnotizen zum 100. Geburtstag von Erik Maria Ritter von Kuehnelt-Leddihn
 |
| Rechts, aber nicht unbedingt »konservativ«: Kuehnelt- Leddihn (1909 – 1999) |
Der am 31. Juli 1909 geborene Erik Maria Ritter von Kuehnelt-Leddihn zählt zu den beinahe vergessenen Geistesgrößen des vergangenen Jahrhunderts – Grund genug, sich seiner zum 100. Geburtstag wieder zu erinnern.
Gebürtiger Steirer, studierte Kuehnelt-Leddihn, schon in jungen Jahren tiefkatholische Anhänger der Reichsidee altösterreichischer Prägung, in Wien und Budapest, unternahm 1930 im Alter von 21 Jahren seine erste Rußlandreise, über die er für eine konservative ungarische Zeitung berichtete, und lehrte von 1937 bis 1947 an verschiedenen Kollegs in den USA.
Zu dieser Zeit hatte er auch bereits seine ersten zeitkritischen Romane veröffentlicht, die stets den Glauben einbezogen. Kuehnelt-Leddihn betrachtete sich als Mann der äußersten Rechten und war ein Gegner der modernen, sich von der Französischen Revolution herleitenden kollektivistischen Ideologien; die Französische Revolution stellte für ihn überhaupt die Urkatastrophe der neueren Geschichte dar. In ihrem Gefolge griff sowohl die Demokratie mit ihren – für Kuehnelt weder theologisch, philosophisch noch anderweitig begründbaren – Prinzipien der Gleichheit aller Menschen und der Richtigkeit von Mehrheitsentsåcheidungen und ihrer Neigung zur Unterdrückung von völkischen und sozialen Minderheiten sowie Eliten Platz als auch der logisch an die Demokratie anknüpfende egalitäre Sozialismus und der ebenfalls auf der Demokratie gründende »identitäre«, d.h. gleichmacherische Nationalismus.
Den Nationalsozialismus betrachtete er als Synthese beider und verortete auch ihn auf der »linken« Seite des politischen Spektrums. Hier ist der bei Kuehnelt-Leddihn zuweilen besondere Gebrauch der Begriffe zu beachten: »Identitär« bedeutet ihm so viel wie »übereinstimmend«; einem solchen Prinzip stellte er das »diversitäre« gegenüber, d.h. ein die gewachsene Vielfalt achtendes. Den »Nationalismus« betrachtete er als »identitär«, der Gewachsenes in ein Prokustesbett zwängen möchte, wie es beispielsweise auch in der Französischen Revolution der Fall war.
Demokratische Sentimentalisierung
Die Ursache für die Katastrophen der Moderne sah der Ritter, der sich nach seiner Rückkehr Ende der vierziger Jahre in Tirol niederließ, im großen Abfall vom Christentum seit dem 18. Jahrhundert und im damit verbundenen Machbarkeitswahn eines sich selbst überschätzenden Menschentums. Er gab einem übervölkischen, traditionalen Reichsgedanken den Vorzug, einem nicht auf »Blut«, sondern »Boden« bezogenen Patriotismus sowie dem freiheitlichen Rechtsstaat und wandte sich gegen die demokratische Sentimentalisierung und Unsachlichkeit, die er in den Wahlkämpfen mit ihrem Stimmenfang und im parlamentarischen Betrieb ausmachte.
In seinem 1953 erschienenen Werk »Freiheit oder Gleichheit« vertrat Kuehnelt unter Bezug auf zahlreiche Denker des 19. Jahrhunderts die These, Freiheit und Gleichheit seien unvereinbar, und beschäftigte sich ausführlich mit den Grundideen von Monarchie und Demokratie und mit politischen Prinzipien. Er unterschied vier Phasen des Liberalismus, wobei er die dritte Phase – den relativistischen Altliberalismus – nicht als im wirklichen Sinne liberal betrachtete, während er für den entstehenden Neuliberalismus, für den u.a. Röpke und Müller-Armack standen, Sympathien hegte.
Als Alternative zur Liberaldemokratie, die an ihrem inneren Gegensatz scheitern und zu Chaos oder totalitärer Tyrannei führen müsse, wie mehrfach geschehen, plädierte Kuehnelt für ein unparteiisches, professionelles Beamtentum, einen unabhängigen Gerichtshof, dem auch Theologen angehören sollten, und eine monarchische Spitze samt Kronrat. Ständische und regionale Volksvertretungen sah sein grober Entwurf ebenfalls vor.
Aktuelle Warnung vor der Linken
Zeitlebens warb Kuehnelt, der 1957 mit alljährlichen ausgedehnten Weltreisen begann, für die Formulierung einer konservativen oder rechten Ideologie, die theistisch und transzendental ausgerichtet und »personalistisch« sein, Vernunft und Gefühl in Einklang bringen, Tradition und Erfahrung achten, die gewachsene Vielfalt des Menschengeschlechts wertschätzen und Staat und Kirche in ein geordnetes Verhältnis bringen solle.
Vorrangig war für ihn die Wahrung von Freiheit, Recht und Ordnung. Er war überzeugt, daß die Rechte ohne eine solche zusammenhängende Schau und nur mit reinem Pragmatismus der Linken – der östlichen wie der westlichen oder auch einer möglichen Neuauflage des Nationalsozialismus – und ihren profilierten Ideologien nicht entgegentreten könne, worin er sich beispielsweise mit Gerd-Klaus Kaltenbrunner einig sah.
Mit diesem Thema befaßte sich Kuehnelt u. a. in den Aufsätzen »Der Anti-Ideologismus« (Criticon 120, 1973), »Ideologie und Utopie« (in: »Rechts, wo das Herz schlägt«, Graz, 1980) und »Die Krise der Rechten« (in: »Die recht gestellten Weichen«, Wien, 1989). Seine Vorstellungen einer Rechtsideologie stellte er ausführlich im 1982 in den USA erschienenen »Portland-Manifest« dar.
Die Selbstverortung vieler Konservativer als in der Mitte stehend erschien Kuehnelt als mutlos, den Begriff »konservativ« lehnte er ab, da dieser nicht besage, was zu erhalten sei. 1985 erschien eine Generalabrechnung mit der Moderne, »Die falsch gestellten Weichen. Der rote Faden 1789-1984«, in welcher Kuehnelt-Leddihn die neue Geschichte seit der Französischen Revolution aus seiner Sicht kenntnisreich, zuweilen, wie es ihm oft beliebte, im guten Sinne polemisch, darstellte, »eine Anti-Festschrift, die es in sich hat«, wie sich Caspar von Schrenck-Notzing in seiner Besprechung in Criticon ausdrückte.
Trotz der Ereignisse der Jahre 1989-1991 besteht auch heute noch, wenngleich vielleicht in geschwächter Form, das von Kuehnelt festgestellte Ideologiemonopol der Linken. Die Vormachtstellung der Linken bedeutete für Kuehnelt die Herrschaft der Halbgebildeten über die Ungebildeten in Medien und Schulen, Die wahrhaft großen Geister hätten stets rechts gestanden, äußerte er in einem Criticon-Aufsatz 1991.
1995 warnte er unter dem Titel »Die Linke ist noch nicht am Ende« in »Theologisches« die Rechte vor der Unterschätzung der vermeintlich geschwächten Linken. Diese sei »ihre zwei größten Hypotheken losgeworden: den Köhlerglauben an den Staatskapitalismus (der richtige Name für den Sozialismus) und die friedensbedrohende UdSSR mit ihren Gulags und anderen Greueltaten.«
»Panoptikum für unmoderne Menschen«
Sie sei gegen Bindungen und wende sich nun neben der Kirche vor allem gegen die Familie, ihr Programm sei »nicht mehr die Götterdämmerung marxistisch-leninistischen Charakters [...] sondern die Verschweinung der Völker, die zum Schluß womöglich nur mehr aus Hurenböcken, Dirnen, Urningen, verwahrlosten Kindern, Drogensüchtigen und Aids-Kranken bestehen, eine wahrhaft ›marcusische‹ Vision!« An der Richtigkeit dieser Anmerkungen kann heute kaum noch ein Zweifel bestehen. Die nach 1990 aufkeimende Hoffnung, mit linker Utopie und daraus hervorgehenden, von Lüge begeleiteten Experimenten sei es vorbei, hat sich noch nicht erfüllt.
Seinen Lebensabend verbrachte Kuehnelt-Leddihn weiterhin studierend, schreibend und lehrend. Über Kindheit und Jugend sowie seine ausgedehnten Bildungs- und Vortragsreisen schrieb er sein letztes, erst posthum im Jahre 2000 erschienenes Buch »Weltweite Kirche«. Die Theologie hatte er immer als Kern seiner Beschäftigung betrachtet. Am 26. Mai 1999 starb Erik von Kuehnelt-Leddihn in Lans/Tirol.
Manfred Müller hatte schon 1981 in Nation & Europa in seiner Besprechung des bereits erwähnten Aufsatzbandes »Rechts, wo das Herz schlägt. Ein Panoptikum für garantiert unmoderne Menschen« geäußert, man treffe »heute selten auf einen so belesenen und weitgereisten Schriftsteller wie Kuehnelt-Leddihn«, und er biete »auch Nationalisten vielfältige Anregung zu fruchtbarer geistiger Auseinandersetzung.« Und der im Januar dieses Jahres verstorbene Freiherr von Schrenck-Notzing, welcher den Ritter gut gekannt hatte, bezeichnete ihn 2006 als »Fundgrube, die noch der Erschließung harrt.«
Über Erik von Kuhnelt-Leddihn erscheint voraussichtlich Ende des Jahres eine von Marco Reese, Marius Augustin und Martin Möller herausgegebene Monographie.
Marco Reese
00:15 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, conservatisme, idéologie, antimodernité, modernité, allemagne, autriche |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 20 janvier 2010
In necessariis diversitas
In necessariis diversitas
 Vergelijkbare discussies vinden ook plaats wanneer het erom gaat de rol van de Europese Unie en die van de lidstaten te beoordelen.
Vergelijkbare discussies vinden ook plaats wanneer het erom gaat de rol van de Europese Unie en die van de lidstaten te beoordelen.Wat is de waarde van het argument en het tegenargument ?
Wel, op de eerste plaats zijn er zaken waarvoor noch het ene argument noch het andere erg relevant zijn. Als het gaat over bevoegdheidsverdeling, gaat het over zaken waarin verschillen beslecht moeten worden door een regel of een beleidsbeslissing. Zaken als vriendschappen horen daar gelukkig nog niet onder. Wanneer zaken aan de markt of de samenleving kunnen worden overgelaten, zou men dit ook kunnen betogen. Evenwel is de vraag of dat moet gebeuren natuurlijk al een politieke keuze, waarover men van mening kan verschillen. Kortom, het gaat natuurlijk over de vraag op welk niveau het best bepaalde politieke keuzes worden gemaakt. En over de vraag of het iets uitmaakt dat die meningsverschillen zich niet alleen voordoen tussen de meerderheid van de ene en de andere Gemeenschap of lidstaat, maar ook binnen die gemeenschap of lidstaat.
In wezen dezelfde vraag rijst in bijna elke discussie over zgn. mensenrechten (1).
Mensenrechten pretenderen universeel te zijn, maar over de invulling ervan zijn er zeer verschillende opvattingen; die invulling houdt dus ook een politieke keuze in, en opnieuw rijst de vraag of die keuze dan moet gemaakt worden op meer bepaald europees niveau (met daarbij ook de Raad van Europa en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens) of moet worden overgelaten aan de lidstaten of hun deelstaten of kantons, of nog lokalere niveaus. Moet de betekenis van een kruisbeeld in de klas overal op dezelfde manier ingeschat worden en de regel dus overal dezelfde zijn ? Moeten het "recht op" huwelijk en echtscheiding of het "recht op" abortus of euthanasie overal in Europa hetzelfde zijn omdat het over mensenrechten zou gaan ? Moet de regel over het dragen van hoofddoekjes op school in heel Europa dezelfde zijn omdat het over mensenrechten zou gaan, is dat een zaak van elke staat of deelstaat, of zelfs van elke school apart ? Aanhangers van het democratisch centralisme zoals de Belgische grootinquisiteur vinden natuurlijk het eerste (2). In zulke materies in diversiteit blijkbaar opeens geen waarde meer.
Welnu, er zijn zeer goede redenen om precies in die zaken waarin er fundamenteel verschillende opvattingen bestaan, de beslissing aan het lagere niveau over te laten, zelfs wanneer men ook op dat niveau sterk verdeeld is. Dat laatste is met andere woorden geen goed argument. Hoe meer zo'n vragen gecentraliseerd worden, hoe scherper de tegenstellingen worden, hoe meer ideologische groepen tegen elkaar worden opgezet, hoe absolutistischer de kampen gaan denken.
Wat het voorbeeld abortus betreft, werd dit zeer scherpzinnig opgemerkt in een afwijkende opinie van de Amerikaanse opperrechter Scalia (in de zaak Planned Parenthood (3)): abortus is in Amerika een nationaal probleem geworden dat de Amerikaanse samenleving dieper verdeelt dan ooit tevoren, precies omdat de opperrechters ooit beslist hebben dat dezelfde regel moest gelden in heel de VS (nl. recht op abortus tijdens de eerste 3 maanden van de zwangerschap). Voordien bleven deze conflicten lokale conflicten.
Toepassing van het subsidiariteitsbeginsel - dus de zaak overlaten aan het lagere niveau - heeft precies in materies die in wezen gecontesteerd zijn ("essentially contested") (4) omzeggens enkel voordelen. Op de eerste plaats zijn er meer mensen tevreden met de geldende regel: in elke (deel)staat zal wellicht de regel gelden waarvoor men aldaar een meerderheid vindt, en die zal juist verschillen. Wie daar echt niet mee kan leven, kan overigens over de grens trekken, wat niet leuk is, maar nog veel minder leuk is wanneer een opvatting niet slechts in sommige landen, maar in heel Europa wordt opgelegd. Bij schoolreglementen die verschillen kan men naar een andere school trekken. En inwoners van Vlaanderen die echt niet zouden kunnen leven met hervormingen die de Vlaamse meerderheid zou beslissen na een defederalisering en toch zo'n schrik hebben van Vlaams cryptofascisme kunnen Tony Mary volgen naar Frankrijk - het fiscaal stelsel zal daar sowieso vaak gunstiger zijn.
Het in verschillende streken naast elkaar bestaan van uiteenlopende regels leert vele zaken ook wat relativeren en vermijdt dus de totalitaire mentaliteit die dreigt wanneer er maar één politiek correcte oplossing (want opgelegd door de mensenrechten") geldt. En ze maakt het mogelijk te leren van de ervaringen van de buren met andere regels.
Een goed voorbeeld van een domein om dit op toe te passen is justitie: zijn de verschillen in de "Vlaamse" en "Waalse" opvatting van justitie geen verschillen waarover ook de betrokkenen in Vlaanderen zelf en Wallonië zelf niet grondig verdeeld zijn ? Inderdaad, maar dat is dus veeleer een reden voor opsplitsing dan ertegen.
(verkort in Doorbraak januari 2010 als "Diversiteit of centralisme?")
(1) Zie hierover mijn "Tegendraadse bedenkingen betreffende de invulling van de mensenrechten", lezing UA-reeks 60 jaar UVRM, in Steven Dewulf & Didier Pacquée (red.), 60 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 1948-2008, Intersentia Antwerpen 2008, p. 53-59; ook gepubliceerd in september 2008 op onder meer http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2008/09/tegendraadse-bedenkingen-betreffende-de.html
(2) Zie Jozef de Witte in De Morgen van 26 juni 2009: "Laat scholen niet zelf beslissen over hoofddoek"
(3) In zijn dissenting opinion reageert hij als volgt op de idee dat de beslissing om abortusbeperkingen in alle staten van de VS ongrondwettig te verklaren in de zaak Roe v. Wade pacificerend werkte:
"The Court's description of the place of Roe in the social history of the United States is unrecognizable. Not only did Roe not, as the Court suggests, resolve the deeply divisive issue of abortion; it did more than anything else to nourish it, by elevating it to the national level, where it is infinitely more difficult to resolve. National politics were not plagued by abortion protests, national abortion lobbying, or abortion marches on Congress before Roe v. Wade was decided. Profound disagreement existed among our citizens over the issue - as it does over other issues, such as the death penalty - but that disagreement was being worked out at the state level. As with many other issues, the division of sentiment within each State was not as closely balanced as it was among the population of the Nation as a whole, meaning not only that more people would be satisfied with the results of state-by-state resolution, but also that those results would be more stable. Pre-Roe, moreover, political compromise was possible.
Roe's mandate for abortion on demand destroyed the compromises of the past, rendered compromise impossible for the future, and required the entire issue to be resolved uniformly, at the national level"
(uit "U.S. Supreme Court, PLANNED PARENTHOOD OF SOUTHEASTERN PA. v. CASEY, 505 U.S. 833 (1992), http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&vol=505&invol=833)
(4) Het begrip "essentially contested concept" werd ontwikkeld door de amerikaanse filosoof Walter B. Gallie, met name in een lezing uit 1956. Zie http://en.wikipedia.org/wiki/Essentially_contested_concept
00:20 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, réflexions personnelles, flandre |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 18 janvier 2010
Bernard Stiegler: sur la consommation et la dépendance
| Bernard Stiegler : sur la consommation et la dépendance |
|
Les gens sont d’autant moins heureux de consommer qu’ils sont de grands consommateurs. Pour de plus en plus de gens, le fait de consommer apparaît aujourd’hui comme le symptôme d’un malaise que la consommation tente de combler, mais qu’elle aggrave en réalité. Mon hypothèse, c’est que les consommateurs sont devenus dépendants de la consommation comme les drogués le sont de leur drogue. Et cette dépendance leur apporte de moins en moins de bonheur, comme chez l’héroïnomane arrivé au dernier stade de l’intoxication : quand il devient incapable de se passer de l’héroïne alors qu’elle ne lui procure plus aucun plaisir. Il faudrait évidemment raffiner l’analyse. Il existe de grandes différences entre la consommation culturelle, alimentaire ou d’hydrocarbures. Mais, grosso modo, la question reste la même: celle d’une structure devenue addictive. Prenez un consommateur lambda, qui est d’abord un téléspectateur puisque la télévision a organisé le consumérisme comme mode de vie depuis l’après-guerre. Selon les derniers chiffres dont je dispose, un Français passe chaque jour 3 heures et 35 minutes devant sa télévision. Pour un père de famille, cela signifie qu’il n’a absolument pas le temps de parler à ses enfants ou à sa femme. La durée moyenne qu’une famille consacre à la discussion a d’ailleurs diminué des deux tiers depuis une quinzaine d’années. Le temps que le consommateur passe à absorber des images se substitue donc à toutes sortes d’activités sociales – les relations familiales par exemple ou les relations avec des amis. La consommation développe ainsi des processus de désinvestissement et détruit les circuits sociaux. Résultat : le consommateur est devenu un irresponsable, comme l’a révélé la crise de 2008. C’est quelqu’un qui se moque de son environnement, qui se fiche des conséquences de son comportement sur ses enfants. Je ne dis pas cela pour accuser le consommateur ; j’en suis un comme tout le monde. Mais ça ne peut plus durer. Cela faisait des années que nous en souffrions plus ou moins consciemment, mais l’année 2008 aura été l’explosion de la gueule de bois. Ce qu’on a découvert alors, c’est que ce système de l’hyperconsommation est allé de pair avec le développement d’une hyperspéculation. Le spéculateur est d’ailleurs lui-même un capitaliste qui serait devenu addict. Les golden boys marchent souvent à la cocaïne, tout le monde sait ça. Ce sont des gens qui ne peuvent plus se passer du stress extraordinaire qu’ils éprouvent en donnant des ordres d’achat ou de vente d’actions. Tout cela forme un système qui est aujourd’hui en train de s’écrouler. »
Bernard Stiegler, interviewé par L’Hebdo, 29 décembre 2009 |
00:15 Publié dans Sociologie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : consommation, philosophie, sociologie, économie, moeurs contemporaines |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 17 janvier 2010
Capitalisme libéral et socialisme, les deux faces de Janus
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1992
CAPITALISME LIBERAL ET SOCIALISME,
LES DEUX FACES DE JANUS
par Pierre Maugué
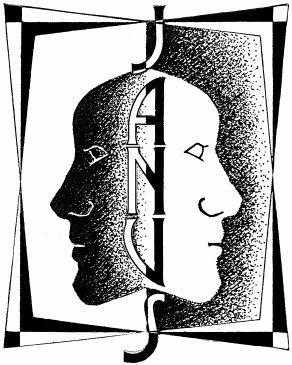 L'effondrement des régimes marxistes, en Union soviétique et en Europe orientale, et le triomphe du modèle capitaliste occidental sont généralement présentés comme l'issue d'un conflit qui opposait depuis des décennies deux conceptions du monde fondamentalement antagonistes. Cette vision manichéenne, sur laquelle se fondent les démocraties occidentales pour réaffirmer leur légitimité, mérite néanmoins d'être mise en question. En effet, l'opposition entre les deux systèmes qui se partageaient le monde sous la direction des Etats-Unis d'Amérique et de l'Union soviétique était-elle si essentielle, et ne masquait-elle pas d'étranges convergences, voire même d'inavouables connivences?
L'effondrement des régimes marxistes, en Union soviétique et en Europe orientale, et le triomphe du modèle capitaliste occidental sont généralement présentés comme l'issue d'un conflit qui opposait depuis des décennies deux conceptions du monde fondamentalement antagonistes. Cette vision manichéenne, sur laquelle se fondent les démocraties occidentales pour réaffirmer leur légitimité, mérite néanmoins d'être mise en question. En effet, l'opposition entre les deux systèmes qui se partageaient le monde sous la direction des Etats-Unis d'Amérique et de l'Union soviétique était-elle si essentielle, et ne masquait-elle pas d'étranges convergences, voire même d'inavouables connivences?
En 1952, dans son "Introduction à la métaphysique" , Heidegger écrivait : "L'Europe se trouve dans un étau entre la Russie et l'Amérique, qui reviennent métaphysiquement au même quant à leur appartenance au monde et à leur rapport à l'esprit". Si, pour lui, notre époque se caractérisait par un "obscurcissement du monde" marqué par "la fuite des dieux, la destruction de la terre, la grégarisation de l'homme, la prépondérance du médiocre", et si cet obscurcissement du monde provenait de l'Europe elle-même et avait commencé par "l'effondrement de l'idéalisme allemand", ce n'en est pas moins en Amérique et en Russie qu'il avait atteint son paroxysme.
L'affirmation de Heidegger, qui pose comme équivalentes, au plan de leur rapport à l'être, deux nations porteuses d'idéologies généralement pensées comme antinomiques peut paraître provocatrice. Elle ne fait pourtant que reconnaître, au plan métaphysique, la parenté certaine qui existe, au plan historique, entre capitalisme et socialisme (dont le marxisme n'est que la forme la plus élaborée et la plus absolue).
Capitalisme et socialisme sont aussi intimement liés que les deux faces de Janus. Tous deux sont issus de la philosophie du XVIIIe siècle, marguée par la trilogie : raison, égalité, progrès, et de la Révolution industrielle du XIXe siècle, caractérisée par le culte de la technique, du productivisme et du profit, et s'ils s'opposent, c'est beaucoup plus sur les méthodes que sur les objectifs.
L'émergence du socialisme moderne tient au fait gue non seulement la proclamation de l'égalité des droits par la Révolution de 1789 laissa subsister les inégalités sociales, mais que furent supprimées toutes les institutions communautaires (gérées par l'Eglise, les corporations, les communes) gui créaient un réseau de solidarité entre les différents ordres de la société, Quant à la Révolution industrielle, si elle marqua un prodigieux essor économique, elle provoqua également une détérioration considérable des conditions de vie des classes populaires, de sorte que ce qui avait été théoriquement gagné sur le plan politique fut perdu sur le plan social, La protestation socialiste tendit alors à démontrer qu'une centralisation et une planification de la production des richesses était tout-à-fait capable de remplacer la libre initiative des entrepreneurs et de parvenir, au plan économique, à l'égalité qui avait été conquise au plan juridique.
Bien que divergeant sur les méthodes (économie de libre entreprise ou économie dirigée), libéraux et socialistes n'en continuaient pas moins à s'accorder sur la primauté des valeurs économiques, et partageaient la même foi dans le progrès technique, le développement industriel illimité, et l'avènement d'un homme nouveau, libéré du poids des traditions. En fait, tant les libéraux que les socialistes pouvaient se reconnaître dans les idées des Saints-Simoniens, qui ne voyaient dans la politique que la science de la production, et pour lesquels la société nouvelle n'aurait pas besoin d'être gouvernée, mais seulement d'être administrée.
La même négation de l'autonomie du politique se retrouve ainsi chez les libéraux et les socialites de toute obédience. A l'anti-étatisme des libéraux, qui ne concèdent à l'Etat qu'un pouvoir de police propre à protéger leurs intérêts économiques, et la mission de créer les infrastructures nécessaires au développement de la libre entreprise, répond, chez les sociaux-démocrates, le rêve d'un Etat qui aurait abandonné toute prérogative régalienne et dont le rôle essentiel serait celui de dispensateur d'avantages sociaux. On trouve même chez les socialistes proudhoniens un attrait non dissimulé pour un certaine forme d'anarchie. Quant aux marxistes, bien qu'ils préconisent un renforcement du pouvoir étatique dans la phase de dictature du prolétariat, leur objectif final demeure, du moins en théorie, le dépérissement de l'Etat. Le totalitarisme vers lequel ont en fait évolué les régimes mar~istes constitue d'ailleurs aussi, à sa manière, une négation de l'autonomie du politique.
La pensée de Marx, nourrie de la doctrine des théoriciens de l'économie classique, Adam Smith, Ricardo, Stuart Mill et Jean-Baptiste Say, est toujours restée tributaire de l'idéologie qui domine depuis les débuts de l'ère industrielle . Le matérialisme bourgeois, l'économisme w lgaire se retrouvent ainsi dans le socialisme marxiste. Marx rêve en effet d'une société assurant l'abondance de biens matériels et, négligeant les autres facteurs socio-historiques, il voit dans l'économie le seul destin véritable de l'homme et l'unique possibilité de réalisation sociale.
Mais ce qui crée les liens les plus forts est l'existence d'ennemis communs. Or, depuis l'origine, libéraux et marxistes partagent la même hostilité à l'égard des civilisations traditionnelles fondées sur des valeurs spirituelles, aristocratiques et communautaires.
Le Manifeste communiste de 1868 est à cet égard révélateur. Loin de stigmatiser l'oeuvre de la bourgeoisie (c'est-à-dire, au sens marxiste du terme, le grand capital), il fait en quelque sorte l'éloge du rôle éminemment révolutionnaire qu'elle a joué. "Partout où elle (la bourgeoisie) est parvenue à dominer", écrit Marx, "elle a détruit toutes les conditions féodales, patriarcales, idylliques. Impitoyable, elle a déchiré les liens multicolores qui attachaient l'homme à son supérieur naturel, pour ne laisser subsister entre l'homme et l'homme que l'intérêt tout nu, le froid 'paiement comptant'... Elle a dissous la dignité de la personne dans la valeur d'échange, et aux innombrables franchises garanties et bien acquises, elle a substitué une liberté unique et sans vergogne : le libre-échange".
Prenant acte de cette destruction des valeurs traditionnelles opérée par la bourgeoisie capitaliste, Marx se félicite que celle-ci ait "dépouillé de leur sainte auréole toutes les activités jusque là vénérables et considérées avec un pieux respect" et qu'elle ait "changé en salariés à ses gages le médecin, le juriste, le prêtre, le poête, l'homme de science".
La haine du monde rural et l'apologie des mégapoles s'expriment également sans détours chez Marx, qui juge positifs les effets démographiques du développement capitaliste. "La bourgeoisie", écrit-il, "a soumis la campagne à la domination de la ville. Elle a fait surgir d'immenses cités, elle a prodigieusement augmenté la population des villes aux dépens des campagnes, arrachant ainsi une importante partie de la population à l'abrutissement de l'existence campagnarde". Il n'hésite pas non plus à faire l'éloge du colonialisme, se félicitant que "la bourgeoisie, de même qu'elle a subordonné la campagne à la ville ... a assujetti les pays barbares et demi-barbares aux pays civilisés, les nations paysannes aux nations bourgeoises, l'Orient à l'Occident". Cette domination sans partage de la fonction économique est magnifiée par Marx, de même que l'instabilité qui en résulte. C'est en effet avec satisfaction qu'il constate que "ce qui distingue l'époque bourgeoise de toutes les précédentes, c'est le bouleversement incessant de la production, l'ébranlement continuel de toutes les institutions sociales, bref la permanence de l'instabilité et du mouvement... Tout ce qui était établi se volatilise, tout ce qui était sacré se trouve profané".
Mais la bourgeoisie capitaliste n'en a pas moins souvent cherché à faire croire qu'elle défendait les valeurs traditionnelles contre les marxistes et autres socialistes, ce qui amène Marx à rappeler, non sans une certaine ironie, que les marsistes ne peuvent être accusés de détruire des valeurs que le capitalisme a déjà détruit ou est en voie de détruire. Vous nous reprochez, dit Mars, de détruire la propriété, la liberté, la culture, le droit, l'individualité, la famille, la patrie, la morale, la religion, comme si les développements du capitalisme ne l'avait pas déjà accompli.
«Détruire la propriété?" "Mais" dit Mars, "s'il s'agit de la propriété du petit-bourgeois, du petit paysan, nous n'avons pas à l'abolir, le développement de l'industrie l'a abolie et l'abolit tous les jours". "Détruire la liberté, l'individualité?" "Mais l'individu qui travaille dans la société bourgeoise n'a ni indépendance, ni personnalité". "Détruire la famille?" "Mais par suite de la grande industrie, tous les liens de famille sont déchirés de plus en plus".
Tous ces arguments de Marx ne relèvent pas seulement de la polémique. En effet, les sociétés capitalistes présentent bien des traits conformes aux idéaux marxistes. Ainsi, à l'athéisme doctrinal professé par les marxistes répond le matérialisme de fait des sociétés capitalistes, où toute religion structurée a tendance à disparaître pour faire place à un athéisme pratique ou à une vague religiosité qui, sous l'influence du protestantisme, tend à se réduire à un simple moralisme aux contours indécis, dont tout aspect métaphysique, tout symbolisme, tout rite, toute autorité traditionnelle est banni.
De même, au collectivisme tant reproché à l'idéologie marxiste (collectivisme qui ne se réduit pas à l'appropriation par l'Etat des moyens de production, mais consiste également en une forme de vie sociale où la personne est soumise à la masse) répond le grégarisme des sociétés capitalistes. Comme le note André Siegfried, c'est aux Etats-Unis qu'est né le grégarisme qui tend aujourd'hui à gagner l'Europe. "L'être humain, devenu moyen plutôt que but accepte ce rôle de rouage dans l'immense machine, sans penser un instant qu'il puisse en être diminué", "d'où un collectivisme de fait, voulu des élites et allègrement accepté de la masse, qui, subrepticement, mine la liberté de l'homme et canalise si étroitement son action que, sans en souffrir et sans même le savoir, il confirme lui-même son abdication". Curieusement, marxisme et libéralisme produisent ainsi des phénomèmes sociaux de même nature, qui sont incompatibles avec toute conception organique et communautaire de la société.
L'idéologie mondialiste est également commune au marxisme et au capitalisme libéral. Pour Lénine, qui soutient le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, la libération complète de toutes les nations opprimées n'est en effet qu'un instrument au service de la Révolution et ne peut constituer qu'une "phase de transition", la finalité étant "la fusion de toutes les nations". Or, cette fusion de toutes les nations est également l'objectif du capitalisme libéral qui, tout en ayant utilisé les nationalismes des peuples de l'Est pour détruire l'Union soviétique, vise en fait à établir un marché mondial dans lequel toutes les nations sont appelées finalement à se dissoudre. Toutes les identités nationales sont ainsi destinées à disparaître pour être remplacées par un modèle uniforme, américanomorphe, au service duquel une intense propagande est organisée, modèle dont les traits caractéristiques sont le métissage, la culture rock, les jeans, le coca-cola, les chaînes de restaurant fast-food et le "basic English", le tout étant couronné par l'idéologie des droits de l'homme dont les articles de foi sont dogmatiquement décrétés par les grands-prêtres d'une intelligentsia qui n'a d'autre légitimité que celle qu'elle s'est elle-même octroyée.
En fait, tant le marxisme que le capitalisme libéral approuvent sans réserves toutes les conséquences économiques et sociales de la Révolution industrielle, qui se traduisent par la destruction de tous les liens communautaires, familiaux ou nationaux, le déracinement et la grégarisation. Une telle évolution est en effet nécessaire aussi bien à l'établissement d'un véritable marché mondial, rêve ultime du capitalisme libéral, qu'à l'avènement de l'homme nouveau, libéré de toute aliénation, qui constitue l'objectif du marxisme. Pour ce dernier, le prolétariat était d'ailleurs appelé à jouer un rôle messianique et à porter plus loin le flambeau de la Révolution, afin de mener à son terme la destruction de toutes les valeurs traditionnelles.
Pour le philosophe chrétien et traditionnaliste Berdiaev, capitalisme libéral et marxisme ne sont pas seulement liés au plan des sources idéologiques, mais ils sont également les agents d'une véritable subversion. "Tant la bourgeoisie que le prolétariat", écrit Berdiaev, "représentent une trahison et un rejet des fondements spirituels de la vie. La bourgeoisie a été la première à trahir et à abdiquer le sacré, le prolétariat lui a emboîté le pas." Soulignant les affinités qui existent entre la mentalité du bourgeois et celle du prolétaire, il déclare : "Le socialisme est bourgeois jusque dans sa profondeur et il ne s'élève jamais au-dessus du sentiment des idéaux bourgeois de l'existence. Il veut seulement que l'esprit bourgeois soit étendu à tous, qu'il devienne universel, et fixé dans les siècles des siècles, définitivement rationalisé, stabilisé, guéri des maladies qui la minent."
Si, pour Berdiaev, l'avènement de la bourgeoisie en tant gue classe dominante a correspondu à un rejet des fondements spirituels de la vie, Max Weber voit, pour sa part, une relation étroite entre l'éthique protestante et le développement du capitalisme moderne. Ces deux points de vue ne sont pas aussi contradictoires qu'ils peuvent paraître de prime abord. En effet, outre que la spiritualité ne se réduit pas à l'éthique, l'éthique protestante a tendu à devenir une simple morale utilitariste qui s'apparente en fait à la morale laïgue, et qui n'est plus sous-tendue par une vision spirituelle du monde. Max Weber relève d'ailleurs que "l'élimination radicale du problème de la théodicée et de toute espèce de questions sur le sens de l'univers et de l'existence, sur quoi tant d'hommes avaient peiné, cette élimination allait de soi pour les puritains ..." °
L'utilitarisme de l'éthique protestante apparaît d'ailleurs clairement dans sa conception de l'amour du prochain. En effet, selon celle-ci, comme le rappelle Max Weber, "Dieu veut l'efficacite sociale du chrétien" et "l'amour du prochain ... s'exprime en premier lieu dans l'accomplissement des tâches professionnelles données par la "lex naturae" revêtant ainsi "l'aspect proprement objectif et impersonnel d'un service effectué dans l'organisation rationnelle de l'univers social qui nous entoure." C'est d'ailleurs par la promotion de cette conception éthique dans le monde chrétien que le protestantisme a pu créer un contexte favorable au développement du capitalisme moderne.
Mais l'état d'esprit qui en est résulté, et qui s'est développé sans entraves aux Etats-Unis d'Amérique, paraît bien éloigné de toute sorte d'éthique. Comme l'a relevé Karl Marx à propos des "habitants religieux et politiquement libres de la Nouvelle Angleterre", "Mammon est leur idole qu'ils adorent non seulement des lèvres, mais de toutes les forces de leur corps et de leur esprit. La terre n'est à leurs yeux qu'une Bourse, et ils sont persuadés qu'il n'est ici-bas d'autre destinée que de devenir plus riches que leurs vo;sins".
Etudiant les liens qui existent entre l'esprit du capitalisme et l'éthique protestante, Max Weber avait souligné la "bibliocratie" du calvinisme, qui tenait les principes moraux de l'Ancien Testament dans la même estime que ceux du Nouveau, l'utilitarisme de l'éthique protestante rejoignant l'utilitarisme du judaïsme. Avant lui, Marx avait d'ailleurs déjà relevé les affinités qui existent entre l'esprit du capitalisme et le judaïsme même si cette analyse était peu conforme aux principes du matérialisme historique. Considérant que "le fond profane du judaïsme" c'est "le besoin pratique, l'utilité personnelle", Marx estimait ainsi que, grâce aux Juifs et par les Juifs, "l'argent est devenu une puissance mondiale et l'esprit pratique des Juifs, l'esprit pratique des peuples chrétiens", concluant que "les Juifs se sont émancipés dans la mesure même où les chrétiens sont devenus Juifs".
Ignorant délibérément la complexité des origines de l'idéologie socialiste, Berdiaev privilégiait quant à lui les affinités entre socialisme et judaïsme. Selon Berdiaev, le socialisme constitue en effet une "manifestation du judaïsme en terreau chrétien", et "la confusion et l'identification du christianisme avec le socialisme, avec le royaume et le confort terrestre sont dues à une flambée d'apocalyptique hébraïque", au "chiliasme hébreu, qui espère le Royaume de Dieu ici-bas" et "il n'était pas fortuit que Marx fût juif" . Cioran rejoint sur ce point Berdiaev lorsqu'il écrit : "Quand le Christ assurait que le "royaume de Dieu" n'était ni "ici ni "là", mais au-dedans de nous, il condamnait d'avance les constructions utopiques pour lesquelles tout "royaume" est nécessairement extérieur, sans rapport aucun avec notre moi profond ou notre salut individuel. 5
De différents points de vue, capitalisme libéral et socialisme moderne paraissent ainsi liés, non seulement au plan historique, mais également par leurs racines idéologiques, et ce n'est probablement pas un hasard si leur émergence a coïncidé avec l'effondrement du système de valeurs qui, pendant des siècles, avait prévalu en Europe, et qui affirmait, du moins dans son principe originel, la primauté de l'autorité spirituelle sur le pouvoir temporel, et la subordination de la fonction économique au pouvoir temporel.
L'écroulement des régimes marxistes, incapables d'atteindre leurs objectifs économiques et sociaux, n'aura donc pas changé fondamentalement le cours de l'Histoire, puisque la "Weltanschauung" commune au marxisme et au capitalisme continue toujours à constituer le point de référence de nos sociétés. Se trouvent en effet toujours mis au premier plan : le matérialisme philosophique et pratique, le règne sans partage de l'économie, l'égalitarisme idéologique (qui se conjugue curieusement avec l'extension des inégalités sociales), la destruction des valeurs familiales et communautaires, la collectivisation des modes de vie et le mondialisme. C'est peut-être d'ailleurs ce qui permet d'expliquer pourquoi les socialistes occidentaux et la majeure partie des marxistes de l'Est se sont aussi facilement convertis au capitalisme libéral, qui paraît aujourd'hui le mieux à même de réaliser leur idéal.
Mais la chute des régimes marxistes a l'Est nombre de valeurs qui, bien qu'ayant été niées pendant des décennies, n'avaient pu être détruites. On voit ainsi, dans des sociétés en pleine décomposition qui redécouvrent les réalités d'un capitalisme sauvage, s'affirmer à nouveau religions, nations et traditions.
Toutes ces valeurs qui refont surface, et dont l'affirmation avait été jugée utile par les Etats occidentaux, dans la mesure où elle pouvait contribuer au renversement des régimes marxistes, sont toutefois loin d'être vues avec la même complaisance dès lors que cet objectif a été atteint.
L'idéologie matérialiste des sociétés occidentales s'accommode en effet assez mal de tout système de valeurs qui met en question sa prétention à l'universalité et qui n'est pas inconditionnellement soumis aux impératifs du marché mondial. Tout véritable réveil religieux, toute affirmation nationale ou communautaire, ou toute revendication écologiste ne peuvent ainsi être perc,us que comme autant d'obstacles à la domination sans partage des valeurs marchandes, obstacles qu'il s'agit d'abattre ou de contourner.
Ainsi, l'établissement d'un véritable marché mondial qui puisse permettre aux stratégies des multinationales de se développer sans entraves étant devenu l'objectif prioritaire, des pressions sont exercées au sein du GATT - par le lobby américain - pour que les pays d'Europe acceptent le démantèlement de leur agriculture, quelles que puissent en être les conséquences sur l'équilibre démographique et social de ces pays, sur l'enracinement de leur identité nationale et sur leur équilibre écologique.
De même, les cultures et les langues nationales doivent de plus en plus se plier aux lois du marché mondial et céder le pas à des "produits culturels" standardisés de niveau médiocre, utilisant le "basic English" comme langue véhiculaire, et aptes ainsi à satisfaire le plus grand nombre de consommateurs du plus grand nombre de pays. Quant aux religions, elles ne sont tolérées gue dans la mesure où elles délivrent un message compatible avec l'idéologie du capitalisme libéral, et si elles s'accommodent avec les orientations fondamentales de la société permissive, qui ne sont en fait que l'application, au domaine des moeurs, des principes du libre-échange.
L'écologie, enfin, n'est prise en compte que si elle ne s'affirme pas comme une idéologie ayant la prétention d'imposer des limites à la libre entreprise. Les valeurs néo-païennes qu'elle véhicule (que le veuillent ou non ses adeptes) sont par ailleurs vivement dénoncées. Ainsi, Alfred Grosser se plaît à relever que "ce n'est pas un hasard si l'écologie a démarré si fort en Allemagne où la nature ("die Natur") tient une place tout autre qu'en France. La forêt ("der Wald") y est fortement chargée de symbole. La tradition allemande ... c'est l'homme mêlé, confondu à la nature". Ne reculant pas devant les amalgames les plus grossiers, il n'hésite pas à écrire : "La liaison entre les hommes et la nature, le sol et le sang, cette solide tradition conservatrice allemande a été reprise récemment par Valéry Giscard d'Estaing à propos des immigrés. C'était la théorie d'Hitler;". Et Grosser de conclure avec autant de naïveté que de grandiloquence : "La grandeur de la civilisation judéo-chrétienne est d'avoir forgé un homme non soumis à la nature".
L'idéologie capitaliste libérale, actuellement dominante, entre ainsi en conflit avec d'autres ordres de valeur, et ces nouveau~ conflits, dont nous ne voyons que les prémisses, pourraient bien reléguer au rang des utopies la croyance en une "fin de l'histoire". En effet, ces conflits n'opposent plus, comme c'était le cas depuis deux siècles, deux idéologies jumelles qui, tout en se combattant, partaqeaient pour l'essentiel les mêmes idéaux fondamentaux et ne s'opposaient que sur les moyens de les réaliser. Les sociétés fondées sur le capitalisme libéral vont en effet avoir désormais à affronter des adversaires dont l'idéologie est irréductible à une vision purement économiste du monde. L'antithèse fondamentale ne se situe pas en effet entre capitalisme et marxisme, mais entre un système où l'économie est souveraine, quelle que soit sa forme, et un système où elle se trouve subordonnée à des facteurs extra-économiques.
On voit ainsi reparaître l'idée d'une hiérarchie des valeurs qui n'est pas sans analogies avec l'idéologie des peuples indo-européens et celle de l'Europe médiévale, où la fonction économique, et notamment les valeurs marchandes, occupait un rang subordonné aux valeurs spirituelles et au pouvoir politique (au sens originel de pouvoir régulateur de la vie sociale et des fonctions économiques). Bien que, dans cet ordre ancien, la dignité de la fonction de production des biens matériels fût généralement reconnue , il était toutefois exclu que les détenteurs de cette fonction puissent usurper des compétences pour l'exercice desquelles ils n'avaient aucune qualification. L'économie se trouvait ainsi incorporée dans un système qui ne considérait pas l'homme uniquement comme producteur ou consommateur, et l'organisation corporative des professions mettait beaucoup plus l'accent sur l'aspect qualitatif du travail que sur l'aspect quantitatif de la production, donnant une dimension spirituelle à l'accomplissement de toutes les tâches, même des plus humbles. Quant à la spéculation, au profit détaché de tout travail productif, ils n'étaient non seulement pas valorisés, comme c'est le cas aujourd'hui, mais ils étaient profondément méprisés, tant par la noblesse que par le peuple, et ceux qui s'y adonnaient étaient généralement considérés comme des parias.
Ce n'est en fait que depuis deux siècles que les valeurs marchandes ont pris une place prépondérante dans la société occidentale, et que s'est instituée cette véritable subversion que Roger Garaudy qualifie de "monothéisme du marché, c'est-à-dire de l'argent, inhérent à toute société dont le seul régulateur est la concurrence, une guerre de tous contre tous". Un champion de l'ultra-libéralisme, comme Hayek, reconnaît d'ailleurs lui-même que "le concept de justice sociale est totalement vide de sens dans une économie de marché".
Cette subversion des valeurs est particulièrement sensible dans le capitalisme de type anglo-saxon que Michel Albert oppose au capitalisme de type rhénan ou nippon : le premier pariant sur le profit à court terme, négligeant outrancièrement les secteurs non-marchands de la société, l'éducation et la formation des hommes, et préférant les spéculations en bourse à la patience du capitaine d'industrie ou de l'ingénieur qui construisent et consolident jour après jour une structure industrielle; le second planifiant à long terme, respectant davantage les secteurs non-marchands, accordant de l'importance à l'éducation et à la formation et se fondant sur le développement des structures industrielles plutôt que sur les spéculations boursières.
Il est d'ailleurs intéressant de relever gue c'est le capitalisme de type rhénan ou nippon, qui conserve un certain nombre de valeurs des sociétés pré-industrielles et s'enracine dans une communauté ethno-culturelle, qui se révèle être plus performant que le capitalisme de type anglo-saxon, qui ne reconnaît pas d'autres valeurs que les valeurs marchandes, même s'il aime souvent se draper dans les plis de la morale et de la religion.
Mais le meileur équilibre auquel sont parvenues les sociétés où règne un capitalisme de type rhénan ou nippon n'en demeure pas moins fragile, et ces sociétés sont loin d'être exemptes des tares inhérentes à toutes les formes de capitalisme libéral. On peut d'ailleurs se demander si le capitalisme de type rhénan ou nippon, qui s'appuie sur les restes de structures traditionnelles, n'est pas condamné à disparaître par la logique même du capitalisme libéral qui finira par en détruire les fondements dans le cadre d'un marché mondial.
Par delà ces oppositions de nature éphémère qui existent au sein du capitalisme libéral, la question est finalement de savoir si celui-ci parviendra à établir de manière durable son pouvoir absolu et universel, marquant ainsi en quelque sorte la fin de l'histoire, ou s'il subira, à plus ou moins longue échéance, un sort analogue à celui de marxisme. En d'autres termes, une société ne se rattachant plus à aucun principe d'ordre supérieur et dénuée de tout lien communautaire est-elle viable, ou cette tentative de réduire l'homme aux simples fonctions de producteur et de consommateur, sans dimension spirituelle et sans racines, est-elle condamnée à l'échec, disqualifiant par là-même l'idéologie (ou plutôt l'anti-idéologie) sur laquelle elle était fondée?
Pierre Maugué
Novembre 1992
NOTES
1) Cf. Martin Heideqger, "Introduction à la métaphysique", page 56, Gallimard, Paris 1967.
2) Cf. Werner Sombart, "Le Socialisme allemand", Editions Pardès, 45390 Puiseaux.
3) Cf. Karl Marx, "Le manifeste communiste" in "oeuvres complètes", La Pléïade, Gallimard, Paris 1963.
4) René Guénon fait la même constatation gue Rarl Marx, mais, loin d'y voir l'annonce d'un monde nouveau, supérieur à l'ancien, il y voit au contraire une déchéance, la fin d'un cycle. Il relève ainsi que "partout dans le monde occidental, la bourgeoisie est parvenue à s'emparer du pouvoir", que le résultat en est "le triomphe de l'économique, sa suprématie proclamée ouvertement" et qu'"à mesure qu'on s'enfonce dans la matérialité, l'instabilité s'accroît, les changements se produisent de plus en plus rapidement". Cf. René Guénon, "Autorité spirituelle et pouvoir temporel", page 91, Les Editions Vega, Paris, 1964.
5) Cf. André Siegfried, "Les Etats-Unis d'aujourd'hui", pages 346, 349
et 350, Paris 1927.
6) Cf. Lénine, "Oeuvres", tome 22, page 159, Editions sociales, Paris 1960.
7) Comme le relève Régis Debray, "Nous avions eu Dieu, la Raison, la Nation, le Progrès, le Prolétariat. Il fallait aux sauveteurs un radeau de sauvetage. Voilà donc pour les aventuriers de l'Arche Perdue, les Droits de l'Homme come progressisme de substitution. Cf. Régis Debray, "Que vive la République", Editions Odile Jacob, Paris 1989.
8) Cf. Nicolas Berdiaev, "De l'inégalité", pages 150 et 152, Editions l'Age
d'Homme, Genève 1976.
9) Cf. Nicolas Berdiaev, op. cité, page 150. Dans le style qui lui est propre, Louis-Ferdinand Céline avait relevé la même analogie entre esprit bourgeois et esprit prolétaire. "Vous ne rêvez que d'être lui, à sa place, rien d'autre, être lui, le Bourgeois! encore plus que lui, toujours plus bourgeois! C'est tout. L'idéal ouvrier c'est deux fois plus de jouissances bourgeoises pur lui tout seul. Une super bourgeoisie encore plus tripailleuse, plus motorisée, beaucoup plus avantageuse, plus dédaigneuse, plus conservatrice, plus idiote, plus hypocrite, plus stérile que l'espèce actuelle". Cf. Louis-Ferdinand-Céline, "L'école des cadavres", Editions Denoël, Paris.
10) Cf. Max Weber, "L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme", page 129, Librairie Plon, Paris 1964.
11) Cf. Max Weber, op cité, pages 128 et 129.
12) Cf. Rarl Marx, "La question juive", pages 50 et 55, collection 10/18, Union générale d'éditions, Paris 1968.
13) Cf. Karl Marx, op cité, pages 49 et 50.
14) Cf. Nicolas Berdiaev, op cité, page 154
15) Cf. Cioran, "Histoire et Utopie", Gallimard, Paris 1960.
16) C'est ainsi que le modèle de la société libérale avancée, qui s'est imposé en Occident, correspond parfaitement à certains objectifs qu'Engels avait fixés au 21e point de son avant-projet pour le Manifeste du Parti communiste. Il écrivait ainsi : "(L'avènement du communisme) transformera les rapports entre les sexes en rapport purement privés, ne concernant que les personnes qui y participent et où la société n'aura pas à intervenir. Cette transformation sera possible du moment que ... les enfants seront élevés en commun, et que seront détruites les deux bases principales du mariage actuel, à savoir la dépendance de la femme vis-à-vis de l'homme, et celle des enfants vis-à-vis des parents".
17) Cf. Alfred Grosser, interview paru dans "Le Nouveau Quotidien" (Lausanne) du vendredi 24 janvier 1992 sous le titre : "Après le dieu Lénine des communistes, voici la déesse Gaia des écologistes".
18) Dans l'Inde traditionnelle, les "vaishya", représentants de la troisième fonction, ont la qualité d'"arya". Toutefois, dans le monde méditerranéen, chez les Romains et les Grecs de l'époque classique, on constate une dépréciation du travail manuel, qui n'existe pas en revanche dans les sociétés celtiques et germaniques, où l'esclavage tenait une place beaucoup moins importante.
19) Cf. Roger Garaudy "Algérie, un nouvel avertissement pour l'Europe", in "Nationalisme et République", No 7.
20) Cf. Michel Albert, "Capitalisme contre capitalisme", Editions du Seuil, collection "L'histoire immédiate", Paris 1991.
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : philosophie, socialisme, libéralisme, capitalisme, théorie politique, sciences politiques, politologie, réflexions personnelles |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 11 janvier 2010
Camus, con Jünger e la Arendt sta a pieno titolo nel "nostro" pantheon
 Camus, con Jünger e la Arendt sta a pieno titolo nel "nostro" pantheon
Camus, con Jünger e la Arendt sta a pieno titolo nel "nostro" pantheon
00:15 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, littérature française, littérature, lettres, lettres françaises, lettres allemandes, littérature allemande, italie, camus, sarkozy, france |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Der absolute Krieg
 Der absolute Krieg
Der absolute Krieg
Da man den unabhängigen Willen des Gegners sich gegenüber hat, so gilt es, diesen Willen zu brechen. Dies geschieht mit Hilfe der eigenen Machtmittel und der eigenen Willenskraft. Wenn sich die eigenen Machtmittel als unzureichend erweisen oder die eigene Willenskraft der des Gegners nachsteht, müssen daraus gewissen Gegengewichte erwachsen. Diese beiden Faktoren sind daher von geradezu entscheidender Bedeutung. Jeder Kriegführende wird folgerichtig bestrebt sein, sie zu möglichst grosser Wirkung zu bringen, d. h. die "äusserste Anstrengung der Kräfte" vorzubereiten und in die Tat umzusetzen.
Theoretisch betrachtet, müsste man nun zu einem Maximum an personeller, materieller, wirtschaftlicher und willensmässiger Anstrengung gelangen können, aus dem sich ein völlig ungehemmter Krieg ergeben würde, den Clausewitz mit dem Begriff "Absoluter Krieg" umfasst. Aber das ist nur höchst selten der Fall. Vielmehr ist "die Gestalt, die der Krieg gewinnt, abhängig von allem Fremdartigen, was sich darin einmischt und daran ansetzt..., von aller natürlichen Schwere und Reibung der Teile, der ganzen Inkonsequenz, Unklarheit und Verzagtheit des menschlichen Geistes".
Der "absolute" oder, wie ihn Clausewitz gelegentlich auch nennt, der "abstrakte" Krieg hat also mit dem Krieg, wie er sich in der Wirklichkeit abspielt, nur wenig zu tun. Wenn auch gerade in neuester Zeit seit dem Zeitalter Napoleons das offensichtliche Bestreben zutage tritt, dem Kriege auch in der Wirklichkeit eine absolute Gestalt zu verleihen, so wurde dies doch noch nie in der letzten Vollkommenheit erreicht. Selbst die glänzendsten Feldzüge weisen hier und da, wenn auch kleinere, Lücken auf, die z. B. durch unvermeidliche Fehler von Unterführerm hervorgerufen worden sind.
Friedrich von Cochenhausen, Der Wille zum Sieg. Clausewitz´ Lehre von den dem Kriege innewohnenden Gegengewichten und ihrer Überwindung, erläutert am Feldzug 1814 in Frankreich, Berlin 1943.
00:10 Publié dans Polémologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, guerre, sociologie, théorie politique, sciences politiques, politologie, allemagne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 10 janvier 2010
Ende der Geschichtlichkeit
 Ende der Geschichtlichkeit
Ende der Geschichtlichkeit
Ernst Nolte, Brief an François Furet vom 11. Dezember 1996, in: "Feindliche Nähe". Kommunismus und Faschismus im 20. Jahrhundert. Ein Briefwechsel, München 1998.
00:15 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, histoire, réflexions personnelles |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 09 janvier 2010
Slavoj Zizek, un fascista di sinistra dei nostri giorni
Slavoj Zizek, un fascista di sinistra dei nostri giorni
di Luciano Lanna
Ex: http://robertoalfattiappetiti.blogspot.com/
 Luciano Lanna, laureato in filosofia, giornalista professionista dal 1992 e scrittore (autore, con Filippo Rossi, del saggio dizionario Fascisti immaginari. Tutto quello che c'è da sapere sulla destra, Vallecchi 2004), oltre ad aver lavorato in quotidiani e riviste, si è occupato di comunicazione politica e ha collaborato con trasmissioni radiofoniche e televisive della Rai. Già caporedattore del bimestrale di cultura politica Ideazione e vice direttore del quotidiano L'Indipendente, è direttore responsabile del Secolo d'Italia.
Luciano Lanna, laureato in filosofia, giornalista professionista dal 1992 e scrittore (autore, con Filippo Rossi, del saggio dizionario Fascisti immaginari. Tutto quello che c'è da sapere sulla destra, Vallecchi 2004), oltre ad aver lavorato in quotidiani e riviste, si è occupato di comunicazione politica e ha collaborato con trasmissioni radiofoniche e televisive della Rai. Già caporedattore del bimestrale di cultura politica Ideazione e vice direttore del quotidiano L'Indipendente, è direttore responsabile del Secolo d'Italia.L'articolo è anche sul sito web del Secolo d'Italia: QUI
00:15 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, slovénie, théorie politique, politologie, sciences politiques, sociologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Le monde comme système
 Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1990
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1990
Le Monde comme Système
par Louis SOREL
Si le substantif de géopolitique n'est pas la simple contraction de «géographie politique», cette méthode d'approche des phénomènes politiques s'enracine dans la géographie; elle ne peut donc se désintéresser de l'évolution. Réputée inutile et bonasse (1), la géographie est un savoir fondamentalement politique et un outil stratégique. Confrontée à la recomposition politique du monde, elle ne peut plus se limiter à la description et la mise en carte des lieux et se définit comme science des types d'organisation de l'espace terrestre. Le premier tome de la nouvelle géographie universelle, dirigée par R. Brunet, a l'ambition d'être une représentation de l'état du Monde et de l'état d'une science. La partie de l'ouvrage dirigée par O. Dollfuss y étudie le Monde comme étant un système, parcouru de flux et structuré par quelques grands pôles de puissance.
O. Dollfuss, universitaire (il participe à la formation doctorale de géopolitique de Paris 8) et collaborateur de la revue Hérodote, prend le Monde comme objet propre d'analyses géographiques; le Monde conçu comme totalité ou système. Qu'est-ce qu'un système? «Un système est un ensemble d'éléments interdépendants, c'est-à-dire liés entre eux par des relations telles que si l'une est modifiée, les autres le sont aussi et par conséquent tout l'ensemble est transformé» (J. Rosnay).
Nombre de sciences emploient aujourd'hui une méthode systémique, les sciences physiques et biologiques créatrices du concept, l'économie, la sociologie, les sciences politiques… mais la démarche est innovante en géographie.
Le Monde fait donc système. Ses éléments en interaction sont les Etats territoriaux dont le maillage couvre la totalité de la surface terrestre (plus de 240 Etats et Territoires), les firmes multinationales, les aires de marché (le marché mondial n'existe pas), les aires culturelles définies comme espaces caractérisés par des manières communes de penser, de sentir, de se comporter, de vivre. Les relations entre Etats nourrissent le champ de l'international (interétatique serait plus adéquat) et les relations entre acteurs privés le champ du transnational: par exemple, les flux intra-firmes qui représentent le tiers du commerce mondial. Ces différents éléments du système Monde sont donc «unis» par des flux tels qu'aucune région du monde n'est aujourd'hui à l'abri de décisions prises ailleurs. On parle alors d'interdépendance, terme impropre puisque l'asymétrie est la règle.
L'émergence et la construction du système Monde couvrent les trois derniers siècles. Longtemps, le Monde a été constitué de «grains» (sociétés humaines) et d'«agrégats» (sociétés humaines regroupées sous la direction d'une autorité unique, par exemple l'Empire romain) dont les relations, quand elles existaient, étaient trop ténues pour modifier en profondeur les comportements. A partir du XVIième siècle, le désenclavement des Européens, qui ont connaissance de la rotondité de la Terre, va mettre en relation toutes les parties du Monde. Naissent alors les premièrs «économies-mondes» décrites par Immanuel Wallerstein et Fernand Braudel et lorsque toutes les terres ont été connues, délimitées et appropriées (la Conférence de Berlin en 1885 achève la répartition des terres africaines entre Etats européens), le Monde fonctionne comme système (2). La «guerre de trente ans» (1914-1945) accélèrera le processus: toutes les humanités sont désormais en interaction spatiale.
L'espace mondial qui en résulte est profondément différencié et inégal. Il est le produit de la combinaison des données du milieu naturel et de l'action passée et présente des sociéts humaines; nature et culture. En effet, le potentiel écologique (ensemble des éléments physiques et biologiques à la disposition d'un groupe social) ne vaut que par les moyens techniques mis en œuvre par une société culturellement définie; il n'existe pas à proprement parler de «ressources naturelles», toute ressource est «produite».
Et c'est parce que l'espace mondial est hétérogène, parce que le Monde est un assemblage de potentiels différents, qu'il y a des échanges à la surface de la Terre, que l'espace mondial est parcouru et organisé par d'innombrables flux. Flux d'hommes, de matières premières, de produits manufacturés, de virus… reliant les différents compartiments du Monde. Ils sont mis en mouvement, commandés par la circulation des capitaux et de l'information, flux moteurs invisibles que l'on nomme influx. Aussi le fonctionnement des interactions spatiales est conditionné par le quadrillage de réseaux (systèmes de routes, voies d'eau et voies ferrées, télécommunications et flux qu'ils supportent) drainant et irriguant les différents territoires du Monde. Inégalement réparti, cet ensemble hiérarchisé d'arcs, d'axes et de nœuds, qui contracte l'espace terrestre, forme un vaste et invisible anneau entre les 30° et 60° parallèles de l'hémisphère Nord. S'y localisent Etats-Unis, Europe occidentale et Japon reliés par leur conflit-coopération. Enjambés, les espaces intercalaires sont des angles-morts dont nul ne se préoccupe.
L'espace mondial n'est donc pas homogène et les sommaires divisions en points cardinaux (Est/Ouest et Nord/sud), surimposés à la trame des grandes régions mondiales ne sont plus opératoires (l'ont-elles été?). On sait la coupure Est-Ouest en cours de cicatrisation et il est tentant de se «rabattre» sur le modèle «Centre-Périphérie» de l'économiste égyptien Samir Amin: un centre dynamique et dominateur vivrait de l'exploitation d'une périphérie extra-déterminée. La vision est par trop sommaire et O. Dollfuss propose un modèle explicatif plus efficient, l'«oligopole géographique mondial». Cet oligopole est formé par les puissances territoriales dont les politiques et les stratégies exercent des effets dans le Monde entier. Partenaires rivaux (R. Aron aurait dit adversaires-partenaires), ces pôles de commandement et de convergence des flux, reliés par l'anneau invisible, sont les centres d'impulsion du système Monde. Ils organisent en auréoles leurs périphéries (voir les Etats-Unis avec dans le premier cercle le Canada et le Mexique, au-delà les Caraïbes et l'Amérique Latine; ou encore le Japon en Asie), se combattent, négocient et s'allient. Leurs pouvoirs se concentrent dans quelques grandes métropoles (New-York, Tokyo, Londres, Paris, Francfort…), les «îles» de l'«archipel métropolitain mondial». Sont membres du club les superpuissances (Etats-Unis et URSS, pôle incomplet), les moyennes puissances mondiales (anciennes puissances impériales comme le Royaume-Uni et la France) et les puissances économiques comme le Japon et l'Allemagne (3); dans la mouvance, de petites puissances mondiales telles que la Suisse et la Suède. Viennent ensuite des «puissances par anticipation» (Chine, Inde) et des pôles régionaux (Arabie Saoudite, Afrique du Sud, Nigéria…). Enfin, le système monde a ses «arrières-cours», ses «chaos bornés» où règnent la violence et l'anomie (Ethiopie, Soudan…).
La puissance des «oligopoleurs» vit de la combinatoire du capital naturel (étendue, position, ressources), du capital humain (nombre des hommes, niveau de formation, degré de cohésion culturelle) et de la force armée. Elle ne saurait être la résultante d'un seul de ces facteurs et ne peut faire l'économie d'un projet politique (donc d'une volonté). A juste titre, l'auteur insiste sur l'importance de la gouvernance ou aptitude des appareils gouvernants à assurer le contrôle, la conduite et l'orientation des populations qu'ils encadrent. Par ailleurs, l'objet de la puissance est moins le contrôle direct de vastes espaces que la maîtrise des flux (grâce à un système de surveillance satellitaire et de missiles circumterrestres) par le contrôle des espaces de communication ou synapses (détroits, isthmes…) et le traitement massif de l'information (4).
Ce premier tome de la géographie universelle atteste du renouvellement de la géographie, de ses méthodes et de son appareil conceptuel. On remarquera l'extension du champ de la géographicité (de ce que l'on estime relever de la discipline) aux rapports de puissance entre unités politiques et espaces. Fait notoire en France, où la géographie a longtemps prétendu fonder sa scientificité sur l'exclusion des phénomènes politiques de son domaine d'étude. Michel Serres affirme préférer «la géographie, si sereine, à l'histoire, chaotique». R. Brunet lui répond: «Nous n'avons pas la géographie bucolique, et la paix des frondaisons n'est pas notre refuge». Pas de géographie sans drame!
Louis SOREL.
Sous la direction de Roger Brunet, Géographie universelle, tome I, Hachette/Reclus, 1990; Olivier Dollfuss, Le système Monde, livre II, Hachette Reclus, 1990.
(1) Cf. Yves Lacoste, La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre, petite collection Maspero, 1976.
(2) Cf. I. Wallerstein, The Capitalist World Economy, Cambridge University Press, 1979 (traduction française chez Flammarion) et F. Braudel, Civilisation matérielle, Economie et Capitalisme, Armand Colin, 1979. Du même auteur, La dynamique du capitalisme (Champs Flammarion, 1985) constitue une utile introduction (à un prix "poche").
(3) I. Ramonet, directeur du Monde diplomatique, qualifie le Japon et l'Allemagne de «puissances grises» (au sens d'éminence…). Cf. «Allemagne, Japon. Les deux titans», Manières de voir n°12, édition Le Monde diplomatique. A la recherche des ressorts communs des deux pays du «modèle industrialiste», les auteurs se déplacent du champ économique au champ politique et du champ politique au champ culturel tant l'économique plonge ses racines dans le culturel. Ph. Lorino (Le Monde diplomatique, juin 1991, p.2) estime ce recueil révélateur des ambiguïtés françaises à l'égard de l'Allemagne, mise sur le même plan que le Japon, en dépit d'un processus d'intégration régionale déjà avancé.
(4) Les «îles» de «l'archipel-monde» (le terme rend compte tout à la fois de la globalité croissante des flux et des interconnexions et de la fragmentation politico-stratégique de la planète) étant reliée par des mots et des images, Michel Foucher affirme que l'instance culturelle devient le champ majeur de la confrontation (Cf. «La nouvelle planète», n°hors série de Libération, [ou du Soir en Belgique, ndlr], déc. 1990). Dans le même recueil, Zbigniew Brzezinski, ancien «sherpa» de J. Carter, fait de la domination américaine du marché mondial des télécommunications la base de la puissance de son pays; 80% des mots et des images qui circulent dans le monde proviennent des Etats-Unis.
00:05 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politologie, sciences politiques, philosophie, géopolitique, stratégie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 08 janvier 2010
Armin Mohler et la révolution conservatrice
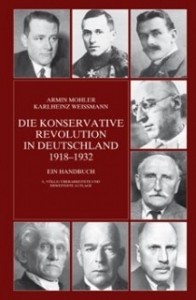 Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1990
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1990
Armin Mohler et la «Révolution Conservatrice»
(2ième partie)
par Luc PAUWELS
Dans notre numéro 59/60 de novembre-décembre 1989, Robert Steuckers avait analysé la première partie de l'introduction théorique d'Armin Mohler. Au même moment, Luc Pauwels, directeur de la revue Teksten, Kommentaren en Studies (in nr. 55, 2de trimester 1989), se penchait sur le même maître-ouvrage de Mohler et mettait l'accent sur la seconde partie théorique, notamment sur la classification des différentes écoles de ce mouvement aux strates multiples. Nous ne reproduisons pas ci-dessous l'entrée en matière de Pauwels, car ce serait répéter en d'autres mots les propos de Steuckers. En revanche, le reste de sa démonstration constitue presque une sorte de suite logique à l'analyse parue dans notre n°59/60.
Débuts et contenu
Les premiers balbutiements de la Révolution Conservatrice, écrit Mohler, ont lieu lors de la Révolution française: «Toute révolution suscite en même temps qu'elle la contre-révolution qui tente de l'annihiler. Avec la Révolution française, advient victorieusement le monde qui, pour la Révolution Conservatrice représente l'adversaire par excellence. Définissons provisoirement ce monde comme celui qui refuse de mettre l'immuable de la nature humaine au centre de tout et croit que l'essence de l'homme peut être changée. La Révolution française annonce ainsi la possibilité d'un progrès graduel et estime que toutes les choses, relations et événements sont explicables rationnellement; de ce fait, elle essaie d'isoler chaque chose de son contexte et de la comprendre ainsi pour soi».
Mohler nous rappelle ensuite un malentendu tenace, que l'on rencontre très souvent lorsque l'on évoque la Révolution Conservatrice. Un malentendu qui, outre la confusion avec le fascisme et le national-socialisme, lui a infligé beaucoup de tort: c'est l'idée erronée qui veut que tout ce qui est (ou a été) fait et dit contre la Révolution française, son idéologie et ses conséquences, relève de la Révolution Conservatrice.
La Révolution de 1789 a dû faire face, à ses débuts, à deux types d'ennemis qui ne sont en aucune manière des précurseurs de la Révolution Conservatrice. D'abord, il y avait ses adversaires intérieurs, qui estimaient que les résultats de la Révolution française et/ou de son idéologie égalitaire étaient insuffisants. Cette opposition interne a commencé avec Gracchus Babeuf (1760-1797), adepte d'«Egalité parfaite» (la majuscule est de lui), qui voulait supprimer toutes les formes de propriété privée et espérait atteindre l'«Egalité des jouissances». Sa tentative de coup d'Etat, appelée la «Conjuration des Egaux», fut tué dans l'œuf et l'aventure se termina en parfaite égalité le 27 mai 1797... sous le couperet de la guillotine.
Toutes les tendances qui puisent leur inspiration dans l'égalitarisme de Babeuf et qui, sur base de ces idées, critiquent la Révolution française, n'ont rien à voir, bien entendu, avec la Révolution Conservatrice (RC). Elles appartiennent, pour être plus précis, aux traditions du marxisme et de l'anarchisme de gauche.
Ensuite, la Révolution française, dès ses débuts, a eu affaire à des groupes qui la combattaient pour maintenir ou récupérer leurs positions sociales (matérielles ou non), que les Jacobins menaçaient de leur ôter ou avaient détruites. Les adeptes de la RC ont toujours eu le souci de faire la différence entre leur propre attitude et cette position; ils ont qualifié l'action qui en découlait, écrit Mohler, de «restauratrice», de «réactionnaire», d'«altkonservativ» («vieille-conservatrice»), etc. Mais, au cours du XIXième siècle, les tenants de la RC (qui ne porte pas encore son nom, ndt) et les «Altkonservativen» font face à un ennemi commun, ce qui les force trop souvent à forger des alliances tactiques avec les réactionnaires, à se retrouver dans le même camp politique. Ainsi, la différence essentielle qui sépare les uns des autres devient moins perceptible pour les observateurs extérieurs. Dans les rangs mêmes de la RC, on s'aperçoit des ambiguïtés et le discours s'anémie. Pour les RC de pure eau, ces alliances et ces ambiguïtés auront trop souvent des conséquences fatales. Mohler nous l'explique: «Car, à la RC, n'appartiennent —comme le couplage paradoxal des deux mots l'indique— que ceux qui s'attaquent aux fondements du siècle du progrès sans simplement vouloir une restauration de l'Ancien Régime».
Sous sa forme pure, la RC est toujours restée au stade de la formulation théorique. Rauschning, lui aussi, décrit ce caractère composite dans son ouvrage intitulé précisément Die Konservative Revolution: «Le mouvement opposé, qui se dresse contre le développement des idées révolutionnaires, a amorcé sa croissance au départ de stades initiaux embrouillés et semi-conscients, pour atteindre ce que nous nommons, avec Hugo von Hoffmannstahl, la RC. Elle représente le renversement complet de la tendance politique actuelle. Mais ce contre-mouvement n'a pas encore trouvé d'incarnation pure, adaptée à lui-même. Il participe aux tentatives d'instaurer des modèles d'ordre totalitaire et césariste ou à des essais plattement réactionnaires. C'est pour toutes ces raisons, précisément, qu'il reste confus et brouillon...».
Sur base de cette constatation, Mohler observe que toute description cohérente du processus de maturation de la RC se mue automatiquement en une véritable histoire des idées. Si on cherche à la décrire comme une partie intégrante de la réalité politique, elle déchoit en un événement subalterne ou marginal. De ce fait, il ne faut pas donner des limites trop exiguës à la RC: elle déborde en effet sur d'autres mouvements, d'autres courants de pensée. Et vu le flou de ces limites, flou dû à la très grande hétérogénéité des choses que la RC embrasse, des choses qui font irruption dans son champs, Mohler est obligé de tracer une démarcation arbitraire afin de bien circonscrire son sujet. Il s'explique: «Au sens large, le terme "Révolution Conservatrice" englobe un ensemble de transformations s'appuyant sur un fondement commun, des transformations qui se sont accomplies ou qui s'annoncent, et qui concerne tous les domaines de l'existence, la théologie comme par exemple les sciences naturelles, la musique comme l'urbanisme, les relations interfamiliales comme les soins du coprs ou la façon de construire une machine. Dans notre étude, nous nous bornerons à donner une définition exclusivement politique au terme; notre étude se limitant à l'histoire des idées, nous désignons par "Révolution Conservatrice" une certaine pensée politique».
Les pères fondateurs, les précurseurs et les parrains
Une pensée politique, une Weltanschauung, implique qu'il y ait des penseurs. Mohler les appelle les Leitfiguren, les figures de proue, que nous nommerions par commodité les «précurseurs». Mohler souligne, dans la seconde partie de son ouvrage, inédite dans les premières éditions, que l'intérêt pour les précurseurs s'est considérablement amplifié. Les figures qui ont donné à la RC sa plus haute intensité spirituelle et psychique, ses penseurs les plus convaincants et aussi ses incarnations humaines les plus irritantes ont désormais trouvé leurs biographes et leurs analystes».
Si l'on parle de «père fondateur», il faut évidemment citer Friedrich Nietzsche (1844-1900), reconnu par les amis et les ennemis comme l'initiateur véritable du phénomène intellectuel et spirituel de la RC. A côté de lui, le penseur français, moins universellement connu, Georges Sorel (1847-1922)... Nous reviendrons tout à l'heure sur ces deux personnages centraux.
Au second rang, une génération plus tard, nous trouvons le «trio» (ainsi que le nomme Mohler): Carl Schmitt (1888-1985), Ernst Jünger (°1895) et Martin Heidegger (1889-1976). Mohler cite ensuite toute une série de penseurs dont l'influence sur la RC est sans doute moins directe mais non moins intense. Les parrains non-allemands sont essentiellement des sociologues et des historiens du début de notre siècle qui, très tôt, avaient annoncé le crise du libéralisme bourgeois: les Italiens Vilfredo Pareto (1848-1923) et Gaëtano Mosca (1858-1941), l'Allemand Robert(o) Michels (1876-1936), installé en Italie, l'Américain d'origine norvégienne Thorstein Veblen (1857-1929). L'Espagne nous a donné Miguel de Unamuno (1864-1936) puis, une génération plus tard, José Ortega y Gasset (1883-1956). La France, elle, a donné le jour à Maurice Barrès (1862-1923).
Quelques-uns de ces penseurs revêtent une double signification pour notre propos: ils sont à la fois «parrains» de la RC en Allemagne et partie intégrante dans les initiatives conservatrices-révolutionnaires qui ont animé la scène politico-idéologiques dans nos propres provinces.
Parmi les «parrains» allemands de la RC, Mohler compte le compositeur Richard Wagner (1813-1883), les poètes Gerhart Hauptmann (1862-1946) et Stefan George (1868-1933), le psychologue Ludwig Klages (1872-1956) et, bien sûr, Thomas Mann (1875-1955), Gottfried Benn (1896-1956) et Freidrich-Georg Jünger (1898-1977), le frère d'Ernst.
D'autres parrains allemands sont à peine connus dans nos provinces; Mohler les cite: les poètes Konrad Weiss (1880-1940) et Alfred Schuler (1865-1923), les écrivains Rudolf Borchardt (1877-1945) et Léopold Ziegler (1881-1958), un ami d'Edgar J. Jung, connu surtout pour son livre Volk, Staat und Persönlichkeit («Peuple, Etat et personnalité»; 1917). Enfin, il y a Max Weber (1864-1920), le plus grand sociologue que l'Allemagne ait connu, célèbre dans le monde entier mais pas assez pratiqué dans nos cercles non-conformistes.
La RC dans
d'autres pays
Pour Mohler, la RC est «un phénomène politique qui embrasse toute l'Europe et qui n'est pas encore arrivé au bout de sa course». Dans la préface à la première édition de son ouvrage, nous lisons que la RC est «ce mouvement de rénovation intellectuelle qui tente de remettre de l'ordre dans le champs de ruines laissé par le XIXième siècle et cherche à créer un nouvel ordre de la vie. Mais si nous ne sélectionnons que la période qui va de 1918 à 1932, nous pouvons quand même affirmer que la RC commence déjà au temps de Goethe et qu'elle s'est déployée sans interruption depuis lors et qu'elle poursuit sa trajectoire aujourd'hui sur des voies très diverses. Et si nous ne présentons ici que la partie allemande du phénomène, nous n'oublions pas que la RC a touché la plupart des autres pays européens, voire certains pays extra-européens».
Mohler réfute la thèse qui prétend que la RC est un phénomène exclusivement allemand. Il suffit de nommer quelques auteurs pour ruiner cet opinion, explique Mohler. Quelques exemples: en Russie, Dostoievski (1821-1881), le grand écrivain, chaleureux nationaliste et populiste russe; les frères Konstantin (1917-1860) et Ivan S. Axakov (1823-1886). En France, Georges Sorel (1847-1922), le social-révolutionnaire le plus original qui soit, et Maurice Barrès (1862-1923). Ensuite, le philosophe, homme politique et écrivain espagnol Miguel de Unamuno (1864-1936), l'économiste et sociologue italien Vilfredo Pareto (1848-1923), célèbre pour sa théorie sur l'émergence et la dissolution des élites. En Angleterre, citons David Herbert Lawrence (1885-1930) et Thomas Edward Lawrence (1888-1935), qui fut non seulement le mystérieux «Lawrence d'Arabie» mais aussi l'auteur des Seven Pillars of Wisdom, de The Mint, etc.
Cette liste pourrait être complétée ad infinitum. Bornons-nous à nommer encore T.S. Eliot et le grand Chesterton pour la Grande-Bretagne et Jabotinski pour la diaspora juive. Tous ces noms ne sont choisis qu'au hasard, dit Mohler, parmi d'autres possibles.
Dans les Bas Pays de l'actuel Bénélux, on observe un contre-mouvement contre les effets de la Révolution française dès le début du XIXième siècle. En Hollande, les conservateurs protestants se donnèrent le nom d'«antirévolutionnaires», ce qui est très significatif. Guillaume Groen van Prinsterer (1801-1876) et Abraham Kuyper (1837-1920) donnèrent au mouvement antirévolutionnaire et au parti du même nom (ARP, depuis 1879) une idéologie corporatiste et organique de facture nettement populiste-conservatrice (volkskonservatief). Conrad Busken Huet (1826-1886), prédicateur, journaliste et romancier, infléchit son mouvement, Nationale Vertoogen, contre le libéralisme, héritier de la Révolution française. Son ami Evert-Jan Potgieter (1808-1875) qui, en tant qu'auteur et co-auteur de De Gids, avait beaucoup de lecteurs, évolua, lui aussi, dans sa critique de la société, vers des positions conservatrices-révolutionnaires; il décrivait ses idées comme participant d'un «radicalisme conservateur» (konservatief radikalisme).
Après la première guerre mondiale, aux Pays-Bas, les idéaux conservateurs-révolutionnaires avaient bel et bien pignon sur rue et se distinguaient nettement du conservatisme confessionnel. Ainsi, le Dr. Emile Verviers, qui enseignait l'économie politique à l'Université de Leiden, adressa une lettre ouverte à la Reine, contenant un programme assez rudimentaire d'inspiration conservatrice-révolutionnaire. Sur base de ce programme rudimentaire, une revue vit le jour, Opbouwende Staatkunde (Politologie en marche). Le philosophe et professeur Gerard Bolland (1854-1922) prononça le 28 septembre 1921 un discours inaugural à l'Université de Leiden, tiré de son ouvrage De Tekenen des Tijds (Les signes du temps), qui lança véritablement le mouvement conservateur-révolutionnaire aux Pays-Bas et en Flandre.
Dans les lettres néerlandaises, dans la vie intellectuelle des années 20 et 30, les tonalités et influences conservatrices-révolutionnaires étaient partout présentes: citons d'abord la figure très contestée d'Erich Wichman sans oublier Anton van Duinkerken, Gerard Knuvelder, Menno ter Braak, Hendrik Marsman et bien d'autres. En Flandre, la tendance conservatrice-révolutionnaire ne se distingue pas facilement du Mouvement Flamand, du nationalisme flamand et du courant Grand-Néerlandais: la composante national(ist)e de la RC domine et refoule facilement les autres. Hugo Verriest et Cyriel Verschaeve, deux prêtres, doivent être mentionnés ici (1), de même qu'Odiel Spruytte (1891-1940), un autre prêtre peu connu mais qui fut très influent, surtout parce qu'il était un brillant connaisseur de l'œuvre de Nietzsche (2). En dehors du mouvement flamand, il convient de mentionner le leader socialiste Henri De Man (3), le Professeur Léon van der Essen (4) et Robert Poulet, récemment décédé et auteur, entre autres, de La Révolution est à droite (5). Sans oublier le Baron Pierre Nothomb (6), chef des Jeunesses Nationales et Charles Anciaux de l'Institut de l'Ordre Corporatif (7).
Les noms de Lothrop Stoddard et de Madison Grant, défenseurs soucieux de l'identité de la race blanche, de James Burnham, théoricien de The Managerial Revolution, mais aussi auteur du The Suicide of the West et de The War we are in, montrent que les Etats-Unis aussi ont contribué à la RC. Dans les grands bouleversements qui affectent depuis quelques dizaines d'années l'Afrique, l'Asie et l'Amérique Latine, on peut, explique Mohler, trouver des phénomènes apparentés: «Notamment le mélange, caractéristique de la RC, de lutte pour la libération nationale, de révolution sociale et de rédécouverte de sa propre identité».
Le mouvement ouvrier péroniste en Argentine, avec Juan et Evita Perón, constitue, sur ce chapitre, un exemple d'école. Plus nettement marquée encore est l'œuvre du révolutionnaire chinois, le Dr. Sun Ya-Tsen (1866-1925), fondateur du Kuo-Min-Tang, qui, dans son livre Les trois principes du peuple (8), prêche explicitement pour le nationalisme, la révolution sociale et la voie chinoise vers la démocratie.
Mohler pose un constat: le fait que la Révolution française a mis en branle un contre-mouvement conservateur dont le point focal a été l'Allemagne, indique clairement que nous avons affaire à un phénomène de dimensions au moins européennes; «L'accent mis sur l'élément allemand dans la RC mondiale se justifie sur certains plans. Mêmes les expressions non allemandes de cette révolution intellectuelle contre les idées de 1789 s'enracinent dans ce chapitre de l'histoire des idées en Allemagne, qui s'étend de Herder au Romantisme. En Allemagne même, cette révolte a connu sa plus forte intensité».
L'un des facteurs qui a le plus contribué à l'européanisation générale de la RC est sans conteste la large diffusion des œuvres et des idées de Nietzsche. Armin Mohler tente de ne pas englober Nietzsche dans la RC, mais démontre de façon convaincante que sans Nietzsche, le mouvement n'aurait pas acquis ses Leitbilder («images directrices») typiques et communes. Son influence s'est faite sentir dans les Bas Pays, notamment chez le jeune August Vermeylen (9) et, d'après H.J. Elias (10), sur toute une génération d'étudiants de l'Athenée d'Anvers, parmi lesquels nous découvrons Herman van den Reeck, Max Rooses, Lode Claes et d'autres figures célèbres. La philosophie de Nietzsche a permis qu'éclosent dans toute l'Europe des courants d'inspiration conservatrice-révolutionnaire.
Le Normand Georges Sorel, le second «père fondateur» de la RC selon Mohler (11), est toutefois resté inconnu dans nos régions. Cet ingénieur et philosophe n'a pratiquement jamais été évoqué dans notre entre-deux-guerres (12). A notre connaissance, la seule publication néerlandaise qui parle de lui est l'étude de J. de Kadt sur le fascisme italien; elle date de 1937 (13). On dit qu'il aurait exercé une influence discrète sur Joris van Severen (14) mais son meilleur biographe, Arthur de Bruyne (15), dont le travail est pourtant très fouillé, ne mentionne rien.
Les groupes «völkisch»
Nous ne devons pas concevoir la RC comme un ensemble monolithique. Elle a toujours été plurielle, contradictoire, partagée en de nombreuses tendances, mouvements et mentalités souvent antagonistes. Mohler distingue cinq groupes au sein de la RC; leurs noms allemands sont: les Völkischen, les Jungkonservativen et les Nationalrevolutionäre, dont les tendances idéologiques sont précises et distinctes. Ensuite, il y a les Bündischen et la Landvolkbewegung, que Mohler décrit comme des dissidences historiques concrètes qui n'ont produit des idéologies spécifiques que par la suite. Cette classification en cinq groupes de la RC allemande n'est pas aisément transposable dans les autres pays. Partout, on trouve certes les mêmes ingrédients mais en doses et mixages chaque fois différents. Cette prolixité rend évidemment l'étude de la RC très passionnante.
Le premier groupe, celui des Völkischen, met l'idée de l'«origine» au centre de ses préoccupations. Les mots-clefs sont alors, très souvent, le peuple (Volk), la race, la souche (Stamm) ou la communauté linguistique. Et chacun de ces mots-clefs conduit à l'éclosion de tendances völkische très différentes les unes des autres. Dans la foule des auteurs allemands de tendance völkische, signalons-en quelques-uns qui ont été lus et appréciés à titres divers chez nous, de manière à ce que le lecteur puisse discerner plus aisément la nature du groupe que par l'intermédiaire d'une longue démonstration théorique: Houston Stewart Chamberlain, Adolf Bartels, Hans F.K. Günther, Ernst Bergmann, Erich et Mathilde Ludendorff, Herman Wirth et Erwin Guido Kolbenheyer.
Chez nous, quand la tendance völkische est évoquée, l'on songe tout de suite à Cyriel Verschaeve qui y a indubitablement sa place. Les mots-clefs volk (peuple) et taal (langue) peuvent toutefois nous induire en erreur car l'ensemble du mouvement flamand a pris pour axes ces deux vocables. Une fraction seulement de ce mouvement peut être considérée comme appartenant à la tendance völkische, notamment une partie de l'orientation grande-néerlandaise qui, explicitement, plaçait le «principe organique de peuple» (organische volksbeginsel), théorisé par Wies Moens (16), ou le «principe national-populaire», au-dessus de toutes autres considérations politiques et/ou philosophiques. Nous songeons à Wies Moens lui-même et à la revue Dietbrand, à Ferdinand Vercnocke, à Robrecht de Smet et sa Jong-Nederlandse Gemeenschap (Communauté Jeune-Néerlandaise), à l'aile dite Jong-Vlaanderen (Jeune-Flandre) de l'activisme (17), à l'anthropologue Dr. Gustaaf Schamelhout (18), etc.
Au sein de la tendance völkische a toujours coexisté, chez nous, une tradition basse-allemande (nederduits), à laquelle appartenaient Victor Delecourt et Lodewijk Vlesschouwer (qui participait, e.a., à la revue De Broederhand), le Aldietscher (Pan-Thiois) Constant Jacob Hansen (1833-1910) (19) et le germanisant plus radical encore Pol de Mont (1857-1931), qui déjà avant la première guerre mondiale avait développé son propre corpus völkisch.
Le groupe des Jungkonservativen
A rebours de volks (völkisch), le terme de jungkonservativ (jongkonservatief) n'a jamais, à ma connaissance, été utilisé dans nos provinces. En Allemagne, démontre Mohler, le terme jungkonservativ est le vocable classique qu'ont utilisé les fractions du mouvement conservateur qui, par l'adjonction de l'adjectif «jeune» (jung), voulaient se démarquer du conservatisme antérieur, purement «conservant» et réactionnaire, l'Altkonservativismus. Les Jungkonservativen s'opposent, en esprit et sur la scène politique, au monde légué par 1789 et tirent de cette opposition des conséquences résolument révolutionnaires. Les grandes figures du Jungkonservativismus, également connue hors d'Allemagne, sont notamment Oswald Spengler (20), Arthur Moeller van den Bruck (21), Othmar Spann, Hans Grimm et Edgar J. Jung.
Le peuple et la langue, concepts-clefs des Völkischen, ne sont certes pas niés par les Jungkonservativen, encore moins méprisés. Mais pour eux, ces concepts ne sont pas pertinents si l'on veut construire un ordre: ils conduisent à la constitution d'Etats nationaux fermés, monotone, comparables aux Etats d'inspiration jacobine. De plus, ces Etats précipitent l'Europe, continent qui n'a que peu de frontières linguistiques et ethniques précises, dans des conflits frontaliers incessants, dans des querelles d'irrédentisme, des guerres balkaniques. En pervertissant le principe völkisch, ils provoquent une extrême intolérance à l'encontre des minorités ethniques et linguistiques à l'intérieur de leurs propres frontières. De tels débordements, l'histoire en a déjà assez connus.
Le mot-clef pour les Jungkonservativen est dès lors le Reich. L'idée de Reich, prisée également dans les Bas Pays, n'implique pas un Etat fermé à peuple unique ni un Etat créé par un peuple conquérant sachant manier l'épée. Le Reich est une forme de vivre-en-commun propre à l'Europe, né de son histoire, qui laisse aux souches ethniques et aux peuples, aux langues et aux régions, leurs propres identités et leurs propres rythmes de développement, mais les rassemble dans une structure hiérarchiquement supérieure. Dans ce sens, explique Mohler, l'Etat de Bismarck et celui de Hitler ne peuvent être considérés comme des avatars de l'idée de Reich. Ce sont des formes étatiques qui oscillent entre l'Etat-Nation de type jacobin et l'Etat-conquérant impérialiste à la Gengis Khan.
En langue néerlandaise, Reich peut parfaitement se traduire par rijk. Dans d'autres langues, le mot allemand est souvent traduit à la hâte par des mots qui n'ont pas le même sens: «Empire» suggère trop la présence d'un empereur; «Imperium» fait trop «impérialiste»; «Commonwealth» suggère une association de peuples beaucoup plus lâche.
Mentionnons encore trois particularités qui nous donnerons une image plus complète du groupe jungkonservativ. D'abord, l'influence chrétienne est la plus prononcée dans ce groupe. L'idée médiévale de Reich est perçue par quelques-uns de ces penseurs jungkonservativ comme essentiellement chrétienne, qualité qui demeurera telle, affirment-ils, même si l'idée doit connaître encore des avatars historiques. Les Jungkonservativen chrétiens perçoivent la catholitas comme une force fédératrice des peuples, comme une sorte de ciment historique. Pour eux, cette catholitas ne semble donc pas un but en soi mais un instrument au service de l'idée de Reich.
Ensuite, ces Jungkonservativen cutlivent une nette tendance à peaufiner leur pensée juridique, à ébaucher des structures et des ordres juridiques idéaux. C'est en tenant compte de cet arrière-plan que le deuxième concept-clef de la sphère jungkonservative, en l'occurrence l'idée d'ordre, prend tout son sens. En dehors de l'Allemagne, c'est incontestablement ce concept-là qui a été le plus typique. Mohler écrit, à ce propos: «L'unité, à laquelle songent les Jungkonservativen (...) englobe une telle prolixité d'éléments, qu'elle exige une mise en ordre juridique».
 Enfin, troisièmement, les Jungkonservativen sont les plus «civilisés» de la planète RC et, pour leurs adversaires, les plus «bourgeois». Après eux viennent les Völkischen, qui passent pour des philologues mystiques ou des danseurs de danses populaires, et les Nationaux-Révolutionnaires, qui font figures de dinamiteros exaltés. Des cinq groupes, les Jungkonservativen sont les seuls, dit Mohler, qui ne s'opposent pas de manière irréconciliable à l'environnement politique établi, soit à la République de Weimar. Ils sont restés de ce fait des interlocuteurs acceptés. Entre eux et les adversaires de la RC, les ponts n'ont pas été totalement coupés, malgré les césures profondes qui séparaient à l'époque les familles intellectuelles.
Enfin, troisièmement, les Jungkonservativen sont les plus «civilisés» de la planète RC et, pour leurs adversaires, les plus «bourgeois». Après eux viennent les Völkischen, qui passent pour des philologues mystiques ou des danseurs de danses populaires, et les Nationaux-Révolutionnaires, qui font figures de dinamiteros exaltés. Des cinq groupes, les Jungkonservativen sont les seuls, dit Mohler, qui ne s'opposent pas de manière irréconciliable à l'environnement politique établi, soit à la République de Weimar. Ils sont restés de ce fait des interlocuteurs acceptés. Entre eux et les adversaires de la RC, les ponts n'ont pas été totalement coupés, malgré les césures profondes qui séparaient à l'époque les familles intellectuelles.
Dans les Bas Pays, plusieurs figures de la vie intellectuelle étaient apparentées au courant jungkonservativ. Songeons à Odiel Spruytte qui, malgré son ancrage profond dans le Mouvement Flamand, restait un défenseur typique de l'«universalisme» d'Othmar Spann (22). Aux Pays-Bas, citons Frederik Carel Gerretsen, historien, poète (sous le pseudonyme de Geerten Gossaert) et homme politique (actif, entre autres, dans la Nationale Unie).
Lorque l'on recherche les traces de l'idéologie jungkonservative dans nos pays, il faut analyser et étudier les concepts de solidarisme et de personnalisme: les tenants de cette orientation doctrinale appartenaient très souvent à la démocratie chrétienne. Les «navetteurs» qui oscillaient entre la démocratie chrétienne et la RC, version jungkonservative, étaient légion.
Le Jungkonservativ le plus typé, le seul à peu près qui ait vraiment fait école chez nous, c'est Joris van Severen. Chez lui, les concepts-clefs d'«ordre» et d'«élite» sont omniprésents; sa pensée est juridico-structurante, ce qui le distingue nettement des nationalistes flamands aux démarches protestataires et friands de manifestations populaires. Autre affinité avec les Jungkonservativen: sa tendance à chercher des interlocuteurs dans l'aile droite de l'établissement... Mais ce qui est le plus étonnant, c'est la similitude entre sa pensée de l'ordre et l'idée de Reich des Jungkonservativen de l'ère weimarienne: Joris van Severen refuse la thèse «une langue, un peuple, un Etat» et part en quête d'un modèle historique plus qualitatif, reflet d'un ordre supérieur, mais très éloigné de l'Etat belge de type jacobin, qui, pour lui, était aussi inacceptable. Dans cette optique, ce n'est pas un hasard qu'il se soit référé aux anciens Pays-Bas, dans leur forme la plus traditionnelle, celle du «Cercle de Bourgogne» du Reich de Charles-Quint. Jacques van Artevelde (23) en avait lancé l'idée au Moyen Age et elle avait tenu jusqu'en 1795. L'argumentation qu'a développé Joris van Severen pour étayer son idéal grand-néerlandais dans le sens des Dix-Sept Provinces historiques (24), et contre toutes les tentatives de créer un Etat sur une base exclusivement linguistique, est au fond très semblable à celle qu'avait déployé Edgar J. Jung lorsqu'il polémiquait avec les Völkischen pour défendre l'idée de Reich. A la fin des années 30, van Severen parlait de plus en plus souvent du «Dietse Rijk» (de l'Etat thiois; du Regnum thiois), utilisant dans la foulée le vieux terme de Dietsland (Pays Thiois) (25) pour bien marquer la différence qui l'opposait aux «nationalistes linguistiques» (26).
Les nationaux-révolutionnaires
Le troisième groupe, celui des nationaux-révolutionnaires, est un produit typique de la «génération du front» en Allemagne. Il est plus difficile à cerner pour nous, dans les Bas Pays. De plus, la plupart des auteurs nationaux-révolutionnaires sont peu connus chez nous. Friedrich Hielscher, Karl O. Paetel, Arthur Mahraun, pour ne nommer que les plus connus d'entre eux, sont très souvent ignorés, même par les politologues les plus chevronnés. D'autres, en revanche, sont beaucoup plus célèbres. Mais cette célébrité, ils l'ont acquise pendant une autre période et pour d'autres activités que leur engagement national-révolutionnaire. Ainsi, Ernst von Salomon acquit sa grande notoriété pour ses romans à succès. Otto et Gregor Strasser, à la fin de leur carrière, ont été connus du monde entier parce qu'ils ont été les compagnons de route de Hitler, avant de s'opposer violemment à lui et, pour Gregor, de devenir sa victime. Ernst Niekisch, lui, est souvent considéré à tort comme un communiste parce qu'après la guerre il a enseigné à Berlin-Est (27). Mais cette notoriété, due à des faits et gestes posés en dehors de l'engagement politique, fait que les nationaux-révolutionnaires sont en général très mal situés. On les considère comme des «nazis de gauche», ce qui est inexact dans la plupart des cas, sauf peut-être pour Gregor Strasser, assassiné sur ordre de Hitler en 1934. Ou bien on les considère comme des communistes sans carte du parti, ce qui n'est vrai que pour quelques-uns d'entre eux.
En réalité, l'attitude nationale-révolutionnaire est le fruit d'une étincelle jaillie du choc entre l'extrême-gauche et l'extrême-droite. Les étincelles ne meurent pas si l'on parvient, grâce à elles, à allumer un foyer: ce que voulaient les nationaux-révolutionnaires. Ils considéraient plus ou moins les Völkischen comme des romantiques et des «archéologues» et les Jungkonservativen comme des individus qui voulaient construire du neuf avant que les ruines n'aient été balayées. Evacuer les ruines, mieux, contribuer énergiquement au déclin rapide du monde bourgeois, dénoncer la décadence capitaliste: voilà ce que les nationaux-révolutionnaires comprenaient comme leur tâche. Pour la mener à bien, ils présentait un curieux cocktail de passion sauvage et de froideur sans illusions, produit de leur expérience du front.
Mohler cite une phrase typique de Franz Schauwecker, figure de proue du «nationalisme soldatique»: «L'Allemand se réjouit de ses déclins parce qu'ils sont le rajeunissement». La gauche comme la droite sont dépassées pour les nationaux-révolutionnaires. Ils voulaient dépasser la gauche sur sa gauche et la droite sur sa droite. Pour eux, Staline était un conservateur et Hitler un libéral. Ce que les temps nouveaux apporteront, ils ne le savent pas trop: «mouvement», tel est le premier mot-clef. Le deuxième, c'est la «nation», celle qui est née dans les tranchées. Schauwecker décrit comment la réalité et la foi, comment l'instinct et la profondeur de la pensée, la nature et l'esprit ont fusionné. «Dans cette unité, la nation était soudainement présente». C'est cela pour eux, le nationalisme: la société allemande sans classes.
Au Pays-Bas, il y a eu une figure nationale-révolutionnaire bien typée: Erich Wichman (1890-1929), surnommé souvent avec mépris le «premier fasciste néerlandais», alors qu'il est très difficile de coller l'étiquette de fasciste (si l'on entend par fasciste, cette sorte de militaires d'opérette chaussés de belles bottes bien cirées) sur ce représentant impétueux de la bohème hollandaise, au visage déformé par un oeil de verre. Les noms des groupuscules qu'il a fondé De Rebelse Patriotten (Les Patriotes Rebelles), De Anderen (Les Autres), De Rapaljepartij (Le Parti de la Racaille) trahissent tous l'élan oppositionnel et le défi adressé à «tout ce qui est d'hier», assortis d'un résidu de foi nationale. A son ami, le Dr. Hans Bruch, il écrivit ces phrases révélatrices: «Je n'ai pas besoin de vous dire que, moi comme vous, nous souhaitons que les Pays-Bas et Orange soient au-dessus de tout! Mais... ce cri de guerre ne peut plus être un cri de guerre parce qu'il a été répété a satiété, éculé, galvaudé et usé par les nationalistes de vieille mouture; par de gros bonshommes tout gras affublés de moustaches tombantes, qui remplissent des salles de réunion pour se plaindre, se lamenter et se consumer en jérémiades parce que notre nation, hélas, n'a jamais eu assez de sentiment national. (...) Et nous, les combatifs, nous ne pouvons rien avoir en commun avec eux! Car, nous, nous ne voulons pas nous plaindre, mais agir. Mais nous ne voulons pas non plus pousser des cris de joie, car nous savons qu'en tant que peuple nous n'avons encore rien - nous avons la ferme volonté de mettre un terme définitif à notre misère!» (28).
La prose de Wichman, en violence et en radicalisme, ne cède en rien devant les phrases de Franz Schauwecker ou d'autres nationaux-révolutionnaires: «Tout, aujourd'hui, est cérébralisé et calculé. Il n'y a plus place en ce monde pour l'aventure, l'imprévu, l'élasticité, la fantaisie et la «démonie». La raison raisonnante la plus bête garde seule droit au chapitre. Dieu s'est mis à vivre peinard. Cette époque est morte, sans âme, sans foi, sans art, sans amour. (...) Ce n'est plus une époque, c'est une phase de transition mais qui peut nous dire vers où elle nous mène? Si tout devient autrement que nous le voulons — et pourquoi cela ne deviendrait-il pas autrement? On pourra une fois de plus nous appeler "les fous". Tout acte peut être folie, est en un certain sens une folie. Et celui qui craint d'être appelé un "fou", d'être un "fou", celui qui craint d'être une part vivante d'un tout vivant, celui qui ne veut pas "servir", celui qui ne veut pas être "facteur" en invoquant sa précieuse "personnalité" et ainsi faire en sorte qu'advienne un monde contraire à ses pensées, celui qui a peur d'être un «lépreux de l'esprit», qui ne veut être "particule", qui ne veut être ni une feuille dans le vent ni un animal soumis à la nécessité ni un soldat dans une tranchée ni un homme armé d'un gourdin et d'un revolver sur la Piazza del Duomo (ou sur le Dam); celui qui ne commence rien sans apercevoir déjà la fin, qui ne fait rien pour ne pas commettre de sottise: voilà le véritable âne! On ne possède rien que l'on ne puisse jeter, y compris soi-même et sa propre vie. C'est pourquoi, il serait peut-être bon de nous débarrasser maintenant de cette "République des Camarades", de cette étable de "mauvais bergers". Oui, avec violence, oui, avec des "moyens illégaux"! C'est par des phrases que le peuple a été perverti, ce n'est pas par des phrases qu'il guérira (Multatuli) (29). Donc, répétons-le: aux armes!».
Le type du national-révolutionnaire a également fait irruption sur la scène politique flamande, surtout dans les tumultueuses années 20. Notamment dans le groupe Clarté et dans sa nébuleuse, qui voulaient forger un front unitaire révolutionnaire regroupant les frontistes flamands (30), les communistes, les anarchistes et les socialistes minoritaires. On hésite toutefois à ranger des individus dans cette catégorie car l'engagement proprement national-révolutionnaire n'a quasi jamais été qu'une phase de transition: quelques flamingants radicaux ont tenté de trouver une synthèse personnelle entre, d'une part, un engagement nationaliste flamand et, d'autre part, une volonté de lutte sociale-révolutionnaire. Après une hésitation, longue ou courte selon les individualités, cette synthèse a débouché sur un national-socialisme plus proche du sens étymologique du mot que de la NSDAP, encore peu connue à l'époque. Chez d'autres, la synthèse conduisit à un engagement résolument à gauche, à un socialisme voire un communisme teinté de nationalisme flamand.
Boudewijn Maes (1873-1946) est sans doute l'une des figures les plus hautes en couleurs du microcosme «national-révolutionnaire» flamand. Ce nationaliste flamand libre-penseur (vrijzinnig) avait lutté contre les activistes pendant la première guerre mondiale parce qu'ils étaient trop bourgeois à son goût. Après 1918, il les défendit parce qu'il était animé d'un sens aigu de la justice et parce qu'il s'estimait solidaire du combat national flamand. Aussi parce qu'il voyait en eux des victimes de l'«Etat bourgeois» belge et donc des révolutionnaires potentiels. En 1919, il est élu au Parlement belge sur les listes du Frontpartij. Il y restera seulement deux ans. Dans des groupuscules toujours plus petits, notamment au sein d'un Vlaams-nationaal Volksfront, il illustra un radicalisme pur, dont il ne faut pas exagérer la portée, et par lequel il voulait dépasser les socialistes et les communistes sur leur gauche. Plus tard, il passa au socialisme et mourut communiste flamand.
A propos des deux derniers groupes de la RC allemande, nous pouvons être brefs. Les Bündischen, héritiers des célèbres Wandervögel, constituent un phénomène typique dans l'histoire du mouvement de jeunesse allemand, lequel a véritablement alimenté tous les cénacles de la RC. Notre mouvement de jeunesse flamand, depuis Rodenbach (31), en passant par l'Algemeen Katholiek Vlaams Studentenverbond (AKVS) (32), jusqu'au Diets Jeugdverbond, n'est pas comparable aux Bündischen sur le plan idéologique: la majeure partie des affiliés à l'AKVS, à ses successeurs et à ses émules, est restée, des années durant, fidèle à une sorte de tradition völkische catholisante. D'autres noyauteront l'aile droite de la démocratie chrétienne flamande. Cette communauté de tradition forme aujourd'hui encore le lien entre les groupes nationalistes flamands et certains cénacles du parti catholique. C'est l'idéologie de base que partagent notamment un journal comme De Standaard et les animateurs du pélérinage annuel à la Tour de l'Yser (IJzerbedevaart).
La Landvolkbewegung fut une révolte paysanne, brève mais violente, qui secoua le Slesvig-Holstein entre 1928 et 1932. On peut tracer des parallèles entre des événements analogues qui se sont produits au Danemark et en France mais, dans nos régions, nous n'apercevons aucun phénomène de même nature. Mohler lui-même, dans son Ergänzungsband (cf. références infra) de 1989, revient sur sa classification antérieure des strates de la RC en cinq groupes: la Landvolkbewegung a été de trop courte durée, trop peu chargée d'idéologie et trop dépendante d'orateurs issus d'autres groupes de la RC (surtout des nationaux-révolutionnaires) pour constituer à égalité un cinquième groupe.
Le fascisme défini
par les Staliniens
Mohler note que la littérature secondaire concernant la RC parue depuis 1972 (année de parution de la seconde édition de son maître-ouvrage) est devenue de plus en plus abondante et imprécise. La raison de cet état de choses: la propagation de la conception stalinienne du fascisme, y compris dans les milieux universitaires. «Cette conception, qui a l'élasticité du caoutchouc, est en fait un concept de combat, contenant tout ce que le stalinisme perçoit comme ennemi de ses desseins, jusque et y compris les sociaux-démocrates. Lorsque l'on parlait jadis du national-socialisme de Hitler ou du fascisme de Mussolini, on savait de quoi il était question. Mais le «fascisme allemand» peut tout désigner: la NSDAP, les Deutsch-Nationalen, la CDU, le capitalisme, Strauß comme Helmut Schmidt - et c'est précisément cette confusion qui est le but. Et bien sûr, la RC, elle aussi, aboutit dans cette énorme marmite».
Cette confusion a débouché d'abord sur une littérature tertiaire traitant du fascisme et dépourvue de toute valeur historique, ensuite sur des petits opuscules apologétiques qui «désinforment» en toute conscience. Prenons un exemple pour montrer comment le concept illimité de fascisme, propre au vocabulaire stalinien, s'est répandu dans le langage courant au cours des années 70 et 80: l'écrivain néerlandais Wim Zaal écrit un livre qui connaitra deux éditions, avec un titre chaque fois différent pour un contenu grosso modo identique. Ce changement de titre est révélateur. En 1966, l'ouvrage est titré De Herstellers (Les Restaurateurs). Il traite de plusieurs aspects de l'idéologie conservatrice-révolutionnaire aux Pays-Bas. La définition qu'il donne de cette idéologie n'est pas tout à fait juste mais elle a le mérite de ne pas être ambiguë et parfaitement concise; nous lui reprocherions de réduire l'univers conservateur-révolutionnaire à celui des adeptes de l'«ordre naturel», ce qui n'est pas le cas car d'autres traditions intellectuelles l'ont alimenté. Ecoutons sa définition: «Ce que visait le mouvement restaurateur, c'était précisément de restaurer l'ordre naturel du vivre-en-commun et de le débarrasser des maux que lui avait infligés les forces révolutionnaires à partir de 1780. Toutes les conséquences de ces révolutions n'étaient pas perverses mais leurs principes l'étaient». La seconde édition (remaniée) du livre paraît en 1973: elle traite du même sujet mais change de titre: De Nederlandse fascisten (Les fascistes néerlandais).
De Gorbatchev au Pape Jean-Paul II, de Reagan à Khomeiny, y a-t-il une figure de proue du monde politique ou de l'innovation idéologique qui n'ait jamais été traité de «fasciste» par l'un ou l'autre de ses adversaires? Dans de telles conditions, ne doit-on pas considérer que le mot est désormais vide de toute signification, du moins pour ce qui concerne le récepteur. En revanche, dans le chef de l'émetteur, le message est très clair; celui qui traite un autre de «fasciste», veut dire: «J'entends vous discriminer sur le plan intellectuel»; en d'autres mots: «Je refuse tout dialogue».
Ni dans cet article ni dans le travail de Mohler, le fait de dénoncer cet usage élastique du terme «fascisme» ne constitue pas une tentative d'évacuer du débat les rapports historiques réels qui ont existé entre, d'une part, la RC et, d'autre part, le fascisme ou le national-socialisme. La pensée révolutionnaire-conservatrice ne peut être purement et simplement réduite au rôle de «précurseur» de l'idéologie fasciste. ce serait trop facile et grotesque. A ce propos, Mohler écrit: «Tous ceux qui critiquent les idées de 1789 courent le risque de se voir étiquettés par les protagonistes de ces idées révolutionnaires de "pères fondateurs du fascisme" (ou du "nazisme") (...) D'Héraclite à Maître Eckehart, en passant par Paracelse et Luther, Frédéric le Grand, Hamann et Zinzendorf, pour aboutir à Schopenhauer et Kierkegaard, on peut, dans la foulée, construire les arbres généalogiques du fascisme les plus fantasmagoriques».
En réalité, parmi les protagonistes des idées conservatrices-révolutionnaires, on trouvera les appréciations et les attitudes les plus diverses vis-à-vis du fascisme, tant en Allemagne que dans nos pays. La prudence et la précision s'imposent. Quelques figures de la RC se sont en effet converties très vite et avec beaucoup d'enthousiasme au nazisme, comme, par exemple, un Alfred Bäumler ou un Ernst Kriek, ou, chez nous, un Herman van Puymbroeck (33), futur rédacteur-en-chef de Volk en Staat. D'autres ont vu leur enthousiasme s'évanouir rapidement, mais trop tard pour échapper à la mort: l'exemple de Gregor Strasser, assassiné le 30 juin 1934, un jour avant Edgar J. Jung, qui avait, lui, combattu le national-socialisme dès le début et avec la plus grande énergie. Thomas Mann et Karl Otto Paetel choisirent d'émigrer, tout comme Otto Strasser et Hermann Rauschning. Le national-révolutionnaire dur et pur, ennemi de Hitler, Hartmut Plaas, mourra en 1944 dans un camp de concentration tout comme l'avocat liégeois Paul Hoornaert, grand admirateur de Mussolini et chef de la Légion Nationale.
Pour d'autres encore, la collaboration mena à un ultime engagement dans la Waffen-SS, dont ils ne revinrent jamais; pour citer deux exemples, l'un flamand, l'autre néerlandais: Reimond Tollenaere (1909-1942) et Hugo Sinclair de Rochemont (1901-1942). Au cours de cette même année 1942, la collaboration était déjà un passé bien révolu pour un Henri De Man ou un Arnold Meijer, ex-chef du Zwart Front néerlandais. Quant à Tony Herbert, jadis figure symbolique de tout ce qui comptait à droite en Flandre dans les années 30, il était déjà entré de plein pied dans la résistance. Dans la véritable résistance à Hitler, derrière l'attentat du 20 juillet 1944, se profile une quantité de figures issues de la RC, notamment de la Brigade Ehrhardt, comme l'Amiral Wilhelm Canaris, le Général Hans Oster voire l'écrivain Ernst Jünger. Quant à l'homme qui, en 1945, dans le tout dernier numéro de Signal, la revue de propagande allemande qui paraissait dans la plupart des langues européennes pendant la guerre, publia un article pathétique pour marquer la fin du IIIième Reich, était une figure de la RC: Giselher Wirsing, issu du Tat-Kreis (34). En 1948, il participera à la fondation du journal Christ und Welt, dont il deviendra le rédacteur en chef en 1954 et le restera jusqu'à sa mort en 1975 (35).
Les noms que nous venons de citer ne constituent pas des exceptions. Loin de là. Tous répondent en quelque sorte à la règle. Mais comment expliquer à quelqu'un qui a été élevé sous l'égide du concept stalinien de fascisme, ou a reçu un enseignement universitaire marqué par ce concept, que c'est un fait historiquement attesté que dès le début de l'année 1933, le citoyen néerlandais Jan Baars (36), chef de l'Algemene Nederlandse Fascistenbond (ANFB; = Ligue Générale des Fascistes Néerlandais), envoie un télégramme à Hitler pour protester contre la persécution des Juifs (37). Le 30 janvier 1933, le jour où Hitler arriva au pouvoir, un autre télégramme partit de Hollande. Non pas envoyé par Jan Baars mais par l'association des étudiants catholiques d'Amsterdam, le cercle Thomas Aquinas. C'était un télégramme de félicitations. Précisons-le. Au cas où vous ne l'auriez pas deviné.
Luc PAUWELS.
(texte paru dans la revue anversoise Teksten, Kommentaren en Studies, nr. 55, 2de Trimester 1989; adresse: DELTAPERS v.z.w., Postbus 4, B-2110 Wijnegem).
(1) cfr. Arthur De Bruyne, Cyriel Verschaeve - Hendrik De Man, West-Pocket, 4-5, De Panne, 1969.
Jos Vinks, Cyriel Verschaeve, de Vlaming, De Roerdomp, Brecht/Antwerpen, 1977.
Hugo Verriest (1840-1922) fut l'élève de Guido Gezelle au couvent théologique de Roeselare (Roulers). Nommé prêtre en 1864. Enseigne à Bruges, Roeselare, Ypres, Heule. Curé à Wakken, commune de la famille de Joris van Severen en 1888. Exerça une influence prépondérante sur le mouvement étudiant nationaliste d'Albrecht Rodenbach (la fameuse Blauwvoeterij).
A son sujet, lire: Luc Delafortrie, Reinoud D'Haese, Noël Dobbelaere, Antoon Van Severen, Rudy Pauwels, Dr. R. Bekaert, Hugo Verriest - Joris Van Severen, Komitee Wakken, Wakken, 1984.
(2) Frank Goovaerts, «Odiel Spruytte. Een vergeten konservatief-revolutionnair denker in Vlaanderen», in Teksten, kommentaren en studies, nr. 55/1989.
(3) Sur De Man en français: André Philip, Henri De Man et la crise doctrinale du socialisme, Librairie universitaire J. Gambier, Paris, 1928.
Revue européenne des sciences sociales, Cahiers Vilfredo Pareto, Tome XII, 1974, n°31 («Sur l'œuvre de Henri De Man»).
Michel Brelaz, Henri De Man. Une autre idée du socialisme, Ed. des Antipodes, Genève, 1985.
En guise d'introduction générale: Robert Steuckers, «Henri De Man», in Etudes et Recherches, GRECE, Paris, n°3, 1984.
En anglais: Peter Dodge, Beyond Marxism. The Faith and Works of Hendrik De Man, M. Nijhoff, The Hague (NL), 1966.
(4) Léon van der Essen, Pages d'histoire nationale et européenne, Les Œuvres/Goemare, Bruxelles, 1942.
Léon van der Essen, Alexandre Farnèse et les origines de la Belgique moderne, 1545-1592, Office de publicité, Bruxelles, 1943.
Léon van der Essen, Pour mieux comprendre notre histoire nationale, Charles Dessart éd., s.d.
(5) Robert Poulet, La Révolution est à droite. Pamphlet, Denoël et Steele, Paris, 1934.
(6) Frederic Kiesel, Pierre Nothomb, Pierre de Meyere éd., Paris/Bruxelles, 1965.
(7) Charles Anciaux, L'Etat corporatif. Lois et conditions d'un régime corporatif en Belgique, ESPES, Bruxelles, 1942.
(8) Dr. Sun Ya-Tsen, The Three Principles of the People, China Publishing Company, Taipei R.O.C., 1981.
(9) August Vermeylen, écrivain flamand, né à Bruxelles en 1872 et mort à Uccle en 1945. Etudie à Bruxelles, Berlin et Vienne. Il enseignera à Bruxelles et à Gand. Sera démis de ses fonctions par les autorités allemandes en 1940. Influence de Baudelaire et du mouvement décadent français mais défenseur de la langue néerlandaise. Co-fondateur de la revue littéraire Van Nu en Straks. Individualiste anarchisant à ses débuts, il évoluera vers un socialisme communautaire, justifié par un panthéisme dynamique. Son œuvre la plus célèbre est De wandelende Jood (Le Juif errant), illustrant la quête de la vérité en trois phases: la jouissance sensuelle, l'ascèse et le travail.
(10) Hendrik J. Elias, Geschiedenis van de Vlaamse Gedachte, 4 delen, Uitg. De Nederlandse Boekhandel, Antwerpen, 1971. Ces quatre volumes retracent l'histoire intellectuelle du mouvement flamand et recense minutieusement les influences diverses qu'il a subies, notamment celles venues des Pays-Bas, d'Allemagne et de Scandinavie. Ces ouvrages sont indispensables pour comprendre les lames de fond non seulement de l'histoire flamande mais aussi de l'histoire belge.
(11) Mohler se réfère surtout au livre de Michael Freund, Georges Sorel. Der revolutionäre Konservatismus (V. Klostermann, Frankfurt a.M., 1972). De même qu'aux passage que consacre Carl Schmitt à Sorel dans Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus (1926), aujourd'hui disponible en français sous le titre de Démocratie et Parlementarisme (Seuil, 1988).
(12) Sorel a exercé une incontestable influence sur le philosophe martyr José Streel (1910-1946), idéologue du rexisme et auteur, entre autres, de La Révolution du XXième siècle (Nouvelle Société d'Edition, Bruxelles, 1942). Dans cet ouvrage concis, on repère aussi l'influence prépondérante de Péguy, Maurras et De Man. Sur José Streel, lire ce qu'en écrit Bernard Delcord, «A propos de quelques "chapelles" politico-littéraires en Belgique (1919-1945)», in Cahiers du Centre de Recherches et d'Etudes historiques de la Seconde Guerre mondiale/Bijdragen van het Navorsings- en Studiecentrum voor de Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, Bruxelles, Ministère de l'Education nationale/Ministerie van Onderwijs, Archives Générales du Royaume - Algemeen Rijksarchief, Place de Louvain 4 (b.19), Bruxelles, 1986. On lira de même toutes les remarques que formule à son sujet le Prof. Jacques Willequet dans La Belgique sous la botte, résistances et collaborations, 1940-1945, Ed. Universitaires, Paris, 1986. Signalons aussi que José Streel fut l'un des artisans de l'accord Rex-VNV, règlant, dans le cadre de la collaboration, le problème linguistique belge.
(13) J. De Kadt, Het fascisme en de nieuwe vrijheid, N.V. Em. Querido's Uitgevers-Maatschappij, Amsterdam, 1939.
(14) Sur Joris Van Severen, lire: L. Delafortrie, Joris Van Severen en de Nederlanden, Oranje-Uitgaven, Zulte, 1963.
Jan Creve, Recht en Trouw. De Geschiedenis van het Verdinaso en zijn milities, Soethoudt, Antwerpen, 1987.
(15) Arthur De Bruyne, Joris Van Severen, droom en daad, De Roerdomp, Brecht/Antwerpen, 1961-63.
(16) Le poète Wies Moens (1898-1982) fut un activiste (un «collaborateur») pendant la première guerre mondiale. Il étudia à l'Université de Gand de 1916 à 1918. Il purgera quatre ans de prison pour ses sympathies nationalistes. Il fondera les revues Pogen (1923-25) et Dietbrand (1933-40). En 1945, il est condamné à mort mais trouve refuge aux Pays-Bas pour échapper à ses bourreaux. Il fut le principal représentant de l'expressionnisme flamand et entretint des liens avec Joris Van Severen, avant de rompre avec lui.
Cfr. Erik Verstraete, Wies Moens, Orion, Brugge, 1973.
(17) L'activisme est la collaboration germano-flamande pendant la première guerre mondiale. A ce propos, lire: Maurits van Haegendoren, Het aktivisme op de kentering der tijden, Uitgeverij De Nederlanden, Antwerpen, 1984.
(18) Frank Goovarts, «Dr. G. Schamelhout, antropologie en Vlaamse Beweging», in Teksten, kommentaren en studies, nr. 42, 1985. Le Dr. G. Schamelhout peut être considéré comme un élève de Georges Vacher de Lapouge. Il s'est intéressé également aux ethnies européennes.
(19) Le mouvement pan-thiois (Alldietscher Beweging) visait à unir toutes les «tribus» basses-allemandes, soit néerlandaises et allemandes du nord, en forgeant un Etat qui aurait rassemblé les Pays-Bas, la Belgique (avec les départements français du Nord et du Pas-de-Calais), la Prusse, le Hanovre, le Oldenbourg, etc. La langue de cet Etat aurait été une synthèse entre le néerlandais actuel et les dialectes bas-allemands. A ce sujet, lire: Ludo Simons, Van Duinkerke tot Königsberg. Geschiedenis van de Alldietsche Beweging, Orion, Brugge, 1980.
(20) Sur Spengler, l'ouvrage en français le plus complet est celui de Gilbert Merlio, Oswald Spengler, témoin de son temps, Akademischer Verlag Hans-Dieter Heinz, Stuttgart, 1982 (deux volumes).
(21) Sur Arthur Moeller van den Bruck, l'ouvrage en français le plus complet est celui de Denis Goeldel, Moeller van den Bruck (1876-1925), un nationaliste contre la révolution, Peter Lang, Frankfurt a.M./Bern, 1984.
(22) Deux livres récents sur Spann: Walter Becher, Der Blick aufs Ganze. Das Weltbild Othmar Spanns, Universitas, München, 1985.
J. Hanns Pichler (Hg.), Othmar Spann oder die Welt als Ganzes, Böhlau, Wien, 1988.
(23) Pour comprendre le mouvement d'unité dans les Bas Pays au Moyen Age, lire Léon Vanderkinderen, Le siècle des Artevelde. Etudes sur la civilisation morale et politique de la Flandre et du Brabant, J. Lebègue & Cie, Bruxelles, 1907.
(24) Les dix-sept provinces regroupent les pays suivants dans l'optique de Joris Van Severen et de ses adeptes de jadis et d'aujourd'hui: la Frise, le Groningue, la Drenthe, l'Overijssel, le Pays de Gueldre, le Pays d'Utrecht, la Hollande, la Zélande, le Brabant, le Limbourg (Limbourg historique, Limbourg belge, soit l'ex-Comté de Looz, Limbourg néerlandais contemporain), le Pays de Liège, le Pays de Namur, le Luxembourg (Grand-Duché, Luxembourg belge et Pays de Thionville/Diedenhofen), le Hainaut, la Flandre, l'Artois et la Picardie.
(25) Le terme néerlandais de «Dietsland» se traduit en français par «Pays Thiois». Le long de la frontière linguistique, en Pays de Liège, on trouve également la forme «tixhe», typique de l'ancienne graphie liégeoise. On parle également de «Lorraine thioise» pour désigner la partie allemande de la Lorraine.
(26) Van Severen semble être le seule représentant de la RC dans nos pays à avoir utiliser et revendiquer le terme de «conservateur-révolutionnaire». C'était dans un article du 23 juillet 1932, paru dans De West-Vlaming. Cité par Arthur De Bruyne, op. cit., p. 140.
Rappelons qu'une querelle demeure sous-jacente entre, d'une part, le nationalisme à base exclusivement linguistique, rêvant d'un Etat néerlandais unissant la Flandre et les Pays-Bas, et, d'autre part, les adeptes des Dix-Sept Provinces Unies, regroupant les régions néerlandophones, wallonophones, picardophones et germanophones de l'ancien «Cercle de Bourgogne».
(27) Pour comprendre l'itinéraire d'Ernst Niekisch, lire Uwe Sauermann, Ernst Niekisch und der revolutionäre Nationalismus, Bibliothekdienst Angerer, München, 1985.
(28) Cité par Wim Zaal dans De Nederlandse Fascisten, Wetenschapelijke Uigeverij, Amsterdam, 1973.
(29) Multatuli est le pseudonyme d'Eduard Douwes Dekker (1820-1887), écrivain néerlandais, pionnier de la colonisation de l'Indonésie. Lecteur de Nietzsche, il se posera en partisan d'une monarchie éclairée et d'un système d'éducation non étouffant. Son roman le plus célèbre est Max Havelaer, une chronique assez satirique de la colonie néerlandaise en Indonésie.
(30) Le frontisme est le mouvement politique des années 20 en Flandre, porté par les soldats revenus du front. Sur la scène électorale, il se présentait sous la dénomination de Frontpartij. Ce mouvement d'anciens soldats du contingent était pacifiste et soucieux de ne plus verser une seule goutte de sang flamand pour la France, considérée comme ennemie mortelle des peuples germaniques et du catholicisme populaire.
(31) Albrecht Rodenbach (1856-1880), jeune poète flamand, formé au séminaire de Roeselare (Roulers), élève de Hugo Verriest (cf. supra), fonde, en entrant à la faculté de droit de l'Université Catholique de Louvain, le mouvement étudiant flamand, la Blauwvoeterij. Ses poèmes mêlent un catholicisme charnel et sensuel, typiquement flamand, à un paganisme wagnérien, nourri de l'épopée des Nibelungen: un contraste étonnant et explosif...
A son sujet, lire: Cyriel Verschaeve, Albrecht Rodenbach. De Dichter, Zeemeeuw, Brugge, 1937.
(32) L'AKVS publie toujours une revue, AKVS-Schriften. Adresse: AKVS-Schriften, c/o Paul Meulemans, Kruisdagenlaan 75, B-1040 Brussel. Tél.: 02/734.25.52.
(33) La radicalité des positions de H. Van Puymbrouck transparaît dans le texte d'une brochure publiée à Berlin en 1941 et intitulée Flandern in der neuen Weltordnung (Verlag Grenze und Ausland, Berlin, 1941) et rééditée en 1985 par Hagal-Boeken, Speelhof 10, B-3840 Borgloon.
(34) Sur le Tat-Kreis, cfr.: Klaus Fritzsche, Politische Romantik und Gegenrevolution, Fluchtwege in der Krise der bürgerlichen Gesellschaft: Das Beispiel des «Tat-Kreises», edition Suhrkamp, es 778, Frankfurt a.M., 1976. Ouvrage très critique mais qui révèle les grandes lignes de l'idéologie du Tat-Kreis.
(35) A propos de Giselher Wirsing, on lira avec profit le texte que lui a consacré Armin Mohler au moment de sa mort en 1975 («Der Fall Giselher Wirsing») et repris dans son recueil intitulé Tendenzwende für Fortgeschrittene, Criticón Verlag, München, 1978.
(36) Jan Baars, né le 30 juin 1903, fit partie de la résistance néerlandaise pendant la guerre. Il est décédé le 24 avril 1989.
(37) Wim Zaal, op. cit., p.119.
00:05 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, années 20, années 30, révolution conservatrice, droite, conservatisme, nouvelle droite, idéologie, sciences politiques, politologie, philosophie, théorie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 07 janvier 2010
La excepcion en Carl Schmitt - Una exposicion introductoria
La excepción en Carl Schmitt
Una exposición introductoria
Christian Reátegui / Ex: http://la-coalicion.blogspot.com/

La previsión de una dictadura comisarial en los dos últimos textos constitucionales peruanos ha pasado inadvertida. Para comenzar, la positivización del concepto jurídico de medida en dichos textos constitucionales ha pasado sin mayores comentarios. Tanto en la Constitución peruana de 1979 como en la de 1993 podemos leer textos similares:
Constitución de 1979“Artículo 211º.- Son obligaciones y atribuciones del Presidente de la República:
...
18.- Adoptar las medidas necesarias para la defensa de la República, la integridad del territorio y la soberanía en caso de agresión.”
Constitución de 1993
"Artículo 118º.- Corresponde al Presidente de la República:
...
15.- Adoptar las medidas necesarias para la defensa de la República, de la integridad del territorio y de la soberanía del Estado".
Se ha dicho que los constituyentes peruanos de 1979 adoptaron la fórmula de la empleada en el artículo 16 de la Constitución francesa de 1958, que fue a su vez recogida del texto del famoso artículo 48 de la Constitución de Weimar (1919). Lo que es menos conocido es que este artículo 48 fue el centro de un debate jurídico rico e intenso en la Alemania de esos años acerca de sus alcances y, en última instancia, acerca del concepto de Constitución, debate en el que el concepto de medida (maßnahme) desempeñó un papel central. Para el jurista alemán Carl Schmitt dicho artículo sustentaba la posibilidad de una Dictadura del Presidente del Reich. Es más, dicho artículo devenía en el referente interpretativo de toda la Constitución:
“Artículo 48. Si un Land no cumpliese con sus obligaciones conforme a lo dispuesto en la Constitución o en una Ley del Reich, el Presidente del Reich podrá hacérselas cumplir con ayuda de las Fuerzas Armadas.
Si la seguridad y el orden públicos se viesen gravemente alterados o amenazados, el Presidente del Reich podrá adoptar las medidas necesarias para el restablecimiento de la seguridad y orden públicos, utilizando incluso las Fuerzas Armadas si fuera necesario. A tal fin puede suspender temporalmente el disfrute total o parcial de los derechos fundamentales recogidos en los artículos 114, 115, 117, 118, 123, 124 y 153.
El Presidente del Reich está obligado a informar inmediatamente al Reichstag de la adopción de todas las medidas tomadas conforme a los párrafos 1º y 2º de este artículo. Las medidas deberán ser derogadas a petición del Reichstag.
En caso de peligro por demora, el Gobierno de cualquier Land podrá aplicar provisionalmente medidas de carácter similar a las referidas en el párrafo 2º de este artículo. Las medidas deberán ser derogadas a petición del Reichstag o del Presidente del Reich.
Una ley del Reich desarrollará el resto"
Para Schmitt el párrafo 2º, primera parte, de este artículo contiene el fundamento constitucional de un apoderamiento para una comisión de acción ilimitada, en términos precisos, una dictadura comisarial. Sobre la verificación o no del presupuesto (alteración o amenaza de la seguridad y del orden públicos) para dicho apoderamiento, decide de por sí el Presidente. De acuerdo a Schmitt, el párrafo 2º, en su parte primera, constituía derecho vigente y no requería la ley que desarrollara el estado de excepción que preveía el 5º párrafo. Ante el acaecimiento de alteración o amenaza de la seguridad y del orden públicos, el Presidente podía adoptar todas las medidas necesarias (nötigen Maßnahmen), cuya necesidad era evaluada de acuerdo a las circunstancias y al solo arbitrio del propio Presidente. En consecuencia la dictadura Presidencial cuya posibilidad preveía la Constitución de Weimar, se concretizaba en la adopción de medidas.
Para Schmitt una medida era una acción individualizada o una disposición general, adoptada frente a una situación concreta que se considera anormal, y que es, por lo tanto, superable, con una pretensión de vigencia por tiempo no indefinido. Una medida se caracteriza por su dependencia de la situación objetiva concreta. Ello supone que la magnitud de la medida, su procedimiento y su eficacia jurídica dependen de la naturaleza de las circunstancias. El aforismo latino rebus sic stantibus preside su adopción y ejecución. Ahora bien, la dictadura comisarial desarrollada por Schmitt no significaba la disolución del orden jurídico existente ni que el Presidente deviniese en soberano, ya que las medidas era sólo de naturaleza fáctica y no podían ser equiparadas con actos de legislación ni de administración de justicia, sin que ello significase que no se pudiesen tomar medidas que se aproximaran por sus resultados y consecuencias prácticas a fallos judiciales, decisiones administrativas conseguidas tras un procedimiento previamente establecido o a normas generales (leyes y/o reglamentos), pero que jurídicamente no serían equiparables en significado ni en eficacia jurídicas. Esto porque una medida no podía reformar, derogar o suspender preceptos constitucionales, pero sí podía desconocerlos, separándose de ellos para un caso concreto o una generalidad de casos concretos, en lo que Schmitt llamaba “quebrantamiento” (durchbrechung) de la Constitución. Hay que apuntar que, de acuerdo a Schmitt, hay que distinguir entre Constitución y leyes constitucionales. La Constitución sería la decisión de conjunto de un pueblo acerca de la forma y modo de su unidad política, mientras que las leyes constitucionales serían los preceptos o normas que, por una razón u otra, han sido recogidas en el texto constitucional. Entonces para nuestro autor la Constitución es intangible, mientras que las leyes constitucionales (preceptos o normas) no, por lo que pueden ser “quebrantadas” por las medidas para un caso determinado o casos determinados, y ello sólo en defensa de la propia Constitución en estados de excepción. Hay que precisar que cualquier ley constitucional podría ser desconocida puntualmente por las medidas (o “quebrantada”) y no sólo las que contienen derechos fundamentales, como sucede con lo permitido por la norma de la segunda parte del párrafo 2º como más adelante veremos.
Un ejemplo para clarificar la diferencia entre medida y decisión administrativa, sería la que da el propio Schmitt a propósito de lo establecido en el artículo 129º de la Constitución de Weimar. Este artículo preveía una serie de garantías a favor de los funcionarios, así, sólo podrían ser privados de su cargo mediante un procedimiento conforme a Derecho, tenían la posibilidad de interponer recursos impugnatorios, el respeto a sus derechos adquiridos, etc. A pesar de ello, a través de una medida se podría suspender a determinados funcionarios y confiar su cargo a otras personas. Tales medidas tendrían efectos o resultados jurídicos, pero no la eficacia de una decisión adoptada tras un proceso disciplinario que concluyese con la separación definitiva del cargo del funcionario. Esto significa que el funcionario suspendido continuaría disfrutando (jurídicamente) de su status de funcionario, situación que no se daría con el separado jurídicamente del servicio. Asimismo, la persona encargada, mediante una medida, del cargo y de sus tareas públicas no conseguiría, por ello, alcanzar la situación jurídica de funcionario.
Para Schmitt no escapó que esta comisión para una dictadura presidencial, entraba en contradicción con lo establecido en la segunda parte de ese mismo 2º párrafo, que para él contenía otra norma que, junto al apoderamiento general de su primera parte, determinaba que para conseguir el restablecimiento de la seguridad y el orden públicos, el Presidente del Reich también podía suspender (suspension), es decir, poner temporalmente fuera de vigencia, en todo o en parte, a los derechos fundamentales contenidos en las leyes constitucionales de los artículos 114º (libertad personal), 115º (inviolabilidad del domicilio), 117º (secreto de la correspondencia y de correo), 118º (libertad de prensa), 123º (libertad de reunión), 124º (libertad de asociación) y 153º (propiedad privada). Esta contradicción, que, por un lado, permitía suspender toda el ordenamiento jurídico existente y, por otro, sólo permitía suspender una serie de derechos enumerados taxativamente, se debía, según Schmitt, a la confusión entre dictadura soberana y comisarial, que supone el considerar que el Presidente del Reich podía emitir ordenanzas con fuerza de ley sin considerar la distinción entre ley y medida y la asignación de competencias que conformaba la Constitución del Reich, y a la creencia ingenua que, en el Estado de Derecho burgués, la seguridad sólo podría ser puesto en peligro por individuos o grupos de individuos en tumultos y motines, no por organizaciones políticas, colectivos o agrupaciones solidarias, ya que los grupos intermedios y gremios de este tipo habían desaparecido.
Esta misma contradicción, entre la existencia del establecimiento de una dictadura presidencial (artículos 211 numeral 18 de la Constitución de 1979, y 118 numeral 15 de la Constitución de 1993) con la de un régimen de excepción limitado (artículos 231 de la Constitución de 1979, y 137 de la Constitución de 1993) se ha dado, a nuestro entender, tanto en la Constitución peruana anterior como en la actual. Basta con leer el artículo 231º de la Constitución de 1979 y el 137º de la que nos rige actualmente:
Constitución de 1979
"Artículo 231.- El Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, decreta, por plazo determinado, en todo o parte del territorio y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente, los estados de excepción que en este artículo se contemplan:
a.- Estado de emergencia, en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación. En esta eventualidad, puede suspender las garantías constitucionales relativas a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, que se contemplan en los incisos 7, 9 y 10 del artículo 2º y en el inciso 20-g del mismo artículo 2º. En ninguna circunstancia se puede imponer la pena de destierro. El plazo del estado de emergencia no excede de sesenta días. La prórroga requiere nuevo decreto. En estado de emergencia, las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno cuando lo dispone el Presidente de la República.
b.- Estado de sitio, en caso de invasión, guerra exterior, o guerra civil, o peligro inminente de que se produzcan, con especificación de las garantías personales que continúan en vigor. El plazo correspondiente no excede de cuarenta y cinco días. Al decretarse el estado de sitio el Congreso se reúne de pleno derecho. La prórroga requiere aprobación del Congreso”
Constitución de 1993
“Artículo 137.- El Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar, por plazo determinado, en todo el territorio nacional, o en parte de él, y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente, los estados de excepción que en este artículo se contemplan:
1.- Estado de emergencia, en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación. En esta eventualidad, pueden restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2º y en el inciso 24, apartado f del mismo artículo. En ninguna circunstancia se puede desterrar a nadie.
El plazo de emergencia no excede de sesenta días. Su prórroga requiere nuevo decreto. En estado de emergencia las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno si así lo dispone el Presidente de la República.
2.- Estado de sitio, en caso de invasión, guerra exterior, guerra civil, o peligro inminente de que se produzcan, con mención de los derechos fundamentales cuyo ejercicio no se restringe o suspende. El plazo correspondiente no excede de cuarenta y cinco días. Al decretarse el estado de sitio, el Congreso se reúne de pleno derecho. La prórroga requiere aprobación del Congreso".
El que el artículo 55 de la Constitución actual, que prescribe que los tratados celebrados por el Estado, y que se encuentren en vigor, forman parte del derecho nacional, y la 4º Disposición Final y Transitoria que dispone que las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre dichas materias ratificadas por el Perú, pueden dar la impresión que el problema jurídico se ha zanjado. Ello puede ser considerado efectivamente así, pero pasa por alto que toda disciplina jurídica que pretende tener vigencia en el tiempo, es decir, eficacia social, no puede responder a autoengaños a partir de visiones ideologizadas de experiencias pasadas. Sobre ello queda mucho por abundar aún.
00:16 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : carl schmitt, théorie politique, révolution conservatrice, sciences politiques, philosophie, politologie, droit, décisionnisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 06 janvier 2010
Démocratie américaine et dialectique de la liberté
 Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1990
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1990
Démocratie américaine et dialectique
de la liberté
à propos d'un livre de Gottfried Dietze
par Hans-Dietrich SANDER
Parmi les livres dignes d'intérêt récemment parus, et soumis à la conspiration du silence, il y a l'ouvrage sur l'Amérique de Gottfried Dietze:
Gottfried Dietze, Amerikanische Demokratie — Wesen des praktischen Liberalismus, Olzog Verlag, München, 1988, 297 S., DM 42.
Depuis longtemps déjà, l'auteur n'avait plus publié d'articles dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung et dans Die Welt (Bonn). Il n'est plus membre de la Mount Pelerin Society. Il s'en est retiré, parce qu'il ne lui a pas été permis de prononcer son discours sur Kant en langue allemande lors d'une diète de la dite société à Berlin! Mais personne en revanche n'a pu le traiter de «terroriste intellectuel». Gottfried Dietze est professeur ordinaire de «théorie comparée des pouvoirs» à la John Hopkins University de Baltimore, l'une des cinq universités les plus cotées aux Etats-Unis (sa faculté occupe d'ailleurs la première place en son domaine). Ses travaux, il les publie en Allemagne chez J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) et chez Duncker & Humblot, c'est-à-dire chez les meilleurs éditeurs de matières politologiques. La maison Olzog, qu'il a choisie pour éditer son livre sur l'Amérique, ouvrage destiné à un public plus vaste, ne suscite pas davantage les colères des professionnels hystériques qui entendent façonner l'opinion publique selon leurs seuls critères. La démocratie ouest-allemande vient manifestement d'atteindre un seuil critique, où, désormais, ceux qui prononcent des paroles libres, claires, transparentes, passent pour des excentriques. Et, «notre démocratie», pour reprendre les mots de son Président Richard v. Weizsäcker, ne peut pas se permettre des excentriques politiques.
Critique du libéralisme pur et réminiscences tocquevilliennes
Dietze passe depuis longtemps déjà pour un excentrique dans notre bonne république. Pour être exact, depuis que le Spiegel a découvert, jadis, qu'il servait de conseiller au candidat à la Présidence américaine Barry Goldwater, et cela, au moment où la guerre du Vietnam atteignait son point culminant. Toute évocation de son nom, à l'époque, suscitait la suspicion. Il a tenté de revenir en Allemagne, en y postulant un poste universitaire. Sans succès. Le dernier des grands théoriciens du libéralisme politique n'est pas le bienvenu dans la République fédérale, acquise pourtant aux principes du libéralisme. Cette situation n'est pas incompréhensible. Elle découle, d'une part, du rapport même que Dietze entretient avec l'idéologie libérale et, d'autre part, de son engagement politique aux côtés de Goldwater. La modestie de Dietze est telle, qu'il n'a pas osé paraphraser Kant dans les sous-titres de ses ouvrages majeurs, Reiner Liberalismus (Le libéralisme pur) et Amerikanische Demokratie (La démocratie américaine). Au premier, il aurait parfaitement pu donner le titre de Kritik des reinen Liberalismus (Critique du libéralisme pur); au second, Kritik des praktischen Liberalismus (Critique du libéralisme pratique). Il aurait ainsi imité le grand penseur de Königsberg, avec sa Critique de la raison pure et sa Critique de la raison pratique.
Le titre du livre qui me préoccupe ici, Amerikanische Demokratie, paraphrase pourtant un autre grand théoricien politique, Alexis de Tocqueville, auteur de La démocratie en Amérique. Mais Dietze adopte une perspective critique à l'endroit des idées de Tocqueville. Il cherche à donner d'autres définitions aux concepts. Contrairement à Tocqueville, qui, il y a 150 ans, voulait explorer l'essence de la démocratie à la lumière de la démocratie américaine, Dietze cerne la démocratie américaine en soi, qui, dans la forme qu'elle connaît aujourd'hui, n'existait pas encore vers 1830-40, sa transformation radicale par Andrew Jackson n'en étant qu'à ses premiers balbutiements. La démocratie américaine, explique Dietze, est fondamentalement différente des autres démocraties, ce qui la rend précaire quand elle est imposée à d'autres pays.
La néomanie américaine
Dietze approche son sujet en analysant les phénomènes et les discours de la quotidienneté américaine, de la banalité quotidienne de l'American Way of Life, qui, soutenu par cette bonne conscience typique du «Nouveau Monde», se présente comme une poussée incessante vers la nouveauté (Drang nach dem Neuen), vers tout ce qui est nouveau. Le concept américain de liberté repose sur un fondement problématique: en l'occurrence sur la volonté d'être toujours prêt à réceptionner cette nouveauté. Ensuite, ce concept trouve son apogée dans la notion de Manifest Destiny, du destin et de la mission de l'Amérique, qui est d'apporter cette liberté à tous les autres peuples. Dans la foulée de ses possibilités illimitées, la démocratie américaine n'a pas créé une forme spécifique de libéralisme politique mais des variations libérales toujours changeantes.
Ce type de démocratie a très fortement marqué le peuple américain et, à l'inverse, le peuple a marqué la démocratie américaine. Les origines des Etats-Unis, faites d'émigrations et d'immigrations, se sont transformées en migrations et en vagabondages, en manifestations et en agitations. Le résultat: une absence permanente de racines, qui trouve un parallèle saisissant dans le monde juif toujours dé-localisé (ent-ortet). Cette absence de racines est la condition première de la symbiose actuellement dominante. Contrairement aux symbioses d'antan, cette symbiose actuelle ne présente pas une panoplie de négations qui se combinent utilement à des positions données, mais une gamme de négations qui s'imposent sur la scène publique en se créant du tort les unes aux autres.
Une pulsion jamais assouvie de liberté jouissive
Le pouvoir du peuple en Amérique oscille ainsi de la démocratie élitaire à la démocratie égalitaire, de la démocratie représentative à la démocratie directe, de la démocratie limitée à la démocratie illimitée. Quelle vue d'ensemble cela donne-t-il? Celle d'un «pot-pourri dans le melting pot»; par «melting pot», nous n'entendons pas, ici, le seul mélange des races et des ethnies. Ce jeu chaotique dérive précisément de cette pulsion incessante vers la nouveauté et se maintient par la force intrinsèque dégagée par cette pulsion. Il dérive des droits inaliénables à jouir de la triade life, liberty and pursuit of happiness, d'une liberté toujours plus grande qui se mesure surtout à la possession de biens matériels et à leur jouissance. Dans une telle optique, le pays n'est rien, l'individu est tout.
Ce serait bien là le perpetuum mobile d'un monde totalement immanent, si la pulsion de liberté n'était pas pluri-signifiante et à strates multiples. Dans son analyse, Gottfried Dietze déploie une dialectique de la liberté, où sa position vis-à-vis du libéralisme prend des formes socratiques. En effet, le livre, en de longs passages, se lit comme un dialogue, où chaque facette est opposée à son contraire (son négatif), si bien qu'à la fin, on débouche sur des questions ouvertes.
La pulsion de liberté du libéralisme pur n'est pas seulement dirigée contre les tyrans: elle s'épuise dans la lutte interne de concurrences diverses aux frais des autres. Cela ne nous mène pas seulement à la lutte hobbesienne de tous contre tous, lutte où apparaîtrait juste la crainte de Hegel de voir l'homme considérer qu'une telle liberté autorise et prône le vol, le meurtre et le désordre, mais aussi à une exploitation despotique de la minorité par la majorité, ce qui serait parfaitement conciliable avec le libéralisme, parce qu'il exige plus de liberté pour l'individu sans regard pour les autres.
La transposition de cette émancipation dans le domaine de la libido, comme on a pu l'observer au cours de ces dernières décennies en Amérique, fait que cette pulsion, sans regard pour autrui, qui poursuit sa quête insatiable de bonheur conduit à une «jungle sexuelle» que Hobbes n'avait pas pu imaginer.
Une symbiose entre
Jefferson et Freund
La permissivité engendrée par la lutte concurrentielle outrancière et la multiplication des contacts sexuels, où la question du bien et du mal n'est plus posée, a forgé une symbiose entre Jefferson et Freud, dont les conséquences excessives ne peuvent surgir qu'en Amérique: «Les idées de Freud, telles qu'elles ont été prises en compte et perçues par les Américains, ont complété celles de Jefferson —du moins dans les interprétations qu'elles avaient acquises au cours du temps; elles les ont complétées de façon telle que le pensée libérale ancrée dans ce peuple s'est vue considérablement élargie, s'est apurée à l'extrême et s'est détachée de tout contexte axiologique».
Sur le plan de la liberté, nous apercevons très vite la différence essentielle entre Tocqueville et Dietze. Tocqueville voyait une démocratie américaine liée à l'idée d'égalité, suscitant une tendance générale et progressive à expulser toute notion de liberté. Dietze, au contraire, voit dans la liberté le pôle adverse de la démocratie et de l'égalité; et, pour lui, la liberté est tout aussi illusoire que la démocratie et l'égalité. Ce que Tocqueville craignait jadis, soit de voir advenir une dictature égalitaire de la démocratie, n'a pas eu lieu: la pulsion de liberté s'y est sans cesse heurtée et en a émoussé les contours.
La pulsion de liberté, en tant que fondement ultime du libéralisme à l'américaine, s'est toujours mise en travers de toutes les mesures de contrôle, d'équilibrage et de conservation. Sans ces mesures, le libéralisme devient un mouvement anti-autoritaire. De ce fait, le despotisme de la majorité et le mouvement anti-autoritaire sont les extrêmes du libéralisme pratique, extrêmes qui se rejoignent dans le libéralisme pur. Prenons deux exemples.
Une presse libre qui censure
ce qui ne lui plaît pas
Le premier montre comment l'expression «presse populaire» a acquis un sens ambigu. La presse, qui, à l'origine, était un instrument servant à presser des lettres sur du papier, a fini très vite par presser ses vues dans les cerveaux du peuple, à la manière la plus libérale qui soit: «L'ancienne liberté de presse, soit la liberté de la presse vis-à-vis de toute censure étatique, s'est transformée radicalement: elle est devenue liberté pour la presse de censurer, dénoncer et vilipender l'Etat, des citoyens individuels et des groupes précis de la société d'une manière éhontée, nuisant aux cibles infortunées et profitant à ceux qui usent et abusent de cette liberté. Cette situation s'observe dans tous les pays où la presse est libre mais elle est plus frappante encore aux Etats-Unis, écrit Dietze, le plus libéral des pays».
Le deuxième exemple nous montre les possibilités illimitées que laisse entrevoir le jeu de mot democracy/democrazy, où le «pouvoir du peuple» apparaît comme l'«enfollement du peuple». Dietze souligne à plusieurs reprises que la quintessence de la démocratie américaine ne permet pas de percevoir cet «enfollement» comme une dégénérescence. Car la quintessence de la démocratie américaine, c'est que son libéralisme est réellement sans principes, dépourvu de tout point de référence éthique et de toute forme de responsabilité.
Les déceptions des Européens face à l'extrême versatilité américaine ne sont dès lors pas convaincantes: «Vu d'Amérique, vu du lieu où se bousculent toutes les variantes et variations du libéralisme, il ne peut guère y avoir de déceptions nées du spectacle et du constat de comportements instables, du va-et-vient de la politique américaine. On ne peut être déçu que lorsque quelque chose évolue d'une façon autre, pire, que ce que l'on avait prévu. Mais, dans la démocratie américaine, qui se rapproche plus du libéralisme pur que n'importe quelle autre démocratie, on ne doit guère s'attendre à une politique constante. Toute constance y disparaît sous la pression des souhaits et des désirs des individus et du peuple, mus par l'humeur du moment».
Anarchie et volonté de simplification outrancière
Au point culminant de ses analyses enjouées et sans pitié, qui rappellent celles de Machiavel, Dietze cite le poète irlandais William Butler Yeats: «Things fall apart; the center cannot hold; Mere anarchy is loosed upon the world» («Les choses se disloquent; le centre ne maintient plus rien; une anarchie brute envahit le monde»). Pour Dietze, Yeats, dans cette phrase résume l'essence du libéralisme pur. Quand cette situation d'anarchie est atteinte, toute dialectique de liberté prend fin.
Dietze explique ensuite le processus dans son moteur intime et profond: «Bien des signes nous l'indiquent: la complexité croissante de la vie a éveillé une nostalgie du simple, du pur, avec des simplifications outrancières, si bien que la démocratie n'apparaît même plus comme une forme politique dans le sens où l'entendaient Locke ou Rousseau mais bien plutôt comme l'entendait Bakounine». La démocratie à l'américaine est le catalyseur de ce courant sous-jacent fondamental: «Sans doute, très probablement, les évolutions du Nouveau Monde, avec la pulsion constante de changement qui règne là-bas, ont accéléré le processus. Car l'américanisation du monde est un fait que l'on ne saurait ignorer en ce siècle, que les Américains déclarent être le leur, même si le rêve d'une pax americana est passé depuis longtemps».
La question finale que pose le livre de Dietze est la suivante: «Qu'adviendra-t-il de l'Amérique et de l'américanisme? Il faut attendre. L'avenir nous le dira». Question rhétorique ou question macabre? Dietze prononce des vérités que l'on n'aime guère entendre dans la République de Bonn, où l'on considère la démocratie à l'américaine comme une sotériologie, pour ne pas dire comme une vache sacrée, alors que cette démocratie a été instaurée en RFA comme un système provisoire mais qu'on s'est habitué à considérer comme définitif. Ce sont des vérités que l'on n'aime guère entendre parce qu'elles sonnent justes. On préfère se boucher les oreilles.
Après la révolution populaire allemande de RDA, qui fait apparaître la démocratie de Bonn pour ce qu'elle est vraiment, soit un système provisoire, et la remet en question, il n'est pourtant plus possible de se boucher les oreilles. Les Allemands devront, en opérant la synthèse de leurs divers systèmes politiques actuels, trouver une réponse adéquate, adaptée à leur histoire, pour dépasser le système de la démocratie à l'américaine.
Hans-Dietrich SANDER.
(recension parue dans Staatsbriefe 1/1990; adresse: Castel del Monte Verlag, Türkenstr. 57, D-8000 München 40).
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, liberté, théorie politique, sciences politiques, politologie, histoire, etats-unis, amérique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook




 Le bien, c’est ce qui existe. Chaque jour, à chaque heure, en tout lieu, des personnes tiennent les promesses qu’elles ont faites ; des enfants naissent d’amours réelles ; des parents élèvent leurs enfants ; des couples demeurent fidèles, des familles restent unies ; des écoliers apprennent quelque chose à l’école ; nombreux sont ceux qui se lèvent le matin en vue de bien faire leur travail ; des artistes se perfectionnent et produisent de belles œuvres ; des vieillards quittent ce monde dans la sérénité. […]
Le bien, c’est ce qui existe. Chaque jour, à chaque heure, en tout lieu, des personnes tiennent les promesses qu’elles ont faites ; des enfants naissent d’amours réelles ; des parents élèvent leurs enfants ; des couples demeurent fidèles, des familles restent unies ; des écoliers apprennent quelque chose à l’école ; nombreux sont ceux qui se lèvent le matin en vue de bien faire leur travail ; des artistes se perfectionnent et produisent de belles œuvres ; des vieillards quittent ce monde dans la sérénité. […]



 « Ce que nous vivons aujourd’hui me semble être plus qu’une fatigue de la consommation. C’est un véritable épuisement. En 2004, j’ai lu dans Le Monde les résultats d’une enquête sur la grande distribution française réalisée par un cabinet de marketing américain. Les hypermarchés étaient alors confrontés à un problème : on observait une baisse de la vente des produits de grande consommation alors qu’aucun facteur économique, comme un recul du pouvoir d’achat, n’était en mesure d’expliquer ce phénomène. La réponse proposée par cette enquête avançait l’idée qu’une nouvelle race de consommateurs était née : les “alter-consommateurs”, c’est-à-dire des consommateurs qui voudraient ne plus consommer. La même année, Télérama a publié les résultats d’une autre enquête sur les téléspectateurs français : 56% d’entre eux disaient ne pas aimer les programmes de la chaîne qu’ils regardaient le plus. Dans les deux cas, s’est exprimé un même désamour pour la consommation.
« Ce que nous vivons aujourd’hui me semble être plus qu’une fatigue de la consommation. C’est un véritable épuisement. En 2004, j’ai lu dans Le Monde les résultats d’une enquête sur la grande distribution française réalisée par un cabinet de marketing américain. Les hypermarchés étaient alors confrontés à un problème : on observait une baisse de la vente des produits de grande consommation alors qu’aucun facteur économique, comme un recul du pouvoir d’achat, n’était en mesure d’expliquer ce phénomène. La réponse proposée par cette enquête avançait l’idée qu’une nouvelle race de consommateurs était née : les “alter-consommateurs”, c’est-à-dire des consommateurs qui voudraient ne plus consommer. La même année, Télérama a publié les résultats d’une autre enquête sur les téléspectateurs français : 56% d’entre eux disaient ne pas aimer les programmes de la chaîne qu’ils regardaient le plus. Dans les deux cas, s’est exprimé un même désamour pour la consommation.