dimanche, 21 novembre 2010
Repolitizar la Economia
Ex: http://elfrentenegro.blogspot.com/
00:20 Publié dans Economie, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : économie, philosophie, slavoj zizek |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
"Le crépuscule d'une idole" de Michel Onfray

Le crépuscule d'une idole (M. Onfray)
« Le crépuscule d’une idole » est une charge de Michel Onfray contre Freud. Nous lui devons le distrayant spectacle de la secte psychanalytique en émoi. Toutefois, au-delà du côté ridicule de cette bataille d’intellos et sous-intellos (1), il y a le texte.
Note de lecture, donc. Histoire de savoir de quoi on parle.
*
D’emblée, notons que le rapport d’Onfray à la psychanalyse est… psychanalytique. Il l’avoue, sans faire de chichi : pour lui, Freud, c’est important. Le petit Michel, voyez-vous, a subi l’orphelinat (avec prêtre pédophile en option gratuite et automatique, d’après ce qu’il dit – d’où, sans doute, sa rage antichrétienne).
Trois auteurs l’aident à s’évader de cet « enfer » : Marx, Nietzsche, Freud. Alors soyons clair : il est évident que pour Onfray, flinguer Freud est une manière de liquider ce qu’il y a de psychanalytique dans sa propre pensée. Onfray réglant ses comptes avec Freud, c’est un peu l’intello français anticatholique de base faisant un choix. Nietzsche, et pas Freud (2). Avec la répudiation discrète de Marx, auquel il dit maintenant préférer Proudhon, Onfray achève de définir une identité idéologique. Une quête identitaire qui, visiblement, nourrit depuis pas mal de temps la démarche de cet intello français typique, perpétuellement à la recherche de maîtres. Des maîtres qu’il va idolâtrer, puis brûler – et bien sûr il faut qu’il les idolâtre, pour ensuite les brûler.
Très classique, tout ça : quand on analyse le parcours de nos intellos, on trouve souvent, très souvent, un traumatisme dans l’enfance, au départ de ce qui va devenir leur « raison », et qui est, d’abord, la rationalisation de leur sensibilité. Celle d’Onfray est caractérisée par un très fort individualisme (doublé d’un hédonisme revendiqué), une volonté d’indépendance intellectuelle farouche (d’où l’appétit de rupture avec toute « classe sacerdotale ») et, d’une manière générale, un enfermement non su dans les catégories modernes. Vraiment, une caricature d’intellectuel français. Ce que les héritiers des Lumières françaises, imprégnés malgré eux d’une culture catholique détestée mais intériorisée, et en outre un tantinet enfermés dans leur narcissisme intellocrate par l’héritage de mai 68, peuvent comprendre de Nietzsche : voilà, en gros, la pensée d’Onfray.
Le côté positif du personnage est sa capacité à produire une pensée iconoclaste. Onfray déboulonnant une idole, c’est logique, c’est dans la nature du bonhomme.
Or donc, le jour est venu où, ayant fini de déboulonner « l’idole » judéo-chrétienne, notre intello français s’avisa qu’il convenait à présent de déboulonner une idole juive, ou réputée telle. Et notre intello, donc, s’attaqua au bon docteur Sigmund…
C’est là que les ennuis du philosophe commencèrent, mais c’est aussi là qu’il devint vraiment iconoclaste – puisque, par les temps qui courent, on obtient son diplôme d’hérétique en attaquant la psychanalyse, et certes pas en décochant un coup de pied rageur au catholicisme européen, ce corps immense et moribond.
Cette inscription dans la catégorie des hérétiques du moment vaudra à Onfray de figurer parmi les auteurs commentés sur ce modeste blog – ce sera notre humble contribution à son excommunication par les cléricatures dominantes.
*
Onfray analyse l’œuvre de Freud comme un travail avant tout autobiographique. En gros, il ne nie pas que les constats du bon docteur aient été justes le concernant, lui, personnellement. Il nie que ces constats soient vrais pour l’ensemble de l’humanité. Pour Onfray, Freud n’est pas un scientifique : c’est un philosophe à la rigueur. Et, en outre, un philosophe de seconde zone.
Démonstration.
Freud a menti sur sa biographie, ou en tout cas, disons qu’il l’a fortement arrangée. Pourquoi ? Parce que, nous dit Onfray, il éprouvait un besoin pathologique qu’on parle de lui en bien. Il ne supportait pas la critique. Et Onfray, ici, de suggérer que le bon docteur, toute sa vie, a cherché à donner de lui-même une image conforme à celle que sa mère se faisait de lui (la dénonciation du rôle de la mère juive n’est pas loin, mais Onfray s’arrange pour frôler le précipice sans y tomber). Exemple caricatural : Freud est cocaïnomane, donc la cocaïne permet de guérir certaines pathologies – voilà la méthode freudienne.
Pour dissimuler les conditions dans lesquelles il a bâti son système, Freud, à 29 ans, a brûlé tous ses papiers. Objectif selon Onfray : présenter la psychanalyse comme un « coup de génie », nier qu’elle soit le résultat d’une démarche à la scientificité douteuse.
D’où encore, selon Onfray, la volonté de Freud de « détruire Nietzsche » : il s’agit avant tout de dissimuler que la psychanalyse est née dans le contexte intellectuel créé par Nietzsche (un meurtre du père, en somme !). Idem pour Schopenhauer : si Freud l’a rejeté, c’est pour ne pas avouer que sa théorie du refoulement n’est qu’une resucée du « monde comme volonté et comme représentation ». Idem, au fond, pour toute la philosophie : Freud prétend s’en être détourné à cause de son caractère « abstrait » : en réalité, ce qu’il veut cacher, c’est le caractère abstrait de son œuvre à lui.
Pourquoi cette imposture ? Parce que Freud est un aventurier, obligé de dissimuler qu’il est un aventurier. La thèse d’Onfray a le mérite de la clarté : Freud ne veut pas la vérité scientifique, il veut les honneurs, l’argent, la célébrité. Mais pour avoir les honneurs, l’argent, la célébrité, il doit prétendre avoir découvert une vérité scientifique qu’il a longuement cherchée (l’inconscient), et trouvée à l’issue de travaux très sérieux. Cette vérité, en réalité, était déjà toute entière dans Nietzsche (la volonté de puissance), Schopenhauer (le vouloir vivre), et quelques autres (l’inconscient de Hartmann, et même, déjà, le conatus de Spinoza). Simplement, Freud l’habille d’un vernis de fausse scientificité, pour la revendre au meilleur prix. Si, au passage, il faut assassiner la philosophie, nier qu’elle possède une valeur spécifique, pour tout ramener à une catégorie naissante des « sciences humaines », tant mieux : une main lavera l’autre, la destruction de la filiation permettra de cautionner l’imposture. Freud est un médiocre philosophe, qui se déguise en grand médecin. Et donc, la psychanalyse n’est pas une science, c’est la philosophie d’un petit philosophe.
Après cette première salve d’artillerie à longue portée, Onfray part à l’assaut pour l’attaque à la baïonnette. Et là, c’est du corps à corps, on achève le blessé au couteau de tranchée.
La philosophie de Freud se résume, nous dit Onfray, à une banale pathologie de la relation au père, à la fois humilié (donc castré) et humiliant (donc castrateur). Le complexe d’Œdipe n’est pas une vérité universelle, mais tout simplement une pathologie spécifique à la famille du petit Sigmund, qui prend son cas pour une généralité. On nage, chez Freud, dans l’autobiographie vaguement hystérique d’un adulte qui n’est jamais parvenu à échapper à une mère fusionnelle, qui n’a pas pu construire son identité sexuelle normalement (collision des générations dans la famille), et qui, pour se dissimuler qu’il est un fils à maman, va présenter sa pathologie comme une règle générale. Onfray consacre une centaine de page à l’analyse des pathologies freudiennes ; un ami à moi, menuisier de son état, sait très bien résumer ça en une phrase définitive : ça sent le slip de pédé.
Toute la pensée de Freud, nous explique Onfray, tourne autour de sa pathologie propre. Il veut tuer Moïse, créateur de la religion où il fut élevé, parce que Moïse est assimilé à la figure paternelle (Freud interdit à sa femme, fille de rabbin, d’élever leurs enfants dans la religion). Il déteste le président Wilson au seul motif que celui-ci a pris son père en modèle. Il y a, chez Freud, une rage anti-patriarcale qui a plus à voir avec la névrose qu’avec la méthode scientifique.
Voilà, à très grands traits et sans entrer dans les détails, la théorie d’Onfray sur Freud. C’est un carnage.
*
La théorie est étayée par une analyse approfondie des méthodes du bon docteur Sigmund. Où l’on apprend en vrac :
- Que Freud s’est vanté de guérisons imaginaires, les patients en cause ayant généralement fait des rechutes (limite de l’effet placebo),
- Qu’il a lui-même présenté sa théorie du « père de la horde originaire » comme un « mythe scientifique » (soit un aveu du caractère non-scientifique de la théorie),
- Qu’il a lui-même présenté la psychanalyse comme l’incarnation de « l’esprit du nouveau judaïsme », c'est-à-dire non comme une science, mais comme une religion qui se substitue à une autre religion (ici, Onfray fait une remarque inattendue et intéressante : Freud aurait-il été ami de l’Egypte, et ennemi de Moïse, précisément parce que la terre des Pharaons fut une des rares civilisations connues pour pratiquer l’inceste à grande échelle ? – Onfray va jusqu’à parler d’un antisémitisme latent chez Freud, au-delà d’un antijudaïsme évident),
- Que les patients de Freud et de certains de ses disciples immédiats ont une fâcheuse tendance à se suicider après quelques années d’analyse (dont, entre autres, Marilyn Monroe, qui, en léguant une partie de sa fortune à la Fondation Anna Freud, a beaucoup fait pour les finances de la secte),
- Que le bon docteur a beaucoup écrit sous l’emprise de la cocaïne, ce qui, on l’admettra, n’est pas franchement un gage d’objectivité scientifique (au passage, on peut remarquer que Freud a si bien soigné un patient à grands coups de cocaïne par injection… que ledit patient en est mort !),
- Que Freud annonça avoir renoncé à l’hypnose à cause de son caractère « mystique », mais que ce renoncement arriva comme par hasard après qu’il se fut avéré qu’il était mauvais hypnotiseur,
- Qu’il a ouvertement reconnu avoir abandonné la balnéothérapie parce qu’elle n’était pas rentable financièrement,
- Etc. etc.
Plus intéressant que ce dossier à charge lourd mais anecdotique au regard des enjeux réels, Onfray attaque le freudisme, et pas seulement Freud. Et bien sûr, c’est là qu’est le vrai débat : au fond, que le bon docteur n’ait été qu’un charlatan n’a aucune importance ; ce qui est important, c’est de savoir si l’impact de sa pensée est positif ou négatif. Un charlatan médical peut très bien être un philosophe de grande portée ; est-ce le cas de Freud ?
Onfray accuse Freud d’avoir plongé l’esprit occidental dans un rapport magique au monde. Sa philosophie est caractérisée par une dénégation inconsciente du corps, dont le primat accordé au psychisme n’est que le masque. Ce déni du corps traduit, en profondeur, un refus de l’incertitude, une volonté obstinée de ne pas concéder à l’humain sa part de mystère : l’inconscient freudien est une pure abstraction, qui se révèle par des phénomènes que l’existence de cette abstraction permet de relier arbitrairement. Le discours freudien est donc celui d’une reconstitution artificielle d’un monde parallèle, où le pouvoir du mage transcende les limites de la connaissance humaine. C’est une pensée magique, et, plus grave, c’est le point de départ d’un univers sectaire : le monde freudien, déconnecté du réel, fournit en réalité un placebo à des malades eux-mêmes atteints d’une semblable déconnexion. Le psychanalyste ne guérit pas, il cautionne la maladie, il la rend acceptable par son patient. Fondamentalement, c’est de la magie noire.
Cette magie, explique Onfray, est dangereuse parce qu’elle repose sur un ensemble de mythes agissants. Si vous vivez dans un monde où l’on vous dit que tout est sexe, au bout d’un moment, dans votre esprit, tout sera effectivement sexe (surtout si ce discours vous libère d’un puritanisme étouffant). Si vous vivez dans un monde où l’on analyse toute relation comme perverse, alors toute relation deviendra effectivement perverse (surtout si vous vivez dans un monde dont les structures socio-économiques sont réellement perverses). Et si en plus, vous vivez dans un monde où les tenants des thèses en question pratiquent l’intimidation à l’égard de quiconque ne partage pas leurs certitudes, vos réflexes d’obédience viendront renforcer l’impact pathogène du discours sectaire dans lequel votre société est enfermée. Ne perdons pas de vue qu’à travers le Comité Secret de la Société psychologique et ses ramifications à travers toute l’Europe, la psychanalyse s’est, très tôt, organisée comme une franc-maçonnerie particulièrement sectaire, dont les affidés chassaient en meute – d’où la dictature intellectuelle des milieux freudiens dans les intelligentsias.
Sous cet angle, on sort de la lecture d’Onfray avec en tête une hypothèse : Freud se rattache peut-être à la catégorie des faiseurs « d’horribles miracles », pour parler comme René Girard – il crée une peste, la répand dans la société en jouant sur les mimétismes, et se vante ensuite de pouvoir guérir du mal qu’il a lui-même créé. C’est en effet ainsi, explique Girard dans « Je vois Satan tomber comme l’éclair », que procédaient les thaumaturges du paganisme tardif – dans les catégories chrétiennes, Freud serait donc un faux prophète, un antéchrist.
Qu’Onfray n’ait pas anticipé la formulation de cette hypothèse, parmi les réactions possibles de son lecteur, se laisse bien voir à la dernière partie de son livre, où il nous présente le Freud « réactionnaire » – rappelons ici que Freud réaffirme, à travers la théorie de la sublimation, un interdit de l’inceste (fût-ce pour y voir la source de toutes les névroses). Et, à juste titre, Onfray nous fait remarquer que cette manière de poser le problème débouche, mécaniquement, sur une vision du monde très noire : rares seront les hommes heureux, car rares seront les hommes qui sauront accorder leurs désirs et leurs possibilités, donc la règle est la compétition pour le peu de bonheur disponible, presque un concours de bites, au fond, et que le meilleur gagne ! (sous cet angle il est évident que le freudisme est en partie une idéologie bourgeoise, voire un proto-fascisme, et en tout cas un nihilisme).
Et cependant, on sort de cette cinquième partie avec un sentiment d’inachevé…
En fait, Onfray passe à côté de la conclusion qui aurait dû couronner sa charge. On soupçonne ici que, pour dire les choses simplement, l’intello d’Argentan ne s’est jamais remis de son passage chez les curés (pédophiles d’après lui, et qui en outre lui auraient interdit de se branler). Résultat : chez Onfray, il manque l’essentiel.
Onfray ne peut condamner l’instrumentalisation du désir qu’au nom du désir, parce qu’il ignore, ou en tout cas néglige, la notion d’Amitié (au sens aristotélicien). C’est pourquoi, à ses yeux, il ne peut y avoir que deux camps : ceux qui veulent réprimer le désir (où il range Freud), et ceux qui veulent le libérer (où il se range). Puisque Freud décourage les hédonistes, c’est que Freud est un réac : voilà la conclusion d’Onfray – qui montre ici les limites de son positionnement, et passe donc complètement à côté de la question où, pourtant, son travail aurait dû l’amener : est-ce que le fond du problème, chez Freud, ce ne serait pas tout simplement une certaine incapacité à aimer ? A s’oublier soi-même ? Et si, pour sortir de la névrose, il ne fallait tout simplement admettre que l’on doit s’occuper d’autre chose que de soi ?
Autant de questions qu’Onfray, profondément individualiste, irréductiblement moderne, ne peut pas poser, parce qu’il ne peut pas les penser. Pour Onfray, le monde se réduit à un face-à-face entre phallocratie et libération sexuelle : il n’a pas remarqué que ce ne sont là, fondamentalement, que deux figures possibles d’une même réduction de l’Agapè à l’Eros. En quoi, et il l’avoue d’ailleurs à demi-mots dans sa conclusion, Onfray ne peut pas, à ce stade, se libérer vraiment de l’emprise de Freud…
( 1 ) Les lecteurs désireux de se détendre pourront se régaler de ce morceau de bravoure, offert par un « psy » tellement caricatural qu’on a peine à croire au premier degré : voici l’impossible remix de « Freud est grand et je suis son prophète » sur un sampling d’Offenbach, la vie parisienne, « Yé choui bréjilien y’ai dé l’or » (ne pas manquer).
( 2 ) Sur le sous-nietzschéisme d'Onfray, à lire très bientôt sur ce blog un résumé de la critique de Nietzsche par Lukacs. Qu'il soit bien entendu que cette note de lecture ne vaut pas approbation de la position d'Onfray dans l'absolu.
00:10 Publié dans Philosophie, Psychologie/psychanalyse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel onfray, sigmund freud, psychanalyse, psychiatrie, médecine, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Prima che Nietzsche venisse: Giacomo Leopardi
Prima che Nietzsche venisse: Giacomo Leopardi
Alessandra COLLA - http://www.alessandracolla.net/
Archives: 1994
 Negli scritti di Nietzsche, è stato detto, si può trovare tutto e il contrario di tutto. Questa pretesa contraddizione interna del grande pensatore ha fornito materiale in quantità per molte opere — talvolta critiche talvolta denigratorie — che hanno accompagnato negli anni la fortuna del filosofo senza, peraltro, mai scalfirne il nòcciolo.
Negli scritti di Nietzsche, è stato detto, si può trovare tutto e il contrario di tutto. Questa pretesa contraddizione interna del grande pensatore ha fornito materiale in quantità per molte opere — talvolta critiche talvolta denigratorie — che hanno accompagnato negli anni la fortuna del filosofo senza, peraltro, mai scalfirne il nòcciolo.
In mezzo alla feconda complessità dei temi trattati, emergono però alcuni aspetti interessanti e solitamente poco noti ai più. Vogliamo qui accennarne qualcuno, almeno per suggerire nuove curiosità.
L’UOMO CHE VISSE DIETRO LA SIEPE
… questa siepe, che da tanta parte
dell’ultimo orizzonte il guardo esclude.
(G. Leopardi, L’infinito, 1819)
Il XVIII secolo sta per finire quando, nel 1798, nasce a Recanati Giacomo Taldegardo Francesco Leopardi, figlio del conte Monaldo e della marchesa Adelaide Antici. Autentico bambino prodigio, all’età di undici anni Giacomo si ritrova senza precettore: sa già tutto quello che c’è da sapere, e non c’è nessuno in grado di seguirlo negli studi. Con la beata incoscienza della sua età, il primogenito di casa Leopardi continua da solo. Da solo impara il greco, l’ebraico, il francese, l’inglese e lo spagnolo; padrone, a soli quindici anni, di tante lingue vive e morte, sviluppa a quest’età l’amore per gli studi filologici: le grammatiche e le sintassi non hanno più per lui alcun segreto, ed ora è finalmente libero di cogliere nella loro pienezza i tesori che si celano dietro l’aridità apparente delle forme verbali e delle declinazioni.
Il 1816 segna una svolta di importanza capitale nella vita e nel pensiero di Leopardi: è in quest’anno, infatti, che il giovane scopre le lettere e la poesia, sulle quali riversa la passione finora consacrata all’erudizione e alla disciplina filologica. Dello stesso anno è anche la prima, e non la più grave, delle molte crisi fisiche e nervose che travaglieranno la sua breve vita: con orrore e certo senza rassegnazione, Giacomo intuisce di aver definitivamente minato la sua già gracile costituzione con un’applicazione mentale eccessiva. Ad aggravare la situazione psicologica del giovane sopraggiunge, sul finire dell’anno, il breve soggiorno in casa Leopardi della bella cugina Gertrude Cassi sposata Lazzari: scoppia la prima infatuazione amorosa, tutta platonica e ovviamente unilaterale, di Giacomo, che recita qui per la prima volta il copione dell’amore illuso e deluso — lo ripeterà per tutta la vita.
Il suo stato d’animo non migliora affatto. In una celebre, drammatica lettera all’amico scrittore Pietro Giordani, datata 2 marzo 1818, Leopardi lascia sgorgare senza pudori tutta la sua amarezza profonda e inconsolabile: «[…] in somma io mi sono rovinato con sette anni di studio matto e disperatissimo in quel tempo che mi s’andava formando e mi si doveva assodare la complessione. E mi sono rovinato infelicemente e senza rimedio per tutta la vita, e rendutomi l’aspetto miserabile, e dispregevolissima tutta quella gran parte dell’uomo, che è la sola a cui guardino i più; e coi più bisogna conversare in questo mondo». Nel settembre dello stesso anno il Giordani, allarmato dalle parole del giovane, lo raggiunge a Recanati per condurlo con sé a Macerata: un viaggio di ben pochi chilometri — il primo in assoluto di Giacomo, allora ventenne. L’impatto con una dimensione estranea a quella del sonnolento “borgo natio” e la consapevolezza di un mondo vasto e sconosciuto destinato a restare fuori dalla sua portata non fanno che aumentare l’inquietudine di Leopardi, che si sente (e sa di essere davvero) profondamente diverso dagli altri, e anela alla gloria.
Nella primavera del 1819 la sua già malferma salute va peggiorando: un esaurimento fisico generale lo prostra, e si manifestano i primi disturbi agli occhi che gli impediscono di leggere per quasi un anno e che, d’ora in poi, lo accompagneranno per tutta la vita. Questo episodio rientra a pieno titolo fra i motivi scatenanti di quel pessimismo assoluto che diverrà cifra e referente del pensiero leopardiano (1).
Corollario inevitabile di questo crollo di ogni illusione è la perdita della fede religiosa; per compensare la quale il Leopardi si getta nell’elaborazione di un suo sistema filosofico — una sorta di materialismo pessimistico radicale sull’onda, paradossalmente, delle suggestioni illuministiche. Se infatti l’illuminismo tracciava il disegno grandioso di un progresso inarrestabile volto a condurre l’umanità intera verso luminosi e necessari destini, per il Leopardi le istanze deterministiche e la constatazione di uno “stato di natura” suggeriscono piuttosto l’idea di un decadimento dell’uomo dalle altezze dell’età antica alle bassure di quella moderna; e la civiltà, lungi dal rappresentare il punto d’arrivo dell’evoluzione umana, si configura invece come l’allontanamento dell’uomo dalla beata condizione naturale, unica e sola in grado di garantire la felicità — cioè l’assenza o la cessazione del dolore (secondo la scuola stoica prediletta dal poeta-filosofo). Il grande passo è compiuto: da qui in avanti il Leopardi alternerà meditazioni filosofiche a composizioni poetiche, per approdare, dopo un silenzio durato cinque anni (dal 1823 al 1828), alla sublime fusione di sostanza filosofica e forma poetica. Sempre più minato nel fisico, trascinerà un’esistenza sofferente, alleviata soltanto dalle cure assidue e affettuose di pochi amici, fino alla morte, sopravvenuta il 14 giugno 1837 a Napoli, in casa dell’amico Antonio Ranieri.
IL POETA E IL FILOSOFO: AFFINITÀ ELETTIVE
È un destino singolare, come si vede, quello che accomuna Giacomo Leopardi e Friedrich Nietzsche: entrambi sono stati mutilati dalla critica, contemporanea e successiva, in gran parte della loro opera — si sa che il Leopardi è noto, apprezzato e studiato come poeta, ma per lo più ignorato come filosofo, mentre Nietzsche è giudicato a buon diritto un gigante del pensiero ma poco più che un semplice dilettante nel campo delle arti. Eppure, come pochi ormai si azzardano a negare, la verità è molto diversa.
Ma le somiglianze non finiscono qui. Sia l’italiano inquieto che il riservato tedesco iniziano il loro percorso intellettuale sui testi di filologia, anche se per motivi dìversi: il piccolo Giacomo perché la pur nutrita biblioteca paterna non era in grado di offrire più niente a un bambino così sorprendentemente dotato; il giovane Federico perché la formazione ricevuta nel prestigioso istituto di Pforta gli aveva rivelato le immense possibilità speculative legate allo studio del mondo classico e delle sue lingue. Inoltre, entrambi furono costretti a viaggiare molto, ed entrambi per questioni di sopravvivenza, soggiornando addirittura negli stessi luoghi; entrambi furono di salute assai cagionevole, soffrendo persino degli stessi disturbi; entrambi trovarono l’ultimo conforto nella vicinanza di amici fedeli e disinteressati; e, per finire, il pensiero di entrambi è stato spesso snaturato e stravolto così da renderli invisi non soltanto a generazioni di studenti, ma anche a molti seri studiosi irrimediabilmente viziati nell’interpretazione dei loro testi.
La complementarità dei loro destini li rende simili al di là delle differenze oggettive, portandoli verso un unico sentire e un’identica visione della vita, tanto che sarà proprio Leopardi ad anticipare alcune delle più brillanti e rivoluzionarie intuizioni di Nietzsche.
Il pensatore di Röcken conosceva, almeno in parte, il Leopardi: sappiamo che nella biblioteca di Nietzsche figuravano due traduzioni tedesche di Leopardi, ad opera dello Hamerling e dello Heyse; sicuramente vi erano compresi i Canti, che il poeta italiano scrisse a partire dal 1818, lo Zibaldone e molto probabilmente le Operette morali. Ed è lo stesso Nietzsche a menzionare il Leopardi, anche se di passata e in modo non proprio lusinghiero: «Gli infelici raffinati, come Leopardi, che dalla loro sofferenza traggono orgogliosamente vendetta su tutta l’esistenza, non si accorgono come il divino mezzano dell’esistenza rida di loro: proprio così essi ora berranno di nuovo dalla sua coppa; infatti la loro vendetta, il loro orgoglio, la loro inclinazione a pensare tutto quanto soffrono, la loro arte nel dirlo: tutto questo non è di nuovo — dolce miele?» (2).
Alla luce di un’attenta lettura del poeta italiano e del filosofo tedesco, è innegabile che le influenze del primo sul secondo esistano, e siano ben documentabili. Confrontiamo, ad esempio, Il sabato del villaggio e La sera del dì di festa (composte entrambe nel settembre 1829) con un frammento di Nietzsche. Il Leopardi scrive:
«[…] intanto riede alla sua parca mensa,
fischiando, il zappatore,
e seco pensa al dì del suo riposo.
Poi, quando intorno è spenta ogni altra face,
e tutto l’altro tace,
odi il martel picchiare, odi la sega
del legnaiuol, che veglia
nella chiusa bottega alla lucerna,
e s’affretta, e s’adopra
di fornir l’opra anzi il chiarir dell’alba.
Questo di sette è il più gradito giorno,
pien di speme e di gioia:
diman tristezza e noia
recheran l’ore, ed al travaglio usato
ciascuno in suo pensier farà ritorno» (3).
E ancora:
«[…] Ahi, per la via
odo non lunge il solitario canto
dell’artigian che riede a tarda notte,
dopo i sollazzi, al suo povero ostello;
e fieramente mi si stringe il core,
a pensar come tutto al mondo passa,
e quasi orma non lascia. Ecco è fuggito
il dì festivo, ed al festivo il giorno
volgar succede, e se ne porta il tempo
ogni umano accidente. […]» (4).
Quello che segue, invece, è il testo nietzscheano:
«Il pomeriggio del sabato si deve passare per un villaggio, se si vuol vedere sui volti dei contadini la vera quiete del dì di festa: allora essi hanno ancora indelibata davanti a sé la giornata di riposo e si industriano a far ordine e pulizia in suo onore con una specie di piacere anticipato, quale non sarà raggiunta dal piacere stesso. La domenica è già quasi lunedì» (5).
Oppure si paragonino questi due brani:
«Ogni grande amore porta con sé il crudele pensiero di uccidere l’oggetto dell’amore, perché sia sottratto una volta per tutte al sacrilego giuoco del mutamento: giacché di fronte al mutamento l’amore inorridisce più che di fronte alla distruzione»;
«Il veder morire una persona amata, è molto meno lacerante che il vederla deperire e trasformarsi nel corpo e nell’animo da malattia (o anche da altra cagione)».
Il primo è di Nietzsche (6), mentre il secondo è di Leopardi (7).
Con un minimo di attenzione, è facilissimo trovare, sparsi qua e là nello Zibaldone senza un ordine fisso, ma sull’onda di meditazioni e concatenamenti apparentemente confusi che fanno delle elaborazioni leopardiane un autentico “pensiero in movimento” destinato ad arrestarsi soltanto con la morte, intuizioni e abbozzi di teorie poi ripresi e sviluppati compiutamente da Nietzsche nell’arco di pochi decenni, e che nella prosa densa del Leopardi spiccano in tutta la loro grandezza.
Così alcuni notevoli passi che anticipano la Genealogia della morale sono del 4-5 settembre 1821: «La legge naturale varia secondo le nature. Un cavallo che non è carnivoro giudicherà forse ingiusto un lupo che assalga e uccida una pecora, l’odierà come sanguinario, e proverà un senso di ribrezzo e d’indignazione abbattendosi a vedere qualche sua carnificina. Non così un lione. Il bene e il male morale non ha dunque nulla di assoluto. Non v’è altra azione malvagia, se non quelle che ripugnano alle inclinazioni di ciascun genere di esseri operanti: né sono malvage quelle che nocciono ad altri esseri, mentre non ripugnino alla natura di chi le eseguisce» (8); «Si suol dire che tutte le cose, tutte le verità hanno due facce, diverse o contrarie, anzi infinite. Non c’è verità che prendendo l’argomento più o meno da lungi, e camminando per una strada più o meno nuova, non si possa dimostrar falsa con evidenza ec. ec. ec. Quest’osservazione (che puoi molto specificare ed estendere) non prova ella che nessuna verità né falsità è assoluta, neppure in ordine al nostro modo di vedere e di ragionare, neppur dentro i limiti della concezione e ragione umana?» (9); «Da ciò che si è detto della legge pretesa naturale, risulta che ne vi è bene né male assoluto di azioni; ci queste non sono buone o cattive fuorché secondo le convenienze, le quali son stabilite, cioè determinate dal solo Dio ossia, come diciamo, dalla natura; che variando le circostanze, e quindi le convenienze, varia ancora la morale, né v’è legge alcuna scolpita primordialmente ne’ nostri cuori; che molto meno v’è una morale eterna e preesistente alla natura delle cose, ma ch’ella dipende e consiste del tutto nella volontà e nell’arbitrio di Dio padrone sì di stabilire quelle determinate convenienze che voleva […]. Da tutto ciò resta spiegata la differenza fra la legge che corse prima di Mosè, quella di Mosè, e quella di Cristo. […] L’antica legge Ebraica permetteva il concubinato, fuorché colle donne forestiere ec. L’odio del nemico costituiva lo spirito delle antiche nazioni. Ecco le leggi di Mosè tutte patriottiche, ecco santificate le invasioni, le guerre contro i forestieri, proibite le nozze con loro, permesso anche l’odio del nemico privato. E Gesù comandando l’amor del nemico, dice formalmente che dà un precetto nuovo. Come ciò, se la morale è eterna e necessaria? Come è male oggi, quel ch’era forse bene ieri? Ma la morale non è altro che convenienza, e i tempi avevano portato nuove convenienze. Questo discorso potrebbe infinitamente estendersi generalizzando sullo stato del mondo antico e moderno, e sulla differente morale adattata a questi diversi stati. L’uomo isolato non aveva bisogno di morale, e nessuna ne ebbe infatti, essendo un sogno la legge naturale. Egli ebbe solo dei doveri d’inclinazione verso se stesso, i soli doveri utili e convenienti nel suo stato. Stretta la società, la morale fu convenienza, e Dio la diede all’uomo appoco appoco, o piuttosto ora una ora un’altra, secondo i successivi stati della società: e ciascuna di queste morali era ugualmente perfetta, perché conveniente; e perfetto è l’uomo isolato, senza morale» (10).
Un rilievo del 1823 sembra attagliarsi perfettamente a certe considerazioni contenute nell’Anticristo: «Persone imperfette, difettose, mostruose di corpo, tra quelle che non arrivano a nascere e […] tra quelle che son tali dalla nascita […]; quelle che così nate vivono e […] quelle finalmente che tali son divenute dopo la nascita […]; sommando dico e raccogliendo tutti questi individui insieme, si vedrà a colpo d’occhio e senza molta riflessione che il loro numero nel solo genere umano, anzi nella sola parte civile di esso, avanza di gran lunga non solamente quello che trovasi in qualsivoglia altro intero genere d’animali, non solamente eziandio quello che veggiamo in ciascheduna specie degli animali domestici, che pur sono corrotti e mutati dalla naturale condizione e vita, e da noi in mille guise travagliati e malmenati; ma tutto insieme il numero degl’individui difettosi e mostruosi che noi veggiamo in tutte le specie di animali che ci si offrono giornalmente alla vista, prese e considerate insieme. La qual verità è così manifesta, che niuno, io credo, purché vi pensi un solo momento e raccolga le sue reminiscenze, la potrà contrastare. Simile differenza si troverà in questo particolare fra le nazioni civile e le selvagge, e proporzionatamente fra le più civili e le meno, secondo un’esatta scala» (11). Di questa lunga citazione merita, a nostro avviso, sottolineare anche l’accenno agli animali, che è una costante del Leopardi: la sua attenzione nei confronti della natura e degli esseri viventi è continua e delicata, comprendendo ogni forma di vita nel mistero del dolore universale e del pessimismo cosmico. Anche questo è un tratto (e non dei minori) che lo accomuna a Nietzsche.
Sempre nell’Anticristo, troviamo invece una frase illuminante del filosofo tedesco: «Se si avesse nel petto una qualche misura, anche esigua, di religiosità, un Dio che cura al momento giusto il raffreddore o che ci fa salire in carrozza nel preciso istante in cui si scatena un acquazzone dovrebbe essere per noi tanto assurdo, che occorrerebbe eliminarlo anche nel caso in cui esistesse. Un Dio come domestico, come portalettere, come venditore d’almanacchi — una sola parola, in fondo, per indicare la specie più stupida tra tutte le circostanze fortuite…» (12). Il riferimento alla celebre operetta morale che il Leopardi scrisse nel 1832, e intitolata appunto Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere, ci sembra assolutamente fuor di dubbio: nel Dialogo, il poeta immagina l’incontro fra un “passeggere” e un venditore di calendari che propone al passante l’acquisto di un calendario per l’anno nuovo. Il passante si informa se l’anno nuovo sarà o no migliore del precedente, e il venditore risponde di sì; ma il passante incalza, e vuole sapere a quale degli ultimi vent’anni potrebbe essere paragonato l’anno nuovo in quanto a bontà; il venditore annaspa, travolto dalla stupidità dei luoghi comuni che il passante gli sciorina uno dietro l’altro, e il dialogo si conclude col timido “speriamo…” del venditore che non può fare altro che rifilare al passante un calendario qualsiasi, nell’illusione che il futuro sarà comunque migliore del passato. Eccolo qua, il Dio schernito da Nietzsche: un Dio buono per tutte le stagioni, che porterà il sole al villeggiante e la pioggia al contadino, la pace a chi combatte e la guerra al mercante d’armi — proprio un Dio che, se davvero esistesse, andrebbe eliminato.
Non sono — ovviamente — tutti qui i paralleli fra il poeta-filosofo e il filosofo-poeta. L’argomento meriterebbe ben più di qualche cenno frettoloso, ma sappiamo che l’insofferenza di troppi per la poesia leopardiana non è certo né il minore né l’ultimo dei guasti fatti dalla scuola italiana. Per chiudere in bellezza, scegliamo l’insegnamento supremo di Zarathustra il Distruttore: «Uomini superiori, imparatemi - a ridere!» (13), adombrato in uno degli ultimi appunti dello Zibaldone: «Terribile e awful è la potenza del riso; chi ha il coraggio di ridere, è padrone degli altri, come chi ha il coraggio di morire» (14).
(testo apparso originariamente sulla rivista “Origini”,
numero monografico su Friedrich Nietzsche, 1994)
NOTE
(1) Lui stesso descriverà così l’avvenuto mutamento, in un’annotazione datata 1 luglio 1820: «Sono stato sempre sventurato, ma le mie sventure d’allora erano piene di vita, e mi disperavano perché mi pareva […] che m’impedissero la felicità, della quale gli altri credea che godessero. […] La mutazione totale in me […] seguì […] nel 1819 dove privato dell’uso della vista, e della continua distrazione della lettura, cominciai […] a divenir filosofo di professione (di poeta ch’io era), a sentire l’infelicità certa del mondo» (Giacomo Leopardi, Zibaldone, Oscar Mondadori, Milano 1972, vol. 1, p. 118).
(2) Friedrich Nietzsche, Umano, troppo umano (e scelta di frammenti postumi), Oscar Mondadori, Milano 1976, vol. II, fr. 38 [2], p. 273.
(3) G. Leopardi, Il sabato del villaggio, vv. 28-42.
(4) Idem, La sera del dì di festa, vv. 24-33.
(5) F. Nietzsche, Umano…, cit., fr. 45 [3], p. 286.
(6) Ivi, fr. 280. p. 95.
(7) G. Leopardi, Zibaldone, cit., p. 290 (8 gennaio 1821).
(8) Idem, Zibaldone, cit., vol. II, p. 582 (4 settembre 1821).
(9) Ivi, p. 585 (5 settembre 1821).
(10) Ivi, pp. 587-589 (5 settembre 1821).
(11) Ivi, p. 844 (28 luglio 1823).
(12) F. Nietzsche, L’Anticristo. Maledizione del cristianesimo, Adelphi, Milano 1977, par. 52, p. 75.
(13) F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, Adelphi, Milano 1973, p. 359 (“Dell’uomo superiore” - 20, 25).
(14) G. Leopardi, Zibaldone, cit., vol. II, p. 1160 (23 settembre 1828).
(© Alessandra Colla, Prima che Nietzsche venisse, 1994, in “Origini - Nietzsche”, 2006)
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, italie, allemagne, nietzsche, giacomo leopardi, 18ème siècle, 19ème siècle |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 19 novembre 2010
L'administration de la peur (Paul Virilio)
L'administration de la peur (P. Virilio)
Ex: http://www.scriptoblog.com/

Jadis, rappelle Virilio, grandir, c’était dépasser ses peurs. A cette aune, on peut se demander, continue-t-il, si nos contemporains ne sont pas infantiles. L’angoisse chimérique est, apparemment, à la mode. Pire, elle fait figure de propédeutique : passe pour sage celui qui a peur, et l’avoue. La peur, principe heuristique, méthode pour penser le monde à l’heure où l’Homme détient le pouvoir de se détruire entièrement ? Virilio, en attendant, fait observer que cette progression de la peur traduit, concrètement, un affaiblissement de la confiance en la perfectibilité du genre humain.
D’où vient cet affaiblissement ? – Voilà sa question. Comment y remédier ? – Voilà son projet.
*
La peur, nous dit en substance Virilio, est l’un des deux grands modes d’administration des citoyens par l’Etat (l’autre est la promesse, la rétribution). La peur permet, en particulier, à des Etats qui n’ont plus grand-chose à promettre (fin des Trente Glorieuses) de continuer à justifier leur existence : si les citoyens ont peur, ils cherchent une protection ; et cette protection, c’est l’Etat qui peut l’offrir.
Or, l’Etat contemporain est, justement, un bon administrateur de peur – en ce sens qu’il dispose de moyens formidables pour instiller l’angoisse, propager la crainte, généraliser la méfiance. Le facteur décisif en la matière, c’est la vitesse : vitesse de transmission de l’information, qui permet de saturer le destinataire, de l’entretenir dans l’angoisse parce qu’il ne peut plus traiter l’information transmise ; mais aussi vitesse des évolutions potentielles, si rapides, si soudaines, qu’on ne peut plus les anticiper. La discontinuité engendre la peur : si tout est possible, alors le pire est possible.
Virilio prend ensuite l’exemple de l’équilibre de la terreur, tel qu’il s’est maintenu pendant toute la guerre froide. C’est pour lui l’image parfaite du processus qui fait de l’Etat moderne un grand administrateur de peur : une catastrophe est en surplomb, elle tétanise les peuples ; mais l’Etat apporte la contre-force qui permet de suspendre indéfiniment cette catastrophe, de la maintenir en surplomb, comme une épée de Damoclès. Il est logique que les complexes militaro-industriels, un peu partout, aient fini par prendre tout ou partie du pouvoir : ils sont le pouvoir, l’incarnation du pouvoir contemporain. Le pouvoir de suspendre indéfiniment un mouvement dont la vitesse est telle qu’elle terrorise.
Le terrorisme contemporain, inséré dans cette grille de lecture, prend un sens bien précis : il est l’instrument d’un déséquilibre de la terreur menaçant constamment de rompre l’équilibre par suspension du mouvement. En ce sens, il constitue la figure aboutie du pouvoir contemporain : je ne sers plus à rien, dit le pouvoir, mais si vous me supprimez, qui sait ce qui arriverait ? L’impossibilité de répondre à cette question du « qui sait ? » fonde la nouvelle légitimité du pouvoir : le pouvoir de ne rien faire, le pouvoir de faire en sorte que rien ne se passe.
Pour Virilio, ce pouvoir d’un type nouveau s’incarnera, demain, commence même déjà à s’incarner, dans l’intériorité des individus. Le seul moyen de faire face à la vitesse toujours croissante induite par la technique, c’est de se techniciser soi-même ; seul un homme transformé en automate peut suivre le rythme des robots.
Plutôt que l’extinction du réel et le simulacre, les concepts de Baudrillard, Virilio propose donc la dissolution de l’espace, de tous les espaces, y compris le corps humain, comme clef de lecture de notre temps. L’avantage est, évidemment, que cette clef de lecture souligne davantage le caractère automatique des implications de l’univers technicisé à outrance ; c’est aussi l’inconvénient : on perd de vue la stratégie autonome du pouvoir, ici, il s’agit de se représenter l’évolution de la structure sociale comme une dynamique favorisant le pouvoir, mais qu’il n’enclenche pas.
Virilio le sait, et c’est pourquoi il souligne que, plus que le progrès en lui-même, c’est la propagande du progrès qui engendre la panique. Il veut dire par là que l’Etat, le pouvoir au sens large, ne crée certes pas cet univers de la vitesse, porteur de toutes les peurs, mais qu’il entretient délibérément, par contre, les individus et les groupements intermédiaires dans l’illusion qu’il n’est pas possible d’anticiper collectivement, de construire une intelligence humaine partagée qui permettrait, précisément, de penser ensemble à la vitesse du progrès.
D’où son projet : construire une dissuasion civile.
Il entend par là, en substance, la constitution d’une société des individus postmodernes. Il s’agit d’inventer une manière d’être collective qui permet, justement par le collectif, de rendre à nouveau le monde prévisible, non en réduisant la vitesse (qu’on ne maîtrise plus), mais en augmentant la vision latérale de chacun, par le partage des visions. En effet, si la vision latérale augmente, le risque de surgissement d’un objet inattendu dans le champ de vision central diminue.
En somme, pour Virilio, c’est donc par la construction d’une intelligence collective, capable de penser un monde imprévisible, que le pouvoir sera contrebattu : si mon voisin partage sa vision latérale avec moi, alors il n’est plus un corps étranger qui participe, par son mouvement trop rapide, à l’incertitude angoissante de mon habitat ; il devient au contraire un partenaire de mon habitat, contre l’incertitude d’un monde trop rapide.
Il s’agit, fondamentalement, de refaire des lieux. Virilio ne refuse pas le localisme ; sa définition de l’impérialisme contemporain, c’est l’abolition de la géographie. Sa définition de la lutte anti-impérialiste, c’est la défense de la géographie : il doit exister des lieux, où des hommes mettent en commun leur destin, et pour cette raison, « partagent leur vision latérale ». Refaire du sens, en somme, pour bâtir cette dissuasion civile, indépendante du pouvoir, c’est, d’abord, recréer des sujets collectifs.
Cette conclusion n’est évidemment pas originale. Mais Virilio a le mérite, au moins, de proposer une grille de lecture stimulante, de mettre en perspective ce projet. Quand on le lit sur les raves, dans lesquelles il voit une simulation d’intelligence collective enfin adaptée au règne de la vitesse, on se dit qu’il y a quelque chose à tirer de sa perception.
00:10 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, paul virilio, peur |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 17 novembre 2010
Remembering René Guénon
Remembering René Guénon
Edouard RIX
Ex: http://www.counter-currents.com/
Translated by Greg Johnson
Editor’s Note:
This essay and the one that follows are presented in commemoration of René Guénon’s birth on November 15, 1886.
 On January 7th, 1951, the Frenchman René Guénon, one of the principal representatives of Traditional thought in the 20th century, died in Cairo.
On January 7th, 1951, the Frenchman René Guénon, one of the principal representatives of Traditional thought in the 20th century, died in Cairo.
From Occultism to Esotericism
Guénon was born in Blois, on November 15, 1886, to a strongly Catholic family. In 1904, after a pilgrimage to Lourdes, he went to Paris to continue his education. A dawdler, he only obtained his license when he was 29, then at 32 he failed his aggregation in philosophy when his doctoral thesis, devoted to “A General Introduction to the Study of Hindu Doctrines,” was rejected.
Parallel to his studies, Guénon frequented, from his arrival in the capital, the occultist milieu, launching himself headlong into a series of affiliations and initiations. He entered the Hermetic School, was received into the Martinist Order, attended various occultist Masonic organizations, was initiated in the Tebah Lodge of the Grand Lodge of France. In 1908, he was secretary of Second Spiritualistic and Masonic Congress and became Sovereign Grand Commander of the Order of the Renovated Temple. At the age of 23, he was consecrated “bishop of Alexandria” of the Gnostic Church of France, under the name of Palingénius and became editor of La Gnose, “the monthly review devoted to the study of esoteric sciences.”
After several disappointing experiences in the occultist milieu, he turned to the East to find the right path, that of “initiatory Knowledge.” After being interested in Taoism, he was initiated in 1912 into Sufism, an Islamic initiatory current, without embracing the Islamic religion, as he would later explain to a correspondent. Having learned Chinese and Arabic, reading the original texts, he tried to work with initiates in each tradition.
While giving his own lessons and courses of philosophy, René Guénon wrote many articles for Catholic publications like the Revue universelle du Sacré-Cœur Regnabit and Traditionalist publications like the Le Voile d’Isis (Veil of Isis), which became Etudes traditionnelles. He also published books.
The Tradition Against the Modern World
In his Introduction to the Study of Hindu Doctrines (1921), and the Man and His Becoming According to the Vedanta (1925), he defined the criteria of universal traditional metaphysics. For Guénon, Tradition means the whole of “metaphysical” knowledge of order: it admits a variety of forms, while remaining one in its essence.
He insists on the idea, already formulated before him by Joseph de Maistre and Fabre d’ Olivet, of a primordial Tradition, which goes back to a supreme Center, the repository of all spiritual knowledge, which diffuses it by the means of “initiatory chains” present in the various religious paths. In Perspectives on Initiation (1946), he defended the need to attach oneself to a “chain,” to a “regular organization,” but hardly offers an alternative to those who refuse to defer, like him, to Muslim or Oriental ones. But in all fairness, he recognizes that in spite of its degeneration Freemasonry remains in theory a conduit of genuine initiation.
The most interesting aspect of Guénon’s work lies in his radical criticism of the modern world, to which he opposes the world of Tradition as a positive foil. According to him, traditional civilization,which was realized in the Orient as well as the West—India, Medieval Catholicism, Imperial China, the Islamic Caliphate—rests on metaphysical foundations. It is characterized by the recognition of an order higher than anything human and the authority of elites which draw from this transcendent plane the principles necessary to found an articulated social organization.
This rests on the division of society into four castes or functional classes: at the top representatives of spiritual authority, then a warlike aristocracy, a middle-class of the merchants and craftsmen, and finally the toiling masses. This concept of caste refers obviously to the Hindu, Indo-Aryan system, divided between the Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas, and Shudras. In the same way, ancient Iran, Greece, and Rome also had somewhat analogous social organizations, which one finds, moreover, in the political doctrines of Plato. The ultimate revival of this system in the West was the feudal Middle Ages, the clergy corresponding to the Brahmins, the nobility to the Kshatriyas, the third estate with the Vaishyas, and the serfs with the Shudras.
The polar opposition of the world of the Tradition is held to be modern civilization, which is characterized by desacralization, ignorance of all that is higher than man, materialism, frenzied activity.
Two major books, The Crisis of the Modern World (1927) and The Reign of Quantity and the Signs of the Times (1946) contain the essence of this critique, to which one can add East and West (1924), which holds that the only remaining Traditional civilizations are in the East. This led Guénon to move to Cairo in 1930, where he took the identity of Sheik Abdel Wahid Yahia.
The Regression of the Castes
René Guénon was never politically active, although he moved in the Parisian circles of Action française, because he believed that “at present, there is no movement deserving one’s adherence.”
For him, we are at the end of a cycle, in the Kali Yuga or “Dark Age” of the ancient Hindu texts or Hesiod’s “Iron Age.” His interpretation of the course of History as decline, resolutely anti-Marxist and reactionary, rests on the idea of the “regression of the castes.” In quasi-mythical times, society is ruled by sacred Kings ruling by divine right selected from the first caste. This is followed by the reign of the warlike caste, secular monarchs, military chiefs, or lords of temporal justice, which comes about in Europe with the decline of great monarchies. Then comes rule by the third estate, the middle-class, aristocracy giving way to plutocracy. Finally comes rule by the last caste, the working class, which finds its logical conclusion in Communism and Sovietism.
The idea of the regression of the castes was taken up by Julius Evola in his masterpiece, Revolt Against the Modern World, published in 1934. Guénon, moreover, allowed the publication of his writings in the cultural page edited by Evola from 1934 to 1943 in the daily newspaper Il Regime Fascista.
Knowledge and Action
Although Evola is indebted to Guénon in many ways, they differ on one point: the relationship of spiritual authority and temporal power, i.e., priesthood and royalty. In its book Spiritual Authority and Temporal Power published in 1929, Guénon affirms the primacy of the priesthood over royalty. For him, the Brahmin is higher than the Kshatriya because knowledge is higher than action and the “metaphysical” domain higher than the “physical.” Even if the members of the sacerdotal caste no longer appear worthy of their function, the validity in principle of their superiority cannot be denied lest one risk the disintegration of the socio-political system. Evola, however, who thought that Western culture is rooted in a “tradition of warriors,” defends the opposite thesis, claiming that Guénon’s reasoning is marked by “brahmanico-sacerdotal point of view of an Oriental.”
Faithful to his nature as a Brahmin, as a sage, René Guénon was more a witness of the Tradition than an actor in his time, contrary to the Kshatriya, the warrior Julius Evola, the 20th century’s only true rebel against the modern world.
Source: “Un témoin de la Tradition: René Guénon,” http://www.voxnr.com/cc/ds_tradition/EpZpkZVVlAJuBArRHD.s...
00:05 Publié dans Philosophie, Traditions | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : philosophie, tradition, traditionalisme, rené guénon |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 16 novembre 2010
The Primordial Tradition: A Tribute to Ananda Coomaraswamy
The Primordial Tradition:
A Tribute to Ananda Coomaraswamy
by Ranjit Fernando
Ex: http://www.freespeechproject.com/
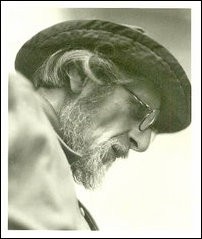 Ananda Coomaraswamy once suggested that Buddhism has been so much admired in the West mainly for what it is not; and he said of Hinduism, that although it had been examined by European scholars for more than a century, a faithful account of it might well be given in the form of a categorical denial of most of the statements that have been made about it, alike by European scholars and by Indians trained in modern modes of thought.
Ananda Coomaraswamy once suggested that Buddhism has been so much admired in the West mainly for what it is not; and he said of Hinduism, that although it had been examined by European scholars for more than a century, a faithful account of it might well be given in the form of a categorical denial of most of the statements that have been made about it, alike by European scholars and by Indians trained in modern modes of thought.
In the same way, it could perhaps be said of Coomaraswamy himself, that he is admired in Lanka, as in India, almost entirely for what he was not, and that a true account of his ideas might well take the form of a denial of most of the statements made about him in the land of his birth.
Coomaraswamy has long been presented, both in India and in Lanka, as a patriot, a famous indologist and art historian, an eminent scholar and orientalist; it would be as well to examine the validity of these widely-held beliefs about a man who was undoubtedly one of the greatest figures of our time.
The subject matter of all Coomaraswamy's mature writings can be placed under one heading, namely, Tradition. The Tradition that he writes about has little to do with the current usage of this term to mean customs or social patterns that have prevailed for some time. Coomaraswamy's theme is the unchanging Primordial and Universal Tradition which, as he shows, was the source from which all the true religions of the present as well as the past came forth, and likewise the forms of all those societies which were molded by religion.
The particular aspect of Tradition which Coomaraswamy chose as his own specialty -- the one best suited to his own talents -- was, of course, the traditional view of art, now mainly associated with the East, but once universally accepted by East and West alike, as also by the civilizations of antiquity and, indeed, by those societies which we are pleased to call primitive. Coomaraswamy never tired of demonstrating that the traditional view of life and of art was always the universal and normal view until the Greeks of the so-called classical period first introduced a view of life and of art fundamentally at variance with the hitherto accepted view.
In his aversion to what has been called 'the Greek miracle', Coomaraswamy is at one with Plato whose attitude to the changes that were taking place in his time was, to say the least, one of the strongest disapproval. Coomaraswamy shows, as Plato did, that the view of life and of art invented and glorified by the Greeks, and subsequently adopted by the Romans was, in the context of the long history of mankind, an abnormal view, an aberration; and that although this view lost its hold on men's minds with the rise of Christendom in the Middle Ages, it was to re-establish itself with greater force at the Renaissance thus becoming responsible for the fundamental ills of the modem world.
In all traditional societies, quite apart from his ability to reason, man was always considered capable of going further and achieving direct, intuitive knowledge of absolute truth which, as the traditionalist writer, Gal Baton says, "carries with it an immediate certainty provided by no other kind of knowledge."
"In the modem world," he continues, "we think in terms of "intellectual progress", by which we mean a progress in the ideas which men formulate with regard to the nature of things; but, from the point of view of traditional knowledge, there can be no progress, except in so far as particular individuals advance from ignorance to reflected or rational know ledge, and from reason to direct intuitive knowledge which, we might add, by its nature cannot be defined, but which, nevertheless stands over and above all other forms of knowledge being nothing less than knowledge itself.
From a traditional point of view, the fault of the Greeks lay in their substitution of the rational faculty for the supra-rational as the highest faculty of man, and in the words of Coomaraswamy's distinguished colleague, Rene Guenon, "it almost seems as if the Greeks, at a moment when they were about to disappear from history, wished to avenge themselves for their incomprehension by imposing on a whole section of mankind the limitations of their own mental horizon." Since the Renaissance, as Baton points out, the modem world has, of course, gone much further than did the Greeks in the denial even of the possibility of a real knowledge which transcends the narrow limits of the individual mentality." Moreover, as we are all aware, that which, from a traditional point of view, appears to be a serious narrowing of horizons, is seen from our modem point of view as an unprecedented intellectual breakthrough!
While it is hardly possible in a brief summary, such as this, to further discuss the issues involved, we might usefully ponder on Plato's story of the subterranean cave where some men have been confined since childhood. These men are familiar only with the shadows cast by a fire upon the dark walls of the cave, which they have all the time to study, and about which they are most knowledgeable. They know nothing of the outside world and therefore do not believe in its existence.
Coomaraswamy, like Plato, would have us realize that we, too, are in darkness like these men, and that we would do well to seek the light of another world above by concerning ourselves with those things, which our ancestors knew and understood so well. He constantly points out, that modem or anti-traditional societies are shaped by the ideas men develop by their own powers of reasoning, there finally being as many sets of ideas as there are men; he also tries to show that traditional societies, on the other hand, were based on perennial ideas of quite another order -ideas of divine origin and revealed -- whereby all the aspects of a society were determined.
A recurrent theme in Coomaraswamy's writings was the traditional view of art. When referring to European art, he repeatedly stressed that Graeco-Roman art and Renaissance art, like all the more modern schools of European art, were of earthly inspiration and therefore of human origin like the philosophies that went with them, whereas traditional art, like traditional philosophy, was related to the metaphysical order and therefore religious in character and divine in origin.
We now see that in his earliest works such as the monumental Medieval Sinhalese Art, Coomaraswamy did not as yet fully understand the difference between these two contrasting points of view which were to form the basis of his later and more significant work; in his early writings, his profound understanding of the traditional arts of Greater India, as indeed his already considerable grasp of the true meaning of religion, was a little clouded with modernistic prejudice, the outcome, no doubt, of his early academic training in England which was of a kind that he had, even then, begun to despise. But later, following his association with the French metaphysician, Rene Guenon, Coomaraswamy's writings assumed the complete correctness of exposition and the great authority, which we associate with his most mature work.
Insofar as we are able to see that a universalist approach to the study of the world's religions, coupled with an understanding of the true meaning of Tradition, have, at the present time, a special importance for the modern world, we shall also see that two men, the Frenchman, Rene Guenon, and Sri Lanka's Ananda Coomaraswamy, stand out as the greatest thinkers of the first half of this century. A great gulf separates their thought from the thought of nearly all their contemporaries. The second half of this century has witnessed the emergence of a whole school founded on their pioneering work and on the Perennial Philosophy, a movement which has found acceptance in many parts of a confused and bewildered world.
It will now be apparent that, if we are to regard Coomaraswamy as an eminent orientalist and art historian, it must first be clearly understood that he stands apart from almost all those other scholars who can be similarly described, in that while they approach the life and art of traditional societies from a modern standpoint {which is both "skeptical and evolutionary", to use his own words), Coomaraswamy, like his few true colleagues and collaborators, takes the view that takes the view that Tradition can only be understood by a careful consideration of its own point of view however inconvenient this may be. Once this is realized, it would certainly be true, not only to say that Coomaraswamy was an eminent scholar but, as Marco Pallis has said, a prince among scholars.
Coomaraswamy saw that a feudal or hierarchical society based on metaphysical principles is essentially superior to the supposedly egalitarian systems held in such high esteem today. Like Plato, he maintained that democracy was one of the worst forms of government, nor did he view any other materialistic system with more favour. His enthusiasm for such institutions as caste and kingship was based, not on sentiment, but on a profound understanding of the vital relationship between spiritual authority and temporal power in society and government. He would hardly have approved of the road which India and Lanka have taken since achieving their so-called independence, although he would have regarded it as inevitable.
It is well known that, from the very beginning, Coomaraswamy deplored the influence of the West on Eastern peoples, and especially the consequences of British rule in Greater India. He has therefore been placed alongside those who in India and Lanka have been regarded as national leaders in the struggle for independence. But here again, a complete difference of approach separates Coomaraswamy from his contemporaries, for it was not imperialism or the domination of one people by another that he was concerned about, but rather the destruction of traditional societies by peoples who had abandoned sacred forms. It was what the British stood for and not the British that he detested; on the contrary, there is no doubt that he loved England because he knew another, older England which in form as well as spirit was so much like the oriental world he understood so well.
It would, in conclusion, be appropriate to quote the words of that highly respected English artist-philosopher, Eric Gill, who in his autobiography paid Coomaraswamy this great tribute:
"There was one person, to whose influence I am deeply grateful; I mean the philosopher and theologian, Ananda Coomaraswamy. Others have written the truth about life and religion and man's work. Others have written good clear English. Others have had the gift of witty exposition. Others have understood the metaphysics of Christianity and others have understood the metaphysics of Hinduism and Buddhism. Others have understood the true significance of erotic drawings and sculptures. Others have seen the relationships of the true and the good and the beautiful. Others have had apparently unlimited learning. Others have loved; others have been kind and generous. But I know of no one else in whom all these gifts and all these powers have been combined. I dare not confess myself his disciple; that would only embarrass him. I can only say that I believe that no other living writer has written the truth in matters of art and life and religion and piety with such wisdom and understanding."
00:05 Publié dans Philosophie, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, tradition, tradition primordiale, traditionalisme, inde |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 15 novembre 2010
El neoliberalismo, la derecha y lo politico
El neoliberalismo, la derecha y lo político
Jéronimo MOLINA
Ex: http://www.galeon.com/razonespanola/
 1. Aquello que con tanta impropiedad como intención se denomina «a la derecha» se ha convertido, como el socialismo utópico y el liberalismo político en el siglo XIX, en el chivo expiatorio de la política superideologizada que se impuso en Europa desde el fin de la I guerra mundial. Entre tanto, «la izquierda», como todo el mundo sabe, se ha erigido en administradora «urbi et orbe» de la culpa y la penitencia del hemisferio político rival. La izquierda, consecuentemente, ha devenido el patrón de la verdad política; así pues, imperando universalmente la opinión pública, su infalibilidad no puede tomarse a broma. Por otro lado, la retahíla de verdades establecidas y neoconceptos políticos alumbrados por el «siglo socialista» no tiene cuento.
1. Aquello que con tanta impropiedad como intención se denomina «a la derecha» se ha convertido, como el socialismo utópico y el liberalismo político en el siglo XIX, en el chivo expiatorio de la política superideologizada que se impuso en Europa desde el fin de la I guerra mundial. Entre tanto, «la izquierda», como todo el mundo sabe, se ha erigido en administradora «urbi et orbe» de la culpa y la penitencia del hemisferio político rival. La izquierda, consecuentemente, ha devenido el patrón de la verdad política; así pues, imperando universalmente la opinión pública, su infalibilidad no puede tomarse a broma. Por otro lado, la retahíla de verdades establecidas y neoconceptos políticos alumbrados por el «siglo socialista» no tiene cuento.
Removidas en su dignidad académica las disciplinas políticas polares (el Derecho político y la Filosofía política), caracterizadas por un rigor y una precisión terminológicas que hoy se nos antojan, al menos de momento, inigualables, el problema radical que atenaza al estudioso de la Ciencia política tiene una índole epistemológica, pues las palabras fallan en lo esencial y ni siquiera alcanzan, abusadas, a denunciar realidades. Agotado hasta la médula el lenguaje político de la época contemporánea, nadie que aspire a un mínimo rigor intelectual debe apearse del prejuicio de que «ya nada puede ser lo que parece». En esta actitud espiritual, dolorosamente escéptica por lo demás, descansa probablemente la más incomprendida de las mentalidades políticas, la del Reaccionario, que casi todo el mundo contrapone equívocamente al vicio del pensamiento político conocido como progresismo.
2. En las circunstancias actuales, configuradoras, como recordaba no hace mucho Dalmacio Negro, de una «época estúpida», lo último que se debe hacer, por tanto, es confiar en el sentido inmaculado de las palabras. Todas mienten, algunas incluso matan o, cuando menos, podrían inducir al suicidio colectivo, no ya de un partido o facción, sino de la «unidad política de un pueblo». Hay empero raras excepciones en la semántica política que curiosamente conducen al pensamiento hacia los dominios de la teología política (politische Theologie) cultivada por Carl Schmitt, Alvaro d'Ors y unos pocos más escritores europeos. Parece que en dicha instancia todavía conservan los conceptos su sentido. De la importancia radical de lo teológico político, reñida con la consideración que estos asuntos merecen de una opinión pública adocenada, pueden dar buena cuenta los esfuerzos del llamado republicanismo (Republicanism) para acabar con toda teología política, uno de cuyos postulados trascendentales es que todo poder humano es limitado, lo detente el Amigo del pueblo, el Moloch fiscal, la Administración social de la eurocracia de Bruselas o los guerreros filantrópicos neoyorquinos de la Organización de las Naciones Unidas. Este nuevo republicanismo, ideología cosmopolítica inspirada en el secularismo protestante adonde está llegando en arribada forzosa el socialismo académico, no tiene que ver únicamente con el problema de la forma de gobierno. Alrededor suyo, más bien, se ha urdido un complejo de insospechada potencia intelectual, un internacionalismo usufructuario de los viejos poderes indirectos, cuya fe se abarca con las reiterativas y, como recordaba Michel Villey, antijurídicas declaraciones universales y continentales de derechos humanos. Todo sea para arrumbar la teología política, reducto ultramínimo, junto al realismo y al liberalismo políticos tal vez, de la inteligencia política y la contención del poder. Ahora bien, este republicanismo cosmopolítico, que paradójicamente quiere moralizar una supuesta política desteologizada, no es otra cosa que una política teológica, íncubo famoso y despolitizador progeniado por Augusto Comte con más nobles intenciones.
3. A medida que el mito de la izquierda, el último de los grandes mitos de la vieja política, va desprendiéndose del oropel, los creyentes se ven en la tesitura de racionalizar míticamente el fracaso de su religión política secular. Una salida fácil, bendecida por casi todos, especialmente por los agraciados con alguna canonjía internacional, encuéntrase precisamente en el republicanismo mundial y pacifista, sombra ideológica de la globalización económica. Vergonzantes lectores del Librito Rojo y apóstatas venales de la acción directa predican ahora el amor fraternal en las altas esferas supraestatales y salvan de la opresión a los pueblos oprimidos, recordando a Occidente, una vez más, su obligación de «mourir pour Dantzig!». Estas actitudes pueden dar o acaso continuar el argumento de las vidas personales de los «intelectuales denunciantes», como llamaba Fernández-Carvajal a los «soixante huitards», mas resultan poca cosa para contribuir al sostenimiento de la paz y la armonía mundiales. Tal vez para equilibrar la balanza se ha postulado con grande alarde la «tercera vía», postrera enfermedad infantil del socialismo, como aconsejaría decir el cinismo de Lenin. Ahora bien, esta prestidigitante herejía política se había venido configurando a lo largo del siglo XX, aunque a saltos y como por aluvión. Pero no tiene porvenir esta huida del mito hacia el logos; otra cosa es que el intelectual, obligado por su magisterio, lo crea posible. Esta suerte de aventuras intelectuales termina habitualmente en la formación de ídolos.
Aunque de momento no lo parezca, a juzgar sobre todo por los artistas e intelectuales que marcan la pauta, la izquierda ha dejado ya de ser sujeto de la historia. ¿Cómo se explica, pues, su paradójica huida de los tópicos que constituyen su sustrato histórico? ¿A dónde emigra? ¿Alguien le ha encomendado a la izquierda por otro lado, la custodia de las fronteras de la tradición política europea? La respuesta conduce a la inteligencia de la autoelisión de la derecha.
Suena a paradoja, pero la huida mítico-política de la izquierda contemporánea parece tener como meta el realismo y el liberalismo políticos. Este proceso, iniciado hace casi treinta años con la aparición en Italia de los primeros schmittianos de izquierda, está llamado a marcar la política del primer tercio del siglo XXI. No cabe esperar que pueda ventilarse antes la cuestión de la herencia yacente de la política europea. Ahora bien, lo decisivo aquí, la variable independiente valdría decir, no es el derrotero que marque la izquierda, pues, arrastrada por la inercia, apenas tiene ya libertad de elección. Como en otras coyunturas históricas, heraldos de un tiempo nuevo, lo sustantivo o esencial tendrá que decidir sobre todo lo demás.
El horizonte de las empresas políticas del futuro se dibuja sobre las fronteras del Estado como forma política concreta de una época histórica. El «movimiento», la corrupción que tiraniza todos los asuntos humanos, liga a la «obra de arte» estatal con los avatares de las naciones, de las generaciones y, de manera especial, a los de la elite del poder. La virtud de sus miembros, la entereza de carácter, incluso el ojo clínico político determinan, como advirtió Pareto, el futuro de las instituciones políticas; a veces, como ha sucedido en España, también su pasado.
4. Precisamente, el cinismo sociológico paretiano -a una elite sucede otra elite, a un régimen otro régimen, etcétera- ayuda a comprender mejor la autoelisión de la derecha. La circulación de las elites coincide actualmente con el ocaso de la mentalidad político-ideológica, representada por el izquierdismo y el derechismo. En términos generales, la situación tiene algún parangón con la mutación de la mentalidad político-social, propia del siglo XIX. Entonces, las elites políticas e intelectuales, atenazadas por los remordimientos, evitaron, con muy pocas excepciones, tomar decisiones políticas. Llegó incluso a considerarse ofensivo el marbete «liberal», especialmente después de las miserables polémicas que entre 1870 y 1900 estigmatizaron el liberalismo económico. Son famosas las diatribas con que el socialista de cátedra Gustav Schmoller, factótum de la Universidad alemana, mortificó al pacífico profesor de economía vienés Karl Menger. Así pues, aunque los economistas se mantuvieron beligerantes -escuela de Bastiat y Molinari-, los hombres políticos del momento iniciaron transición al liberalismo social o socialliberalismo. La defección léxica estuvo acompañada de un gran vacío de poder, pues la elite europea había decidido no decidir; entre tanto, los aspirantes a la potestad, devenida res nullius. acostumbrados a desempeñar el papel de poder indirecto, que nada se juega y nada puede perder en el arbitrismo, creyeron que la política era sólo cuestión de buenas intenciones.
El mundo político adolece hoy de un vacío de poder semejante a aquel. La derecha, según es notorio, ha decidido suspender sine die toda decisión, mientras que la izquierda, jugando sus últimas bazas históricas, busca refugio en el plano de la «conciencia crítica de la sociedad». En cierto modo, Daniel Bell ya se ocupó de las consecuencias de este vacío de poder o «anarquía» en su famoso libro Sobre el agotamiento de las ideas políticas en los años cincuenta (1960). Al margen de su preocupación por la configuración de una «organización social que se corresponda con las nuevas formas de la tecnología», asunto entonces en boga, y, así mismo, con independencia de la reiterativa lectura de esta obra miscelánea en el sentido del anuncio del fin de las ideologías, Bell se aproximó a la realidad norteamericana de la izquierda para explicar su premonitorio fracaso. El movimiento socialista, del que dice que fue un sueño ilimitado, «no podía entrar en relación con los problemas específicos de la acción social en el mundo político del aquí y del ahora, del dar y tomar». La aparente ingenuidad de estas palabras condensa empero una verdad política: nada hay que sustituya al poder.
6. El florentinismo político de la izquierda, que en esto, como en otros asuntos, ha tenido grandes maestros, ha distinguido siempre, más o menos abiertamente, entre el poder de mando o poder político en sentido estricto, el poder de gestión o administrativo y el poder cultural, espiritual o indirecto. La derecha, en cambio, más preocupada por la cuestiones sustanciales y no de la mera administración táctica y estratégica de las bazas políticas, ha abordado el asunto del poder desde la óptica de la casuística jurídica política: legitimidad de origen y de ejercicio; reglas de derecho y reglas de aplicación del derecho; etcétera. La izquierda, además, ha sabido desarrollar una extraordinaria sensibilidad para detectar en cada momento la instancia decisiva y neutralizadora de las demás -pues el dominio sobre aquella siempre lleva implícito el usufructo indiscutido de la potestad-. De ahí que nunca haya perdido de vista desde los años 1950 lo que Julien Freund llamó «lo cultural».
En parte por azar, en parte por sentido de la política (ideológica), la izquierda europea más lúcida hace años que ha emprendido su peculiar reconversión a lo político, acaso para no quedarse fuera de la historia. Lo curioso es que este movimiento de la opinión se ha visto favorecido, cuando no alentado, por la «autoelisión de la derecha» o, dicho de otra manera, por la renuncia a lo político practicada sin motivo y contra natura por sus próceres.
La izquierda europea, depositaria del poder cultural y sabedora de la trascendencia del poder de mando, permítese abandonar o entregar magnánimamente a otros el poder de gestión o administrativo, si no hay más remedio y siempre pro tempore, naturalizando el espejismo de que ya no hay grandes decisiones políticas que adoptar. Resulta fascinante, por tanto, desde un punto de vista netamente político, el examen de lo que parece formalmente una repolitización de la izquierda, que en los próximos años, si bien a beneficio de inventario, podría culminar la apropiación intelectual del realismo y del liberalismo políticos, dejando al adversario -neoliberalismo, liberalismo económico, anarcocapitalismo- que se las vea en campo franco y a cuerpo descubierto con la «ciencia triste». Aflorarán entonces las consecuencias del abandono neoliberal de lo político.
Jerónimo Molina
00:10 Publié dans Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, théorie politique, sciences politiques, politologie, néolibéralisme, libéralisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 14 novembre 2010
Communal Freedom and Democracy

Adolf Gasser’s attempt of a conceptual clarification
by Dr phil René Roca, historian, Switzerland
Ex: http://www.currentconcerns.ch/
The historian Adolf Gasser (1903 – 1985) suggests that democracy is a historically evolved but rather fragile achievement. In his major work “Gemeindefreiheit als Rettung Europas” (Communal freedom as the salvation of Europe)1 and in many further contributions he reflects on a definition of the term “democracy” which should be as comprehensive as possible. For Gasser the term has a historical, an ethical and an educational dimension. The term “communal freedom” is at the center of his considerations. Starting point of his theoretical considerations is a historical paper on “sound and fragile democracies” in Europe after World War I.
In 1919 all European states up to the Russian border were characterized by democratic structures. But during the next two decades the democratic beginnings disappeared in favor of authoritarian or totalitarian systems of government in many states. This could particularly be observed in states, which had introduced a democracy for the first time after World War I. Gasser does not consider the principal reason for this “widespread dying of European democracies” a foreign problem, but a domestic one. Democracy particularly failed in those states, in which it did not succeed to combine freedom and order to an “organic compound”. Those states, which had a specifically shaped democratic tradition, resisted the totalitarian temptation despite the world economic crisis and World War II. Among them were, besides the Anglo-Saxon countries USA and Great Britain, the Scandinavian states, Holland and Switzerland. This, Gasser says, proves that there are two kinds of democracies, sound ones and fragile ones:
“Therefore we are to refrain from claiming that somehow democracy as such or an interlinked economic system has failed. We rather have to keep in mind that the uniform term ‘democracy’ is a quite unrealistic abstraction. In reality the term democracy, like all other social auxiliary terms, reveals a different trait from country to country. ‘Democracy’ and ‘democracy’ can be rather different things despite corresponding constitutional features; particularly, its nature is determined by the spiritual-political attitude of the individual people. In other words: After all, democracy is not a matter determined by the kind of state order, but a matter determined by the people’s convictions.”2
Thus Gasser describes a feature, which makes it possible to differentiate clearly between the sound and the fragile democracies at any time. The terms “spiritual-political attitude” and “people’s convictions” illuminate an ethical dimension of democracy. To Gasser, this dimension is not ideationally inflated or ideologically curtailed, but linked with a fundamental structural feature. The feature is the organization of the communal and regional autonomy. All sound democracies, as different as they may be, have a
“traditional and extremely lively self-governing system of their local and regional subsidiary associations. Widespread decentralization of the administration: that is the essential characteristic of these ‹old and free people’s states›.”3
Gasser considers the contrast between decentralized and centralistic administrative systems to be the key to the problem, which explains why some democracies were successful and sustainable and others were not.
For Gasser, the starting point for decentralized public administration is the “free”4 commune, which has cooperative roots. The cooperative as “a particularly finely-woven organizing element”5 defines itself by the three so-called “selves”: self-governing, self-determination and self-help. If free communes, organized in such a manner, come together to build a state, this state is federal, thus structured in a decentralized way. The human dimension in this structure must be based on certain ethical principles. The people, based on their specific cultural background, develop into these socio-economic structures; they shape and advance them. The ethical principles provide the stability, security and predictability:
“State formations, which grew from bottom to top and which represent the concept of self-governing, are usually communities of a very special kind; because they are primarily held together by spiritual and ethical forces while power-political braces are subordinate.”6
The ethical dimension of communal freedom
With the description of different principles Gasser tries to define the ethical dimension more clearly. In this context, he speaks of a kind of “synthesis of civic watchfulness on the one hand and civic self-discipline on the other”7. This mental-moral dimension cannot simply be introduced by a written constitution. It does also not follow automatically, if a commune is free. In order to make this dimension humane, moral values are required, which are to be taught in education and set as an example within the political level. The free commune, Gasser writes, educates the citizens not to a quantitative, but to a qualitative way of civic thinking. This important element shows the commune as “autonomous small-scale organization”, as “a school for citizenship”8 in an educational context, which is both founded on values and creates them.
In the following Gasser’s different ethical principles will be described in more detail.
The principle of co-ordination
Civic community life is only possible in the context of an organizing principle. The two possible organizing principles are the principle of subordination and that of co-ordination. In other words, the principle of administration by authoritarian dominance opposes that of co-operative self-governing.
“Either the stately order becomes secured by an authoritarian command and power apparatus, or it is based on the free social will of a people’s collectivity.”9
In the first case the structure of the state develops essentially from top to bottom, in the second case from ground to top. Either the people have to get used to being commanded or (most of them) to obeying, or they are guided by the will to co-operate freely. In this context, Gasser mentions that there are of course mixed forms; however, all the examples show a certain tendency towards one of the two organizing principles.
For Gasser, the contrast “rule vs. cooperative” is the most important contrast social history knows. It sheds light on the most elementary foundations of human community life and has mental and moral consequences.
The principle of voluntariness
Co-operatively organized communes require free, social co-operation. The working together represents a synthesis of freedom and order and is possible only if the will to free collective co-operation is inseparably combined with the will to free collective integration. The free acceptance of voluntary and adjunct work in addition to the regular duties results in a militia system, which is indispensable for the smoothest possible social procedures on all national levels.
“A sound development of democracy on a large scale will only be possible where it is practiced and realized on a small scale every day.”10
The principle of shared responsibility
 The voluntary cooperation, which is practiced within the manageable area of the commune, naturally leads to a further ethical principle, the principle of the shared responsibility. It develops, as Gasser expresses, an “internal bond to reality”,11 i.e. primarily to the commune, which shapes a “system of collective readiness to share responsibility and to political tolerance”.12 Freedom must combine itself with a feeling of duty for the public matters, because
The voluntary cooperation, which is practiced within the manageable area of the commune, naturally leads to a further ethical principle, the principle of the shared responsibility. It develops, as Gasser expresses, an “internal bond to reality”,11 i.e. primarily to the commune, which shapes a “system of collective readiness to share responsibility and to political tolerance”.12 Freedom must combine itself with a feeling of duty for the public matters, because
“[…] where there is a lack of genuine will for responsibility, for shared responsibility, there is an immediate threat that freedom will dege nerate into bare individualism and egoism.”13
However, the individual does not completely dissolve in the collective; it must not subordinate to the community:
“Starting point of the cooperative, decentralized states is not the individual freedom, but the communal freedom. But there is a seed of individual freedom to be found inevitably in the communal freedom […].”14
The principle of the collective respect for law
A collective conviction of what is right is central to the communal freedom. Those national state systems that were developed from bottom to top, that are based on communal freedom, show a completely different development of the law than centralistic authoritarian states. The “ancient right” (or also the “ancient freedom”) developed in co-operative and decentralized political systems has become a tradition throughout the centuries, and in conflict situations it represents an important point of reference in each case. The old civic and legal education – often verbally delivered and condensed in a kind of customary law – was of great importance, because it was backed by the collective. This backing of the existing order, often expressed in rituals and symbols, is only possible if the order is considered to be absolutely legal in its basic outlines. If this legal order is to be changed and adapted, it is usually developed, but not destroyed.
The principle of collective confidence
According to Gasser, the co-operative combination of freedom and right creates forces of “outrageous moral strength”15. For Gasser, this is above all general political and social confidence. The individual’s readiness for confidence is a prerequisite for a collective fundament of trust. Under these circumstances, no communal citizen must fear a political breach of law by fellow citizens. This “being free from fear” represents a substantial characteristic of all co-operative and decentralized communities for Gasser. Where the communal freedom exists, people steadfastly stick to the decentralized organizing, self-governing principle, and usually native confidants are entrusted with certain executive functions. So bi-partisan readiness for confidence can develop, which leads to the acceptance of the democratic majority principle:
“Only from deep-rooted confidence in communalism, i.e. to the free community will, one is able to generally take it as natural that a majority considers the free will of a minority if possible – and a minority is for its part morally obliged to submit by its own free will to the free will of a people’s and a parliament majority.”16
The principle of collective tolerance
In the free commune, Gasser says, everyone is forced to compromise with the political opponent. If the communal citizen gets accustomed to being responsibly moderate in this small, assessable area, then “from the beginning strong forces of reconciliation and mediation are involved.”17
The “communal freedom” is not able to manufacture heavenly conditions. Human passions and feeling of hate remain components of human nature. However, these often destructive forces repeatedly encounter “wholesome barriers” in the free commune, which “diminish their political explosive effects”, Gasser states.18 One of these “barriers” is the readiness to compromise:
“Striving for clear compromises backed by genuine consideration for the justified vital interests and attitudes of our fellow citizens, also of those organized in other parties, must become second nature somehow, if the liberal democracy were to become a firmly rooted way of life.”19
From this collective tolerance emerges a high readiness to accept good faith as a guiding value. Thus one cannot absolutely guarantee but effectively secure the inner and outer peace of a community nevertheless.
Conclusion: the principle of ethical collectivism
Gasser’s term “communal ethics” is determined by the described mental and moral principles, to which the individual must feel bound. For its existence and advancement, the free commune requires such a “collective will to bind oneself”20 or, expressed differently, an “ethical collectivism”21. Gasser thus sheds light on the “internal nature”22 of democracy and gives his definition a socio-psychological dimension by including ethical principles.
Gasser always refers to this dimension in his texts. He starts out from a positive concept of man: Man is good by nature.23 As a person, each human being has certain rights and duties and can establish his necessary social relations at best in the surroundings of a free commune. Thus people develop their skills and forces and are able to solve the problems together with others. Thus, the autonomous small areas form the basis, and take influence on greater stately regions, regardless of their structure.
“Moral bonds” secure the peace of a society against inside threats as well as threats from outside. All communal and federal democracies, built from bottom to the top, have a basically pacifist tendency, Gasser claims. With its synthesis of freedom and order, the decentralized structure including free communes reaches a degree of social justice, which curbs militarist and expansive forces. The individual is more content, feels safe and cannot easily be seduced to foreign policy war adventures.
Educational dimension of communal freedom
Finally the “educational dimension” of communal freedom is to be presented briefly, as Gasser repeatedly mentions it. For him, the commune is a “humanitarian school for citizenship”24 and in a lively democracy it serves an educational purpose which should not be underestimated:
“Only in an assessable, natural community the normal citizen is able to acquire what we use to call political sense of proportion, a feeling for the human proportions. It is the only place where he can learn to understand and consider the justified requests of his neighbors and their different ideas and interests in the daily discussion; it is the only place where the necessary minimum of communal structure develops on the ground of freedom, which is able to effectively impede the tendency to authoritarianism as well as to anarchy. In this sense autonomous small areas remain irreplaceable schools for citizenship, without which the free democratic state would wither from the roots.”25
A lively democracy does not only require educated humans, who master cultural techniques and who acquire certain abilities and skills and develop them. A democracy also requires as it were the people’s “emotional intelligence”.26 This intelligence must develop in the family first, as well as in the assessable, natural community first; later on it can also be effective beyond that sphere. As far as educational issues are concerned, Gasser always refers to the work of Heinrich Pestalozzi (1746 – 1827). In digesting and summarizing the different historical aspects and the ideas of progressive thinkers, Gasser can be called the actual discoverer of the “small region” and “assessability” as the basic conditions of a working democracy. Therefore it is certainly worthwhile to apply his ideas, modified by new research, to the question how direct democracy was historically developed in Switzerland.•
Translation Current Concerns
1 Adolf Gasser, Gemeindefreiheit als Rettung Europas. Grundlinien einer ethischen Geschichtsauffassung, Second, grossly extended edition, Basel 1947, p. 7–12.
2 Gasser, Gemeindefreiheit, p. 10.
3 Gasser, Gemeindefreiheit, p. 10f.
4 Gasser uses the term “free” or “freedom” in the context of a national political category of the “commune” quite comprehensively. He does not limit it to the political rights of co-determination. Those were limited in Switzerland in the “ancient régime” to the citizens of a single commune, i.e. they were exclusive. Only in times of the Helvetica and then again during Regeneration the rights of co-determination were extended on a cantonal level. Women were excluded longest.
5 Gasser, Gemeindefreiheit, p. 15.
6 Gasser, Gemeindefreiheit, p. 17.
7 Adolf Gasser, Bürgermitverantwortung als Grundlage echter Demokratie, in: Gasser,A., Staatlicher Grossraum und autonome Kleinräume, Basel 1976, p. 43
8 Adolf Gasser, Staatlicher Grossraum und autonome Kleinräume, Basel 1976, p. 147
9 Gasser, Gemeindefreiheit, p. 12
10 Gasser, Gemeindefreiheit, p. 11
11 Gasser, Gemeindefreiheit, p. 19
12 Adolf Gasser, Der europäische Mensch in der Gemeinschaft, in: Gasser, A., Staatlicher Grossraum und autonome Kleinräume, Basel 1976, p. 4
13 Gasser, Bürgermitverantwortung, p. 33
14 Gasser, Gemeindefreiheit, p. 27
15 Gasser, Gemeindefreiheit, p. 20
16 Gasser, Gemeindefreiheit, p. 97
17 Gasser, Gemeindefreiheit, p. 24
18 Gasser, Gemeindefreiheit, p. 24
19 Gasser, Gemeindefreiheit, p. 24
20 Gasser, Gemeindefreiheit, p. 16
21 Gasser, Der europäische Mensch …, p. 4
22 Gasser, Gemeindefreiheit, p. 10
23 Gasser, Gemeindefreiheit, p. 255
24 cf. Adolf Gasser, Die Schweizer Gemeinde als Bürgerschule (1959), in: Gasser, A., Staatlicher Grossraum und autonome Kleinräume, Basel 1976, p. 85–91
25 Adolf Gasser, Zum Problem der autonomen Kleinräume. Zweierlei Staatsstrukturen in der freien Welt, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, Attachment to the weekly magazine Das Parlament, vol. 31/77, p. 4
26 cf. Daniel Goleman, Emotional Intelligence, New York, 1996
Adolf Gasser
The Swiss historian Adolf Gasser (1903–1985) completed his studies in Heidelberg and Zurich with doctorates in history and classical philology. From 1928 to 1969 he taught as a grammar school teacher in Basel. In the course of his lectureships he became private lecturer in 1936 and an adjunct professor in 1942; from 1950 to 1985 he taught as an extraordinary professor for constitutional history at the University of Basel. After World War II he started an active lecturing activity in the Federal Republic of Germany. Gasser was joint founder of the Council of European Municipalities and Regions, from 1953 to 1968 he was a Liberal member of the Grand Council of Basel, and he was a president of the FDP of the canton Basel.
His works include (published in German language, all titles are translated here for better understanding):
– The territorial development of Switzerland. Confederation 1291–1797, 1932
– History of the People’s Freedom and Democracy, 1939
– Communal freedom as salvation of Europe, 1943
– On the foundations of the state, 1950
00:10 Publié dans Affaires européennes, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, liberté communale, démocratie, suisse, europe, affaires européennes, théorie politique, sciences politiques, politologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
El organicismo de Maetzu
El organicismo de Maeztu
Pedro Carlos Gonzàlez Cuevas
Ex: http://www.galeon.com/razonespanola/
1. EL CORPORATIVISMO INGLES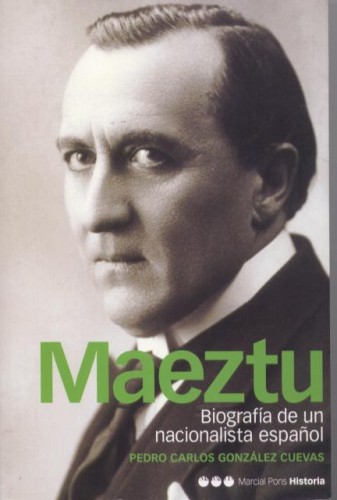 En 1912, Maeztu había empezado a interesarse por las ideas sindicalistas y corporativistas que comenzaban a dominar en algunos círculos intelectuales europeos. No encontró, desde luego, el sindicalismo revolucionario de raíz soreliana un simpatizante en Maeztu, quien rechazó de plano sus actitudes violentas y, sobre todo, un irracionalismo tomado de Bergson; era «antiintelectual y antiinteligente», heredero de la «sofistería moderna»1. Se equivocaban, además, Sorel y sus acólitos en la percepción de la realidad social, al sostener, como el marxismo, la visión dicotómica de las clases sociales; lo que suponía, tanto a nivel teórico como práctico, una enorme simplificación, que prescindía de sectores tan decisivos como el campesinado y toda la clase media -comerciantes, industriales, pequeños rentistas, intelectuales, etc.-. El fundamento real del sindicalismo, por el contrario, era la pluralidad de las clases sociales, que, a través de sus organizaciones sindicales, se disponían a defender sus intereses. «Se funda en que las clases sociales son muchas. Y en esta multiplicidad de intereses de clase es necesario precisar y concretar los de la clase obrera, si ha de evitarse que los trabajadores tomen por propios los intereses de otras clases sociales2.
En 1912, Maeztu había empezado a interesarse por las ideas sindicalistas y corporativistas que comenzaban a dominar en algunos círculos intelectuales europeos. No encontró, desde luego, el sindicalismo revolucionario de raíz soreliana un simpatizante en Maeztu, quien rechazó de plano sus actitudes violentas y, sobre todo, un irracionalismo tomado de Bergson; era «antiintelectual y antiinteligente», heredero de la «sofistería moderna»1. Se equivocaban, además, Sorel y sus acólitos en la percepción de la realidad social, al sostener, como el marxismo, la visión dicotómica de las clases sociales; lo que suponía, tanto a nivel teórico como práctico, una enorme simplificación, que prescindía de sectores tan decisivos como el campesinado y toda la clase media -comerciantes, industriales, pequeños rentistas, intelectuales, etc.-. El fundamento real del sindicalismo, por el contrario, era la pluralidad de las clases sociales, que, a través de sus organizaciones sindicales, se disponían a defender sus intereses. «Se funda en que las clases sociales son muchas. Y en esta multiplicidad de intereses de clase es necesario precisar y concretar los de la clase obrera, si ha de evitarse que los trabajadores tomen por propios los intereses de otras clases sociales2.
Al lado del sindicalismo revolucionario existía otro, de carácter conservador, defendido en Gran Bretaña por Hilaire Belloc y los hermanos Chesterton; en Francia por León Duguit. Maeztu consideraba a esta tendencia mucho más seria que la anterior. No obstante, rechazaba, por entonces, los planteamientos de Duguit, cuyo «solidarismo» tanto influiría en la gestación de La crisis del humanismo. El corporativismo de Duguit significaba, para el Maeztu todavía liberal, un intento de retorno a la Edad Media, ya que pretendía reducir al individuo a una mera dimensión profesional, aboliendo la individual y política, es decir, la subjetividad, producto de la emancipación lograda desde el Renacimiento3. Chesterton y Belloc eran comparables a Charles Maurras y León Daudet4.
Con todo, tanto los sindicalistas revolucionarios como los conservadores incidían en aspectos reales de la vida social; en particular su insistencia en el carácter objetivo de las clases sociales como portadoras de intereses materiales específicos, que los parlamentos de las sociedades liberales, anclados todavía en una filosofía social profundamente individualista, se obstinaban en ignorar, incluso en marginar: «La idea política se trueca en retórica que cubre un interés; el interés rapaz se cubre con piel de cordero. Todo por no reconocer al hombre su doble carácter de profesional y de hombre, de miembro de una clase y de miembro de la comunidad»5.
Como ya habían propugnado los krausistas, el corporativismo podía servir de correctivo al individualismo liberal; y, por otra parte, a la racionalización del pluralismo social. En ese sentido, Maeztu abogaba por un sistema de tipo bicameral, que diera asiento diferenciado a la representación corporativa. Una de las cámaras se organizaría mediante el sufragio universal; mientras que la otra se basaría en la representación por clases, profesiones y grupos de interés, «hacendados, industriales, comerciantes, labradores, obreros, abogados, médicos, personal pedagógico, etc»6.
A este tipo de corporativismo tampoco era ajeno su contacto con los intelectuales reunidos en torno a la revista «The New Age», que dirigía el antiguo fabiano Alfred Richard Orage; quien, con la ayuda económica del dramaturgo Bernard Shaw, había logrado sacarla a la luz en 19077. «The New Age» se convirtió en el órgano doctrinal del socialismo guildista, iniciado bajo la inspiración de William Morris y John Ruskin; y cuyo origen más próximo se encontraba en los escritos del arquitecto Arthur Joseph Penty, sobre todo en The Restoration of the guild system, en donde abogaba por el retorno del artesanado, y la producción simple bajo la inspiración reguladora de los «gremios». Dos miembros de «The New Age» Samuel George Hobson y Alfred Richard Orage -su director- aprovecharon las ideas de Penty, que también colaboraba en la revista, convirtiéndolas en algo diferente. Ninguno de ellos compartía el medievalismo de Penty; y eran partidarios de las nuevas formas de producción y concebían los gremios como grandes agencias democráticamente controladas para encargarse de la industria8.
El «guildismo» se oponía tanto al marxismo como al socialismo de raíz fabiana, cuyo estatismo rechazaba. Sobre la base de empresas organizadas en cooperativas de producción elevaba un sistema social que confiaba al Estado un papel subsidiario, es decir, el cuidado de las funciones de interés general, dejando la solución de los otros problemas a las comunidades inferiores. Así, las funciones que abandonaba el Estado eran ocupadas por la guilda, que era, en la concepción de Hobson, una asociación de todos los trabajadores, de todas las categorías de la administración, de la dirección y de la producción en la industria. Dentro de la revista existían, sin embargo, diferentes orientaciones y tendencias. Mientras Hobson y Orage defendían una estructura gremial que controlase y organizase la producción bajo la inspección del Estado; otros, como Cole, se mostraban contrarios a la idea de Estado soberano y proponían la doctrina del «pluralismo», basada en el principio de «función»9.
Esta teoría, sobre la que Maeztu edificaría su doctrina de la sociedad defendida en La crisis del humanismo, suponía indudablemente un desafío a las ideas dominantes sobre el sistema demoliberal y el gobierno representativo y, según reconocería el propio Cole, podía armonizarse perfectamente tanto con el liberalismo como con un ideario de carácter antiliberal10.
Para Maeztu, el guildismo era, y así lo expresó en una carta a su amigo Ortega, un auténtico reto intelectual, dado que aún no estaba suficientemente teorizado, tarea que él se proponía abordar: «El socialismo gremial tiene una ventaja y una desventaja. No está aún pensado. Hay que inventarlo»11.
«The New Age» se convirtió en un importante centro de discusión sobre temas económicos, sociales y filosóficos, donde acudían y colaboraban intelectuales de distinta militancia política e ideológica. Allí conoció al poeta Ezra Pound12, a los hermanos Chesterton, Percy Widham Lewis, Hilaire Belloc, Orage, Penty, etc. Maeztu simpatizó con Orage, a quien consideraba un pensador carente de originalidad, pero de gran capacidad de divulgación, que «pulió, fijó y dio esplendor a cuantas percibió y le parecían interesantes por ser nuevas»13. La influencia de Penty fue mucho mayor en Maeztu, sobre todo, por sus críticas a la civilización industrial. Penty le enseñó «la necesidad de restaurar la supremacía del espíritu sobre el culto supersticioso de las máquinas a que fian los modernos sus esperanzas de un mundo mejor»14.
De la misma forma, el «distributismo» de Belloc, que insistía como Penty, en la restauración de la pequeña propiedad, del artesanado y de los gremios, mediante la creación de juntas de oficios y profesiones, tuvo influencia en la ulterior trayectoria política e intelectual de Maeztu. Se trataba del «mayor enemigo que ha encontrado en Inglaterra la propaganda socialista y el defensor más brillante de la única alternativa democrática al colectivismo, a saber: el Estado distributivo, es decir, un Estado en que la riqueza se halle distribuida entre la inmensa mayoria de los ciudadanos»15.
Mención aparte merece, por su impronta en Maeztu, la figura de otro de los colaboradores de «The New Age», el escritor y filósofo Thomas Ernst Hulme. Miembro de una comoda familia, Hulme había nacido en Endon, en 1883; y se educó en prestigiosos colegios de Cambridge, de donde fue expulsado por su carácter pendenciero y bohemio. Luego, residió en Canadá y Bruselas. Amigo de Henri Bergson, gracias a su ayuda logró la readmisión en Cambridge16. Hulme era conocido entonces como traductor de las obras de su amigo Bergson y de las Reflexiones sobre la violencia de George Sorel. Amigo de Ezra Pound y colaborador de «The New Age», su perspectiva ideológica era deudora del intuionismo de Bergson, de las ideas estéticas de Charles Maurras y Pierre Lasserre, y de las críticas de Sorel al hedonismo y relativismo característicos de la sociedad finisecular. Hulme sostenía que la cultura moderna, cuyos orígenes se encontraban en el Renacimiento, llevaba a la Humanidad hacia un callejón sin salida. El humanismo renacentista supuso la eliminación radical del distanciamiento medieval del hombre con la civitas terrena y del mundo natural con respecto al sobrenatural. Y, en consecuencia, su principal error consistió en destruir la objetividad de los valores, interpretándolos «en términos de categorías de vida»; lo que conducía a un peligroso relativismo ético17. Por contra, el pensamiento medieval, a diferencia del humanismo, tenía por base la objetividad de los valores y la imperfección radical del hombre; y ello en virtud de los principios religiosos que le servían de fundamento. A la luz de los principios religiosos, el hombre aparecía, no como la medida de todas las cosas, sino como un ser radicalmente imperfecto, lastrado por el pecado original, al que solo mediante la disciplina y la religión podía conseguirse algo de valor. Ello tenía su manifestación en el arte, en las diferencias entre la vitalidad del arte renacentista y la tendencia a la abstracción del medieval. El resurgir de la abstracción, con su simbolismo geométrico y desantropomorfizado, presagiaba el ocaso del humanismo y la vuelta a los principios tradicionales de servidumbre a supuestos suprahumanos.
Tanto el humanismo como la ética medieval habían sufrido, a lo largo del XVIII y XIX, una renovación, que llevaba a una contínua confrontación entre el romanticismo, como concreción estética y política del sinuoso proceso de desarrollo de la subjetividad que arranca del Renacimiento, y el clasicismo, con su perspectiva pesimista, que llevaba a supuestos políticos de carácter conservador, como habían propugnado Charles Maurras y Pierre Lasserre. En ese sentido, Hulme estaba convencido de que se iba gestando en el interior de la cultura contemporánea un profundo cambio ideológico que llevaba a un renacimiento del espíritu clásico frente a los supuestos relativistas del proyecto de la modernidad; y ello era visible en los escritos de George Sorel: «Hay muchos -señalaba- que empiezan a estar desilusionados de la democracia liberal y pacifista, aunque huyan de la ideología opuesta a causa de sus asociaciones reaccionarias. Para estas gentes, Sorel, revolucionario en economía, pero clásico en ética, puede resultar un liberador»18.
Fiel a sus ideas, Hulme murió luchando en Francia durante la Gran Guerra, cerca de Newport el 28 de septiembre de 1917. Comentando la huella que Hulme dejó en su pensamiento, Maeztu afirmó que su influencia no se redujo al ámbito doctrinal y filosófico; fue importante también su ejemplo de heroismo y valor cívico «sobreponiéndose a las flaquezas de la carne»19.
La huella de Hulme fue perceptible igualmente en figuras cimeras de la intelectualidad inglesa: T.S. Eliot, Ezra Pound, David H. Lawrence, etc20.
2. «LA CRISIS DEL HUMANISMO», O EL APOCALIPSIS DE LA MODERNIDAD
Así, el estallido de la Gran Guerra sorprendió a Maeztu en plena evolución ideológica. Su opción, sin embargo, no fue dudosa, y a pesar de su admiración intelectual por Alemania, estuvo en todo momento a favor de Inglaterra. El vasco nunca dudó de la victoria final de Gran Bretaña y sus aliados: «Inglaterra -dirá a Ortega en una carta- ha estado dormida en estos años, pero empieza a despertar. Y, no lo dude usted, acabará por ganar la guerra»21. No obstante, celebraba que España permaneciese neutral en el conflicto; hecho que atribuyó a la presión de los intelectuales y de las clases populares frente «a la germanofilia de las clases conservadoras22»
Su progresivo cambio de perspectiva ideológica tuvo su concreción en la fundamentación religiosa-católica de su militancia aliadófila. Alemania era la representante de la «herejía germánica», consecuencia directa de la Reforma protestante y su doctrina de la justificación por la fe, frente a la doctrina católica del pecado original y la justificación por las obras. El luteranismo había afirmado la dominación del sujeto en lo relativo a la capacidad de atenerse a sus propias intelecciones; y en consecuencia, dejó al hombre libre de ataduras de orden ético y moral. La consecuencia lógica de aquel proceso fue la independencia del Estado en relación a la autoridad ética de la Iglesia, debido a los principios subjetivistas que le servían de base. Libre de cualquier poder ajeno a sí mismo, se convirtió con Hegel en un valor completamente autónomo; lo cual explicaba la crueldad de los alemanes a lo largo del conflicto23.
Pero la guerra no era sólo producto de esa mentalidad religiosa; y mucho menos de las disputas entre imperios rivales. Ni Francia, ni Gran Bretaña, ni Rusia habían amenazado el poder de Alemania. El estallido de la guerra había sido, muy al contrario, producto de la voluntad de la nobleza, el Ejército y el Kaiser para conservar su hegemonía en el interior de Alemania frente al empuje de la burguesía, los intelectuales y la clase obrera24.
Enviado como corresponsal al frente, Maeztu se mostró, en algunas de sus crónicas, entusiasmado por el espectáculo de la guerra. Y es que pensaba que las consecuencias sociales del conflicto podían ser, a la larga, positivas, porque la convivencia en las trincheras contribuiría poderosamente al establecimiento de vínculos permanentes entre las distintas clases sociales. Además, la guerra enseñaría a «trabajar mejor y más deprisa, y con mejor organización, disciplina y solidaridad25. El propio Ejército se había convertido en el modelo de sociedad jerárquica, estable y disciplinada: «No es lo justo que los hombres desiguales sean tratados como iguales. Lo justo es que se dé lo suyo a cada uno y el respeto a todos. Aquí, en el Ejército, el soldado es soldado y el general es general». Al mismo tiempo, volvía a aparecer en sus escritos el elemento nietzscheano de su juventud. La guerra era incluso un factor de regeneración moral, tanto a nivel individual como colectivo, porque suscitaba el impulso heroico: «El cañoneo entiende la sangre. Se vive como un redoble permanente. Se recupera el sentido de la aventura. Las historias dejan de ser historias. Se es uno mismo historia. Y aunque no se vea nada desde nuestro agujero, se siente uno mismo centro de la Historia»26.
Bajo la impresión del desarrollo del conflicto, Maeztu redactó en 1916, a partir de una serie de escritos publicados en «The New Age» y otros diarios y revistas, Autority, liberty and function in the light of the war, traducido posteriormente, en 1919, al español con el título de La crisis del humanismo. Los principios de autoridad, libertad y función a la luz de la guerra27.
El punto de partida de la obra era la dramática situación en la que se debatían las sociedades europeas, cuya raíz se encontraba en el subjetivismo y relativismo característicos de la modernidad. En el Renacimiento se había generado un sentimiento fuertemente mundano del hombre, que comenzaba a hallarse confinado en la esfera y dimensión de lo puramente corporal, en los acontecimientos vitales; y, en consecuencia, tuvo lugar la aparición de un nuevo tipo de hombre, seguro de su individualidad, que lo define todo, y, por lo tanto, cada vez más alejado de la transcendencia. La individualidad se encontró libre de frenos, y la ética se antropoformizó, relativizándose. El hombre se convirtió, pues, en «un esclavo de sus propias pasiones». Y en este relativismo ético se encuentra la génesis de los dos errores característicos de la modernidad, dominante en las sociedades contemporáneas: el liberalismo y el socialismo. El liberalismo tenía como sustrato el individualismo atomista que no contemplaba otra fuente de certeza y de moralidad que el individuo aislado; sobre la cual era imposible fundamentar una sociedad bien organizada. De la misma forma, el socialismo, a pesar de sus diferencias ideológicas con el liberalismo, tenía su raíz última en el relativismo subjetivista, sustituyendo la arbitrariedad individual por la del Estado, error en el que igualmente habían caído Hegel y la mayoría de la intelligentsia alemana. El proyecto socialista convertía en el único propietario de los medios de producción al Estado, que, de esta forma asumía en relación a la sociedad civil las funciones de juez y parte, encarnados en una burocracia despótica, cuya situación era, en el fondo, análoga, incluso más tiránica, a la de la vieja oligarquía del dinero.
Frente a todo ello, Maeztu propugnaba la superación del relativismo inherente al proyecto de la modernidad, mediante el retorno al principio de la «objetividad de las cosas». Continuando su evolución ideológica iniciada en su interpretación de la filosofía kantiana, en la que, como sabemos, encontró los supuestos absolutos que transcienden a la relatividad asociada al mundo empírico, Maeztu se decide por el intento de renovación de la vieja pretensión ontológica de entender el mundo bajo el signo de un idealismo objetivo y de volver a ensamblar metafísicamente los momentos de la razón disociados en la evolución cultural del mundo moderno, como medio para poner coto a la desintegración de la jerarquía de los valores comúnmente aceptados. Como ya hizo Hulme. Maeztu toma, para ello, de George E. Moore la noción de «bien objetivo», de valor intrínseco de la objetividad de los principios morales. La objetividad de las cosas abre a los hombres el acceso al mundo suprahistórico. Cuando Maeztu hace referencia a la «primacía de las cosas» se refiere a los valores eternos, que se encuentran por encima de la subjetividad y del mundo material, tales como la Verdad, la Justicia, el Amor y el Poder, cuya unidad se encarna en Dios. Desde esta perspectiva, se llega a la conclusión de que el hombre no se encuentra en el mundo para seguir su personal arbitrio, sino como servidor de esos valores objetivos. Tal es el supuesto en el que descansa el «clasicismo cristiano», debelador del romanticismo y del humanismo, de su ilusoria creencia, sobre todo, en la bondad natural del hombre. El catolicismo era consciente de que el optimismo antropológico conducía a la disolución social; y sólo mediante la autoridad que domeñara su naturaleza corrupta, consecuencia del pecado original, podía conseguirse la armonía y la estabilidad.
Sobre la base de esté moral objetiva, era posible edificar una teoría objetiva de la sociedad. Maeztu se sirve para ello, de las aportaciones de León Duguit, en cuanto éste negaba la noción de derecho subjetivo individual y admite los derechos objetivos, nacidos de la función de cada uno en el conjunto social. La organización de la sociedad en torno al principio de «función» puesta al servicio de los valores objetivos conduce a una estructura gremialista. El conflicto entre autoridad y libertad, individuo y sociedad es superado mediante la restauración de los gremios, que servirían de corrección tanto al individualismo anárquico de los liberales como a la burocracia despótica de los socialistas y estatistas.
Maeztu entiende por «gremio» una asociación autónoma e independiente del Estado, en la que se encuentran organizadas todas las clases sociales y grupos de interés. La razón de ser del gremialismo es la pluralidad de clases sociales y sus respectivos intereses. El principio «funcional» comprende todas las actividades del hombre y sanciona cada una de ellas con los derechos correspondientes a la «función». En el reparto de funciones y competencias se encuentra la garantía de las libertades reales. Maeztu se inclina por las tesis propias del «pluralismo» británico frente al concepto de soberanía estatal. No había razón alguna para dar por buena la tesis del poder soberano del Estado, ni nadie que mirara con los ojos la realidad social podía admitir la existencia de la voluntad general de Rousseau o la estatolatría de Hegel. Antes al contrario, la sociedad ofrecía el espectáculo de una multitud de grupos y corporaciones, dueños cada uno de su propia esfera y servidores de sus diversos fines y funciones. De esta forma, Maeztu se muestra partidario de una cierta forma de anarquismo legal, es decir, de la relativa disolución de los poderes del Estado, donde pueden ser ejercidos directamente por los ciudadanos y las instituciones gremiales.
El contenido de La crisis del humanismo en modo alguno pasó inadvertido para sus contemporáneos. Quizá fue Salvador de Madariaga, amigo de Maeztu por aquel entonces e igualmente relacionado con los escritores de «The New Age»28, el primer comentarista de la obra, que no dudó en calificar de «excelente»29. En un sentido igualmente elogioso, se manifestó el escritor catalán Eugenio d'Ors, que vio en La crisis una «excelente y nueva teorización del gremialismo»30. Años después, Antonio Sardinha, líder intelectual del Integralismo Lusitano, la consideró breviario de pensamiento tradicionalista, por su insistencia en el principio del pecado original y en la instauración de un sistema gremial31.
La crisis del humanismo despertó igualmente el interés de los católicos. No era para menos; dado que hasta entonces Maeztu había sido uno de los representantes del liberalismo intelectual en España. Pero la valoración de sus contenidos fue, en gran medida, ambivalente. Así, Rafael García y García de Castro -futuro obispo de Granada- vio en ella el afortunado abandono por parte de Maeztu de los principios liberales; pero también le reprochó una insuficiente asimilación de la dogmática católica. Maeztu valoraba en mayor medida los factores menos transcendentes del catolicismo, es decir, la jerarquía, el culto y la propagación de los sentimientos de identidad y de comunidad. En el fondo, parecía que para Maeztu la religión brotaba más de una «necesidad de coherencia social» que de «las relaciones del hombre con Dios»32.
La crítica de las izquierdas fue más dura. Luis Araquistain le reprochó sus objeciones al socialismo. Lejos de configurar un absolutismo de Estado, era un absolutismo de la sociedad. No obstante, la idea más combatida por Araquistain fue la de objetividad de las cosas y su primacía, cuya consecuencia podía ser, a su juicio, una regresión hacia un sistema de carácter teocrático, «a una civilización como la china, o a una sociedad tan estéril y terrible como algunas congregaciones religiosas»33. Otro socialista, Fernando de los Ríos, se apresuró a dejar bien claro que su interpretación del Renacimiento -sustentada en su obra El sentido humanista del socialismo- era por entero diferente a la de Maeztu. Por otra parte denunciaba el principio de «función» como puramente «formalista», sin contenido real, pues resultaba incompatible tanto con el sistema capitalista como con el socialista34.
Con mayor acritud se expresó el discípulo de Giner de los Ríos e institucionista de pro, Francisco Rivera Pastor, quien, recordando la anterior compenetración de Maeztu con el pensamiento moderno, consideró La crisis como una regresión intelectual. Ahora, Maeztu aparecía como un auténtico tradicionalismta negador del progreso y defensor del pecado original; todo lo cual equivalía políticamente al «ruralismo, a los arcaicos latifundios patriarcalistas, a la concepción pseudoaristocrática de una decadente república platónica…»35.
Más recientemente, La crisis del humanismo ha sido vista, al menos por algunos historiadores del pensamiento español contemporáneo, como precedente ideológico del fascismo e incluso del régimen del general Franco. Así, José María de Areilza calificó la obra como «lejana predicción de los fascismos europeos»36. Posterioremente, Salvador de Madariaga -cuyas alabanzas a La crisis del humanismo ya conocemos- sostendrá una tesis semejante en su discutible ensayo España. La obra de Maeztu era «una de las primeras y mejores definiciones del Estado autoritario funcional que se ha escrito en Europa»; y llama al escritor vasco «precursor del falangismo y aún quizás del fascismo»37. En la misma línea, el historiador marxista Manuel Tuñón de Lara afirma que Maeztu, se adelanta a Mussolini en la concepción de una «sociedad sindicalista»38.
¿Qué decir de tales aseveraciones? Ante todo, destacar su superficialidad. En el caso de Areilza, su opinión era comprensible en un momento, como 1941, de exaltación totalitaria, tras el final de la guerra civil. Madariaga, por su parte, fue siempre un historiador sumamente superficial, que, salvo en su célebre biografía de Bolívar, no pasó del afán divulgativo39. La opinión de Tuñón de Lara, como de costumbre en la obra de este autor, era más política que propiamente historiográfica. Se trataba, en el fondo, de interpretar a Maeztu como fascista; y con él al sistema político nacido de la guerra civil.
En ninguno de los casos, hubo un análisis mínimamente serio de la obra. Y es que, a diferencia de lo sustentado por estos autores, la concepción corporativista de Maeztu dista mucho de ser favorable a cualquier forma de totalitarismo, pues uno de sus aspectos centrales consiste en la limitación del poder estatal, que se reduce, en la práctica, a la función de armonizar la vida social. De hecho, uno de los grandes teóricos del totalitarismo, Carl Schmitt, vio en el guildismo y en el pluralismo británicos, base de la concepción social de Maeztu, una teoría que encubría el dominio político de los «poderes indirectos» frente a la soberanía estatal40.
Por otra parte, las reflexiones de Maeztu se inscribían claramente en la crisis del Estado liberal de Derecho característica del período posterior a la Gran Guerra, que implicó la creación de nuevos marcos institucionales de distribución de poder que llevaban a un desplazamiento en favor de las fuerzas sociales organizadas de la economía y la sociedad en detrimento de un parlamentarismo debilitado41. Como en el resto de Europa, la sociedad española -si bien con cierto retraso, dado su menor desarrollo económico- comenzó a articularse en organizaciones que representaban, desde distintos prismas ideológicos, los diversos grupos e intereses sociales. Este proceso de «corporativización» fue clave tanto por el desarrollo que experimentaron como por el protagonismo que lograron las distintas asociaciones42.
Pedro Carlos González Cuevas
00:10 Publié dans Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : espagne, théorie politique, philosophie, sciences politiques, politologie, conservatisme, droite, droite espagnole |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 11 novembre 2010
Réflexions archéofuturistes inspirées par la pensée de Giorgio Locchi
Réflexions archéofuturistes inspirées par la pensée de Giorgio Locchi
par Guillaume FAYE
Ex: http://guillaumefayearchive.wordpress.com/
« Ils reviendront ces dieux que tu pleures toujours,
Le temps va ramener l’ordre des anciens jours. »
Gérard de Nerval
J’ai eu deux inspirateurs principaux : Nietzsche et Giorgio Locchi. Le premier, je ne l’ai jamais rencontré, le second, si.
Il est certain que je n’aurais pas pu, dans mes divers ouvrages, de 1980 à 1986, puis surtout depuis 1998, développer certaines vues et expliciter une certaine conception du monde, sans l’étincelle que m’a communiquée Giorgio Locchi, à travers nos très nombreuses conversations et la lecture de ses textes concis et explosifs, dans lesquels, comme chez tout grand maître, chaque mot pèse lourd et demande un temps d’arrêt.
La plupart des intellectuels (à l’apogée de la “nouvelle droite” franco-italienne aujourd’hui pratiquement disparue) qui fréquentaient Giorgio n’ont pas vraiment compris son discours. Ou plutôt, je pense qu’ils ne voulaient pas le comprendre. Ils ne voulaient pas franchir le Rubicon, pénétrer dans ce dangereux territoire de la dissidence absolue. Il n’y a pas que la légendaire paresse intellectuelle parisienne ou les subtils stratagèmes de l‘intelligentsia italienne qui expliquent ce fait, mais une véritable peur d’apparaître comme un délinquant intellectuel.
Car la position posthume de Locchi est étrange. J’ai entendu nombre de ses “disciples” lui décerner de prestigieux lauriers, mais se dérobant toujours quand il s’agissait d’aborder le fond de sa pensée, trop brûlante sans doute. Un philosophe ? Un journaliste ? Un publiciste ? Un penseur ? Pas assez de tout cela. Giorgio Locchi est un éveilleur et un dynamiteur.
***********
Je pèse mes mots : sans Giorgio Locchi et son oeuvre, qui se mesure à son intensité et non point à sa quantité, et qui reposa aussi sur un patient travail de formation orale, la véritable chaîne de défense de l’identité européenne serait probablement rompue.
Ce bref texte de Giorgio Locchi, d’une exceptionnelle densité conceptuelle, d’une richesse philosophique que peuvent lui envier bien des candidats au statut de “penseur”, présente l’avantage de dévoiler un des centres nerveux de ses analyses. Il parle du “fascisme” non pas comme d’une simple nébuleuse politique, mais comme d’une conception-du-monde totalisante ; non pas comme d’un phénomène circonscrit dans le passé, mais comme d’une sorte de feu allumé dans l’histoire européenne et certainement pas près de s’éteindre. Pour lui, l’essence du fascisme, son moteur intérieur, c’est le renversement historique de l’Égalitarisme au profit de ce qu’il nomme le Surhumanisme.
Il commence par remarquer que le fascisme, militairement vaincu, a toujours été jugé d’un point de vue moral et politiquement peccamineux par ses vainqueurs, mais pratiquement jamais sous un angle historique, philosophique et spirituel, (« vision du monde et référence spirituelle » ainsi que « système de valeurs ») ce qui est pourtant le plus important, sachant que « le “phénomène fasciste” est surtout présent en tant que fantasme de ses adversaires ». Pour Locchi, on peut dire que le fascisme se dépasse lui-même et signifie bien davantage pour le destin européen que les péripéties de mouvements politiques divers. Cette signification du “phénomène fasciste” est un tel tonnerre philosophique pour l’éthique occidentale en décomposition d’aujourd’hui qu’il est totalement occulté.
Pour Locchi, comme pour Adriano Romualdi, l’origine du phénomène fasciste se trouve dans Nietzsche (« la “matrice” du phénomène fasciste [ est] dans le discours de Nietzsche ».) A l’image de ce dernier qui associe mémoire ancestrale pré-chrétienne et avenir audacieux et révolutionnaire, le fascisme, partie constitutive de la Révolution conservatrice, est à la fois « repli sur les origines et projet d’avenir ».
Cette analyse de Locchi m’a frappé, car il m’a semblé que le fascisme était très exactement archéofuturiste, du nom de ce néologisme que j’ai forgé pour intituler un de mes derniers livres. Le fascisme est archéofuturiste parce qu’il veut s’appuyer sur l’archè , le commencement fondateur pré-chrétien des peuples indo-européens, afin de construire une vision du monde et un projet d’avenir post-chrétiens pour notre civilisation.
Pour Locchi, le fascisme est la première expression incarnée du Surhumanisme, dont l’origine remonte principalement à Nietzsche et à Wagner, opposition absolue à l’Égalitarisme des temps modernes, produit déspiritualisé du christianisme et cause principale de la décadence de l’oecoumène européen. Le mouvement fasciste n’a évidemment rien de matérialiste ou de politicien : il vise à instaurer une nouvelle spiritualité (donc communautaire et populaire), une nouvelle forme-de-vie a-chrétienne dans l’avenir, conforme à l’esprit archaïque des anciens cultes grecs, romains ou germaniques ; en opposition radicale, absolue, irréconciliable avec le grand cycle égalitaire commencé avec le christianisme, début de la sémitisation de l’Europe.
On ne peut qu’être frappé par la pertinence de ces vues puisque c’est bel et bien le caritarisme humanitaire et égalitaire chrétien, qu’il soit laïcisé dans la social-démocratie européenne ou encore un peu religieux dans les Églises chrétiennes modernes, qui est le principal ferment de la dégénérescence de l’identité et de la volonté des Européens.
Locchi démontre que le fascisme est, à l’échelle historique, le seul mouvement révolutionnaire et qu’Horkheimer, un des fondateurs du marxisme dissident de l’École de Francfort, avait bien raison d’affirmer que « la révolution ne peut être que fasciste ».
*************
Locchi inclut le national-socialisme et d’autres mouvements de l’époque dans l’orbe fasciste et ne limite pas celle-là à la doctrine impériale “néo-romaine” de Mussolini ; de même, il estime que, plus ou moins consciemment, depuis Nietzsche et Wagner, avec plus ou moins de pureté et de compromission, les principes généraux du fascisme ont essaimé dans toute l’Europe dans la première moitié du XXe siècle, sous des formes politiques mais aussi métapolitiques et culturelles.
Locchi entend donc l’appellation de “phénomène fasciste”, non pas, étroitement, comme un mouvement politique italien repris dans d’autres pays d’Europe et vaincu par la Seconde guerre mondiale, mais comme un mouvement global de portée historiale, comme le retour transfiguré, métamorphique, d’une conception-du-monde qui s’exprime dans tous les domaines humains, culturels, esthétiques, philosophiques, spirituels, et évidemment sociaux, économiques géopolitiques et politiques. Cette conception-du-monde, à la fois radicalement nouvelle et ancestrale, est en même temps une rupture absolue avec l’Égalitarisme – jugé ferment de décomposition à la manière d’un virus – et une volonté de projeter, de construire dans le présent si possible, mais surtout dans l’avenir un autre monde ; ce dernier, à l’inverse des utopies égalitaires (communistes, libérales, chrétiennes, etc) qui se veulent “rationnelles” mais dont les mondes projetés ne sont que des chimères impraticables qui se terminent en putréfaction et en catastrophes, n’est nullement le fruit d’un ubris “irrationnelle” mais, par le biais du mythe mobilisateur, la réappropriation par les Européens sous des formes nouvelles de leur âme oubliée — et non point perdue. Locchi est le découvreur de ce mythe surhumaniste, rappel aux vrais Européens de leur identité profonde. Cet ultra-monde auquel vise le fascisme est donc à la fois un fantastique défi historique, mais aussi une visée réalisable, à l’inverse des vaticinations anti-vitales (et de ce fait condamnées d’avance par le Tribunal de l’Histoire) de toutes les variations de l’idéologie égalitaire.
Le fascisme est donc une reconstruction métamorphique d’une conception-du-monde et d’une forme de civilisation dont les Européens ont été dépossédés par le virus égalitaire, siècle après siècle, depuis la christianisation de Rome. Sa portée est donc immense et dépasse (bien qu’il l’inclue) le champ des “programmes” politiques.
L’objet du fascisme est en effet bel et bien un changement de civilisation et pas seulement de régime. Il envisage le politique comme une véritable forme d’esthétique historique, la fonction souveraine ayant en charge de modeler sur le long terme et pour l’avenir un destin pour le peuple et un projet pour sa civilisation.
Le fascisme – avec les idéologies qu’il contient – est la seule vision du monde qui s’oppose diamétralement, et sur tous les points, dans les analyses comme dans les visées et les idéaux, à toutes les autres idéologies, qu’elles soient chrétiennes, libérales, sociales-démocrates, marxistes, etc.
Locchi démontre que ces idéologies ne divergent entre elles que superficiellement mais s’accordent sur l’essentiel, l’Égalitarisme, avec ses conséquenses connues : cosmopolitisme, universalisme, individualisme, économisme, pan-mixisme, etc. Elles forment un véritable “parti unique”, articulé en pseudopodes, innervé par la même “pensée unique” ; et le clivage politique, idéologique et philosophique en Europe depuis les années 30 ne sépare nullement la “droite” de la “gauche” (la droite n’étant qu’une gauche modérée et la gauche qu’une droite dissimulée) mais oppose explicitement ou implicitement l’ensemble des familles politiques du Système hégémonique et les courants fascistes avoués ou inavoués. Les conflits entre les droites et les gauches ne sont qu’électoralistes tandis que le conflit entre ces dernières et le fascisme est global et porte sur l’ensemble des valeurs et des visées de civilisation. Seul contre tous, tel est le destin du fascisme. Situation normale puisqu’il est le seul porteur d’un contre-projet radical.
Même s’il ne l’avoue pas toujours, le Système en est parfaitement conscient, puisque depuis les années 30 jusqu’aujourd’hui on voit fort souvent, à chaque crise politique, se constituer des “fronts antifascistes”, nommés en France “Fronts républicains”.(1)
Et c’est bien – entre autres causes – ce qui permet au fascisme de perdurer ; puisqu’il bénéficie de cette situation unique de monopole de l’opposition, qui, en dépit de la diabolisation dont font l’objet les mouvements soupçonnés d’appartenir à cette caverne maudite et peccamineuse, lui confère malgré tout un prestige et une puissance d’attraction secrète (et de recours, surtout en période troublée), qui n’auraient pas existé si le Système se fût abstenu de jeter des anathèmes quasi-religieux sur tout ce qui est supposé être infecté par le Mal fasciste.
Cette diabolisation du fascisme trouve sa cause première dans les atrocités auxquelles se serait livrée l’Allemagne nationale-socialiste avant sa défaite militaire. Mais l’argument tient mal puisque bien d’autres idéologies et systèmes politiques (les régimes communistes, les États-Unis, Israël, l’islamisme, etc.) ont perpétré et commettent des “crimes contre l’humanité” ou des “crimes de guerre” bien avérés, cette fois-ci, et jamais reconnus comme tels, jamais sources de diabolisation. L’anathème contre le fascisme date en réalité des années trente, avant les prétendues “atrocités” allemandes, et fut initié par la Guépéou soviétique, immédiatement relayée par les régimes “démocratiques” occidentaux. Troisièmement, le régime mussolinien n’a été reconnu par les vainqueurs coupable d’aucune exaction satanique, et pourtant il n’échappe pas à l’excommunication.
D’où vient donc cette démonisation du fascisme ? En réalité – et c’est là la cause seconde – elle provient de son idéologie même, en ce qu’elle réfute radicalement les axiomes de l’Égalitarisme et surtout élabore un projet de civilisation considéré comme diabolique et pervers par la cléricature du Système. Il est tout-à-fait normal que l’Égalitarisme s’émeuve et fasse donner son artillerie lourde contre une entreprise politique et civilisationnelle qui ne vise rien moins qu’à mettre fin à son règne plus que millénaire. La conception-du-monde véhiculée par le fascisme est ressentie par les élites du Système non seulement comme un défi majeur, comme une démoniaque tentation à laquelle pourraient succomber les peuples européens (intrinsèquement pécheurs), mais – sincèrement – comme une malédiction, l’incarnation du Mal, barbarie ressurgie du fonds des âges. Les courants fascistes ne sont pas, pour les partis égalitaires, des adversaires strictement politiques qui joueraient le sympathique sport de l’”alternance”, mais – à juste titre – une entreprise séculaire décidée à les éliminer définitivement du champ historique ; et une entreprise qui est déclarée hors-civilisation, c’est-à-dire hors de la civilisation occidentale qui se pense comme la seule digne de ce nom. (2)
L’explication est simple : comme l’a décelé Locchi, l’ensemble des courants égalitaires – même athées – exprime les valeurs et les utopies du christianisme, tandis que, dans la lignée de Nietzsche, l’ensemble des courants du fascisme – même s’ils absorbent des Églises chrétiennes – entend implicitement en revenir à une sensibilité spirituelle et philosophique européenne pré-chrétienne, réactualisée et durcie. Or rien n’est plus fort, plus cristallisateur de haines que les oppositions de nature religieuse ou para-religieuse. La démonisation des courants fascistes par le Système s’apparente assez exactement à la démonisation des cultes païens pendant le Bas-Empire et le Moyen Âge. L’objet du fascisme est plus ou moins consciemment ressenti comme une tentative de rétablir une éthique pré-chrétienne pour un monde post-chrétien à construire ; ce qui constitue une abomination, tant les valeurs de l’égalitarisme chrétien ont été intégrées, digérées, aborbées par l’establishment des pays européens et toute la bourgeoisie “occidentale”.
L’Égalitarisme a parfaitement perçu dans le phénomène fasciste l’ennemi absolu ; il a bien compris que l’ambition du fascisme était de même ampleur que la sienne : devenir la nouvelle conception-du-monde hégémonique en Europe ( en divorçant de manière révolutionnaire les notions d’”Europe” et d’”Occident”) Locchi ne le cache pas et comprend parfaitement cette guerre totale menée au fascisme, en évitant intelligemment de s’en plaindre.
*************
Quelles sont les principales valeurs partagées par tous les mouvements de la “sphère fasciste” depuis les années trente, et qui font entrer en transes les gardiens du Temple et les gourous de la pudibonderie égalitaire ?
On retiendra :la reconnaissance de l’inégalité de valeur entre les hommes, le différentialisme hiérarchisant entre les peuples, la recherche de l’homogénéité ethnique des nations et le refus des métissages (3 ), l’autarcie économique, l’éthique de l’honneur, l’esthétique codée comme fondement de l’art, l’éducation disciplinaire, le principe de sélection aux mérites et aux talents étendu à toute la société, l’interdiction du capitalisme spéculatif et mondialisé, l’éradication des déviances et des pathologies sociales ou sexuelles (non pas au nom d’une métaphysique mais de principes d’hygiène biologique et éthologique) ( 4), et enfin, plus ou moins consciemment formulée, le recours à la Volonté de Puissance, principe vitaliste de dépassement inégalitaire de la condition humaine, totalement incompatible avec l’humanisme chrétien fondé sur la monade métaphysique de l’Homme ou l’universalisme moral de Kant.
Mentionnons aussi la relativisation du Bien et du Mal et le dynamitage de cette dualité, opérés par Nietzsche, dans la lignée des systèmes moraux de l’Antiquité européenne.
Fascisme : pensée de la totalité, explique Locchi. Car la totalité de la vie du citoyen, dans ses aspects privés, biologiques et lignagiers, festifs et communautaires, professionnels, etc. sont rassemblés en une seule force, au sein de l’énergie commune de son Peuple, entité non plus quantitative et présentiste mais assimilée à un être historique
**************
Locchi relève qu’aujoud’hui la sphère fasciste, même si elle ne peut dire son nom, est condamnée au silence médiatique, aux persécutions, à l’exclusion. La “barbarie” fasciste n’est pas autre chose que son audace à commettre un crime de lèse-majesté contre les racines de l’humanisme égalitaire, contre sa sôtériologie et son eschatologie, péché capital que jamais le communisme (la vraie barbarie, cette fois-ci) n’avait osé commettre.
Sur le fascisme, en poursuivant la pensée de Locchi, le Règne égalitaire de l’Occident porte le même regard que les chrétiens triomphants du IVe siècle portaient sur la résistance païenne de Julien l’Apostat, que l’Église portait sur les idolâtres amérindiens ou que les Imams portent toujours sur le polythéisme vivant de l’Inde : le Mal absolu, le négationnisme obstiné de la Vérité et du Sens sacré et linéaire-ascendant de l’Histoire, l’hérésie de rejeter la doctrine du Salut – directement chrétienne ou “christianomoprphe” et laïcisée.
L’antifascisme relève donc très exactement de l’anathème, ce qui exclut toute discussion rationnelle et – par effet antidialectique – mine de l’intérieur ce discours antifasciste en conférant en creux au fascisme la légitimité de la contestation, de l’anti-dogmatisme, c’est-à-dire les vertus de la rationnalité grecque (nullement incompatibles avec la mythe), toujours tentantes pour l’âme européenne. Le doute porté par le Surhumanisme sur l’Égalitarisme, par la sphère fasciste sur le Système, est ressenti comme un ébranlement, un coup de poignard, une véritable profanation. Car l’Égalitarisme, lui, n’avait jamais douté de son triomphe. L’antifascisme n’est donc nullement une réaction politique rationnelle, mais une réaction religieuse et métaphysique.
A ce point, deux autres réflexions surgissent. Il s’agit d’abord d’expliquer les causes pour lesquelles le fascisme, issu comme l’a vu Locchi de l’initiation wagnérienne et nietzchéenne, a, dès le départ, été combattu avec une violence désespérée et acharnée par l’Occident égalitaire (dont l’asymptote fut la coalition occidentalo-communiste de la Seconde guerre mondiale). C’est parce que, pour la première fois dans son histoire, depuis la chute de l’authentique Rome impériale, l’ Égalitarisme a vu ressurgir , d’un coup, sans prévenir, comme une horrible surprise, l’Ennemi absolu qu’il croyait mort et enterré. «Le Grand Pan est de retour », écrivait significativement Montherlant dans Le solstice de Juin, au lendemain de la défaite française de juin 1940, dans laquelle il voyait la victoire de la « roue solaire » sur « le Galiléen » ; c’est-à-dire, bien au delà d’un péripétie militaire (car après tout, ce n’était pas la première fois que la France était battue militairement par un voisin), la défaite d’un «principe »(terme locchien) contre un autre que l’on croyait disparu.
Ensuite, demandons-nous pourquoi cette “sphère fasciste” est beaucoup plus combattue, censurée, pénalement poursuivie depuis les années 90 que dans l’immédiat après-guerre où le souvenir de la lutte titanesque et mythifiée contre les fascismes incarnés était encore brûlant.
Première explication : depuis la chute du communisme historique, les deux branches clônées de l’Égalitarisme n’en forment plus qu’une seule, celle du cosmopolitisme capitaliste. Cette dernière ne considère pas l’Islam comme “nouvel ennemi principal”, puisqu’il est lui aussi égalitaire, universaliste et sémitomorphe (5). Reste donc le fascisme, qui redevient le péril principal, bien qu’aucun mouvement ne s’en réclame et bien que les partis soupçonnés de s’en inspirer n’aient pas de prise sur les gouvernements européens.
Ce qui se passe aujourd’hui conforte toutes les prévisions de Locchi. A partir du moment où le Système n’a plus son frère ennemi intérieur communiste, dans les années 90, le fascisme est de nouveau désigné comme le danger absolu. Bien qu’il soit virtuel , il est soupçonné de pouvoir redevenir réel à tout moment, de pouvoir de nouveau mordre sur l’esprit public populaire des Européens de souche, toujours tenus sous surveillance, toujours inculpés de tentation d’hérésie, hantés par le retour à la “barbarie” fasciste. Certains accusent là l’idéologie dominante de “fantasmes”, mais ils se trompent. L’idéologie dominante est perspicace et elle a parfaitement raison de craindre le scénario d’un retour de flammes du fascisme, comme nous le verrons plus loin.
C’est pourquoi l’arsenal juridique sans cesse renforcé, l’assommoir de la propagande médiatique incessante, le martellement d’imprécations culpabilisatrices dirigées contre toute trace de fascisme dans l’Union européenne constituent un imposant appareil de prévention du retour de ce dernier sous une forme nouvelle. Il ne faut pas prendre les maîtres du Système pour des imbéciles.
Et cela nous indique la seconde raison de la reconstitution du “front antifasciste” par les droigauches européennes : car de fait, l’idéologie hégémonique a parfaitement décelé dans la naissance et les percées électorales de divers partis et mouvements identitaires en Europe un inquiétant signal d’alarme. Marginal, circonscrit, contrôlé dans un microscopique bouillon de culture au fond d’un bocal soigneusement caoutchoucté jusque dans les années 80, le virus fasciste, au yeux du Système, a réussi à s’évader de sa prison stérile et prophylactique pour réinfecter des partis et mouvements qui ont pignon sur rue et un début d’accès aux médias (TV notamment) ; et ce, bien que lesdits partis ou mouvements identitaires se gardent de toute référence explicite aux doctrines politiques italiennes et allemandes d’avant-guerre, et prennent la précaution dans leurs programmes (jugée parfaitement hypocrite par les maîtres du Système) d’intégrer des éléments de la vulgate égalitaire.
Le Système, par cet alourdissement des dispositions et propagandes antifascistes, vise également à s’assurer ce que j’appelle une légitimation négative. Un gouvernement se légitime “positivement” lorsqu’il convainc l’électorat de ses mérites, réalisations concrètes, améliorations des conditions de vie, etc. L’entreprise est difficile aujourd’hui pour les gouvernements européens qui peuvent de moins en moins cacher que tous les voyants sont au rouge : situation économique qui s’aggrave, insécurité croissante, colonisation migratoire massive, effondrement des repères culturels autochtones, désastres écologiques divers, soumission humiliante au suzerain américain, etc.
Les gouvernements tentent alors frénétiquement (spécialement en France) de se légitimer “négativement” : c’est nous ou le déluge, c’est notre bonne vieille “démocratie” – certes imparfaite – ou l’Hydre fasciste, la Bête immonde, la pornographie politique et morale, le saccage du Temple des Droits de l’Homme, bref, la Tyrannie aggravée par le péché mortel de l’abomination raciste. De son point de vue, le Système n’a aucun autre moyen que cette légitimation négative (binôme propagande moralisante et culpabilisante / répression judiciaire et exclusion socio-économique des Pécheurs) pour maintenir son pouvoir.
Par “Système”, il ne faut pas entendre seulement les gouvernements et appareils d’État, mais aussi les médias, les Églises, les associations subventionnées, les syndicats, l’Université, le pouvoir judiciaire, les instances culturelles, l’industrie du spectacle, les firmes capitalistes, les pouvoirs financiers etc., tous ligués contre un péril qu’ils estiment à juste titre global : celui d’une vision du monde et d’un mouvement historique qui menace l’ensemble de leurs positions sociales, de leurs idéaux, mais aussi de leurs intérêts.
Une hypothèse eût été que l’Égalitarisme appliquât au fascisme cette célèbre maxime romaine, de minimis non curat praetor, “ le préteur n’a cure des peccadilles”. Mais il ne le pouvait pas, car le fascisme n’est pas une “chose minime”. Giorgio Locchi expose dans son texte qu’il ne vise à rien moins, dans la perspective de l’”énigme” nietzschéenne, qu’« à régénérer l’histoire elle-même en provoquant le Zeitumbruch, la “cassure du temps historique” ».
*************
Dans son combat antifasciste, le Système se heurte à une délicate contradiction : fondé sur la “démocratie”, il doit mettre plus ou moins entre parenthèses ses grands principes démocratiques pour barrer la route à un éventuel néo-fascisme. Car ce n’est pas la bourgeoisie qui est soupçonnée de constituer l’assise du fascisme, mais bel et bien les peuples autochtones européens des classes moyennes et inférieures, rebaptisées “populace”. Ce qui constitue une rupture avec, par exemple, les analyses des antifascistes de gauche des années trente. D’où une double stratégie : d’une part, abolir concrètement la démocratie (au profit de la technocratie) au niveau de l’Union européenne, qui contrôle déjà 40% des réglementations de tous ordres ; d’autre part, “changer de peuple”, selon la formule de Berthold Brecht : c’est-à-dire submerger les classes moyennes et inférieures européennes autochtones sous un flot de migrants, nouvel électorat qui n’aura plus les tentations peccamineuses d’un “retour aux origines et à l’identité”. Un peuple de mulâtres sans mémoire ni projection d’avenir : voilà l’habile contre-feu allumé par l’Égalitarisme, voila le contre-poison qu’il a logiquement trouvé.
Cette stratégie, reconnaissons-le, est assez bien vue. Le seul problème est qu’elle peut prendre du temps et qu’il s’agit d’une course de vitesse. Oui, une course de vitesse entre l’arrivée à un point de rupture et de basculement où les masses européennes, encore largement majoritaires chez elles, pourront verser dans un post-fascisme de reconquête intérieure, et le moment où une certaine proportion du “peuple” ne sera plus d’origine européenne, donc absoute de toute tentation et privée de toute possibilité de porter sur le trône un avatar du fascisme.
************
Mais, se demandera-t-on : pourquoi parler au présent du fascisme et jamais au passé, comme s’il était toujours vivant ? Mais parce qu’il est toujours vivant, et plus que jamais. Locchi l’énonce dans le texte que vous allez lire avec cette notion énigmatique, mais au fond tonitruante de clarté, de catacombes, sur laquelle je vais revenir.
Car il est tout de même extraordinaire qu’un mouvement, écrasé par la guerre, interdit, qui a formellement disparu, continue de faire tant parler de lui et si peur au Système. S’agirait-il d’une sorte de mort-vivant, de fantôme ou d’ectoplasme prêt à se rematérialiser ? De Phénix renaissant de ses cendres ? Le spectre du fascisme hante les gardiens du Temple. Et ils n’ont pas nécessairement tort… D’ailleurs, ses pires ennemis n’ont pas si mal compris que cela sa nature : ils ont bien vu que sa menace existait toujours, que le défunt n’était qu’un ensommeillé en catalepsie, que la chaleur des braises était toujours intacte ; dans la langue de bois inquiète des prêtres du Système, à la fois haineuse et angoissée, on répète depuis plus de cinquante ans ce leitmotiv, d’évidente inspiration biblique : « il est toujours fécond, le ventre de la Bête Immonde ». Cet anathème – qui assimile le fascisme à l’Antéchrist de l’Apocalypse, même chez les penseurs communistes athées – trahit tout de même une certaine lucidité historique.
Car les conditions qui ont présidé à sa naissance au début du XXe siècle, loin de s’atténuer, se sont exacerbées. La progression du virus égalitaire a été telle dans les dernières décennies que la situation des peuples européens se rapproche de ce que les mathématiciens adeptes de la “théorie des catastrophes” (René Thom) appellent le “point de basculement”..
La grande angoisse du Système est qu’il se produise, dans les prochaines années, un cocktail explosif beaucoup plus corsé que dans les années trente qui, par retour du courrier, donnera lieu en Europe à la réémergence d’un second fascisme, nécessairement plus pondéreux que le premier…Cette angoisse, totalement absente jusque dans les années 80, hante aujourd’hui tous les débats idéologiques en Europe de l’ouest.
************
L’optimisme tragique de Locchi, qui me fut confirmé en lisant ce bref essai, rejoint parfaitement les positions que j’ai récemment défendues. Pour lui, le fascisme était prématuré et n’était pas mûr parce que la décomposition du système occidental-égalitaire et son niveau de décadence (dans les années Trente) n’était rien par rapport à ce que nous connaissons aujourd’hui et allons vivre.
Il se demande si « les régimes fascistes de la première moitié du XXe siècle [ ne sont pas ] apparus trop tôt, prématurément » et ne doivent pas leur surgissement à « des circonstances fortuites qui, en apparence et seulement en elle, anticipaient le futur prévu par Nietzsche. » Ce dernier, explique Locchi, estimait que son “mouvement” (Bewegung) de subversion (Umwertung) des valeurs égalitaires « ne pouvait s’affirmer que sur les ruines du système social et culturel existant », ce qui n’était pas du tout encore le cas dans les années trente, car « nous savons que le système égalitaire était en réalité encore fort et que, du point de vue nietzschéen, il était loin d’avoir épuisé ses ressources spirituelles et matérielles ».
Aujourd’hui, avec l’accélération du processus viral de dégénérescence, nous percevons que le point de rupture du système égalitaire n’est peut-être plus très loin, ce que j’ai plusieurs fois qualifié de “convergence des catastrophes”. A ce moment là seulement, un vrai fascisme serait mûr et pourrait se déployer dans l’Histoire européenne. Il serait une réponse à la mesure de la tragédie que nous allons peut-être vivre (et que l’Europe n’a encore jamais affrontée), l’ultime et la seule alternative à la pure et simple disparition de notre civilisation.
Bien entendu, un nouvel âge du fascisme ne prendra sans doute pas cette dernière dénomination. Et son visage sera très différent des mouvements des années 20 et 30. Mais l’inspiration et la vision du monde demeureront évidemment les mêmes.
Il se peut que le scénario se déroule comme je l’ai expliqué dans plusieurs de mes ouvrages récents. En ce cas, le fascisme historique ou premier fascisme n’aura été qu’une répétition générale, un premier acte, et nullement un crépuscule des dieux. Locchi : « la position extrême se fait “nihilisme positif” et veut reconstruire sur les ruines de l’Europe un “ordre nouveau” en donnant la vie au “troisième homme” ». Ce troisième homme serait, selon un mouvement de rebondissement dialectique, l’apparition métamorphique et surhumaine (du moins dans ses élites) de l’homme des paganismes gréco-hélléno-germaniques, en dépassement et en négation de l’homme décadent – et abattu par ses propres virus égalitaires, développés lentement dans la longue macération du christianisme.
Autre point, très intempestif mais fort actuel : Locchi, dans cet essai, estime que « depuis 1945, le “fasciste” qui veut conduire une action politique est obligé de la mener sous un faux drapeau et doit renier publiquement les aspects fondamentaux du “discours fasciste”, en sacrifiant verbalement aux principes de l’idéologie démocratique ». C’était vrai jusqu’à une date récente. Ce le sera de moins en moins, compte tenu de l’aggravation des circonstances. On pourra, plus qu’auparavant, critiquer ouvertement les principes du Système – en pleine faillite –, à condition qu’on ait l’intelligence de ne pas faire de références explicites (ou pire, folklo-iconograhiques) aux mouvements fascistes historiques.
Les temps s’approchent où l’on pourra tenir un discours inégalitaire, surhumaniste, révolutionnaire, débarassé de tout attribut visible des fascismes historiques. La censure du Système est beaucoup moins habile et perspicace que l’on croit, parce qu’elle s’attache aux formes plus qu’au fond, qui n’est plus maîtrisé.
Autre réflexion qui va dans le même sens : Locchi a magistralement décelé la cause profonde de l’antifascisme, qui n’a rien de politique, mais tout de philospophique : « [ce] qui commande au camp égalitaire la répression absolue du “fascisme”, [ c’est que ] le “fasciste” ne veut pas cette fin de l’histoire proposée par l’égalitarisme et il agit pour la rendre impossible. » En effet, Locchi fut le premier à mettre en lumière ce qui semble banal aujourd’hui à beaucoup d’intellectuels “identitaires”, mais ne l’était pas du tout auparavant, à savoir que la grande famille égalitaire (judéo-chrétienne, libérale, marxiste, gauchiste et, évidemment musulmane) est cimentée par sa conception escatologique et sôtériologique de l’Histoire, cette dernière étant une ligne segmentaire se dirigeant vers un point final (jugement dernier), terrestre ou metempsychique, où le Bien triomphera.
Tout à l’inverse, la vision surhumaniste de l’Histoire, exprimée par Nietzsche et ressentie par les fascismes, est aléatoire. Locchi est le seul qui l’ait formulée comme « sphérique » ( et non point “cyclique”), en ayant, le seul, compris la notion nietzschéenne d’ « éternel retour du même » – et non pas de l’”identique”. Or, le Système, avec la chute du communisme, voyait enfin approcher cette fin de l’histoire. Et c’est l’inverse qui se produit, en ce début de XXIe siècle. L’argument de diabolisation de la vision du monde fasciste, accusée d’ historicisme, d’anti-progressisme, de refus du Salut, se trouve singulièrement troublé par les événements observables, qui infirment tous l’angélisme eschatologique du Système et le projet égalitaire : l’histoire planétaire (re)devient un chaudron des sorcières et non plus un long fleuve tranquille qui coule vers la mer, Mare Tranquillitatis… La sagesse démocratique, kantienne, d’une société apaisée, multiethnique, etc.mì, n’est pas au rendez-vous. La rationalité égalitaire se dévoile comme utopie irréaliste et l’”irrationalité” fasciste comme conforme au réel.
Parce que ce nouveau siècle s’avère déjà en totale opposition avec tous les projets de l’Égalitarisme ; il sera un siècle de fer, de feu, de sang, de lutte des peuples et des civilisations entre elles, du ressurgissement des mémoires assoupies en forces formidables (regardez l’Islam…), bref il corroborera la conception-du-monde et l’intuition du fascisme au sens large, disons du nietzschéenne, et rendra stupides les rêveries des Pères de l’Église et obsolètes celles de Kant et de ses successeurs des XIXe et XXe siècles (6).
Le XXIe siècle verra, à mon sens, s’effondrer de l’intérieur la branche occidentale de l’Égalitarisme, comme a implosé son rejeton communiste. Un étroit passage sera donc laissé au Surhumanisme européen, où à autre chose qui ne sera plus du tout européen, et menace déjà… Comme dit le proverbe : ça passe ou ça casse . En optimiste tragique, Giorgio Locchi remarque que les héritiers du fascisme vivent encore aujourd’hui « dans les catacombes », mais il laisse entendre qu’on sort aussi des catacombes, comme le fit en son temps le premier christianisme… Chacun son tour.
*************
Je vous demande de conserver précieusement ce texte de Giorgio Locchi, de le lire, le relire, de le faire lire et de le ruminer. Cette préface comme l’introduction et les notes de mon très cher ami Stefano Vaj, ne sont que des écrins, des cadres où s’insère le tableau central. Car la parole de Giorgio Locchi s’écoute ou se lit lentement . On s’en imprègne, on y décèle toujours quelque chose d’imprévu, d’inquiétant, de vrai. Giorgio Locchi ne parle jamais du passé en tant que tel, comme objet mort, mais il a toujours ce clin d’œil vers l’avenir, On découvre chez lui de nouvelles lumières, comme lorsque que l’on regarde attentivement une toile de maître, des lueurs d’aube, des raisons d’espérer. Et de combattre.
Guillaume Faye
NOTES de la PRÉFACE
(1) Le discours de ces “Fronts républicains” est de désigner comme “fascistes” des forces qui dénient farouchement avoir la moindre accointance avec les fascismes historiques, ce qui est sociologiquement et philosphiquement faux, mais évidemment impossible à avouer. C’est là le “drôle de jeu” de cache-cache et de simulacres qui se joue depuis 1945 et qui aboutit à ce que le vocable “fasciste” ne survit que parce que ses plus farouches adversaires l’entretiennent comme un indispensable “chapeau sémantique” afin de ne pas perdre de vue l’ennemi mortel.
Rappelons que le mot “fascisme”, néologisme italien, renvoie aux “faisceaux des licteurs”, gardes-du-corps des magistrats romains (faisceaux de tiges de bois liées par des bandelettes et maintenant un fer de hache au sommet). Ce symbole était aussi présent dans les armoiries républicaines françaises après la Révolution, par référence à la république romaine. Par ce néologisme de “fascisme”, les révolutionnaires italiens voulaient signifier que la nation ne formait plus qu’un seul corps, qu’un seul esprit organiquement liés, rassemblés comme un faisceau d’armes, en une volonté et un destin totalisants.
(2) Même dans les traités de science politique qui se veulent descriptifs et objectifs, le phénomène fasciste est jugé de manière affective, émotionnelle, religieuse. En guise d’anthologie du genre, voici ce qu’on lit sous la plume de Philippe Nemo (Histoire des idées politiques, PUF), mêlant vérité et lucidité historique à des délires métaphysiques (soulignés) : les fascismes représentent des « pratiques anthropologiques radicalement anti-chrétiennes et anti-civiques, qui sont un rejet total non seulement des valeurs et institutions démocratiques et libérales, mais de la civilisation occidentale elle-même […] Ces monstruosités n’étaient viables que quelques décennies, puisque, quand on entend recréer le type même de lien social qui caractérisait les sociétés tribales ou archaïques, on ne peut que régresser vers le niveau de performance de ces dernières. On se place en mauvaise posture pour rester dans la course au progrès scientifique, technologique et économique, etc. » Cette vision libérale, juste sur le caractère anti-chrétien et anti-occidental du fascisme, sombre dans l’idiotie et l’absence de sens critique : car c’est précisément dans les domaines techniques et économiques que les fascismes furent plus performants et futuristes que les démocraties occidentales !
(3) La “nouvelle droite” parisienne a brouillé les cartes du discours “inégalitaire” qu’elle prétendait incarner, par l’invention du concept superficiel d’”ethnopluralisme” et par une interprétation erronée de la notion d’”Empire” (imperium), pas-de-clercs dont Giorgio se gaussait avec un mépris discret.
L’”ethnopluralisme” était de plus en plus entendu (et l’est toujours) par ces intellectuels comme l’utopique cohabitation “communautariste” d’ethnies venues du monde entier en Europe. Ce qui aboutit inévitablement à ce que H.S. Chamberlain appelait le chaos ethnique, projet dissolvant situé en plein cœur de la thématique de l’ Égalitarisme. La seule définition acceptable de l’”ethnopluralisme” eût été celle du “chacun chez soi”, et encore, cette vision fait l’impasse sur l’idée de hiérarchie qualitative entre les peuples qui, qu’on le veuille ou non, est omniprésente dans la conception-du-monde dite “fasciste”.
De même, l’idée d’”Empire” défendue par les intellectuels précités (semblable à celle de l’imperium romanum christianisé) renvoie à un amalgame de peuplades hétérogènes sans liens ethniques, à l’exact opposé de l’idée impériale européenne que défendait Giorgio Locchi et, qu’à sa suite, je poursuis : un rassemblement de peuples apparentés par les liens du sang, de l’histoire et de la culture, unis par une auctoritas supérieure en un destin commun. Les fascismes, dans leur idée d’homogénéité ethnique ne faisaient qu’appliquer le concept rationnel de philia d’Aristote : parenté ethno-culturelle comme fondement de la Cité.
Toutes ces confusions faites par les intellectuels de la mouvance franco-italienne “ND” étaient jugées par Giorgio Locchi, dans les conversations que nous eûmes, – et avant même que cette dérive ne s’aggrave comme aujourd’hui – comme le pathétique effort de gens affectivement et romantiquement tentés et marqués par certains aspects du “fascisme”, pour récupérer les concepts centraux de l’Égalitarisme, pourtant incompatibles ; et ce, dans un but – d’ailleurs manqué – de bienséance politique et sociale. Cette dérive, prévue par Giorgio Locchi, donne aujourd’hui toute sa mesure puisque les intellectuels italiens et français précités se sont constitués objectivement en opposition interne et factice au Système, alignés sur les positions “antimondialistes” simulées de la gauche, muets sur la colonisation migratoire et l’emprise de l’Islam (ou parfois même sournoisement favorables), bref récupérés tout en étant toujours exclus .
(4) Le “racisme”, au sens actuel de doctrine accordant une grande importance à l’anthropologie biologique dans la formation des civilisations et de recherche politique d’une homogénéité ethno-biologique optimale, dont on nous fait croire qu’il était pratiquement l’unique axe doctrinal des fascismes, était en fait depuis le milieu du XIXe siècle très répandu dans beaucoup de courants de toutes tendances. Disraëli, Marx, Engels, Renan étaient parfaitement racistes au sens actuel. On trouve chez Hegel (in Leçons sur la philosophie de l’histoire) des développements sur l’inégalité des races et l’impasse historique des mixages, et chez Voltaire (Dictionnaire philosophique) l’idée constante d’une hiérarchie qualitative des races, qui lui paraissait parfaitement naturelle.
D’ailleurs, sans parler de Gobineau ou de Lapouge, c’est en France (et non pas dans l’Allemagne d’après Fichte) que les théories racistes ont pris naissance, comme corpus structuré. Le mot “race”, au sens contemporain, a été créé par François Bernier en 1684 et le “racisme”, comme contestation de l’unité de l’espèce humaine, date des zoologues Linné, Maupertuis et Buffon. Bref, tout cela pour dire que le “fascisme”, notamment dans sa version allemande, n’à, à aucun moment, inventé doctrinalement le racisme – même chez des auteurs comme Rosenberg et Darré. Bernard-Henry Lévy dans l’Idéologie française l’avait très bien vu et les agités du chauvinisme “républicain” (“La France des Droits de l’Homme au dessus de tout soupçon”) avaient eu tort de le contester. Les concepts fondamentaux dudit racisme ont été élaborés (et notamment au début du XXe siècle, par les Dr Jules Souris et René Martial, de l’Université de Montpellier) par des savants ou théoriciens français, qui étaient en parfaite contradiction avec la prétentieuse posture cosmopolite et universaliste de la “Grande Nation”, mais qui, il est vrai, étaient tous des anti-cléricaux athées donc, quelque part, des non-chrétiens…C’est là toute l’ambiguité de l’”idéologie française”.
D’autre part qui sait ou qui dit que l’interdiction des mariages mixtes n’a été abolie dans 42 États qu’en 1967 par la Cour surprême américaine ? Etc.
Bref, le discours et la pratique raciales ne constituent pas l’originalité monopolistique du phénomène fasciste mais une simple composante.
(5) Certains estiment que l’Islam est un “fascisme vert”, parce qu’il serait inégalitaire. D’où l’attirance exercée par cette religion idéologique sur plusieurs courants égarés des mouvements identitaires, et ce, depuis longtemps (Siegried. Hunke, Claudio Mutti, René Guénon, etc.).
L’Islam, de fait, subordonne la femme à l’homme, soumis le non-converti (dhimmi) au musulman, l’esclave au maître. Mais cet inégalitarisme est parfaitement trivial, esclavagiste, mécaniciste. Il faut être inconséquent pour y voir un quelconque rapport avec le Surhumanisme européen.
L’Islam appartient tout entier au grand courant égalitaire : il vise le Califat universel, l’homogénéité de l’humanité dans une seule “foi”, il prône rigoureusement la même conception du finalisme historique que le christianisme, le judaïsme, le marxisme, le libéralisme, fondée sur la gnôse du Salut. Il professe aussi la croyance en un Bien et un Mal absolus.
(6) On touche là un grand paradoxe : les courants de pensée égalitaires et démocratistes occidentaux et communistes, se réclamant de la rationalité et de la sagesse (vaste imposture et récupération de la philosophie grecque), ont toujours sombré dans l’erreur historique, l’échec utopique, la prédiction jamais réalisée, la furie de la déraison, le dogme et la méconnaissance des faits, des observations anthropologiques et historiques. Tandis que les “fascismes”, accusés d’irrationalité barbare (chamanisme ?) et régressive, ont développé des principes parfaitement observables et conformes à l’expérience : la récurrence des conflits, l’antagonisme ethno-culturel des peuples, l’inégalité des formes de vie, l’homogénéité ethnique comme fondement de la permanence des formes politiques, etc.
Je peux me tromper, évidemment, mais il se pourrait que l’intuition de Giorgio Locchi fût que les «principes » fascistes, en tant que photographies réalistes et sereines de la réalité du monde, n’eussent rien à craindre du Tribunal de l’Histoire et qu’ils triompheront obligatoirement contre l’Égalitarisme. Mais – car il y a un “mais” – vaincre l’Égalitarisme ne suffit pas puisqu’il risque de s’effondrer de lui-même, ce qui a déjà commencé d’ailleurs. Ce n’est pas pour cela que le Surhumanisme, l’intuition nietzschéenne, vaincra dans l’histoire des Européens. Voici le fond de ma pensée : le “phénomène fasciste” aura bientôt le champ libre pour s’imposer, puisque son ennemi héréditaire s’épuise, rongé de l’intérieur par son manque de carburant. Son ennemi ne sera plus que sa propre absence de Volonté de Puissance face aux forces génésiques et conquérantes d’autres peuples. Je crois qu’il faut en revenir à une certaine simplicité de principes, par delà le bien et le mal. Il m’est assez difficile d’en dire plus.
00:05 Publié dans Nouvelle Droite, Philosophie, Réflexions personnelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, nouvelle droite, guillaume faye, giorgio locchi, nietzschéisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 10 novembre 2010
Tradition & Revolution

Tradition & Revolution
Edouard RIX
Ex: http://www.counter-currents.com/
Translated by Greg Johnson
What are we fighting for? Every political soldier has to raise this question. Contradictory as it might seem, we are inclined to answer that we fight for Tradition and Revolution.
The Tradition
First of all, one should not confuse the Tradition with traditions, i.e., customs and habits.
The Tradition indicates the ensemble of higher-order knowledge regarding Being and its manifestations in the world, such as they were bequeathed to us by former generations. It pertains not to what is given in space and time, but to what is always. It admits a variety of forms — traditions — while remaining one in its essence. One should not confuse it with the one religious tradition, because it covers the totality of human activities — political, economic, social, etc. . . .
Following Joseph de Maistre, Fabre d’ Olivet, and especially René Guénon, Julius Evola speaks about a “primordial Tradition” which, historically, would make it possible to consider the concrete origin of a whole array of traditions. He refers to a “Hyperborean tradition,” coming from the Extreme North, located at the beginning of the present cycle of civilization, in particular the Indo-European cultures.
From Evola’s point of view, “a civilization or a society is traditional when it is governed by principles that transcend what is merely human and individual, when all its forms come to it from on high, and when as a whole it is oriented toward what is above.” Traditional civilization thus rests on metaphysical foundations. It is characterized by the recognition of an order superior to all that is human and contingent, by the presence and the authority of elites that draw from this transcendent plane the principles necessary to found a hierarchically articulated social organization, to blaze trails towards a higher knowledge, and finally to confer on life a vertical orientation.
The modern world, to Evola, is contrary to the world of the Tradition which was incarnated in all great civilizations, West and East. They are free of our ignorance of all that is higher than man, our generalized desacralization, materialism, and confusion of castes and races.
The Revolution
As for the term Revolution, it must be brought back to its double meaning. In its current sense, which is most commonly used, Revolution means the abrupt and violent change in the government of a State. The French Revolution and the Russian Revolution of 1917 are perfect illustrations.
However, in its original sense, Revolution does not mean subversion and revolt, but the opposite, namely the return to a starting point and movement centered around an axis. Thus, in astronomical terms, the revolution of a star precisely indicates its axial motion, its movement around a center that restrains its centrifugal force, thus preventing the star from losing itself in infinite space.
Today, however, we are at the end of a cycle. With the regression of the castes — the progressive descent of authority down the Traditional hierarchy of the four functions — power has passed from sacred kings to warrior-aristocrats, then to merchants, and finally to the masses. This is the Iron Age, the Indo-Aryan Kali-Yuga, the Dark Age of decline characterized by the reign of quantity, number, mass, and the unrestrained scramble for production, profit, material wealth.
Thus to be for the Revolution today is to want our European civilization to return to its original starting point, in conformity with the values and the principles of the Tradition, which happens, to borrow the words of Giorgio Freda, by “the disintegration of the current system,” the antithesis of the traditional world to which we aspire.
Edouard Rix, Le Lansquenet, no. 16, Fall 2002
00:05 Publié dans Réflexions personnelles, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tradition, traditions, traditionalisme, réflexions personnelles, philosophie, révolution, théorie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 08 novembre 2010
Renato Del Ponte: My Memories of Julius Evola
My Memories of Julius Evola
Renato Del Ponte
Ex: http://www.counter-currents.com/
Translated by Greg Johnson
 Renato del Ponte is a central figure in European Evolianism. Founder of the Centro studi evoliani in Genoa in 1969 and editor of the journal Arthos, he also runs the Roman Traditionalist Movement.
Renato del Ponte is a central figure in European Evolianism. Founder of the Centro studi evoliani in Genoa in 1969 and editor of the journal Arthos, he also runs the Roman Traditionalist Movement.
Question: Renato del Ponte, your name is closely related to Evola’s. Can you tell us how you came to Evola and what your relationship was with him?
Reply: I am simply a man who has always sought to give my life, on the existential, political, and cultural levels, a line of extreme coherence. It is no surprise that on this way I crossed paths with Evola, who had made coherence in his life as in his writings his watchword.
Naturally because Evola was born in 1898 and I in 1944, our physical encounter could take place only in the last years of his life.
The circumstances and the characteristics of our relationship are developed partly in the letters from 1969 to 1973 (published in the book Julius Evola, Lettere 1955–1974 [Finale Emilia: Edizioni La terra degli avi, 1996], pp. 120–155).
It was always a very cordial relationship, which imparted in me the desire to create an organizational network to make his thought better known in Italy and abroad.
Q.: It is you who deposited the urn containing Evola’s ashes in a crevasse on Monte Rosa. Could you tell us the circumstances?
R.: Yes, it was I, along with other faithful friends, who ensured the transport and the deposit of Evola’s ashes in a crevasse on Monte Rosa at 4,200 meters of altitude, at the end of August 1974. To tell you the truth, I was not the executor of Evola’s will, but I had promised him that, along with our mutual friend Pierre Pascal, I would be vigilant so that the provisions of his will concerning his burial were correctly carried out.
As Evola feared, there were many serious oversights that obliged me to intervene and carry out the burial with the assistance of Eugene David who was Evola’s alpine guide when he made his ascents of Monte Rosa in 1930. It is impossible for me to relate all these adventures, some rather romantic, but you can refer to the collective work Julius Evola: le visionnaire foudroyé [Julius Evola: The Fallen Visionary] (Paris: Copernic, 1979) where some of them are reported.
Q.: You run the Roman Traditionalist Movement. What is this?
R.: The Movimento tradizionalista romano is an essentially cultural and spiritual structure that aims to raise awareness of the characteristics of the Roman Tradition, which is not a historical reality that has been definitively left behind, but an immortal spiritual reality still able to offer today an operative existential model and a religious orientation based on what we define as the “Roman way of the Gods.” To this end, the movement acts on a very discrete internal and communal dedicated to the practice of pietas, and on an external plane dedicated to making known the traditional set of themes of Romanness through manifestos, books — for example my Religione dei Romani (Milano: Rusconi, 1992) which obtained an important literary prize — and periodicals. For more details, you should refer to my contribution in Paris last February to colloquium of L’originel on paganism that will probably be published in French in the journal Antaios.
Q.: For some, Evola’s involvement with the Ur Group is his most interesting period. It seems to us that he mixed quasi-fascist politics, occultism, and modern art in an astonishing and attractive cocktail. Is this correct? How do you analyze this phase of Evola’s life?
R.: I cannot discuss the Ur Group and Evola’s involvement in a brief manner. I recommend my book Evola e il magico Gruppo di Ur [Evola and the Magical Ur Group] (Borzano: Sear Edizioni, 1994).
I will simply say that it was the most committed period in Evola’s life.
This is because it was the period when certain esoteric current, which for the most part laid claim to Roman tradition, had some concrete hope of influencing Italy’s government.
But this phase of Evola’s life can also be interpreted as an attempt, characteristic of his whole existence, “to proceed differently,” to exceed the limits of the forces that condition existence, to create something once more, or better, to return under quite “normal” conditions to a life according to the Tradition.
Q.: How does one reconcile Evolianism and political commitment?
R.: If you speak to me about possible political actions of more limited orientation, reserved to a minority that tries to influence certain groups or certain environments, but at the individual level and without concrete hope of publication of journals and books.
We soon begin to publish Arthos again at quarterly intervals. It is natural that the Italian initiative is accompanied by the birth of similar groups and movements in Europe and especially in France where Evola’s work is well-known. The year to come will surely see the realization of concrete initiatives of which you will be of course informed since we naturally count on your active contribution.
From Lutte du Peuple, no. 32, 1996, http://www.centrostudilaruna.it/mes-souvenirs-de-julius-e...

00:05 Publié dans Entretiens, Traditions | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : julius evola, tradition, traditionalisme, entretiens, italie, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 07 novembre 2010
A Forgotten Thinker On Nation-States vs. Empire
A Forgotten Thinker On Nation-States vs. Empire
Paul Gottfried
Ex: http://www.freespeechproject.com/
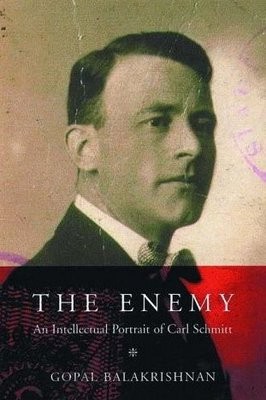 German legal theorist Carl Schmitt (1888-1985[!]) has enjoyed a widespread following among European academics and among that part of the European Right that is most resistant to Americanization. In the U.S. it is a different matter. Outside of the editors and readers of Telos magazine, which has heavily featured his work, Schmitt's American groupies are becoming harder and harder to find.
German legal theorist Carl Schmitt (1888-1985[!]) has enjoyed a widespread following among European academics and among that part of the European Right that is most resistant to Americanization. In the U.S. it is a different matter. Outside of the editors and readers of Telos magazine, which has heavily featured his work, Schmitt's American groupies are becoming harder and harder to find.
My intellectual biography of this thinker, which Greenwood Press published in 1990, has sold rather badly. An earlier, much denser biography, by Joseph W. Bendersky, put out by Princeton in 1983, obtained a broader market. In the eighties, academically well-connected commentators, including George Schwab, Ellen Kennedy, Gary Ulmen, and Bendersky, built up for Schmitt a scholarly reputation on these shores by trying to relate his thought to then-contemporary political issues. This caused so much concern among American global democrats that The New Republic (August 22, 1988) published a grim tirade by Stephen Holmes against the Schmittian legacy. An echo could be found in the New York Review of Books (May 15, 1997), in a screed by another neoconservative, Mark Lila. Though the Schmitt scholars sent in responses, the New York Review would not publish any of them. Apparently the political conversation in Midtown Manhattan is not broad enough to include non-globalists.
Schmitt is properly criticized for having joined the Nazi Party in May 1933. But he clearly did so for opportunistic reasons. Attempts to draw a straight line between his association with the Party and his writings of the twenties and early thirties, when he was closely associated with the Catholic Center Party, a predecessor of the Christian Democrats, ignore certain inconvenient facts. In 1931 and 1932, Schmitt urged Weimar president Paul von Hindenburg to suppress the Nazi Party and to jail its leaders. He sharply opposed those in the Center Party who thought the Nazis could be tamed if they were forced to form a coalition government. While an authoritarian of the Right, who later had kind words about the caretaker regime of Franco, he never quite made himself into a plausible Nazi. From 1935 on, the SS kept Schmitt under continuing surveillance.
There are two ideas raised in Schmitt's corpus that deserve attention in our elite-decreed multicultural society. In The Concept of the Political (a tract that first appeared in 1927 and was then published in English in 1976 by Rutgers University) Schmitt explains that the friend/enemy distinction is a necessary feature of all political communities. Indeed what defines the "political" as opposed to other human activities is the intensity of feeling toward friends and enemies, or toward one's own and those perceived as hostile outsiders.
This feeling does not cease to exist in the absence of nation-states. Schmitt argued that friend/enemy distinctions had characterized ancient communities and would likely persist in the more and more ideological environment in which nation-states had grown weaker. The European state system, beginning with the end of the Thirty Years War, had in fact provided the immense service of taming the "political."
The subsequent assaults on that system of nation-states, with their specific and limited geopolitical interests, made the Western world a more feverishly political one, a point that Schmitt develops in his postwar magnum opus Nomos der Erde (now being translated for Telos Press by Gary Ulmen). From the French Revolution on, wars were being increasingly fought over moral doctrines - most recently over claims to be representing "human rights." Such a tendency has replicated the mistakes of the Age of Religious Wars. It turned armed force from a means to achieve limited territorial goals, when diplomatic resources fail, to a crusade for universal goodness against a demonized enemy.
A related idea treated by Schmitt is the tendency toward a universal state (a “New World Order”?). Such a tendency seemed closely linked to Anglo-American hegemony, a theme that Schmitt took up in his commentaries during and after the Second World War.
German historians in the early twentieth century had typically drawn comparisons between, on the one side, Germany and Sparta and, on the other, England (and later the U.S.) and Athens - between what they saw as disciplined land powers and mercantile, expansive naval ones. The Anglo-American powers, which relied on naval might, had less of a sense of territorial limits than landed states. Sea-based powers had evolved into empires, from the Athenians onward.
But while Schmitt falls back, at least indirectly, on this already belabored comparison, he also brings up the more telling point: Americans aspire to a world state because they make universal claims for their way of life. They view "liberal democracy" as something they are morally bound to export. They are pushed by ideology, as well as by the nature of their power, toward a universal friend/enemy distinction.
Although in the forties and fifties Schmitt hoped that the devastated nation-state system would be replaced by a new "political pluralism," the creation of spheres of control by regional powers, he also doubted this would work. The post-World War II period brought with it polarization between the Communist bloc and the anti-Communists, led by the U.S. Schmitt clearly feared and detested the Communists. But he also distrusted the American side for personal and analytic reasons. From September 1945 until May 1947, Schmitt had been a prisoner of the American occupational forces in Germany. Though released on the grounds that he played no significant role as a Nazi ideologue, he was traumatized by the experience. Throughout the internment he had been asked to give evidence of his belief in liberal democracy. Unlike the Soviets, in whose zone of occupation he had resided for a while, the Americans seemed to be ideologically driven and not merely vengeful conquerors.
Schmitt came to dread American globalism more deeply than its Soviet form, which he thought to be primitive military despotism allied with Western intellectual faddishness. In the end, he welcomed the "bipolarity" of the Cold War, seeing in Soviet power a means of limiting American "human rights" crusades.
A learned critic of American expansionists, Schmitt did perceive the by-now inescapably ideological character of American politics.
In the post-Cold War era, despite the irritation he arouses among American imperialists, his commentaries seem fresher and more relevant than ever before.
Paul Gottfried is Professor of Humanities at Elizabethtown College, PA. He is the author of After Liberalism and Carl Schmitt: Politics and Theory.
05:05 Publié dans Droit / Constitutions, Philosophie, Révolution conservatrice, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : droit, philosophie, révolution conservatrice, carl schmitt, théorie politique, sciences politiques, politologie, weimar, etat-nation, grands espaces, géopolitique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 06 novembre 2010
Ezra Pound and the Occult
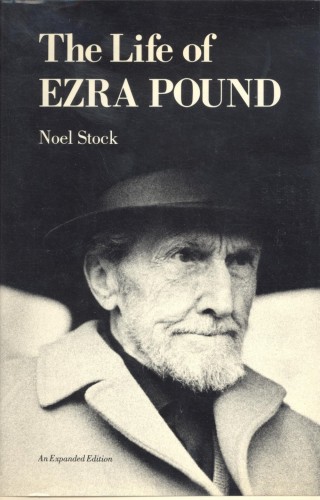 Ezra Pound and the Occult
Ezra Pound and the Occult
Brian Ballentine
In 1907, when Ezra Pound was still teaching Romance languages at Wabash
College in Indiana, he completed the poem "In Durance":
I am homesick after mine own kind
And ordinary people touch me not.
Yea, I am homesick
After mine own kind that know, and feel
And have some breath for beauty and the arts (King 86).
Pound left America and its "ordinary people" behind for Europe shortly after. When he arrived in London in 1908, Pound wasted no time becoming a part of the community of writers which he considered his "own kind." He was quickly running among the more prestigious of London’s literary society including members from the Rhymer’s Club and W. B. Yeats’s publisher Elkin Mathews. Of course, it was Yeats’s association that Pound truly desired and successfully sought out. In Poetry 1, Pound begins his "Status Rerum" by declaring that he found "Mr. Yeats the only poet worthy of serious study" (123). Pound would eventually be content to condense his esoteric community of cutting edge writers down to two men: himself and Yeats. In 1913 he wrote Harriet Monroe proclaiming that London’s writers are divided into two groups: "Yeats and I in one class, and everybody else in the other" ("Status Rerum" 123).When Pound first met Yeats, the older poet was heavily involved and experimenting with theurgy, or magic, that is performed with the aid of beneficent spirits. This form of occult study was not at all of interest to Pound. Shortly after their introduction, it was arranged for Pound to serve as Yeats’s "secretary" at the winter retreat Stone Cottage. Not trying to hide his skepticism , Pound wrote this letter to his mother just prior to his first winter with Yeats at Stone Cottage:
My stay at Stone Cottage will not be in the least profitable. I detest
the country. Yeats will amuse me part of the time and bore me to
death with psychical research the rest. I regard the visit as a duty to
posterity (Paige 25).
The purpose of this research is to expose the various types of occultism that were prevalent during Pound's life and determine what elements of the occult he subscribed to. Although there are signs of an occult influence all the way through his later writing, Pound’s own stance on the occult is difficult to pin down. Pound’s own belief in the occult was one that was constantly being rethought and revised. There are moments when Pound was on the brink of exploration into Yeats’s world of spirits as well as moments when he was ready to abandon the occult altogether. Pound’s exploration of "retro-cognition," his revitalization
of the Greek idea of the "phantastikon," his pursuit of gnosis or what he termed a "crystal" state, and his associations with some of London’s premiere occultists provide evidence for the former. The latter is demonstrated in his revisions on the original 1917 Three Cantos and his apparent desire to be disassociated with the "pseudo-sciences" of the occult. Much of the occult element that dominated the original publication has been edited entirely out of the final and existing copy. In any case, much of Pound’s writing is indebted to an occult influence and it will be explored in this paper.
In his essay "Ezra Pound’s Occult Education," Demetres Tryphonopoulos warns other critics not to view Pound’s skeptical letter to his mother as a rejection towards all forms of the occult. He states that "it is only theurgy and spiritualism that Pound rejects" (76). These "pseudo-sciences" are what Tryphonopoulos believes to be "the areas of human interest which many true occultists would reject as involving the degradation of humanity" ("Occult Education" 74). Yeats’s other interests in astrology and numerology, both of which were popular in the early twentieth century, are also included among the "pseudo-sciences." Occult studies such as gnosticism and theosophy are understood as legitimate pursuits by scholars like Tryphonopoulos. Gnosis, an esoteric form of knowledge that made possible the direct awareness of the Divine, was one of Pound’s major interests with the occult. James Longenbach argues that Pound labored over creating a "priest-like status" for himself and his work (92). The quest for becoming as close to God as possible led Pound on a long exploration of occult texts. According to Walter Baumann, Pound’s quest drove him to "provide further ingredients for [his] own vision of Paradise" (311). These esoteric components or "ingredients" then become the source of much difficulty in understanding Pound’s work. To date only a few scholars have made the occult element in Pound’s work more accessible and in the past only people "deeply steeped in occult literature" could successfully navigate his writing (Baumann 318). Pound never came so far around as to accept Yeats’s interests in what he considered less useful facets of the occult, but he would humor Yeats. The older poet was also interested in astrology and asked Pound for his birth date so he could determine his horoscope. In a letter to Dorothy Shakespear Pound exclaimed:
The Eagle [Yeats] is welcomed to my dashed horoscope tho’ I
think Horace was on the better track when he wrote
"Tu ne quaesaris, scire nefas, quem
mihi quem tibi
Finem dii dederunt" (Litz 113).
[Ask not, we cannot know, what ends the gods have set for me, for thee]
Despite Pound’s show of pessimism, he provided Yeats with all of the necessary information, which included writing a letter to his mother for the exact time of his birth. He told his mother that "half a million people, some of them intelligent, who still believe in the possibility of planetary influences . . . When astrology is taken hold of systematically by modern science there will be some sort of discoveries. In the meantime there is no reason why one should not indulge in private experiment and investigation (Paige 152).A subject of particular interest to both men is something that psychologists today have termed "retro-cognition." Yeats, Pound and the rest of England received their introduction to this phenomenon when Anne Moberly and Eleanor Jourdain published An Adventure in 1911. On August 10, 1901 the two women claimed to have been strolling through the Versailles gardens and found themselves transported back into the eighteenth century. Apparently, neither of them had realized what had occurred at the time but recounted the experience in a narrative:
We walked briskly forward, talking as before, but from the moment we left the lane an
extraordinary depression had come over me. . . In front of us was a wood, within which,
and overshadowed by trees, was a light garden kiosk, circular and like a small bandstand,
by which a man was sitting. There was no greensward, but the ground was covered by
rough grass and dead leaves as in a wood. The place was so shut that we could not see
beyond it. Everything suddenly looked unnatural, therefore unpleasant; even the trees
behind the building seemed to have become flat and lifeless, like a wood worked in a
tapestry (41).
Ten years of research in the French National Archives led them to believe that all the things they saw that day existed not in 1901 but in 1789. Also, they determined the person Moberly saw by the terrace, who is referred to as a "man" in the narrative, to be Marie Antoinette (Longenbach 222-23).Shortly after the publication of An Adventure, Yeats completed two essays for Lady Gregory’s Visions and Beliefs in the West of Ireland. In his essays, Yeats references An Adventure, making it highly probable that the two men had possession of the book during the Stone Cottage years if not sooner. An Adventure became an important beginning for the work of Pound and how the artist can relate to the spirit of his ancestors. The key to these relations with the past is the soul. Pound borrowed from a lot of different sources to derive his own theories on the human soul. He used Cicero’s idea of the "immortality of the soul" in De Senectute (Longenbach 222-23).He also borrowed from Plato and the Phaedrus in the Spirit of Romance: "And this is the recollection of those things which our souls saw when in company with God-when looking down from above on that which we now call being, and upward toward the true being" (140-41). Pound himself claimed to have had two experiences with retrocognition which were extremely important to him. As Longenbach writes, "Pound’s poetic goal was the cultivation of ‘adventures,’ the soul’s visionary memories of the paradise or the past it once knew" (229).Pound recounts his own experiences with retrocognition in an essay on Arnold Dolmetsch published in 1914. "So I had two sets of adventures. First, I perceived a sound which was undoubtedly derived from the Gods, and then I found myself in a reconstructed century- in a century of music, back before Mozart or Purcell, listening to clear music, to tones clear as brown amber" (Eliot 433). Pound was drawing on or participating in what he determined to be the soul’s eternal memory. His essay begins with a description of his first adventure:
I have seen the God Pan and it was in this manner: I heard a bewildering and pervasive music moving from precision to precision within itself. Then I heard a different music, hollow and laughing. Then I looked up and saw two eyes like the eyes of a wood- creature peering at me over a brown tube of wood. Then someone said: Yes, once I was playing a fiddle in the forest and I walked into a wasps’ nest. Comparing these things with what I can read of the Earliest and best authenticated appearances of Pan, I can but conclude that they relate to similar experiences. It is true that I found myself later in a room covered with pictures of what we now call ancient instruments, and that when I picked up the brown tube of wood I found that it had ivory rings upon it. And no proper reed has ivory rings on it, by nature. . . .Our only measure of truth is, however, our own perception of truth. The undeniable tradition of metamorphoses teaches us that things do not remain always the same. They become other things by swift and unanalysable process (Eliot 431).
Pound’s own understanding of truth and what he perceived to be his reality are bold advancements from what was presented in the original An Adventure. The visionary’s experience becomes the sole measure of reality and therefore Pound’s encounter with Dolmetsch as Pan becomes factual. In his essay, "Psychology and Troubadours," Pound draws a parallel between himself and early visionaries who had no way of differentiating imaginary visions from a "real" environment: "These things are for them real" (Spirit of Romance 93). Also, although Pound’s adventures and experiences cannot technically be affirmed in any way, they "stand in a long tradition of similar experiences recorded in the literature of folklore, mythology, and the occult" (Longenbach 230). In the essay on Dolmetsch, Pound works to place himself in this tradition when he writes: "When any man is able, by a pattern of notes or by an arrangement of planes or colours, to throw us back into the age of truth, everyone who has been cast back into that age of truth for one instant gives honour to the spell which has worked, to the witch-work or the art-work, or whatever you like to call it" (Eliot 432). Like Moberly and Jourdain, who had peered into the past and subsequently took ten years to write about it, Pound was wrestling with putting his visions into poetry. The "arrangement of planes or colours," the "art-work" which "throws us back into the age of truth" is what Pound wanted to create with the early Cantos. Pound began writing the first of the Cantos around 1910 but did not pursue them in earnest until 1915. It was during this time that Pound is documented in his letters as having read Robert Browning’s poem "Sordello" out loud to Yeats at Stone Cottage. Although Pound had read the poem before, it was not until he read it to Yeats that "Sordello" became a major influence. He praises the poem in a letter to his father on December 18, 1915: "It is probably the greatest poem in English. Certainly the best long poem since Chaucer. You’ll have to read it sometime as my big long endless poem that I am now struggling with starts out with a barrel full of allusions to ‘Sordello’" (Bornstein 119-20). However, the original support Pound relied on from Browning would soon be replaced with occult references. In the June, July and August 1917 edition of Poetry Magazine, Pound published his Three Cantos. These three were supposed to be the beginning of his existing long work The Cantos. Even after the highly positive review of Browning’s poem to his father, Pound would have nothing to do with Browning’s style. The original opening, which served more or less as a dialogue with Browning, is deceiving. Pound makes no effort to sustain Browning’s technique through his poem. It does not function in a lyric mode, rather it is an "apologia for the lyric mood" (Nassar 12). Pound began to question Browning’s elaborate metaphor for the stage and his character’s acting on it. Pound did not hide his "aesthetic and philosophic problems" (Nassar 13) that he had with Browning when he wrote:
. . . what were the use
Of setting figures up and breathing life upon them,
Were’t not our life, your life, my life extended?
I walk Verona. (I am here in England.)
I see Can Grande. (Can see whom you will.)
You had one whole man?
And I have many fragments, less worth? Less worth?
Ah, had you quit my age, quit such a beastly age and
cantankerous age?
You had some basis, had some set belief (Poetry, June 1917, 115).
As if to answer his own question, and provide Browning with proper examples, Pound continued with passages in the mode of An Adventure. The only way to contain the "beastly and cantankerous age" in which one lived was to tap into the past as Moberly and Jordain had done.
Sweet lie!-Was I there truly? . . .
Let’s believe it . . .
No, take it all for lies
I have but smelt this life, a wiff of it-
. . . And shall I claim;
Confuse my own phantastikon,
Or say the filmy shell that circumscribes me
Contains the actual sun;
confuse the thing I see
With actual gods behind me?
Are they gods behind me?
How many worlds we have! If Botticelli
Brings her ashore on that great cockle-shell-
His Venus (Simonetta?),
And Spring and Aufidus fill the air
With their clear outlined blossoms?
World enough.
(Poetry, June 1917, 120-21)
Eugene Nassar claims that Pound demonstrated the "mind circumscribed by its diaphanous film-its limits-[which] imagines gods when in the presence of beauty . . . The mind as ‘phantastikon’ may be intuiting transcendent truths" (12). Pound wrestled with the "truth" about his occult link to the past in his revisions on Three Cantos all the way up until its republication in 1925. The once long opening addressed to Browning was reduced to the opening four lines of Canto II:
Hang it all, Robert Browning, There can be but the one Sordello. But Sordello and my Sordello? Lo Sordels si fo di Mantovana" (6).Following the address to Browning, Pound presents his vision of his characters or in this case "Ghosts" that "move about me / Patched with histories" (Poetry 116). There is no need for Pound to go "setting up figures and breathing life into them" because his characters were already part of a living past. Pound’s "fragments" are in fact not "less worth" because together they form a more complete whole than Browning’s characters. Pound sees these apparitions hovering over the water at Lake Garda. As with his Imagist poetry, these early portions of the Cantos reflect Pound’s attention to presenting the clearest possible picture of his experience:
And the place is full of spirits.
Not lemures, not dark and shadowy ghosts,
But the ancient living, wood white,
Smooth as the inner bark, and firm of aspect,
And all agleam with colors-no, not agleam,
But colored like the lake and like the olive leaves (Poetry June 1917, 116).
Pound used specific people and places, such as Lake Garda, to set up a desired historical backdrop. Often with Pound, the more oblique source was championed. The names are obscure and esoteric, leaving "ordinary people" in the dark just as Pound intended. Pound’s references to antiquated places, his use of foreign language, all in addition to his occult content, contribute to a higher level of difficulty in his poetry:
‘Tis the first light-not half light-Panisks
And oak-girls and the Maenads
Have all the wood. Our olive Sirmio
Lies in its burnished mirror, and the Mounts Balde and Riva
Are alive with song, and all the leaves are full of voices (Poetry June 1917,118).
The visionary experiences that Pound recreates in the Three Cantos are matched with these areas to "emphasize their origin in the meeting of a particular consciousness with a particular place" (Longenbach 232). This association was a technique that Pound had already begun experimenting with in some of his writing such as "Provincia Deserta." Yeats put it into his own words in a portion of his prose piece Per Amica Silentia Lunae: "Spiritism . . . will have it that we may see at certain roads and in certain houses old murders acted over again, and in certain fields dead huntsmen riding with horse and hound, or in ancient armies fighting above bones or ashes" (354). The spirits that haunt Pound’s Cantos are ones which he spent much time excavating from history during his reading at Stone Cottage. Also, Pound used specific names and places from his research to create a sense of locality. In the first Canto it was places such as Sirmio, and in the second there were others such as the Dordogne valley in France:
So the murk opens.
Dordogne! When I was there,
There came a centaur, spying the land,
And there were nymphs behind him.
Or going on the road by Salisbury
Procession on procession-
For that road was full of peoples,
Ancient in various days, long years between them.
Ply over ply of life still wraps the earth here.
Catch at Dordoigne (Poetry July 1917, 182).
At the same time that Pound was struggling with the original Three Cantos, Yeats was preparing his own take on An Adventure. The older poet was busy formulating what he called the "doctrine of the mask" (Autobiography 102). According to Yeats, this doctrine "which has convinced [him] that every passionate man . . . is, as it were, linked with another age, historical or imaginary, where alone he finds images that rouse his energy" (Autobiography 102). Yeats’s link to the past came in a voice which he claimed to have heard for awhile but ignored. The voice even provided him with information leading to its identity. Yeats discovered that he was communicating with a Cordovan Moor named Leo Africanus. However, he did not take Leo seriously until a seance conducted on July 20, 1915. After the seance, Yeats began to consider the possibility of an anti-self existing from another period of time. Communication with this opposite personality would lead to a more complete existence as well as a better understanding of the self. Yeats began writing letters to Leo and in turn would write letters back to himself believing that Leo’s intentions could be conveyed through him. Now that Yeat’s theory had advanced to a stage where his opposite existed in another century, his idea advanced from one that was grounded in psychology to a theory that had just as much to do with history (Longenbach 190-91). There is no documented proof of Pound ever participating in one of Yeats’s seances. Despite Pound’s lack of involvement, it is impossible to overlook the parallels between the two poets work at the time. Pound was using his own ghosts and their historical associations in his early Cantos. In his final winter at Stone Cottage, Pound took interest in the seventeenth-century Neo-Platonic occult philosopher John Heydon. In 1662, Heydon published his Holy Guide. Although Pound enthusiastically read Heydon’s book, he presented a mixed image of him with Heydon’s debut in the original Three Cantos . In the final version of the original Three Cantos III, Pound introduces Heydon in a fashion that is somewhere between mockery and praise:
Another’s a half-cracked fellow-John Heydon,
Worker of miracles, dealer in levitation,
In thoughts upon pure form, in alchemy,
Seer of pretty visions (‘servant of God and secretary of nature’);
Full of a plaintive charm, like Botticelli’s,
With half-transparent forms, lacking the vigor of gods. . .
Take the old way, say I met John Heydon,
Sought out the place,
Lay on the bank, was ‘plunged deep in the swevyn;’
And saw the company-Layamon, Chaucer-
Pass each his appropriate robes; (Poetry Aug, 1917, 248)
Walter Bauman refers to Heydon as Pound’s "spiritual brother" (314). Despite the not-so flattering introduction of Heydon, Pound would appear to agree with Bauman. One possible explanation for Pound’s harsher opening remarks on Heydon could be that many people of Heydon’s own time did not think highly of his work. To many, Heydon was simply "a charlatan trifling with occult lore" (Bauman 306). In any case, Pound seems to make a point of acknowledging Heydon’s uncertain past before citing him as a credible source. Pound begins to spell out exactly what one could obtain by reading Heydon in a section of his prose piece Gaudier-Brzeska: A Memoir. In section 16, Pound writes positively about artists like Brzeska, Wyndham Lewis and Jacob Epstein who were on the forefront of the new movement Vorticism. Here he discusses the power a work of art can have:
A clavicord or a statue or a poem, wrought out of ages of knowledge, out of fine perception and skill, that some other man, that a hundred other men, in moments of weariness can wake beautiful sound with little effort, that they can be carried out of the realm of annoyance into the realm of truth, into the world unchanging, the world of fine animal life, the world of pure form. And John Heydon, long before our present day theorists, had written of the joys of pure form . . . inorganic, geometrical form, in his "Holy Guide" (157).
Pound also closes the section with a final reminder to read "John Heydon’s ‘Holy Guide’ for numerous remarks on pure form and the delights thereof" (Gaudier-Brzeska: A Memoir 167). There are several facets of the occult found in Pound’s memoir. He infers that the perfect work of art is layered with history. It is hundreds of years and hundreds of men in the making. The "realm of truth" is reached when the mind, as Nassar previously described it, has the ability to imagine "gods when in the presence of beauty." The "transcendent truths," that are a conglomeration of the past, can then be tapped as a source for the pure form Pound is describing (Nassar 12).Much of Pound’s desire for a pure truth goes hand in hand with his quest to be close to the Divine and obtain his "priest-like status." His use of Heydon becomes clearer as one reads that Heydon pondered questions such as "if God would give you leave and power to ascend to those high places, I meane to these heavenly thoughts and studies (Heydon 26). Pound borrows almost verbatim from Heydon and then cites him in "Canto 91":
to ascend those high places
wrote Heydon
stirring and changeable
‘light fighting for speed’ (76).
Heydon continues stating that people involved with studies such as his should realize that "their riches ought to be imployed in their own service, that is, to win Wisdome" (31). This "Wisdome" was something Pound wanted to make certain the masses or the "ordinary people" would not be privy to. It was exactly the divine wisdom, or gnosis, that Pound was in search of. Pound was asking the same questions and desiring the same answers that Heydon was asking hundreds of years earlier: "let us know first, that the minde of man being come from that high City of Heaven" (33). With these overt connections to Heydon, Pound’s opening remarks on him as a "half-cracked fellow" remain puzzling. Again, it is likely that Pound was initially shy about such overt references to a less-than-favorable occultist just as he was with some of Yeats’s mysticism. As it turns out, the title "Secretary of Nature" was actually Heydon’s and was printed on the title page of Holy Guide. Pound was respectful enough to include the title. Also in the Cantos, Heydon is in the company of men such as Ocellus, Erigena, Mencius and Apollonius. Pound appears to have thought much higher of Heydon than his opening remarks lead a reader to believe. In total, over half a dozen quotes are taken from Heydon’s work adding to the "crystal clear" quality of Pound’s Cantos (Davie 224).
From the green deep
he saw it,
in the green deep of an eye:
Crystal waves weaving together toward the gt/healing
Light compenetrans of the spirits
The Princess Ra-Set has climbed
to the great knees of stone,
She enters protection,
the great cloud is about her,
She has entered the protection of crystal . . .
Light & the flowing crystal
never gin in cut glass had such clarity
That Drake saw the splendour and wreckage
in that clarity
Gods moving in crystal
(Canto 91, 611)
In this selection, the "Pricess Ra-Set" has completed a journey that has allowed a metamorphosis to take place about her. The crystal which has encompassed her represents Heydon’s "pure form" that Pound was himself searching for. Inside this crystal protection "gods are manifest, whatever their ontological status outside" (Nassar 110). Pound’s metaphor shows up in several places. In "Canto 92," Pound describes "a great river" with the "ghosts dipping in crystal" (619). Also, in "Canto 91," Pound wrote:
"Ghosts dip in crystal,
adorned"
. . . A lost kind of experience?
scarcely,
Queen Cytherea,
che ‘l terzo ciel movete
[who give motion to the third heaven]
Pound already knew the answer to his own question about experience when he asked it. Crystal was chosen not only for its clarity to represent the pureness of form but it is hard and durable as well. The experience was not lost in the protection of this divine state that is the "crystal."
There are several individuals who were contemporaries of Pound that had a large influences on Pound and exposed him to their own ideas about the occult. People such as Yeats, A. R. Orage, Allen Upward, Dorothy Shakespear, and Olivia Shakespear all had their own occult interests. However, the largest occult influence on Pound, even greater than that of Yeats, was G. R. S. Mead. Mead became a member of Madame Blavatsky’s Theosophical Society in 1884. In 1889 he was Blavatsky’s private secretary and kept that position until her death in 1891. He served as the society’s editor for their monthly magazine but branched off and quit the society altogether in 1909. Blavatsky’s writings and practices aligned themselves more with the "pseudo-sciences" that Pound would not have approved of. Oddly enough, in Mead’s essay "‘The Quest’ - Old and New:
Retrospect and Prospect," he apparently does approve of Blavatsky’s ways either:I had never, even while a member, preached the Mahatma - gospel of H. P. B. [Blavatsky], or propagandized Neo-theosophy and its revelations. I had believed that "theosophy" proper meant the wisdom-element in the great religions and philosophies of the world (The Quest 296-97).
This passage represents thinking that was in line with Pound’s ideas on gnosis and his own pursuit of wisdom. Mead is considered by some to be "the best scholar the Theosophical Society ever produced" (Godwin 245).Pound’s assessment of what he experienced in his visionary episodes as well as his readings was heavily influenced by the writings and teachings of Mead. Pound met him at one of Yeats’s "Monday Evenings" at 18 Woburn Building in London which Mead regularly attended. On October 21, 1911, Pound wrote to his parents: "I’ve met and enjoyed Mead, who’s done so much research on primitive mysticism - that I’ve written you at least four times." [1] In another letter to his parents dated February 12, 1912, Pound praises Mead writing: "G. R. S. Mead is about as interesting - along his own line - as anyone I meet"(Beinecke 238). In a letter to his mother dated September 17, 1911, Pound relays that Mead had asked him to write a publishable lecture. Pound discusses the task with his more skeptical side of the occult: "I have spent the evening with G. R. S. Mead, edtr. of The Quest, who wants me to throw a lecture for his society which he can afterwards print. ‘Troubadour Psychology,’ whatever the dooce that is" (Beinecke 223). Pound did go on to give the lecture which gave birth to his essay "Psychology and the Troubadours." In this essay Pound wrote that "Greek myth arose when someone having passed through delightful psychic experience tried to communicate it to others" (92). Again Pound was referring to an occult "adventure" similar to that of Moberly and Jourdain. Once an individual has undergone this event "the resulting symbol is perfectly clear and intelligible" (Longenbach 91). Pound also endeavors to explain further his idea of the Greek "phantastikon." According to Pound, "the consciousness of some seems to rest, or to have its center more properly, in what the Greek psychologists called the phantastikon. Their minds are, that is, circumvolved about them like soap-bubbles reflecting sundry patches of the macrocosmos" (92). In April of 1913, Pound wrote a letter to Harriet Monroe attempting to clarify this element of his essay: "It is what Imagination really meant before the term was debased presumably by the Miltonists, tho’ probably before them. It has to do with the seeing of visions."
Pound’s phantastikon became his link to tapping into the purest form of "real symbolism." Dorothy Shakespear requested that Pound explain to her the difference between this symbolism and aesthetic or literary symbolism. He wrote her stating:
There’s a dictionary of symbols, but I think it immoral. I mean that I think a superficial acquaintance with the sort of shallow, conventional, or attributed meaning of a lot of symbols weakens - damnably, the power of receiving an energized symbol. I mean a symbol appearing in a vision has a certain richness and power of energizing joy - whereas if the supposed meaning of the symbol is familiar it has no more force, or interest of power of suggestion than any other word, or than a synonym in some other language (Pound/Shakespear 302).
Of course, the ability to perceive these symbols was not within the reach of everyone. It was only for those who have set sail in the pursuit of higher wisdom. Those in pursuit of gnosis "possess the key to the mysteries of its symbolism and establish themselves as priests - divinely inspired interpreters to whom the uninitiated public must turn for knowledge" (Longenbach 91). From here, the possibilities are endless according to Pound:
"All is within us", purgatory and hell,
Seeds full of will, the white of the inner bark
the rich and the smooth colours,
the foreknowledge of trees,
sense of the blade in seed, to each its pattern.
Germinal, active, latent, full of will,
Later to leap and soar,
willess, serene,
Oh one could change it easy enough in talk.
And no one vision will suit all of us.
Say I have sat then, the low point of the cone,
hollow and reaching out beyond the stars,
reaches and depth, the massive parapets,
Walls whereon chariots went by four abreast (Longenbach 237).
Pound made it a habit to not only read Mead’s article’s and books but he also religiously attended his lectures outside the "Monday Evenings." In another letter to his parents he wrote: "I’m going out to Mead’s lecture. And so on as usual. This being Tuesday" (Beinecke 271). From these readings and lectures, Pound most likely got his inspiration for the beginning of his revised Cantos:
the passing into the realms of the dead, while living, refers to the initiation of the soul of the candidate into the states of after- death consciousness, while his body was left in a trance. The successful passing through these states of consciousness removed the fear of death, by giving the candidate an all sufficing proof of the immortality of the soul and of its consanguinity with the gods (Taylor 319).
The "initiation" process of the soul was one that Pound decided must begin his entire Cantos. "Canto 1" starts with: "And then went down . . ." which initiates a descent that is the beginning of this journey (3). Pound made it clear in "Canto 1" that the Odysseus figure was alive during his descent just as Mead required the figure to be "living." Also, in a blatant attempt to achieve the "consanguinity with the gods," Pound’s character drank the blood of the sheep that was sacrificed to them.
The process that Pound is discussing is palingenesis, or the birth and the growth of the soul. The ultimate goal of the entire process, as Pound saw it, was "the expansion of the initiand’s consciousness into a state where he awakes to his relationship with the gods, and participates in their world" (Celestial Tradition 107). At this initial stage the initiate knows nothing except that he is on a quest for gnosis. As Pound wrote in Canto 47: "Knowledge the shade of a shade, / Yet must thou sail after knowledge / Knowing less than drugged beasts" (30).
The completion of the journey is the passage into what was previously described as "the crystal." This stage is the graduation from the ephemeral world of man to the realm of the gods. The soul has passed "from fire" of the "Kimmerian lands" of "Canto 1" "to crystal / via the body of light" (Canto 91,61). Pound put it much more bluntly when he stated that one must "bust thru" to this realm of understanding but he made his point (Celestial Tradition 107). Although he makes references to the exceptions, Tryphonopoulos contends that "Scholarly comment on Pound’s relation to the occult is virtually nonexistent" ("Occult Education" 75). The difficulty in analyzing Pound’s occult studies is that his reading and influences are so vast. From his amassed material Pound would piece together a detailed mosaic. This method provided a coherence for his presentation. In this fashion, structure begins to surface in even his most dense work The Cantos. Tryphonopoulos understands The Cantos to be a "collection of fragments gathered according to a predetermined plan for the purpose of validating the author’s original value system" (1). Pound seems to be speaking of this in the very late "Canto 110" when he writes: "From times wreckage shored / these fragments shored against ruin" (781). These elements pulled from the rubble of history and which Pound tiles together are what make the picture complete.
00:05 Publié dans Littérature, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, littérature américaine, lettres, lettres américaines, etats-unis, ezra pound, occultisme, usure, usurocratie, philologie, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
La solitudine del cittadino globale
La solitudine del cittadino globale
Bauman, Zygmunt, La solitudine del cittadino globale
Feltrinelli, Milano, traduzione dall’inglese di Giovanna Bettini, 2000, 6a ed. 2003, pp. 224, ISBN 88-07-10287-0
(v.o. In search of Politics, Cambridge, Polity Press, 1999)
Recensione di Daneila Floriduz
 Le politiche neoliberiste si avvalgono degli attuali processi di globalizzazione per incrementare in maniera pressoché illimitata le libertà personali, di associazione, di pensiero, di espressione. Ma, si chiede Bauman, «quanto è libera la libertà?» (p. 69)?
Le politiche neoliberiste si avvalgono degli attuali processi di globalizzazione per incrementare in maniera pressoché illimitata le libertà personali, di associazione, di pensiero, di espressione. Ma, si chiede Bauman, «quanto è libera la libertà?» (p. 69)?
Parafrasando Isaiah Berlin, Bauman sostiene che la libertà propugnata dal mercato sia negativa, intesa cioè come assenza di limiti e di costrizioni, come deregolamentazione, come «riduzione, sul piano legislativo, dell’interferenza politica nelle scelte umane (meno Stato, più denaro in tasca)» (p. 77). Il mercato non è invece in grado di costruire una «libertà attiva fondata sulla ragione» (ivi), strettamente connessa alla responsabilità individuale, atta a fungere da criterio di scelta e da guida per l’azione, una libertà che sappia coraggiosamente incidere sulla realtà ed elaborare (concettualmente e concretamente) il significato di bene comune. Dopo la caduta del muro di Berlino, il capitalismo si presenta come un dogma, come il paradigma economico vincente perché privo di alternative reali e praticabili. Ne deriva una progressiva erosione della politica a vantaggio dell’economia: come sostiene Bauman, «al centro della crisi attuale del processo politico non è tanto l’assenza di valori o la loro confusione generata dalla loro pluralità, quanto l’assenza di un’istituzione rappresentativa abbastanza potente da legittimare, promuovere e rafforzare qualunque insieme di valori o qualunque gamma di opzioni coerente e coesa» (p. 79).
Ciò conduce a una generalizzata apatia da parte delle istituzioni e dei singoli cittadini, che hanno rinunciato alla prospettiva e alla promessa di “cambiare il mondo”, ad ogni dimensione progettuale, a ogni interrogazione del presente e vivono la «solitudine del conformismo» (p. 12). Tale atteggiamento di indifferenza, sfociante spesso nel cinismo e nel nichilismo, a ben guardare, si fonda su un generalizzato sentimento di disagio esistenziale che può essere sintetizzato con il termine tedesco Unsicherheit, traducibile in inglese in una vasta gamma semantica, che va dall’uncertainty (incertezza), all’insecurity (insicurezza) e unsafety (precarietà). Come si vede, in italiano questi tre sostantivi risultano pressoché sinonimici, mentre per Bauman designano tre tipologie di esperienza piuttosto diverse, pur se convergenti nel terreno comune dell’angoscia e dell’incomunicabilità.
Il termine unsecurity viene esplicitato da Bauman attraverso l’ossimoro «sicurezza insicura» (p. 26): «L’insicurezza odierna assomiglia alla sensazione che potrebbero provare i passeggeri di un aereo nello scoprire che la cabina di pilotaggio è vuota» (p. 28). E’ la situazione che si avverte nel mondo del lavoro, in cui dominano la flessibilità, i contratti a tempo determinato, in cui le aziende chiudono o convertono la produzione ed è impossibile per l’individuo spendere le proprie competenze in un mercato in continua evoluzione e specializzazione. Di qui la sfiducia nella politica, come testimonia il crescente astensionismo che accompagna le consultazioni elettorali nella maggior parte dei Paesi occidentali: la politica interessa solo quando emergono scandali che riguardano personaggi famosi, ma è una politica/spettacolo, non uno spazio pubblico partecipato e sentito dalla collettività. Di qui anche l’inautenticità vissuta nei rapporti con gli altri e con se stessi: citando Milan Kundera, Bauman ricorda come un tempo l’amicizia fosse sacra, eroica, possibile anche tra uomini appartenenti per necessità a schieramenti nemici (I tre moschettieri). Oggi un amico non può salvare l’altro dalla disoccupazione. Anche a livello di identità personale, l’incertezza lavorativa costringe gli uomini a dislocarsi in tanti ruoli o a rifugiarsi nella sfera del virtuale (si pensi alle chat, nelle quali è possibile nascondersi dietro nomi fittizi). Bauman usa, a tal proposito, la metafora dell’uomo modulare: al pari dei mobili componibili, la nostra identità non è determinata alla nascita, ma mutevole, multiforme, sempre aperta a nuove possibilità, sicché l’uomo di oggi «non è senza qualità, ne ha troppe» (p. 160).
La certezza incerta (uncertainty) riguarda i meccanismi stessi del liberismo: «Contrariamente a quanto suggerisce il supporto metafisico della mano invisibile, il mercato non persegue la certezza, né può evocarla, e tanto meno garantirla. Il mercato prospera sull’incertezza (chiamata, di volta in volta, competitività, flessibilità, rischio e ne produce sempre più per il proprio nutrimento» (p. 38). Mentre il temerario giocatore d’azzardo sceglie il rischio come un fatto ludico, l’economia politica dell’incertezza oggi imperante lo impone a tutti come destino ineluttabile. L’uncertainty riguarda «la paura diffusa che emana dall’incertezza umana e il suo condensarsi in paura dell’azione; […] la nuova opacità e impenetrabilità politica del mondo, il mistero che circonda il luogo da cui gli attacchi provengono e in cui si sedimentano come resistenza a credere nella possibilità di opporsi al destino e come sfiducia nei confronti di qualunque proposta di modo di vita alternativo» (p. 176). La precarietà (unsafety) è riconducibile all’intrinseca mortalità propria della condizione umana. «Il viaggiatore non può scegliere quando arrivare né quando partire: nessuno ha scelto di essere inviato nel mondo, né sceglierà il momento in cui partire. L’orario degli arrivi e delle partenze non è compilato dai viaggiatori, e non c’è nulla che essi possano fare per modificarlo» (p. 42). Dalla capacità di reagire e di trovare risposte alla precarietà esistenziale deriva il grado di autonomia che un individuo o una società possono conseguire.
In passato i «ponti per l’eternità» sono stati, di volta in volta, ravvisati nella religione, nella famiglia, nella nazione, intesi come totalità durevoli, capaci di dotare di significato l’esistenza dell’uomo comune che dopo la morte poteva, per così dire, perpetuare la propria esistenza dando la vita per la patria o generando i figli. Le politiche della globalizzazione, imperniate sulla crescita delle multinazionali, tendono a rendere superflui i controlli da parte degli Stati tradizionali e delle amministrazioni locali perché «il capitale fluisce senza vincoli di spazio e tempo, mentre la politica resta territoriale, globale» (p. 123), per cui si potrebbe parlare di «fine della geografia, piuttosto che di fine della storia» (ivi). Se è vero che la nazione, a partire dal Romanticismo, era intesa come un’entità innata, spirituale, come un fatto di sangue, un’appartenenza quasi biologica, è anche vero che questa appartenenza doveva essere rivitalizzata quotidianamente da parte dell’individuo: ciò è richiamato dal celebre detto di Renan, secondo cui «la nazione è il plebiscito di ogni giorno».
Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il nazionalismo è stato funzionale al liberalismo poiché è servito a rimediare alle sue carenze: infatti, laddove il liberalismo «chiude gli occhi di fronte all’atomizzazione prodotta da una libertà personale non completata dall’impegno dei cittadini a ricercare il bene comune dalla loro capacità di agire in conformità con quell’impegno» (p. 168), il nazionalismo chiama invece a raccolta gli individui, parlando loro, ad esempio, di etica e di giustizia, realtà relegate dal liberalismo alla sfera privata.
Anche la famiglia non è più un’istituzione durevole, si sgretola con facilità e, «ormai emancipata dalla sua funzione riproduttiva, l’unione sessuale non dà più la sensazione di una via per l’eternità tracciata dalla natura, di uno strumento per costruire la comunità o di un modo per sfuggire alla solitudine, ma una sensazione diversa, tanto piacevole quanto fugace, destinata a essere consumata in un istante insieme ad altre sensazioni nel succedersi degli episodi che scandiscono la vita del solitario collezionista di sensazioni» (p. 48).
L’io, dunque, non può aspirare più ad alcuna pretesa di immortalità, anzi, si sente vulnerabile, in esubero, sostituibile, incapace di influenzare il corso naturale delle cose. Questo ridimensionamento dell’io è testimoniato dal mutamento semantico subìto dal termine greco psyché, che designa ora la personalità, la mente, l’ego, mentre originariamente indicava l’anima e, dunque, una realtà spesso immortale e trascendente.
Quali spazi di autonomia può, allora, rivendicare un soggetto così depotenziato? Per Bauman l’autonomia odierna ha a che fare piuttosto con l’autoreferenzialità, con una concezione monadologica degli individui, poiché alla privatizzazione sfrenata vigente in economia corrisponde l’autarchia dei sentimenti e del disagio. «Occupati come siamo a difenderci o a tenerci alla larga dalla varietà sempre più ampia di alimenti avvelenati, di sostanze ingrassanti, di esalazioni cancerogene, e dagli innumerevoli acciacchi che minacciano il benessere del corpo, ci resta ben poco tempo [….] per rimuginare tristemente sulla futilità di tutto questo» (p. 50). Si spiega così la fortuna dei prodotti dietetici e delle terapie di gruppo dimagranti (weight watchers) molto diffuse in America: questi gruppi sono comunità che condividono analoghi rituali, ma che affidano all’individuo la risoluzione dei suoi problemi. Questo dimostra che, «una volta privatizzato e affidato alle risorse individuali il compito di affrontare la precarietà dell’esistenza umana, le paure esperite individualmente possono solo essere contate, ma non condivise e fuse in una causa comune e rimodellate nella forma di azione congiunta» (p. 54).
Analoga situazione si verifica nei talk-show: la televisione ha invaso la sfera privata irrompendo come un’intrusa nelle pieghe più intime degli individui per esibirle al vasto pubblico (synopticon); tuttavia «gli individui assistono ai talk-show soli con i loro problemi, e quando lo spettacolo finisce sono immersi ancora di più nella loro solitudine» (p. 71). Il paradosso sta nel fatto che gli individui ricercano queste effimere forme di aggregazione proprio per vincere l’isolamento e invece assistono alla spettacolarizzazione di modelli che si sono affermati a prescindere dalla società: il motto kantiano sapere aude, che è considerato l’atto di nascita dell’Illuminismo, viene tradotto attualmente nell’esaltazione del self-made man.
Questa complessiva carenza di autonomia riverbera le sue lacune nella sfera della cittadinanza. L’epoca della globalizzazione del capitale considera i cittadini quasi unicamente come consumatori, i cui desideri sono creati ad hoc dalla pubblicità e dal mercato. Le società occidentali sono paragonabili ad un negozio di dolciumi, poiché il sovraccarico di bisogni indotti e facilmente appagabili dal consumismo rende la vita «punteggiata di attacchi di nausea e dolori di stomaco» (p. 29), anche se i consumatori «non si curano di un’altra vita – una vita piena di rabbia e autodisprezzo – vissuta da quelli che, avendo le tasche vuote, guardano avidamente ai compratori attraverso la vetrina del negozio» (Ivi). Il consumismo produce nuove povertà: sempre meno persone hanno pari opportunità di istruzione, alimentazione, occupazione. Ci si rivolge ai poveri con compassione e turbamento, si tenta di esorcizzarne le ribellioni, la povertà compare spesso nelle piattaforme programmatiche dei vertici fra le potenze occidentali. In realtà, anche la povertà è funzionale al mercato, perché rappresenta, per così dire, la prova vivente di che cosa significhi essere liberi dall’incertezza, per cui «la vista dei poveri impedisce ai non poveri di immaginare un mondo diverso» (p. 181). Ma Bauman osserva che la parte più ricca della società non può essere liberata «dall’assedio della paura e dell’impotenza se la sua parte più povera non viene affrancata: non è questione di carità, di coscienza e di dovere morale, ma una condizione indispensabile (benché soltanto preliminare) per trasformare il deserto del mercato globale in una repubblica di cittadini liberi» (p. 179). Poiché il lavoro viene inteso esclusivamente come lavoro retribuito, il mercato non si pone la questione del reddito minimo garantito, mentre esso permetterebbe a tutti, non solo ai poveri, di migliorare la qualità della vita dedicandosi anche all’otium, «determinerebbe nuovi criteri etici per la vita della società» (p. 186).
I poveri invece sono spesso criminalizzati, insieme agli stranieri, secondo i riti della ben nota mitologia del capro espiatorio (Girard). La socialità, secondo Bauman, si estrinseca, infatti, «talora in orge di compassione e carità», talaltra in scoppi di aggressività smisurata contro un nemico pubblico appena scoperto» (p. 14). L’ansia collettiva, in attesa di trovare una minaccia tangibile contro cui manifestarsi, si mobilita contro un nemico qualunque. Lo straniero viene identificato tout-court con il criminale che insidia l’incolumità personale dei cittadini e i politici sfruttano questo disagio a fini elettorali. In America la pena di morte è ancora vista come il deterrente principale alla criminalità, sicché «l’opposizione alla pena capitale significa il suicidio politico» (p. 21). Ciò ha condotto al «raffreddamento del pianeta degli uomini» (p. 60): il tessuto della solidarietà umana si sta disgregando rapidamente e le nostre società sono sempre meno accoglienti.
Bauman individua quale strategia risolutiva a questa situazione di disagio il recupero dello spazio privato/pubblico dell’agorà, la società civile. È «lo spazio in cui i problemi privati si connettono in modo significativo, vale a dire non per trarre piaceri narcisistici o per sfruttare a fini terapeutici la scena pubblica, ma per cercare strumenti gestiti collettivamente abbastanza efficaci da sollevare gli individui dalla miseria subita privatamente» (p. 11). Solo nell’agorà è possibile costruire una società autonoma, capace di autocritica, di autoesame, di discussione e ridefinizione del bene comune. «La società autonoma ammette apertamente la mortalità intrinseca di tutte le creazioni e di tutti i tentativi di derivare da quella fragilità non scelta l'opportunità di un'autotrasformazione perpetua, magari anche di un progresso. L'autonomia è uno sforzo congiunto, concertato, di trasformare la mortalità da maledizione in benedizione… Oppure, se si vuole, l'audace tentativo di utilizzare la mortalità delle istituzioni umane per dare vita eterna alla società umana» (p. 88). Gli intellettuali dovrebbero riappropriarsi della politica, inseguire le «tracce di paideia» (p. 104) disseminate qua e là all’interno della società civile, riformare, educare, stimolare, evitando di arroccarsi in una filosofia lontana dall’uso comune del linguaggio e del logos.
La riconquista dell’autonomia deve passare attraverso gli individui poiché «non esiste autonomia sociale senza quella dei singoli membri di una società» (p. 140). In un’epoca in cui le ideologie, sia in senso settecentesco che marxista sono in crisi, in un’epoca in cui la stessa idea di crisi non designa più, secondo l’originario significato medico, un’evoluzione cruciale positiva o negativa, ma un disagio complessivo della civiltà, è necessario che le istituzioni recuperino il potere decisionale che spetta loro. Solo nell’agorà è possibile recuperare il valore delle differenze: spesso, infatti, si confonde la crisi dei valori con la loro molteplicità e abbondanza, ma «se la molteplicità dei valori che richiedono un giudizio e una scelta è il segno di una crisi dei valori, allora dobbiamo accettare che tale crisi sia una dimora naturale della moralità: soltanto in quella dimora la libertà, l’autonomia, la responsabilità e il giudizio […] possono crescere e maturare» (p. 153). La globalizzazione ha sostituito l’universalismo e la reciprocità tra le nazioni; d’altra parte appare fuorviante anche il termine multiculturalismo, spesso usato dai sociologi, perché «suggerisce che l’appartenenza a una cultura non sia una scelta, ma un dato di fatto […] implica tacitamente che essere inseriti in una totalità culturale è il modo naturale, e dunque presumibilmente sano, di essere-nel-mondo, mentre tutte le altre condizioni – lo stare all’incrocio delle culture, l’attingere contemporaneamente a differenti culture o anche soltanto l’ignorare l’ambivalenza culturale della propria posizione – sono condizioni anomale» (p. 200). L’agorà non è nemica della differenza, non esige di abdicare alla propria identità culturale. Solo all’interno dell’agorà è possibile acquisire il valore della diversità come arricchimento dell’identità individuale e sociale.
Bibliografia citata
- Berlin Isaiah, Two Concepts of Liberty, in Four Essays on Liberty, Oxford, Oxford UP, 1982
(tr. it. in Quattro saggi sulla libertà, Feltrinelli, Milano 1989)
- Girard, René, Le bouc missaire, Paris, Editions Grasset & Pasquelle, 1982.
(tr. it., Il capro espiatorio, Adelphi, Milano, 1987)
- Kundera, Milan, L’identité, Milan Kundera, Paris, 1997
( tr. it., L’identità, Milano, Adelphi, 1997)
Indice
Ringraziamenti - Introduzione
1. In cerca dello spazio pubblico: Un tipo sospetto si aggira nei dintorni; Il calderone dell'Unsicherheit; Sicurezza insicura; Certezza incerta; Incolumità a rischio; Paure che cambiano; Il raffreddamento del pianeta degli uomini.
2. In cerca di rappresentanze: Paura e riso; Quanto è libera la libertà?; La decostruzione della politica; Dove privato e pubblico si incontrano; L'attacco all'agorà: le due invasioni; Tracce di paideia.
Primo excursus. L'ideologia nel mondo postmoderno; Il concetto essenzialmente controverso; La realtà essenzialmente controversa; Il mondo non più essenzialmente controverso.
Secondo excursus. Tradizione e autonomia nel mondo postmoderno. Terzo excursus. La postmodernità e le crisi morale e culturale
3. In cerca di modelli: La seconda riforma e l'emergere dell'uomo modulare; Tribù, nazione e repubblica; Democrazia liberale e repubblica; Un bivio; L'economia politica dell'incertezza; La causa dell'uguaglianza nel mondo dell'incertezza; Le ragioni del reddito minimo garantito; Richiamare l'universalismo dall'esilio; Multiculturalismo - o polivalenza culturale?; Vivere insieme nel mondo delle differenze
Note - Postfazione di Alessandro Dal Lago - Indice analitico
L'autore
Zygmunt Bauman è professore emerito di Sociologia nelle Università di Leeds e Varsavia. Tra le sue opere recenti tradotte in italiano: Modernità e Olocausto (1992), Il teatro dell'immortalità Mortalità, immortalità e altre strategie di vita (1995), Le sfide dell'etica (1996), La società dell'incertezza (1999), Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone (1999), Modernità liquida (2002), La società individualizzata (2002).
Link
www.alice.it/news/news/n20030911.htm
Sito in lingua italiana, contiene interviste allo stesso Bauman, ma anche a scrittori quali Grossman e Arundhati Roy
Siti in lingua inglese, tracciano un profilo dell’attività sociologica di Bauman:
www.tcd.ie/Sociology/readinglist/sfsociologicalimagination.htm
www.inter-disciplinary.net/mso/dd/dd2/s2.htm
00:05 Publié dans Philosophie, Sociologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, sociologie, zygmunt bauman, néolibéralisme, globalisation, globalisme, mondialisme, citoyenneté |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 05 novembre 2010
Il n'y a que la mauvaise presse qui sauve ou Philippe Muray ressuscité
Il n'y a que la mauvaise presse qui sauve ou Philippe Muray ressuscité
«Par ailleurs, il devient facile de reconnaître un écrivain conformiste : c’est celui, tout simplement, qui se flatte le plus haut et le plus fort d’être politiquement incorrect.»
Philippe Muray.
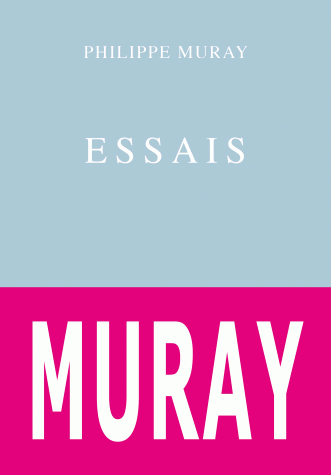 À propos de Philippe Muray, Essais (Éditions Les Belles Lettres, 2010).
À propos de Philippe Muray, Essais (Éditions Les Belles Lettres, 2010).
Nous ne sommes jamais assez durs avec les journalistes, c'est peut-être ce que découvrit aussi, avec un peu de stupeur tout de même, Elias Canetti. Leur médiocrité est toujours un cran au-dessus (ou au-dessous, c'est affaire de perspective) de celle que, par compassion plus qu'ignorance, nous avions cru être le maximum qu'un être humain pût supporter sans se dissoudre instantanément. Comme les créatures des très grandes profondeurs sous-marines, les journalistes se sont adaptés à des pressions extrêmes, n'ont pas besoin de lumière, se nourrissent des déchets qui lentement glissent vers leurs petites bouches translucides et, pour certains, parviennent même à écrire sans avoir, une seule fois, pris la peine de remuer leurs branchies atrophiées.
Tous ont beau ne pas être les résidents de la fosse dite de Marianne, ils n'en sont pas moins extrêmophiles, comme disent les biologistes qui paraissent tous les jours découvrir de nouvelles espèces de ces monstres mous habitués à l'obscurité la plus impénétrable. Vivants, ils sont morts car, à de pareilles profondeurs, toute dépense d'énergie inutile peut être létale. Ils végètent, ils planctonnisent, ils regardent parfois, de leurs gros yeux globuleux et aveugles, le ciel impénétrable et très profondément noir qui tend sa gueule au-dessus d'eux.
Vivants, s'agitant, ils sont déjà morts et se nourrissent de la chair de certains morts, mille fois plus vivants qu'eux.
Voyez-les, tous ces imbéciles claironnants et demi-soldes boulevardiers qui découvrent Philippe Muray quelques années seulement, ce n'est déjà pas si mal me dira-t-on, après sa mort, et encore, pressés qu'ils sont d'écrire leurs petits articulets navrants et incultes pour ne pas paraître en reste de ceux de leurs confrères, bluettes elles-mêmes incultes et creuses, voyez-les qui rédigent des papiers tellement originaux que le plus scrupuleux des experts en faux ne pourrait établir aucune différence entre eux. Ils s'agitent. Ils frétillent. Ils bavardent. Ils ne créent rien, car ils sont morts bien que vivants, et le règne des morts-vivants est une constante mais inéluctable pétrification, comme nous le voyons dans l'étonnant conte de Michel Bernanos. Il y a plus de différences entre deux ouvrières d'une termitière japonaise qu'entre deux journalistes qui partagent la même table de restaurant, rêvent de partager la même maîtresse et, quoi qu'il en soit, défendent les mêmes idées, c'est-à-dire celles qui sont l'émanation de l'air du temps.
Même le très gauchi et bientôt centenaire Jean Daniel, m'a-t-on dit, s'est subitement mis à trouver du génie à son illustre cadet contempteur, Philippe Muray, promettant à son fantôme ironique de sonner l'hallali, le derrière vissé sur sa bréhaigne, pour une cavalcade poussive de quelques centimètres sur les pâtures du lieu commun. Il ne sera pas dit que l'illustre Jean Daniel a méprisé, du moins après son trop court séjour sur terre, Philippe Muray.
Élisabeth Lévy elle-même, inflexible Cassandre du marronnier réactionnaire plutôt que du scoop véritable, causeuse lassante y compris même lorsqu'elle consent à vous laisser parler, journaliste point trop inintéressante tout de même lorsqu'elle écrit plutôt qu'elle bavarde, ronchonneuse professionnelle qui a réussi à faire reconnaître aux services de l'État la profession de mouche du coche, moderne incarnation d'une Amazone de toute éternité contrariée et peut-être même de tous les dangers réunis de la sauvage Amazonie ou de ce qu'il en reste, walkyrie miniaturisée du verbe journalistique qui ne rate jamais une occasion de se prétendre femme jusqu'aux bouts de ses flèches enduites de curare et d'affirmer qu'elle ne doit rien aux hommes (pas même sa propre naissance, référence faite à une conversation animée, désormais ancienne, en présence de Maurice G. Dantec), Élisabeth Lévy en personne n'a pas eu assez de mains et de pieds pour serrer tous ceux de ses collègues journalistes masculins lors de telle récente soirée privée (ce mardi 21 septembre vers 18 heures, au Lucernaire, un restaurant naguère fréquenté par Muray) où elle but les paroles de Fabrice Luchini, pas franchement dupe du cirque qui l'entourait et même, bien que disert et aimable, étrangement réservé.
Bien évidemment, unique couac (ou peu s'en faut) dans cette magnifique symphonie en culbute majeure, j'aurais quelque mauvaise grâce à ne point saluer le mystérieux regain d'intérêt dont paraissent (restons prudents) bénéficier les livres (en l'occurrence, ses exorcismes spirituels, regroupés en un seul beau volume préparé par Vincent Morch pour les Belles Lettres) de Muray mais enfin, nul ne m'en voudra je l'espère de jeter quelque sonde soupçonneuse dans la flache de cette subite attention, ni même de gentiment moquer le fait que le meilleur livre de cet auteur, le livre même qu'il n'a fait que décliner ou répéter jusqu'à sa mort, je veux bien sûr parler du XIXe siècle à travers les âges, est tout aussi étonnamment absent des meilleures ventes de la rentrée, catégorie essais comme il se doit.
Gageons même que cette si propitiatoire période de ventes d'ouvrages de qualité soit elle-même affublée d'une tare que Philippe Muray avait caractérisée de la façon suivante : «Il n’y a pas de lucidité sans séparation. Il n’y a pas non plus de littérature sans conflit et sans aggravation de conflit» (1).
Nous pouvons tirer deux postulats de cette constatation trempée, comme l'acier, dans un bain d'eau froide. D'abord, puisque nous voici plongés dans la mélasse la plus indifférenciée où gauche et droite se disputent la dépouille aimablement désagréable d'un mort et tentent de convoquer au-dessus de leur table barbante son mauvais génie posthume, le phénomène auquel nous assistons est tout ce que l'on voudra sauf le témoignage d'une miraculeuse prise de conscience, pour ne point évoquer, comme Muray le fait, quelque lucidité qui n'est tout de même pas la vertu la mieux partagée par nos contemporains, surtout s'ils exercent la profession immodeste de journaliste.
Ensuite, puisque ce remarquable et sans contestation possible mélodique accord sur la portée des œuvres de Muray nous a plongés dans le sucre candi des bons sentiments qui creusent, comme des larves de mouches, leur nid douillet dans la dépouille d'un auteur qui fut un redoutable vivant, il y a fort à craindre que la littérature soit, de nouveau l'absente des bouquets de toutes ces fiancées froides qui pleurent la mort d'un fiancé et même celle d'un véritable père, d'un père plus intensément père en ceci qu'il ne présente aucun lien de parenté avec les intéressées.
Pardon, vous me dites qu'il n'y a, encore elle, qu'Élisabeth Lévy qui menace de faire monter le niveau de la Seine à force d'ouvrir les vannes cyclopéennes de ses conduits lacrymaux ? J'ai cru qu'elles étaient au moins un bon millier, ces Antigones s'arrachant de douleur les cheveux et criant sur tous les toits, sur tous les plateaux de télévision, sur toutes les ondes radiophoniques que c'était bel et bien le corps maltraité de leur propre malheureux frère qui était laissé sous les soleils corrupteurs des flashs des photographes qui, par conscience professionnelle sans doute, se déclarent près à déterrer un cadavre pour voir si sa texture réactionnaire l'a affublé de particularités anatomiques troublantes.
Non, il n'y a sur scène, vérification faite auprès du metteur en scène de notre impeccable et si actuelle tragédie, qu'Élisabeth Lévy mais celle-ci, phénomène qui devrait passionner et intriguer les physiciens de l'étrange et même les frères Bogdanoff, semble posséder la particularité d'être sur plusieurs plateaux d'émissions télévisées en même temps, à seule fin d'y délivrer son message aussi convenu que le bruit d'un coucou d'horloge suisse, prêt-à-consommé de crieuse et gouaille vulgaire de cabaretière éraillée rendant grâce au père, maître, intercesseur, modèle et bientôt bienheureux Philippe Muray d'avoir irrigué de sa sève polémistique les plates-bandes où poussent ses quelques navets journalistiques de si pâle couleur qu'on les confond avec des feuilles de gélatine.
La si brillante et versicolore réacosphère, ce mélange improbable de petits frontistes se planquant derrière des pseudonymes, de gros beaufs avinés commentant, comme le matin ils sont accoudés au zinc et le ballon de blanc faisant cercle sur un exemplaire de SAS, les communiqués immondes, suintant la haine et la peur la plus ignoble, la crispation identitaire autour de belles valeurs gersoises qu'hélas ces lamentables vivandiers de l'action politique véritable n'illustrent guère par leurs écrits, émis, avec un sérieux d'un grotesque inégalé, par le ridicule Parti de l'In-nocence de Renaud Camus, cette si probe congrégation d'évanescents ectoplasmes appartenant, par leur seul corps astral, à la Nouvelle Droite, ce maigre raout de puceaux proches de la quarantaine qui croient sans rire que Kierkegaard, Chesterton, Unamuno et peut-être même le Christ en personne leur soufflent à l'oreille les phrases suintantes de prétention et de vulgarité qui composent leur catéchisme névrosé et enfin ce bordel bien sous tout rapport composé de vieilles demi-mondaines confondant hostie et godemiché et ne se rendant pas compte qu'elles risquent une déchirure anale plutôt qu'une excommunication papale, la réacosphère donc, mutualisation de talents nanométriques et de prétentions himalayesques adore, mais alors là vraiment adore, paraît-il, les textes d'Élisabeth Lévy.
Ce doit donc être, hypothèse la plus sobre, un fameux signe d'excellence. Il est vrai que cette même réacosphère aime immodérément Philippe Muray, qu'elle ne cite d'ailleurs jamais très précisément, se contentant de tirer, sur sa face blême et maladive, un peu de la lumière crue que Muray dirige toujours, avec une cruauté raffinée, sur ses cibles fuligineuses.
Revenons au texte de Muray, qui poursuit, dans le même ouvrage : «Un critique, plutôt que de perdre son temps à analyser tous les romans de néo-sacristains, tous ces livres rédigés avec un style directement trempé dans le préservatif, pourrait s’amuser à les rapprocher de slogans publicitaires connus, montrer qu’ils se ramènent tous à l’une ou l’autre des injonctions récentes de la pub» (p. 13).
Un bon critique, colligeant donc les différents titres qui ont récemment fleuri à propos de la découverte, par de hardis paléontologues, d'un nouveau type humanoïde baptisé Homo festivus festivus (en somme, le sursinge qui prend conscience du fait qu'il fait la fête) en hommage à celui qui en avait théorisé le chaînon clinquant, Philippe Muray, pourrait donc montrer qu'ils ne sont que la forme la plus récente, et déjà parfaitement obsolète, de l'éternelle hydre publicitaire, dont voici quelques têtes sans beaucoup de cerveau : Exorcismes spiritueux pour Philippe Lançon (Libération Livres du 24 juin) qui commence nullement par un «Être de son époque, c'est savoir la détester», Désaccord parfait pour Laurent Lemire (Livres Hebdo du 16 septembre) qui, encore plus stupidement, n'a pas peur de faire hurler de rire ses lecteurs en calant dès son point de badinage : «Il y avait quelque chose de vrai chez Philippe Muray (1945-2006), c'est ce qu'il pensait», Le mieux-disant pour l'inégalable Aude Lancelin (Le Nouvel Observateur, semaine du 22 au 28 juillet), qui bavarde sur Fabrice Luchini, cet interprète de la Modernité qui, non content d'avoir mis Paris à ses pieds, a bel et bien réussi l'exploit de faire courber la nuque si raide de quelques journalistes après leur avoir déclaré qu'il n'était pas plus de droite que de gauche. Quoi d'autre encore, puisqu'il est vrai que même le canard le plus déplumé de France et de Navarre y est allé de sa petite bluette admirative pour Muray, histoire de ne pas rater la curée journalistique et peut-être même, qui sait, d'être repéré par les grosses légumes parisiennes ? Le petit-fils naturel de Georges Bernanos, Sébastien Lapaque, le sobre François Taillandier pour Le Figaro ou sa déclinaison en revue, le si mélomane Benoît Duteurtre (Marianne du 25 septembre) qui fait mine de s'extasier sur les rythmes délicieusement reggae du très oubliable Ce que j'aime ou l'intrusion de Léon Bloy dans la comptine pré-natale, tandis que Pierre Bottura (Philosophie Magazine du mois d'octobre) nous révèle, bien conscient qu'il prend des risques peut-être exagérés, que Philippe Muray était «romancier, essayiste et critique d'art», travail d'enquête tout de même moins poussé que celui de Tristan Savin (pour Lire du mois d'octobre), lequel rend grâce à l'histrion Luchini d'être un histrion. Subtile fausse note, celle émise par Alain Finkielkraut, l'autre père spirituel et intellectuel de notre chère Élisabeth, encore elle, note grinçante bien évidemment recueillie par l'antenne d'Arecibo d'une extrême finesse qu'est notre impénitente journaliste (Causeur numéro du mois de septembre) qui remet le couvert pour Le Point (du 16 septembre) où elle nous apprend que, chez Muray, «jubilation et exécration sont sœurs».
Si je n'avais pas connu les livres de Muray depuis quelques années, ces poussées hormonales imprimées sur papier recyclable m'auraient-elles donné envie de me jeter sur eux ?
Je ne crois pas.
Je suis même certain que non.
Il n'y a pas seulement, hélas, dans la canonisation actuelle dont Philippe Muray est la victime muette, que dévaluation du verbe, ce qui ne doit point nous étonner puisqu'il s'agit là de la plus constante et habituelle production des bouches mécaniques que sont les journalistes. En effet, si, selon notre redoutable polémiste, l'histoire de la littérature est celle des «prospérités de l'irrespect» (p. 250), nous ne pouvons que constater que Philippe Muray n'est point salué comme un véritable écrivain mais, tout au plus, comme un penseur réactionnaire, c'est-à-dire peu ou prou comme un fâcheux en perpétuelle colère contre le monde entier et nageant à contre-courant du fleuve tranquille où la France finit de noyer son ennui vertueux de n'être plus rien.
Puisque le fantôme de Muray est ces derniers temps très sollicité, j'oserai abuser quelque peu de son temps et poursuivre la lecture d'un de ses recueils de textes. Qu'est-ce qu'un bon critique selon Philippe Muray qui doit décidément se tordre de rire en nous observant du coin de l'œil ? C'est en tout premier lieu un esprit qui s'écarte de la foule et ne salue, dans un livre, que son essence la plus profondément romanesque, rien, donc, qui puisse ressembler au charlatanisme actuel consistant à mélanger pseudo-verve et acrimonies habituelles contre l'air du temps. Qu'est-ce dire ? Que Muray place la tâche du critique à une magnifique hauteur, la leste d'une lourde responsabilité. La critique est, ni plus ni moins, une œuvre qui répond à une œuvre. Non point un Du Bos, ni même un Thibaudet ou un Sainte-Beuve mais, tout simplement, tout impossiblement, un Conrad, un Joyce, un Faulkner, un romancier extravagant, un romancier sans roman, un maître du langage second cher à Foucault qui n'aurait pour seule mission que celle de pénétrer les romans qu'il n'a pas écrits, qu'il ne peut pas écrire, avec la souveraine vision de leur propre créateur.
C'est quelqu’un donc, ce critique idéal sinon rigoureusement surhumain, qui ne se considérerait pas comme «un agent culturel destiné à signaler au public des produits culturels (les livres), quelqu’un qui serait donc également un bon critique de la société [apte à devenir] un spécialiste de toute la consternante fantasmagorie qui tend socialement à rendre le roman impossible» (pp. 4-5).
Et Muray de poursuivre en écrivant que : «La connaissance de l’ennemi, la science de l’ennemi des romans, c’est-à-dire de presque tout ce qui se met en place, aujourd’hui, sous nos yeux (y compris dans certains romans, dans ceux que je viens d’évoquer par exemple, les livres de la nouvelle Bibliothèque rose universelle, les romans de l’École des sacristains), voilà ce qui pourrait être le propre de la critique, d’une critique faite dans l’intérêt de l’art romanesque, et non dans le dessein de s’auto-célébrer, de justifier sa propre existence ou carrément de nuire, comme les deux charlatanismes critiques, l’universitaire et le médiatique […]» (p. 14).
Curieux que nul, à ma connaissance du moins, n'ait songé à commenter cette célébration si spontanée et post-mortem du génie de Philippe Muray en l'éclairant par la seule lumière qui en révélerait la part d'ombre. Nous sommes ainsi parvenus au cœur de notre sujet, comme le fantôme de Muray d'ailleurs ne manque pas de nous le confirmer d'un sourire à peine esquissé.
C'est d'ailleurs, une fois de plus, l'auteur lui-même qui nous donne la clé de ce rituel propitiatoire autour d'une tombe encore fraîche, clé qui nous fait retrouver la magnifique ligne de basse qui cimente l'architecture du XIXe siècle à travers les âges. Cette clé est fort commune, qui ouvre pourtant toutes les portes, y compris celles qui sont réputées être les plus inviolables. Lisons Muray puisque c'est ce que ne font pas, jamais, nos amis les journalistes : «La Révolution française, mouvement de panique contre cette sortie du religieux, sursaut de révolte contre la mort des dieux, tentative de retrouver par la terreur (et d’abord par l’exécution d’un roi de «droit divin», reprise modernisée des rituels sacrificiels de rétablissement de l’ordre social dans les communautés primitives) la légitimité transcendante volée au peuple par le souverain et son clergé, bruits et clameurs contre la désertification de l’espace magique (restauration des fêtes de la Fertilité universelle), ne pouvait donc pas voir le jour dans un pays protestant, par exemple, pour la bonne raison que la Réforme y avait déjà opéré le réancrage rationnel et social du religieux et que les liens de parenté y avaient été énergiquement renoués contre la Rome vaticane déréalisante, déterritorialisante, désubstantifiante» (p. 344).
Les festivités qui ont depuis quelques semaines lieu autour de la dépouille de Philippe Muray sont donc liées à une cérémonie propitiatoire, voire fertilisante, sur laquelle Jeanne Favret-Saada a mené ses patientes enquêtes qui toutes ont révélé le fait que, à l'insu bien sûr de celles et ceux qui en constituent les participants enfiévrés, les prestiges secrets du sacré ne s'exposent jamais mieux que dans les mouvements de foule. La ruse de notre âge est de remplacer par une fausse spontanéité l'évidence charnelle tout autant que symbolique de gestes parfois incompris, transmis néanmoins pieusement au fil des générations, qu'il s'agisse de rites impies ou de survivances de croyances païennes. L'âge de la masse a étendu la surface sur laquelle le sacré va agir, faisant lever la pâte du présent insignifiant, parce que cet âge sans âme ni cœur est incapable de totalement le détruire : de quelques personnes vivant en vase clos, communautés religieuses fanatisées ou petits villages gagnés par les démangeaisons de l'interdit, nous voici face à des océans d'être indifférenciés dont les pensées, toutes semblables, paraissent agitées d'un lent mouvement cauchemardesque.
Un mort attire toujours les vivants, pas besoin de lire Monsieur Ouine pour nous en convaincre. Un mort permet aux vivants de se croire plus vivants qu'ils ne le sont en vérité. Ainsi, le consternant spectacle que nous avons sous les yeux est-il le contraire même d'une œuvre critique qui, pour sa part, tenterait de redonner vie, à l'abri des regards curieux, au fantôme qu'est Philippe Muray. Les journalistes se nourrissent d'un mort formidable, eux qui ne vivent pas. Le véritable critique doit rendre Muray à la vie, commander à Lazare de sortir de son tombeau puant, lui redonner chair et réelle présence, en montrant que ses textes ont parfaitement sondé les reins de notre époque, en montrant que Philippe Muray est plus vivant que ses zélateurs nécrophages et ses livres plus réels que leur propre langue saponifiée.
Notre seul guide, dans ce petit exercice de lecture ? Philippe Muray, encore, jamais aussi passionnant que lorsqu'il utilise son flair infaillible pour déterrer l'unique truffe qui fait rêver tous nos cochons : «La connaissance et l’analyse théologiques passeraient donc aujourd’hui par des formes inconnues des pères de l’Église et qui les surprendraient plutôt ? Oui, et il me paraît démontrable, par exemple, que l’enquête accomplie dans ses romans ou nouvelles par quelqu’un comme Flannery O’Connor en plein Sud américain, au cœur même de l’occultisme yankee halluciné, cet autre western hérétique et chamanique mettant en scène des prêcheurs ambulants, des révérends délinquants, des baptistes fous, des guérisseurs échappés d’asile poursuit à sa façon les extraordinaires reportages de saint Irénée de Lyon ou de saint Épiphane sur les officines gnostiques des premiers siècles chrétiens…» (pp. 259-260).
Dans un texte intitulé Il n’y a que la mauvaise foi qui sauve datant de 1985, dont ma note a du reste parodié le titre, Philippe Muray affirme encore que : «La fiction, toute la fiction, toute la nécessité du roman, sortent du coup de théâtre du péché, de l’intuition d’une impureté ou au moins d’un malentendu de base, d’une racine sombre et gluante au fond du fond, d’une Défaite terrible à l’heure du big-bang» (p. 256).
Spécifiquement religieux ou tout simplement utilisant la ruse de l'oraison qu'est le sacré aux milliers de visages, le Verbe ne peut en finir d'épuiser sa cargaison de signes incompréhensibles pour qui refuse de braquer son regard sur un horizon bruissant de révélations.
La conclusion de cette note que l'on affirmera être, dans le meilleur des cas, discordante, est une prière, comme toute conclusion qui se respecte : «Un écrivain religieux, loin du bornage de nos repères plombés, esquisse un vol nomade insaisissable, transversalement, au-dessus des frontières. Un écrivain religieux ne peut être que le véritable nomade de notre temps sans religion, mais plein du bruit et de la fureur de sa mort ressassée» (p. 191).
Un écrivain lucide aussi, cher Philippe Muray.
Notes
(1) Philippe Muray, Rejet de greffe (Exorcismes spirituels, 1) (Les Belles Lettres, 2006), p. X. Les références entre parenthèses renvoient à cet ouvrage, bien évidemment recueilli dans le fort volume récemment publié par Les Belles Lettres. La citation placée en exergue de cette note provient de ce même volume, p. 376 (originellement : La mondification (Autopsie du pacifisme), L’Esprit libre, n°12, 1995).
00:20 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, philippe muray, problèmes contemporains, moeurs contemporaines |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Dentro la globalizzazione: le conseguenze sulle personne
Dentro la globalizzazione: le conseguenze sulle personne
Bauman, Zygmunt, Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone
Laterza, 2002, pp. 152, Euro 6,5, ISBN 88-420-6258-8,
Recensione di Carmen Dal Monte
 “A voler scovare il suo significato più profondo, l’idea di globalizzazione rimanda al carattere indeterminato, ingovernabile e autopropulsivo degli affari mondiali, ancora, fa pensare all’assenza di un centro, di una sala comando, di un consiglio di amministrazione, di un ufficio di direzione.” Questa affermazione di Bauman, che si trova a circa metà (pag. 67) del suo saggio sintetizza la confusione, non solo terminologica, che l’autore sottolinea nell’introduzione. “Globalizzazione” è parola che più che chiarire, confonde e annulla le distinzioni; nell’introduzione Bauman cerca di spiegare come il fenomeno “globalizzazione” si presenti negli aspetti più diversi e all’apparenza inconciliabili. Se, nell’accezione più in voga, globalizzazione e localizzazione sembrano fenomeni opposti, l’analisi del sociologo polacco mostra come in realtà siano due facce della stessa medaglia; la globalizzazione, nei suoi aspetti finanziari ed economici, che sono i suoi aspetti principali, si nutre della localizzazione e della debolezza degli stati nazionali. La distinzione in classi parte dalla divisione degli spazi, chi è separato dallo spazio reale (il capitale finanziario, gli azionisti) ha perso anche le responsabilità che, in qualche modo, segnavano la vita e le azioni del capitalismo moderno: “diversamente da quanto accadeva ai proprietari terrieri assenteisti agli albori dei tempi moderni, i capitalisti e gli intermediari tardo-moderni, grazie alla nuova mobilità delle loro risorse, ormai liquide, non devono fronteggiare limiti sufficientemente reali – solidi, duri, resistenti – che dall’esterno impongano loro linee di condotta.”(p.14). Il mondo si divide, quindi, in globali e locali, in un’élite che vive svincolata dai vincoli spaziali e una maggioranza di persone che ha perso gli spazi caratteristici della formazione della pubblica opinione, e questa distinzione sembra essere molto proficua ai fini della corretta comprensione del mondo contemporaneo.
“A voler scovare il suo significato più profondo, l’idea di globalizzazione rimanda al carattere indeterminato, ingovernabile e autopropulsivo degli affari mondiali, ancora, fa pensare all’assenza di un centro, di una sala comando, di un consiglio di amministrazione, di un ufficio di direzione.” Questa affermazione di Bauman, che si trova a circa metà (pag. 67) del suo saggio sintetizza la confusione, non solo terminologica, che l’autore sottolinea nell’introduzione. “Globalizzazione” è parola che più che chiarire, confonde e annulla le distinzioni; nell’introduzione Bauman cerca di spiegare come il fenomeno “globalizzazione” si presenti negli aspetti più diversi e all’apparenza inconciliabili. Se, nell’accezione più in voga, globalizzazione e localizzazione sembrano fenomeni opposti, l’analisi del sociologo polacco mostra come in realtà siano due facce della stessa medaglia; la globalizzazione, nei suoi aspetti finanziari ed economici, che sono i suoi aspetti principali, si nutre della localizzazione e della debolezza degli stati nazionali. La distinzione in classi parte dalla divisione degli spazi, chi è separato dallo spazio reale (il capitale finanziario, gli azionisti) ha perso anche le responsabilità che, in qualche modo, segnavano la vita e le azioni del capitalismo moderno: “diversamente da quanto accadeva ai proprietari terrieri assenteisti agli albori dei tempi moderni, i capitalisti e gli intermediari tardo-moderni, grazie alla nuova mobilità delle loro risorse, ormai liquide, non devono fronteggiare limiti sufficientemente reali – solidi, duri, resistenti – che dall’esterno impongano loro linee di condotta.”(p.14). Il mondo si divide, quindi, in globali e locali, in un’élite che vive svincolata dai vincoli spaziali e una maggioranza di persone che ha perso gli spazi caratteristici della formazione della pubblica opinione, e questa distinzione sembra essere molto proficua ai fini della corretta comprensione del mondo contemporaneo.
La prima traccia di questo binomio può essere colta nella “mobilità”, divenuta fattore di prestigio che, al tempo stesso, unifica e divide, creando due classi sociali ben separate, da un lato le élites di potenti e dall’altro la grande massa dei “locali” che non solo incide sempre meno sulla vita e sulla società, ma che ne ha perso – secondo Bauman dai primi anni ottanta – anche il diritto. E il concetto di spazio, al quale viene dedicato il secondo capitolo, viene rivisto a partire dalla sua storia moderna, con le costruzioni spaziali degli utopisti e degli architetti e attraverso la lente predisposta da Foucault; il controllo dello spazio, e degli spazi dell’elaborazione sociale, della pubblica opinione, della politica è la battaglia della formazione dello stato moderno e oggi, la sconfitta degli stati di fronte al fenomeno della globalizzazione, si misura anche sottolineando la scomparsa degli spazi locali e cittadini di formazione dell’opinione: “ «L’economia», il capitale, cioè il denaro e le altre risorse necessarie a fare delle cose, e ancor più denaro e più cose, si muove rapidamente; tanto da tenersi sempre un passo avanti rispetto a qualsiasi entità politica (come sempre, territoriale) che voglia contenerne il moto e farne mutare direzione. […] Qualsiasi cosa che si muova a una velocità vicina a quella dei segnali elettronici è praticamente libera da vincoli connessi al territorio all’interno del quale ha avuto origine, verso il quale si dirige, attraverso il quale passa” (pag. 63). E così, in quella che Bauman chiama “la nuova espropriazione” si manifesta la trasformazione delle prerogative classiche dello stato nazione: il ruolo dello stato è divenuto solo quello dell’esecutore di forze che non è in grado di controllare; la nascita di nuove entità territoriali, sempre più deboli, va a favore delle nuove forze economiche; la redistribuzione del potere è già avvenuta, dagli stati nazione alla finanza globalizzata.
Integrazione e parcellizzazione, scrive Bauman, globalizzazione e territorializzazione sono processi complementari, anzi, sono due facce dello stesso processo, che sta ridistribuendo su scala mondiale sovranità, potere e libertà d’azione, (pag. 78).
Bauman individua in questo contesto due tipologie di persone: “Turisti e vagabondi”, cui egli dedica il quarto capitolo del suo studio. Partendo dalla considerazione, ormai nota, della nostra importanza come consumatori piuttosto che come produttori, Bauman coglie un elemento particolare: la necessaria transitorietà anche dei consumi, e dei desideri. Lo scopo del gioco del consumo, sintetizza Bauman, non è tanto la voglia di acquisire e di possedere, né di accumulare ricchezze in senso materiale, tangibile, quanto l’eccitazione per sensazioni nuove, mai sperimentate prima, (pag. 93). Questi nuovi consumatori sono i turisti, per i quali muoversi nello spazio non pone più vincoli e resta solo la dimensione temporale, che ha assunto la forma dell’eterno presente; i vagabondi, al contrario, vivono nello spazio, uno spazio dal quale sono scacciati, uno spazio che ha confini invisibili ma invalicabili. Per le merci e le élites – finanziarie, accademiche, manageriali – non esistono vincoli di territorio, per i “vagabondi” il mondo è a vivibilità limitata, limitati dai quartieri delle metropoli a controllo elettronico, dalle frontiere, dalle leggi sull’immigrazione, dalla “tolleranza zero.
L’esplicitazione delle conseguenze della globalizzazione sulle persone, promessa dal titolo del testo, consiste quindi nella divisione tra turisti e vagabondi, con i vagabondi che hanno, come unico sogno, quello di essere turisti, di entrare a far parte dell’élite del consumo immediato e dell’extraterritorialità. Turista e vagabondo sono uno l’alter ego dell’altro; turista e vagabondo sono entrambi consumatori, con la differenza che il vagabondo è un consumatore pieno di difetti, non essendo di grado di sostenere il ritmo di consumi al quale aspira. Se il vagabondo invidia la vita del turista e vi aspira, a sua volta il turista, nella sua fascia media, ha il terrore che il suo status, del tutto precario, possa cambiare all’improvviso. Il vagabondo, scrive Bauman, è l’incubo del turista, “mentre pretende che il vagabondo sia nascosto sotto il tappeto, fa bandire il mendicante e il barbone dalla strada, confinandolo in lontani ghetti dove «non si va», chiedendone l’esilio o l’incarcerazione, il turista cerca disperatamente, ma tutto sommato invano, di cancellare le sue proprie paure” (pag. 108).
L’ultimo capitolo è la conclusione, quasi obbligata, di un’analisi lucida e spietata; Bauman mostra come lo stato-nazione abbia, quasi come unica prerogativa, quella di mantenere l’ordine, garantendo ad alcuni un’esistenza ordinata e sicura e utilizzando a questo scopo, sugli altri la forza della legge. Lo stesso concetto di “flessibilità” del lavoro, in apparenza “neutro”, “economico”, nasconde la redistribuzione del potere: flessibilità vuol dire offrire al capitale la possibilità di muoversi, escludendo i locali dalla stessa possibilità. Mobilità e assenza di mobilità sono i due lati della questione, e lo stato ha il compito determinato dalla globalizzazione, di “gestire il locale”. E qui, attraverso le riflessioni di Pierre Bourdieu, si torna alla storia della società di Foucault: da sempre, il gioco dello stato nel controllo dell’ordine pubblico si estrinseca attraverso la restrizione degli spazi, la reclusione. E, sottolinea Bauman, uno dei maggiori problemi negli Stati Uniti, senza dubbio l’esempio più maturo della globalizzazione, è proprio quello relativo alle prigioni.
Dal Panopticon di Bentham, non a caso esempio del Settecento, secolo in cui, secondo Bauman, comincia la globalizzazione, fino al progetto della prigione di Pelican Bay in California (interamente automatica, in cui i reclusi non hanno contatti né con le guardie né con gli altri reclusi) il cerchio sembra chiudersi. Dalle case di lavoro dei secoli passati a Pelican Bay dove ai prigionieri non è concessa nessuna attività, perché nessuna attività è richiesta dal mercato. La “rieducazione” e il dibattito intorno ad essa, avevano un senso in un mondo in cui l’economia richiedeva forza lavoro, certamente non in una economia globalizzata. E le prigioni sono entrate nell’era che Bauman definisce “post correzionale”, in cui le paure della gente portano a chiedere ai governi risposte sempre più dure: costruire nuove prigioni, inasprire le pene, introdurre nuovi reati sono la cartina di tornasole per mostrare che il potere politico si muove, agisce, ha sotto controllo il territorio. Ma nel mondo della finanza globale “ai governi è attributo un ruolo non molto più ampio di quello assegnato a questure o commissariati di polizia” (pag. 132). Il libro di Bauman ben si inserisce nel dibattito sulla globalizzazione, sia perché sposta l’analisi dal campo economico a quello politico e sociale, sia perché riesce, in un saggio breve e lucido, a fare il punto sulle ambiguità e gli equivoci che il termine “globalizzazione” porta con sé e lo fa affrontandone i problemi più importanti legati sia ai diritti degli individui sia alle particolari situazioni esistenziali che ne derivano come conseguenza.
Indice
Introduzione
1. Tempo e classe - I proprietari assenti: la versione dei nostri giorni; Libertà di movimento e «costituzione» delle società civili; Nuova velocità, nuova polarizzazione
2. Guerre spaziali: una cronaca - La battaglia delle mappe; Dalla cartografia alla progettazione dello spazio; L'agorafobia e il rinascimento della località; C'è una vita dopo il Panopticon?
3. E dopo lo stato-nazione? - Diventare universali o lasciarsi globalizzare?; La nuova espropriazione: stavolta dello stato; La gerarchia globale della mobilità
4. Turisti e vagabondi - Consumatori nella società dei consunti; Divisi muoviamo; Attraversare il mondo o vederselo passare accanto; Uniti nella buona e nella cattiva sorte
5. Legge globale, ordini locali - Fabbriche di immobilità; Le prigioni nell'era post-correzionale; Sicurezza: un mezzo tangibile per un fine elusivo; I disadattati
Note
Indice dei nomi
L'autore
Zygmunt Bauman è nato in Polonia nel 1925; nel 1939 fugge in Unione Sovietica con la famiglia e durante la guerra fa parte di una formazione partigiana. E’ professore di Sociologia nelle Università di Leeds e Varsavia. In italiano sono stati pubblicati i seguenti testi: Memorie di classe. Preistoria e sopravvivenza di un concetto, Einaudi, 1987; La decadenza degli intellettuali. Da legislatori a interpreti, Bollati Boringhieri, 1992; Il teatro dell'immortalità. Mortalità, immortalità e altre strategie di vita, Il Mulino, 1995; Le sfide dell'etica, Feltrinelli, 1996; Modernità e olocausto, Il Mulino, 1999; La società dell'incertezza, Il Mulino, 1999; Il disagio della postmodernità, Bruno Mondadori, 2000; Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone, Laterza, 2000; La Libertà, Città Aperta, 2002; La solitudine del cittadino globale, Feltrinelli, 2000; Voglia di comunità, Laterza, 2001; Modernità liquida, Laterza, 2002; La società individualizzata. Come cambia la nostra esperienza, il Mulino, 2002; Società, etica, politica. Conversazione con Zygmunt Bauman, Raffaello Cortina, 2002; Intervista sull'identità, Laterza, 2003.
00:10 Publié dans Philosophie, Sociologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sociologie, philosophie, globalisation |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
What did Ezra Pound really say?
WHAT DID EZRA POUND REALLY SAY?
by Michael Collins Piper
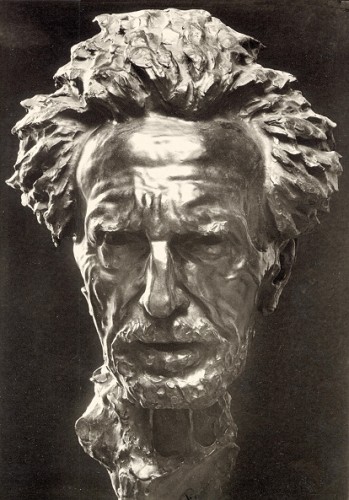 From 1945 through 1958 America's iconoclastic poet--the flamboyant Ezra Pound, one of the most influential individuals of his generation--was held in a Washington, D.C. mental institution, accused of treason. Pound had merely done what he had always done--spoken his mind. Unfortunately for Pound, however, he had made the error of criticizing the American government in a series of broadcasts from Italy during World War II. For that he was made to pay the price. Was Pound a traitor--or a prophet? Read his words and judge for yourself.
From 1945 through 1958 America's iconoclastic poet--the flamboyant Ezra Pound, one of the most influential individuals of his generation--was held in a Washington, D.C. mental institution, accused of treason. Pound had merely done what he had always done--spoken his mind. Unfortunately for Pound, however, he had made the error of criticizing the American government in a series of broadcasts from Italy during World War II. For that he was made to pay the price. Was Pound a traitor--or a prophet? Read his words and judge for yourself.
American students have been taught by scandalized educators that famed American poet and philosopher Ezra Pound delivered "treasonous" English-language radio broadcasts from Italy (directed to both Americans and to the British) during World War II. However, as noted by Robert H. Walker, an editor for the Greenwood Press: "Thousands of people have heard about them, scores have been affected by them, yet but a handful has ever heard or read them." This ignorance of Pound's most controversial political rhetoric is ironic, inasmuch as: "No other American--and only a few individuals throughout the world--has left such a strong mark on so many aspects of the 20th century: from poetry to economics, from theater to philosophy, from politics to pedagogy, from Provencal to Chinese. If Pound was not always totally accepted, at least he was unavoidably there." One critic called Pound's broadcasts a "confused mixture of fascist apologetics, economic theory, anti-Semitism, literary judgment and memory" Another described them as "an unholy mixture of ambiguity, obscurity, inappropriate subject matters [and] vituperation," adding (grudgingly) there were "a few pearls of unexpected wisdom."
Despite all the furor over Pound's broadcasts--which were heard between January of 1941 through July of 1943--it was not until 1978 that a full-length 465-page compendium of transcriptions of the broadcasts was assembled by Prof. Leonard Doob of Yale University in association with aforementioned Greenwood Press. Published under the title "Ezra Pound Speaking"--Radio Speeches of World War II, the volume provides the reader a comprehensive look at Pound's philosophy as it was presented by the poet him self in what Robert Walker, who wrote the foreword to the compendium, describes as "that flair for dramatic hyperbole."
What follows is an attempt to synthesize Pound's extensive verbal parries. Most of what is appears here has never been printed anywhere except in the compendium of Pound's wartime broadcasts. Thus, for the first time ever--for a popular audience--here is what Pound really had to say, not what his critics claim he said. When he was broadcasting from Italy during wartime, Pound evidently pondered the possibility of one day compiling transcriptions of his broadcasts (or at least expected--quite correctly--that one day the transcripts would be compiled by someone else). He hoped the broadcasts would show a consistent thread once they were committed to print. Pound recognized relaying such a massive amount of information about so many seemingly unrelated subjects might be confusing listeners less widely read than he. However, the poet also had very firm ideas about the need of his listeners to be able to synthesize the broad range of material that appeared in his colorful lectures.
Pound was sure his remarks on radio were not seditious, but were strictly informational and dedicated to traditional principles of Americanism--including the Constitution, in particular. In response to media claims that he was a fascist propagandist, Pound had this to say: "If anyone takes the trouble to record and examine the series of talks I have made over this radio it will be found I have used three sorts of material: historical facts; convictions of experienced men, based on fact; and the fruits of my own experience. The facts . . . mostly antedate the fascist era and cannot be considered as improvisations trumped up to meet present requirements. Neither can the beliefs of Washington, John Adams, Jefferson, Jackson, Van Buren, and Lincoln be laughed off as mere fascist propaganda. And even my own observations date largely before the opening of the present hostilities. "I defend the particularly American, North American, United States heritage. If anybody can find anything hostile to the Constitution of the U.S.A. in these speeches, it would greatly interest me to know what. It may be bizarre, eccentric, quaint, old-fashioned of me to refer to that document, but I wish more Americans would at least read it. It is not light and easy reading but it contains several points of interest, whereby some of our present officials could, if they but would, profit greatly." Pound's immediate concern was the war in Europe--"this war on youth--on a generation" --which he described as the natural result of the "age of the chief war pimps." He hated the very idea that Americans were being primed for war, and on the very day of Pearl Harbor he denounced the idea that American boys should soon be marching off to war: "I do not want my compatriots from the ages of 20 to 40 to go get slaughtered to keep up the Sassoon and other British Jew rackets in Singapore and in Shanghai. That is not my idea of American patriotism," he added. In Pound's view, the American government alliance with British finance capitalism and Soviet Bolshevism was contrary to America's tradition and heritage: "Why did you take up with those gangs?" he rhetorically asked his listeners. "Two gangs. [The] Jews' gang in London, and [the] Jew murderous gang over in Moscow? Do you like Mr. Litvinov? [Soviet ambassador to Britain Meyer Wallach, alias Litvinov, born 1876.--Ed.] "Do the people from Delaware and Virginia and Connecticut and Massachusetts . . . who live in painted, neat, white houses . . . do these folks really approve [of] Mr. Litvinov and his gang, and all he stands for?" There was no reason for U.S. intervention abroad, he said: "The place to defend the American heritage is on the American continent. And no man who had any part in helping [Franklin] Delano Roosevelt get the United States into [the war] has enough sense to win anything . . . The men who wintered at Valley Forge did not suffer those months of intense cold and hunger in the hope that . . . the union of the colonies would one day be able to stir up wars between other countries in order to sell them munitions."
What was the American tradition? According to Pound: "The determination of our forbears to set up and maintain in the North American continent a government better than any other. The determination to govern ourselves internally, better than any other nation on earth. The idea of Washington, Jefferson, Monroe, to keep out of foreign shindies." Of FDR's interventionism, he declared: "To send boys from Omaha to Singapore to die for British monopoly and brutality is not the act of an American patriot." However, Pound said: "Don't shoot the President. I dare say he deserves worse, but . . . [a]ssassination only makes more mess." Pound saw the American national tradition being buried by the aggressive new internationalism.
According to Pound's harsh judgment: "The American gangster did not spend his time shooting women and children. He may have been misguided, but in general he spent his time fighting superior forces at considerable risk to himself . . . not in dropping booby traps for unwary infants. I therefore object to the modus in which the American troops obey their high commander. This modus is not in the spirit of Washington or of Stephen Decatur." Pound hated war and detected a particular undercurrent in the previous wars of history. Wars, he said, were destructive to nation-states, but profitable for the special interests. Pound said international bankers--Jewish bankers, in particular--were those who were the primary beneficiaries of the profits of from war. He pulled no punches when he declared: Sometime the Anglo-Saxon may awaken to the fact that . . . nations are shoved into wars in order to destroy themselves, to break up their structure, to destroy their social order, to destroy their populations. And no more flaming and flagrant case appears in history than our own American Civil War, said to be an occidental record for size of armies employed and only surpassed by the more recent triumphs of [the Warburg banking family:] the wars of 1914 and the present one.
Although World War II itself was much on Pound's mind, the poet's primary concern, referenced repeatedly throughout his broadcasts, was the issue of usury and the control of money and economy by private special interests. "There is no freedom without economic freedom," he said. "Freedom that does not include freedom from debt is plain bunkum. It is fetid and foul logomachy to call such servitude freedom . . .Yes, freedom from all sorts of debt, including debt at usurious interest." Usury, he said, was a cause of war throughout history. In Pound's view understanding the issue of usury was central to understanding history: "Until you know who has lent what to whom, you know nothing whatever of politics, you know nothing whatever of history, you know nothing of international wrangles. "The usury system does no nation . . . any good whatsoever. It is an internal peril to him who hath, and it can make no use of nations in the play of international diplomacy save to breed strife between them and use the worst as flails against the best. It is the usurer's game to hurl the savage against the civilized opponent. The game is not pretty, it is not a very safe game. It does no one any credit."
Pound thus traced the history of the current war: "This war did not begin in 1939. It is not a unique result of the infamous Versailles Treaty. It is impossible to understand it without knowing at least a few precedent historic events, which mark the cycle of combat. No man can understand it without knowing at least a few facts and their chronological sequence. This war is part of the age-old struggle between the usurer and the rest of mankind: between the usurer and peasant, the usurer and producer, and finally between the usurer and the merchant, between usurocracy and the mercantilist system . . . "The present war dates at least from the founding of the Bank of England at the end of the 17th century, 1694-8. Half a century later, the London usurocracy shut down on the issue of paper money by the Pennsylvania colony, A.D. 1750. This is not usually given prominence in the U.S. school histories. The 13 colonies rebelled, quite successfully, 26 years later, A.D. 1776. According to Pound, it was the money issue (above all) that united the Allies during the second 20th-century war against Germany: "Gold. Nothing else uniting the three governments, England, Russia, United States of America. That is the interest--gold, usury, debt, monopoly, class interest, and possibly gross indifference and contempt for humanity."
Although "gold" was central to the world's struggle, Pound still felt gold "is a coward. Gold is not the backbone of nations. It is their ruin. A coward, at the first breath of danger gold flows away, gold flows out of the country." Pound perceived Germany under Hitler as a nation that stood against the international money lenders and communist Russia under Stalin as a system that stood against humanity itself.
He told his listeners: "Now if you know anything whatsoever of modern Europe and Asia, you know Hitler stands for putting men over machines. If you don't know that, you know nothing. And beyond that you either know or do not know that Stalin's regime considers humanity as nothing save raw material. Deliver so many carloads of human material at the consumption point. That is the logical result of materialism. If you assert that men are dirty, that humanity is merely material, that is where you come out. And the old Georgian train robber [Josef Stalin--ed.] is perfectly logical. If all things are merely material, man is material--and the system of anti-man treats man as matter." The real enemy, said Pound, was international capitalism. All people everywhere were victims: "They're working day and night, picking your pockets," he said. "Every day and all day and all night picking your pockets and picking the Russian working man's pockets." Capital, however, he said, was "not international, it is not hyper-national. It is sub-national. A quicksand under the nations, destroying all nations, destroying all law and government, destroying the nations, one at a time, Russian empire and Austria, 20 years past, France yesterday, England today."
According to Pound, Americans had no idea why they were being expected to fight in Britain's war with Germany: "Even Mr. Churchill hasn't had the grass to tell the American people why he wants them to die, to save what. He is fighting for the gold standard and monopoly. Namely the power to starve the whole of mankind, and make it pay through the nose before it can eat the fruit of its own labor." As far as the English were concerned, in Pound's broadcasts aimed at the British Isles he warned his listeners that although Russian-style communist totalitarianism was a threat to British freedom, it was not the biggest threat Britain faced: You are threatened. You are threatened by the Russian methods of administration. Those methods [are not] your sole danger. It is, in fact, so far from being your sole danger that I have, in over two years of talk over this radio, possibly never referred to it before.
Usury has gnawed into England since the days of Elizabeth. First it was mortgages, mortgages on earls' estates; usury against the feudal nobility. Then there were attacks on the common land, filchings of village common pasture. Then there developed a usury system, an international usury system, from Cromwell's time, ever increasing." In the end, Pound suggested, it would be the big money interests who would really win the war--not any particular nation-state--and the foundation for future wars would be set in place: "The nomadic parasites will shift out of London and into Manhattan. And this will be presented under a camouflage of national slogans. It will be represented as an American victory. It will not be an American victory. The moment is serious. The moment is also confusing. It is confusing because there are two sets of concurrent phenomena, namely, those connected with fighting this war, and those which sow seeds for the next one." Pound believed one of the major problems of the day--which itself had contributed to war fever--was the manipulation of the press, particularly in the United States: "I naturally mistrust newspaper news from America," he declared. "I grope in the mass of lies, knowing most of the sources are wholly untrustworthy." According to Pound: "The United States has been misinformed. The United States has been led down the garden path, and may be down under the daisies. All through shutting out news.
00:05 Publié dans Littérature, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : économie, philosophie, philologie, ezra pound, etats-unis, lettres, littérature, lettres américaines, littérature américaine, usure, usurocratie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 04 novembre 2010
Un libre penseur: Pierre-André Taguieff

Un libre penseur: Pierre-André Taguieff
Ex: http://unitepopulaire.over-blog.com/
« [Dans] "Contre-réactionnaires – le Progressisme entre Illusion et Imposture" paru il y a six mois, Pierre-André Taguieff fustigeait le pavlovisme d’une certaine gauche qui n’a plus que l’exhortation contre un fascisme imaginaire pour croire en sa vocation – livre qui a d’ailleurs subi l’ostracisme dévolu aux ouvrages mal-pensants. Il est vrai que Pierre-André Taguieff ne s’est pas fait que des amis dans un milieu où la peur d’être blâmé tient parfois lieu d’unique ligne de conduite. Auteur de près d’une vingtaine d’ouvrages, l’intellectuel illustre, à sa manière, l’évolution d’une partie de l’intelligentsia de gauche vers une forme de conservatisme mâtiné de souverainisme, ce qui lui vaudra d’être la cible, avec d’autres, comme Alain Finkielkraut, de campagnes virulentes. [...]
Né en 1946 d’une famille d’immigrés d’Europe centrale, ayant fait ses études à la faculté de Nanterre dans les années 60, Taguieff sera, durant sa jeunesse, un compagnon de route de la mouvance situationniste. Libertaire fasciné par le surréalisme, le jeune homme croit trouver une patrie parmi ces milieux parfois talentueux, mais aussi sectaires et dogmatiques. Très dur à l’encontre de Guy Debord, qu’il considère aujourd’hui comme un gourou aussi sentencieux que nihiliste, il sera néanmoins reconnaissant aux "situs" de lui avoir inspiré de la méfiance à l’endroit des sectes maoïstes et trostkistes qui vont essaimer en France dans le sillage de Mai 68. Devenu enseignant de philosophie dans les années 70, puis directeur de recherche au CNRS, l’homme allait se passionner pour des philosophes de gauche en rupture de ban avec le marxisme comme Claude Lefort, célèbre initiateur, dans les années 60, du groupe Socialisme et Barbarie. [...]
Tout en devenant un expert de ce que les médias ont nommé "populisme" pour qualifier un mouvement protestataire qui monte dans toute l’Europe, Taguieff va critiquer avec virulence la doxa libérale-libertaire ambiante à travers plusieurs livres, notamment "Résister au Bougisme", "Démocratie Forte contre Mondialisation Techno-marchande" ou "L’Effacement de l’Avenir". Il va aussi critiquer sévèrement l’idéologie du métissage, qui n’est que l’inversion de la xénophobie en xénophilie. »
Michel Rival, La Nouvelle Revue d’Histoire n°34, janvier-février 2008
00:18 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : philosophie, france, libre pensée, esprits libres |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Visages de l'archéofuturisme
Après la « Grande Catastrophe » qui a vu sombrer dans le chaos l’ancien système politico-économique du fait de la convergence de désastres de toutes natures, ont subsisté des bulles de survie, sortes de baronnies qui se sont ensuite rapprochées les unes des autres. La nouvelle structure regroupait dans une Communauté des Etats Européens, les anciennes régions de l’Europe Occidentale dotées d’une très large autonomie. Mais de graves problèmes internationaux resurgirent avec de nouvelles menaces. La Russie et ses pays satellites proposèrent alors à la Communauté des Etats européens de fusionner pour assurer l’unité et la défense des « peuples apparentés »: la Fédération Eurosibérienne était née.
La Fédération comporte 125 états autonomes comme les Etats autonomes de Bretagne ou d’Ile de France, la République Romaine et le Royaume d’Albanie, etc. qui s’entendent sur les « questions principales »: quel est l’ennemi commun ? Quel est l’ami commun ? Ils sont représentés face au Gouvernorat impérial installé à Bruxelles, par le Directorat central de la Fédération.
Les litiges internes entre les États de la Fédération sont résolus par un Conseiller plénipotentiaire auprès du Tribunal-Inter-États de Saint Petersbourg et son Prévôt auquel il doit rendre compte, et qui dépend aussi du Gouvernorat impérial de Bruxelles où sont ses bureaux.
Dans la Fédération, on tente de concilier deux principes: l’autorité absolue et la rapidité de décision de l’autorité politique centrale, le Gouvernorat élu par le Sénat Impérial; et une grande liberté d’organisation laissée aux Régions-Etats.
Chacune des Régions-Etats autonomes est libre dans les domaines où elle n’est pas soumise aux compétences du Gouvernorat Impérial, d’organiser ses institutions comme elle l’entend. Elle doit simplement, par les moyens qu’elle désire, désigner un nombre de députés fixé en proportion de sa population au Sénat Fédéral d’Empire.
L’ idéologie officielle de la Fédération est le « constructivisme vitaliste ».
La nouvelle économie techno-scientifique n’est plus, comme autrefois au XXe siècle, destinée à toutes les zones de la Terre ni à tous les humains. Seulement 10 % de l’ humanité en bénéficient, en général regroupés dans les villes, beaucoup moins étendues et peuplées qu’autrefois. Dans la fédération, 20% de la population vit dans une économie industrielle techno-scientifique; ce qui a permis de repeupler les zones rurales désertées et résolu les problèmes de pollution et de gaspillage énergétique.
L’innovation scientifique est très dynamique bien qu’elle ne repose plus sur un énorme marché mondial et ne concerne donc qu’une minorité de la population, les autres étant revenus à une économie rurale, artisanale et pastorale de type médiéval. L’explication de ce dynamisme est simple: le volume global de l’investissement et des budgets publics et privés n’ont plus à se préoccuper des besoins de toutes natures de 80% de la population vivant dans des communautés néo-traditionnelles, selon un système socio-économique archaïque, qui se débrouillent seules et librement pour leur production et leurs échanges, et pour nombre desquelles le solstice d’été est un moment fort
La Fédération Eurosibérienne pratique le libre-échange intérieur, mais ses frontières extérieures sont protégées par des barrières douanières très élevées. Les flux financiers et spéculatifs internationaux n’existent plus.
Dans l’élite, 18% des naissances sont assurées par l’ingénierie génétique: gestations en incubateurs, sans grossesse pour les femmes, avec « amélioration programmée du génome ». Mais cette technique est rigoureusement prohibée dans les communautés néo-traditionnelles et, ailleurs, soumise à l’approbation du Comité Eugénique Impérial. Les enfants issus de cette procréation artificielle sont souvent consacrés « pupilles d’Empire » et placés dans des centres d’éducation qui les transforment en cadres ultra-performants. Seuls les dirigeants et les cadres de la Fédération ont accès au réseau d’informations, l’ EKIS « Euro Kontinent Information Service ». Le système des médias, ouvert à tous, en cours au XXe siècle, a entièrement disparu car, pense-t-on, il aboutissait paradoxalement à la désinformation, à la désagrégation de l’esprit public et créait des paniques.
Les véhicules électriques sont généralisés, les automobiles interdites aux particuliers avec retour aux tractions hippomobiles, prohibition des véhicules à moteur dans les communautés rurales néo-traditionnelles, abandon des autoroutes sur le tracé desquelles ont été construites des lignes de chemin de fer classiques rapides pour le transport des camions et des containers (« ferroutage »), limitation progressive des transports aériens au profit des planétrains, introduction de dirigeables-cargos pour le fret et les transports civils, restauration du réseau des canaux, utilisation mixte des énergies nucléaires et éoliennes pour les transporteurs maritimes, etc.
(dessins de Schuiten)
00:09 Publié dans Nouvelle Droite, Philosophie, Synergies européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle droite, synergies européennes, faye, guillaume faye, archéofuturisme, futurisme, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
El Manifiesto de Unamuno

00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : philosophie, espagne, lettres, lettres espagnoles, littérature, littérature espagnole |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 03 novembre 2010
Confession of a Reluctant Hater

Gregor JOHNSON
Ex: http://www.counter-currents.com/
Author’s Note:
I wrote the following essay in June of 2005. I circulated it around the internet under the pen name Michael Meehan. It is the first of many “illegitimate” children of my pen that I wish to claim as my own.
Racism, properly understood, is the acknowledgement of the reality of objective, biological differences between the races, differences that are so dramatic that racial mingling inevitably causes hatred and violence, thus racial separation is the best way to preserve all races.
Racism, properly understood, is also the recognition that it is perfectly healthy and normal and right to love what is one’s own more than what belongs to others. It is natural, normal, and right to show preferences to one’s self, one’s family, one’s friends, one’s homeland, one’s nation, and one’s race.
Why is so healthy, rational, and enlightened an outlook as racism smeared as “hate”? To prefer one’s family to the neighbors is not hate. To prefer one’s friends to strangers is not hate. To prefer one’s homeland to a foreign country is not hate. I prefer Whites to other races, but that fact alone does not mean that I hate other races.
Preference does not mean hatred, but merely an inequality of loves. I love New Mexico, but I love California more. And I perfectly understand why a New Mexican might feel exactly the opposite.
I will grant that some are people attracted to the White Nationalist movement simply because, for whatever psychopathological reasons, they are filled with hate, and they think that the movement will offer them a place to express their hate openly. But angry, hate-filled people are attracted to all causes. Every cause has an enemy, who is marked as an appropriate object of hate. Thus every cause will attract angry, sick people looking for an outlet for their aggression. I know from personal experience that anti-racists are typically a venomous, aggressive, hate-filled lot.
I suspect, moreover, that some marginal, psychopathic people are attracted to White Nationalism precisely because anti-racists have fostered the impression that we are all crazy. But I also suspect that far more psychopathic haters are attracted to the cultural and political mainstream than to a marginal movement like White Nationalism, simply because the establishment offers no shortage of socially acceptable objects of hatred. It is, for instance, socially acceptable to hate White people, especially rural and Southern Whites, White Nationalists, Arabs, Muslims, and other enemies of the Jews. So look for the majority of psychopathic haters in the ranks of the anti-racists, in the police forces, in the military, and in the mainstream conservative movement, especially among the warmongers.
But I must be frank. Although preferring one’s own race does not in itself lead to hating other races, I really do hate other races. This is where my enemies will place the close quotes, when they lift my words out of context to smear me. What follows is the context, i.e., some necessary distinctions, qualifications, examples, and explanations.
First of all, I find it very difficult to say that I hate anyone or anything. It goes against my nature. If anything, I tend to be too sentimental and soft-hearted, too open to appeals to emotion. I fawn over children and dogs, and I find it especially hard to say no to women.
Second, I do not hate all other races. If tomorrow we discovered life on Mars, I know that I would prefer my race to the Martians. But I would not hate them. Likewise, I prefer my own race to the headhunters of Papua, the Aborigines of Australia, the Pygmies of the Congo, and the Bushmen of the Kalahari. But I do not hate them.
Why not?
Because I do not have to live with them. Because I am separate from them. Because, so far as I know, they do not negatively affect my life.
If, however, the Catholic Church, the federal government, or the Hebrew Immigrant Aid Society established a colony of Papuans, Aborigines, Pygmies, Bushmen, or Martians on my block, and I had to live in close proximity with them—and, worse yet, subsidize them with my tax dollars—then I probably would start hating them.
Of course it would begin slowly. I might try to get to know them at first. I might bring them food as a housewarming gift—although nervously, because I would not know if it would upset their stomachs or violate some unknown food taboo. Since they would probably know little or no English and show little interest in learning, I might try to greet them with a few words of their native tongue—although nervously, because I would always fear that the Pygmy word for “hello” would, to my ears, be undetectably similar to a cuss word. I would try my best to interpret their reactions, to determine how my friendly gestures were being received, but I would probably find them inscrutable and begin to feel uncomfortable around them. Then, as time revealed more and more of our racial and cultural differences, we would really start getting on one another’s nerves.
A year ago, I would have placed Polynesians on the list of peoples I had nothing against. But I had no direct contact with them. Then several families from Samoa or Tonga moved in a few buildings down. I thought they were aesthetically unappealing: large, brown, Australoid-Mongoloid hybrids who easily run to flab. But they seemed pleasant enough at first. Then I started noticing certain annoying differences.
For instance, although their personal hygiene does not seem problematic—though I have not gotten close enough to confirm that—in other respects, they are unspeakably filthy people. For instance, they are fond of noisily socializing and eating together outdoors. This is bad enough, but days later, the ground is still littered not only with trash and toys, but also with discarded food. After their last cookout, their landlord had to pay Mexicans to clean up after them. After another cookout, I found a mound of rotting fish, crawling with flies and maggots, dumped in a neighbor’s yard. Of course this kind of behavior would not be a problem in Tonga or Samoa, where it is probably accepted by everyone. But here it is disgusting and disrespectful, not to mention a potential health hazard.
Other behaviors are simply attempts to exploit White Americans, whom these Polynesians seem to regard with cordial contempt. It is hard not to be contemptuous of people whose commitment to “multiculturalism” means abandoning their own cultural standards whenever they conflict with foreign standards, no matter how barbarous and inferior. For instance, when the local Samoans or Tongans (or whatever) find the washing machines in their apartment building engaged, they simply come over and use the machines in my building. I do not know how they get in. I suspect that they have their abundant children lurk around and then prop open the door when someone leaves. Not only does this inconvenience people in my building who wish to do their laundry, it is a security hazard for doors to be propped open. Furthermore, once they gained access to the laundry room, the detergents I had left out without fear of theft by fellow Whites were rapidly depleted. These Polynesians did not even care to hide their theft by pilfering a little at a time. Either they are incredibly stupid, or they think they can steal from Whites with impunity.
Now these are minor problems, particularly compared with the plight of Whites forced to live among Blacks. But they illustrate how irritating diversity rapidly becomes. Furthermore, I can’t honestly say that I hate Polynesians—not yet. But if I confronted them about their behavior and the response were ugly, I might very well end up hating them. (I have not confronted them because I am planning to move in the near future, because it would do no good, and because I have bigger fish to fry.) But hate them or not, I don’t want to live around Polynesians, any Polynesians, ever again.
I do not deny that White people can be obnoxious. But I prefer obnoxious Whites to obnoxious non-Whites any day. Even the worst White people are easier to handle. At least I can appeal to common standards, and confronting them is not an international incident.
A third important qualification: It is possible to hate a group of people and yet not hate individual members. I am unfailingly polite in my dealings with individuals of other races. I have met likeable individual Blacks, Jews, Mestizos, and Orientals. I have even met non-Whites who are capable of adopting White standards and customs and living harmoniously in a White society.
But I never lose sight of the fact that these likeable individuals are members of races with identities and interests different from my own, races that inevitably come into conflict with my own when we share the same territory.
An individual Black, especially if nurtured by a White civilization, may turn out to be an intelligent and admirable scholar like Thomas Sowell. But a lot of Blacks living together according to their own natures never rise above primitive savagery. The potential Thomas Sowells are nipped in the bud. And when large numbers of Blacks are loosed on a White civilization, they inevitably drag it down to their level, as can be seen in Haiti, South Africa, and Detroit. There are just not enough good Blacks in the Black community to make any other outcome possible.
An individual Jew can make genuine contributions to White civilization. Gustav Mahler, for instance, was a first rate composer. But a lot of Jews living amongst us according to their own natures and interests have been overwhelmingly destructive. Without the Jews, there would have been no Communism, which is the single deadliest folly in human history. (Christianity, another Jewish product, is not far behind.) Without the Jews, the United States would never have gotten into World War I. Without the Jews, there would have been no World War II. Without the Jews, the United States would not be at war with Iraq. Nor would the US government be planning wars with Syria and Iran. Nor would the US be pursuing a reckless anti-Russian foreign policy. If any of these adventures leads to World War III, a future historian will tell us that it would not have happened without the Jews either. Compared with these crimes, it seems almost petty to complain about the Jewish role in promoting every form of cultural ugliness, filth, and degeneracy. There are just not enough good Jews in the Jewish community to make any other outcome possible.
By all means, treat individuals as individuals. But don’t fall for the folly of individualism, which denies the reality of group identities, group interests, and group conflicts. Be on guard when an individualist waxes gooey and sentimental about the Gustav Mahlers and Thomas Sowells and then “concludes,” by sheer assertion, that collective problems are non-existent or that collective solutions are immoral and out of the question.
Alex Linder once summed up this sort of individualism brilliantly: “Because the Black race produced a Thomas Sowell, the White race must die.” Because the Jews produced a Mahler, the race that produced Bach, Mozart, Beethoven, Brahms, and countless other geniuses must perish. After all, if Whites were to secure their survival, that would be “collectivism.” But individualism founders on the fact that groups are real. And collective problems require collective solutions.
I showed a draft of this essay to a friend who questioned the wisdom of giving our enemies a sentence like “I really do hate other races” to quote. My reply was: we White Nationalists claim that, as a general rule, the mixing of races inevitably causes hatred and conflict, so it is preposterous for us to pretend that we are immune to the effects of racial mixture. If White Nationalists who claim this are honest, then they are living refutations of their own claim that multiracial societies breed racial hatred.
I am living proof that multiracial societies cause racial hatred. But here is another line to quote: I do not want to hate other races. That is why I want to live in a homogenously White society. Such a society would have plenty of problems, but racial hatred and conflict would not be among them.
Racism, properly understood, means recognizing biological differences between populations and preferring members of one’s own group. Racism has no necessary connection to hatred or violence towards other races. In a racial nationalist utopia, all races would have separate, homogenous homelands. All distinct tribes or nationalities would have separate homelands too.
Racial and cultural nationalism would not impede peaceful cooperation: the exchange of goods and ideas, tourism, international athletic competitions, artistic and cultural exchanges, studies abroad, etc. But nationalism would impede the hatred and violence that are inevitable when different races and peoples are forced to share the same territories and governments. Nationalism, consistently practiced, would even discourage the scourge of war between ethnostates, since true racial nationalists would neither seek to rule over other peoples nor stand in the way of the secession of separate ethnostates from multiracial, multiethnic states.
Multiracialism and multiculturalism do, however, have a necessary connection to hatred and violence toward other races. In theory, of course, the advocates of multiracial, multicultural societies are all about love, tolerance, and peace towards all men. (Except for racial and cultural nationalists, of course, for whom they have no love and tolerance, and against whom they are willing to wage wars of extermination.) But in practice, multiracial, multiethnic states do not work. They lead inevitably to hatred, intolerance, and bloodshed.
They even made a hater out of a nice guy like me.
00:15 Publié dans Réflexions personnelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : réflexions personnelles, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 02 novembre 2010
Un esprit libre: Slavoj Zizek
Un esprit libre: Slavoj Zizek
Ex: http://unitepopulaire.over-blog.com/
 « Ce philosophe, issu d’un pays encore plus improbable que la Pologne d’Ubu Roi, la Slovénie, est un dur, aux antipodes des essayistes tièdes dont la France s’est fait une manière de spécialité. Mais sa dureté est bardée d’humour. [...] Marxisme et christianisme, qui ont été chats et chiens avant d’être copains comme cochons ont aujourd’hui un ennemi commun : les "nouvelles spiritualités", c’est-à-dire, en langage politiquement incorrect, la bétise bleu ciel. "L’héritage chrétien authentique est bien trop précieux pour être abandonnés aux freaks intégristes" insiste avec vigueur et jubilation Zizek. [...] Confrontant l’amour (la charité chrétienne) à la loi (la prescription judaïque), et défaisant la première par la seconde à partir des épîtres de Saint Paul, comme l’avait déjà fait son maître Alain Badiou, Zizek montre avec brio que les droits de l’homme sont en réalité des droits autorisant la violation des dix commandements. L’ONU ne descend pas du Sinaï, elle le contourne. [...] Aussi rappelle-t-il comment [en Slovénie] la régression ethnique et nationaliste a été vécue par ceux qui s’y étaient éclatés comme une formidable libération vis-à-vis d’une société postmoderne mondialisée, permissive et hédoniste en apparence, corsetée de restrictions et d’interdits en réalité, et donnée comme indépassable partout. Les démocraties occidentales ont tout faux lorsqu’elles s’imaginent que toutes les libertés sont de leur côté et toutes les servitudes de l’autre. »
« Ce philosophe, issu d’un pays encore plus improbable que la Pologne d’Ubu Roi, la Slovénie, est un dur, aux antipodes des essayistes tièdes dont la France s’est fait une manière de spécialité. Mais sa dureté est bardée d’humour. [...] Marxisme et christianisme, qui ont été chats et chiens avant d’être copains comme cochons ont aujourd’hui un ennemi commun : les "nouvelles spiritualités", c’est-à-dire, en langage politiquement incorrect, la bétise bleu ciel. "L’héritage chrétien authentique est bien trop précieux pour être abandonnés aux freaks intégristes" insiste avec vigueur et jubilation Zizek. [...] Confrontant l’amour (la charité chrétienne) à la loi (la prescription judaïque), et défaisant la première par la seconde à partir des épîtres de Saint Paul, comme l’avait déjà fait son maître Alain Badiou, Zizek montre avec brio que les droits de l’homme sont en réalité des droits autorisant la violation des dix commandements. L’ONU ne descend pas du Sinaï, elle le contourne. [...] Aussi rappelle-t-il comment [en Slovénie] la régression ethnique et nationaliste a été vécue par ceux qui s’y étaient éclatés comme une formidable libération vis-à-vis d’une société postmoderne mondialisée, permissive et hédoniste en apparence, corsetée de restrictions et d’interdits en réalité, et donnée comme indépassable partout. Les démocraties occidentales ont tout faux lorsqu’elles s’imaginent que toutes les libertés sont de leur côté et toutes les servitudes de l’autre. »
Christian Godin, "Slavoj Zizek : sauver le christianisme... et le marxisme !", Marianne, du 16 au 22 février 2008
Sur la Suisse :
« Je l’aime beaucoup et je déteste les gauchistes qui la trouvent trop aseptisée. Au moment de son indépendance, le rêve de la Slovénie était d’ailleurs de devenir une autre Suisse. D’une certaine manière, elle a réussi : on est anonyme, personne ne sait qui est notre premier ministre... »
Sur la liberté et l’ordre :
« Je suis absolument hostile à l’idée selon laquelle l’ennemi serait l’autorité ou l’ordre. La liberté suppose d’abord que les choses fonctionnent. Aujourd’hui, dès que vous dites discipline ou sacrifice, ou vous répond fascisme ou goulag. La gauche devrait rejeter ce chantage et se réapproprier l’ordre et l’héroïsme. »
Sur la société hédoniste :
« Les psychanalystes constatent qu’on se sent coupable lorsqu’on ne peut pas jouir. La jouissance est littéralement élevée au rang de devoir. La formule libérale est : ton devoir est de jouir. La formule autoritaire : tu dois jouir de ton devoir. Cet hédonisme radical est hégémonique. [...] Le destin de la psychanalyse se joue là : est-ce qu’elle va nous apprendre à nous libérer de ce surmoi obscène qui nous contraint à la jouissance ? »
Sur la gauche :
« Qu’est devenue la gauche ? Quand j’étais jeune, on parlait de socialisme à visage humain. Aujourd’hui, tout ce que la gauche est capable d’imaginer, c’est le capitalisme à visage humain, avec plus d’écologie, un peu plus de respect pour le tiers-monde... Mais on reste devant le même horizon : tout le monde considère qu’on ne peut pas penser au-delà du capitalisme associé à la démocratie libérale. »
Sur le marxisme :
« Je ne suis pas un marxiste en quête de révolution, je suis plutôt un marxiste pessimiste qui observe les contradictions du capitalisme global. [...] Nous ne sommes pas devant une alternative entre le capitalisme sous sa forme actuelle et autre chose. Dans quelques décennies, il est clair que cela sera autre chose. »
Slavoj Zizek, L’Hebdo, 6 mars 2008
00:15 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : philosophie, slovénie, sociologie, esprits libres |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 28 octobre 2010
Carlo Michelstaedter: Far di se stesso fiamma
Fonte: fondazionecarigo.it
 Nel centenario del suicidio apre una mostra sul giovane autore goriziano
Nel centenario del suicidio apre una mostra sul giovane autore goriziano
Il 17 ottobre 1910 un filosofo di ventitré anni muore suicida a Gorizia. Dopo pochi mesi i suoi compagni di studio pubblicano a loro spese le sue opere. Nel corso dei decenni successivi il suo nome diventa sempre più noto. Passa il secolo, passa il millennio e i testi di Carlo Michelstaedter vengono tradotti nelle principali lingue europee e pubblicati in vari continenti.
Perché le sue opere e la sua vicenda personale sono diventati materia di studi e di tesi di laurea? Perché la sua tesi di laurea, diventata poi il libro La persuasione e la rettorica, ormai è considerato uno dei contributi più originali alla filosofia del Novecento?
Credo che l’esame spietato della condizione umana di Carlo Michelstaedter riassuma in sé tutti i problemi, tutte le potenzialità di talento, creatività, immaginazione, onestà, capacità di lavoro, voglia di vivere dei giovani di questi ultimi cento anni.
Ma qual è stato il contesto, l’humus peculiare in cui si è formata la figura di Carlo Michelstaedter? Nel primo decennio del Novecento erano sorti in Europa movimenti d'avanguardia assai significativi, il cui intento di fondo era quello di contrapporsi al passato, di superarlo con nuove e rivoluzionarie visioni del mondo e della vita. Essi costruiscono il loro pensiero scoprendo e trasmettendo quella grandissima cultura europea che diagnostica e porta a effetto la crisi del sapere e della sua organizzazione. Ibsen, forse il più grande poeta di quest'intuizione nichilista del conflitto fra la vita e la rappresentazione, appare come tragico demistificatore della “megalomania della vita” – com'egli diceva – che non permette la realizzazione dell'individuo e lo rende colpevole di quest'impossibilità.
Ma che cosa sappiamo di questo giovane uomo, della sua vita, di ciò che l’ha portato al suicidio? La mostra di Gorizia, curata da Sergio Campailla, grazie anche ai molti documenti che la famiglia ha conservato, ce ne fornisce importanti testimonianze.
Suddivisa in quattro percorsi fondamentali, la mostra è composta da oltre 250 pezzi che raccontano il mistero di una vocazione esuberante e tragica attraverso una rassegna straordinaria di dipinti, schizzi, fotografie, documenti, manoscritti, edizioni, cimeli, in parte inediti.
Il percorso comincia da Gorizia, la “Nizza austriaca”, una città-giardino a misura d'uomo, circondata da dolci alture e sovrastata dal castello, sede di una comunità ebraica ristretta ma fiorente.
La seconda parte del percorso è dedicata a Firenze dove Michelstaedter frequenta l'Istituto di Studi Superiori venendo a contatto con professori famosi e colti condiscepoli. Si scoprono le prime relazioni sentimentali e amorose di Carlo, rimaste sino ad ora in ombra.
Nella terza parte il discorso ci riconduce a Gorizia dove Michlstaedter rientra definitivamente e, consegnata la tesi si laurea, il 17 ottobre 1910, si toglie la vita.
La rassegna chiude con l'esposizione dei libri provenienti dalla biblioteca di Michelstaedter e con le edizioni postume dei suoi scritti.
Carlo Michelstaedter. Far di se stesso fiamma
17 ottobre 2010 - 27 febbraio 2011
Sala Espositiva della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia
Via Carducci, 2 - Gorizia
Orario: da martedì a venerdì 10:00 – 13:00 e 16:00 – 19:00,
sabato e domenica orario continuato 10 – 19
www.fondazionecarigo.it
Tante altre notizie su www.ariannaeditrice.it
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, carlo michelstaedter, italie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 27 octobre 2010
Humor as a Weapon
Humor as a Weapon
Ex: http://www.counter-currents.com/
 This article has been researched and compiled for the purposes of educating New Right and N-A activists in the use of humor as a political weapon. There is a paranoid feeling amongst many on the New Right that the mass media is our greatest enemy. Not so. This article looks at the ways in which activists can use and manipulate the media, rather than the other way around.
This article has been researched and compiled for the purposes of educating New Right and N-A activists in the use of humor as a political weapon. There is a paranoid feeling amongst many on the New Right that the mass media is our greatest enemy. Not so. This article looks at the ways in which activists can use and manipulate the media, rather than the other way around.
As an example: mention the 1932 opening of the Sydney Harbour Bridge to any older Australian, and the first image that will spring to their mind is a man on horseback, galloping forward to slash the ribbon with his sword, before the ‘official’ representative could get to it. The swordsman was a member of a political group called the New Guard. And while this stunt was not especially humorous, it was certainly eye-catching – it remains in the mass mind to this day. In that same city in 2007, the crew of television show The Chaser made world headlines when they infiltrated the APEC forum (one of them dressed as Osama bin Laden), making a complete mockery of the forum’s expensive security measures.
In general, the media doesn’t give coverage to alternative politics (the recent 9/11 Truth Forum in Sydney was completely ignored, even though one of the speakers was a prominent Japanese MP). But ‘fringe’ views can get past the editors if they are presented by means of some humorous prank or stunt. Humor equals saleability . . . it’s as simple as that. People like to laugh, and the editors know it. For the mass media, the dollar is the bottom line . . . and the skilled prankster can actually make this work in his or her favor. A prankster called Mark Pauline claimed that “the media can never deny coverage to a good spectacle. No matter how ridiculous, absurd, insane or illogical something is, if it achieves a certain identity as a spectacle, the media has to deal with it.” In other words, instead of letting the mainstream media pigeonhole and stereotype them, activists using humor and spectacle can turn this around and actually use the media.
This was confirmed by a spokesman for the environmental group EarthFirst!: “The media need stories – they want to run them, especially the television media. What they don’t want is some meeting or run-of-the-mill visual situation they’ve seen a million times before. You give them something different and they actually get excited about working on the story.” Perhaps (shock horror!) it might even lead to greater accuracy in their reporting.
Humor also wins favor with the common man in the street. Stridency and self-righteousness turn people off – but humor can get them on side. It’s considered ‘cute’, and could even help you attract the opposite sex. As punk singer Jello Biafra said, “historically the ‘Merry Prankster’ has had a lot more to look forward to than the humorless politico who sits around moaning about ‘the struggle’.” And trickster characters have a rich history in mythology and literature.
Targets for political pranks are rife – for instance, the legions of pseudo-left academics who condemn ‘privilege’ and praise ‘globalism’ whilst making over $100,000 a year. The obnoxious billboards of Benettons are just begging to be creatively altered, as are posters for phoney humanitarians such as the rock group U2. I remember seeing footage of U2 on the news a few years ago when they were touring Australia. Bono, the singer, was here to lecture people about giving more money to Africa. Then the cameras showed the band members leaving the airport – in four separate limousines! One limo just wasn’t enough. For the cost of a stretch limo you could probably feed an African village for twenty years. The band are currently engaged in trying to build a skyscraper in Dublin – an act of cultural vandalism if there ever was one.
U2 have already been the target of an amusing prank in the past. A band called Negativeland put out a CD entitled ‘U2′, with the name prominently featured on the cover so people would think it was a U2 album. When people took it home and put it on, they found it was a recording of someone insulting and attacking U2! The bloated multi-millionaires failed to see the funny side and (predictably) sued Negativeland.
A punk band called CRASS (posing as Creative Recording and Sound Services) managed to get some tacky music (with subversive lyrics) inserted as a flexidisc into a bestselling teenage bride magazine. CRASS also leaked a faked conversation between Margaret Thatcher and Ronald Reagan discussing the possibilities of launching a nuclear war. The conversation was spliced together from radio and TV statements, but was taken seriously by the media and caused an uproar.
When the US Forestry Service (responsible for a lot of old growth logging) put on a ‘Smokey the Bear’ birthday party for 300 children, an EarthFirst! activist hired a Smokey the Bear costume and walked through the crowd handing out anti-logging flyers. The kids were treated to the bizarre spectacle of the rangers trying to arrest Smokey at his own birthday! This made front page headlines the next day.
A media prankster called Joey Skaggs tricked a room full of journalists and news readers (including some famous ones) into getting down on their hands and knees and roaring like lions. He simply issued fake press releases, pretending to be a trendy new therapist called ‘Baba Wa Simba’ (the Lion King), and the journalists fell for it hook, line and sinker. The journalists were induced to take part in ‘roaring sessions’, which many reported on positively afterwards. People can be fooled into believing almost anything if it’s seen to emanate from some ‘official’ quarter. There are no end to the ways in which consensus reality can be manipulated.
Websites are also fair game. A musician from a band called Feederz once set up a site parodying CNN. To add authenticity, when someone clicked on the masthead they would be taken back to the real CNN site. As a result, some of his fake stories actually found their way into mainstream papers. It was seriously reported that Saddam Hussein was training suicide camels, and that he had plans to blow up Pearl Harbour!
A group called the Yes Men set up a fake website for Dow Chemical. On the anniversary of the Bhopal disaster (where thousands were killed by chemical contamination in Bhopal, India) they were contacted by the BBC (who thought they were genuine representatives of Dow), and proceeded to give a statement saying that Dow claimed responsibility for the disaster and were now going to do something about it. Because of this the real Dow was embarrassed into cleaning up the mess.
A group called the Cacophony Society once held a fake welcoming party for a new Starbucks, which seemed to praise Starbucks while actually ridiculing everything they stood for. A member of the group spoke of the successful nature of this strategy “where you pretend to side with the thing you really hate. It makes it hard for the subject of the protest to get rid of you.” Similarly, the aforementioned Yes Men have done speaking tours claiming to represent the World Trade Organisation. Taking WTO logic to its ultimate conclusion, they delivered lectures with messages like ’sweatshops are great’. The same tactic could easily be employed by nationalists or National-Anarchists. For instance, a nationalist posing as a pro-multiculturalist could get invited onto a public forum, and then give a speech saying that “multiculturalism is great, because it causes social alienation and helps advance our ideal of a rootless global population, more easily herded into line…”
Obnoxious advertising billboards are excellent targets for humorous or creative political statements. A group called the Billboard Liberation Front, established in 1977, have published a handy guide for billboard alteration at: http://www.billboardliberation.com/guidebook.html When doing a prank like this in an area with surveillance cameras, it might be an idea for the prankster to wear some kind of ridiculous disguise.
Pranks can also be played on establishment politicians. Once when Richard Nixon was giving a speech from a stationary train, someone put on a conductor’s cap and waved the train out of the station with Nixon still in mid-speech. A Texas politician called Tim Moore highlighted the way in which representatives often pass bills without even understanding the content, by convincing his fellow pollies to pass a motion commending one Albert de Salvo (actually the Boston Strangler).
Pranksters can even run for office. Local elections are easy to run in, and candidates with a humorous platform often attract a protest vote from those who are sick of the lies of the mainstream candidates. When Jello Biafra ran for mayor of San Francisco, one of his policies required all corporate businessmen to wear clown suits between the hours of nine and five. He finished fourth out of ten candidates – quite a respectable result.
The contemporary art world is also ripe for satire. Australia has a well-known history of literary pranks, including the Ern Malley hoax, where two writers created a fictitious modernist ‘poet’ to expose what they saw (rightly or wrongly) as the shallow nature of literary modernism. Another one was the Wanda Koolmatrie hoax, where a writer called Leon Carmen posed as an aboriginal woman in order to get his book published, thereby illustrating the biases inherent in the publishing industry.
In Austria, a group of artists who wanted to expose the pretensions of the art world created a non-existent writer called Georg Paul Thomann, and it actually worked. Newspaper articles were written about him because he was perceived to be a ’somebody’ . . . even though he was fictional and his work was non-existent! This fake ‘artist’ was even chosen to represent Austria at a world art fair.
An artist called Jeffrey Vallance couldn’t get a major gallery to show his work, so he bought a number of power point wall sockets from the hardware shop, and covered them with his art. Then he went around the art gallery in a tradesman’s outfit and replaced all the wall sockets with his own ones. Next he printed up programs, and invited his friends to view his work on the art gallery wall sockets. He sent a program to the art gallery itself – and they were so shocked they didn’t do anything about it. The employees hushed it up, in case they got in trouble! The wall sockets weren’t removed, and it was only two years later that they were finally painted over.
Schwaller de Lubicz defined magic as “the science of the right gesture, the right word, at the right moment.” That is what a successful prank is – an act of magic. I hope this short article has provided suggestive ideas for anti-global activists of all stripes, whether National-Anarchist or otherwise.
Hail to the clowns.
Source: http://newrightausnz.blogspot.com/2008/05/humour-as-weapo...
00:12 Publié dans Le coin de Diogène | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : humour, satire, satire politique, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook






