vendredi, 29 avril 2022
Pourquoi l'Occident déteste la Russie et Poutine

Pourquoi l'Occident déteste la Russie et Poutine
par Fabrizio Marchi
Source : Fabrizio Marchi & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/perche-l-occidente-odia-la-russia-e-putin
Bien que cela puisse ressembler à un fantasme politique, surtout pour ceux qui ne sont pas impliqués dans la politique internationale, il est important de souligner que l'objectif stratégique de l'offensive globale américaine (lire, entre autres, l'expansion de l'OTAN à l'Est), est la Chine, et non la Russie.
L'affaiblissement, voire la déstabilisation de la Russie à moyen-long terme n'est "que" (avec beaucoup de guillemets...) une étape intermédiaire, même si elle est d'une importance énorme, pour isoler la Chine, le véritable et plus important concurrent des Américains. Tout reste à vérifier, bien sûr, pour savoir si cela est possible, mais à mon avis, telle est bien l'intention.
Les États-Unis cherchent à prolonger le conflit en Ukraine le plus longtemps possible, voire à le rendre permanent. Ils espèrent ainsi saigner la Russie, tant sur le plan militaire que, surtout, sur le plan économique, et l'user psychologiquement au fil du temps, en sapant sa cohésion interne. À moyen terme, la guerre pourrait renforcer le leadership de Poutine, et c'est déjà le cas, mais à long terme, elle pourrait peut-être l'affaiblir. Après tout, rester embourbé dans une guerre à long terme peut être, et a été, déstabilisant pour tout le monde. Pensez au Vietnam pour les États-Unis et à l'Afghanistan pour l'Amérique et l'Union soviétique, pour ne citer que quelques exemples bien connus. Et quelle que soit la solidité du leadership de Poutine, nous ne pouvons pas exclure a priori qu'il puisse être affaibli en interne au fil du temps. Dans quelle mesure et si cela est possible, comme je l'ai dit, est une autre question, mais je crois que la stratégie du Pentagone est la suivante.

Immédiatement après l'effondrement de l'URSS (mais la désintégration avait déjà commencé depuis un certain temps), la Russie a été réduite à l'état de colonie, un pays disposant d'un énorme réservoir de matières premières à piller et d'une grande masse de main-d'œuvre bon marché à la disposition des multinationales et des entreprises occidentales, ainsi que d'un gouvernement d'hommes d'affaires sans scrupules, de mèche avec la mafia et dirigé par une marionnette ivre au service des États-Unis. Ils étaient convaincus qu'ils avaient le monde entre leurs mains. Et c'était leur plus grande erreur. Une erreur qu'ils ont en fait souvent commise au cours des trente dernières années. Ils ont été littéralement délogés par la croissance économique impétueuse, voire inquiétante, de la Chine et n'ont pas pensé que la Russie pouvait se relever et retrouver sa force, son centre de gravité, son identité, qui est celle d'un grand pays, avec une grande histoire, une grande culture et un grand peuple qui ne peut accepter d'être réduit à une colonie de l'Occident.

Qu'on le veuille ou non (cela n'a absolument rien à voir avec la compréhension des choses), Poutine était l'homme qui incarnait cette renaissance. Et c'est précisément cela que l'Occident ne lui pardonne pas. Parce qu'il leur a enlevé le grand jouet qu'ils pensaient avoir entre les mains et, ce faisant, leur a enlevé le rêve - qui semblait avoir été réalisé - de pouvoir dominer la planète entière.
Que la croisade anti-russe se fasse pour défendre les valeurs occidentales, la liberté, les droits civils et la démocratie, c'est évident, mais c'est du bavardage, de la propagande des plus évidentes, de la soupe pour les naïfs (je ne veux pas m'y frotter...). L'Occident fait et a fait des affaires, a soutenu, financé, armé et souvent créé les dictatures les plus féroces dans le monde entier (tout comme il n'hésite pas aujourd'hui à anoblir la pire racaille nazie-fasciste jamais vue en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale), et encore moins si le problème peut être les droits et la démocratie. Si Putin était à votre service, vous pourriez aussi bien manger littéralement de la chair de petit enfant au petit déjeuner et personne ne s'en soucierait le moins du monde et tout le monde trouverait même un moyen de le dissimuler.
Affaiblir, réduire radicalement ou même déstabiliser la Russie et installer un gouvernement complaisant signifierait, comme je l'ai dit, isoler la Chine. Pensons aujourd'hui à l'Inde, un pays formellement placé dans la sphère d'influence occidentale, mais en fait non homogène avec cette même sphère, pour des raisons géographiques évidentes et donc économiques et commerciales. Avec la disparition de la Russie, l'autre principal bastion, outre la Chine, du bloc (euro-asiatique), l'Inde serait inévitablement aspirée dans la sphère d'influence occidentale, et peut-être aussi le Pakistan, un allié des États-Unis jusqu'à il y a tout juste un an ou deux.
Il s'agit évidemment d'une stratégie et d'un projet très ambitieux avec lesquels les Américains pourraient jouer à moyen et long terme. D'autre part, s'ils ne parviennent pas à briser d'une manière ou d'une autre le lien entre la Russie et la Chine, c'est-à-dire l'axe central du bloc asiatique (possible mais pas encore complètement homogène), les choses pourraient se gâter pour les États-Unis et le bloc occidental.
C'est pourquoi la crise actuelle est certainement la plus grave et la plus inquiétante depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Objectivement, nous ne sommes pas en mesure de prévoir les évolutions et, surtout, les résultats potentiellement dramatiques.
18:15 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : russie, chine, états-unis, occident, vladimir poutine |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 28 avril 2022
La CIA adopte une idéologie de gauche

La CIA adopte une idéologie de gauche
Michael Tracey (2021)
Source: https://misionverdad.com/traducciones/la-cia-adopta-una-ideologia-de-izquierda
Dans une vidéo marketing époustouflante diffusée pour la première fois le 25 mars 2021, mais qui était passée inaperçue jusqu'à il y a quelques jours, la CIA a approuvé avec enthousiasme plusieurs principes clés de ce qui est désormais indiscutablement devenu une construction idéologique et rhétorique hégémonique de la gauche et du libéralisme :
"Je suis une femme de couleur", proclame triomphalement la protagoniste de la vidéo, un agent de la CIA anonyme". "Je suis une millenian cisgenre à qui on a diagnostiqué un trouble d'anxiété généralisée. Je suis intersectionnelle, mais mon existence n'est pas un exercice de mise en boîte".
Elle poursuit: "J'avais l'habitude de lutter contre le syndrome de l'imposteur. Mais à 36 ans, je refuse d'intérioriser les idées patriarcales erronées sur ce qu'une femme peut ou doit être. Je suis fatiguée de me sentir comme si je devais m'excuser pour l'espace que j'occupe".
La vidéo est un rapide tour de force des tropes et des bizarreries les plus étroitement associés à l'"idéologie Woke" contemporaine, comme par exemple:
- Une référence directe à la doctrine de l'"intersectionnalité". On peut soutenir que c'est le principal principe de fonctionnement de la dite idéologie, ce qui signifie qu'un large éventail d'oppressions fondées sur l'identité se "croisent" et doivent être renversées.
- L'invocation du terme "cisgenre", qui vise à signifier l'inclusion par la CIA des personnes sans normes de genre, c'est-à-dire les personnes trans.
- Une dénonciation du "patriarcat", l'un des systèmes d'oppression identitaire les plus abhorrés.
- L'étrange fierté d'être diagnostiquée avec une maladie mentale, comme s'il s'agissait simplement d'un autre trait d'identité à rendre public et à accepter, plutôt que d'une affection débilitante à guérir.
- L'utilisation désormais omniprésente du substantif "espace" pour désigner non pas un lieu physique quelconque, mais la vague force métaphysique que l'on est censé exercer dans la vie... ou quelque chose comme ça. ("Connaissez votre valeur. Maîtrisez votre espace", ajoute la femme).
"Woke Ideology" est un terme vague et amorphe désignant un vaste ensemble de croyances et de pratiques; les adeptes de l'idéologie nient souvent qu'une telle chose existe. Et pourtant, toute personne qui n'a pas vécu sous une roche sait à peu près ce que ce terme signifie, reconnaît le style rhétorique dans lequel il est exprimé et comprend immédiatement que cette vidéo en est un exemple. Tout comme on peut identifier des exemples de "communisme" ou de "libertarisme" malgré les débats perpétuels sur la définition précise de ces désignations idéologiques.
Bien que la vidéo ait été produite par la CIA, elle aurait facilement pu être produite par n'importe quelle entreprise du Fortune 500 ou organisation militante financée par une fondation, qui lisent toutes plus ou moins le même script.
La vidéo de la CIA est en fait un épisode d'une série intitulée Humans of the CIA, un titre probablement destiné à rappeler la mode des médias sociaux Humans of New York, dans laquelle des citoyens ordinaires sont "humanisés" avec des histoires sentimentales et touchantes. Tout comme la CIA a tenté de le faire avec cette série.
Une autre vidéo de la série Humans of the CIA présente un homme qui raconte son parcours avec la citation suivante: "Ayant grandi en étant gay dans une petite ville du sud, j'ai eu la chance d'avoir une famille merveilleuse et acceptante. J'ai toujours lutté contre l'idée de ne pas pouvoir parler de ma vie personnelle au travail. Imaginez ma surprise lorsque, lors de mon assermentation à la CIA, j'ai remarqué un arc-en-ciel sur le cordon du directeur de l'époque, M. Brennan".
"L'inclusion est une valeur fondamentale ici", poursuit The Man Who Came Out Gay. "Les membres du personnel, du haut en bas de l'échelle, s'efforcent de faire en sorte que chaque personne - quel que soit son sexe, son identité sexuelle, sa race, son handicap ou son orientation sexuelle - puisse apporter tout son être au travail chaque jour".
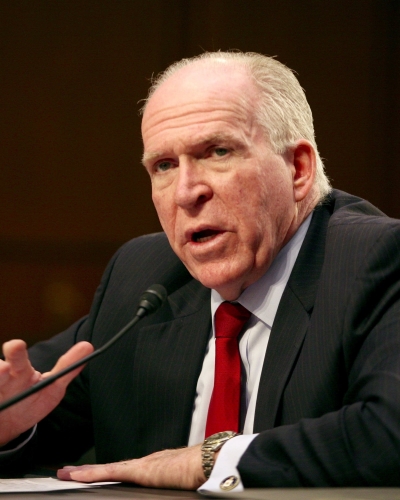
Il s'avère que John Brennan (photo) , l'ancien directeur de la CIA sous Barack Obama (et protagoniste de la saga Trump/Russie générée par la CIA) apparaît dans ces deux vidéos comme un homme qui cherche à s'assurer que les agents de la CIA puissent "apporter tout leur moi au travail chaque jour", plutôt que juste une partie de leur moi, comme quelques membres. Il est là, souriant aux côtés de la femme latina, symbole de l'engagement de la direction de la CIA en matière d'équité et d'inclusion. L'un des successeurs de Brennan, Gina Haspel, dont la nomination a été annoncée par l'administration Trump comme une victoire pour "l'émancipation des femmes", fait également un caméo. Il est clair que la nouvelle dévotion passionnée de l'Agence pour ces valeurs identitaires n'a rien de partisan !
S'il est possible que le zèle du département marketing de la CIA à adopter ce jargon se soit intensifié avec le début d'une nouvelle administration démocrate, le plan de relations publiques semble être antérieur à l'inauguration de Joe Biden. Le 4 janvier 2021, une vidéo a été publiée dans laquelle un autre agent anonyme vante son expérience en tant que "responsable de la stratégie d'entreprise et de l'éducation pour la diversité et l'inclusion" comme une merveilleuse préparation à une carrière à la CIA.
On a du mal à imaginer Donald Trump autorisant personnellement une telle campagne de marketing (mais qui sait). Quoi qu'il en soit, le rôle de la CIA dans l'activisme politique gauche/libéral a atteint une sorte de crescendo sous la présidence de Trump. Brennan a joué un rôle particulièrement important dans le lancement du récit selon lequel Trump aurait été "de connivence" avec le gouvernement russe pour subvertir la démocratie américaine, et ce récit est devenu un objet de fixation furieuse de la gauche/gauche libérale, en partie en raison de l'agitation constante de Brennan sur Twitter et de sa position dans les médias d'entreprise :
(Traduction de ce Twitter du 16 juillet 2018: La performance de Donald Trump lors de sa conférence de presse à Helsinki nous mène au seuil, et dépasse même ce seuil, du "délit et méfait de haute gamme". Ce n'était rien moins que de la trahison. Non seulement les commentaires de Trump étaient imbéciles, mais il s'avère qu'il est complètement dans la poche de Poutine. Patriotes républicains: où êtes-vous???")
(Pour tous ceux qui nient que des segments de "la gauche" ont été impliqués dans le récit Trump/Russie, veuillez jeter un coup d'œil aux organisations qui ont parrainé des rassemblements pour défendre le conseiller spécial Robert Mueller tout au long de 2017 et 2018. Ils comprennent le Working Families Party, Progressive Democrats of America, People for the American Way, Indivisible, et d'autres. Ce ne sont pas seulement les "libéraux" ou les "centristes" insipides qui ont fait cela).
Ainsi, la dernière ouverture rhétorique de la CIA pourrait être comprise comme une continuation de la tendance selon laquelle les prérogatives de la CIA sont de plus en plus alignées sur les prérogatives du complexe à but non lucratif de la gauche libérale et des activistes financés par des fondations. Ce n'est peut-être pas une coïncidence si les anciens (ou "ex") agents de la CIA ont constitué une part importante des nouveaux membres du Parti démocrate lorsque celui-ci a pris le contrôle de la Chambre des représentants en 2018.
Chaque fois qu'ils sont confrontés à la réalité que leurs styles rhétoriques sont imités dans tous les centres de pouvoir du pays, y compris maintenant la Communauté du renseignement, les militants et les journalistes de gauche ont tendance à nier rageusement toute culpabilité. La décision de la CIA de se déclarer institutionnellement comme une source d'"intersectionnalité", insisteront-ils, est une cooptation fausse et cynique.
Cependant, il ne s'agit pas tant d'une "cooptation" que d'une évolution naturelle des impératifs de l'idéologie woke. La CIA peut facilement adopter quelque chose qui s'approche d'une attitude "intersectionnelle" à l'égard des oppressions raciales, de genre et d'identité sexuelle et poursuivre sa mission ordinaire. En fait, l'adoption de cette rhétorique pourrait améliorer sa mission en renforçant son cachet culturel interne. Supposons que John Brennan soit un vrai croyant dans la doctrine de l'intersectionnalité - ce qui n'est absolument pas hors de question - et qu'il croit vraiment que la CIA peut contribuer à la réalisation de ses objectifs. Que faire alors ?
Prétendre qu'il y a une discontinuité entre la nouvelle popularité universelle de ces concepts et l'activisme de gauche n'a aucun sens. Y a-t-il une croyance de gauche plus puissante en circulation en ce moment que celle des oppressions "intersectionnelles" et de leur influence omniprésente et déterminante sur la vie américaine ? La CIA ne fait que signaler son empressement à participer au projet idéologique de démantèlement de ces supposées oppressions. D'une certaine manière, il s'agit d'une véritable victoire pour la gauche militante, dont les convictions gagnent des adhérents à un rythme vertigineux, probablement jamais aussi rapide que l'année dernière.
Mais au lieu de se demander pourquoi le paradigme rhétorique et idéologique qu'ils ont promu sans relâche s'accorde si facilement avec les institutions les plus puissantes du pays, des banques de Wall Street aux grands monopoles technologiques en passant par la CIA, les activistes et les journalistes de gauche changent souvent de sujet avec pétulance. Après que j'ai commenté la vidéo "Woke CIA" hier via Twitter, le frontman radical de Rage Against the Machine, Tom Morello, est sorti de nulle part pour m'accuser de nier les "maux" des actions passées de la CIA - comme les assassinats et les coups d'État - et de faire comme si le "vrai problème" de la CIA était sa pratique soudaine de distribution de soi-disant "pamphlets woke".
En ce moment, je lis un livre très éclairant (ce n'est pas un pamphlet) qui détaille de nombreuses transgressions brutales et largement oubliées de la CIA, comme une mission secrète de 1958 qui a abouti au bombardement d'un marché et d'une église sur l'île d'Ambon, en Indonésie, anéantissant des civils. Tous ceux qui ne connaissent pas ce chapitre de l'histoire de la CIA, ainsi que d'autres, devraient "s'instruire", et peut-être cela les aidera-t-il à comprendre ce que le guitariste gauchiste audacieusement subversif ne comprend manifestement pas: que l'"idéologie du réveil" est parfaitement compatible avec la prérogative institutionnelle de la CIA d'asseoir davantage son propre pouvoir.
Cette histoire rend doublement absurde le fait que les libéraux (et, bien que plus tacitement, les gauchistes) aient été si tolérants à l'égard des interventions de la CIA dans les affaires politiques intérieures parce que leurs objectifs politiques à court terme (désactiver et destituer Trump) s'alignaient les uns sur les autres. Maintenant, ils semblent plus en colère contre ceux qui soulignent l'absurdité évidente de cette tactique de marketing de la CIA que contre la tactique elle-même. Peut-être est-ce parce qu'ils ont été les principaux artisans de la création des conditions politiques dans lesquelles l'adoption de telles tactiques est considérée comme astucieuse.
(L'été dernier, Morello s'est déclaré un grand admirateur de White Fragility de Robin DiAngelo, l'un des pires livres jamais écrits et une source primaire des préceptes "antiracistes" insensés adoptés dans toute l'Amérique des entreprises. Cela vous donne donc une idée d'où il vient).
Les libéraux et les gauchistes doivent constamment nier que leurs croyances, leur esthétique et leurs codes d'expression sont devenus hégémoniques, car se positionner comme des marginaux nobles et assiégés est au cœur de leur concept de soi. Comme me l'a dit un commentateur sur Twitter : "A mon avis, la CIA a examiné les croyances de ceux qui sortent des écoles d'élite et a décidé que c'est ainsi qu'elle doit se présenter à eux". Eh bien... oui.
Nombreux sont ceux qui ne trouvent pas intéressant ou digne de commentaire le fait que les prescriptions idéologiques et les formulations rhétoriques, autrefois largement reléguées au Tumblr et aux cercles académiques obscurs, ont migré vers les plus hauts niveaux de l'appareil de renseignement américain en l'espace de quelques années. Qu'ils se sentent libres de continuer à hurler dans le vide en ligne, tandis que d'autres tentent d'évaluer de manière critique ce phénomène qui perturbe la culture.
Michael Tracey est un journaliste américain qui se concentre sur l'analyse et le commentaire de la politique américaine. Son livre sur la façon dont la psyché collective des élites politiques et médiatiques américaines a été déformée par une rupture épistémique sismique pendant l'ère Donald Trump doit être publié en 2022.
Cet article a été initialement publié sur le blog de Michael Tracey le 4 mai 2021, traduit pour Mision Verdad par José Aponte.
- Nous sommes un groupe de chercheurs indépendants qui se consacrent à l'analyse du processus de guerre contre le Venezuela et de ses implications mondiales. Depuis le début, l'utilisation de notre contenu est gratuite. Nous comptons sur les dons et les collaborations pour soutenir ce projet. Si vous souhaitez contribuer à Misión Verdad, vous pouvez le faire ici: https://misionverdad.com/donate .
13:54 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cia, états-unis, actualité, services secrets, services secrets américains |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Les "Straussiens" ou les architectes des guerres de l'Amérique
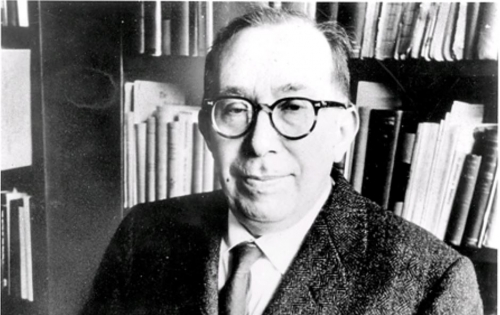
Les "Straussiens" ou les architectes des guerres de l'Amérique
Javier Barraycoa
Source: https://posmodernia.com/guerra-en-ucrania-iii-los-straussianos-o-los-arquitectos-de-las-guerras-de-estados-unidos/
Qui sont les "Straussiens" et quel est leur lien avec la guerre actuelle en Ukraine ? Nous allons nous référer à une série de doctrinaires et de politiciens qui ont guidé la politique étrangère américaine pendant des décennies, tant en matière économique que militaire. Nombre d'entre eux ont été, directement ou indirectement, des disciples du philosophe allemand Leo Strauss (1899-1973) et sont connus dans certains milieux sous le nom de "secte straussienne" [1]. Face à la montée du nazisme, Strauss se réfugie à l'université de Chicago où il enseignera la philosophie. Tous ses premiers disciples, qui formaient un cercle presque secret, étaient d'origine juive. Strauss les a rassemblés et a transmis oralement sa pensée la plus cryptique et la plus ésotérique. Aucune trace écrite de ces leçons ou réunions privées ne nous est parvenue, car elles étaient orales, et nous n'en avons que des références indirectes. Le fil conducteur de "l'enseignement secret" de Strauss était que, pour éviter un nouvel holocauste, une dictature forte devait être mise en place pour défendre les Juifs. Il a également soutenu que les démocraties libérales isolées ne pouvaient pas survivre par elles-mêmes et que les sociétés devaient cohabiter face à un "ennemi" hostile.
Strauss pensait que les œuvres des anciens philosophes contenaient délibérément des concepts "ésotériques" dont la vérité ne peut être comprise que par un petit nombre et qui seraient mal compris par les masses à endoctriner avec des connaissances "exotériques". On sait que le maître lui-même appelait ses élèves choisis les "hoplites" [2]. Le professeur leur avait inculqué l'idée d'utiliser le soi-disant "noble mensonge" (il est moralement éthique de mentir afin de préserver une fin noble)[3], quelque chose que ses disciples allaient rapidement apprendre à appliquer à leurs activités politiques. Ils n'ont pas renoncé à l'action, et il les a envoyés révolutionner les classes des enseignants opposants. Strauss soutenait qu'il fallait toujours se battre, et cette agitation en classe pouvait être appliquée à la géopolitique. C'est pourquoi il soutenait qu'un État (comme les États-Unis) qui voulait survivre devait toujours être en guerre. Pour le philosophe, cela fournissait une éthique spartiate, car la paix mène toujours à la décadence. Les straussiens croient donc à la "guerre perpétuelle" prônée par leur maître et non à la "paix perpétuelle" prônée par Kant.
Leo Strauss
Le platonisme et une fausse idée du droit naturel dominent l'ensemble de la pensée de Leo Strauss. Il a toujours défendu l'existence d'une élite qui devrait être compatible avec les structures démocratiques formelles. Par conséquent, il a sensibilisé ses disciples à l'idée que dans les sociétés, certains sont destinés à diriger et d'autres à être dirigés. Qui, alors, doit diriger ? Ceux qui réalisent qu'il n'y a pas de moralité en dehors d'eux et qu'il n'y a qu'un seul "droit naturel": le droit du supérieur de dominer l'inférieur. Néanmoins, il a fait valoir que la loi morale, n'étant pas une fin en soi mais plutôt un artifice, était nécessaire pour maintenir l'ordre et la cohésion interne des sociétés. Et que l'un des moyens les plus efficaces pour diffuser ces principes moraux était la religion. Alors que Marx considérait la religion comme l'"opium du peuple", Strauss l'appelait la "sainte fraude". La religion est devenue l'un des instruments les plus efficaces de l'action politique, comme la "colle qui lie les sociétés entre elles". La religion n'était nécessaire que pour les masses, car les dirigeants n'en avaient pas besoin. Toute cette révolution d'idées finira par influencer la politique étrangère américaine au cours des dernières décennies.
Les premiers "Straussiens"
Peut-être Strauss n'aurait-il pas été beaucoup plus loin que les autres penseurs de son époque sans la force et l'influence politique que ses disciples ont progressivement acquises [4]. Ils se sont infiltrés dans l'administration américaine aux plus hauts niveaux et font maintenant partie des groupes de réflexion les plus influents des États-Unis. Toute l'architecture des guerres menées - directement ou indirectement - par les Etats-Unis depuis la chute de l'URSS a été légitimée par les thèses des "straussiens" et leur capacité de contrôle idéologique dans les administrations américaines, qu'elles soient républicaines ou démocrates.
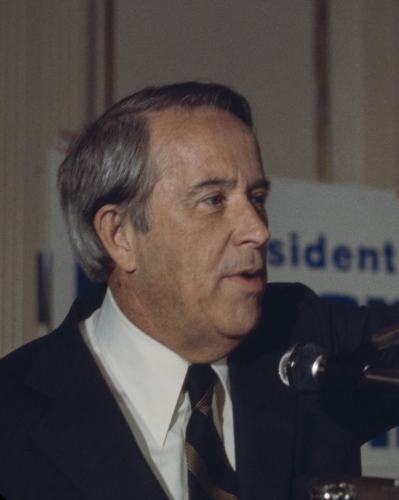
Lorsque Leo Strauss meurt en 1973, ses disciples restent groupés et s'engagent en politique par l'intermédiaire du sénateur démocrate Henry "Scoop" Jackson (photo). Parmi les plus connus, citons Elliott Abrams, Richard Perle et Paul Wolfowitz [5]. Ils ont été rejoints par un groupe de journalistes trotskistes du City College de New York qui publiaient le magazine Commentary (pensée et opinion conservatrices en vogue dans les milieux juifs de la côte Est). Ces derniers étaient connus comme "les intellectuels de New York". En raison de leur ancrage idéologique dans le trotskisme et de leur haine de l'URSS stalinienne, ils se sont impliqués dans la politique par le biais de la RAND Corporation [7]. L'acte fondateur de ce groupe a été la rédaction et l'adoption ultérieure de l'"amendement Jackson-Vanik" (1974) qui devait contraindre l'Union soviétique à autoriser l'émigration de sa population juive vers Israël sous la menace de sanctions économiques.

Paul Wolfowitz, un straussien par excellence
Un Paul Wolfowitz encore très jeune (que l'on appellera plus tard le Wolfowitz d'Arabie, étant donné son obsession pour le renversement du régime de Saddam Hussein), formé auprès de Leo Strauss et de son collaborateur Albert Wohlstetter (un homme de l'État profond américain au temps de la guerre froide). Le véritable mentor de Wolfowitz serait Albert Wohlstetter (1913-1997), partisan d'une politique nucléaire ferme contre l'URSS, qui enseignait au département des sciences politiques de Chicago à cette époque. Grâce à ce contact, Paul Wolfowitz et Richard Perle (un autre des futurs architectes de la future guerre en Irak) [8], à l'été 1969, commencent à collaborer avec le Committee to Maintain a Prudent Defense Policy (CMPDP), un organisme créé par le secrétaire d'État Dean Acheson pendant la guerre froide pour élaborer des stratégies contre l'URSS.
Selon Francis Fukuyama, un néoconservateur et disciple indirect des straussiens: "Wolfowitz a fait la synthèse entre Strauss et Wohlstetter", ils étaient l'un, le philosophe, et l'autre, le stratège; les deux maîtres des néoconservateurs. Comme nous le soulignerons ci-dessous, ces collaborateurs trostkystes du parti démocrate, se sont progressivement convertis au républicanisme et sont devenus la base idéologique des "néocons". Wolfowitz, pendant son mandat de secrétaire adjoint à la défense sous George W. Bush, a été à l'origine de concepts tels que la "guerre préventive" ou l'"axe du mal", qui ont fait florès.
La formation "straussienne" des néoconservateurs
Dès 1976, Wolfowitz met en place l'équipe B, sous la présidence républicaine de Gerald Ford, pour analyser le danger que représente l'URSS pour le monde occidental. La conclusion de l'étude était qu'il ne suffisait pas de l'isoler, mais de l'éradiquer. Par la suite, les straussiens et les intellectuels new-yorkais - tous d'origine juive et anciens bolcheviks, comme nous l'avons déjà dit - se sont paradoxalement mis au service de Ronald Reagan et des républicains. C'est alors qu'ils ont commencé à s'appeler "néo-conservateurs". Ils ont été les architectes de groupes de travail et de groupes de réflexion tels que le National Endowment for Democracy (NED - Dotation nationale pour la démocratie) et l'US Institute of Peace (USIP). Ce dernier a été impliqué dans la révolution de Tianamen et les révolutions dites de couleur: manifestations d'octobre 2000 en Yougoslavie qui ont conduit au renversement de Miloševich; révolution des roses qui a conduit à la chute d'Edouard Chevardnadze (pro-russe) en Géorgie en 2003 et s'est terminée par la guerre russo-géorgienne de 2008; révolution orange qui a conduit à la fuite du candidat Viktor Iouchtchenko (pro-russe) en Ukraine en 2004; la Révolution des tulipes qui a conduit à l'éviction du gouvernement (pro-russe) d'Askar Akayev au Kirghizstan en 2005 (photo, ci-dessous); la Révolution blanche qui a tenté sans succès de renverser Alexandre Lukashenko (pro-russe) en Biélorussie; ou les manifestations en Moldavie contre le gouvernement du Parti communiste (pro-russe) en 2009.

Plus inquiétant est un document rédigé par Paul Wolfowitz en 1992 après la chute de l'URSS, qui précise que les Etats-Unis doivent maintenir l'hégémonie mondiale en empêchant l'émergence de nouvelles puissances et même en s'imposant en Europe [9]. Gary Schmitt, Abram Shulsky et Paul Wolfowitz, grâce au groupe de travail sur la réforme du renseignement du Consortium for the Study of Intelligence, ont progressivement imprégné les agences de renseignement américaines de leurs idées. Ils ont diffusé la thèse selon laquelle les autres gouvernements démocratiques du monde n'avaient pas la vision globale que l'Amérique avait. L'empire américain a donc dû prendre des décisions unilatérales pour diriger le monde [10]. Cette année-là, Bill Clinton est arrivé au pouvoir, ce qui a relégué les néoconservateurs dans les puissants groupes de réflexion d'où ils affinent leurs théories.

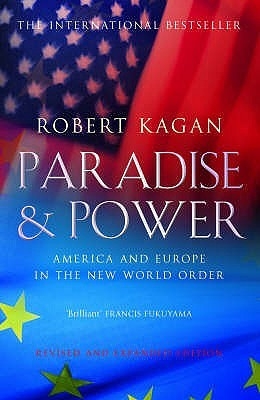
En 1992, William Kristol [11] (photo, ci-dessus, il est le fils du célèbre néocon, juif et ex-trotskiste Irving Kristol [12]) et Robert Kagan (futur conseiller de George W. Busch, auteur d'un livre intéressant contre l'Europe, Paradise and Power - America and Europa in the New World Order) et mariée à Victoria Nuland [13] (porte-parole du département d'État sous Obama), a publié un article important dans le magazine Foreign Affairs défendant "l'hégémonie mondiale bienveillante des États-Unis" [14]. L'année suivante, ils ont fondé le Projet pour un nouveau siècle américain/Project for a New American Century (PNAC) dans les locaux de l'American Enterprise Institute, un très puissant think tank conservateur financé principalement par la compagnie pétrolière Exxon Mobil. Le PNAC a réuni des néocons comme Gary Schmitt, Abram Shulsky et Paul Wolfowitz et des admirateurs non juifs de Leo Strauss, comme le protestant Francis Fukuyama (un autre néocon influent). Il comprenait également des membres du cabinet de George W. Bush : le vice-président Dick Cheney et le secrétaire à la défense Donald Rumsfeld, qui devaient jouer un rôle clé dans la guerre contre l'Irak.

En 1994, Richard Perle (photo, ci-dessus) est passé de la politique de haut niveau au trafic d'armes. Soudain, il apparaît en Bosnie-Herzégovine comme conseiller du président bosniaque et d'Alija Izetbegovic. C'est Richard Perle qui a fait venir Oussama ben Laden d'Afghanistan avec sa Légion arabe, le prédécesseur d'Al-Qaida. Perle était même membre de la délégation bosniaque qui a signé les accords de Dayton à Paris. Les "straussiens" ont utilisé (et utilisent encore) les islamistes pour affaiblir les alliés de la Russie, comme la Serbie à l'époque. Mais ils coopèrent également avec les Israéliens pour les soutenir dans leurs plans visant à "achever" l'État d'Israël, qui serait alors sans population palestinienne. Lorsque Benyamin Netanyahou gouvernait Israël en 1996, des membres du PNAC tels que Richard Perle, Douglas Feith et David Wurmser ont rédigé une étude [15] à la demande de Netanyahou à l'Institute for Advanced Strategic and Political Studies (IASPS). Il s'agit d'un rapport résolument sioniste, conseillant l'élimination de Yasser Arafat, l'annexion des territoires palestiniens, le lancement d'une guerre contre l'Irak et la déportation massive des Palestiniens vers le territoire irakien. Ce rapport s'inscrit clairement dans la lignée de la pensée de Leo Strauss et de son collègue Zeev Jabotinsky, le fondateur du "sionisme révisionniste". Il s'agit du courant qui cherche à faire de l'État d'Israël un État entièrement juif, à annexer la Jordanie et à transférer massivement la population palestinienne dans des pays en faillite comme l'Irak.
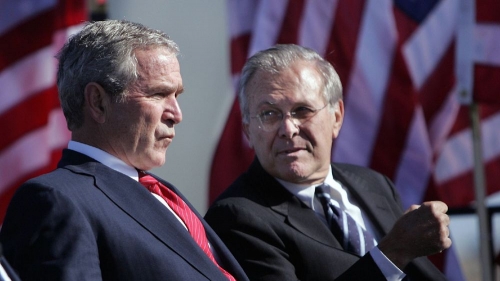
George W. Busch et Donald Rumsfeld
Ce qui était une théorie, avec la chute des tours jumelles, pourrait devenir une réalité. Wolfowitz est crédité de la paternité de la fameuse opération "Tempête du désert". Les néo-conservateurs, du Bureau des plans spéciaux, ont développé des arguments en faveur de l'invasion, tels que l'idée des armes de destruction massive. Ils n'ont fait qu'appliquer la stratégie des "nobles mensonges" inculquée par Leo Strauss: les "armes de destruction massive" en sont un. Les contacts "straussiens" ont fonctionné à la perfection. Richard Perle et Paul Wolfowitz ont promu l'amiral Arthur Cebrowski (photo, ci-dessous), qui devait rendre compte à Donald Rumsfeld (aujourd'hui décédé). La "Doctrine Rumsfeld-Cebrowski" a été imposée.

Pour l'essentiel, cette doctrine peut être résumée comme suit: 1) les États-Unis ont besoin de s'assurer des ressources bon marché des pays en développement; 2) de nos jours, les guerres coloniales conventionnelles pour conquérir et dominer totalement l'administration d'un pays sont pratiquement impossibles (ou très coûteuses); 3) par conséquent, les conflits doivent être prolongés dans une "guerre sans fin" [16] qui laisse derrière elle des "États en faillite" (cf. Libye); 4) dès lors, les États-Unis n'essaieraient plus de gagner des guerres mais seulement de les déclencher (même indirectement par le biais d'Isis) afin de les prolonger le plus longtemps possible (voir l'Afghanistan, l'Irak ou la Syrie); 5) sans un État en position de négocier avec lui, il est beaucoup plus facile d'extraire des ressources. Dans ce lien, http://centredelas.org/actualitat/galeria-de-monstruos/?lang=es, on peut trouver une liste de tous les néocons impliqués dans le business du pétrole et qui sont passés par les échelons supérieurs de l'administration publique américaine, notamment dans le domaine de la Défense.
Les échecs ultimes de ces conflits ont conduit les "néocons straussiens" à repenser les stratégies visant à maintenir l'instabilité mondiale. Ce n'est que dans cette perspective que nous pouvons comprendre la guerre actuelle en Ukraine.
Notes:
[1] Il y a déjà plusieurs générations de Straussiens.
[2] Nom des citoyens-soldats d'Athènes.
[3] L'idée du "noble mensonge", c'est-à-dire que la vérité n'est pas la même pour le citoyen que pour le politicien, se trouve déjà chez Aristote, mais Leo Strauss l'applique à la modernité.
[4) Leo Strauss a ensuite supervisé une centaine de thèses électorales, laissant son empreinte sur bon nombre de ses doctorants. L'un de ses disciples, Allan Bloom, qui a eu une influence significative sur la formation des "straussiens", a également supervisé une centaine de thèses. De plus, les élèves et étudiants qui le suivent se marient entre eux, créant ainsi des liens qui leur permettent d'infiltrer l'administration publique.
[5] Paul Dundes Wolfowitz est né le 22 décembre 1943 à Brooklyn, New York, dans une famille d'origine juive et polonaise, dont la plupart ont péri dans l'Holocauste. Il a appris l'hébreu dans un environnement familial intensément religieux. Après avoir occupé des dizaines de postes de direction et de groupes de réflexion, il est devenu président de la Banque mondiale.
[6] Dans un article récent, Zelensky a été décrit comme le "héros juif".
[7] Le principal groupe de réflexion du complexe militaro-industriel américain.
[8] Richard Norman Perle (né le 16 septembre 1941) est un consultant politique américain qui a occupé le poste de sous-secrétaire à la défense pour les affaires stratégiques mondiales pendant la présidence de Ronald Reagan. Il a commencé sa carrière politique en tant que membre senior du personnel du sénateur Henry "Scoop" Jackson au sein de la commission des services armés du Sénat dans les années 1970. A siégé au comité consultatif du Defense Policy Board de 1987 à 2004, dont il a été le président de 2001 à 2003 sous l'administration Bush. Conseiller clé du secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld dans l'administration Bush.
[9] L'existence de ce document a été révélée dans un article intitulé "US Strategy Plan Calls For Insuring No Rivals Develop", par Patrick E. Tyler, The New York Times, 8 mars 1992.
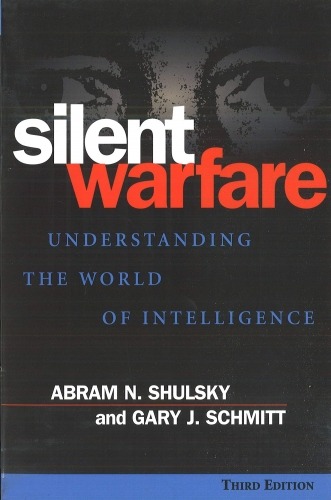
[10] Voir Silent Warfare : Understanding the World of Intelligence, Abram N. Shulsky et Gary J. Schmitt, Potomac Books, 1999.
[11] Rédacteur en chef du magazine The Weekly Standard.
[12] Irving Kristol, issu d'une famille juive non pratiquante d'Europe de l'Est, était membre du groupe trostkyste de jeunes intellectuels new-yorkais mentionné ci-dessus.
[13] Il appartient au noyau dur de l'administration américaine qui se considère comme l'"État profond".
[14] "Toward a neo-Reaganite Foreign Policy", Robert Kagan et William Kristol, Foreign Affairs, juillet-août 1996, vol. 75 (4), pp. 18-32.
[15] "A Clean Break : A New Strategy for Securing the Realm", Institute for Advanced Strategic and Political Studies, 1996.
[16] Expression utilisée par le président de l'époque, George Bush Jr.
13:17 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : néocons, néo-conservateurs, leo strauss, états-unis, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 27 avril 2022
Les Iles Salomon: elle peuvent conférer l'hégémonie!
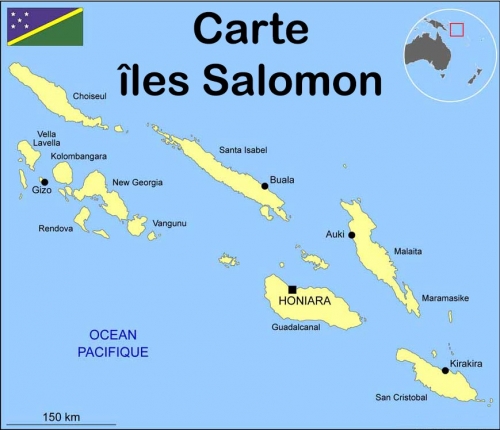
Les Iles Salomon: elle peuvent conférer l'hégémonie!
Anastasia Tolokonina
Source: https://www.geopolitika.ru/article/gegemonovy-ostrova
Comment les États-Unis et la Chine utilisent les îles Salomon comme un point d'appui pour protéger leurs intérêts.
Il a été révélé le 18 avril que le coordinateur du Conseil national de sécurité américain pour les affaires indo-pacifiques, Kurt Campbell, et le secrétaire d'État adjoint américain pour les affaires de l'Asie de l'Est, Daniel Kritenbrink, visiteront trois îles du Pacifique cette semaine: les Fidji, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les îles Salomon, ce dernier État présentant un intérêt particulier. Selon Adrienne Watson, porte-parole du NSC, la délégation américaine entend veiller à ce que leur partenariat "assure la prospérité, la sécurité et la paix dans le Pacifique et les îles indo-pacifiques". Quel est le véritable objectif de la visite des fonctionnaires du département d'État aux îles Salomon et qu'est-ce que l'Australie a à voir avec cela ?
Officiellement, le voyage a été programmé pour coïncider avec la visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken dans la région en février et en fait, il s'agit d'une continuation de celle-ci. C'est après la tournée asiatique du chef de la politique étrangère américaine que la Maison Blanche a publié la stratégie indo-pacifique, qui explique en grande partie le très fort intérêt de Washington pour la région, ainsi que les objectifs réels des visites prévues cette semaine, notamment aux îles Salomon.
Échiquier asiatique
La région indo-pacifique a été le principal centre d'intérêt de la politique étrangère américaine, car le principal objectif de Washington en matière de politique étrangère depuis la fin de la guerre froide était (et est toujours) la domination du monde.
Néanmoins, avec l'influence croissante de la République populaire de Chine, avec sa soi-disant "ascension" dans le monde et ses ambitions de leadership mondial, les États-Unis ne peuvent pas avoir le statut de superpuissance mondiale sans domination dans la région indo-pacifique. Il existe donc une rivalité constante entre ces deux "géants" pour le leadership dans la région indo-pacifique, et les pays asiatiques sont confrontés au choix d'être avec l'Amérique contre la Chine ou sans l'Amérique dans une alliance avec la Chine. Ainsi, la rivalité entre la Chine et les États-Unis dans la région indo-pacifique est principalement motivée par des raisons géopolitiques, même si l'économie joue également un rôle important, étant donné la croissance économique continue des pays de la région. Néanmoins, l'importance de la géopolitique est également notée dans la stratégie indo-pacifique des États-Unis:
"La RPC combine sa puissance économique, diplomatique, militaire et technologique dans la poursuite d'une sphère d'influence dans la région indo-pacifique et cherche à devenir la puissance la plus influente du monde".
Pour l'Amérique, la région indo-pacifique fait partie de "l'échiquier" eurasien dont parlait l'idéologue de la politique étrangère américaine Zbigniew Brzezinski dans son livre The Great Chessboard (1997). C'est dans cette région que se déroule une confrontation féroce entre les États-Unis et la Chine, et c'est l'un des endroits où la suprématie américaine est contestée.

Le dilemme des îles Salomon
En ce qui concerne les îles Salomon, c'est le seul État qui n'a pas encore totalement résolu le dilemme d'"être avec l'Amérique contre la Chine ou sans l'Amérique dans une alliance avec la Chine". Ce dilemme a de profondes racines historiques.
Le fait est que les îles Salomon, qui ont obtenu leur indépendance de la Grande-Bretagne en 1978, sont géographiquement et culturellement fragmentées. Ces facteurs ont rendu difficile une gouvernance centralisée et ont créé un certain nombre de problèmes, notamment une méconnaissance de la communauté politique par l'État et la quasi-impossibilité pour les insulaires éloignés de participer à la vie politique du pays. En outre, en 1998, une guerre civile a éclaté dans les îles Salomon à la suite d'un conflit interethnique entre les résidents de Guadalcanal (où le gouvernement central est basé) et les migrants de Malaita. La population indigène exigeait plus de respect et de réparation de la part des Malaitis et bientôt, les Guadalcanais ont commencé à attaquer les Malaitis et ont fondé une organisation paramilitaire, le Mouvement de libération de l'Isatabu (ODI), forçant la plupart des Malaitis à quitter Guadalcanal. Les Malaitis restants ont formé les Malaitan Eagles pour se défendre contre l'ODI.

Il convient de noter que l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont joué un rôle important dans le conflit en envoyant leurs troupes dans les îles Salomon en 2003. Comme raison de l'introduction de ces troupes, les deux pays ont indiqué le fait que les îles Salomon ne sont pas en mesure d'assurer seules la stabilité de leur territoire, qui peut donc devenir un champ d'action pour diverses organisations criminelles et terroristes. En conséquence, l'intervention australo-néo-zélandaise a permis de ramener l'ordre dans les îles Salomon, mais les conflits internes ne se sont pas arrêtés là, ils ont juste été "gelés" pendant un certain temps.
Le conflit a repris de plus belle le 24 novembre 2021, lorsque des manifestations pacifiques ont éclaté et sont devenues violentes, les manifestants (pour la plupart originaires de la province de Malaita) affrontant la police et les forces gouvernementales, faisant des victimes et mettant le feu au bâtiment du parlement des Îles Salomon.
Les émeutes semblent avoir été suscitées par un autre désaccord entre le gouvernement et les Malaitis: en 2019, le premier ministre des îles a décidé d'établir des relations diplomatiques avec la République populaire de Chine, rompant 36 ans de liens officiels avec la République de Chine (Taïwan) partiellement reconnue, qui, du point de vue de la Chine continentale, est l'une de ses unités administratives, bien qu'indépendante de facto. Cette décision a provoqué un fort mécontentement parmi les habitants de la province de Malaita, dont le premier ministre a accusé le premier ministre des îles Salomon d'entretenir des liens trop étroits avec Pékin.
Il convient de noter que tant Taïwan, soutenue par Washington, que la RPC apportent une aide financière à la région depuis le milieu des années 2000 pour obtenir une reconnaissance diplomatique. Si les Malaitis se sont initialement rangés du côté de Taipei, le gouvernement central des Iles Salomon a eu tendance à coopérer avec Pékin. En conséquence, Malaita a continué à soutenir Taïwan et les États-Unis, et ces désaccords, associés au rejet par le gouvernement du référendum sur l'indépendance de Malaita ainsi qu'à la hausse de la pauvreté et du chômage, ont provoqué des troubles en 2021.
Cette fois, l'Australie est à nouveau intervenue dans le conflit, déployant du personnel de la police fédérale australienne et de la force de défense australienne à la demande du gouvernement des îles Salomon, en vertu d'un traité de sécurité bilatéral entre l'Australie et les îles Salomon.
Ainsi, l'essence du dilemme des îles Salomon est que l'État est effectivement divisé en deux sphères d'influence, comme c'était le cas pendant la guerre froide, par exemple en Allemagne, en Corée ou au Vietnam. Une des sphères d'influence (le gouvernement du pays) appartient à la Chine communiste, l'autre (la province de Malaita) à Taïwan soutenue par Washington (c'est-à-dire les États-Unis). Si, jusqu'à présent, la Chine remporte cette bataille géopolitique, il est possible que les Malaitis déclenchent à nouveau une guerre civile. Pour cette raison, il est trop tôt pour parler de la certitude totale des Îles Salomon face au dilemme "être avec l'Amérique contre la Chine ou sans l'Amérique dans une alliance avec la Chine".
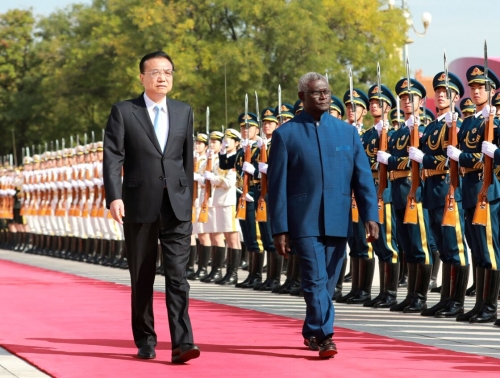
Visite géopolitique
De toute évidence, les îles Salomon constituent un autre champ de bataille pour les deux grandes puissances représentées par les États-Unis et la Chine. Par conséquent, la prochaine visite de responsables du département d'État américain aux îles Salomon ne porte pas en elle l'objectif de simplement "s'assurer que le partenariat garantit la prospérité, la sécurité et la paix dans le Pacifique et les îles indo-pacifiques", comme l'a déclaré le porte-parole du NSC. Quel est donc l'objectif principal ?
Le 19 avril, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a annoncé un pacte de sécurité de grande envergure avec les îles Salomon. L'accord, essentiel pour une nation insulaire aux prises avec des troubles politiques incessants, a particulièrement alarmé les États-Unis et l'Australie, car la possibilité d'une tête de pont militaire de la RPC dans le Pacifique Sud menace les intérêts des pays de la région. Bien que le texte du traité n'ait pas été divulgué, un projet de document ayant fait l'objet d'une fuite indique qu'il permettrait aux navires de guerre chinois de s'arrêter dans les îles Salomon et que la police de la RPC, à la demande de l'archipel, pourrait aider à maintenir l'ordre public.
C'est pourquoi, immédiatement après l'échec de l'Australie à convaincre les Îles Salomon d'annuler l'accord de sécurité avec la Chine, de hauts responsables américains se sont immédiatement rendus dans le pays. Bien entendu, l'objectif principal de Washington est de "tirer" Honiara de son côté et de le convaincre que l'accord avec la Chine doit être abandonné.
Compte tenu de la politique américaine à l'égard des Îles Salomon, on peut affirmer qu'à ce stade, il ne sera pas possible de "tirer" Honiara de son côté. Pendant de nombreuses années, les États-Unis n'ont pas accordé suffisamment d'attention aux îles; ils y ont été pratiquement absents, distraits par d'autres problèmes mondiaux et laissant l'élaboration de la politique régionale à l'Australie. Par conséquent, la visite de Campbell aux îles Salomon est probablement une entreprise vaine.
Toutefois, si l'on considère le long terme, le succès de la visite des officiels américains dans le pays pourrait être favorisé par une rencontre avec toutes les forces politiques des îles, y compris l'opposition. Tôt ou tard, le pouvoir peut changer, ce qui fera le jeu des États-Unis.
En outre, un facteur qui affecte négativement la politique américaine dans la région est l'absence fondamentale d'ambassade. Une représentation diplomatique renforcerait le poids politique et économique de la région, mais elle est absente depuis 29 ans. En revanche, la Chine dispose d'une grande ambassade de trois étages à Honiara, avec suffisamment de place pour accueillir la police et le personnel militaire, qui pourrait arriver sous peu.
Enfin, les îles Salomon ont besoin d'investissements dans les infrastructures. On pense que c'est la promesse du gouvernement chinois d'une aide financière sous la forme d'un prêt de 500 millions de dollars qui a contribué à la décision d'abandonner Taipei pour se joindre à Pékin en 2019.
Il est clair que dans la bataille géopolitique entre la RPC et les États-Unis dans les îles Salomon, la Chine mène actuellement par une large marge. Mais Washington pourrait également tirer son épingle du jeu s'il intensifie sa politique dans la région et commence à fournir une assistance financière et militaire. Mais le temps presse.
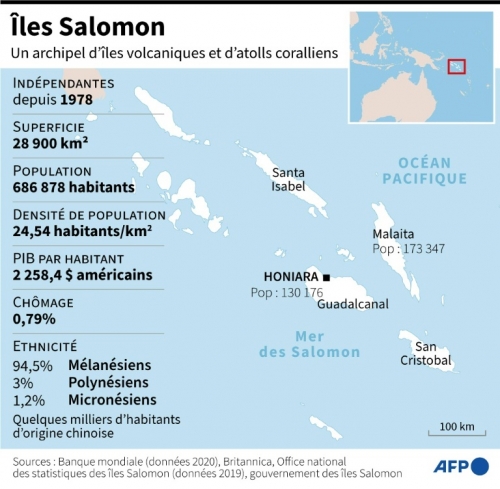
L'intérêt de l'Australie
Si les intérêts des États-Unis dans la région sont presque évidents, la situation est quelque peu différente avec l'Australie, qui ne rivalise pas avec la Chine pour le statut de leader mondial.
L'Australie a conclu un pacte de sécurité avec les îles Salomon en 2017, mais malgré le respect du droit des îles à prendre des décisions souveraines, la signature du pacte avec la Chine a été profondément décevante pour l'Australie. En effet, le parti travailliste de l'opposition l'a qualifié de "plus grand échec de la politique étrangère australienne dans le Pacifique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale".
Bien entendu, l'accord préoccupe l'Australie car il pourrait compromettre la stabilité de la région. Et cela se comprend: une présence militaire chinoise potentielle à quelque 1 600 km de l'Australie n'est pas agréable.
Il ne faut pas non plus oublier le fait qu'en 2021, l'Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni ont créé l'alliance politico-militaire AUKUS, qui vise précisément à contenir la Chine dans la région. Les relations difficiles entre Pékin et Canberra sont également mises en évidence par l'abandon par l'Australie de presque tous leurs projets de coopération conjointe au cours des deux dernières années.
Une autre raison de l'inquiétude de l'Australie est la crainte que le pacte n'entraîne une nouvelle poussée d'instabilité dans les îles Salomon. En particulier, elle pourrait provoquer chez les Malaitis, qui ont des sentiments anti-chinois très forts, une nouvelle vague de protestations. L'instabilité au sein des îles, à son tour, pourrait conduire à une autre intervention australienne dans le conflit au sein de l'État.
En outre, les îles Salomon sont un partenaire économique de l'Australie et un point stratégique essentiel, car elles constituent une route maritime reliant la côte est de l'Australie à l'Asie. Par conséquent, Canberra est effrayée par la perspective d'une détérioration des relations avec les îles Salomon.
Ainsi, les îles Salomon constituent un autre champ de bataille pour les États-Unis et la Chine. Malgré l'avantage diplomatique de Pékin sur les îles, il est prématuré de parler d'un nouveau succès chinois dans la région, car les îles Salomon sont un État très spécifique avec beaucoup de contradictions et de problèmes internes qui pourraient ultérieurement affecter de manière significative l'issue de la rivalité entre les États-Unis et la Chine pour le leadership dans la région indo-pacifique.
19:08 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : iles salomon, australie, chine, états-unis, mélanésie, océan pacifique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 26 avril 2022
Bombes de vérité : comment les Etats-Unis ont mis la main sur l'Ukraine

Bombes de vérité : comment les Etats-Unis ont mis la main sur l'Ukraine
par Fabio Mini
Source : Il Fatto quotidiano & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/bombe-di-verita-cosi-gli-usa-hanno-messo-le-mani-sull-ucraina
Il y a quelques semaines, lors d'une apparition à la télévision américaine, la célèbre journaliste Lara Logan a lâché tant de "bombes de vérité" sur un public médusé que les présentateurs du programme ont dû supplier (sur des téléphones internes) pour une pause commerciale. Les "bombes" étaient en fait des choses que les soi-disant complotistes disaient au monde entier depuis longtemps, sauf aux Américains bien sûr.
Outre la rhétorique poutiniste, qui reflète la rhétorique anti-poutiniste, ce qui est étonnant, c'est la réaction du public: une avalanche de compliments pour les vérités non dites, quelques objections, de nombreuses expressions d'admiration pour le courage et tout autant de prières de la part de ceux qui craignent pour la vie de Lara.

Lara Logan.
Même au pays de la liberté d'expression, si vous dites quelque chose qui dérange les pouvoirs en place, vous êtes mort. La tirade de Lara Logan est plus que cela: c'est un appel clair à la responsabilité du leadership américain dans ce qui se passe en Ukraine. Là-bas, la rhétorique des bons gars et des méchants voyous a explosé, tout comme au Vietnam, en Irak et en Afghanistan, mais pour les Américains qui se sont habitués à l'idée d'être les bons gars, c'est toujours une "découverte" saine mais traumatisante.
Rechercher des traces d'une implication directe des États-Unis dans cette guerre, présentée comme une question subalterne qui ne concerne que la Russie et l'Ukraine et tout au plus l'UE ou l'OTAN et la Russie, est moins difficile qu'il n'y paraît.
Les États-Unis sont présents en Ukraine depuis 1991 et n'en sont jamais repartis. Lorsque l'URSS s'est désintégrée, l'Ukraine s'est retrouvée avec le troisième arsenal nucléaire le plus puissant du monde, après les États-Unis et la Russie. Pas moins de 176 missiles intercontinentaux avec 1240 têtes nucléaires.
Plusieurs dizaines de bombardiers nucléaires stratégiques avec 600 missiles et bombes à gravité et 3000 dispositifs nucléaires tactiques. Les États-Unis et la Russie se sont mis d'accord sur une réduction de l'armement nucléaire et, avec l'idée que l'Ukraine serait toujours dans la sphère d'influence de la Russie, ont décidé d'éliminer tout l'armement nucléaire existant en Ukraine.
À partir de 1992, l'Ukraine a exploité la sensibilité de l'Occident à la question nucléaire et, jusqu'en 1994, elle a continué à gagner du temps et à marchander son adhésion au traité de non-prolifération et la ratification de START. Le démantèlement de chaque silo à missiles coûtait 1 million de dollars (à l'époque) et les États-Unis ont fourni 399,2 millions de dollars pour payer Bechtel Corp. afin de sous-traiter les travaux.
La dénucléarisation a été achevée, du moins sur le papier, en 1996, mais ce n'est qu'en 2000 que les bombardiers stratégiques ont été remis à la Russie en échange d'un allègement des dettes de gaz qui s'étaient accumulées. L'Ukraine a hérité d'environ 30 % de l'industrie militaire soviétique, qui représentait 50 à 60 % de toutes les entreprises ukrainiennes et employait 40 % de sa population active. L'armée ukrainienne a échangé des armes conventionnelles et signé des contrats avec des entreprises commerciales. Les premiers contrats de livraison d'armes à l'Iran, signés à la mi-1992, ont provoqué une réaction négative en Occident (surtout aux États-Unis). Depuis lors, l'Ukraine n'a cessé de produire des armes et de les vendre sur le marché noir à divers pays, toujours sous l'œil attentif des États-Unis, de la Russie et de leurs trafiquants et oligarques.

Depuis la révolution orange de 2004, les États-Unis sont intervenus en Ukraine pour déstabiliser les relations avec la Russie. Les différentes tentatives se sont concrétisées dix ans plus tard avec les incidents de Maidan. L'ingérence est flagrante et il s'agit, en l'occurrence, de l'appel téléphonique de Victoria Nuland - "Fuck the EU !" - pour révéler qu'elle ne se contente pas de surveiller les événements, mais qu'elle assure une direction politique et opérationnelle. De 2014 à 2022, grâce aux sanctions et à l'aide militaire des États-Unis et de l'OTAN, l'armée a été restructurée, des milices paramilitaires ont été équipées et entraînées, et des laboratoires de recherche biologique ont été installés par des entreprises américaines. Dans une tentative grotesque de faire passer la question des laboratoires pour des fake news, l'équipe Vox Check écrit: "Des laboratoires biologiques américains secrets en Ukraine? Un mythe de la propagande russe. Rien ne prouve qu'il y en ait... Cependant, il existe une coopération entre les institutions ukrainiennes et américaines. Depuis 2005, les États-Unis ont aidé à moderniser les laboratoires ukrainiens, à mener des recherches et à améliorer la sécurité pour prévenir les épidémies de maladies infectieuses dangereuses par le biais du programme de réduction des menaces biologiques. Pendant toute la période de coopération, les États-Unis ont investi environ 200 millions de dollars dans le développement de 46 laboratoires et institutions médicales en Ukraine. Ces institutions ne sont pas impliquées dans le développement d'armes chimiques ou biologiques".
Et en effet, comme la mutuelle ukrainienne ne s'occupe pas de vaccins mais d'agents pathogènes à haut risque, l'Organisation mondiale de la santé a conseillé à l'Ukraine, le 11 mars dernier (source : Reuters), de détruire ces agents hébergés dans les laboratoires de santé publique du pays afin d'éviter "toute fuite potentielle" qui propagerait des maladies au sein de la population.
Mais la question est que "au contraire, les États-Unis ont lancé un programme visant à empêcher le développement de telles armes. L'Union soviétique avait son propre programme d'armes biologiques. Après l'effondrement, des matières biologiques dangereuses sont restées sur le territoire de l'Ukraine. Le programme américain vise à garantir que ces matériaux ne soient pas volés ou utilisés à des fins autres que la recherche. Jusqu'en 2014, le programme s'étendait également aux laboratoires russes".
Cependant, ces matériaux laissés par l'URSS soulèvent la question d'autres matériaux soviétiques en Ukraine. L'URSS disposait d'un stock de près de 40.000 tonnes d'agents chimiques neurotoxiques, vésicants et suffocants. Selon certains rapports, le stock total a dépassé 50.000 tonnes, avec un stock supplémentaire de 32.300 tonnes d'agents phosphorés. Quelle proportion de ce stock est restée en Ukraine?
Officiellement aucune, mais si les armes biologiques sont laissées, pourquoi ne pas laisser aussi les armes chimiques que la Russie et les États-Unis possèdent encore?
Les traces des États-Unis en Ukraine sont également présentes ici, ne serait-ce que parce qu'elles savent exactement où elles ont abouti. Si l'on devait mesurer l'implication américaine par le nombre de soldats américains sur le terrain, on peut se limiter à compter les soi-disant volontaires parmi les combattants et les contractants étrangers. Le président Zelensky a parlé d'environ 20.000 volontaires du monde entier (y compris des États-Unis).


La "légion internationale" a été intégrée aux forces de défense de l'Ukraine, afin de ne pas tomber dans un vide juridique sur le statut des mercenaires. En fait, nombre d'entre eux sont payés avec des fonds donnés par les États-Unis et l'Europe, ainsi que par des "particuliers". Le commandant de la Légion géorgienne, M. Mamulashvili, procède depuis avril 2014 au recrutement et à la formation de bataillons composés de professionnels, principalement américains et britanniques. Eante a personnellement dirigé ses bataillons contre les Russes à l'aéroport d'Hostomel, dans la région de Kiev. Si l'on veut ensuite examiner le rôle des États-Unis dans la question ukrainienne à quelques pas de la frontière, on peut en déduire que la "défense" de l'OTAN est peu défensive et très provocatrice. Le Pentagone a repositionné ses troupes avant l'invasion russe. Les 160 hommes de la Garde nationale de Floride (instructeurs) ont été retirés d'Ukraine. Sur les quelque 40.000 soldats américains présents en Allemagne, plusieurs milliers ont été déployés dans les pays voisins de l'OTAN. L'OTAN a déployé 5000 soldats depuis 2014 dans les États baltes et les États-Unis ont envoyé 5000 autres soldats en Allemagne.
La présence américaine dans la cyberguerre est également ancienne. La dernière attaque russe contre le réseau ukrainien de contrôle de l'électricité (8 avril) a été miraculeusement évitée grâce à Microsoft et à la société slovaque Eset. Le collectif Anonymous a attaqué à plusieurs reprises la Russie et s'est entièrement rangé du côté de l'Ukraine. L'origine des membres éphémères du collectif est des plus variées et offre diverses possibilités aux agents de la cyberguerre de se déguiser derrière cette marque. La même opportunité est offerte aux sites anti-russes comme RURansom Wiper et à des dizaines d'autres plateformes formelles et informelles. Les grandes entreprises américaines sont toutes présentes en Ukraine et boycottent et censurent toute communication "indésirable". Il s'agit d'activités collatérales mais importantes.

Cependant, l'implication la plus importante se situe avec et derrière l'envoi de fonds et d'armes. Le président Biden a porté la contribution américaine à 1 milliard de dollars en une semaine et à 2 milliards de dollars depuis son entrée en fonction. Les nouvelles armes envoyées comprennent des missiles Stinger (800), des missiles Javelin (2000) et des systèmes antichars (6000). Le transfert de véhicules blindés, de technologies et de drones d'autres pays vers l'Ukraine a été autorisé. Beaucoup de ces systèmes ont également besoin de leurs opérateurs et ceux-ci sont normalement fournis par des sociétés militaires privées, qui continuent à recruter du personnel spécialisé.
Avec tout cela, seul un pays délibérément laissé dans l'ignorance peut encore penser qu'il n'est pas impliqué et peut avoir une Pâques paisible.
16:56 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ukraine, états-unis, europe, affaires européennes, politique internationale, lara logan |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 25 avril 2022
Nord Stream 2, une des clés de la guerre en Ukraine
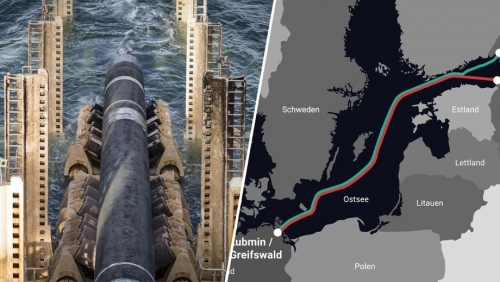
Nord Stream 2, une des clés de la guerre en Ukraine
Daniel Miguel López Rodríguez
Source: https://posmodernia.com/nord-stream-2-una-de-las-claves-de-la-guerra-de-ucrania/
Le flux du Nord
Le sous-sol ukrainien contient un réseau de gazoducs par lequel passe une partie de l'approvisionnement russe vers l'Europe. Entre 2004 et 2005, 80 % du gaz russe destiné à l'Europe a transité par le sous-sol ukrainien. Lorsque Gazprom (le géant russe de l'énergie appartenant à l'État) a interrompu l'approvisionnement des Ukrainiens en janvier 2006 et en janvier 2009, ces derniers ont saisi le gaz destiné à l'Europe, ce qui a entraîné des pertes énormes pour ces pays, qui sont très dépendants du gaz russe, et a jeté un sérieux discrédit sur la Russie en tant que fournisseur.
Afin d'éviter ce transit ukrainien, les Russes ont décidé de construire deux nouveaux gazoducs. Gazprom a fait valoir que le fait de relier un gazoduc directement à l'Allemagne sans avoir besoin de passer par des pays de transit permettrait d'éviter que les exportations de gaz russe vers l'Europe occidentale ne soient coupées, comme cela s'est produit deux fois auparavant. C'est ainsi qu'est né le projet Nord Stream (Севеверный поток), un gazoduc qui relierait la Russie à l'Europe (directement à l'Allemagne via la mer Baltique) sans devoir passer par l'Ukraine ou la Biélorussie.
En avril 2006 déjà, le ministre polonais de la défense, Radek Sikorski, comparait les accords sur la construction d'un gazoduc au pacte de non-agression germano-soviétique, le pacte Ribbentrop-Molotov signé aux premières heures du 24 août 1939, car la Pologne est particulièrement sensible aux accords passés par-dessus sa tête (https://www.voanews.com/a/a-13-polish-defense-minister-pi... ). Tout pacte conclu par la Russie et l'Allemagne y fera penser et sera diabolisé (telle est la simplicité de la propagande, mais elle est tout aussi efficace non pas en raison du mérite des propagandistes mais du démérite du vulgaire ignorant, qui abonde).
Le ministre suédois de la défense, Mikael Odenberg, a indiqué que le projet constituait un danger pour la politique de sécurité de la Suède, car le gazoduc traversant la Baltique entraînerait la présence de la marine russe dans la zone économique de la Suède, ce que les Russes utiliseraient au profit de leurs renseignements militaires. En fait, Poutine justifierait la présence de la marine russe pour assurer la sécurité écologique.
L'hebdomadaire allemand Stern a émis l'hypothèse que le câble à fibre optique et les stations relais le long du gazoduc pourraient être utilisés pour l'espionnage russe, mais Nord Stream AG (le constructeur du gazoduc) a répondu en arguant qu'un câble de contrôle à fibre optique n'était pas nécessaire et n'avait même pas été prévu. Le vice-président du conseil d'administration de Gazprom, Alexander Medvedev, minimise la question en soulignant que "certaines objections sont soulevées qui sont risibles : politiques, militaires ou liées à l'espionnage. C'est vraiment surprenant car dans le monde moderne, il est ridicule de dire qu'un gazoduc est une arme dans une guerre d'espionnage" (https://web.archive.org/web/20070927201444/ et http://www.upstreamonline.com/live/article138001.ece ). Où que soient les Russes, on craint toujours les espions (on ne se méfie pas autant des Ricains, malgré les révélations d'Edward Snowden : l'enfer, c'est toujours les autres).
Le Rockefellerien Greenpeace se plaindrait également de la construction du gazoduc, car il traverserait plusieurs zones classées comme aires marines de conservation.

Le 13 juin 2007, face aux préoccupations écologiques, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a déclaré que "la Russie respecte pleinement le désir d'assurer la durabilité environnementale à 100 % du projet et soutient entièrement cette approche, et toutes les préoccupations environnementales seront traitées dans le cadre du processus d'évaluation de l'impact environnemental" (https://www.upstreamonline.com/online/russia-backs-green-... ).
Le gazoduc devait être inauguré le 8 novembre 2011 lors d'une cérémonie dans la municipalité de Lubmin (Mecklembourg-Poméranie occidentale) par la chancelière Angela Merkel et le président russe Dmitri Medvedev ; étaient également présents le Premier ministre français François Fillon et le Premier ministre néerlandais Mark Rutte.
Il était également prévu de construire South Stream, un gazoduc qui devait relier la Russie à la Bulgarie en traversant la mer Noire jusqu'à la Grèce et l'Italie. Mais il a finalement été annulé au profit de Blue Stream, qui transporte du gaz naturel du sud de la Russie vers la Turquie via la mer Noire. Grâce à ce gazoduc, la Turquie est le deuxième plus grand importateur de gaz russe, juste derrière l'Allemagne.
Alors que l'Allemagne a pu réaliser le projet Nord Stream 1, la Grèce et l'Italie ont vu leur projet South Stream mis au rebut. C'est un signe de qui a le plus de pouvoir dans la prétentieuse Union européenne. Mais Nord Stream 2 n'est pas allé aussi loin et - comme nous le verrons - les Allemands se sont pliés aux diktats des Américains.
Nord Stream 1 se compose de deux pipelines allant de Vyborg (nord-ouest de la Russie) à Greifswald (nord-est de l'Allemagne). Il a la capacité de transporter 55 milliards de mètres cubes par an, même si en 2021, il était capable de transporter 59,2 milliards de mètres cubes. Il s'agit du gazoduc par lequel transite le plus grand volume de gaz à destination de l'UE.
Les travaux sur le gazoduc Nord Stream 2 ont duré de 2018 à 2021, et on estime que le matériau du gazoduc peut durer environ 50 ans. Le pipeline part de la station de compression Slavyanskaya, près du port d'Ust-Luga (dans le district Kingiseppsky de l'Oblast de Leningrad), et va jusqu'à Greifswald (Poméranie occidentale). En 2019, la société suisse Allsea, qui était chargée de poser le gazoduc, a abandonné le projet et Gazprom a dû le mener à bien par ses propres moyens. La première ligne a été achevée en juin 2021 et la seconde en septembre. Son ouverture était prévue pour le milieu de l'année 2022, ce qui devait permettre de doubler le gaz transporté pour atteindre 110 milliards de mètres cubes par an. Outre Gazprom, les partenaires pour la construction de Nord Stream 2 ont été Uniper, Wintershall, OMV, Engie et Shell plc.
Le gouvernement allemand a approuvé le projet en mars 2018, afin d'éloigner l'Allemagne du nucléaire et du charbon (c'est-à-dire pour des raisons environnementales, toujours aussi sensibles en Allemagne, déjà depuis des temps pas particulièrement démocratiques). Les coûts du gazoduc sont estimés à 9,9 milliards d'euros, Gazprom apportant 4,75 milliards d'euros et ses partenaires le reste.

Nord Stream 2 aurait complété les troisième et quatrième lignes (par rapport aux première et deuxième lignes de Nord Stream 1). À travers la Baltique, Nord Stream 1 et 2 suivent fondamentalement le même itinéraire. Les deux pipelines tirent leur gaz des gisements de la péninsule de Yamal et des baies d'Ob et de Taz. Avec ces deux gazoducs (avec quatre lignes au total), l'Allemagne fournirait du gaz russe à d'autres pays, ce qui améliorerait sans aucun doute la situation sur le marché européen et permettrait de surmonter la crise énergétique. Les Allemands sont allés jusqu'à affirmer que le Nord Stream 2 serait plus rentable que les livraisons terrestres via l'Europe de l'Est. La Russie a fourni 35,4 % du gaz arrivant en Allemagne (et avec Nord Stream 2, elle aurait doublé cette quantité) et 34 % du pétrole.
Les principaux opposants à Nord Stream 2 ont été les pays baltes, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie ( ?), la Roumanie, la Croatie, la Moldavie et principalement la Pologne et l'Ukraine, tous soutenus par la Commission européenne et les États-Unis. Ces pays se sont opposés à Nord Stream 2 au motif qu'un gazoduc direct vers l'Allemagne pourrait entraîner l'arrêt de leur approvisionnement en énergie et les priver des lucratifs frais de transit.
Chronologie de la politique américaine contre Nord Stream 2
Les plaintes américaines contre le gazoduc ne sont pas propres à l'administration Biden (qui a subi la pression de ses collègues démocrates pour adopter une ligne dure contre la Russie, qualifiant ainsi Poutine de "meurtrier" - comme si l'administration Obama dont il était le vice-président n'avait pas commis d'innombrables crimes de guerre, bien plus que la Russie ne l'a jamais fait : mais le premier président afro-américain est un démon qui "ne sent pas le soufre"). Déjà sous Obama, les protestations ont commencé alors que le projet n'avait pas encore totalement pris forme (l'idée du projet a commencé à prendre forme en octobre 2012).
Sous l'administration Trump, les plaintes se sont poursuivies et n'ont jamais cessé, même si Trump a d'abord affirmé qu'il n'appliquerait pas la loi contre les ennemis de l'Amérique par le biais de sanctions sur les exportations énergétiques russes, mais il a rapidement changé d'avis. M. Trump a même menacé d'imposer des droits de douane aux pays de l'UE et a proposé de rouvrir les négociations en vue de conclure un accord commercial entre les États-Unis et l'UE si le projet était annulé.
Le 27 janvier 2018, coïncidant avec le 73e anniversaire de la libération du camp de concentration d'Auschwitz, le secrétaire d'État Rex Tillerson (un ancien PDG d'Exxon Mobil, c'est-à-dire un homme de Rockefeller infiltré dans l'administration Trump, qui sera finalement évincé par le plus loyal Mike Pompeo) a fait valoir que les États-Unis et la Pologne s'opposaient à Nord Stream 2 en raison du danger qu'il représente pour la sécurité et la stabilité énergétiques de l'Europe, "tout en donnant à la Russie un outil supplémentaire pour politiser le secteur de l'énergie" ( https://www.expansion.com/economia/politica/2018/01/27/5a... ).
Les sénateurs américains des deux partis se sont inquiétés en mars 2018, lorsque le gouvernement allemand a approuvé le projet, et ont écrit que "en contournant l'Ukraine, Nord Stream II éliminera l'une des principales raisons pour lesquelles la Russie évite un conflit à grande échelle dans l'est de l'Ukraine, comme le Kremlin le sait bien" (https://www.cfr.org/in-brief/nord-stream-2-germany-captiv... ).
Le transit ukrainien fournissait autrefois 44 % du gaz russe à l'UE, ce qui permettait aux caisses de l'État (de plus en plus corrompu) d'empocher quelque 3 milliards de dollars par mois. Mais avec Nord Stream 2, cela devait changer et le transit par le sous-sol ukrainien devait être encore décuplé. Cela aurait fait perdre à l'Ukraine 3 % de son PIB. L'Ukraine y voyait une atteinte à sa souveraineté, mais aussi à la sécurité énergétique collective de l'Europe dans son ensemble, car le transit du gaz par l'Ukraine dissuade l'agression russe. L'ouverture de Nord Stream 2, qui aurait fait de l'Allemagne la première plaque tournante du gaz en Europe, aurait mis fin à cette situation.
En janvier 2019, l'ambassadeur américain en Allemagne, Richard Grenell, a envoyé une lettre aux entreprises qui construisent le gazoduc, les exhortant à abandonner le projet et les menaçant de sanctions si elles le poursuivent. En décembre de la même année, les sénateurs républicains Ted Cruz et Ron Johnson ont également fait pression sur les entreprises impliquées dans le projet.
Le président du Conseil européen Donald Tusk, le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki et le ministre britannique des Affaires étrangères de l'époque Boris Johnson ont protesté contre la construction de Nord Stream 2. Tusk a clairement indiqué que le gazoduc n'était pas dans l'intérêt de l'Union européenne. Les fonctionnaires de la Commission européenne ont déclaré que "Nord Stream 2 n'améliore pas la sécurité énergétique [de l'UE]" (https://euobserver.com/world/141584 ).
Nord Stream 2 est quelque chose qui a divisé l'UE. Bien que lorsque Donald Trump était dans le bureau ovale de la Maison Blanche, le projet ne semblait pas si mauvais, et la France, l'Autriche et l'Allemagne, plus la Commission européenne, ont critiqué les États-Unis (c'est-à-dire l'administration Trump) pour les nouvelles sanctions contre la Russie au sujet du pipeline, se plaignant que les États-Unis menaçaient l'approvisionnement énergétique de l'Europe.

Le chancelier autrichien Christian Kern et le ministre allemand des Affaires étrangères Sigman Gabriel se sont plaints dans une déclaration commune : "L'approvisionnement énergétique de l'Europe est l'affaire de l'Europe, pas celle des États-Unis d'Amérique" (https://www.usnews.com/news/business/articles/2017-06-15/... ). Et ils ajoutent : "Menacer les entreprises d'Allemagne, d'Autriche et d'autres États européens de sanctions sur le marché américain si elles participent ou financent des projets de gaz naturel comme Nord Stream 2 avec la Russie introduit une qualité complètement nouvelle et très négative dans les relations entre l'Europe et les États-Unis" (https://www.politico.eu/article/germany-and-austria-warn-... ). Mais - comme nous le verrons - les politiciens allemands, avec un gouvernement social-démocrate, n'ont pas été aussi audacieux avec l'administration Biden.
Isabelle Kocher, PDG du groupe ENGIE (un groupe local français qui distribue de l'électricité, du gaz naturel, du pétrole et des énergies renouvelables), a critiqué les sanctions américaines et a affirmé qu'elles tentaient de promouvoir le gaz américain en Europe (ce qui est la clé de toute l'affaire). Olaf Scholz, lorsqu'il était ministre des finances dans le gouvernement de coalition dirigé par Merkel, a rejeté les sanctions comme "une intervention sévère dans les affaires intérieures allemandes et européennes". Un porte-parole de l'UE a critiqué "l'imposition de sanctions contre des entreprises de l'UE faisant des affaires légitimes" (https://www.dw.com/en/germany-eu-decry-us-nord-stream-san... ).
Le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Mass, a déclaré sur Twitter que "la politique énergétique européenne se décide en Europe, pas aux États-Unis". M. Lavrov a affirmé que le Congrès américain "est littéralement submergé par le désir de tout faire pour détruire" les relations avec la Russie (https://www.cnbc.com/2019/12/16/ukraine-and-russia-look-t... ). Toutefois, il convient de noter que l'Allemagne a fortement soutenu les sanctions contre la Russie suite à l'annexion de la Crimée en 2014.
L'Association allemande des entreprises orientales a déclaré dans un communiqué que "les États-Unis veulent vendre leur gaz liquéfié en Europe, pour lequel l'Allemagne construit des terminaux. Si nous arrivons à la conclusion que les sanctions américaines visent à chasser les concurrents du marché européen, notre enthousiasme pour les projets bilatéraux avec les États-Unis se refroidira considérablement" (https://www.dw.com/en/nord-stream-2-gas-pipeline-faces-sa... ).
Le 21 décembre 2019, Trump a signé une loi imposant des sanctions aux entreprises ayant contribué à la construction de l'oléoduc, qui a été interrompue après la signature de Trump, mais reprendrait en décembre 2020, après l'élection de Joe Biden à la présidence. Mais immédiatement, le 1er janvier 2021, un projet de loi annuel sur la politique de défense adopté par le Congrès américain prévoyait des sanctions pour les entreprises travaillant sur le pipeline ou le sécurisant. Le 26 janvier, la Maison Blanche a annoncé que le nouveau président estime également que "Nord Stream 2 est une mauvaise affaire pour l'Europe", et que son administration va donc "revoir" les nouvelles sanctions (https://www.reuters.com/article/us-usa-biden-nord-stream-... ).
Ainsi, le bipartisme au Capitole s'est prononcé contre l'achèvement du gazoduc Nord Stream 2, non pas parce que c'est "une mauvaise affaire pour l'Europe", mais parce que c'est une mauvaise affaire pour les États-Unis. Sur ce point, les "mondialistes" et les "patriotes" sont d'accord.
Le 30 juillet 2020, le secrétaire d'État Mike Pompeo s'est adressé au Sénat en critiquant la construction de Nord Stream 2 : "Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer que ce gazoduc ne menace pas l'Europe. Nous voulons que l'Europe dispose de ressources énergétiques réelles, sûres, stables, sûres et non convertibles". C'est comme s'il disait : "Nous ferons tout ce que nous pouvons pour nous assurer que ce pipeline ne menace pas les États-Unis. Nous voulons que l'Europe dispose de ressources énergétiques qu'elle achète aux États-Unis". Il a ajouté que le département d'État et le département du Trésor "ont très clairement indiqué, dans nos conversations avec ceux qui ont des équipes sur place, la menace expresse que représente pour eux la poursuite des travaux d'achèvement du pipeline" (https://www.rferl.org/a/pompeo-u-s-will-do-everything-to-... ).
Le 20 avril 2021, on pouvait lire sur le site Web du Conseil européen des relations étrangères (think tank de Soros) : "Ce serait mauvais pour l'Europe si la pression américaine devait forcer l'annulation du gazoduc et laisser l'Allemagne et les autres États membres dont les entreprises participent à sa construction amers et meurtris. Ce serait également mauvais pour l'Europe si le gazoduc finissait par balayer les réticences de la Pologne et par dépeindre l'Allemagne comme un acteur égoïste qui ne se soucie pas de ses partenaires. L'un ou l'autre résultat affaiblirait également l'alliance transatlantique et, plus ou moins directement, profiterait à Moscou... si Washington arrête le projet, Moscou trouvera une autre raison de rejeter l'Europe comme un acteur politique qui manque de crédibilité. Bien sûr, cela ne doit pas signifier que l'Europe doit sauver Nord Stream 2 juste pour impressionner la Russie. Le raisonnement de l'UE devrait avoir des racines plus profondes que cela". Il s'agit donc d'un "problème de gestion des relations" (https://ecfr.eu/article/the-nord-stream-2-dispute-and-the... ).

Cependant, le 19 mai 2021, le gouvernement américain a levé les sanctions contre Nord Stream AG, mais a imposé des sanctions contre quatre banques russes et cinq sociétés russes. Sergueï Ryabkov, vice-ministre russe des Affaires étrangères, a salué cette démarche et y a vu "une opportunité pour une transition progressive vers la normalisation de nos liens bilatéraux" (https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57180674 ).
Le sénateur républicain Jim Risch a déclaré qu'une telle démarche était "un cadeau à Poutine et ne fera qu'affaiblir les États-Unis" (https://www.reuters.com/business/energy/us-waive-sanction...).
Yurity Vitrenko de Naftogaz (la compagnie pétrolière et gazière d'État ukrainienne) s'opposerait à cette démarche et affirmerait que l'Ukraine fait pression sur les États-Unis pour qu'ils réimposent des sanctions afin d'empêcher l'ouverture du pipeline. Biden prétendrait qu'il a mis fin aux sanctions parce que le pipeline était presque terminé et parce que les sanctions avaient nui aux relations entre les États-Unis et l'Union européenne.
Le président ukrainien, alors inconnu en Occident, Volodymyr Zelensky, s'est dit "surpris et déçu" par la décision de l'administration Biden, qui a également refusé de sanctionner le PDG de Nord Stream AG, Mathias Warning, un allié de Poutine.
Cependant, en juin 2021, la pose des deux lignes de pipelines a été entièrement achevée. Le 20 juillet 2021, Biden et une Angela Merkel sortante ont convenu que les États-Unis pourraient sanctionner la Russie si elle utilisait Nord Stream 2 comme une "arme politique", dans le but d'empêcher la Pologne et l'Ukraine de manquer de gaz russe.
Mme Merkel est une atlantiste avouée et n'était pas exactement enthousiaste à l'égard du projet Nord Stream 2, mais elle ne voyait aucun moyen de faire marche arrière. Pour elle, c'était une situation très délicate.
L'Ukraine obtiendrait un prêt de 50 millions de dollars pour investir dans les technologies vertes jusqu'en 2024, et l'Allemagne créerait un fonds d'un milliard de dollars pour la transition de l'Ukraine vers l'énergie verte, afin de compenser la perte de droits de douane due au fait que tout le gaz russe qui devait passer par le gazoduc Nord Stream 2 ne passerait pas par son sous-sol.
Après cette étrange hésitation, le département d'État américain prendra une décision complète et imposera, en novembre 2021, de nouvelles sanctions financières aux entreprises russes liées à Nord Stream 2.
Le 9 décembre 2021, le Premier ministre polonais Mateusz Marawiecki a fait pression sur le nouveau chancelier allemand, le social-démocrate Olaf Scholz, pour qu'il n'inaugure pas le Nord Stream 2 et ne cède pas à la pression russe, et donc "ne permette pas que le Nord Stream 2 soit utilisé comme un instrument de chantage contre l'Ukraine, comme un instrument de chantage contre la Pologne, comme un instrument de chantage contre l'Union européenne" (https://www.metro.us/polish-pm-tells-germanys/ ).
Après avoir détecté des troupes russes à la frontière orientale de l'Ukraine, le secrétaire d'État Antony Blinken a annoncé de nouvelles sanctions le 23 décembre.
Olaf Scholz serait pressé d'arrêter l'ouverture du pipeline lors du sommet de l'UE. Le 7 février 2022, il rencontrera Biden à la Maison Blanche et, lors de la conférence de presse, il déclarera que les États-Unis et l'Allemagne sont "absolument unis et nous ne prendrons pas de mesures différentes". Nous prendrons les mêmes mesures et elles seront très, très dures pour la Russie et ils doivent le comprendre. Toutes les mesures que nous prendrons, nous les prendrons ensemble. Comme l'a dit le président [Biden], nous nous y préparons. Vous pouvez comprendre et vous pouvez être absolument sûrs que l'Allemagne sera de concert avec tous ses alliés et surtout les États-Unis, que nous prendrons les mêmes mesures. Il n'y aura aucune différence dans cette situation. Je dis à nos amis américains que nous serons unis. Nous agirons ensemble et nous prendrons toutes les mesures nécessaires et toutes les mesures nécessaires que nous prendrons ensemble" (https://edition.cnn.com/2022/02/07/politics/biden-scholz-... ).
On peut voir qu'il ne se plaignait plus de l'intervention des États-Unis "dans les affaires intérieures allemandes et européennes", comme on l'a vu dire lorsqu'il était ministre des finances dans le gouvernement de coalition avec Merkel, alors que Trump était à la Maison Blanche.
Pour sa part, Joe Biden a averti que si la Russie envahit l'Ukraine, avec "des chars et des troupes", comme cela finirait par arriver, "alors il n'y aura plus de Nord Stream 2 : nous y mettrons fin" (https://edition.cnn.com/2022/02/07/politics/biden-scholz-... ).
Face aux menaces de Biden envers la Russie, Scholz a gardé un silence timide, ne disant absolument rien sur l'ingérence flagrante des États-Unis dans les relations économiques de l'Allemagne avec la Russie. Il s'est plié aux diktats de Washington.

Le 15 février, Scholz devait rencontrer Poutine à Moscou, où le dirigeant russe a affirmé que le gazoduc renforcerait la sécurité énergétique européenne et qu'il s'agissait d'une question "purement commerciale" (https://www.reuters.com/business/energy/putin-says-nord-s... ). Comme si l'économie n'était pas une économie-politique et une question géopolitique de la plus haute importance et, comme nous l'avons vu, d'une transcendance vitale.
Scholz a affirmé que les négociations avaient été intenses mais confiantes et a supplié la Russie d'éviter toute interprétation dans le conflit avec l'Ukraine.
Lors de la conférence de presse, Poutine est allé jusqu'à dire : "L'Allemagne est l'un des principaux partenaires de la Russie. Nous nous sommes toujours efforcés de favoriser l'interaction entre nos États. L'Allemagne est le deuxième partenaire commercial extérieur de la Russie, après la Chine. Malgré la situation difficile causée par la pandémie de coronavirus et la volatilité des marchés mondiaux, à la fin de 2021, les échanges mutuels ont augmenté de 36 % et ont atteint près de 57 milliards. Dans les années 1970, nos pays ont mis en œuvre avec succès un projet historique. Il s'appelait "Gaz pour les tuyaux". Et depuis lors, les consommateurs allemands et européens sont approvisionnés en gaz russe de manière fiable et sans interruption. Aujourd'hui, la Russie satisfait plus d'un tiers des besoins de l'Allemagne en matière de transport d'énergie" (https://1prime.ru/exclusive/20220220/836108179.html ).
Le projet "Gaz pour les pipelines" a été possible malgré la guerre froide. Les États-Unis ont tenté d'empêcher la construction du gazoduc Urengoy-Pomary-Uzhgorod et ont également essayé d'empêcher les entrepreneurs allemands de participer au projet, bien qu'il ait finalement été construit en 1982-1984 et officiellement ouvert en France, complétant le système de transport transcontinental de gaz Sibérie occidentale-Europe occidentale qui était en place depuis 1973. Ce gazoduc traverse l'Ukraine, pompant du gaz vers la Slovaquie, la Hongrie et la Roumanie. À cette époque, l'URSS n'avait pas la capacité de produire les pipelines nécessaires. Après la construction, d'importantes livraisons de gaz en provenance de Russie ont commencé, depuis le gigantesque champ de Vengoyskoye vers l'Allemagne et d'autres pays européens. Les conséquences d'une telle quantité de gaz ont été le remplacement du charbon américain sur le marché européen, et la RFA a bénéficié d'un énorme élan économique. Nous constatons que les accords gaziers entre la Russie et l'Europe (alors l'URSS) n'ont pas profité aux États-Unis, où ils en prendraient acte.
Scholz a ensuite rencontré Zelensky, accusé d'avoir utilisé le "livre de jeu de Merkel" en évitant les questions sur le gazoduc lors de la conférence de presse qu'il a donnée avec le président ukrainien (https://www.telegraph.co.uk/news/2022/02/14/olaf-scholz-f... ).
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a affirmé que l'avenir du pipeline dépendrait du comportement de la Russie en Ukraine. Le 19 février, elle a déclaré à la Conférence sur la sécurité de Munich que l'Europe ne pouvait pas être aussi dépendante de la Russie pour ses besoins énergétiques (peut-être veut-elle qu'elle soit dépendante des États-Unis, et pas seulement sur le plan énergétique mais aussi sur le plan géopolitique, ce qui est la conséquence logique). "Une Union européenne forte ne peut pas être aussi dépendante d'un fournisseur d'énergie qui menace de déclencher une guerre sur notre continent. Nous pouvons imposer des coûts élevés et des conséquences graves sur les intérêts économiques de Moscou. La pensée bizarre du Kremlin, qui découle directement d'un passé sombre, pourrait coûter à la Russie un avenir prospère. Nous espérons encore que la diplomatie n'a pas dit son dernier mot" (https://www.dw.com/en/natos-jens-stoltenberg-urges-russia... ).
Le 22 février, le lendemain de la reconnaissance par la Russie des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, Olaf Scholz, qui a toujours été favorable au projet mais qui venait de voir Biden (alors qu'il devait rendre visite à Poutine immédiatement après), a suspendu la certification de Nord Stream 2. <...> Il s'agit d'une étape nécessaire pour que la certification du pipeline ne puisse avoir lieu maintenant. Sans cette certification, Nord Stream 2 ne peut être lancé" (https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/02/22/91... ). La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Berbock, a déclaré aux journalistes que le gouvernement allemand avait "gelé" le projet.
Le 23 février, M. Biden a ordonné des sanctions contre l'exploitant du gazoduc, Nord Stream 2 AG, ainsi que contre des responsables de la société. "Ces mesures sont une autre partie de notre tranche initiale de sanctions en réponse aux actions de la Russie en Ukraine. Comme je l'ai dit clairement, nous n'hésiterons pas à prendre de nouvelles mesures si la Russie poursuit l'escalade." Ces sanctions ont été imposées après des "consultations étroites" entre les gouvernements américain et allemand. Et il a remercié Scholz pour son "étroite coopération et son engagement inébranlable à tenir la Russie responsable de ses actions" ; en d'autres termes, il l'a remercié pour sa soumission aux États-Unis. En reconnaissant les républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, Poutine, a déclaré Biden, "a donné au monde une incitation irrésistible à abandonner le gaz russe et à passer à d'autres formes d'énergie" (https://www.rbc.ru/politics/23/02/2022/621684c49a794730b4... ).

Le jour suivant, la Russie commencera une "opération militaire spéciale" en Ukraine. Les États-Unis avaient donc déjà la guerre qu'il leur fallait pour empêcher l'ouverture du gazoduc Nord Stream 2 et la rupture des relations germano-russes ; même si Nord Stream 1 continuerait à transporter du gaz vers l'Allemagne, fonctionnant comme les autres gazoducs approvisionnant l'Europe, dont la Russie empoche quelque 800 millions d'euros par jour, plus 260 millions d'euros pour l'exportation de pétrole.
Le 8 mars, les États-Unis ont interdit toute importation de pétrole et de gaz en provenance de Russie, établissant un record historique pour le prix de l'essence (7 % du pétrole consommé aux États-Unis est russe).
Le 9 mars, le secrétaire de presse du président russe, Dmitry Preskov, a répondu à la sous-secrétaire d'État américaine aux affaires politiques, Victoria Nuland - la femme qui a dit "fuck the EU" (https://www.youtube.com/watch?v=dO80WVMy5E4&ab_channe... ), en déclarant que Nord Stream 2 est "mort et ne sera pas ressuscité" (un jour plus tôt, devant le Congrès américain, elle avait déclaré que le gazoduc n'est qu'"un tas de métal au fond de la mer") - en lui disant que le gazoduc est prêt à être utilisé, en ajoutant que les États-Unis déclarent la guerre économique à la Russie.
Un différend géo-économique et donc géopolitique
Plutôt qu'un projet d'infrastructure dans le pouvoir fédérateur (ou le commerce international) des couches corticales des États concernés, Nord Stream 2 ressemble davantage à un symbole de discorde dans le pouvoir diplomatique, voire militaire, que l'on observe en Ukraine. Il ne fait aucun doute que Nord Stream 2 et tous les gazoducs et oléoducs entraînent des problèmes géopolitiques, car les ressources de base sont intégrées dans les problèmes corticaux de la dialectique des États (l'économie est toujours l'économie-politique ; c'est-à-dire que les deux ne peuvent être compris comme des sphères mégaréales mais comme des concepts conjugués : conceptuellement dissociables, existentiellement inséparables).
Sans aucun doute, comme on l'accuse à juste titre, la Russie utilise sa puissance énergétique comme une arme géopolitique et géostratégique, tout comme les États-Unis. En effet, cette puissance russe est énorme. En additionnant les exportations de pétrole, de gaz et de charbon, la Russie serait le premier exportateur mondial de ces produits.
Si Nord Stream 2 avait été mis en œuvre, les États-Unis auraient perdu leur influence sur l'UE et aussi sur l'Ukraine. Cela rendrait les pays européens, notamment l'Allemagne, encore plus dépendants des ressources énergétiques russes. Certains de ces pays et bien sûr le meneur de la bande, les États-Unis, ont pris position contre la construction de ce pipeline. L'Ukraine est considérée comme l'une des économies les plus touchées si le Nord Stream 2 est mis en service, car une grande quantité de matières premières en provenance de Russie ne passerait plus par son sous-sol (bien que cela affecte également le Belarus, allié plutôt vassal de la Russie).
Les Russes affirment qu'avec Nord Stream 2, le prix du gaz baisserait, car quelque 55 milliards de mètres cubes de gaz seraient transportés par an (plus ou moins la même quantité que Nord Stream 1). Il ne faut pas oublier qu'un peu plus d'un tiers du gaz qui atteint l'Europe provient de Russie.
En Espagne, seulement 10 % du gaz que nous recevons est russe. L'Algérie (alliée historique de la Russie) est notre principal exportateur de gaz (30 % de son gaz finit en Espagne), et le gouvernement de Pedro Sánchez ne fait pas vraiment preuve de tact diplomatique avec ce pays ; il le traite même avec une extrême insouciance, cédant le Sahara au Maroc (abandonnant pour la deuxième fois les pauvres Sahraouis). C'est peut-être la récompense que le sultanat a reçue pour avoir reconnu Israël. Mais puisqu'en Espagne, depuis plusieurs décennies, la politique étrangère est une trahison continue plutôt qu'une politique étrangère ?
Regardez ce que dit le rapport 2019 de l'important groupe de réflexion américain RAND Corporation : "Augmenter la capacité de l'Europe à importer du gaz de fournisseurs autres que la Russie pourrait étirer la Russie sur le plan économique et protéger l'Europe de la coercition énergétique russe. L'Europe avance lentement dans cette direction en construisant des usines de regazéification de gaz naturel liquéfié (GNL). Mais pour être vraiment efficace, cette option nécessiterait que les marchés mondiaux du GNL deviennent plus flexibles qu'ils ne le sont déjà et que le GNL devienne plus compétitif en termes de prix par rapport au gaz russe" (https://www.rand.org/pubs/research_briefs/RB10014.html ).
L'Allemagne verrait sa sécurité énergétique menacée si Nord Stream 2 n'est pas mis en service. Et il ne faut pas oublier que ce projet a été construit à l'initiative de Berlin et non de Moscou. Et pourtant, l'Allemagne s'est rangée du côté de l'Ukraine (se pliant ainsi aux diktats de l'empire de Washington).
Mais il faut garder à l'esprit qu'avec Nord Stream 2, la relation entre la Russie et l'Allemagne ne serait pas exclusivement une relation de dépendance de la seconde vis-à-vis de la première, puisque la Russie dépendrait également de l'Allemagne, c'est-à-dire qu'une relation de coopération serait établie, ce que les États-Unis ne veulent pas. Et l'Allemagne distribuerait à son tour le gaz qui arrive de Russie aux autres pays.

Le problème serait que si ce gazoduc commence à pomper du gaz, les États-Unis pourraient alors perdre la vassalité de l'Allemagne et d'autres pays européens. Les États-Unis ont toujours essayé d'empêcher les relations commerciales entre l'Allemagne et la Russie de s'épanouir (comme ils l'ont fait lorsqu'il s'agissait de la RFA et de l'URSS, comme nous l'avons vu).
D'où les plaintes de Biden (ainsi que celles de Trump, et déjà celles d'Obama), car les États-Unis veulent à tout prix empêcher l'ouverture de Nord Stream 2. Ce gazoduc n'aiderait-il pas la Russie à consolider le leadership allemand dans l'UE ? Bien qu'historiquement, malgré Napoléon, la Russie a eu de meilleures relations avec la France. Et les Russes n'oublient certainement pas les deux guerres mondiales, en particulier la Grande Guerre patriotique.
L'Allemagne a fait valoir que Nord Stream 1 n'empêchait pas le Reich d'adopter une ligne dure contre l'expansionnisme russe. Et, élément crucial, que les États-Unis se sont opposés au projet parce qu'ils voulaient vendre davantage de gaz naturel liquéfié sur les marchés européens (cela résume l'intrigue).
Près d'un quart de la consommation énergétique de l'UE est constituée de gaz naturel, dont un tiers provient de Russie, les pays de l'Est étant évidemment plus dépendants de ce gaz. L'UE obtient 40 % de son gaz de la Russie, ainsi que 27 % de son pétrole. Les États-Unis ne reçoivent pas de gaz russe, bien que - comme nous l'avons déjà dit - ils reçoivent 7 % de leur pétrole (qu'ils ont maintenant l'intention de remplacer par du pétrole vénézuélien). Le 25 mars 2022, l'UE a signé un accord dans lequel les États-Unis fourniront 15 milliards de mètres cubes de gaz liquéfié au marché européen cette année. Et entre maintenant et 2030. Mission accomplie : l'Europe courbe la tête devant son serviteur.
Et comment les États-Unis peuvent-ils se permettre de freiner un projet entre deux nations souveraines derrière un chantier pharaonique à des milliers de kilomètres de distance ? Se pourrait-il que l'Allemagne, qui avec la France dirige l'UE, ne soit rien d'autre qu'un vassal des États-Unis, même si elle a maintenant l'intention de se réarmer ? Et si l'axe franco-allemand est un vassal des États-Unis, l'Espagne, l'Espagne délaissée, ne sera-t-elle pas un vassal des vassaux ? Quoi qu'il en soit, les États-Unis se sont comportés envers l'Allemagne comme le gangster extorqueur : celui qui oblige les commerçants sous la menace d'une arme à acheter ses marchandises. Puis, armés d'un visage en diborure de titane, ils appellent cela un "marché libre".
Selon un rapport de la Commission européenne intitulé "EU-US LNG trade", en 2021, le record d'approvisionnement en gaz naturel liquéfié (GNL) des États-Unis vers l'UE a été battu, dépassant les 22 milliards de mètres cubes. En janvier 2022, elle a déjà atteint 4,4 milliards de mètres cubes (si elle continue à ce rythme, elle atteindra plus de 50 milliards). Mais cela ne suffit pas pour les États-Unis. Bien que la Commission européenne soit favorable à ce que les Yankees soient les principaux fournisseurs de gaz naturel sur le marché européen.
Au vu de tout cela, on pourrait dire que les États-Unis ont fomenté une guerre en Ukraine afin de restreindre la coopération économique de l'UE avec la Russie, ce qui va à l'encontre des intérêts de l'Union, qui s'est comportée dans cette crise comme un ensemble d'États vassaux de Washington ; ce qui est le cas depuis longtemps, pratiquement depuis la Seconde Guerre mondiale, sauf que cela apparaît maintenant de manière embarrassante.
Dans une interview avec Jacques Baud, colonel de l'armée suisse, expert en renseignement militaire et député à l'OTAN et à l'ONU, il a déclaré : "Je suis sûr que Poutine ne voulait pas attaquer l'Ukraine, il l'a dit à plusieurs reprises. De toute évidence, les États-Unis ont exercé des pressions pour déclencher la guerre. Les États-Unis ont peu d'intérêt pour l'Ukraine elle-même. Ce qu'ils voulaient, c'était augmenter la pression sur l'Allemagne pour qu'elle ferme Nord Stream II. Ils voulaient que l'Ukraine provoque la Russie, et si la Russie réagissait, Nord Stream II serait gelé" (https://www.lahaine.org/mundo.php/militar-suizo-experto-d... ).
Le Royaume-Uni semble également devoir bénéficier de son statut de pays de "transit" pour l'approvisionnement en gaz naturel de l'Europe, via le gazoduc traversant la Belgique et les Pays-Bas, qui tentera de se sevrer de sa dépendance au gaz russe, comme le prévoit pour cet été le seul opérateur énergétique britannique qui collecte le gaz de la mer du Nord en Norvège : National Grid. Selon le Daily Telegraph, National Grid pense pouvoir exporter environ 5,1 milliards de m3 vers l'Europe cet été. Elle envisage également d'importer du gaz liquéfié des États-Unis au Royaume-Uni pour le transformer en gaz normal et l'exporter en Europe.
En raison de l'opération militaire russe dans la marine des pays de l'OTAN (pas tous) en Ukraine, la non-ouverture de Nord Stream 2 n'a pas divisé les pays européens, comme ce fut le cas en 2003 avec la guerre en Irak, même si le Royaume-Uni a quitté l'UE. Il semble y avoir un consensus anti-russe (la Hongrie anti-sorosienne est peut-être l'exception, quoique de manière ambiguë).
Pour gagner l'alliance de la Russie contre la Chine, ni l'administration Trump (ce qui était son intention) ni l'administration Biden (qui a montré au monde sa russophobie exacerbée, dans la lignée du trilatéraliste-rockefellerien polonais et américain Zbigniew Brzezinski) n'ont su agir avec tact diplomatique. Et ils devraient savoir que les alliances sont aussi importantes que les forces elles-mêmes. C'est pourquoi la Russie a conquis l'allié chinois, mais toujours avec la crainte que ce dernier ne l'absorbe ou ne la trahisse à un moment donné (l'hypocrisie est notre pain quotidien dans les relations internationales).
L'humiliation du président allemand par Zelensky
Pendant des années, le président allemand Frank-Walter Steinmeier a entretenu une relation cordiale avec Vladimir Poutine, dont il a fait l'éloge en tant que chancelier sous Gerhard Schröder, puis en tant que ministre des affaires étrangères sous Angela Merkel. Et il a également montré son plus grand soutien au projet Nord Stream 2 pendant ces années, jusqu'à juste avant la guerre, ce que, après l'entrée des troupes russes en Ukraine, le chef d'État allemand a admis comme une "erreur manifeste". Une erreur qu'il a entretenue pendant des années, presque une décennie ? Après la diffusion sur Twitter de photos de M. Steinmeier embrassant le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, le président a exprimé ses remords. Pour cela, il ne serait pas le bienvenu à Kiev, et a dû annuler sa visite : "Il semble que ma présence ne soit pas souhaitée" (https://www.elmundo.es/internacional/2022/04/12/6255a91f2... ). "Nous n'avons pas réussi à créer une maison européenne commune qui inclut la Russie. Nous n'avons pas réussi à inclure la Russie dans l'architecture de sécurité globale. Nous nous sommes accrochés à des ponts auxquels la Russie ne croyait plus, comme nos partenaires nous en avaient avertis" (https://ria.ru/20220404/evropa-1781787894.html ). Tout cela montre la honteuse servilité de l'Allemagne envers les États-Unis.
L'ambassadeur ukrainien à Berlin, Andriy Melnyk, poursuit en soulignant que l'Allemagne a "trop d'intérêts particuliers" en Russie et que Steinmeier est en grande partie à blâmer, car il a passé des décennies à tisser une toile d'araignée de contacts avec la Russie (tout comme Merkel, avec qui Poutine a parlé en russe et en allemand). "Beaucoup de ceux qui sont maintenant en charge dans la coalition (allemande) sont impliqués dans cette affaire" (https://www.elmundo.es/internacional/2022/04/12/6255a91f2... ).

Le porte-parole adjoint du gouvernement allemand, Wolfgang Büchner, a calmé les esprits en comprenant "la situation exceptionnelle" que traverse l'Ukraine. Il a déclaré que "l'Allemagne a été et est l'un des plus ardents défenseurs de l'Ukraine... et continuera de l'être. Le président a une position claire et sans équivoque en faveur de l'Ukraine" (https://www.elespanol.com/mundo/europa/20220413/zelenski-... ).
Dans le magazine allemand Spiegel, Steinmeier a rappelé qu'en 2001, Poutine avait prononcé un discours en allemand au Bundestag même : "Le Poutine de 2001 n'a rien à voir avec le Poutine de 2022, que nous voyons maintenant comme un fauteur de guerre brutal et retranché" (https://www.elespanol.com/mundo/europa/20220413/zelenski-... ). Et qu'il attendait toujours "un reste de rationalité de la part de Vladimir Poutine" (https://www.spiegel.de/politik/frank-walter-steinmeier-ue... ).
Mais nous avons déjà montré de manière assez puissante dans les pages du Postmodernisme, en réfléchissant contre l'hystérie des politiciens et des journalistes, que Poutine n'est pas fou : https://posmodernia.com/putin-esta-loco/ .
20:22 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, politique internationale, allemagne, russie, ukraine, états-unis, nord stream 2, gazoducs, gaz, gaz naturel, hydrocarbures, mer baltique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 24 avril 2022
Jeffrey Sachs : l'arrêt de l'élargissement de l'OTAN est le chemin vers la paix
Jeffrey Sachs : l'arrêt de l'élargissement de l'OTAN est le chemin vers la paix
Markku Siira
Source: https://markkusiira.com/2022/04/21/jeffrey-sachs-naton-laajentumisen-pysayttaminen-tie-rauhaan/
On observe un changement intéressant parmi les universitaires américains: alors qu'auparavant, seuls les réalistes (comme le politologue John Mearsheimer) tenaient l'OTAN pour responsable de la crise actuelle en Ukraine, désormais, même les mondialistes comme Jeffrey Sachs reconnaissent que c'est exactement le cas. Sachs explique son point de vue dans un éditorial pour CNN.
Sachs estime que la stratégie américaine "visant à aider l'Ukraine à vaincre l'agression russe en imposant des sanctions sévères et en fournissant à l'armée ukrainienne des armes de pointe" a peu de chances de réussir.
L'économiste américain estime que la seule solution est un accord de paix négocié. "Toutefois, pour parvenir à un accord, les États-Unis devraient faire des compromis sur l'OTAN, ce que Washington a rejeté jusqu'à présent."
Selon la Russie, les négociations sont dans l'impasse. Avant de lancer son opération militaire, Poutine a présenté à l'Occident une liste de demandes, dont notamment "l'arrêt de l'expansion de l'OTAN". Les États-Unis n'ont pas voulu s'engager dans cette voie, mais M. Sachs estime que le moment est venu de "revoir cette politique".
Sachs se rapproche de la position des réalistes en matière de politique étrangère et de sécurité. Selon lui, "l'approche américaine en matière de transferts d'armes et de sanctions" peut sembler convaincante "dans la chambre d'écho de l'opinion publique américaine, mais elle ne fonctionne pas sur la scène mondiale". Selon M. Sachs, même aux États-Unis et en Europe, les sanctions bénéficient d'un "faible soutien" et un "retour de bâton politique" pourrait encore se produire.
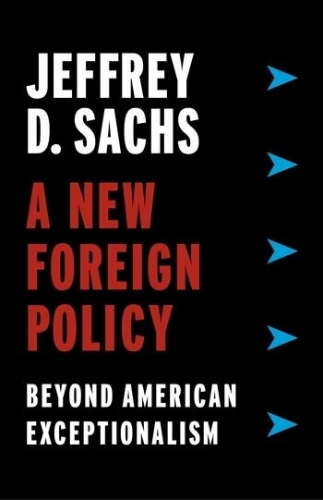
En Occident, il a été considéré comme acquis que l'action militaire en Ukraine mettrait la Russie dans la position d'un pion exclu. Selon Sachs, ce n'est pas le cas : les pays émergents en particulier ont refusé de se joindre à la campagne de l'Occident visant à isoler la Russie.
Cet échec s'est traduit tout récemment par le vote dirigé par les États-Unis visant à exclure la Russie du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. "Il est vrai que 93 pays ont soutenu la démarche, mais 100 autres ne l'ont pas fait (24 se sont opposés, 58 se sont abstenus et 18 n'ont pas voté du tout). Plus important encore, 76 % de la population mondiale vit dans ces 100 pays".
La politique de sanctions américaines présente une "myriade de problèmes", selon l'économiste.
La première est que "si les sanctions causeront des difficultés économiques en Russie, il est peu probable qu'elles modifient la politique russe de manière décisive".
"Pensez aux sanctions sévères imposées par les États-Unis au Venezuela, à l'Iran et à la Corée du Nord", suggère Sachs. "Ils ont affaibli l'économie de ces pays, mais n'ont pas modifié leurs politiques de la manière souhaitée."
Deuxièmement, "les sanctions sont faciles à contourner, du moins en partie, et d'autres contournements sont susceptibles d'apparaître au fil du temps". Les sanctions américaines s'appliquent le plus efficacement aux "transactions en dollars impliquant le système bancaire américain".
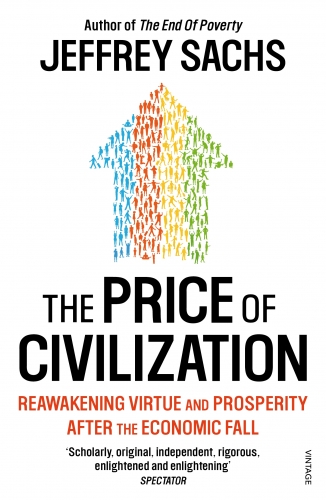
Les pays qui cherchent à contourner les sanctions trouveront des moyens de faire des affaires par des moyens autres que la banque ou le dollar. "Nous pouvons nous attendre à voir une augmentation du nombre de transactions en roubles, roupies, renminbis et non-dollars avec la Russie", prédit Sachs.
Le troisième problème, selon Sachs, est que la majeure partie du monde ne croit pas aux sanctions. "Lorsque vous additionnez tous les pays et territoires qui ont imposé des sanctions à la Russie - les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Union européenne, le Japon, Singapour, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et quelques autres pays - leur population combinée ne représente que 14 % de la population mondiale."
Le quatrième problème est "l'effet boomerang". Les sanctions à l'encontre de la Russie ne feront pas seulement du tort à la Russie, mais à l'ensemble de l'économie mondiale, entraînant une augmentation des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, de l'inflation et des pénuries alimentaires. C'est pourquoi de nombreux pays européens continuent d'importer du gaz et du pétrole de Russie. "L'effet boomerang est également susceptible de nuire aux démocrates lors des élections de mi-mandat de novembre, car l'inflation ronge les revenus réels des électeurs", estime Sachs.
Un cinquième problème est "la demande inélastique et sensible aux prix des exportations russes d'énergie et de céréales". La chute des exportations russes entraînera une hausse des prix mondiaux de ces matières premières. La Russie pourrait se retrouver avec des volumes d'exportation plus faibles mais des revenus d'exportation presque identiques, voire plus élevés.
Le sixième problème énuméré par Sachs est - surprise, surprise - géopolitique. "D'autres pays - et surtout la Chine - voient la guerre Russie-Ukraine au moins en partie comme une guerre dans laquelle la Russie s'oppose à l'expansion de l'OTAN en Ukraine. C'est pourquoi la Chine soutient sans cesse que la guerre concerne les intérêts légitimes de la Russie en matière de sécurité", explique Sachs.
Les États-Unis aiment dire que l'OTAN est une "alliance purement défensive", mais la Russie, la Chine et bien d'autres pays ne sont pas d'accord. Sachs sait pourquoi. "Ils sont sceptiques quant aux bombardements de l'OTAN en Serbie en 1999, aux forces de l'OTAN en Afghanistan pendant 20 ans après le 11 septembre et aux bombardements de l'OTAN en Libye en 2011, lorsque Mouammar Kadhafi a été renversé."
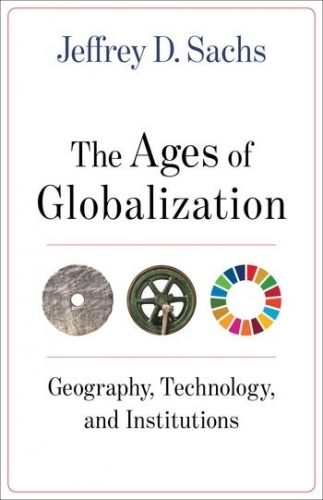
Les dirigeants russes s'opposent à l'expansion de l'OTAN vers l'est depuis qu'elle a commencé au milieu des années 90 avec la République tchèque, la Hongrie et la Pologne. De façon remarquable, lorsque Poutine a demandé à l'OTAN de mettre fin à son expansion en Ukraine, Biden a refusé catégoriquement de négocier avec la Russie.
De nombreux pays dans le monde, y compris une Chine montante, ne soutiennent pas une pression sur la Russie qui pourrait conduire à une expansion de l'OTAN. "Le reste du monde veut la paix, pas la victoire des États-Unis ou de l'OTAN dans une lutte de pouvoir avec la Russie", affirme Sachs.
Les États-Unis aimeraient voir Poutine vaincu militairement, mais il est peu probable que la Russie accepte la défaite et se retire. Les armes des États-Unis et de l'OTAN peuvent imposer des coûts énormes à la Russie, mais elles ne peuvent pas sauver l'Ukraine, qui sera détruite dans le processus, d'autant plus que l'Occident prolonge la crise.
Sachs affirme que l'approche actuelle "sape la stabilité économique et politique dans le monde et peut diviser le monde en camps pro-OTAN et anti-OTAN, ce qui est profondément dommageable à long terme, y compris pour les États-Unis eux-mêmes".
La diplomatie américaine punit donc la Russie, mais a peu de chances de réussir réellement en Ukraine, "en termes d'avancement des intérêts américains". Le véritable succès serait que les troupes russes rentrent chez elles et que la situation en Ukraine se stabilise. Ces résultats peuvent être obtenus à la table des négociations.
L'étape la plus importante, selon Saschi, serait que "les États-Unis, les alliés de l'OTAN et l'Ukraine fassent clairement savoir que l'OTAN ne s'étendra pas en Ukraine". Ensuite, les pays alignés sur Poutine et ceux qui ne prennent aucun parti diraient que "puisque Poutine a arrêté l'expansion de l'OTAN, il est maintenant temps pour la Russie de quitter le champ de bataille et de rentrer chez elle".
Sachs est convaincu que le discours musclé de Biden sur "le retrait de Poutine du pouvoir, le génocide et les crimes de guerre" ne sauvera pas l'Ukraine. "En donnant la priorité à la paix plutôt qu'à l'expansion de l'OTAN, les États-Unis gagneraient le soutien d'une plus grande partie du monde et contribueraient ainsi à apporter la paix en Ukraine et la stabilité dans le monde", estime-t-il.
Pour l'instant du moins, Washington ne partage pas l'avis de Sachs, mais un "soutien militaire plus direct" - artillerie lourde et drones - est toujours prévu pour l'Ukraine. Pendant ce temps, les Russes ont complètement encerclé les forces ukrainiennes dans la ville de Mariupol, dans la zone de l'usine Azovstal. Un tournant décisif sera-t-il bientôt atteint ?
13:30 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jeffrey sachs, actualité, ukraine, russie, états-unis, sanctions, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 23 avril 2022
Israël, Biden et les élections de mi-mandat de 2022
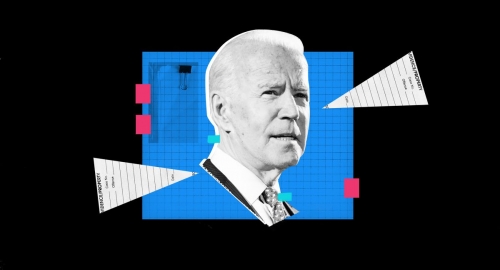
Israël, Biden et les élections de mi-mandat de 2022
par German Gorraiz Lopez
Source: https://www.ideeazione.com/israele-biden-e-le-midterms-2022/
Les offensives militaires israëliennes successives contre Gaza et la Cisjordanie ont toujours été protégées par la "spirale du silence" des principaux médias mondiaux contrôlés par le lobby juif transnational, une théorie formulée par la politologue allemande Elisabeth Noelle-Neumann dans son livre The Spiral of Silence. Public Opinion: Our Social Skin (1977).

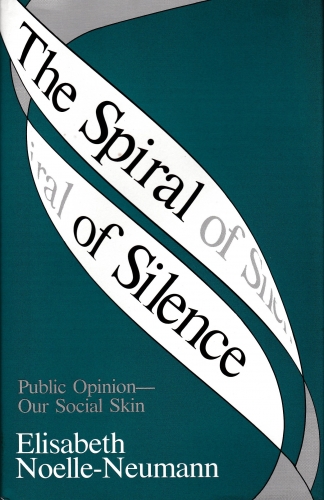
Cette thèse symboliserait "la formule de superposition cognitive qui établit la censure par une accumulation délibérée et étouffante de messages à un seul signe", ce qui produirait un processus en spirale ou une boucle de rétroaction positive et la manipulation conséquente de l'opinion publique mondiale par le lobby juif transnational (droit d'Israël à se défendre).
Cependant, le caractère inéquitable de la punition infligée aux Palestiniens de Gaza, avec près de 300 morts, des centaines de blessés et la destruction des infrastructures de base à Gaza, entraînerait une répudiation internationale contre Netanyahou et la chute de Bibi devant l'AIPAC. Après quoi, le gouvernement de coalition dirigé par le centriste Yair Lapid et le droitier Naftali Bennett (Coalition Arc-en-ciel) s'est cristallisé. Cela représente le déclin politique du dernier empereur israélien, Netanyahou, après 12 ans au pouvoir mais suivant l'endémisme atavique de tous les gouvernements israéliens, l'actuel gouvernement Bennett poursuit sa campagne systématique de colonies illégales, dont l'avant-dernier épisode serait l'annonce de la création des nouvelles colonies d'Asif et de Matar dans le but avoué de "doubler la population du plateau du Golan" après avoir reçu les bénédictions des deux administrations Trump et Biden et aurait signé des alliances avec les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite pour former une entente contre l'Iran, pour laquelle il utilisera une fois de plus la dictature invisible de la peur du troisième holocauste.
L'Iran, la "bête noire" d'Israël
En 1978, Zbigniew Brzezinski déclarait dans un discours : "Un arc de crise s'étend le long des rives de l'océan Indien, les structures sociales et politiques fragiles d'une région d'importance vitale pour nous menacent de se fragmenter. La Turquie et l'Iran, les deux États les plus puissants du flanc sud, sont potentiellement vulnérables aux conflits ethniques internes, et si l'un ou l'autre était déstabilisé, les problèmes de la région deviendraient incontrôlables", ébauche d'une théorie qu'il a fini par dessiner dans son livre The Grand Chessboard. American supremacy and its geostrategic imperatives (1997), considéré comme la bible géostratégique de la Maison Blanche ainsi que la table de chevet de générations successives de géostratèges et de politologues.
L'Iran a acquis une dimension de puissance régionale grâce à la politique erratique des États-Unis en Irak, (le résultat de la myopie politique de l'administration Bush obsédée par l'Axe du Mal) éliminant ses rivaux idéologiques, les talibans sunnites radicaux et Saddam Hussein avec le vide de pouvoir qui en résulte dans la région, pour lequel il a réaffirmé son droit inaliénable à la nucléarisation, mais après l'élection de Hasan Rowhani comme nouveau président élu de l'Iran, un nouveau scénario et une nouvelle opportunité se sont ouverts pour la résolution du différend nucléaire entre les États-Unis, Israël et l'Iran, car un éventuel blocus du détroit d'Ormuz (par lequel passe un tiers du trafic énergétique mondial) pourrait aggraver la récession économique mondiale et affaiblir profondément l'ensemble du système politique international, ce qui obligerait les États-Unis à reconsidérer le rôle de l'Iran en tant que puissance régionale et arbitre potentiel dans le différend syrien.
Toutefois, après l'approbation par le Congrès et le Sénat américains d'une déclaration préparée par le sénateur républicain Lindsey Graham et le démocrate Robert Menéndez, qui affirme catégoriquement que "si Israël est contraint de se défendre et d'agir (contre l'Iran), les États-Unis seront à vos côtés pour vous soutenir militairement et diplomatiquement", nous assisterions à une pression accrue du lobby pro-israélien américain (AIPAC) pour procéder à la déstabilisation de l'Iran par des méthodes rapides.

Ainsi, le Sénat américain a renouvelé à l'unanimité l'Iran Sanctions Act (ISA) jusqu'en 2026 et après que l'Iran ait lancé un nouveau missile balistique, Trump a augmenté les sanctions contre plusieurs entreprises iraniennes. liées aux missiles balistiques sans violer l'accord nucléaire signé entre le G+5 et l'Iran en 2015, connu sous le nom de Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), un accord que l'administration Trump a abandonné.
Cet abandon a eu pour effet secondaire d'étrangler les exportations de pétrole brut de l'Iran et de le faire entrer dans l'orbite d'influence de la Chine, ainsi que d'augmenter son enrichissement d'uranium à 60 %, pour lequel Israël déplacerait ses pièces MOSSAD par le biais d'attaques médiatiques. et sélective pour déstabiliser le régime du Guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei à l'époque. Israël scellerait alors des alliances avec les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite pour former une entente contre l'Iran. Ainsi, Bennett considère l'Iran comme "le plus grand exportateur de terreur et de violation des droits de l'homme dans le monde alors qu'il continue à enrichir de l'uranium et dangereusement proche d'obtenir une bombe nucléaire". Et selon un rapport du portail Veterans Today, "Israël transfère des armes de défense aérienne, de l'artillerie à longue portée, des hélicoptères et des avions de combat F-15 à Erbil, la capitale du Kurdistan irakien, en vue d'une guerre plus large contre l'Iran" (Operation Persia).

Biden et les élections de mi-mandat de 2022
La démocratie américaine est sui generis. Les Etats-Unis auraient comme pilier de leur système politique l'alternance successive au pouvoir des partis démocrate et républicain (tous deux engloutis par le lobby), avec Joe Biden comme nouvel outsider de l'AIPAC. Ainsi, la victoire surprise de Donald Trump sur Hillary Clinton a représenté Israël "perdant un ami précieux pour gagner un meilleur ami", Donald Trump, qui a établi le puzzle désarticulé du chaos qui s'est terminé par la victoire du candidat démocrate Joe Biden, qui a déclaré en 2007: "Je suis un sioniste. Il n'est pas nécessaire d'être juif pour être sioniste". Alors que les réserves stratégiques américaines n'ont jamais été aussi élevées et que l'industrie américaine du schiste ne parvient pas à décoller malgré la flambée des prix du pétrole, et qu'un défi croissant à l'hégémonie américaine est représenté par le géant chinois, cela pourrait obliger Joe Biden à utiliser une première attaque surprise d'Israël contre l'Iran pour déclencher une nouvelle guerre au Moyen-Orient avec le double objectif de drainer les sources d'énergie de la Chine et de diluer les stigmates de la division dans la société américaine.
L'attrition subie par Biden après le fiasco en Afghanistan, l'inflation galopante et l'entrée possible de l'économie en récession l'année prochaine après la guerre en Ukraine, pourraient conduire à une victoire républicaine aux élections de mi-mandat de 2022 qui anticiperait un retour triomphal de Trump aux élections présidentielles de 2024 et ce qui serait un paradigme de la récente victoire républicaine dans l'État de Virginie. Ainsi, après les fiascos de la Syrie, de la Libye et de l'Irak, l'Iran serait le nouvel appât du plan machiavélique esquissé par l'Alliance anglo-israëlienne en 1960 pour attirer à la fois la Russie et la Chine et provoquer un conflit régional majeur qui marquerait l'avenir de la zone dans les années à venir et qui serait un nouvel épisode local qui s'inscrirait dans le retour à l'endémie récurrente de la guerre froide américano-russe. Ce conflit pourrait impliquer les trois superpuissances (USA, Chine et Russie) comptant comme collaborateurs nécessaires les puissances régionales (Israël, Syrie, Egypte, Jordanie, Arabie Saoudite et Iran), couvrant l'espace géographique s'étendant de l'arc méditerranéen (Libye, Syrie et Liban) au Yémen et à la Somalie, avec l'Irak comme épicentre et rappelant la guerre du Vietnam avec Lyndon B. Johnson (1963-1969).
12:53 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, joe biden, états-unis, israël, iran |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 22 avril 2022
Au bord de la rupture? L'effondrement du dollar et des alliés des États-Unis
Au bord de la rupture? L'effondrement du dollar et des alliés des États-Unis
par Luciano Lago
Source: https://www.ideeazione.com/sullorlo-della-rottura-il-crollo-del-dollaro-e-gli-alleati-degli-usa/
Le partenariat transatlantique continue de vaciller ouvertement: les alliés se chamaillent sur l'instabilité du dollar et les sanctions contre la Russie. Selon le représentant du département du Trésor américain, Wally Adeyemo, un autre problème des initiateurs des sanctions contre la Russie a été l'incapacité de parvenir à un compromis sur la question des restrictions économiques contre la Fédération de Russie. La guerre des sanctions lancée contre l'économie russe est devenue une véritable pomme de discorde entre les alliés autrefois solides: les pays de l'Occident collectif, l'UE en particulier.
Elle atteint le point où l'absence de consensus peut même conduire à la désunion du système économique mondial, dont ces pays sont les principaux acteurs. De telles prédictions sont ouvertement exprimées par certains alliés européens des États-Unis qui, dans le cadre d'une politique étrangère dépendant de l'hégémonie mondiale des États-Unis, sont contraints de suivre l'agenda fixé par Washington au détriment de leurs propres intérêts.
Le secrétaire adjoint au Trésor américain, Wally Adeyemo, a souligné à juste titre que de nombreux partenaires étrangers reprochent aux États-Unis le fait que la nouvelle réalité économique (vraisemblablement dure) pour la Russie ne fera que devenir une incitation à la formation d'un nouveau système économique.
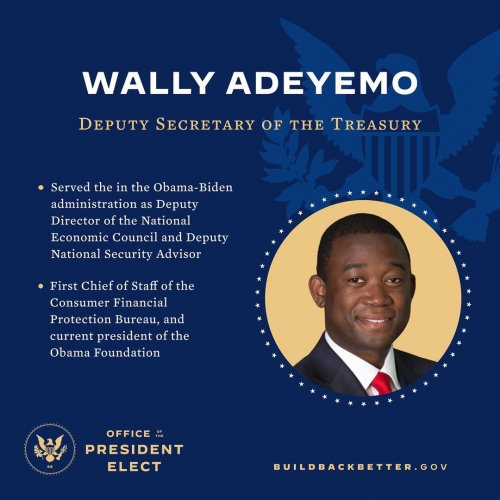
Un politicien d'un avis similaire n'est pas d'accord et tente toujours de promouvoir l'idée que Washington démontre ainsi une fois de plus au monde entier l'importance et l'exceptionnalité de la structure économique mondiale actuelle dans laquelle il joue un rôle dominant. L'Occident, a-t-il dit, montre à la Russie et à tous les autres pays combien il est coûteux de s'isoler de ce système financier.
À Washington, on craint également l'effondrement du dollar en raison des sanctions anti-russes et le renforcement potentiel de la Fédération de Russie et de son lien avec la Chine. En outre, la position de pays tels que l'Inde et l'Arabie saoudite, qui indiquent qu'ils effectuent leurs paiements dans des devises autres que le dollar, constitue un facteur de risque pour la stabilité du système financier dominé par les États-Unis.
Selon Adeyemo, la devise américaine conserve son statut, mais tout peut facilement changer en raison de l'imprévisibilité de la situation géopolitique.
17:43 Publié dans Actualité, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, économie, dollar, états-unis, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
L'impact de la coopération énergétique stratégique entre les États-Unis et l'Union européenne

L'impact de la coopération énergétique stratégique entre les États-Unis et l'Union européenne
par Giulio Chinappi, Ding Yifan & Shi Junqi
Source: https://www.ideeazione.com/limpatto-della-cooperazione-strategica-usa-ue-sullenergia/
Ding Yifan et Shi Junqi, chercheurs à l'Institut Taihe de Pékin, ont publié un article analysant la dépendance énergétique de l'Europe et, en particulier, la coopération énergétique entre les États-Unis et l'UE à la lumière des récents événements en Ukraine. Vous trouverez ci-dessous une traduction de l'article.
Introduction
Lors du voyage du président américain Joe Biden en Europe, les États-Unis et la Commission européenne ont conclu un accord pour mener une coopération stratégique en matière d'énergie visant à atteindre l'indépendance vis-à-vis des combustibles fossiles russes, et un groupe de travail conjoint sur la sécurité énergétique a été créé pour définir les paramètres de la coopération. La coopération stratégique actuelle entre les États-Unis et l'Union européenne dans le domaine de l'énergie est encore entravée par des facteurs tels que l'inertie du commerce du gaz naturel, la capacité américaine de produire du gaz naturel liquéfié (GNL) et les différences au sein des États membres de l'UE. Cependant, la volonté politique affichée par les États-Unis et la Commission européenne a déstabilisé la coopération énergétique entre l'UE et la Russie et a créé des implications de grande envergure pour les stratégies énergétiques, industrielles et monétaires de l'UE.
L'UE pourrait devenir dépendante de l'énergie américaine
Après la fin de la guerre froide, l'UE a pris l'initiative d'entamer une coopération énergétique avec la Russie. Derrière cette démarche se cachait une politique rationnelle en matière d'énergie et de sécurité: l'UE était déjà le plus grand importateur d'énergie de la Russie et celle-ci ne menaçait donc pas la sécurité de l'UE. En conséquence, les éventuelles menaces de sécurité provenant de l'Est ont été davantage atténuées et l'UE a pu allouer d'importantes dépenses financières, autrement utilisées pour la défense nationale, à la poursuite du développement économique.
Contrairement aux importations en provenance du Moyen-Orient, les importations d'énergie russe offraient à la fois des coûts inférieurs et une meilleure stabilité de l'approvisionnement, ce qui a renforcé la compétitivité internationale de l'économie européenne. En d'autres termes, la coopération énergétique entre l'UE et la Russie a contribué à jeter les bases de l'autonomie stratégique de l'UE. Malgré la pression américaine, l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel a fait avancer le projet de gazoduc Nord Stream 2 afin d'augmenter l'approvisionnement stable en gaz naturel directement depuis la Russie et de contourner la Pologne et l'Ukraine, toutes deux sensibles à l'influence américaine.
Non seulement les États-Unis ont désapprouvé la mise en œuvre de l'autonomie stratégique par l'UE, mais ils ont activement cherché des occasions de perturber la coopération énergétique UE-Russie. Ces dernières années, les États-Unis ont vendu du pétrole et du gaz de schiste à l'UE sous le couvert du "renforcement de la sécurité énergétique européenne", occultant ainsi leur véritable agenda qui consiste à forcer l'énergie russe à quitter le marché européen.
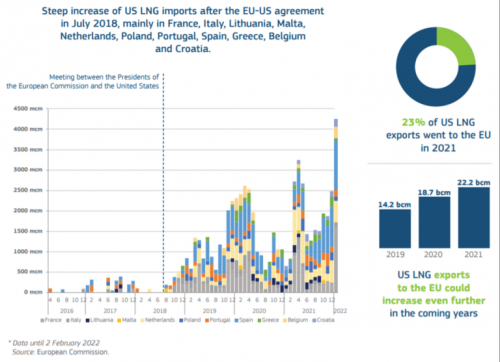
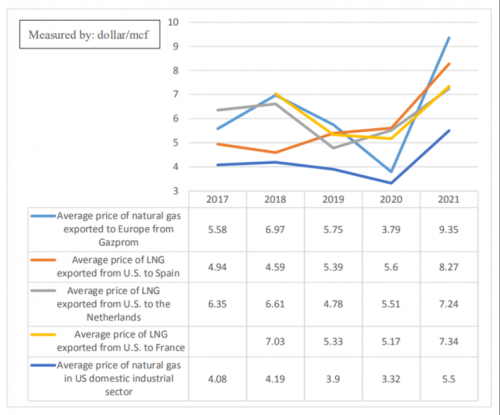
Actuellement, l'énergie russe détient une part de marché plus importante que l'énergie américaine sur le marché de l'UE. En 2021, l'UE avait importé 155 milliards de mètres cubes de gaz naturel de Russie, dont 140 milliards de mètres cubes de gaz naturel par gazoduc et 15 milliards de mètres cubes de GNL, soit 45 % de ses importations totales de gaz naturel. Bien que le volume total des exportations américaines de GNL vers l'UE ait atteint un nouveau record au cours de la même période, avec un total de 22 milliards de m3, cela ne représentait que 6 % des importations totales de gaz naturel de l'UE.
Cependant, le 25 mars 2022, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président américain, Joe Biden, ont publié une déclaration commune sur la sécurité énergétique européenne, qui a démontré la volonté politique de la Commission européenne de déplacer sa dépendance énergétique de la Russie vers les États-Unis.

Le nouvel accord énergétique entre les États-Unis et l'Union européenne verra les États-Unis s'engager à garantir des volumes supplémentaires de gaz naturel liquéfié (GNL) pour le marché européen d'au moins 15 milliards de mètres cubes en 2022, avec d'autres augmentations prévues au fil du temps. Ainsi, les États-Unis ont pratiquement déclaré qu'ils remplaceraient toutes les commandes de GNL russe auprès de l'UE, qui s'élevaient également à 15 milliards de m3 de GNL en 2021. En effet, un haut fonctionnaire du gouvernement américain a déclaré publiquement que le pacte énergétique entre les États-Unis et l'UE "visait à rendre l'UE indépendante du GNL russe dans un délai très court".
Outre les accords susmentionnés, la Commission européenne a indiqué qu'elle travaillerait avec les États membres de l'UE pour garantir une demande stable de GNL américain supplémentaire d'environ 50 milliards de mètres cubes par an jusqu'en 2030 au moins. Dans le plan REPowerEU dévoilé le 8 mars, la Commission européenne a proposé que l'UE importe chaque année 50 milliards de mètres cubes supplémentaires de GNL en provenance du Qatar, des États-Unis, d'Égypte, d'Afrique occidentale et d'ailleurs. Selon la déclaration commune, la Commission européenne semble avoir attribué l'intégralité du "quota" d'importations supplémentaires de GNL aux États-Unis. Si le plan ci-dessus est mis en œuvre et que l'UE parvient à réduire sa demande de gaz naturel de 100 milliards de m3 d'ici 2030, le GNL américain pourrait représenter environ 30 % des importations totales de gaz naturel de l'UE à ce moment-là.
Les deux parties ont également confirmé leur détermination commune à mettre fin à la dépendance de l'UE vis-à-vis des combustibles fossiles russes d'ici 2027. Cela a interrompu la stratégie de longue date de l'UE visant à atteindre l'"indépendance énergétique" grâce à la coopération énergétique entre l'UE et la Russie au cours des trois dernières décennies et a considérablement augmenté la susceptibilité de l'UE à être "manipulée" par les États-Unis dans les domaines de l'énergie et de la finance.
La compétitivité des industries européennes pourrait diminuer
Ces dernières années, et surtout après l'apparition de la pandémie covidienne, les États-Unis et l'UE ont pris conscience de l'importance de la réindustrialisation. Bien qu'ils restent de fidèles partenaires d'alliance, les États-Unis et l'UE sont désormais engagés dans le jeu à somme nulle de la concurrence pour attirer les entreprises industrielles sur leurs marchés intérieurs respectifs. Les États-Unis se sont transformés en exportateurs d'énergie et éclipsent l'UE en termes de puissance financière. Toutefois, l'ampleur de l'évidement de la chaîne industrielle américaine est bien plus grave que celle de l'UE. C'est pourquoi l'accès à un approvisionnement énergétique stable et abordable est devenu un domaine clé pour les deux parties qui s'affrontent dans le processus de réindustrialisation.
En tant qu'importateur d'énergie, l'UE est dans une position relativement désavantageuse. Le graphique ci-dessus montre qu'après la déclaration États-Unis-UE de juillet 2018, lorsque le GNL américain est entré pour la première fois sur le marché européen, le prix moyen du gaz naturel exporté par Gazprom vers l'Europe était relativement élevé. En 2019, l'Espagne, la France et les Pays-Bas, positionnés le long de la côte atlantique, sont devenus les trois premiers acheteurs de GNL américain au sein de l'UE, position qu'ils conservent aujourd'hui (NB : les Pays-Bas ont acheté plus que la France en 2021).
Au milieu de l'année 2021, l'UE a commencé à promouvoir le paquet Fit-for-55 et le mécanisme d'ajustement à la frontière du carbone (CBAM), dans le but d'appliquer le gaz naturel importé par la Russie à bas prix à partir de 2020 comme un "antidouleur" industriel pendant sa transition vers une économie verte. Depuis sa transition, l'UE a imposé d'énormes tarifs carbone aux pays exportateurs d'énergie, ce qui a contraint le prix moyen du GNL de Gazprom à dépasser celui du GNL américain exporté vers l'Espagne, les Pays-Bas et la France. En tant que tel, le passage de la Commission européenne au GNL américain a une certaine justification économique mais ne compense pas le risque significatif d'une dépendance accrue à l'énergie américaine.
Plus important encore, une fois que les États-Unis et l'Europe auront établi une relation stable entre l'offre et la demande de GNL, l'économie de l'UE sera très probablement confrontée à la situation difficile de coûts de production plus élevés et d'une compétitivité industrielle plus faible que celle des États-Unis. Après tout, le prix moyen du gaz naturel sur le marché industriel intérieur américain est bien inférieur à celui du GNL exporté des États-Unis vers l'Espagne, les Pays-Bas et la France. Contrairement au gazoduc russe, qui a déjà bénéficié de l'investissement initial dans l'infrastructure, les importations de GNL par l'UE impliquent des frais de transport maritime et des coûts de construction et d'exploitation des terminaux GNL. Depuis le déclenchement du conflit entre la Russie et l'Ukraine, le coût de la construction du terminal GNL de Brunsbuttel en Allemagne est passé à plus d'un milliard d'euros, dépassant de loin les 450 millions d'euros précédemment estimés.
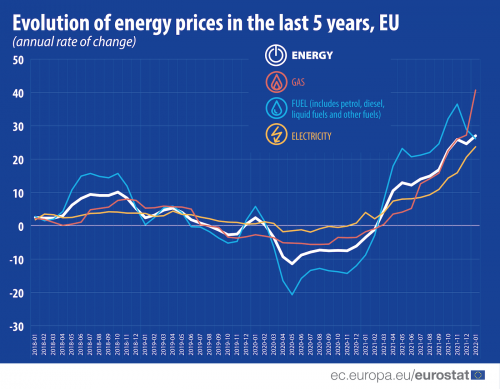
En outre, le prix de l'énergie a entraîné une baisse de la compétitivité industrielle de l'UE, et les risques de sécurité posés par le conflit entre la Russie et l'Ukraine ont augmenté la probabilité que l'industrie des pays en développement gravite vers les États-Unis plutôt que vers l'UE. Cela ne désavantagera pas seulement l'UE dans la compétition pour la réindustrialisation avec les États-Unis, mais aura un impact considérable sur l'économie de l'UE. La combinaison de l'affaiblissement de la réindustrialisation de l'UE, des hausses de taux d'intérêt plus élevées que prévu par la Réserve fédérale américaine et de la fuite des capitaux de l'UE causée par le conflit entre la Russie et l'Ukraine pourrait encore affaiblir l'effet stimulant des investissements dans l'économie européenne. Ainsi, l'impact de l'inflation élevée dans la zone euro, qui a atteint 7,5 % en mars 2022, indique que les États membres de l'UE risquent de répéter les erreurs commises par d'autres pays développés au début du siècle dernier et de tomber dans la stagflation où l'intervention du gouvernement ne parvient pas à inverser la contraction économique.
La domination du dollar sur l'euro pourrait encore se consolider
Depuis son introduction, l'euro a contesté la domination du dollar. Le mode de règlement des transactions sur les marchandises, que ce soit en dollars ou en euros, affecte directement la proportion et le statut de la monnaie dans le système de paiement international. Étant donné que les échanges entre l'UE et la Russie peuvent être réglés en euros, la coopération énergétique entre l'UE et la Russie a non seulement accru l'utilisation de l'euro dans la communauté internationale, mais a également réduit les réserves en dollars des États membres de l'UE pour les achats d'énergie. Récemment, le chancelier allemand Olaf Scholz a réaffirmé que l'Allemagne refuse d'acheter du gaz naturel à la Russie en roubles, soulignant que la plupart des contrats d'approvisionnement en gaz naturel allemand prévoient un paiement en euros, une petite partie seulement étant libellée en dollars.
À la suite du conflit russo-ukrainien, l'Allemagne a non seulement suspendu le processus de certification du projet germano-russe Nord Stream 2, mais a également décidé de construire un nouveau terminal GNL à Brunsbuttel d'une capacité de 8 milliards de mètres cubes par an, destiné à soutenir la nouvelle demande énorme d'importations de GNL en provenance de pays autres que la Russie. Si la déclaration commune des États-Unis et de la Commission européenne du 25 mars est mise en œuvre, les deux parties pourraient avoir des commandes supplémentaires de GNL allant jusqu'à 15 milliards de mètres cubes en 2022, pouvant atteindre 50 milliards de mètres cubes par an jusqu'en 2030 au moins. Ces commandes de GNL seront très probablement réglées en dollars plutôt qu'en euros, ce qui aura un impact majeur sur le statut international de l'euro.
Publié sur World Politcs Blog
17:36 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Economie, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, actualité, europe, affaires européennes, gaz naturel, hydrocarbures, gaz gnl, gaz de schiste, etats-unis, dollar, euro |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 19 avril 2022
La Russie, les Etats-Unis et la Chine dans une conjoncture de conflit. Quels sont les objectifs prioritaires de la "nouvelle guerre froide"?

Puisque la politique internationale a été tenue depuis toujours comme politique de puissance, Macht-Politik dans la culture allemande et Power politics dans le monde anglo-saxon, la conversion idéaliste des Etats en porteurs d'avenirs pacifiés n'a concerné que l'Europe post-moderne, héritière du droit des gens, des empires universels du passé et du cosmopolitisme des élites intellectuelles des XVIIIème et XIXème siècles.
La morphologie triadique du système multipolaire actuel distingue toujours entre objectifs historiques et objectifs éternels et accorde à la géopolitique et à dialectique de l'antagonisme la tâche de distinguer entre types de paix et types de guerres. En fonction des rôles joués par les grands acteurs historiques nous passerons en revue - et à des seules finalités de connaissance,- les différents types de paix, car ils déterminent non seulement les types de guerre, mais également les stratégies générales des acteurs majeurs du système.
Pour l'Europe l’Idéal-type de paix dans un système planétaire est une paix d'équilibre entre l'Amérique et la Russie, puisque le continent est situé à la jonction du Rimland et du Heartland, entre la terre centrale et la grande île du monde ; pour la Russie une paix d'empire, fédératrice de plusieurs peuples, de plusieurs terres et de multiples confessions religieuses. Une paix d'Hégémonie est celle qui convient au choix de l'Amérique, vouée, par sa mission universelle, à exercer son pouvoir sur les trois Océans, Indien, Pacifique et Atlantique, en respectant la souveraineté des pays de la bordure des terres. Pour l'Empire du milieu, le mandat du ciel situe le meilleur type de paix entre une architecture régionale équilibrée et une vision planétaire à long terme, déterminée en partie par sa position géopolitique et en partie par la rivalité qui découle de sa culture et du système mondial des forces. Quant à la crise ukrainienne et à son issue, la superposition de trois types d'hostilité et donc d'insécurité alimentera un conflit de longue durée. S'y entremêlent de manière contrastée:
- Une hostilité/insécurité de la Russie vis-à-vis l'Otan et des Etats-Unis.
- Une inimitié de l'Union européenne vis-à-vis de la Russie. Une ambiguïté de la Chine quant à la pression américaine sur les sanctions occidentales, concernant l'économie russe et ses conséquences et ces incertitudes influent sur le dilemme de fond de notre époque, "affrontement ou condominium" sino-américain, auquel est subordonnée la paix mondiale.
Dans cette conjoncture de changement, le continent européen, sans hauteur symbolique et historique devient le reflet du type d'ordre qui règne dans le monde selon la formule d'une "Nouvelle guerre froide", contestée par certains (G. H. Soutou).
Les objectifs prioritaires de la "Guerre Froide" de l'âge de la bipolarité. Une approche comparée
Le conflit entre les deux blocs de l'époque de la bipolarité n'était qu'un aspect du processus de transformation et de passage du capitalisme au socialisme, qui se voulait révolutionnaire. Il conjuguait tous les aspects de la vie collective des peuples et des nations et excluait des accords durables comme celui d'une coexistence pacifique entre les deux systèmes. Tout devait se passer suivant le primat du conflit et guère de la paix, selon les lois inexorables et objectives de l'histoire.
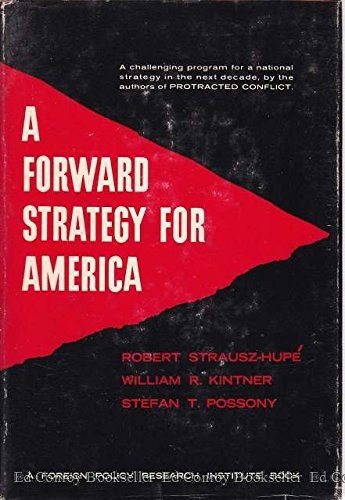 Cependant l’objectif stratégique de l'Occident, selon un courant de pensée américain offensif, représenté par Robert Strausz-Hupé, William R. Kintner et Stefan T. Possony et exposé dans le livre "A forward strategy for America", devait exiger comme "objectif prioritaire, la préservation et la consolidation de notre système politique, plutôt que le maintien de la paix". Selon ce courant, la survie du régime politique des Etats-Unis, n'autorisait "d'autre choix qu'une stratégie à la Caton": "Carthago delenda est !". La coexistence de deux empires rivaux était conçue comme une cause d'instabilité profonde, qui devait déboucher fatalement sur une guerre inexpiable. La situation multipolaire d'aujourd'hui est-elle comparable à celle de l'époque? Change-t-elle sur le fond, à l'essence de la rivalité et à la structure de l'hostilité déclarée? La précarité apportée à la sécurité de la Russie est-elle le premier pas d'une stratégie générale d'élimination d'un adversaire, pour qu'il ne s'allie au troisième, en vue d'un guerre totale, difficile à gagner ?
Cependant l’objectif stratégique de l'Occident, selon un courant de pensée américain offensif, représenté par Robert Strausz-Hupé, William R. Kintner et Stefan T. Possony et exposé dans le livre "A forward strategy for America", devait exiger comme "objectif prioritaire, la préservation et la consolidation de notre système politique, plutôt que le maintien de la paix". Selon ce courant, la survie du régime politique des Etats-Unis, n'autorisait "d'autre choix qu'une stratégie à la Caton": "Carthago delenda est !". La coexistence de deux empires rivaux était conçue comme une cause d'instabilité profonde, qui devait déboucher fatalement sur une guerre inexpiable. La situation multipolaire d'aujourd'hui est-elle comparable à celle de l'époque? Change-t-elle sur le fond, à l'essence de la rivalité et à la structure de l'hostilité déclarée? La précarité apportée à la sécurité de la Russie est-elle le premier pas d'une stratégie générale d'élimination d'un adversaire, pour qu'il ne s'allie au troisième, en vue d'un guerre totale, difficile à gagner ?
Le triple rôle de la Russie, national, eurasien et mondial
La rivalité est-elle compatible avec la paix, indépendamment du rôle historique d'un acteur de l'importance de la Russie ? Cet immense pays remplit aujourd'hui un triple rôle, national ou de régime, régional ou eurasien, et mondial ou de système. En fonction du premier, il constitue un modèle spécifique d'autocratie, porteuse d'une Weltanchauung anti-occidentale, qui doit résoudre en permanence le problème de la légitimité du pouvoir et du consensus des opinions; en rapport au deuxième, un facteur de stabilité et d'équilibre en Eurasie, convoité par le grand Turc. Par référence au système planétaire, un type d'ordre, de meneur du jeu et de leadership, qui apparaît indispensable contre l'entreprise multipolaire et désagrégeante de l'hégémonie américaine. Sur sa face européenne la menace d'une alliance germano-russe ferait de Moscou une candidate moderne à l'empire universel, ôtant la liberté des pays d'Europe centrale; sur l'échiquier de la jonction du Rimland planétaire et du Heartand continental, la Turquie et l'Iran se disputeraient le rôle d'alliés privilégiés pour un condominium, excluant l'hégémon de la terre centrale et agrégeant l'Inde à une entreprise de long terme. Et, dans la profondeur des espaces et du temps, vers les bordures des deux océans, indien et pacifique, la Russie se joindrait à l'Empire du milieu pour donner vie à une civilisation renouvelée et non décadente s'imposant sur la multiplicité des centres asiatiques de décision. Ce rôle de la Russie est à la fois ambivalent, entrainant et dangereux, pour l'Est et pour l’Ouest. Pour l'ensemble des menaces actuelles, politiques, idéologiques et militaires, la stratégie de Caton, définie dans les années soixante, demeure-t-elle toujours valable. "Carthago delenda est!". L'Occident et l'Otan recommandent l'asphyxie de l’économie russe, en pratiquant au même temps la stratégie de la provocation, de l'usure et de l'escalade militaire.
Se faire justice soi même
Puisque la théorie des relations internationales part de l'idée que chaque unité politique a le droit, en dernier recours, de se faire justice d'elle -même, l'enjeu de la décision finale sur la paix et la guerre est défini par le Chef de l'Etat- Chef de guerre. Comment les opérations militaires engagées sur le terrain des combats, peuvent-elles être reconduite à la logique de la négociation et du compromis? Et, faute d'univocité et d'objectifs communs, qui peut jouer, à une échelle diplomatique, le rôle du médiateur et de l’arbitre?
Qui peut juger enfin de la pertinence et satisfaction des objectifs atteints? La stratégie du Blitz initial imputée au Chef d'Etat-Chef de guerre du pouvoir perturbateur part du principe de la primauté du système interétatique, ce qui exclut la prédominance explicative du facteur économique. En effet la guerre d'Ukraine est une guerre politique et pas une guerre personnelle, d'homme à homme, soumise à l'idée d’une punition ou d'un crime.
Le système interétatique est un système dans lequel s'intègrent les Etats, dont aucun n'est soumis à un pouvoir central de contrôle et qui s'organise autour du principe de survie. En ce sens le recours à des fictions comme celles de la paix par la morale ou de la paix par le droit, voilent les relations d'inimitié, idéologiques ou géopolitiques. A ce propos, le changement de stratégie opérationnelle pratiquée par l'Etat major russe, après l'attaque initiale et le siège des métropoles, a été de consolider l'emprise sur la mer d'Azov et de lier plus étroitement la Russie à la Crimée, soustrayant celle-ci et l'intégralité de la Mer Noire, au contrôle de l'Otan. Par ailleurs et à propos de la conduite de terrain, tactique ou stratégique, le principe de solidarité des Etats-nucléaires face au risque paroxystique de l'atome, se fonde sur le principe du concept "d'acteur rationnel" et exclut toute notion d'effets pervers, par vice mental ou par égarement de la raison, qui constitue un des sujets de prédilection de la communication psycho-politique occidentale.
Inimitié et hostilité
Or, l'enjeu du conflit ukrainien, de nature géopolitique et sécuritaire, oppose deux frères-ennemis, qui ont beaucoup de choses en commun (ethnie, religion, histoire) et appartiennent à une même zone de civilisation, se réclamant des mêmes principes, poursuivis alternativement par le dialogue ou par le combat. Le dialogue a donné lieu à l'intérieur de l'aire culturelle de l'ancienne Byzance à l'antithèse classique de l'Etat et de l'Eglise sous la forme du césaro-papisme, come subordination du pouvoir idéologico-religieux au pouvoir étatique et à l'hybridation bicéphale de la souveraineté encore effective sous le régime soviétique. Le combat a marqué la division de l'Ukraine en deux zones culturelles, lors de la deuxième guerre mondiale, exploitées intensément par les médias mainstream et par leurs efforts de propagande.
Persuasion et subversion à l'heure du conflit ukrainien
L'effort constamment entretenu pour dresser les opinions contre leurs élites, (oligarques à l'Est, et anti-souverainistes à l'Ouest), désigne un mode d'action qui a pour but une conversion des esprits au profit de la cause défendue par l'un ou l'autre des deux belligérants. En l'absence d'un objectif commun d'ordre et de stabilité, visant à délimiter des zones d'influence légitimes, la mobilisation mondiale autour du conflit, acquiert la signification d'un choix entre globalisme occidental et souverainisme oriental (Russie et Chine) et cette signification a pour origine l'hétérogénéité des intérêts et des cultures des deux camps, démocratique en Occident et autocratique en Eurasie. L'objet de dispute demeure cependant la sécurité, et, en amont, la préservation d'une certaine conception de l'aire civilisationnelle, de la société et de ses mœurs. La propagande forcée du temps de la bipolarité est devenue guerre de l'information, brouillard de Fake news et théâtre de cyberwars. L'un et l'autre camps considèrent cette propagande comme une entreprise de subversion et tiennent la sienne propre pour persuasion.
Homogénéité et hétérogénéité des deux camps
Du point de vue des régimes constitutionnels pluralistes, l'hétérogénéité des structures politiques et sociales des pays de l'Ouest, favorise la liberté d'expression et la compétition des idées, tandis que l'homogénéité organisée, entretenue par les régimes autocratiques, de Russie ou de Chine, décourage la critique ou l'opposition et la propagande apparaît comme l'une des armes de l'arsenal politique du pouvoir en place. Les campagnes multiples contre les maux de la société post-moderne, par lesquels les opposants aux régimes occidentaux, s'efforcent de gagner des adeptes, sont amplifiés par une militance plus au moins déguisée, mais présentés comme des infiltrations intellectuelles du camp d'en face. Cette infiltration ne réussit pas à éliminer l'engagement du camp adverse, se situant entre le pouvoir et le peuple.
Dans le cadre du conflit ukrainien ces infiltrations sont emphatisées ou suscitées de toute pièce pour dénigrer le régime adverse. Ainsi les trois voix de la Triade (Chine, Occident et Russie), sont différemment audibles, car elles sont différemment ostracisées et l'adhésion intellectuelle et morale aux régimes du Heartland (Chine, Russie et Iran), ou du Rimland (Amérique, Europe, Grande Bretagne et Indopacifique ), est exaspérée et poussée aux extrêmes par la dialectique de la subversion et de la persuasion des deux camps, qui se rejettent réciproquement l'accusation d'agresseurs, de dangers publics et de criminels de guerre. Chacun des deux justifie son combat au nom de deux conceptions de la géopolitique actuelle qui oppose l'eurasisme au globalisme et donc le souverainisme du premier à l'individualisme démocratique du deuxième. Or, si , dans ce dialogue péremptoire et confus, la persuasion consiste à convaincre, la subversion et le langage de la passion attisent la flamme du mécontentement et incitent à la rébellion et à la révolte. Cependant la subversion suppose l'existence d'agents dormants et de structures opérationnelles, aptes à la transformation du mécontentement en rébellion et de la rébellion en révolte, puis, de celle-ci en révolution, de couleur ou pas et, à l'extrême en coup d'Etat de Palais A ce point, ce qui est décisif, ce sont la prise de pouvoir et le changement de régime, effectués grâce aux alliances militaires, supportées de l'extérieur par le pouvoir en place.
Les Etats-Unis et le "Regime change"
Une des finalités de l'action politique contemporaine est de mettre en œuvre la démocratie, de dénigrer le pouvoir autoritaire et d'assurer la stabilité du pouvoir. Une dégradation des conditions de vie ou un affaiblissement du soutien conscient et intentionnel du gouvernement peuvent inverser très rapidement les bases sociales ou le socle idéologique du pouvoir établi. Pour rappel, la politique américaine du "regime change" a été le cadre théorique de l'interventionnisme militaire dans plusieurs pays jugés faibles, au nom des intérêts stratégiques des Etats-Unis et de politiques d'incitation à des réformes politiques. Or, dans le cadre de sa visite à Varsovie du 27 mars dernier, le Président J. Biden, n'a pas hésité à proclamer, dès son arrivée, que le départ de Poutine du pouvoir, n'était pas un but de guerre pour les Etats-Unis, pendant que la presse anglaise formulait l'hypothèse qu'un insuccès militaire de l'armée russe condamnerait le Chef du Kremlin à quitter le pouvoir dans les deux ans. Ainsi dans une campagne orchestrée autour des résultats obtenus par l'invasion de l'Ukraine, de sa surprise stratégique et de son enlisement présumé, l'ex-oligarque et opposant russe Mikhail Khodorkovski, après 10 ans de prison, purgés en Sibérie pour "fraude fiscale", en appelle à l'histoire, pour prophétiser une chute prochaine de Poutine, comme une constante de l'histoire russe, en cas d'échec politique ou militaire. La guerre prochaine,- dit-il - dans une interview accordée au Figaro du 29 mars dernier, contre la Pologne ou un pays balte, scellera une prise de risque supplémentaire, marquant un décalage entre la vision des occidentaux et celle de Poutine.
A titre de rappel la politique d'Obama/Bush de "regime change", recherchant une ligne directrice pour résoudre le dilemme entre démocratie et stabilité, ou de l'actuelle administration démocrate pour articuler une stratégie globale et définir une doctrine pour le paix en Europe et dans le monde, a été de construire un ordre international pacificateur, en incitant les régimes en place à des réformes politiques et socio-économiques. Cependant, en partant de perspectives historiques antagonistes, les objectifs opposés de l'Occident et des puissances de l'Eurasie et du Pacifique, peuvent-ils trouver une conciliation dans leurs intérêts et stratégies divergentes? Ou bien, en revanche, ne contribuent-ils pas à frayer la voie des seules puissances montantes, visant à définir un nouvel ordre international plus adapté à l'époque de la multipolarité et, à l'aide de celui-ci, à définir un système post-wesphalien plus stable et une conception plus conséquente de la démocratie?
Bruxelles le 31 mars 2022.
19:17 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, ukraine, chine, états-unis, russie, politique internationale, géopolitique, relations internationales |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Unipolarité, bipolarité, multipolarité et la guerre d'Ukraine

Unipolarité, bipolarité, multipolarité et la guerre d'Ukraine
Vers une multipolarité de plus en plus complexe: scénario pour l'avenir
Enric Ravello Barber
Source: https://www.enricravellobarber.eu/2022/04/unipolaridad-bipolaridad-multipolaridad.html#.Yl5zFNPP2Uk
Derrière la prétendue fin de l'histoire proclamée par le publiciste du Pentagone Francis Fukuyama, se cachait une aberration philosophique : sortir l'homme de son habitat, celui de l'Histoire, entendue comme son "faire-dans-le-monde", et ouvrir la porte au post-humanisme qui nous apparaît déjà aujourd'hui comme une réalité de fait. Cette entorse à l'histoire a signifié la mise en œuvre urbi et orbi de ce que les occupants successifs de la Maison Blanche, sans la moindre dissimulation, ont appelé le Nouvel Ordre Mondial - nous insistons sur le mot "Monde" - : c'est-à-dire l'unification du monde sous la direction des Etats-Unis, ou, en d'autres termes, un monde unipolaire, c'est-à-dire avec un seul centre de pouvoir : Washington.
Les erreurs stratégiques des administrations américaines successives, toujours sous inspiration néo-con unipolaire, ont donné à la Russie le temps nécessaire pour se reconstruire en tant que puissance militaire et la Chine a émergé comme une puissance mondiale de premier ordre, non seulement en tant que puissance militaire mais aussi en tant que puissance globale (économique, stratégique, industrielle, technologique et diplomatique).
La Chine est devenue le principal acteur de la deuxième vague de mondialisation. Ce n'était qu'une contradiction apparente pour une puissance communiste de prôner la réduction de tous les obstacles au commerce mondial, puisque la vente de ses produits manufacturés sur les marchés mondiaux était la principale cause de sa croissance en tant que puissance.
L'essor de la Chine annonce en quelque sorte la fin du rêve unipolaire des Etats-Unis et montre une nouvelle réalité bipolaire. Quelques décennies après la chute de l'URSS, le monde vit à nouveau la lutte pour l'hégémonie planétaire entre deux puissances: les États-Unis et la Chine.
La Russie, devenue le troisième acteur mondial, propose un pas en avant, une nouvelle correction au Nouvel Ordre Mondial de Washington: le monde multipolaire. La Russie constituerait un troisième pôle géopolitique, une situation qui se conjuguerait également avec l'émergence de puissances régionales qui fragmenteraient davantage le plan de domination mondiale de la Maison Blanche: la Turquie, l'Iran et l'Inde joueraient ce rôle.
Dans cette réalité, l'Europe, le non-sujet géopolitique par excellence, pourrait cependant jouer un rôle décisif - comme l'ont constaté certains de ses dirigeants. Dans ce contexte multipolaire, l'Europe devrait s'émanciper de sa soumission aux États-Unis et devenir un autre centre de pouvoir, capable d'agir sur la scène internationale selon ses propres dynamiques et intérêts, de plus en plus opposés et divergents de ceux de la métropole colonisatrice Stars and Stripes. Et pour cela, l'une des conditions nécessaires - de la culture à l'énergie - serait une synergie entre l'Europe et la Russie, qui renforcerait le rôle de ces deux réalités et, partant, remettrait en question et diminuerait celui des États-Unis.
Aujourd'hui, tous ces scénarios sont en jeu dans la guerre d'Ukraine. Les États-Unis, qui provoquent depuis des années des situations inacceptables pour Moscou, voient dans cette guerre la possibilité ultime de couper le rapprochement et la collaboration croissante entre la Russie et l'Allemagne - dont le gaz est l'un des éléments clés - et de détruire ainsi l'option de ce troisième pôle et la construction d'un monde multipolaire: son premier objectif est d'isoler Moscou de ses partenaires géopolitiques potentiels, le second est de détruire la Russie en tant que puissance et de réduire encore l'UE au statut de colonie. C'est pourquoi elle est aujourd'hui la principale intéressée à prolonger la guerre en Ukraine, afin que Washington regagne du terrain dans une logique unipolaire. La Chine joue une fois de plus son grand atout diplomatique, la patience, l'objectif est aussi un affaiblissement progressif de la Russie et son éloignement de l'Europe, une Russie faible et isolée dépendrait de plus en plus de sa relation avec Pékin, ce qui ferait de la Chine à nouveau la seule puissance disputant la domination du monde aux Etats-Unis (logique bipolaire). Une Russie renforcée, confortée dans son prestige diplomatique et militaire, renforcerait la logique multipolaire, une logique que certains dirigeants européens tentent de soutenir dans le peu de marge de manœuvre dont ils disposent ; le refus d'inclure le gaz et l'énergie dans les sanctions contre la Russie est la preuve de cette réalité.
En bref, l'issue finale de la guerre en Ukraine marquera le scénario mondial des prochaines décennies, et surtout pour les Européens. Deux options s'offrent à eux : soit la non-existence géopolitique et la soumission absolue à l'atlantisme américain, soit l'émancipation géopolitique et l'articulation en tant qu'acteur international dans une réalité multipolaire, et nous le répétons, cette dernière pour une synergie - et non une soumission - avec une Russie puissante et antagoniste à l'unipolarisme de Washington et au bipolarisme de Pékin.
10:27 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : unipolarité, bipolarité, multipolarité, relations internationales, politique internationale, europe, affaires européennes, chine, russie, états-unis, géopolitique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 18 avril 2022
La mémoire sélective de Robert Kagan

La mémoire sélective de Robert Kagan
Andrew Bacevich
Source: https://katehon.com/ru/article/izbiratelnaya-pamyat-roberta-kagana
Selon un journaliste de Foreign Affairs, la Russie est entrée en Ukraine parce que les Etats-Unis ne sont pas suffisamment impliqués dans les conflits mondiaux.
Récemment, dans les pages de Foreign Affairs, l'infatigable Robert Kagan a fait un autre plaidoyer enflammé au nom de l'empire. En véritable Américain, Kagan évite bien sûr d'utiliser le mot "I(mperium)", qui est offensant. Il préfère le terme "hégémonie", qui, explique-t-il, est doux et n'implique ni domination ni exploitation, mais une soumission volontaire - "une condition plutôt qu'un objectif". En grattant la surface, cependant, vous verrez que The Price of Hegemony offre une variation sur le thème standard de Kagan : l'impératif de la domination mondiale militarisée des États-Unis, quel qu'en soit le prix et sans trop se soucier de qui paie.
Peu de gens accuseraient Kagan d'être un penseur profond ou original. En tant qu'écrivain, il est moins un philosophe qu'un pamphlétaire, bien qu'il ait un véritable don pour formuler ses pensées. Considérez, par exemple, sa célèbre déclaration selon laquelle "les Américains viennent de Mars et les Européens de Vénus". Cette phrase "les guerriers contre les faibles", autrefois considérée comme exprimant la vérité du fond de la pensée de Lippmann, a depuis perdu beaucoup de son attrait persuasif, notamment parce que les guerriers, également connus sous le nom de "troupes", ne se sont pas particulièrement bien débrouillés lorsqu'ils ont été envoyés pour libérer, soumettre ou renverser qui que ce soit.
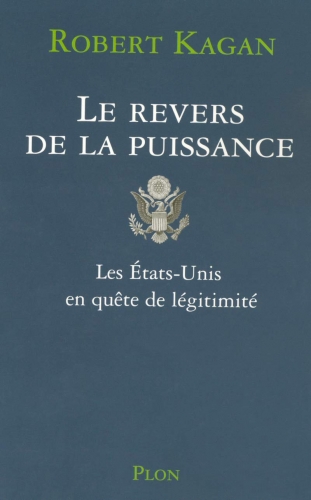
Ainsi, Kagan est susceptible de partager le sort non seulement de Walter Lippmann, mais aussi de Scotty Reston ou de Joe Olsop, autrefois éminents chroniqueurs de Washington, aujourd'hui complètement oubliés. Bien sûr, le même sort attend toute la foule de commentateurs (y compris l'auteur de ces lignes) qui fulminent sur le rôle de l'Amérique dans le monde, croyant à tort que des responsables de haut rang à la Maison Blanche, à Foggy Bottom ou au Pentagone leur demandent conseil. Ils le font rarement.
Néanmoins, Kagan se distingue des autres sur un point : sa capacité à combiner cohérence et flexibilité est inégalée. Il est lui-même tout à fait agile. Quoi qu'il arrive dans le monde réel, il est prêt à expliquer comment les événements confirment le caractère indispensable d'un leadership américain affirmé. À Washington (et dans les pages de Foreign Affairs), cela est toujours bienvenu.
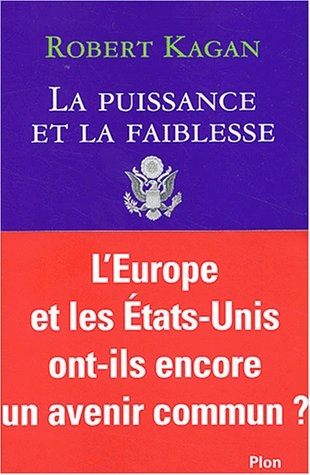
Cette dextérité se manifeste de manière éclatante dans son dernier essai, dont le sous-titre pose la question suivante : "L'Amérique peut-elle apprendre à utiliser sa puissance?". Kagan arrive à sa propre réponse - les États-Unis non seulement peuvent apprendre, mais ils doivent le faire - même s'il ignore complètement ce qu'ils ont finalement obtenu avec le vigoureux déploiement de la puissance américaine au cours des deux dernières décennies et à quel prix.
Ainsi, son essai contient diverses références sinistres au mauvais comportement de la Russie, ainsi que des allusions à quelques actions indésirables de la Chine. Peut-être inévitablement, Kagan jette aussi quelques allusions tout aussi sinistres à l'Allemagne et au Japon à l'approche de la Seconde Guerre mondiale, la source d'enseignement historique faisant autorité dans les cercles de Washington. Cependant, il est silencieux sur les guerres américaines en Afghanistan et en Irak après le 11 septembre. Ils n'ont pas reçu la moindre mention - aucune, zéro.
Selon Kagan, la guerre russo-ukrainienne en cours s'est produite au moins en partie à cause de la passivité américaine. Les administrations américaines successives depuis la fin de la guerre froide ont refusé de faire leur travail. En termes simples, ils n'ont fait aucun effort pour garder la Russie sous contrôle. Alors qu'il serait "obscène de blâmer les États-Unis pour l'attaque inhumaine de Poutine contre l'Ukraine", écrit Kagan, "insister sur le fait que l'invasion n'était absolument pas provoquée est trompeur". Les États-Unis "ont mal joué la carte de la puissance". Ce faisant, ils ont donné à Vladimir Poutine une raison de penser qu'il pouvait s'en tirer avec une agression. Ainsi, Washington, comme si elle était restée les bras croisés pendant les deux premières décennies de ce siècle, a provoqué Moscou.
"En gérant l'influence des États-Unis de manière plus cohérente et plus efficace", les présidents, à commencer par Bush père, auraient pu empêcher la dévastation dont ont souffert les Ukrainiens. Du point de vue de Kagan, les États-Unis ont été trop passifs. Aujourd'hui, écrit-il, "la question est de savoir si les États-Unis continueront à commettre leurs propres erreurs" - des erreurs d'omission, selon lui - "ou si les Américains apprendront à nouveau qu'il vaut mieux dissuader les autocraties agressives avant qu'elles ne s'emparent de la puissance".
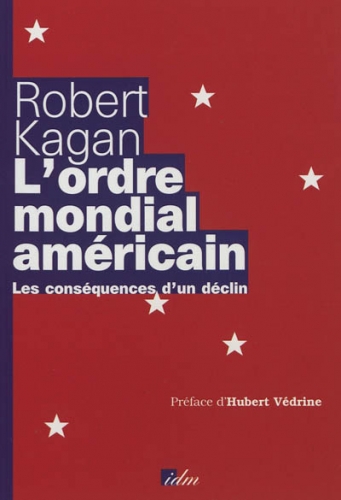
La référence précoce à l'endiguement des autocraties agressives doit être déchiffrée. Kagan fait semblant de le faire. Ce qu'il suggère en fait, c'est de poursuivre l'expérimentation de la guerre préventive, qui est devenue un élément central de la politique de sécurité nationale américaine depuis le 11 septembre. Kagan, bien sûr, a soutenu la doctrine Bush de la guerre préventive. Il était pleinement préparé à l'invasion de l'Irak. Mise en œuvre en 2003 sous la forme de l'opération Iraqi Freedom, la doctrine Bush a eu des résultats désastreux.
Aujourd'hui, même deux décennies plus tard, Kagan ne peut se résoudre à reconnaître l'immensité et le grotesque de cette erreur, ni ses effets secondaires, notamment la montée du Trumpisme et tous les maux qui en découlent.
"L'Amérique peut-elle apprendre à utiliser sa puissance ?" - Que cette question soit évaluée comme une question urgente est certainement vrai. Cependant, penser que Robert Kagan est qualifié pour donner une réponse cohérente est trompeur.
16:47 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : robert kagan, actualité, hégémonisme, hégémonisme américain, états-unis, géopolitique, néoconservatisme, bellicisme américain, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 11 avril 2022
La Chine et la Russie, une menace pour la suprématie financière américaine

La Chine et la Russie, une menace pour la suprématie financière américaine
par Sherish Khan
Source: https://www.ideeazione.com/cina-e-russia-una-minaccia-per-la-supremazia-finanziaria-americana/
Le système financier mondial est actuellement sous pression sous différents angles. La structure du commerce mondial est compliquée. L'une des principales raisons est que les intérêts des États-Unis et de l'Europe ont été gravement endommagés. En termes de commerce, la Chine a dépassé ces deux régions du monde. Les Chinois en sont convaincus et sont par ailleurs habitués à la production de masse. La Chine dans son ensemble est également appelée "l'usine du monde". La capacité à concurrencer la Chine dans le processus de production n'est actuellement pas possible pour les États-Unis et l'Europe. L'une des principales raisons est que la Chine a fait des efforts systématiques pour se procurer des matières premières dans différentes régions du globe ; elle importe de grandes quantités de matières premières d'Afrique, d'Asie et d'autres régions. Ce processus a renforcé non seulement son statut économique, mais aussi son statut politique et social. Les États-Unis sont actuellement préoccupés par la manière de maintenir leur domination sur la politique et l'économie mondiales, notamment dans le domaine de la finance. La Chine et la Russie deviennent une menace pour la suprématie financière des États-Unis.
La Russie a tiré la plus retentissante sonnette d'alarme pour le système financier mondial contrôlé par l'Occident. Les États-Unis et l'Europe ont tenté de renforcer leur position en imposant des sanctions économiques à la Russie en riposte à une intervention militaire russe en Ukraine. La Russie a été exclue du système de paiement international Swift. Dans ce système, tous les paiements sont effectués en dollars et en euros. Les États-Unis ont déclaré que la Russie ne pouvait plus mener ses affaires financières en dollars. L'exclusion de Swift signifie qu'aucune entreprise russe ne peut percevoir de quelqu'un un paiement quelconque en dollars ou payer quelqu'un en dollars. Dans ce cas, quelle option a la Russie ? Que peut-elle faire pour briser le monopole du dollar ? La Russie est un exportateur majeur. Ses exportations comprennent l'aluminium, le palladium, le nickel et d'autres métaux, le pétrole brut, le gaz, les diamants, le charbon et de nombreuses autres matières premières importantes. La part de la Russie dans le commerce mondial est d'environ 22%. Un pays dont le statut commercial est aussi important ne peut être facilement négligé. Maintenant, la Chine parle de conclure des accords pétroliers avec la Russie en roubles. D'autre part, l'Arabie saoudite, dans certains cas, semble être jalouse d'une configuration comme Swift, et si la Russie commençait à faire tout son commerce en roubles ? La position mondiale du dollar serait affaiblie. Si la Russie réussit, d'autres pays devront également commercer dans leur propre monnaie. Les plus grands exportateurs de pétrole brut sont l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Que se passerait-il s'ils décidaient de vendre leur pétrole dans leur propre monnaie ?
Tout comme la Chine a accepté de commercer avec la Russie en roubles et en yuans. Si deux ou trois autres pays agissent de la sorte, il sera très dangereux pour le dollar de monter. Au moment de l'invasion russe de l'Ukraine, le monde entier avait l'impression qu'un nouveau bloc était sur le point d'émerger, qui serait anti-occidental et donnerait du fil à retordre à l'Occident. Le monde musulman, y compris le Pakistan, est très important à cet égard, car c'est sur la base de nos décisions que les caractéristiques de ce bloc deviendront claires. Il importe peu que l'Inde ne soit pas d'accord. Beaucoup de choses changeront si la plupart des pays du monde musulman se rangent du côté de la Chine et de la Russie. Dans ce cas, les États-Unis ne seront pas en mesure de maintenir leur position dans la politique et l'économie mondiales. La véritable préoccupation pour les États-Unis et l'Europe est que la Russie et la Chine détiennent toutes deux une part importante du commerce mondial. En tant que plus grand moteur manufacturier du monde, la Chine et, à côté d'elle, la Russie se démarquent des États-Unis et de l'Europe.
La question clé est maintenant de savoir ce que veulent les États-Unis et l'Europe. Sont-ils prêts à faire des concessions au reste du monde ? Le monde occidental est-il prêt à impliquer d'autres puissances émergentes dans la politique et l'économie mondiales ? La tête de cet Occident global n'a pas l'air d'y penser. L'attitude des superpuissances à chaque époque est la même que celle des États-Unis et de l'Union européenne. Tous deux ne sont pas prêts à reculer. Les États-Unis ne sont pas favorables à l'idée de céder la place à la Chine et à la Russie ; cela ne signifie pas que leur puissance est intacte, même s'il y a eu un déclin de la puissance, ils ne veulent pas donner l'impression qu'ils s'affaiblissent. Si la Chine et la Russie devaient mettre de côté le système de paiement international actuel et développer un système alternatif pour elles-mêmes, la supériorité financière des États-Unis et de l'Europe serait gravement affectée. Si les États arabes ou du Golfe sont également intéressés par l'adoption de ce système alternatif, beaucoup de choses seront inversées. La Russie parle depuis longtemps de rétablir le système de troc, c'est-à-dire de remplacer les marchandises par des produits de base. Si un tel système est introduit, la position décisive du dollar sera gravement compromise.
20:48 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : chine, russie, rouble, dollar, yuan, monnaies, économie, politique internationale, états-unis, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
L'empire américain s'autodétruit

L'empire américain s'autodétruit
Par Michael Hudson
Source: https://jornalpurosangue.com/2022/03/09/o-imperio-americano-autodestroi-se/
Les empires suivent souvent le cours d'une tragédie grecque, provoquant précisément le sort qu'ils cherchaient à éviter. C'est certainement le cas de l'Empire américain, qui se démantèle en un mouvement qui n'est pas très lent.
L'hypothèse de base des prévisions économiques et diplomatiques est que chaque pays agira dans son propre intérêt. Un tel raisonnement n'est pas utile dans le monde d'aujourd'hui. Les observateurs de tout le spectre politique utilisent des expressions comme "se tirer une balle dans le pied" pour décrire la confrontation diplomatique des États-Unis avec la Russie et ses alliés. Mais personne ne pensait que l'empire américain s'autodétruirait aussi rapidement.
Pendant plus d'une génération, les plus éminents diplomates américains ont mis en garde contre ce qu'ils considéraient comme la menace extérieure ultime : une alliance entre la Russie et la Chine dominant l'Eurasie. Les sanctions économiques et la confrontation militaire de l'Amérique ont rapproché ces deux pays et poussent d'autres pays dans leur orbite eurasienne émergente.
La puissance économique et financière américaine était censée éviter ce destin eurasien. Pendant le demi-siècle qui a suivi l'abandon de l'étalon-or par les États-Unis en 1971, les banques centrales du monde entier ont fonctionné selon l'étalon-dollar, en détenant leurs réserves monétaires internationales sous forme de bons du Trésor américain, de dépôts bancaires américains et d'actions et d'obligations américaines. Le standard des bons du Trésor qui en a résulté a permis à l'Amérique de financer ses dépenses militaires à l'étranger et la prise de contrôle d'autres pays simplement en créant des billets à ordre (IOU) libellés en dollars. Les déficits de la balance des paiements des États-Unis finissent dans les banques centrales des pays ayant des excédents de paiement comme réserves, tandis que les débiteurs du Sud ont besoin de dollars pour payer leurs partenaires et effectuer leur commerce extérieur.

Michael Hudson.
Ce privilège monétaire - le seigneuriage [NT] du dollar - a permis à la diplomatie américaine d'imposer des politiques néolibérales au reste du monde sans avoir à utiliser beaucoup de force militaire propre, sauf pour capturer le pétrole du Proche-Orient.
La récente escalade des sanctions américaines qui empêchent l'Europe, l'Asie et d'autres pays de commercer et d'investir avec la Russie, l'Iran et la Chine a imposé d'énormes coûts d'opportunité - le coût des occasions perdues - aux alliés des États-Unis. Et la récente confiscation de l'or et des réserves étrangères du Venezuela, de l'Afghanistan et maintenant de la Russie [1] [NT], ainsi que la capture sélective des comptes bancaires de riches étrangers (dans l'espoir de gagner leurs cœurs et leurs esprits, attirés par l'espoir du retour de leurs comptes séquestrés), a mis fin à l'idée que les avoirs en dollars - ou maintenant aussi les avoirs en livres sterling et en euros des satellites de l'OTAN en dollars - sont un refuge d'investissement sûr lorsque les conditions économiques mondiales deviennent instables.
Je suis donc quelque peu dégoûté d'observer la vitesse à laquelle ce système financé centré sur les États-Unis s'est déprécié en quelques années seulement. Le thème de base de mon livre Super Impérialisme était la façon dont, au cours des cinquante dernières années, l'étalon des bons du Trésor américain a canalisé l'épargne étrangère vers les marchés financiers et les banques américaines, donnant libre cours à la diplomatie du dollar. Je pensais que la "dédollarisation" serait menée par la Chine et la Russie qui prendraient le contrôle de leurs économies pour éviter le type de polarisation financière qui impose l'austérité aux États-Unis [2]. Mais les responsables américains obligent la Russie, la Chine et d'autres nations à se déverrouiller de l'orbite américaine pour se rendre à l'évidence et surmonter toute hésitation qu'ils avaient à "dédollariser".
J'avais espéré que la fin de l'économie impériale dollarisée se produirait grâce à l'effondrement d'autres pays. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Les diplomates américains ont eux-mêmes choisi de mettre fin à la dollarisation internationale, tout en aidant la Russie à construire ses propres moyens de production agricoles et industriels autosuffisants. Ce processus de fracturation mondiale est en effet en cours depuis quelques années, à commencer par les sanctions qui empêchent les alliés de l'OTAN et autres satellites économiques de l'Amérique de commercer avec la Russie. Pour la Russie, ces sanctions ont eu le même effet que celui qu'auraient eu des tarifs protectionnistes.
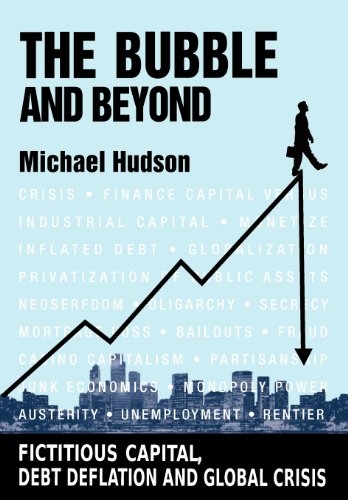
La Russie est restée trop fascinée par l'idéologie néolibérale du marché libre pour prendre des mesures visant à protéger sa propre agriculture et son industrie. Les États-Unis ont apporté l'aide nécessaire en imposant à la Russie l'autosuffisance intérieure. Lorsque les États baltes ont obéi aux sanctions américaines et ont perdu le marché russe pour leurs fromages et autres produits agricoles, la Russie a rapidement créé sa propre industrie fromagère et laitière - tout en devenant le premier exportateur mondial de céréales.
La Russie découvre (ou est sur le point de découvrir) qu'elle n'a pas besoin de dollars américains pour soutenir le taux de change du rouble. Sa banque centrale peut créer les roubles nécessaires pour payer les salaires nationaux et financer la formation de capital. Les confiscations par les États-Unis de leurs réserves en dollars et en euros pourraient finalement amener la Russie à mettre fin à son adhésion à la philosophie monétaire néolibérale, Sergei Glaziev plaidant depuis longtemps en faveur de la "Théorie monétaire moderne" (MMT).
La même dynamique de réduction des cibles ostensibles des États-Unis s'est produite avec les sanctions américaines contre les principaux multimillionnaires russes. La thérapie de choc néolibérale et les privatisations des années 1990 n'ont laissé aux kleptocrates russes qu'un seul moyen de s'approprier les actifs qu'ils avaient arrachés au domaine public. Il s'agissait d'incorporer leurs acquisitions et de vendre leurs actions à Londres et à New York. L'épargne intérieure avait été décimée et les conseillers américains ont persuadé la banque centrale russe de ne pas créer sa propre monnaie en roubles.
Le résultat est que les actifs pétroliers, gaziers et minéraux nationaux de la Russie n'ont pas été utilisés pour financer une rationalisation de l'industrie et du logement russes. Au lieu d'être investis dans la création de nouveaux moyens de protection de la population russe, les revenus de la privatisation ont été dilapidés dans de nouvelles acquisitions d'actifs nouveaux-riche, d'immobilier de luxe en territoire britannique, de yachts et d'autres actifs de la fuite mondiale des capitaux. Mais l'effet des sanctions qui ont pris en otage les avoirs en dollars, en livres sterling et en euros des multimillionnaires russes a été de faire de la City de Londres un endroit trop risqué pour eux de détenir leurs actifs - et pour les riches de toute autre nation potentiellement soumise aux sanctions américaines. En imposant des sanctions aux Russes les plus riches et les plus proches de Poutine, les responsables américains espéraient les inciter à s'opposer à leur rupture avec l'Occident et ainsi servir efficacement d'agents d'influence de l'OTAN. Mais pour les multimillionnaires russes, leur propre pays commence à paraître plus sûr.
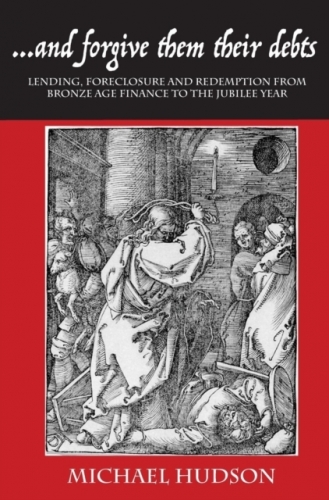
Pendant de nombreuses décennies, la Réserve fédérale américaine et le Trésor ont lutté contre [la possibilité que] l'or retrouve son rôle dans les réserves internationales. Mais comment l'Inde et l'Arabie saoudite considéreront-elles leurs avoirs en dollars lorsque Biden et Blinken tenteront de les forcer à suivre l'"ordre fondé sur des règles" des États-Unis plutôt que leur propre intérêt national ? Les récents diktats américains ne leur laissent guère d'autre choix que de commencer à protéger leur propre autonomie politique en convertissant leurs avoirs en dollars et en euros en or, un actif libre de la responsabilité politique d'être pris en otage par des exigences américaines de plus en plus coûteuses et perturbatrices.
La diplomatie américaine a frotté le nez de l'Europe dans sa servilité abjecte, en disant à ses gouvernements d'obliger leurs entreprises à se débarrasser de leurs actifs pour quelques centimes de dollars après le blocage des réserves étrangères de la Russie et la chute du taux de change du rouble. Blackstone, Goldman Sachs et d'autres investisseurs américains se sont empressés d'acheter ce dont Shell Oil et d'autres sociétés étrangères se débarrassaient.
Personne ne pensait que l'ordre mondial d'après-guerre 1945-2020 céderait aussi rapidement. Un véritable nouvel ordre économique international est en train d'émerger, même si la forme qu'il prendra n'est pas encore claire. Mais les confrontations résultant de la "montée de l'ours" avec l'agression US/OTAN contre la Russie ont dépassé le niveau de la masse critique. Il ne s'agit plus seulement de l'Ukraine. Celle-ci n'est que le déclencheur, un catalyseur pour éloigner une grande partie du monde de l'orbite USA/OTAN.
La prochaine confrontation pourrait venir de l'intérieur même de l'Europe, alors que les politiciens nationalistes cherchent à mener une rupture avec le super-impérialisme américain qui agit à l'encontre des intérêts de ses propres alliés européens et autres, afin de les maintenir dans la dépendance du commerce et des investissements basés aux Etats-Unis. Le prix de leur obéissance continue est d'imposer une inflation des coûts à leur industrie tout en subordonnant leur politique électorale démocratique aux proconsuls américains de l'OTAN.
Ces conséquences ne peuvent pas vraiment être considérées comme "involontaires". De nombreux observateurs ont indiqué exactement ce qui allait se passer - à commencer par le président Poutine et le ministre des Affaires étrangères Lavrov lorsqu'il a expliqué quelle serait leur réponse si l'OTAN insistait pour les coincer tout en attaquant les Russophones de l'Est de l'Ukraine et en déplaçant des armes lourdes vers la frontière occidentale de la Russie. Les conséquences étaient prévues. Les néoconservateurs qui contrôlent la politique étrangère américaine s'en fichaient tout simplement. Reconnaître les préoccupations des Russes était considéré comme du Putinverstehen (compréhension de Poutine) comme on dit en Allemagne.
Les responsables européens n'étaient pas mal à l'aise pour parler au monde de leurs inquiétudes quant au fait que Donald Trump était fou et déstabilisait les bénéficiaires de la diplomatie internationale. Mais ils semblent avoir été pris de court par la résurgence de la haine viscérale de la Russie par l'administration Biden via le secrétaire d'État Blinken et Victoria Nuland-Kagan. La façon de s'exprimer et les manières de Trump ont peut-être été vulgaires et incongrues, mais la bande des néocons américains a des obsessions bien plus menaçantes risquant de déclencher une confrontation mondiale. L'enjeu pour eux était de savoir de quelle réalité ils sortiraient victorieux : la "réalité" qu'ils pensaient pouvoir fabriquer, ou la réalité économique hors du contrôle des États-Unis.
Ce que les pays étrangers n'ont pas fait de leur propre chef pour remplacer le FMI, la Banque mondiale et les autres bras forts de la diplomatie américaine, les politiciens américains les obligent maintenant à le faire. Au lieu que les pays d'Europe, du Proche-Orient et du Sud s'éloignent en calculant leurs propres intérêts économiques à long terme, c'est l'Amérique qui les repousse, tout comme elle l'a fait avec la Russie et la Chine. De plus en plus d'hommes politiques cherchent à obtenir le soutien des électeurs en leur demandant si leurs pays seraient mieux servis par de nouveaux accords monétaires pour remplacer le commerce, les investissements et même le service de la dette étrangère en dollars.
L'effondrement des prix de l'énergie et des denrées alimentaires frappe particulièrement les pays du Sud, ce qui coïncide avec leurs propres problèmes de Covid-19 et l'imminence du service de la dette dollarisée qui arrive à échéance. Quelque chose doit céder. Pendant combien de temps ces pays vont-ils imposer l'austérité pour rembourser les détenteurs d'obligations étrangers ?
Comment les économies américaine et européenne vont-elles faire face à leurs sanctions contre les importations de gaz et de pétrole russes, de cobalt, d'aluminium, de palladium et d'autres matériaux de base. Les diplomates américains ont dressé une liste de matières premières dont leur économie a désespérément besoin et qui sont donc exemptées des sanctions commerciales imposées. Cela fournit-il à M. Poutine une liste utile de points de pression américains à utiliser pour remodeler la diplomatie mondiale et aider les pays européens et autres à se libérer du rideau de fer que l'Amérique a imposé afin d'enfermer ses satellites dans la dépendance des fournitures américaines à prix élevé ?
L'inflation de Biden
Mais la rupture définitive avec l'aventurisme de l'OTAN doit venir de l'intérieur même des États-Unis. À l'approche des élections du Congrès de cette année, les politiciens trouveront un terrain fertile pour montrer aux électeurs américains que l'inflation des prix entraînée par l'essence et l'énergie est un sous-produit politique du blocage des exportations de pétrole et de gaz par l'administration Biden (mauvaise nouvelle pour les propriétaires de gros SUV gourmands en essence !). Le gaz est nécessaire non seulement pour le chauffage et la production d'électricité, mais aussi pour la production d'engrais, dont il y a déjà une pénurie mondiale. Cette situation est exacerbée par le blocus des exportations de céréales russes et ukrainiennes vers les États-Unis et l'Europe, qui provoque déjà une hausse des prix alimentaires.
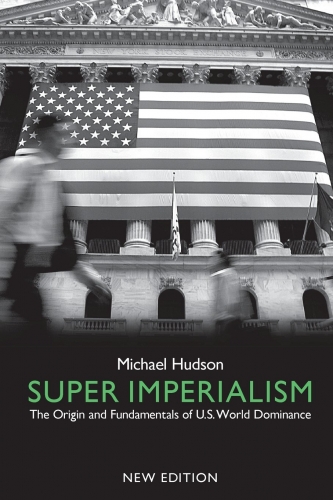
Il y a déjà une déconnexion frappante entre la vision de la réalité du secteur financier et celle promue par les grands médias de l'OTAN. Les marchés financiers européens ont plongé à l'ouverture le lundi 7 mars, tandis que le pétrole Brent a atteint 130 dollars le baril. Le journal télévisé "Today" de la BBC a présenté ce matin le député conservateur Alan Duncan, un négociant en pétrole, qui a averti que le quasi-doublement des prix des contrats à terme sur le gaz naturel menaçait de mettre en faillite les entreprises engagées à fournir du gaz à l'Europe aux anciens tarifs. Mais revenons aux nouvelles militaires des "Deux minutes de haine". La BBC a continué à applaudir les courageux combattants ukrainiens et les politiciens de l'OTAN ont demandé un plus grand soutien militaire. À New York, l'indice Dow Jones a plongé de 650 points et l'or est passé à plus de 2000 dollars l'once - ce qui reflète l'opinion du secteur financier sur la façon dont la partie américaine est susceptible de se dérouler. Les prix du nickel ont encore augmenté - de 40 pour cent.
Tenter de forcer la Russie à répondre militairement et à faire mauvaise figure aux yeux du reste du monde s'avère être un coup monté visant simplement à garantir que l'Europe contribue davantage à l'OTAN, achète plus de matériel militaire aux États-Unis et s'enferme davantage dans une dépendance commerciale et monétaire vis-à-vis des États-Unis. L'instabilité ainsi provoquée a pour effet de faire passer les États-Unis pour aussi menaçants que l'OTAN/l'Occident prétend que la Russie l'est.
Source : Portal Resist Info.
Références :
[1] L'or de la Libye a également disparu après le renversement de Mouammar Kadhafi par l'OTAN en 2011.
[2] Voir plus récemment Radhika Desai et Michael Hudson (2021), "Beyond Dollar Creditocracy : A Geopolitical Economy", Valdai Club Paper No. 116. Moscou : Valdai Club, 7 juillet, repris dans Real World Economic Review (97), https://rwer.wordpress.com/2021/09/23.
[NT]
[1] Seignorage : Bénéfice résultant du différentiel entre le coût de production de la monnaie et sa valeur nominale.
[2] Hudson aurait pu ajouter le vol des propres réserves d'or de la Banque centrale d'Ukraine.
20:07 Publié dans Actualité, Economie, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : etats-unis, politique internationale, économie, sanctions, sanctions antirusses, géopolitique, otan, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 09 avril 2022
La guerre américaine en Ukraine est en réalité une guerre contre l'Allemagne

La guerre américaine en Ukraine est en réalité une guerre contre l'Allemagne
Valentin Katasonov
Source: http://geoestrategia.es/index.php/noticias/politica/37335-la-guerra-estadounidense-en-ucrania-es-en-realidad-una-guerra-contra-alemania
Il est connu que toute sanction économique s'accompagne d'un effet boomerang (conséquences négatives pour l'État à l'origine des sanctions). La force de l'impact d'un boomerang varie fortement d'un pays à l'autre. L'effet boomerang est beaucoup plus fort pour l'Europe que pour les États-Unis. Et au sein de l'UE, la propagation des effets négatifs est également très importante.
Les sanctions de 2014 ("pour la Crimée") ont varié considérablement quant à la force de l'effet boomerang. Une étude de Matthieu Crozet et Julian Hinz a tenté de calculer les pertes subies par l'Occident du fait de la réduction des exportations de marchandises vers la Russie jusqu'à la mi-2015. Les pertes se sont élevées à 60,2 milliards de dollars et seulement 17,8 % de ces pertes étaient dues à l'introduction de contre-sanctions par Moscou. Les 82,2 pour cent restants sont des pertes que l'on peut qualifier de "tir dans le pied". 76,7 % de ces pertes (plus de 46 milliards de dollars) ont été subies par les pays de l'UE. Et seulement 23,3% correspondaient au reste des pays occidentaux (USA, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Suède, Suisse, etc.).
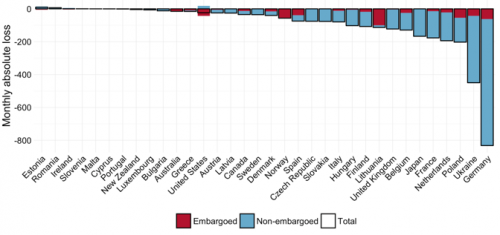
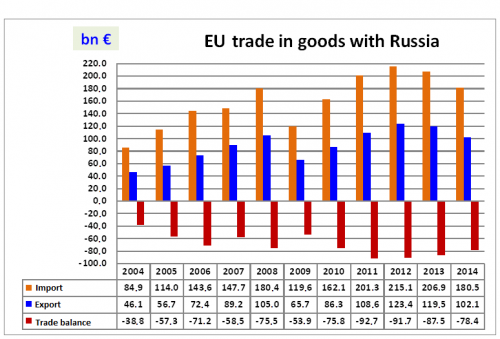
Au sein de l'UE, le résultat négatif de la première vague de sanctions est également très différent. L'étude "Les leçons des sanctions de l'UE contre la Russie en 2014-2015" fournit des estimations des dommages subis par les différents États membres de l'UE jusqu'à la mi-2015. Voici la liste des pays ayant subi les plus grosses pertes (en millions d'euros) : Allemagne - 2 566 ; Italie - 668 ; France - 612 ; Pays-Bas - 591 ; Pologne - 521. Si l'on prend des indicateurs relatifs, il s'avère que pour l'Allemagne (première économie de l'UE), ils sont trois fois plus sensibles que pour la France et l'Italie.
Aujourd'hui, dans le contexte d'une nouvelle guerre de sanctions contre la Russie, nous voyons une image similaire. Début mars, le Kiel Institute for World Economics (Allemagne) et l'Institut autrichien de recherche économique (WIFO) ont préparé un rapport opportun sur les conséquences économiques des sanctions prévues par l'Occident. Selon ce document, les pertes pour les économies de tous les pays initiant des sanctions sont estimées à 0,17 % du PIB total. L'Allemagne et l'Autriche subiront des pertes de 0,4 et 0,3 pour cent du PIB annuel respectivement, tandis que les États-Unis ne subiront que des pertes de 0,04 pour cent. Parmi les alliés, la Lituanie (2,5 pour cent dans le scénario simulé), la Lettonie (2,0 pour cent) et l'Estonie (2,0 pour cent) subiront la plupart des pertes.
Les médias occidentaux affirment que les coûts de la guerre de sanctions contre la Russie sont inévitables, mais pour obtenir la victoire dans cette guerre, il faut résister, ce qui démontrerait l'unité de l'Occident. Cependant, il n'y a pas d'unité. On le voit clairement dans l'exemple des achats de gaz naturel à la Russie. On sait que les fournitures russes à l'UE en 2021 représentaient 45 % des importations de gaz naturel et 40 % de la consommation. Il s'agit d'une moyenne. Pour des pays comme la Bulgarie, la République tchèque, la Lettonie, l'Autriche, la Roumanie et la Slovénie, la dépendance vis-à-vis de la Russie pour les importations de gaz se situe entre 75 et 100 %. Dépendance supérieure à la moyenne de l'UE vis-à-vis de la Russie pour les importations de gaz naturel et de l'Allemagne à hauteur de 49 %. L'Italie en est à 46%.
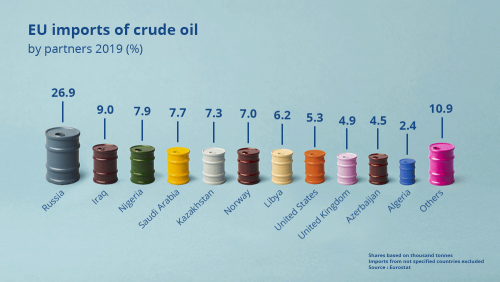
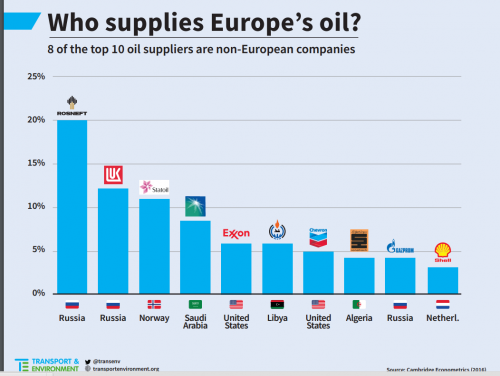
Le tableau est également mitigé en ce qui concerne la dépendance à l'égard des importations de pétrole en provenance de Russie. À la fin de 2020, la Russie représentait 24,9 % des importations d'or noir de l'UE. Les pays suivants ont la plus forte dépendance vis-à-vis des importations de pétrole russe (%) : Slovaquie - 78,4 ; Lituanie - 68,8 ; Pologne - 67,5 ; Finlande - 66,8 ; Hongrie - 44,6. Significativement plus élevé que la moyenne de l'UE, l'indicateur de dépendance dans ces autres pays (%) : Roumanie - 32. 8 ; Estonie - 32,0 ; Allemagne - 29,7 ; République tchèque - 29,1 ; Grèce - 26,3. Et la dépendance à l'égard des importations de pétrole russe est nettement inférieure à la moyenne de la deuxième plus grande économie de l'UE : la France (13,3 %), de la troisième économie : l'Italie (12,5 %), des Pays-Bas (21,0 %). Au Royaume-Uni, la Russie ne représentait que 12,2 % des importations de pétrole. Vous pouvez imaginer que les positions de la Hongrie ou de la Finlande sur les restrictions ou les interdictions d'importation d'or noir en provenance de Russie peuvent être très différentes des positions des Pays-Bas ou de la France. Et ils ne coïncident pas vraiment.
Il existe de grandes différences entre les 27 pays de l'UE en termes de dépendance aux importations d'engrais, de céréales, de métaux et d'autres biens. D'où les grandes différences politiques dans l'évaluation par les dirigeants de ces pays de l'opportunité des sanctions de l'UE contre la Russie.
Les États-Unis ne sont pas un participant, mais un initiateur et un organisateur de la guerre des sanctions. Le commerce extérieur entre les États-Unis et la Russie n'a jamais été excellent. L'année dernière, les États-Unis ne représentaient que 4,4 % du chiffre d'affaires du commerce extérieur de la Russie. L'Union européenne a représenté 35,9 %. Même si Washington mettait à zéro ses échanges avec Moscou, cette dernière ne ressentirait pas grand-chose. Mais réduire à zéro le commerce de l'UE avec la Russie pourrait porter un coup tangible et même écrasant. Ainsi, la guerre des sanctions contre la Russie ressemble à ceci : Washington planifie une guerre, introduit de nouvelles sanctions "infernales" contre Moscou, et l'exécution est confiée à Bruxelles, qui transmet les ordres de Washington aux 27 États membres de l'UE.
Toutefois, plus Washington fait pression sur Bruxelles, plus la structure de l'UE se fissure.
Trois camps ont été clairement identifiés en Europe. La première comprend la Hongrie, la Serbie (un pays non membre de l'UE) et plusieurs autres États. Ils indiquent clairement que pour eux, les intérêts nationaux sont au-dessus des intérêts de l'Occident collectif. L'autre camp est représenté par les États baltes et la Pologne. Ils se caractérisent par un fanatisme russophobe. Le troisième camp est représenté par l'Allemagne et la France. Ils essaient de manœuvrer et de se mettre progressivement d'accord sur quelques points avec Moscou. Berlin et Paris comprennent tous deux que si l'UE ne s'effondre pas à la suite de la guerre des sanctions, ce sont eux qui devront payer les dégâts de l'effet boomerang.
Cependant, certains experts prédisent qu'il n'y a aucune chance de sauver l'UE. L'opportunisme de Bruxelles, Berlin et Paris, succombant à la pression de Washington, pourrait aboutir à l'effondrement de l'UE.
Il existe également des lignes de fracture au sein des États membres. Ceci est particulièrement évident dans l'exemple de l'Allemagne. L'équipe du chancelier Olaf Scholz fait tout son possible pour mettre en œuvre les idées de sanctions de Washington. Et des millions d'Allemands protestent contre les sanctions. Les entreprises allemandes protestent également. Le 10 mars, l'Association allemande des petites et moyennes entreprises a exprimé ses craintes que l'apparition de la hausse des prix de l'énergie n'entraîne des faillites massives d'entreprises. Le directeur général de l'association, Markus Jerger, a déclaré : "L'association fédérale des petites et moyennes entreprises craint les faillites d'entreprises et les pertes d'emplois dues aux prix élevés de l'énergie. Les prix de l'énergie sont devenus un problème existentiel pour de nombreux entrepreneurs".
Le fardeau disproportionné de la guerre des sanctions, qui pèse sur l'Europe, est largement évoqué dans les médias. Cependant, la plupart des auteurs décrivent cela comme un coût inévitable dans toute guerre. "Dites, la guerre est la guerre, ce n'est pas le moment de se déguiser, Sue".
Mais certains experts soupçonnent que la Russie n'est pas la seule cible de la guerre de sanctions américaine. A en juger par les pertes que subit l'Europe, il s'avère qu'elle n'est pas considérée comme un allié par Washington, mais bien plutôt comme une cible. C'est l'avis de Yakov Kedmi, qui a déclaré le 30 mars : "Je suis intéressé de voir ce qui se passe en Europe en ce moment. Rappelez-vous comment s'appelait l'Union européenne à l'origine ? C'est ça, la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Où sont le charbon et l'acier maintenant ? Les Européens eux-mêmes oublient ce sur quoi cette union était fondée. Maintenant, l'Europe risque de manquer de charbon et d'acier. Qui applaudit à cela ? Les États-Unis. Il n'y a pas de moyen plus efficace pour affaiblir et mettre à genoux l'industrie européenne que des sanctions contre la Russie. Et les Européens ont obéi. Seule l'industrie américaine en profitera... Les Américains gagnent deux fois : ils vendront leurs ressources énergétiques à l'Europe à des prix exorbitants, rendant son industrie non rentable, et en parallèle, ils développeront leur propre industrie. C'est très simple".
Ce regard, certes nouveau, sur la guerre des sanctions peut être exprimé comme suit : Les États-Unis, après avoir déclenché une guerre, veulent faire d'une pierre deux coups. Non seulement la Russie, mais aussi l'Europe. De plus, Washington a de bien meilleures chances de tuer le deuxième lièvre.

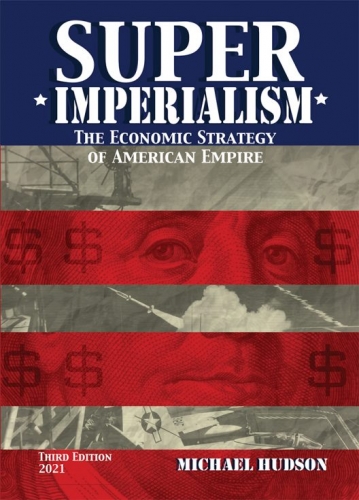
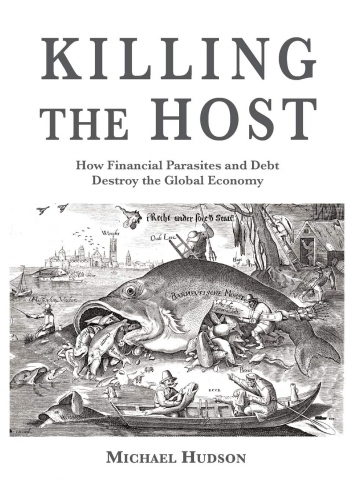
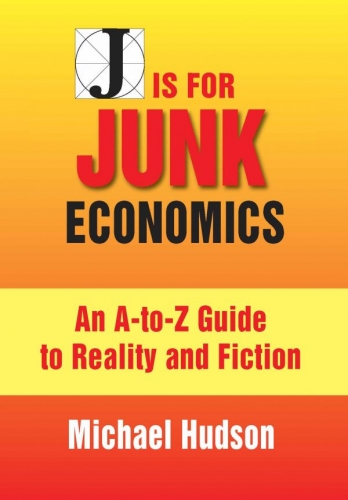
Et voici un regard sur ce qui se passe par le célèbre économiste américain Michael Hudson. À son avis, ceux qui ont planifié la guerre des sanctions à Washington ne sont pas du tout des imbéciles. Ils ont sérieusement compris que les sanctions ne feraient pas tomber Moscou. Mais l'Europe, elle, est facile à "soumettre". "Abaisser", se débarrasser d'un concurrent dans l'Ancien Monde et prendre sa place. Michael Hudson sur les opérations militaires en Ukraine: "C'est une guerre pour enfermer nos alliés afin qu'ils ne puissent pas commercer avec la Russie. Ils ne peuvent pas acheter de pétrole russe. Ils doivent compter sur le pétrole américain, pour lequel ils devront payer trois à quatre fois plus cher. Ils devront dépendre du gaz naturel liquéfié américain pour les engrais. S'ils n'achètent pas de gaz américain pour les engrais, et si nous ne leur permettons pas d'en acheter en Russie, ils ne pourront pas fertiliser la terre, et sans engrais, les rendements seront réduits de 50 %...".
Et le principal concurrent de l'Amérique, selon Hudson, est l'Allemagne. Si l'Allemagne est "déclassée", le reste de l'Europe s'effondrera tout seul. Hudson conclut: "La guerre américaine en Ukraine est en réalité une guerre contre l'Allemagne... L'Allemagne et l'Europe sont les ennemis. La guerre américaine en Ukraine est en réalité une guerre contre l'Allemagne, et les États-Unis l'ont fait savoir clairement".
15:37 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : michael hudson, états-unis, russie, ukraine, europe, affaires européennes, géopolitique, géoéconomie, politique internationale, actualité |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
La rivalité entre grandes puissances va s'intensifier
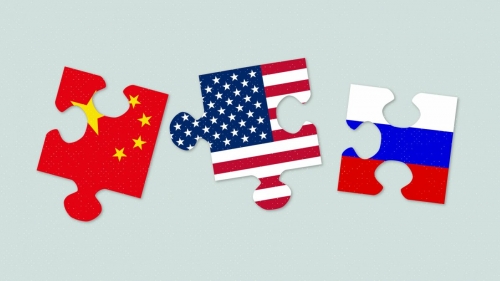
La rivalité entre grandes puissances va s'intensifier
Leonid Savin
Source: https://katehon.com/ru/article/sopernichestvo-velikih-derzhav-budet-usilivatsya
RAND prédit plus d'instabilité entre les États-Unis d'un côté et la Russie/Chine de l'autre.
À la fin du mois de mars 2022, la RAND Corporation américaine a publié une étude intitulée "Understanding Competition. Great Power Rivalry in a Changing International Order - Concepts and Theories" [i]. L'auteur en est Michael Mazarr, Senior Fellow de la RAND, connu pour ses publications sur la guerre hybride, la sécurité, la stratégie militaire et la théorie de la dissuasion [ii]. Il a déjà commenté et contribué régulièrement à des rapports sur la rivalité, mais le nouveau matériel s'accompagne d'un ajustement à l'opération militaire spéciale de la Russie. La remise en question de la manière dont les analystes américains abordent la conduite des affaires mondiales est donc intéressante.
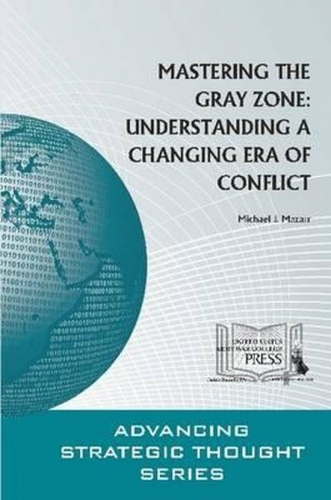
Les études de RAND sont généralement utilisées comme doctrines théoriques avec un ciblage pour les militaires et les politiciens. Il est donc possible de prédire des scénarios envisageables pour le comportement futur de Washington et de ses satellites.
RAND a déjà abordé le même sujet à plusieurs reprises. Un rapport publié en novembre 2021 par un groupe d'auteurs sur la stabilisation de la rivalité entre grandes puissances a noté que, sur la base de l'analyse des facteurs clés, la confrontation des États-Unis avec la Chine et la Russie ne fera qu'augmenter.
Parmi les recommandations adressées au gouvernement américain figurait celle de prendre au sérieux la nécessité d'élaborer des règles d'engagement formelles et informelles, et de rechercher des possibilités de transparence mutuelle, de notification et de contrôle des armes. Il a également été question de chercher à donner aux rivaux (c'est-à-dire la Russie et la Chine) un statut amélioré en échange de la création d'un espace commercial pour des accords qui serviraient les intérêts américains et renforceraient la stabilité [iii].
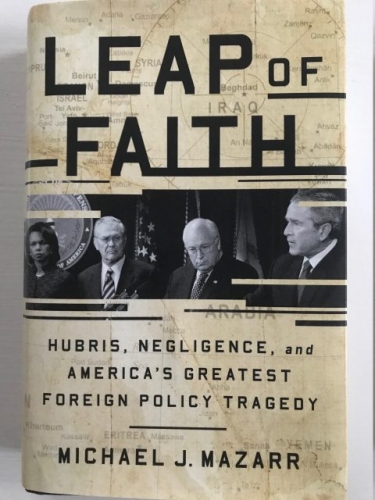
Mais à en juger par le refus de Washington d'examiner les propositions de la Russie de décembre 2021, soit ces recommandations ont été ignorées, soit les décideurs n'ont pas eu le temps de les lire.
Une étude antérieure sur un thème similaire datant de 2018 parlait davantage de la Chine.
Il a déclaré que "le point clé de la compétition sera la relation entre l'architecte de l'ordre fondé sur des règles (les États-Unis) et le principal concurrent révisionniste impliqué dans les différends les plus spécifiques (la Chine)...
La concurrence sera probablement plus intense et persistante dans les domaines non militaires d'intérêt national, et le fait de cibler ces moyens sur d'autres sociétés pose des risques d'escalade émergents et mal compris" [iv].
Aujourd'hui, Mazarr, compte tenu de la crise ukrainienne, note que "cela risque d'avoir un impact profond sur le système international et la rivalité parallèle entre les États-Unis et la Chine, de manière encore peu claire. Mais d'importantes dynamiques concurrentielles à long terme persisteront, exacerbant encore la nécessité pour les États-Unis de comprendre ce que signifie exactement une stratégie de sécurité nationale fondée sur la concurrence stratégique".
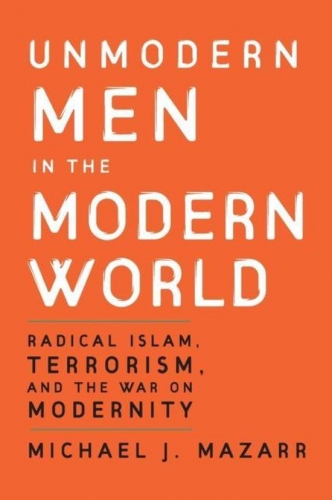
Citant des concepts reconnus par les spécialistes, Mazars identifie quatre niveaux ou types de concurrence. Il s'agit du degré constant de concurrence interétatique visant à maximiser le pouvoir ou l'influence ; de la concurrence plus aiguë entre les États cherchant à obtenir un leadership systémique ; de la concurrence entièrement militarisée entre les États agressifs désireux et même cherchant à utiliser la force ; et du concept de concurrence le plus discuté aujourd'hui - des campagnes d'action organisées pour obtenir un avantage sans passer par une grande guerre.
L'auteur fait l'observation importante que, dans sa forme, la concurrence est une condition ou une situation, et non une politique ou une stratégie. La réalité fondamentale du système international est que les pays se font concurrence de différentes manières avec des objectifs différents. La manière dont ils le font, c'est-à-dire les objectifs qu'ils choisissent, l'ensemble des outils qu'ils utilisent pour atteindre ces objectifs, est une question de stratégie. Et la nature du système international de toute époque définit le contexte de la concurrence.
Pour M. Mazarr, la réponse de la communauté mondiale (et en réalité des pays occidentaux - note de l'auteur) à l'opération en Ukraine démontre à quel point la plupart des pays partagent des normes et des valeurs fondamentales et, dans de nombreux cas, sont prêts à prendre des mesures décisives pour coordonner les actions de défense.
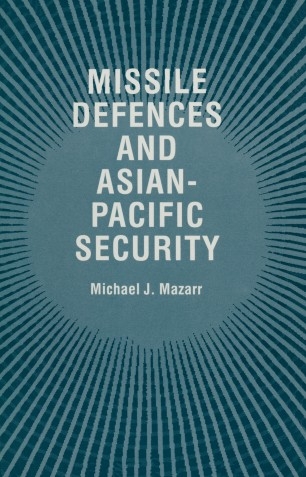
Les grandes stratégies les plus complètes ont toujours cherché à faire avancer les intérêts nationaux, en utilisant au mieux tout le spectre du comportement mondial - de la coopération au conflit en passant par la concurrence. Il poursuit en soulignant que "tant de pays aujourd'hui soulignent explicitement l'importance de l'ordre fondé sur des règles dans leurs stratégies de sécurité nationale. En particulier pour les petites et moyennes puissances, les institutions et les normes qui assurent une plus grande stabilité et prévisibilité dans la politique mondiale sont hautement souhaitables". Cependant, Mazarr passe sous silence le fait que de nombreux pays ont rejeté et continuent de rejeter l'hégémonie américaine. Par conséquent, la suppression de l'ordre dit "fondé sur les règles" sera accueillie favorablement et soutenue par eux.
Il poursuit en résumant son évaluation des autres aspects majeurs de la rivalité internationale. Il s'agit notamment des éléments suivants :
- L'existence de litiges "spatiaux" ou "positionnels", ou les deux. Certaines rivalités se caractérisent principalement par des rivalités de territoire ou de souveraineté (questions spatiales), mais parmi les véritables grandes puissances, les rivalités se concentrent souvent sur des conflits de position plus larges concernant le contrôle ou "des questions de statut, d'influence et de hiérarchie dans un ordre ou un système donné". Ces différends sont "exceptionnellement difficiles à résoudre" et ont tendance à ne se terminer que lorsque l'un des rivaux refuse de se battre pour la supériorité systémique.
- Le risque de "prolifération de différends insolubles". Au fil du temps, les rivalités peuvent générer de multiples litiges sur de nombreuses questions, déclenchant une spirale d'hostilité.
- Une tendance à déstabiliser la course aux armements. La rivalité stimule souvent le renforcement militaire mutuel, ce qui exacerbe la perception des menaces et augmente le risque de guerre.
- Le risque constant de conflits militarisés. La rivalité est souvent caractérisée à la fois par une histoire de conflits armés et par le risque constant de crises qui menacent de dégénérer en guerre.
Ainsi, selon l'auteur, l'opération de la Russie en Ukraine s'inscrit dans le schéma classique du comportement de rivalité des grandes puissances. "Ces rivalités se sont souvent accompagnées de différends militarisés, d'agressions locales et de guerres indirectes".
Mais l'Ukraine ne peut pas être une grande puissance en principe, d'où le différend entre la Russie et les États-Unis/l'OTAN/l'UE, où l'Ukraine n'est qu'un pion de l'Occident qui a délibérément été un irritant géopolitique pour la Russie, y compris une course aux armements, qui a élevé l'Ukraine à un niveau de menace critique aux yeux de Moscou. Il s'agit donc d'un conflit entre la Russie et l'Occident.
Mazarr passe ensuite à la théorie du transit du pouvoir et examine les relations sino-américaines dans un système mondial où le rôle et la fonction des États-Unis déclinent et où ceux de la Chine, au contraire, augmentent. Un concept étroitement lié est celui des puissances révisionnistes, auxquelles l'auteur inclut l'Irak de l'ère Saddam Hussein, la Chine et la Russie. Mais sur l'échelle détaillée du révisionnisme se trouvent également l'Inde, le Brésil et les Etats-Unis eux-mêmes, qui se positionnent comme une puissance exceptionnelle.
La question est alors de savoir comment se déroule cette rivalité. Pour déterminer sa nature, cinq facteurs clés sont suggérés.
1. La nature de la rivalité elle-même. Certaines rivalités historiques ont été liées à des facteurs territoriaux (ou spatiaux) tels que la domination d'une masse continentale, comme la rivalité franco-britannique ou franco-allemande pour l'hégémonie en Europe. D'autres étaient principalement liées à des influences idéologiques : la rivalité américano-soviétique pendant la guerre froide était une lutte pour établir un système d'idées dominant dans la politique mondiale. Certaines rivalités portaient davantage sur la réputation et le prestige, de manière moins systémique.
2. Les objectifs des participants. Ont-ils des intentions agressives de dominer la politique mondiale ou cherchent-ils au moins une hégémonie régionale ? Leurs objectifs sont-ils principalement défensifs ? Recherchent-ils le pouvoir économique plutôt que le pouvoir militaire ? Un aspect clé de cette question est l'utilisation et la justification de la force militaire.
3. à partir de ces deux-là, une troisième question émerge : comment définir le succès dans une compétition donnée ? Évidemment, le succès dans la compétition en général n'exige pas de réussir dans chaque bataille, guerre ou compétition de niveau inférieur.
4. La quatrième question déterminante cherche à décrire le degré d'intensité de la rivalité. Cet aspect permettrait d'évaluer le degré d'extrémité et/ou de futilité de la rivalité, mesuré par des indicateurs tels que l'historique des conflits violents, le niveau de mécontentement mutuel exprimé publiquement, le degré de nationalisme hostile d'un ou des deux côtés, l'effet aggravant des groupes d'intérêts nationaux enclins à la guerre, le nombre d'intérêts et de griefs incompatibles, et d'autres variables.
On peut dire que la rivalité bilatérale est très intense lorsque les deux parties pensent qu'elles ne peuvent pas réaliser leurs intérêts vitaux ou leurs objectifs importants sans nuire à l'autre partie, et lorsque les deux parties sont prêtes à entreprendre des actions complexes et potentiellement violentes pour y parvenir.
5. La cinquième et dernière caractéristique demande dans quelle mesure la concurrence ou la rivalité est stable selon les facteurs objectifs qui déterminent la stabilité. Une concurrence stable est une concurrence dans laquelle les rivaux se font rarement, voire jamais, la guerre ou sont au bord de la guerre, même s'ils peuvent se percevoir comme étant en concurrence féroce et chercher à saper le pouvoir de l'autre de façon continue.
Ce facteur recoupe dans une certaine mesure le problème de l'intensité, mais ce n'est pas la même chose : les rivalités peuvent être intenses mais rester stables, avec une tendance à se remettre des crises et à ne pas dépasser le seuil de la guerre.
Le rapport conclut que même avant le récent conflit en Ukraine, la rivalité entre les États-Unis et la Russie et les États-Unis et la Chine était devenue très volatile. Maintenant, avec les deux batteries de sanctions et les effets qui en découlent sur l'économie mondiale, il y a encore moins de stabilité.
Enfin, quels pourraient être les objectifs et les moyens des États-Unis dans cette rivalité? Mazarr se limite à quatre points :
1. assurer la sécurité à l'intérieur des États-Unis, y compris les institutions politiques et l'environnement informationnel ;
2. en préservant des avantages et des forces technologiques et économiques suffisants pour garantir qu'un ou plusieurs concurrents majeurs ne dominent pas l'économie de l'information du 21ème siècle ;
3. le maintien d'un système mondial et d'ordres régionaux représentant le libre choix souverain et l'absence d'influence hégémonique et coercitive des rivaux des États-Unis ;
4. atteindre un équilibre durable de la concurrence et de la coopération avec les concurrents américains, y compris les éléments de base d'un statu quo cohérent et commun et les sources importantes d'équilibre dans la relation.
Il n'y a rien de nouveau ici. Ces dispositions ont été énoncées dans les stratégies américaines de sécurité nationale et de défense sous les administrations Trump et Biden. En d'autres termes, Washington veut maintenir son ordre mondial unipolaire hégémonique et empêcher les autres États de le contester. Et les mots sur le choix souverain sont des arguments hypocrites, tout comme les droits, les libertés, la démocratie et l'autre série de phrases de devoir que nous entendons constamment de la part des responsables du département d'État et de la Maison Blanche.
Mazarr tente également de définir ce que veulent la Chine et la Russie dans la compétition actuelle :
"La Chine aborde la concurrence ou la rivalité actuelle du point de vue d'un pays qui se considère soit comme la puissance dominante légitime du monde, soit comme l'une des quelques puissances dominantes".
La Chine est déterminée à retrouver un rôle et une voix dans le système international à la mesure de son degré de puissance et, selon de nombreux fonctionnaires et universitaires chinois, de la supériorité inhérente de la société et de la culture chinoises. Ce faisant, la Chine se prépare à une rivalité permanente avec les États-Unis pour la suprématie régionale et mondiale, une rivalité qui s'inscrit dans la structure actuelle de la politique mondiale.
Néanmoins, les ambitions de la Chine dans cette rivalité ont des limites et, du moins pour le moment, la Chine ne s'approche pas du niveau de révisionnisme militariste que certaines grandes puissances du 20ème siècle...
Les approches de la Russie en matière de rivalité avec les États-Unis ont beaucoup de points communs avec la Chine, mais il y a aussi quelques différences. Il est clair que la Russie a des ambitions mondiales plus modestes à la hauteur de sa puissance potentielle. Mais sa volonté de prendre des risques et sa franchise à défier les normes existantes semblent maintenant avoir augmenté de manière significative. Cela peut être en partie le résultat de l'insatisfaction de la Russie vis-à-vis du contexte mondial actuel et de sa frustration quant à la trajectoire de sa puissance depuis la guerre froide...
L'utilisation frappante de la force par la Russie en Ukraine ouvre également la possibilité que sa vision fondamentale de la rivalité et peut-être ses ambitions aient changé de manière plus radicale - par exemple, qu'elle devienne un révisionniste militariste plus classique. C'est certainement possible, bien qu'il soit trop tôt pour le dire. L'incursion de la Russie en Ukraine reflète un acte de violence extrêmement risqué visant à promouvoir un intérêt déjà bien établi dans la compétition : le contrôle du contexte sécuritaire de son étranger proche. Il est possible que les principes de base de l'approche de la rivalité par la Russie restent inchangés.
Même si c'est le cas, la guerre comporte de dangereux risques d'escalade qui pourraient placer les États-Unis et l'OTAN sur la voie de la confrontation militaire avec la Russie d'une manière qui diffère de la nature actuelle de la rivalité et créer de nouveaux dangers pour une guerre majeure. Ces risques, une fois encore, reflètent précisément les dangers qui tendent à surgir dans les rivalités stratégiques impliquant des différends militarisés".
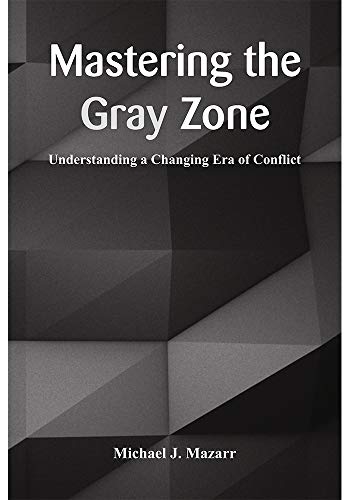
En conséquence, M. Mazarr s'interroge sur ce que les dirigeants américains doivent faire pour se préparer autant que possible à une escalade de la rivalité. Il écrit que "les États-Unis n'ont actuellement pas la capacité institutionnelle d'organiser et de mettre en œuvre une approche de la rivalité semblable à celle d'une campagne, depuis la zone grise ou la phase de rivalité jusqu'à la planification de crise et de guerre.
L'absence de mécanismes substantiels de planification intégrée inter-agences risque désormais d'avoir un effet dévastateur sur les efforts américains pour réussir les missions compétitives hors guerre. Les États-Unis disposent de divers plans d'engagement spécifiques à chaque pays, allant des stratégies d'équipes d'ambassade spécifiques à chaque pays aux plans de coopération en matière de sécurité. Mais ceux-ci ne sont souvent pas intégrés ou coordonnés de manière centralisée.
D'autres problèmes résident dans la façon dont les services prévoient d'utiliser leurs capacités : permettre plus de flexibilité et appliquer des objectifs de mission spécifiques, même pour un petit nombre d'unités, aiderait à ouvrir l'espace pour des rôles militaires plus efficaces et plus adaptables."
Mazarr parle de la faiblesse institutionnelle politico-militaire des États-Unis. Peut-être délibérément pour que le Pentagone et les autres services obtiennent plus de financement et de soutien. Il prend également le temps d'évaluer le rôle et le statut de la Russie dans le conflit en Ukraine, probablement pour abaisser l'évaluation de la menace militaire pour les États-Unis. Mais si l'on considère les quatre points, qui constituent des défis pour les États-Unis, on peut conclure que la résistance continue de la Russie à l'Occident collectif sapera les objectifs américains d'une manière ou d'une autre.
La Chine, sans aller jusqu'au même niveau d'escalade, fait déjà la même chose, bien que de manière différente. Ce sera un avantage supplémentaire pour les deux pays s'ils amènent davantage d'États dans leur alliance informelle pour lutter contre l'hégémonie américaine.
Notes:
[i] https://www.rand.org/pubs/perspectives/PEA1404-1.html
[ii] https://www.rand.org/about/people/m/mazarr_michael_j.html#publications
[iii] https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA456-1.html
[iv] https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2726.html
12:26 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rand corporation, etats-unis, stratégie, géostratégie, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 06 avril 2022
Le plan américain de guerre en Ukraine implique aussi l'Europe

Le plan américain de guerre en Ukraine implique aussi l'Europe
par Luciano Lago
Source: https://www.ideeazione.com/il-piano-americano-per-la-guerra-in-ucraina-coinvolge-anche-leuropa/
Les signaux provenant de la table des négociations, après plusieurs cycles de pourparlers entre l'Ukraine et la Russie, pourraient permettre de progresser et de surmonter la phase d'impasse, avec l'acceptation préalable par l'Ukraine de certaines conditions, mais les États-Unis y ont mis leur veto et leur marionnette Zelensky s'est pliée à leurs directives.
Il n'en reste pas moins que la guerre aurait pu être évitée si les États-Unis et l'OTAN avaient adopté une attitude différente face aux demandes de la Russie concernant sa propre sécurité et la nécessité pour l'OTAN de ne pas s'étendre sous ses frontières. Au lieu de cela, quelqu'un a voulu et instigué la guerre, et ce quelqu'un se trouve à Washington et à Londres.
Toutefois, nous attendons de voir si l'administration Biden opposera définitivement son veto aux pourparlers en cours, étant donné qu'elle soutient le régime de Kiev en lui envoyant massivement de nouvelles armes et des prêts financiers.
Il semble clair désormais que les Etats-Unis ne veulent pas la paix en Ukraine mais la poursuite de la guerre, quel qu'en soit le coût, étant donné que le prix sera payé par d'autres, en premier lieu les Ukrainiens, utilisés comme chair à canon pour les intérêts américains, et en second lieu les Européens qui paieront les plus lourdes conséquences de la crise économique et de l'afflux de réfugiés.
La guerre permet aux États-Unis de maintenir leur hégémonie et est donc un fait utile qui produit des affaires pour l'industrie de l'armement et contribue à engager et à affaiblir la Russie. C'est le point de vue du parti de la guerre qui soutient Biden à Washington et prévaut au Congrès.
Dernier développement en date, le même parti de guerre de Washington a enrôlé les caméras d'Hollywood pour diffuser des images de prétendus massacres commis par les troupes russes en Ukraine et gagner la guerre de propagande médiatique. Il s'agit d'une technique habituelle des services de renseignement anglo-américains, déjà adoptée en Syrie avec l'aide des "casques blancs" mais qui, dans ce contexte, n'a pas donné les résultats escomptés. Il n'est pas certain que cette fois-ci elle puisse produire des résultats, mais face à la clameur des fausses nouvelles, elle pourrait se retourner contre ceux qui l'emploient cyniquement.
Les gouvernements européens suivent la ligne américaine même si elle est en conflit évident avec leurs propres intérêts et sans être conscients que cette ligne les mènera vers le chaos, la récession, les troubles sociaux et, en un mot, vers l'abîme. Le poids de cette politique sera supporté par les sections les plus faibles et les plus défavorisées de la population.
L'arrogance américaine et la servilité européenne semblent n'avoir aucune limite.
Ce qui importe aux États-Unis, c'est la poursuite de l'hégémonie, même si elle sape les fondations de leur propre puissance. Les gouvernements européens suivent sans réserve les directives américaines, même au prix d'une dévastation économique dans leur propre pays.
Tout cela ne peut empêcher l'émergence d'un nouvel ordre multipolaire mondial dans lequel les puissances occidentales seront reléguées à un rôle secondaire et non plus dominant sur la scène internationale.
Liés à leur objectif hégémonique, les États-Unis et le Royaume-Uni poursuivent également l'objectif de détruire l'Union européenne dans sa composante économique. Ceci afin de priver l'Europe de son importante industrie, devenue non compétitive en raison des coûts de l'énergie, de réduire l'agriculture et de rendre l'Europe de plus en plus dépendante et intégrée aux États-Unis, une solution qui présente de nombreux avantages pour l'élite du pouvoir américain. En substance, faire de l'Europe sa propre colonie, un marché pour ses propres industries et toujours subordonnée aux directives du patron américain.
De sorte que l'on puisse percevoir que l'UE restera la principale victime de cette guerre, la guerre que les États-Unis ont constamment et méthodiquement déclenchée contre la Russie pendant de très nombreuses années. La stratégie anti-russe et anti-européenne de Washington n'a pas commencé en 2014, ni même en 2008, mais remonte à bien plus tôt.
Le pire cauchemar des États-Unis a toujours été ce projet eurasien lui-même : un immense espace économique ouvert de Lisbonne à Vladivostok. Une économie totalement autosuffisante avec des perspectives de développement incroyables. Une perspective qui, par le passé, avait eu ses partisans parmi certains politiciens européens qui comprenaient le projet. Il est vrai que, même à l'époque, l'Europe était sous le contrôle des États-Unis, mais il était encore possible à l'époque d'avoir une certaine marge de manœuvre pour construire sa propre politique souveraine. Cependant, ce qui s'est passé depuis a produit un changement pour le pire dans les élites européennes, qui sont de plus en plus subordonnées au pouvoir d'outre-Atlantique.
Les nouvelles élites européennes ne sont que des gouverneurs généraux coloniaux qui, en général, ne se soucient pas de leurs pays et de leurs peuples. Ces gens sont prêts à ruiner même l'économie de leur propre pays, juste pour plaire au maître suprême. L'inclusion des pays baltes et de la Pologne dans l'Union européenne s'est avérée très utile, car ils sont littéralement devenus les chefs d'orchestre de la ferme volonté de leur maître d'outre-mer. L'Europe, qui n'était pas complètement libre dans les années d'après-guerre, a été réduite à la subordination et à la vassalité à la puissance américaine.
De plus, il semble que ce processus soit déjà irréversible. L'Europe ne pourra plus échapper à ce piège et, si elle tente de le faire, elle se prépare à un nouvel afflux de réfugiés, ou à une autre surprise. En ce moment, les troupes américaines se déversent en Europe comme un fleuve. Bientôt, il sera tout à fait possible de parler d'occupation directe.
Et s'il y a des politiciens qui ont le courage de résister à ce processus, on peut être sûr qu'il y aura des tentatives pour les éliminer et les destituer comme agents du Kremlin.
18:25 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : états-unis, europe, affaires européennes, ukraine, otan, politique internationale, géopolitique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 05 avril 2022
Le Moyen-Orient et la guerre des sanctions
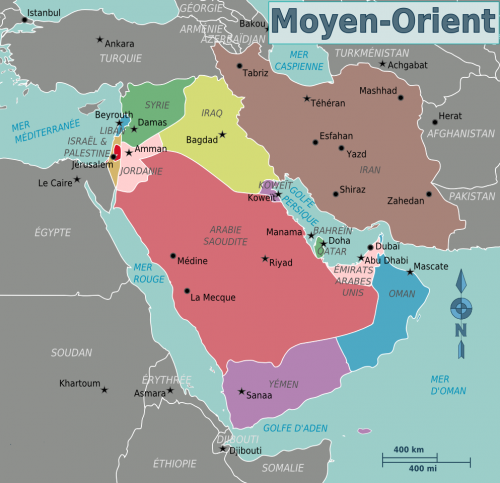
Le Moyen-Orient et la guerre des sanctions
par Salam Rafi Sheik
Source: https://www.ideeazione.com/il-medioriente-e-la-guerra-delle-sanzioni/
Alors que les États-Unis ont jusqu'à présent réussi à ressouder l'"unité" transatlantique qui s'effrite en poussant de manière agressive, provocante et irresponsable l'expansion de l'OTAN en Europe de l'Est, soi-disant contre la Russie, le Moyen-Orient - autrefois une aire géographique complètement dominée par les États-Unis - a refusé de se ranger du côté des États-Unis.
En raison des mauvaises relations de Washington avec les principaux acteurs du Moyen-Orient, les États-Unis n'ont plus assez de poids pour les persuader de faire pression sur la Russie. Comme l'ont indiqué sans équivoque les médias occidentaux, Riyad a clairement rejeté l'insistance de l'administration Biden à augmenter la production de pétrole en rompant l'accord OPEP+Russie sur la production de pétrole.
Lorsque Joe Biden a appelé le roi Salman au cours de la troisième semaine de février pour discuter d'une série de questions relatives au Moyen-Orient, notamment pour "assurer la stabilité des approvisionnements énergétiques mondiaux", il a soulevé la question de la rupture de l'accord OPEP Plus. Peu après l'appel, une déclaration du roi Salman a refusé de se plier à Biden et a souligné "le rôle de l'accord historique OPEP+", affirmant qu'il était important de respecter ses engagements. Il ne s'agit pas seulement du roi ; le prince héritier Mohammad bin Salman (MBS) est également derrière, grâce à la décision de l'administration Biden de l'impliquer dans le meurtre de Jamal Khashoggi, en espérant que cette controverse aidera finalement à renverser MBS.
Comme le rapporte l'agence de presse Saudia, lors de son appel téléphonique au président Poutine, "SAR porteur de la Couronne a réitéré le désir du Royaume de maintenir l'équilibre et la stabilité des marchés pétroliers, soulignant le rôle de l'accord OPEP+ à cet égard et l'importance de le maintenir."
La décision saoudienne est particulièrement alarmante pour l'administration Biden car, comme le pensent certains à Washington, le rejet par Riyad des appels américains à augmenter la production de pétrole fera grimper les prix du pétrole, ce que le public américain reprochera directement au parti démocrate qui détient actuellement la Maison Blanche et la majorité au Congrès. Mais les États du Moyen-Orient s'en tiennent à leur politique, quel qu'en soit le coût pour les États-Unis.
Par conséquent, le président Poutine a également eu un entretien téléphonique avec le prince héritier d'Abu Dhabi, le cheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan. Les dirigeants auraient discuté de l'accord OPEP+ et se seraient engagés à poursuivre la coordination sur les marchés énergétiques mondiaux, selon les agences de presse russe et émiratie.
En conséquence, la réunion de l'OPEP+ du 2 mars a réaffirmé la position susmentionnée, concluant non seulement à maintenir les niveaux actuels de production de pétrole, mais déclarant également que la volatilité actuelle du marché n'était pas due à des changements dans la dynamique du marché mais à l'évolution géopolitique, c'est-à-dire à la politique américaine de sanctionner la Russie pour avoir porté atteinte à son économie.

Cela se traduit, en termes simples, par un refus de se ranger du côté des États-Unis pour nuire à l'économie russe. Si les pays de l'OPEP avaient décidé d'augmenter leur production de pétrole, cela aurait réduit la hausse actuelle des prix du pétrole et nui à l'économie russe, qui compte davantage sur des prix du pétrole plus élevés pour maintenir sa santé économique face aux sanctions occidentales pendant la crise. Le fait que l'OPEP ait refusé d'aider les efforts occidentaux visant à endommager l'économie russe signifie que la maison énergétique mondiale est contre les États-Unis.
Lors du Forum international de l'énergie qui s'est tenu récemment en Arabie Saoudite, selon un rapport du Wall Street Journal, le ministre saoudien de l'énergie, le prince Abdulaziz bin Salman, a rejeté les appels à pomper davantage de pétrole. Selon le rapport, d'autres délégués de l'OPEP ont déclaré que "le royaume n'est pas sur la même longueur d'onde que les États-Unis en ce moment" et que "nous savons tous qu'ils ne sont pas prêts à travailler avec les États-Unis pour calmer le marché".
Rien n'aurait pu être plus embarrassant pour les Etats-Unis de voir leurs anciens alliés snober la pression de Washington.
Si l'on peut avancer que la raison du refus des principaux producteurs de l'OPEP de soutenir les États-Unis peut être le résultat de leurs mauvaises relations, le fait qu'Israël ait également refusé de soutenir les États-Unis montre non seulement que le soutien à la politique américaine d'encerclement de la Russie n'existe pas en dehors de l'alliance transatlantique, mais que ce soutien est en train de se réduire à l'échelle mondiale.
Comme l'ont montré les médias israéliens, Tel Aviv a effectivement torpillé les projets américains de vente de Dôme de Fer à l'Ukraine pour renforcer son système de défense contre la Russie. Comme le montrent les rapports, Israël a catégoriquement rejeté le plan américain en raison de sa politique visant à ne pas déstabiliser ses liens avec la Russie pour le moment.
Israël a décidé de rester dans le camp opposé aux États-Unis lorsqu'il a refusé de coparrainer la résolution du Conseil de sécurité américain sur l'Ukraine contre la Russie. Cette politique est très cohérente avec la manière dont le Premier ministre israélien Naftali Bennett a évité de condamner la Russie à l'instar des États-Unis ou même de mentionner le pays par son nom, même depuis le début de la crise.
À l'instar d'Israël, d'autres États du Moyen-Orient n'ont pas non plus critiqué la Russie. Les Émirats arabes unis, qui ont présidé le CSNU en tant que membre non permanent en mars, se sont abstenus de voter contre la Russie. Bien que la décision des Émirats arabes unis puisse donner l'impression qu'Abu Dhabi se trouve en équilibre entre deux géants, sa décision, lorsqu'elle est analysée dans le contexte de ses liens tendus avec les États-Unis depuis qu'il s'est retiré des pourparlers avec Washington sur la vente d'avions à réaction F-35, devient un message particulièrement poignant pour les États-Unis, à savoir que Washington ne doit pas s'attendre à être soutenu s'il ne tient pas sa part du marché.
Le manque de soutien de la part du Moyen-Orient est le résultat direct de la prise de distance des États-Unis vis-à-vis de la région et de l'attention croissante qu'ils portent à l'Asie du Sud-Est pour faire face à la montée en puissance de la Chine dans la région indo-pacifique. De plus en plus d'États du Moyen-Orient affirment leurs choix autonomes en matière de politique étrangère, ce qui signifie que Washington a peut-être surestimé le soutien qu'il pensait pouvoir obtenir pour sa politique d'expansion de l'OTAN.
20:08 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : péreole, hydrocarbures, moyen-orient, arabie saoudite, politique internationale, états-unis, sanctions, russie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 31 mars 2022
De la "Doctrine" de Monroe aux "Quatorze points" de Wilson

De la "Doctrine" de Monroe aux "Quatorze points" de Wilson
par Michele Rallo
Les origines de l'interventionnisme américain dans les affaires européennes
Source : https://www.ereticamente.net/2022/03/dalla-dottrina-di-monroe-ai-quattordici-punti-di-wilson-michele-rallo.html
C'est en 1823 que James Monroe, le 5e président des États-Unis d'Amérique, a énoncé la "doctrine" qui allait prendre son nom (en réalité dû à son ministre des affaires étrangères John Adams). Selon cette doctrine, les États-Unis revendiquent une suprématie totale sur les Amériques du Nord et du Sud, ordonnant aux puissances européennes de ne pas intervenir dans cet "hémisphère", à l'exception des territoires coloniaux qui leur appartiennent encore. En réalité, seule la présence des cousins britanniques serait tolérée (du Canada aux Malouines), tandis que les autres puissances coloniales (France, Espagne, Portugal) seraient directement ou indirectement évincées de leurs possessions.
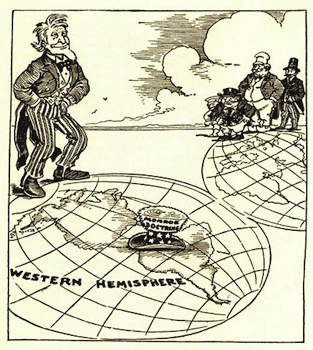 Quoi qu'il en soit, tout le monde s'accordait à l'époque à dire que la doctrine de Monroe était essentiellement une proposition de partage du monde : l'Amérique aux Américains et - corollaire logique - l'Europe aux Européens. Liberté d'action dans le reste du monde, avec toutefois quelques voies préférentielles : l'Asie orientale et le Pacifique pour les États-Unis, l'Asie occidentale et l'Afrique pour les puissances européennes.
Quoi qu'il en soit, tout le monde s'accordait à l'époque à dire que la doctrine de Monroe était essentiellement une proposition de partage du monde : l'Amérique aux Américains et - corollaire logique - l'Europe aux Européens. Liberté d'action dans le reste du monde, avec toutefois quelques voies préférentielles : l'Asie orientale et le Pacifique pour les États-Unis, l'Asie occidentale et l'Afrique pour les puissances européennes.
Cela a duré quelques décennies : le temps nécessaire aux Américains pour se débarrasser de certaines présences gênantes, notamment aux frontières. Le dernier épisode fut la guerre hispano-américaine de 1898, à l'issue de laquelle les États-Unis ont acquis Cuba (officiellement "indépendante"), Porto Rico et - en Asie - les Philippines et l'île de Guam.
L'Espagne étant ainsi expulsée du continent américain, on a eu l'impression pendant un moment que les États-Unis et les puissances européennes étaient retranchés dans leurs sphères d'influence respectives. Mais ce n'était qu'une impression - justement - parce que depuis quelques années (après l'assassinat de Lincoln en 1865), les cercles de la City de Londres avaient déjà commencé à tisser la toile d'une entente transocéanique qui unirait les États-Unis et le Royaume-Uni avec ses dominions : cimentant ainsi, derrière le paravent d'une alliance ethnique, les intérêts financiers et mercantiles du bloc anglo-saxon. Quelques années plus tard, le Sud-Africain (blanc) Jan Smuts qualifiera ce bloc de "fédération britannique des nations" et vantera sa fonction anti-européenne : "N'oubliez pas qu'après tout, l'Europe n'est pas si grande et ne continuera pas à le paraître à l'avenir. (...) Ce n'est pas seulement l'Europe que nous devons considérer, mais aussi l'avenir de cette grande confédération d'États à laquelle nous appartenons tous" [1].
Le projet de bloc anglo-saxon a franchi une étape décisive lors de l'élection présidentielle de novembre 1912, lorsque le parti républicain - dominant depuis l'époque de Lincoln - s'est divisé et a présenté deux candidats opposés de taille (le président sortant William Taft et l'ancien président Theodore Roosevelt), permettant à l'outsider démocrate Thomas Woodrow Wilson d'être élu.
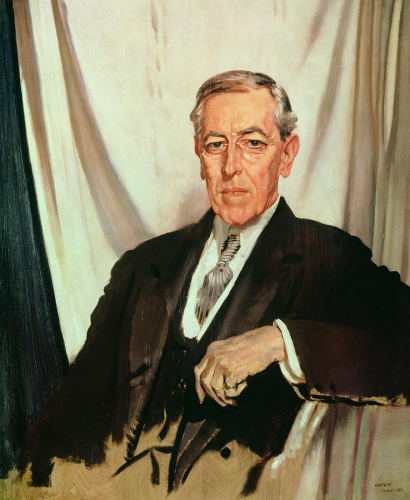
Wilson prend ses fonctions en mars 1913 et se lance immédiatement dans un vaste programme de "réformes" apparemment positives. En réalité, l'objectif de toute son activité frénétique de réforme était de privatiser le système bancaire, alignant ainsi les États-Unis sur le modèle financier qui dominait la politique britannique. En décembre 1913, la Réserve fédérale a été créée, une banque "centrale" qui était aux États-Unis d'Amérique ce que la Banque d'Angleterre des Rothschild était à la Grande-Bretagne depuis 1694 : toutes deux étaient privées et avaient le droit exclusif de frapper la monnaie nationale et de la prêter à leurs gouvernements respectifs.
Avec l'élection de Wilson, le monde des affaires et de la finance quittait donc le parti républicain pour se lier - étroitement - au parti démocrate. Et ce monde trépignait, il avait envie de franchir les frontières, de se lier à d'autres hommes d'affaires et à d'autres financiers, de s'étendre bien au-delà des frontières tracées par la Doctrine Monroe. Il s'agissait d'une nouvelle forme de colonialisme, un colonialisme économique ; qui, toutefois, ne rivalisait pas avec les partenaires britanniques pour les domaines traditionnels afro-asiatiques, mais visait plutôt le "marché" le plus riche, celui de l'Europe. Avec une connotation particulière : alors que le colonialisme européen visait des pays arriérés, presque toujours dépourvus d'une structure étatique complète, le néocolonialisme américain prétendait s'imposer à des pays hautement civilisés et développés, ceux dont étaient issus les colons qui ont construit les États-Unis d'Amérique. Ce sont les fils enrichis qui se sont retournés contre leurs pères.
Naturellement, les nations européennes n'étant pas prêtes à se laisser coloniser le sourire aux lèvres, les Américains ont dû attendre la bonne occasion pour intervenir sur le Vieux Continent, pour faire peser le poids de la puissance américaine sur la balance : puissance industrielle et militaire, mais surtout puissance économique. Et l'occasion ne tarde pas à se présenter : le 28 juin 1914, l'attentat de Sarajevo a lieu, et un mois plus tard, le premier coup de canon est tiré dans ce qui deviendra la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale.

Bien que la majorité de la population américaine (anglo-saxonne) ait naturellement sympathisé avec leurs cousins britanniques, ils n'ont pas dévié de leur attitude traditionnelle à l'égard des affaires européennes : un isolationnisme "historique" profondément ancré, qui, en temps de guerre, se traduisait par une neutralité absolue, à la limite de l'indifférence.
Au contraire, les milieux financiers, industriels et mercantiles sont pieds et poings liés à leurs correspondants britanniques, qu'ils approvisionnent par des envois massifs et continus par voie maritime. Leur intérêt spécifique était non seulement la victoire à Londres, mais aussi - en perspective - la pénétration des marchés européens, que seule cette victoire pouvait favoriser.
Le président Wilson, officiellement du moins, semblait fermement ancré dans des positions non-interventionnistes. En fait, il était plus que favorable à l'intervention américaine dans la guerre en Europe. Cependant, il avait les mains liées par les nouvelles élections présidentielles, qui approchaient à grands pas. Étant donné la neutralité viscérale de l'électorat américain, il ne pouvait être réélu que s'il donnait l'impression, ou plutôt la certitude, qu'il maintiendrait les États-Unis en dehors de la guerre en Europe.
Même après sa réélection (novembre 1916), Wilson ne pouvait pas changer sa ligne diplomatique d'un iota : les Américains étaient toujours très opposés à la possibilité même la plus lointaine d'une intervention, et le président ne pouvait certainement pas aller dans la direction opposée.
Ce sont toutefois les Allemands qui ont offert sur un plateau d'argent l'excuse qui permettrait à Woodrow Wilson de décider d'intervenir. Au fur et à mesure que les approvisionnements de l'industrie américaine vers l'Angleterre augmentaient, le nombre de torpillages de navires marchands américains augmentait, avec les pertes humaines que cela impliquait. Les Allemands auraient pu obtenir le même résultat en arrêtant les navires américains et, peut-être, en les saisissant. Au lieu de cela, ils ont préféré torpiller et couler les navires. Ils ne se rendaient pas compte (et ne se rendraient pas compte non plus pendant la Seconde Guerre mondiale) qu'un comportement brutal provoque la désapprobation et l'hostilité générales, même si ce comportement est le résultat d'une "provocation" de l'ennemi.

Le casus belli s'est produit le 19 mars 1917, avec le naufrage du cargo "Vigilantia" avec tout son équipage. L'indignation de l'opinion publique américaine est telle que Woodrow Wilson peut demander au Congrès de voter l'entrée en guerre des États-Unis. Cela s'est produit le 6 avril.
La voie du "libre-échange" était enfin ouverte. Il fallait cependant rassurer les Européens (amis, ennemis et neutres), les convaincre que l'envoi des armées américaines sur le Vieux Continent ne cachait aucune intention colonialiste, mais n'était que le fruit de la générosité, d'une propension à la charité à l'échelle planétaire. Voici donc le recours à un alibi idéologique : ce n'est pas par soif de pouvoir que les États-Unis ont envoyé leurs soldats outre-Atlantique, mais pour défendre la démocratie ; non pas pour en retirer des avantages économiques, mais pour libérer le peuple. [Un refrain répété de manière obsessionnelle dans toutes les guerres américaines, de la Seconde Guerre mondiale à la destruction de la Libye].
Wilson s'est dessiné le profil moraliste d'un grand leader qui a conduit sa nation à la guerre non pas pour des raisons futiles, mais pour défendre les idéaux les plus élevés de liberté, de démocratie, de justice, de progrès, de prospérité, de paix entre les nations et d'autodétermination des peuples. D'où la nécessité d'idéologiser le choix de la guerre, en la présentant comme une intervention visant à réparer les torts imposés aux nations par les "méchants" du moment, presque comme la transposition d'un film "occidental" sur la scène mondiale tout entière.
Le président a très bien su camoufler un choix clairement utilitaire sous de nobles idéaux. Il a inventé un certain nombre de slogans frappants - "la guerre pour mettre fin aux guerres" ou "rendre le monde sûr pour la démocratie" - et est allé jusqu'à esquisser un scénario d'après-guerre idyllique : "pas d'annexions, pas de contributions, pas d'indemnités de guerre" [2]. Rien de tout cela ne se produira. Au contraire, les annexions, contributions et indemnités de guerre - appliquées de manière disproportionnée au profit de Londres, de Paris et de leurs clients - contribueraient de manière décisive à rendre le monde peu sûr pour la démocratie et à préparer le terrain pour de nouvelles guerres. Et ce, avec la circonstance aggravante d'une attitude qui variera fortement d'un sujet à l'autre : forcer - par exemple - l'Italie à renoncer à Fiume/Rijeka, et en même temps permettre à la France de mutiler impitoyablement l'Allemagne, ou à l'Angleterre de tenter de rayer la Turquie de la carte. Tout cela a été couronné par un fort coup de pinceau de la fierté et de l'arrogance du nouveau riche, du nouveau maître du monde qui dicte benoîtement à ses sujets les règles de la coexistence civilisée.
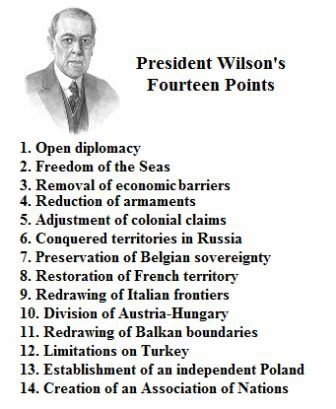
Tout cela a été inclus et condensé dans un véritable manifeste idéologique de l'interventionnisme américain, qui est entré dans l'histoire sous le nom des "Quatorze points de Wilson". Il s'agissait d'un "message au Congrès" par lequel le président tentait d'adoucir la pilule de l'intervention ; une intervention qui - malgré le comportement imbécile des Allemands qui avait indigné les Américains - continuait à susciter des doutes et de la perplexité, tant dans l'opinion publique nationale que dans de nombreux secteurs du Congrès. Mais les Quatorze Points - en même temps - étaient aussi une sorte de message aux chancelleries du monde entier, énonçant dès le départ les diktats de la pax americana, auxquels tous - vainqueurs et vaincus - devraient se conformer.
Le bavardage initial était un exercice de justification inventive de l'intervention, entièrement basé sur les déclarations de principe (mensongères) déjà mentionnées : "Nous sommes entrés dans cette guerre parce qu'il y avait eu des violations du droit qui nous touchaient au plus profond de nous-mêmes et qui rendaient la vie de notre peuple impossible à moins qu'il n'y soit remédié et que le monde soit une fois pour toutes protégé du danger de leur retour. Ce que nous exigeons de cette guerre n'a donc rien de particulier pour nous. Ce que nous voulons, c'est que le monde devienne un lieu sûr où chacun puisse vivre, un lieu possible pour toutes les nations qui veulent la paix, pour toutes les nations qui veulent vivre leur vie librement, décider de leurs propres institutions, être sûres d'être traitées équitablement et justement par les autres nations, au lieu d'être exposées à la violence et à l'agression. Tous les peuples du monde sont en effet unis dans cet intérêt suprême ; et en ce qui nous concerne, nous voyons très clairement que si la justice n'est pas rendue aux autres, elle ne peut l'être à nous-mêmes. Notre programme est donc le programme de la paix mondiale."
Mais lorsqu'il s'agit de détailler "le programme de paix mondiale", les vagues déclarations se transforment en diktats concrets et arrogants qui préfigurent l'avenir établi à Washington (et à Londres) pour les différentes nations d'Europe. Avec la réserve que ce programme était "le seul programme possible".
Le point 9 était consacré à l'Italie : "Une révision des frontières de l'Italie doit être effectuée sur la base de la frontière ethnographique facilement reconnaissable." Nous verrons plus tard comment "la frontière ethnographique facilement reconnaissable" était, en réalité, le mécanisme qui devait empêcher la réalisation de nos objectifs, laissant des milliers et des milliers de nos compatriotes sous la souveraineté yougoslave.
Mais, au-delà de l'arrogance avec laquelle le sort de chaque pays européen était fixé, ce qui était particulièrement significatif, c'était un point général, le numéro 3 : "L'abolition, jusqu'à l'extrême limite du possible, de toutes les barrières économiques, et la création de conditions égales en matière de commerce entre tous les pays qui adhéreront à la paix et s'uniront pour la maintenir" [3].
Le seul programme possible pour la paix mondiale était donc l'abolition des barrières économiques, des "murs" du Vieux Continent, dans le seul but de favoriser la diffusion de la production et des capitaux américains en Europe. C'était l'anticipation de ce qui, un siècle plus tard, serait appelé "mondialisation".
NOTES:
[1] Jan Christian SMUTS : La Federazione Britannica delle Nazioni. Discorso del generale Smuts tenuto a Londra il 15 maggio 1917.
[2] Thomas Woodrow WILSON : Le Président Wilson, la guerre, la paix. Recueil des déclarations du Président des Etats-Unis d'Amérique sur la guerre et la paix. 20 décembre 1916 - 6 avril 1918. Librairie Berger-Levrault, Paris, 1918.
[3] WILSON : Le Président Wilson, la guerre, la paix. Cit.
Librement tiré de la rubrique " Rievocazioni " du mensuel de Trapani " La Risacca " publié en décembre 2017.
18:36 Publié dans Affaires européennes, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europe, affaires européennes, états-unis, histoire, première guerre mondiale, pax americana, woodrow wilson, doctrine de monroe, impérialisme américain, américanisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 29 mars 2022
Après le pétrodollar, le pétrorouble ?

Après le pétrodollar, le pétrorouble?
par Fabrizio Pezzani
Source: https://www.ariannaeditrice.it/articoli/dopo-il-petrodollaro-il-petrorublo
La terrible et pénible guerre sur le terrain est flanquée d'une guerre financière qui a commencé par des sanctions et l'utilisation du système Swift pour geler la finance russe, qui répond maintenant par une demande d'obtenir des paiements en roubles pour son énergie, son gaz et son pétrole, soit un milliard de dollars par jour. Le "rouble pétrolier" se range-t-il aux côtés du pétrodollar dans la guerre des devises ?
Afin de comprendre la signification de cette opération, qui visait à soutenir le rouble, mais aussi à soutenir de manière incisive un processus de dédollarisation avec la Chine, il est utile de rappeler la naissance du pétrodollar et du système Swift.
Le pétrodollar a été créé en 1973, en même temps que le Swift, pour soutenir le dollar, dont l'émission a été détachée de l'étalon-or en 1971, créant ainsi un système infini de production monétaire, basé sur le dollar et constamment exposé à des turbulences inflationnistes.
Le système en vigueur jusqu'alors était l'étalon de change-or, qui liait l'émission de la monnaie papier à la détention d'une certaine quantité d'or (36 dollars par once d'or) définie dans les accords de Bretton Wood de 1944 pour éviter, justement, les turbulences monétaires. Jusqu'en 1971, le système a assuré la stabilité monétaire dans les échanges internationaux, le dollar valait 630/4 lires, l'inflation était faible, 4%, tout comme la dette par rapport au PIB, 33%. Mais la guerre du Vietnam et les troubles internes ont contraint les États-Unis à imprimer de la monnaie papier sans disposer de l'or nécessaire au maintien de l'équilibre. En 1971, Nixon a donc déclaré unilatéralement la fin de ce système, déclenchant la révolution financière qui allait tous nous frapper comme un tsunami.

L'effet immédiat a été d'augmenter l'inflation en raison du volume de papier-monnaie imprimé sans aucun actif sous-jacent, de sorte que pour ne pas finir comme l'Allemagne de Weimar en 1923, écrasée par l'inflation, il était nécessaire de créer fictivement une demande croissante de dollars imprimés sans aucun actif sous-jacent. Les Arabes ont été persuadés de n'être payés pour leur pétrole qu'en dollars en échange de la protection américaine, ce qui a conduit à la création du pétrodollar, scellé par le système Swift qui lie le système de change international au dollar. Le dollar est devenu la monnaie de référence mondiale et les autres devises ont été contraintes de se déprécier et d'accepter un rôle accessoire.
L'évolution des systèmes économiques a modifié les conditions qui permettaient au dollar d'être utilisé presque exclusivement dans les transactions financières avec, mais dans une moindre mesure, l'euro. Les développements géopolitiques ont renforcé d'autres économies, en premier lieu la Chine, qui ont progressivement partagé un projet de dédollarisation afin de pouvoir utiliser leurs monnaies de manière alternative. Les accords, qui sont aujourd'hui sur la table, concernent l'échange de pétrole en monnaie locale entre l'Iran, les États arabes et la Chine, qui pourrait payer ses fournitures en yuan, ainsi que l'Inde et la Russie, qui peuvent régler leurs échanges dans leur propre monnaie. Il convient de noter, comme cela a déjà été écrit dans ces colonnes, que la Chine et la Russie courent après l'or afin de donner à leurs devises un support en or, et la Chine a déjà émis des contrats à terme liés à l'or. La Chine et la Russie ont déjà réduit leurs échanges en dollars de 90 % à 40 %.
L'introduction d'un système de paiement lié à des monnaies autres que le dollar réduit la demande de cette monnaie et risque de déclencher un processus inflationniste, comme nous pouvons le constater aujourd'hui, ainsi qu'une éventuelle dévaluation de celle-ci : une once d'or vaut plus de 2000 dollars. De cette manière, les États-Unis courent le risque de voir la demande de dollars diminuer face à une offre illimitée de dollars, et il est clair que si le processus de dédollarisation se poursuit, le dollar devra compter avec sa faiblesse croissante en raison de la logique qui sous-tend l'équilibre entre l'offre et la demande de monnaie.
Comme Carl von Clausevitz l'a affirmé, la politique devient une guerre dramatique sur le terrain et une guerre monétaire sur les marchés financiers ; les deux guerres se déroulent sur le même plan, créant un désordre non seulement dans les principes de protection des personnes avec la guerre sur le terrain mais aussi avec le déséquilibre des économies mondiales.
15:12 Publié dans Actualité, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dollar, rouble, yuan, russie, chine, états-unis, actualité, économie, or, étalon-or, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 28 mars 2022
Même aux États-Unis, on dit non aux provocations de l'OTAN

Même aux États-Unis, on dit non aux provocations de l'OTAN
Luca Bagatin
Source: https://electomagazine.it/anche-negli-usa-ce-chi-dice-no-alle-provocazioni-nato/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=ReviveOldPost
Comme l'a rapporté vendredi dernier, le 18 mars, le média américain "Kitco News" (https://www.kitco.com/news/2022-03-18/Ron-Paul-Bitcoin-still-in-danger-of-being-banned-Ukraine-war-could-get-out-of-control.html), par le biais d'une interview vidéo et d'un article, l'ancien membre du Congrès américain et actuel membre de la Chambre des représentants, Ron Paul, né en 1935 et politicien libertaire de longue date, s'est exprimé sur la question de l'Ukraine.
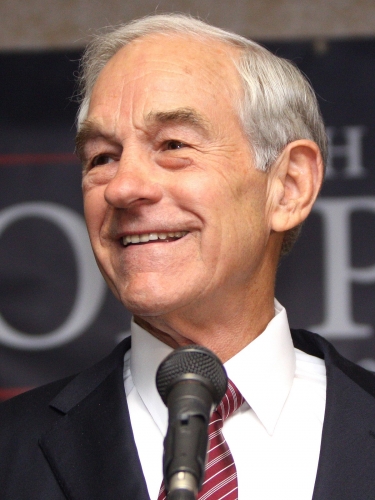
Ron Paul, né en 1935 et homme politique libertaire de longue date, qui s'est présenté plusieurs fois aux primaires pour la présidence des États-Unis d'Amérique (en 1988 avec le Parti libertarien et en 2008 et 2012 dans les primaires du Parti républicain), a déclaré qu'au lieu d'envoyer des armes ou une assistance militaire à l'Ukraine, les États-Unis devraient "plier bagage et rentrer chez eux".
"Nous n'aurions jamais dû être là si nous avions une politique étrangère constitutionnelle non interventionniste", a déclaré Ron Paul à Michelle Makori, rédactrice en chef de Kitco News.
"Je pense que l'un des événements les plus importants qui ont conduit à la crise que nous connaissons actuellement, est le coup d'État qui a eu lieu en Ukraine en 2014, et les preuves sont accablantes que nous avons participé à ce coup d'État, pour nous débarrasser d'un dirigeant qui était quelque peu juste et équilibré dans ses relations avec la Russie", a déclaré Ron Paul.
Et d'ajouter : "Il n'y a rien dans la Constitution qui dit que nous pouvons arbitrairement nous impliquer dans des conflits étrangers sans une déclaration de guerre."
Ron Paul craignait que la situation ne s'aggrave encore si le feu continuait à brûler et a déclaré : "J'espère certainement que ceux qui prédisent une escalade nucléaire ont absolument tort. C'est juste quelque chose auquel je ne veux même pas penser parce que c'est tellement fou, mais là encore, vous êtes obligé d'y penser quand les gens commencent à en parler."
Et ses pensées remontent à la guerre du Vietnam, un long conflit qui n'a apporté que des désastres aux États-Unis eux-mêmes, alimentant l'inflation des années 1970.

Ron Paul est connu pour ses positions libertaires sur les droits civils et contre le racisme, ainsi que pour sa politique économique libérale-libertaire, dont il a cependant toujours souligné qu'il ne voulait l'exporter dans aucun pays.
En politique étrangère, il s'est toujours opposé à toute intervention militaire à l'étranger, depuis qu'il a porté de dures accusations contre l'administration Clinton sur la conduite de la guerre du Kosovo, affirmant que le président n'avait pas informé le Congrès en temps réel de la progression des événements militaires, manquant ainsi de respecter la Constitution américaine. Et il a dénoncé cette déclaration de guerre, approuvée par Clinton sans le consentement du Congrès.
Il a également toujours prôné une politique non-interventionniste et anti-guerre pour les Etats-Unis.
Il a toujours été très boycotté par les médias et le système politique américain, mais il a toujours été très respecté et populaire parmi les citoyens, qui ont souvent soutenu ses aventures politiques avec enthousiasme.
Il a également toujours été pour l'abolition de la Réserve fédérale et donc pour un retour à l'étalon-or et pour le retrait des USA de l'OTAN, ainsi que pour la fin de l'embargo contre Cuba.
Il a toujours soutenu que la Constitution américaine devait être respectée et donc que les États-Unis ne devaient pas entrer en guerre contre d'autres pays, mais seulement commercer avec eux et entretenir des relations pacifiques, sans interférence.
Il a également été soutenu par le réalisateur Oliver Stone (connu pour ses opinions libertaires mais de gauche), qui a déclaré en 2012 qu'"il est le seul de ceux qui disent quelque chose d'intelligent sur l'avenir du monde".
Les essais politiques de Ron Paul ont également été publiés en Italie par Liberilibri, tels que La terza America et End the Fed.
Probablement, si le gouvernement des États-Unis, par rapport à un Clinton, un Bush, un Obama, un Trump et un Biden, avait été le Ron Paul malheureusement délibérément boycotté, l'histoire aurait été très différente et beaucoup de guerres et de morts civiles conséquentes auraient été évitées.
Et serait encore évité aujourd'hui. De nos jours.
Bien que ses idées sociopolitiques et économiques soient diamétralement opposées à celles du président chinois Xi Jinping, Ron Paul, comme le dirigeant chinois, suit la ligne de la non-ingérence, du dialogue et du respect mutuel.
Lors de ses entretiens avec Biden, Xi a notamment déclaré : "Les conflits ne sont dans l'intérêt de personne. Les relations entre les États ne peuvent pas atteindre le stade de la confrontation militaire".
Et le porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères, Zhao Lijian, a rappelé peu avant les pourparlers que "la Chine fournit à l'Ukraine de la nourriture, du lait en poudre, des sacs de couchage, des couettes et des nattes imperméables, mais les États-Unis offrent des armes mortelles. Il n'est pas difficile pour les gens de bon sens de juger si la nourriture, les sacs de couchage ou les armes sont plus essentiels pour la population ukrainienne".
Tels devraient être les points de départ de toute personne de bonne volonté, qui a à cœur les intérêts des habitants de la planète.
Quelles que soient les idées politiques de chacun, il faut toujours faire preuve d'honnêteté intellectuelle et morale et être capable de s'ouvrir et de dialoguer. Des qualités souvent rares, mais les seules capables de sortir le monde du conflit.
18:54 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, états-unis, otan, ron paul, libertariens |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 26 mars 2022
Rompre une lance pour la vérité

Rompre une lance pour la vérité
par Helmut Müller
Source : https://helmutmueller.wordpress.com/
Au début de la Première Guerre mondiale, Lord Arthur Ponsonby s'est exprimé à la Chambre des Communes sur ce qu'il considérait comme un désir impossible d'équilibrer les forces en Europe. Cela conduirait, selon Ponsonby, à deux camps armés "se regardant en face avec suspicion, hostilité et haine... et faisant saigner les hommes pour payer les armements". C'est là une bonne mise en scène qui correspond àce qui nous arrive aujourd'hui, et le pacifiste avéré qu'est Ponsonby s'étonnerait sans doute que cette folie soit encore possible, même à l'ère des armes de destruction massive. "Mais", ai-je lu quelque part, "la représentation armée des entreprises d'armement, l'OTAN, a fait tout ce qui était possible pour mettre le feu à l'Ukraine jusqu'à ce qu'il y ait un incendie assimilable à une guerre". Le journaliste belge Michel Collon a même qualifié l'OTAN d'"organisation criminelle".
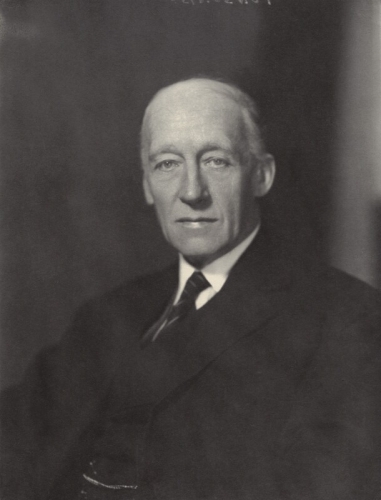
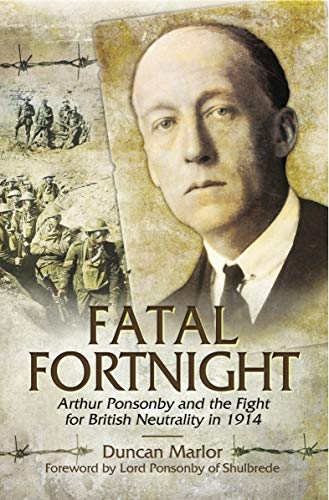
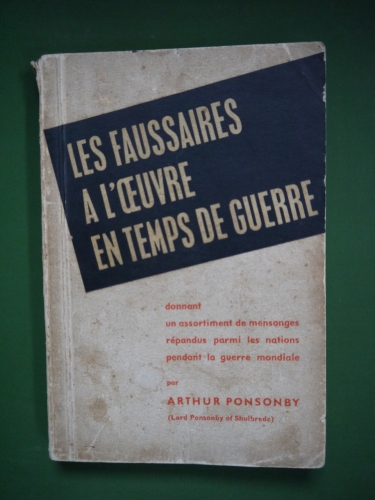
Et rien n'est plus utile que la propagande pour mettre le feu, pendant et après la guerre, quand on sait en plus que la majorité des médias "indépendants" sont derrière soi. Dans son livre Falsehood in Wartime, l'homme politique et écrivain Ponsonby a décrit les méthodes de propagande de guerre des belligérants de la Première Guerre mondiale, toujours en vigueur aujourd'hui, dans lequel on trouve la fameuse remarque : "When war is declared, truth is he first casuality" ("Quand la guerre est déclarée, la vérité est la première victime").
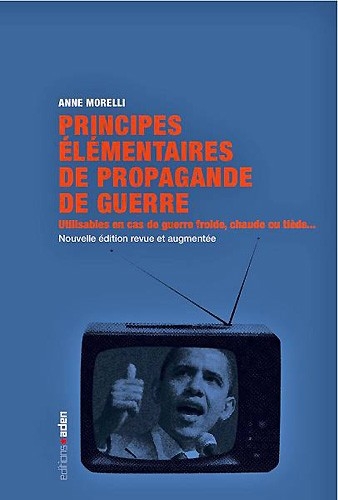
L'historienne belge Anne Morelli a présenté son exposé dans ses Principes élémentaires de propagande de guerre sous une forme claire et moderne qui, d'un point de vue occidental, ressemblerait à ceci, complété par mes propres notes :
1. nous ne voulons pas la guerre (nous voulons seulement dominer) .
2. l'adversaire porte seul la responsabilité (la Russie aujourd'hui)
3. le leader de l'adversaire est un diable (Poutine)
4. nous nous battons pour une bonne cause (démocratie des entreprises).
5. l'adversaire se bat avec des armes non autorisées (armes chimiques, selon Bush et maintenant Biden)
6. l'adversaire commet des atrocités intentionnellement, nous seulement par inadvertance (voir Hiroshima, Vietnam, Irak et autres).
7. nos pertes sont faibles, celles de l'adversaire sont énormes.
8. les artistes et les intellectuels soutiennent notre cause (veulent être encouragés).
9. notre mission est "sacrée" (contre l'empire du mal)
10. quiconque met en doute notre couverture médiatique est un traître. (Ceux qui comprennent Poutine, par exemple).
Pour mieux comprendre, voici une liste, évidemment incomplète, de guerres présentées il y a des années par Ticinolive et menées selon cette méthode par les Etats-Unis :
Dix guerres et dix mensonges des États-Unis
1. le Vietnam (1964-1975)
Le mensonge : les 2 et 3 août 1964, le Nord-Vietnam a attaqué deux navires de guerre américains dans le Golfe du Tonkin.
La vérité : L'attaque n'a jamais eu lieu. Il s'agissait d'une invention du gouvernement américain.
L'objectif : empêcher l'indépendance du Vietnam et maintenir la domination des États-Unis dans la région.
Les conséquences : Des millions de victimes, des malformations génétiques, d'énormes problèmes sociaux.
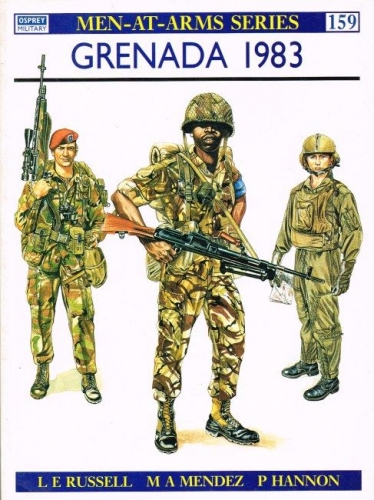
2. Grenade (1983)
Le mensonge : La petite île des Caraïbes est accusée de construire une base militaire soviétique et de mettre en danger la vie des citoyens américains.
La vérité : Tout est faux. La nouvelle a été diffusée sur ordre du président américain Ronald Reagan.
L'objectif : empêcher les réformes sociales et démocratiques du Premier ministre Maurice Bishop (qui a été abattu en octobre 1983).
Les conséquences : Répression brutale et consolidation du contrôle de Washington.
3. Panama (1989)
Le mensonge : l'invasion est menée pour arrêter le président Manuel Noriega pour trafic de drogue.
La vérité : Bien qu'il soit un protégé de la CIA, Noriega a revendiqué la souveraineté sur les droits du Canal de Panama. Cette revendication était inacceptable pour les États-Unis.
L'objectif : maintenir le contrôle des États-Unis sur le canal, une voie de communication stratégique.
Les conséquences : Les bombardements américains ont tué des milliers de civils dans l'indifférence des médias et de l'opinion publique.
4. Irak (1991)
Le mensonge : les soldats irakiens ont tué des prématurés koweïtiens en les arrachant de leurs couveuses.
La vérité : Une invention de l'agence de publicité Hill & Knowlton, payée par l'émir du Koweït.
L'objectif : Empêcher le Moyen-Orient de se rebeller contre Israël et de se soustraire au contrôle américain.
Les conséquences : De nombreuses victimes de la guerre (un million, ndlr) et un long embargo, qui concernait également les médicaments.
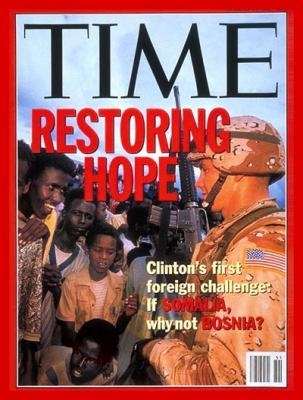
5. la Somalie (1993)
Le mensonge : l'homme politique et médecin français Bernard Kouchner se met en scène comme le héros d'une intervention humanitaire.
La vérité : Quatre sociétés américaines avaient acheté une partie du sous-sol somalien riche en pétrole.
L'objectif : le contrôle du pétrole et d'une région militairement stratégique.
Les conséquences : Les États-Unis n'ayant pas réussi à contrôler le pays, un chaos persistant s'est installé dans la région.
6. Bosnie (1992-1995)
Le mensonge : la société américaine Ruder Finn et le ministre français de la Santé de l'époque, Bernard Kouchner, ont mis en scène une série de camps d'extermination serbes.
La vérité : Ruder Finn et Kouchner avaient menti. Il s'agissait de camps dans lesquels des prisonniers attendaient d'être échangés contre d'autres prisonniers. Alija Izetbegovic, président de la Bosnie-Herzégovine de 1990 à 1996, l'a reconnu.
L'objectif : démanteler la Yougoslavie, trop à gauche, supprimer son système social, soumettre la région aux multinationales, contrôler le Danube et les voies de communication stratégiques dans les Balkans.
Les conséquences : Une guerre atroce de quatre ans entre les musulmans, les Serbes et les Croates.
7. Yougoslavie (1999)
Le mensonge : les Serbes commettent un génocide contre les Albanais du Kosovo.
La vérité : C'était une invention de l'OTAN, comme l'a reconnu plus tard le porte-parole officiel Jamie Shea.
L'objectif : imposer la domination de l'OTAN dans les Balkans et établir une base militaire américaine au Kosovo.
Les conséquences : Des milliers de victimes des bombardements de l'OTAN. Nettoyage ethnique au Kosovo par l'organisation paramilitaire albanaise UÇK - l'"Armée de libération du Kosovo" - qui était sous la protection de l'OTAN.

8. Afghanistan (2001)
Le mensonge : le président américain George Bush voulait venger les attentats du 11 septembre 2001 et capturer Oussama Ben Laden, un ancien ami des États-Unis et chef sanguinaire d'Al-Qaida.
La vérité : Il n'y avait aucune preuve de l'implication d'Al-Qaïda et de Ben Laden dans les attentats du 11 septembre. Selon les "théoriciens du complot", les attentats auraient même été organisés par les services secrets américains.
L'objectif : le contrôle militaire du centre stratégique de l'Asie, la construction d'un gazoduc pour contrôler l'approvisionnement énergétique de l'Asie du Sud.
Les conséquences : Occupation à long terme et forte augmentation de la production et du commerce d'opium.
9. Irak (2003)
Le mensonge : le président irakien Saddam Hussein possédait des armes de destruction massive, comme l'a déclaré le général Colin Powell devant les Nations unies, avec une éprouvette censée contenir une substance dangereuse saisie dans des laboratoires irakiens à l'appui.
La vérité : Le gouvernement de Washington avait ordonné de falsifier (affaire Libby) ou de créer les documents correspondants.
Le but : contrôler le pétrole irakien et donc les acheteurs : Chine, Europe, Japon...
Les conséquences : Une longue guerre civile a commencé en Irak ; les armes expérimentales et les munitions à l'uranium ont causé plus de dommages génétiques que la bombe d'Hiroshima.
10. la Libye (2011)
Le mensonge : le colonel libyen Mouammar Kadhafi veut massacrer la population de Benghazi. Une intervention militaire occidentale est nécessaire pour éviter un bain de sang. Le président américain Barack Obama et le président français Nicolas Sarkozy ont lancé la guerre contre la Libye en violation de la résolution 1973 des Nations unies.
La vérité et l'objectif : le contrôle du pétrole et des compagnies pétrolières du pays, la fin du premier satellite africain RASCOM 1, la fin du Fonds monétaire africain, l'installation d'une base militaire Africom en Libye et la mise à mort de Mouammar Kadhafi.
Les conséquences : Près de 50 000 Libyens ont été tués dans les frappes aériennes de l'OTAN.
Source : Ticinolive : Le 10 guerre e le 10 menzogne degli Stati Uniti - 4 décembre 201
Note sur la guerre en Ukraine :
Oui, Poutine est en guerre, cela ne fait aucun doute. Mais est-ce sa guerre ? Et oui, des crimes de guerre sont malheureusement possibles, de part et d'autre, ceux des Ukrainiens (et le rôle de M. Zelensky) seront certainement à discuter. Mais aucun pays n'a commis autant de crimes de guerre après la Seconde Guerre mondiale que les États-Unis, selon Noam Chomsky : "World's biggest terrorist". Le fait que ce soient eux qui se présentent aujourd'hui comme accusateurs, avec une kyrielle de vassaux à leur suite, est une parodie de vérité et de justice. Si Poutine devait être traduit en justice, alors, s'il vous plaît, que Biden et tous les anciens présidents américains encore en vie le soient également.
Sur le même sujet:
Confessions de Victoria Nuland : https://youtu.be/skHJ251ogfA
Le général de division Schulze-Rhonhoff : https://youtu.be/mHzDonjwYZg
Pris en flagrant délit de mensonge : https://bachheimer.com/images/2022/aktuell/ukraine_tag14/VID-20220309-WA0003_3.mp4
19:19 Publié dans Actualité, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guerre, propagande de guerre, états-unis, actualité, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 13 mars 2022
George F. Kennan : l'élargissement de l'OTAN, l'erreur la plus fatale

George F. Kennan : l'élargissement de l'OTAN, l'erreur la plus fatale
Source: https://www.pi-news.net/2022/03/george-f-kennan-nato-erweiterung-verhaengnisvollster-fehler/
Par KEWIL | George F. Kennan (1904 - 2005) a été l'un des responsables de la politique étrangère américaine les plus influents du siècle dernier. Il a connu Staline et Hitler, a été ambassadeur à Moscou, Berlin, Prague, Lisbonne et Londres, a travaillé au Département d'État de Washington pendant la Guerre froide, et la politique d'endiguement était son idée. Plus tard, il a enseigné comme professeur à l'université de Princeton et également à Berlin, a écrit des livres et a reçu de nombreux prix.
Le 5 février 1997, George F. Kennan, âgé de 93 ans, a écrit un long article dans le New York Times intitulé "A Fateful Error". L'administration Clinton réélue prévoyait justement d'intégrer la Pologne, la Hongrie et la Tchéquie dans l'OTAN, sans aucune raison dictée par l'actualité.
L'opinion, exprimée par Kennan, est, pour le dire crûment, que l'élargissement de l'OTAN serait l'erreur la plus désastreuse de la politique américaine de tout l'après-guerre.
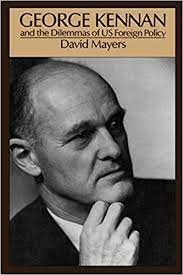 L'extension de la puissance américaine jusqu'aux frontières de la Russie laisse présager que les tendances nationalistes, anti-occidentales et militaristes s'enflammeront dans la pensée russe, qu'elles auront une influence néfaste sur l'évolution de la Russie, qu'elles rétabliront l'atmosphère de guerre froide dans les relations entre l'Est et l'Ouest et qu'elles forceront la politique étrangère russe à prendre des directions qui nous déplairont résolument.
L'extension de la puissance américaine jusqu'aux frontières de la Russie laisse présager que les tendances nationalistes, anti-occidentales et militaristes s'enflammeront dans la pensée russe, qu'elles auront une influence néfaste sur l'évolution de la Russie, qu'elles rétabliront l'atmosphère de guerre froide dans les relations entre l'Est et l'Ouest et qu'elles forceront la politique étrangère russe à prendre des directions qui nous déplairont résolument.
Enfin, l'extension de la puissance américaine pourrait rendre impossible la ratification des accords Start-Il par la Douma russe, ce qui empêcherait à son tour toute nouvelle réduction des armes nucléaires.
Il serait évidemment malheureux que la Russie soit confrontée à un tel défi. D'autant plus que le gouvernement russe se trouve actuellement dans un état de grande incertitude. C'est d'autant plus malheureux si l'on considère que cette mesure n'est absolument pas nécessaire.
Avec toutes les possibilités d'espoir qu'offre la fin de la guerre froide, pourquoi les relations Est-Ouest devraient-elles se concentrer sur la question de savoir qui pourrait être allié avec qui, et donc contre qui, dans un futur conflit militaire imaginé, totalement imprévisible et improbable ?
Voilà un extrait de l'article prophétique de Kennan, qui montre une fois de plus que même les Américains, du moins dans le passé, avaient parfois des opinions différentes de celles de leur gouvernement ! La traduction vient d'ici: https://corona-transition.org/nato-osterweiterung-verhangnisvollster-fehler-der-us-politik-in-der-gesamten Plus d'infos et l'original en anglais ici: https://www.infosperber.ch/politik/welt/1997-2007-2017-20-jahre-fehlpolitik-der-usa/ . L'élargissement de l'OTAN à l'Est était certainement une erreur !
14:24 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : george f. kennan, diplomatie, états-unis, europe, otan, atlantisme, affaires européennes, géopolitique, russie, guerre froide |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 11 mars 2022
Pourquoi Biden voulait que Poutine attaque l'Ukraine

Pourquoi Biden voulait que Poutine attaque l'Ukraine
Maria Scopece
Toutes les convergences parallèles de la Russie et des États-Unis en Ukraine. Le rôle du Qatar sur le gaz à destination de l'Europe selon l'administration américaine. Et les faiblesses internes de Biden et de Poutine. Conversation entre Germano Dottori (Limes) et Lucio Martino (Institut Guarini)
SOURCE : https://www.startmag.it/mondo/ucraina-russia-usa/?fbclid=IwAR2eShy-pb385NegsS_0TTT8kXsvbNBTzUFlRIl2uAArvB5XNheqDgeB7Qc
Cui prodest la menace de guerre en Ukraine ? Au président russe Vladimir Poutine et au président américain Joe Biden. Le professeur Germano Dottori, analyste géopolitique et conseiller scientifique de la revue de géopolitique Limes, et Lucio Martino, membre de l'Institut Guarini pour les affaires publiques de l'Université John Cabot et ancien directeur de recherche au Cemiss, le Centre militaire d'études stratégiques, soutiennent la convergence parallèle des intérêts des deux dirigeants.
Dossier Ukraine
"Les objectifs de politique étrangère actuellement poursuivis par l'administration américaine sont clairement wilsoniens, l'extension et la protection de la démocratie partout dans le monde font désormais partie d'une stratégie et d'une idéologie néo-conservatrices - a souligné Lucio Martino lors d'une conversation sur la page Facebook du professeur Dottori . De plus, la politique étrangère de l'administration Biden est entre les mains de personnes comme Victoria Nuland, l'épouse de Robert Kagan, l'idéologue de l'administration de Bush fils, celui des guerres du Moyen-Orient, mais aussi comme Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale, ou Antony Blinken, le secrétaire d'État lui-même. C'est la même équipe qui a signé la politique étrangère américaine de 2003, la guerre en Irak, la question du Kosovo de 2008 et la crise ukrainienne de 2014. C'est une équipe qui a pour objectif de réduire la taille de la Fédération de Russie, de ce point de vue idéologique, il y a donc une cohérence."
Victoria Nuland et le scandale de la crise ukrainienne de 2014
Victoria Nuland est une diplomate de longue date, elle a été directrice adjointe du département des affaires soviétiques pendant la présidence Clinton et conseillère du vice-président Dick Cheney. George Bush Jr l'a nommée ambassadrice auprès de l'OTAN à Bruxelles et, sous le président Obama, elle est devenue secrétaire d'État adjointe aux affaires européennes et eurasiennes, gérant les relations diplomatiques avec les pays européens et l'OTAN. Elle a joué un rôle central dans la gestion de la crise ukrainienne en 2014, et a été au centre d'un scandale parce qu'elle a dit Fuck the EU lors d'un appel téléphonique privé avec l'ambassadeur américain en Ukraine, Geoffrey Pyatt. L'appel téléphonique a été intercepté et publié sur Youtube.
Biden et les difficultés de la politique intérieure
Environ un an après son élection, Joe Biden navigue déjà en eaux troubles. Sa cote d'approbation personnelle n'a cessé de baisser, passant de 55 % à 36 %, son retrait précipité d'Afghanistan a porté un coup à son image, l'inflation a atteint 6 % pour la première fois depuis des décennies et le déficit fédéral a atteint le chiffre record de 3000 milliards de dollars. "L'administration Biden n'a guère connu de lune de miel avec son électorat", a ajouté M. Martino. "L'inflation est la plus élevée depuis quarante ans, ce qui a même entraîné une pénurie de produits de première nécessité. C'est un pays divisé culturellement, politiquement et aussi ethniquement selon des lignes identitaires qui sont les mêmes que celles de la guerre civile d'il y a 150 ans". Dans ce contexte, le succès en politique étrangère pourrait être une porte de sortie. "L'administration Biden se tourne vers la politique étrangère pour chercher l'affirmation et le succès, ce théâtre pourrait être l'Ukraine".
Les intérêts américains au Qatar
L'une des raisons des intérêts anti-russes des États-Unis concerne le gaz qatari. Selon Lucio Martino, les Etats-Unis voudraient "rediriger les intérêts européens loin de la Russie par le biais d'un mécanisme de sanction encore plus sévère que celui qui est actuellement en place. Je ferais le rapprochement entre la crise ukrainienne et l'accord qui vient d'être conclu avec le Qatar, qui est un autre grand producteur de gaz naturel". Le Qatar "a été élevé au rang de pays allié, presque comme s'il était membre de l'OTAN. Le grand dessein, s'il en est un poursuivi par l'administration Biden, me semble être celui-ci", a ajouté M. Martino.
Poutine cherche le succès en politique étrangère
Détourner l'attention des problèmes intérieurs vers la politique étrangère n'est pas l'apanage de l'administration américaine. "J'ai l'impression que le succès que Poutine cherche à obtenir actuellement en Ukraine est de fixer des enjeux et d'empêcher l'alliance atlantique de s'étendre davantage vers l'est, en arguant que la Fédération de Russie ne peut l'accepter, et en essayant également de montrer aux dirigeants ukrainiens actuels que la garantie de sécurité fournie par l'Occident à leur pays n'est pas si solide. Le jeu dialectique qui se joue entre les parties atteindra à un moment donné un "moment de vérité".
La guerre : une hypothèse plausible pour le déclenchement des sanctions
La guerre, selon Dottori, serait une hypothèse plausible. Mon impression est que les Américains essaient de convaincre les Russes que l'agression peut être payante", selon le conseiller scientifique de la revue Limes : "Au moment où ils font savoir au monde entier que la guerre est probable, ils en font en quelque sorte une hypothèse normale, voire acceptable, à laquelle l'opinion publique internationale est préparée, et d'autre part, en abandonnant les Ukrainiens à leur destin, ils mettent Poutine dans la position de devoir envisager une attaque facile, ou en tout cas une situation dans laquelle l'Ukraine se retrouve complètement seule".
L'attaque contre l'économie européenne
Tout cela peut entraîner d'énormes conséquences. "Si les Russes n'attaquent pas, la stratégie américaine tire un coup dans l'eau - a ajouté M. Dottori - Si les Russes attaquent et mènent une offensive même limitée, des sanctions sont déclenchées, ce qui pourrait être le véritable objectif de l'administration américaine, afin de séparer définitivement la Russie du marché européen de l'énergie et de porter en quelque sorte un coup à la solidité de l'économie européenne à un moment où l'Europe sort de la pandémie et a besoin de se relancer. La stratégie comporte de multiples objectifs dans lesquels l'Europe peut également être une cible. L'Ukraine est un jeu complexe dans lequel les Européens, les Américains et les Russes ne sont pas complètement alignés, en fait ils me semblent être en compétition les uns avec les autres.
Maria Scopece
12:07 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, affaires européennes, politique internationale, vladimir poutine, joe biden, russie, états-unis, ukraine |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook




